L'Illustration, No. 0026, 26 Août 1843
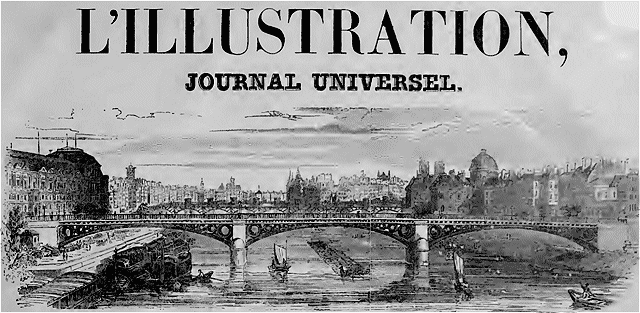
Nº 26. Vol. I.--SAMEDI 26 AOÛT 1843.
Bureaux, rue de Seine, 33.
Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr.
Prix de chaque Nº 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75.
Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr. Un an, 32 fr.
Pour l'Étranger. - 10 - 20 - 40
SOMMAIRE.
Statue de Lapérouse, par M. Raggi, exposée dans la cour du Louvre. Gravure.--Courrier de Paris.--De la Peinture sur Lave émaillée.--Révolutions du Mexique. Le général Santa-Anna. (Suite et fin.) Fort de Saint-Jean d'Ulloa; Soldats du Texas.--Nouvelles inventions. Chemin de fer atmosphérique. Sept Gravures. --Moeurs parisiennes. Ce qu'il y a dans une goutte d'huile. Gravure.--Camps d'instruction. Camp de Lyon; Camp de Bretagne. Vue du Camp de Plélan, près Rennes; Tentes de Soldats; Manteau d'armes et Guérite de paille; Grandet manoeuvres au Camp de Plélan.--Margherita Pusterla. Roman de M. César Cantù. Chapitre IV, l'Attentat. Quatorze Gravures.--Bulletin bibliographique.--Annonces.--Modes. Costumes de Chasse. Deux Gravures.--Amusements des Sciences. Gravure.--Problème de dessin. Solution.--Rébus. Trois Citations classiques.
Statue de Lapérouse,
PAR M. RAGGI.
Depuis quelques années, nos principales villes ont à l'envi consacré des monuments à la mémoire de leurs grands hommes. Nous avons vu successivement s'élever les statues de P. Corneille et de Boïeldieu à Rouen, de Kléber et de Gutenberg à Strasbourg, de Jean Bart à Dunkerque, de Hoche à Versailles, d'Ambroise Paré à Laval, de Nicolas Poussin aux Andelys, de Racine à la Ferté-Milon, de Lannes à Lectoure, etc. Albi vient de rendre la même justice à l'un de ses plus illustres enfants, Jean-François Galaup de Lapérouse. Sa statue, exécutée par M. Raggi, fondue en bronze dans les ateliers de M. Saint-Denis, est exposée au centre de la cour du Louvre, d'où elle partira dans un mois pour être solennellement inaugurée.

Statue de Lapérouse, par M. Raggi,
exposée dans la cour
du Louvre.
Lapérouse, par ses talents et par son malheur, méritait l'hommage de ses concitoyens, et la France entière s'y associera. C'est le plus populaire de tous nos navigateurs; sa mystérieuse destinée a consolidé la gloire que lui avaient acquise ses observations nautiques, et la mort qu'il trouva sur les écueils de la Polynésie lui fut une garantie d'immortalité. Né en 1741, garde de la marine à quinze ans, Lapérouse avait prouvé autant de capacité que de courage en diverses expéditions contre les Anglais. Louis XVI, en 1785, lui confia les frégates la Boussole et l'Astrolabe pour un voyage de découvertes. Il partit le 1er août 1785, et donna de ses nouvelles jusqu'au 7 février 1788. Pendant trois ans, on put suivre ses traces, frémir de ses dangers, applaudir à ses explorations; puis il disparut tout à coup; son sort demeura longtemps un problème, et ce ne fut qu'en 1828, après bien des indices vagues, bien des recherches infructueuses, que les débris de son naufrage furent recueillis par M. Dumont d'Urville dans les îles Malicolo.
Il est à regretter que la plastique n'ait pu grouper autour de la statue de Lapérouse assez de symboles, d'emblèmes caractéristiques pour raconter aux yeux sa vie et sa mort. Son image est conçue comme celle de tant d'autres marins; il tient de la main droite une longue-vue, et la main gauche est posée sur une carte géographique que supporte le fût d'un mat brisé; la tête a de la noblesse en dépit des ailes de pigeon; les plis du manteau sont sévèrement agencés; les mains, surtout la gauche, sont modelées avec soin.
Cette statue est la sixième du même genre qu'exécute M. Raggi, auteur du Montesquieu, de Bordeaux; du Bayard, de Grenoble; du Henri IV, de Neyrac, de celui de Pau, et d'une statue équestre de Louis XIV, destinée à la ville de Rennes. Ce sera un nouveau titre pour ce sculpteur émérite, qui, déjà six fois candidat à l'institut, se présente pour recueillir l'héritage de M. Cortot.
Courrier de Paris.
Nos rues, nos jardins et nos places publiques ressemblent depuis quelques jours à des corridors et à des préaux de collèges: on n'y rencontre qu'écoliers enchâssés dans l'habit uniforme gros-bleu et boulonnés jusqu'au menton; mais, à leur allure libre, insouciante et résolue, on devine que les oiseaux ont passé à travers les barreaux de la cage. La voix du maître ne les éveille pas en sursaut dans leur liberté; ils s'en vont au hasard, à travers la ville, l'oeil curieux et les bras ballants, ici et là, sans que la règle leur crie: «Allons, messieurs! en classe! silence! taisez-vous!» Heureuse saison des écoliers en vacances! Pareils à des soldats en congé, ils ont mis bas les armes et cheminent sans sabre et sans giberne, c'est-à-dire sans Gradus et sans Conciones; le Lexique et la Grammaire sont au repos; le Virgile et l'Ovide gisent abandonnés sur quelque rayon poudreux de la salle d'études. C'est un désarmement général.
Le soir, les théâtres sont peuplés de cette gent écolière: la voyez-vous disséminée dans les loges ou groupée au parterre? on s'aperçoit bien vite de leur présence à la gaieté bruyante qui éclate aux endroit? plaisants, et au sérieux avec lequel ils écoutent les passages pathétiques. Parlez-nous de ce public-là! il n'est ni exigeant ni blasé; tout l'amuse, tout l'intéresse, tout l'enchante! Ce n'est pas lui qui se laissera aller au fond de sa loge ou de sa stalle en étouffant de sa main gantée un bâillement dédaigneux! Ce n'est pas lui qui s'écriera d'un air maussade: «Ah! quel ennui! mauvais! pitoyable! exécrable!» interrompant les acteurs et sortant, comme les marquis de Molière, au moment le plus beau.
Quel plaisir, au contraire, de voir l'attention naïve de nos jeunes spectateurs! Ils ne quittent pas la scène du regard, écoutent de toutes leurs oreilles, examinent de tous leurs yeux immobiles, absorbés, insatiables. A minuit la toile tombe, et eux, s'éveillant comme d'un rêve, de s'écrier, tout surpris: «Tiens! est-ce que ça finit déjà?»
Demandez-leur ce qui s'est passé autour d'eux; s'il y avait du monde dans la salle ou s'il n'y en avait pas; de quelle couleur était la robe ou le chapeau de leur voisine; était-elle jeune ou vieille, laide ou jolie? ils n'en savent rien. Nos écoliers, en effet, sont loin encore de cette science qui consiste à venir au spectacle pour y tout voir, excepté le spectacle; pour s'occuper de tout, hormis des acteurs et des pièces. Ils n'ont pas à faire étalage de leurs gants glacés, de leur binocle, de leur frisure, de leurs moustaches; ils ne songent pas, au lieu de la comédie qu'on leur montre, à se montrer et à se contempler eux mêmes; mais, patience! laissez faire le temps, et tel de ces bambins que vous voyez le coude appuyé sans cérémonie, sur la devanture d'une loge et se rongeant les doigts, tandis qu'un camarade lui passe le bras par-dessus le dos et l'enlace; tel de ces petits sauvages, vous dis-je, prendra, dans deux ou trois ans, les airs d'un lionceau parfumé, et caressera sa barbe en souriant, de l'avant-scène, à mademoiselle Castellan ou à madame Doche.
Quand vous rencontrez ces bandes d'écoliers symétriquement rangés sous la férule du magister, et descendant le long des rues avec un confus murmure pour gagner la grille du collège; quand vous voyez ces petits garçons et ces petites filles qui roulent dans le sable des Tuileries ou lancent un ballon en l'air sur le rare gazon du carré Marigny, ne vous arrive-t-il pa de vous adresser à vous-même cette simple question: «Qu'est-ce que tout cela deviendra? Vaudront-ils mieux ou moins que nous?» Horace répond: ils donneront des fils pires encore que leurs pères, et Béranger chante;
Chers enfants, dansez, valsez.
Votre âge échappe à l'orage.
Vous échapperez, aux tempêtes
Où notre courage expira.
Lequel croire des deux poètes? Celui qui prédit des nuages plus sombres, ou celui qui annonce un beau ciel? J'ai grand'peur qu'Horace n'ait raison! N'est-ce pas pour nous, en effet, les jeunes d'il y a quinze ans, que Béranger avait dit;
J'en crois votre allégresse:
Oui, bientôt d'un ciel pur
Vos jeux, brillants d'ivresse,
Réfléchiront l'azur!
O noble poëte! notre ivresse et nos yeux ont menti: où est le ciel pur? où est l'azur que tu nous promettais?
--M. Alexandre Dumas, tout le monde le sait, a donné récemment un assez curieux échantillon de la colère où peut se laisser emporter la rancune d'un poète critiqué et sifflé: pour défendre une mauvaise pièce, il écrivit à M. Jules Janin cette mauvaise lettre qui prouvait tout ce que vous voudrez, excepté la chose importante, à savoir que la comédie de M. Dumas est une bonne comédie; le critique a répliqué au dramaturge par un article plein de traits acérés et piquants. Quel bénéfice, cependant, M. Dumas et M. Jules Janin ont-ils retiré de cette lutte à l'encre de la Petite-Vertu? Beaucoup de bruit et de ridicule pour rien: le public, juge du camp, les a renvoyés dos à dos, scandale compensé.
M. Alexandre Dumas avait mal choisi son terrain: c'est à Vienne et non à Paris, en Autriche et non en France, que nous conseillons à l'auteur des Demoiselles de Saint-Cyr d'aller désormais porter son ressentiment contre la critique; à Paris on trouve des feuilletons qui ripostent et un public qui se moque de vous; à Vienne, l'auteur mécontent a meilleure chance: pour peu qu'il soit bienvenu de la police et du gouvernement, il impose silence à ses contradicteurs par un moyen sans réplique, par la loi du plus fort. Il y a à Vienne une manière d'entendre la liberté de la presse et de régler le droit d'examen, qui conviendrait parfaitement à l'amour-propre de M. Dumas, et lui procurerait une satisfaction assurée, économique et sans frais de correspondance. Vous en aurez la preuve tout à l'heure; je tiens le fait d'un témoin personnellement impliqué dans l'aventure.
A Vienne donc, pendant l'hiver dernier, sous le gouvernement paternel de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohème et de Hongrie, la troupe italienne donnant ses représentations, on joua le Don Pasquale de Donizetti. L'ouvrage plut à ceux-ci et déplut à ceux-là, comme il arrive assez généralement pour toutes les comédies humaines, grandes ou petites, sérieuses ou bouffonnes. Un feuilleton,--l'Autriche a aussi le bonheur d'avoir des feuilletons,--fut de l'avis des spectateurs que Don Pasquale n'avait que médiocrement charmés; il s'en expliqua sans plus de façon et imprima les raisons de son antipathie. Quoique allemande et autrichienne, la critique était, dit-on, vive et mordante. Savez-vous ce qu'il en advint?--Une réclamation de Donizetti, affirmant que sa musique était fort bonne? une lettre incommensurable comme la lettre que M. Alexandre Dumas a décochée contre M. Jules Janin?--Non point, vraiment: l'Autriche ne s'amuse pas à de pareilles bagatelles; elle a, pour faire taire la critique, des moyens plus brefs et plus efficaces.
Le feuilleton avait à peine paru, à peine la bonne ville de Vienne avait-elle eu le temps de briser l'enveloppe du journal, qu'un personnage tout de noir babillé se présentait chez l'auteur, et d'un ton solennel et sévère: «Monsieur, lui dit-il, c'est vous qui avez écrit l'article scélérat que votre feuille publie ce matin contre l'opéra de M. Donizetti?--Oui, monsieur.--J'en suis fâché pour vous, monsieur.--Et la raison, s'il vous plaît, monsieur?--La raison, la voici en peu de mots: M Donizetti est attaché à la musique de Sa Majesté Impériale; il est malséant que vous osiez parler avec cette irrévérence d'un compositeur qui a obtenu de Sa Majesté cette marque d'estime et de faveur. Sa Majesté et toute la cour impériale font grand cas de M. Donizetti et de ses opéras; vous voudrez bien désormais vous conformer à leur avis.--Mais, monsieur, répliqua le journaliste.--Point de mais.--Cependant!--Point de cependant; tenez-vous pour averti!» L'avis était formel, et le journaliste avait reconnu dans son interlocuteur un des agents de la police supérieure; il s'agissait de choisir entre le plaisir de critiquer M. Donizetti et la suppression immédiate du journal; le feuilleton ne crut pas que Don Pasquale valût ce sacrifice; il s'abstint d'en parler davantage. Nous avons à Paris d'honnêtes feuilletons qui, après avoir condamné Donizetti la veille, auraient eu le courage d'en faire l'éloge le lendemain.
Quel dommage que M. Alexandre Dumas n'ait pas mis sa comédie des Demoiselles de Saint-Cyr sous la protection de la police autrichienne, soit comme attaché aux récréations de Sa Majesté l'empereur, soit comme porte-queue de Sa Majesté l'impératrice! cela viendra, j'espère!
Vous avez vu avec quelle bénignité la critique est traitée là-bas; c'est absolument la liberté que définit Figaro: parler de tout à condition qu'on ne parlera de rien. Ce régime libéral s'applique indistinctement à tout le monde, dans cette charmante ville de Vienne, où la valse seule et les gros repas jouissent d'une liberté illimitée; les chanteurs n'en sont pas plus exempts que les critiques.
Un ténor italien--une basse peut-être--que nous entendrons cet hiver à Paris, Salvi, chantait dernièrement à l'Opéra de Vienne: le public viennois le traitait avec faveur, et les belles Viennoises, aux blanches épaules, battaient des mains toutes les fois que Salvi se faisait entendre. Un soir cependant--on jouait la Lucia--un murmure s'élève dans la salle; on s'agite, on trépigne, et les sifflets retentissent. Qu'est-ce? qu'y a-t-il? La cavatine! la cavatine! s'écrie de tous côtés le parterre; et Salvi de regarder le public d'un air ébahi. La cavatine! répète-t-on avec plus de violence. Salvi témoigne par sa pantomime, qu'il ne comprend rien à ce vacarme; puis il fait trois respectueux saluts, se retire dans la coulisse et la toile tombe.
Dans la salle, le bruit était effroyable; il n'y a rien de tel que les Allemands, quand ils s'y mettent; c'est l'histoire du mouton enragé.
Un homme, cependant, s'introduisait dans la loge où Salvi était déjà occupé à filer son rouge et son costume de théâtre; c'était sans doute le même homme qui avait eu avec le feuilleton l'entretien que nous avons raconté plus haut. Le personnage intime à Salvi l'ordre de chanter la cavatine réclamée par le parterre; Salvi répond qu'il ne sait de quelle cavatine on veut lui parler; puis, d'explication en explication, il devine enfin qu'il s'agit d'un air ajouté à la partition de la Lucia par le virtuose qui tenait son emploi l'année précédente, air qui avait fait fureur. «Mais je ne sais pas cet air, dit Salvi.--N'importe, vous le chanterez.--Je ne le connais même pas!--Chantez toujours, sinon vous aurez à sortir de la ville dans les vingt-quatre heures.» Ainsi s'expliqua l'autorité paternelle. Salvi tint bon, et le lendemain il quittait Vienne par le faubourg de Léopoldstadt, chantant à plein gosier sans doute; O Lucia inamorata! comme un oiseau échappé qui gazouille dans l'air libre.
Pour en revenir à la querelle de M. Janin el de M. Alexandre Dumas, on sait de quelle agréable façon elle s'est terminée; M, Jules Janin, qui avait montré beaucoup d'esprit dans sa réplique, s'en est bien repenti dans un article suivant; et aussitôt M. Alexandre Dumas, ce foudre de guerre, a mis bas les armes; on a vu, spectacle touchant, les deux adversaires, occupés depuis trois semaines à se faire les déclarations les moins amoureuses et à se regarder d'un air dévorant, se sourire tout à coup, et déclarer, par la plume de M. Janin, qu'ils professaient l'un pour l'autre la plus parfaite estime. Pourquoi donc s'injurier si fort et si longtemps, quand on est si dignes de s'entendre? Il faut espérer qu'une autre fois M. Alexandre Dumas et M. Jules Janin commenceront par où ils ont fini, par s'embrasser. Ce sera une économie toute claire.
Ce beau duel à la pointe de la plume, qui a fait diversion aux grandes chaleurs du mois d'août, aura eu du moins l'avantage de mettre au jour le dévouement du valet de chambre de M. Jules Janin; cet estimable domestique est digne maintenant de figurer dans l'histoire des chiens de Terre-Neuve et des caniches à l'épreuve. Voici un trait de sa façon, qui justifie la colonne que nous dressons ici à sa fidélité.
C'était le jour où M. Alexandre Dumas voulait, à toute force, avaler M. Jules Janin tout cru; il le cherchait malheureusement partout où il n'était pas; de leur côté, ses témoins s'étaient mis en campagne; l'un d'eux, M. le duc de Guiche, arrive enfin rue de Vaugirard, et sonne à la porte de l'auteur de l'Ane mort; quelqu'un ouvre; c'était l'excellent Frontin en question.
M. le duc de Guiche.--M. Jules Janin?
Frontin, flairant l'odeur de témoins.--Monsieur n'y est pas.
Le duc.--Où est-il?
Frontin.--Il est sorti.
Le duc.--Pour longtemps?
Frontin.--Pour très-longtemps.
Le duc.--Quand rentrera-t-il?
Frontin.--Jamais!
Certes, voila un jamais qui l'emporte de beaucoup sur tous les qu'il mourût! du monde. C'est du sublime pur.
Un matin, il était décidé qu'on irait sur le terrain. Restait le point en litige, le choix des armes. «Nous nous battrons à l'épée,» dit M. Alexandre Dumas à son adversaire.--«Vraiment non, réplique M. Jules Janin; j'ai deux ans de salle, et je sais un coup d'abattage auquel vous n'échapperiez pas. Battons-nous au pistolet.--Ah bien oui! à trente-cinq pas je vous tuerais net comme une mouche!»
Ils ne se sont tués, Dieu merci, ni l'un ni l'autre, et ils ont eu raison. Ce qui convient à M. Jules Janin, c'est d'abattre autant qu'il pourra de bons feuilletons et non des poitrines d'homme; et M. Alexandre Dumas a bien mieux à faire que de tuer des mouches à trente-cinq pas; qu'il mette au monde de beaux drames et d'excellentes comédies, pour faire bien vite oublier les Demoiselles de Saint-Cyr et tout ce bruit inutile, irréfléchi, malheureux, qui leur a servi de cortège!
--Tout à l'heure nous racontions les mésaventures de Don Pasquale en Autriche. Vienne, on l'a vu, n'a goûté que médiocrement les charmes de sa mélodie. Est-ce la faute de Vienne ou la faute de la mélodie? Nous ne discuterons pas ici ce point important, de peur que le gouvernement de S. M. l'empereur d'Autriche n'y trouve à redire, et que M. de Metternich n'envoie une déclaration de guerre à la France, si mieux elle n'aime trouver Don Pasquale une oeuvre excellente, admirable, parfaite. Je connais trop la témérité et l'ardeur belliqueuse de nos ministres pour les engager dans un tel conflit.
Mais si Don Pasquale a rencontré des adversaires sur les bords du Danube, Maria di Rohan n'y a trouvé que des amis et des bravos. Maria a pris la revanche de Don Pasquale et consolé M. Donizetti. Le Théâtre-Italien nous promet pour la prochaine saison cet opéra si fêté. Paris n'est pas toujours de l'avis de tout le monde, c'est un sultan fantasque qui aime à briser les statues élevées ailleurs au milieu des acclamations unanimes. Plus d'une fois il a pris des couronnes tout fraîchement cueillies à l'étranger, et les a brisées, en riant, de sa main capricieuse. Nous verrons ce qu'il fera de la touchante Maria.
M. Donizetti se dispose à un hiver prodigue; outre Maria pour la scène italienne, nous aurons un grand opéra en cinq actes de sa façon, Don Sébastien de Portugal, que l'Académie Royale de Musique prépare à grands frais. Cinq actes ici et deux là, ce serait quelque chose pour un autre; mais pour M. Donizetti ce n'est rien; le maestro ne s'inquiète pas de si peu. Les notes coulent de sa veine avec une inépuisable abondance. Voulez-vous un opéra de Donizetti en deux, en trois, en cinq actes, ou voulez-vous un, deux, trois, quatre, dix? tournez le robinet; et tout est dit.
Les lauriers de M. Donizetti empêcheraient-ils M. Castil-Blaze de dormir? Voici ce terrible critique musical qui passe tout à coup de la théorie à la pratique; il tient fabrique d'opéras et menace d'en inonder Paris et la banlieue. M. Castil-Blaze ne lésine pas sur la marchandise: l'intrépide fait tout lui-même, musique et paroles. Après une lutte à outrance contre les théâtres et les directeurs, M. Castil-Blaze est enfin parvenu à mettre au jour un enfant de sa double fécondité, oint par lui et baptisé du nom original de Pigeon vole. Hélas! l'enfant n'a pas eu longue vie, il est mort au berceau, dès son premier pas, et jamais mort n'a excité une hilarité plus générale;--ce n'est pas Pigeon vole qu'il fallait dire, murmurait le public en sortant, mais le vol au pigeon.
--Cette disgrâce n'a pas abattu la résolution de M. Castil-Blaze: il nous promet encore quelque oiseau rare. M. Castil-Blaze a plus d'un pigeon en cage.
--On annonce le retour de M. Scribe, qui était allé refaire sa santé aux Pyrénées, et qui en revient avec une comédie en cinq actes. Mademoiselle Rachel, de son côté, arrivera bientôt de Chamouny et du Montauvert; Phèdre s'est abritée sous le chalet: elle a bu du lait pur et marché sur la mer de glace; c'est un régime bien tiède pour la brûlante fille de Minos et de Pasiphaé!
Mais si nous recouvrons mademoiselle Rachel, mademoiselle Esther nous quitte; dans son genre, mademoiselle Esther n'est pas moins célèbre que mademoiselle Rachel.--Qui ne connaît mademoiselle Esther du théâtre des Variétés, ou n'a eu envie de la connaître? L'École de Droit en raffolait, l'École de Médecine en perdait la tête; de quoi rêvait l'École Polytechnique? de mademoiselle Esther. Le commis-marchand lui tressait des couronnes, et le jockey-club a vidé en son honneur plus de bouteilles de vin d'Aï qu'il n'y a de pavés sur le boulevard Montmartre.
D'où venait la grande popularité de mademoiselle Esther?
--Et pourquoi ne le dirais-je pas? Messieurs les sergents de ville ne sont pas là pour m'en empêcher. Mademoiselle Esther a introduit au théâtre le style débardeur et..... le cancan.
Voilà ce qui l'a fait adorer de ses contemporains.
Au moment où j'écris ces lignes, mademoiselle Esther a quitté Paris et la France; elle a compris qu'il était temps d'exporter ses doctrines en Europe et de faire de la propagande; mademoiselle Esther part pour la Russie, pays encore sauvage, comme chacun sait. L'influence de mademoiselle Esther ne tardera pas à se faire sentir dans l'empire des czars et à le civiliser. Bientôt la Russie s'habillera en débardeur et dansera... ce que vous savez.
De la Peinture sur lave émaillée (1).
Note 1: Ces réflexions nous sont communiquées par un artiste que recommandent également son talent et son caractère, M. Achille Dévéria.
Nous avons signalé à l'attention de nos lecteurs l'heureux essai de peinture sur pierre de lave émaillée, qui a été fait dans l'église de Saint-Nicolas-des-Champs. Ce succès vient confirmer toutes les espérances que l'on avait fondées sur l'emploi de la lave, destinée peut-être à être un jour la seule base de toutes les décorations peintes dans nos monuments publics.
Le Christ de M. Perlet, toutefois, n'est pas encore une expérience complète; les dispensateurs des travaux d'art feront sagement de commander une oeuvre d'une grande dimension, afin qu'il devienne hors de doute que les joints de diverses plaques de lave réunies ne nuiraient en rien à l'effet d'ensemble d'une grande décoration.
Aujourd'hui, on ne travaille guère pour la postérité seule: nous aimons à jouir, nous faisons tout vite; l'architecture élève des palais par enchantement: on peut citer l'Hôtel-de-Ville comme exemple. Quelle est la cause ordinaire des plus longs retards? C'est la décoration intérieure, ce sont les peintures que les pauvres artistes se fatiguent à faire sur les murailles, sans pouvoir, malgré leur talent, satisfaire à l'impatience du pouvoir et du public. La pierre de lave fera gagner tout ce temps si regrettable; la peinture alors, comme la sculpture, ordonnée d'avance, viendra, sous la main de l'architecte, se mettre en place avant qu'il ait enlevé ses échafauds.
Cette peinture s'exécutera par les mêmes hommes que les vitraux; les peintres-verriers sont des émailleurs. Des cartons, ordonnés aux plus habiles maîtres, seront confiés à l'exécution d'excellents praticiens, et particulièrement à la Manufacture royale de Sèvres, où M. Brougniart, secondé par les efforts de M. Louis Robert, a donné, dans ces derniers temps, un si merveilleux développement à l'art de la peinture vitrifiable. En moins d'un an, d'après les beaux cartons de M. Ingres, quatorze fenêtres viennent d'être exécutées et mises en place dans la chapelle funèbre de Sablonville.
Plus durable que tout ce qui a été expérimenté jusqu'à ce jour, la peinture sur lave présente tous les avantages de la mosaïque sans en avoir aucun des inconvénients. Le prix excessif de la mosaïque, le temps considérable qu'en exige l'exécution, auraient suffi pour faire renoncer à cette peinture, qui, d'ailleurs, tombe par pièce à mesure que le ciment se détache. On n'a rien de semblable à redouter pour le nouveau mode; des scellements bien faits dureront, comme tout revêtissement de marbre, jusqu'au jour où le monument lui-même tombera.
Les peintures de nos monuments n'auront donc plus à craindre l'humidité, le soleil, le vernisseur, le restaurateur, ou la pierre lancée par un étourdi. Que cette peinture vitrifiée décore l'intérieur ou l'extérieur d'un monument, un coup d'éponge suffira pour en ôter la poussière.
Le prix en sera le même que celui d'une peinture ordinaire, car un peintre habile, pour donner un carton et son esquisse, ne demandera que le tiers du prix d'un travail complet, et le reste suffira pour payer l'exécution.
Ainsi, même prix que toute autre peinture, durée égale à celle du monument, économie immense sur le prix d'une mosaïque, ce sont là des avantages immenses et dont on ne saurait trop se hâter de jouir.
Révolution» du Mexique.
LE GÉNÉRAL SANTA-ANNA.
(Suite et fin.--V. p. 337.)
Le président Pedraza, dont l'élection avait causé le bouleversement que nous avons raconté, échappé au sac de Mexico, s'était réfugié à Guadalajara. Le général Guerrero avait été nommé vice-président, et Santa-Anna, tout en blâmant les excès commis dans la capitale du Mexique, s'était hautement déclaré pour lui. Tout était tranquille. Il y avait bien de temps à autre quelques pronunciamentos isolés d'ambitieux subalternes; mais personne ne s'en préoccupait, et les clameurs s'en perdaient sans échos dans les vastes solitudes de la république.
Cet état de choses dura jusqu'en septembre de l'année 1829. A cette époque une ridicule tentative fut faite par l'Espagne, pour reconquérir le Mexique. L'expédition partit cette fois encore de la Havane, comme trois cents ans auparavant; mais Cortez n'était plus là. Le brigadier Barradas vint débarquer à Tampico avec 3,000 hommes.
Pendant que le général espagnol, indécis sur la marche qu'il doit suivre, lance des proclamations qui demeurent sans effet; pendant qu'à Mexico on s'agite sans rien arrêter, à cette surprenante nouvelle, Santa-Anna s'arrache à la vie des champs, rassemble de nouveau ses soldats, met en réquisition forcée tous les navires caboteurs en rade de Vera-Cruz, y embarque ses hommes à la hâte et sans ordre du gouvernement, sans aucun pouvoir spécial, traverse le golfe, débarque près de Tampico, livre bataille aux troupes de Barradas et les taille en pièces. Celui-ci se rembarque aussitôt, emporte sa caisse militaire pleine de quadruples, laisse ses soldats se disperser comme bon leur semble, et la nouvelle de sa déroute parvient à Mexico presqu'en même temps que celle de son débarquement.
Au mois de décembre suivant, le général Bastamante, proclamé par les troupes du camp de Jalapa pour renverser Guerrero, marche sur Mexico. Santa-Anna, de retour à Manta de Clavo, avait, avec sa rapidité accoutumée et l'ascendant de sa parole, réuni une nouvelle année pour voler au secours du vice-président. Il arrive à Jalapa qui frémit encore de la nouvelle insurrection, et là il apprend que Guerrero a quitté Mexico et s'est jeté dans le sud. Pensant alors que la fortune de Bastamante l'emporte sur celle de Guerrero; que le temps n'est pas encore venu de lutter personnellement avec un rival dont le nom l'importune déjà, Santa-Anna licencie ses troupes qu'il retrouvera toujours, et revient, comme Cincinnatus, à ses champs jusqu'au moment où il combattra lui-même pour cette présidence qu'on se dispute sous ses yeux et à laquelle son âge ne lui permet pas encore d'aspirer, car il n'a pas trente-cinq ans révolus. Deux années s'écoulent pendant lesquelles Santa-Anna, retiré dans son hacienda, se livre paisiblement à ses passe-temps favoris, les combats de coqs, les courses de chevaux, le jeu, et paraît avoir rejeté loin de lui toute idée d'ambition. Le 14 février 1831, dans cette même ville de Oajaca où il avait bravé lui-même avec tant d'insouciance les efforts du gouvernement, l'infortuné Guerrero achevait à la fois sa campagne et son existence aventureuse. Il venait d'être fusillé, et la nouvelle de son exécution dut troubler la solitude de Santa-Anna. Bastamante succédait à Guerrero, et gouvernait tranquillement dans Mexico. Pendant le cours de cette année, rien ne put faire soupçonner que Santa-Anna commençât à trouver pesante une inaction si prolongée, si étrangère à ses habitudes et à son esprit. Le chemin qui conduit de Vera-Cruz à Manga de Clavo restait désert; ou n'y entendait plus résonner le galop de ces courriers qui se croisent et se suivent aux jours où il médite quelque pronunciamiento imprévu. Au dehors et au dedans de l'hacienda, tout était tranquille.
Le 2 janvier 1832, deux officiers s'y présentent devant Santa-Anna, lui communiquent une pétition de la garnison de Vera-Cruz demandant à Bastamante le renvoi de son ministère, et le prient de l'appuyer du prestige de son nom. Santa-Anna leur promet son appui, et, comme les demi-mesures n'ont jamais été de son goût, il dit adieu cette fois-ci et pour longtemps à son séjour de prédilection, arrive le lendemain à Vera-Cruz, reconnaît la déchéance du ministère Alaman, s'empare des coffres de la douane, perçoit les droits et s'installe en seigneur et maître dans une ville dont la possession lui assure les trésors qu'y viendra verser le commerce européen. Il ne sollicite pas, il dicte des ordres. Ses fidèles officiers, au nombre desquels on compte en première ligne les deux frères Arago, abandonnent Mexico et viennent se joindre à lui. Santa-Anna est dans son élément; il s'est rassasié de solitude jusqu'à satiété: un immense champ d'activité s'étend devant ses yeux.
Bastamante ne veut pas accorder à l'intimidation ce qu'on exige de lui; il envoie contre les révoltés un corps de troupes de 3,000 hommes commandés par le général Calderon. Celui-ci vient camper à Santa-Fé; c'est un village à trois lieues de Vera-Cruz que Calderon a choisi pour s'y arrêter, car il termine la zone meurtrière que la fièvre jaune et les sables brûlants tracent autour de cette ville. L'influence mortelle ne franchit pas sa ceinture de chênes verts.
Pendant ce temps, le général Arago avait été chargé par Santa-Anna du commandement de Vera-Cruz, et son frère avait reçu assez à contre-coeur l'ordre de former et de discipliner un corps de 1,200 hommes composé des Jarochos de la côte. Pour que nos lecteurs se fassent une idée de la difficulté d'exécution de l'ordre donné notre compatriote Joseph Arago, il est bon qu'ils sachent que ces Jarochos sont les habitants des campagnes embrasées qui bordent le littoral, gens inquiets, remuants, à la peau basanée, dont le corps nerveux n'est pas susceptible de laisser échapper une goutte de sueur sous ce soleil brûlant; cavaliers indomptés comme leurs chevaux, aux jambes unes, aux culottes de velours bleu, le sabre toujours à la main, s'en servant à chaque instant ou pour terminer leurs querelles, ou pour s'ouvrir un passage à travers les réseaux compliqués de leurs forêts, et, pour éviter toute perte de temps, le portant à leur côté sans fourreau. Il vaudrait donc autant essayer de former régulièrement les Bédouins les plus vagabonds, ou de rassembler en masse compacte les sables de leurs déserts, que de vouloir apprendre à ces hommes à soutenir une charge ou à l'exécuter en corps, ou à se plier aux exigences de la discipline. Santa-Anna devait en faire bientôt l'expérience.
Il est instruit, à dix heures du soir, qu'un riche convoi d'argent et de munitions, escorté par 500 hommes, est attendu par le général Calderon. Il monte aussitôt à cheval avec quelques soldats, longe silencieusement, à la faveur des ténèbres, les bords de la mer sur le chemin de l'Antigua (l'ancienne Vera-Cruz), et, se rabattant tout à coup sur la gauche, se trouve au point du jour entre le camp de Calderon qu'il a tourné et le convoi qu'attend celui-ci, c'est-à-dire au milieu d'une forêt qu'il faudra traverser. Sous ces voûtes sombres où les premières lueurs de l'aube n'ont pas encore pénétré, Santa-Anna et sa troupe dressent leur embuscade et se tiennent immobiles derrière les fourrés épais.
Un des Jarochos accoutumé, comme ils le sont tous, à suivre une piste sur des traces presque invisibles, est envoyé en avant. L'oreille collée contre terre, il distingue déjà le piétinement des mulets chargés, la clochette de la jument conductrice du convoi, le trot de la cavalerie qui l'accompagne et le bruit de la conversation des officiers. Il fait entendre le signal convenu, chacun se tient prêt; les divers murmures se rapprochent; en un instant, aux yeux de l'escorte étonnée, le convoi disparaît derrière un mur vivant qui surgit tout d'un coup, et pendant que la fusillade s'échange, il est rapidement dirigé en sens opposé. Une voix s'écrie: «C'est le général Santa-Anna qui est ici!» et, au prestige de ce nom, les fuyards reviennent sur leurs pas en criant; «Vive le général Santa-Anna!» se joignent à lui, et le général regagne Vera-Cruz avec une augmentation considérable dans son trésor et 500 hommes de plus dans son année.
Puis, après un court répit, sans permettre que les chevaux soient même débridés, Santa-Anna l'ait sonner le boute-selle de tous les Jarochos, prend avec lui quelques régiments d'infanterie, et laissant au général Arago le soin de défendre la place, se met en marche pour aller offrir la bataille à Calderon, le joint à Tolomé, et quoique sans artillerie, avec une cavalerie indisciplinée, donne l'ordre de commencer l'attaque.
Malheureusement, aux premières détonations de l'artillerie, les Jarochos lâchent pied, entraînant avec eux leur capitaine Arago, qui fait de vains efforts pour les rallier. L'infanterie seule tient bon contre les batteries de Calderon, et la lutte héroïque d'un régiment de Santa-Anna prolongea la bataille jusque dans l'après-midi; mais quand le dernier homme tomba, la déroute devint complète. Tout le monde s'enfuit, ceux qui demandent quartier sont égorgés; le colonel Landero, un des plus braves officiers de Santa-Anna, est massacré dans sa fuite par un lancier qu'il implore en vain, et Santa-Anna lui-même, accompagné d'un seul homme, jette un regard de douleur sur ses braves muchachos couchés dans la plaine, pique son cheval, s'enfonce dans les bois, et disparaît.................
Vingt-quatre heures s'étaient écoulées, et Vera-Cruz présentait un aspect bien différent de celui qu'elle offrait lors de l'entrée de ce convoi si heureusement capturé. L'inquiétude est universelle; Santa-Anna n'a pas reparu depuis la sanglante affaire de Tolomé. Le général Arago, sur qui pèse toute la responsabilité, après avoir pris les mesures nécessaires pour résister à l'attaque de Calderon qu'il attend de minute en minute, se promène soucieusement sur une terrasse élevée, en interrogeant tous les points de l'horizon. La plage jusqu'à Bergara est déserte, la brise agile tristement les masses sombres de verdure qui la terminent, et sous lesquelles Santa-Anna doit errer à l'aventure. Dans chaque nuage de sable que le veut de la mer fait tourbillonner, il croit voir ou les colonnes de Calderon s'avancer, ou reconnaître le cheval et le costume de son général en chef. Cet espoir enfin se réalise; accompagné d'un seul domestique, poudreux, pâle et son uniforme en lambeaux, Santa-Anna regagne Vera-Cruz.
Le général Arago, après les premiers épanchements, n'eut rien de plus pressé que de lui dire;
«Maintenant, mon général, que votre précieuse personne nous est rendue, je désire avant tout que vous veniez inspecter mes travaux de défense.
--Nous avons tout le temps demain, mon cher Arago, lui répondit Santa-Anna en descendant péniblement de cheval.
--Mais, mon général, d'une minute à l'autre Calderon va venir.....
--Je connais mes vieux camarades, interrompit Santa-Anna, cédant déjà à un sommeil invincible, ils doivent, avant de nous attaquer, se refaire aussi, quant à moi, depuis vingt-quatre heures que ces enragés m'ont traqué comme une bête fauve, je ne suis pas descendu de cheval; j'ai à peine bu, à peine mangé, et je n'ai pas dormi. Je vais m'en dédommager. Vous ne me réveillerez que quand l'attaque commencera; aussi vais-je dormir tranquille. Buenas noches.»
Nous rapportons ici ces paroles historiques pour faire mieux connaître l'esprit de cet homme extraordinaire, et pour dire, comme on l'a vu déjà et comme on le verra encore, que de tous ses besoins le sommeil est le plus impérieux, et qu'aucune circonstance critique ne peut l'empêcher de s'y livrer.
Santa-Anna connaissait bien ses compatriotes. Le 3 mars, avait eu lieu la déroute de Tolomé: Calderon se serait emparé presque sans résistance de Vera-Cruz, et le 10 seulement son armée arriva sous ses murs. Tout alors était remis en état; mais Santa-Anna comptait plus encore, pour se défendre, sur les exhalaisons ardentes des sables qui entourent la ville, sur la fièvre jaune, sur la famine, et ces terribles alliées ne trompèrent pas son attente. La faim, la soif, la maladie, la désertion, déciment l'armée, du gouvernement, elle 15 mai suivant, le général Calderon lève le siège et se replie sur Mexico.
Cependant l'insurrection contre Bastamante avait fait d'immenses progrès. Le général Pedraza, président de droit, élu en 1828, est de nouveau redemandé par les insurgés. Santa-Anna, qui jadis s'était opposa à son élection, se range maintenant de son côté, et se met en marche pour Mexico. Calderon veut de nouveau l'arrêter. Ils se rencontrent à Corral-Falso, près de Jalapa (13 juin); mais, cette fois, Calderon capitule. Par ordre du congrès, il est remplacé dans le commandement de l'armée par le général Facio; Santa-Anna le bat complètement, et se dirige sur la capitale du Mexique.
A cette nouvelle, Bustamante se porte en toute hâte à sa rencontre; les deux rivaux sont en présence devant Puebla; une affaire générale est inévitable. Mais Bustamante cède à l'influence de l'étoile toute-puissante de Santa-Anna, et donne gain de cause au chef de l'insurrection en se rendant au voeu des insurgés.
Ainsi se termine pour Santa-Anna l'année 1832; celle de 1833 le voit porté à la présidence, et, comme César, le premier dans Rome.
Vers la fin de mai de cette année, une nouvelle insurrection éclate dans Valladolid, C'est la première scène d'une haute comédie dans laquelle Santa-Anna s'est réservé le rôle le plus brillant. L'insurrection, sous les ordres du général Duran, a pour but de proclamer le président dictateur. Santa-Anna s'indigne de cette violation des lois dont il est le premier sujet, et devant lesquelles il doit, en cette qualité, s'incliner le premier. Il donne à son fidèle Arista l'ordre de le suivre, et tous deux marchent une fois encore sur les rebelles. Tout d'un coup celui-ci lui propose d'accepter les offres de ces serviteurs dévoués qu'ils vont combattre. Santa-Anna reproche à Arista de ne pas l'avoir mieux apprécié, lui impose silence; mais Arista résiste, lui remet son épée, lui déclare qu'il n'est plus sous ses ordres, qu'il va passer avec le général Duran, et que malgré lui il saura le faire dictateur. On pense bien que cette scène ne se passait pas dans le silence de l'intimité.
Santa-Anna, bientôt fait prisonnier par les insurgés, s'échappe de leurs mains et revient à Mexico, où le vice-président Gomez Farias résistait de meilleure foi à une insurrection de la garnison même du palais, se remet en campagne contre Arista et Duran, et les force à capituler à Guanajuato (la capitulation fut douce); puis, satisfait d'avoir donné à la face du monde cet exemple digne de l'ancienne Rome, dégoûté peut-être de la réalité ou fatigué des travaux de l'administration, Santa-Anna remet son autorité, jusqu'à nouvel ordre, entre les mains du vice-président, et va retremper son âme dans la solitude de Manga de Clavo. Il la quitte bientôt pour aller soumettre la ville de Zacatecas, y revient de nouveau, et s'en éloigne encore pour châtier la rébellion des Texiens.
Nous avons vu, dans l'affaire de Vera-Cruz. Santa-Anna complètement battu dès le principe, terminer la campagne en vainqueur; dans celle du Texas, la victoire ne le conduira qu'à la défaite.
Il commence par emporter à la baïonnette la ville de SanAntonio-de-Bejar, défait les Texiens dans les deux rencontres de Goliah et de Copano, leur fait 600 prisonniers, en fait immédiatement fusiller la moitié, et s'avance jusqu'auprès de San-Jacinto.
Là, fatigué de la régularité de cette guerre, de la précision des manoeuvres stratégiques, ses goûts de guérillero et son esprit aventureux reprennent le dessus. Il laisse sous les ordres du vieux général Filisola le gros de son armée à quelque distance de cette ville, pour aller en personne diriger une de ces attaques soudaines qui lui réussissent ordinairement si bien. Il choisit pour l'accompagner le major-général Castrillon, surnommé le Murat de l'armée mexicaine, comme lui-même en est surnommé le Napoléon, et emmène 800 hommes de sa meilleure cavalerie. Certes, avec ces hommes pour qui aucun obstacle naturel n'est infranchissable, qui galopent avec une dextérité merveilleuse au milieu des halliers et des branches, partout enfin où le corps de leur cheval peut passer; avec ces chevaux qui ont sur les rochers la légèreté du chamois, comme ils ont la vitesse du cerf dans les plaines, Santa-Anna n'avait rien à craindre des ennemis qu'il a l'habitude de combattre. Ceux qu'il va si aventureusement chercher sont d'une nature bien différente. Ce ne sont plus ces soldats intrépides, il est vrai, à l'arme blanche, mais entre les mains desquels les armes à feu sont peu dangereuses; l'armée texienne s'est recrutée d'un grand nombre de ces Kentuckiens, redoutables chasseurs de loutres, dont les longues carabines rayées (rifles), lancent à coup sûr et à de prodigieuses distances une balle inévitable, qui choisissent l'oeil ou l'oreille de l'animal qu'ils poursuivent, pour l'atteindre sans gâter sa fourrure; pour qui la cavalerie de Santa-Anna n'a rien de terrible, car c'est hors de sa portée qu'ils prendront à leur gré pour victime ou le cheval ou le cavalier.
Le 20 avril 1836, le président et sa troupe arrivent vers trois heures de l'après-midi près de San-Jacinto. Le soleil, réverbéré par les terrains calcaires, est si brûlant, que ces hommes de bronze, que ces chevaux dont, après une longue course, pas un poil n'est humide, éprouvent le besoin de faire une halte. Quelques hauteurs éloignées terminent la plaine où le détachement s'arrête, des maisons abandonnées y sont disséminées çà et là, et, à la demande du major-général, Santa-Anna permet à ses hommes de mettre pied à terre. Ceux-ci se désaltèrent en fumant, et, pour rafraîchir leurs chevaux dont les naseaux aspirent la réverbération ardente du terrain, ils se bornent à relâcher les courroies de leurs selles et à les remuer sur leur dos (réjouir la selle, selon l'expression consacrée).
Santa-Anna donne ses ordres et va se livrer au sommeil dans une des maisons qui sont à l'entour; Castrillon pose des sentinelles et va faire sa toilette dans une autre, car l'ennemi est proche, et ce n'est qu'en grand costume qu'il veut le charger.
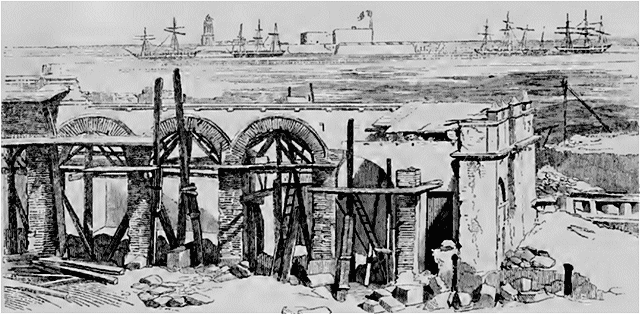
Le fort de Saint-Jean-d'Ulloa, à Vera-Cruz, d'après une
vue prise au daguerréotype.--C'est à la porte au fond de l'arcade à
droite, que Santa-Anna a perdu la jambe droite.
Comme il arrive toujours dans les haltes faites au milieu de ces solitudes embrasées, un silence général se fait parmi ces cavaliers que la chaleur assoupit; les cigales seules bruissent avec fureur sous les rayons du soleil. Tout d'un coup les mots: Aux-armes! aux-armes! retentissent de différents côtés; les sentinelles se replient précipitamment sur le détachement, et à peine les chevaux sont-ils ressanglés, les hommes en selle, qu'un millier de Texiens les attaquent avec vigueur. Castrillon soutient bravement le choc, mais les balles des Kentuckiens sifflent à ses oreilles. Montés sur les hauteurs qui dominent la plaine, leurs longues carabines jettent successivement à terre tous les officiers; Castrillon, atteint de plusieurs coup à la fois, chancelle sur son cheval et tombe; mais les chasseurs de loutres, à l'oeil d'aigle, cherchent en vain Santa-Anna dans la mêlée: son sommeil l'a sauvé.--Un domestique du président est à la porte de la cabane, d'où il sort au bruit de la fusillade, et lui dit, en lui présentant son cheval tout bridé:
«Votre Excellence n'a pas le temps de fuir; Castrillon, tous nos officiers sont tués; vite, vite, à cheval.»
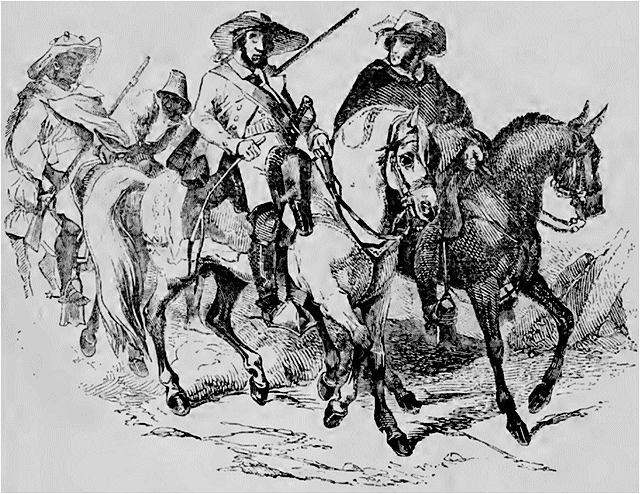
Soldats du Texas.
Santa-Anna s'élance au galop pour rejoindre le corps d'armée et Filisola: la route est coupée; il tourne bride, mais il a été aperçu. Vingt cavaliers galopent après lui: son cheval l'a bientôt, mis hors de leur vue, et il gagne, toujours fuyant, une maison abandonnée. Il met pied à terre pour laisser souffler sa monture, entre dans la cabane, et, s'emparant de quelques vêtements que le hasard l'y fait rencontrer, les troque contre les siens et reprend sa course. Malheureusement l'empreinte des fers de son cheval a été distinguée par l'oeil auquel rien n'échappe de ceux qui le poursuivent. Un instant dépistée par la disparition, sa trace est reconnue parmi cent autres sur le sable, sur les rochers, sur la moindre tige d'herbe, et, malgré son déguisement, il se voit de nouveau pressé par ses ennemis. Arrivé près d'un torrent qui gronde avec fracas, son cheval hésite à le franchir; le temps s'écoule, l'ennemi gagne du terrain.... Santa-Anna est prisonnier.
Il est conduit à Washington, et là, le congrès délibère sur le sort qui lui sera réservé. La majorité est presque d'avis de le fusiller; un membre de l'honorable assemblée se lève et dit:
«Messieurs, nous sommes en guerre avec le Mexique; quel est, notre but? lui faire, tout le mal qu'il nous sera possible... (Oui, oui.) Eh bien! le plus sûr moyen à employer est de lui rendre son fatal président.»
Cette singulière motion lui sauva la vie, el Santa-Anna fut remis en liberté après avoir prêté serment de ne plus jamais porter les armes contre le Texas.
Pendant cette captivité, qui ne se termina qu'au mois de novembre de la même année, Santa-Anna avait achevé les cinq années de sa présidence. A son retour à Mexico, abattu déjà par sa défaite et sa détention, sentant que le prestige de son nom est presque évanoui, il a l'humiliation plus poignante encore de retrouver son rival Bustamante élu président presqu'à l'unanimité. Sur 62 voix il en a obtenu 57, tandis que 5 voix seulement se sont hasardées à proclamer le nom de Santa-Anna.
Deux ans plus lard, au mois de novembre. 1838, Santa-Anna est arraché à ses méditations dans Manga de Clavo par les détonations du canon français, qui foudroie le fort jusqu'alors imprenable de San Juan de Ulua, et par le fracas de ses bastions qui s'écroulent. Il accourt à Vera-Cruz, où il trouve sa nomination de gouverneur de la ville expédiée, déjà par le Sénat. En vain il ordonne, aux défenseurs du fort de s'ensevelir sous ses ruines, ils sont contraints à le rendre, et Santa-Anna grince des dents en pensant à l'irrésistible puissance des nations européennes.--Un hasard providentiel lui évite une seconde captivité.
Le prince de Joinville, sachant que le général Santa-Anna est dans Vera-Cruz, résolut de s'emparer de sa personne; il s'agit de le surprendre pendant son sommeil. Le lendemain, à cinq heures du matin, le prince descend dans sa chaloupe et se fait accompagner d'une embarcation. Vera-Cruz n'est pas encore rendue.
Par ce hasard providentiel, dont nous avons parlé, au lieu de cette atmosphère toujours pure et limpide, de ce ciel toujours bleu qui couvre la ville et la rade, ce matin-là, comme par miracle, la rade et la ville sont enveloppées d'une brume épaisse, opaque, et, armé à la pointe du môle, le prince est forcé d'attendre quelques minutes l'embarcation qui l'accompagne et qui s'est égarée au milieu du brouillard. Cette embarcation porte les pétards nécessaires pour faire sauter les portes, les clous pour enclouer les canons. La maison de Santa-Anna est entourée, forcée; mais ces quelques minutes de retard l'ont sauvé, son lit est encore chaud, et Arista, son fidèle Arista, surpris seul, a l'honneur de remettre son épée au prince français.
Le prince se retire en bon ordre. Les embarcations sont déjà chargées de monde, quand une des portes qui donnent sur le môle s'ouvre, et un officier-général s'y laisse voir à moitié, une jambe en avant, l'épée à la main. Au même instant, sur l'extrémité de la jetée, une mèche allumée fume à côté d'une caronade dont la bouche laisse voir des grappes de mitraille. Pour faire à l'ennemi un dernier adieu, un marin approche la mèche, le coup part, et Santa-Anna tombe à la tête des siens, la jambe droite emportée au-dessous du genou, et la main qui tenait l'épée mutilée par un biscaïen.
Depuis ce temps, il jette sur sa jambe amputée de douloureux regards; mais depuis lors aussi il a reconquis la présidence, la présidence s'est changée pour lui en une dictature pleine et entière dont le temps n'est pas borné, dont la puissance n'est pas limitée; et qui sait en quoi se changera cette dictature? Tout ploie devant lui, lui seul est puissant, taxe les impôts, et, dans le cours de cette année 1843, il en a institué un direct: c'est celui d'une loterie dont les billets coûtent fort cher; chaque riche particulier reçoit l'ordre d'en prendre un certain nombre. Les lots gagnants sont nombreux, les sommes promises séduisantes, mais, hélas! les bons billets sortent rarement, et ils n'en valent alors guère mieux, car l'impitoyable loterie ne paie jamais.
Le désintéressement jusqu'alors héroïque, nous devons le dire, de Santa-Anna, a été remplacé par l'avidité de s'enrichir. Manga de Clavo est devenu le centre de vastes propriétés qui embrassent une partie de l'État de Vera-Cruz, et un chemin de fer, entrepris par ses ordres, doit les traverser et doubler sa fortune privée, tout en servant à l'utilité publique.
............................................................. Nous avons essayé de dépeindre Santa-Anna tel que nous l'avons connu ou que les récits de ses lieutenants et de ses généraux nous l'ont l'ait connaître, et nous avons omis bien des faits dans notre récit; maintenant, qui peut savoir le secret de cette âme blasée, mélancolique, inquiète? Son insatiable ambition est-elle enfin assouvie? Ou ne peut révoquer en doute, chez lui, des talents extraordinaires, une promptitude de décision admirable, une imperturbable audace, une connaissance approfondie du caractère de ses compatriotes; mais, à tout prendre, s'il paraît dans le prisme de l'éloignement comme un géant, c'est grâce aux pygmées dont il est entouré, et qu'il dépasse de toute sa hauteur.
Nouvelles inventions.
CHEMIN DE FER ATMOSPHÉRIQUE.
L'attention des ingénieurs et de tous ceux qui s'occupent de la construction et de l'exploitation des chemins de fer, soit au point de vue pratique, soit au point de vue théorique, est vivement excitée en ce moment par les essais, qui vont avoir lieu en Irlande, d'un nouveau système de locomotion rapide, dans lequel le moteur ne sera plus la vapeur, mais simplement la pression atmosphérique.

Fig. 1.--Élévation d'un convoi en marche sur un chemin de
fer atmosphérique.
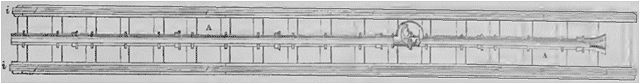
Fig. 2.--Plan du chemin de fer atmosphérique et vue de la
soupape d'entrée f.
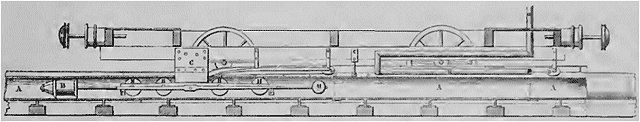
Fig. 3.--Coupe longitudinale suivant l'axe du tube de
propulsion.
Le public lui-même, préoccupé de la gravité des accidents auxquels a donné lieu jusqu'à ce jour le mode de remorquage des convois par la locomotive, désire vivement que la science puisse substituer à ce moteur un moteur plus sûr et tout aussi rapide; car, il faut bien le dire, à quelque degré de perfection qu'on pousse la construction de la locomotive, et quelque prudence qu'on apporte à la conduite d'un convoi, on aura toujours à redouter certains accidents que rien ne peut faire prévoir, et dont on ne peut amortir les funestes effets que dans un cercle assez restreint. D'un autre côté, la rapidité de locomotion due à ces nouvelles voies de communication commence à si bien entrer dans nos moeurs et dans les besoins industriels et commerciaux du pays, qu'on ne pourrait plus y renoncer, dût le danger être mille fois plus grand. Tous les efforts ont donc dû tendre vers l'amélioration du pouvoir moteur, et, dans la persuasion où sont les ingénieurs que la locomotive la plus perfectionnée sera encore une machine imparfaite, on a cherché ailleurs la puissance nécessaire pour mouvoir d'énormes masses avec une vitesse considérable.
Cette puissance, qu'on n'avait pas encore songé à appliquer directement à la locomotion, entre cependant dans tous les calculs des différentes espèces de moteurs employés jusqu'à ce jour; mais on n'en tient compte dans ces calculs que comme d'une puissance qu'il faut vaincre et détruire, et les machines reçoivent toujours un supplément de force destinée à contre-balancer la pression atmosphérique. Aujourd'hui, au lieu de la détruire, on l'emploie. Le moteur, c'est cet élément (pour nous servir de l'appellation en usage, quand les chimistes ne connaissaient que quatre éléments, qui, aujourd'hui, n'en sont même plus), c'est cet élément au milieu duquel nous vivons, nous marchons, et qui est répandu partout, si bien que nulle part n'existe le vide; c'est cette pression tellement puissante qu'elle fait équilibre à une colonne d'eau de 32 pieds, on de 10m 40 de hauteur.
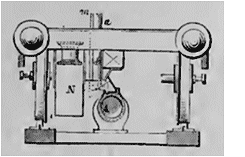
Fig. 4.--Coupe perpendiculaire au
tube et vue de face du chariot après
le passage du piston voyageur.
Déjà, en 1821, un inventeur anglais nommé Vallance, frappé de l'imperfection de la locomotive, qui n'était pas arrivée au degré de force qu'elle possède aujourd'hui, avait proposé de se servir de la pression atmosphérique, pour mouvoir les convois. Il imaginait, pour y arriver, de construire des cylindres en fonte assez larges pour recevoir à leur intérieur les voitures de passagers et le chemin de fer qui les portait. On conçoit tout le ridicule de ce projet, qui prouvait seulement toute la confiance qu'inspirait à l'auteur la puissance de la pression atmosphérique.
Cette idée fermenta cependant, et quelques personnes, parmi lesquelles nous citerons M. Pinkus, s'occupèrent du mode de propulsion atmosphérique, et proposèrent des systèmes de soupapes plus ou moins ingénieuses; mais c'est seulement entre les mains de MM. Clegg et Samuda frères que cette invention a revêtu le caractère pratique qui la recommande aujourd'hui, et a fait naître le système dont nous allons donner la description.

Fig. 5.--Détails d'assemblage de la soupape
longitudinale G avec le tube de propulsion.
Dans ce nouveau système, la voie est composée, comme dans les chemins de fer ordinaires, de deux rails réunis de distance en distance par des traverses. Au milieu de cette voie, et à égale distance des rails, se trouve un tube A (Fig. 1, 2 et 3), qui offre dans le sens de sa longueur, et à sa partie supérieure, une ouverture assez large pour donner passage à une tige métallique verticale C (fig. 3). C'est à cette tige métallique, à laquelle on peut à volonté attacher les voilures qui sont sur les rails, qu'est lié invariablement le système de propulsion, c'est-à-dire le piston.
Pour bien comprendre le jeu de ce mécanisme, supposons, pour un instant, que l'ouverture longitudinale on tube A, qui sert à donner passage à la tige métallique, soit hermétiquement fermé, et qu'une machine pneumatique, située à son extrémité, aspire l'air qu'il contient, un vide plus ou moins parfait s'établira, et si l'on présente à l'orifice du tube un piston, ce piston, soumis à la pression atmosphérique par une de ses faces, s'avancera dans le tube, où on a fait le vide, en vertu de la différence de pression entre l'air extérieur et l'air qui est encore dans le tube, et la marche de ce piston ou sa vitesse sera d'aillant plus grande que le vide du tube sera plus parfait. De plus, en vertu de l'impulsion que lui donne la pression atmosphérique, il pourra entraîner, après lui, un poids plus ou moins considérable.
La difficulté, à vaincre consistait donc ici dans le mode d'attache du poids à remorquer avec le piston voyageur, et surtout dans le système à employer pour que le piston communiquât de l'intérieur du tube le mouvement à la masse extérieure, sans cesser d'être soumis à la pression atmosphérique et sans que le vide diminuât sur sa face antérieure.
A la tige métallique C (fig. 3) est lié un châssis dont la longueur peut varier, et qui porte à une de ses extrémités le piston voyageur B, et à l'autre un contrepoids M, destiné à équilibrer le piston. Ce châssis supporte également quatre galets II, II, II, II, destinés à soulever la soupape longitudinale après le passage du piston, pour permettre à la tige métallique de passer. En arrière de cette tige sont deux autres galets D, D, inclinés à l'horizon, qui soulèvent la couverture I destinée à abriter la soupape contre les intempéries de l'air. Cette couverture I est formée de plaques minces en tôle de 1m 50 à 2m de longueur, formant ressort au moyen d'une bande de cuir. L'extrémité de chaque lame passe sous la suivante dans la direction du mouvement du piston, assurant ainsi le mouvement de chacune successivement.
On peut voir déjà, d'après ce qui précède, toute la manoeuvre de ce nouveau système. Nous allons la restituer en peu de mots, au moyen de la seule fig. 3. Le vide est fait dans le tube A; la pression atmosphérique agissant sur la face postérieure du piston B, le met en mouvement; dés qu'il est passé, les galets II soulèvent la soupape longitudinale et livrent passage à la tige métallique qui lie le convoi au piston. Les lames dont se compose la couverture I se sont déjà levées successivement, comme nous venons de le dire, avant le passage de la tige métallique, et elles sont soutenues par les galets D, pendant que la soupape longitudinale retombe et qu'un tube N, rempli de charbons incandescents, contribue à la fermer hermétiquement en liquidant une matière composée de cire et de suif qui en assure l'adhérence parfaite.
La fig. 4 montre une coupe du tube A, après le passage de la tige métallique et en élévation l'appareil complet destiné à fermer la soupape longitudinale.
Nous donnons (fig. 5) une section transversale du tube avant l'arrivée du piston voyageur. Cette figure permet de bien saisir le mode d'établissement de la soupape et la manière dont elle agit.

Fig. 6.--Section transversale dans le tube
après le passage de la tige métallique..
Le tube porte une côte ou un talon ce qui est fondu et fait corps avec lui. Le cuir de la soupape G étant mis en place, on l'assujettit au moyen de la barre de fer a, que l'on recouvre avec la plaque métallique a'; on serre alors fortement a' sur a et sur e, au moyen de l'écrou en équerre b; puis, au moyen d'un second écrou ce, on règle invariablement l'écartement de a et de c. La bande de cuir G est serrée entre deux plaques de tôle découpées par morceaux juxtaposés. La plaque supérieure est plus large que l'ouverture longitudinale, et a pour but d'empêcher que l'air extérieur n'enfonce la bande de cuir dans le tube quand le vide s'opère; la plaque inférieure remplit la rainure lorsque la soupape est fermée, et en terminant ainsi le cylindre dans sa partie supérieure, empêche que l'air ne dépasse le piston.
La figure 6 représente une section transversale du tube de propulsion dans un point où la soupape longitudinale est fermée et immédiatement après le passage de la tige de propulsion; R représente le rouleau qui marche en avant du tube N, et qui ferme la soupape après le passage de la tige. N est le tube rempli de charbons incandescents destinés à fondre la composition de cire et de suif placée en F (fig. 5); I est la couverture soulevée; M M est le manchon d'assemblage des deux tubes consécutifs, oo les oreilles au moyen desquelles le tube est fixé sur les traverses de la voie.
La figure 7 représente la coupe transversale du tube au moment du passage de la tige verticale C. On voit quelle est la forme donnée à cette tige. V est le système d'attache de la tige au chariot de tête; p p sont les plaques de fer qui lient ensemble le piston, la tige et le contrepoids, et qui soutiennent les galets H H.
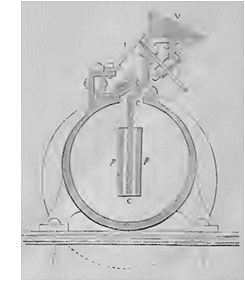
Fig. 7--Section transversale
dans le tube pendant le passage
de la tige métallique.
Une seule chose nous reste à expliquer, c'est comment le piston peut s'insérer dans le tube de propulsion, sans permettre à l'air extérieur d'entrer en même temps que lui, et comment il peut quitter le tube et le refermer après en être sorti. Les méthodes employées pour parvenir à ces deux résultats ne sont pas les parties les moins ingénieuses du système que nous examinons.
Le tube (fig. 2) est terminé en entonnoir, et à quelque distance de son extrémité se trouve une soupape f. A cet endroit et sur le côté est un espace demi-circulaire qui renferme une autre soupape plus grande que f, et reliée à la première au moyen d'une branche recourbée: ce système peut tourner autour d'une charnière. Quand on fait le vide, la soupape f est pressée sur une de ses faces par la pression atmosphérique qui tend à l'ouvrir, mais elle est retenue par l'autre soupape qui, étant plus grande qu'elle, oppose à l'ouverture une résistance proportionnelle à sa surface. Sur le haut de l'espace demi-circulaire, on pratique deux trous, un de chaque côté de la plus grande des deux soupapes: ces deux trous peuvent être couverts par une boîte à coulisse. Pendant que le vide s'opère, ou ne couvre qu'un des trous, qui est ainsi en communication avec la partie où s'opère le vide, et l'autre reste ouvert à l'air extérieur. Mais, quand le convoi s'avance, il pousse la boîte à coulisse qui, recouvrant alors les deux trous, les met en communication, la pression sur la grande soupape diminue, puisque ses deux faces sont maintenant en communication avec la partie où l'on a opéré le vide, et la soupape f, soumise maintenant à une pression prépondérante, peut tourner autour de son axe et donner passage au piston.
Pour la sortie, la manoeuvre est plus simple encore; le tuyau d'aspiration qui communique avec la machine pneumatique s'embranche sur le tube de propulsion à 4 ou 5 mètres de l'extrémité de ce tube, en sorte que, dès que le piston a dépassé le point d'embranchement, il accumule l'air qui se trouve à l'extrémité du tube et qui, pressant sur la soupape, la force à s'ouvrir en tournant autour d'une simple charnière; elle tombe sur un levier à deux branches, dont l'une, choquée aussitôt après la sortie du piston par une tige attenante au convoi, relève la soupape et l'applique de nouveau contre le tube, où elle est maintenue par la raréfaction de l'air, qu'on recommence immédiatement.
Le piston est un simple rouleau de fonte d'un diamètre inférieur à celui du tube, armé à ses deux extrémités d'une mâchoire pinçant une lame de cuir: il est placé à 1m 40 en avant de la tige de connexion. Le piston est donc flexible; la pression de l'air qui s'exerce sur lui force les lames de cuir dont il se compose à s'appliquer exactement sur les parois du tube, rend le contact partait, quelles que soient les défectuosités de forme de ce tube, et prévient la rentrée de l'air.
On conçoit très-bien que si le tube était aussi hermétiquement fermé que nous l'avons supposé, si l'air ne pouvait s'introduire en avant du piston ni par les interstices de la soupape longitudinale ni par ceux des lames de cuir du piston, une seule machine à vapeur suffirait pour faire un vide parfait sur une longueur de tube illimitée, et même que, dès que le piston aurait commencé son voyage, cette machine devrait rester en repos; mais il n'en est pas ainsi dans la pratique: à chaque instant l'air extérieur doit trouver et trouve, en effet, des interstices par lesquels il rentre. L'action de l'appareil pneumatique doit donc à la fois contre-balancer l'effet de ces prises d'air et enlever successivement l'air primitivement contenu dans le tube pour produire le mouvement. Une même machine ne peut donc desservir qu'une longueur de tube limitée.
Du reste, ce projet n'est pas à l'état d'utopie; il est en exécution depuis plusieurs années.
Tout l'appareil que nous venons de décrire marche régulièrement, non pas sur un modèle en petit (depuis longtemps on sait que ces modèles, exécutés avec une précision mathématique et entretenus avec soin, ne prouvent rien et induisent même en erreur sur les résultats de l'application en grand), mais sur un chemin de fer de dimensions ordinaires de 800 mètres de longueur, qui, depuis quatre ans, sert à toutes les expériences qu'a suggérées aux ingénieurs le désir d'étudier sous toutes ses faces ce nouveau système. Il est établi à Wormwood-Scrubs près de Londres, et on atteint régulièrement des vitesses de 36 kilomètres à l'heure avec une charge de 15 tonnes, dans une partie de railway en courbe de 1,000 mètres de rayon et sur une pente ascendante de 8 millimètres et demi. La machine à vapeur qui met en mouvement l'appareil pneumatique a une force de 16 chevaux-vapeur, mais ne déploie ordinairement que les deux tiers ou les trois quarts de cette puissance. Le tube a un diamètre de 22 cent. 85.
Quand on veut faire fonctionner l'appareil, on laisse descendre le chariot par l'action de la gravité: pour cette manoeuvre, la tige, métallique et le châssis armé du piston, du contrepoids et des galets, qui peuvent se déplacer horizontalement, sont en dehors du tube; quand le chariot est en bas et attaché au train, l'appareil pneumatique se met en mouvement et en une minute et demie opère le vide convenable; on insère alors le piston dans le tube, on ouvre la soupape d'entrée, et la voiture se met en mouvement et augmente progressivement de vitesse jusqu'à ce qu'elle atteigne une rapidité de marche maximum qui se produit environ aux deux tiers du parcours. Si l'un veut s'arrêter en un point quelconque, il suffit de serrer les freins; le conducteur du convoi a de plus à sa disposition une soupape, et peut, en la soulevant, laisser passer l'air extérieur à travers le piston, ce qui diminue immédiatement le vide.
Il est évident que la force de l'appareil pneumatique et de la machine à vapeur qui le fait agir doivent avoir, avec la longueur et le diamètre du tube de propulsion ainsi qu'avec la vitesse que l'on veut obtenir, un rapport que le calcul peut indiquer. Plus le tube de propulsion est long, plus la rentrée d'air par la soupape longitudinale est importante; on trouve que le nombre de coups de piston nécessaires pour enlever cet air est le tiers du nombre total des coups nécessaires pour faire un vide convenable. Il parait certain qu'une machine de cinquante chevaux-vapeur serait plus que suffisante pour opérer et maintenir le vide dans un tube de 8 kilomètres de longueur. (Les lecteurs de l'Illustration comprendront que nous ne pouvons entrer ici dans tous les calculs relatifs aux propriétés de cet appareil ingénieux, et que nous devons nous borner à indiquer des résultats.)
La pression atmosphérique a, dans l'appareil, à vaincre des frottements considérables qui diminuent d'autant son effet utile; ainsi le frottement du piston absorbe 5 pour 100 de la force motrice, le soulèvement de la soupape longitudinale et sa compression 6 pour 100 environ, et la couverture 4 pour 100, quantité énorme quand on songe à l'utilité restreinte de ce dernier appareil.
M. Teisserene, qui avait reçu de M. le ministre des Travaux publics la mission d'aller étudier l'appareil atmosphérique sur les lieux, et dont le rapport nous a été fort utile pour la description que nous venons de faire, s'est livré à une série d'expériences sur ce chemin de fer, desquelles il a déduit certains principes assez curieux.
Ainsi, 1° il y a économie relative à employer des tuyaux de plus grand diamètre; 2° sur les grandes longueurs, le travail est d'autant plus économique qu'il s'effectue sous de moindres pressions; mais alors, pour arriver à des vitesses égales, le tube doit avoir un diamètre plus grand.
Il nous reste maintenant à comparer ce système à celui des locomotives, et nous avouons que nous craignons qu'on ne nous accuse d'engouement pour la chose nouvelle, si nous disons qu'il nous paraît supérieur à ce dernier sous le triple point de vue des dépenses de construction et d'exploitation, de la vitesse et de la sécurité.
Pour la construction, on peut aborder des pentes infranchissables aux locomotives, et pour ainsi dire aux voitures tirées par des chevaux; les courbes à petit rayon n'ont plus d'importance, l'absence de locomotive permet de diminuer le poids des rails, la hauteur des tunnels, la solidité des ponts et viaducs. On peut se borner à une seule voie sans que le service en souffre, puisqu'il n'y a pas de collision possible, un piston ne recevant de l'impulsion par l'air extérieur que si le vide existe devant lui, et ce vide n'existant plus dès qu'un autre piston voyage déjà dans le tube. Il y a donc économie sur tous ces objets; le pouvoir moteur seul est plus cher. En effet, on calcule que, pour assurer un bon service sur nos chemins de fer, il faut par kilomètre un tiers de locomotive, ou 15,000 francs environ, tandis que, sur le chemin atmosphérique, l'appareil complet, tube et machine, est évalué à 100,000 francs. Malgré le prix plus élevé du pouvoir moteur, il y aura cependant une économie considérable dont les détails ne peuvent pas entrer dans cet article, mais que nous ne craignons pas de perler à 50 pour 100.
Pour les dépenses d'exploitation, les frais généraux restant les mêmes dans les deux systèmes, les frais variables seront bien moindres dans le système atmosphérique; en effet, les dépenses de combustible et de réparation des locomotives varient proportionnellement aux distances parcourues; les mêmes frais avec les machines fixes ne dépendent que du temps pendant lequel l'appareil est chauffé, et ils décroissent relativement avec la quantité d'ouvrage effectuée dans ce temps.
La vitesse peut être indéfiniment augmentée avec le diamètre du cylindre de la pompe pneumatique. Pour les locomotives, on ne peut dépasser certaines vitesses; à 80 kilomètres à l'heure, ces machines ne peuvent plus remorquer aucune charge.
Enfin, au point de vue de la sécurité, outre que les collisions, comme nous l'avons dit, sont impossibles, le convoi ne peut pas dérailler, le piston le maintient toujours sur la voie; la rupture des essieux de locomotives, qui est la source de tant de graves accidents, disparaît. Le chemin pouvant se modeler sur le terrain et aborder les pentes naturelles du sol, ou n'a plus à craindre les éboulements des grandes tranchées; l'incendie, les scènes affreuses du 8 mai sur la rive gauche ne peuvent plus se présenter dans ce système.
Les ingénieurs anglais qui, s'ils ont de la persévérance à poursuivre une idée quand ils la trouvent bonne, sont toujours en défiance contre les nouveautés quand il s'agit de les mettre en pratique, ont visité avec un puissant intérêt le railway atmosphérique de Wormwood-Scrubs, et attendent le résultat de l'épreuve qu'on va tenter en Irlande sur le chemin de Dublin à Dalkey, entre Kingstown et Dalkey, sur une longueur de 2,722 mètres. MM. Clegg et Samuda établissent en ce point une machine de la force de 100 chevaux; ils ont adopté cette puissante machine, parce que, si le succès est complet, on étendra le tube jusqu'à Dublin d'une part, et la longueur desservie par la machine serait de 12 kilomètres et demi, et jusqu'à Bray de l'autre, et cette machine desservirait alors 22 kilomètres.
On conçoit quel intérêt s'attache à ces essais, qui, s'ils réussissent, renverseront complètement le système actuel. Quant à nous, nous ne formons qu'un voeu: c'est que le gouvernement, engagé par la loi du 11 juin 1842 dans les dépenses considérables d'exécution du grand réseau des chemins de fer, concentre son attention sur les essais du chemin de Kingstown à Dalkey, fasse suivre les expériences par une commission expérimentée; et si le système atmosphérique présente tous les avantages que nous avons signalés, son devoir et son intérêt seront d'entrer franchement dans cette nouvelle voie, qui épargnera à la France, déjà obérée, des dépenses si peu en rapport avec l'état actuel de ses finances.
Moeurs parisiennes.
CE QU'IL Y A DANS UNE GOUTTE D'HUILE.
L'infortuné dandy dont nous avons raconté les succès et les revers sous ce titre: L'Habit et le Moine, le pseudo-lion Roger de Cancale, jeune employé au Mont-de-Piété, qui veut trancher, comme quelques-uns de nos lecteurs s'en souviennent peut-être, du millionnaire et du marquis, eut un jour une de ces heureuses chances qui ne se présentent, dit-on, qu'une seule fois dans la vie d'un homme. Il faillit réaliser la chimère, le rêve de son existence tout entière, devenir ce que, depuis dix ans, il s'efforce si laborieusement de paraître, c'est-à-dire posséder des rentes, de vrais chevaux, un hôtel non imaginaire, des laquais poudrés et galonnés, des châteaux, des parcs, des métairies et une loge à l'Opéra. Toutes ces splendeurs brillèrent un instant à ses yeux, et puis s'évanouirent sans retour. Tant d'opulence tint pour lui à un fil, ou pour mieux dire à une... mais n'anticipons pas sur les événements.
Vous saurez donc que notre vicomte avait eu naguère l'heur extrême de séduire une riche veuve, la charmante baronne Dorliska de la Fenouillère, qui, avec son coeur et sa main, devait lui apporter une dot de cinquante mille écus de rente amassés par le défunt baron, munitionnaire sous l'Empire, et transformé en gentilhomme sous le règne de la branche aînée, moyennant une somme ronde de dix mille francs, qui était alors le prix-courant des lettres de noblesse. D'ailleurs, comme le disait le financier Zamet, l'ami de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, l'homme qui est seigneur de trois millions ne saurait être un roturier.--Comment Cancale s'y était pris pour opérer cette conquête, nous ne saurions trop vous le dire: mille causes avaient concouru à ce capital résultat. Le noeud gordien de sa cravate y était certainement pour quelque chose. Les bottes vernies dans lesquelles se mirait ce nouveau Narcisse pouvaient aussi revendiquer une part dans ce brillant succès. Son gilet extravagant ne pouvait manquer de charmer la plus folle de toutes les baronnes. Son aplomb, sa fatuité, l'assurance avec laquelle il parlait de ses terres, de ses gens et de ses poneys, les quelques relations aristocratiques sous le protectorat desquelles il avait soin de se produire, n'avaient pas moins contribué à fasciner cette dernière, dont le coeur ressemblait beaucoup à la noblesse, c'est-à-dire qu'il n'était pas de roche. Bref, dans le tourbillon d'une valse à deux temps exécutée l'hiver dernier au bal de M. de Rambuteau, le vicomte, qui était de première force à cet exercice gymnastique cher à la nouvelle jeunesse dorée, avait osé risquer une déclaration en forme que sa Françoise de Rimini, entraînée avec lui dans l'espace, avait accueillie en souriant. Au bout de la spirale, tout était dit: ils s'étaient avoué leur mutuel amour. On va si vite quand on valse!
Au samedi suivant, on donna libre cours à de timides souhaits trop longtemps comprimés, et il fut convenu qu'on s'épouserait aussitôt le printemps venu. Le vicomte était trop habile pour se permettre de brûler du moindre feu illégitime.
Mais, hélas! au moment où luisait déjà pour lui le chaste flambeau de l'hyménée, un quinquet jaloux versa une larme, et cette larme (de combien d'autres pleurs ne devait-elle pas être suivie!) vint tomber juste sur le collet du futur époux de Dorliska.
Le lendemain, celui-ci, en passant d'un oeil plein de sollicitude l'inspection de sa chère toilette, complice de son glorieux succès, et comme il chantonnait dans ses dents le refrain du grand poète national:
Ah! mon habit, que je vous remercie!
il aperçut avec épouvante une odieuse tache qui se prélassait, s'épanouissait sur la cime de son elbeuf numéro un. En vain il regratta, frictionna, brossa la place où l'horrible stigmate avait fait élection de domicile, il ne réussit qu'a le rendre un peu plus visible à l'oeil nu. L'huile est de ces forbans avides qui n'abandonnent pas facilement leur proie, et c'était merveille de voir comme elle s'étendait à la ronde, imprégnant la trame moelleuse et rongeant de ses tons livides la fraîche teinte du tissu.
Or, Cancale devait, le jour même, faire sa cour à la baronne qui, la veille, en prenant congé de lui, avait languissamment laissé tomber de sa bouche cette suave parole: «A demain!» Manquer à cette invitation, à cet ordre, c'eût été se perdre, se suicider, matrimonialement parlant.
Dans son désespoir, le vicomte songea d'abord au dégraisseur; mais, outre que cet industriel vend ses services au poids de l'or (deux francs cinquante centimes, prix net d'une paire de gants blancs), il était trop tard pour qu'il pût recourir à son ministère. L'heure pressait. Le vicomte, en proie à de sombres réflexions, endossa machinalement son frac terni, prit son chapeau, et descendant les cinq étages qui conduisaient à sa mansarde de la rue Jean-Pain-Mollet, gagna le quai, dont il suivit mélancoliquement le trottoir, qu'ombragent de jeunes fagots d'épines décorés du nom de tilleuls par l'autorité municipale. Les mains dans ses poches, le nez au vent, il semblait chercher au ciel une inspiration et implorer la Providence.
Tout à coup cette dernière se manifesta à lui sous la forme d'un quidam, porteur d'un chapeau jadis blanc, penché comme la tour de Pise, d'une énorme paire de favoris, d'une cravate rouge et d'une ample redingote de castorine. Ce personnage, qui se tenait adossé au parapet sur lequel on voyait étalée près de lui une petite boîte de fer-blanc, bondit à l'aspect du vicomte, et s'élançant au-devant de lui:
«Dieu! la belle tache! s'écria-t-il; ah! monsieur, pour l'amour de l'art, souffrez qu'on vous en débarrasse!»
En même temps il saisit le collet de Cancale et commença à le frotter vigoureusement d'une sorte de substance bleuâtre qu'il tenait dans l'une de ses mains, et qui ressemblait à s'y méprendre à du savon dit de lessive.
Le vicomte ouvrit de grands yeux, et, tiré en sursaut de sa rêverie, crut voir un ange libérateur dans le rébarbatif Bohémien qui venait de lui barrer le passage.
«Qui donc êtes-vous? demanda-t-il.
--Qui je suis? répondit l'homme à la castorine; vous voyez devant vous, monsieur, l'inventeur breveté du célèbre savon oléagineux-végétal, le fruit de mes explorations dans toutes les parties du monde, y compris la Polynésie et l'archipel des îles Marquises. A l'aide de ce savon, monsieur, composé de simples recueillies sur les plus hautes montagnes du globe, j'enlève toutes les taches qui veulent bien m'honorer de leur confiance. Il n'est pas d'habit si graisseux, de paletot si maculé, d'étoffe généralement quelconque si outrageusement souillée, que je ne rende en peu de minutes propre, nette, resplendissante comme une pièce de six liards; et tout cela, monsieur, tout cela pour la modique bagatelle de dix centimes, deux sous, vieux style!»
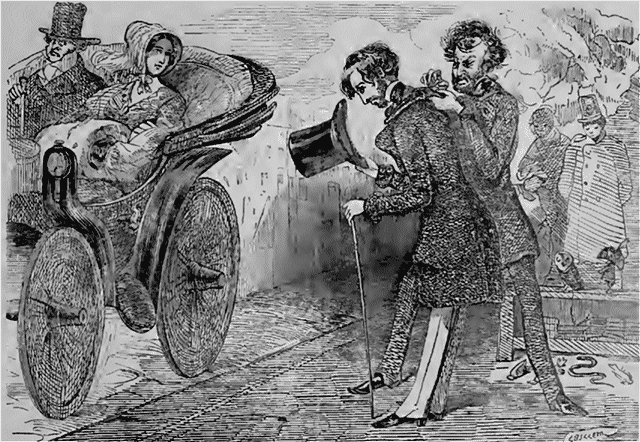
En prononçant ces mots, l'industriel en plein vent, dont la propre redingote témoignait par écrit du cas qu'il faisait de son savon, substance si précieuse à ses yeux qu'il n'osait s'en servir pour lui-même; l'industriel, dis-je, continuait d'empâter avec une ardeur sans pareille le collet du vicomte. Séduit par l'éloquente tirade ci-dessus, celui-ci le laissait faire et attendait avec confiance le résultat de l'opération.
En ce moment fatal, le bruit d'une voiture se fit entendre. Une brillante calèche, traînée par deux chevaux dépareillés, s'avançait au milieu de la chaussée. Cancale y jeta les yeux et reconnut..... quel coup de théâtre! j'en frémis encore quand j'y pense... dans la belle dame assise au fond de l'équipage, la prétendue, la divine baronne Dorliska de la Genouillère. Quel génie, malfaisant, quel démon vomi par l'enfer, pouvait l'attirer à cette heure sur l'excentrique et antifashionable quai désigné sous le nom de Pelletier? Pénètre qui pourra le mystère! Ce qu'il y a de certain, c'est que Cancale, médusé à l'aspect de son amante, perdit, en cet instant critique, toute présence d'esprit au point de la saluer gauchement, se coupant ainsi toute retraite, toute dénégation ultérieure, et constatant lui-même sa triste, sa déplorable identité. Le vertige qui parfois nous saisit aux heures de péril extrême peut seul expliquer cette lourde, cette inqualifiable aberration.
La baronne, qui jusqu'à ce moment n'avait point aperçu Cancale, devint pourpre de confusion et de colère en reconnaissant, dans le cavalier qui lui tirait son chapeau si maladroitement, le radieux vicomte aux prises avec l'industriel à la mine équivoque que nous venons de vous dépeindre. Elle s'agita convulsivement sur son siège en se mordant les lèvres, donna ordre à son cocher de fouetter, et s'éloigna emportée par ses rapides normands, non sans avoir lancé au malheureux dandy un regard de mépris souverain et de foudroyante ironie.
Atterré, écrasé, stupéfié, celui-ci sentit une sueur froide lui ruisseler par tout le corps. La bouche béante, le jarret tendu, l'oeil instinctivement fixé sur la calèche qui s'enfuyait, emportant tous ses rêves dorés, il demeura immobile, sans haleine, sans voix, comme s'il eût éprouvé soudain le sort de la trop curieuse femme de Loth.
L'inventeur breveté du célèbre savon oléagineux-végétal le tira de sa léthargie en lui disant:
«C'est fait, bourgeois! vous voilà maintenant propre comme cinq sous. C'est dix centimes que vous me devez pour vous avoir enlevé votre tache...
--Misérable! mais ce n'est pas ma tache, c'est ma maîtresse que tu m'as enlevée! s'écria d'une voix de tonnerre le malheureux vicomte, rappelé par cette interpellation au triste sentiment de l'horrible réalité.
--Qu'est-ce qu'il me chante donc là, ce moderne? reprit l'homme à la cravate rouge; est-ce que je ne vous ai pas dégraissé, par hasard? mes deux ronds tout de suite, ou sinon...»
L'infortuné Cancale paya et s'éloigna la mort dans l'âme, conservant, toutefois, encore une parcelle de ce vague espoir qui n'abandonne jamais l'homme au milieu des plus grands revers.
Cette dernière planche de salut ne tarda pas à lui manquer. Le soir même, il reçut par la poste, à son domicile d'emprunt, une petite lettre ainsi conçue:
«Monsieur,
«Il est inutile de vous présenter chez moi, comme vous aviez dessein de le faire. Je ne pourrais jamais m'attacher à un homme qui se fait détacher dans la rue.
«Signé baronne D.... de la F..........»
Toute brève qu'elle fût, cette épître renfermait deux inexactitudes que notre qualité d'historien nous fait un devoir de relever. D'abord, ce n'était pas dans la rue, mais sur le quai que le malencontreux dandy avait été pris en flagrant délit de contrebande lionine; ensuite, il ne s'était nullement fait détacher, comme le supposait la baronne; car, dès le lendemain, la tache reparut plus florissante que jamais. Depuis ce jour elle a résisté à l'emploi de tous les caustiques et n'a cessé de progresser; si bien que le vicomte peut parodier le mot de ce François Ier sous lequel ses aïeux combattirent, dit-il, à la bataille de Pavie, et s'écrier, avec beaucoup d'à-propos et de vérité, que «tout est perdu, fors la tache.»
Camps d'Instruction.
CAMP DE LYON.--CAMP DE BRETAGNE.
L'utilité des camps d'instruction pendant la paix ne saurait être révoquée en doute; ce sont les meilleures écoles pour les soldats connue pour les généraux. Là, les uns se préparent à l'exécution simultanée de tout ce qui se pratique en campagne, par des évolutions semblables à celles que nécessite la guerre; les autres apprennent à manier un grand nombre de troupes sur toutes sortes de terrains, et se familiarisent ainsi avec le jeu des divers corps; tous contractent les habitudes de la vie militaire, et le concours des différentes armes, dans les opérations d'une guerre simulée, donne à chacune des idées justes sur la part qu'y prennent toutes les autres.
Dans l'histoire des institutions militaires de la France, le plus ancien camp d'exercice parait remonter au règne de Louis XI. Commines rapporte que ce monarque, sur la fin de son règne, forma à Pont-de-l'Arche, en Normandie, un camp de ce genre où plus de 20,000 hommes furent réunis pendant plusieurs années. Il se composait de 10,000 Français, 10,000 Suisses et 2,000 pionniers.
De cette époque, il faut venir jusqu'à Louis XIV pour en trouver un semblable. Comme, d'ailleurs, l'armée française ne manquait pas alors de généraux expérimentés, et que la fréquence des guerres tenait les troupes en haleine, ce n'est que lorsque ce roi voulut initier son fils, le duc de Bourgogne, au commandement, qu'il forma à Mouchy, près de Compiègne, en 1698, un camp de 52 bataillons, de 152 escadron» et de 15 bouches à feu. Les troupes, au nombre d'environ 70,000 hommes, exécutèrent, sous les yeux de Louis XIV, toutes les opérations d'une campagne.
Louis XV, pendant les premières années de son règne, ne songea pas d'abord à former des camps. Dans un intervalle de vingt-trois ans, il n'en avait été ordonné qu'un, en 1727, de 20 bataillons et de 20 escadrons; plus, trois petits de cavalerie en 1730, sur la Sambre, la Meuse et la Sarre; enfin, un cinquième des bataillons d'infanterie ne formant pas 5,000 hommes, et d'un bataillon de royal-artillerie, avec 40 pièces de divers calibres et 20 mortiers. On s'y occupa principalement de l'instruction de l'artillerie. Mais après la bataille de Fontenoy, la nécessité fut reconnue de faire faire aux généraux l'apprentissage du commandement, dans des camps installés en 1753, 1754 et 1755, en Alsace et en Lorraine. Les résultats de la guerre de Sept Ans forcèrent à refondre l'organisation de l'armée, et des inspections annuelles en furent passées, de 1764 à 1770, dans les camps de Compiègne et de Fontainebleau.
La position de Compiègne, au confluent de l'Aisne et de l'Oise, sa proximité de la capitale et la topographie de ses environs l'ont fait regarder depuis longtemps comme un lieu favorable à cette destination. Fontainebleau ne présente peut-être pas au même degré des avantages semblables; malgré le passage de la route de Paris à Bourges, le voisinage de celle de Paris à Orléans et la proximité de la Seine et de l'Essonne, les bois des environs se prêtent peu aux hypothèses militaires. Cependant le terrain est sablonneux et très-praticable à toutes les armes, quoique recouvert de genêts et de buissons; le soldat ne glisse pas en marchant sur une terre sablonneuse, et il use peu sa chaussure.
L'établissement des camps de plaisance, comme on les appelait, était, sous l'ancien régime, pour le plus grand nombre des généraux, une occasion d'afficher un luxe incompatible avec l'austérité de la vie militaire. Tel colonel qui, pour la première fois, paraissait à la tête de son régiment, dépensait dans cette circonstance, en quelques jours, deux ou trois années d'un immense revenu. Les intrigues de cour, les longs dîners, les soupers interminables, absorbaient presque tous les instants. L'intérieur des marquises (c'est sous ce nom qu'on désignait les tentes des généraux et des officiers supérieurs) offraient toutes les recherches de l'ameublement le plus élégant. Dans ces réunions on s'occupait de tout, excepté de l'art militaire; puis, après une semaine consacrée à ces occupations, les corps rentraient dans leurs garnisons respectives, sans avoir exécuté d'autres manoeuvres qu'une grande revue et un défilé général.
Ces camps néanmoins eurent parfois pour résultat d'éveiller dans l'armée le goût de l'étude, et si quelques tacticiens, proposant une expérience, une amélioration, furent d'abord traités de rêveurs, de novateurs, sans pouvoir se faire écouter, d'autres réussirent à faire discuter leurs théories. C'est principalement pour examiner celles sur l'ordre profond et l'ordre mince que fut institué, en 1778, le célèbre camp de Vaussieux. On y concentra, sous le commandement du maréchal prince de Broglie, 48 bataillons, 20 escadrons et 40 pièces de canon. En 1770, il y eut à Saint-Omer un nouveau camp de 21 bataillons et 10 encadrons. Depuis cette époque, on rassembla en Lorraine et en Alsace plusieurs autres camps. Les plus considérables furent ceux de Saint-Omer et de Frascati sous Metz, en 1788. Dans le premier, on réunit, sous les ordres du prince de Condé, 37 bataillons, 30 escadrons avec 20 bouches à feu. Le maréchal prince de Broglie commandait le second, fort de 31 bataillons, 62 escadrons et 45 pièces d'artillerie.
Pendant la première période de la révolution, il n'y eut, à proprement parler, pas de camp d'instruction; car ceux de Maulde, de Famas, de Maubeuge, de Vaux sous Sedan, de Fontoy, de Hesingen, de Saint-Laurent du Var, étaient des camps de guerre en face de l'ennemi; mais lorsque, après la paix de Lunéville, les armées victorieuses de la République rentrèrent en France, le premier consul Bonaparte sentit la nécessité de les faire camper, pour les assujettir à une discipline sévère et mettre de l'uniformité dans leur tenue et leur instruction. Ce fut alors qu'on vit se former les camps de Bruges, de Saint-Omer, de Boulogne, créés par une pensée politique non moins que militaire. Les vétérans de l'armée, commandés par des généraux de la plus haute distinction, furent là réunis sous les yeux de leur général et de leur empereur. Les grands simulacres de guerre, exécutés par eux, dépassèrent de beaucoup tout ce que l'Europe avait vu jusque-là. Toutes les idées connues y turent appliquées sur une échelle inusitée. La science des grandes manoeuvres vint s'ajouter à l'expérience de la guerre. Les divisions arrivèrent à mettre dans leurs mouvements une précision telle qu'auparavant on ne l'eût pas attendue d'un bataillon. La tenue, la discipline et l'instruction des troupes ne lassaient rien à désirer. «Que feriez-vous avec une semblable armée, dit un jour Napoléon au maréchal Soult, qui commandait le camp.--La conquête du monde, sire,» répondit le maréchal. La courte et mémorable campagne de 1805 justifia pleinement cette prévision.
La cérémonie de la distribution des croix de la Légion-d'Honneur se fit au camp de Boulogne, en grande pompe, le 10 août 1804. Quatre-vingt mille hommes assistèrent à cette solennité. Napoléon, entouré de ses frères, de ses maréchaux, de ses grands-officiers, prononça le serment de l'ordre: il fut répété par tous les récipiendaires, disposés en pelotons à la tête de chaque colonne. Après le serment, les décorations, portées dans des casques et sur des boucliers de l'armure de Duguesclin et de Bayard, furent distribuées aux légionnaires.
Le camp de Boulogne fit trembler l'Angleterre et prépara l'armée qui devait, en deux mois, conquérir l'Allemagne, s'emparer de Vienne, et détruire à Austerlitz les restes des armées de l'Autriche appuyées par celles de la Russie.
Sous la Restauration, des camps furent formés presque annuellement depuis 1826 à Saint-Omer et à Lunéville; il n'y a été, souvent réuni que des troupes d'une seule arme, comme au camp de Lunéville, destiné à la cavalerie. Le plus nombreux et le plus remarquable entre tous est celui de Saint-Omer, en 1827, dans lequel ont été exécutés, outre un simulacre de siège, les essais que demandait la rédaction de la nouvelle ordonnance sur les manoeuvres d'infanterie et de cavalerie.

Vue du camp de Plélan, près Rennes.
Les puissances étrangères réunissent aussi des camps de manoeuvres, et il ne se passe guère d'année que le quart ou le tiers de l'effectif des armées russe, autrichienne et prussienne n'y soit exercé. Les plus considérables ont été celui de Vérone, en 1834, qui comptait 60,000 hommes de toutes armes el plus de 100 bouches à feu; celui de Kapsdorf, où les 5e et 6e corps prussiens présentèrent une force de plus de 40,000 hommes et de 60 bouches à feu; celui de Kalish, en 1835, où manoeuvrèrent, sous les yeux de l'empereur de Russie et du roi de Prusse, des détachements combinés de troupes russes et prussiennes, au nombre de 60 bataillons, 67 escadrons, avec 136 bouches à feu; enfin celui de Wosnesensk, qui réunit, en 1837, 50 escadrons, 28 bataillons, 168 pièces de canon, indépendamment de 24 escadrons et 5 batteries de cantouistes.--Les troupes sardes ont un camp d'instruction à Ciriè, dix-neuf kilomètres nord-ouest de Turin; les troupes austro-italiennes en ont également un permanent, construit à Montechiaro, sur la route de Brescia à Mantoue, par le prince Eugène, quand il était vice-roi d'Italie. Napoléon, peu de jours après son couronnement à Milan, rassembla à Montechiaro, au mois de mai 1805, et fit manoeuvrer 35,000 hommes d'infanterie, 4,500 de cavalerie avec 10 batteries d'artillerie.
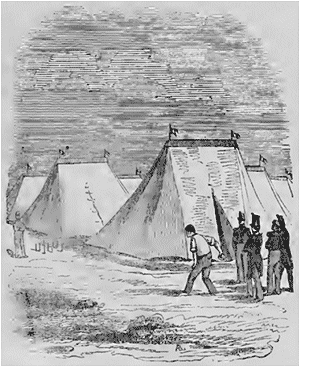
Tentes de soldats.
Depuis 1833, des camps d'instruction ont été presque annuellement Lunéville, Compiègne, Saint-Omer, Verdun, Fontainebleau, etc., sous les ordres, soit du duc d'Orléans, soit du duc de Nemours.
Les camps de Fontainebleau, en 1839, furent faites des expériences sur le service auquel on destinait le bataillon de tirailleurs; ces expériences satisfaisantes motivèrent la création de neuf autres: ces dix bataillons ont, depuis la mort du prince royal, reçu le nom de chasseurs d'Orléans.
En 1842, toutes les dispositions étaient prises pour la formation d'un camp d'opérations sur la Marne. Les officiers-généraux désignés pour les commandements étaient les suivants: commandant en chef, M. le duc d'Orléans; chef d'état-major-général, M. le maréchal-de-camp Anpick; infanterie, 3 divisions, MM. les lieutenants-généraux de Rumigny, d'Hautpoul, d'Houdelot; cavalerie commandée par M. le duc de Nemours, 3 divisions, MM. les lieutenants-généraux de Lawoestine, Oudinot, Dejean; artillerie, M. le maréchal-de-camp de Laplace; génie, M. le maréchal-de-camp de Bellonet; administration militaire, M. l'intendant militaire Evrard de Saint-Jean. Déjà les diverses brigades étaient toutes groupées sur les points de réunion qui leur avaient été assignés; le mouvement de concentration des troupes devait s'effectuer dans la première quinzaine d'août, quand la mort du duc d'Orléans, arrivée au moment même de son départ pour l'inspection des différents corps, fit contremander le rassemblement de troupes précédemment ordonné. Les travaux et manoeuvres ont continué séparément aux camps de Saint-Omer, Lunéville et autres lieux, sous le commandement supérieur du duc de Nemours.
Les camps d'instruction de 1843, sous le commandement en chef de M. le duc de Nemours, ayant pour chef d'état-major M. le colonel Perrot, sont composés ainsi qu'il suit:
Camp de Lyon:--M. le lieutenant-général baron de Lascours, commandant le camp; M. le colonel Dupouey, chef d'état-major.--Infanterie: Ire brigade, M. le maréchal-de-camp baron Anthoine de Saint-Joseph; 16e léger, 16e et 19e de ligne; 2e brigade, M. le maréchal-de-camp Loyré d'Arbouville; 20e léger, 34e et 51e de ligne.--Cavalerie: M. le maréchal-de-camp comte de Waldener de Freudenstein; une brigade, 12e chasseurs, 5e lanciers, 3e dragons.--Artillerie: état-major, une batterie montée du 11e régiment, une batterie à cheval du 14e régiment, une compagnie du 15e régiment d'artillerie pontonniers, une compagnie du 2e escadron du train des parcs d'artillerie.--Génie: une compagnie du 3e régiment.--Équipages militaires: un détachement.--Gendarmerie: un détachement.
Camp de Bretagne:--M. le lieutenant-général comte de Rumigny, commandant le camp; M. le lieutenant-colonel Teyssières, chef d'état-major.--Infanterie: 1re brigade, M. le maréchal-de-camp Boullé; 21e léger, 4e et 30e de ligne; 2e brigade, M, le maréchal-de-camp Noumayer; 59e, 60e et 75e de ligne.--Cavalerie: M. le maréchal-de-camp de Brémont; une brigade, 5e hussards, 8e chasseurs.--Artillerie:--2 batteries montées du 13e régiment.--Génie: une compagnie de sapeurs du 1er régiment.--Équipages militaires: un détachement.--Gendarmerie: un détachement.
Dans les deux camps, les régiments d'infanterie ont seulement 2 bataillons, et ceux de cavalerie 1 escadrons.
Les troupes d'infanterie du camp de Lyon, à Villeurbane, sont arrivées sur le terrain du 5 au 7 août; la cavalerie, du 8 au 10; l'artillerie, du 9 au 11. L'infanterie du camp de Bretagne est arrivée du 17 au 22 juillet; la cavalerie, les 24 et 25, et l'artillerie le 26.
La durée ordinaire des camps est de deux mois, et en général du 15 août au 15 octobre. Quelquefois le mauvais temps en fait avancer la dissolution.
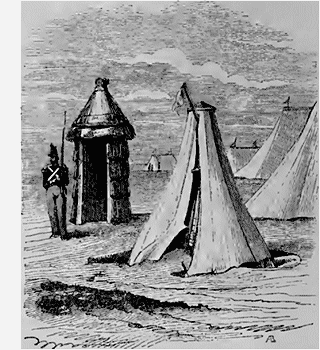
Manteau d'armes et guérite de paille.
Camp de Lyon.--Le gros de l'infanterie, composé de 5 régiments à 2 bataillons chacun, a dressé ses tentes à droite et à gauche de la route de Crémieux, en avant de Villeurbane et à 1,500 mètres de la nouvelle église. A gauche de la route, sont les 2 bataillons du 51e de ligne et la compagnie de sapeurs du génie; à droite sont rangés, sur des lignes parfaitement égales et parallèles, les bataillons des 54e de ligne, 20e léger, 19e et 16e de ligne. Les faisceaux sont formés du côté de l'est, et le parc d'artillerie, composé de 2 batteries, se trouve derrière le 54e de ligne. A 4 kilomètres du camp principal, sur la hauteur du Molard et à gauche de la route, le 16e léger a été installé comme camp avancé. La cavalerie, dragons, lanciers et chasseurs, est cantonnée à. Décince-Charpieux, dans les hameaux et les formes qui sont entre ce village et le camp principal. Le quartier-général est établi à 700 mètres en arrière du camp, sur la roule de Crémieux. Les steppes qui s'étendent le long du Rhône, sur la commune de Vaulx-En-Velin, serviront de champ de manoeuvres.
Les mesures prises par les autorités sont toutes appliquées au bien-être du soldat. Le gouvernement paie aux logeurs des cantonnements 15 cent, par homme, 5 cent, par attache de cheval. Les voituriers des environs ont quadruplé leurs voyages et leurs recettes. Les aubergistes, les jardiniers, les marchands de toute sorte, travaillent au delà de leurs espérances. Les officiers louent à un prix élevé les plus humbles chambres et paient assez cher leurs pensions.
Les distributions sont réglées avec exactitude. Les troupes du camp de Lyon, comme de celui de Plélan, ont droit à la fourniture du pain; elles recevront en sus, d'après une décision du ministre de la guerre, une ration de riz par homme et par jour; il pourra aussi leur être fait éventuellement des distributions de vin et d'eau-de-vie. Les indemnités extraordinaires de solde sont celles du pied de rassemblement.
Le camp avancé du Molar, formé par le 16e léger, est assis sur un plateau d'où l'oeil découvre une vue magnifique: le Mont-Blanc couvert de neige, les superbes plaines de la Bresse, les bois du Dauphiné, le Rhône et ses coteaux pittoresques, les marais impraticables, qu'on appelle dans le pays les marais tremblants, et les immenses pâturage qui serviront de champ de manoeuvres, les hauteurs de Fourvière, et cette admirable campagne couverte de maisons blanches.
A chaque pas, en avançant de Décine vers Villeurbane, on rencontre des cabarets ornés des enseignes les plus curieuses, des marchands en plein vent, des jongleurs, une masse pressée de promeneurs; bientôt on aperçoit les flammes et les pignons des tentes du quartier-général, puis leurs toiles blanches reflétant les rayons du soleil, et habillant en quelque sorte la ville militaire d'un vêtement de brocart d'or et d'argent.
Le dimanche surtout la scène s'anime, la foule des visiteurs augmente, la route est tellement embarrassée que les cavaliers envoyés en ordonnance ont grand'peine à s'y faire place. Tous ceux qui ont voiture à Lyon viennent voir le camp: les élégantes en calèche découverte, les jeunes gens à cheval, les modestes fortunes en carriole, les vrais flâneurs et les artisans à pied; c'est comme une promenade de Longchamp. Ce jour-là, les ouvriers ne dînent pas à Lyon mais au camp; les spectacles, de la ville sont abandonnés pour le camp. Là, en effet, se groupent les plaisirs citadins et champêtres; les jeux de quilles, les jeux de boules, les jeux de bagues sont en mouvement perpétuel; des soldats de toutes les armes fraternisent le verre et la chanson aux lèvres, les cafés regorgent à tel point, qu'il est impossible de s'asseoir et que le promeneur se rafraîchit et consomme debout sur ses deux jambes. Les tréteaux ne font pas faute, pas plus que les bals égayés par les éclats d'une joie bruyante, mais sans désordre. Enfin, les musiques des régiments s'assemblent en cercle devant chaque front de bandière et jouent des symphonies.
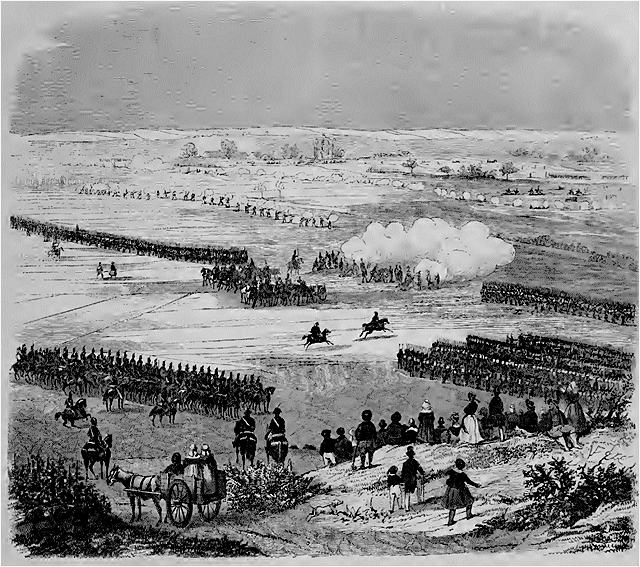
Camp de Plélan, en Bretagne.--Grandes manoeuvres.
Quand le jour baisse, la route s'illumine comme par enchantement, et couronne de feu toutes les têtes de ligne, qui, vues de loin, font un effet magique. Tout à coup les tambours battent, les clairons sonnent, l'heure de la retraite vient surprendre les joyeux convives, les visiteurs, les curieux, les danseurs: il faut partir, il faut se séparer, non sans se promettre de se revoir le dimanche suivant, et de continuer le quadrille interrompu. Au bruit, aux éclats de, la gaieté, succède un calme grave, un silence militaire. Les appels se font, les feux sont éteints; le soldat, rentré sous sa tente, prend, par ordre, quelques heures de repos. Et le jour suivant, dès quatre heures du matin, tous ces braves gens, le sac sur le dos, ou le pied à l'étrier, recommenceront leur journée laborieuse et leur rude apprentissage du métier des armes.
De nos jours, en effet, les choses ne se passent plus comme sous l'ancien régime. Avant six heures du matin, les brigades occupent le champ de manoeuvres. Là, on étudie sérieusement, et l'expérience des chefs agit de la manière la plus heureuse sur les soldats, qui savent que c'est vraiment aujourd'hui que chacun d'eux a le bâton de maréchal dans sa giberne. Au camp, tout a un aspect réellement militaire: les colonels et les officiers couchent sous la tente au milieu des compagnies.
Les tentes des soldats, lieutenants et capitaines sont de toile écrue. Les soldats ont une tente pour seize hommes; les lieutenants et sous-lieutenants une pour deux officiers, les capitaines et officiers supérieurs chacun la leur. Chaque tente a six mètres de long sur quatre de large, et est soutenue par deux montants de trois mètres de hauteur et trois pouces d'équarrissage, réunis par une traverse horizontale qui forme le faîtage de la tente. Les tentes des officiers supérieurs et des généraux sont d'un autre modèle: elles ont la forme d'une petite maison, dont le toit serait à environ un mètre de la terre; elles sont de différentes grandeurs et faites en coutil bleu, avec double toit; la plupart ont neuf mètres de long et six de large. L'intérieur des tentes, uniforme pour toutes, ne renferme que les objets d'absolue nécessité. Celles des officiers ne contiennent qu'un lit de sangle, un matelas, quelques chaises de paille ou des pliants. Dans celles destinées aux conseils d'administration est une table adaptée aux deux montants qui soutiennent le faîte; celles des soldats renferment, avec le sac à coucher, une planche à pain, quelques fichets pour suspendre le sac et le fourniment, ainsi qu'une collection d'ustensiles et d'outils composée de deux marmites, deux gamelles, deux bidons, deux pelles, deux pioches, une hache, une serpe.
On doit faire, au camp de Lyon, l'essai d'une nouvelle tente fabriquée en tissu imitant celui des tentes arabes, qui sont généralement en poil de chameau. Celles qui ont été expédiées par l'administration pour le service des deux camps sont au nombre de 2,250, avec 400 manteaux d'armes.
Lorsque le temps le permet, les fusils sont formés en faisceaux sur le front de bandière. Les officiers prennent leurs repas en commun; ils se réunissent par grades; la dépense est la même pour tous; les sous-officiers, les soldats, mangent à l'ordinaire.
La première réunion des troupes de toutes armes a eu lieu le 15 août dans la plaine comme sous le nom de Grand-Camp, pour la revue du lieutenant-général.
Camp de Plélan.--Placé à quarante kilomètres de Rennes et à vingt de Ploërmel, près de la route qui conduit de l'une à l'autre de ces deux villes, le camp de Plélan offre l'aspect le plus pittoresque. La vue que nous en publions a été exécutée par Mung, dessinateur au dépôt général de la guerre, sur un croquis, pris sur les lieux mêmes, de la lande du Thélin, à quatre kilomètres du village de Plélan, par M. Soitoux, capitaine au corps royal d'état-major, l'un des officiers chargés de lever le plan du camp.
L'infanterie est installée en une seule ligne de quinze cents mètres de développement, dans une vallée traversée par la rivière d'Aff. Le sol, perméable à l'eau, est sec après le moindre coup de soleil. Chaque compagnie occupe une ligne de tentes perpendiculaires au front de bandière; en arrière sont les tentes des officiers; plus loin, contre les clôtures des terres cultivées, sont réunies les cantines; les compagnies, les bataillons, les régiments, les brigades, sont séparés par des intervalles de plus en plus grands. Les cuisines, construites en briques et en gazon sur un modèle uniforme, mais dont la décoration varie pour chaque régiment, sont placées entre les tentes des soldats et celles des officiers. Le sol est creusé d'un mètre en avant des fourneaux, pour diminuer la hauteur qu'ils doivent avoir, et ces fourneaux sont abrités par de petits hangars en planches. Il y a une cuisine pour chaque compagnie, et une pour chaque escadron.
Les guérites sont de simples abris en paille d'un mètre de diamètre, formées en clayonnage garni de paille, et recouvertes d'un toit en paille.
En arrière de l'infanterie, dans la partie nord-ouest de la lande, se trouvent des hauteurs couvertes des plus beaux arbres; à la suite, au milieu de quelques rochers qui les dominent, le lieutenant-général de Rumigny a établi ses tentes, celles des maréchaux-de-camp et de l'état-major. Un ruisseau d'eau limpide et excellente à boire coule au pied du rocher. Sur le bord de ce ruisseau est établie la manutention des vivres.
Plus loin, sur le sommet des collines, sont placées les tentes et les baraques de la cavalerie. L'artillerie est campée plus bas, à gauche de l'infanterie. Les sapeurs du génie occupent le centre, entre les brigades des généraux Boullé et Nenmayer.
A 2,500 mètres environ en avant du camp, sur la gauche, sont les hauteurs du champ de manoeuvres, les vastes landes du Coëlquidan. Dans l'ouest de la position occupée par les troupes, on découvre la belle forêt de Paimpont, dont les masses de verdure offrent un magnifique coup d'oeil. Plusieurs vastes étangs, bordés par des futaies romantiques, et propres à servir d'école de natation, complètent l'entourage du camp.
Les chevaux sont sous des hangars couverts en planches et fermés à leurs pignons seulement. Ces écuries ont sept mètres de largeur. Les chevaux, espacés à un mètre, y sont placés sur deux rangs, tête à tête, et séparés par une cloison longitudinale de deux mètres cinquante centimètres environ de hauteur, le long de laquelle règne un double râtelier. Les fourrages occupent trois magasins, un pour chaque régiment et l'autre pour l'artillerie. Un hangar est disposé pour le bottelage des foins, une baraque pour le dépôt des avoines, une pour le magasin des effets de campement, et quatre autres pour le service des vivres et la boulangerie.
L'éloignement de la manutention de Rennes supposant à ce que le pain soit envoyé au camp tout fabriqué, il a été expédié de Paris des fours de campagne en tôle déjà éprouvés et garantissant la bonne exécution du service. Ces fours portatifs, dont le prix est d'environ 1,300 fr., se montent en quarante-cinq minutes et cuisent 3,000 rations en vingt-quatre heures; leurs produits sont de la meilleure qualité. Comme d'ailleurs les localités n'offrent pas assez de ressources pour permettre aux troupes de se procurer par elles-mêmes le pain de soupe et la viande qui leur sont nécessaires, il a été passé des marchés par adjudication au moyen desquels ces approvisionnements sont assurés à un prix raisonnable. La viande, fournie par un parc établi près de L'Aff, est excellente.
Dix puits alimentent d'eau tout le camp.
Le service hospitalier est organisé au camp de Plélan comme à celui de Lyon, de manière à suffire aux besoins les plus urgents. L'ambulance se compose d'un aide-major, de trois sous-aides, d'un pharmacien, et de deux officiers d'administration. Les malades seront évacués, s'il y a lieu, sur Lyon et sur Rennes.
Le service des transports, au camp de Plélan, est assuré par un détachement du 4e escadron du train des équipages militaires, dont les voitures, de modèles nouveaux, doivent être l'objet d'un examen tout particulier. Trois voilures de transport et une forge, qui n'emploient qu'un seul modèle d'essieu et deux modèles de roues, remplacent en effet aujourd'hui le matériel auparavant si nombreux des équipages militaires. La première de ces voitures, le caisson à roues égales, a été déjà, au camp de Compiègne, en 1841, soumise à des essais qui ont complètement réussi. La seconde est un chariot destiné à tenir lieu à la fois de l'ancienne prolonge et de l'ancienne fourragère, au moyen d'une transformation facile qui permet de la faire servir indistinctement au transport du gros matériel, des barriques, etc., et à celui des fourrages. La troisième voiture, ou caisson léger, servant aussi au même usage, est cependant plus spécialement affectée au transport des blessés et au service des ambulances. Pour ce dernier emploi, suspendue sur ressorts et composée de deux caisses tout à fait séparées, elle peut contenir dans la caisse principale dix blessés parfaitement assis et à couvert, plus trois autres ou trois infirmiers sur une banquette qui domine la caisse de devant; celle-ci, de la contenance de 200 rations de pain (la grande en contient 800), reste alors disponible pour le placement de médicaments ou de tous autres objets. Comme caisson d'ambulance, cette voiture contient plus d'appareils que trois caissons de l'ancien système. Comparaison faite des objets de même espèce, il a été constaté qu'elle renferme 1,890 pansements au lieu de 1,400.
Un grand nombre d'établissements civils sont venus pourvoir aux besoins du camp de Plélan ou en égayer les loisirs. Un restaurateur y a fait établir, dans une position heureusement choisie, une baraque de 50 mètres de longueur, en arrière de laquelle de vastes cuisines fournissent chaque jour à la table de plus de 400 officiers et à de nombreux étrangers. Des boutiques de toute espèce approvisionnent les marchés du camp. A côté des cafés et des restaurants, des spectacles forains offrent de nombreuses distractions. Une troupe de saltimbanques, moyennant une très-modique rétribution, procure aux amateurs les amusements les plus variés. Les comédiens de Vannes, jouant le vaudeville, sont venus élever, sur l'une des collines les mieux situées, une salle où, grâce au prix modeste des dernières places, les soldats eux-mêmes peuvent aller rire aux lazzi des émules d'Odry, d'Arnal et de Vernet.
Les travaux de première installation ont été consacrés par chacun à rendre son habitation plus commode et plus élégante. Celles des capitaines se distinguent par les petits jardins dont chaque compagnie, pour faire honneur à son chef, s'est montrée jalouse d'entourer sa tente. Les fleurs manquant dans les environs, nos apprentis Le Nôtre ont suppléé à leur absence par des touffes de bruyère fleuries, égayant d'ailleurs leurs créations d'horticulture de gais refrains et de joyeuses chansons.
Les manoeuvres du camp, tous les corps réunis, ont commencé le 9 août. Les troupes ont marché pendant à peu près sept heures sous un soleil brûlant.
Notre gravure (page 409) représente une attaque d'artillerie au centre; d'un côté une charge de cavalerie par escadrons; entre l'artillerie et la cavalerie, l'infanterie en bataille, ayant devant elle des tirailleurs; et, derrière l'infanterie, des bataillons serrés par divisions.
MARGHERITA PUSTERLA.
Lecteur, as-tu souffert?--Non.
--Ce livre n'est pas pour toi.
CHAPITRE, IV.
L'ATTENTAT.
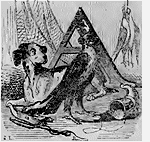 lerte!--Prends!--Laisse!--Ces cris des chasseurs, les
hurlements des limiers et des chiens, les fanfares du cor le rappel des
faucons et des éperviers, le piétinement des chevaux et le tapage des
palefreniers, le braiement de la monture du bouffon Grillincervello,
attiraient les Milanais sur le passage d'un nombreux cortège que le
seigneur Luchino menait à la chasse par la porte de Côme. Les citadins
s'écriaient: «O la brillante chasse!» pendant que les paysans
gémissaient sur leurs champs qu'elle allait dévaster.
lerte!--Prends!--Laisse!--Ces cris des chasseurs, les
hurlements des limiers et des chiens, les fanfares du cor le rappel des
faucons et des éperviers, le piétinement des chevaux et le tapage des
palefreniers, le braiement de la monture du bouffon Grillincervello,
attiraient les Milanais sur le passage d'un nombreux cortège que le
seigneur Luchino menait à la chasse par la porte de Côme. Les citadins
s'écriaient: «O la brillante chasse!» pendant que les paysans
gémissaient sur leurs champs qu'elle allait dévaster.

Lorsqu'on sort par la porte de Côme, après une marche de dix milles, on trouve, à main gauche, entre Boisio et Limbiate, un charmant palais auquel les agréments de son site avaient fait donner le nom de Montebello. Il s'élève sur une colline, dernier ondoiement de cette terre, qui, s'abaissant en gradins superposés depuis les hauts sommets des Alpes, vient se perdre et s'effacer dans l'interminable plaine lombarde. De là le regard s'étend sur les fécondes campagnes du Milanais, d'où surgissent çà et là des hameaux, des bourgs, des villes très-peuplées, et, plus au centre, la métropole de l'Insubrie, étalant la merveilleuse masse de son dôme, monument de l'originalité et de la puissance des siècles robustes dans la foi; de l'autre côté on admirait un cercle de collines, puis de montagnes superbes, qui, au levant et au couchant, limitaient l'horizon, de formes, de hauteur, de nuances différentes. Les unes verdoyaient aux yeux sous la vigne et les blés qu'on y cultivait; les autres se couvraient d'un manteau de forêts; d'autres encore se dressaient âpres et dépouillées, comme la vieillesse d'un homme qui, jeune, a vécu dans le mal.
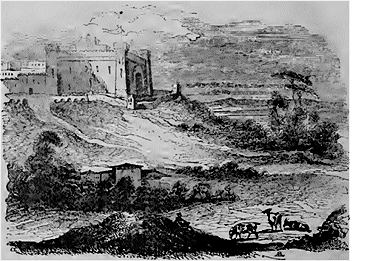
Ce palais, tel qu'il existe aujourd'hui, a été rebâti, par les seigneurs Crivelli, dans le dernier siècle. Vers la fin de cette époque il devint célèbre, lorsque le jeune Bonaparte, ayant passé les Alpes pour asservir la Lombardie, sous prétexte de lui rendre la liberté au nom de la République française, se plut à placer son quartier-général dans le château. Là, autour du héros, fils de la liberté, et qu'ils croyaient disposé à établir le règne de sa mère, tandis qu'il ne songeait qu'à hériter d'elle, les députés des républiques improvisées de l'Italie accouraient apportant de serviles hommages. Le pouvoir des armes avait restreint le nombre de leurs actions libres et augmenté celui de leurs obligations; mais, avec la liberté de payer beaucoup plus d'impôts, il leur avait concédé celle de planter sur leurs places un grand arbre autour duquel ils pouvaient rire, danser et chanter, jusqu'à ce qu'il plût à quelque officier de mauvaise humeur de leur imposer silence. Dans sa villa, Bonaparte riait de ces démonstrations; il riait de la sincérité du petit nombre, et s'aidait de l'astuce de la majorité; cependant il marchandait Venise, et il se préparait à se frayer le chemin du trône, où relevèrent ceux qui, après en avoir abattu une autre royauté, avaient annoncé au monde la fin des rois, l'ère de l'égalité et de la liberté,--mais non l'ère de la justice.
Ne t'effraie pas, lecteur bénévole; ne crains point que je veuille retracer ici la pente sur laquelle glissa l'Italie pour tomber de la tyrannie des Visconti sous le joug de Napoléon. Si j'en ai fait mention, ce n'est que par une de ces digressions trop communes dans notre récit, et qui avait été amenée par le palais dont nous avions à parler. Peu de temps avant l'époque qui nous occupe, les Pusterla avaient bâti cette demeure pour en faire leur villa, et ils y avaient déployé une magnificence égale à leurs richesses. On avait mis à l'embellir tout l'art que l'on connaissait alors pour rendre agréable une maison des champs. Les jardins renfermaient toutes sortes de plantes belles et rares, des collines couvertes de vignes; des jets d'eau, des ruisseaux qu'on avait été chercher au loin répandaient une douce fraîcheur; On trouvait dans l'intérieur des appartements toutes les commodités, sans que les dehors du palais perdissent rien de leur solidité et de leur force. Aux quatre angles de la muraille qui l'entourait, quatre tours s'élevaient, capables, à l'occasion, de tenir tête à une de ces attaques imprévues qui, dans ces temps de guerres civiles et de débilité du gouvernement, pouvaient venir ou d'un peuple mutiné, ou d'une bande de brigands, ou des barons rivaux.
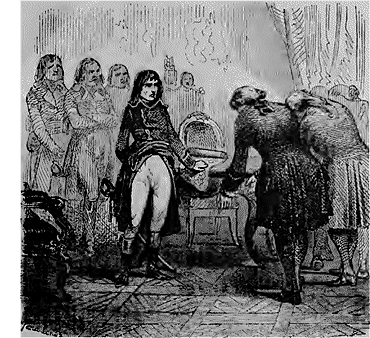
C'était là que s'était retirée Marguerite, lorsque Franciscolo, séduit par la fausse confiance que lui montrait Luchino, avait accepté, malheureusement pour lui, la conduite de l'ambassade envoyée à Mastino della Scalla. Ni les dissuasions de Buonvicino, ni les caresses de sa femme, n'avaient pu le détourner de prendre une de ces charges qui, honteuses sous un gouvernement honteux, semblent un assentiment donné à l'oppression de la patrie, ni l'amener à une retraite honorable, protestation muette et sans péril contre les gouvernements tyranniques. Dès qu'il fut parti, Marguerite résolut de quitter la ville, de s'épargner, dans le repos de la campagne, le déplaisir de voir le triomphe des méchants, et d'y chercher de plus fréquentes occasions de répandre des bienfaits.
Ramengo de Casale interpréta ou voulut interpréter autrement cette retraite. Ce flatteur de Luchino, dont nous avons eu déjà occasion de parler, se présenta chez Visconti peu de temps après le départ de Francesco Pusterla pour Vérone. «Seigneur, lui dit-il, madame Marguerite s'est retirée à Montebello. Certainement elle ne cherche la solitude que pour inspirer à quelqu'un le désir d'aller la consoler. Votre sérénité ne l'honorerait-elle pas d'une visite?»
L'utilité la plus directe que les méchants princes tirent de leurs courtisans, c'est de se faire suggérer par eux les mauvaises actions qu'ils méditaient déjà, et de se ménager ainsi une excuse devant leur propre conscience. Luchino, dissimulant ses sentiments, ne montra pas qu'il fit grand cas d'une suggestion qui concordait pourtant si bien avec ses secrets désirs; mais, peu de jours après, il ordonnait une grande chasse dans les bois de Limbiate.
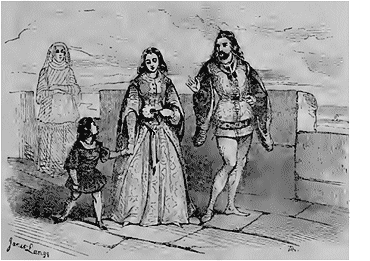
Lorsqu'on lui annonça la venue de Luchino, un pense bien que Marguerite fut troublée. Vêtue avec cette élégance sans apprêt qui convient à la campagne, pleine de toutes les grâces, mais pourtant majestueuse, elle accueillit la cour du prince, lorsqu'il vint se reposer dans son palais. Par ses ordres, la salle à manger et les offices étaient garnies de rafraîchissements délicats pour les seigneurs et pour leur suite. Lorsqu'ils se furent rafraîchis au milieu de la joie, des bruyantes saillies et des affectations déplacées de Grillincervello, auxquelles Marguerite n'opposait qu'un silence plein de dignité, Luchino demanda à la belle hôtesse de lui faire admirer, seul à seul avec elle, la belle position du château et toute l'élégance de son site. Marguerite y consentit, et, du haut des tours d'où on dominait toute la plaine, elle montra à Luchino le paysage animé par sa suite. Celle-ci, se formant en groupes, admirait un ciel si salubre et les riants accidents de la lumière et des terrains, qui, dans cette saison, montraient toute chose sous le jour de la beauté et de la perfection. Mais la châtelaine tenait toujours par la main son jeune Venturino; une grave suivante ne la quitta pas d'un instant, et quelques domestiques, comme pour faire honneur à son hôte, ne cessèrent de l'accompagner. Luchino put à peine lui dire quelques galanteries, qu'elle reçut sans paraître y attacher plus d'importance qu'à des politesses banales et insignifiantes. A son départ, Luchino, après avoir exalté la beauté du site et le parti qu'on en avait tiré, murmura à l'oreille de Marguerite: «Dans une solitude, madame, il serait à désirer que vous fussiez moins entourée.»
Le téméraire crut avoir fait comprendre ses désirs; il l'espéra d'autant plus, qu'il avait été charmé de l'aimable accueil de sa belle cousine. La pudeur bien connue de la noble dame, loin de le détourner de ses honteux desseins, ne l'excitait que davantage à y persévérer, en vertu de ce penchant de l'âme humaine qui nous fait aimer les obstacles. Ramengo et les autres courtisans ne manquèrent pas d'attiser la flamme en élevant aux nues les mérites de cette beauté, et les grâces, et les honneurs avec lesquels elle avait reçu le prince, son parent. Seul, le bouffon osa lancer à son maître quelques mots de chasse manquée, et je ne sais quelles autres baies, qui, en faisant rire Luchino, aiguillonnaient son amour-propre et l'excitaient à assouvir sa passion.
Cette première tentative n'était que comme la course qu'on fait sous une place ennemie pour reconnaître les lieux, les campements favorables et les endroits propres à l'assaut. Peu de jours se passèrent, et Luchino, avec un petit nombre de ses affidés, revînt audacieusement à Montebello. Ce retour désagréable n'était point inattendu. Marguerite n'avait, que trop compris le perfide usage que le prince voulait faire de la familiarité que le sang autorisait, de l'autorité de son rang et de l'éclat de ses richesses. Le péril grandissait donc, non pour la vertu de Marguerite, mais pour son repos qu'elle allait perdre dans sa lutte contre un audacieux, incertaine encore du caractère que prendraient à la fin les persécutions de son parent.
Un jour Luchino revenait vers Milan, calculant en lui-même les pas qu'il avait faits vers le terme de ses désirs. Il cherchait, par sa gaieté et par la marche bruyante de sa troupe, à faire présumer un triomphe qu'il était encore à souhaiter, et voulait en hâter l'heure en inspirant l'idée qu'il était déjà accompli. Tout à coup Grillincervello lui dit: «Regarde, regarde, maître! celui-là est certainement un de tes débiteurs.» Et il lui montrait un jeune homme qui venait à bride abattue par le chemin, et qui, dès qu'il aperçut le cortège du prince, se jeta à travers champs pour l'éviter. C'était Alpinolo que, s'il vous en souvient, nous avons rencontré, dans le premier chapitre, marchant à côté de Pusterla; et, comme il aura désormais une grande part dans notre récit, il convient d'en dire ici quelques mois. On le tenait pour un de ces infortunés qui, dans ces temps de désordre et d'orages, ignoraient leurs parents, et il avait grandi comme une plante au milieu du désert.
Ottorino Visconti, frère de notre Marguerite, avait obtenu en 1329, de l'empereur Louis de Bavière le fief de Castelletto, sur le Tésin, et la juridiction du Novarais, domaine resté depuis dans la maison des Visconti d'Aragona, descendants de cette famille. Pour témoigner sa gratitude à ce souverain, il l'accompagna jusqu'à Pise. A son retour de cette ville, après avoir passé le Pô près de Crémone, il lui arriva de s'arrêter dans une chaumière du rivage, habitée par des meuniers qui transportaient dans des barques leurs moulins mobiles là où ils croyaient trouver le meilleur courant, et, par occasion, prenaient avec eux des passagers. Ottorino, désirant se reposer un instant en cet endroit. demanda que l'un des enfants du meunier tint son cheval pour le faire brouter un peu l'herbe du pré devant la maison, «Ce n'est pas moi,--ni moi,» répondirent les enfants craintifs; et ils s'enfuyaient, se retournant de temps en temps pour observer le cavalier et son cheval» qui leur semblait une dangereuse merveille. Mais l'un d'eux, qu'à sa taille un aurait cru plus âgé, quoiqu'il ne comptât réellement pas sept années, s'avança hardiment et dit: «Qui est-ce qui a peur? A moi le cheval!» Et il le prenait par la bride, le regardait, le caressait, s'amusait à lui donner de l'herbe dans sa main, à sentir le souffle du destrier sur son visage, tout fier de pouvoir dominer un si gros et si noble animal. Puis, avec un soupir qu'on n'aurait point attendu de son jeune âge et de sa contenance à la fois pleine d'ingénuité et de résolution, il s'écria: «Oh! que n'en ai-je un aussi, moi!
--Eh! qu'en ferais-tu? lui demanda Ottorino, charmé de cette vive franchise.
--Oh! je sais bien ce que j'en ferais. Je voudrais courir par terre et par mer pour chercher mon père.
--Ton père n'est donc pas ici? reprit Ottorino.
--Oh! non! reprit le jeune garçon en secouant la tête avec une tristesse enfantine. Ils m'ont trouvé sur le rivage, ils m'ont porté dans cette maison, ils m'ont élevé! mais je n'ai point de parents! Je ne puis jamais dire comme tous les autres: cher père!
--Et ta mère?»
Les yeux de l'enfant s'emplirent de larmes, et, pendant qu'il les essuyait d'une de ses mains, de l'autre il tendait un doigt en disant: «Elle est là!» Et il montrait un monticule surmonté d'une croix à laquelle pendait une couronne de marguerites et d'oeillets fraîchement cueillis.
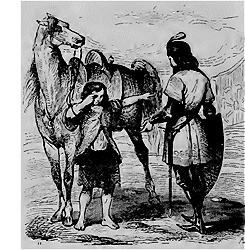
Ottorino, ému de pitié: «Viendrais-tu avec moi?
--S'il ne tenait qu'à moi! Je crains de déplaire à ces braves gens... Ils me veulent tant de bien!... Mais ce n'est pas ici qu'est mon père.»
Ces meuniers s'étaient en effet pris d'un grand amour pour cet enfant. Quand Visconti les pria de le lui laisser l'homme répondit: «Oh! votre seigneurie, elle est trop bonne! Qu'il parte pourtant: trop de bonté de la part de votre seigneurie!»
Mais la Nena, sa femme, qui avait ouï parler en général des malheurs du monde, des caprices des seigneurs, manquait de courage, et disait à l'enfant: «Ne prends pas garde à ce qu'il dit; reste ici. Le pain ne te manquera pas si tu veux travailler, et tu seras tranquille, et du moins tu demeureras dans la crainte de Dieu.»
Au contraire. Maso (c'est ainsi qu'on nommait le meunier), homme qui avait parcouru le monde, c'est-à-dire qui était allé prendre du grain et porter de la farine jusqu'à Crémone et à Castelmaggiore, et qui croyait avoir quelque connaissance des hommes, parce qu'il avait connu beaucoup de marchands de grains, lui coupa la parole et dit: «Comment, tu voudrais lui ravir cette bonne fortune? Ne vois-tu pas? c'est un petit diable: grande santé, grand courage, grand appétit; il a tout ce qu'il faut pour faire un grand homme. Laisse-le emmener par sa seigneurie, et tu verras qu'il fera son chemin. Il n'est pas né meunier, et ce n'est pas là ce qu'il doit faire.»
L'avis du mari prévalut. La Nena, au moment de prendre congé de son enfant d'adoption, et en lui rajustant sur le dos les méchants haillons qui le couvraient, pendant qu'il sautait de joie, lui dit: «Garde-toi du danger, fuis les mauvaises compagnies, les femmes et les cabarets.» conseils dont toutes les mères entremêlent leurs adieux à leurs fils. Maso ajouta: «Respecte sa seigneurie et fait fortune.» Puis Ottorino emmena le jeune garçon avec lui.
C'était précisément notre Alpinolo. Ottorino se proposait d'en faire un écuyer, et en attendant que les années lui vinssent, de le placer en qualité de page auprès de Bice, sa femme. Mais, hélas! de retour dans sa patrie, il apprit que Bice l'avait trahi, et qu'elle s'était réfugiée dans le château de Dosate pour y vivre avec Marco Visconti, son cousin. Celui-ci, peu de temps après, rassasié ou jaloux, un jour la précipita d'une fenêtre dans les fosses du château, sauf à la pleurer abondamment une fois qu'il l'eut tuée. Ottorino souffrit de cette infidélité comme une âme généreuse qui se voit trahie par une personne aimée. Il chercha des distractions dans la guerre et dans les voyages; mais il y a des blessures que le temps ne cicatrise pas. Son désespoir le conduisit au tombeau à la fleur de son âge, et, en 1336, il fut enseveli dans l'église de Saint-Eustorge, à côté de son père, Hubert Visconti.

Il laissa Alpinolo à Marguerite, sa consolatrice dans ses cruelles douleurs, en le lui recommandant spécialement. C'est pourquoi le jeune homme grandit près d'elle, et passa avec sa maîtresse dans la maison des Pusterla, où Franciscolo le prit pour son écuyer. Doué d'une âme où débordait la tendresse, et ne pouvant l'épancher sur des êtres que le sang eût attachés à lui, il l'avait reportée tout entière sur la famille au sein de laquelle il avait grandi. Il en aimait les membres et les intérêts avec toute l'impétuosité d'une passion, passion naturelle dans un jeune homme qui, n'ayant passé sous le joug d'aucune discipline, avait conservé, dans toute leur vigoureuse virginité, la fougue, l'irréflexion, cet extrême besoin de sensations et de bonheur, défauts et qualités de la jeunesse. Un désir, une véritable furie de liberté lui avait été inspirée par les bouillants discours de son jeune seigneur, et par les compagnies qu'il voyait à Milan, composées de jeunes gens avides de nouveautés, ou de vieillards pleins des souvenirs des libertés antiques et du mépris de l'esclavage nouveau. On dit que les hommes de basse naissance, une fois parvenus à un haut rang, s'efforcent de faire oublier leur origine; de même Alpinolo voulait faire oublier aux autres et oublier lui-même qu'il n'avait ni parents ni patrie, par l'excès de son amour pour sa patrie d'adoption. Aucun sacrifice n'aurait paru grand à son immuable et violente résolution de servir la république milanaise, les enfants d'Hubert Visconti et Pusterla: donner sa vie lui eût semblé bien peu de chose.
De tels caractères, qui, lorsqu'ils se passionnent pour une idée ou pour une personne, oublient le reste de l'univers, sont rares aujourd'hui dans notre société, dont le niveau adoucit et égalise toutes les aspérités à la superficie, comme le torrent polit les cailloux. Est-ce un bien? est-ce un mal? Demandez, si la poudre à canon est un bien ou un mal, qui, bien employée, est une protection et une puissance, et qui, employée sans règle, n'est que la mort.
A cette nature violente, mais généreuse, joignez la fraîcheur d'une âme de dix-sept ans, une grâce hardie, bien que modérée par l'habitude de vivre avec les grands, une mélancolie répandue sur tous les sentiments et née du mystère de sa naissance, et vous comprendrez combien Alpinolo devint cher aux Milanais, race d'un naturel exquis, et non-seulement au peuple, mais aux grands. L'incertitude même de sa naissance, que le monde, par une de ses mille injustices, impute ordinairement à crime, ou considère, du moins avec une compassion hautaine, voisine du mépris, loin de nuire à Alpinolo, le rendait plus intéressant à ceux qui le connaissaient, par l'ardeur perpétuelle qu'il montrait de chercher, de retrouver son père, de s'arracher à cette situation qu'il regardait comme une infamie. Si on racontait devant lui les embarras de quelque personne malheureuse: «Au moins il a un père, il a une mère,» s'écriait-il. Lorsqu'il voyait un enfant dans les bras de ses parents, il se consumait de douleur, de regrets. Combien de fois Marguerite ne le surprit-elle pas contemplant Venturino et le couvrant de mélancoliques caresses, en retenant des larmes avec effort!
On a déjà conquis combien Marguerite était faite pour inspirer de l'amour à tout ce qui l'approchait. Pour peu qu'il ait l'expérience du monde, le lecteur doit avoir remarqué que ceux qui n'ont point à se louer des hommes se tournent avec un enthousiasme plein de dévouement vers les femmes, sûrs de trouver en elles la compassion, le désintéressement, la tendresse dont les hommes sont dépourvus, ou qui sont étouffés en eux par les calculs de l'amour-propre et le tumulte des affaires.
Ainsi, Alpinolo avait concentré sur Marguerite l'affection qu'il portait à Uberto et à Ottorino pendant leur vie: affection qui ne ressemblait en rien au sentiment qui d'ordinaire unit les deux sexes, mais une sorte de culte fait pour mettre à néant toutes les manoeuvres de la vanité, toutes les espérances de la passion. Il la considérait comme une lumineuse étoile au milieu des ténèbres universelles de la société, et il n'eût pu la croire capable d'une action qui eût été moins que généreuse et sainte.
Si jamais vous n'avez répandu des pleurs sur le sein d'une femme respectée, si jamais vous n'avez dévoilé à ses yeux les blessures d'un coeur contristé, vous ne devinerez point quelle douceur il y avait pour Alpinolo dans ces heures où, assis près de sa maîtresse, avec l'affection d'un frère et le respect d'un vassal, il lui découvrait ses angoisses. Les hommes en auraient dédaigneusement souri comme d'une faiblesse, d'un enfantillage, d'une exagération sentimentale; mais en elle il trouvait un écho, de la sympathie, et quelques-unes de ces paroles qui peuvent en un instant chasser les nuages du coeur et y ramener la sérénité.
L'année qui précéda celle où commence notre récit, les Visconti s'étaient vus au moment d'être dépossédés de leur seigneurie. Lodrisio Visconti, neveu du grand Matteo, courroucé de se voir exclu de la seigneurie, tenta d'amener un changement, et, se confiant sur le grand nombre des mécontents, sur les promesses de quelques voisins, sur sa propre audace et sur la fortune, il mena contre Azone une bande de mercenaires. Cette bande, composée d'Allemands, et conduite par le capitaine Malerba, fut appelée la compagnie de Saint-Georges. Elle était, la première de toutes ces bandes qui depuis firent un métier de la valeur militaire, et qui, non moins terribles à leurs amis qu'à leurs ennemis, ravagèrent pendant deux siècles notre patrie déjà assez affligée.
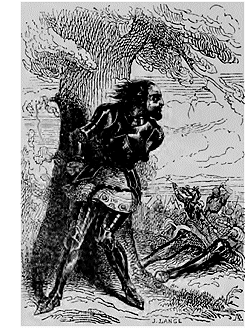
En face de cet imminent péril, tous les Milanais prirent les armes. Quoiqu'ils n'eussent pas grand sujet de se louer de leurs maîtres, ils avaient assez d'ouverture d'esprit pour ne point croire aux promesses de liberté que Lodrisio voulait accomplir par la violence, ni qu'un ramas de bandits mercenaires vînt en pays étranger pour y redresser les torts et y rétablir la justice. Lodrisio, qu'on ne put point empêcher de passer l'Adda à Rivolta, pénétra jusque dans le comté de Seprio, dont il réclamait la seigneurie, et assit son camp à Legnano. Les Milanais s'avancèrent jusque-là à sa rencontre avec trois mille cinq cents cavaliers, deux mille arbalétriers, quatorze mille fantassins, armée considérable pour un si petit état. Luchino, qui n'était point encore prince, la commandait. Il disposa l'avant-garde à Parabiago, à Nerviario le centre, à Ro l'arrière-garde; mais, surpris de grand matin, le 21 février (c'était le jour de sainte Agnès, et il neigeait à flots), il y eut une telle mêlée qu'il fui fait prisonnier, et qu'on l'attacha à un arbre jusqu'à ce que la journée fût décidée.
Alpinolo, qui combattait derrière Francisco Pusterla, aperçut Luchino dans cette position critique. Il en donna aussitôt avis aux cavaliers les plus braves de l'armée, et avec eux il rafraîchit le combat, et, redoublant d'efforts, ils parvinrent à délivrer leur capitaine. S'il n'était pas du style de l'histoire de ne jamais rapporter qu'aux personnages illustres le mérite des actions d'éclat, elle aurait confessé qu'Alpinolo avait eu la meilleure part dans cette affaire. Il fit en effet des merveilles de sa personne, arriva le premier jusqu'à Visconti, coupa les liens qui le retenaient, le mit à cheval, et, lui donnant une masse d'armes, revint avec lui montrer le visage aux ennemis. Ceux-ci, à la fin d'une journée où le combat s'était cinq fois renouvelé, s'enfuirent enfin en pleine déroute, laissant prisonnier Lodrisio, qui fut jeté dans le cachot de Saint-Colomban, où il souffrit beaucoup d'années.

Cette bataille est celle de Parabiago, si célèbre parmi les Milanais, et dans laquelle on raconte que saint Ambroise apparut dans l'air, tenant en main un fouet gigantesque, dont il frappait les mercenaires. En mémoire de cette journée, on bâtit une église superbe au lieu même où Luchino avait été délivré. Il fut réglé que chaque année, au jour anniversaire considéré comme jour de fête, les douze seigneurs de l'approvisionnement iraient à cette église en grande solennité y faire une offrande au nom de la commune, et assister à une messe spéciale, dont la préface contenait des imprécations contre les mercenaires. Cette cérémonie se poursuivit jusqu'au temps de saint Charles Borromée, qui la restreignit à une simple visite à la basilique de Saint-Ambroise, dans la cité.
Ce furent alors de grandes fêtes, de grands feux de joie. Azone se rendit à Parabiago avec une pompeuse suite, et arma chevaliers ceux qui s'étaient le plus distingués dans la bataille. Un héraut d'armes appelait les braves les uns après les autres par leurs noms, les titres de leurs familles et de leurs pères; s'il ne s'y trouvait pas de tache, il disait: «Viens et l'approche pour recevoir cette ceinture militaire, dont la patrie et les chevaliers te trouvent digne.» Le héraut nomma el examina Ambroise Cotiea, Protaso des Caimi, Giovanni Scaccabarozzo, Milanais, Lucio des Vestarini, de Lodi, Inviziato, d'Alexandrie, Lanzarotto Anguissola et Doudazio Malvicino della Fontana, de Plaisance, Rainaldo des Alessandri, de Mantoue, Giovannolo de Monza, et l'Allemand Sfolcada Melik. Ils se présentaient à la file les uns des autres devant Azone, qui recevait leur hommage-lige, leur donnait une légère accolade, leur présentait l'épée, et la leur attachait au côté avec la ceinture chevaleresque, pendant que deux autres chevaliers leur attachaient aux talons les éperons d'or. On appela ensuite Giovanni del Fiesco, Génois, frère d'Isabelle, femme de Luchino; mais ou ne put rendre les honneurs qu'à son cadavre, qu'on voyait étendu sur un riche lit de parade, revêtu de toute son armure, tel qu'enfin il était tombé sur le champ de bataille, en combattant à côté de son beau-frère.
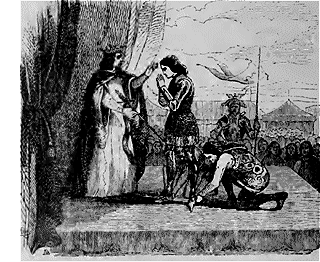
Enfin on proclama le nom d'Alpinolo. Mais quand on demanda quel était son père, quelle était sa lignée, personne ne put en rendre compte, et il resta lui-même confus, comme au souvenir d'une ignominie. Comme il ne put prouver qu'il n'était point sorti d'une souche infâme, il ne fut point admis aux honneurs des preux. Je laisse à penser quel coup ce fut pour son âme; il lui paraissait qu'il n'y avait que la tyrannie la plus grossière et la plus absurde qui pût regarder à la naissance plutôt qu'au mérite personnel. Il se comparait aux uns et aux autres parmi les nouveaux chevaliers, surtout à Melik, l'Allemand mercenaire, et de ce jour augmentèrent sa haine contre les Visconti et son désir de connaître son père. Semblable à des vierges involontaires, après une suite de désirs trompés, il était devenu irritable, aigri contre la société, selon lui mal réglée, et de plus en plus enthousiaste des exceptions sociales, de plus en plus avide de rêves nouveaux, de périls, de renaissantes épreuves.
A l'entrée de presque toutes les maisons nobles de Milan, on trouvait un portique où ou pouvait se réunir pour prendre l'air, pour causer avec ses amis, pour censurer le voisinage, comme le comportait la vie publique et toute en dehors de cette époque, de même que se renfermer chez soi et s'isoler est d'usage dans des temps où chacun se fait une règle de ne vivre que pour soi et de s'instituer le centre et la circonférence de ses actes. De soixante de ces lieux de réunion, que nous appelions coperti, il ne subsiste plus guère que celui de Fugini, bâti peu après sur la place du Dôme.
Précisément, sous l'un de ces portiques, Alpinolo échangeait quelques paroles avec le feu qu'il mettait à toutes choses, lorsqu'il fut accosté par un certain Monelozzo Basabelletta, d'humeur satirique, mauvais plaisant, chaud partisan du peuple, pareil à tant d'autres à qui le mépris qu'on a pour eux tient lieu de liberté. Je ne sais si c'était par amour du bien, par envie ou pour flatter le peuple, qui a aussi ses adulateurs, il s'était fait l'investigateur malin et le caustique détracteur de la conduite des nobles, des riches et des magistrats.
Il salua le jeune homme, et, lui frappant sur l'épaule: «Eh! lui dit-il, cette perle de toutes les femmes, cette coupe d'or dont on n'a jamais fini de raconter les merveilles, elle supporte assez bien l'absence de son mari, en recevant les visites du magnifique seigneur Luchino. Je l'ai vu se diriger plusieurs fois vers la villa de cette dame.»

Qui eût vu Alpinolo entrer en fureur lorsqu'il entendit prostituer à la foule un nom si sacré pour lui, l'eut comparé à un basilic se dressant contre celui qui l'a tiré de sa retraite. Rouge comme la pourpre et le feu dans les yeux: «Tu en as menti par la gorge, bavard effronté!» hurla-t-il, les cheveux en désordre; et, jetant la main sur son épée, sans plus de paroles, il allait arracher la vie à l'indiscret. Les assistants aidèrent celui-ci à s'échapper des mains de son adversaire, puis, par leurs paroles et surtout par la force de leurs bras, retenant Alpinolo, ils parvinrent à l'apaiser. Toutefois, jurant à haute voix qu'il tirerait vengeance d'une pareille injure, criant au mensonge, les poings levés et grinçant des dents, il courut en furie à la maison des Pusterla. Là, sans proférer une parole, il alla aux écuries, jeta la bride au premier cheval qu'il rencontra, sauta dessus avec promptitude, et partit ventre à terre. «Prenez garde! prenez garde!» criaient les mères en le voyant venir ainsi au galop, et elles s'empressaient d'arracher leurs enfants à leurs jeux de la rue. Il eut bientôt gagné la porte de Côme, située peu après le pont Vieux. Il sortit, et son cheval frappait, dans sa course emportée, le sol alors étroit et tortueux de la route, lorsque, Inès de Boisio, il reconnut la troupe de Luchino qui revenait de Montebello.
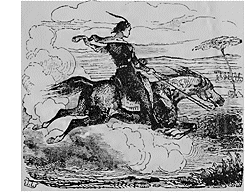
Il n'en crut point d'abord ses yeux, tant il avait le coeur navré de voir la vérité d'une nouvelle qu'il avait si fièrement démentie devant Monelozzo. Plus que jamais exaspéré, il enfonce ses éperons dans les flancs de son cheval, et le lance à travers un champ couvert d'épis pour éviter la troupe abhorrée. Ce fut alors que Grillincervello le remarqua; mais celui-ci ne put entendre les imprécations qu'Alpinolo lançait contre eux, non-seulement en pensée, mais encore en paroles, si ou peut appeler ainsi le râle de la rage et des rugissements à demi étouffés.
Il arriva ainsi, à travers champs, à Montebello. Au milieu de la cour, il sauta de cheval, et sans même y songer, les vêtements poudreux et en désordre, il se présenta aussitôt devant Marguerite. Jamais il ne s'était permis avec elle une telle dérogeance à l'étiquette; mais c'était aussi la première fois qu'il l'abordait avec un autre sentiment que celui de la vénération. Mais à peine eut-il vu le suave et paisible aspect de la belle châtelaine, encore un peu troublée par la visite qu'elle venait de recevoir, comme un beau ciel sur lequel le zéphyr, après l'ouragan, laisse encore quelques flocons de nuages, toute indignation tomba dans le coeur d'Alpinolo, tout soupçon s'évanouit. Autant il avait été prompt à supposer un crime, autant il se reprochait amèrement d'avoir pu douter un instant de cet ange. Il baissa donc les yeux, comme s'il les eût crus indignes de la fier, et il ne put lui dire que ces mois: «Luchino est-il encore ici?»
Marguerite, avec la dignité de la vertu que n'atteignent point les injures, leva la tête, et avec l'accent d'un doux reproche, s'écria: «Alpinolo! tout autre que vous eut pu me faire cette demande; mais de votre part, je ne l'attendais pas.»

Alpinolo éclata en sanglots, et se jeta aux pieds de Marguerite en lui demandant pardon. Il raconta ses doutes, il entendit les explications de sa maîtresse, et la conclusion de leur entretien fut qu'il irait aussitôt avertir frère Buonvicino. Le lendemain ne s'était pas écoulé, et le moine était déjà chez Marguerite. Il lui conseilla de prendre les devants et de revenir sans délai à la ville; elle suivit ce conseil, et se renferma dans son palais pour se laisser ignorer jusqu'au retour de son mari.
Cependant Luchino revint bientôt à la charge, plein d'une insolente confiance. Il approche de Montebello, et tout n'y est que silence; les fenêtres sont closes, aucune bannière ne flotte sur les tours. Un violent soupçon commence à torturer l'âme de Luchino, et Grillincervello de se prendre à rire. II lance son âne en avant, fait quelques pas, puis revient en disant: «La porte est fermée; c'est le visage de bois. «Ils avancèrent néanmoins, et lorsqu'ils furent à la ferme ils demandèrent au paysan si la dame Pusterla n'était pas au logis.
«Elle est partie.--Quand?--Hier au soir, Excellence. --Oui est-elle allée?--Les actions de mes maîtres ne me regardent pas.--Tout n'était-il pas disposé pour qu'elle demeurât ici plusieurs jours?--Plusieurs mois aussi, Excellence.--D'où vient donc cette subite résolution?--Les actions de mes maîtres ne me regardent pas. Mon devoir est d'obéir, Excellence.»
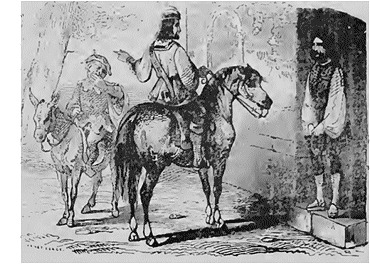
Il importait, à Luchino que personne ne s'aperçût qu'on lui avait fait injure; aussi montra-t-il qu'il prenait la chose gaiement, qu'il s'en réjouissait même, et donna-t-il à entendre que ce départ n'était rien qu'un accord, une intelligence entre Marguerite et lui. Mais cette nécessité de feindre ne fit qu'attiser le feu de sa colère, et, plein de ressentiment, il jura de se venger de ce qu'il appelait un outrage. Il était encore excité par les lazzi du bouffon, qui ne voulait point paraître dupe de la feinte de son maître, et par le vil courtisan Ramengo, qui, ayant ses raisons de haïr Marguerite, savait, avec un art extrême, animer contre elle les passions du prince, dans l'espoir d'amasser sur la tête de l'innocente un orage terrible. L'espérance du scélérat ne fut point trompée. L'amour, disons mieux, le voluptueux caprice de Luchino, ainsi contrarié, se changea en une animosité violente, et, dès lors, avec une résolution atroce, il se proposa de perdre l'infortunée. Les occasions ne manquent pas à l'homme puissant de nuire à son ennemi, et trop souvent les victimes s'offrent d'elles-mêmes à ses coups, ou sont conduites au sacrifice par leurs propres amis. C'est ce qui arriva dans cette circonstance.
Alpinolo, avec l'impétuosité sans frein qui lui était naturelle, ne se borna point à remplir la mission dont il avait été chargé par Marguerite. Elle lui avait même enjoint d'épargner à son mari la connaissance d'une injure qu'elle se sentait assez forte pour repousser, tandis qu'elle savait que son mari n'était pas assez grand pour la supporter en homme, ni assez puissant pour la laver par un juste châtiment. La prudence lui avait appris à ne point révéler les maux irrémédiables; Alpinolo, au contraire, pensait que découvrir la plaie, c'était la guérir. A peine eut-il donc envoyé Buonvicino près de Marguerite, que, sans en avertir personne, il sortit de la ville et fit route vers Vérone.
Lorsqu'il y arriva, il fut témoin de la pénitence publique accomplie par Mastino della Scala, seigneur de la ville. Excommunié par le pape pour avoir égorgé, dans les rues de Vérone, l'évêque Bartolomeo della Scala, Mastino avait d'abord voulu se rire des foudres du saint-siège; mais, voyant que l'anathème avait pour sa prospérité les plus fâcheuses conséquences, il se résolut à expier son crime dans la forme que lui prescrivait le saint-père, et à rentrer dans le giron de l'Église.
Une fois réconcilié avec le pape, Mastino reculait devant la conclusion d'un traité avec Luchino Visconti, qui, au reste, ne la désirait pas davantage. Celui-ci n'avait envoyé Pusterla à Vérone que pour l'éloigner de Marguerite, et parce qu'il croyait que son nouvel ambassadeur, peu affectionné pour lui, traînerait les choses en longueur, et ne terminerait point d'alliance entre les Scala et les Visconti.
Les négociations en étaient là, lorsque Alpinolo entra à Vérone et vint y trouver Pusterla. L'ambition seule, et le désir de plaire au maître avaient conduit celui-ci à se prêter aux desseins de Luchino. On pense quelle fut son indignation lorsque Alpinolo, avec les couleurs sombres que lui fournissait l'exagération de son esprit, lui peignit les tentatives de Luchino. Rien n'est plus cruel que d'éprouver l'ingratitude de ceux qu'on a servis aux dépens de l'équité. Franciscolo le ressentit; d'autant plus exaspéré contre le prince qu'il était tout à l'heure mieux disposé pour lui, et découvrant un nouvel outrage dans ce qu'il avait regardé comme une reparution des outrages passés, il résolut aussitôt d'abandonner son poste. Il prit donc le chemin de Milan, plein de noires pensées, et de l'espoir non-seulement d'éviter l'injure, mais encore de s'en venger.
Bulletin bibliographique.
Oeuvres philosophiques du père André, de la Compagnie de Jésus, avec Notes et Introduction, par M. Victor Cousin. 1 vol. in-18.--Paris, 1843. Charpentier. 3 fr. 50 c.
La vie de l'auteur d'un Essai sur le Beau, justement estimé, le Père André, de la Compagnie de Jésus, était demeurée presque complètement inconnue avant la publication de l'intéressante notice que M. Victor Cousin a mise en tête de la nouvelle édition de ses oeuvres choisies. Deux courtes biographies, l'une de l'abbé Guyot dans l'Éloge historique qui précède les Oeuvres posthumes (Paris, 4 vol., 1766), l'autre du père Tabaraud, ancien oratorien, dans le tome II de la Biographie, universelle, ne contenaient, sur les instructives agitations de son existence, que des renseignements vagues et insuffisants; des documents nouveaux nous ont apporte des lumières inattendues, et, «en ajoutant des détails authentiques et douloureux à ce que nous avait appris le père Tabaraud», dit M. Cousin, «ils transforment à nos yeux le père André en un personnage digne de l'attention et de l'intérêt de l'histoire par les longues disgrâces, absurdes et cruelles, qu'il souffrit dans le sein de la Compagnie comme cartésien à la fois et comme janséniste; par l'attachement éclairé et courageux qu'il garda toute sa vie à une grande cause proscrite; par le rare talent d'écrivain ingénieux, délicat, élevé, quelquefois éloquent et pathétique, que nous revoient les pages, jusqu'ici inconnues, échappées à sa plume pendant une persécution de près de cinquante années.»
Ces nouveaux documents viennent de deux sources différentes. En 1839, M. Leglay, archiviste du département du Nord, acheta, chez un libraire de Lille, un manuscrit qui contenait quatre-vingt-trois lettres inédites du père André, embrassant une période d'environ quinze années (de 1707 à 1722), adressées à Malebranche, à un jésuite nommé Larchevêque, et à M. l'abbé de Marbeuf, de l'Oratoire. M. Cousin, devenu possesseur de cette correspondance, en publia des extraits dans le Journal des Savants (janvier et février 1841), sur deux points intéressants: 1º la persécution trop peu connue du père André; 2º les matériaux qu'il avait amassés pour composer une Vie de Malebranche.
Vers la fin de 1811, M. Mancel, conservateur de la bibliothèque de Caen, découvrit, dans un ballot de papiers manuscrits qu'on se disposait à vendre à la livre, la majeure partie îles manuscrits, autographes et inédits de railleur de l'Essai sur le Beau (dix); plus, trois cahiers contenant la correspondance du père André avec les jésuites Guimond, Hardouin, Porée et Dutertre, lors de sa persécution comme malebranchiste; avec Fontenelle (dont seize lettres autographes de ce dernier) et avec Malebranche. Ces précieux manuscrits appartenaient à une demoiselle Peschet, légataire d'une demoiselle de La Boltière, héritière elle-même d'un avocat littérateur de Caen nommé Charles de Quens, élève du père André; leur authenticité ne saurait donc être contestée, car le père André mourut à Caen en 1764, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. Achetés par M. Mancel, ils ont été déposés à la bibliothèque publique de Caen, et M. Mancel, le conservateur, aidé de ses collaborateurs, MM. Trébulien et Leflaguais, les étudie, afin de reconnaître ce qui mérite d'en être publié. Toutefois, ils ont eu la complaisante attention de communiquer à M. V. Cousin la correspondance du père André avec plusieurs de ses confrères et de ses supérieurs de la Compagnie de Jésus, pendant le temps qu'il lut persécuté comme partisan de la nouvelle philosophie de Descartes et de Malebranche. Cette correspondance, suite et complément nécessaire de celle que M. Leglay avait retrouvée à Lille, et qui avait déjà été imprimée en partie dans le Journal des Savants, a permis à M. Cousin de réunir toutes les lumières qui peuvent éclairer ce triste et intéressant épisode de l'histoire du cartésianisme.
Une différence grave, qu'il importe de signaler, distingue la nouvelle correspondance de la première. «Dans celle-ci, dit M. Cousin, le père André écrit à des amis qui pensent comme lui, à Malebranche, à l'oratorien de Marboeuf, disciple de Malebranche, ou à M Larchevêque, qui parait avoir partagé ses sentiments; il leur ouvre son coeur, il se complaît à leur montrer son goût vif et constant pour la nouvelle philosophie; ses études secrètes et obstinées, son pieux et fidèle attachement à leur commun maître et son dédain courageux pour leurs communs ennemis. Ici la scène est toute différente. Ce n'est plus le père André parlant à son aise à des amis et à des hommes étrangers à sa compagnie; c'est le père André dans le sein même de cette compagnie, aux prises avec ses supérieurs, entouré d'ombrages, de menaces et de tracasseries, obligé de cacher ses études, de dissimuler ses amitiés et ses opinions sans les trahir; perpétuellement placé entre une circonspection qui pourrait ressembler à de l'artifice et une franchise bien voisine de la révolte; réclamant sans cesse la justice, prodiguant les explications et les apologies; abandonné peu à peu par ceux de ses confrères qui paraissaient d'abord plus ardents que lui dans la môme querelle; se débattant en vain contre de sourdes intrigues ou contre une persécution déclarée; gêné et tourmente dans les plus petits détails de sa vie; renvoyé de ville en ville et de collège en collège; tour à tour accusé de cartésianisme et de jansénisme, en butte à une inquisition qui ne se relâche jamais; une lois même livré au bras séculier, emprisonné à la Bastille, et traînant ainsi une vie inquiète et agitée pendant toute la première moitié du dix-huitième siècle. On voit ici l'intérieur de la Compagnie de Jésus, sa forte hiérarchie, le mystère dont s'y enveloppe l'autorité, ses ménagements astucieux ou ses coups d'éclat, des esprits d'une souplesse infinie et des coeurs de fer, une politique toujours la même sous les formes les plus diverses, et, au milieu de tout cela, dans cette nombreuse société, toutes les variétés de la nature humaine, bien des mécontents, quelques hommes excellents, beaucoup de gens faibles, plus d'un lâche, l'empire de l'habitude et de la routine, le monde enfin tel qu'il est et sera toujours. Ajoutez que nous avons ici tous les noms propres, que les masques sont ôtés, et qu'on voit comparaître dans cette affaire les principaux personnages du jésuitisme de cette époque. On peut donc, se promettre plus d'une révélation inattendue et piquante; c'est en quelque sorte la chronique philosophique de la fameuse compagnie et comme un chapitre inédit de son histoire intérieure, dans la dernière période de sa domination et de son existence légale en France.»
Outre cette longue introduction de 200 pages, dont M. Victor Cousin a rédigé lui-même, avec un certain art, le piquant sommaire, et qui, connue on le voit, offre un intérêt d'actualité, le nouveau volume dont M. Charpentier vient d'enrichir sa bibliothèque philosophique contient l'Essai sur le Beau, composé de dix discours, et douze antres discours académiques sur l'âme, sur l'union de l'âme et du corps, sur la liberté, sur la nature des idées, sur l'idée de Dieu, sur l'amour désintéressé, etc. «Ces discours, dit M. Cousin, tout en se sentant un peu trop de l'occasion à laquelle ils durent naissance, portent la vive empreinte de la pensée et de la langue du dix-septième siècle. On y reconnaît partout le philosophe cartésien, le disciple de saint Augustin et de Malebranche. Mais, il faut l'avouer, et dans l'Essai sur le Beau et dans les discours, on est bien loin de soupçonner la netteté, la force et la verve qui paraissent à chaque ligne des lettres que nous avons publiées. Elles placent André parmi les meilleurs écrivains, et, dans la Compagnie de Jésus, immédiatement après Bourdaloue.»
Le père André avait écrit une Vie de Malebranche, remplie d'une foule de faits curieux et importants pour l'histoire de la philosophie au dix-septième siècle. Malheureusement, le détenteur actuel de ce précieux manuscrit s'obstine, par égoïsme ou par un misérable esprit de parti, à priver le public d'un écrit qui lui était destiné, et dont la perte ne peut pas même servir le plus violent ennemi des doctrines de Malebranche, puisque désormais rien ne peut abolir les oeuvres de ce grand homme. M. V. Cousin publie à ce sujet un grand nombre de renseignements curieux, empruntés au manuscrit de Lille; puis il termine par une allocution que nous sommes heureux de reproduire, car elle nous prouve qu'il a compris enfin que la suppression ou la mutilation des oeuvres posthumes d'un philosophe devait soulever contre son auteur tous les honnêtes gens de tous les partis.
«Avant de quitter cet important sujet, dit-il, nous voulons adresser encore une fois, avec toute la force qui est en nous, notre publique et instante réclamation à celui qui possède encore aujourd'hui les matériaux de ce grand ouvrage; qu'il sache qu'il ne lui est pas permis de retenir ce précieux dépôt tombé entre ses mains, encore bien moins de l'altérer. Tout ce qui se rapporte à un homme de génie n'est pas la propriété d'un seul homme, mais le patrimoine de l'humanité. Malebranche aujourd'hui, élevé par le temps au-dessus des misères de l'esprit de parti, n'est plus l'ami de Port-Royal et le confrère de Quesnel; ce n'est pus que le Platon du christianisme, l'ange de la philosophie moderne, un penseur sublime, un écrivain d'un naturel exquis et d'une grâce incomparable. Retenir, altérer, détruire la correspondance d'un tel personnage, c'est dérober le public, et, à quelque parti qu'on appartienne, c'est soulever contre soi les honnêtes gens de tous les partis.»
Les Poésies du duc, Charles d'Orléans, publiées sur le manuscrit original de la bibliothèque de Grenoble, conféré avec ceux de Paris et de Londres, et accompagnées d'une préface historique, de notes et d'éclaircissements littéraires; par M. Aimé Champollion-Figeac (de la Bibliothèque Royale). 1 vol. in-18.--Paris, 1843. Belin-Leprieur. 3 fr. 50,
«Charles d'Orléans, père de Louis XII, tournait la ballade et le rondeau avec assez de facilité.» Telle est la dédaigneuse mention que Laharpe accorde en passant, dans son Cours de Littérature, à ce prince poète, proclamé plus tard par M. Villemain de plus heureux génie qui soit né en France au quinzième siècle, et à qui on est redevable d'un volume de poésies, le plus original de cette époque, le premier ouvrage où l'imagination soit correcte et naïve, où le style offre une élégance prématurée. «Il n'est pas d'étude, ajoute avec raison M. Villemain, on l'on puisse mieux découvrir ce que l'idiome français, manié par un homme de génie, offrent déjà de créations heureuses. Il y a dans Charles d'Orléans un bon goût d'aristocratie chevaleresque, et cette élégance de tour et cette fine plaisanterie sur soi-même, qui semblent n'appartenir qu'à des époques très-cultivées. Il s'y mêle une rêverie aimable, quand le poète songe à la jeunesse qui fuit, au temps, à la vieillesse. C'est la philosophie badine et le ton gracieux de Voltaire dans ses stances à madame Du Delfant. Le poète, par la douce émotion dont il était rempli, trouva de ces expressions qui n'ont point de date, et qui, étant toujours vraies, ne passent pas de la mémoire et de la langue d'un peuple.»
Cependant, malgré tout leur mérite littéraire, malgré leur importance historique, et, bien que leur auteur eût été le père d'un roi de France, les poésies de Charles d'Orléans, si peu comprises et si mal jugées par Laharpe, sont restées presque entièrement ignorées pendant plusieurs siècles. Il y a 109 ans, en 1734, l'abbé Sallier, bibliothécaire des manuscrits du roi, fut le premier critique qui songea à les retirer de l'oubli où elles avaient été si longtemps enfouies. Il en fit le sujet d'un mémoire lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et il en publia même quelques fragments. Plus tard, l'abbé Gouget, dans sa Bibliothèque française, tome IX, consacra quelques pages au père de Louis XII. Depuis, M. de Pauluy, les auteurs des Annales des Muses et de la Bibliothèque des Romans, M. Anguis, M. Villemain, M. F. Michel, M. Ferriat-Saint-Prix, M. Sainte-Beuve, M. Ch. Lenormant, M. Michelet (Histoire de France, tome IV), ont écrit sur sa vie et sur ses oeuvres diverses notices biographiques et critiques; mais jusqu'ici il n'avait été publié qu'une très-incomplète et très-imparfaite édition des poésies de Charles d'Orléans (Grenoble, 1805). L'année dernière en a vu paraître deux éditions nouvelles: l'une d'après les manuscrits de Paris, par Mario Guichard (Bibliothèque d'élite), l'autre d'après les manuscrits de Grenoble et de Paris, celle qui nous occupe en ce moment.
Les poésies de Charles d'Orléans nous ont été conservées par onze manuscrits: celui de Grenoble, que M. Champollion-Figeac regarde comme le plus authentique et le meilleur de tous incontestablement; celui qui se trouve dans la bibliothèque de Carpentras; les trois de la Bibliothèque Royale de Paris; deux à la bibliothèque de l'Arsenal, et quatre que possèdent les bibliothèques de Londres. (On sait que l'infortuné fils de Valentine de Milan, fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, passa vingt-cinq années en Angleterre.) Dans la notice historique qui précède l'édition qu'il vient de publier, M. Champollion-Figeac explique pourquoi il préfère aux dix autres le manuscrit de Grenoble, exécute par les soins d'un secrétaire du prince, homme très-versé dans les lettres, et écrit par le frère de ce secrétaire, Nicolas Astezan, aussi attaché en la même qualité à la maison du duc.--Il l'a suivi très-exactement pour son texte; toutefois, après l'avoir collationné avec les deux manuscrits de Paris, il a adopté, dans quelques vers, des variantes tirées de ces derniers manuscrits. Enfin, comme le manuscrit de Grenoble ne contenait que les poésies composées jusques et y compris l'année 1453, M. Champollion a suivi, pour les poésies postérieures, le manuscrit de Colbert (Bibliothèque Royale), conféré, complète et corrigé au moyen du manuscrit de la Vallière (Idem). Il a relégué dans les notes «celles sur lesquelles un peu de goût lui laissait quelque incertitude.»
Jeanne d'Arc, par M. Alexandre Dumas, suivie d'un appendice contenant, une analyse raisonnée des documents anciens et de nouveaux documents inédits sur la pucelle d'Orléans, par J.-A. Buchon; avec une introduction par M. Charles Nodier, de l'Académie Française.--Paris, 1843. 1 vol. in-18 de 450 pages. Gosselin (Bibliothèque d'élite), 3 fr. 50 c.
«Voici un de ces livres qu'il faut lire comme il a été écrit, avec la foi,» dit M. Alexandre Dumas, au début de son introduction. Que l'auteur des Demoiselles de Saint-Cyr nous permette de donner au lecteur de Jeanne d'Arc un avis tout contraire. Si M. Alexandre Dumas raconte avec esprit, en revanche, comme historien, il ne doit inspirer aucune confiance. Non-seulement il n'étudie pas l'histoire, mais quand il la connaît par hasard, il la défigure à plaisir, il en fait des feuilletons plus ou moins spirituels, et comparables, pour la véracité, aux fameuses Impressions de Voyage. Au lieu de lire son roman de Jeanne d'Arc avec une foi entière, il faut le lire avec la plus prudente méfiance. Les éditeurs l'ont si bien senti, qu'ils ont eu le soin de mettre l'antidote à côté du poison. Aux lecteurs qui ne demandent qu'un récit animé et intéressant, la Jeanne d'Arc de M. Alexandre Dumas; à ceux qui veulent s'instruire en s'amusant, l'introduction de M. Charles Nodier et l'appendice de M. Buchon. Cet appendice contient, en effet, une analyse raisonnée des documents anciens et de nouveaux documents inédits sur la pucelle d'Orléans. Il forme les deux tiers de ce volume, dont il devient ainsi la partie principale. Les curieux documents que publie M. Buchon renferment toute l'histoire de Jeanne d'Arc, car ils se divisent en neuf chapitres: 1º enfance de Jeanne d'Arc; 2° ses premières inspirations avant son départ de Greux; 3º sa présentation au roi et son admission; 4° ses services jusqu'au couronnement de Reims; 5° ses services après le couronnement et sa prise à Compiègne; 6º son emprisonnement et sa remise aux Anglais; 7º son procès et ses interrogatoires; 8º sa condamnation et son exécution; 9º la réhabilitation de sa mémoire.
Des Sociétés civiles et commerciales, commentaire du Titre IX du Livre III du Code civil; par M. Troplong, conseiller à la Cour de cassation, membre de l'Institut (ouvrage qui fait suite à celui de M. Touillier). 2 vol. in-8,--Paris, 1843. Charles Hingray. 15 fr.
Le zèle et l'activité de M. Troplong ne se ralentissent pas. Il continue, avec une persévérance égale à son talent, l'important ouvrage que Touillier n'avait pas eu le temps de terminer. Quelques années encore, et il aura l'honneur de poser la dernière pierre de ce vaste et colossal édifice élevé à la science du droit. Aujourd'hui il publie le commentaire du Titre IX du Livre III du Code civil, du Contrat de Société. Ce commentaire, qu'il ne nous est pas donné d'apprécier ici, obtiendra sans aucun doute, alors même qu'il leur serait inférieur, un succès plus grand que ceux de la Prescription, de la Vente, des Hypothèques, etc.; car les matières qu'il traite ont un intérêt plus actuel et plus général, M. Troplong y a réuni en effet la société civile et la société commerciale, et à cette époque ou l'association a pris et s'apprête à prendre des développements si imprévus, un pareil travail a tout à la fois pour but de résoudre la grave question que fait naître la législation existante et de préparer les réformes nécessaires de l'avenir. Peut-être cependant, nous devons l'avouer, M. Troplong montre-t-il, en divers passages, une affection trop vive pour le présent. «Convaincu, dit-il, que notre loi sur les sociétés civiles et commerciale est le fruit d'une longue expérience; qu'elle a été mûrie par les épreuves les plus décisives, par les combinaisons pratiques les plus variées et les plus ingénieuses; qu'elle est la formule de tout ce que le passé a accumule de faits considérables en économie et en industrie, j'ai foi en sa sagesse; et quoique je reconnaisse en elle quelques défauts secondaires, je ne me laisse pas aller à des désirs de changements plus rétrogrades que progressifs; je me contente d'en appeler à la jurisprudence pour tous les cas où il est permis de corriger des contours vicieux, des traits sans harmonie.»
A l'appui de cette opinion, M. Troplong a réimprimé, en tête de ces deux volumes, une savante et curieuse dissertation qu'il avait lue jadis à l'Académie des Sciences morales et politiques, et dans laquelle il a fait l'histoire de l'esprit d'association depuis les Romains jusqu'à nos jours. Nous n'analyserons pas cette remarquable dissertation, qui, selon les propres expressions de son auteur, renferme quelque chose de plus sérieux qu'un ornement scientifique. Qu'il nous suffise, pour donner une idée de son importance et de son but, d'en citer un court fragment: «La vérité est, dit M. Troplong, que le législateur du Code civil et du Gode de commerce, en réglant les conditions des sociétés par actions, ne s'est pas aventuré dans une région inconnue; qu'il n'a pas hasardé une innovation dont l'avenir seul a pu révéler les avantages ou les inconvénients. L'expérience avait été faite; depuis des siècles l'institution marchait; elle avait eu ses moments de crise à côté de ses heures de prospérité; elle était passée par les principales épreuves qui peuvent éclairer la prudence du législateur. Il est utile de constater ces précédents, qui mettent nos codes dans leur véritable cadre, parce que naguère, après certaines surprises de l'agiotage, les esprits émus s'en sont pris trop légèrement à la loi des erreurs des hommes. Au lieu de faire le procès aux intrigants devant la police correctionnelle, on a fait le procès au Code devant les Chambres... Dans tout cela on oubliait bien des choses, mais surtout l'histoire, dans laquelle on aurait vu que le passé n'est pas aussi petit, aussi dépourvu de grandes tentatives commerciales et de grands faits économiques que l'on se l'imagine... Chez ce peuple romain qui avait remué l'univers, dans ce Moyen-Age qui créa tout par l'association, dans cette Europe d'autrefois qui sut coloniser le Nouveau-Monde, sillonner les mers les plus lointaines de sa marine marchande, trouver l'assurance et le crédit, défricher, dessécher, canaliser; dans tout ce passe, si riche d'entreprises et de découvertes, soyons convaincus que la jurisprudence fut sans cesse alimentée par de grandes applications de l'esprit d'association; qu'elle en a connu l'importance et le but économique, et que, par une généralisation savante de faits industriels très-nombreux et très-compliqués, elle est arrivée à asseoir le contrat de société sur ses véritables rapports intérieurs et extérieurs, à calculer avec exactitude la force relative des valeurs que ce contrat met en action, à donner au personnel une organisation sagement étudiée, et qui, se prêtant avec souplesse aux exigences de tous les cas, réunit tour à tour les avantages de l'égalité et ceux de la hiérarchie.»
Souvenirs d'un Voyage à Munich, ou Description des principaux monuments de la ville nouvelle; par Al. Lusson, architecte des travaux publics, ancien commissaire-voyer de la ville de Paris. 1 vol. in-8 de 112 p.--Paris, 1843. M. Al. Lusson est un fanatique admirateur du roi de Bavière. Pendant son séjour à Munich, il a pris un vif plaisir à contempler et à étudier les innombrables monuments élevés «par les soins de ce prince artiste et poète, qui a compris que les sciences et les arts «ennoblissent les peuples et achèvent de les polir.» A son retour à Paris, il a publié sur Munich une brochure de 112 pages, dans laquelle les artistes et les architectes trouveront une description claire, exacte et détaillée de toutes les merveilles de cette ville que les Bavarois appellent l'Athènes du Nord.
Modes.
COSTUMES CE CHASSE.
On ne s'occupe en ce moment que de costumes de chasse. La mode, qui ordinairement ne permet presque pas de variétés dans les toilettes d'homme, est plus tolérante pour celles qui sont destinées à la chasse.
 |
Ce dessin représente un chasseur à courre; son habit est rouge; le fouet qu'il tient à la main et le couteau de chasse fixé à son ceinturon de cuir verni sortent des magasins Verdier; sa culotte de daim et ses bottes à revers complètent un costume irréprochable de grande chasse.  |
Qu'on ne suit pas étonné de voir une dame en habit de chasse à pied. Autrefois les hommes brodaient au tambour, faisaient de la tapisserie, en un mot, s'occupaient d'ouvrages de femmes pour se rapprocher d'elles; de nos jours, les élégantes se livrent aux exercices de la gymnastique et de la natation, à l'enivrement de la cigarette et aux fatigues de la chasse. Il faut bien que nous cherchions à partager les plaisirs de nos maris et de nos livres, jusqu'à ce qu'il leur plaise de revenir aux nôtres. Chaque sexe fait à son tour un pas vers l'autre, et il y a longtemps que le symbole de la mode est, comme celui de la fortune, une roue.
Amusements des Sciences.
SOLUTIONS DES QUESTIONS PROPOSÉES DANS LE DERNIER NUMÉRO.
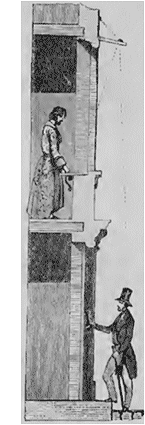
I. Puisque la marchande est arrivée au marché avec trois douzaines d'oeufs ou 36 oeufs, c'est qu'en passant au troisième corps-de-garde elle en avait le double de 36 augmenté de 1, ou 73; car elle en a laissé la moitié 36 et demi plus la moitié d'un, ou 37. De même, avant le second guichet, elle avait 147 oeufs; et avant le premier 295. Tels sont les nombres qui satisfont à la question.
II. Adossez à la face inférieure du linteau de la fenêtre un miroir que vous inclinerez un peu du côté de l'appartement, en sorte qu'il réfléchisse, à quelques décimètres de l'appui de la croisée, ou sur cet appui même, les objets placés au-devant et près de l'ouverture de la porte du rez-de-chaussée. En vous plaçant près de cet appui et en regardant dans le miroir, vous pourrez voir les personnes qui se présentent à l'entrée de la maison. Mais comme vous ne verriez, de cette manière, que l'image renversée de l'objet, ce qui le rendrait assez difficile à reconnaître; comme d'ailleurs il est fatigant et incommode de regarder de bas en haut, il sera mieux de placer sur l'appui de la croisée, à l'endroit où le premier miroir renvoie l'image, un second miroir plan à peu près horizontal, dans lequel on cherchera. On y apercevra l'image redressée de l'objet, presque comme si on le fixait de haut en bas en se mettant à la fenêtre; seulement il paraîtra à une distance un peu plus grande. Notre figure représente cet arrangement de miroirs et leur usage mis en action.
Le célèbre astronome Hévélins avait inventé, en 1657, un instrument ayant quelque analogie avec l'appareil que nous venons de décrire. Comme cet instrument, destiné à faire apercevoir par réflexion des objets qui auraient été invisibles directement, semblait à son auteur devoir être utile à la guerre, il avait reçu le nom de polémoscope (polemos, combat; scopéô, je vois); mais le polémoscope n'a probablement été jamais beaucoup employé à cet usage, et on y a renonce peut-être plus vite encore qu'aux aérostats, qui avaient eu pourtant quelque influence, au moins morale, comme chacun sait, sur le gain de la bataille de Fleurus.
NOUVELLES QUESTIONS A RÉSOUDRE.
I. Tirer par-dessus l'épaule un coup de pistolet aussi sûrement que si l'on couchait en joue.
II. Un homme est sorti de chez lui avec une certaine quantité de napoléons pour faire des emplettes. A la première, il dépense la moitié de ses napoléons et la moitié d'un; à la seconde, il dépense aussi la moitié de ses napoléons et la moitié d'un; à la troisième pareillement, et il rentre chez lui ayant dépensé tout ce qu'il avait emporte, et sans avoir jamais changé de l'or pour de l'argent. On demande combien il en avait.
III. Même question, en supposant que c'est seulement à la quatrième, à la cinquième, à la sixième emplette, etc., que tout a été dépensé.
Problème de Dessin.
SOLUTION.
La solution de ce problème est facile.--Placez le journal de côté, joignez le cou du chien dont la tête est en haut avec la queue de celui qui a la tête en bas; tracez une autre ligne parlant du coude de la patte de devant, et prolongez-la jusqu'à la patte de derrière; retournez le papier, et faites de ce côté la même opération.
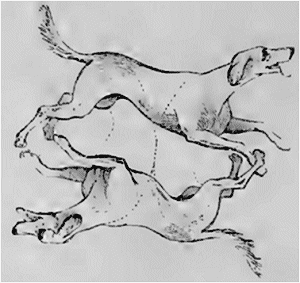
Erratum.
Quelques erreurs se sont glissées dans l'article que nous avons consacré au statuaire Cortot. Sans attendre qu'on nous les signale, nous nous empressons de les rectifier, et nous les expliquons par la difficulté de réunir en peu de jours les matériaux nombreux et épars d'une biographie inédite. Parmi les oeuvres que nous avons citées, nous avons omis de dire que les unes avaient été exécutées et placées, mais que d'autres étaient seulement à l'état de modèles. De ce nombre sont: la Justice, composée pour l'une des assises du grand escalier de la Bourse; Louis XVI et quatre figures, pour le monument expiatoire de la place Louis XVI. Nous avons confondu à tort cette dernière statue avec celle que M. Bosio a faite pour la chapelle expiatoire de la rue d'Anjou; Cortot n'a exécuté pour cet édifice que le groupe en marbre de Marie-Antoinette soutenue par la Religion.
La Ville de Paris, figure de 8 mètres (vingt-quatre pieds), fut commandée à J.-P. Cortot en même temps qu'un fleuve de 5 mètres (quinze pieds), en bronze, à M. Pradier, pour la fontaine de l'Éléphant; les modèles seuls ont été exécutés.
L'Immortalité a figuré à la porte de la Chambre des Députés, le jour de la translation des cendres de l'Empereur; mais le bronze n'en est pas encore fondu. La statue de Charles X, que plusieurs artistes nous ont dit n'avoir jamais vue, avait été faite par Cortot en 1827, avec la collaboration de M. Caillouette; elle était, avant 1850, à l'Hôtel-de-Ville. Dans notre liste des travaux de Cortot, nous avons oublié de comprendre un bas-relief pour l'arc du Carrousel, exposé en 1824, et deux villes de la place de la Concorde, Nantes et Brest.
Ce fut aux eaux de Vichy que Cortot éprouva les premières atteintes d'une hydropisie symptomatique déterminée par une autre affection dont il souffrait depuis longtemps. M. Drolling, peintre, abandonna ses travaux et ses élèves pour aller donner des soins à son ami mourant, et le ramena à Paris.
A la cérémonie funèbre, le 16 août, les coins du poète étaient tenus par MM. Raoul-Rochette, Bosio, Blondel et Jarry de Maney, professeur d'histoire à l'École des Beaux-Arts. M. Émery représentait la famille. Nous avons donné une analyse fidèle des discours que nous avons entendus et que nous avons sous les yeux, imprimés par Firmin Dudot pour être distribués aux membres de l'Institut.
Ces rectifications prouveront à nos lecteurs que nous n'épargnons rien pour être d'une rigoureuse exactitude.
Rébus.
EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS.
Un effet de lune.
TROIS CITATIONS CLASSIQUES.