FAITES
A L’ÉCOLE SPÉCIALE DES LANGUES ORIENTALES
PAR
L É O N D E R O S N Y
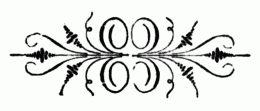
PARIS
ERNEST LEROUX, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE PARIS
DE L’ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES, ETC.
28, RUE BONAPARTE, 28
—
1883
Title: La civilisation japonaise
Author: Léon de Rosny
Release date: August 16, 2012 [eBook #40516]
Most recently updated: October 23, 2024
Language: French
Credits: Produced by Guillaume Doré, Chuck Greif and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive)
| Notes de transcription: Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. |
CONFÉRENCES
FAITES
A L’ÉCOLE SPÉCIALE DES LANGUES ORIENTALES
PAR
L É O N D E R O S N Y
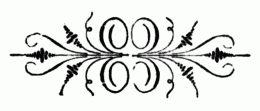
PARIS
ERNEST LEROUX, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE PARIS
DE L’ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES, ETC.
28, RUE BONAPARTE, 28
—
1883

 E
volume fait partie de la série de publications que j’ai entreprises
pour l’usage des personnes qui veulent étudier la langue et la
littérature japonaise. Il se compose de douze conférences[1] préparées
conformément au programme des examens de l’École spéciale des Langues
Orientales. J’ai essayé d’y réunir, sous une forme nécessairement très
succincte, les principales données ethnographiques, géographiques et
historiques qui sont indispensables à quiconque est appelé à résider au
Japon ou à se trouver en contact avec les indigènes de ce pays.
E
volume fait partie de la série de publications que j’ai entreprises
pour l’usage des personnes qui veulent étudier la langue et la
littérature japonaise. Il se compose de douze conférences[1] préparées
conformément au programme des examens de l’École spéciale des Langues
Orientales. J’ai essayé d’y réunir, sous une forme nécessairement très
succincte, les principales données ethnographiques, géographiques et
historiques qui sont indispensables à quiconque est appelé à résider au
Japon ou à se trouver en contact avec les indigènes de ce pays.
Outre les faits relatifs aux insulaires de l’extrême Orient, j’ai tenu à donner à mes élèves quelques notions relatives à l’histoire et à la littérature de la Chine, parce que c’est de ce pays que le Japon tire sa culture intellectuelle et un nombre considérable de mots de sa langue.
J’avais eu l’intention de joindre en appendice toute une série de documents et d’index utiles pour les étudiants. J’ai dû renoncer à ce projet pour ne pas dépasser de beaucoup le nombre de pages réglementaire des volumes de la Bibliothèque Orientale elzévirienne dans laquelle sont publiées ces conférences. Ces documents et ces index, plus nombreux et plus développés qu’ils ne devaient l’être, formeront un volume spécial que j’espère être à même de mettre bientôt sous presse, et qui sera publié sous titre de Manuel du Japoniste[2].
Ce nouveau volume sera le complément naturel et indispensable des ouvrages classiques que je fais paraître depuis quelques années sous le titre général de Cours pratique de Japonais. La publication de ce recueil se poursuit sans interruption, bien que plus lentement que je ne l’aurais désiré; et quelques-uns de ses volumes ont été déjà l’objet de plusieurs éditions[3], tandis que d’autres n’ont pas encore été imprimés pour la première fois.
Bien que mes instants soient, en ce moment, consacrés à un travail d’érudition japonaise et chinoise[4], je me propose de mettre sous presse un nouveau volume de mon Cours pratique aussitôt après avoir fait paraître la troisième édition de la première partie de ce Cours qui est complètement épuisée depuis près d’une année. Je continuerai de la sorte à faire mes efforts pour rendre de plus en plus facile l’étude de l’idiome dont l’enseignement m’a été confié à l’École spéciale des Langues Orientales.
Nogent-sur-Marne, le 3 mai 1883.
LÉON DE ROSNY.

 L me paraît utile, au début des études que nous allons entreprendre, de
jeter un coup d’œil rapide sur les principales divisions
ethnographiques que les progrès de la science ont permis d’établir au
sein de ce vaste continent d’Asie, dont les Japonais occupent la zone la
plus orientale.
L me paraît utile, au début des études que nous allons entreprendre, de
jeter un coup d’œil rapide sur les principales divisions
ethnographiques que les progrès de la science ont permis d’établir au
sein de ce vaste continent d’Asie, dont les Japonais occupent la zone la
plus orientale.
Les premiers essais de classement des populations asiatiques sont dus aux orientalistes. Ces essais ont projeté de vives lumières sur le problème, mais elles ne l’ont point résolu, parce que les orientalistes, au lieu de se préoccuper de tous les caractères des races et des nationalités, se sont à peu près exclusivement attachés à un seul de ces caractères, celui qui résulte de la comparaison des langues.
Les orientalistes ont fait, d’ailleurs, ce qui a été fait à peu près pour tous les genres de classification scientifique. En botanique, par exemple, à l’époque de Tournefort, on attachait une importance exceptionnelle à la forme de la corolle; Linné, le grand Linné, ne portait guère son attention que sur les organes sexuels des végétaux. La classification ne pouvait être définitivement acceptée que lorsqu’avec les Jussieu, les familles de plantes ont été fondées sur l’ensemble de leurs caractères physiologiques.
Il devait en être de même pour la classification des peuples. L’affinité des langues peut certainement nous révéler des liens de parenté entre nations; mais ces affinités sont souvent plus apparentes que réelles. Les peuples vaincus ont parfois adopté la langue de leurs vainqueurs, sans que pour cela il y ait eu, entre les uns et les autres, le moindre degré de consanguinité, la moindre communauté d’origine. La colonisation a souvent transporté fort loin l’idiome d’une nation maritime, et l’a fait accepter par des tribus on ne peut plus étrangères les unes aux autres. Nous parlons en Europe des langues dont le sanscrit est un des types les plus anciens; mais, s’il est établi qu’il existe une famille de langues aryennes ou indo-européennes, personne n’oserait plus soutenir aujourd’hui qu’il existât une famille ethnographique aryenne et indo-européenne. Au premier coup d’œil, on reconnaît l’abîme qui sépare le Scandinave aux cheveux blonds et au teint rosé, de l’Indien aux cheveux noirs et au teint basané. Personne, non plus, ne voudrait soutenir que les naturels des îles de l’Océanie, où l’anglais est devenu l’idiome prédominant, aient des titres quelconques de parenté avec les habitants de la fraîche Albion.
Les caractères anthropologiques, d’ordinaire plus persistants que les caractères linguistiques, sont à eux seuls également insuffisants pour établir une classification ethnographique solide. Le métissage a, dans tous les temps et sous tous les climats, profondément altéré les caractères ethniques. Il n’est point possible de répartir dans deux familles différentes les Samoièdes qui habitent le versant oriental de l’Oural et ceux qui vivent sur le versant occidental de cette montagne. Les uns cependant appartiennent, au moins par la couleur de la peau, à la race Jaune, tandis que les autres font partie de la race Blanche.
Lorsque l’histoire ne nous fait pas défaut, c’est à l’histoire que nous devons emprunter les données fondamentales de la classification des peuples. Lorsque l’histoire manque, alors, mais alors seulement, nous devons recourir, pour reconstituer des origines ethniques sans annales écrites, à la comparaison anthropologique des types, aux affinités grammaticales et lexicographiques des langues, à la critique des traditions et à l’exégèse religieuse, aux formes et à l’esprit de la littérature, comme aux manifestations de l’art, et demander à ces sources diverses d’information les rudiments du problème que nous nous donnons la mission de résoudre, ou tout au moins d’éclaircir ou d’élaborer[5].
Trois grandes divisions nous sont signalées tout d’abord dans le vaste domaine de la civilisation asiatique.
La première et la moins étendue est occupée par les Sémites qui habitent surtout le sud de l’Asie-Mineure, sur les deux rives de l’Euphrate et du Tigre, la péninsule d’Arabie, la côte nord-est du golfe Persique et quelques îlots, provenant pour la plupart de migrations israélites et musulmanes, au cœur et au sud-est de l’Asie.
La seconde division est peuplée par les Hindo Iraniens, dont les linguistes ont formé le rameau oriental de leur grande famille aryenne, famille dans laquelle ils ont incorporé la plupart des populations de l’Europe. Le foyer primitif de ce groupe ne doit pas être placé, comme on le fait trop souvent, dans la péninsule même de l’Hindoustan, mais au nord-ouest de cette péninsule. Les Aryens ne sont, dans l’Inde, que des conquérants, superposés sur les Dravidiens autochtones, aujourd’hui refoulés vers la pointe sud de la presqu’île Cis-Gangétique et à Ceylan.
La troisième division, qui comprend une foule de nations diverses, a été considérée par quelques auteurs comme le domaine d’un prétendu groupe dit des Touraniens. Jadis, on aurait avoué simplement son ignorance au sujet de ces nations; et, sur la carte ethnographique de l’Asie, on se serait borné à une mention vague, telle que «populations non encore classées». Aujourd’hui, on a honte de dire qu’on ne connaît pas encore le monde tout entier: on aime mieux débiter des erreurs que d’avoir la modestie de se taire.
Je me propose de m’étendre un peu sur cette prétendue famille touranienne; car c’est, en somme, celle qui doit nous intéresser le plus ici, puisque les Japonais devront être compris dans ce troisième groupe des populations asiatiques.
Du moment où il s’agit de désigner une idée nouvelle, et, dans l’espèce, une nouvelle circonscription ethnographique, il est presque toujours nécessaire de créer un mot nouveau. Le choix heureux de ce mot n’est pas tellement indifférent pour le progrès de la science, qu’il ne vaille la peine de le chercher avec le plus grand soin. L’emprunt à la Genèse des noms de Japhétiques, Sémitiques et Chamitiques, pour servir à la classification des races humaines, a poussé l’ethnographie dans des ornières dont il est bien difficile de la faire sortir. Je craindrais, pour ma part, que la dénomination de Touranien, si elle était définitivement acceptée, entraînât la science des nations dans des erreurs bien autrement funestes encore. D’abord, cette dénomination manque non-seulement de précision, mais, par suite du sens que les linguistes lui attribuent aujourd’hui, elle signifie deux choses très différentes. Touran, pour les Perses de l’antiquité, n’a jamais été la désignation d’un peuple particulier; autant vaudrait admettre, comme terme de classification, les noms de Refaïm et de Zomzommin donnés aux populations à demi-sauvages que les Sémites rencontrèrent à leur arrivée dans la région biblique où ils se sont établis. Pour les linguistes, au contraire, il faut entendre par Touraniens à peu près tous les peuples asiatiques qui ne sont ni Aryens, ni Sémites. Dans les tableaux qu’on publie journellement pour la classification de ces peuples, je vois figurer côte à côte les Finnois, les Hongrois et les Turcs, dont les affinités paraissent certaines, les populations que M. Beauvois a réunies sous le nom de Nord-Atlaïques, les populations Mongoliques, les Mandchoux, les Coréens, les Japonais, parfois même les Chinois, les Malays, c’est-à-dire les Océaniens et les Dravidiens. Or, comme la parenté de ces derniers peuples avec les Nord-Altaïens,—possible, je le veux bien,—est encore loin d’avoir été établie d’une manière scientifique, le nom de Touranien n’est guère plus explicite, suivant moi, que le mot terra incognita, sur nos vieilles cartes géographiques. Et, si l’intention des ethnographes était de faire usage d’une dénomination générale pour tous les peuples asiatiques que nos connaissances ne nous permettent pas encore de classer sérieusement, je préférerais de beaucoup le nom d’Anaryens (non Aryens), que M. Oppert a employé dans ses premiers travaux sur l’écriture cunéiforme du second système. Les Aryens, sur lesquels repose la constitution de la grande famille linguistique successivement appelée indo-germanique, indo-européenne et aryenne, forment en effet le seul groupe considérable des peuples de l’Asie dont la parenté ait été définitivement établie, sinon au point de vue de l’anthropologie, au moins en raison des affinités de leurs idiomes respectifs. Le procédé par voie d’exclusion ne saurait donc, en ce cas, nuire à la clarté de la doctrine, et, provisoirement, je préfère adopter la dénomination d’Anaryens, pour les peuples sur lesquels je dois fixer votre attention.
Le groupe des peuples anaryens de l’Asie, dont l’unité n’a pas encore été établie par la science, comprend plusieurs familles, sur lesquelles vous me permettrez de vous dire quelques mots.
La famille Oural-Altaïque s’étend depuis la mer Baltique et la région des Carpathes à l’ouest, jusqu’aux limites orientales de la Sibérie à l’est.
Cette famille se subdivise en quatre rameaux principaux:
Le rameau septentrional comprend les Finnois et les Lapons au nord de l’Europe;—les Samoïèdes répandus au nord-est de la Russie et au nord-ouest de la Sibérie;—les Siriænes, au nord et à l’ouest de la rivière Kama;—les Wogoules, entre la Kama et les monts Ourals, d’une part, et sur la rive gauche de l’Obi, de l’autre;—les Ostiaks, des deux côtés de l’Iénisseï.
Le rameau occidental se compose des Hongrois, répartis dans de nombreux îlots, situés dans la région du Danube et de deux de ses affluents, la Theiss et le Maros.
Le rameau méridional comprend les Turcs qui occupent, en Europe, non point la contrée connue en géographie sous le nom d’Empire Ottoman, mais seulement quelques îlots disséminés çà et là dans cette contrée; l’Asie-Mineure, à l’exception de la zone maritime occupée surtout par des colonies helléniques; et une vaste étendue de territoire au nord de la Caspienne et de l’Aral, prolongé jusqu’aux versants occidentaux du Petit-Altaï. Il faut rattacher à ce rameau, les Iakoutes, habitants des deux rives de la Léna et d’une partie de la rive droite de l’Indighirka, ainsi que de l’embouchure de ce fleuve, où ils vivent côte à côte avec les Toungouses et les Youkaghirs.
Le rameau oriental, enfin, se compose des Youkaghirs, des Koriaks et des Kamtchadales.
La famille Tartare comprend les rameaux suivants:
Le rameau Kalmouk-Volgaïen, composé de tribus Euleuts ou Kalmouks, au nord-ouest de la mer Caspienne, sur les rives du Volga, s’étendant à l’ouest non loin des rives du Don, et formant plusieurs îlots dans la partie sud-ouest de la Russie d’Europe; et le rameau Altaïen, comprenant les Kalmouks répandus dans la région du lac Dzaïsang;
Le rameau Baïkalien, comprenant les Bouriæts de la région du lac Baïkal;
Le rameau Mongolique, composé de plus de deux millions et demi de Tatares-Mongols, habitant le nord de la Chine, depuis le lac Dzaïsang et les monts Kouën-lun à l’ouest, jusqu’au territoire occupé par les Mandchoux à l’est;
Le rameau Toungouse comprenant les Toungouses, chasseurs et pasteurs, errant surtout dans le bassin de la Léna et sur les rivages de l’Océan Glacial, au-delà de la limite des terres boisées, en face de l’archipel inhabité de la Nouvelle-Sibérie, et à l’embouchure de la rivière Kolima:—les Lamoutes, pêcheurs, sur les rivages occidentaux de la mer d’Ockostk;—les Mandchoux, sur les bords du fleuve Amoûr, principalement sur sa rive droite.
La famille Dravidienne, composée des anciennes populations autochtones de l’Inde, aujourd’hui refoulées dans la partie méridionale de cette péninsule et dont les langues paraissent avoir des affinités avec les idiomes tartares, se compose des rameaux suivants:
Le rameau septentrional, composant les Télinga ou Télougou, dans la région du Dékhan;
Le rameau occidental, formé des Indiens Karnataka, à l’ouest des précédents,—et des Indiens Toulou, au sud;
Le rameau méridional, formé des Indiens Malayalam, sur la côte de Malabar;
Enfin, le rameau oriental, formé du peuple Tamoul, qui occupe la côte de Coromandel et la pointe septentrionale de l’île de Ceylan.
En dehors de ces familles à peu près définies, nous trouvons encore, dans le vaste groupe des anaryens, plusieurs nations d’une importance considérable, dont la situation ethnographique n’a pas été reconnue jusqu’à présent d’une façon satisfaisante et qui, par ce fait, semblent former autant de familles distinctes, savoir:
La famille Sinique, composée des Chinois, implantés, environ trente siècles avant notre ère, sur le territoire occupé primitivement par les Miaotze, les Leao, les Pan-hou-tchoung, les Man, et autres populations autochtones; des Cantonais et des Hokkiénais, habitants des côtes orientales de la Chine, qui parlent un dialecte dans lequel on retrouve de nombreuses traces d’archaïsme;
La famille Tibétaine, qui est répandue dans le petit Tibet, le Ladakh, le Tibet, le Népâl, le Bhotan, dans la partie sud-ouest de la province chinoise du Ssetchouen, et dans quelques îlots situés dans les provinces du Kouang-si, du Koueitcheou et au nord-ouest de la province du Kouang-toung;
La famille Annamite, comprenant les populations du Tong kin et de la Cochinchine;
La famille Thaï, composée des Siamois.
Je vous demande la permission de ne pas m’occuper des Barmans et des Cambogiens, dont la situation ethnographique est encore difficile à déterminer, et qui, en tout cas, paraissent étrangers au groupe de peuples que nous avons, en ce moment, la mission d’étudier ensemble.
Les affinités plus ou moins nombreuses que l’on peut constater entre ces peuples, sont tantôt des affinités anthropologiques, tantôt des affinités linguistiques.
Vous connaissez tous le type chinois, et, pour l’instant, je ne parle de ce type qu’au point de vue de ses caractères reconnaissables par le premier venu. Vous connaissez peut-être un peu moins le type mongol et le type japonais, ou plutôt vous devez bien souvent confondre ceux-ci et celui-là. C’est qu’il existe, en effet, entre ces types, des traits de la plus étonnante ressemblance. Si vous avez vu des Samoïèdes, des Ostiaks, des Tougouses, des Mandchoux, des Annamites, des Siamois, que sais-je, des indigènes d’à peu près toute la zone centrale et sud-orientale de l’Asie, vous avez dû vous trouver porté à la même confusion. Il n’est pas nécessaire de sortir d’Europe pour rencontrer ces individus aux cheveux noirs, à la face large et aplatie, aux yeux bridés, aux pommettes saillantes, aux lèvres épaisses, à la barbe rare, autant de caractères frappants s’il en fût; il ne faut pas même aller jusqu’à Kazan: à Moscou, dans tout le cœur de la Russie, et même à Pétersbourg, cette ville finno-allemande, vous rencontrez, à chaque instant, le type sui generis dont je viens de vous rappeler les principaux traits.
Au premier abord, il y a donc une présomption pour croire à l’existence d’une grande famille, composée de tant de nations non pas précisément douées d’un type identique, mais d’un type fortement marqué du stigmate de la parenté:
Les affinités linguistiques sont naturellement moins faciles à reconnaître. Les vocabulaires de ces peuples n’offraient, aux yeux des philologues de la première moitié de ce siècle, que de rares homogénéités, et la tendance était de croire à un ensemble de familles de langues essentiellement différentes les unes des autres. Il faut dire que ce n’est guère que depuis une vingtaine d’années, que plusieurs des idiomes les plus importants de ce groupe ont été étudiés d’une façon approfondie. En outre, les formes archaïques du chinois, idiome considérable par son antiquité et par son développement, étaient à peu près complètement ignorées. Les caractères fondamentaux des mots chinois étaient peut-être plus difficiles à reconnaître que ceux des racines des autres langues, par suite de la forme monosyllabique et uniconsonnaire de ces mots. On comparait de la sorte gratuitement, avec le vocabulaire de toutes sortes d’idiomes de l’Asie Centrale, les monosyllabes des dialectes de Péking et de Nanking, qui sont ceux qui ont subi avec le temps les plus graves altérations. La reconstitution de la langue chinoise antique nous a signalé notamment l’existence ancienne de thèmes bilitères, c’est-à-dire de racines composées d’une voyelle intercalée entre deux consonnes, racines analogues aux racines primitives des langues sémitiques et des langues aryennes[6]. Ces thèmes bilitères ont été d’une valeur sans pareille pour arriver à des rapprochements d’une rigueur philologique incontestable: ils ont permis de constater des affinités certaines et jusqu’alors inaperçues entre les glossaires chinois, japonais, mandchou, mongol, etc.
Des affinités certaines, je le répète, ont été constatées par ce moyen; mais ces affinités sont encore insuffisantes pour donner lieu à de larges déductions. Des rapports de vocabulaires ont même été signalés entre des rameaux bien autrement éloignés. Le turc et le japonais, par exemple, possèdent des mots dont la ressemblance est certainement de nature à faire réfléchir les linguistes. Quelques rapprochements ont été tentés aussi avec le magyar, langue sœur du finnois et du turc, et le tibétain, langue apparentée au mongol, et dans une proportion non encore déterminée, au chinois[7]. Le coréen possède enfin des désinences de déclinaison et de conjugaison semblables à celles du japonais[8].
Mais ce qui est bien autrement important que ces assimilations sporadiques de mots et de vocables, c’est l’unité du système grammatical qui caractérise l’ensemble des langues du groupe sur lequel j’appelle, en ce moment, votre attention. Cette unité est telle, qu’une phrase turque, par exemple, peut généralement se traduire en japonais sans qu’un seul mot ou particule occupe, dans une de ces deux langues, une place différente de celle qu’il occupe dans l’autre. Et remarquez que la grammaire japonaise se distingue de la grammaire des langues aryennes et des langues sémitiques, par une syntaxe essentiellement originale. Dans cette langue, comme en mantchou, en tibétain et en turc, la construction phraséologique est rigoureusement inverse. En japonais, comme en turc, pour dire: «j’ai vu hier le gouverneur chassant sur les bords du Coïk avec ses chiens», on construira: hesterno-die Coici littore-suo-in, canibus-sui cum, Alepi præfectum-suum vidi;—en mandchou, comme en japonais, pour dire «habitant de la ville de Nazareth, dans la province de Galilée», on construira: Galileæ provinciæ Nazareth vocatam civitatem incolens; en tibétain, comme en japonais, pour dire: «As-tu vu ma (bien-aimée) appelée Yidp’ro?», on construira: mea Yidp’ro sic vocata te a prospecta fuitne?
Dans toutes ces langues, le qualificatif, quelqu’il soit, adjectif ou adverbe, précède le mot qualifié. Pour dire: «les hommes de la haute montagne, on construira, alti montis homines.—Le régime direct précède le verbe; pour dire: «il a vu la pierre dans la montagne,» on construira, montis interiore-in lapidem vidit.—Les particules de condition sont des postfixes; en d’autres termes, au lieu et place de nos prépositions, nous trouvons des postpositions.—Enfin, pour donner encore un exemple de similitude syntactique, je rappellerai la manière d’exprimer le comparatif par une simple règle de position, avec le concours de la postposition de l’ablatif, jointe à l’objet aux dépens duquel est faite la comparaison[9].
Quelques noms de peuples, compris dans les groupes que j’ai énumérés tout à l’heure, sollicitent également l’attention. La dénomination d’Ougriens, donnée aux peuples de l’Oural, vient de l’ostiak ôgor «haut»; elle pourrait bien être la même que celle de Mogol ou Mongol, bien que ce dernier nom soit expliqué comme signifiant «brave et fier»[10]. Le correspondant turc de ôgor est ioughor et ouighor, qui, à son tour, rappelle le nom des Ouigours. D’autre part, le nom de Vogoules et celui des Ungari ou Hongrois, ont été rattachés à cette même racine ostiake Ogor[11]. Enfin, on nous donne le nom de Moger, nom dont on ignore le sens[12], comme la plus ancienne appellation des Magyars ou Hongrois: ce nom renferme les trois consonnes radicales du mot Mogol, car on sait que l’l et l’r se permutent sans cesse dans les idiomes de l’Asie moyenne, idiomes qui ne possèdent quelquefois qu’une seule de ces deux articulations semi-voyellaires. Ces étymologies, que je vous donne pour ce qu’elles peuvent valoir, ne sont cependant pas plus impossibles que celle qui rapproche le nom Sames des Lapons, de celui des Finnois, dont le pays est appelé Suom-i.
Des affinités anthropologiques et linguistiques dont je viens de vous entretenir, que pouvons-nous déduire?—Non point encore une certitude au sujet de l’origine des Japonais et de leur parenté avec les nations de la terre ferme, mais du moins des arguments de nature à consolider une hypothèse, suivant laquelle les Japonais seraient une émigration du continent asiatique. Si cette hypothèse doit être un jour établie d’une manière rigoureusement scientifique, il est hors de doute que la date de cette migration sera reportée à une époque fort ancienne, et sans doute antérieure à la fondation des grands empires historiques de l’Asie Centrale et Orientale. Si, cependant, la critique historique admettait pour cette migration le siècle de l’arrivée au Japon de Zin-mou, premier mikado de cet archipel, c’est-à-dire le VIIe siècle avant notre ère, il ne faudrait pas trouver une objection contre cette doctrine dans le silence des historiens chinois au sujet de ce grand mouvement ethnique. L’avénement de Zin-mou et son établissement dans le palais de Kasiva-bara, 660 ans avant notre ère, sont antérieurs d’un siècle à la naissance de Confucius. Or l’histoire rapporte que c’est à ce célèbre moraliste que la Chine doit la possession de ses annales primitives, reconstituées par ses soins à l’aide des documents conservés dans les archives impériales des Tcheou. Si l’on étudie, d’une part, dans quelles conditions difficiles Confucius put réaliser cette œuvre gigantesque d’érudition, et, d’autre part, si l’on tient compte du parti pris par ce philosophe de ne livrer à la postérité que ce que l’histoire ancienne de son pays pouvait offrir de bons exemples à ses compatriotes pour les moraliser et leur faire accepter ses enseignements, on ne s’étonnera point qu’il ait négligé de recueillir les données qu’on pouvait avoir, à son époque, sur l’émigration de Zin-mou.
Dans l’hypothèse que nous examinons, cette émigration serait venue d’un grand foyer de civilisation anaryenne, car Zin-mou n’apparaît point au Nippon comme un chef de sauvages ou de barbares, mais bien comme le prince d’une nation polie et déjà avancée en civilisation. Ce foyer, où le trouver, si ce n’est en Chine? A moins que nous nous décidions à l’aller chercher chez ce peuple anaryen auquel M. Oppert attribue l’invention de l’écriture cunéiforme.
L’identité à peu près absolue du système de l’écriture cunéiforme anaryenne et du système de l’écriture japonaise viendrait, au besoin, à l’appui de cette audacieuse théorie. Il est, en effet, très singulier de trouver chez deux peuples étrangers l’un à l’autre une invention aussi compliquée, aussi originale que le système de l’écriture cunéiforme anaryenne et de l’écriture japonaise[13]. Des signes figuratifs, employés tantôt avec la valeur de l’objet qu’ils représentent, tantôt avec une valeur purement phonétique; des signes polyphones, c’est-à-dire susceptibles d’être lus de plusieurs manières différentes, suivant le contexte de la phrase; des mots écrits partie en caractères idéographiques, partie en caractères phonétiques; tant de procédés graphiques employés simultanément et dans les mêmes conditions chez deux peuples, ont à coup sûr quelque chose d’étonnant, d’énigmatique, qui provoque malgré soi dans l’esprit l’hypothèse d’une origine commune. Cette hypothèse, je vous conseille de ne l’accueillir qu’avec réserve, comme on doit accueillir une hypothèse non encore démontrée. Dans l’obscur dédale des origines ethniques, il faut envisager en même temps toutes les possibilités et se défier de toutes les vraisemblances.
Je me résume: les Japonais sont des étrangers dans l’archipel qu’ils habitent aujourd’hui. Leur provenance du continent asiatique est peu douteuse, mais la route de leurs migrations primitives, que divers ordres de faits font entrevoir sur la carte d’Asie, est encore environnée de ténèbres et de mystères. Ils ne sont point venus d’Océanie, comme l’ont supposé quelques ethnographes, encore moins d’Amérique: le sang mongolique coule dans leurs veines, l’esprit tartare a procédé à la formation de leur grammaire, et probablement aussi de leur vocabulaire. Leurs aptitudes civilisatrices, le caractère chercheur, inquiet de leur génie national, ne permet point de les croire Chinois d’origine, à moins que les effets du métissage aient produit en eux une prodigieuse transformation intellectuelle.
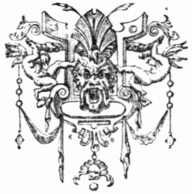
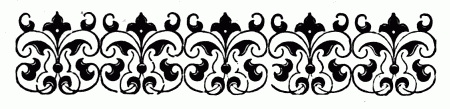
 VANT de nous occuper de l’étude ethnographique et historique de
l’émigration qui s’est établie au Japon, près de sept siècles avant
notre ère et y a répandu les germes de la civilisation extraordinaire
que nous y rencontrons aujourd’hui, il me semble nécessaire de jeter un
coup-d’œil rapide sur la constitution géographique de l’archipel
japonais.
VANT de nous occuper de l’étude ethnographique et historique de
l’émigration qui s’est établie au Japon, près de sept siècles avant
notre ère et y a répandu les germes de la civilisation extraordinaire
que nous y rencontrons aujourd’hui, il me semble nécessaire de jeter un
coup-d’œil rapide sur la constitution géographique de l’archipel
japonais.
S’il était possible de plonger les regards jusque dans les profondeurs géologiques de l’Extrême-Orient, vers ces lointains pays, au-delà desquels toute terre disparaît pour laisser le champ libre à un océan immense, un spectacle imposant viendrait, à coup sûr, frapper notre imagination. Du sein d’un vaste foyer souterrain, un fleuve de lave et de feu, sillonnant les artères du sol, contourne, aux environs de l’équateur, l’archipel Malay, d’où il atteint, par les Molusques et les Philippines, la pointe méridionale de Formose qu’il traverse longitudinalement pour gagner ensuite, par l’archipel des Lieou-kieou, les trois grandes îles du Japon, et aller, en se bifurquant au-delà des Kouriles, à la pointe du Kamtchatka, se perdre dans les glaces éternelles des régions polaires. De distance en distance, la force de ce brasier souterrain, qui entoure comme d’une ceinture de feu les confins orientaux du vieux monde, se manifeste, soit par des soulèvements telluriques, soit par de nombreux cratères d’où s’exhale une haleine de soufre et de fumée. Ainsi s’explique le système orographique de ces étranges contrées, et les phénomènes hydrographiques qui se manifestent non-seulement dans l’intérieur des terres, mais encore et surtout au sein des eaux tourbillonnantes des mers de la Chine et du Japon.
Œuvre de longues et terribles commotions géologiques, l’archipel japonais, ce long cordon de plus de 3,850 îles et îlots, qui ne compte pas moins de onze cents lieues d’étendue, depuis l’extrémité septentrionale de Formose jusqu’au cap Lopatka, se caractérise par une succession de chaînes de montagnes, dont plusieurs présentent encore de nos jours d’énormes cratères en ébullition. Ces bouches, sans cesse béantes et toujours prêtes à vomir des torrents de lave et de cendres, peuvent être considérées comme des soupapes de sûreté sans lesquelles le pays serait exposé périodiquement aux plus épouvantables révolutions.
L’issue que fournissent ces bouches ne suffit cependant pas pour calmer le tempérament impétueux de la fournaise sans cesse en travail dans les profondeurs de ces régions. Des tremblements de terre d’une violence extrême viennent de temps à autres, signaler les crises du fléau emprisonné dans les entrailles du sol.
Un des plus anciens cataclysmes de ce genre dont l’histoire fasse mention, est le soulèvement de la colossale montagne ignivome nommée le Fuzi-yama[14], l’an 286 avant notre ère, époque avec laquelle coïncide l’arrivée de la première émigration chinoise au Japon rapportée dans l’histoire. Cette montagne, située un peu au sud-ouest de la ville de Yédo, sur la frontière des provinces de Sourouga et de Kaï, a la forme d’une pyramide tronquée, dont l’élévation atteint près de 4,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. «Sous le règne de l’empereur Kwanmou, la 19e année de l’ère Yen-reki, une éruption du Fuzi-yama dura plus d’un mois[15]. Pendant le jour, l’atmosphère était obscurcie par la fumée du cratère en combustion; pendant la nuit, l’éclat de l’incendie illuminait le ciel. On entendait des détonations semblables au tonnerre. Les cendres que lançait le volcan, tombaient comme de la pluie. Au bas de la montagne, les rivières étaient de couleur rouge[16]».
En 864, le 5e mois, une éruption encore plus épouvantable vint répandre la terreur dans la contrée. Le Fouzi-yama fut en feu pendant dix jours, et son cratère lança à de grandes distances d’énormes éclats de roches, dont quelques-uns tombèrent dans l’océan, à une distance de trente ri. De nombreuses habitations furent détruites, et une centaine de familles riveraines furent ensevelies dans le désastre.
Les annales japonaises citent une autre éruption de ce volcan, au XVIIIe siècle. Durant la nuit du 23e jour du 11e mois de l’année 1707, on ressentit successivement deux tremblements de terre, à la suite desquels le Fouzi-yama s’enflamma. Des tourbillons de fumée, accompagnés de violentes projections de cendres, de terre calcinée et de pierres, se répandirent dans les campagnes avoisinantes à une distance de plus de dix ri.
Actuellement le volcan le plus actif du Japon est le Wun-zen daké ou «Montagne des Sources d’eau chaude», situé dans la province de Hizen. Sa hauteur est de plus de 1,200 mètres. Une de ses plus terribles éruptions a eu lieu en 1792[17].
L’île de Yézo n’a pas encore été explorée d’une manière quelque peu satisfaisante. On sait cependant que cette île, très montagneuse, est essentiellement volcanique. M. Pemberton Hodgson, consul britannique a fait en 1860, dans cette île, l’ascension d’un volcan qui ne mesurait pas moins de 4,000 pieds d’élévation. L’archipel des Kouriles renferme au moins douze volcans, dont la jonction souterraine est révélée par ceux qui se rencontrent au Kamtchatka, et parmi lesquels il en est actuellement quatorze en pleine activité.
Les Japonais, les habitants des campagnes surtout, vivent sous l’empire de la terreur que leur causent ces volcans qui menacent sans cesse de se rallumer, comme les anciens Mexicains vivaient dans la crainte perpétuelle de voir se renouveler les effroyables inondations diluviennes qui avaient jadis bouleversé leur pays. La légende nationale fait voir, dans les profondeurs des montagnes volcaniques, les divinités infernales de leur mythologie. Kæmpfer rapporte que les bonzes japonais ont profité de la crédulité populaire pour placer dans toutes les régions sulfureuses et volcaniques des lieux d’expiation destinés aux hommes fourbes et méchants. C’est ainsi qu’ils attribuent aux marchands de vin qui ont trompé leurs pratiques, le fond d’une fontaine bourbeuse et insondable; aux mauvais cuisiniers, une source à écume blanche et épaisse comme de la bouillie; aux gens querelleurs, une autre source chaude où l’on entend sans discontinuer d’effroyables détonations souterraines, etc., etc.[18].
La constitution essentiellement volcanique de l’Extrême-Orient a causé, à diverses époques, de brusques soulèvements de montagnes ou d’îles qui se sont conservées jusqu’à nos jours. En 764 de notre ère, trois îles nouvelles apparurent soudainement au milieu de la mer qui baigne les côtes du district de Kaga-sima, et aujourd’hui on y trouve une population laborieuse qui s’y adonne à l’agriculture et au commerce. Les écrivains japonais citent également une montagne qui s’élança du sein de la mer de Tan-lo (au sud de la Corée), vers l’an 100 de notre ère. Au moment où cette montagne commença à surgir du milieu des flots, des nuages vaporeux répandirent dans l’espace une profonde obscurité, et la terre fut ébranlée par de violents coups de foudre. L’obscurité ne se dissipa qu’au bout de sept jours et de sept nuits. Cette montagne mesurait mille pieds et avait une circonférence de quarante ri. Des vapeurs et de la fumée environnaient sans cesse son sommet, et elle ressemblait à un immense bloc de soufre.
Le Japon est un domaine neptunien. Le plus grand océan du monde, le frère aîné de notre Atlantique, baigne ses côtes orientales; et, du côté de l’occident, la mer furibonde des typhons et des tempêtes mugit avec fracas sur les innombrables rochers qui hérissent ses bords. D’énormes glaçons, détachés des eaux du Kamtchatka et du détroit de Behring, s’avancent vers ses côtes boréales, avant-garde des mers polaires; tandis que ses rivages du sud sont battus par les vagues gigantesques des mers tropicales.
Un courant d’eau chaude, sombre, noire, salée, parsemée de fucus flottants, vient promener sa course vagabonde sur les côtes du Japon et, de là, sur toute l’étendue du Pacifique, dans la direction du nord-est. Respectueux sur son passage, l’océan retire ses ondes verdâtres et le laisse tracer librement sa route semblable à une voie lactée des mers terrestres, pour me servir d’une expression assez originale de l’hydrographe Maury.
Issu du grand courant équatorial, le Kuro-siwo, c’est-à-dire le «Courant Noir», comme l’appellent les Japonais, commence à se manifester à la pointe méridionale de l’île de Formose, d’où il atteint d’un côté la mer de Chine, tandis que de l’autre il se dirige vers le nord, baignant ainsi toute la côte du Japon jusqu’au détroit de Tsougar. La rapidité qu’il donne aux navires emportés avec lui vers le nord-est est considérable. D’abord, de 35 à 40 milles par jour, cette vitesse s’accroît parfois jusqu’à 72 et 80 milles par vingt-quatre heures, aussitôt qu’on atteint la latitude de Yédo. Sa puissante influence sur le climat des îles du Japon s’étend jusqu’aux rivages de la Californie et de l’Orégon. Des varechs flottants, d’une espèce assez semblable au fucus natans du Gulf-Stream (courant de l’océan Atlantique), se rencontrent en quantité sur tout son parcours.
Un contre-courant aux eaux froides, et sans doute issu des mers glaciales, vient côtoyer le Kouro-siwo et rendre plus sensible la différence de température de ses eaux. Partout, en dehors des côtes de Chine, sur le parcours de ce contre-courant froid, les sondages constatent que la mer acquiert une grande augmentation de profondeur. Le Kouro-siwo jouit habituellement de 20 à 25 degrés de chaleur de plus que ce contre-courant. Dans la région du Kamtchatka et des Aléoutiennes, les différences de température entre ces deux courants sont encore plus sensibles.
Le climat des îles du Japon est beaucoup plus froid que celui des contrées de l’Europe occidentale placées sous les mêmes parallèles. L’âpreté relative du climat asiatique, comparé à celui de l’Europe, a d’ailleurs été déjà plus d’une fois signalée. Le sud de l’île de Yéso, sous la latitude de Madrid, endure des hivers très vifs, durant lesquels le thermomètre descend jusqu’à 15 degrés au-dessous de zéro (Réaumur). Entre le 38e degré et le 40e degré de latitude Nord, sur le parallèle de Lisbonne, la glace recouvre les lacs et les fleuves jusqu’à une profondeur suffisante pour qu’on puisse les traverser à pied sans danger. Le riz ne croît déjà plus dans l’île de Tsou-sima (34° 12’ lat. bor.), et le blé ne parvient que difficilement à sa maturité dans les environs de Matsmayé (41° 30’ lat. bor.). Sur la côte sud et sud-est du Japon, la température est plus douce, grâce à la haute chaîne de montagnes qui garantit le pays des vents glacés de l’Asie. On rencontre déjà le palmier, le bananier, le myrte et autres végétaux de la zone torride, entre le 31e degré et le 34e degré de latitude nord. Dans certaines localités, on cultive même la canne à sucre avec succès, et les rizières produisent annuellement deux récoltes.
Il a été établi, je crois, d’une manière incontestable, que les parties du Japon tournées du côté de l’Asie étaient beaucoup plus froides que celles qui regardent l’océan Pacifique. Ainsi le Siro-yama ou Mont-Blanc japonais, situé sous le 36e degré de latitude est déjà couvert de neiges perpétuelles à une hauteur de 2,500 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que le Fouzi-yama qui s’élève, comme je l’ai dit tout à l’heure, à près de 4,000 mètres, est presque toujours dégagé de neiges pendant les beaux mois de l’année. On cherche à expliquer ce phénomène en disant que la partie occidentale du Nippon se trouve exposée aux vents froids du continent asiatique, tandis que la partie orientale, abritée par les hautes montagnes de l’intérieur, en est, au contraire, généralement garantie. Cette explication ne me paraît pas péremptoire, et je crois qu’il faut la chercher dans une foule d’autres actions, parmi lesquelles celle du Kouro-siwo n’est peut-être pas la moins considérable.
La température de Yézo est d’ordinaire très froide. Dans le nord de l’île, la neige recouvre souvent le pays en plein mois de mai, et les arbres ne donnent encore aucun feuillage. On endure, l’hiver, de grandes pluies accompagnées de coups de vents tempêtueux, et d’épais brouillards se répandent sur le sol, où ils continuent souvent à épaissir pendant des semaines entières. En été même, il est bien rare que le ciel ne soit pas obscurci par quelque brume. Ces brouillards sont funestes aux navigateurs qui, au milieu de l’obscurité qu’ils produisent, vont se perdre sur les innombrables récifs que renferme l’Océan dans ces parages.
A Matsmayé, l’une des localités les plus méridionales de l’île, située sous la latitude de Toulon, les étangs et les marais gèlent pendant l’hiver. La neige ne disparaît plus pendant la période comprise entre novembre et mai, et il n’est pas rare que le thermomètre descende à 15 degrés au-dessous de zéro (Réaumur).
Dans l’île de Nippon, l’atmosphère est moins variable. Les étés sont très chauds, et, certaines années, ils seraient même insupportables, si la mer n’apportait une brise qui rafraîchit la température de l’air. Par un remarquable contraste, les hivers, au mois de janvier et de février, sont très durs; et, lorsque le sol est couvert de neige, la réverbération produit une sensation de froid fort aiguë, surtout quand le vent souffle du nord et du nord-est.
Les pluies sont fréquentes au Japon, principalement vers le milieu de l’été, à l’époque dite des «mois pluvieux[19]». Ces pluies, accompagnées de coups de tonnerre, durent quelquefois toute l’année. On dit qu’on leur doit en grande partie la fertilité du pays, dont la terre, d’ailleurs pauvre, ne produirait que d’assez maigres végétaux, si elle n’était sans cesse ranimée par des arrosements naturels. Toujours est-il que ces abondantes ondées contribuent à entretenir une humidité très sensible qui pénètre ceux qui sortent et se répand partout dans l’intérieur des habitations. C’est ce qui a fait dire à un poète-roi, au mikado Ten-dzi:
Dans le Seto-uti, ou Mer intérieure, le thermomètre varie, en été, de 26 à 35 degrés centigrades; en hiver, la température est rarement inférieure à 5 degrés au-dessous de zéro[21].
Le climat de Nagasaki est très variable. Les étés sont extrêmement chauds et la température, pendant cette saison, n’est guère moins élevée qu’à Batavia. Les hivers, au contraire, sont souvent rigoureux; la neige reste longtemps sur le sol, surtout dans la campagne, et la glace elle-même y est fort épaisse.
La superficie territoriale du Japon a été évaluée à 400,000 kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près aux trois quarts de la France. Mais, comme cet archipel est très long (plus de 800 lieues), il en résulte que le développement de ses côtes est considérable et peut être évalué à environ dix fois celui des nôtres[22].
La forme longitudinale du Japon, et la chaîne de montagnes qui le traverse du sud au nord, fait que ce pays présente dans toute son étendue deux versants à peu près partout également orientés, l’un à l’ouest, l’autre à l’est. Le versant oriental, c’est-à-dire celui qui fait face au Pacifique, semble à bien des égards avoir été privilégié.
Le berceau de la civilisation a été établi sur ce versant oriental au VIIe siècle avant notre ère; les deux capitales, Miyako et Yédo, les cités les plus opulentes, Oho-saka, Kama-kura, Mito, Sira-kawa, Ni-hon-matu, Sen-dai, etc., y ont été fondées; le Tô-kai-dau, «la Voie de la mer de l’Est», cette grande route stratégique créée par Taï-kau Sama, pour assurer sa suprématie sur les princes féodaux de l’empire, et qui est devenue l’artère principale de la vie politique, industrielle et commerciale des Japonais, a été également construite sur le flanc oriental du Nippon. Les mines d’or et d’argent [les plus riches] du pays paraissent aussi situées du même côté, à l’exception cependant des mines de Tazima dont l’importance serait, dit-on, considérable, si elles étaient convenablement exploitées.
Avant de terminer ce rapide exposé, vous me permettrez d’ajouter quelques détails descriptifs relativement à la géographie des îles du Japon. Ces détails vous seront utiles pour vous familiariser avec des dénominations topographiques, que nous retrouverons sans cesse dans le cours de nos études.
L’archipel japonais se compose de trois grandes îles et d’un nombre considérable de petites îles et d’îlots que j’ai évalué tout à l’heure, d’après les statistiques les plus récentes, à 3,850.
La principale des trois grandes îles, appelée Nippon «Soleil Levant», a donné son nom à l’archipel tout entier. C’est de ce nom, prononcé en Chine Jih-pœn, que vient la désignation européenne de Japon. D’autres noms sont employés dans la littérature, et surtout en poésie, pour désigner cette grande île et en même temps le Japon en général. Parmi ces noms, je me bornerai à vous mentionner les suivants: Hi-no moto, synonyme, en dialecte indigène, du nom chinois d’origine Nippon;—Yamato «le Pied des Montagnes», nom d’une des provinces où s’était établie la cour des mikados;—Ya-sima «les Huit Iles[23]»;—Ya-koku «la Vallée du Soleil», nom emprunté à une ancienne légende chinoise;—Fu-sau koku «le Pays des Mûriers», autre nom légendaire chinois, dans lequel quelques savants ont cru voir une ancienne appellation de l’Amérique, etc.[24].
Les deux autres grandes îles se nomment: Si-koku «les Quatre Provinces», et Kiu-siu «les Neuf Arrondissements». Cette dernière île n’est séparée du Nippon que par un détroit d’une demi-lieue de largeur.
Les fleuves qui baignent le Japon ont tous un cours peu étendu, résultant de la configuration même de ce pays. Quelques uns, cependant, comme la Tamise en Angleterre, s’ils n’ont point de longueur, sont larges et profonds à leur embouchure. La capitale est traversée par l’Oho-gawa, ou «grand fleuve», qui sépare la ville proprement dite de ses faubourgs, et sur lequel on a construit cinq ponts, dont plusieurs présentent une architecture remarquable. L’Oho-basi, ou «grand pont», mesure environ 320 mètres. Le Yodo-gawa, qui coule à Ohosaka, est également traversé par plusieurs beaux ponts construits en bois de cèdre.
Parmi les lacs du Japon, il en est un qui, par son étendue et les facilités de communications qu’il assure aux populations riveraines, mérite une mention particulière. C’est le Biwa-ko, ou «lac de la Guitare», situé dans l’ancienne province d’Omi. Suivant une légende accréditée dans le pays, cette petite mer intérieure aurait été formée en une nuit, à la suite d’un grand tremblement de terre qui produisit un affaissement du sol et creusa le lit qu’elle occupe aujourd’hui, en même temps que s’élevait la gigantesque montagne sacrée du Fouzi.
Isolés pendant de longs siècles du reste du monde, les Japonais se sont vus dans la nécessité de donner un grand développement à l’agriculture et à l’industrie, afin de s’assurer dans leur archipel les moyens d’existence qu’ils ne pouvaient tirer d’ailleurs. Cet archipel n’est pas, comme certaines contrées favorisées de l’Asie Méridionale, d’une grande fertilité naturelle. L’activité intelligente, le travail opiniâtre de ses habitants, ont su en faire une des régions les plus productives de l’Asie. Il faut dire que, grâce à sa configuration géographique, le Japon jouit, à ses diverses latitudes, des climats les plus variés. Tandis que, dans le nord, on y trouve les fourrures et les essences de la Norvège; dans le midi, le sol produit les végétaux les plus précieux de la flore tropicale. Aux îles Loutchou[25], on cultive avec succès la canne à sucre, le bananier, le cocotier, l’oranger, l’ananas; le coton, l’indigo, le camphre y sont d’une qualité supérieure.
Dans la zone moyenne, où s’est développée surtout la civilisation japonaise, le climat tempéré est propre à la culture du riz qui constitue la base essentielle de la nourriture de la plupart des peuples de race Jaune, et à celle du bambou qui leur rend les services les plus variés pour la vie domestique[26]. L’arbre à vernis fournit à l’industrie indigène la laque incomparable du Japon, et une espèce de Broussonetia dont les fibres forment la matière première d’un papier d’une solidité remarquable. Le thé croît à peu près sans culture dans plusieurs provinces. Dans la région du nord enfin, le mûrier vient apporter un nouvel élément de richesse à la population des campagnes, en lui assurant les moyens de s’adonner sur une large échelle à l’éducation des vers à soie[27].
La pêche, très active sur toute la vaste zone côtière de l’archipel japonais, apporte à son tour un précieux contingent pour la nourriture de la nation, qui a été pendant longtemps essentiellement icthyophage.
Les profondeurs du sol sont, au Japon, d’une remarquable richesse: mais ce n’est que dans ces derniers temps que les mines ont commencé à être exploitées d’une façon sérieuse et lucrative. L’or se rencontre dans le Satsouma, le Tazima, le Kaï, le Bou-zen et le Boun-go, le Sado et l’Aki; l’argent, dans plusieurs de ces mêmes provinces et aussi dans l’Isé, le Hida, l’Ivasiro, l’Iwaki, le Moutsou, l’Ivami et le Bizen. Le cuivre, le fer et le plomb paraissent également assez communs. Enfin, on trouve de riches houillères d’autant plus dignes d’attention, que le charbon de terre devient de jour en jour un produit plus indispensable aux progrès de l’industrie moderne. Avant l’établissement des Européens au Japon, on ne demandait aux mines de houille que ce qui était nécessaire aux besoins des forgerons et de quelques autres corps de métiers moins importants. Le développement de la navigation à vapeur dans les mers de l’extrême Asie a donné à ce produit du sol une valeur dont on ne se doutait guère, au Nippon, il y a seulement cinquante ans, et l’exploitation des terrains houillers a été organisée de toutes parts. En 1877, on évaluait la production annuelle du charbon au Japon à environ 400 mille tonnes anglaises, représentant une valeur d’à peu près 6 millions de francs. Ces chiffres, il faut le dire, sont tout à fait insignifiants, en comparaison de ce qu’ils pourront être, le jour où une législation meilleure viendra encourager, au lieu de la gêner, l’exploitation des carrières par l’industrie privée[28]. Les districts carbonifères de l’île de Yézo, à eux seuls, pourraient devenir pour le Japon une source de richesse en quelque sorte inépuisable.
Je n’ai fait qu’effleurer, à mon vif regret, une foule de sujets sur lesquels je voudrais pouvoir m’arrêter davantage. Ces courtes observations suffiront cependant, je l’espère, pour vous donner une idée générale de la constitution physique du pays dont nous nous proposons d’étudier ensemble la langue, les origines ethniques, l’histoire et la civilisation.

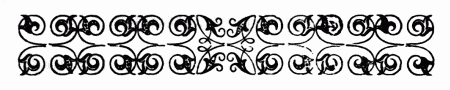
 ES historiens indigènes font remonter la fondation de la monarchie
japonaise au VIIe siècle avant notre ère[29]; et, à partir de cette
époque, ils nous présentent une suite non interrompue de règnes et
d’événements rapportés chronologiquement. Ce n’est pas là une antiquité
fort reculée; mais cette antiquité est respectable, si l’on songe que le
Japon n’a pas cessé d’exister depuis lors comme nation autonome, et
qu’en somme, on trouverait sans doute difficilement, dans l’histoire, un
autre exemple d’un empire qui ait vécu plus de 2,500 ans, sans avoir
jamais subi le joug d’une puissance étrangère. L’Égypte et la Chine sont
les états qui ont le plus duré dans l’histoire; mais ces états ont
maintes fois perdu leur indépendance: l’Égypte, de nos jours, appartient
à des conquérants turcs; la Chine, à des conquérants mandchoux. Le Japon
n’a jamais cessé d’appartenir aux Japonais. Les Japonais sont peut-être,
dans les annales du monde, le seul peuple qui n’ait eu qu’une seule
dynastie de princes[30], le seul peuple qui n’ait jamais été vaincu.
ES historiens indigènes font remonter la fondation de la monarchie
japonaise au VIIe siècle avant notre ère[29]; et, à partir de cette
époque, ils nous présentent une suite non interrompue de règnes et
d’événements rapportés chronologiquement. Ce n’est pas là une antiquité
fort reculée; mais cette antiquité est respectable, si l’on songe que le
Japon n’a pas cessé d’exister depuis lors comme nation autonome, et
qu’en somme, on trouverait sans doute difficilement, dans l’histoire, un
autre exemple d’un empire qui ait vécu plus de 2,500 ans, sans avoir
jamais subi le joug d’une puissance étrangère. L’Égypte et la Chine sont
les états qui ont le plus duré dans l’histoire; mais ces états ont
maintes fois perdu leur indépendance: l’Égypte, de nos jours, appartient
à des conquérants turcs; la Chine, à des conquérants mandchoux. Le Japon
n’a jamais cessé d’appartenir aux Japonais. Les Japonais sont peut-être,
dans les annales du monde, le seul peuple qui n’ait eu qu’une seule
dynastie de princes[30], le seul peuple qui n’ait jamais été vaincu.
L’authenticité des annales japonaises antérieures au IIIe siècle après notre ère a été contestée. On a fait observer que l’écriture n’existait pas au Japon avant le mikado O-zin (270 à 312 de J.-C.), et que, par conséquent, l’histoire n’avait pu être écrite que postérieurement au règne de ce prince; on a émis des doutes sur les empereurs mentionnés avant les premières relations historiques du Japon avec la Chine, par ce fait que les noms de ces empereurs étant tous des noms chinois avaient été nécessairement inventés après coup; on a dit que le plus ancien livre historique du Nippon, le Kiu-zi ki «Mémorial des choses anciennes», composé sous le règne de Sui-kau (595-628 après notre ère), avait été perdu dans l’incendie d’un palais où il était conservé, et que la plus vieille histoire qui soit parvenue jusqu’à nous, datée de l’an 712, avait été écrite sous la dictée d’une femme octogénaire, à laquelle le mikado Tem-bu l’avait transmise verbalement; on a signalé, enfin, dans le récit des règnes contestés, des invraisemblances de nature à les rendre suspects à plus d’un égard.
J’examinerai rapidement la valeur de ces divers genres d’objections soulevées contre la véracité des annales japonaises primitives.
Il est généralement admis par les japonistes que l’écriture chinoise était ignorée au Japon avant le règne d’O-zin, fils et successeur de la célèbre impératrice Zin-gu, conquérante de la Corée et surnommée la Sémiramis de l’Extrême-Orient. L’introduction de cette écriture, chez les Japonais, est attribuée à un certain lettré coréen, de l’Etat de Paiktse, nommé Wa-ni, qui apporta quelques ouvrages chinois à la cour du mikado, en l’an 285, et y fut nommé précepteur des princes du sang[31]. Un savant russe a trouvé, dans le fait même de cette nomination de Wa-ni comme instituteur des fils du mikado, une raison pour croire que la langue chinoise n’avait rien d’insolite pour les Japonais de cette époque[32]. Il est, en tout cas, très probable que les relations du Nippon avec la Corée, antérieurs au règne d’Ozin, avaient déjà fait connaître la civilisation chinoise aux insulaires de l’Asie orientale; les historiens indigènes nous fournissent, d’ailleurs, des renseignements qui ne sont pas absolument dépourvus de valeur pour consolider cette opinion. L’expédition que Tsin-chi Hoang-ti, de la dynastie de Tsin, le célèbre persécuteur des lettrés et le constructeur de la Grande-Muraille, envoya au Japon pour y chercher le breuvage de l’immortalité, appartient surtout à la mythologie. Cette expédition est cependant mentionnée dans quelques historiens japonais. Le médecin Siu-fouh (en jap. Zyo-fuku) qui la dirigeait, n’ayant pu réussir, disent-ils, à réaliser les espérances du despote chinois, jugea prudent de ne plus retourner dans son pays: il se fixa au Nippon, et y mourut près du mont Fouzi; après sa mort, les indigènes bâtirent à Kuma-no, dans la province de Ki-i, un temple en son honneur, sans doute en mémoire des services qu’il avait rendus aux insulaires en leur faisant connaître les sciences et les lettres de la Chine. Si cette expédition doit être reléguée dans le domaine de la fable, il n’en est pas de même de l’ambassade envoyée au mikado Sui-zin, par le roi d’Amana, l’un des états qui composaient la confédération coréenne. Cette ambassade arriva au Japon dans l’automne, au septième mois de l’année 33 avant notre ère, apportant avec elle des présents pour la cour[33]. Voilà donc les Japonais en relation avec la Corée, plus de trois siècles avant l’arrivée de Wa-ni auquel on attribue, comme je l’ai dit tout à l’heure, l’introduction de l’écriture chinoise au Japon. Et comment croire que le Japon soit resté jusque-là dans l’ignorance des progrès réalisés par les Chinois, quand nous voyons le mikado Sui-nin, successeur de celui qui avait reçu la mission du royaume d’Amana, envoyer à son tour une ambassade, non point en Corée, mais bien en Chine, à l’empereur Kouang-wou Hoang-ti, l’an 56 de J.-C.[34].
De ces quelques faits, il résulte au moins la possibilité que les Japonais aient eu connaissance de l’écriture chinoise avant le IIIe siècle de notre ère. Mais, en supposant même qu’ils aient ignoré complètement cette écriture jusqu’à l’arrivée dans leurs îles du célèbre Wa-ni, il paraît certain qu’ils faisaient préalablement usage d’une écriture coréenne, d’origine indienne, peu différente de celle qu’on pratique encore aujourd’hui en Corée[35]. Et il reste en plus aux japonistes à élucider la question d’une écriture indigène nationale encore plus ancienne, mentionnée par quelques savants, et sur laquelle on n’a recueilli, jusqu’à présent, que de trop vagues indices pour qu’il soit possible de s’en occuper aujourd’hui.
Enfin, s’il était établi malgré tout, que les Japonais ont ignoré l’art d’écrire avant les conquêtes de l’impératrice Zin-gou, il n’en résulterait pas pour cela que l’histoire ancienne du Japon n’ait pu être transmise de génération en génération par la tradition orale, comme cela s’est opéré chez une foule de nations différentes. L’histoire primitive d’un peuple ne se rencontre parfois que dans des poèmes, dans des épopées ou des chants populaires. Nous verrons, dans un instant, qu’il en a été ainsi de l’histoire primitive (hon-ki) des Japonais.
Le fait que les noms sous lesquels les premiers empereurs du Japon sont connus dans l’histoire sont des noms chinois, n’est pas une objection concluante: ce fait a induit en erreur Klaproth et d’autres orientalistes qui ignoraient que ces noms honorifiques et posthumes ont été donnés à ces princes par Omi mi-fune, arrière-petit-fils de l’empereur Odomo, mort en 787 après J.-C., alors que les idées chinoises avaient pénétré de toutes parts la civilisation japonaise. Les premiers mikados sont d’ailleurs mentionnés également, dans les annales indigènes, par leurs véritables noms, qui étaient des noms purement japonais. C’est ainsi que le premier empereur, Zin-mu, avait pour petit nom Sa-no, et pour désignation honorifique Yamato no Ivare Hiko no mikoto; sa femme s’appelait A-hira-tu hime; ses compagnons d’armes, ses ministres portaient aussi des noms purement japonais. Il en a été de même, de tous les princes qui lui ont succédé, dans la période contestée des annales du Nippon.
Quant à la destruction des anciennes archives historiques du Japon, lors des troubles de Mori-ya, il y a là un fait reconnu par les auteurs indigènes les plus autorisés. Ces auteurs nous apprennent que le Ni-hon Syo-ki, qui renferme l’histoire des mikados depuis les dynasties mythologiques jusqu’au règne de Di-tô, avait été transmis verbalement par l’empereur Tem-bu, à une jeune fille de la cour, nommée Are, de Hiyeda, et que cette femme, à l’âge de quatre-vingts ans environ, en dicta le contenu au prince Toneri Sin-wau et à d’autres chefs de lettrés, qui le rédigèrent en caractères indigènes.
Ne trouvons-nous pas un fait analogue dans l’histoire de la Chine, où nous voyons que le Chou-king ou Livre sacré des annales, détruit par ordre de Tsin-chi-hoang-ti, fut reconstitué à l’aide des souvenirs d’un vieillard appelé Fou-seng? Et cependant aucun savant, que je sache, n’a cherché à contester la parfaite authenticité du Chou-king, appris par cœur dans son enfance par Fou-seng, comme le Ni-hon syo-ki l’avait été par Aré, de Hiyéda.
En somme, les annales primitives des Japonais, sans être à l’abri de toute suspicion, ne méritent guère moins de confiance que les annales primitives de la plupart des autres peuples. Le mythe, la fiction, les récits merveilleux et fantastiques se retrouvent au début de toutes les histoires. On peut même dire, en faveur du Japon, qu’il a su séparer mieux qu’une foule de peuples, la partie légendaire de la partie historique des temps primordiaux de son existence nationale: avant Zin-mu, les récits extraordinaires de la vie des Génies célestes et terrestres, mais après ce premier mikado des faits qui, s’ils ne sont pas toujours vrais, sont du moins presque toujours vraisemblables.
Il faut admettre, cependant, une réserve sur cette déclaration: on a fait observer que les «annales du Japon nous présentent, durant une période de plus de mille ans (de 660 avant J.-C. à 399 de notre ère), une série de souverains régnant de soixante à quatre-vingts ans en moyenne, et ne quittant parfois le trône pour descendre dans la tombe qu’après avoir compté cent quarante et même cent cinquante ans parmi les vivants[36]». M. le marquis d’Hervey de Saint-Denys, auteur de cette remarque, explique la durée anormale de l’existence attribuée aux anciens empereurs du Japon, par la nécessité où se sont trouvés les premiers compilateurs, de combler un espace de 1060 ans, dans lequel ils ne pouvaient découvrir le nom de plus de dix-sept souverains. Les chroniques chinoises, suivant ce savant, permettent d’ajouter quelques princes à la liste que nous ont conservée les écrivains indigènes. Il serait peut-être bien sévère de contester l’authenticité des vieilles annales japonaises, par ce fait de la durée exagérée de certains règnes y renfermés; et l’on pourrait retourner la critique, en faveur de la sincérité des historiographes du Nippon, en disant qu’ils ont préféré laisser cette invraisemblance, plutôt que d’inventer des noms d’empereurs pour mieux remplir les vides de la période archaïque qu’ils s’étaient donné la mission de reconstituer. Le désir de donner à leur mikado une longévité qu’atteignent, par rare exception seulement, quelques autres hommes, ne paraît pas les avoir guidés en cette occasion. Le hon-ki n’est pas exempt de merveilleux, mais la tendance qu’ont tous les peuples à émailler de légendes la vie de leurs premiers ancêtres, est certainement plus modérée au Japon qu’en maint autre pays: il est juste de lui en tenir compte.
Les sources de l’histoire du Japon ne sont pas encore connues, et, pour l’instant, nous devons les chercher dans trois ouvrages: le Kiu-zi ki ou «Mémorial des vieux événements», le Ko-zi ki ou «Mémorial des choses de l’antiquité», et le Ni-hon syo-ki ou «Histoire écrite du Japon». Aucun de ces livres ne jouit de plus de 1,500 ans d’ancienneté.
Le texte original du Ku-zi ki a été perdu, dit-on[37], en l’an 645, dans l’incendie du palais de Sogano Yemisi. C’était une histoire écrite par le prince Syau-toku tai-si et par Sogano Mumako, sous le règne de l’impératrice Soui-kau, qui régnait de 595 à 628 de notre ère. L’ouvrage en dix volumes, qui existe aujourd’hui sous ce titre, est d’une authenticité douteuse[38], mais il est des lettrés qui pensent qu’on peut en tirer parti, parce que son auteur a dû profiter de documents qui n’ont pas été retrouvés après lui.
Le Ko-zi ki, composé en 712 par Futo-no Yasu-maro, d’après les données de Are, de Hiyeda, dont il a été question tout à l’heure, est écrit en caractères chinois, employés tantôt avec leur valeur idéographique, tantôt avec la valeur phonétique qu’on leur affecte dans le syllabaire dit Man-yô-kana.
Enfin le Ni-hon syo-ki, de même provenance que le Ko-zi ki, n’est autre chose que ce dernier ouvrage revu, un peu mieux coordonné et enrichi de quelques développements. Le prince Toneri Sin-wau, fils de Tem-bu, offrit le Ni-hon syo-ki à l’impératrice Gen-syau, le 5e mois de l’année 720. Dans ces ouvrages, les mikados ne sont point désignés sous le nom honorifique chinois qu’on leur attribue communément, mais bien sous leur nom purement japonais. Le premier empereur, par exemple, au lieu d’être appelé Zin-mou, est désigné sous le nom de Kami Yamato Iva-are hiko-no Sumera Mikoto; l’impératrice Di-tô, sous celui de Taka-Ama-no Hara-Hiro-no Hime.
Il n’entre pas dans mon dessein de vous mentionner ce que les Japonais nous racontent de leurs dynasties célestes et terrestres, qui précédèrent les «souverains humains» (nin-wau) dans le gouvernement du monde, c’est-à-dire de leur pays. Je me bornerai à vous rappeler en quelques mots les idées communément répandues parmi les sectaires de la religion sintauïste, au sujet de la création du monde, en attendant que nous possédions la traduction des monuments primitifs de l’histoire du Japon auxquels j’ai fait allusion tout à l’heure.
Les écrivains populaires ont imaginé plusieurs systèmes de cosmogonie qui ont obtenu plus ou moins de faveur parmi leurs compatriotes. La plupart d’entre eux s’accordent pour considérer le Nippon comme le berceau du genre humain. Voici, à cet égard, comment s’exprime un auteur indigène:
«Le Japon est le pays le plus élevé du monde: il en résulte naturellement que de là sont sortis tous les hommes qui ont peuplé la terre. En Chine, il y a eu un grand déluge, ainsi que les livres nous l’apprennent. Dans l’Occident, au dire des savants de cette région, il y a eu également un grand déluge. Au Japon seulement, il n’y a pas eu de déluge, parce que le Japon est beaucoup plus élevé que la Chine et l’Occident. C’est donc le Japon qui a dû fournir la population primitive des autres parties du monde.
«Mais on me dira: «S’il en est ainsi, les arts devraient être plus avancés au Japon que partout ailleurs, et cependant les arts sont plus avancés chez les Occidentaux. Comment cela se fait-il?»
—«Le fait est facile à expliquer: le Japon étant le pays le plus beau, le plus riche et le plus heureux du monde, il a toujours pu se suffire à lui-même et ne s’est pas vu dans l’obligation de demander quelque chose à l’étranger; tandis que les hommes partis du Japon se sont trouvés dans des pays mauvais, incapables de suffire à leurs besoins, et ont dû s’ingénier à découvrir des moyens de communication et d’échange. Voilà ce qui explique pourquoi l’astronomie (ten-bun) et la science de la navigation sont plus avancées en Occident qu’au Japon.»
Les différentes périodes de la création du monde nous sont exposées dans les termes suivants[39]:
«A l’origine, le Ciel et la Terre n’étaient pas encore séparés; le principe femelle (me) et le principe mâle (o) n’étaient pas divisés. Le chaos était comme un œuf [compacte[40] et renfermant des germes]. La partie éthéréenne [pure] et lumineuse s’évapora et forma le Ciel; la partie pesante et trouble se condensa et forma la Terre. L’évaporisation des parties subtiles et délicates s’opéra aisément; la congélation des parties lourdes et troubles s’opéra difficilement. C’est ce qui fait que le Ciel fut formé le premier, et que la Terre ne fut établie qu’après. Ensuite naquit au milieu d’eux un génie (Kami). Aussi l’on dit qu’à l’origine du dégagement du Ciel et de la Terre, les îles et les terres flottèrent sur l’eau comme des poissons. En ce moment, il naquit au milieu du Ciel et de la Terre une chose qui, par sa forme, ressemblait à un roseau (asi-gai), lequel se métamorphosa et devint le dieu appelé Kuni-no toko tati-no mikoto[41], également nommé Kuni-soko-tati-no mikoto[42]. Suivant une autre tradition, le roseau Asi-gai se serait transformé en un génie appelé Umasi Asi-gai hiko-ti-no mikoto, à la suite duquel serait venu Kouni-no toko-tati-no mikoto[43]. Une autre tradition enfin fait sortir du roseau le dieu Ama-no toko tati-no mikoto, auquel il donne pour successeur Oumasi Asi-gaï hiko-ti-no mikoto, et elle ne fait naître que plus tard Kouni-toko tati-no mikoto, produit par la métamorphose d’un corps gras qui flottait dans l’empyrée[44].»
On rencontre d’ailleurs, dans la mythologie japonaise, d’assez nombreuses variations au sujet des noms des Génies et de leur ordre de succession. Le plus communément cependant on fait commencer avec Kouni-no toko tati-no mikoto la dynastie des Génies Célestes dont l’origine remonte à plusieurs centaines de mille millions d’années. Ces génies furent au nombre de sept[45]. Le second régna par la vertu de l’eau, et le troisième par la vertu du feu. Tous trois étaient dépourvus de sexe[46] et s’engendraient d’eux-mêmes. Le quatrième génie régna par la vertu du bois, et fut le premier qui possédât une épouse; mais, pour donner le jour à ses successeurs, il ne la connut pas suivant la manière des hommes. La conception n’eut lieu que par une sorte de contemplation de chaque couple et par des moyens surnaturels que la dégradation des hommes ne leur permet plus de comprendre. Le cinquième génie régna par la vertu du métal et conserva son épouse immaculée, comme aussi son successeur. Le sixième génie régna par la vertu de la terre, le dernier des cinq éléments dont ses ancêtres avaient symbolisé l’existence. Enfin le septième génie mit un terme à la dynastie des génies célestes en s’abandonnant aux jouissances matérielles de notre monde. Un certain jour, après avoir contemplé d’un regard lascif les formes charmantes de son épouse, il suivit l’exemple d’un oiseau qu’il avait vu un instant auparavant s’accoupler avec sa femelle. Il la connut alors à la manière terrestre; et, dès ce moment, elle enfanta suivant la loi générale de l’humanité. Les successeurs de ces deux génies cessèrent ainsi d’appartenir à la race excellente de leurs aïeux et furent l’origine de la dynastie des génies terrestres.
Le septième des génies célestes dont nous venons de parler s’appelait Izanagi, et son épouse Izanami. De tout temps, l’un et l’autre ont été l’objet d’un culte particulier de la part des Japonais qui les considèrent, en quelque sorte, comme leur premier père et leur première mère. Suivant Kæmpfer, les Japonais, qui embrassèrent le christianisme aux XVIe et XVIIe siècles, les appelaient leur Adam et Ève. La tradition rapporte que ces deux génies passèrent leur vie dans la province d’Isé, au sud de l’île de Nippon, et qu’ils engendrèrent beaucoup d’enfants de l’un et de l’autre sexe, d’une nature très inférieure à celle des auteurs de leurs jours, mais cependant bien supérieure à celle des hommes qui ont vécu depuis lors.
La mythologie japonaise nous montre, en effet, Izanagi et Izanami donnant le jour, par des procédés de toutes sortes et par de singulières métamorphoses[47], à la plupart des dieux qui personnifient, dans le panthéon indigène, les différentes puissances de la nature. Mais, de toutes ces divinités, celle qui tient la plus large place dans le culte populaire appelé Kami-no miti, celle qui est devenue la Grande Déesse de la religion nationale du Japon, ce fut Oho-hiru me-no mikoto, communément appelée Ama-terasu oho-kami ou Ten-syau dai-zin. Cette déesse, à cause de son étonnante beauté, fut appelée par ses père et mère à régner au plus haut des Cieux, d’où elle éclairerait le monde par sa splendeur. Elle est identifiée avec le Soleil, comme sa sœur cadette, Tuki-no yumi-no mikoto, avec la Lune.
Quatre autres génies terrestres, placés après Ten-syau daï-zin, complètent la dynastie des génies terrestres, à laquelle devait succéder celle des mikado ou souverains des hommes[48].
Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur ce que les historiens nous apprennent relativement aux périodes semi-historiques antérieures à O-zin, XVIe mikado, avec lequel nous faisons commencer l’histoire proprement dite de l’archipel du Nippon.
Les Japonais, dans le but de donner une origine divine à leurs souverains, ont fait descendre le premier mikado, Zin-mou, de la déesse du Soleil, Ama-terasu-oho-kami[49], c’est-à-dire «le Grand Génie qui brille au firmament.» La mère de ce prince, Tama-yori hime, était fille du Riu zin «le Génie Dragon», ou dieu de la Mer; elle lui donna le jour en l’an 712 avant notre ère, quinze ans avant la mort d’Ezéchias, roi de Juda, et soixante-cinq ans avant la prise de Babylone, par Nabuchodonosor, roi de Ninive.
Dans le système adopté par les Japonais, Zinmou, tout en étant le premier mikado, n’est pas, à proprement parler, le fondateur de la monarchie japonaise. Le Ni-hon Syo-ki[50] et, après lui tous les historiens qui l’ont copié, rapporte que ce personnage fut proclamé prince héréditaire lors de sa quinzième année, et, par conséquent, futur héritier d’un trône déjà fondé en 697 avant notre ère, c’est-à-dire trente ans avant la conquête de l’île de Kiousiou, la plus méridionale des trois grandes îles de l’archipel, et sa première étape.
De l’île de Kiousiou, Zinmou se rendit avec des vaisseaux dans la province d’Aki, située au nord du Suwo-nada ou mer intérieure; puis, au troisième mois dans l’automne de 666[51], dans les pays voisins de Kibi, où se trouvent aujourd’hui les provinces de Bingo, de Bitsiou et de Bizen. Il séjourna trois années dans ce pays pour remettre sa flotte en état et réunir des provisions de guerre. En 663, il arriva dans la région où s’élève actuellement la ville d’Ohosaka, région qui fut appelée, à cause de la forte marée qu’il rencontra sur ses côtes, Nami-haya on-kuni «le pays des vagues rapides», et, par la suite, Nani-ha ou Nani-va[52]. Peu après, il se trouva, à Kusa ye-no saka, en présence d’un puissant prince aïno, nommé, en japonais, Naga-sune hiko[53], qui lui fit subir plusieurs échecs et mit ses troupes en déroute. Dans un des combats, le frère aîné de l’empereur, Itu-se-no mikoto, fut atteint d’une flèche et mourut[54]. Zinmou reprit, en conséquence, la mer, où le mauvais temps mit sa flotte en péril: «Hélas! s’écria un de ses frères, j’ai parmi mes aïeux les Génies du Ciel; ma mère est Déesse de l’Océan. Comment se fait-il qu’après avoir été malheureux sur terre, je sois encore malheureux sur mer?» Puis il tira son épée et se jeta dans les ondes; son troisième frère suivit son exemple, de sorte que Zinmou se trouva seul avec son fils pour continuer sa mémorable expédition[55].
L’histoire des relations de l’empereur Zinmou et de Nagasoune me paraît avoir été altérée à dessein et d’une façon assez transparente pour éveiller l’attention de la critique. Les Japonais, conquérants des îles occupées primitivement par les Yézo ou Mau-zin «peuples velus», comprirent tout d’abord l’utilité, pour leur politique envahissante, de faire croire à l’origine commune de leur prince et des principaux chefs aïno. Le meilleur moyen pour arriver à ces résultats, était d’emprunter aux autochtones leur mythologie nationale, et de greffer la généalogie de Zinmou sur un des principaux rameaux de leur grande famille de Kami ou de Génies. Je ne veux pas dire pour cela que le panthéon sintauïste, dont nous trouvons les principales représentations dans le Ko-zi ki, est un panthéon purement aïno: bien loin de là, je crois apercevoir, dans ces dieux originaires du Japon, des créations d’origine multiple, et notamment des créations du génie asiatique continental. La question est trop étendue, trop complexe, pour être examinée en ce moment. J’essaierai seulement d’appeler votre attention sur le procédé adopté par Zinmou pour effacer les conséquences funestes qu’aurait pu avoir, sur l’esprit des indigènes, son caractère de conquérant étranger, de nouveau venu, dans l’archipel de l’Asie orientale.
Nagasoune était un des chefs aïno avec lequel Zinmou comprit, tout d’abord, qu’il avait beaucoup à compter. Sa première attaque contre ce puissant hi-ko lui avait prouvé que les autochtones ne se laisseraient pas assujétir aussi aisément qu’il l’avait espéré de prime abord. Zinmou, je l’ai dit, perdit plusieurs batailles engagées avec Nagasoune.
Nagasoune, disent les historiens japonais, avait, antérieurement à l’arrivée de Zinmou dans le Yamato, proclamé prince des tribus indigènes, Mumasimate, fils de sa sœur cadette et d’un certain Nigi-hayabi[56]. Or, ce Nigi-hayabi était lui-même fils d’Osiho-mimi, le second des grands dieux terrestres (ti-zin); de telle sorte que Zinmou, qui se prétendait issu de son côté de Ugaya-fuki awasesu, le quatrième de ces grands dieux, se trouvait apparenté avec le principal chef de ses ennemis. Seulement, il s’agissait pour lui de faire accepter à son adversaire ce système généalogique. Voici comment il s’y prit, d’après la légende:
Nagasoune avait envoyé un émissaire à Zinmou pour lui faire voir un carquois provenant des génies célestes, et qui appartenait à son beau-frère, Nigi-hayabi. L’empereur, de son côté, montra un carquois qu’il possédait; et comme, en les rapprochant, ils se trouvèrent identiques, il devint évident pour tous que Zinmou et Nigi-hayabi descendaient l’un et l’autre des anciens dieux du pays. Ce dernier, convaincu de cette parenté qu’il n’avait pas soupçonnée, voulut faire sa soumission au mikado. Nagasoune tenta de s’y opposer: sa résistance lui coûta la vie[57]. Zinmou avait, de la sorte, aplani par la ruse les obstacles que ses troupes étaient impuissantes à renverser. Fort de l’alliance du prince aïno Nigi-hayabi, il lui fut désormais facile de vaincre et d’anéantir l’un après l’autre tous les chefs des tribus qu’il rencontra sur sa route. Ces petits chefs, il n’avait plus désormais de nécessité de les attacher à sa fortune; au lieu de voir en eux des descendants des anciens dieux du pays, il ne les considéra plus, væ victis! que comme des bandits. L’histoire, qui nous les represente comme vivant dans des tanières, à l’état sauvage, les appelle «des araignées de terre» (tuti-gumo).
Maître de la situation, après sept années consacrées à des préparatifs militaires et à des combats, en l’an 660 avant notre ère, Zinmou fit construire, dans la province de Yamato, le palais de Kasiva-bara, où il fut proclamé mikado. Il organisa ensuite son gouvernement; et, après soixante-treize ans de règne, mourut à l’âge de cent vingt-sept ans, en 585 avant notre ère. L’année suivante, il fut inhumé sur une colline au nord-est du mont Ounebi[58]. De nos jours encore, on va faire un pèlerinage au tombeau du fondateur de la monarchie japonaise.


 A période de l’histoire du Japon dont nous allons nous occuper
aujourd’hui, est comprise entre les années 585 avant et 313 après notre
ère. Cette période, quel’on peut considérer, en partie du moins, comme
semi-historique, s’étend de la sorte depuis le second mikado jusqu’à
l’époque où la civilisation du continent asiatique, à la suite de la
guerre de Corée, commence à se répandre dans les îles de
l’Extrême-Orient. C’est un espace d’environ 900 ans, durant lequel le
Japon se développe en dehors de toute influence étrangère, à l’exception
de celle que représente Zinmou et ses compagnons d’armes sur le sol
envahi des tribus aïno.
A période de l’histoire du Japon dont nous allons nous occuper
aujourd’hui, est comprise entre les années 585 avant et 313 après notre
ère. Cette période, quel’on peut considérer, en partie du moins, comme
semi-historique, s’étend de la sorte depuis le second mikado jusqu’à
l’époque où la civilisation du continent asiatique, à la suite de la
guerre de Corée, commence à se répandre dans les îles de
l’Extrême-Orient. C’est un espace d’environ 900 ans, durant lequel le
Japon se développe en dehors de toute influence étrangère, à l’exception
de celle que représente Zinmou et ses compagnons d’armes sur le sol
envahi des tribus aïno.
Pendant ce millénaire, quatorze mikados et une impératrice occupent, à peu près sans interruption, le trône établi pour la première fois, en 660 avant notre ère, dans le palais de Kasiva-bara. Plusieurs d’entre eux n’ont guère laissé, dans les annales de leur pays, d’autre souvenir que celui de leur nom[59] et du lieu de leur résidence.
A la mort de Zinmou, nous trouvons quelques années d’interrègne. Zinmou avait laissé trois fils, de deux lits différents. Le troisième, Kam Nu-na-kawa Mimi-no Sumera-mikoto, parvint à se faire reconnaître mikado, avec l’appui de son frère, né de la même mère que lui. Ce dernier tua le rival de celui qui devait figurer dans l’histoire sous le nom de Sui-sei Ten-wau. Elevé au rang suprême en l’année 581 avant notre ère, il mourut en—549. Son frère, mort en—578, fut inhumé, comme l’avait été son père, sur le Unebi-yama, dans la partie nord[60], qui fut, de la sorte, la plus ancienne sépulture impériale du Japon[61].
Nous voyons ensuite quatre mikados se succéder de père en fils, sans la mention, dans leur règne, d’aucun incident digne d’être rapporté, entre les années 548 et 291 avant notre ère.
Sous le règne du VIIe mikado, Neko Hiko Futo-ni (—260 à 215), quelques historiens placent un événement que j’ai eu déjà l’occasion de citer, et qui, s’il était admis comme authentique, aurait une importance de premier ordre pour l’histoire des origines de la civilisation japonaise. Je veux parler de la mission envoyée au Japon par l’empereur Tsin-chi Hoang-ti, auquel on avait persuadé qu’il existait, dans ce pays, un breuvage donnant l’immortalité. La vingt-huitième année du règne de ce prince (219 avant notre ère), un homme du pays de Tsi, nommé Siu-fouh, adressa un mémoire à l’Empereur, où il disait que, dans l’océan Oriental, il y avait trois montagnes divines, appelées Poung-laï, Fang-tchang, et Ing-tcheou; que ces trois montagnes divines étaient situées dans la mer Pouh-haï, et que les habitants de ces îles possédaient un remède pour ne pas mourir. Il demandait enfin à Chi-hoang d’y être envoyé, pour y chercher ce remède. L’empereur approuva la demande, et envoya Siu-fouh à la recherche du pays des Immortels, en compagnie d’un millier de jeunes gens, garçons et filles. Les vaisseaux qui emportèrent cette mission se perdirent en mer, à l’exception d’un seul, qui vint apporter en Chine la nouvelle du désastre[62].
Cet événement est mentionné dans quelques historiens japonais[63]; mais, comme il ne figure point dans le Ni-hon Syo-ki, il y a lieu de croire qu’il a été emprunté aux sources chinoises par des historiens japonais de date relativement récente. D’après Syoun-sai Rin-zyo[64], sous le mikado Kau-rei, à l’époque où régnait en Chine l’empereur Chi-hoang, de la dynastie des Tsin, il y eut un homme appelé Siu-fouh, qui exprima l’idée d’aller chercher au mont Poung-laï un médicament pour éviter la mort. Il se rendit en conséquence au Japon. On prétend qu’il s’arrêta au mont Fu-zi Yama. Il existe un temple (yasiro) construit en son honneur à Kuma-no, dans la province de Ki-i[65]».
J’ai tenu à recourir aux sources originales pour connaître la provenance de cette légende. Je l’ai trouvée dans les Mémoires de Sse-ma Tsien, le plus célèbre des historiens du Céleste-Empire; mais, au Japon, je ne l’ai rencontrée que dans des écrits en général peu estimés. Nous ne nous y arrêterons pas davantage.
Ce qu’on nous apprend des deux mikados suivants, le huitième et le neuvième, est à peu près insignifiant. Ils régnèrent de 214 à 98 avant notre ère, et vécurent le premier 117 ans, le second 115 ans. Ces cas de longévité extraordinaire se rencontrent sous plusieurs règnes de la période semi-historique des annales du Japon. Ils provoquent sur l’authenticité de ces règnes des doutes que nous aurons l’occasion d’examiner plus tard.
Le dixième mikado, Mi-maki-iri-biko Imi-ye (-97 à 30), commence à occuper une certaine place dans l’histoire. Sous son règne, en l’année 88 avant notre ère, fut établie, pour la première fois, la charge de syau-gun ou de «lieutenant-général» qui devait être, par la suite, prépondérante dans l’empire, et ne laisser au mikado qu’une autorité purement conventionnelle et nominale.
A cette époque, les tribus autochtones relevaient la tête de toutes parts; le mikado se vit obligé d’établir, dans son empire, quatre grands commandements militaires, à la tête de chacun desquels il plaça un syau-gun. Ce serait cependant une erreur de confondre le caractère de la fonction de syaugoun, à cette époque, avec celui qui devait s’attacher à ce titre environ mille ans plus tard. Dans les anciens temps, et jusqu’au VIIe siècle de notre ère, il n’y a pas eu de caste militaire proprement dite: l’empereur, en cas de guerre, était toujours de droit seul commandant en chef de l’expédition, et jamais cette charge importante n’était confiée à un de ses sujets[66].
C’est également sous le règne de ce même mikado qu’arriva au Japon, la première ambassade étrangère dont l’histoire nous ait conservé le souvenir. Je veux parler de l’ambassade du pays de Mimana, que j’ai eu l’occasion de mentionner dans une conférence précédente. Le Ni-hon Syo-ki nous dit que cette ambassade apporta un tribut au Japon, en automne, au 7e mois de la 65e année du règne de Mi-maki-iri-biko Imiye (an 33 avant notre ère), et ajoute que le pays de Mimana est éloigné de plus de 2000 ri du pays de Tukusi (côté nord-ouest de l’île Kiou-siou), et situé au sud-ouest du pays de Siraki[67], l’un des états qui existaient alors dans la péninsule Coréenne[68]. L’ambassadeur nommé Sonakasiti demeura auprès du prince héréditaire[69]. Le pays de Mimana est également désigné sous le nom d’Amana[70].
Sous le règne du onzième mikado, Ikume Iri hiko I sati (de 29 avant notre ère à 70 après notre ère), le Ni-hon Syo-ki cite une nouvelle ambassade de Corée, qui vint apporter des présents à la cour du Japon. Je m’attache à vous citer les missions envoyées du continent asiatique à la cour des mikado, parce que ces missions ont dû contribuer puissamment à éveiller la curiosité des Japonais, et à implanter dans leur pays les premières racines de la civilisation chinoise.
Sonakasiti, ambassadeur de Mimana, qui était venu à la cour sous le règne précédent et qui avait été attaché à la personne du prince héréditaire, exprima le désir de retourner dans son pays. Le mikado accéda à sa demande, lui fit des présents, et lui remit cent pièces de soie rouge pour son souverain. Pendant le voyage, l’ambassade de Mimana fut arrêtée par des hommes du Sinra, qui la dévalisèrent. On attribue à ce fait l’origine de la haine qui exista, par la suite, entre les deux états[71].
Ces riches présents, sans doute, éveillèrent la convoitise du Sinra. Nous voyons, en effet, un fils du roi de ce pays, nommé Ama-no Hi-hoko, se rendre au Japon, la 27e année avant notre ère, au printemps, le troisième mois, et demander au mikado la faveur d’être admis parmi ses sujets. Ce prince débarqua dans la province de Harima, et s’arrêta dans la ville de Si-sava-no mura. Le mikado lui envoya demander qui il était, et quel était son pays. Ama-no Hi-hoko répondit qu’il était fils du maître du royaume de Sinra, et qu’ayant appris que le Japon était gouverné par un sage empereur, il était venu s’y instruire et se mettre au nombre de ses sujets; qu’enfin il apportait en présent des objets de son pays pour les offrir au mikado. Celui-ci accéda à la demande du prince coréen qui, après avoir visité plusieurs localités du Nippon, se rendit par la rivière U-dino kava dans la province d’Au-mi, et habita quelque temps à A-na-no mura. Il quitta ensuite cette ville et passa dans la province de Waka-sa; puis il se rendit à l’ouest dans celle de Tati-ma, où il fixa sa résidence. Là, il épousa une femme du pays, qui lui donna une progéniture[72]. Les indigènes ont élevé un temple pour honorer sa mémoire[73].
Je suis entré dans ces détails pour montrer que les historiens japonais les plus anciens et les plus autorisés ont conservé avec soin le souvenir de ces premières relations de leur pays avec la Corée, relations auxquelles le Japon doit, sans doute, à une époque très reculée, la connaissance, au moins rudimentaire, des arts et de la civilisation asiatique.
En dehors des relations engagées avec la Corée, les annales du Japon nous rapportent, sous le règne d’Ikoumé Iri-hiko I-sati, quelques autres événements intéressants. Une épouse du mikado, sur les instances de son frère aîné, consent à assassiner ce prince pendant son sommeil; mais, au moment de commettre le crime, elle laisse tomber sur le front de son époux une larme qui le réveille, et l’instruit du projet conçu pour attenter à ses jours. L’impératrice obtient son pardon; mais, désespérée d’avoir causé le malheur de son frère, elle se rend dans un retranchement que celui ci s’était construit avec des sacs de riz. Un envoyé du mikado y met le feu, et le frère et la sœur périssent ensemble dans la fournaise[74]. Il y a, dans ce récit, un motif de tragédie orientale; mais nous n’avons rien de plus à en tirer.
L’art de lutter, si estimé au Japon, commença à se répandre dans ce pays sous le même règne. On y voit aussi l’érection d’un temple consacré à la grande déesse solaire Ten-syau dai-zin, dans la province d’Isé, et une fille du mikado, Yamato-bimé, devenir prêtresse de ce temple, événement qui fut l’origine des fonctions religieuses de Naï-kû, confiées à des femmes, et qui ont continué à subsister jusqu’à notre époque.
Enfin, la quatre-vingt-sixième année du règne d’Ikoumé Iri-hiko I-sati (an 67 de notre ère), le Japon envoya, pour la première fois, une ambassade dans un pays étranger. Cette ambassade, qui apporta des présents à la cour de Chine, est mentionnée dans les historiens chinois[75], mais on ne la trouve citée que dans un petit nombre d’historiens japonais, qui n’en ont gardé la mémoire que grâce aux annales de la Chine[76].
Le douzième mikado, Oho-tarasi-hiho O siro-wake, régna de 71 à 130 après notre ère. Au fur et à mesure que nous approchons du siècle de la guerre de Corée, les annales japonaises deviennent plus précises, plus explicites, plus substantielles: on sent que l’on quitte peu à peu le domaine de l’histoire mythique et légendaire, pour entrer dans celui de l’histoire positive. Durant ce règne, nous voyons rapportées les luttes qui devaient aboutir à l’expulsion définitive du Nippon des chefs Aïno, lesquels perdaient, d’année en année, du territoire et se réfugiaient dans les régions du nord. La première grande campagne, dont on nous donne le récit, fut engagée contre les O-so qui se trouvaient, encore à cette époque, en grand nombre dans le pays de Tukusi (île de Kiousiou). On ne sait pas bien à quoi s’en tenir au sujet de ces Oso, et de nouvelles recherches seront nécessaires pour connaître exactement ce qu’ils étaient. Cependant leur organisation politique, leur manière de combattre, et peut-être davantage leur nom, nous portent à croire qu’ils appartenaient à la race indigène des Kouriliens. O-so signifie «les descendants des ours». Or, l’on sait que l’ours tient une place considérable dans la religion des Aïno, que cet animal est de leur part un objet de vénération, et que leurs chefs, tout au moins, prétendent tirer leur origine des ours sacrés.
Une seconde révolte des O-so, sous le même règne, fut dominée par les forces militaires du mikado, et surtout par la ruse d’un de ses fils, Yamato Take, dont le nom est resté célèbre dans les fastes militaires du Japon.
Enfin les Atuma Yebisu ou Sauvages de l’Est—et, cette fois, il n’y a plus à douter qu’il s’agisse des Aïno—se révoltèrent à leur tour. Yamato Také, chargé par le mikado de marcher contre eux, les battit et les obligea à chercher un refuge dans l’île de Yézo, où ils vivent encore de nos jours sur les côtes et dans la région montagneuse de l’intérieur.
Pendant le cours de son expédition militaire, Yamato Také avait été assailli en mer par une violente tempête. Une de ses femmes de second rang, nommée Tatibana, persuadée que cette tempête s’était élevée par suite de la colère de Riu-zin, le Génie de l’Océan, s’offrit en holocauste à ce dieu, et se noya. La tempête s’apaisa aussitôt. Quelque temps après, le prince Yamato Také se trouva sur une hauteur d’où l’on pouvait contempler à l’est de vastes régions; se rappelant alors le dévoûment de Tatsibana, il s’écria: A-ga tuma! «ô mon épouse!» Depuis cette époque, les provinces orientales du Japon ont conservé le nom de A-tuma.
A la mort de Yamato Také[77], l’empereur plaça les rênes du gouvernement entre les mains de Take-no uti sukune, célèbre personnage qui fut ministre sous six mikados. Les annales du Japon lui attribuent une existence d’une longueur fabuleuse: il aurait vécu suivant les uns 317 ans, et suivant d’autres 330 ans.
Oho-tarasi-hiko-o-siro-wake établit, à la fin de son règne, sa résidence dans la province d’Au-mi. Après avoir occupé le trône pendant soixante années, il mourut âgé de 106 ans, laissant une soixantaine de fils, auxquels il distribua des territoires féodaux dans toute l’étendue de son empire. Les descendants de ces princes existent encore de nos jours en grand nombre au Japon.
On ne sait à peu près rien du règne du treizième mikado, Waka-tarasi (131 à 191 de notre ère), si ce n’est qu’il n’y eut point de guerre à cette époque, et que le peuple vécut heureux et content.
Le successeur de ce prince, Tarasi-naka, quatorzième mikado (192 à 200 de notre ère), était fils du célèbre Yamato-Take, dont je vous ai entretenus tout à l’heure. Il fit une guerre aux O-so, durant laquelle il mourut de maladie d’après les uns, d’une blessure occasionnée par une flèche d’après d’autres[78]. Son règne ne dura que neuf ans: il fut inhumé dans la province de Yetizen.
Nous voici arrivés au grand événement qui clôt la période semi-historique des annales du Japon. Je veux parler de la conquête d’un des royaumes qui composaient à cette époque la Corée, par cette femme extraordinaire que les orientalistes ont surnommée la Sémiramis de l’Extrême-Orient.
L’impératrice Iki-naga-tarasi, plus connue sous son nom posthume de Zin-gu kwau-gu, était arrière-petite-fille de l’empereur Waka-Yamato-neko-hiko-futo-hibi-no sumera-mikoto, et fille d’Iki-naga-sukune: elle avait été élevée au rang de kisaki ou impératrice, la seconde année du règne de Tarasi-naka. Son intelligence n’avait d’égale que sa beauté, et, pour comble de mérite, elle excellait dans l’art de la sorcellerie.
Comme elle se trouvait enceinte à la mort de Tarasi-naka, son époux, elle résolut, d’accord avec le ministre Také-no-outi-Soukouné, de cacher au peuple la mort de l’empereur, afin de ne pas mettre le désordre dans le pays et de pouvoir mener à bonne fin plusieurs campagnes qu’elle avait projetées. Elle convoqua en conséquence son armée, battit les O-so, et se débarrassa de quelques autres rebelles qui fomentaient des troubles dans l’empire. Se confiant ensuite à un pressentiment, elle résolut d’aller attaquer, au-delà des mers, le pays de Sin-ra, en Corée; elle ne voulut cependant point partir sans consulter le sort. Comme elle se trouvait sur le bord de la rivière de Matura, dans la province de Hizen, elle jeta dans l’eau un hameçon suspendu à une ligne, et dit: «Si ce que j’ai projeté doit réussir, l’amorce attachée à mon hameçon sera saisie par un poisson.» Elle souleva aussitôt sa ligne, à laquelle était suspendu un éperlan. L’impératrice s’écria: «Voilà une chose merveilleuse!» A la suite de cet événement, on appela Medura «merveilleuse», la localité qui fut plus tard désignée par corruption sous le nom de Matura[79]. La légende rapporte qu’on n’a pas cessé jusqu’à présent de trouver des éperlans dans cette rivière, mais que les femmes seules réussissent à les y pêcher[80].
Avant de partir pour la Corée, l’impératrice voulut se soumettre à une autre épreuve, afin de bien connaître la volonté des Dieux. Elle se baigna la chevelure dans l’eau de mer, et tout à coup ses cheveux se divisèrent en deux parties et formérent un toupet (motodori) sur le haut de sa tête. Ayant de la sorte l’apparence d’un homme, elle réunit son conseil de guerre, fit les préparatifs pour l’expédition qu’elle avait projetée, mit une pierre sur ses reins pour retarder son accouchement, et prit le commandement de son armée. Une divinité protectrice de l’Océan, Fumi-yosi, plaça la flotte impériale sous sa protection, et marcha à l’avant-garde des vaisseaux.
La flotte de l’impératrice venait à peine de quitter le port de Wa-ni, qu’une violente tempête s’éleva sur l’océan. De gros poissons parurent alors à la surface de l’eau et soutinrent les vaisseaux japonais. L’armée arriva de la sorte, saine et sauve, en Corée. Le roi de Sin-ra, Hasamukin, saisi de terreur, s’écria: «J’ai entendu dire qu’il y avait à l’Orient un royaume des Génies appelé Nip-pon, gouverné par un sage prince du titre de Sumera-mikoto. Ce sont évidemment les troupes divines de ce royaume; comment serait il possible d’y résister[81]?» Il arbora donc un drapeau blanc en guise de pavillon parlementaire, et se constitua volontairement prisonnier de l’impératrice qui lui accorda la vie et se fit livrer ses trésors, ainsi que des otages. Il prit en outre l’engagement de payer un tribut annuel à la cour du Mikado. Les rois de Korai et de Haku-sai, ayant appris ce qui se passait, envoyèrent des espions pour savoir à quoi s’en tenir sur les forces de l’armée japonaise. Convaincus que la lutte serait inégale et sans succès possible pour eux, ils se rendirent au camp de l’impératrice, se prosternèrent la tête contre terre, et implorèrent la faveur de la paix, prenant l’engagement de se reconnaître pour toujours les tributaires du Japon. La triarchie des San-kan fut, de la sorte, soumise tout entière à l’autorité des mikados[82].
Iki-naga-tarasi établit ensuite un campement en Corée, au commandement duquel elle plaça un personnage appelé Oho Ya-da Sukune; puis elle s’en retourna au Japon, emportant avec elle, outre les objets précieux dont elle s’était emparée, des livres et des cartes géographiques.
Arrivée dans le pays de Tsoukousi, conformément à ses vœux, elle accoucha d’un fils, qui fut plus tard l’empereur Hon-da. Elle se rendit ensuite à Toyora, pour accomplir les funérailles de Tarasi-naka, son époux décédé avant la guerre.
Un des fils de Tarasi-naka, né d’une autre mère que Iki-naga-tarasi, sous prétexte qu’il était l’aîné, voulut revendiquer ses droits au trône de son père. Il leva, pour appuyer cette revendication, une armée qui attaqua les troupes de l’impératrice. Také-no outsi Soukouné, ministre de cette princesse, parvint à l’aide d’un stratagème à surprendre à l’improviste le prince révolté, qui ne put sauvegarder sa liberté que par la fuite. De désespoir, il se noya.
Iki-naga-tarasi envoya deux fois des ambassadeurs à la cour des Weï, qui régnaient, à cette époque, en Chine. On trouve, en effet, dans le recueil des Historiens de la Chine, la mention de plusieurs ambassades d’une reine du Japon appelée Pi-mi-hou, qui paraît être la même que l’impératrice épouse de Tarasinaka. Les auteurs chinois disent, il est vrai, que, «devenue adulte, elle ne voulut pas se marier»; mais ils ajoutent qu’elle s’était «vouée au culte des démons et des esprits[83]», particularité qui contribue à rendre l’identification très vraisemblable. Il y a, d’ailleurs, une question de synchronisme qui éclaircit sensiblement le problème.
Une de ces ambassades est fixée à la seconde année de l’ère King-tsou (238 après J.-C.). Une autre ambassade est mentionnée à la quatrième année de l’ère Tching-tchi (243 après J.-C.).
La plupart des historiens japonais sont muets au sujet de ces ambassades; et ceux qui les mentionnent se sont probablement renseignés à des sources chinoises.
Le Nipponwau-dai iti-ran, dont une traduction très imparfaite, rédigée par Titsingh avec le concours des interprètes japonais du comptoir de Dé-sima, a été publiée par Klaproth, parle d’une ambassade de l’empereur des Weï qui aurait été envoyée à la cour du Japon[84]. Le même ouvrage dit que Sun-kiuen, souverain chinois de la dynastie de Ou, eut l’idée d’attaquer le Japon; mais, bien qu’il ait fait passer la mer à plusieurs myriades de soldats, il n’obtint aucun résultat, une maladie pestilentielle ayant décimé son armée pendant la traversée.
Iki-naga-tarasi, suivant les historiens japonais, aurait régné 69 ans et vécu un siècle. Les historiens chinois, au lieu d’attribuer un si long règne à cette princesse, font figurer plusieurs souverains pendant cette période: un roi, qu’on ne nomme point et auquel le peuple refusa de se soumettre; puis une fille de l’impératrice, appelée I-yu, qui monta sur le trône à l’âge de treize ans.
Le successeur de l’impératrice Iki-naga-tarasi fut l’empereur Hon-da, fils de cette princesse et du mikado Tarasi-naka. Si le règne précédent tient encore à la mythologie par le merveilleux dont les historiens indigènes se sont plu à l’entourer, le nouveau règne appartient définitivement à l’histoire. C’est à partir de cette époque que l’usage de l’écriture s’est répandu au Japon, et que les lettrés de ce pays ont commencé à cultiver la littérature chinoise.
Le Ni-hon Syo-ki rapporte qu’en automne de la quinzième année du règne de Hon-da (284 de notre ère), le roi de Paiktse envoya un personnage appelé A-ti-ki ou A-to-ki offrir au mikado deux beaux chevaux de son pays. Ce personnage savait lire le chinois, de sorte que le mikado le nomma précepteur (fumi-yomi-hito «maître de lecture») de son fils, le prince héréditaire Waka-iratuko. A-ti-ki, ayant désigné un lettré du royaume de Haku-sai, nommé Wa-ni, comme le plus capable pour remplir cette mission, Honda envoya chercher Wa-ni en Corée. Celui-ci arriva au Japon l’année suivante (285 de notre ère), et fut aussitôt appelé aux fonctions de précepteur du prince impérial.
Wani appartenait à la famille de l’empereur Kaotsou, de la dynastie des Han, dont un des membres était venu s’établir en Corée, dans le royaume de Paiktse. Mandé à la cour du mikado, il apporta au Japon le Lun-yu ou Discussions philosophiques de l’École de Confucius, le Tsien-tze-wen ou Livre des Mille Caractères, et quelques autres ouvrages chinois, dont nous ne possédons malheureusement pas la nomenclature.
Toutefois, les relations de la Corée avec le Japon, dont elle reconnaissait la suzeraineté[85] depuis les conquêtes de Iki-nagatarasi, deviennent très suivies sous le règne de Honda; et nous voyons des gens de la triarchie des Sankan employés par le mikado à de grands travaux publics, notamment à creuser un lac qui fut nommé San-Kan-no ike «le lac des Trois Kan»[86]. Le prince Waka Iratsouko, élève de Wani, acquit bientôt la connaissance de l’écriture chinoise. On rapporte, en effet, qu’en 297 le roi de Koraï, ayant écrit au mikado une lettre dans laquelle il se vantait que son pays avait apporté l’instruction au Japon, ce prince lut lui-même la lettre, et, après avoir témoigné à l’ambassadeur qui l’apportait son mécontentement pour l’impolitesse de sa teneur, la déchira en morceaux[87].
A partir de cette époque, avec la littérature de la Chine, nous voyons la civilisation chinoise, d’année en année, de plus en plus pénétrer de part en part la civilisation japonaise. La langue écrite du Céleste-Empire devient la langue savante du Nippon, les livres composés dans cette langue, les livres classiques sur la culture desquels sera basée désormais toute instruction soignée, toute éducation libérale.
Nous avons donc à examiner à présent, au moins dans ses traits les plus caractéristiques, cette vieille et à tant d’égards étonnante civilisation du Céleste-Empire, dont la connaissance était naguère encore considérée comme indispensable à tout Japonais qui prétendait au titre de lettré ou même simplement d’homme bien élevé. Depuis la récente invasion des idées européennes au Japon, les indigènes négligent plus que par le passé les études chinoises auxquelles ils s’adonnaient naguère des leur entrée à l’école et jusqu’à la fin de leurs classes. On aurait tort de croire cependant que ces études soient absolument dédaignées, abandonnées par les insulaires de l’Extrême-Orient. Quiconque possède une solide érudition sinologique est assuré de leur estime, de leur courtoisie; et, en bien des circonstances, il n’y a pas pour l’Européen de meilleur moyen d’acquérir la confiance de ces intelligents orientaux, d’arriver à être admis sans détour dans leur intimité, que celui qui consiste à leur montrer qu’on connaît à fond la littérature antique du pays d’où ils ont tiré jadis leur écriture, leurs sciences, leur religion et une grande partie de leurs idées morales et philosophiques.
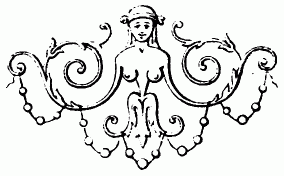

(agrandir)
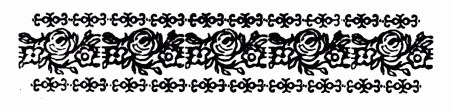
 ES premières relations suivies des Chinois avec les Japonais, au
IIIe siècle de notre ère, furent pour ces derniers le signal d’une
ère nouvelle de transformation sociale. La Chine apportait au Japon une
écriture d’une savante complexité[88], bien faite pour frapper
l’imagination d’un peuple encore enfant, et, avec cette écriture, une
histoire déjà vieille à cette époque de plusieurs milliers d’années
d’antiquité, une philosophie raffinée et des connaissances scientifiques
et industrielles relativement très avancées. Les insulaires de l’extrême
Orient, au naturel inquiet et essentiellement curieux, virent, dans
cette civilisation du continent, un grand modèle à suivre et à imiter,
quelque chose qui était pour eux une véritable révélation. De même que
les Japonais de nos jours se sont empressés de s’initier à toutes les
découvertes du génie européen, depuis l’ouverture des ports de leur
empire au commerce de l’Occident (1852), de même les Japonais des
premiers siècles de notre ère se jetèrent avec avidité sur tout ce qui
pouvait leur faire connaître les progrès accomplis alors sur la terre
ferme du continent asiatique.
ES premières relations suivies des Chinois avec les Japonais, au
IIIe siècle de notre ère, furent pour ces derniers le signal d’une
ère nouvelle de transformation sociale. La Chine apportait au Japon une
écriture d’une savante complexité[88], bien faite pour frapper
l’imagination d’un peuple encore enfant, et, avec cette écriture, une
histoire déjà vieille à cette époque de plusieurs milliers d’années
d’antiquité, une philosophie raffinée et des connaissances scientifiques
et industrielles relativement très avancées. Les insulaires de l’extrême
Orient, au naturel inquiet et essentiellement curieux, virent, dans
cette civilisation du continent, un grand modèle à suivre et à imiter,
quelque chose qui était pour eux une véritable révélation. De même que
les Japonais de nos jours se sont empressés de s’initier à toutes les
découvertes du génie européen, depuis l’ouverture des ports de leur
empire au commerce de l’Occident (1852), de même les Japonais des
premiers siècles de notre ère se jetèrent avec avidité sur tout ce qui
pouvait leur faire connaître les progrès accomplis alors sur la terre
ferme du continent asiatique.
La Chine a toujours vécu dans le passé: elle n’a jamais rêvé d’avenir qui puisse égaler, et encore moins surpasser, les perfections des premiers âges. C’est en étalant les fastes de son antiquité reculée, qu’elle devait d’abord fasciner l’imagination des insulaires du Nippon. Cette antiquité, que les Japonais instruits se sont fait un devoir d’étudier durant la période de leur éducation classique, nous allons essayer de l’envisager dans ses traits les plus saillants et les plus caractéristiques.
On a beaucoup discuté sur l’origine de la nation chinoise: la plupart des orientalistes inclinent à l’idée de placer son berceau au nord ou à l’ouest du continent asiatique. M. d’Hervey de Saint-Denys est porté à lui attribuer une origine américaine[89]. Je ne discuterai point ici ces diverses théories; je me bornerai à dire qu’il résulte de mes travaux que le plus ancien domaine de la civilisation chinoise doit être placé en dehors des limites actuelles de la Chine proprement dite, à l’ouest, dans la direction du Koukou-noor, probablement sur les versants orientaux du mont Kouën-lun.
Quelques savants n’admettent point, sans de grandes réserves, les récits antérieurs à la dynastie des Tcheou (1134-256 avant notre ère), et encore n’accueillent-ils pas sans difficulté ce qu’on nous apprend des règnes de cette dynastie avant Confucius. Je crois les scrupules de ces savants fort exagérés. Il est évident que plus on recul loin dans l’antiquité, plus il faut s’attendre à trouver l’histoire mêlée à la mythologie. Nous possédons néanmoins trop de sources certaines de l’histoire antique de la Chine pour pouvoir reléguer dans le domaine de la fable ce que nous savons, non-seulement des premiers temps de l’époque des Tcheou, mais même une foule d’indices historiques remontant à la dynastie des Chang, à celle des Hia, et, dans une certaine mesure, au-delà de cette dynastie. L’authenticité de cette histoire n’est que médiocrement établie, il est vrai, par les monuments de l’art proprement dit. Les édifices de pierre sont de toute rareté[90], les inscriptions insuffisantes, les bronzes pour la plupart sans légendes sur lesquelles puisse s’exercer la critique avec quelque chance de succès. En revanche, l’institution antique de la charge d’historiographe officiel de l’empire, les conditions remarquables d’indépendance dans lesquelles étaient placés les lettrés chargés de cette haute fonction publique, nous fournissent des garanties de vérité qu’on rencontrerait difficilement ailleurs. La création des historiographes officiels et du Tribunal de l’Histoire est attribuée par les Chinois au règne de Hoang-ti (2637 avant notre ère). Choisis parmi les savants les plus renommés de l’empire, ils écrivaient jour par jour les événements qui se passaient sous leurs yeux; pour les garantir du danger qu’ils pouvaient encourir en racontant les faits qui n’étaient pas de nature à plaire à l’empereur et aux grands, les institutions leur accordaient le privilège de l’inamovibilité.
Les Chinois, comme tous les peuples qui ont occupé une large place dans l’histoire, ont cherché à reporter aussi loin que possible dans l’antiquité les vestiges primitifs de leur existence sociale. Confucius, auquel on doit la reconstitution de leurs plus vieilles annales, était un esprit sobre, d’une imagination étroite, peu enclin aux récits merveilleux. Il chercha sans doute à trouver dans le passé une base sur laquelle il put appuyer sa doctrine; mais, cette base trouvée, il n’eut ni le goût, ni le besoin de faire remonter à des temps plus reculés les fastes du peuple dont il s’était donné la mission de réformer les mœurs et de régler l’existence. Eh bien! Confucius a non-seulement admis comme historique le règne de Hoang-ti, qui vivait au XXVIIe siècle avant notre ère, près de 600 ans avant la naissance d’Abraham, mais même les règnes de princes antérieurs à Hoang-ti, tels que Chin-noung et Fouh-hi, qu’il désigne sous le nom de Pao-hi[91]. Le règne de ce dernier empereur est placé par les historiens indigènes au XXXVe siècle avant notre ère, c’est-à-dire longtemps avant l’époque probable de la fondation des empires d’Égypte, de Babylonie et d’Assyrie, et près de deux siècles avant la date attribuée au déluge biblique.
De quelque côté que nous tournions nos regards, lorsque nous voulons pénétrer les ténèbres de ces premiers temps de l’histoire, nous nous trouvons en présence de fables et de légendes. S’il fallait renoncer aux annales de tous les temps où la vérité s’est associée à la fiction, l’histoire de notre globe serait bien moderne. Il appartient à la critique, fondée sur les principes de l’ethnographie, de démêler ce qui, de ces vieux âges, doit être acquis aux annales de l’humanité et ce qui doit être relégué dans le domaine du mensonge et de la fantaisie. Le contrôle de l’érudition ne saurait être exercé d’une façon trop sévère; mais ce contrôle ne doit point avoir pour effet de repousser sans ample discussion les faits dont l’authenticité ne paraît pas absolument démontrée. L’esprit humain, on l’a dit souvent, invente peu; ses prétendues inventions ne sont souvent que des échos, des réminiscences des temps passés. Une foule de légendes décèlent des faits réels, dont la trace mérite d’être recherchée. Qu’importe, au fond, qu’Homère soit un personnage mythique: son nom signifie l’auteur ou les auteurs de l’Iliade et de l’Odyssée. Il peut se faire que beaucoup de noms chinois des premiers âges n’aient pas été portés par ceux auxquels on les attribue. Ce qui est utile de savoir, dans l’espèce, c’est avant tout quelle a été l’évolution de l’humanité, l’évolution des peuples. Les légendes archaïques de la Chine nous apprennent ce que la tradition locale a conservé des époques primitives de ce vaste empire. Il est intéressant de le connaître.
De ces légendes, la plus considérable, celle qui nous raconte la condition du peuple chinois avant la fondation de la monarchie[92], a été vulgarisée par les Taosse, prétendus sectateurs de la philosophie de Lao-tse, dont l’influence fut prépondérante en Chine à l’époque de la néfaste, mais à coup sûr mémorable dynastie des Tsin (IIIe siècle avant notre ère). Nous y trouvons l’histoire de deux chefs de tribus Yeou-tchao et Soui-jin[93], qui représentent la période durant laquelle les Chinois, non encore civilisés, vivaient à l’état de tribus nomades et à peu près sauvages, dans les régions montagneuses de l’Asie Centrale.
Avec l’empereur Fouh-hi[94], sur l’existence duquel les lettrés indigènes, dit le Père Amyot, n’émettent aucun doute, commence la période où les Chinois se constituent en nation proprement dite, reconnaissent un chef pour toutes leurs tribus et établissent au milieu d’eux une sorte de gouvernement politique et religieux. A ce prince, la tradition attribue l’invention d’une écriture rudimentaire, composée de trois lignes entières ou brisées, qui, suivant leurs combinaisons, servaient à rappeler un certain nombre d’idées simples, adaptées aux besoins de l’administration publique. Les signes de cette écriture sont désignés sous le nom de koua ou trigrammes; ils remplacèrent une écriture formée à l’aide de cordelettes nouées, analogues aux qquipou des anciens Péruviens. Fouhhi est représenté avec des excroissances sur le front, emblèmes du génie, qu’on remarque également sur l’image traditionnelle de Moïse. On le désigne comme le premier législateur de son pays; il ordonna que les hommes et les femmes portassent un costume différent, et institua les cérémonies du mariage. Il passe aussi pour l’inventeur du cycle de soixante ans, encore en usage de nos jours en Chine, en Cochinchine, en Corée et au Japon, ainsi que du calendrier; il enseigna à ses sujets plusieurs arts inconnus jusqu’alors, la musique, la pêche, etc.
A la mort de Fouh hi, Ching-noung[95], dont le nom signifie «le laboureur divin», fut appelé à lui succéder. Il inventa la charrue et l’art de cultiver les champs. Il organisa les premiers marchés, enseigna les principes de l’art de la guerre et s’appliqua à l’étude de la médecine, fondée sur la connaissance des propriétés des plantes.
Les historiens chinois placent quelque fois plusieurs règnes entre ceux de Chin-noung et de Hoang ti; mais ils s’accordent assez mal sur ce qu’ils rapportent sur ces règnes. Avec Hoang ti seulement, leur récit acquiert une apparence de vérité qui ne permet guère de le reléguer en dehors du domaine de l’histoire positive. La soixante et unième année du règne de ce prince (2634 ans avant notre ère), commence le premier des cycles sexagénaires qui se sont succédé depuis lors sans interruption jusqu’à nos jours.
Nous nous trouvons désormais dans le domaine de la chronologie rigoureuse; car cette chronologie est fondée sur une computation des années et des siècles qui ne paraît pas avoir été modifiée, en Chine, depuis les temps les plus reculés. L’année chinoise la plus ancienne était de 365 jours et un quart, juste comme l’année julienne; quant aux siècles chinois, ils se composent de soixante années, formées par la combinaison de deux petits cycles primordiaux, l’un de dix, l’autre de douze éléments, qui, juxtaposés, ne peuvent jamais produire deux fois une notation semblable pendant toute la durée de la période[96].
Hoang ti personnifie donc le point de départ historique des annales de la Chine. Quant aux événements dont le récit est rapporté à son époque, il est évident qu’il ne faut les admettre qu’avec réserve. On nous le représente comme auteur d’une foule d’inventions, attribuées déjà, pour la plupart, aux souverains semi-historiques qu’on cite comme ayant été ses prédécesseurs. Enfin c’est à lui qu’est décerné pour la première fois le titre de ti «empereur», qui fut substitué à celui de wang «autocrate», donné aux princes qui avaient gouverné jusque-là sur la Chine[97]. Ce titre, employé parallèlement avec celui de chang-ti «le haut empereur», par lequel on désignait déjà sous son règne l’Être suprême, établissait, entre le Ciel et le maître de la Terre, une corrélation de nature à rendre sacrées, aux yeux du peuple, les prérogatives de sa haute magistrature. Après Hoangti, on place quatre souverains: Chao-hao fit exécuter de grands travaux publics, composa une musique nouvelle et régla le costume que devaient porter les mandarins des différentes classes; Tchouen-hioh organisa le service des mines, des eaux et des forêts, réforma le calendrier et plaça le commencement de l’année à la première lune du printemps; il décréta enfin que l’empereur seul offrirait désormais le grand sacrifice au Chang-ti; Ti-ko[98] réforma les mœurs de son peuple et introduisit la coutume de la polygamie; Ti-tchi[99], le dernier de cette période, se livra à la débauche et à toutes sortes de désordres. Les anciens de l’empire le déposèrent et élevèrent à sa place son frère Yao[100], avec lequel commence l’histoire enregistrée dans le livre canonique des Chinois appelé Chou-king. Yao et ses deux successeurs au trône, Chun et Yu[101] sont considérés par les Chinois comme les modèles éternels de toutes les vertus qui doivent entourer la majesté d’un souverain. Aussi leur a-t-on décerné le titre de san-hoang «les trois augustes».
Yao attachait un grand prix à l’étude de l’astronomie: il voulut que la vie du peuple fût réglée sur les révolutions des corps célestes. Il considérait la suprême puissance comme une lourde charge, que nul ne devrait envier, mais à laquelle, non plus, personne n’avait droit de se soustraire. Préoccupé de trouver un successeur, il repoussa la proposition que lui faisaient ses ministres de désigner son fils pour occuper le trône après lui, et finit par arrêter son choix sur un pauvre laboureur nommé Chun, qui, né dans une famille obscure et entouré de parents sans talent ni sagesse, sut vivre en paix en pratiquant les devoirs de la piété filiale, étendue, comme le font les Chinois, à tous les rapports qui existent entre les différents membres de la société: l’empereur, les parents et les amis.
Chun (2285 ans avant notre ère) hésita longtemps à accepter le trône que Yao venait de lui offrir; il ne se trouvait pas à la hauteur de la charge que l’empereur avait résolu de lui confier. Sur les instances réitérées de Yao, il se décida enfin à prendre en main les rênes du gouvernement. Comme son prédécesseur, il s’attacha à l’étude des révolutions célestes et au perfectionnement du calendrier; il établit un système de poids et mesures uniforme pour tout l’empire et institua un code de justice criminelle, moins dur pour les coupables que les lois qui étaient en usage avant sa promulgation. Quelques auteurs prétendent même que les punitions corporelles ne furent mises en pratique que sous la dynastie des Hia, et que les châtiments infligés sous le gouvernement de Chun ne consistaient qu’en cérémonies infamantes. Pendant son règne, Chun avait eu à se préoccuper du débordement du fleuve Jaune et des inondations diluviennes qui avaient rendu inhabitables de grandes étendues du territoire chinois. Un jeune homme pauvre, nommé Yu, qui passait pour descendre de l’empereur Hoangti, était devenu l’ingénieur de l’empire et avait dirigé de grands travaux de canalisation pour faciliter l’écoulement des eaux. La sagesse dont ce jeune homme avait fait preuve en maintes circonstances, engagea Chun à le désigner pour son successeur. Yu fit ses efforts pour décider l’empereur à lui préférer un sage du nom de Kao-yao[102]. Cédant enfin à la volonté du prince, il fut installé dans la Salle des Ancêtres et proclamé empereur en 2205 avant notre ère. Avec lui commence la première dynastie chinoise dite des Hia, qui gouverna la Chine pendant plus de 420 ans (2205-1783 avant notre ère). La seconde dynastie fut celle des Chang, laquelle dura 649 ans (1783-1134 avant notre ère). La troisième dynastie enfin, celle des Tcheou, qui vit paraître les deux plus célèbres philosophes de la Chine, Lao-tsze et Confucius, dura 878 ans (1134-256 avant notre ère).
C’est aux livres canoniques appelés King, coordonnés par Confucius et publiés par ses soins, que nous devons la connaissance d’à peu près tout ce que nous savons des âges antérieurs à l’apparition de ce grand moraliste. Les King nous révèlent, dans la haute antiquité chinoise, l’existence d’une sorte de religion monothéiste, dont le culte principal aurait été celui d’un Être supérieur aux hommes, personnification du Ciel, adoré sous le nom du Chang-ti «le Suprême souverain». Quelques orientalistes ont vu, dans ce nom ti, une analogie linguistique avec la racine qui sert à désigner la divinité chez les peuples âryens, et même dans quelques autres rameaux de l’espèce humaine. Nous n’avons pas à examiner ici s’il est possible de croire sérieusement à la parenté du mot chinois ti et des mots θεὁς en grec, deus, divus en latin, dieu en français, teotl en aztèque, etc. De nombreuses et savantes disputes ont été engagées sur le caractère monothéiste de la religion des Chinois préconfucéens. Je ne saurais en rendre compte sans entrer dans une foule de détails qui m’entraîneraient trop longtemps en dehors du cadre de cette conférence[103]. Je me bornerai à ajouter que ce monothéisme, tel au moins qu’il résulte des livres publiés par Confucius, se présente à nous de la façon la plus vague, et que le Chang-ti, le prétendu dieu unique des King, sans cesse confondu avec le Ciel impersonnel, ne saurait être en aucune façon assimilé au Jehovah du canon biblique.
Certains passages des livres sacrés des Chinois sont cependant de nature à rehausser l’idée que nous avons pu concevoir de leur doctrine relative à l’existence d’un être supérieur, directeur libre des choses de l’univers, et à quelque chose qui ressemble fort à notre notion de l’immortalité de l’âme. Mais ces passages n’ont pas encore été suffisamment étudiés, et vous comprendrez que, lorsqu’il s’agit de questions de doctrine aussi délicates, il serait imprudent de prononcer un jugement avant d’avoir soumis les textes à toutes les investigations de la critique. «Le Ciel lumineux, dit le Livre sacré des Poésies, a des décrets qui s’accomplissent[104].» Et, ailleurs, le même livre s’exprime ainsi: «Le Ciel observe ce qui se passe ici-bas; il a des décrets tout préparés[105].» Les passages de ce genre ont été longuement discutés par les auteurs chinois; mais leurs commentaires en affaiblissent plutôt qu’ils n’en étendent la portée. Je ne saurais m’y arrêter.
L’idée de l’immortalité de l’âme, et peut-être même celle de la résurrection de la chair ou de la renaissance du corps dans l’empyrée, semblent résulter également de quelques passages fort anciens des King. On lit notamment dans le Livre des Vers: «Wenwang réside en haut: oh! qu’il est lumineux au Ciel[106]», et un peu plus loin, dans la même pièce: «Wenwang est aux côtés du Suprême Souverain[107]». D’ailleurs, le culte des ancêtres, qui tient une place si considérable dans les institutions chinoises, présuppose une sorte de croyance dans la perpétuité de l’individu, et il ne paraît pas se réduire à une simple vénération du souvenir. Ce culte, largement célébré dans le Chi-king, où l’on trouve une série d’hymnes en l’honneur des parents défunts[108], remonte aux temps les plus reculés de la monarchie; car les commentateurs du Koueh-foung voient, dans une des odes de cette section[109], l’éloge de ceux qui ont conservé la coutume de porter trois ans le deuil de leurs parents, coutume déjà tombée en désuétude à cette époque.
Ce qui pourrait contribuer à rehausser l’idée que nous pouvons nous faire des croyances métaphysiques de la Chine antique, c’est la persistance avec laquelle ses anciens codes s’attachent à distinguer le formalisme des sacrifices de l’esprit qui doit les inspirer. A cet égard, le Mémorial des Rites est aussi clair, aussi explicite que possible: «Dans les cérémonies, nous dit le quatrième livre canonique, ce à quoi on attache le plus d’importance, c’est le sens (i) qu’elles renferment. Si l’on supprime le sens, il ne reste que les détails extérieurs, qui sont l’affaire des servants des sacrifices; mais le sens est difficile à comprendre[110].»
Aux époques primordiales de l’histoire de Chine, nous trouvons déjà les sacrifices en grand honneur, et celui que l’on offrait au Ciel, accompli par l’empereur en personne. Ces sacrifices, comme l’a fort bien remarqué Pauthier[111], différaient profondément de ceux que nous voyons pratiquer dans les autres cultes: c’étaient des témoignages de reconnaissance et de respect, et non des actes expiatoires pour obtenir des faveurs exceptionnelles ou des changements aux lois régulières de la nature.
Quel que soit, en somme, le caractère précis de la religion primitive de la Chine, nous pouvons constater qu’elle s’est traduite, du moins dans la pratique, par une organisation patriarcale de la société et de la famille. L’expression fondamentale de la morale religieuse des Chinois—et leur religion n’a guère été autre chose qu’une morale religieuse—est incontestablement le hiao, mot que les orientalistes traduisent d’ordinaire par «piété filiale», mais dont le sens est beaucoup plus large, plus étendu que celui des mots par lesquels nous le rendons en français. Le hiao résume les devoirs sociaux entre l’empereur et ses sujets, entre les divers rameaux de la famille, entre les différents membres de la société. Ces devoirs ont pour point de départ ou pour fin l’autorité paternelle, autorité absolue et indiscutable, qu’elle s’attache à la personne du prince, père du peuple, ou qu’elle s’applique à celle du chef de famille, père et tuteur né de tous les individus qui la composent. De même que la majesté de l’empereur est inviolable et ne saurait être appelée à un tribunal quelconque par ses sujets qui sont ses enfants, de même le père de famille n’est justiciable d’aucune autorité judiciaire, lorsqu’il est accusé par ses fils. Au contraire, le parricide, les mauvais traitements, les injures qu’on fait subir à son père, sont punis par les peines les plus effroyables: le fils criminel envers l’auteur de ses jours est taillé en pièces et brûlé; sa demeure est rasée[112].
La loi, malgré la constitution despotique de la Chine, est plus exigeante encore pour l’accomplissement des devoirs envers les parents qu’envers l’empereur lui-même. Tout fils soumis à ses père et mère doit cacher leurs fautes et s’abstenir de les blesser par des réprimandes ou des observations inopportunes. Tout sujet soumis à son prince ne doit ni craindre de l’offenser par les remontrances que suggère le bien public, ni cacher les fautes qu’il lui voit commettre[113].
Maître absolu de ses enfants, le chef de famille est également maître absolu de son épouse. Ce serait cependant une exagération regrettable de dire que la femme, dans l’antiquité chinoise, ait été esclave. La femme intelligente y est, au contraire, l’objet d’une grande estime: les liens du mariage y sont sacrés, inviolables. Le Livre canonique des Chants populaires, à part un très petit nombre de pièces dont la tournure est un peu lascive, respire un parfum de vertu conjugale qui s’accorde mal avec ce qu’on a dit de la polygamie des anciens Chinois. Il est certain que la pluralité des femmes était permise dès les temps des premières dynasties, mais il est aussi positif que la fidélité, le bonheur des époux monogames, la perpétuité des liens contractés pour une durée qui dépasse même la vie terrestre, étaient hautement vantés en Chine, bien des siècles avant Confucius. «L’union des époux, dit le Livre sacré des Rites, une fois accomplie, jusqu’à la mort il n’est plus permis d’y rien changer[114].» Un vieux chant sacré du royaume du Tching[115] exprime les sentiments d’un homme qui se montre heureux de vivre avec sa seule épouse et indifférent aux charmes des beautés qui rivalisent autour de lui par le luxe de leur éclatante toilette[116]. Un autre chant nous représente une femme séparée de son mari pour le service du roi, ne rêvant plus qu’au moment d’être réunie à lui dans la tombe[117].
Les Chinois attachent un si grand prix à la perpétuité des liens du mariage qu’ils font un objet de vénération des veuves qui ne consentent point à se remarier. La coutume de décerner à ces femmes des honneurs publics existe en Chine depuis des temps bien antérieurs à Confucius. Leurs vertus sont célébrées dans les hymnes sacrées[118]; on érige, au nom de l’empereur, des tablettes de marbre blanc pour perpétuer leur souvenir. Je dois avouer que, du côté de l’homme, la conservation de la fidélité conjugale et la perpétuité de ses liens n’ont pas préoccupé au même degré les philosophes chinois. L’infériorité de condition de la femme n’est évidemment pas contestable dans la morale écrite; elle l’est beaucoup moins encore dans la vie quotidienne. «Les femmes, dit le P. Lacharme, s’occupaient à coudre les vêtements. Le troisième mois après la célébration de leurs noces, elles se rendaient à la salle consacrée à la mémoire des ancêtres de leur mari, et, après cette visite seulement, elles prenaient la direction de leur ménage[119]».
Le respect professé par la morale chinoise pour le père de famille devait entraîner nécessairement, comme conséquence, le culte des aïeux. Ce culte, profondément enraciné dans le cœur des Chinois, est peut-être l’institution qui a le mieux résisté à toutes les vicissitudes des siècles de démoralisation et de décadence. Il est encore pratiqué avec le plus grand zèle, non-seulement au Céleste-Empire, mais encore dans les pays voisins, qui ont subi l’influence civilisatrice de la Chine. Les souverains se sont d’ailleurs attachés de tout temps à donner, à cet égard, un exemple édifiant à leurs sujets, et ils ont toujours professé le plus profond respect pour les hommes avancés en âge. «Dans le festin en l’honneur des vieillards, qui se donnait au Grand-Collège, dit le Livre sacré des Rites, l’empereur retroussait ses manches et découpait les viandes; il prenait les assaisonnements et il en offrait; il prenait la coupe et donnait à boire».[120]
Je ne puis m’étendre davantage sur le sujet si intéressant que je n’ai fait qu’effleurer ici. Il ne me reste plus que quelques instants; je les emploierai à expliquer comment, dans une monarchie despotique comme l’a toujours été la Chine, les préceptes de la morale antique ont su atténuer la rigueur de l’autocratie souveraine, assurer d’importantes prérogatives aux hommes de science, et donner, en somme, aux lettrés de l’empire une certaine liberté pour la critique des actes du Fils du Ciel et de son gouvernement.
Si l’on étudie la philosophie de Confucius, sans tenir compte du milieu où elle s’est produite et de l’application pratique qu’elle devait avoir dans ce milieu, on est d’abord porté à n’y voir qu’un tissu de lieux communs, et rien de ce qui rehausse les grandes doctrines de la Grèce et de l’Inde. Confucius n’a jamais été métaphysicien, rêveur, ni poète: il n’avait en vue que des résultats immédiats, et, parmi ces résultats, il n’en trouvait pas qui lui parussent plus nécessaires que d’assurer la concorde entre le prince et ses sujets. Il fallait modérer l’exercice de l’omnipotence impériale, habituer le peuple à souffrir le joug, et lui donner, sinon la possession de ses droits civiques, du moins le bonheur de la famille, le bonheur domestique. A ce point de vue, on peut dire qu’il a grandement réussi, qu’il a accompli une œuvre aussi digne d’éloges que digne de mémoire. En lisant les chroniques des «saints empereurs» Yao, Chun et Yu, on serait tenté de croire que la vertu la plus parfaite était la seule loi qui guidât les princes dans la Chine antique. Mais nous ne pouvons douter que cette vertu impériale, si vantée par les historiens chinois, appartienne bien plus à la légende qu’à la froide réalité. D’ailleurs, à côté de ces souverains exemplaires, les annales indigènes nous citent des empereurs qui ont abusé de la façon la plus cruelle, la plus dévergondée, de tous les privilèges de la suprême autocratie; et, à l’époque où parut le célèbre philosophe de Lou,—cette époque-là ne saurait être contestée comme historique,—la Chine était en pleine démoralisation, en pleine désorganisation sociale. Le grand art de Confucius fut de faire accueillir par les maîtres de l’état l’idée que la vertu était une qualité enviable pour un souverain; qu’un souverain était bien autrement grand quand il savait mettre un frein à l’exercice de sa toute-puissance, que lorsqu’il montrait au monde la satisfaction effrénée de sa volonté et de ses caprices. Il ressuscita, s’il n’inventa point complètement, le spectacle d’un empire gouverné par des princes jaloux du bien-être de leur peuple. Il montra la souveraineté comme une lourde charge imposée par le ciel, que le plus noble dévouement permettait seul d’accepter. Il sut faire accepter les Rites comme la base sur laquelle devait reposer l’édifice de la monarchie, et sans lequel cet édifice était inévitablement condamné à s’écrouler à courte échéance. Voltaire a dit de lui:
On le crut en effet, et vingt-cinq siècles après lui n’ont cessé de le croire et de le respecter. Les souverains n’ont pas toujours suivi ses enseignements; mais, quand ils s’en sont éloignés, l’exercice de leur autorité est bientôt devenu impraticable; ils n’ont pas été brisés par la force brutale: ils se sont anéantis par la force d’une morale puissante et traditionnelle.
Le respect social, autre forme de ce que Confucius appelait le hiao «piété filiale», est devenu, grâce à ce grand moraliste, le fondement de la civilisation chinoise. Le respect, c’est vis-à-vis de la raison, c’est vis-à-vis des interprètes de la raison, qu’il doit se manifester. Les rites chinois ont voulu que tout citoyen, depuis l’empereur jusqu’au dernier des plébéiens, s’inclinât devant le sage, devant l’instituteur de la philosophie et de la science. «Le prince qui fait ses études, dit le Li-ki, éprouve de la difficulté à respecter son précepteur (parce qu’il est habitué à traiter tout le monde comme ses sujets). Cependant le respect pour son maître n’est qu’un hommage à la vertu; et, en rendant hommage à la vertu, on fait que le peuple apprend à avoir de la considération pour les études. Aussi y a-t-il deux circonstances où un souverain ne traite pas ses sujets comme des sujets: la première, lorsque quelqu’un représente la personne d’un aïeul défunt; la seconde, lorsqu’une personne remplit les fonctions de précepteur[121].»
Les hommes de science, c’est-à-dire les hommes qui ont approfondi la philosophie et la morale antique, jouissent de la sorte, en Chine, des plus précieuses prérogatives. Dans un pays essentiellement égalitaire, où il n’existe aucune noblesse féodale, où les lettrés sont les nobles[122], les grades universitaires servent seuls à constituer une caste supérieure et privilégiée. Le modeste titre de bachelier suffit pour modifier la situation d’un inculpé cité à la barre d’un tribunal, vis-à-vis du magistrat appelé à le juger.
Les prérogatives des lettrés se manifestent surtout dans plusieurs grandes institutions dont je ne puis dire que quelques mots en ce moment. Les fonctions d’historiographe officiel de l’empire, qui furent en quelque sorte des fonctions héréditaires, depuis la dynastie des Tsin jusqu’à celle des Soung[123], donnèrent aux lettrés qui en furent successivement investis le droit d’écrire avec une certaine liberté de critique les annales des princes qui régnaient à leur époque. J’ai résumé dans une autre enceinte[124] les principaux traits de l’histoire de cette institution, qui donne aux annales de la Chine un caractère de véracité et d’indépendance difficile à trouver ailleurs. J’ai cité l’histoire de cet historiographe qui, invité par l’empereur à se taire au sujet d’un des actes de son règne, se borna à répondre à l’autocrate que, non seulement il lui était impossible de passer sous silence ce qu’il désirait cacher à la postérité, mais que son devoir lui imposait encore de rapporter l’injonction de l’empereur d’avoir à se taire en cette circonstance.
Il ne suffisait pas cependant qu’il y eût un fonctionnaire chargé de faire connaître aux âges futurs les vertus et les défauts du prince, il fallait encore qu’un magistrat placé près de la personne de l’empereur fût chargé de lui adresser des représentations, lorsqu’il jugerait que le souverain s’était écarté de la droite ligne. Ainsi fut créée la haute dignité de Censeur Impérial. Le censeur avait le droit d’accuser publiquement l’empereur de manquer à ses devoirs; et, lorsque celui-ci abandonnait la sainte doctrine des sages rois de l’antiquité, il avait sans cesse présente à la mémoire, pour la lui répéter, cette parole du Livre sacré des Poésies: «Empereur, ne sois point la honte de tes aïeux[125]!» Il est bien évident que, dans la longue durée de cette institution, plus d’un censeur se fit le plat courtisan du maître; mais il est juste de dire aussi que plus d’un n’hésita pas à accomplir son devoir au péril de sa vie. Un censeur, persuadé du sort qui l’attendait, un jour qu’il avait à faire à l’empereur des représentations contrairement à sa volonté, fit conduire son cercueil à la porte du palais où il allait s’acquitter de sa charge.[126] Un autre, torturé, écrivit avec son sang ce qu’il n’avait plus la force d’exprimer à haute voix. La tyrannie éphémère a pu les condamner parfois au dernier supplice: elle a été impuissante à arracher de l’esprit chinois le droit qui leur appartient de blâmer au besoin les actes du souverain et de faire appeler devant leur tribunal les princes et les prolétaires devenus égaux, du moment où les uns ou les autres sont tombés sous le coup de leurs accusations.
En somme, sous le despotisme chinois, les disciples et successeurs de Confucius ont proclamé hautement et fait accepter par tous, comme principe fondamental de la politique, des formules qu’on croirait émanées de la démocratie moderne: «Le Fils du Ciel est établi pour le bien et dans l’intérêt de l’empire, et non l’empire, pour le bien et dans l’intérêt du souverain[127].» Le droit à l’insurrection est même énoncé clairement dans un passage du livre de Mencius[128].
On doit assurément flétrir le despotisme des empereurs de Chine comme tous les autres despotismes; mais il serait injuste de croire qu’il est plus barbare que ne l’a été l’autocratie d’une foule de souverains européens. Il faut même ajouter, à l’honneur de la civilisation chinoise, que la morale publique, la morale écrite, je pourrais dire la morale officielle, condamne ses abus et ses excès, avec une énergie et une persistance dignes à plus d’un égard de notre respect et de notre admiration.

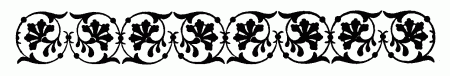
 E siècle de Confucius fut un des grands siècles de l’histoire morale et
intellectuelle de l’humanité. Il vit paraître en Chine le philosophe
Laotsze, dans l’Inde le bouddha Çâkya-Mouni, à peu près en même temps
que Zoroastre allait chercher dans des pays inconnus les préceptes
d’une foi nouvelle, et Pythagore, en Égypte, l’initiation, à la suite de
laquelle il fonda la célèbre École Italique.
E siècle de Confucius fut un des grands siècles de l’histoire morale et
intellectuelle de l’humanité. Il vit paraître en Chine le philosophe
Laotsze, dans l’Inde le bouddha Çâkya-Mouni, à peu près en même temps
que Zoroastre allait chercher dans des pays inconnus les préceptes
d’une foi nouvelle, et Pythagore, en Égypte, l’initiation, à la suite de
laquelle il fonda la célèbre École Italique.
Je ne vous présente point ces synchronismes dans le but d’en tirer la conclusion que tous ces célèbres instituteurs ont puisé leurs idées à une source commune. Si, avec quelque apparence de vérité, on a pu énoncer l’hypothèse que Laotsze avait tiré sa doctrine du même courant philosophique où Çakya-Mouni avait trouvé l’inspiration première de la sienne[129], c’est sans raison qu’on a dit que Confucius avait pu profiter des enseignements de la Grèce et s’approprier les théories de Pythagore et les préceptes du prophète Ezéchiel[130]. L’histoire de la vie du philosophe chinois et l’itinéraire de ses voyages, qui ne l’ont jamais porté en dehors des frontières de la Chine, sont trop bien connus pour qu’on soit en droit de supposer qu’il ait jamais rien su des opinions morales et politiques cultivées chez les peuples étrangers. Son œuvre ne lui est pas exclusivement personnelle, bien loin de là; mais tous ses emprunts, il les a faits aux vieilles traditions de son pays. De sorte qu’on peut affirmer sans crainte que son œuvre est essentiellement chinoise. C’est ce qui fait, sans doute, qu’elle a survêcu à vingt siècles de révolutions, dans un des plus vastes empires qu’ait connus l’histoire, et est restée, de nos jours encore, debout et florissante au milieu du groupe ethnographique le plus dense, le plus populeux qui se soit conservé sur la surface du globe.
Confucius, c’est la Chine ancienne et moderne personnifiée dans un seul homme. Cet homme n’a certainement pas été le génie le plus original, le penseur le plus profond, le philosophe le plus pénétrant, le narrateur le plus aimable qu’ait enfanté l’immense région où coule le fleuve Jaune. Loin de là; son génie ne s’assimila qu’avec peine celui qui avait plané sur l’empire aux mémorables époques antérieures à la dynastie des Tcheou (1134 avant notre ère); sa pensée ne sut point s’élever au-dessus du domaine du bon sens le plus vulgaire; sa philosophie ne s’engagea, pour ainsi dire, jamais dans les régions périlleuses de la métaphysique, et ne se préoccupa guère plus de la physique; ses connaissances, en somme, furent des plus modestes, et sa faible imagination ne lui permit qu’après de pénibles efforts de comprendre quelque chose à la musique, sans qu’il lui fût jamais donné d’atteindre à la hauteur de la poésie. Ce serait à tort qu’on appellerait Confucius philosophe, si l’on entendait donner à ce mot une signification supérieure à celle que fournit son étymologie. Il fut un sage, un moraliste, tant soit peu un économiste; en tenant compte de l’époque où il vécut, c’est assez dire pour sa gloire, et je ne vois pas l’avantage de lui attribuer des qualités qu’il n’eut point, et dont l’énonciation enthousiaste, par la bouche de maint historien, n’a eu pour effet que de fausser l’histoire et de dénaturer le caractère d’une œuvre toute de paix et d’éducation publique.
Tout autre fut Laotsze, son contemporain[131]. Laotsze ne nous est connu que par un ouvrage mutilé, fort obscur, en certains endroits inintelligible. Cet ouvrage, intitulé Tao-teh-king «Le livre de la Voie et de la Vertu»[132], n’en a pas moins suffi pour assurer à son auteur une célébrité exceptionnelle, et pour donner naissance à une secte nombreuse, à certaines époques omnipotente, et au sein de laquelle se sont élevés, d’âge en âge, des philosophes d’une incontestable valeur.
Les difficultés inhérentes au texte du Tao-teh-king sont telles que, sur bien des points essentiels, il n’est pas possible de savoir au juste à quoi s’en tenir au sujet des idées de Laotsze; mais on peut en comprendre suffisamment pour entrevoir au moins les traits caractéristiques de sa doctrine.
Confucius croyait à la perfection dans la nature et dans l’homme: il admettait qu’en se conformant à la nature, l’homme pouvait être heureux. L’idée de la perfection originelle de l’homme, profondément enracinée dans son esprit, est l’objet d’une maxime enseignée dans toutes les écoles où l’on garde religieusement le culte de sa mémoire: «La nature de l’homme est bonne en principe» (Jin-seng pen chen).
Au contraire, Laotsze, comme le bouddha Çâkya-Mouni, n’a pas foi dans la destinée de l’homme, dont il considère l’activité comme un suprême malheur. A l’inverse du philosophe Fichte, il enseigne que la suprême vertu consiste dans le «non-agir». C’est en se soumettant au principe de l’inaction qu’on se conforme à la Loi éternelle (tchang tao). L’individu n’est rien qu’un instrument de cette loi qui est la Fatalité absolue; et, comme la raison de cette fatalité est incompréhensible pour l’homme, son devoir est de ne rien faire, car toute action, toute pensée même, est inutile, partant nuisible et coupable, puisqu’elle ne peut s’associer à la Voie Suprême dans laquelle est entraîné, inconscient, l’univers tout entier. C’est quand l’homme est arrivé à ne plus être distinct de la Loi Eternelle par l’annihilation de son individualité qu’il atteint la suprême perfection, laquelle consiste à se confondre lui-même dans cette Loi Eternelle, qui ressemble étonnamment à ce que les bouddhistes appellent le nirvâna.
Confucius, voyant la décadence des mœurs de son pays,—et la corruption dont la cour des Tcheou donnait le fatal exemple au peuple chinois,—se crut prédestiné au rôle de réformateur. Il parcourut plusieurs parties de l’empire pour étudier les mœurs et les besoins des populations; puis, comme il trouva nécessaire de baser ses enseignements sur une autorité non encore complètement oubliée des masses, il s’attacha à rechercher les préceptes écrits de la morale antique, et les rites que les anciens rois avaient adoptés pour faciliter l’application de ces préceptes. A la mort de sa mère, il voulut accomplir, de point en point, les cérémonies que la sagesse des premiers rois avait prescrites pour les funérailles. Le spectacle solennel de ces cérémonies, oubliées depuis longtemps, impressionna à un haut degré les Chinois qui, depuis lors jusqu’à notre époque, ne cessèrent plus de s’y conformer de la façon la plus rigoureuse.
La vie austère du grand moraliste appela sur lui l’attention de plusieurs des princes qui régnaient alors sur diverses parties de la Chine. Appelé à leur cour, il y fut accueilli avec les plus grands honneurs, et reçut des charges qu’il accepta parfois dans l’espoir de profiter de son autorité pour réformer les abus. Mais, le plus souvent, ces princes, tout en lui témoignant la plus haute estime, continuèrent à vivre dans le luxe et la débauche. La rigidité de sa doctrine le mit souvent en butte à la persécution, et peu s’en fallut qu’il ne fût mis à mort, en châtiment de l’indépendance des représentations qu’il ne craignait pas d’adresser aux rois et aux grands.
Dégoûté de la vie publique, à l’âge de soixante-huit ans, il rentra dans le royaume de Lou, sa patrie, et se livra dès lors sans relâche à la révision des Livres Canoniques de la Chine antique, dont il avait recueilli des fragments dans ses voyages, et surtout dans les archives de la grande bibliothèque impériale des Tcheou. A ses derniers moments, il confia ces livres canoniques à ses disciples qui les transmirent à la postérité sous le nom de King.
L’existence de Laotsze nous est dépeinte sous des couleurs qui contrastent, de la façon la plus tranchée avec celle de Confucius. Loin d’aller au-devant des masses, de rechercher leur confiance, d’ambitionner une popularité, quelque légitime qu’elle ait pu être, Laotsze cherche à vivre dans l’isolement, ne s’entoure point de disciples, ne reçoit qu’avec regret les visiteurs qui viennent lui demander des leçons, et se montre toujours indifférent à l’opinion du monde. Lorsqu’un jour Confucius se décide à l’aller voir dans sa retraite, il le reçoit froidement, lui reproche l’orgueil qu’il fonde sur la foule des admirateurs dont il se laisse entourer, et le congédie après n’avoir donné à ses questions que des réponses brèves et évasives.
Confucius et Laotsze n’en ont pas moins été les deux plus grands instituteurs de la Chine, et leur doctrine n’a jamais cessé d’y compter de nombreux sectateurs, même depuis l’époque où la foi du bouddha Çâkya-Mouni est devenue la religion officielle de l’Empire. Il est juste de reconnaître, cependant, que la morale essentiellement pratique de Confucius y a implanté plus profondément ses racines que la philosophie abstraite de Laotsze. Confucius, en fondant ses enseignements sur les antiques doctrines des premières dynasties, répondait aux besoins de la nation chinoise, jalouse de trouver dans le passé la raison d’être de son autonomie nationale. Les Fils du Ciel eux-mêmes avaient tout intérêt à s’appuyer sur les principes de son École, pour consolider leur autorité suprême. Il fallait un homme aussi audacieux que le fut Tsin-chi Hoang-ti, ce génie puissant et orgueilleux de la révolution chinoise au IIIe siècle avant notre ère, ce célèbre persécuteur des lettrés et ce constructeur de la Grande-Muraille, pour répudier les enseignements de Confucius et leur préférer, non point la philosophie de Tao-teh-king, comme on l’a trop souvent répété, mais les pratiques extravagantes et désordonnées de la congrégation des Taosse. Les tao-sse se donnent comme les disciples de Laotsze; mais rien n’est aussi contraire à la pensée de ce grand maître que leur culte, dans lequel se sont infiltrées toutes les pratiques de la plus grossière idolâtrie, alliée à l’exercice de la magie et de la sorcellerie. La faveur dont ils furent l’objet, sous le règne de Tsinchi Hoangti, vint de ce que le prince, dont le nom signifie le Souverain suprême premier de sa race, voulait, à tout prix, effacer les souvenirs des âges qui l’avaient précédé; ce qui l’obligeait à proscrire la lecture des livres de Confucius, où ces âges étaient exaltés, glorifiés. Les Tao sse eurent encore quelques jours de faveur, sous la dynastie de Tang (618 à 906 de notre ère), grâce à la supercherie au moyen de laquelle ils persuadèrent à l’empereur qu’il descendait du philosophe Laotsze. Mais, sous la dynastie mongole, ils se virent persécutés, poursuivis, et leurs livres condamnés à la destruction. Depuis lors, ils ont pu reconquérir une certaine somme de liberté, mais ils n’ont jamais cessé d’être surveillés par le gouvernement chinois, qui a tenu à les isoler, autant que possible, dans les enceintes étroites de leurs monastères et de leurs couvents[133].
Laotsze, s’il n’a pas eu de disciples durant sa vie, n’en a pas moins fondé, en dehors du tao-sséisme vulgaire et grossier, une école philosophique où se sont distingués des penseurs et des écrivains remarquables à plus d’un titre. Il n’entre pas dans le cadre exigu de cette conférence, d’énumérer même les noms les plus distingués de cette école. Je me bornerai à citer les deux plus anciens, qui sont d’ailleurs les plus célèbres.
Lieh Yu-keou, communément appelé Lieh-tsze, est un des plus fameux philosophes de l’école de Laotsze. Il vivait au IVe siècle avant notre ère; on lui doit un livre intitulé Tchoung-yu tchin king, qui n’a encore été l’objet d’aucune traduction, d’aucune notice analytique.
A la même époque parut le célèbre Tchouang-tsze, qui composa un ouvrage intitulé Nan hoa king «le Livre sacré de la Fleur du Sud».[134] En tête de cet ouvrage, se trouve un chapitre intitulé Siao-yao-yeou, que l’on considère comme une des productions les plus remarquables et les plus singulières de cette branche de la littérature chinoise[135].
Ce n’est qu’à une époque plus moderne, et à la suite de la grande révolution opérée par Tsinchi Hoangti, que l’on rencontre, dans les ouvrages de cette secte, des dissertations sur les sciences occultes, la magie, les divinités célestes et infernales, le breuvage de l’immortalité, etc.
La philosophie de Confucius, si elle ne décèle pas une somme de spéculation intellectuelle égale à celle qui a donné naissance à l’œuvre de Laotsze et de quelques-uns de ses successeurs, a eu du moins l’avantage de ne jamais provoquer le dévergondage qui s’est maintes fois donné libre carrière dans les productions des auteurs taosseistes. Le bon sens, qui fut le guide fidèle du grand moraliste de Lou, fut aussi l’inspirateur des écrits de son école. Un de ses plus illustres représentants, Meng-tsze, connu des Européens sous le nom latinisé de «Mencius», et contemporain des philosophes taosseistes, Liehtsze et Tchouangtsze, consigna ses idées relatives à l’organisation sociale et à l’économie politique dans un livre qui, par son ancienneté et sa valeur, a mérité d’être compté parmi les Quatre livres classiques des Chinois (Sse chou). Mencius avait été disciple de Tsze-sse, lui-même disciple et petit-fils de Confucius, et auteur du Tchoung-young, second des Quatre livres que je viens de mentionner. Mengtsze croit que l’homme est bon par nature; mais que, doué du libre arbitre, il a besoin d’être dirigé pour ne pas corrompre les qualités qui, dès sa naissance, existent en lui à l’état rudimentaire.
A l’époque où se produisit le grand mouvement intellectuel auquel s’attachent les noms de Confucius et de Laotsze, la Chine, dont l’étendue était beaucoup plus restreinte qu’elle ne l’est aujourd’hui, se trouvait morcellée en plusieurs petits états, au milieu desquels était enclavé le maigre empire suzerain des Tcheou. L’insuffisance des derniers princes de cette dynastie, la corruption qui régnait à leur cour, resserraient sans cesse les étroites frontières de cet empire. A l’époque d’Alexandre le Grand (312 av. notre ère), il ne s’étendait pas, du côté du nord, au delà des rives du fleuve Jaune, et n’atteignait déjà plus, du côté du sud, celles du Kiang.
Tandis que l’empire des Tcheou, rongé par toutes les débauches et toutes les dépravations, allait s’amoindrissant de jour en jour, les états feudataires relevant de cet empire devenaient de moins en moins nombreux, à l’avantage de celui de Tsin qui dominait déjà sur un cinquième de la Chine. Nan-wang, souverain des Tcheou, comprenant enfin les projets ambitieux de Siang-wang, roi de Tsin, ordonna à tous les princes qu’il considérait comme ses vassaux, de prendre les armes contre ce puissant ennemi. Mais bientôt, saisi lui-même de terreur, il alla se constituer prisonnier de son rival qu’il reconnut pour son maître, après lui avoir cédé les trente-six dernières villes qui étaient restées en son pouvoir. Ainsi finit la dynastie des Tcheou, l’an 256 avant notre ère.
Nous ne nous occuperons pas ici du règne éphémère des rois de Tsin que l’histoire place en tête de la dynastie de ce nom, et nous arriverons de suite à l’époque mémorable de Tsin-chi Hoang-ti, qui fut en réalité le premier empereur de cette dynastie, et même le prince qui la résume tout entière. Ce puissant génie, que quelques auteurs ont comparé à Napoléon Ier et qui sut élever pour la première fois la Chine à la hauteur d’un grand et puissant empire autonome, voulait, dans son orgueil, que l’histoire commençât avec lui, que ses successeurs ne portassent plus pour nom qu’un numéro d’ordre d’une série unique dont il aurait occupé la tête, et qu’en conséquence tout le passé fût enseveli dans un éternel oubli. C’est en partant de ces idées qu’il décréta l’incendie des livres sacrés recueillis par Confucius et par ses disciples, ainsi que tous les ouvrages historiques qui étaient alors dans l’empire. Ses persécutions contre les lettrés lui valurent la haine implacable de presque tous les hommes qui, depuis son époque, se livrèrent en Chine à la culture des lettres. L’histoire de ce prince a sans doute été, de la sorte, profondément altérée; et il paraît évident que, si ses crimes ont été soigneusement enregistrés, la haine et une certaine somme de calomnie se sont efforcées d’amoindrir la mémoire de ses hautes capacités politiques et militaires. Les annalistes chinois vont jusqu’à prétendre qu’il n’appartenait pas à la race des princes de Tsin. Un riche marchand du pays de Tchao aurait conçu l’ambitieux projet de faire monter au trône un enfant de son sang, et, dans ce but, se serait procuré une esclave d’une extrême beauté qu’il aurait fait accepter pour épouse à I-jin, héritier du prince de Tsin, après l’avoir fait séjourner quelques jours sur sa couche.
Ce récit paraît d’autant plus apocryphe que la mère de Tsinchi Hoangti, au dire des mêmes chroniqueurs, ne lui donna le jour qu’après une grossesse de douze mois. Quoiqu’il en soit, ce prince sut conquérir, tant par la force de ses armes que par ses stratagèmes et ceux de son fameux ministre Li-sse, les sept états féodaux qui se partageaient alors la Chine. Devenu seul maître de tout l’empire, il s’arrogea le titre de Hoang-ti «le suprême Empereur», qu’aucun prince n’avait osé s’attribuer avant lui, et se fit redouter au-delà de ses frontières, au nord-ouest par les Hioung-nou qu’un de ses généraux se chargea de tailler en pièces, au sud-est par des victoires qui lui assurèrent la domination des pays barbares où sont situées aujourd’hui les provinces du Kouangtoung et du Kouangsi.
Le succès éclatant de ses armes, la grandeur de son empire, le luxe de sa cour où il avait réuni les trésors enlevés aux palais des princes qu’il avait dépossédés, l’obéissance servile qu’il était sûr de rencontrer sur son passage, tout était fait pour exalter son orgueil et le confirmer dans la pensée que jamais la Chine n’avait eu un souverain digne de lui être comparé. Quelques lettrés cependant ne craignirent pas de provoquer, à plusieurs reprises, sa colère en lui faisant des représentations et des remontrances de nature à rabaisser la haute idée qu’il avait conçue de ses mérites et de ses perfections. Les châtiments terribles qui furent presque toujours la suite de ces actes d’audacieuse indépendance ne découragèrent pas les lettrés qui persévéraient avec une constance infatigable dans la voie où ils s’étaient engagés. Ces remontrances sans cesse renouvelées finirent par exaspérer à un tel degré le puissant monarque, qu’à la suite d’un grand banquet offert, à l’instar des fondateurs des premières dynasties, aux grands de sa cour et à soixante lettrés de premier ordre, il décréta, sur la proposition de son ministre Lisse, l’incendie de tous les livres sacrés et historiques qui pouvaient exister dans son empire, et des punitions sévères pour ceux qui chercheraient à les sauver de l’anéantissement (en 213 av. n. è.). Et, pour que les lettrés que cet édit exaspérait n’eussent pas le temps de susciter des troubles, il ordonna, peu après, que tous les mécontents et ceux qu’on pouvait supposer tels fussent employés à la construction de la grande muraille qu’il fit élever au nord de ses états pour mettre obstacle aux invasions des Tartares. Trois cent mille hommes, sous les ordres du général Mong-tien, furent chargés de surveiller ceux qui avaient été envoyés pour travailler à cette construction et pour châtier, au besoin, toute tentative d’indiscipline et de révolte qu’on pourrait provoquer parmi eux. Quelque temps auparavant, les lettrés de la capitale, appelés à donner leur opinion sur l’idée de Lisse s’étant trouvés d’accord pour la blâmer énergiquement, furent déclarés coupables du crime de lèse-majesté: quatre cent soixante d’entre eux furent condamnés à être enterrés vifs, et on n’en trouva pas un seul qui, au moment du supplice, consentît à racheter sa vie au prix d’une déclaration contraire à celle qu’il avait faite aux émissaires du puissant ministre.
On a considérablement exagéré les conséquences du décret de Chi Hoangti qui ordonnait la destruction par le feu de certains livres de l’antiquité chinoise. Ce décret ne pouvait aboutir au résultat qu’avait fait espérer à l’autocrate chinois le ministre Lisse; et, parmi les livres qui furent brûlés, les ouvrages de Confucius, qu’on avait surtout l’intention d’anéantir, se sont à peu près tous retrouvés après la mort du tyran, qui eut lieu d’ailleurs trois années après la promulgation de l’édit incendiaire. Ainsi que l’a fait justement remarquer un écrivain de l’époque des Soung nommé Tching Kiah-tsaï, ce ne sont pas les Tsin qui ont anéanti les anciens livres disparus dans la proportion de 98 à 99 sur 100: ce sont les lettrés eux-mêmes qui les ont perdus!
A la mort de Tsinchi Hoangti, toutes les femmes de ce prince qui ne lui avaient pas donné d’enfant furent condamnées à le suivre dans la tombe, ainsi qu’un grand nombre de guerriers qui furent enterrés vifs à ses côtés. Les intrigues d’un eunuque du palais, nommé Tchao-kao, firent monter sur le trône le second fils du monarque, au détriment de son fils aîné qu’il avait envoyé en exil pour s’être permis quelques représentations au sujet de sa manière despotique de gouverner le peuple. Ce jeune prince qui prit, suivant la volonté qu’avait exprimée son père, le nom de Œll-chi Hoang-ti «le suprême empereur nº 2», passa dans la débauche les trois années de son règne, durant lequel l’empire commença à se démembrer de tous côtés. L’eunuque Tchaokao, redoutant que le ministre Li-sse fût un obstacle à ses desseins ambitieux, le dénonça au jeune prince comme coupable de haute trahison. L’empereur chargea l’eunuque de le juger lui-même et de le condamner: la sentence ne se fit pas attendre, et le fameux conseiller de Chi Hoangti fut coupé en morceaux sur la place publique. Peu de temps après, l’eunuque Tchao-kao donnait la mort à l’empereur, qui lui demandait en vain grâce de la vie et une petite seigneurie, en échange de l’empire dont il lui abandonnait la souveraineté. L’eunuque appela sur le trône le frère aîné de l’empereur qu’il avait dépossédé lui-même quelques années auparavant. Le nouveau souverain, persuadé du sort qui l’attendait, s’il ne parvenait pas à se défaire du tout-puissant eunuque que son prédécesseur avait élevé à la dignité du premier ministre, réussit à l’assassiner par ruse au moment où celui-ci lui faisait les salutations d’usage. Après quarante-cinq jours de règne, apprenant que deux armées des rebelles s’avançaient à grands pas vers sa capitale, il descendit volontairement du trône, et remit les insignes de la souveraineté impériale entre les mains de Licou-pang, fondateur de la nouvelle dynastie des Han. Sur ces entrefaites, un autre chef de révoltés détruisit le palais, entra dans la capitale des Tsin, tua l’empereur de sa propre main, fit mettre à mort tous les membres de sa famille, et ne se retira qu’après avoir fouillé les tombeaux de ses prédécesseurs et jeté leurs cendres au vent.
Ainsi s’éteignit la courte et étonnante dynastie des Tsin, qui avait occupé le trône impérial de Chine pendant quarante-neuf ans (de 255 à 206 av. n. è.).
La grande dynastie des Han, qui dura 470 années (de 206 av. n. è. à 264 apr. n. è.), eut comme je l’ai dit, pour fondateur, un soldat heureux nommé Lieou-pang, qui figure dans la liste des empereurs de la Chine sous le nom de Kao-hoang-ti «le grand Empereur suprême». Sous son successeur, Hoeï-ti (de 194 à 188 av. n. è.), le décret contre la conservation des anciens livres fut révoqué. On s’occupa aussitôt à rechercher les manuscrits qui avaient pu échapper aux prescriptions incendiaires du ministre Li-sse, et tous les lettrés se livrèrent avec une ardeur infatigable à cette grande œuvre de restauration que la nouvelle dynastie considérait comme une des gloires les plus solides qu’il lui était réservé d’obtenir aux yeux de la postérité.
La restauration des lettres, sous la dynastie des Han, fut définitivement accomplie par le quatrième souverain qui mérita, à ce titre, le nom de Wen-ti, «L’Empereur de la littérature». Sous son règne, on inventa le papier, l’encre et les pinceaux à écrire, et on renonça à l’usage des tablettes de bambou sur lesquelles on avait jusqu’alors l’habitude de graver les caractères.[136] Ce prince réduisit en outre de moitié les impôts, et fit refleurir l’agriculture qui avait été ruinée pendant les guerres incessantes de la dynastie des Tsin. Bientôt après on rouvrit les écoles, et la doctrine de Confucius fut de nouveau l’objet d’un enseignement public. Quatre siècles et demi plus tard les premiers livres de la doctrine du grand moraliste de Lou étaient apportés pour la première fois au Japon, où une fête fut instituée en son honneur par ordre du mikado, l’an 701 de notre ère.
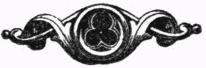
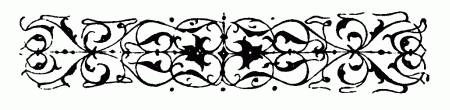
 A littérature chinoise est essentiellement la littérature classique du
Japon. Depuis l’ouverture des ports du Nippon au commerce étranger,
depuis la dernière révolution qui a rétabli l’autorité effective des
mikados, on peut bien constater un certain abaissement des études
chinoises dans les îles de l’Extrême-Orient: la préoccupation presque
générale des indigènes de s’assimiler les idées occidentales et de
connaître nos langues et nos sciences a certainement contribué à faire
négliger dans les écoles l’étude longue et pénible des monuments
littéraires du Céleste-Empire; on peut même constater un certain dédain
que professe «le jeune Japon» pour tout ce qui peut rattacher sa
civilisation à la patrie de Confucius. Il n’en demeure pas moins vrai
qu’il n’y a pas de bonne éducation chez les Japonais sans de solides
connaissances en chinois, et qu’un indigène qui serait ignorant du style
des livres canoniques et des historiens de la Chine, eût-il une forte
teinture de sciences européennes, n’en serait pas moins un homme mal
instruit et incapable d’occuper une place quelque peu éminente dans les
destinées de son pays.
A littérature chinoise est essentiellement la littérature classique du
Japon. Depuis l’ouverture des ports du Nippon au commerce étranger,
depuis la dernière révolution qui a rétabli l’autorité effective des
mikados, on peut bien constater un certain abaissement des études
chinoises dans les îles de l’Extrême-Orient: la préoccupation presque
générale des indigènes de s’assimiler les idées occidentales et de
connaître nos langues et nos sciences a certainement contribué à faire
négliger dans les écoles l’étude longue et pénible des monuments
littéraires du Céleste-Empire; on peut même constater un certain dédain
que professe «le jeune Japon» pour tout ce qui peut rattacher sa
civilisation à la patrie de Confucius. Il n’en demeure pas moins vrai
qu’il n’y a pas de bonne éducation chez les Japonais sans de solides
connaissances en chinois, et qu’un indigène qui serait ignorant du style
des livres canoniques et des historiens de la Chine, eût-il une forte
teinture de sciences européennes, n’en serait pas moins un homme mal
instruit et incapable d’occuper une place quelque peu éminente dans les
destinées de son pays.
J’ai souvent rencontré des Japonais qui, sans ignorer complètement la langue écrite des Chinois, ne pouvaient comprendre que difficilement les chefs-d’œuvre de leur antique littérature. Eh bien! il est tellement vrai que l’intelligence de ces chefs-d’œuvre est essentielle à quiconque, dans l’Extrême-Orient, prétend jouir des privilèges d’une éducation soignée, que j’ai toujours constaté une sorte d’embarras chez ces insulaires quand ils se trouvaient en présence d’Européenns plus familiarisés qu’eux-mêmes avec les livres qui ont été, pendant bien des siècles, la base de toute éducation libérale dans leur empire. J’ai connu également des lettrés japonais profondément versés dans la culture des lettres idéographiques, et il m’a suffi de lire en leur présence quelques anciens textes chinois pour établir avec eux des liens d’une amitié profonde et durable. La citation à propos d’une phrase des King ou des Sse-chou, l’interprétation exacte d’une locution rare et difficile, suffit parfois pour vous assurer leur estime et leur sympathie. Et, croyez-le bien, l’estime et la sympathie conquises de la sorte est toute différente de celle qu’on acquiert en se posant vis-à-vis d’eux en professeurs de sciences ou d’idées européennes.
Dans le premier cas, vous vous êtes à demi naturalisé japonais: vous leur avez montré que vous ne professez pas de dédain pour ce qu’avaient, pendant des siècles, cultivé leurs pères, que vous ne condamnez pas en tout leurs vieilles traditions et leur histoire, que vous pouvez admirer avec eux des beautés à peu près complètement inconnues ou incomprises des orgueilleux Occidentaux, vous associer aux nobles émotions de leur intelligence, vivre de leur vie à eux et non point exclusivement d’une vie étrangère à la leur. Pour vous, ils sont capables de cette amitié solide que saint François-Xavier considérait comme une des précieuses qualités de l’esprit japonais.
Dans le second cas, au contraire, si, ignorant ou dédaigneux de leur littérature classique chinoise, vous venez étaler à leurs yeux les merveilles de la civilisation européenne, de cette civilisation qui s’est imposée par la force à la leur, curieux par nature, ils s’attacheront momentanément à vous pour s’initier à toutes les merveilles de nos sciences et de nos arts; ils se feront volontiers vos élèves pour chercher à s’assimiler vos connaissances et à se donner aussi vite que possible l’apparence de les avoir acquises; mais, dès qu’ils croiront posséder ces connaissances—et ils le croiront bientôt, car ils apprennent vite et se contentent aisément de notions superficielles,—vous leur deviendrez au fond aussi antipathiques que possible; ils resteront peut-être courtois vis-à-vis de vous; mais, soyez-en sûrs, ils n’auront aucune estime pour votre savoir, aucune amitié pour votre personne, aucune reconnaissance pour vos leçons. Sans vous en douter, et tout en répondant à leurs incessantes questions, vous aurez blessé leur sentiment national, vous serez devenus à jamais des étrangers pour eux.
Je pense donc qu’il est nécessaire, pour vous qui êtes appelés à vous trouver en contact de tous les instants avec les Japonais, de ne pas être ignorants, comme je viens de vous le dire, de ce qui constitue, à leurs yeux, la base de l’instruction supérieure. Dans ce but, je jetterai un coup d’œil rapide sur les monuments de cette littérature classique de la Chine que je regrette, faute de temps, de ne pouvoir vous faire connaître d’un façon suffisamment étendue et approfondie.
La littérature chinoise est tout à la fois une des plus vastes et l’une des plus anciennes littératures du monde. La science à laquelle on a donné le nom de sinologie s’est efforcée, depuis plus de deux siècles, de nous faire connaître ses principaux monuments. Sa tâche si laborieuse, si méritoire, est cependant loin d’être accomplie. Et quand on songe que les livres sacrés de la Chine n’ont pas encore été tous traduits[137]; que nous ne possédons, pour ainsi dire, aucune version européenne des grands historiens de cet empire; que, à l’exception du livre de Laotsze[138], tous les ouvrages des philosophes chinois nous sont inconnus; que nous n’avons publié presque rien, dans nos langues, des grands recueils d’érudition, d’archéologie, de mythologie, de géographie et de science de cette étonnante civilisation, on peut, sans craindre d’être démenti, affirmer qu’il reste aux futurs adeptes de la sinologie à accomplir plus de travaux de premier ordre que n’en ont produit, depuis le siècle de Louis XIV, tous les orientalistes qui ont rendu leur nom célèbre par leur connaissance solide de la langue chinoise et par l’usage intelligent qu’ils ont fait de leur érudition.
Pour remonter à l’époque de la rédaction originaire des premiers monuments de la littérature chinoise, nous devons nous reporter à plus de quarante siècles en arrière. David, Moïse, Jacob, Abraham lui-même n’étaient encore apparu qu’aux yeux illuminés des seuls prophètes. De longtemps il ne devait pas être question de Rome, d’Athènes, de Persépolis, ni de Jérusalem; et, dans ces siècles extrêmement reculés, une végétation sauvage et vierge recouvrait encore d’immenses forêts impraticables le sol où devait s’élever, par la suite, les grandes métropoles de la civilisation occidentale.
Les livres qui doivent être placés chronologiquement en tête de la bibliographie chinoise peuvent donc être attribués sans hésitation aux périodes les plus reculées que nous puissions apprécier dans l’histoire de la littérature sur notre globe. Et, comme la langue dans laquelle ces livres ont été écrits a survécu, de même que le peuple qui l’a parlée, à toutes les révolutions des temps, il en résulte que la Chine, seule sur la terre, nous a conservé une tradition écrite non interrompue, depuis les premiers âges du monde jusqu’au siècle où nous vivons aujourd’hui.
Ce phénomène remarquable, ici-bas où tout périt, suffirait, à lui seul, pour expliquer l’intérêt qu’on n’a cessé de porter, dans l’Europe savante, aux travaux des sinologues qui nous révèlent sans cesse des pages inconnues de la grande et imposante littérature chinoise.
Les plus anciens monuments de la littérature chinoise antique, ou tout au moins ceux que les Chinois ont l’habitude de placer en tête de leurs classements bibliographiques, portent le nom de King. Ils sont, pour le Céleste-Empire, les livres sacrés ou canoniques par excellence.
Profondément révérés et sans cesse l’objet d’un véritable culte, les King ont servi presque exclusivement de point de départ et de moule aux idées philosophiques, politiques ou religieuses qui se sont répandues, en Chine, depuis Confucius jusqu’à nos jours. L’esprit qui leur est propre a tellement pénétré dans le cœur de la littérature chinoise, il en est devenu à un tel point l’âme et la vie que, sans les connaître, il est à peu près impossible de comprendre les livres indigènes et surtout d’apprécier leur valeur et leurs tendances. Aussi les King sont-ils étudiés et commentés par chaque génération, et la connaissance approfondie de leur contenu est-elle considérée comme indispensable à quiconque aspire à une position littéraire dans le Royaume du Milieu.
Le recueil des King tel que nous le possédons aujourd’hui, se compose de cinq ouvrages distincts qui portent les titres suivants: 1º le Yih-king, ou Livre des Transformations; 2º le Chou-king ou Livre par excellence; 3º le Chi-king ou Livre des Vers et Chants populaires; 4º le Li-ki ou Mémorial des Rites; 5º le Tchun-tsieou ou le Printemps et l’Automne. Il existait un sixième king intitulé Yoh-king ou Livre de la Musique; il a par malheur été à peu près complètement perdu.
Les trois premiers King surtout, sont composés de fragments d’anciens ouvrages, recueillis, expurgés et coordonnées six siècles avant notre ère, dans la forme où nous les possédons aujourd’hui. Confucius qui en fut l’éditeur, doit être considéré comme une des causes principales de la perte des antiques écrits dans lesquels il a puisé. C’est, du reste, ce qu’ont toujours fait les abréviateurs. Justin a fait perdre les écrits de Trogue-Pompée, Florus une partie de ceux de Tite-Live. Aussi Bacon appelait-il les abréviateurs, non sans quelque raison, les vers rongeurs de la littérature.
La question de l’authenticité des King a été souvent discutée: il ne nous paraît pas, cependant, qu’elle ait été complètement élucidée. On a bien établi d’une manière incontestable l’authenticité des compilations que Confucius a transmises à la postérité, sous le titre de King, mais on n’a pas encore dégagé des textes primitifs les interpolations nombreuses que le célèbre moraliste a introduites dans les antiques ouvrages qu’il avait recueillis. Un travail d’exégèse et de critique, dont la portée serait considérable pour les études religieuses et historiques, est réservé à la philologie moderne, qui trouvera plus qu’à glaner dans le champ fécond, mais encore très obscur, de l’archéologie chinoise.
Pour le moment, bornons-nous à ajouter quelques mots sur le mode de transmission, à travers les siècles, des livres que Confucius a livrés au monde comme le résumé et l’essence de tout ce que renfermaient de notions moralisatrices les anciens ouvrages qui existaient encore de son temps et dont il put prendre connaissance tant dans les fameuses archives des Tcheou que dans les bibliothèques particulières des villes qu’il eut occasion de visiter.
Les historiens chinois racontent que Confucius, sentant sa fin prochaine, réunit ses disciples et leur ordonna de dresser un autel. Quand l’autel fut dressé, il y déposa avec respect les manuscrits des King; puis, s’étant prosterné du côté de la constellation de la Grande-Ourse (Peh-teou), il remercia le ciel, par une longue adoration de lui avoir accordé la faveur de reconstituer ces monuments sacrés de la grandeur antique de la Chine. Il fit ensuite quelques nouvelles corrections à ses manuscrits et les livra à ses disciples, après leur avoir recommandé solennellement d’en propager les copies et d’en répandre les saintes doctrines.
Depuis lors, les King, devenus les codes de la philosophie nationale et en quelque sorte l’Évangile de tous ceux qui, en Chine, ambitionnent un rang dans les lettres, furent enseignés et expliqués de toutes parts; et le nombre des exemplaires se multiplia de jour en jour, jusqu’à l’avénement de la courte mais terrible dynastie des Tsin!
Les neuf royaumes qui partageaient alors la Chine venaient d’être réunis sous le sceptre du fils putatif du roi de Tsin. Ce jeune prince, après avoir rétabli en sa personne la dignité impériale, s’était arrogé le titre pompeux de Tsin-chi Hoang-ti «l’Auguste Empereur de la nouvelle race», et avait résolu, comme je vous l’ai dit dans une conférence précédente, de faire disparaître toute trace du passé, afin qu’il ne restât plus en Chine d’autre souvenir que celui de sa race. Avec de telles dispositions, il était naturel que ce jeune prince voulût faire disparaître tous les monuments qui pouvaient rappeler les grands jours du passé et la gloire des dynasties déchues. Un édit incendiaire ne tarda pas à signaler les débuts de ses orgueilleux desseins. Une foule de livres, ceux-là surtout qui traitaient l’histoire et dont le contenu pouvait rappeler les faits des temps antérieurs à l’avénement des Tsin au trône impérial, furent impitoyablement livrés aux flammes, et des ordres sévères émanèrent de la Cour contre tous ceux qui en conserveraient ou en cacheraient des copies.
Le Chou-king, principalement, fut l’objet des plus rigoureuses recherches des agents destructeurs nommés par Tsinchi Hoangti et par son ministre Li-sse. Tous les exemplaires qu’on put découvrir furent brûlés; et peu s’en fallut alors que cet ouvrage ne fût complètement anéanti. Je vous ai raconté grâce à quelles circonstances une partie du Chou-king put échapper à l’incendie des livres.
L’intelligence des King présente, non-seulement pour les Européens, mais pour les Chinois eux-mêmes, de sérieuses difficultés. Ce n’est le plus souvent que grâce aux commentaires composés d’âge en âge que l’on est parvenu à saisir tolérablement le sens de ces antiques écrits. Le Livre des Chants populaires, par exemple, aurait besoin, pour être bien compris dans toutes ses parties, de la composition d’une grammaire et d’un vocabulaire particulier, car la phraséologie de ce beau livre est souvent rebelle aux règles ordinaires de l’ancienne syntaxe chinoise.
Les principes tout à la fois délicats et rigoureux de la linguistique moderne, appliqués à l’interprétation des King, éclairciront, sans aucun doute, une foule de passages qui restent obscurs pour les commentateurs chinois tout aussi bien que pour nous.
Le premier des Cinq Livres sacrés ou canoniques de la Chine antique est intitulé Yih-king ou «Livre des Transformations». Il passe assez communément pour le plus ancien monument de la littérature chinoise. Toujours est-il que Confucius lui vouait un culte particulier et s’attachait sans cesse à en interpréter ou à en approfondir le sens. Jusqu’à présent, il faut le reconnaître, ce livre obscur n’a présenté pour nous qu’un assez médiocre intérêt. La raison en est, sans doute, que nous ne le comprenons plus, et cela pour une bonne raison, c’est que les Chinois eux-mêmes, quoi qu’ils puissent dire, ne le comprennent guère davantage.
Je passerai donc très rapidement sur ce qui touche au Yih-king, me bornant à mentionner le sujet principal sur lequel il repose.
Dans la haute antiquité, c’est-à-dire 34 siècles environ avant notre ère, un personnage aux trois quarts fabuleux et peut-être un quart historique, Fouh-hi, traça huit trigrammes ou koua, composés de diverses combinaisons de trois lignes, tantôt entières ou continues, tantôt brisées ou interrompues. Ces sortes de signes linéaires, suspendus sur les places publiques où se rassemblait le peuple, étaient destinés à lui enseigner les principes généraux de la morale et à lui faire connaître les volontés du Ciel et du Prince.
Par la suite, ces koua ont servi de base à tout un système de philosophie cabalistique fort apprécié en Chine, mais qui est devenu, avec le temps, fort complexe et souvent vague et embrouillé. C’est vraisemblablement le caractère obscur et diffus de cette philosophie qui a engagé les sorciers chinois à prétendre qu’ils trouvaient dans les formules du Yih-king les bases fondamentales de leurs sciences occultes et divinatoires.
Quelle que soit l’opinion peu favorable que nous puissions avoir de ce livre, il serait téméraire, dans l’état infime où en sont nos connaissances à son égard, de prétendre qu’il n’est qu’un tissu d’extravagances, bonnes tout au plus à exercer la loquacité des magiciens chinois et des diseurs de bonne aventure. Confucius révérait ce livre au suprême degré, et c’était à sa conservation qu’il attachait le plus de prix. Longtemps après la mort de ce grand moraliste, la philosophie chinoise classique a reposé sur les aphorismes du Yih-king et sur les développements que leur ont donnés ses commentateurs. La dualité primordiale est le point de départ de l’ouvrage et le principe d’après lequel il a été composé; les deux éléments constitutifs de cette dualité sont désignés abstractivement par les noms de Yin et de Yang; traduits en objets concrets, ils deviennent indistinctement le principe femelle et le principe mâle, la terre et le ciel, l’eau et le feu, l’obscurité et la lumière, etc.; par le contact ou par l’union, ils se complètent, se fécondent, se vivifient; et ainsi se génèrent tous les êtres de la création. Une fois générés, tous ces êtres s’analysent et s’expliquent par les caractères spécifiques ou par les propriétés inhérentes à chacun des deux grands principes Yin et Yang.
Telle est, sommairement, la base sur laquelle repose le Livre sacré des Transformations.
Dans l’état actuel de la science sinologique, ainsi que je le disais tout à l’heure, tout jugement sur le système général et l’esprit du Yih king me paraîtrait prématuré[139]: je m’abstiendrai donc d’en faire l’objet d’une appréciation quelconque. Il me suffira, pour compléter ce que j’ai dit du premier des cinq King, de rappeler que le sens des koua de Fouh-hi était depuis longtemps perdu lorsque le sage Wen-wang chercha à le retrouver; que les explications de Wen-wang et de son fils Tcheou-koung étaient elles-mêmes à peu près inintelligibles lorsque Confucius entreprit de les élaborer; que l’ordre des koua de Fouh-hi et des interprétations de Wen-wang et de Tcheou-koung a été plusieurs fois interverti; qu’enfin l’authenticité de la partie du Yih-king attribuée à Confucius a été elle-même l’objet de doutes de la part de quelques savants.
Le Yih-king, toutefois, ne courut pas les mêmes dangers que la plupart des écrits sacrés ou historiques de la Chine primitive. L’empereur Tsinchi Hoangti, en publiant son décret de prohibition et de destruction des anciens livres, avait fait une réserve en faveur de ceux qui traitaient de médecine, d’agriculture ou de divination. Le Yih-king, ayant été compris au nombre de ces derniers, ne fut pas condamné aux flammes.
Le second livre sacré est désigné sous le nous le nom de Chou-king[140], expression qui, dans le sens de «Livre par excellence», répond parfaitement à notre mot «Bible». Par une curieuse coïncidence, le Chouking des anciens Chinois, comme la Bible des Hébreux, est un recueil de documents tout à la fois religieux et historiques, qui est devenu, avec le temps, une sorte de canon politique du Céleste-Empire. De nos jours encore, il est considéré comme le plus beau, le plus parfait de tous les monuments de la Chine antique.
Le Chou-king commence au règne de Yao (2357 ans avant notre ère) et arrive, non sans de fréquentes interruptions, jusqu’au règne de Siang-wang (624 av. J.-C.). Il a été rédigé ou plutôt compilé par Confucius sur les documents qu’il put recueillir dans la grande bibliothèque des Tcheou et dans les différentes localités qu’il eut occasion de visiter. Parmi ces documents, ceux qui entrèrent dans la composition des chapitres consacrés aux règnes de Yao et Chun (de 2357 à 2205 avant notre ère) passent, en Chine, pour contemporains de ces deux empereurs.
Lors de la destruction des livres, sous le règne de Tsinchi Hoangti, le Chou-king, ainsi que je vous l’ai déjà dit, fut mentionné tout particulièrement dans le rapport du ministre d’Etat Li-sse pour être anéanti. Mais, malgré les efforts des mandarins pour exécuter ces ordres incendiaires, malgré les supplices et même la peine de mort qui devait être prononcée contre ceux qui en conserveraient ou en cacheraient des exemplaires, ce beau livre résista à tous les orages politiques et nous transmit ainsi les annales les plus authentiques des premières dynasties chinoises.
Lors de la restauration des lettres, sous le règne de l’empereur Wenti, «le souverain lettré» (an 179 avant notre ère), on apprit à la cour qu’un vieillard nommé Fou-cheng possédait le Chouking par cœur et que, malgré son grand âge, il lui était encore possible de le transmettre de vive voix: une députation de lettrés lui fut aussitôt envoyée, mais elle ne put obtenir de lui que vingt-huit chapitres, c’est-à-dire trente de moins que n’en contient le Chou-king tel que nous le connaissons. Encore ces lettrés eurent-ils grand’peine à bien saisir les paroles de Foucheng dont l’accent leur était étranger et à trouver les caractères correspondant aux mots qu’il leur prononçait.
On en était réduit au texte du vieillard Foucheng, lorsqu’on retrouva par hasard, en démolissant une maison appartenant à la famille de Confucius, un exemplaire du Chou-king, qui avait été caché dans l’intérieur d’une muraille. Malheureusement le manuscrit ainsi découvert était écrit en anciens caractères (en signes ko-teou), qu’on ne comprenait plus à cette époque, et les tablettes de bambou, sur lesquelles étaient tracés ces caractères, se trouvaient considérablement endommagées par le temps et par les insectes. Cependant Koung Ngan-koueh, descendant de Confucius au treizième degré, fut chargé d’étudier ce manuscrit, afin d’en tirer tout ce qui serait de nature à compléter la rédaction fournie par le vieillard Foucheng.
En confrontant avec soin les chapitres obtenus oralement avec les chapitres correspondants du manuscrit nouvellement découvert, Koung Ngankoueh parvint à établir le texte de cinquante-huit chapitres du Chouking; mais il préféra abandonner les autres à la destruction que de les publier comme il les possédait, c’est-à-dire dans un état défectueux et conjectural. Il entreprit toutefois, pour remédier autant que possible à ce défaut, de rédiger un commentaire étendu du Chouking, dans lequel il inséra la plupart des faits dont il avait acquis la connaissance dans les parties qu’il n’avait pu restituer d’une manière satisfaisante.
Ce commentaire a été lui même perdu; mais le grand historiographe Sse-ma Tsien, entre les mains duquel il se trouva, en a fait de nombreux extraits pour la rédaction de ses Mémoires historiques (Sse-ki) qui, eux du moins, sont parvenus de siècle en siècle jusqu’à nous.
Le style du Chou-king est la conique et inégal; parfois, il approche du sublime. Les discours que renferme ce beau livre sont exprimés avec une noble et énergique simplicité. Les paroles que prononcent, par exemple, les saints empereurs Yao, Chun et Yu, dans les premiers chapitres de l’ouvrage, captivent notre admiration et notre respect pour ces trois grands monarques que la Chine cite avec orgueil, de siècle en siècle, comme le modèle des vertus nécessaires aux rois. Certaines expressions, au milieu d’un récit sans art et sans apprêt, saisissent l’esprit et le réchauffent. On est tenté d’y voir des éclairs de génie.
Sévère en ce qui touche les princes et les grands, ferme mais moins exigeante à l’égard des peuples, la morale du Chou-king, qui, du reste, ne transige avec personne, fournit à la Chine non seulement les principes de sa religion, mais ceux de son droit national: elle constitue les véritables assises de la société chinoise.
On voit, dans ce beau livre, le Chang-ti ou Souverain suprême (Dieu) inspirer la conduite des princes sages, ou bien appesantir sa main sur les princes pervertis pour frapper leurs œuvres d’insuccès ou de malédiction; les saints rois tenir leur mandat du Ciel et s’appliquer à procurer aux peuples de quoi satisfaire à leurs besoins matériels, les rendre vertueux et les préserver de ce qui peut leur nuire; les peuples s’adonner aux sciences, aux arts utiles, surtout à l’agriculture, et repousser le luxe comme une source incessante de malheurs et d’avilissement; respecter l’autorité du prince considéré comme «père et mère» de ses sujets; apprécier, glorifier la vertu, honorer les vieillards, resserrer à l’intérieur les liens de la famille; cultiver les usages d’une politesse rigoureuse et raffinée.
Le troisième livre sacré des anciens Chinois est intitulé Chi-king «Livre des Vers»[141]. C’est une collection de poésies de tous les genres, recueillie par Confucius, 484 ans avant notre ère, dans les archives de la fameuse Bibliothèque impériale des Tcheou.
Primitivement composée de trois mille pièces, cette collection fut réduite à trois cent onze par le moraliste de Lou, soit parce que beaucoup de ces pièces blessaient ses prudes oreilles, soit parce qu’elles ne concordaient pas avec les principes de ses doctrines.
Parmi ces poésies, quelques-unes remontent jusqu’au XIIe siècle avant l’ère chrétienne. Leur style est des plus varié. L’authenticité des unes et des autres est incontestable.
Confucius, à qui l’histoire attribue l’honneur de nous avoir transmis les Cinq Livres sacrés de la Chine antique, Confucius, dis-je, a peut-être conservé au seul Chi-king sa forme et sa structure primitives. Il avait pour cela une excellente raison. Il lui était bien facile, à ce philosophe doué d’une vertu austère, mais lourd et sans inspiration, de remanier comme il l’a fait des livres historiques ou moraux tels que le Chou-king ou le Yih-king, et de les façonner dans le moule étroit de son esprit terre à terre. Mais il ne pouvait en être de même à l’égard du Livre des Poésies. Comment, en effet, serait-il parvenu à substituer les lieux communs de sa philosophie pratique aux tournures pleines de verve, de grâce et de naïveté des pièces éminemment caractéristiques du Chi-king? Le célèbre moraliste du royaume de Lou le comprit heureusement: un tel recueil ne souffrait point, ne tolérait point de retouches. Il fallut donc passer sur quelques expressions un peu légères; et, grâce à leur forme inimitable, à leurs rimes et à leur mesure, les pièces de la plus ancienne anthologie du monde sont parvenues vierges et immaculées jusqu’à nous.
Nous avons lieu de nous en féliciter, car le Livre des Vers est assurément le plus beau monument de l’antique littérature chinoise, et celui qui présente pour nous, à une foule de points de vue, l’intérêt le plus réel et le plus incontestable.
Le Chi-king, c’est la Chine primitive tout entière qui nous est dépeinte par le pinceau de ses premiers poètes. Et par quels poètes! par des poètes sans fard, sans apprêt; par des poètes vrais, sincères, incapables de tout déguisement; par des poètes pleins de vie et d’inspiration; bref, par le peuple chinois lui-même, qui s’y est manifesté tout entier dans les chants qui l’ont bercé à l’époque infiniment reculée de sa naissance à la vie sociale et à la civilisation.
Le Chi-king comprend quatre parties:
La première, intitulée Koueh-foung «Mœurs des Royaumes», renferme les chants populaires que les anciens empereurs avaient fait recueillir afin de juger de l’esprit du peuple de leurs différentes provinces, de ses sentiments pour le prince, et de la moralité de la vie publique et privée.
La seconde et la troisième portent les titres de Ta-ya «Grande Excellence», et de Siao-ya «Petite Excellence». Ce sont deux collections d’odes, de cantiques, d’élégies, d’épithalames, de chansons et de satires.
Enfin, la quatrième, intitulée Soung «Louanges», contient les hymnes chantées dans les sacrifices en l’honneur des ancêtres.
Le quatrième des livres sacrés est parvenu jusqu’à nous sous le titre de Li-ki, que l’on traduit communément par «Mémorial des Rites»[142]. C’est une compilation de documents empruntés pour la plupart à un antique rituel intitulé I-li, dont on attribue la rédaction primitive au sage Tcheou-kong, que j’ai déjà eu l’occasion de vous citer tout à l’heure. Ce dernier livre renferme, dit-on, la même substance qu’un antique rituel découvert à côté du Chou-king, lors de la restauration des lettres, dans une vieille muraille d’une maison qui avait été habitée par Confucius.
A côté de ces deux ouvrages, on place d’ordinaire le Tcheou-li, ou Rituel de la dynastie des Tcheou[143], œuvre dont on fait également honneur à Tcheoukong. On y trouve l’exposé des devoirs des fonctionnaires publics sous cette mémorable dynastie. Les règles qu’il renferme étaient adoptées dans la plupart des états qui se partageaient la Chine à cette époque, excepté cependant dans le pays de Tsin. L’aversion du despote Tsinchi Hoangti pour ce livre fut telle, qu’il ordonna spécialement la recherche et la destruction de toutes les copies qu’on pourrait découvrir. Plusieurs d’entre elles échappèrent néanmoins à cette rigoureuse prohibition et furent présentées plus tard à l’empereur Wouti (IIe siècle avant notre ère).
Enfin, on désigne assez généralement comme cinquième livre sacré ou canonique de la Chine antique, le Tchun-tsieou, «le Printemps et l’Automne»[144], ouvrage composé par Confucius, et renfermant l’histoire du royaume de Lou, son pays natal, de 722 à 484 avant notre ère. Un développement de cet ouvrage a été composé par Tso Kieou-ming, disciple du grand moraliste, sous le titre de Tso-tchouen, ou «Narration de Tso». On doit à ce même auteur la composition des Koueh-Yu, ou «Paroles sur les Royaumes»[145], annales pour lesquelles les lettrés chinois professent aussi une estime toute particulière.

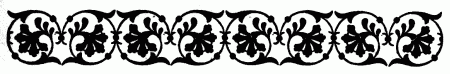
 ENDANT près de trois cents ans, du IIIe au vie siècle, la
civilisation japonaise n’eut guère à subir d’autre influence étrangère
que celle de la morale de Confucius et de son école. Cette influence fut
essentiellement économique, sociale et politique. C’était au Bouddhisme
qu’était réservé d’opérer au Japon une grande révolution
intellectuelle, religieuse et philosophique.
ENDANT près de trois cents ans, du IIIe au vie siècle, la
civilisation japonaise n’eut guère à subir d’autre influence étrangère
que celle de la morale de Confucius et de son école. Cette influence fut
essentiellement économique, sociale et politique. C’était au Bouddhisme
qu’était réservé d’opérer au Japon une grande révolution
intellectuelle, religieuse et philosophique.
Le Bouddhisme est, de toutes les religions du globe, celle qui compte le plus d’adeptes: on ne serait même pas loin de la vérité en disant qu’elle en compte, à elle seule, presque autant qu’ensemble les autres grandes religions réunies. Toujours est-il qu’elle est professée par quatre cents à cinq cents millions de sectateurs plus ou moins fidèles, plus ou moins croyants, en Mongolie, en Mandchourie, au Tibet, au Ladâk, au Cachemyre, à Ceylan, à Java, en Birmanie, au Pégou, au Siam, au Lao, dans l’Annam, en Corée, aux îles Loutchou et au Japon. D’origine indienne, elle a été supplantée par l’Islamisme dans la région qui fut son berceau. Mais, si la foi de Mahomet a triomphé de l’Inde bouddhiste, elle n’a pu y réussir que par la terreur du sabre; le Bouddhisme, lui, n’a augmenté le nombre de ses partisans que par la seule arme dont il ait jamais fait usage: la persuasion. Cette persuasion s’est opérée dans les conditions les plus étonnantes, et l’histoire ne nous montre nulle part une doctrine se propager avec moins de promesses et aussi peu d’artifice. Ses missionnaires n’avaient à offrir aux peuples qu’ils venaient convertir que des mortifications en ce monde, et, dans l’autre, point de résurrection, partant point de jouissances, point de paradis. Ils demandaient beaucoup de sacrifices dans la vie présente, et promettaient peu ou rien après la mort. Le nombre de leurs prosélytes fut immense: ils trouvèrent partout des disciples dévoués, enthousiastes, pour les aider à continuer leur œuvre de conversion et de propagande.
Le Bouddha vécut au VIe siècle avant notre ère. Il subsiste encore quelques incertitudes sur l’époque précise de sa mort, mais la date de son existence ne saurait être éloignée de celle que nous venons de mentionner. Il fut ainsi le contemporain de Laotsze en Chine, et s’éteignit, dit-on, en 543 avant notre ère, alors que Confucius était âgé de huit ans. J’appelle tout particulièrement votre attention sur ce synchronisme qui repose, en somme, sur des dates à peu près certaines.
Bouddha n’est point un nom propre; c’est un mot qui désigne le plus haut degré de la Sagesse, la Sagesse transcendante. Le personnage auquel on l’applique communément, le bouddha Çâkya-Mouni, se nommait Siddhârta et était fils d’un roi de Kapilavastou[146], ville située dans le nord de l’Inde, sur la rive gauche du Gange. A l’âge de vingt-neuf ans, il quitta la cour de son père, pour vivre de la vie des mendiants, et étudia la doctrine des Brahmanes. Persuadé de l’insuffisance de cette doctrine, il se retira dans les environs du village d’Ourouvilva, bâti sur les bords de la rivière appelée aujourd’hui Phalgou. Là, pendant des années consécutives, dans la plus austère des retraites, il se condamna à toutes sortes de mortifications. Après avoir dompté ses sens et subi de nombreuses extases, il acquit, pendant l’une d’elles, la conviction qu’il était enfin arrivé à la connaissance absolue de la route par laquelle l’homme peut assurer à sa personnalité la délivrance éternelle. Il se décida, en conséquence, à quitter sa retraite, et alla prêcher, pendant quarante-cinq ans, sa doctrine à Bénarès, à Râdjagriha, dans le Magadha, et à Çrâvastî, dans le Kôsala (Oude). A sa mort, ses disciples se réunirent en concile, sous les auspices du roi Adjâtaçatrou, et chargèrent trois d’entre eux de composer les livres sacrés qui devaient servir désormais de loi écrite pour le culte. Kâçyapa, président du concile, fut chargé de l’Abhidharma ou Métaphysique; Ananda, cousin germain de Çâkya-Mouni, des Soûtras ou prédications du Bouddha; Oupâli, de la Vinaya, c’est-à-dire de tout ce qui concerne la Discipline. Ces trois parties du canon bouddhique formèrent la Tripitaka ou Triple Corbeille.—Deux autres conciles postérieurs achevèrent de donner aux livres sacrés du Bouddhisme la forme dans laquelle ils ont été transmis jusqu’à nous.
On a beaucoup disputé sur l’esprit de la doctrine de Çâkya-Mouni, et sur le sens du nirvâna, fin suprême de cette doctrine, tout aussi philosophique que religieuse. Le désaccord, qui se manifeste dans les appréciations qui ont été faites au sujet de ce nirvâna, vient, ce me semble, de ce qu’on n’a pas suffisamment tenu compte des modifications qui se sont produites, suivant le temps et suivant les lieux, dans l’interprétation des préceptes fondamentaux attribués au Bouddha. Suivant ces préceptes, d’accord en cela avec la religion brahmanique, l’Homme a été, de toute éternité, condamné à des transmigrations successives, durant lesquelles il est soumis à toutes les souffrances; et la mort, au lieu d’être un terme à ses maux, n’est que le signal d’une période nouvelle d’afflictions et de douleurs. Les moyens que les Brahmanes indiquaient pour échapper à cette persécution incessante de l’individu parurent insuffisants, inefficaces à Çâkya: il leur en substitua d’autres qu’il déclara infaillibles. Pour échapper au malheur de la métempsycose, il faut d’abord reconnaître quatre vérités, et régler sa vie en conséquence de ces vérités: 1º la douleur est la destinée inévitable de l’individu; 2º les causes de la douleur sont l’activité, les désirs, les passions et les fautes qui en sont la résultante; 3º ces quatre causes de la douleur peuvent cesser par l’entrée de l’individu dans le nirvâna; 4º c’est en suivant les préceptes du Bouddhisme qu’on atteint à la sagesse transcendante, et qu’on finit par aboutir au nirvâna.
Les préceptes du Bouddhisme nous ordonnent d’éviter dix défauts, savoir: 1º le meurtre des êtres vivants; 2º le vol; 3º le viol; 4º le mensonge; 5º l’ivresse; 6º le goût pour les danses et les représentations théâtrales; 8º la coquetterie; 9º la mollesse (avoir un coucher doux et somptueux); 10º l’amour de l’or et des objets précieux.—La nomenclature de ces dix défauts varie suivant les écoles; elle a été sensiblement modifiée par le Bouddhisme japonais.
Les six vertus à acquérir sont: 1º la générosité dans l’aumône; 2º la pureté; 3º la patience; 4º le courage; 5º la contemplation; 6º la science.
Il ne rentre pas dans le cadre de cette conférence de vous exposer d’une façon approfondie le système général de la doctrine de Çâkya-Mouni. Je ne m’occupe ici du Bouddhisme que parce qu’il a été adopté par les Japonais, qui font l’objet de nos études. Et comme cette religion, différente, au Tibet et en Mongolie, de ce qu’elle était originairement dans l’Inde, s’est modifiée en Indo-Chine, en Chine, en Corée, et peut-être plus encore au Japon, je serais entraîné dans de trop longs développements si j’essayais de vous exposer ses principes dans tous les pays où elle est parvenue à s’enraciner. Je m’occuperai donc, à peu près exclusivement, de son existence dans les îles de l’Extrême-Orient.
Le Bouddhisme fut introduit en Chine en l’an 65 de notre ère[147], sous le règne de l’empereur Ming-ti, de la dynastie des Han. Ce prince envoya, cette année, des ambassadeurs dans l’Inde, pour y chercher la doctrine bouddhique.
Trois siècles plus tard, en 372, des missionnaires chinois la répandirent en Corée, dans le royaume de Kao-li, et dans celui de Paik-tse, en 384. C’est de ce dernier pays qu’elle fut transportée au Japon, où elle parut, dit-on, pour la première fois, au milieu du VIe siècle de notre ère. Le dixième mois de la treizième année du règne d’Ama-kuni-osi-hiraki-niwa (Kinmei), le roi de Paiktse, nommé Sei-mei wau «le Roi resplendissant de sainteté», ou simplement Sei-wau «le saint Roi», envoya, en hommage, au mikado, une statue de cuivre de Çâkya-Mouni, des drapeaux, des dais de soie et les livres sacrés du Bouddhisme[148]. L’empereur, en recevant ces présents religieux et après avoir entendu l’envoyé du roi de Paiktse exposer les mérites de la doctrine de Çâkya, que le sage Tcheoukoung et Confucius lui-même n’avaient pas eu le bonheur de connaître, éprouva une vive satisfaction, sauta de joie et s’écria que, jusqu’alors, depuis l’antiquité, nul n’avait obtenu[149] la faveur de posséder la Loi merveilleuse. So-ka-no Iname-no Su-kune, ministre du mikado, insista pour que le Bouddhisme fût reconnu comme religion de l’Etat, se fondant sur ce que, tous les pays occidentaux l’ayant accepté, il ne convenait pas que le Japon fût seul à le repousser.
O-kosi, du mono-no be (l’un des corps constitués de l’armée nationale), fut d’un avis contraire. Il fit observer à l’empereur que le Japon, avec ses cent quatre-vingts dieux, avait des adorations à accomplir le printemps et l’été, l’automne et l’hiver, et soutint que, si l’on se décidait à adorer des dieux étrangers, il était fort à craindre que les dieux du pays n’en éprouvassent de la colère[150].
Le mikado, intimidé par les paroles d’Okosi, fit don de la statue de Bouddha à son ministre Iname. Celui-ci la transporta dans son habitation, qu’il transforma en temple (tera) pour la recevoir.
Sur ces entrefaites, une grande maladie pestilentielle se déclara dans l’empire. Okosi attribua la cause du fléau à l’arrivée au Japon de la statue de Çâkya, laquelle avait provoqué le mécontentement des divinités locales. Le mikado se rendit à ses représentations: la statue fut jetée dans le Horiyé de la rivière d’Ohosaka, et le temple qui lui avait été consacré fut livré aux flammes.[151]
Cet événement, funeste aux premières tentatives de prédication du Bouddhisme au Japon, n’empêcha cependant pas cette doctrine de faire rapidement des progrès dans l’archipel. En dépit des persécutions, le nombre de ses sectateurs devint de jour en jour plus considérable; et, bien qu’à l’occasion d’une nouvelle épidémie on ait encore une fois renversé les statues de Çâkya et brûlé ses temples, sous le règne de Nu-naka-kura-futo-tamasiki (Bindatsou), plusieurs grands de l’empire, un neveu de l’empereur, nommé Mumaya-do-no Wausi, et le premier ministre Muma-ko, entre autres, se montrèrent très ardents sectateurs du nouveau culte. Ce dernier tomba malade de désespoir, en voyant les persécutions dont était l’objet la religion qu’il avait embrassée. Il supplia le mikado de lui permettre d’adorer Çâkya, sans l’intervention duquel il ne pourrait jamais rétablir sa santé. L’empereur daigna écouter sa supplique, et lui dit: «Je te permets, à toi seul, de pratiquer la religion bouddhique[152]». Mumako fut rempli de joie: il avait obtenu «l’inouï» (mi-zô-u)[153]. On considère cet événement comme l’origine de la restauration du Bouddhisme au Japon.
Sous le règne suivant, la seconde année, le mikado étant tombé malade, on lui conseilla d’autoriser la pratique du Bouddhisme dans son empire. Cette permission fut accordée, en dépit des résistances de l’ancien régent Mori-ya. A la mort de l’empereur, qui survint peu de temps après, Mumako offrit le trône à un de ses fils, Mumaya-do-no Wau-si, que je vous ai cité tout à l’heure pour son dévouement à la religion bouddhique. Ce prince, profondément pénétré des principes de Çâkya, n’accepta pas le trône, mais il profita de son influence pour donner de grandes facilités à la propagande des bonzes. Il est resté très populaire au Japon, sous son nom posthume de Syau-toku-tai-si «le prince impérial à la sainte vertu». On lui doit l’édification de neuf pagodes[154]. En outre, on cite le temple qu’il fit bâtir dans la province de Setsou, sous le nom de Si-ten-wau-si «le temple des quatre Mahârâdja».
Syautoku-taïsi, devenu régent, sous le règne de l’impératrice Toyo-mi-ke kasikiya bime (Souikô), continua à protéger le Bouddhisme et à en expliquer les livres sacrés. Fidèle aux enseignements de Çâkya, il s’abstint toute sa vie de tuer aucun être vivant; et, dans les repas qu’il donnait aux hauts fonctionnaires de l’empire, il ne leur offrait que des légumes pour nourriture. Il mourut en 621 de notre ère[155].
Sous les règnes suivants, le Bouddhisme se propagea de plus en plus au Japon, et devint bientôt la religion officielle de l’Empire. A ce sujet, je dois appeler votre attention sur une erreur très communément répandue. On répète sans cesse qu’il existe trois religions au Japon: 1º la Kami-no miti ou Sin-tau, religion des Génies; 2º la Hotoke-no miti ou But-tau, religion du Bouddha; 3º la Syu-tau, religion de Confucius ou des Lettrés. Rien n’est plus inexact. La sin-tau est une sorte de culte des héros antiques de la nation, n’excluant, en aucune façon, la pratique de la But-tau ou Bouddhisme, qui est, en réalité, la seule doctrine religieuse des Japonais. Quant à la prétendue religion des Lettrés, ce n’est, tout au plus, qu’une philosophie morale, cultivée dans les écoles, alors que les jeunes gens s’initient à la langue et à la littérature chinoises, et par quelques savants qui, au sortir de leurs classes, ont persévéré dans l’étude des monuments écrits du Céleste-Empire.
Il est donc bien entendu qu’un Japonais peut pratiquer le culte, d’ailleurs bien simple, bien rudimentaire, de la Kami-no miti, sans, pour cela, cesser d’être un bouddhiste fervent et dévot. D’ailleurs le Bouddhisme s’est partout associé, plus ou moins, aux croyances et aux préjugés des pays où il est venu s’implanter. Le mélange des idées est tel, au Japon, qu’on serait parfois tenté de trouver la contradiction même de l’idée fondamentale du Bouddhisme dans la doctrine des sectes qui n’en prétendent pas moins suivre les enseignements du bouddha Çâkya-Mouni.
Cela est tellement vrai que le nirvâna, fin suprême de l’individu, qui s’accomplit, pour la majeure partie des écoles bouddhiques, dans le Grand-Tout, où viennent s’anéantir les individualités, comme les gouttes d’eau viennent se perdre dans l’Océan, représente, au contraire, pour quelques sectes du Japon, l’état de béatitude de l’âme dans le sein de la divinité, après l’extinction de la vie terrestre. Une des deux écoles des Svabhâvikas, lesquelles comptent parmi les plus anciennes du Bouddhisme, admet également que les âmes qui ont atteint le nirvritti (délivrance finale) y conservent le sentiment de leur autonomie et ont conscience du repos dont elles jouissent éternellement[156].
L’alliance du Bouddhisme avec le Sintauïsme ou culte national des héros japonais, était d’ailleurs une nécessité pour faire accepter la doctrine de Çâkya-Mouni aux fiers insulaires du Nippon. Un des plus célèbres docteurs de la foi indienne, qui vivait au ixe siècle, Kau-bau Dai-si, l’avait fort bien compris. Il annonça donc au peuple que les deux doctrines n’en formaient en réalité qu’une seule, et que l’âme du Bouddha avait transmigré dans le corps de la grande Déesse solaire, Tensyau Dai-zin. De la sorte, il était loisible à tout fidèle d’adorer en même temps le Bouddha et les Kamis ou Génies tutélaires de la nation.
Il y a d’ailleurs, dans les habitudes regieuses des Japonais, la plus grande liberté, jointe souvent aussi à la plus profonde indifférence. Chacun adore les dieux qui lui conviennent, quand et comme il l’entend. La population des campagnes surtout ne se préoccupe guère de l’origine des idoles présentées à sa vénération: pourvu qu’elle ait, dans ses temples, quelques statues auxquelles elle puisse adresser des prières et demander des faveurs, elle n’a garde de s’enquérir de la source et de la raison d’être du culte auquel elle s’adonne moins par goût que par habitude invétérée.
L’étude du Bouddhisme japonais doit donc être envisagée sous deux aspects absolument distincts: le Bouddhisme philosophique, cultivé par un petit nombre de bonzes instruits et exposé dans des ouvrages indigènes d’exégèse, de polémique et de spéculation, et le Bouddhisme vulgaire, pratiqué par intérêt social ou individuel, par tradition ou par routine, dans les différentes classes de la population du pays.
Le Bouddhisme philosophique japonais passe pour avoir atteint un haut degré d’élévation intellectuelle[157], mais il n’est pas possible encore à la science de l’apprécier, car les orientalistes n’ont point abordé l’étude des monuments littéraires qui pourront nous le faire connaître un jour. Tout ce que je puis dire, d’après quelques entretiens que j’ai eus avec des moines éclairés du Nippon, c’est qu’il règne une grande indépendance d’idées dans cette doctrine, qu’elle tend à s’établir sur des bases scientifiques, qu’elle admet tous les changements que les progrès de l’expérience et de l’observation pourront motiver, et que, sauf quelques affinités plutôt philosophiques que dogmatiques avec la foi de Çâkya-Mouni, elle ne tient guère à maintenir comme canoniques un grand nombre d’aphorismes du célèbre rénovateur indien[158].
Le Bouddhisme vulgaire des Japonais, comme le Bouddhisme vulgaire de la Chine et de la plupart des contrées qui ont adopté cette doctrine, est une religion fondée sur les croyances les plus grossières et sur un énorme amas de superstitions inventées pour assouvir le besoin de merveilleux d’une population naïve et ignorante. Le culte essentiellement formaliste dont les bonzes se font les instruments intéressés, mais presque toujours inintelligents, se traduit par des cérémonies de dévotion en l’honneur des innombrables idoles offertes à l’adoration de la masse inculte qui fréquente les pagodes et les lieux de pèlerinage. La foule aime le spectacle: les bonzes ont imaginé un rituel de nature à donner ample satisfaction à ce besoin de mise en scène, si avantageux pour maintenir la domination d’un clergé avide et abruti. La plupart des exercices religieux sont accompagnés par le son des cloches ou des gongs, que les bonzes frappent à coups de marteau répétés en cadence. Dans certaines sectes, les prêtres se revêtent de costumes brillants, tandis que, dans d’autres, ils affectent de se couvrir d’habits crasseux et de haillons. Les uns prescrivent le baptême, la confession, et font des sermons en forme de conférences; d’autres s’abstiennent de ces pratiques, et font consister la liturgie en des chants langoureux et monotones qui amènent doucement les fidèles à une sorte d’abaissement intellectuel et même d’hébètement contemplatif. De toutes parts, l’idée fondamentale de la doctrine est reléguée sur un plan lointain, où elle n’est plus perceptible pour la courte vue des croyants, et la pensée religieuse est noyée dans d’étroites formules et dans les aphorismes le plus souvent inintelligibles d’insignifiantes litanies. Et cela à un tel point que la lecture des livres sacrés à haute voix et dans une langue de convention, notamment celle du Beô-hau Ren-ge Kyau (le Lotus de la Bonne Loi), dont on débite des fragments dans les pagodes, comme on lit des versets de l’Evangile dans les églises et les temples chrétiens, ne fournit aucun sens à l’oreille de ceux qui l’écoutent, ni même à l’esprit des bonzes qui sont chargés de les fredonner[159].
Nous ne possédons jusqu’à présent que des renseignements vagues et très insuffisants sur le caractère particulier de chacune des grandes sectes bouddhiques qui se sont successivement constituées au Japon. Une appréciation quelconque de leurs doctrines serait donc à tous égards prématurée. Je me bornerai, en conséquence, à vous citer trois d’entre elles qui sont souvent mentionnées dans les auteurs indigènes, et à vous donner, sur la première, quelques indications basées sur la traduction récente d’un livre dû à son célèbre instituteur dans les îles de l’extrême Orient.
Les règles de la secte dite Sin-gon, fondée par le bouddhisattwa Loung-meng, natif de l’Inde méridionale (800 ans après la mort de Çâkya-Mouni), furent introduites au Japon par Kô-bau Daï-si. Ce personnage, l’un des plus populaires du Nippon, naquit la cinquième année de la période Hau-ki (774 de notre ère), et montra, dès son enfance, des qualités intellectuelles qui lui firent donner le nom de Sin-tô «le jeune homme divin». Après avoir fait une étude approfondie des King ou Livres sacrés de la Chine et des historiens chinois, il entra au couvent et s’adonna à la culture des canons bouddhiques. On lui conféra d’abord le titre de Kô-kaï «l’Océan du Vide», et, quelques années après, celui de Kô-bau Daï-si «le Grand Maître qui répand la Loi», sous lequel il est connu dans l’histoire. A l’âge de trente ans, il s’embarqua pour la Chine, où il demeura trois ans pour se perfectionner dans la connaissance de la doctrine de Çâkya, sous la direction d’un moine nommé Hoeï-ko. De retour dans son pays, il s’appliqua à vulgariser les enseignements qu’il avait recueillis durant son séjour sur le continent. On lui attribue, en outre, l’invention de l’écriture encore en usage de nos jours, sous le nom de hira-kana. Il mourut en 835, à l’âge de soixante-deux ans, et, depuis lors, de nombreux temples ont été édifiés pour célébrer sa mémoire.
Parmi les ouvrages de Kôbau Daïsi, l’un des plus répandus au Japon est le Zitu-go kyau ou «l’Enseignement des Vérités». Ce traité, dont j’ai publié le texte avec une traduction française et un commentaire[160], a été pendant longtemps expliqué dans toutes les écoles, où, le plus souvent, les élèves en apprenaient les maximes par cœur. C’est à peine si on y reconnaît des traces de la doctrine de Çâkya-Mouni, et il faut y voir plutôt un recueil d’instructions morales qu’un livre religieux proprement dit. On y trouve cependant l’expression des idées de l’auteur, au sujet de l’âme «qui périclite au fur et à mesure que le corps s’affaiblit par la vieillesse». Il y est également question du nirvâna (en Japonais: ne-han). Suivant Kôbau, cet état suprême de l’être émancipé consiste dans l’absence absolue de désirs, alors que l’homme, se confiant à la nature, se plaît dans un milieu de quiétude. Il paraît d’ailleurs évident que l’École dite Sin-gon ne croyait pas à l’immortalité de l’âme. Un recueil de maximes populaires, imprimé d’habitude à la suite du livre de Kôbau, le Dô-zi kyau, dit expressément: «Quand l’homme est mort, il reste sa renommée; quand le tigre est mort, il reste sa peau[161].»
Ne nous hâtons pas cependant,—je ne saurais trop le répéter,—de prononcer un jugement au sujet de la métaphysique des sectes bouddhiques du Japon, et attendons pour cela que nous possédions les livres qui représentent réellement leur philosophie doctrinale. Toute appréciation, fondée sur les seules données recueillies par les voyageurs, est nécessairement incertaine, insuffisante et dépourvue du véritable caractère scientifique[162].
L’observance dite Ten-tai, créée en Chine par un moine connu sous le titre de Tien-taï ta-sse[163], fut apportée au Japon par un certain Saï-tô et devint, lors de la fondation de la fameuse pagode Yenryaku si (en 824), la doctrine d’une des sectes importantes du pays.
La secte de Ik-kau-zyu, fondée par le bonze Sin-ran, qui vivait de 1171 à 1262, fut pendant longtemps, et même jusqu’à notre époque, une des plus considérables du Nippon. Profondément dévoués à la personne des Syaugouns, ses prêtres jouissaient d’honneurs et de privilèges exceptionnels. Ils n’étaient point d’ailleurs astreints aux rigueurs imposées aux autres associations monastiques: le mariage leur était permis, ils avaient la liberté de manger de la viande et ne se rasaient point la tête. Constitués, dans une certaine mesure, en ordre militaire, à l’instar des Templiers, la cour de Yédo comptait sur leur assistance, en cas de guerres intestines. Pour témoigner de leur dévouement envers cette cour, lorsqu’un nouveau Syaugoun venait à prendre en mains les rênes de l’Etat, ils avaient l’habitude de lui offrir l’assurance de leur fidélité sur un document écrit, qu’ils arrosaient préalablement de leur sang.
L’organisation de cette secte fut, en outre, une conséquence du système général de la politique soupçonneuse des Syaugouns, qui ne pouvaient laisser vivre, sans la soumettre à une surveillance policière, une caste aussi nombreuse et aussi puissante que celle du clergé bouddhique. Des mesures avaient d’ailleurs été déjà prises, depuis bien des siècles, pour assurer au gouvernement la haute main sur les monastères. A l’occasion d’un assassinat commis par un bonze, en 625 de notre ère, l’impératrice Toyo-mi-ke Kasiki-ya bime (Souiko) avait créé des fonctionnaires appelés Sô-syau «régisseurs des bonzes», dont la mission était de veiller à la discipline des prêtres et probablement aussi de donner au gouvernement connaissance de leurs agissements[164].
Peu à peu le personnel des monastères se vit, de toutes parts, hiérarchisé, enrégimenté, et une foule de dignités et de titres officiels furent imaginés, dans le but de le placer directement sous la dépendance de l’administration séculière. Cette intervention incessante de l’autorité laïque dans l’organisation et les affaires des couvents, d’une part, l’absence de toute communication entre le Nippon et le continent asiatique, d’autre part, eurent pour effet rapide d’altérer, jusque dans ses principes fondamentaux, le bouddhisme japonais, auquel il ne resta bientôt, de la grande doctrine indienne, plus guère autre chose que le nom. J’ignore ce qu’il peut y avoir de vrai dans ce qu’on a dit au sujet d’une philosophie bouddhique, à laquelle certains bonzes auraient su donner une remarquable élévation. Mais il est hors de doute que, tel qu’il est pratiqué de nos jours par la masse des insulaires de l’Asie orientale, il n’est plus rien qu’un tissu des plus extravagantes idolâtries. Et, si j’en juge par quelques moines éclairés avec lesquels je me suis trouvé, il y a plusieurs années, en rapports quotidiens, le petit nombre de Japonais qui se préoccupe encore aujourd’hui de la pensée première et de la théorie du bouddhisme s’y intéresse bien plutôt par goût des choses de l’érudition proprement dite que dans un but de spéculation ou de propagande religieuse et philosophique.
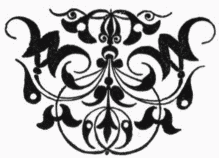
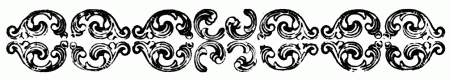
 E Japon, durant la longue période dont j’essaierai de vous donner un
aperçu rapide, est resté à peu près complètement isolé du reste du
monde; et c’est à peine si nous aurons l’occasion de rattacher une fois
son histoire à celle de la Chine, en parlant de la grande expédition
organisée par le célèbre empereur Koubilaï-khan, dans le vain espoir
d’établir sa puissance jusque dans les îles de l’extrême Orient. Le fait
le plus important que nous devrons, en conséquence, faire ressortir sera
la constitution de la puissance des Syau-gun qui devaient un jour ne
plus laisser aux mikado, les véritables empereurs, autre chose qu’une
autorité purement conventionnelle et nominale; jusqu’à ce qu’enfin la
révolution opérée, par suite de rétablissement des Européens au Japon,
vienne à son tour détruire la formidable organisation politique des
autocrates de Yédo, et rendre aux successeurs de Zinmou la puissance
suprême dont leurs généralissimes les avaient dépouillés pendant
plusieurs siècles.
E Japon, durant la longue période dont j’essaierai de vous donner un
aperçu rapide, est resté à peu près complètement isolé du reste du
monde; et c’est à peine si nous aurons l’occasion de rattacher une fois
son histoire à celle de la Chine, en parlant de la grande expédition
organisée par le célèbre empereur Koubilaï-khan, dans le vain espoir
d’établir sa puissance jusque dans les îles de l’extrême Orient. Le fait
le plus important que nous devrons, en conséquence, faire ressortir sera
la constitution de la puissance des Syau-gun qui devaient un jour ne
plus laisser aux mikado, les véritables empereurs, autre chose qu’une
autorité purement conventionnelle et nominale; jusqu’à ce qu’enfin la
révolution opérée, par suite de rétablissement des Européens au Japon,
vienne à son tour détruire la formidable organisation politique des
autocrates de Yédo, et rendre aux successeurs de Zinmou la puissance
suprême dont leurs généralissimes les avaient dépouillés pendant
plusieurs siècles.
Durant les premiers règnes de la période qui nous occupe, le Japon jouit d’une paix profonde et les mikados passent leur existence à se divertir dans leurs palais, à réunir autour d’eux des assemblées de poètes, à se faire expliquer les chefs-d’œuvre de la littérature chinoise, et à faire des pèlerinages. L’empereur Zyun-wa ordonne, en 831, la composition d’un recueil des ouvrages japonais les plus élégamment écrits. Son successeur Nin-myau, en 835, va présider une fête en l’honneur de la floraison des chrysanthèmes, et reçoit les vers que les poètes les plus célèbres du pays viennent lui offrir à cette occasion. Son fils, Bun-toku, se rend, en 851, à un de ses palais pour admirer les cerisiers en fleurs et composer des poésies. Sei-wa, encore enfant, accorde, en 859, des promotions à plusieurs divinités du pays; l’une d’elles obtient le premier rang de la première classe.
L’histoire de la plupart des mikados de cette période antérieure à la domination des syaugouns, rapporte une foule d’événements de ce genre. La plupart de ces princes se préoccupaient déjà fort peu des affaires du gouvernement et se livraient sans relâche à tous les amusements que leur haute situation leur permettait de se procurer. On cite cependant quelques actes de tyrannie qui contrastent tristement avec les plaisirs innocents des empereurs que nous venons de citer. Yau-zei, par exemple, renouvela les horreurs qui signalèrent le règne du tyran Bourets; les chroniques rapportent, en effet, que, pour se divertir, ce mikado, alors qu’il n’avait pas encore dix-sept ans, faisait monter des hommes sur des arbres pour les abattre à coups de flèches ou d’autres projectiles.
En l’an 899, l’ex-mikado fut consacré prêtre de la religion bouddhique. Ce fut la première fois qu’eut lieu un pareil événement. Les souverains ainsi devenus prêtres, sont appelés Hau-wau «empereur de la Loi».
Arrivé à l’époque de l’empereur Zu-zyaku, le Japon est le théâtre d’une grande révolte qui jette la terreur dans tout l’empire. A la fin de l’année 939, un personnage appelé Masa-kado lève l’étendard de la révolte, se rend maître de quelques provinces et s’arroge plusieurs des prérogatives de la dignité impériale. En même temps, un certain Sumitomo, à la tête d’une nombreuse troupe de bandits et de pirates, s’empare de diverses autres parties de l’empire, où il établit sa domination. Cette fois le mikado parvint à dominer l’insurrection, et Masakado, blessé par une flèche sur le champ de bataille, eut la tête tranchée par un des princes envoyés à sa rencontre avec une armée de seize mille hommes pour le réduire. Soumitomo et son fils subirent le même sort, peu de temps après.
La tranquillité ne fut pas rétablie pour longtemps dans le Nippon, et nous voyons bientôt la caste militaire devenir toute puissante et anéantir à peu près complètement l’autorité souveraine des mikados. Plusieurs princes féodaux avaient acquis, pendant les guerres intestines de cette époque, une influence considérable dans les affaires de l’état. Les maisons de Taira, de Minamoto et de Fudiwara ne tarderont pas à ensanglanter le pays dans les luttes qu’elles vont engager pour s’assurer la suprématie dans l’empire.
Originairement, la constitution de la monarchie japonaise était en général fort simple et de nature à prévenir toute tentative de désorganisation sociale. L’autorité militaire n’était pas séparée de l’autorité civile: tout le monde, sans distinction de caste, était soldat, et l’empereur remplissait seul les fonctions de général en chef de la nation armée. En cas de guerre, le mikado prenait en personne le commandement des troupes, ou confiait à son héritier présomptif cette charge qui ne pouvait être placée entre les mains d’aucun autre de ses sujets. Au VIIe siècle, cette constitution fut modifiée, et on chercha à imiter celle qui avait prévalu en Chine, sous la dynastie des Tang. On constitua deux classes essentiellement distinctes de fonctionnaires publics et à peu près complètement indépendantes l’une de l’autre: la classe des fonctionnaires civils et la classe des fonctionnaires militaires.
De 938 à 1087, les deux puissantes maisons de Taïra et de Minamoto établirent des camps permanents dans les provinces de l’Est; les soldats, ainsi séparés de l’élément civil de la population, ne tardèrent pas à se persuader qu’il lui était complétement étranger, et insensiblement ils considérèrent leur chef comme leur véritable souverain. Les mikados, dans leur indolence, trouvaient fort commode, en cas de révolte intestine, de confier à ces maisons le soin de châtier les rebelles; mais ils s’aperçurent trop tard que ceux-là qu’ils avaient créés leurs défenseurs, étaient appelés, dans un temps peu lointain, à les réduire eux-mêmes à une somptueuse mais non moins réelle servitude[165].
Lorsqu’une de ces deux maisons accomplissait un acte qui portait ombrage à la cour, le mikado chargeait l’autre de la châtier. Ce système politique, où les empereurs croyaient voir une garantie de conservation pour leur autorité souveraine, ne devait point aboutir aux résultats qu’ils avaient espérés. Les Taira et les Minamoto ne tardèrent pas à lutter entre eux pour leur propre compte, et il en résulta les plus effroyables désordres dans tout l’empire. Après de longues guerres entre ces deux maisons rivales, un jeune enfant, nommé Yori-tomo, dernier représentant de la famille des Minamoto, tomba prisonnier entre les mains des Taïra. L’intervention d’une femme lui sauva la vie, mais il fut banni dans la province d’Idzou. Bien qu’il n’eût alors que quatorze ans, il songea secrètement à venger l’honneur de sa maison; et bientôt, avec l’aide d’un courtisan dont il avait épousé la fille, il parvint à s’échapper des mains de ses ennemis, et à constituer, loin du domaine de leur action, une puissante armée de mécontents, à la tête desquels il put exterminer les troupes des Taïra, réduire à l’impuissance les derniers débris de ses partisans, et créer à Kamakoura la capitale de ses états et le centre de son autorité militaire dans le nord du Japon[166].
C’est avec ce personnage, désigné dans les historiens indigènes sous le titre de Mina-mo-tono Yori-tomo, que commence, pour le Japon, cette dynastie de princes qui régnèrent pendant plusieurs siècles et jusqu’en 1868, sous le titre de syau-gun «généralissime», titre que les Européens ont transformé, à notre époque, en celui de taï-kun «grand prince».[167] On fait remonter, il est vrai, l’institution des fonctions de syaugoun à l’origine même de la monarchie japonaise, et on rapporte que, sous Zinmou (VIIe siècle avant notre ère), un personnage appelé Miti-no Omi-no Mikoto fut élevé au syaugounat par l’empereur qui le plaça, en conséquence, à la tête de l’armée, pour combattre les barbares de l’Est.
Ce serait toutefois une grave erreur de confondre le titre et les fonctions de syaugoun confiés à cette époque et plus tard, à divers commandants en chef de l’armée, avec la dignité en quelque sorte souveraine que s’arrogea, au XIIe siècle, le célèbre Yoritomo. A partir de cette époque, et jusqu’à la date encore toute récente de la restauration des mikados, le syaugoun, que beaucoup d’auteurs ont appelé «le second empereur du Japon», était en réalité le véritable possesseur de l’autorité dans les îles de l’extrême Orient. Il était quelque chose de plus que les maires du palais de nos rois mérovingiens, car il avait réuni toutes les rênes du gouvernement dans sa résidence personnelle, laissant le mikado jouir de tous les plaisirs de l’oisiveté, mais à peu près absolument impuissant, dans un palais situé à grande distance de cette résidence.
Il serait cependant inexact de considérer, comme on l’a fait maintes fois, le syaugoun comme le véritable empereur du Japon. La puissance des traditions, le caractère sacré que la religion indigène donnait aux mikados[168], considérés comme les descendants directs et légitimes des anciens dieux du pays; les restes encore imposants de la vieille organisation féodale de l’empire, tout s’opposait à ce que les Généralissimes s’arrogeassent le titre et certaines prérogatives de la dignité impériale. Les syaugouns les plus puissants éprouvèrent eux-mêmes le besoin d’obtenir une sorte d’investiture que les premiers allèrent recevoir à Myako, résidence des mikados, et que les autres se firent donner solennellement, au nom de ces mêmes mikados, dans leur résidence effective[169]. Bien plus, ils crurent devoir demander au souverain légitime les titres et rangs nobiliaires qu’ils reconnaissaient à lui seul le droit de conférer, et ces titres, ils n’osèrent souvent les réclamer que de la façon la plus humble et la plus modeste. Taïkau-sama est le seul qui ait été promu, comme je vous le dirai tout à l’heure, jusqu’au quatrième rang; en 1862, le syaugoun régnant ne possédait que le huitième rang, et le président du Go-rau diu ou chef du cabinet, n’était arrivé qu’au quinzième.
Même sous l’empire de l’autorité syaugounale, la hiérarchie de la cour impériale de Myako fut conservée à peu près complètement dans son intégrité, et il était admis que, dans le cas d’événement d’une importance exceptionnelle, c’était par un Grand Conseil présidé par le mikado et composé des principaux dignitaires de l’état que des résolutions exécutoires pouvaient seulement être prises[170]. Bien plus, dans ce Grand Conseil, le syaugoun ne pouvait occuper qu’une place plus ou moins inférieure, déterminée par le rang auquel il avait été promu à l’avance. Après le mikado, la seconde place était réservée à ses fils ou filles majeurs, c’est-à-dire âgés au moins de quinze ans révolus;[171] la troisième aux enfants mineurs du souverain, la quatrième aux ses-syau[172], régents ou descendants des anciens empereurs. Les petits-fils du mikado recevaient en naissant le treizième rang et arrivaient, en grandissant, à être promus jusqu’au second. Il fut entendu que si la dynastie directe des successeurs de Zinmou venait à s’éteindre, un des tiu-na-gon[173], élevé au deuxième rang de sin-au, pourrait être appelé à la succession. Enfin, au bout de la salle, relégués en quelque sorte comme d’infimes serviteurs, étaient admis les koku-si[174], c’est-à-dire les dix-huit grands dai-myau ou «princes féodaux[175]» dont on fait remonter l’origine au règne de Seïmou (131 à 191 de notre ère). Les autres daïmyaux n’étaient pas admis au Grand Conseil, parce qu’ils étaient considérés comme placés dans la dépendance directe du syau-goun.
Les mikados, qui se succédèrent à l’époque de la fondation du syaugounat avaient tous été élevés à la dignité impériale alors qu’ils étaient encore en bas âge, de sorte que l’autorité souveraine passait tour à tour dans les mains de tous les courtisans qui cherchaient à profiter de la situation pour donner libre cours à leurs menées égoïstes et ambitieuses. Roku-deô, proclamé empereur à deux ans (1166), fut déposé deux ans après (1167) par son grand-père Sirakava II;—Taka-kura monta sur le trône à l’âge de huit ans (1169); son successeur An-toku, à l’âge de trois ans (1181); les empereurs suivants, Toba II (1184) et Tuti-mikado (1199), l’un et l’autre, à l’âge de quatre ans.
Les descendants de Yoritomo ne se montrèrent pas à la hauteur de la mission que leur avait léguée le chef de la dynastie syaugounale; bientôt les fonctions de régent, devenues en quelque sorte héréditaires dans la famille des Hô-deô, qui étaient maîtres d’élire ou de déposer les syaugouns, vint placer ces derniers dans une condition de dépendance occulte, analogue à celle qui avait été faite aux représentants nominaux de l’autorité impériale.
C’est durant cette période qu’eut lieu la première tentative des Mongols de placer le Japon sous leur suzeraineté. Leur souverain, le fameux Koubilaï-khan, envoya dans ce but plusieurs ambassades au Nippon, avec des lettres par lesquelles il réclamait le tribut; mais, comme ces lettres étaient conçues dans des termes hautains et insolents, il ne leur fut pas fait de réponse. Pour donner une sanction à ses menaces, il envoya, en 1274, sur neuf cents vaisseaux, une armée de 33,000 hommes, dont 25,000 Mongols et 8,000 Coréens. Cette armée débarqua à l’île d’Iki, où eut lieu un grand combat naval, dans lequel l’un des deux généraux qui la commandaient fut tué d’un coup de flèche. Les Mongols songèrent alors à se retirer, mais leur flotte fut en partie détruite par un de ces typhons si fréquents dans les mers de l’extrême Orient. Le général des Coréens fut noyé, et treize mille hommes environ purent seuls regagner la Chine.
L’année suivante (1275) Koubilaï envoya une nouvelle ambassade à Kama-koura, avec la mission de réclamer de nouveau le tribut. Le régent Toki-mune, pour toute réponse, fit trancher la tête au chef de la mission et l’exposa aux regards du peuple. Quelques années après (1281), l’empereur des Mongols ou Youen leva une nouvelle armée de 180,000 hommes qui atteignit le Japon en vingt-quatre jours. Cette armée possédait des catapultes et autres engins inusités jusqu’alors, que le célèbre voyageur Marco Polo venait de faire connaître aux Tartares, à la cour desquels il avait été accueilli. Cet armement nouveau et le nombre considérable des soldats qui avaient été réunis pour cette circonstance, eussent probablement triomphé du courage dont les Japonais firent preuve en présence de cette invasion, si la mer des typhons ne leur avait encore une fois prêté le secours du vent et des flots. L’expédition tout entière fut submergée, à l’exception de 3,000 combattants qui, faits prisonniers par les insulaires, furent immédiatement mis à mort, et de trois individus auxquels on fit grâce, pour qu’ils pussent aller porter en Chine la nouvelle du désastre.
En 1334, Dai-go II, élevé pour la seconde fois sur le trône, s’efforça de ressaisir la puissance impériale qui s’était échappée des mains de ses prédécesseurs. Pour être agréable à son épouse, il commit l’imprudence d’accorder des titres et des fonctions nouvelles à Taka-udi. Celui-ci en profita pour s’assurer l’appui de l’armée et ne tarda pas à se proclamer lui-même grand syaugoun. Deux ans plus tard, il élevait au trône de Myako un nouvel empereur du nom de Kwan-myau, tandis que Daï-go II, qui était parvenu à s’échapper secrètement, allait s’établir à Yosino. L’empire japonais se trouva ainsi morcellé en deux cours: celle du nord ou hoku-tyau et celle du sud ou nan-tyau. De la sorte, deux mikados régnèrent simultanément sur cet empire pendant une période de cinquante-six ans (de 1336 à 1392). La réconciliation des deux empereurs ne profita qu’à un certain Asi-kaga qui réussit, au milieu de la confusion générale où se trouvait le pays, à s’assurer pour lui-même la puissance héréditaire du syaugounat, laquelle demeura dans sa famille jusqu’en 1573.
Cette nouvelle période nous présente le tableau des guerres intestines les plus effroyables, auxquelles semblent vouloir participer de la façon la plus confuse et la plus capricieuse, tous les daïmyaux ou princes feudataires de l’empire. Pendant ces guerres de tous les instants, non-seulement la majesté impériale n’est plus respectée, mais les syaugouns, eux aussi, ne parviennent souvent point à maintenir leur autorité. D’un bout à l’autre de l’archipel, le sang coule pour la satisfaction de petits intérêts personnels: ce ne sont qu’intrigues, vengeances, fourberies; le désordre, partout, est porté à ses dernières limites.
C’est également durant cette période que les Portugais abordèrent pour la première fois au Japon (1551), où ils introduisent la prédication du Christianisme.
Un daïmyau nommé Nobu-naga apparaît au milieu du XVIe siècle; et, après s’être ménagé de puissantes alliances, s’engage au service des Asikaga, avec lesquels il finit par se mettre ouvertement en voie de rébellion (1573). La même année, il marche à la tête d’une armée contre les troupes du syaugoun Yositoki. Celui-ci, ne se trouvant pas en état de résister, se constitue prisonnier; et, après avoir renoncé au syaugounat, se fait raser la tête. Ses principaux partisans sont mis à mort par ordre du vainqueur.
Sur ces entrefaites, un homme de basse extraction, que le hasard a fait bet-tau (palefrenier) de Nobounaga, parvient à gagner la confiance de son maître qui finit par l’élever au rang de général de ses troupes. Cet homme, appelé Hide-yosi, mais qui est plus généralement connu sous son nom posthume de Tai-kau sama, n’hésita pas, après la mort de Nobounaga, à supplanter les fils de son bienfaiteur, et, après les avoir réduits à l’impuissance et l’un d’eux à s’ouvrir le ventre, à prendre en mains les rênes du pouvoir. Devenu tout puissant dans l’empire, il fut élevé par le mikado à la dignité de Kwan-baku, dignité qui ne fut jamais accordée à un autre syaugoun, et qui jusqu’alors avait été exclusivement conférée à la famille princière des Fudivara. Il reçut en même temps de l’empereur le nom de Toyo-tomi.
Hidéyosi, sentant sa fin prochaine, et voulant assurer sa succession à son fils Hide-yori, fiança cet enfant en bas âge avec la petite fille de Iyéyasou, l’un des princes les plus puissants de l’empire, et lui fit signer de son sang la promesse qu’aussitôt que Hidéyori aurait atteint sa treizième année, il le ferait reconnaître syaugoun par le mikado. Mais bientôt Iyéyasou, qui aspirait à l’autorité souveraine, trouva un prétexte pour se brouiller avec le fils de Taïkau. Il assiégea le jeune prince dans son château d’Ohosaka et le fit périr dans l’incendie qu’il y alluma.
Devenu, par ce meurtre, maître de l’autorité souveraine, Iye-yasu, également connu sous le nom posthume de Gon-gen-sama, et qui appartenait à la noble famille de Toku-gawa, fut le fondateur de la quatrième et dernière dynastie des syaugouns, laquelle gouverna le Japon pendant deux cent soixante-cinq ans, depuis le commencement du XVIIe siècle jusqu’à nos jours (1603-1868). Ce prince, d’une haute intelligence politique, fit subir une transformation complète au Japon, dont il devint le maître absolu, tout en laissant aux mikados le titre et l’appareil de la majesté souveraine. Yédo, qui n’était avant lui qu’un petit village, devint sa résidence; et, avec le concours de trois cent mille ouvriers, il y construisit le siro ou cité impériale, les vastes fossés qui l’entourent et les canaux qui donnent à la capitale l’aspect d’une ville hollandaise. Iyéyasou promulgua non-seulement un Code de lois nouvelles, mais il régla jusque dans leurs moindres détails la manière de vivre des différentes castes composant la société japonaise.
Afin d’assurer sa personne et ses successeurs contre toute tentative du mikado à ressaisir l’autorité effective, Iyéyasou ne se contenta pas d’enfermer le successeur de l’empereur Zinmou dans son palais de Miyako, avec une nombreuse garde, dont la présence avait pour but avoué de lui rendre les honneurs dus à son rang suprême, mais qui, en réalité, avait pour mission d’assurer sa captivité; il établit encore, dans cette capitale du sud, un gouverneur chargé de veiller sur tous ses actes et de prévenir au besoin, par la force, toute tentative d’émancipation. En même temps, un des proches parents du mikado fut appelé à Yédo, pour y remplir les fonctions de grand-prêtre et fournir, le cas échéant, au syaugoun un successeur immédiat au mikado qui parviendrait à lever l’étendard de la révolte.
Quant aux princes féodaux qui se partageaient l’empire, il leur était sévèrement interdit d’engager aucune espèce de relations avec la cour du mikado; il leur était même défendu de traverser cette ville et d’y séjourner. Ils ne pouvaient non plus se visiter les uns les autres, ni être représentés par des agents à leurs cours respectives. Chaque année, ils devaient venir faire une visite à l’autocrate de Yédo; mais les époques de ces visites étaient déterminées de façon à ce qu’ils ne pussent jamais se rencontrer avec les princes dont les états étaient limitrophes des leurs. Enfin, durant leur absence de la capitale du Nord, ils étaient obligés d’y laisser demeurer leur famille en guise d’otages.
Iyéyasou est inscrit dans les annales du Japon, comme n’ayant régné que trois ans (1603-1605) avec le titre de Grand Syaugoun; mais, en réalité, sa domination sur l’empire date de peu de temps après la mort de Taïkau.
En 1605, Hide-tada, son fils, et, en 1623, Iye-mitu, son petit-fils, lui succédèrent. L’un et l’autre se firent un devoir de continuer avec un zèle énergique et intelligent, la politique de l’habile fondateur de leur dynastie. C’est durant le règne de ce dernier qu’eut lieu, à Sima-bara (1638), l’extermination des chrétiens, dont 37,000 furent impitoyablement massacrés, et l’expulsion de tous les étrangers, à l’exception des Hollandais qui, en récompense du concours qu’ils avaient donné au syaugoun pour détruire le christianisme dans ses états, jouirent du privilège exclusif de commercer avec le Japon. Les Hollandais n’obtinrent cependant pas la faculté de parcourir le pays, et ils furent en quelque sorte emprisonnés dans le petit îlot de Dé-sima, sur la baie de Nagasaki, que l’autocrate de Yédo fit construire pour leur résidence. L’histoire raconte que cet îlot présente l’aspect d’un éventail, le syaugoun, consulté sur la forme qu’il fallait donner à sa construction, s’étant contenté pour toute réponse de montrer l’objet qu’il tenait en ce moment à la main. L’exclusion des autres Européens ne souffrit point d’autre exception; et lorsque l’Espagne envoya peu après une ambassade à Nagasaki, le chef de la mission et les soixante personnages qui l’accompagnaient furent décapités et exposés sur la place publique (1640).
Sous le règne de ces deux princes et de leurs successeurs, le système de police et d’espionnage organisé par Hidéyosi, acquit encore de nouveaux développements. C’est ce qui a fait dire que le Japon était divisé en deux parties, dont l’une était chargée de surveiller l’autre. Toujours est-il que jusqu’à la révolution de 1868, aucun fonctionnaire public ne pouvait circuler sans se faire accompagner par son o me-tuke «celui qui a l’œil», ou par son «ombre», pour me servir de l’expression employée par les Européens pour désigner les espions officiels des officiers japonais. En 1862, lors de l’arrivée en Europe de la première ambassade du syaugoun, non-seulement toutes les classes d’attachés de la mission, y compris les domestiques, avaient sans cesse un ométsouké en leur compagnie, mais les deux ambassadeurs avaient également le leur, qui participait à leur rang et sans lequel ces derniers n’auraient pas osé accomplir un acte quelconque.
Les princes qui prirent, par la suite, la succession de Iyéyasou, ne se montrèrent généralement pas à la hauteur de la charge qu’ils avaient reçue en héritage, et leur puissance ne tarda pas à péricliter. Lorsque les Américains tentèrent, en 1852, pour la première fois d’une manière sérieuse, d’ouvrir les ports du Japon au commerce étranger, le syaugoun régnant alors, Iye-yosi n’avait déjà plus entre les mains qu’une faible partie de l’autorité suprême qui était passée insensiblement entre les mains de son Conseil. Nous verrons plus tard comment il se trouva impuissant à résister à l’invasion étrangère, et comment lui et ses successeurs rendirent possible la grande révolution de 1868 qui restitua la souveraineté effective aux mikados, successeurs légitimes de l’empereur Zinmou.
![]()
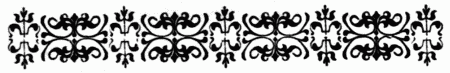
 ’ART d’écriture ne fut guère en usage au Japon avant le milieu du
IIIe siècle de notre ère. On a cependant prétendu que des
inscriptions antiques, en caractères différents de ceux de la Chine,
avaient été découvertes, et que ces inscriptions étaient une preuve que
les Japonais connaissaient l’écriture antérieurement à leurs premières
relations historiques avec les Chinois.[176] Mon illustre et très
regrettable ami, le docteur de Siebold, m’annonçait même la prochaine
publication de monuments de ce genre, lorsque la mort est venue
l’enlever aux sciences et aux lettres japonaises qu’il avait cultivées
toute sa vie avec tant de zèle et de dévoûment. Plusieurs fois, depuis
lors, j’ai reçu l’assurance que ces inscriptions énigmatiques existaient
réellement; mais, malgré mes efforts, il ne m’a pas été possible de m’en
procurer des spécimens d’une authenticité satisfaisante.
’ART d’écriture ne fut guère en usage au Japon avant le milieu du
IIIe siècle de notre ère. On a cependant prétendu que des
inscriptions antiques, en caractères différents de ceux de la Chine,
avaient été découvertes, et que ces inscriptions étaient une preuve que
les Japonais connaissaient l’écriture antérieurement à leurs premières
relations historiques avec les Chinois.[176] Mon illustre et très
regrettable ami, le docteur de Siebold, m’annonçait même la prochaine
publication de monuments de ce genre, lorsque la mort est venue
l’enlever aux sciences et aux lettres japonaises qu’il avait cultivées
toute sa vie avec tant de zèle et de dévoûment. Plusieurs fois, depuis
lors, j’ai reçu l’assurance que ces inscriptions énigmatiques existaient
réellement; mais, malgré mes efforts, il ne m’a pas été possible de m’en
procurer des spécimens d’une authenticité satisfaisante.
En revanche, j’ai eu connaissance de plusieurs ouvrages indigènes traitant d’une écriture qui aurait été pratiquée au Japon avant l’expédition de l’impératrice Iki-naga-tarasi contre la Corée (200 ans avant notre ère). Les caractères de cette écriture, appelés sin-zi «signes divins», ne différent que fort peu de ceux qu’emploient de nos jours les habitants de la Corée. Les savants japonais disputent sur la question de savoir si ces caractères ont été inventés dans le Tchao-sien ou dans le Nippon. Leur origine continentale paraît incontestable; mais l’amour-propre des insulaires de l’extrême Orient ne trouve pas son compte dans une pareille théorie et il fait tous ses efforts pour la renverser.
Quoi qu’il en soit, cette écriture n’a probablement jamais été bien répandue au Japon; sans cela, les intelligents habitants de cet archipel n’auraient sans doute point adapté à leur langue les signes si nombreux, si compliqués de l’écriture idéographique de la Chine, et ils eussent probablement préféré le système analytique si commode de l’écriture coréenne au système à tant d’égards défectueux et insuffisant des kana syllabiques. Je ne connais pas d’autre exemple d’un peuple qui, ayant fait usage d’une écriture alphabétique, l’ait abandonnée pour lui substituer une écriture figurative. L’abandon de l’alphabet coréen eût été d’autant moins raisonnable que ses lettres se distinguent par une remarquable simplicité, un tracé facile, une lecture rapide et toujours exempte d’incertitudes[177]. Il faut dire, il est vrai, que la simplicité n’a guère été du goût des Japonais, dont la calligraphie admet plus de caprices et d’excentricités qu’on n’en pourrait trouver d’exemples, en pareil cas, chez aucun autre peuple connu[178].
Ce n’est, en réalité, qu’après l’introduction de quelques-uns des monuments littéraires de la Chine dans les îles de l’extrême Orient que les Japonais ont commencé à posséder de véritables livres. Plusieurs de ces livres renferment des productions de l’esprit indigène, qui remontent parfois à une époque de beaucoup antérieure à la connaissance de l’écriture dans le Nippon. Certaines poésies, des chants relatifs aux fastes de l’antique dai-ri, conservés par la tradition orale, sont certainement de plusieurs siècles antérieurs au temps où les Japonais commencèrent à employer l’écriture idéographique des Chinois. Nous possédons déjà, sur quelques-unes de ces vieilles productions poétiques, des données qui nous permettent de fixer leur âge et qui en font, de la sorte, des documents philologiques d’une valeur inappréciable pour l’étude de l’ancien idiome de Yamato.
Il n’entre point dans ma pensée de vous présenter ici un tableau, fût-il très succinct, de la riche littérature du Nippon. Même en me bornant à de simples citations bibliographiques, je serais entraîné fort au-delà des limites que doit avoir cette conférence. Je me propose donc de jeter seulement un coup d’œil rapide sur les divers genres de monuments qui constituent cette littérature; et, tout en m’attachant à vous signaler quelques-unes des œuvres exceptionnelles que vous devez connaître au moins de nom, de vous mentionner les ouvrages dont les orientalistes nous ont déjà donné des traductions complètes ou partielles.
En tête de leurs livres, et comme documents originaux de leur histoire littéraire, les Japonais placent un petit nombre d’ouvrages dont l’authenticité a été établie d’une manière incontestable. Parmi ces ouvrages, ils citent tout d’abord une sorte d’anthologie intitulée Man-yô siû, et une narration légendaire et historique connue sous le nom de Ko zi ki.
Le Man-yô siù, littéralement: «Collection des Dix-mille Feuilles»[179], est un recueil de toutes sortes de poésies antiques, dont on attribue la réunion à un sa-dai-zin, ou grand officier de la droite, appelé Tati-bana Moro-ye, lequel vivait sous le règne de l’impératrice Kau-ken (749-759 de notre ère). Ce lettré mourut avant d’avoir complété son œuvre, qui ne fut achevée que sous le LIe mikado, Hei-zei (806-809), auquel elle fut présentée. Ainsi s’explique la présence, dans le Man-yô siù, de beaucoup de pièces composées après la mort de Moro-ye[180]. L’opinion la plus accréditée est que la coordination de cette anthologie est due à un personnage nommé Yaka-moti[181], lui même auteur de plusieurs des poésies qui y ont été insérées.
Le Man-yô siû est écrit exclusivement en caractères chinois; mais ces caractères y perdent le plus souvent la signification qui leur est propre, pour ne plus devenir que de simples lettres d’un syllabaire destiné à reproduire les sons de la langue de Yamato. Ce syllabaire, ayant servi tout d’abord à écrire les poésies de l’antique recueil qui nous occupe, a reçu, par ce fait, le nom de Man-yô kana «caractères des Dix-mille Feuilles ou des Poésies».
Parmi les pièces réunies dans le Man-yô siû, il en est un grand nombre qui n’offrent de l’intérêt qu’en raison des faits historiques auxquels elles font allusion. Quelques-unes, au contraire, se distinguent par une tournure gracieuse et par une fraîcheur d’expression qui les rendent aimables, même pour les Européens les moins initiés aux rouages si originaux de la civilisation de l’extrême Orient. Il en est enfin un certain nombre qui sont fort obscures et à peu près inintelligibles pour les lettrés du pays. Jusqu’à présent, il n’existe aucune version complète du Man-yô siû dans une langue étrangère: quelques pièces ont été traduites en allemand[182]; j’en ai publié d’autres en français, avec le texte original et un commentaire[183].
Le Ko zi ki, ou Annales des choses de l’antiquité, peut être considéré comme le plus ancien livre d’histoire japonaise qui soit parvenu jusqu’à nous. Composé, ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire, en 712, par Yasu-maro, d’après les souvenirs d’une vieille dame de la cour qui l’avait appris dans sa jeunesse de la bouche du mikado Tem-bu, il est écrit, comme le Man-yô siù, en caractères chinois employés tantôt avec leur signification idéographique, tantôt avec une valeur purement phonétique. L’ouvrage commence par un exposé de la cosmogonie et par une histoire généalogique des kami ou dieux primitifs d’où est descendue la dynastie impériale des mikados. Le récit des règnes de cette dynastie commence avec Kam Yamato Iva-are-hiko, fondateur de la monarchie (660 ans avant notre ère), et se termine avec l’impératrice Toyo-mi-ke Kasiki-ya-bime (593 à 628 après notre ère).
La forme un peu confuse du Ko zi ki engagea Yasumaro à en entreprendre la révision, avec le concours de deux collaborateurs. L’ouvrage, refondu et complété par leurs soins, devint le Ni-hon Syo-ki, ou «Annales écrites du Nippon», dont l’authenticité est incontestable, et que l’on doit placer à la tête de tous les ouvrages historiques des Japonais[184]. Les deux premiers tomes sont consacrés aux dynasties divines (Ka-mi-no yo); les vingt-huit derniers à l’histoire des mikados, depuis Kam Yamato Iva are hiko-no sumera mikoto (660 ans avant notre ère) jusqu’à l’impératrice Taka ama-no hara-hiro-no bime-no sumera mikoto (687 à 696 de notre ère). Il comprend, de la sorte, sept règnes de plus que n’en renferme le Ko zi ki.
Au point de vue du système graphique, le Ni-hon Syo-ki, tout en se rapprochant du Ko zi ki, est cependant plus conforme au style chinois; on y rencontre fréquemment les marques de transpositions de signes que les Japonais ont l’habitude d’employer lorsqu’ils écrivent suivant les lois de la syntaxe chinoise. On serait néanmoins dans l’erreur, si l’on croyait que des textes de ce genre peuvent être compris sans une connaissance approfondie des deux langues; le livre d’ailleurs doit être lu de façon à fournir une succession de phrases purement japonaises.
Le meilleur ordre de classification qu’on puisse choisir pour la bibliographie japonaise me paraît devoir être, à peu de chose près, celui qui a été adopté par Landresse pour la bibliographie chinoise. Cet ordre est emprunté, en partie du moins, au grand Catalogue de la Bibliothèque impériale de Péking, intitulé Kin-ting Sse-kou-tsuen-chou soung-mouh: je m’y conformerai dans les indications que je vais vous fournir.
Livres sacrés et religieux.—Les Ou-king ou Livres canoniques de la Chine, les Sse-chou ou Livres de philosophie morale et politique de Confucius et de son École, ont été l’objet de nombreuses éditions japonaises, accompagnées pour la plupart de commentaires. Les unes se composent du texte original chinois, auquel on a joint seulement les signes de transposition phraséologique destinés à faciliter leur traduction et les désinences grammaticales qui permettent, au premier coup d’œil, de déterminer la catégorie des mots; les autres présentent le texte accompagné d’une traduction complète et juxta-linéaire[185].
Pendant longtemps les sinologues ont fait valoir l’importance qu’avaient, pour l’étude de ces livres, les traductions qui existent en langue mandchoue; et c’est en vue du secours qu’ils y pouvaient trouver qu’ils se sont livrés à l’étude de la langue, d’ailleurs dépourvue de littérature originale, des derniers conquérants de la Chine. Aujourd’hui que la connaissance du japonais commence à se répandre parmi les orientalistes, on ne peut plus tarder à demander à cette langue l’aide philologique qu’on tirait naguère de la connaissance du mandchou: les traductions japonaises des ouvrages chinois sont en général plus commodes que les traductions tartares; et, grâce au système des transpositions syntactiques, elles offrent presque toujours un mot à mot interlinéaire de nature à faire comprendre plus vite le sens des signes idéographiques que les versions relativement libres qu’on rencontre dans les éditions mandchoues.
La plupart des anciens livres classiques que les Chinois placent d’ordinaire à la suite des King et des Sse-chou ont été également réimprimés et traduits par les Japonais. On possède de la sorte, dans la langue du Nippon, le Hiao-king ou Livre sacré de la Piété filiale;[186] le Siao-hioh ou la Petite Etude, dont il a été fait divers genres d’imitations; le Tsien-tsze-wen ou Livre des Mille mots[187], etc.
Il existe beaucoup d’écrits japonais sur leur religion nationale, appelée sin-tau «culte des Génies». Tous prennent pour point de départ les données mythologiques consignées dans l’antique Ko zi ki, dont je vous ai entretenus tout à l’heure.
Nous ne connaissons encore que fort peu la littérature bouddhique du Japon[188].
J’ai donné cependant la traduction d’une œuvre du représentant le plus populaire de cette doctrine Kô-bau dai-si, ainsi que celle d’un traité d’éducation morale répandu dans toutes les écoles et composé sous l’inspiration de la doctrine des bonzes[189]. Quant aux éditions des grands ouvrages chinois relatifs à la doctrine de Çâkya-Mouni, si j’en juge par celles du Lotus de la Bonne Loi dont j’ai pu me procurer des exemplaires, elles ne prêteront très probablement aucun secours nouveau pour l’étude de la grande religion de l’Inde. A voir les colonnes du texte chinois accompagnées de colonnes interlinéaires en caractères hira-kana ou kata-kana, on pourrait croire tout d’abord à la présence d’une traduction en langue japonaise. Un examen quelque peu attentif prouve qu’il n’en est rien: ces éditions ne donnent, en plus du texte chinois, que la seule notation phonétique des signes, de façon à rendre possible leur prononciation aux prêtres et aux dévots qui ne sont pas en état de lire les caractères idéographiques. Mais comme cette prononciation, par suite des innombrables homophones de l’idiome du Céleste-Empire, ne rappelle, le plus souvent, aucune idée à l’esprit, il en résulte ce fait singulier, mais incontestable, à savoir que les bonzes, en lisant à haute voix les livres bouddhiques, n’attachent guère plus de sens aux sons qui sortent de leur bouche que le peuple qui les écoute de confiance et ne comprend rien de ce qu’ils disent: Verba et voces[190].
Quelques fragments de la Bible et du Nouveau Testament ont été traduits et publiés en japonais. Le plus ancien ouvrage de ce genre que je connaisse est une version de l’Évangile de saint Jean, attribuée au missionnaire Gützlaff et imprimée en caractères kata-kana[191]. Cette version est aussi défectueuse que possible.
Philosophie et Morale.—Les Japonais ne se sont pas contentés de réimprimer, avec des annotations grammaticales, les livres canoniques et classiques des Chinois. Ils ont encore publié de savantes éditions de leurs principaux philosophes des différents siècles. C’est ainsi que je possède les œuvres de Meh-tih (Ve siècle avant notre ère), chef de l’École de la fraternité universelle; de Tchouang-tsze (IVe siècle avant notre ère), célèbre philosophe de la doctrine taosseiste; de Han-feï (IIIe siècle avant notre ère), le remarquable et infortuné jurisconsulte de la cour de Han, et la victime des débauches calomniatrices de la maison de Tsinchi Hoangti, etc.
A côté des ouvrages de philosophie proprement dite, il faut placer un grand nombre de traités populaires de morale qui ont vu le jour dans les îles de l’extrême Orient. Ces livres se composent, pour la plupart, d’aphorismes et de préceptes accompagnés d’anecdotes destinées à les faire comprendre plus aisément aux classes populaires, pour l’éducation desquelles ils ont été composés. Un curieux spécimen d’un ouvrage de ce genre, le Kiu-ô dau-wa, a été publié en français par M. le comte de Montblanc[192].
Jurisprudence et administration.—Nous ne possédons, jusqu’à présent, que de rares données sur la législation des Japonais, antérieurement à la dernière révolution de 1868. Les seuls livres de cette classe dont j’aie pu prendre connaissance, ne sont que des règlements administratifs dans lesquels on ne peut découvrir facilement les éléments du droit politique, tel qu’on le comprenait au Nippon avant l’invasion des idées européennes. On m’a assuré que le testament politique attribué au fameux syaugoun Iye-yasu, et communément appelé «les Cent Lois de Gon-gen Sama», avait été publié au Japon avec une traduction européenne. Je ne connais pas, même de titre, ce travail, qui doit offrir un grand intérêt pour l’étude des rouages compliqués du gouvernement déchu des autocrates de Yédo[193].
Quelques résumés chronologiques nous fournissent, année par année, un aperçu des événements de l’histoire du Japon et de l’histoire d’Europe. La partie japonaise d’un de ces traités a été traduite en allemand[194]. En ce genre, le meilleur ouvrage que je possède est le Sin-sen Nen-hyau de Mitu-kuri;[195] il est précédé des arbres généalogiques des souverains du Nippon et de la Chine, d’une table des nen-gau ou noms d’années japonaises, etc. Les événements y sont mentionnés de façon à présenter, sur trois colonnes, le tableau synoptique des annales du Japon, de la Chine et des pays étrangers à ces deux empires de l’Asie orientale.
Je vous ai fait connaître tout à l’heure les ouvrages qui devaient être considérés comme les sources authentiques de l’ancienne histoire du Japon. En dehors de ces ouvrages, d’une importance capitale pour l’orientalisme, on a publié au Japon une foule de livres d’histoire dont il me paraît utile de citer au moins les principaux.
Le Dai Nihon si, un des plus étendus, car il ne comprend pas moins de deux cent quarante-trois livres rédigés en chinois, a été publié, pour la première fois, la cinquième année de l’ère Sei-toku (1715). Ces savantes annales, plus complètes à bien des égards que tous les autres ouvrages du même genre qui sont parvenus jusqu’à nous, ont été composées avec la pensée de rappeler au peuple que, bien que les rênes du gouvernement soient tombées dans les mains du syaugoun de Yédo, le véritable empereur du Japon n’en était pas moins le mikado relégué dans une luxueuse captivité à Myako.
Le Nippon Sei ki, ou «Annales du gouvernement du Japon», a été publié en chinois avec des annotations grammaticales japonaises. On y trouve l’histoire des mikados, depuis l’origine de la monarchie jusque et y compris le règne de Yô-zei II (1587-1611).
Le Koku-si ryaku, ou «Abrégé des historiens du Japon», a été composé en chinois et publié en 1827 par Iva-gaki. Nous en possédons des éditions accompagnées de notes grammaticales japonaises et de commentaires. Comme l’ouvrage précédent, il ne va pas au delà du règne de Yo-zei II (1587-1611). C’est d’ailleurs un livre médiocrement estimé des savants japonais[196], auquel on préfère souvent une autre histoire de la même période, intitulée Wan-tyau si-ryaku «Abrégé des historiens de la Cour impériale», en dix-sept volumes, dont cinq de supplément.
Les auteurs que je viens de citer ont tous composé leur livre en chinois. Il en est d’autres qui, avec de moindres prétentions littéraires, ont préféré adopter, pour écrire, la langue nationale de leur pays. De ce nombre est le moine Syun-zai Rin-zyo, auquel on doit un livre intitulé Nippon wau-dai iti-ran, «Coup d’œil sur les règnes des empereurs du Japon», dans lequel on trouve l’histoire des mikados depuis l’origine jusqu’à la fin du règne de Yô-zei II (1611), où s’arrêtent également les auteurs dont j’ai parlé précédemment. Ce livre, publié pour la première fois en 1652, est d’une lecture aride, et les indigènes en font assez peu de cas. En revanche, c’est l’ouvrage historique le plus connu des Européens et le seul dont on possède une traduction complète, écrite à la fin du siècle dernier par Titsingh, sous la dictée des interprètes du comptoir hollandais de De-sima[197]. Un autre ouvrage, également en langue japonaise et d’une lecture bien plus agréable que le précédent, porte le titre de Koku si ran-yô: il a été publié la septième année de l’ère actuelle de Mei-di, c’est-à-dire en 1874, et se compose de seize livres. On y trouve les annales des empereurs du Japon, depuis les dynasties préhistoriques jusque et y compris les premières années du règne du mikado actuel, Mutu-hito (1869).
Après les ouvrages précédents qui traitent de l’histoire générale du Japon, depuis l’origine de la monarchie, je dois citer le Ni-hon Gwai-si ou «Histoire non officielle du Japon», qui nous raconte les événements qui se sont passés pendant les guerres des Mina-moto et des Taira, et sous le gouvernement des syaugouns, depuis son origine jusqu’au milieu du XVIIe siècle, époque où régnait la dernière maison syaugounale des Toku-gawa. Ces annales, rédigées par Rai-san-yau, sont très estimées des Japonais, tout au moins au point de vue du style. Deux traductions françaises en ont été entreprises dans ces derniers temps[198]; mais le début seul a été publié jusqu’à ce jour.
A côté des ouvrages rigoureusement historiques que je viens citer, il faut placer toute une série de livres très populaires au Japon, et qui participent les uns et les autres, bien que dans des proportions diverses, de l’histoire et du roman.
Parmi ces livres, il en est un que les indigènes placent à juste titre parmi les chefs-d’œuvre de leur littérature: c’est le Tai-hei ki «Histoire de la Grande Paix[199]». On pourrait se méprendre étrangement sur la nature de cet écrit, si l’on s’en rapportait à la traduction pure et simple de son titre. C’est, en effet, l’histoire des guerres longues et violentes que se firent au moyen âge les deux célèbres familles de Gen-zi et de Hei-ke, et qui aboutirent à l’anéantissement de la dernière, à l’époque de Yoritomo, élu généralissime de l’empire (tai-svau-gun) en 1186 de notre ère, sous le règne nominal du mikado To-ba II.
Un roman historique, très goûté du public japonais, et que les anciens missionnaires espagnols et portugais classaient, comme le précédent, au nombre des chefs-d’œuvre de la littérature au Nippon, est le Hei-ke mono-gatari, ou «Récits sur la maison de Taïra».[200] L’auteur, Yuki-naga, prince de Sinano, composa son livre dans un couvent où il s’était retiré après l’extinction de cette maison (1186); il a été l’objet d’une foule d’éditions successives.
Plusieurs autres compositions du même genre sont également en faveur chez les Japonais; je me bornerai à citer l’Ise mono-gatari, ou «Récits sur le pays d’Isé», célèbre par le temple sintauïste de la grande déesse solaire Ten-syau dai-zin, et qui est devenu un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés du Japon; le Oho-saka mono-gatari ou «Récits sur la ville d’Ohosaka», l’un des principaux ports de la grands île du Nippon; le Gen-zi mono-gatari ou «Récits sur la maison des Minamoto», l’heureuse rivale de celle de Taïra, au XIIe siècle de notre ère.
Géographie.—Les Japonais n’ont peut-être obtenu, dans aucune autre branche de la littérature, une perfection égale à celle qu’ils ont atteinte dans leurs ouvrages consacrés à la géographie. C’est à peine si l’on peut dire que les grandes publications des Malte-Brun, des Ritter, des Elisée Reclus peuvent être comparées aux productions analogues de l’érudition japonaise. En dehors des innombrables monographies sur lesquelles je ne saurais m’arrêter ici, ils ont composé sous le titre de Mei syo du-ye, de véritables descriptions encyclopédiques de chacune de leurs provinces. Ces descriptions, conçues en général sur le même plan, nous font connaître de la façon la plus minutieuse les particularités intéressantes de leur archipel: orographie, hydrographie, viabilité, histoire naturelle, archéologie, légendes et traditions locales, biographie des hommes célèbres, monuments de l’art, industrie, commerce, que sais-je? Rien n’a été oublié. On n’a fait jusqu’à présent que de rares emprunts à ces excellents ouvrages: ils méritent à tous égards l’attention des japonistes.
J’ai eu l’occasion de citer ailleurs, avec les éloges qu’ils méritent, les guides des voyageurs et les routiers, genres d’écrits qui n’ont guère obtenu une certaine perfection en Europe que depuis quelques années. Ces publications sont entreprises au Japon essentiellement dans un but d’instruction populaire. «Partant du principe que les leçons de géographie doivent être au début des leçons de topographie; qu’avant de se préoccuper des cinq parties du monde, il faut bien connaître son village et ses environs, les Japonais ont publié de petits atlas routiers dont les cartes se déroulent au fur et à mesure qu’on avance sur un chemin donné, et font connaître toutes les particularités intéressantes des stations qu’on est appelé à rencontrer. Une route vient-elle à se bifurquer, le petit atlas portatif indique, par un double tracé de lignes parallèles, les deux routes nouvelles qui se présentent au touriste; et, par de courtes notes, il enseigne la direction, l’aboutissement des deux routes. Notions succinctes sur les curiosités de tout genre que le voyageur est invité à visiter sur son passage, renseignements précis sur les auberges où l’on peut prendre un repas ou passer la nuit, rien n’y manque. L’atlas est aussi intelligible pour l’enfant que pour l’homme adulte; il éveille une curiosité féconde en enseignements; il crée des géographes dont les érudits peuvent sourire, mais des praticiens d’un genre fort utile en somme, et qui nous a trop souvent manqué en France pour que nous ayons le droit de nous en moquer[201].»
La géographie des pays étrangers à leur archipel a toujours vivement intéressé les Japonais; aussi, depuis l’ouverture de leurs ports au commerce étranger, ont-ils fait paraître une foule de descriptions des principaux états de l’Europe et de l’Amérique. Ces ouvrages sont une preuve de l’activité curieuse qui caractérise à un si haut degré les insulaires de l’extrême Orient; mais ils n’ont pas pour nous l’intérêt que présentent leurs anciennes narrations de voyages dans les contrées voisines du Nippon, et sur lesquelles ils ont recueilli, depuis bien des siècles, des renseignements qu’on chercherait vainement ailleurs. Je veux parler des régions qu’ils désignent communément sous le nom de San-koku «les trois contrées», et qui comprennent les terres Aïno (Yézo, Karafto et le Kouriles), l’archipel Loutchouan et la Corée.
Titsingh s’est fait traduire par les interprètes japonais de Désima un volume relatif à ces trois contrées[202]; mais ce volume est loin d’être le meilleur qui ait été écrit sur la matière. Nous possédons déjà en Europe de nombreuses narrations des îles habitées par les Aïnos velus[203], des documents historiques et descriptifs sur la Corée, composés à la suite des guerres du Japon contre cette péninsule[204], et quelques monographies détaillées des îles Loutchou[205].
Histoire naturelle.—Les Japonais ont de tout temps cultivé avec ardeur les sciences naturelles. Ils possèdent de nombreux ouvrages disposés suivant le système antique du Pen-tsao chinois[206], et, depuis quelques années, des traités composés d’après les méthodes européennes. Leur pays, qu’on a appelé le «paradis terrestre des botanistes», était essentiellement propre à les encourager à l’étude des plantes; aussi les travaux de phytologie sont-ils de beaucoup les plus nombreux dans leur littérature scientifique. Jusqu’à présent, on n’a publié en langue européenne que des fragments d’ouvrages botaniques japonais[207]; mais d’importants travaux de synonymie ont été accomplis, de façon à faciliter les traductions que les orientalistes pourront entreprendre à l’avenir.
La médecine est également représentée au Japon par un ensemble d’écrits que l’on peut répartir en deux classes: ceux qui ont été composés d’après la méthode indigène ou chinoise, et ceux qui ont été inspirés par les principes de la science européenne.
L’agriculture, si développée chez les Japonais, a donné lieu à d’importantes publications qu’il ne sera certainement pas sans utilité pour nous de voir traduire dans une langue européenne. Parmi ces publications, je me bornerai à citer l’encyclopédie agricole intitulée Nô-geo zen syo, en onze volumes in-4º, dont j’ai publié en français l’index détaillé des matières[208].
Philologie.—La philologie est représentée d’une façon non moins remarquable dans le cadre de la littérature japonaise.
Le Syo gen-zi kau est un riche dictionnaire fournissant, pour 42,000 mots environ de la langue japonaise, les expressions correspondantes dans l’écriture idéographique de la Chine. Il a été réimprimé en Europe par la lithographie[209], et un précieux index en a été composé récemment à Florence.[210] Plusieurs autres collections de locutions littéraires, pour la plupart fort riches, ont également vu le jour au Japon. Il serait trop long de les énumérer ici; mais je ne puis me dispenser de citer un trésor de la langue japonaise, intitulé Wa-kun siwori, composé de cinquante-neuf tomes (le dernier est daté de 1862), et qui doit être complété par un nouveau supplément dont la publication m’est encore inconnue. Enfin, on annonce un vaste répertoire de la langue japonaise intitulé Go-i, dont les quatre premiers volumes ont paru récemment, et qui, s’il est jamais terminé sur le plan adopté pour le début, donnera, suivant un calcul approximatif de M. Pfizmaier[211], l’explication d’au moins 290,000 mots, en plus de 200 volumes. On pourrait ajouter aux travaux philologiques de ce genre une liste étendue d’ouvrages destinés à faciliter aux indigènes l’acquisition des langues aïno, chinoise, coréenne et sanscrite[212], ainsi qu’une foule de livres pour l’enseignement des principales langues européennes[213].
Poésies et Romans.—Les œuvres d’imagination sont tellement nombreuses dans la littérature japonaise, que je ne saurais même essayer de citer celles qui méritent d’attirer particulièrement l’attention des orientalistes. J’ai publié une liste de 160 recueils de poésie, qui ne comprend que ceux qui étaient alors parvenus en Europe, et dont le nombre est à peu près doublé aujourd’hui. Les genres les plus divers y sont représentés; et, dans quelques-uns du moins, on ne peut nier que les Japonais n’aient donné des produits dignes d’attention. Jusqu’à présent, un très petit nombre de ces poésies, sans doute en raison des grandes difficultés qui s’attachent à leur interprétation, a seulement vu le jour dans des traductions européennes[214]. Une seule collection de uta ou distiques de trente et une syllabes, le Hyaku-nin is-syu «Pièces de vers des Cent poètes», a été publiée et traduite in extenso[215].
Quelques-uns des innombrables romans, contes et nouvelles qui nous sont venus du Japon, ont déjà trouvé des traducteurs européens; mais il s’en faut de beaucoup que tous les genres remarquables soient représentés par ces premiers essais des japonistes. Nous ne possédons encore qu’une seule des œuvres du célèbre romancier de Yédo, Riu-tei Tane-hiko[216], dont M. Pfizmaier a eu l’honneur de tenter la traduction à une époque où bien peu d’orientalistes auraient osé aborder les difficultés réputées inextricables de la langue japonaise.
Les autres œuvres d’imagination qui ont été livrées jusqu’à présent au public dans une langue européenne[217] sont intéressantes à plus d’un titre; mais elles ne jouissent pas au Japon de la faveur qui doit guider le choix des savants capables d’entreprendre de tels travaux de traduction. J’ai cité ailleurs,[218] comme une singularité de la littérature japonaise, les contes sans fin que continuent d’année en année, d’âge en âge, plusieurs générations de romanciers.
Archéologie.—L’étude de l’archéologie, et en particulier de la paléographie et de la numismatique du Japon, sera considérablement facilitée par les grands travaux d’érudition publiés dans ce pays. On pourrait dresser aisément, dès aujourd’hui, un Corpus inscriptionum japonicarum, et traduire la plupart des documents en tirant profit des travaux de déchiffrement accomplis par les archéologues indigènes. Quant à la numismatique, on trouvera toutes les pièces classées, datées et expliquées dans des traités qui ne demanderont plus que des traducteurs pour être accueillis du public européen[219].
Encyclopédies.—La section de la bibliographie réservée aux ouvrages embrassant à la fois toutes les branches des connaissances humaines, est représentée au Japon par une riche série de recueils populaires qui paraissent surtout composés à l’usage des écoles. Nous ne connaissons en effet, jusqu’à présent, qu’un seul ouvrage qui, par son étendue et la variété des matières qu’il renferme, puisse être comparé à nos encyclopédies européennes. Je veux parler du Wa-kan San-sai du-ye, ouvrage en 105 tomes, connu depuis longtemps des orientalistes sous le nom de «Grande Encyclopédie japonaise», et auquel les sinologues et les japonistes ont déjà fait de fréquents emprunts[220]. Il est probable qu’il ne tardera pas à paraître au Japon quelque encyclopédie nouvelle et plus complète; mais une publication de ce genre n’intéressera peut-être pas autant les japonistes qui tiennent à connaître les idées que professaient les indigènes sur toutes choses, avant que ceux-ci se soient décidés à renier leur passé et à s’assimiler les connaissances acquises en Europe et en Amérique. Il est donc très probable que, pour longtemps encore, le Wa-kan San-sai du-ye restera un livre d’une valeur exceptionnelle pour les personnes adonnées à la culture des sciences et des lettres japonaises.
L’énumération qui précède est déjà fort longue, et je n’ai pas la prétention d’avoir même esquissé le sujet que j’avais à traiter[221]. A chaque pas, j’ai dû me condamner à abréger ce que j’avais à dire. Le peu que j’ai rapporté suffira peut être pour faire comprendre combien il serait intéressant de donner aujourd’hui un aperçu développé de la littérature si riche et si variée des insulaires de l’extrême Orient.


 VANT l’arrivée des premiers navigateurs portugais[222], les sciences
n’étaient guère plus avancées chez les Japonais que chez les Chinois.
L’esprit observateur des insulaires de l’extrême Orient leur avait bien
enseigné un certain nombre de faits inconnus à leurs voisins du
continent asiatique; mais aux uns et aux autres, il avait toujours
manqué la véritable méthode scientifique, sans laquelle il était
impossible de franchir le cercle étroit où s’étaient emprisonnés, depuis
des siècles, tous les savants du continent asiatique.
VANT l’arrivée des premiers navigateurs portugais[222], les sciences
n’étaient guère plus avancées chez les Japonais que chez les Chinois.
L’esprit observateur des insulaires de l’extrême Orient leur avait bien
enseigné un certain nombre de faits inconnus à leurs voisins du
continent asiatique; mais aux uns et aux autres, il avait toujours
manqué la véritable méthode scientifique, sans laquelle il était
impossible de franchir le cercle étroit où s’étaient emprisonnés, depuis
des siècles, tous les savants du continent asiatique.
Les pères de la Compagnie de Jésus, établis au Japon dès la seconde moitié du xvie siècle, commencèrent à y enseigner les premiers éléments des sciences européennes. Il ne paraît pas, cependant, qu’ils aient déployé beaucoup d’activité dans leur enseignement, car, à l’arrivée des Hollandais à Hirato (1609), les indigènes étaient encore dans une ignorance à peu près absolue des progrès réalisés parmi nous. On doit, il est vrai, à ces missionnaires de l’Evangile la fondation d’une imprimerie japonaise et européenne dans leur collège d’Ama-kusa; mais cette imprimerie n’a produit, autant que je sache, que des ouvrages de la plus médiocre utilité.
En fait de mathématiques, les Japonais ne connaissaient guère rien de plus que les Chinois, c’est-à-dire quelques idées élémentaires de géométrie, d’algèbre et de trigonométrie sphérique, empruntées d’ailleurs aux Arabes et aux Persans.[223] Plusieurs lettrés du Nippon m’ont affirmé cependant qu’ils possédaient, dès cette époque, des connaissances approfondies en géométrie et en algèbre; mais, bien que cette affirmation ne soit peut-être pas absolument dénuée de fondement, ils n’ont pu me fournir aucune preuve satisfaisante de leurs affirmations. Les mathématiques en tout cas étaient restées dans l’enfance; l’astronomie n’avait guère pu avancer davantage.
En fait de sciences naturelles, les Japonais n’avaient point dépassé le mode descriptif de l’antique Pen-tsao chinois; leurs classifications, comme leurs notices descriptives, ne reposaient que sur les particularités extérieures les plus apparentes; ce qui revient à dire qu’ils ne savaient que fort peu de choses en fait d’anatomie, et moins encore en fait de physiologie animale et végétale, ou en fait d’analyse chimique.
De longues et patientes observations, le hasard plus souvent sans doute, leur avaient bien fait connaître quelques propriétés des plantes et des corps inorganiques. Mais ce qu’ils avaient appris de la sorte, ils le savaient mal, ou du moins d’une façon trop peu scientifique, pour qu’il leur fût possible d’en tirer un parti satisfaisant.
La médecine qu’ils pratiquaient au temps de Kæmpfer (1690), en était encore, au dire du célèbre voyageur, à l’état le plus rudimentaire. Peu de médicaments,—là n’était pas le plus mauvais côté de leur doctrine médicale,—des bains et l’emploi de deux remèdes externes, le moxa et l’acupuncture: à cela se réduisait toute leur pathologie. Dans certains cas particuliers, l’acupuncture et le moxa[224] ont réalisé, dit-on, des cures remarquables; mais il ne faut guère douter que, bien souvent, il n’y avait là qu’un moyen d’achever rapidement le malade.
Les Hollandais contribuèrent tout d’abord à introduire au Japon les sciences médicales européennes, et on leur doit la fondation à Nagasaki d’une première École de Médecine. Cette école, disait un journal de l’époque[225], compte trente-deux élèves qui doivent tous posséder la langue néerlandaise, et qui étudient avec ardeur, sous la direction d’un premier officier de santé impérial nommé Matsoumoto Ryauzin. De la sorte, les principes de la thérapeutique occidentale ont commencé à se répandre parmi les insulaires. La vaccine ne trouva bientôt plus d’opposition du côté du peuple et les inoculations se sont accomplies par milliers. A Sango, ville principale du pays de Tosen, un hôpital pour cent cinquante malades, a été construit d’après les plans du docteur Pompe.
Un obstacle sérieux au progrès de la médecine au Japon tenait aux idées religieuses des insulaires qui s’opposaient à l’ouverture des corps inanimés. Les élèves de l’école de Nagasaki, ayant compris combien l’impossibilité de se livrer à des dissections retardait leurs études, ont amené le gouverneur de la ville à enfreindre en leur faveur les coutumes du pays, et à leur livrer le corps d’un criminel mis à mort pour procéder à son autopsie. Vingt et un jeunes gens assistèrent à cette scène, ainsi que vingt-quatre médecins japonais qui purent se convaincre de la haute importance de ces opérations.
Depuis la dernière révolution, la médecine a fait au Japon les plus remarquables progrès, et aujourd’hui, non seulement l’enseignement médical y est donné par des professeurs savants et expérimentés, mais il existe même des journaux spéciaux qui relatent toutes les observations faites dans les hôpitaux et dans les laboratoires.
S’il est vrai qu’au Japon les sciences n’aient jamais atteint une zone quelque peu élevée de développement avant l’introduction des livres et de l’enseignement européens, on ne saurait en dire autant des arts industriels, qui, pour la plupart, n’ont fait que décroître, depuis l’ouverture des marchés japonais aux négociants de l’Europe et de l’Amérique. Certaines branches de l’industrie avaient réalisé, depuis longtemps, les plus remarquables progrès au Japon. Il n’est pas sans utilité d’en dire quelques mots.
La porcelaine a été de tout temps un des plus fameux produits de l’industrie japonaise. Cette composition céramique que Brogniart définit «une poterie dure, compacte, imperméable, dont la cassure, quoique un peu grenue, présente aussi, mais faiblement, le luisant du verre, et qui est essentiellement translucide, quelque faible que soit cette translucidité,» a été, comme l’on sait, importée des contrées de l’extrême Orient en Europe, où on n’est parvenu à obtenir un article similaire qu’en 1709.
Jusqu’à cette époque, les produits céramiques de la Chine et du Japon ont eu le privilège de l’emporter sur les plus belles poteries émaillées de l’Italie et de Nevers. La fortune des porcelaines venues d’Orient dépassa longtemps tout ce qu’on pouvait imaginer, et la poésie et les légendes merveilleuses vinrent leur prêter leur concours.
Inventée en Chine, sous la dynastie des Han (202 ans avant notre ère), la porcelaine commença à être fabriquée dans le pays de Sin-ping. Transportée bientôt en Corée, elle passa de ce royaume dans l’archipel Japonais, où elle ne cessa plus d’être cultivée jusqu’à nos jours. On rapporte, en effet, qu’un prince de Sinra amena dans l’île de Nippon une corporation de potiers qui s’y établit, et dota le pays du nouveau produit céramique des Chinois.
Ce ne fut, toutefois, que vers l’année 1211 qu’un fabricant japonais nommé Katosiro Uyemon, apporta de Chine les secrets de l’art qu’il cultivait avec un succès exceptionnel, et enrichit sa patrie de porcelaines qui furent, dès l’origine, très estimées.
Depuis cette époque, les progrès de la fabrication de la porcelaine ne se ralentirent plus; et, au commencement de notre siècle, les produits de la province de Hi-zen surpassaient en perfection, aux yeux des amateurs, les plus beaux produits de Kin-teh-tchin et des autres manufactures chinoises.
Ce que nous savons de cet art en Chine et au Japon suffit, en effet, pour nous démontrer que les procédés employés, dans ce dernier pays, sont les plus ingénieux et les plus perfectionnés. Cette opinion a d’ailleurs été soutenue par M. Alphonse Salvétat, chimiste, dont l’autorité en fait de céramique est généralement reconnue, et qui, par les nombreuses opérations qu’il a dirigées à la manufacture de Sèvres, a dû acquérir une grande expérience. Or voici ce que dit M. Salvétat: «Il peut paraître surprenant que les Chinois, si ingénieux dans mille autre circonstances, aient laissé passer inaperçu tout le parti qu’on peut tirer de la porosité du dégourdi de la porcelaine. Cette porosité offre, comme on sait, le moyen de recouvrir de sa glaçure, également et promptement, c’est-à-dire économiquement, toute poterie à pâte absorbante, quel que soit le fini de la forme, quelle que soit la nature de la glaçure. On a d’autant plus lieu d’être surpris de l’ignorance dans laquelle ils demeurent, que les fabricants japonais pratiquent la mise en couverte économique et rapide au moyen de l’immersion.»
La porcelaine est surtout fabriquée avec perfection dans l’île de Kiousiou, notamment dans la province de Hizen, ainsi que nous l’avons dit. Les principales manufactures sont situées, dans l’arrondissement de Matsoura, près du beau hameau de Ourésino, où la matière première se rencontre en abondance.
Le laque est également un produit des plus remarquables de l’industrie japonaise. On sait que cette composition, extraite de la sève du rhus vernicifera, sert à endurcir les objets de bois ou de métal, et à leur donner un brillant qui s’allie de la façon la plus avantageuse avec l’or, l’argent et la nacre. L’emploi de cette substance dans l’ébénisterie et la tabletterie, paraît dater, au Japon, d’une époque des plus reculées. On cite des boîtes de laque, conservées de nos jours à Nara, dans la province de Yamato, et qui remonteraient au IIIe siècle de notre ère; et la célèbre poétesse Mura-saki Siki-bu (Ve siècle), dans ses ouvrages, nous parle de laques incrustées de nacre qui étaient en grande faveur à son époque.
Il faut citer aussi la laque aventurine avec laquelle on fabrique des objets saupoudrés d’or d’une grâce et d’une délicatesse remarquables.
La fabrication des tissus de soie est fort ancienne au Japon: quelques données historiques tendraient même à faire croire qu’elle y était déjà pratiquée antérieurement à notre ère. Toujours est-il que nous trouvons la mention de ces précieux tissus dès une haute antiquité. Le sol du Nippon est d’ailleurs très favorable à la culture des mûriers, et nulle part l’éducation des vers à soie n’y a mieux résisté aux maladies qui, à notre époque surtout, menacent d’anéantir cette grande branche de l’industrie dans une foule de contrées où, naguère encore, elle était florissante.
Le travail des soies a été l’objet de progrès considérables au Japon, avant l’établissement des Européens sur ses côtes[226]. Deux à trois mille balles de trente à trente-cinq kilogrammes envoyées à Londres, il y a vingt ans, à titre d’échantillons, ont surpris les filateurs anglais, non moins par la modicité de leur prix que par leur admirable beauté. La plupart de ces soies égalaient, ou même surpassaient en finesse, en force, et en parfaite régularité tout ce que la France et l’Italie ont produit de plus excellent en ce genre[227].
On possède des échantillons d’anciens tissus japonais dont la qualité et l’ornementation artistique sont dignes des plus grands éloges. On fabriquait également au Nippon, dès le commencement de ce siècle, des velours d’une qualité remarquable; mais on dit que les procédés de ce genre de fabrication avaient été communiqués aux indigènes par les Hollandais établis dans leur pays.
L’art de l’horlogerie ne paraît avoir été introduit au Japon d’une façon régulière qu’à une époque assez récente. Anciennement les insulaires employaient la clepsydre pour mesurer le temps. Il faisaient aussi usage de petits bâtonnets à encens, dont la combustion lente et régulière indiquait les divisions du jour. On voit figurer, il est vrai, dans la grande Encyclopédie japonaise[228], dont la publication primitive remonte au commencement du XVIIIe siècle, une horloge à sonnerie désignée sous le nom de to-kei[229]; mais ce produit est de provenance hollandaise.
Aucun peuple n’a poussé plus loin que les Japonais la perfection de l’art de la menuiserie. Soit que cet art s’applique à la construction des bâtiments, soit qu’il se manifeste dans la fabrication de petits objets de tabletterie, il se traduit par des produits d’une délicatesse incomparable. Les simples caisses d’emballage sont assemblées avec un soin dont on ne trouve point d’exemple dans les autres pays. Les menuisiers japonais ne font pas usage de clous, mais de petites chevilles de bois d’une propreté et d’une justesse étonnantes. Parmi les essences dont ils se servent, il faut citer le camphrier: les caisses faites avec cet arbre ont l’avantage de préserver les objets qu’elles renferment des attaques des insectes.
L’industrie des jouets d’enfant, si développée au Japon, produit une foule d’objets d’amusement qui font honneur à l’imagination des indigènes. Un certain nombre de ces objets ont été imités en Europe et ont fait la fortune de ceux qui les ont répandus parmi nous.
Je mentionnerai également en passant ces charmants petits objets d’ivoire qui sont l’ornement des vitrines de nos collectionneurs et sur lesquels on voit parfois incrustés de la façon la plus gracieuse des insectes aux mille couleurs.
Si je n’étais exposé à prolonger outre mesure cette conférence, il faudrait encore vous parler du bambou que les Japonais utilisent d’une foule de façons différentes au point de vue ornemental, alimentaire, industriel et médical. Un savant botaniste français qui a composé une monographie du bambou au Japon[230], dit avec raison que ce végétal est, pour les insulaires de l’extrême Orient, le plus grand de leurs trésors.
L’imprimerie, cultivée au Japon depuis plus de sept siècles, y a été l’objet de nombreux perfectionnements. A une époque très reculée, mais dont nous n’avons pu parvenir encore à découvrir la date précise, les moines japonais faisaient usage de planches de pierre dans lesquelles ils gravaient en creux les textes de leurs livres sacrés, afin d’en obtenir des copies multiples au moyen d’une encre appliquée sur les parties non creusées. Les épreuves, qui résultaient de ce mode d’impression, donnaient des lettres blanches sur un fond noir.
Suivant un autre procédé, on remplissait les parties creuses d’une composition résineuse, et on encrait les caractères ainsi formés à l’aide d’un tampon. Il resterait à savoir comment ils s’y prenaient pour ne pas noircir la pierre entière, car l’ignorance en chimie des anciens Japonais ne permet pas de supposer qu’ils aient alors connu la ressource de l’eau acidulée employée par nos lithographes.
Les planches de bois dont l’usage était universellement répandu dans le Nippon, n’y furent employées vraisemblablement qu’à une époque plus récente. On se sert pour les graver des mêmes procédés qu’à Canton. Le système de l’écriture japonaise, infiniment plus compliqué qu’aucun autre système connu, semblait repousser toute tentative de reproduction des textes en types mobiles.
Les ouvrages les plus ordinaires, comme les plus précieux, si l’on en excepte les livres de haute littérature écrits avec le concours de caractères chinois droits, sont reproduits dans une écriture tellement cursive qu’il est rare de rencontrer, dans deux auteurs différents, le même signe tracé d’une manière absolument semblable. Si l’on ajoute à cela que les lettres japonaises sont susceptibles de ligatures, comme par exemple les lettres arabes dans l’écriture persane appelée tahliq, on comprendra combien il est difficile de réduire à des éléments typographiques les groupes complexes et constamment enchevêtrés qui pullulent dans les impressions xylographiques.
Ces difficultés n’ont pas rebuté les Japonais; et, dès le XVIIe siècle, ils avaient fait quelques remarquables essais de reproduction de textes cursifs en caractères mobiles. L’impression en couleur avait fait de notables progrès chez les Japonais, qui se sont montrés, dans cet art, infiniment supérieurs aux autres populations asiatiques. Le nombre des nuances qu’ils ont employées au rouleau, et surtout la multiplicité des teintes, tout à la fois pures et variées à l’infini, dépassent la plupart des essais tentés jusqu’ici en Europe. Le relief qu’ils ont su donner, avec une remarquable originalité, à quelques-uns de leurs dessins, et l’emploi des métaux à l’aspect les plus divers, sont encore dignes de la sollicitude de nos imprimeurs européens.
La fabrication de l’encre, dite encre de Chine, est connue au Japon depuis plus de huit cents ans. On sait que, pendant longtemps, on a vainement essayé d’imiter cette encre en Europe. Suivant l’Encyclopédie japonaise, on se servait primitivement pour sa composition d’une sorte de terre noire; ce qui explique pourquoi, dans l’écriture idéographique usitée dans le pays, on a choisi, pour désigner l’encre, un caractère où les signes «noir» et «terre» se trouvent combinés. Plus tard on fit usage du noir de fumée, et on y ajouta des aromes.
L’éditeur japonais de l’ouvrage que je viens de citer ajoute:
«Tant anciennement qu’aujourd’hui, l’encre provient de la capitale du Sud. Ceux qui la fabriquent avec le plus de succès, emploient du noir de fumée préparé à l’huile de lin pour la première qualité; ils y ajoutent du camphre et du musc. La qualité inférieure se prépare avec du noir de fumée de sapin.» L’encre dite de la Grande-Paix est fabriquée principalement à Ohosaka avec du noir de sapin; elle peut être employée pour l’impression.
Le papier japonais mérite également l’attention des fabricants européens, tant par la finesse de son grain, très favorable pour certaines impressions, notamment pour les épreuves de gravures en taille-douce, que par sa prodigieuse solidité. Cette dernière qualité l’a rendu propre à la fabrication de cordage d’une force de résistance peu commune. Il a été employé, au Japon, pour une foule d’usages, notamment pour la confection de vêtements d’hommes, de robes de dames, de parapluies et de parasols, de tentes de voyage, etc., etc.
La bijouterie, sans constituer une branche de commerce bien considérable, n’est pas sans importance dans les grandes villes du Nippon. La taille des pierres dures ne paraît pas avoir été connue des insulaires avant l’arrivée des Européens; et, de nos jours encore, c’est à peine si elle est répandue dans le pays. On trouve cependant, dans les livres indigènes, la mention de gemmes employées comme ornements à des époques fort reculées; mais on n’a pas encore étudié suffisamment l’histoire de l’ancienne bijouterie japonaise, pour pouvoir en parler avec quelque autorité.
Les objets d’or et d’argent ouvrés ne sont pas rares. Quelques-uns sont merveilleusement ornés. Les insulaires emploient aussi avec avantage une composition de divers métaux qu’ils nomment syaku-do, qui est susceptible de recevoir un beau poli et produit l’effet d’un émail.
Les perles fines[231] sont fort recherchées des dames. Elles forment un des ornements les plus appréciés de leurs épingles à cheveux ou de leurs boucles d’oreilles. C’est principalement sur les côtes d’Owari, d’Isé et de Satsouma, qu’on pêche l’huître qui renferme les perles fines. Dans le commerce, on en distingue deux espèces principales: les perles dites gemmes d’argent,[232] et les perles dites gemmes d’or[233]. Ces dernières surtout sont très prisées des amateurs, tant pour la pureté de leur eau que pour l’éclat de leurs reflets, d’un jaune légèrement rosé.
Enfin, il faut citer parmi les produits secondaires de l’industrie japonaise les miroirs[234], les éventails[235], les chapeaux de bambou[236], les parapluies et les parasols, etc.
Les Japonais sont parvenus d’eux-mêmes à de remarquables résultats, en ce qui touche la fonte des métaux. Aucun peuple ne les a surpassés dans la trempe de l’acier, et leurs lames les plus parfaites l’emportent sur les plus fameux produits de Solignen et de l’ancien Damas.
Tout le monde connaît les anciens bronzes japonais, si recherchés, aujourd’hui surtout, pour la décoration de nos appartements. On sait aussi qu’ils avaient inventé des procédés de patine que l’on est à peine arrivé à imiter en Europe d’une façon tout à fait satisfaisante.
Les Japonais se sont également distingués dans l’art de fabriquer les émaux, dont ils se servent soit pour revêtir des surfaces, soit pour imiter des pierres précieuses. Le plus souvent l’émail est employé sous la forme à laquelle on a donné le nom d’émail cloisonné. Les plus anciens émaux ne sont guère employés que pour servir de contour aux ornementations; il sont dessinés dans le goût chinois. Puis viennent les émaux à fonds bleus clair ou verts, avec des dessins plus savamment combinés représentant des fleurs, des oiseaux ou des quadrupèdes. La matière employée durant la période suivante est défectueuse, d’une grande porosité, et les tons sont mats et sans netteté. L’art de l’émailleur est en décadence au commencement de notre siècle. Enfin, une époque de renaissance coïncide avec l’ouverture des ports du Japon au commerce étranger. Au lieu de petits objets, tels que des grains de chapelets, des boutons, des gardes d’épées, on fabrique de larges plats, des vases de grande dimension, des objets de toutes sortes. Le fond est le plus souvent vert foncé. La qualité de la matière est supérieure, mais le dessin est devenu moins original, moins artistique.
Dans les temps modernes, les Japonais se sont adonnés à l’application des émaux cloisonnés sur porcelaine et sur poterie. Les cloisonnés sur cuivre sortent principalement de trois manufactures situées aux environs de Nagoya, dans la province d’Owari; les cloisonnés sur porcelaine se font surtout à Ohosaka et à Kyauto. Une fabrique a été établie, dans ces dernières années, à Yokohama et une autre à Tôkyau; cette dernière a été détruite dans un incendie.
Tel est, en résumé, le tableau succinct des sciences et de l’industrie japonaises avant l’arrivée des Européens.
Une révolution scientifique et industrielle ne devait cependant plus tarder longtemps à se manifester au Japon. Les relations des Hollandais avec les indigènes du Nippon étaient devenues plus intimes par suite du privilège commercial accordé exclusivement à la compagnie Batave.
Le gouvernement de Yédo conçut la pensée de créer un collège d’interprètes, où les Japonais pourraient étudier la langue des Barbares à Cheveux Rouges. Le projet fut réalisé en peu de temps de la façon la plus satisfaisante.
Dès lors, les principaux ouvrages scientifiques qu’on fit venir des Pays-Bas au Japon, furent traduits, commentés et publiés. C’est ainsi que parut, entre autres, une édition sinico-japonaise des Anatomische Tabellen du médecin silésien Adam Kulm, publié avec la reproduction des planches de l’édition originale, par le fils d’un interprète du gouvernement, le docteur Sugita Gen-paku. Ce livre, dont on possède quelques rares exemplaires en Europe, est d’une impression admirable et l’un des monuments les plus curieux des premières tentatives des Japonais pour s’initier à la connaissance de nos sciences et de nos arts.
Par la suite, le gouvernement de Yédo demanda à la factorerie hollandaise de Désima d’acquérir pour son compte divers instruments de mathématiques et de chirurgie, ainsi que quelques livres de nature à faire connaître plus en détail les progrès de la civilisation moderne.
Dans toutes les classes de la population, on vit alors se produire un grand mouvement motivé par un ardent désir d’apprendre et de savoir. Les personnages des classes les plus élevées voulurent être les premiers à être initiés aux grandes découvertes de la science occidentale. Quelques-uns d’entre eux devinrent, pour le milieu où ils vivaient, de véritables savants.
Le Prince de Satsouma, l’un des plus puissants vassaux de l’empire, s’adonna avec ardeur à l’étude de nos sciences exactes. Se trouvant un jour en présence d’officiers de la marine néerlandaise, il leur demanda ce qu’ils pourraient lui apprendre de nouveau au sujet de l’application de la photographie aux observations barométriques. Cette question déconcerta nos marins qui ne surent que répondre; car ils avaient oublié, ou peut-être même ignoraient, qu’à l’observatoire de Greenwich, on faisait usage d’appareils photographiques, pour constater d’une manière plus rigoureuse les variations du baromètre, du thermomètre et de l’hygromètre.
Ce ne fut toutefois qu’après la conclusion du traité avec les États-Unis d’Amérique (1853), traité auquel nous devons l’ouverture définitive des ports du Nippon, que les Japonais entrèrent de plain-pied dans les voies de la civilisation européenne.
Parmi les présents offerts au taïkoun par le président de l’Union, se trouvaient un télégraphe électrique et un petit chemin de fer, comprenant, outre la locomotive, le tender et ses accessoires, les rails et tout le matériel nécessaire pour établir une ligne modèle.
Il n’en fallut pas davantage pour exciter la curiosité enthousiaste des indigènes, et pour leur donner l’ardent désir de connaître les autres inventions d’un pays qui lui apportait en présent des objets aussi étonnants et aussi inattendus.
Le mouvement était donné. Les membres des ambassades envoyées par le syaugoun en Europe et en Amérique, revinrent dans leur pays, la tête exaltée par toutes les merveilles qu’on avait étalées à leurs regards.
Ils racontèrent de point en point ce qu’ils avaient vu, et en firent l’objet de publications populaires qui eurent pour la plupart un brillant succès d’actualité.
Le Japon n’eut dès lors qu’une pensée: celle d’imiter l’Europe et de cesser d’être Japonais, ou tout au moins asiatique. On demanda des officiers instructeurs pour l’armée, des ingénieurs, des mécaniciens, des médecins, des professeurs, des artisans de chaque spécialité; et, à leur arrivée, on se mit en devoir de tout bouleverser, de tout renverser, de raser l’édifice du passé, pour arriver plus vite à la reconstruction d’un édifice nouveau.
La pensée bien arrêtée du gouvernement japonais était de se donner tout d’abord les allures extérieures de la civilisation européenne. Le mikado, dont le père ne donnait audience aux grands de sa cour qu’à demi caché par un store derrière lequel il se tenait accroupi, a remplacé le vêtement ample et traînant de ses aïeux, par le costume étriqué d’un général européen. Sous ce costume, il n’hésite plus à se montrer aux étrangers et à ses sujets vêtus du frac noir et coiffés du chapeau en tuyau de poêle.
Les fonctionnaires de tout rang obtiennent des costumes analogues à ceux que portent leurs pareils dans les monarchies de l’Occident. La forme des édifices publics, l’ameublement des habitations, tout, en un mot, se transforme de jour en jour à l’avenant.
A peine les Japonais eurent-ils reçu le télégraphe modèle que le président des États-Unis avait envoyé en présent au syaugoun, qu’une première ligne fut établie et mit en communication régulière le palais d’été de ce prince et sa résidence à Yédo, sur une étendue d’environ six milles[237].
Des lignes plus importantes ne tardèrent pas à être organisées; et, de nos jours, le réseau télégraphique du Nippon tend à se développer avec une remarquable rapidité. Une ligne principale met déjà en communication Nagasaki et Yédo d’une part, et de l’autre Yédo avec le nord du Japon, dont elle franchit les limites terrestres pour gagner, par un câble sous-marin, Hako-dade, et atteindre de là jusqu’à Satuporo, la nouvelle capitale de l’île de Yézo. En même temps, des traités conclus avec de grandes compagnies européennes ont mis Yokohama en rapport direct avec l’Europe par deux voies différentes, celle de la Sibérie et celle de l’Inde.
Les Européens avaient des chemins de fer: il fallait que les Japonais en eussent aussi. Au mois de juin 1872, un premier tronçon, reliant Yédo à Yokohama, fut ouvert au public. Ce tronçon avait coûté un prix exorbitant, mais peu importe: on ne pouvait plus dire qu’il n’y avait pas de lignes ferrées au Japon. L’amour-propre national venait d’obtenir une première satisfaction. Un autre tronçon fut établi entre Kobé et Ohosaka. Les travaux qui doivent réunir cette dernière ville à Kyauto sont poussés avec une grande activité. Des lignes plus considérables sont à l’étude; de sorte que d’ici peu d’années, si cela continue, les Japonais auront des chemins de fer dans toutes les directions. Il ne leur manquera que des routes!
De nombreux bâtiments à vapeur, la plupart de petites dimensions, tendent à remplacer, chaque jour, les jonques au moyen desquelles se fait encore le cabotage sur toute l’étendue des côtes de l’empire.
La réorganisation militaire du Japon, entreprise sous la direction d’une mission d’officiers français, a été effectuée en quelques années de la façon la plus remarquable. Pourvue d’armes excellentes et fabriquées suivant les derniers perfectionnements de l’art, l’armée japonaise se trouve aujourd’hui dans des conditions incontestables de supériorité sur toutes les armées asiatiques; et il n’y a pas à douter que, même en présence des troupes européennes, elle ne présentât à ses ennemis une très sérieuse résistance. Reste à savoir seulement, si les généraux, peut-être un peu trop improvisés à la hâte, seraient en état de la diriger et de la soutenir dans des circonstances difficiles. D’ailleurs, elle attend avec une impatience facile à comprendre, mais difficile à modérer, l’occasion de donner des preuves de sa valeur et de sa discipline.
La marine a été, de son côté, l’objet de toutes les ambitions du gouvernement japonais; malheureusement, les ressources financières de l’empire, obérées par une foule de dépenses nécessaires ou inutiles, mais qui étaient la conséquence fatale de la voie de réforme générale où le pays s’était engagé, n’ont pas permis de former une flotte de guerre sérieuse, aussi vite que la cour du mikado l’avait espéré. Elle se compose de seize bâtiments, dont un navire cuirassé de provenance américaine.
L’excellente création de l’arsenal maritime de Yokosuka, par un Français, M. Verny, commencé en 1867, contribue puissamment à la conservation et au développement du matériel naval des Japonais.
Tel est le tableau trop abrégé, sans doute, des principales améliorations matérielles réalisées durant ces dernières années, dans la pensée d’élever le Japon au niveau de la civilisation européenne. Ces améliorations peuvent être jugées très insuffisantes; mais elles sont d’un bon augure pour l’avenir, si on les continue avec un esprit de suite et surtout d’une façon plus réfléchie et plus économique. C’est beaucoup assurément que de mettre un pays en état de résister à l’invasion étrangère, et de faire respecter son indépendance. C’est fort peu, si la conséquence de ces réformes n’est pas d’agrandir les ressources de la nation par une augmentation de production, d’ouvrir de nouveaux débouchés aux fruits de son travail, et d’améliorer le sort du peuple en lui facilitant le travail et l’économie, et surtout en ne lui créant pas de nouveaux besoins.
L’avenir du Japon dépend aujourd’hui des mesures plus ou moins heureuses qui seront prises pour y développer l’instruction publique et y répandre la connaissance des sciences européennes. Quelques utiles résultats ont été déjà obtenus. De tous côtés des écoles publiques ont été ouvertes, et quelques grands établissements d’enseignement supérieur ont été fondés avec le concours de professeurs anglais, français, allemands ou américains.
Une Ecole de Médecine, établie primitivement à Nagasaki, a été transférée à Yédo. Le nombre des professeurs japonais, qu’on a hâte de nommer aussitôt que possible à la place de professeurs étrangers, y est déjà supérieur à celui des Allemands, auxquels ont été primitivement confiées les principales chaires.
Une École de Droit est dirigée par deux professeurs français, et une espèce de Faculté des Sciences a été confiée à des professeurs anglais. Enfin, il faut mentionner une École des Mines dirigée par des maîtres allemands.
De la sorte, la jeune génération japonaise ne connaît plus, en fait de sciences, que les sciences européennes; et avec l’intelligence dont elle a déjà donné des preuves si éclatantes, il n’y a pas à douter qu’elle ne dote bientôt l’empire du Soleil Levant d’une petite pléiade de savants sérieux et autorisés.
Par contre, les arts et l’industrie, au lieu de progresser, semblent entrer dans une voie très regrettable de laisser-aller et de décadence.
Les produits japonais sont, de jour en jour, de qualité plus inférieure; et c’est à grand’peine s’ils arrivent à se maintenir sur les marchés, en présence de la concurrence étrangère. Depuis l’ouverture des ports du Japon aux étrangers, le commerce des laques a pris un grand développement; il est même devenu un des articles d’exportation les plus importants du pays. Seulement, l’avantage qu’ont trouvé les fabricants indigènes à produire beaucoup et à bon marché, a nui considérablement au mérite artistique de leurs ouvrages. Les laques anciennes l’emportent en valeur, dans une énorme proportion, sur les laques modernes qui sont, à première vue, d’un aspect agréable, il est vrai, mais qui ne remplissent aucune des conditions de solidité et de bon goût si estimées dans celles qu’on fabriquait au siècle dernier. Il fallut l’intervention active du gouvernement de Yédo pour arracher cette grande branche d’industrie à une décadence complète et définitive. Grâce à ses encouragements, les ouvriers les plus habiles du Nippon se mirent à fabriquer de nouveau de beaux laques qui, grâce à l’intervention de procédés perfectionnés, à l’usage de couleurs qu’on n’avait pu encore employer, l’emportent même parfois sur les meilleurs produits de l’ancien temps.[238]
La même décadence s’est manifestée dans presque toutes les autres branches de l’industrie indigène. Il faut espérer que des mesures également opportunes éviteront des désastres qui seraient, un jour ou l’autre, la conséquence de cet abaissement général des produits manufacturiers du Japon.
Un seul art, la Typographie, a fait en quelques années les plus étonnants progrès; et, comme on a dit que cet art produisait la lumière, on peut voir, dans le développement considérable qu’il a pris au Japon, un heureux pronostic pour l’avenir de ce pays. Plusieurs imprimeries, se servant de types mobiles fondus suivant le système européen, ont été organisées, et elles ont donné les résultats les plus satisfaisants. Mais ce qui est bien autrement remarquable, c’est de voir comment on a pu arriver à disposer ces imprimeries de façon à permettre la production régulière de journaux quotidiens d’assez grandes dimensions. Les Japonais ont renoncé, pour l’impression de ces journaux, à l’emploi du plus grand nombre de leurs caractères cursifs; mais ils n’ont pu se débarrasser de l’immense quantité de signes idéographiques chinois, sans lesquels leurs articles seraient presque toujours incompréhensibles. Et comme on ne saurait admettre, pour le journalisme, un système d’impression qui, comme la xylographie ou la lithographie, rend les remaniements, les changements, les corrections mêmes à peu près impraticables,—surtout lorsqu’il s’agit d’aller vite et de terminer le travail à heure fixe,—ils ont dû mettre en usage les procédés habituels de l’art typographique. Pour quiconque connaît un peu les exigences de cet art, les résultats qu’ils obtiennent pour l’impression de leurs journaux quotidiens sont dignes des plus grands éloges et montrent ce qu’on peut attendre d’un peuple si habile à lever les difficultés qui peuvent nuire à l’accomplissement de ses destinées.
La presse a déjà rendu au Japon de véritables services; et, quoique née d’hier, elle possède déjà une histoire digne de prendre une place honorable dans les annales contemporaines de la civilisation japonaise.


 A révolution qui s’opère au Japon depuis quelques années, révolution
dont le point de départ a été l’anéantissement du pouvoir des syaugoun
ou lieutenants-impériaux et la restauration de l’autorité suprême entre
les mains des mikado ou empereurs légitimes, comptera certainement
parmi les événements les plus étonnants et les plus considérables de
l’histoire contemporaine des nations asiatiques. Le succès de cette
révolution, comme je l’ai dit dans une conférence précédente, a eu pour
cause, d’une part, la faiblesse des derniers autocrates de Yédo, et, de
l’autre, les transformations qu’a dû subir le pays, par suite de
l’ouverture des ports au commerce étranger et de l’immixtion des
Européens dans les affaires politiques des îles de l’extrême Orient.
A révolution qui s’opère au Japon depuis quelques années, révolution
dont le point de départ a été l’anéantissement du pouvoir des syaugoun
ou lieutenants-impériaux et la restauration de l’autorité suprême entre
les mains des mikado ou empereurs légitimes, comptera certainement
parmi les événements les plus étonnants et les plus considérables de
l’histoire contemporaine des nations asiatiques. Le succès de cette
révolution, comme je l’ai dit dans une conférence précédente, a eu pour
cause, d’une part, la faiblesse des derniers autocrates de Yédo, et, de
l’autre, les transformations qu’a dû subir le pays, par suite de
l’ouverture des ports au commerce étranger et de l’immixtion des
Européens dans les affaires politiques des îles de l’extrême Orient.
Il me paraît donc utile de rappeler en peu de mots les premières tentatives des Occidentaux à l’effet d’établir des relations avec les Japonais.
Le Japon a été découvert par les Portugais.
Ce pays avait été mentionné, dès le XIIIe siècle, il est vrai, sous le nom de Zipangu[239], par le célèbre voyageur vénitien Marco Polo; il ne paraît pas toutefois qu’aucun Européen y ait abordé avant le milieu du XVIe siècle. Le Sin-sen nen-hyau de Mitsoukouri mentionne l’arrivée des premiers Portugais une année plus tôt; mais le savant chronologiste ne nous dit pas sur quelle autorité il se fonde pour établir cette allégation.
L’Aperçu des annales des mikados de Syounsaï Rindjo mentionne la première arrivée des Portugais, sous le nom de Barbares du Sud, au Japon en l’année 1551[240]. Chassés par la tempête, des navigateurs de cette nation furent poussés sur l’île de Tané-ga sima. Ils portaient avec eux des armes à feu, dont les Japonais n’avaient pas encore fait usage. C’est en souvenir de ce fait que les pistolets sont encore aujourd’hui désignés sous le nom vulgaire de Tané-ga-sima. Antérieurement à cette époque, les historiens du Japon rapportent l’arrivée de Nan-ban dans le pays de Satsouma en l’an 1020, et une mission de ces mêmes peuples qui apporta un tribut en l’an 1409. Seulement, on n’a pas encore élucidé la question de savoir à quels étrangers ces historiens font allusion; et, jusqu’à ce que le problème ait été résolu, il n’est pas possible de faire remonter les premières reconnaissances des îles de l’extrême Orient par les Européens à une époque antérieure au voyage de Fernand Mendez Pinto qui fut jeté sur les côtes du Japon en l’année 1543.
Dès que les Portugais connurent l’existence du Japon, ils se hâtèrent d’y envoyer de nouveaux navires et des prêtres pour évangéliser le pays. Saint François Xavier et plusieurs autres jésuites y abordèrent le 15 août 1549[241]. La propagande religieuse acquit bientôt un grand développement dans tout l’archipel; et, après s’être établis dans les principautés de Satsouma et de Boungo, les missionnaires catholiques se répandirent dans la grande île de Nippon, à Myako, résidence de l’empereur, et jusque dans les provinces les plus septentrionales du pays. De 1616 à 1620, ils traversèrent le détroit de Sangar et pénétrèrent dans l’île de Yézo.
Après les Portugais, vinrent les Hollandais qui se préoccupèrent beaucoup moins d’évangéliser le Japon que d’y ouvrir de nouveaux débouchés à leur commerce maritime. Seuls, parmi tous les Européens, ils surent gagner la confiance du gouvernement syaugounal et conserver le monopole du commerce, alors que tous les autres Européens, sans exception, durent se soumettre au décret qui leur interdisait de la façon la plus sévère l’entrée des ports du Nippon.
Les Anglais essayèrent cependant de participer aux privilèges commerciaux qui avaient été accordés aux Hollandais. Un pilote de leur nation, William Adams, aborda dans cet espoir à Ohosaka, en 1600. Le syaugoun le reçut avec bienveillance et l’employa à la construction de navires sur le modèle européen; mais, lorsqu’il exprima le désir de retourner dans son pays, il fut informé que le gouvernement ne consentait pas à lui donner cette permission. Adams se résigna donc à demeurer au Japon, où il épousa une femme indigène, avec laquelle il vécut dans le petit port de Yokosuka, où son tombeau a été dernièrement retrouvé. Les services qu’il avait rendus dans sa nouvelle patrie lui valurent l’honneur de voir son nom donné à une des rues de Yédo. Autorisé par le syaugoun à inviter ses compatriotes à venir établir des comptoirs dans ses états, il écrivit en Angleterre, et une mission ne tarda pas à arriver sous le pavillon de Sa Majesté Britannique. Cette mission apprit bientôt qu’elle ne pouvait pas compter sur les espérances qu’on lui avait fait concevoir; le gouvernement syaugounal se refusa brusquement à tout traité d’amitié avec l’Angleterre, parce que son souverain avait épousé une princesse de Portugal, pays que les Japonais considéraient comme l’éternel ennemi du leur. La mission anglaise reçut, en conséquence, l’ordre de se retirer dans un délai de vingt jours. Plusieurs nouvelles tentatives furent faites depuis lors pour ouvrir les portes du Japon au commerce britannique, mais ces tentatives restèrent toutes également infructueuses.
Les Russes voulurent à leur tour pénétrer sur le territoire soumis à l’autorité des syaugouns, et ils envoyèrent dans ce but plusieurs expéditions dont la plus célèbre, celle de Golownine à Yézo, n’eut d’autre résultat que de faire garder son chef dans une longue et pénible captivité (de 1811 à 1814).
Il était réservé aux États-Unis d’Amérique d’obtenir du syaugoun l’abrogation des lois rigoureuses qui défendaient l’accès des côtes de l’archipel Japonais à la marine de tous les peuples du monde, à l’exception des Hollandais et des Chinois auxquels avait été maintenu le privilège du commerce extérieur, à la condition, il faut le dire, de se soumettre à tout un système de vexations intolérables. A la suite d’une motion adoptée par le sénat de Washington, il fut décidé qu’une expédition, sous les ordres du commodore Perry, se rendrait au Japon, pour y conclure un traité d’amitié et de commerce. L’expédition quitta Norfolk le 24 novembre 1852 et vint jeter l’ancre à Nafa, principal port des îles Loutchou, le 26 mai 1853. Le 7 juillet de la même année, le commodore Perry faisait son entrée dans la baie de Yédo, où il notifiait au gouvernement du syaugoun l’intention formelle du gouvernement américain d’engager des relations de commerce avec son pays. N’ayant pu obtenir une satisfaction immédiate, il annonça qu’il reviendrait, l’année suivante, demander une réponse à sa demande. A peine l’amiral américain eut-il quitté les eaux du Japon que tout le pays se prépara à la résistance, en même temps que des ordres étaient envoyés dans les couvents pour prier les Dieux de sauver l’empire de l’invasion des Barbares. Les cloches des monastères furent transformées en canons, on arma tout ce qu’on possédait de bateaux et de jonques, et l’on construisit de tous côtés des fortifications. Quand tous ces préparatifs belliqueux furent terminés, on jugea la résistance impossible, et l’on résolut de chercher, par une politique de ruse et d’atermoiement, à éloigner au moins de quelque temps les malheurs qui menaçaient de fondre sur l’empire.
Les Américains partageaient à cette époque une erreur générale, que les japonistes eussent très probablement dissipée, si on avait daigné les consulter: ils croyaient que le syaugoun de Yédo était le véritable empereur du Japon, et que le mikado de Myako n’était qu’une espèce de pape, un souverain exclusivement spirituel et religieux. Le président des Etats-Unis avait donc écrit une lettre à «l’Empereur du Japon», que son ambassadeur alla porter naïvement au syaugoun: celui-ci, ne sachant comment se tirer de l’impasse où il se trouvait engagé, se décida à se laisser passer pour empereur aux yeux des étrangers, et à conclure à ce titre les traités de commerce et d’amitié qu’on venait arracher à son gouvernement. La ruse audacieuse que les Japonais employèrent en cette circonstance, et la naïveté ignorante dont firent preuve les agents politiques européens, furent la cause de cette longue période de malentendus, d’ajournements de toutes sortes, d’embarras et de malaise réciproque qui commença à la conclusion du premier traité américain avec le syaugoun (1853), et qui ne devait se clore qu’avec la révolution qui détruisit définitivement la fonction longtemps omnipotente de lieutenant de l’empereur au Japon (1868).
La politique usurpatrice dont je viens de vous dire quelques mots, avait été adoptée par I-i, seigneur de Ka-mon[242], qui remplissait, à cette époque, les fonctions de régent pendant la minorité du jeune syaugoun Iye-sada. Ce régent, homme d’ailleurs d’une grande intelligence et d’une remarquable énergie, avait bien pu triompher de la sorte des difficultés qui lui venaient du côté des Européens; mais il ne lui avait pas été aussi facile de faire accepter sa manière d’agir par les daïmyaux qui n’ignoraient pas la véritable condition de dépendance du syaugoun vis-à-vis de la personne suprême du mikado. Une révolte, suscitée par les grands de l’empire, ne tarda pas à éclater contre ces audacieux agissements. L’emprisonnement des meneurs, l’exécution capitale de plusieurs d’entre eux, ne devaient point empêcher le torrent révolutionnaire de poursuivre dans le pays sa course vagabonde. Le prince de Mito qui, dès 1840, avait essayé de soulever le pays au nom de l’empereur légitime, se mit à la tête des insurgés; et, conformément à ses ordres, le régent fut attaqué en mars 1860 par une bande de samurai qui s’emparèrent de sa personne, lui tranchèrent la tête et la promenèrent ensuite triomphalement dans la capitale.
Le syaugoun, qui s’était vu dans la nécessité d’abandonner la plupart des garanties que s’étaient arrogées ses prédécesseurs vis-à-vis des princes féodaux, et qui avait dû renoncer notamment à l’obligation pour eux de résider un certain temps à sa capitale et d’y laisser des otages en leur absence, voyait son autorité décliner en même temps que celle des daïmyaux acquérait plus de force et d’indépendance. L’assassinat du régent laissait, en outre, le jeune syaugoun abandonné à toutes les intrigues de sa cour et presque sans moyen de communication avec les princes féodaux, qui, pour discréditer définitivement le gouvernement de Yédo, se plaisaient à commettre vis-à-vis des étrangers des actes hostiles, souvent même des assassinats, dont le syaugoun supportait la responsabilité, sans avoir les moyens de les empêcher.
Lorsque les rênes du gouvernement de Yédo furent remises au quinzième et dernier syaugoun Nobu-Yosi, plus connu des Européens sous son petit nom de Hitotu-basi, il était bien évident que la dynastie fondée par Iyéyasou ne devait plus compter désormais que sur une très courte existence. Nobouyosi était d’ailleurs un vieillard manquant de l’énergie nécessaire pour diriger les forces imposantes dont disposait encore le gouvernement de Yédo, et pour en tirer tout le parti possible.
Les daïmyaux, convaincus que le moment était plus favorable que jamais pour attaquer le syaugounat dans ses derniers retranchements, offrirent leur concours au mikado, à des conditions diverses. Forts de l’appui que leur donnait le pavillon impérial qu’avaient arboré leurs armées, ils n’hésitèrent plus à sommer le Nobouyosi de résigner ses fonctions. Un moment on vit prévaloir, dans le Conseil suprême de Yédo, la politique de la résistance; et déjà des mesures avaient été prises pour mettre en mouvement l’armée syaugounale, lorsque Nobouyosi fit connaître à la cour de Yédo sa résolution définitive de se soumettre à la volonté du mikado. Cette résolution fut consignée dans un acte de démission officielle, daté du 9 novembre 1867. Les grands daïmyaux, réunis en assemblée nationale, décrétèrent peu après la suppression définitive des fonctions de syaugoun, et reconnurent pour seul et unique souverain du Japon, le jeune Mitu-hito qui venait récemment de succéder à son père, le mikado Kau myau.
La soumission subite et inattendue du syaugoun Nobouyosi n’avait pas été sans irriter profondément ses partisans; et les daïmyaux du Nord, qui ne voyaient pas sans regret la prépondérance dont allaient évidemment bénéficier les principautés du Sud, résolurent de soulever pour leur propre compte l’étendard de la résistance. Les mécontents réunirent, en conséquence, toutes les forces militaires qu’ils purent rallier; et, pour arriver à contrebalancer le prestige que les daïmyaux du Sud empruntaient à la personne du jeune mikado Moutsouhito, ils choisirent un oncle de ce même prince nommé Uye-no-no Miya et résolurent de le proclamer mikado du Nord.
Tous les efforts des partisans des Tokougava ne devaient cependant pas aboutir à des résultats quelque peu durables; et bientôt, tant par la force des armes que par d’habiles négociations engagées avec les ka-rau ou ministres des daïmyaux, l’autorité suprême du mikado fut reconnue dans toute l’étendue du Nippon. Le dernier rempart des opposants fut renversé par la prise de Hakodadé, dans l’île de Yézo, le 25 juin 1869.
Le nouveau gouvernement mikadonal avait bien réussi à anéantir le syaugounat et à faire accepter le principe de son autorité suprême d’un bout à l’autre de l’archipel. On ne pouvait cependant pas dire encore qu’il était assis sur des bases solides. Les grands daïmyaux avaient obtenu des promesses en échange de leur participation active à la guerre engagée contre la dynastie des Tokougawa; au milieu du désordre général, une foule de petits seigneurs avaient rompu les liens qui les attachaient aux Koku-si ou grands princes féodaux, et ne cherchaient qu’une occasion pour s’enrichir aux dépens du premier venu, ou pour conquérir une certaine somme d’indépendance; la révolution s’était développée aux cris de «mort aux étrangers», et les étrangers, tout en ayant conservé pendant cette période une attitude calme et désintéressée, du moins en apparence, se tenaient sur leurs gardes, appuyés par les flottes que leurs représentants avaient mandées dans les eaux du Japon; certaines idées de libéralisme moderne, enfin, échauffaient les têtes des officiers indigènes qui, pendant leur séjour en Europe, s’étaient initiés à toutes les revendications de la réforme sociale et religieuse.
Le premier soin de la Porte Impériale[243] fut de résoudre immédiatement la question des étrangers. Loin de décréter leur expulsion du pays et d’abroger les traités conclus avec le syaugoun, le cabinet s’empressa de reconnaître les représentants des puissances occidentales, de leur notifier que le siège du gouvernement était désormais établi à Kyau-to (Miyako), et qu’ils étaient invités à venir avec leur suite présenter leurs lettres de créance à la personne même du souverain. En même temps des ambassades extraordinaires étaient envoyées en Europe et en Amérique, et des agents diplomatiques résidents étaient accrédités auprès de ceux qui avaient conclu des traités d’amitié avec le Japon.
Cette attitude du nouveau gouvernement n’était évidemment pas de nature à donner une satisfaction générale dans l’archipel, où la haine des étrangers est encore loin d’avoir été tout à fait déracinée. Mais le prestige du successeur d’Ama-terasu Oho-kami était trop considérable pour que quelqu’un osât se révolter contre ses arrêts. D’ailleurs, les rapports des Européens avec les Japonais avaient éveillé dans l’esprit de ces derniers une vive curiosité de savoir, et le désir ardent de régénérer leur pays par l’introduction de toutes les sciences et de tous les progrès réalisés en Occident. Tandis que les Chinois ont peine à comprendre que les «Barbares des quatre frontières» aient pu atteindre et surtout dépasser la civilisation du «Royaume du Milieu», les Japonais, au contraire, ont fait de suite bon marché de leur civilisation, en grande partie calquée sur celle de la Chine, et ils ont résolu de tout transformer parmi eux. Non-seulement ils se sont hâtés d’imiter nos institutions européennes, de transformer leur armée et leur marine à l’instar des nôtres, de se donner quelques premiers tronçons de télégraphes et de chemins de fer, d’organiser des postes, de créer un nouveau système monétaire et de reconstituer leurs finances sur le mode des puissances occidentales; ils ont voulu encore, et presque avant tout, perdre l’apparence extérieure d’Asiatiques: ils ont adopté pour leur souverain, pour les fonctionnaires publics, et même pour les classes supérieures de la société, notre manière de vivre et jusqu’à notre costume. Quant à la religion, dont la réforme eût été, dans toute autre région du monde oriental, la plus grosse difficulté à résoudre, il semble qu’elle ait été, pour les Japonais, le moindre embarras qu’ils aient rencontré pour l’accomplissement de leur œuvre de transformation sociale. Le Bouddhisme, en excluant, ou peut s’en faut (car on doit tenir compte de ses diverses écoles), toute croyance à une divinité suprême et personnelle, ainsi qu’à une existence d’outre-tombe, préparait d’ailleurs les Japonais à accepter toutes les formes du scepticisme moderne et même à se désintéresser dans la solution qui pourrait être donnée au problème religieux. L’ardeur qu’ils avaient mise, deux siècles auparavant, à poursuivre le christianisme de leurs persécutions et de leur colère, se trouvait de la sorte considérablement affaiblie. Ils devaient, sans trop de résistance, laisser s’établir dans leurs villes les missionnaires de l’évangile, et y construire des églises et des séminaires. Quant aux innombrables idoles bouddhiques, le plus souvent, ils ne devaient plus s’en préoccuper; ou plutôt, sachant que toutes ces représentations fantastiques, où l’art ancien avait marqué son génie bizarre et sui generis sur la céramique, sur le bois, sur l’ivoire ou sur le bronze, avaient acquis une grande valeur mercantile pour les collectionneurs européens, ils n’hésitèrent pas à se débarrasser de ces idoles désormais inutiles, et à disperser les divinités auxquelles ils rendaient naguère encore des sacrifices et des hommages, sous le marteau de simples commissaires priseurs.
Je ne veux pas dire pour cela que les Japonais intelligents, que quelques bonzes éclairés, que le gouvernement mikadonal lui-même se soient absolument désintéressés de la question religieuse. Loin de là; j’ai eu l’occasion de rendre compte ailleurs[244] d’une mission envoyée il y a quelques années en Europe, à l’effet d’étudier ce que la transformation actuelle du Japon exigeait qu’on fît le plus tôt possible pour donner un aliment au besoin de croyance des classes populaires de l’empire. Cette mission,—et je pourrais dire en un mot tous les Japonais que j’ai vus se préoccuper de la religion de leur pays,—était, au fond, assez indifférente sur la foi qu’il convenait de faire adopter à ses compatriotes: ce qui la préoccupait, c’est que cette religion pût s’allier avec le mouvement des idées modernes et ne se trouvât pas, dès à présent, en contradiction avec les conquêtes de la science européenne.
Peu après son avènement au trône, Mutsouhito, âgé alors de dix-sept ans, réunit une espèce de Conseil d’Etat composé des principaux seigneurs qui avaient contribué à restaurer le pouvoir effectif qu’avaient exercé ses aïeux, avant la domination des syaugouns. D’accord avec cette assemblée, il arrêta les bases d’une constitution, où furent proclamés quelques principes qui témoignent certainement de progrès que nul n’était guère en droit d’espérer d’une nation asiatique, et qui n’avaient été réalisés nulle part ailleurs en Orient.
Sans reconnaître précisément l’abolition des castes et l’égalité de tous les citoyens devant la loi, cette constitution admettait la possibilité d’appeler à toutes les fonctions publiques les hommes de valeur qui se feraient remarquer dans les différentes classes de la société. Elle déclarait, en outre, abolies toutes les coutumes cruelles et barbares qui avaient été en usage dans les siècles passés.
Après avoir promulgué ces rudiments de constitution, le mikado annonça qu’il avait établi une ère nouvelle dont le nom exprimait l’idée sur laquelle serait fondé son gouvernement. Cette ère fut appelée mei-di «le gouvernement éclairé».
Comme conséquence immédiate du nouvel ordre de choses, la Porte Impériale dut se préoccuper de rendre aussi impuissante que possible l’aristocratie féodale qui gouvernait encore, avec presque toutes les prérogatives de la souveraineté, les principautés et les innombrables clans entre lesquels était partagé l’archipel Japonais. Vouloir se défaire brusquement des anciens Koku-si, et notamment des plus puissants d’entre eux auxquels le mikado devait sa restauration effective au trône, fut jugé chose prématurée, sinon absolument impossible. Loin de là, ces mêmes Kok-si furent appelés aux plus hautes fonctions du nouvel édifice politique, où leur présence, qu’on n’avait pu éviter, devait nécessairement contribuer à rendre plus lente et plus laborieuse l’œuvre projetée de réorganisation politique et sociale. Par un coup d’audace périlleux, mais qui fut couronné de succès, le mikado décréta la suppression des états féodaux et la division de tout l’empire en ken ou «départements», à la tête desquels les daïmyaux ne seraient plus que des préfets non héréditaires, salariés par le gouvernement et tous également révocables. Les princes féodaux acceptèrent sans résistance la situation nouvelle qui leur était faite.
Les Japonais ont, de tout temps, montré de remarquables aptitudes à s’assimiler les idées étrangères. Depuis l’arrivée des Américains dans leurs îles, en 1853, ils se sont préoccupés avec une ardeur infatigable de rechercher les moyens propres à donner à leur pays les apparences civilisatrices des contrées de l’Occident. La révolution de 1868 était une occasion favorable pour introduire dans leur pays les institutions politiques et sociales dont ils avaient acquis une idée plus ou moins superficielle dans leurs voyages en Europe, dans leurs relations avec les étrangers établis au milieu d’eux, ou dans les livres anglais, français et allemands traitant de la matière et dont ils avaient déjà fait des traductions complètes ou analytiques.
Leur première pensée fut, en conséquence, de créer au Japon le régime parlementaire, et de constituer un parlement composé d’une Chambre de Seigneurs et d’une Chambre des Communes. La chambre des seigneurs n’était pas absolument impossible à organiser, bien qu’il y eût à craindre qu’elle ne servît qu’à faciliter l’entente des grands feudataires dépossédés pour préparer le pays à une révolution nouvelle. Et, d’ailleurs, il y avait lieu de supposer que, dans une pareille assemblée, l’inégalité d’importance et d’autorité des différents daïmyaux, ne permettrait pas de résoudre les questions par des votes dans lesquels on se bornerait à additionner les suffrages. Le prince de Satsouma, par exemple, n’hésita pas, dans une de ces assemblées d’essais où la majorité ne lui était pas favorable, à se retirer, montrant par là qu’au lieu de s’attacher à compter les voix des seigneurs, il fallait bien plutôt se préoccuper d’en calculer le poids. Le sénat projeté n’était donc pas établi dans des conditions sérieuses d’existence et de durée.
Mais la difficulté était bien autre, quand on voulut convoquer une Chambre des Communes. Où trouver les communes? où trouver des citoyens capables de comprendre ce que devait être un collège électoral? On proposa de faire enseigner publiquement par des conférenciers officiels, les premiers éléments du droit public, et de décider que les Japonais qui auraient fréquenté ces conférences pendant un certain temps, acquerraient le titre de citoyen et la capacité électorale. Cette proposition originale dont on eût peut-être pu tirer d’utiles résultats, si elle avait été adoptée et mise en pratique avec persévérance, ne pouvait en tous cas donner des résultats immédiats. Elle fut bientôt abandonnée, ainsi que toutes sortes d’autres systèmes ayant pour but de trouver les moyens d’introduire une chambre basse dans le parlement projeté.
Le sénat ou Gen-rau-in[245], fondé par décret du 17 avril 1875, ne devait pas survivre à la retraite du prince de Satsouma que j’ai mentionnée tout à l’heure. Une sorte de Conseil Supérieur, dans lequel furent appelés quelques Européens en qualité de conseillers-adjoints, lui succéda, et prépara les lois que le cabinet acceptait ensuite ou repoussait à son gré.
Le même décret instituait une autre chambre, appelée Fu-ken kai-gi[246], que les journaux se sont hâtés de considérer comme étant une Chambre des Communes. Cette assemblée n’est autre que la réunion des préfets ou chef de Ken, appelés chaque année, durant une session de cinquante jours, à examiner certaines affaires relatives aux intérêts particuliers des départements placés sous leur juridiction administrative.
En somme, les intentions qui ont provoqué le décret d’avril 1875 n’ont pu être réalisées, et le Parlement japonais est encore une création réservée à un avenir plus ou moins éloigné. La Porte Impériale s’est trouvée, de la sorte, dans la nécessité de revenir à peu de choses près au gouvernement personnel et absolu qui avait régi le Japon avant la grande révolution de 1868. Faute de pouvoir trouver des citoyens dans les classes populaires d’un pays maintenu plus de deux mille ans dans un perpétuel esclavage, sous l’autorité absolue de la noblesse et de la classe militaire, le mikado ne put appeler tout d’abord autour de lui que d’anciens serviteurs dévoués, ignorants, sans autorité et sans prestige, ou des daimyaux médiocrement éclairés et, en tous cas, jaloux de recouvrer le pouvoir que la révolution était venue brusquement leur arracher des mains. Le tiers-état, le seul élément social sur lequel puissent être appuyées les institutions nouvelles, est à peine en voie de formation chez les Japonais; il est cependant certain qu’il ne tardera pas à acquérir une large part d’influence dans les résolutions du gouvernement mikadonal.
Le jeune empereur paraît très favorable à l’émancipation de cette classe moyenne de la population japonaise, émancipation qui sera sans doute facilitée par la loi nouvelle qui appelle tous les indigènes, désormais sans distinction de caste ou d’origine, à servir sous les drapeaux. Les conseillers de la couronne, à cette occasion, firent observer au mikado que, si l’émancipation du peuple devait avoir pour résultat le plus prochain, d’ébranler et même d’anéantir un jour les dernières forces sur lesquelles s’appuient les anciens feudataires du Nippon, elle aurait très probablement ensuite pour effet, de discuter jusqu’au droit du souverain lui-même. Ces représentations ne firent point changer la résolution qu’on attribue à l’initiative de l’empereur Moutsouhito lui-même, et la rumeur publique prête au jeune prince cette noble réponse: «Dussé-je subir un jour le sort de Charles Ier d’Angleterre et de Louis XVI de France, je persévérerai dans la voie que j’ai ouverte pour l’émancipation et pour le bonheur de mes sujets.»
Quoiqu’il en soit de ce récit, et de l’origine des idées libérales qui ont signalé à plusieurs reprises les actes du gouvernement japonais, il est certain que le Japon a réalisé, en quelques années, des réformes dignes de lui donner une place dans le grand concert politique des nations de race Blanche, et un rang distingué à la tête de tous les empires asiatiques.
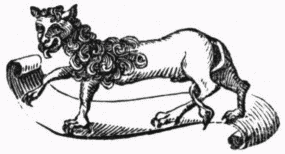
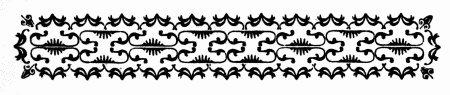
| Pages. | ||
| I. | —Place du Japon dans la classification ethnographique de l’Asie | 1 |
| II. | —Coup d’œil sur la géographie de l’archipel Japonais | 29 |
| III. | —Les origines historiques de la monarchie japonaise | 55 |
| IV. | —Les successeurs de Zinmou, jusqu’à la guerre de Corée | 87 |
| V. | —Influence de la Chine sur la civilisation du Japon.—La Chine avant Confucius | 119 |
| VI. | —Les grandes époques de l’histoire de Chine, depuis le siècle de Confucius jusqu’à la restauration des lettres sous les Han | 163 |
| VII. | —La littérature chinoise au Japon | 191 |
| VIII. | —Le Bouddhisme et sa propagation dans l’extrême Orient | 223 |
| IX. | —Aperçu général de l’histoire des Japonais, depuis l’établissement du Bouddhisme jusqu’à l’arrivée des Portugais | 253 |
| X. | —La littérature des Japonais | 283 |
| XI. | —Les sciences et l’industrie au Nippon | 327 |
| XII. | —La révolution moderne au Japon | 369 |


[1] Ces conférences ont été, pour la plupart, recueillies par M. Vignon, sténographe.
[2] Ce Manuel se composera des documents suivants: 1. Liste des Dieux du Panthéon Japonais;—2. Liste ordinale et chronologique des Mikado ou Empereurs du Japon;—3. Liste ordinale et chronologique des Syaugoun ou Généralissimes Japonais;—4. Liste alphabétique des Mikado;—5. Liste chronologique des Nengaux ou noms d’années;—6. Liste alphabétique des Nengaux;—7. Chronologie cyclique de l’Histoire du Japon;—8. Chronologie des principaux faits de l’Histoire du Japon;—9. Petite Biographie des hommes célèbres;—10. Liste des anciennes Provinces du Japon;—11. Liste des Ken ou Départements actuels de l’empire Japonais;—12. Liste des Temples célèbres;—13 Liste chronologique des Résidences impériales;—14. Liste des Ports de mer japonais;—15. Petit Dictionnaire géographique.
[3] Introduction au Cours pratique de Japonais. Résumé des principales connaissances nécessaires pour l’étude de la langue japonaise. Seconde édition (Paris, 1872);—Guide de la Conversation Japonaise. Troisième édition (Paris, 1883).
[4] Les Livres sacrés du Japon. Yamoto bumi. La Genèse des Japonais, traduite pour la première fois, accompagnée d’un commentaire perpétuel composé en chinois et d’une glose exégétique en français.
[5] Voy., pour le développement de ces idées sur la classification ethnographique, l’introduction de mon ouvrage intitulé: Les Populations Danubiennes (Paris, 1882, in-4º et Atlas in-folio).
[6] J’ai signalé, avec d’assez grands développements, cette théorie dans un fragment, couronné par l’Institut, de mon Histoire de la langue chinoise. En attendant la publication de cet ouvrage encore inédit, voy. les observations que j’ai publiées sur la Reconstitution de la langue chinoise archaïque, dans les Transactions of the second Session of the International Congress of Orientalists. London, 1874, p. 120.
[7] Voy., sur ce sujet, l’ouvrage de M. Ludwig Podhorszky, intitulé: Etymologisches Wœrterbuch der magyarischen Sprache, genetisch aus chinesischen Wurzeln und Stæmmen, 1877; in-8º.
[8] Voy. mon Aperçu de la langue coréenne. Paris, Impr. impér., 1864, in-8º, et dans le Journal asiatique, 6e série, t. III, p. 287 et suiv.
[9] Voy. mon Introduction à l’étude de la langue japonaise. Paris, 1856, in-4º, p. 29.
[10] Klaproth, Tableaux historiques de l’Asie, p. 153.
[11] Castren, Nordiska Resor och forskningar, t. IV, cité par Beauvois, dans la Revue Orientale et Américaine, 1864, t. IX, p. 137.
[12] Beauvois, Lib. cit., p. 139.
[13] Voy., à ce sujet, ma Lettre à M. Oppert, dans la Revue Orientale et Américaine, t. IX, p. 269.
[14] Wa-kan San-sai du-ye, liv. LXVI, f. 13.—«En une nuit, le sol s’entrouvrit et forma un grand lac, qui reçut le nom de Mitu-umi. La terre forma une grande montagne, qui devint le Fu-zi-no yama, dans la province de Suruga. Cet événement n’est pas à l’abri du doute, car les historiens n’en parlent pas». (Voy. cependant Nippon wau dai iti-rau, liv. I, f. 3.)
Les Japonais qui, depuis des siècles, n’ont cessé de professer pour cette montagne un véritable culte d’admiration, lui ont donné différents noms témoignant tous de ce sentiment. Ils l’écrivent parfois avec des caractères qui signifient «il n’y en a pas deux pareilles au monde», ou «l’inépuisable», ou «l’immortelle»; ils la désignent aussi sous le nom de Hô-rai (chinois: Poung-laï), qui est celui d’une montagne célèbre où séjournent les immortels, suivant la mythologie de la Chine, et dont il est question dans la plus vieille géographie du monde, le Chan-haï-king. «Le mont Poung-laï, dit cette géographie, est une montagne habitée par les immortels et située au milieu de la mer; il n’y a pas de route pour y arriver».
[15] Du 14e jour du 3e mois au 18 du mois suivant.
[16] Ni-hon-go-ki, cité par le Wa-kan San-sai du-ye, liv. VI, f. 14.
[17] Voy., sur ce volcan, mes Etudes Asiatiques, p. 298.
[18] Histoire naturelle de l’empire du Japon, trad. de Naude, t. I, p. 168.
[19] En japonais: sat-tuki «le cinquième mois».
[21] Banaré, Instructions nautiques, Mer de Chine 3e partie, p. 2.
[22] Bousquet, le Japon de nos jours, t. I, p. 6.
[23] Voy. Syo-gen-zi-kau, édit. lith., p. 223, c. 4.
[24] A ces noms, il faut ajouter les suivants: Toyo-asi-vara-ti-i-wo-aki-no-mitu-ho-no-kumi, Ura-yasu-no kuni, Hoso-hoko-ti-taru-no kuni, Siwa-gami-ho-no-ma-no kuni, Tama-gaki-utitu kuni, désignations appartenant à la période mythologique des Génies célestes;—Toyo-Akitu-su, nom donné par le premier mikado Zin-mu au Japon, parce que ce pays lui avait semblé avoir la forme d’une espèce de sauterelle;—Ya-ba-tai, altération du nom de Yamato, empruntée aux Annales des Han postérieurs (Heou-Han chou);—Ziti-iki «le pays du Soleil»; Zit-tô, «le lever du soleil»; Siki-sima «les îles disséminées»; Asivara-no kuni.
[25] Ces îles sont souvent appelées, dans les géographies, de leur nom chinois Lieou-kieou; les Japonais les nomment Riou-kiou. La forme locale est Loutchou.
[26] Voy. sur les usages si variés du Bambou au Japon, la curieuse notice de M. le Dr Mène, dans les Mémoires de la Société des études japonaises, t. III, p. 6 et suiv.
[27] On peut consulter, sur ce sujet, mon Traité de l’éducation des vers à soie au Japon, traduit du japonais et publié par ordre du ministre de l’Agriculture, à l’Imprimerie nationale. Cet ouvrage a été traduit en italien, par M. F. Franceschini, et publié à Milan (un vol in-8º).
[28] Geerts, Les produits de la nature japonaise et chinoise, p. 209.
[29] Le premier mikado ou empereur du Japon, Zin-mu, commença à régner en 667 avant notre ère.
[30] L’empereur de Chine Taï-tsoung, de la dynastie des Soung, ayant appris, en l’an 984, que les souverains japonais ne formaient qu’une seule lignée de descendants, ne put s’empêcher de pousser un soupir et de s’écrier: «Cela n’est-il pas la véritable voie de l’antiquité?» (Voy. mes Textes chinois anciens, traduits en français, p 89.)
[31] Mitukuri, Sin-sen Nen-hyau, ann. 285; Dai Ni-hon si, liv. III, p. 13. Voy. aussi mes Archives paléographiques, t. I, p. 234.
[32] Russko-Iaponskii Slovar, p. 2.
[33] Dai Ni-hon si, liv. 11, p. 6.
[34] Il est fait mention de cette ambassade dans les Heou-Han chou, ou annales officielles chinoises de la dynastie des Han postérieurs, à la date de la deuxième année tchoung-youèn, dans l’histoire de l’empereur Kouang-wou.—Cf. Dai Ni-hon si, liv. II, p. 10.
[35] Voy., sur cette écriture, les renseignements que j’ai donnés dans les Mémoires du Congrès international des Orientalistes, Session inaugurale de Paris, 1873, t. I, p. 221.
[36] D’Hervey de Saint-Denys, Mémoire sur l’histoire ancienne du Japon, p. 7.
[37] Voy. l’intéressante notice de M. Addison van Name, dans les Mémoires du Congrès international des Orientalistes, Session de Paris, 1873, t. I, p. 221.
[38] Ko va noti no hito no ituvari atume taru mono ni site, sara-ni Kano Syau-toku no mi ko no mikoto no erabi tamaisi, makoto uo fumi ni va arazu (Ko-zi ki, Préliminaires, p. 20 vº).
[39] Wa-kan Kwó-tó fen-nen-gau un-no du, Introduction.
[40] Les deux mots ming-hing, rendus en japonais par «en se nuagifiant,» forment, en chinois, une expression qui désigne «la matière première des choses».
[41] Ni-hon Syo-ki, liv. 1, p. 1.
[42] Ni-hon Syo-ki, lib. cit., p. 1 vº.
[43] Ni-hon Syo-ki, liv. 1, p. 2.
[44] Ni-hon Syo-ki, lib. cit., p. 2 vº.
[45] Les six autres génies de la dynastie divine (Ama-no Kami) furent:
2º Kuni-no Sa-tuti-no mikoto, également appelé Kuni-Sa-tati-no mikoto.
3º Toyo-Kun-nuno Mikoto également appelé Toyo-kuni-nusi-no Mikoto, Toyo-kumi-no-no Mikoto, Toyo-ka-busi-no-no Mikoto, Uki-fu no no toyo-kai-no Mikoto, Toyo-kuni-no-no Mikoto, Toyo ku’i-no-no Mikoto, Hako kuni-no-no Mikoto, ou Mi-no-no Mikoto.
4º U’i-ti ni-no Mikoto, qui eut pour épouse Su’i-ti-ni-no Mikoto.
5º Oho-to-no di-no Mikoto, qui eut pour épouse Toma-be-no Mikoto.
6º Omo-taru-no Mikoto, lequel eut pour épouse Kasiko-ne-no Mikoto.
7º Iza-nagi-no Mikoto, lequel eut pour femme Iza-nami-no Mikoto.
[46] D’autres auteurs disent qu’ils étaient seulement mâles.
[47] Izanagi et Izanami ayant vomi, par métamorphose naquit le dieu Kana-yama-hiko, ou «le Génie des Montagnes d’or»; ayant uriné, par métamorphose naquit la déesse Midu-ha-no me; ayant fait des excréments, par métamorphose naquit la déesse Hani-yama bime (Voy. Ni-hon Syo-ki, liv. 1, p. 11).
[48] Une notice sur les deux dynasties des génies célestes et terrestres du Japon a été insérée par Klaproth en tête de la traduction du Nippon-wau dai iti-ran rédigée par Titsingh avec l’aide des interprètes japonais du comptoir hollandais de Dé-sima. Cette notice renferme malheureusement de nombreuses inexactitudes. On trouvera un tableau complet de la mythologie antique des Japonais dans la traduction que j’ai entreprise du Ni-hon Syo-ki, l’une des sources les plus anciennes et les plus authentiques de l’histoire primitive du Nippon. Le premier volume de cette traduction sera livré prochainement à l’impression et paraîtra à la librairie d’Ernest Leroux dans le recueil des publications de l’Ecole spéciale des Langues orientales.
[49] Ou en dialecte sinico-japonais Ten-syau daï-zin.
[50] Livr. iii, p. 1; Au-tyau si-ryaku, liv. I, p. 1.
[51] Ni-hon Syo-ki, liv. iii, p. 3.
[52] Ni-hon Syo-ki, loc. cit.
[53] Ce nom pourrait se traduire par «le géant à la grande moëlle»; mais un commentaire du Koku-si ryaku (liv. i, p. 6) nous apprend que Naga-sune est un nom de ville, dont on a fait la désignation d’un chef aïno.—Hiko est le titre des princes à l’époque kourilienne de l’histoire du Nippon: il signifie littéralement «fils du Soleil», de même que hime, donné aux princesses, signifie «fille du Soleil.»
[54] Ni-hon Syo-ki, liv. III, p. 5.
[55] Koku-si ryaku.
[56] Ni-hon Syo-ki, liv. iii, p. 15.—Le Wau-tyau si-ryaku dit que ce fut Nigi-hayabi lui-même que Nagasoune proclama roi; les principaux chefs de clans étaient Ye-ugasi, Oto-ugasi, Yaso-takeru, Yesiki, Otosiki, etc.
[57] Koku-si ryaku, liv. 1, p. 6; Wau-tyau siryaku, liv. 1, p. 2.
[58] Ni-hon Syo-ki, liv. III, p. 20; Koku-si ryaku, liv. I, p. 8.
[59] J’ai dit, dans une conférence précédente, que les noms sous lesquels on nous a fait connaître jusqu’à présent les 41 premiers mikados étaient des noms posthumes. Ces noms posthumes, si l’on en croit Rai-san-yo (Ni-hon Sei-ki), liv. v, p. 8; leur auraient été donnés par Omi-mifoune, arrière-petit-fils de l’empereur Odomo, en l’an 784 de notre ère. Il est singulier que, jusqu’à présent, on n’ait pas encore publié la liste des noms que portaient originairement ces 41 souverains, et que nous fournit le Ni-hon Syo-ki. La voici, d’après ces vieilles annales:
| 1. | Kam Yamato Iva are hiko (Zin-mou). | — | 660 à 585 |
| 2. | Kam Nu-na Kawa mimi (Sui-seï). | — | 581 à 549 |
| 3. | Siki-tu hiko Tama-te-mi (An-nei). | — | 448 à 511 |
| 4. | Oho-yamato-hiko Yuki-tomo (I-tok). | — | 510 à 476 |
| 5. | Mi-matu-hiko Kaye-sine (Kau-syau). | — | 475 à 393 |
| 6. | Yamato tarasi hiko Kuni osi hito (Kau-an). | — | 392 à 291 |
| 7. | Yamato neko hito Futo-ni (Kau-rei). | — | 290 à 215 |
| 8. | Yamato neko hito Kuni-kuru (Kau-gen). | — | 213 à 158 |
| 9. | Waka Yamato-neko-hiko futo hi-bi (Kai-kwa). | — | 157 à 98 |
| 10. | Mi maki iri hiko I-ni-ye (Siou-zi). | — | 97-30 |
| 11. | Iku-me-iri hiko I-sa-ti (Soui-nin). | — | 29 -|- 70 |
| 12. | Oho tarasi hiko O-siro-wake (Kei-kau). | -|- | 71 à 130 |
| 13. | Waka-tarasi-hiko (Sei-mou). | 131 à 191 | |
| 14. | Tarasi-naka-tu hiko (Tyou-ai). | 192 à 200 | |
| 15. | Iki-naga-tarasi bime (Zin-gou). | 201 à 269 | |
| 16. | Honda (Au-zin). | 270 à 312 | |
| 17. | Oho-sasagi (Nin-tok). | 313-399 | |
| 18. | I-sa-ho-wake (Ri-tiou). | 400-405 | |
| 19. | Mitu-ha-wake (Han-syau). | 406-411 | |
| 20. | O-asa-tu ma-hoku ko Sukune (In-ghyau) | 412-453 | |
| 21. | Ana-ho (An-kau). | 454-456 | |
| 22. | Oho bas-se waka-take (Iou-ryak). | 457-477 | |
| 23. | Sira-ka-take-hiro-kuni-osi waka yamato neko (Sei-nei). | 480-484 | |
| 24. | O-ke ou Ku-me-no waka-go (Ken-sô). | 485-487 | |
| 25. | O-ke ou Oho-si, ou Oho-su (Nin-ghen). | 488-498 | |
| 26. | O bas se-waka-sagasi (Bou-rets). | 499-506 | |
| 27. | O-ho-tô (Kei-tai). | 507-531 | |
| 28. | Hiro-kuni-osi-take-kana-bi (Au-kan). | 534-535 | |
| 29. | Take-o-hiro-kuni-osi-tate (Sen-kwa). | 536-539 | |
| 30. | Ama-kuni-osi-haraki-hiro-niva (Kin-mei). | 540-571 | |
| 31. | Nu-naka Kura-futo-tama-siki (Bin-tats). | 572-585 | |
| 32. | Tatibana-no toyo-hi-no (Yô-mei). | 586-587 | |
| 33. | Bas-se he (Syou-zyoun). | 588-592 | |
| 34. | Toyo-mi-ke Kasiki-ya bime (Soui-ko). | 593-628 | |
| 35. | Oki-naga-tarasi hi-hiro-nuka (Syo-mei). | 629-641 | |
| 36. | Ama-toyo-takara-ikasi-bi-tarasi bime (Kwan-kyok). | 642-644 | |
| 37. | Ama-yorodu-toyo-bi (Kau-tok) | 645-654 | |
| 38. | Ama-toyo-takara ikabi-tarasi bime (Sai-meï). | 655-664 | |
| 39. | Ama-mikoto-hirakasu-wake (Ten-di) | 662-672 | |
| 40. | Ama-no nuna-bara oki-no ma-bito (Tem-bou). | 672-686 | |
| 41. | Taka ama-no hara-hiro-no bime (Dzi-tô). | 687-696 |
[60] Ni-hon Syo-ki, liv. IV, p. 4.
[61] L’érudition japonaise s’est occupée, dans ces derniers temps, de la recherche des tombeaux de souverains antérieurs à Zinmou. De curieux travaux ont déjà été publiés à ce sujet, mais nous manquons jusqu’à présent des moyens de contrôler les assertions des savants du Nippon qui cherchent à faire remonter les origines historiques de leur pays au-delà du VIIe siècle avant notre ère.
[62] Sse-ma Tsien, Sse-ki (Pen-ki), liv. VI, p. 17; Kang-kien yih tchi-loh, liv. VIII, p. 5; Koku-si ryaku, liv. I, p. 12.
[63] Nippon wau-dai iti-ran, liv. I, p. 3; Koku-si ryaku, loc. citat.
[64] Nippon wau-dai iti-ran, loc. cit.
[65] Le nom de Siu-fouh est écrit dans le Nippon wau-dai iti-ran avec le caractère fouh «bonheur», au lieu de fouh «genouillère»; mais cette orthographe se rencontre également dans quelques auteurs chinois.
[66] On pourrait peut-être faire quelques réserves sur cette opinion que l’on trouve développée de la façon la plus intéressante dans le travail de M. Ogura Yémon, intitulé «La Maison de Taïra» (Mémoires de la Société des Etudes Japonaises, t. I, p. 2 et sv.).
[67] Siraki est un des noms du pays plus connu sous celui de Sinra, et appelé par les Chinois Sin-lo.
[68] Ni-hon Syo-ki, liv. V, p. 12; Han-tyau si-ryaku, liv. I, p. 6.
[69] Ni-hon Sei-ki, liv. I, p. 10.
[70] Koku-si ryaku, liv. I, p. 15.
[71] Ni-hon Syo-ki, liv. VI, p. 2; Ni-hon Sei-ki, liv. I, p. 12.
[72] Ni-hon Syo-ki, commentaire, liv. VI, pp. 3-4.
[73] Au-tyau si-ryaku, liv. I, p. 6.
[74] Koku-si ryaku, liv. I, p. 17.
[75] A la seconde année Kien-wou tchoung-youen.
[76] Au-tyau si-ryaku, liv. I, p. 8; Nippon wau-dai iti-ran, liv. I, p. 6.
[77] Ce prince mourut à Isé, au retour de la guerre qu’il avait dirigée contre les Atuma-yebisu, en 113 de notre ère (Mitukuri, Sin-sen Nen-hyau, p. 16).
[78] Ni-hon Syo-ki, liv. VIII, p. 6.
[79] Ni-hon Syo-ki, liv. IX, p. 3.
[80] Nippon wau-dai iti-ran, liv. I, p. 11.
[81] Ni-hon Syo-ki, liv. IX, p. 6.
[82] Dai Ni-hon si, liv. III, p. 8.
[83] D’Hervey de Saint-Denys, Ethnographie des peuples étrangers à la Chine, t. I, p. 56.
[84] La traduction de Titsing, revue par Klaproth, porte: «Deux fois l’impératrice envoya des ambassades avec des présents à l’empereur de la Chine de la dynastie des Weï, et elle reçut souvent des ambassadeurs et des présents de ce monarque». Le texte japonais signifie simplement: «Il vint également à la Cour un ambassadeur du royaume des Weï; de part et d’autre, on s’offrit des présents» (Gi-no kum yori mo, si-sya rai-tyau su; tagai-ni okuri-mono ari).
[85] Voy. la Carte de l’empire japonais au siècle de Iki-naga-tarasi, à la fin de cette Conférence, p. 118.
[86] Ni-hon Syo-ki, liv. X, p. 3.
[87] Ni-hon Syo-ki, liv. X, p. 11.
[88] Certains dictionnaires chinois fournissent l’explication de plus de 100,000 signes différents; le dictionnaire impérial intitulé Kang-hi Tsze-tien comprend 42,718 caractères disposés sous 214 clefs. La connaissance de 8,000 de ces caractères suffit généralement pour lire les productions littéraires de la Chine ancienne et moderne. Voy., sur ce sujet, le travail de M. F. Maurel, dans les Mémoires de l’Athénée oriental, 1871, t. I, p. 143.
[89] Dans les Actes de la Société d’Ethnographie, t. VI, 1869, p. 171 et suiv.
[90] L’un des plus anciens monuments de l’antiquité chinoise est l’inscription gravée sur un rocher du mont Heng-chan, par ordre de Yu-le-Grand (XXIIIe siècle avant notre ère), en commémoration de l’écoulement des eaux du déluge. Sur cette inscription, écrite en caractères dits Ko-teou, et reproduite dans l’Encyclopédie japonaise Wa-kan San-sai du-ye (liv. XV, p. 30), on peut consulter: Hager, Monument de Yu (Paris, 1802, in-fol.); Klaproth, Inschrift des Yü (Berlin, 1811, in-4º).
[91] J’ai donné, dans les Actes de la Société d’Ethnographie (1863, t. III, p. 139 et suiv.), le résumé de mes recherches sur les origines de la nation chinoise. J’ajouterai ici quelques renseignements qui me paraissent utiles pour l’étude de cette question. Les Mémoires historiques (Sse-ki), primitivement composés par Sse-ma Tan, et qui furent coordonnés et publiés, après sa mort, par le fils de cet historien, le célèbre Sse-ma Tsien, commencent avec Hoang-ti «l’Empereur Jaune», dont le règne remonte à l’année 2698 [avant] de notre ère. L’authenticité de ce règne est admise par tous les critiques chinois; celui de Fouh-hi, qu’on reporte sept cent soixante-dix ans plus haut dans la nuit des temps, est lui-même loin d’être considéré comme fabuleux, et les auteurs les plus scrupuleux nous le donnent tout au plus comme un règne semi-historique. Les anciennes annales intitulées Kou-chi, composées par Soutchih, de la dynastie des Soung, font, de la sorte, remonter les annales de la Chine à ce même Fouh-hi. Les récits qui appartiennent précisément à la légende, et dans lesquels il n’est peut-être cependant pas impossible de découvrir quelques traces d’ethnogénie dignes d’être étudiées, sont réputées l’œuvre de Tao-sse. L’ouvrage de Lo-pi, intitulé Lou-sse, est un de ceux qui font reculer davantage les légendes relatives aux origines de son pays; mais cet ouvrage, malgré sa grande popularité, est généralement peu estimé des lettrés qui ne prennent pas au sérieux sa chronologie fantaisiste des premiers âges. Le classement des souverains mythologiques sous le nom de «Souverains Célestes primitifs» (Tsou tien-hoang), de «Souverains Terrestres primitifs» (Tsou ti-hoang), et de «Souverains Humains primitifs» (Tsou jin-hoang), paraît avoir été adopté par les Japonais qui ont imaginé également, à l’origine de leur empire, des dynasties fabuleuses rattachées aux trois grandes puissances constitutives de l’univers (San-tsaï), savoir: le Ciel, la Terre et l’Homme.
[92] Le grand ouvrage historique intitulé Kang-kien I-tchi loh a cru devoir accueillir les légendes relatives aux temps antérieurs au règne de l’empereur Hoang-ti. Il les publie dans ses deux premières sections:
I.—San-hoang ki «Annales des Trois Souverains», comprenant Pan-kou chi ou Pan-kou, dont le nom a été rapproché de celui du Manou indien, fils de Brahmâ et père de l’espèce humaine. Pan-kou, dans la légende chinoise, est également le premier ancêtre des hommes, le souverain du monde à l’époque du Chaos primordial (Hoen-tun) avec lequel il est parfois identifié;—Tien-hoang chi «les Souverains Célestes»;—Ti-hoang chi «les Souverains Terrestres»;—Jin-hoang chi «les Souverains Humains»;—Yeou-tchao chi «le chef Yeou-tchao»; et Soui-jin chi «le chef Soui-jin».
II.—Ou-ti ki «Annales des Cinq Empereurs», comprenant Fouh-hi;—Chin-noung;—Hoang-ti;—Chao-hao;—Tchouen-hioh;—Ti-kouh;—Yao,—et Chun.
Le grand Yu (Ta Yu) est placé en dehors de cette section et en tête de la dynastie des Hia, dont il est considéré comme le fondateur.
[93] Le Kang-kien I-tchi loh nous fournit de curieuses notices sur ces deux personnages qui sont représentés comme les chefs de la première émigration chinoise, à une époque où elle était encore plongée dans les langes de la barbarie la plus primitive. Les Chinois, avant Yeou-tchao, formaient une population de troglodytes: ils habitaient des cavernes et vivaient dans les lieux sauvages en compagnie des animaux. Ils n’avaient aucun sentiment de convoitise; par la suite, ils devinrent astucieux, et les animaux commencèrent à être leurs ennemis. Yeou-tchao enseigna aux hommes à se construire des tannières avec du bois et à y habiter pour éviter leurs attaques. On ne connaissait pas encore l’agriculture, et on mangeait les fruits des plantes et des arbres. On ne possédait pas l’art de se servir du feu; on buvait le sang des animaux et on en mangeait la chair avec le poil.
Le successeur de Yeou-tchao, Soui-jin, parvint à obtenir du feu en perçant du bois. Les hommes, sous Yeou-tchao, avaient appris à se construire des tannières, mais ils ne savaient pas encore faire cuire leurs aliments. Soui-jin le leur enseigna; il observa en outre les astres et étudia les cinq éléments. Il enseigna au peuple à cuire les mets [avec le feu produit par la friction du bois], et le peuple fut satisfait; aussi lui décerna-t-on le nom de Soui, qui signifie «tirer du feu du bois». Il fit connaître les quatre saisons et la manière de se conformer à la volonté du ciel. A cette époque, on ne possédait pas d’écriture. Soui-jin établit, pour la première fois, le système des cordelettes nouées. Il eut quatre ministres, nommés Ming-yeou, Pi-yuh, Tching-poh et Yun-kieou.
[94] Fouh-hi (3468 ans avant notre ère).
[95] Chin-noung (vers 3218 avant notre ère).
[96] Voy, sur le système du cycle chinois de 60 ans et sur son application dans la supputation des temps chez les Japonais, mon recueil de Thèmes faciles et gradués pour l’étude de la langue japonaise, p. 74.
[97] Dans les ouvrages chinois que j’ai eus à ma disposition, on fait usage, pour les souverains antérieurs à Hoangti et pour Hoangti lui-même, du titre de hoang, qui, dans l’ancienne écriture, était tracée sous une forme où l’on trouve les éléments idéographiques tsze, «soi-même» et wang «gouvernant», c’est-à-dire «autocrate». Pauthier nous dit que ces premiers princes portaient simplement le titre de wang «regulus». J’ignore où le regretté sinologue a trouvé ce renseignement, et s’il n’a pas confondu les signes hoang et wang en cette circonstance.
[98] Ti-kouh, père du célèbre empereur Yao, régna 70 ans et mourut vers l’an 2366 avant notre ère.
[99] «Ti-tchi (2366 à 2357), dit le Kang-kien yih-tchi-loh, régna dix ans comme un mannequin et fut déposé.» Un grand nombre d’historiens chinois ont jugé à propos de supprimer son nom de la liste des souverains; c’est ainsi qu’il ne figure point dans l’histoire des Cinq Empereurs (Ou-ti pen-ki) placée en tête des Mémoires historiques (Sse-ki) du grand historiographe Sse-ma Tsien, où l’on voit paraître Yao immédiatement après Ti-kouh (Livre I).
[100] Yao ou Tao-tang.
[101] Yu, ou Ta Yu «le Grand Yu».
[102] 2200 avant notre ère.
[103] Parmi les travaux publiés sur cette question, je citerai seulement les suivants: le P. Prémare, dans la Revue orientale et américaine, t. III, p. 100, et t. IV, p. 248 W.-H. Medhurst, An inquiry into the proper mode of rendering the word God, in translating the Sacred Scriptures into the Chinese language (Shanghaë, 1848).
[104] Chi-king, section Soung, partie I, ode 6.
[105] Chi-king, section Ta-ya, partie II, ode 4.
[106] Chi-king, section Ta-ya, partie I, ode 1.
[107] Chi-king, loc. cit.
[108] Voy. notamment section Siao-ya, parties V et VI.
[109] Section Koueh-foung, partie XIII, ode 2.
[110] Li-ki, chap. X; et Calleri, dans les Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, 2e série, t. XV. p. 66, et le texte chinois, p. 33.—Voyez également Li-ki, chap. XIX (Libr. cit., p. 117).
[111] Chine, p. 44.
[112] Voyez, pour plus de détails, mon introduction à l’Enseignement des Vérités, du philosophe japonais Kaubau Daï-si (texte et traduction), p. XI.
[113] Li-ki, chap. III, et Calleri, dans les Mem. della R. Acad. delle Scienze di Torino, t. XV, p. 9.
[114] Li-ki, ch. X, et Calleri, dans les Mem. della Acad. delle Scienze di Torino, t. XV, p. 66.
[115] Territoire actuel de Si-ngan fou, dans la province de Chen-si.
[116] Voyez Chi-king, section Koueh-foung, partie VII, pièce 7.
[117] Ibid., partie X (chants des Tang), pièce 11.
[118] Voyez notamment le Chi-king, section Koueh-foung, partie IV (chant de Young), pièce 1.
[119] Liber carminum, édit. J. Mohl, p. 254.
[120] Li-ki, chap. XVI, et Calleri, dans les Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, 2e série, t. XV, p. 107.
[121] Li-ki, chap. XV, et Calleri, dans les Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, 2e série, t. XV, p. 79.
[122] Il y aurait bien quelques restrictions à faire, notamment en ce qui concerne les membres de la famille impériale, les descendants de la famille de Confucius, etc. Il me paraît inutile de m’y arrêter ici.
[123] Le fondateur de cette dynastie, Taï-tsou (960 de notre ère), abolit la charge de grand historiographe et constitua, dans le sein de l’Académie des Han-lin, un tribunal chargé de composer l’histoire officielle de l’empire.
[124] Dans mes Conférences sur l’Ethnographie de la race Jaune, faites au Collège de France pendant les années 1869 et 1870. J’espère publier un jour ces conférences, qui ont été recueillies par la sténographie.
[125] Chi-king, section Ta-ya, partie III, pièce 10, in fine.
[126] On rapporte que le fondateur de la dynastie des Ming, scandalisé de ce que Mencius avait qualifié de bandit le prince qui n’a point de respect pour les représentations de ses ministres, ordonna que ce philosophe fût dégradé et que sa tablette commémorative fût enlevée du panthéon des lettrés. Il défendit, en outre, que qui que ce soit se permît de lui faire des représentations au sujet de cette décision souveraine.
Un lettré nommé Tsien-tang se décida cependant à contrevenir à l’ordre exprès de l’empereur, et à s’exposer à la mort pour la mémoire du grand moraliste de Tsou. Il rédigea donc une requête, et, dans l’intention de la remettre à son prince, il se rendit au palais impérial, précédé de son cercueil.
Dès qu’il eut déclaré le motif de sa visite, un garde lui décocha une flèche pour le châtier de son insolence. L’empereur, auquel on remit néanmoins la requête, la lut attentivement, ordonna que la blessure du courageux lettré fût soignée au palais même, et décida que Mencius serait réintégré dans les titres qu’il lui avait enlevés.
Plus d’un souverain chinois s’est fait gloire de faciliter aux censeurs le soin de lui adresser des remontrances. On cite un empereur qui parfumait les requêtes de ses ministres et se lavait les mains avant de les toucher, prétendant qu’il était bon de se préparer à recevoir des vérités qui ne sont pas toujours agréables à entendre; et, s’adressant à un de ses ministres, il lui disait: «Ménage mon peuple, mais ne crains pas de ne point me ménager moi-même. Il vaut mieux que j’aie cent fois à rougir que d’être cause qu’il coule une seule larme.»
L’histoire de Chine est remplie de faits de ce genre, qui formeraient aisément la matière d’un volume tout entier.
[127] Youen-kien-loui-han, cité par Pauthier, Chine, t. II, p. 136.
[128] Siouen-wang, roi de Tsi, adressa à Mengtsze cette question: «On rapporte que le fondateur et premier roi de la dynastie des Chang (1783 avant notre ère), Tching-tang [détrôna et] envoya en exil le roi Kie (de la dynastie des Hia, et que Wou-wang) (fondateur de la dynastie des Tcheou, 1134 avant notre ère) mit à mort Tcheou (dernier prince de la dynastie des Chang). Est-ce possible?»
Mengtze répondit: «Dans l’histoire, cela est rapporté.»
Le roi lui dit: «Est-il donc permis à un sujet de tuer son prince?»
Mengtze répondit: «Celui qui vole [les droits de] l’humanité, on l’appelle un voleur; celui qui vole la justice, on l’appelle un scélérat. Or un voleur, un scélérat, n’est qu’un individu ordinaire [et nullement un prince]. J’ai entendu dire que [Tching-tang] avait tué un individu appelé Tcheou; mais je n’ai jamais entendu dire qu’il ait tué son prince.»
[129] Cette opinion était celle du poète Sou Toung-po, auquel on doit un célèbre commentaire du livre de Laotsze, publié sous le titre de Tao-teh king kiaï.
[130] Voy., dans la Biographie universelle de Michaud, art. CONFUCIUS, seconde édition, p. 31.
[131] Un savant sinologue anglais, M. John Chalmers, a écrit: «Je me hasarde à appeler Laotsze le philosophe de la Chine, parce que si Confucius a obtenu une plus grande réputation, il le doit bien plus aux circonstances qu’à la profondeur de sa pensée.» (The speculations of «the Old Philosopher», translated from the Chinese, London, 1868, introd., p. VII.)
[132] Cet ouvrage a été traduit en français par Stanislas Julien, et publié, avec la reproduction du texte chinois, à l’Imprimerie Royale de Paris, en 1842.
[133] Voy., pour plus de détails, mon article Taosséisme, dans le Dictionnaire général de la Politique, de M. Maurice Block, t. I, p. 991.
[134] Cet ouvrage est très répandu au Japon, où il compte de nombreux admirateurs. En l’an 847 de notre ère, le mikado Nin-myau Ten-wau en entendit la lecture dans son palais.
[135] Malgré les difficultés exceptionnelles que présente l’intelligence de ce chapitre initial du Nan-hoa-king, j’ai essayé d’en donner une traduction française qui a paru, avec un commentaire, dans mes Textes chinois anciens, pp. 73 et suiv.
[136] Suivant le Sse-wou-ki-youen, l’usage de l’encre et de la pierre à broyer remonterait, ainsi que les caractères chinois, au règne de l’empereur Hoangti (XXVIIe siècle avant notre ère); mais il n’y a pas à s’arrêter à cette opinion fondée sur la présence des signes désignant l’encre et les pinceaux dans les ouvrages de l’antiquité. Il paraît avéré que ce fut seulement sous la dynastie des Tang (618 à 906 de n. è.) qu’on commença à faire usage d’encriers fabriqués en terre cuite. La plus ancienne encre de Chine fut fabriquée avec de la terre noire, ainsi que l’indique le caractère meh qui signifie «encre». Plus tard, on fit usage de noir de fumée, auquel on ajouta divers ingrédients et des substances aromatiques.
Quant aux pinceaux, on rapporte qu’ils ont été inventés sous la dynastie des Tsin, bien que quelques auteurs soutiennent que l’empereur Chun (XXIIIe siècle avant n. è.) fut le premier à en répandre l’usage chez les Chinois (voy. l’encyclopédie San-tsaï-tou-hoeï) et que le système de leur fabrication seulement fut perfectionné sous les Tsin. Suivant le Wou-youen, Fouhhi traça des caractères avec du bois; Hoangti remplaça le bois par des couteaux et Chin-noung par des pinceaux. L’usage des encriers aurait été introduit par Tchoung-yeou, et celui du papier à écrire par Tsaï-lun. Sous les Han, les Weï et les Tang, les pinceaux étaient faits avec du poil de rat; puis on employa le poil de renard pour donner plus de résistance à la partie intérieure. Enfin Tchang-hoa, sous les Tçin, fabriqua les pinceaux avec du poil de cerf.
Dans les temps les plus reculés, on traçait les caractères sur des tablettes de bambou; plus tard, on leur substitua des tissus de soie. C’est ce qui fait que le signe chinois qui désigne le «papier» est tracé avec la figure de «la soie». L’emploi de l’écorce d’arbre date de Tsaï-lun, de Koueï-yang, qui vivait sous le règne de l’empereur Hoti, de la dynastie des Han (89 à 105 de n. è.).
Au Japon, l’introduction du papier à écrire date du règne du mikado Sui-ko (593 à 628), auquel une ambassade avait été envoyée du royaume de Kao-li (en Corée) avec des présents. Mais ce papier manquait de solidité et était constamment piqué par les insectes. Le prince héréditaire imagina alors de se servir du mûrier noir (Broussonetia), qui continua depuis lors à servir de matière première pour la fabrication du papier japonais.
[137] Nous ne possédons notamment qu’une traduction d’un abrégé du Li-ki, le quatrième des livres sacrés.
[138] Le Tao-teh King ou Livre de la Voie et de la Vertu.
[139] Le Yih-king a été traduit en latin sous ce titre: «Y-king, antiquissimus Sinarum liber quem ex latina interpretatione P. Regis aliorumque ex Soc. Jesu P. P. edidit Julius Mohl» (Stuttgartiæ, 1834, deux vol. in-12).—Au moment où m’arrivent les épreuves de cette conférence, je reçois une nouvelle traduction du Yih-king due à l’éminent sinologue anglais, M. James Legge. Elle forme le tome XVI des Sacred books of the East, publiés sous la direction de M. Max Müller (London, 1882, un vol. in-8º.)
[140] Il existe plusieurs traductions du Chou-king. La plus ancienne porte le titre de: Le Chou-king, un des livres sacrés des Chinois, qui renferme les fondemens de leur ancienne histoire, traduit et enrichi de notes par le P. Gaubil; revu, corrigé et accompagné de nouvelles notes et de planches par de Guignes. Paris, 1770, in-4º.—Depuis cette époque, une nouvelle traduction de cet ouvrage a paru en anglais: Ancient China. The Shoo-king, or the historical classic, being the most authentic record of the Annals of the Chinese empire: illustrated by later commentators; translated by Medhurst. shanghae, 1846, in 8º.—Enfin M. James Legge nous en a donné une savante traduction, accompagnée du texte original et de nombreux commentaires, dans sa belle collection des Chinese Classics (Hong-kong, 1865, in-8º).
[141] Le Chi-king a été traduit en latin par le P. Lacharme et en anglais par M. James Legge. Il n’en existe qu’une traduction partielle en français, rédigée par Pauthier, d’après la version de Lacharme.
[142] Il n’existe jusqu’à présent qu’une traduction d’un abrégé du Li-ki. Elle a été rédigée en français par l’abbé Callery et insérée dans les Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, 2e série, t. XV.
[143] Traduit en français par Edouard Biot (Paris, 1851, deux vol. in-8).
[144] Traduit en anglais par M. James Legge, dans sa collection des Chinese Classics, vol. V.
[145] Cet ouvrage n’a pas encore été traduit dans une langue européenne.
[146] Suivant une légende insérée dans la Vinaya.
[147] Et non en l’an 64, comme le disent les Mémoires concernant les Chinois, t. V. p. 51.
[148] Ni-hon Syo-ki, liv. XIX, p. 25.
[149] Allusion à une expression du style bouddhique que l’on rencontre dans les Dharmas, et notamment dans la traduction chinoise du Lotus de la Bonne Loi.—Voy. mes Textes chinois anciens et modernes traduits en français, p. 53.
[150] Ni-hon Syo-ki, livr. XIX, p. 26.
[151] Ni-kon Syo-ki, liv. XIX, p. 27.
[152] «Nandi hitori bup-pauwo okonahe to ynrusi tama’u» (Nippon wau dai iti-ran liv. I, p. 27).—Hoffmann n’est pas absolument exact quand il dit: «Um diese Zeit wurde der Buddhacultus auf Japan begründet» (Archiv zur Beschreibung von Japan, part. V, p. 4) Le Bouddhisme ne fut définitivement établi au Japon que sous le règne de Yô-mei (586-587 de notre ère).
[153] Voy. p. 232, note 1.
[154] Hoffmann, dans les Archiv zur Beschreibung von Japan, de Siebold, part. V, p. 5.
[155] Et non la 28e année de Souiko (620), comme le rapporte Kæmpfer.—Suivant quelques auteurs, il vécut quarante-neuf ans. (Nippon wau-dai iti-ran, liv. I, p. 30); suivant d’autres, trente ans seulement (Mitukuri, Sin-sen nen-hyau, ann. 621).
[156] Eugène Burnouf, Introduction à l’histoire du Buddhisme indien, p. 441.
[157] Le célèbre voyageur Ph.-Fr. von Siebold a soutenu, d’après ses entretiens avec des savants japonais qu’il avait eu pour élèves en médecine, que, dans les classes éclairées, le Bouddhisme repose au Nippon sur tout un système de doctrines profondes et abstraites, que l’Orient n’a jamais su dépasser. (Voy., pour plus de détails à ce sujet, mes Etudes asiatiques, p. 323.)
[158] Voy., sur le Bouddhisme japonais et sur l’école en voie de formation du Néo-Bouddhisme, les Mémoires du Congrès international des Orientalistes, session de Paris, 1873, t. I, p. 142, et mon article dans la Revue scientifique, 2e série, t. VIII, p. 1068.
[159] Voy., à ce sujet, mes Textes chinois anciens, p. 67.
[160] Zitu-go kyau, Dô-zi kyau, l’Enseignement des Vérités et l’Enseignement de la Jeunesse, traduits du japonais par Léon de Rosny. Paris, 1878, in-8.
[161] Voy. ma traduction du Dô-zi kyau p. 53 (v. 77-78).
[162] Les personnes qui voudraient cependant connaître les indications recueillies par les voyageurs sur les idées des bouddhistes japonais pourront lire, entre beaucoup d’autres ouvrages, Fraissinet, Le Japon, t. II, p. 209; Humbert, Le Japon illustré, t. I, p. 245; Bousquet, Le Japon de nos jours, t. II, p. 79.
[163] Voy., sur cette secte d’origine chinoise, la savante brochure de M. J. Edkins, intitulée: Notice of Chi-kai and the Tian-tai School of Buddhism. Shanghae, in-8º.
[164] Je m’abstiens de parler des sectes de Hosyau, de Gousya et des trois grandes écoles qui furent constituées, plus tard, sous les noms de Yodo, Mon-tau et Syau-retu, les renseignements que j’ai rencontrés à leur sujet ne me paraissant pas avoir la précision nécessaire pour être reproduits dans cette conférence.
[165] Voy., pour plus de détails, la traduction du Ni-hon Gwai-si, de M. Ogura Yemon, dans les Mémoires de la Société des Études Japonaises, t. II, p. 1 et suiv.
[166] Yoritomo mourut en 1199, à l’âge de cinquante-trois ans; il avait gouverné l’empire pendant vingt années consécutives.
[167] Voy., sur ces princes, ma Chronologie japonaise, reproduite à la suite de mes Thèmes faciles et gradués pour l’étude de la langue Japonaise, p. 65.
[168] L’empereur ou mikado est désigné par une foule de titres différents: suberaki (Cf. sumera-mikoto), ten-si «Fils du Ciel», ten-wau «autocrate du Ciel», kwau-tei «autocrate empereur», zyau-wau «saint-autocrate», si-son «le respectacle suprême», siu-zyau «le haut maître», sei-zyau «le haut saint», seï-tyau «la sainte cour», etc. Le titre du suberaki, suivant les Japonais, date de l’origine de leur monarchie, celui de tei ou mikado a été emprunté à la Chine où il remonte au personnage semi-fabuleux appelé Fouh-hi; celui de kwau-tei, également d’origine chinoise, date de Tsin-chi Hoang-ti, le fameux autocrate de la dynastie de Tsin, dont j’ai eu déjà l’occasion de parler; celui de ten-si vient de l’empereur de Chine Chin-noung; celui de zyau-wau a été employé pour la première fois en s’adressant à l’empereur Kouang-wou, de la dynastie des Han (Ier siècle de notre ère). Une autre appellation du souverain, hei-ka, c’est-à-dire «celui qui a ses ministres aux pieds de son trône», est due à Li-sse, ministre de l’empereur de Chine, Tsinchi Hoangti. Kin-rin-zyau-wau «le saint autocrate de la roue d’or» signifie aussi «l’empereur».
Les mikados antérieurs au mikado actuel n’apparaissaient dans les grandes audiences que cachés derrière un store, la partie inférieure de leur robe étant seule visible pour les grands seigneurs admis à pénétrer dans le sanctuaire impérial.
L’empereur qui a abdiqué s’appelle Sen-tô «la caverne des immortels» ou daï-zyau ten-wau «le très haut autocrate céleste». Il ne se présente également que caché derrière un store. Ce second titre a été conféré pour la première fois, en l’an 703, par l’empereur Monmou à l’impératrice Dzitô qui l’avait précédé sur le trône.
L’impératrice est désignée sous le nom de kisaki ou ki-sai-no-mya «le palais de l’épouse de l’autocrate», ou kwau-kô-gû, nom emprunté à l’époque de Tsinchi Hoang-ti, ou gyoku-tau «la salle de jade», seô-ï «l’enclos poivré», etc.
[169] C’était le mikado qui envoyait au syaugoun la coiffure ou couronne, ainsi que tous les vêtements insignes de sa dignité. Le go-taï-rau, les ministres, tous les daïmyaux, les ambassadeurs (notamment ceux qui furent envoyés en 1862 dans plusieurs contrées de l’Europe), les docteurs eux-mêmes reçoivent leurs titres du mikado. On reconnaissait à ce dernier le droit de créer de nouveaux daïmyaux, mais le syaugoun s’était arrogé le privilège de doter seul, et suivant son caprice, de domaines territoriaux ceux qui auraient été l’objet de la faveur impériale.
[170] Lorsque le commodore Perry vint demander, au nom des États-Unis d’Amérique, à conclure un traité avec le Japon (1852-54), le syaugoun Iye-sada ne crut pas pouvoir se dispenser de consulter le mikado. Celui-ci se borna à lui répondre: «Impossible». Le syaugoun passa outre.
[171] L’héritier présomptif du mikado est appelé tai-si «grand fils», tô-kû «palais du printemps», sei-kû «palais vert», seô-yau «le petit soleil», ryau-rô «le pavillon du dragon», etc.—Le premier empereur du Japon, Zinmou, fut élevé au titre de tai-si, dit l’histoire. Les critiques en concluent que l’empire japonais était déjà constitué antérieurement, et ils lui donnent pour prédécesseur Fuki-awasezu, dont il était le quatrième fils.
Les princes impériaux ou sin-wau sont également nommés diku-yen «le jardin des bambous», ren-ti «l’étang des nénuphars», tei-yau «la feuille impériale», ten-ti «la branche céleste», etc., etc. Beaucoup d’entre eux entrent en religion et s’appellent dès lors Hau-sin-wau.
[172] On désigne sous le nom de Ku-gyau, les trois premiers rangs de fonctionnaires de la cour, savoir: les Ses-syau, les Kwan-baku et les San-ku. Dans le Tcheou-li ou Rituel des Tcheou, on cite trois ku et six gyau. Les fonctionnaires des trois premières classes étaient appelés gek-kei «seigneurs de la lune», ceux de la quatrième et de la cinquième classe un-kaku «hôtes des nuages».
[173] Aussi désignés sous le nom chinois d’origine kwau-mon «la Porte Jaune».
[174] Avant la révolution de 1868, les trois principaux d’entre eux, appelés go san-ke, étaient les princes de Owari, de Kisiou et de Mito. Leur puissance venait surtout de leurs liens de parenté avec le syaugoun. Le prince de Satsouma était également considéré comme un des plus puissants koku-si du Japon; il prétendait à une certaine indépendance, en sa qualité de suzerain des îles Loutchou. Dans les derniers temps, on lui avait inspiré la pensée de se faire reconnaître comme roi de cet archipel, et il fut admis sous ce titre à participer à l’Exposition Universelle de Paris, en 1867.—Les autres daïmyaux qui jouaient le plus grand rôle dans les événements du Japon, étaient ceux de Hizen, de Ohono, de Uwazima, de Tosa, de Awa, de Tsikouzen et de Wakatsou; c’étaient également les princes qui s’étaient le plus initiés aux idées et à la civilisation de l’Europe et de l’Amérique—L’existence de Koku-si date du règne de Kwaugok (Voy. le Syo-gen-zi-kau).
[175] L’aîné des fils des daïmyaux était appelé à lui succéder; ses autres fils pouvaient devenir à leur tour daïmyaux, si l’un des daïmyaux régulièrement titré venait à mourir sans laisser d’héritier. Si l’aîné ou héritier présomptif mourait, le second fils le remplaçait et ainsi de suite. En cas de démence ou d’insanité, le droit de l’aîné passait également à son frère cadet.
[176] Voyez mes Archives paléographiques de l’Orient et de l’Amérique, t. I, p. 233.
[177] On peut consulter sur l’alphabet coréen, mon Aperçu de la langue Coréenne extrait du Journal asiatique de 1864, et mon Vocabulaire Chinois-Coréen-Aïno, expliqué en français et précédé d’une Introduction sur les écritures de la Chine, de la Corée et de Yezo, dans la Revue orientale et américaine, première série, t. VI, p. 261.
[178] Voy., sur l’écriture antique des Japonais, les Mém. du Congrès international des Orientalistes (première session, Paris, 1873, p. 229), et mes Questions d’Archéologie japonaise (dans les Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. IX, 1882, p. 170 et sv).—C’est aux difficultés de tout genre que présente l’écriture japonaise qu’il faut attribuer surtout l’ignorance où sont restés pendant longtemps les orientalistes au sujet de la langue et de la littérature du Nippon. Tous les anciens missionnaires qui ont traité de la grammaire japonaise se sont abstenus d’expliquer le système de ses alphabets, et, pour expliquer ce silence, l’un d’eux, le P. Oyangeren, n’a pas hésité à écrire que ces alphabets étaient une «œuvre du démon imaginée pour augmenter les peines des ministres du saint Évangile.» (Voy., mon Discours prononcé à l’ouverture du Cours de Japonais, Paris, 1863, p. 8.)
[179] Le titre de cet ouvrage a été interprété de plusieurs manières différentes par les commentateurs indigènes. Suivant l’un, le mot yeô «feuille» y serait synonyme de yo «âge» et de dai «règne»; et comme man, vulg. «dix mille», signifie «un nombre immense, indéfini», il faudrait traduire la «Collection de tous les siècles». Je préfère cependant l’interprétation des auteurs qui identifient ici yô avec ka «poésie», et je crois devoir traduire «le Recueil des innombrables poésies».
[180] D’après le Gun-syo iti-ran, liv. IV, p. 1.—Je regrette de n’avoir pu me procurer que quelques fragments de ce très intéressant ouvrage, dans lequel j’aurais trouvé, sans doute, de précieuses indications bibliographiques sur le sujet qui m’occupe en ce moment.
[181] Oho-tomo-no Sukune Yaka-moti—Voy. les raisons qui lui ont fait attribuer la composition du Man-yô siû, dans la préface de l’édition Ryak-kai, préface que j’ai traduite dans mon Anthologie Japonaise, p. 6.
[182] Pfizmaier, Ueber einige Eigenschaften der japanischen Volkspoesie, et dans les Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Wien, t. VIII, 1852, p. 377.
[183] Rosny, Anthologie Japonaise. Paris, 1871, part. 1.—Cinq pièces du Man-yô siû ont été, en outre, publiées en français par M. Imamura Warau, avec le texte original, dans les Mémoires du Congrès international des Orientalistes, première session, Paris, 1873, t. 1, p. 273.
[184] Je mettrai prochainement sous presse la traduction de cet ouvrage, avec un parallèle du Ko zi ki, dans le recueil des Publications de l’École spéciale des langues orientales (Ernest Leroux, éditeur, à Paris). En attendant, un spécimen des travaux d’exégèse et de critique entrepris sur le Ko zi ki paraîtra à la même librairie dans un volume intitulé: Recueil de Mémoires publiés par les professeurs de l’École spéciale des Langues Orientales.
[185] Le plus court des Sse-chou, ou Quatre livres de Confucius et de son Ecole, a été publié en chinois, avec une version japonaise interlinéaire, par Hoffmann, sous ce titre: De Groote Studie. Leiden, 1864, in 8º.
[186] Je compte publier une traduction de ce livre, accompagnée de nombreux extraits des commentaires chinois et japonais que j’ai eu d’ailleurs plusieurs fois l’occasion d’expliquer à mes élèves de l’École spéciale des Langues Orientales.
[187] Cet ouvrage a été traduit d’après la version japonaise par Hoffmann, et publié sous ce titre: Tsiæn-dsü-wœen oder Buch von tausend Wœrtern, aus dem Schinesischen mit Berücksichtigung der koraischen und japanischen Uebersetzung, in Deutsche uebertragen, von Dr J. H. Leiden, 1840, gr. in-4.
[188] Il n’a été publié jusqu’à présent, en fait de traductions d’ouvrages bouddhiques japonais, que celle du recueil d’images intitulé Butu-zau du-i. Elle a paru dans les Archiv zur Beschreibung von Japan, du Dr Ph.-Fr. von Siebold, part. V, et, à part, sous le titre de: Das Buddha-Pantheon von Nippon. Aus dem japanischen Originale übersetzt, und mit eræuternden Anmerkungen, versehen von Dr J. Hoffmann. Leiden, 1851, gr, in-4.
[189] Zitu-go kyau, Dô-zi kyau. L’Enseignement des Vérités et L’Enseignement de la Jeunesse, traduits du japonais, par Léon de Rosny. Paris, 1878, in-8 (ouvrage accompagné du texte original en écriture chinoise cursive et d’une version en langue japonaise vulgaire, transcrite en caractères hira-kana et en lettres latines).
[190] J’ai donné, pour la première fois, je crois, un spécimen de cet étrange système de lecture des textes bouddhiques au Japon, dans mes Textes Chinois anciens et modernes, pp. 67 et suiv.
[191] Un spécimen de cette édition, qui n’a d’ailleurs de mérite que sa rareté pour les bibliophiles, a été publié par l’autographie sous ce titre: Évangiles de saint Jean en japonais, conservés à la Bibliothèque impériale de Paris. Spécimen, suivi de l’alphabet katakana, avec lequel le texte est imprimé. Paris, 1853, in-8.
[192] Dans les Mémoires de la Société des études Japonaises, t. II, p. 135; voy. également Mitford, Tales of old Japan, t. II, p. 136.
[193] J’ai appris depuis que la traduction du Testament d’lyéyasou avait été publiée au Japon, en 1874, par M. Lowder. Son travail est, je crois, tout a fait inconnu en Europe. On en trouvera une analyse dans les Transactions of the Asiatic Society of Japan, 1875, t. III, p. 131.
[194] Wa nen kei, oder Geschichtstabellen von Japan, von Zin-mu, der Eroberer und ersten Mikado, bis auf die neueste Zeit (667 vor Chr. bis 1822 nach Chr. Geb.), aus dem Original übersetzt, von Dr J. Hoffmann. [Leiden, s. d.], in-4.
[195] Un vol. in-4, s. l. n. d. Cette chronologie se termine avec l’année 1863.
[196] Un fragment de ce livre a été publié en français, sous ce titre: La Mythologie des Japonais, d’après le Koku-si ryaku ou Abrégé des historiens du Japon. Traduit pour la première fois, sur le texte japonais, par Émile Burnouf, élève de l’École spéciale des Langues Orientales. Paris, 1875, in-8.
[197] Cette traduction, d’ailleurs très défectueuse, a été publiée par Klaproth, qui avait supposé à tort que la connaissance du chinois lui suffirait pour corriger toutes les imperfections du travail hollandais. Elle est intitulée: Annales des empereurs du Japon, traduites par Isaac Titsingh. Ouvrage revu, complété et corrigé sur l’original japonais-chinois, accompagné de notes et précédé de l’histoire mythologique du Japon par J. Klaproth. Paris, 1834, in-4.
[198] Histoire des Taïra, tirée du Nit-pon gwai-si, traduit du chinois, par François Turettini Genève, 1874, in-4.—Histoire indépendante du Japon, traduite en français par M. Ogura Yemon, dans les Mémoires de la Société des études Japonaises. Paris, 1878, t. II. pp. 1 et suiv.
[199] Comme spécimen de cette œuvre remarquable à plus d’un titre, j’ai publié la traduction du chapitre premier, sous le titre de Histoire de la Grande Paix, traduite pour la première fois du japonais, par Léon de Rosny, dans le Lotus, nº de janvier-février 1873. Le texte de ce premier chapitre a été reproduit dans mon Recueil de textes japonais, à l’usage des élèves de l’École spéciale des langues orientales. Paris, 1863, p. 41.
[200] Le commencement de cet ouvrage a été traduit en français sous le titre suivant: Récits de l’histoire du Japon au XIIe siècle, traduits du japonais, par François Turettini. Partie I. Genève, 1871. in-4.
[201] Rosny, L’Enseignement des Vérités, Introduction, p. VII.
[202] Le San-koku du-ran to-setu, publié en français par Klaproth, sous ce titre: Aperçu général des Trois Royaumes. Ouvrage accompagné de cinq cartes [japonaises]. Paris, 1832, in-8.
[203] J’ai traduit un fragment de l’une d’elles, intitulée Te-siho nis-si, dans les Mémoires du Congrès international des Orientalistes, première session. Paris, 1873, t. I, p. 208.—Parmi une foule d’autres ouvrages intéressants sur les Aïnos ou hommes velus (mau-zin), on pourra consulter avec fruit les suivants qui sont parvenus jusqu’en Europe: Kita Yezo yo-si, Histoire sommaire du Yézo septentrional; Higasi Yezo ya banasi, récit pour passer la soirée sur les Yézo de l’Est; Tô Ka-i nis-si Journal du Yézo oriental; Kita Yezo du-setu, récit avec figures du Yézo du Nord; Hoku-kai ki-kau, Description géographique du Yézo; etc.
[204] Un fragment d’un de ces ouvrages a été publié par J. Hoffmann, dans les Archiv zur Beschreibung von Japan, du Dr Siebold.
[205] Notamment le Tiu-san den sin-roku, important ouvrage orné de planches et publié en 1722, en 6 tomes in-4; et le Riu-kiu koku-si ryaku ou Abrégé des historiens de Loutchou.
[206] Appelé au Japon Hon-zau.
[207] Japanese Botany, being a fac-simile of a Japanese book, with introductory notes and translations. Philadelphia, s. d., in-8;—des extraits du Kwa-ï, dans Die Sprache in den botanischen Werken der Japaner, von Dr Aug. Pfizmaier. Wien, 1866, in-8;—des notices extraites de diverses sources et traduites par Léon de Rosny, dans les Mémoires de l’Athénée Oriental, in-4, t. I, 1871, p. 123;—etc.
[208] Dans l’introduction de mon Traité de l’éducation des Vers à soie au Japon, édit. du gouvernement, p. LVII.—Quelques articles sur l’agriculture et l’industrie des Japonais ont été traduits par divers orientalistes: Les procédés industriels des Japonais: L’arbre à Laque, notice traduite par Paul Ory, élève de l’École spéciale des Langues Orientales; La toile de Kudu, notice traduite par le comte de Castillon; et L’arbre à Champignons, notice traduite par le même, dans les Mémoires de la Société des études Japonaises, t. II, pp. 165 et 173.
[209] Thesaurus linguæ Japonicæ, sive illustratio omnium quæ libris recepta sunt verborum ac dictionum loquelæ tam japonicæ quam sinensis; addita synonymarum literarum ideographicarum copia; opus Japonicum, in lapide exaratum a sinensi Ko tsching dschang, editum curante Ph. Fr. de Siebold Lugduni-Batavorum, 1835, gi. in-4.
[210] Repertorio Sinico-Giapponese. Parte prima. Registro alfabetico delle voci contenute nel Wa Kan won seki Sijo ken si kau, Setu you siu, e nel compendio di esso Faya fiki yei tai setu you siu. Firenze, 1855, in-4. Ce travail de patience est l’œuvre de M. Antelmo Severini, et d’un des élèves les plus distingués de ce savant professeur, M. Carlo Puini.
[211] Dans les Mém. de la Société des études Japonaises, t. II, p 190.
[212] Notamment les suivants: Mosiwo-gusa, Manuel de la langue aïno;—Zi-rin gyoku-ben, grand dictionnaire de la langue chinoise et une foule d’autres livres pour l’étude de l’écriture idéographique de la Chine;—Sen-zi-mon, le Livre de mille caractères, en chinois, en coréen et en japonais;—Si-tvan mata-tei-bun, Traité de l’écriture sacrée de l’Inde; Sit-tan gu-seô, Exposé élémentaire du syllabaire attribué à Brahmâ (sanscrit: Siddha); etc.
[213] Les Japonais possèdent depuis longtemps des dictionnaires pour l’étude du hollandais, du russe, de l’anglais, du français, et plus récemment de l’allemand et du portugais.
[214] Anthologie japonaise. Poésies anciennes et modernes des insulaires du Nippon, traduites en français et publiées avec le texte original, par Léon de Rosny; avec une préface par M. Ed. Laboulaye, de l’Institut.
[215] Hyaku-nin is-shiu, or Stanzas by a century of poets, being Japanese Lyrical Odes, translated into english, by F.-V. Dickins. London, 1866, in-8.
[216] Sechs Wandschirme in Gestalten der vergænglichen Welt. Ein japanischer Roman in Originaltexte, übersetzt und herausgegeben von Dr August Pfizmaier, Wien, 1847, in-8.—Une nouvelle traduction de cet ouvrage a été publiée en italien, sous ce titre: Uomini i paraventi, racconto giapponese, tradotto da A. Severini. Firenze, 1872, in-32.—Enfin une version française: Komats et Sakitsi ou la Rencontre de deux nobles cœurs dans une pauvre existence. Nouvelles scènes de ce monde périssable exposées sur six feuilles de paravent, par Riutei Tanehiko, et traduites, avec le texte en regard, par F. Turettini. Genève, 1875, in-8.—L’École spéciale des langues orientales de Paris a eu l’honneur de compter MM. Ant. Severini et Fr. Turettini, au nombre de ses élèves les plus distingués.
[217] Tales of old Japan. By A.-B. Mitford. London, 1871, 2 vol. in-8; Tami-no Nigivai, L’activité humaine, contes moraux. Texte japonais transcrit et traduit par Fr. Turettini. Genève, 1871, in-4.
[218] Discours prononcé à l’ouverture du Cours de Japonais, le 5 mai 1863, p. 24.
[219] Un ouvrage de numismatique a paru sous ce titre: Traité des monnaies d’or au Japon, traduit pour la première fois du japonais par François Sarazin, élève de l’École spéciale des langues orientales (Paris, 1874, in-8º).
[220] On trouvera des extraits de la grande Encyclopédie japonaise dans les publications de Klaproth, de Hoffmann, de Pfizmaier et dans les miennes. La partie relative au Bouddhisme a été traduite par M. Carlo Puini, et la Zoologie par M. Serrurier.
[221] J’ajouterai ici la mention de quelques publications japonaises qui me sont parvenues depuis que cette conférence a été publiée pour la première fois, et qui me paraissent de nature à intéresser les élèves de l’Ecole spéciale des Langues Orientales: Die Lehre von dem Te-ni-wo-fa, von Dr. Aug. Pfizmaier. Wien, 1873;—Kau-kau wau-rai, ossia la Via della pietá filiale, testo giapponese trascritto in caratteri romani e tradotto in lingua italiana, con note ed appendice, da Carlo Valenziani. Roma, 1873;—Zur Geschichte Japans in dem Zeitraume Buu-jei, von Dr. Aug. Pfizmaier. Wien, 1874;—Die Geschichte der Mongolen-Angriffe auf Japan, von Dr. Aug. Pfizmaier. Wien, 1874;—Les produits de la nature chinoise et japonaise, par A.-J.-C. Geerts. Yokohama, 1878;—Le curiositá di Jocohama. Testo giapponese trascritto e tradotto da A. Severini. Firenze, 1878;—La ribellione di Masacado e di Sumitomo, brano di storia giapponese, tradotto da Lodovico Nocentini. Firenze, 1878;—Il Take-tori monogatari, ossia la Fiaba del nonno Tagliabambù. Testo di lingua giapponese del nono secolo, tradotto, annotato e pubblicato per la prima volta in Europa, da A. Severini. Firenze, 1881;—Jasogami e Camicoto, da Ant. Severini. Firenze, 1882.
[222] Vers le milieu du XVIe siècle.
[223] Voy., sur les mathématiques des Japonais, l’article de M. le capitaine Levallois, dans les Mémoires du Congrès international des Orientalistes, première session, Paris, 1873, t. I, p. 289.
[224] Le moxa des Japonais est composé avec la bourre des feuilles de l’armoise (Artemisia vulgaris). Roulé en forme de pyramide, on le place sur la partie malade et on y met le feu, de manière à le consumer entièrement et à permettre aux humeurs de découler de la plaie qu’il a produite.
[225] Le Nederlansche Tijdschrift voor Geneeskunde, 1859-60.
[226] Les Japonais fabriquent des tissus de soie d’une foule de genres. On appelle nisiki un tissu qui était originairement obtenu par le mélange de soies de cinq couleurs différentes. Les vieilles annales intitulées Ni-hon gi rapportent que la 37e année du règne d’Au-zin (306 de n. è.), l’empereur envoya des ambassadeurs dans le royaume de Ou, en Chine, pour chercher des tisseuses; il vint quatre sortes d’ouvrières appelées Ye-bime, Oto-bime, Kurea-dori et Aya-dori. Telle fut l’origine de l’introduction du tissage de la soie au Japon.—On fait usage de fils d’or pour la fabrication des nisiki, sur lesquels on représente des fleurs et des animaux fantastiques.—Les soieries appelées aya se distinguent par leur finesse et leur légèreté; on en fait également venir une variété spéciale de la Chine; les tobi-zaya ou aya à fleurs sont plus épaisses et sont tirées de Canton et de la Corée.—Le rin-su ou damas de soie, d’une qualité supérieure, avec ou sans ornements, est un produit japonais; on en fait venir néanmoins du Tongkin.—Le satin appelé syusu est d’une beauté incomparable; on en teint de toutes couleurs; on en fait venir de Canton, de Nanking et du Fouhkien.—La gaze d’or (kin-sya) est d’invention chinoise. (Voy., pour plus de détails, les appendices de mon Traité de l’éducation des vers à soie au Japon). En dehors des soieries, les Japonais fabriquent une foule de tissus avec diverses sortes de matières végétales ou animales. L’indienne dite sarasa, que les indigènes allaient jadis acheter au Siam et qui, pour ce motif, s’appelle aussi Siamuro-zome, est devenue l’objet d’une grande industrie au Nippon;—le kwa-kwan-fu, tissé avec de longs poils de rat, est une étoffe sur laquelle on raconte des anecdotes fantastiques;—le ba-seo-nuno est une toile formée avec les fibres du bananier et qui vient des îles Loutchou; elle est belle, solide et reçoit très bien la teinture;—la mousseline sarasi est un produit de Nara, dans la province de Yamato, où l’on trouve la meilleure qualité; elle est d’ordinaire d’une extrême blancheur; l’abuya de Noto est également blanche et formée de fils de chanvre;—les cotonnades proprement dites se nomment momen, et le coton non tissé wata (ouate); la bourre de soie s’appelle aussi wata (ma-wata).
[227] Courrier de Lyon, février 1860
[228] Wa-kan San-sai du-ye, liv. XV, p. 4
[229] En chinois: tse-ming-tchoung «cloche sonnant d’elle-même».
[230] M. le docteur Mène, dans les Mémoires de la Société des Etudes Japonaises, t. III, p. 11.
[231] Kai-no tama «gemmes d’huîtres».
[232] Gin-tama.
[233] Kin-tama.
[234] Voy., sur les miroirs chinois et japonais: Julien et Champion, Industries anciennes et modernes de l’empire chinois, 1869, pp. 63 et 234; et la Revue scientifique, 2e série, 1880, t. XVIII, p. 1143.
[235] Jap. a’ugi. On rapporte que l’impératrice Zin-gû, à l’époque de la guerre des Japonais contre le pays des San-kan (Corée), vit des chauves-souris (jap. hen-puku) qui lui donnèrent l’idée de faire faire des éventails. Depuis cette époque, on a fabriqué des éventails de toutes sortes dont l’usage est répandu dans les différentes classes de la population indigène, aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes. On cite notamment les éventails peints appelés akome; les éventails qui ressemblent à une fleur à demi épanouie et dont se servent les bonzes et les mèdecins; les éventails des danseuses d’assez grandes dimensions; les éventails en bois de pin (hi a’ugi) en faveur chez les fonctionnaires publics; les écrans, de forme circulaire, nommés utiva, qui étaient les seuls éventails usités en Chine jusqu’à la dynastie des Ming. Le nom de uti-va leur vient de ce qu’ils sont assez forts et solides pour servir à battre (utu) les vêtements ou à écraser les insectes; on en fabrique avec du cuir ou des planchettes laquées, supportées par un manche de bambou; va désigne une sorte particulière d’écran, dont on fait usage à la cour.
[236] Les chapeaux de bambou (Jap. take-no ko-kasa) s’emploient, comme chez nous les chapeaux de paille, pour se garantir des rayons du soleil. On a tenté, non sans quelques succès, de les faire accepter dans les modes européennes. En Chine, ces chapeaux se fabriquent avec des joncs.—Les parasoles ou parapluies sont dits parasols de Chine (kara-kasa). On en fait remonter l’invention à l’époque de Yu-le-Grand (XXIIIe siècle avant notre ère); mais les véritables parapluies ne datent que du règne de Youen-ti, de la dynastie des Weï (260 de notre ère). On fabrique des parasoles de soie et surtout de papier huilé et impénétrable à la pluie; les principales manufactures se trouvent dans la province de Setu.
[237] Morning Chronicle, du 4 février 1858.
[238] On a pu en juger en visitant en 1878, à Paris, le département Japonais de l’Exposition universelle.
[239] Zipangu est une notation à peine corrompue des mots chinois Jih-pen-koueh «le royaume du Japon».—Rachid-Eddin, qui écrivait en 1294, désigne ce même pays sous le nom de Djemenkou, et Aboulféda sous celui de Djemkout.
[240] Nippon-wau dai itî-ran, livr. VII, p. 46.
[241] Saint François Xavier gagna le Japon à bord de la jonque d’un corsaire chinois. Il était accompagné d’un Japonais converti au christianisme et baptisé sous le nom de Paolo de Santa-Fe. Le hasard le fit aborder à Kago-sima qui était justement le lieu de naissance de ce Paolo. Il y fut accueilli avec enthousiasme, et le daïmyau régnant de Satsouma lui permit de faire des prédications dans toute l’étendue de son domaine. Sur l’instigation des bonzes, cette permission finit cependant par être révoquée, et le prince annonça qu’il était défendu à ses sujets, sous peine de mort, de se livrer aux pratiques du christianisme. François Xavier dut chercher dans d’autres parties du Japon les moyens de poursuivre son œuvre d’évangélisation.—Il n’est peut-être pas inutile de faire observer que, dans les récits des missions chrétiennes au Japon, non-seulement les grands princes feudataires, mais même les plus petits daïmyaux, sont qualifiés de l’épithète de roi. Et c’est par une erreur de ce genre qu’on parle souvent de l’ambassade envoyée au pape Grégoire XIII par «l’empereur du Japon». Cette ambassade, à laquelle on fit une réception pompeuse en Europe, représentait des princes féodaux de l’île de Kiousiou, et nullement le mikado ou son syaugoun.
[242] I-i Ka-mon-no Kami.
[243] Le mot mi-ka-do, par lequel on désigne l’Empereur, signifie littéralement «La Grand’porte Impériale». C’est là une des nombreuses analogies que l’on peut constater entre les Japonais et les Turcs (Sublime-Porte), dont l’idiome notamment appartient au même système grammatical.—Aujourd’hui, le titre de mikado est à peu près complètement abandonné; il a été remplacé par l’ancien titre de Ten-au «l’Auguste du Ciel».
[244] Comment on crée une religion, dans la Revue scientifique du 7 mai 1875.
[245] Gen-rau-in, sorte de Conseil des Anciens.
[246] Fu-ken kwai-gi, sorte de Conseil des Préfectures.