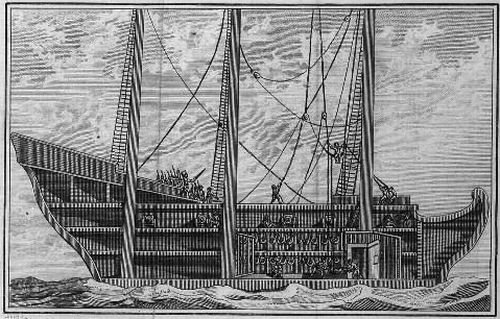VOYAGE
À CAYENNE.
TOME PREMIER.
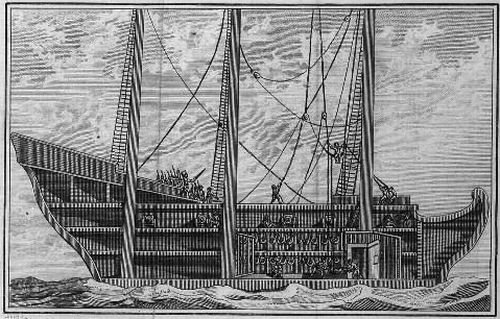
Prison des Déportés sur la Frégate la Décade.
Moment du départ. On hisse les Viellards et les Malades à bord.
L'entrepont a 30 pds. de large; 37 de long; 4½ de haut;
193 personnes y sont logées avec leur sac de nuit. Deux rangs de hamacs les uns
sur les autres sont soutenus de 3 pds. en 3 pds. par de
petites colonnes (les Époutilles), le tout est fermé par de grosses barres
de bois et par deux grosses portes de prison avec leurs verroux.
Le jour ne pénètre qu'à regret dans ce Monde.
VOYAGE À CAYENNE,
DANS LES DEUX AMÉRIQUES
ET
CHEZ LES ANTROPOPHAGES,
Ouvrage orné de gravures; contenant le tableau général des
déportés, la vie et les causes de l'exil de l'auteur; des
notions particulières sur Collot-d'Herbois et
Billaud-de-Varennes, sur les îles Séchelles et les déportés
de nivôse (an 8 et 9), sur la religion, le commerce et les
mœurs des sauvages, des noirs, des créoles et des
quakers.
SECONDE ÉDITION,
Augmentée de notions historiques sur les Antropophages, d'un
remercîment et d'une réponse aux observations de MM. les journalistes.
Par L. A. PITOU, déporté à Cayenne en 1797, et rendu à la liberté, en
1803, par des lettres de grâce de S. M. l'Empereur et Roi.
TOME PREMIER.
Prix, 7 fr. 50 c.
PARIS,
CHEZ L. A. PITOU, LIBRAIRE,
rue Croix-des-Petits-Champs, no 21, près celle du Bouloi.
Octobre 1807.
NOTICE DES LIVRES
DE L. A. PITOU,
Télémaque, 2 vol. in-8o.
Bossuet, 2 vol. in-8o.
La Fontaine, 2 vol. in-8o.
Jean Racine, 3 vol. in-8o.
Biblia sacra, 8 vol. in-8o.
Édition du Dauphin, de Didot aîné. Papier vélin, collection rare et
précieuse, reliée en maroquin, dorée sur tranche.
Voltaire, 70 vol., in-8, papier à 6 fr. avec figures, relié racine,
filets.
Rousseau de Poinçot, 38 vol. in-8, papier vélin, avec figures, relié
en veau dentelle, filets, tranche dorée.
Histoire de Russie, par Pierre-Charles L'Évêque, 8 vol. in-8, reliés
en veau, filet, avec un superbe atlas.
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 4e édition, de l'imprimerie de
Didot jeune. 7 volumes in-8, atlas in-fol.
On n'a tiré que cinquante exemplaires en papier d'Hollande. Celui-ci
est le trente-sixième.
Rollin, in-4, complet. Histoire ancienne, romaine, traité des études,
les empereurs, 22 vol.
Magnifique exemplaire de collection de voyages, in-folio.
- 1o Voyage en Grèce, par Choiseul-Gouffier, 1 vol.
- 2o Voyage de Naples et de Sicile, par Saint-Nom, 5 vol.
- 3o Tableau pittoresque de la Suisse, 4 vol.
- Table analytique, 1 Vol.
- Reliure uniforme.
On ne séparera aucun de ces voyages.
(p. a-1) AVIS
SUR CETTE SECONDE ÉDITION.
Si l'on pouvait toujours juger de la bonté d'un ouvrage par le débit
qu'il a eu, je me ferais illusion sur le mien; mais il doit plutôt son
succès à la bienveillance des journalistes, à l'indulgence du public,
et à la célébrité des personnes dont j'ai partagé la destinée, qu'à
moi qui n'ai rapporté en France que mes haillons, mon humeur enjouée,
et une brillante santé, trésors inépuisables pour moi au milieu des
plus grands revers.
Puisque la constance et la gaieté, en émoussant les traits du malheur,
ont commandé l'intérêt et le prompt débit de ma première édition,
elles m'encouragent à en faire une seconde. Combien je serai riche, si
l'homme sensible, en me lisant, fait trève à ses peines; si je ranime
dans son cœur le feu vivifiant de l'espérance; si, dans mes
tortures et dans ma gaieté, il retrouve des forces pour soulever ses
chaînes; si, (p. a-2) loin de vouloir les user par ses larmes, il les
allège par les divines chimères d'une imagination enflammée par la
religion, l'innocence et l'honneur; s'il apprend dans mon ouvrage à se
voir sans effroi couvert d'ulcères de la tête aux pieds, et à être
enfermé pendant huit mois dans un cachot humide et infect; s'il
apprend à lutter contre la faim et la soif, à rester calme pendant dix
heures que ses juges délibèrent s'il portera sa tête à l'échafaud, ou
s'il la verra blanchir dans les déserts de la ligne; s'il apprend
enfin à entendre trois fois prononcer sa mort sans perdre le calme, le
courage et l'espérance d'en sortir aussi heureusement que moi; alors
je serai riche, puisque j'aurai partagé avec mon semblable le trésor
de ma sécurité. C'est à ce trésor, autant qu'à mes malheurs, que je
dois cette célébrité d'intérêt que le spectateur anglais définit si
naturellement.
«J'ai observé, dit-il, qu'on lit rarement avec plaisir un ouvrage
entier avant de savoir si son auteur est brun ou blond, d'un caractère
sombre, gai, doux ou colère, marié ou garçon, et mille autres détails
de la même nature qui contribuent beaucoup à l'intelligence de ce
qu'il écrit.»
(p. a-3) Que mon ouvrage soit écrit plus ou moins purement, il date du
lieu où il fut fait; et ce sujet, qui intéresse tant d'honnêtes gens,
m'a procuré l'honneur dont parle Addisson; il m'a donné cette
célébrité du malheur sans prétention, bien moins empoisonnée par la
jalousie que celle de la gloire ou des talents. Comme personne ne
porte envie au sort de Job, tant que la fortune ne l'élève point
au-dessus de sa sphère, j'ai reçu des visites, des félicitations; on
s'est attendu au récit de mes peines; on m'a aimé, parce que je n'ai
pas cherché à rendre mes longs revers artisans de ma fortune; on m'a
fait cent questions. Mon Voyage m'a procuré la visite de mes anciens
supérieurs de séminaire, de mes professeurs et de mes compagnons
d'étude et de déportation; chaque jour il me fait rencontrer des amis
de malheur, de jeunesse et de collège; et beaucoup de lecteurs ont
voulu tenir l'ouvrage de ma main. Chacun y reconnaît ma physionomie,
mes passions, mon caractère et mon cœur; et je puis me vanter que
mes plus grands ennemis en révolution m'auraient couvert de leur corps
s'ils m'eussent vu chez moi, car jamais personne n'en sortit avec la
haine ou l'indifférence. Ma première (p. a-4) édition m'en a fourni
une preuve des plus complètes; car la critique m'a éclairé sans me
léser; et je dois des remercîments au public, à mes amis, à mes
censeurs, et une réponse à leurs observations.
Le Journal de Paris, en révoquant en doute ce que je dis de la
grosseur des reptiles de la Guiane, avait oublié que Buffon, La
Harpe et l'abbé Prévôt parlent d'un énorme serpent, que des
voyageurs prirent pour un tronc d'arbre, autour duquel ils voulurent
faire du feu le soir pour enfumer les nuées de maringouins qui les
obsédaient; que cette énorme masse se réveilla par degrés et leur
laissa le temps de fuir, parce que cette espèce de serpent n'est pas
aussi venimeuse que le dragon, dont l'haleine empestée pompe le
voyageur de la manière que chez nous la couleuvre attire le crapaud.
Il est tant de faits simples et naturels sur les lieux qui deviennent
invraisemblables par l'éloignement et l'irréflexion, que le voyageur
est forcé de rendre la vérité circonspecte pour qu'elle ne soit pas
honnie. Aussi me suis-je bien gardé de dire que j'ai vu des sauvages
dont les dents ont été limées en forme de mèche pour mieux percer et
déchirer leur proie: on aurait dit que (p. a-5) c'était un raffinement
de coquetterie; car on est ingénieux à trouver des expédients pour
prouver le système qu'on invente, ou pour éloigner l'évidence à
laquelle on se refuse. Mais quant à la grosseur des reptiles, on
m'aurait adapté le proverbe, a beau conter qui vient de loin, si
j'eusse dit que durant mon séjour à Kourou, l'épouse de M. de Givry,
l'un de nos compagnons d'infortune, s'assit sur une couleuvre, croyant
se reposer sur un tronc d'arbre; que cet animal, assommé à coups de
leviers, ayant été ouvert, on tira entiers de son estomac la tête et
les cornes d'un chevreau qu'il venait d'avaler, et qu'enfin cette
couleuvre fournit vingt-deux livres de graisse.
Comme mes témoins et la vérité eussent été bafoués si j'eusse consigné
ce fait dans mon voyage; puisque le Journal de l'Empire a plaisanté
l'expérience que nous fîmes de retirer de l'estomac d'un serpent
chasseur les œufs de poule qu'il venait d'avaler sous nos yeux.
Nous eûmes la curiosité d'en faire une omelette, et le courage de la
manger: voilà la chose incroyable à Paris! Faut-il s'en étonner?
puisque dans la Guiane, où l'on mange du tigre rouge, on ne pouvait
croire que nous eussions mangé du tacheté (p. a-6) sans devenir
tachetés au bout de quinze jour. Tel est l'empire du préjugé sur la
croyance ou l'incrédulité.
Le Publiciste, la Gazette de France et la Clef du Cabinet ont trouvé
déplacées mes recherches sur les Indiens; ma digression sur l'époque
de la population de l'Amérique leur a paru un hors d'œuvre sous la
plume d'un déporté dont le sort intéresse exclusivement à tout autre
objet. Je leur répondrai, en les remerciant de cette remarque
infiniment chère à mon cœur, que trois ans de séjour dans un pays
épuisent la source des larmes; que le sol qui nous nourrit fixe notre
attention; qu'il est naturel à l'homme policé d'y remarquer la nuance
qui le différencie du sauvage, et de remonter à la cause de cette
dissimilitude; qu'il serait aussi étonnant que dans trente mois je
n'eusse fait aucune recherche et aucune observation sur des personnes
avec qui j'ai vécu; qu'il serait invraisemblable que la tristesse
empêchât un prisonnier de connaître son réduit. Le plaisir et la peine
continus ressemblent à ces fleuves qui, dans leur cours, jaillissent
et disparaissent tour à tour. Une conscience pure et une âme franche
font toujours surnager l'esprit au-dessus de la (p. a-7) peine et du
plaisir. Que de chefs-d'œuvre de génie et de gaieté sont sortis du
fond des cachots et du séjour des pleurs! Enfin, si je n'eusse parlé
que de nos malheurs, on m'aurait accusé d'égoïsme. J'ai semé quelques
traits de gaieté dans mon Voyage, afin de fixer l'attention de plus
d'un lecteur; peut-être que si nos voyageurs étaient moins méthodiques
et moins sombres, nos dames préféreraient le voyage au roman: enfin,
si j'ai cousu quelques épisodes à mon ouvrage, c'est qu'au désert
comme au village, où la nature est sans fard, on danse auprès du
cimetière, et ces contrastes pourraient avoir un but louable qui les
identifieraient au sujet.
Qu'on se reporte au moment où j'écrivais; la religion avilie ou
calomniée passait pour une illusion ou pour un cerbère prêt à dévorer
celui dont la franche gaieté faisait épanouir le front; c'était le
moyen qu'on employait alors pour empêcher l'honnête homme de remonter
à la foi par la morale. Si j'eusse sèchement invoqué le ciel, et
pleuré sur mes malheurs, mon livre aurait eu le sort de tant d'autres;
on m'eut traité de cafard sans vouloir me lire. Comme le sexe avait eu
le plus d'influence dans la subversion des principes de l'ordre
antique, j'ai (p. a-8) profité de l'ascendant que la pitié me donnait
dans son âme pour parler à son cœur, et le conduire à l'instruction
par la voie du plaisir. Il est peu de circonstances où la morale eût
plus de poids. Qu'un millionnaire rayonnant de joie remercie Dieu de
la pluie d'or qui tombe chez lui, c'est un devoir dont on peut le
louer sans l'admirer; mais qu'un innocent, réduit à manger des
feuilles, sourie encore, et trouve l'abondance dans son cœur; que
la religion soit son refuge; qu'en écrivant ses malheurs il égaye le
tableau pour attirer l'œil, son but est louable et sa morale est
persuasive. Enfin, ce qui me console, c'est qu'une partie de mes
lecteurs a approuvé ce que l'autre a blâmé.
Un reproche mieux fondé m'a été fait par des amis judicieux, qui ont
blâmé ce que j'avais écrit contre ma tutrice; si elle a semé des
épines sur mes pas, le soin qu'elle a pris de mon éducation aurait dû
mettre un cachet sur mes lèvres. Il serait possible que mes longs
malheurs eussent été la punition de mon ingratitude. Personne ne
posséda mieux qu'elle le précieux talent de former le cœur et
l'esprit. Si elle eût été moins économe et moins butée à me traîner au
sacerdoce, je l'aurais mieux jugée, et je n'aurais pas (p. a-9) resté
dix-huit ans sans l'embrasser, car le moment où je passai par
Châteaudun pour aller en exil fut trop court pour que je l'appelle une
entrevue. La visite qu'elle me rendit en prison pouvant être notre
dernier adieu, elle crut pleurer ma mort. Mais j'ai été la voir un an
après la publication de mon Voyage; elle avait lu son article; elle me
bouda pendant quinze jours. Des amis communs, au nombre desquels je
dois compter des parents que j'ai peu ménagés, nous rapprochèrent: on
convint de tout oublier; je fus convaincu que les obligations de ma
tutrice à mon égard étaient moins importantes que je ne le croyais. La
réconciliation a été pleine et entière; et je n'oublierai point son
bonjour du lendemain de notre entrevue: «Mon ami, voilà ma première
nuit de bonheur depuis dix-huit ans que tu m'as quittée; je t'aimais
autant que tu as cru que je te haïssais; juge-moi sans prévention. Je
me suis trompée, peut-être un peu par ambition, mais par zèle pour ton
bonheur, plus que pour le mien, en te choisissant un état considéré
avant la révolution. Je t'applaudis d'avoir contrarié mon goût, et je
ne mourrai contente qu'en te voyant établi. Je touche à ma
quatre-vingt-sixième (p. a-10) année: donne-moi promptement cette
satisfaction.»
J'ai profité de ses leçons: je suis marié, établi, et, dans ma
paisible médiocrité, je travaille, je ris, je chante, et je vends des
livres après avoir vendu des chansons.
(p. v) À MONSIEUR GARAT,
Membre du Sénat-Conservateur et de l'Institut impérial.
Monsieur,
Je suis payé de mes peines, et mes malheurs me sont précieux, quand
vous en accueillez l'hommage; en fixant votre attention, ils
m'assurent l'intérêt du lecteur: je vous dois leur publicité; et
l'estime que vous accordez à l'auteur, est un garant de sa franchise
et de son caractère.
Un philosophe dit que les hommes en place ont deux visages et deux
existences: on vous croiroit simple particulier; car personne ne peut
désirer plus que vous, Monsieur, d'avoir une fenêtre à son cœur.
Votre vie privée (vos ouvrages à part) au milieu des dignités et des
places éminentes où la confiance publique et votre intégrité vous ont
appelé et maintenu depuis quinze ans, nous reporteroit aux siècles de
ce Romain qui labouroit son champ de ses mains consulaires, et
s'arrêtoit au bout du sillon pour manger son plat de légumes.
Aujourd'hui même, vous pourriez (p. vi) encore dicter pour votre
enfant; le testament d'Eudamidas de Corinthe. Monsieur, voilà vos
droits à l'immortalité dans mon cœur, et dans celui des vrais amis
de leur pays.
Au reste, les dignités et les talens, dons des hommes ou de la
Providence, comme les rayons de l'astre du jour, sont des biens hors
de nous, dont l'éclat éblouit, mais dont la propriété ne nous est
acquise que par le bon usage que nous en faisons pour les autres. Que
j'aime bien mieux retrouver l'homme privé, adoré dans sa famille, bon
avec tous les hommes, sublime et profond dans son cabinet comme
Montesquieu, naïf et franc dans la société comme Lafontaine! Horace
lui diroit avec vérité: Domus non purior ulla est; sa maison est le
temple de la candeur, de l'amitié et de la bonne foi; le local est
petit, mais c'est celui de Socrate.
Le Sénateur membre de l'Institut, donne de l'éclat a mes malheurs;
mais l'estime de l'homme privé donne encore bien plus de mérite à
l'auteur qui a l'honneur d'être,
Avec un très-profond respect,
Monsieur,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
L. A. PITOU.
Paris, 30 pluviose an 15 (19 février 1805).
(p. vii) MA VIE
ET
LES CAUSES DE MON EXIL.
Voici le tableau de mes inconséquences, de mes persécutions et de mes
malheurs. La Providence a tout fait pour me rendre sage et réfléchi;
j'ai bien résolu aujourd'hui de profiter de ses leçons, et tout
lecteur, de quelque opinion qu'il ait été, en croira sans peine à ma
parole, après avoir lu cet ouvrage: je le plaindrois bien s'il avoit
besoin de faire une école aussi dure que la mienne pour rentrer dans
la société.
Doué d'un cœur sensible et d'une âme confiante, j'ai été poussé
dans une carrière célèbre, périlleuse et singulière, par la dureté de
ma tutrice, qui me devoit et les soins et les comptes d'une
dépositaire de ma fortune.
L'expérience l'a convaincue, à mon détriment (p. viii) et au sien,
que les parens complaisans et les amis flagorneurs sont les moins
désintéressés et les plus habiles à faire des dupes. La pauvre femme,
qui se seroit fait pendre pour un liard, a donné sa confiance à une
fine intrigante qui, pour des riens, lui a fait des emprunts
hypothéqués sur un avenir trompeur. Ma tutrice a beaucoup pleuré comme
le juif de Maison à vendre; et la confidente qui l'a abusée la
haïssoit tant, que, croyant me faire plaisir, elle vint à Paris la
décrier auprès de moi, et ne fut jamais si interdite que de ma réponse
à ce sujet, quoique j'ignorasse encore ses projets et sa conduite.
Au reste, les premiers momens de ma jeunesse furent bien plus hérissés
d'épines que semés de roses. Né d'une famille de laboureurs et de gens
de robe, je perdis mon père à huit ans. Il mourut de chagrin de voir
qu'un de mes oncles, mon parrain, célibataire, intendant d'un château
(p. ix) de M. Delaborde, venoit de décéder après avoir substitué
oralement sur ma tête, la part du bien qu'il me destinoit comme à son
fils adoptif, et à l'un de ses plus proches parens. Ce bon père étoit
loin de m'envier mon bonheur; mais il frémissoit de me laisser aux
soins d'une épouse sans fortune et sans défense, ou bien de me voir
sous la tutelle d'une légataire universelle, qui n'étoit engagée que
sur parole, et dont il connoissoit l'avarice. Elle me devoit de
l'éducation et un établissement à mon choix.
À l'âge de dix ans, ma mère me conduisit jusqu'à la porte de cette
tutrice, où elle n'osa pas entrer de peur d'être éconduite. Ô
nécessité! pourquoi contraignis-tu ma bonne mère à ce pénible
sacrifice! Mon père avoit épousé une pauvre villageoise, riche en
vertus, mais simple, honnête, bonne et trop peu fastueuse pour que ma
tutrice daignât la regarder du haut de sa grandeur. Combien de fois
(p. x) ne fus-je pas forcé d'embrasser dans la rue cette tendre mère
qui n'osoit mettre le pied sur le seuil de la maison, d'où j'étois
souvent obligé de m'esquiver pour voir à la dérobée la meilleure et la
plus tendre des mères! Ma tutrice étoit pourtant sa sœur, et même
elle étoit dévote: mais l'avare manichéen concilie pour lui seul le
dieu de l'or avec celui de la pauvreté.
Que mon cœur auroit aimé cette tutrice, si elle l'eût voulu! elle
avoit de grandes qualités, des vertus, de la sensibilité, même plus
que les êtres abâtardis par l'avarice n'en sont susceptibles; mais je
n'ai jamais pu oublier le mauvais exemple que sa conduite auroit pu
m'inspirer contre ma mère.
Elle m'aimoit à sa mode, car elle poussa l'épargne jusqu'à me refuser
les premiers besoins de la vie. Dans un âge aussi tendre, j'étois
dévoré par la faim et réduit à demander du pain à mes camarades, et à
ramasser ce que je trouvois (p. xi) dans les classes et ailleurs: au
point que mon premier maître s'en étant aperçu, me gronda, l'en
prévint, et fit un peu améliorer mon sort. Si dans la suite, elle
n'osa plus me défendre de retourner deux fois au chanteau, quand j'y
revenois elle me regardoit d'un air si dur, que si je n'avois pas eu
l'âme honnête, elle m'auroit rendu aussi vil que certaine personne qui
lui est parfaitement connue, et qui fit à certain âge le supplice de
parens bien moins rigides qu'elle. Comme elle étoit commerçante et
très à son aise, je trouvai dans des babioles le secret d'éviter sa
mauvaise humeur: elle m'y avoit tellement réduit, qu'un de mes
professeurs mérita que je lui en fisse la confidence, et qu'il en rit.
Au bout d'un certain temps, elle s'aperçut de mes espiégleries.... Ce
fut un crime irrémissible, et depuis ce moment elle ne m'a jamais
pardonné mes vétilles, que je dois appeler ses propres erreurs.
(p. xii) À dix ans, elle me destina à l'étude des langues, et ne
négligea rien pour me donner une bonne éducation; elle étoit dévote et
mondaine, et me destinoit à la prêtrise. Je réussis à son gré; alors
elle me traita comme son enfant: elle avoit même cette divine ambition
des bons pères qui jouissent et renaissent dans leurs enfans qui se
distinguent dans leurs classes. Rien ne lui coûtoit trop cher quand il
s'agissoit de mon avancement; mais elle ne vouloit toujours pas voir
ma mère, ce qui étoit un crève-cœur pour moi.
À quatorze ans, je lui demandai à étudier en droit; alors elle ne me
laissa que l'alternative de prendre un métier pénible et contraire à
mon goût, ou de me faire prêtre; et de ce moment elle aliéna, vendit
et dénatura notre fortune, me disant que j'avois eu ma part, que je
n'avois plus à choisir que le sacerdoce. De mon côté, je me promis de
ne lui jamais ouvrir mon cœur; et je (p. xiii) jurai en moi-même
que je ne ferois rien contre ma conscience. J. J. Rousseau fut
sensible à huit ans.... Quand mes camarades s'écrioient à
l'invraisemblance, en lisant dans ses Confessions les premiers
mouvemens de la nature dans l'enfance corrigée par mademoiselle
Lambercier, je me disois tout bas: ils sont nés après moi. Cet
instinct prématuré me rendit rêveur, jusqu'à l'âge de quatorze ans.
Confié aux soins des femmes, j'éprouvois un charme inexprimable et une
contrainte involontaire, douce et quelquefois gênante, dans les petits
cercles d'enfans des deux sexes, avec qui le hasard et le voisinage
nous faisoient souvent rencontrer. Dans le cours de mes études, les
jours de congé de la semaine m'étoient indifférens.
Je ne comptois de momens d'existence que les dimanches soir, après les
offices, où nos parens nous réunissoient à tour de rôle.... Alors,
mon plaisir étoit toujours (p. xiv) empoisonné par cette pensée
terrible: je suis sensible, j'aime et j'aimerai toute ma vie, et on
veut me faire prêtre: non, je ne le serai jamais.... mais que
ferai-je?...
Quoique cette pensée me tourmentât quelquefois jour et nuit, jamais
elle ne vint sur mes lèvres avec aucun de mes camarades les plus
intimes, dans ces petits cercles où l'enfance, éloignée des regards
paternels, énonce librement ses projets, ses inclinations et ses
goûts. Moi, je serai avocat, moi notaire, moi marchand, moi prêtre, se
disoit-on; et toi Pitou?... Je n'en sais rien. Les femmes plus fines
et aussi discrètes que nous, n'ont pas eu plus d'empire contre mon
secret. Si elles eussent pu, à cet âge, attacher le prix de l'amour à
la solution de cette question, je ne l'aurois pas donnée. Plus j'étois
réservé, plus elles me questionnoient. Quelle épreuve!... ô quelle
épreuve! j'ai tellement résisté, que celle qui avoit le plus d'empire
sur mon cœur, me croyant parti (p. xv) à Chartres, en 1789, pour me
lier irrévocablement au sanctuaire, se brouilla avec moi, et finit par
épouser un de mes écoliers. Que m'auroit servi de l'informer de mon
projet? ma tutrice venant à le savoir, j'étois exhérédé et sans état.
Ne vaut-il pas mieux être malheureux seul, que de lier ceux qu'on aime
à une destinée cruelle qu'ils ne peuvent adoucir?
Au lieu de suivre la route de Chartres, je me décidai à aller à Paris.
Quand ma résolution fut une fois prise, j'en fis part à deux voisines
dignes de ma confiance. (En lisant ceci elles se souviendront et de
leur discrétion, et de mon amitié, et des conseils qu'elles m'ont
donnés.) Quoique cette résolution fût irrévocablement prise, je fus
huit jours entiers sans dormir: un noir pressentiment me montroit dans
le lointain, la terrible perspective de mon sort. J'avois beau me dire
que la contrainte exercée envers moi étoit injuste; que les passions
ardentes dont j'étois dévoré (p. xvi) m'éloignoient du sanctuaire, que
l'honnête homme ne doit prendre que l'état dont il peut remplir
civilement et religieusement les obligations, tout cela ne me
rassuroit pas de la crainte et de l'abandon où j'allois me trouver à
mon âge, sans état, sans fortune, dans un moment aussi critique, au
milieu d'une ville qui est un univers, où je ne connoissois personne,
où l'on vend l'air qu'on respire; mais le sort en étoit jeté. Au lieu
d'aller prendre les ordres, je partis de Châteaudun avec deux abbés de
mes amis, le 17 octobre 1789, époque de la rentrée des classes.
En arrivant à Chartres, le 18 octobre, je dînai avec tous les
camarades de mon cours, qui, ne soupçonnant rien de mon projet, me
firent promettre de venir les reprendre à l'enseigne du Gros-Raisin,
faubourg de la Grappe: nous nous embrassâmes au bout de la rue aux
Changes. Ils cheminèrent vers Beaulieu, grand séminaire qui étoit à
une lieue de la ville, et (p. xvii) moi vers Paris. La famine s'y
faisoit déjà sentir; tout étoit en rumeur; chaque jour les rues
étoient illuminées, tout le monde étoit sous les armes, dans l'attente
et dans l'effroi d'une prétendue armée de brigands invisibles, qui,
chaque nuit, marquoient les maisons, couroient les campagnes et
affamoient les villes. Quinze jours auparavant, Louis XVI et sa
famille avoient été traînés aux Tuileries par un peuple affamé, qui
avoit, disoit-il, conduit promptement dans sa ville, le boulanger, la
boulangère et le petit mitron. Ainsi Paris, à cette époque, étoit le
cratère d'un volcan prêt à faire éruption. Les gens riches se
sauvoient ou dans les campagnes, ou dans les pays étrangers; et ceux
que leurs affaires ou leur commerce y retenoient, restoient
claquemurés et enfermés comme s'ils fussent morts au monde. Un morne
silence rembrunissoit tous les fronts; la famine et le trouble
augmentoient chaque jour; la police étoit désorganisée. Tous
(p. xviii) ces détails étoient encore amplifiés dans les provinces....
Je les connoissois bien. N'importe, j'avois résolu de venir à Paris,
et j'y arrivai le 20 octobre, à six heures du matin.
Il est difficile de peindre l'attitude d'un jeune provincial de
dix-neuf ans, séquestré depuis six dans les séminaires, étourdi et
embarrassé tout-à-coup de la grande liberté dont il jouit pour la
première fois de sa vie, au milieu d'une cité qui ressemble à un
univers. J'avançois, d'un air rêveur, dans les Champs-Élysées; un
groupe d'assassins traverse la place Louis XV, vient à ma rencontre,
portant la tête du malheureux boulanger, dont l'enfant posthume, en
mémoire de cet événement, a été tenu sur les fonts baptismaux par
notre dernière reine. Quelle réception! Je me persuadai que cette
funeste rencontre me présageoit de grands malheurs. Ils ne me sont pas
arrivés pour confirmer mon pressentiment, (p. xix) mais peut-être
ai-je pu aider à la prophétie de mon imagination enflammée, par
l'opinion que cet événement m'a donnée de la révolution.—Si ce
château n'est pas le palais du roi, dis-je en voyant les Tuileries, le
génie d'Armide est inférieur au nôtre. Sur les quais, vingt fois la
foule ondulante me fait tourner comme un moulin à vent, pendant que je
baye en l'air, tout ravi d'admiration et d'extase à l'angle de la
belle colonnade du Louvre. J'ai mis deux heures à examiner le cours de
l'eau, l'architecture de ce palais et la magnificence de la galerie.
Le mouvement des ports, le concours des ouvriers, l'activité des
artisans, le bruit de la lime et du marteau, l'ensemble mobile d'un
peuple laborieux, qui, dans un chaos admirable, offre le tableau des
arsenaux de Vulcain, du palais de Flore, des grottes de Bacchus, du
temple de l'Abondance et de l'Industrie, émousse presque mes organes
par l'attention qu'ils en exigent.
(p. xx) Je fus distrait de ma stupidité contemplative par un appétit
dévorant, qui me rappela en un clin d'œil mon isolement, le peu de
moyens pécuniaires que j'avois, la disgrâce et l'exhérédation dont
j'allois être puni. «Te voilà donc à Paris sans état, sans fortune,
sans parens, sans connoissances; la porte de ta tutrice est fermée
pour toi; vole de tes ailes.... Fais ici le serment de ne jamais rien
demander à personne, d'être fidèle à l'honneur, à la probité. Tu vois
ces flots: qu'ils t'engloutissent, plutôt que la société, ta famille
et ta conscience puissent te reprocher quelque chose ...! Oui, je le
promets...., je le promets et je le jure, ô mon Dieu!...» D'après ce
soliloque, je perche mon chapeau au bout de ma canne; je le fais
tourner, attachant ma destinée à la direction de la corne droite, qui
se fixe à l'E. S. E. Me voilà dans la rue Saint-Jacques, autrefois le
Latium parisien.
(p. xxi) Où loger? peu m'importe: mais quel état prendre sur le
registre de police? Étudiant en théologie. Le hasard me conduit à
l'hôtel de Henri IV.... Je loue un cabinet près des faubourgs du
Paradis; une Chartraine est ma voisine: cette femme, d'un âge
au-dessus de la critique, étoit chérie et connue avantageusement de
toutes les personnes de la maison. Le soir, j'allai au
Théâtre-Français, voir Molé et mademoiselle Contat, dans le Glorieux
et le Legs. Des filous me firent léguer trois louis pour mon début.
Cette perte étoit terrible; mais il m'en restoit encore cinq, et je me
promis d'être plus circonspect.
Pendant huit jours, je rôdai dans Paris, sans être dupe. Mes affaires
commençoient à s'améliorer: j'avois vendu mon frac violet pour acheter
un habit de rencontre; car ma voisine m'avoit fait connoître à MM.
Brune, aujourd'hui ambassadeur à la Porte-Ottomane, et (p. xxii) à
Fabre-d'Églantine. Le premier me promit de l'emploi; l'autre
m'encouragea à cultiver les lettres. Je lui montrai différens
opuscules: il approuva mon ouvrage intitulé: La Voix de la Nature,
et se borna là. Je ne l'ai jamais revu depuis.
Ces promesses me firent bâtir des châteaux en Espagne; je me crus
placé sous trois jours. Dans un élan de reconnoissance, je cours vîte
au Palais-Royal acheter quelque chose à la bienfaitrice qui me
délivroit de la férule de ma tutrice. Un petit mouvement d'orgueil
dirigeoit ma démarche; j'avois déjà honte de la misère, et cette dette
que je payois à l'ostentation, me faisoit passer pour un jeune homme
libéral. D'ailleurs, pouvois-je trop payer le plaisir d'écrire dans
mon pays à celle qui m'avoit tenu sous une verge de fer: Je suis
heureux sans vous, et malgré vous? Une main invisible corrigea
bientôt ce désir de vengeance. Il me (p. xxiii) restoit quatre louis;
car ma compatriote m'avoit offert sa table, et je lui redevois un
louis sur les emplettes qu'elle avoit bien voulu faire pour moi, dans
la persuasion que j'étois beaucoup plus riche.
En entrant dans la première cour du Palais, du côté de la rue
Saint-Honoré, je vois un gros homme bien vêtu, qui grondoit une jeune
dame dans une boutique de bijoutier. Pourquoi l'as-tu laissé aller?
Falloit acheter, c'est pour rien, disoit-il en me tournant le dos, et
me suivant de l'œil sans que je m'en doutasse. J'arrive sous la
galerie.... «Monsieur, Monsieur, rendez-moi un grand service.... Voici
de l'argent....» Il fouille à sa poche. «Voyez-vous cet homme qui s'en
va devant nous? Il a des boucles d'oreilles et de jarretières à
diamans, et quatre superbes paires de bas de soie à vendre; ça vaut
huit ou dix louis comme un liard; il veut en avoir cinq, mais il les
donneroit pour trois ou quatre. (p. xxiv) Il s'est adressé ici à mon
épouse; elle n'entend rien aux coups de commerce; elle ne lui en a
offert que trente-six livres. Ils se sont dit des injures; l'homme
s'est fâché; il est intraitable avec moi.... Voilà comme elle manque
toutes les bonnes occasions. Tenez, Monsieur, voilà un louis; je vais
derrière vous, et si l'homme s'arrange pour quatre louis au plus,
celui-ci est à vous.» Je suis l'homme à la piste; il s'arrête dans une
encoignure; il étoit remarquable. Un petit chapeau, sorti de la fripe
depuis quinze ans, couvroit sa chevelure mastiquée de poudre, de sueur
et de poussière, et ombrageoit sa figure blême et veinée de barbillons
longs comme le doigt; une cravate brune, et autrefois blanche,
relevoit la richesse de son uniforme noir et fripé comme s'il fût
sorti de l'eau. N'avez-vous rien à vendre, lui dis-je? Il verse des
larmes, me regarde d'un air contrit, et tire mystérieusement (p. xxv)
de dessous sa mantille la boîte à Pandore. Nous entrons en
négociation. Ces gens-là sont les meilleurs acteurs du monde. Le
premier aventurier me suivoit réellement d'un air inquiet et avide; le
prétendu infortuné lui tournoit encore le dos, comme par l'effet du
hasard. Il me fait de longues jérémiades. Nous tombons d'accord à
quatre louis. Le premier me félicitoit et du geste et de l'œil;
l'autre se retourne, voit son prétendu antagoniste, feint de vouloir
se rétracter par vengeance. Je le somme de sa parole; mon prometteur
s'éloigne, comme pour lui laisser passer sa foucade; je paie.... Le
vendeur et le marchand ont disparu....
Je retourne à la boutique; personne ne me connoît: ce ne sont plus les
mêmes figures. J'en fus enchanté. Au bout d'une heure, j'arrive chez
moi d'un air triomphant. Ma compatriote étoit avec d'autres voisines.
Je lui offre galamment la fameuse boîte, dont j'avois provisoirement
(p. xxvi) retiré les boucles de jarretière et une paire de bas.... On
ouvre.... Des éclats de rire se prolongent d'un bout à l'autre du
cercle, je rougis; je suis dupe. On détaille l'emplette. Je m'enferme
vîte dans mon cabinet pour mettre mes bas; ils étoient gommés et
resavetés; le pied étoit de deux morceaux, et la jambe trouée comme un
filet à prendre du goujon. Les boucles et les pendans d'oreille
étoient de cuivre doré; le diamant répondoit au métal, et le tout
valoit six francs. Voilà soixante-six livres perdues pour moi de bien
mauvaise grâce.
Cette largesse diminua mon crédit dans l'esprit de mon hôtesse. Il ne
me restoit que dix-huit francs, et j'en devois trente-six. De peur
qu'à force d'être dupe je ne devinsse fripon, le soir, en me couchant,
je trouvai mon petit mémoire annexé à ma chandelle. Toute la nuit, je
baignai mon lit de larmes. Le lendemain, je descendis à la dérobée,
avec (p. xxvii) un paquet de six chemises, que je portai vîte à un
commissionnaire du Mont-de-Piété, qui me donna 30 fr. Mes dettes
payées, il me resta 4 fr ..., deux cravates, une chemise et l'habit
qui me couvroit.
Mais un malheur ne vient pas sans un autre. Le soir, je reçus une
lettre de mon mentor de province. En voici la teneur: Je suis donc
débarrassée de vous; ma maison vous est fermée pour toujours: j'ai
fait mettre une double serrure à mes portes, de peur que vous
n'arriviez à l'improviste. N'espérez pas m'attendrir; vous n'avez plus
rien à espérer de moi. Vous prétendiez que le pain que je vous donnois
étoit celui de la douleur; je vous verrois mourir à ma porte, que vous
n'auriez pas un verre d'eau. Vous apprendrez ce qu'il en coûte pour me
désobéir.... J'entrai en fureur contre moi, contre le sort ... contre
l'honneur, contre la vertu. «Vains fantômes, m'écriai-je! n'êtes-vous
donc suivis que du désespoir (p. xxviii) et des larmes! Pourquoi tant
vous chérir, si le malheur, la misère et la honte sont toujours le
partage de vos prosélytes? Pourquoi préférer l'avilissement à la
gloire; la détresse à l'opulence; la bonne foi à la duplicité, quand
ces vertus ne sont que des mots dont la fortune et le crédit annullent
la réalité...?» Je déchirai la lettre avec mes dents, je m'étendis
sur mon grabat; et, pour la première fois de ma vie, je perdis pendant
trois heures l'usage de la raison. Je m'étois enfermé chez moi sans le
savoir; je ne pus jamais trouver la clef qui étoit dans ma poche, et
le lendemain j'avois le visage d'un mort inhumé depuis plusieurs
jours.
Je retournai voir M. Brune. Il me remit à une quinzaine, sans me
désigner encore quelle place il me donneroit. Alors je me crus perdu:
la malle qui étoit à mon séminaire ayant été renvoyée à mon mentor,
je restai avec le seul habit que (p. xxix) j'avois sur mon corps; il
étoit d'une qualité assez bonne; je passai aux Charniers des Innocens,
le troquer pour un plus mauvais, moyennant du retour, et je changeai
de quartier. Au bout de quinze jours, les audiences des tribunaux
étant devenues publiques, je revis M. Brune, qui m'employa à prendre
des notes au Châtelet, pour le journal de la Cour et de la Ville, dont
il étoit co-propriétaire avec un Genevois assez connu. L'affaire du
baron de Besenval et celle du marquis de Favras (dont par suite j'ai
rédigé le mémoire en révision), furent entamées. Le premier,
colonel-général des Suisses et Grisons, avoit blanchi et sous les
myrtes de Vénus et sous les lauriers de Mars. Il étoit accusé d'avoir
fourni des munitions au gouverneur de la Bastille, de Launai; de lui
avoir prêté main-forte pour tirer sur les assiégeans; de l'avoir
invité à tenir bon en cas d'attaque; d'avoir mis tout en œuvre
pour cerner Paris et (p. xxx) réduire les insurgés, et d'être, par ce,
comptable du sang versé les 13 et 14 juillet 1789, aux Tuileries et
sous les murs de la Bastille. Il avoit pris la fuite, avoit été arrêté
à Brie-Comte-Robert, et enfermé nu dans un cachot, où on le montroit
au peuple comme une bête rare et vorace. Les têtes étoient si
échauffées contre lui que l'auditoire influençoit ouvertement les
témoins et les juges. Le rapporteur, Boucher-d'Argis, étoit invectivé
à chaque séance, ainsi que tous ceux qui se présentoient pour
l'accusé, ou qui ne déposoient rien à sa charge.
Deux hommes sensibles et illustres, chacun dans leur genre,
s'immortalisèrent dans cette cause. Le premier, est M. de Ségur, bras
d'argent, qui n'abandonna jamais l'accusé, et s'identifia
volontairement à lui dans sa prison, dans ce moment critique où les
injures, les menaces et les persécutions pleuvoient sur tous les
hommes titrés, qui, pour (p. xxxi) la plupart, ne trouvoient pas de
retraite assez sombre pour se cacher. Le second est M. de Sèze, qui,
par son éloquence, brisa les fers de l'accusé. Cette première cause
célèbre de la révolution, où le talent de l'orateur animé par la
stoïcité du tribunal et par cette âme grande qui le caractérise, fut
développée avec des traits si mâles, qu'il auroit forcé les juges de
mourir sur leur siège, s'il eût été nécessaire, pour ne prononcer que
d'après leur conscience, lui mérita la confiance de Louis XVI, dont il
prononça si éloquemment la défense à une époque que nous connoissons
tous.
Le marquis de Favras, sans fortune, mais brave et plein d'intrigue,
avoit été mis en avant par des personnages marquans, pour enlever le
roi et se défaire, à force ouverte, du premier ministre, M. Necker; du
maire, M. Bailly, et du commandant général, M. de la Fayette, si
célèbre dans les Deux-Mondes, et (p. xxxii) toujours pour la même
cause. Les dénonciateurs de l'accusé étoient ses premiers agens;
plusieurs témoins venoient à l'appui: mais l'arrestation de ce seul
prévenu, sous les arcades de la place Louis XIII, le 25 décembre 1789,
au moment où il étoit en embuscade avec deux autres qu'on ne put
(dit-on) atteindre, prouve assez que le peuple, qui le plaignoit en le
conduisant au supplice, a le jugement sain et le cœur droit quand
on ne l'influence pas, et que sa sagacité naturelle lui indique
souvent le vrai coupable.
Les débats de cette affaire présentèrent une scène unique. Le marquis
de Favras, qui abhorroit le fameux comte de Mirabeau, avoit dit, en le
comptant au nombre de ceux qu'il falloit acheter pour leurs talens:
«Mirabeau est à moi pour trois cents louis.» Un témoin irrécusable
avoit consigné ces faits, et Mirabeau, à l'assemblée, étoit
inviolable. Cependant (p. xxxiii) il fut mandé. Le sourire, les grands
airs de cour et les civilités politiques du témoin et de l'accusé,
dont les yeux également expressifs, marquoient autant de duplicité et
de crainte que leurs dehors affectueux étaloient de loyauté, fixoient
l'attention du plus petit génie, au point que chacun, en devinant et
leur réserve et leurs transes, ne pouvoit ni accuser leur déposition
de faux, ni s'imaginer qu'elle pût être vraie. Mirabeau atténua les
faits par une éloquence si simple et si sublime, qu'on l'auroit prise
malgré soi pour de l'ingénuité; et le marquis démentit avec le même
art ce qu'il avoit dit, et qu'on devinoit bien qu'il répétoit encore
dans son cœur, et cette discrétion fut sacrée pour lui, même au
pied de la potence.
Au milieu de 1790, M. Brune ayant été exproprié de son journal, je me
trouvai sans place. Déjà l'amour avoit semé de quelques roses les
premiers momens (p. xxxiv) de ma nouvelle existence. J'avois fait
quelques ouvrages; l'imprimeur R. me les acheta à un crédit qui dure
encore. Comme je ne rentrois que le soir chez moi, un beau jour je ne
trouvai que les quatre murs: je connoissois bien le voleur, mais
l'amitié, ou peut-être un sentiment plus tendre, m'ôta le droit de me
plaindre. Il fallut être battu, volé, content, et le reste. Je mourois
d'envie de savoir le domicile de mes effets et de leur dépositaire.
Depuis six mois que je logeois dans la même maison, je ne connoissois
pas un seul voisin: une vieille femme qui logeoit sur mon carré, fut
la première personne qui me rendit visite, pour me consoler de ma
disgrâce. Elle avoit l'air et la réalité d'une magicienne: son début
fut assez simple pour m'exempter de rougir du lit de planches sur
lequel je couchois.—«Vous avez été volé hier à trois heures,
dit-elle, et la personne qui vous a fait ce coup, vous est connue:
vous n'avez pas (p. xxxv) besoin de faire des poursuites, dans un mois
vos effets vous seront rendus.... Ne vous offensez pas de ma
proposition: je vous offre les habits et le lit de mon fils, vous y
resterez jusqu'à ce que vos meubles soient de retour.»—Je la pris
pour une folle, et je me mis à rire de la bizarrerie du sort; car
j'avois fait des connoissances, et je me consolois. On s'accoutume au
mal comme au bien. Je revins le soir, sans avoir mangé; un génie
maudit précédoit mes pas pour mettre en fuite tous ceux dont j'avois
besoin. J'eus recours à ma vieille: elle disoit la bonne aventure; un
nombreux auditoire féminin la consultoit, chaque soir, comme un
oracle: «Jeune homme, me dit-elle en entrant, voilà votre dîner, vous
n'avez pas mangé de la journée; tous vos amis étoient absens: vous
avez cru hier que j'étois une vieille folle amoureuse de vous....
Soyez rassuré, depuis trente ans je n'ai été (p. xxxvi) dupée qu'une
fois, et je ne le serai jamais. Les autres viennent ici à l'école, et
je n'ai appris la chiromancie que pour apprendre à apprécier les
hommes.» Je fus d'abord émerveillé, comme le lecteur qui me suit; mais
la Bohémienne n'étoit qu'une ancienne coquette, dont les enfans
naturels suivoient la conduite. La fille aînée, qui m'avoit démeublé,
étoit abandonnée à elle-même depuis cinq à six ans: j'avois été sa
dupe, comme tant d'autres. Sa mère, qui craignoit que je ne portasse
plainte, avoit mis le frère à ma poursuite. Durant ce mois de répit,
je trouvai à me placer chez le comte de Mahé, qui me confia
l'éducation de son fils. Mes meubles revinrent, sans que d'abord je
pusse savoir comment; ma prétendue bienfaitrice vouloit me lier à elle
par la reconnoissance, pour me donner la main de sa seconde fille,
qui, trouvant en moi un mari commode, auroit suivi paisiblement la
conduite de la mère sous (p. xxxvii) l'aile bénévole de l'hymen. Cette
double intrigue me fut certifiée par la demoiselle qui, certain jour,
me croyant loin d'elle, s'entretenoit dans un cabinet avec une de ses
compagnes, sur la bonhomie du provincial qu'elle alloit épouser pour
la forme.
Je leur répétai ce colloque. La mère entra dans une si grande colère
contre moi, qu'elle manqua d'en étouffer; elle me jura qu'elle s'en
vengeroit. Elle n'y manqua pas. D'abord elle me calomnia auprès du
comte de Mahé, qui me fit remercier et me rappela au bout d'un an.
Dans cet intervalle, je me liai avec un nommé D..., aujourd'hui avoué
dans les tribunaux. La différence de nos caractères et de nos humeurs,
me prouve que la sympathie entre les hommes ne naît pas toujours de la
conformité de leurs penchans. Il étoit aux expédiens comme moi.
Quoique nous fussions toujours à nous quereller, nous ne pouvions pas
nous passer l'un de l'autre. (p. xxxviii) Cette intimité cimentée par
le malheur, me fait regretter encore aujourd'hui les momens de
détresse où nous nous orientions le matin, pour savoir où nous
pourrions dîner. Cette importante affaire nous occupoit jusqu'à midi;
mais comme nous n'employions que des moyens avoués par l'honneur, je
ne m'étonne pas de regretter ce temps d'épreuve.
Nous avons passé des crises bien terribles; mais jamais je n'ai songé
à écrire à ma tutrice, pour rentrer en grâce avec elle. Ma détresse
lui fut connue, et elle m'offrit mon pardon, si je voulois me faire
prêtre. La misère et la contrainte n'ont jamais servi qu'à me rendre
plus intrépide dans mes résolutions; et si je n'ai pas gagné de
fortune par cette tenacité, j'ai donné à mon caractère cette trempe
d'acier qui émousse les traits du sort. Les incommodités et les
privations des premiers besoins de la vie ont été pour moi des
accidens si ordinaires, que mon humeur (p. xxxix) ne s'en altère
jamais long-temps, et l'ami avec qui j'ai acquis ce trésor, doit
m'être toujours cher. Que le lecteur qui criera à l'exagération, ne
croie pas que cette fermeté s'acquière dans un clin d'œil, qu'elle
soit le lot de tous les hommes probes! Tel richard qui jouit du
respect, de l'amour et de la considération de ses voisins et de ses
amis, auroit-il été aussi courageux que moi? Certain jour, je me
trouvois à jeûn depuis vingt-quatre heures; je n'avois absolument rien
à vendre, et la faim me faisoit mordre les lèvres: mon ami étoit avec
moi; mais l'épreuve où nous étions étoit si cruelle, que nous ne nous
envisagions plus sans pleurer. Nos yeux hagards se tournoient
quelquefois vers le ciel; ils étoient rouges et immobiles. Abandonnés
de la nature entière, nous gémissions sans rien demander à personne;
nous nous promenions pour nous promener. Le hasard nous conduisit sur
le Cours-la-Reine; des marchands (p. xl) de comestibles bordoient le
parapet; nous les côtoyons avidement. Un d'eux avoit étalé un morceau
de pain et un petit cervelas de trois sous, dans un endroit d'où on
pouvoit facilement les prendre. Je passai et repassai au moins cent
fois; ma main s'alongeoit presque malgré moi; je frissonnois de tous
mes membres: enfin, je m'éloignai avec mon ami, à qui je racontai ma
tentation. Il me moralisa avec tant de douceur et d'éloquence, que je
le reconnus pour mon maître, pour avoir eu le courage de me prêcher
dans un moment comme celui-là. La Providence, que nous avions inculpée
plus d'une fois, nous prouva bien ici qu'elle forme notre cœur et
couronne nos projets quand nous avons rempli notre tâche. En entrant
aux Champs-Élysées, je trouvai un billet de dix francs de la Maison de
Secours; alors le propriétaire du Pérou ne fut pas plus riche que moi.
Nous dînâmes à frais communs. Comme (p. xli) je n'avois ni linge ni
vêtement, nous partageâmes également, et pour cinq livres je remontai
ma garde-robe, depuis les pieds jusqu'à la tête. Sedaine a fait
autrefois une épître à son habit: que j'aurois bien voulu l'avoir le
soir en sortant de la friperie! Je n'ai jamais ri de si bon cœur
que ce jour-là. Le salon des Tableaux étoit ouvert; j'avois mangé ma
suffisance, à bien peu de frais et de bien bon appétit. Libre de ma
vieille enveloppe, qui, avec toute ma philosophie, me concentroit dans
moi-même plus que je ne voulois, je marchois lestement avec mon habit
de dix-sept sous, une chemise de vingt, et le reste de la garde-robe à
l'avenant, et j'admirois et je controlois tout. On me questionnoit, on
me regardoit, on ne fuyoit plus à mon approche; ou, pour parler plus
vrai, je croyois qu'on s'occupoit de moi, parce que j'osois m'occuper
de tout le monde. La fierté d'un villageois qui trouve un (p. xlii)
trésor, n'est qu'une image imparfaite de ma jouissance et de ma
vanité.
Le soir, j'osai voir un ami, qui me gronda de ma pusillanimité, et le
lendemain mon ami fut placé par le comte d'Angevilliers, et moi chez
M. Dup... et au journal Historique et Politique. Oh! que j'y passai
un temps heureux! mais il fut bien court. La révolution devint
terrible. On retrouvera cette lacune dans le cours de l'ouvrage. Cette
année est une des plus remarquables de ma vie. (Voyez page 155.) En
1794, après le 9 thermidor, je fis imprimer le Tableau de Paris en
Vaudevilles. J'avois tout perdu; je résolus de chanter moi-même[1].
«Le chant réjouit l'âme, me (p. xliii) dis-je; le fripier se pare de
l'adresse du tailleur; le comédien joue le seigneur, et emprunte le
génie du poète: pourquoi rougirois-je plus de vendre mes chansons
qu'un libraire un volume qu'il n'a pas fait? Cette propriété est le
fruit de mon éducation. Mais si l'ouvrage ne vaut rien? je ne vendrai
pas chat en poche.—Mais les convenances, les préjugés même ne
s'opposent-ils pas à cette résolution sage en elle-même, qui contraste
pourtant avec l'opinion qu'on doit avoir de toi?—le premier devoir
est rempli, lorsque je gagne ma vie à la sueur de mon front. Je ne vis
pas avec deux onces de pain.» (Nous étions au mois de mai 1795;
(p. xliv) j'étois rédacteur de la séance aux Annales patriotiques et
littéraires; l'agiotage du papier faisoit monter mon traitement à un
sou par jour.)
D'après ces réflexions, je me levai un jour à quatre heures du matin;
je venois de faire imprimer des couplets contre l'agiotage; je vais
les vendre; j'étois confus, mais il falloit manger. Je me mets à
chanter: des pleurs rouloient dans mes yeux, pendant que le sourire
s'épanouissoit sur mes lèvres. À six heures j'eus gagné cent écus en
papier, et je retournai à l'assemblée. Ceux qui travailloient à
d'autres journaux, dans la même loge que moi, se trouvoient heureux de
partager mon pain; mais la manière dont je le gagnois, donnoit matière
à un rire caustique qui me déplut. Au bout de quinze jours je cédai la
place, et les laissai jeûner glorieusement. Au reste, la mauvaise
honte et la crainte firent place à la tranquillité et à une vie
pénible, mais (p. xlv) moins austère. La multitude s'accoutuma à
m'entendre; on me chercha une origine. Je m'étois prononcé contre les
anarchistes: ceux-ci, pour me perdre, inventèrent sur mon compte cent
fables plus honorables les unes que les autres. D'abord, ils me firent
prêtre, pour avoir droit de me faire proscrire; puis attaché à la
maison de Rohan; ensuite évêque, confesseur de nonnes[2],
gouverneur (p. xlvi) de l'enfant d'un grand seigneur. J'ai donné
l'énigme de toutes ces exagérations, en offrant l'analyse de ma
conduite, imprimée, six mois avant mon exil, dans le Chanteur ou le
Préjugé vaincu.
Je passe ici différentes anecdotes plaisantes, dont je me suis bien
réjoui avec mes amis: car j'ai trouvé plus d'un homme (p. xlvii)
sensible qui a secoué le préjugé, et m'a favorablement accueilli[3].
J'oserai même dire que je n'ai bien connu le cœur humain que dans
cet état que la sotte vanité appelle abject, et que j'ai su honorer
par ma conduite. Durant mon exil, j'ai consacré mes loisirs à
recueillir tous ces traits; ils tiennent à la révolution, dont j'ai
fait l'analyse. Il est prudent de laisser refroidir la lave du volcan.
J'atteins le rivage; mon cœur, ivre de reconnoissance, est disposé
à prouver au gouvernement qu'il n'a point fait un ingrat.
(p. a-48) Cet ouvrage ayant été écrit dans les déserts d'une zone
brûlante, peut bien n'avoir pas été dicté par une rigoureuse
impartialité: les angoisses du malheur auront pu y laisser quelques
traits acérés que j'aurois peut-être adoucis en France. J'ai pu, ne
consultant que la position des déportés, peindre la conduite des agens
sous des traits un peu sombres; je leur ai peut-être trouvé des torts
et des délits qui ne seroient que des erreurs involontaires, si je les
eusse approfondis en homme d'état, si je les eusse vus dans leur
cabinet.
Le malheur des circonstances, la pénurie des moyens, la détresse de la
colonie, l'insubordination des noirs et des blancs, l'affreux mélange
et le chaos militeront beaucoup en leur faveur. Les chefs ont affaire
à des êtres si indolens, si peu conséquens avec eux-mêmes, qu'il faut
souvent être un ange ou un Prothée pour se faire tout à tous: cette
versatilité continuelle, si nécessaire dans les colonies au moment où
nous nous y trouvions, et si incohérente avec le caractère européen,
leur a beaucoup nui à nos yeux.
Les déportés qu'on leur envoyoit étoient presque tous des hommes
marquants et regardés comme dangereux. Il falloit plaire à la
mère-patrie, aux colons, aux noirs, aux exilés, ne point dévier de sa
place, et se faire aimer en punissant. L'amour, la haine ou la crainte
n'ont point eu de part à cet écrit; je leur en ai donné la preuve en
leur présence, quand d'un seul mot ils pouvoient m'ôter la vie, au
moment où je leur (p. a-49) disois, avec le caractère que mes amis me
connoissent, des vérités dures que le danger de la mort ne m'a jamais
fait taire. Ici, je leur dois la vérité; la voilà toute entière.
Si je consulte la vérité sur le 18 fructidor et sur ses causes, je
conviendrai avec franchise que la déportation, nécessaire pour l'état
et pour quelques individus, n'est devenue odieuse que par les
proscriptions et les vengeances partiales des hommes exaspérés qui ont
substitué leurs intérêts et leurs ennemis personnels à ceux du
gouvernement. La France républicaine, à cette époque entre le couteau
des royalistes et des anarchistes, fut forcée de mettre en vigueur les
loix de Rome et d'Athènes, l'ostracisme, la déportation, le
bannissement et l'exil.
Si je voulois, ou flatter les hommes ou pallier les torts des
déportateurs, je rapporterois la belle parole d'un des chefs de l'état
qui dit, le 19 fructidor, à un énergumène, prêchant la mort des
vaincus: Nous ne voulons ni les perdre ni les rendre malheureux; mais
priver pour quelque temps de leur patrie les étourdis et les
inconséquens qui méconnoissent la liberté et la mutilent, et
l'interdire pour jamais à ceux qui l'assassinent.
Je sais bien que la chaleur et l'énergie que j'ai déployées à cette
époque ont pu faire croire que j'étois influencé par un parti. Je
m'étois mis trop en avant pour espérer éluder la loi: mon exil ne m'a
point surpris; je l'ai presque légitimé par ma hardiesse; mais
(p. a-50) voilà ma religion et le fond de mon âme: la liberté dans le
cœur de l'homme est le feu sacré de l'autel de Vesta; les
gouvernemens ne peuvent ni l'allumer ni l'éteindre. Je ne suis libre
que quand un seul chef commande dans ma famille; je n'en veux pas plus
dans un état. L'anarchie est l'ivresse de la liberté; la république
est un beau songe, et l'uniformité de l'ordre et l'unité sont
l'aliment sacré du premier titre et du droit que l'on ne peut aliéner
qu'en voulant l'étendre ou le partager.... Voilà mes principes.....
mon erreur étoit bien pardonnable; j'en appelle au témoignage des
hommes probes. Aucune faction, aucun parti n'eut jamais de rapport
avec moi; je les défie tous sur ce point.
(p. a-51) Du 21 fructidor an II.—8 septembre 1805.
TRIBUNAL CRIMINEL
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.
Extrait des minutes du greffe du tribunal criminel du
département de la Seine, séant au Palais de Justice, à
Paris.
Au nom du peuple français.
Bonaparte, premier consul de la
République,
Aux membres composant le tribunal criminel du
département de la Seine, séant à Paris.
Le grand juge et ministre de la justice nous ayant exposé que
Louis-Ange Pitou, condamné à la déportation, pour avoir tenu des
discours tendans au rétablissement de la royauté, par jugement du
tribunal criminel du département de la Seine, en date du 9 brumaire an
6, s'est pourvu à fin d'obtenir grâce; nous avons réuni en conseil
privé, au palais du gouvernement, le 21 du mois de fructidor an II,
les citoyens Regnier, grand Juge et ministre de la Justice;
Dejean, ministre de (p. a-52) l'administration de la guerre;
Barbé-Marbois, ministre du trésor public; Rœderer et Abrial,
sénateurs; Bigot-Preameneu et Treilhard, conseillers d'état;
Muraire, président du tribunal de cassation; Viellard,
vice-président du même tribunal; ce dernier convoqué, mais non
présent.
D'après l'examen qui a été fait, en notre présence, de toutes les
pièces, et les circonstances du délit mûrement pesées, nous avons
reconnu qu'il y avoit lieu à accorder la grâce demandée.
En conséquence, nous avons déclaré et déclarons faire grâce à
Louis-Ange Pitou, condamné à la déportation, par jugement du tribunal
criminel du département de la Seine, du 9 brumaire an 6, pour avoir
tenu des discours tendans au rétablissement de la royauté, sans
toutefois que le présent acte puisse en rien préjudicier aux droits de
la partie civile.
Ordonnons que les présentes lettres de grâce, scellées du sceau de
l'état, vous seront présentées dans trois jours, à compter de leur
réception, par le commissaire du gouvernement, en audience publique,
où l'impétrant sera conduit pour en entendre la lecture, debout et la
tête (p. a-53) découverte; que lesdites lettres seront de suite
transcrites sur vos registres, sur la réquisition du même commissaire,
avec annotation d'icelles en marge de la minute du jugement de
condamnation.
Donné à Saint-Cloud, sous le sceau de
l'état, le 21 fructidor an II de la République,
Signé Bonaparte.
Par le premier consul, le secrétaire d'état,
Signé H. Maret.
Le grand juge et ministre de la Justice,
Signé Regnier.
Délivré, pour copie conforme, par moi greffier,
soussigné
Fremin.
(p. a-54) TOME PREMIER.
ANALYSE SOMMAIRE
DE LA PREMIÈRE PARTIE.
Division de l'ouvrage, pages
1 et
2. — Causes de déportation de
l'auteur. Voyez préface,
3. — Son départ. — Des antiquités de
Chartres. — Du séminaire, du collège où l'auteur a fait ses études.
— Il y trouve deux compagnons de déportation,
14,
15 et
16. — Il
passe à Châteaudun, son pays natal. — Il y voit sa famille,
16,
23.
— Passe-temps comique de Sainte-Maure à Châtellerault,
30,
31. — Du
commerce des couteaux,
32. — Singulier crime d'une jeune femme de
Poitiers,
33,
34. — À Niort, ils logent dans la prison où naquit mad.
de Maintenon,
38. — À Surgères ils se promènent librement sur leur
parole; on veut les faire sauver; pour quoi ils refusent; ils vont
visiter les tombeaux: réflexions sur l'immortalité de l'âme; anciennes
prophéties sur la révolution,
39,
44. — Arrivée à Rochefort,
46.
(p. a-55) DEUXIÈME PARTIE.
Entrée à la municipalité, les trois déportés font danser le
président, le commissaire se fâche, les fait serrer de près,
48,
49.
— Affreuse prison de Saint-Maurice,
50. — Évasion de Jardin et
Richer-Sérisy, journalistes. — Comment le concierge les fait sauver
par argent,
53. — Annonce d'embarquement,
56. — Un vieillard de
soixante ans reçoit un coup de fusil au milieu de la prison. — Départ
pour la rade. — Grand désordre dans la prison. — Arrivée sur la
frégate la Charente. — Nombre des déportés embarqués,
64. —
Description de la nouvelle prison de ce bâtiment,
66,
67. — Tableau
de l'intérieur de cette prison,
68. — Ration du bord,
70. — Conduite
de l'équipage à notre égard,
71. — Combien chacun a de lignes d'air
pur à respirer (ibid). — Un déporté se jette à la mer, de
désespoir,
73. — Les Anglais viennent bloquer le port. — La brume
nous donne le moment de sortir. — Nous sommes poursuivis par trois
bâtimens ennemis. — Terrible combat,
74,
80. — La frégate est jetée
sur les rochers,
82. (p. a-56) — À la côte d'Arcasson nous manquons
d'être assassinés par les écumeurs de mer des landes de Bordeaux,
83.
— On nous rembarque sur la Décade. — On hisse les malades et les
vieillards à bord,
85. — Portrait du capitaine et de l'état-major. —
Ration de marine. — Coq ou cuisinier du bord,
91, jusqu'à
97. —
Départ,
98. — Description des côtes d'Espagne. — Hymne du départ,
103. — Testament des exilés. — Leurs legs aux âmes sensibles et aux
directeurs,
105. — Passe-temps de l'entrepont durant la traversée. —
Horrible histoire du capitaine Lalier,
107 et
108. — La peur des
Anglais trouble la vue au capitaine Villeneau; il prend des souffleurs
pour une escadre ennemie,
110. — Suite des passe-temps de
l'entrepont. — Causes secrètes de la révolution. — Énigme du fameux
collier-cardinal,
111, jusqu'à
114. — Causes de la haine de la reine
contre le duc d'Orléans, de la vengeance du duc sur la famille de
Louis XVI,
115. — Causes de la fertilité de l'île de Madère,
116. —
Suite des passe-temps de l'entrepont. — Conte de l'amour suffoqué
par la jouissance,
117. (p. a-57) — Résurrection de l'amour. —
Sacrifice de l'innocence,
118, jusqu'à
122. Tempête,
123. —
Passe-temps de l'entrepont. — On agite la question du divorce,
124.
— Suite. — Histoire d'une femme dans le tombeau, exhumée,
ressuscitée, épousée par son amant et retrouvée par son mari,
125,
jusqu'à
144. — Passage et baptême du tropique,
145. — Température de
la zone Torride. — Description des cinq zones,
146, jusqu'à
151. —
Observation sur l'aérométrie,
151. — Passage entre les îles du cap
Vert. — Ce qu'elles produisent. — Banc de poisson. — Description
d'une belle nuit sur mer,
154. — Passe-temps de l'entrepont.
Événemens les plus remarquables et les plus terribles de ma vie,
155,
jusqu'à
165. — Pompe d'eau, ou trombe; ce que c'est,
166. — Résumé
de la traversée,
167, jusqu'à
169. — On voit terre,
170. — Mouillage
dans la rade de Cayenne. — Misère du pays. Mariage impromptu de la
colonie de 1763,
174. — Nous apprenons l'évasion des huit premiers
déportés. — Leurs noms,
174, jusqu'à
177. — Du port de Cayenne,
178.
(p. a-58) TROISIÈME PARTIE.
Entrée à Cayenne. — Procès-verbaux de débarquement. — Réception
faite aux déportés,
179. — Un mot sur les habitans. — Description
générale de l'Amérique. — Des Guianes, et particulièrement des
possessions françaises,
185. — De la ville de Cayenne. — Température
du pays. — Peinture des habitans,
204. — Des agens ou gouverneurs.
— Leur autorité,
218. — Maladies du pays,
224. — Départ de l'auteur
et de ses compagnons pour le canton de Kourou,
248. — De la colonie
de 1763, en parallèle avec la déportation,
258. — Leur misère. — Ils
luttent contre la famine. — Intérieur de leur case. — Anecdote
curieuse sur Terdisien. — Quel personnage c'étoit,
265 et suiv. —
Insectes des cases,
272. — Plantation, culture, commerce de la
Colonie; coton, cannes à sucre, indigo,
289. — Animaux domestiques et
reptiles, caïman,
310.
Fin du premier volume.
(p. a-59) TOME SECOND.
ANALYSE SOMMAIRE
DE LA SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE.
Caméléon, phénomène, pag.
1 et
2. — Cancer guéri d'une manière
étonnante, au Diogène du pays,
4. — Existence de Billaud et de
Collot-d'Herbois; leurs caractères, leurs malheurs; mort terrible de
Collot-d'Herbois,
16. — Nos malheurs à la case Saint-Jean; notre
abandon; nos camarades meurent,
30. — Nous sommes sans vivres, sans
connoissances. — Catastrophe terrible de Saint-Aubert,
33 et
suivantes; comment nous sortons de cette crise, jusqu'à
56. — Départ
de Jeannet.
QUATRIÈME PARTIE.
Désert de Konanama. — Liste des morts dans ce lieu,
59. — Les
déportés sont réunis à Synnamari. — Seconde liste des morts,
131. —
Portrait et agence de Burnel; il est chassé de la colonie,
151. —
Voyage chez les mangeurs d'hommes, où l'auteur court (p. a-60) risque
d'être dévoré, et ensuite empoisonné,
214, jusqu'à
278.
CINQUIÈME PARTIE.
Notre rappel. — La corvette qui vient nous chercher est prise sous
nos yeux par les Anglais, au moment où nous allions embarquer,
301. —
Départ de l'auteur par les États-Unis; il fait naufrage dans le port,
305. — Liste des déportés partis, restés et réfugiés à la Martinique.
— Retour. — Nouveaux malheurs et leur fin,
307, et suivantes.
FIN.
(p. 1) VOYAGE
À CAYENNE.
Forsan et hæc olim meninisse juvabit.
Virg. Æneid., lib. I.
L'innocent dans les fers, sème un doux avenir.
Les causes de mon exil sont connues; je le suis moi-même par mes
malheurs; ils ne m'ont pas été infructueux; j'écris librement ce que
je pense, non de mes ennemis, car je n'en connois plus; mais des pays
que j'ai vus, des compagnons d'exil dont j'ai partagé la destinée
pendant trois ans, des déserts brûlans qui les ont dévorés. Je
parlerai aussi des différentes classes d'hommes et de quelques animaux
de la zone torride. J'ai obtenu la liberté de voyager dans ce vaste
pays; j'ai resté à Synnamari et à Konanama; j'en ai tracé le plan
sur les lieux, et il n'y a pas une famille (p. 2) de déportés, à qui
je ne puisse donner des nouvelles certaines du genre de vie ou de mort
des personnes qui les intéressent. Le lecteur saura comment je me suis
procuré à ce sujet les pièces authentiques du gouvernement que je
mettrai sous ses yeux. J'ai commencé ce manuscrit sur la Décade, il
appartient plus à mes compagnons qu'à moi. J'ai été assez heureux pour
découvrir dans la Guyane une excellente bibliothèque, un peu rongée de
vers, mais bien meublée de manuscrits de voyageurs et d'historiens.
MM. Gourgue (notaire), Jacquard, Colin, Gauron (médecin) et Terasson
ne m'ont rien laissé désirer à cet égard; je leur dois aussi la
meilleure partie de mes recherches sur les mœurs des Indiens, des
noirs, des blancs, sur la culture du pays, sur les reptiles et autres
animaux curieux dont je dirai un mot. Ce préambule est déjà trop long,
nous avons du chemin à faire, mettons-nous en route.
Je fus arrêté le 13 fructidor an V (30 août 1797), pour avoir fait
quelques couplets où les Jacobins et le Directoire crurent se
reconnoître: traîné à la Force, jugé le 9 brumaire an VI (31
octobre) à la mort, puis à la déportation, (p. 3) j'en rappelai pour
gagner du temps, je me persuadois, comme plusieurs, que la déportation
seroit une noyade, sous un autre nom.
Le 2 novembre, on me conduit à Bicêtre, où, me voyant seul dans une
cellule de huit pieds quarrés, j'esquisse quelques notes sur mes
malheurs; j'avois le pressentiment d'une future inquisition. Chaque
cahier étoit à peine fini que je le remettois aux personnes qui
faisoient tous les jours une lieue pour venir me voir au travers d'une
grille de fil-d'archal, aux deux bouts de laquelle étoient des gardes
qui coupoient jusqu'au pain qu'on m'apportoit; heureusement que
j'avois un porte-clefs qui m'étoit affidé.
Le 6 janvier 1798, je venois d'envoyer mon dernier cahier, je
remonte à ma chambre sur les quatre heures après midi, pour me
remettre à l'ouvrage; à six heures, la porte de la galerie s'ouvre
avec grand bruit; deux porte-clefs entrent dans mon cabanon avec deux
flambeaux et deux dogues; j'étois sur mon lit, ils m'en font
descendre, me fouillent; mettent le scellé sur la porte de ma chambre,
et m'annoncent qu'un gendarme à cheval vient (p. 4) d'apporter un
ordre du commissaire de visiter mes papiers, et de me mettre
provisoirement au cachot, au pain et à l'eau, sur une botte de paille.
J'y descends, aussi-tôt me voilà à côté de deux condamnés à mort, l'un
pour assassinat sur la route de Pantin, l'autre, (Dupré) pour avoir
coupé les deux seins à sa maîtresse, par jalousie.
Le 12 janvier, on m'extrait de cette fosse pour lever le scellé de
mon cabanon, toujours avec un ordre du commissaire.
Il ne se trouve que des pièces insignifiantes, que je paraphe toutes
par numéros, et qui sont envoyées de suite à Paris.
Le 13 janvier, on me fit remonter dans mon cher cabanon qui devint
un palais pour moi, depuis que j'étois descendu à quelques pieds sous
terre; la porte en étoit fermée sur moi, mais je pouvois respirer
l'air. Ma fenêtre donnoit sur la cour voisine; ce jour là même je vis
mes amis à qui je ne pouvois parler que par signes, leur étendant la
main au travers des barreaux. Je leur avois appris un langage muet que
j'avois inventé en 1793, pour converser avec une voisine, qui
demeuroit en (p. 5) face de la maison d'arrêt de la section de
Marat. L'inflexion de mes doigts formoit toutes mes lettres. Ils
avoient un mouchoir à la main; j'appris par leurs signes que mon
jugement étoit confirmé.
J'attendois cette confirmation, que je n'ai jamais reçue.
Le 26 janvier, à dix heures du matin, deux gendarmes à cheval
viennent me prendre, et pour que je sois absolument sans ressources,
ils ont ordre de me dire que je suis mandé à Versailles, pour déposer
dans une affaire. La ruse est trop grossière pour que je ne m'en méfie
pas; ils me mettent les menottes; me voilà en route pour Rochefort, ou
pour la déportation.
Je marchois à pied au milieu de mes deux archers à cheval, ayant les
deux mains enferrées et cachées dans mon mouchoir; je ne me souciois
pas de traverser Paris dans cet accoutrement; mes guides y
consentirent, et nous prîmes par le boulevard d'Enfer. C'étoit
l'hiver; que ces lieux étoient déserts! ils me rappeloient le plaisir
que j'y avois goûté dans la belle saison dernière. En approchant de
la (p. 6) maison de Maury (une des bastilles de Robespierre), je
comparai les deux époques.
À dix heures, j'arrive à Vaugirard, guinguette fameuse autrefois, et
qui ressembloit à un désert: c'étoit le point de ralliement des
babouvistes au 23 fructidor an IV (4 septembre 1796). Le brigadier me
fit traverser le village sans autres menottes que ma parole, me remit
à ceux qui devoient me conduire à Versailles, et me força d'accepter
du tabac pour ma route; je lui remis deux lettres que j'adressois à
Mrs. B43ss2t et B2v2c265t, les invitant à ne pas m'abandonner dans
le moment où je partois sans argent et sans linge. Plusieurs voisins
et voisines se rendirent chez mon nouveau guide pour me voir. Un
scélérat, un proscripteur, un proscrit, deviennent toujours des objets
de curiosité; on me plaint, on me fait cent questions pour m'engager à
répondre: j'attends le moment de mon départ en silence. J'étois encore
à jeûn; l'épouse de mon nouveau guide me fait déjeûner; l'officier me
met sur ma route avec un seul guide à cheval, en exigeant ma parole
d'honneur que je ne chercherai pas à m'évader: je la donnai, mais à
regret, car je trouvai plus d'une occasion (p. 7) de prouver aux
inconséquens que les honnêtes gens mettent l'honneur et le serment
au-dessus de la vie.
Le brouillard venoit de se dissiper; le soleil perçoit les nuages, je
marchois tête baissée, rêvant à la sensibilité de cette jeune femme
que je n'avois jamais vue.
Je foule une pelouse qui commence à poindre, des rigoles d'une eau
argentine traversent par mille sinuosités une prairie déjà tapissée de
verdure. À ma gauche, une montagne escarpée n'offre encore que les
désastres de l'hiver; les coteaux de vignes qui la couvrent sont nuds;
les vieux pampres d'un noir grisâtre, amoncelés dans les ruisseaux, en
arrêtent le cours et tamisent les eaux. Nous voilà à Issy; j'y cherche
en vain les ruines du fameux temple d'Isis ou Cérès. C'est à ce
petit village que Paris doit son nom. Issy vient d'Isis, et Paris de
paratum ysi ou par isi, temple dédié à Isis ou égal à celui
d'Ysis. Le tems qui ronge les monumens et l'histoire, effacera de même
ce moment de tristesse. Avec le tems, je me souviendrai d'avoir passé
à Issy pour être déporté; avec le tems, je reviendrai dans ce
village, avec autant de plaisir que j'ai de peine à (p. 8) le
quitter. Ce superbe parc qui l'embellit, me
prouve que la peine, le plaisir, la richesse
et la puissance passent comme l'ombre. Ce
jardin d'Eden appartenoit à madame de
Rohan-Guéménée; il fit envie à Robespierre;
il se l'appropria, en faisant guillotiner la
propriétaire. Quinze jours avant sa mort, ce tyran
rêveur cherchoit à dissiper son chagrin par une
promenade dans le genre du Promeneur solitaire.
Sa vue inspiroit tant d'effroi, que personne
n'osoit l'approcher, si ce n'est Collot-d'Herbois,
Billaud-Varennes, associés de ses proscriptions.
Les hommages de la multitude étoient un poids qui
l'accabloit. Pour venir à Issy, il se déroba à tous
les témoins, excepté aux remords. Après avoir fait une
promenade en bateau sur l'étang de ce parc, il dit à ses
chers collègues: «Rien ne me plaît ici, tout
m'ennuie à la ville comme à la campagne; je voudrois m'en
retourner...--Tout me plairoit ici; j'ai le trésor qui lui
manquoit, la paix d'une bonne conscience. Sans elle, le bonheur
est du fiel, et l'adversité un enfer.»
Nous voilà au pied de la montagne de Bellevue: Ah! mon cher
conducteur, de (p. 9) grâce
arrêtons-nous un moment, je suis fatigué. Je me repose sur une pointe
de rocher et me retourne vers Paris, je découvre cette ville, le nuage
de fumée qui s'élève au-dessus me sert à désigner les quartiers, je
les nomme à mon guide, voilà la place Louis XV, le boulevard, le
faubourg Saint-Germain: maintenant mon ami songe à m'apporter à
dîner, il ne sait pas que je suis en route pour un autre monde.
Depuis un quart d'heure, le bois du parc de Bellevue m'a dérobé Paris,
et je me surprends encore les mains jointes et les yeux fixes; en
parcourant l'horison j'apperçois la prison d'où je sors, elle est à ma
gauche sur une montagne parallèle à celle-ci, je la regrette parce
qu'elle est près de Paris, parce que j'y voyois mes amis. Quand on
perd tout, nos vues restreignent nos besoins au seul nécessaire; quand
on éprouve des douleurs aiguës, on envie le moment où l'on pleuroit
pour une égratignure.
En traversant Viroflay, je reconnois l'auberge où je descendis le 19
octobre 1789, en arrivant à Paris pour la première fois. Nous nous
mettions à table, lorsqu'un courier entra (p. 10) en s'arrachant les
cheveux: Ils sont des scélérats! crioit-il, ils sont des
scélérats!—Eh! qui donc? est-il fou?—Eh! non, je ne suis pas fou:
ce sont ces brigands qui viennent d'assassiner un boulanger, un des
plus honnêtes hommes de la terre, et qui vont promener sa tête sur une
pique.
Ces lieux me fournissent un conflit d'idées qui s'effacent l'une par
l'autre, comme les ondulations d'une mer orageuse. Ici tout parle à ma
mémoire, là, tout parle à mon cœur: je vois dans la plaine de
jeunes garçons avec de petites filles, abrités par une haie, auprès de
laquelle ils font du feu, en gardant leurs vaches et leurs chèvres.
J'ai eu le même bonheur qu'eux, ayant été élevé à la campagne jusqu'à
neuf ans: ils me représentent les pâturages de Deury et de
Valainville. On dit que cet âge est celui de l'innocence, soit, mais
on passe bien son tems; si j'y revenois je ne pourrois jamais mieux
l'employer; comme eux, nous faisions du feu près de la grosse
pierre; Mathurine et Nanette nous proposoient de danser autour. Le
jupon de toile tomboit au milieu du bal, on s'asseyoit auprès du feu,
une jambe en l'air.—Mais cache-toi donc, (p. 11) Nanette!—Pourquoi
me cacher?—Maman t'a grondée, l'autre jour, pour avoir ôté ton
cotillon.—.... Oh! elle n'est pas là. Voilà l'instinct de la nature,
qu'une lueur de raison éclaire quand l'enfant cherche à se cacher. Un
beau jour la maman les surprend, leur donne le fouet, ils rougissent,
se taisent, se cherchent, et veulent deviner un mystère qui ne devroit
se développer qu'avec l'âge. Fait-on bien de les fouetter? je ne le
crois pas, il vaudroit mieux leur faire honte, ou les changer de
village.
Nous voilà à Versailles: on me met en prison dans les Petites-Écuries
de la reine; le concierge Bizet est le gardien de son épouse, prévenue
d'émigration; ils voient les déportés de bon œil. On me loge dans
un grand chauffoir où sont douze ou quinze villageois, arrêtés pour
avoir voulu soustraire leur curé à la déportation. À neuf heures on
ouvre la porte de la grille, on m'appelle, ce sont mes amis à qui
j'avois écrit le matin; le lendemain, ils m'accompagnent jusqu'à
Rambouillet; nous descendons au Grand Monarque, puis on me conduit en
prison tandis que mes amis sont descendus payer le dîner; malheureux
stratagème (p. 12) pour ménager leur sensibilité! La prison est un
cabaret; le concierge me prie de faire mon signalement sur son
registre, et de donner décharge de ma personne aux deux gendarmes qui
m'ont amené. Je prends la plume en riant.
Le soir, je faillis en montant dans ma chambre enfermer le concierge
qui avoit passé devant moi, et m'enfuir avec les clefs de la prison,
qu'il laissoit aux portes; je n'avois qu'un pas à faire pour gagner la
rue; mais je ne voulus pas tromper sa confiance.
28 janvier. Je devois faire route avec une jeune femme; au mot
déporté, elle a reculé d'effroi: c'étoit la sœur du dernier
président de la société populaire. Un soldat qui vient d'obtenir sa
retraite, n'est pas si scrupuleux. À sept heures, nous avons traversé
le parc; on parle du 18 fructidor; il n'a pas connoissance des
causes de cette journée; mais Pichegru est un conspirateur, ainsi
que tous ceux qui pensent comme lui. Je lui demande, en riant, la
preuve de ce qu'il vient d'avancer.—On l'a imprimée dans tous les
journaux, par ordre du directoire; donc que cela est vrai.—Vous avez
servi sous Pichegru, étoit-il royaliste?—Non, mais il l'est devenu
depuis.—Pour (p. 13) quels motifs?—Je n'en sais rien, mais les bons
journaux le disoient bien avant le 18 fructidor.—Quels sont les bons
journaux?—L'Ami du Peuple, l'Ami des Loix, les Hommes Libres, le
Batave, le Révélateur, l'Ami de la Patrie, le Pacificateur.—Pourquoi
ceux-là valent-ils mieux que les autres?—Parce que le directoire les
achetoit pour nous en recommander la lecture; ceux-là sont ennemis
jurés des rois, des richards et des propriétaires insolens; ils
veulent l'égalité parfaite dans toutes les fortunes.—Marat la
demandoit aussi.—C'est bien comme lui que nous la voulons; puis je
n'entends rien à toutes vos raisons; tout le monde est pour le
directoire; il me paie bien, et je n'ai qu'à m'en louer. Nous
descendîmes à Épernon pour dîner; il fit bande à part, crainte,
dit-il, d'être empoisonné par un royaliste. Nous le plaisantâmes; il
se mit en grande colère, et nous donna la comédie, jusqu'à une lieue
avant d'arriver à Chartres.
Voilà le Bois-de-la-Chambre, maison de campagne où nous allions
promener souvent, quand je faisois mon séminaire dans cette ville. Je
ne m'en rapportois pas à ceux qui me disoient (p. 14) alors que ce
tems étoit le plus heureux de ma vie.... Voilà le parc, la petite
montagne du Permesse, où Phébus a entendu tant de sottises..., la
cabane de la jolie vigneronne qui faisoit mordre à la grappe..., la
charmille où nous nous enfoncions, tandis que le supérieur faisoit une
partie de trictrac. Le nouveau propriétaire a réparé la brèche faite
au mur de l'enclos. Nous entrons dans les faubourgs de Chartres.
Voilà les prés de Reculée, ainsi nommés par Henri IV, qui en fit
reculer les ligueurs le 12 avril 1591. En face, sur la rive gauche de
l'Eure, est le jardin du fameux Nicole.... Je ne vois plus que les
ruines de l'église de Saint-Maurice. Nous avons passé sous la porte
Drouard, pour arriver dans la ville par la rue du Muret. Voilà la
maison de M. l'abbé Ch172s, à côté de celle de la belle marchande de
modes aux pâles couleurs. M. le professeur de rhétorique, si riche en
vermillon, ne put jamais lui donner des roses pour des rubans. Plus
haut, est le collège de Poquet, qui sert aujourd'hui de caserne. On
fait la soupe dans le cabinet de physique; des fusils sont rangés à
la place de l'électricité; cependant (p. 15) les anciens hôtes de la
rue sont encore tranquilles propriétaires. Notre petit séminaire n'est
pas démoli!... Il sert de corps de garde et de tribunal de police
correctionnelle. Voilà ma chambre en 1784. Quel sentiment de plaisir
et de peine j'éprouve à l'aspect de ces lieux que je regarde comme mon
berceau! Nous traversons la cathédrale; on chante vêpres; je reconnois
la Vierge noire de bout sur son pilier usé par les lèvres des
pélerins et pélerines de toute la Beauce. À ma droite, est la chaire
où l'abbé Ch17hs avoit prêché avec tant de succès en 1783, le
triomphe de la religion, où il monta en 1793 pour apostasier cette
même religion. Il étoit professeur de rhétorique et puriste en 1783;
il étoit montagnard en 1792. S'il n'avoit eu que la douce ambition de
cultiver les lettres avec honneur, il auroit autant illustré Chartres
que le fameux Regnier, un des maîtres de Despréaux, que M. Guillard,
notre Quinault moderne, et Colin d'Harleville, dont l'optimiste,
l'inconstant font autant de plaisir à la scène, que d'honneur au
cœur du poète.
Le brigadier me recommande au concierge Frein, parfait honnête homme:
j'aurai deux (p. 16) compagnons de voyage et de malheur; un jeune
officier, nommé Givry, et un ancien bénédictin de Vendôme, nommé
Cormier.
31 janvier. Nous voilà en route pour Châteaudun, mon pays; je vais
embrasser ma tante, ma mère nourrice, ma meilleure amie, celle à qui
je dois mon éducation! Nous avons dépassé Thivart; que ne puis-je
allonger ma route! Je serai isolé, quand j'aurai laissé mon pays
derrière moi. Nous arrêtons à Bonneval; le capitaine de gendarmerie de
cette petite ville a épousé une dunoise qui me reconnoît; nous avons
soupé ensemble, il y a dix ans, chez une dame Hazard.... Souvenir
délicieux! Heureux tems! Si vous lisez ce passage, aimables convives,
vous regretterez comme moi ces beaux jours. Si les roses tombent de
nos joues, que l'amour ramène l'amitié; nous nous en contenterons
peut-être: dînons vîte pour faire les trois lieues jusqu'à Châteaudun.
Nous voilà à Marboué; le Loir reçoit ici le tribut d'une petite
rivière où j'ai failli me noyer à l'âge de six ans.
Cette rivière, nommée la Cony, ou la Resserrée, coule de l'est à
l'ouest, et ne tarit jamais. Au milieu de la canicule, tandis que
(p. 17) les autres fleuves se dessèchent, son lit est souvent trop
étroit pour la contenir; elle présente le phénomène du Tigre dans les
montagnes d'Arménie. Comme lui elle disparoît à deux lieues au-dessus
de la paroisse à qui elle donne son nom. Si les habitans se hasardent
d'ensemencer le vallon qu'elle semble abandonner, au milieu du
printems, elle se gonfle, emporte les moissons et recule sa source
d'une lieue. Ses bords sont couverts d'aunes qui ceintrent d'un
berceau l'eau tranquille et noire. Les bestiaux qui pacagent à deux
portées de fusil de son lit, disparoissent souvent dans les gouffres
innombrables qui sont dans la prairie.
Il y a quinze ans, je me transportois en idée dans la chaumière de mon
père à Cony ou à Valainville où je suis né; nous expliquions alors la
Descente d'Énée aux Enfers; du grenier de notre cabane, je croyois
voir dans les sinuosités de la Cony le Styx ou l'Achéron se replier
sept fois sur lui-même. Heureux tems que celui-là! Je n'avois vu que
notre hameau, le clocher de notre paroisse et la prairie où nos vaches
pâturoient; le château de Prunelay et le comté de Dunois me tenoient
lieu des quatre parties du (p. 18) monde. À neuf ans, ma mère me mena
à la ville pour y rester chez ma tante: je me tenois des heures
entières sur le seuil de la porte, fixant la campagne avec le même
serrement de cœur que j'éprouve aujourd'hui; Valainville, Cony me
sembloient à deux mille lieues.
De nouveaux obstacles m'empêchent de remonter à la source de cette
rivière. Hélas! qu'y trouverois-je? La chaumière où je suis né est
passée à d'autres maîtres; depuis vingt-cinq ans mon père repose dans
le tombeau; il y a dix ans que j'ai versé des larmes sur sa fosse;
j'étois fixé à Paris depuis la révolution, et je passe dans mon pays,
déporté dans un autre monde. Ô mon père! que ton ombre voltige dans ma
prison, qu'elle me console dans mes revers: je l'entends, cette ombre
chère à mon cœur, me tracer la voie de l'honneur et de la
constance: «Tu n'as plus que ma sœur qui t'a tenu lieu de mère,
dit-elle; cette révolution qui t'engloutit, a fait mourir ta mère de
chagrin, et j'ai été assez heureux pour la devancer de vingt ans: sois
toujours honnête homme et invariable dans tes principes; cette
bourrasque révolutionnaire n'aura qu'un tems; tu as le sort des
hommes probes, et tu trouveras (p. 19) des âmes sensibles dans la
France équinoxiale.»
Humble cabane de mon père,
Témoin de mes premiers plaisirs,
Du fond d'une terre étrangère,
C'est vers toi qu'iront mes soupirs.
Nous approchons de la montagne dont la cîme me montre Châteaudun;
voilà mon pays, voilà mon cher pays; depuis si long-tems que j'en suis
sorti, reconnoîtrai-je encore mes amis? Les Dunois ne sont pas
changeans, on les accuse même de trop de probité en révolution, car en
1793 on eut toutes les peines du monde à trouver douze membres de
comité révolutionnaire.
Le tems du Messie revient sans doute; les montagnes s'applanissent et
les vallons se comblent: une roche escarpée servoit d'escabelle pour
grimper à cette ville, aujourd'hui la pente est douce et
imperceptible. Nous voilà au haut du rocher qui a fourni les pierres
de la nouvelle Albe assise sur la plate-forme de ces grottes
blanchâtres. En 1400, avant la naissance de Thibault, comte de Dunois,
surnommé le Beau Bâtard du premier duc d'Orléans, Châteaudun étoit
nommé la Ville-Blanche; elle fut brûlée (p. 20) en 1736 par de
petits enfans qui faisoient du feu auprès d'une meule de Chaume. Louis
XV en fit relever les premières façades, et exempta les habitans de
taille pendant vingt ans. Châteaudun, par cet incendie, est devenu une
des villes les plus régulières: ses rues tirées au cordeau,
aboutissent à une grande place parfaitement carrée, du milieu de
laquelle on voit toute la ville.
Les plus habiles peintres épuisent leurs palettes pour copier sur la
toile ou l'ivoire les coteaux parallèles à la cité, vus du côté du
nord.
Deux chaînes de montagnes frugifères à droite et à gauche de la
rivière, laissent au milieu une vallée fertile, d'une demi-lieue de
largeur; la ville s'élève à près de quatre cents pieds en l'air; le
Loir, qui coule au pied, se divise en deux bras, et roule paisiblement
dans son lit étroit une eau argentine qui semble quitter à regret la
montagne d'où elle filtre par cent crevasses invisibles. Le printems
sur ces bords est le vallon de Tempé. Des jardins d'un côté; de
l'autre, de riches prairies laissent le spectateur immobile promener
ses regards sur un tapis de verdure liseré de fleurs: quand Pomone a
succédé à Flore, il grimpe dans des vignes rampantes (p. 21) vers la
cîme des rochers à pic, plantés de bois qui ombragent çà et là des
réservoirs d'une eau pure; bois, prés, vallons, montagnes, gazons,
jardins, vergers, se trouvent mêlés et confondus dans un magnifique
désordre.... Horison enchanteur, tu me laisses appercevoir les chênes
touffus de Macheclou, où nous vendangeâmes avec l'Amour en 1785....
Retrouverai-je cette jolie vendangeuse? Des simples jeux de notre
enfance se souviendra-t-elle encore? Entrons à Châteaudun.... Je ne
désirerois qu'une de ces huttes sous le rocher d'où s'élève un nuage
de fumée. Autrefois je dédaignois le sort de ces malheureux blottis
dans les fentes de la montagne, comme les Lapons dans leurs
souterrains. Nous voilà sur la route de la prison. Au Point-du-Jour
restoit un de mes amis, qui a tant aboli de préjugés depuis la
liberté, qu'il ne croit plus à rien; son flegmatique cousin est plus
sage et moins brillant.... Ô ma bonne tante Durand, il y a dix ans que
j'ai donné des larmes à vos cendres; vous revivez dans vos enfans qui
emporteront comme vous les regrets des amis de la vertu!
Le tems a flétri les roses de cette jolie femme qui nous offroit en
1785 le couple de Mars et de Vénus; petite brune agaçante, consultez
(p. 22) votre miroir, l'Amour n'a qu'un tems pour vendanger. La
liqueur que vous versiez en 1783, étoit du nectar; vous avez encore le
bocal, c'est un souvenir qui nous plaît. Non loin de la maison du
notaire, dont le fils m'apprit à décliner musa, je vois celle qui me
fit décliner amor.... Nous sommes près de la rue de Luynes, cette
belle église de Saint-André est une grange d'où Jérémie s'écrieroit:
Comment, en un plomb vil, l'or pur s'est-il changé?
Voilà le collège où j'ai commencé mes études; un savetier remplace M.
Bucher, proscrit avec son frère, pour avoir été fidèles à Dieu; leur
père est mort de chagrin de l'exil de ses deux enfans si chers à toute
la jeunesse dunoise pour laquelle ils se sont sacrifiés: M. Doru, qui
les avoit précédés dans la place de principal du collège, quoiqu'il
ait soixante-sept ans, nous suivra dans le Nouveau Monde, pour avoir
voulu remettre dans la voie de l'honneur un prêtre qui avoit abjuré sa
religion et son Dieu pour sauver sa vie.
La prison de Châteaudun, aussi affreuse que la bastille, sera bien
moins désagréable pour nous. Le commissaire du pouvoir exécutif,
(p. 23) Dazard, est mon ami; nous avons étudié et vécu ensemble à
Paris pendant deux ans; il descend derrière nous; la place qu'il
occupe me le rend suspect. Il m'échappe quelques vérités sur nos
persécuteurs dont il prend la défense; le tout se dit en riant du bout
des lèvres.—Trève de révolution, dit-il, je ne veux voir en toi qu'un
ancien ami, et ta prison sera ouverte à toutes tes connoissances. Mes
amis entrent un moment, et nous laissent bientôt la liberté de souper.
Dazard m'amène mon cousin avec une de nos voisines et un jeune homme
que j'aurois bien dû reconnoître; c'étoit le frère de celle que je
n'ai jamais oubliée; en ce moment, il me faisoit fête pour sa sœur.
Mon cousin, en me remettant une petite somme de la part de ma tante,
que la révolution a ruinée, me dit, avec sa gravité ordinaire, qu'elle
ne viendra pas me voir, parce que ma position la désole; il veut
ensuite me moraliser; je réplique par un grand salut qu'il comprend
fort bien. Nous étions seuls, livrés à nos réflexions, transis de
froid auprès d'un grand feu. Les planchers ont vingt ou trente pieds
de haut, et la grandeur de la chambre répond à son élévation. Mes
compagnons se (p. 24) couchèrent tristement, pour moi, je renouvelai
connoissance avec Mrs. Desbordes, Courgibet, Thierry, qui étoient
nos gardiens pendant cette nuit. Que de nouvelles à apprendre! Voilà
la plus marquante. Ma première amie est mariée avec un ancien abbé qui
avoit été mon écolier; il est plus heureux que son maître; ces pertes
sont fréquentes pour moi, depuis la révolution.
Il étoit trois heures du matin avant que le sommeil me fît quitter la
société. Au point du jour, une foule d'amis nous réveillèrent; je
revis ce jeune homme d'hier, avec Feulard que j'avois quittés à l'âge
de huit ans. Tous deux ont gagné en grandissant, et du côté des traits
et du côté du cœur. Gillement et son épouse nous donnent des
preuves de sincère amitié. Parler des Allaire, des Bourdin, des
Feulard, des Rousseau, des Dimier, des Lumière; c'est nommer
la probité et la franchise du vieux tems. Si ces momens pouvoient
durer; nous ferions ici volontiers trois tentes. Pour nous voir, des
sexagénaires descendent en prison, pour la première fois de leur vie.
Mr. B. Desbordes, vous m'avez vu naître, et déjà vous touchiez à
votre quarantaine; vous avez (p. 25) été à mon âge; si j'atteins le
vôtre, je vous donnerai pour modèle à mes enfans.... Des dames
viennent aussi nous consoler; et qui peut mieux y réussir que les
Grâces? C'est ma première amie, avec sa mère et sa belle-sœur; ses
traits sont charmans, mais un autre la possède; elle fait son bonheur,
et moi, je suis déporté.... Voilà, dit-elle en me présentant un jeune
enfant que sa belle-sœur tenoit, voilà le gage de notre hymen. Je
l'embrassai en fixant la mère qui se mit à sourire en baissant les
yeux. Voilà le gage de notre hymen! Un sentiment involontaire le
repoussoit de mes bras, le souvenir de sa mère le concentroit dans mon
cœur.... Voilà le gage de notre hymen!... Tu ne m'appartiendras
donc jamais. Un autre Dunois monsieur Drouin, que je n'attendois
guères, me tire à l'écart (je puis l'appeler mauvaise tête et bon
cœur) pour m'offrir des moyens d'évasion.
—Je vous remercie, lui dis-je, on inquiéteroit ma tante; je ne veux
pas causer sa mort; je violerois ma parole; je suivrai ma destinée.
Des amis en crédit m'avoient peut-être fait faire cette proposition.
Nous dînons avec de nouveaux hôtes; la (p. 26) prison qui étoit si
grande hier, est trop petite maintenant; enfin je revois ma tante,
j'essuie par des baisers les pleurs qu'elle répand. Ô ma bonne tante,
vous méritez un article bien long dans cet écrit! Que je vous ai donné
de chagrins! J'étois ingrat en partant de chez vous; l'expérience et
le malheur me font rentrer reconnoissant. Elle me serre les mains, me
donne des leçons pour l'avenir, en blâmant mon étourderie.
Vivier, Gasnier, Marcault, Thibault, Leveau, Prudhomme, mes camarades
de collège, reviennent passer l'après midi à la prison; on récapitule
les fredaines d'école. Le soir nous surprend à table; on boit, on rit,
on chante, on épuise tous les sentimens; dans une heure, on vit pour
vingt ans.
Le 2 février, à six heures, nous sommes sur la route de Vendôme. Je
dis adieu en pleurant à Châteaudun.... Quand le reverrai-je?...
Mlle. Lebrun, belle-sœur du capitaine des gendarmes, fait route
avec nous jusqu'à Tours. Le concierge de Vendôme, espèce de Vulcain,
qui ne sait ni lire ni écrire, nous fouille comme des forçats, et nous
conduit en grondant à l'abbaye, dans les chambres de Babœuf
(p. 27) et Buonarotti. Cormier, notre troisième compagnon de voyage,
bénédictin de cette maison, est prisonnier dans son ancienne cellule
changée en cachot.
La ville que nous allons quitter, n'étoit remarquable que par une
riche abbaye de bénédictins, qui a servi en 1797 de tribunal et de
prison à la haute-cour nationale. C'est la patrie de Ronsard.[4]
(p. 28) La société populaire nous fait escorter par un bon nombre de
chasseurs à nos gages; et pour ne pas effaroucher la sensibilité des
habitans, le brigadier ne nous met les menottes qu'au sortir de la
ville. (Nous ne les eûmes que deux lieues, grâce aux sollicitations de
mademoiselle Lebrun. À cela près, nous n'avons point fait une route
aussi désagréable que plusieurs de nos confrères, qui ont été
enchaînés et confondus avec les voleurs et les assassins qui alloient
subir leur jugement.) Nous fûmes donc libres à deux lieues de Vendôme,
à condition que nous irions loger chez la cousine du brigadier, que
nous paierions sa dépense et celle de toute sa garde.
La nouvelle brigade de Châteaurenaut fut plus honnête; le capitaine,
nous dit le lieutenant de Vendôme, devoit être destitué, parce qu'il
traitoit les déportés avec trop de ménagement: (p. 29) il étoit de
l'opinion de tous les châteaurenaudins. Nous passons au pied d'une
tour antique à moitié démolie; c'étoit l'ancien château de la famille
du comte d'Estaing. Nous voilà à Tours.
Les environs de cette ville sont enchanteurs. Nos rois de la troisième
race jusqu'à Henry II, ont choisi la Touraine pour leur jardin de
plaisance; les muses et les grâces y faisoient leur séjour sous
François Ier., l'un des plus aimables rois de France. Grecourt,
dont les dévotes ne lisent les contes que dans leurs cellules, étoit
tourangeau; je ne le mettrai point en parallèle avec le savant
Grégoire de Tours; l'un honoroit le sanctuaire et donnoit des
matériaux à l'histoire, l'autre souilloit l'autel et les grâces par
des obscénités; mais cet air de volupté est un vent du terroir; et si
l'amour n'étoit pas éternel, il seroit né à Tours. Je ne recherche
point les antiquités de cette ville si attrayante par son site et
l'amabilité de ses habitans, que tous les voyageurs sont tentés de s'y
fixer. Quel beau coup-d'œil présentent ces quais et cette Loire qui
coupent la ville en deux!... La Seine n'offre rien qui approche du
majestueux de ce pont entouré çà et là d'îlots et de monceaux de
pierres, de (p. 30) parapets et de promenades superbes. À droite et à
gauche, une forêt de mâts s'élève d'une infinité de bateaux semblables
à une flottille prête à appareiller. Mais le lieutenant nous invite au
silence. Les jacobins plus fouettés ici qu'ailleurs, sont plus
vindicatifs et plus furieux depuis le 18 fructidor. MM. Barthélemy,
Marbois, ont failli devenir leurs victimes. M. Perlet a couru le même
danger, pour avoir inséré dans son journal la justification d'un jeune
homme que la commission militaire avoit fait fusiller, comme émigré,
et dont la famille a obtenu la réhabilitation.
Je n'ai pas trouvé de guides plus disposés à nous laisser évader, que
ceux qui nous ont accompagnés de Tours à Sainte-Maur. Le capitaine de
la brigade, homme fort instruit, est venu le soir nous faire un long
sermon sur la grandeur et la solemnité du 18 fructidor. Il a bu et
parlé à son aise, tandis que nous dormions.
Nous coucherons ce soir à Châtellerault; nous sommes en route de bonne
heure, pour ne pas nous trouver à la fête patriotique qu'on chomme aux
Ormes. On y plante l'arbre de la liberté; nous en voyons seulement
les apprêts; (p. 31) des tonnes de vin sont aux pieds de longues
tables rangées autour de ce grand peuplier ceintré d'épines. Le hasard
nous dédommage de cette privation; nous avons derrière notre voiture
un petit cheval qui appartient à l'entrepreneur de Châtellerault; il a
trois pieds de haut; on compte ses côtes; il ne mange qu'une fois dans
vingt-quatre heures; mes deux compagnons m'affourchent dessus;
j'étends les bras comme un oiseau qui a les ailes cassées; je
représente Sancho au naturel; on pique la rossinante; nous arrivons à
Dangé; les enfans nous suivent avec leur musique ordinaire; enfin, il
s'agit de sauter un fossé; ils viennent à bout de me faire passer
par-dessus les oreilles du cheval; les enfans sont au comble de la
joie; je ne sais s'ils rioient de meilleur cœur que moi. Plus loin,
nous trouvions des bourbiers, car c'est une route d'enfer; mes deux
compagnons portoient le cheval et le cavalier, et nous figurions
presque comme le meunier, l'âne, et son fils allant au marché. À
Châtellerault, nous descendons au Faisan-Couronné.
Nous ne sommes pas assis, que trois jeunes demoiselles viennent
civilement nous présenter (p. 32) leur magasin de couteaux. Il faut en
acheter malgré soi; elles nous suivent par-tout, nous promettent leurs
faveurs pour un couteau. Tout se vend, se troque et s'achète ici pour
un couteau; l'amour s'y trafique pour un rasoir ou pour un couteau. Ne
croyez pas qu'on y voie plus d'Abailard que dans nos cloîtres; on n'y
voit même pas de Fulbert. Ce commerce est du goût des petites filles;
les parens les envoient à tous les étrangers. Sont-elles jolies, le
père y trouve son compte, l'étranger le sien, et la vendeuse est la
mieux servie. C'est à la galanterie des jolies châtelleraudaines que
nous devons ce proverbe d'amour, je te donnerai de petits couteaux
pour les perdre. Les châtelleraudains sont actifs, polis, spirituels
et industrieux; ils ne devroient pas borner leur commerce à la
coutellerie, qu'ils ne perfectionnent point, et qu'ils livrent à
très-bon compte: les marchands ne s'y portent point envie comme dans
les autres villes. Notre aubergiste, qui est coutelier, laisse monter
les autres voisines. Jusqu'à huit heures, les marchandes sont à la
queue les unes des autres. En passant ici, le général Dutertre, qui
escortoit les seize premiers déportés, s'est donné (p. 33) la comédie
de s'acheter à bon compte, car il est économe, et il avoit carte
blanche, pour mille écus de couteaux.
Le 13 février, une mauvaise charette, un voiturier escloppé sont à
la porte à six heures du matin, pour nous mener à Poitiers. Nous
sommes à quatre-vingts lieues de Paris.
Notre abbé prend le fouet du charetier, jure comme un diable dans un
seau d'eau bénite; sans cette précaution, nous serions encore en
route.
Poitiers est bâti sur un rocher; ses maisons sont sans art et sans
goût. Charles-Quint l'appeloit le village de France; les rues sont
obstruées par d'énormes bœufs qui servent de chevaux; ses alentours
sont agréables: c'est le berceau de la belle Brézé, si fameuse sous le
nom de Diane de Poitiers. Nous montons en prison dans le couvent des
Visitandines.
Le concierge nous traite avec tant d'égards, que nous ne croyons pas
être détenus. Une jolie prisonnière vient faire nos lits pour se
délasser de l'oisiveté; elle a l'air d'une Agnès, mais c'est une
Agnès Sorel, ou une princesse Jeanne, accusée d'avoir étranglé son
mari parce qu'il n'étoit pas vigoureux. L'idée de ce (p. 34) crime
nous la fait envisager avec cette attention qu'on donne aux traits des
grands personnages et des grands coupables. Le ho! qu'elle est
jolie! quel dommage qu'elle soit aussi méchante! est dans notre
cœur bien avant de venir à nos lèvres.
Jusqu'ici nous avions ouvert nos chaînes avec la clef d'or. Ce soir
nous sommes tout tristes de voir le fond de la bourse. On s'en prend
aux bijoux. Il me reste une montre d'or à répétition avec sa chaîne.
Je l'engage à regret; mais un exilé doit-il encore songer aux biens de
ce monde? Où allons-nous?.... Ne nous noiera-t-on point? La montre est
engagée pour quatre louis entre les mains de mademoiselle Pélisson,
sœur du citoyen Beauregard déporté.
À quatre heures, nous arrivons à Lusignan, petite ville bâtie sur les
ruines d'une ancienne forteresse des comtes de Lusignan. Les greniers
de certaines maisons sont au niveau des forteresses; les ruisseaux de
l'ancienne ville s'écoulent par le faîte de la nouvelle. Nous rentrons
sur les six heures, après avoir vu la ville, qui n'offre rien de
curieux. Nous soupons avec le professeur de mathématiques de Niort,
et la conversation tombe sur l'éducation actuelle; (p. 35) elle est
presque nulle, et infiniment plus vicieuse que l'ancienne; les enfans
font ce qu'ils veulent depuis que la liberté n'a laissé aux
instituteurs d'autre férule que les tendres réprimandes du langage
de la raison.
Jusqu'ici les gendarmes nous avoient supportés pour notre argent; ceux
qui vont nous conduire nous chérissent pour nos principes. Pendant que
nous traversions la ville, une aubergiste, à l'enseigne de la
Montagne, rassemble ses amis pour nous voir passer. Cette bande, parée
de bonnets rouges, forme des ronds de danse en chantant la
Marseilloise. Nos guides nous expliquent cette pantomime. «Ils
insultent à votre malheur. Vous n'iriez pas si loin, si vous étiez à
leur discrétion. Cette femme qui vous faisoit signe en riant, est une
des commères du général D***. Les relations du directoire disoient que
les seize premiers n'avoient pas été gênés, que D***. avoit pourvu
splendidement à leurs besoins; ils étoient entassés dans des chariots
rouges grillés et fermés à cadenas.
»Dut***, en passant à Orléans, y recruta une femme sans pudeur qu'il
traînoit avec lui dans un char découvert. À Châtellerault, (p. 36) il
fit une bruyante orgie; le bal se prolongea bien avant dans la nuit;
les jacobins dansèrent autour des charettes, en flairant la prison des
déportés. Plusieurs toasts furent portés aux cendres de la
société-mère: la même fête étoit commandée à Lusignan et à
Saint-Mexan. Ceux qui vous fixoient ce matin étoient du repas; ils
étoient déjà enluminés. Arrive un courier extraordinaire, porteur
d'ordres très-pressés.... Devinez quels ordres....? D'arrêter et de
faire conduire sur-le-champ à Paris, sous bonne et sûre garde, le
général Dutertre.... Notre brigadier, à la tête d'un détachement,
monte lui signifier l'ordre. Ses compagnons confus, s'échappent en
baissant l'oreille; le général se dégrise, et sa maîtresse se jette à
nos genoux pour faire les comptes de son amant. Il partit
sur-le-champ, en jurant après ses victimes, qui étoient cause,
disoit-il, de son rappel. Quoique son compte fût chargé, il en fut
quitte pour une légère réprimande, car il avoit de puissans
protecteurs.»
Nous voilà à Saint-Mexan; nous dînons en ville, et n'arrivons que le
soir en prison. Le (p. 37) concierge est un cardeur de laine, qui ne
sait ni lire ni écrire; nous le dérangeons d'une commande de bonnets
rouges; il est de très-mauvaise humeur; il prend les clefs pour nous
mener au cachot. D'une joie bruyante, nous passons à un morne silence.
Il se déride un peu en trinquant avec nous; il étoit fâché que nous
eussions mangé notre argent ailleurs. On nous avoit assuré que nous ne
trouverions rien chez lui. (À l'intérêt près, les trois quarts des
hommes sont les plus honnêtes gens du monde.) Il avoit des provisions
pour des centaines de déportés attendus depuis six mois. Tous les
concierges nous ont tenu le même langage jusqu'à Rochefort. Nous
couchons sur la rue, dans une grande chambre sans serrure, sans gardes
et sans clef: ainsi tout s'appaise par une fraternité pécuniaire, Ô!
Danaé! ta fable est une réalité!
Nous voilà à Niort: cette petite ville assez commerçante, est peuplée
de braves gens. C'est dans ses environs que le ministre Cochon
s'étoit réfugié, pour se soustraire à la déportation qu'il avoit
encourue pour avoir déposé le terrorisme en 1797.
Nous descendons dans la prison où naquit (p. 38) mademoiselle
d'Aubigné, depuis marquise et dame de Maintenon: son père avoit été
persécuté pour ses opinions religieuses, comme nous pour la
révolution.
Le concierge est humain pourvu que les prisonniers aient de l'argent;
il chante, boit, ne s'enivre jamais à ses dépens, et invite tous ses
amis à souper aux frais des nouveaux venus; il est patriote et
aristocrate au gré de la fortune de ses hôtes. Nous dînerons avec lui
parce qu'il ne voit pas le fond de notre bourse.
17 février. Nous voilà en chemin pour Surgères; nous avons engagé le
reste de nos bijoux et il ne nous reste pas deux louis entre trois; ne
comptons plus avec nous-mêmes, la prodigalité, dans ce moment-ci, est
la plus sage économie; trop heureux de ressembler au cygne, chantons
encore sur le bord de notre fosse. Nous avons dépassé Niort; sur le
penchant d'une colline, la route se divise en deux branches, à droite,
je lis un écriteau qui me confirme que nous ne sommes pas loin de
Rochefort. Un secret pressentiment sèche en nos cœurs cette
hilarité que l'innocence verse dans le plaisir; le nuage de tristesse
se dissipe à mesure que nous nous éloignons (p. 39) de la fatale
légende; pendant la journée nous sommes assez occupés à nous tirer des
bourbiers, car c'est une route d'enfer; la nuit nous surprend, nous
n'aurons pas le bonheur d'être accostés par les voleurs qui rodent
toujours ici; nous n'avons plus d'argent, il faut aller en prison.
Nous passons le pont-levis du château de la Rochefoucault, nous voilà
rendus; le concierge est le boulanger de la petite ville, il aime à
boire et le vin est pour rien, il nous cède son lit et nous donne
pleine liberté d'aller où nous voudrons avec promesse de ne pas nous
évader.
18 février. Ce matin on nous annonce que nous ne partirons que dans
cinq jours. Le père Robin nous laisse seuls; nous visitons l'église
qui ressemble plus à une écurie qu'à la maison de Dieu; comme la
richesse du pays consiste en vin, des vignerons ont fait une cuverie
du sanctuaire; nous appercevons sous l'autel un caveau, vénéré jadis
par ceux qui avoient quelque religion ou quelque morale; le soleil
n'entre qu'à regret dans ce lugubre séjour, qui servoit de dépôt aux
cendres des comtes de la Rochefoucault. En 1794, le comité
révolutionnaire força le père Robin et (p. 40) d'autres ouvriers
d'enlever ces tombes pour en dérober le plomb; les corps étoient
scellés si hermétiquement, que la dent du tems n'avoit pas encore pu
les morceler, ils exaloient une odeur si méphitique que les ouvriers
tombèrent à la renverse. Les membres du comité mirent la main à
l'œuvre, éprouvèrent la même syncope, firent une libation à Bacchus
et reprirent l'ouvrage; les cercueils arrachés à force de bras,
n'étoient encore qu'entr'ouverts; un Mucius Scævola saisit un
ciseau, les fendit et les foula aux pieds; alors la putréfaction les
força tous d'abandonner l'entreprise pour ce jour-là; ils y revinrent
le lendemain, parachevèrent l'ouvrage au risque de leur vie, après
avoir jetté çà et là dans des coins, les membres encore charnus des
morts, dont ils violoient l'asyle en triomphateurs[5]. (p. 41) Ils
abandonnèrent ce lieu à la hâte, sans se donner le tems d'effacer les
inscriptions et les armoiries. Cette chapelle ressembloit à un antre
de bêtes féroces, dont les ronces et les morceaux de rochers défendent
l'accès aux voyageurs; plus elle étoit horrible, plus elle piquoit
notre curiosité: nous prîmes une torche.... nous voilà comme Young et
Hervey au milieu des tombeaux, plongés dans une religieuse
mélancolie; nous lisons les inscriptions: CY (p. 42) GÎT TRÈS-HAUT ET
TRÈS-PUISSANT SEIGNEUR, etc.... Toute grandeur disparoît ici, nos
persécuteurs y viendront comme nous.... ceux-ci ont été riches, fameux
dans l'histoire, chéris de leurs rois, nous nous occupons d'eux, nous
touchons leurs ossemens; en fixant ces restes, nos cœurs émus,
sentent qu'il existe un autre être en nous. Voltaire et Lamétrie
ne voient dans les tombeaux que la preuve du néant; et moi que celle
d'une autre vie. Il est impossible que l'homme pense, agisse, veuille
le bien, évite le mal à son détriment, pour finir d'une manière aussi
opposée à son être; la réalité d'une autre vie, est un contrat que
l'éternel signe dans nos cœurs, en nous en donnant la pensée; la
certitude s'en suit pour moi, quand je suis proscrit et honnête homme.
Nous ne pouvions nous arracher de ce lieu infect, où la vapeur ne
laissoit presque pas d'air atmosphérique à notre torche. On y voyoit
des cheveux, des crânes encore couverts de chair, des bras dégoûtans
de sanie, noirs et brisés, des cadavres à demi réduits en terre. Les
chauves-souris et les autres animaux nocturnes en faisoient leur
nourriture depuis trois ans, d'où nous jugeâmes que les comités
révolutionnaires (p. 43) avoient trouvé des cadavres entiers, qu'ils
avoient laissés sans sépulture, afin que la putréfaction scellât
l'entrée du temple aux fidèles qui voudroient s'y réunir dans des tems
plus heureux.
Un bon déjeûner nous attendoit, nous suivîmes la messagère et connûmes
la bienfaitrice; c'étoit une aimable veuve nommée madame le G13. À
peine fûmes-nous assis, qu'après les complimens d'usage, nous vîmes se
former un cercle nombreux d'honnêtes gens, ravis de nous voir libres
et sans gardes, et surpris de notre constance à courir notre
sort.—Vous êtes libres, messieurs, et vous ne songez pas à en
profiter.—Notre parole est plus sûre que la garde du prétoire.—Vous
serez dupes d'une générosité aussi gratuite, nous dit M. de la T45ch2,
sauvez-vous. MM. de Crainé et de Craisse nous donnèrent le même
conseil, nous offrirent de l'argent; les dames du lieu où nous
passâmes la soirée chez M. H29v2, voulurent nous mettre sur la route;
le concierge, à qui M. de Crainé avoit remis une dette pour qu'il
fermât les yeux, s'étoit enivré et dormoit profondément quand nous
revînmes à minuit le faire lever, en lui apportant un verre de
(p. 44) liqueur pour avoir droit d'être détenus[6].
Le jeudi, 24 février, un seul gendarme nous accompagna, en nous
disant que nous ne devions pas songer à nous évader, que nos camarades
étoient libres à Rochefort, qu'ils avoient la ville pour prison.
Malgré ces belles promesses, nos cœurs étoient comprimés en
quittant ce paradis terrestre: c'étoit le déclin d'un beau jour qui ne
luira pas demain pour nous. La brigade nombreuse, qui vient nous
prendre au milieu de la route, est armée jusqu'aux dents, peu s'en
faut qu'elle ne nous mette les menottes.
Terminons cette route par une analyse prophétique des événemens qui
vont se succéder.
On devine bien que nous ne serons pas libres, comme on nous le
promettoit. Trouverons-nous l'argent qui doit nous avoir devancés?
Nos deux louis sont bien échancrés. (p. 45) Si nous allions être
embarqués tout-à-coup sans argent, ce ne seroit là encore qu'un petit
malheur: nos paquets seront pillés, le secret de nos lettres violé,
notre argent volé, nos effets resteront aux messageries, le peu que
nous emportons sera jeté à la mer pour délester la frégate que nous
monterons; après trois heures d'un combat opiniâtre, nous échouerons
sur les ruines d'une ville ensevelie sous les eaux; nos ennemis nous
croyant morts, se partageront nos dépouilles; quand ils sauront que
nous survivons à tant de malheurs, ils nous laisseront un mois entier
en rade, sans nous permettre de recevoir de secours de nos familles,
afin que nous périssions de misère, et qu'aucun ne publie ces
atrocités. Ils n'oseront nous noyer, et nous feront monter une autre
frégate, dont le capitaine sera un Cerbère; nous serons ballotés dans
la traversée, exposés à perdre la vie sur les rochers des îles du cap
Vert. À Cayenne, nous serons emprisonnés, escortés de soldats noirs,
puis répartis sur les habitations et dans les affreux déserts de la
Guyane; nous serons exilés de la ville et de l'île de Cayenne,
l'hospice nous sera interdit; ceux qui ne seront pas placés à
certaine (p. 46) époque, seront envoyés à Konanama et à Synna-Mary, où
les deux tiers mourront de désespoir, de peste et de soif...... La
nuit approche, nous voilà à Rochefort.
Fin de la première partie.
(p. 47) SECONDE PARTIE.
Première soirée.
Les habitans de Cayenne et de la Guyane seront curieux d'entendre
parler de la France. J'y trouverai peut-être des amis, qui me
demanderont la cause de mon voyage; heureux si après mon récit, je
m'applaudis de l'avoir fait!
J'écris ces lignes, tranquille au milieu du tumulte, à l'écart sur les
porte-haut-bancs de la maison flottante, qui nous fait voguer dans un
autre monde. La proue fend l'onde amoncelée; un nuage de neige, sur
une plaine verdâtre, borde la frégate. La mobilité des flots, dont
l'un engloutit l'autre, est l'image des générations; elle est encore
pour moi celle de la peine et du plaisir. Jadis je fus heureux,
aujourd'hui mon bonheur n'est qu'un songe. (p. 48) Ma vie s'écoulera
de même, et l'onde que je vois à regret s'abaisser pour nous déporter
dans une terre étrangère, blanchira peut-être un jour sous nos voiles,
pour nous rendre à nos familles désolées. Reprenons la série des
événemens.
Nous voilà à Rochefort, entrons à la municipalité; les plaisirs de
Surgères nous troublent encore un peu la tête; nous voulons que tout
le monde soit dans la joie. Quatre ou cinq secrétaires ont les yeux
emprisonnés de lunettes magiques, et nous regardent en bâillant. Je
m'approche d'un vieillard à cheveux blancs dont le front rayonnoit de
gaité. Voilà un aimable homme, dis-je en lui serrant les mains, et le
faisant danser en rond, malgré sa rotondité... Vous êtes de bons
enfans, laissez-nous cette salle pour prison, nous nous y trouverons
bien. Quelques-uns prennent cette gaité en bonne part, d'autres
froncent le sourcil; je riposte aux deux partis en battant quelques
entrechats. Aussi-tôt entre un grand homme noir, à figure inexplicable
comme son âme. C'est le commissaire du pouvoir exécutif, nommé B......
Ma gaité le fâche, déjà il balbutie un réquisitoire. Le (p. 49)
président, dont j'avois serré la main, dit en riant: C'est moi qui
suis le plus malade, et je lui pardonne de bon cœur. On signe notre
obédience, pour aller à St. Maurice, parce que nous sommes des
grivois, qui pourrions prendre notre congé sans permission.
Nos guides frappent à la porte d'un grand bâtiment. Un petit homme,
frisé comme le dieu des Enfers, nous lance un regard sinistre, et leur
dit d'un ton aigre... Ils sont à moi... Venez par ici. Nous
traversons une grande cuisine, où cuit un bon souper qui ne sera pas
pour nous; et de peur que nous ne le mangions des yeux, le petit
Pluton prend son gros paquet de clefs, nous conduit dans une grande
salle, nommée chapelle de Saint-Maurice. Nous passons avec efforts par
une porte extrêmement étroite, et haute de deux pieds. Les verroux se
referment sur-le-champ, nous voilà au milieu de soixante-dix prêtres,
destinés comme nous au voyage d'outre-mer. Nous attendions au moins
une botte de paille pour nous coucher, mais ces messieurs qui
connoissent l'humanité de Poupaud, nous font un lit avec des valises
et des serpillières.
(p. 50) Le 26 février, le soleil a à peine dissipé les nuages du
matin, quand nous ouvrons nos yeux rouges et mouillés de larmes
brûlantes. Nos funestes pressentimens se réalisent; au midi, le
spectacle de la campagne aggrave nos peines; l'horison est bordé de
hautes montagnes dont le pied resserre et fait grossir la Charente;
un nuage varié des plus belles couleurs, couvre l'herbe naissante
d'une grande prairie marécageuse, à moitié desséchée par les premiers
beaux jours du printemps. Des troupeaux paissent çà et là, gardés par
de jeunes filles, qui fredonnent librement des airs champêtres.
L'herbe est plus abondante et plus touffue sur les bords des rigoles,
gonflées pendant l'hiver des pluies et des sucs de la plaine. Dans les
jardins, les arbres sont chargés de boutons; les amandiers et les
abricotiers, courriers de Flore, exhalent une odeur suave; les bords
du fleuve sont couverts d'oiseaux qui cachent déjà leurs nids dans la
verdure prête à fleurir, tout nous dit nous respirons la liberté, et
vous êtes prisonniers....
Au nord, quelques arbres secs, des masures, de grandes rues
semblables à des déserts, (p. 51) quelques filles errantes avec des
militaires en uniforme; des tombereaux, traînés par des coupables
enchaînés et attelés comme des chevaux, nous reflètent la réalité de
notre misère.
Le malheur nous rend plus sages, toutes les fois qu'il ne nous réduit
point au désespoir. Nous nous conformons à la régle de nos
prédécesseurs d'infortune, qui, en ouvrant les yeux, offrent leurs
maux à l'Éternel, et lui demandent la patience et l'amélioration de
leur sort.
À huit heures, on nous sert un pain noir, dans lequel nous trouvons du
gravier qui nous brise les dents, des pailles, des cheveux, et
cinquante immondices; on croiroit que le boulanger l'a pétri dans le
panier aux balayures. On apporte en même temps une tête de bœuf,
quelques fressures et un gigot de vache, qui paroît tuée depuis quinze
jours, et arrachée de la gueule des chiens voraces, qui se la
disputoient à la voirie. Pour dessécher nos lèvres noires de
méphitisme, on nous donne pour deux liards de liqueur appelée
eau-de-vie, mais tellement noyée d'eau, qu'il n'y en a pas pour un
denier.
Poupaud jure comme un comité révolutionnaire, (p. 52) quand nous ne
sommes pas assez lestes pour emporter un très-petit broc de vin
très-aigre, dont la nation nous fait cadeau pour la journée. Six
détenus, accompagnés de la garde, profitent de ce moment pour emporter
les baquets, où chacun a vaqué à ses besoins, depuis vingt-quatre
heures. Ces bailles sont découvertes, et plusieurs couchent au pied
des immondices. Ce spectacle nous révolte, mais les plus anciens nous
invitent au silence. Quand ils font ces représentations à Poupaud, il
leur répond avec un rire sardonique...... Oh! Oh! vous n'y êtes pas!
et quand vous serez ici trois ou quatre cents, comme en 1794, faudra
bien que vous appreniez à vivre; une partie se couchera, et l'autre
restera debout.
Depuis huit heures du matin jusqu'à dix, une partie désignée
nominativement va respirer le frais dans le jardin, et cède la place à
l'autre qui remonte à midi, pour ne plus sortir de la journée. Nous
devons cette grâce à quelques membres de la municipalité qui
s'intéressent à nous. Poupaud est si fâché de cet acte de clémence,
qu'il ouvre la porte du vestibule quand il fait beau, et la ferme
quand il pleut, (p. 53) en nous jettant dans le jardin comme des
forçats.
Voici le tableau de notre local et de notre existence: La salle a 42
pieds de long et 60 de large pour 80 personnes, qui n'en sortent que
deux heures par jour, comme vous l'avez vu: elle est entourée d'un
marais pestilentiel. Dans l'intérieur, ne se trouvent point de lieux
d'aisance; on est forcé d'y vaquer à ses besoins: jour et nuit, un
nuage rougeâtre s'élève des sentines; il gêne la respiration, nous
occasionne des lassitudes et des sueurs; il rend le sommeil accablant
et nuisible. Nous sommes ensevelis à demi-vivans dans l'ombre de la
mort. Notre salle, le soir, ressemble à un champ de bataille jonché de
morts, et pourtant nous chantons[7] encore au milieu des tourmens.
Les sœurs (p. 54) de l'hospice font faire notre cuisine et blanchir
notre linge. Tous les cœurs sensibles compatissent à nos maux, et
les victimes de la révocation de l'édit de Nantes, très-nombreuses
dans ce département, ne sont pas les dernières à secourir les apôtres
de Rome. Notre dîner arrive à midi; la moitié mange tour-à-tour sur
(p. 55) ses genoux et sur de longues tables; le repas est très-frugal
et très-prompt; la digestion ne nous empêche pas d'exécuter l'ordre du
docteur Viv..., qui nous visite lestement: il paroît à Saint-Maurice
tous les jours, et ne se montre dans notre prison que deux fois par
décade. Aujourd'hui, par extraordinaire, il vient à deux heures
après-midi, fait un tour dans la salle sans saluer personne; et se
souvenant tout-à-coup de sa mission, se frotte les mains et dit: «Il
n'y a point de malades.... Adieu.—Fixez-nous, lui répond Soursac qui
étoit sur son passage.—Qu'avez-vous? Vous ne guérirez que dans les
pays chauds.—À un autre.—Votre imagination travaille trop; ce ne
sera rien que cela ... À la diète ...—Mais, citoyen, j'ai la fièvre
depuis cinq jours.—Contes que tout cela; adieu....»
Une heure après, un jeune homme à qui il n'avoit voulu trouver ni
fièvre ni symptômes de maladie, jetté dans un coin depuis huit jours,
tomba évanoui; un autre médecin fut appelé; Viv... eut tort, et le
malheureux gagna l'hôpital. Comme on le transféroit, Poupaud entama
l'éloge de l'empirique. Vous avez raison, M. Poupaud, reprit un
auditeur; M. Viv... (p. 56) est expéditif. Il y a dix jours qu'en
faisant sa visite à l'hospice, il dit, en tâtant le pouls d'un homme
dont la figure étoit couverte de son drap, à la portion.... Ça fait
le malade, et ça n'a pas de fièvre. Le malheureux étoit délivré de
tous maux.....
Qu'il me passe ma rhubarbe, je lui passerai son séné, disoit le
médecin Tard ... à ce collègue; ils se relayoient tour-à-tour à
l'hôpital et aux prisons: si l'un étoit forcé d'y envoyer un déporté
malade, au bout de quelques jours, le collègue expédioit un exeat
illicô.
3 mars. À deux heures du matin, un vieillard de soixante-quinze ans,
prêtre de Toulouse, amené en place de son frère qui s'étoit évadé,
obtient sa liberté, après trois mois d'incarcération, et à la suite
d'une route de soixante-quinze lieues, durant lesquelles il avoit été
enchaîné par les quatre membres.
Le soir, son lit est pris par quatre nouveaux venus, MM. Dozier,
grand-vicaire de Chartres; Margarita, curé de Saint-Laurent de
Paris; Kéricuf, chanoine de Saint-Denis, et Bremont. Le substitut
du commissaire du pouvoir exécutif vient nous voir. Nous nous
étendons sur nos grabats, afin de parler à (p. 57) ses yeux. «Si nous
en croyons les apparences, lui dit-on, la terreur n'a fait que changer
de nom. Ici, chacun n'a pas deux pieds d'espace pour loger sa malle et
son matelas. On dit pourtant que nous renaissons au siècle de Rhée.
Rochefort est un marais infect, et nous y sommes plus entassés que
dans aucune prison de France.» Ce substitut, qui étoit un honnête
homme, fit un rapport favorable. «Ils me demandent plus d'espace, dit
B***; je les mettrai au large.»
Le 4 mars, Jardin, rédacteur du Tableau de Paris, s'évade de
l'hospice; Boischot en prend de l'humeur, et Poupaud, qui nous donne
cette nouvelle, s'en réjouit et n'a jamais été si poli. Nous sommes
ses amis; il nous ouvrira la porte tant que nous voudrons; il est tout
à notre service.
Dans la nuit du 6 mars, grand bal dans la prison et dans le
corps-de-garde sous nous; Poupaud donne la fête. À minuit, Langlois et
Richer-Sérisy ouvrent la porte de la prison avec la clef d'or, et
s'évadent. Langlois, qui crachoit le sang, avoit joué son rôle en fin
renard. Le lendemain, Poupaud attache des draps à la croisée, pour
faire croire qu'il y (p. 58) avoit fracture. (Voyez à ce sujet la
déportation de M. Aimé, page 63. On peut en croire ce témoin oculaire,
qui a refusé de s'enfuir, ainsi que M. Gibert-Desmolières.)
11 mars. On double la garde; on nous embarque demain, les figures
s'allongent, on écrit, on prépare ses paquets, on doute encore de
cette nouvelle; Parisot, qui a péri si tragiquement sur les côtes
d'Écosse, nous lit une lettre d'Auxerre, où on lui dit qu'il ne
partira pas; nous demandions exemption pour nos vieillards de
soixante-dix ans, chacun rédigeoit pour eux un mode de pétition. Le
soir, la prison étoit un peu bruyante; une sentinelle, prise de vin,
tire un coup de fusil, dont la balle frappe la voûte de notre salle et
rebondit sur la tête d'un vieillard de soixante ans, nommé Saoul; on
ne nous envoya personne pour le panser, quoiqu'il fût plein de sang.
L'officier de garde, avec un planton, vint seulement voir si nous ne
songions point à nous évader; nous ne pouvions pas y songer, car la
prison, depuis le matin, étoit entourée de vingt-deux factionnaires.
Au jour, Poupaud nous fait vider les bailles, (p. 59) et nous ordonne
de nous préparer à partir dans deux heures.
La prison offre le tableau d'un camp cerné par l'ennemi: l'un se hâte
d'emballer ses effets, celui-ci cherche une issue, cet autre pleure,
tout est pêle-mêle, on travaille beaucoup sans avancer à rien, tout se
trouve et s'échappe de nos mains. Au bout de deux heures, nous voilà
comme les Israëlites, la ceinture aux reins, le bâton à la main, les
sandales aux pieds, pour le voyage de la mer Rouge et du désert.
Au nord, du côté des promenades, une haie de baïonnettes borde le
cours et les avenues de la prison; des servantes, des enfans, une
populace assez nombreuse se disputent le plaisir de nous voir passer.
B****. va, vient, retourne, passe les soldats en revue, commande aux
voituriers d'emporter nos malles, est entouré de flots de
pétitionnaires, rebute les uns, parle à l'oreille des autres, reçoit
des billets de toutes espèces.
Nous délibérons aussi entre nous: l'amitié, les regrets, les malheurs,
la disproportion des fortunes, l'égalité du sort, les chances que
nous (p. 60) allons courir, dilatent nos cœurs, confondent nos
intérêts, réunissent toutes nos opinions, amortissent toutes les
haines, des larmes coulent, le pressentiment d'un avenir malheureux
leur donnent ce touchant qu'on éprouve rarement dans le cours de la
vie. Le prélude du départ est celui d'une réconciliation parfaite;
chacun se promet assistance réciproque, celui qui n'a rien partagera
la fortune de son voisin; nous renaissons aux premiers âges du monde;
nos patriarches seront nos pères, ils garderont nos cases, pendant que
nous pourvoirons à leurs besoins: déjà chacun a formé sa société; nous
ne sommes plus européens, nous voilà colons, cultivateurs,
propriétaires, négocians, navigateurs.... L'homme agité d'une crise
violente, détourne les yeux de dessus l'abîme, pour y jetter quelques
fleurs avant de s'y précipiter; le sage, pour n'être pas accablé sous
le poids de l'infortune, allège son fardeau par l'illusion d'une
perspective enchanteresse.
B****. arrive, et nous dit d'un air riant: Allons, messieurs, je vous
mets au large. Il déroule un beau cahier, noué de deux faveurs, où
chaque nom est inscrit en gros caractère, (p. 61) et entouré de
notices particulières, qui sont les motifs de déportation; les trois
quarts (comme nous l'avons vu dans la suite en recopiant la liste
après le combat) sont déportés sur ce protocole:
| Loi du 19 fructidor. |
| |
BONS
À
DÉPORTER. |
Doru, mal vu des patriotes. |
Suspects. |
| Douzan, pour avoir déplu au Directoire. |
| Clavier, dénoncé.
|
| |
| LAPOTRE. |
Département des Insoumis. |
BONS
À
DÉPORTER. |
| POIRSIN. |
| GRANDMANCHE. |
| etc., etc. |
Vosges. |
Ce seul titre de la loi est la base de condamnation du plus grand
nombre, qui n'auroit pas de peine à se justifier, si on lui appliquoit
explicativement tel ou tel article de la loi; car il en est déporté
comme prêtres, qui sont laïcs, comme on le verra dans la liste. Tous
les individus du même département ou pris dans le même arrondissement,
sont rassemblés dans la même parenthèse, dont vous voyez le modèle.
Chaque dénommé se met en rang pour aller en procession funèbre: Nous
ne serons peut-être pas fusillés en rade comme ici, dit le dernier;
Bois.... rit et donne le signal; le (p. 62) tambour bat aux champs pas
redoublé. L'un est infirme et ne peut avancer, l'autre est
sexagénaire; on leur crie de doubler le pas; le commissaire fait
fonctions de lieutenant-colonel.
Ce prêtre proscrit, habillé en voyageur, paroît émigrer pour l'autre
monde, ce prélat respectable est chargé comme un homme de journée;
jadis il étoit le patriarche de sa paroisse ou de sa ville, on le
prendroit dans ce moment pour un criminel échappé du bagne. Les
honnêtes gens ferment leurs croisées, pour pleurer en liberté. Nous
faisons halte dans la cour de la prison de l'ancien hôpital, pour
recruter d'autres déportés. La loi qui exempte les sexagénaires est
nulle quand ces victimes n'ont pas de quoi se rédimer.
À deux heures, nous traversons les chantiers où s'élèvent les
vaisseaux, la Princesse-Royale et le Duguay-Trouin ou le Mendiant.
De ces deux carcasses, sortent deux ou trois cents ouvriers qui
travaillent pour l'amirauté, et deux longs attelages de galériens,
commandés par des nègres, retournent au bagne. Ils sont décorés d'un
bonnet rouge, d'un sur-tout de bure grise, d'un large pantalon, et
tiennent (p. 63) toujours en main une chaîne assez pesante, attachée à
la jambe de chacun un camarade de malheur, ou de crime et de supplice.
Quand nous arrivons à la nacelle, on parle à l'oreille du commissaire.
Après différens gestes, il expédie un ordre de retour au citoyen
Tacherau de Tours, qui venoit à côté de moi.
La Charente, dans ses sinuosités, regrette le moment où elle va nous
confier à l'Océan. Enfin elle rentre dans son lit, et nous laisse
voguer vers le soir, dans le vaste sein des mers. Le soleil sur son
déclin couvre l'horison d'incarnat; nos yeux n'apperçoivent déjà plus
que quelques langues de terre au milieu des ondes qui blanchissent
sous nos frêles nacelles. Nous promenons nos regards étonnés sur ce
spectacle majestueux et terrible... Mer immense, nous voilà sur ton
sein! Quelle idée sublime tu nous donnes de ton auteur! Que ces vagues
inspirent de respect! L'astre du jour descend dans les abymes;
l'Océan, imprégné des derniers rayons de lumière, paroît s'enflammer.
Un léger brouillard nous dérobe ces objets ravissans; nous voilà au
pied des deux frégates qui nous porteront tour-à-tour. (p. 64) Notre
nacelle est aussi petite auprès d'elles, qu'un enfant au berceau, à
côté d'un grand et vigoureux Hercule. Nous nous élançons dans
l'escalier du bâtiment; après avoir monté vingt marches, nous voyons
sous nos pieds les voiles et les mâtures de nos goëlettes. On nous
reçoit pour nous faire décliner nos noms, et nous mener à notre
dortoir. Je vous en ferai demain la description. Nous sommes 193, si
pressés ce soir, que nous allons nous coucher sans souper.
Seconde soirée.
13 mars 1798. Nous n'avons encore vu que des roses, voici les
épines. La frégate que nous montons s'appeloit jadis la Capricieuse,
et se nomme aujourd'hui la Charente. Je ne décrirai que les parties
du bâtiment nécessaires pour l'intelligence de ces soirées.
Le pont est la première surface de bois d'où s'élèvent les mâts et les
cordages. La queue ou le derrière se nomme le gaillard de derrière;
c'est là que sont la boussole, le gouvernail, le pilote, la chambre de
l'état-major, la salle du conseil, le logement des officiers, la
sainte-barbe (p. 65) ou magasin à poudre, et l'arsenal. Les deux
extrémités d'un vaisseau se nomment la proue et la poupe. La proue est
la partie qui avance; ce mot vient de procedere, avancer; cette
extrémité est terminée par une pointe où aboutissent tous les bois du
coffre, qui se terminent en dessous par un tranchant nommé quille.
Cette quille est la partie qui plonge dans l'eau; elle ressemble à un
dos d'âne renversé, dont l'intérieur prend le nom de fond de cale.
Entre la poupe et la proue, est le milieu du coffre; c'est dans ce
local que nous logeons.
Je vous ai dit hier que nous avions monté quinze ou vingt marches pour
arriver sur la frégate; personne ne loge sur le pont, de peur de gêner
la manœuvre. Un vaisseau est distribué comme un hôtel, sinon que
dans l'un on monte à sa chambre, et que dans l'autre, on y descend.
Nous sommes donc entrés par le grenier. Les officiers, les matelots et
les soldats occupent le second étage; les extrémités sont pour les
cuisines, la fosse aux lions, les cables et les autres ouvriers
employés au service du bâtiment, qui logent en grande partie à la
proue. Le milieu, nommé passe-avant (p. 66) sur le pont, est l'endroit
le plus large de la maison flottante. Le côté qui répond à la droite
de celui qui regarde la proue, se nomme stribord et l'autre,
bas-bord. Quand un bâtiment a trois ponts ou trois batteries, on
distingue les ponts par les noms des batteries. La première est la
plus près de la mer, et porte du 36; la seconde, du 24, et la
troisième, du 12. Cette dernière se trouve sur le pont. Un vaisseau de
cette force est plus élevé qu'un second étage, et se nomme bâtiment de
ligne du premier rang. Les intermédiaires sont les frégates, qui n'ont
que deux batteries, du 12 et du 6. Elles sont beaucoup plus grandes
que les bâtimens marchands, plus lestes que les vaisseaux de ligne, et
capables de couler à fond les corsaires les plus forts. Au milieu,
entre la poupe et la proue, sont placés le grand, le petit canot, et
la chaloupe. Ces trois nacelles, longues de vingt-huit ou trente
pieds, sont engrènées l'une dans l'autre, et servent pour les vivres,
les embarcations, et le cas de naufrage sur les côtes. Quand la
frégate ne peut approcher d'une plage, on jette l'ancre, et les canots
servent à débarquer. Il n'y a rien d'inutile dans un vaisseau; ces
nacelles (p. 67) servent de parc aux moutons; voilà donc le pont et le
second étage entièrement occupés. Le troisième étage se nomme
entrepont; on y descend par deux escaliers à droite et à gauche, et,
pour parler techniquement, de stribord et bas-bord. Nous n'avons
dans cette partie que le local qui s'étend depuis les cuisines
jusqu'au grand mât, au pied duquel est le four du boulanger. Ce local
est de trente pieds de large, sur trente-sept de long, sur quatre et
demi de haut. Pour dispenser le lecteur d'un calcul ennuyeux, il ne
nous reste que cinq pieds en longueur, sur deux en hauteur.
Figurez-vous une vaste hécatombe dans une grande ville, où la famine
et la peste moissonnent chaque jour des milliers de victimes qu'on est
obligé d'inhumer dans le même journal de terre; les cadavres, pressés
les uns contre les autres, sont cousus dans des serpillières, et
séparés les uns des autres par un lit de chaux-vive. L'espace
qu'occupe la chaux, est le vide qui se trouve au-dessus et au-dessous
de nous.
Dans cette hauteur de quatre pieds et demi sont deux rangs de hamacs
les uns sur les autres, soutenus de trois pieds en trois pieds par de
petites colonnes nommées épontilles. (p. 68) Sur ces colonnes sont de
petites solives de traverse, percées à dix-huit pouces de distance
l'une de l'autre, où l'on a passé des cordes appelées rabans, qui
suspendent par les quatre coins un morceau de grosse toile à bords
froncés, dont le dedans ressemble à un tombeau.
Chacun ne doit avoir qu'un sac de nuit ou une valise; ces paquets
occupent encore plus du tiers de l'espace; ainsi sur cinq pieds cubes,
nous n'en avons pas trois.
Le jour ne pénètre jamais dans cet antre entouré de tous côtés de
barricades de la largeur de trois pouces et de deux fortes portes
fermées par de gros verroux. Au milieu et aux extrémités, sont des
baquets où nous sommes forcés de vaquer à nos besoins depuis six
heures du soir jusqu'à sept du matin.
La vue de ce gouffre vous feroit invoquer la mort; aujourd'hui même
que je suis accoutumé au malheur, sans qu'il endurcisse mon âme, je ne
puis réfléchir à notre position, sans que mes idées se confondent.
Quelle nuit! Grand Dieu, quelle nuit! Ce sexagénaire replet ne peut
grimper au milieu des poutres, dans le sac suspendu pour le recevoir:
il s'écrie d'une voix mourante: Mon Dieu, j'étouffe, (p. 69) mon
Dieu, que je respire un peu.... Une sueur brûlante mêlée de sang
découle de tous ses membres. Il est tout habillé, car le local est
trop étroit, pour qu'il puisse étendre les bras pour tirer son habit;
voilà mon tombeau, dit-il, voilà mon tombeau!... Puis soulevant un peu
la tête, il aspire une ligne d'air qui prolonge sa malheureuse
existence. Un officier de marine de l'ancien régime, qui partage notre
destinée, s'écrie que nous sommes aussi entassés que les cargaisons du
Levant qui apportent la peste. Ce fléau nous paroît inévitable, et
nous n'espérons voir notre sort amélioré que par la mort de la moitié
de nos camarades.... L'échafaud est un trône auprès de ce genre de
supplice, l'homme, en y marchant, jouit encore à son déclin, du
plaisir de respirer l'air; mais ici, il doit succomber dans des
convulsions effrayantes sur le cadavre de celui qui le tue, même après
sa mort, par la place qu'il occupe encore. Plus nous sommes gênés,
plus nous nous agitons pour trouver une position moins critique. Nos
hamacs mal suspendus se lâchent, et plusieurs tombent sur l'estomac de
leurs camarades: des soupirs, des cris étouffés redoublent nos
malheurs, la mort est moins (p. 70) affreuse que cette torture.
Pourquoi n'avons-nous pas le courage d'y recourir? Pourquoi vouloir
exister malgré ses ennemis et soi-même?
Dieu ne nous suscite point de tribulations au-delà de nos forces; du
sein de l'abîme, un rayon d'espérance nous luit avec l'aurore. Jeudi,
15 mars 1798 (24 ventôse an 6), la cloche nous appelle à déjeûner;
nous avons plus besoin d'air que de nourriture ... nous allons
respirer ... nous avons autant de peine à nous arracher de nos
tombeaux qu'à y pénétrer, nous ne pouvons retrouver nos vêtemens ...:
l'un réclame ses bas, ses souliers, son habit. Et comment se sont-ils
égarés dans un espace de dix-huit pouces? On sacrifie tout pour
respirer l'air, on se déchire, on s'arrache les cheveux épars et
dégouttans de sueur; celui-ci heurte et culbute son voisin qui
s'élance dans un escalier à pic de la largeur d'un pied et demi; cet
autre entraîne ses vêtemens au milieu de la foule, s'habille sur le
pont, étend ses membres, et renaît à la vie, comme cet oiseau qui bat
des ailes, au sortir d'une cage éternellement enveloppée d'un crêpe
noir.
On nous sert une ration d'eau-de-vie double de celle que nous avions
à Rochefort. Le pain (p. 71) est noir, mais excellent. Nous saluons le
capitaine M. Bruillac, qui s'attendrit sur notre sort, et nous promet
de l'améliorer aussi-tôt qu'il le pourra. Aujourd'hui nous prenons la
précaution de nous déshabiller avant que de descendre.........
Calculons les lignes d'air qui circulent chez nous. La moitié qui se
trouve entre les autres, aux deux extrémités de la prison, ne respire
que le souffle brûlant qui vient d'enfler le poumon de ses voisins. Le
plancher n'est pas à un pied au-dessus de la tête de ceux qui couchent
sur les autres; il étouffe tellement la voix, qu'il faut crier comme
des sourds pour se faire entendre de ses plus proches voisins.
Les deux escaliers[8] renvoient un huitième (p. 72) de l'air qui
n'entre dans nos caves que par la pression. Ces deux ouvertures n'ont
pas quatre pieds quarrés, ce qui donneroit à chacun un pouce et demi
d'air pur, en y joignant celui que nous recevons très-obliquement au
travers des canots par l'ouverture du fond de cale, pratiquée à côté
du poste des aide-majors. Cet air est méphytisé d'avance par les
moutons qui couchent au-dessus de nous, et obstrué par les chaloupes
fichées dans le vide.
16 mars. Nous restons toute la journée sur le pont; faire quelques
pas de plus est une consolation inexprimable. Hier, nous invoquions la
mort; ce matin, nous donnerions tout pour survivre à cette crise. La
justice tombant goutte à goutte, commence à cicatriser nos plaies.
Nous éprouvons trop de privations, pour n'être pas indifférens sur la
vie animale; elle est frugale et suffisante. Nous sommes tous munis
d'un gobelet de fer-blanc, d'une cuiller et d'une fourchette, qui
restent toujours pendues à notre boutonnière. On dîne à midi.
(p. 73) Toutes les tables sont composées de sept personnes, chacune a
sa cuisinière; c'est une brochette de bois qui traverse les morceaux
de viande des sept convives; la ration est emmaillotée avec du fil,
afin que rien ne se perde dans l'immensité de la chaudière; un petit
baquet sert de plat à la société qui mange à la gamelle. Chaque
convive est marmiton à son tour et lave l'auge dans l'eau de mer.
L'appétit faisant les frais du repas, on s'apperçoit sans dégoût que
la soupe grasse du soir sent la merluge du matin. Nous mangeons debout
comme les Israélites dans le désert; en dix minutes le repas est fini.
Le marmiton de jour reporte l'auge et le bidon à la cambuse ou magasin
de comestibles, et chacun se disperse dans les chaloupes et sur les
gaillards pour charmer son homicide loisir par l'aspect des ondes où
se balancent les goëlans ou gobeurs en volans, que les poètes nomment
alcions chéris de Thétis, parce qu'ils sont précurseurs du calme. Plus
loin, des marsouins ou cochons de mer, révolutionnent quelques petits
poissons..... Un cri nous perce le cœur; un déporté vient de se
jeter à la mer du côté de bas-bord; vingt matelots s'y plongent à
l'instant; à peine a-t-il (p. 74) touché les flots, qu'il est saisi et
remis dans une chaloupe.
Ce malheureux, nommé Jacob, lieutenant de la légion de Mirabeau, étoit
détenu depuis deux ans, et reconnu pour fou; il fut renvoyé à
Rochefort avec sept autres infirmes, et remplacé par six sexagénaires
et trois scorbutiques. Le commissaire de marine, Martin, vient nous
compter sur la liste de Bois....; elle a été rédigée si à la hâte, que
Martin passe les noms de ceux qui y sont, et nomme ceux qui n'y sont
point.
18 mars. Trois bâtimens anglais viennent croiser jusqu'à l'entrée du
port.
19 mars. Le capitaine de la frégate mouillée à côté de nous, nous
signale à l'ennemi; M. Bruillac se rend à son bord; ils se donnent
parole au retour du voyage. Depuis dix jours, nous avons vu trois fois
l'anglais, ce qui nous fait croire que nous ne partirons pas; mais nos
ennemis n'ont rien à ménager pour se satisfaire.
21 mars 1798 (Ier. germinal an 6). Tems nébuleux; bon vent;
nous levons l'ancre; nous luttons toute la journée contre les bancs de
roches. Sur le soir, nous entrons en pleine mer. Entre minuit et une
heure, on sonne (p. 75) l'alarme: nous sommes poursuivis par trois
bâtimens anglais, au milieu desquels nous donnions, sans la fracture
d'une de nos vergues qui a ralenti notre marche.
À six heures du matin, les matelots descendent précipitamment dans
notre dortoir briser la prison et les rambardes, couper les rabans de
nos hamacs, pour donner plus de jeu à la frégate. Les uns, à moitié
endormis, tombent sur les autres; tout est pêle-mêle. Ce désordre ne
dure qu'un moment; officiers, soldats, déportés forment un même
peuple; tous ont les mêmes sentimens et les mêmes ennemis à combattre:
les uns commandent de sang froid, les autres exécutent de même;
ceux-ci préparent les canons, ceux-là se précipitent dans le fond de
cale pour passer aux autres, qui jettent à la mer le leste volant et
le bois à brûler. On ensevelit dans les flots jusqu'à nos effets.
À huit heures, nous découvrons la terre; ce sont les sables
d'Arcasson, canton de Médoc, à douze lieues de la rade de Bordeaux.
L'ennemi qui nous poursuit avec acharnement, avoit fort bien compris
les signaux du capitaine de la Décade. Sa feinte retraite n'est
(p. 76) plus un mystère pour nous; ses forces sont quintuples des
nôtres. Le vent nous pousse au large, et nous voulons gagner la côte.
L'anglais qui voit nos manœuvres, songe à nous couper la route.
Le conseil s'assemble pour prendre un parti, car l'ennemi n'est pas à
trois lieues; il nous gagne; on se décide à échouer: ce moyen violent
nous donneroit peut-être la liberté. Une partie de l'équipage s'en
réjouit d'avance, dans l'espoir du pillage; l'autre craint que la
frégate ne se brise sur des rochers en cherchant un fond de vase.
Depuis le point du jour, nous flottons entre la crainte, l'espérance,
le naufrage, la mort, la prison et la liberté.
Le soir, la côte n'est plus pratiquable pour échouer; le vaisseau rasé
(le Vieux Canada) et les deux frégates (la Pomone et la Flore), ne
sont pas à six milles de nous; tout est prêt pour le combat; nous
soupons avant le coucher du soleil; on brise les cuisines, la cloison
de l'arsenal, et l'on nous fait descendre dans l'entrepont. Quelle
horrible nuit va succéder à ce jour d'alarmes!....
Une prison, dont les plafonds s'écroulent subitement, offre un
tableau moins horrible (p. 77) que notre dortoir; des planches
brisées, des caisses vides, des épontilles, des hamacs déchirés, des
bréviaires, des souliers, des chemises, des peignes, des bouteilles
cassées, sont confondus dans ce local de quatre pieds et demi de haut.
On se heurte; on se blesse; on se renverse les uns sur les autres; on
parvient enfin à nous faire passer une lanterne qui nous donne une
lumière sépulcrale: l'un est couché sur les jambes de l'autre;
celui-ci replié en double, sert de marche-pied ou de siège à trois ou
quatre autres. Le plancher dégoutte de sueur, comme si les soupiraux
du pont et de la batterie étoient ouverts pour arroser le fond de
cale.
La nuit est close; notre frégate vogue à l'aventure. Quand on peut
voir le danger, la recherche des moyens de s'y soustraire distrait la
réflexion et émousse les aiguillons de la crainte. Nous sommes sur des
écueils; les nouvelles changent à chaque minute; tantôt nous allons
échouer, un moment après nous allons entrer dans la rivière de
Bordeaux; le vent mollit, et nous sommes en panne; nous allons
toucher; il faut encore décharger le bâtiment. On déblaie
l'entrepont; tout le bois de (p. 78) chauffage est jetté à la mer. On
défonce les pièces de vin et d'eau-de-vie. Les bidons, les marmites,
les malles, les ferrailles et le leste volant sont à l'eau. Il est
neuf heures, et nous sommes à trois lieues de la rade du Verdon.
L'ennemi nous a perdu de vue, mais la lune le guide; il nous suit
peut-être à la piste.
Le feu d'une tour fameuse, nommée Cordouan, nous indique que nous
sommes près de la côte. Ce phare est redouté des navigateurs; l'onde
mugit et couvre la surface d'une île qui a donné son nom à la tour.
Notre pilote qui ne reconnoît pas ces attérages, conseille au
capitaine de faire mettre le canot à la mer, pour aller reconnoître la
côte, nous faire débarquer de suite et brûler la frégate à la barbe de
l'ennemi, qui ne manquera pas de venir nous attaquer au point du jour.
Ce conseil est sage, mais un peu tardif; cependant on s'en occupe; on
jette l'ancre, et les canotiers partent et rament à force de bras vers
le phare Cordouan, qu'on a pris pour une anse abordable: ils
reviennent, et nous reconnoissons trop tard notre méprise. Nous sommes
à plus de neuf milles de cette côte. La lumière semble fuir devant
les canotiers. (p. 79) Le phare qui la donne est à moitié ténébreux,
et réellement cette lanterne tourne et partage la lumière avec les
ténèbres, pour défendre aux navigateurs d'approcher. Les brisans ont
failli submerger nos canotiers.... Il est minuit, nous levons l'ancre
pour filer quelques nœuds et échouer en sûreté au premier
crépuscule. Aurons-nous le sort de Robinson Crusoé? Ce navigateur
trouva une île hospitalière, et nous serons jettés dans le sein de nos
ennemis.
Tout l'équipage harassé de fatigues, profite de ce moment de fausse
sécurité pour se livrer à un profond sommeil. Le capitaine,
l'état-major et les hommes de quart sont les seuls qui veillent sur le
gaillard de derrière.
À minuit et demi, M. Dupé, chirurgien-major, vient au poste de ses
aides, leur ordonne de se préparer à panser les blessés.
On s'éveille en sursaut; on crie aux armes; on coupe le cable de
l'ancre: l'anglais nous a débusqués par la lumière de nos canotiers;
il n'est qu'à deux portées de fusil de notre bord; le combat va
commencer.
Une de ses frégates, meilleure voilière que les deux autres, nous
atteint et nous salue d'une décharge de 16 et de 9.
(p. 80) À notre bord, on s'éveille en tombant les uns sur les autres;
les officiers courent, crient de tous côtés. Canonniers, à vos
postes, feu de stribord, feu de bas-bord; la frégate tremble et
retentit du bruit des foudres: d'horribles sifflemens se prolongent,
et semblent, en passant sur nos têtes, mettre le bâtiment en pièces.
L'ennemi qui sait que la partie est inégale, nous crie d'amener; sa
proposition est accueillie par une salve qui met le feu à son bord. Il
s'éloigne pour faire place au vaisseau rasé et à l'autre frégate. Nous
ripostons en gagnant la côte. D'épaisses ténèbres couvrent l'horison,
et la lune n'a achevé son cours que pour rendre notre destinée plus
affreuse.
Comment vous peindre la situation des pauvres déportés? Les trois
quarts sont d'anciens curés de campagne, qui n'ont jamais entendu que
le bruit des cloches de leur paroisse; tandis que ceux-ci pleurent,
que ceux-là se confessent et s'absolvent, une bordée démonte notre
gouvernail; le feu redouble des deux côtés; l'alarme est générale à
notre bord; on balance sur le parti qu'on doit prendre. Notre frégate
ne fait plus que rouler. La Pomone a éteint le feu qui avoit pris à
son bord; (p. 81) elle revient à la charge; nous sommes entre trois
assaillans: nous longeons la côte au gré du vent, faute de pouvoir
gouverner. L'ennemi partage ses forces pour nous prendre en flanc et
en queue; il vient de nous tirer une bordée en plein bois: nous
pirouettons depuis deux heures..... Nous touchons.... Un horrible
craquement fait trembler l'énorme machine. Grand Dieu! nous périssons,
s'écrie l'équipage d'une voix perçante. La frégate paroît se partager
et abandonner aux flots nos cadavres mutilés. La mer commence à
monter; nous pirouettons un peu moins; le feu diminue, mais l'ennemi
s'acharne à nous poursuivre; nous approchons du rivage. Comme il est
moins délesté que nous, il craint de s'engager; il s'éloigne de peur
de toucher sur nos attérages.
Pouvons-nous respirer un moment? quel plaisir de survivre à de si
grands dangers! Il n'est que quatre heures, nous nous battons depuis
minuit et demi; depuis une heure la quille de notre bâtiment est aux
prises avec les rochers et les bancs de sable: chaque flot relève ou
accroche la lourde masse qui vacille et nous renverse en asseyant son
poids sur les (p. 82) pierres ou dans les cavités des montagnes
ensevelies sous les ondes. Nous voilà à l'embouchure de la rivière de
Bordeaux, l'anglais ne peut plus nous atteindre, notre frégate est
criblée, son artillerie démontée, il n'y a eu, dit-on, personne de
tué.
Le capitaine songe à nous plutôt qu'à lui, il nous envoie un officier
pour nous tranquilliser et nous faire rafraîchir.
À la pointe du jour, une partie de nos matelots réceleurs va à terre
sous prétexte d'avertir un pilote-côtier, pour vendre les effets qui
nous ont été volés pendant le combat par les fripons qu'on déporte
avec nous pour nous avilir. En déjeûnant on s'étourdit pour oublier le
malheur, et chacun fait à sa mode l'historique de l'action. Le
bâtiment est une maison au pillage.
À neuf heures, un pilote-côtier nous aborde, en joignant les mains:
«Que vous êtes heureux, mes bons messieurs, d'avoir la vie sauve!
cette côte dont l'anse est bordée de sables, cache des rochers
affreux; dans les petites marées je les touche souvent avec ma rame;
il n'y a pas long-tems que je remarquois encore les ruines d'une
ancienne ville nommée les Olives, submergée comme l'île de Cordouan
dont vous ne voyez plus que la tour. (p. 83) Quand vous auriez gagné
cette plage, les écumeurs de mer, qui l'habitent, vous auroient
assommés pour vous voler.»—Il nous fit remarquer un groupe de
sans-culottes montés sur des échasses, qui, comme des harpies,
ramassoient avec des crocs les vivres et les effets que la mer jettoit
sur ses bords. Nous mouillons dans la rade du Verdon, dans l'espoir de
débarquer le lendemain.
24 Mars. La frégate fait dix-huit pouces d'eau par heure; nous
pompons pour laisser reposer l'équipage.
Les matelots réceleurs reviennent; tous les vols ont disparu, excepté
la houppelande du capitaine qu'on retrouve dans un tramail et qui est
encore toute couverte de sable et de boue; l'état-major a été
également pillé. On fait une visite qui n'intimide personne; les
objets de moindre valeur vont se loger où les propriétaires ne les
avoient jamais mis; et le dieu Mercure dépêche deux commissaires de
Bordeaux pour distraire de cette recherche par l'inspection de la
frégate. Ils passent entre deux haies de déportés qui obstruent
involontairement leur passage: Retirez-vous, disent-ils, citoyens,
ou plutôt messieurs, car des monstres comme vous (p. 84) ne sont pas
citoyens. Ils ont trouvé fort mauvais que les officiers
communiquassent avec les déportés, ce n'étoit pas là leur mission;
aussi ont-ils prononcé sans examen que nous devions retourner à
Rochefort, de suite, quoique nous n'ayons pas de gouvernail. Notre
équipage est décidé de son côté à ne pas marcher sans garder pour
otages les commissaires qui viendront lui en réitérer l'ordre; on les
jettera à la mer au premier danger. Cette résolution leur parvient,
la frégate est hors d'état de mettre à la voile.
5 avril (6 germinal). Nous recevons deux lettres contradictoires;
l'une, d'un détenu de St. Maurice; l'autre, d'un citoyen de Rochefort.
La première nous assure que nous serons déposé à Blayes, sous trois
jours; l'autre, que nos lettres et paquets seront remis au capitaine
de la Décade, qui va venir nous prendre au Verdon.
20 avril (1 floréal). À cinq heures et demie, nous appercevons un
bâtiment, on le signale; c'est la Décade; elle mouille à la chute du
jour.
Troisième soirée.
22 avril 1798 1798 (3 floréal an 6). Depuis (p. 85) quarante jours
que nous sommes en mer, nous n'avons pas eu un moment de repos; après
un combat opiniâtre, où nous sommes spoliés de tout, quand nous
demandons à descendre à terre, pour reprendre quelques effets, on nous
leurre, afin que nous ne sachions où donner nos adresses, et que nous
consommions le peu qui nous reste, sans pouvoir le remplacer. On nous
fait enfin rembarquer tout nus.
À huit heures, la première embarcation part. Nos vieillards[9]
commencent à croire qu'ils iront dans le Nouveau-Monde. Le dénuement
où ils se trouvent, le changement d'équipage, les infirmités qui les
accablent, leur rendent ce moment plus cruel; des larmes mouillent
leurs cheveux blancs, ils invoquent la mort. Quoique nos malades
n'aient plus qu'un souffle de vie, on les hisse à bord, (p. 86) comme
des bêtes de somme. Nous voilà sur la Décade. L'officier de quart
prend son porte-voix, et nous donne la consigne: «Messieurs les
déportés, il vous est expressément défendu de communiquer avec qui que
ce soit de l'équipage, vous reprendrez les mêmes places que vous aviez
sur la Charente; vous remplirez les articles du réglement, dans les
pancartes qui sont à la porte des rambardes de votre dortoir. Les
voici:
Article Premier.
Les déportés seront détenus dans le lieu qui leur est destiné
(l'entrepont. Voyez plus haut la description de ce local), depuis six
heures du soir jusqu'à sept heures et demie du matin, et plus tard si
les circonstances retardent le nettoyage du pont, ou tout autre motif.
Art. II.
Lorsque les détenus auront des besoins pendant la nuit, ils auront
pour y satisfaire des bailles divisées dans leur local, lesquelles
bailles seront vidées de quatre heures en quatre heures par les gens
de l'équipage; pendant le jour, quand ils seront sur les ponts, ils
iront (p. 87) à la poulaine, (lieux-d'aisance à gauche et à droite de
la proue du bâtiment), à moins de mauvais tems, et dans ce dernier
cas, les bailles seront mises dans la batterie.
Exécuté ponctuellement.
Art. III.
Les déportés seront applatés par plats de sept: les heures de leurs
repas seront celles de l'équipage, c'est-à-dire des matelots, devant
vivre comme eux et de la même chaudière: ils mangeront toujours dans
la batterie, depuis le grand mât jusqu'au panneau de l'avant; ils
auront pour leur service, pendant le repas, quatre novices (ou
mousses), qui iront à la chaudière et à la cambuse prendre leur
manger.
Art. IV.
Entre les repas et aux heures indiquées, lorsque les circonstances le
permettront, les déportés pourront se tenir sur les passe-avants et
dans la batterie; mais jamais, sous aucun prétexte que ce puisse être,
ils ne passeront au-delà du grand mât, ni n'iront sous les cuisines,
sous peine d'être punis comme infracteurs de l'ordre.
(p. 88) Ce dernier article a été de rigueur.
Art. V.
Il leur est expressément défendu de lier aucune conversation avec les
gens de l'équipage et d'insulter personne, sous les peines portées par
le précédent article.
La première partie de cet article n'a pas été observée à la lettre;
elle a été faite pour que les voleurs déportés avec nous ne
trouvassent point de réceleurs dans les matelots; la seconde a prévenu
les rixes et produit un fort bon effet.
Art. VI.
Si quelqu'un de l'équipage les insultoit de quelque manière que ce
soit, ils en porteront plainte à l'officier de service, et justice
leur sera rendue.
Exécuté à la lettre.
Art. VII.
Il leur est expressément défendu d'adresser au capitaine aucun écrit,
à moins que ce ne fût des lettres pour terre, qui seront toutes
remises sous cachet volant: ils porteront toutes leurs réclamations
verbalement aux officiers de service.
(p. 89) Bonne précaution contre les flatteurs et délateurs, mais champ
vaste à l'arbitraire des commis aux vivres, qui donneront ce que bon
leur semblera, de l'aveu même du capitaine, qui n'en pourra jamais
rien savoir, puisqu'il ne communiquera point avec nous, et qu'il nous
défend de lui écrire....
Exécuté à la lettre.
Art. VIII.
Toutes les fois que la générale battra, les déportés se retireront
avec précipitation dans le lieu de leur détention, à moins qu'il n'en
fût autrement ordonné.
La rédaction de cet article marque la verge d'un capitaine
négrier.—Exécuté selon sa forme et teneur.
Art. IX.
S'il s'élevoit quelque rixe entre les déportés, ils laisseront leur
dispute au premier ordre qui leur en sera donné, sous peine aux
délinquans d'être arrêtés et mis aux fers au lieu de leur détention,
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le capitaine.
Cet article a été inutile.
Art. X.
Dans tous les cas de manœuvre ou toute (p. 90) autre circonstance,
dès que l'officier de service ordonnera aux déportés de laisser les
passe-avants pour descendre, soit dans la batterie, soit dans le lieu
de leur destination, ils en exécuteront l'ordre avec exactitude.
Suivi à la lettre.
Art. XI.
Les déportés n'auront dans le lieu de leur détention que le hamac qui
leur est destiné, les couvertures qu'ils se seront procurées, et un
porte-manteau ou sac de nuit pour leur traversée, la petitesse du lieu
qu'ils occupent, la salubrité qu'il est urgent d'entretenir ne
permettant pas de leur accorder d'autres effets. Le surplus sera
déposé dans les autres parties de la frégate, pour leur être remis à
l'arrivée.
Cet article très-sage a été ponctuellement suivi.
Art. XII.
Lorsque le branle-bas de propreté sera ordonné au lieu de détention,
chaque déporté ira prendre ses effets qu'il mettra dans son hamac, ou
les portera où il lui sera indiqué, les gardera près de lui pour les
descendre, dès que l'ordre s'en donnera.
Art. XIII.
Il est enjoint à tous les déportés de se conformer (p. 91) à tout ce
qui est prescrit par la présente consigne, sous peine d'être punis
conformément à la loi.
À bord de la frégate la Décade, sixième
année de la république française.
Le commandant de la frégate, Villeneau.
23 avril (4 floréal). Voici notre traitement. Après une grande
confusion, nous avons repris nos places; nous sommes plus entassés que
dans la Charente; la prison est plus étroite et plus noire; nos
malades sont provisoirement au bas des écoutilles.
On se lève à six heures; on déjeûne à sept et demie. Un petit mousse
va à la cambuse prendre pour chaque société composée de sept, un bidon
contenant sept boujearons d'eau-de-vie (une chopine moins un huitième,
mesure de Paris), et trois biscuits pesant au total quatorze onces.
Ces biscuits mis trois ou quatre fois dans le four, sont piqués ronds
de l'épaisseur d'une galette de pain d'épice, et si durs que le moins
édenté est réduit à les briser sur deux boulets ramés, dont l'un lui
sert d'enclume, et l'autre de marteau. Dans huit jours, nous
trouverons ces biscuits dentelés (p. 92) par des vers longs comme le
doigt; en voilà pour jusqu'à midi.
Chacun va se coucher, ou dans l'entrepont, ou dans les batteries, ou
dans les porte-haut-bancs, pour faire une visite domiciliaire dans ses
habits, où il trouve des milliers de buveurs de sang et de comités
révolutionnaires. En vain changeroit-on de linge à toute heure, le
nombre des indigens est si grand, que la mal-propreté est inévitable.
Les lépreries juives étoient des palais en comparaison de notre
dortoir; le bois est imprégné d'une odeur cadavéreuse, capable de
donner la peste; les alimens se corrompent aussi-tôt qu'on les met à
l'embouchure de ce gouffre.
Le pilote vient de retourner le sablier pour la douzième fois; on
sonne le dîner. (Voyez l'ordre pour notre table dans l'article III du
réglement ci-dessus.)
Notre cuisine est à stribord, celle de l'état-major à bas-bord; de ce
côté, les poulets tournent à toutes les heures du jour. Quatre ou cinq
mousses élégans aident le cuisinier des officiers, et vendent à la
dérobée jusqu'aux miettes qui tombent de cette table; il nous est
défendu d'en marchander, et même de parler (p. 93) à leur chef qui
est séparé de nous par une toile. Tout ce qui approche Villeneau[10],
jusqu'au mousse qui tourne la broche, regarde le déporté le moins
déguenillé comme une être infiniment au-dessous de lui; à peine nous
est-il permis de manger notre morceau de biscuit à la fumée du rôt.
Pendant que nous attendons notre sale dîner, l'officier de service
fait scrupuleusement sa ronde, et pose une sentinelle à sa cuisine.
Passons dans la nôtre.
Pour peindre un coq, ou cuisinier de bord, (p. 94) il faut tout le
génie de Calot dans la Tentation de Saint-Antoine; un coq est un
animal extraordinaire par sa bêtise et sa mal-propreté: figurez-vous
un être plus sec qu'une éclanche, dont le teint olive enfumé est
huileux de graisse et de sueur, des yeux rouges et pleureurs, un nez
large comme une chaudière, des mains calleuses, des durillons d'une
crasse noire, de ses alvéoles gonflés de deux monticules de Tabago,
coulent deux sources brunes qui filtrent amoureusement sur les racines
sanguinolentes de ses clous de gérofle découronnés; sa main essuie
souvent les rigoles nasales qui vont se perdre jusqu'à son menton; sa
chemise n'est ni noire, ni blanche, ni brune; mais couverte de deux
lignes d'épais d'une liqueur agglutinée par le feu et encore un peu
moite; ses cheveux dégouttent d'huile; ses oreilles sont percées, deux
poires de plomb descendent galamment sur le col de sa chemise, assez
ouvert pour qu'on voie à nu presque tout son corps. Un mauvais cheval
mené à l'écarisseur est plus gras que lui, ce squelette dans un
amphithéâtre exempteroit les anatomistes d'user leur scalpel; les
insectes ne piquent point cet être plastrone de crasse; sa sale
carcasse (p. 95) ressemble à une vieille peau tannée où l'on ne voit
aucune monticule de veines.
Je n'aurois pas de spectacle plus amusant que de suivre, sur les
boulevards de Paris, cet animal singulier, pris sur le bord au moment
qu'il va distribuer sa chaudière. Je voudrois qu'une femme des plus
coquettes lui donnât le bras, qu'il pût s'oublier au point de vouloir
être galant; quelle suite accompagneroit ce couple original! quel
divertissement pour les spectateurs, au moment où la main du coq,
contrastant avec celle de la nymphe, s'approcheroit de ses lèvres en
lui chatouillant le menton! quelle grimace feroit celle-ci s'il
devenoit téméraire!....... Ne sortons pas de la frégate au moment de
prendre un dîner aussi appétissant.
Le coq ouvre sa vaste chaudière et vide trois cuillerées de bouillon
dans chaque baquet: on nous fait faire gras et maigre tout ensemble;
nos légumes sont des fèves de marais, grosses comme des rognons de
mouton, enveloppées d'un sac dur comme une corne de cheval: si ce
grainage étoit commun en Asie, on devroit bien s'en munir pour les
chameaux qui mangent pour plusieurs jours quand les voyageurs (p. 96)
traversent les déserts de l'Arabie-Pétrée. Ces fèves sont à bord
depuis deux ou trois ans, on y trouve souvent de petits insectes qui y
font leur case, et de petites pilules de rats et de souris.
Demain nous aurons quatre onces de bœuf salé ou les trois seizièmes
d'une livre de porc; le troisième jour, de la merluche couleur citron
émiettée, à l'huile rance, que le coq retournera avec ses mains pour
la jetter dans nos baquets. Le jour de la décade, un breuvage de riz
aussi clair que celui du renard à la cicogne; tous les cinq jours, une
fois du pain et pas à discrétion; tous les jours un demi-septier de
vin à dîner et à souper.
Les mousses nous servent comme le matin. Voici l'espace que nous
occupons: nous sommes sur deux haies d'un côté et de l'autre, depuis
l'escalier des cuisines jusqu'à une toise en-deçà du grand mât; cet
espace est de trente-deux pieds de long sur onze de large, dont il
faut retrancher l'emplacement de quatre pièces de canon montées sur
leurs affûts: l'affût a quatre pieds et demi de long sur quatre de
large, à partir du bout des essieux: il faut encore laisser un chemin
pour aller de la cuisine (p. 97) à l'arsenal; nous sommes cent
quatre-vingt-treize, ce qui fait quatre-vingt-seize personnes dans
l'espace de trente-deux pieds de long sur six de large, évaluation
faite de l'emplacement des canons. On nous sert dans une gamelle qui
est lavée quatre ou cinq fois par an.
Il ne tiendroit pourtant qu'au capitaine de nous entasser un peu
moins, car la batterie a cent pieds de long, et la frégate cent
vingt-huit sur trente-huit de large à son grand mât. Nous sommes
enveloppés dans le tourbillon de fumée des cuisines; si nous montons
sur le pont, le soleil nous rôtit; nous ne sommes bien nulle part;
vingt ou trente sont attaqués du scorbut, et les salaisons contribuent
beaucoup à cette branche de peste, mais on ne peut pas faire
autrement, et nous ne nous plaindrions pas, si le commissaire aux
vivres, qui s'entend avec Villeneau, échancroit moins notre ration.
(D'abord il a écouté nos plaintes, puis elles ont été vaines; nous
pourrions rester long-tems en mer, subterfuge pour cacher les
rapines.) À six heures, on soupe aussi frugalement qu'on a dîné, puis
on descend au cachot. (Voyez-en la description à notre entrée sur la
Charente.)
(p. 98) 25 avril (6 floréal.) À trois heures du matin, le vent
souffle du nord-est; on lève l'ancre, le silence de la nuit est
interrompu par les cris et les chants barbares des matelots, qui
saluent le père du jour par des juremens ou des discours orduriers,
répétés avec d'autant plus d'éclat qu'ils veulent les faire entendre
aux malheureux, qui du fond de leur cachot, lèvent les mains et les
yeux au ciel. Le vent tombe; nous mouillons à deux portées de fusil de
l'ancienne et trop fameuse ville de Royan, rebelle et ruinée par le
cardinal de Richelieu. Oh! que ne nous est-il permis de parcourir ses
ruines!... nous ne sommes pas à cent vingt toises du sol français. Un
ordre désespérant nous enchaîne au rivage.
26 Avril 1798 (7 floréal an 6). Nous mettons à la voile: cette
fois nous voilà en route pour Cayenne; à midi, nous avons dépassé le
phare Cordouan; nous reconnoissons notre redoutable passage des
Olives; chacun, placé sur le pont et dans les batteries, les yeux
fixés sur ces côtes, fait les réflexions les plus sinistres; la
frégate vogue à pleines voiles, nous filons sept nœuds et demi à
l'heure. (Un nœud est le tiers d'une lieue.)
27 Avril. Nous avons fait trente lieues, le (p. 99) sol français a
entièrement disparu, nous sommes dans le golfe de Gascogne. La brume
qui couvroit l'horison se dissipe, nous appercevons à bas-bord la
pointe des Pyrénées; les plus clairvoyans distinguent avec de longues
vues le port de Saint-Sébastien: à stribord, la mer est couverte de
planches et de poutres: quelque bâtiment a fait naufrage sur ces côtes
toujours battues par les tempêtes. Ces objets nous plongent un instant
dans de sombres réflexions que le trouble et la dissipation effacent
un instant après. Une grosse tonne vogue au gré des flots. On met la
chaloupe à la mer, elle est à bord, c'est une excellente pièce de
quatre cents pintes d'eau-de-vie; on la déguste sur le gaillard de
derrière, et Villeneau la fait mettre dans son greffe. Toute la
journée demi-calme: le soir, des marsouins ou cochons de mer jouent
sur les ondes et nous annoncent du vent; il s'élève au bout d'une
heure, mais il nous pousse d'où nous sortons.
28 Avril (9 floréal), soir, vent de bout (ou contraire), nous
n'avons fait que douze lieues; nous ne sommes qu'à neuf ou dix
nœuds des côtes d'Espagne; nous découvrons parfaitement les
Pyrénées: ces hautes montagnes ont leurs (p. 100) sommets couverts de
neiges et leurs pieds plantés de bois. Des cavités immenses, des
gouffres, des décombres, des antres effrayans nous présentent de
majestueuses horreurs; une fumée blanchâtre s'élève de ces rochers qui
amoncèlent les nues. Leur approche rend les vents variables et excite
de violentes tempêtes. Un voyageur égaré dans ces abîmes, entendroit
sans merveille la foudre gronder sur sa tête, pendant qu'il la verroit
rouler à ses pieds.... Nous n'avons encore dépassé que les ports de
Bayonne, de Saint-Sébastien, de Saint-Andero, en rangeant toujours les
Asturies. Les hirondelles frisent l'eau ... Messagères du printems,
plus heureuses que nous, vous allez suspendre vos nids aux toits dont
on nous a arrachés!
3 Mai (14 floréal). Vent en poupe, nous filons neuf nœuds. Sur
les dix heures, le corsaire les Sept-Amis invite notre capitaine à
gagner le large. La pointe du Finistère, nous dit-il, est gardée par
un stationnaire anglais qui rôde à vingt-cinq lieues; Villeneau répond
qu'il a des ordres précis de ne pas quitter la côte. Les deux bâtimens
s'éloignent en se promettant un mutuel secours.
Après midi nous découvrons le cap Ortugal; (p. 101) il nous rappelle
que nos aïeux, jaloux de voler à la défense de l'Espagne à
demi-embrasée par les Maures et les Arabes, entrèrent dans ces
royaumes par cette brèche qui a conservé le nom de Ortugal ou Ortus
Gallorum, comme le Portugal a retenu le sien du premier port dont ces
mêmes Gaulois se rendirent maîtres en poursuivant les dévastateurs à
qui ils succédoient.
Sur les quatre heures, nous longeons les arides montagnes de la Galice
où Saint-Jacques de Compostel reçoit tant de pélerins et fait tant de
miracles. Le sommet de ces rochers est couronné d'une bruyère de trois
pouces de haut, parsemée de thym, de serpolet et d'autres herbes
odoriférantes. Ces simples sont si abondantes en Espagne, qu'au retour
du printems, l'air du soir et du matin est parfumé d'une douce
ambroisie.
Les malheureux prêtres rélégués en Espagne depuis 1792, sont nos
géographes, et nous marquent à loisir toutes les côtes du nord-ouest
de ces royaumes.
Ces parages, à plus de cent cinquante lieues, sont défendus par des
rochers si élevés, que des enfans avec des frondes et des pierres
(p. 102) repousseroient une armée de cent mille hommes, et feroient
tête à une flotte de quatre cents voiles. Au haut des montagnes de la
Galice sont différens hermitages, où des solitaires demandent à Dieu
le retour de la religion catholique en France, son maintien en
Espagne, l'abolition du gouvernement révolutionnaire et de l'athéisme
dans le pays qui nous exile. Autour de ces hermitages, quelques
journaux de terre semés de bled, nous présentent des morceaux de
verdure qui contrastent agréablement avec les autres plantes grisâtres
des montagnes. Le casanier de ces lieux ressemble à ce vieillard de
Corfou, qui étoit heureux dans sa retraite d'Ebalie; son trésor, seul
patrimoine de ses aïeux, étoit, dit Virgile, un petit jardin et
quelques journaux de terre cultivée par ses mains.
Namque sub Œbaliæ memini me, turribus altis,
Quò niger humectat flaventia culta Galesus,
Coricium vidisse senem cui pauca relicti
Jugera ruris erant...
Virg. Georgicon, lib. 4.
Divine médiocrité, tu n'es le partage ni des grands d'Espagne, ni des
directeurs de France!
À six heures, nous ne sommes qu'à vingt lieues du Finistère; nous
forçons de voiles à la vue d'un bâtiment qui nous poursuit depuis
(p. 103) trois heures; les lunettes sont braquées; Villeneau se croit
déjà prisonnier. Le soir, le vent fraîchit, les lumières sont
éteintes, une frégate anglaise nous chasse quelque tems, et nous
abandonne ensuite en voyant le corsaire les Sept-Amis se rapprocher
de nous. Le cap Finistère nous échappe entre minuit et une heure; nous
n'appartenons plus à la France, quelle que soit notre destinée, nous
ne serons plus reconduits au Verdon.
4 mai. Ce matin nous formons tous un cercle dans les batteries, en
chantant avec attendrissement ces paroles, qui tirent une grande
partie de leur mérite de la circonstance:
Air: Sous la pente d'une treille.
Pour la Guiane française,
Nous mettons la voile au vent
Et nous voguons à notre aise
Sur le liquide élément:
L'état qui nous a vus naître,
Comme nous chargé de fers,
À nos yeux va disparoître
Dans l'immensité des mers.
Mais les Dieux ont quelque empire
Contre l'ordre du Soudan,
Et le pilote déchire
L'arrêt de mort du divan.
N'importe sur quel parage
Le ciel fixe nos destins,
(p. 104) Nous sortons du plus sauvage,
De celui des jacobins.
Pour se soustraire à la rage
Du sombre Pygmalion,
Didon vint bâtir Carthage
En s'éloignant de Sydon:
Comme cette souveraine,
Déportés et malheureux,
Pour nous l'isle de Cayenne,
Nourrit des cœurs généreux.
Votre malheur nous étonne,
Diront cent peuples divers,
«Quand le crime les couronne,
«La vertu doit être aux fers:»
Dans un moment moins critique,
Se croyant à l'abandon,
Jadis sous les murs d'Utique
On vit s'inhumer Caton.
De ce courage inutile
César sut bien profiter,
Marius fut plus habile,
Il faut savoir l'imiter.
Sur les ruines de Carthage,
Écrivons à nos tyrans:
Nos malheurs sont votre ouvrage;
Guerre éternelle aux brigands.
Etc., etc., etc....
Nous ne reverrons pas la France cette année; comme notre voyage sera
un peu long, il faut songer à nos amies et à ceux qui nous le font
entreprendre; faisons notre testament pour que chacun ait son lot.
(p. 105) Pour l'art d'aimer, Ovide en Sybérie
Fut exilé comme un franc séducteur;
On ne m'eût point sevré de ma patrie,
Si j'eusse écrit pour certain directeur.
Sexe charmant, je fus plus excusable
À vos beaux yeux qu'à ceux de nos traitans,
Lorsque ma main, plus qu'à demi-coupable,
Avec du sel, vous brûloit de l'encens.
Pour arriver au fond de la Colchide,
Vous savez bien comment s'y prit Jason,
Le tendre amour vint lui servir de guide
Et la beauté broda son pavillon....
Dans les déserts d'une zone brûlante,
Loin de la France et des jeux et des ris,
Je chanterai dans ma carrière errante
Tous les plaisirs du séjour de Paris.
Proscrit, fêté, malheureux, dans l'aisance,
Gagnant beaucoup et n'ayant jamais rien,
Le seul trésor que je regrette en France,
Sont des amis qui faisoient tout mon bien.
Au gré des flots, quand le sort m'abandonne,
Sur leurs vertus je fonde mon espoir,
Dussé-je ailleurs gagner une couronne,
Je la rendrois pour venir les revoir.
Pour mes biens-fonds, faut qu'un séquestreur leste
Scelle d'abord la gueule à tous les rats,
Car mes chansons, c'est tout ce qui me reste,
Qu'en feront-ils quand je n'y serai pas?
Ô nos tuteurs! tout ce qui nous démonte
C'est le chagrin de ne plus vous revoir;
Nos chers amis, pour rendre votre compte,
Montez au haut de la Croix du Trahoir.
(p. 106) Nous voudrions que vous prissiez dans Rome
Le rang des saints que vous faites chasser,
Chacun de vous, messieurs, est un grand homme
Que nous avons le désir d'enchâsser.
Nous ne voyons plus que le ciel et l'onde, nous sommes à vingt-cinq
lieues du Cap; nous désirons maintenant dépasser les Açores et Madère.
L'état-major est tout rayonnant de joie, et Villeneau paroît vouloir
s'humaniser, c'est Pluton qui ne remet Euridice à Orphée que sous des
conditions inexécutables.
Nescia humanis precibus mansuescere corda.
Pendant le jour, nous charmons les loisirs de la traversée par des
contes et des questions intéressantes. La pensée de notre dortoir nous
désespère; quatre de nos compagnons, Mrs. Frère,
Rabaud-Desroland, Clavier et Bernard-Modeste, embarqués en 1793,
sur le Washington devant l'île d'Aix, nous disent que c'est un
palais spacieux, auprès de celui qu'ils occupoient: ils étoient sept
cents dans un local plus petit que celui-ci, sur un seul rang de
lits-de-camp, réduits ou à se tenir debout les uns contre les autres
les mains jointes pressées contre leurs hanches, ou à rester assis sur
leurs talons, la tête entre les jambes; la peste les (p. 107) entama
bientôt, chaque nuit ils rouloient à leurs pieds dix ou douze morts,
qu'on remplaçoit par vingt nouvelles victimes. Le capitaine de ce
bord, nommé Lalier, fermoit tous les soupiraux sur eux, et les
fumigeoit avec des fientes de volaille; le sang leur sortoit souvent
par les yeux et par la bouche; quand ils parloient au chirurgien, il
leur répondoit en pleurant qu'il avoit ordre de ne pas les soigner,
qu'ils étoient tous réservés à périr. Ils nous peignent en traits de
feu la rapacité de Lalier, qui s'emparoit de tous les effets des
morts, les laissoit nus, forçoit leurs confrères moribonds de les
ensevelir à leurs frais, et de les charger sur leurs épaules pour les
descendre dans le canot, d'où ils alloient les inhumer à l'île d'Aix
avec des soldats de la compagnie Marat, qui leur donnoient des coups
de bourrades quand ils vouloient prier, parler ou pleurer. Enfin,
Lalier et ses janissaires impatientés de ne pas les voir tous périr
assez promptement, inventèrent une conspiration pour avoir un prétexte
de les spolier; ce moyen leur réussit, il étoit à l'ordre du jour:
deux mois après, arrive le 9 thermidor; Lalier s'humanise, court les
embrasser, leur lit une belle proclamation; (p. 108) ils lui
redemandent leurs effets: «Ils sont déposés à la Société Populaire,»
dit-il. (À ces mots notre entrepont retentit, pour la première fois,
de grands éclats de rire). Ils furent rappelés; Lalier et son équipage
leur demandèrent humblement des certificats d'humanité qu'ils ne
refusèrent pas; mais le dénuement où ils se trouvèrent, le pillage des
effets des morts, le nombre des victimes qui étoit de six cent
cinquante, sauta aux yeux des nouveaux commissaires; Lalier fut
destitué et classé dernier matelot du bâtiment qu'il commandoit. Ici
l'horreur de l'entrepont disparut un moment et nous applaudissions de
bon cœur, quand nous apperçûmes un janissaire de Villeneau qui
venoit visiter nos barreaux; d'une main il tenoit son sabre nu, et de
l'autre une lanterne sourde; il inspecta toutes les rambardes en
disant au piquet de soldats qui étoit au haut des écoutilles: «Les b...g..res
se taisent, je suis bien fâché de n'avoir pas entendu ce
qu'ils disoient, sûrement que nous n'étions pas ménagés.» (Bonne
brise, nous sommes à 260 lieues de France).
5 mai. Ce matin, grand désordre dans la frégate; le capitaine fait
briser une partie de (p. 109) nos barricades, nous gagnons douze pieds
de long sur un de large; pendant la nuit, nous pourrons vaquer à nos
besoins, un à un seulement; il n'y a plus de bailles que pour nos
malades, qui ne resteront en bas que quelques jours; on leur prépare
des cadres entre les batteries, le major a fait de vives instances à
ce sujet; ce soir, il s'est évanoui en venant au secours d'un
sexagénaire qui a eu la jambe fracassée en descendant.
7 mai. Trois bâtimens paroissent dans le lointain, Villeneau croit
voir toutes les flottes de la Manche; nous changeons de route; le
soir, on sonne l'alarme, le feu prend dans la cuisine, après quelques
mouvemens on parvient à l'éteindre.
8 mai (19 floréal.) Les bâtimens ont disparu; beau tems, nous
filons dix nœuds..... (trois lieues un tiers.) L'équipage est
toujours préoccupé des anglais, et les vigies, sur les perroquets, ont
double ration de vin, quand elles apperçoivent un bâtiment, l'intérêt
leur grossit la vue.
À quatre heures, un nuage d'eau s'élève sur la plaine verdâtre,
éclairée par un beau soleil; la vigie crie; Navire!... à
bas-bord.—Vîte (p. 110) on braque les lunettes: le capitaine: Est-il
gros?—Oui.—L'état-major: Ne vois-tu que celui-là?—Non.—Vient-il à
nous?—Oui, à toutes voiles.—Villeneau d'une voix lamentable: Ô mon
Dieu! oui les voilà! On bat la générale; vîte, les déportés dans
l'entrepont.—L'équipage en riant: Quelle escadre!... ce sont des
souffleurs!... Un moment après, l'escadre parut à notre bord, élevant
un nuage d'eau à vingt ou trente pieds en l'air. C'étoit réellement de
très-gros souffleurs, poissons de mer, qui, pour étourdir leur proie,
lui jettent de l'eau par les narines. Villeneau un peu honteux, alla
avec ses champions boire un verre de punch pour se remettre de sa
frayeur. (Nous sommes à 380 lieues de France.)
10 mai (21 floréal) À huit heures, on sonne l'alarme.....
Navire, crie la vigie; celui-là n'est point un souffleur, et
Villeneau n'a pas peur! Il court sus, malgré les ordres qu'il a de ne
pas changer de route. Tranquillisez-vous, ce n'est qu'un bateau de
pêcheurs. On le joint, c'est un anglais qui va au banc de Terre-Neuve.
On lui vend cher sa liberté; puis on lui prend en outre quelques
voiles, (p. 111) des oranges et du vin de Porto. Il n'étoit monté que
par six hommes.
Depuis la rupture de nos barrières, on a plus de facilité à se réunir,
et chacun fait à son tour les frais de la veillée. Ce soir, l'un
chante le cantique de Saint-Roch, l'autre discute gravement une thèse
de théologie. Un homme impartial (M. Pradal, mort à côté de moi dans
la Guyane française, qui m'a beaucoup aidé dans cet écrit) entame
l'analyse succincte de la révolution et des causes qui l'ont amenée
depuis 1788 jusqu'à 1798. Quoique cette revue soit concise, je n'en
ferai point usage ici, pour ne pas trop allonger notre traversée. J'en
copierai seulement ces deux traits qui m'ont paru piquans. Un collier
et un mariage manqué ont été les premières causes de la révolution
française. Ces deux greffes de réconciliation entre les deux branches
des Bourbons, ont partagé l'arbre et renversé le tronc sur le trône
qui a été brisé ensemble avec la cîme et les rameaux.
L'intrigue du fameux collier-cardinal est encore une énigme pour
beaucoup de monde.
Voici quelques notes qu'un protégé de la maison de M. de Rohan m'a
données à ce sujet:
(p. 112) «Breteuil, ministre sous Louis XVI, et alors secrétaire de
Louis XV, avoit été nommé ambassadeur pour aller chercher la dernière
reine dauphine venant en France recevoir la main de Louis XVI. Le
prince Soubise rappela à Louis XV la parole qu'il lui avoit donnée
qu'un Rohan auroit l'honneur d'amener la dauphine à la cour. Breteuil
étoit nanti des pouvoirs; on les lui retira pour les remettre au
cardinal de Rohan, et il eut l'ambassade de Londres au lieu de celle
d'Autriche. Il se lia alors avec d'Orléans pour concerter sa
vengeance.
»Marie Antoinette parut jolie au prélat; elle crut voir l'amour sous
la mitre de l'ambassadeur. De ce moment, la calomnie et la médisance
eurent beau jeu. Le cardinal, fier de sa conquête, mangea ses
bénéfices à la cour. Louis XV avoit confiance en lui. Au moment où il
étoit allé à Strasbourg, et que la Dubarri en faveur cherchoit à
indisposer le grand-père contre sa belle-fille, le roi demanda au
cardinal ce qu'il pensoit. Celui-ci qui soupçonnoit déjà son illustre
amante de quelque infidélité, s'étant retiré un peu par pique,
répondit à Louis XV:
(p. 113) »La dauphine est une aimable princesse; elle est un peu
coquette et mondaine; il seroit prudent de la veiller de près. La
Dubarri ne fit point mystère de cette lettre qu'on retrouve toute
entière dans sa vie privée imprimée en 1774. Louis XV la resserra dans
un tiroir à secret de son secrétaire.
»À la mort du monarque, ce secrétaire fut porté au Garde-Meuble;
Breteuil le visita, et trouva l'original de cette lettre que le
cardinal dénioit. Un jour que la reine faisant sa partie s'étendoit en
éloges sur M. de Rohan, Breteuil qui étoit à l'embrasure d'une
croisée, reprit en souriant: On s'intéresse souvent pour des
ingrats. La reine le mit au défi de la preuve. Il montra la fameuse
lettre qui causa la disgrâce du cardinal. Celui-ci pour regagner les
faveurs de son illustre amante, fit chercher les diamans qui devoient
monter le fameux collier. La reine comme Eriphile, reçut l'offre du
collier, et s'engagea simulément de l'acquitter pour ôter le soupçon à
Louis XVI. Les finances étoient obérées, et Rohan vouloit ne paroître
qu'avoir fait les avances, (p. 114) tandis qu'il s'étoit déclaré
payeur aux joailliers à qui il avoit annoncé que le cadeau étoit pour
la reine. La somme ne s'étant pas trouvée au jour dit, et le collier
étant démonté et engagé par les intrigues de la Lamotte, le cardinal
fut arrêté et poursuivi comme faussaire à la sollicitation de
Breteuil. De-là, la fameuse cause. Le parlement, influencé par
d'Orléans, prononça en faveur du cardinal; on rejetta la faute sur
quelques misérables filoux qui furent ensuite relaxés pour donner plus
d'odieux à la cour. Cependant Louis XVI étourdi des murmures et des
bruits scandaleux qui attaquoient les mœurs et l'économie de la
reine, tint un conseil de famille pour savoir quel parti il prendroit
sur elle. Le duc de Penthièvre lui conseilla de la mettre au
Val-de-Grace; un appartement y fut préparé pour l'y recevoir; mais le
roi changea d'avis, ne voulant pas, dit-il, servir de risée à son
peuple. La reine soupçonnant d'Orléans d'avoir aidé à ce conseil,
rompit en visière avec lui, et résolut de s'en venger.
»Au bout de deux ans le duc d'Orléans voulant faire sa paix avec la
cour, demanda (p. 115) au roi pour sa fille aînée la main du duc
d'Angoulême, fils aîné de M. le Comte d'Artois. Le roi répondit en bon
père de famille: «Eh bien, nous verrons cela; j'en parlerai à mon
frère.» M. d'Artois y consentit; les accords se firent un après-midi;
la reine en fit compliment à M. d'Orléans, qui donna le soir un grand
bal au palais Royal, où il invita toute la cour. Le roi s'en dispensa;
la reine s'y trouva pour le narguer. Le lendemain, le notaire de la
cour, Brichard, alla à Versailles pour dresser le contrat. Ce fut en
vain. La reine avoit saisi ce moment pour se venger du conseil du duc
de Penthièvre et des obscénités que le duc d'Orléans avoit secrètement
fait imprimer contr'elle par dépit à la naissance du premier dauphin.
«Sire, dit-elle au roi, vous n'y pensez pas de marier votre neveu à la
fille de d'Orléans, tandis que ma sœur, reine de Naples, a une
princesse qu'elle lui destine.» Le roi, quoiqu'avec peine, revint sur
sa parole, et le duc d'après ce refus jura et consomma par la
révolution la perte de la famille royale et la sienne.»
Du reste j'analyserai les sujets courts, ou je (p. 116) les
indiquerai seulement pour que le lecteur ne nous perde pas de vue sur
le bord, car nous ne pouvons pas arriver en deux secondes du cap
Finistère à Cayenne. Ainsi l'histoire de la révolution tient dix
soirées, suspendue chaque fois à dix heures par la visite du capitaine
d'armes, Chotard, qui descend avec son sabre et sa lanterne en nous
chantant ce vers retourné de l'hymne du Départ:
Brigands, je vous vois au cercueil.
11 mai. Vent en poupe. Nous courons la hauteur des Açores et de
Madère. On dit que cette île doit sa fécondité au désespoir des
premiers navigateurs qui, n'y trouvant que des bois, y mirent le feu,
sur ce précepte d'un poète agricole:
Sæpe etiam steriles incendere profuit agros
Atque levem stipulam crepitantibus urere flammis.
Les cendres fertilisèrent ces fameux vignobles, dont le jus n'arrosera
point nos lèvres, car le plaisir et son ombre fuient loin de nous.
Les jours augmentent en France et diminuent sensiblement ici; le
soleil se couche à sept heures.
12 mai. Le corsaire les Sept Amis, après avoir joué Villeneau qui
ne le reconnoît pas, s'abouche ce soir avec nous; il a rencontré
trois (p. 117) portugais; c'étoient les bâtimens que nous vîmes le 7
du courant; ce corsaire a eu forte affaire avec ces trois marchands
qui ont 42 pièces de canon de calibre inférieur au sien, mais
quadruples par leur jonction; ils sont chargés de poudre d'or et de
morphile. Quel deuil pour Villeneau! En revanche il vante pompeusement
sa prise du bateau. Ils prennent hauteur et se quittent. Nous sommes
par les 36 degrés 36 minutes, trente lieues au-delà des Açores, à la
hauteur de Tunis, à 474 lieues de France.
Plus la misère nous accable, plus nous luttons contr'elle; l'entrepont
retentit de contes et de chants. Un amateur nous donne ce soir la
suite de l'ariette de Florian: L'Amour suffoqué par la Jouissance:
Quand l'Amour naquit à Cythère,
On s'intrigua dans le pays,
Vénus dit: «Je suis bonne mère,
C'est moi qui nourrirai mon fils:»
Mais l'Amour quoiqu'en si bas âge,
Trop attentif à tant d'appas,
Préféra le vase au breuvage
Et l'enfant ne profita pas.
«Ne faut pourtant pas qu'il pâtisse,
Dit Vénus, parlant à sa cour,
Que la plus sage le nourrisse,
Songez toutes que c'est l'Amour...»
Soudain, la Candeur, la Tendresse,
(p. 118) L'Égalité vinrent s'offrir
Et même la Délicatesse....
Nulle n'eut de quoi le nourrir.
On penchoit pour la Complaisance,
Mais l'enfant eût été gâté.
On avoit trop d'expérience,
Pour songer à la Volupté;
Et sur ce grand choix d'importance,
Cette cour ne décidant rien,
Quelqu'un proposa l'Espérance,
Et l'enfant s'en trouva fort bien.
On prétend que la Jouissance
Qui croyoit devoir le nourrir,
Jalouse de la préférence,
Guettoit l'enfant pour s'en saisir:
Prenant les traits de l'Innocence,
Pour berceuse elle veut s'offrir;
Et la trop crédule Espérance
Eut le malheur d'y consentir.
Un jour avint que l'Espérance,
Voulant se livrer au sommeil,
Remit à la fausse Innocence
L'enfant jusques à son réveil.
D'abord la trompeuse déesse
Donna bonbons à pleine main,
D'abord l'enfant fut dans l'ivresse
Et bientôt mourut sur son sein.
Résurrection de l'Amour, sacrifice de l'Innocence.
Dans l'Olympe comme à Cythère,
Dans les hameaux comme à la cour,
Chez Pluton comme sur la terre,
On pleuroit la mort de l'Amour.
Lyse apprenant cette nouvelle,
Nuit et jour va se dépiter;
(p. 119) Comme j'y perdrois autant qu'elle,
Je m'en vas le ressusciter.
À l'homicide Jouissance,
Quand Vénus arracha son fils,
Sa cour la suivit en silence,
Si-tôt elle exila les Ris...
Mais son inséparable amie,
Du succès se flatta trop tôt;
Sur le mort, l'aimable Folie,
En vain agita son grelot.
La Sagesse et la Pruderie,
Compatissoient à ce malheur;
Mais une vieille antipathie,
Brouilloit le frère avec la sœur.
Enfin l'étique Jalousie
Qui se repaît de ses douleurs,
N'offrit pour le rendre à la vie,
Qu'un sein épuisé par les pleurs.
Contre les Dieux et les trois Grâces,
Le destin toujours irrité,
Voyant l'Amitié sur leurs traces,
Rendit son souffle inanimé.
Déjà dans les cieux et sur l'onde,
Tout meurt dans l'ennuyeux repos,
Et ce malheur fait craindre au monde
Ou le néant ou le cahos.
Dans cette terrible aventure,
Vénus réduite au désespoir,
Avoit déchiré sa ceinture
Et vouloit briser son miroir:
Quelqu'un annonça l'Espérance;
Elle entra d'un air bien confus,
Promettant que par l'Innocence
Renaîtra le fils de Vénus.
(p. 120) Mais où trouver cette déesse?
Elle n'habite point la cour,
Elle a même un peu de rudesse,
Elle redoute et fuit l'Amour:
Elle est toujours fraîche et jolie,
Jamais elle ne vieillira
Que le jour ou par tricherie,
Ce Dieu sur son sein renaîtra.
Vénus abandonnant Cythère,
Cache son fils dans son giron,
S'élance à l'instant sur la terre,
Vers le pied du sacré vallon.
Pour apprivoiser l'Innocence,
Elle voile tous ses appas,
Et conjure la Prévoyance
De vouloir devancer ses pas.
Sous une grotte solitaire,
D'où jaillit un petit ruisseau,
Étoit une jeune bergère
Qui ne gardoit qu'un seul agneau.
Vénus la reconnoît sans peine;
Puis feignant de se délasser,
S'assied au bord de la fontaine,
Afin de la mieux contempler.
L'Innocence simple et tranquille
Filoit pour charmer son loisir;
Vénus mise en dame de ville,
Laisse échapper plus d'un soupir;
Sur les bords de l'onde argentée,
Jette son fils à l'abandon,
Et s'écrie en désespérée:
«Péris, malheureux avorton!»
L'Innocence trop attentive
À faire tourner son fuseau,
(p. 121) N'appercevoit pas sur la rive,
L'enfant prêt à tomber dans l'eau,
Pour couronner son stratagème,
Vénus dans sa feinte fureur,
D'un trait fait par l'Amour lui-même,
Tourne la pointe sur son cœur.
Prompte comme la jeune Aurore,
L'Innocence accourt à l'instant:
«Ciel! ô ciel! il respire encore,
Dit-elle en embrassant l'enfant,
Malheureuse et tendre victime!
Je voudrois te rendre le jour,
T'immoler est bien un grand crime,
À moins que tu ne sois l'Amour.»
Mais l'Amour commande au tonnerre
Et celui-ci n'est qu'un enfant.
Puissions-nous sur toute la terre,
N'avoir jamais d'autre tyran!
La déesse trop charitable,
Le réchauffa dessus son sein,
Et se sentit bientôt coupable,
Car son agneau mourut soudain.
L'Amour va renaître à la vie,
L'Innocence voit le danger,
Sur son sein il palpite, il crie,
Il frappe, il cherche à se venger;
Du trait de sa perfide mère,
L'ingrat ne se sert à son tour,
Que pour mieux percer la bergère
Par laquelle il revoit le jour.
L'indiscret vole à tire-d'aile
Annoncer sa victoire aux Dieux,
L'Innocence voit qu'elle est belle,
Elle a déjà de nouveaux yeux,
(p. 122) Elle convoite l'art de plaire,
Dans l'onde veut se rajeunir,
Et meurt en disant sans mystère:
Je meurs du moins dans le plaisir.
13 mai. Après-midi, nous trouvons les vents alizés; ils soufflent du
nord-est pendant les deux tiers et demi de l'année. Les premiers qui
allèrent au Nouveau-Monde avec Christophe Colomb, poussés comme malgré
eux vers une terre qu'ils cherchoient en ne faisant que la soupçonner,
ayant gagné ces vents, les nommèrent alizés ou attracteurs, parce
qu'ils ne leur permettoient plus de s'égarer et les attiroient à leur
but. Nous trouvons les grains blancs; ce sont des nuages blanchâtres
que deux vents opposés amoncellent sur ces mers tranquilles. Les
tempêtes, aussi dangereuses que sur nos côtes, sont moins prévoyables;
le pilote qui les brave, sombre très-souvent.
14 Mai (25 floréal.) Les Alizés nous favorisent au-delà de notre
attente; le ciel est grisâtre et le vent très-fort, souffle du
Nord-Est. Nous filons 9 N.... La chaleur est aussi supportable qu'en
France, dans les premiers jours d'un beau mois de mai, quand le zéphyr
rafraîchit nos campagnes.
À la nuit, toutes les voiles sont carguées, et (p. 123) les lames
s'élèvent encore jusques sur le pont; on ferme les sabords.
Depuis la chute du jour, les vents sont si violents, qu'ils enlèvent
la frégate, qui retombe dans l'onde avec un bruit sourd. À dix heures
et demie, elle semble rouler sur les flots; les poutres de l'entrepont
crient comme si elles alloient se briser; l'onde imite le mugissement
de cent taureaux enfermés dans une étable à-demi enflammée; les cris
des officiers, des matelots, des cordages, le nombre des manœuvres,
redoublent l'effroi; une nuit obscure couvre l'horison, la mer
furieuse n'est éclairée que par la foudre, et par des flots d'écume et
des montagnes de neige, d'où scintillent des milliers de diamans, pour
éclairer les horreurs de l'abîme, aussi-tôt refermé qu'il est ouvert.
Ces violentes secousses font casser trente hamacs; trente déportés qui
couchent au-dessus, tombent sur le ventre de leurs confrères.
L'obscurité du lieu, la surprise de la chute, l'anxiété des uns à
moitié suspendus, donnent à ce tableau tout le dramati-comique. La
sentinelle, à moitié endormie à bord de la fosse aux lions, nous
prenant pour des révoltés ou des sorciers, se précipite avec sa
(p. 124) rouillarde et sa lanterne, dans la fosse aux cables, au
risque d'y mettre le feu. La tempête cesse à deux heures, nous avons
fait 60 lieues.
15 Mai. Depuis quatre heures du matin, nous filons dix nœuds et
demi. Douze jours de ce vent nous feroient mouiller à Cayenne; nous
sommes près du tropique du Cancer. À midi, un baleineau de 35 à 40
pieds de long, du poids de 4 à 5 mille, joue sur l'onde, et vient
rôder autour de la frégate.
Ce soir nos prêtres agitent la question du divorce et des nouveaux
mariages.
Le divorce est le plus grand fléau de la société, dont il rompt les
liens. En vain se récrie-t-on sur l'incompatibilité des humeurs; les
plus forts ont fait l'indissolubilité du mariage, disoient les
femmes, au commencement de la révolution. Aujourd'hui qu'elles ont
goûté du divorce, le remède leur paroît pire que le mal. Elles font
les plus vives instances pour l'abolition de cette loi; l'expérience
en démontre mieux le danger que les plus beaux raisonnemens. Tout le
monde est d'accord sur cette proposition, mais quelques vieux
bénéficiers, plus heureux jadis que le soudan dans son sérail,
(p. 125) et plus rigoristes que les autres, prétendent que la
séparation est un crime équivalent au divorce. Ces casuistes ont sucé
la doctrine des grands inquisiteurs d'Espagne, chez qui ils se sont
rélégués jusqu'à la loi du 7 fructidor an 5 (4 août 1797), qui les
rappeloit en France. On rit de ce cagotisme. Un orateur observe que
cette matière est si épineuse, qu'il est des cas où l'on doit presque
passer sur l'indissolubilité du mariage; grands murmures. Il cite le
trait suivant, à l'appui de sa proposition:
Femme dans le tombeau, exhumée, ressuscitée, épousée par
son amant, et retrouvée par son mari.
Per cahos hos ingens vastique silentia regni,
Euridices oro propiora relexite fata.
Ovid. de Orpheo.
Hélas! vous me l'avez ravie
Au premier beau jour de sa vie.
Dieux du cahos, sombres horreurs,
Rendez Euridice à mes pleurs.
Qui ne connoît pas le pouvoir de l'amour, ne connoît pas son
existence. Son souffle fait fondre les glaces de la vieillesse......
Il rajeunit la nature entière. Sans puiser dans la fable le trait
d'Ariane, ou des enchantemens (p. 126) de Médée, je connois d'après
mon cœur, la magie de ce Dieu. Si la Parque eût été sensible à mes
larmes, elle eût renoué les jours d'Ismène Dorvigny comme Laurenci
renoua ceux de la belle Dumaniant.
Laurenci et Louise Dumaniant étoient fils de deux riches marchands de
la rue Saint-Honoré de Paris. Ils étoient voisins, ils étoient jeunes,
ils s'aimoient, on projettoit de les marier ensemble. Un contrôleur
des fermes, veuf, sans enfans, et qui couroit après sa cinquantaine,
voit en passant Louise dans son comptoir. Il arrête sa voiture,
descend, fait des achats considérables, étale des louis, et demande au
père en sortant, si sa fille n'est promise à personne. Quand on est
riche, puissant et un peu vieux, on consulte plutôt les parens que la
fille. Le contrôleur part, et promet de revenir le lendemain.
Il tient parole, on prend des arrangemens secrets; le mariage est
conclu par la famille, sans que Louise en sache rien. Laurenci vient à
la maison, où on le prévient de ne plus compter sur sa chère
Dumaniant; on signifie le même arrêt à sa famille. Louise, innocente
de ce stratagème, écrivant à son ami (p. 127) pour lui reprocher son
indifférence, apprend par sa réponse qu'il a été congédié, parce
qu'elle va devenir madame la contrôleuse générale; Louise jette les
hauts cris, on l'enferme, on la menace du couvent. Laurenci, ne
recevant point de réponse à sa lettre secrète, accuse Louise
d'inconstance. Pour la punir, il s'éloigne par foucade, lui écrit
qu'elle est libre, qu'il lui rend son cœur, et autres choses que
l'on ne fait que par dépit, sur-tout quand on aime bien. Les parens de
Louise, enchantés de ce billet, feignent à leur tour de lui rendre la
liberté du choix. Le financier est un homme aimable; du moment qu'il
est assuré de la parole du père, il ne veut plus forcer l'inclination
de la fille. On choisit ce moment pour lui remettre le billet de
Laurenci. On aide à la lettre, en ajoutant devant le financier, que
celui qu'elle aime s'est absenté pour une maîtresse qu'on ne lui
connoissoit pas; on va même jusqu'à supposer une lettre des parens de
Laurenci, qui précède celle de M. Dumaniant, à qui l'on donne à
entendre que Laurenci a disposé de son cœur, en faveur d'une autre.
D'abord, Louise refuse de croire à ces (p. 128) lettres; elle
soupçonne qu'elles sont supposées; elle se souvient des mauvais
traitemens qu'elle vient d'essuyer, pour avoir refusé la main du
Mondor. Si elle est libre, se dit-elle, c'est que son riche amant a
signifié qu'il ne vouloit pas l'obtenir malgré elle. M. le contrôleur,
qui faisoit jouer cette comédie, s'étonne qu'on ne lui ait pas déclaré
que son amie avoit fait un choix; il veut se retirer. Louise dans ce
moment le retient par pure politesse ... Ah! petite Louise, pour être
un peu plus franche, sois un peu moins polie. Un sentiment d'ambition,
mêlé d'un petit mouvement de vengeance et de jalousie de voir Laurenci
absent, rend Louise sensible aux propositions de la fortune;
d'ailleurs son nouvel amant est généreux, aimable, sans être par trop
vieux. Elle donne une parole ... que l'amour est prêt de retirer..
n'importe, elle est reçue. On profite de l'absence de Laurenci, pour
conclure le mariage; la voilà madame la contrôleuse.
Laurenci revient; une fée a tout changé depuis son absence; il ne
retrouve ni Louise, ni ses parens. Mr. le contrôleur a fait fermer la
boutique, pour donner à son beau-père un emploi conséquent, qui doit
faire oublier que (p. 129) son épouse n'est que la fille d'un
marchand. «Elle ne m'appartiendra donc jamais! s'écria-t-il! Elle est
mariée, elle est riche! Ô fortune, aveugle déesse, tu feras le malheur
de ma vie..! Je veux la revoir, je veux.... Elle riroit de mes larmes
... La perfide a oublié la parole qu'elle m'a donnée tant de fois ...
quand un sommeil léthargique la mit si près du tombeau, parce que son
père vouloit s'opposer à notre hymen.. lorsqu'elle me baignoit de
larmes ... me trouvant au chevet de son lit, plus désolé que ses
parens. C'étoit une feinte!... Je ne lui ai donc sauvé la vie que pour
qu'elle me donnât la mort!.. Quand ses parens, aveuglés par la
douleur, avoient déserté sa chambre ... que son corps froid et
presqu'inanimé n'avoit aucun mouvement.. le miroir que l'amour
m'inspira de saisir, pour l'appliquer sur ses lèvres, fut donc terni
du souffle du parjure! Dussé-je expirer de dépit, dût-elle rire de mes
larmes, je veux lui rappeler ses sermens ... Je veux qu'elle se
souvienne qu'elle me doit la vie; je veux la voir, je veux lui
arracher des pleurs, en répandre ... et périr.» Il sort sans
consulter personne, va à l'hôtel, (p. 130) demande à parler à madame
... Il est dix heures, il ne fait pas encore jour chez madame. Il
insiste; elle fait annoncer qu'elle est indisposée, et lui envoie un
billet, par une confidente qu'elle a déjà choisie. Le mari étoit
soupçonneux sans être jaloux; il falloit prendre des précautions.
Louise avoit des joyaux, de beaux habits, des dentelles, des voitures,
des valets, des admirateurs, des envieux, mais pas un ami, pas un
moment où elle pût être seule; le contrôleur avoit mis des Argus à sa
suite. Le lendemain elle se rend chez Laurenci ... et apprend un peu
tard, combien on l'a trompée. Elle versoit des larmes amères, et
donnoit un baiser à ce malheureux amant, qui l'avoit reçue en présence
de ses parens. Les cœurs honnêtes en amour ne cherchent pas la
solitude. Le contrôleur arrive ... Louise lui dit d'un ton ferme: Je
suis bien aise que tu sois témoin de cette scène; si je pouvois
oublier les premières impressions de l'amour, je pourrois cesser de
t'aimer.—Sortons, madame ... je ne veux pas de ces sentimens
romanesques dont le dénouement est toujours au désavantage des maris
comme moi. Louise obéit, et tomba dès ce jour dans un chagrin qui
décolora (p. 131) ses joues, altéra sa santé, et la conduisit
peu-à-peu au tombeau. Toujours seule, et livrée à elle-même, elle
déplora son sort, invoqua la médiocrité, et fut si affectée de la
perte de Laurenci, qu'au bout de six mois, on la trouva étendue, sans
respiration, sans mouvement, et conséquemment sans vie. Son mari, ne
voyant plus en elle qu'une femme mélancolique, ne lui rendoit que
très-rarement quelques visites de bienséance. Il se dédommageoit
ailleurs, comme c'est la coutume des grands. Sa femme meurt, on fait
un grand deuil, un grand convoi; la défunte va reposer dans le caveau
de la chapelle où sont les ayeux de son mari. Le plus triste des
assistans, c'est Laurenci: «Hélas, si je pouvois encore la rendre à la
vie! Et peut-être l'aurois-je fait, si j'eusse été près d'elle, comme
dans le moment où elle tomba dans un sommeil semblable à celui de la
mort.... Aujourd'hui, il est trop tard ... il est trop tard ...! Je
l'ai perdue.... pour jamais, pour jamais ... Oh! je voudrois baigner
son cercueil de mes larmes ... Elle est morte de douleur d'avoir été
trompée..! Je n'ai pas eu son dernier soupir ... Je n'ai pu lui
donner de (p. 132) secours ... Je n'ai pu la voir ... Depuis six mois
elle étoit seule, prisonnière au milieu des grandeurs. Elle
m'appeloit, des sbires secondoient son tyran.... Aujourd'hui.... Elle
a disparu pour jamais ...»—En prononçant ces mots, il étoit attaché à
la grille de la chapelle; le soir le surprend..... Au moment de fermer
l'église, il sort comme d'un profond sommeil, et résout, à quelque
prix que ce soit, de descendre dans le caveau, dont il ne peut
détourner les yeux. Il entend le Suisse, armé de sa hallebarde, qui
fait sa ronde; il se laisse éconduire, et lui fait part de son projet.
La chose est si facile que ce seroit une folie de refuser douze louis,
qu'on offre pour une heure d'entretien avec une défunte. Le Suisse lui
prête sa lanterne, et Laurenci descend. L'amour, couvert d'un crêpe,
en lui donnant la main, avoit dissipé les fantômes de la nuit. Il
approche du cercueil, adresse des prières à l'amour et à la
divinité.—«Les pleurs qui coulent de mes yeux, dit-il, ne mouillent
que la prison où elle repose ... Je suis si près d'elle, et je ne puis
entendre sa voix ... Elle est toute entière dans cette tombe, et
c'est pour s'évanouir en (p. 133) poussière, pour disparoître à ma vue
et à mon toucher; c'est pour recomposer une parcelle des quatre
élémens, qui minent et reproduisent sans cesse leur ouvrage! Elle est
peut-être déjà défigurée, peut-être aurois-je peine à la reconnoître
... Dans quelqu'état qu'elle soit, je baiserai son linceul. Ah, si la
mort siège, ou sur ses yeux, ou sur ses lèvres, je veux l'aspirer, je
veux qu'elle m'enferme dans la même bière.» Il saisit son couteau,
lève les planches du cercueil, le découvre, arrache les linges, les
baise[11], découvre la figure de Louise ... «Est-ce un songe? dit-il.
Elle respire ... Non, je ne me trompe pas ...» Il la saisit,
l'embrasse, l'appelle ... se relève, sent palpiter son cœur; va,
revient cent fois à l'escalier du caveau. Le grand air (p. 134)
précipite son réveil, elle entr'ouvre les yeux, aspire ... «Je n'en
puis plus douter, dit Laurenci ... Ô Dieu ... Je la revois ... Mais
... remontons.» Il remet les planches du cercueil; Louise étoit si
foible, qu'elle n'avoit encore reconnu, ni son amant, ni le lieu où
elle étoit. Il remonte, les larmes aux yeux, et achète au Suisse le
corps de Louise. «Elle étoit ma maîtresse, lui dit-il, je veux avoir
ses restes précieux ...» Le marché conclu, à huis-clos, Laurenci court
chercher un vieux domestique qui l'a élevé, lui confie son secret. Le
Suisse attend le porteur. Quelle surprise pour Louise! Son amant avec
elle!.. Dans un tombeau! Une bière pour lit, des cadavres, rangés çà
et là; quel horrible et délicieux réveil! «Quoi! je suis inhumée!
dit-elle; je me suis endormie hier, aujourd'hui me voilà enterrée ...
Laurenci auprès de moi!.. Est-ce un songe?..—Hâtons-nous, dit
l'amant, mon bon vieux Jacques et moi allons vous emporter chez lui
... Le temps presse ...» Ils emportent Louise jusqu'à la porte d'un
hôtel voisin; une remise les conduit. Le Suisse, en recevant
vingt-cinq louis, engage Laurenci au secret. Il étoit loin de
soupçonner qu'elle (p. 135) fût ressuscitée, car elle avoit consenti à
faire la morte, jusqu'au lieu convenu.
—«Oh! pour cette fois, dit Louise, je suis à toi, mon cher Laurenci
... Le cruel m'épousa pour mes attraits ... Je n'ai plus rien à
t'offrir, tu ne vois plus qu'un squelette ... Je ne suis que l'ombre
de Louise Dumaniant..... Je te dois la vie; si tu m'aimes, je suis
encore au printemps de mon âge; tu me rendras ces charmes qui ne se
sont flétris qu'en songeant à toi..» Après les reproches, que l'amour
et l'amitié font toujours, Laurenci prend sa dot, sans rien dire à ses
parens de la résurrection de Louise, part pour l'Angleterre, avec elle
le vieux Jacques; ils se marient, ont deux enfans, et reviennent à
Paris, au bout de trois ans. Laurenci, en retournant chez son père,
voulut en vain lui persuader que Louise Dumaniant étoit une Anglaise,
il reconnut madame la contrôleuse, voulut apprendre son histoire, et
promit le secret à son fils. Elle étoit si belle avant son premier
mariage, qu'elle avoit fixé l'attention de plus d'un voisin. Toutes
les connoissances de Laurenci ne faisoient l'éloge de son épouse,
qu'en l'assurant (p. 136) qu'elle ressembloit parfaitement à Louise
Dumaniant ... La nouvelle de sa mort étoit si bien confirmée, qu'elle
ne craignoit pas d'être reconnue, quoiqu'elle sût que le contrôleur
vivoit encore.
Elle avoit été enlevée du tombeau avec célérité; libre, inconnue à sa
famille, à qui elle se garda de rendre visite, elle éprouvoit une joie
secrète de revoir les lieux où, sans la reconnoître, on la comparoit à
elle-même. Jusqu'à ce moment, elle n'avoit pas encore rencontré son
premier mari. Passant un jour dans le quartier où son convoi l'avoit
conduite à l'église, un monsieur qui lui donnoit la main, la fit
entrer pour lire le cénotaphe de celle à qui elle ressembloit. C'étoit
dans une chapelle, près du maître-autel. Elle approche, voit son père
à genoux, les yeux baignés de larmes, qui prioit pour elle ... Ce bon
vieillard, les mains jointes, les yeux au ciel, se croyant seul,
disoit: «Ô mon Dieu! pardonnez-moi cet hymen forcé ... Je l'ai rendue
malheureuse, car j'ai creusé son tombeau pour satisfaire mon ambition.
Innocente victime, modèle de candeur, d'obéissance et de beauté, tu
reposes dans le sein de l'Éternel.... (p. 137) invoque-le pour ton
père, plus aveugle que méchant.» Louise, satisfaite, lit son épitaphe,
puis, fixe son père, qui ne se détourne pas. Au même instant le
contrôleur, précédé du Suisse qui a reçu 20 louis pour la laisser
enlever, conduit un de ses amis, pour voir le superbe mausolée de J.
C., qui forme le chœur d'une des plus belles églises de Paris.
Passant auprès de la chapelle, il dit d'un ton étouffé: C'est là que
repose mon épouse, la belle Louise Dumaniant, dont je t'ai parlé tant
de fois. À ces mots, M. Dumaniant se lève, salue son gendre, et fixe
la jeune dame, qui feint de lire différentes inscriptions, pour que
son embarras ne la trahisse point. Heureusement que Laurenci est
absent. «Ah! dit M. Dumaniant, que je voudrois bien connoître
l'honnête homme, dont la fille ressemble si bien à la mienne!» Après
un moment d'examen.. «Mais, c'est elle.. Mon gendre.. Que dis-je? Elle
est dans ce fatal caveau ...» Pendant qu'un torrent de larmes mouille
ses cheveux blancs, son premier mari, M. le contrôleur, lui fait un
grand salut, la fixe ... «Madame ... (à son ami, pendant qu'elle se
retourne); mais c'est elle, trait pour trait, (p. 138) c'est
elle.—Madame est-elle françoise?—M., j'arrive d'Angleterre, mon pays
natal.»—Le contrôleur, la fixant toujours, à son ami ... «C'est le
son de sa voix, sa taille, ses gestes, ses traits; c'est ma femme....
Oui, madame, voilà votre père et votre époux... M. Dumaniant
s'approche de plus près:—Oui c'est ma fille, c'est ma Louise ... Je
ne puis le croire et ne puis en douter.... Ma fille!... Ah! tire-moi
d'inquiétude.. Ô Dieu.....» Le contrôleur.—Madame n'auroit-elle point
été élevée en France?—Je suis surprise de toutes ces
questions.—Sortons, monsieur, dit-elle à son cavalier, je suis
Anglaise ... et ne puis m'empêcher de rire de ce nouveau genre de
galanterie française.»
M. Dumaniant.—«Madame, vous avez les yeux bien fixes sur cette
chapelle, elle vous rappelle sans doute des souvenirs inexplicables,
et à nous, une peine que vous pouvez alléger ...»
—«Depuis mon arrivée d'Angleterre, voilà bien la première fois que je
viens ici ... et je n'ai jamais eu pareille scène ... Messieurs, je
suis épouse et mère, je suis étrangère, je suis enchantée de votre
méprise, et je ne (p. 139) conçois rien à votre entêtement ... Qui
voulez-vous que je sois?»
Le contrôleur et le père.—«Celle dont vous lisiez l'épitaphe, quand
nous sommes arrivés..»
—«Quoi! elle est morte et enterrée depuis quatre ans, son époux lui a
fait mettre cette belle inscription; et moi je suis cette personne..!
Oh! les Anglais ont raison de dire que les Français sont fous.» À ces
mots elle s'éloigne, monte dans un vis-à-vis, rentre chez elle, conte
cette scène à Laurenci qui s'en amuse, d'autant mieux que personne ne
connoît son secret que son père, car le vieux Jacques est mort, en
revenant dans sa patrie.
Cependant M. le contrôleur a fait suivre la voiture; il sait qu'elle
s'est arrêtée à la porte de Laurenci. Il envoie des espions dans le
quartier, pour en apprendre plus long. S'il pouvoit s'assurer si
Louise est encore dans sa bière, il ne feroit pas tant de recherches;
mais, depuis quatre ans.. elle est en cendre.. Mais, son cercueil
existe..... Descendons dans le caveau. Il suit cette idée folle....
trouve la bière déclouée ... et ne doute plus (p. 140) que sa femme
n'ait été enlevée ... Il ignore comment.. N'importe.. Le ravisseur
s'est décelé. Instances, promesses, argent, sont employés auprès du
Suisse, qui pourroit savoir quelque chose de ce mystère ... Les
émissaires reviennent annoncer que Laurenci est arrivé d'Angleterre,
depuis un mois, avec une jeune personne qu'il dit être de Londres,
avec qui il s'est marié, et dont il a deux enfans; qu'il est parti un
mois après la mort de madame la contrôleuse ...; que, le jour de son
enterrement, il assista au convoi..; qu'il resta le dernier à pleurer,
appuyé sur les grilles de la chapelle, et abîmé de douleur; une de ses
voisines a fait cette remarque ... Depuis ce moment, il avoit disparu
jusqu'à son retour.. Le rusé contrôleur fit aussi-tôt venir le Suisse;
se servant des notes qu'il avoit reçues, y mit un commentaire de cent
louis, et apprit que, pour 25 louis, il avoit permis à un jeune homme,
qui s'étoit dit l'amant de madame la contrôleuse, d'abord, de la voir,
puis d'emporter son corps, dont il vouloit, dit-il, faire une momie;
qu'un vieux domestique l'avoit aidé, et que ce rapt avoit été fait la
nuit du jour qu'elle avoit été enterrée. M. Dumaniant (p. 141) vint à
l'appui des preuves, en annonçant que Laurenci avoit sauvé sa fille,
une fois qu'elle étoit tombée en léthargie, à la suite d'une
mélancolie.
Il n'en fallut pas davantage au contrôleur. Dès le lendemain, il va
chez Laurenci, y trouve Louise, rend compte des renseignemens qu'il
s'est procurés, réclame sa femme, et s'oublie jusqu'à menacer de son
crédit....—«Votre crédit, monsieur, peut faire incliner la balance
de l'injustice. Mais, est-ce avec de l'or que je l'ai rappelée à la
vie? Vous lui avez payé de somptueuses funérailles, et moi, j'ai tout
sacrifié pour l'arracher du tombeau; que n'employiez-vous votre crédit
pour lui rendre la vie ... Vous réclamez votre femme?.. Prenez-la, j'y
consens, à condition que vous userez de votre crédit pour me payer ce
que vous lui devez; et quand votre fortune pourroit vous rendre les
droits que vous avez enfermés avec elle dans la poussière des
tombeaux, n'auroit-elle aucune dette personnelle envers moi? Il faudra
qu'elle repousse de son sein ces deux enfans, dont le père est son
sauveur, son amant et son époux! Il faudra qu'elle (p. 142) foule aux
pieds les sentimens les plus tendres. Si elle peut les étouffer,
reprenez-la, monsieur, pour le supplice de vos vieux jours ... Votre
hymen fut conclu par surprise, elle y donna un consentement forcé, le
mien est le sceau de l'amour et de la reconnoissance; elle a auprès de
moi le double titre d'épouse et de mère; elle vous doit la mort, elle
me doit la vie...»
—«Oui, monsieur, dit Louise, je suis celle que vous soupçonnez; je
vous appartins avant mon trépas, l'empire de l'hymen ne s'étend pas
au-delà du tombeau. Montrez-moi les gages de notre union, montrez-moi
nos enfans, leurs cris me feront balancer entre vous et Laurenci.
Mais, voilà les gages de ma nouvelle existence ... Je ne me souviens
de ma vie que depuis quatre ans. À cette époque, je ne connoissois
qu'un tombeau.» Le contrôleur se retire, fait ébruiter cette affaire;
la Sorbonne et la justice s'en saisissent. Laurenci, ne connoissant le
droit français que d'après son cœur, comptoit gagner sa cause sans
difficulté.
Le parlement, indécis, penchoit presque (p. 143) pour lui, par égard
pour ses deux enfans, qui ne devoient pas être bâtards. Mais les deux
amans avoient contracté ce second hymen, avec connoissance de cause;
cette décision entraînoit des suites dangereuses. D'un autre côté, le
contrôleur n'avoit point eu d'enfans avec Louise Dumaniant; elle ne
vouloit plus le reconnoître pour son époux; elle l'avoit pris malgré
elle, et par surprise; elle avoit le droit de se séparer. La Sorbonne
trancha la difficulté, par ce texte du code sacré: Quod conjunxit
Deus, homo non separet ... «Que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu
a uni.»
Les deux amans n'avoient pas attendu cette décision ... Ils étoient
retournés à Londres, où ils restèrent jusqu'à la mort du contrôleur,
qui décéda six mois après. Ils revinrent en France, firent légitimer
leurs enfans et leur union, et vécurent en paix.
L'orateur prétendit que cet événement devoit être rangé au nombre des
cas imprévus, ou plutôt imprévoyables; qu'il confirmoit la régle, en y
faisant exception; que le parlement et la Sorbonne pouvoient faire ici
une exception particulière à la loi. Mais cette (p. 144) question
nous mèneroit trop loin, et le sablier vient d'être retourné pour la
douzième fois, depuis le coucher du soleil.
Quatrième soirée.
20 mai.—Passage du Tropique.—Ce matin à trois heures nous avons
passé le Tropique; j'en dirai un mot.
Les marins s'assemblent au moment où l'officier de quart annonce ce
passage: si c'est pendant la nuit, on se porte en foule au lit des
passagers qu'on réveille et qu'on fait monter sur le gaillard. Le plus
vieux, plus ivrogne et plus rusé des matelots monte à la grande hune,
s'affuble d'une couverture, entend du bruit, et comme dieu des mers de
ces parages, veut reconnoître son monde avant de le laisser passer; il
s'écrie d'une voix caduque: «Qui vient ici? Il y a long-tems que je
n'ai vu personne; approchez, mes amis, que nous fassions connoissance
et que je vous régénère.» À ces mots, le bonhomme Tropique descend à
la première hune dans la chambre de son maître des cérémonies, demande
aux voyageurs où ils vont, d'où ils viennent, s'ils ont des malades à
bord; (p. 145) il fait chaud dans mon empire, ajoute-t-il; faites
rafraîchir ces messieurs.» Il tombe à chaque passager une voie d'eau
sur la tête. Pendant que tout le monde rit aux éclats, le bonhomme
Tropique s'assied majestueusement pour débiter sa harangue, que l'on
écoute dans le plus grand silence. «Vous êtes purs maintenant, et
dignes d'être avec mon peuple; vos aïeux sont venus autrefois
régénérer les rustiques habitans de la zone torride. Nous avions des
trésors qui leur ont fait envie; ils nous les ont pris pour de l'eau
bénite et des crucifix. Aujourd'hui, nous vous rendons le change, et
vous nous devez des dragées.» Chaque baptisé paie l'amende avec un
rire forcé: cette contrainte est l'image des horreurs commises dans le
Pérou, où le soleil de Cusco éclaire à regret le tombeau des Incas et
celui de deux millions d'indiens égorgés par les européens.
Nous allons donc habiter ce climat brûlant, dont parle Virgile, quand
il nous décrit le globe céleste et terrestre, divisé en cinq
bandelettes, au milieu desquelles est la route que le soleil ne
quitte jamais, et d'où il échauffe (p. 146) tour-à-tour dans ses
sinuosités les deux zones froides et tempérées.
Sous la ligne, les jours sont égaux et de douze heures; les nuits sont
froides, les pluies durent cinq ou six mois: ce tems appelé hivernage,
est celui de la plus belle végétation. Dans les courts intervalles que
le soleil perce les nuages, il fait sentir que cette zone, quoique
bien rafraîchie, est toujours un chemin de feu. L'été dure à
proportion; on s'apperçoit bien alors que Virgile a raison de nommer
ce pays volcan éternel[12].
Comme je n'ai ni traduction ni original, que je vais loin des climats
qui ont vu naître Segrais, le Batteux et M. l'abbé Delille, je
rassemble et traduis comme je peux ce beau morceau du premier livre
des Géorgiques, que M. Bucher m'expliqua jadis avec tant de goût, que
je ne l'oublierai jamais. Ce passage donnera au lecteur une agréable
teinture de géographie nécessaire pour la suite de cet ouvrage:
De ses douze palais, éclairant l'univers
L'astre du jour revoit tous les peuples divers;
Des cinq routes qu'on trace à son char de lumière,
À celle du milieu se borne sa carrière.
C'est un chemin de feu qu'il embrâse toujours.
Les deux autres climats les plus loin de son cours,
Sont formés de rochers de glace amoncelée,
De brume, de frimat, de neige congelée.
Près du chemin brûlant et de ceux des hivers,
Deux climats tempérés, aux mortels sont ouverts.
L'axe s'élève à pic vers la froide Scythie,
S'applatit dans les champs de l'aride Libye.
Notre sommet du globe est au séjour des Dieux,
Et l'autre sous nos pieds au manoir ténébreux.
Un énorme dragon franchit cet intervalle,
En replis tortueux, de sa gueule infernale,
Il pompe les deux ours qui bravant sa fureur
Se cramponnent d'effroi quand Neptune vengeur,
Ou relève ou suspend sur leur axe opposé
Les énormes replis de son front courroucé.
L'hémisphère à nos pieds où Minos nous appelle,
Est, dit-on, le manoir de la nuit éternelle,
Où le jour qui nous fuit renaît dans ces climats:
L'étoile du berger sur des monts incarnats,
Le remplace à son tour quand sa foible lumière,
De l'Orient pourpré nous franchit la barrière.
Par ces détours réglés sur les ailes du tems,
On prédit les beaux jours, les calmes, les autans;
L'heure de confier des dépôts à la terre,
Celle de les reprendre à cette tributaire.
Sur le front de Thétis, et serein et trompeur,
Le marin lit le sort de l'avide armateur;
Il sait s'il doit voguer ou rester dans la rade,
Si le sapin attend la hache.......
Dans l'étude des cieux nous lisons les saisons,
L'astronome est un œil qui veille à nos moissons.
(p. 147) Le tropique et la ligne sont les endroits les plus dangereux
quand le soleil en est près; (p. 148) nos marins qui ont fréquenté ces
parages, nous disent qu'il y a quatre ans ils restèrent en panne
pendant un mois à l'endroit où nous sommes; ils étoient accompagnés
d'un suédois qui perdit la moitié de son monde par la peste et faute
d'eau, eux-mêmes étoient (p. 149) rationnés à un quart par jour. Le
suédois venoit à leur bord au moment où la brise se leva; ils
appareillèrent et ne savent pas ce qu'il est devenu. Ces accidens sont
très-ordinaires: les calmes, les chaleurs excessives, la faim, la
soif, le scorbut, la dyssenterie, la peste, les fièvres chaudes,
putrides et malignes, sont les fléaux de la zone torride. Dieu ne veut
pas que nous y périssions. Nous filons 8, 9 et 11 nœuds; le soleil
a peine à percer la brume. À midi, les nuages s'élèvent, le vent
mollit un peu; on met des tentes pour rappeler l'ombre qui disparoît
tout-à-fait, afin que le zéphyr qui caresse toujours l'onde, allège le
poids du jour, et émousse les traits de lumière et de chaleur qui nous
éblouissent et nous étouffent.
Nous voilà engagés maintenant dans la route de Christophe Colomb, et
nous ne pourrions presque plus nous empêcher d'aller visiter les
mortels du Nouveau-Monde. La découverte de ce continent nous a-t-elle
été plus profitable que nuisible? Qu'avons-nous gagné en arrivant à
Saint-Domingue, au Mexique et au Pérou? Que n'avons-nous pas perdu
dans nos trajets, dans nos déportations? L'Espagne, le (p. 150)
Portugal, Venise et les pays voisins ou conquérans des deux Indes se
sont abâtardis pour satisfaire leur cupidité. L'oisiveté, apanage des
grands propriétaires, est un vice utile dans un grand empire pour
alimenter l'ambition et l'industrie indigente, et devient un germe
destructeur de l'état qui compte plus de riches oisifs que de pauvres
industrieux. Les espagnols ont d'abord déporté dans les îles les
voleurs et les sujets qui ne plaisoient point à l'inquisition; la
fortune brillante que conquirent ces proscrits en fit émigrer
d'autres. Ainsi l'Espagne en se dépeuplant, négligea ses terres pour
aller planter du cacao, du café, de l'indigo au fond de la Jamaïque,
de la Guyane et du Pérou; elle ferma jusqu'à ses mines d'argent pour
s'inhumer au sein de la foudre dans les abîmes d'or de Lima. Si la
vieille fable des trésors soupçonnés à Cayenne est accréditée de
nouveau par un autre Walter Raleig, le lieu de notre exil sera plus
fréquenté que Paris, car les frères et amis se vendroient pour le
plus petit lingot d'or. Laissons-les tranquilles, et contemplons
l'atmosphère en goûtant le plaisir d'une belle navigation.
Après-midi, tems extrêmement (p. 151) doux et favorable, nous filons
dix nœuds et demi. Plus le soleil baisse, plus la brise a de force.
En Europe, dans les beaux jours d'été, quand un ciel d'azur laisse la
force au soleil de pomper les exhalaisons de la terre, les physiciens
assurent que l'atmosphère est plus chargée que dans un jour nébuleux.
Ils n'auroient pas besoin de tant de raisonnemens pour démontrer cette
vérité à leurs élèves, s'ils venoient faire leurs expériences dans les
parages voisins de la ligne sur un élément qui donne à l'observateur
un climat mitoyen entre les zones tempérées et torrides.
Depuis hier, le soleil est presque à pic sur nos têtes: quelques
européens s'imaginent que nous devons être rôtis; mais la main qui a
arrangé l'univers a pourvu à tout. Voici comme elle opère:
Le soleil dilate les ondes qui imprégnent l'air de nitre; les parties
aqueuses les plus légères s'élèvent dans une région supérieure,
forment un brouillard, compriment l'air intermédiaire entr'elles et la
mer; par leur pression font souffler les vents que nous nommons
zéphyrs en France, parce qu'ils viennent du midi, et brise dans les
pays chauds, parce (p. 152) qu'ils viennent du N. E. C'est ce que nous
observâmes le 20 mai après-midi, en prenant le frais sur les
porte-haubans.
Un vent très-fort soulevoit les flots; le ciel étoit chargé d'une
brume épaisse et blanchâtre; le soleil ne donnoit qu'une lumière pâle;
l'horison eût été d'azur si nous n'eussions pas été sur un élément qui
renouveloit sans cesse ces parties qui sur la terre se seroient
enlevées; la chaleur à demi-concentrée dans notre région n'ôtoit rien
au zéphyr de sa fraîcheur et de sa force. Nous nous trouvions donc
dans une atmosphère mitoyenne. Si dans ce moment ont eût consulté le
baromètre, la pression de l'air de haut en bas eût été beaucoup moins
sensible, et le mercure eût remonté comme après un orage, d'où il faut
conclure que l'air qui borde notre horison est beaucoup plus chargé
quand le ciel est d'azur que dans le moment où il se couvre de nuages;
l'eau s'élevant dans une région supérieure, enlève les vapeurs,
purifie l'air, lui rend sa pression et son élasticité, tandis qu'il
perd de sa force quand il est mélangé avec le brouillard; quoique le
ciel nous paroisse alors plus beau, le plombé de l'air nous est
démontré le matin (p. 153) par les vapeurs, qui en couronnant
l'horison pourpré, nous laissent voir le plus beau firmament.
22 mai. Ce matin, une brume épaisse nous dérobe les îles du cap
Verd; après-midi, les brisans nous attirent sur la pointe des rochers
qui les entourent. Nous filons au milieu sans accident et non sans
danger; ces îles appartiennent aux portugais: si elles étoient
gardées, nous serions pris sans pouvoir nous défendre; mais les
possesseurs les abandonnent à quelques blancs expatriés et à des
mulâtres affranchis. La religion catholique y est la seule connue et
professée par un évêque blanc et quelques prêtres nègres. Le terroir,
assez fertile et mal-sain, produit de l'indigo, des cannes à sucre et
du coton. Il n'y pleut quelquefois que tous les deux ou trois ans. On
garde l'eau dans les citernes. L'une de ces îles, nommée
Saint-Vincent, présente les restes d'un volcan qui fume encore. Ce
rocher est peuplé de serpens, de petits singes et de quelques mauvais
oiseaux de mer: les autres îles, qui sont assez étendues, nourrissent
de nombreux troupeaux de chèvres sauvages, et (p. 154) sont à 861
lieues de France, et à 100 d'Afrique, par le travers de la Nigritie.
Ce matin, nous avons pris un requin de cent livres avec son pilote,
petit poisson qui s'attache sur sa tête, le guide dans ses courses,
vit de sa substance et suit sa destinée. Le soir, la mer est couverte
à une lieue à la ronde d'un banc de poissons si serrés qu'ils peuvent
à peine nager: les plus gros sont des marsouins et des chiens de mer
qui cernent des bonites; celles-ci en sautant à plusieurs pieds en
l'air pour se sauver des gueules béantes des requins, attrapent
quelques poissons volans dont elles sont friandes. Nous sommes à 30
lieues des îles.
Du 24 au 29 mai. Quel spectacle ravissant que celui d'une belle nuit
sur mer! quand les cieux se réfléchissent dans l'onde, que le bâtiment
vogue à pleines voiles et sans danger, que la lune éclairant un
immense horison paroît sortir du cristal des eaux, que les vagues
coupent son disque; tout repose dans la nature, excepté ce monstre qui
n'est jamais rassasié, qu'on appelle requin: d'un côté, les matelots
oisifs lui jettent un fer pointu caché (p. 155) d'un morceau de
viande; il s'élance, se retourne sur le dos, l'engueule avidement, se
sent pris, est hissé à bord, et fait trembler de ses coups de queue le
tillac qui le reçoit; de l'autre, le pilote consulte sa carte, sa
boussole et son sablier. Ses timoniers attentifs tournent plus ou
moins la roue du gouvernail; il paroît commander à la mer: la frégate
avance majestueusement, portée sur un lit de neige et de diamans, et
le spectateur, dans un doux recueillement, promène ses regards dans
l'horison à dix lieues à la ronde. Belle nuit, tu me rappèles celle
que je goûtai en 1794, à pareil jour, en sortant du tribunal
révolutionnaire! Je prie le lecteur de me pardonner cette digression,
c'est mon contingent de soirée.
Je fus arrêté le 1er. octobre 1793 avec messieurs Pascal,
lieutenant de gendarmerie à l'armée du Rhin, et Welter, interprète
allemand. Le premier avoit amené avec lui un officier autrichien
déserteur, que le général Custine envoyoit à la Convention pour lui
donner des instructions sur les forces de l'ennemi. La loi du 17
septembre sur les suspects et les étrangers venoit d'être
proclamée. L'autrichien (p. 156) pour s'y soustraire, obtint d'être
sous la surveillance de Pascal; il se lia avec Anacharsis Cloots, qui
lui dit que pour se mettre en crédit, il devoit faire trois ou quatre
dénonciations. Pascal donna un dîner où je me trouvai avec une
ancienne marchande de Lyon, nommée Morl13, ruinée par ses
prodigalités, qui vivoit d'intrigues et de dénonciations. Pascal,
qu'elle avoit vu élever et qui étoit du même pays, ne la connoissoit
pas sous ce rapport. La conversation roula sur les jacobins; elle en
prit la défense avec chaleur. Nous soutînmes que les choses n'iroient
bien que quand on auroit rasé leur salle. Hyerchmann, c'étoit
l'autrichien, en feignant de ne pas nous entendre, écoutoit de tout
son cœur. Les noms des meneurs du tems furent accompagnés
d'épithètes un peu profanes. Tout se calma sous le manteau de
l'amitié. Je me levai de table le premier, pour envoyer mes articles
au Journal Historique et Politique que je rédigeois alors avec M. de
la Salle. L'amie de Pascal étoit malade; Hierchmann reconduisit la
Morl13 chez elle; chemin faisant, ils complotèrent notre perte.
Le 1er. octobre, le comité révolutionnaire (p. 157) nous traîne à
la prison du Théâtre Français, ci-devant Marat; nous y restons trois
mois, pendant lesquels Hierchmann fut arrêté et conduit à
Sainte-Pélagie, et de-là au Luxembourg. Notre affaire passa au
tribunal révolutionnaire, en même tems que nous à la Conciergerie le
dernier décembre 1793.
On nous conduisit dans une vaste chambre où trois cents prévenus comme
nous de délits révolutionnaires, étoient couchés quatre à quatre sur
des paillasses enfermées de cadres en forme de tombeaux.
Le 1er. janvier 1794, il faisoit un froid cuisant; on nous fit
descendre dans la cour ceintrée d'une haie de fer; les fenêtres du
greffe du tribunal donnoient dessus.
À dix heures, Faverole et sa maîtresse montèrent au tribunal, en
descendirent à onze. Faverole en passant les mains autour de son cou,
fit signe qu'il étoit condamné à mort. Sa maîtresse le suivoit de
près, les yeux hagards, les cheveux épars, les joues rouges; elle
serra la main à plusieurs détenus en s'écriant: «Nous allons à la
mort; ces juges sont des scélérats; vous y passerez tous!» Ce jour
devoit être marqué par des scènes d'horreur. (p. 158) En me promenant
sous les vestibules, je vis différentes figures peintes avec une
liqueur brune: là étoit Montmorin, plus loin la fameuse bouquetière du
palais Royal, qui avoit mutilé son amant; au bas des figures on lisoit
ces mots: Cette figure est dessinée avec le sang des victimes
égorgées ici au 2 septembre. Pendant que je parcourois cette galerie
funèbre, nous entendons un grand tumulte à l'occasion d'un détenu
conduit à l'interrogatoire: un canonnier l'avoit abordé en lui
demandant s'il n'étoit pas Maratmaugé, du département de l'Isère; sur
sa réponse affirmative, ce canonnier l'avoit saisi à la gorge en lui
disant: «Te souviens-tu, scélérat, d'avoir fait la motion d'enduire
les prisons de matières combustibles pour brûler les détenus au
premier signal?» Maratmaugé, en descendant de l'interrogatoire, perdit
la tête; on le mit dans un petit cachot, pour le séparer des autres;
il se brisa les dents aux barreaux, se déchira les bras et mourut de
suffoquement et de désespoir. J'en tombai malade d'effroi; on me
conduisit à l'infirmerie: une odeur cadavéreuse infectoit en y
entrant; l'un avoit la figure couverte de boutons et d'ulcères, un
autre les lèvres bouffies et noires comme du charbon, (p. 159) deux
ou trois autres moribonds étoient dans le même lit. Un sale coquin,
nommé Pierre, condamné à dix ans de fers, étoit notre infirmier depuis
la mort de la reine à qui il avoit servi de valet-de-chambre. Il
faisoit sa fortune au milieu de la putréfaction; car la plupart des
malades étoient sans connoissance et soigneusement dévalisés. J'étois
au milieu des fiévreux; dans trois jours je fus avec les lépreux. Des
vers gros comme le doigt tomboient des paillasses et des cadavres
vivans, entassés jusqu'à quatre dans un lit. La nouvelle de cette
épidémie fit du bruit; Fouquier-Tainville fit construire un hospice à
l'Évêché: le mal faisoit des progrès; le travail n'étant pas achevé,
on voulut vider la Conciergerie.
Le 8 janvier, à 7 heures du soir, dix-sept fiacres vinrent nous
conduire à Bicêtre; quand nous montâmes, un peuple nombreux
remplissoit la grande cour du palais; quoiqu'il fit froid, l'odeur que
nous exhalions étoit si infecte qu'on ne pouvoit nous approcher à plus
de trente pas; en route, la neige voltigeoit sur nos lèvres noires.
Dans ce misérable état nous fûmes encore enchaînés deux à deux; quatre
ou cinq furent gelés en route; enfin, nous (p. 160) arrivâmes à
Bicêtre à 8 heures du soir. Je perdis de vue Pascal et Welter, qui
furent conduits aux Carmes, rue de Vaugirard.
À Bicêtre, nous fûmes confondus avec les plus grands scélérats, qui me
volèrent jusqu'à ma chemise; celui qui me la prit me dit qu'il en
avoit besoin pour aller à la chaîne, où il étoit condamné pour dix
ans, et que j'eusse à me taire si je ne voulois pas être assassiné
pendant la nuit: je me tus, mais je pleurai à mon aise.
On me guérit à moitié, car il falloit faire place à d'autres, mes
plaies n'étoient qu'à demi-fermées quand je montai aux cabanons; la
maison fournit de linge comme un hôpital, on me donne une chemise
élimée et trouée à l'estomac du côté gauche: cette tunique avoit servi
deux ans auparavant aux malheureux qu'on avoit égorgés dans cette
prison; les trous étoient faits par les sabres et les piques qu'on
leur avoit enfoncés dans le cœur, quand ils étoient aux cabanons et
aux infirmeries, car les malades furent les premières victimes.
J'étois seul dans mon cabanon: depuis dix jours mes plaies s'étoient
rouvertes, un sang noir mêlé de pus en découloit; la rudesse du
(p. 161) linge et du grabat, l'insalubrité des alimens, la crudité de
l'eau corrosive, avoient contribué à cette rechute; j'éprouvois des
douleurs inexprimables, toute la nuit je hurlois comme un chien, on me
donna à boire de l'absinthe et des tisanes anti-putrides; mes plaies
augmentoient toujours et mon corps étoit comme un crible; je devins
enflé, la mort faisoit chaque jour un pas vers mon lit. Le 23 mai, à
cinq heures du soir, on ouvre mon cabanon pour la première fois depuis
trois mois; un porte-clef m'annonce que je vais être transféré et
jugé.
Je me traîne en lui donnant le bras; deux gendarmes m'attendoient au
greffe, pour me conduire à pied à Paris, ils me mettoient les
menottes: «De grâce, achevez de m'ôter la vie, leur dis-je, voilà
l'état où je suis» (en leur découvrant ma poitrine et mes jambes): ils
reculèrent d'effroi, m'offrirent le bras...... Le grand air me saisit
en sortant, et je tombai évanoui sous un tilleul de l'avenue. Pendant
ce tems un des gendarmes avoit couru sur la route arrêter une voiture
de charretier; je revins à moi, mes vêtemens étoient mouillés de sang:
il me sembloit qu'on me tiroit dans tous les (p. 162) membres des
coups de fusil chargé à balles; mon sang caillé reprenoit sa
circulation. «Belle saison du printems! dis-je en traversant un
champ de pois fleuris, je goûte tes douceurs, je respire un air pur;
depuis huit mois, voilà le premier beau jour de mon existence, et
demain je ne vivrai peut-être plus.» J'arrivai à la porte de la
Conciergerie à sept heures du soir; mon cœur tressailloit de joie
et d'effroi. Je retrouvai Pascal et Welter; nous nous embrassâmes en
pleurant. À onze heures nous reçûmes nos actes d'accusation pour
monter le lendemain au tribunal.
Le matin (24 mai), pendant que nous déjeûnions entre les deux
guichets, on ouvrit l'armoire où étoient les cheveux que le bourreau
avoit coupés la veille à ceux qui avoient été à la mort. Ce lieu est
l'antichambre du trépas et de la résurrection.
À neuf heures, nous montâmes au tribunal; nous étions dix-sept pour
différentes causes; nous ne nous connoissions pas, mais c'étoit la
mode d'englober plusieurs affaires, afin, disoit-on, d'expédier les
royalistes et de libérer les patriotes.
J'occupai le fauteuil de fer; le sort étoit las (p. 163) de me
persécuter; l'état où j'étois excita la compassion des auditeurs;
Hierchmann fut amené du Luxembourg pour déposer; sa présence me fit
horreur sans me déconcerter; la femme Morl15 fut appelée de même. Par
une heureuse méprise, l'huissier avoit assigné à sa place une autre
Morl13 qui ne nous connoissoit pas, et qui fut plus effrayée que nous
de paroître devant les Euménides. Hierchmann se voyant seul, balbutia;
je me défendis de sang froid, mais Pascal perdit la tête et l'injuria;
les débats furent fermés à deux heures. À deux heures cinq minutes les
jurés revinrent des opinions. Pascal, Durand et Paulin furent appelés
les premiers pour entendre leur arrêt de mort. Le premier pour n'avoir
pas approuvé ce que faisoient les jacobins; le second pour avoir dit
du mal de Marat; le troisième, maître de langue, pour avoir été
calomnié par une sous-maîtresse de pension, qui le dénonça par
vengeance de ce qu'il n'avoit pas répondu à ses sollicitations
amoureuses. On nous appela ensuite pour nous prononcer notre liberté,
qui fut précédée d'une grande semonce.
Comme je ne pouvois me soutenir, un gendarme en me reconduisant à mon
domicile, (p. 164) m'apprit que j'avois eu cinq voix pour la mort.
L'amie de Pascal, qui ne savoit pas qu'on avoit appelé notre affaire,
étoit à dîner en face du palais au moment où il alla à la mort; elle
rentra en même tems que moi, et s'évanouit en me voyant. Ces violentes
secousses avoient aliéné ma raison. J'étois si accoutumé à être sous
les verroux, que le lendemain en m'éveillant, je me traînai à ma porte
pour voir si j'étois réellement libre. Je m'habillai à la hâte; le
grand air avoit presque refermé mes plaies; je souffrois beaucoup
moins et me traînois avec un bâton; personne n'étoit encore levé; je
regardois de tous côtés, dans les rues, autour de moi, comme si je
fusse arrivé à Paris pour la première fois. J'allai déjeûner chez
l'amie de Pascal; nous nous attendrissions sur son sort; un gendarme
vint l'arrêter et la conduire à la Conciergerie; on devine son crime;
elle sortit après le 9 thermidor, vit la fin tragique d'Hierchmann,
qui se sauva du Luxembourg, alla retrouver la Morl13 justement
suspecte à la justice, s'associa à une troupe de voleurs, fut pris,
condamné aux fers, enfermé à Bicêtre, pendant quatre mois, dans le
même cabanon où j'avois tant souffert, brisa ses chaînes, (p. 165)
fut poursuivi près de Lyon, et se noya dans le Rhône.
Nous sommes à 1,155 lieues de Paris.
1er juin. Ce matin, calme plein, brume: on sonde, point de fond.
La sonde est un morceau de plomb de quinze à vingt livres, rond, en
forme de cône tronqué, dont le dessous un peu creux, est rempli d'une
couche de suif mou. Quand il a fond, le sable ou la vase s'attachent
au suif; la couleur de la terre, du gravier ou des rocailles indiquent
au pilote le parage où il est. On trouve des marins si instruits dans
ce genre de cosmographie, que dans la première tentative faite
secrètement en 1797, sous les ordres du général Hoche, pour une
descente en Irlande, notre escadre, battue par une violente tempête,
craignant les côtes, jetta la sonde; le pilote reconnut qu'il n'étoit
qu'à quatre lieues des attérages indiqués pour l'expédition. Une
tourmente dissipa nos vaisseaux, et la Charente fit tant d'eau,
qu'elle faillit sombrer. (Je dois ces détails à M. Thomas, officier de
cette frégate.)
Nous sommes à 1,338 lieues de Paris.
2 juin. Nous voyons une trombe, ou pompe d'eau, phénomène
redoutable en mer. Le (p. 166) conflit de deux vents opposés laisse un
vide, la pression des colonnes voisines fait monter l'eau avec tant de
rapidité, qu'un vaisseau surpris par la nuit, ou par l'ignorance du
pilote, est attiré, enlevé et sombré. On entend au loin mugir l'onde;
une brume épaisse borde la pompe aspirante que le hasard a formée.
Cette attraction tourbillonnante sert aux naturalistes à expliquer la
cause de ces immenses gouffres qu'on trouve au milieu des mers. Ces
abîmes sont toujours avoisinés de vents violens qui par leur conflit,
forment une pompe aspirante ou foulante. Les parages voisins sont
sujets à de violentes tempêtes. Quand l'orage approche, on entend un
bruit semblable au mugissement de cent taureaux. Si le tourbillon est
moins considérable, on le nomme pompe d'eau; on la coupe à coups de
canons, et alors elle inonde le bâtiment.
4 juin. Aujourd'hui on radoube les canots; les moutons galeux qui
les habitoient, se couchent aux pieds des affûts des canons: on en tue
chaque jour une couple pour nos soixante malades; l'état-major prend
seulement les poitrines et les gigots pour qu'ils n'aient pas
d'indigestion. Nous désirons d'arriver pour (p. 167) arriver, car le
janissaire Villeneau, intrépide le soir dans ses recherches sonde avec
la pointe de son sabre, dans les lieux les plus secrets, où
quelques-uns de nous se retirent pour ne pas descendre dans
l'entrepont. Depuis qu'on a déplacé les canots, ils se blottissent sur
le col et dans le bras de la grosse donzelle de bois qui est à la
proue de la frégate.
6 juin. Tems couvert, calme, pluie abondante; on sonde, 225 pieds
d'eau, fond de vase, côte du Brésil; nous sommes par le premier degré
40 minutes au-delà de la ligne, voici le résumé de notre traversée.
L'Analyse de la Révolution a été suivie de quelques contes galans,
de la Vie privée du cardinal de Rohan, de celle du dernier duc
d'Orléans, de l'origine du télégraphe, de l'utilité qu'en tira
Philippe, père de Persée, dans la guerre qu'il fit aux Romains. Cette
découverte, perfectionnée dans la révolution, remonte à plusieurs
siècles avant l'ère chrétienne; elle se nommoit signaux par le feu.
Les narrateurs, MM. Job-Aimé, Gibert-Desmolières et Calhiat,
disent que l'historien Polybe donne l'invention du télégraphe à Énée,
fameux capitaine, contemporain d'Aristote et d'Alexandre-le-Grand.
(p. 168) Ils renvoient pour les détails au VIIIe. volume de
l'Histoire ancienne de Rollin; en disant un mot de la Perfection de
l'Aréostat, ils parlent du Champs de Fleurus; enfin, de toutes les
découvertes perfectionnées par la révolution. L'électricité et le
docteur Franklin ne sont point oubliés.
Ces importantes matières nous ont amenés à ces deux problèmes encore
insolus, si les républiques produisent plus de grands hommes que les
monarchies, et pourquoi. Le si a été appuyé par les uns, nié par
les autres; tous en l'accordant par supposition, ont pensé sur le
pourquoi, que l'on n'apprend bien la guerre que dans les camps;
qu'une monarchie paisible est comme une théorie auprès de la pratique.
Ils ont encore comparé les deux gouvernemens à deux vaisseaux qui
voguent sur deux mers, orageuse et tranquille: l'un n'a souvent que
quelques routiniers à son bord: chaque marin qui sort de l'autre est
expérimenté. La question du divorce a été également traitée par nos
théologiens, sous le point de vue religieux, politique, civil et
moral: on en devine bien la solution. M. Thomas, chanoine de
Saint-Claude, qui a vécu à Ferney avec Voltaire, (p. 169) dans ses
dernières années, nous a donné des particularités intéressantes sur ce
grand homme. En 1776, des prédicateurs zélés pour la conversion du
philosophe, insérèrent sous son nom une superbe ode à Jésus-Christ
dans le journal de Fréron. M. Thomas courut pour l'en féliciter en
pleurant de joie. Elle n'est pas de moi, mon ami, reprit Voltaire;
je n'ai jamais rien fait de bon pour cet homme-là. M. Trolé, qui a
étudié avec les deux Robespierre, nous a donné la vie privée de
l'aîné. Il voyoit tous ses camarades de si mauvais œil, qu'il
cherchoit toutes les occasions de les faire battre, en se retirant à
l'écart. Ceux qui le surpassoient étoient ses ennemis
irréconciliables; il les divisoit toujours entr'eux; et les faisoit
souvent battre au canif, dans l'espoir de s'en délivrer. (Nous sommes
à 1632 lieues de Rochefort; nous courons nos longitudes.)
7 Juin. Enfin, l'eau a changé de couleur, elle est d'un vert pâle
tirant sur le jaune; la brume nous circonscrit; à deux heures nous
jettons une petite ancre pour ne pas trop dévier par le courant du
fleuve des Amazones, qui a cent lieues d'embouchure; le soir, au
moment où nous allions mouiller, un matelot tombe à la mer; on vire
de bord, on lui jette des cages (p. 170) à poulets, il étend un bras
défaillant pour les saisir, et se perd pour jamais dans les flots qui
portent son cadavre aux poissons affamés.
8 Juin 1798 (20 prairial) Beau tems à la pointe du jour; tout
l'équipage crie terre: on reconnoît le cap Cachipour, sol inculte
qui nous est disputé par les Portugais; ces bords, couverts de vases
et de palétuviers, rendent le sauvetage presqu'impossible. Nous filons
sept et huit nœuds. À midi nous sommes dans les eaux bourbeuses de
l'Oyapok; nous approchons du cap Orange, ainsi nommé par les
Hollandais qui, l'ayant découvert en 1500, à la suite des voyages
d'Améric Vespuce, lui donnèrent le nom de la famille de leur
stathouder. On y voit un fort sur une pointe de rocher, qui s'élève au
bout d'une petite anse bordée de monticules et de bois toujours verts.
Toutes ces possessions ont passé tour-à-tour des Anglais aux
Espagnols, et des Espagnols aux Portugais qui les conservent encore
aujourd'hui. Quand Christophe Colomb eut découvert le Nouveau-Monde,
l'Espagne, le Portugal, Venise et la cour de Rome se partageoient ces
conquêtes; ce qui fit dire à François premier: «Je voudrois bien voir
l'article du testament par lequel Dieu (p. 171) donne les deux Indes à
la cour de Rome, aux Portugais et aux Espagnols, sans que j'y puisse
rien prétendre.» Comme ce testament n'étoit pas olographe, la cour de
France envoya à la découverte comme les autres; le continent de
l'Amérique est si vaste, que nous y fîmes de rapides conquêtes. En
1530, Cristoral Jacques, envoyé par Jean III, roi de Portugal, avec
une flotte de huit vaisseaux, après avoir découvert la baie de
Tous-les-Saints, trouva deux petits vaisseaux français à l'embouchure
du fleuve du Paraguai, appelée de la Plata ou d'Argent, les prit,
les coula à fond et fit massacrer l'équipage; preuve que les Français
avoient connu et possédé ce pays avant les Portugais. Ils y
trafiquoient paisiblement avec les Indiens, ennemis jurés des
inventeurs de l'inquisition, si atroce au Para et au Brésil. Un jour,
on ne s'étonnera plus de voir les Français circonscrits momentanément
entre l'Oyapok au midi, et le Maroni au nord, s'efforcer de franchir
ces bornes. (Extrait du chevalier Desmarchais.)
9 Juin. Nous ne sommes qu'à dix-huit lieues de Cayenne. Le vent
fraîchit, nous laissons les Deux-Connétables à notre droite; ces deux
rochers arides, point de mire des (p. 172) navigateurs, ne sont
couverts que de nids et d'œufs. Les oiseaux s'y rassemblent en si
grand nombre, que ces rochers en sont tout blancs; on leur tire
souvent un coup de canon, et ils obscurcissent l'air; ils ne fuient
pas à l'approche de l'homme, lui déclarent la guerre pour défendre
leurs couvées; leur nombre égal à celui d'un essaim de moucherons au
bord d'une eau croupissante, ne se rebute jamais des coups de bâtons
dont on ne frappe pas inutilement l'air: tous cherchent avec leurs
longs becs à tirer les yeux aux chasseurs. Un vent favorable enfle nos
voiles, nous cinglons Remire et Montabo, d'où on signale les vaisseaux
venant d'Europe. Ce signal est rendu de suite à Cayenne. Nous rangeons
à notre gauche les îlets le Malingre, les Deux-Mammelles, le Père, la
Mère et l'Enfant-Perdu; ces différens rochers ressemblent de loin à
des grottes antiques qui menacent ruine; ils doivent leur nom à la
forme que la nature leur a donnée.
À quatre heures et demie nous arrivons dans la rade de Cayenne, à
trois lieues de la citadelle qui ressemble à une masure sur la pointe
d'un rocher: nous appelons un pilote par un coup de canon. Je ne puis
exprimer le serrement (p. 173) de cœur que j'éprouve au bruit des
cables et des ancres qui se précipitent dans l'onde. De même qu'ils
enchaînent la frégate au rivage, de même nous serons prisonniers dans
ces climats..... Nous voilà mouillés.
10 Juin. À la pointe du jour, une petite pirogue, chargée de
quelques nègres et d'un capitaine de port, vient à nous. Ils rament en
chantant, et font tourner en mesure une petite pelle appelée pagaye,
arrondie par le bout. Le capitaine monte à notre bord, et nous
entourons les rameurs qui sont vêtus de leurs plus beaux habits; car
on nous a pris pour un nouvel agent. Leur garde-robe n'est pas
difficile à porter, c'est une veste blanche ou bleue, qui paroît
sortie du panier aux ordures; une chemise trouée aux épaules, aux
coudes et aux endroits les plus remarqués par les dames; ceux-là sont
les richards; les novices n'ont qu'un travers d'étoffe large de quatre
doigts, long de six pieds, qui fait deux tours sur leurs rognons,
passe dans la vallée postérieure et se termine par deux bouffettes qui
emmaillotent l'extrémité. Nous leur demandons quand nous irons à
terre; ils nous répondent dans un jargon moitié français moitié
barbare. Ils repartent à dix heures avec une (p. 174) de nos
chaloupes, montée par le capitaine et un sous-lieutenant qui vont
rendre compte de notre arrivée. Cette visite nous donne une idée
sinistre du pays. Quelqu'un, pour nous rassurer, nous adapte
l'histoire de la servante de Rochefort, vue, connue à onze heures par
son amant, fiancée, publiée et mariée à midi. On avoit alors distribué
avec profusion le fameux programme de la colonie de 1763, et chacun,
des quatre coins de la France, accouroit ici pour faire fortune. Un
homme entre deux âges, marié ou non, vend son bien, arrive à Rochefort
pour s'embarquer, et veut choisir une compagne de voyage; il rôde dans
la ville en attendant que le bâtiment mette à la voile.
À onze heures, une jeune cuisinière vient remplir sa cruche à la
fontaine de l'hôpital. Notre homme la lorgne, l'accoste, lui fait sa
déclaration.—«Ma fille, vous êtes aimable; vous me plaisez, nous ne
nous connoissons ni l'un ni l'autre, ça n'y fait rien; j'ai quelque
argent; je pars pour Cayenne; venez avec moi, je ferai votre
bonheur. Il lui détaille les avantages promis, et se résume ainsi:
Donnez-moi la main, nous vivrons ensemble.—Non, monsieur, je veux
me marier.—Qu'à (p. 175) cela ne tienne, venez.—Je le voudrois bien,
monsieur, mais mon maître va m'attendre.—Eh bien! ma fille, mettez-là
votre cruche, et entrons dans la première église; vous savez que nous
n'avons pas besoin de bans; les prêtres ont ordre de marier au plus
vîte tous ceux qui se présentent pour l'établissement de Cayenne.»
Ils vont à Saint-Louis; un des vicaires achevoit la messe d'onze
heures; les futurs se prennent par la main, marchent au sanctuaire,
donnent leurs noms au prêtre, sont mariés à l'issue de la messe, et
s'en retournent faire leurs dispositions pour le voyage. La cuisinière
revient un peu tard chez son maître, et lui dit en posant sa cruche:
«Monsieur, donnez-moi, s'il vous plaît, mon compte.—Le voilà, ma
fille; mais pourquoi veux-tu t'en aller?—Monsieur, c'est que je suis
mariée.—Mariée! et depuis quand?—Tout-à-l'heure, monsieur, et je
pars pour Cayenne.—Qu'est-ce que ce pays là?—Oh! monsieur, c'est
une nouvelle découverte; on y trouve des mines d'or et d'argent, des
diamans, du sucre, du café, du coton; dans deux ans on y fait sa
fortune!—C'est fort bien, ma fille; mais d'où est ton mari?—De la
Flandre autrichienne, (p. 176) à ce que je crois.—Depuis quel tems
avez-vous fait connoissance?—Ce matin à la fontaine: il m'a parlé
mariage; nous avons été à Saint-Louis; monsieur le vicaire a bâclé
l'affaire, et voilà mon extrait de mariage.—Bien, ma fille, soyez
heureux; c'est la misère qui épouse la pauvreté.»—Cette rencontre
n'eut pas l'effet que le maître avoit prophétisé; ils vécurent dix ans
à Cayenne, et revinrent en France avec quelqu'argent. Voilà de ces
coups du sort qu'il nous faut espérer. Le soir, Villeneau capture un
brik américain qui va porter des vivres à Surinam, colonie hollandaise
avec qui nous sommes en paix.
11 juin. Le sous-lieutenant revient à bord; les administrateurs de
Cayenne n'ont point reçu de lettre d'avis de notre arrivée; la colonie
est dans la plus grande disette; ils sont fort embarrassés de nous;
les matelots nous apportent des fruits du pays, qu'ils veulent nous
vendre au poids de l'or. Monsieur Jagot est obligé de décréter un
maximum. Nous débarquerons incessamment; mais nous serons veillés de
près, car les autorités sont encore en rumeur de l'évasion de MM.
- Aubri, représentant du peuple (mort à Demerari.)
- (p. 177) Barthélemi, membre du directoire exécutif;
- De la Rue, représentant du peuple;
- Dossonville, inspecteur de police;
- Marais-le-Tellier, attaché à M. Barthélemi (mort dans l'évasion.)
- Pichegru;
- Ramel, commandant de la garde des conseils;
- Villot, représentant du peuple;
déportés sur la Vaillante, qui se sont sauvés à Surinam, dans la
nuit du 3 du courant.
Une brume épaisse nous dérobe Cayenne et les montagnes voisines. Le
mois de mai est ici la mousson pluvieuse; la rade est peu sûre, et les
gros bâtimens ne peuvent approcher à plus de trois lieues du port. Les
goëlettes qu'on nous envoie ne peuvent nous atteindre qu'au bout de
vingt-quatre heures, encore a-t-il fallu les remorquer, au risque de
voir périr une partie de nos canotiers. Nos malades, au nombre de 60,
sont enfin partis ce matin 14 juin; une nouvelle embarcation en
emporte ce soir autant.
15 juin. Nous voguons les derniers au port. Adieu, France ... Adieu,
nos amis ... Songez à nous.... Nous sommes déjà loin de la frégate.
(p. 178) Quel regard nous lançons à ce fatal bâtiment! Le cerbère qui
le commande mériteroit bien le sort de Lalier. Qu'il nous tarde de
mettre pied à terre! Les montagnes s'approchent..... Quel beau tapis
de verdure! Nos cœurs s'élancent dans ces vastes forêts.... Y
serons-nous libres....? Nos nouveaux pilotes sont honnêtes, mais aucun
d'eux ne répond à cette question. Nous voilà à l'embouchure de la
rivière; voilà le fort, les cases, le port, les bateaux rangés et
ancrés sur le rivage; quelles masures de boue et de crachat ces nids à
rats croulent.... Voilà Cayenne; il est cinq heures et demie: nous
voilà donc au port le pied sur la grève; nous sommes à 1500 lieues de
Rochefort, à 1632 de Paris; quelle réception allons-nous avoir après
45 jours de traversée, trois mois d'embarquement et 3325 lieues de
route?
Fin de la seconde partie.
(p. 179) VOYAGE
À CAYENNE.
TROISIÈME PARTIE.
O socii (neque enim ignari sumus antè malorum),
O passi graviora! dabit Deus his quoque finem.
Vos et Scylleam rabiem, penitusque sonantes
Accestis scopulos, vos et Cyclopea saxa
Experti: revocate animos mœstumque timorem
Mittite, forsan et hœc olim meminisse juvabit.
Æneid., lib. I. v. 198.
Courage, mes amis, dans nos nouveaux revers,
Dieu nous visitera dans ces vastes déserts:
Heurtés sur les rochers, ensevelis sous l'onde,
Après une infortune à nulle autre seconde,
Nous vivons.... Ô jour cher à notre souvenir!
L'innocent dans les fers, sème un doux avenir.
Entrée à Cayenne. Description du pays. Mœurs des
Indiens, des blancs, des noirs. Caractère et habitude des
colons. Autorité des agens. Traitement des déportés. De
l'établissement de la colonie de 1763 en parallèle avec
celui des exilés de 1797, dans les déserts de Kourou,
Synnamari, Konanama, etc.
La goëlette est à l'ancre: une foule de monde accourt au rivage, un
fort détachement de (p. 180) blancs et de noirs borde les deux
parapets du pont de charpente, où nous montons par une échelle de
meunier; les soldats serrent les rangs. Les haillons qui nous
couvrent, la misère empreinte sur nos fronts, notre air déconcerté et
inquiet, réveillent l'attention des spectateurs; au bout de quelques
minutes, la joie d'avoir enfin touché la terre nous rend à nous-mêmes,
nos pieds incertains cherchent l'équilibre, comme si nous étions
ballottés par un roulis; nos nerfs, continuellement tendus, se
dilatent; enfin nous étendons nos membres, comme le cerf dont les
jambes roides à la sortie d'un étang, se refont après quelques heures
de repos. Des yeux avides nous toisent ... Quels êtres, grand
Dieu!..... sont-ce des hommes ou des bêtes fauves? Parmi cette race
nuancée de toutes couleurs, quelques européennes nous fixent avec cet
intérêt que les âmes sensibles prennent aux malheureux. La milice
noire, les pieds nus, plats et épatés comme un éléphant, revêtue d'un
mauvais juste-au-corps blanc et d'un large pantalon de même couleur,
qui contrastent avec les traits des figures gaufrées, nous traite plus
impitoyablement que les grenadiers d'Alsace, à peine (p. 181) nous
est-il permis de lever les yeux..... Nous dépassons les remparts, la
foule de peuple qui nous suit obstrue le passage; nous entrons dans
une grande maison au milieu de la principale rue, la populace noire
est sous nos fenêtres, assise et entassée l'une sur l'autre, comme les
gouvernantes et les batteurs de pavés en Europe auprès des
marionnettes ou des loges d'animaux curieux. Je reviendrai sur ces
objets. Nous voilà dans une prison un peu plus spacieuse que
l'entrepont de la Décade; Villeneau sur le balcon d'une grande
maison au milieu des élégantes de cette ville, nous fixoit à notre
passage avec une pitié orgueilleuse..... On nous distribue des hamacs;
nous logeons au grenier; des nègres nous commandent, nous gardent et
nous servent; on prend nos noms. Les seize premiers ont été conduits
chez l'agent; les municipaux se transportent dans notre prison, avec
une toise pour nous mesurer comme si nous devions tirer à la milice.
LIBERTÉ.——ÉGALITÉ.
Extrait des procès-verbaux de débarquemens à Cayenne des
cent quatre-vingt-treize déportés par la frégate la Décade,
commandée par le citoyen Villeneau, capitaine de frégate.
(p. 182) «Ces jours-ci 25, 26 et 27 prairial an VI de la république
française (13, 14 et 15 juin 1798), nous commissaires exécutifs près
l'administration centrale du département de la Guyane française, en
vertu d'une lettre à nous remise par le citoyen agent du directoire en
cette colonie, et à nous écrite par le citoyen Boischot commissaire
exécutif de Rochefort, par laquelle il nous donne avis qu'il sera
déporté, par la frégate la Décade, cent quatre-vingt-treize
condamnés, qui nous seront remis par le citoyen Villeneau commandant
de ladite frégate. À cet effet, sur l'avis qui nous a été donné le 25,
que cinquante-cinq de ces condamnés[13] (c'étoient les malades),
venoient d'être débarqués par le citoyen la Marillière, capitaine de
la goëlette l'Agile, qui avoit été (p. 183) les prendre à bord de la
frégate; nous les avons fait conduire, sous bonne et sûre garde, à
l'hôpital civil et militaire de cette colonie. Sur un autre avis à
nous donné les 26 et 27 du même mois, par les capitaines la Marillière
et le Danseur; le dernier commandant la goëlette la Victoire et
l'autre l'Agile, ayant à leurs bords soixante-huit individus
faisant partie des cent quatre-vingt-treize condamnés, et soixante-dix
faisant le complément; nous sommes transportés à la maison le Comte
dite la Cigoigne, sise dans la grande rue, le 28 du même mois, où
ils avoient été conduits la veille par un détachement de force armée,
à l'effet de prendre les noms, prénoms, professions et signalemens
desdits condamnés, ce à quoi nous avons procédé en présence du chef du
deuxième bataillon (c'est-à-dire du bataillon nègre), de l'officier de
santé et du commandant de la force armée. Signé la Borde commissaire
du directoire exécutif, Lerch chef de bataillon, Noyer officier de
santé, Desvieux commandant en chef de la force armée, faisant
fonctions de commandant de place.»
(p. 184) Il semble au lecteur que ce devroit être ici la place de la
liste des déportés; je la transcrirai ailleurs, pour être plus à
portée de mettre à la suite de chaque personne, les événemens, la
cause de sa déportation, un précis de son existence et de ses
malheurs; quand nous aurons pris racine sur ce sol, ou qu'il aura
dévoré une grande partie de nous, alors si je survis, je mettrai ma
liste au net avec le plus grand soin, bien convaincu d'après mon
cœur, que cette partie présentera le plus tendre intérêt aux
familles de mes compagnons d'infortune.
Maintenant que nous sommes toisés et signalés, montons sur la galerie
pour passer en revue le peuple de Cayenne; cet examen nous tiendra
lieu de soirée. Aujourd'hui que nous voilà rendus, les soirées ne
seront plus les entretiens oisifs d'une ennuyeuse journée; nous ne
compterons plus les nœuds que nous filerons par heure; mais la
misère et l'abandonnement dont les cables sont bien plus longs et plus
forts que ceux des vaisseaux à trois ponts. J'ai déjà crayonné en gros
l'accoutrement des sauvages qui sont venus à notre bord le lendemain
que nous mouillâmes, ceux-là étoient confus en notre présence; nous
(p. 185) sommes donnés en spectacle à ceux-ci; la scène est un peu
différente. Nous pouvons dormir tranquilles, car nous avons une forte
patrouille qui nous veille jour et nuit; le peuple noir ne désempare
pas; l'odeur de ces boucs nous infecte, chacun de nous peu accoutumé
au fumet d'un gibier si semblable au corbeau du pays, jure sa parole
d'honneur que la virginité ne sera jamais un fardeau pour lui auprès
de pareils objets; pour nous guérir du mal d'amour, l'une couvre la
laine noire de sa tête d'un vieux mouchoir tout déchiré; celle-ci
laisse pendre jusqu'au bas de sa ceinture deux flasques vessies toutes
plissées et rembrunies de quelques gouttes de sirop de tabac, loin de
relever ses pendeloques elle les écrase tant qu'elle peut, pour les
faire descendre jusqu'à ses genoux. La coquetterie des négresses,
entre deux âges, consiste à porter de longues mamelles; cet abandon
prouve qu'elles ont eu beaucoup d'enfans, qu'elles ont beaucoup de
compères et qu'elles ne sont pas encore stériles, c'est un
porte-respect pour les marmots qu'on appelle ici petit monde. La loi
de Judas, canton d'Afrique d'où elles sortent, accorde des honneurs
et des privilèges à toutes (p. 186) les filles ou femmes qui sont
fécondes (c'étoit la loi de Propagande en 1793.)
Ces individus à figure humaine portent un profond respect à la
vieillesse, et nos européens policés auroient besoin de prendre ici
des leçons. Chez nous on craint l'âge avancé, parce qu'on craint
l'abandon; ici on l'attend, ou plutôt on l'espère: c'est l'époque des
prévenances, du repos, du respect et d'une paisible jouissance. Le
vieux nègre dans sa case, au sein d'une très-nombreuse famille
d'enfans et de petits-enfans, commande en roi; aussi les hommes
décrépits, loin de vouloir se rajeunir comme nos grisons de France,
portent à cinquante ans une jarretière blanche à leur genou, pour
avertir qu'ils sont parvenus au terme de leur carrière. Alors ils se
font appeler grand-papa, et à soixante ans apa, qui dans leur
jargon signifie patriarche.
Ces squelettes ambulans sont couverts de lèpre et d'infirmités, et
entourés d'enfans de toutes couleurs; les uns d'un noir bronzé, les
autres d'un cuivre rouge tirant sur le gris; ceux-ci d'un jaune
citron, ceux-là d'un blanc pâle et livide; d'autres ne sont
distinctibles des européens que par la couleur de leurs grosses
(p. 187) lèvres blanches; tous sont presque dans l'état de nature.
Quelques négresses, moins par pudeur que par coquetterie, ont une
petite chemise, nommée verreuse, qui leur descend jusqu'au nombril,
à un doigt et demi de cette brassière de marmot; elles entortillent en
bourlet une toile plus ou moins fine, d'une aune et demie de tour sur
trois quarts de haut. Elles nomment ce bas de chemise dioco ou
transparent. Elles le couvrent d'un camisa, morceau d'étoffe de
couleur de même mesure, seulement ourlé à la coupe. Cette seconde robe
de luxe, ainsi que la verreuse, ne sortent du panier que pour faire
quelques conquêtes. Plus les négresses sont hideuses, plus elles se
croient belles: leurs compères ou maris sont presque tout nus; ils ne
couvrent la nature, comme je vous l'ai dit, que d'une lisière d'étoffe
large de trois doigts, qu'ils appèlent kalymbé. Nous ne voyons que des
nègres; les créoles seront autrement costumés; nous en appercevrons
demain quelques-uns en allant promener depuis six heures du matin
jusqu'à huit, sur la crique ou sur le bord de la mer, dans une espace
de deux portées de fusil; nous serons escortés d'une garde nombreuse,
qui ne nous (p. 188) laissera parler à personne, et qui ne pourra
converser avec nous sans être mise au cachot.
Ce soir, les colons nous envoient des fruits, du vin et du poisson
bouilli au sel et au poivre. Nous savons déjà que nous ne resterons
point à Cayenne; nous serons relégués dans les cantons et dans les
déserts comme les seize premiers.
Cette terre où nous nous trouvons avec étonnement, est destinée depuis
sa découverte à servir de champ à l'ambition, de retraite aux vaincus,
de cimetière aux africains, et d'hécatombe aux européens proscrits. En
1637, Cromwel vouloit s'y reléguer avec les presbytériens pour y
fonder une chaire de prédicans au milieu de la Pensylvanie, sur les
bords de la Delaware. En 1550, l'amiral de Coligny, ballotté par les
flots de l'opinion et par le destin des guerres civiles, avoit armé
des bâtimens, reconnu le sol que nous foulons, et la partie
septentrionale de ce continent pour y faire une retraite pour le parti
qu'il commandoit. En 1690, Philippe V, chancelant sur le trône des
Espagnes, fut sur le point de porter son sceptre à Mexico ou à Lima.
La Caroline, la Louisiane, le Canada et Philadelphie n'ont
(p. 189) été peuplés que des mécontens; les uns y sont venus de force,
les autres pour donner un libre cours à leurs opinions. Nous avons eu
des prédécesseurs; plaise à Dieu que nous n'ayons pas de successeurs,
car on attend ici 3000 déportés! La distance de Cayenne à notre patrie
ne doit pas nous désespérer. Ces déserts et ces précipices sont du
choix de nos ennemis; mais les arts naissent par-tout, apprivoisent
tout, peuplent tout. Tant que notre Gaule fut couverte de bois, les
romains y déportèrent leurs exilés, et Milon se dépitoit de manger des
huîtres à Marseille. Que le tems nourrisse dans nos cœurs l'espoir
de revoir nos foyers, et nos cendres retourneront en France.... Vous
dont les noms nous sont chers, parens, amis, bienfaiteurs, opprimés,
que nos soupirs se répondent, nous voilà rendus à notre destination.
Après tant de dangers, nous nous croyons immortels.
L'heure du souper nous distrait. Au moment où chacun forme sa société,
cinq voleurs déportés avec nous, un peu pris de boisson, se réunissent
et se font appeler le directoire. Cette qualité leur reste, et les
administrations de Cayenne, à qui nous les recommandons, (p. 190) les
logent à l'écart dans un coin qu'ils appèlent palais. Dans la suite,
l'agent Jeannet demandoit souvent à table, quand on parloit du
directoire ... duquel est-il question, de celui de la Décade ou du
Luxembourg? On nous fait l'appel matin et soir. Nous avons la ration
de marine; trois boujearons de taffia, deux onces de riz, une livre
et demie de pain, quatorze onces de viande salée pour deux jours.
Chacun reçoit une assiette, un couvert et un gobelet d'étain; un grand
plat, un baquet de bois et deux bouteilles vides sont le mobilier de
sept convives, que le hasard ou l'amitié a réunis. Le gouvernement
paie des nègres pour nous servir. Notre viande cuit sous un grand
hangar; les cheminées ne sont pas de mode ici, où les plus belles
cuisines sont comme nos poulaillers de France. Nous serions heureux,
si ce bon tems pouvoit durer, car tous les habitans lestent notre
table d'une partie de la leur, et ils mettent tant de délicatesse dans
leurs procédés, que nous ne connoissons pas le nom de nos
bienfaiteurs, à qui l'entrée de la prison est sévèrement interdite.
Pendant un mois nous allons promener matin et soir sur le bord de la
mer; le détachement (p. 191) qui nous escorte garde toutes les issues,
mais les habitans nous parlent aux travers des haies de leurs jardins:
plus on nous serre de près, plus nous devenons intéressans. Je ne puis
dire si Jeannet donne des ordres aussi sévères; en nous plaignant
beaucoup, il nous gêne de plus en plus. MM. Ramel et Job-Aimé ont
peint cet agent sous des traits peut-être plus durs
qu'invraisemblables; je le peindrai aussi avec quelque vérité, car je
n'ai pas plus à me louer qu'à me plaindre de lui; mais comme nous
avons vu le sol et les cases avant que de connoître l'agent et les
colons, faisons précéder leurs portraits de quelques notions
géographiques de la terre que nous foulons.
De l'Amérique et des Guyanes.
La Guyane ou grande terre, est une portion de l'Amérique proprement
dite formant la quatrième partie du monde. On entend par ce mot
grande terre, ou terre ferme, une immense surface solide qui confine
du pôle antarctique[14] au pôle arctique, et même à (p. 192) l'Asie,
par l'extrémité septentrionale du détroit de Davis, et par les
immenses solitudes glacées au nord-ouest, apperçues en 1741 par
Tchiricouv. L'Amérique se divise en deux parties, septentrionale et
méridionale. La première, qui s'étend jusqu'à l'isthme de Panama, est
bornée au levant par les Antilles, au couchant par la mer Pacifique,
au midi par l'Orénoque, les îles galapes et des cocos; au nord,
elle est sans bornes: l'autre, bornée au levant par la mer du Nord et
par l'Océan, au couchant par la mer Pacifique, s'étend en-deçà de la
ligne depuis l'équateur jusqu'au dixième degré du pôle arctique, et
au-delà jusqu'au cinquante-cinquième degré de latitude du pôle
antarctique. C'est dans les dix degrés du pôle arctique que se
trouvent les Guyanes, immenses presqu'îles bornées au levant par la
mer du Nord, au couchant par les Cordelières, au nord par l'Orénoque,
au midi par les Amazones ou la ligne.
On confond souvent les îles de l'Amérique (p. 193) avec la terre
ferme, parce que ce vaste pays, le plus grand des quatre parties du
monde, fut d'abord peu connu du côté du pôle nord. Quelques-uns ont
même cru pendant long-tems que le golfe du vieux Mexique étoit un
passage pour aller aux Indes orientales. Les Anglais, aussi habiles
dans la navigation que les Phéniciens et les habitans de Tyr, ont
fait, à diverses reprises et dans deux différens golfes et baies,
diverses tentatives pour trouver une route de l'Océan par les mers du
Sud, pour se rendre en droite ligne au Pérou, et de-là à Pékin. Ainsi
la Louisiane, le Canada, le Labrador, la baie de Répulse
furent connus par les Anglais pour appartenir à la terre ferme.
L'amiral Hudson donna son nom au vaste bassin qui baigne le couchant
de la Nouvelle-Bretagne. Les îles sont en grand nombre et si près les
unes des autres dans certains endroits, qu'on les confond souvent avec
l'Amérique proprement dite. Mais pour entendre ceci, il faut savoir
que la mer qui avoisine chaque partie de la grande terre, en prend le
nom. L'Océan entre l'Europe et l'Afrique jusqu'à la ligne, se nomme
mer du Nord; mais quand cette mer du Nord baigne l'Espagne, (p. 194)
l'américain la distingue sous le nom particulier de mer d'Espagne, de
Barca, de Guinée, de Monomotapa. Ainsi les îles du cap Vert,
suivant cette définition, paraîtroient en Afrique, quoiqu'elles en
soient à cent lieues, comme on croiroit que Saint-Domingue et les
Antilles sont attenantes à l'Amérique: Erreur géographique
très-commune; celui qui n'a resté que dans chacune des îles, au Vent
ou sous le Vent, n'a point été en Amérique.
Qu'un vaisseau sorti de Plymouth ou de Rochefort pour aller aux
Grandes-Indes, éprouve une tempête qui le jette au-delà du Brésil,
près de Magellan, où il fait naufrage, le voyageur à terre au
cinquante-quatrième degré de latitude du pôle antarctique ne sera pas
relégué dans une enceinte entourée d'eau de tous cotés; il parcourra
de pied les montagnes magellaniques, le Chili, le Pérou, Panama, la
Nouvelle-Espagne, le Vieux et le Nouveau-Mexique, la Louisiane, le
Canada, la Nouvelle-France, les Assinoboels, les terres de
Tchiricouv, et se trouvera en tournant ainsi à l'extrémité de la
Sibérie orientale. Cette route faite par terre, toujours par le
couchant de l'Amérique, à commencer du (p. 195) pôle antarctique,
conduit le voyageur en Asie, vers le quatre-vingtième degré de
latitude. Une femme du Mexique, convertie par un jésuite, fournit une
preuve de ce que j'avance. Le bon père forcé de mettre à la voile, dit
à sa pénitente qu'elle trouveroit les mêmes secours spirituels dans
ses confrères. Celle-ci, peu contente de se voir confinée dans un pays
d'où son directeur s'éloignoit pour aller à Pékin, se mit en route par
terre, au risque de périr. Le jésuite arrivé à Pékin l'année suivante,
fut surpris d'y rencontrer sa pénitente qui l'avoit devancé d'un mois;
elle lui dit: Que profitant du soleil qui venoit amener le grand jour
dans les pays qu'elle parcouroit, elle avait couru de hameau en
hameau; que surprise de se trouver dans un autre monde, elle avoit
suivi pendant près de trois mois une route opposée à la première, et
qu'enfin, après avoir passé de grands fleuves, de grands bois et des
lieux qui paroissoient inhabités, elle étoit venue de pied du
Nouveau-Mexique à Pékin. Il paroît que cette femme, partie au
commencement du mois de juin, étoit arrivée à la fin de septembre de
l'année suivante. Ce fait, dont la possibilité est reconnue par
(p. 196) tous les voyageurs, se trouve dans les missions du Pérou et
des Indes. On me pardonnera de ne pas le détailler plus au long dans
le désert où j'écris. Privé quelquefois de plume et d'encre, n'ayant
que quelques volumes détachés, je ne puis avoir recours qu'à ma
mémoire, dont je me défie d'après l'épuisement et les angoisses qui
l'ont presque tarie.
Reportons-nous à cent trente lieues du midi au nord, du cap de Nord,
par le 1er degré 51 minutes de latitude septentrionale, et 52
degrés 23 minutes de longitude estimée à l'occident du méridien de
Paris, confins septentrionaux de la Guyane portugaise et méridionaux
de la française.
Là commence la baie de Vincent-Pinçon, nom d'un des compagnons
d'Améric Vespuce qui alla la reconnoître. La Crique-Macari et la
rivière de Manaye, coulent dans ce canal à l'embouchure d'un autre
plus grand, nommé Carapapouri. Ces rivages toujours verts,
présentent de loin un abord gracieux; on croiroit qu'ils sont habités,
et ils pourroient l'être si la colonie étoit plus populeuse; mais ils
creuseront toujours le tombeau des blancs d'Europe, qu'on y enverra
sans les acclimater. Je m'y arrête un moment pour les peindre
(p. 197) au lecteur, parce que nous devions y être exilés. L'intérieur
offre de grandes prairies, des précipices, des forêts impénétrables,
des lacs à perte de vue, des nuées d'insectes et de mouches altérées
de sang, d'énormes serpens, des tigres, des hyènes, des couleuvres
plus grosses que des tonneaux et longues à proportion, des crocodiles
ou caïmans, dont la gueule peut servir de tombeau à l'homme; nous y
aurions plus de terre que nous n'en pourrions cultiver, mais de ce sol
vierge s'élèvent des vapeurs homicides, qui empoisonnent celui qui
l'ouvre le premier. On n'y respire qu'un air condensé par les étangs
et par les grands arbres, qui, comme des siphons, versent sur le
nouvel habitant le méphitisme et la mort.
Le gouvernement a déjà essayé d'en tirer parti. En 1784, M. le comte
de Villebois, gouverneur de la colonie, sur les avis de monsieur
Lescalier, alors ordonnateur, y fit établir des ménageries, dont la
garde fut confiée au député Pomme, assez connu en France depuis la
révolution. Elles réussissoient bien; on y envoyoit des soldats qui se
fixoient dans la colonie. Après avoir obtenu leurs congés, des
créoles même s'y rendoient volontiers; le (p. 198) gouvernement leur
donnoit des nègres pâtres, des vivres, leur avançoit un certain nombre
de bêtes à cornes, dont ils avoient le laitage. Ils partageoient
seulement les rapports avec l'état; ils choisissoient les lieux les
plus propices pour abattre les forêts et y substituer à leur loisir,
des denrées coloniales. Par ce moyen, ce désert se peuploit de
cultivateurs et de pâtres. Depuis la révolution les invasions des
Portugais ont tout ruiné, et ce sol, si productif par la végétation, a
repris sa forme hideuse. On en peut juger par les rapports des
ouvriers que l'agent vient d'y envoyer pour bâtir nos cases.
«Les makes et les maringouins ne nous ont laissé reposer ni jour ni
nuit; les brousses, les étangs, les forêts, les terres tremblantes,
les énormes reptiles qui habitent ces déserts, ne nous ont pas permis
d'approcher du lieu que vous nous avez indiqué. Les indiens ont refusé
de nous conduire. Nous sommes partis vingt en bonne santé; dix sont
attaqués de fièvres putrides, et nous autres sommes convalescens.
Parmi les fléaux de cet horrible séjour, dit un officier du poste
d'Oyapok, on compte la mouche sanguinaire deux fois grosses comme nos
guêpes de (p. 199) France, aussi nombreuses que les gouttes de pluies,
et plus acharnée à l'homme que la mouche au cheval; son dard est si
aigu et si long, qu'elle perce les vêtemens les plus épais, et se
gorge de sang, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voler.» Il ajoute
qu'il en a écrasé une si grande quantité sur ses veines, qu'il en a
retiré près d'une palette de sang. Il faudroit se faire suivre d'un
palankin couvert d'une large case nommée moustiquaire, passer sa vie
sous ce mausolée; car c'est en vain que des négrillons seroient
occupés à chasser ces insectes sous la table pendant le repas, comme
cela se pratique dans un grand nombre d'habitations de la colonie.
Les autres cantons du midi au nord, prennent leurs noms des rivières
ou des caps du midi au nord dans l'ordre suivant: Conani,
Cachipour, Couripi, Oyapoc, Ouanari, Appronague, Kau,
Mahuri, qui se nomme Oyac dans tout son cours, et Cayenne qui
tient le milieu; nous y reviendrons tout-à-l'heure.
Dans la partie du nord.... Makouria, vous vous engagez ici dans un
sable mouvant, aussi pénible que celui qui incommoda si fort les
soldats de Cambise dans son voyage en Libye, (p. 200) et ceux
d'Alexandre allant au temple de Jupiter Ammon. Un sexagénaire qui
seroit venu à Cayenne à quinze ans, ne se reconnoîtroit plus dans ce
canton; la mer s'en est retirée à deux lieues, après y avoir apporté
des vases qu'on pourroit appeler île de Délos. La déesse qui auroit
accouché sur cette plage, n'auroit pas, comme Latone, donné naissance
au dieu du jour, mais à des tigres, à des serpens, à toutes sortes
d'animaux carnivores ou mortifères: l'ancienne plage de sables et de
coquillages est couverte aujourd'hui de palétuviers, de cotonniers, de
rocouyers, de cannes à sucre, d'indigo et de bois touffus et
ténébreux, qui semblent déjà avoir affronté des siècles. À six lieues,
la rivière nommée Makouria coupe le canton en deux jusqu'à la grande
rivière de Kourou, poste fameux, dont je vous parlerai dans la
suite. À six lieues, toujours dans la même direction, vous trouvez la
petite rivière de Malmalnouri, engorgée comme les autres à son
embouchure par des sommes de vase. À la même distance est celle de
Synnamari, qui doit son nom à la salubrité d'une fontaine qui se
trouve à deux lieues à l'est-sud. On y avoit bâti autrefois un
hôpital pour les (p. 201) attaques de nerfs, les malingres, les
fraîcheurs; il n'existe plus aujourd'hui.
Le poste de Synnamari, qui a pris son nom de la rivière, est à
l'extrémité N. O. d'une savane, ou prairie de 15 ou 16 milles de long
sur 8 ou 10 de large. Il est composé de 15 ou 16 cases, restes des
débris malheureux de la colonie de 1763. C'étoit le lieu d'exil des 16
premiers, ce sera aussi le nôtre. Mais nous irons premièrement à six
lieues plus loin sur les bords malheureux de Konanama. Voici
provisoirement l'origine de ce séjour d'horreur. Des marchands
Rouennois, dit l'auteur des relations sur la France équinoxiale, y
débarquèrent en 1626. La plage d'où la mer s'est retirée à deux lieues
et demie, étoit sous l'eau jusqu'aux montagnes. Konanama leur parut
propre à faire une colonie, Cayenne et ses environs n'étant alors
peuplés que de sauvages. Ils s'établirent sur la cîme des rochers,
pour faire la guerre aux indiens. Au bout de trois semaines, les trois
quarts moururent de peste, et les autres firent promptement voile pour
France. La rivière d'Yracoubo, celle de Mana, à vingt-huit lieues
des côtes, jusqu'au fleuve Maroni, arrosent et fixent ici les
(p. 202) bornes de la Guyane Française, du côté du Nord. L'embouchure
du Maroni est par environ 5 degrés 50 minutes de latitude
septentrionale, et 56 degrés 22 minutes de longitude, estimée à
l'occident du méridien de Paris.
Le Maroni et l'Oyapoc sont les seules rivières, ou fleuves de la
Guyane Française qui sortent d'une grande chaîne de montagnes, de
celles qui, partant des Cordillères, séparent dans cette partie du
globe, les eaux qui coulent vers d'Océan, d'avec celles qui se rendent
dans l'Amazone. Les rivières de Mana, de Synnamari, d'Oyac et
d'Approuague, naissent dans des montagnes du second ordre; les autres,
moins considérables, viennent des montagnes d'ordre inférieur. Toutes
ont plusieurs branches, plus ou moins fortes, grossies par un grand
nombre de petits ruisseaux. Revenons à Cayenne.
Le chef-lieu de cette colonie est assez généralement connu sous le nom
d'île de Cayenne; mais on ne prendroit pas une idée juste de cette
île, si on se la représentoit comme une terre éloignée du continent,
isolée et entourée d'une mer navigable pour les (p. 203) vaisseaux;
au contraire, lorsque le navigateur aborde ce terrain, il lui paroît
faire partie de la terre ferme. Peut-être même cela étoit-il vrai
autrefois; maintenant il n'en est séparé que par des rivières, dans
lesquelles la mer monte et descend à chaque marée, mais où l'on ne
peut naviguer qu'avec des barques, ou avec des pirogues.
La plus grande largeur de l'isle de Cayenne, mesurée sur une ligne
allant de l'est à l'ouest, est de quatre lieues terrestres, de
vingt-cinq au degré. Sa plus grande longueur, du nord au sud, de cinq
lieues et demie, et sa circonférence, eu égard à toutes ses
sinuosités, est d'environ seize lieues et demie. La partie de cette
circonférence, bornée par la mer, et qui regarde le nord-est, peut
avoir à-peu-près trois lieues et demie.
La ville de Cayenne située à l'extrémité nord-ouest de cette île, à
l'embouchure de la rivière du même nom, est fortifiée, et pourroit
être défendue assez avantageusement par un petit morne (montagne) qui
se trouve dans son enceinte. Sa latitude est de 4 degrés 56 minutes,
et sa longitude, de 54 degrés 35 (p. 204) minutes, d'après les
observations de M. de la Condamine, en 1744.
Température du climat de Cayenne.
À cinq heures et demie, le crépuscule paroît; à six heures moins un
quart, le petit jour, à six heures, le soleil s'élance du sein des
mers, entouré d'un nuage de pourpre. L'ombre de la terre ne s'efface
presque ici qu'à l'instant où cet astre est à l'horison, tandis que
cette ombre diminuant vers les pôles, laisse aux habitans des zones
tempérées et froides, la lueur des rayons obliques qu'il darde sous
eux, pendant six mois, sous l'une et l'autre partie du globe.
Nous sommes amphisciens, c'est-à-dire que notre ombre va de côté et
d'autre. Depuis le vingt avril jusqu'au vingt août, elle est du côté
du midi, et, pendant les six autres mois, elle tourne du côté du nord.
Nous avons tous les jours égaux aux nuits, à une demi-heure près, que
nous perdons de septembre à mars, et que nous retrouvons dans les six
autres mois. Nous avons deux étés, deux (p. 205) équinoxes, deux
hivers et deux solstices. La chaleur est tempérée par des pluies
très-abondantes, qui tombent depuis le solstice d'hiver, mi-décembre,
jusqu'en mars, et reprennent en mai jusqu'à la fin de juillet, où
commence le grand été, jusqu'en décembre. Le soleil passe deux fois à
pic sur nos têtes, le 20 avril et le 20 août; il est peu sensible la
première fois, par les pluies dont la terre est arrosée. Son retour
nous donne pourtant un mois et demi de beau temps, qui sèche un peu
les étangs; mais l'inconstance de ces climats, boisés et montueux,
trompe souvent l'attente des colons, qui feroient toujours deux riches
récoltes, si les étés et les hivernages étoient réglés. On rit, quand
je parle d'hiver et d'été sous la zone torride. L'été pour nous est un
soleil brûlant, qui, pendant plusieurs mois, n'est rafraîchi que par
l'haleine d'une brise ou vent violent, qui souffle toujours de l'est
au nord-est. Pendant la journée, le vent vient de mer, et étouffe
celui de terre. Ce dernier ne se fait sentir aux côtes que dans
certains temps, pendant quelques heures, et presque toujours le matin
et le soir, après le coucher du soleil.
(p. 206) L'hiver est la chute continuelle des pluies; elles sont si
abondantes, que souvent les cases sont inondées, et les plantages sous
l'eau. La pluie tombe quelquefois pendant quinze jours, sans
interruption; ce qui a fait dire à Raynal, que la plage où la
colonie de 1763 avoit débarqué, étoit un terrain sous l'eau. Horace
seroit très-croyable, s'il disoit que dans ces déserts, les daims
craintifs nagent vers la cîme des arbres, où les poissons s'étonnent
de trouver le nid de la tourterelle englouti[15]; quatre à cinq heures
de beau temps ont pompé l'étang. Cependant les ondées sont si
fréquentes, que, durant l'hivernage, l'eau n'est pas à plus de trois
pouces du niveau de la terre. Ces grandes pluies forment des torrens
qui grossissent les fleuves; on les appelle avalasses. Tandis que nos
rivières de France laissent leurs lits à sec, celles de la zone
torride sont gonflées de doucins, aussi rapides, que la fonte des
neiges dans les montagnes.
(p. 207) Les hivers sont quelquefois secs et chauds, alors les
plantages meurent; le vent de nord, qu'on appèle bise en France,
brûle et gèle de son souffle nitreux sec et froid, les fleurs, les
fruits et les tendres bourgeons. Tel on voit le soleil sans nuage, se
levant sur la vigne gelée, mettre en cendres le bouton trop prompt à
s'épanouir à la chaleur; ou tel le vent et la brume noire du mois de
mai, saisissent la fleur de l'épi et transforment son lait en noir de
fumée; tel le vent de nord des pays chauds, gèle, crispe et appauvrit
les fleurs, les fruits et les plantages.
Voilà le sol et la température du pays. Voyons les cases, les
habitans, l'agent et les autorités de Cayenne.
Les cases sont de vilaines cabanes où l'on ne voit que des châssis
sans vitres, un amas de maisons sans art et sans goût, des rues en
pente, sales et étroites, pavées de pointes de baïonnettes; au lieu de
phaëtons, de vieilles rosses plus étiques que nos mazettes de fiacre,
attelées sept à huit à un diable ou cabrouet, traînent quelques
mauvaises futailles, quelques barils de bœuf ou de morue salée;
voilà ce qui compose l'ancienne ville, où les maisons (p. 208) à deux
étages sont des palais, et des boutiques de commerce qu'on loue huit
et dix mille francs par an, pour servir d'entrepôt ou de magasin de
déchargement des denrées coloniales ou européennes. La nouvelle ville,
que nous nommerions chez nous queue de bourgade, est plus régulière,
plus gaie, quoique bâtie dans le même genre, sur une savane ou prairie
desséchée depuis quinze ou vingt ans; le tout est moins considérable
qu'un beau village de France: les cases paroissent vides ou occupées
en grande partie par des gens de couleur qui n'ont rien, qui ne font
rien, qui ne s'inquiètent de rien, et qui vivent plus à l'aise que nos
respectables artisans de France que l'aurore ne trouve jamais dans
leurs lits, et qui portent tout le poids du jour. Ici tout le monde
vend, troque, achète et revend la même chose, tout est au poids de
l'or, et chacun en trouve, presque sans savoir comment. Ce paradoxe
est facile à entendre quand on connoît les colonies; ceux qui les
habitent dépensent avec profusion l'argent qu'ils gagnent sans peine;
pour peu qu'ils en aient, ils ne se passent de rien, leur indolence
est si grande que pour ne pas se déranger ils paieroient un
domestique, (p. 209) pour cueillir les fruits qui sont sous leurs
mains, et un autre pour les leur porter à la bouche; n'ont-ils rien,
ils empruntent, ils trouvent facilement du crédit, car tous les
insulaires sont confians pour des bagatelles; ne trouvent-ils pas à
emprunter, ils mangent un morceau de pâte de racine, se promènent,
dorment et ne s'inquiètent de leur existence que quand ils n'ont
absolument plus rien. Cette classe d'oisifs est alimentée par les
riches marchands qui troquent les négresses comme les denrées,
lesquelles négresses troquent, à leur tour, tout ce qu'elles ont reçu
pour les faveurs des nègres. Les arrivans d'Europe paient tout, et
quand les bâtimens sont long-tems à venir, la famine est générale sans
épouvanter personne. Dans ce moment, le pain vaut dix sols la livre,
la viande seize; mais la monnaie de cette colonie perd un quart sur
celle de France; la plus commune est la piastre forte d'Espagne
frappée au Mexique à 5 fr. 10s. de France, et 7 fr. des colonies;
le louis 24 f. de France, 32 f. de colonie. Les sous marqués, frappés
pour Cayenne à l'ancien coin 2s. colonie, 1s. 6 den. de France;
le prix de toutes les autres monnaies est réglé sur la valeur de la
piastre, et ce qui (p. 210) coûte un liard en France se paie deux sols
à Cayenne.
Vous n'avez vu jusqu'ici que des noirs et des gens de couleur; nous
allons passer en revue toute la population, afin de la réunir sous un
point de vue pour la peindre plus à notre aise.
On compte ici autant de races d'hommes que de distinctions sous la
monarchie. Les blancs ou colons, qui diffèrent des européens par
leurs cheveux blonds, leur teint pâle, et quelquefois plombé; les
nègres par les nuances plus ou moins foncées de leur peau bronzée,
ou couleur d'ébène ou de cuivre rouge tirant sur le gris. Le mélange
de toutes ces couleurs donne une progéniture semblable à l'habit
d'Arlequin: un indien et une blanche ont un enfant dont la peau est
d'un blanc roussâtre; un nègre et une indienne, un rejetton cuivre
rouge bronzé; une négresse et un blanc, un mulâtre dont la couleur
en naissant n'est reconnaissable qu'aux ongles et aux grosses lèvres;
un mulâtre et une blanche, un métis; une métisse et un blanc, un
quarteron qui est plus blanc que les européens. Chaque espèce a des
nuances de singularité, et souvent de rusticité du (p. 211) terroir.
Les indiens, comme vous le verrez quand nous traiterons leur article,
l'adresse, la jalousie, la férocité des peuples nomades des trois
Arabies: les nègres, le génie destructeur, paresseux et borné des
sauvages de l'Afrique; les autres avortons nés du croisement des
races, joignent aux vices du climat l'insipidité de leurs pères; on ne
peut décider s'il ne seroit pas à souhaiter qu'ils fussent plutôt
noirs qu'à moitié blancs. Les créoles, enfans nés d'européens,
résidans dans les colonies, sont pétris d'infirmités, souvent de
défauts, et assaillis de maladies que je détaillerai plus bas. Élevés
avec les nègres qu'ils détestent et dont ils ne peuvent se passer, ils
en contractent les habitudes et les goûts; commencent-ils à marcher
seuls, ils mangent d'une terre blanche qui les rend livides, les fait
enfler et mourir; on cherche en vain à les corriger de ce goût, s'ils
y sont bien enclins, les autres alimens les dégoûtent, on ne les en
détourne qu'en les dépaysant. Si ce n'est pas de cette dépravation de
goût que vient leur insouciance dans un âge plus avancé, c'est
toujours du même fonds que naissent leur inertie et leur mollesse; la
nature abrutie dès (p. 212) son commencement dans le principe animal,
ne porte plus au sensorium ces fortes vibrations qui font les élans
du génie, et la machine usée encore par d'autres excès, ressemble à un
alambic ouvert et trop large, qui laissant évaporer la liqueur, ne
fait plus de jets, mais tombe tristement goutte à goutte, ce qui fait
dire à un voyageur qu'ils sont ennuyés, ennuyans et ennuyeux; tantôt
ils regardent les nègres comme des bêtes de somme et les croient
communément d'une autre origine qu'eux; tantôt ils les idolâtrent
comme leurs plus chers enfans; les belles négresses sur-tout, vengent,
et leur nation et elles-mêmes des mépris qu'elles ont essuyés:
d'esclaves, devenues plus impérieuses que les Aspasie et les Phrynée,
elles rendent leur maître plus petit qu'un ciron, plus rampant qu'une
chenille, plus sale qu'un pourceau. Non-contentes de dissiper son bien
et de donner sous ses yeux et ses joyaux et leurs faveurs à d'autres
amans, elles le font soupirer, courir, passer les nuits, et faire
plusieurs lieues pour les trouver; elles n'ont nulle amabilité, nulle
grâce; nul entretien, nulle douceur; leur lubricité animale fait tout
leur charme auprès des maîtres qui, (p. 213) fidèles aux cyniques
principes qu'ils ont sucés avec le lait, les préfèrent toujours et
leur sacrifient souvent les plus aimables européennes. On voit ici de
vieux célibataires corrompus et entourés de bâtards et de mères de
toutes couleurs, et des maris impudens qui du lit conjugal passent,
sous les yeux de leur épouse, dans les bras et dans les sales réduits
de leurs esclaves; les cases sont pleines de servantes inutiles, de
négrillons, de mulâtres et d'enfans naturels dix fois plus nombreux
que les légitimes; ces instrumens d'iniquité sont autant d'Argus pour
la légitime épouse qui doit tout souffrir sans se plaindre et sans
trébucher, les maris épuisés n'étant pas moins jaloux que médisans,
ils se ressemblent, se contrôlent, se défendent, se déchirent,
s'aiment et se haïssent, leur cœur est un crible au travers duquel
le bien passe comme le mal, la haine succède à l'amour, la vengeance
au repentir, la froideur à l'intimité, à la parcimonie la prodigalité,
le désir à la satiété, avec la vîtesse d'un éclair. On ne peut pas
dire qu'ils sont méchans, on ne peut pas dire qu'ils sont bons, ils
n'ont point de caractère, et pourtant ils sont tous généreux,
hospitaliers par (p. 214) inclination, par plaisir, par jouissance;
ils ne peuvent pas voir de malheureux et ils portent envie aux
heureux; mais quand ils sont bons, et le climat, vu la facilité de se
procurer sans gêne les moyens de vivre, leur donne souvent cette
qualité; ils le sont à l'excès. Le portrait que je trace ici est si
frappant que tous ceux qui m'ont obligé ou qui se trouvoient à portée
de l'entendre m'ont engagé de n'y rien changer.
Peignons maintenant le sexe créole. Je n'emprunterai pour lui ni la
lyre d'Orphée, ni le pinceau de Zeuxis qui mourut d'aise d'avoir bien
saisi et les traits de Vénus et les rides d'une vieille femme. Ovide
chez les Sarmates ne sera même pas mon modèle, quoique je pusse dire
comme lui: «Ô mes amis! reportez mes cendres dans mon pays, car je
mourrois mille fois en reposant ici[16].» Mesdames, vous crieriez
peut-être à l'invraisemblance, si je vous peignois avec les grâces de
Junon prenant le foudre en main pour endormir entre ses bras le maître
des Dieux, son époux et son frère; vous avez pourtant cette (p. 215)
mignardise intéressante de Vénus qui, blessée au petit doigt par
Diomède, fait retentir l'Olympe de ses cris et rire les immortels de
son égratignure; vous avez l'indolence, les caprices, les ruses, la
coquetterie, l'expression et plus souvent la molle langueur de cette
déesse; mais elle n'a mis ni son incarnat sur vos lèvres, ni ses roses
sur vos joues, ni ses traits dans vos yeux: elle pare ses atours et
vous êtes guindées dans vos robes; les zéphyrs et les grâces marquent
les ondulations de la sienne; vos guirlandes sont faites avec art; ses
cheveux flottent avec goût: vous êtes riches et brillantes, elle n'a
qu'une ceinture, elle la met bien et elle est jolie; quelques-unes
d'entre vous ont le gros vermillon des amours, d'autres l'esquisse des
grâces, celles-ci le superficiel du beau, celles-là l'amabilité
locale, la dextérité des fées, d'autres dans le domestique la tyrannie
des despotes et la bassesse des esclaves; quelques-unes le charme de
l'éducation du sentiment, presque toutes celui de l'affabilité; mais
beaucoup la mignardise et la rusticité des vétilles et des caprices;
quelques-unes la galanterie, toutes l'orgueil et la coquetterie, mais
toutes aussi la sensibilité et beaucoup plus de sagesse que vos maris.
(p. 216) Monsieur Préfontaine, ancien commandant de la partie du nord
de cette colonie, donne le dernier coup de pinceau à mon croquis, dans
son essai manuscrit sur les mœurs créoles, que je copie ici. «Nos
créoles, dit-il, ressuscitent les sybarites qui étoient froissés en
couchant sur des feuilles de roses pliées en deux, et qui tuoient les
coqs pour n'être pas éveillés par leur chant. À mon arrivée ici,
j'étois porteur d'une lettre d'amitié ou d'amour pour une dame dont le
soupirant étoit retourné en France, et lui avoit laissé son portrait,
en attendant qu'il vînt lui offrir sa main. Je me fais annoncer.
Madame repose dans un branle voisin de celui de son complaisant qui
lui présente nonchalamment un bouquet de roses qu'elle voudroit tenir,
mais qu'elle ne peut atteindre, n'ayant pas la force d'allonger la
main, et le monsieur étant trop mollement bercé pour descendre de son
hamac. Une esclave aux pieds de la déesse, les lui chatouille pour
appeler doucement Morphée, tandis qu'une autre lève sa jupe pour
ranimer avec un oualy-oualy (éventail de paille de palmier),
l'haleine libertine d'un zéphyr artificiel. Le complaisant a aussi un
nègre qui lui évente la figure. Un chat ose miauler; (p. 217) la
négresse reçoit un soufflet pour n'avoir pas éloigné cet importun.
J'entre au milieu de la scène; madame ne me voit pas, tant elle est
occupée de son prochain réveil. Le monsieur ouvre les yeux en bâillant
nonchalamment, se remue en mesure, crache, tousse, se mouche sans
bruit et sans précipitation, fait un effort pour prendre ma lettre, et
me prie d'appeler madame, parce qu'il n'en n'a pas la force ... Elle
s'éveille; ce n'est plus la molle indolence, c'est la sémillante Hébé;
ses yeux pétillent de gaieté et d'esprit. Elle est prévenante,
aimable, vive. Elle s'élance dans son salon, tire la gaze qui couvroit
le portrait de la personne dont je lui remettois la lettre, la lui
présente, la mouille de quelques larmes, remet la gaze, revient à
nous, rit de ses pleurs, et me fait souvenir de cette saillie de
Ninon: Le bon billet qu'a la Châtre!»
De pareils enfans ont besoin de bons mentors, et la mère-patrie a
toutes les peines du monde à les contenter sur ce point. Les
gouverneurs ou les agens qu'elle leur envoie, sont-ils trop doux, ils
en font comme les grenouilles du soliveau; sont-ils trop sévères, ils
les maudissent (p. 218) et se taisent. Leur souplesse ou leur mépris
changent souvent le caractère du chef qui les gouverne; de-là les
contradictions fréquentes dans leurs rapports sur l'administration de
tel ou tel gouverneur ou ordonnateur. Le bien-être pour eux est un
cheval de bois à dos aigu, et le mal-aise un plancher de marbre poli.
Je ne connois point de républicains comme les créoles, mais ils le
sont tous comme les premiers habitans d'Agrigente et de Syracuse,
durant les révolutions de la Sicile. L'agent qui les gouverne
aujourd'hui, m'en fournit la preuve; ils ne savent encore s'ils
doivent se plaindre ou se louer de lui. Mais comme son portrait tient
à notre existence, avant de m'en occuper, je reviens pour un moment à
la maison le Comte où nous sommes détenus.
Nous allons promener, comme je vous l'ai dit, depuis six heures du
matin jusqu'à huit, et depuis quatre jusqu'à six du soir. Les habitans
nous comblent de présens et de promesses. Quoiqu'ils arrangent la
religion à leurs mœurs, nos prêtres excitent pourtant leur plus
vive sollicitude; presque tous les blancs par enthousiasme font choix
de ceux qui n'ont point prêté serment, et les noirs de ceux qui l'ont
prêté, car le (p. 219) schisme de France a passé dans les Indes. Les
nègres et les blancs traitent la religion comme la femme jeune, et la
vieille, l'homme entre deux âges. Le moment de quitter Cayenne
approche. Jeannet, chef suprême, prend une décision que voici:
Arrêté de l'agent du directoire exécutif délégué dans la Guyane.
Art. Ier. Aucun déporté ne pourra rester à Cayenne ni dans l'île.
II. Tout déporté qui désirera former un établissement de commerce et
de culture dans une des parties non exceptées par l'article précédent,
sera tenu de s'adresser par écrit au commandant en chef, qui fera part
de la demande à l'administration départementale.
III. La pétition sera appuyée d'un certificat d'un citoyen domicilié
et bien connu, qui prouve que l'exposant est en mesure d'acheter ou de
louer, soit une habitation, soit une maison, et qu'il a les moyens
suffisans, soit pour faire valoir l'habitation, soit pour entreprendre
le commerce.
IV. L'administration départementale s'assurera (p. 220) des faits
contenus dans le certificat à l'appui de la demande qu'elle fera
passer de suite avec son avis motivé à l'agent du directoire, pour
être par lui pris sur le tout telle détermination qu'il appartiendra.
À Cayenne, le 30 prairial an VI (18 juin 1798.) Signé
Jeannet; contresigné Édmé Mauduit, secrétaire.
Comment profiter du bénéfice d'une pareille loi? Nous ne pouvons
parler à personne. Qui viendra nous offrir son bien? Nos verroux ne se
desserreront pas. Tous les colons demandent un déporté pour mettre sur
leur habitation; ils s'informent de la moralité de chacun, et
choisissent ainsi en tâtonnant: tous sont mus du saint désir
d'arracher un malheureux au gouffre dévorant de Konanama[17], où vont
(p. 221) aller ceux qui ne trouveront point d'asyle et qui n'auront
pas les moyens de former des (p. 222) établissemens à leurs frais, en
s'engageant de ne rien recevoir de l'administration pour tout le tems
de leur existence dans la Guyane. Les habitans qui se chargent d'un
déporté, sont tenus de lui passer une partie de leur bien, et de
répondre de son évasion. L'état ne leur fournit absolument rien; ils
le médicamenteront à leurs frais. Une fois rendu chez eux, il ne
pourra pas même venir à l'hôpital, ni mettre le pied dans l'île de
Cayenne. Ces dispositions rigoureuses sont faites pour prévenir le
dégoût et la légèreté des contractans, dit Jeannet, ou pour le libérer
lui-même d'une dette sacrée...., car tous sont gardés à vue, tous sont
prisonniers d'état; et dans quel état le souverain privant un individu
de sa liberté, l'exilant à deux mille lieues de sa patrie, lui
séquestrant son bien, lui interdisant la communication avec les
hommes, ne lui donne ou ne lui prête-t-il pas des moyens d'existence?
Jeannet outre-passe bien ici l'intention du gouvernement, mais les
loix de la mère-patrie sont des fusils sans détente à une pareille
distance. Le cultivateur européen, qui nous voit sur une terre sans
bornes où chacun peut s'en allouer tout autant qu'il veut, envie
notre sort, et nous (p. 223) reproche notre indolence. L'état,
dira-t-il, leur avance des instrumens aratoires, leur concède un sol
vierge, ils n'ont qu'à travailler; leur condition est préférable à la
mienne. Je n'ai que dix journaux de terre que j'ensemence moi-même, et
dont je ne demande que le produit net pour être heureux. Au lieu de
ronces, si j'avois les arbres de la Guyane, je les déracinerois ou je
les brûlerois.
Les vapeurs homicides de cette terre vierge tuent l'homme qui l'ouvre
sans précaution. Les arbres qui l'ombragent, plantés par les siècles,
sont quatre ou cinq fois plus gros que nos sapins; il faut les
échafauder pour les couper à certaine distance du tronc, car le pied
est trop étendu pour qu'on songe à le déraciner. Un homme seul dans
ces forêts, ne trouveroit pas le temps de nettoyer un coin de champ,
que l'autre extrémité seroit déjà couverte de broussailles plus
épaisses que nos bois taillis, tant la végétation a de force. Songer à
brûler les forêts, sans les couper, est une pensée folle; d'ailleurs,
l'incendie découvrant le terrain, y feroit circuler l'air, et les
arbustes naissans en foule au pied des troncs à-demi enflammés, ne
laisseroient que peu d'espace à la culture. (p. 224) Il faut donc
travailler sans relâche à abattre d'abord le petit bois, et à le
mettre en pile. Pour cela, il faut des bras et des hommes acclimatés;
mais les grands arbres restent encore; si vous n'avez pas assez de
monde pour les faire tomber promptement, les petits reviennent, et
vous n'avez rien fait. Le sol qui n'est pas boisé, est désert,
stérile, ou étang ou savane (prairie que les avalasses d'hivernage
couvrent pendant six mois de quatre ou cinq pieds d'eau.) On pourroit
quelquefois dessécher ces marais, mais il faudroit des avances
d'argent et d'hommes. Nous sommes 193; la moitié sera répartie dans
130 lieues, et abandonnée à elle-même, l'autre sera gardée à vue, et
confinée dans un désert. Un tiers est sexagénaire, l'autre n'a rien,
et tous sont moribonds.[18] Nous passons à l'hôpital les uns après
les autres, la maladie nous marque nos (p. 225) lits. Le pays nous
fait végéter comme les plantes. Aujourd'hui mon voisin se porte bien,
demain il a la fièvre chaude, après demain on le porte en terre. Il y
a huit jours que Bourdon (de l'Oise) et Tronçon-Ducoudrai étoient à la
chasse: avant hier ils buvoient du punch et projettoient une partie
pour le lendemain, ils sont enterrés ce matin, et Brotier qui les a
soignés dans leurs derniers momens, est mort hier au soir d'un coup de
soleil. On croiroit qu'ils sont empoisonnés. L'air et le soleil de la
Guyane, sont les venins les plus subtils; aucun de nous n'est
dangereusement malade, et au mois d'octobre, la moitié sera morte.
Le plus habile docteur de France ne seroit ici qu'un ignorant. Noyer
tient la lancette d'Esculape, et il le mérite par ses talens; il vous
enseigne son art en peu de mots: «Ôtez-moi les cantharides, la
lancette, l'opium, l'émétique et la seringue, je ne suis plus
médecin.» Cet Hypocrate fait pourtant chaque jour des cures que
Pelletan et Dessaux auroient enviées. La pratique vaut mieux que la
théorie. Le pharmacien Cadet, dans son laboratoire, auroit dépeuplé la
Guyane en quinze jours. L'émétique, le jalap, la saignée, les
lavemens (p. 226) sont le manuel pratique des écoliers et des maîtres.
Les maladies sont des fièvres chaudes et putrides qui font jouer les
hommes à pair ou non, et en emportent toujours la moitié. Les crises
de Collot sont communes à la plupart des malades, d'autres perdent la
tête, tombent en apoplexie, et meurent en dormant, faute d'avoir été
saignés à-propos. Pendant l'été, les fièvres chaudes et
pestilentielles sont plus communes que la migraine en France; elles
occasionnent souvent des obstructions au foie, et vous emportent l'été
suivant.
L'hiver est funeste aux vieillards et aux asthmatiques, les brumes et
les fraîcheurs des nuits en dépêchent un bon nombre chez Pluton. La
pulmonie n'est pas commune dans ce pays, mais le cathare et l'éthisie
font très-bien la besogne de leur sœur.
Voici des maladies d'un autre genre: On conduit un vieux nègre aux
isles du Malingre. Toute sa famille est éplorée, il est suivi d'un
autre blanc que ses amis n'approchent que de loin. Ces malheureux se
désespèrent, et crient à l'injustice. Le passager qui les traverse,
ressemble au nocher Caron.
(p. 227) Les isles du Malingre, que nous avons vues en abordant, sont
une léprerie où l'on confie ceux qui sont atteints d'un mal honteux,
connu ici sous le nom de mal-rouge ou des arabes; en Guinée, sous
celui d'épian rouge; ses symptômes sont plus effrayans que ceux de
la maladie d'Aria de la Plata, si bien décrite par le compère
Mathieu. Le principe de ce mal vient d'un libertinage honteux. Quand
il se déclare au-dehors, il est presque sans remède, c'est une
gangrène lente, qui fait tomber les membres sans douleur. Un lépreux
se brûle sans s'en appercevoir, on lui enfonce des épingles dans les
bras, dans les jambes, sans qu'il se réveille, s'il dort; et sans
qu'il crie, s'il est éveillé. La honte est attachée à cet exil, et la
faculté y regarde à deux fois pour y condamner un homme. Tout ce qui
approche de lui, occasionne une juste répugnance, car cette peste est
communicative. Les anciennes lépreries n'étoient pas plus effrayantes
que celle-ci. Ces malades sont relégués sur une isle à trois lieues au
sud-est de Cayenne, d'où ils ne communiquent avec qui que ce soit au
monde. Leur isle est presque inabordable, d'où lui vient le nom de
Malingre, ou mal-aisé à ancrer. (p. 228) Quelques curieux y vont par
faveur, mais les malades se retirent et n'osent les toucher. C'est un
spectacle digne de compassion de voir ces cadavres vivans, en
lambeaux, dont l'un a perdu les deux bras, un autre les doigts des
pieds; celui-ci est couvert d'ulcères purulents, cet autre a la figure
rongée de chancres. Enfin, tous savent que l'enceinte qu'ils foulent
est leur tombeau. Ils n'ont souvent pas la force d'inhumer leurs
confrères qui viennent de mourir.
Aujourd'hui la pluie nous force au milieu de la promenade, à nous
abriter chez un menuisier; la sentinelle nous attend à la porte: une
mère jette les hauts cris, son enfant nouveau-né vient de mourir du
thetanos, coqueluche qui moissonne les trois quarts des enfans,
jusqu'au septième jour après leur naissance. Ils tombent en syncope,
se brisent les reins, et meurent subitement. Quand un nouveau-né passe
sept jours, on ne craint plus rien jusqu'à sept ans. Le mari, en
courant au secours de sa femme, s'enfonce un pieux dans le mollet, qui
lui donne le cathare. Ses membres se retournent, il ne parle point, il
se remue à peine, et son dos se redresse en arc. On appelle M. Noyer,
il le panse, mais sa convalescence (p. 229) sera longue, trop heureux
s'il en est quitte pour quelques grandes infirmités. Tous les grands
maux occasionnent un gonflement de muscles qui fait mourir ceux qui en
sont atteints, dans un état affreux. Presque tout le monde est sujet
au mal de jambe, qui devient incurable, si on le néglige. La gangrène
et les vers s'y mettent, il faut mourir ou s'accoutumer à l'opium et à
la pierre infernale. On coupe ainsi ces branches de peste, quand elles
sont à l'extérieur; mais les fièvres inflammatoires gangrènent aussi
les viscères, et le malade expire en criant guérison. Que nous soyons
guéris ou non, nous allons bientôt évacuer Cayenne, et nous
connoissons déjà assez l'agent, pour le peindre avant de partir.
Jeannet, chef suprême de la colonie, sous le nom d'agent, commande en
sultan, aux noirs, aux habitans comme aux soldats; sa volonté fait la
loi, rien ne contre-balance son autorité, il ne doit compte qu'au
Directoire qu'il représente; il ne reste en place que pendant 18 mois,
et il peut être réélu; il nomme toutes les autorités, les influence
toutes, les renouvèle toutes, les fait mourir (p. 230) toutes; enfin,
quand un agent sourcille, tout doit trembler devant lui. Voilà sa
puissance; quel usage en fait-il?
Jeannet, d'un physique avantageux, dans sa trente-sixième année, fils
d'un fermier de la Beauce, est manchot du bras gauche, qu'un cochon
lui a mangé quand il étoit au berceau. Il doit son avancement à ses
talens, à son oncle Danton, et un peu à ses maîtresses qui ont payé sa
complaisance et sa vigueur. Son abord est prévenant, la gaieté siège
plus sur son front que la franchise, ses manières sont aisées, il
débite avec une égale effusion tout ce qu'il pense comme tout ce qu'il
ne pense pas; son grand plaisir est d'être impénétrable en paroissant
ouvert, il se pendroit si on pouvoit lire dans son cœur, et je ne
sais pas s'il en connoît lui-même tous les replis. Il fait autant de
bien que de mal, et toujours avec la même indifférence. Il met chacun
à son aise, il pardonne de dures vérités et même des injures; il manie
le sarcasme et la répartie avec esprit; il écoute volontiers les
reproches, les remontrances, les plaintes, et ne les apostille jamais
que de grandes promesses. La prodigalité, la galanterie, la soif de
l'or, sont ses organes, (p. 231) ses esprits moteurs, ses élémens, son
âme. Il est brave et prévoyant dans le danger, peu sensible à
l'amitié, encore moins à la constance, blasé sur l'amour, très-facile
au pardon, et peu enclin à la vengeance. La vertu pour lui, est la
jouissance et le plaisir, il ne fait jamais de mal sans besoin, mais
un léger intérêt lui en fait naître la nécessité. Tient-il la place de
l'âne de Buridan, entre deux biens égaux, provenans de deux moyens
opposés, son cœur fait pencher la balance du côté du plus honnête,
ne manqueroit-il que quelques centimes de grains dans le bassin, il en
feroit encore le sacrifice. C'est un homme de plaisir et de
circonstance, qui aime l'argent et puis l'honneur, les hommes pour ses
intérêts, ses amis pour la société, et qu'on a regretté par ses
successeurs. Voilà l'ensemble du tableau, étudions-en chaque trait
dans l'historique des révolutions de la colonie, par la liberté des
nègres.
Il vint ici en 1793, après la mort du roi, remplacer le chevalier
d'Alais, mettre la colonie à la hauteur des circonstances, fit
ouvrir les clubs, en fut président, et s'allia aux hommes de toutes
les couleurs. Son cœur répugnoit à ces bassesses, mais c'étoit le
marche-pied (p. 232) de son crédit, et il s'y prêtoit avec autant
d'aisance que s'il n'eût jamais eu d'autres inclinations. Plus la
crise étoit difficile, plus il déposoit et même avilissoit son
autorité. Le décret de la liberté des noirs, annoncé depuis
long-temps, plus redouté que la foudre, faisoit émigrer les riches
habitans, qui craignoient à juste titre d'être égorgés par leurs
esclaves, devenant vagabonds et furieux, comme une bête vorace hors de
sa cage. Jeannet se trouvoit entre l'enclume et le marteau: d'un côté,
les anarchistes qu'il détestoit dans son âme, et avec qui il s'étoit
trop popularisé, dissipateurs ici comme en France, soupirant après le
décret, dans l'espoir du pillage, l'assiégeoient sans cesse, pour
savoir quand et comment il le proclameroit. Il avoit lui-même
désorganisé le bataillon d'Alsace, en substituant un nouvel état-major
à l'ancien, qu'il avoit fait déporter comme aristocrate. La société
populaire, dont la troupe faisoit partie, avoit fait choix de ses
créatures. D'un autre côté, les vrais habitans le sollicitoient de ne
pas recevoir le décret, et lui offroient des fonds. Il leur en avoit
fait la promesse, aussi bien qu'au gouverneur de Surinam, dont il
ménageoit (p. 233) l'alliance, quoique la France fût alors en guerre
avec la Hollande. Il avoit reçu avis que des bâtimens Hollandais
stationneroient devant Cayenne, pour capturer l'aviso, porteur de la
liberté des nègres. En les voyant paroître, le 28 mars, il annonce une
grande conspiration, pour jetter l'alarme dans les cantons. Quelques
riches propriétaires prennent la fuite, sont déclarés émigrés; il
confisque leurs habitations, et achève de s'affermir comme il le dit,
après avoir connu les hommes et les choses. Pour faire sa bourse, il
avoit créé, le 5 septembre 1793, pour trois millions de billets qui
ont achevé de ruiner la colonie en 1795. Du même coup, il séquestre
l'habitation de la Gabrielle, appartenant à M. Lafayette, qui rapporte
300,000 fr.; fait rentrer une partie de la dette arriérée, ferme les
portes de l'assemblée coloniale, retourne les caisses, change les
tribunaux. Enfin il alloit achever sa riche moisson, comme il le dit,
au moment où vint le fameux décret. Copions ce qu'il en rapporte
lui-même, dans son compte rendu, page 6:
«Ce fut le 25 prairial an 2, à six heures du soir, qu'Apolline,
capitaine de la corvette (p. 234) l'Oiseau, me remit le décret de la
liberté des nègres, sans aucunes instructions, et avec ordre de le
faire aussi-tôt promulguer. Le 26, à six heures du matin, le bataillon
étant sous les armes, je proclamai moi-même le décret de liberté, en
déclarant traître et infâme à la patrie, quiconque tenteroit un
instant de s'opposer à son exécution.»
La proclamation se répéta de suite dans tous les cantons. Alors la
colonie fut à la débandade; quelques commissaires, porteurs de ce
décret dans la grande terre, loin de préparer les nègres à ce passage
subit et redoutable de la dépendance à la liberté, les enlevoient des
ateliers, les indisposoient contre leurs maîtres, leur crioient avec
emphase: Vous êtes libres, faites maintenant ce que vous voudrez.
Jeannet admettoit à sa table, à ses côtés, dans son conseil, les noirs
de préférence aux blancs. Les nègres étoient si bien pliés au joug,
qu'ils crurent pendant deux mois que ce qu'ils voyoient n'étoit qu'un
songe. Personne n'osant leur parler d'ouvrage, ils commencèrent à
vouloir se débarrasser de tous les blancs, de peur de rentrer dans
l'esclavage. On vit les (p. 235) cantons fermenter, les habitans
s'enfuir dans les bois, les esclaves armés courir d'un bout à l'autre
de la colonie, pour faire, disoient-ils, la chasse à leurs maîtres,
qui se réfugioient à Cayenne, où ils n'étoient pas plus en sûreté.
Jeannet écoutoit les plaintes des blancs, leur faisoit de belles
promesses, et donnoit de légères réprimandes aux noirs. Le capitaine
Apolline lui avoit apporté aussi la nouvelle de la mort de son oncle
Danton, à qui il devoit sa place: ils font bien de se défaire de tous
les conspirateurs, dit-il. Cette réponse n'étoit que sur ses lèvres,
car il lui donna long-temps des larmes en secret, et résolut dès ce
moment de mettre ordre à ses affaires, pour s'enfuir dans les
États-Unis. Le girofle de la Gabrielle n'étant pas encore prêt, il
ajourna son départ en brumaire an III. Son dessein transpira, il n'en
fit point mystère, il se concilia de plus en plus les nègres et la
société populaire, dont il étoit l'âme, écoutant sérieusement les
folies que les noirs y vociféroient dans leur jargon. L'un y demandoit
que les femmes blanches, qui se reposoient depuis si long-temps,
fissent à leur tour la cuisine aux nègres; un autre sollicitoit un
arrêté pour le (p. 236) partage des habitations; un troisième trouvoit
mauvais que son ancien maître mangeât encore dans des plats d'argent,
et lui, dans une gamelle. L'agent se contentoit de rire, mais un
dernier orateur lui poussa trop vivement la botte:—Je suis libre,
citoyen agent.—Oui.—Je puis me faire servir aujourd'hui.—Oui, en
payant, et je serai moi-même à tes ordres pour de l'argent.—Citoyen
Jeannet, ce n'est pas toi que je veux, s'il arrive des nègres, je
pourrai en acheter à mon tour.—À ces mots Jeannet s'élance à la
tribune, pérore long-temps sur le prix de la liberté, et termine par
cette sentence: «Je crains bien que la mère-patrie n'ait versé son
sang pour briser les fers d'une classe d'hommes qui ne mérite que
l'esclavage, et qui ne connoît que le bâton.»
Les cultures étoient abandonnées, l'orage grossissoit, la terreur
grondoit dans le lointain, la troupe n'étoit point payée, l'argent des
prises avoit été dissipé, la récolte étoit serrée. Jeannet avoit des
fonds, il termina sa session par une fuite, et fit légitimer ses
rapines par un prétendu compte rendu que j'ai sous les yeux. Cette
manière de s'y prendre est originale; le (p. 237) bataillon qui étoit
presque nu s'opposoit à son départ; il assemble le département, lui
dit qu'il va en France pour solliciter des fonds pour la colonie, que
les caisses sont vides pour le moment, mais qu'il y a plusieurs
recettes sûres (en parlant du produit des récoltes) dont
quelques-unes sont prochaines (il touchoit à ses coffres en parlant);
d'autres éventuelles sur lesquelles il est raisonnable de compter
(les prises que les corsaires devoient faire). Le département fait
imprimer ce petit compte. Il pare à tout par un prompt départ, et fort
de cette pièce auprès du directoire, se fait renommer agent, revient
en 1796 remplacer Comtet à qui il avoit remis ses pouvoirs à la fin de
1794, comprime les nègres, et fait ressentir sa colère à
Collot-d'Herbois et à Billaud-Varennes qui avoient presque gouverné la
colonie pendant son absence.
Le premier de ces deux exilés est péri à Kourou d'une mort violente,
avant notre arrivée; l'autre est resté long-tems à Synnamari avec les
seize premiers déportés. Ce contraste peut intéresser le lecteur; j'en
dirai un mot dans la suite.
Revenons à l'état actuel de la colonie. Les (p. 238) nègres, d'abord
classés à vingt sous par jour; le sont aujourd'hui à six, à cinq et à
trois; ils ne peuvent sortir de chez les maîtres qu'ils ont choisis,
que faute de paiement ou de gré à gré. Ils ne peuvent aller d'un
canton dans l'autre sans permis. Le fouet est remplacé par la prison
sur les habitations ou par la franchise, maison de correction où ils
travaillent au dessèchement des terres basses, et reçoivent en entrant
et en sortant soixante et quatre-vingts coups de nerf de bœuf. Ces
entraves leur font regretter les premiers jours de leur liberté; ils
travaillent peu et redoutent un nouvel esclavage qui les feroit
rentrer chez leurs maîtres qu'ils n'ont pas ménagés. Les deux partis
sont en observation: les noirs, entre la crainte et l'espérance,
ressemblent à une bête de somme qui, voyant son cavalier, fait de
légers mouvemens de tête pour ne pas laisser couler le collier de
fatigue. Leurs anciens maîtres, comme le chien en arrêt sur une
caille, attendent le signal pour les happer. Les noirs sont craintifs,
méchans et dix fois plus nombreux que les blancs. Ces derniers
désireroient que nous restassions dans l'île pour leur donner
main-forte en cas de révolte, et notre vie n'est pas plus en (p. 239)
sûreté que la leur; car les Africains nous regardent comme des tyrans.
Jeannet leur a déjà insinué cette idée en se transportant à la caserne
des soldats noirs, lors de l'arrivée des seize premiers; il y pérora
sur la conspiration du 18 fructidor, et peignit aux nègres ces
honorables victimes comme des oppresseurs qui vouloient leur ravir
leur liberté.
On imprime nos noms, la liste en sera envoyée à chaque poste de la
colonie française et hollandaise: donnons en place, celle des gens
distingués à qui les arts et la mère-patrie doivent ici des égards.
Cette mauvaise bourgade où nous croyions à peine trouver un maître
d'école qui sût lire, et un curé qui dît son bréviaire, renferme de
fins renards et des gens de mérite en tous genres. Si M. de la
Condamine revenoit sur la montagne qui porte son nom, il n'iroit pas
jusqu'à Oyapok pour trouver un homme de bon sens. MM. Noyer, Remi et
Tresse sont très-habiles en médecine: je mets les Hypocrates en tête,
parce que nous avons toujours besoin d'eux. Mentelle et Guisan pour le
génie et la partie hydraulique; Couturier-de-Saint-Clair pour sa
probité et ses talens dans le même genre; l'ancien administrateur, M.
Lescalier, (p. 240) est cher à tous les gens de bien par sa probité et
ses connoissances. Dans l'administration de la marine, Roustagnan
mérite un rang distingué pour ses lumières, ses vues claires et
philanthropiques: Richard, dans la partie du contrôle, apure bien les
comptes de l'état et les siens; sa précision, les connoissances qu'il
a de toutes les branches de l'administration, en font un homme
d'autant plus plus précieux qu'il ne s'en fait pas accroire; Lemoyne,
commissaire des guerres, natif de Versailles, joint les belles-lettres
à la connoissance du barreau et de la marine; je ne connois pas
d'homme plus sociable et qui ait moins de prétention. Ninette,
secrétaire de l'administration, seroit plus prisé s'il marioit plus de
bonne foi à ses talens et à ses opinions; il est aimable et n'a point
d'amis. M. Valet de-Fayol trouva ici, en 1782, le problème de la
longitude cherché depuis si long-tems. Le baron de Bessner, gouverneur
de la colonie à cette époque, reçut un ordre du roi, sollicité par
l'académie des sciences, pour faire repasser en France M. de Fayol qui
mourut en route d'une fluxion de poitrine. On dit qu'à la même époque
un résident à Saint-Domingue fit la même découverte et eut le même
sort. Ainsi, Chanvallon (p. 241) a raison de dire dans ses Relations
sur la Martinique, que les grands hommes ne sortent point des
colonies, qu'ils ne s'y perfectionnent pas même; mais que l'ardeur des
climats allume le feu du génie chez ceux qu'elle n'énerve pas. M.
Mignot, dit Picard, est un excellent ouvrier-artiste qui exécute tout
ce qui concerne la partie du génie avec autant d'adresse que de
principes.
En 1785, on apporta à Cayenne au jardin du roi le palmier des
Moluques, arbre rare, dont la peinture ou manquoit ou étoit
incorrecte. M. Charles Gourgue fut prié de le peindre pour le comte du
Pujet, gouverneur des enfans de France. Il exprima la mobilité, la
verdure, le dentelé des feuilles, les étamines, les pistils des
fleurs, le jet de la sève, avec tant de force et de vérité, qu'on
alloit toucher le papier. Un de ses amis, un peu incrédule sur son
talent, fut trompé comme Zeuxis par Paraphasius. L'ouvrage n'étant pas
achevé, l'artiste laisse son tableau pour aller déjeûner: l'incrédule
monte et veut ôter de dessus une feuille, une fleur de belle-de-nuit
que le peintre sembloit avoir laissé tomber d'un bouquet. Louis XVI
trouva ce morceau si frappant, qu'il breveta (p. 242) sur-le-champ la
petite-nièce de M. Gourgue d'une pension à Saint-Cyr ... Cet homme
végète à Kourou, quoiqu'il n'ait pas que ce seul talent.
La maison Lecomte se vide tous les jours. Chaque habitant vient faire
un choix ... Si je pouvois être placé chez quelques-uns de ces braves
gens, mon sort seroit digne d'envie. Nous nous associons sept, et MM.
Trabaud et Bonnefoi, à la recommandation de M. Carré (à qui je dois
autant d'éloges que de reconnoissance) nous louent leur case à Kourou,
pour y faire le commerce: mes camarades se cotisent pour eux et pour
moi, car on m'a volé mon argent et mes effets à Rochefort et dans le
pillage de la frégate. Depuis mon départ sur la Décade, je n'ai eu
qu'un louis en ma possession; nous étions trois à le partager: au bout
de deux jours il m'est resté quarante sous pour faire 1800 lieues; je
vivrai pourtant dans la Guyane pendant trois ans sans l'assistance du
gouvernement.... Ô Providence! je serois bien ingrat de te
méconnoître! Quel impie dans le malheur nie votre existence! Ô mon
Dieu! est-il rien de plus doux que de vous trouver pour consolateur?
On vend les (p. 243) montres, les boucles d'argent et les habits pour
faire des emplettes. Nos propriétaires envoient nos noms à
l'administration départementale, et moi, je vais les donner au
lecteur:
J. B. Cardine, curé de Vilaine, diocèse de Paris, âgé de 41 ans, natif
de Coumion, département du Calvados.
Jean-Charles Juvénal, chevalier de Givry de Destournelles, natif de
Laon, âgé de 27 ans.
Gaston-Marie-Cécile-Margarita, âgé de 37 ans, né à Avenay, diocèse de
Rheims, départ de la Marne, curé de Saint-Laurent de Paris.
Jean-Hilaire Pavy, âgé de 32 ans, de Tours.
Hilaire-Augustin Noiron, âgé de 49 ans, natif de Martigni, curé de
Mortier et Creci, diocèse de Laon, département de l'Aisne.
Louis-Ange Pitou, âgé de 30 ans, né à Valainville, commune de Moléans
en Dunois, district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir, homme
de lettres et chanteur, résidant à Paris.
Louis Saint-Aubert, âgé de 55 ans, né à Rumaucourt, département du
Pas-de-Calais, résidant à Paris.
Distribuons les emplois de notre futur établissement; Cardine aura
les clefs du magasin (p. 244) avec Pavy, l'un et l'autre tiendront
note de la recette et de la dépense; chaque soir, avant de nous
coucher, Margarita portera le tout sur un livre à double partie. La
société se réunira tous les quinze jours pour apurer les comptes et
prendre la balance de recette et de dépense.
Givry et Noiron iront à la chasse; Saint-Aubert taillera les arbres et
bêchera le jardin, ou se délassera à la chasse, quand l'un ou l'autre
veneur sera fatigué: Pavy fera la cuisine avec Cardine.
Margarita et Pitou iront chercher de l'eau, balaieront la case,
compteront le linge pour le blanchissage et laveront la vaisselle
tour-à-tour. Margarita sera attaché à la case, pour aider les deux
premiers à tenir les livres.
Pitou portera des marchandises à deux et trois lieues dans les
habitations, ira dans les sucreries faire emplette de liqueurs et de
sirops pour la vente et la consommation. Il s'agit maintenant de faire
enregistrer nos baux de location, et d'obtenir préalablement l'aveu de
l'agent, qui a remis ces détails au commandant de place; un soldat
nous y conduit après-midi. «Ne voyez-vous pas qu'il n'est point ici?
(p. 245) nous dit sa négresse: écoutez-le chanter dans la maison du
gouvernement; il n'est visible que depuis huit jusqu'à neuf heures du
matin, ne manquez pas l'heure.»
Le lendemain nous fûmes ponctuels: le commandant de place donnoit un
grand déjeûner: nous étions tout confus. La négresse prit sur elle de
nous annoncer; la maison retentissoit déjà du cliquetis des verres et
des bouteilles cassées. J'apperçus autour d'une grande table ronde, un
grand cercle que présidoit l'agent; tous se tenoient par la main en
chantant à plein chœur cet invitatoire bachique:
Voulez-vous suivre un bon conseil?
Buvez avant que de combattre,
À jeûn je vaux bien mon pareil,
Mais quand je suis saoul, j'en vaux quatre.
Versez donc, mes amis, versez,
Je n'en puis jamais boire assez. bis.. bis..
Quel pauvre agent et quel soldat!
Que celui qui ne sait pas boire,
Il voit les dangers du combat
Et moi, je n'en vois que la gloire.
Versez donc, etc....
Le bon goût que je trouve au vin!...
Si le poisson le trouve à l'onde,
Il a le plus heureux destin
De tous les habitans du monde...
Versez donc, etc...
(p. 246) Cet univers, ho! c'est bien beau!
Mais pourquoi dans ce grand ouvrage
Le Seigneur y mit-il tant d'eau?
Le vin m'auroit plu davantage...
Versez donc, etc...
S'il n'a pas fait un élément
De cette liqueur rubiconde,
Le Seigneur s'est montré prudent,
Nous eussions desséché le monde...
Versez donc, etc...
Nous sommes expédiés en cinq minutes. «Par ma foi c'est un drôle
d'homme que ce Jeannet, nous dit en revenant la sentinelle qui nous
avoit accompagnés. Voici les convives du déjeûner: le capitaine du
corsaire la Chevrette, qu'il avoit mis au fort il y a deux jours, et
voici pourquoi; il amène une prise dans le port; on met le scellé à
bord du bateau: l'argent disparoît; Jeannet mande ce capitaine: il y
a de grands fripons à votre bord, monsieur, lui dit-il; ce sont les
petits, citoyen agent, les grands sont à terre; il l'envoie au fort
pendant deux heures, puis il le rappelle, et lui répète sa réponse:
les grands sont à terre; ce n'est pas moi, puisque je n'ai qu'une
main; elle en vaut dix, citoyen agent, reprit le capitaine; Jeannet
se mit à rire; et ce matin ils (p. 247) déjeûnent ensemble. Son voisin
à gauche est un habitant qui avoit écrit contre lui au ministre, quand
il s'en alla d'ici, en 1794. Jeannet a eu les lettres bien signées de
cet homme, les lui a montrées il y a deux jours, les a déchirées en sa
présence, l'a retenu à dîner avec lui, lui a protesté qu'il ne s'en
souviendroit jamais, et ce matin ils déjeûnent ensemble. Je ne sais
pas comment ils peuvent tenir à toutes ces fêtes; ces festins durent
depuis six mois, et ils n'ont pas de fonds pour nous payer sept sols
et demi par jour. Vous les avez vus à table; ils ne se lèveront qu'à
minuit; le couvert ne s'ôte jamais. Les quarteronnes iront partager
le dessert. Quand ils seront las d'elles, ils iront au billard, de-là
à table, au lit, puis à table, au lit, au jeu. La bureaucratie en fait
autant; voilà comme l'habitant et le soldat profitent des prises
faites sur l'ennemi. La Chevrette a amené dix portugais chargés de
vins, de comestibles et d'or; tout a descendu à Surinam pour être
vendu: la moitié des piastres sera pour l'agent, le quart pour les
employés, et le reste tombera à la caisse. Ainsi, l'or leur vient en
dormant. Quelle (p. 248) différence de la vie d'un déporté et d'un
soldat à celle d'un agent!....»
Sous ce point de vue, le séjour de Cayenne peut fixer bien des gens de
mérite: ubi benè, ibi patria (dit Epicure). Nous partons demain pour
Kourou.
Neuf Thermidor an 6, (27 juillet 1798.)
Le petit jour ne nous surprend pas au lit, nous faisons plus d'apprêts
que si nous allions à la noce, la joie de recouvrer la liberté et un
noir pressentiment d'un avenir malheureux gonflent notre cœur. Six
heures sonnent, Clérine fait l'appel, et nous enjoint de lui remettre
et la vaisselle et le hamac que la nation nous a prêtés; les
serpillières de la Décade nous serviront de couchettes; nous n'avons
les vivres que pour ce matin, parce que nous dînons en ville chez nos
propriétaires. À trois heures après midi, nous nous embarquons pour
Kourou, nous sommes treize personnes avec notre bagage dans un canot
aussi petit qu'une barque de meunier, on pousse au large et Cayenne
s'éloigne.
Notre mauvaise coque est si chargée, que l'eau n'est pas à un pouce
du bord; nous (p. 249) sommes à l'embouchure d'une rivière
très-rapide, agitée par un vent violent; il y a douze lieues de mer
jusqu'à Kourou. La grande terre forme une pointe à une lieue au
nord-ouest. La route par terre est plus courte, mais il faut passer
sur un sable mouvant, nous entrons dans la crique Méthéro, petite
saignée faite par le reflux de la mer. Cette crique est entourée
d'islets. On respire la fraîcheur et la paix sur ces bords couverts de
palétuviers rouges dont les racines sans fin s'entrecroisent et
descendent de la cîme jusqu'au fond de l'eau vaseuse, nous y
débarquerons; chacun frappe de son pied la terre et casse une branche
de bois vert en s'écriant: «Nous ne mourrons pas sans avoir mis le
pied dans l'Amérique». Margarita revient avec moi dans le canot, pour
escorter le bagage. Nous rentrons en mer, et nous voguons à pleines
voiles, au bruit du canon du neuf thermidor. Nous sommes à deux lieues
et demie de Cayenne.—«Mon ami, dit Margarita, il y a quatre ans à
pareil jour et à pareille heure, le tocsin sonnoit à la commune et à
la convention, nous étions entre deux écueils; aujourd'hui nous sommes
dans une frêle nacelle, exposés aux vagues d'une mer écumante ...»
Une douce mélancolie nous (p. 250) fit rêver à ce rapprochement ... Si
l'homme lisoit au livre des destins, que de chances il voudroit
éviter!... que de chagrins le rongeroient dans le cours de ses
triomphes ou de ses plaisirs!.. Seroit-il plus juste? Il deviendroit
plus ombrageux sans être plus parfait. La lune entre deux nuages
d'argent, poursuit tranquillement sa carrière et nous laisse promener
nos regards sur le vaste Océan et sur le rivage planté de grands
arbres dont la verdure nous paroît d'un gris sombre. Un nuage plus
noir que l'ébène étend son vaste rideau sur la plaine éthérée. Le vent
souffle, nous sommes inondés et bientôt arrêtés par le calme. Nos
rameurs sont en nage sans pouvoir avancer ... Cependant nous avons
encore six lieues jusqu'à notre destination, après mille efforts nous
entrons enfin dans l'embouchure de la rivière de Kourou, ce passage
est extrêmement dangereux; à deux heures du matin nous approchons du
Dégras. Où est notre case? Qui va nous l'indiquer? Que faire le reste
de la nuit? Quelle consigne va nous donner la sentinelle? Nous voilà à
Kourou..... Mais je ne vois que des bois; serons-nous libres ou
assujétis aux caprices des soldats....?
Nous mourons de soif, Margarita reste dans (p. 251) le canot. Comme
la marée est basse, le rivage est couvert de vase, deux nègres me
chargent sur leurs épaules et me conduisent au poste; je regarde avec
étonnement ce Kourou si fameux dans l'histoire de la colonie de 1763.
Des herbes de la hauteur et 2 et 3 pieds obstruent un petit sentier
qui est la grande route. Quel désert, mon Dieu! À la distance de deux
portées de fusil, je n'ai trouvé que huit mauvaises loges de
sabotiers; voilà Kourou!... Nous passons à côté de l'église; la
bâtisse en paroît jolie, elle est fermée ... Plus loin un grand
bâtiment long comme un boyau sert de magasin, de corps-de-garde et de
caserne; un nègre à moitié endormi auprès d'un feu couvert de cendre
me crie qui vive, je demande l'officier. Il se lève et me conduit à
notre case; un troupeau de bétail parque dans notre jardin; le vacher
occupe la maison, il dort d'un profond sommeil, ce spectacle me navre
d'effroi. Comment vivre sept dans un pareil désert? Je vais retrouver
Margarita, le passager nous ouvre sa case, fait débarquer notre
bagage, nous invite à nous reposer jusqu'au jour.
Nous sommes enfin libres et sans gardes (p. 252) sur la terre qui
confine à l'Asie: si nous avions des ailes, nous serions bientôt en
Europe.... Que sont devenus nos camarades? Ne se sont-ils point égarés
dans les forêts? Au bout d'une heure nous retournons voir le village;
la lune éclaire toute la solitude des huttes.... Une seule case est
entourée de fleurs et d'arbres de luxe.
C'est sans doute la maison du seigneur du canton. L'avenue de la nôtre
est plantée de deux rangs de cocotiers, palmiers dont le corps droit
comme une flèche, et gros comme un tilleul de vingt ans, s'élève à
cent-vingt pieds en l'air; ses branches confondues avec ses feuilles,
longues de vingt pieds, coupées en lance à trois tranchans, forment un
bouquet à sa cîme, qui se termine en aigrette. Sa fleur qui ressemble
à un épi en maturité, est couverte d'une enveloppe faite comme un
parasol qui la garantit de la tempête; son fruit, rond dans
l'intérieur, est couvert d'une enveloppe triangulaire, filandreuse et
extrêmement tenace; il ressemble à une grappe de raisin du poids de
trente livres. Cet arbre est toujours en rapports et en fleurs. Au
bout de douze ans, il est dans son adolescence; alors son tronc se
dégage des branches ou feuilles (p. 253) gourmandes; les grappes les
plus près de la terre, pèsent sur le dernier rang de feuilles, qui
sèchent et tombent à mesure que la cîme enveloppée d'une toile comme
nos canevas, brise sa natte deux fois par mois, pour éjaculer une
nouvelle sève. Le cocotier n'est point hérissé de piquans comme les
autres palmistes, à qui il ressemble pour la feuille, et dont il
diffère pour le fruit. Il donne, comme le Maripa et le Tourlouri, le
fameux vin de palme, dont les Africains sont si gourmets.[19]
La fatigue nous invite au sommeil; la curiosité, le chagrin, le
plaisir de marcher sans gardes, nous font braver les insectes et
oublier les douceurs du repos; nous nous enfonçons dans (p. 254) un
bois touffus ...; la route est pleine de sable, les oiseaux de nuit
marient leurs voix lugubres à notre sort; nous retournons chez le
passager après avoir fait mille et un projets comme la laitière au pot
cassé. Le jour tarda trop à luire, nous dormons sur une chaise; les
coqs nous réveillent, ils sont les seules horloges du pays; ils ont
chanté trois fois; le pierrier du poste annonce le jour, nous secouons
l'oreille pour aller nous montrer au maire, comme le lépreux à
Jésus-Christ.
Le maire est le premier officier civil, il inspecte les habitations et
les travaux, reçoit les plaintes pour les griefs ou crimes civils
veille à la police des cantons de la colonie. La force armée est à sa
disposition. Le juge de paix prononce en dernier ressort sur les
affaires de police correctionnelle; quand un blanc est aux prises avec
un nègre, il appelle des assesseurs qui sont nommés par le canton. Ces
deux officiers seuls sont payés par le gouvernement.
Le maire de Kourou se nomme Gourgue; son habitation est au milieu du
bois, au nord du poste dont il est éloigné de trois portées de fusil,
et entouré d'une crique hérissée d'une forêt de palmistes armés de
longues épines. (p. 255) Le boulanger des militaires nous conduit à sa
case qui tombe en ruines. Il revient de son jardin le dos voûté, un
long bâton à la main, comme un semeur de ses champs; il nous fait
déjeûner, s'excuse de la frugalité de son repas sur la misère des
colons, et se résume par cette prophétie: «Vous n'avez pas les
vivres!.. malheureux! vous végéterez ici pendant l'été ... mais
l'hiver ... nous vous aiderons ... nous sommes ruinés.»
Nous retournons prendre possession de notre case. Sur notre passage à
droite, à vingt pas, deux blanches, qui ont quelque chose des
européennes, sont sur le seuil de leur porte, les jambes et les pieds
nus; elles nous regardent, se parlent tout bas et rentrent annoncer au
mari renfermé dans la case, qu'elles ont vu deux étrangers.... C'est
une merveille dans ce pays où l'on reconnoît au bout de trois jours la
marque des souliers qu'un européen imprime sur le sable. Ces dames
sont l'épouse et la fille d'un vieillard de soixante ans aveugle,
infirme et extrêmement aimable...... Bonne nouvelle.... nous leur
devons une visite..... ce sera pour demain. Voyons notre logis et
apportons notre mobilier.
(p. 256) Une haie de très-grands citronniers ceintre notre jardin,
dont le sol sablonneux est engraissé par le bétail à qui il sert
d'étable, car les troupeaux couchent toujours en plein air. Les arbres
fruitiers qui faisoient l'ornement du jardin, ont été coupés par un
homme de couleur qui habitoit la case avant nous. Les oranges et les
citrons couvrent la terre. Des lianes et des brousses étouffent l'air,
tout est en désordre; l'extérieur ressemble à l'approche d'une grotte.
La case est propre, spacieuse, composée, d'un petit magasin de trois
chambres, d'un grenier assez grand elle est couverte en bardeaux.
Au bout de deux heures notre bagage est en place; un seul nègre a tout
apporté. Un pain d'une livre et demie, deux fromages tête-de-moine,
six flacons de genièvre, six flacons de tafia, cinquante livres de
cassonade, quelques chaudières, douze bouteilles d'huile d'olive, deux
jambons, une caisse d'huile à brûler et 100 livres de riz sont nos
provisions de bouche. Une partie de ces denrées est destinée au
commerce.
Quatre pièces d'indienne, quatre de toile, deux de coton bleu, trois
poignées de fil mélangé, (p. 257) sont notre fonds de boutique; voilà
nos provisions de sept pour 3 ans. Notre case est vide, heureusement
que nous avons trouvé un vaisselier, un buffet, des bancs et des
tables, qui sont attachés à la maison, sans cela nous siégerions à
terre. Que vont dire nos compagnons? Sur quoi allons nous coucher? Nos
serpillières de la Décade sont toutes mouillées des vagues qui sont
entrées cette nuit dans le canot. Quelle perspective! Nous refermons
la case, nous promenant pour nous promener. Bourg, brave homme, nous
retient à dîner, il n'a qu'un morceau de poisson boucané et de la
cassave (pain de racine, plat comme du pain-d'épice, sec comme du bran
de scie, qu'on mouille pour qu'il n'étrangle pas). Margarita, en me
regardant a les larmes aux yeux; il ne peut manger de cette cuisine;
je parois m'y conformer sans répugnance, quoique mon cœur bondisse:
ces pauvres gens s'en apperçoivent, nous apportent un morceau de pain
frais, de l'huile et du vinaigre pour assaisonner le poisson; après
dîner, ils nous enferment pour nous laisser reposer.
À cinq heures, nos camarades hèlent à l'autre bord, nous nous levons
pour les recevoir, (p. 258) la rivière en cet endroit est trois fois
large comme la Seine, au quai de l'École; au bout d'un quart-d'heure,
ils sont à notre dégras; nous nous embrassons en nous racontant nos
dangers; ils ont failli périr de fatigue au milieu des sables; les
habitans les ont bien accueillis, ils sont exténués; ils ont bien dîné
chez une négresse libre nommée Dauphine. Il ne nous reste que 5 liv.
pour la maison.... mais le commerce nous rendra des fonds......
Bourg nous donne à souper, une indienne nous prête deux hamacs,
chacun se blottit comme il peut; la fatigue nous accable, le plaisir
de la réunion attire le sommeil, demain nous examinerons le local.
29 juillet. Au point du jour, chacun prend son emploi: nous buvons
un petit verre de tafia pour la dernière fois. Givry et Noiron partent
pour la chasse, St. Aubert s'arme d'une serpe et d'une bêche;
Margarita et moi allons au puits de Préfontaine, ensuite à la
provision chez le pêcheur qui a pris un machoiron jaune de 40 livres,
à 4 sols la livre, suivant la taxe ordinaire. Nos voisins nous
apportent une douzaine de cassaves ..., des habitans, à deux lieues
sur l'anse, nous envoient du sirop, du (p. 259) riz, de la vaisselle.
L'ancien chirurgien de ce poste, M. Gauron, nous fait apporter trois
matelas et un hamac. Nous voilà pourvus de lits et de vivres pour
quelques jours. Les brèches du jardin sont bouchées, les citronniers
tombent sous la serpe; dans peu on soupçonnera enfin qu'il y a des
vivans à la case S. Jean, dont les limites touchent au cimetière.
Nous visitons les alentours de notre domaine; à l'ouest-nord nous
sommes bornés par un bois épais et marécageux; à l'est les palétuviers
nous dérobent les bords de la mer; au midi la rivière coupe notre
passage; au nord une forêt de palmiers s'étend jusqu'à l'anse. On n'y
découvre aucuns vestiges de la splendeur de ce séjour, où quinze mille
hommes débarquèrent autrefois. Nous n'avons qu'un pas à faire pour
voir la grandeur des tombeaux qu'on leur creusa. Rendons visite aux
morts.
Au milieu de l'asile du silence est une chapelle très-solidement bâtie
des débris de l'hôpital de la colonie de 1763, et couverte de
palmistes; l'obscurité que le hasard y ménage, imprime le respect, et
fixe l'attention. Nous y entrons, après avoir lu sur les deux battans
de la porte: Temple dédié à la bonne mort. Un autel (p. 260) fait
face; à droite un vieux guerrier grossièrement modelé en terre, laisse
tomber son casque, et paroît s'ensevelir, en disant aux curieux: Vous
viendrez ici avec moi (nous avons peur que sa prophétie ne
s'accomplisse); à gauche une femme modelée de même joint les mains, et
bénit le moment qui la délivre de la vie. Le jugement dernier est
grotesquement barbouillé sur les murs; Dieu y descend au milieu d'un
nuage de lumière, précédé de l'ange qui sonne de la trompette: Morts
levez-vous. L'enfer à la gauche de Dieu, est représenté par un feu
ardent où la justice divine précipite des prêtres, des cardinaux, des
papes, quelques rois, et très-peu de militaires. Ainsi chacun se fait
une idée de Dieu suivant son intérêt; les arts sont donc venus habiter
ces déserts? Les trappistes ne mettent pas tant d'art en creusant
chaque jour leurs tombeaux. Qui repose ici?.... C'est M. de
Préfontaine et son épouse.... L'admirateur de Voltaire, le bel esprit
de Cayenne, l'auteur du plan de la colonie de 1763. Mais respectons
ses mânes. Nous allons dîner chez M. Colin qui nous en dira plus long.
Ce vieillard est de Caen; il a épousé en premières noces, une
demoiselle de Châteaudun: (p. 261) il est privé de la vue, il me serre
les mains en pleurant de joie, de ce que je lui apprends de la famille
de sa première femme nommée Beaufour. Comme il est contemporain de
Préfontaine, nous parlons du cimetière; et il nous met sur la colonie
de 1763. «Quoique Préfontaine fût mon ennemi, dit-il, je lui rendrai
justice, il n'est pas cause des malheurs de la colonie de 1763. Si le
ministre Choiseul l'eût écouté, Cayenne et Kourou seroient florissans;
il avoit demandé trois cents ouvriers, et des nègres à proportion pour
leur apprêter l'ouvrage; chaque année en ayant fourni un pareil
nombre, auroit fait affluer les étrangers; la Guyane inculte et
hérissée de piquans, se fût peuplée peu-à-peu; le commerce et
l'industrie auroient donné la main aux arts; la grande terre seroit
devenue aussi habitable que Cayenne; nous aurions remonté le haut des
rivières sans nous borner aux côtes: pour cela, il falloit marcher pas
à pas, c'étoit le moyen de trouver des mines d'or dans la fertilité
inépuisable de ce sol. Le gouvernement français voulut agir plus en
grand, afin de recueillir tout de suite le fruit de son entreprise.
Il ouvrit un champ (p. 262) vaste à l'ambition et à la cupidité. Le
sol de la Guyane, renommé depuis un siècle, servit à faire revivre le
système de Law sous une autre forme. Chaque particulier reçut une
promesse de tant d'arpens de terre qu'il pourroit cultiver avec les
avances de l'état, à qui il remettroit, ou ses propriétés en France,
ou une somme remboursable à Cayenne. Si la colonie réussissoit, cent
mille particuliers venoient déposer leurs fortunes au trésor royal
pour acheter des terres dans la Guyane; ainsi le gouvernement vendoit
cher à gage un désert inculte; d'ailleurs c'étoit un asile pour les
Canadiens, dont le pays venoit de tomber au pouvoir des Anglais. Si la
colonie ne réussissoit pas, on s'en prenoit au gouverneur qui ne
manquoit pas de fonds pour cette grande entreprise; voilà les vues
secrètes que la politique donne au cabinet de France.
»Les quinze mille hommes débarqués ici, et aux îles du Salut ou du
Diable, à trois lieues en mer, ont été gardés dans l'intention de les
acclimater, puis de les faire travailler quand ils auroient passé à
l'épreuve des maladies du pays. Cette colonie de Kourou (p. 263) a
coûté trente-trois millions; tout a échoué par la mauvaise
administration des chefs et par le brigandage des commis et des
fournisseurs, et plus encore par la mésintelligence de Turgot et de
Chanvalon. Le premier vouloit commander au second qui se croyoit
maître absolu. Il avoit donné pour limite aux débarqués, tout le
terrain de la rive gauche de la rivière Kourou jusqu'à l'anse. Cette
forêt qui nous obstrue le jour, étoit rasée jusqu'aux rochers. J'ai vu
ces déserts aussi fréquentés que le jardin du palais Royal....... Des
dames en robe traînante, des messieurs à plumet, marchoient d'un pas
léger jusqu'à l'anse; et Kourou offrit pendant un mois le
coup-d'œil le plus galant et le plus magnifique; on y avoit amené
jusqu'à des filles de joie. Mais comme on avoit été pris au dépourvu,
les Karbets n'étoient pas assez vastes, trois et quatre cents
personnes logeoient ensemble. La peste commença son ravage, les
fièvres du pays s'y joignirent, et la mort frappa indistinctement. Au
bout de six mois, dix mille hommes périrent tant aux islets qu'ici;
Turgot fit prendre Chanvalon la nuit de Noël, quand la (p. 264) mort
étoit lasse de moissonner. La Guyane est toujours un pays mal-sain qui
dévore dans l'année la moitié de ceux qu'on y envoie. Vos ennemis qui
connoissent bien ce séjour, espèrent qu'il n'échappera aucun de vous;
ils se trompent sans doute, mais ils avoient sous les yeux le tableau
de ceux qui ont survécu à cette déportation volontaire.
Jusqu'au 22 décembre 1763, époque de l'arrivée de Chanvalon,
15,560 personnes; au 24 décembre 1764, 2,000 rembarqués même
année. Établis à Synamari, 200. 100 morts dans la même
année. 100 enrôlés dans les bataillons.
260 répartis à Cayenne et dans les autres cantons.
En 1765, 300 vivans y compris les enfans nés depuis
l'établissement de la colonie.
Total général des morts de 1763 à 1764 13,060
Rembarqués 2,000
Vivans jusqu'à ce jour 30 sur. 15,560
»Cayenne et les cantons de la Guyane ne contiennent pas plus de 800
blancs, y compris (p. 265) les enfans. Les quatre cinquièmes trois
quarts sont des Européens débarqués depuis cette époque; ainsi ces
quinze mille malheureux, tous à la fleur de leur âge, sont morts sans
postérité. Les ravages de la peste étoient si effrayans, qu'aucun
registre de décès n'a été tenu, par la mort subite du premier, du
second, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième commis à
qui la cédule étoit remise. Celui qu'on dressa l'année suivante à
Cayenne, fut rédigé sur le témoignage de deux personnes prises au
hasard parmi ceux qui restoient: de-là les contestations qui ont
divisé tant de familles en France et en Canada.»
Ce tableau effrayant est peut-être l'image de la destinée des déportés
à Konanama! Le vieillard nous détailla ensuite les causes de
l'épidémie qui les moissonna, leur destination, leur genre de vie,
l'arrestation de Chanvalon par Turgot qui le fit prendre au milieu
d'un grand repas. Pendant son récit, je me grattois les pieds de
toutes mes forces; madame Colin et sa demoiselle, se mirent à rire,
appellèrent une négresse et lui dirent de m'arracher les
chatouilleuses de la colonie de 1763. Elle s'arme (p. 266) d'une
épingle bien pointue, m'assujétit le pied sur son genou, me coupe les
ongles jusques dans la chair vive, y cerne une fosse ronde de la
largeur d'une lentille, d'où elle tire un sac blanc. J'apperçois un
insecte de la grosseur d'une pointe d'aiguille; le sac est la maison
que l'animal s'est bâtie entre cuir et chair; il est plein d'œufs
qui échappent à nos yeux, ce qui me feroit croire que Mallesieux avec
un bon microscope a pu voir des milliers d'animaux sur la pointe d'une
aiguille. La démangeaison que j'éprouvois étoit occasionnée par la
trompe incisive de ce petit animal. Son extraction me fit beaucoup de
mal, c'est l'amusette des créoles, mon pied en étoit couvert; la
négresse fut plus d'une demi-heure à m'arracher ces piquans de cendre
appellés chiques et niques. Elle frotta mes pieds sanglans avec de
l'huile amère de Carapa. Cet incident nous remit sur la question de la
colonie de 1763. «Nos créoles, reprit le vieillard, vous caresseront
ainsi jusqu'à ce que vous soyez acclimaté; ayez soin de visiter vos
pieds tous les jours; sans cette précaution, au bout d'un certain
tems, ces insectes engendreroient des vers, et la gangrène suivroit.
Ce fléau a moissonné une (p. 267) grande partie des colons de 63. La
mal-propreté des Karbets, le nombre des malades, la sensibilité de
quelques-uns qui pleuroient pour une égratignure, firent pulluler
cette vermine au-delà de ce qu'on imagine. Enfin elles s'attachèrent
aux parties internes de la génération; plusieurs femmes furent rongées
de vers, et finirent de la manière la plus déplorable. En peu de
jours, une seule chique entreprend toute une partie du corps, elle ne
meurt jamais sans avoir été extirpée et écrasée. Un capucin arrivé
ici, qui avoit lu ce qu'en dit le père Labat, voulut retourner en
France avec une de ces chatouilleuses; elle lui occasionna un malingre
si compliqué, qu'on fut obligé de lui couper la jambe avant qu'il mît
pied à terre. Joignez à ce fléau, la peste, les fièvres chaudes et
putrides, les ravages de la mort vous étonneront moins; ils ne
vivoient que de salaisons; le scorbut gagnoit les Karbets, et la
mortalité fut si grande, que, soir et matin, un cabrouet ou tombereau,
précédé d'une sonnette passoit dans le village avec quatre chargeurs,
qui crioient: Mettez vos morts à la porte.
(p. 268) »On rangeoit les colons en deux classes: les pauvres, les
ouvriers et les vagabonds étoient injustement confondus et engagés
pour trois ans au service de ceux qui avoient laissé leurs biens ou
leur argent en France; on les avoit relégués sur les islets ou sur la
côte, et leur liberté étoit beaucoup plus restreinte que celle des
riches, des protégés et des bailleurs de fonds qui approchoient un peu
Chanvalon et sa cour débordée, ils étoient si affamés d'alimens frais,
qu'un cambusier de vaisseau s'étant avisé de faire la recherche aux
rats, gagna 20,000 liv. à ce genre de chasse, en vendant ce gibier
jusqu'à vingt sols la pièce. (Je me suis convaincu de cette vérité
dans mes voyages, j'en trouverai la preuve chez mes compagnons dans le
désert). Turgot fut instruit de ces horreurs, la cour lui avoit donné
carte blanche, il fit entourer le gouvernement pendant qu'on chantoit
la messe de minuit; deux compagnies de grenadiers se saisirent de
Chanvalon et de tous ses commis, les conduisirent à Cayenne, et
prirent leurs registres. Préfontaine fut arrêté le même jour, et
suivit Chanvalon; le contrôleur seul, nommé Terdisien, (p. 269) si
connu par ses talens dans la musique, ne fut pas mis en prison par la
régularité de ses comptes. Ce singulier personnage, reprit le bonhomme
en riant, mérite une digression dans ce récit:
»Il devoit sa fortune à son archet; les dames de France l'ayant
appellé pour jouer, il brisa son violon, disant que le talent étoit
fils de la liberté. Madame Chanvalon l'ayant prié un jour de jouer à
sa considération, il se leva brusquement de table, et ne reparut plus
de huit jours. Après cette boutade, il vint à un grand repas où un
célèbre musicien étoit invité. Des violons étoient suspendus çà et là
dans le salon où il n'y avoit encore personne; il pince les cordes, en
trouve un à sa fantaisie, s'enferme seul dans un cabinet, et joue
jusqu'à la moitié du dîner. Il s'enfermoit souvent dans les casernes
pour divertir les ouvriers, et cessoit à l'instant où un amateur
s'arrêtoit pour l'écouter[20]. Il (p. 270) ne se piquoit de talent
qu'avec son égal ou avec son maître. Un jour, en passant dans la rue
Coquillière à Paris, il entend un musicien qui essayoit le menuet
qu'il avoit composé. (p. 271) Il monte, lui dit d'un air niais, «M.,
je voudrois me perfectionner dans le violon, me donneriez-vous
quelques leçons?» L'autre accepte la proposition; Tardisien demande un
instrument, manie son archet comme un écolier, et feint de s'accorder
avec son maître qui met le menuet sur le pupitre, en disant, «Voilà un
morceau bien difficile à exécuter.» Tous deux essaient un moment;
après quelques coups d'archets, l'écolier tourne le dos au pupitre, et
joue le menuet en compositeur.—Vous êtes Tardisien, ou le diable,»
dit l'autre en jetant son violon; Tardisien gagna la porte, et laissa
un louis pour sa leçon.
»Turgot, qui le respectoit, lui dit après l'apurement de ses comptes:
«Je suis enchanté M., de vous trouver aussi intact.» Il repassa
librement en France, tandis que Chanvalon fut trop heureux d'être
relégué pour sa vie au mont St.-Michel en Bretagne. Préfontaine en fut
quitte pour quelques tonneaux de sucre qu'il donna à son rapporteur,
pour obtenir la justice qu'il méritoit sans cela.»
(p. 272) Voilà une journée bien employée, si nous pouvions bien
reposer la nuit ...
Ce climat n'offre que l'aspect de l'intérieur d'un tombeau. Nous ne
pouvons dormir ni jour, ni nuit, des nuées d'insectes se reposent sur
les cases au commencement et à la fin de l'hivernage. Les bords de la
mer, des étangs, des rivières sont noirs de petits vers qui se
retirent à l'écart, changent d'existence et de peau dans moins d'une
heure, pour prendre des ailes, de très-longues pattes plus fines que
la soie, un aiguillon ou couteau pointu et tranchant, et une trompe
aspirante pour pomper le sang dont leur dard a brisé l'enveloppe; ils
occasionnent d'abord une crispation peu sensible, qui devient bientôt
insupportable par l'avidité de l'animal qui enfonce la conque de sa
trompe qu'il élargit encore pour se plonger tout entier dans le sang.
Si vous le laissez boire jusqu'à la satiété, il se gonfle au point de
ne pouvoir plus s'envoler. L'air pénètre dans la petite incision qu'il
a faite; le peu de sang extravasé occasionne une petite tumeur et une
démangeaison cruelle, ou plutôt une brûlure par la multiplicité des
plaies; la saleté des ongles et la malignité de l'air font dégénérer
l'égratignure (p. 273) en malingre. Si on veut y remédier en se
frottant de jus de citron, l'acidité de ce fruit ne fait pas moins
souffrir, et éloigne le sommeil. Les prairies, les bois, les maisons
sont pleines de mouches ignées; ces essaims lumineux ressemblent à des
gouttes de feu aussi nombreuses que les étangs de pluie que décharge
une nuée d'orage. L'horison embrasé offre un spectacle majestueux et
redoutable, les moustiques ou brûlots, les makes, les maringouins,
dont la piqûre est celle des cousins en France, nous forcent de
devenir naturalistes. Nous n'avions point éprouvé ces incommodités à
Cayenne, la fumée de la ville met en fuite ce nuage assassin. Ici il
faut mettre un voile épais sur ses yeux et allumer du feu avec du bois
vert ou des filandres de coco, pour boucaner la chambre; les
maringouins enivrés, se tapissent contre les murs. Quand on est jaloux
de s'encenser, on arrache la gomme du thurifer, ou bien on casse ses
branches; ce bois si vanté par la reine de Saba, est un grand arbre si
commun ici, que les habitans le regardent comme de mauvais bois; ainsi
on s'embaume en chassant les maringouins, mais les makes ne s'en vont
qu'à la fumée du piment cacarrat, espèce de poivre (p. 274) du pays.
Le soleil nous brûle durant le jour, les insectes nous dévorent
pendant la nuit, le chagrin est toujours à nos côtés.
Notre jardin est bien enclos; les citronniers sont taillés, le
commerce s'anime, mais Cardine tombe malade. La mauvaise nourriture et
la chaleur excessive de cette plage couverte de sable, altèrent notre
santé. Nous ne pouvons rien semer que dans l'hiver; notre petit enclos
est peu productif, et les légumes y viennent difficilement, comme à
Cayenne; l'été les tue, et les avalasses de l'hiver tiennent les
graines sous l'eau, et souvent les entraînent; car les torrens
viennent jusques dans notre case; d'ailleurs, les légumes seront
maigres et filandreux, malgré les soins de notre jardinier qui a déjà
les jambes perdues de chiques, et qui crache le sang. Si nous quittons
ce séjour, nous ne pourrons pas pleurer ses oignons et ses aulx, car
il n'y croît que de mauvaises petites échalotes, des choux verts et
petits, des carottes galeuses, d'excellens melons; et en tout tems,
des ignames rouges et blancs, gros comme nos topinambours, également
farineux et d'un doux agréable, des ananas, fruit délicieux, dont la
tige d'un vert plus foncé que (p. 275) nos artichauts, est armée de
piquans et présente pour fruit un cône rond en pain de sucre d'un pied
de haut, couronné d'une tige verte et armée extérieurement de bosses
régulières et de piquans distribués intérieurement en alvéoles; ce
fruit, le plus beau qu'on puisse voir, orne et parfume la table. C'est
une offrande que le vice-roi du Mexique envoie au roi d'Espagne, qui
ne peut jamais le manger aussi bon que sur les lieux. La plante qui le
produit, talle et ne s'élève pas à plus de deux pieds de terre.
L'ananas est si corrosif avant sa maturité, qu'en trois jours il fond
une lame de couteau qu'on y enfonce. Nous manquons de tafia, je vais
en chercher à la sucrerie de Pariacabo, dont la case est sur une haute
montagne entourée de superbes cafiers chargés de fleurs et de cerises
vertes, et en maturité, qui sont très-bonnes à manger. Ces cerises ou
enveloppes de café, sont douces et fournissent une fève enveloppée
d'un parchemin; on la partage en deux, pour l'envoyer en Europe. Voici
l'origine de la découverte et de l'envoi du café de l'Arabie en Europe
et en Amérique: On prétend qu'un troupeau de moutons ayant découvert
un bois de cafiers chargés de cerises (p. 276) mûres, se mit à les
brouter; et que chaque soir le berger étoit étonné de voir ses moutons
sauter en retournant à la bergerie; il les suivit, goûta à ces
cerises, se sentit beaucoup plus léger, fut surpris de retrouver au
noyau le même goût qu'à la pulpe du fruit, s'avisa de le faire groler,
en flaira le parfum, et fit part de sa découverte à un Morlak qui en
prit pour ne pas s'endormir durant ses longues méditations; l'usage du
café passa bientôt de l'Asie à l'Afrique, à l'Europe et dans les deux
mondes. Les Hollandais étant parvenus à en élever en Europe dans des
serres chaudes, et en ayant fait part à la France, ces espèces
d'entrepôts ont fourni les premiers pieds qui ont été transportés en
Amérique. L'île de la Martinique a reçu les siens du jardin des
Plantes de Paris; mais si l'on en croit une tradition assez
généralement adoptée, ceux de Cayenne lui ont été apportés de Surinam.
On raconte que des soldats de la garnison ayant déserté et passé dans
cette colonie hollandaise, se repentirent ensuite de leur faute; et
que désirant rentrer sous leurs drapeaux, ils apportèrent au
gouvernement de Cayenne quelques graines de café que l'on commençoit
à (p. 277) cultiver dans la colonie de Surinam; qu'ils obtinrent leur
grâce en faveur du service qu'ils rendoient à Cayenne, et des
avantages qu'elle pourroit retirer de cette culture: on dit aussi que
cet événement est arrivé pendant que M. de la Motte Aigron y
commandoit en chef; ce qui se rapporteroit à l'année 1715 ou 1716.
Quoi qu'il en soit, on voit par une ordonnance de MM. les
administrateurs, en date du 6 décembre 1722, qu'à cette époque «les
succès de la culture des cafiers étoient regardés comme certains, et
que plusieurs habitans en avoient des pépinières.»
Le café de Cayenne est de fort bonne qualité: il croît dans toutes les
terres hautes; il dégénère bientôt dans celles qui sont médiocres, et
ne vient bien que dans les meilleures. Comme ces dernières sont rares,
il y a peu de grands plantages en cafiers dans la colonie. Ces arbres
étant plantés et entretenus avec les soins que ce genre de culture
exige, y réussissent aussi bien que chez les Hollandais de Surinam et
de Demerari; mais le café est d'une qualité inférieure. Au haut de la
montagne, le cacoyer étend ses branches éparses, et cache, sous ses
grandes feuilles, son fruit (p. 278) brun, entouré d'une sève baveuse
et douce, enfermée dans une calotte sphéroïde canelée. Il y a lieu de
croire que le cacoyer est naturel à la Guyane: du moins est-il vrai
que l'on en connoît ici une forêt assez étendue; elle est située
au-delà des sources de l'Oyapok sur les bords d'une branche du Yari,
qui se rend dans les fleuves des Amazones. On croit que l'espèce des
cacoyers que l'on cultive dans cette colonie vient originairement de
cette forêt, parce que les naturels du pays, établis sur les bords de
l'Oyapoc, ont fait plusieurs voyages dans cette partie, soit
d'eux-mêmes pour visiter d'autres nations, soit lorsqu'on les y
envoyoit exprès pour en rapporter des graines de cacao, lorsque le
prix de cette denrée pouvoit supporter les frais de ces voyages, qui
ne sont jamais dispendieux pour ces gens-là.
Au bas de la montagne est l'arbre-à-pain qui végète entre deux gorges,
c'est le marronnier des Indes orientales: il est étouffé par des
plants d'indigo sauvage; voici quelques notions sur cette plante:
Les naturalistes l'appellent anil; sa feuille d'un vert pâle, est
sphéroïde, lisse; sa fleur (p. 279) jaune est en petits bouquets et en
grappes; sa racine est très-utile dans les maladies bilieuses; infusée
dans de l'eau, elle charie l'humeur par les voies excrémentaires.
Cette plante vient sans culture ici comme dans les autres parties de
la colonie peu éloignées de la mer, dont le sol est mêlé de sable et
de sel. Cette espèce d'herbe s'appelle indigo-bâtard, qui n'est pas
moins estimé que l'indigo-franc; ce dernier a la feuille comme notre
trèfle, est de la même verdure, mais sa fleur est rouge-violet sans
odeur: la culture de cette denrée a été entreprise plusieurs fois dans
cette colonie, et suivie avec beaucoup d'ardeur; mais pendant
long-tems ceux qui s'y étoient livrés, séduits d'abord par de belles
espérances, ont été obligés de l'abandonner après avoir fait d'assez
grands sacrifices sans précaution et en pure perte. S'ils avoient
voulu suivre les conseils de l'ingénieur Guisan, et donner aux fossés
la profondeur nécessaire et la surface aux chaussées; la mer n'eût pas
englouti les plantages, et le roi n'eût pas perdu plus de 280,000
francs.
Il est vrai que l'herbe dont on tire l'indigo use beaucoup la terre,
parce qu'on coupe cette herbe cinq à six fois l'année pour la
manufacturer, (p. 280) et que les terres de la Guyane sont
très-détériorées par les pluies prodigieuses qui y tombent pendant
plusieurs mois de l'année et par le soleil brûlant de l'été,
lorsqu'elles y sont exposées. D'après cela on voit qu'il n'étoit pas
étonnant qu'un plantage de cette nature commençât par donner d'abord
des récoltes très-flatteuses, et qu'ensuite les plants venant à
dégénérer, ses produits diminuassent très-rapidement. Cette
observation conduisoit naturellement à en faire une autre; c'est que
les pluies qui entraînent avec elles les parties les plus végétales
des terres élevées et les débris de leurs productions, doivent les
déposer sur les terrains les plus bas, c'est-à-dire dans les
marécages: ces détrimens accumulés doivent donc y déposer un sédiment
très-propre à faire des cultures permanentes. Ces marécages sont
ordinairement désignés dans la colonie sous le nom de terres basses.
On en distingue de deux sortes; les unes sont des espèces de bassins,
presque tous entourés de terres hautes et dans lesquelles les eaux de
la mer ne parviennent jamais; les autres se trouvent à portée des
côtes ou sur les bords des rivières; les marées ont beaucoup
contribué à la formation de ces dernières (p. 281) par les couches de
vase qu'elles y ont déposées. C'est en faisant des dessèchemens dans
ces deux sortes de marécages, que l'on étoit parvenu, avant la
révolution, à cultiver l'indigo avec assez de succès, particulièrement
sur les bords d'Approuague. Il seroit très-possible que malgré la
bonté de ces terres, la plante qui donne cette denrée, n'y crût pas
toujours avec la même vigueur; on ne doit pas même s'en flatter; mais
il doit suffire pour le cultivateur qu'elle s'y soutienne assez de
tems pour lui donner les moyens d'entreprendre une culture plus riche.
On sait que presque toutes les habitations à sucre de Saint-Domingue
ont commencé par être indigoteries. Montons à Pariacabo.
C'est sur cette hauteur d'où le possesseur voit tous ses travaux, que
Préfontaine a composé sa Maison rustique ornée de belles gravures.
Le peintre a flatté son Élysée: il est pourtant vrai que le
coup-d'œil de la montagne est très-agréable; la grande rivière de
Kourou en baigne le pied du côté du midi-est; à l'est-plein une
forêt de grands arbres forme un tapis de verdure; au nord une grande
prairie est plantée de palmistes; la vue n'est bornée qu'à (p. 282)
l'ouest par une autre montagne parallèle, plantée de cannes à sucre,
dont la tige et la feuille ressemblent à nos roseaux.
Les cannes à sucre viennent de l'Asie d'où elles ont passé en Europe
et dans l'île de Madère; cette dernière île a fourni une partie de
celles que les européens ont portées en Amérique: on en distingue de
deux espèces; les unes jaunes, les autres violettes; ces dernières
étoient cultivées ici par les Indiens, avant que nous eussions
retrouvé le Nouveau-Monde. Toutes croissent bien dans les hautes
terres et s'y appauvrissent ensuite; les gorges et les alluvions
desséchées leur sont beaucoup plus favorables; mais en dépérissant sur
les montagnes, elles deviennent beaucoup plus succulentes et plus
élaborées que dans les terres basses, où elles s'élèvent comme des
bois taillis; mais elles n'y donnent qu'un jus ou salé ou fade et des
liqueurs désagréables et moins spiritueuses; cependant on préfère les
terrains bas, parce qu'on préfère toujours la quantité à la qualité.
Voici comme on obtient le sucre:
La canne est noueuse comme notre sureau; chaque nœud forme une
bouture; on le couche en terre; on le couvre; il rapporte la première
(p. 283) fois au bout de dix-huit mois, la seconde au bout de quinze,
et successivement au bout d'un an. Les moulins tournent ou par l'eau
ou par les bœufs. Deux cylindres de fer, bien ronds et polis,
tournent perpendiculairement autour d'un troisième qui est immobile;
le tout est tenu par une forte maçonnerie et par des crampons de fer:
entre les pivots passent les cannes dont le jus se rend dans l'égout
du passoir qui communique aux fourneaux contigus, sous lesquels est un
feu qui les échauffe par degrés. On l'active avec le chanvre des
cannes, appelé bagasse. Le jus qui coule du pressoir, est gris et d'un
doux fade: il purge quand on en boit à l'excès; on le mélange avec
celui qui tiédit dans le second bassin, et il prend le nom de vezou.
Après qu'il a bien bouilli, on l'écume, on le passe dans un vase fait
comme un pot à bouquets, pointu et troué à sa plus mince extrémité; ce
sirop fige; on suspend le pot sur une claie; on le bouche avec une
canelle de bois mastiquée de vase. Quand il est froid, on ôte la
canelle; il en sort un sirop qu'on fait recuire pour le mettre dans
des canots avec de l'eau; il y fermente pendant huit ou dix jours: le
tout passe ensuite à l'alambic qui donne le tafia. Le gros sirop sert
encore à faire la mélasse, (p. 284) qu'on peut appeler crasse de
sucre; il est purgatif, moins agréable que l'autre, et beaucoup plus
utile en médecine. L'Amérique septentrionale produit aussi un grand
arbre semblable à notre érable, dont on obtient le sucre par des
incisions; son travail est beaucoup moins dispendieux que celui de la
canne. Sa sève coule deux fois par an, et donne un sucre blanc
agréable, mais moins corporé que celui de la canne. On dit que nous
avons obtenu aussi le sucre de la betterave, mais par des procédés
dispendieux.
L'habitation Préfontaine est nationale, et régie par le juge de paix
du canton. Les propriétaires, MM. d'Aigrepont, sont censés émigrés
pour avoir pris la fuite quelques mois avant la liberté des noirs,
pour sauver leur vie. Je retourne à la case sans emporter de tafia.
10 août. J'accompagne un de nos chasseurs dans le bois et sur les
bords de la mer; je ne puis pénétrer dans ces forêts; des ronces, des
lianes, grosses comme les jambes, m'entrelacent; des arbres touffus et
serrés ne laissent pas percer la lumière. Je cherche des fruits; et
comme le poison est à côté de l'orange, je sais déjà que mes
dégustateurs et mes guides sont les oiseaux et les singes. Quand je
vois un (p. 285) arbre chargé de fruits, je n'y touche point s'ils
n'en mangent eux-mêmes. Des bandes de sapajous se balancent dans les
mont-bins, pour chercher des prunes semblables à la mirabelle, et sur
l'acajou pour savourer son fruit jaune et rouge, aigrelet en forme de
cône tronqué à angles obtus, dont la graine faite comme une virgule,
naît avant le fruit, et pend à la base du cône suspendu par la pointe.
Ces pommes mousseuses et d'un bon goût aigrelet, aiguisent mon
appétit; leur jus est corrosif; j'emporte leur graine enveloppée d'un
parchemin; mes voisines en sont friandes; elle brûle les lèvres quand
elle est crue; rôtie, elle vaut nos amandes et sert à faire du
chocolat. Une grosse corde noire, que je prends pour une liane,
m'arrête au milieu de la vendange; je l'agite pour passer; un énorme
animal noir, velu, s'élance à grand bruit du haut de sa guérite, le
long de ce tramail..... C'est une araignée-crabe; j'ai beaucoup de
peine à rompre son pêne; ce monstre avec ses horribles accessoires, me
paroît plus gros que ma tête; nous nous sommes fait peur l'un à
l'autre; il regagne son gîte, et je crie à mon camarade. Nous visitons
les alentours de son vaste épervier; il enveloppe trois gros arbres,
et les petits cables sont artistement (p. 286) passés dans les
branches, pour arrêter les oiseaux ou les agratiches qui s'approchent
de ce redoutable labyrinthe.—Nous songeâmes à la tarentule, et à ce
monstre logé dans le cachot de mort d'un château antique, qui
étouffoit toutes les victimes que le gibet attendoit le lendemain. Un
condamné enfermé dans le même lieu, obtint sa grâce et des armes pour
lutter contre le meurtrier. Sur les minuit, une énorme bête descend
d'une antique cheminée; elle le saisit; il se défend, la frappe; on
accourt; c'étoit une araignée qui suçoit le sang des patiens, et les
plongeoit dans un sommeil homicide.
En revenant, nous prêtâmes l'oreille au chant mélodieux et plaintif
d'oiseaux qui étoient agglomérés et comme captifs sur un grand
courbari; ils descendoient en voltigeant de branches en branches; un
d'eux tomba par terre; nous vîmes un mouvement dans l'herbe, et deux
yeux plus étincelans que des diamans; une gueule béante les attendoit
pour les recevoir et les inhumer; c'étoit un serpent-grage, gros comme
le bras, qui par son regard attracteur, leur ordonnoit impérieusement
de venir se faire dévorer. Ce charme réel a peut-être fait (p. 287)
inventer aux poètes philosophes, qui ne peuvent pas plus que nous en
expliquer la cause, la fable du cygne chantant sur le bord de sa
fosse. Mais cette vertu attractive est très-commune dans les bois; la
couleuvre, en Europe, charme également le rossignol, et l'homme porte
lui-même dans ses yeux un poison très-subtil. Que deux personnes se
fixent long-tems, peu-à-peu la rétine enflammée crispera le nerf
érecteur; le rideau de l'œil ne s'abaissera plus, et celle qui aura
la vue la plus foible tombera en syncope. Je raisonne ici d'après mon
expérience.—Nous courions pour délivrer ces pauvres
victimes.—N'avancez pas, nous dit un nègre qui nous avoit
accompagnés; ce monstre se jetteroit sur vous.» Il nous en fit la
description; il est noir, marqué en carreaux comme nos grages (rapes
du pays); il fuit la société; il porte l'effroi avec lui; il ne se
plaît que dans les sombres forêts, dans les terres moètes; il se plie
en cercle sur lui-même, sa tête au milieu, pour se lancer sur le
voyageur ou l'animal qui le distrait, l'éveille ou le dérange; il
abhorre la lumière. Si durant la nuit des guides portent des flambeaux
à un voyageur égaré près d'un grage, il siffle, saute à la (p. 288)
flamme, entrelace et tue le porteur. La femelle est ovo-vi-vipare;
elle met bas en se traînant par un chemin rocailleux, comme si elle
vouloit changer de peau; ses petits courent aussi-tôt que leur ovaire
est brisé par le frottement; la mère revient sur ses traces, et dévore
tous ceux qui sont trop foibles ou trop paresseux pour éviter sa
rencontre. Pendant qu'il parloit, une troupe de fourmis coureuses
étoit à nos pieds; nous nous sauvâmes à toutes jambes de ces dangereux
inquisiteurs, aussi nombreux que les grains de sable. Elles dévorèrent
le grage, car leur nombre est tel, qu'elles tiennent souvent dans
leurs marches plusieurs journaux de terre. Si un homme épuisé de
fatigue ou pris de boisson, se trouvoit sur leur passage sans pouvoir
se sauver promptement, elles le dévoreroient. Cependant elles sont
petites, brunes, mais leur piqûre forme des bouteilles sur la peau, et
occasionne des démangeaisons âcres; enfin elles dévorent tout ce
qu'elles rencontrent. Ceux qui ont vu le pays, avoueront avec moi
s'être plusieurs fois égarés dans les bois, en prenant des chemins des
vieilles fourmilières pour des routes fréquentées.
À deux milles du village, une vache pousse un (p. 289) un meuglement
de douleur; nous étions vent à elle. Un tigre rouge lui avoit donné un
coup de griffe dans le fanon; elle perdoit tout son sang. Il passa
près de nous, emporta un de nos chiens, et disparut comme un éclair.
Nous courons vîte à la case de M. Colin, lui conter notre rencontre,
et partager notre chasse. Nous avions tué un haras, gros perroquet, et
un agouty, lièvre ou lapin du pays, qui a le poil gris fauve, le
museau noir et pointu, et les pattes luisantes, rases, sèches et
musculeuses.
L'araignée que nous avons vue, est la tarentule du pays. Sa morsure
endort et donne une fièvre apoplectique, nous dit notre vieillard;
quant au tigre qui nous a fait si grand peur, il est très-commun sur
cette côte. Il y en a de quatre espèces, le noir, qui se cache dans
le creux des rochers, et qu'on appelle hyène. Le rouge qui étoit si
nombreux en 1664, sous le gouvernement de M. de la Barre, que les
habitans de Cayenne désertèrent l'isle, pour éviter les ravages qu'il
faisoit à leurs troupeaux. M. de la Barre, pour remédier à ce
désastre, fit faire une battue autour des côtes, donna cinquante
francs par chaque tête (p. 290) de tigre.[21] Cet animal ne s'adresse
jamais à l'homme qui, par sa démarche et sa tête élevée, lui paroît
être sur l'attaque et sur la défensive. Le tigre martelé se divise en
deux espèces: l'une plus petite, qui s'attache aux côtes, est marquée
de taches plus petites, et beaucoup plus régulières que l'autre, qu'on
appelle balalou, ou tigre des grands bois, qui ressemble à celle du
Bengale. Le tigre ne s'attache qu'aux animaux vivans, et c'est une
erreur de dire qu'il creuse les tombeaux. La hyène et le chacal seuls
n'épargnent ni les vivans ni les morts..... Dans tous les pays chauds
où ils se trouvent, les cimetières sont ceintrés de murs très-élevés,
et les fosses recouvertes de très-grosses pierres. Le soir en
(p. 291) nous déshabillant, nous nous grattions jusqu'au sang. La
démangeaison augmentait à mesure que nous nous tourmentions; notre
peau étoit couverte de tiques et de poux d'agouty. Cette dernière
vermine est rouge, se trouve par milliers à chaque brin d'herbe,
s'insinue si profondément dans la peau, qu'elle occasionne souvent des
tumeurs, sur-tout aux parties velues; c'est un des fléaux de l'été de
la zone torride. Vous ne pouvez marcher dans aucune savane, sans en
être rongé, et forcé, à votre retour, de changer promptement de linge,
en arrachant premièrement chacun de ces insectes, avec la même
précaution que la chique; sans cela point de sommeil, point de repos,
point de santé. Cette vermine fait la guerre aux grands comme aux
petits animaux domestiques, mais la volaille sur-tout est sa victime,
et je crois qu'elle lui donne l'épian, peste qui dépeuple presque
chaque année tous les poulaillers de la Guyane.
Je veillois malgré moi aux cadences sépulcrales de l'horrible couple
des kouatas singes noirs et rouges, plus hideux que tous les
animaux, et fidèles comme des ramiers. Le mâle et la femelle (p. 292)
hurloient dans le fond des grands bois leurs cyniques amours. Un parc
est auprès de nous. J'étois à la fenêtre de notre grenier; une
tigresse martelée, suivie de ses deux petits, rôde autour de la case;
ses yeux brillent comme des diamans, elle regarde à ses côtés si sa
progéniture la suit. Rien n'est plus beau que cet animal, quand il
marche sans crainte, agitant sa queue, et guettant sa proie; l'ombre
des feuilles l'inquiète: elle se couche et s'élance sur une génisse
qui n'est pas rentrée au parc: lui ouvrir le crâne, l'égorger,
l'emporter, est pour elle le tems d'un clin-d'œil. Le vacher se
réveille; elle est à cent pas dans les palmistes, avant qu'il ait
ouvert sa loge. Tout le village se réveille, prend des armes, on suit
la bête aux traces de ses pattes et du sang. Elle est à deux portées
de fusil; elle a mangé la ventrêche de sa proie, et enterré le reste
sous des branches de moukaya, pour y revenir demain, dans la matinée.
Les chasseurs laissent la proie et se mettent à l'affût. Je reviens à
la case; Givry, contre son ordinaire, dormoit d'un profond sommeil. Je
l'appelle, il est sourd. La lampe n'étoit pas allumée; j'approche, je
le touche; son hamac étoit tout (p. 293) trempé. On apporte de la
lumière, il nageoit dans le sang. Deux chauves-souris grosses comme la
tête lui avoient ouvert la veine, et leur lancette soporifique lui
donnoit le cochemar. Nous l'agitons; il ouvre les yeux comme un
mourant qui renaît par degré. Quel pays ...!
25 thermidor (12 août.) Le régisseur de l'habitation de Guatimala
vient tenir compagnie à nos malades, et nous apporte la femelle du
singe rouge que son fils vient de tuer. Cet animal est aussi bon à
manger qu'il est laid; mais on en tue beaucoup plus qu'on en peut
avoir besoin; son salut est dans sa queue musculeuse; par ce moyen, il
se suspend aux plus grands arbres, où il reste jusqu'à ce qu'il soit
mort et privé de chaleur: celle-ci a du lait blanc comme neige,
très-gras, j'en tire dans un verre, il a le goût de celui de vache, il
est même plus sucré, et approche de celui de femme. Nos chasseurs
reviennent de l'affût, ils ont manqué la tigresse; elle traverse la
rivière, un tamanoir étoit sur l'autre rive: cet animal amphibie ne
pouvant se soustraire à sa rage, l'a attendue en étendant ses pattes
armées de crocs; au moment où la tigresse est venue se précipiter sur
lui, il l'a étreinte (p. 294) fortement, ses ongles sont restés dans
les entrailles de son bourreau, tous deux sont morts sur le rivage.
26 therm. (13 août.) Il y a deux jours que nos camarades sont
arrivés à Konanama; y seront-ils plus heureux que nous à la case
Saint-Jean?
Nous continuerons la visite domiciliaire de notre habitation; nous
ferons nos adieux à Jeannet qui va quitter la colonie; que nous
serions heureux de n'avoir pas sujet de le regretter! Mais
n'anticipons pas trop sur ces tems, la perspective en est trop
affreuse pour commencer à nous en occuper; cette troisième partie
finira par le départ de l'agent actuel.
15 août 1798. Nous avions enfermé notre linge sale dans une malle
qui étoit par terre; ce matin, une négresse vient pour le blanchir, je
m'apprête à compter...... Mirez, monsieur, mirez, dit-elle; je
regarde; il est en lambeaux, des poux de bois en ont fait de la
dentelle semblable à la maline de gaze estampée des marchands de
camelote du Louvre ou du boulevard. Ces insectes sont des (p. 295)
fourmis blanches qui ont la structure de l'animal dont elles portent
le nom; on les appelle poux de bois, parce qu'elles suspendent et
maçonnent leur ruche sur les plus hautes branches; leur nombre est si
prodigieux, qu'une seule ruche dans une case pleine d'étoffes met tout
en pièces dans trois jours. Elles changent souvent de demeure, leur
vieille ville sert de résidence au perroquet pour ses petits. Les
ruches sont si considérables, que deux nègres en ont leur charge;
elles sont maçonnées avec tant d'art, de solidité et de vîtesse, qu'on
ne les brise qu'avec un marteau; les ouvrières les cimentent avec de
la glu; pour activer le travail; elles se passent les matériaux de
main en main et se postent comme les hommes occupés à éteindre un
incendie; quand la ville est bâtie, toujours dans un canton bien
approvisionné, les plus jeunes vont à la découverte; si elles trouvent
aux environs un lieu plus riche que le premier, une case par exemple,
le royaume se divise en deux ou trois villes, toutes dépendantes de la
capitale à qui elles portent un tribut, en lui indiquant la
découverte. Si cette fourmi est moins dangereuse que notre teigne,
parce qu'elle n'échappe pas (p. 296) à nos yeux, elle est beaucoup
plus expéditive et plus nombreuse. Au fond de la malle, j'apperçois
des centaines d'animaux qui ont un caparaçon de parchemin d'un brun
clair et luisant; ils imprègnent ce qu'ils rongent d'une odeur fade et
musquée; je veux les prendre, ils déploient une double paire d'ailes,
et ils sont de la grosseur d'un hanneton; cette peste se fourre
par-tout, touche à tout, ronge tout, corrompt tout, on la nomme
ravets. La malle est tapissée de toiles d'araignées; je m'arme d'un
bâton pour les tuer, la négresse me dit de n'en rien faire, je ne
l'écoute pas, et je décharge ma colère sur les innocens faute
d'atteindre les coupables; après avoir jetté dans le hallier le reste
des lambeaux aux découpeuses, je rentre la malle, et trouve ma
blanchisseuse qui faisoit sauver les araignées à qui je n'avois cassé
que les pattes: «D'où te vient cette affection pour un animal aussi
hideux?—Si vous en aviez eu une cinquantaine dans vos malles, vos
effets auroient été à l'abri des poux de bois et des ravets; cette
utile ouvrière tend des filets à ces coquins qui dévorent tout, elle
ne fait de mal à personne; ses pièges sont pour (p. 297) vos ennemis
qui se multiplient à l'infini, elle vous débarrasse également des
mouches de terre qui bourdonnent à vos oreilles pendant l'été, en
creusant vos murs pour s'y loger.» Elle me fit examiner une cloison
percée de trois ou quatre mille trous et couverte çà et là de ruches
en forme de coquilles de limaçon; le bousillage étoit criblé de
lézardes, par ces insectes ailés qui ne font pas de mal au
propriétaire quand il les laisse dégrader sa case. «Les comités
révolutionnaires n'étoient pas pires, dis-je à Margarita; je ne me
serois pas imaginé en France de comparer les honnêtes gens aux
araignées dont les filets sont ou trop lâches ou trop mal tendus pour
prendre tous les coquins.» Je gesticulois en parlant, je heurte une
assez grosse mouche brune extrêmement mince par le milieu du corps et
pourvue d'un gros ventre; elle me pique le doigt avec la double scie
qu'elle tire de son arrière-train écaillé et couvert d'hermine; ma
main enfle; la négresse rit, me demande la permission de me guérir....
«Oui, oui, volontiers.—Mais, mais.—Mets-y du poil de diable si tu
veux.» Elle fourre sa main sous son camisa, frotte mon (p. 298) bras
enflammé, le picotement cesse à l'instant: au bout de quelques minutes
l'inflammation diminue. Ce remède risible est infaillible en Europe
contre la guêpe, le bourdon, l'abeille: quelques prudes en lisant ma
recette mettront mon livre de côté; d'autres, preux chevaliers, y
trouveront une cajolerie; pour moi, je n'y cherchai que ma guérison.
L'eau-de-vie est une recette plus facile à trouver et qui m'a été
aussi efficace. La mouche adrague qui m'avoit piqué, alla dans la
ruche suspendue au plancher, avertir ses compagnes qui nous
entourèrent. La négresse leur tendit la main; enivrées de cette odeur
elles s'y fixèrent sans la piquer, soit sympathie, soit ivresse, je ne
sais; mais le chien s'attache à celui qui le fait coucher sur un linge
imbibé de sa sueur, ou qui lui jette un morceau de pain trempé sous
ses aisselles. En comparant les grands objets aux petits, Henri III
devint éperduement amoureux d'une princesse à qui il ne songeoit pas
avant le bal où elle se trouvoit, lorsque sans le savoir il se fut
essuyé la figure avec la chemise qu'elle venoit de changer; une mort
prématurée la lui enleva, il ne put s'attacher à personne, et par
elle commencèrent sa honte et ses (p. 299) malheurs. Revenons à nos
mouches ... D'où nous vient cette odeur de rose? «Voilà vos donneuses
de parfum, dit la négresse, ne les agacez jamais, elles vous
laisseront tranquille et vous embaumeront pendant la nuit et à votre
réveil.» Elle disoit la vérité; ainsi le mal est compensé par le bien;
le pou de bois nous guérit de la paresse; le ravet nous force à la
propreté; l'araignée attrape ceux qui se sauvent dans les coins; la
mouche de terre nous avertit de réparer nos maisons; l'adrague nous
pique et nous embaume: celui qui nous indique ce remède peut-il mieux
nous prouver que nous dépendons essentiellement les uns des autres? Le
parfum qu'elle répand, c'est l'emblème de la peine et du plaisir.
Tandis que la négresse couroit écraser une araignée-crabe semblable à
celle que nous avons vue dans le bois ces jours derniers, il me prend
envie de visiter notre linge blanc; elle accourt me l'ôter des mains,
le secoue en me disant de ne toucher à rien sans précaution; il en
tombe un gros ver caparaçonné en anneaux velu, long comme le doigt,
d'un gris jaune, armé de mille pattes ou mille dards.—«Cette espèce
de scorpion donne la fièvre, (p. 300) dit-elle; s'il vous piquoit à
certains endroits, vous en mourriez; nous en avons déjà vu des
exemples dans la colonie. Une demoiselle eut le malheur d'en froisser
un sur son sein, elle tomba en syncope, et expira au bout de trois
jours.» Jusqu'ici la Providence nous a préservés, car nous couchons
sans moustiquaire, et ces fléaux tombent souvent pendant la nuit des
faîtages couverts en feuilles de palmistes, ou des planchers faits de
mauvais bois qui les retirent. La négresse moins heureuse que moi, fut
piquée au doigt par un petit scorpion qui s'étoit blotti dans les plis
d'une cravate. Elle portoit le remède avec elle; et tout en riant de
sa précaution inutile, je jetai les yeux sur mon vieux chapeau
suspendu dans un coin de la chambre; un petit rossignol de case y
avoit fait son nid. Ce volatil, que les créoles nomment oiseau
bondieu, ressemble à notre roitelet pour le plumage et le chant; il
aime les hommes, et vient volontiers becqueter les miettes à un coin
de la table pendant qu'ils sont assis à l'autre. La curiosité me porta
à voir si la couvée de notre commensal étoit avancée: en haussant la
tête, je sentis pendre sur mon front la peau d'un serpent (p. 301)
qui venoit de changer d'habit. Tandis que je réfléchissois sur cette
trouvaille, un de nos camarades nous appèle au magasin.
De grosses fourmis rouges marchent en rang pressées comme une colonne
de troupes; toutes se rendent à un centre commun, d'où elles
paraissent attendre l'ordre. Givry se prépare à tout déloger pour
éviter un second désastre.—«N'ôtez rien, nous dit la négresse;
couvrez votre sucre, et soyez tranquilles. Si votre linge sale eût été
ici, il ne seroit pas rongé; ces fourmis se nomment coureuses ou
visiteuses; elles vont parcourir les replis de vos étoffes et tout
l'appartement, pour faire la chasse aux ravets, aux mouches et aux
araignées; enfin à tous les insectes qui vous chagrinent. Au bout de
cinq ou six jours, elles iront ailleurs.» Disons donc avec
l'Optimiste:
Tout est bien pour celui qui sait s'y conformer.....
Nous avons perdu notre linge, et non pas notre matinée; j'aime mieux
une bonne leçon à mes dépens qu'à ceux des autres.
Notre bon voisin m'invite avec Givry à venir passer l'après-midi chez
lui.
Nous ne sommes pas à une portée de fusil de sa case; Givry a été
frappé d'un coup de (p. 302) soleil pour y avoir été sans chapeau; il
est attaqué d'une fièvre brûlante et d'une migraine des plus
insupportables. Nos voisines nous indiquent le remède; elles
remplissent un verre d'eau fraîche, entourent ses bords d'un linge
double, et promènent le vase sur toute la tête. Quand elles ont touché
le point où le soleil a frappé, l'eau bout à gros bouillons; la
migraine et la fièvre diminuent sensiblement. Pendant trois jours, on
lui applique le même remède le soir et à midi. Il est convalescent.
Pour éteindre l'inflammation qu'il éprouve encore, on lui met une
couronne de feuilles de plateau. Quand elle est sèche, on prépare un
cataplasme de cassave mouillée de citron, de piment et de vinaigre. Au
bout de trois jours, il prendra du jalap, et sera parfaitement guéri.
16 août. Aujourd'hui, nous sommes en fête chez M. Gourgue, maire du
canton, qui traite ses voisins. En attendant le dîner, nous visitons
avec lui son abattis et son jardin; l'un est planté de coton, de
quelques pieds de rocou et de quelques épices; l'autre d'arbres
fruitiers, de pois de sept ans, de bons melons et de chétifs légumes du
pays.
L'abattis, est en terres basses; quelques nègres, (p. 303) enfoncés
dans la vase comme les crabes, relèvent les fossés et réparent les
ravages de la dernière marée. Les plantages végètent faute de bras.
Cependant, ce propriétaire est un bon habitant; mais la liberté l'a
ruiné comme les autres. Après avoir déploré son sort, il entre dans
les détails de la culture, nous montre la différence du vrai coton de
Cayenne de celui que les Guadeloupiens ont apporté en venant ici
former une partie de la colonie de 1763. Le cotonnier est un arbre
qu'on rend nain pour le faire taller et le rendre plus productif. On
n'est pas sûr s'il est naturel au pays: il ne se trouve pas dans les
bois de la Guyane, cependant les Indiens avant notre découverte le
cultivoient pour en faire des hamacs et d'autres choses pour leurs
usages. La feuille du coton est large, octogone, lisse intérieurement
et un peu laineuse extérieurement; sa fleur est jaune, unie, évasée,
semblable à une cloche, et faite comme la fleur de nos citrouilles; il
s'en élève une cabosse faite comme un œuf pointu et à angles, qui
emprisonne la denrée et la graine. La chaleur ouvre cet œuf, il
présente quatre à cinq petites graines noires un peu plus grosses que
notre vesce. Cette graine passée au moulin feroit de l'huile:
(p. 304) les vaches, les cochons et les brebis en sont très-friands,
et dévastent souvent les abattis pour la manger. Le cotonnier se sème
et rapporte au bout d'un an; il seroit toujours chargé si la
température étoit moins pluvieuse et moins sèche; il donne deux fois
l'année; mais la petite récolte du mois de mars est souvent rongée par
les chenilles qui viennent à la suite des premières pluies. On a
cherché, toujours vainement, les moyens de parer à ce fléau; les
habiles gens y perdent leur tems. L'année dernière, le botaniste
Leblond, homme instruit, publia une recette infaillible pour faire
mourir les chenilles; huit jours après la publication, la récolte fut
dévorée par ces insectes qui ne laissèrent pas une cabosse à
l'infaillible destructeur. Les terres basses ou neuves sont faites
pour le coton, il y vient comme des forêts, tandis qu'il dépérit sur
les montagnes et se racornit dans les vieux abattis. Le coton de
Cayenne est plus prisé dans le commerce que celui des autres colonies,
tant par sa nature que par les soins que l'on donne à sa préparation.
L'abbé Raynal a raison de dire que toute la culture des colonies
consiste à abattre et à brûler des bois, à gratter la terre, à
planter, à tailler, (p. 305) à sarcler, mais les herbes sont si
abondantes, que l'entretien des plantages demande autant de façons que
nos vignes.
Le rocouier donne quatre récoltes; il ne craint ni la chenille ni les
vers, qui dévorent la canne à sucre et le cotonnier; les grandes
pluies peuvent seulement le faire couler.
L'arbre qui produit le rocou est toujours chargé de fruits et de
fleurs; sa feuille ressemble à celle de nos poiriers de martin-sec; sa
fleur à nos roses de chien; sa caboce armée de piquans à l'enveloppe
de nos châtaignes; son fruit rouge et rond est divisé en petits grains
sur deux épistyles qui colorent sa caboce; une rocourie en plein
rapport offre un coup-d'œil magnifique; mais la manipulation de
cette denrée, comme celle de l'indigo, est dégoûtante et mal-saine. Le
déchet du roucou fume la terre, celui de l'indigo la ruine et
empoisonne les rivières.
Le rocouier ne s'est trouvé dans la Guyanne que chez les Indiens ou
naturels du pays qui le cultivent pour leur usage, c'est-à-dire pour
se frotter le corps avec la couleur rouge qu'ils tirent de son fruit.
Les grands arbres l'étouffent mais plusieurs personnes assurent en
avoir trouvé quelques pieds çà-et-là dans les bois; ce qui (p. 306)
fait présumer ou que cet arbre est naturel au pays, ou que l'Amérique
a été plantée et policée antérieurement à sa découverte, et que des
révolutions arrivées ou au sol ou aux habitans, l'ont dévastée et
abrutie à des époques qui nous sont inconnues.
Le fruit du rocouier sert à faire une pâte d'un grand usage dans l'art
de la teinture pour donner le premier apprêt aux étoffes.
Malheureusement les manufactures ont eu lieu de se plaindre autrefois
de la négligence ou de la mauvaise foi avec laquelle certains habitans
préparoient le rocou. Depuis quelque tems on est parvenu à lui
donner une perfection à laquelle on n'auroit pas cru pouvoir
atteindre. Les réglemens exigent que tous ceux qui cultivent cette
denrée, la fabriquent avec le même soin: des experts-jurés sont
chargés d'examiner tout ce qui s'en apporte à la ville, et l'activité
du ministère public à cet égard est telle qu'il ne se livre plus au
commerce que du rocou de la plus belle qualité. Par ce moyen la
colonie de Cayenne ne tardera pas à regagner toute la confiance des
grandes manufactures, pour une denrée qui n'a jamais été bien
remplacée par aucune autre plante, et qu'elle est presque (p. 307)
seule en possession de fournir à toute l'Europe.
M. Gourgue nous dit aussi un mot des épiceries, et nous montre une
plante brune sarmenteuse, rampante comme la vigne et le lierre, parée
de distance en distance de petits boutons rouges comme des diamans,
soutenus par de grosses feuilles lisses sphéroïdes, d'un vert pâle, et
épaisses de trois lignes. Cette plante est la vanille, dit-il; son
fruit ressemble à celui du bananier; elle est naturelle au pays, et
les Indiens qui la connoissent ne songent pas à en tirer parti pour
leur plaisir ou pour le commerce, car ces nomades qu'on appelle
brutes, laissent l'étude des besoins factices aux Européens.
C'est en 1773 que la cour a fait porter à Cayenne, pour la première
fois, des plants d'arbres à épiceries, venant des Indes. Cette
expédition a été suivie de deux autres semblables; l'une en 1784, et
l'autre en 1788, toutes venant de l'île de France. Le géroflier et le
cannelier ont bien réussi, les autres plants ont péri dans les
voyages, ou par les avaries ou par les suites de ce qu'ils y avoient
souffert.
Pendant long-tems la culture de ces arbres a été prohibée aux
habitans de la colonie, et (p. 308) c'est ce qui en a empêché la
multiplication. Ce système ayant été abandonné, la cour en a fait
passer dans les îles de Saint-Domingue et de la Martinique en 1787 et
1788. Maintenant le gouvernement de Cayenne s'occupe de les multiplier
dans la colonie; il a fait distribuer, dans les derniers mois de 1798
beaucoup de plants et une grande quantité de graines de gérofliers à
tous les cultivateurs qui en ont demandé: les jardins de la ville
n'offrent plus que des allées de manguiers et de gérofliers.
Outre les arbres à épiceries, la colonie a reçu de l'Inde d'autres
arbres fruitiers et d'autres plantes plus intéressantes, qui
deviennent précieuses: l'arbre-à-pain et le palmier-sagou, quoique
jeunes, sont très-vigoureux, et réussiront parfaitement.
Le muscadier, le poivre liane, semblable à notre lierre, le
piment-cerise ou café, qui tire son nom de sa forme; le poivre de
Guinée, les oignons de safran et de gingembre, réussissent également.
Nous devons encore à l'Inde de bons fruits: la sapotte et la
sapoutille qui ont la peau rude et brune, et qu'on ne mange que quand
elles sont molles; leur parfum est, selon moi, celui du beurré-gris.
La mangue, dont la forme (p. 309) ressemble à nos abricots-pêches, est
filandreuse, fort-douce et très-agréable, quoique sentant un peu la
thérébentine: l'arbre qui la produit est très-grand et toujours en
rapport; on incise son écorce pour rendre son fruit meilleur; des
coups faits par la hache sort la sève qui est la thérébentine. Les
feuilles du manguier sont tout-à-fait semblables à celles du pêcher;
on ne peut trop multiplier cet arbre qui se plaît bien à Cayenne:
c'est un trésor pour les gens en bonne santé et un élixir-de-vie pour
les malades. Le corossolier n'est pas à négliger non plus; son fruit,
comme un cœur de bœuf, couvert d'une peau verte, nuancée de
piquans charnus, offre une pulpe blanche, alvéolaire et douce, qui a
le parfum de la julienne.
Les chaussées de mon abattis, dit M. Gourgue, demandent des bananiers;
cette plante donne la mâne et les fruits en même tems.
En regagnant la case, nous vîmes sortir d'un pripris (étang momentané)
que nous passions, un caïman qui coupa en deux le chien qui nous
suivoit à la nage. Celui-là n'est qu'un petit marmot, dit notre
conducteur; ces grands lézards sont couverts d'écailles qui ne
redoutent ni la balle, ni le boulet. Les plus communs (p. 310) ont de
quinze à vingt pieds. Les nègres les mangent quand ils sont petits. Ce
sont des amphibies qu'on trouve et dans les étangs et sur le bord des
fleuves; la femelle dépose ses œufs dans l'eau; quand on les
touche, elle accourt en glougloutant, car elle ne les perd jamais de
vue.
Les rivières de Vasa et de Cachipour où vous deviez être déposés, sont
si pleines de grands caïmans, qu'ils attirent souvent la ligne, le
poisson et le pêcheur, ils sont aussi monstrueux et aussi voraces que
ceux du Nil. Ils déclarent une guerre à mort aux chiens; s'ils
poursuivent un cerf qui traverse un étang, ils laisseront passer la
proie pour s'en prendre aux quêteurs. Pour attirer une victime, ils
gémissent souvent comme un enfant abandonné. Si un plaisant, dans un
canot, s'avise de contrefaire les aboiemens du chien, le caïman
s'élance et le saisit; il dévoreroit tous ceux qui se baigneroient
dans ces rivières, fussent-ils aussi nombreux que l'armée de Perdicas,
qui en faisant la guerre à Ptolémé Soter, fit passer un bras du Nil à
ses troupes pour gagner l'île de Memphis, où il perdit deux mille
hommes, dont la moitié se noya, et l'autre fut dévorée (p. 311) par
les crocodiles ou caïmans. Ceux de la Guyane ont jusqu'à trente pieds,
et le pays est si peu connu dans l'intérieur, qu'on ne peut pas dire
s'il ne s'en trouve pas de plus grands, mais un homme entre sans peine
dans la gueule de ceux-ci.
Les plus gros reptiles se trouvent ici, et tous les animaux
domestiques y sont de l'espèce la plus chétive. Le bétail y dégénère;
son lait ne vaut rien, il couche toujours en plein air, sur ses
immondices, dans des parcs serrés; en hiver, il a de l'eau et de la
vase jusqu'au poitrail. Il faut l'enclore, crainte du tigre, et le
laisser en plein air pour qu'il ne soit pas épuisé par les
chauve-souris. Elles sont si communes et si grosses dans certains
cantons à Oyac et dans les plaines de Kau, par exemple, qu'il ne peut
s'en défendre. Elles s'acharnent à son dos, l'ulcèrent; les mouches
sucent les plaies, y déposent des œufs; des vers surviennent; car
ici, toutes les plaies qui restent à l'air, sont pleines de vers dans
les vingt-quatre heures; on peut presque dire que la peste ne
désempare jamais du pays. Le poisson est pourri en sortant de l'eau,
le pain moisit en froidissant, la viande presque putréfiée en
palpitant. Le ciel (p. 312) et la terre y déclarent la guerre à
l'homme, et il ne s'obstine pas moins à s'y établir et à y rester.
Fin du premier volume.
Notes
Note au lecteur de ce fichier numérique:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été
corrigées. L'orthographe de l'auteur a été conservée.