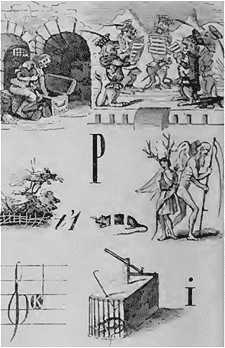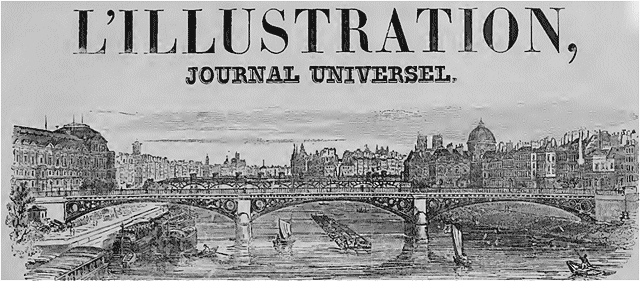
N° 48. Vol. II.--SAMEDI 27 JANVIER 1844.
Bureaux, rue de Seine, 33.
Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--un an, 30 fr.
Prix de chaque N°, 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr.75.
Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--un an, 32 fr.
pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 30
SOMMAIRE.
Histoire de la Semaine. Portraits de MM. Thiers et Guizot.--Théâtres. Le Ménage parisien; Marjolaine; Paris bloqué.--Courrier de Paris. Un Dîner de la Saint-Charlemagne; Une Réunion d'ouvriers dans les caveaux de Saint-Sulpice; Bouffé dans l'Oncle Baptiste.--Approvisionnements de Paris. Marché Bonne-Nouvelle. Entrée du Marché sur l'impasse Mazagran; Vue du Marché.--Hasard et Calomnie, nouvelle traduite de l'allemand, de Vilhelmine Willmar. Une Gravure.--Pénitencier militaire de Saint-Germain.--Sept Gravures.--Académie des Sciences. Compte rendu des second et troisième trimestres de 1843.--Romanciers contemporains. Charles Dickens. Expériences américaines; Martin prend un associé; Vallée d'Eden en perspective. (Suite.) Une Gravure.--Chasses d'Hiver. La Chasse aux Canards. Une Gravure.--Une Caricature anglaise.--Bulletin bibliographique.--Annonces. Amusements des Sciences. Une Gravure.--Lettre d'un Abonné de Bordeaux. Gravure.--Rébus.
Histoire de la Semaine.

M. Thiers.
Toute la semaine a encore été remplie, par la discussion de l'adresse de la Chambre des Députés, dont les débats ont eu une élévation et une importance qui rappellent les époques les plus brillantes de nos luttes parlementaire? Trois orateurs en ont principalement porté le poids: M. Guizot, M. Thiers et M. Billaut. Au moment où nous mettions notre dernier numéro sous presse, M. Billaut montait à la tribune et, dans une de ces revues complètes, ingénieuses, piquantes, comme il sait les faire, et dont la manière incisive ne l'orateur double encore l'effet et l'éclat, examinait tous les actes de la politique extérieure du cabinet, et mettait en relief ce qu'il regarde comme ses failles. Cette attaque a amené le lendemain à la tribune M. le ministre des affaires étrangères, qui s'est efforcé de suivre pas à pas, d'emboîter son adversaire, et de démontrer que là où l'on avait cru voir de la faiblesse il n'y avait eu que de la prudence. Ainsi se serait terminée la dernière semaine parlementaire si un débat que nous avions pressenti et annoncé, la vérification de l'élection de M. Charles Laffitte, n'était venu ajouter à ces grandes journées oratoires un intérêt épisodique. Nous y reviendrons tout à l'heure. La séance de lundi a été une des plus importantes dont mémoire de député ait conservé le souvenir. M. Thiers s'était montré, dans le premier discours dont nous avons précédemment fait mention, orateur plein d'habileté et d'apparent abandon, adversaire d'autant plus redoutable que la mesure était toujours parfaitement gardée. Examinant cette fois notre situation extérieure, il a traité la question des alliances, les conditions auxquelles elles se forment, leurs causes naturelles et leurs causes momentanées, non plus en orateur, mais en homme d'État qui a profondément réfléchi sur un difficile sujet, et qui, s'en étant rendu maître, peut le résumer d'une façon claire et saisissante pour tout le monde. Son exposé renfermait la condamnation de la politique actuelle. M. Guizot, toujours infatigable et le seul athlète du ministère que la majorité, voie avec confiance monter à la tribune, lui a succédé. Sa parole a toujours été éloquente, mais moins inspirée et moins heureuse que lorsqu'il avait répondu à M. Berryer. Comme ce dernier, dans cette occasion nouvelle, il avait à se défendre, et le discours de M. Thiers avait été si élevé et si peu personnel, qu'à une défense il était impossible de substituer, aux applaudissements de la Chambre, une attaque et des récriminations. M. Guizot l'a senti, il a accepté et subi les conséquences de cette situation.--On a vu reparaître les mêmes orateurs sur plusieurs autres paragraphes de l'adresse; mais, dans toute cette discussion, on a paru moins préoccupé des scrutins auxquels on procédait, que du travail intérieur qu'elle semble devoir assez prochainement amener dans le sein de la majorité. Il n'y a pas d'exemples, que nous sachions, d'un ministère renverse par les votes d'une discussion d'adresse. En 1839, le ministère du 15 avril eut la majorité. Une louable susceptibilité la lui lit regarder comme insuffisante; mais il avait, lui aussi, la majorité. Ce n'est point aux premiers coups de feu que les changements de front s'opèrent et que les gros bataillons se dissolvent. Quand, dans une première attaque, un parti a montré de l'ensemble, de la précision, de l'habileté; quand il a su, par sa discipline, inspirer confiance à la portion incertaine de ses adversaires, il s'opère ensuite dans leurs rangs une fermentation qui ne tarde pas à éclater. On a déjà cru en voir un symptôme dans un simple vote d'ajournement de discussion demandé par M. Thiers et obtenu par une majorité composée de la gauche, du centre gauche et de cette partie du centre qui a toujours passé pour prêter au cabinet actuel un concours sans sympathie réelle, et pour croire qu'une alliance était possible entre le centre gauche et elle, dès que les chefs de ces deux fractions trouveraient un terrain commun.

M. Guizot.
Nous revenons au malencontreux élu de Louviers. Nous avons dit le reproche qui lui était adressé: son élection, avait-on publié par avance, était le résultat, le produit d'un marché. M. Grandin, député d'Elbeuf, est venu exposer ses griefs. Le choix de l'agresseur n'était pas le plus heureux possible; car il était facile de répondre, comme on l'a fait, que c'était là une lutte de deux villes rivales. L'attaque n'était pas assez habile pour faire disparaître ce que le choix avait de mal entendu, et il est probable, que, si l'on eût voté immédiatement, les assertions de M. Grandin n'eussent pas été considérées comme suffisamment probantes, et que M. Charles Laffitte eût été admis. Malheureusement pour le nouvel élu il a demandé à répondre. Il l'a fait sans l'embarras qui accompagne d'ordinaire et protège en quelque sorte un début; et c'est avec une confiance parfaite et un aplomb que beaucoup de vétérans de la Chambre envieraient, qu'il est venu confirmer par ses incroyables déclarations tout ce qu'avait avancé M. Grandin. Il s'était proposé de combattre ses conclusions, il en rendait l'adoption inévitable; et quand ses déclarations agitaient la Chambre, il n'en était en rien décontenancé, mais laissait voir un étonnement qui semblait dire: Mais où suis-je donc ici? est-ce que j'aurais affaire à d'honnêtes gens? Ce maladroit plaidoyer et la demande faite par M. Dufaure d'une enquête ont déterminé presque unanimement la majorité à se joindre à la gauche et à casser immédiatement cette élection.
Pour ceux qui ne regardent pas comme probable un changement de cabinet, un mouvement prochain semble assez vraisemblable. M. de Bastard, président de chambre à la Cour de cassation, vient de mourir; M. Laplagne-Barris est d'avance désigné, pour le remplacer; mais en même temps un autre président de la Cour souveraine, M. Zangiacomi, serait amené par des considérations de famille à abandonner son siège à M. Martin (du Nord), que M. le procureur-général Hébert remplacerait à la chancellerie. Voilà ce qu'à la salle des conférences du palais Bourbon l'on regarde comme arrêté, ainsi que dans la chambre du conseil de la Cour de cassation, fort émue depuis quelques jours des débats de l'affaire de M. Defontaine, juge suppléant du ressort de Douai, cité devant elle pour être allé à Belgrave-Square, de la correspondance à cette occasion de M. Madier de Montjean avec quelques journaux, et de la publicité donnée, on ne sait trop comment, à la discussion secrète de toute cette affaire.
Nos nouvelles extérieures ont été peu nombreuses et peu certaines. Nous avons lu dans la Gazette navale et militaire, journal qui a cependant un caractère presque officiel en Angleterre, la note suivante, qui, si elle se continuait, pourrait servir d'explication aux moqueries dont les feuilles de Londres, comme nous le remarquions précédemment, accompagnaient la nouvelle de l'envoi de missions française, américaine et danoise dans le Céleste Empire: «Nous apprenons que le major Pottinger, défenseur héroïque d'Hérat, est porteur du traité additionnel de la Chine, par lequel sir Henri Pottinger a si sagement mis nos relations à unir avec la Chine à l'abri des intrigues, des cabales d'une bande d'ambassadeurs et envoyés des Etats européens et des Etats repoussés.»--On a dit aussi qu'un successeur avait été donné au contre-amiral Dupetit-Thouard dans la mission qu'il remplit avec fermeté dans l'océan Pacifique. Tous ces bruits, nous le répétons, ont besoin de confirmation.--La Gazette de Turin annonce que le consul sarde s'est retiré de Tunis, mais que le consulat est géré par le vice-consul, et que ses relations diplomatiques ne sont pas interrompues. Déjà la Porte s'est interposée, et la France ayant offert sa médiation, qui a été acceptée, les chances de collision se sont bien affaiblies.--Des lettres de Tanger parlent de nouvelles et graves difficultés survenues entre la France et le Maroc.
Le procès d'O'Connell et de ses coaccusés continue à absorber toute l'attention de l'Angleterre et tient l'Irlande dans une émotion que l'agitateur sait entretenir et contenir. Des journaux politiques de Londres ont cru indispensable, pour satisfaire la curiosité de leurs lecteurs, d'ouvrir leurs colonnes aux illustrations, et des dessins, analogues à ceux que nous avons publiés il y a huit jours, ont paru cette semaine, dans le Sun, journal quotidien. Les deux premiers jours du procès ont été remplis par le réquisitoire de l'avocat-général, qui, de l'aveu des journaux anglais, n'a pas produit d'effet défavorable aux accusés. Puis sont venues des dépositions qui jusqu'ici établissent assez mal le chef de conspiration; car ce mot comporte une idée de mystère et de secret que rendent difficile les réunions de milliers de repealers dont les témoins, sténographes ou agents du gouvernement, viennent taire le récit. Ces déposants se montrent assez peu contents du rôle qu'on leur fait jouer; ils ont presque tous jusqu'ici été fort impartiaux et fort modérés, et le second témoin, M. Ross, sténographe, a déclaré que, s'il avait su l'emploi que le gouvernement voulait faire du compte rendu des meetings, pour rien au monde il n'eut accepté la mission qu'on lui a donnée. Cette déclaration a été très-favorablement accueillie.--Ce qui n'a eu ni la même faveur, ni le même accueil, c'est l'exigence de l'avocat-général, M. Kemmis, qui voulait que les honnêtes jurés demeurassent, pendant tout le temps du procès, absolument isolés de toute communication avec l'extérieur, et ne sortissent de la salle d'audience que pour passer dans des appartements contigus qu'on leur avait fait préparer. Un cri général s'est élevé du banc du jury contre la prétention de M. Kemmis, qui garantissait, du reste, que les pièces étaient chaudes et les lits excellents. «Mais, s est écrié un des jurés, c'est donc à dire que nous subirons la prison en attendant qu'on sache si les accusés y seront condamnés.» La Cour, investie d'un pouvoir discrétionnaire, a décidé que les jurés iraient coucher chez eux s'ils s'engageaient à dénoncer à la justice quiconque leur parlerait du procès.--Cette tolérance est d'autant mieux entendue qu'un des membres du jury est un vieillard de soixante-dix-sept ans, qui a négligé de se faire rayer de la liste à raison de son âge, et que les accusés ont refusé de récuser. S'il tombait malade, la cause serait nécessairement renvoyée à une autre session. O'Connell se montre calme, souriant, et répète souvent: «Notre cause est gagnée, quoi qu'il advienne dans cette enceinte, si la paix se maintient en Irlande, et, Dieu aidant, elle s'y maintiendra.»--Les débats de Dublin détourne un peu l'attention de l'ouverture du Parlement, à laquelle la reine ira procéder le 1er février.
En Espagne, dont l'ambassadeur, M. Martinès de La Rosa, a été reçu par le roi, le cabinet Gonzalès Bravo continue à jouer un triste rôle. Les élections complémentaires ont été favorables aux progressistes, et le témoignage estime que M. Olozaga a reçu en cette circonstance de ses concitoyens lui a inspiré une lettre de remerciements datée de Lisbonne, dans laquelle il déclare que si, menacé dans sa demeure, il s'est déterminé, d'après l'avis de ses amis politiques, à quitter l'Espagne, il est prêt à y rentrer dès qu'on voudra donner suite à sa mise en accusation, qu'il appelle de ses vœux.
--A Séville et dans la Galice, la résistance s'organise contre la loi des municipalités.--A Madrid, le général Narvaez prend ses mesures pour combattre les résistances, et 2 millions ont été demandés au ministre des finances pour l'organisation et la mobilisation de trois corps d'armée à établir dans ce but.--Ametter et un certain nombre d'officiers sont arrivés à Perpignan, venant de la citadelle de Figuières, dont la capitulation a été sanctionnée à Madrid.--Nous devons enregistrer le jugement porté par un des membres les plus influents du Parlement belge, M. Devaux, dans la discussion du budget à la Chambre des députés, contre la marche des ministres actuels du roi Léopold: «Par une politique toujours la même, on a voulu faire craindre au gouvernement français une alliance avec l'Allemagne et à l'Allemagne une alliance avec la France. La politique a été double à l'extérieur, comme la politique de M. le ministre de l'intérieur est double à l'intérieur du pays, ce qui doit aussi avoir le même résultat; à l'intérieur, le gouvernement flotte entre les deux partis, s'est fait déconsidérer par l'un et par l'autre; de même, à l'extérieur, il a eu, à l'égard de la France et de l'Allemagne, une politique peu sincère, et il a fini par être méprisé par l'un et l'autre pays.»--Une lettre de Rome, citée par la Gazette d'Augsbourg, va au-devant de nouvelles qu'on pensait avoir déjà été expédiées en France, et devoir y être dénaturées. Nous la citons textuellement: «Les journaux français annonceront peut-être que des esprits mécontents cherchent à fomenter des troubles dans notre capitale; pour éviter toute méprise à ce sujet, nous dirons ce qui s'est passé en réalité. Les danseurs avaient le droit de paraître sur la scène, dans les ballets, avec des habits d'une transparence extraordinaire. Cette tolérance, qui remonte fort loin, était un vrai scandale. En conséquence, l'autorité avait enjoint, à l'occasion de la réouverture du théâtre d'Apollon, aux danseurs de se vêtir plus décemment. Le public n'a point goûté cette innovation. Dans le théâtre et au dehors, il y a eu des rixes entre les bourgeois et les militaires; puis quelques arrestations ont été opérées, et le calme a été promptement rétabli.»--On lit dans le Journal Allemand de Francfort: «L'interrogatoire final de MM. Haber, de Arndt et de Thouret a eu lieu le 16 à Alzei, devant le juge d'instruction. Les débats publics auront lieu bientôt, et le jugement ne pourra tarder à moins que les accusés ne veuillent faire venir de Bade des témoins à décharge. Cela entraînerait nécessairement des lenteurs. On dit en effet que les accusés ont adressé aux autorités badoises une demande dans ce but. On pense que les autorités mettront d'autant plus d'empressement à satisfaire à ce désir, que M. de Haber est sujet badois.»--Une lettre de Montévideo, en date du 4 novembre, annonce que, dans la nuit du 1er au 2 novembre, un corps de trois mille hommes étant sorti de la ville, s'est emparé de la petite rade de Budes, qui était au pouvoir d'Oribe, a mis le feu aux magasins et a détruit toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Dans cette sortie, les Montévidéens n'ont eu que vingt hommes tués; un de leurs officiers a été fait prisonnier. Comme de leur côté ils avaient pris un officier d'Oribe, le gouvernement a fait offrir l'échange à ce général; mais, comme de coutume, les assiégeants ont reçu pour toute réponse la tête de leur compatriote, à laquelle on avait coupé une oreille. M. le ministre de la marine a dit à la tribune de la Chambre des Députés que le gouvernement montévidéen ne pouvait tenir longtemps encore, qu'ainsi cette triste et longue affaire touchait à son terme, et que nous étions au moment de recueillir les fruits de la politique ferme et éclairée suivie depuis quatre ans sur les bords de la Plata; ces paroles ont été vivement attaquées. Pour nous, nous avouerons la crainte que M. le ministre, en nourrissant l'espoir de voir Montévideo succomber et en tenant pareil langage, ne se laisse, trop aller à la satisfaction d'amour-propre que peut éprouver l'amiral signataire du traité avec Rosas; nous craignons qu'il ne se préoccupe pas assez des dangers que cette catastrophe, objet de ses vœux, fera inévitablement courir aux Français qui se trouvent sur ces bords. Quels que soient le dévouement et l'énergie bien éprouvés de nos marins, la station que nous entretenons dans ces parages, composée seulement d'un brick et d'une corvette, est complètement insuffisante pour protéger nos vingt mille compatriotes au milieu du bouleversement sanglant que l'on prévoit et que l'on regarde comme prochain.
L'Académie des Sciences morales et politiques a pourvu au remplacement de MM. Edwards et de Gérando, qu'elle avait récemment perdus. A l'une comme à l'autre élection le nombre des votants était de 26; à la première, après trois tours de scrutin sans résultat, M. Frank a été élu au ballottage: il a réuni 13 voix. M. Lélut en a obtenu 12. Il y a eu un billet blanc.--A la seconde élection, après le même nombre de tours de scrutin, également sans résultat, M. Lélut, prenant sa revanche, a été nommé au ballottage: il a réuni 14 voix, M. Peisse en a obtenu 11. Il y a encore eu un billet blanc. On dit que la discussion de l'adresse à la chambre des Députés avait empêché de se rendre à l'Institut un certain nombre de membres de l'Académie, qui passaient pour favorables à M. Peisse.
Des accidents nombreux ont été, cette semaine, enregistrés dans les journaux. Une fuite et un commencement d'incendie survenus dans une usine à gaz située dans un des faubourgs de Paris, nous fourniront l'occasion de parler prochainement de ces curieux et importants établissements.--Un autre incendie a également éclaté dans l'enceinte, voisine du Luxembourg, où se trouvait déposé le matériel dont se servait M. le marquis de Jouffroy pour les expériences du système de chemin de fer dont l'Illustration a rendu compte dans son avant-dernier numéro. Une lettre de M. de Jouffroy, insérée dans les feuilles judiciaires, attribue sans hésitation ce sinistre à la malveillance.--A Reims, dans un cours de chimie où étaient faites des expériences sur le gaz, un endomètre a été brisé; une explosion a eu lieu, et cinq élèves ont été blessés.--A Toulouse, une aéronaute, madame Lariet, qui s'était embarquée dans une montgolfière imparfaite, a failli payer de sa vie ses téméraires expériences. Elle est tombée dans la Garonne, dont les eaux étaient considérablement grossies, et n'en a été tirée que par le dévouement de plusieurs bateliers. C'est du reste la sixième chute qu'elle faisait dans cette même rivière; mais celle-ci a pensé lui être définitivement fatale.
Des crimes audacieux, dont les auteurs sont encore inconnus, ont, depuis le commencement de ce mois, effrayé Paris et ses environs. En attendant que la justice, dont l'activité est en ce moment absorbée en très-grande partie par des procès de presse et des demandes en dommages civils, parvienne à mettre la main et à faire asseoir sur les bancs de la Cour d'assises ces meurtriers jusqu'ici anonymes, les habitués de ces sortes de débats suivent avec une curiosité assidue ceux de l'affaire Poulmann, assassin de l'aubergiste de Nangis. On frémit en entendant les confessions de cet homme, en voyant le calme de cet assassin. Encore fait-il ses réserves et renvoie-t-il après son jugement pour se livrer à des aveux plus explicites, et un épanchement plus complet.
Outre la mort de M. le président de Bastard, que nous avons mentionnée plus haut, nous avons à comprendre également dans ces dernières lignes celles du maréchal comte d'Erlon, dont l'Illustration a publié le portrait accompagnant une notice (tome 1er, page 112); de sir Francis Burdett, en Angleterre; de M. de Montferrand ancien inspecteur général des études, nommé récemment directeur au ministère de l'instruction publique; de M. Teillard-Nozerolles, député du Cantal, et de la veuve de l'illustre maréchal Gouvion-Saint-Cyr.

Théâtres
THÉÂTRE-FRANÇAIS; Un Ménage parisien, comédie en cinq actes et en vers, de M. BAYARD.--VARIÉTÉS: Marjolaine.--VAUDEVILLE: Paris bloqué.
M. Bayard est un de nos producteurs dramatiques les plus féconds, et, comme on dit, un de nos vaudevillistes les plus distingués; mais enfin, jusqu'ici, M. Bayard n'avait obtenu que des succès de théâtres secondaires: le Gymnase, le Palais-Royal surtout, le théâtre des Variétés et le théâtre du Vaudeville avaient été ses seuls champs de bataille; deux ou trois comédies tentées à l'Odéon, il y a quelque quinze ou vingt ans, au début de le carrière de M. Bayard, ne peuvent être comptées que pour des coups d'essai. En revanche, M. Bayard occupe depuis longtemps toutes les avenues du Vaudeville: il y est un des plus heureux, et à part M. Scribe, qui les domine tous, il n'en est guère qu'on puisse lui comparer.
On se lasse de tout cependant, même de réussir toujours: M. Bayard, au rebours de la maxime de César, semble donc s'être lassé d'être le premier dans un village; voici qu'il tente de le devenir à Rome; ce n'est plus d'un vaudeville qu'il s'agit avec lui, mais d'une comédie en cinq actes et en vers. Le sujet en est grave, comme on va le voir, et tient par plus d'un côté aux intérêts moraux de la société et de la famille.
La comédie nous conduit d'abord chez M. et madame Vernange: M. Vernange est un homme honorable, jeune encore, spirituel, mais légèrement enclin à la dissipation et au plaisir; madame Vernange a toutes les qualités d'une amiable femme; veuve d'un premier mari, elle a épousé Vernange en secondes noces, du moins le monde le croit ainsi, et c'est là le point important de la comédie. Le fils du premier lit, Arthur, jeune officier de marine, est la joie et l'orgueil de sa mère; Vernange, tout beau-père qu'il est, a, de son côté, pour Arthur une véritable affection.
Les choses vont ainsi quand M. Bernais et sa sœur, mademoiselle Bernais, amis et voisin? des Vernange, viennent leur rendre visite: il s'agit d'un bal que Bernais donne le lendemain même; une querelle s'est élevée, au sujet de la liste des invitations, entre la vieille demoiselle Bernais et son respectable frère: mademoiselle, qui a des principes, ne vent pas inscrire sur cette liste une certaine dame Vernillac; monsieur insiste au contraire pour qu'elle soit invitée. Mais pourquoi n'inviterait-on pas madame Vernillac? C'est que l'union de madame Vernillac et de M. Vernillac est d'une légitimité plus que suspecte. «Qu'y manque-t-il? s'écrie Bernais.--Presque rien, réplique la sœur: l'église et la mairie!»
A ces mots Vernange se trouble, et madame Vernange pâlit. Quoi donc! seraient-ils tous deux dans une situation analogue? Précisément! Vernange et madame Vernange ne sont époux qu'aux yeux du monde; en réalité ils ne sont qu'amants. Nous allons indiquer les principales conséquences de cette situation équivoque.
Le bal de Bernais a lieu: on cause, on danse, on joue, on médit. Parmi les médisants se trouve un jeune homme qui a trouvé, dans une lettre tombée entre ses mains, le secret de Vernange et de sa maîtresse. Tout en raillant, à droite et à gauche, la vertu et l'honnêteté des assistants, il en vient à ce fait, que madame Vernange n'est pas madame Vernange. Arthur est là qui entend tout; Arthur, qui aime et vénère sa mère; Arthur, qui n'a jamais soupçonné la faute où un moment d'entraînement l'a conduite. «C'est une infâme imposture! s'écrie-t-il en s'adressant au conteur indiscret, une lâche calomnie, et vous m'en rendrez raison.--Soit! dit l'autre. A demain?--A demain,» répond Arthur.
Bientôt le bruit de cette querelle arrive aux oreilles de la mère; c'est Bernais qui la lui annonce. Jugez de ses terreurs. Quoi! son fils va se battre! «Vous empêcherez aisément ce malheur, dit le bonhomme Bernais.--Comment!--En prouvant à ce jeune étourdi qui vous a outragée qu'il s'est trompé, et que vous n'êtes pas ce qu'il pense.» Alors la pauvre femme est obligée de tout avouer, et de se confier à l'honnêteté de Bernais. Non, elle n'est pas la femme de Vernange: aveuglée par un penchant irrésistible, séduite par des promesses toujours différées, elle s'est mise dans cette situation coupable dont elle commence à comprendre tous les dangers.
Le reste de la comédie ou plutôt du drame se devine: à la suite de cette insulte et de cette provocation, la mère n'est occupée qu'à sauver son honneur, à détourner de son fils le coup qui le menace, et à l'arracher aux chances de ce duel fatal; de son côté, le fils interroge sa mère, et peu à peu arrive à savoir le véritable mot de l'aventure; alors ce sont des inquiétudes et des larmes réciproques, douleurs d'un fils blessé dans la réputation de sa mère, pleurs d'une mère inquiète de son fils et près de le perdre où de rougir devant lui. Quant à Vernange, il continue sa vie légère et ne prend aucune part à ces désespoirs qui s'agitent autour de lui; mais enfin la vérité lui est connue; alors cet homme, indifférent et frivole en apparence, montre le cœur et les sentiments d'un honnête homme; il veut empêcher Arthur de se battre; c'est lui que cela regarde; mais comment éviter le scandale? Comment sauver la réputation de la femme qu'il aime et qui jusqu'ici a porté son nom? Vernange emploie le moyen le plus sûr: devant tous il déclare qu'à ses yeux elle a toujours été madame Vernange, mariés tous deux en Angleterre, selon la coutume anglaise. Vernange était de bonne foi en croyant son union à l'abri de toute atteinte; mais puisqu'on doute, il satisfera à la loi française et renouvellera le contrat à la face de tout le monde et dans toutes les rigueurs légales. Ce biais adroit et cette chaleur d'âme désarment les plus incrédules, jettent le repentir dans le cœur du provocateur qui s'excuse, empêchent le duel, comblent Arthur de joie, mettent en déroute les médisants, et rendent le bonheur à madame Vernange, qui sera incessamment bien et dûment mariée à la française. Ainsi tout le monde est content, même M. Bayard, qui a réussi.
L'ouvrage, en général, manque de force et de chaleur; les caractères pourraient être plus solidement et plus nettement posés, les passions mises aux prises avec plus de vivacité; on peut dire que l'auteur n'a fait qu'effleurer son sujet et n'en a pas sondé toutes les profondeurs; mais des situations dramatiques, surtout vers le dénoûment, une versification agréable, facile, spirituelle, bien que manquant de contrastes et d'élan, ont fait le succès du M. Bayard. Provost, Régnier, Geoffroi, Maillart, madame Mélingue et mademoiselle Denain y ont contribué, chacun pour sa part de zèle et selon son talent.
--Marjolaine est une petite fermière du théâtre des Variétés, non pas en sabots et en robe de bure, mais pimpante et enrubannée, pied fin et jupon coquet, peux gentilshommes la courtisent, l'un en habit de marquis, c'est-à-dire dans son costume naturel; l'autre déguisé en garçon de ferme; le premier est un niais dont la fermière se moque, le second un habile séducteur qui commence à faire son chemin. Mais une baronne survient, et voilà la guerre allumée; peu à peu, madame la baronne attire le galant à elle, et finit par l'enlever à Marjolaine; celle-ci se désole d'abord, puis elle fait cette réflexion philosophique, qu'après tout les marquis: reviennent de droit aux baronnes, et les fermiers aux fermières; ce disant, elle épouse Gros-Jean.
Le joli visage et la douce voix d'une jeune débutante, nommée mademoiselle Valence, sont ce qu'il y a de mieux dans ce vaudeville de MM. Cormon et Dennery.
Dans Paris bloqué, autre vaudeville, de M. Morel-Dupéré, la fronde est en jeu: il s'agit d'un jeune gentilhomme royaliste qui file une intrigue amoureuse avec la femme d'un frondeur; à la place de cette femme, qui est la vraie coupable, une honnête femme se trouve compromise. Tout le vaudeville roule sur ce quiproquo, qui se dénoue par le triomphe de l'innocence.
Ceci vaut beaucoup mieux que Marjolaine, pour le goût du dialogue et l'esprit.


Courrier de Paris.
Chacun a son saint: ces demoiselles fêtent sainte Catherine, ces messieurs saint Nicolas; les cordonniers sont voués à saint Crépin; saint Charlemagne est le patron des collèges; bienheureux saint qui ouvre les grilles pour vingt-quatre heures et donne la volée et la liberté à cette nichée d'oiseaux bruyants et jaseurs qu'on nomme des écoliers! Saint trois et quatre fois béni, terque quaterque!
La Saint-Charlemagne n'est pas seulement chère aux collèges par les douceurs d'un congé, elle a des agréments culinaires qui les affriande; mais si tous peuvent aspirer à l'honneur de mordre au gâteau, le nombre des élus est limité: il faut avoir lutté avec éclat, il faut avoir conquis le premier rang à la grande bataille du thème, des vers et de la version; tout élève qui a obtenu cette palme vient s'asseoir au banquet, et le collège, pour le récompenser de ses victoires, met, ce jour-là, un peu de vin dans son eau.
Le dîner de la Saint-Charlemagne est une espèce d'avant-garde à la fourchette de la distribution des prix qui termine l'année scolaire; seulement, au lieu de couronnes, le lauréat obtient un morceau de dinde farcie ou de galantine; au lieu de livres attachés par une faveur rose et reliés en veau, il mange le veau lui-même à l'huile ou cuit dans son jus.
Dans les états de service d'un écolier, avoir tâté de la Saint-Charlemagne est un titre de gloire; on dit au collège: J'ai été à la Saint-Charlemagne, j'ai été au concours général, comme d'autres disent: J'étais à Austerlitz et à Wagram! Et plus tard, quand ces enfants sont devenus des hommes, s'ils se rencontrent au milieu d'une vie de luxe et d'abondance, dans les joies d'un repas sensuel, il leur arrive de se demander en souriant d'un air de regret: «Te souviens-tu de ce bon petit vin plat de la Saint-Charlemagne!»
On boit, en effet, à ce festin d'écoliers que Balthazar n'accepterait pas, mais que la vive gaieté de l'enfance assaisonne et rend plus aimable que les splendides repas; oui, on y boit.... jusqu'à du Champagne; mais les coteaux d'Aï n'en sont pas complices; c'est un nectar parfaitement doux de caractère, dont saint Charlemagne est l'inventeur prudent et l'unique propriétaire.
Rien ne manque à la fête, pas même les poêles et les orateurs; le proviseur ou le censeur adresse une petite allocution aux assistants, à la façon de Démosthènes et de Cicéron, entre la poire et le fromage; et parmi les jeunes convives, il y a toujours un Ovide, un Virgile, un Voltaire ou un Gresset en herbe, qui réplique par quelques centaines d'hexamètres ou d'alexandrins. Le grand Charlemagne défraie ces rimes, bien entendu; c'est lui qu'on loue, c'est lui qu'on chante, et le poète ne manque jamais de comparer les Saxons de Wilikind, pourfendus par ce terrible conquérant, aux débris des pâtés mis en pièces et qui jonchent la table.
La Saint Charlemagne tombe au vingt-huitième jour de janvier; au moment où nous publions ces lignes, les collèges de Paris sont en pleine Saint-Charlemagne; malheureusement, cette année, le bon saint a choisi un dimanche pour se manifester à ses adorateurs; c'est une petite malice d'almanach qu'il leur joue; l'année prochaine il arrivera un lundi, et ainsi il vous vaudra deux jours de congé, mes chers petits amis. Prenez patience!--S'il est bien de parler des choses, mieux vaut encore les faire voir; c'est le procédé de l'Illustration; elle joint l'exemple au précepte; voici donc un fac similé de la Saint-Charlemagne qu'elle me charge de mettre sous vos yeux. Où la scène se passe-t-elle? Aux collèges Bourbon, Saint-Louis, Henri IV, Rollin, Louis-le-Grand, peu importe: tous les dîners de Saint-Charlemagne se ressemblent.--Voyez la joie de nos écoliers! certes, ils songent moins à manger qu'à se divertir et à se jouer quelques malins tours; cependant, un personnage se distingue par son appétit, au milieu de ces riants convives. Par Cornus! quel mangeur! on voit qu'il profite de l'occasion, et ne rencontre pas tous les jours une table aussi bien garnie.--Quel est cet affamé?--Ne le devinez-vous pas? Et quel autre qu'un maître d'études peut se livrer avec tant de satisfaction aux agréments du festin?--Le maître d'études est sobre par nécessité; l'année pour lui est un grand jeûne. Mais vient la Saint-Charlemagne, et le maître d'études s'en donne pour le passé et pour l'avenir; semblable à ces maigres figurants de comédie qui se gaudissent et font chère-lie dans le vaudeville ou le drame qui leur fournit par hasard à souper.
Puisque nous voici au vaudeville, restons-y, et entrons au théâtre des Variétés: là nous trouverons Bouffé, son nouvel hôte, Bouffé que le Gymnase a perdu. Mais Bouffé n'est-il donc qu'un acteur de Vaudeville? n'est-ce pas là un mot bien petit pour un talent si grand, et Bouffé ne se dépasse-t-il pas de toute la tête? Oui, sans doute, l'homme qui a créé Michel Perrin, le père Grandet, le pauvre Jacques et tant d'autres personnages par lui marqués au coin de l'observation et de la vérité profonde, celui-là fait mieux que jouer le vaudeville; il s'élève jusqu'à l'art des éminents comédiens.
Il faut mettre l'oncle Baptiste au nombre des rôles où Bouffé excelle et qu'il a particulièrement frappés de son estampille; nous en parlons ici parce que la pièce vient de passer du Gymnase au théâtre des Variétés; Bouffé l'avait emportée dans ses bagages. Au fond, c'est une production assez médiocre, où l'honnêteté des intentions et des sentiments mérite d'être louée plutôt que l'habileté et la finesse du travail; mais Bouffé! relève ce qu'il y a de vulgaire dans l'œuvre par une exécution admirable: c'est, pour le coup, que l'auteur doit allumer un beau cierge en l'honneur du comédien.
Cet oncle Baptiste est un ancien soldat redevenu ouvrier après la guerre.--Baptiste a le cœur excellent et d'une probité à toute épreuve; je vous défie de trouver un plus brave homme, plus sensible, plus dévoué, plus prêt à se donner à vous, corps et âme; mais l'éducation manque à toutes ces vertus; Baptiste sent que c'est par là qu'il pèche; cette conviction le rend défiant, susceptible, à l'égard de ceux qui se distinguent de lui par les manières et par la fortune; pour un rien, Baptiste croit qu'on le dédaigne ou qu'on veut l'humilier; ce n'est pas contre le premier venu, mais contre son propre frère qu'il exerce cette susceptibilité, contre son frère que le travail et l'intelligence ont placé honorablement dans le monde, en effaçant les traces de son ignorance première. De là, de la part de Baptiste, des soupçons sans fondement, des querelles à tout propos, des ruptures douloureuses que l'amitié de ce frère ne peut empêcher; il y a même une heure terrible, où la prévention de Baptiste est si aveugle et si violente, qu'elle compromet l'honneur et la fortune de l'excellent homme. Oui, dans un moment d'ivresse, égaré, hors du lui, Baptiste révèle des secrets d'où dépend la ruine de son frère! Heureusement qu'il s'éveille à temps de son délire, et que, recouvrant la raison, il répare tout le mal qu'il a fait sans le vouloir et sans y songer. Voilà le personnage; mais ce qu'on ne peut se figurer, c'est l'art charmant et profond avec lequel Bouffé en exprime toutes les nuances et tous les contrastes, passant de la honte à la colère, de la naïveté à la finesse, des larmes au sourire, et rendant surtout avec une vérité surprenante ce mélange de sensibilité et de rudesse, d'abandon et de défiance, qui se trouvent au fond du caractère de Baptiste. La scène d'ivrognerie donne le frisson.
Nous ne savons, si Bouffé allait à Saint-Pétersbourg, comment l'empereur de Russie récompenserait un talent si fin et si touchant; mais, à en juger par les nouvelles que nous recevons de la munificence du czar pour les artistes italiens, il ne lui épargnerait pas les roubles. Plus d'une fois on a parlé, ici même, du prodigieux succès obtenu à Saint-Pétersbourg par Rubini, Tamburini et madame Pauline Viardot Ce qu'on nous rapporte en dernier lieu dépasse tous les récits précédents, et, à ce titre, on ne s'étonnera pas que nous en fassions mention.
Il y a eu à la cour de Russie une fête splendide pour les fiançailles de la grande-duchesse Alexandra avec un prince de Hesse; le dimanche, 7 janvier, un festin de huit cents couverts avait réuni les noms les plus illustres et les plus magnifiques parures; la salle, en stuc blanc, étincelait de l'éclat des uniformes, des riches vêtements et du feu de mille bougies; c'était un merveilleux spectacle, qu'une fée toute-puissante semblait avoir créé d'un coup de sa baguette.
Les artistes italiens, invités à dîner chez le prince Wolkonsky, ont reçu de sa main, à table, les présents envoyés par l'empereur en signe de sa satisfaction: madame Pauline Viardot, une agrafe de collier composée d'une magnifique émeraude entourée de vingt-deux diamants, le tout valant 1,200 roubles, ou 4,800 francs; Rubini et Tamburini, chacun une émeraude de 500 roubles; madame Assandri, de 400; des présents d'une valeur proportionnelle ont été distribués aux autres artistes de la troupe. Cette magnificence envers les comédiens de la troupe italienne s'est, dit-on, élevée dans cette journée à une valeur totale de 4,100 roubles, soit 16,400 francs.
Retournons à Paris et à d'autres spectacles; nous en avons près de nous et de tout genre: les uns publics et se montrant ingénument à la foule sans voile et sans arrière-passée; les autres plus mystérieux et ne disant pas toujours ce qu'ils ont l'air de dire.
A laquelle de ces deux espèces appartiennent certaines réunions qui se pratiquent dans plusieurs quartiers de Paris? n'ont-elles pour cause que le but qu'elles affichent? ou bien cachent-elles sous leurs apparences visibles une idée secrète, le mot d'un logogriphe? C'est aux sphinx à le savoir ou à le deviner; pour nous, il nous suffit d'être les simples narrateurs du fait.
Le lieu de la scène est tout à fait dramatique et prête aux mystérieuses conjectures. Figurez-vous un immense caveau dont les sombres profondeurs s'étendent dans les entrailles d'un temple divin: par exemple l'église Saint-Sulpice. Là, à certains jours, s'assemble une foule considérable d'hommes de tout rang, de toute condition et de tout âge, depuis l'adolescent jusqu'au vieillard, et de la simple veste de l'ouvrier à l'habit de drap fin. Des lampes suspendues aux voûtes jettent une lumière fantastique dans la nuit de ce noir caveau; alors les assistants prennent place sur des bancs symétriquement rangées, et il est aisé de voir à leur attitude qu'ils obéissent à une sorte de hiérarchie et de discipline. Chaque banc, en effet, est divisé, pour ainsi dire, en compagnie de dix personnes soumises à un chef. Sur le fond de cette assemblée, vêtue en majorité du costume laïque, se détachent des prêtres et des frères de la doctrine chrétienne. Ceux-là surtout semblent avoir l'autorité et prendre une part active dans ses réunions.
Pour obtenir les honneurs de l'association, il faut avoir dix-sept ans au moins: la profession, la naissance, le pays, la religion, ne sont comptés pour rien dans les clauses d'admission; chacun y a droit, pourvu qu'il ait l'âge prescrit et qu'il ait assisté à trois réunions pour toute épreuve.
Que se passe-t-il entre tous ces hommes assemblés? Comment occupent-ils les heures qu'ils se partagent ensemble? Des poètes lisent leurs vers, des savants traitent des questions de science, des orateurs prononcent des panégyriques ou soumettent des thèses morales ou religieuses; des musiciens exécutent des chants sacrés: il y a un bureau présidé par le curé de Saint-Sulpice, qui règle l'ordre des discussions; tantôt l'assemblée chante en chœur des psaumes accompagnés de l'orgue, et tantôt elle procède au tirage d'une loterie dont les lots, livres ou tableaux, sont distribués aux membres de l'association que le sort a désignés. Chaque séance est close par une prière. L'association est placée sous le patronage de saint François-Xavier.
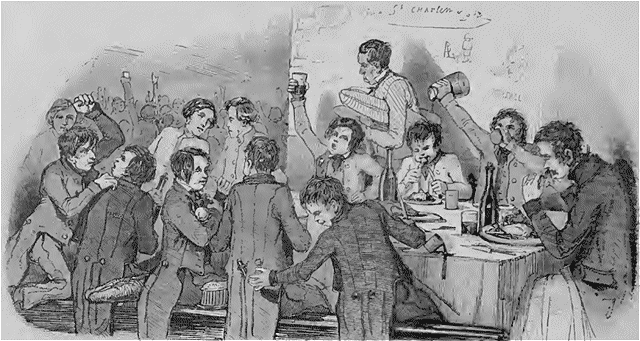
Dîner de la Saint-Charlemagne dans un Collège de Paris.
Avez-vous deviné? Comprenez-vous le véritable mot de l'énigme? Et d'ailleurs, y a-t-il une énigme? Ces réunions singulières auraient-elles un but occulte? Pour moi, je n'en sais rien, et c'est pourquoi je vous le demande, peut-être vous aiderai-je dans vos recherches en vous nommant quelques-uns des personnages notables qui en font partie ou comme membres ou comme assistants: le nonce et l'internonce du pape, des archevêques, la plupart des curés de Paris, les abbés de Dreux-Brézé, de Bonnechose, Ravinat, de La Bouillerie, Dupanloup, de Ravignan; et parmi lus laïques MM. Guillemin, de la Cour royale, Cauchy, de l'Académie des Sciences, et Alexandre Guiraud, de l'Académie Française.
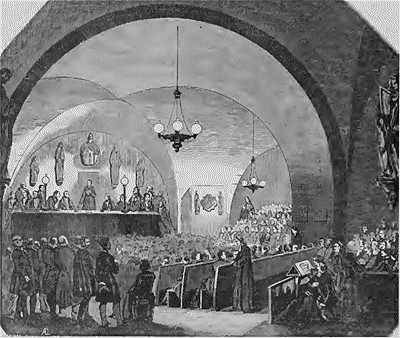
Conférences pour les ouvriers dans une chapelle souterraine,
à Saint-Sulpice.
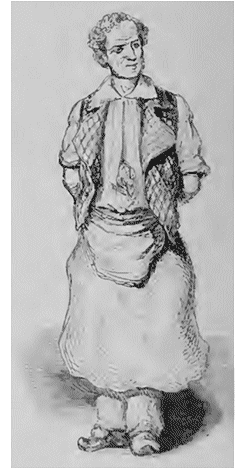
Bouffé, rôle de l'oncle Baptiste.
--Pour revenir aux simples comédies, nous annoncerons le retour de mademoiselle Nau à l'Académie Royale de Musique. Mademoiselle Nau avait quitté l'Opéra depuis deux ans, après une rupture complète: mais voyez le hasard! M. Léon Pillet, revenant d'Italie et de sa chasse au ténor, rencontre mademoiselle Nau à Lyon. On se revoit, on oublie le passé, et faute du ténor introuvable, le directeur ramène l'agréable cantatrice. Le public de l'Opéra a retrouvé, non sans quelque plaisir, cette jolie voix, un peu faible, mais habile et légère.
Mademoiselle Déjazet quitte le théâtre du Palais-Royal pour le théâtre du Vaudeville; en revanche mademoiselle Nathalie passe du Gymnase au théâtre du Palais-Royal: c'est une espèce de chassé-croisé que dansent ces demoiselles. L'engagement de mademoiselle Nathalie est de quatorze mille francs. Pauvre Nathalie!
L'Odéon promet toujours son Vieux Consul, tragédie en cinq actes, qui annonce la prétention de recommencer le succès de Lucrece. Quelqu'un demandait au directeur, M. Lueux, son avis sur ce nouveau chef-d'œuvre: «C'est très-beau, répondit-il; je n'ai pas eu cette année un seul succès à mon théâtre; mais cette fois je le tiens; je suis sûr d'avoir un succès d'ennui.»
La censure a définitivement défendu les Mystères de Paris. Le manuscrit est renvoyé depuis hier à M. Eugène Sue, avec invitation de refaire complètement la pièce, s'il veut échapper à l'interdit. Cette décision recule indéfiniment la représentation de ce drame si impatiemment attendu, et pour lequel on se battait déjà au bureau de location.
Un député qui n'est que médiocrement ferré sur l'orthographe et la langue française a écrit sérieusement à un électeur: «J'ai assisté hier à l'inauguration du monument de Molière. Il n'est pas étonnant qu'on ait donné une fontaine à ce grand homme; il a assez fourni à la Seine.
Approvisionnements de Paris.
NOUVEAU MARCHÉ BONNE-NOUVELLE.
Lorsque Paris presque tout entier était renfermé dans l'île de la Cité, les halles ou marchés se trouvaient placés dans les faubourgs et occupaient les environs de la rue du Marché-Palu. Avant le règne de Louis VI il y avait un marché sur les terrains de la place de Grève, et Louis VI choisit lui-même en 1136, l'emplacement actuel des halles appelé alors Champeaux (petits champs), pour y établir un vaste marché destiné à l'alimentation de toute la ville. Le grand nombre de paysans qui le fréquentait y attira bientôt une foule de corps de métiers, tels que changeurs, merciers, drapiers, etc., pour lesquels Philippe-Auguste fit construire, en 1180, des halles particulières.

Entrée sur l'Impasse Mazagran du
nouveau Marché
Bonne-Nouvelle.
Sous Henri II, en 1553, et sur les terrains occupés par ces halles, furent percées les rues qui, sous les dénominations de rues de la Tonnellerie, de la Cordonnerie, de la Friperie, de la Poterie, etc., qu'elles ont conservées, attestent aujourd'hui que toutes ces professions s'exerçaient alors exclusivement sur cet emplacement.
L'agrandissement de Paris, depuis cette époque jusqu'à la révolution de 1789, n'apporta pas de notables changements aux habitudes des Parisiens, et c'était toujours à la grande Italie, ou marché des Innocents, que tous les quartiers de la ville venaient s'approvisionner.
Le gouvernement impérial sentit tous les inconvénients d'une semblable centralisation, et il fit en conséquence commencer et terminer plusieurs des grands marchés, qui existent aujourd'hui. Le marché Saint-Honoré, élevé sur l'emplacement du cloître des Jacobins, date de l'année 1810; le marché Saint-Germain, commencé sous l'Empire et fini en 1816, sous la Restauration, a remplacé les loges de l'ancienne foire Saint-Germain, établies en 1786; le marché Saint-Martin, commencé le 15 août 1811, occupe les terrains dépendants de l'ancienne abbaye placée sous l'invocation de ce saint.
Quelques marchés de Paris sont exploités par des compagnies particulières qui paient à la ville des redevances annuelles; tel est le marché Saint-Joseph, que ses emménagements restreints et peu aérés n'empêchent pas d'être très-achalandé et de produire des bénéfices considérables.

Vue intérieure du nouveau Marché Bonne-Nouvelle.
Le marché d'Aguesseau, propriété de la famille Berryer, a longtemps été d'un très-grand rapport; mais les nouveaux quartiers qui se sont élevés derrière la rue Tronchet lui ont suscité une rivalité dangereuse. Une compagnie a eu l'idée de bâtir le marché de la Madeleine, et cette construction vaste, aérée et bien percée se faisait remarquer surtout par l'élégance de sa couverture en fer, qu'a dernièrement enlevée un ouragan, et que remplace provisoirement une toiture en planches.
Les nombreuses constructions entreprises sur les terrains situés entre la rue du Faubourg-Poissonnière et celle du Faubourg-Saint-Denis ont amené un résultat semblable, et les propriétaires du bazar de l'Industrie, situé sur le boulevard Bonne-Nouvelle, ont obtenu de la ville de Paris le droit de consacrer l'étage demi-souterrain de cette propriété à l'établissement d'un marché.
Ce marché, qui a pris le nom de marché Bonne-Nouvelle, et auquel on parvient par des ouvertures pratiquées sur le boulevard et sur l'impasse Mazagran, ne se distingue pas moins que celui de la Madeleine, par l'élégance et la commodité de ses emménagements: placé à quelques mètres en contre-bas du sol des rues qui y conduisent, il est aussi frais en été que confortable en hiver; sa construction en pierres de taille offre une remarquable solidité, et il est assez spacieux pour desservir tout le nouveau quartier élevé à la place des ignobles impasses qui venaient naguère déboucher sur le boulevard.
Les travaux intérieurs de ce marché, et la décoration de la nouvelle entrée sur l'impasse Mazagran, que représentent nos gravures, ont été exécutés sur les dessins de M. Lussy, architecte, qu'un long séjour en Espagne a familiarisé avec le style mauresque.
Hasard et Calomnie
NOUVELLE TRADUITE DE L'ALLEMAND, DE WILHELMINE WILLMAR.
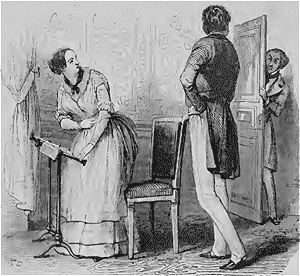
I.
Je m'étais rendu à la ville de M***, racontait un jour Léopold d'Ambach à ses amis, pour conférer de mes intérêts avec le conseiller de Justice; Werner, mon fondé de pouvoirs. Je me trouvais chez lui lorsqu'on vint annoncer le chambellan de Reich.
«Ce vieux fat, dit Werner, m'apporte une nouvelle qui est pour moi de la plus haute importance; oserais-je vous prier d'entrer pour quelques minutes dans l'appartement de ma fille?
--Pour quelques heures si vous voulez!» Telle fut ma réponse, et j'entrai.
Henriette, dans un déshabillé simple mais plein d'élégance, était assise devant un métier à broder; sur son invitation, je pris place auprès d'elle. Lorsque les lieux communs de la pluie et du beau temps furent épuises, je dirigeai la conversation sur le charmant ouvrage qui l'occupait, et tout en admirant l'adresse des dames d'aujourd'hui, je hasardai de dire que leurs grand'mères me semblaient l'avoir emporté sur elles pour le travail des mains.
Henriette combattit cette opinion; sans refuser aux chefs-d'œuvre de l'aiguille antique une plus grande solidité, elle soutint que l'on ne pouvait nier les progrès du goût et préférer une épaisse étoffe de soie à ramages à un dessin léger dont le blanc ressort avec grâce sur le blanc même du canevas.
La conversation s'anima. Je ne me tins pas pour battu, et j'alléguai en plaisantant que les médisants pourraient prendre acte de la légèreté du travail de nos dames, comparé à celui de leurs aïeules, pour tirer quelques malignes inductions.
Dans le feu du discours, j'avais appuyé mon bras sur le dossier de la chaise d'Henriette, lorsque le chambellan de Reich, poussé par sa curiosité, entr'ouvrit la porte à laquelle nous tournions le dos, et avança la tête. Henriette se leva précipitamment; j'en fis autant, et Reich, avec l'air satisfait de l'homme qui vient de découvrir quelque mystère:
«Pardon, dit-il, je suis de trop;» puis il se retira vivement et ferma la porte.
Je regardai Henriette, Henriette me regarda, et nous allions éclater de rire, lorsque, songeant à mon mariage prochain et à la mauvaise langue du chambellan, je craignis quelque sot bavardage. Henriette semblait faire des réflexions du même genre; elle était devenue pâle, et l'inquiétude qui se peignit sur ses traits me fit augurer qu'elle avait aussi quelque motif de redouter les commérages. Je voulais courir après Reich pour le désabuser; mais elle devina mon projet et me retint, assurant qu'une telle démarche ne ferait qu'empirer le mal, cet homme étant capable de prendre toutes mes allégations comme de maladroites défaites.
Werner, après l'avoir congédié, vint me chercher pour continuer notre conférence. Je m'attendais à quelque explication d'Henriette devant bon père; mais elle garda le silence, et je crus devoir en faire autant.
II.
Mes occupations à la campagne me mirent pendant plusieurs mois dans l'impossibilité d'aller à B***, rendre visite à ma fiancée, Clémentine de Blumer; mais je lui écrivais fréquemment, et je m'étonnais du laconisme et du style contraint de ses réponses; aussi, dès que les dernières gerbes de ma moisson furent rentrées dans mes granges, je montai à cheval, galopai vers la ville et descendis chez elle.
Réception glaciale de la mère et de la fille. Il s'était passé quelque chose d'étrange, je n'en pouvais douter. Je demandai une explication à Clémentine, qui aussitôt quitta le salon avec, un geste dédaigneux; je m'adressai alors à ma future belle-mère pour obtenir la clef de cette énigme.
Madame de Blumer, afin sans doute d'apaiser mon impatience, remonta au péché originel, dont, à son avis, le sexe masculin avait seul eu sa part; et après maintes digressions aussi appropriées au sujet, il lui échappa une allusion à l'aventure que j'ai racontée plus haut. Je n'en fis que rire et lui rendis un compte fidèle, m'en rapportant d'ailleurs au témoignage du conseiller Werner, qui m'avait lui-même introduit près de sa fille.
Mes paroles et mon accent de vérité convainquirent la mère, qui se hâta de faire ma paix avec Clémentine; cependant je crus remarquer chez celle-ci quelques doutes qu'il me fut impossible de dissiper; il me sembla même qu'elle n'aurait point été lâchée si j'avais eu réellement une petite faille à excuser, tandis qu'elle avait de la peine à me pardonner l'offense dont elle-même s'était, rendue coupable envers moi, sans autre fondement que les calomnies d'un désœuvré.
Afin pourtant de lui persuader que je n'attribuais sa bouderie qu'à un accès de tendre jalousie, je suppliai madame de Blumer de hâter notre union; mais elle commença l'énumération de tout ce qui manquait encore au trousseau, depuis le linge de table, encore chez la blanchisseuse, jusqu'aux cornettes de nuit, auxquelles travaillait la lingère. En vain j'assurai que ma maison était suffisamment fournie pour un jeune ménage; la bonne dame ne voulait pas, disait-elle, s'exposer aux railleries de la ville entière; elle prétendait que Clémentine n'allât s'installer à ma campagne qu'avec l'attirail d'une dame châtelaine.
Vaincre des caprices féminins est une œuvre de géant dont je ne me sentais pas la force; j'en passai par ce qu'on voulut, et retournai tranquillisé dans mon village.
Chemin faisant, je rencontrai l'assesseur Braun, un de mes amis, et je dirigeai vers lui les pas de mon cheval; mais il piqua des deux et prit un chemin de traverse pour m'éviter, selon toute apparence. Ma mauvaise humeur allait me reprendre; néanmoins je réfléchis qu'il pouvait ne m'avoir pas reconnu, et je poursuivis gaiement ma route.
III.
«Quand le mauvais esprit a dépose un œuf quelque part, il aime à le couver!» C'est ce que je me dis en moi-même peu de temps après, lorsque survint un nouvel incident qui pouvait donner prise à la médisance.--Je me trouvais à B*** et revenais de chez ma fiancée. Un orage me surprit. Tout à coup j'aperçus Henriette qui luttait contre la violence du vent, près d'enlever son parapluie; je courus à son aide, lui offris mon bras, et la conduisis chez une amie qu'elle allait visiter.
Au moment d'atteindre la maison, nous rencontrâmes Braun, qui fit une horrible grimace, et l'empressement avec lequel Henriette dégagea son bras du mien fut un trait de lumière: leur amour m'était dévoilé, et je m'expliquais la conduite de Braun à mon égard. Les propos du chambellan en étaient la cause.
La foire de B*** me ramena en ville, je devais aller chercher Clémentine pour la conduire à un théâtre d'optique et de fantasmagorie; mais, retenu par quelques affaires, j'appris en arrivant chez elle que ma fiancée était déjà partie avec une autre dame; je fus les rejoindre au théâtre.
Le spectacle était commencé et la salle complètement obscure. Pour ne déranger personne, je pris, la première place venue restée libre, à l'extrémité d'un banc.
J'étais là depuis quelques minutes, et déjà le spectre fantasmagorique de Catherine II succédait à celui de Frédéric le Grand, lorsque ces mots, prononcés à voix basse derrière moi, frappèrent mon oreille: «Perfide! nierez-vous encore votre coupable intelligence?»
Cette voix ne m'était point étrangère, et quand les ténèbres furent dissipées, je reconnus dans ma voisine Henriette Werner; Braun était place derrière elle, et près de celui-ci Clémentine avec son amie. Pour achever de me déconcerter, le misérable Reich, assis devant nous, poussait le coude de son voisin pour le rendre attentif à notre situation embarrassante. On rit, on chuchota, et au moment où Voltaire paraissait sur la toile la patience me manqua et je sortis sans savoir où j'allais.
IV.
Ce fut dans la rue seulement que je réfléchis combien cette fuite ridicule nous exposait aux nouveaux traits de la médisance. Était-ce ma faute si, ébloui par la lumière du dehors et entrant tout à coup dans l'obscurité j'avais, sans reconnaître personne, pris place à côté d'Henriette? C'était encore bien moins la sienne; et le tort que pouvaient faire les mauvaises langues à sa réputation me chagrinait beaucoup plus que la petite bouderie à laquelle je devais m'attendre de la part de ma fiancée.
Je rentrai dans la salle, et me plaçai de manière à pouvoir tout observer sans être aperçu. Clémentine et Braun causaient ensemble vivement, et sans doute il était question d'Henriette et de moi, car le maudit chambellan s'approcha d'eux avec son vilain rire sardonique. Je ne me possédais plus de fureur et je l'aurais étranglé volontiers, lorsque je vis Henriette porter plusieurs fois son mouchoir à ses yeux.
Enfin, la toile étant tombée, la foule s'écoula, et, à mon grand étonnement, Braun offrit son bras à ma fiancée, qui l'accepta en jetant un regard dédaigneux sur la pauvre Henriette.
Celle-ci sortit avec une tante qui était venue passer chez elle le temps de la foire. Je les suivis, tout à coup des cris d'alarme se firent entendre; la foule, épouvantée par des chevaux fougueux, s'écartait en tumulte:--à quelques pas de moi, Henriette cherchait avec inquiétude sa tante, qu'elle avait perdue. Devais-je la laisser seule dans l'embarras?
«Ah! votre rencontre porte malheur!» s'écria-t-elle douloureusement; mais elle ne pouvait en ce moment se passer d'un appui, elle dut agréer le mien.
Elle prit donc mon bras, et nous cherchâmes ensemble sa compagne; mais la foule s'étant dissipée, nous jugeâmes qu'elle était retournée seule au logis, et nous en primes aussi la route.
Le sort qui semblait nous avoir choisis pour jouets de ses caprices, rapprochant deux personnes jusqu'alors à peu près inconnues l'une à l'autre, établit entre elles une liaison plus intime. Je racontai à Henriette la scène qui m'avait été faite chez ma fiancée, et lui dis que je croyais aussi deviner le motif de son affliction. Elle m'avoua alors que depuis plus de six mois l'assesseur Braun la recherchait en mariage, mais que Werner s'y opposait, alléguant que le caractère violent de ce jeune homme rendrait certainement sa femme malheureuse. Elle-même ne pouvait s'empêcher de reconnaître en partie la justesse de cette opinion; mais une sorte de crainte, plus encore qu'une véritable inclination, l'empêchait de rompre avec Braun.
Je m'efforçai de la tranquilliser en disant tout ce que je savais de favorable à Braun, et en promettant de ne rien négliger pour éclaircir ces funestes malentendus. Les images de son front se dissipèrent, et nous commencions à plaisanter sur l'étrange fatalité qui s'attachait à nous, lorsqu'à peu de distance de la maison un bonsoir retentit à nos oreilles, et nous reconnûmes avec effroi la voix du chambellan.
Je demandai à Henriette si son père était instruit du hasard qui nous avait, pour la première fois, offerts aux yeux de ce misérable; elle me répondit que c'était pour elle une grande consolation qu'il n'en fût point informe.
Je ne devinai pas pourquoi elle lui taisait une chose aussi innocente, quelques mots du conseiller Werner pouvant fermer la bouche à la calomnie.
V.
J'avais toujours reconnu en Braun un homme d'honneur, quoique la passion l'aveuglât souvent; c'est pourquoi je jugeai nécessaire à son égard une démarche qui, envers le chambellan, eût été inutile et peut-être nuisible. Je lui écrivis le soir même une lettre dans laquelle, après avoir détaillé les bizarres circonstances qui nous avaient désunis, je lui représentai que, fiancé de mon libre choix avec mademoiselle Clémentine de Blumer, il ne pouvait me venir en pensée de faire la cour à une autre, fût-elle douée de tous les avantages qui distinguaient Henriette. J'offrais, au contraire, l'emploi de tout mon crédit auprès du conseiller Werner pour amener la réalisation de ses désirs; je n'oubliais pas néanmoins, en terminant, de déclarer à Braun que, s'il conservait encore quelque défiance, je ne reculerais pas devant une explication d'un autre genre.
Cette lettre produisit l'effet que j'en attendais. Le lendemain matin, Braun accourut chez moi, me serra avec attendrissement dans ses bras, et me demanda excuse de tout ce qui s'était passé. Notre réconciliation fut sincère, et non-seulement il agréa avec joie l'offre que je lui fis de parler pour lui au père d'Henriette, mais il me promit, de son côté, de désabuser Clémentine.
Satisfait de lui et de moi-même, je me rendis sans délai chez Werner et lui exposai les vœux de Braun, en les appuyant avec chaleur. Werner m'écouta en silence et avec une émotion qui me frappa. «C'est vous qui me faites cette demande! vous!» s'écria-t-il à plusieurs reprises en me serrant la main. Puis il m'expliqua sans aucune aigreur les motifs de son opposition au mariage de sa fille avec le jeune assesseur, mettant en parallèle la douceur angélique de l'une et son extrême sensibilité, la roideur et la violence de l'autre, dont il m'était impossible de ne point convenir.
Il ne me restait donc plus qu'à parler de leur mutuel attachement et du changement qu'une affection véritable peut amener dans le caractère, personne n'étant aussi propre à opérer une telle métamorphose que l'aimable et bonne Henriette.
Werner en tomba d'accord avec moi, non sans exprimer la crainte que le premier feu de la passion étant apaisé, les anciennes habitudes ne vinssent à reprendre le dessus.
«Eh bien! répliquai-je, fixez un temps pour éprouver Braun: votre fille alors ne pourra vous accuser d'avoir opposé à ses vœux une aveugle inflexibilité.
Ce projet obtint son suffrage. Après une conférence avec Henriette, Werner résolut d'accorder au jeune assesseur l'entrée de sa maison, sans que pourtant celui-ci dût regarder cette tolérance comme un consentement.
Braun n'ignorait pas qu'il me dût cette faveur, et néanmoins il ne paraissait pas entièrement satisfait. J'eus lieu de penser que Clémentine était là-dedans pour quelque chose: Braun avait tenu sa parole en lui expliquant les aventures du théâtre de fantasmagorie; mais le perfide Reich ayant raconté que le soir même il m'avait rencontré riant avec mademoiselle Verner, on en avait conclu que ni Henriette ni moi n'aurions été d'aussi bonne humeur si nous ne nous faisions un plaisir de nous jouer de nos engagements.
VI.
Depuis ce moment, il régnait entre Clémentine et moi une contrainte pénible qu'en vain je cherchait à dissiper. Quelquefois je la pressais de me déclarer sans feinte si elle avait changé de sentiments à mon égard; alors elle semblait émue, m'appelait son cher Léopold, mais son humeur chagrine ne tardait pas à renaître.
Une telle situation ne pouvait me rendre heureux, et, malgré l'attachement que m'inspirait encore Clémentine, je ne regardait point sans inquiétude dans l'avenir. Un entretien que j'eus avec madame de Blumer mit le comble à mon déplaisir.
Un jour l'ayant trouvée seule, je lui fis sérieusement part de mes craintes, en lui déclarant que quelle que fût la grandeur du sacrifice, je renoncerais à la possession de sa fille plutôt que de compromettre son bonheur.
«Il ne s'agit ici, répliqua-t-elle, que de la réputation de Clémentine; si elle s'est trompée, elle doit expier son erreur, il est trop tard pour reculer. Je crois même nécessaire, ajouta-t-elle, de céder aux vœux que vous m'avez exprimés, et de hâter votre union.»
Une visite interrompit la réponse qui allait s'échapper de mon cœur ulcéré, et, sans attendre le retour de Clémentine, je sortis désolé de cette maison où j'avais rêvé le comble de la félicité.
J'errais dans les rues de B***; un poids énorme oppressait ma poitrine; j'avais besoin d'une âme qui s'ouvrît à la confidence de mes peines et qui sût me présenter ma cruelle situation sous un aspect moins affligeant.
Je me trouvai inopinément devant la demeure d'Henriette Werner, dont une commune destinée avait fait pour moi une amie. Je savais qu'elle écouterait mes plaintes avec intérêt, qu'elle me donnerait des conseils et ne me cacherait pas si j'avais, moi aussi, des reproches à me faire envers Clémentine; car l'amour-propre offensé devient aisément injuste; une faute entraîne les autres, elles forment les anneaux d'une chaîne que notre peu de fermeté nous empêche de rompre.
VII.
L'entretien que j'avais eu avec madame de Blumer se retraçait toujours à mon souvenir: je la voyais pressant les ouvrières pour que tous les objets qui faisaient obstacle à notre union fussent promptement cousus, blanchis, et plissés; j'entendais ces paroles qui m'avaient si vivement froissé: «Si Clémentine s'est trompée, elle doit expier son erreur.» Je la voyais, cette bonne mère, calculer l'assistance qu'elle donnerait à sa fille pour mettre un gendre à la raison.
On voulait en effet regagner le temps perdu, car bientôt arriva chez, moi un tapissier, chargé par madame de Blumer de prendre la mesure de mes appartements pour préparer tapis et rideaux. Je répondis que j'étais satisfait de mon ameublement, que plus tard je m'entendrais avec ma femme pour changer ce qui lui déplairait.
A peine l'ouvrier fut-il parti, que je me reprochai ma résistance. Pour châtiment de mon refus, j'attendais une lettre piquante; ma confusion fut extrême lorsque Clémentine m'écrivit qu'elle s'accommoderait volontiers mes moindres désirs, persuadée d'avance que ce qui me plairait aurait également son approbation. En même temps elle m'envoyait divers échantillons d'étoffes pour sa robe de noce, me priant de lui faire connaître mon goût, afin que le tailleur et la marchande de modes se missent à l'ouvrage sans délai.
Il y eut dans ma réponse de l'affection et presque de l'humilité, car le tribunal de ma conscience ne m'absolvait pas entièrement; toutefois je cherchais sincèrement à réveiller notre tendresse, et j'éprouvai une véritable joie lorsqu'un de mes voisins de campagne m'invita à une fête où ma fiancée et sa mère avaient promis de se trouver. J'espérais que cette tête serait une occasion de rapprochement qui effacerait toute trace de rancune.
VIII.
Je me mis en route plus tôt que je n'aurais fait en d'autres circonstances. Franchement ce n'était pas cette fois l'amour qui m'aiguillonnait: je voulais que mon empressement réparait ma faute aux yeux de Clémentine. Cet espoir fut trompé: les convives arrivèrent successivement; elle ne parut point. Mais Henriette Werner, que je n'attendais pas, survint avec sa tante.
Cette apparition me troubla. Était-ce du plaisir? était-ce un pressentiment confus que notre rencontre aurait encore de fâcheuses suites? Jamais Henriette ne m'avait paru plus séduisante. Lorsqu'elle me reconnut dans l'embrasure d'une fenêtre, une prompte rougeur couvrit son visage; mais avant que mon amour-propre ait eu le temps de l'interpréter cette rougeur me fut expliquée. Henriette s'approcha, et par manière de conversation m'apprit que l'assesseur Braun serait au nombre des convives. Nouveau sujet d'inquiétudes. Pour y mettre le comble, le premier auteur de toutes mes tracasseries, le maudit chambellan de Reich, entra pendant notre colloque.
J'eus soin dès lors de me tenir éloigné d'Henriette, que malgré moi mes regards cherchaient à tout instant; elle m'évitait avec la même attention, et quand par hasard nos regards se rencontraient, notre frémissement prouvait assez la crainte que nous inspirait notre fâcheux observateur.
Le dîner se passa sans que Braun ni Clémentine eussent paru. J'étais excédé par la contrainte à laquelle m'obligeait la présence du chambellan, désolé de ne pouvoir m'entretenir avec la bonne Henriette, dont l'amitié m'était devenue précieuse; et cette privation m'affectait plus que l'absence de ma fiancée, au sujet de laquelle chacun me venait présenter ses condoléances. Il me semblait dur aussi pour Henriette que je ne pusse aller lui dire quelques paroles d'intérêt; lorsque enfin à tant de déplaisirs, tint se joindre la pensée que dans notre application à nous fuir l'un l'autre, le malfaisant Reich pourrait voir une nouvelle preuve d'intelligence entre nous. Mon dépit redoubla; je quittai l'assemblée pour aller chercher dans une chambre éloignée la solitude et le repos. Là je me jetai dans un grand fauteuil placé derrière le poêle, asile dont les ténèbres sympathisaient avec l'état de mon âme.
IX.
Depuis une demi-heure j'y pestais contre ma destinée, lorsque j'entendis ouvrir, puis refermer la porte de la chambre et pousser le verrou; j'avançai la tête, et reconnus, à mon grand effroi, mademoiselle Werner, un billet à la main, que sans doute elle voulait lire sans témoin.
Le triomphe de nos persécuteurs, si l'on nous surprenait ensemble avec toute l'apparence d'un plan concerté, s'offrit à ma pensée; au risque d'effrayer Henriette, je me levai rapidement pour quitter la chambre.
Mais lorsque je la vis pâlir et chanceler, toute idée de précaution m'abandonna; je courus à elle, je la reçus dans mes bras et je la conjurai dans les termes les plus tendres de calmer ses inquiétudes. Elle pleurait, hors d'état d'articuler une parole, et chacune de ses larmes pénétrait jusqu'à mon cœur; enfin elle me tendit le billet qu'elle venait de recevoir: Braun annonçait qu'une affaire indispensable l'empêchait d'assister à la fête; mais qu'il viendrait dans l'après-dinée avec ma fiancée et sa mère, également retenues par leurs occupations.
«S'ils arrivaient eu ce uniment!» En prononçant ces mots je m'élançai vers la porte, et déjà j'en avais saisi le verrou, lorsqu'un bruit confus se fit entendre au dehors, et je reconnus les voix de ceux que nous redoutions.
Dans mon anxiété j'agitais le verrou avec un mouvement presque convulsif. Tout à coup le fatal Reich s'écria: «Ils doivent être ici, je les y ai vus entrer l'un et l'autre.» Une faire? L'épouvante d'Henriette était sans bornes; je ne pensais qu'à elle, je pressais ses mains tremblantes, tantôt sur mon sein, tantôt sur mes lèvres; je la conjurais tout bas de se tranquilliser, protestant que je me précipiterais par la fenêtre plutôt que de compromettre sa réputation.
Cependant une porte que l'obscurité nous avait dérobée se présente à mes yeux, j'y cours. Elle donne dans un cabinet sans issue. Mais une vaste armoire m'offre ses entrailles libératrices; je m'y élance, non sans craindre que le remède ne soit pire que le mal: et tandis que je me blottis entre les cartons et les robes, Henriette m'enferme, prend la clef, et plus rassurée, va ouvrir la porte de la chambre. Les premiers mots qui frappent mes oreilles sont des reproches violents de Braun; il somme mademoiselle Werner de faire à l'instant connaître ma retraite. La plus timide, colombe s'enhardit lorsqu'elle est poussée à bout par des outrages. Henriette en donna la preuve; elle releva fièrement la tête et interdit à Braun un langage aussi inconvenant.
Pour moi, plié dans ma cachette de la manière la plus incommode, j'admirais la présence d'esprit des femmes. Si, au lieu d'une mince cloison, les eaux du grand Océan nous eussent séparés, Henriette ne su fût point exprimée avec plus d'assurance.
Lorsqu'on eut en vain fureté partout, et que j'eus résisté à des appels fort peu tendres de Clémentine, l'impétueux Braun s'efforça d'excuser ses emportements, par la vivacité de amour. Son billet trouvé par terre dissipa tout les doutes. Cependant la société s'éloigna sans qu'Henriette eût prononcé le mot de pardon.
Persuadé alors que je n'avais plus rien à craindre, j'essayai de me redresser tant soit peu pour respirer plus librement... Mais les arrêts, du destin sont inévitables!... Ma tête heurta une pyramide de cartons à chapeaux, qui roula par terre avec fracas.
«Il est là! là, dans l'armoire! cria le chambellan; j'imaginais bien qu'il ne pouvait être loin: c'est pourquoi j'ai voulu attendre qu'il fit connaître sa présence.
--Les apparences sont contre moi, dit Henriette avec une fermeté que lui inspiraient son innocence et les mauvais procédés de Braun; cependant il n'y a ici en jeu que le hasard et la malignité. Oui, celui que vous cherchez est dans cette armoire, et moi-même je l'y ai enfermé pour éviter les fausses interprétations auxquelles pouvait donner lieu notre rencontre fortuite. Mais avant d'ouvrir cette porte, je déclare formellement que cet instant me sépare à jamais de M. l'assesseur Braun.»
Braun, frappé de cet accent de vérité, voulut faire quelques objections; mais Henriette, sans l'écouter, ouvrit l'armoire, d'où je m'élançai, la rage dans le cœur.
X.
Peu m'importaient en ce moment les invectives de Clémentine; l'injure que souffrait mademoiselle Werner était ma seule préoccupation. Reich aurait été la première victime de ma vengeance, s'il ne se fût adroitement réfugié dans l'armoire que je venais de quitter; elle lui rendit le service que j'en avais espéré vainement, une main compatissante ayant fermé la porte et enlevé la clef tandis que je cherchais mon ennemi parmi les assistants.
Alors ce fut à Braun que je m'adressai; heureusement nous n'avions d'armes ni l'un ni l'autre, car le débat aurait coûté du sang.
Cependant les convives s'étaient assemblés autour de nous, et les représentations du maître de la maison, qui nous priait de vider notre querelle ailleurs, furent assez puissantes pour rétablir la tranquillité.
Henriette était partie; sur-le-champ avec sa tante; j'avais étalement ordonné d'atteler mes chevaux. Dans l'indignation qui me maîtrisait, je laissai entendre à Clémentine que je regardais notre mariage comme rompu; une femme qui avait si peu de confiance dans ma loyauté ne pouvait que me rendre malheureux.
Sans attendre sa réponse, je dis en passant à Braun qu'il me trouverait le lendemain matin dans un petit bois près de B***, et, je me hâtai de m'éloigner.
XI.
Rentré chez, moi, je fis les préparatifs d'un long voyage. Si le sort me favorisait dans mon combat, j'avais résolu d'aller à Paris pour me distraire et guérir les blessures de mon cœur.
Je ne me couchai point; je partis la nuit même à cheval, et le lever du soleil me trouva au rendez-vous. Braun se fit attendre; une sorte de repentir paraissait le dominer. Maintenant que la passion ne l'aveuglait plus, il reconnaissait que ni moi, dont il avait plus d'une fois apprécié la franchise, ni la sage et modeste Henriette, n'étions capables d'entretenir une intelligence secrète et criminelle. Il me tendit la main en signe de réconciliation, donnant à entendre que la prolongation de nos démêlés ne servirait qu'à aiguiser les traits de la calomnie.
Mais je demeurai sourd à ses paroles. L'espoir qu'il témoignait de voir bientôt s'aplanir ses différends avec Henriette m'indignait jusqu'à la fureur. Je le contraignis de mettre l'épée à la main, et quoique son sang-froid lui donnât sur moi de grands avantages, je parvins à le blesser et à le désarmer. Puis, après lui avoir recommandé prudence et discrétion, je montai à cheval pour gagner ma voiture, et partis à l'instant même.
Parmi des sensations bien contradictoires, celle qui m'agitait le plus, c'est qu'Henriette aurait compassion de Braun, qui venait de répandre son sang, et que cette compassion réveillerait peut-être un penchant mal éteint.
Ce fut alors que je reconnus combien je l'aimais. Pour justifier mon inconstance à mes propres yeux je maudissais le calomniateur, qui, en nous imputant à crime des hasards innocents, nous avait rapprochés l'un de l'attire, et m'avait donné l'occasion d'apprécier tout le mérite de mademoiselle Werner.
XII.
Vers la fin du second jour, je suivais tristement la grande route, sans jeter un regard sur les objets qui se succédaient autour de moi, lorsque le postillon me cria qu'une voiture était versée à peu de distance. Je fis arrêter, et, malgré les ténèbres qui commençaient à s'étendre, j'aperçus lieux dames dans le plus grand embarras; je m'avançai, et grande fut ma surprise en reconnaissant Henriette et sa tante.
Henriette avait fait connaître à son père les scènes désagréables dont nous venions d'être les acteurs. Non-seulement Werner avait approuvé sa résolution d'aller passer quelques mois chez sa tante, mais il ne lui avait pas caché que cette bonne tante prolongeait son séjour auprès d'eux sur son invitation, afin de pouvoir l'emmener aussitôt que serait survenue la rupture qu'il prévoyait depuis longtemps. Une plus ample connaissance avec le caractère de Braun ne lui permettait pas d'hésiter à refuser un pareil gendre.
Cette fois je bénis le hasard qui nous réunissait encore, et je commençai même à le regarder comme une sorte de prédestination.
Je m'empressai d'offrir ma voiture aux deux dames, la leur étant fort endommagée. La tante d'Henriette s'était froissé le bras gauche dans sa chute; les douleurs augmentèrent au point que nous fûmes obliges de nous arrêter dans une petite ville voisine.
Une seule auberge s'y trouvait; j'eus donc un logement dans la même maison qu'Henriette. Aurais-je pu la quitter au moment où une fièvre violente se déclarait chez sa compagne?
Nous prodiguions ensemble nos soins à la malade, et entre nos cœurs se formait un lien de plus en plus intime.
Henriette avait sur-le-champ envoyé à son père un messager pour lui mander l'accident; mais quelque diligence que fit Werner, lorsqu'il arriva, sa sœur était déjà presque rétablie, et il ne manquait que son consentement pour mon mariage avec sa fille.
Le bon Werner me serra dans ses bras en versant des larmes de joie, et m'avoua que depuis bien des années cette union avait été son vœu le plus cher.
«Le ciel a exaucé mes souhaits, s'écria-t-il, et la méchanceté de vos ennemis, sera la source de votre félicité.»
Nous prîmes tous ensemble la route de ma campagne, où peu de jours après notre bon curé, mon ancien instituteur, joignit nos mains comme l'étaient déjà nos âmes. Cet événement fit d'abord la matière de toutes les conversations à B***; on prétendait, non sans quelque vraisemblance, en tirer la preuve que nous n'avions point été injustement accusés. Cependant le chambellan, qui aurait voulu se procurer l'entrée de notre maison, déclara lui-même s'être permis envers nous ce qu'il appelait une innocente malice; nous consentîmes à lui pardonner, puisque après tout il était la cause première de notre bonheur, mais nous ne voulûmes point le recevoir, car on se préserve plus aisément d'un ennemi déclaré que d'un médisant.
Braun alla conter ses doléances à Clémentine; elle lui confia son dépit, et pour se venger, ils ne surent mieux faire que de nous imiter.
N.
Pénitencier militaire de Saint-Germain.
En entrant sous cette vaste porte sombre, en franchissant cette grille dont la clef est tenue par un sous-officier, oublions les brillantes fêtes, les magnifiques splendeurs, le luxe royal, dont ce château fut un temps le théâtre; préparons-nous plutôt à la visite que nous allons faire par le souvenir des grandeurs déchues qui ont remplacé dans ces lieux la majesté de Louis XIV émigré à Versailles; dans ces tours, le long de ces vastes balcons, erra madame La Vallière, consolée par de rares visites, jusqu'au jour où son âme aimante ne trouva plus que Dieu qui put remplir le vide laissé par le grand roi; dans ce corps de logis, qui fait face à la pelouse, Jacques II, qui, pour être un prince imbécile, n'en dut pas être moins malheureux, passa plus d'une triste soirée, entre sa femme et sa fille, reportant sa pensée à la belle réception que lui avait faite son hôte de France, et que suivit l'abandon nécessairement réservé au malheur qui s'abrite trop près des grandes prospérités. Le triste monarque, dont le doyen de Killerine nous montre la modeste cour, mourut là, faisant ces rêves de restauration que plusieurs générations devaient continuer; sa femme, sa fille, y moururent après lui. Depuis lors, les princes de France semblèrent éviter la contagion de déchéance dont les murs de Saint-Germain étaient imprégnés; le château devint une caserne, puis une école militaire de cavalerie, et enfin il est devenu ce que vous annoncent ces grilles; ces verrous, ces murs qui s'ajoutent à la profondeur des fossés, un pénitencier militaire.

Entrée du Pénitencier militaire
de Saint-Germain.

Conseil de guerre à Paris.
Si, en entrant dans ces cours, en entendant fermer derrière soi toutes ces ferrures, on n'éprouve pas ce serrement de cœur, ce pressentiment douloureux qui vous accueille à la porte de toute prison, c'est qu'on sait que là on ne va pas voir le crime hideux, endurci par le temps, rendu incorrigible par les mauvaises passions, par les habitudes de corruption et de débauche; on se dit que toute cette population, qu'une faute a privée pour un temps de sa liberté, est dans la force de l'âge, que tous ces prisonniers ont un avenir, qu'ils vivaient sous une loi exceptionnelle, sous la loi militaire, dont la rigueur nécessaire fait un crime, un crime sévèrement puni, de ce qui, pour un jeune homme de cet âge, dégagé des liens de fer de la discipline, ne serait souvent qu'un tort excusable, ignoré du monde et couvert par l'indulgence de la famille. Pénétrons donc sans hésitation dans cette maison de rachat; nous ne verrons que des corps jeunes et robustes, apprenant à faire un emploi intelligent de leurs forces, des cœurs qui s'émeuvent à tous les nobles sentiments, et qui travaillent à se réhabiliter assez pour être encore dignes de porter l'uniforme.
Cette institution, qui, jusqu'à présent, a donné les plus heureux résultats, a été appliquée, pour la première fois, à l'année par ordonnance royale du 3 décembre 1832. Les essais en furent faits dans les bâtiments de l'ancien collège Montaigu, situés entre le collège Sainte-Barbe et la place du Panthéon; mais ce local, dont les sombres constructions vont disparaître dans les plans d'amélioration et d'embellissement qui vont s'exécuter dans ce quartier, devint bientôt trop étroit pour le nombre des détenus; il fallut faire un nouveau choix, et, au mois d'avril 1836, le pénitencier militaire fut transféré à Saint-Germain. Les vastes appartements, les galeries, avaient été distribués en rangées de cellules ordinaires, où chaque prisonnier se retire le soir; les celliers avaient fait place à des cellules ténébreuses, où sont renfermés ceux qui ne se soumettent pas à l'ordre de la maison. L'immense hauteur des salles d'armes, des, salles de gala, avait été coupée en plusieurs étages d'ateliers, et le château royal pouvait recevoir cinq cents prisonniers. La haute surveillance du pénitencier est remise à M. le lieutenant-général comte Sébastiani, commandant de la première division, et qui, plus d'une fois, a manifesté le chaleureux intérêt qu'il porte à l'établissement; chaque aimée un inspecteur-général est désigné par le ministre de la guerre pour lui faire un rapport sur les résultats de l'année et les améliorations à obtenir.
Cette création, dont tout l'honneur revient à M. le maréchal Soult, est surtout remarquable par ce point, que le condamné militaire est seulement suspendu de son service, mais ne cesse pas de faire partie de l'année et reste soumis au code particulier qui la régit. Lorsqu'il entre dans le pénitencier, où l'envoie le jugement d'un conseil de guerre, il est dépouillé pour un temps du l'uniforme de son régiment, et en revêt un de couleur grise, dont la forme rappelle beaucoup celui de la petite tenue du cavalier, et dont la simplicité n'admet aucune de ces couleurs voyantes et bariolées dont on affuble ordinairement les détenus. La tenue militaire est de rigueur pour tous les chefs employés à l'établissement; ces chefs sont encore soumis à tout ce qu'ils devaient observer à l'égard de leurs soldats: il leur est défendu d'injurier, de maltraiter de gestes ou de paroles les détenus, qui, de leur côté, doivent le respect à leurs chefs de tout grade. Afin que personne n'en ignore, les dispositions qui règlent ces devoirs réciproques sont lues tous les dimanches à l'inspection. Tous les mouvements sont réglés par le commandement militaire; le compte de masse que le condamné avait à son régiment est transmis à l'administration, qui continue à le régler de la même, manière; les fautes contre la discipline sont punies disciplinairement; les délits et les crimes sont soumis aux conseils de guerre; enfin, à l'expiration de leur peine, ceux qui n'avaient plus qu'un an de service à faire sont renvoyés dans leurs foyers, les autres sont dirigés sur un des trois bataillons d'infanterie légère d'Afrique; quelques-uns, par une exception que leur mérite une conduite exemplaire, obtiennent la faveur de rentrer, aussitôt après leur libération, dans des régiments de l'armée intérieure.
Le système d'Auburn est celui dont se rapproche le plus le système de Saint-Germain, c'est-à-dire que les prisonniers couchent isolément dans des cellules et mangent et travaillent en commun et en silence. Pendant les récréations, ils peuvent parler. Nous allons examiner l'emploi d'une journée de travail pendant l'hiver.
A six heures et demie du matin, un tambour choisi parmi les prisonniers bat la diane signal du réveil; les sous-officiers surveillants prennent les clefs de leurs divisions respectives et vont ouvrir les cellules. Chaque détenu nettoie sa demeure nocturne, plie dans des dimensions données ses couvertures et le sac de campement dans lequel il couche; les ablutions corporelles ont lieu dans les corridors, du 1er octobre au 1er avril; le reste de l'année, elles ont lieu dans la cour; tous les détails d'une propreté parfaite sont scrupuleusement surveillés et s'exécutent en silence.
Environ un quart d'heure après les détenus descendent en ordre dans la cour; l'appel a lieu de la même manière et avec les mêmes batteries que dans la ligne; les hommes sont formés en bataille sur trois rangs et inspectés. La distribution du pain se fait immédiatement; chaque homme reçoit pour sa journée une ration de pain de même poids et de même qualité que celui délivré à la garnison. Aussitôt après, au commandement de l'adjudant de semaine, tous les détenus sont conduits en ordre et au son de la caisse à leurs ateliers; chacun d'eux se rend à la place qui lui est assignée et se met à l'œuvre; à l'exception d'explications données à voix basse par les contre-maîtres, un silence complet règne partout; rompre ce silence est un cas de punition.
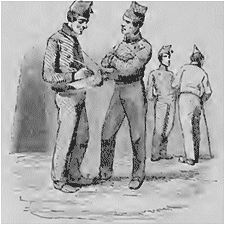
Costume des détenus du Pénitencier
militaire de Saint-Germain.
À huit heures et demie a lieu la visite du chirurgien-major; il visite les malades mis à l'infirmerie pour indispositions légères; à la tisanerie il reçoit ceux qui viennent se présenter, prescrit les remèdes nécessaires et envoie à l'hôpital du lieu ceux dont l'état exige cette translation; là, dans une salle consignée, ils reçoivent, comme tous les autres malades, ces soins touchants que l'on rencontre partout où se trouvent les dignes sœurs de charité.
A onze heures du matin, un roulement donne le signal du repas; les hommes sortent des ateliers en ordre et se forment en bataille; au commandement de l'adjudant, ils entrent au réfectoire, tous s'arrêtent devant leur place accoutumée et se tiennent debout; à un coup de baguette, tout le monde s'assied et le repas commence.
A son arrivée au pénitencier, chaque détenu est pourvu d'un litre, d'une gamelle de même contenance et d'un gobelet d'un quart de litre, le tout en étain; il reçoit, de plus, une cuiller de bois et un couteau à pointe arrondie: tous ces objets sont disposés sur la table à la place du détenu auquel ils appartiennent.
Les rations sont individuelles; elles consistent, pour le repas du matin, les mardi, jeudi et dimanche, en une soupe grasse et une portion de viande désossée pesant quatre-vingt-douze grammes; et pour le repas du soir, les mêmes jours, en une soupe aux légumes; les autres jours de la semaine, les détenus reçoivent, pour le repas du matin, une soupe aux légumes; et pour le repas du soir une portion de légumes assaisonnés.
Les détenus qui se conduisent bien peuvent améliorer leur nourriture en prenant à leurs frais, au repas du matin, un quart de litre de vin, dix centimes de fromage, un demi-kilog. de pain bis blanc. On retire cette permission pendant un temps donné à ceux qui se font infliger des punitions.
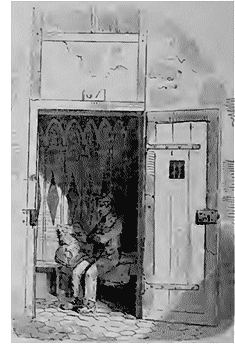
Une cellule du Pénitencier militaire
de Saint-Germain.
A onze heures et demie, un nouveau coup de baguette annonce la fin du repas; les hommes, qui, pendant toute sa durée, ont gardé le silence, se lèvent, sortent en ordre et vont au préau à la récréation; là encore ils sont suivis par ces conseillers muets qu'une bienveillante prévoyance a multipliés autour d'eux; des inscriptions ingénieusement choisies mettent sans cesse sous leurs yeux des avis résumés en phrases courtes et qui frappent l'esprit en se fixant dans la mémoire. Dans leurs ateliers, si un moment de découragement a ralenti leur ardeur, en levant la tête, ils ont lu:
LE TRAVAIL DU CORPS DÉLIVRE DES PEINES DE L'ESPRIT.
Dans ces inscriptions ils trouvent même une protection; si un maître d'atelier ou un surveillant oubliait les recommandations du règlement, l'ouvrier peut lui montrer sur la muraille:
REPRENDS TON PROCHAIN AVANT DE LE MENACER.
Dans les préaux, il n'a pas suffi de défendre les mauvais propos et les jeux de hasard; il a fallu mettre ces hommes en garde contre l'entraînement de la colère ou de leurs courts loisirs; ils lisent ici:
POINT DE PROBITÉ POSSIBLE AVEC LA PASSION DU JEU; ON COMMENCE PAR ÊTRE DUPE, ON FINIT PAR ÊTRE FRIPON.
et là:
DANS UN COEUR PERVERS, LA PASSION DU JEU MÈNE À L'ÉCHAFAUD: DANS UNE ÂME ENCORE HONNÊTE, ELLE CONDUIT AU SUICIDE.
Toutes ces pensées sont salutaires, utiles; mais nous ne pouvons nous refuser à en citer deux encore qui nous ont surtout frappé. En entrant au pénitencier, le condamné trouve sa sentence justifiée par la morale quand il aperçoit devant lui, dans la première cour, ces mots:
QUICONQUE ENFREINT LA LOI N'EST PAS DIGNE D'ÊTRE LIBRE.
Enfin, en sortant, voici la dernière pensée qu'il trouvera sur ces murs qu'il abandonne:
ON NE PEUT PLUS ROUGIR LE SES FAUTES QUAND ON A TOUT FAIT POUR LES RÉPARER.
Reprenons l'emploi de la journée. Pendant que leurs camarades causent ou lisent des livres d'instruction appartenant il l'établissement, ceux qui sont illettrés vont assister à un cours d'enseignement mutuel qui a lieu à la même heure.
A midi et demi, après l'appel, les travaux recommencent, et se prolongent jusqu'à sept heures; le souper ne dure qu'un quart d'heure; la retraite se bat, et à huit heures un roulement annonce, le coucher. Chaque homme emporte dans sa cellule son bidon rempli d'eau; les portes sont fermées, et les clefs rapportées à un poste intérieur, où elles restent sous la responsabilité de deux surveillants de garde. Pendant la nuit, un officier de service fait, dans l'intérieur, trois rondes, pour s'assurer s'il n'y a pas d'hommes malades ou de tentatives d'évasion, et le commandant d'une garde de vingt-six hommes, placée au pénitencier, est chargé des rondes extérieures.
L'été n'apporte à ce régime d'autre changement que d'avancer l'heure de la diane, et de prolonger d'une heure la journée d'atelier, qui se trouve ainsi portée à onze heures de travail.
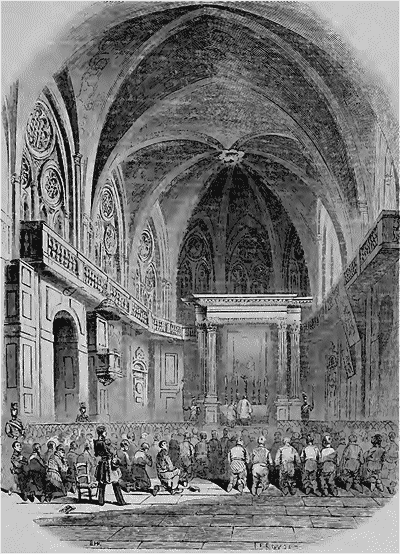
Chapelle du Pénitencier militaire de Saint-Germain.
Le dimanche est un jour consacré plus spécialement aux soins de propreté: ce jour-là, chaque homme descend dans les préaux son sommier, son sac de campement, sa couverture et son oreiller pour les battre; les cellules sont frottées, les portes et les serrures nettoyées à fond. Après une première inspection des sous-officiers, les prisonniers, dans leur tenue la meilleure, vont assistera la messe dans la chapelle gothique ornée par Louis XIII, et où Louis XIV fut baptisé. Du haut de cette chaire qu'ont occupée les plus grands orateurs chrétiens, un aumônier leur fait une instruction religieuse. C'est un spectacle imposant que de voir de la tribune tous ces hommes en colonne serrée, officiers et sous-officiers en tête, assister avec respect au service divin. On ne peut se défendre d'une vive émotion, lorsque, au moment où le prêtre élève l'hostie, cette masse compacte, par un seul mouvement, met le genou en terre, et écoute, dans un pieux recueillement, les chants que font entendre quelques-uns de leurs camarades placés derrière l'autel. On est bien plus impressionné encore si l'on vient à apprendre là que ces voix énergiques chantent des vers composés par un de ceux qui les a précédés dans ce séjour d'expiation, un jeune soldat que son talent, ses malheurs et son repentir avaient rendu célèbre, il y a quelques années. J'ai vu plus d'un œil devenir humide quand une voix jeune et fraîche fait entendre ces paroles:
Sur nous qui l'implorons, à genoux sur la pierre;
Sur nous tous, qu'un moment d'imprudence et d'erreur
Conduisit en ce lieu, domaine du malheur,
O Dieu! laisse tomber un regard tutélaire.
Et plus loin:
Du trône saint d'où ta main guide
Les astres roulant dans le vide,
Seigneur, Dieu clément, oh! vois notre douleur
Vois nos regrets et nos alarmes,
Rends-nous la liberté, nos armes,
Et finis nos jours de malheurs.
Le digne aumônier qui dirige la conscience de ces soldats leur a dit, du haut de la chaire de vérité, que tout motif humain devait être écarté dans l'accomplissement des choses saintes: «Vos actes religieux, leur a-t-il dit, sont entre le ciel et vous, et jamais ils ne serviront à vous procurer des biens temporels.» Cette règle, sagement observée, éloigne tout soupçon d'hypocrisie. Le 30 avril dernier, une soixantaine de détenus ont reçu la communion des mains de monseigneur l'évêque de Versailles, qui vient tous les ans visiter et consoler les habitants du pénitencier.
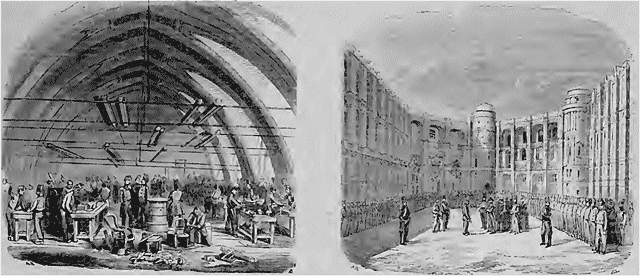
Pénitencier militaire de Saint-Germain.--Atelier.
--Remise de peine.
Les touchantes allocutions de ce pasteur, les sages instructions de l'aumônier, ne sont pas les seuls moyens que l'on emploie pour fortifier dans le cœur des prévenus le désir de leur régénération morale; le lieutenant-colonel Boudonville, commandant du pénitencier, seconde puissamment tous les sentiments qui peuvent ramener au bien ces jeunes citoyens, qu'un seul instant d'erreur a souvent amenés là; un registre de moralité est établi avec un soin scrupuleux, et présente un compte ouvert à chaque homme; on y inscrit exactement les progrès successifs dans la conduite et le travail, ainsi que les punitions et les motifs de ces punitions. A deux époques de l'année, au 1er mai et dans le mois de novembre, le commandant va examiner les titres que peut avoir chaque; détenu à la clémence royale; mais cette faveur ne peut s'étendre qu'à ceux qui ont au moins subi la moitié de leur captivité; les lettres de grâce qui réduisent ou remettent la peine sont lues à la grande revue du dimanche, à midi, en présence de tous les détenus formant le carré. C'est là un beau jour pour tous, et pour ceux qui sont rendus à la France, à l'armée, à leur famille, et pour ceux à qui la délivrance de leurs amis semble dire: Méritez, espérez.
Le lendemain de ce jour de délivrance est souvent triste et plein de regrets. On sait, en effet, que les abords des prisons, les jours où les portes doivent s'ouvrir, sont assiégés, par des hommes perdus, par d'ignobles femmes, qui spéculant à la fois sur le pécule amassé pendant la captivité, sur les privations subies, sur l'enivrement du grand air de la liberté, guettent les libérés comme une proie, s'emparent d'eux, les entraînent à tous les désordres, à toutes les débauches; et ces heureux du matin doivent se féliciter si, le lendemain, au réveil, ils n'ont perdu que le fruit du leurs économies forcées.
L'administration du pénitencier de Saint-Germain vient de donner un bon et grand exemple. Il y a quelques jours, seize hommes avaient atteint le terme de leur expiation ou obtenu remise du reste de leur peine; au lieu du quitter le château pour tomber dans les hideuses séductions qui déjà les attendaient, on les a vus, revêtus de l'uniforme des corps divers auxquels ils appartenaient avant leur faute, sortir en rangs sous le commandement d'un sous-officier, traverser au pas et en bon ordre cette ville que leurs devanciers avaient plus d'une fois troublée des excès de leur joie et se diriger sur Versailles, où ils ont trouvé dans la discipline militaire l'appui dont ils avaient besoin contre eux-mêmes. Loin de se plaindre de cette précaution, ils ont chargé le sous-officier qui les accompagnait de leurs remerciements pour le commandant.
Rendons un juste hommage; à M. le maréchal Soult, dont la prévoyante sollicitude a créé, organisé cet établissement, où, tandis que la punition se subit, l'homme s'améliore, et d'où il sort le cœur plus affermi dans le bien, l'intelligence plus cultivée, et possédant une des industries, qui s'exploitent dans les huit ou neuf ateliers entre lesquels les prisonniers sont répartis. Mais pour que la généreuse pensée du ministre produisît tous ses résultats, il fallait que l'exécution en fût remise à un officier dont le cœur fût noble, la pensée droite, la raison ferme; le pénitencier de Saint-Germain a dépassé toutes les espérances, et le maréchal et les officiers, recommandables de cet établissement ont reçu leur plus douce récompense quand les rapports ont constaté que parmi tous les militaires rendus à la liberté depuis 1839, on ne compte qu'une récidive sur deux cents libérés, que plusieurs ont obtenu de l'avancement, occupent des emplois de confiance et même ont mérité des distinctions.
Académie des Sciences.
COMPTE RENDU DES SECOND ET TROISIÈME TRIMESTRES DE 1843.
(Voir t. 1er, p. 217, 234, 238; t. II, p. 182 et 198.)
II.--Sciences physiques et chimiques.
Compressibilité des liquides.--La propriété dont jouissent tous les Corps de pouvoir être réduits à un volume moindre sous l'influence d'une pression plus forte que celle à laquelle ils étaient d'abord soumis, a été longtemps méconnue dans les liquides. C'est à MM. Sturm et Colladon que l'on doit les premières mesures exactes de la contraction des corps qui existent à cet état. M. Aimé, professeur de physique au collège d'Alger, a fait de nouvelles expériences à ce sujet, à l'aide d'appareils à déversement, analogues à ceux dont l'idée est due à M. Walferdin. La mer, qui atteint une profondeur considérable aux environs d'Alger, lui a fourni le moyen d'obtenir des pressions variables jusqu'à 220 atmosphères. Les corps soumis il cette énorme pression doivent être plongés à environ 2 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Chaque centimètre carré de leur surface supporte un poids d'environ 227 kilogrammes.
Un résultat important des expériences de M. Aimé, c'est que la contraction éprouvée par le liquide est proportionnelle à la pression à laquelle on le soumet. Cette loi a été vérifiée par lui jusqu'à 220 atmosphères de pression. Il est à noter aussi que les nombres qu'il a obtenus à la température: de 12°,6 sont supérieurs à ceux que MM. Sturm et Colladon ont trouvés pour la température de zéro.
Elasticité des alliages.--M. Wertheim avait présenté à l'Académie, dans le courant de l'année dernière, un travail extrêmement remarquable sur les propriétés mécaniques des métaux simples. Dans un second mémoire, faisant suite au premier, il s'est occupé des alliages. Ce sujet, malgré le fréquent emploi des alliages dans les arts, n'a encore été que fort peu étudié, surtout en ce qui concerne l'élasticité.
Les expériences de M. Wertheim ont porté sur cinquante-quatre alliages binaires et sur neuf alliages ternaires, parmi lesquels se trouvent le laiton, le tombac, le métal des tamtams trempé et non trempé, le bronze, le pakfong, l'alliage des caractères typographiques, etc. Les résultats les plus positifs auxquels il soit parvenu sont les suivants:
1º L'élasticité d'un alliage est en général égale à la moyenne des élasticités des métaux constituants; quelques alliages de zinc et de cuivre font seuls exception;
2º Les alliages se comportent comme les métaux simples quant aux vibrations longitudinales et transversales et quant à l'allongement, c'est-à-dire qu'il existe entre ces divers éléments des rapports que la théorie indique et que l'expérience confirme d'une manière satisfaisante.
Electricité, galvanisme, électro-magnétisme, etc.--MM. Edmond Becquerel et de La Rive, de Genève, se sont l'un et l'autre occupés séparément de rechercher les lois de dégagement de la chaleur pendant le passage des courants électriques à travers les corps solides et liquides.
Parmi les autres communications que l'Académie a reçues sur cette branche importante de la physique, nous devons citer une théorie de la pile voltaïque par le prince Louis-Napoléon. «La netteté des raisonnements et des résultats, a déterminé M. Arago à publier entièrement la lettre du prince.
Mais l'expérience la plus curieuse, sans contredit, est celle que MM. Palmieri et Santi-Linari ont exécutée en Italie, et qui a été communiquée à l'Académie par une lettre de M. Melloni. Elle est relative aux courants d'induction produits sous l'influence du magnétisme terrestre. Ces courants, découverts par M. Faraday en 1831, pourraient aussi être appelés courants instantanés ou temporaires parce qu'ils ne durent qu'un instant. Ils se développent dans les corps conducteurs de l'électricité, sous l'influence d'un autre courant ou sous celle d'un aimant, et sont soumis à la loi générale suivante: «Lorsqu'un circuit conducteur fermé commence à recevoir dans quelques-uns de ses points l'action d'un courant quelconque, il est traversé par un courant inverse; lorsqu'il cesse de recevoir telle action, il est traversé par un courant direct; enfin, pendant qu'il reçoit cette action d'une manière constante, il n'est traversé par aucun courant et n'éprouve aucune modification apparente sensible.» (Phys. de Pouillet.)
Or, on sait que la terre peut être comparée à un grand aimant; son action sur les circuits fermés était donc facile à prévoir depuis que M. Faraday avait signalé l'existence de courants d'induction excités dans des spirales de cuivre par le rapprochement et l'éloignement brusques d'un aimant. Cet habile physicien lui-même avait démontré directement l'action de la terre sur les mêmes spirales retournées rapidement dans le plan du méridien magnétique. Mais il lui avait fallu employer un instrument très-sensible pour reconnaître l'influence du magnétisme terrestre, et toutes les tentatives faites depuis cette époque pour obtenir des effets plus puissants avaient été complètement infructueux.
Enfin, MM. Palmieri et Santi-Linari, après avoir varié leurs appareils de plusieurs manières, sont parvenus à en construire un qui est assez puissant pour imprimer des commotions sensibles et pour décomposer l'eau. Il paraît même probable à M. Melloni, qu'au moyen de quelques modifications à leur appareil, ses ingénieux compatriotes arriveront à rougir les fils métalliques et à produire des étincelles électriques.
Chaleur latente de la glace.--Lorsqu'on mêle ensemble un kilogramme d'eau à 10° et un kilogramme d'eau à 80°, le mélange a une température de 45°, précisément égale à la moitié de la somme 10 plus 80. Un kilogramme d'eau à zéro, c'est-à-dire à la température de la glace fondante, et un kilogramme à 80° donneraient encore un mélange à 40°. Mais il n'en est plus de même lorsqu'on substitue un kilogramme de glace à zéro à un kilogramme d'eau de même température. Le mélange de cette glace avec l'eau à 80° donnera de l'eau à une température très-basse, que Laplace et Lavoisier ont évaluée à 5°; de sorte que, suivant ces savants illustres, il faut 75° de chaleur pour faire passer un kilogramme de glace à zéro à l'état d'eau ayant la même température. C'est cette chaleur absorbée uniquement pour la transformation du solide en liquide, et dont le thermomètre n'accuse plus l'existence, que l'on appelle chaleur latente.
MM. de la Provostaye et Desains ont pensé avec raison que cette donnée importante avait besoin d'être déterminée par de nouvelles observations, et ils ont entrepris une longue série d'expériences qui leur a donné pour la chaleur latente de fusion de la glace, un nombre beaucoup plus fort que celui de Laplace et Lavoisier, savoir 79 au lieu de 75.
Leur travail, qui est destiné à figurer dans le recueil des savants étrangers, a été l'objet d'un rapport très-favorable de M. Régnault. Cet habile physicien avait lui-même effectué un grand nombre d'expériences dans le même but, et il était parvenu à des résultats presque identiques. On doit donc considérer comme à fort peu de chose près exact le nombre 79, adopté désormais pour la chaleur latente de fusion de la glace.
Singuliers effets de rupture.--M. Ségnier a répété devant l'Académie une expérience fort curieuse, déjà indiquée par M. Bellam, et depuis par M. Sorel. Tout le monde connaît les larmes bataviques, ces petits fragments de verre en forme de poire allongée, terminés par une queue très-effilée, que l'on obtient en laissant tomber dans l'eau froide, de l'extrémité de la canne du verrier, quelques parcelles de verre en fusion. On sait qu'il suffit de casser l'extrémité de la larme, pour que celle-ci se réduise immédiatement en poussière, avec une petite détonation.
La nouvelle expérience consiste à briser un vase de verre ou de terre, une bouteille épaisse, qui a résisté à des pressions intérieures de plus de vingt atmosphères, au moyen d'une seule larme batavique faisant explosion au milieu du liquide dont ils sont remplis.
Une autre expérience non moins curieuse est due à M. Ségnier. On suspend en l'air un verre cylindrique ordinaire rempli d'eau, et dont le fond est remplacé par un obturateur en parchemin; une balle tirée de haut en bas, au centre du liquide et suivant l'axe du cylindre, détermine la rupture des parois en une foule de parcelles longitudinales et étroites, parallèles entre elles, comme les douves d'un tonneau dont on enlèverait les cercles.
Dans ces deux expériences, lorsque les vases ne sont point entièrement pleins, les fractures s'arrêtent précisément à la hauteur du niveau du liquide. Cette circonstance a de l'analogie avec ce qui a été observé lors de l'explosion de certaines machines à vapeur.
Optique.--M. Adolphe Matthiessen d'Altona a fait à l'Académie plusieurs communications d'un haut intérêt, dont le laconisme des comptes rendus officiels ne nous permet pas de donner le détail. Au nombre des instruments proposés par l'auteur, on remarque des lunettes de spectacle qui, sous un volume réduit, auraient plus de lumière et de champ que les lunettes usitées, grossiraient d'avantage, et coûteraient moins. M. Matthiessen a trouvé aussi un verre de couleur verte parfaitement monochromatique. Enfin, il a imaginé un appareil commode et portatif, à l'aide duquel on peut voir les raies noires du spectre beaucoup plus aisément que par toute autre méthode. Employé à l'analyse de la flamme d'une chandelle, cet appareil fait apercevoir trois spectres différents l'un de l'autre par la nature et la position des raies de Fraunhoffer: un provenant de la combustion de l'oxyde de carbone; un second provenant de la lumière qu'émettent les molécules de carbone incandescent qui nagent dans la flamme, enfin, un autre qui résulte de la combustion de l'hydrogène.
Nous souhaitons que le rapport détaillé qui nous était promis pour un délai rapproché, le 21 avril dernier, ne se fasse pas trop longtemps attendre.
Photographie,--La formation des images de Moser, dont nous avons déjà parlé ailleurs (voir tome 1er, page 234), et la théorie des images daguerriennes, ont fait le fonds de communications assez nombreuses. Mais comme il s'agit de sujets que l'on est loin d'avoir ramenés, à une théorie simple, et sur lesquels il y a presque autant d'opinions que de physiciens, nous pensons inutile d'en entretenir cette fois nos lecteurs.
Travaux chimiques.--Une analyse fort remarquable des principes constituants du thé, par M. Péligot, est le travail chimique le plus intéressant qui ait occupé l'Académie.
Voici les résultats principaux auxquels ce chimiste est parvenu.
Le thé est, de tous les végétaux analysés jusqu'à ce jour, celui qui renferme la proportion d'azote la plus considérable. Cette proportion est pour 100 parties de thé desséché à 110 degrés, contenue dans le petit tableau ci-après:
Thé pekoe 6.58
-- poudre à canon 6.15
-- souchong 6.15
-- assam 5.10
En opérant sur 27 sortes de thés, M. Péligot a trouvé que les thés verts contiennent, en moyenne, 10, et les thés noirs 8 pour cent d'eau. Puis, tenant compte de cette eau que la feuille contient déjà, soit que la dessiccation en Chine n'ait pas été complète, soit qu'elle ait absorbé pendant ou après son transport une certaine quantité d'humidité, il a exprimé la proportion des produits solubles dans l'eau chaude, pour 100 parties de thé, par les nombres suivants:
Thés noirs secs 42.3
-- verts secs 47.1
-- noirs pris dans leur état commercial 38.1
-- verts dans le même état 43.1
Lorsqu'on évapore à siccité une infusion de thé, il reste un résidu brun-chocolat qui, lorsqu'il provient du thé vert poudre à canon, contient 435 d'azote sur 10 000 parties, et 470 lorsqu'il provient du thé noir souchong.
La principale matière azotée qui se trouve dans l'infusion de thé est une substance très-riche en azote, cristallisable, la théine, qu'on rencontre également dans le café (ce qui lui a fait souvent donner le nom de caféine), et qui existe aussi dans le guarana, médicament fort recherché par les Brésiliens. M. Péligot a trouvé jusqu'à plus de 6 p. 100 de théine, proportion beaucoup plus considérable que celle qui avait été admise jusqu'à ce jour; et, ce qui n'est pas moins curieux, il a signalé dans le thé l'existence en forte proportion d'une autre matière azotée, la caséine, dont le thé, dans son état ordinaire, renfermait 11 à 15 p. 100.
«On voit, en résumant ces expériences dit M. Péligot, que le thé renferme une proportion d'azote tout à fait exceptionnelle; mais il faut se rappeler que cette feuille n'est pas prise dans son état naturel, et qu'elle nous arrive après avoir été, pour ainsi dire, manufacturée. On sait, en effet, qu'avant d'être livré à la consommation, le thé subit une torréfaction qui ramollit la feuille et qui permet d'en exprimer, au moyen de la pression exercée par les mains, un suc assez abondant, âcre et légèrement corrosif; la feuille est ensuite enroulée et desséchée plus ou moins rapidement, selon qu'il s'agit de la fabrication du thé vert ou de celle du thé noir. Or, il est possible que ce suc soit peu ou point azoté et que sa séparation augmente par suite la quantité d'azote qui reste dans la feuille. En déterminant celle qui se trouve dans les feuilles fraîches des arbres à thé cultivés aux portes de Paris, dans les belles pépinières de MM. Cels, j'ai trouvé 4,37 d'azote p. 100 du thé desséché. Peut-être la différence du climat et la culture suffit-elle pour produire ces variations.»
L'auteur a terminé son travail par quelques considérations sur l'emploi du thé considéré comme boisson et comme aliment. «On ne peut nier, dit-il, en présence de la proportion d'azote renfermée dans cette feuille et de l'existence de la caséine, que le thé soit un véritable aliment lorsqu'il est consommé dans son ensemble, avec ou sans infusion préalable, comme le consomment, assure-t-on, quelques populations indiennes.»
Ainsi on lit dans une lettre de Victor Jacquemont: «Le thé vient à Cachemire par caravane, au travers de la Tartarie chinoise et du Thibet... On le prépare avec du lait, du beurre, du sel et un sel alcalin d'une saveur amère... A Kanawer, on le fait d'une autre façon: on fait bouillir des feuilles pendant une heure ou deux, puis on jette l'eau et un accommode les feuilles avec du beurre rance, etc.»
Les rapides progrès de la chimie ne feront jamais oublier les travaux des pères de la science, parmi lesquels figure au premier rang notre illustre Lavoisier. On ne peut donc qu'applaudir au projet, déjà formellement annoncé depuis quelques années par M. Dumas, de rendre un digne hommage à la mémoire de ce grand homme, en publiant ses œuvres complètes. Président de l'Académie en 1843, M. Dumas a sollicité du ministre de l'instruction publique le concours du gouvernement pour cette publication, et le ministre, dans une lettre adressée à l'Académie à ce sujet, s'est exprimé dans ces termes:
«Je viens appeler votre attention sur un projet qui se lie aux dispositions législatives adoptées en 1842 et en 1843, pour la réimpression des œuvres de deux savants géomètres. En demandant aux Chambres les crédits nécessaires pour ces deux réimpressions, j'avais pensé que la même disposition pourrait s'étendre à divers écrits éminents dans d'autres parties du vaste domaine des sciences. Ce serait le moyen de réaliser, pour les études mathématiques et physiques, dans des limites nécessairement plus étroites, ce qui a été fait depuis quelques années pour l'histoire nationale. Dans cette vue, et pour répondre à un vœu récemment exprimé dans un rapport présenté à la Chambre des députés; je désirerais que vous voulussiez bien consulter l'Académie des Sciences sur l'intérêt qu'il y aurait à publier, aux frais de l'État, les œuvres de Lavoisier. Il n'y a pas dans l'histoire de la chimie, un nom plus digne d'un pareil hommage: il n'y a pas non plus de publication plus utile, si l'on songe que Lavoisier est mort en préparant une édition compile de ses œuvres, qui manque encore aujourd'hui à la science.....»
Nous ne connaissons pas encore la réponse de l'Académie. Nous savons seulement que M. Arago a remis à la commission nommée pour préparer cette réponse des manuscrits de Lavoisier qu'il possédait; et nous souhaitons vivement que l'on ne tarde pas à rendre un hommage si mérité à la mémoire de cette victime d'une terrible réaction contre les abus de l'ancien régime.
ROMANCIERS CONTEMPORAINS.
CHARLES DICKENS.
Expériences américaines: Martin prend
un associé.--Vallée d'Eden en perspective.
(Suite.--V. t. II, p. 26, 58, 105. 139, 155, 214, 251 et 326.)
Votre Tour de Londres, monsieur, poursuivit le général, souriant dans l'intime et satisfaisante conviction de l'étendue de ses lumières; votre Tour, située dans le voisinage immédiat de vos parcs, de vos promenades, de vos arcs de triomphe, de votre opéra, de votre royal Almack, est tout naturellement la résidence où peuvent s'étaler les pompes et le luxe royal d'une cour étourdie et légère. La conséquence, monsieur, c'est là que se tient votre cour1.
Note 1: (retour) La Tour de Londres est située à l'extrémité orientale de la ville, tandis que le quartier de la mode et de l'aristocratie, les parcs Hyde-Park, Green-Park, le parc Saint-James, etc, le palais qu'habite la reine, les théâtres fréquentés par la haute société, les salles de bal, de concert, et tous les rendez-vous du grand monde, sont situés dans le quartier opposé, le West-end (extrémité occidentale de la ville).
--Êtes-vous allé en Angleterre? demanda Martin.
--Grâce à la presse, oui, monsieur; répondit le général; je m'y suis rendu en lecture, pas autrement. Vous êtes ici chez un peuple studieux, monsieur; vous trouverez parmi nous une connaissance des choses qui vous surprendra.
--Je n'en doute nullement, répliquait Martin, lorsqu'il se vit interrompu par M. Aristide Kettle, lequel murmura à son oreille:
--Vous connaissez, le général Choke?
--Non, reprit Martin sur le même ton.
--Vous savez sous quel point de vue on le considère ici?
--Comme l'un des hommes les plus remarquables du pays, répondit Martin à tout hasard.
--Justement; j'étais sûr que vous auriez, entendu parler de lui.
--Je crois, dit Martin, s'adressant au général, je crois être assez heureux pour avoir une lettre d'introduction auprès de vous, monsieur; elle est de M. Bévan, du Massachussets,» ajouta-t-il en la lui présentant.
Le général la prit et la lut avec attention; de temps en temps il s'arrêtait pour lancer un regard aux deux étrangers. Arrivé à la signature, il s'avança, donna une poignée de main à Martin, et s'assit auprès de lui.
«Ainsi donc, vous songez à vous établir dans l'Eden? lui dit-il.
--Sauf meilleur avis, et en me conformant à vos conseils et aux renseignements fournis par l'agent. On m'assure qu'il n'y a rien à faire dans les vieilles villes.
--Je puis vous présenter à l'agent, monsieur, dit le général; je le connais, car je suis membre de la corporation des propriétaires du territoire de l'Eden.»
Cette nouvelle, des plus sérieuses pour Martin, lui donnait fort à penser. Son ami du Massachussets n'avait fait tant de fond sur les conseils du général que parce que, le croyant étranger à toutes les spéculations de terrain, il en attendait un avis désintéressé. En effet, c'était, tout récemment que le général avait pris un intérêt dans la corporation de l'Eden; et il expliqua à Martin que depuis lors il n'avait eu aucune communication avec M. Bévan.
«Nous n'avons que bien peu à hasarder, dit Martin avec anxiété; seulement quelques guinées, et ce peu est tout notre avoir! Dites, général, croyez-vous que cette spéculation puisse offrir quelques chances de succès à un homme de ma profession?
--Et croyez-vous, dit le général d'un ton grave; croyez-vous que si la spéculation n'offrait aucune chance de succès, j'eusse fait la folie d'y mettre mes dollars?
--Je ne parle pas des vendeurs, dit Martin, mais des acquéreurs. Y a-t-il chance pour les acquéreurs?
--Pour les acquéreurs, monsieur! répéta le général avec quelque émotion et d'un ton péremptoire, je conçois. Vous venez d'une contrée vieillie, qui a entassé, aussi haut que la tour de Babel, les veaux d'or devant lesquels, de temps immémorial, elle s'agenouille. Mais cette terre-ci, monsieur, est neuve et vierge. L'homme ici ne naît pas décrépit comme dans la vieille Europe. Nous n'avons pas derrière nous, pour excuse, l'exemple de siècles écoulés en pratiques corruptrices; point de faux dieux chez nous, monsieur; l'homme s'y montre dans toute sa grandeur native. Si ce n'est pas dans ce but que nous avons combattu, c'est en vain que notre sang aura coulé. Me voilà ici, moi, monsieur, ajouta le général, plantant devant lui son parapluie comme un digue représentant de sa philanthropie (et c'était un affreux parapluie); me voici, avec ma tête grise et mon sens moral; eh bien, irais-je, désavouant mes principes, placer mes capitaux dans une spéculation que je ne jugerais pas féconde en espérances et en chances de bonheur pour mon prochain, pour mes semblables!»
Marlin, qui ne pouvait s'empêcher de songer à New-York, s'efforça à grand-peine d'avoir l'air convaincu.
«Que seraient ces vastes États, monsieur, poursuivit le général, s'ils n'étaient destinés à la régénération de l'homme? Mais je vous pardonne; de pareils doutes doivent naître dans l'âme d'un homme qui vient de votre pays, et qui ne connaît pas le mien.
--Vous pensez donc qu'à part les fatigues que nous sommes disposés à endurer, il y a quelques chances raisonnables (le ciel sait que lions ne sommes pas extravagants dans nos prétentions), quelque espoir fondé de réussite?
--Un espoir fondé de réussite dans Eden, monsieur! Mais voyez, l'agent, voyez-le; voyez les cartes, les plans, monsieur, et ne formez votre jugement, n'établissez votre décision que d'après ce que vous aurez vu, de vos yeux vu. La vallée d'Eden n'en est pas réduite à mendier des habitants, monsieur!
--Il est de fait que c'est un endroit furieusement agréable et effroyablement salubre,» dit M. Kettle, qui continuait à se mêler à la conversation, selon son usage.
Martin sentit que, mettre en doute des témoignages de ce genre, uniquement parce qu'il éprouvait au fond une secrète défiance, serait chose tout à fait inconvenante et de mauvais goût. Il remercia donc le général, et se résolut à se rendre chez l'agent dès le lendemain.
Ce ne fut que tard dans la soirée, que nos voyageurs arrivèrent à leur destination. Ils s'établirent à l'hôtel National, où les usages et la société leur rappelèrent, par plus d'un trait de ressemblance, la pension bourgeoise du major Pawkins.
«Maintenant, Mark, mon bon garçon, dit Martin fermant la porte de sa petite chambre, il nous faut tenir grand conseil, car c'est demain que notre sort se décide. Êtes-vous toujours résolu à fondre vos économies dans le capital commun? Est-ce dit?
--Si je n'avais pas été déterminé à courir tous les risques, monsieur, je ne serais pas ici.
--Combien avez-vous là-dedans? demanda Marlin, soulevant un petit sac.
--Trente-sept livres sterling et seize pences, au moins à ce que dit la Caisse d'épargne. Pour moi, je n'en ai jamais fait le compte; ils doivent savoir leur affaire là-bas, Dieu merci! répliqua Mark avec un mouvement de tête qui exprimait sa confiance illimitée dans la sagesse et l'arithmétique de MM. les administrateurs.
--L'argent que nous avons apporté est fort en baisse, dit Martin; nous n'avons pas même huit livres sterling.»
Le sourire indifférent de Mark, et les vagues regards qu'il promena de tous cotés, montrèrent que ce détail était tout à fait au-dessous de son attention.
«De la bague, de son anneau, Mark! poursuivit Martin, regardant avec amertume sa main dépouillée de son ancienne parure.....
--Ah! soupira Mark Tapley; mais pardon, monsieur. --De sa bague, nous n'avons tiré que quatorze livres sterling, argent anglais; de sorte que, cela même compris, votre part de capital se trouve encore, comme vous voyez, la plus forte. A présent, Mark, ajouta Martin, reprenant son ancien ton dégagé, celui qu'il avait naguère avec ses plus humbles compagnons, mon plan est fait: j'ai tout arrangé pour que vous fussiez, non pas seulement dédommagé, mais récompensé, j'espère. Je prétends améliorer matériellement votre sort, et relever votre position, votre état, vos espérances..... --Oh! ne parlons pas de cela, je vous en prie, monsieur, s'écria Mark. Je ne tiens pas le moins du monde à être relevé; je suis content comme je suis, monsieur.
--Un moment, écoutez! reprit gravement Martin, la chose est d'une haute importance pour vous, et je m'en réjouis quant à moi. Je vous ai choisi pour associé, Mark, et cela, sur le pied d'une égalité parfaite. J'apporte, comme capital additionnel, ma capacité, mes talents, mon habileté dans ma profession; et la moitié, l'intégrale moitié des profits annuels sera vôtre, Mark; je vous en considère comme propriétaire dès aujourd'hui.»
Pauvre Martin! toujours bâtissant en l'air, muré dans sa personnalité, se nourrissant de projets chimériques, d'aveugles espérances: tout fier de la protection qu'il accordait, du magnifique cadeau qu'il faisait au compagnon de ses traversés, en lui donnant moitié du revenu douteux d'un capital certain qui appartenait presque tout entier au généreux garçon.
«Je ne sais, reprit ce dernier d'un ton plus attristé que de coutume, mais par des causes que n'aurait pu deviner Martin, je ne sais que vous dire, monsieur, pour vous remercier. Tant il y a que je vous soutiendrai du meilleur de mon âme, monsieur, et jusqu'au bout; et c'est là tout ce que je puis faire.
--Nous nous comprenons pleinement l'un l'autre, mon bon garçon, dit Martin, se levant avec un sentiment intime d'approbation flatteuse pour l'un et de condescendance affectueuse pour l'autre. De ce moment, nous ne sommes plus le maître et le serviteur, mais deux amis, deux associés qui s'applaudissent mutuellement de ce changement de relation. Si c'est en faveur de la vallée d'Eden que nous nous décidons, eh bien! du jour de notre arrivée, continua Martin, qui aimait à battre le fer pendant qu'il était chaud, notre maison se fondera sous la raison CHUZZLEWIT ET TAPLEY.
--Oh! pour l'amour du ciel, pas mon nom, monsieur! s'écria Mark; je n'entends rien aux affaires, et c'est bien assez pour moi d'être la compagnie. J'ai souvent songé, poursuivit-il à demi-voix, que j'aimerais à voir comment est faite une compagnie. Je n'imaginais guère en devenir une moi-même.
--Il n'en sera que ce que vous voudrez. Mark, dit le chef de la future maison Chuzzlewit et compagnie.
--Grand merci, monsieur; et si quelque propriétaire, quelque gros richard des environs, se met en tête de faire établir un beau jeu de quilles, bien dessiné, bien aplani, soit pour l'image publie, soit pour le sien, je me charge de cette partie de la besogne.
--Et je réponds que sur ce point vous battrez tous les architectes de l'Union, reprit son associé en riant. Allons, Mark, apportez-nous une couple de verres, et buvons au succès de l'entreprise.»
Martin mettait en oubli, cette fois, ce qui, du reste, lui arriva fréquemment par la suite, l'égalité, qu'il venait de proclamer si hautement. Peut-être aussi regardait-il ce genre de service comme dévolu de droit à la compagnie. Mark n'en obéit pas moins avec sa promptitude ordinaire; et, avant de se séparer pour la nuit, les deux associés convinrent de voir l'agent le lendemain ensemble. Mais c'était l'infaillible jugement de Martin seul qui devait décider la question de l'Eden. Mark, en sa joviale humeur, ne se fit pas un mérite, même à ses propres yeux, de sa condescendance. Il savait bien, d'ailleurs, que, de façon ou d'autre, il en serait toujours ainsi.
Le général se trouvait à la table d'hôte le lendemain; à l'issue du déjeuner, il proposa de voir l'agent sans plus de délais; les deux Anglais ne demandaient pas mieux, et tous quatre se rendirent au bureau de la Vallée d'Eden, situé à une portée de fusil environ de l'hôtel National.
Le bureau était petit et de peu d'apparence. Mais, puisqu'on peut tirer de vastes propriétés d'un seul cornet de dez, pourquoi ne marchanderait-on pas une province entière dans une guérite? D'ailleurs, c'était un bureau temporaire, les Edennéens se disposait à bâtir un superbe édifice pour y établir leur administration; ils en avaient même marqué le site, ce qui, en Amérique, est l'essentiel. La porte du bureau était toute grande ouverte, pour la commodité de l'agent, qui se tenait à l'entrée. Il fallait que ce fût un rude travailleur; car, paraissant avoir toutes ses affaires à jour, il se balançait paisiblement dans une chaise-berceuse, tenant une de ses jambes appuyée très-haut contre le chambranle de la porte, et l'autre repliée sous lui, comme s'il couvait son pied.
C'était un homme maigre, décharné, la tête couverte d'un large chapeau de paille, et vêtu d'un frac vert. Il ne portait point de cravate, vu la chaleur, et son col de chemise était assez écarté pour qu'à mesure qu'il parlait on vît quelque chose, s'enfoncer et resauter dans sa gorge, à peu près comme ces petits marteaux qui dansent et retombent pour reparaître dès qu'on touche les notes d'un piano. Si c'était la vérité faisant un faible effort pour s'élancer jusqu'à ses lèvres, nous pouvons rendre témoignage qu'elle n'y atteignait jamais.
Deux yeux gris se tenaient à l'affût au fond de la tête de l'agent; l'un d'eux, privé de vue, demeurait immobile, et ce côté du visage semblait épier et surveiller ce que faisait l'autre. Chaque profil conservait, ainsi son expression distincte, et c'était au moment où le profil en vie était le plus animé que le profil mort paraissait le plus inflexible dans sa sournoise vigilance, passer de l'un à l'autre, c'était retourner son homme, et mettre le dedans dehors.
Chacun des longs cheveux noirs qui pendaient de sa tête tombait aussi droit que le fil d'un aplomb. En revanche, des touffes mêlées formaient l'arc aigu de ses sourcils, comme si le corbeau, dont la patte était empreinte au coin de ses yeux, avait, en sa qualité d'oiseau de proie, par droit de parenté, tordu et hérissé de son bec tous ces poils menaçants.
Tel était l'homme qu'ils abordèrent, et que le général salua du nom de Scadder.
«Fort bien, général, répondit-il; et vous, comment vous en va?
--Toujours prêt, et de feu pour le service du pays et la cause de la sympathie mutuelle... Mais voici deux étrangers venus pour affaire, monsieur Scadder.»
Ce dernier donna une poignée de main aux nouveaux venus, préambule indispensable en Amérique, et recommença à se balancer.
«Je présume que je sais pour quelle affaire vous me les amenez, général.
--Eh bien, monsieur; nous voilà à vos ordres.
--Ah! général, général! vous ne savez rien garder! vous parlez trop, beaucoup trop, c'est un fait! dit Scadder. Je sais bien que vous êtes monstrueusement éloquent en public; mais, dans le particulier, vous ne devriez pas aller si fort de l'avant. Non, il faut que je le dise.
--Si je comprends où vous voulez en venir, faites-moi galoper avec un rail entre les jambes, repartit le général, après un moment de réflexion.
--Bah! comme si vous ne saviez pas aussi bien que moi que nous avions résolu de ne plus vendre un seul lot de l'Eden aux amateurs, et de réserver ce qui en reste aux privilégiés, aux favoris de la nature!
--Mais, justement! s'écria le général avec chaleur, les voilà ces privilégiés! ce sont ceux que je vous amène.
--Si ce sont eux, reprit l'agent d'un ton de reproche et de doute, cela suffit. Mais vous ne devriez pas jouer au fin avec moi voyez-vous, général!»
Celui-ci murmura dans l'oreille de Martin que Scadder était la plus honnête créature du monde, et qu'il ne voudrait pas, non, pas pour dix mille dollars, l'offenser de propos délibéré.
«Je remplis mon devoir, si, dons le but de servir mes semblables, je fais monter les offres, dit Scadder à voix basse, l'œil fixé sur la route, et se balançant toujours. Ils font la moue quand je leur reproche de donner l'Eden à trop bon compte! Si la nature humaine est ainsi faite, eh bien! à la bonne heure!
--Monsieur Scadder, dit le général, reprenant son ton oratoire; monsieur! voici ma main, voilà mon cœur! Je vous estime, monsieur, et je vous demande pardon. Ces messieurs sont de mes amis, sans cela je ne les eusse pas conduits ici, sachant bien, monsieur, que les lots sont cotés en ce moment fort au-dessous de leur valeur. Mais ce sont des amis, monsieur, des amis particuliers, je vous le répète.»
M. Scadder fut tellement satisfait de cette explication, qu'il se leva pour serrer plus cordialement la main du général et inviter ses amis particuliers à le suivre dans le bureau. Quant au général, il déclara, avec sa bienveillance habituelle, que, faisant partie de la corporation, il ne convenait pas à sa délicatesse d'être mêlé en rien dans les transactions de vente et d'achat. En conséquence, s'appropriant la chaise-berceuse, il se mit à considérer la perspective, comme le bon Samaritain attendant son voyageur.
«Bon Dieu!» s'écria Martin, dès que ses yeux tombèrent sur le plan gigantesque qui occupait tout un côté du bureau, car, à part cette carte, la pièce ne contenait que quelques échantillons de botanique et de géologie, un ou deux vieux registres, un grossier pupitre et un mauvais tabouret; «Dieu du ciel! que vois-je là?
--C'est l'Eden! dit Scadder, occupé à se curer les dents avec une sorte de petite baïonnette qu'il faisait sortir du manche de son canif en touchant un ressort.
--Eh mais! je ne me doutais pas que ce fût une ville!
--Vous ne vous en doutiez pas?... c'en est une, pourtant!» Et ville florissante encore! cité architecturale! Il y avait banque, églises, cathédrales, places, marchés, manufactures, hôtels, magasins, maisons, quais, une bourse, un théâtre, des édifices publics de tout genre, et jusqu'au bureau de l'Aiguillon, journal quotidien dit l'Eden; le tout sur papier et fidèlement enregistré dans le plan affiché sur le mur.
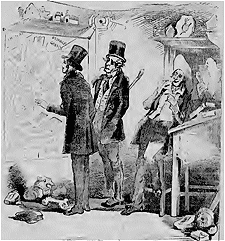
(La suite à un prochain numéro).
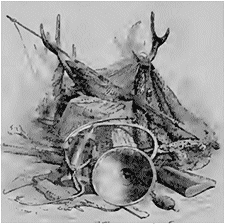
Chasses d'hiver.
LA CHASSE AUX CANARDS.
C'est le véritable moment de se mettre en route, les canards arrivent. Allons, graissez vos longues bottes, et disposez-vous à barboter comme eux. Cette chasse n'est pas toujours fort agréable, surtout lorsque, croyant marcher sur un terrain solide, on s'enfonce dans la vase jusqu'au cou. Il est quelquefois très-difficile de sortir de là sans aide; les corbeaux qui voltigent autour du malheureux chasseur, attendant son heure dernière, n'ont pas un chant assez harmonieux pour lui inspirer des pensées couleur de rose. Mais ceci n'est que l'exception. Dans l'état normal, un chasseur aux canards se mouille, se crotte; il a les pieds dans l'eau, la pluie sur la tête, ce qui établit l'équilibre; mais aussi, quel plaisir au retour! Un feu brillant et une soupe aux choux largement saupoudrée de fromage; du linge blanc et un gigot rôti: des pantoufles chaudes et la vaste robe de chambre ouatée; quelques bouteilles d'excellent vin et le visage riant de sa femme, voilà des jouissances inconnues à ceux qui, toujours munis du confortable, n'éprouvent jamais aucune privation.
Quelle étonnante reproduction que celle des canards! On en voit partout, on en tue partout, on en mange partout. Lisez, le récit de tous les voyageurs, ils ont trouvé des canards sous toutes les latitudes. En été, les canards habitent les lacs et les marais du Nord. Là, ils multiplient à l'infini, puisqu'en se promenant dans ces pays, lorsqu'on veut manger une omelette, on trouve des œufs à chaque pas; on n'a qu'à se baisser pour en prendre2. Et puis l'hiver arrive; tout ce peuple ailé se met en route pour chercher des climats tempérés; il fend l'air derrière un chef de file qui guide la troupe pendant un temps déterminé, toujours égal pour chacun.
Note 2: (retour) Voici ce que dit Regnard, dans son Voyage en Laponie: «Je ne crois pas qu'il y ait de pays du monde plus abondant en canards, sarcelles, plongeons, cygnes, oies sauvages que celui-ci. La rivière en est partout si couverte qu'on peut facilement les tuer à coups de bâton. Je ne sais pas de quoi nous eussions vécu pendant tout notre voyage, sans ces animaux qui faisaient notre nourriture ordinaire. Nous en tuions quelquefois trente ou quarante dans un jour, sans nous arrêter un moment, et nous ne faisions cette chasse qu'en chemin faisant. Tous ces animaux sont passagers, et quittent ces pays pendant l'hiver pour en aller chercher de moins froids, où ils puissent trouver quelques ruisseaux qui ne soient point glacés; mais ils reviennent au mois de mai faire leurs œufs en telle abondance que les déserts en sont couverts.»
Ainsi dans leur saison les canes du Lapland
Partent, formant dans l'air un triangle volant;
Chaque oiseau tour à tour à la pointe se place,
Un autre le relève aussitôt qu'il se lasse.
Chacun du dernier rang se transporte au premier,
Chacun du premier rang se replace au dernier.
Ils abordent les bois, les monts et les rivages
Retentissent du vol de ces vivants nuages,
Que l'instinct, le besoin, aidés d'un vent heureux,
Poussent vers des climats qui n'étaient pas pour eux.
(Delille.)
Il y a bien des manières de faire la chasse aux canards: avec des filets, des hameçons; à l'affût, avec un long fusil; en bateau, avec la vache artificielle, avec un chaudron rempli de charbons ardents, qui ressemble au soleil levant comme un soleil d'opéra; avec un petit chien couvert de la peau d'un renard, qui les attire près du rivage comme la chouette attire les petits oiseaux, etc. Dans cette saison, les rives de la Somme et de beaucoup d'autres rivières sont nuit et jour couvertes de chasseurs aux canards. La nuit, de vingt pas en vingt pas, elles sont gardées par un homme qui, bravant le froid et la pluie, reste là, toujours guettant l'arrivée de ces voyageurs lapons; et voilà pourquoi nous mangeons de si bons pâtés d'Amiens. C'est dommage que la croûte en soit si mauvaise.
En Angleterre, dans le Lincolnshire, on chasse le canard d'une manière qui tendrait à détruire l'espèce, si l'espèce pouvait être détruite. Près d'un marais fréquenté par ces oiseaux, on creuse un large fossé tournant, et qui va toujours se rétrécissant. Ce fossé, couvert d'un treillage et d'un filet est d'abord fort large, et finit par n'avoir plus qu'un demi-mètre. Des hommes, des chiens, postés sur les extrémités du marais, poussent peu à peu les canards vers le fossé, où règne le plus grand silence. Des canards privés sont là qui attirent les autres. Lorsque toute la bande est engagée dans la fausse rivière, un filet tombe pour en couvrir l'entrée, et le tour est fait. Alors le massacre commence, et des voitures emportent marche le produit de cette boucherie.
Il existe une autre manière de prendre les canards, et c'est principalement celle-là que je vais vous décrire. Avec plusieurs citrouilles, videz-les, façonnez-les de sorte à y introduire votre tête, percez-les de deux petit-trous pour vos yeux, et laissez-les flotter sur l'eau. Les canards s'habitueront bientôt à voir ces objets loin d'eux, près d'eux et au milieu d'eux. Ensuite, pendant la nuit, vous et vos amis, mettez-vous dans l'eau jusqu'au cou, mettez sur votre tête ce casque potironien, et flottez tout doucement sur l'eau. Au point du jour, les canards vont et viennent pour chercher à manger; ils s'approcheront de vous ou vous irez près d'eux, sans qu'ils se doutent que cette citrouille est habitée. En passant la main sous l'eau, vous en saisirez un par les pattes... Si je voulais rire, je vous dirais qu'en passant la main sous leur ventre vous tâterez ceux qui sont les plus gras; mais la chose est trop sérieuse pour que je me permette une mauvaise plaisanterie. Le canard saisi, vous l'accrocherez à un ressort en fer placé à votre ceinture, qui l'étouffera sur-le-champ et l'empêchera de remuer. Ses camarades ne s'apercevront de rien; ils croiront qu'il à plongé. Vous procéderez ainsi tant qu'il restera des canards, ou tant qu'ils ne se douteront pas du chemin pris par leurs amis pour aller faire un tour de broche ou de casserole.
Il me semble vous voir lever les épaules de pitié. Vous avez, souvent entendu citer cette chasse comme une hâblerie, et prémuni contre la rime du mot chasseur, vous n'avez rien cru. Eh bien! je vous parle très-sérieusement: dans ma bibliothèque cynégétique j'ai vingt ouvrages où l'on en trouve la description. J'ai des gravures faites par Philippe Galle, d'après Stradau, où tous les chasseurs sont représentés une citrouille sur la tête, prenant des canards par douzaine. Lisez ce que dit le père du Halde: «La manière dont ils prennent les canards mérite d'être rapportée: ils mettent la tête dans de grosses citrouilles sèches, où il y a quelques trous pour voir et pour respirer, puis ils marchent nus dans l'eau, ou bien ils nagent sans rien faire paraître au dehors que la tête couverte de la citrouille. Les canards, accoutumés à voir de ces citrouilles flottantes autour desquelles ils se jouent, s'en approchent sans crainte, et le chasseur, les tirant par les pieds dans l'eau pour les empêcher de crier, leur tord le cou et les attache à sa ceinture; il ne quitte point cet exercice qu'il n'en ait pris un grand nombre 3.»
Le père du Halde est un écrivain sérieux dont les ouvrages ont toujours joui d'une haute estime; ils sont sans cesse pillés par tous ceux qui écrivent sur l'Amérique, sur l'Inde ou sur la Chine. C'est une mine inépuisable pour ceux qui voyagent sans sortir de leur cabinet.
Vous allez me répondre peut-être: «Mais les canards arrivent en décembre, il fait bien froid; comment est-il possible de se mettre toute une nuit dans l'eau jusqu'au cou?» Cela ne me regarde pas, je vous donne la recette, libre à vous de ne point vous en servir. Comme à vous, il me paraissait à peu près impossible qu'un homme pût prendre un tel bain de sept ou huit heures; aujourd'hui, et je vais vous en dire la raison, je crois que nous pouvons tout ce que nous voulons.
Un de mes amis et moi nous chassions sur l'étang de Saclai, près de Bièvre; il gelait fort, et dans notre bateau nous étions transis de froid. Cachés dans une touffe de grands roseaux, nous attendions les canards que d'autres chasseurs poursuivaient des extrémités vers le centre. Tout à coup nous entendons une voix humaine qui sort d'une masse de joncs, à dix pas de nous.
«Ohé! prenez garde à moi, ne tirez pas de mon côté; il y a quelqu'un ici; je ne suis pas un canard.
--Et qui diable parle ainsi?
--Un confrère qui s'est mis à l'affût comme vous.
--Je ne vois point de bateau.
--Je crois bien; je n'en ai jamais. Voyez-vous, un bateau ne sert qu'à effrayer les canards.
--Vous êtes donc dans l'eau?
--Eh!... sans doute... jusqu'au cou. Si vous vouliez faire comme moi, nous serions sûrs de tuer.
--Merci.
--Vous avez gâté mon affût; les canards vous verront, et je ne tuerai pas.
--Il a raison me dit l'ami G; si nous nous fourrions dans l'eau, nos chances de succès seraient plus que doublées. Qu'en dites-vous, professeur?
--J'aime mieux le croire que d'y aller voir.»
A force de regarder, nous aperçûmes une tête d'homme couverte de roseaux, et ressemblant à celle d'un fleuve personnifié, comme on en voyait jadis à l'Opéra, et comme il en existe encore dans le jardin des Tuileries, à la grille du Pont-Tournant, où le pont ne tourne pas, car il n'y a point de pont. Si son fusil, qu'il portait horizontalement sur l'eau, avait été surmonté d'une fourche, il aurait ressemblé trait pour trait à ce brave Neptune lorsqu'il paraissait à cheval sur une vague pour dire son fameux quos ego.
«Taisez-vous, nous dit le Fleuve enfoncé dans l'étang; les canards arrivent.»
Ils venaient droit à nous, mais apercevant notre bateau, ils firent volte-face; nos six coups de fusil, partis à la fois de fort loin, n'eurent point de résultat.
«Je vous le disais bien, dit le Fleuve sortant de l'étang, couvert d'une bouc qui se gelait sur sa peau, je vous le disais bien, les bateaux sont toujours vus par les canards; c'est trop grand, on ne peut pas les cacher. Si les canards volaient à fleur d'eau, passe encore; mais ils s'enlèvent, d'en haut leurs yeux plongent sur vous, et sauve qui peut.
--Soit, mais vous avez beau dire, vous trouverez peu d'imitateurs.
--Tant pis ou tant mieux, je n'aime pas la concurrence.

Chasses d'hiver.--La Chasse aux Canards.
Ah ça! je vais me placer ailleurs, là-bas, au bout; faites-moi le plaisir de m'y laisser tranquille.
--Comment! vous allez prendre encore un bain?
--Ceux-ci ne coûtent pas cirer.
--Qui sait? on peut gagner une fluxion de poitrine.
--C'est le pis-aller.
--En tout cas, vous êtes certain d'attraper un bon rhume.
--C'est ce que je cherche.
--Avec un peu de bonheur vous réussirez.
--Ce n'est pas sûr.
--Ah ça! dites-nous donc pourquoi vous avez tant d'envie de gagner un rhume?
--Je n'ai pas le temps, je ne veux pas perdre ma journée. Ce soir je vous conterai cela, quand la chasse sera finie. Voilà ces messieurs qui vont poursuivre les canards à l'autre bout; je vais me poster, et vous entendrez parler de moi.
--Et votre chien?
--Je n'en ai pas; un chien ne vaut pas mieux qu'un bateau.
--Et si vous blessez un canard?
--Est-ce que je ne sais pas nager!
--A la bonne heure.»
Et notre homme se mit à courir sur la rive; sa peau, couverte d'une couche de place, devint luisante comme un miroir; on l'aurait pris pour un de ces Cynocéphales qui vainquirent l'armée de Gengiskan. Ceci, pour beaucoup de gens, demande une explication. Les Tartares, conduits, par Gengiskan, arrivèrent sur les bords d'un fleuve habité par les Cynocéphales; quoiqu'il fit très-froid, ceux-ci se jetèrent tous dans l'eau. Bientôt ils en sortirent pour se rouler dans le sable; ils répétèrent cette manœuvre, et à chaque fois ils se formait sur leur corps une croûte de glace et de terre qui bientôt acquit la consistance du roc. Alors les Cynocéphales formèrent leurs rangs et se précipitèrent sur les Tartares, qui leur lançaient des milliers de flèches; mais rien ne pouvait traverser le bouclier qu'ils venaient de se faire. Les Cynocéphales mordirent les Tartares et les mangèrent. De là vient le proverbe encore en usage en Tartarie: «Mon père a été jadis mangé par les chiens.» Les anciens livres parlent des Cynocéphales, monstres avec tête et queue de chien. Pline, Chen, Aristote, saint Augustin, racontent sur ces gens-là des choses merveilleuses que je ne répéterai point ici, car vous ne les croiriez pas. Notre siècle est essentiellement sceptique; pour croire, il veut voir, et quand il a vu, quelquefois il doute encore.
La chasse continua sans épisode remarquable, et, le soir, nous rentrâmes chez le garde avec quelques bécassines, deux judelles et un canard.
«Connaissez-vous cet original qui chasse tout nu dans l'eau? dis-je au brave Germain, garde breveté de l'étang.
--Ah! ah! vous l'avez rencontré dans les joncs? Ce n'est Cas facile, je vous assure; il se cache comme un plongeon blessé.
--Si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais pas croire que, par la gelée, un homme fît de pareils tours de force.
--C'est vrai. Quand je serais sûr de tuer tous les canards du monde, je ne voudrais pas imiter ce camarade-là.
--De quel pays est-il?
--De Versailles. Il chante à la cathédrale. Par le canal des curés il a obtenu la permission de chasser ici.»
Pendant que nous changions de linge et d'habits auprès d'un bon feu, nous vîmes arriver notre Fleuve. Il était proprement vêtu, gai, frais et dispos; il portait un ramier plein de canards, et sur ses épaules on en voyait encore une demi-douzaine qui n'avaient pas trouvé place dans le sac de cuir.
«Eh bien! lui dis-je, il paraît que la journée est bonne?
--Pas mauvaise; mais si vous ne m'aviez pas dérangé ce matin, j'aurais quatre ou cinq canards de plus. Avec votre maudit bateau, vous m'avez fait grand tort; c'est comme si vous m'aviez pris quatre ou cinq canards dans ma poche.
--Allons! allons! vous ne devez pas vous plaindre; car à vous seul vous avez tué plus que tous les autres chasseurs ensemble.
--Pardi! je crois bien; vous allez en bateau. Et pourquoi ne venez-vous pas en fiacre?
--Mais vous avouerez, mon cher, que peu d'hommes sont assez forts pour faire ce métier-là.
--Parce qu'ils ont peur, et voilà tout. Essayez, et vous ne vous en porterez que mieux. Tenez, dans ce moment, j'ai un appétit de loup. Allons, la fille, apporte-moi du pain, un gigot, du fromage, du vin, et du bon.
--Ce qui m'étonne, c'est qu'après cette immersion de sept heures, vous avez encore la voix claire.
--Et voilà le mal: car, entre nous, j'espérais gagner un bon rhume.
--A propos, vous me l'aviez déjà dit. Je serais curieux de savoir pourquoi vous désirez si fort un rhume. Bien des gens ne sont pas de votre avis, car lorsqu'ils en ont un, ils ne demandent qu'à s'en débarrasser.
--Parce que cela les gêne; mais moi, c'est tout le contraire; j'ai besoin d'un rhume dans ce moment, et je ne puis pas me le donner.
--Je ne comprends pas.
--Voici la chose: Je suis chantre de la cathédrale de Versailles; je chante les dessus, et c'est mal payé. A peine si je gagne pour acheter mon plomb et ma poudre. Heureusement que je tue assez de canards pour vivre. La basse-taille vient de mourir; j'ai demandé sa place, qui vaut trois fois plus que la mienne; mais le curé, mais l'évêque disent que j'ai la voix trop claire.
--J'y suis. Vous voulez vous enrhumer pour perdre votre voix de ténor.
--C'est cela. Ils disent que j'ai un ténor, et ils ne veulent pas de voix de ténor. Il leur faut des voix de bœuf qui font trembler les vitres. Soyez tranquille, si j'ai le bonheur que la gelée augmente, je finirai bien par m'enrhumer, et mon ténor s'en ira.
--Vous pourrez bien partir avec lui.
--Ah bah! c'est bon pour les élégants de Paris; ils ont peur de l'eau comme des chats. En attendant que le rhume vienne, j'ai toujours trouvé une fameuse recette pour tuer les canards.
--C'est vrai.
--On dit que vous faites des livres sur la chasse.
--Oui, par-ci, par-là, quelques-uns.
--Eh bien! dans le premier que vous publierez, vous pourrez donner ma méthode.
--Peu de gens chercheront à vous imiter.
--C'est égal, je serais bien aise de me voir imprimé tout vif.
--Votre nom?
--Jacques Rinart, rue Satory, à Versailles.
--Un de ces jours vous figurerez dans l'Illustration.
ELZÉAR BLAZE.
Caricature.
Le procès d'O'Connell donne lieu, en Angleterre, à un grand nombre de caricatures qui témoignent de la colère un peu plus que de l'esprit de John Bull. Celle que nous publions ici, empruntée à un journal souvent mieux inspiré dans ses moqueries pittoresques, représente le grand Agitateur en costume de mendiant, supporté par un peuple de fainéants; nous la reproduisons comme un échantillon de la verve et de la gaieté britanniques au sujet d'O'Connell et du rappel. Elle ne vaut pas assurément les sarcasmes et les lazzi dont O'Connell a semé ses discours contre l'Angleterre. A ne regarder que le côté comique de la question irlandaise, les rieurs ne seraient pas pour les Anglais, qui s'efforcent de se moquer d'O'Connell et de l'Irlande.

Caricature anglaise sur O'Connell.
Bulletin bibliographique.
Catalogue d'une belle Collection de lettres autographes, dont la vente aura lieu le 5 février 1844 et jours suivants, à la salle Sylvestre.--Paris, 1844 Charon. In-8.
Il y a peu de temps, nous rendions compte d'un catalogue de livres auquel nous n'aurions eu aucun reproche à faire si son auteur eût pris le même parti que l'auteur de celui-ci. M. Charon s'intitule marchand d'autographes. Quand on ne se donne, en pareille occasion, ni pour un bibliographe, ni pour un bibliophile; quand on ne cache pas au public qu'il a affaire à un marchand, le public tient compte des annotations qui accompagnent chaque article, comme des réclames de la quatrième page des journaux; il sait qu'il a à voir par lui-même si on ne surfait pas sur l'importance des articles offerts et sur leur mise à prix; il n'a à se plaindre d'aucune surprise, et la critique, qu'on n'a pas cherché à abuser, est disposée à reconnaître la modestie et la franche bonne foi avec laquelle on s'est présenté à elle.
Le Catalogue de M. Charon n'est donc point une œuvre de charlatanisme déguisé. Les pièces qu'il renferme n'en avaient pas besoin; ce n'eût pas été un empêchement pour tel autre; mais M. Charon n'est pas charlatan. Sa notice, composée dans un système, qu'avait déjà adopté M. Leblanc, libraire consciencieux et instruit fait connaître les pièces qu'elle annonce suffisamment pour en faire comprendre l'intérêt ou l'importance, mais non assez pour satisfaire pleinement la curiosité. C'est un calcul fort naturel et fort bien entendu. Une pièce publiée perd de son prix pour les collecteurs d'autographes; en analysant les siennes et en se bornant à en donner des extraits, il leur a donc conservé, leur valeur en même temps qu'il l'a démontrée. Les noms les plus fameux et les plus illustres ont fourni leur contingent à cette collection: les rois et les notabilités républicaines, les papes et les actrices, les illustrations politiques, scientifiques et littéraires de ce siècle et des précédents, Richelieu, aussi bien que Descartes, aussi bine que George Sand, femme distinguée dans la littérature, comme le dit M. Charon.
Veut-on un passage d'une lettre d'Henri IV, que M. Berger de Xivrey aura à comprendre dans le recueil qu'il publie des lettres de ce roi dans la Collection des Documents inédits sur l'Histoire de France?
«9 mars...
«Mon cœur, jamais homme n'eut plus de plesyr à la chasse que j'ai eu aujourduy, car pour milan, pour héron, pour rinière, pour corneyle et pour les perdrys, yl ne ce peut myeus notter, je suys dans la chambre d'où je partys pour prandre Parys, despuys je ny avoys esté, le tamps a esté assés beau, mays crayns bien demayn de la nege; je me porte myeux aux chams qu'à la vylle. Mais je seroys plus contant sy vous etyés avec moy. Je vous donne mylle bonjours et autant de baisers.»
Aime-t-on mieux voir le trop fameux Carrier se mettre, bien autrement que le roi vert-galant, en dépense de baisers? qu'on achète une lettre de lui au général Raxo, se terminant ainsi:
«Embrasse l'ami Dutony et tous les sans-culottes qui combattent avec toi, et prends promptement Noirmoutiers. Salut et fraternité.»
Il y a une simplicité et, comme l'évènement l'a prouvé, une résignation antique dans la fin de cette lettre écrite au ministre de la guerre, le 8 mai 1815, par le général Barbanègre, allant prendre le commandement supérieur de la place d'Huningue, où il devait s'immortaliser par la plus héroïque défense:
«Je pars avec le désir de bien servir Sa Majesté, comme j'ai toujours fait, sans songer à vouloir mettre un prix à mes services, sans rechercher aucun stimulant.»
Que n'y a-t-il pas dans la lettre de la fameuse Sophie Arnould, adressée, le 1er pluviôse an VIII, au ministre de l'intérieur, Lucien Bonaparte, dont voici l'analyse et des extraits?
«Je me nomme Sophie Arnould, peut-estre très-ignorée de vous; mais autres fois très-connue au théâtre des dieux:
«Je chantois, ne vous déplaise.»
Elle ne voudrait cependant pas user de son temps et l'ennuyer d'un long préambule pour lui tracer ses vingt-six infortunes: elle avait déjà pris la liberté d'adresser sa plainte au premier consul: «Mais! je viens d'estre avertie par un journal qu'il n'en devoit connaître que par vous, mon ministre; eh! je me suis dit: Sois contente, Sophie; va! c'est un cœur de famille; conte luy ta chance; eh la voicy tout comme je l'ai dit à votre aîné.»--Elle lui parle de sa jeunesse, des vingt années consacrées au Théâtre des Arts; de son éducation; de son instruction; de ses amis; de ses protecteurs. Z... Quant à moy, j'avois alors pour recommandation: un physique heureux, une grande jeunesse, de la vivacité, de l'âme, mauvaise tête et bon cœur; voilà! sous quels auspices j'ay été asses heureuse pour illustrer ma vie......
Quand aux amis; je puis dires! que je les avoient si bien mérités, que je n'aie perdue que ceux que la mort m'a enlevée; et ceux, dont la tâche décemvirale m'a privés: il n'y a donc que cette inconstante fortune, qui, sans rimes, n'y raisons; m'a fait faux bon... eh! dans qu'elle circonstance! encorre! lorsque je suis devenue trop vieille pour l'amour; et trop jeune pour la mort: voyez donc, citoyen ministre; combien il est cruelle après tant de bonheur, de se trouver réduite à un état si misérable, eh! après avoir allumée tant de feux de n'avoir pas aujourd'huy, de quoy brûler un fagot dans ma cheminée: car, le fait est, que depuis que la Nation m'a couchée sur son grand livre, je n'aie plus, n'y me coucher, ny de quoy vivres.»
Quelquefois il arrive au Catalogue que nous analysons de dire, comme à l'article Boismont, par exemple: Lettre très-spirituelle, et d'en citer un fragment qui probablement n'est pas choisi pour le démontrer. La lettre toute intime de Diderot à l'abbé Lemonnier, dont le nom figure si souvent dans la Correspondance du philosophe avec mademoiselle Volant, eût mieux justifié cette qualification. Elle se termine ainsi:
«Je vous embrasse de tout mon cœur. Songez à votre poitrine et soyez, sage. Voyez, de jolies femmes et regardez-les tant qu'il vous plaira. Soupez avec des gens qui boivent du vin de Champagne, mais laissez-les faire.»
Une fort curieuse pièce est une lettre écrite le 7 ventôse an II, par Robespierre jeune à son frère aîné Maximilien, il l'engage à donner audience à la citoyenne La Saudraie:
«Il est nécessaire que tu l'entendes pour parvenir à connaître certains personnages qui jouent un rôle dans la révolution, et qui devroient cacher leur honte et leur immoralité. Les fripons montent à califourchon sur les bons citoyens; ils se disent les amis des républicains les plus distingués, j'ai rencontré des milliers d'intrigants qui répètent ton nom avec emphase, qui se disent tes plus intimes amis; les sots se laissent attraper par ces imposteurs qui se glissent dans toutes les administrations, tous les comités; guerre aux fripons, mon cher ami, guerre aux fripons; ce n'est pas la moins difficile, ils sont si nombreux qu'ils chassent partout les représentants du peuple. Ils osent dénoncer ceux qui leur découvrent le masque, et la réputation la mieux établie n'est point à l'abri de leur audace calomnieuse»
Enfin un autographe de cette collection, émanant de Boileau-Despréaux et renfermant ses stances Pour M. Molière sur sa comédie de l'École des Femmes, dissipe un doute, ou plutôt sert à relever l'erreur des éditeurs de Boileau. Cette pièce fut d'abord imprimée en cinq stances dans les Délices de la Poésie galante des plus célèbres Autheurs de ce temps, Paris, 8° veau, 1664, in-12. Dans les éditions que le satirique a données de ses œuvres, on la trouve composée de quatre stances seulement. On en a conclu que la cinquième n'était pas de lui, et on a eu tort, cette pièce datée et signée le prouve. La seule conclusion qu'il en fallût tirer, c'est que Boileau avait trouvé ces vers faibles et qu'il les avait retranchés. Nous n'appellerons pas de son jugement:
Tant que l'univers durera
Avecque plaisir on dira
Que quoiqu'une femme complotte,
Un mari ne doit dire mot.
Et qu'assez souvent la plus sotte
Est habile pour faire un sot.
T.
Histoire militaire des Éléphants, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'introduction des armes à feu; avec des observations critiques sur quelques-uns des plus célèbres faits d'armes de l'antiquité; par le chevalier P. Armandi, ancien colonel d'artillerie, 1 gros volume in-8. Paris, 1843. Amyot, 7 fr. 50,
Cet ouvrage, publié en français par un Italien, «fruit de quelques années de loisir passées sur une terre hospitalière, patrie commune des lettres, des sciences et des arts,» a pour but de remplir une lacune importante dans l'histoire de l'art militaire des anciens. Jusqu'à ce jour, en effet, des gens de guerre ou des érudits s'étaient occupés de la composition des troupes, des différentes manières dont on les rangeait en bataille, des armes, des machines, de la castramétation et de la poliorcétique, mais ils avaient complètement négligé l'emploi des éléphants dans les armées. Et cependant de l'époque d'Alexandre à celle de César, c'est-à-dire pendant les trois siècles de l'antiquité les plus féconds en grands événements, il s'est livré peu de batailles, dans les contrées qui entourent le bassin de la Méditerranée, où les éléphants n'aient exercé une grande influence, soit comme moyen de victoire, soit comme cause de revers. «Frappé de ces considérations, excité d'ailleurs par la richesse et par l'attrait du sujet, dit M. le chevalier Armandi, j'ai essayé de réparer cette omission de l'archéologie militaire. Malheureusement, les anciens écrivains didactiques dont les ouvrages sont parvenus jusqu'à nous, ayant vécu à une époque où l'on avait renoncé (en Occident du moins) à l'usage des éléphants de guerre, ne fournissent sur ce service que des notions de peu d'importance. C'était donc dans l'histoire même, et seulement là que je pouvais espérer de puiser les matériaux de mon travail. C'est là, en effet, que j'ai été les chercher. J'ai étudié avec attention toutes les expéditions militaires, soit de l'antiquité, soit du Moyen-Age, auxquelles les éléphants ont pris une part quelconque, et je suis parvenu ainsi à réunir les données fondamentales de mon sujet. Je me suis ensuite efforcé de compléter ces données, à l'aide de renseignements recueillis dans les poètes, dans les naturalistes, dans les polygraphes, ou tirés des inscriptions, des médailles et des autres monuments de l'antiquité. Ces traits épars et isolés, dont jusqu'ici on n'avait point cherché à tirer parti, m'ont été souvent du plus grand secours, soit pour comprendre les faits, soit pour donner de l'autorité à mes déductions.»
L'Histoire militaire des Éléphants se divise en trois livres, suivis d'appendices et de notes. Le premier chapitre du livre premier forme une espèce d'introduction. Avant de commencer leur histoire militaire, M. Armandi a voulu présenter à ses lecteurs un résumé des notions les plus importantes que nous possédons sur l'histoire naturelle des éléphants, sur leur instinct, sur leurs aptitudes et sur les moyens que l'on emploie pour les prendre et pour les apprivoiser. Ces renseignements préliminaires complètes, il nous donne, dans le chapitre suivant, quelques considérations sur l'état des éléphants dans l'Inde avant Alexandre. Les annales des peuples orientaux renferment un trop grand nombre de fables et de mensonges, pour qu'il soit possible d'y découvrir la vérité. C'est l'expédition du conquérant macédonien qui forme le véritable point de départ de l'histoire militaire des éléphants; car c'est le premier événement bien constaté où ces animaux se soient montrés sur un champ de bataille, c'est la première occasion qu'aient eue les Grecs de les connaître et de les combattre.
Les successeurs d' Alexandre introduisirent les éléphants dans le monde occidental. Les Vagides, et surtout les Séleucides, en comptèrent un nombre considérable dans leurs armées. Antipater amena en Grèce les premiers qu'on y vit; Pyrrhus en transporta une certaine quantité en Italie, et habitua ainsi les Romains à triompher de ces nouveaux adversaires, qui allaient jouer un rôle si important dans leur lutte avec Carthage. Les rois de Numidie se servirent des éléphants à l'imitation des Carthaginois. Juguetha opposa vainement ses éléphants aux légions de Metellus; Juba ne fut pas plus heureux dans l'essai qu'il fit des siens contre César; enfin, les Romains voulurent, à leur tour, suivre l'exemple de ces peuples; mais ils n'attachèrent jamais qu'une faible importance à leurs éléphants, et ils ne tardèrent pas à y renoncer. Tel est le résume succinct des faits principaux dont le premier livre contient le développement.
Le second livre est entièrement didactique. M. Armandi y expose les règles que les anciens ont suivies dans l'organisation des éléphants de guerre et les moyens qu'ils ont employés pour les dresser, les armer et les conduire à l'ennemi. Il tâche de déterminer, à l'aide des documents consignés dans le livre précédent, quelle était leur place dans les camps, dans les marches et dans les combats; comment on en tirait parti pour le passade des rivières, pour l'attaque des postes, et même pour les sièges, opérations auxquelles ils étaient moins étrangers qu'on ne serait tenté de le supposer; puis, après avoir traité des expédients offensifs et défensifs imaginés contre eux, il examine en dernier lieu si les inconvénients de leur service ne l'emportaient pas sur les avantages qu'on pouvait en espérer. Chacune de ces questions forme le sujet d'un chapitre.
L'emploi des éléphants avait été abandonné en Occident vers la fin de la république romaine. Pendant longtemps ces animaux ne servirent que pour les spectacles du Cirque et de l'Amphithéâtre. Ce ne fut que quelques siècles plus tard, pendant la longue et sanglante querelle qui s'éleva entre la Perse et l'empire, qu'on les vit reparaître sur les champs de bataille avec les armées des rois sassanides. Ils prirent, durant cette nouvelle période, une part importante aux sièges des places fortes de la Mésopotamie et de la Colclude. Dans les deux premiers chapitres du livre troisième, M. Armandi a donné un récit sommaire de ces événements, et les documents nouveaux qu'il y a puisés lui ont permis de compléter encore ces premières recherches. «Une fois arrivé à l'époque où l'islamisme fit invasion dans l'Asie centrale j'aurais pu regarder ma tâche comme terminée, du M. Armandi car après la chute de la dynastie de Sassan, il ne fut plus question d'éléphants de guerre, ni en Europe, ni en Afrique, ni dans toute la partie de l'Asie qui s'étend en deçà de l'Indus. Mais, pour n'être point sortis des limites que la nature leur avait assignées, ces animaux n'en continuèrent pas moins à figurer dans les guerres de l'Inde, et ils ne cessèrent d'y jouer un rôle considérable dans tous les événements militaires, jusqu'à ce que l'usage des armes à feu, devenu commun, même à l'extrémité de l'Asie, les bannit définitivement des champs de bataille. Quoique les guerres, de cette période n'ajoutent pas beaucoup de lumières à celles que j'ai pu tirer des périodes précédentes, j'ai pensé que le lecteur ne serait pas fâché d'en connaître les épisodes les plus remarquables, et j'ai consacré un dernier chapitre à les raconter.
Ces différentes époques de l'histoire des éléphants embrassent une succession de plus de vingt siècles. En les passant en revue, M. Armandi s'est efforcé de ne rien avancer qui ne fût fondé sur des autorités positives, et il s'est toujours fait une loi de citer celles sur lesquelles il s'est appuyé. En outre, à la suite du troisième livre, il a réuni, sous le titre général de notes et d'appendices, une certaine masse de renseignements qui n'auraient pu entrer dans son récit sans nuire à l'ensemble, et qui servent en quelque sorte de supplément au texte: tels sont, entre autres, une comparaison de la légion avec la phalange, des notices sur la force et sur la justesse des armes des anciens, sur l'emploi des chameaux dans la guerre, sur les découvertes des Lagides dans l'intérieur de l'Afrique, sur la quantité prodigieuse d'animaux sauvages exposés par les Romains dans leurs spectacles, etc.
L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres avait écouté avec le plus vif intérêt la lecture des principaux passages de ce curieux ouvrage; nous ne doutons pas que le public ne ratifie son jugement. L'Histoire des Éléphants a sa place marquée d'avance dans toutes les bibliothèques publiques et dans un grand nombre de bibliothèques particulières. L'éloge le plus flatteur que nous puissions adresser à M. Armandi, c'est qu'il a su,--chose rare,--faire livre qui, avant lui, était, et qui maintenant n'est plus à faire.
Les Césars; par M. le comte Fr. de Champagny.--4 vol. in-8º. Au Comptoir des Imprimeurs-Unis.
L'histoire romaine sera, dans tous les temps, l'étude des esprits sérieux et élevés. Rien, en effet, dans les annales du monde ne peut entrer en comparaison avec l'histoire de cet empire qui, durant mille ans dans sa force et mille ans dans sa décadence, prend dans l'étendue des temps comme un tiers par sa durée, et la première place par son importance.
Et cependant, cette étude admirable d'un peuple qui, laborieusement arrive à une grandeur inouïe, a laissé dans le monde des racines si profondes; et si vivaces que le christianisme s'est comme greffé, au point de vue humain, sur elles, et a bâti son édifice sur ses ruines; cette étude, disons-nous, est comme réservée à quelques âmes d'élite. Peu d'ouvrages d'une véritable valeur ont répondu à sa hauteur, et en France notamment au-dessous des excellents travaux de Rollin et de Lenain de Tillemont et des pages rapides et brillantes de Montesquieu et de Michelet, on ne voit plus qu'une foule inconnue d'abrégés vulgaires, de livres médiocres, de tableaux sans couleur et sans vie.
Ainsi, chose étrange! le livre si remarquable de M le comte de Champagny sur les Césars, est une œuvre nouvelle, sans précédent, sans modèle, sur une matière qui semblait devoir être épuisée.
Mais c'est surtout par sa forme, par son style, par sa pensée, que cette œuvre est neuve.
Suetone a laissé, dans les habitudes de l'esprit, l'idée que les douze premiers Césars forment dans l'histoire comme une partie séparée, complète, et désormais consacrée.
C'est là une de ces idées fausses qui ont cours et vie. Suetone, s'il eût vécu plus tard eût inventé les quinze ou les vingt Césars, et ce chiffre fût resté désormais immuable dans l'esprit sans critique du vulgaire.
M. de Champagny a vu autre chose qu'un chiffre dans l'histoire de Rome. Appelé par ses études sur le christianisme et l'histoire générale de cette époque extraordinaire, il s'est attaché à ces temps qui sont comme la sommité de l'histoire du peuple romain; et traçant dès lors les bornes du cadre où il allait faire entrer tant de choses, il n'écrit que l'histoire de la véritable famille césarienne, qui commence à Jules César et finit à Néron.
Jules César, Auguste, Tibère, Caligula. Claude et Néron, telles sont donc les grandes figures, les existences prodigieuses dont M. de Champagny, dans les deux premiers volumes, peint la biographie et l'histoire.
Rome, sa grandeur géographique, sa puissance, sa politique, l'étendue de l'empire, son armée, sa capitale, ses mœurs, ses usages, ses vices, ses vertus, sa philosophie, sa religion, voilà ce que contiennent les deux autres volumes.
Nous venons de rappeler, dans ces deux phrases, le plan de cet ouvrage remarquable.
Ce plan est neuf aussi: il a quelque chose de hardi. Détacher ainsi de l'histoire les hommes qui la dominent, raconter leur vie à part, introduire dès l'abord le lecteur dans le drame des faits, et réserver ensuite comme corollaire et conséquence les aperçus philosophiques et les hautes vues qui les résument pour les placer à la fin de l'œuvre et la couronner, c'est le fait d'un esprit élevé sans doute, et qui se fait à lui-même sa voie, sans chercher devant lui d'autres traces.
Mais à quelle époque historique cette forme de l'histoire conviendrait-elle plus qu'à celle des premiers Césars lorsque devant l'univers silencieux, un seul homme paraît et agit: le maître, le tout-puissant, le César, le presque dieu?
Ainsi partagée dans ces deux grandes et simples divisions, la manière de l'auteur également différente, vive, colorée, dramatique dans la première parte, dans la seconde, elle s'élève encore, devient rigoureuse, austère, philosophique.
Lire ces quatre volumes, c'est vivre dans la société romaine, c'est respirer dans l'antiquité. Les historiens vulgaires montrent de loin l'histoire, qui, à cette distance, paraît déformée et indécise. M. de Champagny a fait comme Shakespere dans Corialan et dans Jules César il met le lecteur au milieu même de Rome, et il l'y fait vivre de l'existence et des émotions romaines.
Le style de ce livre est aussi neuf et orignal que l'est l'ouvrage lui-même. Quelque part. M de Champagny a dit de Tacite que sa pensée s'incruste dans sa phrase: ceci est aussi à dire de M. de Champagny lui-même.
Peut-être pourrait-on cependant faire un reproche à ce livre: ce sont les allusions passagères aux choses actuelles. Notre époque, quelle qu'elle soit, n'avait pas de place à prendre dans ce tableau; ces allusions, aujourd'hui comprises dans leur finesse vieilliront vite, et disparaîtront, et dans quelques années il y aura quelques lignes qui ne seront plus comprises dans un livre où tout le reste est excellent, et qui a bien d'autres éléments de durée dans l'avenir.
G. C.
Amusement des Sciences.
SOLUTION DES QUESTIONS PROPOSÉES DANS L'AVANT-DERNIER NUMÉRO.
I. Tous nos lecteurs connaissent le moyen d'obtenir un mouvement de rotation continu au moyen de l'air échauffé par un poêle. Ils savent que si, après avoir coupé dans une carte un cercle de la largeur de cette carte, on découpe ce cercle suivant une spirale qui fasse trois ou quatre révolutions, en réservant un petit espace intact autour du centre, il suffira d'appuyer ce centre sur une pointe verticale, auprès du tuyau d'un poêle, pour que l'espèce de surface hélicoïdale obtenue par le déroulement de la carte se mette à tourner sur elle-même avec une vitesse qui dépendra de l'excès de la température du tuyau sur celle de la chambre.
Ce petit jeu mécanique est fondé sur la propriété dont jouit une colonne d'air chaud de s'élever au milieu d'une masse d'air plus froid. Le courant qui en résulte tend à faire monter la carte découpée; mais, en égard à l'inclinaison de la surface de cette carte, l'impulsion qu'elle reçoit agissant obliquement et n'étant pas assez furie pour soulever la carte entière, ne peut que la faire tourner autour de son point de suspension.
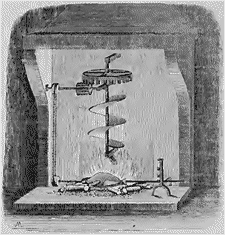
Cela posé, l'intelligence de notre figure, n'offrira aucune difficulté. Il suffit d'y jeter les yeux pour reconnaître que le courant d'air chaud de la cheminée agissant sur une surface hélicoïdale analogue à celle dont nous parlions tout à l'heure, doit produire le même effet. Ainsi l'appareil prendra un mouvement de rotation autour de l'arc vertical en fer, qui est scellé au milieu de la cheminée, et qui est mobile sur les deux pointes placées à ses extrémités. Quant à la transmission du mouvement à la broche, elle s'opère très-simplement par l'intermédiaire d'une grande roue agissant sur un pignon et d'une chaîne sans fin verticale, semblable à celle que l'un voit dans les tourne-broches ordinaires.
Cette espèce de tourne-broche est employée en quelques points du territoire. Elle fonctionne parfaitement quand elle est convenablement établie, et elle mériterait d'être plus connue. Il est à remarquer qu'elle satisfait pleinement aux exigences culinaires, en ce que la vitesse de rotation est d'autant plus considérable que le feu est plus actif.
On a construit, d'après les mêmes idées, des lampes assez, singulières. Le verre qui sert de cheminée étant surmonté d'un appareil hélicoïdal du genre de celui que représente notre figure, a suffit d'allumer la lampe pour que le mouvement de rotation ait lieu. Or, les transformations de mouvement, faciles à concevoir, servent à tirer parti de cette faible force de rotation et à la faire agir, soit sur du petites pompes qui montent l'huile à la partie supérieure de la lampe, soit sur un mécanisme d'horlogerie sans ressort ni poids; de sorte que c'est le mouvement, de la lampe qui fait marcher les aiguilles sur le cadran.
Les transformations de mouvement dont il vient d'être question se retrouvent à chaque instant dans les machines les plus importantes et les plus utiles. Ainsi, l'air chaud en montant suit une direction rectiligne, et, au moyen de la surface hélicoïde, ce courant ascendant imprime la rotation aux engrenages de notre tourne-broche. La rotation qui a lieu d'abord autour d'un axe vertical, se transforme finalement en une autre autour d'un axe horizontal.
Remarquons en outre l'analogie frappante, ou plutôt la similitude parfaite qu'il y a entre l'appareil propulseur hélicoïdal qui paraît avoir un si grand avenir dans la navigation à vapeur et l'âme de notre petite machine.--La seule différence consiste en ce que l'un reçoit l'impulsion d'un moteur étranger dans un liquide immobile, d'où résulte son mouvement de progression dans ce liquide, tandis que l'autre reçoit l'impulsion d'un courant de fluide aérien, et que ne pouvant acquérir un mouvement de progression, il transmet sa rotation à d'autres parties de la même machine. Ainsi, un des progrès les plus remarquables de la navigation à la vapeur se trouvait implicitement dans notre tourne-broche sans ressort ni contre-poids! Que de grandes choses dans les plus petites!
II. Disons d'abord en quoi consiste le jeu de passe-dix. On jette trois dés sur une table, et un joueur parie contre l'adversaire que la donne des points amenés excédera 10. Il y a 216 combinaisons possibles. Or, les points sont disposés sur les dés ordinaires de manière que la somme des points sur deux faces opposées soit constamment sept, l'as opposé au six, et ainsi pour les autres. La somme des points qui se trouvent sur les faces opposées des trois dés fait donc constamment 21. Donc chaque combinaison qui fait gagner le joueur pariant pour passe-dix, en comprend une autre qui le fait perdre, savoir celle qu'on obtiendrait en retournant les trois dés, ou en faisant la lecture sur les faces inférieures au lieu de la faire sur les faces supérieures. Donc, les chances des joueurs sont égales lorsqu'ils parient, l'un pour, l'autre contre passe-dix en un coup.
Cela posé, d'après l'énoncé de notre problème, les probabilités de Paul sont évidemment
1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 pour gagner 1, 2, 4, 8, 16 fr., etc.,
selon que Pierre passera dix au premier, au second, au troisième coup, etc. La valeur de son espérance mathématique de gain est égale à la somme de tous les gains aléatoires multipliés respectivement par les probabilité correspondantes. Or, chacun de ces produits partiels est égal à un demi-franc Ainsi, Paul devrait, pour que le jeu fût égal, déposer un enjeu de 50 francs, si l'on convient de s'arrêter au centième coup; 500 francs pour mille coups, etc.
Il semble donc qu'il doit déposer pour enjeu une somme infinie, quand on convient que le jeu se prolongera jusqu'à ce que Pierre ait passé dix, si loin qu'il faille aller pour cela. Et cependant, ajoute-t-on, quel est l'homme sensé qui voudrait risquer à ce jeu, non pas une somme infinie dont personne ne dispose, mais une somme tant soit peu forte relativement à sa fortune.
Tel est le paradoxe curieux qui est célèbre dans l'histoire de la science sous le nom de problème de Pétersbourg.
Pour lever ce paradoxe, ce que nous connaissons de plus satisfaisant est la remarque très-simple faite par M. Poisson, que Pierre ne peut pas payer plus qu'il n'a, et que possédât-il 50 millions, il ne pourrait loyalement s'engager à prolonger le jeu au-delà du 26e coup, puisqu'au 27e coup sa dette envers Paul, en cas de perte, serait le nombre de francs représente par le produit de 29 facteurs égaux à 2, ou par 67, 108, 864 francs, somme supérieure à sa fortune. Réciproquement, Paul connaissant la fortune de Pierre, ne s'engagera pas après plus de 26 coups, et ne risquera que 15 francs. En supposant qu'on ne limite pas le nombre des coups, comme il ne peut recevoir de Pierre, quoi qu'il arrive, plus de 50 millions, on trouve que son enjeu ne doit pas dépasser 13 francs 50 centimes.
(Cette question est empruntée à l'ouvrage de M. Cournot, déjà cité.)
NOUVELLES QUESTIONS A RÉSOUDRE.
I. Puiser de l'eau dans un puits avec une corde sans seau.
II. On demande de combien de manières différentes on pourrait payer 3 livres tournois, lorsque l'on faisait usage de nos anciennes monnaies, telles que: écus de 3 livres, pièces de 24, de 12, de 6, de 2 sous, de 18 deniers, d'un sou, de 2 liards, d'un liard.
A M. le Directeur de L'Illustration,
Bordeaux, 17 janvier 1843.
Monsieur,
Vos rébus finiront par causer quelque grand malheur. Deux honorables négociants de Bordeaux, n'ayant pu se mettre d'accord sur le sens de celui que contenait votre avant-dernier numéro, en sont venus à des propos affligeants et presque à des voies de fait. Voici comment les choses se sont passées:
M. A..., remarquant dans votre rébus un rayonnement circulaire d'un diamètre fort étendu, pensa que l'intention de l'auteur avait été de représenter le soleil. Cela posé, il constata au centre de l'astre la présence d'une laie et les attributs généraux des beaux-arts. Armé de ces deux éléments de conviction, il arriva successivement à la combinaison d'une phrase ainsi conçue:
Les beaux-arts sont dans le plus grand désastre.
(Laie, beaux-arts sont dans le plus grand des astres.)
Je ne sais, monsieur, ce que vous penserez de cette interprétation. M. A... soutint qu'elle était parfaitement raisonnable: il déclara qu'il avait visité la dernière Exposition du Louvre; qu'il avait reculé d'horreur à la vue de toutes les monstruosités qui s'étaient offertes à sa vue; qu'il lui était par conséquent permis de croire que les beaux-arts étant arrivés à leur extrême décadence, ce fait avait pu être proclamé, sous la forme allégorique d'un rébus, dans un journal qui se distingue par la délicatesse et la pureté de son goût.
M. C..., qui avait également visité la galerie du Louvre, mais qui, en sa qualité de spéculateur en indigo et en cochenille, n'avait fixé son attention que sur la nature des couleurs et les avait trouvées fort belles, repoussait la traduction de M. A... comme absurde, inconvenante et attentatoire à la dignité des artistes français. En conséquence, il déclara:
1° Que ce que M. A... prenait pour un soleil, n'était autre chose qu'une gloire;
2° Qu'en effet on voyait au milieu de cette gloire les attributs des beaux-arts;
3º Qu'on y voyait également une laie, mais que cette laie étant sur le point de mettre bas, il fallait en conclure qu'elle était féconde.
A l'aide de ces diverses indications, M. C... déclara formellement que, loin de signifier que les que les beaux-arts étaient dans le plus grand désastre, le rébus contenait ces mots:
La gloire environne les beaux-arts et les féconde. (et laie féconde)
Vous comprenez, monsieur, que, partant de deux points de vue aussi opposés, il était difficile que les deux adversaires pussent se faire la plus légère concession. Vainement des amis, affligés d'une discussion dont les suites pouvaient devenir graves, firent-ils tous leurs efforts pour opérer une conciliation; elle était radicalement impossible. Ils échouèrent donc, et la querelle n'en devint que plus animée et les expressions que plus outrageantes.
Heureusement, monsieur, le courrier de Paris apporta votre dernier numéro et par conséquent l'explication de votre dernier rébus. Ni l'un ni l'autre des adversaires n'avait deviné juste, puisque la phrase était: Les beaux-arts sont dans toute leur gloire, la dispute se calma subitement; des explications satisfaisantes furent échangées; les deux négociants se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre.

Toutefois M. C..., après un instant de réflexion, se ravisa vivement, et s'écria en s'adressant aux témoins de cette terrible scène: «Avouez au moins, messieurs, que j'ai un peu moins tort que M. A...; car, si les beaux-arts sont dans toute leur gloire, il en résulte évidemment qu'ils ne sont pas dans le plus grand désastre!...»
Vous voyez, monsieur, que ce qui vient de se passer à Bordeaux est un nouveau chapitre à ajouter au livre des grands effets produits par les petites causes. Qu'à l'avenir cela vous serve d'avertissement, et croyez-moi,
Votre bien dévoué serviteur et abonné,
P. B..... O.
Rébus.
EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS
L'inauguration de la fontaine Molière s'est faite le 15 du courant.