L'ILLUSTRATION
Prix du Numéro: 75 cent.
SAMEDI 27 JUIN 1891
49e Année.--Nº 2522

LES SYNDICATS OUVRIERS Le «premier en ville» et le
«second en ville» (président et vice-président des compagnons
boulangers).
(Voir l'article plus bas.)

 e garden-party devient un divertissement à la mode. Et c'est
tant mieux, car à Paris il y a une quantité de jardins inconnus dont les
grands arbres et les pelouses semblent avoir la nostalgie des robes
claires et des musiques en plein air. Je ne sais qui a dit, avec quelque
raison apparente:
e garden-party devient un divertissement à la mode. Et c'est
tant mieux, car à Paris il y a une quantité de jardins inconnus dont les
grands arbres et les pelouses semblent avoir la nostalgie des robes
claires et des musiques en plein air. Je ne sais qui a dit, avec quelque
raison apparente:
A Paris les jardins sentent le renfermé!
Ils sont, en effet, enclos dans des cercles de pierres. Mais il en est de très beaux et de très grands dont les bonnes odeurs peuvent monter au ciel en toute liberté! Avez-vous jamais regardé, du haut de quelque plateforme de la tour Eiffel, non pas l'horizon des environs de Paris--où tant de petits lacs, de petits étangs, de petits cours d'eau, apparaissent--mais l'intérieur même de Paris, la masse grise des maisons, l'espèce de plan en relief qu'on a de là-haut sous les yeux, sous les pieds? C'est étonnant, alors, comme on aperçoit parmi ces tas de pierres des touffes fréquentes de verdure. Il y a des arbres un peu partout, des jardins ou des jardinets en nombre considérable.
--Que de jardins! Oh! que de jardins! Je ne l'aurais jamais cru!
C'est l'exclamation que j'ai plus d'une fois entendu pousser par des visiteurs et surtout, car d'instinct les femmes aiment les fleurs, par des visiteuses.
Donc, s'il y a tant de jardins à Paris, pourquoi la mode anglaise des garden-parties ne s'acclimaterait-elle point parmi nous? Le peintre Ziem, qui adore Venise, va faire un tableau représentant la réception de lady Lytton dans les jardins de l'ambassade d'Angleterre, ce qui prouve qu'il y a, pour les peintres coloristes, de la couleur à Paris autant qu'à Venise.
Ziem pourrait peindre encore la matinée dansante que donne Mme Carnot au palais de l'Elysée, le dimanche 28 juin, et les beaux arbres du vieux jardin valent ceux de l'hôtel voisin. C'est exquis, un garden-party à l'Elysée, surtout par un beau temps, quand le soleil, ce grand invité, consent à être de la fête. Il transfigure tout, il illumine tout. Il donne de l'accent et de la lumière à la musique elle-même.
Où en sommes-nous que, vers la fin juin, nous doutions de la présence du soleil? En vérité, je commence à croire qu'il n'ont pas tout à fait tort, les vieux parents qui nous disent:
--De mon temps, le printemps était plus sûr et l'été était plus beau!
L'almanach nous répondra que nous entrons à peine dans l'été. Nous y entrons, c'est bien certain, par la petite porte. Je crois que les théâtres qui ont fermé leur portes ont été bien pressés et que les cafés-concerts en plein air qui ont ouvert leurs barrières ont été fort imprudents. Yvette Guilbert suffirait cependant, à elle seule, à attirer tout Paris, le Paris d'été, aux Champs-Elysées, comme la Fête des Fleurs l'a attiré, dimanche, boulevard d'Argenson à Neuilly.
Mais le Rêve de M. Bruneau que l'on fête en un banquet, mais la pièce nouvelle de M. Ferrier que l'on répète au Théâtre-Français, mais Miss Helyett qui continue à amener la foule, pourraient bénéficier de ce que la saison a de douteux. Les fêtes champêtres et les inaugurations de statues--plaisirs d'été--n'en continuent pas moins, tous les dimanches, quelque temps qu'il fasse.
*
* *
Dimanche prochain--c'est-à-dire quelques heures après l'apparition de ces lignes--les grandes eaux joueront à Versailles, en l'honneur du sculpteur Jean Houdon. L'Institut a délégué pour le représenter à cette fête d'un grand sculpteur la plupart des maîtres de la sculpture française contemporaine: Paul Dubois, Falguière, Mercié. Le bon Jean Houdon (je ne sais pourquoi, je l'appelle le bon, mais il devait être bonhomme) serait flatté de cet hommage rendu par ses pairs.
Il eut une belle existence d'artiste et une triste fin de vieillard. Devenu sénile, il allait ramassant les vieux tessons de faïence qu'il recueillait précieusement et qu'il montrait en disant:
--Je viens de trouver quelque chose d'admirable!
--Et quoi donc?
--Cela.
Il tenait, dans ses pauvres mains ridées, le fragment cassé et il ajoutait:
--Oui, c'est un morceau de Phidias... Vous ne voyez pas?... Un marbre grec. Du Phidias!
Pauvre Houdon! Beaucoup de nos contemporains ont pu le voir encore, étant enfants. Il est mort en 1828, à quatre-vingt-huit ans.
Il est de belles morts. M. Calmann-Lévy, qui joue avec ses petits-enfants comme un patriarche et disparaît tout à coup en leur souriant, a trouvé le moyen de bien mourir. Il avait su aussi bien vivre et, très laborieux, très actif, avait gardé le bon renom de cette maison Michel Lévy qu'il avait fondée vers 1848, lui et ses frères. C'était une figure parisienne bien connue du monde des théâtres et aussi du monde académique, et plus d'un auteur dramatique a coudoyé, le jour des funérailles de l'éditeur, M. le duc de Broglie, et, si M. le duc d'Aumale eût été à Paris, y eût rencontré le duc d'Aumale.
Calmann-Lévy s'était fort occupé, il y a quelque temps, de cette statue de Balzac que la mort de Chapu laisse inachevée et qui, destinée à la galerie vitrée du Palais-Royal, devra être agrandie pour pouvoir faire bonne figure sur la place du Palais-Royal, devant le Conseil d'État, où elle prendra la place du petit abri qui permet aux piétons d'éviter de ce côté, les voitures.
Balzac sera bien placé dans ce centre parisien, bruyant, vivant, turbulent, affairé, et les tramways lui sembleront bizarres, à lui, l'homme des cabriolets, autant que les grands magasins du Louvre, dont il sera le voisin, pourront sembler gigantesques au peintre de la petite Maison du Chat qui pelote. Il l'avait deviné notre Paris international, ce Balzac qui a prévu et prédit tant de choses; mais, c'est égal, Paris le laisserait quelque peu stupéfait sur certains points. Balzac paraîtrait provincial à nos reporters.
*
* *
Le plus joli coup de reportage a été celui que certain interviewer, qui doit être un jeune homme, a fait à propos de l'impératrice. En ouvrant un journal, on a été surpris, l'autre jour, d'y voir le récit d'une conversation de l'impératrice Eugénie avec un journaliste dans un appartement de l'Hôtel Continental. Description de l'impératrice. Cheveux blancs, yeux tristes, un peu voûtée. Echange de propos.
--Je suis heureuse d'être dans une ville où l'on parle français.
Et, axiome final--répété par plusieurs journaux:
--L'Empire?... L'Empire est mort avec mon fils!
C'était très intéressant. C'était même dramatique. Le malheur, c'est que cela n'a jamais été dit.
L'impératrice n'a reçu aucun reporter et n'a confié ses sentiments sur l'empire à personne.
Et voilà cependant comme on écrit l'histoire!
Dans quelques années, il n'en sera pas moins acquis par la chronique qu'un jour de juin, dans une chambre d'hôtel, celle qui fut la mère du Prince Impérial a dit:
--L'Empire est mort avec mon fils!
Quoi qu'il en soit, ceux qui ont rencontré l'impératrice s'accordent à dépeindre son air de tristesse, l'air que notre reporter imaginatif a décrit. Elle a moins sujet d'être gaie que M. Ernest Renan, l'ancienne souveraine, et M. Renan seul, pour tout dire, a le privilège d'affirmer à tout propos le bonheur qu'il a de vivre. Il vient de proclamer, une fois de plus, sa satisfaction, en présidant, dimanche, les fêtes de Florian à Sceaux.
Ah! le joli discours! Et tout épanoui! M. Renan n'aime pas le pessimisme. Il voit tout en beau, la vie et les hommes, et la province et Paris, et le soleil qu'on attendait le matin, et la pluie qui est venue dans l'après-midi. Breton, et content d'être Breton, il a cependant regretté presque de ne pas être du Midi, et il a parlé du Midi de façon à enthousiasmer Tartarin lui-même. Du reste, il n'a pas oublié Paris.
--Vive Paris! a-t-il dit, Paris, la ville des panégyres!
Je gage que ces mots ont fait ouvrir de grands yeux à plus d'un félibre. Mais les félibres sont lettrés, et ils ont souri, en général, et voilà Paris qui, grâce à M. Renan, a une vertu de plus. Le proverbe disait de Paris: «C'est le paradis des femmes et l'enfer des chevaux». Désormais on dira aussi:
--C'est la ville des panégyres!
La plupart des Parisiens ne comprendront point, mais ils n'en seront pas moins très fiers. Toutes les villes ne peuvent être la ville des panégyres!
La ville des panégyres est aussi la ville des phénomènes. Rosa-Josépha, ce spectacle nocturne quand on les ou plutôt la montre dans les Aventures de M. Martin, est un spectacle diurne quand on exhibe au foyer, dans l'après-midi, ces deux pauvres êtres éternellement accouplés.
J'en reparle parce que des lectrices, qui s'intéressent à nos causeries, m'ont posé ce problème de psychologie tout à fait intéressant et inquiétant:
--Rosa-Josepha étant un être formé de deux êtres parfaitement distincts, et réunis seulement par les fonctions animales--le ventre--ne peut-il arriver que Rosa s'éprenne d'un amour ardent pour tel ou tel joli garçon, et que, ce joli garçon, Josepha le haïsse d'une haine féroce?
--Si, parfaitement, cela peut arriver. Cela arrivera peut-être. Et, alors, songez aux complications morales d'une telle situation! Voilà un drame! un drame pour le Théâtre-Libre.
Toutes les deux sont forcées d'épouser celui que l'une d'elles aimera. Elles ont deux pensées, deux cerveaux, deux cœurs, et les malheureuses ne peuvent avoir une affection distincte. Jamais la nature n'a été plus ironique et plus féroce. Creusez cette situation, auteurs dramatiques et romanciers que vous êtes, et je vous défie d'en trouver une plus sauvage.
Les frères Siamois étaient moins unis, l'un à l'autre, que Rosa et Josépha. Ils étaient simplement liés par un lambeau de chair. Ne voulurent-ils pas même se faire opérer et n'est-ce point cette opération qui les tua? J'en ai comme un souvenir vague. Mais Rosa et Josépha ne peuvent songer à demander du secours à la chirurgie. Leurs deux existences séparées sont et seront éternellement rivées l'une à l'autre. Une de ces deux fillettes peut avoir la fièvre sans que l'autre souffre. Mais s'imagine-t-on le dénouement, l'inévitable dénouement futur: l'une morte, et l'autre, bien vivante, condamnée à mourir parce que le cadavre est là, à ses côtés--un cadavre dont, si je puis le dire, la survivante fait partie?
Je souhaite, et je suis certain, que ce dénouement arrivera fort tard, car les deux petites Tchèques sont gaies, alertes, aussi bien vivantes que fort jolies; mais enfin la nature s'est divertie là à une chinoiserie atroce. Elle a, pour ces deux innocentes, inventé un supplice monstrueux, supplice qui est une curiosité pour les désœuvrés. On se rend au foyer de la Gaîté comme à un five o'clock, et--misère!--ce drame de deux existences soudées l'une à l'autre, ça distrait, ça amuse! Flaubert dirait: «La beauté seule étant morale, cette exhibition est de l'immoralité!»
Ma correspondante n'est-elle pas de mon avis?
*
* *
J'ai laissé de côté--on m'en saura gré, je pense--cette grosse question de la mélinite, qui a encore agité l'opinion cette semaine et amené le ministre de la guerre à la tribune.
Certaines fioles de pharmacie portent cette inscription: «Agiter avant de s'en servir». Certaines questions politiques inspirent à nos politiciens cette devise: «Agiter afin de s'en servir».
On a donc agité, et d'avoir agité, cela n'a servi à personne.
Pour faire suite à ce que nous disions l'autre jour des mendiants, voilà que le père Antoine Pucciarelli meurt en laissant une centaine de mille francs gagnés en tendant la main sur les marches de Saint-Sulpice. Le Mendiant de Saint-Sulpice! Un bon titre pour M. d'Ennery. Ce Pucciarelli vivait de croûtes de pain, habitait, rue Princesse, un logement qu'il payait 60 francs par an, et se faisait comme une bosse de ses valeurs, qu'il cachait sous sa redingote. En apprenant la mort de ce riche mendiant, M. de *** a dit: «Parbleu, il n'y a plus aujourd'hui que les millionnaires qui soient pauvres!»
C'est l'histoire de ce passant--c'était Bizet--qui donne un sou à un pauvre. Le pauvre tire de sa poche un cigare et répond avec mépris:
--Un sou? Mes cigares me coûtent un sou et demi!
Rastignac.
LES COMPAGNONS BOULANGERS
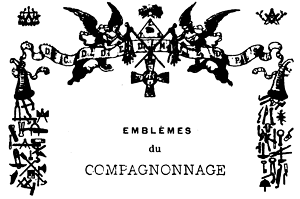
EMBLÈMES DU COMPAGNONNAGE.
L'actualité est aux syndicats, il n'est si petit corps d'état qui n'ait le sien. Patrons d'un côté, ouvriers de l'autre, se réunissent étroitement, forment des corporations comme jadis. Le nom seul a changé, il s'est modernisé. Le syndicat ou la chambre syndicale ont remplacé officiellement le compagnonnage et la maîtrise, qui n'en subsistent pas moins. Ils ont conservé du passé l'esprit de caste étroit et même, comme nous allons le voir, les règlements et les devoirs.
La boulangerie ne devait pas échapper à cette loi, et le syndicat des boulangers viennois convoquait la semaine dernière tous les camarades du métier à une réunion d'où la grève générale a failli sortir.
Exposons d'abord les griefs. A qui en a la boulange en ce moment? Aux patrons? Nullement. L'accord règne dans les boutiques. Contents des 45 à 50 francs qu'ils gagnent par semaine, les ouvriers y trouvent une rémunération suffisante des douze heures de travail qu'on leur demande.
Tout est bien de ce côté... pour l'instant.
Mais nous rencontrons ici, comme partout, l'intermédiaire entre le patron et l'ouvrier, l'éternel parasite, véritable lichen du travail, le placeur, contre les agissements duquel la boulangerie tout entière est soulevée maintenant, et dont elle entend se débarrasser à tout prix.
Il paraît, en effet, que les 8,000, d'autres disent 12,000 ouvriers boulangers parisiens ne peuvent se placer chez les 1,835 patrons de la capitale sans cet intermédiaire, entre les mains duquel il leur faut verser d'abord 10 francs de droit d'inscription, puis 40 à 50 francs de gratification, c'est-à-dire plus d'une semaine entière de travail pour arriver à trouver un emploi.
Un rapport présenté à la Chambre élève à 600,000 francs par an les bénéfices des dix placeurs de la boulangerie de Paris.
On voit d'ici le parti que l'ouvrier peut tirer de ce chiffre qui lui montre le placeur nageant dans l'opulence à ses dépens et ne fournissant du travail qu'à ceux qui lui payent largement tribut. Ajoutons que les placeurs passent pour être de la police, ce qui n'est rien moins que prouvé, mais ce qui suffit pour les faire considérer comme les mouchards du travail; voilà plus qu'il n'en faut pour expliquer les motifs de la réunion de protestation du Tivoli-Vauxhall qui a eu lieu tout dernièrement.
La Boulange donc se remue, les boulangers sont d'actualité. Présentons-les au lecteur.
Et d'abord le Viennois, très facile à reconnaître. Ce n'est certainement ni un marchand de vins, ni un garçon boucher, ce petit homme pâlot, d'apparence nerveuse et maigriotte.
Sa peau est fine, blanche, poudrée, ses yeux bleus, battus et cernés; l'aspect général est souffreteux. On sent que l'anémie tient et que la phtisie guette ce travailleur des poussières, du gaz et de la nuit.
Le chapeau sur l'oreille, la chevelure ondulée, la fine moustache, le laisser-aller précieux de la toilette, le dandinement de la marche enfin, tout trahit en lui le fignoleur.
Le Viennois est en effet l'ouvrier fin de la partie, il fabrique exclusivement la brioche, le croissant qui est son emblème, le pain Viennois dit de luxe auquel il emprunte son nom. Son unique outil de travail consiste en une fine lame d'acier pareille au tranchet du cordonnier, un couteau ordinaire serait trop grossier pour couper et débiter les produits de son pétrin.
L'ensemble et l'attitude de l'homme attestent qu'il a le sentiment de sa supériorité sur son camarade auquel, dans un coup d'œil moqueur et avec un léger rire dans la bouche, il lance habituellement le gracieux vocable: «Hé! va donc, fourneau!»
Bien «fourneau» en effet son camarade, le boulanger proprement dit.
Plus grand, plus trapu, le muscle chez ce dernier supplée à l'intelligence et au goût. C'est à la vigueur de ses biceps qu'ils demande son existence. Voyez ses mains énormes, elles manient la pelle, la lavette et brossent la pâte longtemps et dur.
Pains de ménage, pains de munition, au besoin pains de siège, voilà ce qu'il produit.
Dans la journée, de trois à cinq heures il fait son levain, puis la nuit, de neuf à six heures, ses quatre fournées réglementaires: le reste du temps il dort et quelquefois manifeste au Tivoli-Vauxhall... lorsque son camarade le Viennois l'y conduit.
C'est ce dernier, en effet, qui est à la tête de la boulange et la mène. Mais il est mené lui-même par d'autres. L'orateur, d'abord, que l'on rencontre partout, qui est le même partout, politicien de la foule qu'il pousse au désordre et à la grève, quitte à se sauver au moment du danger.
Cette fois cependant il a eu peu de succès: derrière lui, en effet, se dresse une ombre qu'on croyait morte et qu'on ne s'attendait guère à voir dans cette affaire, celle du compagnon.
Chez le marchand de vins, dans une boutique au fronton entouré d'emblèmes et de hiéroglyphes, le compagnon boulanger tient ses assises, là est son atelier figuré.
A l'heure où les anciennes corporations semblent renaître, le compagnon est peut-être l'homme de demain.
Voyez-le avec son air sérieux, à sa boutonnière pendent des rubans multicolores, sa cravate est ornée d'une équerre et il tient un bâton à la main.
Les boulangers font partie des trente-deux corps d'état établis en compagnonnage dans le but de se porter secours les uns aux autres et de s'entr'aider au travail dans toute l'étendue du pays.
Pour cela, dans chacune des 23 Cayennes, c'est ainsi qu'ils appellent les villes qui constituent le «tour de France», un marchand de vins ou un aubergiste a été désigné, chez lequel les compagnons peuvent descendre, trouver du travail et du crédit. Sa maison devient le siège de l'atelier. Notre dessin représente celle des compagnons boulangers de Paris. La femme de l'aubergiste est en général choisie pour s'occuper des compagnons. Elle prend alors le nom de mère. Ses obligations et celles des compagnons à son égard sont réglées par un contrat en bonne et due forme qui, de part et d'autre, est toujours respecté. Elle les loge, les nourrit, et leur fait des avances jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. Tout cela lui est remboursé par le débiteur ou par les camarades de la ville, qui tous sont solidaires les uns des autres.
*
* *
Voici maintenant les dignitaires qui composent un atelier de compagnonnage et que dans L'argot spécial on appelle les hommes en place.
La mère d'abord, dont les insignes sont une écharpe rouge et un bouquet d'épis; puis, le président, ou premier en ville; enfin le vice-président, ou second en ville; et le rouleur.
Le président a une écharpe blanche, le vice-président une écharpe rouge, le rouleur une écharpe bleue, et tous trois ont un nombre incalculable de rubans dont chacun représente une dignité, une distinction; le plus grand outrage qu'on pourrait leur faire serait de les leur arracher. Comme boulangers, ils n'ont pas droit à l'équerre et au compas, mais en revanche ils pourraient porter en boucles d'oreille des raclettes. Quant à la canne, c'est encore un emblème du compagnon, elle est plus ou moins enrubannée suivant le rang.
Ces trois dignitaires possèdent tous les secrets de la Compagnie et ont des attributions spéciales. Celles du rouleur, par exemple, consistent à embaucher les ouvriers, recevoir les nouveaux-venus, et accompagner ceux qui partent pour le tour de France en portant sur ses épaules leur canne et leur paquet jusqu'au lieu de la séparation.
Pour être reçu compagnon, il faut avoir fait son service militaire, être de bonnes vie et mœurs. Après un noviciat, l'aspirant apprend alors son devoir, c'est-à-dire un ensemble de lois et de règlements appelé les codes sacrés qui ordonnent l'obéissance absolue aux chefs et l'initient.
Quelques-uns de ces règlements, ceux notamment qui fixent l'étiquette des membres de la corporation entre eux, semblent avoir été tracés dans le but de fournir une clientèle aux marchands de vins. Les amendes encourues y sont supputées en litres et l'on en est passible pour le prétexte le plus futile. L'aspirant y apprend aussi qu'il a le droit de tope, c'est-à-dire causer avec ses camarades, et de les qualifier de l'épithète de pays, d'ajouter à son nom patronymique plusieurs surnoms, de l'appeler par exemple: Jazet l'Avignonnais dit le Rempart des frères, ou bien encore: Paulin le Marseillais dit Fleur d'Amour... et de payer une cotisation de deux francs par mois.
Le tout est d'ailleurs entouré d'un grand mystère et comporte des secrets terribles que des mots de passe lui laisseront deviner au fur et à mesure qu'il lui sera permis d'ajouter un ruban à ceux qu'il porte déjà.
Enfin, si le compagnon se rend coupable d'un vol ou d'une action déshonorante, il sait qu'il sera expulsé de la compagnie après une cérémonie appelée conduite de Grenoble, dont voici la description.
Le coupable est amené dans la salle et forcé de s'agenouiller; puis, tandis que tous les camarades qui sont là boivent du vin, on lui présente verre d'eau sur verre d'eau qu'il doit ingurgiter. Il paraît que c'est là une punition terrible. Lorsqu'il ne peut plus avaler, on les lui jette à la figure, puis on brûle ses couleurs et ses rubans devant lui; enfin, le rouleur le fait lever et l'oblige à passer successivement devant tous les assistants qui le soufflèrent et dont le dernier, au moment de son expulsion de la salle, lui allonge un énorme coup de pied.
Voilà rapidement raconté ce qu'est le compagnonnage en ce qui concerne les ouvriers boulangers. Nos dessins nous en montrent les types, mais ils nous montrent autre chose aussi, la transformation qui s'est opérée dans le milieu. Sont-ce bien des prolétaires que ces hommes vêtus à la mode, portant la redingote, le chapeau haut, des gants? Évidemment non, ils ne le sont plus. Grâce au syndicat, grâce au compagnonnage, une sélection s'est faite parmi eux et le bourgeois est apparu, gêné peut-être encore, et comme mal à l'aise, mais néanmoins dessiné. Un pas de plus et l'homme en jouera le rôle, il y aspire, c'est là le vrai but, celui qu'on n'avoue pas. Plus on prêche l'égalité et plus on sue la caste. C'est la morale qui ressort de tout cela.
Il était curieux de le dire et de faire voir qu'à notre époque de scepticisme et d'incrédulité il y a encore des gens qui se laissent prendre à des colifichets et que chez l'ouvrier comme partout une minorité intelligente et habile peut mener la masse sans qu'elle s'en doute, la conduire, toujours à l'aide des mêmes vieux procédés.
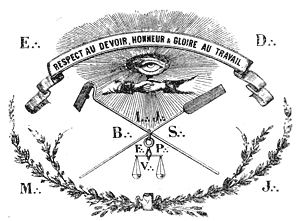
Insignes des compagnons boulangers.
LES SYNDICATS OUVRIERS.
--Types de compagnons boulangers.

La «mère» des compagnons boulangers.
Le siège social des compagnons boulangers.

Un ouvrier de fin.
«L'orateur».
Un ouvrier de gros.

MOBILISATION DES RÉSERVISTES DE LA MARINE.
--Une compagnie
de débarquement.
DAMNÉE!
Était-ce l'effet du vent d'orage qui secouait furieusement les arbres du parc, geignait dans la cheminée des lamentations effrayantes et ébranlait comme un voleur les fenêtres closes du salon tandis que, au loin, le tonnerre grondait sourdement? Je ne sais, mais, ce soir-là, la conversation, d'ordinaire si enjouée chez nos aimables hôtes, s'était singulièrement assombrie. Il ne s'agissait de rien moins que la mort; chacun disait son mot qui n'était point pour rire, car c'est ce diable de mot: enfer, qui, sans cesse, revenait dans les propos.
--Bah! s'écria tout à coup la souriante Mme d'Arzac, l'enfer ne m'épouvante guère, et cependant je devrais terriblement le redouter, car, telle que vous me voyez, n'exhalant aucune vapeur de soufre, je me suis damnée à trois reprises différentes, s'il me faut ajouter foi à la triple malédiction que fulmina contre moi mon digne oncle l'abbé de Janlieu, dont le ciel possède l'âme sainte. Je vous le jure, en pécheresse endurcie, je donnerais beaucoup pour pouvoir encore les mériter, ces trois malédictions!...
Mme d'Arzac est une veuve qui a depuis longtemps quitté le clan des femmes d'un «certain âge» pour entrer dans celui des femmes d'un «âge certain», elle avoue bravement les soixante-deux ans qu'elle porte avec une vaillante allure; sa voix est restée jeune, ses yeux sont vifs; elle a l'humeur joyeuse, la santé robuste, et les cheveux blancs lui seyent à ravir... Les vieilles femmes, quand elles savent être vieilles, ont la grâce pénétrante des souvenirs heureux.
--Cela remonte à... quelques années, poursuivait Mme d'Arzac. En ce temps-là, j'étais blonde... Ne hochez pas la tête à la manière des incrédules parce que personne n'est là pour vous le certifier... J'étais blonde et même une jolie blonde. La vanité posthume m'est permise, n'est-ce pas? Il n'y a plus que moi pour rendre hommage à ce que je fus, et les morts ont droit à des panégyriques.
Vous ignorez peut-être que je débutai fort mal dans l'existence. Mon père, le comte de Janlieu, désirait passionnément un fils, ce fut moi qui vins au monde, me trompant, et j'y vins si malheureusement que ma pauvre mère en mourut. Mon père conçut de cette perte un violent désespoir, qui m'aliéna sa tendresse. Certainement, à la longue, je l'eusse conquise, mais le ciel ne le permit pas; j'atteignais à peine l'âge de raison que Dieu exauçait les ardentes prières de mon père, en l'appelant auprès de lui et de l'épouse chérie si tôt ravie à son amour.
A sept ans, j'étais orpheline; je fus alors recueillie par le seul proche parent qui me restât, mon oncle, l'abbé de Janlieu. C'était un homme assez étrange, ce saint abbé; d'aucuns le traitaient de philosophe--c'est là un bien gros mot dont je préfère me méfier--à coup sûr il était au moins original. Il entra dans les ordres, non tant par vocation que par mépris de l'existence et mépris du monde; il se plaisait à dire qu'il n'avait fait que rendre à Dieu la vie dont il ne voulait pas. Quoique, par son intelligence, son savoir, sa fortune et son nom, il pût prétendre aux hautes dignités ecclésiastiques, il avait sollicité une petite cure dans un village aux environs de Valence, et la seule faveur qu'il postula fut son maintien dans l'humilité de sa condition. C'était le fait d'un modeste qui--puis-je le dire sans manquer de respect à sa mémoire?--ne dédaignait pas le paisible repos, et savait apprécier les heures de loisir. N'allez pas conclure de là qu'il fût un paresseux; il lisait beaucoup, priait davantage, et sa foi, qui agissait, faisait de lui un modèle d'évangélique charité...
Me voici donc installée à la maison curiale... Vous l'avez vue partout, cette maisonnette du curé de campagne: des murs crépis à la chaux, des volets marrons, un grand toit rouge où roucoulent les pigeons... A l'intérieur, un confort simple; l'utile et même l'agréable, sans toutefois l'encombrement du luxe. Vous devinez les rideaux blancs, tendus comme des surplis devant les fenêtres, les carreaux reluisants... l'absence du moindre grain de poussière; partout une propreté méticuleuse, attentive, poussée jusqu'à la coquetterie.
Cet ordre imperturbable et cette propreté immaculée étaient dus à la vigilance de la servante de mon oncle, femme confite en dévotion et fervente en l'art du plumeau. Je ne l'ai jamais connue que sous le nom de Marie-de-l'Abbé, ainsi que la désignaient les gens du pays pour la distinguer des autres Marie du village. Grosse, rougeaude, rieuse et grondeuse, elle abattait à elle seule toute la besogne, faisait la cuisine, bêchait le potager, arrosait, préparait le pât des poules, récoltait les herbes pour les lapins, blanchissait, repassait... A ces divers cumuls devait s'adjoindre la délicate fonction de bonne d'enfant; mon arrivée compliquait son travail, mais Marie-de-l'Abbé ne s'en plaignit pas de peur de l'intrusion d'une rivale; elle était trop fière de sa situation au presbytère pour consentir à la partager; elle tenait à être l'unique servante, de façon à demeurer la souveraine maîtresse.
Une chambrette me fut affectée auprès de la sienne; je dormais là sous sa garde et je dois reconnaître qu'elle me témoigna une sollicitude égale à celle qu'elle témoignait au poulailler ou à sa batterie de cuisine. Mon oncle s'occupa aussitôt de mon instruction et, en dépit des blâmes de Marie qui préférait me voir gambader et sauter à la corde, il s'ingénia à me meubler la cervelle de choses sérieuses et sacrées. Cela, je le confesse, ne m'amusait guère, et j'abondais dans le sens de Marie au sujet des gambades et des sauteries.
Je travaillais en bas, dans le cabinet de mon oncle, pièce sévère, froide comme l'hiver, sombre comme un mauvais rêve, et pleine de gros livres menaçants. Car, dans l'ingénuité de mon ignorance, je m'imaginais que ces gros livres n'étaient là que pour moi--que contre moi!--et que je devrais les apprendre tous, depuis le premier jusqu'au dernier.
Ce qui aggravait mon enfantin martyre était la souriante tentation qui, par les beaux jours, brillait féeriquement derrière les rideaux: le jardin avec ses fleurs, ses fruits, ses papillons; le bassin avec ses poissons et ses grenouilles, le poulailler où les coqs superbes se pavanaient en claironnant; le clapier où les lapins font de si drôles de figures en agitant leur museau... puis, la terrasse, au bout du verger, près d'un mur en ruine, d'où l'on découvrait au loin le Rhône bleu sillonné de barques ailées de blanc, les collines boisées, les plaines infinies, les prairies grasses où paissaient les bestiaux... Au lieu de regarder ces séduisantes choses, hélas! contempler forcément les pages jaunies d'un ancien testament ou d'un catéchisme; au lieu d'écouter les cris des coqs, les gazouillis des oiseaux, les mille chansons de la nature, entendre le murmure monotone et grave de mon oncle l'abbé:
--Qu'est-ce que l'enfer?
Oui, ma première damnation date de cette infernale étude!
--Qu'est-ce que l'enfer?
J'avais neuf ans et c'était une royale journée de juin, ruisselante de soleil. Mais, dans la journée, le soleil ne visitait jamais le cabinet de mon oncle, ce qui le rendait plus sévère, tandis que, baigné de rayons d'or, le jardin resplendissait davantage.
--Qu'est-ce que l'enfer? redemandait mon oncle.
Les giroflées épanouies se balançaient lentement sur leurs tiges; honteuses de n'être ni cueillies ni flairées, des roses blanches pleuraient leurs feuilles parfumées... Et je répondis à l'abbé:
--L'enfer est un lieu horrible où, étant privé pour jamais de la vue, de la vue...
Oh! les coquets papillons qui voltigeaient dans les rais du soleil où ils se doraient les ailes!...
--De la vue?... s'informait mon oncle.
--De... Dieu! m'écriai-je.
-Bien; après?
Qu'il était donc curieux!
--... On souffre...
Moi aussi, je souffrais! Et les coqs qui m'appelaient! Je poursuivis docilement:
--... On souffre, dans le feu, des... des...
--... tourments, m'aida l'abbé.
--... éternels!
J'avais le dernier mot! Mais je n'étais pas à la leçon; il faisait trop beau dehors! Mon oncle n'y était pas, lui non plus, parce qu'il faisait trop chaud--chacun comprend l'atmosphère à sa façon. Sur son front la sueur perlait; il respirait difficilement, poussait des soupirs à faire envoler le bonnet de Marie et, par instants, oubliait sa tête au point de la laisser tomber lourdement sur son rabat. Évidemment il luttait contre le désir de faire une douce méridienne. Il se secoua:
--Comment l'Enfer est-il désigné dans les Saintes Écritures?
Cet effort l'épuisa; il posa sa tête dans sa main et s'accouda. Je répondis en embrouillant tout:
--L'Enfer est appelé le puits ardent de la colère du grand lac et la fournaise de l'abîme de l'étang de Dieu.
Le coude de mon oncle glissa; l'abbé faillit donner du coude sur la table. Il se leva, très digne, et, dissimulant un bâillement significatif:
--Tu ne sais pas, petite, dit-il d'un ton d'affectueux reproche. Je vais te laisser seule pour que tu étudie ta leçon... travaille.
Sur ce, il sortit, fut dans la pièce voisine dont il entrebâilla la porte. J'entendis qu'il roulait un fauteuil. Puis, le silence. Pas longtemps. Bientôt le bruit de sa respiration vint jusqu'à moi, s'accentuant par degré. Un premier ronflement très court, timide; un second, encore un peu hésitant; un troisième plus franc... l'abbé ronflait dans la sérénité de l'homme juste qu'il était. Tout doucement, je me levai pour m'assurer de ce sommeil. L'abbé était abîmé, accablé, dans son fauteuil de reps grenat, les bras ballants, la tête oscillant, ayant comme pivot son menton appuyé sur son rabat. Jacob devait dormir aussi profondément lorsqu'il rêva de l'Échelle! Je gagnai la fenêtre et, profitant d'un ronflement plus sonore, je l'ouvris. Oh! la bonne bouffée d'air tiède chargée de parfums! Immédiatement, je me dis:
--Si je sautais par la fenêtre!
Je résistai un instant à la tentation. Mais voilà que j'aperçois tout à coup, là-bas, dans le verger, sur la terrasse, près du vieux mur à demi écroulé, voilà que j'aperçois de ravissants rubis qui se balançaient dans les feuillages. Ah! ce cerisier constellé de fruits savoureux!
--Si je sautais par la fenêtre!
Mais que faisait Marie-de-l'Abbé? Je tendis l'oreille dans la direction de la cuisine et je perçus un bruit qui me rassura. Marie-de-l'Abbé astiquait ses cuivres: or, quand elle astiquait ses cuivres, Marie en avait pour trois bonnes heures durant lesquelles le tonnerre lui-même, entrant dans la maison, n'aurait pas réussi à la troubler...
Certainement, je sauterai par la fenêtre!... Et je sautai. D'un bond je fus au verger. J'escalade le vieux mur; m'aidant des pieds et des mains, je saisis une grosse branche du cerisier, j'attrape le tronc, je me hisse et m'arrange le plus commodément possible dans une fourche. Les excellentes cerises! J'en mangeai à cœur joie; à mesure je recueillais les noyaux dans mon tablier relevé.
Soudain, la porte de la maison s'ouvrit et l'abbé apparut, tout noir dans le soleil.
--Où es-tu? Où es-tu, petite vagabonde?
Je me gardai bien de répondre et me tins blottie dans mon arbre.
--Où es-tu?
Il avançait fouillant les buissons du regard. Mon Dieu! viendrait-il jusque sur la terrasse? Oui, il y vint; pis que cela, il vint tout près du vieux mur, sous le cerisier. Je me sentis perdue; la frayeur me dicta un geste maladroit... mon tablier retombe et, patatras! les noyaux de cerises vont s'abattre en pluie sur le large chapeau de l'abbé. Stupéfait, il lève le nez et m'aperçoit.
--Petite malheureuse! s'exclama-t-il en brandissant désespérément son bréviaire, petite malheureuse, tu iras tout droit en enfer!...
Cette malédiction précipita ma descente; je dégringolais plutôt que je ne descendis...
--Maintenant, au travail! La sais-tu enfin, ta leçon?
--Oui, dis-je d'un air à la fois penaud et fanfaron.
--Récitez alors, mademoiselle. Qu'est-ce que l'enfer?
--Et, pleurant à demi, rejetant insolemment ma tête en arrière, secouant mes boucles blondes et tapant du pied:
--L'enfer, mon oncle, est un lieu horrible... très horrible!... où il n'y a pas de fleurs, pas de papillons, pas de coqs, pas de soleil, pas de cerises... enfin tout comme votre cabinet de travail, mon oncle!
Et je vous certifie que c'est bien ainsi que je m'imaginais l'enfer, ce jour-là!...
*
* *
Ma seconde damnation eut une cause moins futile, car j'avais poussé depuis l'aventure du cerisier; il ne s'agissait plus de paresse et de gourmandise--menues peccadilles qu'on pardonne aux enfants--mais de curiosité et de coquetterie, péchés quasi-mortels qui, plus tard, deviennent péchés mignons, lorsque sonne l'heure de l'éclosion de la femme.
Alors, je ne redoutais plus les insidieuses questions de mon oncle sur les deux Testaments ou le catéchisme. J'allais vers mes onze ans et préparais ma première communion. Je puis le dire, sans me flatter, j'étais la plus dévote ainsi que la plus savante des aspirantes de l'abbé. Au milieu des bambins et des bambines, je jouais aussi sérieusement à la madone que je jouais à la maman avec mes poupées, affectation qui doublait chez moi l'ingratitude de l'âge ingrat. Pleine d'onction et d'orgueilleuse modestie, je parlais à voix basse, m'empêchais de rire, tenais les yeux baissés et mes lèvres pincées. Mon oncle prétendait que je faisais l'édification de la paroisse...
Un jour, en ma présence, l'abbé ouvrit son armoire à glace et y farfouilla. Comme il me tournait le dos, j'eus la franchise de lever les yeux, et j'aperçus, sur un rayon de l'armoire, une sorte de coffre en marocain rouge. Ce coffre m'intrigua, m'intrigua au point que ma langue, d'elle-même, se mit en mouvement:
--Qu'est-ce donc, mon oncle, cette boîte? demanda-t-elle.
L'abbé répondit d'un ton de chaire:
--Cela ne regarde pas les fillettes comme toi.
Ça lui était facile à dire, à lui qui savait ce que contenait ce coffre mystérieux. En fait de réponse, il ne pouvait en choisir une meilleure pour exciter ma curiosité d'Ève naissante, et le malin diable qui habitait toujours en moi, sortant de la prison où ma ferveur le maintenait, me taquina aussitôt, criant:
--Qu'est-ce donc que ce coffre rouge?
Je ne voulais pas l'entendre, mais, obstiné comme tous ses pareils, il se plaisait à m'obséder. Pour le réduire au silence, je redoublais de dévotion, mais, trop souvent, la pensée tentatrice se glissait parmi les Pater et les Ave, et, tandis que mes lèvres continuaient à implorer Dieu ou la Vierge, je m'oubliais à écouter la diabolique voix:
--Qu'est-ce donc que ce coffre rouge?...
J'en souffrais tant que je dus songer au remède. Il n'y en avait qu'un: pénétrer sournoisement dans la chambre de mon oncle, m'emparer du coffre, l'ouvrir et voir ce qu'il y avait dedans. Les circonstances se donnèrent le mot pour me perdre. Un après-midi, des paysans vinrent quérir mon oncle pour le conduire en toute hâte au chevet d'un agonisant.
--Sois bien sage, me recommanda l'abbé en s'en allant.
Je promis. Je ne m'étonne plus que les vendeurs de promesses fassent fortune!... Il y avait marché à Valence; Marie-de-l'Abbé, toujours à l'affut des économies à réaliser, s'y trouvait. Donc, j'étais seule à la maison... Seule avec ma tentation et le coffre mystérieux. Pouvais-je résister?... J'entre dans la chambre de mon oncle. Le confiant abbé laissait toujours ses clefs aux serrures. J'ouvre l'armoire, et découvre, sous une pile de mouchoirs, le coffre, le coffre mystérieux.
A bas les piles de mouchoirs! Je saisis le coffre. Je crus d'abord qu'il était scellé dans l'armoire, tant il parut lourd à mes maigres bras. Je raidis mes forces, j'attire le coffre à moi, l'appuie sur ma poitrine en le soutenant de mes deux bras, et me cambrant, suant sang et eau, je parviens à gagner une chaise près de la fenêtre, où je le laisse tomber... Ouf!...
Le coffre était rempli de boîtes de différentes tailles, toutes recouvertes de peau de nuances diverses, mais fanées, rappelant les teintes discrètes des fleurs séchées.
Au hasard, j'en ouvris une, et je restai éblouie devant un bracelet d'or enrichi de diamants... Oui, l'abbé conservait là, dans ce coffre--et conservait pour moi, le cher homme; je l'ignorais alors--les bijoux de famille. D'abord l'étonnement me dicta une timidité respectueuse. Je m'enhardis. J'ouvris un second écrin, un troisième... Je les ouvris tous et les étalai par terre pour mieux contempler leur magique ensemble.
Il y avait des bagues, des pendants d'oreilles, des châtelaines, des chaînes, des colliers, des bracelets, des boucles, des broches... une boutique de joaillier. Lors, la coquetterie parla. Je ne me laissai point troubler par l'embarras du choix; j'usai de tout. Me voilà à quatre pattes, à trois plutôt, fourrageant parmi les écrins. Autour de mon cou, je passai au moins cinq colliers; je retirai mes modestes boucles de corail et les remplaçai par une paire de pendeloques qui me tombaient jusque sur les épaules; j'utilisai les autres en les accrochant dans les mailles de ma résille. Je chargeai mes poignets de bracelets; je piquai une demi-douzaine de broches sur mon tablier d'alpaga, sans omettre deux châtelaines, une à ma poche gauche, l'autre à ma poche droite. Finalement, j'enfilai des bagues... trois à chaque doigt, sauf les pouces. Et, me jugeant assez parée, j'allai me regarder dans la glace de l'abbé, en ayant soin de tenir mes mains en l'air, car les bagues, trop larges, eussent glissé de mes doigts.
C'est dans cette attitude que mon oncle, rentrant inopinément, me surprit... Epouvantée, je reculai, laissant tomber les vingt-quatre bagues, qui roulèrent sur le parquet.
--Petite misé...
... Rable, voulut dire l'abbé. Les mots ne sortaient pas; l'indignation l'étouffait.
Il devint cramoisi; son bréviaire lui échappa et fut rejoindre les bagues sur le parquet. S'emportant pour tout de bon, cette fois, il s'avança, la main levée... Oh! il ne me frappa point... mais je reçus, sur le bout du nez, une chiquenaude qui blessa profondément mon amour-propre. Il acheva:
--Petite misérable! Tu iras tout droit en enfer.
Et je ne répondis rien!
*
* *
Voici enfin ma troisième damnation. La scène du drame est une allée ombreuse d'un beau parc, dans la vallée de Chevreuse. C'est un matin d'été, et j'ai dix-huit ans... Mais il faut que je vous apprenne d'abord comment il se fait que je me trouve là, dans ce parc luxueux, au lieu de rêvasser dans le rustique verger de mon oncle. Sitôt ma première communion accomplie, l'abbé m'avait envoyée au Sacré-Cœur de Paris en me confiant aux soins d'une famille amie, quelque peu parente, les d'Orchères. Trois fois par an, en janvier, à Pâques, aux grandes vacances, mon oncle quittait sa cure et venait me voir chez les d'Orchères où il recevait l'hospitalité la plus cordiale. Outre leur hôtel du faubourg Saint-Germain, les d'Orchères possédaient un château, près Saint-Remy-lès-Chevreuse, et c'est là qu'ils m'hébergeaient durant les vacances de la belle saison.
Or, chez les d'Orchères venait tous les ans, au mois d'août, certain sous-lieutenant de dragons dont les attentions galantes et les courtoises prévenances étaient loin de me déplaire. Son casque ne me déplaisait pas non plus, ni la tête qui était dessous. Ma cervelle de jeune fille galopait à la suite de ce brillant officier, et, bien des fois, dans la tristesse sombre du couvent de la rue de Varenne, je rêvais à cet uniforme resplendissant... Enfin, je n'insiste pas...
Donc, j'achevai mes études et, à dix-huit ans, je rentrai au château des d'Orchères où je trouvai l'affectueuse surveillance de mon oncle l'abbé.
Quelques jours se passent au bout desquels survient, comme par hasard, le séduisant dragon devenu lieutenant entre temps. Vous jugez de ma joie, que, du reste, je m'empressai de dissimuler sous une glaciale froideur. Tel est notre instinct. A l'homme indifférent toutes nos grâces, à l'homme secrètement aimé toutes nos rigueurs; nous en souffrons, l'homme aimé aussi, mais c'est plus fort que nous. Qu'arrive-t-il? Ah! vous le savez bien! L'homme aimé supplie, implore... Nous étions d'avance vaincues; nous résistons encore pour le plaisir d'entendre de douces choses et de respirer de l'encens. Puis, nous nous laissons fléchir; l'attendrissement nous saisit, la pitié nous entraîne et... et on fait comme moi, n'est-ce pas? Un matin, de très bonne heure, on va se promener dans le parc où l'on rencontre son dragon... une allée ombreuse... Il parle, on écoute...
Que disait-il, mon cher dragon? Je l'ai oublié, ma foi! Mais ce devait être des choses bien émouvantes, car j'avais les larmes aux yeux, et, mollement, j'abandonnais ma tête sur son épaule...
Tout à coup, l'abbé surgit devant nous, toujours porteur de son inséparable bréviaire... De honte, je couvre ma figure de mes mains, écartant légèrement les doigts néanmoins, pour voir. J'aurais souhaité être à cent pieds sous terre. Mon dragon, lui, ne semblait nullement troublé.
Pour la troisième fois, l'abbé fulmina sa terrible malédiction:
--Malheureuse fille! Vous prenez le chemin de l'enfer.
J'éclate en sanglots; mon dragon se met à rire. Il me saisit la taille et, tendrement, tout haut, narguant ce pauvre abbé:
--N'ayez pas peur, mignonne, dit-il, nous irons ensemble.
Et, en effet, nous y allâmes, puisque cinq mois plus tard nous nous mariâmes à la plus grande joie de l'abbé qui donna la bénédiction nuptiale.
Je ne sais trop, hélas! où peut être à cette heure mon cher dragon, mais serait-il encore en purgatoire je ne le plaindrais pas trop, car il a eu ici-bas sa part de paradis...»
Et Mme d'Arzac, comme pour excuser cette petite vanité conjugale, se hâta d'ajouter:
--Moi aussi, du reste, moi aussi, j'ai eu ma part de paradis...
Gustave Guesviller.
NOTES ET IMPRESSIONS
Soyons hommes et sachons ce que valent les hommes: ne faisons pas d'une classe, si nombreuse qu'elle soit, l'origine et la souche de toutes les vertus.
Sainte-Beuve.
*
* *
Nos passions et nos besoins, voilà nos vrais tyrans. On devrait toujours être simple et vertueux, ne fut-ce que par amour de l'indépendance.
Mme Ackermann.
*
* *
Je lis dans chaque épitaphe cette règle de conduite: Voulez-vous qu'on dise du bien de vous? Faites le mort.
Alfred Bougeart.
*
* *
Naturaliste, psychologue, idéaliste, etc.: étiquettes collées au hasard sur les fioles et petits pots de la pharmacie littéraire et ne répondant guère aux onguents et électuaires qu'ils renferment.
Jules Lemaitre.
*
* *
Vivre sans bruit console de vivre sans gloire.
Jean Dolent.
*
* *
On a vu le fils ou la fille d'un artiste rappeler par leurs traits les types favoris de leur père: il y a des hommes qui se mettent tout entiers dans toutes leurs œuvres.
*
* *
Ce que les peintres appellent les hasards de la palette ressemble à tous les hasards: il n'y en a que pour les habiles.
G.-M. Valtour.
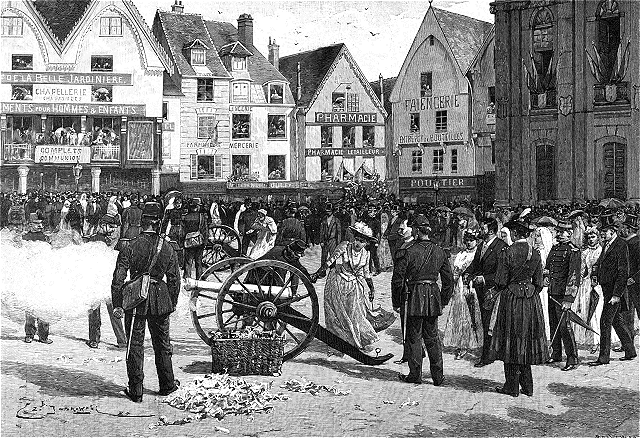
LA FÊTE DE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS.--Jeunes filles de
Beauvais tirant le canon, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, en souvenir
du siège de 1472.
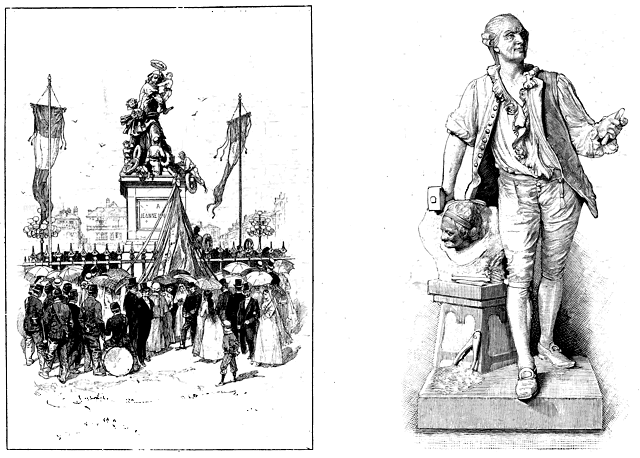
| BEAUVAIS.--Décoration de la statue de Jeanne Hachette. | La statue de Houdon Inaugurée à Versailles le 28 juin.--Tony Noël, statuaire.--Phot. de M. Terrade. |
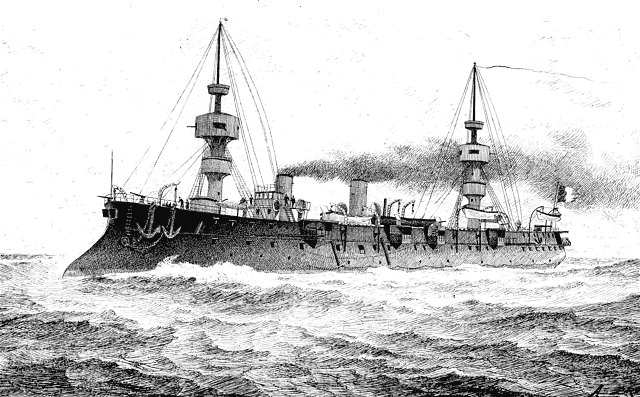
Le croiseur «Jean-Bart», en armement dans le port de
Rochefort.--D'après un croquis du Dr Géo.
HISTOIRE DE LA SEMAINE
La semaine parlementaire.--La faculté qu'a la Chambre de renvoyer à un mois la discussion des interpellations qui la gênent a de très réels avantages, mais elle a aussi de très sérieux inconvénients. Le plus souvent, quand la majorité emploie ce procédé commode de l'ajournement, elle espère que la question soulevée par l'interpellateur n'aura plus aucun intérêt quand elle sera admise à la discussion et que, par conséquent, elle sera enterrée par celui-là même qui a essayé de la porter à la tribune. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Dans certains cas, l'interpellateur s'obstine et alors il faut bien se résigner à entendre les discours qu'on aurait voulu écarter. On est forcé alors de faire renaître le souvenir d'événements oubliés, ou du moins sur lesquels on s'était efforcé de faire l'oubli. C'est ce qui est arrivé pour l'interpellation que M. Chiché avait déposée au lendemain de l'affaire de Fourmies, «au sujet de la non-application de la loi pénale aux agents de la force publique qui n'ont pas procédé aux sommations prescrites par la loi du 7 juin 1848.»
Heureusement M. Chiché, avec une grande modération, a déclaré lui-même que son intention n'était pas de passionner le débat, mais bien de se renfermer dans une discussion purement juridique. M. Fallières, qui était mis en cause, a répondu que dans l'espèce ce n'était pas la loi de 1848, mais celle de 1791 qui était applicable; or, celle-ci permet aux troupes, on pourrait même dire prescrit, de faire usage de leurs armes quand elles sont attaquées, c'est-à-dire quand elles sont en état de légitime défense.
Cette question des sommations légales en cas d'attroupements ayant donné lieu à des débats passionnés dans la presse et dans le public, il est intéressant de constater que la thèse soutenue par le garde des sceaux a été sanctionnée par la Chambre, car l'ordre du jour pur et simple auquel s'était rallié le gouvernement a été adopté par 374 voix contre 94.
--La majorité, subissant la direction toute-puissante du président de la commission des douanes, M. Méline, continue sans désemparer son œuvre protectionniste. Il est à constater une fois de plus qu'elle reste absolument sourde aux protestations, parfois violentes, qui se produisent quotidiennement dans la presse, alors cependant que, de toute évidence, la presse répond en cette circonstance au sentiment de l'opinion publique. C'est particulièrement au sujet de la taxe établie sur le pain que ces protestations se sont fait entendre. Cette taxe, fixée à cinq francs par cent kilos, était logique du moment que les céréales étaient imposées, mais, précisément parce qu'elle était forcée, cette conséquence a produit l'effet le plus déplorable. On se demande s'il n'est pas funeste le système qui aboutit à cette nécessité cruelle d'augmenter le prix du produit qui forme la base, sinon l'élément unique, de l'alimentation des pauvres gens. La majorité elle-même semble avoir eu conscience de l'impression fâcheuse que pouvait faire sa décision, car, après avoir voté la taxe de cinq francs par 291 voix contre 211, elle a adopté une disposition additionnelle proposée par M. Viger, aux termes de laquelle «la taxe ne frappera pas les petites quantités importées individuellement.» Elle ne sera prélevée que sur les grandes quantités introduites en France dans un but commercial. Il sera peut-être nécessaire de modifier cette rédaction assez vague, et quand la loi passera au Sénat, il est probable que la haute assemblée lui donnera un peu plus de précision juridique.
Pour en finir avec la question des céréales et du pain, il faut mentionner le conflit qui s'est élevé entre le Sénat et la Chambre au sujet de la date à laquelle doit commencer l'application de la loi portant réduction du droit d'entrée sur les grains. Moins protectionniste que la Chambre, le Sénat voulait que l'effet de cette loi fut immédiat, alors que la Chambre entendait en retarder la promulgation jusqu'au 1er août. En dernier lieu, la Chambre s'est arrêtée à un moyen terme et a proposé la date du 10 juillet.
Malgré le parti pris des députés, les libres-échangistes reçoivent cependant de temps à autre satisfaction, quand il s'agit des matières premières. Ils ont eu victoire complète en ce qui concerne les graines oléagineuses. Malgré l'intervention de M. Méline, et le talent déployé par M. Graux, rapporteur de la commission, l'exemption a été votée. M. Jules Roche, ministre du commerce, dans un discours très substantiel et très motivé, a démontré que les graines françaises ne peuvent servir à aucun des usages industriels qui réclament absolument, pour la savonnerie notamment, les graines des tropiques. Taxer ces produits, ce serait donc sacrifier l'une de nos plus importantes industries, et avec elle les intérêts de notre marine marchande. En conséquence, le gouvernement a déclaré qu'il n'accepterait l'établissement d'un droit que sur les graines oléagineuses similaires à celles que l'on cultive en France. Ce système a prévalu, et, cette fois, M. Méline et la commission ont subi un échec complet. Ce résultat a fait regretter que le gouvernement n'apporte pas plus souvent dans ce débat l'appui de son intervention, car, dans bien des cas, on croit qu'elle serait décisive.
--A l'unanimité la Chambre a adopté d'urgence les conclusions du rapport de la commission ouvrant au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de 1,500,000 francs, pour combattre l'invasion des sauterelles en Algérie.
--Le Sénat a consacré plusieurs séances à la discussion du projet de M. Bovier-Lapierre, prescrivant des peines correctionnelles contre les patrons qui auraient renvoyé des ouvriers par le motif qu'ils font partie d'un syndicat. M. Goblet a profité de cette discussion pour faire ses débuts à la tribune et développer cette thèse, qu'il faut protéger la liberté d'association accordée à l'ouvrier, et accepter en principe la sanction pénale formulée par le projet de loi de M. Bovier-Lapierre. Mais, manifestement, la Chambre-Haute est disposée à craindre--comme beaucoup d'excellents républicains, d'ailleurs très favorables à la classe ouvrière--que cette loi des syndicats ne finisse par devenir un instrument d'oppression, dont les travailleurs eux-mêmes auront peut-être à souffrir dans un temps donné. Cette impression s'explique d'autant mieux, qu'on voit dans toutes les grèves--et on vient d'en avoir une nouvelle preuve par la grève des tramways de Bordeaux--un certain nombre d'agitateurs profiter des décisions des syndicats pour mettre obstacle à la liberté du travail. Ces excès sont de nature à nuire à la cause des véritables ouvriers.
L'affaire de la mélinite.--La condamnation au maximum de la peine prononcée contre M. Turpin et contre ses complices Triponé, Feuvrier et Fasseler, loin de calmer l'émotion produite par la brochure: «Comment on a vendu la mélinite», n'a fait au contraire que la surexciter. En effet, par crainte des révélations qui pouvaient se produire au cours des débats, et dans l'intérêt supérieur de la défense nationale, le tribunal a cru devoir juger l'affaire à huis clos. Or, le mystère gardé par la justice, alors que le public était avide d'explications claires et catégoriques, a eu précisément l'effet opposé à celui que l'on cherchait. L'opinion a supposé qu'on lui cachait quelque chose, et quelque chose de grave, car la sévérité du tribunal paraissait en désaccord avec cette déclaration faite antérieurement par M. de Freycinet à la tribune de la Chambre que les révélations de Turpin ne pouvaient porter aucun préjudice à nos armements.
Comme il arrive toujours en pareille circonstance, l'opinion, privée d'éléments d'appréciation précis, a cherché à reconstituer, à l'aide des faits connus, ceux qu'on paraissait vouloir dissimuler, et c'est ainsi que, peu à peu, grâce à cette nervosité que nous ont léguée nos désastres de 1870 et que l'on croyait à tort guérie pour toujours, on en est venu à voir partout des espions ou des traîtres, car le grand mot de trahison a été prononcé.
On comprend que, dans ces conditions, le parlement ne pouvait laisser passer les choses avec indifférence, et M. Lasserre a porté à la tribune, sous forme d'interpellation, cette question qui passionnait la presse et le public. Son argumentation a porté principalement sur ce point que les faits révélés par Turpin étaient connus de l'administration de la guerre depuis deux ans et que cependant ils n'ont donné lieu pendant toute cette longue période à aucune poursuite. L'observation a son importance, mais d'autre part, quand on voit les inconvénients graves qu'a entraînés ce procès retentissant, on se demande si la juste punition des coupables compense le désordre et la défiance apportés dans les esprits par les révélations faites au public, et provenant, non plus d'un industriel suspect dont la parole peut être mise en doute, mais d'un tribunal se prononçant dans toute la majesté de la justice. Les hésitations de M. de Freycinet se comprennent, et, s'il n'a pas fait valoir ces considérations, elles étaient sous-entendues dans la réponse qu'il a faite à M. Lasserre. Dans tous les cas le président du conseil, comprenant que la première nécessité était de ramener la confiance, a exigé un ordre du jour, sans atténuation, sans réserves. M. Viette le lui a fourni et la Chambre l'a voté par 326 voix contre 130. Il reste de cette attristante affaire une bonne leçon qui portera ses fruits, car, si le patriotisme de ceux qui ont la direction de notre armée n'est mise en doute par personne, il faut aussi que leur vigilance égale leur patriotisme.
Les droites, les catholiques et la République.--De temps à autre les événements viennent donner une nouvelle preuve de l'évolution qui s'accomplit chez les partisans de la monarchie vers la République. Deux manifestations importantes dans ce sens viennent de se produire tout récemment.
En premier lieu, le groupe de la droite constitutionnelle, qui a pour chef M. Piou, a fait paraître un programme dont la réalisation n'implique en aucune façon le changement du régime actuel. Ce programme, essentiellement conservateur, mais nullement monarchique, a été exposé bien des fois. La seule chose intéressante à noter, c'est qu'il est repris et affirmé de nouveau, alors que l'existence même du groupe en question a été périodiquement présentée comme compromise. Il semble même que la droite constitutionnelle s'organise pour affirmer plus que jamais sa vitalité.
En même temps une autre association se constitue sous le titre d'«Union de la France chrétienne.» Cette association a également fait paraître un programme sous forme de déclaration signée par un comité composé de vingt membres qui aura la direction du groupe. On remarque, dans ce comité, les noms de MM. Chesnelong, Keller, baron de Mackau, Albert de Mun, Buffet, Lanjuinais, etc... Les signataires demandent le concours des chrétiens et de tous les honnêtes gens, quelles que soient leurs opinions politiques, «pour défendre et réclamer d'un commun accord les libertés civiles, sociales et religieuses dont on les dépouille.» Ils les convient à s'unir «pour revendiquer la liberté religieuse, la liberté d'enseignement, la liberté d'association, et pour obtenir la révision de tout ce qui dans les lois scolaires, militaires ou fiscales, en est la violation manifeste.»
Le Soleil, qui occupe une place importante dans le parti monarchique, donne sur la constitution de ces deux groupes une appréciation qui en précise le caractère et qui lui donne toute sa portée: «Les conservateurs de la droite constitutionnelle, dit le journal de M. Hervé, sous la signature de M. de Kerohant, acceptent le régime actuel, en lui demandant de rétablir l'équilibre financier, d'abroger les lois d'exil et de respecter les droits de l'Église. Le groupe de l'Union chrétienne accepte le régime actuel à la seule condition que les droits de l'Église soient respectés. Il y a là une évolution vers la République que nous déplorons, mais dont nous ne pouvons méconnaître la signification.»
Les événements d'Haïti.--Le sang vient encore une fois de couler à flots dans la République d'Haïti. Le général Hippolyte, qui en est le président, cherche à se maintenir au pouvoir par la terreur et il apporte, dans l'exercice de la dictature, une telle fureur sanguinaire qu'on le soupçonne atteint d'aliénation mentale.
Le général Hippolyte a remplacé, on se le rappelle, le général Légitime que toute l'Europe avait reconnu, mais qui, depuis, a été condamné par le sort des armes, à la suite d'une guerre civile qui a duré plusieurs mois. Le pays s'était partagé en deux camps. Légitime était maître à Port-au-Prince; Hippolyte jouait au souverain au Cap haïtien. Ce dernier a réussi à organiser ses forces de manière à l'emporter sur son rival et à le mettre en fuite, et l'Europe a dû reconnaître son gouvernement, qui était le gouvernement de fait. Des conspirations se sont tramées, mais le général Hippolyte les a découvertes et les conspirateurs ont été mis en prison. Leurs amis ont trouvé le moyen de les délivrer et ils ont marché sur l'arsenal. Mais leur tentative a échoué et Hippolyte, qui en avait été prévenu, est sorti de son palais à la tête d'une bande de forbans prêts à toutes les besognes. Il a fait fusiller tout ce qu'il rencontrait.
Sur son chemin s'est trouvé un honorable commerçant, M. Rigaud, qui a invoqué en vain la qualité de Français. Il n'a pas été écouté et a été fusillé sur l'heure comme les autres.
Ce meurtre a provoqué, on le comprend, un véritable mouvement d'indignation dans notre pays. Il est vrai qu'informations prises, la qualité de Français, dont avait cherché à se prévaloir le malheureux Rigaud, n'a pas été officiellement reconnue. Rigaud avait fait les démarches nécessaires auprès de la légation pour l'obtenir et n'y avait pas encore réussi. Toutefois, le refus de la légation de France n'avait pas été notifié au gouvernement du général Hippolyte. Cette circonstance permettait à notre gouvernement d'agir, et, avec une promptitude dont l'opinion lui sait gré, M. Ribot a chargé notre représentant à Haïti de réclamer une indemnité au gouvernement haïtien, pour ce meurtre accompli en violation du droit des gens. Le ministre des affaires étrangères verra la suite qu'il convient de donner à cette affaire, d'après l'accueil qui sera fait à cette première demande de réparation.
Nécrologie.--M. Auguste Marcade, publiciste.
M. Noblot, ancien député.
M. Mahou, ancien agent de change.
M. Albert Ducroz, député de la Haute-Savoie.
Le comte David de Fitz-James.
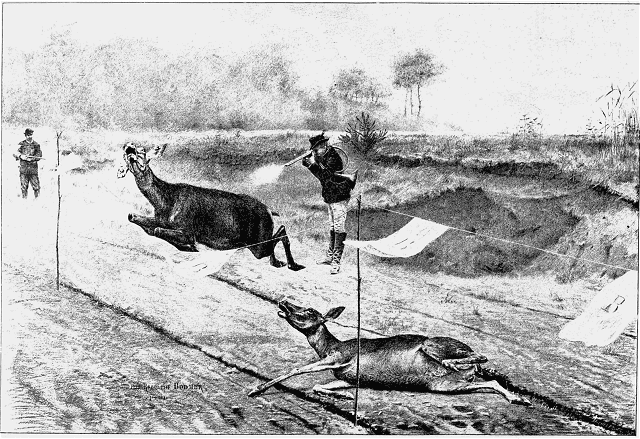
La chasse aux banderoles dans les fourrés de
Fontainebleau.

LA MODE
Le moment est venu où Paris commence à se dépeupler, chaque jour lui enlève une partie de son animation habituelle. Généralement, c'est le lendemain du Grand-Prix que se font tous les préparatifs de voyages, de déplacements, car il n'est pas de bon ton pour une élégante mondaine de rester dans la capitale longtemps après ce jour.
Bien des départs ont été retardés cette année en raison de la température que nous avons subie, et j'en profite pour jeter un aperçu rapide sur les dernières nouveautés qui apparaissent encore aux courses, au Bois, le matin de 10 heures à midi, le soir, de 5 à 7. Ce délicieux coup-d'œil est toujours charmant; il semble qu'il y a moins d'affectation, de pose, qu'en pleine saison; les femmes paraissent toutes joyeuses de respirer encore quelques jours le bon air de leur Bois, qu'elles vont quitter pourtant, mais à regret, parce que la mode le veut ainsi, et que ses lois sont suivies aveuglément.
Le matin, toutes les femmes semblent, porter un uniforme avec leur petit costume de lainage clair, leur jupe semi-collante, la veste ouverte sur une chemisette de fine batiste rosée, jaune, mauve, bleutée, plissée, chiffonnée, maintenue par une ceinture de cuir blanc ou fauve; le petit canotier à bords plats, gentiment enroulé de gaze assortie au gilet, avec deux ou trois ailes de plumes posées en vedette dans la gaze.
Surtout des voiles blancs de fines dentelles formant bordure, ou des voiles de tuile brun à pois de chenille qui s'assortissent admirablement aux pailles mordorées, brunes, beiges, grises, qui sont fort appréciées.
Les grandes formes capelines en paille de riz, d'Italie, Manille, à calottes très basses, sont cabossées à droite, à gauche, carrément retroussées derrière avec une avalanche de plumes blanches ou noires, ces dernières font très bien sur les pailles d'Italie; ou des jonchées de fleurs s'égrenant jusque sur les bords des larges passes.
Voici trois bien jolis chapeaux, le premier de forme nouvelle, genre Marie-Antoinette, en paille de riz beige clair, les bords plats tout autour, larges devant, plus étroits derrière, sans aucun retroussé. Un ruché de satin rose ancien entourait la calotte et retenait un fin plissé de dentelle Chantilly noire, panache de plumes noires posé droit devant. La même forme en paille gris argent, ruche et dentelle blanche avec pouf de roses rose, était délicieux de fraîcheur. Le second, une petite toque, faite de trois torsades d'herbe verte de deux tons, fixées sur une forme invisible en tulle noire, derrière un bouquet de pâquerettes des prés, et devant, une petite touffe qui semblait avoir poussé là parmi les herbes.
Puis, j'ajouterai une nouveauté, la capote coquille Saint-Jacques, ainsi nommée naturellement parce qu'elle rappelle la forme de ce coquillage.
On recommence à porter des brides, de vraies larges brides comme autrefois, surtout blanches en satin faille avec de longs bouts tombants sur la poitrine; autour de certains visages, elle font un encadrement des plus seyants.
Plus que jamais les jupes sont en forme de parapluie, plate du haut, cachant presque les pieds devant et s'étalant en traînant derrière; elles ne se doublent plus; un haut faux ourlet de soie et les garnitures suffisent à les maintenir et à donner de l'élégance à la traîne. Des lambrequins de dentelle, retenus de ci de là par des nouds Louis XV, des volants bien froufroutants, des ruchés à la vieille également superposés forment les principales garnitures du bas des jupes. Les rubans de soie, de velours, sont aussi employés avantageusement, formant des zigzags, des ovales, ou simplement posés en cercle, suivant les contours de la traîne, entremêlés d'entre-deux de guipure. Puisque nous parlons de dentelle, disons que son succès va toujours en ascendant. Toutes les dentelles de prix, point de Venise, guipure d'Irlande, dentelle Cluny, etc. s'utilisent de mille manières, posées en berthe, en jabot, en rabat, en guimpe, basque, etc; les corsages ne sont plus qu'un délicieux assemblage de dentelle de ruban.
Du reste, les étoffes en taffetas glacé, en foulard, la grenadine ou gaze noire à fleurs de couleurs, se prêtent admirablement à toutes les combinaisons. Les robes légères d'organdi, de mousseline de batiste semées de bouquets de fraises, de cerises fraîches à croquer, de roses, de violettes, etc. tous ces tissus délicats, avec leur ton éteint et leur air vieillot, semblent avoir fait partie des garde-robes de nos grand'mères et ne se comprennent qu'avec des froufrous de dentelle.
L'une des charmantes toilettes que représente notre dessin en est une preuve. Ne dirait-on pas que cette mousseline, coquettement parsemée de tulipes délicatement nuancées, sort de l'armoire d'une vieille douairière? La jupe posée en transparence sur un dessous de soie est cerclée de deux entre-deux d'Alençon. La veste ouverte est entourée de ce même entre-deux qui s'enroule lâchement autour des parements, laissant voir la petite guimpe froncée coupée de deux entre-deux formant ceinture. Les manches avec une simple dentelle au poignet. Le grand chapeau de paille de riz ivoire est gracieusement cabossé par un mince bord de velours vert gazon, rappelant le feuillage des tulipes de la robe; touffe de fleurs sur la calotte.
La seconde toilette est en crépon de Chine lys, le bas garni d'un haut point belge tout rebrodé de fil d'or. Un volant froncé orné de dentelle brodé fait le contour de la taille, sous la ceinture de velours jonquille. Sur la poitrine le petit rabat d'avocat fixé au col de velours. Les manches à l'italienne sont ornées d'un poignet brodé.
La délicieuse petite capote est formée d'une couronne de roses Niel sans feuillage, avec deux ailes noires posées en aigrette. L'ombrelle est simplement ornée d'un papillon de dentelle noire posé à jour.
Les manches d'ombrelles rustiques adoptés avec une prétention à la simplicité sont, au contraire, de la plus grande recherche; aux fruits, aux fleurs finement sculptés, se sont joints les insectes, les bestioles de toutes formes, de toutes couleurs; les légumes ont pris place sur les manches; petites carottes, radis, font concurrence aux cerises, fraises, etc.
La plupart de ces ombrelles sont en soie changeante, en dentelle, en gaze, mais les garnitures du dôme sont plus plates. Ce sont des appliques de broderie, de passementerie, de petits rubans entrecroisés, ou des motifs de dentelle posés à jour en bordure ou dispersés ça et là.
Fanfreluche.
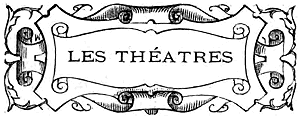
Opéra-Comique: Le Rêve, drame lyrique en quatre actes, d'après le roman de M. Zola, poème de M. Louis Gallet, musique de M. Bruneau.--Châtelet: Tout Paris, pièce à grand spectacle.
Je commencerai tout d'abord par faire mes compliments les plus sincères à M. Louis Gallet: M. Louis Gallet a écrit, d'après le roman de M. Émile Zola, Le Rêve, un des meilleurs poèmes lyriques que nous ayons vus au théâtre depuis bien des années. Tout en restant fidèle au sujet, il l'a renouvelé pour ainsi dire, non dans l'action, qu'il a entièrement respectée, mais dans la marche du drame, dans la disposition des scènes, dans les mouvements des sentiments, dans leur progression, dans leur intérêt enfin. J'ajouterai qu'il y a là véritablement œuvre de poète: le vers est charmant, plein de délicatesse toujours, et souvent d'une émotion exquise. Les livrets de l'Opéra-Comique ont rarement cette bonne fortune d'être traités avec tant de soin; il est vrai que le roman de M. Zola, avec son retentissant succès, s'imposait à l'auteur dramatique, et que M. Louis Gallet s'est piqué sans doute d'honneur dans cette lutte du vers contre la prose. Il n'a fallu rien moins que cette habileté pour rendre supportable au théâtre un des sujets les plus réfractaires à la mise en scène.
Malgré l'indifférence du public en général sur telle ou telle question de convenance, il fait ses réserves; il met à part, comme chose sacrée dans son esprit, les cérémonies religieuses, surtout celles qui touchent au ministère actif du prêtre; il les condamne non seulement parce quelles comportent une solennité trop imposante à la scène, mais parce qu'elles le froissent dans son respect et dans sa conscience. Le talent de l'auteur du Rêve l'a sauvé de ce grand danger. J'ai été étonné de ne rencontrer que de faibles résistances contre ce tableau de l'extrême-onction apportée à une jeune fille au milieu des saints cantiques. Les préparations scéniques nous ont conduit à de pareilles concessions; je crains bien que ce soit au plus grand péril de la pièce, qui a été consciencieusement écoutée à la première représentation, mais qui ne rencontrera pas des lendemains toujours aussi complaisants. Du reste, ce Rêve troublait toutes les idées reçues. M. Carvalho a la réputation d'être audacieux et, en vérité, je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin dans les innovations; M. Antoine lui-même, si vous le supposez un instant directeur de l'Opéra-Comique, M. Antoine, ce révolutionnaire du Théâtre-Libre, ne les aurait pas tentées.
Songez donc! les personnages sont en redingote, en paletot; un évêque apporte à une mourante les saintes huiles; ses clercs l'accompagnent, les cierges sont allumés, le prélat bénit les assistants et récite les prières latines pour les agonisants. Le réalisme a donc pris possession du théâtre. Je ne vous cache pas ma pensée, j'ai pour ma part l'antipathie la plus prononcée pour ce genre de spectacle. C'est une conquête pour l'art de la mise en scène, je le veux bien; mais il me serait agréable que cet art dirigeât ses efforts sur d'autres sujets; je me souviendrai donc de cette soirée dans laquelle toutes mes habitudes de spectateur de l'Opéra-Comique ont été si radicalement attaquées.
Vous n'avez sans doute pas oublié ce roman du Rêve, avec sa simplicité, son mysticisme, qui sembleraient devoir rejeter le sujet de cette pieuse idylle dans l'époque du moyen-âge, et qui se passe de nos jours à Beaumont-l'Église. Des braves gens, Hubert et Hubertine, fabricants de chasubles, ont adopté une enfant, trouvée un jour de neige à demi-morte, sous le porche, au-dessous de Sainte-Agnès; ils l'ont élevée dans la pratique de la religion. Les yeux constamment attachés sur les vêtements sacerdotaux qu'elle brode, n'abandonnant son travail que pour lire la légende des martyrs, l'esprit tout rempli de sainte Marceline, de sainte Solange, de Saint-Georges combattant le dragon, ou de sainte Agnès, le col troué d'un glaive; aux chants religieux qui s'échappent de la cathédrale, comme un parfum enivrant de foi, Angélique est devenue une sorte de visionnaire extatique: à travers le grand vitrail de la nef, au milieu des figures des saints, elle a entrevu le visage doux et charmant d'un jeune homme. Le rêve de son âme l'a emportée vers l'amour; le roman s'est ouvert. Pour elle, c'est un prince qui doit bientôt l'épouser. Elle le rencontre au clos Marie, pendant qu'elle lave son linge. Le prince se présente, l'explication n'est pas longue. Ce beau jeune homme est simplement Félicien, un ouvrier verrier, chargé de faire quelques réparations au vitrail de la cathédrale. Il aime Angélique. A cet aveu, la jeune fille lui répond avec candeur: «Parlez au plus tôt à mon père, à ma mère, les choses peuvent se faire rapidement. A demain, je vous adore». A quoi Félicien répond: «Ma chère âme, à toujours.» C'est rapide, vrai, peut-être, car, en fait d'ingénuité, je ne sais pas jusqu'où peuvent aller et s'arrêter les aveux.
Or, ce Félicien, qui n'est nullement un humble artisan, a pour père Mgr l'évêque Jean de Hautecœur, lequel était marié avant de se consacrer à Dieu. A la mort de sa jeune femme, son chagrin a été si profond que Jean est entré dans les ordres et que, pour préserver des douleurs de ce monde le fils que Dieu lui avait donné, il a résolu d'en faire un prêtre. Il vit auprès de lui au palais épiscopal. Malgré ses larmes, ses prières, Monseigneur se refuse au mariage de son fils et d'Angélique. L'enfant attend la réponse de Félicien. Le jour de la fête de Dieu, pendant qu'elle est à la fenêtre de l'atelier au premier étage, elle voit passer la procession au-devant de laquelle elle jette des fleurs; c'est le saint sacrement, c'est une confrérie et l'oriflamme d'or; c'est le chapitre! c'est Monseigneur sous le dais! à la suite de l'évêque, Félicien, le portrait frappant du prélat! le voilà accompli, le rêve. Le bien-aimé est le fils de Monseigneur!
Mais Félicien n'a rien obtenu de son père. Désespéré, il pénètre dans la chambre d'Angélique et la conjure, au nom de leur amour, de fuir avec lui. Mais les voix conseillères qui parlent à l'âme d'Angélique sauvent l'enfant de ce crime; elle reste attachée au devoir, malgré le refus cruel que l'évêque, qu'elle a été trouver jusque dans la salle du chapitre de la cathédrale, a opposé à sa demande. Angélique va mourir de douleur; un miracle peut la sauver. Ce miracle, Félicien le demande à son père. Jean V de Hautecœur rendait la vie aux mourants; il approchait ses lèvres de leurs lèvres et il disait: «Si Dieu veut, je veux.» Le prélat n'a qu'à dire comme son saint aïeul qui a laissé à sa famille cette noble devise. L'évêque s'y refuse. A quoi Félicien, fou de douleur, s'écrie: «Vous n'avez jamais aimé ma mère!» Le prélat descend, à ce reproche, dans le fond de son âme. Il lui semble qu'une voix appelle sur la créature humaine qui va mourir la pitié du prêtre: il part, il se met en marche avec son fils; il va vers la mourante; il la trouve revêtue d'une robe blanche; elle gît sur son lit virginal: il donne l'extrême-onction et, les prières achevées, il pose ses lèvres sur le front d'Angélique avec ces paroles: «Si Dieu le veut, je veux!» et l'enfant sauvée par le miracle ouvre ses lèvres et cherche Félicien du regard. C'est le mariage.
La pièce a évité le sombre épilogue du roman, dans lequel Angélique meurt le jour de son mariage sur le seuil même de l'église au premier baiser de Félicien.
Sur ce drame lyrique des plus touchants, et qui demandait un musicien tout entier à l'émotion dramatique, M. Bruneau a essayé un système. Plus d'air, plus de mélodie, plus de phrases musicales, un récitatif perpétuel; le procédé se prolonge pendant quatre actes et sept tableaux, c'est-à-dire durant quatre heures, sans repos, sans rémission, c'est raide. Que l'école d'aujourd'hui rejette toutes les théories du passé, je le veux bien; qu'elle ne dise pas comme ont dit les maîres d'autrefois, j'y consens; mais toujours faut-il qu'elle dise quelque chose. Va pour le récitatif continu, à la condition pourtant qu'il sera juste. Va pour la déclamation persistante, oui; mais pour la déclamation aux gestes, aux accents vrais, et, il faut le dire, je ne sais rien de plus cherché, contourné, tourmenté, que cette partition du Rêve. A peine trouvez-vous un mouvement sincère, une impression naturelle dans tous ces personnages; l'esprit du compositeur se met volontairement à la torture. Le musicien ajoute à ce supplice même une singulière combinaison: l'orchestre dément à chaque instant ce que dit le chanteur. C'est une lutte entre eux; on ne sait de quel côté aller. Il semble que M. Bruneau se plaise à ces contradictions; qu'il ait livré de parti pris la guerre à toutes les conventions! la patience se perd dans cette bataille contre ces habitudes reçues, et, avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de résister à la fatigue d'une telle soirée. J'ai beau rappeler à ma mémoire quelques détails charmants, je dirai même quelques pages d'un véritable compositeur, l'ensemble l'emporte dans son implacable système; j'ai vu des gens irrités au dernier degré Je ne suis pas de ceux-là; j'ai échappé à l'exaspération mais je n'ai pas évité l'ennui.
La pièce est montée avec un soin, avec un goût extrême. Elle est exécutée à merveille. Je ne saurais assez louer Mlle Simonne! qui a joué et chanté en perfection le rôle d'Angélique. Mme Deschamps-Jéhin prête sa belle voix de contralto au personnage effacé de Hubertine. M. Lorrain tient avec talent le rôle de Hubert. M. Engel a été chaleureusement applaudi dans Félicien. Quant à M. Bouvet, il a donné au personnage de l'évêque Jean une physionomie des plus imposantes à la fois et des plus sympathiques. Son succès a été très grand et très mérité.
Le Châtelet joue une pièce à grand spectacle qui a pour titre: Tout-Paris. Je ne vous la donne pas comme des plus ingénieuses par son sujet et par son intrigue, mais je vous la signale comme des plus amusantes par ses décors et par ses divertissements: avec sa scène du théâtre des Caprices-Parisiens, son cabaret du Chat-Noir, son bal du Moulin-Rouge, son rallye-paper. Mlle Gilberte, M. Germain et M. Peutat du Vaudeville enlèvent prestement ces cinq actes qui leur devront une bonne partie de leur succès.
M. Savigny.
LES LIVRES NOUVEAUX
Nouveaux pastels, dix portraits d'hommes, par Paul Bourget. 1 in-18, 3 fr. 50 (Lemerre).--Si fin pastelliste que soit M. Paul Bourget, il est parfaitement capable d'une très solide peinture, et, dans les dix portraits d'homme qu'il nous présente aujourd'hui, il en est quelques-uns, et dans tous les cas au moins un, dont la vigueur accuse quelque chose de mieux aux doigts du portraitiste qu'un simple crayon, fût-il de couleur. Nous voulons parler de ce farouche Monsieur Legrimaudet, ce naufragé de la destinée, énigme vivante que le peintre nous pose, mais qu'il a la cruauté de ne pas nous résoudre; Legrimaudet, ce type effroyable d'ingratitude, cet affamé qui n'a jamais dit merci à qui lui a donné du pain, mais qui emprunte un louis pour acheter un jouet à un enfant malade. Et ce portrait de moine gardien dans les montagnes de Pise d'un couvent sécularisé, un saint, comme il l'appelle, je ne vois rien d'un La Tour à cette figure-là. Donc, pastels, ou aquarelles, ou sépias, peintures à l'huile ou à la détrempe, comme on voudra, les Nouveaux pastels (hommes) sont à lire et ne sont point inférieurs à leurs aînés, Pastels (femmes) comme on sait.
Lirette, par Georges Beaume. 1 vol. in-12. 3 fr. 50(Dentu).--Une jeune fille mariée par ses parents à un bellâtre qu'elle n'aime pas et emportant dans le mariage le regret attendri d'un jeune homme qu'elle aime. Le mari, lâchement indigne, l'abandonne à son foyer pour aller jouer au cercle et courir après des créatures. La pauvre enfant se désole en silence, essayant de se reprendre à l'espoir d'une maternité prochaine, lorsqu'on lui annonce la mort de celui dont elle écartait de toutes ses forces le souvenir. Alors le vide se fait devant elle, elle ne sait plus si elle doit désirer vivre ou mourir... C'est, en de jeunes pages pleines de fraîcheur, un début plein de promesses.
Les Parisiens peints par un Chinois, par le général Tcheng-Ki-Tong. 1 volume in-12, 3 fr. 50 (Charpentier).--Ce pauvre général, qui était devenu si Parisien lui-même, se doutait-il, quand il écrivait ces pages, que c'était un adieu, un testament qu'il nous laissait? Pensait-il nous quitter si tôt, aller si tôt retrouver ce Céleste-Empire, si différent de notre République, où les têtes tiennent si peu sur les épaules des mandarins les plus considérables, qu'on a pu craindre un moment pour la solidité de la sienne? On se le demande, et l'on est tenté de trouver que ce Chinois occidentalisé manque à notre boulevard. Toujours est-il que nous lui devons bien de lire ce testament, dans lequel nous nous verrons à travers les yeux d'un homme jaune, ce qui est toujours amusant et fort instructif. Nous pourrons même compléter le portrait qu'il a fait de nous en ajoutant ce qu'il n'a pas osé dire, mais ce qu'il a dû certainement penser, à savoir que le Parisien est superlativement gobeur, et que, lorsqu'il s'entiche d'une personnalité quelconque, il n'y en a plus que pour elle.
Saracinesca, par Marion Crawford, 2 vol. in-12, 7 fr. (Sauvaitre, 72, boulevard Haussmann). A l'époque où l'auteur a placé son récit, c'est-à-dire en 1865, Rome est encore la Rome d'autrefois, la ville pontificale, la ville morte, éternel regret des artistes, que les Italiens et les politiques peuvent se vanter d'avoir fait sortir de ses cendres, mais qui a cessé d'être la ville éternelle depuis qu'elle est rentrée dans la vie. C'est aussi l'époque des luttes politiques entre les conservateurs et les libéraux, luttes ardentes quoique cachées, où les conspirations tiennent une grande place, où les partis se résument en deux hommes: le grand ministre Cavour et l'énigmatique cardinal Antonelli. Sans entrer dans le récit de ces événements politiques, l'auteur en a fait le fond de son tableau. Cette haute société romaine, si étrange et si curieuse à connaître, nous y apparaît fidèlement, on peut le croire, et à coup sûr spirituellement dépeinte, et la donnée dramatique du roman en fait une œuvre du plus vif intérêt.
De Paris au Soudan, par Émile Broussais, avec la carte d'Afrique indiquant les possessions et les zones d'influence de tous les États européens de Fr. Schrader. (Leroux, éditeur, 28, rue Bonaparte).--L'auteur, avocat à la Cour d'appel d'Alger, est de ceux qui ont foi dans l'avenir de la patrie française, dans le développement de notre colonisation africaine, et c'est à servir cette cause qu'il a consacré son livre. Rapprocher le plus possible de Paris le centre de l'Afrique, voilà le but; mettre le Soudan à six jours de Paris, voilà le résultat auquel il est possible d'arriver. C'est une idée depuis longtemps poursuivie, qui a déjà coûté la vie à bien des victimes: les Flatters, les Joubert, les Palat, d'autres encore, auront marqué de leur sang cette route brillante de l'avenir. M. Émile Broussais, qui a la connaissance parfaite du pays et de ses intérêts, étudie avec soin la question qui n'est pas, comme on pense bien, de mettre Tombouctou à proximité du boulevard des Italiens, mais d'étendre sur l'Afrique la souveraineté politique, commerciale et industrielle de la France. Ceux qui s'y intéressent comme lui liront avec fruit son ouvrage si complet et si documenté.
Une fois l'an, la librairie Dentu publie un volume collectif dans lequel chaque membre du Comité de la Société des gens de lettres fournit sa quote-part; le produit de ce volume appartient à la Caisse des retraites de la Société.
C'est ainsi qu'on a vu paraître en 1879: Les Contes de toutes les couleurs; en 1880: En petit Comité; en 1881: Chacun la sienne; en 1882: Entre amis; en 1883: la Ronde des Conteurs; en 1884: l'Enfant de 36 pères; en 1885: Comme chez Nicolet; en 1886: 47, Chaussée d'Antin; en 1887: Pique-Nique; en 1888: Nos cinquante ans; en 1889: Dans le même train; en 1890: les Compagnons de la plume. Cette année, le recueil se nomme: Coude à coude.
La variété des tempéraments fournit la variété des genres dans ce livre toujours intéressant, parfois remarquable. Tous les sujets s'y confondent, depuis la nouvelle jusqu'au conte, en passant par le récit, l'anecdote, le poème, le monologue, les mémoires, voire même l'archéologie. Le grave et le doux, le plaisant et le sévère se coudoient habilement pour former un ensemble agréable à l'esprit, plaisant à l'œil.
Quant aux noms des auteurs, tous connus, tous aimés du public, voici leurs noms par lettre alphabétique.
Philibert Audebrand, George Bastard, Élie Berthet, Fortuné du Boisgobey, Paul Bonhomme, Borel d'Hauterive, Édouard Cadol, Théodore Cahu, Charles Chincholle, Albert Cim, Jules Claretie, Louis Collas, Henri Demesse, Charles Diguet, Paul Eudel, Gourdon de Genouillac, Charles Gueulette, Ernest Hamel, Fernand Hue, Arsène Houssaye, Léonce de Larmandie, Camille Le Senne, Hector Malot, Jules Mary, Édouard Montagne, Charles de Mouy, Joseph Noulens, Émile Richebourg, Armand Silvestre, Jules Simon, Édouard Thierry, Gustave Toulouze, Charles Valois.
Bébé-rose, par André Godard. (3 fr. 50. Ollendorff, éditeur.)--Les récents débats législatifs relatifs à la réglementation des courses et du pari-mutuel ajoutent un intérêt d'actualité à cette étude de mœurs sportives à la fois amusante et passionnée, et que tout le monde peut lire. Le héros, Remo van Derben, surnommé Bébé-rose, est un aimable insouciant, voilé d'une nuance de mélancolie. Il vivrait du jeu volontiers, et dans les courses prévoit une combinaison de fortune. Que de Bébé-rose en ce temps-ci! Remo s'éprend d'une jeune fille sur une plage à la mode, et lance le père, un curieux type de magistrat-homme de lettres, dans une vaste agence sportive, le Paris-Libre; la seconde partie du roman nous fait assister à la lamentable odyssée de la famille dans tous les milieux parisiens et à la catastrophe finale de l'agence sur l'hippodrome de Saint-Ouen. C'est très observé, très actuel et très honnête.
Dette de haine, par Georges Ohnet. (1 vol. chez Ollendorff, 28 bis, rue Richelieu. Prix: 3 fr. 50.)--Nous ne voulons que mentionner aujourd'hui l'apparition de ce nouveau roman de Georges Ohnet, sur lequel nous reviendrons prochainement et dont le succès s'est dessiné dès le premier jour.
Les pièces de Molière. La librairie des bibliophiles vient de faire paraître le Mariage forcé (5 fr.). C'est la dixième. Notice et notes de M. Auguste Vitu; dessins de Louis Leloir, gravés à l'eau-forte par Champollion.
De New-York à Brest en 7 heures, par André Laurie. Un vol. in-18, 3 fr. 50. (Hetzel).--Roman d'aventures, que les jeunes gens et les jeunes filles peuvent lire, ce qui est toujours à noter. Cette traversée de l'Atlantique en moins d'une demi-journée ne s'opère, on le pense bien, ni en ballon, ni en bateau. Le procédé imaginé par l'auteur est beaucoup plus ingénieux, mais nous n'aurons garde de le dévoiler.
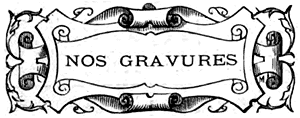
LES COMPAGNIES DE DEBARQUEMENT
Les réservistes de la marine ont été appelés lundi dernier dans les ports de Brest, Cherbourg et Toulon, et vont être embarqués pour une période d'exercices qui durera jusqu'au 15 juillet.
Pour la première fois, ils vont faire leur service à la mer; jusqu'à présent, on se contentait de les caserner dans les ports et de leur faire faire à terre des exercices purement militaires.
Nous croyons que le ministre a été bien inspiré en prenant une mesure qui retrempe les réservistes de la marine, soit dit sans vouloir faire un jeu de mots facile, dans un métier pour lequel un entraînement continu est si nécessaire.
Nos matelots eux-mêmes préféreront certainement les exercices de leur profession à ceux du métier militaire pour lequel ils professent une aversion, plus simulée d'ailleurs que véritable.
Ils aiment en effet, par dessus tout, les manœuvres de débarquement dans lesquelles ils jouent un rôle tout à fait militaire.
Dans tout navire de guerre, une certaine quantité d'hommes, pouvant aller jusqu'au tiers de l'équipage, est embrigadée, pour faire partie de la «Compagnie de débarquement». Cette Compagnie se fractionne par pelotons, sections ou escouades en groupant les hommes par bordées, divisions et sections, et chacun de ces groupes se compose d'hommes se connaissant, habitués à manœuvrer ensemble et appartenant à diverses spécialités, manœuvre, timonerie, etc., afin de pouvoir se suffire en cas d'isolement.
Nous ne décrirons pas les diverses opérations parfaitement réglementées, qui régissent la mise en terre d'une compagnie de débarquement. Cette manœuvre s'effectue avec la rapidité et l'entrain familiers à notre marine; les marins y trouvent d'ailleurs une diversité fort agréable à la monotonie du service à bord. Ces grands enfants y prennent un plaisir de collégiens en promenade. Quant à la façon dont ils se comportent dans ces «promenades» et dont ils y soutiennent l'honneur du pavillon, les plages de Tunisie, du Tonkin, de Madagascar, en ont gardé le souvenir.
LA FÊTE DE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS.
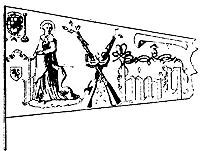
Bannière de Jeanne Hachette.
Tous les ans, fin juin, la vieille capitale du Beauvaisis célèbre solennellement la fête commémorative du siège quelle soutint en 1472 contre Charles-le-Téméraire, et où s'illustra, en tête des femmes de la ville, celle que l'histoire a immortalisée sous le nom de Jeanne Hachette. Cette fête remonte à l'année même du siège, car dès 1472, Louis XI, pour récompenser Beauvais de son héroïsme, rendit à ses habitants leurs anciens privilèges et institua une procession annuelle.
Depuis 1851, date de l'inauguration de la statue de Jeanne Hachette à Beauvais, la procession a fait place au cortège de l'assaut, et, à la suite de dissentiments entre la municipalité et le clergé, ce dernier n'assiste plus à la cérémonie.
Cette fête n'en a pas moins conservé un caractère des plus imposants, et aussi des plus curieux. Elle a lieu sur la grande place de l'Hôtel-de-Ville, où se dresse la statue de l'héroïne.
Les troupes font la haie autour de la place et maintiennent la foule qui se presse, avide de voir. De l'Hôtel-de-Ville sort une théorie de jeunes filles escortant l'étendard des Bourguignons porté par la rosière de l'année, et qui viennent occuper la place d'honneur devant la statue; puis suivent les autorités civiles et militaires par ordre de préséance.
Des gymnastes grimpent sur le monument et y accrochent leurs couronnes.
Alors, suivant l'antique usage, des salves d'artillerie sont tirées par les jeunes filles qu'accompagne galamment un aimable fonctionnaire ou un délégué de corporations. Les descendantes des héroïnes de 1472 ne tremblent pas et mettent crânement le feu aux poudres.
L'étendard de Jeanne Hachette, en très mauvais état, est exposé dans une vitrine à l'Hôtel-de-Ville; c'est seulement le fac-similé qui est porté par les jeunes filles.
Quant à la statue de l'héroïne, elle fut inaugurée le 6 juillet 1851.
Le monument en bronze est l'œuvre de M. Dubray-Vital. Jeanne est représentée dans une fière attitude, le pied sur l'échelle, tenant de la main droite la hache dont elle vient de frapper son ennemi roulant dans le fossé, et qu'elle semble suivre du regard; de la main gauche elle arrache le drapeau brisé.
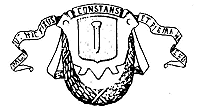
Les armes de la ville, qui sont armes parlantes, ont subi quelques transformations à travers les siècles; elles sont aujourd'hui De gueule, au pieu posé en pat d'argent avec la devise: Palus ut hic fixus, constans et firma manebo.
Éridan.
LA STATUE DE HOUDON
La ville de Versailles, sur l'initiative de l'association artistique et littéraire, rend à Jean Houdon l'hommage qui lui est dû.
L'auteur de Saint-Bruno, de l'Écorchée, de la Diane, conservée avec un soin jaloux au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, des statues de Voltaire et de Washington, des bustes de d'Alembert, de Diderot, de Mirabeau et de tous les grands hommes de son époque, attendait depuis longtemps la consécration du marbre.
Cette consécration va lui être donnée; M. Tony Noël, l'éminent statuaire qui a obtenu l'une des grandes médailles d'honneur de l'Exposition de 1889, a su rendre dans un style élevé la figure à la fois si fine et si noble du plus grand sculpteur du dix-huitième siècle.
Le piédestal, de l'architecte Paul Favier, inspecteur des bâtiments civils, est le complément de ce monument; très léger dans son ensemble harmonieux dans ses lignes, sa simplicité élégante fait admirablement ressortir l'œuvre de Noël sans l'écraser.
LE «JEAN-BART»
Ce croiseur de 1re classe appartient à un type absolument nouveau; commencé le 6 juin 1888, dans les chantiers de l'État, à Rochefort, il a été lancé le 21 octobre 1889. Il termine actuellement son armement sous les ordres du commandant Servan, capitaine de vaisseau, et doit très prochainement commencer ses essais.
Le Jean-Bart est construit en acier et déplace 4,100 tonneaux. Sa machine, construite dans les ateliers de l'État à Indret, est de 2,000 chevaux nominaux, soit 8,000 effectifs, et doit imprimer au navire une vitesse de 19 1/2 nœuds, soit un peu plus de 35 kilomètres à l'heure.
L'équipage se compose de 331 hommes, dont 16 officiers.
L'armement comprend: 4 canons de 16 centimètres; 6 de 14 centimètres; 8 à tir rapide sur les hunes et sur le pont; 8 revolvers sur le pont léger et 2 petites pièces de montagne pour la compagnie de débarquement; 5 tubes lance-torpille, soit 2 sur l'avant, 2 sur l'arrière et 1 de chaque bord; 6 projecteurs électriques; 11 embarcations, dont 1 chaloupe à vapeur et un torpilleur-vedette.
Le Jean-Bart mesure 105 m. 10 de long sur 13 m. 28 de large; son tirant d'eau arrière est de 6 m. 14. Ses plans sont de M. Thibaudier, ingénieur de 1re classe.
LA CHASSE AUX BANDEROLES
Depuis une vingtaine d'années les treillages et murs qui enclosent la forêt de Fontainebleau ne sont plus guère entretenus, et il en résulte que cerfs et biches quittent, le soir leurs demeures, et profitent des brèches pour se rendre au gagnage.
Les propriétaires riverains, se trouvant lésés par les dégâts occasionnés sur leurs territoires, ont adressé au Préfet de Seine-et-Marne des réclamations à la suite desquelles les cerfs et les biches ont été reconnus animaux nuisibles, et les propriétaires autorisés en tout temps et par tous les moyens possibles à les détruire.
Actuellement le mode de chasse ou de destruction le plus usité, et aussi le plus meurtrier, est celui que représente notre gravure et qu'on appelle le «Fermé de Banderoles». Il est, destiné à empêcher les animaux venus en plaine pour y chercher leur nourriture, de rentrer en forêt ainsi qu'ils le font tous les matins au petit jour.
C'est vers le milieu de la nuit qu'on opère. On commence par tendre une ligne de banderoles en bordure de la partie de forêt par laquelle les animaux sont sortis. Puis de chaque extrémité de cette ligne on en tend une nouvelle. Ces deux dernières lignes doivent se rejoindre de façon à enfermer complètement la portion du territoire où se trouvent les animaux.
Au petit jour commencera la battue. Les animaux poussés par les rabatteurs n'approcheront la ligne de banderoles que d'une vingtaine de mètres au plus; c'est-à-dire à bonne portée des chasseurs. Quelque fois cependant, les animaux franchissent cette ligne, et la chasse devient alors un véritable massacre.
Et ici une réflexion s'impose: s'il reste encore dans le centre quelques forêts assez fournies en gros gibier, au lieu de le détruire, ne serait-il pas préférable de panneauter tous les ans 10, 20 ou 50 de ces animaux pour les envoyer repeupler certaines forêts du midi ou ils manquent totalement?
Rodolphe Bodmer.
M. RIGAUD
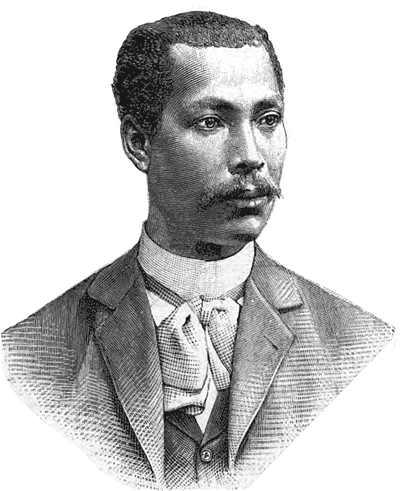
M. ERNEST RIGAUD Fusillé à Port-au-Prince,
par ordre du général Hippolyte.--Phot. Monrgeon.
Le lecteur trouvera dans l'Histoire de la semaine des détails sur les exécutions sommaires ordonnées à Haïti par le général Hippolyte, et au cours desquelles M. Rigaud a été fusillé.
Voici à cet égard un complément d'informations.
C'est le 28 mai, jour de la Fête-Dieu à Port-au-Prince, que ces événements ont eu lieu.
Pendant que le président. Hippolyte était à la messe, une bande d'émeutiers conduits par le général Sully Guerrier se dirigeait vers la prison, massacrait le geôlier et les soldats de la garde, et mettait en liberté les prisonniers qui s'y trouvaient.
Instruit de ces faits, le général Hippolyte envoyait contre les émeutiers quinze cents hommes de troupes fidèles qui se saisirent d'eux et les fusillèrent.
Parmi ces émeutiers, on crut reconnaître. M. Rigaud, épicier, qui put d'abord s'enfuir, mais qui fut arrêté quelques instants après et passé immédiatement par les armes.
Au dire du général, M. Rigaud ne serait nullement Français, ni même protégé français, comme on se plaît à le dire. C'était un noir sans aucun mélange de sang blanc, dont le grand-père, après s'être allié avec le général Leclerc, lors de l'expédition française du commencement du siècle, se mit à la tête d'une émeute en 1810. Le père de Rigaud a été ministre il y a une trentaine d'années. Rigaud est donc Haïtien de naissance et de famille.
Lors de l'assassinat du général Télémaque il y a deux ans, Rigaud prit parti pour le général Légitime, mais, quand il vit que les affaires tournaient mal, il prit peur et se fit inscrire comme protégé français. Il n'en continuait pas moins à s'occuper de politique et à être en quelque sorte un chef d'opposition au gouvernement établi. Pour en finir avec lui, le général Hippolyte demanda officiellement au gouvernement français sa radiation de la liste des protégés. Il crut la radiation effectuée et c'est ainsi qu'il a fait fusiller Rigaud qu'il considérait comme un Haïtien rebelle au gouvernement légalement établi.
BARCAROLLE
La Barcarolle que nous publions dans ce numéro-ci a été composée spécialement pour l'Illustration par un compositeur qui fut tout simplement un enfant prodige. Qu'on en juge. Césare Galeotti, né en 1822, à Pietrasanta, commença des tournées artistiques à l'âge de sept ans. A dix ans et demi il entrait au Conservatoire, obtenait à treize ans le premier prix de piano; à quinze ans, le premier prix d'orgue et d'improvisation; à dix-sept ans, le premier prix d'accompagnement, et à dix-huit le premier prix de contre-point et de fugue. Le jeune compositeur compte à ce jour trente morceaux d'édités chez Lemoine. La nouvelle page que nous publions ne pourra que confirmer sa légitime renommée.

CHARGE D'AME
Roman nouveau, par Mme JEANNE MAIRET
Illustrations d'ADRIEN MOREAU
Suite.--Voir nos numéros depuis le 13 Juin 1891.
Pendant que la jeunesse se promenait au jardin, les deux matrones devisaient au salon. Mme d'Ancel, tranquillisée par un dernier tour à la cuisine et à la salle à manger, était maintenant prête à recevoir ses invités. Elle s'entendait fort bien avec Mme Despois, et cependant il eût été difficile de voir deux personnes se ressemblant moins. La baronne était une contemplative, restée fort jeune de cœur, conservée pour ainsi dire par l'isolement. Elle avait arrêté sa montre au moment où son mari l'avait laissée seule; elle ne songeait plus à la remonter; elle ne vivait plus que dans le passé; son amour maternel, très vif et très tendre, n'avait même pas suffi à la remettre dans le courant du siècle.
Sa voisine, au contraire, résignée de bonne heure à ne pas connaître de bonheur parfait, s'était fait une philosophie à hauteur d'appui. Elle prétendait que les petites satisfactions de la vie, habilement cultivées, font un semblant de bonheur très acceptable, en somme; que réveiller des chagrins qui dorment est une sottise et que, rire étant le propre de l'homme, bien fol qui s'en prive, d'autant plus que le rire, selon elle, comprenait une foule de choses agréables, comme de bien manger, de s'entourer de luxe, de causer avec des gens d'esprit lorsque l'on a la chance d'en rencontrer, et, à défaut de gens d'esprit, savoir se contenter de personnes agréables et de bonne éducation. C'était dans cette dernière catégorie qu'elle rangeait Mme d'Ancel.
--Il me semble que votre fils s'humanise. Le voilà qui rit comme s'il n'avait jamais mis le nez dans les archives poudreuses des affaires étrangères.
--Dieu merci! vous vous souvenez, chère amie, que j'ai toujours prédit que Robert rajeunirait avec les années. Il était trop sérieux à vingt ans; ce n'était pas naturel. Et puis...
Mme d'Ancel grillait de raconter à la tante Rélie toutes ses espérances. Elle n'en ferait rien puisqu'elle avait promis le silence à Marthe, mais si Mme Despois voulait seulement deviner!... Il lui semblait, à elle, que la nouvelle attitude de Robert était cependant assez significative.
--Et puis, interrompit Mme Despois, il n'y a rien de tel que deux beaux yeux pour dissiper les brouillards de l'étude. Voyons, mon amie, ne prenez donc pas cet air effarouché. Vous savez bien, comme moi, que c'est depuis l'arrivée d'Edmée que Robert s'est détendu. S'il ne sait pas encore qu'il en est amoureux, je le sais, moi.
--Vous vous trompez, vous vous trompez, je vous assure, s'écria Mme d'Ancel suffoquée.
--Ta, ta, ta! Je ne me trompe que bien rarement en ces sortes de matières. Depuis que je ne suis plus que spectatrice, je tiens ma lorgnette bien nette, je regarde et je m'amuse énormément. Après tout, ma bonne amie, vous désiriez Mlle Levasseur comme belle-fille, de quoi vous plaignez-vous? Celle-ci est gentille. Je ne l'aime guère, mais enfin, je suis obligée de convenir qu'elle est gentille.
--Et, ajouta son amie qui commençait à se remettre de la secousse, vous seriez enchantée de vous en débarrasser en la mariant au plus vite.
--Dame, oui! Elle dérange mes habitudes, cette petite. Puis, tout, en ne l'aimant pas, j'ai peur d'être forcée de subir son charme. Je me raidis; il n'y a rien de fatigant comme cela.
--Alors, vous-même, dit la baronne dont l'égoïsme maternel se réveilla, qui, en un instant, envisagea la possibilité que son fils préférât la cadette à l'aînée--après tout, il n'y avait pas d'engagement pris--vous-même vous convenez du charme de cette petite?
--Si j'en conviens! Mais, en l'étudiant, j'en arrive à excuser presque mon beau-frère. La vieille légende des sirènes se continue à travers les siècles et se continuera jusqu'à la fin des temps. Edmée est l'image de sa mère, à l'exception des yeux qui lui viennent de son père. J'allais en cachette voir jouer la mère, une actrice comme on n'en voit plus: un naturel, un charme, une diction... enfin tout, elle avait tout pour elle, cette créature, excepté le cœur. Je retrouve dans la fille les mêmes intonations de voix, le même sourire qui illumine soudain le visage comme un rayon de soleil passant à travers un nuage. Regardez-la lorsqu'elle s'assied; nous prenons une chaise pour nous reposer tout bonnement, nos jupes s'en accommodent comme elles peuvent: la robe d'Edmée s'étale en plis harmonieux; quand elle cause, ses gestes sont arrondis, jamais d'angles, et cela tout naturellement. Écoutez-la parler: jamais elle ne bredouille, chaque syllabe a sa valeur, le son de sa voix est modulé avec un art tout à fait inconscient chez elle; du reste, l'élocution lui a été inculquée sans qu'elle s'en doutât, elle n'a eu qu'à écouter sa mère.
--Mais, objecta son amie, vous avez dit que sa mère avait tout pour elle, excepté le cœur. Est-ce qu'en cela aussi Edmée lui ressemble?
--Je me le demande tous les jours. Je n'en sais rien encore. Il est possible qu'elle en ait tout de même un peu. A la voir avec Marthe, on le jurerait. Il n'y a pas de câlineries, de caresses, de gentillesses, qu'elle ne prodigue à sa sœur; elle la suit partout, comme un enfant, elle cherche à l'aider dans l'administration de la maison, ce qui embrouille tout, cela va sans dire, elle court chez nos deux fermiers pour donner des ordres, oublie ceux-ci et s'attarde à jouer avec les poussins ou les chiens, parce que Marthe aussi aime les chiens et les poussins. Elle est toujours gaie, trouve tout admirable, s'extasie sur la vue, barbotte avec bonheur dans l'eau, marche, court, se donne un mouvement extraordinaire et entraîne sa sœur même lorsqu'elle a l'air de la suivre. Mais le joujou est tout neuf. La campagne au mois de juillet avec ses routes bruyantes, des baigneurs partout, les châteaux pleins de monde, c'est très bien. Je l'attends au mois de novembre où elle sera réduite à notre société uniquement.
--La jeunesse sait se faire de la joie partout et toujours, murmura Mme d'Ancel pleine d'indulgence. En tout cas, il est clair que Marthe aime sa sœur, et qu'elle fera tout ce que voudra celle-ci.
--Si elle l'entraîne à Paris un mois ou deux plus tôt que d'habitude, je ne me plaindrai pas, pour ma part. Marthe, cependant, n'est pas faible; si elle croit devoir résister à un caprice de l'enfant, elle résistera, soyez-en sûre. Alors, nous verrons. Edmée me fait penser aux jolies soies souples et douces de ma broderie; ça s'enfile aisément, ça caresse les doigts, on en fait ce que l'on veut; puis, tout d'un coup, sans qu'on sache comment, il se forme un petit nœud imperceptible et la jolie soie souple vous casse l'aiguille net. Il ne s'est pas encore produit de nœud. Il n'est pas dit qu'il ne s'en produise pas.
Le nœud se produisit avant la fin de la soirée.
Le dîner fut des plus gais. Une vingtaine d'invités, tous désireux de s'amuser, jeunes pour la plupart, firent honneur aux nombreux plats; la table était décorée des plus jolies roses du jardin, et les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer l'air très doux de cette belle soirée d'été. Edmée oubliait un peu ses bonnes résolutions. De toute la jeunesse assemblée autour de la table, elle se sentait la reine incontestée; elle se savait de beaucoup la plus jolie de toutes les femmes, la plus admirée, la plus entourée, et la joie de son triomphe débordait un peu dans le son de son rire, dans l'éclat de ses yeux. Elle se trouvait avoir pour voisin le capitaine Bertrand, et elle s'amusait à lui tourner complètement la tête. Robert, comme maître de maison, était placé entre deux femmes d'âge respectable, et jetait des regards envieux au coin où Edmée mettait tout l'entrain de sa verve parisienne. Celle-ci avait pleinement conscience de ces regards et redoublait de coquetterie. Marthe, de l'autre bout de la table, ne pouvait rien pour modérer l'allure un peu tapageuse de sa sœur; et du reste, comme tout le monde était un peu en joie ce soir-là, qu'on était à la campagne, entre voisins, il n'y avait pas trop à se formaliser de quelques rires perlés. Puis, elle était si jolie, sa petite Edmée, si jolie et si admirée! L'idée qu'elle eût pu un instant songer à être jalouse de cette nouvelle venue qui l'éclipsait si complètement ne traversa même pas son esprit. Elle était, au contraire, extrêmement fière de la beauté et du succès de sa petite sœur.
Après le dîner on alla prendre le café au jardin, chose rare au bord de la mer, et Marthe passa son bras autour de la taille d'Edmée. Les jeunes gens, les jeunes filles, formaient un groupe bruyant et gai; la lune ce soir-là avait un éclat extraordinaire, on se voyait presque comme en plein jour, et la sœur aînée remarqua les joues un peu rouges, les yeux trop brillants de la cadette.
Tu as bien chaud, Edmée, mets donc cette dentelle autour de ton cou. Savez-vous bien, mademoiselle, que vous faisiez beaucoup de bruit dans votre coin? Et cette sagesse exemplaire, qu'en avons-nous fait?
--Je te l'ai passée, Marthe, toi ça ne te gêne jamais; moi, au bout d'une heure, je ne sais qu'en faire. Ah! laisse-moi être un peu folle, c'est si bon la folie et on n'a dix-huit ans que pendant douze mois, hélas!... Si tu savais, nous avons fait mille projets, n'est-ce pas, capitaine? Ah! nous allons bien nous amuser.
--Et quels sont ces projets? demanda Marthe, souriante et indulgente.
--Est-ce que j'en serai? fit à son tour Robert, attiré par les deux sœurs, n'osant se demander s'il l'était plus par l'une que par l'autre.
--Je le crois bien, et le capitaine, et ces messieurs, tous. Songez, nous serons huit jeunes filles, il nous faut des cavaliers. D'abord, lundi, nous irons déjeuner à la Fontaine de Virginie, n'est-ce pas, Marthe?
--Très volontiers, ma mignonne.
--Puis, nous voulons jouer la comédie, c'est si amusant la comédie de société, à la campagne surtout, et tu sais le grand salon, avec le petit boudoir du fond, c'est fait exprès. Le capitaine joue très bien, et moi...
Edmée s'arrêta net. Sa sœur avait retiré son bras, et elle semblait très blanche sous la lumière de la lune.
--Pas cela, Edmée, pas cela, dit-elle d'une voix changée.
--Pourquoi? demanda la jeune fille avec passion, C'était la première fois qu'un de ses caprices se trouvait contrarié, et son joli visage en était tout bouleversé.
--La comédie de salon est une chose amusante sans doute pour les acteurs de rencontre, pour les actrices surtout; très ennuyeuse pour les autres, je t'assure.
--Puisque nous serons tous acteurs, tous les jeunes du moins. Les autres, ça ne compte pas.
--Chez moi, Edmée, les autres comptent, au contraire. Nous ne jouerons pas la comédie.
Ce fut dit d'un petit ton qui n'admettait pas de réplique. Chacun devinait que Marthe ne disait pas la raison véritable de son antipathie pour les choses de théâtre; Edmée comme les autres. Elle releva fièrement sa jolie tête, à l'expression devenue subitement dure, et dit négligemment:
--Comme tu voudras, naturellement! Monsieur d'Ancel, donnez-moi le bras, voulez-vous? Je voudrais admirer la vue du haut de la terrasse, on peut monter, n'est-ce pas? Venez donc, mesdemoiselles, je suis sûre qu'avec ce clair de lune la mer au loin doit être une merveille!
Marthe ne suivit pas les autres invités. Quelque chose dans la façon dont Edmée avait pris le bras de Robert l'avait subitement frappée.
Elle alla s'asseoir près de Mme d'Ancel. Celle-ci lui prit affectueusement la main. Au fond, elle lui demandait pardon, comme d'une infidélité, de sa conversation avec la tante Rélie.
--Vous n'êtes pas souffrante, Marthe? Voulez-vous que nous rentrions?
--Oh! non, on est bien ici.
--Alors?
--Alors, je suis un peu triste, voilà tout. Ne faites pas attention. C'est une bizarrerie de ma nature qui me fait songer à des choses pas très gaies lorsque, autour de moi, on rit un peu trop. Que voulez-vous, je n'ai plus dix-huit ans, moi. Comme dit Edmée, on n'a dix-huit ans que pendant douze mois. Les ai-je jamais eus? Je crains bien que non.
--Vous les aurez un peu tard, voilà tout. Comme Robert, vous rajeunirez à mesure que le temps passera.
--Peut-être! murmura la jeune fille. En effet, ce soir Robert est très jeune...
Et elle se mit à rêver un peu tristement.
VI
Pour aller à la «Fontaine de Virginie», on quitte la grand'route de Villerville pour monter assez rapidement entre des murs de vastes propriétés. A travers des grilles on aperçoit des jardins bien tenus, à faire honte à la sauvagerie qu'aimait tant Marthe Levasseur, des châteaux et des villas tout flambants neufs, de grasses fermes aussi, à l'air reposé et prospère. Puis, à mi-côte, il faut prendre un chemin de traverse où les voitures ne s'aventurent guère. Ici, de temps à autre, par-dessus des toits de fermes ou des prairies où paissent les troupeaux, on aperçoit la pleine mer toute gaie sous le soleil d'été, traversée de grandes ombres d'un bleu noir projetées par les nuages vagabonds. C'est un sentier très solitaire, très silencieux, où l'aboiement d'un chien de garde prend des sonorités étranges. A mesure que l'on avance, le bois devient plus sauvage, le taillis plus épais, on ne voit plus la mer, on n'entend plus rien que le vol subit d'un oiseau effarouché, et le bruissement des feuilles sous la douce brise d'été. Alors tout d'un coup le taillis cesse, et des arbres immenses, des hêtres centenaires, de toute beauté, s'élancent en pleine liberté. On traverse un ponceau jeté sur le ruisseau formé par la source, et l'on se trouve dans une clairière ombragée par d'autres hêtres aux troncs énormes, et environnée de toutes parts par la forêt. Au beau milieu, presque au pied du plus vénérable des arbres, jaillit une source d'eau vive et abondante qui, avant de se faire ruisseau, se répand en une nappe claire et cristalline, un étang tout mignon, tout coquet. On ne saurait voir un coin de terre plus adorable, plus fait pour y être heureux, amoureux, un peu fou aussi; c'est le domaine de la reine Mab, de Titania et d'Obéron.
Marthe, pour faire plaisir à sa jeune sœur, avait, en cet endroit délicieux, organisé un véritable pique-nique. Il n'avait plus été question de comédie de salon, et, pour faire oublier cette légère contrariété, Marthe avait redoublé de tendresse et de gentillesse. Certes, Edmée ne boudait pas, c'eût été trop dire; mais, de temps à autre, un léger nuage qui passait sur son jeune visage, un petit silence, un soupir à peine sensible, marquaient que cette jeune personne songeait à des choses dont elle ne pouvait parler. Pour la première fois, un de ses caprices n'avait pas fait loi; elle en était étonnée, froissée aussi; mais elle pardonnait cependant. Marthe était très bonne, elle faisait de son mieux; on ne pouvait s'attendre à ce qu'elle se mît tout à fait au-dessus des préjugés bourgeois de sa caste. Edmée, au contraire, dans le monde de sa mère, avait été élevée à regarder de haut tout les «préjugés bourgeois», et comme, dans cette petite tête, les idées étaient encore mal débrouillées, elle mettait sous cette rubrique plus de choses peut-être qu'il n'eût fallu. Elle se sentait pour certaines libertés, ou d'allures ou de conduite, des indulgences excessives qui parfois faisaient ouvrir de grands yeux à la tante Rélie. Devant Marthe, Edmée, d'instinct, laissait peu voir son imparfaite science du monde; elle sentait que son aînée était bien plus réellement «jeune fille», au sens propre du mot, qu'elle ne l'était elle-même.
La plupart des invités de Mme d'Ancel se retrouvaient au pique-nique. Plusieurs jeunes filles avec leurs mères, entre autres deux Américaines très gaies, un peu folles, installées dans un vieux manoir presque au pied de la Côte-Boisée et qu'Edmée avait prises en amitié; un certain nombre de jeunes gens, trop jeunes pour la plupart, comme cela arrive souvent à la campagne, tout ce petit monde formait un groupe très agréable à voir. Les claires toilettes des femmes se détachaient en notes vives et gaies sur le fond sombre du feuillage.
Le boute-entrain de la société était le capitaine Bertrand, arrivé au galop de Trouville. Son cheval, blanc d'écume, mené à fond de train, s'était effaré au moment de traverser le petit pont; le capitaine, voyant que tous, toutes surtout, le regardaient, avait forcé sa bête, qui se cabrait, à revenir sur ses pas, à traverser et retraverser le ponceau de bois, dont le son lui faisait peur, et cela à coups de cravache si impitoyablement administrés que le cheval, les yeux injectés de sang, tremblait visiblement.
--Je vous en prie, capitaine, épargnez cette pauvre bête, lui cria enfin Marthe indignée, croyez que ce spectacle est peu agréable, et vous nous avez assez prouvé que vous êtes bon cavalier.
--A vos ordres, mademoiselle, mais si vous étiez chargée de conduire un régiment ou de dresser un cheval, je vous assure qu'il faudrait un peu endurcir votre trop bon cœur.
--Je sais pourtant me faire obéir à l'occasion, croyez-le.
--J'en suis la preuve, fit le beau capitaine en s'inclinant avec une ironie souriante.
Et tout de suite il offrit ses services, se rendant utile, très gai, très remuant, un peu envahissant même. Edmée le regardait faire avec une satisfaction évidente. Ce jour-là, l'équilibre que, savamment, elle maintenait entre ses divers admirateurs--et tous les jeunes gens qu'elle voyait, elle les rangeait naturellement dans cette catégorie--se trouva un peu dérangé en faveur du jeune officier.
Celui-ci, du reste, ne cherchait nullement à cacher son admiration; il la dévorait des yeux hardiment, presque brutalement. Elle avait mis un léger costume de batiste bleu tendre, très simple, mais qui allait à merveille à sa beauté blonde. Elle prenait des petites mines impayables de ménagère, retroussant ses manches jusqu'au coude, relevant sa jupe de façon à laisser voir les plus jolis petits pieds du monde. Tandis que les autres jeunes filles ouvraient d'énormes paniers apportés par avance--on n'avait pas voulu de domestiques pour servir le déjeuner--Edmée se chargeait de remplir les carafes à la source. Le capitaine devait les remporter une fois remplies, mais elle tenait à y faire entrer elle-même l'eau pure, si fraîche que le cristal était tout de suite couvert d'une légère buée. Quelques pierres jetées au bon endroit facilitaient l'approche; mais il fallait alors se baisser et ne pas trop mouiller le bas de la jolie robe. Comment ne pas accepter la main solide qu'on lui offrait, ne pas permettre qu'on la soutînt? En bonne foi, il n'y avait pas moyen. Et qu'elle était donc jolie ainsi, toute à sa besogne, à demi agenouillée, l'air sérieux, tenant de la main droite sa carafe, tandis que l'autre s'abandonnait en toute confiance à la main du capitaine. Celui-ci se pencha aussi, et, dans l'eau limpide, leurs deux images un instant se confondirent. La voix du jeune homme frémissait en disant presque bas:
--Voyez, mademoiselle Edmée, la source nous marie, c'est la divinité du lieu, et la volonté des dieux est sacrée.
--Ce n'est que de l'eau, dit en riant Edmée, nullement scandalisée, et les poètes disent que l'onde est perfide.
--Laissez-moi vous dire que je vous adore; vous me rendez fou, et cela depuis le jour où je vous ai vue pour la première fois...
--En chemin de fer, interrompit Edmée, vous savez, les sifflets, les «cinq minutes d'arrêt», la fumée qui salit et sent mauvais--tout cela n'est guère poétique.
--Moqueuse! Je vous le dirai pourtant, je vous le répéterai tant, ce «je vous adore», que vous finirez par le croire.
--Mais je le crois.
--Ah! et cela vous fâche?
--Nullement. Cela m'amuse.
Le capitaine fit un mouvement brusque qui faillit compromettre l'équilibre de la jeune fille, et, à cet équilibre-là, Edmée tenait beaucoup plus qu'à l'autre.
--Ah! mais... prenez garde! ma carafe était presque pleine. Maintenant, il faudra recommencer.
--Tant mieux...
--Edmée! lui cria sa sœur, prends garde, tu vas prendre un bain qui n'aurait rien d'agréable, je t'en réponds. Et puis, tu sais, nous t'attendons pour commencer.
--J'arrive! Voici ma dernière carafe remplie.
--Après le déjeuner, murmura l'amoureux, vous me permettrez de vous parler un peu à l'écart, là où il n'y aura pas de trouble-fête.
Edmée ne répondit pas, mais un vague sourire et un regard coulé sous ses longs cils et qui n'avait rien de courroucé satisfirent pleinement le galant capitaine.
Cette petite scène, qui n'avait guère duré plus de cinq minutes, avait été notée par des yeux aussi vigilants, pour le moins, que ceux de la sœur aînée. Tout en aidant miss Jessie Robinson à déballer le pâté monstre et le jambon, Robert d'Ancel avait surpris l'attitude du capitaine et les coquetteries d'Edmée.
--Savez-vous, monsieur d'Ancel, que vous me répondez, tout de travers? Je vous demande où nous devons placer le pâté, et vous dites: «dans l'eau»...
--Je croyais que vous parliez du champagne, mademoiselle, qu'il s'agit de rafraîchir.
--Vous voyez bien...
--C'est que, sans doute, vous m'avez tourné la tête.
--Moi? Oh! que non, ce n'est pas moi.
Et un regard de la malicieuse Américaine désigna Edmée, qui à ce moment revenait de la source, sa carafe à la main. Robert se sentit rougir, et, furieux de cette faiblesse, rougit davantage, à en perdre contenance. Alors, on le croyait donc amoureux d'Edmée? Lui?... Mais il était le fiancé, ou à peu près, de Marthe. De nouveau, il regretta que le secret de cet engagement eût été si bien gardé. Il fut sur le point de tout dire, bien certain que, sur-le-champ, la nouvelle courrait d'oreille à oreille, et puis il n'osa pas. Il n'était pas seul en cause. Marthe désirait la liberté pour elle comme pour lui; et, de fait, cette calme personne semblait, aussi peu que possible, ou amoureuse, ou jalouse. Sans doute, elle lui dirait bientôt de sa voix douce et froide qu'il était libre, qu'elle ne serait jamais sa femme. A cette pensée, il fut pris d'une émotion violente, et cette émotion ressemblait terriblement à de la joie. Cependant il avait désiré ce mariage et, sans éprouver de passion véritable pour son amie d'enfance, il s'était senti attiré vers elle, il avait rendu justice à ses qualités de cœur et de tête. Alors?...
Mais il ne voulait pas se questionner; il voulait être heureux pendant quelques heures, si cela se pouvait!
Une grande nappe étalée au pied du hêtre monstre, qui dominait toute la clairière et dont les racines énormes formaient un siège naturel, disparaissait maintenant sous le mélange bizarre de plats divers, depuis le poulet froid jusqu'au dessert, de bouteilles, de couverts mis à la diable par les amateurs, de fleurs cueillies dans le bois et jetées pêle-mêle. Moins il y avait d'ordre et plus cela semblait ravissant à ces gens du monde qui n'auraient certes pas toléré un domestique faisant son service aussi mal qu'ils faisaient le leur. On se plaça n'importe comment, chacun à sa fantaisie; on était fort mal assis sur le gazon, il fallait, pour prendre une bouteille ou du pain au milieu de la nappe, se mettre à genoux, c'était incommode et délicieux. Le soleil filtrait à peine ici ou là à travers la fouillée, mettant de tremblotantes taches d'or sur le gazon, réveillant l'eau de la source, s'accrochant à une chevelure de femme, à un pli de robe claire.
Le capitaine avait trouvé une place pour Edmée en face de sa sœur, mais Robert veillait.
--Mademoiselle Edmée, dit-il, Marthe vous a réservé un bout de son trône. Voyez, vous formerez ainsi un groupe adorable, et nous serons vos sujets à toutes deux.
Edmée ne se fit pas prier. Un trône, qu'il fût fait d'une racine d'arbre ou de bois doré et de velours, lui appartenait de droit. Rieuse, elle se glissa entre les groupes, sauta par-dessus un panier à provisions et s'assit à côté de sa sœur. Elle passa le bras autour de la taille de Marthe et se blottit contre elle. Un instinct lui disait qu'on ne la trouvait jamais plus jolie que lorsque son charmant visage, souriant et malicieux, se pressait tout contre la figure régulière mais un peu pâle et sérieuse de la jeune châtelaine. Edmée était toujours caressante et câline; jamais plus, cependant, que lorsque ses caresses avaient des témoins. A côté d'elle, Marthe semblait presque froide; elle réservait ses caresses pour l'intimité.
M. Bertrand profita d'un moment où Robert allait chercher le champagne pour lui souffler rageusement:
--C'est pour me séparer d'elle que tu lui as offert la moitié du siège de sa sœur?
--C'est possible, répondit Robert avec beaucoup de calme. Tiens, porte donc cette bouteille-là; je me charge des autres.
--Tu te charges de beaucoup de choses, même de celles qui ne te regardent pas. Veux-tu que je te dise la vérité? Tu es jaloux, furieusement jaloux.
--Ah! ça, mon cher, ce n'est pas le moment de faire une scène; on nous regarde déjà. C'est moi qui t'ai présenté à ces jeunes filles, je suis un peu responsable de ta conduite; tu oublies un peu trop que tu n'es pas ici en garnison et que, dans notre monde, on ne fait pas la cour tambour battant.
--Si cette façon de faire la cour plaît, tandis que tes airs d'amoureux transi déplaisent?... Tu n'es ni le père ni le frère d'Edmée, que je sache.
--Finissons, Bertrand, n'est-ce pas? Mlle Levasseur est presque une enfant, elle ne sait pas à quel point tu es compromettant...
--Et tu te charges de le lui dire?
--A elle ou à sa sœur, oui, je ne m'en cache pas.
--C'est ce que nous verrons!
Il n'en put dire plus, car, en effet, la discussion rapide, presque à voix basse, avait été remarquée.
--Est-ce un duel qui se prépare? demanda en riant miss Robinson, ne sachant pas combien elle approchait de la vérité.
--En effet, mademoiselle, répondit Georges Bertrand, un duel à coups de verres de champagne. D'Ancel prétend qu'il a la tête plus solide que moi; les paris sont ouverts!
A partir de ce moment, on eût dit que le champagne produisait à l'avance son effet sur le jeune officier; sa gaieté un peu fébrile finit par gagner tout le monde, à l'exception de Marthe qui trouvait que le ton de la conversation était un peu trop monté.
Après le déjeuner, qui fut prolongé le plus possible, il y eut une détente. Les Américaines, infatigables, proposèrent des jeux, mais, décidément, il faisait trop chaud. On resta à l'ombre des grands arbres, causant à bâtons rompus, en attendant l'heure du retour. Quelques jeunes jeunes filles, parmi elles Edmée, s'éparpillèrent à la recherche de fleurs et de fougères. Robert, pris de remords, ne quittait pas sa fiancée, causait avec elle doucement, affectueusement, et la pauvre Marthe un instant crut qu'il lui revenait, qu'il avait été ébloui, mais que l'éblouissement était passé. Subitement, elle le vit tressaillir.
--Qu'y a-t-il?
--Votre sœur est-elle au milieu de ces jeunes filles là-bas? Vos yeux voient mieux que les miens.
--Non, certes, elle n'y est pas.
--Et Bertrand a disparu, lui aussi. J'aurais dû m'en douter.
--Pourquoi? que s'est-il passé?
--Marthe, c'est moi qui suis en faute. Je vous avais présenté Bertrand, je ne pouvais pas faire autrement, c'est un camarade, il s'est attaché à moi dans son désœuvrement de Trouville. J'aurais dû vous prévenir, cependant; c'est un garçon violent, peu scrupuleux, ce n'est pas du tout le mari qu'il faut à votre sœur.
--Soyez sans crainte, Edmée ne compte pas être sa femme; elle a pesé le pour et le contre, car, avec ses airs évaporés, elle a un sens pratique de la vie singulièrement développé. Elle ne se mariera qu'à bon escient. Le capitaine est militaire, il n'est pas très riche, et le nom--un nom quelconque--ne la tente nullement.
--Mais elle se laisse compromettre par lui! En ce moment, je gage que ses petites amies, là-bas, jasent sur son compte et savent très bien qu'elle a accordé un entretien à Bertrand.
Marthe se leva.
--Allons ensemble faire un tour; cela aura un air plus naturel que si vous alliez seul les interrompre. Ils ne peuvent pas être bien loin.
Marthe trouvait au fond que Robert prenait la chose bien à cœur, qu'il était très nerveux, très irrité. Ce fut en silence qu'elle le suivit.
Georges Bertrand, en effet, tout en offrant ses services aux jeunes filles, leur cueillant de grandes fougères, des branches de clématite, ou des traînées de lierre, avait insensiblement entraîné Edmée sous prétexte de violettes tardives qu'il prétendait avoir trouvées. Le taillis était fort épais en cet endroit, et le ruisseau y entretenait une fraîcheur délicieuse.
--Et vos violettes, où sont-elles?
--Plus loin, là où elles seront seules à nous entendre.
--Alors, dit Edmée souriant, très maîtresse d'elle-même, c'est un guet-apens?
--Non, c'est le rendez-vous que vous m'avez accordé.
--Mais, je ne vous ai rien accordé du tout, monsieur Bertrand!
--Vous croyez?... Alors vos yeux ont menti, voilà tout.
--Que vous ont dit mes yeux?
--Que vous vouliez bien m'écouter, que vous me saviez fou de vous et que cette folie, vous êtes prête à la partager...
--Alors, en effet, ils ont menti. Sachez, mon capitaine, que je ne ferai jamais de folie, que je suis une petite personne très raisonnable...
--Alors, si vous êtes une petite personne raisonnable, vous savez que ce que vous avez de mieux à faire, c'est de vous marier de suite.
Un léger nuage passa sur le front de la jeune tille.
--Pourquoi? Je n'ai que dix-huit ans.
--Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que vous ne seriez pas longtemps heureuse avec votre sœur. Pour l'instant elle joue à la petite maman, vous êtes pour elle une poupée toute neuve et dont elle raffole. Cela ne durera pas. Vous sortez de deux mondes, non pas seulement différents, mais hostiles. Vous l'avez bien vu lorsque vous avez proposé de jouer la comédie. Mlle Levasseur craint que vous ne la jouiez trop bien, en fille de votre mère.
Edmée cassa net une branche, et, colère, rageuse, en déchiqueta les feuilles, mais elle ne dit rien.
--C'est un petit indice, continua le capitaine, mais très suffisant. Votre sœur a l'habitude de passer huit ou neuf mois en pleine campagne; croyez-vous qu'elle change sa façon de vivre pour vous faire plaisir, pour vous accompagner dans un monde où vous seriez acclamée reine, tandis qu'elle y serait négligée?
--Vous plaidez pour les besoins de votre cause, fit Edmée un peu moqueuse.
--C'est vrai, car je vous aime, car je vous veux pour ma femme, à moi pour toujours. Il n'y a rien que je ne fasse pour vous obtenir, pour vous arracher, de force s'il le faut, à ce monde si peu fait pour vous...
--Et à M. d'Ancel, n'est-ce pas? dit en riant Edmée.
--Ah! vous savez qu'il est amoureux de vous--et cela vous amuse--comme mon amour à moi aussi vous amuse? Prenez garde; je vous jure qu'il y a des moments où je vous tuerais plutôt que de vous voir à un autre.
--Voyons... le drame est bien démodé, songez donc.
--Au théâtre, plus que dans la vie. Jamais il ne s'est vu plus de crimes de la passion que de nos jours--et moi, je suis capable de crime...
Edmée avait gardé jusqu'à présent son calme moqueur de petite Parisienne peu sentimentale, fort brave aussi, mais elle commençait à trouver cet amoureux un peu gênant; elle se demandait si les nombreux verres de champagne du déjeuner n'étaient pas pour quelque chose dans son exaltation. Elle le trouvait affreux avec ses yeux injectés de sang, sa respiration haletante, son teint cramoisi; elle ne reconnaissait plus son beau capitaine.
--Monsieur Bertrand, fit-elle non sans dignité, vous seriez très aimable de me reconduire auprès de mes amis; vous avez eu tort de m'entraîner si loin, j'ai eu tort de vous y suivre, mais je n'ai pas douté un instant que je me trouvais avec un homme d'honneur.
--Donnez-moi un peu d'espoir, Edmée--ayez pitié de moi. Je vous jure qu'il faut que vous soyez ma femme!...
Hors de lui, il lui saisit les mains et les couvrit de baisers. La jeune fille prit peur. Elle cria d'une voix haute et nette:
--Marthe! Marthe!...
--Voici, ma chérie--je te cherche depuis un quart-d'heure.
Edmée à l'instant recouvra sa présence d'esprit.
--C'est le capitaine qui prétendait avoir trouvé un banc de violettes, et nous avions si bien tourné et retourné dans ce fouillis, que nous ne savions comment nous en tirer. Maintenant, monsieur Bertrand, c'est ma sœur qui se chargera de me montrer le bon chemin--elle s'y entend mieux que vous...
Les deux jeunes filles s'éloignèrent tranquillement. Lorsqu'elles furent hors de vue, Georges Bertrand, d'une voix qui tremblait de colère, dit à son ancien camarade qui, silencieux, le regardait, résolu à s'expliquer une bonne fois avec lui:
--C'est, encore à toi que je dois ceci, n'est-ce pas?
--Parfaitement.
--J'en ai assez de ta surveillance!
--Cependant, il faudra bien que tu la subisses, à moins que--ce qui vaudrait mieux--tu ne t'abstiennes de quitter Trouville.
--Je comprends cela de ta part. Tu ne serais pas fâché de te débarrasser d'un rival dangereux.
--Tu te trompes, Bertrand, répondit Robert avec beaucoup de calme; je ne prétends nullement à la main de Mlle Edmée Levasseur.
Le capitaine éclata de rire, un rire au son très faux, très moqueur aussi.
--Et moi je te dis que tu en es amoureux fou. Si tu crois que je ne connais pas les symptômes de cette maladie-là!... Eh bien, non, mon cher, je ne pousserai pas la complaisance jusqu'à te laisser le champ libre. J'irai demain au château, et après demain, et tous les jours si cela me convient.
--Je saurai l'empêcher, dit Robert, dont le sang-froid commençait à céder.
--Et comment cela?
--En te faisant interdire la porte par Mlle Levasseur.
--Tu ne feras pas cela.
--Je le ferai...
Les deux hommes se regardaient les yeux dans les yeux; leur ancienne antipathie de nature tournait à la haine, et la haine, chez Bertrand, devenait vite une sorte de folie furieuse. Il voulut se jeter sur Robert, il l'aurait tué s'il avait pu, mais Robert veillait: il rejeta avec violence l'officier qui, non sans peine, garda son équilibre. La scène menaçait de tourner au pugilat. Robert, très vigoureux malgré sa vie sédentaire, saisit les mains de son adversaire.
--Écoute, si tu as encore une lueur de raison. Nous sommes ici à quelques pas seulement de toutes ces femmes qui, sûrement, ont entendu les éclats de ta voix. Je ne veux pas les mêler à notre querelle; je ne veux pas qu'un nom de jeune fille puisse être prononcé en cette affaire. Il est certain que nous ne pouvons en rester au point où nous sommes. Tu veux une affaire, un duel? J'avoue que la chose ne me déplairait pas. Mais il faut un prétexte plausible. Tu es joueur et mauvais joueur. J'irai bientôt, pas tout de suite, mais vers la fin de la semaine, à Trouville, nous ferons un piquet ensemble, après avoir fait semblant d'être, comme par le passé, bons camarades, après nous être montrés sur la plage à l'heure de la promenade; la querelle viendra facilement. Nous nous battrons, et sérieusement. Si tu me tues, eh bien, ce sera une solution comme une autre! Mais je ne t'épargnerai pas si j'ai l'avantage, je t'en préviens. Je te tuerai sans pitié, car je te hais bien.
--Et moi donc! Mais je suis tranquille quant à l'issue. Je suis de première force aux armes, et tu sais à peine tenir une épée. Au pistolet, je mets dans le blanc cinq fois sur six, et toi?
Robert haussa les épaules. A ce moment-là, il faisait bon marché de sa vie. Il avait enfin vu clair en lui-même. A la lueur de sa haine il avait compris qu'il aimait la sœur de celle à qui il avait donné sa foi, qu'il l'aimait follement, et qu'il était ainsi traître à la parole donnée. Marthe l'avait voulu libre: il avait refusé de se considérer comme tel; il était donc réellement parjure.
Le capitaine alla détacher son cheval et partit au galop, sans prendre congé des femmes groupées maintenant autour de la fontaine. Celles-ci, fort étonnées, un peu inquiètes de la querelle qu'elles devinaient, commentaient ce départ précipité. Robert leur fit les excuses de son ami, subitement indisposé. Personne ne crut à cette indisposition venue à la suite d'une altercation dont l'écho leur était parvenu, et la fin de la journée, commencée si gaiement, fut un peu languissante et triste.
On se rendit en bande jusqu'à la route où attendaient les voitures. Marthe, à un moment donné, se trouvant à côté de Robert, un peu loin des autres, dit rapidement:
--Que s'est-il passé?
--Mais rien du tout, ma chère Marthe. Je crois que Bertrand avait trop bien tenu son pari à propos du champagne; je lui ai fait honte; il m'en a voulu un moment. Mais c'est, au fond, un garçon assez raisonnable, quand on sait le prendre; il a compris que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de partir, et il est parti. Voilà.
Marthe, très absorbée et ne voulant pas paraître douter de cette version, à laquelle cependant elle ne croyait pas, ne répondit pas de suite. Elle avait vu, elle avait compris beaucoup de choses, pendant cette longue journée. Elle souffrait et se raidissait pour n'en rien laisser voir. Elle était surtout très lasse.
--Écoutez, Robert, dit-elle enfin, j'ai besoin de causer avec vous un peu longuement, à cœur ouvert. Jeudi il y a réunion chez les Américaines. Je m'arrangerai pour y envoyer Edmée avec ma tante. Trouvez-vous à trois heures et demie au carrefour de la croix. Là, nous ne serons pas dérangés.
--J'y serai, Marthe.
Lui aussi se sentait horriblement triste. La vie qu'il avait entrevue si belle et si bonne déviait lamentablement.
(A suivre.)
Jeanne Mairet.

