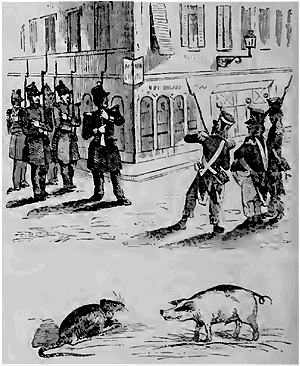L'ILLUSTRATION,
JOURNAL UNIVERSEL.
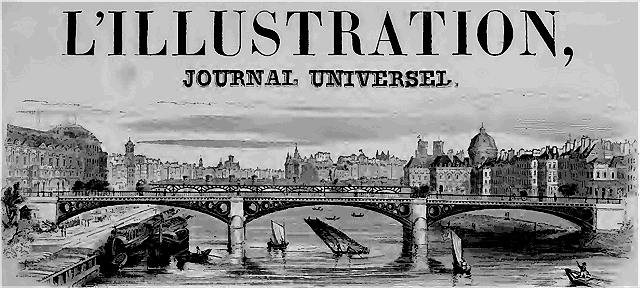
|
Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |
N° 63. Vol. III. |
Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |
Histoire de la Semaine. Décoration de l'ordre de la Toison d'Or; Portrait de lord Ellenborough, gouverneur général des Indes.--Courrier de Paris.--Courses de la Société d'Encouragement. Tiger sautant une haie; Coupe Janisset gagnée par Commodore Napier.--Exposition des Produits de l'Industrie. (Deuxième article.). Orfèvrerie et Bijouterie. Fontaine à thé de M. Mager; Couvert de chasse et Seau à rafraîchir le vin, par M. Morel; Développement du Seau à glace; Flacon par M. Moret; Bracelet par M. Morel.--Salon de 1844. (Septième et dernier article.) Traîneau par M. Milankiewicz; Giorgione Barbarelli faisant le portrait de Gaston de Foix, par M. Baron: Jeune fille d'Albano, par M. de Madrazo: Vue prise aux environs de Paris, par M. Français; l'Amour de l'or, par M. Couture.--Second-Théâtre-Français. Sardanapale, tragédie de M. Lefèvre. Une Scène du 3e acte--Le dernier des Commis Voyageurs, roman par M. XXX. Chapitre VII. Récit: Agathe.--La Police correctionnelle de Paris. Le Panier à salade; la Grande Souricière; Vue intérieure de la 6e chambre; Types de la Police correctionnelle.--Bulletin Bibliographique.--Allégorie de Mai. Les Gémeaux.--Amusements des sciences. Une gravure.--Rébus.
Histoire de la Semaine.

Décoration de l'Ordre de la Toison d'Or.
Le rappel de lord Ellenborough, du gouvernement général des possessions anglaises dans l'Inde, bien qu'il n'ait rien de politique, bien qu'il ne soit qu'un acte spontané du comité des secteurs, n'en a pas moins pris les proportions d'un événement, par la vivacité du dépit avec laquelle cette mesure a été d'abord accueillie par le cabinet. C'était à la suite de la révolution ministérielle qui venait de ramener sir Robert Peel et ses amis au pouvoir, et de rendre à lord Wellington son ancienne influence sur la direction des affaires, que lord Ellenborough, qui s'était fait remarquer par la fougue de son torysme, fut appelé à occuper cette position par les directeurs, qui savaient, par cette désignation, se rendre agréables au ministère nouveau et à ses puissants adhérents. Lord Auckland avait déplorablement compromis les intérêts de la compagnie, et l'armée de l'Inde presque tout entière, par la trouée téméraire qu'il avait fait faire dans l'Afghanistan, et qu'avait terminée un si épouvantable désastre. Les événements de Caboul avaient rendu impossible l'administration de celui qui n'avait pas su les prévoir, qui y avait si fatalement poussé huit de victimes; lord Ellenborough le remplaça donc. Le nouveau gouverneur parut bien comprendre, au début, que les intérêts de la compagnie et les satisfactions de l'amour-propre anglais pouvaient ne
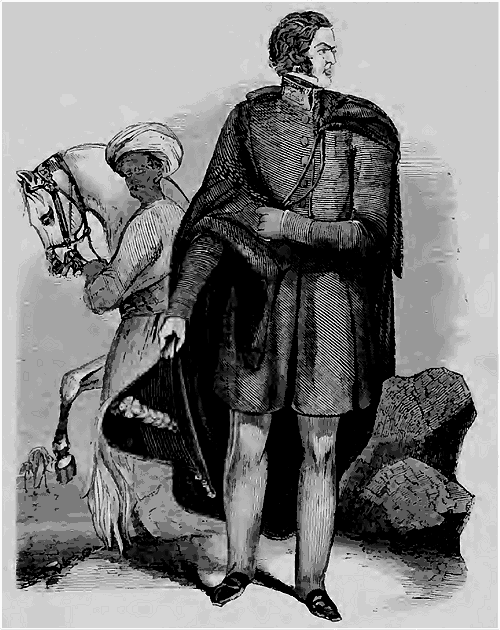
Lord Ellenborough, gouverneur général des Indes.
pas être toujours en parfaite harmonie, et que tandis que celles-ci étaient de porter le plus loin possible la domination britannique, la compagnie pouvait ne pas trouver don compte à opérer par la force armée sur des points aussi éloignés de sa base; aussi le vit-on en quelque sorte consentir avec peine à tirer au moins vengeance des massacres de Caboul, et ce fut presque malgré lui que les généraux Nott et Pollock relevèrent le prestige des armes anglaises, en allant encore une fois dicter des lois aux Afghans dans leur capitale, avant d'abandonner leur funeste pays. Ce fut à la suite de cette expédition obligatoire que lord Ellenborough publia cette fameuse proclamation dans laquelle il crut devoir traiter l'idolâtrie indienne avec tant de flatterie, et annoncer la translation du fond des gorges de l'Afghanistan, au milieu de toutes sortes de fêtes, des fameuses portes du temple de Soumatah, avec une complaisance si pompeuse, que les susceptibilités religieuses de l'Angleterre furent profondément choquées. Mais bientôt forcé à son tour, après avoir renoncé à la limite qu'avait rêvée son prédécesseur, d'en assigner une à l'occupation anglaise, on le vit, dans ce but, au lieu de recourir aux négociations, exécuter successivement des entreprises violentes contre les Ameers du Scinde et les Mahrattes de Gwalior. Le succès les couronna en définitive, c'est tout ce qu'il faut pour les faire pardonner, à un ami surtout, par les ministres du cabinet actuel; mais des hommes politiques les blâmèrent, et les directeurs de la compagnie surtout se virent avec beaucoup de regret engagés de nouveau dans la voie des conquêtes armées. Toutefois, comme ce système compte des défenseurs, les directeurs, qui voulaient en finir sans conteste avec celui qui le leur imposait, et n'avoir point, à l'occasion de son rappel, à discuter la question coloniale avec le cabinet, ont uniquement motivé cette mesure sur ce que le gouverneur général prenait constamment vis-à-vis d'eux le ton et les allures d'un dictateur, ne leur communiquait jamais ses plans, n'écoutait jamais les conseils et les prenait souvent en mauvaise part. Une dépêche où il répondait sur le ton du plus altier dédain à quelques observations des directeurs, est arrivée tout à point pour justifier plus complètement encore un reproche que rendaient déjà bien digne de foi la témérité naturelle de l'esprit du noble lord, et la morgue intraitable dont il avait fait preuve au Parlement. Le comité des directeurs et le ministère ont fait choix, à l'unanimité, pour succéder au gouverneur général rappelé, de sir Hardinger, ministre de la guerre. On annonce qu'il s'embarquera avec sa famille dans la première quinzaine de juin, pour se rendre à son nouveau poste. Cette détermination a enlevé nécessairement son intérêt et sa vivacité à la discussion qu'avait provoquée dans la chambre des communes la motion de M. Hume sur le rappel de lord Ellenborough. Le compte rendu de ce débat, devenu insignifiant, nous arrive, en attendant celui de la discussion nouvelle du bill des manufactures.
La malle de l'Inde a apporté la nouvelle que le choléra avait éclaté à Bombay et qu'il sévissait avec rigueur contre les Européens et surtout contre les indigènes. Du 1er au 15 mars on avait compté 140 victimes du fléau.
L'Espagne vient de voir une révolution nouvelle s'opérer dans son administration. Il semble vraiment que nos gracieusetés aient porté malheur à M. Gonzalès Bravo; tandis qu'il tendait une main pour recevoir le grand cordon que nous lui envoyions, en échange de la Toison d'or expédiée à M. Guizot, le portefeuille de premier ministre lui tombait de l'autre. M. Olozaga, lui aussi, venait de recevoir une distinction de ce genre quand il succomba sous une accusation de trahison. Le tort de M. Gonzalès Bravo, c'est de s'être pris au sérieux. Le ministre de la marine, M. Portillo, avait quelques démêlés avec le chef de la marine espagnole, l'amiral Romay. M. Carasco, ministre des finances, était en querelle de bourse avec M. Salamanca. Les deux ministres Portillo et Carasco tombèrent en disgrâce, et il fut question de les remplacer. Gonzalès Bravo était d'abord résigné à les sacrifier; mais au moment, d'exécuter sa résolution il se crut assez fort pour imposer le maintien de ses deux collègues, et tous les ministres offrirent leur démission, convaincus quelle ne serait pas acceptée. Cependant on les prit au mot, on l'accepta, et ils s'aperçurent trop tard qu'on cherchait une occasion de les obliger à la retraite. Le général Narvaez a été chargé de composer un cabinet nouveau; il en a pris la présidence et s'est réservé le portefeuille de la guerre. Le marquis de Viluma, qui venait de partir pour Londres, où il allait occuper le poste d'ambassadeur, a été rappelé pour prendre le portefeuille des affaires étrangères; M. Mon, neveu de Toreno, est chargé des finances; M. Pidal, beau-frère de M. Mon, élu président de la chambre des députés en concurrence avec M. Lopez, et qui a consenti à jouer le rôle qui lui a été soufflé dans l'intrigue contre M. Olozaga, est ministre de l'intérieur; M. le général Armero ministre de la marine, M. Mayans est le seul membre de l'ancien cabinet qui conserve son portefeuille; il reste ministre de grâce et de justice. La façon dont la grâce et la justice ont été administrées jusqu'ici lui méritait bien en effet cette exception. Les modérés purs sont donc maîtres absolus des affaires. Ils ont rompu même avec les transfuges du parti progressiste; il n'y a plus qu'un pas à faire pour en revenir aux partisans de l'estatuto real. Une dépêche télégraphique nous apprend que l'état de siège a été levé à Madrid. Attendons pour apprécier la portée réelle de cette mesure.
La place d'Almeida, au Portugal, s'est rendue aux troupes de dona Maria. Le comte de Bomfin et un assez grand nombre d'officiers qui lui étaient attachés sont passés en Espagne.
Nous nous sommes bornés, dans notre dernier numéro, à une simple allusion à un fait qui s'était passé à Tunis et que nous croyions ne devoir plus occuper l'attention publique; mais la façon dont les journaux anglais y reviennent nous met dans l'obligation d'en parler. Un Maltais, sujet anglais par conséquent, était en discussion d'intérêts avec un de ses compatriotes, valet de chambre de sir Thomas Reade, consul général d'Angleterre, le même qui joua à Sainte-Hélène un rôle si odieux sous les ordres de sir Hudson-Lowe. Ce Maltais tua ce valet de chambre dans la chaleur d'une dispute, ainsi qu'un drogman, sujet tunisien, attaché au consulat britannique, et qui voulut s'interposer. Le premier de ces deux crimes, le seul dans lequel on put supposer préméditation, devait avoir la priorité dans les poursuites de la justice, et l'accusé aurait dû être traduit devant une cour anglaise; le cas si délicat d'une intervention musulmane se trouvait ainsi écarté de droit. Sir Thomas Reade, prenant peu de souci de ce danger, et sans se préoccuper de compromettre, par une mesure passionnée et imprudente, la tranquillité de la population chrétienne à Tunis, a déféré le meurtrier au tribunal du bey pour le meurtre peut-être involontaire du sujet tunisien, au lieu de l'envoyer à Malte pour y être jugé sur le fait principal, l'homicide du sujet anglais. Dès que la notification faite à l'accusé fut connue, tous les consuls et les supérieurs des religieux en mission apostolique dans ce pays, vivement préoccupés des suites d'un tel événement, se réunirent chez le consul général de France, M. de Lagau, pour s'entendre avec lui dans une conjoncture aussi déplorable. Dans cette conférence, une lettre, signée par tous les agents des puissances européennes, fut adressée collectivement à sir Thomas Reade, pour le prier de revenir sur une mesure qui, par ses conséquences, pouvait amener tant de malheurs au milieu d'une population dont le supplice d'un chrétien allait réveiller le fanatisme. Rien ne put agir sur le consul anglais, qui ne voulait qu'une chose, à quelque prix que ce fût, la prompte vengeance de la mort de son valet de chambre. La justice du bey est, en effet, fort expéditive; et les défenseurs de l'accusé ne pouvant se faire entendre, se bornèrent à protester contre toute la procédure et contre la condamnation à mort. Deux jours doivent s'écouler entre la sentence et l'exécution. Ce délai paraissait trop long à l'impatience de M. le consul général d'Angleterre. Il prit dès le lendemain matin la direction des préparatifs du supplice, envoya chercher un religieux, se rendit à la Goulette pour activer toutes les dispositions, croyant enfin pouvoir assister au spectacle qu'il s'était ménagé, quand M. de Lagau, qui l'avait devancé, obtint du bey, auquel il fit entendre un langage à la fois ferme et entraînant, l'ordre de suspendre l'exécution du condamné. Le retour, à Tunis, de notre consul général fit renaître dans tous les cœurs l'espérance et la joie. Les notables européens lui votèrent spontanément une adresse de félicitations, qui fut bientôt couverte de signatures. Les feuilles anglaises ont toutes discuté ces faits. Les unes donnent à entendre que la justice est si mal rendue à Malte, que sir Thomas Reade aura été déterminé à préférer encore la justice tunisienne, dans la crainte de voir un meurtrier impuni. Mais, en vérité, si l'aveu est précieux, la raison n'est pas bonne. La justice de Malte est rendue au nom de la reine d'Angleterre, et c'est à son gouvernement à en réformer les abus, à en améliorer, s'il est besoin, le personnel; mais le mauvais état de choses actuel ne peut être une raison pour renoncer à un droit au maintien duquel toutes les nations européennes et la cause de l'humanité sont également attachées. D'autres disent à notre consul, à peu près comme Martine du Médecin malgré lui: «Il nous plaît d'être jugés et exécutés à Tunis; mêlez-vous de vos affaires.» Mais la similitude n'est pas complète; quand la femme de Sganarelle était battue, cela ne faisait de mal qu'à elle; mais quand la justice tunisienne et le fanatisme mahométan se seront mis en appétit et en verve avec un sujet que l'Angleterre leur aura livré, la population chrétienne sera bien compromise sur ces bords. Des notes diplomatiques ont été échangées à ce sujet.
La Porte nous a donné, à Latakié, les satisfactions exigées par M. de Bourqueney, pour les mauvais traitements dirigés par des musulmans contre des chrétiens, et pour violation de la résidence consulaire. Mais notre chargé d'affaires a eu à faire au divan des remontrances sur la façon de procéder des autorités dans cette affaire. Des individus fort peu compromis ont été traités avec une excessive sévérité, tandis que les véritables et principaux meneurs ont été traités avec de grands ménagements. Nous trouvons dans le Journal de Francfort quelques lignes qui prouvent de même que la Porte saisit toutes les occasions de protester contre les concessions qu'on lui arrache. «Méhémet-Reschid-Pacha, lui écrit-on de Constantinople, destitué de son poste à la suite de l'affaire du pavillon, a été parfaitement accueilli à son arrivée ici, et il vient d'être nommé chef d'état-major de l'armée de Romélie à Andrinople, où il s'est rendu ces jours derniers.»
La Gazette officielle de Turin renferme les lignes suivantes: «Nous avons parlé en son temps, y est-il dit, du déplorable événement arrivé à l'agent consulaire d'Espagne à Mazayan, qui fut arraché de la maison du vice-consul de S. M. notre souverain, et cruellement mis à mort. L'agent et consul général de S. M. à Tanger fit immédiatement parvenir ses réclamations au sultan de Maroc. Celui-ci, ayant reconnu la justice de ces réclamations, a accordé la satisfaction due à la violation du domicile consulaire, en faisant entendre qu'il était bien peiné de ce qui était arrivé, et en assurant au gouvernement de S. M. que pareille chose, occasionnée seulement par un excès instantané de colère de Haggi-Mussa-el-Garbi, ne se renouvellerait pas. Ce différend, aussi désagréable pour l'un que pour l'autre des deux gouvernements, est ainsi terminé.» C'est parfait de modération. L'Espagne prendra-t-elle aussi philosophiquement son parti?
La Grèce a vu former son premier ministère constitutionnel. M. Mavrocordato en a été nommé président, en même temps que ministre des finances; M. A. Londos, de l'intérieur; M. Tricoupis, des affaires étrangères, et provisoirement de l'instruction et des cultes; M. A. Ch. Londos, de la justice; M. Rodios, de la guerre. Tous ces choix appartiennent au parti anglais; aussi M. Piscatory étant allé visiter quelques parties de la Grèce, on a pensé qu'il voulait donner au cabinet français le temps de lui faire passer des instructions sur la conduite qu'il a à tenir dans la situation nouvelle qui nous est faite.
On a reçu de Londres des nouvelles de la Plata qui vont jusqu'au 19 février pour Buénos-Ayres, et jusqu'au 21 pour Montévidéo. Elles sont favorables aux assiégés. L'armée d'invasion avait, à cette époque, éprouvé de graves échecs. Urquiza et Oribe avaient, l'un et l'autre, été battus, et les troupes de la république orientale avaient célébré avec enthousiasme l'anniversaire du commencement de ce siège qu'elles soutiennent depuis un an, avec des chances beaucoup meilleures depuis quelque temps. D'autres dépêches vont même jusqu'à présenter la chute de Rosas comme inévitable, par suite d'une insurrection à la tête de laquelle s'est mise la province de Salta. Nous faisons des vœux ardents pour que les vingt mille Français qui luttent sur ces bords contre la mort, qui les a si longtemps menacés, recueillent le fruit de leur courage et de leur confiance.
Munich vient d'être le théâtre de scènes sanglantes. Nulle part, proportion gardée, il ne se consomme autant de bière que dans la capitale de la Bavière. Aussi le gouvernement, pour éviter les troubles, intervient-il dans la fixation du prix de cette boisson, comme à Paris l'administration de la police dans celle du prix du pain. De son côté, l'archevêque de Munich, pour maintenir chez le peuple cette prédilection et le détourner de s'adonner de nouveau aux boissons spiritueuses, qu'il a presque entièrement abandonnées, a pris la bicère sous sa protection, et se rend, le 1er mai, chaque année, processionnellement avec son clergé, dans toutes les brasseries de la capitale, pour bénir les provisions qui s'y trouvent et les ustensiles qui s'emploient dans la fabrication de cette boisson. Cette cérémonie eut lieu dans l'après-midi, et le soir, le peuple, selon son habitude, se rendit en foule aux brasseries pour boire de la bière nouvellement bénie. Malheureusement, ce même jour, la taxe venait de subir une augmentation, et la mesure avait été portée du prix de 6 kreutzers à 6 kreutzers et demi. Cette hausse excita le plus vif mécontentement; des rassemblements tumultueux et menaçants se formèrent; les rues furent dépavées, les brasseries saccagées, et les maisons de plusieurs fonctionnaires furent attaquées par la foule. La police fit battre la générale; les troupes montrèrent de la mollesse, parce que les soldats, grands consommateurs de bière, voyaient eux-mêmes d'un fort mauvais œil l'augmentation, cause du soulèvement populaire; mais, néanmoins, le sang coula ce premier jour. On compta plusieurs blessés, entre autres un lieutenant et deux ouvriers, qui ont reçu, annonce-t-on, des blessures mortelles. Cependant les troupes ne firent pas feu. Le lendemain 2, on tenta de renouveler, chez plusieurs brasseurs et dans les rues de la ville, les scènes de la veille. L'hôtel et la vie du directeur de la police furent particulièrement menacés. Quatre pièces d'artillerie, placées devant un corps de garde où ce fonctionnaire s'était réfugié, ont été déchargées sur le peuple après une assez longue hésitation de la part des artilleurs, qui s'en firent répéter l'ordre par leurs officiers. Cette terrible démonstration mit fin aux troubles, et un morne silence succéda le soir dans les rues à cette agitation de deux jours.
Notre chambre des députés a fait trêve, samedi dernier, à la longue discussion de la réforme des prisons, dans laquelle elle paraît engagée pour un long temps encore, et a entendu un rapport de pétitions de plusieurs milliers d'ouvriers de Paris, appelant la sollicitude des représentants de la France sur d'autres ouvriers soumis au cruel régime de la servitude, et venant demander l'abolition de l'esclavage dans nos colonies. A coup sur les pétitionnaires et le pays ne pouvaient croire qu'après les engagements solennels pris par les Chambres, par les ministères précédents, par le ministère actuel lui-même, l'abolition de l'esclavage trouverait encore des contradicteurs officiels. Cette question et les moyens de la résoudre ont été l'objet des travaux les plus suivis et les plus mûrs. M. le duc de Broglie, au nom de la grande commission coloniale, a fait sur ce sujet un rapport où ont été indiquées diverses solutions entre lesquelles le gouvernement peut choisir; mais, en face de ce travail, qui établit aussi clairement l'indispensable nécessité que la moralité de l'émancipation des esclaves, le ministère reste inactif. La commission des pétitions, de peur sans doute de troubler cette quiétude, proposait l'ordre du jour, que son rapporteur motivait sur ce que les pétitionnaires s'exagéraient assurément les souffrances de l'esclavage, et sur ce que le principe de l'abolition de l'esclavage étant admis, c'était bien assez. Ce laisser-aller d'égoïsme et de cruauté a inspiré à M. Agénor de Gasparin une chaleureuse et éloquente réplique; c'est aux applaudissements d'une grande majorité de la Chambre qu'il a fait justice de ces tableaux du bonheur des esclaves, et qu'il a peint la situation de ces hommes qui ne peuvent dire, en mettant la main sur leur cœur: Ma chair est à moi. La pétition a, contre les conclusions de la commission, été renvoyée au ministre. Ce renvoi sera-t-il enfin pris au sérieux? Restera-t-on immobile en présence de cette démonstration nouvelle? et ne se mettra-t-on pas enfin à préparer cette mesure de l'émancipation, qu'on semble vouloir n'aborder jamais, pour pouvoir répondre toujours qu'elle ne peut être improvisée?
L'enseignement secondaire n'aura point encore son code cette année, et la discussion qu'on a provoquée ne sera qu'un semblant de satisfaction donnée aux engagements de 1830 et aux impatiences des partis. On a entendu à la tribune du Luxembourg plus d'un discours dont on eût pu dire avec raison, connue M. Agénor de Gasparin le disait du rapport de M. Denis: «C'est un anachronisme qui nous jette de vingt ans en arrière.» Mais ajoutons bien vite qu'un noble et digne langage y a aussi été tenu, et que M. Cousin y a combattu, avec autant d'esprit que de fermeté et d'élévation, les prétentions exagérées mais sincères et les concessions hypocrites.
Pendant ces discussions publiques, les commissions continuent leurs travaux. Le rapport de celle des crédits supplémentaires à la chambre des députés amènera un débat où nous verrons renaître les grandes discussions politiques qui ont déjà animé cette assemblée. L'affaire de Taïti sera reprise à cette occasion, et les grandes luttes parlementaires seront ouvertes de nouveau.--La commission chargée de l'examen du projet de loi sur le chemin de fer du Nord, en se prononçant en majorité pour l'exécution de cette ligne et même pour son exploitation par l'État, va également ramener des questions que la loi de 1842, cette espèce de loi électorale, ne pouvait en effet prétendre avoir bien définitivement résolues.
D'affreux désastres sont venus porter la terreur dans des contrées bien diverses. A l'île Bourbon, où une chaleur excessive a amené des torrents de pluie, le 1er janvier, une inondation formidable a emporté un pont, ravagé toute la campagne et menacé la basse ville de Saint-Denis tout entière.--Un violent incendie a éclaté à Brème, et huit personnes y ont succombé.--Paris aussi a été le théâtre d'un sinistre du même genre qui a fait trois victimes. Enfin de plusieurs points de nos départements on signale des événements de ce genre, et en quelques endroits on a la douleur d'être obligé de les attribuer à la malveillance.
Le cardinal Pacca, un des hommes les plus influents du sacré collège, et qui était revêtu d'un grand nombre de foncions et de dignités, vient de mourir. Sa succession a permis au pape de faire plusieurs heureux. Ses obsèques ont été célébrées en grande pompe. S. S. y a assisté.--M. Burnouf père, professeur au Collège de France et bibliothécaire de l'Université, auquel l'étude de la langue grecque doit à coup sûr un peu de la faveur qu'elle a reprise chez nous depuis trente ans, a été enlevé aussi à la science et à sa famille.--Le conseil général de la Seine a perdu également un de ses membres les plus laborieux et les plus capables, M. Preschez, secrétaire de la chambre des notaires de Paris.

Les restaurateurs, les maîtres d'hôtel, les directeurs de théâtre, les cafés, les fiacres, les tailleurs, les bottiers tout ce qui nourrit, abrite, divertit, voiture, abreuve, chausse et habille l'humanité, est dans le ravissement depuis quinze jours. Paris est assiégé, envahi, inondé d'étrangers et de curieux; il en arrive de tous les points de l'horizon, du nord, du midi, de l'ouest et de l'est, par ici et par là; le printemps d'abord en est cause, cette charmante saison qui nous sourit depuis avril, et nous caresse de son souffle doux et embaumé. Allons à Paris, disent de tous côtés les riches de la province et les hommes de loisir du chef-lieu, qui ont besoin de se distraire un peu de la monotonie et de la régularité de la vie départementale. Partons! et les voici qui s'entassent dans la diligence ou roulent en chaise de poste, avec le cortège immense des cartons à chapeaux, des malles, des porte-manteaux, des nécessaires, des sacs de nuit et des étuis de parapluie; il y a des familles tout entières qui émigrent, depuis l'aïeul jusqu'aux petits-enfants; la jeune fille est ravie en songeant qu'elle va montrer sa plus jolie robe et son chapeau le plus joli aux Tuileries et à l'Opéra; et le jeune homme, frais éclos du collège vicinal, tressaille d'aise à l'idée qu'il dînera chez Véfour, qui sait! chez les Provençaux ou au café de Paris; et que, le soir venu, il ira voir jouer mademoiselle Plessis, mademoiselle Furgueil, madame Vollys et mademoiselle Déjazet.
Paris est dont accru, en ce moment, de cette foule départementale que le soleil invite, chaque année, à sortir de chez elle pour se hasarder et se plonger dans l'océan parisien; on le reconnaît aisément à son air curieux et empressé, et à certains excès de parure qui ne sont pas scrupuleusement conformes à la règle du goût le plus exquis; la plus jolie femme de département, la plus fine, la plus habile, la plus distinguée, a toujours, le lendemain de son arrivée à Paris, quelque chose qui la trahit, et fait voir qu'elle a passé l'hiver, ne fût-ce que cinq ou six mois, hors de l'essence et de la quintessence parisienne; c'est une nuance d'étoffe, c'est une couleur de ruban, c'est ce je ne sais quoi qui se perd bien vite, dès qu'on a quitté ce pays mobile et charmant où l'heure qui commence apporte un changement dans la fantaisie et dans la mode de l'heure qui finit; mais cette allure, légèrement arriérée, disparaît avec une visite à la marchande de modes et à la couturière en crédit, et trois ou quatre promenades au bois de Boulogne et au boulevard Italien. Rencontrez-vous madame, deux jours après son entrée à Paris, cette rouille départementale a déjà disparu, et vous la prenez pour une Parisienne pur sang.--Restent les provinciales incarnées que dix ans d'études et de séjour à la Chaussée-d'Antin ne parviendraient point à transformer; race éternellement vouée à l'exagération du mauvais goût, qui sortent à midi en pleine rue, avec une robe à trente-six volants et un chapeau surmonté d'un oiseau de paradis.
Ces visiteurs annuels sont loin cependant de représenter le total des étrangers qui pullulent en ce moment à Paris, et dont le chiffre s'accroît tous les jours; Paris n'a pas seulement affaire aux curieux qui visitent Paris pour Panis même, espèce qui se compose en grande majorité d'administrateurs en congé, de propriétaires qui s'émancipent, d'héritiers qui veulent prendre un peu de bon temps sur la succession, et de jeunes mariés désireux de procurer à leur femme le plaisir de voir la capitale pour la première fois, gratification obligée de toutes fiançailles et de tout mariage récent, doux rayon de la lune de miel! Il y a, en outre, la multitude que l'exposition de l'industrie fait, de toutes parts, sortir du fond du département et du canton, et qui ajoute un supplément extraordinaire à la population nomade que Paris reçoit annuellement dans ces premiers beaux jours de mai. Les faiseurs de chiffres et de recensements prétendent que ce supplément s'élève à plus de quatre-vingt mille personnes; ce nombre ne paraîtra ni exagéré ni invraisemblable, si on en croit les preuves qui se donnent pour convaincre les incrédules. Ainsi le journal d'Angers atteste qu'il a été délivré à la préfecture de Maine-et-Loire plus de 3,000 passe ports pour Paris, depuis quinze jours; et le journal de Nantes, qui ne veut pas être en reste, se vante, pour le compte de la Loire-Inférieure, de 6,000 passe ports expédiés en moins d'une semaine. Qu'on juge du reste par cet échantillon, et de combien de pieds qui usent des bottes et de bouches qui mangent, Paris, à l'heure qu'il est, se trouve augmenté. Nous ne désespérons pas de pouvoir donner incessamment le total des livres de pain et des coups de fourchette que cette invasion inaccoutumée produit, par surcroît, chez les boulangers et dans les cuisines; la statistique est une si belle chose!
Les théâtres surtout se ressentent de cette surabondance; la foule y afflue. Tout à l'heure déserts et priant Dieu de leur venir en aide, les voici maintenant remplis du parterre aux combles; Dieu leur a envoyé l'exposition de l'industrie pour peupler leur solitude; il n'est pas jusqu'au Gymnase, le plus délaissé des théâtres de Paris, qui ne fasse ce qu'un appelle de l'argent en terme du métier; quant à l'Opéra, il faut voir comme il est heureux et comme il se pavane! Lundi dernier on y jouait la Juive; et le caissier a compté pour le total de la représentation 10,000 fr. de recette! Il y a de quoi vraiment se réjouir; ces bonnes fortunes inespérées raniment cette pauvre Académie royale de musique, qui commençait à se sentir l'estomac aussi vide que sa caisse. Le retour de Carlotta Grisi contribuera amplement à augmenter cette prospérité de circonstance. Revenue de Londres depuis vingt-quatre heures, Carlotta Grisi a repris tout aussitôt ses ailes de wili C'était le surlendemain de cette recette monstrueuse de dix mille francs; si la wili n'a pas encaissé ses dix mille francs à son tour, du moins peu s'en est fallu: il ne restait pas une seule place vide ni en haut ni en bas, et toute cette multitude avait l'œil attentif, le cou tendu, et battait des mains avec transport; il était aisé de voir à cette constance d'attention, à cette bonne foi d'attitude, à cette chaleur d'applaudissements, que l'Opéra n'avait pas affaire à son public accoutumé, ou du moins qu'une forte dose d'éléments d'emprunt s'y était infiltrée. Le public ordinaire l'Opéra n'a pas, en effet, cette naïveté d'émotion et ce scrupule; il fait le nonchalant et le distrait, même au morceau de chant le plus pathétique, même au pas de Carlotta le plus vif et le plus amoureux, comme un sultan accoutumé à de pareils présents et qui approuve mollement, en vainqueur blasé, du bout des doigts et du bout des lèvres.
On se bat à la Sirène d'Auber, on s'y précipite, on s'y étouffe; l'Opéra-Comique est encore plus fêté que l'Opéra, si cela est possible; c'est que la province a gardé toute la sincérité et toute l'ardeur de son penchant ou plutôt de sa passion pour l'Opéra-Comique. Ce culte-là est un de ceux qu'on aura peine à lui ôter; on aime l'Opéra-Comique en province comme au plus beau temps de Martin et d'Ellevion; les trois quarts des départements fredonnent encore avec satisfaction, tous les malins en se levant:
Oui, c'en est fait, je me marie.
Je veux vivre comme un Caton.
Ou bien:
Enfant chéri des dames,
Heureux en tous pays;
Très-bien avec les femmes.
Mal avec les maris.
Ou bien encore;
L'hymen est un lien charmant,
Lorsque l'on s'aime avec ivresse.
Quoi d'étonnant, après cela, que les départements, se trouvant de passage à Paris, se ruent sur l'Opéra-Comique pour contenter leur amour, cet amour qui ne trouve là-bas que de rares occasions de se satisfaire, et pourrait bien, à tout prendre, ressembler à une passion malheureuse.
Le 5 mai a ramené l'anniversaire de la mort de Napoléon, et réveillé les souvenirs de cet homme et de cette époque héroïques dans le cœur des vieux soldats et des vieux serviteurs fidèles au génie et au malheur. Tous ces adorateurs de l'empire et de l'Empereur, adoration touchante et désintéressée, puisqu'elle ne s'adresse plus qu'à des ruines et à des morts, tous ces gardiens d'un culte passé ont payé leur dette à la mémoire de Napoléon, à l'occasion du grand et funèbre anniversaire; des messes solennelles ont été célébrées dans la plupart des églises de Paris, et, pendant toute la journée, ou a vu des mains pieuses déposer sur l'airain de la colonne de la place Vendôme des couronnes de fleurs funéraires et de lauriers. Ce jour-là, plus d'un brave survivant de nos armées impériales s'est revêtu de son vieil uniforme pour venir saluer la colonne héroïque et visiter les Invalides, temple militaire où repose immobile le héros infatigable de tant d'entreprises gigantesques et de tant de batailles. Là, c'était un grenadier de la garde; ici, un volite, un cuirassier, un hussard, un chasseur à cheval; cependant la foule étonnée s'arrête avec curiosité en les voyant passer, et les regardait d'un œil surpris et respectueux. Cette époque impériale est si loin de nous, moins par les années que par les sentiments et par la grandeur des événements, qu'il semble, quand par hasard on en rencontre quelques témoins encore debout, voir des fantômes séculaires tout à coup évoqués de la tombe et s'échappant de la nuit des siècles.
Par une circonstance assez singulière et que les superstitieux pourraient prendre pour une allégorie, le jour même du 5 mai, l'aigle dont nous avons dernièrement annoncé l'apparition sur les hautes tours de Notre Dame, cet aigle errant qu'on voyait depuis quelque temps planer sur plusieurs quartiers de Paris, tout à coup s'est abattu dans la plaine de Mont-Rouge; des ouvriers de carrières se sont approchés, et l'un d'eux a frappé de son bâton l'aigle impérial; celui étourdi du coup, s'est laissé prendre; le vainqueur brutal a vendu son prisonnier vingt francs à un oiseleur, et aujourd'hui le pauvre aigle est en cage. Il y restera, car Jupiter et Napoléon ne sont plus là pour tonner!
Holà! oh! quel fracas! que nous arrive-t-il? est-ce la fin du monde? d'où vient ce tourbillon de poussière? Rassurez-vous, ce n'est rien, ce n'est qu'une maison qui s'écroule; et les locataires? et les passants? Les locataires étaient absents, par bonheur;--quelle intelligence! aller se promener la canne à la main, visiter ses parents ou ses voisins au moment d'un pareil éboulement, n'est-ce pas une grande marque de perspicacité? Quant aux passants, ils ne passaient pas de ce côté, heureusement; de sorte que, par une fortune inexplicable, il n'y a eu ni morts ni blessés; cette maison qui a pris de telles licences est une maison du boulevard Bonne-Nouvelle, récemment reconstruite; il faut espérer que l'exemple ne gagnera pas les maisons voisines, et que de proche en proche nous n'assisterons pas à l'écroulement de la ville entière, le cinquième étage et les mansardes descendant à l'entre-sol et au rez-de-chaussée; mais qui sait? il ne faut pas trop s'y fier: les mauvais exemples sont contagieux, et il y a à Paris plus d'un architecte mal bâti qui fait des maisons qui lui ressemblent.
A propos de maisons, ou met en vente la maison d'or, vente volontaire et non par autorité de justice; c'est le propriétaire qui se décide à se défaire bénévolement de cet immeuble fameux et immense, véritable palais de la bonne chère et du plaisir, temple du boudoir et du petit souper. La mise à prix est de 2 millions, 50,000 francs; jamais cette maison n'a mieux mérité son nom; 2 millions! ne voilà-t-il pas, en effet, de l'argent de quoi bâtir une maison d'or?
On n'a pas oublié l'épouvantable aventure de la famille Pamel: le père, furieux et privé de la raison, tuant sa femme et deux enfants, et en laissant deux autres cruellement frappés et sanglants: ces deux infortunés échappés à la mort ont trouvé deux âmes charitables qui les ont adoptés et se chargent de leur éducation. Le sentiment public n'était pas d'ailleurs resté indifférent en présence d'un tel malheur; une souscription, ouverte au profit des deux pauvres survivants, a produit près de 10,000 francs; ce serait une misère pour un Rothschild, c'est un trésor pour ces petits malheureux! on aime à citer ces preuves de la sensibilité publique. Nous sommes moins égoïstes et nous valons mieux qu'on ne le dirait à l'apparence; et nos précepteurs politiques ont beau faire.
Il faut espérer qu'enfin M. Adolphe Adam sera membre de l'Institut, Académie des Beaux-Arts; voici bien huit ou dix fuis qu'il se présente et frappe à la porte sans être admis; mais, pour le coup, tous les augures sont en sa faveur et lui promettent le fauteuil de Berton. M. Adolphe Adam est, en effet, un compositeur fécond et spirituel: ces qualités là sont pas si ordinaires, même à l'Institut, qu'on puisse les dédaigner. D'ailleurs M. Adolphe Adam n'a pas, pour cette succession de Berton, de concurrents sérieux dans la musique dramatique: on lui oppose M. Ambroise Thomas; mais M. Adam est un combattant lyrique plus éprouvé et plus ancien, et il faut espérer que l'Académie des Beaux-Arts tiendra compte des chevrons.
Mademoiselle Déjazet a définitivement rompu avec le théâtre du Palais-Royal, après une intimité de près de dix années; Frétillon est disponible et ne demande pas mieux que de contacter une nouvelle liaison. Avis aux théâtres qui frétillent!
Après tout, si les départements viennent à Paris, Paris le leur rend bien et gagne les départements, sans compter les pays hors frontières: Paris va dans sa maison de campagne. Paris va voir ses fermes et ses bois; c'est aussi le temps où commencent les voyages: les Pyrénées, les Alpes, le Rhin, Sua et Bade attirent les imaginations malades et les corps délabrés. En définitive il sort de Paris autant de monde qu'il en entre: équilibre! poids égal! dépens compensés!
Courses de la Société d'Encouragement.
Les courses fondées par la Société d'Encouragement ont commencé le dimanche 28 avril. Trente deux chevaux étaient engagés; onze ont été retirés, vingt et un se sont produits sur le turf pour disputer les cinq prix de la journée. Une course nous a rappelé les temps honteux où la victoire était disputée au pas et avec acharnement par un seul combattant; Nativa, au prince de Beauvau, a gagné, sans se fatiguer beaucoup, le prix du cadran, 3,000 francs. Caméléon, Drummer et Governor ont fait hommage de leur entrée de 500 francs à Nativa; on n'est pas plus généreux. Quant à Ratopolis à M. Lupin, il est assez redoutable pour que Nativa se regarde, comme trop heureuse de lui laisser emporter 1,000 francs et son entrée.
Pour la bourse de 1,000 francs, entrée 100 francs, six chevaux sont partis; trois sont arrivés; Dona Isabella, première, Barcarolle seconde, et Quinola troisième; quant aux autres, nous croyons qu'ils ne nous en voudront pas de notre silence; mais, qu'ils se consolent, ce n'est pas au Champ-de-Mars seulement qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
La maison Janisset ne se contente pas d'être la maison de prédilection des riches et galants sportsmen de Paris. Tous les ans elle fait du sport pour son propre compte; elle donne des prix de course; tantôt un poignard entouré de pierres fines, tantôt une coupe d'un travail précieux et exquis. Dimanche, la coupe est échue à M. de Rothschild et à son cheval Commodore Napier. Elle tiendra dignement sa place sur les dressoirs de l'honorable consul autrichien, mais l'Illustration a songé aux amateurs qui ne sont pas admis dans les salons de la rue Laffitte; regardez admirez.
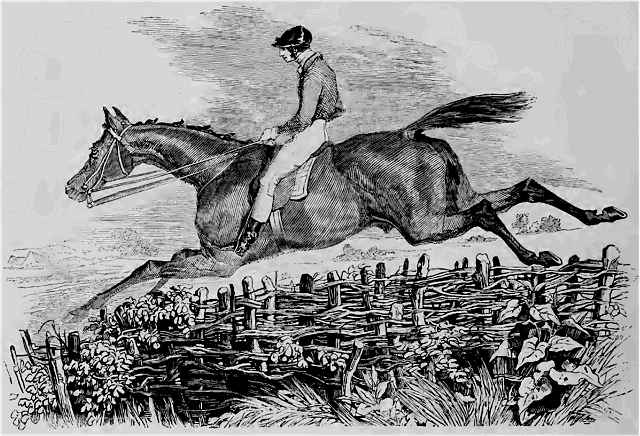
Courses de haies.--Tiger sautant une haie.
Le prix de l'administration des haras, 2,000 francs, entrée 100 fr.: Conjecture, magnifique poulain de trois ans, à M. du Morny a battu Aise, Angelina, à M. de Rothschild; le Maître d'École, au prince de Beauvau; Masmus, à M. du Cambis et Quinola, à M. Fould. Ce succès imprévu de Conjecture donnera une nouvelle activité et une autre direction aux paris sur le prix du Jockey-Club à Chantilly. Ce beau cheval va se trouver élevé au rang des trois ou quatre favoris qui se partagent les faveurs publiques.
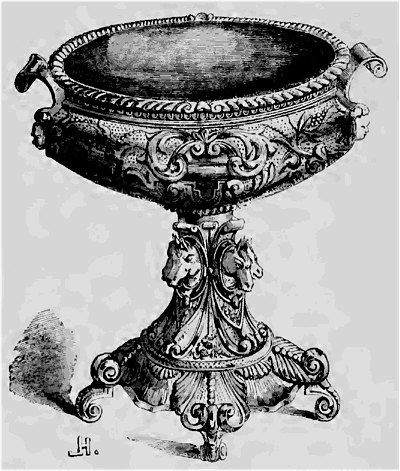
Coupe Janisset, gagnée par Commodore Napier,
appartenant à M. de Rothschild.
La course de haies inspirait un tout autre intérêt. 2,500 francs à gagner, un tour et un tiers du Champ-de-Mars, six haies à franchir, plusieurs bras ou jambes à se casser, tels sont les plaisirs promis aux jockeys de Tiger, Pantalon, Wild Irish Grit, Voyageur et King of the Gypsies. Déjà, en 1843, Tiger a battu Pantalon; mais Pantalon est opiniâtre, il tient à se faire battre une seconde fois. Tiger est trop complaisant pour ne pas lui rendre ce petit service. Voyageur et King of the Gypsies ont voulu nous offrir tous les plaisirs d'une course de haies. Et que serait une course de haies sans quelque chute? Ils ont désarçonné leurs jockeys, qui heureusement ne se sont pas blessés. Voyez sauter Tiger: quel immense développement! Il n'a pas encore gagné, et déjà vous le proclamez vainqueur. Vous ne vous êtes pas trompés: à Tiger les 2,300 francs et l'honneur de la journée.
Les courses ont continué le dimanche 3 mai, mais le ciel était moins pur et la foule moins grande. Les eaux de Versailles et un peu plus tard les eaux du ciel leur ont fait une rude concurrence. L'enceinte réservée compte moins de sportsmen à 20 fr. par tête, mais tout autant de sergents de ville et de commissaires de police. Les tribunes réservées aux merveilleuses ne se remplissent qu'avec peine; la crainte de la pluie est-elle plus forte que le plaisir de se montrer? Les absents ont eu tort; les courses ont été magnifiques d'imprévu, de vitesse et de désappointement. M. A. Lupin, l'un de nos plus sérieux éleveurs, a vu, au moment où il s'y attendait le moins, couronner ses sacrifices par le succès. Oremus, dont il désespérait, a gagné les deux épreuves du prix du ministère de l'agriculture et du commerce, 2,000 fr., avec une facilité qui a soulevé mille bravos.
Prix de l'École Militaire, 2,000 fr., entrée 150 fr.; deux tours en partie liée.--Commodore Napier; premier, à M. de Rothschild.
Le vainqueur du prix du printemps, Edwin, appartient encore à l'écurie Rothschild.
Course particulière: pari 2,500 fr., moitié forfait; distance 3,200 mètres. Ont couru Cattonian à M. Turner, et Wild Irish Girl à sir Ch. Ibbesson. Cattonian est arrivé le premier.
Le conseil municipal de la ville de Paris s'est montré généreux: il a voulu s'associer pour un prix de 6,000 fr. aux louables efforts de la Société d'Encouragement, et ce prix de 6,000 fr. n'est pas allé en aveugle s'abattre sur un éleveur indigne ou sur un vainqueur par hasard. Ratopolis à M. Lupin avait à lutter contre Mustapha à M. Aumont, l'un des gagnants présumés du derby de Chantilly. Il a mené la course si vite, que deux cents pas après le départ Qu'en Dira-t-on, à M. de Cambis, était presque distancé. Aleindor a tenu un peu plus longtemps; puis Karagheuse, Prospero, ont lâché pied; il n'est plus resté que Mustapha et Djaly. Ratopolis avait toujours la tête, et il l'a constamment gardée jusqu'à l'arrivée.--Cette course est une des plus vites que nous ayons encore vues. A jeudi et à dimanche les dernières courses de Paris.
Exposition des Produits de l'Industrie.
(Deuxième article.--Voir t. III, p. 49 et 133.)
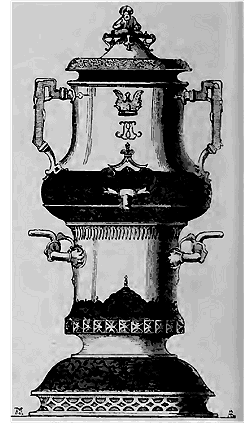
Exposition.--Fontaine à Thé.
Nos lecteurs doivent se rappeler à quelles solennités industrielles nous les avons fait assister l'année dernière à pareille époque. Après la fête du roi, dont le programme tourna malheureusement dans un cercle assez restreint, et dont les divertissements ne brillent pas par la variété, nous avons eu à leur montrer l'inauguration des deux chemins de fer de Rouen et d'Orléans. La fête, après avoir déployé ses ressources au centre de la ville, s'était portée aux extrémités, et s'était continuée à trente lieues de Paris. Aujourd'hui encore les réjouissances officielles n'ont été que le signal, que l'introduction d'une magnifique fête industrielle, qui doit se prolonger pendant deux mois; et, cette fois, ce n'est pas hors barrière, mais au cœur de la ville, que se déploient ses magnificences. Ce ne sont pas les paisibles Parisiens qui vont chercher, loin de leurs demeures, les plaisirs et les émotions; c'est la province tout entière qui envahit Paris, et qui vient se livrer pieds et poings liés, mais bourse déliée, aux bons hôteliers de la capitale, aux restaurateurs et aux directeurs de spectacle. Aussi, voyez dans cette foule ébahie, qui se promène le nez en l'air et les mains sur les poches, quelle naïve admiration, comme tous les monuments sont visités avec un pieux respect, et quel enthousiasme pour les décorations de nos places et de nos jardins publics, pour la marqueterie de mauvais goût de la place de la Révolution comme pour la
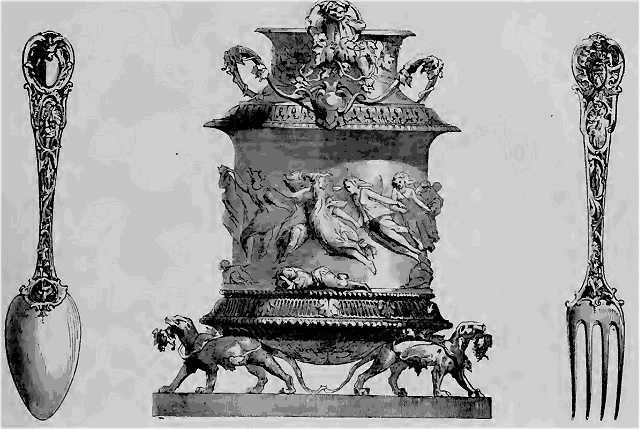
Couvert de Chasse et Seau à rafraîchir le vin, par M.
Morel.
place du Carrousel, malgré son état pitoyable. Quant à nous, qui nous étions résignés et habitués à voir Paris rentrer dans son calme de tous les ans dès que les feuilles reparaissent aux arbres et les fleurs dans les jardins, nous avons été surpris et effrayés de cette avalanche de visiteurs qui vient avec fracas rouler dans les rues paisibles de Paris.
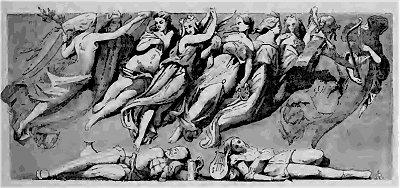
Développement de la frise du seau à glace.

Bijouterie: Étalon par M. Morel.
Mais, avec ces immenses machines qui fonctionnent maintenant à chaque extrémité de Paris, nous devons nous attendre à bien d'autres miracles; chaque coup de piston de cette machine amène, dix fois par jour, sans gêne, sans trouble et sans malheur, des milliers de curieux provinciaux; et la machine ne s'arrêtera pas, elle va, elle va toujours en avant, en arrière, apportant, emportant, déposant, reprenant, et il ne tiendra pas à elle que la France entière ne vienne jouir du magnifique spectacle que lui offre en ce moment la capitale.
Aux deux extrémités d'une ligne, qui s'étend du Louvre aux Champs-Elysées, c'est-à-dire à travers des palais et des jardins, les artistes et les industriels ont été conviés à venir exposer leurs œuvres. Le. Musée de Peinture et le Palais de l'Industrie, tels sont les deux termes d'une course entreprise à travers les Tuileries et la place de la Révolution. Au Louvre, ou reçoit l'œuvre d'art, l'œuvre exceptionnelle, le chef-d'œuvre, le plus possible du moins; au Palais de l'Industrie, le chef-d'œuvre est prohibé; ce qu'on demande à l'industriel c'est une fabrication bonne et continue, c'est de livrer à un prix qu'il doit déclarer, en envoyant ses produits à l'exposition, et aussi bien confectionnés que ceux qu'il expose, tout ce que le consommateur peut lui demander. Pourtant, sans examiner ici comment l'artiste et l'industriel ont
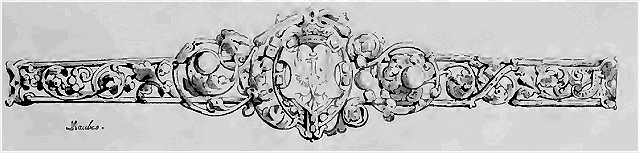
Bijouterie: Bracelet par M. Morel.
répondu à l'appel qui leur a été fait, sans nous préoccuper en ce moment du plus ou moins de perfection apportée par l'artiste à son œuvre, par l'industriel à sa fabrication, disons que l'une et l'autre de ces deux expositions, celle qui finit et celle qui commence, celle qui ne s'adresse qu'aux sentiments les plus élevés de l'homme et celle qui parle plus spécialement à son intelligence, que ces deux expositions sont bonnes à voir, et que c'est un des plus imposants spectacles, un des fruits les plus admirables de l'état de paix dans lequel nous vivons et de l'essor qu'a pris l'esprit humain, que cette réunion d'hommes remarquables à un titre quelconque, qui, à un jour donné, ont quitté le fond des provinces les plus reculées, pour venir s'exposer aux regards de tous, et se faire juger par leurs rivaux et leurs concitoyens.
D'autres ont rendu compte aux lecteurs de l'Illustration de l'exposition de peinture, et signalé à leur attention les ouvrages remarquables du Salon: à nous maintenant de les promener dans ces vastes salles où se presse aujourd'hui le public, et d'indiquer, bien sommairement il est vrai, les produits qui nous ont semblé dignes de notre juste admiration. Notre tâche a été rendue singulièrement difficile par les retards qu'a subis le transport des objets qui doivent figurer dans cette exposition, et qui, à l'heure où nous écrivons, ne sont pas encore tous placés, étiquetés et numérotés. Pour la peinture, un terme fatal est indiqué, passé lequel les portes sont impitoyablement closes au retardataire, et le jour de l'ouverture, la foule arrive et voit les tableaux rangés avec ordre: elle peut faire son choix et distinguer telle ou telle œuvre. Il n'en a pas été de même pour l'industrie: le 1er mai, les salles de l'exposition étaient encore dans un désordre difficile à décrire; les seuls objets que le public ait pu examiner étaient les machines; partout ailleurs des barrières s'opposaient au passage des curieux, qui, désappointés, refluaient, au milieu des locomotives, des pompes et des machines à tisser. Ce n'est donc pas encore l'impression générale que nous a causée la première vue de l'exposition que nous pouvons exprimer à nos lecteurs.
La vue d'ensemble nous manque, et nous sommes obligés de nous en tenir aux détails, qui, eux-mêmes, ne sont pas encore fort nombreux. Une autre difficulté que nous devons signaler consiste dans la manière dont est rédigé le livret de l'exposition. Le désordre y est tel qu'il est impossible de se rendre compte de la quantité d'objets de la même catégorie, à moins de se livrer à un travail long et minutieux. Les exposants y sont rangés, nous le supposons du moins, par ordre d'arrivée; les produits ne sont pas classés: cependant rien n'était plus facile, et nous ne concevons pas que, pour une exposition prévue depuis cinq ans, ordonnée depuis six mois, les listes d'exposants n'aient pas été envoyées en temps utile pour qu'il fût possible de les classer suivant les catégories qui ont présidé au choix du jury d'examen. Nous serons donc obligés, malgré notre bonne volonté, de rendre à tous et à chacun la justice qui leur est due, d'en passer sous silence, et peut-être des meilleurs. Nous ferons comme l'abeille qui va butinant de fleur en fleur, trop heureux si nous parvenons à amasser assez pour satisfaire la juste curiosité de nos lecteurs.
Une première indication nécessaire pour guider les visiteurs dans la promenade industrielle à laquelle nous les convions est celle des galeries où le directeur de l'exposition, plus intelligent que le rédacteur du livret, a réuni les produits de chaque branche d'industrie.
La galerie du milieu, ou cour couverte, renferme les machines; chèvres, cabestans, locomotives, modèles de chemins de fer, chaudières, voitures, machines à filer, à tisser, à faire le papier, et en général les produits encombrants. Les quatre autres galeries sont formées de quarante-deux travées triples à double galerie, avec une table au milieu. La galerie du nord est occupée par l'orfèvrerie, les bronzes, les instrument d'optique, de mathématique, de musique, l'horlogerie, les armes, les cristaux; la galerie de l'est contient les porcelaines, les faïences, les poteries de toute espèce, les papiers peints; la galerie du midi, les étoffes précieuses; celle de l'ouest, les meubles, les objets d'art et de luxe. Tel est le magnifique ensemble que doivent présenter ces galeries, quand tous les produits seront classés et arrangés symétriquement. Le Palais de l'Industrie est, de plus, entouré d'une balustrade qui laisse, outre la promenade des Champs-Elysées et l'enceinte, un espace de dix mètres de profondeur, où l'on voit déjà des tentes, des pompes, des bestiaux envoyés par l'agriculture, innovation qui va prendre un grand développement. Tout le pourtour de cette balustrade est en outre éclairé pendant la unit par trente-deux lanternes, d'après le système de MM. Busson et Rouen.
Nous avons donné à nos lecteurs, dans un article précédent, le chiffre des industriels admis aux précédentes expositions; le nombre en est encore augmenté en 1844: il est de 3,963. Plus de 5,000 s'étaient fait inscrire, mais les jurys d'admission ont cru devoir en repousser un certain nombre dont les produits ne présentaient pas les conditions nécessaires: peut-être même, autant que nous avons pu en juger par un premier aperçu, auraient-ils dû se montrer plus sévères dans leurs choix, et ne pas laisser envahir les galeries par une foule de productions indignes d'y figurer.
Avant de commencer avec nos lecteurs notre exploration à travers les vastes galeries dont nous venons de leur indiquer les divisions principales, il n'est peut-être pas hors de propos de jeter un coup d'œil rapide sur l'histoire générale de l'industrie en France, nous pourrions presque dire de l'industrie dans tous les pays civilisés. En effet, partout elle a suivi la même marche, passé par les mêmes phases, grandi et vécu de la même manière. Nulle dans le premier âge des peuples, quand la force est le droit, quand la seule matière nécessaire à l'existence de chacun est pour ainsi dire le fer, elle prend naissance dans les besoins plus développés, dans les distinctions de castes, qui donnent pour lot aux uns de se battre sans travailler, et aux autres de travailler sans se battre. L'industrie est d'abord un commerce d'échange; l'invention d'un signe particulier, représentatif d'une valeur purement de convention, de la monnaie, lui donne un caractère différent, bientôt les besoins du luxe et les raffinements de la civilisation lui impriment un essor remarquable; le commerce devient industrie; les systèmes de douanes et de tarifs donnent une immense valeur aux productions d'un pays, et lui permettent d'aborder les marchés étrangers. Alors la science de l'industrie entre dans le domaine de l'économie politique. Ce ne sont plus les commerçants qui la pratiquent et l'enseignent; il ne sont plus que des instruments dociles entre les mains d'un gouvernement éclairé.
Telle est ou au moins telle doit être l'industrie. Voyons si en France elle a suivi la marche que nous venons d'indiquer sommairement. Nous ne la prendrons pas à son berceau, ni même à la première trace qu'elle a laissée dans l'histoire. Notre cadre ne le comporterait pas, et d'ailleurs les développements que cette étude nécessiterait ne pourraient trouver place ici. La véritable ère de notre industrie date de l'époque où tant de grandes choses ont commencé en France, de celle de l'émancipation et de la régénération sociale. Avant ce moment, elle a seulement servi à faire naître, à propager et à hâter la maturité des idées libérales, de la suppression des privilèges.
Deux grands hommes cependant, Henri IV et Sully, érigent en maxime de gouvernement la nécessité d'encourager l'industrie, le commerce et l'agriculture. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de l'État, disait Sully, et dans sa conviction rigide, il ne négligeait rien pour les aider. Henri IV étendait davantage et sur d'autres branches d'industrie sa royale protection. Il plantait des mûriers, il dotait le royaume de diverses manufactures de tapis de Perse, de glaces de Venise, etc., et surtout, titre immortel de gloire, il prêtait son appui à la construction du premier canal à point de partage conçu et exécuté en France, du canal de Briare.
Colbert, après eux, est celui de tous les ministres des rois de France qui s'est le plus occupé de l'industrie. Il sentait profondément que le travail est la véritable force des États, il a favorisé l'agriculture, principalement par des réductions d'impôt. Il a mis en œuvre tous les moyens propres à protéger l'industrie et à lui ouvrir de nouveaux débouchés. Il appelait en France les manufacturiers et les savants les plus célèbres des pays étrangers, et sous son administration, en moins de vingt années, la France égala l'Espagne et la Hollande pour la belle draperie; le Brabant, pour les dentelles; l'Italie, pour les soieries; Venise, pour les glaces; l'Angleterre, pour la bonneterie; l'Allemagne, pour le fer-blanc et les armes blanches, et la Hollande, pour les toiles. Le canal du Languedoc était mené à bonne fin; enfin, Colbert fit paraître l'ordonnance de 1664, code commercial de la France pendant plus d'un siècle. Il fit rédiger, sous le titre de règlements, des traités complets, où les procédés de fabrication étaient décrits avec le soin le plus minutieux. Malheureusement les corporations immobilisèrent l'industrie au moyen de ces instructions, qui devinrent leurs règles, et des règles fixes et invariables fermant la porte à toute innovation, à toute invention, et ôtant par suite à l'industrie son plus puissant stimulant, la possibilité de la concurrence. C'est ainsi qu'une chose excellente en principe et dans l'intention de son auteur devint une force retardatrice du progrès industriel.
Après la mort de Colbert, le mouvement commercial et industriel s'arrêta. Un coup funeste d'ailleurs pour l'industrie, coup si funeste qu'aujourd'hui même la France en sent encore la portée, la révocation de l'édit de Nantes, vint frapper le commerce de la France. Plus de cinquante mille familles sortirent du royaume, allant porter chez les étrangers les arts, les manufactures et les richesses de leur ingrate patrie.
Une des grandes entraves au développement de l'industrie était, nous venons de le dire, rétablissement des corporations prenant pour règles les instructions rédigées par Colbert. Un ministre de Louis XVI, Turgot, le sentit, et il eut le courage de proposer et le bonheur de faire sanctionner et enregistrer l'édit de 1776, qui proclame l'abolition des jurandes et maîtrises. Mais ce bonheur ne fut pas de longue durée: deux mois après, l'édit était rapporte, et Turgot forcé de donner sa démission. Cet acte de honteuse faiblesse de la part du roi, loin de conjurer l'orage qui grondait de tous côtés autour du trône, ne fit que lui donner de nouvelles terres et, disons mieux, de nouveaux et plus plausibles motifs. Quoi qu'il en soit, bien que Turgot ait succombé dans la lutte, c'est à lui qu'on doit reporter l'honneur de la chute des corporations qui n'eut pourtant lieu que quinze ans plus tard. Turgot fut plus heureux dans l'exécution d'une autre mesure d'une importance immense pour l'avenir agricole de la France, la suppression des douanes intérieures et la libre circulation des grains; on lui doit aussi l'édit sur la libre circulation des vins, sur la suppression de la corvée et la confection des routes à prix d'argent.
Le commerce extérieur était enlacé à cette époque d'une multitude de liens qui, sous le nom de tarifs de douanes et avec la prétention de protéger les nationaux, livraient le marché français à une contrebande effrénée. Un traité intervint en 1786 entre la France et l'Angleterre; ce traité, en laissant subsister quelques prohibitions, remplaçait les autres par des droits calculés sur le taux auquel s'opérait la contrebande, tarif suffisamment protecteur, puisque malgré la contrebande, nos fabriques faisaient des progrès évidents.
Enfin vint la révolution, qui devait donner l'essor le plus brillant à toutes les libertés; ainsi l'égalité devint la loi, la division des propriétés, la constitution de l'unité française sont dues à l'assemblée constituante. En deux ans cette assemblée se signala par une foule de mesures favorables au développement de l'industrie et du commerce. En 1790, fut décrétée la suppression des traites ou douanes intérieures, tous droits seigneuriaux et féodaux sur la circulation, la vente, le magasinage et la manutention des marchandises. La même année furent décrétées la propriété des découvertes et perfectionnements industriels, et la loi des brevets d'invention, et enfin, en 179, la constituante vota l'abolition des jurandes et maîtrises, et établit en même temps un droit de patente sur les fabricants et industriels de toutes les classes. Plus tard elle vota le tarif des douanes en se basant sur les principes suivants:
1º Affranchir de droits tes productions les plus indispensables à la subsistance et les matières premières les plus utiles aux fabriques nationales;
2° Imposer à l'entrée des droits d'autant plus forts sur les produits des fabriques étrangères qu'ils sont moins nécessaires à la fabrication ou aux fabriques nationales, ou qu'ils ont reçu à l'étranger une valeur industrielle nuisible aux fabriques du même genre que possède le royaume;
3° Favoriser autant que possible l'exportation du superflu des productions de notre sol et de notre industrie, et retenir par des droits les matières premières utiles à nos manufactures.
Tel est l'ensemble des grandes mesures qui signalèrent l'existence de l'assemblée à laquelle la France doit les premiers pas qu'elle ait faits dans la liberté et les premières bases sur lesquelles elle a fondé sa grandeur future. A ce moment, d'ailleurs, commence la grande lutte de la France contre l'Europe, lutte dont la partie commerciale devait se personnifier dans le blocus continental. La crainte des invasions étrangères a fait surgir comme par enchantement des arts tout nouveaux en France. La fabrication des fusils, des armes blanches, du salpêtre, de la poudre, des bouches à feu, fut ou créée ou renouvelée à cette époque. De là date également l'alliance intime de la théorie et de la pratique, de la science qui guide l'application, de la fabrication par des procédés rationnels; la routine est abandonnée de tous côtés; les faits chimiques et mécaniques, mieux étudiés, mieux connus, la remplacent. A la Convention sont dus l'organisation de l'École Normale, de renseignement au Muséum d'histoire naturelle, le Conservatoire des arts et métiers, le bureau des longitudes, et enfin la création d'une école qui a rendu à la France tant d'immenses services, de l'École Polytechnique.
Nous passons sous silence les jours mauvais où le système prohibitif reparut dans toute sa force; à ce moment, où la haine des étrangers était profondément enracinée dans l'esprit français, on faisait entrer précieusement dans les mœurs toutes les mesures qui semblaient devoir leur être préjudiciables.
Nous nous arrêtons ici dans le tableau rapide que nous avons voulu tracer de la marche de l'industrie; après les guerres de la révolution et de l'empire sont venues des années de paix, pendant lesquelles le gouvernement a cherché à donner à l'industrie tout son essor, au commerce tout son développement. A-t-il réussi? Nous n'hésitons pas à dire que chaque jour nous rapproche du but tant désiré, que les systèmes de douanes s'améliorent, que les traités de commerce se concluent sous des inspirations plus libérales, que les voies de communication, en se perfectionnant, tendent à supprimer des dépenses improductives, et à alléger les matières premières des énormes frais de transport qui pèsent principalement sur elles et réagissent par conséquent sur le prix du produit.
Maintenant, devons-nous faire commencer aux lecteurs la revue des produits de l'exposition, ne devons-nous pas plutôt attendre que tout soit en ordre et exhibé? Nous serions de ce dernier avis. Cependant nous ne pouvons résister au plaisir d'offrir aujourd'hui à nos lecteurs le dessin de quelques pièces d'orfèvrerie les plus remarquables de l'exposition, nous réservant d'y revenir plus tard, et de donner une idée générale des produits de l'orfèvrerie et du plaqué.
L'exposition de M. Mayer consiste en surtout, pièces de table et de toilette en orfèvrerie. Nous avons retrouvé dans ces productions le bon goût et surtout l'extrême habileté de nos ouvriers; la fontaine à thé exécutée pour lord Seymour est un beau spécimen de la perfection à laquelle l'art est arrivé.
Nous donnons quatre dessins d'un autre artiste en orfèvrerie et bijouterie, M. Morel, un bracelet, un couvert de chasse et un flacon; nous blâmerons dans ce dernier bijou la position forcée des deux torses de femmes, espèce de cariatides qui descendent le long du flacon. Mais la pièce capitale de l'exposition de M. Morel est un seau à rafraîchir le vin. Ce seau, en argent, est d'un admirable travail; sur le pourtour est une scène tout à fait symbolique, dont les dessins sont d'une grande pureté; quatre personnages couchés et endormis par l'influence du vin, dont on voit à leurs pieds les coupes vides, rêvent, et au-dessus de chacun d'eux court, en guirlande, le sujet de son rêve, de ce rêve qu'il fait, probablement, étant éveillé; au guerrier, la gloire, le laurier et le char triomphal; au philosophe, la science et les douceurs de cette divine maîtresse; au poète, les muses gracieuses, les harpes éoliennes, le sourire de la beauté et les applaudissements de la foule; à l'homme du peuple, enfin, aux épaules robustes, à l'imagination ardente, mais peu raffinée, les jouissances matérielles. Tout cela est rendu avec un rare bonheur d'expression, et fait honneur à l'artiste et à l'ouvrier.
Une autre fois nous reviendrons sur d'autres œuvres non moins remarquables, dues au ciseau d'artistes déjà connus et aimés du public, mais que le défaut d'espace nous force à négliger aujourd'hui.
Salon de 1844.
(7e et dernier article.--Voir t. III, p. 33, 71, 84, 103, 134 et 148.)
PEINTURE ET DIVERS.
Dans cet article, qui est le dernier donné par ce journal sur le Salon de 1844, force nous est de faire une Olla podrida, de parler de tout un peu, de la peinture, des pastels, de la gravure, etc. Nous dirions, en commençant nos critiques, qu'entreprendre une revue de l'exposition, c'était entreprendre une rude tâche. En effet, que d'erreurs nous aurons commises, et pour combien d'omissions serons-nous blâmé par les artistes dont les noms n'ont pas même été imprimés dans l'Illustration! Qu'ils soient justes à leur tour, nous ne pouvons pas refaire un livret illustré; il nous faut choisir, et nous avons la liberté du choix.
Ceux que nous avons méconnus ou omis se consoleront en se disant qu'ils ne sont pas les seuls; ceux que nous avons critiqués auront la ressource de répondre que nous ne sommes pas infaillible; ceux que nous avons loués nous remercieront du fond du cœur.
M. Romain Cazes a peint un Ave Maria qui ne laisse pas d'être une œuvre à citer. Les figures ont une expression religieuse qui est tout à fait dans le style convenable au sujet; l'Ave Maria est traité avec sagesse, et le peintre s'est occupé de rechercher la forme, qu'il a trouvée, dans certaines parties complètement, faiblement dans d'autres parties; mais l'intention n'échappe point aux yeux des spectateurs. La couleur du tableau de M. Romain Cazes est agréable, un peu pâle cependant. Son Portrait de madame la baronne de P... doit avoir de la ressemblance, car en y remarque une harmonie qui ne peut guère exister dans un portrait, si ce portrait n'est point une copie exacte de l'original.
La manière de M. Hippolyte Lazerges est plus sévère et plus large que celle de M. Romain Cazes, et convient mieux aux tableaux de genre religieux. L'Agonie du Christ au jardin des Oliviers est peinte avec conscience. Toutefois le grand écueil n'a point été évité, à savoir la noblesse du personnage divin. Sommes-nous trop exigeant, ou bien le peintre n'a-t-il pas assez étudié sa composition? C'est au public connaisseur à décider. Saint Jean évangéliste a plus de grandiose que l'Agonie du Christ, quoique le peintre ait employé les mêmes moyens pour ce tableau que pour l'autre. Saint Jean a un air véritablement inspiré. M. Hippolyte Lazerges a exposé un bon Portrait de M. R... B.
En nous rappelant la Sainte Madeleine repentante, exposée en 1842 par M. Marcel Verdier, nous sommes surpris des progrès immenses de cet artiste. Les Jeunes Savoyardes, de M. Verdier, sont d'une jolie composition et d'une brillante couleur; la tête de la jeune fille brune a de la gravité pensive; la petite fille brune a une espièglerie charmante. Somme toute, son tableau a d'excellentes qualités. Nous n'adresserons pas les mêmes éloges à M. Verdier pour ses Portraits de madame Léon Gozlan et de sa fille, sans lui refuser néanmoins de la netteté dans le dessin.
Le talent de M. Chambellan n'est pas tourné à la peinture religieuse, et nous n'en voulons pour preuve que son tableau exposé sous le n° 303, Jésus-Christ guérit les malades qu'on amène de tous les pays a une foule de qualités, excepté celles qui seraient le plus indispensables, la majesté, l'expression religieuse, la pureté des formes. Nous conseillons à M. Chambellan de reprendre son pinceau d'autrefois, pour suivre ce précepte aussi juste que connu:
Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier.
Et vraiment, nous serions tenté d'en dire autant à M. Lécurieux, bien qu'il ait mieux réussi. Affreuse page de l'histoire chrétienne que celle où est rapporté le Martyre de saint Bénigne! M. Lécurieux a voulu reproduire les circonstances terribles de ce supplice en s'inspirant de l'école espagnole, et peu s'en est fallu qu'à force de vigueur, il n'en soit venu à une noirceur de tons déplorable et à une dureté de contours fort peu admissible. M. Lécurieux s'est arrêté à temps. Saint Bernard allant fonder l'abbaye de Clairvaux dont il venait d'être nommé abbé, est un tableau estimable dont l'effet porte moins que les Préparatifs du martyre de saint Bénigne.
La chose est pénible à dire, mais nous cherchons l'ancien M. Joseph Beaume, l'auteur de tableaux si frais et si gracieux, celui qui nous rappelait souvent, à distance, l'admirable Grenze, par la naïveté et la bonhomie que l'on rencontrait dans ses compositions. Le retrouvons-nous dans l'Éducation de la Vierge, qui est une de ces toiles que l'on regarde avec indifférence, non pas à cause de leur peu de valeur, mais parce qu'elles n'ont aucun cachet d'originalité? Agar dans le désert ne nous satisfait pas davantage. Par bonheur, un joli petit tableau, Enfants surpris par la marée, nous réconcilie avec M. Joseph Beaume; il est là dans sa sphère, il donne du mouvement aux personnages, il donne de l'expression aux figures.
Il faut s'arrêter devant le Dernier banquet des Girondins, par M. Boilly. On lit dans l'Histoire-musée de la république française, par M. Augustin Challamel: «Lorsqu'on fit sortir les Girondins de la salle d'audience, tous crièrent: Vive la république! et entonnèrent l'hymne des Marseillais. Ils jetèrent à la foule les assignats qu'ils avaient dans leurs poches. Arrivés dans leur prison, ils passèrent une partie de la nuit et les premières heures du jour suivant à se préparer à la mort; tour à tour gais ou sérieux, le cœur plein de regrets ou résignés à leur sort.» Le Dernier banquet des Girondins a été rendu par M. Boilly avec une entente parfaite de la vérité historique. Nous ne reprochons au peintre que ses tons sombres poussés à l'extrême.
Halte de paysans bretons à Concarneaux, petite toile signée du nom d'Adolphe Couveley, est un délicieux tableau, qu'il est difficile de trouver à cause de sa dimension. Les personnages sont disposés avec beaucoup de goût, le dessin est d'une simplicité charmante, la couleur est vraie.--Nous aimons aussi la Lecture et l'Automne, de M. Oscar Guêt, dont la Madeleine nous semble être un peu faiblement peinte. Ce tableau a néanmoins des qualités réelles.
Vendanges d'Alsace, par M. Édouard Elmerich, a des tons séduisants. Sans parler de la composition, qui est gracieuse et des plus simples, nous dirons que la couleur du tableau est agréable, et que son ensemble plaît. M. Elmerich fera bien, lui aussi, de se préoccuper davantage de la perspective: sa petite toile ressemble un peu à une fresque.--Au contraire, M. Émile Loubon plaît surtout par sa manière de disposer les plans. Ses Bords de la Durance et ses Souvenirs de la Camargue sont assez sérieusement faits pour satisfaite le goût des artistes, et assez agréablement peints pour plaire aux amateurs.--Le Soir et la Rêverie, de M. Émile Wattier, rappellent Watteau, dont les œuvres sont si recherchées aujourd'hui; seulement, il faudrait que M. Émile Wattier mît ses personnages en saillie plus qu'il ne le fait.--Un Concert rustique, par M. Vennemann, rappelle Téniers, avec moins d'air et moins de simplicité dans la composition.--Raphaël et la Fornarina, par M. Michel Carré, attire les regards des visiteurs, soit à cause du sujet risqué, soit à cause de la façon dont le tableau est peint.--Les quatres petites toiles de M. Oscar Gué sont tout à fait jolies, notamment Blanche de Castille, ou l'éducation de saint Louis, et Jeanne d'Albret, ou l'enfance de Henri IV.
La Nature morte, de M. Charles Béranger, ressemble à toutes celles que ce peintre a déjà exposées. Nous ne partageons pas complètement l'enthousiasme de certaines personnes à l'endroit des tableaux de M. Béranger. Les Natures mortes, de M. Henri Berthoud, sont exécutées avec talent; cependant, qu'elles sont loin d'avoir cette exactitude indispensable au genre!
La fable de l'Huître et des Plaideurs a fourni à M. Charles Bouchez l'occasion de faire un joli petit tableau, moitié genre, moitié paysage. M. Charles Bouchez n'a pas été aussi bien inspiré pour ses Vieux Matelots.
Deux peintres ont abusé de leur talent, après avoir débuté avec éclat: ce sont MM. Court et Jouy. Le premier, l'auteur de la Mort de César, est parvenu depuis, de chute en chute, au rôle de peintre d'actualité. Les Mystères de Paris fixent l'attention générale; aussitôt voici que M. Court peint Rigolette cherchant à se distraire pendant l'absence de Germain, tableau que ne recommandent ni la vigueur du pinceau, ni l'étude de l'expression. Le Domino attire l'œil, voilà tout. Les portraits de M. Court ne sont plus même aussi habilement peints que ceux qu'il exposa autrefois. Le brillant les fait seul regarder; et ensuite, après les avoir examinés avec attention, on y découvre des qualités qui condamnent les œuvres de M. Court. Le tableau officiel, du même artiste, S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans posant la première pierre du pont-canal d'Agen, est un de ces ouvrages qui se mesurent par la grandeur plutôt que par la valeur d'exécution. M. Court nous pardonnera notre sévérité à son égard; nous savons qu'il peut beaucoup; nous fermerions volontiers tes yeux sur quelques œuvres lâchées, mais il faudrait pour cela qu'il nous dédommageât par une belle composition, telle qu'il sait les faire quand il le veut.--Le second, M. Jouy, mérite, avons-nous dit, les mêmes reproches; ses portraits tombent de plus en plus dans le domaine du commerce, et ne plaisent qu'à ceux qui les commandent, ce qui est déjà quelque chose. Au point de vue de l'art, les portraits de M. Jouy sont peints avec une déplorable facilité. Son tableau officiel, le Martyre de saint André, n'est pas plus heureux que celui de M. Court.
La fécondité des deux peintres que nous venons de nommer les a perdus, ou à peu près, vis-à-vis du monde artistique; la timidité d'un peintre qui, lui aussi, a brillamment débuté, pourrait également le perdre. M. Gaspard Lacroix ne se fie pas assez à lui-même, il ne produit pas assez. De là une certaine hésitation dans le faire qui nuit à l'ensemble de ses tableaux. Les Laboureurs, dont le sujet est emprunté au Jocelyn de M. de Lamartine, ont de l'aspect, mais un peu de lourdeur dans la disposition des plans; nous préférons la Promenade sur l'eau, M. Gaspard Lacroix possède une véritable originalité; sa couleur est brillante sans exagération, et il ménage parfaitement bien les effets de lumière.
La Vue prise en Bretagne, par M. de Francesco, nous prouve que tes études de détails faites depuis longtemps par cet artiste, lui serviront fructueusement pour ses travaux à venir. Que M. de Francesco y prenne garde, cependant: son paysage n'a pas d'ensemble, nous voudrions bien ne pas lui préférer les Plantes aquatiques et l'Arbrisseau de sureau, qu'on ne peut considérer que comme des études.
M. Charles Landelle a peint deux jolis pendants qui n'ont pas un mérite égal. L'Idylle est, en réalité, moins brillante de couleur que l'Élégie: l'Idylle est un peu terne, mais sa pose est délicieuse. L'Élégie a une admirable tristesse.
Un peintre universel comme M. Horace Vernet, mais au deuxième degré, c'est M. Biard. Aucun sujet ne lui fait peur, et il les traite tous avec verve, sinon avec supériorité.
Il aurait bien dû donner plus de noblesse au roi Louis-Philippe, lorsqu'il l'a peint au bivouac de la garde nationale, dans la soirée du 5 juin 1832. D'abord le sujet ne peut nous plaire, car il rappelle des circonstances trop affreuses. Ce tableau a été commandé à M. Biard par la maison du roi; c'est affaire particulière. Mais, nous le répétons d'après bien des remarques faites par quelques plaisants, M. Biard outrage singulièrement la personne royale. A la rigueur, on le condamnerait pour crime de lèse-majesté. Et cependant, que de véritable talent dans la disposition des personnages! Combien il faut tenir compte à M. Biard de la difficulté qu'il a vaincue pour peindre tous ces uniformes de garde nationale!
La Baie de la Madeleine, au Spitzberg, a le tort d'être une continuation de son interminable série de tableaux à ours blancs, à buttes de neige, à aurores boréales. Ici, ce sont des phoques. Pour Dieu, l'année prochaine, nous prions M. Biard de nous faire faire connaissance avec d'autres animaux polaires.
On va rire devant la Pudeur orientale, et, sans pruderie, nous nous abstenons. De tels tableaux n'appartiennent pour ainsi dire pas au domaine de l'art, et plus ils sont habilement peints, plus nous en voulons à leur auteur. Il ressemble à un poète de talent composant des vaudevilles grivois tout pleins de mots gaillards et de plaisanteries épicées. M. Biard ne mérite pas les mêmes reproches pour sa Convalescence et pour son Appartement à louer, sujets plus admissibles, et en même temps mieux réussis.
Comme M. Biard, mais dans un autre genre et avec moins de supériorité, M. Alexandre Colin veut être peintre universel. Neuf tableaux composent son envoi, devant l'examen duquel nous reculons. Il s'y trouve des sujets religieux, des sujets historiques, les Quatre Saisons et une Plage à Gravelines. M. Alexandre Colin ne devrait pas éparpiller son talent; il lui arrivera malheur, à une époque où les spécialités sont encore forcées de se restreindre.
Les animaux de M. Verbœckhoven ne nous font pas oublier ceux de M. Brascassat, mais ils sont dessinés et peints avec science. On peut reprocher à M. Verbœckhoven de la lourdeur et une composition souvent mal ordonnée. Ceux de M. Louis Robbe ont certainement plus de légèreté, quoiqu'ils ne puissent soutenir comparaison avec les premiers.

Départ de Wilna, guerre de 1812,
par M. Charles Malankiewicz.
Un grand tableau, que nous ne pouvons appeler officiel parce qu'il n'a point été commandé à l'auteur, c'est le Retour de son A. R. monseigneur le due d'Aumale dans la plaine de la Mitidja, après la prise de la smalah d'Abd-el-Kader. M. Benjamin Rimbaud y a déployé beaucoup d'habileté; le groupe qui entoure le prince est fort bien arrangé.--Avec M. Eugène Appert, dont la réputation n'a pas encore égalé le talent, il faut être sévère, et cela dans son intérêt. Lorsqu'on fait un tableau tel que la Vision de saint Owens, rempli de qualités du premier ordre, on doit être blâmé pour avoir composé une toile telle que les Baigneuses dans les lagunes, pénible et malheureuse imitation de la manière de M. Decamps.--Nous avons remarqué le Dante commenté en place publique, par M. Auguste Gendron. La composition en est fort bonne, et les figures expriment parfaitement l'attention. Les deux femmes qui écoutent à gauche ont, l'une une belle tête de profil, l'autre une belle tête de face. M. Auguste Gendron devra se préoccuper avant tout de son coloris; il est pâle.--L'Enfance de Callot, par M. Alexandre Debacq, plaît par le sujet et par l'exécution--M. Auguste Bourget, qui illustra dernièrement la Chine et les Chinois, a exposé un joli paysage, la Vallée de l'Acacongue, où les Gahutchos sont groupés avec art. Sa Mosquée dans le territoire d'Assam produit moins d'effet, sans avoir pour cela moins de mérite.
Le premier des tableaux de genre historique exposés au Salon de cette année est sans contredit le Giorgione Barbarelli, de M. Baron. Quel peintre a plus de goût que ce jeune artiste? Le sujet qu'il a pris est Giorgione Barbarelli faisant le portrait de Gaston de Foix, duc de Nemours. Le célèbre maître du Titien naquit à Castel-Franco en 1478, et mourut en 1511, à l'âge de trente-trois ans. Sa carrière de peintre fut courte et brillante; il vivait dans l'intimité des plus hauts personnages de son temps.
M. Baron le représente pourtraictant Gaston de Foix, et environné de galants seigneurs qui le regardent travailler. Il est impossible de faire un plus grand éloge du tableau de M. Baron, que de le déclarer mieux peint encore que les Condottieri de l'exposition dernière; il faudrait seulement un peu plus d'air parmi les groupes. Quant à l'expression des figures, à la pose des personnages, à l'ajustement des accessoires, il n'y a rien à reprendre. C'est toujours le même goût exquis, le même charme délicieux que l'on remarque dans les ouvrages de M. Baron. Le Giorgione Barbarelli est remarquable principalement par la surabondance des détails et par la coquetterie des tons, auxquels le peintre a sacrifié un peu la perspective.
M. Frédéric de Madrazo a exposé une Jeune fille d'Albano prenant de l'eau bénite en entrant à l'église. C'est une charmante étude qui fait le plus grand honneur à son auteur. M. de Madrazo est un des peintres les plus renommés de l'Espagne; il réside d'ordinaire à Madrid, où il s'est occupé, pendant les dernières années, de la restauration des tableaux de la galerie royale de la capitale de l'Espagne.
Un autre étranger, un Polonais, M. Malankiewicz, a envoyé aussi au Salon un tableau, que nous reproduisons également, car c'est une œuvre de mérite (voir la page précédente). Napoléon, assis dans un traîneau et enveloppé d'épaisses fourrures, part de Wilna en 1812.
M. Français est le paysagiste qui nous plaît par excellence: une allée de forêt, un site aux environs de Paris, un fourré de bois, lui suffisent pour peindre un de ces magnifiques paysages-études qui obtiennent tant de succès, et que tout le monde peut apprécier. Sous ce titre: Novembre, Paysage, M. Louis Français a exposé un tableau excellent, où l'on trouve reproduite la froide et brumeuse nature de l'automne, quand les arbres vont être entièrement dépouillés de leurs feuilles, et quand les bois ont conservé encore une teinte dorée qui plaît aux yeux et fait regretter les beaux jours de l'été. La Vue prise aux environs de Paris, à Bougival, brille surtout par les fonds. Le grand arbre sous lequel un groupe est assis a des ramures fort bien dessinées; le ton manque de puissance; c'est une reproduction un peu froide de la nature.
Il est vrai de dire que le nombre des bons paysages est grand cette année. Par exemple, dans le genre composé, tel que l'exécute M Paul Flandrin, M. Alexandre Desgoffe occupe un rang très-recommandable, Narcisse à la Fontaine est loin d'être sans défauts, et nous reprochons même à M. Desgoffe sa couleur effacée; mais comme lignes c'est un ouvrage de maître. La Campagne de Rome, plus heureuse sous le rapport de la couleur, a moins de grandeur; la lumière manque dans ce paysage. Le feuiller de M. Desgoffe est généralement un peu vague: on voit difficilement quels arbres il a voulu peindre.--M. Francisque Schœffer a envoyé cinq paysages, dont trois composés; plus de fermeté dans le pinceau, plus de largeur dans la composition, voilà ce que nous souhaitons à M. Francisque Schœffer.--Les deux paysages de M. Stanislas Thierrée révèlent un talent déjà acquis chez cet artiste. Son Étude de Forêt, notamment, est exécutée avec soin.--M. Alphonse Testard, dans sa Vue prise au canal de l'Ourcq, a fait preuve de science en matière de perspective; mais la couleur de son tableau est pâle; le mirage des arbres dans le canal produit de l'effet. Un Vieux Lapin, nature morte, par le même, est une jolie miniature... à l'huile.
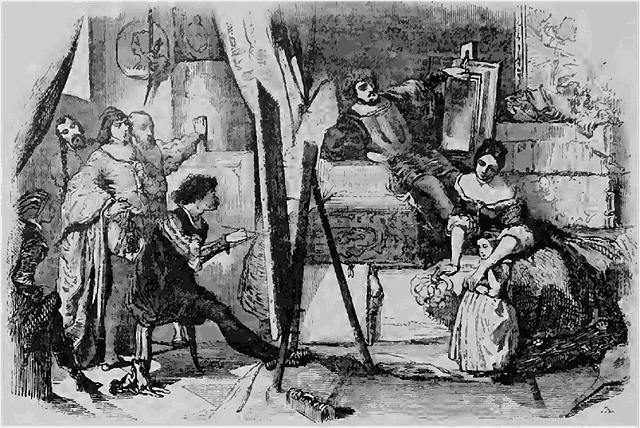
Giorgione Barbarelli faisant le portrait de Gaston de
Foix, tableau par M. Baron.

Jeune Fille d'Albano, par M. Madrazo,
de Madrid.
L'Amour de l'or, par M. Thomas Couture, a obtenu le succès que nous lui avions prédit. Plusieurs critiques ont reproché à ce tableau d'avoir besoin d'explication: donnons-la au lecteur. Un avare est assis, ayant sous ses mains des pièces d'or et des pierreries; deux femmes, une brune et une blonde, lui offrent leurs charmes, un écrivain lui montre sa plume, une pauvre mère tient son enfant et demande l'aumône. L'avare reste insensible, il n'a que l'Amour de l'or. Appelez l'œuvre de M. Thomas Couture un tableau philosophique, humanitaire, énigmatique; donnez-lui toutes les épithètes qu'il vous plaira,--il n'en restera pas moins un bon tableau auquel il ne manque qu'un peu de fini.
Il n'est pas que vous n'ayez entendu parler de M. Ducornet, né sans bras, dont les ouvrages peuvent être considérés comme des tours de force. Nous lui devons des éloges pour les portraits de femme qu'il a peints: passables, ils auraient droit à notre indulgence; remarquables, ils ont droit à notre admiration.--Les portraits de M. Charles Gomien ont beaucoup d'expression; le dessin est un peu mou, mais la couleur est sage. Celui de M. le vicomte D.... principalement est peint avec verve.--M. Antoine Chazal, qui a exposé un Groupe de fleurs et de fruits dans un vase orné d'un bas-relief, que nous nous plaisons à mentionner, a envoyé aussi un très-beau portrait.--Citons enfin les portraits peints par MM. Jeanron, Brossart, Meyer, J. Forey, Ravergie; mesdames Louise Desnos et Godefroy.

Vue prise aux environs de Paris, par M. Louis Français.
Passer sous silence les aquarelles, les pastel et les miniatures, serait de l'injustice, ces différentes branches de l'art de la peinture étant cette année en progrès.
Parmi les aquarelles, celle de M. Vincent Courdouan est tout à fait hors ligue; sa Vue prise dans les fouilles de Pomponiana, entre Hyères et Carqueiranne, est d'une vigueur de tons extraordinaire.--Les trois aquarelles de mademoiselle Anaïs Colin présentent de belles têtes d'expression;--les Chevaux de M. Foussereau ne pèchent que par la dureté du dessin;--les trois paysages de feu Gué valent les plus charmantes œuvres de cet artiste qui a tant de droits à nos regrets.--M. Petit et M. Alexandre Pernot ont chacun un talent fait: le premier a exposé une jolie Vue d'une partie des ruines de l'abbaye de Dilo; le second un très-pittoresque Souvenir d'un des vieux châteaux des bords du Rhin.
Parmi les peintres de pastel, M. V. Vidal marche le premier, surtout à cause de la grâce, du charme et de la poésie qu'on remarque dans ses ouvrages. Il est certain que Frasquita, Nedjmé et Noémi sont de délicieuses petites créations, dont les charmes ne laissent personne froid ou insensible. Petit Tony est un enfant ravissant, un de ces enfants gâtés qui font l'orgueil de leur mère. Le Portrait de M. Mélesville a du naturel et une ressemblance exquise.--M. Eugène Tourneux, dont nous avons reproduit la Bohémienne dans notre premier article, a exposé les Rois Mages, une Etude de femme d'un fort beau caractère, et un Portrait spirituellement fait.--Jouvenceau et Jouvencelle, de M. Antonin Moine, ont de la poésie.--Les portraits de M. Eugène Giraud sont dignes de la réputation acquise à ce peintre, dont les tableaux ont tant de coquetterie et tant d'esprit.--M. Camille Flers a rendu au pastel la Butte de Chelles, Vue prise de Montfermeil, et les Environs de Charenton, près Paris; l'effet de brouillard de ce dernier paysage est merveilleux.--Les pastels de M. Conrdouan sont encore plus magnifiques que son aquarelle; dans son Corsaire poursuivi par un navire de guerre par un gros temps, tout est remarquable, les vagues, les accessoires de marine et l'effet de soleil couchant.
Parmi les miniatures, on distingue les portraits de madame Guizot, de madame Martin (du Nord), de M. Le Normand, par madame de Mirbel;--les portraits de M. Paul de Pommayrac;--ceux de MM. Ol. et On. de las Marismas, par M. Passot.
Chaque jour, dans vos promenades sur les boulevards, vous voyez une exposition de gravures et de lithographies; aussi, vous ne vous arrêtez guère dans ce petit couloir qui conduit des galeries d'antiquités aux galeries de peinture. Eh bien! sans vous contraindre à regarder au Louvre ce que vous trouvez étalé dans les magasins d'estampes, il nous suffira, pour terminer notre revue critique, de vous signaler les travaux les plus remarquables de la gravure.
La gravure au burin est représentée d'abord par M. Achille Martinet, qui, dans sa Vierge au palmier, d'après Raphaël, a déployé toutes les ressources de l'art;--par M. Eugène Aubert père, qui a gravé deux paysages d'après Salvator Rosa et Ruysdael, et une Marine, d'après Joseph Vernet;--par M. Lorichon, qui n'a cependant réussi qu'à moitié dans la Bénédiction, d'après Raphaël;--par M. Aristide Louis, auteur de Mignon regrettant la patrie, et de Mignon aspirant au ciel, reproductions de deux beaux tableaux de M. Ary Scheffer;--par M. Mercuri, qui a exposé les Portraits de Christophe Colomb et du Tasse;--par M. Victor Normand, dont le Portrait de Michel-Ange pèche
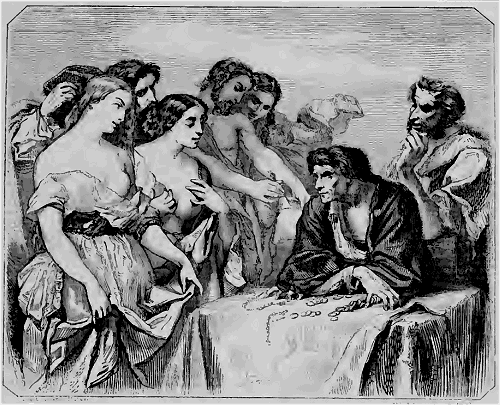
L'amour de l'or, par M. Couture.
par la dureté des tailles;--enfin par M. Tavernier, qui a reproduit le beau tableau de Murillo, Saint Gilles devant le pape.--La gravure à la manière noire et à l'aqua-tinta est représentée par M. Jazet, qui a exposé le Jour de Pâques à Saint Pierre de Rome, d'après M. Horace Vernet, et les Derniers moments de la reine Élisabeth d'Angleterre, d'après M. Paul Delaroche;--par M. Sixdeniers, dont l'Arabe en prière et le Poste au désert, d'après M. Horace Vernet, sont gravés avec une étonnante habileté;--par M. Alphonse Martinet, qui a rendu d'une façon ravissante la Jeune fille avec un chien, de M. Winterhalter;--par M. Rollet, dont nous n'aimons pas beaucoup les Adieux de Napoléon à son fils, ni la Faust et Marguerite;--par M. Alexandre Manceau, qui a gravé avec supériorité l'Agar dans le désert, de M. Murat.--Mentionnons aussi trois dessins, la Vierge d'Orléans, d'après Raphaël, par M. Mercuri;--le Portrait de Velasquez, par M. Desjardins, et la Courtisane, d'après Sigalon, par M. Vacquez.
Ici se termine notre critique du Salon de 1844. Les portes de l'exposition des produits de l'industrie sont ouvertes, et il faut que nous nous occupions de ce grand événement national. L'Illustration attend les artistes au Salon de l'année prochaine.
Théâtres.
Second-Théâtre-Français.--Sardanapale, tragédie en cinq actes, de M. Lefèvre.
Les théâtres sont d'une indigence et d'une stérilité sans égale; il y a longtemps qu'ils n'avaient mis le public à un pareil régime de famine; depuis deux mois, le feuilleton dramatique n'a certainement pas rencontré deux pièces dignes seulement d'une mention et d'un coup d'œil. Quelques chétifs vaudevilles, voilà tout ce que le ciel lui a envoyé pour sa consommation; il faut excepter cependant la Jane Grey de M. Alexandre Soumet, œuvre sérieuse et politique qui a rompu un instant cette monotonie de vaine pâture; faut-il faire aussi une exception pour le Sardanapale de M. Lefèvre? Certes, Sardanapale semble, à la première vue, mériter qu'on en parle avec ménagement et avec respect; d'abord Sardanapale est une tragédie en cinq actes, ni plus ni moins, et tout le monde sait qu'une tragédie en cinq actes n'est pas le moins du monde une chose plaisante; en second lieu, l'auteur, M. Lefèvre, est un homme qui a l'air de se prendre parfaitement au sérieux; or le bon goût consiste, sinon la franchise, à faire croire aux gens qu'on est de leur propre avis sur eux-mêmes, et qu'on les accepte pour ce qu'ils s'estiment. Nous déclarons donc positivement que M. Lefèvre est un auteur tragique des plus respectables, et Sardanapale une tragédie très-grave et très-capable de vous ôter l'envie de vous divertir. Quant à être une bonne tragédie, c'est autre chose; et dût M. Lefèvre jouer avec nous le rôle, qu'Oronte joue avec le Misanthrope, et ne pas être complètement de notre avis, nous soutiendrons, morbleu! que sa tragédie n'est pas bonne et que ses vers sont comme sa tragédie; nous ne pousserons pas, toutefois, l'affaire jusqu'où la pousse Alceste. M. Lefèvre peut donc se dispenser de se faire pendre; car, bien que ses vers soient mauvais, nous ne le croyons pas pendable pour les avoir faits.
La tragédie de M. Lefèvre débute de la façon la plus ordinaire et comme tant de vieilles tragédies, c'est-à-dire, par deux traîtres et une conspiration; ces deux traîtres sont, d'une part, le prêtre Belesès; de l'autre, Arbace le guerrier; quant au complot dont ils sont les meneurs secrets et les chefs, il a pour but de jeter Sardanapale à bas de son trône et de s'y mettre à sa place.
Sardanapale n'est pas homme à se douter du piège qu'on lui tend ni du tour qu'on va lui jouer; il a bien autre chose à faire, vraiment! Une fête sur l'Euphrate, un souper fin, des esclaves charmantes, du vin fumeux dans les coupes brûlantes, le luxe, la mollesse, le plaisir, l'insouciance, voilà les seuls travaux de Sardanapale. M. Lefèvre l'a pris tel que les annales assyriennes le lui donnent, avec l'aide de Diodore de Sicile et de ce bon Rollin.
Le voluptueux serait donc détrôné du premier coup par le traître Arbace et l'infâme Belesès, si l'honnête Salemènes et Zara la Juive ne veillaient sur lui et ne dépistaient la conspiration d'une lieue à la ronde. Zara aime Sardanapale, et c'est là une raison suffisante pour expliquer sa perspicacité et sa clairvoyance. De son côté, Salemènes professe un royalisme ardent, ce qui justifie son dévouement pour Sardanapale, le seigneur et maître du royaume.
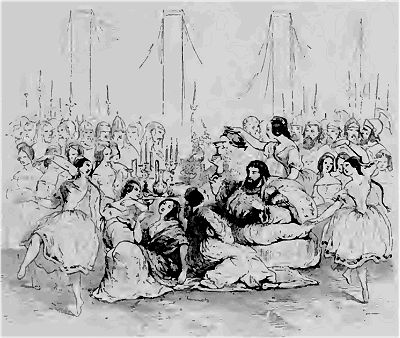
Second-Théâtre-Français.--Sardanapale, scène du 3e acte:
Sardanapale, M. Bouchet; Salemènes, M. Rouvière; Belesès, M. Rey;
Arbace, M. Achille Pirnia, M. Vorbel;
Zara, Mlle Maxime; Saphira, Mlle
Garcia.
«Prenez carde, sire, dit Salemènes; ces gens-là en veulent à votre couronne et à votre vie!--Faites attention. Majesté, ajoute Zara; ces polissons s'apprêtent à vous en faire voir de cruelles!» Mais Sardanapale ne s'émeut pas plus de ses propres dangers que s'il s agissait des affaires du voisin. Que dis-je! le prévoyant Salemènes fait arrêter préventivement Belesès et Arbace, et Sardanapale le débonnaire donne immédiatement l'ordre de les remettre en liberté. Et aussi qu'arrive-t-il? Mes deux scélérats lèvent l'étendard de la révolte (vieux style) et attaquent le palais.
Cependant que fait Sardanapale? Retiré dans un lieu de plaisance sur l'Euphrate, il boit, mange et fait l'amour conformément à sa devise; son échanson remplit sa coupe; ses esclaves sourient de leur plus voluptueux sourire et dansent à son profit des danses assyriennes qui ne sont pas sans analogie avec la polka. Il y a parmi ces complaisantes bayadères une certaine brune d'Assyrie qui laisse dénouer complaisamment sa ceinture par le roi, trait de bonne volonté qui excite la jalousie de Zara et l'oblige à faire des gros yeux à Sardanapale.
«Aux armes! crie un esclave, Belesès est là, et Arbace aussi! Défendez-vous, sire!--Diable dit Sardanapale, ceci me contrarie. J'aimerais mieux rire et boire et narguer le chagrin.» Enfin il se décide, prend son casque et son bouclier, et part pour la bataille; il se bat, pardieu, comme un lion. Le ciel d'abord récompense sa bravoure: Arbace et Belesès sont mis en déroute, et Sardanapale recommence sa bonne vie de membre du caveau de Ninive et de Babylone. Zara, qui a sur le cœur la ceinture démunie, Zara, qui pense après tout qu'une Juive un peu comme il faut ne doit pas permettre qu'on lui fasse des traits, Zara, dans un violent accès de jalousie, est sur le point de tuer Sardanapale; mais le poignard lui tombe des mains au moment de frapper.
Non-seulement Zara n'assassine pas Sardanapale,--qu'elle en reçoive mon sincère compliment,--mais elle finit par lui sauver la vie. Voici comment: Arbace et Belesès sont incorrigibles et reviennent à la charge. Dans ce second combat, Sardanapale est complètement vaincu; un peu plus, il était tué, si Zara n'avait détourné le fer: mais, comme on dit en Assyrie, Sardanapale n'a fait que reculer pour mieux sauter; Belesès et Arbace, en effet, vont s'emparer de sa personne. Pour leur échapper, Sardanapale fait préparer ce fameux bûcher dont vous avez sans doute entendu parler, et s'y jette tout vif avec Zara, non sans avoir pleuré ses péchés passés, demandé pardon au Dieu des Juifs, ce qui n'est pas sans originalité, et dit une espèce de mea culpa, trait rare pour Sardanapale.
Je ne nommerai pas Byron à côté de M. Lefèvre, comme l'ont fait tous les critiques de lundi dernier; Byron, en effet, a composé un Sardanapale étincelant de poésie; le Sardanapale de M. Lefevrc est de la prose incorrecte et rimée. Quelle analogie y a-t-il donc entre les deux ouvrages? la similitude des faits? Mais que sont les faits quand la forme et le style sont si complètement dissemblables?
Pour ne parler que de M. Lefèvre, nous sommes, en bonne conscience, contraint de lui dire que des scènes de mélodrame ne constituent pas un intérêt tragique ni une œuvre tragique, pas plus que ses alexandrins alignés tant bien que mal, et remarquables surtout par l'impropriété des mots, ne sont de la poésie. Le parterre de l'Odéon a paru partager cet avis: il a traité Sardanapale assez peu courtoisement le premier jour, et, après la troisième représentation, tout a été dit: Sardanapale s'est trouvé enterré.
Le dernier des Commis Voyageurs.
(Voir t. III, p. 70, 86, 106, 118, 138 et 150.)
VII.
RÉCIT.--AGATHE.
«Je n'insisterai pas, jeune homme, reprit Potard après une courte pause, sur les moyens que j'employai pour dompter et civiliser l'ex-guerrier. C'est pourtant l'une des opérations les plus brillantes dont j'aie parsemé ma carrière. Quoique amorcé par ma proposition, l'ancien n'avait pas complètement donné dans le panneau; il fallut achever sa conquête, le fasciner, l'éblouir, le stupéfier, l'abrutir par mon aplomb. Pour cela je l'entrepris au point de vue de sir Hudson Lowe et des couleuvres que ce fonctionnaire exotique avait fait avaler à notre infortuné Napoléon. Je fus sublime, mon cher, sublime! Mon vieux dragon clignota d'abord pour me dérober les preuves d'émotion qui se glissaient sous ses paupières; mais bientôt il n'y tint plus, lâcha subitement les écluses, et répandit un demi-litre de larmes, juste ce que peut contenir l'œil d'un grognard. Ce témoignage d'attendrissement fut le signal de sa défaite; dès lors il m'appartint, et comme premier gage, il signa de sa main, de cette main jusque là si rebelle, un ordre de vingt balles de poivre de Sumatra. C'était noblement capituler. Aussi, quel moment pour moi, lorsque, le soir même, en pleine table d'hôte, je fis circuler ce certificat de mon triomphe! Les concurrents ne revenaient pas de leur surprise, et Alfred, de la maison Papillon en fut atterré.
«J'avais donc conquis, à la pointe de l'élocution, mon entrée chez le fabricant de moutarde, il faut rendre cette justice à Poussepain, qu'il défendit ses pénates pied à pied, et me contraignit, à faire chaque jour un nouveau siège. Si je l'emportai, ce ne fut qu'à force de flonflons patriotiques et même anacréontiques. Le cerbère montrait-il les dents, je l'endormais à l'aide d'une romance. D'abord il ne me reçut que sur le seuil de sa porte, avec un auvent pour tout abri, et au milieu des outrages de l'atmosphère. Plus tard je pénétrai dans le petit comptoir vitré qui lui servait de niche, et où il expédiait ses factures. J'eus accès ensuite dans le magasin, dans la fabrique et dans les moindres recoins de son domicile industriel. Ainsi la confiance arrivait peu à peu avec l'habitude de me voir; je l'égayais, je lui devenais nécessaire. Aucun cataplasme n'avait réussi à calmer ses rhumatismes aussi bien que mes refrains du Soldat laboureur et du Champ d'asile. Quand je voulais le jeter dans des transports extraordinaires, je t'entamais sur le chapitre de Waterloo, et le magnétisais en chantant, avec toute la magnificence de ma voix;
O Mont-Saint-Jean, nouvelles Thermopyles!
Si quelqu'un profanait les funèbres asiles,
Fais-lui crier par les échos:
Tu vas fouler la cendre des héros! (ter.)
«C'est ainsi, Beaupertuis, que je maniais mon homme, et que je m'emparais de son intimité. Cependant, nos relations n'avaient pas encore franchi les sphères commerciales, et madame Poussepain était toujours pour moi une beauté invisible et mystérieuse, comme pour Alfred, de la maison Papillon, et les autres voyageurs. J'avais beau diriger des regards furtifs vers les croisées du logement, me tromper volontairement de porte, essayer de tous les stratagèmes, rien ne m'avait réussi. Le hasard, ce roi du monde, vint heureusement, est-ce heureusement qu'il faut dire? à mon secours. Une attaque de goutte cloua sur son lit le fabricant de moutarde; et, un milieu de ses douleurs, il songea à moi et à mes chansons, comme il eut songé à un baume ou à un spécifique. Un de ses employés vint me réclamer à l'hôtel et m'exprimer le désir du malade. Jugez de ma joie! J'avais pris goût à cette entreprise; elle avait l'attrait du fruit défendu. Cette tour d'airain, si bien gardée, allait n'ouvrir enfin, et me mettre en présence de la victime qui y gémissait sous la garde d'un magicien. L'histoire commençait comme un roman; seulement la princesse était l'épouse légitime d'un troupier, et le donjon une fabrique de moutarde. A cela près, je nageais en pleine chevalerie.
«Aussi n'entrai-je dans la partie réservée du logement qu'avec une certaine émotion, et le spectacle qui m'y frappa d'abord ne fit que l'accroître. Poussepain venait d'essuyer un accès des plus rudes; sa figure contractée portait l'empreinte d'une souffrance violente, et pour se soulager il sacrait comme un païen. Penchée sur son lit, une femme lui soulevait le pied, enveloppé de ouate et de toile cirée, et le déposait avec une délicatesse infinie sur un coussin qui devait le supporter. Quoiqu'il fût impossible de traiter un malade avec plus de dextérité, l'ex-dragon faisait retomber sur la pauvre créature une partie de la mauvaise humeur qu'engendrait le mal, et le nom d'Agathe se mêlait aux jurons brillants et variés qui sortaient de sa bouche, comme un feu de file. Je ne m'étais jamais fait illusion sur les avantages physiques de Poussepain; mais j'avoue que, vu en négligé, il dépassa mon attente. J'estime qu'un têtard bien réussi doit être plus voisin de l'Apollon du Belvédère que ne l'était ce jour-là le ci-devant capitaine, de la vieille, décoré de la main du grand homme. La goutte lui avait poussé les yeux si avant sous le crâne, que les prunelles étaient à peine visibles; la peau du visage avait tourné au maroquin et pris la couleur de l'acajou; la balafre qui sillonnait sa joue gauche semblait s'être agrandie par l'émaciation, et un bonnet de colon, surmonté d'une mèche altière, contrastait par sa blancheur avec les tons terreux du masque et l'expression terne du regard. En outre, dans le désordre qui résulte de la douleur, Poussepain s'offrait de temps en temps sans voiles, et c'était un spectacle peu flatteur que celui de cette académie osseuse et noire, où l'acier et le plomb avaient pratiqué de larges entailles et de nombreuses solutions de continuité.
«Je ne sais si Agathe gagnait à ce contraste, mais, à sa vue, Beaupertuis, je fus ébloui; il me sembla voir un ange. Vous ne pouvez rien vous figurer de plus pur, de plus virginal: le pinceau de l'Albane en eût été jaloux. Ce qui éclatait surtout dans sa physionomie, c'étaient la candeur et la grâce. Peut-être avez-vous remarqué, Édouard, le sentiment naïf que les peintres des grandes écoles ont jeté sur la figure de la Vierge, étonnée pour ainsi dire d'avoir un enfant entre ses bras. Ce sentiment d'innocence dominait chez Agathe. Il n'y avait rien en elle qui trahit la femme; on eût dit une jeune fille. Le regard qu'elle arrêta sur moi était, à la fois curieux et effarouché; il ne se ressentait pas de la pruderie qu'amène toujours l'expérience, et de cette modestie étudiée qui est une arme de plus à l'usage des coquettes. Agathe ignorait ou semblait ignorer ces raffinements; sa pudeur était une pudeur d'instinct, sans mélange, sans apprêt, sans réticence. Non, jamais je n'ai rien ressenti de pareil. Vous savez, Beaupertuis, que la vie des voyages n'est pas étrangère au développement des passions fugitives; je vous ai même cité, je crois, quelques-unes des grandes dames qui m'ont honoré de leur attention. Tenez, comme votre princesse de la place Bellecour, ajouta Potard, qui ne put se défendre d'une allusion maligne.
--Vous n'oubliez donc rien, troubadour, répliqua le jeune homme en se prêtant à la plaisanterie.
--Je n'oublie que le mal, Beaupertuis, ajouta Potard sur un ton plus sérieux. Les bons cœurs sont comme les bons vins, ils gagnent à vieillir.»
Et il reprit son récit.
«Agathe était vraiment belle. Je ne vous la décrirai pas, Édouard; on a trop abusé de la méthode descriptive appliquée aux femmes. Je ne mesurerai ni ses méplats, ni l'arc de ses sourcils, ni l'aile de ses narines, comme s'il s'agissait d'une surface géométrique; je ne décomposerai pas les couleurs de la palette pour vous dire ce qu'étaient ses yeux, son teint, ses cheveux, ses dents, ses lèvres; je n'emprunterai pas la langue du statuaire pour vous entretenir de son buste et de ce qu'il réunissait de charme sous tous les aspects; je ne dirai rien de son cou rond et pur comme celui d'une vierge, et des extrémités les plus délicates et les plus distinguées que l'on pût voir. C'est une triste besogne que d'analyser ce qui ne vit que par l'ensemble, de livrer une créature parfaite à une dissection minutieuse, où se perdent l'harmonie générale et la beauté de relation. Agathe était une adorable blonde; que cela vous suffise; Potard vous l'assure et Potard a la prétention de s'y connaître. J'ai parcouru les routes royales et départementales, j'ai battu même les chemins vicinaux, de manière à rendre des points à tous les voyageurs de l'antiquité et des temps modernes. Eh bien! dans le cours de mes pèlerinages, je n'ai nulle part rencontré une beauté aussi accomplie. Figurez-vous quelque chose de souple comme un jonc, des mouvements empreints d'une grâce exquise, des traits ravissants, une élégance particulière de formes, et, par-dessus tout cela, un air de simplicité et d'ignorance, de curiosité et de vivacité, que je n'ai jamais rencontrés ailleurs. Mais, Dieu me pardonne! je crois qu'à mon tour je cède à la manie des descriptions. Encore une fois, Beaupertuis, ne décrivons pas les femmes; contentons-nous de les adorer.
«C'est ce que je fis à l'égard d'Agathe. Jusque-là j'avais traité l'amour en voyageur de commerce, et je ne vous cache pas que je l'ai encore traité depuis par le même procédé. Mais, au milieu de mes vicissitudes galantes, je n'ai éprouvé ici-bas qu'une seule passion véritable, celle qui m'atteignit alors. Bien des années ont passé sur ces souvenirs; le deuil a terni cette page de mon histoire, et pourtant je sens là, quand je m'y reporte, je ne saurais dire quelle joie amère et quelle sève de rajeunissement. Pendant trois mois j'oubliai tout, même les affaires; les Grabeausec ne me reconnaissaient plus. Mon âme était enchaînée à cette maison et à ses hôtes; tout ce qui ne s'y rattachait pas m'était devenu indifférent. À quoi ne me résignai-je pas! J'étais l'esclave de Poussepain, son bouffon, son souffre-douleurs. J'épargnais ainsi à sa pauvre compagne quelques bourrades soldatesques, je partageais avec elle le calice des mauvais procédés; et ainsi s'établit entre nous une sorte d'union mystérieuse avant qu'aucun mot d'amour eût été échangé. Elle me devinait, et cela suffisait à mon bonheur; un aveu plus formel m'eût semblé moins doux. Il faut aimer, Beaupertuis, beaucoup aimer pour avoir le secret de ces délicatesses et des joies ineffables qui y reposent.
«Plus la goutte empirait, plus l'ancien dragon devenait difficile à amuser. Un homme moins épris eût envoyé l'impotent à tous les diables; moi je trouvais dans ces tracasseries même un charme de plus; c'était un sacrifice que je faisais à ma tendresse. Pour calmer les douleurs de Poussepain, j'avais épuisé mes ressources lyriques. Dans les accès ordinaires, le chant patriotique obtenait d'heureux résultats. Je touchais la fibre belliqueuse et les réminiscences de l'époque impériale; la culotte de peau faisait chorus, et la crise se passait ainsi. Mais lorsque l'attaque devint plus vive et la douleur plus aiguë, ce topique agit en sens inverse; Poussepain entrait alors dans une effervescence extraordinaire; il bondissait sur sa couche, parlait de se lever et d'aller charger les Prussiens. Au lieu de calmer ses fureurs, la romance plaintive ne faisait que les accroître, et il fallut chercher un autre moyen d'agir sur le moral du fabricant de moutarde.
«Je me rabattis donc sur la chanson comique, afin d'agir par le contraste. Il m'en souvient, c'était dans une longue soirée d'hiver. La pauvre Agathe veillait depuis deux nuits; ses joues pâlies trahissaient sa fatigue. Poussepain était devenu intolérable; un temps orageux exaspérait son mal, et il nous faisait payer la folle enchère de ses douleurs. Sa femme était à bout d'efforts, et de temps à autre, je voyais une larme furtive descendre lentement sur ses joues. Vous l'avouerai-je, Beaupertuis? il me prenait parfois des envies épouvantables d'étrangler cet homme et de délivrer l'ange dont il lassait la patience. Un pareil accouplement de la jeunesse et d'une incurable infirmité me semblait un fait contre nature; cette enfant n'était pas arrivée à la fleur de l'âge, ne s'était pas épanouie à la beauté pour être seulement une garde-malade. Cependant, je domptai ces mauvaises pensées, et cherchai une autre diversion aux maux du patient. Dans le genre badin et grivois, je possédais un répertoire fort étendu: ignorant jusqu'à quel point un ancien dragon est sensible aux jeux de l'ironie, je n'avais pas abordé cette partie de mon bagage musical. Je craignais qu'il ne prit ce divertissement en mauvaise part et ne s'effarouchât de certains refrains un peu décolletés. Au point où nous nous trouvions, je résolus de tout oser, et prenant la parole au milieu d'un fort accès.
«--Capitaine, lui dis-je, si je l'osais, je vous communiquerais une chanson d'un style léger, mais foncièrement militaire.»
«L'ex-dragon, au lieu de me répondre, continuait à se tordre sur son lit; je fis semblant de prendre ce silence pour un acquiescement, et je commençai:
Un grenadier est une rose
Qui brille de mille couleurs;
Il n'est point de périls qu'il n'ose
Les affronter par sa valeur (bis).
Chanteur, danseur, il danse, il chante,
D'un lit de paille il se contente;
Le dieu d'amour voltige auprès (bis).
Voilà (quater) le grenadier français (bis).
«A mesure que je débitais ma symphonie militaire, je voyais les convulsions de mon malade se calmer comme par enchantement; le visage reprit plus de sérénité, l'œil s'anima, l'attitude devint plus tranquille. Les doses de laudanum que nous lui administrions toutes les demi-heures produisaient un effet moins prompt et moins sûr que ce simple et innocent flonflon. Cela tenait du prodige. Il est vrai, Beaupertuis, que j'y mettais un accent inimitable et une pantomime qui semblait empruntée à la vie des camps. Agathe était là; je me surpassais à son intention. Tous les deux nous étions émerveillés du résultat, et pour assurer l'action du remède, je m'empressai de redoubler la dose.
«--Autre couplet, dis-je, et je chantai:
Le sapeur est très-respectable,
Sincère à son gouvernement;
Franc buveur, militaire aimable,
Esclave de son fourniment (bis).
A son pays vouer sa barbe,
Au feu rester droit comme un arbe,
De rien ne redoutant jamais (bis).
Voilà (quater) le vrai sapeur français (bis)
«Vous me croirez si vous le voulez, Beaupertuis, mais je vous déclare, foi de Potard, que l'accès de goutte s'arrêta devant ce couplet et ceux qui le suivirent. Poussepain, qui, depuis cinq semaines, se livrait à la plus affreuse collection de grimaces qui ait jamais déshonoré un visage humain, se sentit soulagé comme par miracle: ses membres devinrent plus souples, sa bouche se délia, le sourire reparut sur ses lèvres, et, au moment où je m'y attendais le moins, il fit chorus. C'était un homme sauvé. Dès lors, je me prodiguai; je passai en revue mon répertoire facétieux; par exemple, le conscrit de Corbeil, qui n'avait pas son pareil, et une foule d'autres nocturnes appropriés à mon auditeur. Poussepain accueillait ces cantates avec des éclats de rire qui devaient lui désopiler la rate, rétablir la circulation du sang et donner une issue à la bile qui engorgeait ses vaisseaux. Au bout d'une semaine de ce traitement musical, un mieux sensible se manifesta; les douleurs avaient perdu de leur énergie et de leur fréquence, l'appétit était revenu, la langue était belle, le pouls régulier, la physionomie meilleure. Je continuai mon système de médication et prodiguai mes sons de poitrine: le succès couronna mes efforts.
«Dans le cours de cette cure, j'eus avec Poussepain un entretien singulier, dont je ne compris le sens que plus tard. Au milieu de ces barcarolles d'un genre folâtre, je me trouvais entraîné parfois à en essayer quelques-unes qui arrivaient jusqu'à la limite de l'Anacréon. C'était voilé pourtant et pouvait se chanter parfaitement devant le sexe. J'avais même obtenu avec ces mélodies, spirituelles, mais transparentes, un succès fou dans les meilleures sociétés. Exemple: Ma Lisa, tiens bien ton bonnet! Genre léger, si l'on veut, mais d'une légèreté accessible à des oreilles de femmes mariées; pour les autres, je ne dis pas. Eh bien! un jour, au moment où j'entamais cette barcarolle, dans laquelle j'excellais, l'ex-dragon me secoua le bras de manière à me le désarticuler.
«--Potard, me dit-il à demi-voix, ne vous lancez pas tant. Il ne faut pas jouer ces airs-là sans sourdine.
«--De quoi! lui répondis-je, c'est très-décent; vous allez voir, capitaine.
«--Du tout, du tout, reprit-il avec un peu de brusquerie; il y a des jeunesses ici; gardez la chose pour un autre endroit.
«--Comment! des jeunesses! Il y a votre femme, capitaine, dis-je en insistant. Quand je vous dis que c'est gazé au possible; on chanterait cela à la cour.
«--Non, non, Potard; pas devant cette innocente, je vous en prie; ce serait mal.»
«Quand je vis que Poussepain le prenait ainsi, je n'insistai plus; mais ces paroles me revenaient sans cesse à l'esprit. Une jeunesse! une innocente! On ne parle pas ordinairement ainsi de sa femme; je m'y perdais. D'un autre côté, les manières d'Agathe avaient quelque chose d'inexplicable. La pauvre enfant m'aimait, je n'en pouvais douter; tout la trahissait, son regard, ses gestes, ses paroles. Sans nous parler, nous nous étions compris. Tout ce je que faisais pour elle, à son intention, allait droit à son cœur, et un coup d'œil expressif venait à l'instant m'en remercier. Dans les longues veillées écoulées au chevet du malade, ce langage muet, où l'amour place tant d'éloquence, nous tient lieu de tous les plaisirs et de toutes les distractions. Nous vivions ainsi l'un dans l'autre, et l'un par l'autre, et ce bonheur mystérieux et doux semblait nous suffire.
«Cependant, j'avais pu remarquer qu'Agathe n'apportait pas, dans notre complicité tacite, la prudence ordinaire d'une femme et cette timidité qui naît toujours de la certitude du péril. Elle semblait s'abandonner à un sentiment nouveau pour elle avec le calme d'une conscience pure, sans que rien indiquât une lutte, même légère, contre le sentiment du devoir. Cette conduite ne pouvait provenir que d'une perversité profonde ou d'une simplicité inouïe. La candeur de la jeune femme, l'innocence empreinte sur son front, écartaient la première hypothèse et justifiaient la seconde. Mais il restait toujours là-dessous une énigme à éclaircir. J'essayai de le faire en pressant Agathe, en lui adressant ces demi-mots qui sont presqu'un aveu. Elle ne me comprit pas ou ne parut pas me comprendre. Je n'osai pas insister, de peur d'éveiller les soupçons du fabricant de moutarde, et remis l'explication à une occasion plus sûre. L'abandon d'Agathe m'obligeait à beaucoup de réserve, et plus d'une fois, en présence de son irascible mari, je me fis forcé de contenir, par la froideur de mon attitude, des démonstrations qui auraient pu nous trahir. Telle était la situation étrange qui se prolongeait entre nous.
«Il avait été convenu que nous célébrerions la convalescence et la guérison de Poussepain par un gala en petit comité. Pour la première fois, j'étais admis à la table de l'ex-dragon et faisais diversion à l'éternel tête-à-tête qu'il poursuivait depuis le jour de son mariage. Pour que notre homme en fût venu là, il fallait une je l'eusse fasciné. Depuis que son Empereur était descendu dans la tombe, Poussepain n'avait plus qu'une chose au monde, la bonne chère et le bon vin; j'oublie à dessein sa femme. Aussi se piquait-il d'être gourmet et connaisseur en crus de Bourgogne. Son patriotisme provincial ne lui permettait pas de pousser plus loin ses recherches, mais dans les limites de la Côte-d'Or et même du Beaujolais, il s'estimait passé maître en matière de dégustation. Sa cave se ressentait de cette prétention, et sa santé aussi. Il y puisait ces accès que je venais de guérir avec des romances. Peut-être la diète et les tisanes y avaient-elles légèrement concouru; mais l'honneur le plus réel en revenait à mes sons de poitrine.
«Poussepain craignait sans doute les tortures de la goutte, mais il aimait encore plus le bouquet du liquide bourguignon. A peine guéri d'un accès, sur-le-champ il avait le soin de s'en ménager un autre, et n'épargnait rien pour qu'il fût plus violent que le premier. Son existence s'écoulait ainsi entre deux tisanes, dont l'une était l'expiation de l'autre, et celle-ci la revanche de celle-là. Agathe était habituée à ces alternatives, et passait d'un mari goutteux à un mari en goguette. Seulement, dans ce dernier état, elle avait à essuyer de plus le passage de la Bérésina ou la campagne d'Égypte.
«Le dîner de convalescence fut splendide; Poussepain aimait à bien faire les choses. Mais le luxe de la table n'était rien auprès de celui des vins. Volney, Pomard, Clos-Vougeot, Itémanée, Thorins, Nuits, tous les grands crus y passèrent, et le grognard ne s'en tint pas à une seule année; il avait à venger trois mois d'eau chaude. Vous savez, Beaupertuis, que j'ai laissé un nom parmi les hommes qui lèvent agréablement le coude. Eh bien! Poussepain faillit me compromettre ce soir-là. Heureusement une autre ivresse balançait l'effet du bourgogne. Agathe était près de moi; nos regards ne se quittaient pas; nos mains et nos pieds se touchaient. Peu à peu, la surveillance de Poussepain s'était relâchée, sa langue s'embarrassait déjà, et c'est à peine s'il avait la force d'articuler quelques mois.
«Attention, Potard, dit-il de sa voix la plus solennelle, je vais vous raconter une histoire.
«--Miséricorde, me dit tout bas la pauvre Agathe, nous y voici. Je me sauve.
«--Potard, mon bon Potard, poursuivit l'ex-capitaine de dragons, avec une effusion qu'il venait de trouver au fond de dix bouteilles, vous êtes un brave garçon... je veux faire quelque chose pour vous... Vous aimez la mémoire de l'Empereur... Vive l'Empereur!... Je vais vous raconter le passage de la Bérésina.»
XXX.
(La suite à un prochain numéro.)
La Police correctionnelle de Paris.
(Voir tome I, page 85.)
Dans un précédent article, nous avons jeté un rapide coup d'œil sur l'aspect général des audiences de la police correctionnelle; nous compléterons aujourd'hui cette esquisse, en nous arrêtant sur les détails du tableau, et en faisant passer sous les yeux de nos lecteurs les physionomies si diverses des malheureux que le vice ou la misère amènent chaque jour sur la fatale sellette îles prévenus.
L'idée que le public se fait du caractère des audiences correctionnelles est complètement inexacte; il se les représente vulgairement sous la forme joviale du vaudeville judiciaire, que son imagination, amie des contrastes, place volontiers en regard du drame grave et sérieux de la cour d'assises. Le contraste n'est pas si grand; et, sauf la différence des dénouements, les deux représentations de la justice répressive offrent plus d'une triste analogie.
La police correctionnelle est par le fait le premier degré de la juridiction criminelle; nous pourrions dire qu'elle sert de premier échelon à la cour d'assises, car le délit conduit au crime, le vol simple au vol qualifié et au meurtre. C'est vainement qu'on a appliqué à ce tribunal l'illusoire qualification de correctionnel; faut-il s'en prendre à l'inefficacité de notre code pénal? aux mauvais résultats de notre système pénitentiaire? Il est malheureusement incontestable que la police correctionnelle ne corrige pas. Nous n'en voulons pour preuve que les cas nombreux de récidives qui se présentent à chacune de ses audiences: sur vingt prévenus on en rencontre à peine cinq qui soient purs de tout antécédent judiciaire; les quinze autres arrivent devant la justice escortés de trois, quatre, six, douze condamnations antérieures.
Si cette preuve n'établit pas assez clairement le contre-sens de cette appellation police correctionnelle, en voici une autre d'une éloquence toute matérielle.
En 1828, une seule chambre du tribunal de première instance, la sixième, tenant, comme aujourd'hui, cinq audiences par semaine, suffisait pour juger toutes les affaires de la compétence de la police correctionnelle.
L'année suivante, la septième chambre civile affecta, par semaine, trois de ses audiences à la connaissance des délits correctionnels; en 1836, les affaires civiles disparurent complètement de cette chambre, dont les cinq audiences furent envahies par les causes correctionnelles.
Trois ans après, la huitième chambre civile subissait la même mollification que la septième avait subie; comme celle-ci, elle consacra d'abord trois audiences à suppléer les deux chambres correctionnelles; depuis 1840, ses cinq audiences suffisent à peine à cette destination supplémentaire.
Il est donc évident qu'il se commet aujourd'hui trois fois plus de délits qu'il ne s'en commettait il y a seize ans.
Ceci prouve que si le chiffre des corrections augmente dans le sens pénal du mot, il diminue d'autant dans la signification morale.
Mais l'on en jugera mieux encore en pénétrant avec nous dans l'enceinte du sanctuaire. Bien que les trois chambres aient aujourd'hui une importance égale sous le rapport de la gravité des délits que l'on y juge, la sixième a conservé le premier rang dans la hiérarchie. C'est la chambre mère, la chambre doyenne, et sa distribution intérieure est mieux adaptée à sa destination spéciale que dans ses deux acolytes; chez ces dernières on aperçoit les traces de l'invasion du correctionnel sur le civil: le civil, modeste dans ses exigences de localité, se contente d'un tribunal flanqué de deux sièges latéraux, l'un pour le ministère public, l'autre pour le greffier; puis d'une barre à hauteur d'appui, assez solidement construite pour supporter le poids des dossiers des avocats belligérants, et pour résister à leurs coups de poing oratoires. A cela se borne le mobilier essentiel; comme objet de luxe, comme superfluité, ajoutez-y quelques banquettes pour MM. les clercs d'avoués et pour les avocats stagiaires, et vous aurez une chambre civile complète et suffisamment meublée.
Mais si le correctionnel met le civil à la porte, il exigera, avant de prendre possession des lieux, bien des changements intérieurs, des réparations, des additions; d'abord il faudra que l'architecte du palais lui construise un banc des prévenus, puis une chambre d'attente pour les témoins, puis une enceinte réservée pour l'auditoire en sabots et en blouse qui constitue la publicité de l'audience, publicité exigée par la loi.
Les deux chambres supplémentaires sont donc assez, mal à l'aise dans leurs locaux usurpés; elle attendent avec une certaine impatience la construction promise d'un nouveau palais de justice; elles l'attendent, mais ne l'espèrent pas, car la promesse et le projet prennent de jour en jour un caractère de plus en plus vague, de plus en plus fantastique.
Entrons donc à la sixième chambre, la seule véritable chambre correctionnelle par son origine et sa disposition, la seule enfin qui soit chez elle, et qu'il soit permis de visiter sans indiscrétion malséante.
Mais je vous dis entrons, et cette invitation de cicérone ne laisse pas que d'être quelque peu téméraire et hasardée. L'entrée n'en est pas si facile que cela.
La porte principale s'ouvre au-dessus du double escalier de pierre que vous voyez à l'une des extrémités de la vaste salle des Pas Perdus. Un garde municipal en garde les abords, bien mieux gardés encore par la foule des curieux et des oisifs qui encombrent, bien avant l'heure de l'ouverture des portes, les degrés du double escalier. Essayez de vous frayer un passage à travers cette foule compacte et serrée, elle vous repoussera par le cri: à la queue! qui a pour elle toute la valeur d'un principe de droit commun. Que si, soutenu par une volonté énergique, vous foulez le principe aux pieds et parvenez à percer jusqu'au seuil la cohorte hurlante, le garde municipal vous saisira au collet et vous demandera de quel droit vous prétendez pénétrer dans l'audience publique.
«Êtes-vous témoin? montrez votre assignation.
--Je n'en ai pas...
--En ce cas, vous n'entrerez point.
--J'attendrai.
--Vous ne pouvez rester là; mettez-vous à la queue.»
Ne répondez pas, ne répliquez pas; le garde municipal est ennemi des colloques; n'ouvrez même pas la bouche, une simple velléité de dialogue lui paraît un attentat à ses épaulettes de laine rouge dans l'exercice de leur consigne, et la crosse de son fusil, la vigueur de sa poigne, le violon du poste voisin, seront les arguments irrétorquables par lesquels l'honnête gendarme croira devoir répondre à une pacifique intention de résistance.
Croyez-moi, il est plus sage et plus prudent d'obtempérer à la consigne, si peu gracieuse qu'elle soit dans sa forme. Par exemple, en redescendant l'escalier armez-vous de philosophie; vos allures de conquérant ont froissé tantôt bien des amours-propres, vous subirez à votre tour la peine du talion; un gros rire railleur accompagnera votre retraite Heureux si vous en êtes quitte à si bon marché, et si, parvenu au bas de l'escalier, vous retrouvez votre redingote entière, et le contenu de vos poches intact.
Mais ne perdez pas courage pour ce premier échec; il vous reste encore un second assaut à tenter. Au pied du grand escalier de pierre, tout à l'angle de la salle des Pas-Perdus, ne voyez-vous pas une sorte de voûte sombre et ténébreuse qui s'enfonce dans le flanc du monument? avancez lentement, à tâtons, dans cette obscurité profonde, vous finirez par vous heurter, tout au fond, à un petit escalier noir, roide et délabré, qui monte en spirale vers une région moins opaque où règne une sorte de demi-jour douteux. Grimpez à cette échelle tournante, arrêtez-vous à la première porte qui s'offrira à vous, et sonnez avec discrétion, cette porte est la porte secrète, l'entrée particulière, l'entrée de faveur de la sixième chambre.
Un garçon d'audience, en habit bleu, en cravate blanche, aux manières douces et polies, complètement étranger à la gendarmerie départementale et municipale, entrouvrira la porte et vous demandera ce que vous désirez.--Comme votre désir n'est qu'un simple désir de curiosité, gardez-vous bien de ne pas mentir. L'honnête garçon se verrait forcé, quoiqu'à regret, de vous fermer doucement la porte sur le nez. Mais à l'aide d'un petit mensonge tout à fait inoffensif, en alléguant que vous êtes le client d'un avocat, le cousin d'un plaignant, ou l'ami intime d'un témoin, la porte vous sera courtoisement ouverte, et vous serez tout doucement introduit dans la salle d'audience de la sixième chambre de police correctionnelle.
La porte par laquelle vous venez d'entrer conduit à la chambre du conseil et à la salle d'attente des témoins. Au-dessus de la porte est un ornement en relief, représentant la figure allégorique de la Vérité, tenant à la main son symbolique miroir. La porte principale est surmontée aussi d'une allégorie de la Justice: la figure est à demi couchée, sa main gauche tient les classiques balances; un glaive flamboyant brille dans sa main droite. Ce terrible attribut nous semble manquer de justesse, en égard à la localité. La police correctionnelle ne happe pas avec le glaive; elle punit par la privation de la liberté; ainsi un trousseau de clefs eût été sans doute un emblème plus exact et plus vrai dans la main de la Justice correctionnelle, que cette fantastique épée flamboyante, épouvantail que la cour d'assises pourrait revendiquer à bon droit.
L'audience n'est pas ouverte encore; les juges n'ont pas encore pris place sur leurs sièges de cuir vert à clous dorés; mais la salle est déjà envahie, encombrée par les curieux, par les témoins, par les avocats, par les jeunes stagiaires qui viennent se familiariser avec la pratique des débats judiciaires. La foule des simples spectateurs se rue, se pousse, se bouscule, dans l'espace qui lui est accordé au fond du prétoire. C'est à qui obtiendra, par droit de conquête, les premières places, contre la cloison à hauteur d'appui qui sépare cette sorte de parterre public des banquettes réservées aux témoins, et qui est coupée au milieu par un vaste poêle chauffé avec une parcimonie hygiénique. Les places des témoins se garnissent avec plus d'ordre et plus de calme. Les personnes qui doivent déposer dans une même affaire se groupent, se rapprochent, se racontent ce qu'elles ont vu et entendu, et prononcent par anticipation la condamnation ou l'acquittement du prévenu que leur déposition doit charger ou défendre.
Sur leurs assignations, les témoins sont convoqués pour dix heures; mais à dix heures on n'ouvre que les portes de la salle, et l'audience commence rarement avant onze heures. Ce retard n'accommode guère les impatients, qui ne se rendent qu'en rechignant à l'invitation de la justice, ni les ouvriers qui perdent le salaire de leur journée et ne reçoivent comme compensation qu'une misérable taxe de 2 fr. Aussi voit-on tous ces gens-là trépigner, s'agiter, assaillir l'audiencier de questions, et être tentés de crier comme au spectacle: «Commencez!»
Quant aux témoins de bonne volonté, à ceux qui tiennent à honneur de venir éclairer la justice de leurs lumières, et qui se font un plaisir du spectacle nouveau pour eux auquel ils vont assister, on les reconnaît aisément à leur attitude calme et posée, à leur toilette quelque peu endimanchée, un naïf béotisme de leurs observations échangées à voix basse. Ils ne manquent jamais de prendre l'audiencier pour un avocat, les avocats pour les juges, le greffier pour le procureur du roi.
Si vous voulez avoir des renseignements fidèles sur les habitudes de l'audience, sur tout ce qui se rattache à la police correctionnelle, approchez-vous discrètement de cette bonne et respectable figure de rentier qui cause là-bas, tout près du barreau, avec un de ces questionneurs ébahis qui viennent pour la première fois dans l'enceinte d'un tribunal, et pour qui tout est sujet d'étonnement et d'informations incessantes.
Le vieux monsieur qui répond avec une complaisance si bénévole aux mille points d'interrogation que lui pose son voisin, n'est ni un témoin, ni un plaignant, ni, encore moins, un prévenu. Aucun devoir, aucune fonction, aucun intérêt de chicane ne l'appelle dans le prétoire, et pourtant il est plus exact, plus fidèle à l'audience que les journalistes, les huissiers, les juges et les grands municipaux. Dès l'ouverture des portes, on le voit entrer des premiers, se placer invariablement derrière le banc des avocats, appuyer ses deux mains sur sa canne, son menton sur ses deux mains, attendre patiemment l'entrée du tribunal, prêter une attention soutenue aux débats, aux plaidoiries, aux réquisitoires, approuver ou blâmer silencieusement chaque jugement prononcé, et ne sortir de la salle que le dernier. Cet honnête vieillard est l'habitué de la police correctionnelle. Petit commerçant retiré des affaires, vieux célibataire sans famille, n'ayant dans son intérieur d'autre société que son chat et son serin, trop vertueux pour hanter les commères ses voisines, trop rangé pour fréquenter les cafés et se livrer aux coûteux passe-temps du domino ou du tric-trac, trop inoffensif citoyen pour prendre quelque intérêt à la polémique des journaux, il s'est créé une distraction, une occupation, je dirai presque un devoir quotidien, en s'imposant le singulier plaisir d'assister aux débats de la police correctionnelle, et d'y assister tous les jours avec une régularité, une ponctualité vraiment édifiante et curieuse!
Il se plaît, en attendant l'ouverture de l'audience, à prêter l'oreille aux propos des voisins, à se mêler à leurs conversations, à leur donner des renseignements officieux, à les instruire sur les habitudes du tribunal, à leur faire en un mot les honneurs de l'audience.
«Monsieur, dit-il et répète-t-il presque chaque jour au témoin que le hasard lui a donné pour voisin; vous voyez la droite du tribunal, c'est-à-dire à votre gauche, cette estrade entourée d'une cloison à hauteur d'appui: c'est le banc des prévenus, c'est là que viendront se placer, à tour de rôle, les prisonniers que l'on va juger dans un moment.
--Mais, monsieur, je n'y vois encore qu'un garde municipal; où sont donc les prisonniers?
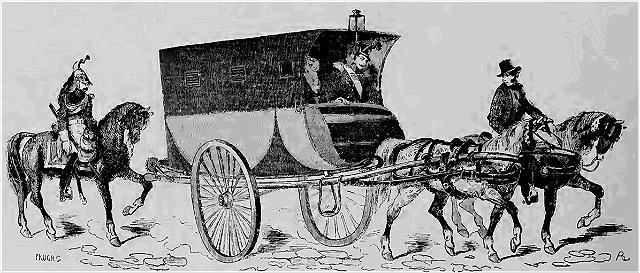
Voiture appelée panier à salade, servant au transfèrement
des prisonniers.
--Je vais vous le dire, monsieur; ne remarquez-vous pas que cette étroite enceinte parquée, qui forme le banc des inculpés, est percée dans le mur d'une petite porte jaune?
--Parfaitement, monsieur.
--Cette petite porte conduit par un étroit escalier à une étroite chambre à peine éclairée, à peine aérée, où sont transférés les inculpés en état d'arrestation préventive qui seront jugés aujourd'hui. On appelle cette espèce de cachot la petite souricière. Avant d'être entassés dans ce bouge malsain, les prévenus ont fait une halte dans la grande souricière, qui est située dans les caves du Palais-de-Justice, à une profondeur de cinq ou six mètres au-dessous des dalles de marbre de la salle des Pas-Perdus.
C'est là que, dès le matin, les prisonniers qui doivent comparaître dans la journée devant une des trois chambres correctionnelles, sont amenés des prisons de la Force, des Madelonnettes, de la Hoquette, de Sainte-Pélagie, de Saint-Lazare. Ce transfert se fait au moyen d'une voiture spéciale, nommée panier à salade, et sous la garde et la responsabilité d'un huissier audiencier et de plusieurs gendarmes.
--Panier à salade! voilà un singulier nom pour une voiture!
--Monsieur, ces voitures ont été ainsi nommées parce que, dans l'origine, elles étaient construites en osier, comme sont façonnés les paniers à salade. Aujourd'hui elles sont fabriquées plus solidement, et leur forme est celle d'une grande carriole hermétiquement fermée; mais, en changeant de forme et d'éléments de construction, elles ont conservé leur dénomination primitive.
--Monsieur, je vous remercie de ces curieux renseignements; je les rapporterai à ma femme, qui en sera charmée.
Monsieur est, sans aucun doute, avocat?
--Non, monsieur; j'aurais pu l'être, mais je ne le suis pas. Je suis tout simplement un habitué de la police correctionnelle; j'y viens tous les jours d'audience, après mon déjeuner, et j'y reste jusqu'à l'heure de mon dîner; je préfère les émotions calmes et modérées de la police correctionnelle aux émotions trop violentes de la cour d'assises; j'écoute avec intérêt les débats de chaque affaire, je me passionne doucement pour ou contre le prévenu; j'écoute les plaidoiries des avocats, ce qui n'est pas toujours amusant, mais enfin il n'est pas de plaisirs sans peines; je discute mentalement les arguments de l'avocat du roi, et pendant que les juges délibèrent, je me plais à formuler en moi-même le jugement qu'ils s'apprêtent à rendre; si ma décision est conforme à la leur, je suis excessivement ravi. Bref, c'est là pour moi une récréation économique, instructive et intéressante tout à la fois. Je suis connu des juges, des avocats, des journalistes, des audienciers, des gendarmes mêmes; et l'on me laisse entrer sans difficulté comme un ami de la maison, comme un accessoire indispensable de l'audience.
--Monsieur, j'envie votre sort... Il me semble que vous devez regretter tous les jours de n'être point avocat.
--Chut! dit le vieil habitué, nous sommes tout près du barreau, et ces messieurs pourraient nous entendre. Écoutez: on voit bien, monsieur, sans vous offenser, que vous ne fréquentez pas nos audiences...
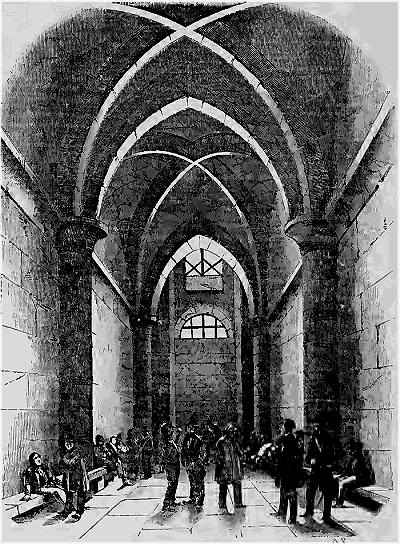
La grande Souricière, au Palais-de-Justice.
--Hélas! monsieur, j'y viens aujourd'hui pour la première fois.
--C'est donc cela: entre nous, monsieur, dit le loquace cicérone en baissant de plus en plus la voix, la profession d'avocat de police correctionnelle ne peut faire envie à personne, et, quant à moi, je l'estime un assez triste métier.
--Monsieur, vous m'étonnez!
--D'abord, dans les trois quarts des causes correctionnelles, l'avocat est complètement inutile; que diable voulez-vous qu'il vienne dire, par exemple, pour ce repris de justice qui a rompu son ban pour la dixième fois; pour cet incorrigible voleur qui comparaît sur la sellette avec une recommandation de douze ou quinze condamnations antérieures; pour cet honnête ivrogne qui a appelé un sergent de ville du nom peu respectueux de mouchard; pour ces vagabonds qui ne demandent qu'un séjour dans les prisons durant la rude saison d'hiver; pour ces pauvres vieilles femmes prévenues de mendicité et qui réclament comme une faveur d'être envoyées dans un dépôt hospitalier? Croyez-vous que la faconde des avocats soit de quelque utilité dans ces sortes d'affaires? qu'elle puisse conjurer la sévérité du tribunal envers les uns, et qu'il soit besoin de leurs phrases creuses et banales pour exciter la pitié, l'indulgence en faveur des autres? Pas le moins du inonde, monsieur; aussi les juges profitent-ils le plus souvent du temps pendant lequel ces orateurs superflus débitent leurs plaidoiries, pour délibérer sur le sort de leurs clients, ou pour s'entretenir de leurs soirées, de leurs récoltes, ou de la séance de la chambre des députés. Puis, quand ils ont accordé une honnête latitude à l'éloquence du défenseur, le président l'interrompt par ces mots sacramentels;
«C'est entendu.» Notez bien qu'il ne dit jamais: «C'est écouté.» Ici les synonymes ont leur valeur. Plus d'une fois, monsieur, j'ai remarqué que cette manière d'entendre et de ne pas écouter certains défenseurs est un bonheur pour le client défendu; et dernièrement encore, de deux prévenus inculpés de délits semblables, l'un, qui n'avait pas d'avocat, a été condamné à six mois de prison; l'autre, qui en avait un, en a eu pour un an. Après cela, monsieur, je vous dirai qu'il faut que tout le monde vive; et, en fait, ces causes sont si peu et si mal payées aux avocats, qu'il leur en faut un certain nombre pour leur donner des moyens d'existence. Je me suis laissé dire par un audiencier fort spirituel et fort malin qui m'honore de son amitié, des choses incroyables sur la manière dont quelques-uns de ces messieurs font ce qu'on appelle le client. Le client ne vient pas toujours de lui-même, il faut l'attirer, le chercher, l'accrocher parfois au passage. C'est une espèce de chasse à l'affût, au miroir ou à courre. Les plus intrépides vont bravement dans les prisons offrir leurs services à ces honnêtes clients; ils y retrouvent aussi leurs anciennes pratiques, et veillent à ce qu'un confrère perfide ne s'avise pas de les détourner à son profit. Les écrivains de la salle des Pas-Perdus sont aussi les fournisseurs de certains avocats, moyennant le partage des maigres honoraires reçus. Enfin l'avocat correctionnel qui arrive le matin au Palais, sans affaires, sans causes, ne désespère pas d'en attraper quelques-unes avant l'ouverture de l'audience en se promenant dans la salle des Pas-Perdus, et en offrant ses services aux plaideurs effarés, qu'il juge sur la mine assez naïfs pour accepter ses bons offices, assez riches pour les payer.»
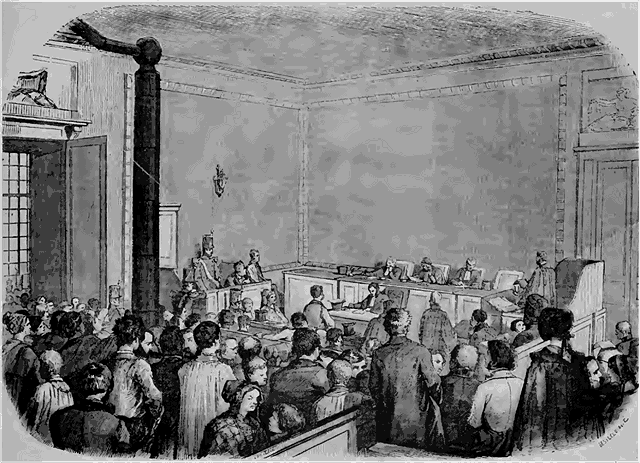
Vue intérieure de la Police correctionnelle de Paris, 6e
chambre.
Mais la voix de l'huissier de service interrompt les indiscrétions du vénérable habitué:
«L'audience! messieurs, ôtez vos chapeaux!»
A ces mots les avocats se lèvent et se découvrent pendant que les juges et le substitut montent à leurs sièges; l'auditoire s'installe, s'arrange de son mieux pour bien voir, pour bien entendre; le greffier essaie sa plume, les rédacteurs des journaux judiciaires se placent dans la tribune qui leur est réservée au-dessous du siège du ministère public; le vieil habitué hume d'un air satisfait et attentif une prise de tabac. Le silence s'établit, et le président prononce la formule;
«L'audience est ouverte: audiencier, appelez les causes.»
(La suite à un prochain numéro.)
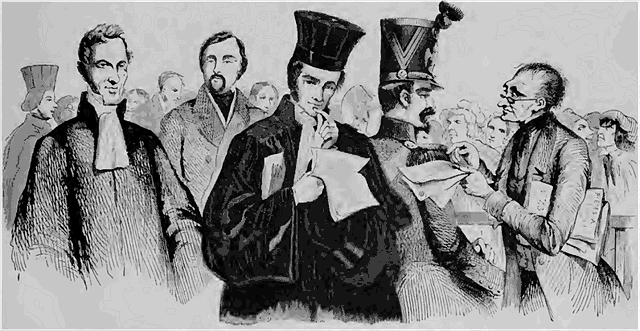
L'Huissier.
Le Journaliste.
L'Avocat.
Le Garde-Municipal.
L'Habitué.
Types de la police correctionnelle.
Bulletin bibliographique.
Histoire de la Poésie française à l'époque impériale, ou Exposé par ordre de genres de ce que les poètes français ont produit de plus remarquable depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu'aux premières années de la restauration; par Bernard Jullien.--Paris, 1844. Paulin. 2 vol. grand in-18.
M. B. Jullien a entrepris d'exposer, dans un cours professé à l'Athénée royal, l'histoire critique de la littérature française à l'époque impériale, en faisant toutefois remonter cette époque jusqu'au moment où Napoléon a pris, sous le titre de consul, le gouvernement de la France. Les leçons des années 1842 et 1843 ont été consacrées à l'histoire de la poésie. Ce ces leçons que le professeur publie aujourd'hui, telles qu'il les a prononcées, sauf quelquefois quelques différences à peu près inévitables entre un cours et un livre, et dont il rend compte dans sa préface.
On trouve aussi dans cette préface un programme par lequel M. Jullien avait annoncé son cours, et qu'il est convenable de transcrire ici, parce qu'il fait connaître nettement le but du professeur, et les motifs qui l'ont déterminé dans le choix de son sujet. Voici ce programme:
«La littérature impériale est aujourd'hui peu connue: elle est surtout peu estimée; peut-être cela vient-il précisément de ce qu'on ne la lit guère, qu'on la juge par oui-dire et sur parole.
«On se rappelle en effet les combats que se sont livres, à une époque encore peu éloignée de nous, deux doctrines littéraires fort opposées en apparence: les deux partis ont tour à tour triomphé dans les journaux et recueils périodiques qui recevaient leurs inspirations. La lassitude du public, la fatigue des combattants, ont seules terminé la guerre; la victoire, cela devait être, est restée à celle des deux armées qui se portait, à droit ou à tort, comme promotrice des idées nouvelles. Tous les journaux ont subi le joug du vainqueur. Ceux qui ont refusé de courber la tête ont été contraints de garder le silence; et bientôt il a été dit, écrit, répété partout et accepté sans réclamation, que l'esprit français, par une raison ou par une autre, avait à peu près sommeillé pendant quinze ans; que cette époque, frappée d'une stérilité houleuse, n'avait rien produit qui méritât d'occuper les loisirs, à plus forte raison d'appeler l'étude de nos contemporains.
«Il est permis aujourd'hui de ne pas accepter une condamnation si rigoureuse: il est permis de réviser ce procès, d'appeler, comme le voulait l'auteur de la Métromanie;
«Du parterre en tumulte au parterre attentif.
«Voilà plus d'un quart de siècle que l'empire a cessé; les passions sont éteintes, les haines ne subsistent plus, les comparaisons ne peuvent irriter personne, les louanges données aux morts ne porteront aucun ombrage aux vivants.
«Faisons donc de nouveau l'inventaire des productions de cette époque, examinons de sang-froid, et pièces en main, ce qu'elle nous a laissé; peut-être y trouverons-nous la preuve que la France n'a pas alors dû toute sa gloire aux armes; qu'elle n'était pas, dans la littérature, aussi déchue qu'on a bien voulu le dire, et que plusieurs des ouvrages qu'elle a vus naître pourront, comme ceux des siècles précédents, affronter sans crainte le jugement de la postérité.»
M. Jullien se propose donc de tous ramener à l'étude de la littérature impériale; il n'en est pas seulement l'historien, il s'en constitue le défenseur, et voudrait la réhabiliter dans l'opinion publique. Cette tentative, quel qu'en soit le succès, ne peut du moins que lui faire honneur: car elle est, ou s'en aperçoit en le lisant, le résultat d'une d'une consciencieuse et d'une véritable conviction. Tout le monde sans doute, même après avoir lu M. Jullien, ne partagera pas cette conviction; mais les bons esprits n'en reconnaîtront pas moins l'utilité d'un travail entrepris dans des vues honorables, exécuté avec soin, et destiné par son auteur à renouer la chaîne de nos traditions littéraires. On trouvera d'ailleurs, dans un discours préliminaire placé en tête du premier volume, et qui peut être considéré comme un développement du programme, l'exposition des principes qui ont préside à tout ce travail, ainsi que l'indication des ouvrages et des recueils dans lesquels l'auteur a pu puiser des documents où trouver des secours.
L'ouvrage lui-même se divise en quatre livres, dont le premier est consacré à la poésie lyrique, le second à la poésie narrative, le troisième à la poésie expositive et le quatrième à la poésie dramatique. Nous allons présenter un court aperçu de ce que chacun de ces livres contient de plus remarquable.
Dans le livre premier, ou dans la poésie lyrique, nous rencontrons Delille, mentionné pour son Dithyrambe sur l'immortalité de l'Âme; Fontanes, Chénier et surtout Lebrun, sans compter quelques autres, Theveneau, par exemple, mathématicien et poète, aujourd'hui bien oublié, quoiqu'il ait fait quelques beaux vers, et donné un commentaire, autrefois recherché, sur les Leçons de Mathématiques de Lacaille et Marie. Nous signalerons encore un article sur les poésies de circonstance adressées à Napoléon et à sa famille, et spécialement sur le recueil intitulé Hommages poétiques à Leurs Majestés Impériales, recueil qui, à défaut de beaux vers, peut fournir au philosophe plus d'un sujet de réflexions, et dans lequel on remarque la signature de poètes plus ou moins célèbres: Béranger, Michaud, Baour-Lormian, Millevoie, Soumet, Viennet et déjà Casimir Delavigne. Après les poèmes originaux viennent les traductions ou imitations: l'Anacréon de Saint-Victor, l'Horace de Daru, l'Ossian de Baour-Lormian, et le livre est terminé par quelques pages sur la chanson, genre toujours fécond en France, et dans lequel se distinguent, entre beaucoup d'autres, à l'époque impériale, Desaugiers et Béranger.
Dans la poésie narrative, l'auteur comprend naturellement tous les ouvrages qui se présentent sous la forme du récit, depuis l'épopée jusqu'au conte. Il s'occupe non-seulement des poèmes originaux, mais aussi des traductions en vers, parmi lesquelles se distinguent l'Énéide et le Paradis perdu de Delille et la Jérusalem délivrée de Baour-Lormian Les grandes épopées du temps de l'empire sont aujourd'hui plus oubliées que celles du dix-septième siècle, dont Boileau du moins maintient le souvenir; mais parmi les auteurs qui ont consacré leurs veilles à des poèmes narratifs d'un genre moins élevé, quelques-uns ont vu leurs efforts moins ambitieux couronnés d'un plus heureux succès. Tels sont: Parny, qui vivra longtemps encore; Creuze de Lesser, dont le poème de la Chevalerie conserve des lecteurs; Parseval de Grandmaison, dont M. Jullien juge les Amours épiques avec sévérité; M. Roux de Rochelle, dont les Trois Âges sont traités plus favorablement; M. Viennet, dont la Philippide, publiée seulement en 1828, mais composée en partie sous l'empire, obtient ici de grands éloges, accompagnés toutefois de critiques, relatives au plan de l'ouvrage et au défaut d'intérêt. Nous citerons encore la Navigation d'Esmenard, ouvrage qu'il n'est pas facile, comme l'avait déjà fait observer l'Institut (Rapport de la classe de la langue et de la littérature française sur les prix décennaux, pages 59 et 136), de rapporter à un genre déterminé, mais que M. Jullien regarde comme un poème cyclique à cause de la forme historique que son auteur lui a donnée. Nepomucène Lemercier figure aussi dans ce livre pour un assez grand nombre de poèmes dont la plupart n'ont jamais eu de lecteurs. Son Atlantide donne cependant lieu à des considérations assez curieuses, et la Panhypocrisiade, négligée à son apparition, mais justement remarquée depuis pour les beautés originales qu'elle présente, méritait d'arrêter quelque temps l'attention de notre critique, qui lui accorde en effet un assez long article. Nous regrettons que M. Jullien n'ait pu réussir à se procurer les Quatre Métamorphoses du même auteur; il aurait pu s'assurer par lui-même que si la sévère délicatesse de nos habitudes littéraires réprouve le choix du sujet, l'exécution du moins mérite les éloges qui lui ont été décernés par les meilleurs juges. Aux poèmes de longue haleine succèdent les contes, dans lesquels Andrieux surtout obtint beaucoup de succès; puis enfin les contes brefs, c'est-à-dire ces petits récits resserrés dans les proportions de la simple épigramme, dont ils ont le tour vif et la pointe finale. Nos poètes y ont souvent réussi, et Pons (de Verdun) notamment s'y est distingué au commencement de ce siècle.
Sous le titre de poésie expositive, le troisième livre comprend les poèmes didactiques et descriptifs, l'élégie, l'épître, la satire, l'idylle, l'apologue et l'épigramme. Cette partie de l'histoire de la poésie impériale nous offre des noms qui ont obtenu et conservé plus ou moins d'éclat: Delille, dont l'astre a pâli, mais dont la renommée dure encore; Fontanes, poète correct et pur, dont le talent convenait à la poésie tempérée; Chénedolle, qui célébra le Génie de l'Homme; Michaud, qui trouva dans ses malheurs le sujet de son Printemps d'un Proscrit; Castel, qui, dans son poème des Plantes, développa en vers agréables un sujet qui lui était vraiment connu; Legouvé, qui mit son succès sous la protection du sexe auquel il consacra ses chants; Campenon, que l'Homme des Champs de Delille n'a pas empêché de donner sa Maison des Champs; Berchoux, le chantre de la Gastronomie; Colnet, qui enseigne l'Art de Dîner en Ville; Tissot, qui a mieux réussi que tout autre à compléter le Virgile de Delille; madame Dufrénoy, qui a charmé ses douleurs en les chantant; Millevoie, versificateur distingué auquel le pressentiment, puis les approches de la mort ont inspire deux pièces touchantes et vraiment poétiques; Chénier, génie incomplet, mais vigoureux, qui ne se déploya jamais plus à l'aise que dans la satire; Arnault, qui fut original dans l'apologue; Lebrun, fécond et souvent heureux dans l'épigramme.
Le quatrième et dernier livre a pour objet la poésie dramatique, comprise dans toute son étendue, depuis la tragédie jusqu'au vaudeville.
La tragédie, M. Jullien le dit lui-même (tome II, page 458), est la partie faible de la poésie impériale. Il signale toutefois comme méritant plus spécialement des éloges, l'Omasis de Baour-Lormian, le Tibère de Chénier et l'Agamemnon de Lemercier; «Trois ouvrages qui lui semblent dominer tous les autres, l'un par la richesse et l'harmonie du style, l'autre par la profondeur des caractères, le troisième par la conduite et l'intérêt de l'action.» Plus d'un lecteur s'étonnera sans doute de voir figurer dans cette liste de trois ouvrages la tragédie d'Omasis et de n'y pas trouver les Templiers.
Le drame et la comédie ont été plus heureux; la comédie surtout, genre éminemment français, et qui, à toutes les époques de notre littérature, a produit des ouvrages remarquables. Nous trouvons Collin-d'Harleville, Picard, Duval, Andrieux, Étienne, Lemercier, dont le Pinto, tardivement apprécié, est l'ouvrage le plus original du théâtre impérial; plusieurs autres, dont les productions paraissent encore sur la scène.
Dans une section particulière on peut lire des détails peu connus de la génération actuelle sur les petites pièces qui ont fait rire la génération précédente, et dans une autre il est question des opéras les plus fameux, le Triomphe de Trajan, la Vestale, Fernand Cortez, accueillis avec tant de faveur, mais que d'autres ouvrages, soutenus par une musique d'un autre genre, écartent aujourd'hui du théâtre.
Vient enfin une conclusion, ou récapitulation générale, dans laquelle M. Jullien compare la littérature française de l'empire à celle des époques précédentes, sous le double rapport du nombre et de la valeur des productions. Le résultat de cette comparaison assignerait, si l'on admettait toutes les appréciations de l'auteur, un rang fort élevé à la période littéraire dont il a tracé l'histoire. Cette manière de voir s'écarte assurément beaucoup des idées qui ont cours aujourd'hui, et celui qui écrit ces lignes est fort disposé, sur ce sujet du moins, à penser comme tout le monde. Il appartient d'ailleurs à chacun de se former une opinion d'après ses lumières personnelles et son goût particulier. Au surplus, le livre que nous annonçons offre en abondance les éléments propres à éclairer le jugement du lecteur. Les ouvrages n'y sont pas seulement jugés, ils sont analysés, et des citations nombreuses permettent d'apprécier le talent et de reconnaître la manière des poètes. M. Jullien suit en cela l'exemple de La Harpe; il a même ici un avantage sur l'auteur du Lycée; celui-ci, en effet, traitant des plus belles époques de notre littérature, rapporte souvent des passages que tout le monde connaît; ceux que transcrit M. Jullien, empruntés à des auteurs bien moins lus, auront souvent le charme de la nouveauté; quelques-uns, extraits de livres presque inconnus, causeront cette surprise agréable qui accompagne la découverte d'une richesse qu'on ne soupçonnait pas. Qui a lu, par exemple, le Moïse Lemercier, et qui ne saura gré a M. Jullien de lui avoir fait connaître le monologue de Core, morceau bien remarquable perdu dans un bien mauvais poème?
Les dispositions matérielles du livre sont elles-mêmes calculées pour la
plus grande utilité du lecteur; des indications précises permettent de
recourir aux ouvrages cités; des tables méthodiques et une ample table
alphabétique donnent le moyen de retrouver facilement le sujet et le
point précis auxquels on peut avoir besoin de se reporter.
V.
L'Algérie ancienne et moderne, depuis les premiers établissements des Carthaginois jusqu'à la prise de la Smalah d'Abd-el-Kader; par M. Léon Galibert. 1 vol. grand in-8 de 658 pages, orné de gravures sur acier et sur bois.--Paris, 1844. Furne. 20 fr.
Ce beau volume dont nous avons. Il y a plus d'un an, annoncé la publication et prédit le succès, est depuis longtemps terminé: nos espérances n'ont point été trompées. Jamais, peut-être, la librairie Furne n'avait édité un ouvrage, même illustré, plus complet et plus intéressant. MM. Rouergue et Rattet ont dignement rempli la tâche qui leur avait été confiée; des cartes et des costumes coloriés des principaux corps de l'armée d'Afrique complètent la curieuse collection de paysages ou de tableaux que ces artistes distingués ont dessinée et gravée tout exprès pour l'Algérie ancienne et moderne; mais dans ce bulletin c'est la partie littéraire d'un livre qui doit seule nous occuper. Voyons donc comment M. Léon Galibert a conçu et exécuté l'important travail auquel il a mis son nom.
Le chapitre premier de l'Algérie ancienne et moderne a pour titre: Description physique de la région du l'Atlas. Avant d'entreprendre le récit des événements historiques dont l'Afrique a été le théâtre, avant de dérouler cette longue série de guerres et d'invasions qui ont tant de fois changé la face de ce pays, ruiné ses villes et influé de mille manières sur l'existence de ses habitants M. Léon Galibert esquisse rapidement la physionomie de cette contrée; il gravit ses montagnes, il parcourt ses plaines et ses vallées autrefois si fertiles, et qui offrent encore à l'industrie moderne de si grandes ressources; il indique les différentes zones de cette riche végétation africaine, ainsi que les animaux qui s'y trouvent; il constate enfin les divers phénomènes de climatologie qui s'y succèdent, les vents qui y règnent, la chaleur qu'il y fait, les pluies qui y tombent. Ce tableau succinct a pour but de donner dès l'abord une notion exacte de l'Afrique septentrionale, et de dégager le récit principal de toutes les descriptions qui l'auraient nécessairement surcharge.
Comment les Carthaginois étendirent-ils leur domination dans l'Afrique occidentale? Par quel ingénieux système de colonisation firent-ils concourir les tribus libyennes à leur commerce, à leurs conquêtes? Comment, à leur tour, les Romains s'emparèrent-ils de ces éléments organisés pour détruire Carthage? Comment ces peuples, qui depuis sept cents ans paraissaient façonnés à la civilisation phénicienne, acceptèrent-ils ensuite celle de Rome? Comment, après quatre siècles de soumission apparente, les vit-on passer presque sans résistance sous le joug des Vandales, puis sous celui des Gréco-Byzantins, et enfin se laisser confondre dans le flot arabe qui leur imposa son langage et ses croyances?
«Ce sont toutes ces révolutions que j'ai entrepris d'étudier et que j'essaierai d'expliquer, dit M. Léon Galibert dans son avant-propos; travail difficile, mais fécond en enseignements de plus d'un genre, surtout en rapprochements du plus haut intérêt, car cette même terre où la France voit chaque jour se former et grandir de braves soldats, d'intrépides capitaines, des généraux illustres, fut aussi le théâtre des mémorables batailles que se livrèrent Scipion et Annibal; c'est là que César vint cueillir le dernier fleuron qui manquait à sa couronne de triomphateur du genre humain; c'est là que les factions de Rome, qui se disputaient l'empire du monde, vinrent vider leurs grandes querelles; c'est là que mourut Caton; c'est là que Pompée, Marius et Sylla consolidèrent leur gloire. Massinissa, le roi de Constantine, le fidèle allié des Romains, ainsi que ses descendants, les Micipsa, les Juba, sont les types de ces chefs arabes qui, épris aujourd'hui de la supériorité de notre civilisation, se sont sincèrement ralliés à nous. Abd-el-Kader, c'est Jugurtha, c'est Taclaricas, c'est Firmus; car, en Afrique, les hommes sont toujours les mêmes, les noms seuls ne font que changer. Abd-el-Kader est le successeur de tous ces esprits inquiets et ambitieux qui, à différentes époques, rêvèrent une suprématie nationale et indigène, utopie à la réalisation de laquelle s'opposeront toujours le morcellement des tribus africaines, leurs mœurs égoïstes et leur caractère envieux.»
A la domination des Gréco-Byzantins succéda, dans l'Afrique septentrionale, celle des Arabes. Cette période nous fait assister au magnifique déploiement de la civilisation d'orient, qui de l'Afrique envahit l'Espagne, et ne s'arrêta qu'aux plaines de Poitiers, grâce aux efforts de la France et aux victoires de Charles Martel. M. Léon Galibert suit tour à tour les Arabes et les Maures dans leurs conquêtes intérieures et dans leurs expéditions au dehors; en Sicile, en Italie, sur les côtes de notre belle Provence, où existent encore tant de traces de leur passage.
Les véritables annales de L'Algérie ne commencent qu'au seizième siècle; c'est alors seulement qu'Alger, sous l'influence de deux étrangers, les frères Barberousse, devient le siège de cette espèce de république religieuse et militaire qui fut élevée contre la chrétienté, comme Rhodes l'était depuis un siècle contre l'islamisme; c'est alors seulement que se forme ce terrible gouvernement appelé l'odjeac d'Alger, qui en quelques années envahit toutes les principautés voisines. Mostaganem, Médéah, Tenez, Tlemcen, Constantine, reconnaissent sa souveraineté; Tunis lui est même un instant soumis, et Alger finit par imposer son nom à tout le territoire qui s'étend depuis Tabarque jusqu'à Milonia. Au dehors, le bruit de ses conquêtes et l'influence de ses chefs se répandent avec non moins de rapidité. Alger, à son berceau, est tour à tour l'auxiliaire ou la terreur des États les plus puissants de l'Europe. Le sultan Sélim prend l'odjeac sous sa protection; Soliman l'appelle à son secours; François 1er paie son concours 800,000 cens d'or; Charles-Quint lui-même, vainqueur à Pavie et à Tunis, est obligé de courber le front sous la fatalité qui brise ses vaisseaux et jette l'épouvante parmi son armée.
Les Turcs restèrent pendant plus de trois siècles maîtres de l'Algérie, les puissances européennes essayèrent vainement de la leur disputer; mais les indigènes protestèrent toujours contre la souveraineté qu'ils s'arrogeaient. Trois siècles de possession n'avaient pas subi pour légitimer et consolider leur pouvoir. Ils étaient obligés de subir la loi qui a constamment pesé sur tous les conquérants de l'Afrique septentrionale, c'est-à-dire de combattre pour se maintenir, lorsqu'en 1830 la France s'empara enfin de cette terre qui doit être désormais et à toujours française.
Le récit de la conquête d'Alger et de tous les événements qui l'ont suivie depuis quatorze années remplissent les deux tiers de l'Algérie ancienne et moderne. Nous n'analyserons pas cette partie de l'ouvrage de M. Léon Galibert; bornons-nous à constater qu'il n'a rien négligé pour que son travail, aussi impartial que complet, fût vraiment digne des brillantes campagnes dont il s'était fait l'historien.
M. Léon Galibert s'est arrête au 22 juin 1843, c'est-à-dire à la prise de la Smalah d'Abd-el-Kader. Un dernier chapitre intitulé: «Situation de la domination française 1830-1843», renferme une masse de documents curieux sur le gouvernement et l'administration, l'armée, les finances, l'organisation judiciaire, le rétablissement du culte chrétien, les travaux publics, le mouvement commercial, les progrès de la colonisation, la création d'établissements d'instruction publique, les sciences et les arts, etc. Enfin ce magnifique volume, si plein de faits, se termine par une statistique historique des régiments envoyés en Afrique depuis 1830.
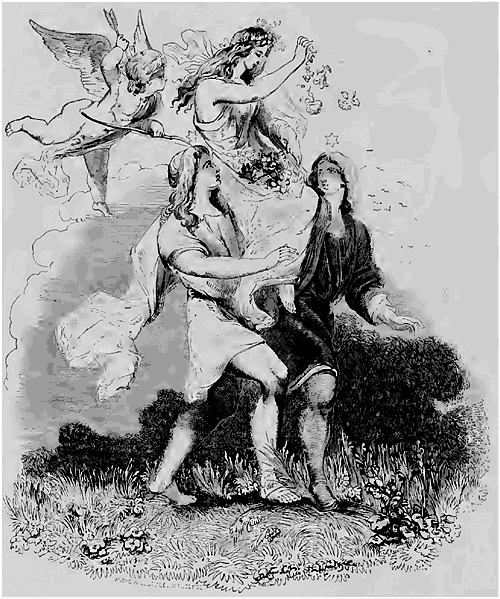
Allégorie du mois de Mai.--Les Gémeaux.
Rébus.
EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS.
Le duel était défendu sous Richelieu.