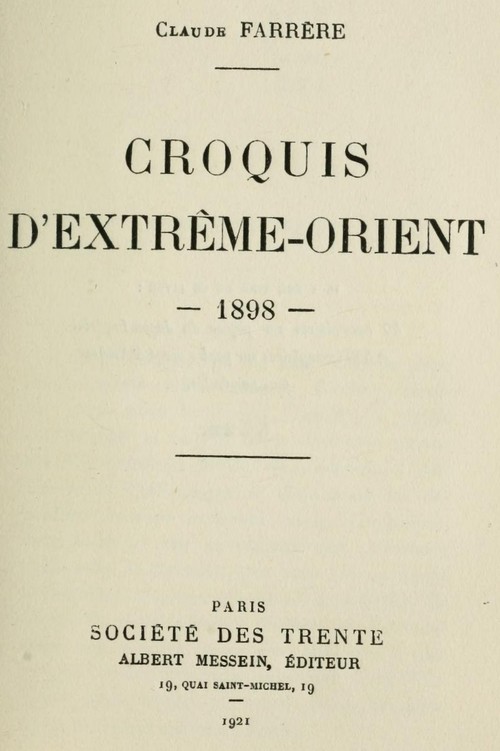
Title: Croquis d'Extrême-Orient, 1898
Author: Claude Farrère
Release date: April 1, 2017 [eBook #54467]
Most recently updated: October 23, 2024
Language: French
Credits: Produced by Julien Sorel, Images provided by The Internet Archive.
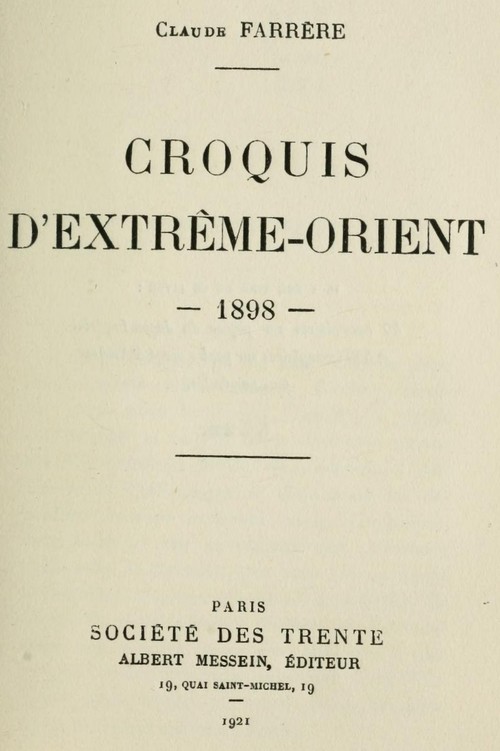
CROQUIS
D'EXTRÊME-ORIENT
– 1898 –
PARIS
SOCIÉTÉ DES TRENTE
ALBERT MESSEIN, ÉDITEUR
19, quai saint-michel, 19
1921
DU MÊME AUTEUR
ROMANS ET CONTES:
Fumée d'opium, contes.
Les Civilisés, roman.
L'Homme qui assassina, roman.
Mademoiselle Dax, jeune fille, roman.
La Bataille, roman.
Les Petites Alliées, roman.
La Maison des hommes vivants, roman.
Thomas l'Agnelet, roman.
Dix-sept histoires de marins, contes.
Quatorze histoires de soldats, contes.
La Dernière Déesse, roman.
Bêtes et Gens qui s'aimèrent, contes.
Les Condamnés à mort, roman.
THÉÂTRE:
La Veille d'armes.
La Vieille histoire, comédie.
Roxelane, tragédie.
EN PRÉPARATION:
Les Hommes nouveaux, roman.
Le Dernier Dieu, roman.
[Pg 6]IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE LIVRE:
40 exemplaires sur papier du Japon Impérial et 500 exemplaires sur papier vergé d'Arches tous numérotés.
L'année 1898 ne fut pas pour nous de celles dont on garde un bon souvenir. L'affaire Dreyfus avait divisé la France. L'armée en restait douloureuse, et notre prestige au dehors amoindri. Nos rivaux profitaient de ce désarroi. L'Angleterre et l'Allemagne se disputaient les dépouilles de notre influence ruinée. Un gouvernement faible et têtu ne résistait pas. L'histoire universelle se déroulait sans nous. On attaquait brutalement l'Espagne. On rêvait de conquérir la Chine. On nous infligeait l'affront de Fashoda. Dans nos colonies, nous perdions peu à peu tous nos droits. Où nous arrêterions-nous? Le XIXe siècle, ouvert par notre gloire, semblait prêt à se fermer sur notre agonie.
[Pg 8]A l'intérieur, la lutte des partis aveuglait les meilleurs citoyens. Il fallait s'éloigner pour prendre conscience du péril qui nous menaçait. De l'étranger, un Français mesurait mieux les erreurs de la France. Nos marins surtout en souffrirent cruellement. A chaque endroit du monde où le service les portait, ils ne se sentaient plus les soldats d'un pays respecté. Le désir de se dévouer davantage, et sans espoir peut-être, s'exaltait en eux. La génération se préparait qui, vingt ans plus tard, courrait au sacrifice. Même en 1921, la France ne sait pas assez ce qu'elle doit à ses marins.
Or, aux premiers jours de 1898, un jeune officier de marine se trouvait en Extrême-Orient. Depuis quelques mois, supportant mal de ne pas dire haut ce qu'il jugeait nécessaire de dire, il écrivait, pour un journal de Lyon, le Salut Public, des articles d'une ardeur et d'une intelligence qu'on apprécia. Dès le 29 septembre 1897 il avait dénoncé les intentions coupables des Etats-Unis d'Amérique contre l'Espagne. Puis, navré de l'ignorance dangereuse où l'on était chez nous des choses de la mer, il avait parlé aux lecteurs du Salut Public, comme on ne le [Pg 9]faisait pas à ceux des journaux parisiens, de Guillaume II et la Marine allemande, de la Marine telle qu'elle est, des Paquebots français et étrangers. Puis, il était parti pour l'Extrême-Orient. Là, il découvrit tout de suite les tristes résultats de notre politique, et il fut assez clairvoyant pour prédire que la vieille Europe aurait sous peu à compter avec les peuples jaunes. Pendant toute l'année 1898, il nous envoya d'Asie des chroniques d'une étonnante et courageuse lucidité sur les principales questions dont le patriotisme français pouvait s'émouvoir.
S'il composait cependant des contes, ou s'il travaillait à quelque roman, il n'en publiait rien. Il était jeune. Il attendait. Quand il se décida, il rendit célèbre le nom de Claude Farrère. En 1898, il signait: Pierre Toulven. Il avait à peine vingt-et-un ans.
C'est un choix de ses articles du Salut Public que nous avons la bonne fortune d'offrir à ses amis. Ils y retrouveront, déjà toutes vives, les qualités de franchise et d'allant qui leur plaisent en Claude Farrère, et ils s'assureront au surplus qu'il est bien vrai que les poètes ont le don de [Pg 10]prophétie, car rien de ce qu'écrivait Pierre Toulven en 1898, sur des sujets délicats, n'a été démenti par le temps et ne saurait être renié par Claude Farrère.
L'Éditeur.
(Singapore, 22 janvier 1898).
La fin de ce pauvre xixe siècle, tant vanté et tant décrié tout à la fois, est marquée par un phénomène géographique à peine sensible encore, et déjà redoutable pour les races occidentales. C'est l'entrée dans le monde civilisé des peuples jaunes. Les hommes d'Europe, Saxons, Latins, Allemands et Slaves, après avoir conquis et peuplé l'Amérique, conquis et colonisé l'Afrique et l'Océanie, conquis et colonisé les deux tiers de l'Asie, se heurtent à une masse compacte de cinq cents millions d'hommes étrangers, différents, hostiles et parfaitement propres au genre de guerre qui devient chaque jour davantage l'unique guerre moderne: la [Pg 14]lutte économique pour le pain et par la famine. Et ces hommes, Mandchoux, Nippons, Tartares, Coréens, Chinois, sortent en ce moment de leur immobilité quarante fois séculaire et commencent la bataille.
C'est le moment pour le négociant et l'industriel,—les soldats de la guerre nouvelle,—d'aller étudier en hâte les positions de l'ennemi, ses ressources et ses intentions.
C'est le moment pour l'artiste et le curieux d'aller voir ces pays d'Extrême-Orient, jadis fabuleux, pleins d'étrangeté et de bizarrerie; d'aller les voir avant que la transformation en train de s'accomplir n'ait achevé d'en faire des usines modernes, perfectionnées et puissantes.
[1] Le Salut Public, 2 mars 1898.
Quand vous irez en Extrême-Orient, trois ou quatre jours après avoir doublé Ceylan, vous verrez la mer se resserrer entre des côtes abruptes et boisées; vous entrerez dans une sorte de corridor colossal au bout duquel votre route sera barrée par un archipel pressé, laissant entre ses îlots un passage étroit qui est la porte unique de l'Extrême-Orient. Cela, c'est le canal de Singapore. Singapore est le vrai seuil des contrées jaunes.
Figurez-vous une espèce de rivière assez, large, sinueuse, bordée de rives merveilleusement vertes, encombrées d'îlots et de rochers. Sur la berge, des quais grossièrement bâtis en bois, mais interminables; amarrés aux appontements, [Pg 16]une flotte de vapeurs de toutes nations; sur les quais, des montagnes de charbon, des docks, des dépôts, des amas de marchandises; plus loin, des prés verts et une route anglaise, large comme une avenue et propre comme une allée. C'est le port de Singapore. La ville est tout au bout, à plus de deux milles des premiers navires.
Débarquons. Si c'est le jour, l'activité fébrile du port fait une profonde impression. Et même de nuit, neuf fois sur dix, se trouvera pas loin quelque paquebot pressé, chargeant son charbon à la lueur des torches et des fagots résineux qui brûlent sur le quai; et ce n'est pas un spectacle d'Europe que ces files d'hommes bruns, écrasés sous des fardeaux énormes, prenant d'assaut le vapeur en poussant des hurlements perçants et redescendant sur le quai à la course pour remonter aussitôt avec de nouvelles charges.
C'est au-delà du canal, côté Orient, qu'est la ville, au bord de la rade même. Singapore, moitié Chine et moitié Inde, est une des physionomies de cités les plus étranges du monde. Bâtie du premier pavé à la dernière [Pg 17]brique par les Anglais, elle abonde en rues droites et larges, sans montrer la prédilection exagérée des Américains pour l'angle droit. Beaucoup de squares, force places immenses, abondantes d'arbres et de pelouses. Voilà le plan.
Là-dessus, dix ou quinze mille maisons à un étage, avec galerie en retrait, toit surplombant, échoppe profonde et sombre; le tout peint en bleu, un bleu criard, dur, violent, qui tire les yeux. Sur la rivière étroite, qui serpente dans la ville, les ponts d'acier, bien jetés, larges et commodes, mais gardant je ne sais quoi d'oriental dans le croisement pourtant logique et simple de leurs poutres métalliques. Sous les ponts, des sampans, ces bateaux-maisons de la Chine, où des familles vivent toute leur existence, pêle-mêle dans une vermine puante;—des sampans, tant de sampans que c'est tout juste si l'on aperçoit l'eau entre les coques noires et grouillantes. Dans ces rues, une foule bariolée de cent mille individus dont je vous défie de deviner la race et même le sexe, à première vue. C'est le plus incohérent amalgame de toutes les peuplades de l'Inde, de la Chine et de l'Indo-Chine. [Pg 18]Il y a des Indiens encore assez purs, barbus, drapés dans leurs étoffes flottantes, avec leur haute stature et leur fier visage intelligent et noble;—des Indiens du Sud, mâtinés de Cinghalais et de Malais, minces, souples, imberbes; hommes et femmes se confondent; c'est la même sveltesse de formes, la même grâce élégante;—des Siamois, des Cambodgiens, des Annamites, petits, intelligents, avec on ne sait quoi de cruel dans leur visage clair;—des Chinois enfin, de toutes classes et de tous rangs, depuis le coolie misérable et craintif, flottant dans son pantalon large et rapiécé, depuis le petit boutiquier, propre et soigneux, chaussé de souliers de feutre, jusqu'au banquier millionnaire qui éclabousse l'Européen du fond de sa victoria à grande livrée. Ceux-là sont tous les mêmes, à tous les degrés de l'échelle: habiles et rapaces à en remontrer à nos juifs d'Europe, impassibles et calmes plus que des mahométans.
A Singapore, nous trouvons déjà la plupart des éléments de population que nous rencontrerons au cours de notre voyage, mais mêlés inextricablement avec un élément indien qui [Pg 19]imprime à l'ensemble un caractère de bariolage étrange.
Sur toute cette foule flotte une odeur indicible, mélange âcre de poivre, d'encens et de fauves échauffés, avec on ne sait quoi de fécal et d'étouffant. C'est l'odeur jaune, l'émanation nauséabonde de toute la race orientale, que nous retrouvons sur toute la côte chinoise, de Chemulpo et de Port-Arthur à Hong-Haï et jusqu'à Singapore.
Tel est à peu près l'aspect des quartiers indigènes de la porte de l'Extrême-Orient. Cela, c'est en quelque sorte le revêtement original et artistique de la maison de commerce anglaise. Car Singapore n'est pas autre chose qu'un comptoir colossal doublé d'une banque florissante. Les Anglais ont respecté volontiers le caractère exotique de la ville et lui ont laissé son cachet oriental intact. Mais ils n'en ont pas moins édifié à côté de la cité chinoise leur ville à eux, avec leurs larges maisons aérées, leurs magasins, leurs entrepôts,—et leur port.
Ce port-là vaut la peine d'être possédé. Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre qu'un navire allant en Extrême-Orient, [Pg 20]qu'il vienne d'Europe, d'Afrique ou de l'Inde, ne peut se dispenser de passer par Singapore. Les Anglais en ont profité pour créer à Singapore d'immenses approvisionnements de houille. Aussitôt, Singapore est devenu grand port de transit et d'escale.
Cette prospérité a couru pourtant un danger terrible; c'est une petite histoire peu connue en France, probablement parce que nous y avons été les premiers intéressés. Au nord de Singapore, la presqu'île de Malacca se resserre en un isthme facile à percer, l'isthme de Kra. Un canal ouvert là abrégeait le chemin de l'Extrême-Orient de deux jours, et remplaçait Singapore par Saïgon. Des Français ont voulu réaliser ce rêve-là. C'était une fortune inespérée pour notre Cochinchine, et la ruine de Singapore, par dessus le marché; double avantage pour nous.
Mais le cabinet de Saint-James a su obtenir d'un ministère français sainement dédaigneux des affaires coloniales l'abandon de l'isthme; et maintenant, je vous garantis que l'isthme ne sera pas percé.
Et Singapore s'accroît toujours, devient [Pg 21]d'année en année plus populeux et plus florissant.
Ce n'est pas seulement une ville de transit, une escale, un dépôt de charbon. C'est le grand marché de l'Indo-Chine, du Sumatra et de la Sonde; c'est le port d'exportation du Siam et de la Birmanie. Si étrange que cela paraisse, tout le commerce siamois, qui devrait se concentrer à Saïgon, plus proche et plus accessible, préfère aller à Singapore, parce que le courant s'en va par là, tandis que nous ne faisons rien pour attirer à nous cette source de richesses. C'en est arrivé à ce point fabuleux que, sur le commerce total de l'Indo-Chine, qui dépasse 2 milliards, les Straits-Settlements, c'est-à-dire Singapore, font plus d'un milliard;—un pays sans industrie, sans agriculture, presque sans territoire;—alors que des contrées peuplées, vastes, productrices, mais françaises! l'Annam, le Tonkin, le Laos, le Cambodge, n'atteignent pas 700 millions!
Les Anglais ont le droit d'être fiers de leur œuvre.
Et pourtant, aujourd'hui, ils sont inquiets et ils ont raison de l'être.
[Pg 22]Il y a, en effet, un principe colonial qu'on ne sait pas en France et qui est pourtant capital. C'est que celui qui retire tout le profit d'une colonie, ce n'est pas le propriétaire, c'est le négociant; ce n'est pas l'administrateur, le fonctionnaire, c'est celui qui détient les banques, qui accapare les marchés, qui organise les lignes de paquebots, qui importe son industrie à lui et emporte les produits et l'or de la colonie. Pendant très longtemps les Anglais ont été à la fois propriétaires et négociants; ils risquent fort aujourd'hui de perdre le rôle le plus fructueux.
C'est que là, comme dans beaucoup d'autres points du globe, les Allemands sont intervenus. Ils se sont attaqués d'abord aux puissances commerçantes de second ordre; à nous, Français; ils nous ont battus, supplantés; ils achèvent maintenant notre ruine; voici des chiffres qui le prouvent, chiffres dus au consul de France à Singapore:
Les Allemands vendent 230.000 piastres de mercerie; nous, 46.000;—229.000 piastres de lainages; nous 18.000;—218.000 de quincaillerie; nous, rien. Seules nos soieries tiennent [Pg 23]encore devant la concurrence allemande; mais notre chiffre décroît et le leur augmente. Ces gens-là font meilleur marché, moins bon et de moins bon goût que nous: trois qualités indispensables ici, car l'Oriental n'est pas riche, aime à acheter souvent et, par suite, veut acheter de la camelote vite usée, et ne prend que des articles criards, aux tons violents et heurtés. Avis à nos exportateurs lyonnais, s'ils veulent triompher de nos mortels ennemis en gagnant des fortunes.
En attendant, la concurrence allemande s'attaque au commerce anglais; sur plusieurs points elle l'a dépassé ou supplanté. Ce n'est pas encore la lutte active, presque politique, qui s'est engagée au Transvald, c'est un envahissement patient et sournois, d'autant plus redoutable à l'Anglais que rien n'est plus opposé à son caractère énergique et brutal que ces menées tortueuses.
Mais, à Singapore, il y a encore autre chose que des Anglais et que des Allemands. Et, notre promenade finie, quand nous reviendrons aux appontements, vers les vapeurs amarrés, chargeant et déchargeant leurs marchandises, nous [Pg 24]verrons sur beaucoup de ces navires flotter un pavillon bizarre, blanc, avec un soleil rouge au centre.
Cela, c'est le pavillon japonais, en train de conquérir l'Extrême-Orient, et qui s'est avancé déjà jusqu'à Singapore.
Derrière Singapore, la mer s'ouvre et s'élargit, orientée vers le nord-est, souvent battue par la mousson d'hiver et périodiquement bouleversée par de formidables typhons. L'Extrême-Orient commence. Singapore en est la porte, Saïgon l'antichambre ou le vestibule.
L'Extrême-Orient commence. Jusqu'à ce que soit doublée cette longue péninsule de Malacca, la Chersonèse antique, nous étions presque en Occident. L'Arabie touche à l'Espagne par Mahomet et ses cavaliers blancs; la Perse est presque le berceau de notre race; l'Inde est toute pleine de la légende de Bacchus et de l'histoire d'Alexandre. Mais l'Annam, le Tonkin, [Pg 26]la Chine, le Japon ont à peine été soupçonnés par l'Occident. Et nous entrons dans un monde différent, personnel, fermé.
De Singapore à Saïgon, il y a deux jours de route, à condition que le paquebot n'ait pas de démêlés trop violents avec la souveraine mousson du nord-est, qui a fort mauvais caractère.
Je n'apprendrai à personne que Saïgon, qui prétend au titre de capitale de l'Indo-Chine française, n'est malheureusement pas bâtie sur la mer, mais bien sur une rivière assez profonde et large, dont l'embouchure est à quarante ou cinquante milles en aval de Saïgon. Le résultat, c'est la nécessité d'une navigation en rivière de quatre ou cinq heures qui allonge et complique fâcheusement les traversées.
Au Tonkin, Hanoï, qui prétend également au titre de capitale de l'Indo-Chine française, est exactement dans la même position défavorable, avec cette circonstance aggravante, que sa rivière est trois fois plus longue et huit ou dix fois moins profonde. Hanoï ne sera évidemment jamais un port. Saïgon en est un; assez mauvais, mais capable tout de même de devenir [Pg 27]florissant, à condition toutefois que nous ne fassions pas trop d'efforts pour le ruiner au plus vite et sans rémission.
Pour l'instant, il y a très peu de navires à Saïgon, et ces navires sont allemands. Jadis, quand le port était franc, il eut son heure de prospérité et de grandeur. Saïgon a rivalisé avec Singapore. Aujourd'hui, n'en parlons pas; espérons simplement que la prospérité défunte revivra, grâce à l'intelligence et à l'effacement bien compris de l'action gouvernementale, grâce surtout à l'initiative et à l'énergie des particuliers et des colons.
Croquer en quelques lignes la physionomie de Saïgon, ce n'est pas chose très facile; et pourtant, Saïgon est cent fois moins bizarre que Singapore. Saïgon est comparativement européen. Mais toute ville d'Extrême-Orient est foncièrement différente d'une ville d'Europe, non seulement par l'architecture et la population, mais même par le plan et la conception.
Saïgon est double. Le Saïgon français est une ville plus vaste que grande, largement distribuée, luxueusement plantée d'arbres, riche en rues spacieuses et droites, et fertile en angles droits. [Pg 28]Les maisons y sont basses, rustiques d'apparence et d'une architecture très coloniale: beaucoup de cours, beaucoup de corridors, beaucoup de galeries et de terrasses, et des passerelles enjambant les cours, et des jardins intérieurs, et des chambres démesurées, le tout meublé du strict nécessaire; on possède dans sa chambre une table, deux chaises, une toilette et une armoire,—et un lit. Mais quel lit! Trois mètres de long, deux de large, et une moustiquaire immense qui le fait paraître plus grand encore. Il est évident que la question d'air respirable a dominé toutes les préoccupations dans les aménagements saïgonnais. C'est qu'il est bon d'avertir les futurs voyageurs que le thermomètre, ici, s'il ne monte que rarement au-dessus de quarante-cinq degrés, ne descend jamais au-dessous de trente, sauf, bien entendu, pendant les nuits qui sont véritablement exquises.
La toile blanche et le casque de sureau font tous les frais de la toilette européenne en Cochinchine. Pour faire honte aux tailleurs de France, disons qu'un «complet sur mesure» et pas trop mal coupé, ma foi, s'achète huit ou neuf francs et s'exécute en douze heures. Je [Pg 29]donne ces deux chiffres là, que je certifie, aux méditations de ceux qui plaisantent les futurs effets de la concurrence industrielle des races jaunes, quand leurs produits commenceront à se glisser dans notre pauvre Europe.
A côté du Saïgon français existe le Saïgon exclusivement indigène, qu'on appelle Cholon, ce qui se prononce Cholenn. Là, nous sommes en pure ville asiatique, et ville chinoise bien plus qu'annamite. Dans les rues étroites et sales, mais franchissables quand même à l'Européen,—ce qui n'est pas le cas de toutes les villes chinoises—, se presse une foule compacte d'indigènes. Plus d'indiens, peu de Malais, et tous de sang déjà très mêlés; pas de Japonais, pas non plus de ces Chinois du Nord qui forment les peuplades les plus nobles et les plus intelligentes de l'Empire, mais une cohue innombrable de coolies, le Chinois d'exportation, sorte de créature à peine humaine qui arrive d'Hong-Kong en troupes de trois ou quatre cents, empilés sur le paquebot comme du bétail.
Si curieuse que soit Cholon, ce n'est qu'une ville chinoise, moins digne d'attention que Hong-Kong, Shang-haï, Fout-Chéou, ou Canton. [Pg 30]Saïgon, au contraire, n'a pas son égal dans l'Extrême-Orient entier. Ville moins riche et moins architecturale que Hong-Kong, moins populeuse que la plupart de ses rivales, Saïgon garde le sceptre de reine du plaisir et de l'élégance de l'Extrême-Orient tout entier. Saïgon a son théâtre, luxe presque inconnu dans ces mers; Saïgon donne, dans les salons du palais gouvernemental,—qui est véritablement un palais,—des fêtes éclatantes; Saïgon a des cafés, ce que n'a ni Hong-Kong, ni Singapore, ni Shang-haï. C'est au reste une supériorité dont nous ferons bien de ne pas nous targuer trop haut. Saïgon regorge d'équipages à livrées, qui chaque soir vont exhiber, sur la select promenade de l'inspection, des chargements très élégants d'adorables toilettes. Et Saïgon a des tramways à vapeur, un éclairage électrique, une cathédrale, un grand pont d'acier, de beaux hôtels, et le plus magnifique jardin zoologique de l'Asie, tout peuplé de panthères, de pythons et de tigres auprès desquels nos pauvres petits tigres de ménagerie feraient tout au plus figure de matous.
Nous avons le droit d'être fiers de notre Cochinchine, [Pg 31]tout en constatant, hélas! que son commerce tend à passer insensiblement aux mains des Allemands et des Anglais. Mais la Cochinchine n'est qu'un très petit morceau de notre empire d'Indo-Chine. C'est au nord, dans le Tonkin, que se trouve la partie de cet empire la plus populeuse, la plus riche d'avenir, mais la plus rebelle à notre influence. Et quoi qu'en aient les Saïgonnais, il est logique de placer à Hanoï le centre administratif de la colonie.
A Hanoï, nous sommes en plein Tonkin. On a bien calomnié ce pauvre Tonkin. Au temps où Jules Ferry, violentant simplement le Parlement, faisait la guerre de 1883 à lui tout seul et se montrait aussi clairvoyant politique que funeste général, que n'a-t-on pas dit du Tonkin? Pays peuplé de bandits indomptables, pays sans avenir et sans utilité; climat funeste, fièvres permanentes; plaines marécageuses, montagnes impraticables; tigres et pirates. La vérité est que le Tonkin est une terre riche, très riche; une mine de charbon et de fer probablement trois fois grande comme la Belgique. Les marais n'y sont pas malsains, la fièvre y est inconnue, sauf dans d'assez rares districts. Les [Pg 32]saisons européennes y sont assez distinctes, sauf que l'été est brûlant et l'hiver très doux. L'agriculture est développée et peut devenir encore plus prospère; mais pour cela, il faudra que le gouvernement ne s'obstine plus à écraser les indigènes d'impôts décourageants.
Hanoï est une capitale convenable pour un empire de douze ou treize millions de sujets. C'est le plus beau type de ville annamite que je connaisse. Les quartiers européens sont greffés sur la cité indigène; ces quartiers sont dessinés et percés, mais pas encore bâtis. Une seule rue, l'inévitable rue Paul-Bert de toute ville tonkinoise, a déjà des maisons et des boutiques. Regrettons en passant que les enseignes exhibent bien souvent des noms trop connus: les Dreyfus, les Meyer abondent; ces gens-là sont d'ailleurs fidèles à leur caractère national et nous savons sur eux des histoires peu alléchantes.
Les rues annamites, rue de la Soie, des Cuivres, de la Saumure, des Riz, des Cantonnais, des Volailles, que sais-je, sont assez larges, très tortueuses, presque propres, et abondent en façades pittoresques, en dragons étranges de pierre ou [Pg 33]de porcelaine. Les échoppes annamites sont innombrables et riches en productions indigènes fort artistiques: incrustations de nacre à reflets nuancés, cuivreries aux formes étranges, et broderies sur soie d'une finesse extraordinaire. L'Annamite a modifié sa manière primitive en s'inspirant de l'art chinois et plus récemment de l'art nippon, et la fréquentation des Français commence à épurer son goût; il est vrai que, par contre, il risque d'y perdre son originalité.
Si près de la Chine, il est tout simple que nous trouvions au Tonkin plus qu'en Cochinchine l'influence dominante de l'architecture chinoise, avec ses lignes horizontales démesurées et ses toits recourbés. Le type le mieux caractéristique est la fameuse Pagode d'Hanoï, à côté du jardin botanique, au bord d'un gentil lac et dans un site charmant. Figurez-vous une dizaine de petits pavillons à toits énormes, mal rangés autour d'une grande pagode, assez basse. Dedans, toute une troupe d'autels et de dieux environnant un immense Bouddha de bronze vêtu d'une robe de soie jaune, la couleur divine que les empereurs ont usurpée, depuis [Pg 34]qu'un roi impie de la IIe dynastie osa s'en revêtir.
Ces légendes chinoises sont d'ailleurs déjà familières aux Annamites; il ne faut pas oublier que d'Hanoï on est à deux journées seulement de la frontière et qu'un touriste sérieux se doit d'aller rendre visite à la célèbre porte de Chine, aux confins de la colonie.
Tandis que la Cochinchine est en plein rendement,—la seule possession française qui rapporte quelque chose à la mère patrie!—le Tonkin, lui, ne se suffit pas encore. Cependant, le Tonkin, pays houiller, propice aux essais industriels, est appelé à un autre avenir que la Cochinchine, région agricole, riche en riz, mais seulement en riz. Les mines tonkinoises, celles de Hong-Haï, de Port-Balue, de Kebao, sont pour ainsi dire inépuisables et ne redoutent pas la concurrence japonaise, car leur charbon est à la fois meilleur et beaucoup plus économique. En outre, le Tonkin cultive aussi du riz et exploite les importantes forêts du nord. Mines, cultures, industrie, tout ici se développe; mais le développement est lent, et, il faut l'avouer, nous réussissons mal à nous concilier l'affection [Pg 35]des indigènes, dans laquelle toute œuvre coloniale est fatalement vouée aux révoltes d'abord, et aux séparations ensuite.
Pour finir cette trop longue étude sur une note moins fâcheuse, disons que notre Indo-Chine est encore aujourd'hui le pays rêvé pour les Tartarins tueurs de fauves. Les tigres y sont certainement plus nombreux que les lions ne le furent jamais dans l'Atlas. Ces honnêtes félins, qu'un bon Annamite n'appellera jamais que Hong, Monseigneur, passé le coucher du soleil, sont d'ailleurs très redoutables, et d'une audace invraisemblable. Un Français, établi au Tonkin depuis plusieurs années, et que je n'ai aucune raison de croire Marseillais, m'a fait le récit suivant, dont j'endosse bravement la responsabilité: Dans je ne sais quel village voisin de Lan-Son, au fond d'une maison, tout au long d'un long corridor, un brave cuisinier tonkinois cuisait son riz et ses volailles. Un tigre en quête de souper pénétra dans le village et entra tout simplement dans la cuisine, attiré probablement par l'odeur du repas, ou peut-être même par l'odeur du cuisinier. Le pauvre homme eut une telle frayeur qu'il renversa du coup toutes ses [Pg 36]casseroles. Le tigre effrayé du tapage s'enfuit. Mais le cuisinier garda de l'aventure une si forte nervosité, que, très souvent, au beau milieu de ses apprêts culinaires, il prend des crises d'épilepsie. Sans doute qu'il voit alors autant de tigres dans sa cuisine que Tartarin croyait en voir dans les champs d'artichauts de la banlieue d'Alger.
[1] Le Salut Public, 20 avril 1898.
Il y a un peu plus de quarante ans, tout au sud de la Chine, à l'embouchure d'un fleuve, tout près de villes déjà vieilles et florissantes, se trouvait un îlot aride et dénudé, montagneux et désert. Les Chinois appelaient cela Hong-Kong, c'est-à-dire «l'arroyau parfumé».
Les Anglais ont pris Hong-Kong. Avec le rocher dénudé, ils ont fait une espèce de paradis terrestre, où foisonnent tous les arbres et toutes les plantes de la flore orientale; avec l'îlot désert, ils ont fait une ville peuplée de deux cent mille âmes, bien bâtie, largement percée; avec le coin de terre ignoré qu'écrasait le voisinage de Canton [Pg 38]et de Macao, ils ont fait le premier port de l'Extrême-Orient, un prodige d'activité commerciale, qui supplée Canton et qui a ruiné Macao. Quand on admire une pareille création, un si magnifique coup de baguette, je vous jure qu'on trouve qu'en matière de colonisation, nous Français, nous sommes bien petits!
Je ne voudrais pourtant pas fatiguer le lecteur de ce parallèle pénible entre nos rivaux et nous; et, si j'y reviens souvent, c'est que, pour tous ceux qui voyagent, ce parallèle s'impose, autrement douloureux, je vous prie de le croire, pour le Français perdu, isolé au milieu d'étrangers souvent hostiles, toujours insolents dans leur triomphe politique et colonial. Et pourtant, le voyageur se doit d'être impartial et de juger avec équité l'œuvre même de nos ennemis. Et Hong-Kong est beau.
Quand on remonte en paquebot la mer de Chine, de Saïgon à Hong-Kong, surtout si l'on fait cette traversée pendant les mois d'hiver, à l'époque où la mousson de N.-E. rend la mer dure aux navires et fatigante aux passagers, c'est un vrai soulagement que cette entrée dans [Pg 39]la baie de Hong-Kong, si verte, si boisée. Et sitôt le navire mouillé, c'est un émerveillement que cette foule de vapeurs et de voiliers, que ce fourmillement de chaloupes à vapeur, de jonques, de sampans qui tournent perpétuellement autour des navires à l'ancre. Hong-Kong est un des ports les plus bariolés du monde, moins par les nationalités multiples des navires que par leurs innombrables destinations. On y trouve des Scandinaves, des Portugais, des Japonais, des Yankees, des Chinois, des Allemands, et par dessus tout des Anglais. Cela va en Europe, dans l'Inde, à Saïgon, à Singapore, à Shang-haï, au Japon, en Corée, en Amérique, en Australie, aux Philippines.
C'est de Hong-Kong que part la malle américaine qui s'en va à San-Francisco en touchant à Shang-haï et à Yokohama: c'est de Hong-Kong que part le service postal de Vancouver, la fameuse ligne des paquebots Empress, qui permettent depuis quelques années au citoyen Anglais de faire le tour du monde sans quitter le territoire britannique; enfin, nos Messageries Maritimes relâchent à Hong-Kong; ils y prennent la soie dont tous les Lyonnais connaissent [Pg 40]le nom, la fameuse soie de Canton. Ils y importent, pour Canton et la Chine, des tissus de coton anglais, des objets de ménage et d'alimentation anglais et allemands; pas grand'chose de français, hélas! Hong-Kong, d'ailleurs, n'est pas un port d'importation et d'exportation. Le grand courant commercial de la Chine prend naturellement la route du Yang-Tsé et aboutit à Shang-haï. Hong-Kong est le grand dépôt, le port de passage, l'escale indispensable où s'arrête tout navire allant en Extrême-Orient. Et c'est la victoire du génie britannique que d'avoir attiré ce mouvement immense dans son port et dans sa ville.
Les Anglais ont bien fait les choses. Aujourd'hui, Hong-Kong est le grand entrepôt de charbon de l'Extrême-Orient. On y trouve même du charbon français, notre charbon tonkinois, qui est assurément le meilleur. On ne peut guère lui reprocher que de n'être jamais en quantité suffisante pour satisfaire immédiatement aux demandes de la consommation. On y trouve des vivres frais de toutes sortes,—un trésor dont tous les marins connaissent la valeur;—on y trouve une rade immense à deux entrées également [Pg 41]praticables à tous les navires; on y trouve toutes les agences, toutes les facilités de commerce, tout ce qui permet de conclure promptement les affaires, de hâter les marchés, de contenter pleinement le «Time is money» des Yankees.
Comme civilisation, malgré son extérieur asiatique et son enseigne chinoise, Hong-Kong vaut n'importe quelle ville d'Europe. Hong-Kong possède une douzaine de banques, dont plusieurs émettent un papier qui a cours sur tout le littoral, jusqu'à Shang-haï. Hong-Kong imprime chaque jour trois journaux, certainement supérieurs à la moitié des journaux de province française: China Mail, Hong-Kong Daily Press, Hong-Kong Telegraph. Hong-Kong possède ses librairies et ses éditeurs, Hong-Kong donne des fêtes, organise des régates, fait courir sur un très beau champ de courses les petits chevaux de la Chine et de l'Indo-Chine et aussi les grands australiens à longue encolure fine.
Hong-Kong réunit, en hiver, dans des clubs somptueux, ses banquiers, ses négociants, et les officiers pleins de morgue de son superbe [Pg 42]régiment de cipayes hindous; il réunit aussi, dans les salons qu'envieraient nos préfectures françaises, toute la colonie féminine de la cité: des Anglaises que le tennis conserve fraîches malgré le climat; des Allemandes nouvelles arrivées, déjà nombreuses; et trois Françaises en tout, si je ne me trompe,—tout cela déshabillé à souhait dans des toilettes qu'on portait à Paris, il y a au moins deux mois. Voilà ces villes d'Extrême-Orient que tout bon Français décrète barbares du coin du feu, en se disant avec conviction: «Ça ne vaut pas mon Landerneau!»
Et ce qu'il faut admirer ici, c'est la large manière dont les colonisateurs ont su respecter la nature, en greffant sur elle leur civilisation. A Hong-Kong, les Anglais ont planté un rocher nu, mais ils l'ont planté d'arbres chinois; ils ont percé de larges rues, parce qu'il leur fallait de la propreté et de l'air, mais ils ont bordé ces rues de maisons chinoises, que des artisans chinois se sont empressés d'habiter. C'est un des plus vifs charmes de Hong-Kong, pour le touriste, que ces rues mi-asiatiques, assez aérées [Pg 43]pour qu'on puisse s'y promener sans trop se boucher les narines, et pittoresques extrêmement avec leurs échoppes étranges, sombres, avec au fond un escalier mystérieux de bois doré, sur la porte deux Chinois actifs et silencieux, devant l'entrée, balancées au vent, une longue enseigne couverte de caractères bizarres et deux énormes lanternes d'osier, mal diaphanes. Dans les rues, entre les trottoirs encombrés de Chinois à queue, vêtus de bleu, coiffés de grands chapeaux de jonc, et parmi lesquels on voit de temps à autre la figure bronzée, aiguë et sympathique, d'un Malais, ou la gigantesque figure d'un cipaye moulé dans son uniforme cachou; sur la chaussée large et propre, entretenue avec un soin britannique, courent les pousse-pousse, les djin-rickshô, comme on les nomme dans tout l'Extrême-Orient, qui sont exactement la même chose que les Kourouma japonais, de minuscules voitures à deux roues, montées sur ressorts et que traîne d'un trot infatigable un Chinois jaune, que vous payez sept ou huit sous par heure. Parfois, c'est un palanquin qui s'en va vers le haut de la ville, par des escaliers raides inaccessibles au simple djin. Cela, c'est [Pg 44]le véhicule de luxe, réservé, sauf nécessité, aux fonctionnaires pas trop pressés, aux ladies en visite, aux Américaines aussi, qui sont à Hong-Hong l'équivalent des demoiselles au Café Anglais, la partie européenne et haut cotée des bataillons demi-mondains d'Extrême-Orient. (Le mot d'Américaines, la chose ne manque pas de piquant, a cessé de désigner ici une nationalité pour étiqueter une profession).
Palanquins, djin-rickshô, il n'y a pas autre chose ici: ni tramways, ni voitures. Mais, la nuit venue, chaque véhicule allume ses lanternes, très semblables à celles de n'importe quel fiacre parisien, lyonnais. Et, dans la rue houleuse de foule, sur laquelle les arcs électriques jettent de loin en loin leur lueur blanche, devant les boutiques dont le bataclan exotique prend dans la pénombre des aspects plus exotiques encore, c'est infiniment, prodigieusement étrange que la course de ces fiacres minuscules, silencieux et pressés, qui trottinent moins vite derrière leur Chinois gêné par l'encombrement, par les flâneurs, par les porteurs de fardeaux équilibrant sur leur épaule le grand bambou aux bouts duquel [Pg 45]ils suspendent la charge par moitié, par les marchands de bonbons, de riz et de poisson séchés...
Terminons par un peu de choses sérieuses. Au hasard de votre arrivée à Hong-Kong, vous y trouverez au moins trente vapeurs et une quinzaine de voiliers. Les premiers jaugeront environ cinquante mille tonnes, et les seconds vingt mille à peu près. De ce tonnage journalier de 70.000 tonnes, les navires anglais, presque tous des vapeurs, détiennent plus de la moitié. Les allemands, vapeurs aussi pour la plupart, interviennent pour 15.000 tonnes. Les Américains font presque autant, mais presque exclusivement avec des voiliers. Il reste huit ou neuf mille tonnes à répartir entre les Norvégiens, les Japonais, les Chinois, les Italiens, les Hollandais, les Portugais, que sais-je? Nous, si, deux fois par mois, le courrier français n'amenait pas en rade de Hong-Kong sa longue coque noire, notre pavillon y serait aussi inconnu que peuvent l'être le pavillon monégasque ou les couleurs du sultan.
Et pourtant, c'est à côté de Hong-Kong que se trouvent Saïgon, Hanoï, le Tonkin, la Cochinchine, [Pg 46]toute une région peuplée, immense, fertile, que nous avons conquise au prix de beaucoup de sang et de haines, pour le plus grand profit de messieurs les Anglais et des Allemands!
[1] Le Salut Public, 26 avril 1898.
En toute humilité, j'avoue qu'il y a six mois, au moment où je bâtissais les plans de ce grand voyage en Extrême-Orient que je poursuis aujourd'hui, le nom de Kouang-Cho-Van m'était totalement inconnu. Et, plus récemment, quand on m'annonça que notre pavillon allait flotter sur cette terre ignorée jusque-là, il me fallut trois bons quarts d'heure pour trouver sur ma carte de Chine où gisait notre nouvelle colonie.
J'étais alors à Hong-Kong. Ceux qui ont suivi mes étapes savent qu'il y a peu, très peu de Français à Hong-Kong. De tous mes compatriotes, [Pg 48]pas un n'avait notion de Kouang-Cho-Van. Je retournai, sur ces entrefaites, au Tonkin. Là, j'obtins tous les renseignements existants.
—Kouang-Cho-Van.—Baie mal connue, dont aucune carte précise n'a été publiée.—Située entre Haï-Phong et Hong-Kong, à peu près à moitié chemin, sur la face orientale de la presqu'île de Leï-Tchéou.—Aucun bâtiment n'y relâche jamais.
C'est tout ce que je pus apprendre. Personne, que je sache, n'était jamais allé là. Et moi, décidé à savoir à quoi m'en tenir, j'ai pris le parti le plus simple, et je suis allé à Kouang-Cho-Van. Je crois bien que je suis le premier Français qui ait mis le pied sur la nouvelle terre française,—après les gens officiels, fonctionnaires, soldats ou marins, s'entend. Et pour attrayant que puisse sembler ce voyage, je ne le conseillerai à personne, car ce n'est pas précisément une partie de plaisir.
J'ai fait une véritable odyssée. Je me suis embarqué à Haï-Phong sur un charbonnier qui allait à Hong-Kong et qui m'a déposé en route à Hoï-Hao, sur la côte d'Haï-Non. Là, j'ai dû [Pg 49]fréter une jonque, qui, après quatre jours de mer, m'a enfin amené devant Kouang-Cho. Inutile de dire que la navigation chinoise, sur une jonque, par mer pénible, sans abri, sur le pont, ce qui ne vous épargne aucunement les relents ignobles des Chinois et de leur cuisine, n'a rien qui puisse séduire l'Européen le plus endurci.
A Hoï-Hao, j'avais trouvé une ville sérieuse, peuplée d'une quarantaine de mille Célestes, suffisamment commerçante, habituée à l'étranger,—autant que peut l'être une petite cité chinoise. Bref, un pays possible. On y fabrique même des bibelots à l'usage des étrangers, de drôles de petites tasses en coco sculpté, doublé d'étain poli. Devant cette civilisation avancée, et sachant Kouang-Cho éloignée d'à peine cent milles, j'augurais déjà à merveille de notre acquisition. Je ne fus pas long à en revenir. Rien qu'à fréter ma jonque, j'eus des difficultés inimaginables. Mon patron chinois, au seul nom de Kouang-Cho, simulait la plus vive terreur et m'expliquait, à grand renfort de gestes, qu'à pareille équipée nous risquerions tous notre tête. Il consentit pourtant, moyennant la somme [Pg 50]respectable de quatre-vingts piastres. Et j'ai vu Kouang-Cho-Van.
La rade de Kouang-Cho est une étendue d'eau très vaste, mal délimitée, entourée de marécages qui se découvrent à marée basse, et semée de brisants un peu partout. Entre les dangers existe un passage profond, large d'un mille à trois, assez semblable au chenal de l'embouchure d'un fleuve et auquel on accède en franchissant une véritable barre qui constitue le plus grand défaut du nouveau port. Cette barre là n'est franchissable par un gros navire qu'à marée haute et par temps calme. Il sera, paraît-il, impossible de l'améliorer. Le fait m'a été postérieurement affirmé par un des marins du Duguay-Trouin qui a passé plusieurs mois au mouillage de Kouang-Cho.
La barre franchie, on pénètre dans le chenal dont j'ai parlé et qui traverse toute la baie. Au nord-ouest, une sorte de bras de mer s'enfonce dans le continent, séparant la terre de Quang-Cho, à l'est, de la terre de Leï-Tchéou, à l'ouest. Rivière? Golfe? La marée s'y fait sentir assez régulièrement. L'eau est toujours profonde, le chemin facile. A cinq ou six milles de l'embouchure [Pg 51]de ce fleuve supposé, j'ai aperçu notre Duguay-Trouin, dont la mâture faisait un effet bizarre au-dessus des prairies et des bouquets d'arbres. En face du croiseur, sur la rive droite, un petit port de construction chinoise montrait ses créneaux entre une rizière et, un champ de pommes de terre. Et le pavillon tricolore y flottait.
De ville, de village, pas de trace. La campagne plate des côtes chinoises s'étend à perte de vue sur les deux rives. Le sol est cultivé soigneusement. Les champs se succèdent, bien entretenus, tirés au cordeau et séparés par des haies vives.
Çà et là, un bouquet d'arbres, un petit bois, à l'abri duquel se dissimule inévitablement un hameau chinois, cinq ou six cases soigneusement cachées au redoutable soleil, le terrier des cultivateurs des champs d'à côté. Ces rizières d'un vert merveilleux, ces bois aux arbres variés et gracieux, tout cela fait un paysage de parc à grandes pelouses jalousement gardées. On prend envie de s'y promener. De près, cela change un peu. La rizière est un marécage où les buffles enfoncent jusqu'au cou; le bois est obscurci [Pg 52]de moustiques; seul est praticable le minuscule sentier qui court en digue le long des champs.
Très peuplé, malgré son apparence déserte, le pays est d'une pauvreté sur laquelle il serait naïf de se faire illusion. Les champs nourrissent à grand'peine les habitants, et pas un pouce de terre n'est perdu. La pêche est pratiquée et peu fructueuse, malgré l'habileté extraordinaire des pêcheurs chinois. La chasse est presque impossible dans un pays aussi cultivé.
Quant aux ressources minières, elles ne doivent pas être importantes sur ce terrain plat et inondé. Cependant, j'ai vu quelques morceaux de charbon provenant d'un gisement reconnu récemment par un missionnaire français, le Père Cellard. Ce charbon ressemblait fort à notre charbon tonkinois, dont l'exploitation, des plus faciles, est loin d'être en pleine activité.
Et, à propos des missionnaires, il n'est pas mauvais de rendre, en passant, justice à l'admirable patriotisme des deux prêtres français qui ont aidé de toutes leurs forces à notre influence, sous la menace, grandissante chaque jour, d'un martyre, hélas! probable.
[Pg 53]Le Père Cellard et le Père Zimmermann ont fait à Kouang-Cho-Van beaucoup plus que leur devoir. Ils ont été, avec un zèle infatigable, guides, interprètes, diplomates, architectes même, et conducteurs de travaux.—Interprètes d'autant plus précieux que le dialecte parle par les indigènes n'est pas le chinois usuel du Sud, le cantonais, mais une langue spéciale dite ouolo, que comprennent fort mal les interprètes ordinaires.
Au physique, tel est Kouang-Cho-Van: un grand champ bien cultivé, trop peuplé, bordant un mouillage parfaitement sûr et abrité, mais à peu près inaccessible aux grands navires, et que les bâtiments de six ou sept mètres de tirant d'eau n'atteindront pas sans difficulté.
Au moral, c'est un pays chinois, c'est-à-dire absolument hostile aux étrangers; j'ai été à terre menacé et insulté, et je n'ai pu pénétrer dans le moindre hameau. Toutes mes excursions se sont bornées à de courtes promenades dans le rayon de vue de ma jonque, que mon patron a refusé fort nettement d'échouer au rivage. Pas une fois je n'ai rencontré de marins français à [Pg 54]terre, hors du fort, ce qui m'a fait supposer que notre zone d'influence était certainement inférieure à la portée de nos fusils. Quant à quoi que ce soit qui ressemblât à une délimitation ou à une frontière, pas le moindre poteau. La reconnaissance géographique était même fort peu avancée. J'imagine que les choses se sont fort embellies depuis mon départ.
Je lis bien, dans un journal tonkinois qu'on vient de m'apporter, que dimanche dernier, 19 juin, un combat horrible se serait livré à Kouang-Cho. Je présume même que la nouvelle va semer la stupeur et la colère en France. Mais je suis à cet égard parfaitement tranquille. Je ne crois pas à la bataille en question. Tout au plus quelques marins auront-ils fusillé quelques pirates. Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, et la répression d'une révolte quelconque est trop facile pour qu'on s'en effraie. N'allons pas assimiler l'occupation de Kouang-Cho-Van à la conquête d'un Tonkin ou d'une Madagascar. C'est bien assez d'être forcé de convenir que cette occupation est inutile et un peu ridicule; qu'elle n'ajoute rien à notre puissance maritime ou coloniale; qu'elle n'offre à notre commerce [Pg 55]aucune chance d'accroissement, et qu'enfin elle ne représente rien d'équivalent aux acquisitions inestimables qu'ont faites nos ennemis ou nos alliés à Kia-Cho, à Talien Van, à Port-Arthur et à Weï-a-Weï.
[1] Le Salut Public, 10 août 1898.
(Hong-Kong, 25 mai 1898).
Le public français a appris la destruction de la division espagnole des Philippines, le lendemain même de la bataille. Si j'envoie si tard ces quelques détails sur le combat, ce n'est pas à titre de spectateur, car je n'étais pas à Manille à cette date sanglante du 1er mai. Mais à Hong-Kong, où les Américains vinrent apporter eux-mêmes la nouvelle de leur victoire, j'ai eu l'occasion d'en faire parler plusieurs officiers; et ce que je voudrais, c'est faire comprendre aux gens étrangers à ces choses comment il se fait [Pg 60]que les Espagnols, braves, bons marins, et disciplinés, ont pu subir un désastre total sans même avoir endommagé leurs adversaires.
Autant qu'il m'en souvient, la dépêche Havas du 2 mai donnait très exactement, à quelques détails près, le résultat de la bataille: «L'escadre américaine a réduit les forts espagnols et coulé ou incendié tous les bâtiments sans exception. Les Espagnols ont eu trois cents tués et quatre cents blessés.»
La nouvelle a dû, en France, paraître invraisemblable. A Hong-Kong, elle n'a surpris personne. On s'y attendait, dans le monde militaire surtout.
Huit jours auparavant, j'avais vu en rade relâcher cette escadre du commodore Dewey. Elle comptait quatre fort beaux navires, redoutables à n'importe quels croiseurs européens: l'Olympia, croiseur amiral, un grand navire de la taille de notre Pothuau, dépourvu de cuirasse, mais mieux armé et plus rapide;—le Baltimore, le Raleigh et le Boston, bons bâtiments un peu moins forts, mais parfaitement modernes et puissamment armés; en outre, deux canonnières, le Pétrel et le Mac-Culloch, [Pg 61]sans grande valeur du reste. C'est ce dernier navire qui, le premier, apporta à Hong-Kong la nouvelle précise de la victoire.
En tout, l'escadre américaine déplaçait dix-huit mille tonnes, réparties sur quatre navires de combat. Sa grosse artillerie comptait dix pièces de 20 centimètres, de modèle récent; en outre, trente-six canons de moyen calibre, et trente-quatre pièces légères; le tout suffisamment abrité derrière des masques d'acier, protégeant pièces et servants des coups de l'ennemi.
La division espagnole, qui attendait son sort dans la baie de Manille, avait une composition bien inférieure. Elle comptait surtout des canonnières mieux faites pour la police que pour la guerre, de petits bâtiments construits pour appuyer près des côtes ou dans les rivières les opérations des troupes régulières contre les insurgés, et non pas pour subir l'attaque de grands croiseurs de haute mer bâtis pour le combat. Tels étaient le Don-Juan-de-Austria, le Don-Antonio-de-Ulloa, le Velasco, l'Isla-Cuba, l'Isla-Luçon. Seuls, les deux derniers, un peu plus récents, possédaient un pont cuirassé leur permettant de recevoir quelques obus sans couler [Pg 62]immédiatement. A ces quelques canonnières, il faut joindre un croiseur en bois, sans protection aucune, la Castilla, et un croiseur en fer, la Reina-Christina, assez pauvre navire, un peu supérieur pourtant à ses compagnons. C'est sur la Reina-Christina que flottait le pavillon amiral.
Le tableau suivant résume en quatre chiffres les forces respectives des deux adversaires.
Valeur numérique.—Américains: 18.000 tonnes, 2.000 hommes.—Espagnols: 12.000 tonnes, 1.500 hommes.
Grosse artillerie.—Américains: 10 pièces de 200 m/m.—Espagnols: Néant.
Artillerie moyenne.—Américains: pièces de 152 m/m, 17 canons.—Espagnols: 10 canons.—Pièces de 125 m/m:—Américains: 20 canons.—Espagnols: 18 canons.
Artillerie légère.—Américains: 34 pièces; Espagnols: 34 pièces.
Et ce que les chiffres ne disent pas, c'est que, dans l'escadre américaine, tout est spécialement fait pour la guerre, et rien dans l'escadre espagnole. Ç'a été presque la bataille de soldats réguliers contre une foule en émeute, les soldats étant plus nombreux d'ailleurs que la foule.
[Pg 63]Ce qu'il faut ajouter encore, c'est que les hommes du commodore Dewey, éloignés de leur pays, entraînés par la navigation fréquente à une discipline plus exacte, étaient sous ce rapport très supérieurs à la moyenne des équipages américains.
Dans ces conditions, les Espagnols pouvaient espérer infliger à l'ennemi quelques pertes avant de succomber, mais rien de plus.
Ils n'ont pas eu cette consolation dans leur désastre.
Dans la nuit du 1er mai, les navires américains, peints en gris (toile mouillée, disent les marins), pour être invisibles, pénétrèrent dans la rade en ligne de file, tous feux soigneusement éteints. La rade de Manille est pauvrement défendue par quelques forts anciens, armés d'une artillerie insuffisante et démodée. Récemment, le commandant de la Castilla, jugeant avec raison son navire sans valeur militaire, avait proposé d'en faire passer les canons à terre pour renforcer une batterie. Je ne sais si l'avis avait été suivi. En tous cas, les forts, dépourvus de projecteurs électriques, n'aperçurent pas les assaillants. Le commodore franchit la passe avec [Pg 64]beaucoup d'audace, et, au jour seulement, il essuya quelques coups de canons de la dernière batterie. Les coups ne touchèrent pas, et les croiseurs américains s'avancèrent contre les navires espagnols.
Ceux-ci étaient mouillés à l'abri des bas-fonds qui interdisaient aux grands bâtiments ennemis de les approcher à moins de trois ou quatre mille mètres. Les Américains défilèrent donc à grande distance, en canonnant vivement la division à l'ancre.
Par une négligence qu'ils ont payée cher, les Espagnols n'avaient pas leurs chaudières allumées, et ne s'attendaient nullement au combat. Il s'en suivit évidemment un désordre inexprimable. Les commandants exécutèrent le branle-bas de combat sous le feu. Avant que les canons espagnols aient pu riposter un coup, plusieurs pièces étaient démontées, plusieurs pointeurs tués. La justesse du tir espagnol s'en ressentit. La Castilla prit feu et cessa de tirer. Plusieurs canonnières se jetèrent à la côte, près de couler bas.
La Reina-Christina alors, ayant réussi à prendre de la pression, leva l'ancre et se dirigea [Pg 65]bravement sur l'ennemi. Ce noble exemple ne put malheureusement être suivi par personne, et le croiseur amiral n'arriva pas à moitié chemin. Déjà percé de toutes parts, il reçut un obus de 200 millimètres en enfilade, qui tua le commandant, blessa l'amiral, et acheva la ruine du malheureux navire. La Reina-Christina abandonna le combat sans amener son pavillon, d'ailleurs, et se jeta à la côte.
Il était alors huit heures du matin. Les Américains, dont les pertes étaient insignifiantes, se retirèrent pour faire reposer et déjeuner les équipages. Après quoi le combat ou plutôt l'exécution recommença. Un seul incident, qui témoigne de l'héroïsme des vaincus, le signala. Deux torpilleurs espagnols, de très ancien modèle et probablement en assez mauvais état, essayèrent de s'approcher des Américains pour leur lancer une torpille. Cette attaque, dangereuse et téméraire contre un ennemi en marche, même de nuit, n'offrait aucune chance de succès en plein jour. A huit cents mètres de l'Olympia, un des torpilleurs coula. L'autre, démonté de sa machine, et tout le monde à bord tués ou blessés, sans exception, alla faire côte. Son pont [Pg 66]était éclaboussé de sang de l'avant à l'arrière.
Alors, tout fut fini. Le Pétrel put s'approcher des Espagnols vaincus et achever la destruction des débris encore flottants. Pas un pavillon ne s'était amené, et le chiffre des hommes hors de combat,—sept cents sur quinze cents,—attestait la bravoure espagnole.
Les Américains ont eu là une victoire facile. Ils en conviennent eux-mêmes. Le commodore a qualifié la bataille de «promenade dans la baie». En outre de leur écrasante supériorité matérielle, les Américains ont eu l'avantage d'une surprise, et ils ont combattu en marche une escadre au mouillage. Rien dans le résultat ne saurait surprendre un marin.
Je ne sais quelle leçon les Espagnols tireront de leur désastre. Ils devraient pourtant comprendre que la guerre d'escadre n'est pas leur fait, et qu'en la pratiquant contre un ennemi deux fois plus fort, ils courent à une défaite certaine. Au contraire, leurs très bons croiseurs et la vulnérabilité du commerce américain, leur offrent un mode de guerre aisé et terrible. Il n'est que temps pour eux d'en venir à la guerre de course.
[Pg 67]Pour finir, deux anecdotes sur la journée du 1er mai: pendant le combat, le feu d'un fort gênant un peu la manœuvre des Américains, le Baltimore exécuta contre ce fort un feu rapide d'une telle intensité que, du coup, les Espagnols durent évacuer immédiatement les pièces devenues intenables.—Autre chose: Pendant le passage des passes, le commodore avait interdit formellement tous signaux, quoi qu'il arrivât, de peur de donner l'éveil à l'ennemi. Pendant la manœuvre, le mécanicien du Mac-Culloch fut frappé de congestion. Il n'y avait pas de médecin à bord. On n'en appela pas, et l'officier mourut. Mais aucun signal n'avait été fait, et la consigne du commodore était respectée.
[1] Le Salut public, 5 juillet 1898.
(Manille, juillet 1898).
Soleil brumeux, rude vent du large. Il fait chaud, mais pas trop. Manille vaut mieux que sa réputation. D'Amoy à Singapore, on ne voit aujourd'hui que des casques blancs. Jusqu'aux femmes, dont la coquetterie doit s'accommoder de l'horrible coiffure de liège, à peine enrubannée de satin blanc. Ici, le soleil est plus indulgent. Les caballeros traversent insoucieusement les rues, mal abrités sous leurs sombreros de feutre fin ou sous leurs grands manilles de paille tissée serrée. Les señoras s'en vont frôlant les murs, la tête encapuchonnée dans la mante, et affrontent [Pg 69]les terribles rayons en déployant seulement leur éventail ou leur petit parasol. Tout cela n'est pas bien méchant...
Gaie et bruyante à l'ordinaire, la ville est étrangement silencieuse. Seulement, comme au-dessus de ce silence, un grondement inégal et perpétuel, les canons qui se répondent, sur la tranchée.
C'est un vrai siège. Sur un immense demi-cercle, long d'une quinzaine de kilomètres, les Tagals enserrent la ville d'une ligne infranchissable, d'autant mieux que tout le pays environnant est à eux, et qu'ils sont bien dix fois plus nombreux que les assiégés. Ceux-ci ont aligné en face une longue tranchée assez mal établie, renforcée de kilomètre en kilomètre d'un fortin garni de quelques canons. C'est tout. On tire tout le temps, mais sans enthousiasme. Nuit et jour, canons, fusils se répondent consciencieusement. Exception pour les repas, que les adversaires ont soin de prendre à la même heure: c'est une trêve scrupuleusement observée.
Mais à part ce bruit persistant dont on prend vite l'habitude, la ville a presque sa physionomie [Pg 70]ordinaire. Les équipages, pour être moins nombreux qu'autrefois, n'en font pas moins la promenade select de la Lunetta, et l'on y rivalise d'élégance comme par le passé. Les combats de coqs groupent toujours autour de leur arène minuscule la même foule passionnée, augmentée même des étrangers, des visiteurs plus nombreux qu'on ne le croirait; beaucoup de gens, des Allemands surtout, se trouvent à Manille, présence un peu étrange, dont on cause beaucoup. Enfin les cafés sont remplis, et, tout en dégustant force sorbets,—rien ici qui décèle la famine; c'est à peine si le prix des vivres augmente peu à peu;—tout en fumant profusion de cigares et de cigarillos, on échange des vues sur la guerre.
La population manifeste une confiance d'autant plus extraordinaire que la situation militaire est absolument désespérée, et que les officiers espagnols mettent presque de l'ostentation à l'avouer. Pas un homme de bonne foi qui ne convienne que Manille peut, d'un instant à l'autre, être emportée d'assaut par Aguinaldo, qui dispose de la moitié des rebelles, suffisamment décidés à lui obéir. Personne surtout à [Pg 71]douter que Dewey puisse anéantir littéralement la ville sous le feu de ses croiseurs, le jour où il lui plaira de défiler devant. En attendant, Aguinaldo ne donne pas l'assaut, Dewey reste mouillé à Cavite. C'est à qui ne commencera pas.
Les Espagnols attendent. Au moral, ils ressemblent aux Parisiens de 70. La psychologie de gens assiégés ne doit pas varier beaucoup. Les Manillais attendent avec certitude l'arrivée d'impossibles secours. Ils attendent l'escadre de l'amiral Camara. On sait pourtant ici qu'elle a repris le chemin de Cadix. Ils attendent on ne sait quel navire sauveur, venant d'on ne sait où. Il y a huit jours, une canonnière autrichienne a mouillé au large. La populace a pris de loin le drapeau blanc et rouge de l'Autriche pour un pavillon espagnol. Pendant deux heures, la ville a été comme électrisée. Puis, ce sont les nouvelles à sensation révolutionnant un quartier. Deux navires américains ont fait côte... Aguinaldo vient d'être tué... Les rebelles ont évacué les avant-postes... Aguinaldo est tué de nouveau,—on tue Aguinaldo avec un plaisir manifeste. Parfois, dans le tas, une vérité se déterre, [Pg 72]celle-ci par exemple: Dewey a débarqué quelques troupes nègres près de Cavite. Les rebelles, qui ont le préjugé de la couleur d'autant plus enraciné qu'ils sont presque tous mulâtres, ont accueilli leurs noirs alliés par une fusillade bien nourrie et les ont rejetés à la mer après un combat furieux. Après quoi, on s'est expliqué, et Aguinaldo a présenté à Dewey mille excuses, tout en insistant pour que les nègres restassent désormais où ils étaient.
La discorde règne évidemment dans le camp d'Agramant. Aguinaldo n'a qu'une influence médiocre sur une grande part des rebelles, et Dewey a de bonnes raisons de se défier de pareils alliés. Mais, par contre, les troupes espagnoles sont dans un découragement complet. Il faut les voir rentrer de la tranchée, traversant les rues en troupeau, sans chefs, sans clairons, allant lourdement, sans énergie, sans ardeur. Il faut voir la tranchée surtout. On y accède librement. Pas un chef, pas une sentinelle, ni laissez-passer, ni mot d'ordre. Dans le fossé à demi plein d'eau, juchés sur des caisses vides, quelques hommes, armés de Mauser, fusillent indolemment la tranchée adverse. D'autres, assis [Pg 73]sur des tas de boue, jouent aux cartes. Les munitions ni les fusils ne manquent; tout cela est allemand, et semble absolument inépuisable. Et toute la garnison est là, éparpillée sur cette tranchée interminable, impossible évidemment à concentrer sur un point menacé. Si l'ennemi attaquait résolument à un bout de la ligne, il serait au cœur de la ville avant que les Espagnols de l'autre bout s'en soient douté.
En rade, tout est normal. Les Américains sont à Cavite et on ne les aperçoit pas. Devant la ville, une véritable escadre battant tous les pavillons du monde, depuis le chrysanthème rouge du Japon jusqu'à la croix de Saint-Georges anglaise. Très peu d'Anglais pourtant. Ils n'ont garde de venir troubler leurs futurs alliés. Nous, nous avons ici l'antique et glorieux Bayard, encore tout plein du souvenir de Courbet; le Pascal, un beau croiseur fort élégant; le Bruix, tout hérissé de longs canons sortant de leurs tourelles. Enfin, une profusion d'Allemands, beaucoup plus que de raison même. Voici le Kaiser, aussi laid que possible; l'Irène, la Princess-Wilhelm, la Kaiserin-Augusta, [Pg 74]d'autres encore. Sans cesse, de grands chalands espagnols accostent les navires allemands et repartent pleins. Visiblement les Allemands débarquent ici quelque chose. Vivres? Armes? Les Américains ne voient rien, ou font semblant. C'est assurément prudent, car, en cas de bataille, ils sont à peu près sûrs d'avoir le dessous.
Ce gros mot de bataille, on le prononce volontiers à Manille. La sympathie marquée des Allemands pour l'Espagne est commentée très vivement. Il est certain que l'attitude des Allemands est extraordinaire. Sans même parler de ce fait inqualifiable de débarquer tout un matériel, quel qu'il soit, dans une ville bloquée, au mépris de toute neutralité, les proclamations successives de l'amiral allemand sont de nature à créer pas mal de difficultés diplomatiques. A diverses reprises, en effet, les Allemands ont déclaré ne pas reconnaître les insurgés comme belligérants; ils ont menacé d'intervenir sur-le-champ si Aguinaldo pénétrait dans la ville; ils ont protesté contre la remise aux insurgés par les Américains de prisonniers espagnols, et protesté de telle sorte que Dewey a repris ses prisonniers. Enfin, à maintes reprises, les officiers [Pg 75]allemands ont manifesté bruyamment en l'honneur de l'Espagne et affirmé, à qui a voulu l'entendre, que les Philippines ne seront pas Américaines de sitôt. Est-ce vrai? De tout cela, on se préoccupe à Manille plus qu'il n'est sensé. Mais il faut avouer aussi qu'une intervention allemande dans le conflit hispano-américain pourrait modifier étrangement les choses.
[1] Le Salut Public, 5 septembre 1898.
Maintenant que l'affaire de Fashoda commence à s'éloigner de nous, nous pouvons en parler avec plus de calme et de clairvoyance. Ce qui est fait est fait, et nous ne nous proposons pas d'apprécier la conduite du gouvernement, ni surtout de récriminer contre lui. Par une concession suprême, évidemment douloureuse au point d'honneur français, une guerre redoutable a été évitée, voilà ce qu'on ne peut guère mettre en doute. Cette guerre, qui aurait mis la France aux prises avec l'Angleterre vers les premiers jours de novembre 1898, nous nous proposons d'envisager les chances [Pg 80]que nous pouvions avoir d'en sortir victorieux.
L'écrivain anglais dont l'opinion en la matière fait autorité en Europe, lord Brassey, a déclaré récemment, dans un discours remarqué, que jamais la puissance navale anglaise n'avait été aussi formidable; et, précisant sa pensée, l'orateur a ajouté que le rapport de cette puissance à celle des nations étrangères passait par un maximum en cette année 1898. Ce qui signifie qu'aux yeux d'un homme particulièrement à même de voir juste, jamais les chances de victoire de l'Angleterre n'ont été si favorables[2].
Quant à nous, il est bon qu'on le sache, jamais, [Pg 81]au contraire, un conflit ne nous a trouvés dans un si complet désarroi.
Nous n'étions pas prêts. Et ce point capital, bien mis en lumière, aidera peut-être ceux qui ont rougi de l'affront à mieux accepter le fait accompli.
Etre prêts est une expression qui renferme force termes. Il va de soi que, parmi ces termes, figure en première ligne la nécessité d'avoir le matériel de guerre nécessaire et le personnel convenablement entraîné et instruit,—ce que n'avait pas l'Espagne, par exemple; ce que nous avons, grâce à Dieu[3]!—Mais là n'est pas tout; ce matériel perfectionné, ces hommes aguerris, ne donneront leur rendement maximum que dans certaines circonstances dont la réunion constitue en quelque sorte un moment psychologique particulièrement favorable. On peut rendre la chose frappante par un exemple: il est évident qu'un corps d'armée surpris par la guerre à la veille des grandes manœuvres est [Pg 82]dans de meilleures conditions qu'un corps d'armée, d'ailleurs identique, mais surpris au moment de l'arrivée des recrues ou d'un changement de commandement. Eh bien, lors de l'affaire de Fashoda, une fatalité inouïe avait réuni contre nous toutes les circonstances défavorables.
Il est d'ailleurs facile de le constater.
Tout d'abord, la transformation des escadres, conçue par M. Lockroy, était commencée et non achevée. On se souvient que cette transformation comportait principalement l'envoi de plusieurs navires de Brest à Toulon, et l'envoi inverse d'autres bâtiments de Toulon à Brest. La guerre survenant aurait trouvé nos deux escadres de la Méditerranée et du Nord également désorganisées.
Quelques jours plus tard, les navires s'étant rejoints, les escadres se seraient, à vrai dire, retrouvées au complet. Mais, faute de quelque temps d'exercices, leurs unités, naviguant ensemble pour la première fois et sur des mers mal familières, se seraient trouvées inférieures à elles-mêmes. Enfin, pour comble de malheur, les commandants en chef venaient d'être changés [Pg 83]et connaissaient forcément mal les navires placés sous leurs ordres. A ce sujet, on ne peut assez féliciter le ministre qui a enfin décidé de porter la durée des commandements d'escadres à deux années. Tout changement de chef entraîne forcément une période de presque indisponibilité pour l'armée.
Ce n'est pas tout. Des six cuirassés de l'escadre du Nord, les deux meilleurs, le Formidable et l'Amiral-Baudin, étaient et sont encore dans un état d'infériorité flagrant. Ces bâtiments ont subi l'an dernier une modification importante. Leur tourelle centrale, contenant une pièce de 370 millimètres, a été supprimée, et à sa place a été installé un réduit blindé abritant quatre canons à tir rapide de 164 millimètres.
La transformation a surtout ceci de bon, qu'elle a allégé sensiblement les deux bâtiments, dont la surcharge était telle que leur cuirasse de flottaison, entièrement enfoncée, ne servait plus absolument à rien. Mais, chose incroyable, les auteurs du projet n'avaient oublié qu'une chose, c'était de commander à l'industrie les plaques de cuirasse destinées à blinder le nouveau réduit. En sorte que, depuis plus d'un an [Pg 84]que la réparation est faite et les navires armés, les réduits attendent toujours leur cuirasse; les canons de 164 n'ont donc, pour le moment, aucune protection, et la valeur militaire des deux cuirassés est diminuée d'autant.
Autre chose. L'escadre de la Méditerranée comptait bien ses six cuirassés au complet, et ces navires homogènes, rapides et puissants, auraient été évidemment pour l'Angleterre un aléa redoutable. Mais la division dite d'instruction, forte de trois cuirassés sérieux, Magenta, Neptune et Marceau[4], n'était pas encore armée; et de ce chef, un temps précieux aurait été perdu.
Enfin, chose plus grave peut-être, nous possédons trois navires qui viennent à peine d'être achevés. Ce sont trois cuirassés d'escadre, absolument de premier ordre, et qui ne le cèdent en rien à aucun cuirassé anglais, quel qu'il soit. Eh bien! ces navires n'auraient pu en aucune façon prendre part à la lutte, parce qu'ils n'ont [Pg 85]pas de canons. Par une négligence invraisemblable, les pièces destinées au Charlemagne, au Gaulois et au Saint-Louis, commandées apparemment un peu tard, ne seront prêtes que dans un an.
Voilà un petit faisceau de faits qui sont à méditer.
Est-ce à dire que nous aurions été vaincus? Peut-être!
Evidemment, l'escadre du Nord n'était pas en mesure d'attaquer. Mais, par contre, mouillée à Brest, elle pouvait braver indéfiniment tous les efforts de l'ennemi et l'obliger à un blocus épuisant. A l'entrée de l'hiver, la flotte anglaise, qui aurait établi sa croisière à l'entrée de la Manche, se serait placée dans une situation périlleuse, prise entre les récifs innombrables, les coups de temps, les batteries de côtes, et les torpilleurs familiers de la mer bretonne.
Et, malgré son infériorité numérique, l'escadre de la Méditerranée, plus rapide, aurait pu sans grand risque prendre la mer et terrifier littéralement le commerce anglais, de Gibraltar à Suez.
[Pg 86]Mais nous aurions dû accepter dès le début des sacrifices douloureux.
La guerre anglaise n'aurait pas borné ses ravages aux mers d'Europe; elle aurait évidemment embrasé le monde entier, car il n'y a guère de coin de terre où un Anglais et un Français n'aient des intérêts opposés.
Et partout nous aurions subi désastres sur désastres.
Je ne parle que pour mémoire du sort de la glorieuse colonne Marchand. Isolés en face d'un ennemi cent cinquante fois supérieur en nombre, pas un de ces héros n'aurait revu son pays.
Nos colonies lointaines auraient peut-être résisté à l'attaque anglaise. Mais chacune de nos divisions navales aurait fourni à l'ennemi l'occasion d'une facile victoire.
Veut-on préciser?
Au 1er novembre, nous avions trois amiraux commandants à l'étranger: le vice-amiral de Beaumont (cuirassé Vauban), au Tonkin, dans une baie absolument ouverte; le contre-amiral de la Bédollière (cuirassé Bayard), au Japon, à quarante-huit heures de Weï-a-Weï; le contre-amiral [Pg 87]Escande (croiseur Dubourdieu), aux Antilles, n'ayant pas un seul port de refuge à sa disposition; tous trois sur des navires de valeur nulle et de vitesse dérisoire, bons à être coulés en cinq minutes par le premier croiseur sérieux qui les aurait attaqués.
Quarante-huit heures après la déclaration de guerre, nous aurions eu trois amiraux tués ou prisonniers. Sans doute, après cela, rien n'était perdu. En Extrême-Orient, par exemple, Saïgon et Haïphong n'ont pas grand'chose à craindre. Et les Anglais réussiraient-ils à bombarder une ville ou deux, que pas un de leurs marins ne mettrait le pied sur la terre française, défendue par une véritable armée d'occupation. Il n'en serait pas moins douloureux d'avoir, dès les premiers coups de canons, à pleurer des deuils et des défaites.
Nous l'avons dit souvent: en matière militaire, mieux vaut rien que pas assez. Ces navires absurdes que nous entretenons malgré tout en service, ces Bayard, ces Duguay-Trouin, ces Dubourdieu, nous vaudraient, en cas de guerre, autant de désastres. Ils constituent uniquement un point vulnérable de notre organisation et, [Pg 88]par suite, une gêne véritable pour notre politique extérieure.
Et qu'on ne nous oppose pas la raison péremptoire: «Nous n'en n'avons pas d'autres, il faut prendre ceux-là.» Nous avons, au contraire, plusieurs navires disponibles qu'il suffirait d'armer. Pour ne citer que les meilleurs, le Cécille, le Tage, le Chasseloup-Laubat, l'Isly, l'Alger, sont de bons croiseurs modernes qui ne figurent actuellement dans aucune de nos escadres ou divisions armées[5].
Encore une fois, nous n'entendons nullement dire que les Anglais nous auraient vaincus. Une guerre navale est une longue affaire, et nous aurions eu le temps de nous ressaisir. Bien osé serait celui qui, dans un conflit semblable, pronostiquerait l'événement! Mais nous voulons mettre en évidence ce fait profondément regrettable: c'est qu'au moment où la guerre a failli nous surprendre, nous n'étions pas prêts, et que nous aurions payé cher notre infériorité momentanée.
Il est pourtant facile d'éviter de pareilles [Pg 89]aventures. Assurément, il serait déloyal et injuste de reprocher au ministre sa transformation d'escadres, qui a failli nous jouer un fâcheux tour, car, à ce compte-là, on n'améliorerait jamais rien, craindre d'être surpris par la guerre pendant la période intermédiaire. Mais l'histoire de la cuirasse du Formidable et celle des canons du Gaulois contiennent une leçon dont on fera bien de se souvenir. De pareilles négligences, qui causeraient un désastre, risqueraient fort de s'appeler des trahisons.
En tout cas, le péril est conjuré, pour cette fois. Mais nul n'oserait affirmer que demain il ne renaîtra pas plus menaçant encore. Si décidément les Anglais exigent que nous leur fassions la guerre, nous entendons la faire avec les meilleures chances. Nous n'avons pas la prétention de battre à la fois sur toutes les mers un ennemi deux fois plus nombreux, mais nous voulons pouvoir n'accepter la bataille qu'à notre heure et sur notre champ, ce qui est absolument possible. Quand nous en serons là, nous pourrons reprendre en face de nos adversaires l'énergique attitude qui convient à la France, [Pg 90]et ne plus souffrir en silence un soufflet sur notre joue[6].
[1] Le Salut Public, 27 décembre 1898.
[2] Il est exact que jamais l'Angleterre ne fut comparativement plus forte qu'en 1898. Seule comptait alors, en face d'elle, notre marine à nous, Français. Et le rapport de l'une à l'autre était à peu près comme 4 à 1. Au contraire, dès 1900, la marine allemande commença de prendre son essor, et aussi la marine américaine. En 1914, les cuirassés de Guillaume II purent affronter, çà et là, les cuirassés de Georges V: au Jutland, ceux-ci n'étaient guère que trois contre ceux-là deux.—Aujourd'hui,—1921,—l'Angleterre, tout à fait décadente, cède peu à peu cet empire des mers qui fit toute sa grandeur aux Etats-Unis, et pousse la folie jusqu'à se fier totalement à une alliance étrangère, à l'alliance du Japon. Nul doute que, d'ici à quelque quinze ou vingt ans, la grandeur britannique ne soit plus qu'un souvenir.—C. F.
[3] Ce que nous avions en 1900; ce que nous avions même encore en 1914; mais ce que nous n'avons plus en 1921. La marine française, elle aussi, et pour des raisons multiples, n'est plus, aujourd'hui, qu'un glorieux souvenir.—C. F.
[4] Il est bien entendu que toutes les unités navales dont il est question dans ce texte n'existent plus depuis de longues années. L'extrême vieillesse d'un navire de guerre n'excède jamais vingt ans.—C. F.
[6] Tout ce qui précède, écrit il y a plus de vingt ans, semble aujourd'hui tout à fait dépourvu d'actualité. Mais l'histoire est un recommencement éternel. Cet an-ci,—1921,—un journal de Londres déclarait, au grand étonnement de toute la France, que jamais les relations franco-anglaises n'avaient traversé de crise plus grave, depuis Fashoda, qu'à l'heure qu'il est. Changez, dans les douze pages qu'on vient de lire, tous les noms de navires cités; changez aussi quelques détails faciles à découvrir par quiconque sait lire entre les lignes, et l'Après Fashoda que Claude Farrère écrivait en 1898 pourra s'intituler en 1921, Après la Conférence de Londres ou Après l'accord de Paris.—Note de l'Éditeur.
| Avertissement de l'Editeur | 7 |
| I.—Croquis d'Extreme-Orient | 13 |
| 1.—Singapore | 15 |
| 2.—De Saïgon à Hanoï | 25 |
| 3.—Hong-Kong | 37 |
| 4.—Kouang-Cho-Van | 47 |
| II.—Tableaux de la guerre hispano-américaine | 57 |
| 1.—La bataille navale de Monilo-Cavite | 59 |
| 2.—Impressions de siège | 68 |
| III.—Après Fashoda.—Un peu de vérité | 77 |
ACHEVÉ D'IMPRIMER
le vingt juillet mil neuf cent vingt-et-un
POUR LA
SOCIÉTÉ DES TRENTE
PAR
BUSSIÈRE
A SAINT-AMAND (CHER)
Publier trente volumes du même format, avec des caractères classiques, une justification agréable, un papier solide, ne publier que des ouvrages lisibles et bien écrits, avec de bons auteurs et sur des sujets intéressants, sans se soucier des modes littéraires et des habitudes d'un jour, en un mot contribuer au relèvement de l'édition et de la librairie, tel est le but de la Société des Trente, formée par un groupe d'amateurs et d'auteurs qui veulent montrer que l'on peut imprimer de beaux livres à un prix relativement peu élevé.
La Société des Trente publiera les trente volumes qui composeront sa collection en cinq ans, à raison de six par an.
Ces ouvrages seront tirés à 500 exemplaires sur papier vergé d'Arches numérotés à la presse, et 30 exemplaires sur papier Chine ou Japon.
Le format choisi est l'in-8 écu (140mm X 200mm), qui est celui de ce volume.
Le caractère est le Didot classique.
Les volumes seront vendus en librairie au prix de 10 francs l'exemplaire sur papier vergé, 30 francs sur papier du Japon.
La collection sera complète lorsqu'il aura paru trente volumes, qui ne seront jamais réimprimés.
Nous avons déjà publié:
Maurice Barrès.—Pour nos Églises (épuisé).
Émile Bernard.—Souvenirs sur Paul Cézanne (épuisé).
Henry Martineau.—L'Itinéraire de Stendhal.
André Salmon.—La Jeune peinture Française (épuisé).
Rémy de Gourmont.—Le Chat de Misère (épuisé).
Lucile de Chateaubriand.—Œuvres. Étude de L. Thomas.
Maurice Barrès.—Autour des Eglises de Village.
Laurent Tailhade.—Quelques Fantômes de Jadis (épuisé).
Alfred Capus.—Boulevard et Coulisses.
A. Sérieyx.—Vincent d'Indy.
Chateaubriand & ***—Journal d'un Conclave.
Jules Destrée.—Wallonie.
Charles Morice.—Quelques Maîtres Modernes.
Marcel Boulenger.—Apologie du Duel.
Rémy de Gourmont.—Trois Légendes da Moyen Age (épuisé).
André Salmon.—La Jeune Sculpture Française (épuisé).
Émile Bernard.—Tintoret-Greco-Magnasco-Manet.
Diderot.—Historiettes. Recueillies par Suzy Leparc.
X.X.X.—Apologie des Nouveaux Riches.
Charles Du Bos.—Notes sur Mérimée.
François Fosca.—Degas.
Claude Farrère.—Croquis d'Extrême-Orient.
Nozière.—Un spectacle sur un Divan.
Louis Thomas.—Sur un Gratte Ciel.
Jacques Boulenger.—Histoires Vraies.
Louis Laloy.—Contes Magiques.