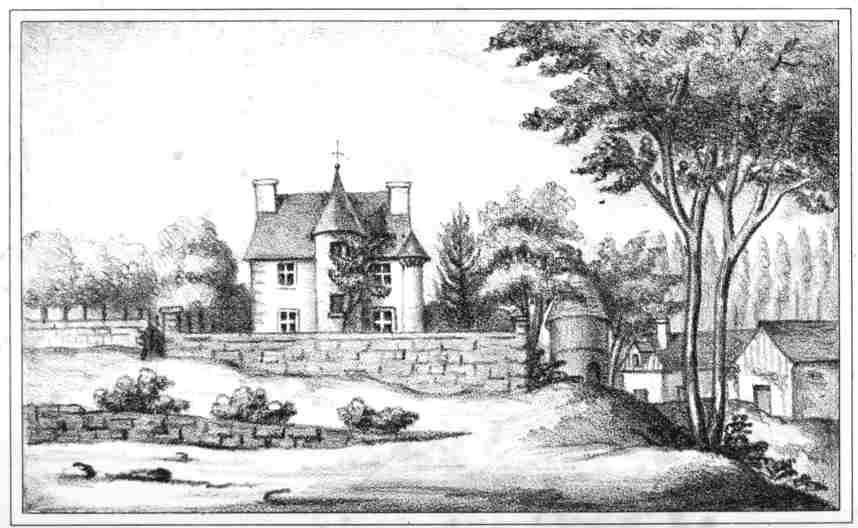
Impr Lith. CARLES, 12, rue JJ. Rousseau.
Dess. d'après nat. par M. E. de CERVAL.
Title: Notice bio-bibliographique sur La Boëtie, suivie de La Servitude volontaire
Author: J.-F. Payen
Estienne de La Boétie
Release date: May 7, 2020 [eBook #62051]
Most recently updated: October 18, 2024
Language: French
Credits: Produced by Claudine Corbasson, Pierre Lacaze and the
Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
(This file was produced from images generously made
available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
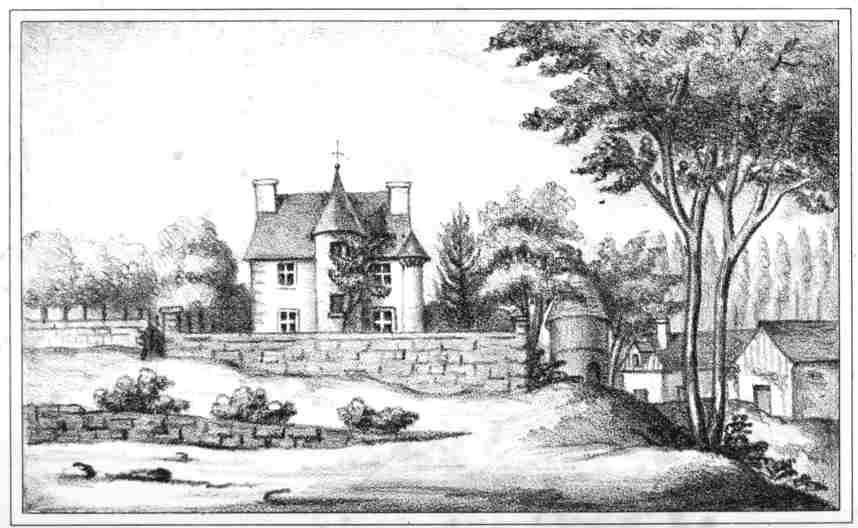
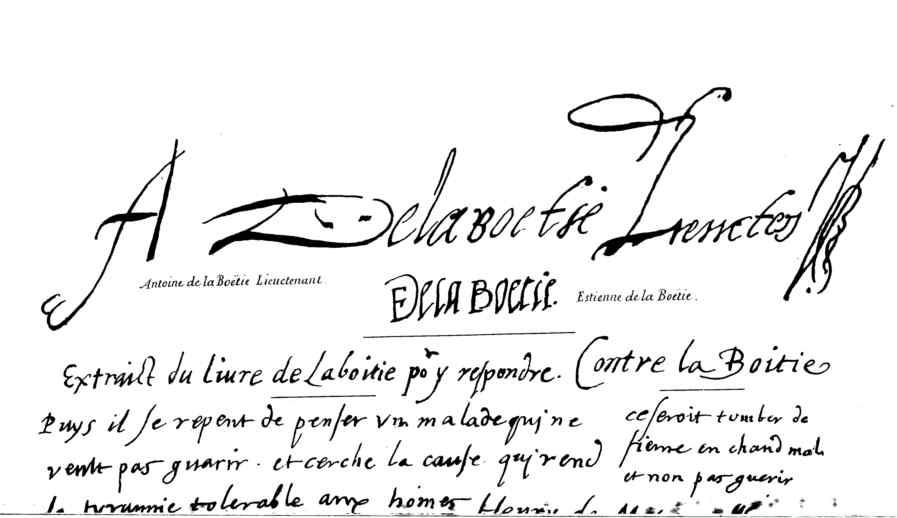
Ce travail biographique est complètement dû au hasard. Nous n'avions, en effet, nulle intention de nous occuper isolément de La Boëtie, qui n'entre dans les recherches que nous avons entreprises sur Montaigne que comme satellite de cet auteur, et il n'a fallu rien moins pour nous décider à l'entreprendre que la demande pressante faite par l'écrivain très-capable et trop scrupuleux qui avait d'abord été chargé de rédiger l'article La Boëtie pour la Nouvelle Biographie universelle.
La vie de La Boëtie est, on le sait, fort peu connue; un petit nombre de faits, la plupart controuvés, quelques dates, dont plusieurs sont inexactes, composent ses articles biographiques; et M. L. Feugère, dans ses travaux si consciencieux et si remarquables, s'est plus occupé de ce personnage au point de vue littéraire qu'au point de vue spécialement biographique et bibliographique.
Nous avons senti de bonne heure la nécessité de fertiliser ce sol abandonné, et les renseignements[p. 6] que nous avons demandés et reçus de toutes parts se sont trouvés assez nombreux pour que leur dépouillement donnât à notre article un développement trop considérable pour l'ouvrage auquel il était destiné.
Ce fut alors que MM. Didot, appréciant l'intérêt que pouvait offrir ce travail, non pour son exécution, mais pour les faits nouveaux qu'il renferme, et ne voulant pas frapper de stérilité un article composé exclusivement à leur intention, résolurent de l'imprimer à part, afin que les lecteurs de la Biographie qui trouveraient que certaines parties n'ont pas assez de développement, que certaines assertions n'ont point leurs preuves, pussent rencontrer dans cette publication isolée ce qu'ils chercheraient vainement dans d'autres ouvrages. Cet essai de biographie peut être d'ailleurs regardé comme un acte provisoire de justice et de réparation pour La Boëtie. Nous avons dit que M. Feugère a surtout étudié l'ami de Montaigne sous son aspect littéraire, mais La Boëtie compte parmi les chefs de la croisade politique du seizième siècle. Chacun d'entre eux a trouvé son historien. La vie de Thomas Morus a été écrite plusieurs fois et en plusieurs langues; Hottmann a[p. 7] été le sujet d'un éloge; Buchanan, De Thou, Lanoue, Pasquier, ont eux-mêmes écrit leurs vies ou leurs mémoires. Hub. Languet a été récemment l'occasion d'un travail remarquable, et un livre non moins important vient d'être publié sur J. Bodin; La Boëtie seul attend encore son historien: nous sommes loin de prétendre à ce titre; mais en attendant qu'une plume plus habile et plus autorisée que la nôtre prononce en dernier ressort sur ce grand homme de bien, en attendant que La Boëtie ait trouvé son Villemain[1], nous apportons humblement des matériaux, nouveaux pour la plupart, et recueillis à des sources sûres où cependant les biographes n'avaient pas encore puisé.
[1] Allusion à l'admirable article que M. Villemain a donné sur saint Ambroise dans la Nouvelle Biographie.
Enfin la découverte d'un manuscrit authentique de la Servitude volontaire, qui montre combien était défectueuse la leçon suivie jusqu'à ce jour par tous les éditeurs, nous a décidé à donner une nouvelle édition de cette pièce, de telle sorte que La Boëtie puisse être équitablement jugé sur l'ouvrage qui aurait le plus fait pour sa réputation, si l'amitié[p. 8] de Montaigne n'avait d'ailleurs entouré son nom d'une auréole impérissable.
Dans son ensemble cette publication sur La Boëtie peut être regardée comme un supplément aux Essais de Montaigne; car, selon nous, les vies et les œuvres de ces deux amis ne devraient jamais être séparées.
D'autres noms encore se rattachent à ce grand nom de Montaigne: Gournay, Sebon, Gamaches. Nous continuerons à recueillir tous les renseignements qui s'y rapportent, sans savoir s'il nous sera donné de les utiliser.... Mais nous espérons que d'autres ne jugeront point ces personnages indignes de leurs recherches.
Déjà M. Feugère s'est occupé, avec la distinction qu'il apporte dans toutes ses œuvres, de la fille d'alliance de Montaigne; heureux celui qui, profitant des travaux de ses devanciers, aura le loisir de réunir dans un même tableau cette famille d'adoption formée entre des âmes d'élite, et de rattacher, par des liens indissolubles, à la mémoire de Montaigne le nom de ceux qui ont, à titres divers, fait son bonheur et dont il a fait la gloire.
J. F. P.
Avril 1853.
Boëtie (de La), nom célèbre et personnages peu connus d'une famille considérée et importante du Périgord.
Ce nom se rencontre dans les manuscrits et les titres anciens écrit de diverses manières. Ainsi on trouve Boëtie, Boitie, Boytie, Boittie; en patois, Boetia, Bouetias, Bouetio, aujourd'hui lo Boïtou; en latin Boetianus. Varillas écrit à tort Boissie (Hist. de Henri III), et quelques éditeurs plus fautivement encore Béotie.
Le T dans ce nom doit être prononcé dur comme dans amitié; la tradition, l'usage actuel du pays, le nom patois, l'existence simultanée de deux T le prouvent. Surabondamment, Bayle (au mot Bongars), Mercier Saint-Léger (Notes manuscrites à la Croix-du-Maine), M. de Mourcin (Société d'agriculture, sciences et arts de la Dordogne, 1841), établissent qu'il en doit être ainsi.
Le nom de cette famille vient d'une terre assez importante, située à deux kilomètres de Sarlat, dont le nom, d'origine celtique, est La Boëtie, et dont la modeste maison d'habitation s'appelle le Castelet.
La famille La Boëtie est originaire de Sarlat, et son nom se rattache anciennement et honorablement à l'histoire du pays. Dès le douzième siècle un Robert de La Boëtie se distingue dans cette longue et souvent sanglante lutte que les consuls soutinrent contre les prétentions de l'abbé et du monastère, et par suite de laquelle fut fondée l'indépendance de la ville sous la seule autorité des rois de France (Tableau des évenements arrivés dans la ville de Sarlat, etc., par A. L. Bouffanges, manuscrit inédit, communiqué par M. Lascoux). En 1238, Pierre de La Boëtie est consul de Sarlat; en 1300, Gabriel de La Boëtie est l'un des vingt-quatre conseillers qui composent la jurade. Gaucelin de La Boëtie stipule, en 1512, pour son frère Étienne et sa sœur Guillerme, mariée à Simon de Laurière.
Antoine de La Boëtie, probablement fils de Gaucelin et père de l'ami de Montaigne, est né à la fin du quinzième siècle; il paraît en juillet 1539[2] comme chargé d'un examen à futur au château[p. 11] de Biron, dont la tour de l'Horloge, qui contenait les archives, avait été incendiée, il est qualifié: «licencié ez droit seigneur de la Mothe Lèz Sarlat[3] et lieuctenant par autorité royal en la sénéchaucée de Périgort au siège de Sarlat et baillaige de Domme. (Pièce communiquée par M. de Mourcin, conseiller de préfecture à Périgueux). Antoine avait un frère, Étienne, sieur de Bouilhonnas, qui, depuis 1517, étudia à Toulouse sous le père Jean Dufresne, et fut reçu bachelier le 3 mars 1523 (Notes inédites de l'abbé de Lespine, communiquées par M. J.-B. Lascoux, magistrat). Antoine avait épousé une Calvimont, d'une famille importante du Bordelais; le frère de cette dame, Sardon de Calvimont (ce prénom est le nom du patron de Sarlat, aujourd'hui Saint-Sacerdos), était président au parlement de Bordeaux. Leur père était vraisemblablement Jean de Calvimont, second président du parlement en 1530, secrétaire du roi à Bordeaux en 1537, le même probablement que je vois qualifié homme honorable et scientifique, conseiller en 1509 en la suprême cour du parlement de Bordeaux[4]. Antoine a dû mourir jeune, laissant trois enfants: l'aîné, Étienne, dont l'article suit, et deux filles, Clémence[p. 12] et Anne. L'une d'elles épousa M. de Saint-Quentin[5] dont la fille assista à la mort du célèbre La Boëtie. (Testament de ce dernier communiqué par M. J. Delpit.)
[2] Probablement peu de temps avant sa mort.
[3] La Mothe, aujourd'hui métairie près de Sarlat.
[4] Ce dut être cette liaison des deux familles qui fut cause que Estienne de la Boëtie fut appelé au parlement de Bordeaux.
[5] La terre de Saint-Quentin, canton de Sarlat, et tout près, de ce chef-lieu, a donné son nom à une commune; Marcillac Saint-Quentin.
La Boetie (Estienne de), fils d'Antoine, naquit à Sarlat, chef-lieu d'un arrondissement qu'on appelle quelquefois le Périgord Noir, le mardi 1er novembre 1530 (deux ans avant son ami, Michel Montaigne, l'année même de la naissance de Jean Bodin). Il perdit son père étant fort jeune, et son oncle Étienne, sieur de Bouilhonnas, qui était aussi son parrain, entoura le jeune orphelin de soins paternels que La Boëtie, dans son Testament, rappelle avec une effusion de reconnaissance.
Le jeune Étienne fut placé au collége de Bordeaux, très-florissant pour lors et le meilleur de France (Essais) et qui comptait des talents de premier ordre, Math.-Cordier, Élie Vinet, Marc-Ant. Muret, Andr. Govéa et d'autres non moins célèbres; et bien que la liaison de La Boëtie et de Montaigne ne date pas de cette époque, il n'est pas sans intérêt de remarquer que celui qui devait être de moitié dans la vie de Montaigne se trouva sous la direction des mêmes savants qui furent les précepteurs domestiques de ce dernier, élevé alors dans le sein de sa famille (Nic. Grouchi, Guill. Guerente, G. Buchanan, Marc-Ant. Muret). Le rapprochement même[p. 14] du nom de ces maîtres avec celui de La Boëtie n'est pas moins intéressant; car si Georges Buchanan reprenant la thèse soutenue par Hottmann (Franco-Gallia) et Languet (Vindiciæ contra Tyrannos) devait, postérieurement à la mort de La Boëtie, publier le traité De Jure regni apud Scotos, son élève devait écrire la Servitude Volontaire et traduire Aristote après avoir eu pour professeur Guill. Guerente, qui a commenté cet auteur, et Nic. Grouchy, qui le premier l'expliqua à Bordeaux avec une grande distinction.
Sous de tels maîtres, La Boëtie développa cette merveilleuse et précoce facilité que lui accordent tous ses contemporains, et c'est à juste titre que Baillet et Klefeker l'ont compté parmi les enfants célèbres.
La Boëtie acquit ainsi, au dire de De Thou, un esprit admirable, une érudition vaste et profonde et une facilité de parler et d'écrire surprenante. De si grandes qualités lui concilièrent tous les suffrages, et, en 1552, le 14 octobre, n'ayant pas encore vingt-deux ans, il fut pourvu d'une charge de conseiller au parlement de Bordeaux, en remplacement de M. de Lur, avec dispense de tenir son office. Cette mesure tenait probablement au défaut d'âge, puisque le 17 mai 1553 les chambres s'assemblèrent «pour procéder à l'examen des sieurs Pommier et La Boëtie, lesquels ayant été reconnus idoines et suffisants, furent reçus à prêter[p. 15] serment.» (Registres manuscrits du parlement de Bordeaux.)
Le jugement, la haute raison de La Boëtie, le rendirent bientôt l'oracle de sa compagnie, et il acquit en ce rang-là plus de vraie réputation que nul autre avant lui (Montaigne). Cependant il paraît que sa modestie le faisait se défier de ses propres lumières, car on lit partout qu'il n'allait jamais aux voix sans émotion, et on cite en preuve les Decisiones Burdigalenses de Boerius (Nic. Bohier ou Boyer), je ne sais ce qui en est de l'émotion, mais je n'ai pu en trouver la trace dans le volumineux in-folio de cet auteur. D'ailleurs, Bohier a-t-il pu écrire ce qu'on lui prête; la Biographie Universelle le fait, il est vrai, mourir en 1579, ce qui, à son compte, ne lui donnerait pas moins de cent neuf ans; mais Nicéron, qui a donné au tome XLIII une Vie de Nicolas Boyer, écrite avec beaucoup de soin par Michaud de Dijon, sur les notes du président Bouhier, fait naître Bohier en 1469 et le fait mourir le 10 juin 1539 à l'âge de soixante-dix ans, et il relève les erreurs commises par Denis Simon et Taisand, qui le font mourir en 1531, de Lurbe en 1538, et Moréri en 1553; ainsi donc, à l'époque de la mort de Bohier, La Boëtie avait neuf ans, et il s'en fallait de quatorze qu'il pût aller aux voix, dût-il trembler plus tard à cette occasion.
Ce fut à ces modestes fonctions que s'arrêta la[p. 16] carrière de La Boëtie[6], et cet homme, que De Thou déclarait capable des plus grandes affaires et Montaigne l'un des plus propres et nécessaires hommes aux premières charges de la France, resta, comme le dit ce dernier, «tout du long de sa vie croupy ez cendres de son fouyer domestique;» mais il n'y resta pas oisif, et ce temps, cette capacité qu'il aurait pu employer au service de l'État et pour sa gloire, il les employa dans une obscurité studieuse dont nous aurons à apprécier les résultats.
[6] Le reçu que je possède, qui est la seule pièce portant autographe de La Boëtie que je connaisse, accuse réception de ving livres parisis pour la présence et les gaiges d'avoir vacqué en la tournelle au jugement et décision des procès criminels durant demye année. 1555.
A une époque que nous ne pouvons fixer, et quoi qu'en aient dit plusieurs de ses biographes, La Boëtie se maria: il épousa Marguerite de Carle, d'une famille distinguée, qui fournit à Bordeaux un maire, Carle de la Roquette en 1561 et un jurat en 1580. Lancelot de Carle Bordelais, évêque de Riez, était vraisemblablement de cette famille (de Lurbe à 1553). D'après Montaigne (lettre à son père), il existait déjà quelqu'alliance antérieure et ancienne entre ces deux familles.
Une circonstance touchante, et qui n'a pas encore été appréciée d'une manière exacte[7], c'est[p. 17] qu'entre les familles de Montaigne et de La Boëtie, les liens du sang vinrent plus d'une fois resserrer les liens volontaires de l'amitié. Entre plusieurs alliances, je ne citerai que les suivantes:
[7] M. Delphin de la Mothe (Éloge manuscrit et inédit de La Boëtie) dit par erreur qu'il avait épousé la veuve d'un frère de Montaigne.
Marguerite de Carle était veuve d'un seigneur d'Arsac[8], et de ce premier mariage elle avait conservé deux enfants. Une fille, Jacquette d'Arsac, épousa Thomas de Montaigne (frère de l'auteur des Essais)[9], qui devint ainsi seigneur d'Arsac, de Lilhan[10], de Loirac et du Castera[11]; et le fils, Gaston d'Arsac, épousa Louise de La Chassaigne, fille de Joseph et sœur de Françoise, femme de Michel Montaigne: de sorte que ce dernier était beau-frère de la fille par alliance de La Boëtie, et madame de Montaigne était belle-sœur du beau-fils du même personnage.
[8] Village et château à quatre ou cinq lieues de Bordeaux, canton de Castelnau de Médoc.
[9] De ce mariage naquit un fils, Mathias, qui fut tué à la descente des Anglais dans l'île de Rhé, en 1627, en même temps que le père de madame de Sévigné.
[10] La terre de Lilhan est celle dont parle Montaigne dans ses Essais comme appartenant à son frère et ayant été couverte par les sables de la mer. Un ancien pouillé dit par les eaux: «est cooperta aquis.»
[11] C'est du Castera qu'est datée la lettre adressée par Montaigne à Claude Dupuy, et qui a fait dernièrement tant de bruit.
Nous arrivons enfin à la circonstance capitale[p. 18] de la vie de La Boëtie, je veux dire sa liaison avec Montaigne.
Henri II avait, en 1553, établi à Périgueux une cour des aides, dont Pierre Eyquem de Montaigne fut conseiller (Conférences des Édits par Ét. Girard.—Recueil de titres etc. de la cité de Périgueux, Paris, 1775). Son fils Michel lui succéda; il est probable que ce fut dès qu'il eut atteint ses vingt-deux ans, c'est-à-dire dans le courant de 1555. Mais en 1557 le roi réunit cette cour, dite des généraux conseillers, à la chambre des requêtes du parlement de Bordeaux. A la réception qui eut lieu le 3 décembre, on voit figurer Michel Montaigne, qui de ce moment devint le collègue de La Boëtie (Registr. manusc. du parlement de Bordeaux), et nous trouvons là en effet les six années pendant lesquelles Montaigne dit qu'a duré leur accointance. (Avertissement du livret de 1571). Si ailleurs Montaigne parle de quatre années pendant lesquelles il lui a été donné de jouir de l'amitié de La Boëtie, c'est qu'alors il supprimait les fractions d'années, et peut-être comptait-il seulement le temps de leur complète intimité; dans un cas il calculait avec le calendrier, dans l'autre avec son cœur.
Du reste, l'intimité s'établit rapidement. «Ils se cherchaient avant de s'être vus; ils s'embrassaient et s'appelaient par leurs noms avant de se connaître, et, au premier contact, ils se trouvèrent[p. 19] si pris, si connus, si obligés entre eux, que Montaigne voyait là quelqu'ordonnance du ciel.» La Boëtie a fait une satire latine pour excuser en quelque sorte la précipitation d'une intelligence si promptement parvenue à sa perfection:
Il faut lire dans les Essais ce que dit Montaigne sur cette liaison, et il y aurait une grande témérité à écrire après lui sur l'ami qu'il a immortalisé. Tout au plus redirais-je quelques-unes de ces phrases si touchantes répandues à profusion dans les Essais. «Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en disant: parce que c'était lui, parce que c'était moi!» Leur amitié c'était: «Je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne, d'une faim, d'une concurrence pareille, je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre ni qui fût sien ou mien.» Mais que citai-je d'un chapitre comme celui de l'amitié où tout serait à citer? comme si ces phrases n'étaient pas gravées dans le souvenir, on pourrait dire dans le cœur de tous ceux qui les ont une fois lues!
Ce dut être peu de temps après cette heureuse rencontre que les deux amis, s'adoptant mutuellement, se donnèrent le nom de Frères. C'était en ce temps un usage assez répandu; on en trouve des exemples dans Marot: témoin l'épigramme intitulée: De sa mère par alliance. C'est ainsi que Montaigne donna plus tard à Marie de Jars de Gournay le titre de fille et en reçut le nom de père, titre dont elle était aussi glorieuse que si elle eût été mère des muses mêmes (Épître du Proumenoir, 1634), et qu'elle étendait à la femme de Montaigne, qu'elle appelait sa mère, à sa fille et à ses frères. (Même Épître, édit. de 1594.)
C'est dans le même ordre de sentiments que La Boëtie institue Montaigne légataire de sa bibliothèque, que Montaigne à son tour donne à Charron par testament le droit de porter ses pleines armes (Vie de Charron par Rochemaillet)[12], qu'à son tour Charron teste en faveur de l'une des sœurs de Montaigne et de son mari, qu'enfin Marie de Gournay lègue ses livres à Lamothe le Vayer. Paisibles et touchantes successions qui témoignent d'une pieuse affection et font autant d'honneur à celui qui donne qu'à celui qui reçoit[13]!
[12] Les mauvaises langues du temps prétendirent que c'était un legs de Gascon.
[13] M. Feugère fait remarquer avec justesse qu'à cette époque il existait dans certaines classes privilégiées pour les mœurs quelques traditions favorables à l'amitié. Il cite l'intimité qui régnait entre De Thou et P. Pithou; entre l'Hôpital et du Faur; mais ces liaisons sont éclipsées par l'éclat qui immortalise celle de Montaigne et de La Boëtie.
Voilà donc deux existences si puissantes déjà par elles-mêmes, l'une par la pensée, l'autre par l'imagination, rapprochées par les dissemblances mêmes qui les distinguent, qui se complètent en s'unissant: quel commerce ce dut être entre ces deux âmes! Nous voyons dans la lettre de Montaigne à son père quelle était la nature de ces graves entretiens: Il m'interrompit, dit Montaigne, pour «me prier de montrer par effet que les discours que nous avions tenus ensemble, pendant notre santé, nous ne les portions pas seulement en la bouche, mais engravés bien avant au cœur et en l'âme pour les mettre à exécution aux premières occasions qui s'offriraient, ajoutant que c'était la vraie pratique de nos études et de la philosophie», on peut presque dire que nous avons dans les Essais un reflet de La Boëtie; car son influence a dû se faire sentir sur toutes les phases de la vie et des opinions de Montaigne: «ils étaient à moitié de tout,» et plus d'une fois en écrivant les Essais l'auteur a dû se demander ce qu'en aurait pensé son ami.
Mais cette sainte couture, ce mélange universel de deux âmes durait déjà depuis six ans: c'était[p. 22] trop pour tant de bonheur, et la mort, qui n'attend pas, réclamait une victime.
Un lundi, 9 août 1563, Montaigne revenait tranquille du palais; il envoie convier à dîner son ami récemment de retour d'une tournée en Périgord et en Agénois; mais celui-ci le fait prier de venir le voir, parce que la veille il a été frappé de refroidissement en jouant à la paume avec M. Descars[14]. Montaigne s'empresse, et trouve La Boëtie ayant déjà les traits altérés; il est affecté de dysenterie. Comme son habitation se trouvait dans un quartier infecté de peste, Montaigne approuva le projet de départ pour le Médoc, et il engagea son ami à n'aller pour ce soir que jusqu'à Germinian[15], qui n'est qu'à deux lieues de la ville. La Boëtie s'arrêta en effet dans ce village, et comme sa maladie en s'aggravant ne lui permit pas d'aller plus loin, ce fut là qu'il mourut, et probablement c'est en ce lieu qu'il est inhumé, car le testament ne fixe rien à cet égard: «a voulu être enterré là où et en la manière qu'il plaira à son héritier».
[14] Alors lieutenant pour le roi en Guyenne.
[15] Ce village, situé entre Le Taillan et Saint-Aubin, sur le chemin de Castelnau, n'est mentionné par aucun dictionnaire géographique, ce qui fait que les biographes ont donné inexactement son nom. On le trouve sur la carte de Cassini et le bel atlas de Guyenne par De Belleyme. Éloi Johanneau l'a confondu avec Germignac, près de Jonzac en Saintonge à vingt-cinq ou trente lieues de Bordeaux.
Il faut lire dans Montaigne même (Lettre à son père) le récit jour par jour, heure par heure de la dernière maladie de son ami et de cette mort digne d'un sage de l'antiquité, mort que Montaigne qualifie de pompeuse et de glorieuse. Car nous possédons au moins un chapitre de la vie de La Boëtie écrit par Montaigne, et certes personne ne sera tenté de le refaire. On peut voir dans cette lettre la pieuse résignation de l'un, le tendre dévouement de l'autre. C'est là qu'on rencontre ces mots sublimes dans leur naïve simplicité, et que nous recommandons à ceux qui, de parti pris, prétendent trouver des phrases d'un égoïsme impie dans Montaigne. La Boëtie fait observer à son ami que sa maladie est bien un peu contagieuse, et il l'engage à n'être avec lui que par bouffées; de ce moment, dit Montaigne, «je ne l'abandonnay plus.»
La Boëtie s'entoure de ses parents, de ses amis; il les console, les conseille, les encourage, et tour à tour nous voyons paraître sa femme, sa semblance qu'il a aimée, chérie et estimée autant qu'il lui a été possible; son oncle, M. de Bouilhonnas, «son vrai père, à qui il est redevable de tout ce qu'il est, et à qui il demande permission pour disposer de son bien;» Montaigne «qu'il aimait si chèrement, qu'il avait choisi parmi tant d'hommes pour renouveler avec lui cette vertueuse et sincère amitié de laquelle l'usage est par les vices dès si longtemps éloigné[p. 24] qu'il n'en reste plus que quelques vieilles traces en la mémoire de l'antiquité;» sa nièce, mademoiselle de Saint-Quentin, à qui il recommande d'être dévote envers Dieu, d'aimer et d'honorer son père et sa mère; sa mère, la sœur de La Boëtie, qu'il estime «des meilleures et des plus sages femmes du monde;» de Beauregard, le frère de Montaigne, qui avait embrassé le protestantisme: La Boëtie respecte ses convictions, mais il lui recommande la modération, l'union avec les siens; il déplore les ruines que ces dissensions ont apportées dans le royaume, et il lui assure qu'à l'avenir elles en produiront bien d'autres!
Mais il lui reste d'autres devoirs à remplir: «il est catholique; tel il a vécu, tel il est délibéré de clore sa vie, il ne veut faillir au dernier devoir d'un chrétien; il se confesse donc à son prêtre et il fait ses pâques.» Enfin il veut faire son testament presqu'aussi modeste que celui d'Eudamidas. Il s'excuse auprès de ses bien-aimées sœurs de ne pouvoir leur faire quelque grand avantage. Il institue son oncle son légataire universel; il donne mille deux cents livres tournoyses à sa bien aymée femme, ses livres et manuscrits à Montaigne, son inthyme frère et inviolable amy; quelques ouvrages sur le droit à son cousin de Calvimont; à sa niepce Saint-Quentin, norrie avecques sa femme, deux cent livres tournoyses, et à Jacquette d'Arsac, sa belle-fille, cent livres. (Testament communiqué par M. Delpit.)
Et puis, désormais libre de tout souci, il s'apprête à mourir avec la fermeté d'un stoïque tempérée par l'humilité du chrétien. Il disserte froidement avec Montaigne sur la gravité, sur les éventualités de sa maladie; «il est prêt à partir quand il plaira à Dieu: il y a longtemps qu'il est préparé; il énumère les misères qu'il évitera en mourant jeune; il espère que Montaigne, par sa résignation, soutiendra le courage défaillant de sa femme et de son oncle.»
Mais le mal s'aggrave, La Boëtie le sait, et «si Dieu lui donnait à choisir ou de retourner à vivre encore ou d'achever le voyage qu'il a commencé, il serait bien empêché au choix». Plusieurs fois il s'évanouit; alors il ne veut plus que Montaigne le quitte: «mon frère, tenez-vous auprès de moi», et puis son jugement s'ébranle, mais le cœur survit, et dans son délire il s'inquiète encore si Montaigne est près de lui. Enfin, après plusieurs heures de lutte, le moment suprême arrive: La Boëtie emploie son dernier souffle à prononcer une fois encore le nom de son ami, et il expire à 3 heures du matin, le mercredi 18 août 1563, après avoir vécu 32 ans 9 mois et 17 jours. Heureuse la vie dont six années se sont écoulées en communauté d'âme et de cœur avec Montaigne! heureuse mille fois la vie qui trouve son terme dans les bras d'un tel consolateur!
Autant avait été exceptionnelle l'amitié, autant sont exceptionnels les regrets qu'elle entraîne. Désormais Montaigne ne fera plus que «traîner languissant, sa vie ne sera plus que fumée, qu'une nuit obscure et ennuyeuse, les plaisirs même lui redoubleraient la perte de son ami[16]; le reste de sa vie sera employé à lui faire à tout jamais les obsèques.» Son unique pensée sera dès lors de sauver de l'oubli sa mémoire; il s'occupe à rassembler tout ce qu'il peut retrouver dans les manuscrits dont il est légataire. Aussitôt après la mort de La Boëtie il écrit à son père cette belle lettre dont il a publié un extrait. Huit ans après il publie le livre de ses œuvres; cinq ans plus tard il écrit le chapitre de l'amitié; près de vingt ans après, aux bains della Villa, occupé uniquement du soin de sa santé «il est pris d'un pensement si pénible de M. de La Boëtie et il est si longtemps sans se raviser que cela lui fait grand mal[17].»
[16] Réminiscence de Pétrarque: Illos annos egi tanta in requie, tantaque dulcedine, ut illud ferme tempus solum mihi vita fuerit, reliquum omne supplicium.»
[17] Rappelons ici que Montaigne avait fait tracer dans sa bibliothèque en l'honneur de La Boëtie une inscription touchante que M. Jouanet paraît avoir vue, mais qui était effacée lorsque nous visitâmes le château.
Était-ce un homme ordinaire que celui qui savait inspirer de tels regrets? S'il est beau d'avoir écrit[p. 27] le chapitre de l'Amitié, avec lequel l'antiquité n'offre peut-être rien de comparable, n'est-il pas bien honorable de l'avoir inspiré? et n'est-elle pas légitime cette immortalité que Montaigne a donnée à son ami en échange du bonheur qu'il en a reçu?
Tel fut dans sa trop courte carrière cet homme chez qui le talent était rehaussé par la vertu, celui que les personnages les plus illustres de son temps proclament un homme véritablement supérieur. De Thou, en maint endroit de son Histoire, en fait un pompeux éloge; Montaigne le regarde comme le plus grand homme de son siècle; Scevole de Sainte-Marthe, Colletet, Florimond de Ræmond, de Lurbe, Tessier, Vivant, le comblent de louanges; Pierre de Brach le célèbre dans ses vers (Hymne en l'honneur de Bordeaux, Millanges 1576). Et pourtant il faut se souvenir que La Boëtie n'a pas atteint sa trente-troisième année. C'est par l'estime de ses contemporains, c'est par la valeur même de Montaigne qu'il faut apprécier cet ami puisque le hasard des événements ne l'a pas élevé à des fonctions qui eussent mis en relief sa haute capacité, et que sa mort prématurée ne lui a pas permis d'attacher son nom à quelqu'œuvre digne de lui. Si Montaigne était mort au même âge que La Boëtie, qui connaîtrait aujourd'hui le nom de cet obscur conseiller d'un parlement de province?
De même, lorsqu'on a jugé Montaigne, on a trop[p. 28] souvent eu le tort de le séparer de son ami. L'étude de l'un est nécessaire à la connaissance de l'autre, et, par exemple, a-t-on suffisamment tenu compte de l'amitié de La Boëtie quand on a voulu établir l'égoïsme de Montaigne, comme si ce jugement ne s'évanouissait pas en présence des témoignages de sensibilité exquise qui abondent dans ses Essais.—Si on avait voulu être juste envers Montaigne n'aurait-on pas pu reconnaître qu'après avoir joui pendant plusieurs années avec un homme d'une nature supérieure d'une amitié passionnée dont notre faiblesse actuelle nous permet à peine de nous faire une idée, toutes les autres affections, lorsque celle-là a été perdue, ont dû lui paraître sans saveur, comme sans attraits, et alors on eût peut-être été amené à conclure que ce qu'on qualifiait d'égoïsme n'était que l'indifférence d'un cœur blasé par une passion ardente violemment interrompue dans son cours.
Je ne pense pas qu'il existe aucun portrait connu de La Boëtie. De quelques passages de Montaigne on peut inférer que son ami jouissait d'une très-vigoureuse santé (Dédicace à M. de Foix), mais que la première impression produite par son extérieur ne lui était pas favorable (Essais). Montaigne, qui a écrit au sujet de la beauté corporelle «je ne puis dire assez souvent combien je l'estime qualité puissante et avantageuse», parle de cette «mésadvenance[p. 29] au premier regard qui loge principalement au visage et souvent nous dégoûte d'un teint, d'une tache, d'une rude contenance,» et il ajoute que la laideur de La Boëtie «était de ce prédicament, laideur superficielle qui est pourtant très-impérieuse.» Ailleurs Montaigne parle de la brave démarche de son ami, de sorte qu'on doit croire que La Boëtie, né sur cette terre toute celtique du Périgord, avait emprunté quelque chose de la puissance et de l'âpreté de la nature, et qu'il avait dans son allure un peu de la rudesse de la plume qui a écrit le Contr'un.
Du reste La Boëtie était de Sarlat, et de tout temps les habitants de cette petite ville ont eu un cachet particulier d'intelligence, de franchise et d'indépendance.—On dit généralement que l'esprit court les rues de Sarlat,—et M. l'abbé Audierne, Sarladais, et digne de l'être (Périgord illustré, 1851), regarde La Boëtie comme le type du Sarladais.
«Aperta in viro frons et sine fuco, a sordibus et quæstu omnino alienus,» dit un contemporain en parlant de La Boëtie (de Lurbe, dans le très-rare volume in-8º intitulé: De illustribus Aquitaniæ viris, Burdig, 1591).
Quant aux autographes de La Boëtie, je ne connais qu'une seule signature apposée au bas d'une quittance que je possède. Le testament que j'ai cité plusieurs fois est une expédition délivrée à Montaigne comme légataire. On ignore ce qu'est devenue[p. 30] la minute, reçue, le samedi 14 août 1563, à Germinian, par Raymond, notaire de Bordeaux[18].
[18] Cette date est incontestable.—Pourtant, à lire la lettre de Montaigne, on pourrait croire que ce testament a été dicté le dimanche 15. Il n'en est rien, mais il est probable que Montaigne avait dans son récit anticipé sur les événements et qu'il n'a pas rétrogradé pour placer le testament en son lieu.
J'ai cité à l'article Antoine La Boëtie une signature autographe de ce personnage; et j'ai donné les fac-simile des signatures du père et du fils dans les Documents inédits ou peu connus sur Montaigne (Techener, 1847).
On trouve une vue du Castelet de La Boëtie dans La Guyenne historique et monumentale de M. Ducourneau (Bordeaux, in 4º).
La maison patrimoniale de la famille à Sarlat, dont la façade rappelle la belle époque de la renaissance, a été représentée dans le même ouvrage et aussi dans le Magasin pittoresque (juin 1850), et dans les Annales agricoles et littéraires de la Dordogne (1848, in-8º). Elle a été décorée, il y a quelques années, d'une plaque de marbre sur laquelle on lit cette inscription:
Cette maison est située sur la place dite du Peyrou, qui précède l'église, et M. J. B. Lascoux, magistrat à Paris, voudrait qu'on donnât à cette voie publique le nom de La Boëtie. Il serait à souhaiter qu'un vœu aussi légitime fût entendu. (Voy. Relation de deux siéges soutenus par la ville de Sarlat etc., par J. B. L. (Lascoux.) Paris, 1832.)
Il nous reste à étudier La Boëtie comme auteur; et bien que ses ouvrages aient peu fait pour sa gloire, et que son titre principal soit, aux yeux de la postérité, l'amitié de Montaigne, nous le connaîtrions imparfaitement si nous négligions de l'étudier sous ce rapport.
A vrai dire les opuscules de La Boëtie ne sont que des promesses qu'il ne lui a pas été donné de réaliser; mais si ce sont des ébauches, l'une d'elles est un chef-d'œuvre. La Boëtie a beaucoup écrit, et une grande partie de ses ouvrages est perdue; il n'a rien publié, ne trouvant rien, au dire de Montaigne, «qu'il estimât digne de porter son nom en public.» Mais Montaigne, qui n'était pas si hault à la main, s'occupa, à la mort de son ami, à rassembler une partie au moins de ses écrits, et les publia en 1571 et 1572. Nous dirons d'abord quelques mots des œuvres qui n'ont pas été imprimées.
Avant seize ans La Boëtie avait déjà composé des rimes françaises; il en cite dans le Contr'un qu'il écrivit à cet âge, comme nous le prouverons. Il fit ensuite des vers français et latins, connus sous le nom de Gironde, qui n'ont pas été imprimés, au moins sous son nom: on ignore ce qu'ils sont devenus. La Boëtie avait encore écrit des poëmes[p. 33] grecs, qui ont été également perdus. Son ingénieuse activité lui faisait saisir toutes les occasions: une mort, un tombeau lui inspiraient des vers; envoyait-il à un ami, à la Chassaigne, à Belot[19], quelques livres, il les accompagnait d'une pièce de poésie. Il paraît qu'il en avait composé sur le duc François de Guise alors vivant, car dans la pièce intitulée: In tumulum Francisci Ovisii (Guise) on lit ce vers:
[19] Belot, fils de Martial Belot. J'ajoute, par respect pour la mémoire de La Boëtie, quelques mots sur ce personnage, qui était son ami et celui de Montaigne et conseiller comme eux. Lati decorat quem purpura clavi, dit La Boëtie, qui lui a adressé plusieurs pièces de vers latins, dont une en communauté avec Montaigne. L'Hôpital mentionne un personnage de ce nom, peut-être celui-là même (Lettre au chancelier Olivier). Belot visita La Boëtie dans sa dernière maladie.
Nous comprenons dans les œuvres inédites de La Boëtie un livre que jusqu'ici personne ne semble avoir vu, et qui est annoncé dans la Bibliothèque historique de la France par le P. Lelong, édition de Fontette, sous le nº. 2,230 et sous ce titre: historique description du solitaire et sauvage pays de médoc (ces qualifications se retrouvent dans les mêmes termes dans des vers imprimés de L. B.), Bordeaux, Millanges, 1593, in-12. (Nous reviendrons ailleurs sur une note qui suit cette indication.)[p. 34] Depuis tantôt un siècle, géographes et bibliophiles, biographes et bibliographes réclament cet ouvrage, sans en avoir trouvé la trace. Baurein en 1784 (Variétés bordelaises) le demandait déjà. M. Lainé, ancien président de la Chambre des députés, l'a cherché longtemps. Beuchot, M. Techener, moi-même avons fréquemment sollicité des renseignements, sans avoir jamais rien obtenu. Le savant M. Weiss, qui mentionne ce livre dans La Biographie Universelle, ne l'a non plus jamais rencontré; et M. Jouanet, l'érudit bibliothécaire de Bordeaux, m'a affirmé que cet ouvrage n'a jamais été imprimé. (Voyez le paragraphe des 29 sonnets.)
Enfin La Boëtie avait, peu de temps avant sa mort, écrit quelques observations sur l'édit de janvier 1562 (ou 1561 suivant qu'on fait commencer l'année au 1er janvier ou à Pâques). Cet édit, œuvre de la sagesse de l'Hôpital, et rendu sous Charles IX, encore mineur, par l'influence de Catherine de Médicis, qui craignait que la jonction du prince de Navarre au triumvirat ne rendît ce parti trop puissant, autorisait, sous quelques réserves, l'exercice du culte réformé. Le parlement de Paris avait refusé de l'enregistrer (non possumus, nec debemus), et il ne fallut pas moins de deux lettres de jussion (président Hénault). L'édit fut l'objet des protestations de cette ligue formée sous le nom de Syndicat de la foi, dont le chef à Bordeaux, l'avocat Delange, homme[p. 35] remuant et populaire, dominait les masses par la hardiesse et la facilité de sa parole. Le parlement de Bordeaux, présidé par un mâle et généreux esprit, Lagebaton[20], s'efforçait de tenir la balance entre les exaltés qui défendaient la vieille foi et les sectes nouvelles qui s'attaquaient à la monarchie elle-même. Delange blâmait cette modération; il prétendait qu'elle mettait en danger le catholicisme. Ce fut alors que La Boëtie prit la plume, «et certes ce fut pour défendre l'autorité royale contre les entreprises d'un zèle dont le mobile n'était pas toujours l'intérêt public.» (M. Compans avocat général, Discours de rentrée à la cour royale de Bordeaux, novembre 1841.) Toutefois constatons ce fait que Montaigne use de la même prudence vis-à-vis de ces observations qu'à l'égard de la Servitude volontaire: il ne les publie pas; il pouvait donc se trouver là quelque souvenir du Contr'un. La Boëtie était de force à dire la vérité aux deux partis, et des deux côtés les vérités pouvaient être dures à entendre.
[20] Il aurait expié plus tard son impartialité, et il aurait compté dans les deux cent soixante-quatre victimes que la Saint-Barthélemy a faites à Bordeaux, si le commandant du fort du Hâ (Merville) ne l'eût caché dans cette forteresse pendant l'exécution.
On trouve l'édit de 1562 avec la date de 1561 dans le Recueil des édits de pacification etc., faits[p. 36] par les rois de France. Mayer l'a donné un peu modifié dans la Galerie philosophique du seizième siècle.
Nous arrivons aux ouvrages imprimés de La Boëtie; nous nous occuperons d'abord des opuscules, réservant l'ouvrage le plus important, la Servitude, pour le dernier.
La Boëtie a suivi l'usage de son temps; et, à l'exemple de l'Hôpital, de Pasquier, de De Thou, il a demandé un délassement à la poésie: il a fait des vers. De plus, comme la plupart des lettrés du seizième siècle, il s'est fait traducteur, moyen certain de fortifier son talent et d'assouplir son langage. Montaigne lui-même s'est engagé dans cette voie, mais non plus par imitation: c'est par une déférence respectueuse pour un vœu formulé par son père peu avant sa mort qu'il a traduit R. Sebon, dont le latin ne lui rappelait guère celui de Tacite; et pourtant, qui pourrait dire que cette œuvre ingrate ne lui a pas révélé une capacité jusque-là ignorée, qu'elle ne l'a pas mis en goût d'écrire? Peut-être est-ce à la traduction de la Théologie naturelle que nous devons les Essais.
J'ai dit précédemment qu'à la mort de La Boëtie, Montaigne s'occupa à rassembler, dans les manuscrits que lui avait légués son ami, tout ce qu'il put réunir «vert et sec», et en 1571 il se trouva en mesure de publier un livre qui comprenait la traduction du grec en français de la Ménagerie de[p. 37] Xénophon, dédiée à M. de Lansac; celle des Règles du mariage, de Plutarque, dédiée à M. de Mesmes; celle de la Lettre de consolation de Plutarque à sa femme, dédiée à madame de Montaigne; les poëmes latins dédiés au chancelier de l'Hôpital; enfin, l'extrait d'une lettre adressée par Montaigne à son père pour lui apprendre la maladie et la mort de son ami. Le frontispice annonçait des vers français, qui ne se trouvent pas dans ce volume.
L'année suivante, Montaigne donna isolément ces vers français, et, en les dédiant à M. de Foix, il lui dit qu'il n'avait pas osé les imprimer l'année précédente, «parce que par de là (c'est-à-dire dans le centre de la France) on ne les trouvoit pas assez limez pour estre mis en lumière.»
On trouve dans ces vers français une traduction partielle de l'Arioste, et vingt-cinq sonnets différents des vingt-neuf dont nous parlerons plus tard. Quant au mérite des vers de La Boëtie, Sainte-Marthe dit que Bordeaux possède dorénavant un poëte capable de rendre l'Italie jalouse[21], et Montaigne trouvait que la Gascogne n'en avait pas encore produit d'aussi parfait. La postérité n'a pas complétement ratifié ces jugements; cependant M. Marguerin avoue qu'il a pour ces sonnets une[p. 38] estime particulière, et on ne peut disconvenir qu'il n'y ait dans ces vers des passages fort agréables.
[21] C'était à cette époque la formule consacrée. Scevole Sainte-Marthe n'en emploie pas d'autre. Voyez les articles de Macrin, de Dampierre, etc.
[22] Je ne sais pourquoi M. Feugère, qui cite ces vers dans son Etude sur La Boëtie, a suivi une orthographe surannée, qui n'est pas dans l'imprimé (aultre pour autre, etc.), et remplace le mot avancé par dévancé.
En général, dans les traductions de La Boëtie, le[p. 39] texte est fidèlement étudié, reproduit avec exactitude et souvent avec bonheur; cependant M. P. Mantz (dans l'Artiste) émet à ce sujet une opinion un peu différente, et dont nous lui laissons la double responsabilité. «La manière de La Boëtie, dit-il, est à peu près celle d'Amyot; comme les femmes et comme lui, il n'est ni tout à fait fidèle ni complétement perfide, il défigure quelquefois l'original, et quelquefois il l'arrange.»
Le Xénophon a été souvent traduit, mais, d'après M. Feugère, excellent juge et très-compétent, il ne l'a jamais été mieux que par La Boëtie. Cette traduction figure textuellement dans l'édition des œuvres de Xénophon traduites par divers auteurs (Seyssel, Doublet, etc. Voy. Barbier, Dict. des anonymes, nº 13255), publiée par Pyramus de Candolle, Cologny (coloniæ Allobrogum); ou Genève, in-fol. 1613; ou Iverdun, in-8º, 1619. Il y a à peine quelques mots de changés, par exemple vous au lieu de tu, chrysobole au lieu de chrysobolus, etc.[23].
[23] Nous connaissons une traduction de Xénophon, très-rare et non citée, que nous avons vu à tort attribuer à La Boëtie: Le mesnagier de Xénophon, plus un discours de l'Excellence, du même auteur; Paris, Vincent Sertenas, 1562, in-8º.
Pour être complet, nous ajouterons que postérieurement à la mort de Montaigne, on retrouva une traduction faite par La Boëtie du grec du premier[p. 40] livre de l'Économique d'Aristote, le seul que quelques critiques admettent aujourd'hui pour authentique; et en 1600, le libraire Claude Morel réimprima les pièces publiées en 1571 et 1572, et y ajouta celle-ci[24].
[24] On sait que l'Économique a été contestée à Aristote. (Voyez Camérarius, Préface des Économiques d'Aristote et de Xénophon; J. G. Schneider, Anonymi Œconomia quæ vulgo Aristoteli falso ferebantur, Leipzig, 1815, in-8º; Schœll, Histoire de la littérature grecque; Barthélemy Saint-Hilaire, Traduction de la Politique; Feugère, Œuvres complètes de la Boëtie. M. Hoëfer, traducteur des deux livres de l'Économique, ne partage pas cette opinion. M. Feugère rappelle que déjà Nicolas Oresme (Baillet, Jugement des savants), par l'ordre de Charles V, avait translaté dans notre langue, sur une version latine, le traité d'Aristote; mais il ajoute: La Boëtie fut à la fois de cet ouvrage le second et le dernier traducteur français. Ceci est contestable, car nous connaissons une autre traduction, très-rare à la vérité, non citée, qui est celle-ci: les Œconomiques de Aristote translatées nouvellement du latin en françoys par Sibert Louvenbroch, licencié es loix demeurant en la noble ville de Coulongne; Paris, etc., sans date (vers 1532), in-16 de 46 pages, lettres rondes, à la fin un feuillet blanc avec la marque de Denis Janot.
Vascosan a aussi publié une traduction du grec en français de ce même traité, 1554, in-8º, par Gabriel Bouin ou Bounin, bailli de Châteauroux.
Enfin le marquis de Paulmy cite (Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque) une traduction faite en 1417 du premier livre de ce même traité, mais qui n'a pas été imprimée, par Laurent de Premierfait, valet de chambre du roi Charles V (mss. Bibl. impér. nº 7351), et une autre traduction, mais cette fois imprimée et en vers français, par Jean Hérault de Sainte-Ferme en Bazadois, in-16, 1561.
M. F. Hoëfer a donné la première traduction française complète de l'Économique, d'après les mss. de la Bibliothèque impériale, à la suite de la Politique, traduite par Champagne, revue et corrigée par lui (Paris, 1843).
Ainsi, en résumé, le livret des opuscules de La Boëtie avec des réimpressions partielles ou générales dont j'ai donné le détail dans le Bulletin du bibliophile de Techener, août 1846, se présente sous le format in-8º dans les différents états qui suivent:
1º 1571. Paris, Fédéric Morel, contenant Xénophon, Plutarque, vers latins, dédicaces, lettre de Montaigne. 131 feuillets numérotés au recto avec un seul frontispice annonçant des vers français qui ne s'y trouvent pas.
2º 1571. Les mêmes pièces que ci-dessus, plus les vers français, avec frontispice particulier et la date 1572, 20 feuillets dont 19 numérotés.
3º 1572. Mêmes pièces que le numéro 2, mais les 2 frontispices portant la date de 1572.
4º 1600. Claude Morel. Aristote avec frontispice, 8 feuillets. Vers français avec frontispice, 20 feuillets, dont 19 numérotés. Xénophon, Plutarque, vers latins, lettre de Montaigne. 131 feuillets avec un seul frontispice.
On trouve encore des exemplaires avec la date de 1572 sans les vers français, d'autres sans la lettre de Montaigne, enfin on peut rencontrer les vers français ou l'Aristote reliés à part.
Le premier état n'est pas très-rare, les vers français le sont beaucoup plus, l'Aristote est extrêmement rare; je n'en connais pas plus de cinq exemplaires, dont un isolé appartient à la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Les vingt-neuf sonnets.—Postérieurement à la publication des œuvres de La Boëtie faite en 1571 et 1572, un de ses amis M. Poyferré retrouva par fortune vingt-neuf sonnets, qu'il s'empressa d'envoyer à Montaigne, qui les inséra au chap. XXIX, du livre Ier des Essais. Montaigne les dédia à madame de Grammont (la belle Corisandre d'Andoins) comme ayant été composés par La Boëtie dans sa plus verte jeunesse, échauffé d'une belle et noble ardeur qu'il promettait de lui dire un jour à l'oreille. Montaigne estimait ces sonnets plus que les vingt-cinq qu'il avait insérés dans les Opuscules; il leur trouvait quelque chose de plus vif et de plus bouillant, tandis que, selon lui, les vingt-cinq sonnets composés lorsque La Boëtie était à la poursuite de son mariage sentaient déjà quelque froideur maritale. Ces vingt-neuf sonnets parurent ainsi dans les quatre éditions connues, publiées pendant la vie de Montaigne,[p. 43] y compris celle de 1588. Mais sur un exemplaire de cette date que Montaigne avait préparé pour une nouvelle édition (Bibliothèque publique de Bordeaux), il avait supprimé ces sonnets et ajouté cette note: Ces vers se voyent ailleurs. Dans ce cas, où se voyent-ils? était-ce une allusion aux premières éditions? Mais Marie de Gournay, dans son édition de 1595, donna une note bien plus explicite: «Ces vingt-neuf sonnets d'Étienne de La Boëtie ont été depuis imprimés avec ses œuvres.» A quelles œuvres cela se rapporte-t-il? serait-ce à la suite de la Description du Médoc, si elle existe? et serait-ce à ces sonnets que se rapporterait cette note de Lelong à l'article précité sur cet ouvrage: «On y a joint quelques vers du même auteur qui ne se trouvent pas dans l'édition qu'avait donnée de ses œuvres Michel de Montaigne.» Mais alors comment se fait-il que Claude Morel, qui en 1600 réimprimait les opuscules à l'occasion de la découverte de l'Aristote, n'ait pas eu l'idée d'y joindre ces vingt-neuf sonnets et d'autres poésies s'il y avait lieu? dans tous les cas, cette explication ne s'appliquerait pas à la note de Montaigne, puisque la publication du Médoc serait, si elle est, postérieure à sa mort.
Marie de Gournay, qui certainement s'occupait moins de La Boëtie que de Montaigne, aurait-elle confondu ces vingt-neuf sonnets avec les vingt-cinq, erreur commise par beaucoup d'écrivains, notamment[p. 44] par Amaury Duval et M. Violet le Duc? Tout cela est fort obscur et fait encore plus désirer l'historique description.
Aux nombreuses interrogations qui composent presque seules ce paragraphe je ne puis répondre qu'en disant: Dubitare et quærere semper.
Quoi qu'il en soit, ces vers exclus des Essais depuis 1595 disparurent pendant cent cinquante ans, jusqu'à ce que Coste ou plutôt Jamet et Gueulette les reproduisissent dans la belle édition de 1725, et, depuis, la plupart des éditeurs ont maintenu cette restitution, sauf de l'Aulnaye, Am. Duval et Naigeon. Ce dernier motivait la suppression en disant que «ces sonnets ne méritent pas d'être réimprimés, parce qu'ils ne méritent pas d'être lus.»
(Je fais remarquer que, par suite d'un changement dans les numéros des chapitres, ces sonnets, qui dans les premières éditions des Essais occupaient le chapitre XXIX, se trouvent aujourd'hui au XXVIII.)
La Servitude volontaire. Le plus célèbre des ouvrages de La Boëtie et, d'après M. Labitte (Prédicateurs de la Ligue, 1841), «le plus remarquable, le plus audacieux et maintenant le seul connu des traités politiques qui composent les Mémoires de l'Estat de France sous Charles IX.» La Boëtie le composa dans sa première jeunesse, mais ne le fit pas plus imprimer qu'aucune autre de ses œuvres.[p. 45] Montaigne avait eu d'abord le projet d'insérer la Servitude volontaire dans le chapitre De l'amitié; mais, l'ayant vu imprimée par un parti politique dont il blâmait les tendances, à mauvaise fin, par ceux qui cherchoient à troubler et à changer l'État sans savoir s'ils l'amenderaient, et mêlée à d'autres écrits de leur farine (allusion aux Mémoires de l'État de France 1576-1578), il renonça à la publier, lui trouvant, ainsi qu'aux observations sur l'édit de janvier, «la façon trop délicate et mignarde pour les abandonner au grossier et pesant air d'une si malplaisante saison.» Néanmoins, un grand nombre d'auteurs ont écrit que Montaigne a publié la Servitude volontaire.
Cet ouvrage fut dès sa naissance très-répandu; il courut «ès mains des gens d'entendement, non sans bien grande et méritée recommandation.» (Essais.) Il ne portait pas de titre, et le manuscrit du temps que je connais est dans ce cas; mais La Boëtie dans son intimité l'avait baptisé la Servitude volontaire. Ce qu'ignorant le public, il l'avait rebaptisé, comme dit Montaigne, le Contr'un, et c'est ce dernier nom qui a donné au sénateur Vernier l'étrange idée d'appeler ce traité Les Quatre Contr'un! (Notices et obser. pour... les Essais de Montaigne).
De Thou, blâmé en cela par La Monnaie, intitulait cet opuscule Anthenoticon, faisant allusion à l'édit de Henri III, dit Édit de réunion, et par cette raison[p. 46] Henoticon (Ἐνωτιϰὀς, ή, ὀν, qui unit, d'ἑνὀω, unio; R. Εἷς, unus), mot qu'on peut dire renouvelé des Grecs, puisque dès le cinquième siècle, en 482, on avait ainsi appelé un édit de l'empereur Zenon pour réunir les catholiques et les eutychiens, sous le pontificat de Simplicius. (Moréri, au mot Henoticon.)
Une grande divergence règne entre les auteurs sur l'âge auquel La Boëtie a écrit le Contr'un, et on le comprend, puisque cet ouvrage circulait en manuscrit, sans date, sans nom d'auteur et même sans intitulé. Quelques écrivains disent seize ans ou moins, d'autres dix-sept, d'autres dix-huit, enfin quelques-uns, et De Thou est de ce nombre, disent dix-neuf. Dans le doute il est évident que c'est Montaigne qu'il faut croire; or, dans toutes les éditions données de son vivant, il a inscrit dix-huit ans; mais dans l'exemplaire annoté pour une édition nouvelle et dans celui de Bordeaux, où un tiers des Essais est écrit de sa main, il a rayé le mot dix-huit et écrit lui-même (j'en ai le calque sous les yeux) sese (seize). Ce chiffre, d'autant plus probant qu'il est le résultat d'une correction, n'a pu être substitué au premier que pour de bonnes raisons et sur de nouveaux renseignements. Il n'y a donc nul motif de le rejeter, et c'est celui qu'on trouve dans toutes les éditions depuis 1595: «mais oyons un peu parler ce garçon de seize ans.»
Cette discussion a son intérêt, parce que De Thou, trompé par la presque coïncidence de la composition du Contr'un et de la révolte de Guyenne, a conclu que l'Anthenoticon avait été inspiré à La Boëtie par l'indignation que lui avaient causée les cruautés exercées dans cette ville par le connétable lors des événements de Bordeaux. Je crois cette opinion erronée, et c'est en cela que l'âge qu'avait La Boëtie en écrivant est essentiel à connaître, car il suffit à décider la question. Si La Boëtie avait seize ans, né en 1530, il faut qu'il ait écrit en 1546; or, le nouvel impôt, le soulèvement de la Guyenne, l'assassinat de Monneins, n'eurent lieu qu'en 1548, et Anne de Montmorency n'exerça ses cruelles représailles qu'à la fin de cette année, c'est-à-dire quand La Boëtie complétait ses dix-huit ans. On voit d'après cela que la version de De Thou n'aurait pas même de probabilité en s'en tenant à l'âge de dix-huit ans indiqué primitivement par Montaigne. De Thou a tellement senti l'objection soulevée par ces dates, qu'au lieu d'accepter l'âge donné d'abord par Montaigne, il a voulu laisser à La Boëtie le temps d'écrire, et il a dit: «Vix tantum XIX annos natus.»
Mais l'erreur de De Thou devient bien plus évidente si on étudie le Contr'un: on n'y trouve pas, en effet, une seule allusion au temps présent. Sa haine contre la tyrannie est une haine toute antique, et c'est bien plus contre Denis et Sylla qu'il se passionne[p. 48] que pour Guise ou Condé. La Boëtie a vu les choses de plus haut que son époque. Son but était de montrer que la liberté est le droit des nations; qu'elles-mêmes se font leur servitude, et que, pour en être délivrées, il leur suffirait de s'abstenir. Ses exemples, il les demande aux Vénitiens et aux Mahométans, aux Grecs et aux Romains: à ses compatriotes, jamais! Si l'inspiration de son siècle se fait jour, c'est pour exprimer un sentiment chrétien qui tempère ce que l'indépendance qu'il prêche pourrait avoir de trop absolu. «Il soumet la puissance des uns aux besoins des autres, et fait dériver d'aptitudes plus grandes de plus grands devoirs et non de plus grands droits.» (Voyez Louis Blanc, Hist. de la Révol., t. I.) Je cite avec bonheur les propres paroles de La Boëtie: «La nature, faisant aux uns les parts plus grandes, aux autres plus petites, a voulu faire place à la fraternelle affection; ayant les uns puissance de donner et les autres besoin de recevoir.» Un seul instant il se souvient de l'histoire de France! et alors, le croirait-on? c'est pour en citer les choses les moins croyables peut-être, l'oriflamme, la sainte ampoule, l'origine des fleurs de lis, et déclarer qu'il «ne les veut mescroire parce que nous ni nos ancêtres n'avons eu jusqu'ici aucune raison de l'avoir mescru,» d'accord en cela avec Pasquier, qui disait que ces choses «étoient non-seulement véritables,[p. 49] mais sacrosaintes, et qu'il était bienséant à tout bon citoyen de les croire pour la majesté de l'empire.» (Rech. de la Fr. liv. VIII, ch. 21.) Et là même, si le Contr'un était une protestation contre des cruautés exercées au nom et par les ordres du souverain, La Boëtie aurait-il inséré un éloge ampoulé de nos rois qu'il est probable qu'il ne l'aurait pas écrit au moins dans ces termes dix ans plus tard «ayans touiours des Roys si bons en la paix, si vaillans en la guerre, qu'encore qu'ils naissent roy si semble il qu'ils ont esté non pas faits comme les autres par nature, mais choisis par le Dieu tout puissant avant que de naistre pour le gouvernement et la conservation de ce royaume.» Ne semble-t-il pas que ce soit là une indignation bien contenue! et le connétable, ce grand rabroueur de personnes, comme dit Brantôme, traitant Bordeaux en ville conquise, n'est-il pas un singulier conservateur[25].
[25] Pour bien faire comprendre la portée de mon objection, je crois devoir, quoiqu'à regret, rappeler les faits principaux de ce déplorable épisode. Une révolte dans laquelle le gouverneur de la ville, Monneins, est tué, éclate à Bordeaux à l'occasion d'un impôt nouveau. Le roi commande à Anne de Montmorency, parent de Monneins, de réprimer cette sédition, quand déjà les Bordelais imploraient leur pardon. Le connétable entre par la brèche, quoique les portes fussent ouvertes et que la ville fût pavoisée, il frappe une contribution de deux cent mille livres. Les archives et titres de la ville sont brûlés, les jurats et cent-cinquante notables déterrent avec leurs ongles le corps du gouverneur; cent vingt personnes (les Annales d'Aquitaine disent cent cinquante) sont pendues, décapitées, rouées, empalées, démembrées à quatre chevaux, et brûlées, trois sont maillotées, (les os broyés avec un pilon de fer); Guillottin est brûlé vif (Mém. de la Vieuville, tome Ier), la femme de Lestonnac, jurat condamné à mort, implore la grâce de son mari; mais la suppliante est belle, le connétable impose une condition infâme, et dans le même moment où l'épouse se sacrifie, la tête du mari roule sur l'échafaud (Lafaille, Ann. de Toulouse), etc., etc.
Et c'est en présence de ces atrocités que La Boëtie aurait reconnu l'Élu du Seigneur, choisi entre tous pour conserver le royaume!!! Quand on a dix-huit ans et qu'on est témoin de pareilles horreurs on se tait ou on écrit autre chose que le Contr'un.
De Thou lui-même se contredit, car il reconnaît que cet ouvrage fut pris par ceux qui le publièrent dans un sens contraire à celui que son sage et savant auteur avait eu en le composant. Quel pouvait donc être ce sens en présence des cruautés auxquelles il l'attribue. Enfin Montaigne nous déclare «qu'il n'était pas un meilleur citoyen, plus religieux observateur des lois ni plus ennemi des nouveautés et remuements de son temps que La Boëtie, et qu'il eût plutôt employé sa suffisance à les éteindre qu'à leur fournir de quoi les émouvoir davantage.»
C'est donc à tort qu'on a voulu transformer La Boëtie en écrivain politique de son temps. Son livre n'est pas un pamphlet; il n'en a ni la marche,[p. 51] car il ne conclut pas, ni même la langue, car, en général, dans ce temps, c'était le latin qu'employait la polémique en politique et en religion. Ce traité appartient à l'antiquité: si on ne savait pas sa date on ne la devinerait pas. La Boëtie soutient une thèse générale pour tous les temps et pour tous les peuples, et dont, par conséquent, on peut user dans tous les temps et dans tous les pays. C'est ainsi que sous Louis XIV, La Fontaine a pu dire: «Votre ennemi c'est votre maître»; La Bruyère, au début du chapitre du Souverain ou de la République n'est pas moins explicite, et Voltaire a écrit: Voulez-vous vivre heureux, vivez toujours sans maître[26]. C'est dans ce sens qu'on a pu considérer La Boëtie comme un des précurseurs de 1789 (Louis Blanc, Mongin, Lebas), et qu'on a pu dire que le Contr'un était la préface du Contrat social, jugement assez piquant, puisque si La Boëtie est le J.-J. Rousseau du seizième siècle, on a dit de son dernier éditeur, M. l'abbé de Lamennais, qu'il était le J.-J. Rousseau du dix-neuvième. La Boëtie n'est pas plus un écrivain politique pour son temps que Montaigne pour le temps de Mazarin, parce qu'il a plu à un frondeur quelconque[p. 52] de composer une Mazarinade tout entière (Ovide parlant à Tieste) avec des extraits des Essais.
[26] C'est ainsi qu'Homère (Iliade, A, vers 231) et Plutarque (dans la Vie de Caton le Censeur) donnent aux rois des qualifications qui semblent étranges, qu'ils attribuent d'une manière générale à cette forme d'autorité sans applications personnelles (δημοϐὀρος, σαρϰοφἀγον).
Tallement des Réaux ne veut voir dans la Servitude qu'une amplification de collége, et M. Mongin (Encyclopédie nouvelle) la regarde comme «jeux et exercices de jeune homme.»[27]
[27] D'Aubigné donne de l'origine de la Servitude volontaire une explication dénuée de toute probabilité et plus digne du baron de Fœneste que d'un historien universel. (Hist. univers., liv. II, ch. II.)
Dirai-je le fond de ma pensée? La Boëtie a seize ans, il sort du collége, il est nourri de l'histoire de l'antiquité, il est actif, laborieux, les vers ne suffisent plus à sa maturité précoce, il choisit un sujet d'amplification dont, au dire de Montaigne, Plutarque lui a peut-être fourni la matière et l'occasion («Les habitants d'Asie servaient à un seul pour ne savoir prononcer une seule syllabe, qui est non»); il s'est lié au collége avec un ami, Longa, qui s'est déjà montré indulgent pour ses vers (Serv. vol.); il le tutoie, il lui dédie son ouvrage, qui a plus de succès qu'il ne l'avait prévu, on veut le lire, on en fait des copies, et il circule dans cet état jusqu'au moment où l'opposition du temps s'en empare, comme elle l'a fait en 1789, comme elle l'a fait de nos jours. Telle est, selon moi, l'histoire vraie de cet écrit, et je crois que si La Boëtie[p. 53] l'avait composé en vue d'un événement contemporain, Montaigne l'aurait su, et il n'aurait pas cherché à nous donner le change sur son origine.
A vrai dire, ces élans spontanés d'une indépendance virginale me plaisent plus encore que s'ils étaient commandés par des émotions actuelles, et ces préceptes, ces observations, grandissent en autorité à être ainsi dégagés de tout intérêt contemporain. Mais une fois le sujet envisagé comme abstraction, j'aurais aimé à voir La Boëtie descendre jusqu'à son temps; de théoricien, d'écrivain spéculatif, devenir homme pratique et apprécier à sa manière ce temps de pénible enfantement des sociétés modernes, ce seizième siècle, si dramatique! siècle de croyance et de scepticisme, de fidélité et de révolte, ce siècle où tout a été mis en question, et que M. Daunou, qui avait vu la terreur, n'a pas craint d'appeler le plus tragique de tous les siècles. Quels tableaux il aurait fournis à l'appréciation de La Boëtie! sans doute notre auteur compterait une belle page de plus; car la plume qui a tracé le Contr'un était de force à nous donner une autre Ménippée[28].
[28] Montaigne (chap. de l'Amitié) paraît être de cet avis, car il regrette que La Boëtie n'ait pas fait comme lui et mis par écrit ses fantaisies. On remarquera que la Servitude a été écrite trente ans avant la République de Bodin, le Franco-Gallia d'Hottmann, les Vindiciæ contra Tyrannos de Languet, etc.
Ce que nous avons dit du Contr'un nous amène à placer ici quelques mots sur l'ami auquel il s'adresse, personnage que M. Feugère semble seul avoir remarqué, mais pour dire qu'il est parfaitement inconnu. Il s'agit évidemment de Bertrand de Larmandie, quatrième du nom, baron de Longa ou Longua (château situé dans la commune de Sainte-Foy de Longa, canton de Saint-Alvere, arrondissement de Bergerac). Bertrand était fils de Jean et neveu de Jacques, évêque de Sarlat en 1532. D'après l'époque de son mariage[29] (le 3 mars 1560 il épousa la fille de Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan), il devait être précisément de l'âge de La Boëtie, qui, cette année-là, complétait ses trente ans. (Voy. Courcelles.)
[29] Ce mariage du baron de Longa prouve l'importance de sa famille puisqu'en entrant dans celle des Bourbon Lavedan il s'alliait jusqu'à un certain point avec la grande famille des Matignon; en effet, il épousait Françoise de Bourbon Lavedan, dont la mère, Françoise de Silli, était sœur d'Anne de Silli, mère du célèbre maréchal de Matignon, qui se trouvait ainsi cousin germain de la femme de Longa.
Montaigne dit que La Boëtie composa le Contr'un «dans sa première jeunesse[30], dans son enfance, par[p. 55] manière d'essai, d'exercitation, comme sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres.» En effet, du temps de La Boëtie, mais postérieurement à sa mort, on a traduit en français un livre dont il connaissait peut-être le texte grec, et qui offre avec le sien une remarquable analogie (Discours de la royauté et de la tyrannie, traduit nouvellement du grec de Dion Prusien, surnommé Chrysostome ou bouche d'or, etc.). Montaigne lui-même met dans la bouche de sauvages qui visitent la France cette pensée «qu'ils ne comprenaient pas que des hommes vigoureux et portant barbe obéissent à un enfant.» C'est là la thèse développée par La Boëtie. La Westminster Review (1838) trouve des rapports frappants entre la Servitude volontaire et les écrits politiques de Milton; on sait que la Mothe Levayer a traité le même sujet (de la liberté et de la servitude); enfin Hobbes (dans son livre De Cive) a soutenu la thèse opposée, etc., etc.
[30] C'est en effet par la grande jeunesse de l'auteur que le Contr'un est remarquable, et un jeune homme d'une précocité remarquable, qui devait être conseiller avant vingt-deux ans, n'était plus un enfant à dix-neuf. Si La Boëtie eût écrit la Servitude à cet âge, comme le veut De Thou, la chose n'aurait plus été assez merveilleuse pour que les protestants, désireux d'avoir dans leurs rangs un homme à opposer à l'homme admirable que les catholiques possédaient en la personne de La Boëtie, eussent imaginé de rajeunir Bongars et de prétendre qu'il n'avait que dix-sept ans lorsqu'il fit la réponse fameuse qu'on lui attribue à la bulle d'excommunication de Sixte V contre Henri de Navarre et le prince de Condé (Voy. Varillas, Hist. de Henri III, et Bayle, au mot Bongars). Le choix même de cet âge pour Bongars prouve que ceux qui ont inventé cette fable savaient que La Boëtie n'avait que seize à dix-sept ans lorsqu'il écrivit.
Il paraîtrait que la Servitude volontaire fit à[p. 56] son apparition une grande sensation, car on voit dans les mémoires manuscrits de Vivant (Geoffroy, gouverneur du Périgord, etc., célèbre dans les guerres du seizième siècle), que les Sarladais se révoltèrent par suite de la lecture qu'ils en firent (manuscrit précité de A. L. Bouffanges).
D'un autre côté, Sarlat était sous la domination des évêques, et la liberté de langage de La Boëtie a pu lui aliéner quelques concitoyens. Le Contr'un lui suscita peut-être des tracasseries, et c'est ainsi qu'il aurait été amené à dire, comme le rapporte Montaigne, qu'il aurait mieux aimé être né à Venise qu'à Sarlat.
Publication. Je ne pense pas que la Servitude volontaire ait été imprimée avant que Simon Goulart la fît entrer dans les Mémoires de l'Estat de France sous Charles IX (trois éditions, 1576-1578). Cependant, interprétant probablement ce que De Thou avait dit de la publicité par les manuscrits, M. Louis Blanc a conclu que ce traité a été donné à la suite de la première édition du Franco-Gallia (1573), et M. Charpentier (Tableau historique de la littérature française), renchérissant sur cette erreur, dit que le Contr'un a été publié sous le titre de Franco-Gallia[31]!
[31] Le marquis de Paulmy (Livres de politique du seizième siècle) dit, sans en fournir la preuve et sans indication aucune, que la Servitude a été publiée en 1572. Je crois que c'est une erreur.
L'ouvrage, à partir de ce moment, tomba dans l'oubli, à ce point que le cardinal de Richelieu, voulant le connaître, le fit demander chez tous les libraires de la rue Saint-Jacques sans qu'aucun d'eux sût ce dont on voulait lui parler. Pourtant un certain Blaise, plus instruit et plus avisé que les autres, dit à l'émissaire du cardinal qu'il connaissait un curieux qui en possédait un exemplaire, mais qu'il ne voudrait pas s'en dessaisir à moins de cinq pistoles. Cette difficulté fut bientôt levée, et le libraire n'eut qu'à découdre un exemplaire des Mémoires et extraire quelques feuillets du tome III pour toucher ce prix (Tallement des Réaux).
Cent cinquante ans s'écoulèrent jusqu'à ce que Coste, le consciencieux éditeur, fît entrer le Contr'un dans ses éditions de 1727, 1739 et 1745. En 1740, on l'avait imprimé à Londres dans un supplément in-4º des éditions des Essais de 1724 et 1725, et, sauf un petit nombre d'exceptions, il a fait partie de toutes les éditions depuis cette époque.
En 1802, le libraire Louis donna de la Servitude volontaire une édition isolée, ou seulement accolée à quelques lettres de Montaigne (format in-8º et in-12).
En 1835, M. de Lamennais en a donné deux éditions exclusives de toute autre pièce, l'une in-8º avec frontispice successif de 1re, 2e et 3e édition, l'autre in-18, toutes deux avec une préface analytique et apologétique de l'ouvrage.
La Servitude a eu les honneurs de la traduction: en français moderne, en anglais et en italien.
En 1789, on a publié à Paris un Discours de Marius, plébéien et consul, traduit de Salluste, suivi du Discours d'Étienne La Boëtie, traduit du français de son temps en français d'aujourd'hui, par l'Ingénu (Lafite, avocat) in-8º. En 1791, la Servitude modernisée a reparu dans le supplément à la huitième Philippique (Ami de la Révolution, 57 nos de 1790 à 1791, in-8º). Enfin, plus récemment, une édition a été imprimée en Belgique, mais elle n'a pas été mise en vente, à cause du commentaire fort étendu qui l'accompagne, et qui, pour parler comme Montaigne, est au moins de la même farine que le texte, mais beaucoup plus actuel et personnel. Voyez: De la Servitude volontaire, ou le Contr'un, par Étienne de La Boëtie, ouvrage publié l'an 1549 (date arrangée d'après les 19 ans de De Thou), et transcrit en langage moderne, pour être plus à la portée d'un chacun, voire des moins aisés, par Adolphe Reschatelet (anagramme de Charles Teste, mort il y a peu de temps, frère de l'ancien ministre); Bruxelles et Paris, chez les marchands[p. 59] de nouveautés, 1836, in-18 (il y a des exemplaires avec errata, d'autres n'en ont pas). L'auteur annonce que cette édition est préparée depuis 1834, et devait paraître avant celles qui l'ont précédée; il ajoute qu'elle s'en distingue par le soin qu'il a apporté à la mettre au niveau de toutes les intelligences, et par les notes dont elle est accompagnée. La Servitude est précédée d'extraits des lettres de Montaigne qui ont trait à La Boëtie et du chapitre de l'Amitié. Elle est suivie de plusieurs pièces étrangères à notre auteur (pages 127 à 158). Je suis entré dans quelques détails sur ce volume puisqu'il ne se vend pas et que les exemplaires en sont fort rares en France.
Il a paru à Londres en 1735, in-12, sous ce titre: a Discourse of Voluntary Servitude, une traduction anglaise faite avec grand soin, qu'on dit être d'un style «plus net, plus coulant et plus poli que l'original», précédée d'une assez longue préface du traducteur. Une expression de La Boëtie, que Coste n'avait pas pu expliquer, se trouve là éclaircie pour la première fois (le panier d'Érichtone). Cette traduction, portée au catalogue du British Museum, est assez rare pour qu'un bibliophile ardent et distingué, M. S. Van de Weyer, ambassadeur belge à Londres, qui a bien voulu m'en donner une analyse, m'ait dit n'en avoir vu qu'un seul exemplaire (bibliothèque de lord Malmesbury).
Enfin une traduction italienne, par César Paribelli, Loisirs d'une Servitude involontaire, car l'auteur était détenu politique, parut à Naples, «anno settimo republicano», in-18, avec les notes de Coste, sous ce titre: «Discorso di Stefano della Boëtie della Schiavitù Volontaria o il Contra uno. Liberta, Eguaglianza.»
Après les honneurs de la traduction, la Servitude a eu ceux de la réfutation. Henri de Mesmes[32], digne émule de La Boëtie pour la précocité, puisqu'il professait le droit à Toulouse à seize ans, ami de Montaigne, qui, cette même année 1570, lui dédie une des traductions de La Boëtie (Règles de mariage), protecteur de tous les savants, celui-là qui fournit à Lambin ses meilleures observations sur Cicéron, à René du Bellay de bons renseignements pour les mémoires de Martin et de Guillaume, Henri de Mesmes avait formé le projet de réfuter in extenso l'opuscule de La Boëtie. Dans ce but il en avait rédigé un extrait analytique pour y répondre, c'était une sorte de programme de son travail. De plus il avait rassemblé dans les anciens auteurs, Xénophon, Isocrate, Plutarque, Aristote, Callimaque, etc., un grand nombre de[p. 61] passages propres à étayer ses raisonnements; ce projet est resté en cours d'exécution.
[32] Seigneur de Roissy et de Malassise, celui-là même qui avec Biron (boiteux), conclut en 1570, à Saint-Germain, avec les chefs des protestants, cette paix éphémère dite boiteuse et malassise, dont la Saint-Barthélemy fit expier la désignation railleuse.
Manuscrit de la Servitude volontaire. Toutes les éditions de la Servitude volontaire ont été données d'après la première publication faite dans les Mémoires de l'Estat de France, c'est-à-dire d'une manière fort incorrecte et en beaucoup d'endroits tout à fait inintelligible, les éditeurs de ce recueil étant préoccupés de tout autre chose que de la pureté des textes. Il devenait donc très-important de rencontrer un de ces manuscrits qui au seizième siècle couraient «ès mains des gens d'entendement.» J'ai été assez heureux pour en trouver un à la Bibliothèque impériale (indiqué par M. P. Paris, Manuscrits français de la bibliothèque du Roi, t. VI); c'est celui qui a appartenu à Henri de Mesmes. Il est joint au projet de réfutation dont j'ai parlé ci-dessus; et, pour surcroît de preuves de sa provenance, les Memoranda de Henri de Mesmes renvoient aux pages du manuscrit. Il ne porte ni titre, conformément à ce que dit Montaigne, et ce qui explique la diversité de ceux sous lesquels on l'a désigné; ni date, ce qui explique la divergence des écrivains sur ce point.
Une collation minutieuse de ce manuscrit avec les imprimés m'a fait découvrir non pas tant des variantes que des fautes énormes reproduites par les[p. 62] éditeurs, de telle sorte qu'une foule de passages obscurs dans les imprimés sont parfaitement clairs dans le manuscrit; un vers entier, des phrases entières ont été omis. On a imprimé le sang de la tyrannie, pour le sein; les bœufs sous les pieds du joug geignent, pour le poids; je ne lui permets pas, pour je lui permets; le feu est sans forme, pour sans force; étendre pour estreindre; connoissance du bien, pour mal; taxés, pour tachés; malhabiles pour mal habillés; marin, pour Macrin (celui qui fit tuer Antonin Caracalla). Le bon sens de Coste avait déjà, par une note, indiqué cette erreur, mais il avait laissé le nom de marin dans le texte; celui de Macrin qui se trouve dans le manuscrit est une preuve décisive entre mille qu'il donne la bonne leçon. Enfin, pour en finir, j'ai antérieurement cité l'expression de «panier d'Érisichtone». Le savant M. J. V. Leclerc avait supposé qu'il fallait écrire d'après Suidas, Erichtone, ce que confirme le manuscrit.
A l'avenir donc les éditeurs de la Servitude ne pourront se dispenser de consulter et, à mon avis, de suivre ce manuscrit, qu'ils trouveront relié avec sa réfutation fonds de Mesmes nº 564; et par une singulière distraction du relieur qui a lu le nom d'Homère aux premières lignes, il est intitulé Extraits d'Homère.
Je voudrais dire maintenant quelques mots des jugements[p. 63] qui ont été portés sur la Servitude volontaire. Mais il est impossible de sortir de ce dédale de contradictions autrement qu'en citant textuellement!
Montaigne juge ce traité gentil et plein au possible.—De Thou qualifie son auteur de sage et savant.—Scévole Sainte-Marthe, Colletet trouvent cet ouvrage excellent.—M. Barthelemy-Saint-Hilaire le dit un admirable traité (Politique d'Aristote).—M. L. Feugère le trouve marqué au coin de la véritable éloquence.—Pour M. P. Lacroix, c'est un beau morceau d'utopie politique (Catalogue Karstner).—Pour Paul Dupont, c'est (Ann. litt. de la Dordogne) un Évangile politique.—Pour M. Lebas (Univers pittoresque), c'est un des plus beaux monuments de la langue française.—Pour M. S. de Sacy (Journal des Débats, avril 1852), c'est une des plus belles pages en prose que nous ait léguées le seizième siècle.—Enfin, M. Chevreul (Hubert Languet) le juge un des monuments les plus remarquables de la prose française au seizième siècle[33].
[33] M. Chevreul toutefois conclut en classant Montaigne et La Boëtie parmi les protestants, par la nature de leurs raisonnements, et par leurs œuvres.—Ce jugement me paraît contestable.
Naigeon dans une note manuscrite ajoutée à son exemplaire, dit que le Contr'un est écrit d'un style mâle et vigoureux.
Mais, en revanche, Baillet dit que, si La Boëtie avait composé son livre en vue de l'usage qu'on en a fait, c'eût été une tache éternelle à son nom.—Lamonnaye trouve que c'est «une très froide, très ennuyeuse et très puérile déclamation.»—M. Henri Aigre, tout en reconnaissant que le Contr'un «est écrit avec une force et une noblesse que la prose de ces temps n'avait pas encore atteintes,» n'en déclare pas moins l'ouvrage «fort dangereux en politique.»—M. Baudrillart trouve dans le Contr'un «un appel à l'insurrection, d'une entraînante éloquence.»—M. Matter (Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles) regarde La Boëtie comme le représentant de la doctrine de la renaissance poussée par le radicalisme à l'action la plus funeste, de même qu'il regarde Thomas Morus comme représentant la même doctrine réduite par l'idéalisme à la nullité pratique.—M. J. B. Laforêt, professeur au séminaire de Bastogne, prend aussi La Boëtie comme type pour le principe démocratique; et il l'oppose à Bodin, qu'il prend pour type du principe monarchique (Voy. le Mém. lu en 1852 à la Soc. litt. de l'Université catholique de Louvain, sous le titre de: Lutte entre le principe démocratique et le principe monarchique au seizième siècle, ou Étude sur La Boëtie et Bodin, analysé dans le rapport que M. Prosper Staes a inséré dans l'Annuaire de cette[p. 65] université; Louvain, 1853, page 35). Mais M. Matter va plus loin: oubliant que, sujet fidèle, La Boëtie a été l'oracle d'un parlement, qu'il se présente à la postérité sous l'égide de l'amitié de Montaigne et de l'estime de De Thou, M. Matter dresse contre la Servitude volontaire un véritable réquisitoire, et il conclut en disant que le Contr'un est une déclamation séditieuse, qui serait de nature à faire traduire son auteur devant les tribunaux!
L'espace nous manque pour citer en entier ce curieux jugement, qui tombe par sa propre exagération, et dont la meilleure réfutation serait la reproduction pure et simple de tout le passage relatif à La Boëtie.
Je n'ajouterai pas un jugement de plus à ceux que je viens de rapporter: le lecteur impartial relira l'œuvre de La Boëtie en tenant compte des conditions dans lesquelles elle a été écrite, et nous osons espérer qu'il ne vouera pas le nom de l'auteur à l'exécration des générations futures.
Quelle que soit d'ailleurs l'opinion qu'on se forme de cet ouvrage, nous devons tous faire comme Montaigne, et «être particulièrement obligés à cette pièce, d'autant qu'elle a servi de moyen à leur première accointance.»
Œuvres complètes. Jusqu'ici j'ai mentionné des parties isolées des œuvres de La Boëtie; mais M. Léon[p. 66] Feugère, qui en 1845 avait donné une «Étude sur la vie et les ouvrages de La Boëtie (Paris, in 8º),» publia en 1846 la première édition complète des œuvres connues de cet auteur. J'ai apprécié cette intéressante collection dans le Bulletin du Bibliophile (Techener, août 1846), et, après avoir rendu justice au remarquable travail d'érudition dont le texte est accompagné, j'ai témoigné le regret que le laborieux éditeur qui avait à juste titre admis les dédicaces de Montaigne n'eût pas inséré la lettre de cet auteur sur la mort de son ami; à mon avis, une édition de La Boëtie ne serait complète qu'à la condition de contenir cette lettre et même le chapitre de l'Amitié.
Ce volume des œuvres complètes (Paris, Delalain, in-12) comprend tous les opuscules connus de La Boëtie, même les vingt-neuf sonnets insérés dans les Essais.
Il ne me reste plus qu'à indiquer un certain nombre d'écrivains qui ont jugé La Boëtie, et que je n'ai pas eu occasion de nommer dans les citations que j'ai faites d'environ cinquante ouvrages différents. Mais auparavant je dois publiquement reconnaître combien je suis redevable à l'assistance de MM. l'abbé Audierne, de Mourcin et Lapeyre, à Périgueux; MM. G. Brunet et Delpit, à Bordeaux; M. S. Van de Weyer, ambassadeur à Londres; M. J. B. Lascoux, à Paris, et surtout à M. Richard, conservateur[p. 67] adjoint de la Bibliothèque impériale, ma providence bibliographique.
J'ajouterai, pour l'acquit de ma conscience, que ce travail biographique, qui n'entrait en aucune façon dans mes projets actuels, est uniquement dû au scrupule honorable, et certainement exagéré, d'un des plus laborieux collaborateurs de la Biographie nouvelle. M. Regnard, qui avait été chargé de l'article La Boëtie, vint me demander quelques renseignements, et, frappé du nombre de pièces que je possédais et que je mettais à sa disposition il renonça à écrire cet article, et je dus, sur ses instances réitérées, consentir à m'en charger. On a vu dans l'avertissement comment je me suis trouvé entraîné au delà des limites qui m'étaient assignées.
Liste complémentaire des ouvrages à consulter sur Étienne de La Boëtie.
Le P. Lelong, édit. de Fontette, écrit ce qui suit sous le nº 33129: Manuscr. Mémoires pour la vie d'Estienne de La Boëtie recueillis par M. Philibert de Lamare, conseiller au parlement de Dijon. Malgré d'actives recherches je n'ai pu parvenir à découvrir ce manuscrit à la Bibliothèque impériale; je l'ai cherché dans le fonds Lamare, qui se compose d'environ 600 volumes, dans les mémoires de ce magistrat, qui se trouvent non dans le fonds qui porte son nom mais dans le fonds Bouhier, et sans plus de résultat. Seulement, dans le catalogue du[p. 68] premier de ces fonds, j'ai trouvé deux morceaux portant le nom de Boëce en latin Boëtius, et je me suis demandé s'il n'y aurait pas eu confusion entre les deux noms; mais cela est peu probable, puisque dans le catalogue il s'agit de la Consolatio philosophiæ, et que dans le P. Lelong il est question de Mémoires.
On sait, du reste, que la Bibliothèque ne possède qu'une partie des manuscrits de Lamare; le reste se trouve encore à Dijon.
Ce qui porte à admettre l'exactitude de la note du P. Lelong, c'est que Lamare a écrit une vie d'Hubert Languet, publiée sans nom d'auteur par J. P. Ludwig. Il a de plus composé plusieurs biographies qu'on n'a pas osé imprimer, dans la crainte de porter ombrage à de puissants personnages. La même raison a pu prescrire la même discrétion relativement aux mémoires sur La Boëtie, mais cela ne porte aucune atteinte à la probabilité de leur existence.
On peut consulter encore sur La Boëtie; 1º Mémoires en forme de lettres pour servir à l'histoire des grands hommes de la Guyenne. Étienne de La Boëtie; Lettre première, lue à l'Académie des sciences de Bordeaux en 1777 par Delphin de Lamothe (manuscrit inédit, Bibliothèque de M. J. Delpit); 2º De Thou, Hist., liv. 5, 35, 47; 3º Tessier, Éloges des savants; 4º Florim. de Ræmond, la Couronne[p. 69] du soldat; 5º G. Naudé, Mascurat; 6º Goujet, Biblioth. française, t. XII; 7º Leclerc, Bibliothèque ancienne et moderne, t. XXVII; 8º Baillet, Jugem. des savants, tom. IV, Enfants célèbres, XLI; 9º Klefeker, Bibliotheca eruditorum precocium, Hamburg, 1717; 10º le Passe Tems de messire François le Poulchre, seig. de la Motte Messemé; 11º Marchet, Delfau, Ann. de la Dordogne; Calendr. administratif, an XI; 12º Concours de 1812 à l'Académie française, Éloges de Montaigne par Villemain, Jay, Droz, Dutens, Biot, etc.; 13º Moréri et les Biographies de Chaudon et Delandine, de Michaud, de Weiss, etc.; 14º Hallam, Hist. de la litt. de l'Europe; 15º Sismonde de Sismondi, Histoire des Français, t. XVII; 16º Henri Aigre, Précis de la littérature en France; 17º Nodier, Manuel de bibliographie, 1835; 18º J. F. Payen, Notice bibliograph. sur Montaigne, 1837; Docum. inédits ou peu connus sur Montaigne, 1847; Bulletin du bibliophile, 1846; 19º Sauveroche, Discours sur les célébrités du Périgord; 20º M. Compans, avocat général à Bordeaux, Discours de rentrée de la cour, Mémor. Bordelais, 6 novembre 1841, reproduit dans les Annales agricoles et littéraires de la Dordogne 1848, et dans la Guyenne historique et monumentale, cinquante-troisième et cinquante-quatrième liv.; 21º Bouffanges, art. dans le journal le Sarladais, 19 mars 1836; 22º M. la Rouverade, président au tribunal civil de Sarlat, journal le Sarladais,[p. 70] 2 juin 1838; 23º Marguerin, Courrier français, 31 décembre 1846; 24º P. Leroux, Revue sociale, 1847; 25º Mongin, Encyclopédie nouvelle, t. II, 1847; 26º M. Lebas, Univers pittoresque, Paris, Didot; France, t. IX; Biographie, t. XI; Philosophie;—Annales historiques, tom. Ier; 27º Violet le Duc, Catalogue raisonné de sa bibliothèque; 28º Lamothe, Compte rendu de la commission des monuments du département de la Gironde, Paris, 1849; 29º Magasin pittoresque, juin 1850, art. biogr., et Maison de Sarlat; 30º H. Baudrillart, J. Bodin et son tems, 1852; 31º Henri Chevreul, Hubert Languet, 1852; 32º le Dictionnaire de la Conversation, art. Boëtie; 33º Naigeon, notes autographes et inédites inscrites sur son exemplaire des Essais.
Dans la notice qui précède, nous avons dit quelques mots du manuscrit d'après lequel nous donnons l'impression nouvelle de la Servitude volontaire. Ce manuscrit a appartenu à Henri de Mesmes, ami de Montaigne et peut-être aussi de La Boëtie[34]. Montaigne lui a dédié la traduction des Règles du Mariage, de Plutarque, ce traité dont Wittenbach disait: «Suavis est materia, suavior est forma.»
[34] Henri était tout à fait contemporain de Montaigne et de La Boëtie, puisque, né en 1532, il se trouvait avoir un an de plus que le premier et deux ans de moins que le second. Son père mourut la même année que celui de Montaigne (1569).
Ce petit in-folio se trouve aux manuscrits de la Bibliothèque impériale, nº 7218. 3, fonds de Mesmes, 564[35]. Il se compose de trente-trois feuillets, sur lesquels la Servitude occupe vingt-six pages, d'une belle et nette écriture, imitant l'italique des impressions du seizième siècle. Sur les feuillets restants, vingt-sept pages contiennent les matériaux d'une réfutation que de Mesmes avait l'intention d'entreprendre. On trouve là un «Extraict du liure de La Boitie pour y respondre,» des citations d'auteurs anciens dont l'autorité devait[p. 74] être invoquée, enfin des memoranda inscrits à la marge des extraicts qu'ils devaient réfuter (on dira... era monstré que.. etc).
[35] Ce fut en 1731 que mesdames la duchesse de Lorges et la marquise d'Ambré cédèrent au roi les manuscrits de leur père, M. le président de Mesmes, composant plus de 600 volumes in-fol. Cette collection avait dû être formée successivement par les ancêtres du président, et au 3e degré des ascendants nous trouvons Henri de Mesmes, celui dont nous nous occupons, conseiller à la Cour des aides, puis au grand Conseil, puis maître des requêtes, podestat de la république de Sienne, chancelier de Navarre, garde du trésor des Chartes, surintendant de la maison de la reine Louise, femme de Henri III, mort en 1596.
La Servitude n'est pas de la main de de Mesmes; mais les annotations qui la suivent sont incontestablement autographes, d'après la comparaison que nous en avons faite avec les pièces que nous possédons de ce personnage.
Le manuscrit de H. de Mesmes offre un grand intérêt.
1º Il fait comprendre comment le public fut amené à imposer un intitulé quelconque à ce discours, puisque le manuscrit (et vraisemblablement aucun des autres) n'en porte pas; comment chacun a varié sur l'époque à laquelle on suppose que la Servitude a été écrite, puisqu'il ne porte pas plus de date que de nom d'auteur.
2º Il offre sur la leçon de tous les imprimés des variantes nombreuses et importantes; mais surtout, en comblant des lacunes considérables, il rend parfaitement intelligibles des passages qui dans les diverses éditions n'ont pas de sens.
3º Enfin l'orthographe du manuscrit est beaucoup moins surannée que celle des imprimés, nous la reproduirons scrupuleusement, et nous avouerons que de prime abord elle nous avait fait hésiter sur l'âge de cette copie. Mais le doute n'est pas permis, puisque les Extraicts, qui sont incontestablement de la main de de Mesmes, portent chacun un numéro qui renvoie au manuscrit, et qui y correspond exactement.
Cette observation sur l'orthographe nous a d'autant plus frappé, que cette manière d'écrire se rapproche beaucoup de celle de Montaigne dans les lettres et manuscrits de cet auteur que nous avons eu occasion d'étudier. Il semble que pour les deux écrivains, elle est moins le résultat d'un système qu'une recherche d'économie de peine et de temps: l'un et l'autre se bornent aux lettres nécessaires pour former le son de chaque syllabe; et ils suppriment la plupart des lettres doubles ou des consonnes surabondantes, sans se soucier de[p. 75] l'étymologie. C'est ainsi que Montaigne écrit le plus souvent, home, somes, miene, come, votre, notre, philosofe, conoysance, etc.[36].
[36] Je me borne à rapprocher comme exemples quelques mots pris au hasard dans les imprimés et dans le manuscrit; aultre, autre; aulcun, aucun; assubiectis, assujetis; avecques, avec; besoing, besoin; chorde, corde; contraincts, contrains; cettuy, celui; desfaict, défait; dangier, danger; doncques, donc; feit, fit; nays, nés; veoy, voi; etc., etc.
Nous avons ajouté quelques notes; et, si quelquefois nous avons rapporté les leçons vicieuses des imprimés, c'était bien moins pour nous donner l'occasion d'un petit triomphe que pour établir incontestablement l'authenticité de notre manuscrit.
Surtout nous n'avons pas voulu priver le lecteur des annotations des savants éditeurs qui nous ont précédé; mais nous nous sommes borné à celles qui ont un rapport direct avec le texte; nous avons même donné quelques exemples des observations critiques de de Mesmes. Notre unique but a été de reproduire l'œuvre de La Boëtie, telle qu'elle a été créée par son auteur. Quelque jugement qu'on porte sur elle nous pouvons espérer par nos soins, qu'au moins elle sera appréciée en connaissance de cause.
Nous donnons en tête de cette publication une Vue du château de La Boëtie et des fac-simile qui se rapportent à ce personnage.
La vue, dessinée d'après nature, est plus étendue que celle que donne la Guyenne monumentale. On y trouve le pigeonnier et le moulin, attributs anciens de la seigneurie. A gauche, on voit le commencement d'une longue avenue plantée d'arbres qui sert de promenade.
En arrière du petit château, et parallèlement à lui, existe un autre édifice: c'est la chapelle, qui se trouve reliée au castelet par un bâtiment transversal; de telle sorte que l'ensemble des constructions représente un P grec, Π.
Cette propriété appartenait encore, dans ces dernières années, à madame Philopal, qu'on nous a assuré, sans en fournir la preuve, être veuve d'un descendant de la famille de La Boëtie.
Quant aux autographes, nous avons relevé les signatures d'Antoine et d'Étienne de La Boetie sur les pièces qui sont mentionnées dans la Notice. Les spécimens de Henri de Mesmes sont pris dans divers endroits du manuscrit; nous y avons ajouté une signature choisie parmi celles que nous possédons de ce personnage.
ce disoit Ulisse en Homere, parlant en public. S'il n'eust rien plus dit, sinon
c'estoit autant bien dit que rien plus: mais, au lieu que, pour le raisonner il falloit dire que la domination de plusieurs ne pouuoit estre bonne, puisque la puissance d'un seul, deslors qu'il prend ce tiltre de maistre, est dure et desraisonnable, il est allé adiouster, tout au rebours,
Il en faudroit, d'auenture, excuser Ulisse, auquel possible lors estoit besoin d'user de ce langage, pour appaiser la reuolte de l'armée; conformant, ie croy, son propos plus au temps, qu'à la verité. Mais à parler à bon escient, c'est un extreme[p. 78] malheur d'estre subiect à un maistre, duquel on ne se peut iamais asseurer qu'il soit bon, puisqu'il est tousiours en sa puissance d'estre mauuais quand il voudra: et d'auoir plusieurs maistres, c'est autant qu'on en a autant de fois estre extremement malheureux. Si ne veux ie pas, pour ceste heure, debattre ceste question tant pourmenée, «Si les autres façons de republique sont meilleures que la monarchie:»[38] ancore voudrois ie sçauoir, auant que mettre en doute quel rang la monarchie doit auoir entre les republicques, si elle en y doit auoir aucun; pource qu'il est malaisé de croire qu'il y ait rien de public en ce gouuernement, où tout est à un. Mais ceste question est reseruee pour un autre temps, et demanderoit bien son traité à part, ou plustost ameneroit quand et soy toutes les disputes politiques.
[38] Voy, sur cette question, Hérodote, III. 80, 84; Polybe, VI, 3. Plutarque, Gouvernements comparés.
L. Feugère.
Pour ce coup, ie ne voudrois sinon entendre, comm' il se peut faire, que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations, endurent quelque fois un tyran seul, qui n'a puissance que celle qu'ils lui donnent; qui n'a pouuoir de leur nuire, sinon tant qu'ils ont vouloir de l'endurer; qui ne sçauroit leur faire mal aucun, sinon lors[p. 79] qu'ils aiment mieulx le souffrir que lui contredire. Grand' chose certes, et touteffois si commune, qu'il s'en faut de tant plus douloir, et moins s'esbahir, voir un milion d'hommes seruir miserablement, aiant le col sous le ioug, non pas contrains par une plus grande force, mais aucunement[39] (ce semble) enchantés et charmés par le nom seul d'un, duquel ils ne doiuent ni craindre la puissance, puis qu'il est seul, ny aimer les qualités, puis qu'il est en leur endroit[40], inhumain et sauuage. La foiblesse d'entre nous hommes est telle: qu'il faut souuent que nous obeissions à la force; il est besoin de temporiser; nous ne pouuons pas tousiours estre les plus forts. Doncques, si une nation est contrainte par la force de la guerre de seruir à un, comme la cité D'Athenes aus trente tirans, il ne se faut pas esbahir qu'elle serue, mais se plaindre de l'accident; ou bien plustost ne s'esbair, ni ne s'en plaindre, mais porter le mal patiemment, et se reseruer à l'aduenir à meilleure fortune.
[39] En quelque sorte.
[40] A leur égard.
Nostre nature est ainsi, que les communs deuoirs de l'amitié emportent une bonne partie du cours de nostre vie: il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les beaus faicts, de reconnoistre le bien doù l'on l'a receu, et diminuer souuent de nostre[p. 80] aise, pour augmenter l'honneur et auantage de celui qu'on aime, et qui le merite: Ainsi doncques, si les habitans d'un païs ont trouué quelque grand personnage qui leur ait monstré par espreuue une grand' preueoiance pour les garder, une grand' hardiesse pour les defendre, un grand soing pour les gouuerner; si, de là en auant, ils s'appriuoisent de lui obeïr, et s'en fier tant, que de lui donner quelques auantages, ie ne sçay si ce seroit sagesse; tant qu'on l'oste de là où il faisoit bien, pour l'auancer en lieu où il pourra mal faire: mais certes sy ne pourroit il faillir d'y auoir de la bonté, de ne craindre point mal de celui duquel on n'a receu que bien.
Mais, ô bon Dieu! que peut estre cela? comment dirons nous que cela s'appelle? quel malheur est celui là? quel vice? ou plustost quel malheureux vice? voir un nombre infini de personnes non pas obéir, mais seruir; non pas estre gouuernés, mais tirannisés; n'aians ni biens, ni parens, femmes ny enfans, ni leur vie mesme, qui soit à eux! souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudroit despendre son sang et sa vie deuant; mais d'un seul! non pas d'un Hercule, ny d'un Samson; mais d'un seul hommeau[41], et le plus souuent le[p. 81] plus lasche[42] et femelin de la nation; non pas accoustumé à la poudre des batailles; mais ancore à grand peine au sable des tournois[43]; non pas qui puisse par force commander aux hommes, mais tout empesché de seruir vilement à la moindre femmelette! Appellerons nous cela lascheté? dirons nous, que ceux qui seruent, soient couards et recreus[44]? Si deux, si trois, si quatre, ne se defendent d'un, cela est estrange, mais touteffois possible; bien pourra l'on dire lors, à bon droict, que c'est faute de cœur: Mais si cent, si mille, endurent d'un seul, ne dira l'on pas qu'ils ne veulent point, non qu'ils n'osent pas, se prendre à luy, et que c'est non couardise, mais plustost mespris ou desdain? Si l'on void, non pas cent, non pas mille hommes, mais cent païs, mille villes, un million d'hommes, n'aissaillir pas un seul, duquel le mieulx traité de tous en recoit ce mal d'estre serf[p. 82] et esclaue; comment pourrons nous nommer cela? Est ce lascheté? Or, il y a en tous vices naturellement quelque borne, outre laquelle ils ne peuuent passer: deux peuuent craindre un, et possible dix; mais mille, mais un million, mais mille villes, si elles ne se deffendent d'un, cela n'est pas couardise, elle ne va point iusques là; non plus que la vaillance ne s'estend pas qu'un seul eschelle une forteresse, qu'il assaille une armée, qu'il conqueste un roiaume: Doncques quel monstre de vice est cecy, qui ne merite pas ancore le tiltre de couardise? qui ne trouue point de nom assés vilain? que la nature desaduoue auoir fait, et la langue refuse de nommer? Qu'on mette d'un costé cinquante mil hommes en armes; d'un autre, autant; qu'on les range en bataille; qu'ils viennent à se ioindre, les uns libres combattans pour leur franchise, les autres pour la leur oster: ausquels promettra l'on par coniecture la victoire? lesquels pensera l'on qui plus gaillardement iront au combat, ou ceux qui esperent pour guerdon[45] de leurs peines l'entretenement de leur liberté, ou ceux qui ne peuuent attendre autre loyer des coups qu'ils donnent, ou qu'ils recoiuent, que la seruitude d'autrui? Les uns ont tousiours deuant les yeulx le bon heur de la vie passée, l'attente de pareil aise à l'aduenir; il ne[p. 83] leur souuient pas tant de ce peu qu'ils endurent le temps que dure une bataille, comme de ce qu'il leur conuiendra à iamais endurer à eux, à leurs enfans et à toute la postérité: Les autres n'ont rien qui les enhardie, qu'une petite pointe de conuoitise qui se rebousche soudain contre le danger, et qui ne peut estre si ardante que elle ne se doiue, ce semble, esteindre de la moindre goutte de sang qui sorte de leurs plaies. Aus batailles tant renommées de Miltiade, de Leonide, de Themistocle, qui ont esté données deux mil ans y a, et qui sont ancores auiourd'hui aussi fresches en la mémoire des liures et des hommes, comme si c'eust esté l'aultr'hier, qui furent données en Grece, pour le bien des Grecs et pour l'exemple de tout le monde; qu'est ce qu'on pense qui donna à si petit nombre de gens, comme estoient les Grecs, non le pouuoir, mais le cœur de soustenir la force de tant de nauires, que la mer mesme en estoit chargée; de défaire tant de nations, qui estoient en si grand nombre que l'escadron des Grecs n'eust pas fourni, s'il eust fallu, des cappitaines aus armées des ennemis? sinon qu'il semble qu'à ces glorieux iours là ce n'estoit pas tant la bataille des Grecs contre les Perses, comme la victoire de la liberté sur la domination, de la franchise sur la conuoitise.
[41] Hommeau, petit homme, N. Duez, C. Oudin, Cotgrave, dans leurs Dictionnaires italien, espagnol et anglais. On trouve hommet et hommelet dans Nicot, et homunculus dans Cicéron. (Tuscul., liv. 1, ch. 9.)
[42] Montaigne s'est souvenu de la pensée et de l'expression dans le chap. sur l'éducation.
[43] Les imprimés portent femenin, féminin, efféminé, le manuscrit dit femelin évidemment dérivé de femelle, mais moins usité que féminin, on trouve ce mot avec cette signification dans le dict. italien de Duez et dans le dict. espagnol de C. Oudin. Ménage et Borel ne le donnent pas.
[44] Lâches, poltrons.
[45] Guerdon, loyer, salaire, récompense. (Κἐρδος)
C'est chose estrange d'ouïr parler de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la[p. 84] deffendent: mais ce qui se fait en tous païs, par tous les hommes, tous les iours, qu'un homme mastine[46] cent mille, et les priue de leur liberté; qui le croiroit, s'il ne faisoit que l'ouïr dire, et non le voir? et, s'il ne se faisoit qu'en païs estranges et lointaines terres, et qu'on le dit; qui ne penseroit que cela fut plustost feint et trouué[47], que non pas véritable? Encores ce seul tiran, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le defaire[48], il est de soymesme defait, mais[49] que le païs ne consente à sa seruitude: il ne faut pas luy oster rien, mais ne lui donner rien; il n'est pas besoin que le païs se mette en peine de faire rien pour soy, pourueu qu'il ne face rien contre soy. Ce sont donc les peuples mesmes qui se laissent, ou plustost se font, gourmander, puis qu'en cessant de seruir ils en seroient quittes; c'est le peuple qui s'asseruit; qui se coupe la gorge; qui, aiant le chois ou d'estre serf, ou d'estre libre, quitte sa franchise, et prend le ioug; qui consent à son mal, ou plustost le pourchasse.[p. 85] S'il lui coustoit quelque chose à recouurer sa liberté, ie ne l'en presserois point, combien qu'estce que l'homme doit auoir plus cher que de se remettre en son droit naturel, et, par maniere de dire, de beste reuenir homme; mais ancore ie ne desire pas en lui si grande hardiesse: ie lui permets qu'il aime mieulx une ie ne sçay quelle seureté de viure miserablement, qu'une douteuse espérance de viure à son aise. Quoi? si, pour auoir liberté, il ne faut que la desirer; s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouuera il nation au monde qui l'estime ancore trop chere, la pouuant gaigner d'un seul souhait? et qui pleigne sa volonté à recouurer le bien lequel il deuroit racheter au prix de son sang? et lequel perdu, tous les gens d'honneur doiuent estimer la vie desplaisante et la mort salutaire? Certes, comme le feu d'une petite estincelle deuient grand, et tousiours se renforce; et plus il trouue de bois, plus il est prest d'en brusler; et, sans qu'on y mette de l'eaue pour l'esteindre, seulement en n'y mettant plus de bois, n'aiant plus que consommer, il se consomme soymesme, et vient sans force aucune[50] et non plus feu: pareillement les tirans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et destruisent, plus on leur baille, plus on les sert; de tant plus ils se fortiffient, et deuiennent[p. 86] tousiours plus forts et plus frais pour aneantir et destruire tout; et, si on ne leur baille rien, si on ne leur obeït point, sans combattre, sans fraper, ils demeurent nuds et deffaits, et ne sont plus rien, sinon que comme la racine, n'aians plus d'humeur ou aliment, la branche deuient sèche et morte[51].
[46] Asservisse, opprime, Montaigne employe ce mot au chap. 3 du livre 2, au sujet du vieillard Rasias.
[47] Les imprimés portent controuvé.
[48] Les imprimés disent certainement à tort de s'en défendre.
[49] Pourvu que. «Un homme sage, dit Philippe de Comines, sert bien en une compaignie de princes, mais qu'on le veuille croire, et ne se pourroit trop acheter.» L. I, c. 12.
[50] Les imprimés disent: sans forme.
[51] Les imprimés: la racine n'ayant plus d'humeur et aliment devient une branche sèche et morte.
Les hardis, pour acquerir le bien qu'ils demandent, ne craignent point le dangier; les aduisés ne refusent point la peine: les lasches et engourdis ne sçauent ni endurer le mal, ni recouurer le bien; ils s'arrestent en cela de les souhaitter; et la vertu d'y pretendre leur est ostee par leur lascheté; le desir de l'auoir leur demeure par la nature. Ce desir, ceste volonté, est commune aux sages et aus indiscrets, aus courageus et aus couars, pour souhaitter toutes choses qui, estant acquises, les rendroient heureus et contens: une seule chose en est à dire, en laquelle ie ne sçay comment nature defaut[52] aus hommes pour la desirer; c'est la liberté, qui est touteffois un bien si grand et si plaisant, qu'elle perdue, tous les maus viennent à la file, et les biens mesme qui demeurent apres elle perdent entierement leur goust et sçaueur, corrompus par la seruitude: la seule liberté, les hommes ne la desirent point, non pour autre raison, ce semble,[p. 87] sinon que s'ils la desiroient, ils l'auroient; comme s'ils refusoient de faire ce bel acquest, seulement par ce qu'il est trop aisé.
[52] Fait défaut, manque.
Pauures et misérables, peuples insensés, nations opiniastres en vostre mal, et aueugles en vostre bien, vous vous laissés emporter deuant vous le plus beau et le plus clair de vostre reuenu, piller vos champs, voller vos maisons, et les despouiller des meubles anciens et paternels! vous viués de sorte, que vous ne vous pouués vanter que rien soit à vous; et sembleroit que meshui ce vous seroit grand heur de tenir a ferme[53] vos biens, vos familles et vos vies[54]: et tout ce degast, ce malheur, ceste ruine, vous vient, non pas des ennemis, mais certes oui bien, de l'ennemy, et de celui que vous faites si grand qu'il est, pour lequel vous allés si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusés point de présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maistrise tant, n'a que deux yeulx, n'a que deus mains, n'a qu'un corps, et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de vos villes; sinon que l'auantage que vous luy faites pour vous destruire. D'où a il pris tant d'yeulx; dont il vous espie; si vous ne les luy baillés? comment a il tant de mains[p. 88] pour vous fraper, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a il, s'ils ne sont des vostres? Comment a il aucun pouuoir sur vous, que par vous? Comment vous oseroit il courir sus, s'il n'auoit intelligence auec vous? Que vous pourroit il faire, si vous n'estiés receleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue, et traistres à vous mesmes? Vous semés vos fruicts, afin qu'il en face le degast; vous meublés et remplissés vos maisons, afin de fournir à ses pilleries; vous nourrissés vos filles, afin qu'il ait de quoy saouler sa luxure; vous nourrissez vos enfans, afin que, pour le mieulx qu'il leur sçauroit faire, il les mene en ses guerres, qu'il les conduise a la boucherie, qu'il les face les ministres de ses conuoitises, et les executeurs de ses vengeances; vous rompés à la peine vos personnes, afin qu'il se puisse mignarder en ses délices, et se veautrer dans les sales et vilains plaisirs; vous vous affoiblissés, afin de le rendre plus fort et roide à vous tenir plus courte la bride: et de tant d'indignités, que les bestes mesmes ou ne les sentiroient point, ou ne l'endureroient point, vous pouués vous en deliurer, si vous l'essaiés, non pas de vous en deliurer, mais seulement de le vouloir faire. Soiés resolus de ne seruir plus; et vous voilà libres. Ie ne veux pas que vous le poussiés, ou l'ebransliés; mais seulement ne le soustenés plus: et vous le verrés,[p. 89] comme un grand colosse à qui on a desrobé la base, de son pois mesme fondre en bas, et se rompre.
[53] De tenir à moitié (imprimés).
[54] Le manuscrit porte vies, mais en marge il est écrit de la même main, Villes.
Mais certes les medecins conseillent bien de ne mettre pas la main aux plaies incurables; et ie ne fais pas sagement de vouloir prescher en cecy le peuple qui a perdu, long temps a, toute congnoissance, et duquel, puis qu'il ne sent plus son mal, cela monstre assés que sa maladie est mortelle. Cherchons donc par coniecture, si nous en pouuons trouuer, comment s'est ainsi si auant enracinée ceste opiniastre volonté de seruir, qu'il semble maintenant que l'amour mesme de la liberté ne soit pas si naturelle[55].
[55] Ce seroit tomber de fièvre en chaud mal et non pas guérir. H. de Mesmes.
Premierement, cela est, comme ie croy, hors de doute, que, si nous viuions auec les droits que la nature nous a donné et auec les enseignemens qu'elle nous apprend, nous serions naturellement obeïssans aus parens, subiets à la raison, et serfs de personne. De l'obéïssance que chacun, sans autre aduertissement que de son naturel, porte à ses père et mère; tous les hommes s'en sont tesmoins, chacun pour soy. De la raison; si elle nait auec nous, ou non, qui est une question debattue a fons par les académiques et touchée par toute l'escole des philosophes[56]; pour[p. 90] ceste heure ie ne penserai point faillir en disant cela qu'il y a en nostre ame quelque naturelle semence de raison, laquelle, entretenue par bon conseil et coustume, florit en vertu, et au contraire, souuent ne pouuant durer contre les vices suruenus, estouffee s'auorte. Mais certes s'il y a rien de clair ni d'apparent en la nature, et ou il ne soit pas permis de faire l'aueugle, c'est cela, que la nature, la ministre de Dieu, la gouuernante des hommes, nous a tous faits de mesme forme, et, comme il semble, à mesme moule[57], afin de nous entreconnoistre tous pour compaignons, ou plustost pour frères; et si, faisant les partages des présens qu'elle nous faisoit[58], elle a fait quelque auantage de son bien, soit au corps ou en l'esprit, aus uns plus qu'aus autres, si n'a elle pourtant entendu nous mettre en ce monde comme dans un camp clos, et n'a pas enuoié icy bas les plus forts ny les plus auiséz, comme des brigans armés dans une forest, pour y gourmander les plus foibles; mais plustost faut il croire que, faisant ainsi les parts aus uns plus grandes, aus autres plus petites, elle vouloit faire place à la fraternelle affection, afin[p. 91] qu'elle eut où s'emploier, aians les uns puissance de donner aide, les autres besoin d'en receuoir: Puis doncques que ceste bonne mere nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés aucunement[59] en mesme maison, nous a tous figurés a mesme patron[60], afin que chacun se peust mirer[61] et quasi reconnoistre l'un dans l'autre; si elle nous a donné à tous ce grand present de la voix et de la parolle, pour nous accointer et fraterniser dauantage, et faire, par la commune et mutuelle declaration de nos pensées, une communion de nos volontés; et si elle a tasché par tous moiens de serrer et estreindre si fort le nœud de nostre alliance et société; si elle a monstré, en toutes choses, qu'elle ne vouloit pas tant nous faire tous unis, que tous uns: il ne faut pas faire doute que nous ne soions tous naturellement libres, puis que nous sommes tous compaignons; et ne peut tomber en l'entendement de personne que nature ait mis aucun en seruitude, nous aiant tous mis en compaignie.
[56] Platon, le Menon; Euripide, Hippol., v., 79. L. F.
[57] Montaigne s'est souvenu de cette pensée et de l'expression, il l'emploie dans un passage très-remarquable du chap. 12 du livre II des Essais.
[58] Les éditeurs ici ont corrigé la répétition et ils ont mis donnoit.
[59] En quelque sorte.
[60] Les imprimés disent: paste.
[61] Montaigne s'était dressé à mirer sa vie dans celle d'autruy, III, 12.
Mais, à la verité, c'est bien pour neant de debatre si la liberté est naturelle[62], puis qu'on ne[p. 92] peut tenir aucun en seruitude sans lui faire tort, et qu'il n'i a rien si contraire au monde à la nature, estant toute raisonnable, que l'iniure. Reste doncques la liberté estre naturelle, et, par mesme moien à mon aduis, que nous ne sommes pas nez seulement en possession de nostre franchise, mais aussi auec affection de la deffendre. Or, si d'auenture nous faisons quelque doute en cela, et sommes tant abastardis que ne puissions reconnoistre nos biens ni semblablement nos naïfues affections, il faudra que ie vous face l'honneur qui vous appartient, et que ie monte, par maniere de dire, les bestes brutes en chaire, pour vous enseigner vostre nature et condition. Les bestes, ce maid' Dieu! si les hommes ne font trop les sourds, leur crient, viue liberté. Plusieurs en y a d'entre elles, qui meurent aussy tost qu'elles sont prises: comme le poisson quitte la vie aussy tost que l'eaue, pareillement celles là quittent la lumiere, et ne veulent point suruiure à leur naturelle franchise. Si les animaus auoient entre eulx quelques preeminences, ils feroient de celles là leur noblesse[63]. Les autres, des plus grandes, iusques aux plus petites, lors[p. 93] qu'on les prend, font si grand' resistence d'ongles, de cornes, de bec et de pieds, qu'elles declarent asses combien elles tiennent cher ce qu'elles perdent; puis, estans prises, elles nous donnent tant de signes apparens de la congnoissance qu'elles ont de leur malheur, qu'il est bel à voir, que dores en là[64] ce leur est plus languir que viure, et qu'elles continuent leur vie, plus pour plaindre leur aise perdu, que pour se plaire en seruitude. Que veut dire autre chose, l'elephant qui, s'estant defendu iusques à n'en pouuoir plus, n'i voiant plus d'ordre, estant sur le point d'estre pris, il enfonce ses machoires, et casse ses dents contre les arbres; sinon que le grand desir qu'il a de demourer libre, ainsi qu'il est, luy fait de l'esprit, et l'aduise de marchander avec les chasseurs si, pour le pris de ses dens, il en sera quitte, et s'il sera receu à bailler son iuoire, et paier ceste rançon, pour sa liberté. Nous apastons[65] le cheual deslors qu'il est né, pour l'appriuoiser à seruir; et si ne le sçauons nous si bien flatter, que quand ce vient à le domter, il ne morde le frein, qu'il ne rue contre l'esperon, comme (ce semble) pour monstrer à la nature, et tesmoigner au moins par là, que s'il[p. 94] sert, ce n'est pas de son gré, ains par nostre contrainte. Que faut il donc dire?
[62] «La principauté est de nature et de justice de Dieu.» H. de M.
[63] La pensée de La Boëtie est que ce fait de perdre sa vie dès qu'on perd la liberté constitue une sorte de noblesse naturelle. Les imprimés changent complétement l'idée en disant: ils feroient de liberté leur noblesse.
[64] Dorénavant.
[65] Montaigne (livre III, ch. 9) exprime le désir de trouver un gendre «qui sçeut appaster commodément ses vieux ans.»
[66] Un grand nombre d'éditeurs ont mis: sous les pieds du ioug.
comme i'ai dit autreffois, passant le temps à nos rimes françoises: Car ie ne craindray point, escriuant à toi, ô Longa[67], mesler de mes vers, desquels ie ne te lis[68] jamais, que, pour le semblant que tu fais de t'en contenter, tu ne m'en faces tout glorieus. Ainsi donc, puisque toutes choses qui ont sentiment, deslors qu'elles l'ont, sentent le mal de la suietion, et courent apres la liberté; puis que les bestes, qui ancore sont faites pour le seruice de l'homme, ne se peuuent accoustumer à seruir qu'auec protestation d'un desir contraire: quel mal encontre a esté cela, qui a peu tant denaturer l'homme, seul né, de vrai, pour viure franchement, et lui faire perdre la souuenance de son premier estre et le desir de le reprendre?
[67] Voyez sur ce personnage (Bertrand de Larmandie, baron de Longa) la notice bio-bibliographique sur La Boëtie.
[68] Les éditeurs mettent: je ne lis jamais.
Il y a trois sortes de tirans[69]: Les uns ont le roiaume, par élection du peuple; les autres, par la force des armes; les autres, par succession de[p. 95] leur race. Ceus qui les ont acquis par le droit de la guerre, ils s'y portent ainsi, qu'on connoit bien qu'ils sont, (comme l'on dit,) en terre de conqueste. Ceus là qui naissent rois, ne sont pas communement gueres meilleurs; ains estans nés et nourris dans le sein[70] de la tirannie, tirent auec le lait la nature du tiran, et font estat des peuples qui sont soubs eus, comme de leurs serfs hereditaires; et, selon la complexion à laquelle ils sont plus enclins, auares, ou prodigues, tels qu'ils sont, ils font du royaume comme de leur heritage. Celui à qui le peuple a donné l'estat, deuroit estre (ce me semble) plus supportable; et le seroit, comme ie croy, n'estoit que deslors qu'il se voit esleué par dessus les autres, flatté par ie ne sçay quoy qu'on appelle la grandeur, il delibere de n'en bouger point: communement, celui là fait estat de rendre à ses enfans la puissance que le peuple lui a baillé: et, deslors que ceus là ont pris ceste opinion, c'est chose estrange de combien ils passent, en toutes sortes de vices, et mesmes en la cruauté, les autres tirans; ne voians autre moien, pour asseurer la nouuelle tirannie, que d'estreindre[71] si fort la seruitude, et estranger tant leurs subiects de la liberté, qu'ancore que la memoire en soit fresche, ils la leur puissent faire perdre. Ainsi, pour en[p. 96] dire la verité, ie voi bien qu'il y a entr'eus quelque différence; mais de chois, ie ni en vois[72] point; et, estant les moiens de venir aus regnes, diuers, tousiours la façon de regner est quasi semblable: Les esleus, comme s'ils auoient pris des toreaus à domter, ainsi les traictent ils: Les conquerans en font, comme de leur proie: Les successeurs, pensent d'en faire ainsi que de leurs naturels esclaues[73].
[69] Les imprimés ajoutent ici ce qui n'est pas dans notre manuscrit: «ie parle des méchants princes.»
[70] Les imprimés portent sang.
[71] Les imprimés portent estendre.
[72] «Silz sont esleus prenons nous en à eulx; s'ilz sont de naissance, c'est la nature, silz nous ont conquis seruons aux plus forts, c'est le droit des gens. Ainsi noz ancêstres respondirent aux Romains.» H. de M. (Le sens de l'observation semblerait exiger pour le premier membre de phrase «prenons nous en a nous.)»
[73] C'est par nécessité et pour maintenir les peuples. H. de M.
Mais à propos, si d'auanture il naissoit auiourd'huy quelques gens, tous neufs, ni accoustumés à la subiection, ni affriandés à la liberté, et qu'ils ne sçeussent que c'est ni de l'un, ni de l'autre, ni à grand' peine des noms; si on leur presentoit, ou d'estre serfs, ou viure francs, selon les loix desquelles ils ne s'accorderoient, il ne faut pas faire doute qu'ils n'aimassent trop mieulx obeïr à la raison seulement, que seruir à un homme; sinon possible que ce fussent ceux d'Israël, qui, sans contrainte, ni aucun besoin, se firent un tiran: duquel peuple ie ne lis iamais l'histoire, que ie n'en aye trop grand despit, et, quasi iusques à en deuenir[p. 97] inhumain pour me resiouïr de tant de maus qui lui en aduindrent. Mais certes tous les hommes, tant qu'ils ont quelque chose d'homme, deuant qu'ils se laissent assuietir, il faut l'un des deus, qu'ils soient contrains, ou déceus: Contrains, par les armes estrangeres, comme Sparthe ou Athenes par les forces d'Alexandre, ou par les factions, ainsi que la seigneurie d'Athenes estoit deuant venue entre les mains de Pisistrat: Par tromperie perdent ils souuent la liberté; et, en ce, ils ne sont pas si souuent seduits par autrui comme ils sont trompés par eus mesmes: ainsi le peuple de Siracuse, la maistresse ville de Sicile (on me dit qu'elle s'appelle auiourd'hui Sarragousse[74]), estant pressé par les guerres inconsiderement ne mettant ordre qu'au danger présent, esleua Denis, le premier tiran, et lui donna la charge de la conduite de l'armée; et ne se donna garde qu'il[75] l'eut fait si grand, que ceste bonne piece là, reuenant victorieus, comme s'il n'eust pas vaincu ses ennemis, mais ses citoiens, se feit de cappitaine, roy, et de roy, tiran. Il n'est pas croiable, comme le peuple, deslors qu'il est assuietti, tombe si soudain en un tel et si profond[p. 98] oubly de la franchise, qu'il n'est pas possible qu'il se resueille pour la rauoir, seruant si franchement et tant volontiers, qu'on diroit, à le voir, qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gaigné sa seruitude[76]. Il est vray qu'au commencement on sert contraint, et vaincu par la force: mais ceus qui viennent apres[77], seruent sans regret, et font volontiers ce que leurs deuanciers auoient fait par contrainte.[78] C'est cela, que les hommes naissans soubs le ioug; et puis, nourris et esleués dans le seruage, sans regarder plus auant, se contentent de viure comme ils sont nés, et ne pensans point auoir autre bien ni autre droict que ce qu'ils ont trouué, ils prennent pour leur naturel l'estat de leur naissance[79]. Et touteffois il n'est point d'heritier si[p. 99] prodigue et nonchalant, que quelque fois ne passe les yeulx sur les registres de son père, pour voir s'il iouïst de tous les droicts de sa succession, ou si l'on a rien entrepris sur lui, ou son prédécesseur. Mais certes la coustume, qui a en toutes choses grand pouuoir sur nous, n'a en aucun endroit si grand vertu qu'en cecy, de nous enseigner à seruir et, comme l'on dit de Mitridat qui se fit ordinaire à boire[80] le poison, pour nous apprendre à aualer et ne trouuer point amer le venin de la seruitude. L'on ne peut pas nier que la nature n'ait en nous bonne part pour nous tirer là où elle veut, et nous faire dire bien ou mal nez: mais si faut il confesser qu'elle a en nous moins de pouuoir que la coustume; pource que le naturel, pour bon qu'il soit, se perd s'il n'est entretenu; et la nourriture nous fait tousiours de sa façon, comment que ce soit, maugré la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues et glissantes, qu'elles ne peuuent endurer le moindre heurt de la nourriture[p. 100] contraire; elles ne s'entretiennent pas si aisement, comme elles s'abatardissent, se fondent, et viennent à rien: ne plus ne moins que les arbres fruictiers, qui ont bien tous quelque naturel à part, lequel ils gardent bien si on les laisse venir; mais ils le laissent aussi tost, pour porter d'autres fruicts estrangiers et non les leurs, selon qu'on les ente: Les herbes ont chacune leur propriété, leur naturel et singularité; mais toutesfois le gel, le temps, le terroir ou la main du iardinier, y adioustent, ou diminuent beaucoup de leur vertu: la plante qu'on a veu en un endroit, on est ailleurs empesché de la reconnoistre. Qui verroit les Venitiens, une poignée de gens, viuans si librement que le plus meschant d'entr'eulx ne voudroit pas estre le roy de tous; ainsi nés et nourris, qu'ils ne reconnoissent point d'autre ambition sinon à qui mieulx aduisera et plus soigneusement prendra garde à entretenir la liberté; ainsi appris et faits dès le berceau, qu'ils ne prendroient point tout le reste des félicités de la terre, pour perdre le moindre point de leur franchise[81]: Qui aura veu, dis-ie, ces personnages là, et au partir de là s'en ira aus terres de celui que nous appellons Grand Seigneur; voiant là les gens qui ne[p. 101] veulent estre nez que pour le seruir, et qui pour maintenir sa puissance abandonnent leur vie, penseroit il que ceus là et les autres, eussent un mesme naturel, ou plustost s'il n'estimeroit pas que, sortant d'une cité d'hommes, il estoit entré dans un parc de bestes? Licurge, le policeur de Sparte, auoit nourri, ce dit on, deux chiens tous deus freres, tous deus allaités de mesme laict[82], l'un engraissé en la cuisine, l'autre accoustumé par les champs au son de la trompe et du huchet[83]; voulant monstrer au peuple lacedemonien que les hommes sont tels que la nourriture les fait, mit les deus chiens en plain marché, et entr'eus une soupe et un lieure; l'un courut au plat, et l'autre au lieure: «Toutesfois, dit il, si sont ils freres.» Doncques celui là, auec ses loix et sa police, nourrit et feit si bien les Lacedemoniens, que chacun d'eux eut plus cher de mourir de mille morts[84], que de reconnoistre autre seigneur que la loy et la raison[85].
[74] Les Siciliens l'appellent aujourd'hui Saragusa ou Saragosa: la manière dont La Boëtie écrit le nom de Syracuse confond cette ville avec celle de Saragosse en Espagne.
[75] Il se rapporte au peuple de Saragusa, les imprimés portent elle.
[76] Cette phrase est très-claire et très-correcte; les imprimés la remplacent par celle-ci: qu'il a non pas perdu sa liberté mais sa servitude.
[77] Les imprimés ajoutent ici «n'ayans iamais veu la liberté et ne sachants que c'est».
[78] Il en était de même «ez republiques.» H. de M.
[79] Montaigne a fait un chapitre sur la Coustume (22e du livre Ier). Il est naturel de croire que ce passage de La Boëtie lui en a fourni la première idée. On y trouve dans une foule d'endroits des réminiscences frappantes de la Servitude volontaire: Je me borne à en citer deux exemples.
«De vray parce que nous la humons avec le laict de notre naissance (la servitude), et que le visage du monde se présente en cet état à notre premiere veuë, il semble que nous soyons nais à la condition de suivre ce train.»
«Les peuples nourris à la liberté et à se commander eux-mesmes estiment toute autre forme de police monstrueuse et contre nature, ceux qui sont duits à la monarchie en font de mesme et quelque facilité que leur prète fortune au changement, lors mesme qu'ils se sont avec grandes difficultez deffaits de l'importunité d'un maître, ils courent à en replanter un nouueau auec pareilles difficultez pour ne se pouuoir résoudre de prendre en haine la maitrise.»
[80] Appien, Guerres de Mithridate; Pline, Hist. nat., XXIV., 2.—L. F.
[81] C'est peut-être ce passage qui a donné lieu à Montaigne de dire que son ami aurait mieux aimé être né à Venise qu'à Sarlat.
[82] Ceci est pris d'un traité de Plutarque, intitulé Comment il faut nourrir les enfants, de la traduction d'Amyot.
[83] Du cor. «Huchet, dit Nicot, c'est un cornet dont on huche ou appelle les chiens, et dont les postillons usent ordinairement.»
[84] Tout ce paragraphe est si favorable au système d'Helvétius sur la grande influence de l'éducation qu'il est étonnant que cet auteur ne s'en soit pas appuyé. (Note manuscrite ajoutée par Naigeon à son exemplaire des Essais postérieurement à l'édition qu'il en a donnée, et imprimée par Am. Duval.
[85] Les imprimés portent: la loy et le Roy.
Ie prens plaisir de ramenteuoir un propos que[p. 102] tindrent iadis un des fauoris de Xerxes, le grand roy des Persans, et deux Lacedemoniens. Quand Xerxe faisoit les appareils de sa grande armée pour conquerir la Grece, il enuoia ses ambassadeurs par les cités gregeoises, demander de l'eau et de la terre: c'estoit la façon que les Persans auoient de sommer les villes de se rendre à eus. A Athenes ni à Sparte n'enuoia il point[86], pource que ceus que Daire[87] son pere y auoit enuoié[88], les Athéniens et les Spartains en auoient ietté les uns dedans les fossés, les autres dans les puits, leur disants qu'ils prinsent hardiment de là de l'eaue et de la terre, pour porter à leur prince: ces gens ne pouuoient soufrir que, de la moindre parole seulement, on touchast à leur liberté. Pour en auoir ainsi usé, les Spartains congneurent qu'ils auoient encouru la haine des dieus, mesme de Talthybie, le dieu des herauds[89]: ils s'aduiserent d'enuoier à Xerxe, pour les appaiser, deus de leurs citoiens, pour se presenter à lui, qu'il feit d'eulx à sa guise, et se paiat de là pour les ambassadeurs qu'ils auoient tué à son pere. Deux Spartains, l'un nommé Sperte[90][p. 103] et l'autre Bulis[91] s'offrirent de leur gré pour aller faire ce paiement. De fait ils y allerent; et en chemin ils arriuerent au palais d'un Persan qu'on nommoit Indarne[92], qui estoit lieutenant du roy en toutes les villes d'Asie qui sont sur les costes de la mer. Il les recueillit fort honnorablement et leur fit grand chère et, apres plusieurs propos tombans de l'un en l'autre, il leur demanda pourquoy ils refusoient tant l'amitié du roy[93]: «Voiés, dit-il, Spartains, et connoissés par moy comment le roy sçait honorer ceulx qui le valent, et pensés que si vous estiez à lui, il vous feroit de mesme: si vous estiés à lui, et qu'il vous eust connu, il n'i a celui d'entre vous qui ne fut seigneur d'une ville de Grece.» «En cecy, Indarne, tu ne nous sçaurois donner bon conseil, dirent les Lacedemoniens, pource que le bien que tu nous promets, tu l'as essaié, mais celui dont nous iouissons, tu ne sçais que c'est: tu as esprouué la faueur du[p. 104] roy; mais de la liberté, quel goust elle a, combien elle est douce, tu n'en sçais rien. Or, si tu en auois tasté, toymesme nous conseillerois de la defendre, non pas auec la lance et l'escu, mais auec les dens et les ongles.» Le seul Spartain disoit ce qu'il falloit dire: mais certes et l'un et l'autre parloit comme il auoit esté nourry; car il ne se pouuoit faire que le Persan eut regret à la liberté, ne l'aiant iamais eue, ni que le Lacedemonien endurast la suietion, aiant gousté de la franchise.
[86] Il n'envoya point à.... parce que, etc.
[87] Ou, comme nous disons aujourd'hui, Darius, roi des Perses, fils d'Hystaspe, le premier de ce nom. Voy. Hérodote, l. 7.
[88] Les imprimés ajoutent là: pour faire pareille demande.
[89] Voy. Iliad., I, 320.—Pausanias, 7, c. 23.
[90] Tous les imprimés écrivent Specte, et les éditeurs ajoutent la note de Coste ainsi conçue: ou plutôt Sperthies, Σπερθιης, comme le nomme Hérodote, l. 7, p. 421 (édit. de Gronovius). On voit que notre manuscrit décide la question, et que l'erreur des éditeurs a seule rendu la glose nécessaire.
[91] Βουλις, id., ib.
[92] Ici encore notre manuscrit donne la bonne leçon Indarne, au lieu de Gidarne que portent tous les imprimés. Hydarnès, Υδαρνες, id., ib., gouverneur de la côte maritime d'Asie. Hérodote, 6., 135.
[93] Voy. Hérodote, l. 7, p. 422.
Caton l'utiquain, estant ancore enfant, et sous la verge, alloit et venoit souuent chés Sylla le dictateur, tant pource qu'à raison du lieu et maison dont il estoit, on ne lui refusoit iamais la porte, qu'aussi, ils estoient proches parens. Il auoit tousiours son maistre quand il y alloit, comme ont accoustumé les enfans de bonne maison. Il s'apperceut que dans l'hostel de Sylla, en sa presence ou par son commandement, on emprisonnoit les uns, on condamnoit les autres; l'un estoit banni, l'autre estranglé; l'un demandoit la confiscation[94] d'un citoien, l'autre la teste: en somme, tout y alloit, non comme chés un officier de ville, mais comme chés un tiran de peuple; et c'estoit, non pas un parquet de iustice, mais un ouuroir de[p. 105] tirannie. Si dit lors à son maistre[95] ce ieune gars: «Que ne me donnés vous un poignard? Ie le cacherai sous ma robe: ie entre souuent dans la chambre de Sylla auant qu'il soit leué: i'ay le bras assés fort pour en despescher[96] la ville.» Voilà certes une parolle vraiement appartenante à Caton: c'estoit un commencement de ce personnage, digne de sa mort[97]. Et, neantmoins qu'on ne die ni son nom ni son pais, qu'on conte seulement le fait tel qu'il est, la chose mesme parlera, et iugera l'on, à belle auenture, qu'il estoit Romain, et né dedans Romme[98], et lors qu'elle estoit libre. A quel propos tout ceci? non pas certes que i'estime que le pais ni le terroir y facent rien; car en toutes contrées, en tout air, est amère la suietion, et plaisant d'estre libre: mais par ce que ie suis d'aduis qu'on ait pitié de ceux qui, en naissant, se sont trouués le[p. 106] ioug au col, ou bien que on les excuse, ou bien qu'on leur pardonne, si naians veu seulement l'ombre de la liberté, et n'en estans point auertis, ils ne s'apperçoiuent point du mal que ce leur est d'estre esclaues. S'il y auoit quelque pais, comme dit Homere des Cimmeriens[99] où le soleil se monstre autrement qu'à nous, et apres leur auoir esclairé six mois continuels, il les laisse sommeillans dans l'obscurité, sans les venir reuoir de l'autre demie année, ceux qui naistroient pendant ceste longue nuit, s'il n'auoient pas oui parler de la clarté, s'esbairoit on si n'aians point veu de iours, ils s'accoustumoient aus tenebres où ils sont nez, sans desirer la lumiere? On ne plaint iamais ce que l'on n'a iamais eu[100], et le regret ne vient point sinon qu'apres le plaisir; et tousiours est, auec la congnoissance du mal, la souuenance de la ioie passee. La nature de l'homme est bien d'estre franc, et de le vouloir estre; mais aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli que la nourriture lui donne.
[94] Les imprimés portent: le confisq.
[95] Plutarque, dans la Vie de Caton d'Utique.
[96] En délivrer la ville.
[97] «Se mocquer de Caton d'Utique, et d'eulx; et come leurs dieus ou pour mieulx dire le nôtre aprouua là l'estat Royal».—H. de Mesmes.
[98] «Qu'apellons-nous Rome? une Republique? nous nous trompons. C'estoit une cage d'oiseaus de rapine, voleurs qui escumoient le monde; c'estoit une oligarchie, une tirannie d'une cité sur toute la terre habitable; ie trouue le monde moins foulé d'Alexandre que d'eux. Ils chasserent les tyrans de dessus eulx pour le deuenir du reste de la terre, ils n'estoient pas Roys, mais ils bailloient les Roys à l'Asie, à l'Afrique, à l'Europe.»—H. de Mesmes.
[99] Montaigne dans ses Essais parle des Ténèbres cimmériennes. Voy. sur les Cimmériens, Κειμἐριος, l'Odyssée, liv. XI, c. 14 et suiv., et Métamorph. d'Ovide, XI, § 14. Ces peuples habitaient la côte occidentale de l'Italie. Leur pays était tellement obscurci par les brouillards, qu'Homère y avait pris ses images de l'enfer, et que les poëtes y plaçaient le palais du Sommeil.
[100] Voltaire a dit dans Zaïre:
Disons donc, ainsi qu'à l'homme toutes choses lui sont comme naturelles, à quoy il se nourrit et accoustume; mais cela seulement lui est naïf, à quoi sa nature simple et non altérée l'appelle: ainsi la premiere raison de la seruitude volontaire, c'est la coustume: Comme des plus braues courtaus[101], qui, au commencement mordent le frein, et puis s'en iouent, et là où n'a gueres ruoiet contre la selle, ils se parent[102] maintenant dans les harnois, et tous fiers se gorgiasent[103] soubs la barde[104]. Ils disent qu'ils ont esté tousiours subiets, que leurs peres ont ainsi vescu; ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal, et se font acroire par exemples; et fondent eus mesmes, soubs la longueur du tems, la possession de ceus qui les tirannisent; mais, pour vrai, les ans ne donnent iamais droit de mal faire, ains agrandissent l'iniure. Touiours s'en trouue il quelques uns, mieulx nés que les autres, qui sentent le pois du ioug, et ne se peuuent tenir de le secouer; qui ne s'appriuoisent iamais de la subietion, et qui tousiours, comme Ulisse, qui, par mer et par terre cherchoit tousiours de voir de la fumée[p. 108] de sa case[105], ne se peuuent tenir d'auiser à leurs naturels priuileges, et de se souuenir de leurs predecesseurs et de leur premier estre: ce sont volontiers ceus là qui, aians l'entendement net et l'esprit clairvoiant, ne se contentent pas, comme le gros populas, de regarder ce qui est deuant leurs pieds, s'ils n'aduisent et derrière et deuant, et ne rememorent ancore les choses passées, pour iuger de celles du temps aduenir, et pour mesurer les presentes: ce sont ceus qui aians la teste, d'eus mesmes, bien faite[106], l'ont ancore polie par l'estude et le sçauoir: ceus là, quand la liberté seroit entierement perdue, et toute hors du monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit, et ancore la sauourent, et la seruitude ne leur est de goust, pour tant bien qu'on l'accoustre.
[101] Cheval qui a crin et oreilles coupés, dit Nicot. Voy. le Dictionnaire de l'Académie française, au mot Courtaud. Roquefort définit ce mot, cheval de course de moyenne taille.
[102] Les imprimés disent: portent.
[103] Se pavanent sous l'armure qui les couvre.
[104] Armure ou paremens de cheval pour la bataille ou pour un jour de fête.
[105] De l'italien Casa.
[106] Montaigne voulait que le gouverneur d'un enfant de bonne maison «eust plustôt la teste bien faite que bien pleine.» L. I., ch. 25.
Le grand Turc s'est bien auisé de cela, que les liures et la doctrine donnent, plus que toute autre chose, aus hommes le sens et l'entendement de se reconnoistre et d'haïr la tirannie: i'entens qu'il n'a en ses terres gueres de gens sçauants ni n'en demande. Or, communément, le bon zele et affection de ceus qui ont gardé maugré le temps la deuotion à la franchise, pour si grand nombre qu'il y en ait, demeure[p. 109] sans effect pour ne s'entrecongnoistre point: la liberté leur est toute ostee, sous le tiran, de faire, de parler, et quasi de penser; ils deuiennent tous singuliers en leurs fantasies: doncques Mome le Dieu moqueur ne se moqua pas trop, quand il trouua cela à redire en l'homme que Vulcan auoit fait, dequoi il ne lui auoit mis une petite fenestre au cœur, afin que par là on peut voir ses pensées[107]. L'on voulsist bien dire que Brute, Casse, et Casque[108] lors qu'ils entreprindrent la deliurance de Romme, ou plustost de tout le monde, ne voulurent pas que Cicéron[109], ce grand zelateur du bien public, s'il en fut iamais, fust de la partie, et estimerent son cœur trop foible pour un fait si haut: il se fioient bien de sa volonté, mais ils ne s'asseuroient point de son courage. Et touteffois, qui voudra discourir les faits du temps passé et les annales anciennes, il s'en trouuera peu, ou point, de ceus qui, voians leur païs mal mené et en mauuaises mains, aient entrepris[p. 110] d'une intention, bonne, entiere et non feinte, de le déliurer, qui n'en soient venus à bout, et que la liberté, pour se faire paroistre, ne se soit elle mesme fait espaule; Harmode[110], Aristogiton, Thrasybule, Brute le vieus, Valere et Dion, comme ils l'ont vertueusement pensé, l'executerent heureusement: en tel cas, quasi iamais à bon vouloir ne defaut la fortune. Brute le ieune et Casse osterent bien heureusement la seruitude[111]; mais, en ramenant la liberté, ils moururent; non pas miserablement, (car quel blaphesme[112] seroit ce de dire qu'il y ait eu rien de misérable en ces gens là, ni en leur mort ni en leur vie?) mais certes au grand dommage, perpetuel malheur, et entiere ruine de la republicque; laquelle fut, comme il semble, enterrée avec eus. Les autres entreprises, qui ont esté faites depuis contre les empereurs romains, n'estoient que coniurations de gens ambitieus, lesquels ne sont pas à plaindre des inconueniens qui leur en sont aduenus; estant bel à voir qu'ils désiroient, non pas oster, mais remuer la couronne, prétendans chasser le tiran et retenir la tirannie. A ceus cy ie ne voudrois pas moymesme qu'il leur en fut bien succedé,[p. 111] et suis content qu'ils aient monstré, par leur exemple, qu'il ne faut pas abuser du saint nom de liberté pour faire mauuaise entreprise.
[107] Lucien, Hermotime, ou le Choix des sectes. Erasme, sur le proverbe Momo satisfacere, etc.—J. V. L.
M. L. Feugère ajoute Babrius, fable LIX, p. 112 (M. boissonnade).
[108] Marcus-Junius Brutus; Caïus-Longinus Cassius; Casca. Ce dernier nom qui ne se trouve dans aucun imprimé est celui du Romain qui porta le premier coup à César lors de la conjuration de Brutus et Cassius.
[109] Plutarque, Vie de Cicéron, c. 53.—L. F.
[110] Harmodius.
[111] «Fault dire les maulx que Brutus et Cassius feirent pour le pretexte de la liberté et Pompéius deuant eulx.»—H. de M.
[112] Les imprimés portent quel blasme.
Mais pour reuenir à notre propos, duquel ie m'estois quasi perdu, la première raison pourquoy les hommes seruent volontiers, est, pource qu'ils naissent serfs, et sont nourris tels. De ceste cy en vient un'autre, qu'aisement les gens deuiennent, soubs les tirans, lasches et effeminés: dont ie sçay merueilleusement bon gré à Hyppocras, le grand père de la medecine, qui s'en est pris garde, et l'a ainsi dit en l'un de ses liures qu'il institue «des maladies[113]». Ce personnage auoit certes en tout le[p. 112] cœur en bon lieu, et le monstra bien lors que le grand roy le voulut attirer pres de lui à force d'offres et grands présens, il luy respondit franchement qu'il feroit grand conscience de se mesler de guerir les Barbares qui vouloient tuer les Grecs, et de bien seruir par son art à lui qui entreprenoit d'asseruir la Grece. La lettre qu'il lui enuoia, se void ancore auiourd'hui parmi ses autres œuures, et tesmoignera, pour iamais, de son bon cœur et de sa noble nature[114]. Or, est il doncques certein[p. 113] qu'auec la liberté se perd tout en un coup la vaillance. Les gens subiets n'ont point d'allegresse au combat, ni d'aspreté: ils vont au danger quasi comme attachés, et tous engourdis par manière d'acquit; et ne sentent point bouillir dans leur cœur l'ardeur de la franchise qui fait mespriser le peril, et donne enuie d'achapter, par une belle mort entre ses compagnons, l'honneur et la gloire. Entre les gens libres, c'est à l'enui, à qui mieulx mieux, chacun pour le bien commun, chacun pour soi, ils s'attendent d'auoir tous leur part au mal de la defaite, ou au bien de la victoire: mais les gens asseruis, outre ce courage guerrier, ils perdent aussi en toutes autres choses la viuacité, et ont le cœur bas et mol, et incapable de toutes choses grandes[115]. Les tirans connoissent bien cela: et, voians[p. 114] qu'ils prennent ce pli, pour les faire mieulx auachir ancore, ils aident ils.
[113] Ce n'est point dans celui des maladies, que nous cite ici La Boëtie, mais dans un autre, intitulé, Περὶ ἁἐρων, ὑδάτων ϰαι τὀπων, de Aere, aquis et locis. Voy. l'excellente édition de M. Littré, Nº 16, page 63, tom. 2. «La plus grande partie de l'Asie est soumise à des rois. Or là où les hommes ne sont pas maîtres de leurs personnes ils s'inquiètent non comme ils s'exerceront aux armes, mais comment ils paraîtront impropres au service, car les dangers ne sont pas également partagés. Les sujets vont à la guerre, en supportent les fatigues, et meurent même, pour leurs maîtres, loin de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs amis; et tandis que les maîtres profitent, pour accroître leur puissance, des services rendus et du courage déployé, eux n'en recueillent d'autre fruit que les périls et la mort; en outre ils sont exposés à voir la guerre et la cessation des travaux changer leurs champs en désert. Ainsi ceux mêmes à qui la nature aurait donné parmi eux du cœur et de la bravoure seraient par les institutions détournés d'en faire usage. La grande preuve de ce que j'avance, c'est qu'en Asie tous ceux, Grecs ou barbares, qui, exempts de maîtres, se régissent par leurs propres lois et travaillent pour eux-mêmes sont les plus belliqueux de tous, car ils s'exposent aux dangers pour leur propres intérêts, ils recueillent le fruit de leur courage et subissent la peine de leur lâcheté.»
Nº 23, pag. 85: «Les Européens sont plus belliqueux aussi par l'effet des institutions, car ils ne sont pas, comme les Asiatiques, gouvernés par des rois; et chez les hommes qui sont soumis à la royauté, le courage, ainsi que je l'ai déjà remarqué, manque nécessairement.»
J'ai rapporté ces passages avec une certaine extension pour montrer les sources où a puisé La Boëtie et pour prouver que les opinions qu'il produisait n'étaient pas nouvelles.
Aristote a donné un véritable résumé de ce traité. Voy. Politique, tom. II, pag. 41 de la traduction de M. Barthélemy Saint-Hilaire.
[114] La citation textuelle que fait La Boëtie prouve qu'il puisait aux sources mêmes, et qu'il était véritablement érudit. Voy. cette correspondance dans les œuvres d'Hippocrate. Artaxerxe écrit à Hystanes: «Dato igitur ipsi (Hippocrati) auri quantum voluerit et reliqua abunde, quibus opus habet.... viros enim invenire qui consilio præstent non est facile». Le même écrit aux habitants de l'île de Cos, les menaçant de sa colère s'ils ne livrent pas Hippocrate: «Ut in posterum tempus nemo sciat an in hoc loco fuerit insula aut urbs Cos.» Les habitants répondent: «Cives non dabunt Hippocratem etiam si pessissima morte sint interituri» et Hippocrate écrit au puissant roi: «Quod et victu, et vestitu, et domo et omni ad vitam sufficienti opulentia fruimur; Persarum autem divitiis uti fas mihi non est neque barbaros homines a morbis liberare qui hostes sunt Græcorum» je ne puis m'empêcher de rapprocher cet: opulentia fruimur par lequel Hippocrate repousse les présens d'Ataxerces, du: je suis, sire, aussi riche que je me souhaite, que Montaigne écrit à Henri IV, qui lui faisait de pompeuses promesses pour l'attirer à la cour.
[115] Ceci est précisément l'opinion d'Hippocrate, que nous avons précédemment transcrite.
Xenophon, historien graue, et du premier rang entre les Grecs, a fait un liure[116], auquel il fait parler Simonide, auec Hieron, tiran de Syracuse, des miseres du tiran. Ce liure est plein de bonnes et graues remonstrances, et qui ont aussi bonne grace, à mon aduis, qu'il est possible. Que pleust à Dieu, que les tirans qui ont iamais esté, l'eussent mis deuant les yeulx, et s'en fussent seruis de miroir! ie ne puis pas croire qu'ils n'eussent reconnu leurs verrues, et eu quelque honte de leurs taches. En ce traité il conte la peine enquoy sont les tirans, qui sont contrains, faisans mal à tous, se craindre de tous. Entre autres choses, il dit cela, que les mauuais rois se seruent d'estrangers à la guerre, et les souldoient[117], ne s'osans fier de mettre à leurs gens à qui ils ont fait tort les armes en main. (Il y a bien eu de bons rois qui ont eu à leur soulde des nations estrangeres, comme des François mesmes, et plus ancore d'autrefois qu'auiourd'huy, mais à une autre intention, pour garder[p. 115] les leurs, n'estimant rien le dommage de l'argent pour espargner les hommes. C'est ce que disoit Scipion, ce croi ie, le grand Afriquain, qu'il aimeroit mieux auoir sauué un citoien, que défait cent ennemis.) Mais, certes, cela est bien asseuré, que le tiran ne pense iamais que sa puissance lui soit asseurée, sinon quand il est venu à ce point qu'il n'a sous lui homme qui vaille: donques à bon droit lui dira on cela, que Thrason, ou Terence, se vante auoir reproché au maistre des elephans,
[116] Intitulé Ἱέρων ῆ Τύραννιϰος; Hiéron, ou Portrait de la condition des Rois. Coste a traduit cet ouvrage, et l'a publié en grec et en français, avec des notes. Amsterd. 1711.
[117] Notre manuscrit porte: «et les soldats;» ce qui n'a pas de sens. Il est clair qu'il y a eu ici erreur de copiste; peut-être y avait-il: «et les soldent:» je maintiens donc la leçon des imprimés.
Mais ceste ruse de tirans d'abestir leurs subiects ne se peut pas congnoistre plus clairement que par ce que Cyrus fit enuers les Lydiens, après qu'il se fut emparé de Sardis, la maistresse ville de Lydie[119], et qu'il eust pris à merci Cresus, ce tant riche roy, et l'eut amené quand et soy: on lui apporta nouuelles que les Sardains s'estoient reuoltés; il les eut bien tost reduit sous sa main: mais ne voulant pas ni mettre à sac une tant belle ville, ni estre tousiours en peine d'y tenir une armée pour la garder, il s'aduisa d'un grand expedient pour s'en[p. 116] asseurer: il y establit des bordeaus[120], des tauernes et ieux publics; et feit publier une ordonnance, que les habitans eussent à en faire estat. Il se trouua si bien de ceste garnison, que iamais depuis contre les Lydiens ne fallut tirer un coup d'espée. Ces pauures et miserables gens s'amuserent à inuenter toutes sortes de ieus, si bien que les Latins en ont tiré leur mot, et ce que nous appellons passetemps, ils l'appellent lude, comme s'ils vouloient dire lyde. Tous les tirans n'ont pas ainsi declaré expres qu'ils voulsissent effeminer leurs gens: mais, pour vrai, ce que celui ordonna formelement et en effect, sous main ils l'ont pourchassé la plus part. A la vérité, c'est le naturel du menu populaire, duquel le nombre est tousiours plus grand dedans les villes, qu'il est soubçonneus à l'endroit de celui qui l'aime, et simple enuers celui qui le trompe. Ne pensés pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieulx à la pipée, ni poisson aucun qui, pour la friandise du ver, s'accroche plus tost dans le haim[121], que tous les peuples s'aleschent vistement à la seruitude, par la moindre plume qu'on[p. 117] leur passe, comme l'on dit, deuant la bouche: et c'est chose merueilleuse qu'ils se laissent aller ainsi tost[122], mais seulement qu'on les chatouille. Les theatres, les ieus, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bestes estranges, les medailles, les tableaus et autres telles drogueries, c'estoient aus peuples anciens les apasts de la seruitude, le pris de leur liberté, les outils de la tirannie[123]. Ce moien, ceste pratique, ces allechemens auoient les anciens tirans, pour endormir leurs subiects sous le ioug. Ainsi les peuples, assotis, trouuans beaus ces passetemps, amusés d'un vain plaisir qui leur passoit deuant les yeulx, s'accoustumoient à seruir aussi niaisement, mais plus mal, que les petits enfans, qui pour voir les luisans images des liures enluminés, aprenent à lire. Les rommains tirans s'aduiserent ancore d'un autre point de festoier souuent les dizaines[124] publiques, abusant ceste canaille comme il falloit, qui se laisse aller, plus qu'à toute autre chose, au plaisir de la bouche: le plus auisé et entendu d'entr'eus n'eust pas quitté son esculée de soupe, pour recouurer la liberté de la republique de Platon. Les tirans faisoient largesse d'un quart de blé, d'un sestier de vin, et d'un[p. 118] sesterce: et lors c'estoit pitié d'ouïr crier viue le roi! Les lourdaus ne s'auisoient pas qu'ils ne faisoient que recouurer une partie du leur, et que cela mesmes qu'ils recouuroient, le tiran ne le leur eust peu donner, si, deuant, il ne l'auoit osté à eus mesmes. Tel eust amassé auiourd'hui le sesterce, et se fut gorgé au festin public, benissant Tibere et Neron et leur belle liberalité, qui, le lendemain, estant contraint d'abandonner ses biens à leur auarice, ses enfans à la luxure, son sang mesmes à la cruauté de ces magnifiques empereurs, ne disoit mot, non plus qu'une pierre, ne se remuoit non plus qu'une souche. Tousiours le populaire a eu cela: Il est, au plaisir qu'il ne peut honnestement receuoir, tout ouuert et dissolu; et, au tort et à la douleur qu'il ne[125] peut honnestement souffrir, insensible. Ie ne vois pas maintenant personne qui, oiant parler de Neron, ne tremble mesmes au surnom de ce vilain monstre, de ceste orde et sale peste du monde; et touteffois, de celui là de ce boutefeu, de ce bourreau, de ceste beste sauuage on peut bien dire qu'apres sa mort, aussi vilaine que sa vie, le noble peuple romain[126] en receut tel desplaisir, se souuenant[p. 119] de ses ieus et de ses festins, qu'il fut sur le point d'en porter le deil; ainsi l'a escrit Corneille Tacite, auteur bon, et graue et des plus certeins. Ce qu'on ne trouuera pas estrange, veu que ce peuple là mesmes auoit fait au parauant à la mort de Iules Cœsar, qui donna congé aus lois et à la liberté: auquel personnage il n'y eut, ce me semble, rien qui vaille, car son humanité mesmes que l'on presche tant, fut plus dommageable que la cruauté du plus sauuage tiran qui fust onques, pource qu'à la verité, ce fut ceste sienne venimeuse douceur qui, enuers le peuple romain, sucra la seruitude: mais apres sa mort, ce peuple là, qui auoit ancore en la bouche ses bancquets, et en l'esprit la souuenance de ses prodigalités, pour lui faire ses honneurs et le mettre en cendre[127], amonceloit, à l'enui, les bancs de la place, et puis lui[128] esleua une colonne, comme au Pere du peuple (ainsi le portoit le chapiteau), et lui fit plus d'honneur, tout mort qu'il estoit, qu'il n'en debuoit faire par droit à homme du monde, si ce n'estoit parauenture, à ceus qui l'auoient tué. Ils n'oublierent pas aussi cela[p. 120] les empereurs romains, de prendre communement le tiltre de tribun du peuple, tant pource que cest office estoit tenu pour saint et sacré qu'aussi il estoit establi pour la defense et protection du peuple, et sous la faueur de l'estat. Par ce moien, ils s'asseuroient, que le peuple se fieroit plus d'eus; comme s'il deuoit en ouir[129] le nom, et non pas sentir les effects au contraire. Auiourd'hui ne font pas beaucoup mieux ceus qui ne font gueres mal aucun, mesmes de consequence, qu'ils ne facent passer, deuant quelque ioly propos du bien public et soulagement commun. Car tu scais bien[130], ô Longa, le formulaire, duquel en quelques endroits ils pourroient user assez finement: mais à la plus part, certes, il ni peut auoir de finesse, là où il y a tant d'impudence. Les rois d'Assyrie, et ancore apres eus ceus de Mede, ne se presentoient en public que le plus tard qu'ils pouuoient, pour mettre en doute ce populas s'ils estoient en quelque chose plus qu'hommes, et laisser en ceste resuerie les gens qui font volontiers les imaginatifs aus choses desquelles[p. 121] ils ne peuuent iuger de veue. Ainsi tant de nations, qui furent asses long temps sous cest empire assyrien, auec ce mistere s'accoustumoient à seruir, et seruoient plus volontiers, pour ne sçauoir pas quel maistre ils auoient, ni à grand' peine s'ils en auoient; et craignoient tous, à crédit, un, que personne iamais[131] n'auoit veu. Les premiers rois d'Égipte ne se monstroient gueres, qu'ils ne portassent tantost un chat, tantost une branche, tantost du feu sur la teste, et se masquoient ainsi, et faisoient les basteleurs; et, en ce faisant, par l'estrangeté de la chose ils donnoient à leurs subiects quelque reuerence et admiration: où, aus gens qui n'eussent esté ou trop sots ou trop asseruis, ils n'eussent appresté, ce m'est aduis, sinon passetems et risee. C'est pitié d'ouïr parler de combien de choses les tirans du temps passé faisoient leur profit pour fonder leur tirannie; de combien de petits[p. 122] moiens ils se seruoient, aians de tout tems trouué ce populas fait à leur poste[132]; auquel il ne sçauoient si mal tendre filet, qu'ils ne si vinsent prendre; lequel ils ont tousiours trompé à si bon marché qu'ils ne l'assuiettissoient iamais tant, que lors qu'ils s'en moquoient le plus.
[119] Sardes, dans l'Asie mineure, capitale de la Lydie, résidence de Crésus. C'est dans cette province que coulait le Pactole.
[120] Lieux publics de prostitution. Voy. Hérodote, I, I; Frank de Franckenau, Tractatio qua lupanaria, vulgo Hurenhauser, improbantur, Halœ magd., 1743, in 4º, insérée antérieurement dans le curieux ouvrage de cet auteur, Satyræ medicæ, Lipsiæ, 1722, in-8º.
[121] Hameçon, de hamus.
[122] Aussitôt, pourvu.
[123] Instrumenta Servitutis, expression de Tacite.
[124] Les décuries du petit peuple, nourri aux dépens du trésor public.
[125] Je maintiens la négation qui se lit dans les imprimés; car elle est nécessaire au sens de la phrase, et elle était assurément dans la pensée de l'auteur, comme elle se trouvait primitivement dans notre manuscrit; un lecteur superficiel l'a rayée à tort, et assez récemment, selon toute apparence.
[126] Plebs sordida, et circo ac theatris sueta, simul deterrimi servorum, aut qui, adesis bonis, per dedecus Neronis alebantur, mœsti. Tacite, Hist., l. I, ab initio.
[127] Suétone, dans la Vie de Jules-César, § 84.
[128] Postea solidam columnam prope viginti pedum lapidis numidici in foro statuit, scripsitque: Parenti patriæ. Id., ibid., § 85.
[129] Comme si le peuple devoit se contenter d'entendre le nom sans sentir les effets de la fonction. Je maintiens devoit au singulier quoique le manuscrit porte deuoient; il s'agit évidemment du peuple et non des empereurs.
[130] Ce tutoiement adressé à Longa est encore une preuve de l'authenticité de notre manuscrit. Les imprimés portent tous; vous sçavez bien, ce qui constraste avec le tutoiement précédemment employé par La Boëtie en s'adressant au même personnage.
[131] M. Feugère fait ici un rapprochement plein d'intérêt: «Omne ignotum pro magnifico est... et major e longinquo reverentia.» (Tacite).
J'ajoute, pour égayer un peu ce grave sujet, une réflexion inédite que je copie sur l'exemplaire des Essais, où Naigeon l'a inscrite, et qui est trop bouffonne pour être impie: «Il n'est rien tel que de voir ces fantômes de près; ils s'agrandissent toujours par la distance et le secret, et Dieu, qui ne se montre jamais, et les despotes orientaux, qui ne se montrent que rarement, savent bien ce qu'ils font.» On reconnaît la plume qui a tracé le fameux avertissement supprimé de l'édition de 1802.
[132] A leur gré.
Que dirai-ie d'une autre belle bourde[133], que les peuples anciens prindrent pour argent content? ils creurent fermement[134], que le gros doigt de Pyrrhe, roy des Epirotes, faisoit miracles, et guérissoit les malades de la rate: ils enrichirent ancore mieus le conte, que ce doigt, apres qu'on eut bruslé tout le corps mort, s'estoit trouué entre les cendres, s'estant sauué, maugré le feu. Tousiours ainsi le peuple sot[135] fait lui mesmes les mensonges, pour, puis apres, les croire. Prou de gens l'ont ainsi escrit, mais de façon, qu'il est bel à voir qu'ils ont amassé cela des bruits de ville et du[p. 123] vain parler du populas. Vespasian, reuenant d'Assyrie, et passant à Alexandrie pour aller à Romme s'emparer de l'empire, feit merueilles[136]: il addressoit les boiteus, il rendoit clair-voians les aueugles, et tout plein d'autres belles choses ausquelles, qui ne pouuoit voir la faute qu'il y auoit, il estoit à mon aduis plus aueugle que ceus qu'il guerissoit. Les tirans mesmes trouuoient bien estrange, que les hommes peussent endurer un homme leur faisant mal: ils vouloient fort se mettre la religion deuant, pour gardecorps, et, s'il estoit possible emprunter quelque eschantillon de la diuinité, pour le maintien de leur meschante vie. Donques Salmonée, si l'on croit à la sybile de Virgile en son enfer, pour s'estre ainsi moqué des gens, et auoir voulu faire du Juppiter, en rend maintenant conte, et elle le veit en l'arrierenfer.
[133] Sornette, fable, tromperie.
[134] Tout ce qu'on dit ici de Pyrrhus est rapporté dans sa vie par Plutarque.
[135] Naigeon a adopté dans l'édition de 1802 (Paris, Didot) la leçon de tous les imprimés, le peuple s'est faict, mais il a ajouté la note suivante: «—Le peuple sot fait.—Cette leçon est une correction manuscrite qu'on trouve, avec plusieurs autres, à la marge de l'exemplaire de la Bibliothèque royale.» J'avais cru d'abord que Naigeon avait eu connaissance du manuscrit de de Mesmes, mais ce qui précède se rapporte à un exemplaire imprimé.
[136] Suetone, Vie de Vespasien, § 7.
[137] Grecs.
[138] Ce vers, omis dans tous les imprimés, est une preuve entre mille que la leçon du manuscrit est préférable, puisque les premiers ne donnent pas la traduction de: mædioque per Elidis urbem ibat.
[139] La pauvreté de cette traduction, que Coste trouvoit fade et grossière, que Naigeon qualifie de burlesque, et qui est certainement l'œuvre de La Boëtie, me servira d'excuse d'en donner une autre qui se trouve en marge de notre manuscrit, et incontestablement écrite du même tems et de la même main; elle est précédée de ces deux lettres, AL, dont j'ignore la signification:
Ces vers sont la traduction de ces beaux vers latins:
(Virg., Énéide, l. 6, v. 585, etc.)
Si cestuy qui ne faisoit que le sot est à ceste heure si bien traité là bas, ie croi que ceus qui ont abusé de la religion, pour estre méschans, s'y trouueront ancore à meilleures enseignes.
Les nostres semerent en France ie ne sçai quoi de tel, des crapaus, des fleurdelis, l'ampoule et l'oriflamb[140]. Ce que de ma part[141], comment qu'il[p. 126] en soit, ie ne veus pas mescroire, puis que nous ni nos ancestres n'auons eu iusques ici aucune occasion de l'auoir mescreu, aians tousiours eu des rois si bons en la paix et si vaillans en la guerre, qu'ancore qu'ils naissent rois, si semble ils qu'ils ont esté non pas faits comme les autres par la nature, mais choisis par le Dieu toutpuissant, auant que naistre, pour le gouuernement, et la conseruation de ce roiaume, et ancore quand cela ni seroit pas, si ne voudrois-ie pas pour cela entrer en lice pour debattre la verité de nos histoires, ni les esplucher si priuement, pour ne tollir[142] ce bel esbat, où se pourra fort escrimer nostre poësie françoise, maintenant non pas accoustrée, mais, comme il semble, faite tout à neuf, par nostre Ronsard, nostre Baïf, nostre du Bellay, qui en cela auancent bien tant nostre langue, que i'ose esperer que bien tost les Grecs ni les Latins n'auront gueres, pour ce regard, deuant nous, sinon possible, le droit d'aisneesse.[p. 127] Et certes ie ferois grand tort à nostre rime, car i'use volontiers de ce mot[143], et il ne me desplaist point pour ce qu'ancore que plusieurs l'eussent rendu mechanique, touteffois ie voy assés de gens qui sont à mesmes pour la ranoblir, et lui rendre son premier honneur: mais ie lui ferois, di-ie, grand tort de lui oster maintenant ces beaus contes du roi Clouis, ausquels desià ie voy, ce me semble, combien plaisamment, combien à son aise, s'y esgaiera la veine de nostre Ronsard, en sa Franciade. I'entens sa portée, ie connois l'esprit aigu, ie sçay la grace de l'homme: il fera ses besoignes de l'oriflamb aussi bien que les Romains de leurs ancilles[144]
[140] L'Oriflamme.
[141] Par tout ce que La Boëtie nous dit ici des fleurs de lis, de l'ampoule et de l'oriflamme, il est aisé de deviner ce qu'il pense véritablement des choses merveilleuses qu'on en conte, et le bon Pasquier n'en jugeait point autrement que la Boëtie. «Il y a en chaque république (nous dit-il dans ses Recherches de la France, l. 8, c. 21) plusieurs histoires que l'on tire d'une longue ancienneté, sans que le plus du temps l'on en puisse sonder la vraye origine; et toutesfois on les tient non seulement pour véritables, mais pour grandement auctorisées et sacrosainctes. De telle marque en trouvons nous plusieurs, tant en Grèce qu'en la ville de Rome; et de cette même façon avons nous presque tiré, entre nous, l'ancienne opinion que nous eumes de l'Auriflame, l'invention de nos Fleurs de Lys, que nous attribuons à la Divinité, et plusieurs autres belles choses, les quelles bien qu'elles ne soient aydées d'aucteurs anciens, si est ce qu'il est bien seant à tout bon citoyen de les croire pour la majesté de l'empire.» Dans un autre endroit du même ouvrage (l. 2, c. 17), Pasquier remarque qu'il y a eu des rois de France qui ont eu pour armoiries trois crapauds; mais que «Clovis, pour rendre son royaume plus miraculeux, se fit apporter par un hermite, comme par advertissement du ciel, les fleurs de lys, les quelles se sont continuées jusques à nous.» (Note de Coste.)
Henri de Mesmes ajoute ici: «Il s'en trouuera ez citéz libres assez, c'est le moien ancien pour les estats, non particulier pour le règne» (monarchie).
[142] Les imprimés portent tollir ce bel estat, que les éditeurs ont expliqué par enlever, ternir; c'est esbat qu'il faut lire, et on comprend le mot escrimer qui vient ensuite.
[143] On se souvient que La Boëtie, au commencement de ce discours, a déjà parlé des rimes françaises.
[144] Ancile ou Ancilies; bouclier que Numa feignit être tombé du ciel et à la conservation duquel il prétendit qu'étaient attachées les destinées de l'empire romain. (Ovid., Tit. Liv., Dionys. Halic.)
Ce dit Virgile:[145] il mesnagera nostre ampoule aussi bien que les Athéniens le panier d'Erictone[146]: il fera parler de nos armes aussi bien qu'eux[p. 128] de leur oliue qu'ils maintiennent estre ancore en la tour de Minerue[147]. Certes ie serois outrageus[p. 129] de vouloir dementir nos liures, et de courir ainsi sur les erres de nos poëtes. Mais pour retourner, d'où ie ne sçay comment i'auois destourné le fil de mon propos, il n'a iamais esté que les tirans, pour s'asseurer, ne se soient efforcés d'accoustumer le peuple enuers eus, non seulement à obeïssance et seruitude, mais ancore à deuotion. Donques ce que i'ay dit iusques icy, qui apprend les gens à seruir plus volontiers, ne sert gueres aus tirans que pour le menu et grossier peuple.
[145] Et lapsa ancilia cælo. (Virgil., Ænéid., l. VIII. v. 664.)
[146] Tous les imprimés portent Erisichthone, et Coste, dans les premières éditions qu'il a données de la Servitude, n'avait pas mis de note en cet endroit, «n'ayant pu rendre raison de ce que veut dire ici La Boëtie.» Mais l'auteur de la traduction anglaise publiée en 1735 suppléa à cette lacune, et mit une longue note, dont la substance est que: «Callimaque, dans son hymne à Cérès, parle d'une corbeille qu'on supposait descendre du ciel, et qui était portée sur le soir dans le temple de cette déesse lorsqu'on célébrait sa fête. Suidas, sur le mot Κανηφὀροι, porteurs de corbeilles, dit que la cérémonie des corbeilles fut instituée sous le règne d'Érisichthon (sic), et c'est peut-être sur cela que La Boëtie s'est avisé de l'appeler Panier d'Erisichthone.» Métamorph. 6. Voy. Metra et aussi Callimaque, à qui Ovide a emprunté cette fable, hymne Ψ, 12.—A cette note M. J.-V. Leclerc a ajouté avec beaucoup de sagacité: «Il y a dans Suidas Ἐριχθονἰου βασιλεὐοντος, sous le règne d'Erichthonius. Il faut lire peut-être dans La Boëtie, leur panier d'Érichthone.» On voit que le doute du savant doyen de la Faculté des lettres était fondé, et qu'il avait restitué la bonne leçon dans sa note, mais il n'avait pas osé le faire dans le texte.
[147] Tous les imprimés donnent ici une phrase qui n'a aucun sens, et on ne comprend pas que les éditeurs n'en aient pas fait la remarque: «il se parlera de nos armes dans la tour de Minerve,» et il s'agit de Ronsard et de la Franciade! risum teneatis!
La Boëtie fait allusion à la cérémonie des Panathénées, dans lesquelles tous les assistants portaient à la main une branche d'olivier pour honorer Minerve, à qui ces fêtes étaient consacrées, et à qui le pays était redevable de cet arbre utile; et il rappelle que les Athéniens prétendaient posséder encore l'olivier que cette déesse fit sortir de terre lors de son différend avec Neptune pour nommer la ville à laquelle, par suite de la victoire qu'elle remporta en cette circonstance, elle donna son nom (Athéna ou Athénée). Voy. tous les auteurs anciens et plusieurs mémoires dans ceux de l'Acad. des Inscriptions. Tomes I à XXVIII.
Mais maintenant ie viens à un point, lequel est à mon aduis le ressort et le secret de la domination, le soustien et fondement de la tirannie: Qui pense que les halebardes, les gardes, et l'assiete du guet, garde les tirans, à mon iugement se trompe fort: et s'en aident ils, comme ie croy, plus pour la formalité et espouuantail, que pour fiance qu'ils y ayent. Les archers gardent d'entrer au palais les mal-habillés[148] qui n'ont nul moyen, non pas les bien armés qui peuuent faire quelque entreprise. Certes, des empereurs romains il est aisé à conter qu'il n'en y a pas eu tant qui aient eschappé quelque dangier par le secours de leurs gardes, comme de ceus qui ont esté tués par leurs archers mesmes. Ce ne sont pas les bandes des gens à cheual, ce ne sont pas les compaignies des gens de pied, ce ne[p. 130] sont pas les armes, qui defendent le tiran; on ne le croira pas du premier coup, mais certes il est vray. Ce sont tousiours quatre ou cinq qui maintiennent le tiran, quatre ou cinq qui lui tiennent tout le païs en seruage. Tousiours il a esté que cinq ou six ont eu l'oreille du tiran, et s'y sont approché d'eus mesmes, ou bien ont esté appelés par lui, pour estre les complices de ses cruautés, les compaignons de ses plaisirs, les macquereaus de ses voluptés, et communs aus biens de ses pilleries. Ces six addressent[149] si bien leur chef, qu'il faut, pour la société, qu'il soit meschant, non pas seulement de ses meschancetés, mais ancore des leurs. Ces six ont six cent, qui proufitent sous eus, et font de leurs six cent ce que les six font au tiran. Ces six cent en tiennent sous eus six mille, qu'ils ont esleué en estat, ausquels ils font donner ou le gouuernement des prouinces, ou le maniement des deniers, afin qu'ils tiennent la main à leur auarice et cruauté, et qu'ils l'executent quand il sera temps, et facent tant de maus d'allieurs, qu'ils ne puissent durer que soubs leur ombre, ni s'exempter, que par leur moien, des loix et de la peine. Grande est la suitte qui vient apres cela; et qui voudra s'amuser à deuider ce filet, il verra[p. 131] que, non pas les six mille, mais les cent mille, mais les milions, par ceste corde, se tiennent au tiran; s'aidant d'icelle, comme, en Homere, Iuppiter qui se vante, s'il tire la chesne, d'emmener vers soi tous les dieus. De là venoit la creue du senat sous[150] Iules, l'establissement de nouueaus estats, erection d'offices; non pas certes, à le bien prendre, reformation de la iustice, mais nouueaus soustiens de la tirannie. En somme, que l'on en vient là, par les faueurs ou soufaueurs, les guains ou reguains qu'on a auec les tirans, qu'il se trouue en fin quasi autant de gens ausquels la tirannie semble estre profitable, comme de ceus à qui la liberté seroit aggréable. Tout ainsi que les medecins disent qu'en nostre corps, s'il y a quelque chose de gasté, deslors qu'en autre endroit il s'y bouge rien[151], il se vient aussi tost rendre vers ceste partie vereuse: pareillement deslors qu'un roi s'est déclaré tiran, tout le mauuais, toute la lie du roiaume, ie ne dis pas un tas de larronneaus et essorillés[152], qui ne peuuent gueres en une republicque, faire mal ne bien, mais ceus qui sont taschés d'une ardente ambition, et d'une notable auarice, s'amassent autour de[p. 132] lui, et le soustiennent, pour auoir part au butin, et estre, sous le grand tiran, tiranneaus eusmesmes. Ainsi font les grands voleurs et les fameus corsaires: les uns discourent le païs, les autres cheualent[153] les voiageurs; les uns sont en embusche, les autres au guet; les autres massacrent, les autres despouillent, et ancore qu'il y ait entr'eus des preeminences, et que les uns ne soient que vallets, les autres chefs de l'assemblée, si n'en y a il à la fin pas un qui ne se sente sinon du principal butin, au moins de la recerche. On dit bien que les pirates ciliciens ne s'assemblerent pas seulement en si grand nombre, qu'il falut enuoier contr'eus Pompée le grand; mais ancore tirerent à leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités, aus haures desquelles ils se mettoient en seureté, reuenans des courses; et pour recompense leur bailloient quelque profit du recelement de leur pillage.
[148] Les imprimés portent ici malhabiles!
[149] Adressent pour dressent. Amyot emploie aussi en ce sens la première expression. (Œuvres mor.)
[150] L'augmentation du sénat sous Jules César.
[151] Rien est là pour quelque chose.
[152] De faquins, de gens perdus de réputation, qui ont été condamnés à avoir les oreilles coupées.—Essaurillez ou essaureillez, rei auribus diminuti.
[153] Poursuivent les voyageurs pour les détrousser: chevaler, piller.
Ainsi le tiran asseruit les subiects, les uns par le moien des autres, et est gardé par ceus desquels, s'ils valoient rien[154], il se deuroit garder; et,[p. 133] comme on dit, pour fendre du bois il faict les coings du bois mesme. Voilà ses archers, voilà ses gardes, voilà ses halebardiers; non pas qu'eusmesmes ne souffrent quelque fois de lui, mais ces perdus, et abandonnés de Dieu et des hommes, sont contens d'endurer du mal, pour en faire, non pas à celui qui leur en faict, mais à ceus qui endurent comme eus, et qui n'en peuuent mais. Touteffois voians ces gens là, qui nacquetent[155] le tyran, pour faire leurs besongnes de sa tirannie et de la seruitude du peuple, il me prend souuent esbahissement de leur meschanceté, et quelque fois pitié de leur sottise. Car, à dire vrai, qu'est ce autre chose de s'approcher du tiran, que se tirer plus arriere de sa liberté, et par maniere de dire serrer à deus mains et ambrasser la seruitude? Qu'ils mettent un petit à part leur ambition, et qu'ils se deschargent un peu de leur auarice; et puis, qu'ils se regardent eus mesmes, et qu'ils se reconnoissent, et ils verront clairement, que les villageois, les païsans, lesquels, tant qu'ils peuuent, ils foulent aus pieds, et en font pis que de forsats ou esclaues;[p. 134] ils verront, di-ie, que ceus là, ainsi mal menés, sont touteffois, aus pris d'eus, fortunés et aucunement libres. Le laboureur et l'artisan, pour tant qu'ils soient asseruis, en sont quittes, en faisant ce qu'on leur dit: mais le tiran voit les autres qui sont pres de lui, coquinans et mendians sa faueur; il ne faut pas seulement qu'ils facent ce qu'il dit, mais qu'ils pensent ce qu'il veut, et souuent, pour lui satisfaire, qu'ils preuiennent ancore ses pensées. Ce n'est pas tout à eus de lui obeïr, ils faut ancore lui complaire; il faut qu'ils se rompent, qu'ils se tourmentent, qu'ils se tuent à trauailler en ses affaires; et puis, qu'ils se plaisent de son plaisir, qu'ils laissent leur goust pour le sien, qu'ils forcent leur complexion, qu'ils despouillent leur naturel; il faut qu'ils se prennent garde à ses parolles, à sa vois, à ses signes, et à ses yeulx; qu'ils n'aient ny oeil, ni pied, ni main, que tout ne soit au guet, pour espier ses volontés, et pour descouurir ses pensees. Cela est ce viure heureusement? cela s'appelle il viure? est il au monde rien moins supportable que cela, ie ne dis pas à un homme de coeur, ie ne di pas à un bien né, mais seulement à un qui ait le sens commun, ou, sans plus, la face d'homme? Quelle condition est plus miserable, que de viure ainsi, qu'on n'aie rien à soy, tenant d'autrui son aise, sa liberté, son corps et sa vie!
[154] Le sens de la phrase semblerait exiger le singulier, car valoit doit se rapporter au tyran «qui se fait garder par ceux dont il se garderait (méfieroit) s'il valoit quelque chose.» Am. Duval dit ici: Rien, Res, chose.
[155] Je ne sais pourquoi quelques éditeurs expliquent ce mot par flattent le tyran, lui font servilement la cour. On appelait naquet le garçon qui, dans le jeu de paume, sert les joueurs: et c'est de ce mot qu'a été formé naqueter, ou nacqueter, qu'on a conservé dans le Dictionnaire de l'Académie française, et qui sous la plume de La Boëtie signifie servir bassement.
Mais ils veulent seruir, pour auoir des biens: comme s'ils pouuoient rien gaigner qui fust à eus puis qu'ils ne peuuent pas dire de soy qu'ils soient à eusmesmes; et, comme si aucun pouuoit auoir rien de propre sous un tiran, ils veulent faire que les biens soient à eus, et ne se souuiennent pas que ce sont eus qui lui donnent la force pour oster tout à tous, et ne laisser rien qu'on puisse dire estre à personne: ils voient que rien ne rend les hommes subiects à sa cruauté, que les biens; qu'il n'y a aucun crime enuers lui digne de mort que le dequoy[156]; qu'il n'aime que les richesses; et ne defait que les riches et ils se viennent presenter, comme deuant le boucher, pour s'y offrir ainsi plains et refaits, et lui en faire enuie. Ces fauoris ne se doiuent pas tant souuenir de ceus qui ont gaigné au tour des tirans beaucoup de biens, comme de ceus qui aians quelque temps amassé, puis apres y ont perdu et les biens et les vies; il ne leur doit pas tant venir en l'esprit combien d'autres y ont gaigné de richesses, mais combien peu ceus là les ont gardées. Qu'on discoure toutes les anciennes histoires; qu'on regarde celles de nostre souuenance, et on verra, tout à plein, combien est[p. 136] grand le nombre de ceus qui aians gaigné par mauuais moiens l'oreille des princes, aians ou emploié leur mauuaistie ou abusé de leur simplesse, à la fin par ceus là mesmes ont esté aneantis, et autant qu'ils y auoient trouué de facilité pour les eleuer, autant y ont ils congneu puis après d'inconstance pour les abattre. Certainement en si grand nombre de gens qui se sont trouué iamais pres de tant de mauuais rois, il en a esté peu, ou comme point, qui n'aient essaié quelque fois en eus mesmes la cruauté du tiran qu'ils auoient deuant attisée contre les autres: le plus souuent s'estant enrichis, sous ombre de sa faueur, des despouilles d'autrui, il l'ont à la fin eusmesmes enrichi de leurs despouilles.
[156] M. Feugère pense que cela est dit dans le même sens qu'aujourd'hui encore le peuple dit, en parlant d'un homme aisé: «il a de quoi.»
Les gens de bien mesmes, si quelque fois il s'en trouue quelqu'un aimé du tiran, tant soient ils auant en sa grace, tant reluise en eus la vertu et intégrité, qui voire aus plus meschans, donne quelque reuerence de soi quand on le voit de prés, mais les gens de bien di-ie ni sçauroient durer, et faut qu'ils se sentent du mal commun, et qu'à leurs despens[157] ils esprouuent la tirannie. Un Seneque, un Burre[158], un Thrasée ceste terne[159] de gens[p. 137] de bien, lesquels mesmes les deus[160] leur male fortune approcha du tiran, et leur mit en main le maniement de ses[161] affaires; tous deus estimés de lui, tous deus cheris, et ancore l'un l'auoit nourri, et auoit pour gages de son amitié, la nourriture de son enfance: mais ces trois là sont suffisans tesmoins, par leur cruelle mort, combien il y a peu d'asseurance en la faueur d'un mauuais maistre; et, à la vérité, quelle amitié peut on esperer de celui qui a bien le cœur si dur, que d'haïr son roiaume qui ne fait que lui obeïr, et lequel pour ne se sauoir pas ancore aimer, s'appauurit lui mesme et destruit son empire?
[157] Je maintiens le mot despens quoique le manuscrit porte desseins.
[158] Un Burrhus, un Thraséas.
[159] Ce trio, pourrait-on dire aujourd'hui, s'il était permis d'employer le mot de trio dans un sens grave et sérieux. Cela n'est pas possible: il faudrait dire, cette trinité ou ce triumvirat de gens de bien.
[160] Sous entendu premiers.—L. F.
[161] Le copiste a écrit, par erreur, leurs.
Or, si on veut dire que ceus là[162] pour auoir bien vescu[163] sont tombés en ces inconueniens, qu'on regarde hardiment au tour de celui là mesme[164], et on verra que ceus qui vindrent en sa grâce, et s'i maintindrent par mauuais moiens ne furent pas de plus longue durée. Qui a ouï parler d'amour si abandonnée, d'affection si opiniastre?[p. 138] qui a iamais leu d'homme si obstinement acharné enuers femme, que de celui là enuers Popée? or fut elle apres[165] empoisonnée par lui mesme. Agrippine sa mere auoit tué son mari Claude pour lui faire place à l'empire; pour l'obliger, elle n'auoit iamais fait difficulté de rien faire ni de souffrir: donques son fils mesme, son nourrisson, son empereur fait de sa main[166], après l'auoir souuent faillie, enfin lui osta la vie: et n'i eut lors personne qui ne dit qu'elle auoit trop bien mérité ceste punition, si c'eust esté par les mains de tout autre, que de celui à qui elle l'auoit baillée. Qui fut oncques plus aisé à manier, plus simple, pour le dire mieus, plus vrai niais, que Claude l'empereur? qui fut oncques plus coiffé de femme, que lui de Messaline? Il la meit enfin entre les mains du bourreau. La simplesse demeure tousiours aus tirans, s'ils[p. 139] en ont, à ne sçauoir bien faire; mais ie ne sçay comment à la fin, pour user de cruauté, mesmes enuers ceus qui leur sont près, si peu qu'ils ont d'esprit cela mesme s'esueille[167]. Assés commun est le beau mot de cest autre la[168], qui voiant la gorge de sa femme descouuerte, laquelle il aimoit le plus, et sans laquelle il sembloit qu'il n'eust sceu viure, il la caressa de ceste belle parolle, «Ce beau col sera tantost coupé, si ie le commande.» Voilà pourquoi la plus part des tirans anciens estoient communement tués par leurs plus fauoris, qui, aians congneu la nature de la tirannie, ne se pouuoiont tant asseurer de la volonté du tiran, comme ils se deffioient de sa puissance. Ainsi fut tué Domitian[169], par Estienne; Commode, par une de ses amies mesmes[170]; Antonin[171], par Macrin; et de mesme quasi tous les autres.
[162] Que Burrhus, Senèque et Thraséas ne sont tombés dans ces inconvénients que pour avoir été gens de bien.
[163] Le manuscrit porte receu, ce qui n'a pas de sens.
[164] De Néron.
[165] Poppœa Augusta, fille de T. Ollius selon Suétone et Tacite. Néron la tua d'un coup de pied qu'il lui donna dans le temps de sa grossesse. «Poppœam (dit le premier dans la Vie de Néron, § 35,) unice dilexit. Et tamen ipsam quoque, ictu calcis, occidit.» Pour Tacite, il ajoute que c'est plutôt par passion que sur un fondement raisonnable que quelques écrivains ont publié que Poppée avait été empoisonnée par Néron. «Poppœa, dit-il, mortem obiit, fortuita mariti iracundia, a quo gravida ictu calcis afflicta est. Neque enim venenum crediderim, quamvis quidam scriptores tradant odio magis quam ex fide.» Annal., l. 16, ab initio.
[166] Voyez Suétone, dans la Vie de Néron, § 34.
[167] Sil s'agit de bien faire, les tirans restent simples, inhabiles quand ils le sont; mais s'il s'agit de commettre des cruautés, le peu d'esprit qu'ils ont s'éveille.
[168] De Caligula, lequel, dit Suétone dans sa vie, § 33, «Quoties uxoris vel amiculæ collum exoscularetur, addebat: Tam bona cervix, simul ac jussero, demetur.»
[169] Suétone, dans la Vie du Domitien, § 17.
[170] Qui se nommait Marcia.—Hérodien, l. I.
[171] Le manuscrit porte Macrin (ce qui est conforme à l'histoire); cependant la plupart des imprimés disent Marin, et à ce sujet Coste et depuis tous les éditeurs qui ont suivi cette leçon ajoutent qu'il s'agit probablement de Macrin. On sait qu'Antonin Caracalla fut tué d'un coup de poignard par un centurion nommé Martial, à l'instigation de Macrin. Voyez Hérodien, liv. 4, vers la fin.
C'est cela, que certainement le tiran n'est iamais aimé, ni n'aime. L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose sainte, elle ne se met iamais qu'entre gens de bien, et ne se prend que par une mutuelle estime; elle s'entretient, non tant par bienfaits, que par la bonne vie. Ce qui rend un ami asseuré de l'autre, c'est la connoissance qu'il a de son intégrité: les respondens qu'il en a, c'est son bon naturel, la foi, et la constance. Il n'i peut auoir d'amitié, là où est la cruauté, là où est la desloiauté, là où est l'iniustice; et entre les meschans quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas une compaignie; ils ne s'entr'aiment[172] pas, mais ils s'entrecraignent; ils ne sont pas amis, mais ils sont complices.
[172] Hæc inter bonos amicitia, inter malos factio est. Sallust., Jugurtha, c. 31.—Les imprimés portent s'entretiennent, mais le bon sens de Naigeon lui avait fait présumer qu'il fallait s'entr'aiment, ce que confirme notre manuscrit, et il avait inscrit cette supposition sur son exemplaire, où Am. Duval l'a prise pour l'insérer dans son édition.
Or, quand bien cela n'empescheroit point, ancore seroit il mal aisé de trouuer en un tiran un amour asseuree; par ce qu'estant au dessus de tous, et n'aiant point de compaignon, il est desià au delà des bornes de l'amitié qui a son vrai gibier[p. 141] en l'équalité, qui ne veut iamais clocher, ains est tousiours egale. Voilà pourquoi il y a bien entre les voleurs (ce dit on) quelque foi au partage du butin, pource qu'ils sont pairs et compaignons, et s'ils ne s'entr'aiment, au moins ils s'entrecraignent et ne veulent pas, en se des-unissant, rendre leur force moindre: mais du tiran, ceus qui sont ses fauoris n'en peuuent auoir iamais aucune asseurance, de tant qu'il a appris d'eus mesmes qu'il peut tout, et qu'il n'i a droit ni deuoir aucun qui l'oblige; faisant son estat de conter sa volonté pour raison, et n'auoir compaignon aucun, mais d'estre de tous maistre. Doncques n'est ce pas grand' pitié, que voiant tant d'exemples apparens, voiant le dangier si present, personne ne se vueille faire sage aus despens d'autrui? et que, de tant de gens s'approchans si volontiers des tirans, qu'il n'i en ait pas un qui ait l'auisement et la hardiesse de leur dire ce que dit, comme porte le conte, le renard au lyon qui faisoit le malade: «Ie t'irois volontiers voir en ta tasniere: mais ie voi assés de traces de bestes qui vont en auant vers toi, mais qui reuiennent en arriere ie n'en vois pas une[173]?»
[173] Horat., Epist. I, v. 72; Esope, fab. 137; Faerne, fab. 74; un anonyme dans le Phèdre de Barbou, p. 134; La Fontaine, VI, 14.—L. F.
Ces miserables voient reluire les tresors du tiran, et regardent tous esbahis les raions de sa braueté[174]; et, allechés de ceste clarté, ils s'approchent, et ne voient pas qu'ils se mettent dans la flamme qui ne peut faillir de les consommer: ainsi le satyre indiscret (comme disent les fables anciennes) voiant esclairer le feu trouué par Promethé, le trouua si beau, qu'il l'alla baiser, et se brusla[175]: ainsi le papillon, qui, esperant iouïr de quelque plaisir, se met dans le feu pource qu'il reluit, il esprouue l'autre uertu, celle qui brusle, ce dit le poëte toscan[176]. Mais ancore, mettons que[p. 143] ces mignons eschapent les mains de celui qu'ils seruent; ils ne se sauuent iamais du roi qui vient apres: s'il est bon, il faut rendre conte de reconnoistre au moins lors la raison: s'il est mauuais, et pareil à leur maistre, il ne sera pas qu'il n'ait aussi bien ses fauoris, lesquels communement ne sont pas contens d'auoir à leur tour la place des autres, s'ils n'ont ancore le plus souuent et les biens et les vies. Se peut il donc faire qu'il se trouue aucun, qui, en si grand péril, et auec si peu d'asseurance, vueille prendre ceste malheureuse place, de seruir en si grand'peine un si dangereus maistre? Quelle peine, quel martire est ce! vrai Dieu! estre nuit et iour après pour songer de plaire à un, et neantmoins se craindre de lui, plus que d'homme du monde; auoir tousiours l'oeil au guet, l'oreille aux escoutes, pour espier d'où viendra le coup, pour descouurir les embusches, pour sentir la mine de ses compaignons, pour auiser qui le trahit, rire à chacun, et neantmoins se craindre de tous, n'auoir aucun ni ennemi ouuert, ny ami asseuré; aiant tousiours le visage riant et le cœur[p. 144] transi, ne pouuoir estre ioieus, et n'oser estre triste!
[174] Braveté, braverie, luxe des vêtements, magnificence, de bravium (prix qu'on donnait à celui qui avait remporté la victoire dans les jeux, βραϐεῖον).
[175] Ceci est pris d'un traité de Plutarque, intitulé Comment on pourra recevoir utilité de ses ennemis, c. 2, de la traduction d'Amyot, dont voici les propres paroles: «Le satyre voulut baiser et embrasser le feu, la premiere fois qu'il le veid; mais Prometheus luy cria: Bouquin, tu pleureras la barbe de ton menton, car il brusle quand on y touche.»
[176] Il s'agit de Pétrarque: le passage auquel il est fait allusion se trouve dans le 17e sonnet:
On regrette que le trait saillant de la seconde strophe ait disparu dans l'élégante traduction de M. de Montesquiou (1842):
La même comparaison est encore employée par Pétrarque dans le sonnet 110.—L. F.
Mais c'est plaisir de considerer, qu'est ce qui leur reuient de ce grand tourment, et le bien qu'ils peuuent attendre de leur peine et de leur miserable vie. Volontiers le peuple, du mal qu'il souffre, n'en accuse point le tiran, mais ceus qui le gouuernent: ceus là, les peuples, les nations, tout le monde, à l'enui, iusques aux païsans, iusques aus laboureurs, ils sçauent leurs noms, ils dechifrent leurs vices, ils amassent sur eus mille outrages, mille vilenies, mille maudissons[177]; toutes leurs oraisons, tous leurs veus sont contre ceus là; tous leurs malheurs, toutes les pestes, toutes leurs famines, ils les leur reprochent; et si quelque fois ils leur font par apparence quelque honneur, lors mesmes ils les maugreent en leur coeur, et les ont en horreur plus estrange que les bestes sauuages. Voilà la gloire, voilà l'honneur qu'ils recoiuent de leur seruice enuers les gens, desquels quand chacun auroit une piece de leur corps, ils ne seroient pas ancore ce leur semble assés satisfaits, ni à demisaoulés de leur peine; mais certes, ancore apres qu'ils sont morts, ceus qui viennent apres ne sont iamais si paresseus, que le nom de ces mangepeuples[178] ne soit noirci[p. 145] de l'encre de mille plumes, et leur reputation deschirée dans mille liures, et les os mesmes, par maniere de dire, traînés par la posterité, les punissans, ancore apres leur mort, de leur meschante vie[179].
[177] Maudisson, maldécéon, maleicéon, malédiction.
[178] C'est la qualification qu'Homère donne à un roi (Iliad., A, v. 341), Δημοϐὸρος βασιλεὺς. Je trouve dans Plutarque que Caton le Censeur (vie de ce philosophe) applique au même personnage une expression analogue «Εστω «εἷπεν» άλλὰ φύσει τοῦτο τὁ ζῶο δ βασιλεὺς σαρϰοφἀγον ἑστἰν.»
[179] «On dira que les republiques n'ont iamais soufert les excellans hommes et fera discours de Nemesis.»—H. de M.
Aprenons donc quelque fois, aprenons à bien faire: leuons les yeulx vers le ciel, ou pour nostre honneur, ou pour l'amour mesmes de la vertu, ou certes, à parler à bon escient pour l'amour et honneur de[180] Dieu tout puissant, qui est asseuré tesmoin de nos faits, et iuste iuge de nos fautes[181]. De ma part, ie pense bien, et ne suis pas trompé, puis qu'il n'est rien si contraire à Dieu, tout liberal et debonnaire[182] que la tirannie, qu'il reserue là bas à part pour les tirans et leurs complices quelque peine particuliere.
[180] Ce qui est souligné ne se lit dans aucune édition; de sorte que la phrase est complétement inintelligible.
[181] A quoi H. de Mesmes ajoute: «qui bien fera bien trouuera.»
[182] D'après M. Genin, on a tort de mettre un accent aigu sur la première syllabe de ce mot, dont l'étymologie est en effet de bonne aire: de là cette métaphore empruntée à la fauconnerie «qui a été si longtemps, comme le remarque H. Estienne, en grande recommandation à nostre France.» (Projet du livre de la Précellence.) L. F.
1º Notice bibliographique sur Montaigne, insérée en tête de l'édition des Essais dans le Panthéon littéraire, augmentée et imprimée à part, à petit nombre; Paris, Duverger, in-8º, 1837, distribuée à cinquante exemplaires.
(N'a pas été mise dans le commerce.)
2º Documents inédits ou peu connus sur Montaigne; Paris, Techener, in-8º, portrait, fac-simile, 1847. (Épuisés.)
3º Nouveaux Documents inédits ou peu connus sur Montaigne; Paris, Jannet, 1850, in-8º, fac-simile.
4º De Christophe Kormart et de son analyse des Essais de Montaigne.
Article inséré dans le Journal de l'Amateur de livres, et tiré à part à trente exemplaires, qui n'ont pas été mis dans le commerce.—Paris, Guiraudet, 1849, in-8º.
5º Note bibliographique sur Étienne de la Boetie, dans le Bulletin du Bibliophile de Techener, nº 20, 1846.