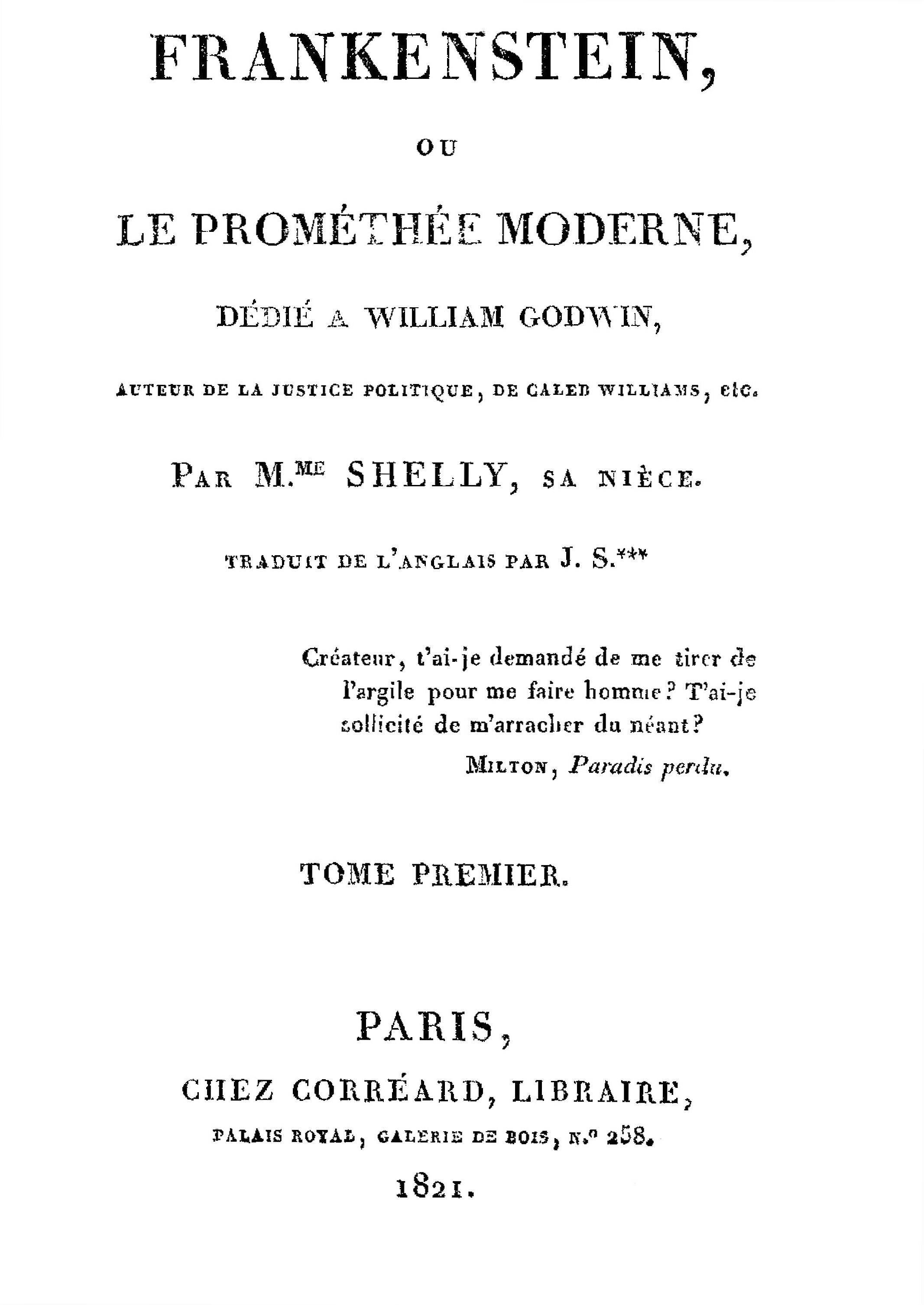
Title: Frankenstein, ou le Prométhée moderne Volume 1 (of 3)
Author: Mary Wollstonecraft Shelley
Translator: Jules Saladin
Release date: June 20, 2020 [eBook #62404]
Most recently updated: October 18, 2024
Language: French
Credits: Produced by Laura Natal Rodrigues at Free Literature (Images
generously made available by Gallica, Bibliothèque nationale
de France.)
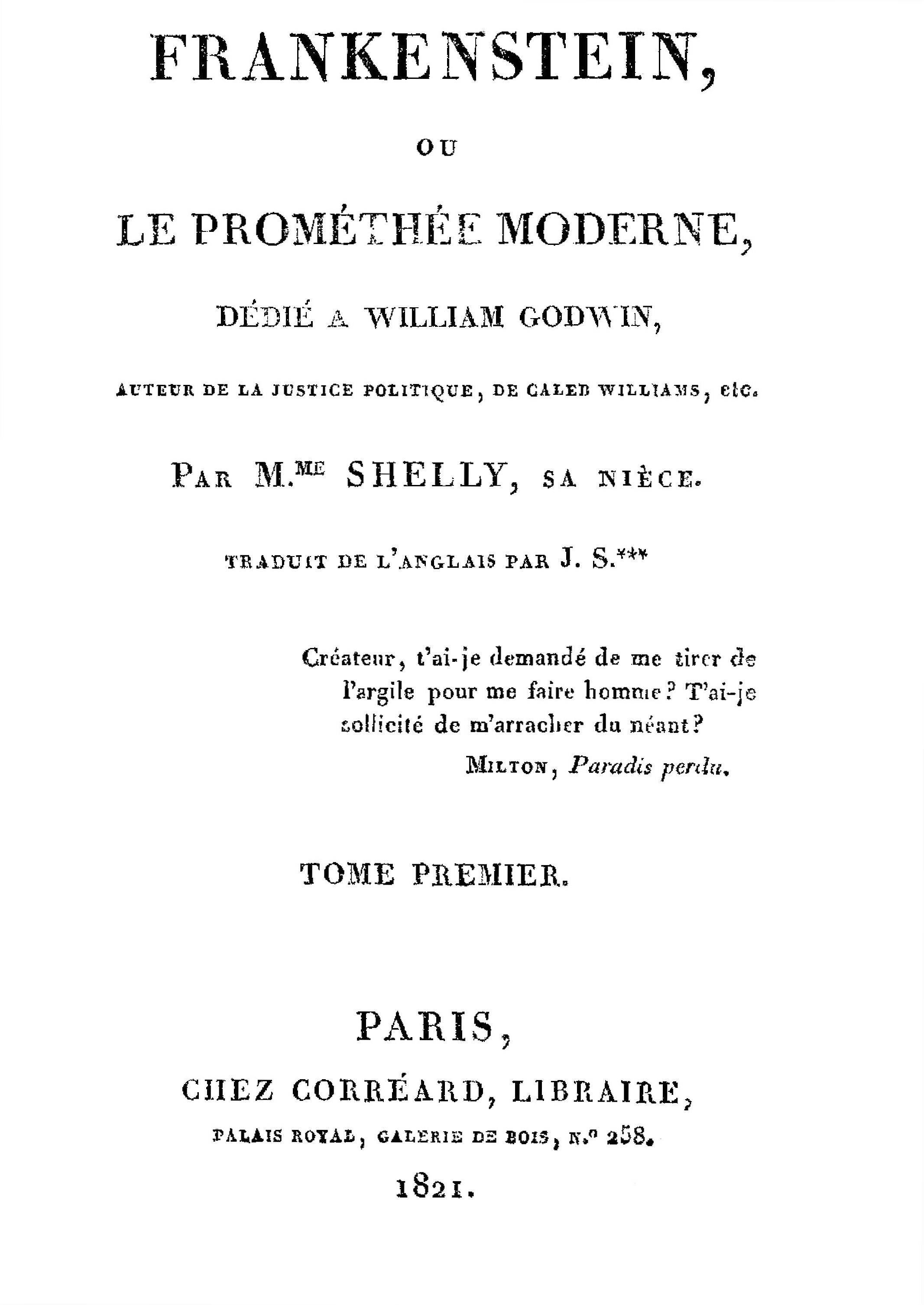
Créateur, t'ai-je demandé de me tirer de
l'argile pour me faire homme? T'ai-je
sollicité de m'arracher du néant?
MILTON, Paradis perdu.
TABLE
PRÉFACE
LETTRE Ière
LETTRE II
LETTRE III
LETTRE IV
CHAPITRE Ier
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
Le fait sur lequel repose cette fiction, n'a point paru impossible au docteur Darwin, et à quelques-uns des Écrivains physiologiques de l'Allemagne. Je ne veux pas laisser croire que je suis porté à y ajouter sérieusement foi. Cependant, en le prenant pour base d'un ouvrage d'imagination, je n'ai pas voulu simplement offrir une suite d'histoires effrayantes et surnaturelles. L'événement dont dépend l'intérêt de cette histoire, sans présenter aucun des défauts d'un pur conte de spectres ou d'enchantements, se recommande par la nouveauté des situations qui y sont développées; et, malgré l'impossibilité du fait matériel, retrace à l'imagination les passions humaines, d'un point de vue plus étendu et plus élevé que ceux où l'on peut se placer dans le cours ordinaire de la vie.
Ainsi, j'ai essayé de conserver la vérité des principes élémentaires de la nature humaine, tandis que je ne me suis pas fait scrupule d'innover dans leurs combinaisons. Homère, dans l'Iliade; les Poètes tragiques de la Grèce; Shakespeare, dans la Tempête et le Songe au milieu d'une nuit d'été; et plus particulièrement Milton, dans le Paradis perdu, se conforment à cette règle; et le plus modeste nouvelliste, qui cherche à plaire ou à s'amuser par son travail, peut, sans présomption, appliquer à ce qu'il raconte, une licence ou plutôt une règle de l'adoption de laquelle sont résulté tant de combinaisons profondes des sentiments humains dans les chefs-d'œuvre les plus sublimes de la poésie.
La circonstance sur laquelle mon histoire est fondée, m'a été suggérée par hasard dans une conversation. Elle fut commencée en partie comme source d'amusement, et en partie comme moyen d'exercer les facultés négligées de l'esprit. D'autres motifs s'y sont mêlés, à mesure que le travail avançait. Je ne suis nullement indifférent aux sensations morales dont sera affecté le lecteur sur les sentiments et les caractères qui y sont tracés; cependant mon premier soin s'est borné à éviter l'effet énervant que produisent les romans du jour, et à montrer le charme des affections domestiques ainsi que l'excellence de la vertu universelle. Les opinions, produites naturellement d'après le caractère et la position du héros, ne doivent pas être considérées comme le fruit de ma conviction personnelle; et rien de ce qui est contenu dans cet ouvrage, ne doit être regardé comme portant attaque à quelque doctrine philosophique, de quelque genre que ce soit.
Un autre motif, qui ajoute à l'intérêt de l'auteur, c'est que cette histoire a été commencée dans le pays majestueux où se passe la plus grande partie de l'action, et dans une société qu'il ne peut cesser de regretter.
Je passai l'été de 1816 dans les environs de Genève. La saison était froide et pluvieuse: nous nous réunissions le soir autour d'un foyer, et nous nous amusions à lire, de temps en temps, quelques histoires allemandes d'êtres surnaturels, que le hasard faisait tomber entre nos mains. Ces contes nous donnaient un vif désir de les imiter. Nous convînmes avec deux de mes amis (dont l'un composa un roman qui ferait plus de plaisir au Public que je ne puis l'espérer pour moi-même), d'écrire chacun une histoire fondée sur quelqu'aventure extraordinaire.
Cependant le temps devint beau tout-à-coup, et mes deux amis me quittèrent pour faire un voyage dans les Alpes. Ils perdirent, au milieu des scènes magnifiques que présentent ces montagnes, tout souvenir de nos visions spirituelles. Le Roman suivant est le seul qui ait été achevé.
Saint-Pétersbourg, 11 décembre 17—
«Vous serez bien aise d'apprendre qu'aucun malheur n'a troublé le commencement d'une entreprise que vous avez envisagée avec de funestes pressentiments. Je suis arrivé ici hier, et mon premier devoir est d'informer ma chère sœur que ma santé est bonne, et ma confiance plus grande dans le succès de mon entreprise.
»Je suis déjà loin au nord de Londres; et, quand je me promène dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens se jouer sur mes joues la brise froide du nord qui me resserre les nerfs et me remplit de volupté. Comprenez-vous cette sensation? Cette brise, qui est venue des régions à travers lesquelles je m'avance, me donne un avant-goût de ces climats glacés. Inspiré par ce vent précurseur, je sens que mes idées deviennent plus ardentes et plus vives. Je m'efforce en vain de me persuader que le pôle est le siège de la glace et de la désolation, il se présente toujours à mon imagination comme le pays de la beauté et du plaisir. Là, Marguerite, le soleil est toujours visible; son large disque borde presque l'horizon, et répand un éclat perpétuel. De là (car, avec votre permission, ma sœur, j'aurai quelque confiance dans les navigateurs qui m'ont précédé), de là, dis-je, la neige et la glace sont bannies; et, naviguant sur une mer calme, on peut être transporté dans une terre qui surpasse en prodiges et en beauté tous les pays jusqu'ici découverts sur le monde habitable. Ses productions et ses traits peuvent être sans exemple, comme les phénomènes des corps célestes le sont, sans doute, dans ces solitudes inconnues. Que ne peut-on pas espérer dans un pays où brille une lumière éternelle? J'y découvre la puissance étonnante qui attire l'aiguille; et je puis fixer une foule d'observations célestes qui n'ont besoin que de ce voyage pour rendre invariables leurs excentricités apparentes. Je rassasierai mon ardente curiosité, en voyant une partie du monde qui n'a jamais été visitée avant moi, et je puis fouler une terre qui n'a jamais été pressée par les pieds d'un mortel. Voilà ce qui m'attire, et cela me suffit pour bannir toute crainte du danger ou de la mort, et m'encourager à commencer ce pénible voyage avec la joie qu'éprouve un enfant lorsqu'il s'embarque sur un petit bateau un jour de fête, avec ses camarades, pour l'expédition d'une découverte sur la rivière qui baigne son pays natal. Mais, en supposant que toutes ces conjectures soient fausses, vous ne pouvez contester le service inappréciable que je rendrai à toute l'espèce humaine, jusqu'à la dernière génération, en découvrant, près du pôle, un passage à ces contrées, où, pour arriver, il faut maintenant plusieurs mois; ou bien en constatant le secret du magnétisme, ce qui, à moins que ce ne soit impossible, ne peut avoir lieu que par une entreprise comme la mienne.
»Ces réflexions ont calmé l'agitation avec laquelle j'ai commencé ma lettre, et je sens mon cœur se remplir d'un enthousiasme qui m'élève jusqu'au ciel; car rien ne contribue tant à tranquilliser l'esprit qu'un projet bien ferme, sur lequel on puisse fixer son attention. Cette expédition a été le songe favori de mes premières années. J'ai lu avec ardeur les récits des différents voyages qui ont été faits dans le but d'arriver à l'océan pacifique du nord, à travers les mers qui entourent le pôle. Vous devez vous souvenir, que l'histoire de tous les voyages entrepris dans l'intention de faire des découvertes, composait la bibliothèque entière de notre bon oncle Thomas. Mon éducation fut négligée; cependant j'aimais la lecture avec passion. J'étudiais ces livres nuit et jour; et la connaissance que j'en eus, augmenta le regret que j'avais éprouvé, comme un enfant, en apprenant que mon père, au lit de la mort, avait défendu à mon oncle de me laisser embrasser l'état de marin.
»Ces visions s'affaiblirent lorsque je lus, pour la première fois, ces poètes dont les effusions pénétraient mon âme et l'élevaient jusqu'au ciel. Je devins poète aussi, et pendant une année je vécus dans un paradis de ma propre création. Je pensais pouvoir obtenir aussi une place dans le temple où sont consacrés les noms d'Homère et de Shakespeare. Vous savez combien je me trompai, et quelle peine j'eus à supporter mon malheur. Mais, justement, à cette époque, j'héritai de la fortune de mon cousin, et mes pensées se reportèrent à mes premières inclinations.
»Six ans se sont écoulés depuis que j'ai pris la résolution que j'exécute en ce moment. Je puis, même à présent, me souvenir de l'heure où je me suis dévoué à cette grande entreprise. J'ai commencé par accoutumer mon corps à la fatigue. J'ai accompagné les pêcheurs de baleine dans plusieurs expéditions à la mer du Nord; j'ai enduré volontairement le froid, la faim, la soif et l'insomnie; souvent, pendant le jour, je supportais des travaux plus rudes qu'aucun des matelots, et je passais mes nuits à étudier les mathématiques, la théorie de la médecine, et ces branches de science physique dont un homme ami des entreprises maritimes peut souvent tirer le plus grand avantage. Deux fois même je me suis engagé comme contremaître, pour la pêche du Groenland, et je me suis acquitté à merveille de mes fonctions. Je dois avouer que je sentis un petit mouvement d'orgueil, lorsque le capitaine m'offrit la seconde dignité du vaisseau, et me supplia de rester, avec le plus grand empressement, tant il appréciait mes services.
»Et maintenant, ma chère Marguerite, ne mérité-je pas d'accomplir quelque grand projet. J'aurais pu passer ma vie dans l'aisance et le plaisir; mais j'ai préféré ma gloire à tous les attraits que la richesse plaçait devant moi. Ah! que quelque voix encourageante me réponde du succès! mon courage et ma résolution sont inébranlables; mais mes espérances sont incertaines, et mon esprit est souvent humilié. Je vais entreprendre un voyage long et difficile; les dangers que je courrai demanderont tout mon courage: j'aurai besoin non-seulement de relever les esprits des autres, mais quelquefois de soutenir les miens lorsque les leurs se découragent et s'abattent.
»Cette saison est la plus favorable pour voyager en Russie. On vole sur la neige dans des traîneaux; le mouvement en est doux, et, à mon avis, beaucoup plus agréable que celui d'une diligence anglaise. Le froid n'est pas excessif, lorsqu'on est enveloppé de fourrures; et j'ai déjà adopté ce costume, car il y a une grande différence de se promener sur un pont, ou de rester assis pendant plusieurs heures, sans faire un mouvement et sans qu'aucun exercice n'empêche le sang de se glacer dans les veines. Je n'ai nullement l'ambition de perdre la vie sur la grande route entre Saint-Pétersbourg et Archangel.
»Je partirai pour cette dernière ville dans quinze jours ou trois semaines; et mon intention est d'y louer un vaisseau, ce qui est bien facile en payant caution au propriétaire, et d'engager autant de matelots que je croirai nécessaires parmi ceux qui sont accoutumés à la pêche de la baleine. Je ne compte pas mettre à la voile avant le mois de juin: et quand reviendrai-je? Ah! ma chère sœur comment répondre à cette question? Si je réussis, bien des mois, des années peut-être s'écouleront avant que nous puissions nous voir. Dans le cas contraire, vous me reverrez bientôt, ou jamais.
»Adieu, ma chère, mon excellente Marguerite, que le ciel verse sur vous ses bénédictions, et qu'il me conserve, afin que je puisse vous témoigner sans cesse ma reconnaissance pour toute votre amitié et vos bontés.
»Votre affectionné frère,
»R. WALTON».
Archangel, 28 mars 17—
«Que le temps passe lentement ici, entouré comme je suis par la glace et la neige! Cependant, j'ai fait un second pas dans mon entreprise; j'ai loué un vaisseau, et je suis occupé à rassembler mes marins, ceux que j'ai déjà engagés paraissent être des hommes sur lesquels je puis compter, et sont doués, sans en pouvoir douter, d'un courage intrépide.
»Mais il est un objet, un seul objet dont je n'ai pu encore jouir, et l'absence de ce bien est pour moi le plus grand des maux. Je n'ai pas d'amis, Marguerite: si je suis animé par l'enthousiasme du succès, je n'aurai personne pour partager ma joie; si je tombe dans le découragement, personne n'essaiera de relever mon courage. Je confierai mes pensées au papier, il est vrai; mais c'est une triste ressource pour l'épanchement de ce qu'on éprouve. Je voudrais avoir pour compagnon un homme capable de sympathiser avec moi, dont les yeux répondissent aux miens. Vous pouvez me croire romantique, ma chère sœur; mais je sens cruellement le manque d'un ami. Que n'ai-je auprès de moi une personne qui soit en même temps douce et courageuse, douée à la fois d'un esprit cultivé et capable, dont les goûts ressemblent aux miens, et qui puisse approuver ou corriger mes plans. Combien un semblable ami réparerait les fautes de votre pauvre frère! Je suis trop ardent dans l'exécution, et trop impatient des difficultés: mais ce qui est pour moi un malheur encore plus grand, c'est que je n'ai reçu qu'une demi-éducation; car pendant les quatorze premières années de ma vie, je courais dans les bois çà et là, et ne lisais que les livres de voyages de notre bon oncle Thomas. À cet âge je devins familier avec les poètes célèbres de notre patrie; je sentis aussi la nécessité d'apprendre d'autres langues que celle de mon pays natal; mais cette conviction fut chez moi trop tardive pour que je pusse en recueillir les plus précieux avantages. J'ai maintenant vingt-huit ans, et suis en vérité plus illettré que bien des écoliers de quinze ans. Il est vrai que j'ai réfléchi davantage, et que mes idées sont plus étendues et plus grandes; mais, comme disent les peintres, elles manquent de fond, et j'ai bien besoin d'un ami qui ait assez de bon sens pour ne pas me regarder comme un romantique, et qui m'affectionne assez pour essayer de régler mon esprit.
»Plaintes inutiles! ce n'est certainement pas sur le vaste Océan que je trouverai un ami, non plus qu'à Archangel au milieu des marchands et des marins. Cependant il y a place, dans ces cœurs, à des sentiments qui semblent ne pouvoir s'allier avec l'écume de la nature humaine. Mon lieutenant, par exemple, est un homme d'un grand courage et d'une audace étonnante. Il aime la gloire avec passion. C'est un Anglais; et au milieu des préjugés de son pays et de son état, qui ne sont pas adoucis par la culture, il conserve quelques-unes des plus nobles qualités de l'humanité. J'ai fait autrefois sa connaissance à bord d'un bâtiment destiné à la pèche de la baleine; je l'ai retrouvé dans cette ville sans occupation, et je l'ai facilement engagé à m'assister dans mon entreprise.
»Le maître est un homme d'un talent très-distingué, et se fait remarquer sur le vaisseau par sa modération et la douceur de sa discipline. Il est vraiment d'un naturel si bon, qu'il ne chassera pas (amusement favori, et presque le seul qu'on trouve ici), parce qu'il ne peut souffrir de verser le sang; en outre, il est d'une générosité héroïque. Il y a quelques années qu'il était amoureux d'une demoiselle Russe, qui n'avait qu'une fortune médiocre. Possesseur d'un capital considérable, amassé dans ses courses maritimes, il obtint sans peine que le père de la jeune fille consentît au mariage. Il la vit une fois avant le jour de la cérémonie: elle était baignée de larmes; elle tomba à ses pieds, le supplia de l'épargner, et lui avoua en même temps qu'elle aimait un jeune Russe, mais qu'il était pauvre, et que son père ne voudrait jamais les unir. Mon généreux ami rassura cette malheureuse personne, s'informa du nom de son amant, et abandonna de suite toute prétention. Il avait déjà acheté, de son argent, une ferme dans laquelle il avait le dessein de passer le reste de sa vie; mais il donna tout à son rival, et pour qu'il pût acheter du bétail, il joignit à son premier don le reste de ses profits dans les prises. Il sollicita lui-même le père de la jeune fille, pour qu'il consentît à l'unir avec celui qu'elle aimait; mais le vieillard se croyant engagé d'honneur avec mon ami, refusa obstinément. Celui-ci, pour fléchir l'inexorable père, quitta son pays, et n'y revint que lorsqu'il apprit que sa maîtresse était mariée suivant son inclination. «Quel noble compagnon»! vous écrierez-vous. Tel est son caractère; mais il a passé sa vie entière à bord d'un vaisseau, et à peine a-t-il une idée hors des cordages et d'un hauban.
Mais si je me plains un peu, ou si je puis concevoir dans mes travaux une consolation que peut-être je ne connaîtrai jamais, ne croyez pas que je sois incertain dans mes résolutions; elles sont invariables comme le destin; et mon voyage n'est maintenant différé, que jusqu'à ce que le temps me permette de mettre à la voile. L'hiver a été horriblement dur; mais le printemps s'annonce favorablement, et cette saison parait même fort avancée. Ainsi, je m'embarquerai peut-être plutôt que je ne m'y étais attendu. Je ne ferai rien avec témérité; vous me connaissez assez pour avoir confiance en ma prudence et en ma circonspection, toutes les fois que la sûreté des autres est commise à mes soins.
»Je ne puis vous dépeindre tout ce que j'éprouve en me voyant si près de mettre mon entreprise à exécution. Il est impossible de vous donner une idée de cette sensation incertaine, agréable et pénible à la fois, qui m'agite au moment de mon départ. Je vais dans des régions inconnues, dans la patrie des brouillards et de la neige; mais je ne tuerai aucun albatros[1], ne soyez donc pas alarmée sur mon sort.
»Vous reverrai-je encore, après avoir traversé des mers immenses, et après avoir doublé le cap le plus au sud de l'Afrique ou de l'Amérique? Je ne puis m'attendre à un pareil bonheur; et cependant je n'ose regarder le revers du tableau. Continuez à m'écrire par toutes les occasions: je puis recevoir vos lettres (quoique la chance soit fort douteuse) au moment où j'en aurai le plus besoin pour soutenir mon courage. Adieu, adieu, je vous aime bien tendrement. Souvenez-vous de moi avec affection, dussiez-vous même ne plus entendre parler de votre affectionné frère.
»ROBERT WALTON».
[1]Oiseau de mer.
7 juillet 17—
Ma chère sœur,
«Je vous écris quelques lignes à la hâte, pour vous dire que je suis en bonne santé, et fort avancé dans mon voyage. Cette lettre parviendra en Angleterre par la voie d'un marchand qui retourne d'Archangel dans sa famille; il est plus heureux que moi, qui, pendant quelques années, ne pourrai peut-être revoir ma patrie. Je suis cependant dans de bonnes dispositions: mes hommes sont courageux et semblent fermes dans leurs projets. Ils ne paraissent pas découragés par les bancs de glaces que nous rencontrons continuellement, et qui nous indiquent les dangers du pays vers lequel nous nous dirigeons. Nous avons déjà atteint une latitude très-élevée, mais nous sommes dans le fort de l'été, et quoiqu'il ne fasse pas aussi chaud qu'en Angleterre, les vents du sud qui nous portent avec vitesse vers les rives où je désire si ardemment arriver, renouvellent sans cesse une chaleur à laquelle je ne m'étais pas attendu.
»Jusqu'ici nul événement qui soit digne d'être rappelé. Un ou deux coups de vent et un mât brisé, sont des accidents dont un navigateur expérimenté se souvient à peine de faire mention; et je serai bien heureux, s'il ne nous arrive rien de pire pendant notre voyage.
»Adieu, ma chère Marguerite. Soyez sûre que, par amour pour vous et pour moi-même, je n'irai pas témérairement au-devant du danger. Je serai froid, persévérant et prudent.
»Rappelez-moi à tous mes amis d'Angleterre.
»Votre très-affectionné,
»ROBERT WALTON».
5 août 17—
«Nous venons d'être témoins d'un événement si étrange, que je ne puis m'empêcher de vous en faire part, quoiqu'il soit très-probable que vous me voyez avant que ce journal ne puisse vous parvenir.
»Lundi dernier (31 juillet), nous étions presque renfermés par la glace qui entourait le vaisseau de tous côtés, et lui laissait à peine un espace dans lequel il flottait. Un brouillard épais, dont nous étions enveloppés, rendait notre situation assez dangereuse. Nous n'eûmes rien de mieux à faire qu'à rester en place, jusqu'à ce qu'il y eût un changement dans l'atmosphère et le temps.
»Vers deux heures, le brouillard se dissipa, et nous vîmes flotter, de toutes parts, des îles de glace immenses et irrégulières, qui paraissaient n'avoir pas de bornes. Quelques-uns de mes compagnons se lamentaient, et mon esprit commençait à être agité d'inquiètes pensées, lorsque tout à coup notre attention fut attirée par un objet singulier, qui fit diversion à l'inquiétude que nous inspirait notre situation. Nous vîmes un chariot bas, fixé sur un traîneau et tiré par des chiens, passer au nord, à la distance d'un demi-mille: un être, qui avait la forme d'un homme, mais qui paraissait d'une stature gigantesque, était assis dans le traîneau et guidait les chiens. Nous observâmes, avec nos télescopes, la rapidité de la course du voyageur, jusqu'à ce qu'il fût perdu au loin parmi les inégalités de la glace.
»Cette vue excita parmi nous un étonnement dont nous ne pûmes nous rendre compte. Nous pensions être éloignés de terre de plusieurs cents milles; mais cette apparition sembla prouver que la distance n'était réellement pas aussi grande que nous avions pu le croire. Cependant, cernés par la glace, il nous fut impossible de suivre la trace de ce que nous avions observé avec la plus grande attention.
»Environ deux heures après cette rencontre, nous entendîmes le craquement de la mer; et avant la nuit la glace se rompit, et débarrassa notre vaisseau. Néanmoins, nous restâmes en place jusqu'au matin, dans la crainte de choquer, dans l'obscurité, contre ces grandes masses détachées qui flottent de tous côtés après la rupture de la glace. Je profitai de ce moment pour me reposer pendant quelques heures.
»Dans la matinée, cependant, dès qu'il fut jour, je montai sur le pont, et trouvai tous les matelots rassemblés d'un seul côté du vaisseau, et ayant l'air de parler à quelqu'un qui était dans la mer. En effet, un traîneau semblable à celui que nous avions vu auparavant, s'était dirigé vers nous, pendant la nuit, sur un large morceau de glace. Il était conduit par un seul chien en vie, et portait un homme auquel les matelots tâchaient de persuader d'entrer dans le bâtiment. Ce n'était pas, comme l'autre voyageur le paraissait, un habitant sauvage de quelqu'île inconnue, mais un Européen. Lorsque je parus sur le pont, le contre-maître lui dit: «Voici notre capitaine, il ne vous laissera pas périr au milieu de la mer».
»En me voyant, l'étranger m'adressa la parole en anglais, quoiqu'avec un accent étranger. «Avant que j'entre à bord de votre bâtiment, dit-il, voulez-vous avoir la bonté de m'informer de quel côté vous vous dirigez»?
»Vous devez concevoir mon étonnement, de m'entendre adresser une semblable question par un homme qui était sur le bord de l'abîme, et à qui mon vaisseau devait paraître un bien plus précieux, que tous ceux dont on puisse jouir, sur la terre. Je répondis cependant que nous faisions un voyage de découverte vers le pôle du nord.
»Il parut alors satisfait, et consentit à venir à bord. Bon Dieu! Marguerite, si vous aviez vu l'homme qui capitulait ainsi pour son salut, vous n'auriez pu revenir de votre surprise. Ses membres étaient presque gelés, et son corps horriblement maigri par la fatigue et la souffrance. Je n'ai jamais vu d'homme dans un état aussi pitoyable. Nous essayâmes de le porter dans la chambre; mais dès qu'il eut quitté le grand air, il s'évanouit. Nous le reportâmes donc sur le pont, et le rendîmes à la vie en le frottant d'eau-de-vie et en le forçant d'en avaler un peu. Dès qu'il montra signe de vie, nous eûmes soin de l'envelopper dans des couvertures, et de le placer auprès de la cheminée du poêle de cuisine. Il recouvra lentement connaissance, et mangea une petite soupe qui le restaura merveilleusement.
»Deux jours se passèrent ainsi, sans qu'il fût capable de parler; et je craignais souvent que ses souffrances ne l'eussent privé de la raison. Lorsqu'il fut un peu rétabli, je le mis dans ma chambre, et eus pour lui autant de soin que mes devoirs purent me le permettre. Je n'ai jamais vu un être plus intéressant: ses yeux ont ordinairement une expression de fureur, et même de folie; mais, dans certains moments, quand on a une attention pour lui, ou qu'on lui rend le plus léger service, toute sa figure est adoucie, et sa physionomie respire un sentiment de bienveillance et de douceur tel que je n'ai jamais vu. Il est ordinairement plongé dans la mélancolie et le désespoir; quelquefois même il grince les dents, comme s'il n'était plus capable de supporter le poids des malheurs qui l'accablent.
»Lorsque mon hôte fut un peu rétabli, j'eus beaucoup de peine à éloigner ceux qui voulaient lui faire une foule de questions; car je ne voulais pas le laisser tourmenter par leur inutile curiosité, dans un état de corps et d'âme dont l'amélioration dépendait évidemment d'un entier repos. Une seule fois, cependant, le lieutenant lui demanda pourquoi il était venu si loin sur la glace, dans un équipage si singulier.
»Sa figure prit aussitôt l'expression du plus profond chagrin; et il répliqua: «Afin de poursuivre quelqu'un qui me fuyait.—Et l'homme que vous poursuiviez, voyageait-il de la même manière?—Oui, dit-il.—Alors je crois que nous l'avons vu; car, la veille du jour où nous vous avons rencontré, nous avions aperçu quelques chiens tirant à travers la glace, un traîneau dans lequel était un homme».
»Ce peu de mots éveilla l'attention de l'étranger; et il fit une multitude de questions pour savoir la route qu'avait tenue le démon (c'est ainsi qu'il l'appelait). Bientôt après, lorsqu'il fut seul avec moi, il me dit: «J'ai, sans doute, excité votre curiosité, aussi bien que celle de ces braves gens; mais vous êtes trop délicat pour me faire des questions.
»—Certainement; il serait très-indiscret et très-inhumain de ma part de vous faire de la peine pour satisfaire ma curiosité personnelle.
»—Et cependant vous ni avez tiré d'une position étrange et dangereuse; vous m'avez généreusement rendu à la vie».
»Ensuite il me demanda si je croyais que la rupture de la glace eût anéanti l'autre traîneau. Je lui dis que je ne saurais répondre avec certitude; car la glace ne s'était guère brisée avant minuit, et le voyageur pouvait être arrivé ayant ce temps en lieu de sûreté; mais que je n'en pouvais juger.
»Depuis ce temps, l'étranger paraissait très-empressé à être sur le pont, pour épier le traîneau qu'on avait vu auparavant; mais je l'ai engagé à rester dans la chambre, car il est beaucoup trop faible pour soutenir la rigueur de l'atmosphère. J'ai promis que l'on observerait pour lui, et qu'il serait averti sur-le-champ, si quelque nouvel objet s'offrait à la vue.
»Voilà mon journal jusqu'aujourd'hui, sur ce qui a rapport à notre étrange rencontre. L'étranger a insensiblement recouvré la santé, mais il est très-silencieux, et parait embarrassé lorsqu'un autre que moi entre dans sa chambre. Cependant, ses manières sont si engageantes et si douces, que les matelots s'intéressent tous à son sort, quoiqu'ils aient eu très-peu de communication avec lui. Pour moi, je commence à l'aimer comme un frère; et son chagrin profond et continuel m'attire vers lui, et m'inspire de la compassion. Il faut qu'il ait été un homme bien remarquable dans des jours plus heureux pour lui, puisque dans le malheur il est encore si attrayant et si aimable.
»Je disais dans une de mes lettres, ma chère Marguerite, que je ne trouverais pas d'amis sur le vaste Océan, et pourtant j'ai trouvé un homme que mon cœur aurait été heureux d'aimer comme un frère, avant que son âme eut été brisée par le malheur.
»Je continuerai de temps en temps mon journal sur cet étranger, si j'ai quelque chose de nouveau à vous apprendre».
13 août 17—
«Mon affection pour mon hôte augmente de jour en jour. Il excite du moins mon admiration et ma pitié d'une manière étonnante. Comment pourrai-je voir un être aussi noble abîmé par le malheur, sans éprouver la plus vive douleur? Il est si doux et si sage à la fois; son esprit est si cultivé; et lorsqu'il parle, ses paroles, quoique choisies avec l'art le plus délicat, coulent avec une rapidité et une éloquence incomparables.
»Il est maintenant très-bien rétabli, et il se tient continuellement sur le pont, pour épier sans doute le traîneau qui a précédé le sien. Cependant, quelque malheureux qu'il soit, il n'est pas si entièrement occupé de sa propre infortune, qu'il ne s'intéresse vivement aux occupations des autres. Il m'a fait beaucoup de questions sur mon projet, et je lui ai raconté franchement ma petite histoire. Il a paru charmé de la confidence et a fait sur mon plan plusieurs observations dont je pourrai faire mon profit. Il n'y a pas de pédanterie dans ses manières, et tout ce qu'il fait semble ne provenir que de l'intérêt qu'il prend naturellement au bien-être de ceux qui l'entourent. Il est souvent abattu par le chagrin, et alors il s'observe beaucoup, et cherche à chasser tout ce qu'il y a de sombre ou d'insociable dans son humeur. Ces paroxysmes fuient devant lui comme un nuage devant le soleil, quoique sa tristesse ne l'abandonne jamais. J'ai tâché de gagner sa confiance, et je crois y avoir réussi. Je lui parlais un jour du désir que j'avais de trouver un ami qui pût sympathiser avec moi et me diriger de ses conseils. Je lui dis que je n'appartenais pas à cette classe d'hommes qui s'offensent d'un avis. «Je n'ai reçu qu'une demi-éducation, et je ne puis avoir assez de confiance en mes propres moyens. Je désire donc que mon compagnon soit plus sage et plus expérimenté que moi, afin de m'affermir et de me soutenir; je n'ai pas cru qu'il fût impossible de trouver un véritable ami».
«Je conviens avec vous, répliqua l'étranger, que l'amitié est non-seulement un bien désirable, mais possible. J'eus autrefois un ami, dont l'âme était la plus noble qui fut sous le ciel: il m'est donc permis de juger de la véritable amitié. Vous avez l'espérance et le monde devant vous: ne désespérez de rien. Mais moi.... j'ai tout perdu, et je ne puis recommencer une nouvelle vie».
»En disant ces paroles, sa figure prit l'expression d'un chagrin calme et profond, qui me toucha le cœur. Il se tut et se retira bientôt dans sa chambre.
»Malgré l'abattement de son esprit, personne ne peut jouir plus vivement que lui des beautés de la nature. Un ciel étoilé, la mer et toutes les vues que présentent ces régions étonnantes semblent encore avoir le pouvoir d'élever son âme au-dessus de la terre. Un tel homme a une double existence: il peut supporter le malheur et être accablé par les revers; quand il est rentré en lui-même, on dirait d'un esprit céleste, entouré d'un nuage au travers duquel le chagrin ou la folie ne peuvent pénétrer.
»Si vous riez de l'enthousiasme avec lequel je m'exprime sur cet aventurier extraordinaire, vous devez avoir certainement perdu de cette simplicité qui était autrefois votre charme caractéristique. Cependant, si vous le voulez, souriez de la chaleur de mes expressions, tandis que j'ai tous les jours de nouveaux sujets de les répéter».
19 août 17—
«L'étranger me dit hier: «Vous pouvez voir facilement, capitaine Walton, que j'ai éprouvé de grands et incomparables malheurs. J'étais décidé d'abord à ensevelir avec moi le souvenir de ces maux, mais vous avez changé ma résolution. Vous cherchez les connaissances et la sagesse; moi aussi j'ai cherché ces biens. J'espère avec ardeur que l'accomplissement de vos vœux ne deviendra pas pour vous, comme pour moi, une cause de douleur. Je ne sais si l'histoire de mes infortunes vous sera utile; mais si vous le désirez, je vous en ferai le récit. Je crois que les événements étranges qui se lient à ma destinée, vous feront envisager la nature sous un point de vue capable d'agrandir vos facultés et votre intelligence. Vous entendrez parler de puissances et d'aventures que vous êtes habitué à croire impossibles. Mais je ne doute pas que mon histoire ne porte avec elle l'évidence de la vérité des événements qui la composent».
»Vous devez concevoir facilement que je fus enchanté d'une offre de ce genre. Cependant je craignais qu'il ne renouvelât sa douleur par le récit de ses infortunes. Je sentis le plus vif empressement d'entendre l'histoire qu'il m'avait promise, tant pour satisfaire ma curiosité, que par un grand désir d'améliorer son sort, s'il était en mon pouvoir. Je lui exprimai ces sentiments dans ma réponse.
»Je vous remercie, répliqua-t-il, de votre bonne volonté, mais elle est inutile; ma destinée est presque accomplie. Je n'attends plus qu'une chose, et alors je reposerai en paix. Je vous comprends, continua-t-il, en s'apercevant que je voulais l'interrompre; mais vous vous trompez, mon ami, si vous me permettez de vous appeler ainsi; rien ne peut changer ma destinée: écoutez mon histoire, et vous verrez qu'elle est irrévocablement fixée».
»Il me dit alors qu'il commencerait le lendemain son récit, lorsque j'en aurais le temps. Cette promesse me fit faire de profondes réflexions, et j'ai résolu de consacrer mes loisirs du soir à écrire ce qu'il m'aura raconté pendant le jour, en rapportant autant que possible, ses propres expressions. Si je n'en ai pas le temps, je prendrai du moins des notes. Ce manuscrit vous fera sans doute le plus grand plaisir: mais pour moi, qui le connais, et qui apprendrai cela de sa bouche, avec quel intérêt et quelle émotion je le relirai un jour»!
Je suis né à Genève, et ma famille est une des plus considérables de cette république. Mes ancêtres avaient été, depuis bon nombre d'années, conseillers et syndics; et mon père avait rempli des fonctions publiques avec honneur et distinction. Il était respecté de tous ceux qui le connaissaient, à cause de son intégrité, et de son application infatigable à veiller aux intérêts de l'État. Il passa les années de sa jeunesse continuellement occupé des affaires de son pays, et il n'attendit pas le déclin de sa vie pour penser à se marier, et à laisser à l'État des fils qui pussent transmettre à la postérité ses vertus et son nom.
Comme les circonstances de son mariage font honneur à son caractère, je ne puis m'empêcher de les rapporter. Il comptait parmi ses plus intimes amis un négociant qui, d'un état brillant, tomba dans la pauvreté, après toutes sortes de malheurs. Cet homme, qui se nommait Beaufort, était d'un caractère orgueilleux et facile à se décourager. Il ne put soutenir l'idée de vivre pauvre et oublié dans le même pays où il avait brillé par son rang et sa magnificence. Ayant donc payé ses dettes de la manière la plus honorable, il se retira avec sa fille dans la ville de Lucerne, où il vécut inconnu et malheureux. Mon père aimait Beaufort de l'amitié la plus vraie; et il fut profondément affligé d'une retraite à laquelle des circonstances malheureuses avaient donné lieu, et qui le privait d'une société qui lui était chère. Il résolut d'aller le chercher et de l'engager à recommencer le commerce, en profitant de son crédit et de son assistance.
Beaufort avait pris toutes les mesures pour se cacher, et ce ne fut que dix mois après que mon père découvrit sa demeure. Charmé de cette découverte, il se rend à sa maison, qui était située dans une petite rue près le Reuss; mais lorsqu'il entra, il eut sous les yeux le spectacle de la misère et du désespoir. Beaufort avait sauvé des restes de sa fortune, une très-petite somme d'argent, mais qui était suffisante pour le soutenir pendant quelques mois; il espérait alors obtenir un emploi respectable dans la maison d'un négociant. En attendant, il n'avait pas d'occupation; et, se livrant, dans son loisir, aux plus tristes pensées, il fut en proie au chagrin le plus profond et le plus cruel, et tellement accablé d'esprit, que trois mois après, il fut sur un lit de douleur, incapable d'aucun mouvement. Sa fille le soignait avec la tendresse la plus touchante; mais elle voyait avec douleur que leur petite somme diminuait rapidement, et qu'ils n'avaient plus d'autre ressource. Caroline Beaufort avait une âme d'une trempe peu commune, et elle s'arma de courage pour se soutenir dans son adversité. Elle se procura une occupation honnête, tressa de la paille, et, par différents moyens, tâcha de gagner de quoi subvenir aux premiers besoins de la vie.
Plusieurs mois se passèrent ainsi. Son père devint plus mal; son temps était plus occupé à le soigner; ses moyens de subsistance diminuaient; et, en dix mois, son père mourut dans ses bras, la laissant orpheline et sans ressources. Ce dernier coup l'accabla; et elle était à genoux devant le cercueil de Beaufort, pleurant à chaudes larmes, lorsque mon père entra dans la chambre. Il arriva comme un ange protecteur pour cette pauvre jeune fille, qui se confia à ses soins; après l'enterrement de son ami, il la conduisit à Genève et la confia à une de ses parentes. Deux ans après cet événement, Caroline devint sa femme.
Lorsque mon père fut devenu époux et père, il se trouva tellement occupé par les devoirs de sa nouvelle position, qu'il abandonna plusieurs de ses fonctions publiques pour se vouer à l'éducation de ses enfants. J'étais l'aîné, et je devais lui succéder dans tous ses travaux et dans ses fonctions. Personne n'eut de plus tendres parents que les miens. Mon éducation et ma santé étaient l'objet de leur sollicitude continuelle, et d'une sollicitude d'autant plus vive, que pendant plusieurs années je fus leur unique enfant. Mais, avant de continuer mon récit, je dois rapporter un événement qui eut lieu lorsque j'étais âgé de quatre ans.
Mon père avait une sœur qu'il aimait tendrement, et qui avait épousé, très-jeune, un gentilhomme Italien. Peu de temps après son mariage, elle avait accompagné son mari dans son pays; et, depuis quelques années, mon père n'avait eu que très-peu de rapport avec elle. Elle mourut vers l'époque dont j'ai parlé; et, peu de mois après, il reçut une lettre de son mari. Celui-ci lui faisait part de son intention d'épouser une Italienne, et priait mon père de se charger de sa fille Élisabeth, seul enfant qu'il eut eu de sa sœur. «Je désire, dit-il, que vous la considériez comme votre propre fille et que vous l'éleviez de même. La fortune de sa mère lui est assurée, et je vous en remettrai les titres. Réfléchissez à cette proposition, et choisissez si vous voulez que votre nièce soit élevée par vous-même ou par une belle-mère».
Mon père n'hésita pas, et alla aussitôt en Italie pour accompagner la petite Élisabeth dans sa nouvelle demeure. J'ai souvent entendu dire à ma mère, qu'elle était alors le plus bel enfant qu'elle eut jamais vu, et qu'elle montrait même un caractère doux et aimant. Ces dispositions, et le désir de resserrer aussi étroitement que possible les nœuds de l'amour domestique, déterminèrent ma mère à regarder Élisabeth comme ma femme future, projet dont elle n'eut jamais à se repentir.
Dès-lors Élisabeth Lavenza devint ma compagne de jeu; et lorsque nous avançâmes en âge, elle fut mon amie. Elle était douée d'un excellent naturel, aussi gaie et aussi folâtre qu'un papillon. Quoiqu'elle fut vive et animée, ses sensations étaient fortes et profondes; son caractère prodigieusement aimant. Personne ne savait mieux qu'elle jouir de sa liberté, personne aussi ne se soumettait avec plus de grâce à la nécessité et au caprice. Son imagination était brillante quoiqu'elle fût capable d'une grande application. Ses traits étaient l'image de son âme; ses yeux bruns, quoiqu'aussi vifs que ceux d'un oiseau, avaient une douceur attrayante; sa figure était vive et animée. Capable de supporter une grande fatigue, elle avait l'air de la femme la plus délicate du monde. Plein d'admiration pour son intelligence et son esprit, j'aimais à la suivre, comme j'aurais pu le faire pour un animal favori; et je n'ai jamais vu tant de charmes dans la personne et dans l'esprit unis à si peu de prétention.
Tout le monde adorait Élisabeth. Si les domestiques avaient quelque chose à solliciter, c'était toujours par son intercession. Nous étions étrangers à toute espèce de désunion et de dispute; il existait, il est vrai, une grande différence dans nos caractères, mais il y avait même de l'harmonie dans cette opposition. J'étais plus calme et plus réfléchi que ma compagne; cependant mon caractère n'était pas aussi doux. Mon application durait plus long-temps; mais elle était moins opiniâtre pendant sa durée. J'aimais à rechercher les faits qui ont rapport au monde physique; elle se plaisait à suivre les inspirations hardies des poètes. Le monde était pour moi un secret que je désirais pénétrer; pour elle, c'était un vide qu'elle cherchait à peupler d'êtres de sa propre imagination.
Mes frères étaient bien plus jeunes que moi; mais j'avais dans un de mes condisciples un ami dont l'âge répondait au mien. Henry Clerval était fils d'un négociant de Genève, intime ami de mon père. C'était un enfant d'un talent et d'une imagination extraordinaires. Je me souviens, qu'à l'âge de neuf ans, il composa un conte de fées, qui faisait les délices et l'étonnement de tous ses camarades. Son étude favorite était celle des romans et des livres de chevalerie; et, lorsque nous étions fort jeunes, je me rappelle que nous jouions des pièces qu'il composait lui-même d'après ses livres, dont les principaux personnages étaient Roland, Robin Hood, Amadis, et Saint-George.
Personne n'a pu passer une jeunesse plus heureuse que la mienne. Mes parents étaient indulgents et mes camarades aimables. Nos études n'étaient jamais forcées; et, par quelques moyens, nous avions toujours devant nous un but qui nous excitait à les poursuivre avec ardeur. Ce fut de cette manière, et non par l'émulation, que nous prîmes goût au travail. Ce n'était pas la crainte d'être surpassée par ses compagnes, qui excitait Élisabeth à s'appliquer au dessin; mais le désir qu'elle avait de plaire à sa tante, en lui mettant sous les yeux quelque joli paysage qu'elle avait fait elle-même. Nous apprîmes le latin et l'anglais, afin de pouvoir lire les auteurs de ces deux langues; et, au lieu de nous rendre l'étude odieuse par les punitions, nous ne cessions d'aimer l'application; nos distractions eussent été des travaux pour d'autres enfants. Peut-être n'avons nous pas lu autant de livres, ou n'avons nous pas appris les langues aussi promptement que ceux qui sont enseignés d'après les méthodes ordinaires; mais ce que nous avons appris nous est resté plus profondément gravé dans la mémoire.
Je place Henri Clerval dans la description de notre cercle domestique, car il était constamment avec nous. Il allait à l'école avec moi, et passait chez nous presque tous les après-midi; son père qui n'avait que ce fils, était bien aise qu'il trouvât dans notre maison les camarades qu'il ne pouvait lui donner chez lui; aussi nous n'étions jamais tout-à-fait heureux lorsque Clerval était absent.
J'ai du plaisir à m'arrêter sur les souvenirs de mon enfance, avant que le malheur n'eût atteint mon esprit et changé ses idées lumineuses sur l'utilité générale en des réflexions sur moi-même, profondes et rétrécies. Mais, en traçant le tableau de mes jeunes années, je ne dois pas omettre ces événements qui me conduisirent insensiblement au dernier degré du malheur: car, lorsque je me rends compte de la naissance de cette passion qui régla ensuite ma destinée, je la vois sortir de sources impures et presqu'oubliées, comme un fleuve qui sort des flancs d'une montagne; mais, en croissant insensiblement, elle est devenue le torrent, qui, dans sa course, a détruit toutes mes espérances et mon bonheur.
La philosophie naturelle est le génie qui a réglé ma destinée; je désire donc, dans ce récit, établir les faits qui m'ont inspiré une prédilection pour cette science. J'avais treize ans, lorsque nous fîmes tous une partie de plaisir, aux bains près de Thonon: le mauvais temps nous obligea de rester toute une journée renfermés dans l'auberge, et le hasard fit tomber entre mes mains, dans cette maison, un volume des œuvres de Cornelius Agrippa. Je l'ouvris avec indifférence; la théorie qu'il cherche à démontrer et les faits étonnants qu'il rapporte, changèrent bientôt ce sentiment en enthousiasme. Une nouvelle lumière sembla éclairer mon esprit; je bondis de joie, et fis part de ma découverte à mon père. Je ne puis m'empêcher de faire remarquer ici les nombreuses occasions qu'ont les instituteurs, pour diriger les idées de leurs élèves vers des connaissances utiles, et qu'ils négligent entièrement. Mon père regarda avec indifférence le titre de mon livre, et dit: «Ah! Cornélius Agrippa! Mon cher Victor, ne perdez pas voire temps là-dessus, c'est une triste occupation».
Si, au lieu de cette remarque, mon père eût pris la peine de m'expliquer que les principes d'Agrippa avaient été tout-à-fait rejetés, et qu'on avait introduit un nouveau système de science, basé sur des raisonnements plus puissants que l'ancien, parce que ceux-ci étaient chimériques, tandis que les autres étaient réels et mis en usage; oh! alors, j'aurais certainement jeté Agrippa de côté, et, avec une imagination échauffée comme la mienne, je me serais probablement appliqué à la théorie d'alchimie, la plus raisonnable qui soit résulté des découvertes modernes. Il est même possible que le cours de mes idées n'eussent jamais reçu la funeste impulsion qui m'a conduit à ma perte. Mais le mépris vague que mon père avait montré pour mon livre, ne me prouvait nullement qu'il connût ce qu'il contenait, et je continuai de le lire avec la plus grande avidité.
Lorsque je fus de retour à la maison, mon premier soin fut de me procurer tous les ouvrages de cet auteur, et ensuite ceux de Paracelse et du Grand Albert. Je lus et j'étudiai avec délices les rêves ténébreux de ces écrivains; ils me parurent des trésors connus à peu d'autres personnes que moi; et, quoique je désirasse souvent faire connaître à mon père ces secrètes profondeurs de la science, j'étais toujours retenu par la critique indéterminée qu'il avait faite de mon auteur favori. J'appris ma découverte à Élisabeth, sous le sceau du secret le plus strict; mais elle ne prenait pas d'intérêt à mon travail, et elle me laissait poursuivre seul mes études.
Il peut sembler très-étrange de voir dans le 18e siècle un disciple du Grand Albert; mais notre famille n'était pas scientifique, et je n'avais pas suivi les lectures recommandées aux écoles de Genève. Mes rêves n'étaient donc pas troublés par la réalité; et je me livrai avec ardeur à la recherche de la pierre philosophale et de l'élixir de vie. Ce dernier objet obtint toute mon application: je le préférai à la richesse; et quelle gloire suivrait ma découverte, si je réussissais à chasser la maladie du corps humain, et à ne rendre l'homme accessible qu'à une mort violente!
Mes idées ne se bornèrent pas là. L'apparition des esprits et des démons était généreusement promise par mes auteurs favoris: je cherchais avec ardeur l'accomplissement de cette promesse; et, si mes enchantements restaient toujours sans succès, j'en attribuais la faute plutôt à mon inexpérience et à mon ignorance, qu'à un défaut d'habilité ou de bonne foi dans mes maîtres.
Les phénomènes de la nature qui s'offrent tous les jours à nos yeux, n'échappèrent pas à mes recherches. La circulation et les effets surprenants de la respiration, dont mes autorités ignoraient entièrement la cause, excitèrent mon étonnement; mais, ce qui m'étonna le plus, ce furent quelques expériences d'une pompe d'air, que je vis employée par une personne que nous avions l'habitude devoir.
L'ignorance des anciens philosophes sur ces points et sur d'autres, servit à leur faire perdre leur crédit auprès de moi; mais je ne pouvais les quitter entièrement, avant qu'un autre système ne les eût remplacés dans mon esprit.
À l'âge d'environ dix-sept ans, nous nous trouvions dans notre maison, auprès de Belrive, quand vint à éclater l'orage le plus violent et le plus terrible. Il s'avançait de l'autre côté des montagnes du Jura, et s'annonçait par les éclats du tonnerre qui retentissait de plusieurs côtés à la fois avec un fracas effrayant. Je restai, tant que l'orage dura, à observer ses progrès avec curiosité et plaisir. Pendant que je me tenais à la porte, je vis tout à coup une traînée de feu sortir d'un chêne antique et élevé, qui était à peu près à vingt pas de notre maison; et à peine la lumière cessa de briller, que le chêne disparut, et il ne restait plus qu'un tronc en ruines. Le lendemain matin nous allâmes le voir; l'arbre avait été singulièrement brisé. Il n'était pas fendu par le choc, mais entièrement réduit en petits éclats de bois. Je n'ai jamais rien vu qui fût si complètement détruit.
La ruine de cet arbre fut pour moi l'objet d'un vif étonnement; je questionnai avec empressement mon père sur la nature et l'origine du tonnerre et des éclairs. «L'électricité», répondit-il, en décrivant en même temps les différents effets de cette force. Il construisit une petite machine électrique, et me fit quelques expériences; il fit aussi un cerf-volant, avec des cordes et un fil de métal, qui attirait des nuages le fluide électrique.
Ce dernier trait acheva de renverser Cornelius Agrippa, le Grand Albert et Paracelse, qui avaient si long-temps régné en maîtres dans mon imagination. Mais, par quelque fatalité, je ne me sentis pas porté à commencer l'étude d'un système moderne, et ce dégoût eut pour cause la circonstance suivante.
Mon père avait témoigné le désir que je suivisse un cours de leçons sur la philosophie naturelle, et j'y avais consenti avec plaisir. Un accident m'empêcha de suivre ces leçons jusqu'à la fin, et la dernière que je pris était tout-à-fait inintelligible pour moi. Le professeur discourait avec la plus grande abondance sur le Potassium et le Boron, les sulfates et les oxides, termes auxquels je ne pouvais appliquer d'idée. Je pris en dégoût la science de la philosophie naturelle, quoique je lusse encore avec plaisir Pline et Buffon, auteurs qui, suivant moi, étaient d'un intérêt et d'une utilité à peu près semblables.
Mes occupations, à cette époque, étaient principalement les mathématiques, et la plupart des branches d'étude qui appartiennent à cette science. Je m'occupais aussi beaucoup à apprendre les langues; le Latin m'était déjà familier, et je commençais à lire quelques-uns des auteurs Grecs les plus faciles sans le secours d'un Lexicon. Je comprenais parfaitement aussi l'Anglais et l'Allemand. Voilà la nomenclature de ce que je savais à l'âge de dix-sept ans; et vous devez penser que mes moments étaient entièrement occupés pour acquérir et conserver la connaissance de ces différentes littératures.
J'eus aussi une autre tâche à remplir; je devins l'instituteur de mes frères. Ernest était de six ans plus jeune que moi et mon principal élève. Il avait eu une mauvaise santé dans son enfance, pendant laquelle Élisabeth et moi nous avions eu pour lui des soins assidus. Son caractère était doux, mais il était incapable de toute application sérieuse. Guillaume, le plus jeune de la famille, était encore enfant, et c'était le plus beau petit drôle du monde; ses yeux bleus et vifs, ses joues ornées de deux fossettes, et ses manières caressantes inspiraient la plus tendre affection.
Tel était notre cercle domestique, dont les soucis et les chagrins semblaient bannis pour toujours. Mon père dirigeait nos études, et ma mère partageait nos plaisirs. Aucun de nous n'avait la plus légère supériorité sur l'autre, nous ne connaissions pas la voix du commandement; mais une affection mutuelle nous portait à condescendre et à obéir au moindre désir de chacun.
Je venais d'atteindre ma dix-septième année, quand mes parents prirent la résolution de m'envoyer étudier à l'université d'Ingolstadt. J'avais d'abord suivi les écoles de Genève; mais mon père pensa qu'il était nécessaire, pour le complément de mon éducation, de me faire connaître d'autres usages que ceux de mon pays natal. Mon départ fut donc prochainement fixé; et, avant que le jour marqué ne fût venu, j'éprouvai le premier malheur de ma vie..... présage de ceux qui m'attendaient.
Élisabeth avait eu la fièvre rouge, mais sans aucun symptôme de danger. Elle ne tarda pas à recouvrer la santé. Pendant le temps de la maladie, on avait tout fait pour persuader à ma mère de ne pas la voir. Elle s'était d'abord rendue à nos supplications; mais, lorsqu'elle apprit que sa chère nièce se rétablissait, elle ne put se priver davantage de sa société, et entra dans sa chambre long-temps avant que l'air ne fut sans danger. Les conséquences de cette imprudence furent funestes. Le troisième jour, ma mère tomba malade; sa fièvre prit un caractère de malignité, et nous vîmes sur le visage de ceux qui la soignaient l'augure du plus triste événement. Au lit de la mort, le courage et la bonté de cette femme admirable ne l'abandonnèrent pas. Elle joignit les mains d'Élisabeth et les miennes: «Mes enfants, dit-elle, j'envisageais dans votre union le plus ferme espoir de mon bonheur futur. Cette perspective sera maintenant la consolation de votre père. Élisabeth, mon amie, vous me remplacerez auprès de vos plus jeunes cousins. Hélas! je regrette d'être séparée de vous; heureuse et aimée comme je l'étais, comment n'aurais-je pas quelque peine de vous quitter tous? Mais ces pensées ne me conviennent point; je lâcherai de me résigner à la mort, et j'espère que nous nous reverrons dans un autre monde».
Elle mourut avec calme, et en conservant sur son visage inanimé l'expression de la tendresse. Je n'ai pas besoin de vous décrire les sentiments de ceux dont les nœuds les plus chers sont rompus par le plus irréparable des maux, le vide qui est dans le cœur et la douleur qui est empreinte sur les figures. Il faut tant de temps pour que l'esprit puisse se persuader que celle que nous voyions tous les jours et dont existence même semblait liée à la nôtre, est perdue à jamais...; que l'éclat enchanteur de ses yeux est éteint; et que le son d'une voix si familière et si chère à l'oreille, est étouffé pour n'être plus entendu. Telles sont les réflexions auxquelles on se livre les premiers jours; mais lorsque le laps du temps a prouvé la réalité du mal, la douleur commence à se faire sentir plus vivement. Et à qui la main terrible de la mort n'a-t-elle pas enlevé quelqu'affection bien chère? Pourquoi vous peindre un chagrin que tout le monde a éprouvé ou doit éprouver? Le temps arrive enfin, où la douleur est plutôt une consolation qu'un mal; et le sourire n'est pas banni de nos lèvres, quoiqu'il paraisse un sacrilège. Ma mère n'était plus, mais nous avions encore des devoirs à remplir; car nous devons continuer notre vie dans le calme, et nous trouver heureux, tant qu'il nous reste un être sur qui la faulx de la mort ne s'est pas encore appesantie.
Mon voyage à Ingolstadt, qui avait été différé par ces évènements, fut décidé de nouveau. J'obtins de mon père un délai de quelques semaines. Ce temps se passa fort tristement. La mort de ma mère et mon prompt départ accablaient nos esprits; mais Élisabeth cherchait à ramener la gaîté dans notre petite société. Depuis la mort de sa tante, son esprit avait acquis une nouvelle fermeté et une nouvelle force. Elle se détermina à remplir ses devoirs avec la plus grande exactitude, et elle sentit que le devoir le plus impérieux qui lui était imposé, était de rendre heureux son oncle et ses cousins. Elle me consolait, amusait son oncle, instruisait mes frères; jamais elle ne me parut aussi charmante qu'à cette époque, où elle s'efforçait continuellement de contribuer au bonheur des autres, en s'oubliant entièrement elle-même.
Le jour de mon départ arriva enfin. J'avais pris congé de tous mes amis, excepté de Clerval, qui passa avec nous la dernière soirée. Il s'affligeait amèrement de ne pouvoir m'accompagner: mais il était retenu chez son père, dont l'intention était de l'associer dans ses affaires, et dont le grand principe était que la science est inutile dans le commerce ordinaire de la vie. Henry avait un esprit plus élevé: il n'avait, nullement le désir de ne rien faire, et s'il était bien aise de devenir l'associé de son père, il pensait aussi qu'on pouvait être un fort bon négociant, et en même temps avoir un esprit cultivé.
Nous restâmes très-tard à écouter ses plaintes et à faire plusieurs petits arrangements pour l'avenir. Je partis le lendemain matin de bonne heure. Des pleurs coulaient des yeux d'Élisabeth; elle ne pouvait les retenir en songeant que mon départ la laissait dans le chagrin, et que le même voyage avait été fixé trois mois auparavant, lorsque la bénédiction d'une mère m'aurait accompagné.
Je me jetai dans la chaise qui devait m'emmener, et me livrai aux réflexions les plus mélancoliques. J'étais seul maintenant, moi, qui avais été toujours entouré d'aimables compagnons, dont l'unique soin était d'être agréables l'un à l'autre. Dans l'université vers laquelle je me rendais, il fallait me faire mes amis et être moi-même mon protecteur. Jusqu'ici, ma vie avait été tout-à-fait domestique et retirée; j'en gardai une répugnance invincible pour les nouveaux visages. J'aimais mes frères, Élisabeth et Clerval; c'étaient pour moi d'anciennes figures qui m'étaient familières; mais je ne me croyais nullement fait pour la société des étrangers. Telles étaient mes réflexions lorsque je commençai mon voyage; mais à mesure que j'avançais, mon courage et mes espérances se relevaient. J'avais un vif désir d'apprendre. Souvent, chez mon père, j'avais trouvé pénible de passer ma jeunesse, attaché à la même place; j'aurais voulu entrer dans le monde, et prendre ma place parmi les autres hommes. À présent que mes désirs étaient accomplis, c'eût été une folie de m'en repentir.
J'eus tout le temps de me livrer à ces réflexions et à bien d'autres pendant mon voyage à Ingolstadt, qui fut long et fatigant. Enfin, j'aperçus les clochers blancs et élevés de la ville. Je descendis de voiture, et je fus conduit dans mon appartement solitaire pour passer la soirée comme il me plairait.
Le lendemain matin, je remis mes lettres d'introduction; je ne manquai pas de rendre visite à quelques-uns des principaux professeurs, et entr'autres à M. Krempe, professeur de philosophie naturelle. Il me reçut avec politesse, et me fit plusieurs questions sur mes progrès dans les différentes branches de science qui appartiennent à la philosophie naturelle. Je lui nommai, non sans crainte et sans hésitation les seuls auteurs que j'eusse jamais lus sur ce sujet. Le professeur me regarda fixement: «Avez-vous, dit-il, réellement perdu votre temps à étudier de pareilles absurdités»?
—«Je vous ai dit la vérité», répondis-je.—«Chaque minute continua M. Krempe avec chaleur, chaque moment que vous avez passé sur ces livres est tout-à-fait et complètement perdu. Vous avez chargé votre mémoire de systèmes repoussés et de noms inutiles. Grand Dieu! Dans quel désert avez-vous habité, puisque personne n'a été assez bon pour vous apprendre que ces rêves, dont vous vous êtes pénétré avidement, sont enfantés depuis mille ans, et sont aussi méprisés qu'ils sont anciens? Je ne m'attendais guère à trouver dans ce siècle éclairé et savant, un disciple du Grand Albert et de Paracelse. Mon cher monsieur, il faut recommencer entièrement vos études».
Après avoir ainsi parlé, il se mit à l'écart, et écrivit une liste de plusieurs livres qui traitaient de la philosophie naturelle. Il m'invita à les acheter; et il prit congé de moi, en me prévenant qu'au commencement de la semaine suivante, il ouvrirait un cours sur la philosophie naturelle dans ses rapports généraux, et que M. Waldman, son collègue, en ferait un sur l'alchimie, alternativement avec le sien.
Je retournai chez moi sans être désappointé, car il y avait longtemps que je regardais comme passés de mode, les auteurs que le professeur avait réprouvés avec tant de force; mais je ne me sentis pas très-porté à étudier les livres dont j'avais fait emplette à sa recommandation. M. Krempe était un petit homme ramassé, dont la voix était rude, et la figure repoussante; ainsi le maître ne me disposait pas, en faveur de la doctrine. Du reste, j'avais du mépris pour les usages de la philosophie naturelle du jour. Quelle différence avec les maîtres de la science, quand ils cherchaient l'immortalité et le grand secret! Leurs vues étaient grandes, quoique futiles. Mais depuis, la scène était changée; l'ambition des nouveaux savants semblait se borner à détruire ces visions qui me portaient vers la science, avec le plus d'intérêt. Il fallait changer des chimères d'une grandeur sans bornes, contre de misérables réalités.
Telles furent mes réflexions pendant les deux ou trois premiers jours que je passai presque dans la solitude. Mais au commencement de la semaine suivante, je pensai à ce que M. Krempe m'avait dit sur les cours. Et, quoique je ne pusse consentir à aller entendre ce petit pédant débiter des sentences dans une chaire, je me rappelai ce qu'il avait dit de M. Waldman, qui avait été absent jusqu'alors, et que je n'avais jamais vu.
Soit par curiosité, soit par oisiveté, j'allai dans la salle des cours: M. Waldman y entra un instant après. Ce professeur ne ressemblait pas à son collègue. Il paraissait avoir environ cinquante ans, et portait sur son visage l'expression de la plus grande bonté: quelques cheveux gris couvraient ses tempes; des cheveux presque noirs garnissaient le derrière de sa tête. Il était petit, mais très-droit, et doué du plus doux organe. Il commença son cours par un précis de l'histoire de l'alchimie et des différentes découvertes dues à plusieurs savants, prononçant avec chaleur les noms de ceux qui s'étaient le plus distingués par ces découvertes. Il fit alors un tableau rapide de l'état actuel de la science, et expliqua plusieurs termes élémentaires. Après avoir fait quelques expériences préparatoires, il termina par un panégyrique de l'alchimie moderne, en des termes que je n'oublierai jamais.
«Les anciens maîtres en cette science, dit-il, promettaient des choses impossibles, et n'accomplissaient rien. Les professeurs modernes promettent très-peu: ils savent qu'on ne peut changer les métaux, et que l'élixir de vie est une chimère. Mais ces philosophes, dont les mains ne semblent faites que pour tremper dans la boue qui semblent n'avoir des yeux que pour observer au travers d'un microscope ou dans le creuset, ont en effet produit des miracles. Ils pénètrent les secrets de la nature, et montrent ses effets dans les endroits les plus cachés. Ils pénètrent jusqu'aux cieux; ils ont découvert la circulation du sang, et analysé l'air que nous respirons. Ils ont acquis des pouvoirs nouveaux et presqu'illimités; ils commandent aux foudres du ciel, imitent les tremblements de terre, et bravent même les ombres du monde invisible».
Je me retirai enchanté du professeur et de sa leçon; j'allai le soir même lui rendre visite. Ses manières chez lui étaient encore plus douces et plus attrayantes qu'en public; car, pendant son cours, il y avait sur son visage une certaine dignité qui, en particulier, faisait place à la plus grande affabilité et à beaucoup de politesse. Il écouta avec attention la petite histoire de mes études, et sourit aux noms de Cornelius Agrippa et de Paracelse, mais sans le mépris qu'avait montré M. Krempe. Il me dit que, «c'était au zèle infatigable de ces hommes, que les philosophes modernes étaient redevables de la plupart des principes de leur science; qu'ils nous avaient laissé la tâche plus facile, de donner les noms, et de classer avec ordre les faits qu'ils avaient puissamment contribué à mettre au grand jour. Les travaux des hommes de génie, quoiqu'erronés, finissent toujours par tourner au profit de l'espèce humaine». J'écoutais son raisonnement, qui était prononcé sans orgueil ni affectation; j'ajoutai alors, que sa leçon avait dissipé mes préjugés, contre les alchimistes modernes; et en même temps, je lui demandai ses conseils sur les livres que je devais me procurer.
«Je suis heureux, dit M. Waldman, de m'être fait un élève; et si votre application égale votre habileté, je ne doute pas que vous ne réussissiez. L'alchimie est la branche de la philosophie naturelle dans laquelle on a fait et pourra faire le plus de progrès. Voilà pourquoi j'en ai fait mon étude particulière, mais en même temps je n'ai pas négligé les autres branches de cette science. On ne serait qu'un bien médiocre alchimiste, si l'on ne s'adonnait qu'à cette partie seule des connaissances humaines. Si vous avez le désir de devenir vraiment un savant, et non simplement un petit faiseur d'expériences, je vous engagerai à cultiver toutes les branches de la philosophie naturelle, ainsi que les mathématiques».
Il m'introduisit alors dans son laboratoire, et m'expliqua l'usage de ses différents instruments; il me montra tous ceux que je devais avoir, et me promit de me prêter les siens, lorsque j'aurais assez d'expérience pour ne pas en déranger le mécanisme. Il me donna aussi la liste des livres que j'avais demandés, et je pris congé de lui.
Ainsi finit cette journée mémorable pour moi; elle décida de mon avenir.
Depuis ce jour, je me livrai presqu'exclusivement à l'étude de la philosophie naturelle, et surtout de l'alchimie, dans le sens le plus étendu de ce mot. Je lus avec ardeur les ouvrages qui ont été composés sur cette science par les observateurs modernes, et où brillent à un haut degré leur génie et leur discernement. Je suivis les cours, je fréquentai les savants de l'université; et je reconnus même en M. Krempe beaucoup de bon sens et un vrai savoir, joints, il est vrai, à une physionomie et à des manières repoussantes, mais qui ne diminuaient pas le mérite de ses connaissances. Je trouvai un véritable ami dans M. Waldman. Sa douceur n'était jamais altérée par un ton tranchant; il donnait ses leçons avec un air de franchise et de bonté qui éloignait toute idée de pédanterie. Ce fut, peut-être, l'aimable caractère de cet homme qui m'entraîna le plus vers la partie de philosophie naturelle qu'il enseignait, qu'un goût intime pour la science même. Mais cette disposition d'esprit ne dura que dans les premiers moments de mes études: car, plus je pénétrais dans la science, et plus je la poursuivais exclusivement pour elle-même. Cette application, qui d'abord avait été un devoir et un ordre, devint alors si ardente et si vive, que souvent les étoiles avaient disparu devant la clarté du matin, que j'étais encore à travailler dans mon laboratoire.
Avec une application aussi opiniâtre, il est facile de concevoir que je fis de rapides progrès. Mon ardeur faisait l'étonnement des étudiants, et mes succès celui des maîtres. Le professeur Krempe me demandait souvent, avec un sourire moqueur, comment allait Cornelius Agrippa; tandis que M. Waldman se réjouissait hautement de mes progrès. Deux ans se passèrent ainsi, sans que j'allasse à Genève; j'étais attaché, de cœur et d'âme, à la poursuite de quelques découvertes que je désirais faire. Il n'y a que ceux qui en ont fait l'épreuve, qui puissent comprendre les attraits de la science. Dans des études quelconques on peut atteindre ceux qui nous ont précédés, mais on ne peut guère les surpasser; dans l'étude des sciences, au contraire, il y a un aliment continuel pour les découvertes, et des sujets toujours nouveaux d'étonnement. Un esprit d'une capacité ordinaire, qui se renferme strictement, dans une seule étude, doit infailliblement y faire de grands progrès; j'avais constamment cherché à atteindre l'objet que j'avais en vue; je n'étais uniquement occupé que de cet objet; aussi, je me signalai par des progrès si rapides, que, deux ans après, je fis plusieurs découvertes pour perfectionner quelques instruments d'alchimie, ce qui me valut beaucoup d'estime et de considération dans l'université. Parvenu à ce point, et devenu aussi habile dans la théorie et dans la pratique de la philosophie naturelle qu'il dépendait des professeurs d'Ingolstadt, je jugeai que ma résidence dans cette ville n'était plus nécessaire à mes progrès. Je pensais à retourner au milieu de mes amis et dans ma ville natale, lorsqu'un événement m'obligea de rester.
Un des phénomènes qui avaient particulièrement attiré mon attention, était la structure du corps humain, et même de tout être animé. Je me demandais même souvent, d'où pouvait procéder le principe de la vie. Cette question était hardie: c'était même un mystère aux yeux du monde; et, cependant, que de choses nous pourrions apprendre, si la lâcheté ou l'insouciance n'arrêtaient pas nos recherches. Ces pensées s'agitèrent dans mon esprit, et me déterminèrent à étudier désormais plus particulièrement les parties de la philosophie naturelle qui ont rapport à la physiologie. Sans un enthousiasme presque surnaturel, mon application à cette étude eût été pleine de dégoûts, et presque insupportable. Pour examiner les causes de la vie, nous devons d'abord avoir recours à la mort. J'appris l'anatomie: mais cette science ne suffisait pas; il fallut aussi que j'observasse la décomposition naturelle et la corruption du corps humain. En m'élevant, mon père avait pris les plus grandes précautions, pour qu'on ne remplit pas mon esprit d'horreurs surnaturelles. Je ne me souviens pas d'avoir jamais frissonné au récit d'un conte superstitieux, ou d'avoir eu peur de l'apparition d'un fantôme. L'obscurité ne faisait aucun effet sur mon imagination; et un cimetière n'était pour moi que le réceptacle des corps privés de la vie, qui, après avoir été le siège de la beauté et de la force, étaient devenus la pâture des vers. Je me mis à examiner la cause et les progrès de cette décomposition, et je fus forcé de passer des jours et des nuits au milieu des tombeaux et dans des charniers. Je portais mon attention sur tous les objets les plus désagréables à la délicatesse des sensations humaines. J'examinai combien la belle forme de l'homme était dégradée et ravagée; je vis la corruption de la mort remplacer l'éclat d'un visage animé, et les vers hériter des merveilles de l'œil et du cerveau. Je m'arrêtais à observer et à analyser toutes les minuties de notre être, dévoilées dans le passage de la vie à la mort, lorsque, du milieu de cette obscurité, une lumière soudaine vint éclairer mon esprit. Elle était si brillante, si merveilleuse, et pourtant si naturelle, que je fus à la fois ébloui par l'immense clarté qu'elle répandait, et surpris que, parmi tant d'hommes de génie dont les recherches avaient eu pour but la même science, je fusse le seul destiné à découvrir cet étonnant secret.
Rappelez-vous que je ne rapporte pas la vision d'un fou: ce que j'affirme est aussi vrai que le soleil brille dans les cieux. Que ce soit par un miracle, il n'en est pas moins vrai que les progrès de la découverte sont distincts et probables. Après des jours et des nuits d'un travail et d'une fatigue incroyables, je parvins à connaître la cause de la génération et de la vie; je devins même capable d'animer une matière inerte.
L'étonnement où me jeta cette découverte, fit bientôt place au plaisir et au ravissement. Après avoir consumé tant de temps à des travaux pénibles, n'était-ce pas pour moi la récompense la plus douce, que d'arriver enfin au terme de mes désirs? Mais cette découverte était si grande et si élevée, que tous les degrés par lesquels j'y avais été progressivement conduit, furent oubliés: je ne vis que le résultat. Ce qui, depuis la création du monde, avait été l'objet des études et des désirs des hommes les plus sages, était maintenant en mon pouvoir. Tout se présentait à moi comme une scène magique. Le résultat que j'avais obtenu, était de nature plutôt à diriger mes efforts dès que je les tournerais vers l'objet de mes recherches, qu'à me l'offrir sur-le-champ. J'étais comme l'Arabe qui avait été enseveli parmi les morts, et qui trouva un passage à la vie, guidé seulement par une lueur qui semblait ne devoir pas lui prêter ce secours.
Mon ami, je vois, à votre impatience, à l'étonnement et à l'espoir qu'expriment vos yeux, que vous vous attendez à ce que je vous instruise du secret de ma découverte; cela ne se peut: écoutez patiemment la fin de mon histoire, et vous verrez facilement pourquoi je me renferme dans le silence. Imprévoyant et ardent comme je l'étais alors, je ne vous conduirai pas à votre perte et à un malheur infaillible. Apprenez-de moi, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien la science est dangereuse. Soyez-en certain: l'homme qui croit que sa ville natale est le monde, est plus heureux que celui qui aspire à s'élever plus qu'il ne peut prétendre.
Maître d'un pouvoir si étonnant, j'hésitai long-temps sur l'usage que j'en ferais. J'avais, il est vrai, la faculté d'animer; mais il restait encore un ouvrage d'une difficulté et d'une peine inconcevables, c'était de préparer un corps destiné à recevoir la vie, avec toutes ses combinaisons de fibres, de muscles et de veines. J'hésitai d'abord, si j'essayerais de créer un être semblable à moi-même ou d'une organisation plus simple; mais mon imagination était trop exaltée par mon premier succès, pour que je misse en doute mon habileté à donner la vie à un être aussi compliqué et aussi merveilleux que l'homme. Les matériaux, dont je pouvais disposer, me parurent à peine suffisants pour une entreprise aussi hardie; mais je ne doutai pas que je ne finisse par réussir. Je me préparai à une multitude de revers; il était possible que mes opérations fussent sans succès, et enfin que mon ouvrage fût imparfait. Cependant, en réfléchissant aux progrès qu'on faisait tous les jours dans la science et dans la mécanique, je me flattais que mes essais seraient du moins la base d'un prochain succès, et je ne pouvais croire que mon plan fût impraticable, par cela même qu'il était grand et compliqué. Ce fut dans ces dispositions que je commençai à créer un être humain. Comme la petitesse des parties formait une grande difficulté, je crus pouvoir accélérer mon ouvrage, en prenant la résolution, contraire à mes premières intentions, de le faire d'une stature gigantesque, c'est-à-dire, d'environ huit pieds de hauteur, et d'une grosseur proportionnée. Cette détermination prise, je m'occupai pendant plusieurs mois à rassembler et à arranger avec succès mes matériaux: enfin, je me mis à l'ouvrage.
On ne saurait imaginer la variété des sentiments qui m'agitaient, comme une tempête, dans le premier enthousiasme de mon heureuse entreprise. La vie et la mort me parurent des limites idéales; j'allais bientôt les franchir; j'allais verser un torrent de lumière sur l'obscurité du monde. Une nouvelle génération me bénirait comme son créateur et sa source: une foule d'êtres heureux et excellents me devraient leur existence. Aucun père ne pourrait réclamer la reconnaissance de son enfant, autant que je mériterais la sienne. En poursuivant ces réflexions, je pensai que si je pouvais animer une matière inerte, je pourrais, avec le temps (quoique je le regardasse alors comme impossible), rendre la vie à un corps que la mort semblait avoir destiné à la corruption.
Ces idées soutenaient mon courage, pendant que je poursuivais sans relâche mon entreprise. Mes joues étaient devenues pâles par l'étude, et mon corps s'amaigrissait par le défaut de nourriture. Quelquefois je pensais être parvenu au but, et j'échouais; mais je ne désespérais pas qu'au premier jour, ou au premier moment, mes espérances ne fussent réalisées. Le désir de posséder seul un pareil secret, me dominait entièrement: la lune éclairait mes opérations nocturnes, pendant que je poursuivais la nature jusque dans ses retraites les plus cachées, avec une ardeur sans relâche. Qui pourra concevoir l'horreur de mes travaux secrets, lorsque je profanais les tombeaux, ou que je torturais l'animal vivant, pour animer un froid argile? Mes membres en tremblent encore; tout est encore présent à mes yeux; mais alors j'étais entraîné par une impulsion irrésistible et presque fanatique; il me semblait n'avoir plus d'âme ou de sensation que pour la poursuite de cet objet. Ce n'était, il est vrai, qu'un enthousiasme passager, qui pouvait seulement contribuer à me faire sentir, avec une nouvelle force, dès que l'aiguillon surnaturel cesserait d'agir, que je retournerais à mes anciennes habitudes. Je ramassais des os dans les charniers; et de mes doigts profanes, je troublais les secrets effroyables du tombeau. Enfermé dans une chambre, ou plutôt dans une cellule solitaire, de la partie la plus élevée de la maison, et séparée de tous les autres appartements par une galerie et par un escalier, je me livrais au travail d'une création pleine de dégoût: mes yeux sortaient de leur orbite, pour suivre les détails de mes occupations. La salle de dissection et la tuerie me fournissaient un grand nombre de matériaux; souvent je me détournais avec horreur de mes travaux, lorsqu'excité encore par une ardeur toujours croissante, j'étais près d'achever mon ouvrage.
L'été se passa, pendant que j'étais engagé de cœur et d'âme dans n'était pas cette seule poursuite. La saison était magnifique: jamais moisson plus abondante ne couvrit les champs; jamais vendanges ne furent plus riches: mais j'étais insensible aux charmes de la nature; et les mêmes pensées qui me firent négliger les scènes qui se passaient autour de moi, me firent aussi oublier ces amis qui étaient éloignés de tant de lieues, et que je n'avais pas vus depuis si long-temps. Je savais que mon silence les inquiétait.
Je me rappelais, mot pour mot, ce que m'avait dit mon père: «Tant que vous serez satisfait de vous-même, vous penserez à nous avec affection, et nous recevrons régulièrement de vos nouvelles. Ne me blâmez pas si je regarde toute interruption dans votre correspondance, comme une preuve que vos autres devoirs sont également négligés».
Ainsi, je connaissais bien quelle devait être l'opinion de mon père, et pourtant je ne pouvais m'arracher à des occupations repoussantes en elles-mêmes, mais dont le pouvoir sur moi était in surmontable. Je remis alors tout ce qui avait rapport à mes sentiments d'affection, jusqu'à ce que j'eusse accompli le grand œuvre qui me détournait de toutes les habitudes de ma vie.
Je pensais que mon père serait injuste, s'il attribuait ma négligence à mes défauts ou à mes vices. Maintenant, je suis convaincu qu'il avait raison de penser que ma conduite n'était pas exempte de blâme. Un homme parfait doit toujours maintenir son esprit dans le calme et dans la paix; sa tranquillité ne doit jamais être troublée par une passion ou par un goût passager. Je ne crois pas que l'étude même soit une exception à cette règle. Si l'étude à laquelle on s'applique, doit affaiblir les affections, et ôter le goût de ces plaisirs simples dans lesquels on ne peut éprouver aucune altération, alors cette étude est sans aucun doute illégitime; c'est-à-dire, qu'elle ne convient pas à l'esprit humain. Si cette règle était toujours observée, si l'homme ne laissait aucune passion altérer le charme paisible de ses affections domestiques, la Grèce n'eût pas été réduite en esclavage; César n'eût pas immolé son pays; l'Amérique n'eût pas été découverte; et les empires du Mexique et du Pérou n'auraient pas été détruits.
Mais que fais-je? Je moralise au moment le plus intéressant de mon histoire, tandis que je lis dans vos regards l'invitation de continuer.
Mon père ne me faisait aucun reproche dans ses lettres, seulement mon silence l'engagea à s'informer de mes occupations, plus particulièrement qu'il ne l'avait fait jusque-là. L'hiver, le printemps et l'été s'écoulèrent pendant mes travaux, sans que je fisse attention à l'apparition successive des fleurs ou des feuilles, qui autrefois me faisait toujours éprouver le plus doux plaisir, tant j'étais plongé dans mon entreprise. Les vacances de cette année s'écoulèrent avant que mon ouvrage ne fut près d'être achevé. Je voyais alors, chaque jour, plus clairement combien j'avais réussi; mais mon enthousiasme était réprimé par mon inquiétude; et j'avais plutôt l'air d'un homme condamné à travailler aux mines, ou à tout autre objet malsain, que d'un artiste au milieu de ses occupations favorites. Toutes les nuits j'étais tourmenté d'une fièvre lente: je reconnus enfin que mon système nerveux était fortement attaqué. J'en éprouvai un grand chagrin, parce que j'avais jusqu'alors joui de la meilleure santé, et que je m'étais toujours vanté de la force de mes nerfs. Mais je croyais que l'exercice et l'amusement dissiperaient bientôt de pareils symptômes, et je me promettais de m'y livrer, dès que ma création serait terminée.
Ce fut en novembre, pendant une nuit affreuse, que je vis l'accomplissement de mes travaux. Dans une inquiétude voisine de l'agonie, je rassemblai autour de moi les instruments propres à donner la vie, pour introduire une étincelle d'existence dans cette matière inanimée qui était à mes pieds. L'airain avait déjà sonné la première heure après minuit; la pluie battait, avec un sifflement horrible, contre mes fenêtres; ma lumière était près de s'éteindre, lorsqu'à cette lueur vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune et stupide de la créature: elle respira avec force, et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif.
Comment décrire ce que j'éprouvai à cette vue, ou comment peindre le malheureux dont la formation m'avait coûté tant d'efforts, de peines, et de soins? Ses membres étaient d'une juste proportion, et les traits que je lui avais donnés n'étaient pas moins beaux. Beaux!... grand Dieu! sa peau jaune couvrait à peine le système des muscles et des artères: sa chevelure flottante était d'un noir brillant; ses dents étaient blanches comme des perles; mais ces avantages ne formaient qu'un contraste plus horrible avec des yeux insipides, qui paraissaient presque de la même couleur que leurs blanches et sombres orbites; une peau ridée, et des lèvres noires et serrées l'une contre l'autre. Les différents événements de la vie ne sont pas aussi variables que les sensations du cœur humain. Je n'avais pas cessé de travailler pendant près de deux ans, dans le seul but de donner l'être à un corps inanimé. Dans cette vue, j'avais négligé mon repos et ma santé: j'avais désiré atteindre ce but avec une ardeur immodérée; et, maintenant que j'y étais parvenu, la beauté du rêve s'évanouit; mon cœur se remplit d'une horreur et d'un dégoût affreux. N'ayant pas la force de soutenir la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire, et me promenai long-temps en parcourant ma chambre, en tous sens, et sans songer au sommeil. Enfin, la fatigue succéda à mon agitation, et je me jetai sur mon lit pour chercher, pendant quelques moments, l'oubli de ma situation. Ce fut en vain: je dormis pourtant; mais je fus troublé par les rêves les plus effrayants. Je crus voir Élisabeth, brillante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé et surpris, je l'embrassai; en imprimant mon premier baiser sur ses lèvres, je les vis devenir livides comme la mort; je vis ses traits changer, et je crus tenir entre mes bras le cadavre de ma mère. Elle était couverte d'un linceul, dans les plis duquel je voyais ramper les vers du tombeau. Je m'éveillai saisi d'horreur; une sueur froide couvrait mon front; mes dents claquaient les unes contre les autres; et tous mes membres étaient en convulsion, lorsqu'à la clarté faible et jaunâtre de la lune qui donnait sur les croisées, je distinguai le malheureux..., le misérable monstre que j'avais créé. Il tenait les rideaux du lit; et ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Sa bouche s'ouvrit, et il fit entendre quelques sons inarticulés, en faisant des grimaces affreuses. Peut-être avait-il parlé; mais je n'entendis pas; il étendit une main, sans doute pour me retenir, mais j'échappai, et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiai dans la cour de la maison, où je passai le reste de la nuit à me promener en long et en large dans la plus grande agitation, prêtant attentivement et avec crainte l'oreille au moindre bruit, comme s'il m'annonçait l'approche du démon à qui j'avais si malheureusement donné la vie.
Ah! quel mortel pourrait soutenir l'horreur de cette situation! Une momie à qui on rendrait l'âme, ne serait pas aussi hideuse que ce monstre. Je l'avais observé lorsqu'il n'était pas encore achevé: il était laid alors; mais, lorsque les muscles et les articulations purent se mouvoir, il devint si horrible, que le Dante lui-même n'aurait pu l'imaginer.
Je passai la nuit dans des transes cruelles. Tantôt mon pouls battait si vite et avec tant de violence, que je sentais la palpitation de tous les artères; tantôt je succombais presque de langueur et de faiblesse. Saisi d'horreur, je compris avec amertume combien je m'étais abusé: les rêves, dont je m'étais bercé si long-temps et avec tant de plaisir, étaient maintenant devenus un tourment pour moi. Comment n'aurais-je pas éprouvé ce tourment? Mon changement fut si rapide; mes espérances furent si cruellement déçues en tous points!
Le jour commença enfin à paraître; le temps était sombre et pluvieux. Cependant, mes yeux découvrirent l'église d'Ingolstadt, ses blancs clochers, et l'horloge qui marquait six heures. Le gardien ouvrit les portes de la cour qui avait été mon asile pendant la nuit: je sortis dans les rues; je me mis à les parcourir avec précipitation comme si je cherchais à éviter le misérable, et en tremblant de le rencontrer à chaque détour de rue. Je n'osais retourner à l'appartement que j'habitais; et je me sentais entraîné avec une vitesse prodigieuse, quoique trempé par la pluie qui tombait à verse d'un ciel noir et couvert.
Je continuai pendant quelque temps à marcher ainsi, essayant, par l'exercice du corps, de me soulager du poids qui accablait mon esprit. Je traversais les rues sans savoir où j'étais, ni ce que je faisais. Mon cœur palpitait de frayeur, et et je marchais à pas irréguliers, sans oser regarder autour de moi:
Semblable à celui qui, en se promenant sur une route solitaire, est saisi de crainte et d'horreur, et qui, après s'être une seule fois retourné, presse le pas et n'ose plus détourner la tête; il craint qu'un ennemi effrayant ne marche derrière lui[2].
En continuant ainsi, j'arrivai enfin devant une auberge où descendaient ordinairement les voitures et les diligences. Je m'y arrêtai machinalement, et je restai pendant quelques minutes les yeux fixés sur une voiture qui arrivait par l'autre bout de la rue, et qui, en s'approchant, me parut être la diligence Suisse: elle s'arrêta à l'endroit même où j'étais; et, dès que la portière fut ouverte, je vis Henri Clerval, qui, en m'apercevant, s'élança dans mes bras. «Mon cher Frankenstein, s'écria-t-il, que je suis content de te voir! que je suis heureux de te rencontrer ici au moment même de mon arrivée»!
Rien ne put égaler le plaisir que j'éprouvai à la vue de Clerval; sa présence reportait toutes mes pensées vers mon père, Élisabeth, et toutes ces scènes domestiques dont le souvenir m'était si doux. Je tenais sa main; et, dans un moment, j'oubliai mes tourments et mon malheur; j'éprouvai tout à coup, et pour la première fois depuis plusieurs mois, une joie calme et sereine. J'accueillis mon ami de la manière la plus cordiale; et nous nous dirigeâmes vers mon collège. Clerval me parla pendant quelque temps de nos amis communs, et me dit combien il se félicitait d'avoir obtenu de venir à Ingolstadt. «Tu peux facilement, me dit-il, t'imaginer les efforts que j'ai dû employer, pour persuader à mon père qu'il n'était pas nécessaire à un négociant de ne connaître absolument que la tenue des livres; vraiment je ne me flatte pas d'avoir ébranlé son incrédulité; car sa réponse, constante à mes sollicitations, était toujours celle du maître d'école Hollandais dans le ministre de Wakefield: (j'ai 10,000 florins de rentes sans savoir le Grec, et cela ne m'empêche pas d'en jouir de bon cœur). Mais son affection pour moi a triomphé enfin de son mépris pour l'instruction; et il m'a permis d'entreprendre un voyage de découverte dans le pays de la science».
—«J'ai le plus grand plaisir à te voir, mais je n'en aurais pas moins à apprendre de toi comment se portent mon père, mes frères et Élisabeth».
—«À mon départ, ils étaient en bonne santé, et très-heureux, mais un peu fâchés de ne recevoir que si rarement de tes nouvelles. Cela me fait penser que j'ai à t'adresser des reproches de leur part. Mais, mon cher Frankenstein, continua-t-il, en s'arrêtant court, et en me regardant en face, je n'avais pas encore remarqué ta mauvaise mine, si maigre et si pâle; tu as l'air d'avoir veillé pendant plusieurs nuits.»
—«Tu as deviné juste; j'ai été dernièrement si plongé dans un travail, que je ne me suis pas donné assez de repos, comme tu vois. Mais j'espère bien sincèrement que je suis maintenant au terme de toutes ces occupations, et que j'en suis enfin délivré».
Je tremblais excessivement; je ne pouvais songer aux événements de la nuit précédente, ni à tout ce qui y faisait allusion. Je marchais d'un pas rapide, et nous arrivâmes bientôt à mon collège. Je réfléchis alors, et je frissonnai à l'idée que la créature que j'avais laissée dans mon appartement, pourrait y être encore, vivre et se promener. Je tremblais de voir ce monstre; mais je craignais encore plus qu'Henri ne le vit. Je le priai donc de rester quelques minutes au bas de l'escalier, et je montai dans ma chambre. J'allais ouvrir la porte, et je ne m'étais pas encore recueilli. Je m'arrêtai alors, en frissonnant. Je poussai la porte avec force, à la manière des enfants qui s'imaginent trouver un spectre qui les attend dans l'autre extrémité: mais rien ne parut. Je marchais avec crainte: l'appartement était vide, et ma chambre était aussi délivrée de son hôte hideux. J'avais peine à croire à mon bonheur; certain enfin de l'absence de mon ennemi, je frappai mes mains de joie, et je courus vers Clerval.
Nous montâmes dans ma chambre, où le domestique nous apporta aussitôt à déjeuner; mais je ne pouvais me contenir. Je n'étais pas seulement troublé par la joie; je me sentais agité aussi par un excès de sensibilité, et par les battements rapides de mon pouls. Je ne pouvais rester un seul instant à la même place; je sautais sur les chaises, je frappais des mains, et je riais aux éclats. Clerval attribua d'abord l'état extraordinaire dans lequel il me voyait au plaisir que me causait son arrivée; mais en m'observant avec plus d'attention, il vit dans mes yeux un égarement dont il ne put se rendre compte; et il fut aussi effrayé qu'étonné de mes éclats de rire immodérés, dont aucun ne venait du cœur.
—«Mon cher Victor, s'écria-t-il, pour l'amour de Dieu, dis-moi ce que tu as? Ne ris pas de cette manière. Comme tu es mal! Quelle est la cause de tout ce que je vois?
—»Ne me le demande pas, lui dis-je, en me mettant les mains sur les yeux, car je crus voir le monstre horrible se glisser dans la chambre; il peut dire.—ah! sauve moi! sauve moi»! Je m'imaginais que le monstre me saisissait; je me débattais avec fureur, et je cédai à un violent accès.
Pauvre Clerval, qu'a-t-il dû éprouver? En quelle amertume se changeait la joie qu'il s'était promise à nous revoir! Mais je n'étais pas le témoin de sa douleur; car j'étais sans vie, et je ne recouvrai les sens que long-temps, long-temps après.
Tel fut le commencement d'une fièvre nerveuse, qui me retint plusieurs mois. Pendant tout ce temps, Henri seul me soigna. J'appris par la suite qu'il avait caché à Élisabeth et à mon père l'excès de mon égarement, pour épargner des chagrins à l'un, qui, dans un âge avancé, ne pourrait entreprendre un aussi long voyage, et à l'autre, qui ne pourrait supporter l'idée de ma maladie. Il savait que je ne pourrais avoir de soins meilleurs et plus assidus que les siens, et ferme dans l'espérance que je recouvrerais la santé, il ne douta pas que loin de mal agir, il ne fit une très-bonne action vis-à-vis de mes parents.
J'étais réellement très-malade, et rien n'était plus propre à me rendre à la vie que les attentions excessives et continuelles de mon ami. Le monstre, à qui j'avais donné l'existence, était toujours devant mes yeux; il était sans cesse l'objet de mes discours dans mon délire. Sans doute Henry fut surpris de mes paroles: il les prit d'abord pour les égarements de mon imagination troublée; mais la ténacité qui me portait à revenir continuellement sur le même sujet, lui donna lieu de penser que ma maladie avait réellement pour cause quelqu'événement extraordinaire et terrible.
Je me rétablis lentement, et après des rechutes fréquentes, qui alarmèrent et affligèrent mon ami. Je me souviens que la première fois que je devins capable d'observer avec une sorte de plaisir les objets extérieurs, je vis que les feuilles tombées avaient disparu, et que de jeunes bourgeons poussaient aux arbres qui ombrageaient ma fenêtre. C'était un printemps délicieux, et la saison eut une grande influence dans ma convalescence. Je sentis aussi renaître dans mon cœur des sentiments de joie et d'affection. Mon chagrin s'était dissipé, et bientôt je devins aussi gai qu'avant que je fusse en proie à ma funeste passion.
«Cher Clerval, m'écriai-je, que tu es aimable, que tu es bon pour moi! Au lieu d'employer tout cet hiver à l'étude, ainsi que tu te l'étais promis, tu l'as passé dans la chambre d'un malade. Comment pourrais-je jamais reconnaître ce service? J'éprouve le plus grand remords de t'avoir détourné de tes projets; mais tu pardonneras à ton ami.
—»J'en serai suffisamment dédommagé si tu ne te troubles pas; si tu te rétablis aussi promptement qu'il est possible. À présent que ton esprit me paraît tranquille, je te puis parler sur un sujet;... ne le puis-je»?
Je tremblai. Quel pouvait être ce sujet? ferait-il allusion à un objet auquel je n'osais même penser?
«Calme-toi, dit Clerval, qui me vit changer de couleur, je ne t'en parlerai pas si cela t'agite; mais ton père et ta cousine seraient bien heureux de recevoir une lettre écrite de ta main. Ils ne savent pas combien tu as été malade, et sont inquiets de ton long silence.
«N'est-ce que cela, mon cher Henry? Comment as-tu pu supposer que ma première pensée ne se porterait pas vers ces amis si chers, que j'aime, et qui méritent tant que je les aime»?
«Si telles sont maintenant tes dispositions, tu seras peut-être bien aise, mon ami, de voir une lettre qui est arrivée ici pour toi depuis plusieurs jours: elle est, je crois, de ta cousine».
[2]Coleridge's «Ancient Mariner».
Clerval me remit la lettre suivante:
«Mon cher Cousin,
»Je ne puis vous peindre l'inquiétude que nous avons tous éprouvée au sujet de voire santé. Nous ne pouvons nous empêcher de croire que votre ami Clerval nous cache la gravité de votre maladie: car voici plusieurs mois que nous n'avons vu de votre écriture, puisque vous avez été obligé, pendant tout ce temps-là, de dicter vos lettres à Henry. Il faut, Victor, que vous ayez été bien malade. Nous en sommes presqu'aussi malheureux, que nous l'étions après la mort de votre excellente mère. Mon oncle s'était persuadé que vous étiez très-dangereusement malade: nous l'avons empêché, mais non sans peine, d'entreprendre le voyage d'Ingolstadt. Clerval écrit toujours que vous allez mieux; j'espère vivement que vous nous confirmerez bientôt cette nouvelle par une lettre écrite de votre propre main; car, vraiment, Victor, nous sommes tous très-affligés de votre état. Qu'un mot de vous nous ôte toute crainte, et nous serons les êtres du monde les plus heureux. Votre père jouit maintenant d'une si bonne santé, que, depuis l'hiver dernier, il parait avoir dix ans de moins. Ernest a tellement grandi, que vous auriez de la peine à le reconnaître; il a maintenant près de seize ans, et ne paraît plus maladif, comme nous l'avons vu il y a quelques années: c'est un garçon tout-à-fait fort et animé.
»Hier au soir, j'ai eu une longue conversation avec mon oncle sur le parti qu'embrasserait Ernest. Dans un état continuel de maladie, pendant son enfance, il n'a pu prendre l'habitude du travail; et à présent qu'il jouit d'une bonne santé, il est sans cesse à courir au grand air, à gravir les montagnes, on à voguer sur le lac. J'ai proposé d'en faire un cultivateur; vous savez, mon cousin, qu'aucun état ne me paraît préférable. Un cultivateur mène la vie du monde la plus paisible et la plus heureuse, et se livre en même temps à un travail, dont les chances sont peu à craindre et les bénéfices presque certains. Mon oncle aurait voulu qu'il fit les études nécessaires pour être avocat, afin que par la suite il pût devenir juge. Mais, outre qu'il n'est nullement propre à une semblable profession, il est certainement plus honorable à lui de cultiver la terre pour la subsistance de l'homme, que d'être le confident, ou quelquefois le complice de ses crimes; car un homme de loi ne fait pas autre chose. Je disais que si les occupations d'un bon cultivateur n'étaient pas plus honorables, elles étaient du moins d'un genre plus agréable que celles d'un juge, qui avait le malheur de n'être jamais témoin que des crimes de l'homme. Mon oncle sourit en me disant que je devrais être avocat moi-même: cela mit fin à notre conversation.
»Je veux maintenant vous raconter une petite histoire qui vous plaira et vous intéressera peut-être. Vous souvenez-vous de Justine Moritz?—Non, sans doute.—Eh bien! je vous raconterai son histoire en peu de mots. Madame Moritz, sa mère, était veuve avec quatre enfants, dont Justine était le troisième. Cette jeune fille avait toujours été l'objet des prédilections du père; mais, par une étrange perversité, la mère ne pouvait la souffrir, et, après la mort de M. Moritz, elle la traita fort mal. Ma tante le remarqua, et pria la mère de Justine, qui était alors âgée de douze ans, de la laisser avec nous. Les institutions républicaines de notre pays ont donné lieu à des habitudes plus simples et plus heureuses, que celles qui dominent dans les grandes monarchies qui l'entourent. Il en résulte moins de distinction entre les différentes classes des habitants; il en résulte aussi que les dernières, qui sont moins pauvres et moins méprisées, conservent des habitudes plus pures et plus honnêtes. Un domestique à Genève ne sent pas de même que ceux de France et d'Angleterre. Justine, ainsi reçue dans notre famille, apprit les devoirs d'une servante: condition qui, dans notre heureux pays, ne renferme pas l'idée d'ignorance, et n'entraîne pas le sacrifice de la dignité d'un être humain.
»À présent, j'ose dire que vous vous rappelez à merveille l'héroïne de ma petite histoire: car vous aimiez beaucoup Justine. Je me souviens même que vous remarquiez autrefois, qu'un regard de Justine suffisait pour calmer votre mauvaise humeur, ainsi que l'Arioste parle de la beauté d'Angélique, tant elle avait un air candide et heureux. Ma tante connut beaucoup d'attachement pour elle, ce qui l'engagea à lui donner une éducation supérieure à celle qu'elle avait d'abord espérée. Ce bienfait fut bien placé; Justine était la petite créature du monde la plus reconnaissante: je ne veux pas dire qu'elle en fît profession; je ne l'ai jamais entendu l'exprimer par des paroles; mais ses yeux eussent fait croire qu'elle adorait presque sa protectrice. Quoique son caractère fût fort gai et souvent léger, elle faisait pourtant la plus grande attention au moindre geste de ma tante. Elle la regardait comme le modèle le plus parfait, et elle tachait d'imiter sa façon de parler et ses manières, au point que, même à présent, elle me la rappelle souvent.
»À la mort de ma chère tante, chacun était trop occupé de sa propre douleur pour faire attention à la pauvre Justine, qui l'avait soignée pendant sa maladie avec la plus vive affection. La pauvre Justine fut très-malade; mais elle était réservée à d'autres épreuves.
»Ses frères et sa sœur moururent l'un après l'autre, et sa mère resta sans autre enfant que la fille qu'elle négligeait. Cette femme, troublée par le cri de sa conscience, commença à croire que la mort de ses enfants préférés était un jugement du ciel, qui la punissait de sa partialité. Elle était Catholique Romaine, et je crois qu'elle fut confirmée dans l'opinion où elle était, par son confesseur. Aussi, peu de mois après votre départ pour Ingolstadt, Justine fut rappelée par sa mère repentante. Pauvre fille! elle pleura en quittant notre maison: elle était bien changée depuis la mort de ma tante; le chagrin avait mêlé à son humeur, autrefois si vive, une douceur et une langueur attrayantes. Son séjour dans la maison maternelle n'était pas de nature à lui rendre la gaîté. La pauvre femme était très-chancelante dans son repentir. Quelquefois elle priait Justine de lui pardonner sa dureté; mais bien plus souvent elle l'accusait d'avoir causé la mort de ses frères et de sa sœur. Madame Moritz, dont le caractère irascible ne fut d'abord qu'irrité par un état d'aigreur continuelle, repose maintenant en paix. Elle mourut aux premières approches du froid, au commencement de l'hiver dernier. Justine est revenue avec nous, et je vous assure que je l'aime tendrement. Elle est très-adroite, très-douce, et extrêmement jolie. Comme je vous l'ai déjà dit, ses manières et ses expressions me rappellent continuellement ma chère tante.
»Il faut aussi, mon cher cousin, que je vous parle un peu du gentil petit Guillaume: il est très-grand pour son âge; je voudrais que vous le vissiez, avec ses yeux bleus, doux et vifs, ses cils noirs et ses cheveux bouclés. Lorsqu'il sourit, on voit sur ses joues deux petites fossettes qui sont fraîches comme la rose. Il a déjà eu une ou deux petites femmes; mais Louisa Biron est sa favorite: c'est une jolie petite fille de cinq ans.
»Je pense, mon cher Victor, que vous serez bien aise que je vous parle un peu des bons habitants de Genève. La jolie mademoiselle Mansfield a déjà reçu les visites de félicitation sur son prochain mariage avec un jeune Anglais, nommé John Melbourne, écuyer. Sa vilaine sœur, Manon, a épousé, l'automne dernier, le riche banquier M. Duvillard. Votre bon camarade d'études, Louis Manoir, a été plusieurs fois malade depuis que Clerval est parti de Genève; il a déjà recouvré la santé, et il est sur le point d'épouser une très-aimable et très-jolie française, madame Tavernier. Elle est veuve et plus âgée que lui; mais on la trouve très-belle, et elle est aimée de tout le monde.
»Moi qui vous écris, je suis en bonne santé, mon cher cousin; mais je ne puis terminer ma lettre sans vous demander encore avec inquiétude des nouvelles de la vôtre. Mon cher Victor, si vous n'êtes pas trop malade, écrivez vous-même, et rendez heureux votre père et nous tous; ou.... Je n'ai pas la force de penser au malheur; mes pleurs coulent déjà. Adieu, mon très-cher cousin.
»ÉLISABETH LAVENZA».
Genève, 18 mars 17—
«Chère Élisabeth! m'écriai-je, après avoir lu sa lettre, j'écrirai sur-le-champ, et je mettrai fin à l'inquiétude qui doit la tourmenter». J'écrivis, et je fus très-fatigué d'avoir écrit; mais ma convalescence venait de commencer, elle continua régulièrement. Quinze jours après, je pus quitter la chambre.
Un de mes premiers devoirs fut de présenter Clerval à plusieurs professeurs de l'université. En agissant ainsi, je suivis une sorte d'usage qui m'était pénible, et qui convenait mal aux souffrances dont mon cœur avait été déchiré. Depuis la nuit fatale qui avait été témoin de la fin de mes travaux, et du commencement de mes malheurs, j'avais conçu une violente antipathie contre le nom même de la philosophie naturelle. Bien plus: dans un état complet de santé, la vue d'un instrument d'alchimie était capable de renouveler toutes mes agitations nerveuses. Henry s'en était aperçu, et avait fait disparaître tous mes appareils. Il avait aussi voulu que je quittasse mon appartement; car il avait remarqué que j'évitais d'aller dans la chambre qui m'avait auparavant servi de laboratoire. Mais tous les soins de Clerval furent perdus au moment où j'allai rendre visite aux professeurs. M. Waldman me mit à la torture, en louant avec bonté et chaleur mes progrès étonnants dans les sciences. Il ne tarda pas à voir que cette conversation me gênait; mais, n'en devinant pas la véritable cause, il l'attribua à la modestie, et cessa de vanter mes progrès, pour parler de la science elle-même, avec le désir bien évident que je me misse à en parler. Que pouvais-je faire? il voulait me plaire, et il me tourmentait. Je souffrais comme s'il avait placé, un à un devant moi, ces instrument qui devaient servir dans la suite à me conduire à une mort lente et cruelle. Je souffrais de ce qu'il disait, sans oser montrer la peine que j'éprouvais. Clerval, qui était toujours si prompt à discerner les sensations des autres, détourna la conversation, en alléguant pour excuse son ignorance complète, et donna à la conversation un tour plus général. Je remerciai mon ami du fond de mon cœur, mais je ne parlai pas. Je vis clairement qu'il était surpris, mais il n'essaya jamais de m'arracher mon secret; et, quoique je l'aimasse avec un mélange d'affection et de respect qui ne connaissaient pas de bornes, je ne pouvais cependant me décider à lui confier l'événement qui était si souvent présent à ma mémoire, mais dont je craignais d'imprimer trop profondément le souvenir à un autre.
M. Krempe ne fut pas aussi docile; et, dans mon état de sensibilité excessive, ses éloges brusques et grossiers me firent même plus de mal que la bienveillante approbation de M. Waldman. «Savant collègue! s'écria-t-il; je vous assure, M. Clerval, qu'il nous a tous surpassés. Oui; regardez-moi si cela vous plaît, mais ce que je dis n'en est pas moins vrai. Un jeune homme qui, il y a quelques années, croyait en Cornélius Agrippa, aussi fermement qu'en l'Évangile, s'est maintenant mis à la tête de l'université; et s'il n'est bientôt à bas, nous ne pourrons tenir à côté de lui.—Allons, allons, continua-t-il, en voyant mon air de souffrance, M. Frankenstein est modeste; c'est une excellente qualité pour un jeune homme. Les jeunes gens doivent se défier d'eux-mêmes, vous savez, M. Clerval; j'étais comme lui dans ma jeunesse; mais cela passe bien vite».
M. Krempe commença alors un éloge de lui-même, qui détourna la conversation d'un sujet qui me causait tant de mal.
Clerval n'aimait nullement la philosophie naturelle. Son imagination était trop vive pour s'arrêter aux minuties de cette science. Sa principale étude était celle des langues; son but, en s'y adonnant, était d'ouvrir un champ à son instruction, lorsqu'il serait de retour à Genève. Le Persan, l'Arabe et l'Hébreu, furent, après une étude approfondie du Grec et du Latin, l'objet de son application. Quant à moi, à qui la paresse avait toujours été odieuse; dans le désir de fuir les réflexions, et en haine de mes premières études, j'éprouvai un grand plaisir à être le condisciple de mon ami, et je ne trouvai pas seulement de l'instruction, mais encore des consolations dans les ouvrages des auteurs Orientaux. Leur mélancolie est brûlante; et leur bonheur vous élève à une hauteur que je n'avais jamais connue dans l'étude des auteurs des autres pays. En lisant leurs écrits, il semble que la vie s'écoule sous un soleil brûlant et dans un jardin de roses, entre les sourires et les dédains d'une beauté cruelle, et dans un feu qui consume le cœur. Combien diffère la poésie forte et héroïque des Grecs et des Romains!
L'été se passa ainsi, et mon retour à Genève fut fixé pour la fin de l'automne; mais, retardé pour plusieurs motifs, je fus surpris par l'hiver et la neige, qui rendirent les chemins impraticables, et je remis mon voyage au printemps suivant. Je fus très-affligé de ce retard; car j'étais impatient de revoir ma ville natale et mes amis. Mon retour n'avait été différé aussi long-temps, que parce que je ne voulais pas laisser Clerval dans une ville étrangère, avant qu'il n'eût fait connaissance avec quelques-uns des habitants. Cependant, l'hiver se passa très-gaîment; et le printemps, qui fut plus tardif qu'à l'ordinaire, fut aussi plus beau et plus agréable.
Nous étions au mois de mai; et j'attendais de jour en jour la lettre qui devait fixer la date de mon départ, lorsqu'Henry me proposa de parcourir à pied les environs d'Ingolstadt, pour faire mes adieux au pays que j'avais si long-temps habité. Je me rendis avec plaisir à cette proposition; j'aimais l'exercice, et j'avais toujours eu Clerval, de préférence, à tout autre, pour m'accompagner dans ces sortes de courses, auxquelles je m'étais accoutumé dans mon pays natal.
Nous passâmes quinze jours à courir d'un côté et d'un autre. Ma santé et mon esprit étaient depuis long-temps rétablis, et s'affermissaient de jour en jour par l'air pur que je respirais, par l'accroissement naturel de mes forces, et la conversation de mon ami. L'étude m'avait éloigné auparavant de mes condisciples et m'avait rendu insociable; mais Clerval excitait les dispositions qu'une nature meilleure avait mises dans mon cœur. J'aimai de nouveau les beautés de la nature et l'enjouement des enfants. Excellent ami! avec quelle sincérité tu m'aimais! Tu cherchais élever mon esprit à la hauteur du tien. J'étais miné et affaibli par un travail profond; mais ta douceur et ton affection ont réchauffé et ranimé mes sens. Je redevins le même qui naguère aimait tout le monde et en était également aimé, qui n'avait ni soucis ni chagrins. Au temps de mon bonheur, la nature inanimée avait le pouvoir de me jeter dans les sensations les plus délicieuses. J'étais en extase à la vue d'un ciel sans nuages et de la verdure des champs. Il est vrai que la saison dont je parle était admirable; les fleurs du printemps embellissaient les jardins, pendant que celles d'été étaient près d'éclore: je n'étais pas troublé par les pensées qui, l'année précédente, m'avaient accablé d'un poids insurmontable, malgré mes efforts pour les éloigner.
Henry se réjouissait de ma gaîté, et partageait sincèrement mes sensations: il s'occupait de m'amuser, et il me rendait compte en même temps des sentiments de son âme. Dans cette occasion, les ressources de son esprit étaient vraiment étonnantes: sa conversation était pleine d'imagination; et très-souvent, à l'imitation des écrivains Persans et Arabes, il inventait des contes dont les idées et les passions étaient surprenantes. D'autres fois, il récitait mes poèmes favoris, ou proposait des arguments qu'il soutenait avec beaucoup d'esprit.
Nous retournâmes à notre collège un dimanche dans l'après-midi: des paysans dansaient, et toutes les personnes que nous rencontrions, paraissaient gaies et heureuses. J'étais dans l'enchantement: j'étais transporté par de vifs sentiments de joie et d'allégresse.»
À mon retour, je trouvai la lettre suivante de mon père:
«Mon cher Victor,
»Tu as sans doute attendu avec impatience une lettre qui fixât l'époque de ton retour au milieu de nous. J'ai d'abord été tenté de ne t'écrire que quelques lignes, uniquement pour te dire le jour où j'espère pouvoir t'embrasser; mais je n'ose pas te rendre un cruel service. Quelle sera ta surprise, mon fils, au moment où tu attends une nouvelle heureuse et agréable, de n'en recevoir au contraire que de tristes et de douloureuses? Et comment, mon cher Victor, pourrai-je te raconter notre malheur? Pourquoi faut-il que je t'afflige, mon fils, toi qui es loin de nous, mais qui, dans ton absence, n'es pas devenu insensible à nos joies et à nos chagrins? Je voudrais te préparer au malheur que je vais t'apprendre, mais je sens que cela m'est impossible, même à présent que tes yeux parcourent la page, pour y chercher les mots qui doivent t'en donner l'horrible certitude.
»Guillaume n'est plus!... Ce charmant enfant, dont le sourire suffisait pour réjouir et ranimer mon cœur, qui était si doux et si gai à la fois! Victor a été assassiné!...
»Je n'essayerai pas de te consoler; je me bornerai à te raconter les détails de cet évènement.
»Jeudi dernier (7 mars), j'allai, accompagné de ma nièce et de tes deux frères, me promener à Plinpalais. Le temps était chaud, et si serein que nous prolongeâmes notre promenade plus que de coutume. La soirée était déjà fort obscure avant que nous eussions pensé à rentrer; mais en nous disposant au retour, nous ne retrouvâmes plus Ernest et Guillaume qui avaient été au-devant de nous. Nous restâmes donc assis à les attendre. Ernest vint bientôt, et nous demanda si nous avions vu son frère: il nous dit qu'ils étaient à jouer ensemble; que Guillaume l'avait quitté pour se cacher, qu'il l'avait inutilement cherché, et attendu ensuite pendant long-temps, mais qu'il n'était pas venu.
»Ce récit ne servit qu'à nous alarmer. Nous continuâmes à le chercher jusqu'à la nuit tombante, quand Élisabeth conjectura qu'il pouvait être retourné à la maison. Il n'y était pas. Nous revînmes avec des torches; car je ne pouvais me reposer en songeant que mon fils s'était perdu, et restait exposé à toutes les humidités et aux rosées de la nuit: Élisabeth éprouvait aussi une angoisse extrême. Vers cinq heures du matin, je découvris mon aimable enfant que la nuit précédente j'avais vu brillant et fort de santé, étendu sur le gazon, livide, sans mouvement, et portant au col l'empreinte des doigts du meurtrier.
»Il fut rapporté à la maison, et la douleur qui était peinte sur mon visage apprit à Élisabeth notre malheur. Elle voulut à toute force voir le cadavre. J'essayai d'abord de l'en empêcher; mais elle persista, entra dans la chambre où il était placé, examina précipitamment le col de la victime, et s'écria, on frappant des mains: «Dieu! j'ai assassiné cet enfant que j'aimais»!
»Elle s'évanouit, et ne reprit ses sens qu'avec beaucoup de peine. Revenue de son évanouissement, elle ne cessa de pleurer et de gémir. Elle me dit que le soir même, Guillaume l'avait priée de lui mettre au col un riche portrait de ta mère, qui lui appartenait. Nul doute que ce portrait, qui a disparu, n'ait tenté le meurtrier, et ne l'ait porté au crime. Nous ignorons quelle trace il aura suivie, malgré l'activité de nos recherches pour le découvrir; mais hélas! rien ne me rendra mon bien-aimé Guillaume.
»Viens, mon cher Victor; tu peux seul consoler Élisabeth. Elle pleure sans cesse, et s'accuse injustement d'être cause de la mort de Guillaume. Nous sommes tous plongés dans la douleur; ne sera-ce pas un motif de plus pour toi, mon fils, de revenir et de nous apporter des consolations? Ta chère mère! hélas, Victor! je puis le dire maintenant, remercie Dieu de ce qu'elle ne vit pas, pour être témoin de la mort cruelle et malheureuse de son plus jeune enfant.
»Viens, Victor; sans nourrir des idées de vengeance contre l'assassin, mais avec des sentiments de paix et de douceur, qui calmeront les blessures de nos cœurs, au lieu de les irriter. Entre dans la maison du deuil, mon ami, l'âme pénétrée de tendresse et d'affection pour ceux qui t'aiment, et non de haine contre tes ennemis.
»Ton affectionné et désolé père,
»ALPHONSE FRANKENSTEIN».
Genève 12 mai 17—
Clerval, qui m'avait observé pendant la lecture de cette lettre, fut surpris de voir le désespoir qui succédait à la joie que j'avais d'abord éprouvée en recevant des nouvelles de mes amis. Je jetai la lettre sur la table, et me couvris la figure de mes mains.
«Mon cher Frankenstein, s'écria Henry, lorsqu'il me vit pleurer avec amertume, seras-tu toujours malheureux? Mon cher ami, qu'est-il arrivé»?
Je lui fis signe de prendre la lettre, pendant que je parcourais la chambre dans la plus grande agitation; des pleurs coulèrent aussi des yeux de Clerval, lorsqu'il lut le récit de mon malheur.
«Mon ami, dit-il, je ne puis t'offrir aucune consolation; cette perte est irréparable. Que veux-tu faire?
»—Partir sur-le-champ pour Genève: viens avec moi, Henry, commander les chevaux».
Pendant la route, Clerval chercha à relever mon courage. Il n'employait pas les phrases communes de consolation, mais il partageait franchement ma douleur. «Pauvre Guillaume, disait-il; il dort maintenant avec son angélique mère. Ses amis sont dans le deuil et dans l'affliction; et lui, il est en paix: il ne sent plus les doigts de l'assassin: il ne connaît pas la douleur; la terre couvre ses jolies formes. Il ne peut plus être un objet de pitié; ceux qui survivent sont les plus à plaindre, et ils ne peuvent attendre de consolation que du temps. On doit mépriser ces maximes des Stoïciens, que la mort n'est pas un mal, et que l'esprit de l'homme doit être supérieur au désespoir causé par l'absence éternelle d'un objet aimé. Caton même pleurait sur le cadavre de son frère».
Clerval parlait ainsi, pendant que nous traversions les rues avec rapidité. Ses paroles s'imprégnaient dans mon cœur; et je me les rappelai ensuite quand je fus seul. En ce moment, dès que les chevaux furent arrivés, je me jetai dans une chaise, en disant adieu à mon ami.
Mon voyage fut triste. Mon premier désir était d'en voir le terme; car il me tardait d'arriver pour consoler mes amis affligés, et partager leur douleur; mais, en approchant de ma ville natale, je ralentis ma marche. J'avais peine à résister à la multitude des sentiments tumultueux dont j'étais assiégé. Je traversais des lieux chers à mon enfance, et que je n'avais pas vus depuis près de six ans. Que de changements depuis cette époque! Un tremblement de terre subit avait tout désolé; et mille autres petites circonstances pouvaient avoir, par degrés, amené d'autres altérations, qui, quoique plus lentes, n'étaient pas moins sensibles. Je fus saisi de crainte: je n'osais pas avancer; je me croyais exposé à toutes sortes de malheurs imaginaires, et je tremblais, sans que je pusse les définir.
Je restai deux jours à Lausanne, dans cet état pénible d'esprit. Je contemplais le lac: les eaux étaient paisibles, tout était calme autour de moi, et les montagnes couvertes de neige, ces palais de la nature, n'étaient pas changés. Le calme et la beauté du ciel me ranimèrent insensiblement, et je continuai mon voyage vers Genève.
La route longeait le lac, qui devenait plus étroit à mesure que j'approchais de ma ville natale. Je découvris plus distinctement les flancs noirs du Jura, et le sommet brillant du Mont-Blanc; je pleurais comme un enfant: «montagnes chères à mon cœur! lac majestueux! dans quel état vous recevez celui qui vous parcourut si souvent? Votre sommet est brillant; le ciel et le lac sont azurés et tranquilles. Est-ce un présage de paix, ou bien une insulte à mon malheur»?
Je crains, mon ami, de vous ennuyer, en appuyant sur ces circonstances préliminaires; mais je me rappelais alors les jours de mon bonheur, et je ne puis y penser encore sans plaisir. Ma patrie, ô ma chère patrie! qui peut mieux qu'un de tes enfants peindre le plaisir que j'éprouvai à la vue de tes sources, de tes montagnes, et surtout de ton lac chéri?
Cependant, plus j'approchais de la maison de mon père, plus j'étais tourmenté par la crainte et le chagrin. La nuit vint à étendre son voile sur la nature; et quand je pus distinguer à peine les montagnes dans l'obscurité, je sentis que ma douleur était plus vive. Je me représentai une longue et effroyable suite de malheurs, et je prévis que j'étais destiné à devenir le plus infortuné de tous les hommes; hélas! j'ai prédit juste; et si je me suis trompé, c'est qu'en prévoyant et en redoutant tant de malheurs, je n'ai pas conçu la centième partie de tous ceux dont je devais être accablé.
Il était tout-à-fait nuit quand j'arrivai dans les environs de Genève. Les portes de la ville étant déjà fermées, je fus obligé de passer la nuit à Secheron, village situé à une demi-lieue à l'est de la ville. Dans une disposition d'esprit qui ne me permettait aucun repos, je voulus profiter de la sérénité du ciel pour voir l'endroit où mon pauvre Guillaume avait été assassiné. Je ne pouvais traverser la ville. Je me déterminai à passer le lac dans un bateau pour arriver à Plinpalais. Pendant ce court voyage, je vis sur le sommet du Mont-blanc les éclairs briller d'un éclat surprenant, et l'orage s'approcher avec rapidité; je touchai le rivage, et je montai sur une petite colline pour en observer les progrès. Il avançait au milieu d'un ciel qui se couvrait de nuages. Je sentis bientôt tomber de larges gouttes de pluie. L'orage éclata tout-à-coup avec violence.
Je quittai ma place et poursuivis ma route, malgré l'obscurité et l'orage qui croissaient à chaque minute, et malgré le tonnerre qui grondait au-dessus de ma tête avec une force effrayante, répété par les échos de Salève, du Jura, et des Alpes de la Savoie. J'étais ébloui par les éclairs qui se réfléchissaient dans le lac, et le rendaient semblable à une vaste nappe de feu; je fus même un moment dans une obscurité profonde, qui dura jusqu'à ce que l'éblouissement de mes yeux eût cessé. L'orage, comme il arrive souvent en Suisse, paraissait venir à la fois de plusieurs parties du ciel. C'était au nord de la ville qu'il était le plus violent, au-dessus de cette partie du lac qui est située entre le promontoire de Belrive et le village de Copêt. Un autre orage montrait le Jura à la lueur se faibles éclairs. Un troisième obscurcissait et découvrait tour-à-tour le môle, montagne escarpée à l'est du lac.
Témoin d'un spectacle si magnifique et si terrible à la fois, je marchais à pas précipités. Cette guerre majestueuse dans les cieux, élevait mes esprits; je frappai des mains en m'écriant avec force: «Guillaume, ange chéri! voici tes funérailles et tes chants funèbres»! En disant ces paroles, j'aperçus dans l'obscurité un fantôme qui sortit d'une touffe d'arbres auprès de moi; je fixai mes yeux sur lui pour le reconnaître: je ne pus m'y méprendre. Un éclair brilla et le découvrit entièrement à ma vue; sa stature gigantesque et la difformité de son aspect plus hideux qu'aucune forme humaine, ne me permirent pas de douter que ce ne fût le malheureux, l'infâme démon à qui j'avais donné la vie. Que faisait-il là? serait-il l'assassin de mon frère? (Je frémis à cette pensée). Elle entra subitement dans mon esprit, et y domina comme si elle était réelle. Je sentais mes dents s'entrechoquer, et je fus forcé de m'appuyer contre un arbre. En peu de temps le fantôme fut loin de moi, et disparut dans l'obscurité. Quel être humain aurait pu donner la mort à ce bel enfant? Son assassin!... Je venais de le voir, à n'en pas douter. Je ne pouvais me tromper: j'avais une preuve irrésistible, c'est que j'y avais pensé. Je voulus poursuivre le démon, mais je ne pouvais espérer de l'atteindre; car à la lueur d'un nouvel éclair, je le vis gravir les rochers presque perpendiculaires du mont Salève, montagne qui borne Plinpalais au sud; il parvint bientôt au sommet, et disparut.
Je restai sans mouvement. Le tonnerre cessa; mais la pluie continua encore, et l'horizon fut enveloppé d'une obscurité impénétrable. Je repassai dans mon esprit les évènements que j'avais jusqu'ici cherché à oublier: la marche entière de mes progrès vers la création, l'apparition auprès de mon lit de l'être que j'avais formé et animé, et enfin son départ. Deux ans s'étaient presqu'écoulés depuis la nuit où il avait reçu la vie; était-ce son premier crime? Hélas! j'avais jeté dans le monde un monstre dépravé, qui se plaisait dans le carnage et la désolation; n'était-il pas l'assassin de mon frère?
On ne peut se figurer tout ce que je souffris pendant le reste de la nuit que je passai en plein air, mouillé et transi de froid. Mais je ne sentais pas les injures du temps; mon imagination était occupée de scènes de malheur et de désespoir! L'être que j'avais mis sur la terre, et à qui j'avais donné la volonté et le pouvoir de commettre des actions atroces, semblables à celle qui m'affligeait, me parut être mon propre vampire, un fantôme échappé du tombeau, et porté à détruire tout ce qui m'était cher.
Dès que le jour parut, je dirigeai mes pas vers la ville, dont les portes étaient ouvertes; et je courus à la maison de mon père. Ma première pensée fut de dire ce que je savais du meurtrier, et d'envoyer sur-le-champ à sa poursuite; mais je m'arrêtai, en réfléchissant à l'histoire que j'avais à raconter. Je devais parler d'un être que j'avais formé, et à qui j'avais donné la vie moi-même; que j'avais vu à minuit, au milieu des précipices d'une montagne inaccessible. Je me rappelai aussi la fièvre nerveuse dont j'avais été attaqué au moment même où j'avais animé ma création, et qui donnerait l'air du délire à une histoire d'ailleurs si peu probable. En effet, un semblable récit m'eût paru le rêve d'un insensé. Du reste, la nature singulière de l'être échapperait à toute poursuite, quand bien même ma famille céderait âmes instances, et se résoudrait à l'entreprendre. D'ailleurs, de quel avantage serait une poursuite? Qui pourrait arrêter un être capable d'escalader les flancs perpendiculaires du mont Salève? Ces réflexions fixèrent mes idées, et me portèrent à garder le silence.
Il était environ cinq heures du matin, quand j'entrai dans la maison de mon père. Je dis aux domestiques de ne pas réveiller la famille, et j'allai dans la bibliothèque, où j'attendis l'heure à laquelle ils avaient coutume de se lever.
Six ans s'étaient écoulés comme un songe, mais comme un songe qui avait laissé une trace ineffaçable; et j'étais à la même place où j'avais embrassé mon père pour la dernière fois, avant de partir pour Ingolstadt. Ce père chéri et respectable me restait encore! Je fixai les yeux sur un tableau qui m'offrait la figure de ma mère, et dans lequel mon père avait voulu retracer un trait de sa vie: c'était Caroline Beaufort dans les transports du désespoir, à genoux auprès du cadavre de son père. Ses vêtements étaient grossiers et ses joues pâles; mais il y avait un air de dignité et de beauté, qui laissait à peine accès au sentiment de la pitié. Au bas de ce tableau était une miniature de Guillaume, dont la vue m'arracha des pleurs. Ernest entra dans le moment: il m'avait entendu arriver, et s'était hâté de venir me joindre. Il témoigna en me voyant un plaisir mêlé de chagrin:—«Sois le bien venu, mon cher Victor, dit-il; ah! j'aurais voulu que tu fusses arrivé il y a trois mois; tu nous aurais trouvés tous gais et contents. Mais nous sommes maintenant malheureux; et je crains que tu n'aies un accueil plus mêlé de deuil que de joie. Notre père a un air si triste! cet évènement affreux semble avoir renouvelé dans son cœur le chagrin qu'il éprouva à la mort de maman. La pauvre Élisabeth aussi est tout-à-fait inconsolable». En parlant ainsi, Ernest fondait en larmes.
—«Ne m'accueille pas de la sorte, lui dis-je; calme-toi, mon ami; que je ne sois pas tout-à-fait malheureux, au moment où je rentre dans la maison de mon père après une si longue absence. Mais, dis-moi, comment mon père supporte-t-il ses malheurs? Et la pauvre Élisabeth, comment est-elle»?
—«Elle a bien besoin de consolation; elle s'est accusée d'avoir été la cause de la mort de mon frère, et elle en a été bien malheureuse! Mais depuis que l'assassin a été découvert...»
—«L'assassin découvert! bon Dieu! comment cela se peut-il? Qui pourrait essayer de le poursuivre? c'est impossible; il serait aussi facile d'arrêter les vents, ou de renfermer un torrent dans une paille».
—«Je ne sais ce que tu veux dire; mais nous avons tous eu une grande peine lorsqu'elle fut découverte. Personne ne l'aurait cru; et même Élisabeth en doute encore, malgré l'évidence la plus complète. En effet, qui aurait pu penser que Justine Moritz, qui était si aimable et qui avait tant d'attachement pour notre famille, ait pu tout à coup devenir si méchante»?
—«Justine Moritz! pauvre fille, est-ce elle qui est accusée? mais c'est bien à tort; tout le monde le sait; personne ne le pense; j'en suis certain, Ernest»?
—«Personne ne le croyait d'abord; mais plusieurs circonstances nous ont convaincus depuis presque malgré nous: sa conduite a été si louche, que je crains bien qu'il soit impossible de mettre en doute l'évidence des faits. Au reste elle doit être jugée aujourd'hui: tu connaîtras tout».
Il me raconta que, le jour où l'on avait découvert le meurtre de Guillaume, Justine était tombée malade et s'était mise au lit; que peu de jours après, un domestique examinant par hasard la robe qu'elle avait portée la nuit de l'assassinat, avait trouvé dans sa poche le portrait de ma mère, par lequel on présumait que le meurtrier avait été séduit. Le domestique le montra aussitôt à un autre, qui, sans en dire un mot à qui que ce fût de la famille, alla trouver le magistrat. C'est sur leur déposition que Justine a été arrêtée. Accusée de ce crime, la pauvre fille confirma le soupçon par un extrême embarras.
Ce concours de circonstances singulières n'ébranla pas ma confiance. Je répliquai avec force: «Vous êtes tous dans l'erreur; je connais l'assassin. Justine, la pauvre et bonne Justine est innocente».
Dans ce moment mon père entra. Je vis sur sa figure les traces profondes du chagrin; mais il essaya de m'accueillir avec gaîté; s'entretint avec moi de nos peines, et il voulait détourner la conversation du triste objet dont nous étions occupés, lorsqu'Ernest s'écria: «Bon Dieu, papa! Victor dit qu'il sait quel est l'assassin du pauvre Guillaume».
«—Nous le savons aussi, répondit mon père, et c'est un malheur; car, vraiment, j'aurais mieux aimé ne le jamais connaître, que de voir tant de dépravation et d'ingratitude, dans une personne qui me devait tout».
«—Mon cher père, vous êtes dans l'erreur, Justine est innocente».
«—Si elle l'est, Dieu a voulu qu'elle souffrît autant que si elle était coupable. Elle doit être jugée aujourd'hui; mais j'aime à croire qu'elle sera acquittée».
Ces paroles me calmèrent. J'étais intimement persuadé que Justine était innocente de ce meurtre, aussi bien que tout autre être humain. Je ne craignais donc pas que l'évidence fût assez forte pour qu'elle fut convaincue du meurtre. Dans cette persuasion, je devins plus calme, et j'attendis avec impatience le jugement, mais sans prévoir un résultat fâcheux.
Nous fûmes bientôt rejoints par Élisabeth. Le temps l'avait bien changée depuis que je l'avais vue. Six ans auparavant, c'était une jeune fille, jolie et vive, que tout le monde aimait et caressait; c'était maintenant une femme d'une taille et d'une physionomie fort remarquables. Son front grand et ouvert, décelait une merveilleuse intelligence jointe à une rare franchise de caractère. Ses yeux bruns exprimaient une douceur, mêlée à une tristesse qui avait pour motif son affliction récente. Ses cheveux étaient beaux, et noirs comme l'ébène; son teint superbe, et sa figure vive et gracieuse. Elle m'accueillit avec la plus grande affection. «Votre arrivée, mon cher cousin, me remplit d'espérance, dit-elle. Vous trouverez peut-être le moyen de mettre au jour l'innocence de ma pauvre Justine. Hélas! qui sera en sûreté, si elle est convaincue du crime? Je me repose sur son innocence avec autant de confiance que sur la mienne. Notre malheur est doublement affreux: nous n'avons pas seulement perdu notre aimable Guillaume; mais cette pauvre fille, que j'aime sincèrement, va nous être enlevée par une destinée encore plus cruelle. Si elle est condamnée, il n'y aura plus pour moi de bonheur; et, si elle est acquittée, comme je l'espère, je pourrai encore être heureuse, même après la mort affreuse de mon petit Guillaume».
—«Elle est innocente, ma chère Élisabeth répondis-je, et son innocence sera prouvée; ne crains rien, et rassure ton esprit par la certitude qu'elle sera acquittée».
—«Que vous êtes bon! on croit généralement qu'elle est coupable, et cette opinion cause mon tourment; car je sais qu'elle ne peut pas l'être. Mais, en voyant tout, le monde avoir contr'elle d'aussi fâcheuses préventions, je me suis abandonnée au désespoir». Elle versa des larmes.
«Ma chère nièce, dit mon père, essuie tes pleurs. Si Justine est innocente comme tu le crois, mets confiance dans l'équité de nos juges, et dans le soin avec lequel je préviendrai toute ombre de partialité».
Le procès devait commencer à onze heures: nous restâmes jusqu'à ce moment dans la tristesse. J'accompagnai à la cour mon père et le reste de la famille, qui étaient obligés de paraître comme témoins. Pendant tout le temps de ce misérable simulacre de justice, je souffris le plus cruel tourment. On allait décider, si le résultat de ma curiosité et de mes inventions illégitimes, causerait la mort de deux de mes semblables: l'un était un enfant charmant rempli d'innocence et de gaîté; l'autre était destiné à une fin bien plus terrible, à l'infamie et à l'horreur qui s'attachent à la mémoire du meurtrier. Justine était aussi une fille de mérite, et possédait des qualités qui promettaient de rendre sa vie heureuse. Ces dons, cet espoir, tout allait être enseveli dans une tombe ignominieuse, et c'est moi qui en étais la cause! Mille fois plutôt je me serais avoué coupable du crime attribué à Justine; mais, absent au moment où il fut commis, j'aurais été pris, en faisant une semblable déclaration, pour un insensé qui s'égare, et je n'aurais pas disculpé celle dont je faisais le malheur.
Justine avait l'air calme; elle était vêtue de deuil; et sa figure, toujours prévenante, paraissait d'une rare beauté, à laquelle ajoutait la solennité des sensations qui l'occupaient. Cependant, elle semblait se confier en son innocence, et ne pas trembler, quoiqu'elle fût observée et maudite par plus de mille personnes; car l'impression qu'avait pu produire sa beauté, s'effaçait de l'esprit des spectateurs, lorsqu'on pensait à l'énormité du crime dont elle était accusée. Elle était tranquille; mais sa tranquillité avait quelque chose de forcé; elle était instruite que son trouble avait été pris pour une preuve de son crime, et elle appliquait son esprit à paraître ferme. En entrant dans la salle, elle la parcourut des yeux, et découvrit bientôt la place que nous occupions. Une larme sembla mouiller sa paupière lorsqu'elle nous aperçut; mais elle se remit promptement: et un regard mêlé de tristesse et d'amitié, parut attester son entière innocence.
Le jugement commença; un avocat établit les charges, et plusieurs témoins furent appelés. On réunit contre elle plusieurs faits étrangers, qui furent attestés par des personnes qui n'avaient pas, comme moi, des preuves de son innocence. Elle était restée dehors pendant toute la nuit où le meurtre avait été commis; et, vers le matin, elle avait été vue par une femme du marché, près de l'endroit où l'on avait trouvé ensuite le corps de l'enfant. Cette femme lui avait demandé ce qu'elle faisait là; mais elle avait les yeux égarés, et ne fit qu'une réponse obscure et inintelligible. Elle était revenue à la maison vers huit heures; et, pressée de répondre où elle avait passé la nuit, elle déclara qu'elle avait cherché l'enfant, en s'informant avec empressement si l'on avait découvert quelque chose. En présence du corps, elle éprouva de violentes attaques de nerfs, et garda le lit pendant plusieurs jours. On produisit alors le portrait que le domestique avait trouvé dans sa poche; et, lorsqu'Élisabeth, d'une voix tremblante, attesta que c'était le même qu'elle, avait placé autour du col de l'enfant, une heure avant qu'il ne partit pour la promenade, un murmure d'horreur et d'indignation se fit entendre dans la salle.
On invita Justine à se défendre. Son visage s'était altéré à mesure que le jugement s'avançait: il exprimait fortement la surprise, l'horreur et la douleur. De temps en temps elle fondait en larmes; mais, invitée à se défendre, elle rassembla ses forces, et s'énonça d'une voix haute, quoique tremblante:
«Dieu connaît, dit-elle, toute mon innocence. Mais je ne prétends pas devoir mon acquittement à mes protestations. Je prouverai mon innocence par une exposition claire et simple des faits, qui ont été dirigés contre moi; et j'espère que le caractère que j'ai toujours montré, disposera mes juges à interpréter favorablement tout ce qui peut sembler douteux, et donner lieu à des soupçons contre moi».
Elle se mit à raconter, qu'avec la permission d'Élisabeth, elle avait passé la soirée de la nuit, où le crime avait été commis, chez une de ses tantes qui demeurait, à Chênes, village situé à environ une lieue de Genève. À son retour, vers les neuf heures, elle rencontra un homme qui lui demanda, si elle avait vu quelque trace de l'enfant qui était perdu. Alarmée par ces paroles, elle passa plusieurs heures à le chercher, laissa pendant ce temps fermer les portes de la ville, et se vit contrainte de passer une partie de la nuit, dans une grange dépendante d'une chaumière, parce qu'elle ne voulait pas réveiller les habitants, dont elle était bien connue. Ne pouvant goûter de repos ni de sommeil, elle quitta de bonne heure son asile, pour lâcher encore de trouver mon frère. Si elle était allée vers l'endroit où était le corps, c'était à son insu. Il n'était pas surprenant qu'elle eût été toute troublée, en répondant aux questions qui lui étaient faites par la marchande, puisqu'elle avait passé une nuit sans dormir, et qu'elle ignorait encore le sort du pauvre Guillaume. Quant au portrait, elle ne pouvait donner aucune explication.
«Je sais, continua la malheureuse victime, combien cette seule circonstance me charge, mais je ne puis y jeter aucune lumière. J'ai déclaré ne rien savoir; je n'ai plus qu'à faire des conjectures sur le fait, qu'il a été placé dans ma poche. Ici, j'éprouve un nouvel embarras. Je ne crois pas avoir d'ennemi sur la terre, et je suis convaincue que nul ne serait assez méchant pour me perdre en badinant. Le meurtrier l'y aurait-il placé lui-même? je n'en vois pas le motif: et même, en supposant ce fait, pourquoi aurait-il volé le bijou pour s'en défaire si promptement?
»Je confie ma cause à la justice de mes juges, sans conserver la plus faible espérance. Je demande la permission de produire quelques témoins pour qu'ils soient interrogés sur mon caractère; et, si leur témoignage n'atténue pas l'accusation du crime qui m'est attribué, je dois être condamnée, malgré mon innocence sur laquelle je compte pour être acquittée».
On entendit plusieurs témoins qui la connaissaient depuis quelques années, et qui en parlèrent avec éloge; mais la peur et l'horreur du crime dont elle était accusée, enchaînaient leur langue. Élisabeth vit que cette dernière ressource, que l'excellent caractère et la conduite irréprochable de Justine ne pouvaient la sauver; et, malgré une agitation violente, elle demanda à la cour la permission de prendre la parole.
«Je suis, dit-elle, la cousine du malheureux enfant qui a été assassiné: je puis même dire que je suis sa sœur, puisque j'ai été élevée par ses parents, et que j'ai toujours vécu avec eux depuis et long-temps même avant sa naissance.
»Avec ces titres, il peut paraître inconvenant que je m'explique dans cette occasion; mais, au moment de voir une malheureuse créature livrée à la mort par la lâcheté de ses prétendus amis, je désire qu'on me permette de rendre témoignage à son caractère. Je connais bien l'accusée. J'ai vécu avec elle dans la même maison, d'abord pendant cinq ans, et ensuite pendant près de deux ans. Durant tout ce temps, elle m'a paru la plus aimable et la meilleure créature du monde. Dans le cours de la dernière maladie de madame Frankenstein, ma tante, elle l'a soignée avec la plus tendre affection et le plus grand zèle. Depuis, elle a donné ses soins à sa mère, qui souffrait d'une cruelle maladie; et elle est devenue un objet d'admiration pour tous ceux qui la connaissaient. À la mort de sa mère, elle est revenue à la maison de mon oncle, où elle était aimée de toute la famille. Elle était fort attachée à l'enfant qui n'est plus, et elle était, pour lui, comme la mère la plus tendre. Quant à moi, je n'hésite pas à déclarer que, malgré toute l'évidence qui s'élève contr'elle, je la crois entièrement innocente. Rien n'a pu la porter à commettre l'action atroce qui lui est imputée. Je dirai du bijou, dont on se sert pour la charger le plus gravement, que je lui aurais volontiers donné, elle l'eût vivement désiré; tant je l'estime et l'apprécie».
Excellente Élisabeth! Un murmure d'approbation s'éleva; mais pour la généreuse personne qui intercédait, et non en faveur de la pauvre Justine, qu'on accusa d'une plus noire ingratitude, et qui excita l'indignation publique avec une violence nouvelle. Elle pleura pendant le discours d'Élisabeth; mais elle ne répondit pas. Mon agitation et mon angoisse furent extrêmes, tant que dura le jugement. J'étais convaincu de l'innocence de Justine; j'en avais la certitude. Le démon, qui avait assassiné mon frère (car je n'en doutai pas une minute), allait aussi, dans son plaisir infernal, livrer une personne innocente à la mort et à l'infamie. Je ne pus supporter l'horreur de ma situation; et, dès que la voix du peuple, et la figure des juges, eurent annoncé la condamnation de ma malheureuse victime, je sortis de la cour dans des transes cruelles. Les souffrances de l'accusée ne pouvaient égaler les miennes; elle était soutenue par son innocence; je me sentais déchiré par des remords dont je ne pouvais me délivrer.
Je passai la nuit la plus affreuse. Le matin j'allai à la cour, dans un état qui enchaînait ma langue: je n'osai faire la fatale question; mais j'étais connu, et l'officier devina la cause de ma visite. L'urne fatale avait reçu les boules; toutes étaient noires; Justine était condamnée.
Il me serait impossible de décrire ce que j'éprouvai alors. J'avais auparavant connu des sensations d'horreur, et j'ai tâché de les peindre par des expressions équivalentes; mais les mots ne pourraient donner une idée du désespoir horrible auquel je fus en proie dans ce moment. La personne, à qui je m'adressai, m'apprit que Justine venait d'avouer son crime. «Cet aveu, observa-t-il, était à peine nécessaire dans un cas aussi clair; mais je suis content qu'on l'ait obtenu, car aucun de nos juges ne voudrait condamner un criminel d'après les apparences, lors même qu'elles seraient aussi décisives qu'aujourd'hui».
À mon retour à la maison, Élisabeth me demanda avec empressement quelle était l'issue du procès.
«Ma cousine, répliquai-je, la décision est celle à laquelle vous devez vous être attendue; tous les juges aimeraient mieux voir dix innocents souffrir, que de laisser échapper un coupable. Au reste, elle a fait l'aveu du crime».
Ce fut un coup affreux pour la pauvre Élisabeth, qui avait eu une confiance inébranlable dans l'innocence de Justine.
«Hélas, dit-elle, comment croire désormais à la bonté humaine? Eh quoi! Justine pour qui j'avais une tendresse de sœur, n'avait-elle ce sourire de l'innocence que pour me trahir? Ses yeux, où brillait la douceur, semblaient inaccessibles à la sévérité ou à la mauvaise humeur, et cependant elle s'est souillée d'un meurtre»!
Bientôt après, nous apprîmes que la pauvre victime avait témoigné le désir de voir ma cousine. Mon père n'était pas de cet avis; mais il la laissa maîtresse de décider, en l'engageant à réfléchir sur cette visite. «Oui, dit Élisabeth, j'irai voir Justine, la coupable Justine; et vous, Victor, vous m'accompagnerez: je ne puis aller seule». L'idée de cette visite était un tourment pour moi, cependant je ne pus me refuser au désir d'Élisabeth.
Nous entrâmes dans une prison obscure. Justine était assise dans un coin, sur la paille, les mains retenues par des menottes, et la tête appuyée sur les genoux. Elle se leva en nous voyant entrer. Lorsque nous fûmes seuls avec elle, elle se jeta aux pieds d'Élisabeth, en pleurant amèrement. Ma cousine ne put retenir ses pleurs.
«Ah! Justine, dit-elle, pourquoi m'as-tu enlevé ma dernière consolation? Je croyais à ton innocence; avec cette pensée, j'étais bien malheureuse, mais je ne l'étais pas autant que je le suis à présent».
—«Et croyez-vous aussi que je sois criminelle? Vous joignez-vous aussi à mes ennemis pour m'accabler»? Sa voix fut étouffée par ses sanglots.
—»Lève-toi, ma pauvre fille, dit Élisabeth; pourquoi es-tu à genoux, si tu es innocente? Je ne suis pas au nombre de tes ennemis; je t'ai crue innocente, contre toutes les apparences, jusqu'au moment où j'appris que tu avais toi-même déclaré ton crime. Ce bruit est faux, dis-tu; sois bien persuadée, ma chère Justine, que ton aveu seul a pu ébranler un moment la confiance que tu m'inspires».
«J'ai fait un aveu; mais un aveu mensonger. Je l'ai fait, afin d'obtenir grâce; et maintenant ce mensonge pèse plus sur mon cœur que toutes mes fautes. Que le Dieu du ciel me pardonne! Depuis ma condamnation, je suis sans cesse assiégée par mon confesseur. Il m'a effrayée et menacée, au point que déjà je m'imaginais être le monstre dont il me parle incessamment. Il m'a menacée de l'excommunication et des feux de l'enfer, si je persévérais dans mes dénégations. Ma chère demoiselle, je n'avais personne pour me soutenir; tout le monde me regardait comme une misérable, vouée à l'ignominie et à la mort. Que pouvais-je faire? Dans un moment que je déteste, je souscrivis à un mensonge; et c'est seulement à présent que je suis vraiment à plaindre».
Elle s'arrêta pour fondre en larmes, et poursuivit en ces termes: «J'ai pensé avec horreur, mon excellente demoiselle, que vous me soupçonneriez d'un crime que le démon seul peut avoir commis; moi qui avais su mériter l'estime de votre bienheureuse tante, et votre affection personnelle. Cher Guillaume! bienheureux enfant, je le reverrai bientôt dans le ciel, où la paix nous est réservée; et c'est ma consolation, au moment où je vais souffrir l'ignominie et la mort».
—«Ah! Justine! pardonne-moi d'avoir pu un moment manquer de confiance en toi. Pourquoi faire un aveu? mais ne t'afflige pas, ma chère fille; je proclamerai partout ton innocence, et je forcerai d'y croire. Cependant il faut que tu meures; toi, ma compagne, toi qui étais pour moi plus qu'une sœur. Je ne pourrai survivre à un malheur aussi affreux».
«Ma chère, ma bonne Élisabeth, ne pleurez pas. Vous devriez me donner du courage en me parlant d'une meilleure vie, et m'élever au-dessus des misères de ce monde d'injustice et de malheur. Mon excellente amie, livrez pas au désespoir».
—«Je tâcherai de te consoler; mais je crains que ce malheur ne soit trop profond et trop cruel pour admettre aucune consolation, car il ne reste aucun espoir. Cependant, ma chère Justine, puisse le ciel t'envoyer la résignation, et élever ton âme au-dessus de ce monde. Ah! combien je hais ses parades si vaines et si dérisoires! Une personne est-elle assassinée? une autre est aussitôt privée de la vie en souffrant de longues tortures. Alors, les bourreaux, les mains encore teintes du sang de l'innocence, se persuadent qu'un tel acte est bien grand, et l'appellent compensation. Nom odieux! dès qu'il est prononcé, je sais qu'on va infliger des châtiments plus grands et plus affreux, que n'en a jamais inventé le tyran le plus cruel pour rassasier sa vengeance. Ce que je dis n'est pas pour te consoler, ma Justine, à moins que tu ne te réjouisses de sortir d'un séjour aussi malheureux. Hélas! plût à Dieu que je reposasse en paix avec ma tante et mon aimable Guillaume, loin d'un monde qui m'est odieux, et des hommes que j'abhorre».
Justine sourit languissamment.
—«Voilà, ma chère demoiselle, du désespoir et non de la résignation. Il ne faut pas que je suive l'exemple que vous me montrez. Parlez de ce qui peut me donner du calme, et non de ce qui sert à augmenter ma douleur».
Pendant cette conversation, je m'étais retiré dans un coin de la prison, pour cacher les horribles angoisses auxquelles j'étais en proie. Du désespoir! qui osait en parler? la pauvre victime, qui le lendemain allait franchir l'effrayante limite qui sépare la vie de la mort, n'éprouvait pas comme moi une agonie profonde et déchirante. Mes dents tremblaient les unes contre les autres; un soupir s'exhala du fond de mon cœur. Justine tressaillit, me reconnut, s'approcha de moi, et dit: «Mon cher monsieur, vous êtes bien bon de venir me visiter; vous ne croyez pas, j'espère, que je sois coupable». Je ne pus répondre.—«Non, Justine, dit Élisabeth, il est plus convaincu de ton innocence que je ne l'étais; car même après ton aveu, il ne voulait pas y ajouter foi».
—«Je le remercie sincèrement. Dans ces derniers moments, j'ai la plus grande reconnaissance pour ceux qui ont de moi une opinion favorable. Que l'affection des autres est douce pour une malheureuse comme moi! elle me soulage de plus de la moitié de mes maux; et je sens que je puis mourir en paix, à présent que mon innocence est reconnue par vous, ma chère dame, et par votre cousin».
Ainsi, la pauvre victime cherchait, en consolant les autres, à se consoler elle-même. Elle trouva enfin la résignation qu'elle désirait. Et moi, le véritable meurtrier, je sentis le remords s'élever dans mon sein: remords impérissable qui devait ne me laisser ni espérance, ni consolation. Élisabeth, en larmes, était aussi plongée dans l'affliction; mais sa douleur était celle de l'innocence, et semblable à ce nuage qui obscurcit un moment les rayons de la lune, la cache pour un moment, et ne peut en ternir l'éclat. L'horreur et le désespoir avaient pénétré dans le fond de mon cœur; je portais en moi-même un enfer que rien ne pouvait éteindre. Nous restâmes plusieurs heures avec Justine, et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'Élisabeth put s'en éloigner. «Je voudrais, s'écria-t-elle, mourir avec toi; je ne puis vivre dans ce monde de misère».
Justine affecta un air de gaîté, tout en retenant avec difficulté des larmes amères. Elle embrassa Élisabeth, en disant, d'une voix à moitié étouffée: «Adieu, bonne et chère Élisabeth, ma tendre et unique amie. Puisse le ciel dans sa bonté vous bénir et vous conserver! puisse ce malheur être le dernier dont vous ayez à souffrir! Vivez, soyez heureuse; et que les autres soient heureux par vous».
En quittant la prison, Élisabeth me dit: «Vous ne savez pas, mon cher Victor, combien je suis soulagée, à présent que je suis convaincue de l'innocence de cette malheureuse fille. Il n'y aurait plus eu de bonheur pour moi, si j'avais été trompée dans ma confiance en elle. Dans le moment où je la croyais coupable, j'éprouvais une angoisse que je n'aurais pu supporter long-temps. Maintenant mon cœur est soulagé. L'innocente souffre; mais celle que je croyais aimable et bonne n'a pas trahi la confiance que j'avais en elle; et je suis consolée».
Aimable cousine! telles étaient vos pensées, douces comme vos yeux et votre voix. Mais moi... j'étais un malheureux dont la douleur en ce moment, était au-dessus de toute imagination.