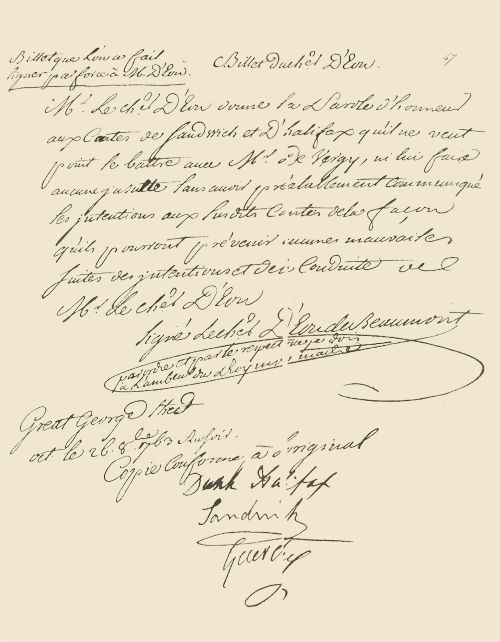Au lecteur
Table des matières
UN AVENTURIER AU XVIIIe SIÈCLE
LE CHEVALIER D’ÉON
(1728-1810)
Les auteurs et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de
reproduction et de traduction en France et dans tous les pays
étrangers, y compris la Suède et la Norvège.
Ce volume a été déposé au ministère de l’intérieur (section de la
librairie) en juin 1904.
PARIS. TYP. PLON-NOURRIT ET Cie, 8, RUE GARANCIÈRE, — 5673
UN AVENTURIER AU XVIIIe SIÈCLE
————
LE
CHEVALIER D’ÉON
(1728-1810)
D’APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS
PAR
Octave HOMBERG et Fernand JOUSSELIN
Avec deux portraits et un fac-similé
PARIS
LIBRAIRIE PLON
PLON-NOURRIT ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8, RUE GARANCIÈRE — 6e
—
1904
Tous droits réservés
PRÉFACE
En retraçant l’aventureuse carrière du chevalier d’Éon, notre dessein
n’a pas été d’apporter une solution nouvelle aux énigmes qui ont
valu à ce personnage la part la plus large, sinon la meilleure, de
sa célébrité. En dépit de la curiosité qui s’y attarde, ces énigmes
ont été résolues déjà et, semble-t-il, de façon définitive. D’Éon
était réellement un homme. L’enchaînement même de ses aventures le
conduisit, après une brillante carrière de soldat et de diplomate, à
une métamorphose que son apparence gracile et son étonnante ingéniosité
firent accepter—avec une facilité qui reste le véritable mystère de
toute cette histoire—par le roi et les ministres, en même temps que
par les compagnons de sa jeunesse. Devenu ainsi, par sa propre volonté,
l’héroïne de son siècle, d’Éon se trouva prisonnier d’un rôle qu’il
joua jusqu’à sa mort avec une stupéfiante perfection.
II
Une existence aussi mouvementée, aussi fertile en incidents de toutes
sortes, devait séduire les écrivains et elle offrait, semblait-il,
assez de pittoresque pour qu’on ne fût pas tenté d’y rien ajouter.
Cependant le premier historiographe de d’Éon, Gaillardet, bien qu’il
ait eu entre les mains les documents originaux les plus importants, se
montra dédaigneux d’une vérité historique qui cependant était autrement
riche et intéressante que ne pouvait le devenir la fiction la mieux
imaginée. De sa collaboration avec l’auteur des Trois Mousquetaires
il avait sans doute retenu un profond mépris pour les méthodes timides
dont usent aujourd’hui les historiens. Il publia en 1836 un ouvrage où
il faisait un véritable roman sentimental d’une vie où le sentiment
n’avait eu aucune place. Ce ne fut que plusieurs années ensuite, pour
confondre un plagiaire, qu’il se décida à donner de son ouvrage une
édition plus conforme à la vérité historique, mais où subsistent de
nombreuses erreurs et de plus nombreuses lacunes[1].
Le piquant et solide ouvrage du duc de Broglie sur le Secret du
roi a mis en lumière, en même III temps que le mécanisme compliqué
de la diplomatie secrète, tout un côté de la vie de d’Éon, qui fut
certainement un des plus intrépides et des plus ingénieux agents du
Secret[2]. Les escrimeurs ont tenu à conserver le souvenir de celui
qui fut, en leur art, un amateur égal aux maîtres les plus réputés de
l’époque[3]. Des érudits ont étudié divers épisodes d’une carrière qui
s’est déroulée, à travers maintes métamorphoses, sur les théâtres les
plus variés. Enfin, c’est en Angleterre, sa seconde patrie, que d’Éon a
trouvé le plus minutieux et le mieux informé de ses biographes[4].
En dépit de ces diverses publications, la matière n’était point
cependant épuisée.
Le hasard d’une vente a permis, en effet, aux auteurs de cet ouvrage
d’acquérir de très curieux documents inédits: ce sont les papiers et
la correspondance que le chevalier d’Éon conserva jusqu’à sa mort et
qui, confisqués alors par l’un de ses nombreux créanciers, demeurèrent
oubliés, pendant plus d’un siècle, au fond de l’arrière-boutique IV
d’un libraire anglais. Rapprochés des pièces diplomatiques qui sont aux
archives des Affaires étrangères et des documents administratifs que
la ville de Tonnerre possède sur le plus célèbre de ses enfants, ces
papiers permettent de fixer d’une façon précise les diverses phases
de l’aventureuse carrière du chevalier d’Éon. Mais ils ont encore à
nos yeux un plus précieux mérite: cette volumineuse correspondance,
que d’Éon entretint sans se lasser pendant plus d’un demi-siècle avec
presque tous les personnages marquants de son époque, nous apparaît
en effet aujourd’hui comme un miroir où viendrait se refléter, avec
l’image de notre singulier héros, celle de tout un siècle plein de
contrastes, à la fois léger et philosophique, crédule et sceptique.
Ce sont ces lettres et ces papiers de toutes sortes, soigneusement
conservés par le chevalier d’Éon lui-même comme pour servir de cadre à
son propre portrait, qui donneront à notre récit une saveur originale
et éveilleront peut-être l’intérêt de ceux qui recherchent avant tout
dans l’histoire le contact d’une société disparue.

Procédé Fillon - PLON-NOURRIT & Cie édit. - Imp. Ch. Wittmann
Le Chevalier d’Eon de Beaumont
CHAPITRE PREMIER
Enfance et jeunesse de d’Éon.—Ses premiers succès et ses
premiers protecteurs.—Entrée dans la diplomatie.—Le «Secret du
roi».—Mission en Russie.—Les négociations du chevalier Douglas et
l’alliance avec la Russie.—Retour triomphant de d’Éon.
«Si vous voulez me connaître, monsieur le duc, je vous dirai
franchement que je ne suis bon que pour penser, imaginer, questionner,
réfléchir, comparer, lire, écrire, ou pour courir du levant au
couchant, du midi jusqu’au nord et pour me battre dans la plaine ou sur
les montagnes. Si j’eusse vécu du temps d’Alexandre ou de Don Quichotte
j’aurais été sûrement Parménion ou Sancho Pança. Si vous m’ôtez de
là, je vous mangerai sans faire aucune sottise tous les revenus de la
France en un an et après cela je vous ferai un excellent traité sur
l’économie[5].»
2
C’est en ces termes que le chevalier d’Éon faisait, au plus fort de la
crise qui décida de sa destinée, son propre portrait au duc de Praslin,
et il se voyait ainsi assez exactement. Il lui eût fallu, pour donner
toute sa mesure, pour accomplir jusqu’au bout sa destinée, vivre en un
siècle et un pays plus propices aux aventures que ne l’était la France
du dix-huitième siècle si fortement organisée et constituée par Louis
XIV. Pour n’avoir pas su respecter cette hiérarchie nécessaire et
avoir prétendu en bouleverser à son seul profit toute la régularité,
d’Éon qui avait commencé sa carrière en gentilhomme l’acheva dans un
rôle assez équivoque d’aventurier. Il fut toujours aussi incapable de
résignation que de modestie. Voulant brusquer la fortune trop lente et
trop parcimonieuse à son gré, il oublia toute mesure dans ses ambitions
et toute règle dans sa conduite, força son talent et le gâta, brisa du
coup le brillant avenir que son courage et son esprit lui avaient fait,
et d’aventure en aventure finit par jouer pendant plus de quarante ans,
avec un art et une ténacité qui eussent illustré un meilleur rôle, la
plus étrange des mascarades que l’histoire ait jamais relatées. Il
a dit lui-même en parlant des Tonnerrois, ses compatriotes, qu’ils
«ressembleront toujours aux pierres à fusil qui se trouvent dans leurs
vignes, qui plus on en bat plus elles font feu[6]». Cette pittoresque
image illustre à merveille sa propre histoire et la lutte épique 3
qu’avec une opiniâtreté grandissante il soutint contre tous ceux qui
contrarièrent son ambition.
Nature intéressante toutefois et qui vaut qu’on s’y arrête. Dans
l’extravagance du reste calculée de ses aventures perce encore
l’énergie indomptable de d’Éon, et le scandale que fit, il y a cent
cinquante ans, sa conduite ne doit pas nous empêcher de reconnaître
aujourd’hui la réalité de ses services. Et si parfois l’attrait de
cette étude de caractère devait faiblir, on en serait sans doute
dédommagé par l’excursion faite à la suite de d’Éon dans tous les
pays, de la Russie à l’Angleterre, dans tous les milieux, de la cour
de l’impératrice Élisabeth ou du camp du maréchal de Broglie au palais
de Versailles et aux boutiques de la Cité de Londres; partout enfin où
l’aventureux chevalier promena pendant plus de soixante ans sa nature
bouillante et inquiète, sous l’habit de diplomate, l’uniforme de dragon
et le costume féminin dont Latour, en un de ses exquis pastels, nous a
laissé l’image.
«Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée, fils de noble Louis
d’Éon de Beaumont, directeur des domaines du roi, et de dame Françoise
de Charanton»—c’est ainsi que s’exprime l’acte de baptême—naquit à
Tonnerre, le 5 octobre 1728. Bien que de très petite noblesse, il était
assez bien apparenté et par les situations qu’occupaient ses proches
devait trouver des protecteurs en haut lieu. Son père avait trois
frères qui tous étaient déjà pourvus: l’un, André-Timothée d’Éon de
Tissey, avocat 4 au Parlement et censeur royal, était le principal
secrétaire du duc d’Orléans; l’autre, Jacques d’Éon de Pommard,
avocat au Parlement, était un des secrétaires de confiance du comte
d’Argenson, ministre de la Guerre; le troisième enfin, Michel d’Éon
de Germigny, chevalier de Saint-Louis, servait parmi les vingt-cinq
gentilshommes de la garde écossaise du roi.
Rien d’extraordinaire ou seulement de notable ne marque les premières
années de d’Éon. Il fut mis en nourrice à Tonnerre, ce qui est fort
banal; ce qui l’est moins pourtant, c’est la gratitude qu’il devait
garder plus tard de ces premiers soins: de Londres, le 1er juin
1763, il écrivait à la mère Benoît, son ancienne nourrice, pour lui
annoncer qu’il lui faisait une pension annuelle de 100 livres, en
reconnaissance des peines qu’il lui avait données. Lorsqu’il fut en
âge d’apprendre, la tâche de son éducation fut confiée au curé de
l’église Saint-Pierre, M. Marcenay, qui vécut assez pour voir changer
de sexe l’élève qu’il avait maintes fois corrigé—il n’est guère besoin
d’ajouter que le précepteur fut de ceux que la métamorphose laissa
obstinément incrédules. A douze ans il fut envoyé à Paris et il acheva
brillamment ses études au collège Mazarin. Docteur en droit civil et en
droit canon, il prêta serment à la barre du Parlement et entra en même
temps comme secrétaire chez M. Bertier de Sauvigny, ami de sa famille
et intendant de la généralité de Paris. En 1749, il perdit en l’espace
de cinq jours son père et l’aîné de ses oncles à qui il succéda bientôt
dans la charge de censeur 5 royal. En même temps que ces protecteurs
naturels, il en voyait disparaître d’autres qui lui avaient déjà
marqué leur intérêt et dont l’appui lui eût été précieux: la duchesse
de Penthièvre, Marie d’Este, et le comte d’Ons-en-Bray, président de
l’Académie des sciences. L’événement ne fut pas cependant inutile à
sa carrière, car il écrivit sur ces deux personnages des panégyriques
qui furent remarqués et que reproduisirent les gazettes et recueils
littéraires du temps. Ce témoignage de gratitude envers ses protecteurs
disparus lui valut dans le public un commencement de réputation et un
redoublement de bienveillance de la part des personnages influents qui
s’intéressaient à ses débuts. Il était admis dans l’intimité du vieux
maréchal de Belle-Isle, fréquentait chez ce séduisant duc de Nivernais,
type accompli du gentilhomme, qu’il devait à l’époque heureuse de sa
carrière retrouver ambassadeur à Londres; pénétrait même chez le prince
de Conti, fort occupé de politique et de poésie, toujours en quête de
rimes, quand il ne cherchait pas un trône, et également malheureux
dans ces deux poursuites. Le charme de son esprit toujours en éveil,
le tour original, vif et piquant qu’il donnait à la conversation, son
goût pour la musique, et surtout pour la musique italienne, comme aussi
un véritable talent dans l’art fort estimé alors de l’escrime, où il
avait gagné le titre de grand prévôt, le firent vite apprécier et
rechercher dans la société, tandis que diverses publications sérieuses,
un Essai historique sur les finances, et même deux volumes 6 de
Considérations politiques sur l’administration des peuples anciens
et modernes attiraient sur lui l’attention des gens en place, le
préservaient de tout soupçon de frivolité et lui valaient cette double
réputation de brillant cavalier et d’infatigable travailleur qui devait
le suivre dans sa carrière.
C’est qu’en effet d’Éon en cherchait une, n’étant pas homme à se
contenter longtemps de stériles succès de salon. Il harcelait ses
protecteurs, avec toute l’ardeur et la ténacité de son caractère
bourguignon, pour obtenir d’eux un emploi où il pourrait se distinguer
et peut-être attirer sur lui la faveur et les bontés du roi. Il devait
être servi à souhait: le prince de Conti, qui comme le plus influent
de ses patrons fut sans doute importuné plus que tout autre, ne put
s’empêcher de remarquer le génie d’intrigue en même temps que le
courage et l’appétit d’aventures de ce «petit d’Éon». Il devina dans
le jeune homme une précieuse recrue pour la difficile entreprise qui,
depuis quelque temps déjà, se tramait très mystérieusement dans le
cabinet du roi: il parla de son protégé à Louis XV et obtint que d’Éon
fût désigné pour accompagner en Russie le chevalier Douglas et le
seconder dans la périlleuse mission qui allait lui être confiée.
Du premier coup d’Éon se trouvait ainsi mêlé aux affaires les plus
délicates et les plus secrètes. Il allait faire partie de ce ministère
occulte que dirigeait personnellement le roi, aidé du prince de Conti,
du comte de Broglie et de M. Tercier, premier 7 commis des Affaires
étrangères, et dont il se servait pour appuyer, ou plus volontiers pour
contrarier et ruiner secrètement la politique officielle qu’il traitait
avec les ministres en charge. Ce que fut cet étrange et mystérieux
gouvernement, cette conspiration contre soi-même, où Louis XV semblait
vouloir prendre sa revanche du rôle effacé auquel son indolence et
sa timidité l’avaient réduit dans la conduite des grandes affaires,
on le sait depuis la curieuse publication faite par Boutaric de la
correspondance secrète[7] et l’attachant récit qu’écrivit plus tard
le duc de Broglie d’après les archives des Affaires étrangères et les
papiers de son ancêtre[8]. Quel fut le lamentable résultat de cette
diplomatie secrète qui ne corrigea rien ou presque rien des erreurs
de la politique officielle et finit par se paralyser elle-même en des
intrigues contradictoires, on le sait aussi et on le verra en partie
dans cette étude. Mais ce qu’on ne connaîtra jamais, ce sont les
multiples détours de ce dédale, dont le plus initié n’a point su tout
le secret et où le roi lui-même n’arrivait pas toujours à se retrouver
puisque, écrivant un jour à Tercier pour lui donner ses instructions,
il ne craignait pas d’avouer qu’il «s’embrouillait un peu» dans toutes
ces affaires. La diplomatie secrète doublait mystérieusement la
diplomatie officielle et 8 s’étendait partout où étaient envoyés les
représentants du roi. Quelquefois c’était l’ambassadeur lui-même qui
était admis au secret et se trouvait ainsi dans la difficile nécessité
de concilier les instructions, fréquemment contradictoires, du roi
et du ministre; le plus souvent c’était un secrétaire d’ambassade ou
quelque agent subalterne qui était trouvé propre à remplir ce rôle et
devenait ainsi l’espion de son chef. Tandis que les ministres, les
ambassadeurs officiels étaient pour la plupart désignés par la favorite
du moment, les agents du secret étaient recrutés par le roi lui-même,
qui n’abandonnait leur choix à personne et les prit souvent, par un
surcroît de défiance ou par un réveil de fierté, parmi les ennemis de
la maîtresse en titre. Tous les correspondants de cette ténébreuse
politique étaient payés ou plutôt soudoyés par le roi sur sa cassette
particulière. Le ministre secret, qui fut d’abord le prince de Conti,
et à qui succéda le comte de Broglie, répondait de leur discrétion;
leurs rapports étaient adressés par des voies sûres et détournées, puis
transmis par l’intermédiaire de Tercier et du valet de chambre Lebel
au roi, qui trouvait à les lire, à les annoter, à y répondre autant
de plaisir qu’il montrait d’ennui lorsqu’il tenait conseil avec les
secrétaires d’État.
Le point de départ de la politique secrète, qui changea bien des fois
de but et de système, semble avoir été le projet caressé par le roi,
et surtout par l’intéressé lui-même, d’assurer au prince de Conti la
couronne de Pologne. Quant à l’idée même de la 9 correspondance, il
est possible que Louis XV l’ait retirée du commerce épistolaire qu’au
début de son règne il avait entretenu avec le maréchal de Noailles;
la maladie qu’il avait eue à Metz et l’amour qu’à cette occasion son
peuple lui avait témoigné l’avaient, semble-t-il, éclairé sur ses
devoirs de roi; aussi montra-t-il pendant quelque temps un ardent
désir de bien faire et une certaine volonté de s’appliquer lui-même au
gouvernement.
La correspondance secrète témoigne de pareilles velléités, mais révèle
en même temps cette impuissance à se décider; ce monstrueux égoïsme,
cet esprit de défiance et de dissimulation qui gâtèrent chez ce roi
toute qualité et rendirent inutiles la clairvoyance et le bon sens
qu’il possédait à un très haut degré. Le duc de Luynes a dit de lui
qu’il parlait et s’occupait historiquement des affaires: ce mot
exprime à merveille, en même temps que la finesse et le jugement de
Louis XV, le détachement égoïste et cette sorte de dilettantisme qu’il
mettait à faire ce que son grand aïeul avait appelé le métier de roi.
Quelles sont les conséquences d’un pareil tempérament chez un homme
d’État, chez un souverain, l’histoire l’a montré à plus d’une reprise.
En 1745, plusieurs seigneurs polonais, préoccupés de l’anarchie et de
la faiblesse où était tombée leur patrie, s’étaient rendus à Paris
pour préparer un avenir meilleur en offrant le trône à un prince
français; ils avaient songé au prince de Conti, petit-fils de celui
qui, sous Louis XIV, avait été appelé à régner 10 sur la Pologne.
Le roi autorisa le prince de Conti, qui était alors son favori, à
accepter les propositions qu’on lui apportait et résolut de s’occuper
personnellement de l’affaire, sans en parler à ses ministres.
Il fit dès lors venir le prince dans son cabinet pour travailler avec
lui; mais les précautions mêmes qui furent prises pour assurer le
mystère de ces entretiens piquèrent la curiosité et provoquèrent les
conversations de toute la Cour. Un dimanche, on remarquait que le roi,
ayant à peine quitté sa chapelle, s’était enfermé avec le prince de
Conti et qu’on avait fait venir plusieurs secrétaires, qui toute la
journée étaient restés fort occupés à noircir du papier[9]. Un autre
jour, on avait vu le prince entrer chez Sa Majesté, portant lui-même
et très mystérieusement de gros portefeuilles. Le marquis d’Argenson,
qui relate le fait, s’attacha à pénétrer le secret qui faisait ainsi
l’entretien de tous; il parvint à savoir qu’il s’agissait d’assurer au
prince le trône de Pologne, et dans ses Mémoires, à la date du 31 mars
1753, il s’en exprime ainsi:
On m’informe de quelques secrets, en voici un. Le travail si fréquent
et si long de M. le prince de Conti avec le roi regarde uniquement
le dessein de faire ce prince roi de Pologne. De mon temps, j’ai vu
ce projet travaillé secrètement et connu du roi seul; mais je ne
pouvais croire que le roi y songeât sérieusement. Voilà cependant
qu’on le lui a montré comme très facile, car c’est ainsi que l’on
fait toujours cheminer les grands et 11 ruineux projets à des
yeux superficiels et sans système. De là arrive ce travail assidu
et souvent répété du prince de Conti avec le roi, car ce prince
reçoit quelquefois des dépêches à la chasse et sur le champ griffonne
quelques lignes qu’il envoie au roi par des courriers. Il y a peu de
jours qu’il arriva pour travailler avec le roi, et il retourna sur le
champ à l’Isle-Adam. L’on ne saurait attribuer à d’autres affaires
d’État cette correspondance secrète, car on ne lui voit aucun crédit
dans les autres affaires[10].
Sur ce dernier point la clairvoyance de d’Argenson se trouvait
en défaut, car l’influence du prince de Conti, aidée du reste de
l’inclination du roi lui-même pour ce genre de conspiration, avait
été assez grande pour étendre sur toute l’Europe, ou à peu près, le
réseau de la diplomatie secrète. Le but principal restait encore le
trône de Pologne; mais les moyens d’en faire la conquête s’étaient
multipliés et élargis, ce qui du reste, comme il arrive souvent, nuisit
singulièrement au succès de l’entreprise.
La mission qu’allait recevoir d’Éon se rattachait au plan compliqué
de ces mystérieuses négociations. Depuis quatorze ans, les relations
diplomatiques étaient rompues entre la France et la Russie. Les peu
corrects et peu galants procédés qui avaient valu au marquis de la
Chétardie d’être, lors de sa dernière ambassade, tant soit peu rudement
reconduit à la frontière, avaient laissé dans l’âme d’Élisabeth un
ressentiment que n’effaçait pas entièrement son inclination pour Louis
XV, et que le chancelier Bestuchef, 12 ennemi juré de la France,
comme d’ailleurs la plupart des grands seigneurs russes, faisait tout
pour entretenir et pour réchauffer. On connaissait à Versailles les
dispositions personnelles de l’impératrice, son antipathie pour les
Anglais et les Prussiens, et l’on avait à plusieurs reprises, depuis
cette déplorable rupture, tenté d’y faire appel pour renouer des
relations qui semblaient plus précieuses à mesure qu’apparaissait
plus décevante et plus perfide l’amitié du roi de Prusse. Plus d’un
émissaire était parti porteur de lettres autographes de Louis XV pour
Élisabeth elle-même, mais tous avaient échoué. L’accès de la Russie
n’était guère aisé et les agents de Bestuchef, qui faisaient bonne
garde à la frontière, avaient su deviner tous ces contrebandiers
politiques. L’un d’eux cependant, le chevalier de Valcroissant,
avait trompé la surveillance; mais, dépisté et reconnu à l’intérieur
de l’empire, il avait été saisi et conduit à la citadelle de
Schlüsselbourg, sur le lac Ladoga, où l’on avait eu la barbarie de le
mettre aux fers. Le malheureux se morfondait dans sa prison depuis un
an lorsque fut tentée de nouveau l’entreprise qui lui avait si mal
réussi.
Or, il se trouvait parmi les protégés du prince de Conti un noble
écossais, le chevalier Mackensie Douglas, qui était venu offrir ses
services à la France[11]. 13 Son attachement aux Stuarts l’avait
forcé à s’enfuir, et sa haine pour les Anglais ne laissait aucun doute
sur l’empressement qu’il apporterait à une mission où il s’agissait de
négocier contre eux. L’Écossais avait donné des preuves de son courage
en accompagnant le prétendant dans ses romanesques expéditions, et son
goût pour la minéralogie permettait de donner à son voyage l’apparence
très vraisemblable d’une excursion scientifique. On comptait que sa
nationalité anglaise et surtout son habileté dérouteraient tous les
soupçons.
Le plan ainsi arrêté fut agréé par le roi, qui jugea prudent de
le révéler à ses ministres, sans doute afin de leur mieux cacher
l’essentiel de la négociation. Le ministre des Affaires étrangères, M.
Rouillé, approuva et contresigna la mission de Douglas.
Les instructions qui furent remises directement à l’Écossais par le
prince de Conti, après avoir été soumises au roi (elles étaient écrites
en caractères très fins et enfermées dans une tabatière d’écaille à
double fond) lui indiquaient minutieusement et la route qu’il devait
suivre et les principaux sujets sur lesquels il devait se procurer des
renseignements[12].
Il lui était prescrit de partir comme un voyageur ordinaire, muni d’un
simple passeport; d’entrer en Allemagne par la Souabe, afin d’éviter
les grandes Cours et de passer de là en Bohême, «sous prétexte 14 d’y
voir pour son instruction les différentes mines du royaume». De Bohême
il devait se rendre en Saxe, où il ne manquerait pas de visiter les
mines de Friberg, puis passer à Dantzick et continuer sa route vers
Saint-Pétersbourg par la Prusse, la Courlande et la Livonie.
Il lui était recommandé avant tout de s’informer de l’état des
négociations entreprises par l’ambassadeur d’Angleterre, le chevalier
Williams, pour obtenir les subsides de la Russie. Il devait par
suite observer les ressources du pays; l’état de ses finances, de
son commerce; savoir le nombre de ses troupes et de ses vaisseaux;
connaître le crédit du comte Bestuchef et du comte Woronzow; les
factions de la Cour et pénétrer autant que possible les sentiments de
l’impératrice elle-même. Il lui était prescrit aussi, mais en passant
et sans insister, de s’enquérir «des vues de la Russie sur la Pologne
pour le présent et les cas à venir». Enfin la plus grande prudence lui
était recommandée; il ne devait risquer par la poste que de très courts
avis exprimés en un style allégorique, dont on était convenu avec lui
et qui roulait sur des achats de fourrures. Le chevalier Williams
devenait le renard noir et Bestuchef le loup-cervier; les peaux de
petit-gris devaient signifier les troupes à la solde de l’Angleterre,
et ainsi de suite.
Tous les préparatifs de cette mystérieuse négociation furent terminés
pendant l’été de 1755, et Douglas put se mettre en route sans plus
d’éclat qu’un inoffensif touriste anglais.
15
Les documents manquent sur le voyage; on sait seulement que Douglas
arriva heureusement à Saint-Pétersbourg dans les premiers jours
d’octobre 1755 et y fut reçu et traité comme un gentilhomme anglais
voyageant pour son plaisir et son instruction. Mais il n’avait encore
accompli que la partie la plus aisée de sa mission; il lui restait à
pénétrer jusqu’à l’impératrice. La difficulté était grande, car le
chevalier Williams, ministre d’Angleterre, connaissant les inclinations
personnelles d’Élisabeth, faisait bonne garde et, d’accord avec
Bestuchef, avait fait admettre qu’aucun Anglais ne serait reçu à la
Cour s’il n’était présenté par lui. Payant d’audace, Douglas s’adressa
à lui comme à son protecteur naturel, et en sa qualité de fidèle
sujet du roi d’Angleterre demanda au ministre d’être présenté par lui
à la tsarine. Toutefois le chevalier Williams se méfia; le voyage
de cet Écossais catholique qui, venu en Russie pour s’occuper de
minéralogie, tenait si fort à voir l’impératrice, lui parut suspect.
Il prévint Bestuchef de faire surveiller ce dangereux compatriote, et
Douglas, averti qu’il était menacé du sort de Valcroissant, repassa
en toute hâte la frontière. C’était, semblait-il, un nouvel échec;
mais moins de cinq mois après, au printemps de 1756, Douglas revenait
à Saint-Pétersbourg; bientôt toutes les portes s’ouvraient devant
lui, jusqu’à celles de la grande salle d’audience où il remettait
solennellement à la tsarine les lettres l’accréditant comme ministre
plénipotentiaire, chargé de reprendre les relations diplomatiques. 16
D’Éon était présent; il assistait en qualité de secrétaire d’ambassade
le nouveau ministre qu’il secondait dans sa mission officielle.
Que s’était-il donc passé durant l’hiver et de qui cet étrange
revirement était-il l’œuvre? Comment Douglas, impuissant à
Saint-Pétersbourg, avait-il vaincu de Paris? C’est un point où
les historiens ne s’entendent pas et où le défaut de documents
authentiques, formels et explicites, augmente encore le mystère. La
tradition veut que ce succès soit attribué à d’Éon, qui serait arrivé
secrètement en Russie en compagnie de Douglas et aurait trouvé le moyen
d’y demeurer après la fuite du chevalier. La légende est fertile en
détails romanesques sur les moyens inventés par le jeune homme pour
tromper la surveillance de Bestuchef et pénétrer jusqu’à l’impératrice.
Tirant avantage de son apparence gracile, de sa figure fine et
imberbe, du timbre féminin de sa voix, le petit d’Éon aurait pris
le nom, l’habit et les habitudes d’une jeune fille. Le chevalier
Douglas aurait ainsi présenté sa nièce, Mlle Lia de Beaumont, au comte
Woronzow, vice-chancelier de l’empire et ennemi déclaré du chancelier.
Devinant tout l’avantage que pourrait donner à sa politique ce nouvel
auxiliaire, Woronzow se serait chargé d’introduire l’aimable et
spirituelle jeune fille dans l’entourage même de l’impératrice, de la
faire admettre parmi les demoiselles d’honneur. D’Éon n’aurait pas
tardé à se concilier les bonnes grâces d’Élisabeth et se serait décidé
alors à révéler sa ruse et le secret de son 17 voyage, en remettant à
la tsarine les lettres du roi qu’il avait apportées, dissimulées dans
la reliure d’un livre de Montesquieu. Le tour romanesque de l’aventure
aurait diverti et séduit l’impératrice qui, loin de lui en vouloir,
aurait su gré au petit d’Éon de sa hardiesse et de son message, et
l’aurait chargé d’aller porter au roi sa réponse, toute favorable à la
reprise des relations régulières entre les deux Cours. C’est alors que
le chevalier Douglas serait revenu à la tête de la mission officielle
dont d’Éon fit partie, sans déguisement cette fois, et avec le titre de
secrétaire d’ambassade, ce qui relie la tradition à l’histoire.
Cette légende se retrouve chez la plupart des chroniqueurs du temps,
chez des historiens sérieux et jusque dans le récit fort documenté qu’a
écrit, il y a cinquante ans, M. Gaillardet pour faire «la vérité sur
les mystères de la vie du chevalier d’Éon». Comme toutes les légendes,
elle mélange à beaucoup d’erreurs un fond de vérité, et comme la
plupart elle s’appuie sur des témoignages et même sur quelques pièces
qui lui donnent un air d’authenticité[13].
18
Toutefois, elle a contre elle la vraisemblance, et c’est le principal
argument qu’ont invoqué le duc de Broglie et après lui M. Albert Vandal
pour y voir une ingénieuse et romanesque supercherie. Mais il y a plus,
et l’étude même des documents authentiques, loin d’éclairer ce petit
point d’histoire, en augmente l’obscurité. Nous avons en effet retrouvé
dans les papiers personnels de d’Éon les originaux de plusieurs lettres
qu’il reçut de Tercier, au moment même où il quittait la France pour la
Russie. Ces pièces fixent son départ au commencement de juin 1756 et
semblent prouver que ce voyage fut le premier qu’il accomplit, chargé
alors, mais alors seulement, 19 d’aller travailler avec le chevalier
Douglas à l’alliance des deux Cours et aussi à la réalisation des
ambitions secrètes du prince de Conti.
L’honneur d’avoir fait admettre officiellement Douglas à
Saint-Pétersbourg reviendrait donc à un autre, et nous verrons que
d’Éon a entrepris et mené à bien assez de délicates négociations pour
qu’on ne frustre personne à son profit. L’adroit intermédiaire de la
réconciliation de Louis XV et d’Élisabeth serait tout simplement un
honnête négociant français de Saint-Pétersbourg, du nom de Michel,
que le soin de ses propres affaires n’empêchait pas de s’occuper avec
autant d’habileté que de désintéressement de celles de son pays. Ce
Michel, originaire de Rouen, franchissait souvent, pour les intérêts
mêmes de son négoce, la longue distance qui séparait Saint-Pétersbourg
de sa ville natale et déjà, en 1753, il avait porté à Versailles
un message secret, où la tsarine se déclarait prête à oublier les
offenses de La Chétardie et à renouer des relations régulières avec un
monarque qui n’avait cessé de lui inspirer le plus vif intérêt. Les
soins d’une politique qui était alors dirigée contre la Russie avaient
empêché Louis XV de répondre à cette première ouverture. Élisabeth
ne se hasarda pas une seconde fois; mais elle laissa deviner que ses
sentiments personnels n’avaient pas changé.
A en croire la relation de La Messelière, qui fut plus tard le
secrétaire de l’ambassade de M. de L’Hospital en Russie, un certain
Sompsoy, fils du suisse du duc de Gesvres et peintre en miniature,
à 20 qui fut accordée la faveur de reproduire les traits de la
tsarine, sut recueillir d’elle une preuve indiscutable de ses bonnes
dispositions. Comme il assurait au cours d’une séance que Louis XV,
ainsi que ses sujets, avait en vénération le nom d’Élisabeth, il
obtint de la tsarine «un sourire qu’il saisit et qui fit réussir le
portrait». La Messelière ajoute que l’impératrice, ayant réfléchi sur
la chose, accorda à l’artiste «plus de séances qu’il n’en fallait pour
la peindre» et finit par le charger de faire connaître au roi l’accueil
favorable qu’elle réservait à la Cour aux gentilshommes français.
Sompsoy s’acquitta fort bien de la commission; mais on ne voulut pas
lui confier la réponse, car on aurait dû lui révéler en même temps et
le secret du roi et les projets du prince de Conti. On s’arrangea donc
pour le retenir à Paris, et ce fut Douglas qui partit à sa place.
Comment et pourquoi il échoua dans sa première mission, nous l’avons
vu; toutefois, avant de repartir, il eut l’heureuse inspiration de
s’adresser au sieur Michel, dont il savait les services et connaissait
la bonne volonté et de lui apprendre qui l’avait envoyé et dans quelle
intention. Celui-ci, sans se laisser effrayer par le danger qu’il
courait à fréquenter ce touriste anglais déjà suspect, mit Douglas en
rapports avec Woronzow, qui lui-même prévint la souveraine. Élisabeth
fit savoir qu’elle était disposée à accueillir un envoyé régulier du
roi. Muni de cette promesse, Douglas put échapper avec sérénité aux
agents de Bestuchef et repartir pour la France. En son absence, 21
Michel continua de négocier avec Woronzow et avertit le chevalier
lorsqu’arriva le moment opportun pour reparaître. Douglas revint alors
à Saint-Pétersbourg; mais il jugea prudent de prendre pour le voyage
un nom supposé et de se cacher en arrivant chez son ami, qui le fit
passer pour un de ses commis. C’est là que d’Éon vint le rejoindre,
envoyé officiellement par M. Rouillé, ministre des Affaires étrangères,
auprès du vice-chancelier Woronzow, dont il devait être «l’homme
de compagnie, de confiance; qui n’aurait que le soin de sa belle
bibliothèque et de quelques affaires importantes avec la France». D’Éon
s’étonna, à la vérité, «de trouver la belle bibliothèque de M. le comte
Woronzow dressée sur une espèce de pupitre», tandis que lui, «pauvre
particulier, avait laissé chez le comte d’Ons-en-Bray une grande
chambre et six coffres pleins de volumes» lui appartenant; mais sa
déception fut purement platonique, car ce n’était pas dans le cabinet
du vice-chancelier qu’il devait travailler, mais bien à l’ambassade de
France, comme le proposa lui-même Woronzow[14]. Douglas, heureux de
conserver un collaborateur aussi zélé, informa aussitôt le ministre de
la décision qu’il venait de prendre à l’égard du jeune secrétaire:
«J’ai toute la satisfaction possible, écrivait-il, de l’arrivée de M.
d’Éon. Je connais depuis longtemps son amour et son ardeur pour le
travail. Il me sera très utile ainsi qu’au service du roi. D’ailleurs
sa 22 conduite est sage et prudente. Je l’ai présenté hier au
soir au vice-chancelier comte Woronzow, qui l’a reçu avec bonté et
politesse; son caractère paraît lui plaire beaucoup; mais, après bien
des réflexions, il n’a pas été d’avis comme ci-devant qu’il suivît le
premier plan de sa destination pour des raisons particulières, connues
de l’impératrice, que j’aurai l’honneur de vous détailler dans la
suite[15].»
Le chevalier Douglas et d’Éon s’employèrent alors à déjouer
les intrigues combinées du chancelier Bestuchef et du ministre
d’Angleterre, le chevalier Williams. Ils y réussirent grâce à l’appui
de Woronzow et aussi du comte Ivan Schouvalow, qui était alors
le favori de l’impératrice. Douglas, escorté de d’Éon, fut reçu
solennellement en audience comme l’envoyé du roi de France. Leurs
ennemis toutefois ne se tinrent pas pour battus; ils usèrent de tout
et tentèrent même l’assassinat, s’il faut en croire La Messelière
qui rapporte qu’on tira la nuit des coups de pistolet dans leur
appartement. Leur crédit auprès d’Élisabeth ne fit qu’y gagner et les
négociations prirent bientôt, au moins en partie, la tournure la plus
favorable.
Elles étaient doubles, en effet, comprenant celles dont on rendait
compte au ministre et celles que, par le canal de Tercier, on
rapportait directement au roi et au prince de Conti. La mission
officielle était de négocier le rapprochement des deux pays, 23
de détacher la Russie de l’alliance de l’Angleterre pour la faire
accéder au traité que la France venait de conclure avec l’Autriche,
son ancienne ennemie. La commission secrète était de déterminer
l’impératrice à favoriser la candidature d’un prince français au trône
de Pologne ou même de gagner son cœur pour Conti. Ce prince avait
l’ambition de s’asseoir sur un trône et se résignait fort bien, s’il
ne pouvait régner tout seul en Pologne, à être associé comme époux
d’Élisabeth au gouvernement d’un grand empire. La politique de la
France eût du reste également trouvé son compte au succès de l’un ou de
l’autre de ces rêves ambitieux: que Conti fût roi en Pologne ou qu’il
fût l’époux de l’impératrice en Russie, Louis XV avait le secours d’un
allié capable de prendre à revers ses ennemis: Frédéric, avec lequel il
venait de se brouiller, et Marie-Thérèse, avec laquelle il venait de se
réconcilier, mais dont il n’osait guère escompter une longue fidélité.
On avait songé à tout pour engager Élisabeth dans cette intrigue:
Tercier avait remis à d’Éon un volume in-quarto de l’Esprit des
Lois; dans la couverture de ce livre, entre deux cartons, pris et
reliés par la même peau de veau, se trouvaient des lettres secrètes
du roi pour l’impératrice ainsi que divers chiffres, ceux de d’Éon
avec le roi et M. Tercier, avec le prince de Conti et M. Monin, ainsi
qu’un troisième qui était destiné à Élisabeth pour qu’elle-même ou
son confident Woronzow pussent en tout temps correspondre avec le roi
par l’intermédiaire de M. Tercier, à 24 l’insu des ministres et
des ambassadeurs. Élisabeth, qui n’avait pas le même goût que Louis
XV pour la dissimulation et qui ne cachait rien de ses plus grandes
fantaisies, ne se laissa pas séduire par l’attrait de cette mystérieuse
correspondance: elle refusa le chiffre, mais reçut d’Éon et consentit
à écouter de sa bouche les ouvertures de Louis XV et du prince de
Conti[16]. Elle ne montra toutefois aucune inclination à prendre le
prince pour époux et même évita de s’engager au sujet de la Pologne.
Elle promit seulement de nommer Conti généralissime des troupes russes
avec le titre de duc de Courlande, si le roi donnait à son cousin la
permission d’accepter et de se rendre à Saint-Pétersbourg. L’affaire
d’ailleurs en resta là, car pendant que d’Éon négociait pour lui en
Russie, le prince de Conti travaillait fort mal pour son propre compte
à Versailles. S’étant brouillé avec la marquise de Pompadour, qu’il
s’était cru assez fort pour braver et railler presque ouvertement, il
perdit la faveur du roi, qui cessa de mettre la politique secrète au
service des ambitions de son cousin. D’Éon reçut l’ordre de laisser
traîner la négociation commencée 25 et de ne plus correspondre
qu’avec M. Tercier et le comte de Broglie qui succéda, au milieu de
l’année 1757, au prince de Conti dans l’emploi de ministre secret.
Si la négociation secrète n’aboutit qu’à un demi-succès, que la
disgrâce de Conti rendit bientôt tout à fait stérile, le résultat de la
mission officielle fut plus satisfaisant. Grâce aux efforts patients
et persévérants de Douglas et de d’Éon, le traité conclu quelques mois
auparavant entre Bestuchef et le chevalier Williams fut déchiré; la
Russie rendit à l’Angleterre les subsides qu’elle avait déjà touchés,
mais reprit ses troupes; il fut décidé que les quatre-vingt mille
hommes, déjà rassemblés en Livonie et en Courlande pour le service de
l’Angleterre et de la Prusse, changeraient de parti et se joindraient
aux armées de Louis XV et de Marie-Thérèse. En même temps on arrêta
que, pour mieux marquer le caractère des rapports qui allaient
s’établir entre elles, les deux Cours s’enverraient réciproquement un
grand seigneur en ambassade. Le choix tomba en France sur le marquis de
L’Hospital et en Russie sur un comte Bestuchef, frère du chancelier.
La Russie avait donc changé son alliance pour entrer dans le nouveau
système franco-autrichien. En France l’opinion, d’abord surprise,
applaudissait à ce revirement imprévu et le succès des négociations
paraissait complet: il n’était pas encore bien assuré cependant,
puisqu’une difficulté suscitée par Bestuchef, qui pour se venger de sa
défaite s’ingéniait à 26 diviser entre eux ses vainqueurs, faillit
tout remettre en question et tout gâter.
En sollicitant l’accession de la Russie au traité qu’elles venaient de
conclure à Versailles, la France et l’Autriche avaient songé à stipuler
une exception à l’alliance générale qu’elles allaient contracter avec
le cabinet de Saint-Pétersbourg. Cette exception concernait la Turquie,
l’ancienne cliente de la France, qui menaçait assurément moins la
Russie qu’elle n’était menacée par elle.
Bestuchef eut vite l’idée de faire de cette restriction la pierre
d’achoppement de l’alliance qui lui répugnait si fort. Il s’efforça de
persuader à Élisabeth qu’en souscrivant à cette humiliante condition
elle violerait l’antique évangile moscovite et renierait le devoir
sacré qu’avait été pour tous ses prédécesseurs la délivrance de
Constantinople. Il sut habilement faire valoir à l’Autriche qu’il
n’était pas plus dans ses intérêts que dans ceux de la Russie de se
lier les mains vis-à-vis du Turc, son ennemi d’hier et sa proie de
demain. On se laissa convaincre à Vienne, et d’autant plus facilement
que la guerre avait recommencé et que, Frédéric ayant déjà pénétré
en vainqueur sur le territoire autrichien, les inquiétudes présentes
l’emportaient de beaucoup sur celles que pouvait inspirer l’avenir.
L’Autriche s’empressa donc d’accepter l’alliance de la Russie, et dans
le péril où elle se sentait fit bon marché des Turcs, clients de la
France.
Douglas eut peur alors de voir lui échapper tout 27 le fruit de sa
négociation et, malgré le conseil que d’Éon lui donnait de tenir bon,
il se décida à entrer dans un biais qu’avait imaginé le représentant de
l’Autriche à Saint-Pétersbourg, le comte Esterhazy, peu scrupuleux pour
arriver à ses fins sur le choix des moyens. Il fut convenu que la Porte
ottomane serait garantie contre l’alliance sur le traité ostensible
qu’on communiquerait à Constantinople, mais que cette exception
elle-même serait annulée par un article à part dit secrétissime. Ce
misérable artifice, vraiment humiliant pour la France, laissait ainsi
le champ libre aux convoitises de la Russie, tout en donnant aux Turcs
une fausse et dangereuse sécurité.
Douglas y consentit; mais par bonheur on se révolta à Versailles, où
l’on refusa de ratifier l’arrangement. Le ministre officiel et le
ministre secret se trouvèrent pour une fois d’accord et envoyèrent
à Douglas, chacun de son côté, les reproches les plus vifs sur sa
faiblesse, son manque de conscience et de dignité. Le roi, quel que
fût son désir de voir enfin consacré un rapprochement qui lui semblait
son œuvre personnelle, partagea ces sentiments. Il en faisait la
confidence à M. Tercier dans un billet qui porte la date du 15 février
1757:
J’approuve fort ce que M. le prince de Conti se propose d’écrire au
chevalier Douglas et désapprouve pareillement ce bel acte secret
que le chevalier Douglas a eu la bêtise de signer. Dans cette
circonstance, ce que M. Rouillé se propose de lui écrire me paraît
bien[17].
28
La dépêche à laquelle Louis XV fait ainsi allusion est en effet d’une
noblesse et d’une hauteur de vues remarquables:
Je ne puis vous dire, monsieur, écrivait M. Rouillé, quelle a été
ma surprise et ma peine en voyant la déclaration dite secrétissime
que vous avez pris sur vous de signer en même temps que l’acte
d’accession. Tout ce que vous alléguez ne peut justifier une démarche
que vous avez bien prévu devoir être désagréable à Sa Majesté, et
je ne puis vous dissimuler qu’Elle est extrêmement mécontente de la
facilité avec laquelle vous avez été porté à signer cette déclaration
qui, loin de lever les embarras, en peut faire naître d’assez
considérables pour retarder peut-être la réunion que les sentiments
personnels de Sa Majesté pour l’impératrice lui fait désirer. Le
roi, invariable dans ses principes, a ratifié l’acte d’accession;
mais Sa Majesté ne peut pas se prêter à ratifier la déclaration
secrète que vous avez signée sans ordre et sans pouvoir, et même
contrairement à ce que vous saviez de ses intentions. Sa Majesté a
désiré vivement l’accession de Sa Majesté l’impératrice de Russie
au traité de Versailles comme un nouveau moyen de contribuer à la
réunion; Elle l’a désirée de concert avec l’Impératrice-Reine qui, à
prendre la chose dans son véritable point de vue, y est la principale
intéressée; mais ce ne pouvait jamais être aux dépens de l’ancienne
amitié qu’elle a pour la Porte ottomane, encore moins de son honneur
qui, aussi bien que celui de l’Impératrice de Russie, se trouverait
compromis, si cette déclaration subsistait.
Que l’acte reste secret ou non, il n’est pas moins contraire à la
droiture et à l’honnêteté publique. Ce n’est point parce qu’il peut
devenir public que Sa Majesté ne le ratifie pas, c’est parce que
l’honneur qui préside à toutes ses résolutions ne lui permet pas de
le faire.
Les sentiments de Sa Majesté sont sincères; elle veut de bonne foi
tout ce qui peut contribuer à la satisfaction 29 de l’impératrice
de Russie, et cette princesse en reçoit des preuves dans toutes
les occasions. Plus les vertus de cette princesse sont éclatantes,
plus elle doit sentir le prix de la probité à laquelle le souverain
comme les particuliers doivent tout sacrifier lorsqu’on leur
propose quelques démarches incompatibles avec ce qu’elle exige. La
déclaration dont il s’agit étant constamment opposée aux usages
établis parmi les nations policées, le roi a une trop haute opinion
des sentiments élevés de l’impératrice de Russie et rend trop de
justice à ceux de ses ministres, pour n’être pas persuadé que
cette princesse ne sera pas blessée du refus que fait Sa Majesté
de ratifier cette déclaration, et qu’elle en aurait porté le même
jugement que Sa Majesté si vous aviez exposé cette affaire sous
son véritable jour. Je vous envoie donc, monsieur, la ratification
seulement de l’acte d’accession. C’est à vous à réparer la faute qui
a été faite dans cette affaire. Si M. le comte d’Esterhazy vous a
induit à signer, je suis bien persuadé qu’il vous aidera de tout son
pouvoir pour faire accepter cette ratification simple[18].
Douglas fut, on le devine, extrêmement mortifié des reproches qui
tombèrent sur lui de tous les côtés; il ne savait comment sauver sa
réputation fort en péril et le résultat non moins compromis de toute
une laborieuse négociation. Ce fut d’Éon qui le tira de ce mauvais pas.
Après s’être assuré l’appui de Schouvalow, le favori d’Élisabeth,
converti depuis peu au parti français, l’intrépide jeune homme s’en
alla livrer un brusque assaut au terrible Bestuchef; il eut avec lui
une querelle épique qui divertit fort le favori et même l’impératrice,
30 qui subissait plus qu’elle n’aimait le tout-puissant chancelier.
Bestuchef tempêta, trépigna, jura, mais finit par se rendre, n’osant
se mettre en travers du désir croissant qu’avait Élisabeth de se
rapprocher de la France. L’article secrétissime fut déchiré et le
chevalier Douglas se hâta d’annoncer au ministre l’heureuse issue de
la bataille; il voulut même, tant sa satisfaction et sa reconnaissance
l’emportaient sur la jalousie qu’il eût été tenté de concevoir, que
d’Éon s’en allât porter lui-même à Versailles l’accession d’Élisabeth
et le plan des opérations de l’armée russe pour la prochaine campagne.
L’impératrice ne sut pas moins bon gré au jeune secrétaire français du
succès remporté sur son propre chancelier et, pour comble d’ironie,
ce fut Bestuchef lui-même dont elle fit son interprète. Au moment de
son départ, d’Éon fut prié de passer chez le chancelier, qui lui fit
fort bonne mine, le combla de compliments et lui remit 300 ducats
comme marque de la bienveillance particulière de la tsarine. Il partit
donc joyeusement, emportant dans sa sacoche avec les écus d’Élisabeth
les témoignages les plus élogieux du chevalier Douglas, qui fut assez
généreux pour ne jamais lui reprocher les services qu’il en avait reçus.
Comme il allait atteindre Varsovie, il rencontra sur la route tout
un imposant cortège: «vingt-trois berlines et vingt-trois chariots
en formaient la masse». Des courriers, des écuyers, une nombreuse
livrée s’empressaient autour des voitures attelées avec luxe, 31 qui
étonnaient les paysans peu habitués à voir passer d’aussi brillantes
caravanes. C’était l’ambassade du marquis de L’Hospital qui se hâtait
vers Saint-Pétersbourg, où il devait remplacer Douglas, et rien n’avait
été épargné pour rendre cette mission aussi brillante par la qualité
des secrétaires que par la pompe des équipages. L’ambassadeur était
escorté du marquis de Bermond, du marquis de Fougères, du baron de
L’Hospital, du baron de Wittinghoff, de M. de Teleins et du comte de la
Messelière, qui nous a transmis sa relation du voyage.
Profitant de cette heureuse rencontre, d’Éon revint sur ses pas et
accompagna le marquis de L’Hospital jusqu’à Bialestock, chez le grand
général de Pologne Branicky. Il informa en chemin l’ambassadeur des
incidents les plus récents de la Cour de Russie, lui apprit que
l’annulation de la déclaration secrétissime était chose faite; il
ne lui cacha pas, sans doute, la part qu’il avait eue à cet heureux
résultat et le laissa tout joyeux de n’avoir pas pour son début à
Saint-Pétersbourg une affaire aussi désagréable à régler. D’Éon
franchit au galop des six chevaux qu’il avait fait mettre à sa chaise
les plateaux de la Moravie et de la Silésie; arrêté sur sa route par
une bande de quatre cents déserteurs prussiens, il leur jeta une
partie des ducats de l’impératrice et atteignit Vienne à la nuit.
Les douaniers l’empêchant d’entrer dans la ville, il dut, furieux et
maugréant, se résigner à demeurer dans une salle de garde des hussards
et à faire demander à l’ambassade un laissez-passer. 32 Il comptait
attendre à Vienne le comte de Broglie, le nouveau ministre secret qui
se rendait à son ambassade en Pologne, lorsqu’il apprit la victoire
que, le 6 mai, les Autrichiens avaient remportée à Prague sur le roi
de Prusse. Aussitôt il repart et, brûlant les étapes, épuisant ses
chevaux, il fait tant de diligence qu’il culbute et se casse la jambe;
il prend à peine le temps de se faire panser et, poursuivant sa route
avec le même emportement, il arrive à Paris harassé, brûlant de fièvre,
mais gagnant de trente-six heures le courrier expédié par le prince de
Kaunitz à l’ambassadeur d’Autriche près le roi de France, et apportant
par conséquent la primeur de deux bonnes nouvelles à la fois.
Louis XV fut heureux du message et fort content du messager dont le
zèle intrépide le toucha et le flatta d’autant plus qu’il venait d’un
des agents de son secret; il commença par envoyer au courrier éclopé
son propre chirurgien et quelques jours plus tard lui fit remettre
une gratification sur le trésor royal, une tabatière d’or ornée de
perles et un brevet de lieutenant de dragons. Cette dernière marque
de la faveur royale fut plus sensible à d’Éon que toutes les autres;
elle n’aida pas peu à sa guérison, qui survint promptement. Il fut le
premier à juger qu’en tombant il avait ramassé la fortune puisque,
grâce à sa jambe cassée, il se retrouvait lieutenant de dragons,
distingué par le roi, ayant désormais, au propre comme au figuré, le
pied à l’étrier. Il n’en resta pas moins dans la diplomatie, où ses
premiers succès avaient 33 montré les services qu’il pourrait rendre,
et pendant quelques années encore il dut se contenter d’appartenir à
l’armée d’une manière honorifique. Arrivé à Paris vers la fin de mai,
il employa son repos forcé à rédiger sur sa mission des notes et des
mémoires[19].
34
CHAPITRE II
D’Éon va rejoindre en Russie le marquis de L’Hospital.—Ambassade du
baron de Breteuil.—D’Éon revient en France, porteur de l’accession
de la Russie au traité de 1758.—Il quitte la diplomatie pour l’armée
et est nommé aide de camp du maréchal de Broglie.—Sa belle conduite
pendant la guerre de sept ans.—Il rentre dans la diplomatie pour
accompagner à Londres le duc de Nivernais.
L’esprit ardent de d’Éon, sous l’aiguillon du succès et de l’espérance,
s’accommodait mal en effet de cette inaction momentanée; les
témoignages flatteurs qu’il recueillit à Compiègne—où il était allé
les chercher—du roi et de la Cour ne parvinrent pas à calmer son
impatience. Il se présenta à l’hôtel du Temple pour rendre compte au
prince de Conti du médiocre résultat de sa mission secrète et savoir,
en vue de son départ, quelle suite il devrait y donner. Il n’était plus
question du duché de Courlande et du commandement général des troupes
russes. Louis XV avait déjà semblé se désintéresser de ce projet et
s’il permit à d’Éon de voir son ancien ministre secret, il différa de
lui donner des instructions à cet égard; puis bientôt, craignant de
compliquer une situation déjà délicate à Pétersbourg, il abandonna
définitivement 35 les intérêts d’un cousin qui avait osé déplaire à
Mme de Pompadour.
Cependant le départ de d’Éon venait d’être fixé au 21 septembre. Ses
sollicitations avaient été entendues par le ministre; Tercier désirait
également le voir rejoindre son poste, et M. de L’Hospital, à qui il
avait pu révéler, en une courte entrevue, sa finesse et la connaissance
qu’il avait du pays et des gens, le pressait de revenir:
Mon cher petit, lui écrivait-il, j’ai appris avec peine votre
accident et avec grand plaisir vos entrevues avec le vieux et le
nouveau testament. Venez pratiquer l’évangile avec nous et comptez
sur mon amitié et mon estime[20].
Le pauvre ambassadeur se trouvait en effet, à peine arrivé, dans la
plus fausse, la plus ennuyeuse situation. Il était en Russie pour
achever le rapprochement des deux Cours, et un incident, léger en
apparence, venait entraver sa mission, menaçait de compromettre une
alliance si laborieusement acquise et de ruiner cette politique
nouvelle qui devait porter remède aux erreurs passées.
Élisabeth, qui à aucun moment ne s’était découragée de faire à la
France des avances souvent flatteuses, quelquefois pécuniairement
intéressées, mais toujours poliment éludées, venait de trouver une
occasion de marquer avec éclat les sentiments qu’elle avait voués
à la personne du roi, en même temps que sa sympathie pour ses
nouveaux alliés. Marraine de 36 l’enfant qui allait naître de la
grande-duchesse, elle voulait que Louis XV le tînt avec elle sur les
fonts baptismaux. Elle avait mis à son désir toute l’intensité et la
ténacité d’un caprice féminin et lorsque, dans le Conseil, on lui avait
suggéré un autre choix, elle avait répondu: «Non, non, je ne veux que
Louis XV et moi...»[21] Woronzow pressentit M. de L’Hospital qui fit
part au ministre de l’offre impériale.
Avec une opiniâtreté qui serait inexplicable s’il n’avait donné maint
exemple de semblables scrupules, le roi ne voulut point accepter
des «engagements qui obligent à veiller autant qu’on le peut à ce
que l’enfant soit élevé dans la religion catholique[22]». Élisabeth
fut fort dépitée de voir repousser ainsi ses avances, et les motifs
étaient faits pour la surprendre de la part d’un monarque qu’elle
avait des raisons de croire plus sceptique encore qu’elle-même. Elle
ne choisit point d’autre parrain et l’enfant reçut dans ses bras le
baptême. Le marquis de L’Hospital, craignant que la blessure faite à un
amour-propre royal et féminin ne fût habilement envenimée par le parti
hostile à la France que menait Bestuchef, attendait impatiemment le
retour de d’Éon dont il connaissait la faveur auprès de l’impératrice.
L’adroit secrétaire ne trompa point la confiance de son chef; il
était instruit à merveille des intrigues d’un palais où lui-même 37
manœuvrait depuis deux ans; aussi fit-il si bien que le parti du
vice-chancelier Woronzow reprit le dessus et se trouva vite assez fort
pour s’attaquer à celui du tout puissant chancelier.
D’Éon, lors de son passage au milieu des troupes russes, avait
acquis la certitude qu’Apraxin entretenait avec le chancelier une
correspondance secrète. L’inaction du maréchal après la victoire qu’il
avait remportée à Gross-Joegendorf sur les Russes, la défaite qu’il
s’était si vite fait infliger à Narva ne laissaient aucun doute sur les
ordres qui lui étaient transmis en sous main et contre la volonté de
la souveraine. Averti par d’Éon qui était parvenu à savoir l’endroit
où Bestuchef tenait cachés ses documents secrets, Woronzow n’hésita
pas à dénoncer à la tsarine la trahison qui menaçait de faire échouer
complètement une campagne si heureusement entreprise; Élisabeth passa
définitivement au parti favorable à la France et la perte de Bestuchef
fut résolue quelques jours après[23].
Au cours d’une audience accordée par l’impératrice au marquis de
L’Hospital, à peine remis d’une longue maladie, et comme celui-ci se
plaignait des procédés du chancelier à son égard, si peu conformes
aux bontés de la souveraine, «le comte Bestuchef, 38 qui était
suivant l’usage derrière la droite de l’impératrice, s’élança comme
un furieux et sortit avec des yeux étincelants qui firent craindre
pour la nuit quelque catastrophe». Il se retira dans son palais; mais
le lendemain l’impératrice l’invitait à assister à son conseil. Il
prétexta une maladie, mais ne put éluder un second ordre. Un récit de
son arrestation, trop pittoresque pour n’avoir point été pris sur le
vif, nous a été transmis par La Messelière:
Bestuchef, comptant que le voile de ses artifices n’était point
encore déchiré, monta en carrosse avec tout l’appareil de sa place.
En arrivant au péristyle du palais il fut fort étonné de voir la
garde des grenadiers, qui prenait ordinairement les armes pour
lui, environner la voiture par un mouvement qui se fit de droite
et de gauche. Un lieutenant général major des gardes le constitua
prisonnier et monta à côté de lui pour le reconduire sous escorte
dans son palais. Quelle fut sa surprise en y arrivant de le voir
investi par quatre bataillons, des grenadiers à la porte de son
cabinet et le scellé mis sur tous ses papiers! Il fut, selon l’usage,
déshabillé tout nu et privé de rasoirs, canifs et couteaux, ciseaux,
aiguilles et épingles. Son caractère atroce et inébranlable le fit
sourire sardoniquement malgré tous les témoignages qu’on devait
trouver contre lui dans ses papiers. Quatre grenadiers, la baïonnette
au bout du fusil, tenaient perpétuellement les quatre coins de son
lit, les rideaux ouverts. On ne put savoir où il avait caché un petit
billet qu’il avait provisoirement écrit et qu’il voulait faire passer
à la grande-duchesse. Il demanda le médecin Boirave, que l’on fit
venir. Lorsqu’il voulut lui toucher le pouls, il tenta de glisser
dans la main du médecin ce billet; mais celui-ci, n’ayant pas entendu
ce que cela signifiait, laissa tomber le billet à terre. Le major de
garde le ramassa et 39 on n’a pas su ce qu’il contenait. Le pauvre
médecin comptant être pris à partie éprouva un tel saisissement que
trois jours après il fut suffoqué[24].
Les papiers du chancelier ne laissèrent aucun doute sur ses
manœuvres secrètes. Accusé de haute trahison, il dut à la clémence
d’Élisabeth de ne pas être condamné à la peine capitale et fut exilé
en Sibérie. Plus de dix-huit cents personnes avaient été arrêtées;
Apraxin venait de se suicider; un courant plus favorable aux intérêts
français allait se former sous l’impulsion de Woronzow, qui recueillit
la succession de son rival.
D’Éon, dont le rôle en cette affaire fut si actif et si heureux, avait,
si l’on en croit La Messelière, sauvé sans le savoir sa propre tête. Il
s’était, en tout cas, créé des droits à la reconnaissance de Woronzow
en même temps que de nouveaux titres à la confiance d’Élisabeth; aussi
eut-on l’idée de l’attacher au service de la Russie et la demande en
fut faite officiellement par le marquis de L’Hospital à l’abbé de
Bernis. Le ministre et M. Tercier, se trouvant ici dans les mêmes
sentiments, ne s’opposèrent point à une combinaison suggérée sans
doute par la tsarine elle-même et qui fixait auprès d’elle un agent
estimé à la fois du ministère et du secret. D’Éon, bien que flatté
d’une offre qu’il n’omettra de relater dans aucun de ses projets de
mémoires, ne crut pas cependant devoir l’accepter. La faveur dont il
jouissait à Versailles, 40 une carrière brillamment commencée dans la
diplomatie, une porte ouverte à ses ambitions dans l’armée, tout lui
promettait un avenir assez enviable dans son propre pays. Il savait
aussi que les étrangers parvenaient rarement à de hautes situations
en Russie. La fortune y était d’une inconstance particulière et sa
roue se brisait le plus souvent sur le chemin de la Sibérie. Enfin sa
santé commençait à se ressentir des rigueurs du climat. Il n’hésita
pas à refuser. «Si j’avais un frère bâtard, écrivait-il à Tercier, je
l’engagerais, je vous assure, à prendre cette place; pour moi, qui suis
légitime, je suis bien aise d’aller mourir comme un chien fidèle sur
mon fumier natal[25].» En remerciant l’abbé de Bernis, «il le suppliait
de l’oublier toujours lorsqu’il s’agirait d’une fortune qui éloigne et
fasse quitter entièrement la France[26]».
Le ministre n’insista pas et le félicita même de son attachement à
son pays. A ce moment d’Éon avait d’ailleurs d’autres projets en
tête. Il était las de la Russie, où il craignait de voir, pendant
longtemps encore, se consumer inutilement une activité qui aspirait
à d’autres champs de bataille. Il avait suivi de son poste la triste
campagne de 1757, qui s’était terminée pour l’armée française par
la sanglante défaite de Rosbach. Les courriers arrivés en mars à
l’ambassade n’avaient pas apporté de meilleures nouvelles: le Hanovre
venait d’être évacué et les troupes du comte de Clermont, contraintes
d’abandonner la 41 Westphalie, avaient dû repasser le Rhin. De tous
côtés les hostilités étaient reprises avec une nouvelle vigueur. D’Éon,
dont l’humeur inquiète s’impatientait de n’avoir pu faire encore ses
premières armes, désirait rejoindre son régiment avant que la guerre
fût finie: «Son honneur et son amour-propre, disait-il, souffriraient
trop de le faire après la paix[27].»
Il se décida donc à écrire, le 14 avril, au ministre de la Guerre
pour solliciter un brevet de capitaine. Le maréchal de Belle-Isle
ne lui refusa pas ce rapide avancement. Moins de trois mois après,
d’Éon recevait une commission de capitaine réformé à la suite de son
régiment; mais il devait encore une fois prendre patience et renoncer
pour le moment à ses projets belliqueux.
Les événements ne lui avaient pas permis, en effet, de quitter
Saint-Pétersbourg. La politique secrète du roi rendait sa présence
nécessaire auprès de l’ambassadeur, dont il devait sans cesse
surveiller et souvent même inspirer les actes. Le duc de Choiseul,
successeur de Bernis au ministère des Affaires étrangères, venait
d’informer le marquis de L’Hospital du traité, signé le 30 décembre
1758, qui unissait plus étroitement Louis XV et Marie-Thérèse dans une
politique d’action contre la Prusse. L’ambassadeur avait pour tâche
d’obtenir l’accession de la Russie à cet accord. Il devait en outre
laisser entendre à la tsarine que sa médiation entre la France et
l’Angleterre 42 serait bien accueillie du cabinet de Versailles, qui
en retour se montrerait moins attaché aux intérêts de la Pologne. Les
circonstances pouvant rendre précieux l’appui de la grande-duchesse,
on serait contraint de lui témoigner plus d’égards, et la tsarine ne
devrait pas en prendre ombrage.
Ce double jeu n’était pas fait pour séduire l’ambassadeur qui,
détestant les intrigues, n’y eût pas réussi et ne s’en mêlait point.
Il avait su plaire à Élisabeth et tenait particulièrement à conserver
son estime. Son esprit fin, ses belles manières, une libéralité que
Louis XV qualifiait d’excessive, lui avaient attiré les sympathies de
la Cour. S’il réalisait parfaitement le type du grand seigneur que l’on
avait d’abord recherché pour représenter dignement la France auprès
d’une Cour fastueuse, son âge, ses infirmités et un manque d’énergie
naturel l’empêchèrent de recueillir les fruits d’une alliance qu’il
se bornait à entretenir et fortifier de son mieux. Il jugeait que
c’était la partie essentielle de sa mission et se reposait sur d’Éon,
auquel il avait voué une véritable affection, du soin de régler les
affaires courantes. Le cas qu’il faisait des connaissances de son jeune
secrétaire, de son expérience des choses et des gens de la Russie,
l’avait accoutumé à ne prendre aucune décision sans avoir consulté
«son petit d’Éon», dont le rôle d’agent secret se trouvait ainsi
singulièrement facilité. Aussi ne manqua-t-il pas de lui communiquer
les instructions qu’il venait de recevoir du duc de Choiseul.
43
D’Éon en connaissait déjà le sens. Mais par une lettre de Tercier il
avait appris également que le roi ne consentirait en aucune façon à
laisser Élisabeth s’agrandir aux dépens de la Pologne; c’était lui
donner dans le nord de l’Europe une prépondérance que l’offre de
médiation viendrait confirmer. A ce prix Louis XV préférait continuer
la guerre avec l’Angleterre. Enfin il ne désirait aucun changement dans
l’attitude que l’on avait adoptée vis-à-vis de la grande-duchesse[28].
D’Éon, sans en découvrir l’inspirateur, fit valoir ces considérations
auprès du marquis de L’Hospital, qui se contenta de négocier la
ratification du traité, mais attendit pour s’avancer sur les autres
points des ordres plus pressants. Ceux-ci arrivèrent bientôt. Choiseul,
impatienté d’une inaction si contraire aux ordres transmis, écrivit
à l’ambassadeur une lettre, dont le caractère intime et affectueux
tempérait seul la vivacité des termes et où il le mettait en demeure
d’obéir ou de demander son rappel[29].
D’Éon renouvela ses instances auprès du marquis de L’Hospital et
n’épargna rien pour le dissuader de se lancer dans des intrigues qui
pouvaient ne pas rencontrer l’approbation du roi. Il parvint ainsi à
faire différer pendant plus d’un an un projet que les revers infligés à
Frédéric par les Russes firent abandonner au ministre lui-même[30].
44
N’ayant pu obtenir ce qu’il désirait d’un ambassadeur que son amitié
l’empêchait de frapper, Choiseul s’était décidé à lui donner en quelque
sorte un coadjuteur. Il avait envoyé à Saint-Pétersbourg, avec le titre
de ministre plénipotentiaire, le baron de Breteuil, jeune homme que ses
capacités, sa distinction et une grande fortune mettaient à même de
plaire à la grande-duchesse et à la jeune Cour. Le roi avait approuvé
officiellement cette mission; mais comme elle était contraire à sa
politique personnelle, il avait voulu en annuler l’effet et s’était
résolu à initier le baron de Breteuil au secret. Il avait signé une
longue lettre, préparée par Tercier, pour inviter d’Éon à mettre le
nouvel envoyé au courant des vues particulières du roi[31].
Le rôle de d’Éon allait se trouver ainsi fort diminué. Après
avoir intrigué pendant cinq ans et servi d’intermédiaire dans la
correspondance secrète de Louis XV et d’Élisabeth, après avoir
travaillé aux négociations de divers traités, il voyait sa carrière
subitement entravée dans la diplomatie. Aussi songea-t-il de nouveau
à la poursuivre dans l’armée. Il n’avait pas cessé d’ailleurs
d’entretenir les meilleures relations avec les chefs du régiment à
la suite duquel il 45 figurait. A diverses reprises il s’était
rappelé de Saint-Pétersbourg au souvenir de son colonel, le marquis de
Caraman, et de son camarade, le capitaine de Chambry. Il avait même
eu l’attention de rechercher des fourrures pour le duc de Chevreuse,
colonel général des dragons, qui lui en avait marqué sa reconnaissance
par un aimable billet:
A Paris, ce 23 novembre 1760.
Je reçois, monsieur, votre lettre et la peau d’écureuil volant de
Sibérie que vous me faites le plaisir de m’envoyer. Elle est très
belle et je vous en rends mille grâces; mais je vous supplie de
vouloir bien m’en mander le prix, parce que je la garderai avec soin
et n’en ferai aucun usage jusqu’à ce que vous m’ayez fait le plaisir
de me le marquer.
Je vous prie de ne jamais douter de tous les sentiments avec lesquels
je suis plus que personne, monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur.
Le duc de Chevreuse[32].
Les études historiques auxquelles il s’était livré dans le loisir que
lui laissaient les négociations (et dont le titre seul révèle bien
le manque de mesure qu’il apportait en toutes choses) n’avaient pu
attacher d’Éon au genre de vie qu’on menait en Russie[33]. Au mois de
juillet 1760, il avait perdu tout courage; sa santé s’était gravement
altérée; il suppliait le marquis 46 de L’Hospital de le laisser
revenir en France:
Votre Excellence sait que depuis plus de dix-huit mois je suis plus
souvent malade qu’en santé. M. Poissonnier m’a conseillé sérieusement
d’aller sucer mon air natal pour reprendre mes anciennes forces.
Quoique je ne craigne ni la mort ni les médecins, et quoique je sois
très persuadé qu’il n’est point réservé à la faculté d’épouvanter
vos secrétaires d’ambassade, cependant je sens en moi-même un
affaissement de la nature plus fort que tous les raisonnements des
docteurs, qui m’avertit de ne pas m’enterrer dans un cinquième hiver
en Russie... En acquérant encore quelques connaissances de plus dans
la politique, je puis aspirer à faire quelque chose de mieux que le
métier de scribe et de pharisien[34].
M. de L’Hospital ne retint pas plus longtemps auprès de lui son petit
d’Éon et le chargea de porter à Versailles l’accession de la Russie au
traité de 1758 et les ratifications de la convention maritime avec la
Russie, la Suède et le Danemark.
D’Éon quitta Saint-Pétersbourg, décidé à n’y jamais revenir, emportant
avec lui des témoignages élogieux de M. de L’Hospital et du baron de
Breteuil et des lettres de recommandation auprès du ministre de la
Guerre. La tsarine avait daigné lui faire remettre une boîte enrichie
de diamants, et comme il prenait congé de Woronzow, le chancelier lui
aurait 47 dit: «Je suis fâché de vous voir partir, quoique votre
premier voyage ici avec le chevalier Douglas ait coûté à ma souveraine
plus de deux cent mille hommes et quinze millions de roubles[35]».
Arrivant ainsi que la première fois porteur de fort bonnes nouvelles,
le messager fut de nouveau bien reçu à Paris comme à Versailles. Le duc
de Choiseul lui fit accorder une pension de 2,000 livres sur le trésor
royal et promit de s’occuper de sa carrière.
D’Éon, que le voyage avait épuisé, venait d’être atteint de la
petite vérole. Il dut se soigner et attendre jusqu’au printemps la
réalisation d’un rêve longuement caressé. Enfin, au mois de février
1761, il put demander au duc de Choiseul, ministre de la Guerre, «de
lui permettre de servir pendant la campagne prochaine en qualité d’aide
de camp de M. le maréchal et de M. le comte de Broglie à l’armée du
Haut-Rhin et de lui accorder une lettre de passe à la suite du régiment
d’Autichamp-Dragons qui sert dans la même armée, le régiment du colonel
général étant employé cette année-là sur les côtes».
Le ministre se montra tout disposé à lui donner satisfaction et à
l’envoyer à l’armée; mais ce n’était pas assez pour d’Éon de recevoir
cette destination officielle, il lui fallait encore l’agrément
particulier du roi, dont il n’avait pas cessé d’être l’agent secret
durant ses séjours en Russie. Le comte de Broglie dont il voulait
devenir l’aide de camp et qui aussi 48 bien continuait à suivre de
l’armée les affaires de la politique secrète, soumit son désir au
souverain et en obtint cette réponse:
A Marly, ce 31 mai 1761.
... Je ne sache point que nous ayons présentement besoin du sieur
d’Éon; ainsi vous pourrez le prendre pour aide de camp, et d’autant
mieux que nous saurons où le prendre si cela était nécessaire[36].
D’Éon fut nommé aussitôt et partit sans délai pour l’armée où, à peine
arrivé, il eut à payer de sa personne. A Hœxter on lui confie
l’évacuation des poudres et des effets du roi qui étaient restés dans
la place: il en charge les bateaux amarrés sur les bords du Weser et
passe le fleuve à diverses reprises sous le feu de l’ennemi. Peu de
temps après, dans un engagement qui eut lieu à Ultrop, près de Soeft,
il est blessé au visage et à la cuisse. Le 7 novembre 1761, à la tête
des grenadiers de Champagne et des Suisses, il attaque les montagnards
écossais qui s’étaient embusqués dans les gorges de montagnes voisines
du camp d’Himbeck, il les déloge et les poursuit jusqu’au camp des
Anglais. Enfin à Osterwick, prenant le commandement d’une petite troupe
d’un peu plus de cent dragons et hussards, il charge avec intrépidité
le bataillon franc-prussien de Rhées qui, établi près de Wolfenbüttel,
coupait les communications de l’armée française, et son attaque est
si prompte que l’ennemi débandé met bas les armes 49 et qu’il se
trouve avoir fait près de huit cents prisonniers. Le prince Xavier de
Saxe profita de cette action hardie pour faire avancer ses troupes et
s’emparer de Wolfenbüttel. Tous ces hauts faits, que d’Éon racontait
complaisamment, et qu’il fit enregistrer par son biographe La Fortelle,
sont d’ailleurs attestés par le certificat qu’en quittant l’armée il se
fit donner par le maréchal et le comte de Broglie:
Victor-François, duc de Broglie, prince du Saint-Empire, maréchal de
France, chevalier des ordres du roi, commandant en Alsace, gouverneur
des ville et château de Béthune et commandant l’armée française sur
le Haut-Rhin;
Et Charles, comte de Broglie, chevalier des ordres du roi,
lieutenant-général de ses armées et maréchal-général des logis de
celle du Haut-Rhin.
Nous certifions que M. d’Éon de Beaumont, capitaine au régiment
d’Autichamp-Dragons, a fait la dernière campagne avec nous en qualité
de notre aide de camp; que pendant le courant de ladite campagne nous
l’avons chargé fort souvent d’aller porter les ordres du général et
que dans plusieurs occasions il a donné des preuves de la plus grande
intelligence et de la plus grande valeur, notamment à Hœxter en
exécutant, en présence et sous le feu de l’ennemi, la commission
périlleuse de l’évacuation des poudres et autres effets du roi; à la
reconnaissance et au combat près d’Ultrop, où il a été blessé à la
tête et à la cuisse, et près d’Osterwick, où, s’étant trouvé second
capitaine d’une troupe de quatre-vingts dragons, aux ordres de M. de
Saint-Victor, commandant les volontaires de l’armée, ils chargèrent
si à propos et avec tant de résolution le bataillon franc-prussien
de Rhées qu’ils le firent prisonnier de guerre, malgré la grande
supériorité de l’ennemi; en foi de quoi, nous lui avons délivré 50
le présent certificat, signé de notre main, et avons fait apposer le
cachet de nos armes.
Fait à Cassel, le 24 décembre 1761.
Signé: Le maréchal duc de Broglie.
Le comte de Broglie.
Et plus bas:
Par Monseigneur,
Signé: Drouet[37].
L’original de ce certificat a été perdu; mais d’Éon lui-même en publia
le texte à Londres en 1764; lors de ses démêlés avec le comte de
Guerchy, le maréchal et le comte de Broglie étaient encore vivants,
aussi l’exactitude de ce témoignage n’est-elle pas douteuse.
C’est qu’en effet d’Éon s’était rencontré à l’armée de Broglie avec
un personnage qui devait exercer plus tard une influence décisive sur
sa destinée, briser sa carrière régulière et le lancer dans une série
d’aventures plus étranges les unes que les autres; où il devait ruiner
ses brillantes qualités et perdre en une extravagante métamorphose
jusqu’à sa dignité d’homme. Le comte de Guerchy, futur ambassadeur
de France en Angleterre, était alors lieutenant général dans l’armée
du maréchal de Broglie; le 19 août 1761, jour où l’armée française
exécutait le passage du Weser sous Hœxter, le capitaine d’Éon 51
fut chargé par son chef de lui porter l’ordre suivant:
ORDRE DU GÉNÉRAL
M. le maréchal prie M. le comte de Guerchy de faire prendre
sur-le-champ par toutes les brigades d’infanterie qui sont à la rive
droite du Weser quatre cent mille cartouches qui s’y trouvent, qu’un
garde-magasin de l’artillerie leur fera distribuer, à l’endroit où M.
d’Éon, porteur de ce billet, les conduira.
Fait à Hœxter, le 19 août 1761.
Signé: Le comte de Broglie.
P.-S.—Il serait bon qu’il vînt sur-le-champ un officier major
avec M. d’Éon, pour faire cette distribution aux troupes sous vos
ordres[38].
Est-il vrai, comme d’Éon le raconta plus tard dans les libelles qu’il
fit paraître à Londres contre l’ambassadeur, que le comte de Guerchy
se contenta de mettre l’ordre dans sa poche et de dire à d’Éon:
«Monsieur, si vous avez des poudres vous n’avez qu’à les faire porter
au parc d’artillerie, vous le trouverez à une demi-lieue d’ici»;
qu’en dépit de la discipline, le jeune aide de camp dut galoper après
le lieutenant général pour lui reprendre l’ordre et se charger tout
seul de remplir les instructions du maréchal? Le comte de Guerchy se
garda naturellement d’en convenir, traita de folle invention toute
cette histoire, et le témoignage tardif et intéressé d’un être aussi
passionné et peu sincère que d’Éon 52 ne peut être accepté que sous
bien des réserves.
Quoi qu’il en soit, il était curieux de noter cette première rencontre
sur le champ de bataille de deux officiers qui devaient trois ans plus
tard, réunis dans la même ambassade, se brouiller avec tant d’éclat et
étonner par le scandale de leur querelle l’Europe tout entière.
Mais, en dépit de sa belle conduite militaire et du goût qu’il prenait
à faire, sur de vrais champs de bataille, le métier de dragon après
avoir fait dans les chancelleries ce qu’il appelait «le métier de
scribe et de pharisien», d’Éon n’avait pu attendre, pour quitter
l’armée, les préliminaires de la paix qui furent signés au mois de
septembre 1762. Dès la fin de décembre 1761, un ordre du ministère
l’avait fait revenir à Paris; il était question de le renvoyer à
Saint-Pétersbourg, où il avait fait avec tant de bonheur ses premières
armes diplomatiques, et de lui donner la succession du baron de
Breteuil. Une fois encore il allait changer de carrière, mais en y
gagnant un nouvel avancement. Il partit donc de Cassel, où il se
trouvait avec l’état-major du maréchal de Broglie, emportant le
certificat qui relatait ses belles actions militaires et arriva en
France dans les premiers jours de l’année 1762. Il était à peine en
route que la tsarine mourait, emportant dans sa tombe l’ambassade de
d’Éon. Si, en dépit de l’infériorité de son grade et de la petitesse
de sa naissance, il s’était trouvé désigné aux yeux du ministre et du
roi pour remplir une mission de confiance auprès de la tsarine qui le
connaissait 53 depuis plusieurs années et à maintes reprises lui
avait marqué sa bienveillance, l’avènement d’un nouveau souverain à
Saint-Pétersbourg ôtait bien de leur poids à ces raisons particulières,
et toutes les barrières de caste et de hiérarchie se dressaient de
nouveau devant l’ambition de l’ardent Bourguignon.
En effet, au lieu d’envoyer d’Éon en Russie, où l’on s’était décidé à
laisser le baron de Breteuil, le ministère avait songé à utiliser dans
les négociations de la paix la hardiesse entreprenante et l’habileté
heureuse du jeune diplomate. Le duc de Choiseul l’avait donné pour
secrétaire au duc de Nivernais, choisi comme le négociateur le plus
subtil et le plus adroit de toute la France pour aller conclure une
paix difficile avec les Anglais.
54
CHAPITRE III
Le duc de Nivernais, ambassadeur de France à Londres.—Difficile
négociation de la paix de 1763.—D’Éon est chargé par le gouvernement
anglais de porter à Paris les ratifications du traité.—Il reçoit la
croix de Saint-Louis.—Le comte de Guerchy est désigné pour succéder
au duc de Nivernais, et d’Éon, nommé ministre plénipotentiaire, fait
l’intérim de l’ambassade.—Le chevalier d’Éon mène à Londres un train
d’ambassadeur et n’entend pas «d’évêque redevenir meunier».—Sa
querelle avec le duc de Praslin et le comte de Guerchy.
Si la paix qu’il s’agissait de conclure avec l’Angleterre était
difficile, le choix qu’on avait fait du négociateur était excellent.
Le duc de Nivernais fut parfaitement accueilli par la société
anglaise, faite pour apprécier les qualités du vrai grand seigneur
et qui les reconnut toutes chez le nouvel ambassadeur de France.
Fils du duc de Nevers et d’une princesse Spinola, il avait épousé
Hélène de Pontchartrain; au crédit que lui donnaient son origine et
ses alliances, il avait su joindre l’amitié particulière de Mme de
Pompadour en organisant à Versailles les comédies dont se servait la
favorite pour retenir le roi. Dans les billets nombreux qu’elle lui
adressait, Mme de Pompadour ne manquait guère d’appeler Nivernais «mon
cher petit époux»; les sobriquets avaient été mis à la mode par le roi
lui-même, et 55 celui-ci marque bien sur quel pied d’intimité on
traitait le duc au château. Il avait du reste des mérites plus solides
et plus rares que les qualités nécessaires au bon courtisan.
Ambassadeur près du Saint-Siège en 1748, au moment où fut publiée la
bulle Unigenitus, il avait su à la fois étonner les Romains par le
faste de ses équipages et gagner, par l’habileté de sa diplomatie,
la confiance du pape Benoît XIV. Envoyé ensuite à Berlin, il avait
réussi à séduire Frédéric, malheureusement trop tard pour détacher la
Prusse de l’alliance anglaise, où elle venait de s’engager secrètement.
L’échec de sa mission n’avait eu d’autre cause que les lenteurs et
l’indécision du gouvernement du roi. Aussi nul n’avait pu songer à en
tirer grief contre lui et à tous il avait paru l’homme le mieux fait
pour obtenir des Anglais de moins rigoureuses conditions à une paix
devenue nécessaire à la France. Grand seigneur accompli et négociateur
habile, agréable causeur et charmant écrivain, cavalier et musicien, il
avait su plaire partout et à tous. Personne mieux que lui ne pouvait
donc prétendre à réconcilier deux nations qui se piquent également de
se connaître en gentilshommes, et les Anglais ne s’y trompèrent pas.
Ils lui firent fête, Horace Walpole allant jusqu’à déclarer que «la
France leur envoyait ce qu’elle avait de mieux».
Nivernais avait été choisi comme le meilleur ambassadeur; d’Éon lui
fut adjoint comme le plus habile et le mieux informé des secrétaires.
Mêlé 56 déjà, à maintes reprises, aux affaires les plus délicates et
les plus importantes, il devait être d’un précieux conseil pour son
chef et trouver dans son esprit ingénieux plus d’une ressource pour
la négociation[39]. Tous deux s’embarquèrent à Calais le 11 septembre
1762 et arrivèrent à Londres dès le 14, grâce aux rapides équipages
du duc de Bedford. Si les Anglais avaient paru pressés de recevoir
l’ambassadeur de France, ils devaient mettre moins de hâte à poursuivre
les négociations de la paix. Le parti de l’opposition, qui désirait
continuer la guerre, était à l’affût de tout ce qui pourrait les rompre
et renverser le cabinet de lord Bute. La nouvelle de la prise de la
Havane, parvenue à Londres le 1er octobre, tourna toutes les têtes
et, sous la pression de l’opinion, le roi et le ministère augmentèrent
leurs exigences. Ils demandèrent la Floride, que la France dut, non
sans peine, obtenir de l’Espagne. «Cette maudite Havane, petit époux,
j’en suis dans la frayeur», écrivait Mme de Pompadour au duc de
Nivernais[40]. Il importait que les préliminaires de la paix pussent
être signés avant l’ouverture du parlement anglais, où le parti de
l’opposition ne songeait qu’à renverser le ministère et à reprendre
la guerre. Nivernais craignait 57 du reste qu’une nouvelle victoire
navale des Anglais ne rendît plus dures encore les conditions de la
paix: «Je tremble à présent, écrivait-il à Choiseul, que Lisbonne soit
pris avant cette diable de signature.»
Lisbonne ne fut pas pris, car le 5 novembre Choiseul put annoncer à
Nivernais que les préliminaires de la paix venaient d’être signés à
Fontainebleau. Il ajoutait, avec une satisfaction quelque peu égoïste
et irritante pour l’ambassadeur qui avait eu à Londres la tâche la plus
ingrate, qu’à cette occasion lui-même avait été fait duc et pair sous
le titre de duc de Praslin. Une bonne part du succès de ce premier
accord qui, malgré tout ce qu’il coûtait à la France, fut considéré à
la Cour comme un grand avantage, était dûe en effet à la mission du duc
de Nivernais. Faut-il croire que pour déterminer les ministres anglais
à faire la paix, en dépit de l’opposition, l’ambassadeur de France
dut les acheter, ainsi qu’on l’affirma hautement à Londres quelques
années plus tard, lors du procès en diffamation intenté au docteur
Mulgrave? Cela n’aurait rien d’invraisemblable, car on sait que plus
d’une fois, dans la longue lutte qui remplit l’histoire du dix-huitième
siècle, la France et l’Angleterre essayèrent l’une contre l’autre de la
corruption. Dans tous les cas, d’Éon a raconté comment un jour, chez
le duc de Nivernais, il aurait réussi à «affriander» par du bon vin
de Tonnerre M. Wood, sous-secrétaire d’État du roi d’Angleterre, et à
prendre, pendant que celui-ci buvait à plein verre, copie des papiers
qu’il 58 avait apportés dans son portefeuille et parmi lesquels
se trouvait l’ultimatum qui allait être expédié au duc de Bedford,
ambassadeur de la Cour de Saint-James à la Cour de Versailles. Grâce à
cet audacieux tour de passe-passe, M. de Choiseul, prévenu à l’avance
de toutes les difficultés qui allaient être soulevées, aurait pu amener
plus facilement, plus vite, et sans rien risquer, le duc de Bedford
à composition. On colporta un peu partout en France cette amusante
anecdote, et les journaux anglais de l’opposition ne tardèrent pas à la
recueillir pour en tirer grief contre le ministère.
Les préliminaires étant signés, il ne restait plus aux deux
gouvernements qu’à se mettre d’accord sur certaines questions
secondaires et sur le texte du traité. Cette tâche, rendue assez
ingrate et difficile par le souci de Choiseul de reprendre
quelques-unes des concessions qu’il avait faites dans sa grande hâte
de traiter avant l’ouverture du parlement anglais, occupa Nivernais et
d’Éon pendant trois mois encore. C’est seulement le 10 février 1765
que fut signé à Paris le traité définitif. Cette paix désastreuse, qui
nous coûtait tout un magnifique empire colonial plein de promesses
plus magnifiques encore, fut accueillie en France par des transports,
tandis qu’elle soulevait en Angleterre une véritable réprobation.
D’Éon était trop ambitieux pour ne pas tirer profit pour lui-même de
l’ouvrage auquel il avait été mêlé. Il savait par deux expériences
personnelles qu’il était toujours avantageux de porter à la Cour 59
une bonne nouvelle et que la satisfaction du roi se traduisait alors
par des faveurs pour le messager. Il avait gagné un brevet de dragons
en portant à Versailles l’accession de l’impératrice Élisabeth au
traité de Versailles, et trois ans plus tard une pension de 2,000
livres en faisant une commission du même genre. Le nouveau traité qui
avait été si fort désiré et si bien accueilli en France lui vaudrait
évidemment des avantages plus précieux encore, mais il fallait arriver
jusqu’au roi lui-même, non pas mystérieusement comme l’agent du secret,
mais devant la Cour tout entière, comme le secrétaire en titre d’une
ambassade officielle. D’Éon, à qui rien ne semblait impossible, pressa
son chef de demander pour lui au gouvernement anglais la faveur de
porter à Versailles les ratifications de la paix. Pareille désignation
de la part d’un gouvernement étranger, pour une mission considérée
comme fort honorifique, était sans précédents et allait contre tous les
usages. L’ambassadeur consentit toutefois à faire la démarche, quelque
insolite qu’elle fût et bien que le duc de Praslin ne pût en admettre
le succès; celui-ci mettait en garde Nivernais et l’assurait que la
Cour de Londres ne donnerait certainement point pareille mission à un
secrétaire français. Il semble bien aussi que le ministre, impatienté
par l’ambition qu’avait inspirée à d’Éon de trop rapides succès, tenait
à le faire rentrer dans le rang: «Il est jeune, disait-il, et a le
temps de rendre encore des services et de mériter des récompenses; je
m’intéresse à lui et je le mettrai volontiers 60 à portée de les
obtenir avec le temps et le travail[41].»
En dépit des prévisions sceptiques de Praslin, le duc de Nivernais
obtint pour «son petit d’Éon» la faveur difficile qu’il avait demandée.
Ce succès manifestait mieux qu’aucun témoignage le très grand crédit de
Nivernais à la Cour de Londres; aussi l’ambassadeur ne se fit-il pas
faute de plaisanter le ministre sur son incrédulité:
Je suis bien aise que vous ayez été une bête en croyant, mon cher
ami, qu’il était inexécutable de faire porter les ratifications du
roi d’Angleterre par le secrétaire de France, mon petit d’Éon. C’est
que vous ne savez pas à quel point vont la bonté et l’estime qu’on a
ici pour votre ambassadeur, et il n’y a pas de mal que vous l’ayez
touché au doigt en cette occasion, car sans cela vous auriez été
homme à me mépriser toute votre vie, au lieu qu’à présent vous me
considérerez sans doute un peu[42].
D’Éon arriva le 26 février à Paris, porteur des ratifications. Praslin
ne manqua pas de remarquer qu’il avait fait «grande diligence» mais,
sans lui tenir rigueur de son succès, s’employa en sa faveur. Il
annonçait le 1er mars à Nivernais que son petit d’Éon aurait la
croix de Saint-Louis et une gratification du roi: «Je crois qu’il
sera content, ajoutait-il; pour moi je le suis fort, car c’est un
joli garçon, bon 61 travailleur, à qui je veux toutes sortes de
biens[43].» D’Éon fut fêté à la Cour et n’eut garde d’y oublier les
commissions dont l’avait chargé son chef. Il donna à Mme de Pompadour
des nouvelles de la chétive santé de son «petit époux» et lui remit des
bourses anglaises qu’elle déclara fort vilaines et «grosses comme des
cordes». La favorite trouva d’Éon «un fort bon sujet» et jugea «MM. les
Anglais très polis de lui avoir donné à apporter le traité». Félicitant
Nivernais d’avoir achevé son ouvrage, elle le pressait de venir faire
«raccommoder sa santé par le bon air de France[44]».
Le duc de Nivernais ayant en effet terminé à la satisfaction de son
maître l’ouvrage délicat et difficile pour lequel on l’avait envoyé à
Londres, le duc de Praslin ne pouvait songer à prolonger une ambassade
dont son ami avait retiré tout avantage et tout honneur, et qui n’était
plus guère pour ce grand seigneur riche et lettré qu’un honorable exil.
D’ailleurs Nivernais lui-même s’était préoccupé depuis plusieurs mois
déjà de sa succession. Il avait songé à son ami le comte de Guerchy,
lieutenant-général des armées du roi, qui s’était distingué pendant la
guerre de sept ans et jouissait à Versailles d’une grande réputation de
courage. Soldat intrépide, Guerchy n’avait jamais eu l’occasion de se
montrer diplomate et ses 62 amis eux-mêmes doutaient de ses capacités
à le devenir. C’était l’avis de Praslin qui, le 8 janvier 1763,
répondait aux ouvertures que venait de lui faire le duc de Nivernais:
Je suis toujours fort occupé de Guerchy. Je ne sais cependant si nous
lui rendrons un bon office en le faisant ambassadeur à Londres... Je
crains ses dépêches comme le feu; et vous savez combien les dépêches
déparent un homme et sa besogne, quand elles ne sont pas bien faites.
On juge souvent moins un ministre sur la manière dont il fait les
affaires que sur le compte qu’il en rend... Mais il ne sait pas du
tout écrire, nous ne saurions nous abuser là-dessus[45].
Guerchy toutefois fut désigné, d’abord parce qu’on ne voulait pas
refuser le candidat du duc de Nivernais, dont tout Versailles chantait
les louanges, et aussi parce qu’en dépit de sa trop juste opinion des
mérites de son ami le duc de Praslin fut heureux d’obliger à 63
la fois deux de ses intimes. Le 16 février 1763, on en avisa le duc
de Nivernais à Londres. Il fut entendu que d’Éon serait maintenu à
l’ambassade afin de conseiller son nouveau chef et de tenir la plume à
sa place. On le chargerait même de l’intérim et, sur les instances de
Nivernais, Praslin consentit à ce qu’on lui donnât le titre de ministre
résident.
D’Éon se trouvait en France, où il avait apporté les ratifications
du roi d’Angleterre, lorsque Nivernais le rappela à Londres pour lui
remettre l’ambassade. Il tarda quelque peu à se rendre à l’appel de
son chef et se fit même passer pour malade. C’étaient en réalité les
intrigues de la diplomatie secrète qui le retenaient à Paris.
Le comte de Broglie se trouvait alors exilé dans ses terres de
Normandie. Il avait été enveloppé dans la disgrâce de son frère le
maréchal, à qui Mme de Pompadour avait attribué, malgré les faits et
en dépit de l’opinion publique, les responsabilités qu’avait encourues
Soubise pendant la guerre de sept ans. Louis XV n’avait su résister
ouvertement à la favorite; mais, ne voulant point se priver des
services de son ministre secret, il s’était résigné à faire passer par
le château de Broglie tout le réseau de sa politique personnelle. C’est
durant cette retraite momentanée que le comte de Broglie avait étudié
un projet de descente en Angleterre, conçu depuis longtemps déjà, mais
qui n’avait pu recevoir d’exécution pendant les dernières hostilités.
Si la paix actuelle en reculait l’opportunité, elle permettait tout
au moins d’étudier 64 sur place les conditions et les moyens qui en
faciliteraient la réussite. Le roi et le ministre avaient mieux compris
que la nation les désastreuses conditions du traité de Versailles et
tenaient à se mettre promptement en mesure d’en réparer les effets.
Louis XV avait donc examiné avec intérêt le projet qui lui avait été
soumis et l’avait renvoyé à Tercier avec son approbation. C’est chez ce
dernier que d’Éon et le comte de Broglie, qui se trouvait de passage
à Paris, se réunirent pour organiser cette périlleuse mission. D’Éon,
par sa situation à Londres et par son expérience dans ces sortes
d’intrigues, était à même de diriger les recherches. On lui adjoignit
un de ses cousins, le sieur d’Éon de Mouloize, qui devait mettre les
documents à l’abri dans le cas où l’intrigue viendrait à s’ébruiter.
Quant à la partie technique, elle devait être confiée à un ingénieur,
Carrelet de la Rozière. Enfin on jeta les bases d’une correspondance
secrète qui devenait nécessaire pour traiter cette affaire[46]. Le roi
lui-même donna ses instructions:
Le chevalier d’Éon recevra mes ordres par le canal du comte de
Broglie ou de M. Tercier sur des reconnaissances à faire en
Angleterre, soit sur les côtes, soit dans l’intérieur du pays, et
se conformera à tout ce qui lui sera prescrit à cet égard, comme
si je le lui marquais 65 directement. Mon intention est qu’il
garde le plus profond secret sur cette affaire et qu’il n’en donne
connaissance à personne qui vive, pas même à mes ministres nulle
part[47].
Elles furent précisées et commentées dans une lettre que, le 7 mai
1763, le comte de Broglie envoya au chevalier d’Éon à Londres. Il lui
recommandait la plus grande prudence dans sa conduite, l’avertissait
que le caractère défiant du comte de Guerchy rendrait sa tâche secrète
des plus difficiles et qu’il devrait prendre mille précautions pour
mettre les papiers de la correspondance à l’abri de toute surprise.
Il l’établissait gouverneur de M. de la Rozière: «C’est, disait-il,
un pupille un peu sauvage, mais dont vous serez content.» Enfin, en
se félicitant de l’avoir pour «lieutenant dans une besogne aussi
importante qui peut faire le salut et même la gloire de la nation»,
il le remerciait du zèle et de l’attachement qu’il n’avait cessé de
témoigner au maréchal de Broglie et à lui-même[48].
La fidélité montrée par d’Éon à une famille aussi suspecte que
l’était devenue alors celle des Broglie avait éveillé la défiance du
duc de Praslin. Aussi le ministre n’avait-il pas hésité à soumettre
le jeune représentant du roi près la Cour de Londres à un véritable
interrogatoire. Il fit mander d’Éon dans son cabinet, où se trouvaient
son premier commis 66 Sainte-Foy et le comte de Guerchy, et sans
préambule lui demanda de raconter la bataille de Fillingshausen, à
laquelle il devait avoir assisté lorsqu’il était aux dragons. D’Éon ne
se fit pas prier et n’hésita point à mettre sur le compte de Soubise
toutes les fautes que l’on attribuait officiellement au duc de Broglie.
Praslin, impatienté, se promenait à grands pas, tapant du pied; puis
l’interrompant soudain: «Je sais, s’écria-t-il, tout le contraire de ce
que vous me dites, et cela par un de mes amis intimes qui s’y trouvait
aussi.» Et en même temps il se tournait vers M. de Guerchy: «Vous
n’avez pas bien vu tout cela, mon cher d’Éon.»
«Le nez du ministre s’allongeait, rapporte d’Éon, et sa mine faisait
des airs sardoniques, car moi de persister et d’assurer, comme je le
ferai toute ma vie, que j’avais bien vu et bien entendu.» Le duc finit
par lui dire: «C’est votre attachement pour les Broglie qui vous fait
parler ainsi?—Ma foi, monsieur le duc, répliqua d’Éon, c’est mon
attachement à la vérité. Vous m’interrogez, je ne puis vous répondre
que ce que je sais par moi-même.»
En sortant de chez le ministre, Sainte-Foy tança fortement d’Éon et lui
conseilla de ne pas rester dans «ce pays où il ne ferait pas fortune,
mais d’aller retrouver ses Anglais». D’ailleurs une nouvelle tentative
pour connaître les véritables sentiments de d’Éon vis-à-vis du parti
Broglie devait être faite, avec plus de délicatesse, par la duchesse
de Nivernais. Se trouvant en particulier dans son cabinet avec d’Éon,
elle lui demanda s’il entretenait une correspondance 67 avec M. de
Broglie. «Non, madame, répondit-il, et j’en suis fâché, car j’aime
beaucoup M. le maréchal de Broglie; mais je ne veux pas le fatiguer de
mes lettres et je me contente de lui écrire au jour de l’an.—J’en suis
bien aise pour vous, mon cher petit ami, répliqua la duchesse, parce
que je vous confierai qu’une grande liaison avec la maison de Broglie
pourrait vous nuire à la Cour et dans l’esprit de Guerchy, votre futur
ambassadeur[49].»
A peine rentré à Londres, où l’attendait le duc de Nivernais fort
impatient de se mettre en route, d’Éon fut reçu «selon les formes
prescrites» chevalier de Saint-Louis par son chef. Il n’avait pas
voulu d’autre parrain. En même temps que sa propre croix, d’Éon
rapportait les présents du roi au ministre de Sardaigne, qui avait
été l’un des négociateurs de la paix. Le comte de Viry reçut «avec
beaucoup de sensibilité et de reconnaissance les bienfaits de Sa
Majesté». C’étaient, avec une lettre autographe, un portrait du roi
enrichi de brillants, ainsi que des tapisseries des Gobelins et des
tapis de la Savonnerie. Le premier mouvement de l’heureux destinataire
fut d’aller montrer 68 ces cadeaux au chef du ministère anglais,
lord Bute. Celui-ci, raconte Nivernais, les «porta sur-le-champ au
roi d’Angleterre, qui trouva les présents magnifiques et la lettre
charmante[50]».
Le 4 mai, le duc de Nivernais fut reçu en audience de congé par
le roi d’Angleterre, et le 22 il partit pour la France, fatigué
des brouillards de Londres, heureux aussi de retrouver Versailles,
l’Académie et son beau domaine de Saint-Maur.
D’Éon devenait son maître à Londres; il commença aussitôt à jouer le
rôle et à mener le train d’ambassadeur. Il tint table ouverte; on vit
passer chez lui le bailli de Fleury, le chevalier Carrion, ami du duc
de Nivernais, «une députation de l’Académie des sciences qui devait
aller à l’Équateur mesurer le méridien terrestre», des savants, des
gens de lettres: Duclos, Le Camus, Lalande et La Condamine. La comtesse
de Boufflers, dont l’esprit et l’élégance avaient séduit le prince de
Conti et les habitués de l’hôtel du Temple, ne dédaigna pas, lors de
son passage à Londres, de faire les honneurs de l’ambassade, ainsi
qu’en témoigne le billet suivant:
Mme de Boufflers et milady Mary Coke viendront lundi dîner avec M.
d’Éon si cela lui convient; elles amèneront lady Suzanne Stuart. Mme
de Boufflers, pour profiter de la proposition de M. d’Éon, amènera
peut-être encore deux hommes de ses amis s’ils sont revenus de la
campagne, mais elle ne le croit pas. Elle fait bien des compliments à
M. d’Éon; elle l’aidera à faire les honneurs 69 du dîner aux dames,
comme compatriote et comme une personne toute disposée à être de ses
amis.
Elle avertit M. d’Éon que milord Harlderness est revenu, et qu’ainsi
il faudra l’inviter[51].
Grâce au duc de Nivernais, qui ne se tenait pas quitte envers lui et
continuait en France à s’employer en sa faveur, il reçut en juillet des
lettres qui l’accréditaient auprès du roi d’Angleterre en qualité de
ministre plénipotentiaire.
La fortune et les honneurs étaient venus vite au «petit d’Éon». En
moins de deux ans il était passé du rôle de secrétaire à celui de
représentant du roi près Sa Majesté Britannique et avait troqué le
titre et l’uniforme de capitaine de dragons pour ceux de ministre
plénipotentiaire. L’obscur gentilhomme de Tonnerre pouvait désormais
traiter sur un pied d’égalité avec les ambassadeurs les plus titrés
et les grands dignitaires de la Cour de Londres. Il n’eut garde
d’y manquer, et dès le 25 août, à l’occasion de la Saint-Louis, il
offrait un dîner de gala où se rendirent lord Hertford, lord March,
David Hume et tout le corps diplomatique. Le succès, lui étant venu
trop soudainement, le grisa. Ce n’était point d’ailleurs une aventure
commune que celle de ce jeune homme de naissance très médiocre, engagé
par occasion dans la diplomatie secrète et introduit ensuite par faveur
dans la carrière régulière; gratifié, en récompense de ses services,
d’un brevet de lieutenant de dragons, 70 qui se trouvait, à peine
âgé de trente-six ans, représenter le roi de France près la Cour la
plus magnifique après celle de Versailles et continuer la mission de
M. le duc de Nivernais, pair du royaume. D’Éon ne sentit pas tout ce
que cette rapide ascension à travers les hiérarchies les plus strictes
et les castes les plus fermées avait de surprenant pour ceux qui
l’observaient et de scandaleux pour ceux qui lui portaient envie. Il
était plus dans son caractère d’abuser du crédit que de le ménager. Le
regard qu’arrivé à ce sommet de la fortune il ne manqua pas de jeter
sur sa carrière passée, le souvenir des difficultés de tout ordre dont
il avait dû triompher, loin de l’avertir et de le mettre en défiance,
augmentèrent sa présomption. Il ne se crut pas à l’apogée, mais bien
au premier début sérieux de sa fortune. La tête lui tourna, quoiqu’il
prévînt le reproche et s’en défendît. Il voulut s’imposer aux Anglais,
à ses compatriotes, à son ministre, à son roi lui-même.
Il continuait à faire figure d’ambassadeur en attendant qu’on se
décidât à lui en accorder le titre et à l’égaler ainsi aux premiers
seigneurs de France. Mais si, dans cette folle entreprise, sa volonté
ne s’usait pas, si les ressources de son esprit toujours en éveil ne
diminuaient jamais, son argent fondait à vue d’œil. Il fallait
payer l’aumônier, l’écuyer, les cinq officiers, les quatre laquais, le
suisse, les quatre servants, les deux cochers, les deux palefreniers,
etc., qui composaient son train ordinaire de maison. Ses appointements
n’y suffisant pas, d’Éon 71 dut avoir recours au duc de Praslin pour
obtenir quelques subsides supplémentaires. Il le fit avec une modestie
et un détachement admirablement joués, exposant que seul le caractère
de ministre plénipotentiaire qui était venu le chercher, à son insu,
l’obligeait, bien malgré lui, à porter quelques habits propres et des
dentelles:
Le caractère de ministre plénipotentiaire, qui est venu me chercher
à mon insu, ne m’a certainement pas fait tourner la tête, grâce
à un peu de philosophie; il m’a seulement jeté dans des frais
extraordinaires, suivant le mémoire ci-joint, tant en habits pour
moi que pour ceux des domestiques et d’un cocher. Quand j’étais
secrétaire d’ambassade, j’allais tout simplement avec mon uniforme
et mes manchettes de batiste; aujourd’hui il faut malgré moi porter
quelques habits propres et des dentelles. Si les affaires du roi
n’en vont pas mieux, du moins ma bourse en va plus mal; votre bonté
et votre justice ne le souffriront pas. Il y a bientôt dix ans que
je suis politique sans en être ni plus riche, ni plus fier. On m’a
beaucoup promis, et les promesses et les prometteurs n’existent plus.
Jusqu’à présent j’ai toujours semé, et j’ai recueilli moins que ma
semence. Mon bail politique étant heureusement fini, je serai forcé
de mettre la clef sous la porte et de faire une banqueroute générale,
si vous n’avez pas l’humanité de venir à mon secours par quelque
gratification extraordinaire. Plus je travaille avec zèle et courage,
moins je deviens riche: ma jeunesse se passe et il ne me reste plus
qu’une mauvaise santé qui dépérit tous les jours, et plus de vingt
mille livres de dettes. Ces différentes petites dettes me tourmentent
depuis si longtemps que cela absorbe en vérité les facultés de mon
esprit et ne lui permet pas de s’appliquer comme je le voudrais aux
affaires du roi. Le temps de la récolte me 72 paraissant à peu près arrivé, je vous supplie
de prononcer sur mon sort présent et futur, sur mes appointements
et sur les faveurs et grâces que je puis attendre de votre justice
et de votre bon cœur[52]...
Le duc de Praslin fut d’autant moins disposé à accueillir la requête
qu’il se trouva en même temps saisi de violentes réclamations formées
par le comte de Guerchy contre d’Éon. Non content de s’endetter
lui-même, celui-ci avait dépensé par avance une partie du traitement
du futur ambassadeur. Il considérait du reste ces appointements comme
les siens, car il ne pouvait admettre qu’après avoir été au premier
rang il se retrouvât au second, que «d’évêque il devînt meunier». Il
s’obstinait avec sa ténacité de Bourguignon au rêve chimérique de
conquérir, lui d’Éon, le titre comme les fonctions d’ambassadeur,
de succéder à Londres à son ancien chef Nivernais. En dépit des
avertissements qui lui viennent de tous côtés, des conseils de
modération que ne cessent de lui prodiguer ses protecteurs les mieux
informés et les plus dévoués, le premier commis des affaires étrangères
Sainte-Foy et le duc de Nivernais lui-même, il s’entête et finit par
recevoir du duc de Praslin des remontrances fort méritées:
Je n’aurais jamais cru, monsieur, que le titre de ministre
plénipotentiaire vous fît si promptement oublier le point d’où vous
êtes parti et je n’avais pas lieu de m’attendre à vous voir augmenter
de prétentions à mesure que 73 vous recevez de nouvelles faveurs.
1o Je ne vous ai point fait espérer le remboursement de votre ancien
voyage de Russie puisque trois de mes prédécesseurs à qui vous
avez fait la même demande n’ont apparemment pas trouvé qu’elle fût
légitime. 2o Vous vous plaignez à moi de vaines promesses qui vous
ont été faites, et ce n’est assurément pas la manière dont j’en ai
agi avec vous. Rappelez-vous que je vous ai reçu à Vienne dans un
temps où je ne pouvais avoir aucune raison de vous obliger, puisque
vous ne m’étiez nullement connu; vous êtes arrivé chez moi malade
et je vous ai guéri; vous en êtes parti dans l’incertitude du sort
qui vous attendait ici, et je vous ai procuré la pension qui vous
a été donnée. Deux ans après, vous trouvant sans occupations, vous
avez eu recours à moi, et je vous ai donné le poste le plus agréable
et l’occasion la plus avantageuse pour vous faire connaître. Vous
êtes enfin venu nous apporter les ratifications de l’Angleterre; ce
voyage vous a été payé comme aurait pu l’être celui de Pétersbourg et
Sa Majesté vous a récompensé comme si vous aviez fait dix campagnes
de guerre. Si ce tableau, monsieur, vous offre des sujets de
mécontentement, je vous avoue que je serai obligé de renoncer à vous
employer de peur de manquer des moyens suffisants pour récompenser
vos services. Mais j’aime mieux présumer que vous en sentirez la
vérité et que vous mettrez à l’avenir plus de confiance en ma bonne
volonté pour vous qu’en des représentations aussi mal fondées. Je
ne dois point oublier de vous dire que je n’ai pas aperçu que le
caractère de plénipotentiaire engageât M. de Neuville à faire ici
aucunes dépenses; je le vois toujours tel qu’il était auprès de M. de
Bedford, et rien ne peut me faire soupçonner la nécessité des frais
extraordinaires auxquels vous vous êtes livré sur le compte de M.
de Guerchy et qui sont extrêmement déplacés. Je ne vous cache pas
que j’ai trouvé très mauvais que vous ayez fait autant de dépense
aux dépens de quelqu’un à qui je m’intéresse autant et qui vous a
donné sa 74 confiance sur ma parole. J’espère qu’à l’avenir vous
serez plus circonspect dans vos demandes et plus attentif à ménager
l’argent d’autrui et que vous vous attacherez autant à lui être utile
que vous l’avez fait auprès de M. le duc de Nivernais.
Je suis très parfaitement, monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur[53].
Le duc de Praslin se trompait étrangement s’il espérait avoir le
dernier mot avec son impétueux correspondant. D’Éon, loin de se rendre,
fut exaspéré par la sagesse même des avis qui lui étaient donnés et,
n’écoutant que son dépit, répondit le jour même:
Aussitôt que j’ai eu appris, monsieur le duc, qu’on voulait me donner
malgré moi le titre de ministre plénipotentiaire, j’ai eu l’honneur
d’écrire à M. le duc de Nivernais que je regardais ce titre plutôt
comme un malheur que comme un bien pour moi; en toutes choses, il
faut envisager la fin.
Je suis parti fort jeune du point de Tonnerre, ma patrie, où j’ai
mon petit bien et une maison au moins six fois grande comme celle
qu’occupait M. le duc de Nivernais à Londres. En 1756 je suis
parti du point de l’hôtel d’Ons-en-Bray, rue de Bourbon, faubourg
Saint-Germain. Je suis l’ami du maître de la maison et j’en suis
parti malgré lui pour faire trois voyages en Russie et autres Cours
de l’Europe, pour aller à l’armée, pour venir en Angleterre, pour
porter quatre ou cinq traités à Versailles, non comme un courrier,
mais comme un homme qui y avait travaillé et contribué. J’ai souvent
fait ces courses quoique malade à la mort et une fois avec une
jambe cassée. Malgré tout cela, je suis, si le destin l’ordonne,
prêt à retourner au point d’où je suis 75 parti. J’y retrouverai
mon ancien bonheur. Les points d’où je suis parti sont d’être
gentilhomme, militaire et secrétaire d’ambassade; tout autant de
points qui mènent naturellement à devenir ministre dans les Cours
étrangères. Le premier y donne un titre; le second confirme les
sentiments et donne la fermeté que cette place exige; mais le
troisième en est l’école...
Si un marquis, monsieur le duc, avait fait la moitié des choses que
j’ai faites depuis dix ans, il demanderait au moins un brevet de duc
ou de maréchal; pour moi, je suis si modeste dans mes prétentions que
je demande à n’être rien ici, pas même secrétaire d’ambassade[54].
D’Éon qui ce jour-là se sentait en verve et, pour le plaisir de faire
des mots, courait au-devant de sa disgrâce ne s’en tint pas encore là.
Par le même courrier il envoyait au comte de Guerchy, qui n’avait cessé
de son côté de l’exhorter à plus de retenue, de pareilles impertinences:
... Je prendrai seulement la liberté de vous observer au sujet du
caractère que le hasard m’a fait donner que Salomon a dit, il y a
bien longtemps, qu’ici-bas tout était hasard, occasion, cas fortuit,
bonheur et malheur, et que je suis plus persuadé que jamais que
Salomon était un grand clerc. J’ajouterai modestement que le hasard,
qui ferait donner le titre de ministre plénipotentiaire à un homme
qui a négocié heureusement depuis dix ans, n’est peut-être pas un des
plus aveugles de ce monde: ce qui m’arrive par le hasard peut arriver
à un autre par bonne aventure...
Un homme quelconque ne peut se mesurer, même dans l’opinion, que
par un ou plusieurs hommes. Il y a même plusieurs proverbes qui
serviraient à prouver la 76 vérité de ceci. On dit communément:
il est bête comme mille hommes, il est méchant comme quatre, il est
ladre comme dix. C’est la seule échelle dont on puisse se servir,
excepté dans certains cas où les hommes se mesurent par les femmes.
Un ambassadeur quelconque équivaut à un demi-homme, ou à un homme
entier, ou à vingt hommes, ou à dix mille. Il s’agirait de trouver
la proportion existant entre un ministre plénipotentiaire, capitaine
de dragons, qui a fait dix campagnes politiques (sans compter
les campagnes de guerre, comme dit M. le duc de Praslin) et un
ambassadeur lieutenant-général qui débute...
J’ai déjà eu l’honneur, monsieur, de vous faire mes sincères
remerciements pour toutes vos offres gracieuses de services; à
l’égard des espérances à venir, j’aurai celui de vous avouer
franchement que je suis le second tome de ma sœur Anne de la Barbe
Bleue, qui regardait toujours et qui ne voyait rien venir, et cela
m’engage souvent à chanter en faux-bourdon ce beau refrain:
Belle Philis, on désespère
Alors qu’on espère toujours.
J’ai l’honneur d’être[55]...
77
CHAPITRE IV
Arrivée à Londres du comte de Guerchy.—Le chevalier d’Éon est
disgracié et se venge.—Il accuse l’ambassadeur d’avoir voulu
l’assassiner; l’affaire Vergy.—Mission de Carrelet de la
Rozière.—Le duc de Choiseul cherche à faire revenir d’Éon et le roi
à obtenir la restitution de ses papiers.—L’extradition de d’Éon est
refusée par le cabinet anglais.—Lettre de d’Éon à sa mère.
Dans sa lettre au duc de Praslin, d’Éon rappelait «le point d’où il
était parti» et n’y trouvait que des raisons de s’enorgueillir de son
succès.
C’était bien se juger soi-même, quoique sans grande modestie; mais
c’était en même temps fort mal connaître son époque. Ayant obtenu fort
jeune encore un grade et des distinctions qui auraient dû paraître à un
homme de sa naissance le couronnement inespéré de toute une carrière,
il ne sut ni se trouver satisfait, ni même s’armer de patience. Il ne
put surtout se résigner à rétrograder. Après avoir été, dans une grande
négociation, le secrétaire d’un ambassadeur éclairé et magnifique,
dont il s’était ingénié ensuite, comme ministre plénipotentiaire, à
conserver la tradition et les allures, il se retrouvait obligé de
«secrétariser» de nouveau, sous les ordres d’un chef novice dans la
diplomatie, court de vues et de 78 moyens, et décidé à retirer de son
ambassade les avantages d’une riche prébende.
Sans argent, exaspéré par les récriminations que lui avaient values les
dépenses de son intérim, d’Éon attendait rageusement son ambassadeur.
Le comte de Guerchy arriva le 17 octobre. «Il me reçut avec une
politesse cafarde, raconte d’Éon, et me demanda d’un ton patelin si
je me repentais de lui avoir écrit la lettre du 25 septembre. Je lui
répondis tranquillement: «Non, monsieur; ma lettre n’était qu’une
réplique un peu vive peut-être, mais juste, à votre attaque du 4 du
même mois, et si vous m’écriviez encore pareille épître, je serais
forcé de vous faire pareille réponse.—Allons, allons, je vois que
vous êtes un peu mauvaise tête, mon cher monsieur d’Éon.» Et il tira
de sa poche mon ordre de rappel à griffe, patte ou grillage, qu’il me
mit entre les mains d’un air contrit, en m’exprimant ses regrets et
en m’assurant encore de son amitié et de son dévouement. Je ne lui
répondis que par un regard... Et le saluant froidement je me retirai
emportant avec moi ce document officiel de ma disgrâce»[56].
79
Si d’Éon parvint aussi bien qu’il le rapporte à masquer son dépit et
à conserver un sang-froid dont il était peu coutumier, la lecture de
la lettre du duc de Praslin dut lui suggérer de cruelles réflexions.
Non seulement il se trouvait rappelé sans délai à Paris, mais l’accès
de la Cour lui était interdit. C’était la disgrâce dans toute sa
rigueur, l’exil, l’arrêt pour longtemps, sinon la fin de sa carrière.
Trop irrité pour se laisser abattre, et espérant encore que Louis XV
interviendrait en faveur de son agent secret, il résolut d’attendre les
événements et d’ajourner, autant qu’il le pourrait, son départ[57].
Son imagination, qui n’était jamais à court d’expédients, lui fournit
tout un plan de résistance dans la lutte scandaleuse qu’il ne craignit
pas d’entreprendre contre les ordres de son ambassadeur, du 80
ministre et du roi. Dès le lendemain, et tout en remettant à M. de
Guerchy les papiers de l’ambassade, d’Éon lui annonça qu’il n’était
nullement pressé d’obtenir ses audiences de congé. Ayant été accrédité
par des lettres portant la signature autographe du roi, il ne pouvait,
prétendait-il, être révoqué que par un acte dans les mêmes formes.
Considérant donc comme non avenues les lettres de rappel qu’il avait
reçues et qui n’étaient signées que de la griffe, il se disait résolu à
attendre des «ordres ultérieurs de sa Cour[58]».
M. de Guerchy lui représenta en termes violents 81 tout ce que sa
conduite avait d’insolite et à quelles conséquences elle l’exposait,
puis s’échauffant peu à peu il lui dit, si l’on en croit d’Éon, qu’il
«saurait bien avoir raison de son obstination et que d’ailleurs sa
perte était résolue».
Au surplus, pour mettre fin à une situation équivoque et priver d’Éon
de tout moyen de résistance, Guerchy alla jusqu’à demander à la
Cour de Londres d’avancer les audiences de congé de son encombrant
collaborateur. D’Éon laissa faire la démarche, mais se trouva fort
opportunément empêché de se rendre au palais le jour fixé[59]. Toutes
ces tracasseries exaspérèrent d’Éon et achevèrent de lui faire perdre
la tête. Il suffit du reste d’un incident pour rendre publique la
dispute et donner à cette intrigue de chancellerie un retentissement
inouï.
Un Français, le sieur Treyssac de Vergy, était arrivé dans le courant
du mois de septembre. Avocat au parlement de Bordeaux, il se disait
homme de lettres, faisait parade de ses belles relations et se vantait
même d’être venu en Angleterre avec la promesse d’y figurer comme
ministre plénipotentiaire en remplacement du chevalier d’Éon. S’étant
présenté à l’ambassade, il y avait été assez sèchement 82 éconduit
par d’Éon lui-même, qui lui avait laissé entendre qu’il ne serait plus
reçu sans apporter avec lui les lettres d’introduction annoncées. Le
sieur de Vergy avait protesté, affirmant qu’il se trouvait de longue
date en relations suivies avec le comte de Guerchy; néanmoins il avait
promis de fournir les références qu’on exigeait de lui. D’Éon n’avait
plus revu ce singulier visiteur, mais il avait reçu de Paris sur son
compte les plus mauvais renseignements: on le représentait comme un
véritable aventurier, perdu de dettes et de réputation, qui faisait des
dupes sous un nom d’emprunt. Aussi, au cours d’une réception donnée par
M. de Guerchy à l’occasion de son arrivée, d’Éon fut-il bien étonné de
la présence de Vergy, que l’ambassadeur ne connaissait pas ou feignait
de ne pas connaître. Il lui témoigna sa surprise de le trouver à
l’ambassade sans qu’il y eût été prié, et sur un échange de paroles
assez vives «l’insulta, le défia à pied ou à cheval» et ne se calma que
sur l’intervention de M. de Guerchy.
Le lendemain, d’Éon se trouvait à dîner chez lord Halifax, en compagnie
de lord Sandwich et du comte de Guerchy. Il était trop surexcité
par les événements de la veille pour pouvoir garder son sang-froid,
même devant les ministres anglais, et la présence de l’ambassadeur
ne fit que l’exaspérer davantage. Il trouva l’occasion bonne pour
déclarer qu’il ne quitterait pas l’Angleterre avant d’être rappelé
régulièrement, et que d’ailleurs il ne pourrait, dans tous les cas,
songer à partir sans avoir terminé une affaire 83 d’honneur. Il
s’agissait de la querelle de la veille, qu’il raconta complaisamment à
ses hôtes, leur annonçant qu’il attendait pour le lendemain la visite
de Vergy, qu’il accepterait le cartel et tuerait son adversaire. Aux
ministres anglais, qui lui objectaient le scandale et les devoirs
de sa situation officielle, il répondit que «s’il était ministre
plénipotentiaire, il était surtout dragon.—Bien, lui rétorqua lord
Halifax; mais fussiez-vous même le duc de Bedford, je me verrais obligé
de vous faire escorter par des gardes.—Je n’ai point l’honneur d’être
le duc de Bedford; je suis M. d’Éon et n’ai besoin d’aucune escorte.»
Il était dans un tel état d’exaltation que Guerchy s’unit à lord
Halifax, et tout fut mis en œuvre pour le calmer. D’Éon n’écouta
ni prières ni menaces et, prétextant un engagement au cercle, tenta
de s’esquiver. Sur l’ordre du ministre, on lui barra le passage[60]
et d’Éon, au comble de la fureur, s’écria qu’il était inconcevable
qu’un ministre plénipotentiaire fût, devant son ambassadeur, retenu
prisonnier dans l’hôtel du secrétaire d’État. La scène devenait
tragi-comique. 84 Lord Halifax et Guerchy sentirent qu’il importait
d’y mettre fin, sous peine de soulever un scandale beaucoup plus
retentissant que celui qu’ils avaient voulu prévenir. Ils se remirent à
raisonner d’Éon, qui se calma peu à peu et finit par consentir à signer
un papier aux termes duquel il donnait sa parole d’honneur aux comtes
de Sandwich et Halifax de ne point se battre avec M. de Vergy et «de ne
point lui faire aucune insulte, sans avoir préalablement communiqué ses
intentions aux susdits comtes».
D’Éon prit lui-même une copie de son engagement et la fit signer par
lord Halifax, lord Sandwich et le comte de Guerchy[61].
Cet étrange scandale, occasionné par la maladresse de l’ambassadeur
au moins autant que par l’exaltation fort peu diplomatique de son
bouillant ministre plénipotentiaire, eut son épilogue le lendemain.
D’Éon en a fait lui-même un récit trop pittoresque pour n’être point
cité:
«La chose s’est passée sans coup férir; ma circonstance était bien plus
critique que la sienne; j’avais promis de ne point agir contre lui
et je ne pouvais prévoir que le brave Vergy était homme à se laisser
intimider de mes moindres démarches; en effet je fermai la porte de ma
chambre pour le retenir jusqu’à ce que les gens de M. l’ambassadeur que
j’avais envoyé chercher fussent arrivés, et aussitôt 85 le sieur de
Vergy s’écria en courant dans ma chambre: «Ah! monsieur, ne me touchez
pas, ne me touchez pas!—Comment, lui répondis-je en souriant, tu viens
chez moi en habit de combat et tu crains que je te touche!» Quelques
expressions dragonnes mêlées à ce discours l’engagèrent à vouloir
prendre la fenêtre pour la porte; j’aperçus sa pâleur et son mouvement
et lui dis: «Si tu sautes je te pousse; mais prends garde: tu trouveras
en bas un fossé et des piques.» Cette observation, qui n’est point
philosophique, suffit pour l’arrêter.
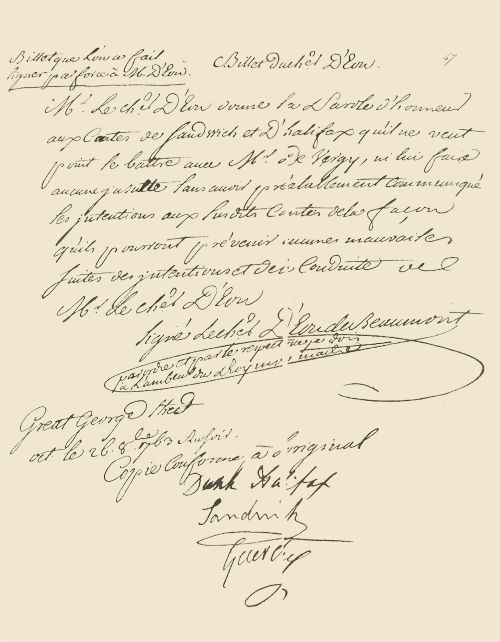
«Je lui présentai alors un papier en lui disant: «Mon ami, voici un
billet qu’il faut signer par duplicata, après que tu en auras pris
lecture.» Il le parcourut avec tant de précipitation qu’en me le
remettant, il me demanda trois semaines pour avoir des lettres de
Paris. «Mon ami, lui dis-je, si tu n’avais pas l’esprit un peu troublé
tu verrais que je te donne un mois.» Je le pris par le bras et le fis
entrer dans ma chambre à coucher, où est placé mon bureau. Aussitôt
qu’il y fut il s’écria: «Ah! monsieur, ne me tuez point.» Je ne savais
qu’augurer de cette exclamation, lorsque tout à coup je vis les yeux du
sieur de Vergy fixés sur mon sabre turc et mes pistolets d’ordonnance
que j’ai rapportés intacts de la guerre d’Allemagne. Je compris alors
d’où venait l’excès de sa frayeur. Pour le tranquilliser, je pris
aussitôt un des pistolets que je mis à terre, et posant le pied dessus
de peur qu’il ne mordît le dit de Vergy, je lui dis: «Tu vois bien
86 que je ne veux point te faire de mal, ni même t’approcher; signe
de bonne grâce.» Alors il se résigna galamment à signer le billet en
duplicata, et il paraît nécessaire de dire qu’il le fit, le chapeau
sous le bras et un genou en terre. Il ne jugea pas à propos d’en
prendre copie, quoique je le lui aie proposé; il était trop pressé de
gagner la porte de ma salle[62].»
Vergy courut directement chez le juge de paix; il lui raconta dans
les termes les plus dramatiques ce qui venait de se passer, et obtint
contre d’Éon une lettre d’assignation[63]. D’Éon, qui jouissait encore
de son immunité diplomatique, ne jugea pas convenable d’y répondre. Il
était d’ailleurs bien trop occupé de ses démêlés avec son ambassadeur,
qui s’aggravaient de jour en jour et finirent par changer en manie de
la persécution cette sorte de folie des grandeurs qui s’était emparée
de lui. Il accusa M. de Guerchy d’avoir tenté de le faire empoisonner.
Il raconta que le 28 octobre, alors qu’il dînait pour la dernière
fois à l’ambassade, l’écuyer Chazal aurait mêlé à un vin de Tonnerre,
dont on le savait très friand, une dose d’opium telle «qu’il faillit
tomber en léthargie» et fut pendant plusieurs jours obligé de garder
la chambre. L’ambassadeur étant venu le lendemain avec deux de ses
secrétaires s’informer de sa santé, d’Éon s’imagina que M. de Guerchy
avait voulu se rendre compte des dispositions de son appartement et
tenter de découvrir où pouvaient 87 être cachés les papiers secrets;
à l’annonce de cette visite il s’était même empressé de monter chez son
cousin d’Éon de Mouloize et d’appeler son secrétaire «afin, dit-il,
d’éviter un coup de main». Il ne cessait de raconter à ses amis toutes
ces persécutions et assurait qu’il était sans cesse espionné. Son
domestique, ayant dû faire remettre une nouvelle serrure à la porte
de son logement, avait naturellement appelé le serrurier voisin, qui
se trouva être celui de l’ambassade. D’Éon se crut alors à la merci
du comte de Guerchy; il vit sa personne en danger et ses papiers sur
le point d’être saisis. Aussi, affolé, n’y tenant plus, il congédia
son domestique et réunit ses fidèles compagnons en un conciliabule où
l’on décida de déménager sur-le-champ. D’Éon, dont la manie d’écrire
ne s’apaisa en aucune circonstance, nous a conservé une sorte de
procès-verbal de cette séance, qui peint bien son état d’esprit:
«Le conseil des trois, y est-il écrit, après avoir fait bien des
réflexions sur le délogement, a résolu que demain matin les meubles et
les effets seraient transportés sur une charrette, parce qu’en un ou
deux voyages le tout sera délogé... Toutes ces batteries sont prêtes à
démasquer en cas de besoin et la garnison est bien résolue, s’il était
question de capitulation, de sortir de la place, tambour battant, mèche
allumée et avec tous les honneurs de la guerre—et operibus eorum
cognoscetis eos[64].»
88
D’Éon n’eut pas à faire usage des procédés de guerre dont il menaçait
son ambassadeur. Il élut domicile chez Carrelet de la Rozière, son
parent et son associé dans la mission secrète qui lui avait été
confiée. Il y apporta armes et bagages; puis, toujours en proie à la
même obsession, transforma sa nouvelle habitation, située au cœur
même de Londres, en une véritable forteresse, militairement occupée et
commandée.
M. de Guerchy n’en était plus à s’étonner des allures de d’Éon, et
cependant cet exode clandestin et subit le laissa tout interdit, et
d’autant plus inquiet qu’il commençait à désespérer d’obtenir les
comptes que d’Éon lui devait, mais différait toujours de lui rendre. Il
lui écrivait dès le 9 novembre en son style d’ambassadeur, dont le duc
de Praslin n’avait pas eu tort de se méfier:
J’ai appris hier, monsieur, que vous étiez sorti de la maison que
j’avais louée pour vous et pour le surplus de ceux qui ne pouvaient
pas loger dans celle de milord Holland que j’occupe. J’ignore
quelle peut être la cause de cette détermination de votre part si
précipitée, et sans m’en avoir informé. Ce jour que je fus savoir
de vos nouvelles sur ce que j’avais appris que vous étiez malade,
j’oubliai de vous parler du compte que vous êtes dans le cas de me
rendre pour toutes les différentes sommes que vous avez touchées et
prises sur mon compte; il y a déjà quelque temps que vous me dites
que vous le remettriez sous deux jours; je vous prie instamment de me
l’apporter ou de me le faire remettre incessamment[65].»
89
D’Éon n’envoya pas les comptes qui lui étaient réclamés, mais il se
rendit au lever du roi, et lorsque Sa Majesté se fut retirée, il
s’approcha de l’ambassadeur: «Je n’ai pas répondu, monsieur, lui
dit-il, à la lettre que vous m’avez écrite ce matin, parce que je me
suis levé tard. Si j’ai des comptes à rendre, je les rendrai à ma Cour
lorsqu’elle me les demandera. Le ministre plénipotentiaire de France a
vécu aux dépens du roi tout comme l’ambassadeur y vit. D’ailleurs je
suis charmé que vous me fournissiez l’occasion de vous déclarer que je
n’ai jamais été votre intendant, ni ne le serai jamais; je ne suis ni
fait, ni né pour cela.» Et sans laisser à M. de Guerchy le temps de lui
répondre, il lui fit une «profonde révérence» et se hâta de regagner
sa forteresse. Ayant réuni son conseil, il employa toute son éloquence
à persuader à M. de la Rozière que, d’après la tournure que prenaient
les événements, les documents secrets allaient se trouver en danger.
Ils étaient assez volumineux pour être gênants et difficiles à cacher,
en cas d’alerte subite. D’Éon fit si bien que M. de la Rozière s’offrit
lui-même à en faire passer une partie en France. C’était une mission
périlleuse que son rôle assez effacé et l’attitude réservée qu’il avait
adoptée lui rendaient plus facile qu’à tout autre. D’Éon lui remit une
grande partie des documents qu’il possédait; mais il eut bien soin de
conserver par devers lui les pièces les plus importantes, les plus
compromettantes, celles qui pouvaient devenir pour lui une arme ou
tout au moins une garantie dont il 90 saurait tirer parti. Parmi ces
pièces se trouvaient naturellement les minutes relatives à la mission
qui le retenait en Angleterre pour y étudier le projet de débarquement
militaire.
Chargé du mystérieux colis, M. de la Rozière partit quelques jours
plus tard pour Paris, emportant, en outre, sous un pli à l’adresse de
M. Tercier, des lettres qui devaient être remises au roi et à M. de
Broglie. D’Éon y racontait tous les complots qu’il avait cru découvrir;
les tentatives d’empoisonnement, d’enlèvement, d’espionnage dont il
avait été l’objet; se vantant même d’avoir «humilié et mystifié son
ambassadeur» et «d’avoir combattu en dragon pour le roi, pour son
secret et pour le comte de Broglie[66].»
Ces lettres, d’une exagération si manifeste, produisirent à Paris un
effet contraire à celui que d’Éon en attendait. Le roi sentit qu’aux
mains d’un tel écervelé sa correspondance pouvait, d’un instant à
l’autre, être saisie par son ambassadeur et revenir à ses ministres.
Tout le plan de sa politique secrète, qu’il avait dissimulé si
jalousement, pouvait ainsi se trouver découvert. Sans consulter le
comte de Broglie ou même M. Tercier, Louis XV se hâta de prendre ses
précautions.
Il envoya un courrier à son ambassadeur à Londres pour lui annoncer
qu’il venait de contresigner une 91 lettre de M. de Praslin requérant
l’extradition de d’Éon; Guerchy devait, dans le cas où il se saisirait
de la personne du chevalier, conserver par devers lui «tous les papiers
qu’il pourrait trouver avec le sieur d’Éon, sans les communiquer à
personne». Ces documents devaient être «tenus secrets pour tout le
monde sans aucune exception» et «demeurer soigneusement cachetés» entre
les mains de l’ambassadeur, qui à son prochain voyage les remettrait
directement au roi. Le sieur Monin, secrétaire du comte de Guerchy
et ami de M. d’Éon, avait reçu pour mission de savoir où ces papiers
pouvaient être déposés[67].
Louis XV avait cru ainsi parer à tout événement; il comptait, par
cette demi-confidence, s’assurer la discrétion de Guerchy et empêcher
l’ambassadeur de faire part de ses découvertes au duc de Praslin.
Tercier et le comte de Broglie furent épouvantés de la mesure
précipitée qu’avait prise le roi et que lui-même leur apprit le
lendemain[68]. Ils savaient Guerchy assez maladroit pour tout révéler
par inadvertance, si toutefois son attachement à la maison de Choiseul
ne lui inspirait pas une indiscrétion qui livrerait au ministre le
secret de la politique particulière du roi. Si de pareilles révélations
devaient être mortifiantes pour le roi, elles étaient redoutables
pour les agents secrets aux dépens desquels se traduirait sûrement
le 92 dépit des ministres. Aussi le comte de Broglie, très alarmé,
exposa-t-il de suite au roi ses inquiétudes au sujet des ordres
envoyés à Guerchy, et M. Tercier lui fit part de réflexions non moins
pessimistes. Louis XV, tout à la satisfaction d’avoir échappé à une
aussi chaude alerte, prit à tâche de rassurer ses conseillers: «Si
Guerchy, leur écrivait-il, manquait au secret, ce serait à moi qu’il
manquerait, et il serait perdu; s’il est honnête homme, il ne le fera
pas; si c’est un fripon, il faudrait le faire pendre. Je vois bien que
vous et le comte de Broglie êtes inquiets. Rassurez-vous, moi je suis
plus froid[69].»
Guerchy, il faut lui rendre cette justice, ne semble pas avoir
trompé la confiance du Roi. Soit qu’il s’aperçût du danger qu’il
courrait en risquant des confidences, soit qu’il préférât voir dans
la lettre du roi une marque de confiance dont il voulût se montrer
digne, il ne s’ouvrit de cette affaire qu’à Mme de Guerchy, qui garda
scrupuleusement le secret. L’ambassadeur était du reste assez satisfait
de trouver contre d’Éon des armes nouvelles, car il ne savait plus
comment agir. N’ayant pu réussir par la menace, il avait eu recours
à la flatterie et avait suggéré au duc de Choiseul d’écrire à d’Éon
une lettre de promesses. Le ministre s’y était prêté et avait usé des
termes les plus affectueux:
Qui est-ce qui vous arrête donc là-bas, mon cher d’Éon! abandonnez,
je vous le conseille, la carrière politique 93 et vos tracasseries
ministérielles avec M. de Guerchy pour venir me rejoindre ici, où je
compte vous employer utilement dans le militaire; je vous promets que
vous n’éprouverez aucuns désagréments quand je vous emploierai. Comme
l’arrangement militaire va être consommé bientôt, j’ai prié M. de
Praslin de vous faire revenir; rien désormais ne doit vous arrêter et
vous me ferez grand plaisir de revenir me joindre sans perte de temps
à Versailles; je vous y attends, mon cher d’Éon, avec tout l’intérêt
que vous me connaissez pour vous et les sentiments avec lesquels j’ai
l’honneur d’être votre très humble et très obéissant serviteur[70].
En dépit des termes engageants de cette lettre, d’Éon ne fut point
tenté d’abandonner la lutte stérile et sans issue qu’il avait
entreprise contre son ambassadeur, pour retourner chercher sur de vrais
champs de bataille des succès plus dignes de son brillant passé. Sans
illusions sur l’accueil qu’il aurait trouvé en France, il se borna à
décliner avec respect et reconnaissance les offres du duc de Choiseul.
Il était résolu à ne pas abandonner Londres, où la loi protégeait si
efficacement le domicile de tout citoyen. Pareille sauvegarde était
bien de nature à étonner un Français du dix-huitième siècle, et M. de
Guerchy lui-même n’avait pu encore s’y accoutumer. Il était si peu fait
aux coutumes anglaises qu’il ne sut pas épargner à son gouvernement un
désagréable mécompte. A peine en possession des nouveaux ordres du roi,
il se hâta de soumettre aux ministres anglais la demande d’extradition
que lui avait transmise 94 le duc de Praslin. Malgré tout le désir
qu’ils avaient de tirer d’embarras le malheureux ambassadeur, les
ministres anglais ne crurent pas devoir prendre, de leur propre
autorité, une décision si contraire aux lois et à l’esprit de la
nation; ils portèrent l’affaire devant le conseil du roi. Guerchy fit
de nouvelles démarches, plus pressantes encore, auprès des secrétaires
d’État; mais ce fut en vain, et le roi d’Angleterre exprima seulement
à l’ambassadeur «le regret qu’il éprouvait de ne pas accueillir la
demande de son cousin, le roi de France, les lois de son royaume ne lui
en laissant pas le pouvoir».
L’échec était d’autant plus mortifiant pour Guerchy qu’il avait
entraîné son gouvernement dans cette fausse manœuvre, et il ne
put trouver qu’une mince compensation dans le congé en forme que le
chambellan du roi d’Angleterre fit remettre à d’Éon:
Monsieur,
Le Roi votre maître a fait savoir au Roi mon maître que vous n’êtes
plus son Ministre à la Cour de Londres et en même temps a exigé du
Roi qu’il donnât des ordres pour que vous ne paraissiez plus à la
Cour, et je suis très mortifié de vous dire que j’ai reçu ce matin
des ordres du Roi mon maître de vous communiquer ses intentions
là-dessus.
J’ai l’honneur d’être...
Gower,
Chambellan du Roi d’Angleterre[71].
Ce billet poli, mais catégorique, marque la fin de la 95 carrière
régulière du chevalier d’Éon. Il consacre, au nom du roi d’Angleterre,
la révocation que sa folie des grandeurs avait value au ministre
plénipotentiaire du roi de France. Désavoué officiellement par le
souverain qui l’avait envoyé et par celui qui l’avait reçu, d’Éon
n’avait plus de situation. Tout autre que lui s’en fût trouvé abattu et
aurait demandé grâce. Il se montra plus insolent et plus intraitable
que jamais. Ne pouvant se croire abandonné de ses protecteurs et
comptant, en dépit de tout, sur le secret appui du roi, d’Éon
s’estimait encore de taille à tenir tête à Guerchy. C’est, en effet,
celui-ci qui dut se déclarer vaincu et faire au roi lui-même le récit
de sa défaite:
J’attendais toujours pour répondre à la lettre dont il a plu à Votre
Majesté de m’honorer, datée de Fontainebleau 4 novembre, que j’eusse
pu exécuter vos ordres; mais quelques moyens différents que j’aie
employés pour y parvenir, cela m’a été absolument impraticable. Votre
Majesté aura vu par ma dépêche les obstacles qui s’opposent à ce que
je me rende maître des papiers de d’Éon, qui refuse constamment de me
les remettre malgré l’ordre qu’il en a reçu de M. de Praslin de la
part de Votre Majesté.
C’est là un des points de sa folie, qui cependant n’existe pas sur
les autres généralement. Elle aura été également informée que la
Cour de Londres m’a refusé main-forte à ce sujet, en me répondant
que c’était contre les lois du pays. Le roi d’Angleterre et ses
ministres ont cependant la plus grande envie d’être débarrassés de ce
personnage-là. Il n’a pas dépendu de moi non plus de m’en saisir par
moi-même ainsi que de sa personne, par force ou par adresse, parce
qu’il ne loge pas dans ma maison et qu’il n’y est pas venu depuis
qu’il pousse les choses au point où il les a poussées jusqu’à ce
moment...
96
Je suis bien peiné, Sire, de n’avoir pu en cette occasion donner à
Votre Majesté, comme je l’aurais désiré, des preuves du zèle ardent
que j’aurai toute ma vie[72]...
D’Éon avait échappé une fois de plus aux manœuvres de Guerchy. Il
s’était moqué des démarches officielles de l’ambassadeur, comme de
ses secrètes intrigues. Il avait amusé Monin, le secrétaire de M. de
Guerchy, par de fausses confidences et lui avait laissé croire qu’il
n’avait pas avec lui en Angleterre les documents importants qu’il
possédait. Quant aux exempts que l’on avait envoyés de Paris pour
l’enlever, il les avait tenus en respect, ne sortant qu’en nombreuse
compagnie et restant la plupart du temps retranché dans son logement.
«Sa chambre, son salon, son cabinet et l’escalier étaient minés; une
lampe brûlait toute la nuit... La garnison était composée de plusieurs
dragons de son ancien régiment qu’il avait fait venir et de quelques
déserteurs recueillis à Londres qui occupaient le rez-de-chaussée[73].»
Ces précautions, qui sembleraient inventées à plaisir si elles
n’avaient été le fait d’un aventurier préoccupé avant tout de frapper
l’opinion publique, étaient bien superflues. La loi du home rule
protégeait mieux d’Éon que «les quatre paires 97 de pistolets, les
deux fusils et les huit sabres de son arsenal», et lord Halifax, qu’il
avait fait interroger sur le sort qui lui était réservé, avait répondu:
«Qu’il se tienne tranquille; dites-lui que sa conduite est exécrable,
mais que sa personne est inviolable[74].»
Sûr dès lors de n’être plus inquiété, d’Éon se refusa obstinément à
venir à composition, et M. de Guerchy, n’ayant plus aucun moyen de
contraindre un homme qui «mettait en poche les lettres de rappel de son
ministre et refusait de rendre les papiers ministériels», se décida à
dresser acte de ce refus. Il se rendit lui-même chez d’Éon vers la fin
de décembre, et la rédaction de ce procès-verbal donna lieu à une scène
où l’exaltation du pauvre chevalier ne connut plus de bornes. Arpentant
la pièce, il gesticulait en protestant «qu’il se ferait plutôt tuer
que de rendre les documents du roi et qu’il faudrait les venir
prendre au bout de son fusil[75]». D’Éon signa cet acte, qui devait
donner à Versailles la preuve formelle de son extravagance. Louis XV
d’ailleurs ne s’intéressait plus à d’Éon; il redoutait ses incartades
et regrettait amèrement «le choix d’un tel agent». Il ne songea plus
qu’à le tenir éloigné sans paraître l’abandonner entièrement, et si
d’Éon obtint dans la suite de nouvelles grâces, il les dut bien plus à
la crainte qu’il inspirait qu’à l’estime que ses anciens 98 services
lui avait méritée. Le roi écrivit en effet à Tercier le 30 décembre:
«M. d’Éon n’est pas fol, je le pense bien; mais orgueilleux et fort
extraordinaire. Je crois qu’il faut laisser écouler assez de temps, le
soutenir de quelque argent et qu’il reste là où il est en sûreté et
surtout qu’il ne se fasse pas de nouvelles affaires[76].»
Épuisé par toutes ces persécutions auxquelles son orgueil l’avait
exposé, blâmé hautement à Paris et à Versailles, d’Éon voyait ses
amis eux-mêmes l’abandonner. La petite ville bourguignonne, d’où
l’on n’avait cessé de le suivre à travers le monde et de lui prédire
les plus brillantes destinées, lui envoyait maintenant l’écho de sa
réprobation. Ses parents doutaient de son bon sens et sa vieille mère
songeait à venir elle-même à Londres pour implorer sa soumission
aux ordres du roi. Mais d’Éon, sans rien perdre de sa triomphante
assurance, lui écrivait à la fin de cette dramatique année:
J’ai reçu, ma chère mère, toutes les lettres lamentables et
pitoyables que vous avez pris la peine de m’écrire; pourquoi
pleurez-vous, femme de peu de foi? comme il est dit dans l’Écriture.
Qu’y a-t-il de commun entre vos affaires tonnerroises et mes affaires
politiques à Londres? Plantez donc vos choux tranquillement,
faites arracher les herbes de votre jardin, mangez les fruits de
votre potager, buvez le lait de vos vaches et le vin de vos vignes
et laissez-moi tranquille avec vos sots discours de Paris et de
Versailles et vos pleurs qui me désolent sans 99 me consoler. Mais
je n’ai pas besoin de consolation, puisque je ne suis nullement
triste et que mon cœur joue du violon et même de la basse de
viole, ainsi que je vous l’ai déjà écrit, attendu que je fais mon
devoir et que mes adversaires, qui se disent de grands seigneurs, des
vicomtes de Marmion, ne font pas le leur; qu’ils veulent tout faire,
tout conduire par caprice, par intérêt particulier et nullement en
vue de la justice générale et du plus grand bien pour le roi et la
patrie. Qu’ils fassent donc comme ils voudront, je ferai comme je
l’entendrai, et je l’entendrai bien. Je ne crains ni de loin ni de
près les foudres de ces petits Jupiters: voilà tout ce que je puis
vous dire; restez tranquille comme je le suis, et si vous venez à
Londres me voir, j’en serai charmé parce que je vous garderai avec
les dépêches de la cour et les comptes du comte de Guerchy, vicomte
de Marmion, qu’il n’aura qu’à bonne enseigne, étendards déployés,
mèche allumée, balle en bouche et tambours battants. Il n’aura pas
même les enveloppes des lettres, je vous le jure sur mes grands
dieux, à moins qu’il ne m’apporte un ordre du roi, mon maître et le
sien, en bonne forme, ce qu’il n’a pu faire jusqu’à présent.
... Je finis en vous disant que si vous voulez faire pour le mieux,
vous resterez tranquille dans votre charmante solitude à la porte
de Tonnerre et vous ne retournerez à Paris que d’autant que la Cour
vous payera vos courses mieux qu’à moi, et songez que soit que les
hommes ou les femmes vous louent ou vous blâment, vous n’en êtes
ni meilleure ni plus mauvaise. La gloire des bons est dans leur
conscience et non dans la bouche des hommes.
Embrassez pour moi tous les parents et amis et surtout la comtesse
de Candale et toute sa maison que j’aimerai plus que Tonnerre tout
ensemble si l’esprit de cabale qui règne de tout temps dans cette
petite ville se fait sentir à mon égard. Un beau jour, j’irai
baptiser leur vin pétulant. Mais c’est en vain qu’on prêcherait cette
morale à ses habitants. Ils ressembleront toujours aux pierres à 100
fusil qui se trouvent dans leurs vignes, qui plus on les bat, plus
elles font feu. Je vous embrasse bien tendrement; attendez l’avenir,
vous devez savoir que je ne suis pas embarrassé de mon existence;
laissez passer la petite tempête: le vent impétueux qu’il fait n’est
qu’une pétarade, et si vous continuez à pleurer, je serai obligé de
vous envoyer des mouchoirs de la Compagnie des Indes anglaises. Je me
porte si bien que je compte enterrer tous mes ennemis morts ou vifs.
Adieu[77].
101
CHAPITRE V
Lutte acharnée du chevalier d’Éon contre le comte de Guerchy; guerre
de libelles; publications à Londres des Lettres, Mémoires et
Négociations.—Louis XV envoie à d’Éon des émissaires; arrestation
d’Hugonnet à Calais; le secret exposé à être découvert.—Procès
intenté par d’Éon au comte de Guerchy; condamnation de l’ambassadeur
de France par le jury anglais.—Le roi accorde une pension au
chevalier d’Éon, qui se décide à rester en Angleterre.
L’orage dont d’Éon semblait faire si peu de cas était loin cependant de
se calmer et «le petit Jupiter» qui en détenait les foudres, furieux de
son insuccès, n’avait pas encore désarmé. Il s’était d’abord attaqué
aux partisans de son adversaire et venait d’obtenir du ministre un
ordre qui rappelait en France M. d’Éon de Mouloize, en le privant
arbitrairement de son titre de lieutenant de cavalerie. Puis, ayant
épuisé toutes les ressources de la pression officielle, il avait essayé
d’une tactique plus détournée: il s’était lancé avec ardeur dans une
guerre de libelles à laquelle l’incident qui s’était passé chez lord
Halifax avait donné naissance. Les feuilles anglaises avaient en
effet, dès le lendemain de cette soirée, donné un discret commentaire
de la querelle. Elles n’étaient pas favorables à l’ambassadeur, qui
avait pu se rendre compte qu’il n’avait pas les rieurs de son côté. Il
avait voulu 102 publier son récit de l’incident et en avait confié
la rédaction à un écrivain nommé Goudard, étrangement maladroit dans
un métier qui le faisait vivre. En échange de quelques guinées, le
sieur Goudard remit à M. de Guerchy un petit libelle d’une forme
assez innocente, mais où les faits étaient relatés sous un jour si
favorable à l’ambassadeur que d’Éon se trouvait naturellement convié
à répliquer[78]. Guerchy savait par expérience combien d’Éon avait la
répartie facile; il espérait que son adversaire ne saurait pas résister
à un tel plaisir et par là s’exposerait de lui-même aux rigueurs de la
loi anglaise, si stricte en matière de libelles.
Cependant, soit qu’il ne se jugeât pas offensé, soit qu’il se doutât
du piège, d’Éon se tint coi et l’attente de l’ambassadeur fut encore
une fois déçue. A ce moment, le sieur de Vergy vint proposer à Guerchy
de mettre à son service, moyennant une légère rémunération, une plume
moins bénigne. Il pouvait, lui aussi, se considérer comme offensé par
le libelle, et ce prétexte était suffisant pour envenimer les choses.
Il publia donc une petite brochure qui prenait directement à partie
le chevalier[79]. D’Éon se crut cette fois obligé de répondre, mais
il le fit en termes assez modérés pour terminer le débat. Ce n’était
pas le compte de l’ambassadeur, que le sentiment de sa 103 dignité ne
retenait nullement et qui voulait avoir le dernier mot. Il s’obstina,
n’épargnant aucune maladresse, et lança une «contre-note», véritable
pathos, lourd et sot réquisitoire contre d’Éon[80]. Cette publication
eut l’effet singulier d’exciter la verve de personnes étrangères à la
querelle. Des libelles anonymes rédigés en anglais se répandirent dans
le public; on fit circuler des opuscules manuscrits, les uns prenant
fait et cause pour d’Éon, d’autres faisant l’apologie de l’ambassadeur.
Vergy; le sieur Lescalier, ancien scribe de l’ambassade; le chevalier
Fielding, juge de paix de Londres, se jetèrent dans la mêlée. Une femme
même, nommée Bac de Saint-Amand, signa quelques feuillets qui furent
jugés si comiques que l’on s’en arracha une seconde édition[81].
D’Éon, pendant les trois mois qui virent éclore plus de vingt
productions différentes, s’était à peu près contenu; mais sa patience
en même temps que ses ressources s’épuisaient de jour en jour.
Abandonné par le roi et sans argent, il avait écrit au duc de Choiseul
pour lui demander, puisque, disait-il, «il ne pouvait obtenir justice
des procédés de M. de Guerchy», la permission de passer avec deux
de ses cousins au service de l’Angleterre. En même temps, et en
termes plus humbles 104 et plus affectueux, mais où les allusions
comminatoires étaient plus clairement exposées, il sollicitait une
dernière fois l’appui du duc de Nivernais[82].
Ces lettres restèrent sans réponse aussi bien que celles qu’il faisait
parvenir en même temps au duc de Broglie et à M. Tercier. Poussé autant
par le besoin que par le désir de vengeance, d’Éon se décida alors à
user contre M. de Guerchy de ses dernières armes. Il publia le 22 mars
1764 un volume fort gros et fort impertinent pour son ambassadeur et
aussi pour les ministres. C’était, sur le ton d’une raillerie parfois
assez fine, mais toujours agressive, un violent exposé de tous ses
démêlés avec M. de Guerchy. D’Éon reproduisait, en outre, les lettres
qu’il avait osé écrire à son ambassadeur et celles qu’il avait reçues
de lui, lettres intimes où, dans un style lourd et confus, s’étalaient
toute la mesquine parcimonie de M. de Guerchy et son embarras à ses
débuts dans la diplomatie. Enfin, dans une troisième partie, d’Éon
donnait des extraits de la correspondance échangée entre le duc de
Praslin et le duc de Nivernais, correspondance que ce dernier lui avait
communiquée et où les deux amis s’exprimaient en toute confiance et
liberté sur le peu de capacité de M. de Guerchy[83].
105
Ces révélations si humiliantes et si pénibles pour M. de Guerchy
produisirent une vive émotion à Londres. Quinze cents exemplaires de
l’ouvrage furent enlevés en quelques jours. Mais tout ce beau scandale
n’eut aucunement le résultat espéré. D’Éon perdit seulement beaucoup
des sympathies que sa bonne humeur et son esprit lui avaient attirées
autrefois et que toutes ses incartades n’avaient pas encore lassées.
Walpole écrivant alors au comte Hertford, ambassadeur d’Angleterre
à Paris, traduit fidèlement l’opinion anglaise, qui blâmait d’Éon,
sévèrement mais non sans regrets:
«D’Éon vient de publier le plus scandaleux in-quarto, accusant
outrageusement M. de Guerchy et très offensant pour MM. de Praslin
et de Nivernais. En vérité je crois qu’il aura trouvé le moyen de
les rendre tous les trois irréconciliables... Le duc de Praslin doit
être enragé de l’étourderie du duc de Nivernais et de sa partialité
pour d’Éon et en viendra sûrement à haïr Guerchy. D’Éon, d’après
l’idée qu’il donne de lui-même, est aussi coupable que possible, fou
d’orgueil, insolent, injurieux, malhonnête; enfin un vrai composé
d’abominations, cependant trop bien traité d’abord, ensuite trop mal
par sa Cour; il est 106 plein de malice et de talent pour mettre sa
malice en jeu... Le conseil se réunit aujourd’hui pour délibérer sur ce
qu’on peut faire à ce sujet. Bien des gens pensent qu’il n’est possible
de rien faire. Lord Mansfield croit qu’on peut faire quelque chose;
mais il a un peu de promptitude à prendre en pareil cas l’opinion la
plus sévère. Je serais bien aise pourtant que la loi permît la sévérité
dans le cas présent[84].»
Le conseil du roi approuva les intentions de lord Mansfield. Si
l’ouvrage n’était pas à proprement parler un véritable libelle, il
contenait des insinuations injurieuses qui permettaient l’application
du bill. D’ailleurs le corps diplomatique entier s’était joint à M.
de Guerchy pour demander qu’on ouvrît une information, et l’attorney
général intenta au nom du roi contre d’Éon un procès en libelle qui fut
plaidé quelques mois plus tard.
L’impression avait été très grande à Londres; elle fut encore bien plus
vive à Paris, et l’auteur du scandale y fut encore plus sévèrement
jugé, ainsi que le relate, à la date du 14 avril, un contemporain qui
notait au jour le jour les nouvelles politiques ou littéraires:
«Le livre de M. d’Éon de Beaumont fait une sensation très vive ici:
on y voit des lettres attribuées à MM. de Praslin, de Nivernais, de
Guerchy, avec des notes de l’infidèle rédacteur. Elles ne donnent
pas une idée avantageuse du génie, de l’esprit et de la politique de
ceux qui les ont écrites. Cet écrit est 107 précédé d’une préface
dans laquelle M. d’Éon expose les motifs qui le forcent à publier ces
lettres. L’indignité de son procédé, les disparates de sa conduite et
de son style dans ses récits dénotent un méchant homme et un fou[85].»
Il ajoute le 26 avril: «... Le procès a été commencé contre M. d’Éon,
dont il est tant question aujourd’hui comme auteur du libelle le plus
scandaleux et des calomnies les plus atroces[86].»
Le recueil que l’opinion publique taxait aussi sévèrement et justement
devait soulever à Versailles non pas seulement de l’indignation, mais
aussi des craintes très vives. En effet, l’on pouvait tout redouter
d’un homme dont l’esprit était égaré à ce point. D’Éon s’était contenté
pour cette fois de ne parler que de ses propres affaires; mais rien
n’assurait qu’il se montrerait aussi réservé dans l’avenir et qu’il ne
révélerait pas les secrètes et délicates négociations auxquelles il
avait été mêlé, lors de la conclusion des derniers traités.
Le duc de Praslin décida que le livre serait mis au pilon; mais pendant
qu’il donnait cet ordre il s’occupait de négocier avec l’auteur. Le roi
l’y encourageait, car il partageait personnellement les craintes de son
ministre. Il venait, en effet, de prendre connaissance de deux lettres
adressées par d’Éon à 108 M. Tercier, qui n’avait pas voulu répondre.
Les termes n’en étaient d’ailleurs que trop clairs:
Je n’abandonnerai jamais le Roi, disait d’Éon dans l’une d’elles,
ni ma patrie le premier; mais si, par malheur, le Roi et ma patrie
jugent à propos de me sacrifier en m’abandonnant, je me disculperai
aux yeux de toute l’Europe, et rien ne sera plus facile, comme
vous devez bien le sentir. Je ne vous dissimulerai pas, monsieur,
que les ennemis de la France, croyant pouvoir profiter du cruel
de ma position, m’ont fait faire des offres pour passer à leur
service. Les avantages qu’ils peuvent m’offrir ne me touchent pas
et l’honneur seul me déterminera en cette occasion. J’ai répondu
comme je le devais... Les chefs de l’opposition m’ont offert tout
l’argent que je voudrais, pourvu que je dépose chez eux mes papiers
et mes dépêches bien fermés et cachetés, avec promesse de me les
rendre dans le même état en rapportant l’argent. Je vous ouvre mon
cœur et vous sentez combien un pareil expédient répugne à mon
caractère... Mais si je suis abandonné totalement et si d’ici au
22 avril, jour de Pâques, je ne reçois pas la promesse signée du
Roi ou de M. le comte de Broglie que tout le mal que m’a fait M. de
Guerchy va être réparé... alors, monsieur, je vous le déclare bien
formellement et bien authentiquement, toute espérance est perdue
pour moi, et en me forçant de me laver totalement dans l’esprit du
roi d’Angleterre, de son ministère et de la chambre des pairs et des
communes, il faut vous déterminer à une guerre des plus prochaines
dont je ne serai certainement que l’auteur innocent, et cette guerre
sera inévitable. Le Roi d’Angleterre y sera contraint par la force et
la nature des circonstances, par le cri de la nation et du parti de
l’opposition[87].
109
Louis XV, qui n’allait pas jusqu’à croire que d’Éon tînt dans son
portefeuille la paix ou la guerre avec l’Angleterre, ne s’émut pas plus
que de raison du péril dont on le menaçait; mais il fut plus sensible
au danger que courait son secret. M. de Praslin ne lui avait pas caché
qu’il avait le plus grand désir «de voir arriver d’Éon en France et
qu’il y fût bien enfermé». Le ministre avait même envoyé en Angleterre
des exempts qui devaient s’emparer du chevalier; mais «il leur avait
défendu de l’avoir autrement que vif». Louis XV toutefois «ne pouvait
croire que son agent fût un traître[88]». Il le jugeait plus froidement
et plus justement que ses ministres secrets. Malgré ses défauts, son
orgueil et sa folie, d’Éon était incapable d’une déloyauté. S’il avait
été amené à écrire des lettres aussi compromettantes, il ne l’avait
fait que contraint par le besoin et poussé à bout par les procédés
d’une rigueur ou d’une faiblesse également excessives employés à son
égard, et aussi par le silence obstiné que gardaient à son égard le
comte de Broglie et Tercier. Il avait cru récemment, en apprenant la
mort de Mme de Pompadour, que les ministres secrets allaient enfin
jouir officiellement du crédit qu’ils avaient auprès du monarque. Son
espoir avait été déçu: Louis XV avait continué son double jeu, et le
comte de Broglie ne s’était pas senti assez fort pour profiter de
l’occasion et s’imposer au roi. Il n’avait pas même osé solliciter en
faveur de d’Éon.
110
Abandonné de tous côtés, celui-ci avait été singulièrement flatté des
offres du parti libéral, qui assimilait son sort à celui de Wilkes,
idole du peuple et victime d’un procès en libelle. Sa popularité à
Londres s’était rapidement accrue; on acclamait son nom à la suite de
celui du tribun populaire, mais on le flattait surtout dans l’espérance
qu’il pourrait révéler quelques détails scandaleux sur la conclusion
de la dernière paix. Ce parti attendait de lui des armes redoutables
contre lord Bute, les anciens ministres et leurs successeurs, que
l’on disait payés par la France. D’Éon n’avait pas voulu répondre à
ces avances, mais il ne les avait pas repoussées; il s’en était vanté
auprès des ministres secrets, espérant obtenir par l’intimidation les
secours refusés à ses prières. Il n’avait pas tout à fait manqué son
but, puisqu’il était parvenu à inspirer au roi des craintes sérieuses,
sinon pour la paix européenne, du moins pour le secret. Louis XV, sur
la proposition du comte de Broglie, envoya en Angleterre M. de Nort,
avec la mission de calmer la colère de M. de Guerchy, mais aussi
avec l’instruction formelle de ramener d’Éon par des conseils et des
promesses, et de savoir tout au moins quelles étaient ses exigences.
D’Éon, qui avait vu maintes fois M. de Nort chez le comte de Broglie,
le reçut avec enthousiasme. Croyant cette fois que l’heure de la
réhabilitation allait sonner pour lui, il se montra d’une modération
inattendue.
A peine eut-il pris connaissance de la lettre du comte de Broglie
apportée par M. de Nort, qu’enivré 111 par les promesses et les
flatteries qui s’y trouvaient en guise d’appât, il écrivit au roi dans
son premier mouvement:
Sire,
Je suis innocent et j’ai été condamné par vos ministres; mais dès que
Votre Majesté le souhaite, je mets à ses pieds ma vie et le souvenir
de tous les outrages que M. de Guerchy m’a faits. Soyez persuadé,
Sire, que je mourrai votre fidèle sujet et que je puis mieux que
jamais servir Votre Majesté pour son grand projet secret, qu’il ne
faut jamais perdre de vue, Sire, si vous voulez que votre règne soit
l’époque de la grandeur de la France, de l’abaissement et peut-être
de la destruction totale de l’Angleterre, qui est la seule puissance
véritablement toujours ennemie et toujours redoutable à votre royaume.
Je suis, Sire, de Votre Majesté, le fidèle sujet à la vie et à la
mort.
D’Éon[89].
En écrivant ce billet, d’Éon n’avait écouté que sa première
inspiration; il reconnut de suite qu’il s’était trop hâté. Il n’avait
voulu voir dans la lettre du comte de Broglie qu’une amorce pour des
négociations plus étendues. Son erreur avait été complète, car si M.
de Nort était disposé à laisser venir d’Éon, il devait s’en tenir aux
termes de la lettre, qui promettait au chevalier une somme d’argent
à déterminer et l’assurance que le roi s’occuperait de son avenir.
On ne parlait point de lui rendre son grade, ni de lui donner aucune
satisfaction contre M. de Guerchy.
112
Il y avait quelque maladresse à infliger à d’Éon cette nouvelle et
plus cruelle déception. C’était l’irriter inutilement et en même temps
augmenter par de vains pourparlers son arrogance et son infatuation. Le
chevalier s’aperçut dès le lendemain de l’arrivée de M. de Nort qu’il
s’était fait de grandes illusions; aussi, dans un accès de colère,
il renvoya au messager la lettre du comte de Broglie en ajoutant que
«puisque l’on n’agissait pas de bonne foi avec lui», il préférait
rester «comme le bouc de la Fable au fond du puits où les ordres du
roi ainsi que ceux de M. de Broglie et les haines particulières des
guerchiens l’avaient jeté[90]». M. de Nort ne se découragea pas et fit
tous ses efforts pour lui faire entendre raison; mais d’Éon se montra
intraitable et les lettres pressantes de M. Tercier n’eurent pas un
meilleur effet. Sentant seulement qu’il avait été trop loin en ne se
ménageant aucune porte de sortie pour l’avenir, d’Éon déclara à M. de
Nort que l’on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il livrât
les seules armes qu’il pouvait opposer aux poursuites judiciaires de
M. de Guerchy. Que l’ambassadeur se désistât de son instance, et les
négociations en seraient aussitôt simplifiées. Devant cette fin de
non-recevoir passablement ironique, M. de Nort jugea qu’il n’avait plus
rien à faire à Londres. Il n’avait pas mieux réussi d’ailleurs auprès
de M. de Guerchy.
Le moment était mal choisi en effet pour parler de 113 modération à
l’ambassadeur. Celui-ci ne s’était jamais vu aussi près du but, aussi
sûr de tenir sous peu le chevalier à merci. L’humiliation retentissante
qu’il venait de subir avait d’ailleurs grandement augmenté son
irritation. Il attendait l’issue du procès en libelle, comptant sur la
loi anglaise pour condamner enfin son ennemi et tenant prêts déjà pour
se saisir de celui-ci quelques sbires soigneusement choisis, que lui
avait envoyés, sur sa demande, le duc de Praslin. «Un voilier monté de
vingt-un hommes armés se trouvait mouillé à Sgravesend», et l’on avait
«détaché un petit bateau de six rameurs qui stationnait entre le pont
de Westminster et celui de Londres» et qui devait recevoir le chevalier
aussitôt qu’on se serait emparé de sa personne. Les admirateurs que
d’Éon avait trouvés dans les bas-fonds de Londres, parmi les ouvriers
du port, appelés les mobs, étaient venus lui faire incontinent ce
rapport, ce qui permit encore une fois à l’insaisissable chevalier
de se soustraire aux poursuites de son ambassadeur, prématurément
triomphant. D’Éon écrivit au lord chief justice, comte Mansfield, à
milord Bute et à M. Pitt des lettres qu’il fit imprimer et que les
journaux publièrent; il y racontait les complots qui se tramaient
autour de lui[91], en appelait à l’opinion anglaise et demandait aux
ministres responsables de pourvoir à sa sécurité.
114
M. Pitt seul lui répondit en quelques lignes: «Vu l’extrême délicatesse
des circonstances, vous pourrez trouver bon que je me borne à plaindre
une situation sur laquelle il ne m’est pas possible d’offrir des avis
que vous me témoignez désirer d’une manière très flatteuse[92]».
L’agitation entretenue par d’Éon autour de sa personne, dans un pays
où la liberté individuelle était si fortement sauvegardée, suffit à le
mettre à l’abri des tentatives de M. de Guerchy. L’été approchait; il
partit pour Staunton Harold, propriété de son ami le comte Ferrers,
tandis que l’ambassadeur prenait un congé et regagnait la France.
L’automne ramena M. de Guerchy à Londres, où allait se dérouler le
procès en libelle intenté contre d’Éon. Le cabinet anglais avait
presque donné à l’ambassadeur l’assurance qu’il obtiendrait un verdict
affirmatif et pourrait mettre la main sur d’Éon et ses papiers.
Cependant d’Éon, dont on pouvait tout attendre, sauf une reculade,
ne parut pas à l’audience. Son avocat demanda un sursis, alléguant
qu’il n’avait pas été accordé à la défense un temps suffisant pour
réunir les témoignages qu’elle comptait fournir; les juges, refusant
tout délai, passèrent outre. La sentence fut telle qu’on l’espérait:
d’Éon était condamné; mais lorsqu’on se présenta chez lui pour lui
notifier le jugement, on trouva l’appartement vide; notre chevalier
avait pris les devants. Ne 115 pouvant douter que l’issue du procès
lui fût défavorable, il avait gagné la Cité et s’était retiré dans un
garni en compagnie de son cousin de Mouloize. Il se croyait si bien
en sûreté et se cachait si peu qu’il faillit être arrêté de suite par
«deux messagers d’État qui vinrent avec un warrant et nombre de soldats
armés en la maison de Mme Eldoves, où l’on supposait que le sieur d’Éon
s’était réfugié». «Les agents, raconte d’Éon lui-même, cassèrent les
portes, armoires, valises, armoires, pour me chercher et ne trouvèrent
que mon cousin d’Éon de Mouloize, qui était tranquillement à se
chauffer auprès du feu avec Mme Eldoves et une autre dame. Cette autre
dame était celle qu’on appelle communément le chevalier d’Éon[93].»
Les ministres anglais, talonnés par Guerchy et furieux de la maladresse
des agents de la police autant que de la mollesse de leur chef,
s’impatientaient; lord Halifax, «violemment fâché que d’Éon fût encore
en liberté», s’étonnait que le solicitor général fût absent à ce moment
critique; il l’invitait à revenir en hâte, afin que cette affaire
n’essuyât plus aucun retard et que l’on s’emparât du coupable, par tous
les moyens légaux, pour l’amener à subir la sentence de la cour[94].
Toutes ces mesures furent vaines; 116 d’Éon, rendu plus prudent par
l’alerte qu’il venait de subir, s’était définitivement terré. Il avait
«mis ses espions en campagne», ne sortant «qu’avec les sûretés qu’un
capitaine de dragons doit prendre en temps de guerre[95]», et dans sa
réclusion travaillait à une «ample et magnifique défense» contre la
cabale de la Cour. C’était le couronnement de toutes ses folies qu’il
préparait, le bouquet du feu d’artifice dont il avait étourdi son
ambassadeur. Sa «magnifique défense» allait causer à Londres et à Paris
un scandale inouï, unique dans les annales de la diplomatie. Ayant
dédaigné de répondre à une assignation devant un simple tribunal du
ban royal, il allait assigner l’ambassadeur de France, pour tentative
d’empoisonnement et d’assassinat, devant le grand jury d’Old Bailey.
D’Éon reprenait, en effet, toutes ses anciennes accusations. Il avait
découvert un précieux témoin et recueilli de nouvelles preuves. A son
instigation, le sieur Treyssac de Vergy rentrait en scène. Emprisonné
pour dettes et abandonné par l’ambassadeur qu’il avait servi de sa
plume, mais dont il n’avait pu obtenir aucun secours, Vergy s’était
retourné tout repentant vers d’Éon; il lui avait promis d’appuyer de
son témoignage les plus graves révélations. Il certifia de nouveau
qu’il était venu en Angleterre sur les ordres des ministres, qui lui
avaient donné à entendre qu’ils désiraient «déshonorer d’Éon, mais
117 qu’il fallait une main étrangère et habile[96]». A peine arrivé à
Londres, M. de Guerchy avait suscité les événements qui, grâce à d’Éon,
avaient eu une si grande publicité. Vergy se disait prêt à signer
ses déclarations, et, pour plus de sûreté, à les résumer dans son
testament; il les renouvela d’ailleurs au moment de sa mort, en 1774,
comme le prouvent les papiers du chevalier[97].
En dépit de tout ce qu’il avait de suspect, un pareil témoignage était
fort compromettant aux yeux des jurés anglais. Guerchy ne voulait
pas s’en convaincre et se refusait à croire qu’on pût ajouter foi à
tous ces racontars qui «faisaient frémir d’horreur». Plus stupéfait
qu’ému, il trouvait seulement que «d’Éon avait mis le comble à sa
scélératesse[98]». Celui-ci exultait bruyamment; toutefois, pour ne
pas rompre avec le ministère secret, il s’efforçait d’intéresser le
comte de Broglie à son sort et de rendre leurs intérêts communs; en lui
communiquant une longue déposition de Treyssac de Vergy, il écrivait:
«Enfin, monsieur, voilà donc le complot horrible découvert; je puis
à présent dire à M. de Guerchy ce que le prince de Conti disait
au maréchal de Luxembourg avant la bataille de Steinkerque: 118
«Sangarède, ce jour-là est un grand jour pour vous, mon cousin. Si
vous vous tirez de là, je vous tiens habile homme...» Le roi ne
peut à présent s’empêcher de voir la vérité; elle est mise au grand
jour... J’ai instruit le duc d’York et ses frères de la vérité et
des noirceurs du complot contre vous, le maréchal de Broglie et moi.
Ceux-ci instruisent le roi, la reine et la princesse de Galles. Déjà
M. de Guerchy, qui a été revu de très mauvais œil à son retour,
est dans la dernière confusion malgré son audace, et je sais que le
roi d’Angleterre est disposé à rendre justice à M. le maréchal et à
moi. Agissez de votre côté, monsieur le comte, et ne m’abandonnez pas
ainsi que vous paraissez le faire. Je me défendrai jusqu’à la dernière
goutte de mon sang et par mon courage je servirai votre maison malgré
vous, car vous m’abandonnez, vous ne m’envoyez point d’argent, tandis
que je me bats pour vous. Ne m’abandonnez point, monsieur le comte,
et ne me réduisez pas au désespoir. J’ai dépensé plus de douze cents
livres sterling pour ma guerre, et vous ne m’envoyez rien: cela est
abominable; je ne l’aurais jamais cru, monsieur le comte, permettez-moi
de vous le dire[99].»
Le comte de Broglie, désirant naturellement ne s’associer en rien à
une telle campagne, se garda bien d’envoyer les secours que d’Éon
sollicitait avec tant d’impudence. Depuis plusieurs mois déjà, il avait
renoncé à faire passer sous les yeux du roi les réclamations 119 de
son agent secret; mais cette fois, comprenant l’imminence du scandale
que d’Éon allait faire naître, il demanda à Louis XV la permission de
se rendre lui-même à Londres. Le roi trouva que d’Éon méritait d’être
«pilé comme le muphti[100]»; il adhéra toutefois à la proposition du
comte de Broglie et chercha un prétexte pour faire approuver cette
mission par M. de Praslin; mais un incident qui mettait son secret en
péril vint absorber son attention et le détourner de ce projet.
Un nommé Hugonnet, ancien courrier du marquis de L’Hospital, puis du
duc de Nivernais, que d’Éon avait conservé à son service, venait d’être
arrêté à Calais porteur de dépêches de Drouet, le secrétaire du comte
de Broglie. Soupçonné depuis longtemps d’être l’intermédiaire de la
correspondance secrète dont les ministres avaient eu vent, il avait
déjoué jusqu’alors les espions mis à ses trousses. Moins heureux cette
fois, il avait été appréhendé au moment même où il se présentait au
bureau de la marine pour y obtenir son passeport. «Sur l’énoncé de son
nom, rapporte d’Éon, le commissaire de la marine lui porta aussitôt
la pointe de son épée sur la poitrine en lui disant qu’il le faisait
prisonnier d’État. Deux grenadiers le conduisirent chez M. de la
Bouillie, commandant de la ville de Calais, qui s’empara du paquet de
papiers et fit conduire le dit sieur Hugonnet au secret de la prison;
on le fit déshabiller, on y décousit 120 ses vêtements jusqu’au talon
de ses bottes. Sept jours après il arriva un exempt de la police de
Paris qui fit mettre les fers aux pieds et aux mains d’Hugonnet et une
chaîne au milieu du corps. Attaché au siège d’une chaise de poste, il
fut conduit à la Bastille[101].»
L’arrestation d’Hugonnet amena celle de Drouet. Le duc de Praslin
crut enfin tenir la preuve de la correspondance du comte de Broglie
avec le criminel d’État qu’était d’Éon. Il se hâta d’avertir le roi
de cette découverte et de ses soupçons. Louis XV, voyant son secret
de nouveau en péril, ne songea pas à arrêter l’enquête par une simple
manifestation de sa volonté: il préféra les tristes expédients que lui
avait déjà suggérés sa faiblesse; l’attrait pervers de cette politique
souterraine lui fit imaginer une comédie dont les agents subalternes de
ses ministres devaient être à la fois les confidents et les acteurs. Il
fit appeler le lieutenant de police, M. de Sartine, et lui recommanda
«de mettre à l’écart tous les papiers qui pourraient être saisis dans
cette affaire concernant le comte de Broglie, Durand et Tercier». Et
satisfait de cette manœuvre habile, mais encore plus étrange, il
écrivait à Tercier cet aveu d’une humilité inattendue de la part d’un
monarque absolu: «Je me suis ouvert et confié au lieutenant de police
et il paraît que cela lui a plu, mais il faut attendre de sa sagesse
et de cette marque de confiance qu’il 121 fera bien; si le contraire
arrive, nous verrons ce qu’il y a à faire[102].»
Sartine s’était, au premier moment, montré flatté de la confidence
inattendue qui lui avait été faite; mais il n’avait accepté qu’en
tremblant un rôle hasardeux qui répugnait à son caractère autant qu’à
sa qualité de magistrat et l’exposait en outre au ressentiment du
duc de Praslin. Le comte de Broglie l’avait même trouvé si hésitant
que, pour le convaincre, il avait dû à deux reprises le chapitrer et
le persuader qu’il ne pouvait se soustraire à la besogne que le roi
attendait de lui. Les papiers de Drouet furent donc soigneusement triés
et on ne laissa, pour l’instruction de l’affaire, que quelques lettres
sans importance. Les pièces ainsi mises en sûreté, on pouvait encore
craindre que les inculpés ne commissent quelque imprudence de langage.
Louis XV dut s’adresser, directement et sous le sceau du secret, au
gouverneur de la Bastille, M. de Jumilhac, afin qu’il permît à M.
Tercier d’entrer dans la prison et de communiquer aux inculpés les
dépositions que le comte de Broglie «avait mis plus de quinze heures
à préparer[103]». Les rôles furent si bien appris et tous les détails
si minutieusement prévus que la comédie eut plein succès. Aucun indice
certain de correspondance compromettante ne put être relevé, et M. de
Praslin, qui assistait à l’audience, 122 dut s’incliner devant un
jugement dont il n’était point dupe. Il sortit furieux de la salle et
dit à M. de Sartine: «Je sens bien que ces gens se moquent de moi...»
Mais, devinant qu’il se heurtait à une volonté supérieure, il résolut
d’attendre de nouveaux incidents pour reprendre cette affaire.
Drouet fut relâché au bout de quelques jours; mais, afin de ne pas
éveiller les soupçons par une trop grande indulgence, on laissa
Hugonnet à la Bastille. Il y resta plus de trente mois, pendant
lesquels il perdit toutes les économies du petit commerce qui le
faisait vivre. Il se trouvait réduit à la misère en 1778 et ne dut
quelques dédommagements qu’aux démarches pressantes que d’Éon fit alors
en sa faveur auprès de M. de Sartine[104].
Cet incident, qui avait provoqué des impressions si diverses à
Versailles, avait à Londres ravivé l’espoir de vengeance que M. de
Guerchy nourrissait contre son antagoniste et le parti de Broglie.
Aussi l’annonce de ce nouvel échec fut-elle une cruelle déception qui
ranima l’irritation de l’ambassadeur.
Des propos bizarres commençaient d’ailleurs à courir sur le compte de
d’Éon, et trouvaient à l’ambassade l’appui d’une malignité toujours
en éveil. Les mœurs réservées du chevalier et l’absence de toute
intrigue féminine dans sa vie avaient depuis longtemps attiré sur lui
une ironique curiosité. Les langues les moins perfides raillaient la
faiblesse de 123 sa constitution, d’autres le soupçonnaient d’être
une femme; mais un grand nombre, épris de singularité, attribuaient au
pauvre chevalier les deux sexes à la fois. Si étrange et si grossière
que puisse paraître l’allégation, il est certain qu’elle fut émise et
rencontra, alors comme plus tard, une surprenante crédulité. D’autres
insinuations, moins ridicules mais plus redoutables, et inspirées
par les mêmes ennemis, lui attribuaient la paternité d’un libelle
injurieux, paru sous la forme d’une lettre anonyme adressée au lord
chief-justice. D’Éon avait dû protester et faire paraître une réponse
assez hautaine pour détruire de pareilles accusations; mais l’attention
publique qu’il avait si souvent éveillée s’attachait maintenant à lui
au point de mettre à son compte plusieurs des ouvrages satiriques
dont la mode commençait à sévir. On le regardait comme l’auteur d’un
«dialogue entre M. Frugalité et M. Vérité» et l’on n’avait pas eu de
peine à discerner sous ces pseudonymes l’ambassadeur et l’ex-ministre
plénipotentiaire de France. A Paris on croyait reconnaître son style
acerbe dans un ouvrage en six volumes intitulé: L’espion chinois ou
l’envoyé secret de la cour de Pékin pour examiner l’état présent de
l’Europe[105]. C’était attribuer à d’Éon beaucoup plus d’ouvrages
qu’il n’en pouvait produire. Tout occupé du procès qu’il avait intenté
à son ambassadeur, aidé de son secrétaire et de ses avocats, il avait
recueilli et souvent inspiré les «affidavit» 124 ou dépositions
écrites de ses témoins. Ce fut le 1er mars 1765 que se réunit le
grand jury de la cour d’Old Bailey, avec des attributions voisines
de celles d’une chambre des mises en accusation de nos jours. A
l’unanimité, les jurés déclarèrent la poursuite fondée et rendirent
leur sentence sous la forme de ce curieux «indictment»:
Les jurés pour notre souverain maître le roi, sous serment,
représentent que Claude-Louis-François Regnier comte de Guerchy,
dernièrement à Londres, étant une personne d’esprit et de disposition
cruels et n’ayant pas la crainte de Dieu devant ses yeux, mais étant
poussé et séduit par les instigations du diable et ayant conçu la
pire malice envers Charles-Geneviève-Louis-Auguste-Andrée-Timothée
d’Éon de Beaumont, et sans égard aux lois de ce royaume, le 31e jour
d’octobre dans la 4e année du règne de notre souverain Seigneur
George III, par la grâce de Dieu roi de Grande-Bretagne, France
et Irlande, défenseur de la foi, etc.... dans le susdit Londres,
dans la paroisse de Sainte-Marie, a méchamment, déloyalement et
malicieusement sollicité et encouragé Pierre-Henry Treyssac de
Vergy à tuer et assassiner le dit Charles-Geneviève-Louis-Auguste
Timothée d’Éon de Beaumont, au grand dommage dudit
Charles-Geneviève-Louis-Auguste-Andrée Timothée d’Éon de Beaumont, au
mépris de notre souverain Maître et de ses lois[106]...
L’émotion que causa ce verdict fut inouïe: M. de Guerchy s’attendait
à toute heure à être appréhendé; son maître d’hôtel Chazal, qui était
accusé d’avoir versé le poison, venait de s’enfuir en même temps qu’un
des secrétaires qui avait rédigé quelques-uns des 125 libelles. Les
cabinets de Londres et de Paris étaient exaspérés; Louis XV et le comte
de Broglie ne pouvaient comprendre une législation qui livrait un
ambassadeur à des tribunaux étrangers. La situation de M. de Guerchy
était d’autant plus grave que le droit anglais reposait sur une foule
de textes assez peu connus et complexes; le cas visé avait été prévu
par une loi fort ancienne que la jurisprudence, dans une matière si
rare, n’avait pas eu l’occasion de modifier. Un seul fait pouvait être
invoqué à titre de précédent: il s’était passé sous Cromwell, et avait
eu pour épilogue l’exécution capitale d’un ambassadeur de Portugal.
M. de Guerchy ne pouvait croire qu’un sort semblable l’attendît;
mais l’esprit anglais lui avait réservé déjà de telles surprises que
l’incertitude augmentait son abattement et le poussait aux démarches
les plus inconsidérées. Il était profondément humilié et son attitude
remplissait de joie d’Éon qui, tout glorieux, arrogant et plein de
menaces, donnait libre cours à son persiflage malicieux: «Dans la
position où sont les choses, écrivait-il au comte de Broglie, il faut
absolument que l’arrangement que vous m’avez fait proposer soit fini
incessamment et que vous arriviez au premier jour sans perdre de temps,
au 20 de ce mois... Ceci est la dernière lettre que j’ai l’honneur de
vous écrire au sujet de l’empoisonneur et du scélérat Guerchy, qui
serait rompu vif en France s’il y avait de la justice. Mais, grâce
à Dieu, il ne sera que pendu en Angleterre... Je vous donne 126 ma
parole que sous peu le Guerchy sera arrêté au sortir de la Cour et
conduit dans la prison des criminels à la Cité de Londres; son ami
Praslin viendra l’en tirer s’il le peut; vraisemblablement l’ami qui
l’en tirera sera le bourreau[107].»
Ces prédictions ironiques ne se réalisèrent pas. Un verdict aussi
singulier ne pouvait autoriser l’application d’une loi surannée. Le
cabinet anglais en eût redouté les conséquences, s’il n’en avait déjà
compris l’injustice et même le ridicule. Il chercha aussitôt un moyen
qui lui permît de parer aux dangers de son inflexible législation et le
trouva dans les arcanes même de son droit. Par un writ d’assertiorari
le procès fut évoqué en appel au banc du roi. Ce nouveau tribunal
déclara le jugement en suspens, et, sans trancher la question pour le
fond, délivra, en faveur de l’ambassadeur, une ordonnance de noli
prosequi.
L’affaire était définitivement enterrée. Le comte de Guerchy dut
se trouver satisfait de ce piètre expédient qu’il avait sollicité
instamment, et qui ne le lavait point aux yeux du public de la honte de
ce scandaleux débat. L’estime des ministres et des gens clairvoyants
lui restait, et il dut s’en contenter, car l’opinion anglaise lui était
en général opposée. On critiqua fort l’intervention du roi dans une
matière purement judiciaire; lord Chesterfield, écrivant à son fils
Philippe Stanhope, en contestait lui-même 127 la légalité[108]. Ce fut
dans le peuple une explosion de mécontentement qui faillit mettre en
danger la personne même de l’ambassadeur. La populace ne ménagea point
ses huées à Guerchy. Un jour même on arrêta son carrosse; il dut cacher
sa croix du Saint-Esprit et déclarer qu’il n’était pas l’ambassadeur,
mais son secrétaire seulement. La foule menaçante ne l’en poursuivit
pas moins jusqu’à son hôtel; les valets de l’ambassade fermèrent
précipitamment la grille, ce qui donna le temps à la force publique
d’arriver et de mettre fin à un incident qui eût pu avoir les plus
graves conséquences.
La situation devenait intolérable à Londres pour M. de Guerchy. Il prit
un congé et passa de longs mois en France; puis il fit de nouveau, en
1766, un court séjour en Angleterre, où il ne devait plus revenir. M.
Durand fut nommé ministre de France par intérim. C’était un des plus
fidèles agents du secret, qui avait déjà représenté le roi en Pologne.
D’Éon n’avait pas attendu l’arrivée à Londres de ce nouvel envoyé,
qu’il connaissait de longue date, pour tenter de renouer, par des
prières et des menaces, ses négociations avec M. de Broglie. Celui-ci,
se montrant toujours indulgent et jugeant le moment opportun, consentit
à reprendre les pourparlers. Le chevalier ne fit plus de difficulté
pour remettre au nouveau ministre plénipotentiaire les brevets royaux
de sa mission (mais ceux-là seulement); il les présenta, 128 dit le
procès-verbal qui fut dressé alors, «en bon état, couverts d’un double
parchemin à l’adresse de Sa Majesté, renfermés et mastiqués dans une
brique cousue à cet effet, prise dans les fondements des murailles de
la cave».
En échange de ces papiers, Louis XV, vivement supplié par M. de Broglie
et Tercier, redoutant surtout les indiscrétions et les incartades de
d’Éon, lui accorda une grâce qu’il daigna lui annoncer de sa main même:
En récompense des services que le sieur d’Éon m’a rendus tant en
Russie que dans mes armées et d’autres commissions que je lui ai
données, je veux bien lui assurer un traitement annuel de 12,000
livres, que je lui ferai payer exactement tous les trois mois en
quelque pays qu’il soit, sauf en temps de guerre chez mes ennemis
et ce jusqu’à ce que je juge à propos de lui donner quelque poste
dont les appointements seraient plus considérables que le présent
traitement.
Louis[109].
Un témoignage aussi flatteur, qui marquait le pardon, sinon l’oubli,
de tant de menées scandaleuses, aurait dû ramener le calme dans un
esprit moins exaspéré. Mis à l’abri, par une pension de ministre
plénipotentiaire, du dénuement complet au milieu duquel il s’était
débattu pendant trois longues années, tout autre que d’Éon eût saisi
l’occasion qui se présentait une seconde fois à lui de se faire
oublier, pour reprendre dans la suite une carrière en vérité très 129
compromise, mais à laquelle ses talents reconnus pouvaient encore
ouvrir quelques perspectives. Il n’en fut rien; sa destinée l’avait
poussé aux aventures et dès lors les aventures l’attiraient.
M. de Guerchy rentré en France venait de mourir[110]. Sa santé,
ébranlée, disait-on, par les tracas de son ambassade, n’avait pu se
remettre de l’affront qui l’avait terminée; du ridicule, sinon du
déshonneur, que lui avait infligé sa condamnation et il n’avait pas
tardé à succomber. La haine de d’Éon contre ce nom qui lui avait été si
fatal ne fut point désarmée cependant par la mort d’un adversaire que
sa plume ne cessa de poursuivre. Il comprit en tout cas l’indignation
que cet événement (dont on ne manquerait pas de le rendre responsable)
allait de nouveau raviver contre lui, et devina l’hostilité qu’il
rencontrerait à la Cour s’il se hasardait à rentrer en France.
Le ressentiment des ministres qu’il avait si librement raillés et
bravés; la colère de la famille de Guerchy, alors toute puissante, lui
parurent de suffisants motifs pour renoncer à tout projet de retour.
L’Angleterre, où le jugement qui l’avait mis hors la loi venait d’être
paralysé par le procès qu’il avait gagné contre son ambassadeur, lui
offrait un asile plein de sécurité et lui assurait une liberté qu’il
ne pouvait espérer nulle part aussi grande. Il se résigna donc à y
demeurer, bien décidé à améliorer, 130 par tous les moyens possibles,
une situation qu’il estimait bien injustement diminuée, et à entretenir
autour de lui un bruit auquel il s’était accoutumé et qui lui était
devenu indispensable.
131
CHAPITRE VI
D’Éon continue à être l’agent secret du roi en Angleterre; sa
correspondance avec le comte de Broglie.—Il offre ses services au
nouveau roi de Pologne, Stanislas Poniatowski; Louis XV s’oppose
à son projet.—Popularité de d’Éon à Londres; les paris sur son
sexe.—Il s’enfuit et parcourt l’Angleterre sous un faux nom.—Le
chevalier d’Éon se détermine à se faire passer pour femme.
En exigeant la restitution du brevet qui donnait mission à d’Éon
d’étudier le projet d’une descente en Angleterre, Louis XV n’avait
point songé à se priver des services que son agent secret pouvait
encore lui rendre comme informateur. Il savait que d’Éon connaissait
admirablement le pays où il vivait, qu’il était bien accueilli dans
les classes élevées de la société anglaise, en même temps qu’il
jouissait dans les plus humbles d’une réelle popularité et par cela
même d’une précieuse influence. Le roi avait tenu seulement à rentrer
en possession d’une pièce revêtue de sa propre signature et qui,
entre les mains d’un aventurier, devenait dangereuse, sinon pour la
politique de la France, tout au moins pour la sécurité du secret. Mais,
dans sa précipitation à s’assurer le silence du chevalier, il avait
négligé d’exiger de lui la remise d’autres pièces qui l’engageaient
moins personnellement. C’étaient le plan de cette même 132 mission
rédigé par le comte de Broglie et toute la correspondance relative
à ce sujet, sans parler de dépêches originales et de copies que le
transfuge avait conservées de son passage à l’ambassade. D’Éon s’était
bien gardé de se dessaisir de ces précieux dossiers qui pouvaient lui
permettre encore de peser sur un gouvernement dont il avait reçu plus
de promesses que de salaires. Ses craintes s’étant un peu apaisées,
en même temps que son ressentiment s’était trouvé satisfait par la
mort du comte de Guerchy, il se remit à la correspondance secrète.
D’ailleurs le comte de Broglie, dans ses lettres, ne lui ménageait
point les encouragements. Il tâchait aussi de lui faire comprendre
toute l’étendue des dernières faveurs royales, et lui conseillait pour
l’avenir «de se conduire avec modestie et sagesse, d’abandonner le
romanesque, pour prendre l’attitude et les propos d’un homme tranquille
et sensé. Avec cela et un peu de temps, disait-il, on se ressouviendra
de vos talents... Quand on a le cœur droit et l’âme courageuse, mais
point féroce ni violente, on peut espérer de l’emporter sur la haine et
sur l’envie de tout l’univers[111]».
Dans une autre lettre, écrite un peu plus tard et où l’on devine
les inquiétudes personnelles que lui inspiraient les armes restées
aux mains de son correspondant, le comte de Broglie exhortait d’Éon
à mériter la bienveillance du nouvel ambassadeur, M. du Châtelet,
en remettant à M. Durand qui rentrait 133 en France «les papiers
ministériaux et autres de tout genre» qu’il possédait encore. Il
terminait ainsi: «Depuis la lettre que je vous ai écrite en chiffres
à la fin du mois dernier, il ne m’est rien venu de votre part; vous
ne nous avez rien appris de ce qui s’est passé dans l’intérieur de
l’Angleterre. Je me rappelle bien, et je ne l’ai pas laissé ignorer
à Sa Majesté, que vous l’attribuez à l’éloignement de votre ami, M.
Cotes, de la capitale, mais votre dextérité devait y suppléer[112].»
Le reproche même prouve combien le comte de Broglie prisait les
renseignements fournis par son correspondant. Dépouillé de tout titre
officiel, d’Éon n’était pas moins demeuré l’agent d’informations sans
cesse sollicité et souvent écouté par les conseillers secrets du roi.
Esprit cultivé et doué d’une curiosité toujours en éveil, il avait, au
cours des négociations diplomatiques, acquis l’expérience des affaires.
Excessif dans ses ressentiments personnels, avantageux et inconsidéré
pour tout ce qui le concernait, il savait en politique apprécier avec
discernement, retenir avec précision et souvent prévoir sans erreur.
Son imagination abondante, bien que dépourvue de goût, donnait aux
faits un tour pittoresque et original. Les portraits qu’il traçait,
avec une légère tendance à la caricature, étaient cependant fidèles.
«En réalité, dit le duc de Broglie, d’Éon fut le précurseur, sinon le
fondateur, de ce métier de reporter politique 134 qui fait si grande
figure aujourd’hui à la porte de tous les parlements de l’Europe[113].»
Il se complaisait à cette tâche et y excellait.
Si d’Éon évita de suivre les conseils intéressés que lui donnait le
comte de Broglie au sujet des «papiers ministériaux», il se montra
sensible aux reproches que sa négligence lui avait attirés. C’est ainsi
que, durant plus de sept ans, nous le voyons rédiger des rapports
qu’il intitule «lettres politiques» et qu’il fait parvenir au ministre
secret, à l’aide d’un chiffre sous sa propre signature, ou en clair
sous le nom de William Wolf. Il y traite à la fois de guerre et de
finances; fournit des aperçus sur l’administration intérieure, sur les
aspirations des colonies; relate avec soin les débats du parlement,
les querelles des partis et ne néglige pas les petits incidents de
cour, les intrigues du corps diplomatique. Dans une de ces lettres,
prise entre tant d’autres, où il s’étend longuement sur la question
des warrants qui passionnait alors l’opinion anglaise, il raconte la
chronique amoureuse des princes.—Le duc d’York, surpris par un mari
jaloux, venait de recevoir un coup d’épée à l’épaule; son frère le duc
de Glocester, sur le point de contracter un mariage secret, allait
être envoyé à l’étranger. Le duc de Brunswick délaissait sa femme,
depuis qu’il avait découvert qu’elle était atteinte «du mal royal
d’Angleterre» et «avait un cautère sur la jambe».
Dans cette même lettre, et à la suite de ces nouvelles 135 piquantes
(qui toutefois ne sont pas toujours négligeables en politique), d’Éon
effleure un point du plus haut intérêt: ce sont les ouvertures que lord
Bute, l’ancien ministre, lui aurait faites en vue d’une restauration
éventuelle des Stuarts; lui-même ajoutait, il est vrai, qu’à son avis
«les hommes et les choses n’étaient pas encore mûrs[114]». Le comte
de Broglie s’empressa de lui répondre qu’il devait donner suite à ces
propositions, sans toutefois s’engager; mais ce projet, si souvent
envisagé par la France, fut dans la suite encore une fois abandonné. La
même année d’Éon annonça au cabinet de Versailles et à l’ambassadeur
d’Espagne, le prince de Masseran, «les desseins que l’Angleterre avait
formés d’envahir, à la prochaine guerre, le Mexique et le Pérou,
d’après les plans du marquis d’Aubarède, qui recevait une pension
de l’Angleterre[115]». Le champ de ses informations ne se bornait
pas du reste à l’Angleterre; les relations qu’il avait conservées en
Russie lui permettent, en 1769, d’informer le roi de l’expédition que
l’impératrice projetait alors contre les Turcs et qui eut lieu, en
effet, huit mois plus tard.
Dans une affaire qui, à la même époque, eut à Londres un grand
retentissement, d’Éon dut jouer un rôle plus actif dont il se tira
fort adroitement et qui lui valut les félicitations des deux Cours et
de toute la société anglaise. A ce moment, en effet, 136 l’opposition
libérale, qui sous l’impulsion de Wilkes avait grandi de jour en jour,
tenta un dernier effort pour renverser le cabinet. Le Dr Musgrave,
un des leaders du parti, venait de faire paraître un virulent libelle
intitulé: Address to the gentlemen, clergy and freeholders of the
country of Devon. Il y renouvelait les insinuations contre lesquelles
d’Éon avait déjà protesté dans les journaux dès 1764 et qui laissaient
croire que la princesse de Galles, lord Bute, le duc de Richemond,
lord Égremont et lord Halifax avaient reçu de l’argent de la France
au moment de la conclusion des traités. Dans cet opuscule le Dr
Musgrave se disait à même de fournir sur ces faits de nouvelles
preuves et de nouveaux témoignages, qu’il avait recueillis dans un
récent séjour à Paris. Il assurait que les offres vénales avaient
été faites par l’intermédiaire du chevalier d’Éon qui devait encore
se trouver possesseur des documents relatifs à cette affaire. Enfin,
s’attaquant directement à lord Halifax, il lui reprochait de s’être
refusé dans un intérêt personnel à ouvrir une enquête publique sur les
papiers de d’Éon et à mettre en cause le chevalier. Il invitait ce
lord à justifier ses actes devant le parlement. Le secrétaire d’État
n’hésita pas à relever le défi du Dr Musgrave et, dans un éloquent
discours, repoussa victorieusement ses accusations. Le parlement les
déclara «sans fondement» et décerna un blâme à l’orateur qui les avait
formulées. D’Éon avait d’ailleurs contribué de tout son pouvoir au
succès de lord Halifax, protestant, avant le débat, contre ce 137
libelle par «des dépositions et des publications». Il avait dès le
principe adressé au Dr Musgrave la lettre suivante qui fut reproduite
par les périodiques de l’époque:
Monsieur, vous me permettrez de croire que je ne suis pas plus connu
de vous que je n’ai l’honneur de vous connaître, et si dans votre
lettre du 12 août vous n’aviez pas fait un mauvais usage de mon
nom, je ne me trouverais pas obligé d’entrer en correspondance avec
vous. Vous prétendez que pendant l’été de 1764 des ouvertures ont
été faites en mon nom à plusieurs membres du parlement. Je me serais
dit prêt à convaincre trois personnes, dont deux pairs et membres du
Conseil privé, d’avoir vendu la paix aux Français, et vous semblez y
trouver la preuve évidente de l’accusation que vous portez vous-même
contre lord Halifax. Je déclare donc ici que je n’ai jamais fait
ni fait faire de semblables ouvertures, soit dans l’hiver ou dans
l’été de 1764, ou à quelque autre époque... Je vous somme donc de
dévoiler au public le nom de l’audacieuse personne qui a fait usage
du mien pour découvrir ses propres et odieuses propositions... Je
vous certifie ici, sur ma parole d’honneur et à la face du public,
que je ne puis vous être d’aucune sorte d’utilité, que je ne suis
jamais entré en aucune négociation pour la vente de papiers et ni
moi-même, ni aucun agent autorisé par moi n’a offert de révéler que
la paix avait été vendue à la France. Si lord Halifax m’avait fait
citer, il aurait su par mes réponses quelles étaient mes pensées; que
l’Angleterre a plutôt payé la France, que la France l’Angleterre,
pour conclure la dernière paix et que le bonheur que j’ai eu de
concourir au travail de la paix m’a inspiré les sentiments de la
plus juste vénération pour les commissaires anglais qui y ont été
employés... Dans le but de vous rendre aussi prudent que patriote, je
signe cette lettre et y joins mon adresse afin que, pour le maintien
de votre bonne foi, vous puissiez me fournir les 138 moyens de
confondre publiquement ces calomniateurs qui ont osé se servir de mon
nom d’une manière encore plus contraire aux faits qu’à la dignité de
mon caractère[116].
Cette réponse fut accueillie avec une égale satisfaction par les deux
gouvernements qui, n’ayant pas d’intérêt à voir jeter sur ces faits une
lumière trop éclatante, ne manquèrent pas de joindre leurs éloges à
ceux que l’opinion avait déjà décernés au chevalier.
Cependant, s’il n’avait point eu de relations avec le docteur Musgrave,
d’Éon avait su s’attacher un autre tribun populaire, le célèbre Wilkes.
Il avait même, un moment, proposé au cabinet de Versailles d’aider
le grand agitateur dans une conjuration contre la maison de Hanovre.
Le comte de Broglie s’était presque laissé convaincre; mais le roi
avait refusé de se lancer dans cette folle équipée. On avait dépêché à
Londres Drouet, le secrétaire du comte de Broglie, pour arrêter cette
entreprise. D’Éon malgré tout n’avait point rompu avec Wilkes; il
songeait même à l’employer d’une autre manière et écrivait au comte de
Broglie:
Voulez-vous avoir une sédition à la rentrée du Parlement, aux
élections prochaines? Il faudra tant pour Wilkes, tant pour les
autres... Wilkes nous coûte très cher, mais les Anglais ont le Corse
Paoli qu’ils ont accueilli chez eux et qu’ils nourrissent aussi à
notre intention. C’est une bombe qu’ils gardent toute chargée 139
pour la jeter au milieu de nous au premier incendie. Gardons bombe
pour bombe[117].
Toutes ces intrigues témoignent de l’ingénieuse activité que d’Éon ne
cessait de déployer à propos de tout. Il était toujours à l’affût,
toujours prêt à partir sur la première piste que l’occasion lui offrait
ou même que son imagination lui fournissait. Si cuisantes qu’aient
été les blessures de son amour-propre, si mortifiants que lui aient
paru les déboires de son ambition, d’Éon ne se résigna pas à devenir
inutile, à être oublié. Grisé par un trop rapide succès, il a contracté
une maladie plus rare à cette époque qu’elle ne l’est aujourd’hui, la
maladie de la réclame. Il faut qu’on s’occupe de lui, fût-ce pour le
blâmer, et à l’obscurité d’un honnête serviteur du roi il préfère la
mauvaise réputation de l’aventurier. Il croit d’ailleurs qu’en rendant
au roi, fût-ce même sans en avoir reçu mandat, de nouveaux services,
il augmentera ses droits au paiement d’une pension qui lui est bien
irrégulièrement servie. La cassette royale était souvent vide, comme
le révèlent la plupart des lettres secrètes. Le pauvre chevalier se
trouvait donc à court d’argent; il implorait le duc de Choiseul,
renouvelait ses plaintes auprès du duc d’Aiguillon, qui venait, avec la
protection de Mme du Barry, de remplacer le duc de Praslin au ministère
des Affaires étrangères; il suppliait le comte de Broglie: «Je me
meurs de faim, écrivait-il à ce dernier, entre 140 les deux pensions
que vous m’avez données, comme l’âne de Buridan entre les picotins
placés à ses côtés, mais que sa bouche ne peut atteindre[118].» Il se
désespérait et bien qu’ayant toujours refusé les offres du cabinet
anglais qui lui proposait une situation égale, mais plus exactement
rémunérée, s’il voulait solliciter des lettres de naturalisation, il
eût quitté volontiers le service de la France, pourvu que ce fût au
profit d’une nation amie.
Il songeait en effet sérieusement à passer en Pologne, où les
seigneurs venaient de se choisir pour roi Stanislas Poniatowski, le
favori de Catherine II. D’Éon, pendant son séjour en Russie, avait
mis tous ses soins à s’attirer la faveur d’un prince très brillant et
particulièrement cher à l’impératrice, et il y avait réussi pleinement.
Aussi s’empressa-t-il, lors de l’élection de Stanislas, d’offrir au
nouveau roi ses respectueuses félicitations, et de lui exprimer le
bonheur qu’il éprouverait à passer à son service. Stanislas lui ayant
répondu avec bienveillance et l’ayant même invité à le rejoindre à
Varsovie dès qu’il le pourrait[119], d’Éon lui écrivit aussitôt une
lettre pleine d’effusion et de reconnaissance, dont il conserva la
copie et où lui-même se met complaisamment en valeur, afin sans doute
d’obtenir un engagement plus avantageux:
141
Sire, écrivait-il, quand je n’aurais pas eu le bonheur de vous être
attaché par les sentiments dès ma jeunesse, il faudrait que je sois
insensible pour n’être pas touché de la réponse dont Votre Majesté a
daigné m’honorer le 26 février dernier. Mon cœur en est si pénétré
que, s’il suivait ses premières impulsions, je partirais sur-le-champ
pour jouir du précieux avantage de vous faire ma cour en Pologne;
mais le devoir m’oblige de vous en demander auparavant la permission.
J’ai eu cent fois l’envie de passer il y a plusieurs années en
Pologne pour offrir à Votre Majesté mes services tant dans le
militaire que dans la politique; mes malheurs m’ont toujours retenu
dans la crainte que Votre Majesté ne regardât mon offre comme
intéressée et provenant uniquement de la nécessité d’une position.
Je prendrais la liberté de Lui exposer naturellement que de ma
fortune passée il me reste à Londres quinze mille livres tournois de
rente et une bibliothèque de trois mille volumes, composée en grande
partie de livres rares et de manuscrits anciens et modernes. Avec
cela je vis tranquille, en philosophe exilé au sein de la liberté,
et avec un petit nombre de seigneurs anglais qui ont de l’amitié
pour moi; mais votre dernier malheur et bonheur et vos bontés
particulières me font souvenir, Sire, que n’ayant que quarante ans
et une bonne santé; que possédant encore mon courage, mon épée et
quelque expérience à la guerre et dans la politique, je pourrais,
en tant qu’il serait en mon pouvoir, servir et venger la cause d’un
roi qui me connaît personnellement et un roi dont la bonté fait la
gloire, qui aime la vérité comme Socrate et les hommes comme Titus.
Si mes faibles talents peuvent être agréables à Votre Majesté, au
premier ordre qu’Elle daignera me donner, je volerai avec tous les
débris de ma petite fortune pour les sacrifier au service de Votre
Majesté.
Recevez, Sire, etc...
P.S.—Depuis mon retour de la terre de mylord Ferrers 142 mon
premier empressement a été de faire ma cour à Son Altesse le jeune
prince Poniatowski, qui a parfaitement réussi à Londres. Il m’a fait
l’honneur d’accepter un dîner philosophique chez moi avec M. de Lind,
son digne mentor, et de me promettre de faire parvenir sûrement cette
lettre à Votre Majesté. Si Elle daigne me faire faire une réponse, je
La supplie de ne la point faire passer par la France, mais de me la
faire parvenir par le canal de Son Altesse le Prince votre neveu ou
de votre envoyé à Londres[120].
D’Éon, toujours obsédé du souvenir de sa scandaleuse querelle,
n’omettait point de joindre à sa lettre un exemplaire des «ouvrages
qu’il avait, disait-il, été forcé de publier dans sa malheureuse et
vieille guerre civile contre le défunt ambassadeur de France, M. de
Guerchy[121]».
Les papiers de d’Éon ne permettent pas de croire qu’il reçut une
réponse à cette lettre, ou s’il en obtint une, ce fut de vive voix et
par l’intermédiaire d’un chambellan du roi de Pologne qui se trouvait
à Londres[122]. En tout cas, d’Éon dut certainement hésiter à donner
suite à ce séduisant projet, car M. de Broglie, auquel il avait demandé
l’autorisation de passer au service de la Pologne, lui répondit que
«le vœu du roi» était qu’il ne quittât point Londres, 143 sans les
ordres de Sa Majesté, qu’«il n’y avait point de lieu où il se trouvât
plus en sûreté contre la malice de ses ennemis et où il pût servir plus
utilement le roi». Il lui conseillait d’entretenir une correspondance
avec le roi de Pologne, le comblait de compliments et lui marquait,
en terminant, que Sa Majesté était sûre «de son attachement et de sa
fidélité[123]». Si d’Éon, en faisant au ministre secret la confidence
de son projet, n’avait eu pour but que de faire monter le prix de son
travail et de sonder les dispositions du roi à son égard, il put se
rendre compte que les services qu’il s’était employé à rendre dans
un exil volontaire n’avaient point suffi à effacer dans l’esprit du
souverain le mauvais souvenir de ses incartades. Plus sévère pour
lui-même, il ne se fût point étonné d’une rigueur méritée; mais
d’Éon se jugea toute sa vie avec une indulgence particulièrement
complaisante. Il se croyait sincèrement une victime de la politique et
se trouvait de nombreux points de ressemblance avec les héros antiques,
avec cet infortuné Caton, auquel un illustre docteur en théologie
d’Oxford n’avait pas craint de le comparer autrefois dans ce pompeux
quatrain:
Exul ades, nimium felix! tu victima veri
Causa boni, patriæ facta, d’Eone, tua est!
Curia quondam habuit Romana Catonem,
Majorem sed habet jam Gallicana suum[124].
144
La lettre du comte de Broglie dut le confirmer dans son orgueilleuse
conviction; mais il en fut en même temps fort dépité, étant trop avisé
pour prendre le change à ces belles assurances et ne point voir qu’on
exigeait de lui qu’il se fît oublier. C’était la peine la plus cruelle
que l’on pût lui infliger. Aussi sa destinée fut désormais tracée;
par une pente fatale elle devait le pousser de plus en plus avant sur
le chemin des aventures. Il va devenir le prisonnier d’une popularité
qu’il a mis jadis tant de soins à rechercher; l’attention de ses
contemporains, si complaisamment provoquée, s’attachera maintenant
à lui jusqu’à l’importuner et le mettra en scène dans une situation
aussi singulière qu’humiliante. Il ne tardera pas d’ailleurs à prendre
allègrement son parti des inconvénients d’une telle célébrité, et en
s’abandonnant aux aventures les plus bouffonnes, en multipliant les
équivoques, il se fera en marge de l’histoire une place énigmatique et,
encore aujourd’hui, bien gardée.
Au cours de ses démêlés avec son ambassadeur, d’Éon n’avait pas eu
scrupule à employer invectives sur invectives; mais il avait dû en
retour s’exposer aux plus blessantes ripostes. On était allé jusqu’à
lancer contre lui une bizarre insinuation qui n’était point restée
inaperçue et qui, habilement exploitée et colportée, avait fini par
intriguer un peuple à l’affût d’excentricités. Un des libellistes à
la solde du comte de Guerchy avait élevé des doutes sur le sexe du
chevalier, dont «l’uniforme de dragon, disait-il, devait 145 cacher
une femme ou un hermaphrodite». L’extérieur frêle de d’Éon, sa taille
petite et élancée, les traits délicats de son visage presque imberbe
prêtaient à l’illusion. On ne connaissait dans sa vie aucune de ces
intrigues dont on n’avait point coutume alors de faire mystère.
D’Éon, qui, dans le feu de la polémique, n’avait probablement attaché
aucune importance à cette singulière injure, n’y avait pas répondu.
Elle devait du reste lui être moins qu’à tout autre sensible, car il
avait l’habitude de parler ouvertement «de la froideur singulière de
sa nature», prenant en bonne part les railleries que ne lui avaient
épargnées ni le marquis de L’Hospital ni le duc de Nivernais[125]. A
Londres, son entourage s’était souvent étonné d’une telle contradiction
en un si exubérant personnage. On avait remarqué, rapporte un
contemporain, que d’Éon auquel, dans les châteaux où il fréquentait,
on avait «souvent proposé des mariages avec les personnes les mieux
apparentées et dotées, s’était toujours refusé à toute entrevue et
avait quitté immédiatement la place; exode rapide que l’on attribuait à
la réalité de son sexe féminin[126]».
L’ambassadeur de France lui-même, qui était alors M. du Châtelet,
s’était «persuadé que d’Éon 146 était une fille» et n’avait pas
tardé à informer le roi de la rumeur publique qui avait commencé à
se répandre lors de l’arrivée à Londres de la princesse Daschkow.
Celle-ci, nièce du grand chancelier de Russie Woronzow, qui avait si
puissamment aidé l’impératrice Catherine II à se défaire de son royal
époux et à monter sur le trône, se trouvait exilée par l’ordre même
de sa souveraine. Elle s’était réfugiée en Angleterre et n’avait pas
manqué de raconter à la Cour et dans les salons qu’elle connaissait de
longue date le chevalier, dont les excentricités défrayaient toutes les
conversations. Par elle on apprit que jadis d’Éon se serait introduit
au palais impérial de Saint-Pétersbourg sous des habits de femme et
que, dupe du déguisement, l’impératrice Élisabeth aurait admis le
jeune officier de dragons dans le cercle de ses filles d’honneur. La
princesse colporta même les plaisanteries que cette aventure aurait
values à d’Éon de la part de son chef, le marquis de L’Hospital, et de
tous ceux qui avaient été informés de cette singulière intrigue. Ces
récits, qui fixèrent la conviction des plus crédules et piquèrent la
curiosité des sceptiques, firent du sexe du chevalier d’Éon l’énigme à
la mode. Ils provoquèrent toute une série de ces paris qui faisaient
alors fureur à Londres et auxquels le moindre événement servait de
matière. Des polices d’assurances furent contractées au Brook’s et au
White’s Clubs. Les cafés affichèrent la cote et des bordereaux qui nous
ont été conservés montrent que les 147 enjeux s’élevaient couramment à
des milliers de guinées[127].
La nouvelle ainsi exploitée ne tarda pas à franchir le détroit; elle
causa à Paris un étonnement non moins vif et fut mise à l’ordre du
jour dans les salons comme dans les milieux officiels. Le chroniqueur
littéraire et politique de l’époque, Bachaumont, relate à la date du
25 septembre 1771: «Les bruits accrédités depuis plusieurs mois que le
sieur d’Éon, ce fougueux personnage si célèbre par ses écarts, n’est
qu’une fille revêtue d’habits d’homme; la confiance qu’on a prise en
Angleterre à cette rumeur, au point que les paris pour et contre se
montent aujourd’hui à plus de cent mille livres sterling, ont réveillé
à Paris l’attention sur cet homme singulier[128]...» Ce témoignage,
qu’il est aisé de vérifier par les journaux de l’époque, n’exagère en
rien l’intérêt avec lequel le public français continuait à suivre d’Éon
dans ses aventures. Il serait difficile d’ajouter foi aujourd’hui à de
pareilles extravagances si les portraits du héros et les caricatures
les plus variées qui parurent alors ne nous étaient parvenus et si
l’on ne retrouvait les traces de cette curiosité dans les périodiques
et les recueils des diverses capitales. Journalistes, dessinateurs,
chansonniers, petits poètes exerçaient à l’envi leur verve à son
profit. C’est ainsi qu’entre tant d’autres pièces fugitives on retrouve
dans l’Almanach des Muses de 1771 ces 148 quelques vers d’une
crédulité flatteuse et d’une bienveillante ironie:
A MADEMOISELLE ***
QUI S’ÉTAIT DÉGUISÉE EN HOMME
Bonjour, fripon de chevalier,
Qui savez si bien l’art de plaire
Que par un bonheur singulier
De nos beautés la plus sévère,
En faveur d’un tel écolier,
Déposant son ton minaudier
Et sa sagesse grimacière,
Pourrait peut-être s’oublier,
Ou plutôt moins se contrefaire.
Mon cher, nous le savons trop bien,
(Le ciel en tout est bon et sage),
Pour un si hardi personnage
Dans le fond vous ne valez rien.
Croyez-moi: reprenez un rôle
Que vous jouez plus sûrement.
Que votre sexe se console,
Du mien vous faites le tourment
Et le vôtre, sur ma parole,
Vous doit son plus bel ornement.
Hélas, malheureux que nous sommes!
Vous avez tout pour nous charmer;
C’est bien être au-dessus des hommes
Que de savoir s’en faire aimer!
D’Arnaud.
Ce regain d’actualité n’était point pour déplaire au vaniteux
chevalier, que la mort de son antagoniste avait réduit à un calme
relatif. Il n’hésita pas à braver le ridicule, ayant d’ailleurs donné
assez de preuves de virilité, l’épée, le sabre ou la plume à la main.
Il se plut à laisser dire. Les femmes se montraient particulièrement
intriguées et presque désireuses 149 de compter parmi elles le
bouillant chevalier. Aussi la curiosité les poussait-elles à lui
demander directement le mot de l’énigme, comme le fit avec une
audacieuse ingénuité la fille du tribun Wilkes:
Mlle Wilkes, écrivait-elle, présente ses respects à M. le chevalier
d’Éon et voudrait bien ardemment savoir s’il est véritablement une
femme, comme chacun l’assure, ou bien un homme. M. le chevalier
serait bien aimable d’apprendre la vérité à Mlle Wilkes, qui l’en
prie de tout son cœur. Il sera plus aimable encore de venir dîner
avec elle et son papa aujourd’hui ou demain, enfin le plus tôt qu’il
pourra[129].
Si une curiosité aussi naïvement exprimée n’avait rien que de
charmant. L’intérêt, beaucoup plus positif que l’équivoque, éveillé
dans le monde des parieurs, se manifestait avec plus de hardiesse et
d’impatience; il était aussi plus difficile à dérouter et d’Éon ne
tarda pas à connaître de nouveau les inconvénients de la célébrité.
Non seulement les gazettes relataient journellement les paris, mais
on commença à faire paraître sur le chevalier les estampes satiriques
les plus burlesques. Le désir de pousser d’Éon à bout augmentait
chaque jour l’insolence des parieurs, qui allèrent jusqu’à prétendre
que le chevalier profitait des spéculations engagées à son sujet.
Cette dernière insinuation décida d’Éon à rompre le silence qu’il
avait gardé jusqu’alors et à protester énergiquement. Il se rendit le
20 mars à la 150 Bourse et dans les différents cafés voisins et là,
en uniforme, la canne levée, se fit «demander pardon par le banquier
Bird, qui le premier avait levé une assurance aussi impertinente».
Bird, malgré ses excuses, assura que, suivant un acte du Parlement, il
avait aussi bien que les autres banquiers le droit de faire les paris
les plus extraordinaires, même sur la famille royale, excepté sur la
vie du roi, de la reine et de leurs enfants. D’Éon, qui rapporte cet
incident dans une lettre au comte de Broglie, ajoute: «J’ai défié le
plus incrédule et le plus insolent de toute l’assemblée (qui allait à
plusieurs milliers de personnes) de combattre contre moi avec telle
arme qu’il voudrait; mais pas un seul de ces adversaires mâles de
cette grande ville n’a osé parier contre ma canne, ni combattre contre
moi, quoique je sois resté depuis midi jusqu’à deux heures à leur
assemblée[130].» Cette sortie pleine de crânerie n’eut pas tout l’effet
que d’Éon en attendait; ses adversaires, intimidés et redoutant une
lame aussi renommée, ne relevèrent pas le défi, mais leur curiosité
demeura aussi vive et si entreprenante que notre chevalier dut, à
quelques jours de là, donner une preuve plus manifeste «d’un sexe qu’il
imprima d’une façon très mâle sur la face de deux impertinents[131].»
Sans cesse en butte à de semblables insolences et prévenu qu’un groupe
de 151 gros parieurs était décidé à s’emparer par ruse ou par force
de sa personne, d’Éon comprit que, pour éviter une telle humiliation
et un si éclatant ridicule, il ne lui suffisait pas de se cacher dans
Londres, comme il avait pu le faire autrefois, ou même de s’enfermer
pendant quelque temps dans sa maison de Brewer-Street. Il se résolut à
suivre les conseils de son puissant ami le comte Ferrers et à accepter
l’hospitalité de ce lord dans sa terre de Staunton Harold. De là il
comptait se rendre en Irlande, où il passerait plusieurs mois, et n’en
reviendrait qu’au moment où l’effervescence se serait calmée. Il partit
donc sans prendre congé d’aucun de ses amis et informa seulement le
comte de Broglie de sa fuite. Dans cette lettre, il protestait avec
énergie contre les bruits qui l’accusaient d’être intéressé à ces
assurances et, découragé, terminait par cet aveu, évidemment sincère,
et qui explique bien les actes de cette vie aventureuse: «Je suis assez
mortifié, disait-il, d’être encore tel que la nature m’a fait et que le
calme de mon tempérament naturel ne m’ayant jamais porté aux plaisirs,
cela a donné lieu à l’innocence de mes amis d’imaginer tant en France
qu’en Russie et en Angleterre que j’étais du genre féminin et la malice
de mes ennemis a fortifié le tout.[132]»
D’Éon parcourut, sous un faux nom, le nord de l’Angleterre, séjourna
quelques semaines en Écosse et se disposait à gagner l’Irlande
lorsqu’il apprit par 152 les gazettes des nouvelles qui le firent
renoncer à ses projets. Ses amis, inquiets de sa disparition et
redoutant qu’il n’eût été victime d’un attentat de la part des joueurs,
le faisaient rechercher à Londres et publiaient son signalement. Ses
créanciers, non moins anxieux, venaient de requérir l’apposition des
scellés sur la porte de son logement; enfin on l’accusait ouvertement
de participer aux paris. Craignant pour ses papiers le zèle indiscret
des uns et des autres, d’Éon se hâta de regagner Londres. Il se rendit
dès son arrivée chez le lord-maire et lui remit une déposition sous
serment qui affirmait qu’il n’était «pas intéressé pour un shilling,
directement ni indirectement, dans les polices d’assurances», que l’on
faisait sur son sexe. Le Public Advertiser publia le soir même cet
affidavit, et d’Éon, soucieux de se disculper d’une telle allégation
aux yeux de son chef, lui envoyait un extrait du journal, non sans
l’accompagner de nouvelles protestations. Désespéré de son impuissance,
il lui écrivait: «Ce n’est pas ma faute si la fureur des paris de
toutes sortes d’objets est une maladie nationale parmi les Anglais.
Je leur ai prouvé et prouverai tant qu’ils voudront que je suis non
seulement un homme, mais un capitaine de dragons, et les armes à la
main[133].»
Il est curieux de voir d’Éon revendiquer à cette date, avec une telle
énergie (car c’est la dernière fois qu’il le fit sans ambiguïté), son
véritable sexe. Dès 153 ce moment d’Éon commence à concevoir l’idée
de l’audacieuse comédie qu’il ne se décidera à jouer que beaucoup plus
tard et dont ses contemporains eux-mêmes lui auront fourni le thème.
Sa résolution de se transformer en femme fut prise entre le mois de
juillet 1771 et le mois d’avril 1772. S’il se garda encore pendant plus
d’une année de faire à ses protecteurs l’aveu de son sexe supposé,
s’il hésita encore à rendre officielle sa métamorphose, il se montra
moins réservé vis-à-vis d’un ami qui en prévint le ministre secret,
et par celui-ci le roi. D’Éon fit ses premières confidences à Drouet,
le secrétaire du comte de Broglie, qui se trouvait alors de passage
à Londres. Celui-ci n’ayant pas manqué de le plaisanter au sujet du
sexe que déjà on lui attribuait également à Paris, d’Éon se récria
et, au grand étonnement de son interlocuteur, affirma qu’il était
véritablement une femme. Ses parents, disait-il, trompés à sa naissance
par des apparences douteuses, et désirant surtout, comme dans toute
famille noble, avoir un héritier mâle, lui avaient imposé un autre sexe
que celui qu’il avait reçu de la nature. Ses goûts et son éducation lui
avaient permis de jouer son rôle publiquement et ses talents de fournir
une belle carrière.
A l’appui de cette thèse, d’Éon déploya toute l’éloquence dont il était
capable et, devant l’incrédulité persistante de Drouet, il se livra à
une comédie déplacée qu’il devait renouveler plus tard en présence de
l’aventurier Morande; il sut trouver des preuves capables de convaincre
entièrement le secrétaire 154 du comte de Broglie. Celui-ci, dès son
retour, rapporta cette révélation inattendue à son maître, qui écrivit
en mai 1772 au roi:
Je ne dois pas, à ce sujet, oublier d’instruire Votre Majesté
que les soupçons qui ont été élevés sur le sexe de ce personnage
extraordinaire sont très fondés. Le sieur Drouet, à qui j’avais
recommandé de faire de son mieux pour les vérifier, m’a assuré
à son retour qu’il y était en effet parvenu et qu’il pouvait me
certifier... que le sieur d’Éon était une fille et n’était qu’une
fille, qu’il en avait tous les attributs... il a prié le sieur Drouet
de lui garder le secret, observant avec raison que, si cela était
découvert, son rôle serait entièrement fini... Puis-je supplier Votre
Majesté de vouloir bien permettre que sa confiance dans son ami ne
soit pas trahie et qu’il n’ait pas à le regretter[134]?
Il est difficile de croire que cette lettre ait pu suffire à persuader
un monarque aussi fin et qui avait jugé dès longtemps d’Éon à sa
mesure exacte; comme Voltaire, Louis XV ne dut voir dans tout cela
qu’une ridicule mascarade dont la première nouvelle l’avait quelques
mois auparavant laissé sceptique, et l’étonnement même qu’il en avait
témoigné alors dément l’assertion qui ferait du souverain le complice
secret du chevalier. C’est la thèse que Casanova n’a pas craint de
soutenir dans ses Mémoires:
Le roi seul savait et avait toujours su que d’Éon était une femme
et toute la querelle que ce faux chevalier eut avec le bureau des
Affaires étrangères fut une comédie 155 que le roi laissa aller
jusqu’à sa fin pour s’en divertir... Personne ne possédait mieux que
lui la grande vertu royale qu’on nomme dissimulation. Gardien fidèle
d’un secret, il était enchanté quand il se croyait sûr que personne
que lui ne le savait[135].
156
CHAPITRE VII
Services secrets rendus par d’Éon au roi de France et à Mme du Barry:
affaire de Morande; négociations de Beaumarchais.—«Les Loisirs du
chevalier d’Éon».—Le roi se désintéresse du secret, qui est surpris
par les ministres: Favier et Dumouriez en prison; le comte de Broglie
en exil.—Mort de Louis XV.—Louis XVI liquide le bureau secret; le
comte de Broglie fait valoir les services du chevalier et lui obtient
une pension.—Nouvelles prétentions de d’Éon.
Louis XV, et sa correspondance le prouve, ignora le secret du
sexe véritable de son ancien agent secret ou plus probablement se
désintéressa du problème. Quant à d’Éon, il n’en était qu’à la genèse
de son projet de transformation. Il commençait seulement à comprendre
que sa carrière était finie, qu’il ne pouvait espérer d’asile en France
qu’à Tonnerre et plus vraisemblablement à la Bastille. Il n’avait
plus grand’chose à perdre avec sa qualité d’homme et envisageait
sérieusement les avantages qu’il tirerait d’un sexe que le public
lui attribuait avec tant d’obstination. Le bruit, la popularité, la
célébrité et de nouvelles ressources pécuniaires étaient l’enjeu d’une
partie hasardée, mais où le gain valait largement le risque aux yeux de
d’Éon qui se décida à en courir la chance dès que l’occasion opportune
se présenterait.
Cependant il n’avait point encore jugé bon de révéler 157 directement
sa métamorphose au comte de Broglie. Celui-ci feignit de l’ignorer
et continua comme par le passé à mettre à contribution ses services;
un cas pressant et particulièrement délicat nécessitant alors son
concours. On venait en effet de répandre dans l’entourage de Mme du
Barry le bruit qu’un ouvrage fort irrévérencieux pour elle, et où la
personne royale elle-même n’était pas épargnée, allait être publié à
Londres pour être colporté de là sur le continent[136].
L’auteur de ce pamphlet était un certain Théveneau de Morande qui,
ayant eu maille à partir avec les tribunaux du roi, était allé
chercher en Angleterre le refuge que tous les gens de son espèce y
trouvaient alors. Déclassé intelligent, intrigant de la pire espèce,
il tenait à Londres commerce ouvert de scandale et d’injures. Dans une
petite feuille de chantage qu’il rédigeait lui-même, il distillait la
calomnie la plus perfide à l’égard des ministres et des gens de Cour,
n’omettait aucune des anecdotes scabreuses qui circulaient à Versailles
et y joignait même «des notices sur quantité de filles d’Opéra, ce
qui—conclut Bachaumont—formait une rapsodie très informe et fort
méchante[137]».
Cette brochure, dans le goût du Colporteur de Paris, s’intitulait le
Gazetier cuirassé. Elle était ornée à la première page d’une estampe
qui «représentait le gazetier vêtu en hussard, un petit bonnet pointu
sur 158 la tête, le visage animé d’un rire sardonique et dirigeant
de droite et de gauche les canons, les bombes et toute l’artillerie
dont il est environné[138]». Ce gagne-pain malhonnête ne suffisait
pas cependant à Morande qui, non content de rançonner directement
les personnages qu’il voulait diffamer, publiait de plus volumineux
ouvrages d’aussi mauvais aloi[139].
Fort bien et promptement renseigné par des correspondants besogneux
qu’il entretenait en France, il informait ses relations de Londres des
dernières nouvelles de Versailles: «Mme du Barry, écrivait-il dans
l’un de ses bulletins, a donné des bals à la haute noblesse pendant le
carnaval et des gardes du corps ont été placés dans toutes les avenues,
tout de même que si c’eût été chez Mme la Dauphine; les jeunes princes
ni les princesses n’y ont paru. M. le duc de Chartres et le comte de
La Marche y parurent un moment avec le roi. Mimi ouvrait le bal avec
M. le prince de Chimay, Mme du B... a eu un grand crève-cœur d’y
voir si peu de monde. On me pend à Paris, on me brûle, on m’élève
des autels; enfin on est aussi pressé d’acheter mon livre que je le
suis de le vendre[140].» En effet, M. des Cars s’occupait activement
159 d’étouffer dans l’œuf ce scandale et il avait déterminé le
comte de Broglie à écrire à d’Éon pour le charger de négocier avec le
diffamateur. La réponse de d’Éon ne se fit pas attendre:
Monsieur,
Vous ne pouviez guère vous adresser ici à personne plus en état
de seconder et même terminer au gré de vos désirs l’affaire dont
vous me parlez, parce que M. Morande est de mon pays, qu’il se fait
gloire d’avoir été lié avec une partie de ma famille en Bourgogne;
et dès son arrivée à Londres, il y a trois ans, son premier soin fut
de m’écrire qu’il était mon compatriote, qu’il désirait me voir et
se lier avec moi. Je refusai pendant deux ans sa connaissance, et
pour cause; depuis, il a si souvent frappé à ma porte que je l’ai
laissé entrer chez moi de temps en temps pour ne point me mettre à
dos un jeune homme dont l’esprit est des plus violents et des plus
impétueux... Il a épousé la fille de son hôtesse, qui faisait et
défaisait son lit avec lui (il en a deux enfants et vit bien avec
elle). C’est un homme qui met à composition plusieurs personnes
riches de Paris par la crainte de sa plume. Il a composé le libelle
le plus sanglant qui se puisse lire contre le comte de Lauraguais,
avec lequel il s’est pris de querelle. A ce sujet le roi d’Angleterre
(si souvent attaqué lui-même dans les journaux) demandait au comte de
Lauraguais comment il se trouvait de la liberté anglaise: «Je n’ai
pas à m’en plaindre, Sire, elle me traite en roi!»
Je ne suis pas instruit que de Morande travaille à l’histoire
scandaleuse de la famille du Barry; mais j’en ai de violents
soupçons. Si l’ouvrage est réellement entrepris, personne n’est plus
en état que moi de négocier sa remise avec le sieur de Morande; il
aime beaucoup sa femme et je me charge de faire de celle-ci tout ce
que je voudrai. Je pourrais même lui faire enlever le manuscrit, mais
cela pourrait faire tapage entre eux; je serais compromis et il 160
en résulterait un autre tapage plus terrible. Je pense que si on lui
offrait 800 guinées il serait fort content. Je sais qu’il a besoin
d’argent à présent; je ferai tous mes efforts pour négocier à une
moindre somme: Mais à vous dire vrai, monsieur, je serais charmé que
l’argent lui fût remis par une autre main que la mienne, afin que
d’un côté ou d’un autre on n’imagine pas que j’aie gagné une seule
guinée sur un pareil marché[141].
Si d’Éon méprisait cet intrigant autant qu’il le dit, il l’avait
cependant toujours ménagé et le connaissait beaucoup plus intimement
qu’il ne désirait le paraître. Morande n’avait cessé de lui offrir les
services de sa plume, soit pour le seconder «dans des travaux qu’il
préparait», soit même pour faire «avec toute la chaleur bourguignonne
la biographie de l’énigmatique chevalier[142].» D’Éon ne s’était point
montré insensible à des flatteries sans cesse renouvelées et à d’aussi
respectueuses protestations de dévouement; il avait même largement
ouvert à leur auteur la porte de son logis et délié en sa faveur les
cordons de sa bourse. Le maître chanteur, reçu à sa table et demeuré
son débiteur insolvable, lui avait dès le principe révélé ses projets
de scandale; d’Éon l’avait souvent exhorté à les abandonner et, s’il
n’y était pas parvenu, il se trouvait à même d’engager facilement des
négociations pécuniaires dans ce but. Aussi les ordres du comte de
Broglie furent-ils 161 promptement exécutés: Morande se montra de
bonne composition avec «son compatriote et compagnon d’exil», comme
il se plaisait à l’appeler. En quelques jours le marché fut conclu
et d’Éon obtint une promesse écrite et signée de la main du sieur
Morande par laquelle celui-ci s’engageait «à ne confier à âme qui vive
cette négociation». Il promettait en outre «non seulement de ne point
imprimer son ouvrage contre la maison du marquis et de Mme la comtesse
du Barry; mais au contraire à en faire entièrement le sacrifice et à
en remettre fidèlement au chevalier d’Éon toutes les minutes et copies
suivant les conditions convenues[143]».
Cette négociation avait été menée par d’Éon avec une grande rapidité et
une réelle adresse; les conditions en étaient relativement modérées;
tout laissait croire qu’on n’aurait pas à attendre longtemps la
ratification du roi et de la famille intéressée. Il en fut cependant
tout autrement, soit parce que Mme du Barry ne désirait pas employer
les services du comte de Broglie, qu’elle détestait particulièrement
et qui avait été sollicité sans son assentiment; soit plutôt peut-être
parce qu’elle pensait que sa réputation n’était guère à la merci de
ces scandaleuses révélations. Moins soucieuse de l’opinion que ses
propres courtisans, «elle semblait tranquille sur un objet qui devait
tant l’intéresser», et quand on lui soumit les conditions obtenues
par d’Éon, elle répondit assez 162 évasivement «qu’il faudrait s’en
occuper». La matière ne fut jamais «traitée plus à fond[144]». Le
roi partageait l’indifférence de la favorite en ce qui le regardait
personnellement, et jugeait avec un pareil bon sens que le mieux était
de ne point s’inquiéter de médisances qui menaçaient de se multiplier
en proportion du cas qu’en feraient les intéressés. Aussi écrivait-il
au comte de Broglie: «Ce n’est pas la première fois qu’on a dit du
mal de moi dans ce genre; ils sont les maîtres, je ne me cache pas.
L’on ne peut sûrement que répéter ce que l’on a dit sur la famille
du Barry. C’est à eux de savoir faire ce qu’ils veulent et je les
seconderai[145].» Ce billet ne nous apprend rien de nouveau sur le
caractère de Louis XV, mais il n’est pas un des témoignages les moins
frappants de l’inconscience naturelle et du manque absolu de moralité
d’un monarque par ailleurs plein de finesse et de bon sens. Quelques
jours s’étaient à peine écoulés que le comte de Broglie recevait du
roi une lettre lui enjoignant de faire cesser définitivement les
négociations entamées par d’Éon.
M. du Barry avait cru devoir enfin veiller lui-même à l’honneur de
sa maison! Il avait envoyé à Londres un émissaire choisi parmi les
aigrefins de son entourage et lui avait fait adjoindre quelques
agents de la connétablie. Cet aventurier, d’aussi mauvaise marque
163 que Morande, était en revanche moins rusé; il avait surtout vu
dans sa mission l’occasion d’un voyage agréable et bien rémunéré.
Aussitôt arrivé à Londres il s’abouche avec Morande, l’étourdit de ses
puissantes relations, de sa charge prétendue dans la maison du comte
d’Artois et du premier coup lui fait miroiter les plus brillantes
promesses. Morande éleva ses prix en proportion, rompit de suite avec
d’Éon et afficha dans Londres l’ambassadeur ainsi dépêché auprès de
lui. Mais au bout de quelques semaines le sieur de Lormoy, ayant
dissipé à mener joyeuse vie les crédits qui lui avaient été accordés et
n’ayant pu vaincre les nouvelles exigences de Morande, quitta Londres
à l’improviste, sans y avoir fait autre chose que quelques milliers de
livres de dettes que d’Éon fut chargé de régler. Morande, déçu et fort
irrité, allait se décider à publier son ouvrage, lorsque la famille
du Barry lui envoya un nouveau négociateur désigné cette fois par M.
de Sartine lui-même. C’était le pamphlétaire Caron de Beaumarchais,
qui n’était pas encore l’auteur applaudi du Mariage de Figaro, mais
seulement le bruyant et processif antagoniste du président Goëzman.
D’Éon nous a laissé de l’origine de cette mission une autre version
qui, dénuée de toute vraisemblance comme de tout bon goût, paraît ne
lui avoir été inspirée que par la haine acerbe qu’il nourrit jusqu’à la
fin de sa vie contre Beaumarchais.
«Le sieur Caron de Beaumarchais, dit-il, blâmé au Parlement de Paris,
sur le point d’être appréhendé 164 au corps pour l’exécution de
l’arrêt, se réfugie dans la garde-robe du roi, asile digne d’un tel
personnage. M. de Laborde, valet de chambre du roi, confie au sieur de
Beaumarchais, dans les ténèbres de la garde-robe, que le cœur du
roi est attristé par un vilain libelle que compose à Londres le vilain
Morande sur les amours de la charmante Dubarry.
«Aussitôt le cœur romanesque et gigantesque du sieur Caron
s’enfle et se remplit des idées les plus chimériques; son ambition
s’élève aussi haut que les flots de la mer qu’il doit traverser...
Il communique à La Borde son projet d’aller à Londres secrètement
corrompre par or le corrompu Morande; le projet est communiqué par
La Borde à Louis XV, qui daigne l’approuver. En conséquence le sieur
Caron de Beaumarchais arrive à Londres incognito escorté du comte de
Lauraguais in publico[146].»
Le jour même de l’arrivée de ces deux seigneurs à Londres, Morande
se rend chez d’Éon, si l’on en croit celui-ci, et lui annonce les
propositions avantageuses qui viennent de lui être faites. Il ne veut
pas les accepter sans prévenir le chevalier qui a entamé les premiers
pourparlers et lui exprime «le désir que les deux gentilshommes ont
de conférer avec le chevalier d’Éon». Ils l’attendent «dans leur
carrosse au coin de la rue». D’Éon, plein de dignité, refuse de voir
des inconnus qui ne possèdent à son adresse aucune lettre «de personnes
en place et qui peuvent être des 165 émissaires de la police». Puis
il congédie Morande en lui faisant bien remarquer «que, la matière
des amours des rois étant chose fort délicate pour tout le monde,
il s’expose aux dangers d’un métier de voleur de grand chemin; que
d’ailleurs il peut faire contribuer la voiture la plus dorée qu’il
trouvera sur son chemin, la sienne à lui d’Éon ne portant que 800
livres sterling».
Peu de jours après, le chevalier «apprit que ces deux seigneurs étaient
le seigneur inconnu Caron de Beaumarchais et le seigneur très illustre
et très connu Louis-François de Brancas, comte de Lauraguais[147]». Ils
avaient conclu avec Charles Théveneau de Morande un traité, à peine
discuté et fort généreux, qui assurait à cet aventurier une rente
annuelle de 4,000 livres sur sa propre tête et de 2,000 livres sur
celle de sa femme, après sa mort. Morande bénéficiait en outre d’une
somme de 32,000 livres, qui lui fut remise de la main à la main en
échange des manuscrits.
D’Éon en additionnant les articles de ce marché et en y ajoutant les
frais et émoluments «des ambassadeurs extraordinaires» assure que ce
libelle coûta à la Cour la respectable somme de 154,000 livres[148].
Aussi s’indigna-t-il véhémentement d’une aussi déplorable prodigalité.
Il était d’ailleurs d’autant plus porté à la critique que lui-même
s’était vu exclure 166 d’une négociation qu’il avait presque menée
à son terme avec plus d’adresse et plus de mesure et dont il avait
escompté le succès pour rentrer en faveur auprès du roi.
Beaumarchais, qui devait un peu plus tard retrouver son contradicteur
en un piquant tête-à-tête, se hâta de revenir à Paris pour y tirer
parti de son avantage, tandis que d’Éon se consolait de son mécompte en
publiant un ouvrage qui était le fruit de ses longues années d’inaction
et qu’il intitula philosophiquement: Les Loisirs du chevalier d’Éon.
C’étaient de studieux et patients loisirs. Dans sa retraite ombragée
de Petty-France, dont le jardin avoisinait le parc, il se livrait aux
plus graves méditations, à en juger par les matières traitées dans ces
treize volumes in-octavo. Guerre, administration, politique générale,
questions extérieures y sont tour à tour compendieusement étudiées;
les finances mêmes ne sont pas négligées et suggèrent à l’auteur des
remarques si judicieuses, des projets de réforme si avisés que le roi
de Prusse prit soin, paraît-il, de les signaler à ses bureaux; c’est
du moins ce que rapportait une feuille de Londres[149]. Fort goûté à
Berlin, l’ouvrage dut surtout son succès à Londres à la hardiesse de sa
dédicace, ce qui, en revanche, lui ferma les librairies de Paris et en
particulier l’éventaire du sieur Antoine Boudet, rue Saint-Jacques. Les
suppliques les plus éloquentes, les apostilles les 167 plus autorisées
ne purent désarmer M. de Sartine contre un livre publié sous les
auspices du duc de Choiseul, dont l’éclatante disgrâce venait de faire
tant de bruit et de soulever tant d’indignation. D’Éon s’était placé
de lui-même sous ce patronage et l’avait fait en ces termes: «En vous
dédiant ce travail, Monsieur le duc, ce n’était pas un protecteur que
je désirais, ma liberté et mon innocence me protègent assez: c’était
un grand homme que je cherchais; je l’ai trouvé dans la retraite de
Chanteloup[150].»
Si l’histoire n’a point discerné en Choiseul le grand homme que
d’Éon s’était plu à voir, il faut reconnaître combien fut ingrate et
malaisée la tâche d’un ministre dont la politique à l’extérieur fut
presque constamment faussée par l’action secrète du souverain et dont
l’initiative, souvent heureuse à l’intérieur, fut à peu près paralysée
par les caprices hostiles de la favorite. Victime du ressentiment de
Mme du Barry, que son esprit acerbe n’avait point épargnée, Choiseul
supporta avec calme et fierté un exil où la Cour et les princes
eux-mêmes vinrent le visiter. Cette belle attitude séduisit d’Éon, et
d’autant mieux que sa vanité se plut à considérer dans cet exil un sort
assez voisin du sien et à voir dans le ministre tombé une autre victime
des mêmes intrigues et des mêmes favoris. C’est un pareil orgueil,
ou pour mieux dire une telle fanfaronnade, qui l’avait déjà poussé à
envoyer 168 au duc, au moment de sa disgrâce, une lettre évidemment
composée pour se mettre lui-même en noble posture:
Monsieur le Duc,
Vous m’avez longtemps honoré de votre bienveillance et de votre
protection manifeste. Celle-ci ne s’est retirée de moi que par
condescendance pour M. le duc de Praslin, mon ennemi et votre parent,
votre collègue.
Je me suis toujours réjoui de votre bienveillance et ne me suis
jamais plaint de votre abandon.
A l’heure où les courtisans de votre fortune vont vous renier,
Monsieur le Duc, et s’éloigner de votre disgrâce, je m’en rapproche
et viens mettre à vos pieds l’hommage de mon dévouement et de ma
reconnaissance, qui ne finiront qu’avec ma vie.
Daignez les accepter et me croire votre très humble et très dévoué
serviteur.
Le Chevalier d’Éon[151].
Louis XV, qui avait une fois de plus sacrifié son ministre à sa
favorite, ne songeait même plus à se dédommager comme jadis en
intrigues cachées de ces honteuses abdications. Le secret, auquel
il n’avait cessé de travailler chaque jour pendant quinze ans, ne
l’intéressait plus. La correspondance publiée par Boutaric en fait foi,
et c’est à peine si pour les années 1773 et 1774 elle contient encore
quelques billets du roi.
Cette indifférence du souverain mettait sans cesse le secret, jadis
si jalousement gardé, en péril d’être découvert. D’ailleurs les
ministres n’avaient 169 pas tardé à en soupçonner l’existence. Le duc
d’Aiguillon, qui avait deviné le rôle du comte de Broglie, guettait
l’occasion de surprendre l’intrigue et en même temps de se venger d’un
rival occulte dont l’arrogance l’avait exaspéré. L’équipée, demeurée
assez mystérieuse, de deux agents du secret, Favier et Dumouriez,
qui semblent avoir voulu nouer alors une négociation avec la Prusse,
au détriment de l’Autriche, lui fournit le moyen longtemps cherché
de mettre le comte de Broglie en mauvaise posture. Il fit répandre à
Versailles le bruit que tout un complot venait d’être découvert et
donna l’ordre de mettre à la Bastille Favier, dont on s’était assuré à
Paris, et Dumouriez, qui venait d’être arrêté à la Haye, sur le chemin
de l’Allemagne. N’ayant rien pu découvrir d’assez compromettant chez
ces deux agents subalternes, le duc d’Aiguillon s’enhardit jusqu’à
insinuer au roi de faire saisir les papiers du comte de Broglie.
Louis XV répondit avec une indifférence affectée qu’il n’en voyait pas
l’opportunité; qu’à la vérité le comte lui soumettait de temps à autre
des mémoires sur les affaires extérieures, mais que c’étaient là des
travaux historiques, sans aucune tendance politique. D’Aiguillon dut se
contenter de la réponse et sut faire bonne figure à mauvais jeu. Favier
et Dumouriez comparurent seuls devant trois commissaires enquêteurs
au nombre desquels le roi, pour plus de sûreté, avait fait mettre M.
de Sartine, dûment averti comme précédemment; ils s’en tirèrent l’un
et l’autre avec 170 quelques mois d’emprisonnement qu’ils subirent,
Favier à la citadelle de Doullens et Dumouriez au château de Caen.
Quant au comte de Broglie que le roi plutôt par égoïsme que par justice
avait soustrait aux commissaires, il n’évita la prison que pour l’exil.
Son caractère hautain n’avait pu supporter en effet la méfiance où les
courtisans le tenaient depuis la découverte de cette intrigue. Devinant
que le duc d’Aiguillon se faisait l’artisan de sa disgrâce, il lui
avait écrit une lettre si impertinente que, communiquée au roi, elle
valut à son auteur d’être aussitôt exilé à Ruffec. Louis XV n’avait
pas été fâché de trouver ce prétexte pour éloigner de lui un serviteur
dévoué, mais dont le zèle parfois indiscret l’importunait de plus en
plus. Aussi se montra-t-il insensible aux lettres de soumission et
d’excuses que le comte lui envoya de Ruffec, aux supplications de la
comtesse, aux démarches mêmes du maréchal. Toutefois il ne voulut ou
peut-être n’osa point retirer entièrement sa confiance au ministre du
secret, qui, exilé et disgracié officiellement, continua à correspondre
secrètement du fond de sa province avec les agents personnels du roi.
La tâche du comte de Broglie ne devait plus être de longue durée. Elle
avait perdu d’ailleurs tout intérêt et toute utilité et n’était mystère
pour personne. Les agents de l’Autriche avaient mis au courant du
secret le cabinet de Vienne, qui en informait régulièrement les autres
Cours d’Allemagne; en 171 France même les ministres étaient désormais
au fait de l’intrigue et la Cour en avait eu vent par les confidences
du cardinal de Rohan, à qui un espion qu’il avait dans le cabinet noir
l’avait révélée.
Lorsque Louis XV mourut, son secret était connu de tous et la politique
pour laquelle il avait stérilement dépensé tant d’ingéniosité, gâché
tant de dévouement, finissait en un scandale dont sa mort seule
put étouffer l’éclat. La France ne perdait plus un souverain en ce
vieillard usé, devenu le jouet d’une femme indigne, et les agents
du secret eux-mêmes n’avaient pas à regretter un protecteur dans
le monarque ingrat qui n’avait jamais fait appel à leur dévouement
que pour les sacrifier ensuite à son repos. Aussi ne furent-ils pas
éloignés de partager l’allégresse générale. En matière d’oraison
funèbre, d’Éon écrivait au comte de Broglie, quelques mois à peine
après la mort du roi:
Je me contenterai de vous dire qu’il est temps, après la cruelle
perte que nous avons faite de notre avocat général à Versailles,
qui au milieu de sa propre Cour avait moins de pouvoir qu’un avocat
du roi au Châtelet, qui, par une faiblesse incroyable, a laissé ses
serviteurs infidèles triompher sur ses fidèles serviteurs secrets
et a toujours fait plus de bien à ses ennemis déclarés qu’à ses
véritables amis; il est temps, dis-je, que vous instruisiez le
nouveau roi qui aime la vérité et qu’on m’a dit avoir autant de
fermeté d’esprit que son illustre aïeul en avait peu, il est temps
et pour vous et pour moi que vous instruisiez ce jeune monarque que
depuis plus de vingt ans vous étiez le ministre secret de Louis XV et
moi le sous-ministre sous ses ordres et les vôtres.
172
D’Éon, qui appréciait sans modestie ses services et les attributions
qui lui avaient été confiées, énumérait ensuite ses griefs et ses
réclamations, se comparait à La Chalotais et espérait une même
réhabilitation; il terminait ainsi:
Quant à vous, Monsieur le comte, vous saurez mieux peindre que moi
par quelle jalousie, quelle perfidie, quelle bassesse et quelle
noire vengeance du duc d’Aiguillon vous vous trouvez encore en exil
à Ruffec, sans avoir cessé d’être l’ami et le ministre secret du feu
roi jusqu’à sa mort. Jamais la postérité ne pourrait croire de tels
faits si vous et moi n’avions pas toutes les pièces nécessaires pour
les constater et de plus incroyables encore; si ce bon roi n’eût pas
chassé les jésuites de son royaume et qu’il eût eu quelque Malagrida
pour confesseur, cela ne surprendrait personne; mais, grâce à Dieu,
j’espère que le nouveau roi nous tirera bientôt du cruel embarras où
vous et moi sommes encore plongés. J’espère qu’il n’aura pas pour
confesseur, ni pour ami, ni pour ministre aucun jésuite, soit en
habit de prêtre, soit en habit de chancelier, soit en habit de duc et
pair, soit en habit de courtisan, soit en habit de courtisane[152].
Le ministre secret de Louis XV n’avait pas attendu cette lettre
pour essayer de rentrer en grâce auprès du nouveau roi. Il avait dû
présenter sa justification par écrit, se trouvant toujours en exil
à Ruffec et sentant peser sur lui des soupçons que l’obstination de
Louis XV à tenir éloigné un collaborateur aussi compromettant avait
fait naître. Il était desservi par 173 tous ceux qui l’avaient
jadis jalousé, et l’influence qu’exerçait sur son époux la reine
Marie-Antoinette, la part qu’elle entendait prendre à la direction
des affaires publiques n’amélioraient pas la cause de celui qui avait
secrètement battu en brèche l’alliance autrichienne.
Aussi dès le 13 mai 1774 avait-il fait parvenir à Louis XVI une
note où il l’instruisait des diverses négociations du secret, ainsi
que des endroits où le feu roi aurait pu cacher ses papiers et sa
correspondance, mais où perçait surtout son désir de se disculper
et d’expliquer son rôle personnel[153]. Quinze jours plus tard, il
écrivait de nouveau au roi, et cette fois c’était surtout la conduite
de d’Éon qu’il s’efforçait d’expliquer et aussi de justifier. En
donnant ainsi au chevalier son témoignage, le comte de Broglie servait
sa propre cause et les termes mêmes qu’il emploie montrent qu’il avait
conscience de cette fatale solidarité: «J’imagine, écrivait-il, qu’il
est possible que Votre Majesté en ait mal entendu parler et qu’ainsi
elle pourrait être étonnée de le trouver compris dans le nombre des
personnes honorées de la confiance du roi[154].» Il reconnaissait que
d’Éon avait été poussé par son extrême vivacité jusqu’à des «éclats
peu décents», mais ne cachait pas que le chevalier avait été provoqué
le premier par la maladresse du comte de Guerchy. Il concluait: «Cet
être singulier (puisque le sieur d’Éon est une femme) est 174 plus
que bien d’autres encore un composé de bonnes qualités et de défauts
et il pousse l’un et l’autre à l’extrême[155].» Aussi le comte de
Broglie faisait-il valoir au roi qu’il serait opportun de continuer à
Mlle d’Éon le service de la pension accordée au chevalier par Louis
XV. Pour lui-même il demandait davantage et laissait entendre qu’il
ne livrerait pas les papiers secrets avant d’avoir pu se justifier
pleinement devant une commission spéciale. Louis XVI, qui avait un
instant songé à continuer la politique secrète de son prédécesseur, y
renonça bientôt sous l’influence de Marie-Antoinette, poussée elle-même
par sa mère[156]; il n’eut plus alors de plus pressant souci que celui
de liquider le bureau secret, et pour en finir avec les réclamations
du comte de Broglie il envoya celui-ci se justifier devant trois
commissaires, Du Muy, Vergennes et Sartine, qui rendirent hommage sans
réserve aux qualités de discrétion, de prévoyance et de dextérité
dont le ministre secret de Louis XV avait fait preuve au cours des
négociations les plus épineuses. Cet éclatant témoignage put satisfaire
la conscience du comte de Broglie, mais ne lui rendit pas la faveur de
son souverain. Louis XVI se refusa obstinément à accorder la pairie ou
même la moindre récompense au serviteur fidèle et malheureux 175 de
son aïeul. Il se borna à fixer les pensions des agents subalternes que
l’abandon de la politique secrète privait désormais de tout emploi.
Parmi ceux-ci d’Éon seul ne figurait pas encore. Les ministres, en
effet, trouvant excessif le chiffre de la pension que Louis XV lui
avait accordée, hésitaient à lui en assurer le payement au même taux.
Le motif de cette libéralité subsistait toujours cependant, puisque
d’Éon possédait encore de nombreux papiers politiques. Le comte de
Vergennes avait pu s’en convaincre et il écrivait au roi le 22 août:
M. de Muy et moi avons déjà vu toute la correspondance que M. le
comte de Broglie a entretenue avec le sieur d’Éon depuis qu’il s’est
fermé le retour dans sa patrie; nous travaillons au rapport que nous
devons avoir l’honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté et
nous aurons celui de lui exposer les moyens de rappeler un homme
qu’il ne serait pas sans inconvénient de laisser en Angleterre[157].
Ces moyens furent en réalité suggérés par le comte de Broglie, qui se
fit l’avocat de d’Éon et se chargea de l’amener à composition. Ce fut
lui qui obtint du roi que l’on continuât à servir intégralement au
chevalier la pension accordée par Louis XV en 1766 et qu’on l’autorisât
à rentrer en France.
En échange, on devait demander à d’Éon de restituer les papiers secrets
et de s’engager à ne plus harceler de ses provocations et poursuivre de
ses écrits 176 une famille qu’il avait déjà si injustement molestée.
Telles furent les propositions que le comte de Vergennes adressa à
d’Éon dans une lettre approuvée de la main du roi. Il fut décidé que
le marquis de Prunevaux, capitaine au régiment de Bourgogne-Cavalerie,
se rendrait tout exprès à Londres pour diriger cette négociation. Il
devait remettre au chevalier un sauf-conduit en même temps qu’un billet
où le comte de Broglie l’exhortait à se soumettre de bonne grâce et
avec reconnaissance aux volontés du roi. «En mon particulier, écrivait
en terminant l’ex-ministre secret, je suis charmé d’avoir pu contribuer
à vous procurer une retraite aisée et honorable dans votre patrie[158].»
Ce que le comte de Broglie regardait comme une retraite honorable ne
parut à d’Éon qu’une récompense misérable qui ne le dédommageait en
rien des pertes pécuniaires et des disgrâces qu’il avait encourues
pour obéir au roi. Il n’avait cessé depuis la mort de Louis XV de se
déclarer «prêt à se soumettre à tout ce qui pourrait être agréable
au nouveau roi», mais cette feinte humilité n’était que l’effet de
la crainte; il redoutait d’être oublié à Londres et s’efforçait par
l’appât qu’offraient les papiers secrets d’engager Louis XVI dans une
négociation qu’il se promettait bien de faire tourner à son avantage.
Dès l’arrivée du négociateur, il abandonna promptement tous les beaux
sentiments dont il avait fait 177 montre pour discuter avec âpreté les
conditions du marché. Il ne se doutait pas qu’une dernière occasion lui
était ainsi offerte de se tirer définitivement de la triste condition
où son orgueil insensé l’avait plongé. Un événement inattendu venait
encore de réveiller en lui l’espérance de la réhabilitation: Treyssac
de Vergy, qui avait été mêlé à sa querelle avec M. de Guerchy, venait
de mourir et, dans un testament auquel d’Éon avait immédiatement
donné la publicité des journaux, certifiait de nouveau la vérité de
tous les complots, de tous les mauvais desseins de l’ambassadeur,
dont il avouait avoir été lui-même l’agent inconscient. A Londres
on avait cru à l’aveu in extremis de l’aventurier; le chevalier
Fielding proclamait l’innocence de d’Éon «claire comme le soleil» et M.
Charles, précepteur des enfants d’Angleterre, envoyait au chevalier les
félicitations du ministre, lord Bute: «L’ancien ami de M. le chevalier
(lord Bute), disait-il, à qui Charles a fait voir le papier ci-joint
(la copie du testament), se félicite du bon train que paraissent
prendre les choses. Adieu, respectable ami[159].»
D’Éon croyait en effet les choses en si bon train qu’il poussa les
hauts cris lorsque M. de Prunevaux lui fit part de la décision et des
offres du comte de Vergennes. Il s’emporta, trouvant inacceptables
ces propositions qui ne tenaient aucun compte «des réparations
honorifiques et de l’argent dû par la 178 Cour» à l’ancien ministre
plénipotentiaire. Il se montra si intraitable que M. de Prunevaux
avertit de suite le ministre des dispositions du chevalier, bien
différentes de celles qu’on lui supposait. M. de Vergennes,
s’apercevant alors que les moments de repentir du sieur d’Éon étaient
courts, chargea le comte de Broglie de tenter un dernier effort auprès
de son ancien agent, qui reçut une nouvelle lettre pleine de judicieux
conseils et de sages avertissements: «A mon arrivée de Ruffec, écrivait
le comte, j’apprends avec le plus grand étonnement que vous n’avez pas
accepté les propositions qui vous ont été faites par M. le comte de
Vergennes... Je vous avoue que je ne peux concevoir sur quel fondement
vous appuyez une pareille résistance. Je désire donc que vous écoutiez
la voix de la raison, du devoir et même de votre propre intérêt, et que
vous répariez par une prompte obéissance des torts qu’une plus longue
résistance aggraverait d’une manière irréparable[160].»
D’Éon ne voulut rien entendre; il allégua qu’un ministre
plénipotentiaire de France, chevalier de Saint-Louis, ne pouvait
«lever le pied comme tant de Français méprisables qui avaient dupé de
généreux Anglais».—«Il avait promis, ajoutait-il, de ne jamais quitter
cette île avant d’avoir préalablement rempli ses engagements.» M. de
Prunevaux crut sa mission terminée et revint à Paris, n’apportant
qu’une lettre à la fois humble et menaçante où 179 d’Éon se permettait
de poser lui-même au roi et au ministre les conditions de son propre
retour. Il désirait d’abord qu’on le réintégrât, ne fût-ce que pour
un moment, dans ses emplois et titres politiques, et qu’on lui payât
toutes les indemnités dont une pièce annexe donnait le détail. C’était,
comme l’a justement remarqué M. de Loménie, le plus impertinent «compte
d’apothicaire» que l’on pût imaginer. D’Éon y réclamait non seulement
ses appointements de capitaine pendant une période de quinze années,
plus le remboursement de folles dépenses qu’il avait faites pendant son
fastueux intérim, mais encore le remboursement des «frais immenses que
lui avait occasionnés son séjour à Londres pendant douze ans, tant pour
la nourriture et pour l’entretien de feu son cousin de Mouloize et de
lui-même, que pour les dépenses extraordinaires que les circonstances
avaient exigées». Il lui était dû de ce chef la modique somme de
100,000 livres! Mais, où ces réclamations prenaient un tour bouffon,
c’était lorsque d’Éon revendiquait une somme de 6,000 livres pour avoir
manqué de recevoir du prince Poniatowski le cadeau d’un diamant de la
même valeur:
Plus, continuait notre chevalier, le comte de Guerchy a détourné le
roi d’Angleterre de faire à M. d’Éon le présent de mille pièces qu’il
accorde aux ministres plénipotentiaires qui résident à sa cour, cy:
24,000 livres.
Plus pour nombre de papiers de famille perdus par Hugonnet lors de
son arrestation, cy: 27,000 livres.
Plus, n’ayant pas été en état depuis 1763 jusqu’en 1773 d’entretenir
ses vignes en Bourgogne, cy: 15,000 livres.
180
En ajoutant à ces avances quelques autres non moins imaginaires qu’il
serait trop long de relater, le total du compte évoluait entre deux
cent et deux cent cinquante mille livres.
181
CHAPITRE VIII
Louis XVI refuse de céder aux exigences du chevalier.—Les créanciers
poursuivent d’Éon, qui remet ses papiers secrets en gage chez son
ami lord Ferrers.—Les embarras d’argent ramènent d’Éon à l’idée de
se faire passer pour femme.—Son aveu à Beaumarchais.—Il consent à
négocier et à signer un traité en bonne forme.—Le comte de Vergennes
écrit à la chevalière d’Éon et lui envoie un sauf-conduit pour
revenir en France.
Le comte de Vergennes, stupéfait et outré, dut, bien qu’à regret,
communiquer au roi l’étrange facture qu’il venait de recevoir:
Elle n’est remarquable, écrivait-il à son maître, que par sa
prolixité et par les traits de présomption et d’avidité qui s’y
décèlent: en tout c’est un nouveau monument de cet esprit par trop
singulier. J’aurais désiré pouvoir épargner à Votre Majesté la
lecture de cette rapsodie; mais je ne puis éconduire les demandes de
cet être singulier sans les ordres de Votre Majesté.
Le sieur d’Éon met à si haut prix la remise des papiers dont il est
dépositaire qu’il faut renoncer pour le présent à les retirer; mais
comme il pourrait n’être pas sans inconvénient de le priver de toute
ressource en le mettant dans la nécessité d’abuser du dépôt, si Votre
Majesté l’approuve, on pourrait laisser les choses au même état où
elles se trouvaient à l’avènement de Votre Majesté au trône[161].
Louis XVI déclara qu’il n’avait jamais vu «une 182 pièce plus
impertinente et plus ridicule que la note de d’Éon, qu’il faudrait
envoyer promener s’il n’avait pas des papiers si importants», et il
jugea inutile de dépenser chaque année 12,000 livres pour un secret
auquel le temps enlèverait de jour en jour de sa valeur.
D’Éon demeura donc à Londres; il dut s’avouer alors qu’à se montrer
trop avide il avait bien compromis ses intérêts, mais il ne voulut
point en convenir officiellement et il s’empressa, comme c’était sa
coutume, d’instruire le public de l’ambassade qu’on lui avait envoyée
et qui avait échoué, disait une feuille de Londres, parce que «le
chevalier estime toute satisfaction pécuniaire incapable de balancer
celle qu’exige son honneur: des monceaux d’or ne pouvant être que le
moyen et non l’objet des grandes âmes[162]».
C’étaient bien, en effet, des monceaux d’or qu’il fallait à d’Éon.
Harcelé par ses créanciers, il se résolut à engager et aussi à
mettre en sûreté sa précieuse correspondance, qu’il déposa chez son
ami lord Ferrers, pair et amiral d’Angleterre. Celui-ci lui avança
100,000 livres sur un coffre scellé où étaient renfermés les papiers
secrets. Cet argent ne lui suffit pas encore; pour se procurer de
nouvelles ressources et aussi sans doute pour sortir d’une inaction
qui lui pesait, il s’efforça par tous les moyens d’obtenir un emploi.
Il s’adressa même à l’étranger, offrant ses 183 services au nouvel
ambassadeur d’Espagne, le prince de Masseran, ce qui lui valut le
billet suivant:
Monsieur,
J’ai reçu votre lettre d’hier; je suis on ne peut plus sensible à la
part que vous voulez bien prendre sur mon arrivée à cette Cour, et
pour ce qui regarde au conseil que vous voudriez me demander, je ne
suis point dans le cas de vous en donner, étant très persuadé que
vous suivrez toujours les ordres et intentions de la Cour de France.
J’ai l’honneur...
Le prince de Masseran[163].
D’incessants déboires et de nouvelles déceptions ramenèrent alors, et
de plus en plus obstinément, d’Éon à l’idée qui lui était apparue déjà
comme le moyen aventureux et quasi héroïque de se tirer d’affaire.
C’était, pour reconquérir une fois encore cette popularité qui lui
échappait, un procédé scabreux; mais, à l’employer, d’Éon n’avait
plus grand’chose à perdre. L’artifice que les circonstances lui ont
jadis suggéré peut devenir une suprême ressource. Aussi laisse-t-il
s’accréditer de plus en plus, sans le démentir, le bruit dont il
tirera parti un jour. On ne se contente plus dans le public de dire
que d’Éon est une femme: on l’imprime et même on édite le portrait de
la Pallas moderne. C’est l’estampe que d’Éon prend soin d’envoyer à
son ancien camarade, M. de la Rozière, alors commandant de la place de
184 Saint-Malo, qui, tout stupéfait, lui accuse ainsi réception de cet
étrange envoi:
Lors de mon passage à Paris, on m’a porté de votre part une estampe
anglaise où vous êtes représenté en Pallas et dont l’inscription
m’a si fort étonné que je doute encore que ce présent me soit venu
de vous directement; je vous prie de me dire ce qui en est de cette
nouveauté, que je ne puis regarder que comme une plaisanterie, à
moins que vous ne m’attestiez vous-même le contraire[164].
D’Éon se garda bien de fixer son correspondant sur le point qui allait
devenir bientôt l’énigme à la mode. Mais il avait besoin, pour opérer
sa métamorphose avec tout l’éclat désirable, d’un auxiliaire dont
le renom ajouterait encore à sa propre célébrité et nul ne pouvait
mieux lui servir en la circonstance que Beaumarchais, l’intrépide
et spirituel adversaire du président Goëzman. C’est pourquoi, comme
lui-même devait l’écrire plus tard, «semblable à un noyé, que le
feu roi et son ministre avaient abandonné au torrent d’un fleuve
empoisonné, il chercha à s’accrocher à la barque de Caron».
Déjà, lors de la négociation relative au libelle publié à Londres
contre Mme du Barry, d’Éon, pressentant tout le parti qu’il pourrait
tirer d’un pareil commerce, s’était efforcé d’entrer en rapports avec
Beaumarchais et son intermédiaire n’avait été autre que Morande,
l’auteur même du factum. Celui-ci s’était fait fort d’amener une
rencontre: «J’ai Beaumarchais 185 en main, écrivait-il à d’Éon;
c’est un homme adorable et je vois la vérité couler sous ses doigts.
Il écrit si joliment que j’ai l’envie de me pendre; jamais Voltaire
n’approcha de son style; vous en jugerez demain.» Mais le lendemain
Beaumarchais, mis peut-être en garde par l’inquiétant patronage choisi
par d’Éon, se dérobait, alléguant son travail, et Morande, tout dépité,
en était réduit à écrire au chevalier: «M. de Beaumarchais jusqu’à
jeudi soir ne quittera pas ses pantoufles, ayant beaucoup à s’occuper
de ses affaires, ce qui est la cause de ses réticences continuelles
pour voir du monde[165].» D’Éon raconta plus tard que Beaumarchais
et lui se rencontrèrent spontanément, «conduits sans doute par une
curiosité naturelle aux animaux extraordinaires de se rechercher».
L’explication est complaisante, mais peu exacte, car Beaumarchais,
après avoir acheté le libelle de Morande et travaillé à la cause des
insurgés américains, était revenu à Paris, et ce ne fut que lors de son
second voyage à Londres, en mai 1775, que d’Éon put enfin le connaître.
Mais l’intrigant chevalier regagna vite le temps qu’il lui avait
fallu dépenser à faire cette précieuse relation. Il sut intéresser le
«sensible» Beaumarchais à sa cause, en faire son avocat et aussi sa
dupe, car il fut assez habile pour se divertir lui-même aux dépens du
spirituel auteur qui semblait avoir fait profession de railler ses
contemporains.
186
C’est en pleurant que d’Éon fit à Beaumarchais son pénible aveu,
lui confessa qu’il était femme et traça un tableau si attendrissant
de son infortune qu’à peine rentré chez lui et encore tout ému son
interlocuteur écrivait au roi: «Quand on pense que cette créature tant
persécutée est d’un sexe à qui l’on pardonne tout, le cœur s’émeut
d’une douce compassion... J’ose vous assurer, Sire, qu’en prenant cette
étonnante créature avec adresse et douceur, quoique aigrie par douze
années de malheur, on l’amènera facilement à rentrer sous le joug[166].»
Beaumarchais fut donc complètement berné par d’Éon, comme le fut aussi
son ami Gudin, et leur erreur permet de mieux comprendre comment le roi
et son ministre purent être à leur tour trompés par l’assurance avec
laquelle on leur affirmait une chose que déjà la rumeur publique avait
accréditée en Angleterre. Du reste le comte de Broglie n’avait-il pas
eu plusieurs années auparavant, par l’intermédiaire de Drouet, la même
étonnante révélation à laquelle il avait cependant ajouté assez de foi
pour en faire part au roi Louis XV?
Touché par la situation de d’Éon, Beaumarchais résolut donc de
s’entremettre. Il offrit à Vergennes de renouer les négociations,
exprimant son espoir de les voir aboutir. Le ministre y consentit
et précisa les conditions de l’accord. Sur la question d’argent il
prescrivait à Beaumarchais de «voir venir, afin de 187 combattre avec
supériorité», ajoutant: «M. d’Éon a le caractère violent, mais je lui
crois une âme honnête et je lui rends assez justice pour être persuadé
qu’il est incapable de trahison.»
Fixer le montant de l’indemnité était la plus grosse, mais non la seule
difficulté. D’Éon n’avait-il pas émis la prétention d’obtenir du roi
d’Angleterre une audience de congé? Sur ce point Vergennes se montra
irréductible: «Il est impossible, écrivait-il, que M. d’Éon prenne
congé du roi d’Angleterre, la révélation de son sexe ne peut plus le
permettre; ce serait un ridicule pour les deux Cours; l’attestation
à substituer est délicate, cependant on peut l’accorder pourvu qu’il
se contente des éloges que méritent son zèle, son intelligence et sa
fidélité[167].» Fort de ces instructions Beaumarchais n’eut pas trop
de peine à convaincre d’Éon, qui ne demandait d’ailleurs qu’à venir
à composition. Il en obtint une première marque d’obéissance, sur
laquelle il s’empressa de chanter victoire auprès du ministre:
Quoi qu’il en soit, Monsieur le Comte, je crois avoir coupé une tête
de l’hydre anglaise. Je tiens à vos ordres le capitaine d’Éon, brave
officier, grand politique et rempli par la tête de tout ce que les
hommes ont de plus viril. Il porte au roi les clés d’un coffre de fer
bien scellé de mon cachet contenant tous les papiers qu’il importe au
roi de ravoir[168].
188
C’était là un résultat important certes; mais il fallait en obtenir un
autre qui seul, aux yeux de Vergennes, pouvait rassurer complètement
la Cour en prévenant à jamais tout nouveau scandale. Puisqu’il était
femme, d’Éon devait le déclarer solennellement et porter à l’avenir
l’habit de son véritable sexe. Le chevalier ne s’attendait guère à
cette dernière exigence: il protesta, supplia; mais voyant qu’il ne
pourrait rien gagner sur ce point, finit par céder, comprenant du reste
qu’il ne pouvait résister davantage sans éveiller sur la réalité de
ce nouveau sexe des soupçons qui eussent tout compromis. Le 7 octobre
1775, Beaumarchais annonce sa victoire au ministre: «Les promesses par
écrit d’être sage ne suffisent pas pour arrêter une tête qui s’enflamme
toujours au seul nom de Guerchy; la déclaration positive de son sexe
et l’engagement de vivre désormais avec ses habits de femme est le
seul frein qui puisse empêcher du bruit et des malheurs. Je l’ai exigé
hautement et je l’ai obtenu[169].»
L’entente était désormais complète entre le négociateur officieux
qu’avait été l’auteur du Mariage de Figaro et l’étrange rebelle
qui avait tenu en échec l’ambassadeur de France, les ministres, le
roi lui-même. Mais il était dit que tout dans cette histoire serait
extraordinaire, et le dénouement le fut au delà de ce qu’on pouvait
imaginer. Pour consacrer l’accord qu’il avait réussi à établir
Beaumarchais 189 reçut une sorte de caractère officiel, et d’agent
secret qu’il était demeuré jusque-là fut promu ambassadeur—ambassadeur
auprès de la chevalière d’Éon. Accrédité par de véritables pouvoirs,
comme s’il se fût agi de négocier quelque important traité,
Beaumarchais signa, au nom du roi, une transaction que d’Éon accepta,
traitant ainsi avec son souverain de puissance à puissance. La pièce,
en sa forme solennelle, est un morceau de comédie plus réussi à coup
sûr que tous ceux qu’écrivit jamais Beaumarchais; mais le mérite n’en
revient pas au créateur de Figaro, car ce fut bien le seul d’Éon qui
put savourer à son aise tout le piquant de la situation. Voici, car il
vaut par tous ses détails, le texte complet de cet acte diplomatique
sans précédent:
TRANSACTION
Nous soussignés, Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais, chargé
spécialement des ordres particuliers du roi de France, en date de
Versailles, 25 août 1775, communiqués au chevalier d’Éon à Londres et
dont copie certifiée de moi sera annexée au présent acte, d’une part;
Et demoiselle Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée d’Éon
de Beaumont, fille majeure, connue jusqu’à ce jour sous le nom du
chevalier d’Éon, écuyer, ancien capitaine de dragons, chevalier
de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, aide de camp des
maréchal-duc et comte de Broglie, ministre plénipotentiaire de France
auprès du roi de la Grande Bretagne, ci-devant docteur en droit civil
et en droit canon, avocat au parlement de Paris, censeur royal pour
l’histoire et les belles-lettres, envoyé en Russie avec le chevalier
Douglas pour la réunion des deux Cours, secrétaire d’ambassade du
marquis de L’Hospital, ambassadeur plénipotentiaire de 190 France
près Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, et secrétaire
d’ambassade du duc de Nivernais, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de France en Angleterre pour la conclusion de la
dernière paix, sommes convenus de ce qui suit et l’avons souscrit:
Article premier.—Que moi, Caron de Beaumarchais, j’exige,
au nom du roi que tous les papiers publics et secrets qui ont
rapport aux diverses négociations politiques dont le chevalier d’Éon
a été chargé en Angleterre, notamment ce qui tient à la paix de
1763, correspondances, minutes, copies de lettres, chiffres, etc.,
actuellement en dépôt chez le lord Ferrers, comte, pair et amiral
d’Angleterre, (in upper Seymour street, Portman square, à Londres),
toujours ami particulier dudit chevalier d’Éon pendant le cours de
ses malheurs et procès en Angleterre, et lesdits papiers renfermés
dans un grand coffre de fer dont j’ai la clé, me soient remis après
avoir été tous paraphés de ma main et de celle dudit chevalier d’Éon,
et dont l’inventaire sera joint et annexé au présent acte pour
prouver la fidélité de la remise entière des dits papiers.
Art. 2.—Que tous les papiers de la correspondance secrète
entre le chevalier d’Éon, le feu roi et les diverses personnes
chargées par Sa Majesté de suivre et entretenir cette correspondance,
désignées dans les lettres sous les noms du substitut, du procureur,
comme la personne de Sadite Majesté y était désignée elle-même sous
celui de l’avocat, etc... laquelle correspondance secrète était
cachée sous le plancher de la chambre à coucher dudit chevalier
d’Éon, d’où elle a été tirée par lui, le 3 octobre de la présente
année, en ma présence seule, et s’est trouvée bien cachetée avec
l’adresse: Au roi seul, à Versailles, sur chaque carton ou volume
in-quarto; que toutes les copies desdites lettres, minutes, chiffres,
etc., me seront remises avec la même précaution des paraphes et
d’un inventaire exact, ladite correspondance secrète composant cinq
cartons ou gros volumes in-quarto.
191
Art. 3.—Que ledit chevalier d’Éon se désiste de toute
espèce de poursuites juridiques ou personnelles contre la mémoire
du feu comte de Guerchy son adversaire, les successeurs de son nom,
les personnes de sa famille, etc., et s’engage de ne jamais ranimer
ces poursuites sous quelque forme que ce soit, à moins qu’il ne s’y
voie forcé par la provocation juridique ou personnelle de quelque
parent ami, ou adhérent de cette famille, ce qui n’est pas à craindre
aujourd’hui, la sagesse de Sa Majesté ayant suffisamment pourvu
d’ailleurs à ce que ces scandaleuses querelles ne se renouvellent
plus de part ni d’autre, à l’avenir.
Art. 4.—Et pour qu’une barrière insurmontable soit posée
entre les contendants et retienne à jamais l’esprit de procès, de
querelle personnelle, de quelque part qu’il pût se reproduire,
j’exige, au nom de Sa Majesté, que le travestissement qui a caché
jusqu’à ce jour la personne d’une fille sous l’apparence du
chevalier d’Éon cesse entièrement. Et sans chercher à faire un tort
à Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée d’Éon de Beaumont
d’un déguisement d’état et de sexe dont la faute est tout entière
à ses parents, rendant même justice à la conduite sage, honnête
et réservée, quoique mâle et vigoureuse, qu’elle a toujours tenue
sous ses habits d’adoption, j’exige absolument que l’équivoque de
son sexe qui a été jusqu’à ce jour un sujet inépuisable de paris
indécents, de mauvaises plaisanteries qui pourraient se renouveler
surtout en France et que la fierté de son caractère ne souffrirait
pas, ce qui entraînerait de nouvelles querelles qui ne serviraient
peut-être que de prétextes à couvrir les anciennes et à les
renouveler; j’exige absolument, dis-je, au nom du roi, que le fantôme
du chevalier d’Éon disparaisse entièrement et qu’une déclaration
publique, nette, précise et sans équivoque du véritable sexe de
Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée d’Éon de Beaumont,
avant son arrivée en France et la 192 reprise de ses habits de
fille, fixe à jamais les idées du public sur son compte; ce qu’elle
doit d’autant moins refuser aujourd’hui[170] qu’elle n’en paraîtra
que plus intéressante aux yeux des deux sexes que sa vie, son courage
et ses talents ont également honorés. Auxquelles conditions, je
lui remettrai le sauf-conduit en parchemin, signé du roi et de son
ministre des Affaires étrangères, qui lui permet de revenir en France
et d’y rester sous la sauvegarde spéciale et immédiate de Sa Majesté,
laquelle veut bien lui accorder, non seulement protection et sûreté
sous sa promesse royale, mais qui a la bonté de changer la pension
annuelle de 12,000 livres que le feu roi lui avait accordée en 1766,
et qui lui a été payée exactement jusqu’à ce jour, en un contrat de
rente viagère de pareille somme, avec reconnaissance que les fonds
dudit contrat ont été fournis et avancés par ledit chevalier pour
les affaires du feu roi, ainsi que de plus fortes sommes dont le
montant lui sera remis par moi pour l’acquittement de ses dettes en
Angleterre, avec l’expédition en parchemin et en bonne forme du
contrat de ladite rente de 12,000 livres tournois, en date du 28
septembre 1775.
Et moi, Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée d’Éon de
Beaumont, fille majeure, connue jusqu’à ce jour sous le nom du
chevalier d’Éon et qualités susdites, je me soumets à toutes les
conditions imposées ci-dessus au nom du roi, uniquement pour donner
à Sa Majesté les plus grandes preuves possibles de mon respect et de
ma soumission, quoiqu’il m’eût été bien plus doux qu’elle eût daigné
m’employer de nouveau dans ses armées ou dans la politique, selon mes
vives sollicitations et suivant mon rang d’ancienneté. Et puisqu’à
quelques vivacités près, qu’une défense légitime et naturelle et le
plus juste ressentiment rendaient en quelque 193 façon excusable,
Sa Majesté veut bien reconnaître que je me suis toujours comporté
en brave homme comme officier et en sujet laborieux, intelligent et
discret comme agent politique, je me soumets à déclarer publiquement
mon sexe, à laisser mon état hors de toute équivoque, à reprendre
et porter jusqu’à la mort mes habits de fille[171], à moins qu’en
faveur de la longue habitude où je suis d’être revêtue de mon habit
militaire, et par tolérance seulement, Sa Majesté ne consente à me
laisser reprendre ceux des hommes, s’il m’est impossible de soutenir
la gêne des autres après avoir essayé de m’y habituer à l’Abbaye
royale des Dames Bernardines de Saint-Antoine-des-Champs, à Paris, ou
à tel autre couvent de filles que je voudrai choisir, et où je désire
me retirer pendant quelques mois en arrivant en France.
Je donne mon entier désistement à toutes poursuites juridiques ou
personnelles contre la mémoire du feu comte de Guerchy et ses ayants
cause, promettant de ne jamais les renouveler, à moins que je n’y
sois forcée par une provocation juridique, ainsi qu’il est dit
ci-dessus.
Je donne de plus ma parole d’honneur que je remettrai à M. Caron de
Beaumarchais tous les papiers publics et secrets, tant de l’ambassade
que de la correspondance secrète désignée ci-dessus, sans en réserver
ni retenir un seul, aux conditions suivantes, auxquelles je supplie
Sa Majesté de vouloir bien permettre qu’on souscrive en son nom:
1o Qu’en reconnaissant que la lettre du feu roi, mon très honoré
seigneur et maître, en date de Versailles, le 1er avril 1766,
par laquelle il m’assurait 12,000 livres de pension annuelle en
attendant qu’il me plaçât plus avantageusement, ne peut plus me
servir de titre pour toucher ladite pension, qui se trouve changée
très avantageusement pour moi par le roi son successeur, en un 194
contrat viager de pareille somme, l’original de ladite lettre restera
en ma possession comme témoignage honorable que le feu roi a daigné
rendre à ma fidélité, à mon innocence et à ma conduite irréprochable
dans tous mes malheurs et dans toutes les affaires qu’il a daigné me
confier, tant en Russie qu’à l’armée et en Angleterre.
2o Que l’original de la reconnaissance que M. Durand, ministre
plénipotentiaire en Angleterre, m’a donnée à Londres, le 11 juillet
1766, de la remise volontaire, fidèle et intacte, faite par moi entre
ses mains, de l’ordre secret du feu roi, en date de Versailles, le 3
juin 1763, restera dans mes mains comme un témoignage authentique de
la soumission entière avec laquelle je me suis dessaisie d’un ordre
secret de la main de mon maître, qui faisait seul la justification de
ma conduite en Angleterre, que mes ennemis ont tant nommée opiniâtre,
et que, dans leur ignorance de ma position extraordinaire vis-à-vis
le feu roi, ils ont même osé qualifier de traître à l’État.
3o Que Sa Majesté, par une grâce particulière, daignera, ainsi que
faisait le feu roi, se faire informer, tous les six mois, du lieu
que j’habite et de mon existence, afin que mes ennemis ne soient
jamais tentés de rien entreprendre de nouveau contre mon honneur, ma
liberté, ma personne et ma vie.
4o Que la croix de Saint-Louis que j’ai acquise au péril de ma vie
dans les combats, sièges et batailles où j’ai assisté, où j’ai été
blessée et employée, tant comme aide de camp du général que comme
capitaine de dragons et des volontaires de l’armée de Broglie, avec
un courage attesté par tous les généraux sous lesquels j’ai servi, ne
me sera jamais enlevée et que le droit de la porter sur quelque habit
que j’adopte me sera conservé jusqu’à la mort.
Et s’il m’était permis de joindre une demande respectueuse à ces
conditions, j’oserais observer qu’à l’instant où j’obéis à Sa
Majesté en me soumettant à quitter pour toujours mes habits d’homme
je vais me trouver dénuée 195 de tout, linge, habits, ajustements
convenables à mon sexe, et que je n’ai pas d’argent pour me procurer
seulement le plus nécessaire, M. de Beaumarchais sachant bien à qui
doit passer tout celui qu’il destine au paiement de partie de mes
dettes, dont je ne veux pas toucher un sou moi-même. En conséquence
et quoique je n’aie pas droit à de nouvelles bontés de Sa Majesté, je
ne laisserais pas de solliciter auprès d’elle la gratification d’une
somme quelconque pour acheter mon trousseau de fille, cette dépense
soudaine, extraordinaire et forcée ne venant point de mon fait, mais
uniquement de mon obéissance à ses ordres.
Et moi, Caron de Beaumarchais, toujours en la qualité ci-dessus
spécifiée, je laisse à ladite demoiselle d’Éon de Beaumont l’original
de la lettre si honorable que le feu roi lui a écrite de Versailles,
le 1er avril 1766, en lui accordant une pension de 12,000 livres,
en reconnaissance de sa fidélité et de ses services.
Je lui laisse, de plus, l’original de M. Durand, lesquelles pièces
ne pourraient lui être enlevées, de ma part, sans une dureté qui
répondrait mal aux intentions pleines de bonté et de justice que Sa
Majesté montre aujourd’hui pour la personne de ladite demoiselle
Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée d’Éon de Beaumont.
Quant à la croix de Saint-Louis qu’elle désire conserver avec le
droit de la porter sur ses habits de fille, j’avoue que, malgré
l’excès de bonté avec lequel Sa Majesté a daigné s’en rapporter à ma
prudence, à mon zèle et à mes lumières pour toutes les conditions à
imposer en cette affaire, je crains d’outrepasser les bornes de mes
pouvoirs en tranchant une question aussi délicate.
D’autre part, considérant que la croix de l’ordre royal et militaire
de Saint-Louis a toujours été regardée uniquement comme la preuve et
la récompense de la valeur guerrière, et que plusieurs officiers,
après avoir été décorés, ayant quitté l’habit et l’état militaire
pour 196 prendre ceux de prêtre ou de magistrat, ont conservé sur
les vêtements de leur nouvel état cette preuve honorable qu’ils
avaient dignement fait leur devoir dans un métier plus dangereux, je
ne crois pas qu’il y ait d’inconvénient à laisser la même liberté à
une fille valeureuse qui, ayant été élevée par ses parents sous des
habits virils, et ayant bravement rempli tous les devoirs périlleux
que le métier des armes impose, a pu ne connaître l’habit et l’état
abusifs sous lesquels on l’avait forcée à vivre, que lorsqu’il était
trop tard pour en changer, et n’est point coupable pour ne l’avoir
point fait jusqu’à ce jour.
Réfléchissant encore que le rare exemple de cette fille
extraordinaire sera peu imité par les personnes de son sexe, et ne
peut tirer à aucune conséquence; que si Jeanne d’Arc, qui sauva le
trône et les États de Charles VII en combattant sous des habits
d’homme, eût, pendant la guerre, obtenu, comme ladite demoiselle
d’Éon de Beaumont, quelques grâces ou ornements militaires, tels que
la croix de Saint-Louis, il n’y a pas d’apparence que, ses travaux
finis, le roi, en l’invitant à reprendre les habits de son sexe,
l’eût dépouillée et privée de l’honorable prix de sa valeur, ni
qu’aucun galant chevalier français eût cru cet ornement profané parce
qu’il ornait le sein et la parure d’une femme qui, dans le champ
d’honneur, s’était toujours montrée digne d’être un homme.
J’ose donc prendre sur moi, non en qualité de ministre d’un pouvoir
dont je crains d’abuser, mais comme un homme persuadé des principes
que je viens d’établir; je prends sur moi, dis-je, de laisser la
croix de Saint-Louis et la liberté de la porter sur ses habits de
fille à demoiselle Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée
d’Éon de Beaumont, sans que j’entende lier Sa Majesté par cet acte,
si elle désapprouvait ce point de ma conduite, promettant seulement,
en cas de difficulté, à ladite demoiselle d’Éon d’être son avocat
auprès de Sa Majesté, 197 et d’établir, s’il le faut, son droit à
cet égard, que je crois légitime, par une requête où je le ferais
valoir du plus fort de ma plume et du meilleur de mon cœur.
Quant à la demande que ladite demoiselle d’Éon de Beaumont fait au
roi d’une somme pour l’acquisition de son trousseau de fille, quoique
cet objet ne soit pas entré dans mes instructions, je ne laisserai
pas de le prendre en considération, parce qu’en effet cette dépense
est une suite nécessaire des ordres que je lui porte de reprendre les
habits de son sexe. Je lui alloue donc, pour l’achat de son trousseau
de fille, une somme de 2,000 écus, à condition qu’elle n’emportera
de Londres aucun de ses habits, armes et nul vêtement d’homme, afin
que le désir de les reprendre ne soit pas sans cesse aiguisé par leur
présence, consentant seulement qu’elle conserve un habit uniforme
complet du régiment où elle a servi, le casque, le sabre, les
pistolets et le fusil avec sa baïonnette, comme un souvenir de sa vie
passée, ou comme on conserve les dépouilles chéries d’un objet aimé
qui n’existe plus. Tout le reste me sera remis à Londres pour être
vendu, et l’argent employé selon le désir et les ordres de Sa Majesté.
Et cet acte a été fait double entre nous Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais et Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée
d’Éon de Beaumont, sous seing privé, en lui donnant de chaque part
toute la force et consentement dont il est susceptible et y avons
chacun apposé le cachet de nos armes, à Londres, le cinquième jour du
mois d’octobre 1775[172].
Signé: Caron de Beaumarchais.
D’Éon de Beaumont.
198
Le coffre-fort engagé chez lord Ferrers fut ouvert et d’Éon joignit au
dossier cinq cartons qu’il avait gardés jusque-là dissimulés sous son
plancher, bien cachetés et étiquetés: Papiers secrets à remettre au
roi seul.... «Je commençai, dit Beaumarchais qui raconte ce fait, à en
faire l’inventaire et les paraphai tous afin qu’on n’en pût soustraire
aucun; mais, pour m’assurer encore mieux que la suite entière y était
contenue, je les parcourais rapidement.»
D’Éon ne manqua pas de faire part de sa transformation à son ancien
chef. Le 5 décembre 1775, il écrivit au comte de Broglie:
Monsieur le Comte,
Il est temps de vous désabuser. Vous n’avez eu pour capitaine de
dragons et aide de camp en guerre et en politique que l’apparence
d’un homme. Je ne suis qu’une fille qui aurais parfaitement soutenu
mon rôle jusqu’à la mort si la politique et vos ennemis ne m’avaient
pas rendu la plus infortunée des filles, ainsi que vous le verrez par
les pièces ci-jointes...
Je suis avec respect, Monsieur le Comte, votre très humble et très
obéissant serviteur (sic).
Geneviève-Louise-Auguste d’Éon de Beaumont[173].
D’Éon témoigna sa reconnaissance à Beaumarchais en prolongeant une
mystification qui dut l’amuser infiniment et à laquelle l’auteur des
plus spirituelles 199 comédies qui eussent alors paru se prêtait avec
une naïveté stupéfiante. Beaumarchais devint de la part de d’Éon,
qui s’intitulait «sa petite dragonne», l’objet des cajoleries les
plus féminines. Reprenant le langage même de la Rosine du Barbier de
Séville, la prétendue chevalière lui écrivait: «Vous êtes fait pour
être aimé et je sens que mon plus affreux supplice serait de vous
haïr», et une autre fois: «Je ne croyais encore que rendre justice
à votre mérite; qu’admirer vos talents, votre générosité; je vous
aimais sans doute déjà! Mais cette situation était si neuve pour moi
que j’étais bien éloignée de croire que l’amour pût naître au milieu
du trouble et de la douleur. Jamais une âme sensible ne deviendrait
sensible à l’amour si l’amour ne se servait pas de la vertu même pour
le toucher.»
La mystification fut complète, et Beaumarchais, bien qu’il affectât
de prendre la chose en riant, se laissa complètement duper par des
déclarations dont il parut même quelque peu flatté:
Tout le monde me dit que cette fille est folle de moi, écrivait-il
à Vergennes; mais qui diable se fût imaginé que pour bien servir le
roi dans cette affaire il me fallût devenir galant chevalier autour
d’un capitaine de dragons? L’aventure me paraît si bouffonne que
j’ai toutes les peines du monde à reprendre mon sérieux pour achever
convenablement ce mémoire[174].
Bien que celui-ci s’en déclarât excédé, ce ne fut 200 pas
Beaumarchais, mais bien d’Éon, qui mit fin à ce marivaudage. La
coquetterie de la nouvelle chevalière n’allait pas, en effet,
jusqu’au mépris des questions d’argent. Aussi l’avidité de d’Éon se
trouva-t-elle aux prises avec la parcimonie de Beaumarchais lorsqu’il
s’agit de fixer le détail des sommes affectées au paiement des dettes.
Le ton de la correspondance des deux amoureux tourna bien vite à
l’aigre, et un entrefilet qui parut alors dans le Morning Post acheva
d’exaspérer d’Éon; il était ainsi libellé:
On prépare à la Cité une nouvelle police sur le sexe du chevalier
d’Éon. Les paris sont de sept à quatre pour femme contre homme, et un
seigneur bien connu dans ces sortes de négoces s’est engagé à faire
clairement élucider cette question avant l’expiration de quinze jours.
D’Éon ne manqua pas d’attribuer l’article à Beaumarchais, qu’il accusa
ouvertement d’avoir pris part avec Morande à des paris sur son sexe et
de s’être ainsi livré à de scandaleuses spéculations. En même temps
il provoqua Morande; mais le fieffé coquin, qui savait la réputation
de d’Éon à l’escrime, fut trop heureux de pouvoir prétendre que
l’honneur lui interdisait de se battre avec une femme; il ne jugea pas
déloyal toutefois de s’armer de sa plume et de publier sur la nouvelle
chevalière un libelle scandaleux qui fit quelque bruit. Harcelé par
l’importunité des Anglais que toute cette affaire avait provoqués à
reprendre leurs paris, d’Éon se résolut à écrire au comte de Vergennes
pour lui annoncer sa prochaine 201 arrivée en France. Il en reçut
d’ailleurs la réponse la plus encourageante:
J’ai reçu, Mademoiselle, la lettre que vous m’avez fait l’honneur
de m’écrire le 1er de ce mois. Si vous ne vous étiez pas livrée
à des impressions de défiance, que je suis persuadé que vous n’avez
pas puisées dans vos propres sentiments, il y a longtemps que vous
jouiriez dans votre patrie de la tranquillité qui doit aujourd’hui,
plus que jamais, faire l’objet de vos désirs. Si c’est sérieusement
que vous pensez à y revenir, les portes vous en seront encore
ouvertes. Vous connaissez les conditions qu’on y a mises: le silence
le plus absolu sur le passé, éviter de vous rencontrer avec les
personnes que vous voulez regarder comme les causes de vos malheurs,
et enfin reprendre les habits de votre sexe. La publicité qu’on vient
de lui donner en Angleterre ne peut plus vous permettre d’hésiter.
Vous n’ignorez pas, sans doute, que nos lois ne sont pas tolérantes
sur ces sortes de déguisements; il me reste à ajouter que si, après
avoir essayé du séjour de la France, vous ne vous y plaisiez pas, on
ne s’opposera pas à ce que vous vous retiriez où vous voudrez.
C’est par ordre du roi que je vous mande tout ce que dessus. J’ajoute
que le sauf-conduit qui vous a été remis vous suffit; ainsi rien ne
s’oppose au parti qu’il vous conviendra de prendre. Si vous vous
arrêtez au plus salutaire, je vous en féliciterai; sinon, je ne
pourrai que vous plaindre de n’avoir pas répondu à la bonté du maître
qui vous tend la main. Soyez sans inquiétude: une fois en France,
vous pourrez vous adresser directement à moi, sans le secours d’aucun
intermédiaire.
J’ai l’honneur...[175]
D’Éon, toutefois, ne voulut point partir sans tenter 202 de mettre
fin aux paris qui s’échangeaient sur son sexe. Il intenta devant lord
Mansfield une action en annulation de ces scandaleux contrats; mais
débouté de sa demande par un jugement qui considérait qu’il était une
femme, puisque le roi de France le regardait comme tel, il se borna à
interjeter appel et se hâta de revenir dans sa patrie.

Procédé Fillon - PLON-NOURRIT & Cie édit. - Imp. Ch. Wittmann
Charlotte-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée
d’Eon de Beaumont [↔]
203
CHAPITRE IX
Arrivée de la chevalière d’Éon en France.—Réception qui lui est
faite par la ville de Tonnerre.—Son installation à Versailles et sa
présentation à la Cour.—Impressions et réflexions de sa famille, de
ses amis, des contemporains.—Popularité de la «nouvelle héroïne» en
France et à l’étranger; ses succès dans le monde de la Cour et la
société de Paris; sa volumineuse correspondance.—Nouvelle querelle
avec Beaumarchais.—D’Éon, ayant quitté ses habits de femme, est
appréhendé par ordre du roi et conduit au château de Dijon.
Le 13 août 1777, d’Éon quittait Londres; dans la nuit même, il
s’embarquait pour la France. Quelle que fût sa joie de rentrer dans
sa patrie, d’embrasser sa vieille mère qu’il aimait tendrement, de
retrouver son foyer et sa fertile Bourgogne toute couverte de pampres,
il dut faire un cruel retour sur lui-même. Quinze ans s’étaient écoulés
depuis son dernier voyage: c’était alors le «petit d’Éon» du duc de
Nivernais, le protégé du comte de Choiseul qui apportait à Versailles
les ratifications d’un grand traité. Sa sacoche était moins gonflée de
papiers d’État que son cœur ne l’était d’illusions et d’espérances.
La fortune souriait à son ardente jeunesse; elle lui apportait de
brillantes récompenses et lui laissait entrevoir un avenir plein de
promesses. Il était accueilli à Versailles, distingué par la marquise
de Pompadour, 204 revenait à Londres la croix de Saint-Louis sur la
poitrine. Bientôt après il était fait ministre plénipotentiaire et
pouvait, grâce à un intérim, représenter lui-même son souverain pendant
deux mois de fastueuse ambassade. Il avait connu alors toute l’ivresse
du triomphe, mais aussitôt après toute la rancœur d’une disgrâce
subite. C’étaient d’abord les vexations et les dédains du comte de
Guerchy; puis une lutte pleine d’embûches et de ruses; le procès enfin
intenté par une suprême audace contre son rival et le scandale si
enivrant pour lui qu’avait été la condamnation de l’ambassadeur de
France. Dernier et périlleux triomphe qui soulevait l’indignation de
Paris et de Versailles, provoquait l’abandon du roi et, l’un après
l’autre, de tous ses protecteurs. Une pénible vie d’expédients avait
commencé alors, le réduisant peu à peu au désespoir et le poussant
enfin à cette métamorphose inspirée par l’illusion tenace du public,
longuement méditée et plus d’une fois rejetée avant d’être enfin admise.
Il revenait maintenant en vaincu. Le «petit d’Éon», tant choyé jadis
par le marquis de L’Hospital et que le duc de Choiseul avait présenté
comme un «fort joli garçon» au duc de Nivernais à cause de ses yeux
bleus au regard hardi et intelligent, de sa taille fine mais bien
proportionnée et souple, était devenu un homme de cinquante ans, à la
démarche brusque et à la voix éclatante; son menton volontaire était
tout piqué d’une barbe noire rasée à grand’peine. Il avait conservé
du dragon les manières et le genre d’esprit 205 en même temps que
l’uniforme, ce cher uniforme gris à parements et à soutaches rouges
qu’il n’avait jamais consenti à abandonner pendant son séjour à Londres
et qui avait fait de lui une silhouette aussi familière aux ministres
d’État qu’aux mobs de la Cité. Aussi témoignait-il d’une égale
répugnance à prendre l’habit féminin et à se résigner au genre de vie
de son nouveau sexe. Bien qu’il eût signé l’étrange convention qui lui
reconnaissait la qualité de femme, il aurait voulu demeurer homme au
moins par la mise et s’était efforcé de fléchir le comte de Broglie
sur la question du costume. Il affirmait que son vœu le plus cher
serait de «continuer sa route militaire dans l’armée, où par sa bonne
conduite il n’avait jamais scandalisé personne; mais en même temps se
déclarait prêt à obéir à toutes les volontés du roi, qu’elles fussent
de le laisser dans le monde en cornette et en jupe», ou même de «faire
couvrir sa tête dragonne du voile sacré dans un couvent de nonnes».
Qu’y avait-il de sincère dans l’emphase de ces déclarations? Dans un
dernier retour de bon sens, voyait-il partir avec casque, aigrette,
épaulette tous les rêves généreux de sa jeunesse follement sacrifiés
à une ambition désordonnée et désormais impuissante? Cet attachement
obstiné à l’uniforme, symbole de la carrière régulière et de la
discipline, marque-t-il chez lui un dernier regret de l’existence
honorable et sûre qu’en bornant ses désirs il n’eût pas manqué de
s’assurer? Peut-être; comme peut-être aussi n’y a-t-il là qu’une feinte
de plus, un moyen détourné de 206 prolonger l’équivoque et de donner
le change? La justice anglaise et la volonté du roi de France le font
femme; mais la répugnance qu’il montre à revêtir les habits de son
nouveau sexe est bien faite pour enraciner dans leur croyance ceux qui
veulent toujours le tenir pour un homme. En déclarant si haut qu’on lui
impose des habits de femme, d’Éon cherche évidemment à laisser entendre
que le sexe n’est pas plus de son goût que la mise, et que la volonté
du roi, à laquelle il doit se soumettre, ne peut cependant rien changer
à la nature. Il évite ainsi les difficultés du présent, tout en se
ménageant pour l’avenir une rentrée en scène sous son costume naturel.
Seul parmi les contemporains, Voltaire semble avoir démêlé au juste
toute cette intrigue dont il a fait justice par une comparaison assez
cruelle: «Je ne puis croire, écrit-il de Ferney au comte d’Argental,
que ce ou cette d’Éon ayant le menton garni d’une barbe noire très
épaisse et très piquante soit une femme. Je suis tenté de croire qu’il
a voulu pousser la singularité de ses aventures jusqu’à prétendre
changer de sexe pour se dérober à la vengeance de la maison de Guerchy,
comme Pourceaugnac s’habillait en femme pour se dérober à la justice et
aux apothicaires[176].»
D’ailleurs tout en protestant véhémentement contre la volonté du roi
qui changeait son casque en cornette, d’Éon s’ingéniait à tirer parti
de son nouveau rôle et à se faire de sa métamorphose une réclame 207
nouvelle et plus bruyante. Il a raconté lui-même comment, passant par
Saint-Denis avant de gagner Versailles, il s’était fait conduire par
Dom Boudier auprès de la supérieure du couvent des carmélites, qui
n’était autre que Mme Louise de France. Celle-ci, avant d’ouvrir le
rideau du parloir, aurait demandé comment était habillée Mlle d’Éon,
et sur la réponse qui lui fut faite qu’arrivant de Londres elle
«était encore en bottes et en uniforme, la supérieure aurait exhorté
son interlocuteur invisible à prendre les habits et à mener la vie
d’une fille chrétienne»[177]. Cependant, malgré les sages avis de
la vénérable princesse et en dépit de la condition formelle que lui
avait imposée Vergennes dans sa lettre du 12 juillet, ce ne fut qu’à
Versailles, où il arriva en dragon, que d’Éon finit par se soumettre et
obéir à l’ordre qui lui fut réitéré en ces termes:
DE PAR LE ROI
Il est ordonné à Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Thimothée
d’Éon de Beaumont de quitter l’habit uniforme des dragons qu’il a
coutume de porter et de reprendre les habillements de son sexe avec
défense de paraître dans le royaume sous d’autres habillements que
ceux convenables aux femmes.
Fait à Versailles, le 27 août 1777.
Signé: Louis Gravier de Vergennes[178].
Enfin, comme notre chevalier, à bout d’arguments, 208 objectait
encore au ministre que ses faibles ressources ne lui permettaient pas
de se commander un trousseau convenable, Marie-Antoinette, intéressée
aux infortunes d’une fille si intrépide, aurait ordonné, si l’on en
croit d’Éon et ses biographes, que ce trousseau serait confectionné à
ses frais. Il est certain, en tout cas, que Mlle Bertin, la célèbre
marchande de frivolités, couturière de la reine, eut la première le
singulier honneur d’emprisonner sous les jupes décentes et sévères
d’une vieille et noble demoiselle le bouillant capitaine de dragons.
Pour le reste de sa garde-robe, d’Éon s’adressa à Mlle Maillot,
marchande de modes plus modeste, et à Mme Barmant, «faiseuse de corps
flexibles et élastiques». Le sieur Brunet, perruquier, rue de la
Paroisse, fut chargé de lui accommoder une «coiffure à triple étage».
Alors que tant de mains agiles remuaient dentelles et rubans, ou
baleinaient les corsets qui allaient si fort incommoder d’Éon,
celui-ci, profitant des quelques jours où il pouvait encore porter
librement sa tunique de dragon, se hâta de prendre le coche qui devait
le mener auprès de sa vieille mère.
C’est le 2 septembre qu’il atteignit la petite cité bourguignonne. S’il
est vrai que les villes ont comme un visage où nous aimons à retrouver
le caractère des plus célèbres de leurs enfants, celle-ci semble
vouloir symboliser à merveille l’humeur de notre héros et en illustrer
le souvenir. Escarpée et montueuse, elle a dans son premier aspect un
air de hardiesse et de vivacité. D’une allure leste et décidée, 209
les rues grimpent comme à l’assaut du rocher d’où l’église Saint-Pierre
domine la ville qu’enserre la double ceinture du fleuve et d’une
rangée de collines agréablement boisées. Il semble qu’à se trouver
enfermée dans cette prison naturelle la petite ville ait pris cet air
de brusquerie et de mutinerie, cette allure un peu désordonnée et
incohérente, comme pour regimber contre la condition plaisante mais
étroite qui lui est faite.
Le soir où d’Éon y pénétra par le pont jeté sur le pétulant Armençon,
Tonnerre illuminée était toute en fête comme pour le retour d’un
fils ou plus exactement d’une fille prodigue. «Plus de douze cents
personnes, écrit d’Éon (non sans exagération probablement), sont
venues au-devant de moi avec canons, fusils et pistolets; ma mère,
quoique prévenue depuis si longtemps de mon retour positif en France,
ne pouvait le croire; elle est tombée sans connaissance en me voyant,
et ma nourrice fondait en larmes. Le lendemain toute la ville en corps
et en particulier est tombée chez moi avant que je fusse sortie du lit
où j’étais campée sans rideaux, sans miroirs, sans tapisseries et sans
sièges. Cette image de mon ancienne guerre est plus agréable à mes yeux
qu’un palais.» La joviale humeur dont faisait montre notre chevalier
ne semble pas lui avoir fait oublier le ton pitoyable qu’il sied
d’employer vis-à-vis d’un puissant correspondant dont on attend quelque
grâce, et il reprend avec non moins d’exagération: «J’ai trouvé dans un
cruel délabrement mon bien de patrimoine 210 consistant principalement
en vignes; on croirait que les hussards s’en sont emparés ainsi
que de ma maison, qui ressemble présentement au château du baron
de Tundertrumtrum; il n’y a plus que les portes et les fenêtres et
la rivière d’Armençon dans mes jardins. Mais si quelque chose peut
m’attacher à la vie, dit-il en terminant, c’est la joie de l’amitié
pure que mes compatriotes tant de la ville que des campagnes voisines,
depuis les plus grands jusqu’aux plus petits, ont bien voulu me
témoigner; d’eux-mêmes ils m’ont rendu les honneurs qui ne seraient dus
qu’à vous et à Mgr le comte de Maurepas si vous passiez par Tonnerre
pour aller dans vos terres et lui à son comté de Saint-Florentin[179].»
Cependant, malgré toute la joie qu’il éprouvait à se trouver au milieu
de sa famille et de ses compatriotes émerveillés de ses aventures et de
ses saillies, d’Éon n’était pas homme à se contenter longtemps d’une
célébrité provinciale; il avait probablement vérifié que nul n’est
prophète en son pays et qu’il fallait à la comédie qu’il allait jouer
une scène plus brillante et plus vaste, ainsi que des spectateurs
plus raffinés. Le ministre s’impatientait de ses retards à exécuter
les ordres du roi et Mlle Bertin lui affirmait que sa présence était
nécessaire pour les derniers essayages.
Il quitta aussitôt Tonnerre et se rendit à Versailles, d’où il se hâta
d’annoncer au comte de Vergennes 211 son retour, sa tardive obéissance
et les déboires qu’elle lui causait: «Il y a une dizaine de jours
que je suis de retour, disait-il au ministre, et il y en a huit que
je me suis conformée à vos intentions, comme Mlle Bertin a dû vous
le certifier à Fontainebleau. Je m’efforce dans la retraite de mon
appartement de m’habituer à mon triste sort. Depuis que j’ai quitté
mon uniforme et mon sabre, je suis aussi sot qu’un renard qui a perdu
sa queue. Je tâche de marcher avec des souliers pointus et de hauts
talons, mais j’ai manqué me casser le col plus d’une fois; au lieu de
faire la révérence, il m’est arrivé plus d’une fois d’ôter ma perruque
et ma garniture à triple étage, que je prenais pour mon chapeau ou pour
mon casque. Je ne ressemble pas mal à cette Catherine Petrovna que
Pierre le Grand enleva d’un corps de garde au siège de Derpt pour la
faire paraître à sa Cour avant de lui avoir fait apprendre à marcher
sur ses deux pieds de derrière[180].»
D’Éon, si l’on en croit ses contemporains, n’exagérait guère le
ridicule de son nouvel accoutrement, et si, comme il disait lui
même, il est malaisé de changer en un jour «d’habits, de chemise,
de logis, de résolution, d’avis, de langage, de couleur, de visage,
de mode, de note, de ton et de façon de faire», il se consolait du
moins par la singularité et l’affectation de la gêne physique qu’il
éprouvait. Toutefois il vivait retiré rue de Conti, à Versailles,
ayant refusé 212 courtoisement l’invitation du sieur Jamin, prêtre
de Fontainebleau, qui «sans avoir l’honneur d’être connu de lui» lui
offrait, «s’il venait à cette Cour à Fontainebleau, un logement des
plus agréables non par les plaisirs bruyants, mais par les promenades
en forêt», et assurait son hôte «qu’il serait à Fontainebleau sans
y être et maître de porter tel habillement qui lui conviendrait».
L’aimable invitation de cette «dévote personne» n’avait pas séduit
d’Éon, qui ne se sentait pas encore préparé à affronter la curiosité
de la Cour. Il tenait aussi à rendre ce coup de théâtre aussi éclatant
que possible et s’ingéniait à en assurer le succès. Quelques mois avant
son arrivée en France il avait déjà prié M. de La Chèvre d’être «son
précurseur», et celui-ci se vantait de lui avoir «préparé les voies
avec toute la chaleur imaginable et un zèle infatigable». Puis c’était
un sieur Dupré, tuteur des lords Dawn et Albergeney, qui, «chez le
chevalier Lambert et le vicomte de Choiseul, avait ouvert les yeux à
une infinité de gens».—«On n’en revient point encore de l’étonnement,
écrivait-il à d’Éon; on s’adresse à moi pour expliquer ce phénomène
politique, et si je n’étais pas aussi bien informé que je le suis,
je me trouverais souvent en défaut[181].» D’Éon, qui avait fini par
prendre goût à la mascarade, se multipliait, accréditant tous les
bruits, entre-bâillant sa porte à ses anciennes relations et annonçant
à ses protecteurs son retour en France:
213
J’apprends avec beaucoup de plaisir, Monsieur, lui répondait le
maréchal duc de Broglie, que vous êtes de retour en France; qu’il
vous est permis de goûter, dans votre famille, une tranquillité dont
vous êtes privé depuis longtemps. Je suis sensible aux sentiments
d’attachement que vous me témoignez et j’ai l’honneur d’être
très parfaitement, Monsieur, votre très humble et très obéissant
serviteur[182].
La comtesse douairière d’Ons-en-Bray, femme du président Legendre, qui
connaissait d’Éon depuis sa plus tendre enfance et fut naturellement
une des premières averties de son retour, ne pouvait sans sourire
s’imaginer sous les jupes de la chevalière celui qu’elle avait connu
étudiant en droit, escrimeur de premier ordre et galant secrétaire
d’ambassade; aussi accueillait-elle avec la plus grande incrédulité
cette nouvelle aventure dont le héros lui faisait un récit plaisant:
Votre lettre, lui répondait-elle, m’a fait rire aux larmes de
vos saillies et de satisfaction que vous ne m’ayez pas oubliée,
Mademoiselle ou Monsieur: je crains de mentir; j’avoue que j’apporte
encore de l’incrédulité à votre métamorphose et ne me permets pas
cependant pour détruire mon incrédulité de faire et même de dire
comme le bon apôtre Thomas. Mademoiselle, soit; j’en suis plus à mon
aise pour vous dire tout le plaisir que je me fais de vous revoir
quand vous serez de retour de Versailles. Je vous y adresse les
marques de reconnaissance de votre souvenir, ne sachant où reposent
à Paris vos appas femelles. Sont-ils parés de plumes? J’avoue qu’il
cadre dans mon esprit que la coiffure de Mars est la seule qui 214
vous convienne, en ayant la bravoure et les inclinations. J’ai avec
moi deux émules avec qui vous me demandez de refaire connaissance.
Ils le désirent plus que jamais, comme vous le croyez bien, et l’un
d’eux, un grand gars qui occupe votre ancien appartement, voudrait
sûrement le partager avec vous; mais en mère de famille qui doit
maintenir le bon ordre chez elle, il faudrait que je vous crusse tout
à fait dragon pour vous prier de faire société nuit et jour avec les
miens, qui s’en tiendront aux égards dus au beau sexe et vous gardent
des bâtons de sucre tors pour guérir votre poitrine des influences
de l’air dont elle est attaquée à présent. Ménagez-vous bien,
Mademoiselle, et sous quelque forme que vous deviez nous reparaître,
soyez persuadée que vous nous serez toujours très intéressante par le
souvenir des anciennes marques de votre attachement, qui vous répond
du mien pour toujours[183].
Aussi peu dupe de la métamorphose que Mme d’Ons-en-Bray, Mme Tercier,
veuve de l’ancien ministre secret de Louis XV qui avait si longtemps
correspondu avec d’Éon, s’étonnait de n’avoir point revu le chevalier
depuis son retour. Elle lui reprochait vivement de ne s’être point
encore présenté chez le comte de Broglie, tout en paraissant deviner la
cause de cette hésitation.
Je ne suis pas étonnée, lui écrivait-elle, que vous ayez tant de
peine à vous faire au nouveau déguisement que vous allez prendre, qui
vous gêne et vous embarrasse; il est bien fait pour cela; aux yeux de
vos amis, vous serez toujours un brave homme et un sujet fidèle; ils
vous aimeront également et chériront votre amitié n’importe 215 dans
quel habit. Je vous prie de me mettre à la tête de vos amies qui vous
sont le plus attachées, ainsi que toute ma famille, qui me charge de
vous faire mille tendres compliments[184].
Les aimables reproches de Mme Tercier et ses billets affectueux ne
réussirent pas à faire sortir d’Éon de sa tanière, où il se tenait,
disait-il, comme un «renard sans queue». Les sucres d’orge de Mme
d’Ons-en-Bray ne parvinrent point non plus à vaincre le rhume qui le
retenait avec tant d’à-propos au logis. Embarrassé dans ses jupes,
il demeurait invisible. Cependant, le bruit de son arrivée, de ses
aventures et de sa singulière métamorphose ne tarda pas à percer le
cercle assez restreint de ses amis intimes et parvint bientôt jusqu’aux
oreilles de la reine, qui voulut aussitôt voir cette moderne amazone:
«Elle envoya un valet de pied, raconte Mme Campan, dire à mon père de
conduire la chevalière chez elle; mon père pensa qu’il était de son
devoir d’aller d’abord prévenir son ministre du désir de Sa Majesté.
Le comte de Vergennes lui témoigna sa satisfaction sur la prudence
qu’il avait eue et lui dit de l’accompagner. Le ministre eut une
audience de quelques minutes. Sa Majesté sortit de son cabinet avec
lui et, trouvant mon père dans la pièce qui le précédait, voulut bien
lui exprimer le regret de l’avoir déplacé inutilement. Elle ajouta en
souriant que quelques mots que M. le comte de Vergennes venait de lui
216 dire l’avaient guérie pour toujours de la curiosité qu’elle avait
eue[185]».
Si d’Éon, en dépit de la reconnaissance officielle de son nouveau
sexe par le roi, ne fut pas reçu en audience particulière par la
reine, il ne manqua pas du moins de paraître à Versailles sous son
nouveau costume et à plusieurs reprises se trouva dans les galeries du
château sur le passage de Leurs Majestés. Ce fut le 21 octobre 1777,
jour de sainte Ursule, ainsi qu’il prend soin de le noter dévotement,
que le chevalier d’Éon, ancien capitaine de dragons, ancien ministre
plénipotentiaire de France à Londres, «reprit sa première robe
d’innocence pour paraître à Versailles, comme il avait été ordonné
par le roi et ses ministres»[186]. Ce fut un véritable événement que
l’apparition dans le cercle des courtisans de ce «phénomène politique»
ou, comme l’appelait fort irrévérencieusement Voltaire, «de cet
amphibie». Chacun voulut voir cette femme extraordinaire, simplement
vêtue, et qui pour tout joyau portait sur son corsage une croix de
Saint-Louis gagnée sur le champ de bataille aussi bien que dans les
ambassades.
Certains, qui avaient été ennemis de Choiseul, se plaisaient à faire
un succès à l’impétueux adversaire du comte de Guerchy; mais la
plupart, poussés par la curiosité, se montraient surtout intrigués par
cette merveille pathologique qui, avec toutes les apparences 217 et
les manières d’un homme, se déclarait cependant femme. Plusieurs des
contemporains n’ont pas manqué de peindre d’Éon tel qu’ils le virent
dans ces circonstances, et il faut avouer que le portrait n’est guère
flatté. «Elle a encore plus l’air d’être homme depuis qu’elle est
femme, assurait un journal de l’époque en parlant de notre chevalier.
En effet on ne peut croire du sexe féminin un individu qui se rase
et a de la barbe, qui est taillé et musclé en hercule, qui saute en
carrosse et en descend sans écuyer, qui monte les marches quatre à
quatre... Elle est en robe noire. Les cheveux sont coupés en rond
comme des cheveux d’abbé, placardés de pommade et de poudre, surmontés
d’une toque noire à la manière des dévotes. N’étant point habituée aux
talons étroits et hauts des femmes, elle continue d’en avoir de plats
et de ronds[187].» D’Éon, à qui cette feuille élégante et mondaine
refuse tous les dons du sexe aimable, n’avait pas voulu pousser trop
loin la mascarade; mais s’il n’avait pas usé du rouge qui faisait
encore fureur, il ne semblait pas non plus ignorer toute coquetterie
féminine, portant quelquefois des «robes noires en raz de Saint-Maur»,
plus souvent des «jupes en taffetas bleu de ciel avec petite rayure
puce» ou même «en croisé broché mordoré», comme le relatent les notes
de la demoiselle Maillot, sa couturière[188]. Mais en dépit 218 de
ses efforts pour parvenir à l’élégance, d’Éon demeurait parfaitement
ridicule: «La longue queue de sa robe, ses manchettes à triple étage»
contrastaient si malheureusement avec ses «attitudes et ses propos de
grenadier qu’il avait ainsi le ton de la plus mauvaise compagnie».
C’est en ces termes peu obligeants que s’exprime dans ses Mémoires,
écrits après la mort de d’Éon, Mme Campan qui, éclairée alors sur le
véritable sexe du chevalier, ne peut s’empêcher de montrer quelque
dépit d’avoir été mystifiée par un personnage qui eut avec sa famille
et avec elle-même des relations de la plus cordiale intimité[189].
Le jugement des contemporains sur l’extérieur de d’Éon, son
accoutrement et ses manières, est d’ailleurs aussi unanime que peu
flatteur. «Quelque simple, quelque prude que soit sa grande coiffe
noire, relate Grimm dans sa Correspondance littéraire à la date du
25 octobre 1777, il est difficile d’imaginer quelque chose de plus
extraordinaire et, s’il faut le dire, de plus indécent que Mlle d’Éon
en jupes[190].» L’abbé Georgel, secrétaire du fameux cardinal de Rohan,
fait d’un trait dans ses Mémoires le portrait de la chevalière, à qui
il a été présenté: «Ses vêtements, écrit-il, auxquels elle ne pouvait
s’habituer lui donnaient un air si gauche et si gêné qu’elle ne faisait
oublier ce désagrément que par les saillies 219 de son esprit et le
récit trop piquant de ses aventures[191].»
La métamorphose causa naturellement une grande stupéfaction; mais,
en dehors de quelques habitants de Tonnerre qui avaient de bonnes
raisons pour ne pas démordre de leur première opinion, ne trouva pas
d’incrédules obstinés. Le sexe désormais officiel de la chevalière
d’Éon fut accepté et respecté. L’intéressé se prêtait d’ailleurs à le
confirmer, et la contrainte même qu’il affectait ainsi que sa difficile
résignation à sa nouvelle existence n’étaient que des ruses plus
savantes pour cacher le subterfuge. Il trouvait à jouer cette comédie,
en outre de la sécurité de son séjour en France et le payement d’une
pension devenue son unique ressource, un regain de la popularité dont
il avait toujours été passionnément friand. Du jour de sa présentation
à la Cour, sa popularité ne fit que grandir, tourner même à cette
célébrité extraordinaire qui, à l’heure actuelle, préserve encore son
nom de l’oubli. Il devint alors l’objet de toutes les conversations, le
point de mire de toutes les curiosités. Les lettres de félicitations
les plus emphatiques, les témoignages d’admiration les plus excessifs
lui parvenaient d’inconnus émerveillés de sa surprenante odyssée,
tandis que ses anciens amis le harcelaient de billets du tour le plus
piquant. Parmi eux le duc de Chaulnes, qui l’avait connu à Londres au
plus fort de sa lutte avec Guerchy, lui 220 écrivait, faisant allusion
aux derniers événements:
Je ne sais pas si la chevalière d’Éon se ressouvient d’avoir vu le
chevalier d’Éon, entouré de grenadiers, imprimer en 1764, une page
de la Guerchiade sur la main du duc de Picquigny; mais je sais
que le duc de Chaulnes s’en ressouvient très bien, ainsi que de
tous les procédés honnêtes qu’il a reçus de lui ou d’elle, car on
ne sait plus où on en est. Je suis fort porté à croire par exemple
que votre ami commun trouvera beaucoup plus du chevalier dans la
chevalière qu’il ne voudrait y en trouver. Quant à moi qui ne suis
qu’un bonhomme, et votre voisin, je voudrais savoir le moment où je
pourrais aller discourir un moment avec Mademoiselle comme j’aurais
discouru avec Monsieur. Comme tout frais remué de la politique, vous
auriez peut-être des raisons pour préférer de venir chez moi: c’est
cinquante pas à faire d’un côté ou de l’autre, que j’aimerais mieux
vous épargner pourvu cependant que ce ne soit ni demain samedi, ni
lundi. Je vous demande pardon de ces si, de ces car, de ces mais,
très ridicules lorsqu’il s’agit de vous témoigner, Mademoiselle,
toute ma reconnaissance des bontés que vous m’avez marquées et de
l’amitié du feu chevalier. J’espère que vous rendrez justice à mon
respect[192].
Les amis de d’Éon ne savaient plus en effet «où ils en étaient», ni
quel style employer. La marquise Le Camus, dans un gracieux billet où
elle l’invitait à souper, trouvant «à coup sûr sa société désirable»,
débutait ainsi:
Brave Être, si j’avais votre facilité pour écrire, je ne serais pas
embarrassée au premier mot; j’ai donc cherché l’épithète qui me
paraît convenir le mieux à ce que vous 221 méritez; j’espère que
vous trouverez bon qu’en vous mettant au-dessus de tout sexe, je ne
vous en attribue aucun précisément, de peur de me tromper[193].
L’embarras était encore plus grand pour ceux qui avaient connu d’Éon
dès sa plus tendre jeunesse, et ne l’avaient jamais perdu de vue dans
son aventureuse carrière. C’était le cas de M. Genêt, premier commis
aux Affaires étrangères, père de Mme Campan, qui avouait avec une
aimable ironie que la langue française manquait d’épithètes appropriées
à la nouvelle condition de son étrange correspondant: «Pour ne point
donner aux cardinaux le Monseigneur qu’ils exigeraient, les ducs leur
écrivent en italien, et moi, être unique, dont je ne trouve le parangon
que dans les divinités des anciens, pour vous adresser la parole d’une
manière digne de vous et des sublimes mystères dont vous êtes l’emblème
je me servirai de la langue anglaise qui n’a point de genre déterminé
dans ses mots appellatifs et qui ne connaît guère de femelle qu’un chat
et un vaisseau, je vous dirai donc: My dear Friend, voulant dire: mon
cher ou ma chère amie, ad libitum[194].»
Ceux qui avaient rencontré le petit d’Éon chez le prince de Conti, dans
les beaux salons du Temple, alors qu’il cherchait fortune et carrière,
se rappelaient au souvenir de l’illustre chevalière et la suppliaient
de leur ouvrir sa porte. Lui, toujours imperturbable, 222 jouait en dilettante
son rôle de phénomène à la mode; il éprouvait une orgueilleuse
satisfaction à duper ses contemporains, ou tout au moins à exciter leur
étonnement. Il retenait les uns par le récit des événements auxquels
il avait été mêlé et captivait les autres par des anecdotes grivoises
débitées avec une verve intarissable. Ses manières singulières ne
lassaient pas; on le recherchait sans cesse et ses amis se séparaient
de lui à grand’peine.
Je pars avec le regret de n’avoir pu vous offrir mon tribut
d’admiration, lui écrivait le chevalier de Bonnard, sous-gouverneur
des enfants du duc de Chartres. Voilà une lettre de votre cousine,
qui est ma tante; je lui dirai dans trois jours que je vous ai
vue et que vous êtes au-dessus de votre grande réputation. Elle
se félicitera sans doute et s’affligera pour moi que je n’aie pas
profité plus souvent et plus longtemps d’un bonheur dont je sens tout
le prix[195].
L’intérêt et la curiosité qu’avait excités d’Éon par sa métamorphose
ne lui avaient pas valu seulement un succès de Cour. Le bruit de
l’aventure avait porté son nom bien au delà des frontières. En
Angleterre, où l’on s’était particulièrement attaché à le suivre,
l’opinion se montrait curieuse de tous les détails. Mlle Wilkes
qui, par un curieux billet que nous avons cité, avait elle-même dès
le premier jour demandé à d’Éon la «vérité sur son nouveau sexe»,
s’enquérait auprès du baron de Castille de l’accueil 223 fait à
Versailles à l’illustre chevalière, et M. de Castille, tout en
transmettant à d’Éon les «plus tendres compliments de la fille du
lord-maire», ajoutait: «J’ai répondu à Mlle Wilkes, ma chère héroïne;
j’interprète vos sentiments et je lui dis beaucoup de choses de vous
comme ayant été témoin de vos succès à la Cour[196]...»
En Allemagne, où cependant il n’avait fait que passer, on s’inquiétait
de d’Éon:
Monsieur, lui écrivait un libraire de Berlin, je ne suis pas en
droit de vous reprocher l’entier oubli d’un homme que vous avez
très honnêtement préconisé et qui vous est attaché depuis 1756;
mais ne cessant de m’intéresser à l’homme célèbre que je considère,
je ne puis me refuser au désir de savoir, s’il se peut et pour
autant que la franchise comportera, à quel clan des mortels je dois
la satisfaction d’avoir connu le chevalier d’Éon de Beaumont. Je
ne doute point que vous n’en deviniez la raison après ce qui se
trouve inséré dans notre dernière Gazette du Bas-Rhin, d’un ton
d’authenticité qui m’en impose enfin et contre lequel tout argument
me manque... Vous aurez toujours donné de la célébrité aux deux
genres et nous serons convaincus que votre conduite a été contenue
et admirable. Du beau sexe, dont certainement je ne suis pas, je
vous aurais l’obligation possible d’avoir appris, à ceux qui lui
sont injustement contraires, qu’il est aussi capable que le nôtre
des bonnes, difficiles et grandes choses, et du mien je ne cesserai
d’être avec autant d’estime que de considération soit de l’un, soit
de l’autre, le très humble, etc.[197].
224
De Londres et de Paris, les échos de l’aventure étaient venus piquer
au vif la sceptique curiosité «du vieux valétudinaire de Ferney»,
qui s’inquiétait auprès de son fidèle ami le comte d’Argental de la
véritable condition d’un hôte qui fort indiscrètement s’était annoncé
lui-même chez le glorieux patriarche des lettres françaises:
Je ne vous parlerai pas aujourd’hui, mon cher ange, des deux enfants
que j’ai faits dans ma quatre-vingt-quatrième année. Vous les
nourrirez s’ils vous plaisent, vous les laisserez mourir s’ils sont
contrefaits. Mais je veux absolument vous parler d’un monstre: c’est
de cet animal amphibie qui n’est ni fille ni garçon, qui est, dit-on,
habillé actuellement en fille, qui porte la croix de Saint-Louis
sur son corset et qui a, comme vous, 12,000 francs de pension. Tout
cela est-il bien vrai? Je ne crois pas que vous soyez de ses amis
s’il est de votre sexe, ni de ses amants s’il est de l’autre. Vous
êtes à portée plus que personne de m’expliquer ce mystère. Il ou
elle m’avait fait dire par un Anglais, de mes amis, qu’il ou elle
viendrait à Ferney, et j’en suis très embarrassé. Je vous demande en
grâce de me dire le mot de cette énigme[198].
Les anciens camarades de d’Éon aux dragons, bien qu’ils eussent partagé
sa vie à l’armée, n’avaient marqué aucune incrédulité particulière
et avaient fêté de bon cœur la nouvelle héroïne. Le baron de
Bréget, ancien capitaine au régiment d’Autichamp, et qui avait fait
campagne avec lui sur le Rhin, lui demandait, quelques mois après sa
métamorphose, s’il pouvait 225 «se flatter d’exister encore dans le
souvenir de son ancien frère d’armes»:
Il n’y a que huit jours, écrivait-il, que je suis revenu de la
campagne et je me hâte de faire demander à mon aimable camarade
la permission de l’aller chercher et lui présenter mes nouveaux
hommages. Je supplie très respectueusement mademoiselle d’Éon de me
laisser embrasser très franchement et de tout mon cœur mon ancien
camarade dragon[199].
Un autre capitaine au même régiment, le comte de Chambry, dans une
lettre écrite à la même époque, reprochait vivement à d’Éon de ne lui
avoir point annoncé son retour:
J’espère, ajoutait-il, retrouver dans mademoiselle la chevalière
d’Éon les mêmes sentiments d’amitié que dans l’ancien chevalier
d’Éon, capitaine de dragons, etc., etc... Quant à moi, sous quelque
forme qu’il paraisse, j’y prendrai toujours le même intérêt et suis
impatient de l’en assurer moi-même[200].
Le marquis d’Autichamp, colonel et propriétaire du régiment à la suite
duquel avait figuré d’Éon, avait été, l’un des premiers, averti par
celui-ci de sa transformation:
Il n’est que trop vrai, mon cher et brave colonel, lui avait écrit
le chevalier, qu’en ma nécessité d’obéir à l’ordre du roi et de la
loi j’ai repris ma robe pour l’édification des esprits faibles qui,
en moi, ont été scandalisés de la liberté grande d’une jeune fille
d’avoir été, par 226 sagesse, cacher et retrancher sa vertu dans
votre régiment de dragons pour qu’elle soit plus en sûreté. Ma ruse
de guerre ayant été découverte, prouvée et manifestée en justice,
le monde fut surpris de me trouver fille. En conséquence, la Cour,
pour me punir ou me récompenser, me fait finir ma vie comme je l’ai
commencée en devenant cornette[201].
Et le galant colonel de répondre aussitôt:
Je vous ai été fort attaché en votre qualité de capitaine de dragons;
la nouvelle forme que vous avez prise n’a jamais été un tort
vis-à-vis de moi, et quoiqu’elle m’impose la loi de vous respecter
beaucoup plus, elle ne m’ôte pas le plaisir de vous aimer, et c’est,
je vous assure, avec empressement que je vous offre l’assurance de
ces deux sentiments[202].
Les mêmes sentiments de bienveillante crédulité, les mêmes formules
affectueuses se retrouvent sous la plume de tous les anciens camarades
de régiment de d’Éon et font foi du bon souvenir qu’il avait laissé
parmi eux. Le cas leur avait paru croyable, bien qu’extraordinaire; de
plus, il n’était pas sans précédents, ainsi que le baron de Castille
s’empressait d’en informer d’Éon dans la lettre suivante:
Mme de Laubespin vous parlera du dragon-fille du régiment de
Belzunce; il est encore venu ce matin chez moi, il a le plus grand
empressement de vous être présenté, et je suis convaincu qu’il vous
intéressera; il a vingt-sept ans, il a près de cinq pieds cinq
pouces, une figure agréable, de très beaux cheveux et bien plantés;
il est bas officier aux Invalides, et porte les marques de vétérance.
M. le 227 duc d’Aiguillon lui donna les deux épées en croix quand
il eut été reconnu, et il le fut à l’occasion d’un coup d’épée qu’il
avait reçu à la hanche. Il fut présenté au feu roi, qui lui fit
beaucoup de questions, il fut présenté au feu roi par M. le prince de
Beauvau à la chasse de Fontainebleau[203].
Il semble d’ailleurs que l’aventure de l’illustre chevalière ait
tourné la tête de plusieurs femmes. D’Éon, dans ses papiers, a composé
tout un dossier des lettres que lui écrivirent des «filles de la plus
grande taille», désireuses «de changer leur sexe en apparence», afin de
pouvoir s’engager et servir à l’armée. Il y avait joint également les
épîtres que lui avaient dédiées quelques insensés, troublés, comme il
arrive fréquemment, par la révélation d’une personnalité retentissante.
Ce bizarre recueil, non moins que les billets de ses amis, de ses
anciens camarades, et des inconnus eux-mêmes qui lui écrivirent dès
son retour, ne laissent aucun doute sur l’étonnement que suscita sa
métamorphose et sur la stupéfiante crédulité avec laquelle elle fut
généralement acceptée.
Tandis que d’Éon trouvait ainsi, dans le bruit d’un accueil inespéré,
d’incessantes satisfactions pour son incommensurable vanité, les
ministres, qui s’étaient flattés de le voir reprendre, avec le sexe
qu’il avait avoué et le costume qu’on lui avait imposé, toute la
décence et la considération désirables, durent s’avouer 228 qu’ils
s’étaient étrangement trompés. Non seulement d’Éon, sous son nouveau
costume, attirait l’attention de tous; mais, ne pouvant s’habituer
aux coiffes, aux corsets et aux jupes, commençait, malgré la défense
qui lui en avait été faite, à s’habiller de nouveau fréquemment en
homme. Afin de prévenir tout nouveau scandale, M. de Vergennes résolut
de donner à l’extravagante chevalière un tuteur vigilant. M. Genêt,
premier commis au ministère des Affaires étrangères, compatriote et
ami de d’Éon, sembla tout désigné pour cette tâche difficile. Dans sa
propriété du Petit-Montreuil, tout voisine de la demeure du comte de
Polignac et de l’hôtel de M. de Vergennes, il possédait justement un
coquet pavillon où la pétulante chevalière pourrait se résigner au
calme que l’on exigeait d’elle. Elle devait y trouver dans la compagnie
de Mme Genêt et de ses filles, attachées au service de la reine, un
milieu moins austère que celui des dames Urselines, Bernardines,
Augustines, au sein desquelles elle avait offert de se retirer dans
l’allégresse de son retour. Aussi Genêt la pressait-il de rejoindre sa
famille, faisant réparer en toute hâte le logement de son «illustre
héroïne». L’hiver s’annonçait rigoureux et il tentait de la séduire
par la promesse de «chambres très chaudes» dans sa petite maison. «Que
vous me déplaisez, disait-il, dans le trou où vous êtes![204]» Cette
affectueuse insistance ne réussit pas à vaincre aisément la répugnance
de 229 d’Éon à subir une tutelle où il avait démêlé la volonté du
ministre; aussi se fit-il prier longtemps et il ne se décida que vers
le milieu de décembre à accepter l’hospitalité de l’aimable famille
bourguignonne. Son hôte l’accueillit avec joie et cordialité.
A dater de ce jour, les liens d’intimité qui unissent d’Éon aux Genêt,
aux Campan, se resserrent naturellement et donnent lieu à un échange de
bons procédés quotidiens dont les papiers de d’Éon nous ont conservé
les traces. Un jour, c’est M. Campan qui le remercie très pompeusement
d’un Essai d’histoire naturelle qu’il trouve «plaisamment imaginé, mais
un peu long»; d’Éon en effet n’était guère ami de la concision. Une
autre fois, c’est Mme Campan qui, dans un style plein d’affectation,
lui demande pour les princes un simple remède contre la surdité. La
femme de chambre de la reine, qui n’a pas encore contre d’Éon le grief
de savoir qu’elle a été mystifiée par lui, l’accable d’invitations. «Le
24 avril 1778, toute la famille Genêt, lui écrit-elle, vient passer la
soirée chez M. Campan. Elle serait comblée si Mlle d’Éon voulait bien
leur faire l’honneur de les y accompagner; elle n’y souperait qu’avec
ses bons amis et est priée par Mme Campan d’y venir sans le moindre
cérémonial[205].»
D’Éon est de toutes les parties qu’organisent les femmes de chambre
de la reine. Se refuse-t-il à les accompagner, Sophie Genêt, de
son écriture d’écolière, 230 lui fait dépêcher un billet pour le
supplier de revenir sur sa détermination; elle redoute cependant de
l’importuner, «ce qui verserait la tristesse parmi ses hôtes». Se
déplace-t-on pour aller visiter l’oncle Genêt de Charmontaut dans sa
jolie terre de Mainville, près Melun, qu’on en avertit aussitôt d’Éon,
qui devant tant d’insistance se laisse convaincre. Il parvient si bien
à séduire le modeste châtelain que celui-ci ne trouve point de formules
assez flatteuses pour le remercier de sa venue, ni de termes assez
humbles pour s’excuser de sa frugale hospitalité:
Je me regarde à présent au nombre des heureux mortels. J’ai eu le
plaisir de partager avec mon frère la même satisfaction que lui de ce
que vous m’avez fait l’honneur de me venir voir à mon petit ermitage,
tout comme à lui d’habiter sa campagne du Petit-Montreuil. Et pour
comble de satisfaction vous m’avez fait l’amitié et l’honnêteté
de m’y écrire. Votre lettre, mademoiselle, me sera tant que je
vivrai précieuse. Puisque votre santé s’est rétablie à Mainville,
je souhaite que ma petite chaumière vous soit agréable pour venir
vous y récréer et conserver une santé qui est chère à ceux qui ont
l’honneur d’être connus de vous et qui connaissent vos mérites. Je
me félicite d’avoir donné une fête à la chevalière d’Éon au même
moment que nous gagnions la victoire sur les Anglais; cela nous a
fait un divertissement très heureux et agréable, qui n’a pas été
troublé par aucune triste nouvelle. Mon sort est bien changé à
présent, mademoiselle; d’agréable qu’il était pendant que j’étais
en l’honneur de votre compagnie, il est maintenant aussi isolé que
ce bel arbre qui est au puits d’Antin. Pour me consoler et secouer
ma mélancolie, je ne tarderai pas à partir pour Versailles, 231 où
j’aurai l’honneur de vous aller voir[206].
D’Éon se montra toujours reconnaissant envers cette famille qui l’avait
si cordialement accueilli. Très fidèle dans ses amitiés il était,
malgré ses modestes moyens, également généreux. De Tonnerre il ne
cessait de leur envoyer des produits de sa riche Bourgogne, des truffes
alors si renommées et peu connues encore, des chevreuils qu’il avait
tués et surtout du vin de son terroir, dont M. Amelot, le comte de
Vergennes et le duc de Chaulnes s’avouaient particulièrement friands.
J’ai reçu, ma chère amie, lui écrivait Genêt, deux délicieux présents
de votre part en huit jours, tous deux faits pour nous réjouir le
cœur. C’est votre portrait en dragon qui m’a été envoyé par M.
Bradel et dont je suis fort content, et une feuillette de votre
excellent vin. Nous mettrons le portrait sur la table, en buvant le
vin à votre santé. Vous savez combien nous vous sommes dévoués et
comptons sur votre amitié parce que nous connaissons votre excellent
cœur.
Mieux que par ces menues attentions, d’Éon sut prouver son attachement
à ses aimables compatriotes, car, avec la prudence et l’autorité d’une
douairière qui se complaît à son rôle, il sut faire le bonheur d’une de
ses jeunes amies, Adélaïde Genêt, si l’on en croit la lettre qu’elle
lui écrivait au lendemain de son mariage avec M. Auguié, «heureux
ouvrage qui fut comblé par la reine, dit 232 M. Genêt au delà de
toutes les espérances[207].»
D’Éon dut trouver cette vie patriarcale bien monotone, et après
quelques semaines, «le charme du Petit-Montreuil sous la neige»
s’évanouit à ses yeux. Il ne rêvait que bruit, succès et publicité,
et se soustrayait avec peine à l’attention de ceux qui désiraient
connaître un aussi singulier prodige. Sa renommée était alors
universelle et l’on recherchait de tous côtés cette héroïne, aussi
modeste qu’intrépide, à laquelle ses contemporains ne savaient comparer
que Jeanne d’Arc ou Jeanne Hachette.
D’Éon avait trop ardemment désiré et savamment préparé cette apothéose
pour n’y point figurer; aussi ne manquait-il aucune occasion de
s’évader de sa retraite et, comme Genêt lui en faisait encore la
remarque, «il tenait à Paris comme un petit maître». Parmi les
anciennes relations qu’il y avait retrouvées, la comtesse de Boufflers,
la spirituelle amie du prince de Conti, «l’idole» du Temple, ainsi que
l’avait surnommée Mme du Deffant, avait une des premières désiré revoir
l’ancien ministre plénipotentiaire, aux côtés de qui elle avait fait à
Londres les honneurs de l’ambassade:
M. d’Usson m’a dit que vous n’aviez point oublié, Mademoiselle, que
nous avons eu le plaisir de vous voir en Angleterre et que vous
paraissiez souhaiter de renouveler la connaissance que nous avons
faite avec vous; j’ai de mon côté le plus grand empressement de
revoir une personne qui sera célèbre à jamais par les événements
de 233 sa vie et par beaucoup de grandes qualités, et je serai
charmée si vous voulez bien venir dîner avec moi vendredi prochain au
Temple[208].
C’est qu’en effet l’audacieux aventurier était devenu l’hôte de choix,
le personnage à la mode dont on se disputait la présence aux jours de
réception. Sur les petits billets d’invitation, que d’Éon conserva
religieusement, figurent les noms des femmes les plus spirituelles et
des plus illustres personnages. Les salons les plus fermés s’ouvraient
fréquemment devant ce phénomène, et ce n’est pas un de ces indices
les moins curieux de la légèreté de ce siècle que cette crédulité
enfantine dans le milieu où l’on faisait le plus ouvertement parade de
scepticisme. Ces esprits raffinés et blasés, devenus comme étrangers
aux préoccupations sérieuses de la vie, insensibles aux découvertes
de la science, fermés aux charmes des chefs-d’œuvre, ne prisaient
plus que l’extraordinaire. Pendant qu’autour d’eux se préparait un
formidable bouleversement social dont ils ne savaient discerner
les indices, hommes de Cour sans emploi et officiers sans régiment
faisaient pour le divertissement des dames qui tenaient «bureau
d’esprit», comme on disait alors, assaut de bons mots, concours de
piquantes anecdotes. D’Éon excellait dans ce genre; son imagination, sa
verve intarissable, ses saillies inattendues faisaient oublier le sel
un peu gros de ses dragonnades trop fréquentes. 234 Il attirait enfin
par une singularité dont il entretenait soigneusement le mystère. On
allait jusqu’à lui savoir gré de la modestie admirablement jouée qui le
poussait à ne se produire qu’en très petit comité. Il se targuait, en
effet, de fuir les curieux et d’être si indifférent à l’attention qu’il
provoquait que ses amis devaient le supplier de remplir ses engagements:
«Le duc de Luynes brûle d’envie de vous voir ainsi que son beau-père,
M. de Laval, lui écrivait son ami Reine. Il m’a dit qu’il vous avait
prié de manger de sa soupe; puisque vous êtes à Paris, allez donc voir
Mme la Duchesse, à qui vous voudrez bien présenter nos hommages[209].»
S’il peut paraître étrange de le voir très aimablement prié chez le
comte de La Rochefoucauld; chez M. de Villaine, le marquis de Chaponay;
chez la vicomtesse de Breteuil; de le voir devenir l’hôte assidu de la
duchesse de Montmorency et du vicomte de La Ferté, n’est-il pas plus
curieux encore de retrouver cet étrange personnage dans les salons
d’une bourgeoisie élevée, d’une noblesse de robe, qui formaient alors
une société particulièrement cultivée et sceptique? Il éveille la même
curiosité parmi ces graves personnages: les Talon, les Fraguier, les
Tascher, les Tanlay, les Nicolaï, les d’Aguesseau, qui se le disputent
à l’envi et l’envoient chercher dans leurs carrosses.
235
Un jour, c’est le comte de Polignac qui le «prie de venir manger à la
dragonne un morceau dans son galetas des Tuileries. La chevalière y
trouvera, dit-il, du bon café précédé par des côtelettes et un homme de
sa connaissance qu’elle désire voir. Le tout se passera à la minute et
sans bruit[210]». Une autre fois, c’est le baron de Castille qui lui
fait part du désir qu’avait le fameux cardinal de Rohan de connaître la
chevalière.
«J’ai donné, lui mande-t-il, votre adresse à M. le prince Louis; il
doit ou aller chez vous pendant que vous serez à Versailles, ou vous
prier de passer chez lui; le peu d’instant dont il a eu à disposer à
Paris l’a empêché d’aller vous chercher[211].» Le mercredi 11 mars
1778, comme il prend soin de le noter sur un agenda méticuleusement
tenu au jour le jour, d’Éon déjeune chez Voltaire. Sa journée commencée
dans un si curieux tête-à-tête est singulièrement chargée, car il dîne
chez la comtesse de Béarn et revient souper chez Mme de Marchais. A
ce moment il a déjà abandonné le Petit-Montreuil pour se fixer rue de
Conti, où il pourra mener plus aisément la vie mondaine à laquelle il
ne peut se soustraire et dont il est d’ailleurs enchanté. L’accueil est
aussi flatteur à la Cour qu’à la ville. Il assiste aux représentations
de gala dans la loge de Mme de Marchais, femme de l’ancien premier
valet de chambre de Louis XV, 236 qu’il admirait particulièrement, à
en juger par le portrait qu’il nous a laissé d’elle: «C’est, dit-il,
une petite femme, aimable, pleine d’esprit, très jolie, bien faite,
avec des cheveux blonds qui lui tombent jusque sur les talons, de
grands yeux bleus et des dents blanches comme de l’ivoire; elle était,
continue-t-il, l’amie complaisante de la feue marquise de Pompadour.
C’est une belle de nuit qui passe sa journée dans le bain, à lire ou à
écrire, ou dans son boudoir ou à sa toilette. On ne la voit que le soir
ou après le spectacle de la Cour, alors que la compagnie s’assemble
chez elle pour y souper délicieusement[212].»
D’Éon, comme l’indique son petit agenda, semblait en effet n’admirer
pas moins la charmante maîtresse de maison qu’il n’estimait sa table.
Il passait la plupart de ses soirées chez elle, et si par hasard il
n’y paraissait pas, tout ce petit cercle qu’il animait de sa gaîté
s’inquiétait de sa santé. Apprend-on qu’il est malade, aussitôt
toutes ces dames se pressent chez lui: «La princesse Sapieha, en
s’informant de ses nouvelles, lui envoie le sirop de calebasse dont
elle lui a parlé: elle désire sincèrement qu’il puisse contribuer à sa
guérison[213].» Puis c’est le marquis de Comeiras, maréchal des camps
et armées du roi, qui se fait l’interprète des intimes de d’Éon et
traduit leurs anxiétés: 237 /#
Moins étonné qu’affligé j’appris hier, cher camarade, que vous aviez
mal à la gorge; que vous vous étiez fait excuser chez Mme de Brige,
d’où l’on vous avait envoyé du bouillon. Je racontai tout cela hier au
soir à Mme de Marchais: aussitôt elle voulait vous envoyer un potage,
une autre un consommé... Mme la princesse de Montbarrey désire fort
vous voir chez elle; j’ai promis de vous faire la proposition; l’on me
fait un honneur infini, mon cher et ancien camarade, l’on croit que je
dispose de vous; le beau sexe, qui veut voir son héroïne, m’en parle
sans cesse[214]...
La popularité de d’Éon était en effet à son comble; il s’efforçait
d’ailleurs d’entretenir par tous les moyens possibles une renommée
dont il était friand et songeait à laisser à la postérité le récit
de ses hauts faits. Il composait de burlesques recueils d’anecdotes
sur la reprise de ses habits féminins, ou de très graves mémoires
sur les négociations auxquelles il avait été mêlé. Tous ces projets,
qui forment de volumineux dossiers, ne furent pas publiés et d’Éon
se contenta de livrer à l’admiration de ses contemporains la Vie
militaire, politique et privée de Mlle d’Éon, connue jusqu’en 1777
sous le nom de chevalier d’Éon[215]. Il en rédigea lui-même la
plus grande partie, qui parut dans les Fastes militaires; mais la
signature de M. de la Fortelle qui figurait sur l’opuscule permit 238
au chevalier de se décerner toutes les louanges dont il se jugeait
digne, en toute sincérité et sans violer les lois de la modestie! Trois
mille exemplaires en furent tirés à part, vendus en Angleterre et
distribués à des amis, auxquels le donateur envoyait aussi son portrait
à l’eau-forte ou au burin.
Tous les graveurs de l’époque s’offraient à l’envi à reproduire les
traits de l’héroïque chevalière, qui d’ailleurs se gardait bien de leur
refuser une pareille faveur. D’Éon fut portraituré en dragon, avec
le casque ou le tricorne; en buste, en pied ou à cheval; en femme,
avantagée d’une abondante poitrine, parée de dentelles et coiffée d’un
bonnet fort coquet, ou en douairière serrée dans un sévère corsage noir
où brille la croix de Saint-Louis. D’autres estampes le représentent
en Minerve, casquée d’une sorte de morion qui n’a rien d’antique et où
le hibou, cimier de la déesse, a été remplacé par le coq, qui figure
dans les armes des d’Éon. Mais le moindre intérêt n’est pas dans les
attributs, les légendes et les devises qui entourent ces portraits.
D’Éon, qui se piquait de lettres et de sciences autant que de bravoure,
sut en effet emprunter à l’antiquité les plus pompeux de ses trophées
et inscrire audacieusement autour de sa propre image les vers que
les poètes latins avaient consacrés aux plus redoutables héros, aux
guerrières les plus farouches de Rome ou de la Grèce. Bien que fort
nombreuses et fort variées, ces estampes eurent un grand succès et sont
encore aujourd’hui très recherchées.
239
On les trouvait chez le sieur Bradel, peintre, ou dans la boutique
d’Esnault et Rapilly; mais le héros lui-même se chargeait de les
vulgariser avec la plus extrême libéralité. Il en avait fait graver une
pour ses anciens camarades: «Dédiée aux dragons», disait la légende, et
ceux-ci se plaisaient à considérer les traits de l’illustre capitaine
et à puiser dans ses hauts faits de nobles enseignements. C’est du
moins ce qu’assurait l’aumônier du régiment des Dragons de Ségur,
l’abbé Moullet de Monbar:
Je n’ai pas, Mademoiselle, écrivait-il à d’Éon, le bonheur de vous
voir; mais je jouis de celui de voir votre image qui attire des
visites à ma chambre, où elle est le seul embellissement. Cette image
pénètre mon âme lorsque je la fixe; j’y vois une héroïne supérieure
aux amazones et à toutes les femmes célèbres de l’antiquité, un
dragon plein de fierté et d’audace, un ministre fidèle et patriote
qui fait respecter son prince et sa personne; j’y vois un personnage
illustre et intéressant qui formera pour les siècles futurs un
phénomène qui les embarrassera[216].
Écrits d’ordinaire d’un style moins emphatique, les remerciements des
hauts personnages n’étaient ni moins empressés ni moins flatteurs. Le
chancelier Maupeou lui envoyait «les témoignages de sa sensibilité»:
«Cette attention de votre part m’a fait grand plaisir; soyez persuadée,
Mademoiselle, qu’on ne peut rien ajouter à l’estime et à tous les
sentiments que j’ai pour vous[217].»
240
Le duc de Guines, ancien ambassadeur de France à Londres, accueillait
«avec beaucoup de reconnaissance le présent»[218] qu’il avait
sollicité de d’Éon par l’intermédiaire de la comtesse de Broglie, sa
belle-sœur; quant aux amis de notre chevalier, ils ne se lassaient
point des gravures dont celui-ci les accablait et ils louaient à l’envi
les grâces du pastel de Latour ou l’allure audacieuse de l’estampe
de Bradel. «Votre gravure est superbe, s’écriait Genêt, surtout par
les yeux, qui sont ceux de Bellone même. Le regard est aussi fier que
si vous aviez Beaumarchais en présence. Je lui défie de le soutenir.
La vérité et l’honnêteté brillent, et c’est la foudre faite pour
l’écraser[219].»
Depuis que la mort l’avait débarrassé de Guerchy, d’Éon avait en effet
trouvé en Beaumarchais un adversaire nouveau et non moins obsédant.
Leur querelle était née, comme jadis celle dont l’ambassadeur avait été
victime, d’une question d’intérêt, d’Éon n’hésitant pas à proclamer
hautement qu’il avait été dupé par Beaumarchais et que celui-ci, au
moment de leur transaction, avait mis dans sa poche une somme de
soixante mille livres qui devait être affectée à désintéresser lord
Ferrers. Cette allégation, que d’Éon allait colportant de tous côtés,
fut accueillie avec satisfaction parmi les ennemis de l’auteur du
Barbier de Séville et ceux-ci, comme il est naturel, étaient fort
241 nombreux; le récit complaisamment fait du ridicule roman d’amour
dans lequel son adversaire s’était un moment laissé entraîner mit
en joie la Cour et la ville. Pour une fois, le célèbre pamphlétaire
dut reconnaître qu’il n’avait pas les rieurs de son côté, et celui
qui s’était si souvent diverti aux dépens de ses contemporains eut
à supporter leurs railleries. Il s’irrita de certaines comédies que
l’on improvisait alors dans les salons, et des mascarades, inspirées
par le carnaval, qui le plaçaient en un amoureux tête-à-tête avec la
virile chevalière. Le spectacle était d’autant plus piquant que d’Éon
se faisait un plaisir de jouer lui-même son propre rôle, celui de
l’ingénue, en face d’un Beaumarchais improvisé. Ainsi mis en scène, et
accusé d’un aveuglement si incroyable, Beaumarchais perdit contenance
et se fâcha. Ne sachant que répondre, il se plaignit et écrivit au
ministre, M. de Vergennes, pour le prier de le laver des calomnies que
l’on répandait publiquement sur son compte:
Tant que la demoiselle d’Éon s’est contentée de vous écrire,
disait-il, ou de vous faire dire du mal de moi relativement aux
services que je lui ai rendus en Angleterre, vous m’avez vu mépriser
son ingratitude en silence et gémir de sa folie sans m’en plaindre;
j’ai dissimulé ses fautes en les rejetant sur la faiblesse d’un
sexe à qui l’on peut tout pardonner... Aujourd’hui, ce n’est plus
de loin ni par écrit qu’elle essaye de me nuire: c’est à Paris
dans les plus grandes maisons où la curiosité la fait admettre un
moment; c’est à table et devant les valets qu’elle pousse la noirceur
jusqu’à m’accuser d’avoir à mon profit retenu 60,000 livres qui lui
appartenaient dans le fonds que j’étais, dit-elle, chargé de lui
remettre... Je ne demande 242 point que la demoiselle d’Éon soit
punie, je lui pardonne; mais je supplie Sa Majesté de permettre au
moins que ma justification soit aussi publique que l’offense qui
m’est faite[220].
Beaumarchais n’eut aucune peine à obtenir la justification qu’il
sollicitait du ministre. M. de Vergennes lui fit parvenir une lettre
des plus flatteuses, avec la permission de la publier. Il y rendait
hommage à la parfaite délicatesse du négociateur, qui, «sans former
aucune répétition pour ses frais personnels, n’avait, dans cette
affaire, laissé apercevoir d’autre intérêt que celui de faciliter à la
demoiselle d’Éon les moyens de rentrer dans sa patrie».
Beaumarchais fut trop satisfait de ce témoignage pour ne point se
hâter de le publier. En guise d’envoi, il y joignit une lettre ouverte
adressée à d’Éon, où il se montrait dédaigneusement généreux:
Qu’un ménagement si peu mérité, écrivait-il, vous fasse rentrer en
vous-même et vous rende au moins plus modérée, puisque mes services
accumulés n’ont pu vous inspirer ni justice ni reconnaissance. Cela
est essentiel à votre repos; croyez-en celui qui vous pardonne, mais
qui regretterait infiniment de vous avoir connue, si l’on pouvait se
repentir d’avoir obligé l’ingratitude même[221].
En publiant ces documents, l’auteur du Barbier de Séville n’avait
cherché qu’à se justifier devant le public, car c’eût été bien mal
connaître son adversaire 243 que d’espérer le réduire aussi aisément
au silence. Provoqué devant le tribunal de l’opinion, dont en toute
occasion il avait recherché les suffrages; piqué au vif par le dédain
de Beaumarchais, humilié par les termes désobligeants du ministre,
d’Éon répondit du tac au tac avec une malicieuse ironie. Son épître,
qui était adressée au comte de Vergennes, est trop longue pour qu’il
soit possible de la citer tout entière; mais quelques passages
suffiront à en donner le ton:
Monseigneur,
A présent que j’ai obéi aux ordres du roi en reprenant mes habits de
fille le jour de sainte Ursule; aujourd’hui que je vis tranquille et
dans le silence, sous l’uniforme des vestales; que j’ai entièrement
oublié Caron et sa barque, quelle est ma surprise en recevant une
épître dudit sieur Caron à laquelle est jointe la copie certifiée
conforme aux originaux d’une lettre qu’il dit vous avoir adressée et
de votre réponse.
Quoique je sache mon Beaumarchais par cœur, j’avoue, Monseigneur,
que son imposture et la manière dont il s’y prend pour l’accréditer
m’ont encore étonnée.
N’est-ce pas M. de Beaumarchais qui, ne pouvant me rendre malhonnête
et me décider à ses vues de spéculation sur mon sexe, publia partout
à Paris qu’il devait m’épouser après que j’aurais demeuré sept mois
à l’abbaye des Dames Saint-Antoine, tandis que dans le fait il n’a
manqué d’épouser que ma canne à Londres? Mais son nom seul est un
remède contre l’amour nuptial, et ce nom achérontique ferait peur à
la dragonne la plus déterminée aux combats nocturnes et des postes
avancés.
D’ailleurs, je dois vous prévenir, Monseigneur, que dans plus d’une
bonne maison à Paris on a présenté de fausses demoiselles d’Éon avec
la croix de Saint-Louis. C’étaient 244 des bouffons qui ont tenu les
propos les plus plaisants sur toutes les connaissances de la vraie
chevalière d’Éon, mais principalement sur l’agréable, l’honnête, le
brave Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais... Cette scène, qui a
été variée à l’infini, s’est renouvelée, m’apprend-on, la semaine
dernière, tandis que moi, solitaire, tranquille, j’étais travaillante
et dormante dans mon ermitage au Petit-Montreuil-lez-Versailles. M.
de Beaumarchais, qui est si naturellement enclin à mystifier tout le
monde, voudrait-il donc jouir à lui seul de ce privilège exclusif...
Je vous dirai, Monseigneur, que toute la probité des quatre ministres
réunie à la vôtre, en y comprenant même celle des premiers commis, ne
serait pas capable de faire de M. de Beaumarchais, malgré tous les
certificats du monde, un honnête homme dans mon affaire. La parfaite
connaissance que sa conduite passée m’a donnée de sa personne m’a
forcée à le placer malgré moi dans la classe des gens dont il faut
être haï pour avoir le droit de s’estimer soi-même.
Pour ajouter encore à l’ironie de cette curieuse réponse et afin de
gagner à sa cause l’aimable sexe dont il se flattait d’être devenu
l’héroïne, d’Éon, jouant à la femme outragée, terminait son épître par
une invocation des plus burlesques qu’il intitulait:
APPEL DE MADEMOISELLE D’ÉON A SES CONTEMPORAINES
M. de Beaumarchais a voulu m’enlever la considération qui doit faire
ma plus douce existence, y disait-il. Je le confonds en me moquant
de lui et de son impuissante colère. C’est un Thersite qu’il faut
fouailler pour avoir osé parler avec insolence des gens qui valent
mieux que lui et qu’il devrait respecter. Je le dénonce et le livre à
toutes les femmes de mon siècle comme ayant voulu élever son crédit
sur celui d’une femme et enfin venger 245 son espoir frustré en
écrasant une femme et celle qui a le plus à cœur de voir triompher
la gloire de ses semblables[222]!
Cet appel à la sensibilité et à l’amour-propre de ses contemporaines
trouva de l’écho, et d’Éon, qui n’avait pas manqué de répandre à
profusion les gazettes où se déroulait cette étrange polémique, reçut
de tous côtés de chaleureuses félicitations. On opposait «à l’élévation
de ses sentiments l’horreur dont son antagoniste pénètre les personnes
qui pensent et sentent».—«Dans l’ignorance des motifs qui poussent
le ministère à avouer un pareil agent, écrivait un correspondant
de d’Éon, on désire au moins qu’il s’oppose à ce qu’il fasse des
élèves. L’humanité serait trop à plaindre si Beaumarchais formait son
semblable[223].» A Caen, «où tous les honnêtes gens de la province
désiraient le voir», on faisait grand succès à son malicieux plaidoyer:
«Je l’ai reçu, écrivait un comte d’Ormesson, chez Mme la comtesse de
la Tournelle, où toute la noblesse du canton était assemblée, attendu
qu’il y a eu comédie et bal pendant quatre jours de suite; je ne peux
pas vous dire l’effet que cela a produit. Tout le monde a été enchanté
de lire votre style et de la manière simple et honnête de dire les
vérités de votre adversaire[224].»
246
Sans doute les nombreuses et ardentes inimitiés que Beaumarchais
s’était attirées n’avaient pas manqué de contribuer au succès de
d’Éon; elles ne suffiraient point cependant à expliquer l’intérêt
qui s’attachait aux moindres gestes de la chevalière. En dépit de
ses extravagances et de tout le tapage qu’il provoquait, d’Éon avait
su plaire à des personnages sérieux et réservés, en même temps qu’il
conquérait la foule par sa science de la réclame. Son esprit avisé
avait deviné la puissance d’une presse alors à peine naissante, et
depuis son séjour en Angleterre il n’avait cessé de défrayer les
gazettes. Sans doute il partageait avec bien d’autres le mérite
d’avoir fait bravement son devoir sur les champs de bataille; mais
ces modestes faits d’armes, déjà mis en relief lorsqu’on les avait
sus accomplis par une femme, étaient devenus dans l’éclat flatteur de
récits enthousiastes de véritables triomphes[225]. La chevalière était
une héroïne unique dont la vie tout entière 247 appartenait à ses
contemporains. C’était certainement ce qu’estimait d’Éon. Aussi à peine
ses démêlés avec Beaumarchais s’étaient-ils apaisés qu’il se croyait de
nouveau obligé d’annoncer aux femmes de son siècle un événement dont
l’éclat devait rejaillir à tout jamais sur elles. C’était le jugement
rendu par les tribunaux d’Angleterre, qui venaient, en appel, d’annuler
les paris ouverts autrefois sur son sexe:
Victoire! mes contemporaines, s’écriait-il, quatre pages de victoire!
mon honneur, votre honneur triomphent. Le grand juge du tribunal
d’Angleterre vient de casser et d’anéantir lui-même, en présence des
douze grands juges d’Angleterre, ses propres jugements concernant la
validité des polices ouvertes sur mon sexe. Voilà le glorieux effet
de la terrible leçon que j’ai donnée à ce tribunal au moment où je
partais pour la France. Son arrêt définitif, du 31 janvier, a reçu
l’opposition de ceux qui avaient soutenu, d’après ma conduite, que
j’étais homme et qu’on voulait forcer à payer leurs gageures, en
exécution de ces deux jugements. Il a eu le courage de prononcer dans
les termes mêmes de mes protestations publiques, en langue anglaise,
que la vérification nécessaire blessant la bienséance et les
mœurs, et qu’un tiers sans intérêt (c’est moi, c’est la chevalière
d’Éon) pouvant en être affecté, la cause devait être mise au néant.
O ma patrie, que je vous félicite de n’avoir point reçu tout cet or
par une voie aussi infâme! Vous avez tant de bras, tant de cœurs
tout prêts à enlever à l’audacieuse Angleterre des dépouilles et plus
riches, et plus glorieuses!
Ombre de Louis XV, reconnaissez l’être que votre puissance a créé;
j’ai soumis l’Angleterre à la loi de l’honneur! Femmes, recevez-moi
dans votre sein, je suis digne de vous[226].
248
Quelque bouffonne que puisse nous paraître aujourd’hui une aussi
pompeuse invocation, il faut constater que les hommes les plus posés et
même des savants austères ne craignirent pas de féliciter à ce propos
l’illustre chevalière. M. de Lalande, avec toute la gravité qui sied à
un astronome et à un immortel, lui écrivait:
Je me suis réjoui bien sincèrement en voyant que vous aviez soumis
l’Angleterre à la loi de l’honneur en même temps que vous punissiez
en France la témérité de celui qui aurait craint le chevalier, mais
qui croyait peut-être pouvoir braver la chevalière; vos plaisanteries
sont aussi amères et aussi plaisantes tout à la fois, que votre style
est noble et majestueux quand vous écrivez à un ministre. Souffrez,
Mademoiselle, que ma lettre vous soit remise par un de mes amis qui
n’a jamais vu d’héroïne et qui brûlait du désir de vous présenter ses
hommages; permettez qu’il vous présente les miens avec le tribut de
l’admiration, de la reconnaissance et du respect avec lesquels[227]...
Un autre membre de la célèbre compagnie, le comte de Tressan, que d’Éon
avait remercié d’un ouvrage récemment paru par l’envoi de ses deux
mémoires, lui répondait par les mêmes louanges et ajoutait:
La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire me pénètre de
reconnaissance: il est également honorable comme militaire ou comme
académicien de mériter votre approbation.
Votre lettre, Mademoiselle, m’ayant été renvoyée mardi 249 dernier à
Paris, j’aurais volé chez vous pour avoir l’honneur de vous remercier
moi-même; mais ce jour me trouvant attaqué d’une espèce de catarrhe
avec de la fièvre, je m’enveloppais dans une peau d’ours et je revins
sur-le-champ dans mon ermitage. Je profite du premier moment de
mieux, Mademoiselle, pour vous dire à quel point je suis touché des
bontés de la personne du monde que j’ai toujours admirée l’épée ou la
plume à la main; vous avez réalisé ce que l’Arioste a célébré de la
valeur de Morphise et de Bradamante. Mais vous avez fait plus, vous
avez bravé les armes de ce méchant enfant à qui tout cède et vous
donnez à l’univers l’exemple d’une âme à l’épreuve de toute espèce
de faiblesse. Vous êtes née, Mademoiselle, pour vaincre également le
guerrier, le négociateur et l’amour et vous méritez d’être adorée par
les amis qui ont l’honneur de vivre avec vous et de jouir des charmes
attachés à l’utilité de vous entendre. Il n’est personne de l’un et
de l’autre sexes qui ne sente naître de l’émulation en vous écoutant
et qui ne soit ému et encouragé par votre exemple et par vos discours
à devenir encore plus brave et plus vertueux. Dès que je pourrai
retourner à Paris, Mademoiselle, j’aurai bien de l’empressement à
vous aller assurer de l’admiration, de l’attachement et du respect
avec lesquels j’ai l’honneur[228]...
Si d’Éon se plaisait à accueillir ces galants propos avec toute la
sensibilité d’une âme féminine de son époque, il avait déjà songé à
un excellent moyen de «vaincre l’amour» et formait le projet de se
retirer pour quelques mois dans un couvent. Pénétré de son rôle et
prenant un malicieux plaisir à la comédie, il s’ingéniait à se placer
dans les plus burlesques situations 250 et s’en divertissait avec
le dilettantisme le plus cynique. Ayant sollicité, par l’entremise
de M. de Reine, la permission de faire une retraite en la maison de
Saint-Louis à Saint-Cyr, il avait dû renoncer à y demeurer, «l’évêque
de Chartres, qui se trouvait alors à Rome, pouvant seul accorder
une faveur aussi rare[229]». Ces dames, en apprenant le désir de la
chevalière, lui avaient, sans la moindre hésitation, ouvert les portes
de leur parloir à défaut de la cellule ambitionnée, et d’Éon, si courte
qu’eût été sa présence, avait laissé parmi ces vénérables personnes une
agréable impression que traduit le billet suivant:
La mère de Montchevreuil, notre supérieure, me donne une très
agréable commission, Mademoiselle, en me chargeant de vous porter
une nouvelle assurance du plaisir que votre visite nous a procuré
et l’expression de l’estime que vous avez inspirée à toutes les
personnes qui composent notre maison; l’envie que vous lui avez fait
naître de vous réitérer la vérité de ces sentiments vous propose
l’option du lundi ou mardi prochain pour la seconde visite dont
vous nous avez flattées. Mais, Mademoiselle, comme il faut toujours
avancer la jouissance de ce qui procure des satisfactions aussi
légitimes, nous espérons que votre choix tombera sur le lundi... Je
vous rappelle à votre parole, dont vous ne sauriez vous dédire sans
vous démentir. Quant à moi, qui ai eu l’honneur de vous accompagner
et de vous voir de plus près, je vous certifie que je joins aux
sentiments d’estime et d’admiration pour le chevalier d’Éon ceux de
l’attachement 251 que j’ai pour Mademoiselle, de qui j’ai l’honneur
d’être...[230]
A la lecture de cette lettre, d’Éon se sent pénétré de reconnaissance
pour ces saintes filles et d’humilité vis-à-vis de soi-même. Il se
souvient des textes sacrés dont la science lui valut dans sa jeunesse
le titre de docteur en droit canon, et c’est sur le ton d’une personne
onctueuse, dévote et repentante, qu’il accepte l’invitation dont il
est l’objet. En quelques pages dont la rédaction dut être un vrai
régal pour cet étrange mystificateur (il en garda trois copies), d’Éon
parvint à se juger avec une impartialité qui eût été méritoire en tout
autre occurrence:
..... Je me propose d’y aller seule, écrit-il, afin d’apporter
le moins de dissipation qu’il sera possible dans la maison des
élues du Seigneur et afin de mieux profiter de la sainteté de vos
discours, qui sont la vive expression du calme de vos cœurs et de
l’innocence de vos mœurs.
Quand je compare le bonheur de la solitude dont vous jouissez, et
que j’ai toujours aimée sans pouvoir en jouir, à la vie terriblement
agitée que j’ai menée depuis plus de quarante ans dans le monde et
dans les diverses armées et Cours de l’Europe que j’ai parcourues, je
sens combien le démon de la gloire m’a éloignée du Dieu d’humilité
et de consolation. J’ai donc couru toute ma vie comme une vierge
folle après l’ombre des choses; tandis que vous, vierges prudentes,
vous avez attrapé la réalité en restant stables dans la maison du
Seigneur et le sentier de la vertu. Erravi a viâ justitiæ et sol
intelligentiæ non luxit in me...
252
Je souhaite que Dieu préserve les personnes de notre sexe du malheur
de la passion de la vaine gloire. Moi seule sais tout ce qu’il m’en
a coûté, pour m’élever au-dessus de moi-même; pour quelques jours
brillants et heureux que j’ai eus, que de mauvaises nuits j’ai
passées: mon exemple est meilleur à admirer de loin qu’à imiter de
près[231].
En même temps que cette longue homélie, et comme pour contre-balancer
l’effet d’aussi humbles déclarations, d’Éon prend soin d’envoyer son
portrait et ses brochures. Il promet aussi à sa correspondante la
lecture de quelques lettres adressées à son oncle «par Mme de Maintenon
et sa bonne amie, la comtesse de Caylus», qu’il «possède en original».
La sœur de Durfort lui répond dans l’instant même:
Vous êtes admirable en tout, Mademoiselle, soit en tenant la plume,
soit en tenant l’épée; votre lettre est délicieuse, je la garderai
avec le même soin qu’un avare son trésor; elle décèle vos richesses
intérieures qui sont encore d’un plus grand prix que les vertus
morales, politiques et guerrières dont vous faites profession
authentique et auxquelles je rends justement hommage. La mère
supérieure et nos dames vous remercient, Mademoiselle, de la gravure
que vous avez envoyée; vous ne sauriez trop vous multiplier dans un
siècle où les faits héroïques sont rares et où les héroïnes seraient
inconnues sans vous.
En post-scriptum elle ajoute:
J’allais oublier de vous envoyer, Mademoiselle, les quatrains
composés par un missionnaire résidant chez 253 nous, qui a eu
l’honneur de dîner avec vous à votre dernier voyage: c’est le cousin
d’un nommé Sedaine, académicien, l’un de nos poètes français portant
le même nom. Il n’est pas le premier qui vous a célébrée, il n’est
pas le dernier qui vous célébrera:
De l’antique Pallas d’Éon a tous les traits,
Elle en a la sagesse et le mâle courage;
Je me trompe: d’Éon par d’historiques faits
Cent fois plus que Pallas mérite notre hommage.
Qu’était-ce que Pallas? Un être fabuleux,
Un brillant avorton du cerveau des poètes.
Le brave d’Éon vit et cent mille gazettes
Vantent par l’univers ses exploits glorieux.
Sa plus belle victoire et sa gloire suprême
N’est pas d’avoir été si longtemps la terreur
De nos fiers ennemis par sa rare valeur,
Mais d’avoir su si bien triompher d’elle-même
[232].
Deux jours se sont à peine écoulés que la mère de Montchevreuil
invite d’Éon à assister à une prise de voile qui doit avoir lieu au
couvent; sachant la chevalière indisposée, elle «espère que la fièvre
n’aura plus de prise» sur l’illustre malade et, pour aider à son
rétablissement, lui envoie quelques levrauts et perdreaux «des chasses
de la communauté».
Ces attentions et surtout la fervente admiration d’aussi édifiantes
créatures confondent d’Éon, qui succombe sous le poids des remords dans
cet assaut d’humilité et de courtoisie:
Je quitte, Madame, l’abbaye de Haute-Bruyère, où Mlle de Torigny,
après avoir refusé un mariage des 254 plus avantageux suivant le
monde, vient de tout abandonner pour n’épouser que les misères et
les douleurs de la croix de Jésus-Christ et pour vivre uniquement
avec de saintes dames recluses qui, par la pureté et l’aménité de
leurs mœurs, rendent leur solitude et la religion aussi aimables
que leur société. Ce spectacle incroyable, auquel je n’avais jamais
assisté, a plus attristé mon cœur et secoué mon âme que tout ce
que j’ai vu d’étonnant dans les armées.
C’est sans doute pour abattre mon orgueil et terrasser totalement
mon courage mondain que vous voulez que je sois encore témoin lundi
prochain du sacrifice aussi attendrissant qu’imposant des deux
victimes royales de votre maison, qui, comme deux colombes blanches
et innocentes, vont être déplumées et immolées à mes yeux sur l’autel
du Roi des rois.
Malgré l’ardeur guerrière que les hommes et les militaires veulent
bien m’accorder, je ne puis m’empêcher de crier au fond de mon
cœur que je suis bien lâche quand je considère de sang-froid,
Mesdames, la grandeur et l’étendue du sacrifice que vous faites à
Dieu. Jusqu’à présent je n’ai sacrifié que mon corps au service du
roi et de la patrie, c’est-à-dire à mon service particulier; le
cheval que je montais dans les combats et les batailles en a fait
autant que moi, au lieu que vous, Mesdames, vous avez fait à Dieu
et à votre maison le sacrifice tout entier de votre corps, de votre
esprit et de votre raison; vous n’avez rien gardé pour vous que votre
innocence et votre obéissance.
Je suis dans ces sentiments avec une sensible et respectueuse
reconnaissance, Madame, votre...
P.-S.—Mme de Montchevreuil est bien bonne d’envoyer pour mon dîner
et levrauts et perdreaux; un seul plat et de la salade suffisent pour
me faire un bon dîner, j’ai le bonheur de n’être point née sensuelle.
Je sais coucher sur la paille et la terre, et vivre avec de 255
l’eau et du pain seul. Je sais aussi que Notre-Seigneur a dit que
l’homme ne vit pas seulement de pain, mais encore de la parole de
Dieu; ainsi je tâcherai de nourrir mon âme de sa parole, en écoutant
attentivement l’excellent discours qui sera prononcé dans votre
église lundi prochain au saint sacrifice de vos deux victimes[233].
Ayant lu les ouvrages de d’Éon «avec une voracité dragonne», la sœur
de Durfort comprit combien étaient motivés les remords de l’auteur des
Lettres, mémoires et négociations. Sans se dissimuler la difficulté
de faire de «ce héros suivant le monde l’héroïne de la religion», elle
s’efforçait avec une touchante simplicité de l’amener à résipiscence et
lui écrivait: «Vous avez bien raison de dire que j’aurais plus de peine
à vous enfanter à la grâce que Mme d’Éon à vous donner le jour: je ne
désespère cependant pas; quand on a autant de courage, de fermeté,
de constance, d’intrépidité, de valeur; en un mot, quand on est
grande comme vous, Mademoiselle, il ne faut qu’un effort pour devenir
sainte[234]...»
D’Éon finit sans doute par comprendre combien il était peu généreux
d’abuser ainsi de la crédulité d’une âme naïve, car il s’arrangea
pour couper court à ces pieuses relations. Il était d’ailleurs fort
préoccupé et plus malheureux que jamais. Loin de songer à prendre le
voile comme l’avait souhaité sa 256 vénérable correspondante, la
chevalière ne désirait rien tant que quitter la cornette et coiffer
de nouveau le casque de dragon. Trop ardent pour le rôle auquel il
était réduit, pour cette vie de Cour, de fêtes et de visites dont il
s’efforçait de tromper l’ennui, en écrivant sans répit, écœuré aussi
par la perpétuelle mystification dont il se trouvait à la fois l’auteur
et la victime, d’Éon regrettait son ancienne existence d’aventurier.
La guerre d’Amérique lui avait paru une occasion favorable pour la
reprendre et, dès l’ouverture des hostilités avec l’Angleterre, il
avait sollicité de MM. de Sartine et de Vergennes de servir à nouveau
dans le militaire; mais il se heurta au refus formel, et facilement
explicable, de ces deux ministres qui souhaitaient de n’entendre plus
parler de lui.
Le comte de Broglie, qu’il supplia d’appuyer sa requête, n’y consentit
point et lui reprocha même avec un peu d’ingratitude—car d’Éon
n’avait cessé de lui rester fidèle et de le défendre en des moments
difficiles—d’avoir cité son nom:
J’ai reçu, Mademoiselle, lui écrivait-il, la lettre que vous vous
êtes donné la peine de m’écrire hier et la copie de celle de M. de
Sartine. Je vous observerai sur celle-ci, quoique je rende bien
justice aux motifs qui vous ont dicté ce qui me regarde, qu’il eût
été mieux sans doute de n’y pas parler de moi.
Je désire que vous obteniez la permission que vous demandez, mais
j’en doute beaucoup. J’espère, en ce cas, que vous ne ferez jamais
rien qui puisse annoncer la moindre résistance aux volontés du roi.
Soyez persuadée, 257 je vous prie, des sentiments avec lesquels je
suis on ne peut plus parfaitement, Mademoiselle, votre très humble et
très obéissant serviteur.
Signé: Le comte de Broglie[235].
Aigri par ces nouvelles déceptions, ébranlé dans sa santé et exaspéré
par l’inaction, d’Éon se décida, malgré les refus qu’on lui avait
opposés déjà, à écrire à M. de Maurepas une lettre qu’il eut la
maladresse de faire imprimer, ainsi qu’une «lettre d’envoi à plusieurs
grandes dames de la Cour». Ces deux pièces valurent à leur auteur un
châtiment immédiat que justifie bien, il faut en convenir, leur ton
extravagant:
Monseigneur, je désirerais ne pas interrompre un instant les moments
précieux que vous consacrez au bonheur et à la gloire de la France;
mais animée du désir d’y contribuer moi-même dans ma faible position,
je suis forcée de vous présenter très humblement et très fortement
que, l’année de mon noviciat femelle étant entièrement révolue, il
m’est impossible de passer à la profession. La dépense est trop forte
pour moi et mon revenu est trop mince. Dans cet état, je ne puis être
utile ni au service du roi, ni à moi, ni à ma famille, et la vie trop
sédentaire ruine l’élasticité de mon corps et de mon esprit. Depuis
ma jeunesse j’ai toujours mené une vie fort agitée, soit dans le
militaire, soit dans la politique; le repos me tue totalement.
Je vous renouvelle cette année mes instances, Monseigneur, pour
que vous me fassiez accorder par le roi la permission de continuer
le service militaire, et 258 comme il n’y a point de guerre de
terre, d’aller comme volontaire servir sur la flotte de M. le comte
d’Orvilliers. J’ai bien pu, par obéissance aux ordres du roi et de
ses ministres, rester en jupes en temps de paix, mais en temps de
guerre cela m’est impossible. Je suis malade de chagrin et honteux
de me trouver en telle posture dans un temps où je puis servir mon
roi et ma patrie avec le zèle, le courage et l’expérience que Dieu
et mon travail m’ont donnés. Je suis aussi confuse que désolée de
manger paisiblement à Paris, pendant la guerre, la pension que le feu
roi a daigné m’accorder. Je suis toujours prête à sacrifier pour son
auguste petit-fils et ma pension et ma vie. Je suis revenue en France
sous vos auspices, Monseigneur, ainsi je recommande avec confiance
mon sort présent et à venir à votre généreuse protection et je serai
toute ma vie avec la plus scrupuleuse reconnaissance, Monseigneur,
votre...
Lettre d’envoi de la chevalière d’Éon à plusieurs grandes dames de la
Cour:
Madame la duchesse,
Je vous supplie instamment de protéger auprès des ministres du Roi le
succès de mes demandes énoncées dans la copie de la lettre ci-jointe
à M. le comte Maurepas pour aller servir comme volontaire sur la
flotte de M. le comte d’Orvilliers, prévoyant qu’il y aura moins de
guerre sur terre cette année que la dernière. Vous portez, Madame,
un nom familiarisé avec la gloire militaire; comme femme vous aimez
celle de notre sexe. J’ai tâché de la soutenir pendant la dernière
guerre en Allemagne, et en négociant dans les différentes Cours de
l’Europe pendant vingt-cinq ans. Il ne me reste plus qu’à combattre
sur mer avec la flotte royale; j’espère m’en acquitter d’une façon
telle que vous n’aurez nul regret de 259 protéger la bonne volonté
de celle qui a l’honneur d’être avec un profond respect, etc...
La chevalière d’Éon[236].
Lassés des excentricités sans cesse renouvelées de d’Éon; excédés par
ses attaques contre Beaumarchais, et apprenant en outre qu’il avait
quitté ses habits de femme, les ministres se décidèrent à sévir.
Le samedi 20 mars 1779, au matin, sans en avoir été prévenue, Mlle
d’Éon était appréhendée en son domicile de la rue de Noailles par deux
exempts de la police et invitée à prendre place dans un carrosse qui
partit aussitôt. Tandis que le sieur Clos, écuyer, conseiller du roi,
lieutenant général de la prévôté de l’hôtel, assisté de son greffier,
perquisitionnait vainement, d’Éon se dirigeait à petites étapes vers le
château de Dijon, où il dut, en vertu d’une lettre de cachet, séjourner
un long mois[237].
260
CHAPITRE X
Captivité de la chevalière d’Éon.—Son élargissement et son
exil à Tonnerre.—Nouvelles démarches: l’armement de la
Chevalière-d’Éon.—D’Éon séjourne à Paris pendant l’hiver
1780-1781.—Il revient à Tonnerre et y mène une existence tranquille
et fêtée.—Il quitte la France à la fin de 1785 pour aller régler ses
affaires à Londres.
Ce qu’était le séjour dans une prison au dix-huitième siècle, on le
sait depuis que les archives de la Bastille ont été ouvertes à la
curiosité des historiens. Cette forteresse, considérée comme le symbole
du despotisme, semblerait bien plutôt une sorte d’hôtellerie où la
meilleure compagnie se retrouvait passagèrement et involontairement
réunie. Il était même presque loisible, en dépit du modeste confort
qu’offrait le logis, d’y conserver le train que l’on menait à la ville.
Les plus favorisés, servis par leurs valets, tenaient salon à jour
fixe, donnaient à souper et, sur la seule promesse de revenir avant
le coucher du soleil, franchissaient quotidiennement les guichets de
la forteresse. Les hôtes de moindre importance étaient passablement
traités moyennant une pistole par jour, voisinaient de cellule à
cellule et trouvaient une distraction suffisante à jouer au pharaon,
à la bouillotte et au biribi. Pour les esprits chagrins qui 261
se lassaient d’un tel régime, il n’était pas impossible de combiner un
projet d’évasion, et l’issue en était souvent favorable.
La prison du château de Dijon, avec la même apparence redoutable,
n’était pas moins hospitalière, et l’obstinée chevalière s’y trouva
d’autant mieux qu’arrivant dans son pays bourguignon avec l’auréole du
malheur elle reçut de ses compatriotes le plus chaleureux accueil. Le
curé-doyen de Saint-Jean, paroisse actuelle de la prisonnière, fut un
des premiers à s’informer de son ancienne camarade et à lui offrir les
consolations qui convenaient à sa qualité et à sa situation présentes.
Il évoquait auprès d’elle des souvenirs d’enfance, leurs relations à
Versailles et terminait ainsi:
«Comme il est du devoir d’un pasteur de chercher sa brebis, et surtout
lorsqu’elle est comme vous un peu errante, trouvez bon que j’aille
vous demander; mais faites-moi savoir l’heure qui vous sera le plus
commode[238].»
Le lendemain les visites affluèrent au château en tel nombre que le
gouverneur dut donner à la sentinelle la «consigne de ne laisser entrer
personne auprès de la chevalière». Un ordre «aussi nouveau et aussi
imprévu» étonna MM. Calon, ancien conseiller au parlement, et Buchotte
de Vermond, qui se plaignirent aussitôt à la chevalière d’avoir été
brutalement congédiés. A défaut de visites, d’Éon 262 recevait de tous
côtés des lettres de condoléances ou de compliments et ses anciens
camarades aux dragons, qui l’avaient constamment suivi dans toutes ses
aventures, lui envoyant un nouveau témoignage de leur affection par le
major d’Arras, demandaient à être «tranquillisés sur le compte de la
prisonnière[239]». D’ailleurs la rigueur de la détention allait chaque
jour s’adoucissant et une semaine s’était à peine écoulée que d’Éon put
non seulement recevoir dans sa cellule les notabilités dijonnaises et
les nombreux curieux qui sollicitaient une audience, mais même «offrir
la soupe en très petit comité». Tandis qu’il prenait gaîment son parti
de sa mésaventure en se délectant de «truites, écrevisses, poulardes,
bécasses et bécassines» arrosées d’un vénérable clos-vougeot que lui
présentait le sieur Gaudelet, aubergiste-traiteur du château, son
beau-frère s’efforçait à Paris d’abréger sa disgrâce.
O’Gorman avait été d’autant plus surpris et inquiet de la disparition
de la chevalière que, venant la prendre à Versailles pour gagner
Tonnerre précisément ce jour-là, il avait trouvé les scellés sur la
porte et la femme de chambre encore «dans la révolution que lui avait
causée l’enlèvement». La Grenade, le valet de d’Éon, n’ayant pu lui
indiquer l’endroit où l’on avait conduit son maître, O’Gorman se rendit
de suite à l’audience de M. Amelot et apprit du premier commis que
d’Éon se trouvait prisonnier à Dijon; 263 mais on lui déclara en même
temps «qu’il n’était ni dans les intentions du roi, ni dans celles
du ministre de rendre malheureuse la chevalière, dont la disposition
de rébellion et de résistance aux ordres du roi avait seule motivé
ce parti violent». On lui rendrait même «le repos dans la maison
paternelle» aussitôt qu’on lui trouverait «l’esprit soumis et disposé à
vivre dans sa patrie tranquille et sans éclat[240]».
Bientôt d’Éon parut souhaiter lui-même ce qu’on voulait lui imposer.
Il ne fit rien pour augmenter le bruit que faisait désormais sa
moindre démarche et subit avec simplicité le châtiment qui lui avait
été infligé. D’aussi bonnes dispositions ranimèrent l’empressement de
ses protecteurs. Le marquis de Vergennes lui conseilla d’écrire à son
frère le ministre une lettre de soumission qu’il accompagna de «l’appui
le plus instant»[241]. Mais ce fut l’évêque de Mâcon qui sut plaider
le plus habilement la cause de son protégé auprès des ministres,
leur représentant «la trop grande sensation» produite à Dijon par la
présence de la chevalière. Enfin, les perquisitions faites au domicile
de celle-ci, bien loin de confirmer l’insinuation de ses ennemis, qui
tendaient à l’accuser d’espionnage au profit de l’Angleterre, n’ayant
au contraire prouvé que «des faits à son honneur», les ministres
lui accordèrent sa grâce après un mois d’emprisonnement 264 en lui
enjoignant de se rendre immédiatement à Tonnerre et de n’en plus sortir
sans la permission du roi.
D’Éon se hâta d’obéir; il était en effet, comme le lui faisait
remarquer son beau-frère, «sous lettre de cachet»; mais il ne quitta
point Dijon sans avoir confié au sculpteur Marlet la commande de
quelques petits médaillons qui devaient commémorer son passage dans la
capitale bourguignonne.
Calmé par cette longue série d’aventures et redoutant sans doute la
colère de ses ennemis, qui ne souhaitaient rien tant que de le voir
«enfermé dans un couvent pour le reste de ses jours», d’Éon se décida
à mener en Bourgogne la vie tranquille d’une vieille demoiselle de
qualité, vie qu’il «avait si souvent enviée», disait-il avec plus de
résignation que de sincérité. La modeste pension du roi lui permit de
remettre en état sa maison de Tonnerre; il y ajouta une aile, orna de
«terrasses et de parterres» son parc, où courait la rivière d’Armançon,
et parvint même à faire abattre une chapelle qui gâtait la vue de son
hôtel, «sans se brouiller avec la Sainte Mère l’Église». Il échangeait
avec le prieur de Saint-Martin «le buis contre la marjolaine»,
replantait ses vignes et surveillait ses vendanges, dont le produit
gagnait à petites journées la capitale pour figurer sur la table des
ministres, de MM. Amelot et de Vergennes. Il réservait ses meilleurs
crus à ses anciens protecteurs, qui se montraient aussi touchés du
souvenir que friands de ces présents:
265
J’ai reçu, Mademoiselle, lui écrivait la comtesse de Broglie au
premier janvier 1780, les soixante-cinq bouteilles de vin de Tonnerre
que votre lettre annonçait; j’aurais bien désiré que vous ne vous
en fussiez point privée; il ne m’était pas nécessaire d’avoir ce
témoignage de votre façon de penser pour être convaincue de votre
attachement pour M. de Broglie: les preuves que vous lui en avez
toujours données me persuadent qu’elles ne varieront jamais. J’en
reçois l’assurance avec la reconnaissance qu’elle m’inspire. J’ai
l’honneur d’être, Mademoiselle, votre très humble et très obéissante
servante[242].
Ce billet paraît être le dernier que d’Éon reçut de cette puissante
famille dont il avait été le client dès sa jeunesse et plus tard le
zélé défenseur. Les Broglie étaient alors dans un oubli pire que la
disgrâce, et la mort du comte, que les déceptions et les injustices
avaient miné, allait porter à cette maison un coup dont elle se
relèverait péniblement. C’était ce moment difficile qu’en courtisan du
malheur d’Éon avait su choisir pour marquer au ministre le souvenir
qu’il gardait de son appui dans une carrière si prématurément et si
fâcheusement brisée. Sa nouvelle vie lui laissait le temps de réfléchir
sur ses erreurs passées et, bien qu’il s’efforçât de se montrer
satisfait de son séjour dans son pays natal, il ne parvenait pas à
cacher ses regrets et à convaincre ses correspondants, car à la même
date du 1er janvier 1780 le général de Monet, qui avait connu toutes
ses aventures, lui écrivait:
J’envie la tranquillité dont vous devez jouir, Mademoiselle, avec
vos dieux Pénates; je souhaite que vous la 266 regardiez avec
cette philosophie que je vous connais, et dont vous avez eu dans le courant
de votre vie tant d’occasions de faire un bon usage. Vos moments
de loisir seront probablement bien employés pour l’utilité de nos
successeurs et les réflexions que des circonstances heureuses
ou malheureuses (car il me serait assez difficile d’en faire la
discussion) vous donnent le temps de leur laisser par écrit, seront
également un grand bien pour leur instruction, et un moyen de donner
le dernier lustre à l’histoire intéressante de votre vie; mais quoi
qu’il en soit, à vous dire le vrai, j’aimerais mieux vous savoir à
Paris qu’à Tonnerre: vous n’y verriez cependant que bien des gens
affectés des réformes que la sagesse de nos ministres a jugées
nécessaires et justes pour trouver des fonds pour soutenir la guerre
sans nouveaux impôts; il vaut donc mieux, dans les moments critiques
où nous sommes, être loin du fracas.
En attendant des circonstances plus heureuses, je vous félicite de
votre position présente, personne n’étant avec un plus inviolable
attachement que moi, Mademoiselle, etc...
Comte de Monet[243].
D’Éon songeait bien, comme on le lui conseillait, à laisser à la
postérité le récit détaillé de ses hauts faits. La courte ébauche
qu’il avait écrite de sa vie lors de son retour en France lui semblait
insuffisante, car elle passait sous silence l’événement capital de sa
carrière, ses démêlés avec son ambassadeur et aussi sa mission secrète
en Angleterre; mais le moment eût été mal choisi et eût fourni à ses
ennemis de nouveaux sujet de plainte. Aussi s’occupait-il à 267 des
travaux moins périlleux; il projetait un ouvrage sur l’agriculture,
correspondait sans cesse à ce sujet avec M. de Buffon, qui lui envoyait
ses œuvres, discutait avec lui le mérite des traités nouveaux et
consentait même à lui fournir les documents qui lui manquaient. Le
marquis de Poncins lui soumettait son livre qui venait de paraître sur
«l’agriculture et la guerre» et estimait que le comble serait mis à sa
gloire «si au suffrage du plus grand roi s’ajoutait celui de la femme
la plus célèbre qui ait jamais illustré les annales du monde[244]».
De Lalande, Cassini l’informaient de leurs découvertes. Mais cette
intéressante correspondance ne suffisant pas, au jugement de d’Éon, «à
dissiper l’air de bêtise que l’on respire en province», il travaillait
assidûment avec l’aide de M. de Palmus à dresser la généalogie de sa
famille. Il le fit d’ailleurs sans la moindre modestie ou plutôt avec
l’abondante imagination dont il avait déjà donné tant de preuves,
car, après avoir épuisé la lignée de ses auteurs qui durant les deux
derniers siècles avaient fait preuve en Bourgogne d’une noblesse
assez mince, il s’était recherché des ancêtres beaucoup plus reculés
en Bretagne et s’attribuait même dans cette province les alliances
des plus puissantes maisons. Or, parmi ces familles quelques-unes
subsistaient encore qui ne se montrèrent pas également flattées de la
parenté que leur offrait l’illustre héroïne et la repoussèrent assez
bruyamment. D’Éon 268 eut donc à soutenir un long procès contre M. de
Kergado, à l’occasion duquel il répandit, suivant sa coutume, quantité
de mémoires et de libelles, mais qui, néanmoins, ne se termina pas
à l’avantage de ses prétentions[245]. Cette affaire était à peine
terminée que d’Éon sentit de nouveau et plus cruellement le poids de
son oisiveté qu’il ne parvenait pas à distraire, et la hantise des
aventures lointaines s’empara une fois encore de lui. Il chercha à
s’évader de la province où il était confiné par ordre du roi, comme
en une prison, et supplia de nouveau qu’on lui permît de mettre au
service des Américains une épée qui, bien que rouillée, pouvait encore
rendre d’utiles services. Tout comme un an auparavant, il essuya un
refus catégorique et, bien que sa requête lui valût la liberté de
revenir à Paris et à Versailles, lorsqu’il le désirerait, il resta très
affecté de cet échec. Mais il n’était pas dans son caractère de se
tenir pour battu; puisqu’on l’empêchait de combattre en personne, il
trouverait tout de même le moyen de s’illustrer dans la campagne qui
commençait. Il n’irait pas à la guerre, mais il s’y ferait représenter
et l’expédient qu’il imagina pour combattre ainsi par procuration fut
d’armer une frégate qui porterait le nom de la Chevalière-d’Éon.
269
Le Journal de Paris, dans ses numéros du 8 septembre 1780 et du
8 janvier 1781, publia les lettres échangées entre MM. Le Sesne,
armateurs à Paris, et Mlle la chevalière d’Éon. Ces messieurs
sollicitaient, par leur première lettre, qu’il leur fût permis de
donner le nom de l’illustre chevalière à l’un des deux bâtiments qu’ils
armaient à Granville pour faire la course aux dépens des Anglais; cette
frégate était «déterminée pour être armée de 44 canons de 18 et 24
livres de balle en batterie et 14 de 8 livres sur ses gaillards, 18
obusiers et 12 pierriers, avec un équipage de 450 hommes choisis et
sous le commandement en chef, ainsi que de toute l’expédition, d’un
capitaine distingué par son expérience et sa réputation».
«Il suffira certainement, Mademoiselle, ajoutaient MM. Le Sesne et
Cie, de présenter un nom aussi recommandable aux amateurs de cette
entreprise, pour que chacun s’efforce de participer à la gloire qui
l’accompagne et se remplisse de l’esprit qui vous anime pour l’avantage
et le bonheur de l’État.»
La réponse de d’Éon à cette flatteuse requête était écrite sur le ton
d’une dignité fière et protectrice:
Paris, le 2 décembre 1780.
J’ai reçu ce matin, Messieurs, la lettre que vous m’avez fait
l’honneur de m’écrire hier, pour donner mon nom à la frégate de 44
canons que vous faites construire à Granville et qui est déjà fort
avancée dans sa construction.
Je suis trop sensible à l’honneur que vous voulez bien 270 me faire
et trop pénétrée des sentiments patriotiques qui animent votre
génie, votre zèle et votre courage pour le service du roi, contre
les ennemis de la France, pour ne pas, en cette occasion, faire
tout ce que vous désirez de moi afin de contribuer promptement et
efficacement au but salutaire et glorieux de vos désirs.
Je connais, aussi, Messieurs, tout le soin que vous apportez pour
le choix d’un excellent capitaine de vaisseau, celui d’officiers
expérimentés et des braves volontaires qu’ils prendront. Avec ces
sages précautions, de l’économie dans votre finance, et une grande
audace dans le combat, votre entreprise doit être couronnée de succès.
Mon seul regret dans ma position présente est de n’en être ni
compagne ni témoin; mais si mon estime particulière peut accroître
votre zèle, les étincelles de mes yeux et le feu de mon cœur
doivent naturellement se communiquer à celui de vos canons à la
première occasion de gloire.
J’ai l’honneur d’être, avec tous les sentiments distingués que vous
méritez à si juste titre, etc...[246]
MM. Le Sesne firent paraître, en même temps que cette réponse, une
nouvelle lettre où, en exprimant à l’«héroïque chevalière» toute
leur reconnaissance pour le précieux patronage qu’elle daignait leur
accorder, ils déclaraient qu’ils ne sauraient trouver un meilleur
témoignage de leur gratitude que de soumettre à Mlle d’Éon le choix du
capitaine, des officiers et des volontaires de la frégate qui devait
porter son nom.
A la suite de cette lettre parut une nouvelle réponse de d’Éon,
empreinte de cette humilité qui sied aux héros:
271
Paris, le 15 décembre 1789.
J’ai à répondre, Messieurs, à la nouvelle lettre dont vous m’avez
honorée le 4 de ce mois.
Si j’avais prévu les conséquences qui résultent de la réponse que
j’ai cru devoir faire à votre demande gracieuse de nommer une de
vos frégates, je me serais bien gardée d’accepter cet honneur. Les
louanges que cette déférence m’attire de votre part donnent de
mes talents et de mon mérite une idée qui ne peut s’accorder avec
l’opinion que je dois en avoir.
Quant au choix du capitaine de vaisseau, des officiers et volontaires
qui désirent se distinguer sur votre armement, je crois, Messieurs,
qu’il suffit d’ouvrir à nos marins et à nos militaires une carrière
de gloire et d’utilité au gouvernement pour les voir s’y présenter
en foule et acheter aux dépens de leur fortune et même de leur vie
le droit de la parcourir, en sorte que je regarde ce choix bien
plus difficile à faire par le grand nombre de concurrents que par
le mérite et le courage: qualités naturelles à tous les militaires
français, que je suis plus dans le cas d’applaudir et d’imiter que de
juger.
Il ne manqua pas, en effet, de gens en quête d’aventures pour
solliciter un poste sur la Chevalière-d’Éon. Les papiers de d’Éon
contiennent nombre de lettres de ce genre, et le bruit courut même que
la chevalière en personne s’embarquerait sur le vaisseau qui porterait
son nom.
Malheureusement, l’argent des actionnaires n’affluait pas rue de
Bailleul, chez MM. Le Sesne et Cie, en la même abondance que les
demandes d’engagement. Un extrait du Journal de Paris, contenant les
lettres échangées entre les armateurs et Mlle la chevalière d’Éon,
avait été lancé sous forme de prospectus et 272 adressé à toutes les
personnes susceptibles de s’intéresser à l’entreprise. La vignette
même représentant la Chevalière-d’Éon entourée de vaisseaux ennemis
et faisant feu de ses deux bords ne décida pas les souscripteurs, et
l’entreprise dut être abandonnée. Pareille tournure d’un si beau projet
ne faisait pas l’affaire de ceux à qui d’Éon avait déjà distribué des
emplois sur sa frégate. Un certain «mestre de camp de dragons», qui
signe seulement de son initiale et qui avait été choisi pour commander
le bâtiment, lui écrivait, le 14 juillet 1781, de Granville, où il
s’était avisé d’aller surveiller les préparatifs de l’expédition:
L’armement de la Chevalière-d’Éon, ma très ancienne et très loyale
amie, ne prend pas cette tournure que j’aurais désirée pour vous,
pour M. Le Sesne et pour moi, malgré tous les mouvements que je me
suis donnés et que je ne cesse de me donner. Je ne dois point vous
cacher, mon ancienne amie, que ce vaisseau qui doit porter votre nom
n’existe encore que dans l’imagination de M. Le Sesne, qu’il n’y a
pas sur le chantier à Granville un pied de bois sur quille destiné
à la construction de ce vaisseau. Il est bien vrai que M. Le Sesne
avait fait acheter une portion de bois destiné ad hoc, qui, n’ayant
pas été payée, a été saisie, et, pour éviter les suites désagréables,
il a été envoyé dernièrement ici un certain M. Agaste pour arrêter
les poursuites; mais tout cela ne fait pas et ne fera pas construire
le vaisseau la Chevalière-d’Éon...
L’affaire engagée par MM. Le Sesne et Cie échoua donc faute d’argent
et d’Éon se vit réduit à licencier le personnel qu’il avait engagé pour
combattre sous 273 ses couleurs; l’idée toutefois ne fut pas perdue et
quelques mois plus tard d’autres armateurs, MM. Charet et Ozenne, de
Nantes, donnèrent le nom de Chevalière-d’Éon, nom qui leur parut sans
doute symboliser l’audace heureuse et fertile en expédients, à l’un des
vaisseaux qu’ils armèrent pour convoyer les marchandises échangées, en
dépit de la guerre navale, avec les colonies françaises de l’Amérique
et de l’Inde[247].
D’Éon ne semble pas s’être mêlé de cette nouvelle entreprise, découragé
sans doute par l’insuccès de la première; mais il demeura à Paris où
cette affaire l’avait appelé; il ne se présenta plus à la Cour et ne
résida dans la capitale que durant l’hiver de 1780-1781. Il habitait
alors la maison de Mme de Brie, rue de Grenelle-Saint-Germain, et s’y
tenait fort calme auprès de son ami Drouet, l’ancien secrétaire du
comte de Broglie; ses relations d’autrefois venaient l’y réclamer.
C’était Mme Tercier qui, le priant à dîner, lui promettait «de parler
affaires secrètes à s’en époumonner». Le marquis de Courtenvaux, de
la famille de Louvois, qui l’appelait «sa chère payse», envoyait
son carrosse prendre la chevalière «au pont tournant des Tuileries»
et tous deux allaient visiter l’abbaye de Port-Royal des Champs et
le château de Bagatelle, propriété du comte d’Artois, 274 ou bien,
traversant le Bois de Boulogne, déjà très fréquenté, ils allaient
entendre les belles voix des dames de l’abbaye de Longchamp qui, au
temps du carême, attiraient la société la plus élégante et, paraît-il,
la moins recueillie[248]. D’Éon vivait en touriste, désireux de
connaître les embellissements et les curiosités de la ville qu’il avait
quittée depuis plus de vingt ans et qu’il n’avait pu visiter lors de
son retour d’Angleterre, tout occupé qu’il était de son avantageuse
métamorphose. Le petit agenda qu’il tint alors laisse deviner qu’il
n’était pas insensible aux charmes nouveaux du boulevard. S’il ne
fréquentait pas le Café Turc, les Babillards et le Café Sergent,
où se fût trouvée très déplacée une vieille demoiselle de condition,
il goûtait fort le Théâtre des Danseuses du roi que Nicollet venait
de transformer, et où, en place de pantomimes, on commençait à donner
de véritables pièces. Il visitait même la fameuse boutique de Curtius,
qui offrait en spectacle les «mannequins illuminés», les figures en
cire de la famille royale et des principaux personnages d’actualité.
L’impresario, informé de sa venue, voulut en profiter pour prendre son
portrait. Mais il faut croire que d’Éon se souciait peu de figurer en
effigie au milieu de l’illustre compagnie qui se trouvait réunie dans
les Salons du boulevard du Temple, car Curtius dut à quelque temps de
là supplier la 275 chevalière de lui accorder cette grâce. D’Éon ne
put céder à ces nouvelles instances, car il avait déjà quitté Paris. La
lettre de Curtius le rejoignit à Tonnerre, où les soins de son petit
domaine l’avaient rappelé au retour du printemps.
Depuis lors, et jusqu’en 1785, sa vie s’écoule paisiblement, sans
qu’aucun événement digne d’être rapporté vienne la troubler ou même
l’animer. Les voyageurs illustres ne manquent pas de le saluer au
passage; ils consacrent les loisirs du relais à s’entretenir avec
l’héroïne bourguignonne et à admirer ce singulier personnage qui n’est
pas une des moindres curiosités de la route. C’est ainsi que le prince
Henri de Prusse, que d’Éon avait connu en Allemagne, voulut revoir
l’ancien capitaine de dragons. Il ne dédaigna pas de souper à la table
de la chevalière et de sa vieille mère, fort intimidée par la présence
d’un aussi illustre convive[249]. Un de ces intrépides pèlerins, qui
joignait au don d’observer avec finesse le talent de conter avec
charme, le comte d’Albon, griffonnait sur un carré de papier, scellé en
toute hâte de l’empreinte d’un écu, ce laconique billet de regrets:
276
Le comte d’Albon salue, embrasse et aime Mlle d’Éon de tout son
cœur; il passe en poste à Tonnerre et est pressé et désespéré de
ne pouvoir aller lui répéter combien sont sincères les sentiments
qu’il lui a voués pour la vie.
D’Éon est accueilli avec la même cordialité dans les châteaux voisins:
à Persey, chez le comte d’Ailly; aux Croûtes, chez le vicomte de
Lespinasse, et particulièrement à Anci-le-Franc. Là se trouve réunie
pendant l’été toute la famille de Louvois: le marquis et la marquise
de Louvois, le marquis de Courtenvaux, Mme de Souvré. Les fêtes s’y
succèdent, bals et saynètes où chacun des hôtes doit remplir son rôle.
D’Éon fournit des costumes, des «habits bruns de camelot galonné» et
lui-même, dont la vie s’est déroulée en si bouffonne comédie, fait
partie de la troupe et se rend à l’invitation que ses voisins lui
adressent le 23 août 1782:
Mme de Louvois a l’honneur de faire mille compliments à Mlle la
chevalière d’Éon et de la faire ressouvenir de la promesse qu’elle a
bien voulu lui faire de venir vendredi au plus tard dîner et coucher
à Anci-le-Franc. La société compte sur la complaisance de Mlle la
chevalière pour se charger d’un petit rôle qui ne consiste qu’à tenir
une boutique et à chanter le couplet suivant:
BOUTIQUE DU PERRUQUIER
(Mlle d’Éon)
Air de la Béquille du père Barnabas.
Ici nous réparons
Le désordre des têtes
Qu’ont causé les tendrons
Dans leurs douces conquêtes.
277
Mais, hélas! quoique fille,
Je ne prétendrai pas
Relever la béquille
Du père Barnabas.
Le rôle était bien modeste pour un tel virtuose; mais la chanson
grivoise ne dut pas déplaire au chevalier, qui s’ingéniait à égayer
la galerie, fût-ce à ses dépens. Toujours recherché dans les châteaux
voisins, il était aux yeux des habitants de Tonnerre et de tous les
Bourguignons le compatriote célèbre, la gloire provinciale à qui
revient de droit la présidence de toutes les réunions. C’est ainsi
que le Père Rosman l’invitait à assister à la distribution des prix
de l’école royale militaire d’Auxerre: «Votre présence, disait-il, ne
peut qu’exciter vivement l’émulation et le zèle de nos élèves qui se
destinent à l’état militaire, dans lequel vous vous êtes distinguée; je
joins mes prières à celles de tous ceux qui ont entendu parler de vos
talents et de votre mérite (et c’est toute la ville)...[250]»
De Joigny, les officiers de Languedoc-dragons, dont le régiment se
trouvait au passage du Weser aux côtés de l’escadron que commandait
d’Éon, viennent en corps le visiter à Tonnerre, et quelques mois après
l’invitent à venir prendre part à la fête qu’ils offrent à la femme de
leur colonel. D’Éon répond alors au comte d’Osseville, chef d’escadron
et secrétaire du régiment:
278
A Tonnerre, le 23 août 1781.
J’ai reçu hier, Monsieur, avec la sensibilité d’un jeune cœur
femelle enté sur celui d’un vieux capitaine de dragons, l’invitation
pleine d’honnêteté et d’agréments que vous m’avez fait l’honneur de
me proposer, tant en votre nom qu’en celui de tous vos messieurs.
Il m’eût été bien doux et bien agréable d’aller me ranger sous les
guidons de Languedoc le jour de la fête que vous avez préparée à Mme
la comtesse d’Arnouville qui, en ne laissant enchaîner son cœur
que par son mari, a néanmoins le talent rare de captiver l’hommage de
tous les dragons et de tous ceux qui ont le bonheur de la connaître.
C’est bien à mon grand regret et chagrin que je suis forcée de rester
chez moi à cause d’une espèce de coup de soleil que j’ai attrapé
sur la tête en faisant construire une terrasse sur le bord de la
rivière d’Armençon par les grandes chaleurs que nous avons eues il
y a huit jours. Je suis entre les mains des médecins et désolée de
ce contre-temps. J’ai trop bonne opinion et du régiment de Languedoc
et de moi-même, monsieur, pour aller le jour même de votre fête vous
présenter un vieux dragon sans tête. J’espère bien qu’après votre
fête et la revue de l’inspecteur vous aurez le temps et l’occasion
de venir dans quelques châteaux du voisinage de Tonnerre et que cela
vous donnera celle, ou à quelques-uns de vos messieurs, de venir
passer quelques jours chez Mlle d’Éon, qui se fera toujours honneur
de recevoir de son mieux ses anciens compagnons.
Je vous prie instamment d’être auprès de M. et Mme la comtesse
d’Arnouville et de tous vos messieurs de Languedoc, tant en général
qu’en particulier, le fidèle interprète de mes regrets sensibles en
cette occasion.
J’ai l’honneur d’être avec les sentiments de la plus haute
considération et du plus parfait attachement que j’ai voué à tous les
dragons et que je vous dois en particulier, Monsieur, votre, etc...,
etc...
279
La chevalière n’était pas seulement la patronne des dragons, elle avait
aussi son grade dans la franc-maçonnerie et était, en dépit du sexe qui
aurait dû lui en fermer l’accès, convoquée aux «tenues» solennelles de
la loge des Neuf-Sœurs:
Je m’estime heureux, lui écrivait le F∴ d’être auprès de vous
l’interprète des sœurs de la R∴ L∴ qui vous prie de lui
faire la faveur d’assister demain à la fête funèbre qu’elle consacre
à la mémoire de ses FF∴ décédés. Je joins ici l’invite de cette
fête où vous avez une place marquée comme maçon, comme littérateur,
comme faisant la gloire de votre sexe après avoir fait tant d’honneur
au nôtre.
Il n’appartenait qu’à mademoiselle d’Éon de franchir la barrière qui
interdit l’accès de nos travaux à la plus belle moitié du monde.
L’exception commence et finit à vous; ne refusez pas de jouir de
votre droit, et si vous nous faites la faveur de vous rendre à
mon désir, ajoutez-y celle d’arriver de bonne heure, afin de voir
complètement une fête qui ne serait pas complète sans vous[251].
La popularité de d’Éon était à ce point établie en Bourgogne que les
poètes qui chantaient les beautés de cette contrée fertile eussent cru
en oublier le plus grand attrait et la plus récente gloire en omettant
de célébrer les hauts faits de leur étrange compatriote. Aussi n’y
manquaient-ils pas, comme en témoigne un petit poème que le prieur de
Chablis écrivait en latin sur Tonnerre et où il traçait un portrait
flatteur de la chevalière, tout en convenant cependant 280 que son
allure martiale s’accommodait mal de son virginal accoutrement[252].
Tant de célébrité faisait supposer beaucoup d’influence, et ses
concitoyens, ses anciens camarades, ne doutant pas qu’il eût un grand
crédit à la Cour et auprès des personnes en place, espéraient obtenir
par son entremise les faveurs les plus variées. Les dragons sont
naturellement très nombreux parmi ces solliciteurs: ils ambitionnent
la croix ou une pension, une lettre de passe ou un congé. D’Éon
accueille ces requêtes qui le flattent avec une bonne grâce inlassable,
met à contribution ses nombreuses relations et s’adresse même à des
personnages qu’il ne connaît point, mais dont il ne peut, à son sens,
être inconnu. Des réponses, comme celle du marquis d’Espinay Saint-Luc
l’assurant que «les égards dus à sa célébrité sont un sûr garant de
l’effet de sa protection», ne faisaient d’ailleurs que confirmer d’Éon
dans cette avantageuse appréciation de soi. Aussi dans cette année de
1783 s’efforce-t-il d’obtenir pour ses protégés des 281 emplois dans
la marine, dans la régie des aides, dans la maison du roi même.
Les religieux trouvent en lui un avocat toujours bienveillant: c’est
l’abbé de Molly-Billorgues qui, apprenant que l’on va former une maison
à Madame Élisabeth, sœur du roi, le prie d’obtenir de M. Amelot le
titre d’aumônier de la princesse; c’est l’abbé de Lacy qui sollicite
d’être attaché à un régiment; une autre fois d’Éon n’hésite pas à
s’adresser directement à l’évêque-duc de Langres, Mgr de la Luzerne, au
profit d’un prieur qui craint d’être dépossédé d’un bénéfice obtenu par
«un arrêt subreptice»; plus tard enfin, c’est à l’archevêque de Paris
qu’il recommande un vicaire d’Épineul en butte à des vexations de la
part de ses ouailles.
C’est aussi à ce moment, où toutes ses incartades semblent effacées
dans le souvenir de ses contemporains par la célébrité qu’il a su se
créer, que d’Éon songe à sa famille. Celle-ci se trouve alors dans une
bien misérable situation. Son beau-frère est sans ressources, ayant
contracté de nombreuses dettes à Tonnerre; d’Éon doit consacrer à les
payer plusieurs quartiers de sa petite pension et sollicite pour M.
O’Gorman d’abord une place de visiteur de la poste aux chevaux, puis
un consulat en Amérique. Il s’intéresse particulièrement à l’aîné
de ses neveux; il compte l’adopter et en attendant lui permet de
porter le nom de d’Éon. Le chevalier O’Gorman-d’Éon sort de l’École
militaire et veut prendre part à la guerre d’Amérique sur le conseil
de son oncle qui, 282 pour les frais de son équipement, lui remet 700
livres; il s’embarquera sur la Cérès, «où le comte de la Bretonnière
l’a accepté. M. de Tréville promet de faire tout ce qui dépendra de
lui pour contribuer à l’avancement du jeune officier[253]» et M.
d’Estaing «s’intéresse à lui autant qu’à la Jeanne d’Arc moderne»,
dont l’intrépide marin eût souhaité d’être le «chevalier loyal[254]».
Le jeune homme est à peine arrivé en Amérique qu’il s’y conduit
vaillamment et que le comte Mac Nemara s’empresse de témoigner à la
chevalière combien il est heureux «d’avoir avec lui un tel camarade».
L’avenir semble sourire au jeune officier que son chef traite aussi
familièrement, et d’Éon, qui lui a ouvert les portes de sa carrière, le
suit par l’imagination dans ces pays lointains qu’il eût tant désiré
parcourir lui-même. L’héroïne tonnerroise, confinée dans sa modeste
demeure, voit en son neveu ses espoirs réalisés; elle ne s’intéresse
guère à l’orage qui gronde en France et qui éclatera bientôt. Elle est
en relations suivies avec les généraux et les amiraux qui luttent aux
colonies, les félicite de leurs succès, et ils s’en montrent flattés:
C’est toujours avec un nouveau plaisir, Mademoiselle, lui écrit
le marquis de Bouillé, que je vois les lettres que vous voulez
bien m’écrire; vos parents et protégés sont on ne peut pas mieux
recommandés auprès de moi et ils ne peuvent pas avoir de meilleurs
titres.
283
M. Rougeot est actuellement commandant de l’artillerie dans le
régiment de la Martinique; il n’a pas été possible de le placer
plus avantageusement. Le jeune O’Gorman a été fort malade; je lui
ai procuré une gratification et il n’est pas en mesure qu’on fasse
davantage pour lui; par la suite peut-être se présentera-t-il des
circonstances favorables.
J’ai été jusqu’ici très heureux et la fortune m’a traité comme une
maîtresse, mais si vous n’étiez pas la chevalière d’Éon, je vous
dirais qu’elle est femme et conséquemment sujette à des caprices.
Ce pauvre Grasse en a essuyé un terrible: il est vrai qu’il est
vieux, que je suis encore jeune et qu’elle aime les jeunes gens; je
vais donc encore briguer ses faveurs, et si elle me tient rigueur,
il faudra la violer. Vous voyez que je pense comme un ancien
dragon[255]...
Le jeune O’Gorman ne pouvant continuer à seconder le brave marquis
dans son corps-à-corps avec la fortune, d’Éon s’inquiète aussitôt de
son retour et obtient pour lui un brevet de lieutenant, grâce à M. de
Sartine:
J’apprends avec plaisir, Mademoiselle, que monsieur votre neveu a
été compris dans la dernière nomination des aspirants-gardes de la
marine; je vous en félicite et je suis charmé d’avoir pu y contribuer
par mon intérêt. Je ne doute pas qu’il ne suive les bons exemples que
sa famille lui offre, je ne suis pas surpris des succès de son frère
aîné: ils se distingueront tous deux s’ils suivent vos conseils.
J’ai l’honneur d’être bien sincèrement, Mademoiselle[256]...
284
Tandis que d’Éon voit ainsi couronnés de succès les efforts qu’il a
faits pour engager ses neveux dans une carrière honorable, il songe
à quitter non seulement Tonnerre, mais la France. La paix qui vient
d’être conclue avec l’Angleterre lui ouvre de nouveau les portes de
ce pays où il a pris la soif de la liberté. Des affaires urgentes l’y
appellent aussi: sa riche bibliothèque, sa collection d’armes de prix y
sont restées aux mains de créanciers qu’il n’a pu désintéresser et qui
le menacent sans cesse de faire vendre leur gage. Il supplie le comte
de Vergennes de lui accorder de nouveaux secours et, en dépit d’un
refus catégorique, n’en persiste pas moins dans son parti.
C’est au milieu de l’été 1785 qu’il revient à Paris où la duchesse de
Montmorency lui offre l’hospitalité; il revoit ses anciens et fidèles
amis, les Campan, les Fraguier, les Tanlay, et est même introduit dans
une famille promise à une brillante fortune: il est présenté à la
comtesse de Beauharnais qui bientôt «raffole» de lui. La même curiosité
qu’il avait éveillée autrefois semble renaître alors; mais les motifs
impérieux qui le rappellent à Londres l’obligent à s’y soustraire
et, le 25 novembre 1785, il quitte sa patrie où il ne reviendra plus
désormais.
285
CHAPITRE XI
D’Éon retourne à Londres pour payer ses créanciers.—Il y retrouve
sa popularité d’autrefois.—Il cherche à vendre ses collections et
manuscrits.—Premières nouvelles de la Révolution: la citoyenne
Geneviève d’Éon se signale par son ardent jacobinisme.—Pétition à
l’Assemblée nationale.—Pour gagner sa vie d’Éon donne des assauts
publics: il est blessé.—Maladie et vieillesse de d’Éon.—Il meurt à
Londres le 21 mai 1810.
Les affaires qu’il allait avoir à régler à Londres étaient en effet des
plus embrouillées. Depuis plusieurs années un créancier, à qui lors
de son retour en France il avait laissé la garde de sa bibliothèque
et de ses papiers, le sieur Lautem, réclamait à son débiteur, qui
faisait la sourde oreille, le remboursement de 400 livres sterling.
N’obtenant rien de d’Éon lui-même, Lautem avait eu recours au comte de
Vergennes et n’avait pas négligé de souligner sa requête d’une discrète
menace: «Les effets de d’Éon, disait-il, sont un nantissement et non un
dépôt; je pourrais donc les faire vendre, mais je ne veux pas vendre
des papiers d’État. Né à Bruxelles, sujet de Sa Majesté Impériale,
alliée du roi de France, je ne serais pas flatté d’avoir amusé les
Anglais aux dépens d’un Français qui a logé chez moi; mais Mlle d’Éon
ne mérite plus aucun ménagement de ma part.» Le ministre fit répondre
par le premier commis Durival que 286 «les arrangements que le roi
avait bien voulu autoriser en faveur de Mlle d’Éon pour faciliter son
retour dans sa patrie et la remise qu’elle avait faite en conséquence
des papiers de sa correspondance, ne permettaient pas de supposer
qu’elle en eût laissé aucun de quelque valeur» entre les mains du sieur
Lautem. Il faut croire toutefois que la confiance du comte de Vergennes
n’était pas entière, car s’il n’envoyait pas les 400 livres sterling,
il offrait du moins 200 louis. D’ailleurs la transaction ne fut pas
acceptée par Lautem, qui se résolut à faire annoncer la vente publique
à Londres de tous les papiers appartenant au chevalier. L’effet de
cette publication fut immédiat. D’Éon reçut aussitôt l’autorisation
de passer lui-même en Angleterre pour y liquider sa situation, et une
somme de 6,000 livres lui fut donnée pour désintéresser ses créanciers.
Il se rendit à Londres le 18 novembre 1785 et s’y réinstalla chez le
sieur Lautem, lui témoignant si peu de rancune qu’il est difficile de
croire que le créancier et le débiteur ne s’étaient pas mis d’accord
pour organiser cet habile chantage. Outre Lautem, son hôte, d’Éon paya
les plus exigeants de ses créanciers. Rentré en possession de ses
livres et de ses documents, il put se remettre à écrire, car jusqu’à la
fin de sa vie il fut un terrible noircisseur de papier; les événements
auxquels il avait été mêlé, et qui à mesure qu’ils reculaient dans
le passé grandissaient dans sa complaisante imagination devinrent le
thème de récits cent fois interrompus et toujours repris sous 287 une
forme nouvelle, plus grandiloquente et plus recherchée. Il se remit à
lancer des opuscules dans la société anglaise; à entretenir le public
par l’intermédiaire des gazettes, qui trouvaient à la fois en lui
un rédacteur toujours fertile en expédients et une réclame pour des
lecteurs avides de singularité[257]. Il consentit même, tant était
grande son impatience d’agir, à utiliser de nouveau les services de
l’aventurier Morande qu’il avait jadis si fort maltraité. Celui-ci,
d’ailleurs, n’avait pas gardé rancune à d’Éon: «Je vous ai aimée
sincèrement, écrivait-il, vous avez paru m’être attachée; un vent
sombre est venu souffler sur nous et nous a ballottés l’un et l’autre
un moment, mais dix ans de calme ont dû nous remettre dans notre
assiette ordinaire.»
L’intrigue était en effet l’assiette habituelle du sieur de Morande
et il s’y retrouvait toujours en équilibre, n’ayant rien perdu que
sa dignité dans ses volte-faces successives. Ce fut lui qui servit
d’intermédiaire à d’Éon auprès des éditeurs de Londres comme aussi
auprès des gens d’affaires et, à l’occasion, des usuriers. Ce n’est
pas d’ailleurs que la chevalière d’Éon fût privée de relations; elle
en avait beaucoup, des plus honorables et même des plus hautes.
D’Éon fut accueilli, dès son arrivée à Londres, par M. Barthélemy,
chargé d’affaires en l’absence de l’ambassadeur de France, le
marquis 288 de la Luzerne, pour lequel il avait reçu du comte de
Vergennes des recommandations particulières. Il semble que l’honnête
homme que fut Barthélemy ne conçut jamais le moindre doute sur la
véritable personnalité de la chevalière d’Éon. Il se montra en effet,
pendant toute la durée de son séjour à Londres, particulièrement
galant et empressé auprès de sa renommée compatriote, lui envoyant
continuellement son carrosse pour l’amener dîner à l’ambassade, lui
servant de cavalier quand elle acceptait l’invitation de quelque grand
seigneur anglais et passant chez elle plusieurs fois par semaine pour
lui «faire sa cour». De 1785 à 1789 il ne lui adressa pas moins de cent
soixante-dix-huit lettres et billets que nous avons retrouvés dans les
papiers du chevalier. Les invitations sont toutes rédigées dans la
forme la plus aimable et la plus respectueuse, comme celle-ci, qui fut
adressée à «Mademoiselle la chevalière d’Éon» le 5 octobre 1788:
M. le duc de Piennes et M. le chevalier de Caraman, qui viennent
d’arriver de Newmarket, ont accepté de dîner demain avec moi. Je
désire plus que je ne saurais vous l’exprimer, Mademoiselle, que
vous soyez libre et que vous veuilliez bien être de la partie. Il
n’y en a pas d’agréable quand vous n’en êtes pas. Nous serons peu de
monde, car le temps me manque pour inviter des personnes de notre
connaissance commune.
Je suis avec respect, Mademoiselle, votre très humble et très
obéissant serviteur.
Barthélemy[258].
289
L’évêque de Langres avait d’ailleurs très chaudement recommandé d’Éon
à son frère le marquis de la Luzerne, ambassadeur de France, qui, par
une curieuse coïncidence, se trouvait avoir connu jadis le chevalier
à l’armée du maréchal de Broglie. C’est à ces anciennes relations de
jeunesse que fait allusion la lettre suivante que le marquis de la
Luzerne lui adressa dès son retour à Londres, après un congé passé en
France:
L’évêque de Langres a été longtemps à la campagne, Mademoiselle; il
ne m’a remis votre lettre qu’au moment de mon départ pour Londres.
J’y ai vu avec bien de la reconnaissance que vous vouliez bien
penser à moi et vous rappeler notre jeunesse. Soyez bien persuadée
que je vous ai suivie depuis cette époque avec beaucoup d’intérêt
et que j’ai fort regretté que les différentes positions de notre
vie nous aient éloignés l’un de l’autre. Je serai charmé de vous
voir à Londres et de vous renouveler de vive voix les sentiments de
l’ancien et tendre attachement avec lequel j’ai l’honneur d’être,
Mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le marquis de la Luzerne[259].
Soit chez son ami Barthélemy, soit chez l’ambassadeur, avec qui il
conserva toujours les bons rapports si curieusement renoués après de
longues années d’intervalle, d’Éon rencontrait tous les Français de
distinction qui séjournaient ou passaient à Londres: c’étaient le duc
de Chaulnes et le marquis du Hallay, le prince de la Trémoille et le
marquis d’Hautefort, 290 le prince Rezzonico, neveu du pape Clément
XIII; M. de Calonne; l’ancien abbé du Bellay, le vicaire général du
diocèse de Tréguier. Il gardait ainsi contact avec la meilleure société
française. Grand écrivassier il entretenait du reste une volumineuse
correspondance. Plusieurs de ses amis lui envoyaient régulièrement
de France des nouvelles sur tout ce qui pouvait l’intéresser; c’est
Drouet, son ancien collègue dans la diplomatie secrète, qui confie à la
comtesse Potocka une lettre où, après lui avoir exprimé son impatience
de le voir revenir en France, il l’entretient du grand scandale du
jour, le procès du cardinal de Rohan, «l’affaire du collier»:
On ne s’est jamais autant entretenu de cette grande affaire que
dans ce moment-ci. M. Cagliostro a donné un mémoire qui lui fait
beaucoup de partisans. Comme bien des gens l’annoncent un escroc,
un charlatan, un empirique et le jugent ainsi d’après sa conduite à
Varsovie, où il était en 1777, j’ai été voir hier le comte Rzewusky
qui dans cette même année était tout puissant en Pologne. Il m’a dit
que lorsque Cagliostro arriva, il ne laissa pas ignorer qu’il avait
des connaissances en physique et en médecine, et même en alchimie. Un
prince Poninsky, désirant beaucoup faire de l’or, se lia étroitement
avec Cagliostro; ayant vu Madame, il en devint amoureux; peu après,
il lui offrit des diamants qu’elle refusa; il s’adressa au mari, et
à force d’instances il obtint de lui de consentir à ce que sa femme
acceptât les diamants. Poninsky n’ayant pu obtenir ce qu’il espérait
de Mme de Cagliostro et ne voulant pas être dupe, dénonça Cagliostro
comme escroc et obtint de reprendre ses diamants qu’on lui aurait
remis s’il les avait demandés.
Peu de jours après l’arrivée de Cagliostro à Varsovie la 291 sœur
du comte Rzewusky, craignant de perdre la vue pour un mal d’yeux
auquel les médecins ne connaissaient rien, s’adressa à Cagliostro qui
dans peu de jours la guérit parfaitement; cette dame, très riche,
lui offrit 2,000 ducats: il les refusa; elle lui fit faire les
mêmes offres par son frère, qui ne réussit pas mieux, et ni l’un ni
l’autre n’ont pu faire accepter à Cagliostro la plus petite marque de
reconnaissance[260].
Le brave Drouet en conclut avec le comte Rzewusky, qui lui a déclaré
qu’il signerait tous ces faits de son sang, que Cagliostro est
peut-être bien victime de quelque machination, hypothèse faite pour
plaire à d’Éon de plus en plus enclin à ne voir partout que pièges et
embûches.
Quelque temps après le même Drouet lui envoie des nouvelles de sa
famille: son beau-frère O’Gorman a reçu la croix de Saint-Louis; l’aîné
de ses neveux réussit à merveille: il ne sera pas longtemps, ajoute
Drouet, sans avoir le brevet de lieutenant-colonel et avant trois ans
il fera un mariage qui lui donnera de la fortune. Ses deux cadets
sont partis au mois d’octobre dernier sur la même frégate destinée
à faire une course de deux ans; à la fin de la campagne, ils auront
l’un et l’autre le brevet de lieutenant de vaisseau[261]. Aussi Drouet
exhorte-t-il «sa chère amie» à aimer ses neveux qui le méritent à
tous égards. Il l’engage aussi à prendre un peu de patience pour le
règlement de ses comptes.
292
C’est qu’en effet la liquidation en était singulièrement laborieuse.
Dès son arrivée à Londres d’Éon avait intenté un procès aux héritiers
de l’amiral Ferrers. Il accusait en effet le feu lord de n’avoir pas
employé à payer ses dettes, ainsi qu’il en avait reçu mandat, l’argent
qui lui avait été remis contre les papiers de la correspondance
secrète, en exécution de la transaction signée le 5 octobre 1775 par
le sieur Caron de Beaumarchais et la demoiselle d’Éon. Le procès avait
été gagné sur le fond, mais l’exécution du jugement était pratiquement
empêchée par les difficultés de toutes sortes que soulevaient les
héritiers. Aussi d’Éon écrivait-il le 6 avril 1787 à son ami M. de
la Flotte, premier commis aux Affaires étrangères, pour se plaindre
que «cette restitution d’argent qui devait faire le bonheur et la
tranquillité de sa vie en devint le tourment[262]». Il se déclarait
infiniment fâché de demeurer encore en Angleterre; mais ajoutait
que, tant qu’il ne pourrait retourner en France avec honneur, il n’y
retournerait point.
En attendant l’argent qui lui était dû, il cherchait—car il fallait
vivre—à en gagner quelque peu par ailleurs. Il s’occupait, dans
l’intervalle des réceptions où il était convié et où il faisait fort
bonne figure parmi la plus haute société, de toutes sortes d’affaires.
Un jour il s’employait à rechercher un jeune homme qui avait fait une
escapade à Londres; une autre fois il aidait de ses recommandations et
de ses appuis un 293 compatriote, le sieur Petit, désireux de fonder
dans la cité une maison de commerce. Quelque temps après, c’est la
vente d’une terre qui l’occupe; la terre est le marquisat de Cailly
en Normandie, dont la duchesse de Montmorency-Boutteville désire se
défaire, et d’Éon cherche un acquéreur dans ses relations anglaises. Il
était du reste avec la duchesse dans de véritables rapports d’amitié,
celle-ci lui écrivant le 30 mars 1788 qu’elle tenait un appartement
prêt dans son hôtel du Petit-Montreuil pour le loger à son retour en
France. Quelques mois plus tard, d’Éon s’adresse au garde des sceaux
Barentin pour lui proposer l’acquisition d’une riche collection de
manuscrits réunis par lui au cours de son aventureuse carrière. Le
noyau de cette collection était formé par une précieuse série de
papiers du maréchal de Vauban, dont d’Éon demandait d’ailleurs un si
haut prix qu’en 1791 il n’avait pu trouver encore aucun acquéreur. Il
se faisait d’ailleurs de l’intérêt et de l’importance de ces manuscrits
une idée quelque peu exagérée, ne craignant pas d’écrire au comte de
Montmorin:
Je laisse, monsieur le comte, à vos lumières et à votre pénétration
le soin de pressentir combien il serait dangereux de laisser entre
les mains des étrangers une collection si considérable et si
supérieure en moyens d’attaque et de défense, qui peut-être, après
les avoir endoctrinés, pourrait un jour, sans les rendre nos égaux,
en faire des voisins ou des ennemis plus dangereux[263].
294
Mais la correspondance de l’aimable chevalière n’avait point trait
seulement à des affaires d’argent, et d’Éon était d’humeur trop
aventureuse pour ne pas savoir à l’occasion s’élever au-dessus des
questions matérielles. Pendant cette période même où il dut se trouver
aux prises avec les plus grands embarras pécuniaires, il ne manqua pas
d’échanger chaque jour avec les personnages les plus divers des lettres
du tour le plus enjoué. D’ailleurs les missives qu’on lui envoyait
étaient parfois charmantes; qu’il suffise de citer celle-ci de l’abbé
Sabatier de Castres, attaché à la maison du Dauphin; elle est, dans sa
forme un peu maniérée, un parfait échantillon du style qu’employaient
entre eux les plus «honnêtes gens» de l’époque:
Mademoiselle,
M. de Lançon, qui a eu la bonté de m’apporter lui-même votre
charmante épître, en sera récompensé par le plaisir de vous
remettre ma réponse. Il vient de m’apprendre qu’il partait demain
pour Londres et je m’empresse de profiter de son voyage pour vous
témoigner combien j’ai été flatté et suis reconnaissant des dix
pages dont vous m’avez régalé. Je me plaindrais moins amèrement de
votre absence si elle me procurait de temps en temps de pareilles
épîtres; jamais on ne parla avec plus de gaîté d’une nation triste
telle que l’anglaise, ni avec plus de raison et de philosophie d’une
nation gaie et frivole telle que la nôtre. Il n’est donné qu’à vous,
Mademoiselle, d’exprimer plaisamment les pensées les plus sérieuses
et les plus profondes. C’est vraiment dommage que vous ne vous soyez
point exercée dans l’art de Thalie! vous y eussiez mieux réussi que
la plupart de nos comiques 295 actuels, qui ne font rire que les
ignorants ou les pervers, témoin l’auteur du Mariage de Figaro,
qui, à propos de mariage, vient d’épouser sa maîtresse pour légitimer
une fille de six ou huit ans qu’il en avait eue. A présent qu’il est
riche, on est persuadé que sa femme qui est, dit-on, la quatrième,
sera plus heureuse avec lui que ses devancières.
Je suis fâché, mais peu surpris, que le frère héritier de lord
Ferrers ne lui ressemble point du côté de la probité, fâché puisque
vous en souffrez, peu surpris parce que de trois de mes frères dont
j’ai fait la fortune aux dépens de la mienne, il n’est aucun qui
voulût sacrifier un louis d’or pour m’obliger, tant ils sont ingrats
et aiment l’argent!
M. de Chalut, qui jouit d’une bonne santé et d’un excellent esprit,
malgré ses quatre-vingt-deux ans, a été très sensible à votre offre
obligeante et en profiterait s’il ne savait que les tableaux dont il
pourrait se défaire ne valent pas la moitié de ce qu’ils coûteraient
de port et de droits d’entrée en Angleterre. La dernière fois que
je l’ai vu, il me chargea de vous renouveler ses remerciements et
de vous présenter son respect. Vous savez sans doute qu’il a marié
sa fille adoptive avec M. Deville, ci-devant premier secrétaire de
M. le comte de Vergennes et à présent fermier général, et qu’il lui
donne par contrat de mariage cent mille écus. M. de Lançon vous
dira le reste, dans le cas que vous ne soyez pas au fait de cette
aventure. Je lui porte envie, puisqu’il vous verra dans cinq ou six
jours, et c’est vous dire que je ferais aussi le voyage d’Angleterre
si je n’étais retenu ici par le besoin que j’ai de présider aux
gravures et à l’impression de l’ouvrage qu’on m’a chargé de faire
pour le Dauphin. Je me flatte que je ne serai point oublié dans vos
libations. J’aurai lundi à dîner M. de Lançon et M. Le Vasseur, et
c’est à votre santé et à celle de l’inestimable voyageur que nous
sablerons le champagne que j’ai en réserve pour les bonnes occasions.
Vendez promptement 296 votre bibliothèque, vous n’en avez que faire;
vos idées valent mieux que celles qui sont dans les livres: tirez-en
le plus d’argent que vous pourrez, l’argent est nécessaire à ceux qui
en font un aussi noble usage que vous, et revenez ensuite à Paris,
où vous ne trouverez sans doute pas des princes de Galles qui vous
recherchent, mais beaucoup de personnes qui, sans être héritières
présomptives d’un trône, n’en sentent pas moins ce que vous valez et
qui vous aiment plus que les meilleurs princes ne sauraient le faire.
Pardon de mon griffonnage. Le désir de profiter du départ de M.
Lançon m’a contraint d’écrire à la hâte et avec une mauvaise
plume, mais c’est avec réflexion et d’un très bon cœur que je
vous renouvelle l’assurance des sentiments d’estime, d’admiration,
d’attachement et de respect que je vous ai voués pour la vie et avec
lesquels je suis votre très humble et très obéissant serviteur.
L’abbé Sabatier de Castres[264].
D’Éon était ainsi occupé à désintéresser ses derniers créanciers et à
préparer son retour en France, lorsque de graves nouvelles parvinrent
à Londres. La Révolution commençait, c’était du moins ainsi qu’on en
jugeait en Angleterre, car beaucoup de ceux qui devaient être en France
les premières victimes de l’émancipation populaire conservaient encore
à cet égard les plus grandes illusions. Une curieuse lettre adressée à
d’Éon le 2 juillet 1789 par M. de Tanlay, conseiller au Parlement, nous
en fournit la preuve:
Vous voulez donc en Angleterre nous refaire la guerre? 297 Cela
serait bien maladroit. Je crois que les Anglais ont aussi besoin que
nous de tranquillité, et nous prenons un parti qui nous rendra plus
d’énergie nationale que le Français n’en a jamais eu, parce que nous
gérerons nos affaires et celles du roi par nous-mêmes. Je conçois
qu’on croit pouvoir se fonder sur un moment de révolution dans notre
système de gouvernement, mais quand il est aussi avantageux pour
une nation, qu’on la voit se montrer animée d’un patriotisme tel
que celui qui nous dirige actuellement, que l’on voit un monarque
faire tant de sacrifices à sa gloire et au bien de son peuple, ce
n’est nullement le moment de croire avoir sur lui quelque avantage.
J’espère que ce moment d’effervescence se calmera et que l’on nous
laissera en paix faire des établissements qui doivent à jamais
assurer le bonheur de la France, s’ils sont bien dirigés, comme il y
a tout lieu de s’en flatter[265].
Les rêves idylliques de M. de Tanlay ne se réalisèrent pas: la Bastille
fut prise, les Tuileries furent envahies et la guerre fut déclarée.
D’ailleurs son correspondant ne manqua pas d’applaudir «aux victoires
de la liberté»: la chevalière d’Éon devint la citoyenne Geneviève et,
soit conviction sincère, soit peut-être aussi souci de tirer parti
pour sa gloire de ce nouveau moyen de popularité, se signala en toutes
circonstances par le jacobinisme le plus ardent.
A son instigation, un grand nombre de Français établis à Londres
se réunirent à Turnham Green, le 14 juillet 1790, «pour célébrer
publiquement l’anniversaire de la glorieuse Révolution et prêter le
298 serment civique». D’Éon y lut un discours écrit dans le style
déclamatoire et sentimental de l’époque et sa harangue fut si goûtée
que toutes les gazettes anglaises la reproduisirent aussitôt:
Frères, amis, compagnons, compatriotes, Français libres, tous membres
d’une même famille, soldats, citoyens voués à la défense de la Patrie
régénérée, nous devons comme Français dans une terre étrangère être
jaloux de donner à notre chère patrie de nouvelles preuves d’un zèle
qui ne s’éteindra qu’avec nos jours.
Nous jurons avec allégresse, sur l’honneur et sur l’autel de la
Patrie, en présence du Dieu des armées, de rester fidèles à la
Nation, à la Loi et au Roi des Français; de maintenir de tout notre
pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et
acceptée par Sa Majesté. Périsse l’infracteur perfide de ce pacte
sacré, prospère à jamais son religieux observateur!
Oui, mes braves compatriotes, nous devons au péril de notre vie
maintenir les décrets émanés de la sagesse du tribunal auguste de
l’Assemblée nationale, qui vient d’élever sur des bases inébranlables
l’édifice de notre félicité.
Nous devons renouveler l’hommage respectueux de notre amour au père
tendre, au monarque citoyen qui met toute sa gloire et son bonheur
dans celui de ses peuples.
Pour mettre le dernier sceau à nos engagements sacrés, appelons sur
nous la protection toute-puissante du Dieu de paix, que des cœurs
purs invoquent avec confiance pour le soutien d’une si sainte et si
juste cause.
Et puisque l’Éternel l’a naturellement gravé dans le cœur de
tous les hommes, puissent les Français ne jamais perdre de vue
la sublimité de leur constitution, la considérer comme un dogme
national, et y demeurer toujours fidèles! Ce sont les vœux ardents
de mon cœur au nom de la liberté, pour laquelle il serait beau de
mourir et sans laquelle il serait affreux de vivre.
299
En même temps que se tenait l’assemblée française, six cent cinquante
Anglais se réunissaient sous les auspices et la présidence de lord
Stanhope pour célébrer de leur côté le glorieux anniversaire et émettre
«le vœu d’une alliance éternelle entre les nations anglaise et
française pour assurer à toujours la paix, la liberté et le bonheur du
monde entier».
D’Éon, retenu au milieu de ses compatriotes, n’assistait pas au meeting
anglais; mais il y avait envoyé un présent dont l’arrivée suscita le
plus ardent enthousiasme: «une pierre de la Bastille faisant partie du
cintre d’une des principales portes de ce château, qui a essuyé le feu
de la mousqueterie de nos braves Parisiens[266].»
Dès le lendemain, il recevait les remerciements émus de lord Stanhope:
Mansfield Street, 15 juillet 1790.
Madame,
J’ai bien des grâces à vous rendre pour votre présent précieux et
pour la lettre obligeante que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire.
Nous nous sommes assemblés hier au nombre de six cent cinquante-deux
amis des droits imprescriptibles des hommes pour célébrer la
victoire éclatante que la Liberté vient de remporter en France sur
le Despotisme et la Tyrannie. Nous avons exprimé par une résolution
unanime le désir qui nous anime, depuis votre glorieuse Révolution,
de nous lier avec la France. Rien ne nous 300 manquait hier qu’une
pierre de la Bastille; nous avons senti ce qui nous manquait
lorsque nous eûmes le plaisir de la recevoir de votre part et notre
satisfaction a été sensiblement augmentée de l’avoir reçue d’une
personne si renommée dans l’histoire.
J’ai l’honneur d’être, etc.[267].
Par toutes ces preuves de civisme, d’Éon pensait bien attirer vers
lui l’attention des patriotes français. Il avait du reste envoyé son
neveu offrir ses services à l’Assemblée législative et l’avait chargé
de présenter une pétition. La «citoyenne d’Éon» y exposait que, bien
qu’elle portât des habits de femme depuis quinze ans, elle n’avait
pas cependant oublié qu’elle était autrefois un soldat; que depuis la
Révolution elle sentait revivre son ardeur militaire et que, prête à
abandonner son bonnet et ses jupes, elle réclamait son casque, son
sabre, son cheval et son rang dans l’armée:
Dans mon excessive impatience, écrivait-elle, j’ai perdu tout, sauf
mon uniforme et l’épée que je portais dans ma première guerre. De
ma bibliothèque il ne me reste qu’un manuscrit de Vauban que j’ai
conservé comme une offrande à l’Assemblée nationale pour la gloire de
mon pays et l’instruction des braves généraux employés à la défendre.
Cette lecture fut interrompue à diverses reprises par des
applaudissements répétés et, mention en ayant été faite au
procès-verbal, la pétition de la 301 citoyenne d’Éon fut renvoyée au
comité de la guerre, où elle devait rester d’ailleurs à tout jamais
enterrée.
Mais si d’Éon sollicita vainement la République d’accepter ses
services, il fut par contre vivement pressé lui-même de se rallier au
parti du roi et de rejoindre à l’armée de Coblentz ces émigrés parmi
lesquels la Convention ingrate l’avait inscrit. Il reçut d’un des
royalistes fidèles qui avaient suivi les princes au delà des frontières
la curieuse lettre suivante:
A Tournay, le 23 novembre 1791.
Serait-il possible, ma très chère héroïne, que vous tardiez plus
longtemps à vous réunir à toute la noblesse française qui se
rassemble depuis Coblentz jusqu’à Houdenarde: au moment où je vous
écris il ne reste plus en France que les vieux nobles infirmes et
les enfants; que diront tous les autres s’ils ne nous voient pas
arriver soit à Tournay, où je suis, ou bien à Mons, Ath, Bruxelles
et Coblentz? Oui, ma chère héroïne, si vous tardez beaucoup, vous
n’arriverez donc qu’après le temps où vous pouvez acquérir beaucoup
de gloire, et alors tous les braves chevaliers français vous diraient
comme Henri Quatre à Crillon: «Pends-toi, brave Crillon!» Beaucoup
sont surpris de ne pas vous voir où le vrai honneur conduit, et
dans le nombre de ceux qui ne vous connaissent pas il en est qui
disent que vous êtes démagogue: sur ce mauvais propos j’ai mis la
main sur l’épée que vous m’avez fait faire et leur ai dit que je
leur répondais sur ladite arme que je tenais de vous qu’avant peu
ils vous verraient, et que si cela n’était pas, ladite épée vous
serait envoyée avec une quenouille. Je ne vous dis pas cela, ma chère
héroïne, pour vous exciter, 302 parce que je vous crois trop bien
pensante pour avoir besoin de l’être, mais bien pour vous assurer que
je suis et veux être votre chevalier envers et contre tous.
En arrivant à Coblentz, où je vais, adressez-vous à M. de Preaurot,
mon ami, auquel les princes ont donné leur confiance pour recevoir
tous ceux qui arrivent. Oui, ma chère héroïne, avant peu tout ce
qui est de gens honnêtes ne resteront en France que parce qu’ils ne
peuvent pas faire autrement, à cause de leurs infirmités et de leur
mauvaise fortune; il en est beaucoup au secours desquels viennent
ceux qui le peuvent. Oui, je pense que nous voilà au moment que vous
pourrez effacer la pucelle d’Orléans: quelle gloire pour notre bonne
ville de Tonnerre, où l’on m’a marqué que l’on s’attendait des bons
principes qui sont en vous que vous n’abandonneriez pas la cause de
l’honneur.
Et plus bas, d’une autre écriture:
La baronne de l’autre monde ne peut rien ajouter au style du brave
chevalier qui écrit cette lettre que le désir qu’elle a de voir
arriver son héroïne; elle la prie d’adresser sa réponse à M. Mazorel,
poste restante à Tournay, où elle sera bien reçue[268].
D’Éon a écrit en marge de cette lettre qu’il n’y a fait aucune réponse.
Mais en vain évitait-il de se compromettre avec les royalistes et les
aristocrates, le loyalisme de ses sentiments républicains ne lui valut
pas le rétablissement par la Convention de la pension que lui faisait
la royauté et dont les quartiers ne lui étaient plus payés depuis
1790[269]. Il dut se 303 faire une sorte de gagne-pain de l’épée qu’il
ne lui était plus permis de mettre au service de son pays et se vit
réduit à prendre part à des assauts publics. A défaut de la gloire du
champ de bataille, il y gagna du moins une véritable renommée. Il eut
pour adversaires les meilleurs escrimeurs de l’Angleterre, le chevalier
de Saint-Georges lui-même, et les battit plus d’une fois. D’Éon n’était
point d’ailleurs novice en cet art: déjà vers 1750, lorsque tout jeune
avocat au Parlement de Paris il écrivait pour se faire remarquer
d’érudits traités d’histoire ou d’économie politique, il s’y était
distingué. Il n’avait fait que développer cette science des armes au
cours de sa vie aventureuse et durant sa carrière à l’armée; aussi son
âge déjà avancé ne l’empêcha-t-il pas de faire honneur à une réputation
que son nouveau sexe rendait tout à fait piquante et extraordinaire.
Bien qu’il reprît d’ordinaire pour tirer en public son ancien uniforme
des dragons, d’Éon fit plusieurs fois assaut sous un costume mi-féminin
et mi-masculin. Au mois de septembre 1793, il prit part dans ce bizarre
accoutrement à un tournoi que le prince de Galles présida lui-même; il
y remporta sur un officier anglais un brillant succès, et des estampes,
qui sont aujourd’hui fort recherchées, fixèrent le souvenir de cette
curieuse solennité. Le profit que lui procurait ce précieux talent le
détermina même à entreprendre hors de Londres de véritables tournées.
Les gazettes anglaises 304 relatent les succès qu’il obtint à Douvres,
à Canterbury, à Oxford. Ce fut au cours d’une de ces tournées, à
Southampton, qu’arriva, le 26 août 1796, le malencontreux accident qui
devait mettre une brusque fin aux succès d’escrimeur que la chevalière
d’Éon remportait encore à l’âge de soixante-neuf ans. Le fleuret de
son adversaire se cassa, lui faisant une sérieuse blessure. D’Éon fit
publier dans les journaux le certificat des médecins qui l’avaient
soigné et une adresse où, remerciant le public des marques d’intérêt
qui lui avaient été données, il déclarait avec amertume qu’il serait
réduit désormais à «couper son pain avec son épée».
Sa blessure le cloua au lit pendant quatre mois; dès qu’il fut
transportable, on le ramena à Londres, où il eut encore à subir une
longue convalescence. Il fut recueilli par une vieille dame anglaise,
son amie, mistress Mary Cole, qui devait l’entourer et le soigner
jusqu’à la fin de sa vie avec un touchant dévouement. La carrière
aventureuse de d’Éon était bien finie désormais et son existence devait
se terminer le plus platement du monde. Lui-même le constatait avec
mélancolie: «Ma vie se passe à manger, boire, dormir; à prier, à écrire
et à travailler avec mistress Cole à raccommoder le linge, les robes et
les bonnets.»
Toutefois, en dépit de l’âge et de la maladie, d’Éon ne se résigna
jamais entièrement à sa triste condition et, demeurant jusqu’à la fin
aussi indomptable dans son énergie que tenace dans son espoir d’une
meilleure 305 fortune, se reprit à préparer et à solliciter son retour
en France. Il sut intéresser à sa cause le citoyen Otto, commissaire de
la République à Londres, et par son entremise envoya, le 18 juin 1800,
à Talleyrand, ministre des relations extérieures, une longue requête,
où il racontait ses services et exposait ses infortunes:
J’ai combattu le bon combat; j’ai 73 ans, un coup de sabre sur la
tête, une jambe cassée et deux coups de bayonnette. En 1756 j’ai le
plus contribué à la réunion de la France avec la Russie. En 1762
et 1763 j’ai travaillé avec succès, jour et nuit, au grand ouvrage
de la paix de la France avec l’Angleterre. Depuis 1756 j’ai été en
correspondance directe et secrète avec Louis XV jusqu’à sa mort. Je
ne compte pour rien tout ce que j’ai fait pour ma patrie. Ma tête
appartient au département de la guerre, mon cœur à la France et ma
reconnaissance au citoyen Charles Max Talleyrand, digne ministre des
relations étrangères, qui me rendra justice. Il ne me laissera pas
périr de faim et de désespoir[270]...
Le désespoir n’était guère dans le caractère de d’Éon, car au moment
où il envoyait cette lettre lamentable il s’occupait à préparer une
édition d’Horace et un Anglais lui proposait en vue de cet ouvrage
une collection de toutes les éditions anciennes du poète latin de
1476 à 1789. Sa misère cependant était telle qu’il en était réduit à
engager chez un joaillier de Londres sa croix de Saint-Louis et ses
bijoux; mais en même temps il se faisait délivrer par le citoyen Otto
un passeport pour Paris et Tonnerre[271]. 306 Les amis qu’il avait en
France ne manquaient point de l’encourager d’ailleurs dans ses projets
de retour et lui promettaient leur appui.
Barthélemy, l’ancien chargé d’affaires à Londres pendant la Révolution,
devenu sénateur et bien vu par Bonaparte, s’offrait à présenter au tout
puissant Premier Consul la chevalière, jadis illustre, qui plus d’une
fois avait fait avec lui les honneurs de l’ambassade de France. C’est
ce que lui écrivait son ami Falconnet, le 13 septembre 1802:
Mais vous, mon illustre amie, qu’allez-vous faire néanmoins? Je vous
conseille toujours de partir. Plus vous attendrez et moins vous en
aurez la facilité. Souvenez-vous de l’homme d’Horace:
Rusticus expectat dum defluat amnis; at ille
Labitur, et labetur in omne volubilis ævum.
Faites un paquet des choses précieuses, emportez-le. Disposez des
autres pour qu’elles vous suivent au fur et à mesure. Mme Cole se
chargera de les faire partir et tout cela vous arrivera. Le sénateur
Barthélemy ne demandera pas mieux que de vous présenter au Premier
Consul, et je ne doute point que vous n’obteniez sinon toute, au
moins partie de votre pension. Quand vous serez en présence, tout
s’arrangera. De loin, rien n’ira comme il faut. Venez pour le premier
moment loger en hôtel garni; cette circonstance même peut n’être pas
indifférente à 307 vos succès. On s’apitoiera plus aisément sur le
sort d’une héroïne à laquelle aucun parti n’a de reproche à faire,
quand on la verra à son âge privée de toute ressource.
Mais soit que l’âge et la maladie l’empêchassent de se mettre en
route, soit que découragé par tant d’efforts inutiles il n’attendît
plus rien du changement, d’Éon demeurait à Londres. Il y connut des
jours de noire misère, bien que plusieurs de ses anciens amis ou même
certaines personnes de la société anglaise aient continué jusqu’à la
fin de sa vie à lui porter intérêt et à le secourir. La marquise de
Townshend, le duc de Queensberry, mistress Crawford lui envoyaient
régulièrement quelque argent. Ses infirmités l’obligèrent à rester au
lit pendant les deux dernières années de sa vie et il fut pendant toute
cette triste période affectueusement soigné par la compagne dont il
partageait le logis, Mme Cole. Il fit appeler plusieurs mois avant sa
mort un Français, le docteur Élisée, ancien médecin des Pères de la
Charité de Grenoble. Celui-ci, lorsque survint, le 21 mai 1810, la mort
de d’Éon, ne fut pas moins étonné que Mme Cole du véritable sexe de
l’étrange personnage qui, malgré l’âge, la misère et la maladie, avait
mis son amour-propre à tenir son rôle jusqu’au bout. Un procès-verbal
d’autopsie, rédigé par le chirurgien Copeland, permit d’enregistrer
officiellement le mot du singulier problème qui, quarante ans durant,
avait éveillé tant de curiosités et suscité tant de polémiques; mais,
publié à une époque où l’attention publique était sollicitée par
tant de grands événements contemporains, 308 ce document qui fixait
définitivement un point de la chronique du siècle passé ne fut guère
remarqué. C’est seulement de nos jours que de patients érudits l’ont
exhumé de l’obscurité des archives anglaises. Aucun mystère ne plane
donc plus sur l’énigme que n’avait pu percer la sagacité même d’un
Voltaire ou d’un Beaumarchais.
Délivrée du travestissement qu’elle s’était imposé et que la tradition,
aujourd’hui encore, lui conserve fidèlement, la chevalière d’Éon de
la légende doit reprendre sa véritable physionomie sous les traits de
l’audacieux et brillant aventurier que son orgueil affola et perdit,
mais dont la vie restera comme l’un des plus étranges défis que
l’histoire ait jamais portés au roman.
TABLE DES MATIÈRES
| |
Pages |
| Préface |
I |
| CHAPITRE I |
| Enfance et jeunesse de d’Éon.—Ses premiers succès et ses
premiers protecteurs.—Entrée dans la diplomatie.—Le
«Secret du roi».—Mission en Russie.—Les négociations
du chevalier Douglas et l’alliance avec la Russie.—Retour
triomphant de d’Éon. |
1 |
| CHAPITRE II |
| D’Éon va rejoindre en Russie le marquis de L’Hospital.—Ambassade
du baron de Breteuil.—D’Éon revient en
France, porteur de l’accession de la Russie au traité de
1758.—Il quitte la diplomatie pour l’armée et est nommé
aide de camp du maréchal de Broglie.—Sa belle conduite
pendant la guerre de sept ans.—Il rentre dans la diplomatie
pour accompagner à Londres le duc de Nivernais. |
34 |
| CHAPITRE III |
| Le duc de Nivernais, ambassadeur de France à Londres.—Difficile
négociation de la paix de 1763.—D’Éon est
chargé par le gouvernement anglais de porter à Paris les
ratifications du traité.—Il reçoit la croix de Saint-Louis.—Le
comte de Guerchy est désigné pour succéder au 310
duc de Nivernais, et d’Éon, nommé ministre plénipotentiaire,
fait l’intérim de l’ambassade.—Le chevalier d’Éon
mène à Londres un train d’ambassadeur et n’entend pas
«d’évêque redevenir meunier».—Sa querelle avec le
duc de Praslin et le comte de Guerchy. |
54 |
| CHAPITRE IV |
| Arrivée à Londres du comte de Guerchy.—Le chevalier
d’Éon est disgracié et se venge.—Il accuse l’ambassadeur
d’avoir voulu l’assassiner; l’affaire Vergy.—Mission de
Carrelet de la Rozière.—Le duc de Choiseul cherche
à faire revenir d’Éon et le roi à obtenir la restitution de
ses papiers.—L’extradition de d’Éon est refusée par le
cabinet anglais.—Lettre de d’Éon à sa mère. |
77 |
| CHAPITRE V |
| Lutte acharnée du chevalier d’Éon contre le comte de Guerchy;
guerre de libelles; publication à Londres des Lettres,
Mémoires et Négociations.—Louis XV envoie à
d’Éon des émissaires; arrestation d’Hugonnet à Calais;
le secret exposé à être découvert.—Procès intenté par
d’Éon au comte de Guerchy; condamnation de l’ambassadeur
de France par le jury anglais.—Le roi accorde
une pension au chevalier d’Éon, qui se décide à rester en
Angleterre. |
101 |
| CHAPITRE VI |
| D’Éon continue à être l’agent secret du roi en Angleterre;
sa correspondance avec le comte de Broglie.—Il offre
ses services au nouveau roi de Pologne, Stanislas Poniatowski;
Louis XV s’oppose à son projet.—Popularité de
d’Éon à Londres; les paris sur son sexe.—Il s’enfuit et
parcourt l’Angleterre sous un faux nom.—Le chevalier
d’Éon se détermine à se faire passer pour femme. |
131 |
| CHAPITRE VII |
| Services secrets rendus par d’Éon au roi de France et à
Mme du Barry: affaire de Morande; négociations de
311
Beaumarchais.—Les «Loisirs du chevalier d’Éon».—Le
roi se désintéresse du secret, qui est surpris par les
ministres: Favier et Dumouriez en prison; le comte de
Broglie en exil.—Mort de Louis XV.—Louis XVI
liquide le bureau secret; le comte de Broglie fait valoir
les services du chevalier et lui obtient une pension.—Nouvelles
prétentions de d’Éon. |
156 |
| CHAPITRE VIII |
| Louis XVI refuse de céder aux exigences du chevalier.—Les
créanciers poursuivent d’Éon, qui remet ses papiers
secrets en gage chez son ami lord Ferrers.—Les embarras
d’argent ramènent d’Éon à l’idée de se faire passer
pour femme.—Son aveu à Beaumarchais.—Il consent
à négocier et à signer un traité en bonne forme.—Le
comte de Vergennes écrit à la chevalière d’Éon et lui
envoie un sauf-conduit pour revenir en France. |
181 |
| CHAPITRE IX |
| Arrivée de la chevalière d’Éon en France.—Réception qui
lui est faite par la ville de Tonnerre.—Son installation à
Versailles et sa présentation à la Cour.—Impressions et
réflexions de sa famille, de ses amis, des contemporains.—Popularité
de la «nouvelle héroïne» en France et à
l’étranger; ses succès dans le monde de la Cour et la
société de Paris; sa volumineuse correspondance.—Nouvelle
querelle avec Beaumarchais.—D’Éon, ayant
quitté ses habits de femme, est appréhendé par ordre du
roi et conduit au château de Dijon. |
203 |
| CHAPITRE X |
| Captivité de la chevalière d’Éon.—Son élargissement et
son exil à Tonnerre.—Nouvelles démarches: l’armement
de la Chevalière-d’Éon.—D’Éon séjourne à Paris pendant
l’hiver 1780-1781.—Il revient à Tonnerre et y
mène une existence tranquille et fêtée.—Il quitte la
France à la fin de 1785 pour aller régler ses affaires à
Londres. |
260 |
| 312CHAPITRE XI |
| D’Éon retourne à Londres pour payer ses créanciers.—Il
y retrouve sa popularité d’autrefois.—Il cherche à vendre
ses collections et manuscrits.—Premières nouvelles de
la Révolution: la citoyenne Geneviève d’Éon se signale
par son ardent jacobinisme.—Pétition à l’Assemblée
nationale.—Pour gagner sa vie, d’Éon donne des assauts
publics: il est blessé.—Maladie et vieillesse de d’Éon.—Il
meurt à Londres le 21 mai 1810. |
285 |
PARIS. TYP. PLON-NOURRIT ET Cie, RUE GARANCIÈRE, 8.—5673
A LA MÊME LIBRAIRIE
| Louis XV et Élisabeth de Russie, par Albert Vandal, de
l’Académie française. 4e édit. Un volume in-8o cavalier. |
8 fr. |
| (Couronné par l’Académie française, prix Bordin.) |
| Une Ambassade française en Orient sous Louis XV: la
Mission du marquis de Villeneuve (1728-1741), par Albert
Vandal, de l’Académie française. 2e édit. Un vol. in-8o. |
8 fr. |
| Le Comte de Vergennes. Son ambassade en Suède (1771-1774),
par Louis Bonneville de Marsangy. Un volume in-8o avec
un portrait en héliogravure. |
7 fr. 50 |
| Le Chevalier de Vergennes. Son ambassade à Constantinople,
par Louis Bonneville de Marsangy. Deux volumes
in-8o. |
15 fr. |
| (Mention honorable de l’Académie française.) |
| Un Diplomate français à la cour de Catherine II (1775-1780).
Journal intime du chevalier de Corberon, chargé d’affaires
de France en Russie. Publié d’après le manuscrit original, avec
une introduction et des notes, par L.-H. Labande. Deux volumes
in-8o avec un portrait en héliogravure. |
15 fr. |
| Le Duc et la Duchesse de Choiseul. Leur vie intime, leurs
amis et leur temps, par Gaston Maugras. 6e édition. Un volume
in-8o avec des gravures hors texte et un portrait en héliogravure. |
7 fr. 50 |
| La Disgrâce du duc et de la duchesse de Choiseul. La
Vie à Chanteloup, le retour à Paris, la mort, par Gaston Maugras.
4e édit. Un vol. in-8o avec des gravures hors texte
et un portrait en héliogravure. |
7 fr. 50 |
| La Fin d’une société. Le Duc de Lauzun et la Cour intime
de Louis XV, par Gaston Maugras. 10e édit. Un vol. in-8o avec
portrait. |
7 fr. 50 |
| (Couronné par l’Académie française, prix Guizot.) |
| La Fin d’une société. Le Duc de Lauzun et la Cour intime
de Louis XV, par Gaston Maugras. 10e édit. Un vol. in-8o avec
portrait. |
7 fr. 50 |
| (Couronné par l’Académie française, prix Guizot.) |
| La Fin d’une société. Le Duc de Lauzun et la Cour de Marie-Antoinette,
par Gaston Maugras. 7e édit. Un vol. in-8o. |
7 fr. 50 |
| (Couronné par l’Académie française, prix Guizot.) |
| La Cour de Lunéville au dix-huitième siècle. Les Marquises
de Boufflers et du Châtelet, Voltaire, Devau, Saint-Lambert,
etc., par Gaston Maugras. 3e édit. Un volume in-8o avec
une héliogravure. |
7 fr. 50 |
| Correspondance secrète inédite de Louis XV sur la
politique étrangère avec le comte de Broglie, Tercier, etc.,
publiée par Boutaric. Deux volumes in-8o. |
16 fr. |
| Choiseul et Voltaire, d’après les lettres inédites du duc de
Choiseul à Voltaire, par P. Calmettes. Un vol. in-16. |
3 fr. 50 |
| La Beaumelle et Saint-Cyr, d’après des correspondances
inédites et des documents nouveaux, par A. Taphanel. Un
volume in 8o. |
7 fr. 50 |
| (Couronné par l’Académie française, prix Thérouanne.) |
| Histoire de Beaumarchais, par Gudin de la Brenellerie.
Mémoires inédits publiés sur les manuscrits originaux, par
Maurice Tourneux. Un volume petit in-8o anglais. |
6 fr. |
PARIS. TYP. PLON-NOURRIT ET Cie, 8, RUE GARANCIÈRE. — 5673.
Au lecteur
Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version
originale. L’orthographe a été conservée. Seules les erreurs évidentes de typographie
ont été corrigées.
La ponctuation n’a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures.