
Title: L'épopée blanche
Author: Louis-Frédéric Rouquette
Author of introduction, etc.: Louis-Ernest Dubois
Willem van Rossum
Release date: May 19, 2023 [eBook #70801]
Language: French
Original publication: France: J. Ferenczi et fils, 1926
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
LOUIS-FRÉDÉRIC ROUQUETTE
Lettres-Préfaces de Leurs Eminences
le Cardinal Dubois
et
le Cardinal van Rossum.
QUAM SPECIOSI PEDES EVANGELIZANTIUM PACEM, EVANGELIZANTIUM BONA.
Isaïe. C. LII. 7.
PARIS
J. FERENCZI ET FILS, EDITEURS
9, rue Antoine-Chantin, 9
1926
DU MÊME AUTEUR
LES ROMANS DE MA VIE ERRANTE
UN CONTE BLEU
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE :
10 exemplaires sur Japon Impérial. H. C. numérotés de A à J.
8 exemplaires sur Japon Impérial, numérotés de 1 à 8.
45 ex. sur Hollande de Van Gelder Zonen numérotés de 9 à 54.
12 exemplaires sur Lafuma H. C. numérotés de K à V.
100 exemplaires sur Lafuma numérotés de 55 à 155.
L’Edition originale a été tirée sur papier Alfa, et vendue au profit de l’œuvre des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Copyright 1926, by J. Ferenczi et Fils.
Tous droits de traduction, reproduction, adaptation, représentation
réservés pour tous pays, y compris la Russie.
Dans le Grand Silence Blanc et dans la Bête Errante, j’ai montré l’effort des hommes pour la conquête de buts matériels ; dans l’Ile d’Enfer, récit de ma traversée de l’Islande, j’ai suivi une âme inquiète à la recherche d’un idéal toujours mobile et toujours plus lointain.
Dans ce livre, je veux dire l’épopée magnifique de ceux qui, ayant abandonné tous les biens de ce monde, sacrifient leur vie pour la gloire de Dieu et la conquête des âmes.
A l’heure où nous sommes, il m’a paru nécessaire de les citer comme un exemple de volonté, d’abnégation, disant à mon pays :
« France, ces hommes sont pétris du limon de ta terre, vois ce qu’ils ont fait pour le rayonnement de ta pensée civilisatrice. Toi, qu’as-tu fait pour eux ? »
Louis-Frédéric Rouquette.

Paris, le 26 novembre 1925.
Monsieur,
Votre Epopée Blanche n’a pas besoin, en guise de prologue, de la Lettre-Préface que vous désirez.
Le titre lui-même de votre ouvrage l’explique dès la première ligne, et, avec vous, nous pénétrons d’emblée, in medias res : je veux dire en pleine activité apostolique, dans ces contrées de l’Extrême Nord où rayonnent, où triomphent la foi et la charité des Oblats de Marie Immaculée.
Quiconque aura fait avec vous les premiers pas, ne vous quittera plus. Avec vous, il voyagera sur ces terres désolées à la suite de ces conquérants d’âmes qui bravent le froid, la faim, la neige, les fleuves et les lacs glacés, les solitudes immenses, la barbarie des hommes, pour étendre toujours plus loin le règne de l’Evangile et les bienfaits de la civilisation chrétienne.
Quels courageux apôtres ! Quelles nobles âmes ! Et quels bons Français ! Vous en citez quelques-uns, héros magiques de votre Epopée. Ceux-là, ce n’est pas la passion qui les hante, ni l’amour des richesses, ni la recherche des honneurs, ni l’ambition. Comme ils dominent ces misères, ces hommes vraiment grands parce qu’ils sont « les hommes-de-la-prière » des hommes de Dieu.
J’en ai connu, j’en connais encore quelques-uns : et je me sens saisi d’admiration pour des missionnaires comme les Grandin, les Grouard, pour ne citer que ceux-là, mes compatriotes et la gloire de notre pays sarthois, de leur Congrégation et de la France entière.
Le Gouvernement français s’est honoré en décorant de la Légion d’honneur le vénérable évêque d’Ibora qui, après plus de soixante ans d’apostolat, continue à quatre-vingt-cinq ans sa vie véritablement épique de missionnaire, prédicateur, défricheur, fondateur et par-dessus tout bienfaiteur très dévoué de ces lointaines populations qu’il chérit comme ses enfants.
Chargé de porter vous-même à Mgr Grouard la croix si bien méritée, vous avez vu à l’œuvre non seulement le vieil évêque, mais tous ses frères. Et ce que vous avez vu, vous le racontez en une série de tableaux où l’on sent vibrer vos sentiments de sympathie, d’admiration, de fierté.
Les âmes de vos lecteurs, Monsieur, vibreront avec la vôtre : pas un, j’en suis sûr, ne résistera au charme prenant de votre livre — livre « de bonne foi », où parlent seuls les hauts faits de vos héros — des religieux, fils de la Douce France.
Que la France, fière de leurs travaux, leur redevienne accueillante et fraternelle !
Veuillez agréer, Monsieur, avec mes félicitations bien vives, l’assurance de mes sentiments tout dévoués.
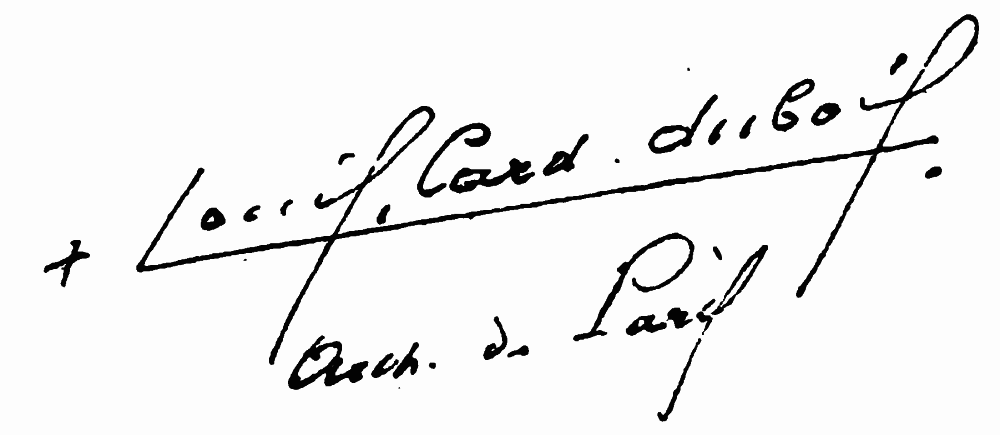

Rome, Palais de la Propagande,
ce 30 décembre 1925.
Monsieur,
Les magnifiques esquisses que vous avez réunies et que vous allez éditer sous le titre suggestif de l’Epopée Blanche, ne laisseront pas de faire une profonde impression sur tous ceux qui auront le bonheur de vous lire. Le cadre de style si vif et si riche dans lequel vous nous présentez ces tableaux de la vie des Missionnaires près du Pôle Nord, ne pourra que la confirmer et l’accroître davantage encore. Cette impression ne restera pas fugitive : elle aura des effets salutaires : bien plus, même, les plus implacables adversaires de tout ce qui a encore une apparence de religion, ne pourront refuser leur admiration à ces héros qui, pour atteindre leur idéal, approchent des dernières limites du sacrifice, puisque, disant adieu à tout et se privant de toutes les commodités modernes, ils se renferment pour des années dans une solitude bien morne à laquelle s’ajoutent des conditions de climat à peine supportables pour la nature humaine, et tout cela pour arriver après de longues années à un résultat que la courte vue humaine dirait mesquin et presque nul.
Bien plus grande que l’admiration stérile de ceux qui n’ont plus la foi, sera l’influence que vos descriptions auront sur ceux de vos lecteurs qui vivent la vie des chrétiens. Ceux-ci, s’ils sont prêtres ou religieux, auront devant les yeux un magnifique spectacle qui leur servira de continuel exemple dans leurs travaux quotidiens pour le salut des âmes. Que de leçons salutaires ils puiseront dans vos pages. S’ils sont simples fidèles, ils apprendront à aimer les Missions et ils comprendront mieux leur devoir de coopérer aux travaux des Missionnaires, de hâter la conversion des pauvres infidèles, du moins par leurs prières et par leurs sacrifices.
Pour moi, j’y ai trouvé une confirmation de cette conviction qui s’est formée en moi à mesure que j’entrais dans la connaissance des Missions, que les RR. PP. Oblats sont de vrais missionnaires dans le sens le plus sublime du mot et que, spécialement pour les missions de l’Extrême Nord, ils ont des mérites uniques. Ici, encore une fois, on voit clairement qu’ils ne sont pas de ceux qui cherchent le succès immédiat, ni de ceux qui se découragent quand, après maints efforts, ils ne recueillent qu’une maigre récolte, ni de ceux qui redoutent les obstacles, les difficultés, les peines et les sacrifices, ni de ceux qui croient toutes les souffrances inutiles s’ils n’en voient pas les fruits eux-mêmes. Les Pères Oblats — on le voit si nettement — sont des hommes de Dieu : ils travaillent pour Dieu, leurs travaux sont pour eux en premier lieu un moyen de sanctification personnelle et cela pour glorifier Dieu : ce but immédiat de la gloire de Dieu atteint, ils sont satisfaits : ils savent du reste que rien de tout ce qu’ils font ne se perd, mais que tout sert au profit du corps mystique du Christ : apôtres universels et embrassant dans leur zèle dévorant tout le genre humain, ils préfèrent les efforts en apparence stériles pour coopérer ainsi plus efficacement à l’extension du Règne du Christ.
Je vous suis reconnaissant, Monsieur, de nous avoir montré tout ceci et d’une manière si attrayante, et tout en vous félicitant de ce travail, je souhaite vivement qu’il soit répandu aussi largement que possible, afin de susciter dans cette France génératrice de si nobles élans, d’autres Apôtres qui marchent sur les traces de ces vrais pionniers du Christianisme et de la civilisation.
Agréez, Monsieur, l’expression de mon estime et de ma reconnaissance avec lesquelles je suis,
Votre tout dévoué en Notre Seigneur,
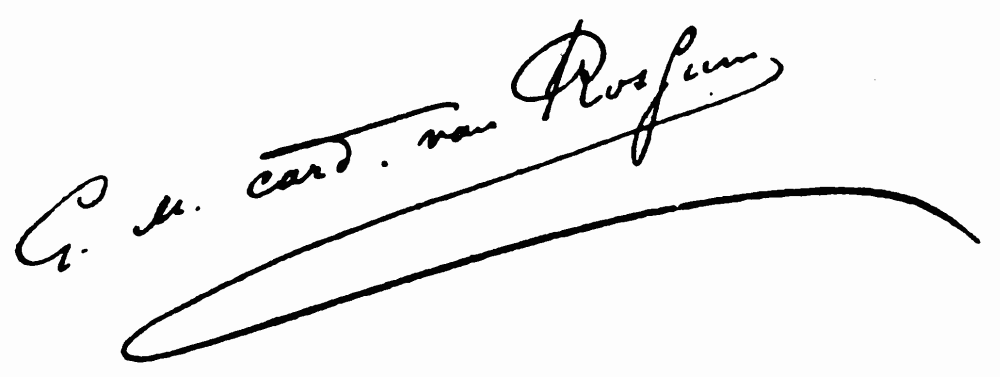
L’ÉPOPÉE BLANCHE
Depuis trois jours et trois nuits, le Canadian National Railway roule.
J’ai traversé la province de Québec, l’Ontario, puis ce merveilleux Manitoba, où les récoltes futures dorment sous la terre glacée, puis les plaines de la Saskatchewan où les chevaux sauvages errent, la crinière fouettée par les rafales de neige.
Et voici Edmonton, au cœur de l’Alberta ; Edmonton, la ville prodigieuse, simple poste de trappeurs il y a quarante ans, aujourd’hui capitale d’un Etat qui sera demain un des premiers de la Puissance.
Edmonton, clef de ce Grand Nord mystérieux, où, dans les forêts inviolées, paissent les troupeaux de caribous et d’orignaux et vivent les bêtes aux royales fourrures : renards argentés ou bleus, visons et hermines, mouffettes et castors.
Là vivent aussi des hommes, derniers vestiges des grandes tribus qui étendaient leur domaine de l’Océan à l’Océan, du Cercle Arctique aux lacs du Sud : Montagnais et Pieds-noirs, Castors et Couteaux-jaunes, Plats-côtés-de-chiens et Esclaves, Peaux-de-lièvres et Loucheux, Cris de la plaine et Cris des bois, tribus jadis errantes, maintenant pour la plupart encloses en des réserves où elles achèvent, fières et résignées, une vie qui fut semée de batailles, de victoires et de famines.
Mais aujourd’hui ils ont l’apaisement de Dieu, du Dieu de rédemption qu’ont apporté les hommes-de-la-prière, ces missionnaires venus de la douce France pour gravir sur ces terres désolées le plus abominable des calvaires.
Ils sont venus, n’ayant qu’une arme : la parole, n’ayant rien à offrir que la Charité et la Foi.
La Charité, la Charité, la Charité ! Trois fois Mgr de Mazenod[1] répétait ce mot sur son lit d’agonie, à l’heure précise où s’entr’ouvraient pour lui les portes lumineuses de l’éternelle vie.
[1] Mgr de Mazenod, évêque de Marseille, fondateur de la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
La Foi, ils la portent dans leur cœur comme un soleil.
Une âme par 250 kilomètres carrés ![2]
[2] Dans les régions du Grand Nord ; dans celles du Mackenzie, une âme par 100 kilomètres carrés.
C’est pour cette moisson que les Oblats se sont mis en route, parcourant des milles et des milles en raquettes, suivant la trace de leurs chiens sur la piste effacée par le blizzard, sautant les rapides sur des canots d’écorce, halant, comme des mercenaires, les lourdes barges dans les passes mauvaises, vivant dans des huttes de sapin qu’ils construisent eux-mêmes.
Souffrant le froid, la faim, l’âme ployée sous l’horrible solitude du grand silence blanc, mais toujours prêts au sacrifice, jamais désespérés, donnant tout leur amour au troupeau confié par le Maître.
Là où le sinistre Arouet ne voyait que des « arpents de neige », des villes ont surgi, des villages se sont groupés : là où régnait la violence, la paix s’est établie.
Voilà l’œuvre des Oblats o. m. i. (Oblats de Marie-Immaculée) : ces trois lettres resplendissent dans le ciel de gloire du Canada.
C’est une épopée admirable qui n’a pas eu d’Homère.
Qui dira votre effort, Père Lacombe, que les Cris appelaient arsous kitsi parpi, l’homme-au-bon-cœur ? Mgr Laflèche, qui arriviez « dans un petit canot avec deux sauvages et un jeune métis » ? Mgr Taché, qui portiez dans le sang tout le passé de Joliette, le découvreur du Mississipi et de la Vérendrye, l’explorateur du Far-West canadien ? Mgr Faraud, vous qui aviez quitté le ciel bleu du Comtat pour défricher la forêt nordique et faire lever la moisson divine ? Mgr Clut, qu’on nommait « l’évêque de peine » ? Mgr Grandin, dont l’âme sainte est un présent direct de Dieu ?
Et les autres, tous les autres, ouvriers obscurs et laborieux, que j’ai rencontrés sur les pistes du Nord, qui chantera votre vie misérable et si belle ?
Je suis venu à Edmonton pour accomplir un acte de foi et pour glorifier au nom de la France le meilleur d’entre vous. Ce rare Mgr Grouard qui, depuis soixante-cinq ans, évangélise les Indiens et à qui le Gouvernement français a conféré la Légion d’honneur.
D’Edmonton à Enilda, quinze heures en tortillard à travers la plaine glacée.
A Enilda, le traîneau, au petit matin, par quarante degrés sous zéro[3]. Les grelots tintent, effarant les lièvres polaires, aux longues oreilles pointues. La caravane met trois taches noires sur la neige ; il y a avec moi le juge Lucien Dubuc, le député Giroux, Paul Jenvrin, agent consulaire de France, l’Honorable M. Hunt, représentant Sa Majesté Britannique, l’ami Romanet, un Français de France, qui vient d’accomplir un voyage de sept années dans l’Extrême-Nord, de la Terre de Baffin aux îles Herschell, pour visiter les forts de la Compagnie de la Baie d’Hudson, dont il est le surintendant pour l’Alberta, l’Athabaska et le Mackenzie.
[3] Le 13 mars 1925.
Il y a aussi ma femme, qui disparaît sous les chandails et les toisons de bêtes…
Tout va bien jusqu’au petit lac des Esclaves. Mais dès que le traîneau s’engage sur le lac, le blizzard nous happe.
Un beau froid, en vérité !
Là-bas, sur la colline, dominant la plaine où le lac est couché, la mission Saint-Bernard, domaine de Mgr Grouard. Elle paraît toute proche, mais combien lointaine.
Enfin, nous arrivons.
Le vénérable prélat — il a quatre-vingt-cinq ans — nous attend. Ses collaborateurs l’entourent, et les métis et les Indiens.
Quelle simplicité, quelle douce émotion ! Combien paraissent vaines à cette heure les querelles politiques et mesquines les colères des hommes.
Cérémonie dont je garderai le souvenir impérissable.
Les religieuses de la Providence — religieuses qui ont tout abandonné pour accomplir ici leur mission de charité — les orphelins, les orphelines… Il y a des chants en français, des compliments en français, des discours en français, et parmi les guirlandes le drapeau du Régiment de Carignan, qui atteste que le Canada se souvient.
Au nom du Président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés… j’ai prononcé les paroles sacramentelles, le cœur à la fois glorieux et humilié d’avoir à épingler, moi, journaliste errant, sur cette poitrine magnifique, la Croix des hommes auprès de la Croix de Dieu.
Qui est Mgr Grouard ?
Ecoutez la simple citation : « Venu au Canada, en 1860, il y a toujours résidé depuis : a fait connaître et aimer le nom de la France en Alberta et jusqu’aux extrémités du Nord ; une foule de noms géographiques sont français grâce à lui ; prêtre zélé, missionnaire infatigable, navigateur, géographe, explorateur, bâtisseur de villes, architecte, peintre, compositeur, écrivain, agriculteur, il est, à quatre-vingt-cinq ans, le pionnier le plus intrépide du Grand Nord.
« Il a recueilli les orphelins et les orphelines dans les institutions françaises, fondées par lui, a sauvé la vie de Mgr Clut en une circonstance mémorable ; a protégé, au péril de sa vie, des femmes indiennes exposées aux brutalités de leurs maris, a soigné les malades et consolé les agonisants, a publié des livres sur la Religion en huit langues indigènes. »
Y a-t-il une chose plus belle ?
Et quelle leçon par l’exemple !
Mgr Grouard, évêque d’Ibora, est la pure incarnation du génie de la France ; il est pétri de ce limon de la terre gauloise qui a vu naître les Bernard et les Vincent de Paul et les héros qui sont partis pour donner à leur patrie le prestige des grandes nations, les d’Iberville, les Marquette, les Francis Garnier, les de Foucauld.
Il n’est pas de ceux qui passent pour conquérir à la pointe de l’épée, dans le pillage et dans le sang, un empire provisoire, mais il est de ces pionniers qui donnent tout leur cœur à la cause qu’ils servent, nobles, désintéressés, bâtisseurs d’avenir.
Mgr d’Ibora est le premier missionnaire qui sema et récolta du grain dans l’Athabaska ; le premier il construisit une école et un moulin à moudre le blé.
Cette école, ce moulin, ce sont les plus belles conquêtes qu’un homme puisse inscrire au livre de sa vie.
Il a, comme saint Paul, beaucoup travaillé de ses mains, comme l’Angelico, il a mis toutes les splendeurs de son âme en des fresques naïves.
Mes mains tremblaient tandis que j’accrochais la croix sur la robe violette. Mais il me semblait que, dépassant ma fonction, et saluant la vérité, c’étaient tous ceux qui ont fait de leur vie un sacrifice quotidien, que je décorais sur la poitrine d’un seul.
Ah ! j’aurais voulu, à la fois justicier et poète, avoir au bout des doigts des poussières d’étoiles pour les faire resplendir et rayonner sur tous ces cœurs !
Et maintenant la cérémonie est terminée. Dans le palais épiscopal — maison de bois qu’il édifia lui-même — nous sommes comme des petits enfants autour d’un Patriarche, écoutant sa parole de miel, tandis que dehors la bourrasque fait rage, démon qui ne peut rien contre la Maison du Seigneur, et que la neige tombe, blanche comme l’âme de ces fils de France qui, sous le signe de la Vierge, se sont faits les serviteurs de Marie, pureté première et consolatrice du monde.
Le Père Falher s’est offert à moi, sur la belle terre canadienne, par une rude journée de froid. Enveloppé dans une peau de bique, la barbe en bataille, il m’a dit avec un sourire bon enfant :
— Je vous présente la bête dans ses poils.
Puis il m’a tendu sa main loyale.
Celui-là est un homme. Il est entré d’un seul coup dans ma vie et j’ai senti aussitôt qu’il avait tout mon cœur. J’ai appris à le connaître, à l’estimer, à l’aimer. Je lui dois des heures inoubliables.
Par lui, j’ai compris qu’aux moments les plus troubles de l’histoire du monde, il y avait des cœurs assez purs, assez désintéressés, assez sublimes pour se donner sans condition, au rachat du péché des hommes.
A Grouard, il a été l’animateur, après avoir été l’apôtre.
Tout le pays était en fête pour honorer Mgr d’Ibora ; c’est lui qui, en quarante-huit heures, a fait surgir guirlandes et oriflammes, réglé les discours et les chœurs. Orphelins, orphelines, religieux et religieuses, métis et indiens, colons venus pour tenter la fortune, tous et toutes l’adorent.
Falher, c’est un drapeau. Falher, c’est un symbole.
Il m’a pris par le bras, ensemble nous avons gravi la colline.
A nos pieds, à perte de vue, s’étend la plaine blanche coupée de bouquets de sapins. Proches les toits de la jeune cité, des fumées mettent des paraphes dans le ciel, des lueurs signalent la vie des hommes.
Avant les Oblats, il n’y avait rien ici, que des solitudes troublées parfois par les tribus errantes, troupeaux que la faim décimait et qui fuyaient, cherchant une terre propice.
Un même mot en montagnais désignait et le chien et la femme. Mais le souffle de l’Evangile est passé, emportant les coutumes barbares, faisant pénétrer dans ces cerveaux enténébrés avec l’amour du prochain l’adorable pitié.
— Dites-moi, père Falher, au début, ça ne devait pas être drôle ?
Le missionnaire fait un geste qui embrasse l’horizon, enveloppant la plaine et les maisons rangées au bord du lac :
— Maintenant, ça va.
Je sais qu’il ne me dira rien de ses souffrances ni de celles de ses compagnons, les premiers pionniers de la parole sainte : ceux qui, de Montréal au lac Huron, franchissaient quarante-quatre portages, du Fort William au Fort Garry, quarante-deux, du lac Winnipeg à l’île de la Crosse, trente-six et de là s’enfonçaient dans la forêt, jusqu’alors inviolable et inviolée, s’ouvrant un chemin à la hache, couchant dans le même trou de neige avec leurs chiens, accueillant la douleur comme une bénédiction du ciel, et l’hostilité des hommes avec des mots fraternels. Depuis, ils ont fait leur route.
Ils apportent à tous la civilisation. Avec eux, c’est la France qui marche.
Tomkins, un métis de Grouard, m’a dit, parlant des Pères :
— Ils nous ont donné la lumière.
Ce qu’il a fallu de force, d’énergie, de zèle, de foi, d’intelligence, le Père Falher ne m’en parlera pas. Mais il n’y a qu’à se pencher sur une carte canadienne pour voir les résultats acquis. Ils sont là, nul ne peut les nier.
Les noms sont français dans cet Ouest mystérieux qui s’éveille à la vie. Morinville, Saint-Albert, Millet, Qu’appelle, Portage-la-Prairie, sont la réplique de Jasmin, Claire, Sainte-Anne, Mont-Joli, au pays de Québec.
Si là-bas Maisonneuve et de Levis disent l’épopée de la Nouvelle-France, ici, Legal, Leduc, Lacombe, Girouxville, Grouard, Falher, Végreville, Cochin sont des noms d’Oblats, des noms deux fois français.
Maintenant nous parcourons la plaine, nos pieds écrasent la neige sous laquelle dort la bonne terre prête à s’ouvrir pour accueillir l’espoir des récoltes prochaines.
Cette terre, le Père Falher l’aime jusqu’au fanatisme.
— Quelle belle œuvre que votre œuvre ! Œuvre de Dieu, œuvre des hommes, Paroles de l’Evangile et colonisation !
— Ami, les deux vont ensemble : sous le joug de la vie, ce sont les bœufs robustes qui tirent la charrue et creusent le sillon. Il ne faut pas épargner sa peine si l’on veut être béni de Dieu.
Il fallait prouver que ces espaces désolés, où seules vivaient les bêtes de la forêt, pouvaient nourrir les petits des hommes.
Pourrait-on vivre ici ? Le nord de l’Alberta était-il colonisable ?
Le Père Le Serrec, dans sa ferme de la rivière la Paix, Mgr Joussard dans son domaine du Fort Vermillon, les Frères Laurent, Kerhervé, Debs, à Grouard, le Père Giroux dans sa solitude de Spirit-River, tous après cinquante ans d’expériences répondent : Oui.
La démonstration faite par les Oblats est formelle. La terre paie le travail avec l’or blond des blés.
Désormais, la route est ouverte.
— A tous ?
— A tous. C’est l’histoire des migrations humaines. Rien ne peut arrêter l’élan que nous avons donné.
Les Anglais de l’Ontario ont suivi, avec quel intérêt, l’effort des religieux, prêts à se gausser s’il restait stérile. Mais, le succès certain, ils sont venus.
Et le Père Falher soupire.
Je comprends sa pensée et je dis :
— Et les nôtres ? Nos Canadiens français auront-ils une place au soleil albertain ? Laisserez-vous ce pays neuf devenir anglais et protestant ?
— Là est la plaie, là est le danger. Dès 1903, Mgr Grouard l’a vu et l’a signalé. Mais nous étions si loin, dans une région si peu connue, au milieu des sauvages. Etait-ce même en Canada ?
Le R. P. Desmarais, envoyé par Monseigneur à Montréal et à Québec, prêcha dans le désert et personne ne vint à nous.
Mais le cœur de Mgr Grouard ne connaît pas la défaite ; il ne perd pas courage, il s’adresse alors au Gouvernement canadien. Oliver est ministre de l’Intérieur. C’est un self-made-man d’Edmonton, un pionnier du Nord.
Hélas ! il ne veut pas se compromettre ni compromettre ses amis. La politique, mon ami, la politique ! Ouvrir un pays à la civilisation, c’est se créer une foule de difficultés. Oliver refuse un agent officiel, adieu la colonisation.
En 1911, les libéraux tombent, les conservateurs arrivent au pouvoir. Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, rencontre Mgr Grouard, à Montréal. C’est un Canadien français, un esprit clair, lucide, un vrai patriote.
Monseigneur lui dit sa tristesse et ses déboires et son espoir toujours déçu.
— « Mon cher évêque d’Ibora, nous irons à Ottawa. Nous verrons le ministre, c’est un de mes amis. »
Et l’homme d’Etat reçoit la visite de Mgr Langevin, de Mgr Grouard, flanqués de votre serviteur ; on lui parle, il accorde un agent officiel de colonisation pour le Nord-Alberta. Mais qui nommer ? Qui désigner pour faire œuvre utile ? L’interrogation se pose. C’est l’inconnu. Pour réussir, tout dépend du choix de l’homme.
Il fallait un Oblat, il fallait un missionnaire du Nord, il fallait un Canadien français.
La Providence avait tout prévu. Le R. P. Giroux était là.
— Le Père Giroux, le plus français des Canadiens ?
— Oui.
— Ah ! Père Falher, j’ai rarement vu dans des yeux si clairs, des yeux d’enfant, une volonté si grande.
— Que diriez-vous si vous l’aviez connu aux jours de sa jeunesse, dans l’enthousiasme de ses vingt-cinq ans ! Actif, intelligent, et avec cela plus normand à ses heures que les Normands ses ancêtres.
Il est, avec Normandeau, Boucher, Boyer, de tous les agents du Gouvernement un de ceux qui ont le mieux réussi ; impossible de chiffrer le nombre de Canadiens français qu’il a ramenés des Etats-Unis. C’est vraiment l’élu de Dieu !
Nommé en janvier 1912, il prend la besogne à bras le corps, il est partout, ici, à Québec, à Montréal, aux Etats. Dès juin, il rentre à Grouard, pasteur suivi d’un troupeau de fidèles.
Nous connaissions, par delà les forêts à quarante milles d’ici, de grasses prairies, dans le bassin de la rivière la Paix.
Là nous avons érigé une croix, sur sa base nous avons gravé le nom des premiers pionniers.
Au pied de cette croix, à genoux sur cette terre encore inculte, nous avons demandé la bénédiction de Dieu.
Elle est venue, toute puissante[4].
[4] Dans la Saskatchewan et l’Alberta, il y a aujourd’hui plus de cent mille Canadiens, presque tous sont agriculteurs.
La caravane se met en route, comme autrefois, de l’est à l’ouest ; wagons bâchés tirés par des bœufs, escortés des hommes, à cheval.
Elle traverse la prairie monotone. Rien ne l’arrête : ni les rivières, ni les marécages, ni la glace, ni les maringouins, ni la neige.
Des semaines, des mois, hommes et bêtes cheminent.
La fièvre les décime, des tombes marquent les étapes, mais l’espérance est avec eux.
Des âmes faibles, moins bien trempées, ploient sous la misère des jours. Le Père Giroux se multiplie, tout zèle et toute charité.
Il va ranimant les cœurs, exaltant les courages : un bon mot, un refrain, et voilà la caravane dans la joie, la route paraît moins pénible et moins longue.
— Allons, mes fils, trois jours encore… plus que deux jours… demain.
Demain, c’est le repos ; demain, c’est l’espérance. Demain, c’est la chanson qui berce les hommes au rythme lent des bœufs.
Enfin ! c’est la Terre Promise. Là-bas, par delà le lac, se dresse la mission. Sur la colline, voici la Croix.
C’est l’arrivée tumultueuse, dans le cri des cavaliers, le rire des femmes, les appels des enfants, l’aboi des chiens, seuls sont placides les bœufs puissants et doux.
Mais la mission Saint-Bernard n’est qu’une halte. Il y a quarante milles à franchir, les plus durs peut-être, les plus terribles. On les fait dans la joie du but prochain, du désir enfin réalisé.
La terre est là. C’est maintenant que la peine commence.
Rude tour de force d’avoir déraciné des gens de l’Est pour les transplanter dans l’Ouest, miracle de les avoir mis sur la bonne route, miracle de tous les jours de les garder, de les soutenir jusqu’au bout. C’est maintenant qu’il faut persévérer, qu’il faut avoir vraiment l’esprit du sacrifice.
Un home-stead, 160 acres de terre, pour la minime somme de 10 dollars. Un chez soi pour si peu ! Oui, mais ce que cela représente de travail, d’énergie, de souffrances morales et physiques !
Tout est à créer : maison, grange, étable, champ, clôture, tables, lits, armoires, chaises, ces mille riens dont l’usage est journalier et que l’on se procure si facilement dans le bourg ou la ville. Mais ici ? Dans ce pays neuf, inculte, sauvage ?
Il faut tout faire soi-même, avec des moyens de fortune. Un colon doit être charpentier, menuisier, forgeron, bourrelier, vétérinaire, chercheur d’eau[5].
[5] L’eau douce est un des grands problèmes de l’Ouest canadien.
Sur ces 160 acres non défrichés encore, le colon et surtout sa femme, se sent seul, loin de tout, il a la sensation d’être isolé, perdu. Les hivers sont durs, les nuits longues.
Dieu ne l’oublie-t-il pas ?
Au début, il n’y a pas d’église ; or, l’église, pour le Canadien, est son second « foyer ».
La solitude enfante des terreurs : il y a les Indiens, les ours, les loups ! Et pourtant les Indiens sont de pauvres Cris, timides et doux, qui, bons voisins, ne demandent qu’à se rendre utiles, ce ne sont plus les Iroquois féroces de jadis qui mettaient en péril Montréal.
Il appréhende aussi la faim ; les premières moissons ne sont pas toujours très brillantes ; le colon n’a pas l’expérience de l’Ouest. La chasse ? Courir après l’orignal ? on peut s’égarer, on s’égare dans la forêt et c’est la mort certaine.
Le découragement naît dans son cœur comme un mauvais désir.
Alors paraît le missionnaire.
Dès qu’il y a un noyau de catholiques, Mgr Grouard établit un de ses prêtres, un Oblat.
Au Père Falher, qui m’explique ces choses, je dis :
— Je connais ces installations : une humble cabane de troncs d’arbres, couverte d’écorce, pas de plancher, une table sert d’autel, un rondin de sapin et voilà le siège. Dans un coin, le Père étend une couverture de laine, c’est là qu’il dort, n’est-ce pas ?
L’Oblat a un sourire :
— Vous ne voudriez pas que le curé soit mieux logé que ses paroissiens !
Tenez, je crois que ce sont les plus beaux jours de sa vie qu’il passe là. C’est dans la pauvreté qu’on fait le bien.
Le premier missionnaire, curé de Falher, est un ancien sergent, s’il vous plaît, qui connaît toutes les sonneries de son régiment et qui vous les siffle… Un Breton de chez nous, un dévoué, un humble, sachant se donner sans mesure. Tout à tous.
Il a compris son sacerdoce.
Tous les jours que Dieu fait, il est en chemin ! Il va de ferme en ferme, disant sa messe ici, prêchant là, exhortant les uns, consolant les autres : été comme hiver, sous le soleil, dans la tempête, il va, toujours sifflotant, toujours gai. Il porte la parole qui encourage et soutient, mais aussi des conseils. Le soir, à la veillée, il donne des nouvelles, c’est une gazette errante : à Québec, on dit… aux Etats, on fait… et les enfants… Ah ! les enfants ! On n’a pas pu les emmener, ils sont à Grouard chez les bonnes Sœurs de la Providence, sœurs maternelles bénies de Dieu.
Grouard est le corps dont Monseigneur est l’âme. C’est là que les colons de Falher sont reçus, gratis pro Deo, en arrivant au pays. On les héberge, on leur prête les premiers instruments aratoires, les semences nécessaires, l’indispensable.
Ce que Grouard et Mgr Grouard ont fait pour Falher, ils l’ont fait pour les autres colonies.
C’est Monseigneur qui a fait bâtir les églises de Slave-Lake, de Kinaseco, de High-Prairie, de Spirit-River, de Grande-Prairie, de Lessmith, de Kleskeenhill, de Peace-River, de Pouce-Coupé. Et comme les colons sont trop pauvres, c’est Monseigneur qui entretient ses prêtres.
— Vous avez laissé le curé de Falher, mon Père, à la veillée.
— Excusez-moi… vous connaissez la veillée canadienne, veillée traditionnelle où revit la France d’autrefois ; les parents, les amis sont là, les anciens content de sempiternelles histoires ; à l’abri de leurs mains, les femmes chuchotent des secrets connus de tout le monde, les jeunes gens jouent aux cartes, l’on chante aussi les refrains du temps jadis : En roulant ma boule, Suivons le vent, C’est le vent frivolant, Fringue, fringue sur l’aviron, Mon cri, cra, tire la lirette. C’est tout l’Anjou, toute la Normandie, l’Aunis et la Saintonge qui passent… et ma Bretagne aussi, il me semble que le vent souffle sur les genêts :
La voix du Père chevrote un peu, et dans ses yeux une buée monte.
Je cherche un mot affectueux et tendre sans le trouver. Je lui prends la main et nous communions, tous deux, dans la pensée de la France lointaine.
Il se reprend :
— Après les Chansons, la Prière, la prière dite en commun comme autrefois aussi.
Et le Père s’endort dans un coin, roulé dans sa couverture.
Le lendemain, il part… et voilà l’histoire du sergent, pardon, du Père Dréau. C’est bien à lui que l’on doit la réussite de la colonisation dans le district de Grouard.
Il a souffert les maux coutumiers. Il faut toujours se répéter : le froid, la faim, la fatigue… et l’ingratitude des hommes.
Mais il va toujours et c’est pourquoi Falher est une belle paroisse française, avec une belle église « en brique », mon ami, la seule du vicariat. C’est l’œuvre d’aujourd’hui, demain nous ferons mieux.
La vie ici est une longue espérance.
Le Père Falher se tait. Je respecte son silence et nous marchons, côte à côte, pendant quelques instants.
Le vent joue dans sa barbe grise, nos pieds enfoncent dans la neige. Nous revenons lentement.
Voici le cimetière où dorment jusqu’au jour de la résurrection Mgr Clut et le Père Collignon, deux Oblats qui ont fini leur peine.
L’évêché de Grouard. Une chambre étroite, un lit de sangle, un escabeau de bois, une table, quelques livres, et, sur le mur, Jésus étend son corps crucifié.
Au loin, la plaine et le lac sous la neige.
Dans l’agonie du jour qui tombe, une ombre passe. C’est le Père Blanchin, l’âme de prêtre la plus haute, la plus sereine, la plus belle qui soit.
Depuis Edmonton, il est avec moi, guide sûr, cœur inépuisable.
Nous entrons, le Père Falher et moi, nous ébrouant comme deux jeunes chiens. Le Père a des glaçons dans sa barbe, j’ai de la neige aux franges de mes cils.
— Eh bien, Père Blanchin, Monseigneur…
— Monseigneur a délaissé son jeu favori, et, cent-trente-deux, comme il dit, savez-vous ce qu’il fait ?
— Ma foi…
— … Il se prépare à partir.
— A partir !
— Oui, une randonnée de plusieurs jours à travers son diocèse.
— Non ?
— Vrai de vrai.
— Il mourra à la peine.
Le Père Falher — cette chambre est la sienne — va et vient, sous ses pas le plancher crie.
— Allez donc tenir ce diable d’homme. A quatre-vingt-cinq ans, il a l’ardeur d’un néophyte.
Je l’ai toujours connu ainsi, pèlerin infatigable d’une foi passionnée. A sa parole, les âmes les plus rebelles se lèvent et le suivent : d’une terre inculte, il a fait jaillir les épis lourds de grains.
— Par quel prodige ?
— Par le miracle d’une volonté chaque jour renouvelée, puisant sa force dans sa propre richesse.
Richesse d’un cœur qui se donne sans calcul, sans arrière-pensée.
Et de l’âme du chef la lumière rayonne jusqu’aux plus humbles, jusqu’aux derniers des serviteurs.
C’est un ruissellement.
Que sont auprès d’eux les héros des épopées éteintes ? Les Grecs astucieux, les chevaliers mystiques ? Le vent qui passe sur la terre africaine emporte la fumée du bûcher de Didon ; sur la mer civilisée la trace est effacée de la barque errante d’Ulysse. L’étrave a fendu le flot, le flot s’est refermé. Rien ne reste, rien ne subsiste.
Dans la marche vers l’ouest, l’histoire du monde se perpétue avec les mêmes douleurs, les mêmes sacrifices et la même espérance.
Dans le fond des bois, la vie s’éveille. L’homme-de-la-prière a passé.
J’ai dit tout haut ma pensée et le Père Falher me répond :
— Ce n’est pas nous qu’il faut citer, mais les colons qui ont eu confiance.
— Mais vous…
— Non, eux, eux seuls sont dignes, eux seuls connaissent la misère absolue et n’ont jamais désespéré. Un exemple ? Un entre mille. A Falher, il y a douze ans. C’est la lutte contre une trinité impitoyable : la forêt, le feu et l’eau.
La forêt qui veut se garder impénétrable, l’eau sournoise qui attire et prend les imprudents au bord des marécages, le feu qui arrive à la vitesse d’un cheval au galop. On l’aperçoit du haut d’une colline, à l’horizon, et soudain il saute dans la vallée ; poussée par un démon invisible, la grande flamme court, monte, serpente et tout à coup elle est là. Les bœufs et les chevaux, affolés, se jettent dans la fournaise.
On perd tout en un jour.
Mais là n’est pas la question. L’exemple, le voici. Un de nos colons, M. Le Blanc, est venu ; pour avoir toutes ses forces actives, il nous a laissé son tout petit garçon. L’enfant est chétif, il a souffert dans la misère des villes ; les bonnes sœurs veillent à son chevet, le dévouement est inutile, l’enfant meurt, le père est là-bas. Je l’envoie prévenir. Trois jours après, il arrive, dans son wagon traîné par des bœufs.
Je cours au-devant de lui. A mon salut, il répond :
— « Père, où vais-je mettre l’autre ? »
Et, soulevant la bâche, j’aperçois le corps d’un garçonnet que la mort a pris.
Le bonhomme, à travers ses larmes, m’explique :
— « C’était le fils unique de ma fille aînée… il est mort le même jour, à la même heure. »
Nous les avons placés tous les deux dans le même cercueil.
Le pauvre père s’en est allé, son chagrin bercé au rythme lent des bœufs. Il est parti tout seul, je l’ai suivi des yeux longtemps, longtemps. Oh ! comme j’aurais voulu l’accompagner, lui dire toute mon affection et toute ma tendresse.
Un matin, Mgr Joussard arrive, je lui conte la chose. Oh ! le brave cœur, il devine ma pensée.
— « A cheval, filons ! »
Nous voilà, chevauchant, sous un clair soleil d’août, dans les bois, autour des lacs, sous les peupliers et sous les saules.
Tout là-bas, une lumière, nous approchons. Une tente blanche, tendue sur des poteaux rustiques, quelques planches, c’est le camp.
Des voix montent, harmonieuses, des voix d’hommes, des voix de femmes, des voix d’enfants. A genoux, dans l’herbe, ils chantent la prière du soir.
Un de nos chevaux hennit, tous se lèvent, viennent à nous, nous reconnaissent.
— « Oh ! Monseigneur ! Oh ! Père, vous ici ! »
Nous avons campé chez eux, nous avons dormi auprès d’eux ; le lendemain, nous les avons laissés pleins d’espérance.
Ils ont semé dans les larmes. Ils sont forts maintenant. Ils ne craignent plus rien de la vie.
Le Père Falher se tait ; pendant que je rédige quelques notes, je l’aperçois, lisant son bréviaire. Son profil se détache, précis. Tel il était et tel je le garde désormais dans ma mémoire, comme le plus pur modèle d’abnégation qui soit.
Chercher, trouver, connaître, unir, voilà l’œuvre du Père Falher, et l’œuvre de ses frères, les Oblats de Marie.
La marée monte des éléments cosmopolites qui, drainés par la réclame, se jettent sur le Canada avec l’espoir de miraculeuses fortunes. Terre de Chanaan ! dans leur esprit, terre de Cocagne.
Après les Indiens, après les métis, après les Canadiens français, voici de nouvelles âmes qu’il faut gagner à Dieu.
Tous se sont mis à l’ouvrage ; le Père Serrand, frère de l’évêque de Saint-Brieuc, dans la Grande-Prairie, le Père Wagner à la rivière la Paix, le Père Le Treste à Peace-River, le Père Pétour à High-Prairie. Il faudrait les citer tous, car tous sont sublimes de travail, d’énergie, de patience, de charité.
Ils vont, créant un pays, paroisse par paroisse, diocèse par diocèse, ils jettent le grain qui se lèvera pour les autres.
Qu’importe ! Ils sont les précurseurs, unanimement respectés. Les catholiques les révèrent, les protestants les admirent.
Pour tous, l’oblat est le Father, il est le Père.
Un orangiste me disait un jour :
— Il faut être Français pour faire ce qu’ils font.
Ah ! si les politiciens de chez nous savaient !
Mais ça c’est de la politique…
Demain, les Oblats de Marie s’enfonceront davantage dans le Nord ; après les Indiens, voici les tribus esquimaudes.
Partout où il y a des âmes à glaner, ils iront, moissonneurs de la cause de Dieu.
Ce qu’ils font, ils l’accomplissent de grand cœur, librement, heureux de suivre la destinée qui est la leur, sur cette terre canadienne si riche en souvenirs, si vaillante dans l’effort.
Non, toute la France n’est pas morte avec M. le Marquis de Montcalm. Elle revit en ses enfants qui ont, à travers le temps, conservé leurs coutumes, leur religion, leur langage.
Que certains Professeurs, de passage, pour quelques heures, dans les universités canadiennes, cessent de traiter ces braves cœurs en parents pauvres. L’un d’eux proclamait, du haut de la chaire, à Montréal — pour la plus grande joie des Anglais — que les Canadiens parlaient « patois ».
Patois alors, le français de nos Normands, de nos Berrichons, de nos Picards, de nos Bretons !
Sont-ils moins français, les fils de nos provinces qui parlent notre langue avec le charme de leur intonation ?
Allons donc !
Oui, des bords de l’Atlantique à la Saskatchewan, de Québec à Edmonton, c’est le cœur de la France qui bat. Si un jour, par un cataclysme inouï, notre vieille terre gauloise perdait tout prestige et en arrivait à l’oubli de soi-même, nos frères du Saint-Laurent, tenant dans un poing qui ne tremble pas le flambeau que nous leur avons confié, rallumeraient chez nous le pur foyer de la civilisation latine.
Je songe à ces choses dans la chambre aux murs nus du Père Falher où le Christ consolateur offre son corps supplicié, là-haut, dans cette mission Saint-Bernard, à la pointe du Petit lac des Esclaves.
Proches, des voix d’enfants chantent.
Sur la neige, une religieuse passe, tenant un falot, la lumière bouge. C’est la seule étoile de cette solitude.
Une cloche tinte. L’Angélus ! Le Père Falher et le Père Blanchin font le signe de la croix.
Dans la nuit polaire, si pure, si belle, une nuit bleue et froide, la traîne indienne suit la piste, les chiens tirent à plein collier, l’ongle dur griffant la neige, le museau bas, flairant le « trail ».
Sapins et épinettes défilent ; où sont les bêtes de la forêt, les caribous et les ours et la harde famélique des loups ?
Là-bas, une lueur. Les chiens se hâtent et bientôt la cabane, faite de rondins de sapins assemblés, se détache nette sur l’horizon.
C’est à flanc de côteau, devant le miroir glacé du lac, une demeure humaine. Qui peut habiter ces parages où tout semble tristesse et désolation ? Un trappeur, sans doute, un vieux solitaire fuyant la civilisation des villes ! Un Oblat, peut-être, venu, selon la parole de l’apôtre, « pour évangéliser les pauvres ».
Un chant monte dans la nuit, un chant inattendu et gai :
Mes chiens arrêtés, j’écoute le chant populaire, le cœur troublé, les yeux remplis de larmes…
C’est toute la vieille France qui s’évoque ; disparue la neige, dissipées les angoisses nocturnes, voici dressée devant moi la cité des corsaires, ses remparts, son clocher pointu.
Mon chien de tête aboie. Les voix s’arrêtent ; la porte s’ouvre.
L’hôte est debout sur le seuil hospitalier :
— Il ne fait pas bon, garçon, rester dehors. Entrez, entrez.
Puis il se nomme :
— Espérance Lamontagne.
La vision continue, certes, c’est toute la France qui vit sous ces poutres robustes.
Voici la mère, c’est elle qui chantait pour bercer son dernier-né, le petit dix-huitième, les autres dorment déjà ; auprès de l’âtre qui flambe, l’ancêtre s’est dressé, le brûle-gueule au coin du bec, il crache dans le foyer, puis il me dit :
— Soyez le bienvenu.
Bientôt la soupe au lard fume. Suis-je dans l’Alberta du nord ou dans une ferme normande ?
Voici les objets familiers : la table de chêne, le fauteuil qui tend ses bras âgés comme pour m’accueillir, l’escabeau où le chat sommeille en boule, la glace déteinte autour de laquelle sont les portraits à demi effacés, la cheminée avec sa crémaillère, la boîte en fer où sont les allumettes, la boîte en bois où l’on met le gros sel. Sur le fronton, il y a des pots de grès jaunes où sont peinturlurées des fleurs naïves…
Mais l’homme parle, il m’interroge :
— Ah ! vous êtes un Français de France !
La joie illumine ses yeux. Pour lui je suis « du vieux pays ».
Et l’on sort une bonne bouteille pour fêter ma présence.
A mon tour, je demande :
— Vous vivez seuls, ici ?
— Seuls ! Non, il y a les camarades.
Sur les rives du lac, des maisons sont rangées, pressées autour d’un clocheton.
Espérance Lamontagne parle :
— Il y a vingt ans. Rien de rien, mon garçon. C’était la grande prairie ondulée avec son foin court et dru et son hiver rude, mais le Père Falher est venu et le Père Giroux, des Oblats de Marie ; à leur appel, des Etats, de Québec, des Canadiens français ont répondu. Nous, on était dans le Maine, mais notre cœur était ici. On est allé vers notre cœur. Voilà.
Ah ! c’était point folâtre, les premiers jours, pouvez me croire ! Mais quoi, on avait confiance, nous tous, les camarades aussi. Puis, notre colonie avait un bon patron.
— Un bon patron ?
— Ben oui, Saint Jean-Baptiste de Falher, Jean-Baptiste comme le paysan canadien français, Falher comme le Père.
Et la vie a commencé.
L’homme se tait. Je lis sur sa face l’effort de la race, cette race qui n’a voulu ni mourir ni se laisser assimiler.
Espérance Lamontagne avait ses ancêtres à Carillon, couronnant la défaite d’une immortelle victoire, sauvant l’honneur avec M. le Chevalier de Levis.
Ils étaient 60.000 aux jours endeuillés de 1763. Aujourd’hui, près de quatre millions !
Sous la houlette de leur pasteur, à l’ombre de l’église, la famille canadienne a puisé sa force dans la vieille tradition de la France.
Douze, dix-huit, vingt-deux enfants… ces petits bouts d’homme grandissent et vont se tailler des domaines dans l’Ouest.
L’enfançon réveillé prend le sein de sa mère et tette goulûment, le patriarche s’est levé, il a déposé sa pipe sur la table, il me tend son verre :
— A la France !
Puis il entonne d’une voix cassée, mais qui sonne dans mon cœur comme un chant d’allégresse, l’hymne de foi :
… Mon sommeil a été peuplé de rêves familiers. Au matin la marmaille m’éveille.
Les voici tous autour de moi, moineaux vifs et piailleurs.
Le père, le grand-père, les aînés sont en forêt, défrichant à la cognée la terre nordique. Là, demain, le blé viendra, l’orge, l’avoine, les patates aussi.
La gelée, la grêle, qu’importe ! A force de labeur, les Canadiens arrachent au sol ses précieuses richesses.
La mère s’active à la maison, préparant la soupe des hommes.
On frappe. La servante va ouvrir, puis revient aussitôt.
— Qui est-ce ? demande l’hôtesse.
Et la fille répond :
— Ce n’est rien. C’est un Anglais !
— Les Indiens, Monseigneur ?
— Les Indiens ? Ah ! mon bon monsieur, dans quel état étaient ces pauvres gens avant que nos Pères leur eussent apporté l’Evangile. Vous ne pouvez pas le savoir !
Crédules, ils étaient à la merci des hommes de médecine, des sorciers ; les pires superstitions, les rites les plus extravagants, ils acceptaient tout.
Une moralité ? L’absence absolue de toute moralité, oui !
Et la femme ! Elle surtout portait le poids de la malédiction d’Eve. Quand nous prêchions la parole de vérité, les hommes nous écoutaient, assis en rond ou debout près de nous ; les femmes se tenaient tout au fond, elles ne pensaient pas que le Verbe de Dieu pût être pour elles.
Miracle de Marie, mère de Jésus, il a fallu qu’elle vînt dans ces contrées sauvages pour relever la dignité de la femme.
La Vierge sur nos autels a ouvert ses bras pour accueillir ses misérables sœurs.
— La stèle de Si-ngan Fou et son inscription chinoise annonçait au VIIIe siècle « la bonne nouvelle de la Vierge qui a enfanté en Syrie ».
Bonne nouvelle portée par qui en ces lointains pays ?
— Miracle de Marie ! Ici rien n’est arrivé de ce qui advint en Judée. Qui saura jamais la voie mystérieuse de la Providence ?
Et Mgr Grouard, évêque d’Ibora, vicaire apostolique d’Athabaska, lève ses mains au ciel.
Dans le palais épiscopal de la mission Saint-Bernard, je rassasie mes yeux de la vue de ce vieillard magnifique, de ce héros que j’ai la joie de pouvoir contempler. Il a quitté sa soutane violette et, coiffé d’une toque de castor, en robe noire, simplement, pareil à ses Pères, il vient de battre au piquet, par deux fois, le R. P. Blanchin, et maintenant nous devisons comme deux amis.
Du geste, il me montre la plaine, écrasée par la neige, où rien ne semble vivre.
— Tenez, ne dirait-on pas la plaine du Livre de Job ? « Sombre et morne région où l’ombre de la mort, le désordre et une horreur éternelle habitent. »
Le décor n’est rien, croyez-moi, le péché est sur toute la terre. Ici, au moins, ils avaient une excuse, ils ne savaient pas.
Mépris, avilissement de la femme-mère, de la femme-épouse, la bonté et la charité, des mots inconnus. Ils ne savaient pas. Et puis des épidémies s’abattaient, ravageant des tribus entières et la famine passait dans les camps, dévastatrice.
Tableau funèbre dont l’horreur est inscrite dans la prunelle de Mgr Grouard. Il se tait quelques instants, puis, comme s’il pensait tout haut, il poursuit :
— Une année, c’était, je crois, en 1863, j’ai remonté la rude rivière aux Liards, des jours et des jours de halage, les pieds dans l’eau, les portages et l’escalade des falaises à pic ; puis la descente vers la rivière des Wahanés, avec, comme toile de fond, la splendeur des Rocheuses.
Le Fort des Liards ! Mon Dieu ! comme ces choses sont lointaines ! Le vieux métis français Houle et sa femme. Une maîtresse femme, ma foi, devant qui tout pliait, son mari, les Indiens, les bourgeois du poste de traite et qui soutenait des thèses religieuses contre le pasteur Hunter… mais cela c’est une autre affaire.
Bonne femme Houle ! Si bonne pour le Père Gascon et Mgr Grandin, si bonne aussi pour moi.
Elle entre un jour, exaspérée :
— « Mon Père, voici la femme qui a tué son enfant. »
Cette femme, qui passait pour belle, avait un mari qu’elle abandonna pour en suivre un autre, quoiqu’elle eût déjà une petite fille.
Le mari, furieux, tue son beau-père et sa belle-mère, qu’il accuse d’avoir facilité la fuite de l’infidèle.
Lorsqu’elle apprend cela, celle-ci passe un lacet autour du cou de son enfant au maillot et l’étrangle en disant :
— « Penses-tu que je vais t’élever, après que ton père a massacré mes parents. »
Je la morigène :
— « Qu’as-tu fait, malheureuse ? Tu as tué ton enfant ? Les bêtes féroces elles-mêmes ont plus de cœur que toi, car elles aiment leurs petits, l’ourse se fait tuer pour sauver son ourson. »
Et je vais, je vais, la menaçant de l’Enfer et de tous les diables fourchus, puis j’essaie de la sermonner, de réveiller en elle quelques bons sentiments. Rien, pas un geste de regret, pas la moindre émotion.
Hors de moi, je la chasse :
— « Va-t’en ! »
Elle sort, et, s’adressant à Houle, elle dit :
— « Le Père a l’air furieux contre moi. Peut-être croit-il que c’est un garçon que j’ai tué ; mais non, explique-lui, ce n’est rien qu’une fille. »
Insensibilité, cœur de roche ? non, non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas.
Du reste, il y avait parfois des tendresses dans le cœur de ces femmes. L’une d’elles — une Esclave de la rivière aux Liards également — vint un jour me trouver.
Elle pleurait et me dit sa misère, l’éternelle misère, la faim. La poursuite du gibier qui se dérobe, les orignaux, les chèvres, les lièvres polaires, rien, pas ça, pas même une perdrix.
Ils vont, elle et son compagnon, l’espoir les mène, la bête mauvaise ronge leurs entrailles. Ils marchent des milles et des milles et mangent ce qu’ils trouvent, des débris de peaux, et jusqu’à leurs mocassins.
La mère porte un jeune enfant, le sein est tari, le petit affamé meurt.
L’homme est parti tenter une dernière chance. Il revient, accablé :
— « Nous sommes perdus… je n’ai rien trouvé et je n’ai plus de force. »
Et voici qu’il aperçoit le misérable corps que le froid et la mort ont bleui : la mère l’a déposé dans un berceau de feuilles.
Les yeux de l’Indien luisent de convoitise :
— « Mais voilà de la viande ! Allons, femme, coupe-moi ça.
— « Oh ! Père, Père, me disait-elle, je ne voulais pas ; mais il avait un regard si mauvais, j’ai eu peur pour ma vie : alors j’ai découpé les membres de mon enfant et je les ai mis dans la chaudière.
« Il m’a ordonné :
« — Mange aussi…
« Je n’ai pas voulu, je pensais : « C’est la chair de ma petite fille », et je pleurais, et je pleurais.
« Hélas ! Père, me pardonnerez-vous, je n’ai pas mangé, mais j’ai bu le bouillon. »
Dans la salle où le crépuscule qui descend met des ombres, il y a un silence peuplé de fantômes.
Misère de ces pays abandonnés, infortune de ces tribus sauvages livrées à elles-mêmes, souffrance de ceux qui sont autour de moi et qui tous sont venus librement pour partager la peine de ces réprouvés !
Mgr Grouard se lève, il marche à petits pas, on l’entend murmurer :
— Venez, les bénis de mon Père, j’avais faim et vous m’avez donné à manger.
Puis il redresse sa taille et le lutteur réapparaît, le vieux lutteur qui a regardé, maintes fois, la vie et la mort face à face, qui, à quatre-vingt-cinq ans, n’a rien abdiqué de sa force et de sa volonté.
Dans ses yeux pétille toute la malice de sa race, cette race de paysans manceaux, fidèle, loyale et brave jusqu’à la témérité.
Il s’arrête, frappe ses mains l’une contre l’autre :
— Cent-trente-deux ! Père Blanchin, je vous dois une revanche ; Père Falher, une lumière, je vous prie.
Les mains du prélat battent les cartes, allumant une lueur à l’anneau d’améthyste.
La Robe-noire, l’homme-de-la-prière, n’est pas venu.
Dans la prairie immense, l’Indien est roi.
Cris de la forêt, pacifiques et doux, errants de la Saskatchewan au petit lac des Esclaves.
Cris des prairies, libres, farouches et fiers.
Les jeunes filles chantent en cadence les fastes de la tribu. Les guerriers sont partis sur leurs chevaux rapides. Les Pieds-Noirs ont été surpris ; à l’arçon de la selle pendent les chevelures. Gloire à ceux qui reviennent victorieux !
Mais les Sikxikakowea sont cruels. Gens du Sang et Gens du Butin, tout ce qui n’est pas Pied-Noir a été exterminé.
Les Assiniboines, alliés des Cris, ont du sang de Sioux dont ils parlent la langue. Ils ont leur terrain de chasse depuis la rivière Souris jusqu’à la rivière Athabaska.
Les Montagnais-Chippeweyans ne connaissent pas la guerre. Leurs canots glissent sur les eaux du lac Caribou. Ils vivent, paisibles, de chasse et de pêche.
Dans la prairie immense, le Grand Esprit charitable a fait naître le Buffalo.
Les ancêtres ont transmis aux anciens les lois de la Prairie. Les chasseurs doivent s’y soumettre.
Les guetteurs s’arrêtent. Leur haute silhouette se détache brune sur le ciel clair. Ils sont hiératiques et beaux, chevaux et cavaliers sont des groupes de bronze. La main haute, le regard fouille l’étendue.
Rien ne bouge dans la prairie immense et rien ne vit.
Si, là-bas, à plusieurs milles, une tache noire sur l’herbe courte et jaunâtre.
Les bisons formidables paissent en sécurité.
Un geste et la ruée commence : dans un galop furieux, les chevaux s’enlèvent.
C’est un horrible carnage dans le beuglement éperdu des bêtes traquées, l’aboi des chiens et le cri des chasseurs.
Les naseaux fumants, l’œil rouge, la langue pendante, battant la prairie d’un sabot affolé, les grands bœufs sauvages veulent fuir…
Lugubre boucherie, inutile hécatombe !
L’Indien et le bison, fils de la liberté, qui dira vos combats dans la prairie immense ?
Sur l’herbe rouge, les bêtes sont dépouillées et puis c’est le retour de la tribu. Longue ripaille autour des feux, dans l’insouciance du lendemain.
Demain ! A quoi bon ! Le Soleil-Dieu nous éclaire, les rites ont été accomplis, le fagot sacré, l’ékestokisim a brûlé au moment même où l’astre est monté au ras de l’horizon ; la vierge a dormi le sommeil de guerre cependant que les sorciers haranguaient la nation ; les sept ordres de guerriers ont dansé et vanté leurs exploits ; les jeunes hommes se sont mutilés ; par les plaies béantes, le sang ruisselle.
Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent ce qu’ils font. Personne n’est venu leur donner des paroles de paix. Que savent-ils ?
Il y a par le monde un esprit bon et un mauvais esprit.
Manitou et machi manitou. Yédarié néson et yédarié slim.
L’un parfois domine l’autre, tissant les jours de joie ou de peine.
Indiens de la forêt ou de la plaine apaisent les mauvais esprits par des sacrifices sanglants.
Une morale existe : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se mettre en colère, mais la vengeance est un droit sacré.
Le ciel est un pays de chasse où les buffles vont en troupeaux.
L’enfer, une gorge dans la montagne, où règne un froid éternel, sans un brin d’herbe, sans une bête errante. On a faim sans pouvoir se rassasier, on a soif sans pouvoir se désaltérer et personne ne peut mourir !
La force seule compte. La pitié n’entre pas dans le cœur des humains. Le vieillard, la femme, l’enfant ? Faiblesses inutiles.
Le grand-père rôde autour du foyer, cassé, les paupières rougies, les mains tremblantes se tendent…
— Va-t’en, il n’y a rien pour toi. Que fais-tu parmi nous ? A quoi sers-tu ? Tu ferais bien mieux de mourir…
Sa mémoire vacillante lui rappelle que ces mots, lui-même les a prononcés alors qu’il était un guerrier valeureux ; résigné, il se retire, essayant de disputer aux chiens de quoi subsister jusqu’à demain… demain on verra, aujourd’hui seul importe.
Mais aux beaux jours ont succédé les heures de détresse, le renne manque, l’orignal a fui, les jeunes hommes sont revenus ayant en vain battu les bois. La faim mord la tribu aux entrailles.
Il faut partir, aller plus loin, ailleurs… et la horde se met en marche. Les vieux alors sont des fardeaux dont il faut s’alléger.
Au petit jour, on a levé le camp. L’ancien se réveille. Quoi, plus de bruits autour de lui ? Où sont les marmots piailleurs, pourquoi n’entend-on pas la voix criarde des femmes ? Où est l’errance fouineuse des chiens ? Qui a replié la loge en peau de caribou ? Il n’y a plus que la cendre dispersée, des os calcinés et des tisons éteints. Il est tout seul, tout seul.
Suivre la piste, comment le pourrait-il ? On lui a laissé des branchages sous lesquels il pourra se blottir lorsqu’il se sentira mourir. Ainsi les bêtes de la forêt ne dévoreront pas son corps abandonné.
Il sait que la tribu repassera dans un nombre déterminé de lunes et ses os alors seront ensevelis. Son esprit est en paix.
Et le vieillard attend la mort. Les heures de cette agonie sont longues, ses doigts décharnés se crispent sur son ventre parcheminé. La nuit amène sa terreur, l’ombre est peuplée de bêtes voraces… et déjà luisent les prunelles des loups.
La femme vit dans l’abjection la plus complète. Bête de somme, souffre-douleur, esclave.
Elle n’est pas la compagne, c’est la chose dont on peut disposer à son gré. Battue, humiliée, ravalée aux pires besognes, elle doit s’estimer heureuse de vivre.
Souffrances, privations, travail, c’est sa part la meilleure avec pour récompense les coups, la mutilation ou la mort.
Impure, elle doit se frayer une route hors des sentiers de la tribu. Elle doit dormir hors de la tente et hors du camp, elle met bas comme une bête de la forêt, sans parents, sans amis, toute seule. Aussi, les petites filles, le plus souvent, on les tue, la mère les étrangle elle-même ou les abandonne, parfois le père les dévore.
Ainsi la femme expie la chute de l’homme.
La faute originelle n’a-t-elle pas été commise par une femme ! N’est-ce pas elle qui a dérobé la vessie pleine de graisse de moelle, cette graisse si douce et si appréciée ?
Et le Grand-Esprit a puni les hommes qui souffrent désormais tous les maux de la vie. L’aventure est certaine.
Ecoutez, c’est la tradition qui parle :
« Aux premiers âges du monde, deux guerriers sont partis et se sont égarés… Après des journées de marche, ils arrivent sur une montagne où demeure un géant. Il y a dans ce lieu beaucoup de flèches. Le géant leur en donne deux très puissantes et leur dit :
« — Quand vous tuerez un animal, ne reprenez pas la flèche, elle vous reviendra d’elle-même.
« — Oui, disent-ils.
« Or, le plus jeune avise un écureuil, lui décoche sa flèche… puis il court la reprendre.
« Dès qu’il l’a saisie, la flèche s’élève dans les airs, entraînant le chasseur.
« La flèche ne s’arrête qu’au ciel. Là est une terre en tout semblable à notre terre. L’homme y rencontre une vieille femme dont les deux filles n’ont qu’un dessein : faire mourir l’imprudent qui est entré dans leur loge.
« Elles ont le sein rempli de bêtes malfaisantes. Elles trompent l’homme qui, pour se venger, déchire leurs vêtements.
« Alors toutes les bêtes immondes se sont répandues sur le monde. C’est depuis ce temps-là qu’il y a des méchants sur la terre. Mais la vieille dit à l’homme :
« — Fie-toi à moi ! Je vais te faciliter le moyen de retourner vers ta tribu.
« Elle attache le jeune homme à une longue lanière en peau de caribou et le fait descendre par un trou.
« — Dès que tu auras touché le sol, lâche la corde.
« L’homme ayant pris pied, obéit, la lanière remonte au ciel.
« Mais il se trouve dans l’aire de l’orepalde, le grand aigle qui se nourrit de chair humaine. Le rapace dort.
« En ravissant les plumes de l’aiglon, l’homme parvient à s’évader et retrouve son camp. Mais la vengeance est dans son cœur et, depuis lors, il porte en lui la traîtrise des femmes. »
… Tout ce qui est faible et sans défense est méprisé, bafoué ; la femme, l’enfant, le vieillard, ne sont plus des créatures de Dieu.
La Bête de l’Apocalypse est lâchée dans la Prairie immense où seule la force est orgueil.
Dans ces âmes frustes, il n’y a pas de place pour la tendresse, pour la pitié et pour l’amour.
La dissolution règne dans tous les camps.
Les hordes chevauchent de l’est à l’ouest la terre vierge, cette terre où demain surgiront les cités. Là où naîtront Winnipeg, Edmonton, Kamloops, Saskatoon, Prince-Albert, Calgary, l’herbe pousse courte et drue. Les Indiens passent, la mort en croupe. La souffrance et la misère règnent sur la Prairie.
Mais l’heure de Dieu va sonner.
De l’Orient vient la lumière. La Nouvelle France conserve le prestige affectueux des découvreurs français, de là comme aux temps héroïques vont partir les premiers pionniers.
Et la vieille terre de France va donner les meilleurs de ses fils.
Sous la pluie, c’est la chevauchée dans la Prairie.
Depuis deux jours, Saint Boniface a disparu de l’horizon.
Hier, c’était la halte du Cheval-Blanc, sur la rivière Assiniboine et maintenant c’est le désert, si grand, si vaste.
Le brouillard s’ouvre et se referme sur les chevaux et sur les hommes. L’averse tombe, oblique. Alexis Cardinal, métis, et Mgr Taché, évêque d’Arath, le dos rond, le cou rentré, vont au pas, les chevaux secouent les oreilles et font tinter les mors. Le métis songe au printemps disparu, aux courses dans l’herbe parfumée qu’animent l’anémone, l’aster, le tournesol, la rose, aux nuits étoilées dans le camp, aux récits des chasseurs ; à l’aube, aux départs joyeux, dans le piaffement des coursiers et l’impatience des hommes.
Ils vont, du Sud au Nord et de l’Est vers l’Ouest, mobiles dans la Prairie comme les nuages dans le ciel ; on marche des jours et des jours sans changer d’horizon. L’air emplit les poumons, la vie est belle, on a un cheval, une tente, des armes et la liberté. Et l’on va, errant, de la Rivière Rouge à la Saskatchewan.
Mais la majesté de l’infini l’obsède, une redoutable puissance ploie son âme et l’émeut. L’idée de Dieu se lève comme un lys sauvage dans son esprit troublé.
Ces Cris qui l’entourent sont ses frères par le sang, mais il perçoit en lui des affinités lointaines, des fils ténus qui le relient à la race venue de l’Est. Il est brave à la guerre, intrépide et résolu, il est beau, il est grand, il est fort.
Mais son cœur a des réminiscences, il sait, par tradition, que son père a couru les bois ; tous les pays d’en haut, il les a foulés de ses pieds chaussés de cuir souple, ouvrant la route aux voyageurs, à tous ceux que hantaient les mirages du Nord et la mystérieuse attirance de l’Ouest.
Le père de son père lui a dit, un soir, tandis que les hautes flammes s’élevaient du foyer :
— « Un jour, des hommes viendront. Ils auront une robe noire, une croix à la main. Ils te diront ce qu’il faut faire pour servir Dieu comme il veut être servi. »
Il sait donc, ses frères savent, que le prêtre existe. C’est Natoya Nikowan, l’homme divin. On ne l’a jamais vu encore mais il viendra.
Il est venu.
C’est pourquoi il a mis tout son dévouement et toute son intelligence au service du missionnaire, de l’homme qui apparut un matin devant les Indiens étonnés, disant :
— « Je suis l’Amour, je suis la Charité, je suis la Rédemption. »
Et c’est pourquoi le fidèle Alexis Cardinal suit Mgr Taché, l’homme-qui-porte-Dieu.
Mais le Prélat sent dans son cœur peser la solitude.
Sa Sainteté dans Rome a fait de lui un chef de la prière. Son jeune front[6] est lourd sous la mitre épiscopale. Sera-t-il maître de la tâche qu’on lui a dévolue ? Obscur Oblat, il allait, de l’île de la Crosse au lac Sainte-Anne, servant son idéal d’obéissance. Maintenant, il faut commander !
[6] Mgr Taché a été sacré évêque à 27 ans.
Sous la pluie qui fait rage, il croit qu’il va faiblir. Il est seul, il est triste, il a laissé tous ceux qu’il aime sur la rive du Saint-Laurent, au loin, par delà les Grands Lacs.
Mais la tendresse maternelle, invisible et présente, exalte son âme qui se reprend.
Il est de la race des premiers conquérants, en lui revivent de la Vérendrye, le découvreur de l’ouest canadien, du lac Supérieur aux Rocheuses, qui donna à la France un pays merveilleux[7] ; Pierre Boucher de Boucherville, qui défendit Trois-Rivières contre les Iroquois[8] et vint à Versailles porter au Roi-Soleil les doléances de ceux qui vivaient en Canada ; et la Sainte Mère d’Youville, qui était toute amour et toute charité. Comment n’être pas fier d’une telle lignée ?
[7] Huit fois la superficie de la France.
[8] En 1651.
Il est né de cette famille canadienne-française, dont les mœurs patriarcales sont une bénédiction de Dieu qui, établie sur une glèbe en friche, à force de labeur et d’opiniâtreté, a su imposer le respect et forcer l’admiration du monde.
On l’a choisi, lui, l’humble serviteur de Marie. Il faut donc qu’il aille, par tous les chemins, chercher la brebis égarée, ramener le troupeau épars.
Il est le pasteur de ces âmes, proies du Malin, qu’il faut éveiller à la Foi. Il faut arracher l’ivraie et le pur froment germera. Il est sûr que la récolte sera généreuse, cette terre que foule le sabot des chevaux est nourricière, elle est grasse, depuis des milliers d’années un riche humus la féconde.
Demain, elle enfantera prodigieusement dans la splendeur du renouveau. Alors qu’importe la souffrance d’une heure !
Un galop chasse les mauvaises pensées. Et bientôt le brouillard se fond, la pluie cesse, là-bas, c’est le repos, là-bas, c’est l’oasis.
Le vent courbe la cime des peupliers dont le feuillage argenté frissonne sur les rives de la Rivière-aux-Castors.
Puis, c’est la marche, de la montagne de Tondre au Fort Carlton. Pendant dix-sept jours l’évêque va, de tribu en tribu, de camp en camp, de loge en loge. Hélas ! la civilisation se manifeste : l’eau de feu des traiteurs ronge et fauche. Comment faire, Seigneur, pour reconnaître vos élus ?
Le 23 octobre, la neige tombe, il faut marcher quand même, il faut marcher toujours.
A l’île de la Crosse, son cœur est dans l’allégresse. Pères et frères, il y a huit Oblats et c’est une joie enfantine.
Maintenant, les chevaux sont inutiles. Alexis Cardinal attelle les quatre chiens et le traîneau court sur la piste.
Dès une heure du matin, on part, la neige est peu profonde. La route pénible, on mange sur le pouce, comme on peut, ce qu’on a, et le soir c’est la halte auprès d’un maigre feu.
L’évêque a froid, il a faim, il est fatigué. Il tend ses mains gourdes à la flamme. Le vent siffle dans les sapins. Un désespoir l’accable et un pressentiment déchire son cœur.
Pourquoi, Seigneur, pourquoi[9] ?
[9] A la même heure, le même jour — 14 décembre — à trois cents lieues de là, son église, l’église de Saint-Boniface, si péniblement édifiée, flambait.
Perdu dans la forêt, souffrant dans sa chair, pleurant de misère sous l’unique couverture qui le recouvre, il grelotte et prie.
Etendu au pied d’un arbre, Monseigneur regarde mourir lentement le foyer : une lueur qui s’avive et s’éteint.
Il n’y a plus rien que le grand silence troublé par le pas feutré des bêtes.
En ce temps-là, un noble lord entreprit d’établir, au confluent de l’Assiniboine et de la Rivière Rouge, « une oasis de civilisation au milieu des prairies et des forêts où erraient les tribus sauvages ».
Mais, « pour civiliser, pour coloniser, il faut le sentiment chrétien », et lord Selkirk, protestant, s’adressa au représentant de l’Eglise catholique.
Gloire impérissable de Norbert Provencher[10] et du jeune séminariste Sévère Dumoulin, qui partirent de Montréal-Ville-Marie — sur un canot d’écorce pour aller vers l’ouest porter la parole du Christ et ouvrir aux Indiens le Royaume de Dieu[11].
[10] Mgr J. Norbert Provencher, premier évêque de Saint-Boniface, 1787-1853.
[11] 19 mai 1818.
Premières heures si pénibles d’un apostolat qui devait être si fécond.
Comme saint Paul, ils devaient éprouver la faim, le froid, la soif, l’hostilité de la nature et l’ingratitude des hommes.
Œuvre admirable édifiée avec amour, mais œuvre trop vaste pour les épaules de quelques-uns. Les collaborateurs, rebutés, épuisés ou vaincus, regagnaient Québec, la douce ville. Le prélat était un chêne robuste, seul debout au milieu de la plaine où l’orage a tout ravagé.
Alors Mgr Provencher appelle les Oblats et Mgr de Mazenod, l’homme au grand cœur, envoie ceux que Dieu a choisis pour être « la lumière des nations et pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre[12] ».
[12] Isaïe, XLIX. 6.
A soixante-quatre kilomètres à l’ouest du Fort des Prairies[13], un lac que les Cris appelaient lac du diable, avant que l’homme-de-la-prière l’eût consacré à sainte Anne, protectrice du Canada.
[13] Aujourd’hui Edmonton.
Mission de Sainte-Anne, première étape vers le Nord, d’où va partir la pensée divine.
Longues courses du fidèle J.-B. Thibault, chez les Sauteux, les Cris et les Dénés.
J.-B. Thibault, compagnon de Mgr Provencher, âme ardente, cœur valeureux, esprit inébranlable, d’une humilité si grande.
A sa parole, toutes les races accourent, toutes les tribus se lèvent.
La Robe-noire est là ; Loucheux, Peaux-de-lièvres, Couteaux-jaunes, Castors, viennent à lui. Il est lumière et son passage est un rayonnement. Ah ! les joyeuses pâques de l’an de grâce 1845 sur les rives du lac Sainte-Anne.
Le Christ sans tache a réconcilié les pécheurs avec son Père. C’est la résurrection d’un peuple qui renaît à la grâce divine.
Et l’apôtre, vêtu d’étoffe grossière, vit dans une pauvreté primitive, jeûnant quatre jours alors qu’il se rend à l’île de la Crosse.
L’île de la Crosse qui va devenir « un berceau d’évêques »[14], verte oasis sur les eaux vertes du lac. C’est l’espérance qui se lève et c’est la joie qui vient.
[14] Quatre grands évêques : Mgr Laflèche, Mgr Taché, Mgr Faraud et Mgr Grandin.
— Hâtons-nous, disent les sauvages, nous allons peut-être mourir et nous n’aurions pas le bonheur de voir Dieu.
Jean-Baptiste Thibault, celui-là, était une modeste Robe-noire, une de ces humbles fourmis de l’armée régulière de Dieu, un membre de ce clergé canadien-français si admirable, qui multiplie les œuvres, qui au lendemain des heures douloureuses du traité de Paris, sut, au milieu des dangers, rassembler le troupeau autour de l’autel et garder dans un même espoir, son Dieu, son verbe, son origine.
Immortelle parce qu’elle a germé dans la persécution et qu’elle a su affirmer sa volonté de vivre.
Ecoutez ! De Québec à Montréal, c’est tout autrefois qui subsiste et qui passe avec la voix des cloches.
Et de clocher en clocher, de cime en cime, le vol de la race s’élargit ; c’est le parler du vieux pays que l’on entend de Winnipeg à Edmonton, de Calgary à Grouard ; au bord des lacs, sur la rive des fleuves, au cœur de la prairie en fleurs, sur la pente des monts, c’est la civilisation française qui vibre et qui vit, gesta Dei per Francos !
Honorons ceux qui ont pris à Québec sa devise : Je me souviens. C’est la gloire des premiers pionniers catholiques d’avoir porté l’Evangile dans le Nord et dans l’Ouest. C’est à eux, c’est à leur souffrance — auréole qui les grandit — que l’on doit la conquête d’un pays aux ressources immenses, ce qui est bien, et le rachat des âmes, ce qui est mieux.
Je me souviens, c’est Jacques Cartier, c’est Champlain, c’est Maisonneuve et ces messieurs de Ville-Marie, c’est le sang précieux de Jogues, de Brebeuf, de Lallemand, de La Lande, de Messager et d’Aulneau, coulant sur la terre nouvelle et la fécondant.
C’est le chemin du martyre montré aux Pères Le Roux et Rivière, o. m. i. Aux temps héroïques ? Non, en octobre 1913. Ce passé est d’hier, et plus que jamais tous ces morts sont vivants.
Je me souviens. C’est le Canada qui chante un hymne de confiance et d’amour.
Or Mgr Taché, évêque d’Arath, in partibus infidelium, parcourt son diocèse blanc suivi du fidèle Alexis. Et c’est Noël à Saint-Joachim[15]. C’est la grande manifestation de l’amour de Dieu pour les hommes.
[15] Aujourd’hui une paroisse d’Edmonton.
Noël ! Satan s’écroule et la voie du salut s’offre à tous les humains. Noël ! C’est l’accomplissement des prophéties, c’est la grâce, c’est le sacrifice et c’est la charité.
Dans ce monde perdu, loin du tumulte des villes, la grâce est plénière, le sacrifice absolu, la charité inépuisable.
Dans ces humbles églises de bois, bâties par les serviteurs eux-mêmes, nues comme l’enfant-roi sur la paille de son étable, on est plus près de vous, mon Dieu ! On est sûr que l’iniquité sera effacée de la terre et que, dans la nuit sainte, la vraie lumière apparaîtra.
Les premiers qui accoururent à l’appel mystérieux, ce furent les bergers qui veillaient sur leur troupeau. L’un d’eux tenait dans ses bras une agnelle bêlante.
C’étaient des âmes de bonne volonté.
Ceux-ci, qui sont autour de vous, ce soir, sont parmi vos enfants, les plus humbles, les plus bas ; regardez leurs yeux pleins de larmes, leur tendresse et leur humilité. Ils sont pareils aux pâtres de Judée, en vérité, votre ciel de gloire est pour eux, Seigneur, ils sont simples, ils sont bons et pauvres comme vous.
Et Monseigneur voudrait officier pontificalement, mais Monseigneur n’a pas de crosse.
Alors, le Père Lacombe, de son couteau, taille un bois vert, qu’il peinturlure avec de l’ocre jaune[16].
[16] Cette crosse est conservée à la mission Sainte-Anne.
Ne dirait-on pas une de ces imageries primitives, légende du bon saint Nicolas ou les trois Maries sur la nef ?
Les sauvages sont là, il y a aussi Michel Normand et sa femme, Rose Plante, et trois Sœurs de la Charité : Sœur Emery, Sœur Lamy et Sœur Alphonse.
Il y a des petits enfants qui balbutient le nom de Jésus et des fillettes qui chantent en cri :
« Chantez au Seigneur des cantiques nouveaux, car il a fait des prodiges. »
Jamais chant n’a monté avec autant de force et de naïveté vers le Trône de Dieu.
Et quand tintent les clochettes annonciatrices, jamais foule ne s’est agenouillée avec plus de foi : le prêtre élevant l’hostie sent que son petit peuple communie avec lui.
« Il n’y a pas de place dans l’hostellerie », mais, entre l’âne et le bœuf, il y a place pour un tout petit être qui tend sa main fragile vers la lumière qui bouge doucement.
Les Indiens Cris et les métis courbent leur front orgueilleux, l’Esprit descend. Et voici que Monseigneur lève sa dextre, dans un geste, il exalte les cœurs ; un Dieu est né pour le bonheur des hommes, de tous les hommes, qu’ils aient la peau cuivrée ou blanche, de l’une à l’autre terre il est pareil pour tous. Gloire au Dieu de Toute-Puissance, méritons-le pour partager, un jour, sa gloire et sa béatitude.
Et les grands enfants de la Prairie s’en vont, éblouis, ayant au fond de leurs prunelles un beau rêve infini.
Au matin, grand émoi parmi les Cris.
Une clameur monte :
— Les Pieds-noirs ! Les Pieds-noirs !
Les enfants terrifiés se cachent, les femmes se lamentent, les chiens hurlent, les hommes se préparent au combat.
Le Père Lacombe accourt. Là-bas, six guerriers dévalent la colline au galop de leurs chevaux bais.
D’un geste, le Père retient les armes.
Ah ! l’arrivée magnifique, l’arrêt merveilleux ! Les six cavaliers ont sauté. Ils se tiennent debout, immobiles et fiers, devant les naseaux de leurs bêtes frémissantes.
L’un s’approche. Le vent incline les plumes d’aigle de sa tête.
C’est Pied-de-Corbeau, chef redoutable des redoutables Pieds-Noirs.
Il dit :
— J’apporte la paix.
— La paix soit avec toi, répond le Père Lacombe, que veux-tu ?
— Des hommes de ma nation racontent que le Grand-chef-de-la-prière est ici, nous voudrions bien le voir.
Mgr Taché s’avance en souriant :
— C’est moi !
Et l’Indien dont le temps a griffé les tempes, au bras fort, au cœur cruel, que rien n’émeut, se sent comme un enfant devant cet homme jeune dont le calme regard fouille le sien.
Prestige de celui qui parle au nom du Maître de la Vie, sérénité des âmes pures, le guerrier tremble comme s’il était en présence d’une vision surnaturelle.
Mais bientôt il se reprend :
— Grand-chef-de-la-prière, je viens te demander, au nom de ma tribu, une faveur.
Donne-nous une Robe-noire pour nous instruire. Je te promets que nul ne la molestera.
Je n’espérais pas avoir le bonheur de te voir. Mon cœur est satisfait de t’avoir rencontré avant de partir vers mes pères.
Donne-nous une Robe-noire pour nous apprendre la Vérité.
Ton envoyé sera notre hôte ; par considération pour lui, nous ne porterons pas la guerre dans les camps ennemis.
Nous le respecterons, nous l’aimerons comme le fils de notre sang.
L’évêque dit :
— Je vous donnerai celui qui est déjà venu parmi vous. Celui-là même qui est auprès de moi et que vous appelez arsous kitsi parpi, l’homme-au-bon-cœur.
Et la joie pénètre l’Indien.
— Si le Père Lacombe vient, c’est que le Grand Esprit veille sur ma nation.
L’homme-au-bon-cœur ! La belle âme — kamiyo atchakwet — qui aux heures sombres où l’Esprit du mal ravageait la tribu est venue leur apporter la consolation.
A ceux qui voulaient le détourner de sa mission, il répondait :
— Je suis le père de tous les sauvages. Ils m’ont appelé, il faut que j’aille. Ne sont-ils pas dans le chagrin et la misère ?
Lamentable tableau, vision d’épouvante, dans les soixante loges le mal est entré. Les fermes, les enfants, les hommes, demi-nus, dévorés par la fièvre, gisent à l’abandon.
Comment faire, ô mon Dieu !
Il y a dix camps dans un rayon de quelques milles, tous sont frappés, la désolation est partout.
Dans une tente close, par dix, par quinze, les morts sont entassés. Les loups rôdent, les corbeaux tournoient.
Un homme tient son enfant dans les bras. L’enfant est mort depuis deux jours et le père lui parle, il lui soulève les paupières, lui ouvre la bouche dans l’espoir insensé de surprendre la vie.
La Robe-noire passe, absolvant les mourants, bénissant les morts, annonçant :
— Ceux qui souffrent verront Dieu !
Il met dans tous les cœurs une longue espérance.
Vingt jours, vingt nuits, sans relâche, sans repos, il va. Et lui-même est frappé.
Que va-t-il devenir ? Que vont devenir ces malheureux ? Il sent le froid de la mort, la fièvre bat ses tempes.
Toute sa foi est en Dieu.
— Seigneur, vous savez pourquoi je suis venu ici. Si vous m’ôtez la vie, beaucoup de ces pauvres sauvages mourront sans baptême et ne verront jamais votre Face adorable. Ma tâche n’est pas terminée, ne me rappelez pas encore. Seigneur ! je veux encore me dévouer de toutes mes forces pour faire connaître et aimer votre Saint Nom…
Dieu a pitié de son fidèle serviteur, le mal recule et fuit.
Le dur hiver s’efface, la neige disparaît, le Renouveau arrive et avec lui des forces nouvelles qui régénèrent la tribu.
Pied-de-Corbeau se souvient, si l’homme-au-bon-cœur revient, un jour, parmi ses frères, Gens du Sang, Sarcis et Pieds-Noirs sont sauvés.
L’Indien, reconnaissant, baise l’anneau du chef de la Prière. Il est heureux, sa mission est remplie.
D’un bond, les guerriers sont en selle. Ils enlèvent leurs chevaux qui partent dans un galop.
On les suit longtemps sur la plaine blanche… ils montent la colline et le rideau de sapins les cache aux yeux des hommes.
Cris et métis sont rentrés sous leur tente, les femmes accroupies surveillent le foyer, les enfants jouent avec les jeunes chiens.
L’homme-au-bon-cœur contemple son petit peuple. Il a bâti la maison du Seigneur, et, sur les bords du lac Sainte-Anne, les errants se sont arrêtés.
Mais ici la terre est rebelle aux efforts, elle refuse ses richesses et le Père Lacombe, pasteur qui a le souci du troupeau, expose sa peine à Mgr Taché.
Le sol est avare, ingrat, il a peur que les Cris ne se rebutent, ne se lassent, et qu’un matin, poussés de nouveau par leur instinct, ils ne reprennent leur course à travers la Prairie.
Des bonnes terres, il y en a, là-bas, plus loin, vers le lac Esturgeon.
L’évêque répond simplement :
— Nous irons, mon fils.
Par un matin clair, les deux hommes s’en vont à la découverte. Le Père Lacombe en raquettes « bat la neige » devant les chiens, cependant que Monseigneur maintient l’équilibre de la traîne.
Et les voici au haut d’une colline ; le Fort des Prairies est à huit milles de là, une rivière serpente dans la vallée avant d’aller se perdre dans le lac qui miroite.
Les chiens soufflent.
Mgr Taché propose :
— Père, arrêtons-nous un peu.
— Bien des fois je me suis attardé ici. Après les longues courses, j’ai goûté le charme de ce paysage et son repos et son harmonie.
— Mangeons un morceau, fait gaiement l’évêque.
Frugal repas — eau claire et pémikan — mais qu’importe à ces hommes qui ont tout abandonné pour la solitude, l’exil, les privations sans nombre.
Etre Oblat, c’est être le dernier parmi les pauvres et les déshérités, c’est sacrifier les affections les plus chères, c’est renoncer, mais c’est être un porteur de lumière.
Depuis qu’ils ont pris le bourdon de saint Jacques, que de chemin ils ont parcouru.
Ils ont ensemencé les champs incultes et délaissés. Sont-ils payés de leur peine ?
— Tu seras évêque, disait affectueusement Mgr de Mazenod à son cher fils Taché, qui refusait l’investiture pour rester Oblat, tu seras évêque et tu resteras Oblat.
Evêque, serviteur et roi !
Mgr Taché, dans le silence blanc qui l’environne, songe à sa destinée.
Il avait tout abandonné pour les missions, et Mgr Provencher, voyant sa jeunesse, murmurait :
— L’on m’envoie des enfants et ce sont des hommes qu’il nous faut.
Mais le vieil évêque discernait vite l’âme de feu qui animait l’apôtre et bientôt « frappé plus du mérite que de la jeunesse », il l’avait désigné pour l’épiscopat.
Cet honneur, il ne l’a pas voulu ; pauvre évêque errant dans un diocèse immense, a-t-il atteint la perfection de la charité par la perfection du sacrifice ?
Sur la neige, le soleil est éclatant, dans un ciel léger, les oiseaux passent. Et le Prélat sourit aux merveilleuses beautés de la nature, présent de Dieu aux âmes exilées.
Le Père Lacombe souffre en sa chair, les lanières de cuir blessent ses pieds déjà meurtris par des courses lointaines, mais « qu’ils sont beaux les pieds de ces hommes qui viennent annoncer la paix, apporter les vrais biens »[17] et l’esprit du missionnaire garde le souvenir de la scène sublime où, prêtre nouvellement ordonné, il vit Mgr Bourget s’incliner devant lui et lui baiser les pieds[18], symbole admirable… Depuis il a parcouru bien des routes, souffert bien des misères, il est l’homme de la Prairie, qu’il connaît dans ses moindres replis.
[17] Isaïe.
[18] 31 juillet 1847.
Mais sa tâche est loin d’être achevée, à chaque jour suffit sa peine et Dieu le mènera sur bien d’autres chemins.
Tout à coup, Mgr Taché se dresse. Le Paraclet le comble de sa grâce, et, plantant dans la neige son bâton, il prend possession de la terre.
— Ici, sera la nouvelle mission, ici, vous élèverez la chapelle et vous l’appellerez Saint-Albert, en l’honneur de votre saint patron.
… La neige a disparu. Les Indiens disent :
— Nous allons revoir notre bonne vieille mère la terre.
A cette place, le Père Lacombe a planté une croix. Tout autour, il y a des Indiens, des métis, une charrue, des bœufs, des chevaux, des chiens.
Le missionnaire a célébré la Sainte Messe sur la colline. Puis les hommes se sont mis en marche vers la forêt. La cognée sur l’épaule, ils cheminent, les voici arrivés. Le Père Lacombe commande :
— A genoux, prions le Maître de toutes choses de nous bénir et de bénir nos travaux.
L’oraison monte pour la première fois sur ce monde nouveau : « Notre Père… Je vous salue… » et l’invocation : « Saint Albert, aidez-nous à faire la volonté de Dieu. »
Puis la hache haute, l’homme-au-bon-cœur attaque un pin majestueux.
Le Père Lacombe commence la maison du Seigneur.
Les années se sont succédé, l’espérance a grandi. Dieu a pris, tour à tour, et l’évêque et son serviteur. Mais autour de l’église une ville a surgi ; dans les prairies, il y a des troupeaux par centaines, les granges sont pleines du blé de la moisson.
Et l’homme-de-la-prière reprend sa course à travers la Prairie où sont les errantes brebis[19].
[19] Février 1865.
La saison est mauvaise, qu’importe ! Il gèle dur, la traîne ira plus vite, plus vite on rejoindra les Cris.
Le fidèle Alexis bat la neige devant les chiens, le Père Lacombe est près de lui. Ils vont depuis l’aube, jouant des raquettes sans échanger un mot. La misère pèse sur leur âme, la fatigue les brise. Une trace est là qu’il faut suivre ; les Indiens ne peuvent être loin, mais dans le mirage des neiges, le but recule qu’on croit atteint.
Voici la rivière La Biche, sur la rive un maigre taillis se hérisse. On va pouvoir dresser la tente.
Le métis siffle. Les chiens s’arrêtent et secouent leurs harnais.
— Mon Père, je suis content de faire « chaudière ».
Le Père Lacombe avoue :
— Je commençais à traîner les raquettes.
Les bêtes dételées s’ébrouent. On prépare un lit de branchages, une brassée de bois sec et le feu pétille sous la marmite.
Les chiens ont croqué leurs poissons, ils creusent un trou dans la neige et s’endorment en boule. Les hommes mangent. La flamme éclaire leurs visages, visages rudes où se mêlent l’effort, la sérénité et la foi.
Ils ne parlent pas, suivant chacun un rêve différent.
Le Père, son espoir des âmes enfin conquises, le métis, l’unique désir de plaire à celui dont il s’est fait le serviteur.
Alexis porte en lui la double hérédité : blanche et crise, il a couru la terre du nord au sud, il connaît tous les secrets de la Prairie, il a vécu la belle vie de liberté, chassant le buffle, traquant le caribou, il a été « engagé », au service de l’Honorable Compagnie, relevant la piste des renards, des castors et des martres. Il a eu un foyer, mais la sauvagesse aimait les rubans et les perles multicolores, un commis passait, elle est partie. Alors il a suivi l’homme-de-la-prière, mettant sa confiance en lui.
Depuis, en toutes saisons, il l’accompagne ! A pied, à cheval, en canot, à travers les prairies et les bois ; sur la glace incertaine des lacs, dans les sentiers de la forêt, il oriente sa route.
Il se lève, ravive le feu, il reprend sa place et son rêve.
Rêve simple, rêve primitif, l’homme qui est là représente la miséricorde divine : le servir c’est servir Dieu.
Le Père est tout à son apostolat. Il a tout quitté pour les « missions sauvages » et la vieille maman attend, dans l’antique maison de Saint-Sulpice, le fils qui peut-être ne reviendra pas.
Vieille chère maman ! Vieille chère maison ! C’est là qu’un soir de 1695, Duhamel, dit « Sans-façon », revenant des champs, trouva son foyer saccagé, les petits enfants fous de terreur, sanglotant ; les Algonquins étaient venus, puis ils étaient partis, emmenant la sœur aînée impuissante.
Vieille chère maison où l’aïeule maternelle a connu la joie du retour !
Il a joué tout enfant sur ces pierres polies par l’âge et sa jeunesse fut bercée par le récit tragique qui, à la veillée, passait de bouche en bouche.
Brrou ! Il ne fait pas chaud ! Si la poitrine est grillée, le dos gèle.
Le Père dit les Grâces, Alexis répond.
Sous la peau de buffle, les membres se détendent, le sommeil pèse sur les paupières. On va pouvoir dormir. Repos de la bête lassée. Enfin !
Un gémissement.
Le Père Lacombe se dresse. Plus rien. Le bruit du vent sans doute qui passe dans les épinettes. Il se recouche. La plainte reprend.
Il appelle :
— Alexis, entends-tu ?
— Il me semble.
— Ce n’est ni un lièvre, ni un hibou.
Le métis claquant des dents murmure :
— Père, c’est un revenant.
Puis il enfouit sa tête sous la couverture :
— Mon brave Alexis, je t’assure que messieurs les revenants restent chez eux par un froid pareil.
La plainte se prolonge, elle monte plus grande, plus forte.
— Allons, debout, viens avec moi.
Le métis hésite.
— Il fait si noir.
— Soit, j’irai seul.
Et le Père se lève, à tâtons dans la nuit, les mains tendues.
On gémit, certes, mais où ?
Il va, se heurtant aux arbres, ses pieds enfoncent dans la neige, s’enchevêtrent dans les broussailles.
Tout bruit cesse ; le silence dans les ténèbres. Et malgré sa bravoure, le prêtre sent l’effroi qui pénètre son cœur.
Ah ! aaaa… Le râle déchire la nuit.
L’homme se penche, une femme est étendue, pressant contre son sein un enfant qui semble n’avoir plus de souffle.
Elle gît sur la cendre encore tiède d’un foyer. Pour trouver un peu de chaleur et de vie, la malheureuse s’est couchée là.
— Que fais-tu ? Qui es-tu ?
— Ils m’ont abandonnée.
— Lève-toi.
— Je ne puis.
— Essaie.
— J’ai les deux pieds gelés. Je vais mourir, je vais mourir.
Le Père Lacombe crie.
— Alexis ! Alexis ! Viens vite, une femme, un enfant… apporte un peu de lumière, vite, vite.
Le métis retrouve toute son énergie. Il s’agit de vivants, il accourt, il est là. Le tison éclaire une face exsangue, un corps à moitié nu. Pour préserver l’enfant du froid, elle s’est dépouillée. La lueur éveille l’enfançon qui tette goulûment le sein épuisé de sa mère. Avec d’infinies précautions, les deux hommes transportent l’Indienne jusqu’au camp.
Alexis ranime le feu et prépare le thé ; cuillère par cuillère la femme boit.
La Robe-noire se penche sur cette misère. Il faut ramener la circulation du sang vers les extrémités. Hélas ! il est trop tard, la décomposition a déjà fait son œuvre.
Quelle pitié ! Ne rien pouvoir, être impuissant devant une telle infortune.
Et la femme conte son histoire. L’éternelle histoire, toujours vraie, toujours pareille sous toutes les latitudes du monde.
— J’ai vingt ans, je suis mariée. Mon mari est devenu un méchant homme. Il ne m’aime plus. Il me bat. Je l’ai accompagné, comme les autres femmes, à la chasse, il m’a repoussée ; je suis allée à l’aventure… puis j’ai voulu revenir, le camp était levé et j’ai marché pendant des heures, j’avais faim, j’avais froid, et mon enfant a pleuré. Il voulait vivre, lui. J’ai couru, j’ai couru, mes pieds devenaient de plus en plus insensibles. J’ai retrouvé un autre campement. Les hommes étaient partis. Aller plus loin, ailleurs, je n’ai pas pu… alors, je me suis traînée sur ces cendres chaudes pour y mourir.
Dans la nuit, il y a des bêtes… la mort est là… Grand Esprit, si tu veux sauver mon enfant, envoie quelqu’un à mon secours avant que je meure.
Le Maître de la vie m’a exaucée, puisque tu es venu. Maintenant, je puis mourir.
Et la malheureuse tombe, épuisée. Le Père la recouvre de son unique couverture. Il passe la nuit accroupi devant le feu, pleurant sur l’infortunée et priant.
Comment rejoindre les Indiens ? Avec le faible traîneau comment transporter une aussi lourde charge ? Mais Alexis s’active, il coupe, taille, coud et lorsque l’aube chasse les affres de cette épouvantable nuit, on peut installer la malade et son petit sur la traîne agrandie, transformée.
Les chiens tirent, le métis aide les chiens, le Père pousse à l’arrière et maintient l’équilibre. Et tout le jour, on va.
Enfin ! Voici les tentes au bord de la rivière.
— L’homme-de-la-prière arrive, l’homme-de-la-prière est là.
Et les sauvages accourent, empressés.
Mais la Robe-noire est courroucée.
— Où est le monstre qui a abandonné sa femme et son enfant ?
— Il est là, dans la petite tente.
— Qu’il vienne.
L’Indien paraît, il se dandine, il fait le beau, il rit, bravant le prêtre :
— Tu aurais mieux fait de la laisser mourir, je n’en veux plus, j’en ai une autre. Fais d’elle ce que tu voudras.
— Ah ! méchant homme. Tu es pire qu’un vil animal. Les animaux ont plus de pitié pour leurs petits, ils les défendent. Va-t’en, tu es indigne de rester avec tes frères, regarde, tous ils ont honte de toi.
Le Père est pareil à l’ange du châtiment et comme l’homme à sa première faute, l’Indien part, accablé sous la malédiction de Dieu[20].
[20] La malheureuse femme survécut, amputée des deux pieds. Elle vécut à Saint-Albert, où elle reçut le baptême. L’enfant, une fille, fut recueillie par les religieuses.
— Ho ! Hisse !
— Attention !
— Ho ! Hisse !
— Ho !
Au commandement, les seize garçons soulèvent le rail, le portent quelques pas.
Un coup de sifflet.
Le rail retombe avec un bruit sourd. La terre tremble.
— Prends garde, Patrick !
— A toi, Arnold !
— Hé là ! La Montagne !
De Mandeville, Johan Johnson, Piccoli, Hans, Rodriguez, Jim…
Toute la vieille Europe est là. Ils sont là les aventuriers du monde, les chercheurs d’horizons nouveaux ; tous ceux qui surgissent on ne sait comment, on ne sait d’où, lorsqu’il y a des coups à donner, de l’or à prendre, de la misère à recevoir.
Ils ont suivi Cabot, Pizzaro, Pinçon, Cartier, Vespucci, Colomb, Champlain, Gama, Cavelier de la Salle, tous les grands découvreurs de terres inconnues, tous ceux qui, pas à pas, dans la douleur et dans la joie, enfantaient un monde, reculant toujours plus loin les limites des connaissances humaines.
Ils accompagnaient le Père Marquette sur le Mississipi, de Querguelen aux mers du Sud, de Lesseps à Suez, Lyautey au Maroc.
Les charniers de Chagres et de Colon ont vu finir leur course.
Ils ont péri dans les ravins de la Sierra.
Leurs os blanchissent dans les déserts de l’Utah et du Colorado.
Ils sont partis, un jour, dans la Pampa, et ne sont jamais revenus.
La jungle s’est ouverte devant eux qui les a dévorés vivants.
La forêt guyanaise a mélangé leur poussière aux chaudes pourritures amassées par les siècles.
Ils ont disparu dans l’énigme religieuse des Indes, dans les passes du Thibet, dans les steppes mongols.
Ils ont eu le vomito-négro à Caracas, la fièvre jaune à Rio, la peste à Malacca.
Francis Garnier les menait au Tonkin, Dodds au Dahomey, Gallieni à Madagascar. Ils suivaient à la piste de Brazza au Congo et Mangin au Chari.
Ils ont été payés par Alexandre, par Rome et par Carthage, Napoléon leur a donné l’Europe, du Guadalquivir à la Bérésina.
Ils ont erré sur la mer des Tropiques.
Ils ont forcé la Vera-Cruz et Saint-Domingue.
Dans l’île de la Tortue, ils ont joué aux gentilshommes, et leur bourse vidée, ils ont guetté les galères de Sa Majesté Catholique, pillé les galions du Roi-Soleil.
Surcouf les connaissait, et Jean Bart et Forbin.
Ils ont ramé sur les barcasses barbaresques, sous la chiourme des pirates salétins. Ils ont fini dagués, arquebusés, la hart au col.
Toutes les ruées, tous les rush les ont vus, alertes, maigres, noirs et gais, francs compagnons et joyeux drilles, sacrant et massacrant.
Pour du pétrole ou pour de l’or, pour rien aussi, pour le plaisir, ils ont donné leur vie, mais toujours comme le phénix fabuleux, ils ont ressuscité d’entre les morts.
Ils sont ici présentement.
Les missionnaires ont dit :
— Il y a dans les pays de l’Ouest des terres fécondes. Mais pour les atteindre, il faut traverser des grands lacs, s’aventurer dans la Prairie jusqu’au pied des Rocheuses.
Il n’y a pas de routes ? On en tracera une de l’Océan à l’Océan.
De Montréal à Fort-Gary, de Fort-Gary à Vancouver[21].
[21] Il y a de Montréal à Vancouver 4.679 kilomètres.
C’est pourquoi Rodriguez, Piccoli, Hans, Johnson, Jim, de Mandeville sont là.
Hier ils étaient à la Rivière Rouge saluant de « hurrahs » frénétiques la première locomotive qui arrivait, sur une goélette remorquée par le Selkirk.
Le carillon de Saint-Boniface sonnait à la volée.
Hymne de joie, cantique d’allégresse ! C’est la civilisation qui vient et le progrès ; une ère nouvelle commence.
Aujourd’hui, ils sont sur la rivière de l’Aigle, à 67 milles du portage du Rat[22]. Il y a vingt camps et quinze cents hommes ; alors, au milieu des chantiers, le Prêtre est venu[23].
[22] Kenora.
[23] Le Père Lacombe.
Apostolat difficile, patience de tous les instants ! Blasphème, profanation, ivrognerie, grossièreté, brutalité, qu’importe ! la Robe-noire est là, prête au pardon de toutes les fautes, à l’absolution de tous les péchés.
Dieu habite une hutte rustique et le miracle s’accomplit.
Après la rude journée, des hommes viennent, ils entrent, un à un, ou par groupe de trois, le bonnet à la main, en habit de travail, faces hâlées, têtes hirsutes, barbes broussailleuses, mentons blancs-becs, les gros souliers cloutés râpent le plancher. Assis sur le bord des bancs, ils chantent.
Au fond du limon des âmes, il y a des réminiscences enfantines. Noël ! Noël ! Peu à peu, le passé remonte de l’ombre.
Une note, un air fugitif, c’est toute une époque qui revit. C’est l’église du village aux murs blanchis, aux saints naïfs, la bonne grosse voix du curé, les fillettes aux tresses blondes, le fichu des grand’mères, la blouse bleue des paysans.
Le banc du catéchisme et, sur l’autel, la Vierge qui tient dans ses bras un tout petit enfant.
Cet enfant lui ressemble comme un frère, il est pareil à lui, ils ont joué tous deux, sur la place, sous les platanes feuillus.
Et deux grosses larmes hésitent aux bords de ses paupières et roulent sur les joues ; du revers de sa main calleuse, il les efface.
Il chante… il chante, lui, l’homme qui a roulé sur toutes les routes de la terre, et dans quels bouges, Seigneur !
Il chante, sa voix est éraillée, les mots roulent comme des graviers, et ses lèvres inhabituées retrouvent des paroles anciennes.
Il chante… N’est-il pas ridicule ? Mais non, son regard aperçoit tous les visages, tendus vers le même effort, dans une même attention.
Et son chant monte à l’unisson, emportant toutes les souillures de son âme.
Mais le Prêtre sait comment il faut parler, comment il faut agir. Et l’office terminé, il entonne à pleine voix des refrains populaires.
Et les grands gosses, amusés, reprennent en chœur :
Dans la nuit, sous un ciel étoilé, les hommes rentrent meilleurs. Leurs pas sonnent plus hardiment sur la route, cette route qu’ils construisent eux-mêmes, et qui demain ira, comme eux, vers l’avenir, vers l’inconnu.
Une à une, les lampes s’éteignent. Dans l’ombre, une bête s’ébroue.
Dans la hutte, une lueur. Dieu veille sur le salut des hommes.
Au matin, les gars s’en vont, l’outil sur l’épaule, les mules font tinter leurs grelots, les ânes aux pattes grêles trottinent, les bœufs tirent de lourds chariots bâchés. Une jument rue, un cheval piaffe.
Il y a des cris, des appels et des rires.
Tous saluent la Robe-noire, debout sur le seuil de sa porte.
Pour chacun, le prêtre a un mot, il les reconnaît tous. Ce gamin aux yeux rieurs, c’est Sylvestre L’Heureux, un Canadien français de Saint-Hyacinthe.
— Buenos dios, padre.
Celui-ci, au teint couleur d’olive, c’est Rodriguez, un Espagnol qui prouve que le Maure occupa les Espagnes.
Goodtag, c’est Johan Johnson, un Islandais de Reykiavik.
— Bonjour, Patrick, gare au brandy !
Et l’Irlandais lève la main pour perpétuer son serment : serment d’ivrogne ? Peut-être… mais le Père est si indulgent.
Ils vont, pour une piastre et demie, faire sauter les rochers qui ferment l’horizon, combler les ravins, assécher les marécages et les lacs, ils vont œuvrer dans l’eau, dans le froid, dans la neige ou dans le soleil.
Les pics sonnent sur cette terre qu’ils ouvrent au progrès des hommes et le long de la voie monte la chanson énorme du travail.
— Bonjour, bonjour, mes enfants.
Le camp est vide, dans les baraquements des femmes préparent du café.
Des Sauteux timides arrivent avec des couffes pleines de poissons.
Ils sont vêtus, déjà ! de défroques civilisées ; dans les manches du veston, leurs mouvements sont moins souples, leurs gestes malhabiles. Oh ! les hilares couvre-chefs !
Et le Père Lacombe voit, dans un tourbillon de poussière qui les suit, les hommes en marche vers l’avenir.
Ceux qui sont là devant ses yeux, c’est tout le passé, la gloire d’être libre, la fierté d’être soi. Une tristesse courbe son âme. Qu’est-ce qui est mieux ? Ceux-ci ou ceux-là ?
Pour ces derniers, il a peiné, il a souffert mille misères, Sauteux, Gens du Sang, Cris de la plaine ou des bois, ils ont accepté la parole divine.
Et la civilisation s’est abattue sur eux comme un vol de sauterelles. La transition ne sera-t-elle pas trop forte ? Comment la supporteront-ils ?
Déjà l’alcool et les maux inconnus vont en croupe des trafiquants.
Autour des clochers, à l’ombre de la Croix, des villages se sont établis. La moisson des âmes a mûri malgré les bourrasques et malgré la tempête.
Mais la marée monte de l’immigration : Ruthènes, Galiciens, Irlandais, Petits Russiens, Piémontais et Lombards, tout ce qui souffre dans les bas quartiers de Rome, de Londres, de Paris, dans les ghettos de Pologne, de Hollande, ou d’Autriche, tout ce qui aspire à la lumière, à l’air pur, traverse l’Océan.
Ils avancent vers les plaines du Manitoba, de la Saskatchewan, ils arrivent, ils sont là.
Les ministres protestants ne craignant plus d’être scalpés les suivent ; ils ont de l’or, des présents, une morale plus souple et plus facile.
— Que va devenir votre peuple, Seigneur ?
La lune affamée[24] roule toutes les nuits dans le ciel morne et le bison a disparu.
[24] Epoque à laquelle disparaissent les bisons pour quelques semaines.
La dernière expédition, quelle tristesse, quel désastre !
Une chaleur torride, les orages qui balaient la Prairie, emportant tout sur leur passage. Hélas ! la Prairie est morte. Des cavaliers passent qui ont perdu la fierté de jadis ; dressés sur les étriers, ils fouillent du regard l’horizon, mais rien ne bouge, rien ne vit.
Autour des missions, à Saint-Albert, à Sainte-Anne, les sauvages se pressent, la faim les ravage.
Arsous kitsi parpi, l’homme-au-bon-cœur, que pourra-t-il pour eux ?
— Mon Dieu, rendez-moi mes sauvages, laissez-moi souffrir et mourir avec eux.
Et quittant les chantiers, le Père Lacombe reprend sa besace et son bâton de pèlerin. Il a cinquante-six ans, toute son énergie et toute sa jeunesse. Mais il ne reconnaît pas sa route. Dans le district de Castor, sur la colline, le Fort de traite a disparu, le Fort qu’il a sauvé au cours d’une nuit mémorable de l’assaut des Pieds-Noirs[25]. Il y a une rue, des maisons, des marchands ; le fil du télégraphe court de poste en poste.
[25] Janvier 1870.
La Robe-noire est revenue. Kamiyo-atchakwé, l’homme-à-la-belle-âme ! Et de toutes parts les Indiens accourent, ils lui baisent la main avec des larmes dans les yeux.
— Père, le buffle a disparu, et plusieurs de notre nation sont morts de faim ! Toi, qui nous a toujours aimés, prends pitié de notre détresse.
Les sauvages sont désormais parqués dans une réserve, ils ne sont plus libres, ils vont s’anémier, ils vont mourir.
Tout change, tout se transforme.
Plus au sud, aux confluents des rivières de l’Arc et du Coude, Calgary se dresse orgueilleuse. Mais là-bas, au pied des Monts-Rocheux, les Pieds-Noirs attendent, maîtres de l’heure qu’ils ont choisie.
Ils guettent la Bête monstrueuse qui mange du feu et crache de la fumée. Ils la guettent et ils l’abattront. Les anciens exaltent déjà le courage des jeunes hommes et ceux-ci ont hâte de montrer qu’ils sont aussi des guerriers valeureux.
Les ouvriers ont conduit le rail jusqu’aux portes du territoire, ils vont franchir le gué de la rivière de l’Arc. Ils sont insouciants et gais. Ils chantent et la mort est en embuscade.
— Les sauvages ! Ils peuvent venir, on les recevra !
Au chant des blancs répond le chant de guerre, toute la nation est debout, et Pied-de-Corbeau est son chef.
Tout a échoué auprès des Pieds-Noirs. Le désarroi est complet dans les sphères gouvernementales, on s’attend aux pires événements. C’est alors que les hauts fonctionnaires de la Compagnie du Canadian Pacific, connaissant le prestige et la grandeur de l’apostolat du Père Lacombe, le supplient d’intervenir. Il accepte, il part, il arrive porteur des présents d’amitié, mais un présent n’est rien à côté de son cœur qu’il apporte.
— Maintenant que j’ai la bouche ouverte[26], je vous prie de m’écouter. S’il y a quelqu’un parmi vous qui puisse dire que je lui ai donné un mauvais conseil, que celui-là se lève et parle sans crainte.
[26] Pour pouvoir prendre la parole dans une assemblée indienne on doit faire un présent.
Personne n’a bougé.
Alors la Robe-noire poursuit :
— Eh bien ! mes amis, j’ai un conseil à vous donner, aujourd’hui ; laissez passer les blancs sur vos terres. Ces blancs ne sont que des travailleurs, ils obéissent à des chefs, c’est avec ces chefs qu’il faut traiter. Dans quelques jours, le gouverneur viendra lui-même, il entendra vos plaintes et, si l’arrangement qu’il vous proposera ne vous convient pas, il sera temps alors de garder vos terres et de les défendre.
Pied-de-Corbeau prend la parole et déclare :
— L’homme-de-la-prière a dit des choses sensées. Ecoutons-le[27].
[27] On donna aux Pieds-Noirs des terres plus au sud de leur réserve. C’est ainsi que le Père Lacombe, Oblat de Marie-Immaculée, en juin 1883, évita le massacre des blancs et gagna l’estime des directeurs du chemin de fer du Pacifique. Ceux-ci, par la suite, le reconnurent « pour un jour » directeur de l’Honorable Compagnie, ce qui lui valut une « passe » gratuite sur tous les trains, passe « Father Lacombe and secretary » qu’il donnait très généreusement à ses collaborateurs, lui-même voyageait « sur sa mine ». Ce qui fit un jour un étrange quiproquo.
La Supérieure des Sœurs Grises, accompagnée d’une jeune converse, se rendait à Edmonton munie de la fameuse passe ; arrive un contrôleur. On lui montre la carte. L’homme, suffoqué, demande :
— Well ! Who is Father Lacombe ?
La Supérieure répond :
— I suppose it ought to be me.
— All right, sisters.
Et maintenant, de l’Océan à l’Océan, sur le rail qui luit, la Bête humaine passe, amenant la prospérité et la vie. Les ranchs succèdent aux ranchs, les villes aux villes. Le train roule au milieu des épis sous le soleil de Messidor.
Les clochers grêles dans un ciel opalin attestent l’effort des serviteurs de Dieu, des précurseurs, de ceux qui ont montré la route.
Quelques totems sont les témoins des races disparues. Aujourd’hui dévore hier. Le Passé ? Des crânes de bisons blanchis dans la Prairie et quelques chaussées de castors.
— Freddy, mon garçon, vous êtes bien le plus insupportable Français de France que je connaisse, et Dieu sait si j’en ai rencontré, au cours de ma vie, des Français.
Quand vous aurez fini de courir le cali-mailla avec ce chien ?
Un chien, d’abord, ça doit coucher sur la dure et non dans une maison d’chrétien.
— Sulpice La Berge, mon ami, vous êtes un sans-cœur. Si vous vouliez lever votre honorable personne, vous constateriez que le thermomètre marque 33° sous zéro et que la sagesse des nations proclame qu’il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors.
— Oh ! J’sais ben, avecque vous on n’a jamais le dernier. Enfin, je préfère vous voir faire l’chicoteux que d’vous voir avec des chimères.
Et, renfrogné, Sulpice La Berge, Canadien de Montréal, en-dessus de Québec, tire sa pipe et ne dit plus mot.
Le chien heureux de sentir mes doigts lui gratter le crâne, s’est couché à mes pieds, devant le feu. Il étend ses pattes et dort, le museau allongé.
J’ai raconté ailleurs[28] mes randonnées et ma vie au cœur de la Forêt nordique, vie dure et saine dont je garde le souvenir parmi les souvenirs de ma jeunesse errante.
[28] La Bête errante, le Grand Silence blanc, 2 volumes. Ferenczi, éditeurs.
Sulpice La Berge et Gregory Land ! Fidèles compagnons, amis sincères ; mes courses de Dawson à Eagle, de Circle-City au placer de Last-Chance. La descente du Yukon, la Porcupine et la rivière Plumée où j’ai failli mourir ; les Barren Grounds, les terres désolées et le delta du Mackenzie : les chiens courent sur la piste, un halo monte dans la transparence du ciel, ses hachures descendent comme une pluie de feu, flammes rouges et vertes, dans une circonférence se forme une croix.
La croix de mort qui veille sur les champs de l’éternel repos ? ou la croix d’espérance qui mène les hommes vers Dieu ?
Faut-il renoncer ?
Faut-il croire ?
J’ai posé l’interrogation à mon âme civilisée. Cette âme qui était si fière d’un peu de science amassée, qui se croyait « pas comme les autres » et souvent « plus que les autres ».
Dans la faim dévorante de savoir, dans la folie de ses vingt ans, elle était allée aux extrêmes, hurlant avec les loups.
Quelle misère !
Mais dans les solitudes du grand silence blanc, j’ai senti peser sur moi l’angoisse du problème à résoudre. Et, dans ma détresse, devant l’immensité qui m’entourait, seul à seul avec Dieu, j’ai retrouvé ma route.
Je suis sorti meilleur, exalté de l’épreuve et si je suis revenu dans le tumulte des villes, j’ai du moins la paix religieuse du cœur.
Magie des aurores boréales, longues nuits polaires, secondes où ma vie coulait peu à peu, misère, dénûment, privations, j’ai tout connu sans jamais regretter.
Je vous ai rencontrés, hommes-de-la-prière, sur les pistes glacées, souffrant de notre souffrance, pleurant sur nos péchés.
Et c’est depuis que je vous aime, Mgr Grouard, Mgr Breynat, Père Falher, Père Lefèbre, Père Moulin, Père Pétour, Père Blanchin, tous ceux, tous ceux, tous ceux qui ont sacrifié les forces vives qui les animaient pour le salut des mauvais garçons que nous sommes.
Depuis lors ? Non, après, bien après. La germination a été lente, l’assimilation longue, l’élaboration secrète.
Lentement, le grain de sénevé est sorti de sa gangue. Ce fut longtemps une tige fragile avant d’être un épi.
Il me souvient, j’entends la voix de mon ami :
— Freddy, mon garçon, vous êtes bien le plus insupportable Français de France que je connaisse…
J’ai joué avec mon chien. Mon chien dort. Sulpice La Berge fume sa pipe et crache.
Puis sa pipe meurt, il la tapote sur le talon de son mocassin, la fourre dans sa poche et dit :
— Du reste, les Français de France, c’est tous des drôles d’corps, turluro-turlurette, ça piaille comme de la volaille et ça crie à la liberté, la liberté pour soi mais pas la liberté des autres. Déplante-toi de là que je m’y mette. Ça veut crâner même avec le Bon Dieu. Ça naît, pour le moins, socialiss’ et révolutionnaire, mais dès que ça a quatre ans, ça joue au soldat. Ça trépigne : « Je veux de la poudre et des balles… »
Je souris :
— Permettez, Sulpice, notre civilisation…
Le grand mot est lâché qui fait bondir mon homme.
— Vot’ civilisation, du propre, hein ! parlons-en !
A ce moment, la porte s’ouvre, une ombre entre à tâtons : c’est Layellé, le vieil aveugle Peau-de-lièvre.
Il va s’asseoir auprès du poêle et tire son chapelet.
Sulpice La Berge poursuit :
— Vot’ civilisation, plus de Bon Dieu, plus rien de rien, des bêtes et pis.
On ne croit plus à saint Joseph ni à saint Antoine, mais le trèfle à quatre, ça c’est sûr et certain, et les couteaux en croix et le treize et le vendredi qu’je te dis, demain vous adorerez un âne, yes, sir, un âne.
Sulpice s’est oublié jusqu’à parler anglais, sa colère est au paroxysme.
Il sort sa pipe, la bourre du pouce, prend un tison, tire trois bouffées et demande :
— Voyons, quoi qu’elle a fait, vot’ civilisation ?
— Mais, Sulpice, l’électricité, le radium, les automobiles ?
— A quoi qu’ça sert d’avoir des « chars » ? On arrive toujours au but. Ma chandelle me suffit pour voir les lettres de mon Evangile, et vot’ radiquoi, radico, radi, que les cinq cent mille diables l’emportent : j’sais-t’y ce que c’est, moi, et d’abord à quoi qu’ça sert ?
Sous sa grosse malice, je sais, parbleu, qu’il a raison et notre pauvre humanité n’est ni meilleure ni pire, — pire peut-être, puisqu’elle se crée sans cesse de nouveaux besoins.
Des progrès techniques, certes, mais des progrès moraux ? Oserai-je soutenir à Sulpice La Berge, Canadien français, que sur la machine ronde nous en ayons accompli un ?
Et la dispute dure des heures. Soudain, Layellé parle, Layellé dont nous avions oublié la présence auprès du poêle.
— Depuis le jour où le Fils a aperçu la petite île[29], et où il a dit en chantant — les Peaux-de-lièvres ont conservé ce chant :
[29] La terre, que les Indiens croient une île ronde.
« O mon Père, assis en haut, allume donc le Feu céleste car les hommes sont malheureux.
« Le Grand Esprit a donné le Feu, mais les hommes n’ont pas eu le bonheur.
« Ils n’auront jamais le bonheur.
« Ils sont tous pareils au corbeau.
« Au temps où l’homme parlait comme le chien, le corbeau était le plus bel oiseau qui jamais ait volé dans le ciel. Il avait la plus belle voix et son chant charmait la terre.
« Mais l’orgueil lui vint de ses plumes et de sa voix.
« Il disait partout : « Je suis le plus beau des oiseaux. » Et cela irrita, à juste raison, les autres oiseaux : la gelinotte, l’alouette, le linot, la buse, le faucon et le grand aigle qui vit au creux des monts. Et comme le corbeau chantait, ils se précipitèrent sur lui, le prirent par le cou et, le tenant ainsi, ils le plongèrent dans le charbon.
« Le corbeau se débattait, il essayait de crier, mais sa gorge était trop serrée.
« Enfin, ils le lâchèrent et le corbeau, traînant ses ailes, regagna son nid, sur le haut d’un peuplier, mais, depuis ce jour, il est tout noir et sa voix ne pouvant sortir, il fait « croa, croa, croa ».
Et Layellé s’arrête de parler.
Doucement, un à un, les grains glissent sous ses doigts.
Le vieil aveugle indien prie pour le salut des âmes.
Le blizzard s’est levé, balayant le lac et la plaine et heurtant la maison. La maison ? Une hutte de bois, recouverte d’écorce, surmontée d’une croix. Une lanière de cuir ferme et ouvre le loquet.
Sous la porte, la bise siffle. Le thermomètre marque 40 sous zéro.
Autour de la « mission », quelques loges sauvages. On n’entend pas un bruit : hommes, femmes, enfants, vieillards, se sont terrés.
La Robe-noire est seule en cette solitude. Depuis trois ans, elle vit dans cette pauvreté. Depuis trois ans, l’homme de la prière n’a rien reçu. Le steamboat qui portait à York le ravitaillement a fait naufrage. Il faut compter sur soi si l’on veut vivre.
Et c’est la pêche sous la glace, la visite des filets et des lignes, la capture problématique de la loche ou de la truite grise.
En dix jours, soixante-dix hameçons ont rapporté quatre poissons.
Mon Dieu ! Mon Dieu ! quelle misère !
Etre tout seul, tout seul, sans espoir, sans ami. Une angoisse l’étreint. S’il allait mourir là !
Sa main passe devant ses yeux et retombe accablée. Les doigts ont rencontré la croix, sa croix d’Oblat, sa croix de missionnaire.
Et le courage lui revient.
N’a-t-il pas accepté ce long et lent martyre ? N’a-t-il pas lui-même choisi cette vie pénitente, cette vie humiliante ?
La souffrance est son apanage mais il a la consolation de la foi.
Oui, mais là-bas, par delà l’Océan, c’est le séminaire ensoleillé, les bons maîtres, les condisciples. Une route s’offre à lui ; la vie paisible dans la campagne, le village assoupi dans la ceinture verte des vignes, la garrigue odorante où les troupeaux s’en vont, tintillants de clochettes, la ligne bleue de la mer et les voiles blanches à l’horizon.
Des ouailles paisibles, une église coquette, une cure ombreuse, le bréviaire est lu ; à l’abri de la treille, des abeilles font une ronde autour des grappes, un grillon chante dans l’herbe drue, la bonne herbe parfumée où les bêtes à bon Dieu processionnent. Le vin est frais, la chère savoureuse, les cuivres étincellent, dans la cuisine voûtée où la servante s’active.
L’Angelus ! Déjà ? Je vous remercie des grâces de ce jour.
— Pourquoi me tentez-vous, Seigneur ?
La porte s’ouvre sous un coup plus violent, la bourrasque entre qui chasse la vision. La réalité est là qui s’impose.
Personne ne verra sa douleur ni sa joie. Pauvre joie, douleur si grande d’être seul.
Il a la sensation certaine d’une présence autour de lui. Quelqu’un est là qui rôde. La chandelle de suif agrandit les ombres, une flamme plus haute met une lueur sur les pieds saignants du Christ, la flamme monte encore, elle éclaire le flanc troué par le fer de la lance, et maintenant voici la belle face résignée.
Jésus en croix a posé ses yeux calmes sur son fils malheureux. Les lèvres bougent. Il va parler, il parle :
— Venez dans la solitude et reposez-vous un peu.
C’est la parole qu’il disait aux apôtres, à ceux dont il avait marqué d’avance le destin.
— Pardon, Seigneur, d’avoir douté.
Un pitoyable sourire anime le visage où les épines pleurent des larmes de sang.
— Pierre a douté et moi-même n’ai-je pas voulu éprouver l’abandon de mon Père ?
Alors, l’homme-de-la-prière tombe à genoux, remerciant Dieu de la part qui lui est faite.
Il est seul, oui, mais la présence du Maître anime sa solitude.
C’est le blizzard qui hurle ? Non, ce sont les démons déchaînés, furieux de voir, debout devant la porte, un bel archange protecteur.
O solitude, paix inaltérable du cœur. Il a exclu à jamais les biens de la terre. S’il le fallait, à nouveau, il dirait :
— Ecce ego, mitte me. Me voici, envoyez-moi.
Il sort purifié de son angoisse, son sacrifice n’est pas accompli. Il n’est rien par lui-même qu’un pauvre être souffrant dans sa chair misérable, mais l’esprit de la Toute Puissance, le Paraclet le dirige, il est la manifestation de Dieu.
La bonté, la charité, sont les sœurs jumelles, nées de la douleur, douleur, source de l’héroïsme. Qui n’a pas souffert ne peut se pencher sur la souffrance des autres.
Et la Robe-noire accepte son destin. Lui, comme les autres, comme tant d’autres, il a souffert, il souffre, il souffrira : la vermine, le froid, la faim, l’affreux isolement.
Il use sa force dans un labeur sans gloire, dans l’obscurité et dans l’abjection.
Cette mission, Seigneur, vous la lui avez donnée. Dans elle, il a mis tout son cœur.
[30] Nuit du 14 au 15 décembre 1863.
Notre-Dame de la Providence, par 61°20 de latitude nord, sur la rive droite du Mackenzie, Naotcha, le fleuve géant.
La croix de Mgr Grandin étend ses bras sur la solitude des terres désolées.
Aurore de la divine moisson. Là, le Père Grollier rencontre pour la première fois la tribu des Esclaves refoulée par les guerriers du Sud[31].
[31] 14 août 1858.
Puis Mgr Grandin arrive ; sur la falaise dominant le tumulte des eaux, il dresse une tente de toile, seule richesse de cette pauvreté.
De ses efforts une église naît. Lui-même, n’ayant pas de truelle, prend de la boue à pleines mains, la pétrit et la lance avec force contre le mur.
Et le palais épiscopal s’élève. Il a vingt-deux pieds carrés, pas de plancher et pas de porte, ni lit, ni chaise ; la course des étoiles dit la marche du temps.
Pas d’outils pour travailler, pas de papier pour écrire, on mange quand on a faim, ce que l’on a : un corbeau, deux belettes, un vieux chien… Un lumignon qui flotte dans l’huile de poisson, met une lueur fumeuse dans la nuit.
Longue lutte de tous les jours, de toutes les heures. C’est la misère du Christ, sa nudité et sa souffrance.
Les Esclaves méprisent cet évêque en haillons — ils s’éloignent. Mais le « grand-chef-de-la-prière » saute dans un canot en écorce, les poursuit, les rejoint, les harangue :
— Je viens de la part de Dieu pour vous enseigner le chemin du ciel. J’ai appris combien vous êtes malheureux dans cette vie si courte, et je voudrais, au moins, que vous soyez heureux dans une vie qui ne finira pas.
Pour vous, j’ai quitté la maison de mon père.
Voyez mes mains ! elles sont crevées d’ampoules, durcies par le travail ; je bâtis pour vous la maison de Dieu et vous me laissez seul. Vous aussi, vous mourrez et vous rendrez compte à Dieu de votre mauvaise vie, et du mépris que vous avez eu pour son envoyé.
Ah ! vous vous plaignez que je ne vous donne pas de tabac. Vous irez fumer avec les mauvais esprits, malheur que j’aurais voulu vous éviter.
Alors un vieillard de la tribu se lève et dit :
— Père, ne juge pas nos cœurs par nos paroles. Nous sommes des enfants et nous parlons comme des enfants.
Nous ne te connaissons pas. Quand on nous a parlé de toi, nous supposions que, comme les autres blancs, tu désirais les peaux des animaux que nous tuons et qu’en retour tu nous donnerais du tabac et les autres choses des blancs.
Les autres blancs viennent à nous comme les maringouins. Un maringouin arrive, suce le sang, puis s’en va. Voilà ce que font les étrangers qui viennent dans notre pays. Ils nous arrachent ce que nous avons et ensuite on ne les revoit plus, mais toi, nous voyons maintenant ce que tu es et nous allons te suivre.
Et le retour fut grand et la moisson fut belle.
L’ardent apôtre, évêque de Satala à 28 ans, — in partibus infidelium — dont l’âme use le corps — parcourt le pays blanc. De la rivière au Sel au lac Caribou, de la Saskatchewan au Mackenzie, il évangélise les Pieds-Noirs et les Cris, les Esclaves et les Plats-côtés-de-chiens.
Pouilleux, hâve, chétif, harassé, il va, les yeux saignant du mal des neiges, les genoux brisés par le mal des raquettes.
Un évêque, cet errant vêtu de peau de renne, casqué de castor ? Dans des moufles en cuir d’ours, les mains sont enfouies, les pauvres mains épiscopales et consacrées, et voici, pendu à son cou, l’anneau d’améthyste, à sa ceinture, passée comme une épée, sa croix d’Oblat.
Aujourd’hui, la malédiction est plus lourde, la détresse plus grande. « Mon père, mon père, pourquoi m’avez-vous abandonné ? » Auprès d’un bordillon de glace, les chiens fourbus hurlent de froid, la traîne est brisée… et l’évêque, résigné, attend. Déjà dans le ciel la ronde tournoie des corbeaux, annonciateurs funèbres. Le cercle diminue, les bêtes de proie vont foncer, mais l’homme s’est dressé, déguenillé, sublime ; à son aspect, la mort recule, épouvantée.
Sa crosse est un bâton de pèlerin, son but le rachat des hommes.
— O douleur ! s’écrie-t-il, dans l’immense pays qui m’est confié, il ne se perd pas une peau de bête et des âmes qui ont coûté le sang de Jésus-Christ se perdent tous les jours. Et j’hésiterais à me sacrifier, moi ? Absit.
Il va.
A Fort Résolution, à gauche du delta de la rivière des Esclaves, sur la rive sud du Grand Lac, que vingt-cinq cours d’eau alimentent, les Tratsan-Ottiné, les Gens du Cuivre attendent, les Couteaux-jaunes issus, dit la légende, du premier homme et d’une gelinotte métamorphosée en femme.
Il fait mauvais, le temps est incertain, la neige est dure. Qu’importe à Mgr Grandin !
De Notre-Dame de la Providence à la mission Saint-Joseph, il faut traverser le grand lac des Esclaves. Du reste, une petite caravane doit partir. Il la suivra.
Mais les démons furieux soulèvent la tempête, la neige tourbillonne, cachant le ciel, cachant la terre. Le blizzard s’élève, balayant la surface du lac qui est polie et glissante comme un miroir, effaçant toute empreinte, pas des hommes, griffes des chiens, sillons des traînes.
Ses compagnons — deux Anglais — happés par le brouillard, ont disparu.
L’évêque est seul avec un enfant de onze ans[32].
[32] Un métis : Baptiste Pépin.
D’après la rude loi du Nord, quiconque tombe, meurt. Il faut marcher ; on marche pendant des heures et la nuit vient, la nuit qui prend, la nuit qui enveloppe, la nuit qui tue.
Des appels montent qui se perdent dans la hurlée de l’ouragan. Les chiens vont à leur gré, mais le Kamasan[33] souffle du large, les bêtes ne sentent pas la terre… L’enfant chancelle que l’homme vacillant soutient.
[33] Vent d’est.
O nuit terrible, nuit mémorable, symphonie blanche et noire où passent deux fantômes errants.
— Monseigneur, je ne puis plus aller.
— Avance encore, courage.
— Il me semble que je suis trop petit pour mourir.
Les mains du pauvret s’agrippent aux bras de l’évêque. Les deux ombres ne sont plus qu’une ombre qui titube et qui tombe.
Il va falloir agoniser ici. Des mots montent à leurs lèvres. Ils balbutient des paroles sacrées :
« Vierge glorieuse et bénie, délivrez-nous de tous les dangers… »
Après le Sub tuum, c’est l’oraison à l’ange gardien :
« Vous que Dieu a chargé de ma conduite… qui me soutenez dans mes découragements… gardez-moi… guidez-moi.
« Bon ange, mon conseiller ; bon ange, mon défenseur, mon ami, mon consolateur, mon frère, mon maître, mon aide, mon gardien vigilant, mon guide, ma lumière. »
L’évêque prie et l’enfant répond au milieu de ses larmes :
— Protégez-moi et soyez toujours auprès de moi. Secourez-moi, dirigez-moi, éclairez-moi.
Il pleure et les larmes se mêlent aux franges de ses cils.
Les chiens, l’évêque, le garçonnet, s’obstinent à vivre, battus par les vents et fouettés par la neige.
— Père, écoutez mes péchés !
Spectacle prodigieux, vision unique, cet évêque, ce petit, ces paroles chuchotées… péchés d’enfant, que pesiez-vous au souffle des tempêtes ? Monseigneur a levé sa dextre secourable… une grande paix est descendue.
Paix déjà surnaturelle des souffrances terminées, paix du devoir accompli, paix du tombeau.
Le froid gagne, les bêtes hurlent à la camarde qui rôde. Vite, vite, levons-nous… marchons encore, marchons toujours ; marcher, c’est vivre.
Et la ronde recommence. Cinglés, aveuglés, éperdus, c’est la fuite devant la mort.
Dieu soit loué ! un trou de neige. Monseigneur y descend son jeune compagnon.
— Ici, les chiens, là, couchez, couchez-vous. Il fait bon, petit ?
— Oui.
— Ne t’endors pas, au moins !
— Je… ne… dors… pas…
Ne pas dormir ! Toute pensée se tend vers cet acte, mais l’âme hallucinée de l’homme fait surgir du passé une vision précise.
C’est là-bas, plus au sud, dans la Nouvelle-France, les premiers colons défrichent la terre généreuse, le missionnaire est déjà là, un de ces admirables jésuites qui aspirent à « mourir sur le champ de bataille ».
Non loin du Fort Richelieu, deux soldats, un Huron, suivent la piste du Père de Nouë, mais ils souffrent de marcher les pieds bridés.
— Je vais au Fort, attendez-moi, on va vous secourir.
Le Père part, sans boussole, sans provision, la neige tombe, la poudrerie fait rage ; dans la forêt, il cherche en vain une trace, il s’égare.
Pendant des heures, il erre, le froid, la fatigue et la faim le tenaillent, puis le brisent.
Deux jours après, on le retrouve, gelé à bloc « en la posture où l’on dépeint ordinairement saint François-Xavier, les bras croisés sur la poitrine, les yeux ouverts et fixés sur le ciel, ressemblant à un homme qui est en contemplation plutôt qu’à un mort[34]. »
[34] Lettre de Marie de l’Incarnation, 10 septembre 1646.
Sur une route pareille, Mgr de Satala aura-t-il une pareille destinée ?
A travers les siècles, les faits se confirmeront-ils ? Décembre 1863 renouvellera-t-il janvier 1646 ?
La neige qui n’a pu clore le regard mort du jésuite ensevelira-t-elle l’Oblat de Marie-Immaculée ?
Lutte inouïe, deux blancheurs qui s’opposent. Vierge, ouvrez votre manteau blanc, ayez pitié de votre serviteur, ayez pitié de ce petit enfant !
Dans un souffle, on entend :
— Je… ne… dors… pas.
Les mots brouillent la vision qui passe.
Tenir cette âme éveillée, c’est la sauver de la mort et Mgr Grandin cherche dans sa mémoire les plus belles histoires du monde, fils légers dont on a brodé l’aube de la vie, pour bercer les petits des hommes.
Mais les légendes sont monotones, l’enfant va s’endormir. Alors, dans une inspiration, l’évêque chante :
Mais le cœur lui fend, il éclate en sanglots. Les larmes arrêtent la chanson, le gel arrête les larmes.
Soudain, l’enfant se dresse :
— Monseigneur, je sens le feu !
Le feu ! le pauvret divague.
Mais non. Le vent s’est calmé, le jour va poindre. Ce trait noir, là-bas, c’est la terre.
— Mon fils, nous sommes sauvés.
Les pieds sont tellement engourdis qu’il est impossible de chausser les raquettes… Enfin, ils sont debout. Miracle, ils peuvent marcher, mais ce boqueteau de sapins, mon Dieu, comme il est loin. Jamais ils ne pourront l’atteindre !
— Monseigneur, un traîneau, deux traîneaux… oui, là !
… Dans la bourrasque de neige, brandissant des tisons enflammés, poussant de grandes clameurs, des hommes ont passé la nuit à la recherche des malheureux. Puis il a fallu prendre le chemin du retour avec l’absolue conviction de la mort des errants.
Ils auraient dû mourir, ils ne moururent point, ils auraient dû se geler « jusqu’au cœur », disent les Couteaux-jaunes, mais les cœurs sont vaillants… L’homme et l’enfant ont vécu l’horrible cauchemar de leur nuit à moins d’un quart d’heure de la Mission Saint-Joseph… de cette mission où ils arrivent un matin, au moment même où les Pères Gascon et Petitot offrent le Saint Sacrifice de la messe pour le repos de leur âme immortelle.
— Non, non, n’entrez pas. Le Père dort.
Et le R. P. Seguin pousse doucement, vers la porte, les Peaux-de-lièvres assemblés.
Le Père va mourir ; de loge en loge, la nouvelle a couru et tous sont venus vers celui qui leur apporta la lumière.
Ils vont sortir, mais une voix faible s’élève :
— Laissez entrer mes enfants.
Les voici dans la chambre, hésitants et timides. Le Père, leur Père est là, sur un misérable grabat, étendu, émacié, livide et déjà hors la vie.
Hutte de Good Hope, faite de troncs d’arbres superposés, tout à tour chambre, cuisine, atelier, réfectoire, parloir, église où Dieu descend à l’appel du Prêtre, Dieu de Bethléem, Dieu de la pauvreté.
Celui qui gît sur ce lit de souffrance, c’est le meilleur d’entre tes fils. Ce Père Grollier admirable, qui a porté la croix du Sauveur, a mari usque ad mare.
C’est un bon ouvrier, sa journée est finie. O Seigneur, donnez-lui votre paix !
Les Peaux-de-lièvres sont à genoux. Ils prient.
Et la prunelle de l’apôtre s’illumine — cette œuvre est la sienne. Le premier, il a évangélisé ces hommes, le premier il a immolé l’Agneau sans tache aux dernières marches du monde.
A travers la membrane parcheminée qui sert de vitre, il aperçoit la grande croix que, hier, son confrère a plantée. Un sourire tend ses lèvres, on l’entend murmurer :
— Je suis content, je suis content, je meurs heureux maintenant que j’ai vu l’étendard de Notre-Seigneur élevé jusqu’aux extrémités de la terre.
Jadis, l’émir Okba, poussant son cheval dans les flots sur la côte marocaine, attestait Allah qu’il avait apporté sa puissance aux limites des régions connues.
Dans une même pensée, deux destinées s’affrontent, l’une faite de violence et de sang, l’autre de paix et d’amour.
Le conquérant porte son Dieu à la pointe du glaive, le sabot des chevaux heurte des crânes d’enfants qui s’ouvrent comme des grenades trop mûres. L’apôtre déchire ses pieds aux cailloux des chemins, il n’a qu’une arme : la parole et cette parole est de miel.
Good Hope ! Notre-Dame de Bonne Espérance !
Les Peaux-de-lièvres sortent, d’autres entrent, s’agenouillent et prient.
— Laissez, laissez, mon Père, ce sont mes enfants.
Oui, ses enfants, au sens absolu du mot. Il les a créés à la vie spirituelle, il les a disputés, un à un, au paganisme, à l’hérésie, pour eux il a souffert.
Ne l’a-t-on pas trouvé errant sur un lac, ayant mangé jusqu’à ses mocassins, passant et repassant sa main sur son visage d’un geste convulsif ?
N’a-t-il pas tendu ses pieds gelés, aux chairs livides, à la pince du métis Pierre Beaulieu ?
A chaque ongle arraché, le sang giclait, il offrait à Dieu sa souffrance.
A Mac Pherson, le commis du Fort de traite refuse de le recevoir ; il reste seul au bord de la rivière, du 28 juin au 4 août, proie des maringouins qui l’assaillent, mourant de faim près d’un logis abondamment pourvu.
Mais la foi le conduit. Da mihi animas ! Donnez-moi des âmes. Et ces âmes, il les recherche chez les Montagnais, les Mangeurs de Caribous, les Couteaux-jaunes, les Plats-côtés-de-chiens, les Esclaves, les Peaux-de-lièvres, et chez les Esquimaux.
Apre au combat, son ardeur l’emporte au delà des forces humaines. Maintenant son œuvre est accomplie, le mal qui le dévore ne lui pardonne pas. La toux déchire sa maigre poitrine.
Tous sont partis, il est seul désormais et sa main retombe accablée. Une douce sensation le ranime, quelqu’un est là, dans l’ombre… les doigts s’écartent et cherchent… c’est un chien. Un de ses compagnons de misère. Avec lui, il a connu les bordillons et les pistes glacées, les longues nuits polaires où ils ont dormi côte à côte.
Le bon vieux chien lève vers lui ses prunelles mouillées et l’apôtre se souvient alors qu’il est de Montpellier, la cité de saint Roch. Comme Roch, il s’est fait pèlerin sur la terre pour la cause de Dieu et le salut des âmes.
N’est-ce pas le 16 août 1858, le 16 août, fête de saint Roch, qu’il arrivait à Fort Simpson, cœur du Mackenzie ? Heureux présage, double destinée, harmonie d’une même vocation.
Là-bas, à des milliers de milles, par-dessus les terres, au delà des mers, la ville dort, écrasée de soleil, la ville de son enfance studieuse, la ville où le ciel bleu se fond à l’infini dans le bleu de la mer.
Le sang de la terre méridionale brûle ses veines et exalte son cœur. C’est de là-bas que sont partis les serviteurs de Marie.
Mgr de Mazenod savait que ses enfants, un jour, auraient besoin d’un rayon de soleil. C’est ce soleil qui illumine leur âme et réchauffe leur cœur aux soirs maudits où la nature est rebelle. Soleil de votre Foi, rayon de votre Amour, Seigneur !
Mgr de Mazenod, qui l’ordonna prêtre, l’offrit à Mgr Taché comme le « présent de son cœur », mais à trente-huit ans il termine sa course, il est fourbu, il est brisé, il va mourir :
— Prenez-moi, mon Dieu, je ne suis plus bon à rien sur cette terre. Tous mes désirs maintenant sont du côté du ciel. Toujours vous voir, divine Eucharistie, vous aimer pendant l’Eternité.
Et l’aube arrive qui voit finir sa peine.
Maintenant, l’apôtre du cercle arctique dort du sommeil de la terre. Il repose, selon sa volonté, dans le cimetière de Good Hope, entre deux sauvages, le visage tourné vers la croix.
Mgr Clut, l’évêque de peine, passait.
Il parcourait la France, demandant, pour les missions du Mackenzie, des cœurs solides, des hommes forts.
Sur ses pas, la Foi se levait ; dans les champs de la Gaule, il glanait les serviteurs de Dieu.
— Laisse là tes filets, va. Je ferai de toi un pêcheur d’hommes.
Et le grand apôtre avait suivi Jésus de Nazareth.
Fidèle à sa mission, Mgr d’Arindèle marchait sur les traces de Simon qu’on appelle Pierre.
Pour bâtir la maison du Seigneur aux extrémités de la terre, il avait besoin de robustes ouvriers.
Pour évangéliser les pauvres, il lui fallait des âmes vaillantes.
C’est en France qu’il était venu les chercher.
Dans le pays d’Armor, aux landes de Bretagne, où le parfum des genêts s’envole avec la voix des cloches, la moisson est toujours abondante.
Mgr Clut passait, l’abbé Lecorre se leva et partit.
Aujourd’hui, dans l’église de la Providence — sœur en misère de Bethléem — l’abbé Lecorre attend. Il a passé la nuit dans la prière et dans l’angoisse, demandant à la Conquérante des Incrédules s’il est digne d’être son serviteur.
Dans le grenier qui sert de chambre, où Mgr Grandin et Mgr Grouard ont couché, à genoux, au pied du crucifix, il s’humilie.
L’aube enfin se lève, aube blême et froide, d’un matin de septembre[35].
[35] 6 septembre 1876.
Le R. P. Petitot, en route pour Good Hope, est là pour l’assister.
— Venez, mon frère.
La pauvre église a pris un air de fête, il y a des guirlandes en papier et des petits drapeaux.
Mgr Clut officie.
Les Sœurs Grises et les orphelines chantent le cantique d’oblation :
Pauvreté, chasteté, obéissance, persévérance, ce sont les quatre vœux qui vont diriger sa vie.
Monseigneur a déposé le calice devant le tabernacle, maintenant, il s’agenouille sur le plus bas degré, puis il entonne :
Les apôtres racontaient en diverses langues les merveilles de Dieu.
Ceux qui sont courbés devant vous, Seigneur, dans cette misérable église, perdue sous le cercle polaire, sont des apôtres selon votre désir. Ils ont appris les dialectes les plus abandonnés pour pouvoir apporter votre parole aux plus déshérités de vos enfants.
L’abbé Lecorre demande au Paraclet l’inaltérable onction de l’âme.
Après l’Evangile, Monseigneur dépose le manipule et parle au récipiendaire.
Il le connaît, c’est lui qui l’a pris jeune sous-diacre du diocèse de Vannes pour le conduire aux lointaines missions. Il l’a ordonné prêtre. Il va le consacrer Oblat. Mais avant a-t-il bien réfléchi à l’acte qu’il va faire ? Est-il sûr de son cœur ? La grâce est-elle en lui ?
Et lorsque Monseigneur a communié, sous la conduite du Père Petitot, l’abbé Lecorre s’avance. Dans sa main droite, il tient un cierge allumé, symbole de sa foi ardente, dans sa main gauche, la formule d’oblation qu’il a écrite lui-même.
Alors, tandis que le célébrant élève la Sainte Hostie au-dessus du ciboire, lorsqu’il a prononcé pour la troisième fois : Domine non sum dignus, le jeune missionnaire récite la formule :
— Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de la Très Sainte Trinité, de la Bienheureuse Vierge Marie, de tous les anges et de tous les Saints, et de vous, mes Frères, ici réunis et devant vous, mon très Révérend Père, délégué par le Supérieur général des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie, qui me tenez la place de Dieu.
« Moi, Auguste Lecorre, fais profession, promets à Dieu et fais vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance perpétuelle. Je jure et fais pareillement vœu de persévérer jusqu’à la mort dans le Saint Institut et la Société des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et Immaculée Vierge Marie.
« Ainsi Dieu me soit en aide. Ainsi soit-il. »
Le Père Petitot dépose la formule sur l’autel.
La messe finie, Mgr Clut bénit la croix d’oblation et le scapulaire de l’Immaculée Conception, puis il donne au nouvel Oblat le livre des Règles en disant :
— Hoc fac et vives.
Devant le Saint Sacrement exposé, dans l’allégresse, les Sœurs Grises, les orphelines, les Indiens et les Métis chantent le Te Deum et le Tantum ergo.
Tandis que Monseigneur présente l’ostensoir — soleil de la Toute-Puissance — les assistants courbent la tête, et s’inclinent comme des épis sous le souffle du vent.
L’Esprit de Dieu passe, le Verbe divin a quitté la droite de son Père pour apporter à ses élus sa joie et sa consolation.
Et, la cérémonie terminée, Mgr Clut s’avance.
— Père, êtes-vous content ?
— Oh ! Monseigneur.
— Eh bien ! si vous voulez que ces enfants fêtent votre oblation, il faut venir avec moi.
Et les voici tous deux, menant les chiens, faisant 64 kilomètres en raquettes, par un froid atroce, pour aller pêcher, sous la glace, de quoi ne pas mourir de faim.
A la mission de la Providence, Sœurs Grises, vieillards, orphelins, orphelines, vivent au jour le jour.
L’histoire de la mission pourrait s’écrire avec des larmes.
Depuis que les Religieux ont bâti la maison, la famine est debout sur le seuil de la porte.
Parmi tous les errants de la terre nordique, c’est le plus passionné qui soit. C’est l’apôtre primitif qui n’épargne jamais sa peine. Il se donne au delà des limites humaines. Son sourire est sa force, son regard une bénédiction du ciel.
Il a ramené à Dieu des âmes égarées, il a fait se courber les fronts les plus hautains.
De l’Athabaska aux bouches du Mackenzie, il va, selon sa devise d’évêque : Peregrinari pro Christo, déjouant les embûches du Malin et faisant se lever sur la terre la plus rebelle, la moisson la plus riche.
Il est l’évêque qui, depuis 25 ans[36], n’a pas de résidence ou, plutôt, il porte sa résidence avec lui. Sa crosse est un bâton de pèlerin et sa besace est lourde de promesses de la vie éternelle.
[36] Mgr Breynat a été nommé évêque titulaire d’Adramyte et vicaire apostolique du Mackenzie, le 22 juillet 1901.
J’ai demandé :
— Où est Monseigneur ?
On m’a répondu :
— Monseigneur est en route… quelque part, là-haut, sur la rivière de l’Ours ; au Fort Bonne-Espérance peut-être, ou bien à la mission du Saint-Nom de Marie, passé le cercle arctique.
Seul Celui-qui-le-mène sait sur quelle misère il se penche, à quelle détresse il apporte la consolation de la Foi.
Dans le blizzard et la tempête, sous la magique splendeur des aurores boréales, il va. On l’appelle : The Bishop of the Wind. L’Evêque du Vent. Comme le vent, il passe sur les terres désolées, pleurant sur la souffrance des hommes, mais portant dans son vol l’espérance et l’amour. Comme le vent chasse à coups de fouet le troupeau des nuages, il chasse devant lui le paganisme et l’hérésie.
Comme le vent il est mobile, comme lui il gémit.
Dans la montée de son rude calvaire, il se souvient de son enfance joueuse au bord du Rhône. Le mistral souffle, et sa toute-puissance fait bouillonner les eaux, se courber la cime des platanes et tourner éperdument les coqs rouillés aux pointes des clochers. Et le grand ciel est une page bleue.
Pareil à Mgr Clut, à Mgr Pascal, Mgr Breynat vient du pays de la lumière. Comme eux, il est venu aux Oblats de Marie, comme eux il a souffert la faim, la solitude, et livré sa chair aux morsures du froid.
Il arrive sur la terre canadienne et l’épreuve l’attend au seuil de la mission qu’on lui a confiée. Le même courrier de France — le premier qu’il reçoit — lui annonce la mort de sa mère et la mort de sa sœur ; alors l’envoyé du Seigneur, se souvenant qu’il est un homme, laisse couler ses larmes.
Mais les Indiens sont là, la belle race montagnaise Etshen Eldeli (des Mangeurs de Caribous) et le chef parle :
— Homme-de-la-prière, maintenant que tu es orphelin, tu nous aimeras encore davantage, car nous serons ton père et ta mère. Arrête l’eau de tes yeux.
Et le Père Breynat, de la Mission de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, s’humilie devant la Reine Admirable dont le cœur saigne de sept plaies pantelantes :
« Debout, tout en larmes, près de la Croix où son Fils était cloué se tenait la mère de douleur… Stabat mater dolorosa. »
Elle n’entend pas les blasphèmes de la foule, elle ne voit pas les soldats jouant aux dés la robe de Jésus, elle entend le bruit sourd du marteau, elle voit les clous, le flanc ouvert, le sang qui coule…
L’Oblat, ayant prié, se relève meilleur. Une consolation l’accueille. Mgr Grouard lui envoie un message le priant de venir à la Nativité.
De Notre-Dame des Sept Douleurs à la mission de la Nativité, il faut franchir le lac Athabaska sur 280 kilomètres. C’est sa première traversée. On est en février. Depuis plusieurs jours le froid oscille entre 45 et 55 sous zéro. Comme équipage, il a trois chiens minables et comme guide un Indien de dix-huit ans, Paulazé.
Qu’importe au Père Breynat ! Il faut partir, il part.
Dès la première étape, le père sent une aiguille lui piquer le pied droit. On enlève mocassins et nippes de laine, le gros orteil paraît blanc et dur, on le dégèle avec une friction de neige.
Le jour suivant, l’Oblat et l’Indien se relayent, battant la piste, à la raquette, devant les chiens. Le soir, impossible de faire du feu ! Les chiens, dételés, hurlent de froid. Une ampoule s’est formée près du membre malade. Sous l’effort, elle crève, l’orteil se gèle à nouveau.
Paulazé essaye de le frictionner, mais ses mains s’engourdissent sous le froid. Les voyageurs font une tranchée dans la neige pour se protéger. Les heures coulent une à une, désespérantes ; avant l’aube, la piste est reprise. A la pointe Caribou, c’est la rencontre d’une loge d’Indiens, ceux-ci examinent le malade, hochent la tête. La plaie ne leur dit rien qui vaille. Il ne faut songer qu’à préserver le pied, avec des peaux de lièvres on établit un pansement.
Cinq jours le blessé va. Cinq jours, il court devant ses chiens, cinq jours, à chaque pas qu’il fait, il sent ses os craquer, comme broyés par un étau.
Au soir du septième jour, le Père et l’Indien arrivent à la pointe de Roche. Encore 60 kilomètres et la Mission de la Nativité apparaîtra.
Soixante kilomètres, une seule étape, oui, mais avec de bons chiens et des jambes valides. Hélas ! la poudrerie se lève dans les ténèbres de la nuit. Avec rage la bourrasque s’acharne, on ne voit rien à deux pas. Hommes et bêtes se terrent pendant deux jours.
Fantasque, la tempête s’est effacée, la misérable équipe reprend sa course errante, mais le père au premier pas tombe, il se relève, retombe encore. Impossible d’aller plus loin. Il gît sur la neige où sa robe met une tache noire. Il attend que son Destin s’accomplisse.
L’Indien se penche vers lui, il lui parle affectueusement, il le soulève avec d’infinies précautions, l’enveloppe avec des couvertures, lui fait un lit de branches de sapin et, s’attelant à la traîne, il tire avec les chiens.
Le voyage dure deux jours, deux jours d’angoisse, deux jours d’agonie.
A la Nativité, depuis de longues heures, Mgr Grouard est dans les larmes.
Des Indiens sont arrivés qui ont suivi la trace du Père et l’ont perdue. « Ils se sont gelés dans la poudrerie », annoncent-ils.
Les sauvages du Fort de traite battent le lac, en vain. Sous le linceul de neige quel lourd secret se cache ?
Les Sœurs Grises et les enfants supplient Dieu, mêlant les prières aux pleurs et le miracle se renouvelle.
Là-bas, une ombre vacille qui se meut lentement.
Ces chiens fourbus, cet homme qui peine, Seigneur, Seigneur, c’est la mort qui s’avance ! Mgr Grouard sent son cœur se glacer.
Hosannah ! sous les couvertures, la tête du jeune missionnaire paraît. Monseigneur crie : Deo gratias et, de glaçon en glaçon, il saute, il accourt, il est là.
Dans ses bras robustes, il porte le corps inanimé comme un père porte son enfant.
Et c’est le chaud réveil dans la quiétude de la mission. Monseigneur est debout au chevet du malade. Il a retrouvé son courage et sa joie.
L’orteil ? Ta, ta, ta, cent-trente-deux, ça ne sera rien. Il est gangrené ? Peuh ! un coup de rasoir. Remercions Dieu.
Monseigneur allume sa pipe, sa bonne pipe qu’il n’avait pas fumée depuis les jours d’angoisse.
— Frère Ancel, affûte ton couteau. Enlève-moi ça.
Ça, c’est l’orteil boursouflé, noir, gangrené.
Il n’y a ni chloroforme, ni cocaïne, on s’en passera. Père, du courage.
Du courage, le patient en a. Il dit simplement :
— Frère, faites vite, à la grâce de Dieu.
La lame glisse sur un tendon. Un cri, un long cri de douleur. C’est fait.
… Et depuis, le Père Breynat est devenu Mgr Breynat. Mgr Grouard, qui l’ordonna prêtre, l’a consacré évêque, et l’évêque a repris les courses errantes du missionnaire à travers un diocèse immense ; dans la désolation de l’hiver arctique, il va, de tribu en tribu, porteur de consolation. Les vents polaires soulèvent la neige en épais tourbillons, il se rit de la neige et se moque du vent, ou plutôt il s’identifie avec lui, il adapte sa force à sa volonté. Ils sont tous deux une manifestation divine que rien n’arrête, que rien ne plie.
L’Evêque du Vent descend le Mackenzie et aux dernières marches du monde, à Aklavik, il bâtit la maison du Seigneur.
Le sol où son pied mutilé se pose devient terre de Dieu.
— Machi Manitou, le mauvais esprit est sur nous.
« Nous espérions toujours que la Robe-noire viendrait nous apprendre la prière. Nous l’attendons chaque printemps. Nous avons vieilli, nos enfants sont devenus grands et nous ne savons pas encore prier ni chanter la prière.
« Alors, j’ai dit à mes fils, descendons vers la mer. »
Tel est le message que porte l’envoyé du chef des Naskapis de Petshikupan, dans la baie du Gros Homme[37].
[37] Tshé shats heu.
La tribu s’est mise en marche, à travers les bois, pour se rapprocher des hommes qui portent avec eux le salut.
Et les Pères Deléage et Pian suivent le messager.
La descente du Kepeskak est facile, mais bientôt la misère commence. C’est le portage dans les marais. Il faut s’arracher à une boue gluante, on s’enlise sous le poids du canot, des roseaux coupants meurtrissent les pieds. Chaque mètre est une douleur, chaque pas un supplice.
Enfin, voici la mer. Un sloop est là. On part. La voile s’incline doucement sous la brise et le soleil joue sur les flots ; le soir, le Fort d’Albany est en vue.
Mais, au réveil, le brouillard est venu, tissant sa brume entre le ciel et l’eau.
Trois jours passent. Calme plat.
Une éclaircie déchire le ciel. On va essayer de partir. Mais le bonheur est fugitif, le vent tombe, la neige descend à gros flocons. La mer blanchit et bientôt l’ouragan se déchaîne.
La voile est repliée, on jette l’ancre, vingt brasses, cinquante, soixante, quatre-vingts, le grondement de la chaîne s’arrête, elle se tend, elle casse.
Un cri :
— Mon Dieu, nous sommes perdus !
Et le navire est le jouet du vent.
Alors, les deux Pères remontent sur le pont. Deux hommes de l’équipage souffrent du mal de mer. Le Père Deléage et le Père Pian aident à la manœuvre.
La nuit vient, noire, horrible.
Où est-on ? Où va-t-on ? la seconde qui tombe est-elle la dernière ? Faut-il vivre ou perdre ici l’espoir ?
L’histoire se renouvelle des apôtres de Dieu au péril de la mer.
Ce navire qui danse sur la cime des flots, dans les passes nordiques, n’est-ce pas le navire qui porte Paul sur la mer latine ?
Des montagnes de Crète, le noroît est descendu. Treize jours, treize nuits, l’ouragan hurle, exigeant une proie. Les mâts craquent, les voiles sont arrachées, les lames balayent le pont, l’abîme ouvre sa gueule béante.
Les fanaux, secoués par les rafales, déplacent les ombres, grappes humaines attendant, résignées, la marque du Destin.
Ils sont deux cent soixante-seize, il n’y a plus d’eau, les vivres manquent, tous défaillent, les matelots se jugent perdus, les passagers grelottent de froid et de peur.
Au grondement du tonnerre, à la lueur des éclairs, Paul voit dans le ciel qui s’illumine la promesse du salut, le signe d’espérance.
Il va, ranimant tous les cœurs, sa voix domine le tumulte des flots.
— Pas un de vous ne perdra un cheveu de sa tête.
Il marche dans les ténèbres, exaltant les courages, clamant sa foi.
Dieu est avec lui, l’ange lui a fait don de ce troupeau.
— Pas un de vous ne périra. Les choses seront comme elles m’ont été dites. Une île est là, prochaine.
Et, dans le matin blême, une terre apparaît…
Oui, l’histoire est pareille et pareille est la destinée.
Sur la fragile embarcation, la tempête s’acharne, les Pères travaillent et prient.
Paul les protège et Pierre les dirige vers la voie du salut.
Mais dans la hurlée de l’ouragan une image prend corps.
N’est-ce pas ton visage, ô doux François-Xavier, apôtre infatigable, ouvrier obéissant du plus ingrat labeur ?
Les matelots blasphèment le nom de Dieu, le capitaine joue aux dés ses esclaves, mais la spirale du typhon s’avance. Les voici tous à genoux implorant le Seigneur.
François-Xavier est là, les anges, les patriarches, les apôtres, les saints, lui font un cortège de gloire.
Dans l’épouvante des gouffres entrevus, il apaise la démence des flots d’un signe de sa main.
Comme autrefois sur la mer des Moluques, pareilles à deux bêtes de l’Apocalypse, la mort et la vie s’étreignent, combat de titans, forces désespérées.
C’est un vaisseau fantôme qui passe sur les flots, caparaçonné de glace, dans le cauchemar d’une nuit qui ne finira pas.
L’aube vient cependant, et quelle aube ! La neige tombe, inlassable. Le brouillard est si dense qu’on ne voit que les vagues échevelées déferlant sur le pont.
La voix du Père Deléage implore :
— Mon Dieu, envoyez-nous un rayon de soleil.
Et Dieu exauce son serviteur. Un soleil laiteux paraît. C’est le salut ! Quelques minutes plus tard, et tout était perdu. Le sloop danse au milieu des brisants. La rivière Moose, au chenal étroit, est proche. Voici la bonne terre. Pour gagner la rive, on marche dans l’eau, elle est glacée, qu’importe ! La flamme claire d’un foyer ranime toutes les défaillances, on a chaud dans sa chair, on a chaud dans son âme. Le danger disparu, l’espoir tenace renaît au cœur des hommes. Et l’on s’endort, bercé de songes magnifiques.
Au matin, une carcasse informe est le jouet des lames. C’est le bateau qui s’est brisé sur les récifs, pendant la nuit. Les Pères ont tout perdu, vêtements, lits, couvertures, rituel, les Saintes Huiles, et les mille petits objets indispensables à ceux qui vivent dans ces régions déshéritées.
Trois jours les naufragés errent sur le rivage, demandant à la mer de leur rendre quelques lambeaux, mais la mer a tout pris.
Alors, dans la neige qui tombe, les deux Robes-noires se mettent à genoux et disent comme Job autrefois :
— Mon Dieu ! Vous nous aviez tout donné, vous nous avez tout enlevé. Que votre saint Nom soit béni !
— Chef de la Prière, lève-toi, vite, vite.
Les coups pleuvent sur la porte.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Ouvre-moi, ouvre-moi.
Et le missionnaire[38] sort de sa couche.
[38] Le Père Bonnald o. m. i.
Le froid entre avec un jeune garçon.
— Ferme la porte.
Au milieu de la chambre, ses raquettes à la main, l’Indien s’arrête, intimidé.
Il a fourni une longue course, sa poitrine se soulève, oppressée, d’un geste machinal il arrache les glaçons qui pendent aux franges de son « parka ».
— Eh bien ! que veux-tu ?
— Chef de la prière, mon père est malade, très malade, il te demande de venir tout de suite, il veut te voir. Hâte-toi, il faut prier pour lui.
— Qui est ton père ?
Et le messager, comme honteux, répond, tête baissée :
— John Peters !
John Peters ! Le plus fameux païen de la tribu qui campe sur les rives du lac de Travers, dans le Kewatin. John Peters, le sorcier ! John Peters, le jongleur ! John Peters, le joueur de tambour !
C’est lui qui demande l’homme-de-la-prière ? N’est-ce pas une supercherie ? Un piège tendu à la bonne foi du missionnaire ?
Après une course dans les neiges, ne va-t-on pas trouver le vieux bougre et ses acolytes assis devant sa loge, frappant de sa main rapide la peau de phoque tendue sur une couronne de bois ?
Ils vont se gausser et bien rire. Ah ! ah ! ah ! La voilà la Robe-noire, que le Grand Esprit a mis de crédulité dans sa faible cervelle. Il dormait, il était bien au chaud, douillet et calme. Il a suffi de l’appel d’un gamin pour le faire lever, chausser ses raquettes et courir sur les pistes gelées. Ah ! ah ! ah ! Battez, tambour, riez avec moi ! voyez-le, voyez-le !
Mais le jeune garçon porte en ses yeux une angoisse profonde.
Il sait ce que pense l’homme-de-la-prière et n’ayant pas de mot pour le convaincre, il dit simplement :
— C’est mon père et il est très malade.
Et l’Oblat sait où se trouve son devoir.
— Allons.
La nuit est calme, une lune énorme est agrafée à la robe sombre du ciel. Il y a des millions d’étoiles, la neige est dure, le froid sec.
Un sifflement réveille les bêtes, qui sortent en s’étirant ; l’une bâille et secoue ses oreilles, le chien de tête presse les flemmards.
Le Père dit à l’Indien :
— Tu es fatigué, couche-toi dans la traîne et dors.
Marche, marche…[39].
[39] Marche qui, par déformation, est devenu dans la bouche des meneurs de chiens du Yukon et de l’Alaska : Mush, mush on.
On quitte Cross Lake. Et c’est la randonnée habituelle dans le même paysage désolé ; les chiens vont leur train — six milles à l’heure — le prêtre bat la neige aux endroits difficiles, avec ses raquettes.
Une bête patine et tombe, les pattes repliées.
Attentif, le conducteur veille :
— Stop ! Rien de cassé. C’est bien, en avant, mes fistons.
Quelques bouquets de trembles, un boqueteau de sapins, des saules rabougris.
Les chiens courent.
Une à une les étoiles s’éteignent, à l’horizon on dirait que la lune chancelle. L’aube point, grise.
Etape. Vite du feu. La bouilloire chante, le thé est prêt qu’on avale bouillant.
En route. Les deux hommes se relaient maintenant et battent la neige devant l’équipe. La piste est molle, il faut l’affermir.
Le soir vient et l’on arrive. Voici la hutte du mécréant.
Le prêtre paraît, une exclamation le salue :
— Ah ! Notta, ni miweysiten et wepamitan. Ah ! mon père, que je suis content de te voir.
Et le jongleur se dresse sur son séant, la main tendue.
Le sorcier et l’homme de Dieu restent face à face. Il y a un long silence. L’un observe, l’autre attend. Enfin, John Peters se décide :
— Je t’ai fait demander car je suis bien mal et j’ignore si je reviendrai à la santé.
Je ne sais quel chemin va prendre mon âme quand elle quittera la terre et je crains de ne pas voir le Grand Esprit. Montre-moi le bon chemin, Robe-noire. Je le sais, j’ai été méchant. J’ai passé ma vie dans le désordre, mais tout cela je le regrette. Je veux être un bon priant.
L’Indien a parlé très vite, comme pour décharger son cœur d’un poids trop lourd pour lui.
Et le prêtre répond :
— C’est bon, mon grand-père, je suis content de te voir.
Oui, je te montrerai le bon chemin et j’y placerai ton âme. Je t’apporte la Grande Médecine du Bon Dieu.
Sans doute, tu l’as offensé, mais il est miséricordieux, il te pardonnera. Lui prendra pitié de ton corps ; moi, je viens pour guérir ton âme.
Raconte-moi ta vie et le Grand Esprit sera de nouveau ton ami…
… Maintenant, ses enfants sont rentrés, sa femme et ses compagnons. Au signal donné par le prêtre, les voix montent, disant la prière du soir, louangeant le Seigneur, lui demandant ses grâces.
Sur la terre nue, recouverte de quelques branches d’épinettes, le malade s’est assoupi. L’Oblat veille, roulé dans son manteau de peaux de lièvres : au milieu des sauvages qui lui sont chers, il est vraiment le missionnaire des pauvres.
Sur le toit, les chiens se battent, grognent et s’apaisent. On n’entend plus que la respiration oppressée de l’homme qui va mourir.
John Peters ! le sorcier, il ne frappera plus son tambour en cadence pour chercher à découvrir la piste de la bête dont la chair se mange, l’approche de l’ennemi ou le mal qui rôde autour du patient.
Il ne chantera plus les combats qui ont rendu fameux les jeunes hommes alors que toutes les tribus étaient libres sur la terre libre.
Le Père remercie Dieu de lui avoir permis de ramener une âme.
Et soudain l’Indien se lève, drapé dans ses haillons, il est debout, décharné, pitoyable et sublime, il va à tâtons et prend un objet bizarre qui pendait à un clou. C’est le vieux tambourin des fêtes, à la peau parcheminée, usé par des générations de jongleurs, celui qui animait les danses païennes et scandait les appels maudits.
— Que fais-tu, mon grand-père ?
— Regarde.
Et du pied écartant les tisons, il jette le tambour dans le foyer. Une grande flamme monte, la carcasse se tord, la peau se fend, il n’y a plus rien, plus rien ne subsiste d’un passé haïssable.
Alors, le vieux sorcier s’étend sur son grabat.
— Tapwé, nasisim, namawikatch ! Vraiment, mon petit-fils, jamais plus.
Et il attend la mort, l’âme sereine.
Ce sont les plus misérables, les plus pauvres, les plus abjects.
Ils errent de la corne de l’Alaska au Labrador, des îles Herschell à la Terre de Baffin.
Leur domaine est désolation.
Et cependant, ils s’appellent : Innuit : les hommes-par-excellence et nomment les Indiens Loucheux : Itkreleït, ceux-qui-sont-nés-des-larves-de-nos-poux.
Les Montagnais Chippewayan disent : Ashkimey, les mangeurs-de-chair-crue.
Ils sont volontaires et fiers, imprévoyants et hospitaliers, rusés et patients, intelligents et forts.
Ce sont les plus misérables, les plus pauvres, les plus abjects.
C’est pourquoi les Oblats devaient tenter le salut de leurs âmes.
L’ardent Père Grollier montre la route[40], bientôt suivi des Pères Seguin et Petitot.
[40] 1860.
Mais les Esquimaux sont rebelles. La poursuite du caribou, l’attente du phoque, seules, les passionnent ; pour le reste, ils s’en remettent à la Très-Vieille-Femme qui vit dans l’Océan, et dirige leurs destinées sur la terre des glaces et la terre des âmes.
De Mac Pherson à l’île Richard, en sept ans, le Père Lefebvre les visite trois fois. Il en retire de maigres consolations. Douze mois, le Père Lecorre parcourt l’Alaska, de la Pointe Barrow à la mer de Behring, fouillant les baies, suivant les tribus à la piste, prêchant l’Evangile et la Révélation. Il baptise quelques enfants.
Et le Père Gasté, du lac Caribou, apporte la parole du Christ aux Esquimaux dont les territoires de chasse avoisinent l’Hudson.
Le grain jeté germera-t-il jamais sur la Terre où passent les tempêtes descendues du septentrion ?
Mais Turquetil paraît ; il est le porteur d’espérance.
Dès 1901, il suit les Esquimaux, vit de leur vie, souffre le froid, la faim, déjoue les pièges des sorciers.
Il prend corps à corps le paganisme et l’hérésie.
Enfin ! En 1912, il a la joie de planter la Croix à Chesterfield Inlet, au nord-est de la Baie d’Hudson.
Notre-Dame de la Délivrande, avant-garde de Dieu aux extrémités de la terre ! La prophétie du Psalmiste se réalise : In fines orbis terræ verba eorum[41]. Mais la terre nordique est vierge du sang des martyrs ; il faut des victimes expiatoires. Elles arrivent, elles viennent, elles sont là.
[41] Ps. XVIII.
Deux sont partis qui servent leur vœu d’obéissance et qui marchent vers le destin que tous leur envient, destin dont tous ont rêvé dans la cellule du séminaire alors que la vocation exaltait leur foi.
Mourir pour Lui, s’immoler pour Lui ; mourir comme Il est mort, s’immoler comme Il s’est immolé ; la terre prédestinée n’a pas bu tout le sang du Golgotha, il coule encore, exaltant le sacrifice et faisant se lever des rouges semailles la sublime moisson.
Par le fer et par le feu, la barbarie se rue contre la vérité, mais de l’épreuve l’Eglise sort, militante et triomphante.
Sang d’Etienne, de Paul, de Pierre, de Sébastien, sang des premiers néophytes : sainte nudité des vierges sous le ciel éclatant de Rome, qu’il était beau votre sang sur le sable du Colisée ; martyrs de la Gaule, les siècles révolus, sur la colline où votre sang fut répandu, a jailli la Basilique du cœur ruisselant de Jésus, dont les Oblats ont eu la sainte garde[42] : sang de ceux qui ont été tenaillés, écorchés, brûlés vifs, en Chine, au Japon, dans les Iles.
[42] C’est Mgr Guibert, archevêque de Paris, qui était Oblat, qui confia la garde du Sacré-Cœur aux o. m. i.
On crevait vos yeux, vous chantiez ; on suspendait des haches rougies au feu autour de votre cou, vous chantiez ; on coupait vos mains, vous dressiez vos moignons sanglants vers le ciel et vous chantiez ; les fauves surgissaient de l’ombre vers la lumière du cirque et vous chantiez, chœur admirable, les louanges de Dieu et Dieu ouvrait pour vous son ciel de gloire !
Jean-Baptiste Rouvière et Guillaume Le Roux, le Dieu qui remet les péchés vous avait marqués au front. Depuis les siècles des siècles il vous avait choisis ! il vous avait élus. Vous êtes allés le cœur en fête vers la peine et vers la mort.
De Fort Good Hope à Fort Norman, de Fort Norman au Grand Lac de l’Ours. Morne voyage !
Au fond de la Baie Dease vous débarquez, les Esquimaux, pressés par la saison[43], ont levé le camp. Vous remontez la Dease aux rapides tumultueux, vous marchez dans l’eau, portant l’esquif, puis vous l’abandonnez et vous suivez la piste à pied, avec sur les épaules, votre besace de mendiant du Seigneur, votre Chapelle et quelques provisions, nourriture du corps, nourriture de l’âme.
[43] Mi-juillet 1912.
L’année se passe, au cœur de la Terre Stérile, dans la hutte du lac Imérénick.
Les Pères apprennent la langue, étudient le pays, les indigènes seront plus nombreux si l’on atteint le golfe du Couronnement[44].
[44] Coronation Bay, à l’extrémité nord du Canada.
Ils n’hésitent pas à reprendre la route. Avant, ils préviennent Mgr Breynat, vicaire apostolique du Mackenzie, l’évêque au grand cœur qui les a envoyés.
— Nous allons partir. Bénissez-nous, Monseigneur. Et que Marie nous garde et nous dirige. On ne devait plus les revoir !
Cent quarante kilomètres séparent Imérénick de la mer Glaciale.
Ils mettent douze jours pour franchir la distance.
Le journal du Père Rouvière — débris trouvés à la place même du martyre — est une litanie de la douleur : Temps affreux, froid intense, chemins difficiles, vent contraire, fatigue des chiens affamés.
Le 22 octobre, c’est l’arrivée à l’embouchure de la Copper River — la rivière du Cuivre — les Esquimaux sont ailleurs.
Désenchantement ! C’est le dernier mot de la dernière phrase qui disait : « Nous sommes menacés de famine. »
Le caribou a fui, le phoque est invisible. Il faut aller plus loin encore.
Mais le démon veille : le Père Le Roux a quelques provisions, on les lui vole, une carabine, on la lui prend.
C’est Kormick qui a brisé les lois de l’hospitalité.
Et Koha, un vieillard, dit :
— Kormick et ses gens vous feront un mauvais parti. Retournez tout de suite à votre hutte du lac Imérénick, vous reviendrez l’année prochaine.
Sagesse d’un homme dont le cœur est juste.
Mais qui peut éviter ce qui doit advenir ?
Koha les accompagne, il s’attelle au traîneau avec les chiens pour aller plus vite.
Ils remontent la rivière du Cuivre, jusqu’au carrefour qui conduit vers la Terre Désolée.
Là, le vieillard s’arrête :
— Vous voici sur la bonne route, il n’y a pas d’arbres ici, continuez d’avancer aussi loin que vous pourrez ; tant que vos chiens auront de la force, allez.
Je vous aime et je ne veux pas qu’on vous fasse du mal.
Les trois jours qui suivent ?
Nul, hormis Dieu, ne saura.
Deux hommes, quatre chiens luttent contre le froid qui mord et la faim qui tenaille.
Comme le Fils de l’homme, ils n’ont pas une pierre pour reposer leur tête, pas une branche pour allumer du feu, pas une toile pour se protéger.
Et la mort est sur leurs pas, elle suit à la piste ces vaillants et ces forts ; ce que la nature hostile ne peut faire, deux créatures le réaliseront.
Sinnisiak et Oulouksak ont quitté la tribu endormie.
Ils rejoignent les hommes-de-la-prière.
— Nous allons, donnent-ils pour excuse, rejoindre nos parents attardés sur les rives du grand lac de l’Ours. Puisque c’est votre direction, nous vous aiderons à traîner votre charge.
Et les deux Esquimaux endossent le harnais et halent le traîneau.
La mort et la vie cheminent côte à côte.
L’Esprit du mal guette l’instant propice ; un jour passe, un autre jour se lève.
On construit un iglou. Dans la maison de glace victimes et bourreaux sommeillent. Au matin, l’on repart, et le kamassan souffle, soulevant la neige, aveuglant les chiens et les hommes.
En avant, le Père Rouvière bat la piste. Plus loin, le Père Le Roux pousse la traîne.
Alors le destin s’accomplit. Sinnisiak lève son coutelas et frappe le Père Le Roux dans le dos.
L’homme-de-la-prière s’écroule, poussant un cri. Déjà Oulouksak est sur lui, deux coups le percent encore, un aux entrailles, l’autre au cœur.
A l’appel de détresse, le Père Rouvière a répondu, il accourt, Sinnisiak l’accueille à coups de carabine. Le Père veut fuir vers le fleuve, une balle l’atteint dans les reins et Oulouksak l’égorge. Alors, prenant une hache, ils coupent les jambes, les mains, les têtes. Ils arrachent le foie et le dévorent : horrible festin.
La neige est rouge. Dans les tourbillons de la tempête, ils fuient les démons chargés des dépouilles opimes.
Le lendemain, près du traîneau, des Esquimaux retrouvent les quatre chiens qui, impassibles, attendent le retour de leurs maîtres.
Un an après, d’Arcy Arden rencontre des Indigènes affublés de soutanes et d’ornements sacrés.
Trois ans après, le gendarme Wight conduit par l’Esquimau Maysouk, trouve quelques débris épars.
— Là était Ilogoak (le Père Le Roux), Kouliavik (le Père Rouvière) est dans le ravin, près du fleuve sur la rive gauche.
Quelques ossements, la harde des loups est passée…
Avec les planches du traîneau, l’homme de police a fait deux croix.
Quatre ans après, Sinnisiak et Oulouksak comparaissaient devant la Cour suprême, à Edmonton, l’ancien fort des Prairies, sauvé jadis par un Oblat[45].
[45] Le Père Lacombe.
La mort fut la sentence.
Alors Mgr Breynat, père à qui l’on a pris les plus chers de ses fils, demande et obtient la grâce des deux misérables.
Ainsi la pitié et la miséricorde naissent du sacrifice et de l’immolation.
Ce sont les plus misérables, les plus pauvres, les plus abjects.
C’est pourquoi il faut les aimer « au delà de la vie » comme les ont aimés les Pères Le Roux et Rouvière, jusqu’à l’abnégation totale et le don de soi-même.
C’est pourquoi d’autres Oblats ont pris la place des Oblats disparus ; la terre peut garder les corps et boire tout leur sang, des âmes vivantes se lèvent pour l’accomplissement de l’œuvre sainte.
L’étoile des mages les conduit où la volonté du Très Haut les mène.
Ils portent la parole divine et les plus misérables, les plus pauvres, les plus abjects, marchent vers la lumière.
Les fils de Cham, de Sem et de Japhet sont les brebis d’un même troupeau.
La nuit polaire est un rayonnement.
Dans son tipi conique, Sapomarxikaw va mourir !
Sapomarxikaw, Pied-de-Corbeau, chef de la tribu des Siksikas, le guerrier sans reproche, qui mena son clan au combat et lui donna la gloire d’être le plus redoutable et le plus redouté.
Pied-de-Corbeau, l’ami d’arsous-kitsi-parpi, de ce Père Lacombe admirable, qui autrefois scella dans le sang une amitié jamais démentie.
Les Cris avaient surpris la nation des Pieds-Noirs : ils en faisaient un grand carnage. Pied-de-Corbeau et ses jeunes hommes s’étaient jetés dans la bataille avec l’ardeur qu’ils tenaient des ancêtres. Le vieux chef Natous — le Soleil — l’avait pressé sur son cœur, lui disant :
— Mon fils, il faut sauver notre nation, mais sauvons avant tout la Robe-noire.
L’homme-de-la-prière, sa bannière blanche dans une main, sa croix d’Oblat dans l’autre, est au cœur de la mêlée. Une balle l’abat.
Alors Pied-de-Corbeau pousse son cri de guerre, son appel fanatise ses troupes. Le jeune chef s’élance, hurlant aux Cris et aux Assiniboines :
— Vous êtes des chiens ! Vous avez tiré sur arsous-kitsi-parpi, vous avez tué l’homme-de-la-prière.
Les Cris, honteux, se retirent.
Le sang versé par le prêtre avait apaisé les démons du carnage.
La protection de Dieu s’étendait sur le camp. Et les Pieds-Noirs, orgueilleux de leur race, rendirent hommage à celui qui vint leur apporter les paroles de paix.
Les années se sont écoulées, dures et pitoyables pour l’Oblat, errant d’une tribu à l’autre, prêchant la mansuétude et l’amour aux frères ennemis. Pied-de-Corbeau est devenu un chef fameux, il a conduit avec bonheur Gens-du-Sang et Sarcis à la poursuite du bison.
Il est l’ami loyal et fier sur qui l’on peut compter aux jours sombres.
Ces jours arrivent, révolte des métis, insurrection, batailles. Pied-de-Corbeau a promis au Père Lacombe que les Pieds-Noirs seraient fidèles. Ils le seront.
Quand la lune affamée se leva sur la prairie, non plus pour vingt-huit jours, mais pour des mois, sous leurs tipis de peaux de buffles, les Pieds-Noirs attendaient la mort, souffrant plus de l’humiliation que de la famine.
Ils mangeaient les carcasses empoisonnées des loups, faisaient « chaudière » avec les os des bœufs blanchissant dans le plaine.
Le Père Lacombe avait obtenu d’Ottawa des semences, des vivres, et l’espoir était revenu au cœur des hommes.
Dans la prairie, la nouvelle est passée plus vite qu’un cheval de chasse :
— Les jours des blancs sent comptés, et le buffle va revenir.
Gros Ours, le chef des Cris de la prairie, dont la réserve est voisine du lac de la Grenouille, parcourt la plaine et se signale par ses atrocités.
Le Jeudi Saint 2 avril[46], les Pères Fafard et Marchand sont massacrés ! et leur église flambe !
[46] 1885. Les Pères Fafard et Marchand, tous deux o. m. i.
Une vieille sauvagesse montagnaise — nouvelle Véronique — essuie le visage saignant des martyrs.
Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière sans fin.
Les Pieds-Noirs sont aussi loyaux que braves. Le chef et les guerriers ne bougent pas.
Aujourd’hui, dans son tipi, Sapomarxikaw va mourir !
Et les hommes de la médecine, les sorciers sont accourus. Pour chasser les esprits du mal qui rôdent, les crécelles grincent, les tambours battent, les cris montent, assourdissants. Les incantations magiques s’élèvent, puis les prières, et puis les chants.
Un silence.
Un vieillard se lève :
— O Manitou ! O Grand Esprit ! Ecoute les exhortations de ton peuple. Ce guerrier que tu vois couché, je l’ai vu sur son cheval qui se cabrait, il portait à sa ceinture les chevelures ennemies, preuve de sa vaillance.
Il nous a fait suivre la loi des ancêtres. Nous avons écouté ses conseils. Aux temps heureux, c’est par centaines que les buffles ont été abattus. Il a été bon, hospitalier, secourable, il a aimé les pauvres, ô Manitou, ô Grand Esprit, laisse-le parmi nous.
Et les clameurs recommencent ; un sorcier harangue les mauvais Esprits, cause du mal, une horrible vieille édentée, les cheveux au vent, le visage exsangue, pousse de rauques aboiements ; un sorcier souffle de la cendre sur le feu, pour éteindre la douleur qui brûle comme la flamme. On promène des fétiches autour du camp.
Les hommes jeunes sont abattus, les femmes déchirent leurs vêtements, les enfants pleurent, les chiens, le museau droit, hurlent à la mort. Dans le tipi en peau de buffle, cependant, le grand chef va mourir.
A son chevet, il y a un Oblat. De Calgary, un médecin arrive, les sorciers le chassent.
Le Père Doucet reste seul au milieu des vociférations.
Pied-de-Corbeau n’est pas un converti, mais il y a longtemps que ses fils sont catholiques : il a défendu l’entrée de sa réserve aux ministres protestants.
Il a dit bien souvent :
— Notre Grand’mère la Reine nous donne le pain, mais le Père Lacombe nous donne plus encore, il nous donne la consolation.
Consoler, divine mission, richesse de l’âme ! Que peut la raison contre l’amour[47] ?
[47] La raison n’a jamais séché une larme. (Chateaubriand.)
Lui a peur de ne pouvoir observer la loi divine. Il ne se croit pas assez pur, assez bon… et les jours ont passé après les jours et voici le dernier qui se lève.
Le missionnaire est toujours là, il ne l’a pas quitté.
Seize heures coulent une à une, les hommes de la médecine sont déchaînés.
Pied-de-Corbeau fait un signe. Tout se tait.
— Appelle mon frère et mon beau-frère.
Et le Père Doucet envoie chercher Trois-Bœufs et Rabbit-Carrier.
Puis le chef ordonne :
— Qu’on m’habille !
On le revêt de ses vêtements d’apparat : jaquette en peau de daim, mitaines en peau de jeune buffle, panache de plumes de corbeau (ekkinam).
Un jeune guerrier lui apporte son calumet de cérémonie et le lui met entre les lèvres.
— Trois-Bœufs, mon frère, la tribu est entre tes mains. Approche, Rabbit-Carrier, et dis-moi le chant de la guerre de Siksikas.
Et l’Indien, grave, chante des mémorables faits de la tribu.
« Nous, les Siksikas, nous sommes les guerriers par excellence. Nos territoires de chasse sont immenses : ils s’étendent des sources du Missouri à la rivière Saskatchewan, des Rocheuses à la Prairie sans fin.
« A l’époque où le cheval n’existait pas, nous forcions le buffle à la course. Nos mocassins se sont teints de la cendre de la Prairie en feu, c’est pourquoi on nous appelle Siksikas, les Pieds-Noirs. Puis, nous avons pris les chevaux de nos ennemis et nous avons alors défié le vent.
« Nous avons fait la guerre et nous avons vaincu les Cris, les Assiniboines, les Sioux, les Corbeaux, les Têtes-Plates, les Kutenais.
« Nous sommes les Siksikas ; les Kainahs et les Piégans sont nos frères, les Atsinas et les Sarcis sont nos cousins.
« Napi, le Vieil Homme, nous protège et Natsous nous donne la puissance. »
Lutte du passé qui s’efface et de l’avenir qui point.
Natsous, le soleil, la fête de la tribu, les danses, le courage des jeunes hommes qui veulent devenir des guerriers, et, près de lui, calme, la Robe-noire, l’homme-de-la-prière, frère de son ami, arsous kitsi parpi.
Le crucifié est-il le sauveur des âmes, accueillera-t-il celui qui a fourni une rude journée ? Il a fait trembler ses ennemis, mais il a protégé les faibles.
Visiblement, la grâce est en lui, alors Sapomarxikaw tourne son regard vers le Père Doucet. Celui-ci comprend, il se penche vers l’agonisant :
— Veux-tu recevoir le baptême ?
Le chef de la nation Siksika lâche le calumet qui tombe et de sa main droite fait un grand signe de croix.
L’Oblat prononce les paroles rituelles.
Les lèvres du mourant remuent : quelles paroles expirent dans un souffle, quelles prières, quels espoirs, quels regrets, quelles réminiscences ? Seul, le Seigneur pourra comprendre. Lui seul écoute, lui seul entend.
Dehors, les hommes de la médecine redoublent de fureur.
Sous le tipi conique, le grand chef est immobile et son âme est ailleurs. Elle monte, sereine et confiante, plane au-dessus de cette Prairie qu’elle a tant aimée, et s’élève jusqu’au seuil de l’Eternité où règne Celui qui juge les vivants et les morts.
Il n’est plus.
Un coup de feu abat son cheval favori. Tout un peuple est désespéré.
Près de la dépouille du chef, il y a une Robe-noire qui prie à genoux, de toute la ferveur de sa foi.
Sur une croix en granit blanc, on a gravé une date et un nom[48].
[48] (Crowfoot, père de son peuple, 24 avril 1890.)
Celui-là est un Canadien de la Nouvelle-France, Canadien comme Mgr Provencher, Mgr Langevin — le grand blessé de l’Ouest, — Mgr Taché, comme le Père Lacombe.
Pareil à eux, il est Oblat. Sur cette terre aimée de Dieu, la Foi est une nécessité de l’existence. Elle est dans l’air que l’on respire, elle bouillonne dans le jaillissement des eaux, aux courbes des rapides, les arbres millénaires l’attestent dans la forêt impénétrable, elle passe sur la prairie avec la voix des cloches et le vent la porte qui peigne la moisson.
Famille canadienne aux mœurs patriarcales qui a su résister à la folie des siècles, tu es la plus pure manifestation de l’Esprit, puisque tu as su conserver malgré tout, malgré tous, la tradition léguée par les ancêtres.
Normands, Picards, Poitevins et Manceaux, vous avez gardé dans la persécution l’âme des premiers néophytes, et vous portez avec joie l’orgueil magnifique de votre terre canadienne.
Dans le miroir des eaux du lac des Deux-Montagnes, Charlebois, tout enfant, a lu sa destinée.
Sa vie pouvait couler unie et douce, pastorale et sereine, il a choisi d’autres chemins.
Croyant, il savait que Jésus n’a jamais été plus beau, plus rayonnant que cloué sur la Croix.
De son sang, l’Eglise a jailli, triomphante. Elle est née dans la douleur d’une étable, elle a grandi sous la verge des bourreaux, mais les cris de la populace n’ont jamais pu étouffer la voix de ceux qui annonçaient au monde que les temps étaient révolus.
Mgr Charlebois a subi toutes les souffrances du Nord. Sa jeunesse s’est usée dans la longue patience de la solitude, mais son âme est sortie de l’épreuve marquée du signe révélateur.
Le jour où la mitre a ceint son front humilié, une voix s’est élevée qui disait : « On n’est jamais plus grand que dans la douleur. Vous avez été préparé par l’épreuve et par le sacrifice. Vingt-trois ans sont passés qui, jour par jour, ont pesé lourdement sur vos épaules solitaires, mais votre zèle est inlassable. »
Et le R. P. Dozois, provincial des Oblats, ajoutait :
« Il a souffert en martyr, il a pleuré en saint. »
Mais, la crosse en main, l’Evêque est resté missionnaire.
Guidé par la volonté de Saint Pierre à l’épiscopat, Mgr Charlebois a vu s’ouvrir à son activité dévorante le diocèse le plus ingrat qui soit.
Ah ! certes, elles n’offrent rien aux convoitises humaines, ces terres du Keewatin, au nord du Cercle arctique ! Sur cette terre glacée, séjour de l’épouvante et de la mort, Mgr Charlebois est allé, acceptant son calvaire.
Ainsi il accomplit la mission qu’on lui a confiée.
« Votre cœur est plein de l’amour de Dieu, qu’il se déverse sur les âmes les plus abandonnées ; allez là-bas dans l’Extrême Nord, allez-y par Marie — Ad Jesum per Mariam, c’est là que votre modèle divin vous attend.
« Votre cathédrale, ce sera la tente de toile ou la voûte des cieux, pour véhicule, vous n’aurez que la misérable traîne à chiens. Votre peuple, ce sera le peuple indien, allez au Calvaire, allez ! »
Et Mgr Charlebois est parti ; depuis, comme le juif de l’opprobre, il a marché, portant à ceux qui souffrent la consolation de sa présence, aimant d’un amour surnaturel les plus bas, les plus ravalés. Il s’est donné avec passion au recrutement des soldats de la Foi, et nombreux sont ceux qui ont répondu : Présent ! à son appel d’apôtre.
Je n’ai pas la joie de le connaître, mais j’ai vu son image. Il marchait courbé sous le faix, les genoux cassés, les jambes molles, ses yeux cherchaient la piste, il semblait prêt à s’écrouler et à mourir.
Mais on sentait que par un effort sublime, d’un coup d’épaule, il allait remonter son fardeau, assurer sa démarche et partir d’un pas mesuré mais sûr, vers des buts toujours plus lointains.
Mgr Charlebois, évêque de Bérénice, en Libye, vicaire apostolique de Keewatin, sait que sa journée n’est pas faite, il ne doit pas connaître les matins calmes où l’homme se réjouit de vivre.
« Quand je serai élevé entre le ciel et la terre, j’attirerai tout à moi. » L’heure de Mgr Charlebois n’est pas venue. C’est pourquoi dans l’humilité la plus absolue, dans la foi la plus ardente, Kitchi ayamihewikimaw — le grand chef de la Prière — continue à subir la pauvreté et toutes les misères que l’on trouve sur cette terre où ses prières ont fait descendre la bénédiction du Seigneur.
Il va, on le croit loin, il est ici.
Des Indiens l’ont reconnu. Ils crient :
« Makawob kitchi ayamihewikimaw ! » Voici le grand Priant qui arrive.
Et le Père sort de sa hutte de bois, il accueille un homme qui vient de faire un portage de deux lieues dans la boue et dans l’eau jusqu’aux genoux. C’est l’Evêque. Sa droite se lève, il bénit ses enfants.
… Un soir, le missionnaire dort. Il est très tard, la journée a été rude.
Un poing heurte la porte :
— Haw ! Wanishka ! Allons, allons, debout !
C’est Sa Grandeur qui passe.
Mission Saint-Joseph, Mission Sainte-Gertrude, Mission du Caribou, Mission Saint-Pierre, où le R. P. Gasté est resté quarante-trois ans de sa vie, mission du Sacré-Cœur à Pakitawagan que le Père Bonnald a fondée, étapes d’une route qui ne finit jamais, vous avez vu passer — combien de fois depuis des ans ? — l’évêque errant, dévoré par la vermine, n’ayant ni pain, ni sel, ni sucre, il a fait halte un soir, au matin, il est reparti. Rien n’arrêtera sa ronde. Ses pas font des trous dans la neige ; il est seul, dites-vous ? Non, il y a une ombre auprès de lui. C’est Jésus, fils de David, qui l’accompagne[49].
[49] Les deux frères de Mgr Charlebois appartiennent à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée.
— Tout est paré ?
— Oui.
— Larguez.
Doucement, le Nascopie s’éloigne du quai où les amis font des signes d’adieu. Il prend le courant et bientôt les hauts élévateurs défilent, puis les dernières maisons de Montréal et voici la campagne qui verdoie au soleil de juin.
A six heures, on double le cap de la Madeleine, sur la maison des Bonnes Sœurs, il y a un drapeau qu’un vent léger fait palpiter comme un cœur.
Sur son rocher, Québec — la bonne ville — veille dans toute la splendeur de son passé et de sa gloire.
Le pilote descend, un autre monte à bord qui conduira jusqu’à la pointe au Père.
Le brouillard tisse de brume l’estuaire. On jette l’ancre et l’on attend.
26 juin, ouatée la voix des cloches vient chanter l’allégresse en l’honneur de Madame Sainte Anne, grand’mère du Petit Jésus et patronne du Canada, mais chaque 17 secondes la sirène du phare gémit. La plainte monte déchirante qui semble dire :
« Où allez-vous ? Arrêtez-vous ! Là-bas sont les dangers, là-bas sont les souffrances. Les démons en folie rôdent sur l’Océan. Restez ici, restez ! »
Mais avec le soleil, l’espoir renaît. On part.
L’Empress passe, géant, près du Nascopie pygmée.
Il va vers les vieux pays, le destin du petit navire est de remonter parmi les icebergs toute la côte du Labrador.
… Voici leurs escadres redoutables descendues du Septentrion, conduites par des mains invisibles, elles arrivent lentes, mais irrésistibles, fortes comme le Destin, aveugles comme lui.
Le froid est intense. Le brouillard pesant comme un suaire.
Avec prudence, le navire louvoie.
Carterets, une anse parmi les rochers abrupts, quelques maisons de bois. Cela sent la morue, le goudron, la saumure.
Départ dans la brume. Le temps est froid, humide et sombre.
Rigolet, à 45 milles en amont de Hamilton Inlet. Pour la première fois, voici les Esquimaux. On embarque des barils pour l’huile de phoque, des madriers. Sur le pont, les canards, les poules, les cochons, voisinent, autour d’eux grondent les chiens faméliques et batailleurs.
Le 9 août, le Nascopie double le cap Childley. La côte est âpre, sauvage, dénudée, pittoresque.
Le bateau joue à cache-cache avec les icebergs et les îlots rocheux que forme l’entrée du Lake Harbour.
Là, une goélette d’Ecosse a péri corps et biens, à l’automne dernier. Les flots gardent leur secret… la mer efface le souvenir des hommes.
Cap Wolstenholme. Extrémité S.-O. du détroit. Un poste de l’Honorable Compagnie et trente familles d’Esquimaux. Ils sont là sur la rive rocheuse, malpropres, huileux et rieurs.
Enfin, le mardi 3 septembre, fête de la Mère du Bon Pasteur, par un temps clair et calme, voici Chesterfield Inlet.
Deux hommes descendent qui vont vivre là, des mois et des mois, dans la misère et la douleur, dans l’espérance aussi.
Les Pères Turquetil et Le Blanc arrivent pour fonder sur ces rivages la première mission esquimaude.
Après quarante-deux jours d’angoisse et de péril, Dieu les a conduits au port. Ils viennent pour travailler à sa sainte gloire.
Les deux Oblats dressent leur tente, la nuit descend ; à genoux, ils remercient le Très Haut et pour la première fois sur cette terre montent vers lui les oraisons du soir.
Pendant les heures nocturnes, la tempête a soufflé, la mer démente a mugi, mais au matin, le calme est revenu, alors les deux hommes commencent à bâtir la Maison du Seigneur.
Dur travail, travail sain, des chansons rythment le tapage des marteaux, planche à planche l’édifice s’élève ;[50] six jours, les hommes peinent, le septième ils l’offrent à Dieu et leurs mains rudes, tailladées de coupures, crevées d’ampoules, consacrent l’Hostie sainte qu’ils élèvent pour la première fois aux yeux des païens étonnés.
[50] Tout a dû être apporté de Montréal, matériaux, outils, le ravitaillement aussi, pour une année entière. Sur ces terres il n’y a rien, absolument, ni arbre, ni végétation.
Mains travailleuses, mains agiles, vous étiez douces à Celui qui songeait à des mains pareilles qui se tendaient vers un petit enfant, là-bas, sous un ciel de Judée, dans un atelier où un Compagnon Charpentier s’activait.
Mains de Joseph, ô mains consolatrices, vous releviez des boucles blondes pour lire le destin sur le front d’un enfant, et vos yeux de bonté rencontraient l’énigme de ces grands yeux qui portaient, au fond de leurs prunelles, le rachat des péchés de la terre.
Le Kyrie, le Gloria, le Credo… le chant grégorien monte ; les femmes, les enfants, les hommes écoutent, graves et réfléchis, ces mots qu’ils ne comprennent pas. Alors le Père Turquetil, le crucifix tendu, explique aux indigènes pourquoi il est venu et pourquoi désormais il vivra de leur vie.
Pour la première fois, les Esquimaux épellent lettre par lettre, mot par mot, le livre de Dieu.
La Croix les intrigue, le Sacré-Cœur les attire, pauvre Sacré-Cœur, ballotté par les vagues, qui est venu jusqu’ici, ouvrant à ces enfants déshérités ses bras secourables. Il est pitoyable, il est triste, il est bon. Un Esquimau demande :
— Père, c’est ton portrait ?
Maintenant, ils sortent : dans leur langue gutturale, ils commentent ce qu’ils ont compris, ce qu’ils ont vu. Les enfants croquent des bonbons, les femmes jacassent. Un vieillard, la joie au cœur, murmure :
— Kouillounamik ! Kouillounamik ! Je suis content ! Je suis content !
Les années ont passé ; dans la misère et dans la joie, l’œuvre s’est poursuivie. La mort a couché un des deux ouvriers de la première heure, ce bon Père Le Blanc dont l’âme dévorante a usé le corps.
Il est tombé et Dieu l’a pris. Le Père Turquetil est resté seul ; tenace, volontaire et têtu, il n’a pas désarmé.
Qui dira ses tristesses et ses désespérances, alors que la famine rôdait, décimant les plus chers de ses fils, usant la patience des cœurs les mieux trempés ?
Le second hiver, le ravitaillement n’est pas venu… on a vécu comme on a pu… et depuis… et depuis. Ah ! Seigneur ! quelle longue misère ! Mais quelle joie aussi : après cinq ans de labeur acharné, le grain a germé et le 2 juillet 1917 douze Esquimaux, instruits, édifiés, recevaient le baptême.
Cinq ans de travail sans relâche, cinq ans de luttes, cinq ans d’efforts. Douze baptêmes !
Depuis, huit ans se sont écoulés. Le Père Turquetil a vu son troupeau croître. Notre-Dame-de-la-Délivrande est une église bénie de Dieu, une mission florissante. L’humble père est désormais préfet apostolique, il porte déjà son effort vers des rivages toujours plus au nord, où errent, dans l’ignorance et dans la nuit, des hommes… la Terre de Baffin l’appelle, il ira, il y vient[51].
[51] Pour 1927 est décidée la fondation de Pond Inlet, à l’extrémité nord de la Terre de Baffin, au 73°, à 700 kms au nord du Cercle Polaire.
Au-delà il n’y a plus rien, plus rien que l’immensité désolée des régions polaires où seules les glaces monstrueuses affirment la puissance divine.
Comment va-t-il vivre, Seigneur ? Et son troupeau ?
Les démons arctiques ricanent, ils tendent déjà leurs mains crochues, ces âmes ne sont-elles pas des proies faciles ?
Mais le Berger fait bonne garde ; il sait que si la croix est lourde, il faut la porter jusqu’au bout.
Après le Golgotha, le Christ est ressuscité, le Christ, sauveur du Monde.
Le Bon Pasteur veille sur les brebis.
Dans cette baie d’Hudson, si redoutable, au nord du 60°, un cap de rochers et de glaces, sur ce cap quelques huttes misérables, battues par la tempête, dans ces huttes des êtres vivants : ces Esquimaux aux mœurs primitives, païens vêtus de peaux de bêtes, mangeurs de viande crue, dont l’âme se déchire écartelée aux quatre vents de la superstition.
Ces hommes qui attaquent au javelot, dont la pointe est une dent de morse, l’ours polaire et dont le poing ne tressaille pas, tremblent comme des petits enfants, devant les manifestations de l’esprit des ténèbres.
Sakkayut, le devin ; Angatkokreartut, le faiseur de tours, évoquent dans l’ombre l’âme des ancêtres disparus. A leur appel, la haine et le meurtre se lèvent, dressant, face à face, le père et le fils comme des ennemis.
On suit la piste du renard, on guette le sommeil du phoque, un harpon invisible frappe entre les deux épaules. Sur la neige, il y a le sang du fratricide, Caïn passe, le sort est conjuré.
Le vieillard se traîne inutile, on le supprime. Une fillette naît, on la tue. La femme est un objet que l’on achète et que l’on vend.
En vérité, ce sont des âmes malheureuses ; sur cette terre, sur ces âmes, Mgr Turquetil a fait descendre la paix religieuse du cœur.
A la pointe du Cap Esquimau, l’homme-de-la-prière a placé un flambeau qui rayonne dont il a confié la garde à Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, « la petite sœur » née comme lui de la glèbe normande et son aînée de quatre ans.
Et désormais, malgré les rafales du vent et la hurlée de la tempête, il y a sur la neige des pétales de roses.
Cœur virginal qui s’effeuille et qui se donne, dans la joie de l’abandon et du sacrifice, cœur mystique qui « passe son ciel à faire du bien sur la terre ».
Mission de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, phare debout aux extrémités du monde, tu as connu la misère de tes fils, alors que, clou à clou, ils élevaient ton autel. Misère du Père Ducharme et du frère Girard, serviteurs fidèles d’un idéal de charité !
Pendant que vous bâtissiez la maison, les éléments se déchaînaient, autour de vous tout s’écroulait, le cierge qui brûlait devant l’image de la « petite Française » ne vacillait pas. Sa flamme montait droite comme la volonté de Dieu, pure comme la Mère Douloureuse.
Des ombres dans le brouillard, une ombre d’homme, une ombre de chien et titubant une ombre de vieille femme, une ombre qui chancelle et qui s’abat.
… Ils ont marché pendant le jour, ils ont marché pendant la nuit. Depuis dix jours, ils vivent d’huile de phoque et de lanières de caribou.
Les chasseurs de la tribu sont là.
— Ittikoudjouk, qu’est devenue ta femme ?
Le chasseur fait un geste, elle est là-bas, très loin.
— Elle ne pouvait plus marcher. Je l’ai portée pendant trois étapes et trois étapes je l’ai traînée, puis je ne pouvais plus, alors je l’ai laissée.
L’homme refait un geste, elle est là-bas, très loin… Depuis, dix fois la nuit est revenue…
Le groupe autour de lui commente la chose.
— Peut-être elle est morte, peut-être elle vit…
Et chacun retourne chez soi.
Les hommes de la police viennent :
— Ta femme ?
— Elle est là-bas, très loin… dix jours…
Et les hommes de la police rentrent dans la hutte où le poêle fait son ronron.
Alors l’homme-de-la-prière arrive.
Ittikoudjouk répète :
— Elle est là-bas, très loin… dix jours…
— J’y vais.
L’Oblat n’a pas hésité, il y a une chance sur deux de sauver une âme, vite des chiens, un traîneau, et en route.
… Un soir, dans un iglou, une larve humaine où vit une dernière lueur. La femme paralysée s’est traînée jusqu’au lac, elle a brisé la glace, elle a pris un poisson ; dans le trou, une voix se lamente.
— Ikki, ikki, ikkikani, je gèle, je gèle à mort.
C’est le retour dans les rafales.
Alors se manifeste le miracle d’amour. L’Esquimaude demande à connaître ce Dieu dont les serviteurs bravent la mort pour sauver une femme.
L’eau du baptême coule sur son front, l’eau qui efface, l’eau qui absout. Maintenant dans son trou de neige, elle peut bien mourir. Le froid qui habitait en elle disparaît, peu à peu, elle entre dans la paix du Seigneur.
Le Père Lionel Ducharme l’a cousue dans une peau de renne ; au-dessus d’elle, il a construit une voûte de glace, la misérable qui a tant peiné, tant souffert, connaît enfin la grâce de l’éternel repos.
Ceci se passait, il y a quelques mois à peine, au Cap Esquimau, dans cette mission perdue à l’autre bout de la terre où la petite Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus étend son manteau blanc de carmélite pour protéger, pour consoler et pour bénir les âmes de bonne volonté.
Sous le ciel polaire, dans les tourbillons de la bourrasque, il neige des pétales de roses.
Rose d’amour, rose de charité, rose qui vient du beau pays de France.
Elles étaient quatre qui partirent un matin de printemps[52].
[52] 24 avril 1844.
On avait fait appel au sacrifice, spontanément elles s’étaient offertes.
Elles avaient abandonné le monde pour vivre, dans le calme, des jours de prière et de foi.
Solitude du couvent, paix de l’esprit et du cœur, allégresse d’être la servante humiliée du Seigneur, joie de contempler sa Face adorable dans le silence obsédant de la chapelle où la veilleuse agrandit les ombres ; être toute faiblesse devant le Tout-Puissant ; à force d’abnégation, atteindre le sublime et ne pas le savoir, avoir tué l’orgueil, la beauté, le désir ; être une petite chose sans nom dans le troupeau confus des brebis du Pasteur, être toute vertu et toute obéissance, ne voir le ciel qu’à travers la cime des arbres ; et quand le soir descend, dans le jardin, retrouver son enfance joueuse.
Prier, à l’aube, pour ceux qui souffrent, prier, à la lumière du soleil, pour les âmes dans la peine, prier, quand le soir vient, pour ceux qui ont péché pendant ce jour.
Tournée vers la lumière, chercher le Dieu secourable qui remet les offenses et le trouver toujours miséricordieux.
N’être qu’une femme et demander pour soi tout le poids de nos fautes.
Elles étaient quatre qui partirent, un matin de printemps parce qu’un vieil évêque était venu frapper à la porte du couvent.
Il avait parcouru des contrées inconnues, il avait vu la misère des hommes.
Il lui fallait des mains de femmes pour soigner des infirmes et consoler des orphelins.
Mgr Provencher disait :
— Lesquelles d’entre vous seraient disposées à venir à la Rivière Rouge ?
Les Sœurs Grises répondirent :
— Nous voici, envoyez-nous.
Elles étaient quatre, qui partirent un matin de printemps.
L’une d’elles s’appelait La France[53].
[53] Sœur Valade, supérieure, Sœur Lagrave, Sœur Coutlée, et Sœur La France.
Depuis des centaines ont suivi la voie du sacrifice.
Descendant la Rivière Rouge, elles ont traversé le lac Winnipeg, elles ont remonté les grands rapides et la Saskatchewan. Elles ont traversé des lacs immenses, pataugé dans des marécages, parcouru la Prairie dans des charrettes traînées par des bœufs, elles ont dormi à la belle étoile, dans la ronde insensée des maringouins, elles ont bravé les orages, les blizzards et les poudreries.
Rien ne les a arrêtées, rien n’a troublé la sérénité de leur âme.
Je les ai vues dans le Grand Nord, attentives et douces, se pencher sur les détresses humaines, le cœur débordant de pitié, je les ai vues, maternelles et divines, au milieu de leurs petits enfants.
Elles avaient des yeux où vivait la lumière.
Elles étaient quatre qui partirent un matin de printemps.
Sur une barge, elles allaient vers l’Ouest.
Huit hommes aux bras robustes rament, scandant leur effort au rythme d’un refrain.
Les quatre petites sœurs sont installées au milieu des ballots et des caisses.
Montréal s’éloigne, Ville-Marie qui vit l’effort des pionniers et le dévouement de la Mère d’Youville, la première Sœur Grise. Leur Mère ! Le Mont Royal se dresse à l’horizon. Un tournant l’efface. Et voici l’inconnu.
Elles sont seules pour deux mois.
Des regrets ? Que sais-je ? Le vent qui enfle le flot du Saint-Laurent les emporte dans sa furie.
Dans leurs doigts glissent les grains du chapelet. Elles prient, demandant à Dieu « la force d’aller jusqu’au bout ».
Il pleut. Le vent est debout, les mariniers s’impatientent.
Le soir, on dresse la tente. Elles sont transies et se pressent autour du foyer. Tandis qu’on brûle d’un côté, on gèle de l’autre.
Voici les rapides. Les saintes filles sont mortes de frayeur, mais peu à peu elles s’habituent, bientôt elles plaisantent.
Les portages sont longs, il faut gravir la montagne, se frayer un chemin dans les broussailles, franchir des ravins sur des arbres couchés qui tremblent au passage.
D’un ciel bas, la pluie tombe, inlassable ; quand on marche, c’est la vase et la boue et l’eau jusqu’à mi-jambes.
Epreuve, la Sœur Lagrave tombe et se foule la cheville : on doit la transporter à travers des fondrières. Les hommes grognent et veulent les abandonner. Etre parvenues si loin pour échouer ! Enfin, deux Iroquois s’offrent qui porteront la blessée. La mission est sauvée.
Pendant dix jours, c’est un déluge et dans leur âme inaccoutumée la détresse grandit. Mais elles réagissent et trouvent la consolation dans un amour infini pour Celui-qui-les-mène.
On campe. Sous la toile, l’eau dégouline, on barbote, et l’on retrouve la gaieté devant un feu clair qui pétille. Le repas terminé, on songe au pays, à ceux qu’on a quittés.
Alors un Iroquois, un guerrier splendide, qui est assis dans l’eau, les mains nouées aux tibias, parle.
Il fixe le foyer de son regard aigu comme si du tourbillon des flammes, les légendes de l’héroïque nation allaient surgir.
« Alors, au commencement, il tomba tant de neige que la terre en était couverte. Le sommet des arbres seul apparaissait. Ce n’était plus tenable.
« Alors tous les animaux qui demeuraient avec l’homme partirent pour aller chercher la chaleur du ciel.
« Leur voyage dura plusieurs heures. Enfin, l’écureuil fit un trou au firmament. Ce trou, c’est le soleil.
« C’est par là qu’ils pénétrèrent tous dans la Terre d’en haut.
« Là, un ours gardait la chaleur. Elle était suspendue, ainsi que les autres éléments, dans différents sacs, à un grand arbre, les uns disent que c’était un érable, d’autres un sapin. Cet arbre était au milieu d’une île.
« Le caribou se dirigea aussitôt en nageant vers l’arbre et s’empara du sac qui contenait la chaleur.
« L’ourson dit :
« — Mon père, on vole la chaleur !
« Et l’ours, en grondant, poursuivit le voleur dans son canot, mais la souris ayant rongé l’intérieur de la pagaie, celle-ci cassa. Et les animaux s’enfuirent avec la chaleur. Le sac étant lourd, ils le portèrent à tour de rôle.
« Mais la souris — depuis elle est maudite — rongea l’enveloppe, l’outre creva et la chaleur se répandit sur la Terre et fit fondre en un instant l’immense quantité de neige qui la couvrait.
« C’est pourquoi il n’y eut plus de Terre. Nihnaouldé !
« Tous les hommes et tous les animaux périrent.
« Un vieillard, seul, eut le bon esprit de construire un grand radeau — certains disent que c’était une barge — sur lequel il se retira avec quelques animaux.
« Alors les Montagnes Rocheuses apparaissaient hors de l’eau.
« Tout à coup, l’eau a recouvert les montagnes.
« C’était fini. Il n’y avait plus de terre.
« Cela dura des jours et des jours. C’est pourquoi tous les animaux et tous les oiseaux plongèrent pour aller chercher la terre, mais de terre point.
« Alors l’aigle s’envola à la recherche d’une cime. En vain.
« La pie partit à son tour, elle vit la tête des sapins et rapporta un bourgeon dans sa patte. Mais on sut qu’elle avait menti, le bourgeon, elle l’avait trouvé flottant sur les eaux.
« Et les eaux montaient toujours.
« Le vieillard dit au Kankanwi :
« — Kankanwi, mon ami, tu plonges fort bien, va donc voir si tu trouves la terre.
« Le canard plongea et revient bientôt, tout essoufflé, il n’avait rien trouvé.
« L’homme le remet sur le radeau et s’adresse au castor :
« — Tu plonges encore mieux que le Kankanwi, va donc voir si tu trouves la terre.
« Le castor obéit, il reste longtemps sous l’eau, mais il remonte épuisé, il n’a rien vu.
« L’homme dit alors au rat musqué :
« — Mon petit frère, tu es ma dernière espérance, mais j’ai confiance en toi ; plonge et tâche de trouver la terre.
« Et le rat musqué plonge. Il reste un jour entier sous l’eau, puis il reparaît plus mort que vif, couché sur le dos. Il respire avec peine. Le vieillard le hisse à bord, le ranime. Quelle joie, le rat musqué a de la boue aux pattes.
« L’homme la ramasse avec soin, l’aplatit en couche bien mince entre ses mains et la pose sur l’eau. Puis il se met à souffler dessus.
« Alors ce peu de terre, grand comme une feuille de peuplier, commence à s’étendre.
« A chaque souffle, elle se développe. L’homme continue de souffler jusqu’à ce qu’il voie une grande île assez solide pour le porter.
« Il demande :
« — Où sont les cadavres des hommes ?
« La pie dit :
« — J’ai vu des oiseaux qui les mangeaient sur le rivage.
« Le radeau aborde. Le vieillard et les animaux débarquent.
« Depuis ce temps-là, la terre existe et les hommes sont sur la terre. »
L’Indien s’est tu. Il reste hiératique, les yeux fixés sur la flamme qui diminue.
Les mariniers se sont étendus à même le sol.
Les quatre petites Sœurs Grises bénissent Dieu qui a mis dans l’âme obscure du sauvage une lueur.
Elles ont foi dans leur mission de charité, de dévouement, d’obéissance.
Le sommeil berce la simplicité de leur cœur.
Elles étaient quatre qui partirent, un matin de printemps[54].
[54] J’unis ici dans un même amour, un même acte de Foi, non seulement les Sœurs Grises, mais toutes les Religieuses de l’Ouest et du Grand Nord. Toutes sont des femmes admirables, d’admirables servantes du Seigneur. L.-F. R.
A l’ombre de la croix, il y a des ombres qui se meuvent.
Ce n’est pas l’ombre de ceux que le Christ appela, après une nuit de prière, sur la montagne sainte.
Ce n’est pas Simon qui fut nommé Céphas, ni André, le pécheur de Bethsaïde, ni Jean, fils de Zébédée, ni Barthélémy que les prêtres des idoles arméniennes écorchèrent vif, ni Simon le Chananéen, ni Jude, ni Thomas, ni Jacques, ni Mathieu. Ce n’est pas Judas qui déjà portait dans son cœur le serpent d’envie.
Non, ce ne sont pas ceux qui « se tenaient debout tous ensemble sous le portique de Salomon » et qu’une multitude entourait, longue théorie montant vers le Temple de Jérusalem pour les voir et les entendre.
Non, non, ceux qui se trouvent à l’ombre de la Croix, ce sont les serviteurs fidèles, les cœurs naïfs et dévoués, les humbles et les chastes qui vivent une vie de labeur sans gloire, obscurément, et qui, après une rude journée, mourront dans la paix du Seigneur « parce qu’ils ont tout quitté pour le suivre sur les routes du monde, par amour pour lui ».
Ce sont ceux qui, ayant purifié leur âme, aident l’oblat à porter sa misère dans les régions les plus ingrates.
Aux heures de tristesse, ce sont les compagnons, les confidents, les amis, les frères.
Ce sont les apôtres inconnus qui marchent à côté des Porteurs de lumière ; ils n’ont pas l’éclat, mais ils ont la sérénité.
Ce sont des ombres qui se meuvent à l’ombre de la Croix.
Le Père a tout abandonné. Il est parti « orné de sa science et de son sacerdoce » pour glaner les âmes dans les champs infinis de l’incrédulité ; aux jours de la moisson, il nouera les épis en gerbe pour les offrir à Celui qui console et qui absout.
Il est l’incarnation la plus pure, la plus sublime de l’esprit de sacrifice, il est celui-qui-combat-en-avant.
Mais l’humble soldat le suit, toujours volontaire et volontairement effacé, il est humilité, il est obéissance, il est le Frère Coadjuteur.
A la forge, à la scierie, abattant les arbres de la forêt, relevant les filets sous la glace des lacs, tirant avec les chiens les traîneaux aux passes difficiles, halant les barges, semant le grain pour la première fois aux flancs de la glèbe nouvelle, poursuivant le caribou qui brâme, se penchant, paternel, sur les cœurs puérils, il est partout, c’est l’auxiliaire indispensable de l’envoyé de Dieu, missionnaire comme lui, Oblat comme lui.
Quand, à la voix des prêcheurs, les Chevaliers se sont armés, sur la terre occitane, pour délivrer le sépulcre du Christ, des cœurs croyants les ont accompagnés, ils se sont croisés pour courir sus aux Infidèles. C’est la foule de ceux dont l’Histoire n’a pas gardé le nom. Mais ce sont ceux qui au jour du sacrifice ayant payé leur dette de souffrance, sont montés s’asseoir à la droite de Dieu.
Pour la croisade des âmes, des cœurs aussi simples sont partis, la même foi les anime, ils n’espèrent rien que servir, obéir et mourir à l’ombre de la Croix.
Cette Croix, ils l’ont façonnée de leurs mains et l’ont placée, avec amour, sur le clocheton de l’église.
Il n’y avait rien sur la page blanche, la carte était nue ; avec une patience attentive leurs doigts noueux ont tracé des croix, et voici que s’éveillent à la civilisation, au monde, à Dieu, des régions inconnues : Saint-Jean-Baptiste à Mac Murray, la Nativité à Chippewayan, Sainte-Marie à Fitzgérald, Saint-Isidore à Fort Smith, Saint-Joseph à Résolution, Sainte-Anne à la Rivière-aux-Foins, que sais-je encore ? Notre-Dame des Sept Douleurs à Fond-du-Lac, au nord du grand lac des Esclaves et Notre-Dame du Rosaire dans la baie Dease, à l’extrémité du grand lac de l’Ours.
La rivière la Paix et la rivière aux Liards, la rivière Athabaska et la rivière des Esclaves reflètent, aux rares beaux jours, le signe merveilleux.
Mgr Faraud a dit :
— Le jour où nos bons et vaillants frères viendront à nous manquer, nous n’aurons plus qu’à fermer les portes de nos orphelinats, hôpitaux, hospices et à renvoyer aux horreurs de l’abandon, au fond des bois, tous les malheureux que nous avions sauvés.
Ils ont quitté la douce France ou les rives du Saint-Laurent pour vivre une vie de peine ; l’hiver arctique pèse sur leurs âmes, mais la désespérance n’entre pas. Tout les émeut, tous les console, un noël chanté par des voix enfantines devant une crèche qu’ils ont édifiée.
Tendrement ils ont façonné les personnages de la plus belle histoire du monde. D’un couteau naïf ils ont taillé l’âne et le bœuf, leurs doigts ont semé des étoiles sur le manteau de la Vierge ; est-ce parce que Joseph était charpentier qu’il a une barbe de copeaux ? Et voici les Rois, porteurs de myrrhe, et les bergers vêtus de peaux, et les chiens au regard fidèle.
Ces cantiques en montagnais que les orphelins chantent, ce sont eux qui patiemment les leur ont appris.
Tout est liesse et joie dans l’éternel dénûment où ils se trouvent.
C’est la voix du Frère Rio, qui monte dans les gorges de la rivière Nelson et qui chante, pour oublier sa peine, l’Ave Maris Stella, de Sainte-Anne-d’Auray, mais le rapide happe la frêle embarcation et le bouillonnement des eaux arrête la chanson.
La mort qui les guette les abat sur la route, en pleine activité, en pleine force, en plein travail.
La fatigue ne compte guère, la fièvre importe peu ; n’est-ce pas, frère Ancel, qui grelottant êtes tombé sur la neige pour vous relever dans un suprême effort et pour mourir ?
Frère Kearney, qui dira votre vie d’abnégation et de souffrances quotidiennes, vous qui avez conduit le Père Petitot de Simpson à Good Hope, au delà du Cercle Polaire, vous qui, perdu, à genoux dans la neige, avez invoqué le nom de Mgr de Mazenod et qui avez été entendu, filiation des âmes qu’un même amour a pétri ?
A Notre-Dame de Bonne Espérance, le Père Grollier qui n’avait vu personne depuis deux ans, s’écrie en vous apercevant :
— Dieu nous aime !
Il vous aimait vraiment ce Dieu qui fit de vous son serviteur le plus fidèle.
— Dieu nous aime !
Et le « petit frère » se met à l’œuvre. Il ne devait s’arrêter que cinquante-six ans après[55].
[55] Le Père Robin l’ensevelit auprès du Père Grollier, dont le petit frère avait lui-même creusé la tombe cinquante-quatre ans auparavant.
Il œuvrait tout le jour ; et la nuit, on le trouvait les bras en croix priant dans la chapelle, appelant au secours des humains la charité du Tout-Puissant.
Il faut espérer que nous aurons un jour la joie suprême de voir s’unir dans une même gloire et le Grand Evêque qui créa les Oblats et le dernier de ses serviteurs, le plus humble et le plus ignoré qui, jusqu’au soir de sa vie, pria pour le salut des âmes.
Celui-là, la mort vint le prendre en fin de journée, alors que sa tâche était accomplie.
Mais la liste est longue de ceux qui furent frappés avant l’heure.
Frères Rio, Welsch, Nicolas, Hand, Thouminet, où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Et vous, Gaudmer, Portelance, Cadieux ? Et les autres, tous les autres ?
Les Sœurs Grises sont en prière, les Pères vous attendent depuis des heures, depuis des jours. Le gouffre bâille, il vous a pris ; la glace sournoise s’est ouverte ; le sauvage païen vous haïssait, vous passiez avec votre traîne et vos chiens, derrière un bouquet de saules un coup de feu est parti. Votre sang souille la pureté de la neige.
Et toi, Alexis Reynaud, ô mon frère, qui, comme moi, vins à la lumière dans ce Languedoc, fils du soleil et de la vigne, le Languedoc des garrigues caillouteuses où le thym croît, des oliviers à têtes rondes, des marais où paissent les taureaux noirs et les cavales blanches.
C’est bien la volonté divine qui t’a pris par la main et t’a conduit du Grau, qui vit partir le Saint-Roi-Chevalier, jusqu’aux rivages polaires. Dans la grande nuit de huit mois, tu n’as pas regretté les splendeurs nocturnes où passaient, avec l’errance des étoiles, toutes les légendes de notre vieille terre.
Et quand elles apparaissaient, tu reconnaissais le chemin de Saint-Jacques, l’Ourse et le Berger. Mais ici on ne les nommait plus dans la langue sonore, c’était Yedhtaa-thèn, Denintchyé, Thèn-Thosé.
Vigneron, Dieu t’avait promis aux célestes vendanges.
… On lui avait offert la prêtrise, il avait renoncé ; pareil à saint François d’Assise, il s’estimait indigne, il voulait servir simplement, se dévouer jusqu’à la mort.
Elle vint.
Mgr Clut lui avait donné la mission de conduire une orpheline aux Sœurs Grises du lac La Biche.
Il remontait l’Athabaska, où les rapides succèdent aux rapides. Un Iroquois guidait sa route. Mais devant la violence des eaux, il voulut couper à travers la forêt pour arriver plus tôt, plus vite.
Plus tôt ! Plus vite !
… On trouva, dans une clairière, des cendres, des tisons et des ossements calcinés, et, sous du sable, des débris humains.
Le sauvage avait abattu l’homme au moment où il priait. Il avait fait un abominable festin, puis il était parti, emmenant la fillette que nul ne revit jamais.
Sous une croix de bois, Mgr Clut a écrit lui-même :
R.I.P.
In memoria æterna erit justus
F. Alexis o. m. i.
Elle serait longue l’histoire de ces âmes naïves ; du reste mon ami le Père Duchaussois l’a contée avec amour[56] mais il me semble que j’aurais un remords d’oublier une des plus belles figures de la mystique de notre temps.
[56] Apôtres inconnus, 1 vol. Œuvres des missions, 75, rue de l’Assomption, Paris.
La vie du Frère Leriche qui semble échappée de la plume de ce Jacques de Voragines qui a bercé nos cœurs aux pures harmonies de la Légende dorée, feuillet du moyen âge arraché aux livres d’heures des monastères.
Il était pareil à ce jongleur, qui, pour honorer Notre Dame, avait repris ses hardes de baladin et chantait et dansait devant son Image.
A ceux qui s’indignaient, le Prieur disait :
— Heureux les simples, ils verront Dieu !
Et l’on vit Madame la Vierge ouvrir ses bras, se pencher et couvrir de son manteau le corps chétif du pauvre hère.
Frère Leriche était saltimbanque ; il allait de foire en marché, de la Mayenne à la Vendée, amusant les badauds par ses tours et ses jongleries, et gagnant à ce jeu une maigre pitance.
Souvent, le ventre creux, il s’endormait aux bords des routes, à la belle étoile « auberge du Bon Dieu qui fait toujours crédit ».
Un jour de misère trop dure, le froid, la pluie, la faim, le chassent à travers les rues où rien ne vit. Une église est là, accueillante. Il entre. L’ombre chaude l’enveloppe et le prend, peu à peu, il voit des lumières et des fidèles attentifs. Une voix monte qui parle de la Vierge. Ces mots qui se suivent font une musique très douce à son oreille. C’est un ronron qui chante, berce, console, et la vie qu’il mène lui fait soudain horreur. Il veut se reprendre, se racheter, se sacrifier totalement.
Mgr Grandin passe, qui demande des serviteurs. Il dit :
— N’oubliez pas que votre vie ne sera qu’un long martyre.
Et le saltimbanque va trouver celui qui se fit une gloire d’être « l’évêque pouilleux ».
— Monseigneur, si vous daignez me prendre, je suis prêt.
Le Prélat hésite, ce Leriche n’est pas un riche cadeau à faire aux missions. Faire un Oblat de ce coureur d’aventures qui, par vaux et chemins, amuse la canaille qui gouaille et rit ?
Un matin, l’Evêque, songeur, suit la route qui mène d’Aron à Mayenne. Un couple devant lui l’intrigue : un grand diable dégingandé qui conduit avec précaution une bonne vieille en coiffe paysanne, cassée par l’âge et les douleurs.
C’était notre homme qui menait sa mère à l’hospice, l’entourant de soins minutieux et de puériles tendresses.
— S’il y a place en ce cœur pour la pitié filiale on peut compter sur lui !
Et l’Evêque emmena le baladin.
Trente-deux ans après, Mgr Grandin prononçait ces mots devant la tombe où le corps qui avait tant souffert allait dormir son dernier somme :
— C’était un missionnaire très humble… le modèle des pénitents… un homme de Foi.
Ainsi vivent, ainsi meurent aux missions du Grand Nord les apôtres inconnus.
Ils ont à jamais renoncé aux biens de ce monde, rien ne les signale à l’attention de ceux qui passent, mais Dieu les voit, ce sont des ombres qui se meuvent à l’ombre de la Croix.
— Le traîneau est prêt.
— Merci, Tomkins.
Allons, il faut partir. Sur le perron de bois de l’évêché baigné de lune, les Pères sont rangés, visages rudes aux yeux si clairs !
Mgr Grouard est là et mes amis, tous mes amis.
Qui dira l’angoisse du dernier serrement de main ?
Il y a quelques minutes, c’était la causerie familière autour du poêle qui ronflait. Des Indiens frileux se chauffaient dans la salle commune, et nous, nous évoquions le Vieux Pays si cher à nos pensées.
Nos cœurs vibraient d’un même amour. Il faisait si bon moralement aux côtés de ces hommes.
Mais voici qu’une porte s’ouvre. Tomkins, le métis, lance :
— Le traîneau est prêt.
On se lève aussitôt et c’est le brouhaha du départ, les souhaits, les recommandations ultimes.
— Vous n’aurez pas chaud sur le lac.
Un frère annonce :
— 42° sous zéro.
— Bah ! J’en ai vu bien d’autres !
Puis un silence, un silence peuplé de mille choses fragiles. Des fils ténus se multiplient, se tendent, se croisent, une trame se forme qui demain, ce soir déjà, sera tissée de souvenirs.
Au revoir ou adieu, qui peut prévoir cela ?
L’Evêque, casqué de castor, enveloppé dans une houppelande, est debout. Sa barbe de patriarche met une tache claire dans la nuit. Il m’a semblé qu’elle tremblait un peu. Le vent, peut-être ?
Le traîneau vire. Sur les marches, les Pères et Monseigneur forment un groupe immobile.
— Allons, adieu, adieu, vous tous.
Un ordre. Les grelots tintent. Nous glissons lentement dans l’ombre.
C’est la descente sur Grouard. La cité sommeille. Je me retourne. Voici, sur la colline, la chapelle, l’hôpital, la mission. Sur la pente, plus bas, l’étroit cimetière, les tertres neigeux et les croix.
Devant moi, le petit lac des Esclaves est bleu de lune.
Le vent souffle, emportant mes pensées.
Je vais partir, je suis parti, je laisse derrière moi des cœurs fidèles. Combien de fois suis-je parti ainsi ?
La sirène des paquebots gémit et pleure, la mer drosse le chalutier, le rivage s’estompe, des arbres, une ligne floue qui s’affaisse et disparaît et l’on est seul entre le ciel et l’eau.
Regrets d’Islande, nuit profonde qui agrandissait le ciel groënlandais, adieux sobres au pays de l’or.
— Bon voyage, garçon. Evitez les mauvaises rencontres.
Et déjà la porte du bar est close. La nappe de lumière crue s’est repliée brusquement.
Je suis seul dans le gel et dans les ténèbres, comme à présent. Mais, ce soir, plus que jamais mon âme est en peine, pourquoi ?
N’ai-je pas maintes fois abandonné bien des désirs aux ronces des chemins comme les brebis des lambeaux de leur laine ? Combien d’images se sont effacées de mon cœur que j’avais gardées longtemps au fond de mes prunelles ?
Ces boqueteaux de sapins, ces maigres saules, vision accoutumée. Je les ai déjà vus sur les pistes de Last Chance. Cette eau figée, est-ce la Porcupine, la Rivière Plumée, le Yukon qui miroitent, prisonniers des glaces pour huit mois ?
Les douze soleils passeront. Après le soleil où le soleil est sous la terre, viendra le soleil où les chiens se chauffent et le soleil de la débâcle et le soleil où les oiseaux muent.
Ainsi revient au cœur des hommes le printemps qu’on croyait disparu.
Courage ! Ceux que je viens de quitter sont des porteurs d’espérance ; les magnifiques serviteurs, les Oblats, d’une cause sainte, sublimisée par le renoncement, l’abnégation et la souffrance.
Ils ont les paroles pour apaiser, pour instruire, pour consoler. Ils ont des mots pour toutes les défaillances ; ils endorment la douleur, fille de la solitude et mère des orages de la passion.
Tout ce qui souffre, tout ce qui chancelle, tout ce qui est irrésolu vient vers eux et la guérison, l’apaisement, la volonté se lèvent à l’appel de leur voix. Eternel miracle de Lazare surgissant du tombeau !
A quel prix achètent-ils la conversion des âmes ? Depuis des mois, des années, ils se consacrent à l’œuvre du manque-de-tout, usant leur vie dans une lutte quotidienne contre le froid, la solitude, la faim, hydre tricéphale de cette terre nordique où ils ont fixé volontairement leur destin.
Je ne raconte pas leur histoire, mais devant le mirage de la nuit polaire qui se déroule à mes yeux, j’évoque l’Epopée blanche dont ils ont écrit tous les chants, des bords du Saint-Laurent jusqu’aux extrêmes limites du monde.
A cette heure, Mgr Turquetil, là-haut, dans vos steppes stériles, que faites-vous ? Où êtes-vous ?
C’est une symphonie merveilleuse, unique dans notre siècle dévorant.
A l’heure où les humains se ruent à la conquête de buts matériels, pour la satisfaction de leurs appétits, je veux simplement dire qu’il y a des prêtres qui font le sacrifice absolu, le complet abandon d’eux-mêmes pour ramener à Dieu ceux qui sont les plus déshérités, les plus pauvres, les plus abandonnés parmi les fils d’Adam.
Ce qu’ils font ici, leurs frères l’accomplissent aux antipodes. Le vicariat de Keewatin a sa réplique dans le Basutoland. La préfecture de Pilcomayo, en Bolivie, naît à la vie apostolique, cependant que la Cimbébasie offre ses six cent mille kilomètres carrés au zèle des Oblats et Ceylan berce leur foi au rythme de ses palmes[57].
[57] Exactement : les vicariats apostoliques du Nord-Américain, Mackenzie, Yukon, Athabaska, Keewatin et Baie d’Hudson ; ceux de l’Afrique australe, du Basutoland, du Natal, du Transvaal, de Kimberley, de la Cimbébasie ; les diocèses florissants de Colombo et de Jaffna, dans les Indes, et la Préfecture de Pilcomayo, au centre de l’Amérique du Sud.
D’autres diront la gloire de ces hommes.
Je ne suis qu’un pèlerin qui vint s’asseoir, un jour, à leur foyer, mais mon âme a gardé l’empreinte de leur âme et mon cœur les vibrations de leur cœur.
Le traîneau glisse, je passe dans la féerie blanche, léger comme un souvenir, ouaté de neige comme ces fantômes qui viennent aux veillées de Noël dans les contes populaires.
Oui, c’est une symphonie, dont tous les tons s’harmonisent, que m’apportent les vents descendus du Septentrion.
Symphonie grise comme les petites Sœurs penchées sur les pires calamités.
Symphonie noire comme la robe des Oblats qui, dans ses plis, porte la Rédemption et la promesse d’une vie éternelle.
Symphonie rouge comme le sang des Pères Fafard, Marchand, Rouvière, Le Roux, rouge comme le cœur du Christ, déchiré et saignant de la misère des hommes.
Symphonie blanche comme les lys de France, blanche comme votre pureté, Mère très chaste, qui effeuillez la rose mystique de votre cœur aimant aux plus généreux de vos fils.
« Vierge immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans votre foi, dans votre amour »[58], c’est votre manteau qui s’étend, ce soir, sur la plaine, donnant à ceux qui vous sont chers protection et miséricorde.
[58] Pie X.
Le salut du monde était en vous, vous nous l’avez donné. Toute grâce, toute charité vient de vous. C’est un don de Dieu et les « dons de Dieu sont sans repentance ».[59]
[59] Bossuet.
Vous êtes la lumière et la consolation, le refuge et l’espérance de tous ces pauvres Indiens que j’ai vus, à genoux, implorant avec une ferveur digne des premiers âges, la fin de leurs angoisses, de leurs périls et de leurs tentations.
Quel sort réservez-vous à ces tribus jadis innombrables ? Elles s’étiolent, elles s’anémient, elles meurent, peu à peu.
Que seront-elles demain ?
Les Oblats qui se dévouent pour elles, qui souffrent pour elles, qui donnent leur vie pour elles, savent que leur œuvre est périssable et cependant ils la poursuivent avec toute la force de leur apostolat.
Faut-il dire avec le poète :
Non, c’est une parole impie. Rien n’est inutile de ce qui touche à la gloire de Dieu.
A l’heure où nous sommes, plus que jamais, nous devons avoir une mystique. Les esprits du mal s’agitent, promettant aux crédules humains des jouissances immédiates, des satisfactions promptement réalisées — par quels moyens, Seigneur ?
Alors, pourquoi pas la mystique chrétienne, d’amour, de lumière et de paix ?
Un sifflet strident déchire la nuit. Sur la neige, il y a une longue traînée noire, dans le ciel des tourbillons de fumée.
Voici la civilisation qui s’avance. Une baraque de bois — halte et village — c’est Enilda.
Demain, je serai à Edmonton, demain il y aura une ville, des maisons, l’activité et les misères de la vie.
Le train part.
Mon traîneau est un point perdu dans la plaine, il s’efface bientôt.
Là-bas, au delà des monts, des lacs et des forêts, il y a des cœurs en prière qui, sous le signe de Marie, mère admirable, préparent les voies de Dieu.
O Pères, ma faiblesse se joint à votre isolement.
Toutes les tristesses de la terre, vous les avez dissipées par vos actes de foi.
En vérité, l’Agneau a racheté les brebis.
Sur la terre canadienne — si vieille et si jeune à la fois — l’esprit de sacrifice a passé ; je suis son vol, je vois ses ailes frémissantes dissiper les ombres de la nuit, et dans l’aube qui naît, le ciel s’ouvre aux béatitudes éternelles.
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée sont expulsés de France.
La Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (o. m. i.)
La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée (o. m. i.) a été fondée le 25 janvier 1816, à Aix-en-Provence, par Mgr de Mazenod, qui lui donna comme devise : Evangelizare pauperibus misit me. Il m’a envoyé évangéliser les pauvres. (Luc, IV, 18).
Le pape Léon XII approuva, le 17 février 1826, cette œuvre, disant : « Cette Société me plaît. Je sais le bien qu’elle a déjà fait. Je suis certain de ce qu’elle accomplira par la suite. Un bref d’éloges ne suffit pas : Non laudanda sed approbanda. »
Destinée à la France, bientôt elle déborde son cadre trop étroit et porte la parole du Christ jusqu’aux dernières marches du monde.
En 1841, Mgr Bourget, l’éminent évêque de Montréal, demande des Oblats pour le Canada. Et le rude sacrifice commence que rien n’arrêtera, de la Province de Québec à la Baie d’Hudson, des côtes du Labrador aux boucles du Mackenzie, de la Mer Glaciale à l’Océan Pacifique.
Les Oblats sont en Asie, à Colombo et à Jaffna ; en Afrique, au Natal, à Kimberley, au Zoulouland, en Cimbebasie, en Australie aussi et maintenant en Bolivie.
En France, jusqu’en 1904, ils furent les réalisateurs du Vœu National. Mgr Guibert leur confia la garde de la Basilique du Sacré-Cœur.
L’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l’Italie, la Belgique, ont leurs provinces apostoliques.
Aujourd’hui, plus de trois mille Oblats — prélats, prêtres ou simples frères coadjuteurs — accomplissent leur mission de charité sous le signe de Marie.
En un siècle, la Congrégation a donné à l’Eglise un cardinal (Mgr Guibert, archevêque de Paris) et 39 archevêques ou évêques.
Mgr de Mazenod. — Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, né à Aix le 1er août 1782. Ordonné prêtre le 21 décembre 1811, il déclina l’offre de Mgr Demandolx, évêque d’Amiens, qui voulait en faire son vicaire général, pour aller à Aix se « consacrer entièrement à la jeunesse et aux pauvres ».
Toute la population accourait le dimanche pour l’entendre prêcher en provençal.
En 1816, il fonda la Congrégation des Oblats. Le 21 mai 1861, le vénérable prélat mourait, ayant vu son œuvre se développer au delà de toute espérance.
Abbé Thibault. — L’abbé Jean-Baptiste Thibault, un des douze prêtres séculiers qui vinrent évangéliser l’Ouest canadien. Il consacra aux missions 39 ans de sa vie sacerdotale. Ses onze compagnons s’appelaient : Sévère Dumoulin, Destroismaisons, Hayer, Boucher, Poiré, Demers, Belcourt, Mayraud, Darreau, Laflèche et Bourassa.
Quatre pères jésuites les avaient devancés au XVIIIe siècle, de 1732 à 1751, mais ils ne purent dépasser le Fort Saint-Charles (sur le lac des Bois) et le Fort la Reine (Portage La Prairie).
Saluons la mémoire du Père Messager et du Père Aulneau, tués par les Sioux à l’Ile aux Massacres.
L’Ouest ne revit les « robes noires » que soixante-sept ans après le départ du dernier jésuite.
La « première » fut celle de Mgr Norbert Provencher. Mgr Provencher avait abordé à la Rivière Rouge le 14 juillet 1818. Là devaient s’élever Saint Boniface et Winnipeg.
Le R. P. Aubert et le R. P. Taché furent les deux premiers Oblats qui débarquèrent à Saint-Boniface (1845).
Mgr Laflèche. — Louis-François Laflèche partit pour la Rivière Rouge sur un canot d’écorce. Douze ans il évangélisa le Nord-Ouest, mais terrassé par la maladie il dut rentrer à Québec. Le 21 février 1867, il fut nommé évêque d’Anthédon. Il était tout zèle et toute charité, allant toujours à pied ; à sa mort, on ne trouva pas cent francs dans « son palais épiscopal » (1818-1898).
Mgr Taché. — Alexandre-Antonin Taché, 1823-1894, « l’évêque d’action », qui créa les diocèses, les vicariats apostoliques. C’est lui qui ouvrit à l’immigration canadienne française les immenses terres de l’Ouest.
Patriote passionné, c’est grâce à lui que le Canada conserva l’Ouest, au moment où il fallait peu de chose pour qu’il passât sous la domination américaine.
Il sauva l’Œuvre des Missions sur le point de sombrer dans la désespérance. Ce fut un Oblat magnifique d’obéissance et de volonté.
Mgr Faraud. — Henri-Joseph Faraud, né à Gigondes, dans le Vaucluse (1823-1890).
Enfant, c’était le pire garnement qui fût, intelligent et batailleur, il affligeait sa mère qui annonça : « Tu ne feras jamais rien de bon. » Un jour, en désespoir de cause, elle le conduisit au pied de la Vierge, disant : « Bonne mère, je vous le donne, moi je ne peux rien en faire. »
Le miracle s’accomplit, l’indiscipliné devint le plus studieux des enfants, il entra bientôt au juniorat des Oblats, à Notre-Dame des Lumières : le 8 novembre 1846, il arrivait au Canada.
Il parcourut d’abord la Prairie, puis il monta au Nord, pionnier de son futur vicariat.
D’une force herculéenne, il faisait l’admiration des Indiens, qui trouvaient auprès de lui un père dévoué, un consolateur aimant, un ami toujours fidèle.
Le 13 mai 1862, il recevait le titre d’évêque d’Anemour et de vicaire apostolique d’Athabaska-Mackenzie. Il prit à Saint Martin sa devise : « Non recuso laborem, je ne refuse pas le travail. »
Mgr Grandin. — Vital-Justin Grandin, né à Saint-Pierre-sur-Orthe (Mayenne), le 8 février 1829. Il fut « l’évêque pouilleux », celui qui fit l’abandon absolu de soi-même, qui, brisé par le mal, marchait quand même, trouvant dans sa souffrance même une façon de louanger le Seigneur.
Missionnaire accompli, administrateur sans reproche, il fut l’âme des missions du Grand Nord.
En 1855, il assista le Père Faraud à la Nativité, il apprit le montagnais sur les bords de la rivière au Sel, en juillet 1858 il reçut le redoutable honneur de l’épiscopat : évêque de Satala, in partibus infidelium. En 1872, il devenait le premier évêque de Saint-Albert, où il mourut le 3 juin 1902.
Mgr Clut. — Isidore Clut, « l’évêque de peine », né le 11 février 1832, à Saint-Rambert-de-Rhône. Le 8 décembre 1854, il est Oblat, le 20 décembre 1857 il est prêtre, le 7 octobre 1858 il arrive au bord du lac Athabaska, neuf ans après c’est là qu’il reçoit la consécration épiscopale (15 août 1867).
Ce fut lui qui tenta avec le Père Lecorre l’évangélisation du Yukon et de l’Alaska. Pour ce faire ils descendirent le Mackenzie et de la pointe du delta se dirigèrent à pied vers les montagnes Rocheuses ; transportant leur canot ils atteignirent enfin la Porcupine, qu’ils suivirent jusqu’au Yukon.
Il passa d’horribles nuits sous le cercle polaire, mais il portait en lui le soleil de la Foi. Il aima ses chers sauvages avec passion. Il mourut ayant accompli son œuvre, le 31 juillet 1903, à la mission de Saint-Bernard, sur le bord du Petit Lac des Esclaves.
R. P. Eynard. — Germain Eynard, 1824-1873. Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, il abandonna les hautes distinctions laïques pour se réfugier en Dieu. En 1853, il est Oblat, en 1858 il arrive à Fort Résolution.
Pendant quinze ans, voyageur infatigable, il desservit les missions du Grand Lac des Esclaves, humble parmi les plus humbles. « Je n’ai connu de religieux plus parfait, disait Mgr Grandin. »
R. P. Grollier. — Pierre-Henri Grollier, né à Montpellier le 30 mars 1826. Il prononça ses vœux perpétuels le 15 octobre 1848, à Notre-Dame de l’Osier ; il fut ordonné à Marseille le 29 juin 1851.
Placé d’abord à Notre-Dame de la Garde, il reçut bientôt son obédience pour le Nord-Ouest (en janvier 1852). Départ en février par Liverpool, avec Mgr Taché, qui venait d’être sacré. On l’envoya d’abord à la Mission de la Nativité (Lac Athabaska), avec le futur Mgr Faraud, qui l’attendait.
Il fonda successivement les missions suivantes : Notre-Dame des Sept Douleurs (Fond du lac Athabaska), chez les Mangeurs de Caribous, en septembre 1853 : Saint-Michel (Rae) chez les Plats-côtés-de-chiens : Grosse Ile ou Wrigley ; Sacré-Cœur (Fort Simpson) ; Sainte-Thérèse (Fort Norman) chez les Esclaves ; Notre-Dame de Bonne-Espérance (Good Hope), en 1859, chez les Peaux-de-lièvres ; Saint-Nom de Marie (Peel’s River, aujourd’hui Arctic Red River) chez les Loucheux et de là il essaya de convertir les Esquimaux.
Il est mort le 4 juin 1864.
C’était une âme ardente et forte qu’une Foi passionnée animait. Il fut le premier Oblat qui mourut à la peine, la terre canadienne garde sa dépouille périssable, mais son souvenir est vivant dans toutes les mémoires.
Mgr Grouard. — Emile Grouard est né le 2 février 1840, à Brûlon, dans le pays manceau.
Petit cousin de Mgr Grandin, il le suivit au Canada. Il avait vingt ans, depuis il ne s’est jamais arrêté. Mgr Taché l’ordonna prêtre le 3 mai 1862. Le 8 juin, il partait pour le lac Athabaska, le 2 août il arrivait à la Nativité. Le 18 octobre, il recevait les bulles le nommant évêque titulaire d’Ibora et vicaire apostolique d’Athabaska-Mackenzie.
Son livre Soixante ans d’apostolat est la plus vivante expression de ce que peut faire la volonté d’un homme qui a voué sa vie à la gloire de Dieu.
Mgr Grouard est l’âme de cette terre nord-canadienne qu’il a parcourue en tous sens, défrichant les forêts, traçant des routes, amenant sur les fleuves le premier bateau à vapeur, faisant tourner le premier moulin.
Tous les Indiens sont ses enfants. Ils le vénèrent, ils l’admirent. Ils l’appellent : Yaltri-bé-da-ra-shlan, le priant à la belle barbe. (Mot à mot : yaltri, le priant ; bé, son ; da, menton ; ra, poil ; shlan, il y en a beaucoup.)
A quatre-vingt-cinq ans, je l’ai vu aussi intrépide, aussi ardent que jamais, parcourant son immense diocèse en raquettes, en traîneau, sur son cheval « Bidet », ou en canot, il est partout et partout il apporte avec lui les mots qui consolent et l’espérance qui élève les cœurs.
Mgr Pascal. — Albert Pascal, 1848-1920, né à Saint-Genest-de-Beauzon (Ardèche). Mgr Clut passait, il le suivit.
C’est lui qui resta de 1875 à 1881 à Notre-Dame des Sept Douleurs seul au milieu des Indiens aux mœurs les plus dissolues, c’est lui qui a écrit : « La solitude sera toujours ici, mais je chante, je chante. »
Le démon des espaces vides le hantait. « Un jour, dit-il, l’isolement dans lequel j’étais plongé, se fit sentir d’une manière écrasante. Tout devint si sombre pour moi, que l’âme pleine d’angoisse et n’en pouvant plus, j’allai me prosterner dans la petite chapelle. Là, la tête appuyée sur l’autel, absolument seul avec Jésus vivant pour moi dans cette étroite prison, je lui parlai comme un ami à son ami ; je lui confiai mes troubles, mes lassitudes, mes tristesses. »
Mais l’accablement ne dure pas. Dieu lui apporte ses consolations et l’Oblat se relève « fort comme un lion ».
Mgr Pascal fut le premier évêque de Prince Albert.
Mgr Legal. — Emile-Joseph Legal, né à Saint-Jean-de-Boiseau, diocèse de Nantes, le 9 octobre 1849, ordonné prêtre le 29 juin 1874, il fait son oblation le 24 septembre 1880.
Il a été sacré évêque titulaire de Pogla et coadjuteur de Mgr Grandin le 17 juin 1897 ; il est devenu évêque de Saint-Albert le 3 juin 1902 et archevêque d’Edmonton le 30 novembre 1912. Il est mort dans cette ville le 10 mars 1920.
Dans son testament, il a écrit : « N’ayant personnellement aucune somme d’argent à ma disposition, je ne puis rien laisser pour faire célébrer des messes pour le repos de mon âme. Je suis reconnaissant envers la congrégation des Oblats de Marie Immaculée qui m’a accueilli dans son sein. »
Paroles dignes d’un croyant à la foi toujours vibrante et d’un homme de bien qui a laissé un souvenir dans la mémoire des hommes.
R. P. Gascon. — Zéphyrin Gascon, 1824-1914, fils de cette race canadienne française, si belle, si forte, si grande par son dévouement et sa foi, il se leva à l’appel de Mgr Taché et dès le 12 août 1859 il était au Grand Lac des Esclaves. Le premier il apporta la parole du Christ sur les rives de la rivière aux Liards. L’histoire de sa vie est une épopée magnifique. Rien n’égale la splendeur de ses courses à travers ces terres désolées, disputant les âmes à l’hérésie, soutenant l’espérance chancelante des néophytes indiens.
Les Dénés voyant sa détresse et « son manque de tout » le nommaient Yalbri-Dougé, le priant de misère. Rongé de vermine, ne mangeant pas à sa faim, les yeux rougis par la neige, les jarrets brisés par le mal des raquettes, il marche en priant Dieu, en offrant au Seigneur ses souffrances, il avait la ténacité de saint Paul, le zèle de saint François Xavier.
La veille de sa mort — à 87 ans — 3 janvier 1914, le chapelet glissa de ses doigts impuissants.
Mgr Joussard. — Célestin Joussard est né le 2 octobre 1871, à Saint-Michel-de-Geoirs, dans le diocèse de Grenoble. C’est encore une recrue de Mgr Clut, qui l’ordonna prêtre à Autun et l’emmena.
Du lac des Esclaves au Fort Smith, du Fort Smith au Fort Vermillion, sur la rivière la Paix, il a, selon la devise des Oblats, « évangélisé les pauvres » et donné tout son cœur aux Montagnais, aux Cris, aux Castors.
Le 11 mai 1909, l’Oblat était consacré évêque d’Arcadiopolis et coadjuteur de Mgr Grouard. La nouvelle lui parvint au temps de la fenaison. Le religieux rentra sa récolte et se hâta vers Vancouver. Comme ses frères, il ne possédait rien, on lui prêta une soutane violette et Mgr Dontenwill un anneau.
Après le sacre, il partit pour Québec et traversa en « char » express la prairie immense qu’il avait parcourue vingt-sept ans auparavant, aux pas lents des bœufs.
R. P. Ducot. — Georges Ducot quitta les terres riches du Bordelais pour les terres désolées du Grand Nord Canadien. Le 14 septembre 1875, il arrivait à Fort Good Hope. Il y passa l’hiver, puis il partit pour Fort Norman. Il évangélisa les Flancs-de-chiens. Comme Mgr Grandin, comme Mgr Breynat, comme tant d’autres parmi ses frères, il connut la longue misère de la solitude et les angoisses de la faim, il s’égara sur le grand lac de l’Ours, mangeant des chiens, dévorant des chandelles de suif de renne, c’était Pâques et l’Oblat puisant dans son âme un dernier rayon, chanta l’Alleluia de la Résurrection.
Mgr Charlebois. — Ovide Charlebois est né à Oka (Lac des Deux Montagnes), diocèse de Montréal, le 12 février 1862 ; après avoir passé six ans au Collège de l’Assomption, a fait son noviciat, à Lachine, en 1882-1883, il est passé ensuite — 17 août 1883 — au Scolasticat d’Ottawa, où il a prononcé ses vœux perpétuels le 15 août 1884. Ordonné prêtre à Ottawa, le 17 juillet 1887, il a reçu son obédience pour le vicariat de la Saskatchewan : Mission de Cumberland (juillet 1887). Nommé évêque titulaire de Bérénice et vicaire apostolique du Keewatin le 29 août 1910, il fut sacré à l’Assomption, par Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, le 30 novembre de la même année.
Mgr Breynat. — Gabriel Breynat est né à Saint-Vallier-sur-Rhône, le 6 octobre 1867.
Devenu Oblat, Mgr Grouard l’ordonna prêtre (21 février 1892). Deux mois après, il traversait l’Océan. A la mi-septembre, il arrivait à Fond-du-Lac. Il resta neuf ans parmi les Mangeurs de Caribous : nommé vicaire apostolique du Mackenzie, il fut l’apôtre nomade, le pasteur errant qui a donné son cœur à ses brebis.
C’est une âme forte qui porte en elle la sérénité de Dieu.
Mgr Turquetil. — Arsène-Louis-Eugène Turquetil, est né le 3 juin 1876, à Reviers, diocèse de Bayeux. Après avoir fait ses études secondaires au petit séminaire de Villiers-le-Sec et commencé ses études philosophiques au grand séminaire de Bayeux, il est entré chez les Oblats, à Angers, le 7 septembre 1896. Son noviciat terminé, il est passé au scolasticat de Liége, où il a fait son Oblation perpétuelle le 15 août 1899. Ordonné prêtre (à Namur) le 23 décembre 1899, il a reçu son obédience pour le vicariat de la Saskatchewan en août 1900, et nous le trouvons au lac Caribou, dès le 8 septembre de la même année. Le 8 décembre 1911, il prend la direction de la nouvelle Mission esquimaude de Chesterfield Inlet. Et le 6 avril 1925, il est nommé par la Sacrée Congrégation de la Propagande, supérieur ecclésiastique (avec les pouvoirs d’un Préfet apostolique) de la Mission de la Baie d’Hudson. Cette mission ayant été érigée en Préfecture, par bref apostolique du 15 juillet 1925, Mgr Turquetil, par Décret de la S. C. de la Propagande, est devenu à la même date Préfet apostolique de la Baie d’Hudson.
Le 21 juin 1925, à la Basilique de Saint-Pierre, à Rome, selon le rite habituel, ont été béatifiés les bienheureux Jean de Brébœuf, Gabriel Lalemand, Antoine Daniel, Charles Garnier, Noël Chabanel, Isaac Jogues, René Goupil, Jean de la Lande, évangélisateurs de la Compagnie de Jésus, martyrisés en Canada.
Du sang des martyrs a germé la moisson.
Cali-malia : colin maillard. Chicoteux : tracassier. Avoir des chimères : idées noires, chagrins, inquiétudes.
(Expressions employées par les Coureurs-des-bois, les « voyageurs-des-pays-d’en-haut », que les métis ont conservées.)

Pages. | |
| Liminaire | |
| Lettre de S. E. le Cardinal Dubois | |
| Lettre de S. E. le Cardinal van Rossum | |
| La croix de Dieu, la croix des hommes | |
| Ceux qui préparent la moisson | |
| Vers l’Ouest | |
| La course du flambeau | |
| La chanson du pays | |
| Misère ! | |
| Dans la prairie | |
| Natoya Nikowan, l’homme divin | |
| « Je me souviens » | |
| L’homme-au-bon-cœur | |
| Le bon Samaritain | |
| De l’Océan à l’Océan | |
| La chanson du travail | |
| Un souvenir parmi mes souvenirs | |
| Solitude | |
| L’horrible nuit | |
| La mort du sage | |
| Hoc fac et vives | |
| L’évêque du vent | |
| Au cœur de la tempête | |
| « Jamais plus » | |
| Le sang des martyrs | |
| Sous une tente en peau de buffle | |
| L’évêque errant | |
| Pour la première fois | |
| Rose de France | |
| Elles étaient quatre | |
| A l’ombre de la Croix | |
| Sous le signe de la Vierge | |
| Notes et références | |
| Bibliographie | |
| Carte ecclésiastique du Nord-Ouest Canadien. | |
FIN
ACHEVÉ D’IMPRIMER
PAR
L’IMPRIMERIE RAMLOT ET Cie
52, AVENUE DU MAINE, 52
PARIS
POUR J. FERENCZI ET FILS
ÉDITEUR
LE 20 FÉVRIER 1926.
Œuvres de Louis-Frédéric Rouquette
LES ROMANS DE MA VIE ERRANTE
LE GRAND SILENCE BLANC
Roman vécu d’Alaska
LES OISEAUX DE TEMPÊTE
Roman vécu des mers australes
LA BÊTE ERRANTE
Roman vécu du Grand Nord Canadien
L’ILE D’ENFER
Roman vécu d’Islande
UN CONTE BLEU
CHÈRE PETITE CHOSE
CHEZ J. FERENCZI & FILS
9, Rue Antoine-Chantin, 9 — PARIS (14e)
PARIS — IMP. RAMLOT ET Cie, 52, AVENUE DU MAINE — 26