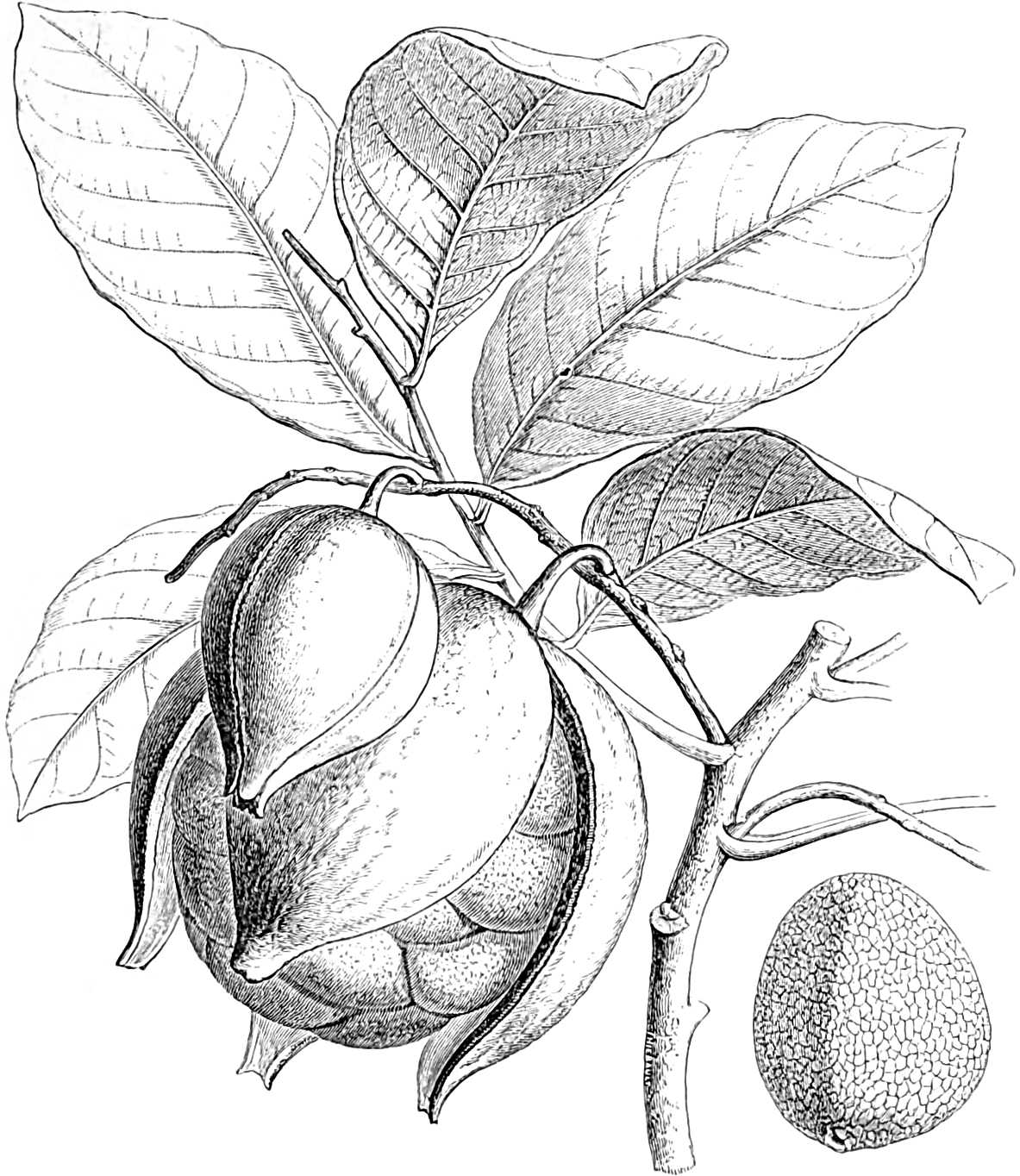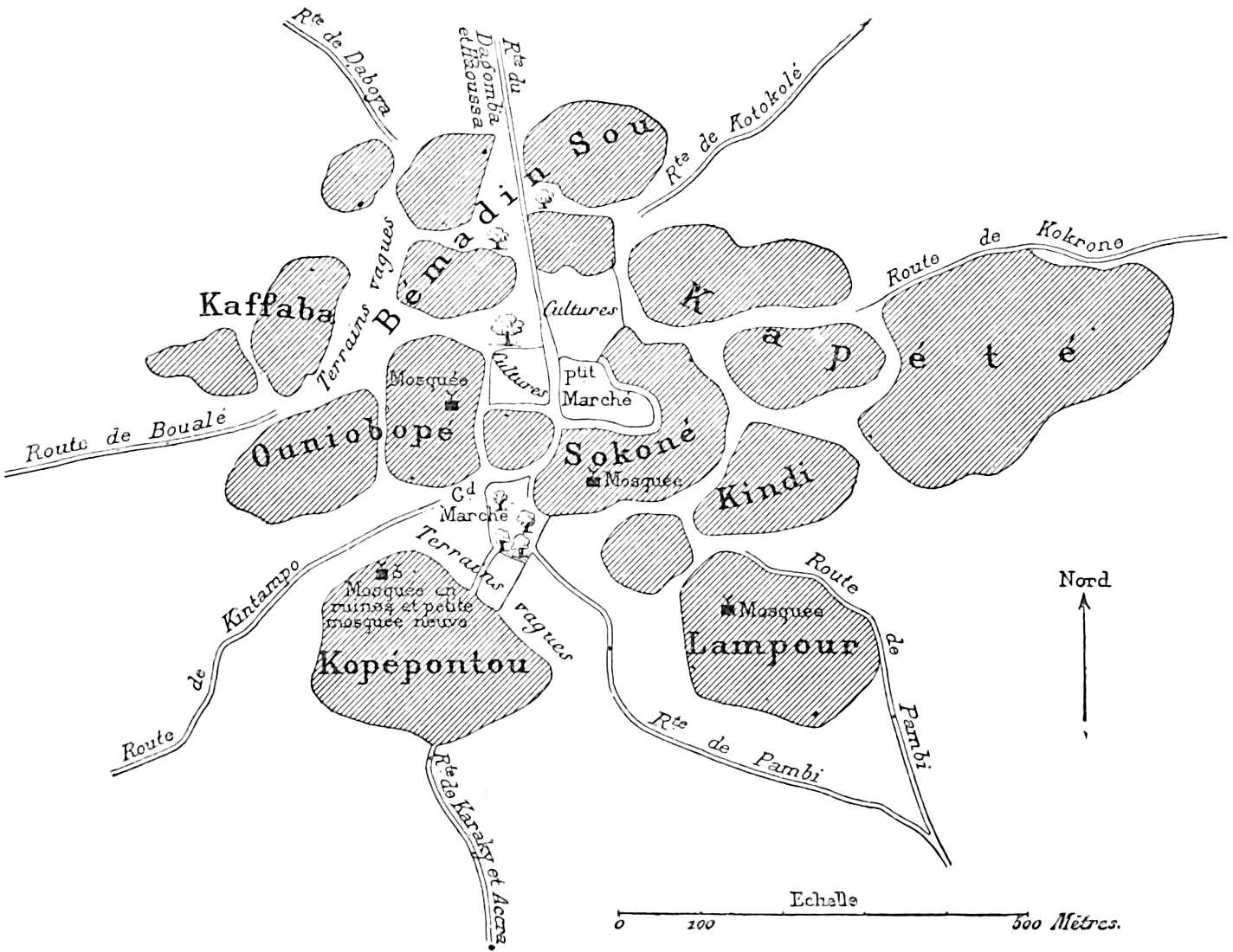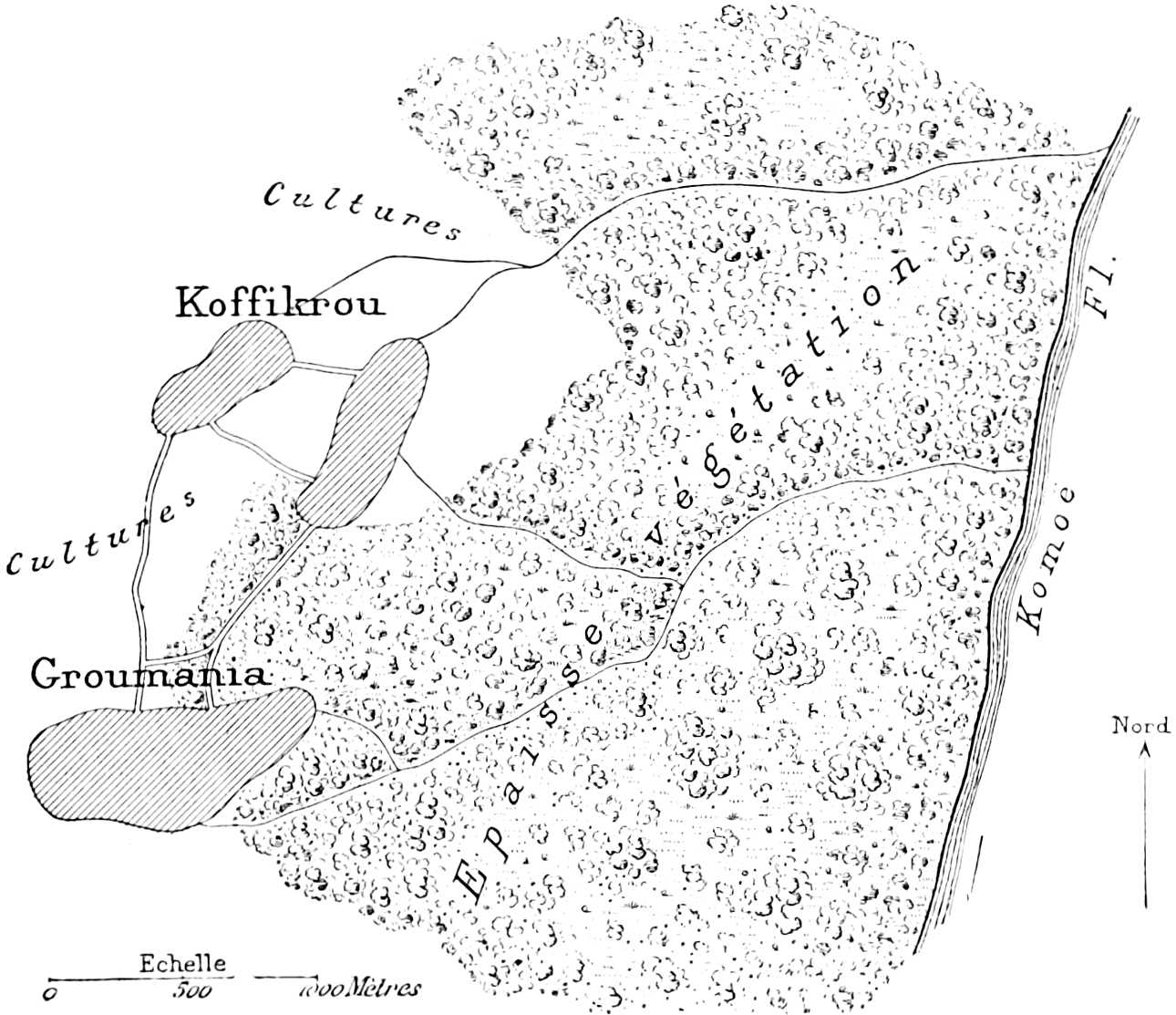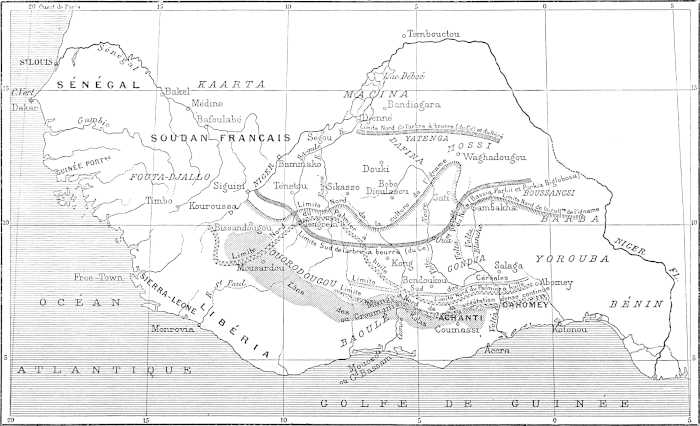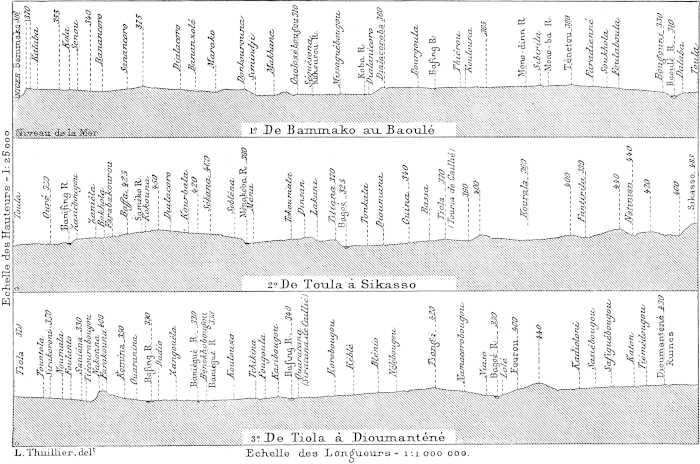On peut cliquer sur les cartes et croquis pour les agrandir.
DU NIGER
AU
GOLFE DE
GUINÉE
PAR LE PAYS DE KONG ET LE MOSSI
22062. —
PARIS, IMPRIMERIE LAHURE
9, rue de Fleurus, 9
DU NIGER
AU
GOLFE DE
GUINÉE
PAR LE PAYS DE KONG ET LE
MOSSI
PAR
LE CAPITAINE
BINGER
(1887-1889)
OUVRAGE CONTENANT
UNE CARTE
D’ENSEMBLE, DE NOMBREUX CROQUIS DE DÉTAIL
ET CENT SOIXANTE-SEIZE GRAVURES SUR BOIS
D’APRÈS LES DESSINS DE RIOU
TOME SECOND
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE
ET Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
1892
Droits de traduction et de reproduction
réservés.
[1]DU NIGER
AU GOLFE DE
GUINÉE
A TRAVERS LE PAYS DE KONG ET LE MOSSI
CHAPITRE X
En route pour le Gourounsi. — Baouér’a. — Arrivée à Koumoullou. — Habitations gourounga. — Une audience chez le naba de Koumoullou. — Une scène de carnage. — Deux fables mandé. — Une étape dans les hautes herbes. — Ruines de Zorogo. — Hostilité des habitants de Kalarokho. — Arrivée à Tiakané. — Chef de village peu commode. — Départ pour Kapouri. — Nous sommes dans une triste situation. — Attaque à main armée entre Kapouri et Pakhé. — Encore des exigences du chef de Mîdegou. — Abandonné par les guides. — Étape à Sidegou. — Arrivée sur les bords de la Volta Blanche. — Renseignements sur cette branche de la Volta. — Arrivée à Oual-Oualé. — Entrée dans le Mampoursi. — Une grave indisposition me retient à Oual-Oualé. — L’almamy, mon hôte et les habitants. — Encore le Gourounsi. — Population. — Religion. — Le Gambakha. — Population du Mampoursi. — Oual-Oualé et son commerce. — Dispositions pour le départ sur Salaga.
Mercredi 25 juillet 1888. — Toutes mes tentatives ayant échoué pour obtenir un guide ou un interprète, je pris la résolution de ne pas rester à Bouganiéna davantage et de me mettre en route sans plus tarder. Les trois femmes que Boukary naba m’a données sont toutes du Gourounsi ; malheureusement, elles ne comprennent ni le mandé ni le mossi, de sorte qu’elles ne pourront me rendre aucun service comme interprètes, et je me demande comment je ferai si je ne trouve pas des Mossi ou des Mandé sur ma route. L’imam et mon diatigué (hôte) m’accompagnent jusqu’à Tébéné (à 4 kilomètres de Bouganiéna).
Ce village était très important il y a une trentaine d’années, mais quand Bouganiéna a pris de l’extension, Tébéné s’est dépeuplé ; il a cependant conservé un marché, et les habitants de Bougouniéna et de la région s’y rendent assez volontiers pour faire ou vendre leurs provisions. Ce marché n’a qu’une importance tout à fait secondaire : il ne s’y vend[2] absolument que des denrées, un peu de coton et d’indigo, de la vaisselle et de la vannerie indigènes.
Comme Bouganiéna, Tébéné est principalement habité par des Mossi, et toutes les cases sont rondes, à toit de chaume conique.
A 4 kilomètres de là, on traverse Kébéro, le premier village à toit plat qui annonce les Gourounga. Cette région, avant l’expédition de Gandiari, semble avoir été très peuplée, car à quelques kilomètres plus loin on laisse à l’ouest un gros village presque abandonné, nommé Nabil Pakha, et avant d’entrer à Baouér’a on traverse encore deux grandes ruines qui constituaient le village de Borokho.
Arrivé à Baouér’a, Isaka me conduisit au groupe principal, habité par des Mossi musulmans ia-dér’a. Le plus ancien m’offrit l’hospitalité. Je fus fort bien accueilli dans ce village, plusieurs habitants vinrent m’apporter quelques provisions et des kolas. J’y ai trouvé une dizaine de Mandé originaires des environs de Djenné, établis ici provisoirement pour y faire le commerce de sel et d’esclaves avec la colonne Gandiari. Ils portent à cet effet assez régulièrement du sel et du mil sur Oua et en ramènent des captifs qui leur servent à se procurer du sel à Mani et un peu de mil sur les marchés des environs. Comme Bouganiéna, Baouér’a Mossi est un village de formation relativement récente. L’ancien Baouér’a (le village gourounga), actuellement en ruine, se trouve à 1500 mètres dans le sud, et ce n’est qu’à un kilomètre au delà de cette ruine que se tient le marché, à côté du village de Baoué (le chef gourounga). La population totale de ces trois groupes ne dépasse pas 600 à 800 habitants.
Jeudi 26. — Isaka, auquel j’ai fait un petit cadeau, veut bien m’accompagner jusqu’à Pouna et me recommander là-bas de la part des Mossi de Baouér’a. Deux ruines, Marakha et Narana, nous séparent de Pouna ; elles sont habitées chacune par deux ou trois vieillards, échappés aux gens de Gandiari.
A Pouna, qui est cependant un petit village, il règne aujourd’hui une certaine animation : c’est parce qu’il se trouve sur la route de Dakay, Oua-Loumbalé, sur laquelle existe un petit mouvement de porteurs de mil destiné à la colonne Gandiari. Une trentaine d’hommes de Dakay sont campés ici avec des charges de cette denrée, qu’ils vont échanger contre des captifs, soit à Kassana, soit à Oua-Loumbalé. Le chef de Pouna est un jeune homme très complaisant ; il réussit à m’en faire céder deux charges à raison de 500 cauries (environ 1 franc) le kilo. La culture d’une variété de petit maïs et du souna (petit mil hâtif), qui sont arrivés cependant à maturité, n’a pas été poussée avec assez de vigueur, de sorte que[3] la récolte de ces deux céréales n’a pas été assez abondante pour apporter une diminution dans le prix des denrées. Ce n’est guère que dans un mois, quand le gros maïs sera récolté, que le prix du mil, qui est très élevé par ici, va baisser.
A Pouna, comme dans la partie ouest du Gourounsi que j’ai traversée, les caïmans, qui vivent dans les marais, près des villages, sont l’objet d’une grande vénération ; il en est de même des iguanes (gueule tapée), qui circulent dans le village et dans les champs de maïs ; elles sont grasses et dodues et mesurent jusqu’à 2 mètres de longueur. Près de la case du chef il y en avait qui dormaient au soleil ; elles ne se dérangeaient même pas quand on les prenait en mains. Cet animal est presque domestiqué : jamais on ne le tue. Cette vénération pour l’iguane existe chez beaucoup de peuples noirs ; dans le temps, on m’a cité Séfé, gros village du Kaarta, où les iguanes sont très nombreuses et presque l’objet d’un culte. Leur faire même involontairement du mal, disent les noirs, attire les plus grands malheurs sur le village.
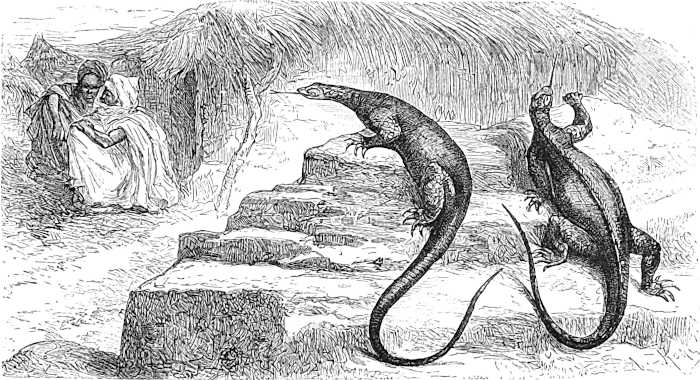
Iguanes dans le village.
Vendredi, 27. — Isaka étant retourné à Baouér’a, le chef de Pouna me donna un homme pour me conduire à Koumoullou.
La terre végétale est abondante ici, mais les villages sont actuellement à peu près déserts ; autrefois ils renfermaient une nombreuse population. Loukourou, Bala, Nitiané, Tapéo, qui se trouvent sur le chemin, n’ont conservé que quelques hommes. Toutes les femmes ont été prises par Gandiari ; aussi les abords des villages seuls, sur une profondeur d’une[4] centaine de mètres seulement, sont plantés de maïs et de sanio (petit mil tardif).
Depuis mon départ de Bouganiéna j’ai trouvé, à maintes reprises, des terrains quartzeux-ferrugineux, analogues aux terrains aurifères de Baporo. J’ignore s’ils renferment de l’or ; toujours est-il que les habitants n’en ont pas connaissance, et Isaka, que j’ai interrogé, m’a affirmé que dans toute cette région, qui lui est parfaitement connue, il n’a jamais entendu dire qu’on ait trouvé quelque part du métal précieux.
A notre approche de Nitiané, les hommes du village, au nombre d’une vingtaine, coururent sur nous en armes, en poussant leur cri de guerre. Les ânes, effrayés, au lieu de continuer à cheminer dans le sentier, entrèrent dans les maïs et y commirent de nombreux dégâts, ce qui augmenta encore la fureur des habitants. Au bout d’une demi-heure, les exhortations du guide de Pouna ramenèrent le calme et ils cessèrent de menacer de nous tirer dessus. Enfin ces forcenés finirent par rentrer dans leur village, et nous laissèrent passer. D’autres, sur les toits plats des cases, nous menaçaient de leurs flèches empoisonnées. J’eus beaucoup de peine à conserver mon monde sous la main et à empêcher un désastre. Cet incident retarda notre marche de près d’une heure, car nous étions perdus dans les maïs et les ruines ; aussi, pour éviter qu’une semblable scène ne se renouvelât, je crus prudent de contourner les cultures de Tapéo, ce qui nous fit arriver à Koumoullou dans l’après-midi seulement et par une pluie battante.
Bien longtemps avant de voir ce village, on aperçoit au loin, dominant la plaine alentour, un cône d’une trentaine de mètres de hauteur ; c’est le tas d’ordures de Koumoullou, qui s’élève au milieu des groupes de cases, comme pour attester de l’ancienneté de la création du village.
Koumoullou est un des rares villages gourounsi qui n’ait pas été mis à sac par Gandiari, son naba ayant, à l’approche de la colonne, envoyé un cadeau assez important en captifs et en bœufs à Naba Sanom. Ce dernier obtint de Gandiari qu’il épargnerait Koumoullou. Cette faveur ne s’étendit cependant pas aux autres villages de cette petite confédération, et ils furent tous détruits.
L’habitation du naba, qui se trouve à peu près au centre des groupes de cases qui forment le village, consiste en une agglomération de cases à argamasses communiquant entre elles souterrainement et par les toits. Elles sont construites sur le type de celles des villages de Ladio et de Diabéré, mais avec plus de soin. Le tout est entouré d’un mur en terre de 4 mètres de hauteur flanqué de tourelles creuses servant d’écuries, mais[5] ne pouvant être utilisées en aucune façon pour la défense. Les murs sont badigeonnés à la cendre et ont un aspect assez sévère ; on se croirait devant une propriété bien tenue. Malheureusement, l’intérieur est loin de répondre à l’extérieur. La cour n’est qu’un bourbier, elle sert de parc aux dix bœufs et aux quelques moutons. Les cases du rez-de-chaussée, comme dans tout le Gourounsi, sont plutôt des caves que des habitations. Elles dégagent une odeur nauséabonde, qui vous prend à la gorge dès qu’on y pénètre ; les chèvres, les poules y circulent librement. Les cases du premier seules peuvent, à l’occasion, être habitables pour un Européen.
Les autres habitations de Koumoullou ressemblent, comme type, aux constructions des Bobofing, seulement le groupe souterrain est surmonté de cases rondes recouvertes de toits coniques en paille.
Les cultures à proximité du village sont clôturées. On y a ménagé des chemins assez larges pour pouvoir circuler sans faire de dégâts.
En attendant qu’on me trouve une case, je m’installai sous un ficus qui tombe en ruine, et dont toutes les branches sont étayées avec soin ; mais, cet arbre étant sacré, on me fait tout de suite évacuer cet endroit. Personne ne doit y camper ou séjourner.
Comme le logement qu’on m’avait destiné était inhabitable, mes hommes et moi, nous nous installâmes sur les argamasses, en établissant tant bien que mal la tente pour nous mettre à l’abri de la pluie.
Dans l’intérieur de ces habitations règne la plus profonde obscurité ; ce sont plutôt des antres que des maisons. Il y circule des rats, des crabes, des lézards et d’autres animaux nuisibles, dont le voisinage n’est pas précisément attrayant, et l’odeur fétide qui se dégage de là dedans empêche de dormir.
Les punaises abondent dans les maisons en terre ; il est absolument impossible de s’en garantir, même avec une moustiquaire.
On est bien mieux et plus en sécurité en plein air ; mais il est souvent difficile de refuser l’hospitalité sans froisser ses hôtes, et bon gré mal gré il faut se laisser abriter.
Le naba, auquel je rendais visite dès que je fus sommairement installé, est le seul individu que j’aie vu vêtu. Son entourage porte, comme vêtements, des peaux de bœuf, de mouton ou de chèvre, d’autres n’ont que des lambeaux de peau en forme de tablier. Ce vêtement (si toutefois on peut lui donner ce nom) ne met pas à l’abri des intempéries, il ne cache la nudité qu’imparfaitement, son port est gênant, et, dès que l’homme doit se livrer à un travail quelconque, ou faire une marche, il lui faut s’en débarrasser ; aussi voit-on plus de gens tout nus qu’habillés. Quant[6] aux femmes du naba, elles portent, comme dans tout le Gourounsi, un simple bouquet de feuilles par derrière ; le devant est tout nu.
Le naba est très grand ; il est vêtu d’un burnous blanc en cotonnade commune indigène. Sa moustache rasée sous le nez, laissant quelques poils qui retombent le long des coins de la bouche à la manière des Chinois, lui donne déjà un air grotesque. Mais ce qui le rend tout à fait ridicule, c’est sa coiffure : il porte, ajustées à son bonnet mafou[1], deux gigantesques têtes d’oiseaux munies de becs. Ces têtes, recouvertes de drap rouge, brodées de cauries, tiennent à son bonnet par des courroies. L’oiseau qui fournit cette parure de luxe est un grand échassier à tête chauve, que l’on appelle vulgairement marabout, et dont les plumes, celles de la queue seulement, sont très recherchées en Europe pour les éventails, les chapeaux, etc.
L’entretien, qui eut lieu en mossi, fut long et laborieux ; nous arrivâmes cependant à nous comprendre mutuellement. Le naba m’informa que, vivant en hostilité avec Bangzoaza, il lui était impossible, à son grand regret, de me faire conduire par ses gens jusqu’à ce village, mais que, pour m’être agréable, il me ferait conduire à Tiakané. Du reste, le chemin n’était pas plus long et le naba était sûr que ce village ne ferait pas de difficulté pour me conduire vers Pakhé et me permettre de gagner Oual-Oualé. Il m’envoya un peu de mil, du poisson sec et des kolas.
Dans la soirée il vint me rendre ma visite précédé de quatre griots qui chantaient en s’accompagnant d’un instrument de musique comme je n’en ai pas encore vu. C’est une bouteille en osier, à fond de calebasse, renfermant des graines. En l’agitant dans divers sens elle produit un bruit assourdissant.
Une pluie continue pendant toute la matinée d’hier m’a forcé de remettre mon départ à aujourd’hui. Le naba a profité de mon séjour pour venir à plusieurs reprises me confier qu’il n’avait pas d’appétit, et me demander un remède. Afin de me débarrasser de sa présence, qui à la fin devenait gênante, je lui donnai le reste d’un flacon de sauce anglaise, lui recommandant d’en user avec modération ; il serra précieusement la fiole dans son boubou, et nous nous quittâmes très contents tous deux, lui de son nouveau remède, moi de le voir partir.
Dimanche 29 juillet. — Pour me prouver sa reconnaissance, le naba m’accompagne à cheval jusqu’à la limite de son territoire, qui comprend[7] deux ruines dans cette direction. Cette espèce d’hercule avait mis pour la circonstance son boubou de guerrier, couvert d’amulettes, en dessous duquel il portait, dissimulé dans le dos, un bouclier en bois qui lui remontait jusqu’aux oreilles. Les têtes de marabout étaient remplacées par tout un attirail de cornes suspendues à son bonnet. Après avoir fait ses recommandations au cavalier et aux deux captifs qui devaient m’accompagner, il prit congé de moi et s’en retourna, précédé de ses quatre griots, et suivi de sept guerriers munis d’arcs.

Le naba de Koumoullou et ses griots.
En arrivant près des ruines de Zorogo ou Diorrogo, Fondou, un de mes hommes, tua un énorme sigui noir (bœuf sauvage). Comme la région que nous traversons vit dans la disette, et que l’étape d’aujourd’hui est fort longue, je fais camper dès que nous atteignons de l’eau, afin de permettre à mes hommes de s’occuper du dépeçage et du boucanage de la viande de l’animal.
Chaque fois que nous avons réussi à abattre une grosse pièce de gibier, le dépeçage et la préparation de la viande ont donné lieu aux mêmes scènes de cannibalisme et de sauvagerie de la part de mes noirs ; c’est là qu’ils se montrent tels qu’ils sont réellement ; leurs instincts sauvages reparaissent, ils ressemblent en cette occasion plutôt à la brute qu’à des êtres humains.
[8]Pendant que ceux qui ont les meilleurs couteaux se ruent sur la bête pour la découper, les femmes amassent du bois mort, un ou deux hommes tendent des cordes autour de quatre arbres disposés sensiblement en carré pour y suspendre la viande ; puis ils construisent au centre du carré un séchoir en branches vertes. Un coup de revolver à bout portant sur un vieux chiffon, ou un tampon de vieux linge disposé à côté du bassinet d’une arme à silex dont on a préalablement bouché la lumière, procurent le feu. Dès qu’une pièce de viande est enlevée, un homme la découpe en longues lanières, qu’il suspend aux cordes, ou dispose sur le séchoir. Pendant tout le cours de cette besogne, quelques-uns s’enduisent le corps de la fiente de l’animal, se lavent certaines parties du corps avec du sang ; d’autres mangent avec avidité du gras-double cru, ou des boyaux à peine passés au feu. Les os, après lesquels il reste toujours un peu de viande, sont placés sur le feu, bien nettoyés et brisés pour en extraire la moelle, dont une partie est tout de suite mangée, l’autre étant employée à se graisser le corps ou à nettoyer les armes.
La nuit, quand je me réveille, je vois à la lueur des feux ces êtres à face noire, luisante, accroupis près de quelque tas de braises. Ils rongent les os, découpent la tête, grillent les pieds, mangent de la viande, et encore de la viande, ne prenant même pas le temps de dormir. Ils sont dix, y compris les trois hommes de Koumoullou. A quatre heures du matin, tout l’intérieur de la bête, la tête, les pieds, les os, tout a disparu. Que reste-t-il de ce bœuf dont la tête à elle seule pèse une charge ? Un petit fagot de viande sèche, de 5 à 6 kilos par homme : tout le reste a été dévoré.
Pour le noir, manger beaucoup est une des plus grosses jouissances qui existent. Quand, n’en pouvant plus, un noir vient, en vous gratifiant de quelques renvois, vous dire Barka (merci), et qu’il ajoute d’un ton souriant : « Moi y en a plein », vous pouvez être sûr qu’il est heureux.
C’est dans ces moments qu’il devient expansif, comme nous après le bon vin. Quand il raconte une histoire, ou une aventure de chasse, c’est avec humour et entrain ; d’autres fois il joue quelque pantomime. Ne riez pas, c’est l’enfance de l’art théâtral.
Couché sur une natte, près d’un bon feu, et en savourant une pipe de mauvais tabac, je les mettais régulièrement à contribution quand je les voyais si bien disposés.
Ce soir-là, Fondou, qui était le héros de la journée, car c’était lui qui avait tué le buffle, nous raconta la fable suivante, que j’ai transcrite à peu près littéralement, et Diawé, ne voulant pas rester en retard, nous en gratifia d’une autre.
[9]L’HYÈNE ET LE LIÈVRE
(traduite du mandé).
L’Hyène dit une nuit au Lièvre : « Allons pêcher ». Ils se rendent de concert à la rivière, et bientôt le Lièvre attrape un beau poisson. L’Hyène, jalouse, préméditait le vol du poisson. Comme il fallait camper en attendant le jour, l’Hyène prétexta la maraude et passa sur l’autre rive de la rivière. Avant de partir, afin de détourner les soupçons, elle recommanda au Lièvre de faire bonne garde pendant la nuit : « Méfie-toi, ami Lièvre, le pays est infesté de voleurs, on pourrait bien venir te voler notre poisson ; encore une fois, veille bien. — J’ai compris, reprit le Lièvre, tu peux être tranquille. »
Vers la moitié de la nuit, l’Hyène, dans le but d’accaparer le poisson, traversa en silence la rivière pour voler son camarade. Mais le Lièvre, qui veillait bien, s’empara d’un tison et le jeta dans les yeux de l’Hyène, qui s’empressa de s’enfuir et de repasser la rivière.
Au jour, l’Hyène, de l’autre rive, interpella le Lièvre : « Bonjour, lui cria-t-elle, tu t’es donc battu avec les voleurs ? »
Le Lièvre répondit, en regardant l’Hyène et en souriant : « Oui ». L’hyène, honteuse, ajouta : « Pour un gaillard si petit, tu as le bras solide : non seulement tu as chassé le voleur et tu lui as fendu la figure, mais encore ton coup a été si rude, que le feu du tison a été projeté sur moi par-dessus la rive, et m’a brûlé les yeux. »
Voici l’autre fable, traduite également du mandé :
LES ANIMAUX ET LE LIÈVRE
Un jour le Lion dit à l’Hyène : « Va rassembler tous les animaux ». L’Hyène partit et bientôt toute la compagnie était rassemblée près du Lion.
Ce dernier prit la parole en ces termes :
« Animaux, je vous ai fait réunir ici pour vous entretenir d’une chose très grave.
« Vous savez tous que quand un homme meurt, ses parents et héritiers creusent un trou et l’enterrent. Chez nous, dans notre société, les choses se passent d’une façon toute différente : quand un des nôtres meurt, on l’abandonne, son corps devient la proie des charognards, des fourmis et des vers. Je suis sûr que, comme moi, vous trouvez cela odieux ; aussi, pour remédier à cet état de choses, j’ai constitué une petite fortune que je mets à la disposition[10] immédiate de celui qui s’engagera à enterrer le premier de nous qui mourra.
« Cette petite fortune ou héritage s’élève à 300000 cauries. »
Le Lièvre dit : « Je les prends. Je me chargerai de l’enterrement ».
La Panthère répliqua : « Comment, tu les prends ? »
Le Lièvre ajouta : « Parfaitement, je les prends. »
L’Hyène arriva à la rescousse : « Ne m’en donneras-tu pas un peu ? »
Le Lièvre : « Non, non. Le Lion s’est adressé à nous tous : pourquoi, Hyène, as-tu hésité à prendre la fortune ? Tant pis pour toi. Cette fortune est à moi et je n’en distrairai pas une caurie pour te la donner. »
L’Hyène, voyant qu’il n’y avait rien à tirer du Lièvre, se mit à le discréditer, et, s’adressant à l’assemblée, lui dit : « Jamais toi, Lièvre, tu ne tiendras tes engagements, cela n’est pas possible ; voyons, tu n’as même pas la force de remuer une jambe d’éléphant et tu prétends en enterrer un entier ?
— Peu t’importe, riposta le Lièvre. J’ai la fortune et tu n’auras rien. » Les animaux se séparèrent. De longtemps personne ne mourut.
On ne pensait plus au Lièvre ni à la fortune.
Lorsqu’un jour l’Hyène, qui gardait rancune, rencontre le Lion et lui tient le langage suivant : « Lion et cher seigneur, ne penses-tu pas comme moi que le Lièvre a tout le temps de manger l’héritage que nous destinions aux pompes funèbres ? Il ne meurt personne, reprenons le tout au Lièvre, d’autant plus qu’il m’a tout l’air de ne jamais pouvoir remplir ses engagements.
— Oui, tu as raison, reprit le Lion, nous allons le mettre à l’épreuve : l’Éléphant va faire le mort, et je vais envoyer mander le Lièvre par un Sanglier de mes amis. »
Le Lièvre arrive bientôt et le Lion, lui faisant voir l’éléphant couché à ses pieds, lui dit : « Notre ami l’éléphant est mort ».
Le Lièvre, après un compliment de condoléance, ajouta : « C’est bien triste, je vais l’enterrer tout de suite » ; et il court chercher une pioche, arrive chez lui et recommande à ses trois petits de venir de quart d’heure en quart d’heure le demander.
Puis le Lièvre s’en retourna et se mit en demeure de creuser la fosse. Comme il rôdait aux environs, cherchant quelque chose, sondant le sol de coups de pioche, l’assistance lui demanda pourquoi il ne se mettait pas sérieusement à l’ouvrage.
« Comment, pas sérieusement ! dit-il, mais ce n’est pas dans des alluvions que je veux enterrer l’Éléphant, je cherche le roc et c’est là que je veux lui creuser sa dernière demeure. »
[11]Sur ces entrefaites, l’aîné des levrauts arriva et dit :
« Baba (père), on te demande à la maison. »
Le Lièvre : « Va-t’en, je ne m’en irai pas d’ici avant d’avoir terminé la tombe. »
Le Lion : « Tu ferais peut-être bien d’aller voir ce qu’on te veut. »
Le Lièvre : « Non ; l’Éléphant est mort, mon devoir est de le mettre en terre : il m’est impossible de manquer à mes engagements, je reste. »
Bientôt survint un deuxième levraut venant chercher son père : « Baba, tu ne viens donc pas ? » dit-il.
Le Lion, intrigué, ordonna au Lièvre d’aller voir ce qui se passait : « Va voir, nous t’y engageons. »
Et le Lièvre obéit et fit retour bientôt. Chemin faisant, le Lièvre en lui-même se disait : « Nous allons rire tout à l’heure ».
En arrivant, il se mit à la besogne sans rien dire, mais la curieuse Panthère voulut à toute force savoir pourquoi on avait appelé le Lièvre.
La Panthère : « Pourquoi as-tu été appelé ? »
Le Lièvre, d’un air indifférent : « Une bêtise, ce sont des étrangers qui sont descendus chez moi ».
Le Lion : « Des étrangers ? comment cela ? quelle espèce d’étrangers ? »
Le Lièvre, en se faisant prier : « Ce sont trois chasseurs ».
Le Lion : « Ils sont venus quoi faire ? »
Le Lièvre : « Le chasseur d’éléphants est venu pour que je lui fasse voir des éléphants, car il a l’intention d’en tirer autant qu’il en trouvera.
« Le second est un chasseur de panthères, de lions et de fauves en général ; il veut également tirer quelques lions.
« Le troisième est un chasseur d’hyènes. »
L’Hyène : « Dis donc, Lièvre, est-ce que le chasseur d’hyènes a un gros fusil ? »
Le Lièvre : « Énorme, mon pauvre ami ».
L’Hyène à l’Éléphant : « Tu peux rester ici faire le mort si tu veux, moi je m’en vais et rapidement. » A ce moment, l’Éléphant et tous les animaux s’enfuirent.
Pour achever la déroute, le Lièvre entama une sorte de dialogue avec les soi-disant chasseurs, ce qui ne manqua pas de produire son effet.
« Comment ! s’écriait le Lièvre, imitant la voix d’un chasseur, tu ne me préviens pas que l’Éléphant est là ! » et immédiatement l’Éléphant, se croyant surpris, changeait de direction en détalant au plus vite.
Le Lièvre, débarrassé de toute la compagnie, s’en retourna en riant chez lui, sa pioche sur l’épaule, et naturellement il mangea les richesses.
[12]La morale de ces deux fables est que « la victoire reste toujours au plus rusé ». C’est vrai dans beaucoup de circonstances, surtout chez les noirs.
Il est très curieux que chez tous les peuples soudanais le lièvre et le singe soient considérés comme les animaux les plus rusés, les plus intelligents. L’hyène et le sanglier jouent toujours des rôles de domestiques, de voleurs, de valets ou de poltrons. Le lion symbolise la force ; la panthère, la curiosité. L’éléphant n’est jamais représenté que comme victime des autres animaux ; il joue rarement un rôle prépondérant ; on le considère un peu comme un bon enfant servant de risée aux autres.
Chez les Mandé, toutes les histoires ou fables se terminent par une phrase dont la traduction veut à peu près dire : « Et l’histoire se continue ainsi jusqu’à ce qu’elle se perde dans la brousse ». Chez les Wolof, au contraire, on dit : « Jusqu’à ce qu’elle tombe à la mer ».
★
★ ★
Les ruines de Zorogo, non loin desquelles nous avions établi notre campement, s’étendent sur une profondeur de 2 kilomètres environ. Ce village, quand il était peuplé, était redouté de toute la région. Il y a quatre ans, elle se révolta contre lui, appela Boukary Naba à son secours et détruisit le village, en forçant son naba à se retirer plus à l’est, vers le Mossi de Koupéla.
A la sortie des ruines de Zorogo, le sentier n’existe plus, on chemine dans les hautes herbes, les hommes sont forcés de s’appeler pour ne pas se perdre. Il faut près d’une heure pour franchir un kilomètre. Heureusement que le guide connaît très bien le pays. Nous arrivons dans ces conditions devant Kalarokho, où, bien avant de soupçonner l’existence d’un village, nous entendons le cri de guerre poussé par les habitants. Bientôt ces sauvages s’échelonnent sur notre flanc gauche, l’arc bandé, les flèches à la main, attendant qu’ils soient en force pour nous attaquer. Le terrain est heureusement découvert en cet endroit, nous pouvons à notre aise observer leurs mouvements. Pendant que le cavalier de Koumoullou qui m’accompagne leur crie à tue-tête de ne pas tirer, les renforts leur arrivent. Tout en se dissimulant derrière quelques arbres, ils essayent de nous envelopper. Mes hommes continuent de défiler avec les ânes et sont prêts à faire feu. Diawé se tient sur le flanc menacé, tandis que je ferme la marche, surveillant de mon mieux ces sauvages. Ils sont là environ une centaine, à moitié cachés par la broussaille, dévorant des yeux les charges[15] de mes six bourriquots éreintés ; ils nous suivent lentement, presque en rampant, en poussant des cris de fauves. Le cavalier de Koumoullou a enfin réussi à s’aboucher avec l’un d’eux ; il lui parle à distance, et par ses gestes je comprends qu’il harangue les forcenés en leur expliquant que nous avons des allures toutes pacifiques. Il fait voir aux Gourounga que nous sommes cependant armés, et qu’en cas de conflit ils n’auraient pas le dessus. — Ce n’est pas bien sûr, avec nos trois fusils !

Ces sauvages nous suivent presque en rampant.
Bientôt le gros de la troupe ralentit la poursuite, nous ne sommes plus suivis qu’à 100 mètres environ, par six gaillards qui s’arrêtent de temps à autre pour nous viser, mais ils ne tirent pas. Arrivés à un petit ruisseau, et ne se voyant pas imités par les camarades, ils n’osent pousser plus loin et s’en retournent.
Sur une croupe découverte de l’autre côté du ruisseau, nous nous arrêtons quelques minutes pour mettre un peu d’ordre dans le convoi, et laisser respirer hommes et animaux.
Mes hommes regrettent de ne pas avoir eu l’occasion de tuer quelques-uns de ces bandits ; cependant, quand je leur fais entrevoir les suites que peut avoir pour nous un engagement même heureux, ils reconnaissent que nous avons mieux agi en conservant notre sang-froid et en ne faisant pas usage de nos armes.
Maintenant ils viennent me remercier, ils se rendent réellement compte du danger que nous avons couru, et Fondou, en matière de conclusion, ajoute « qu’un seul blanc a plus de tête que cent noirs : si nous avions été seuls, nous étions perdus ! »
Deux heures et demie après, nous atteignons le plateau sur lequel s’élève Tiakané, altitude 1050 mètres. Cette région est dominée par une ligne de hauteurs qui court dans le sud-est. Le point culminant est un cône presque isolé, dont j’ai évalué l’altitude à 1800 mètres. Le sol, argileux, renferme des paillettes de mica en abondance, comme chez les Komono.
Le chef de Tiakané est un homme d’une trentaine d’années environ ; il fut plein de prévenances pour moi pendant tout le temps que les hommes de Koumoullou furent là ; mais, dès que ces derniers eurent pris congé, son attitude changea, il essaya de m’intimider en me parlant sur un ton impératif, et au bout de quelques heures les exigences commencèrent. Il demandait beaucoup de choses comme rétribution pour me conduire jusqu’à Kapouri. Voyant qu’il ne réussissait pas, il retarda mon départ pour de vains motifs.
En cherchant le moyen de mettre cet individu à la raison, il me vint l’heureuse idée de le combattre par ses propres armes. Je commençai tout[16] de suite les hostilités en lui demandant pourquoi il ne me donnait pas de nourriture pour mes hommes et mes animaux, puisqu’il ne me faisait pas partir. Comme il ne se pressait pas de s’exécuter, je lui envoyai deux hommes munis de sacs pour réclamer le mil. Dans l’intervalle, le nettoyage de mon revolver, sorti tantôt de l’étui, tantôt d’une musette ou de la poche d’un de mes hommes, lui faisait croire que tout mon personnel était armé jusqu’aux dents, ce qui ne tarda pas à le décider à me faire partir et à filer doux.
Nous quittâmes Tiakané vers neuf heures du matin environ ; arrivés à quelques centaines de mètres du dernier groupe de cases, le naba de Tiakané s’arrêta et me prévint qu’il s’en retournerait au village si je ne lui donnais pas, séance tenante, deux beaux boubous.
De mon mieux je lui fis comprendre qu’il n’obtiendrait rien de moi par ce moyen et lui expliquai que, s’il retournait au village, je ferais de même. Ce manège se renouvela plusieurs fois pendant la route. Nous avons mis ainsi quatre heures pour franchir les cinq kilomètres qui nous séparaient de Kapouri. Comme je ne connaissais pas le chemin et que le pays était très difficile à traverser, même accompagné par des indigènes, je me trouvais à peu près à la merci de cette canaille ; mais je voulais à tout prix éviter de céder à ses exigences. La moindre faiblesse pouvait me valoir, de la part des chefs des villages à traverser ultérieurement, des demandes croissant dans des proportions qui auraient fini par me fermer complètement la route.
Arrivés devant Kapouri, Diawé et le naba prirent les devants pour prévenir le village de mon arrivée, et bientôt après un captif vint me chercher ; ce dernier exigea, avant l’entrée dans le village, la somme de 200 cauries, que je lui fis délivrer, ce tribut pouvant très bien être une coutume ou une redevance payable au chef.
A Kapouri, l’attitude du naba se dévoila tout de suite, car, après lui avoir fait un cadeau en étoffe, glaces et couteaux, il me renvoya le tout, disant qu’il n’était pas satisfait. Quand il me vit serrer tranquillement dans ma malle ce que je lui avais offert, il me le redemanda en m’apportant une petite calebasse de mil. Dans la soirée, je crus prudent de l’importuner en lui envoyant demander des provisions par mes hommes ; moi-même je le priai en gourounga de me donner un bœuf ou un mouton.
Le lendemain il me refusa des guides, voulant se faire payer d’avance une couverture et un bonnet. Je crois qu’il m’aurait été facile de conclure un arrangement avec ce naba, malgré toute son exigence ; malheureusement, il ne comprenait pas assez le mossi pour saisir ce que je m’évertuais[17] à lui expliquer, de sorte qu’une partie de la matinée fut employée en pourparlers[2]. Cette situation menaçait même de se prolonger encore, lorsque deux Dagomba, venus d’un petit village voisin nommé Mamourou-iri, s’informèrent auprès de moi du sujet de notre différend.
Ces Dagomba expliquèrent au naba que si la route est longue et difficile, et que si des guides m’accompagnent jusqu’à Pakhé, je ne leur refuserai certainement pas un cadeau. Ils racontèrent qu’ils avaient vu des Européens à Salaga et que jamais un blanc ne paye à l’avance, attendu que les récompenses qu’ils donnent sont toujours proportionnelles aux services rendus.
Mercredi 1er août. — Avec le secours de ces deux braves gens, je réussis à quitter Kapouri vers onze heures du matin, bien heureux d’arriver le soir à Pakhé, car là, me disait-on, tout est fini, le chemin est bon et fréquenté.
Je dus m’arrêter quelques instants à Mamourou-iri pour saluer Mamourou, le vieux chef dagomba, et le remercier de l’intervention de ses deux hommes. Après m’avoir donné environ 1 kilo de mil et sa bénédiction, il me fit accompagner jusqu’à la limite des cultures par un de ses fils.
Pendant que je me hâtais de rejoindre mon convoi, qui avait gagné sur moi une avance de quelques centaines de mètres, surgit à environ 1 kilomètre du village une bande d’hommes armés d’arcs, flèches en main ; l’un d’eux, qui paraissait être le chef de la bande, voulut me faire rebrousser chemin. Je ne comprenais d’abord pas très bien, j’étais fermement convaincu qu’il venait me prévenir que je courais quelque danger si je continuais à m’avancer, lorsque, brusquement, il saisit la bride du cheval de Diawé et essaya de sauter en croupe. Comme je m’apprêtais à faire feu sur lui de mon revolver, cela calma subitement son ardeur hippique, et il se mit à courir avec ses hommes dans la direction du convoi, où j’arrivai avant lui.
Au convoi, mes hommes étaient déjà aux prises avec une autre fraction de la bande ; j’arrivai juste à temps pour empêcher toute hostilité de la part de mon personnel.
[18]Lorsque le chef de la bande nous rejoignit, j’appris de lui qu’il était envoyé par le chef de Pou ou Poukha avec mission de me ramener à ce village pour saluer son chef (lisez : offrir un cadeau), dont je traversais le territoire, disait-il, et que si je continuais à avancer, il pousserait le cri de guerre afin d’attirer à lui d’autres hommes qui étaient aux environs. Comme je connaissais de réputation ce village et son chef, je fis de suite signe à Diawé de filer avec le convoi et signifiai à cet aventurier que s’il nous suivait, ce serait moi qui l’attaquerais.
Cette décision sembla arrêter un instant l’ardeur de ces sauvages, mais, après s’être concertés entre eux, ils revinrent à la charge de plus belle, criant dans le haut de la voix : Hou ! hou ! hou ! (leur cri de guerre) et cherchant à nous devancer ; mais les trois hommes de mon convoi armés de fusils sortirent des rangs et s’apprêtèrent à tirer sur les plus audacieux, qui prirent la fuite et entraînèrent dans leur retraite le reste de la bande. Pendant 3 kilomètres ils continuèrent à nous suivre à une distance de 150 mètres. Bientôt je les perdis complètement de vue. C’est alors qu’apparurent les hommes de Kapouri, qui pendant tout ce temps-là avaient jugé prudent de s’éclipser.
En parlant de Kapouri, le chef avait mis trois hommes à ma disposition, dont deux ont cru prudent de disparaître au moment où nous étions menacés par les bandits de Poukha. Un seul, garçon de vingt à vingt-cinq ans, ne me quittait pas et voulait constamment me forcer à tenir mon ombrelle ouverte. Comme il me fallait veiller et sur mes flancs et sur mes derrières et tenir mes hommes dans la main, je ne pouvais guère songer à me garantir du soleil en ouvrant mon ombrelle. Me voyant résister, ce malheureux, qui marchait avec moi, me suppliait d’ouvrir le parasol. Enfin, comprenant qu’il le considérait comme un fétiche, je crus ne pas devoir lui refuser cette satisfaction. Sa joie fut si grande qu’il courait de la tête à la queue de la petite colonne, dansant et gesticulant. Il est évident que pour ce jeune Gourounga ce n’est ni nos trois fusils ni notre sang-froid qui nous ont sauvés, c’est l’ombrelle qui a mis tout le monde en fuite.
Cette bande ne se composait que de vingt-deux ou vingt-trois individus armés, et ce n’est pas l’envie de les châtier qui nous manquait. Mais, voyageant dans un pays que l’on ne connaît pas et dont on ne sait pas parler la langue, je crus prudent d’éviter toute hostilité de notre part, d’autant plus que, abandonnés par ceux qui devaient nous guider, j’ignorais si les villages qui nous entouraient sont amis ou non de Poukha. Dans un pays comme celui-là, de victime on passe facilement pour accusé, n’ayant pas le moyen de se justifier ni de fournir des explications.
[19]Une heure avant la tombée de la nuit, nous arrivons à Pakhé. Les habitants sont encore dans les cultures et travaillent au son du tam-tam. Les griots nous accompagnent dans l’espoir de recevoir quelques cauries, et des jeunes gens viennent me saluer en me saisissant la barbiche, comme c’est l’usage par ici. Cette coutume force les Gourounga à enrouler des fibres autour de leur barbe pour ne pas se la voir arrachée par quelque salutation un peu brusque.
Le naba, chez lequel on me conduit, m’installe dans une case relativement propre, s’occupe de mes animaux et renvoie les curieux, assez nombreux pour être gênants.

L’un des hommes saisit la bride du cheval de Diawé.
Mon arrivée tardive et l’état de mes animaux ne me permettent point de partir demain ; je dois, à mon grand regret, rester un jour ici.
La population du village (600 à 700 habitants) m’a paru très mélangée. On y trouve des Gourounga de toutes les tribus. Il y aussi à Pakhé une petite colonie de Dagomba. Ces gens, sans être vêtus luxueusement, portent des effets propres. Leurs femmes, coiffées de foulards, ont des pagnes en cotonnade rayée de couleurs diverses de fabrication indigène.
Auprès des Gourounga, peu ou point vêtus, ils ont l’air de seigneurs. Les femmes dagomba font le petit commerce de sel, piments, tabacs, beurre de cé, kolas, etc., tandis que leurs maris s’occupent du commerce de bestiaux,[20] de captifs, de coton, d’indigo, qu’ils vont vendre à Oual-Oualé et Gambakha. Pendant la belle saison ils font le commerce de kolas entre Salaga et ces deux derniers centres. Les enfants tressent des étuis en palme de différentes dimensions, destinés à renfermer le sel de provenance de Daboya ; ces étuis sont surtout vendus à Gambakha et dans la région avoisinant le Boussanga.
Les Dagomba comprennent tous le mossi. J’appris par eux que le pic que j’ai signalé à Tiakané, et que nous avons dépassé hier, se nomme Naouri-Tanga, et qu’au pied du pic, sur le chemin de Pakhé, se trouve le village de Naouri. D’ici on ne met, d’après eux, que trois jours pour se rendre à Oual-Oualé. On me conseilla de prendre le chemin d’Addoukou-iri, de préférence à celui de Koulor’o, situé plus à l’ouest.
Le chef de Pakhé ne chercha pas à m’extorquer de marchandises en dehors du cadeau que je lui fis, et le lendemain matin il mit deux hommes à ma disposition pour me conduire au chef de Midegou.
Entre Pakhé et Midegou il n’y a qu’un petit village gourounga, nommé Badongo. La végétation n’est pas luxuriante par ici, il est très rare de rencontrer de beaux arbres, mais la terre m’a paru très bonne, les cultures sont plus soignées que dans la région que je viens de traverser. Les champs d’arachides et surtout de haricots arachides sont très nombreux ; cette dernière culture m’a paru aussi importante que celle du mil.
Les indigènes mangent le haricot arachide cuit à l’eau et arrosé d’un peu de cé ou bien simplement grillé au feu. Les musulmans donnent souvent cette graine comme nourriture aux moutons qu’ils engraissent pour la fête des sacrifices.
A quelques kilomètres de Mîdegou on traverse le premier ruisseau important de la région. Quoique son lit soit très encaissé, il n’a encore que 40 centimètres d’eau ; nous le passons sans difficulté. L’accueil du chef de Mîdegou me fait supposer que nous entrons dans une région plus civilisée que celle que nous venons de traverser (les habitants sont cependant encore vêtus de peaux). En venant me rendre visite, le chef s’excuse de ne pouvoir me faire qu’un modeste cadeau en mil, son village venant d’être décimé par la petite vérole ; le soir, il m’offre une petite calebasse de lait.
Samedi 4 août. — Au moment de quitter Midegou, le chef me fit changer d’itinéraire : au lieu de me diriger sur Addoukou-iri comme il était convenu, il me fit rallier le chemin de Nar’a par Koulor’o, situé plus dans l’ouest. C’est en vain que je demandai des explications, je dus me contenter du : Addoukou-iri soûri kanéré (Le chemin d’Addoukou-iri[21] n’est pas bon). Comme ce chef avait été plutôt bienveillant qu’hostile, je crus prudent d’écouter ses conseils et me mis en route vers ma nouvelle destination. Arrivé à un gros village nommé Badou ou Dabo, situé à 4 kilomètres dans l’ouest, les exigences du naba de cet endroit me forcèrent à rebrousser chemin et à retourner à Mîdegou, quitte à faire demander des explications au chef de Pakhé.

L’ombrelle.
De retour à Midegou, le chef changea d’attitude : il voulait bien me faire conduire à Addoukou-iri, mais il exigeait un pistolet, que je lui refusai naturellement. Je fis donc camper en attendant les événements. Dans l’après-midi il revint, par un chemin détourné, à mon campement et m’apporta son bonnet plein de mil et un peu de lait. D’après ce que je crus comprendre, il se disait mon ami et me promit des hommes pour le lendemain.
Dimanche 5 août. — De bonne heure, deux hommes vinrent me prendre au campement, mais pendant la route l’un d’eux se sauva en arrivant à un groupe de cases de culture, et je dus menacer de tirer sur l’autre s’il ne continuait pas à avancer. Nous traversâmes quatre petits cours d’eau, dont l’un d’eux seulement n’était pas guéable.
Les eaux de cette région viennent des hauteurs situées dans l’est, et semblent rejoindre un affluent de gauche de la Volta Blanche ou s’y verser directement.
Le chef d’Addoukou n’ayant pas précisément une excellente réputation,[22] je mis en pratique, dès mon arrivée, le système que j’avais inauguré à Tiakané. Je réussis si bien à l’ennuyer de mes demandes, que dès deux heures de l’après-midi, et sans que je les réclame, il m’envoya deux guides pour me conduire à Sidegou. Je m’empressai de saisir cette occasion pour tâcher de me rapprocher de Oual-Oualé et de sortir du Gourounsi.
Vu l’heure tardive de notre arrivée à Sidegou, il ne me fut pas possible de trouver un abri ; je me fis conduire à la sortie du village et campai dans un endroit découvert, près du chemin à suivre le lendemain. Une abondante pluie et une tentative de vol de bourricots par les habitants nous forcèrent de rester sur pied toute la nuit. Heureusement que le lendemain matin j’eus assez promptement raison des exigences du chef, qui finit par me donner deux guides, ce qui nous permit de nous mettre en route vers sept heures du matin. J’ignore s’il existe un chemin de Sidegou à Sédokho, car les deux hommes me firent prendre à travers la campagne dans un terrain très difficile pour les ânes.
A 3 kilomètres au delà de Sidegou, nous atteignîmes le bord d’une petite rivière très dangereuse à traverser à cette époque, à cause de sa profondeur (1 m. 70) et de la rapidité de son courant. Mes hommes transbordèrent les bagages, ayant de l’eau par-dessus la tête ; ils étaient forcés de soutenir les charges à bras tendus au-dessus de l’eau. J’eus trois ânes entraînés par le courant, et Diawé avec son cheval faillit se noyer. Les deux guides profitèrent de la circonstance pour s’évader.
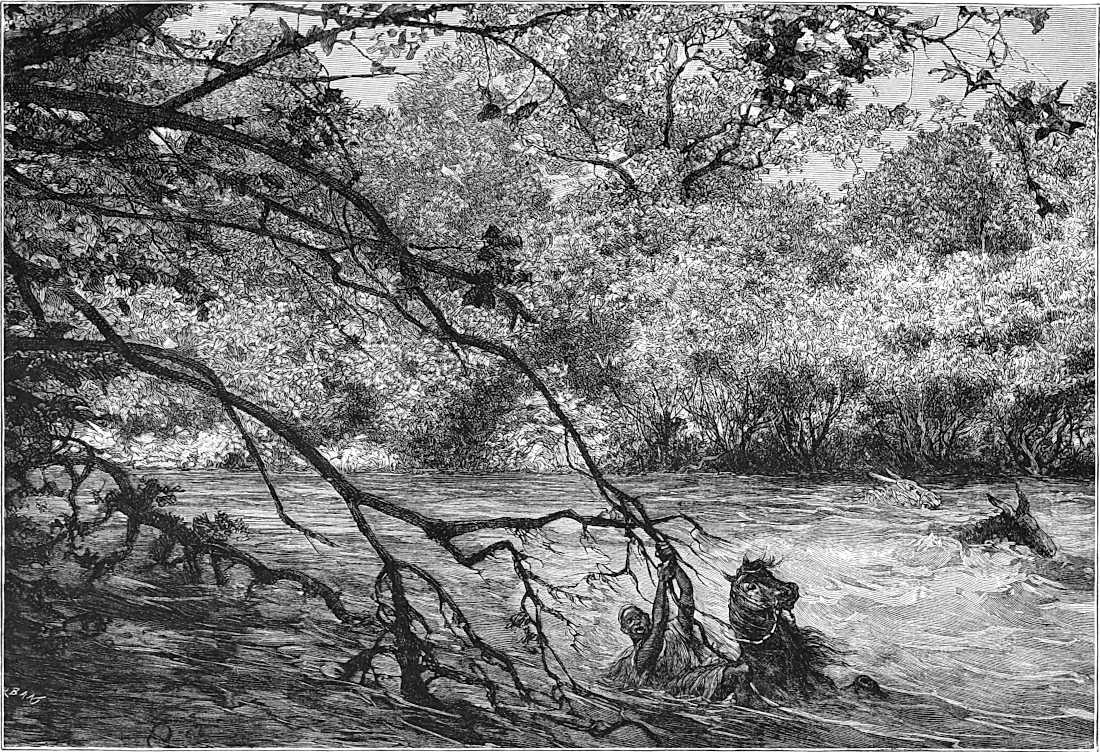
Diawé et trois ânes entraînés par le courant.
Au bout d’un quart d’heure de recherches, nous trouvâmes aux abords de la rivière un petit sentier que nous nous empressâmes de prendre en toute confiance, la boussole nous donnant sensiblement la même direction que celle que nous suivions précédemment. Une heure après, j’eus le bonheur de trouver un jeune homme qui m’affirme que ce chemin est le bon et que bientôt nous apercevrions Bélounga. En effet, nous atteignons ce village peu de temps après ; il s’allonge par groupes isolés sur une étendue de plus de 2 kilomètres. Les habitants nous regardent avec curiosité, mais sans hostilité ; ils m’appellent Zanvéto (Haoussa), ce qui prouve qu’il ne passe jamais de Haoussa par ici, puisque les Gourounga ignorent la couleur de leur peau.
Je comptais pouvoir gagner Korogo, que je savais ne pas être très loin de Bélounga. Malheureusement mes animaux, privés de mil depuis Koumoullou et forcés de marcher pendant toute la journée sans repos, n’en peuvent plus. Il fallut me résigner, vers une heure de l’après-midi, à camper près d’un petit ruisseau à 3 kilomètres au delà de Bélounga. Là,[25] des hommes de ce village nous rejoignirent et tentèrent de me faire rebrousser chemin, prétextant que je devais aller saluer leur naba. Je refusai formellement de me prêter à cette fantaisie et renvoyai ces gaillards, qui ne se décidèrent à retourner à leur village qu’après une bonne demi-heure d’attente.
Dans la soirée j’atteins Korogo (village d’environ 800 habitants), où j’allai demander l’hospitalité chez le naba. Quoique souffrant, et en prévision d’un refus de guide pour le lendemain, je me mis en devoir, tout en ayant l’air de chasser, de chercher le chemin d’Arago. On aperçoit ce village un quart d’heure après être sorti des derniers groupes de Korogo ; aussi, quand le lendemain le naba refusait de mettre un guide à ma disposition, sous prétexte que le cadeau que je lui faisais était insuffisant, je faisais charger mes ânes et partais sans guide, à sa grande stupéfaction.
Nous comptions atteindre la Volta Blanche ce jour-là, ce cours d’eau n’étant pas éloigné, puisque la pirogue appartient au chef d’Arago : malheureusement, une pluie torrentielle nous força de nous arrêter dans ce village et d’y passer la nuit. Dans les environs d’Arago et autour de Korogo, j’ai trouvé du mica en grande quantité. Au cours de mon voyage, j’ai déjà signalé la présence de ce même métal à Kong, chez les Komono et à Tiakané ; celui d’ici, cependant, est plus blanc et ressemble au plomb argentifère.
Les habitants des trois derniers villages que je viens de traverser sont Mampourga ; ils sont tatoués de la même marque que les Mossi. Plus près des Dagomba musulmans de Nabari et de Oual-Oualé, auxquels ils vendent souvent des bestiaux, ils sont aussi moins enclins au mal que les Gourounga de la région située plus au nord ; ils ont cependant, comme ces derniers, toutes les allures d’un peuple sauvage.
Le chef d’Arago est un vieillard fort poli, qui ne chercha en aucune façon à m’être désagréable ; il possède un petit troupeau de bœufs et quelques moutons. A mon arrivée, ses captifs étaient en train de fabriquer des fouets en peau d’hippopotame. Voyant que je regardais travailler avec un peu d’intérêt, il m’offrit de suite un de ces objets et m’envoya plus tard du lait frais.
Mercredi 8 août. — La Volta Blanche n’est éloignée d’Arago que de 3 kilomètres. Aucune particularité dans la configuration du terrain ni dans la végétation n’accuse la présence d’un cours d’eau. En arrivant sur ses bords on est tout surpris de trouver là une aussi importante rivière. Elle sert ici de limite entre le Gourounsi et le Gambakha. Elle vient du[26] nord-est et a environ 120 mètres de largeur. Son lit est très encaissé, ses berges ont plus de 20 mètres de hauteur. Actuellement il y a peu d’eau, l’endroit le plus profond n’a que 3 mètres, mais à 2 mètres des bords il faut déjà nager. C’est une crue toute subite, car il y a cinq jours elle était encore guéable. Le courant n’excède pas 3 milles à l’heure. Cette rivière est aussi considérable que le Comoë, qui coule à quelques journées de marche au nord et à l’est de Kong. J’ai appris par mon hôte d’Arago qu’elle est formée par trois rivières qui se réunissent non loin l’une de l’autre à deux ou trois jours de marche en amont. L’une vient du Boussanga ou Bousangsi ; l’autre sort de chez les Bimba (Gourma), enfin la troisième vient du Mossi. Aucune de ces rivières ne doit avoir une grande importance. Dans le Mossi, on ne m’a pas signalé de cours d’eau important ; il n’y a que la branche située au nord de Gambakha et entre ce pays et le Bousangsi qui doit avoir quelque importance ; en tous cas le passage de ces rivières doit pouvoir en toute saison s’effectuer sans difficulté.
Comme le Mossi est un pays peu accidenté, ses cours d’eau doivent être larges, peu profonds en toute saison et s’étaler en forme de marais ou de flaques d’eau séparées les unes des autres par quelques biefs plus profonds, mais sans écoulement. Le troisième affluent vient du Mossi (disent nos informateurs). Je ne suis pas éloigné de croire que je l’ai traversé, lui ou un de ses affluents, à Banéma. On m’a cité aussi des amas d’eau entre Mani et Boussomo, mais sans pouvoir me préciser si en hivernage leur écoulement avait lieu vers le sud ou le nord. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’aucun de mes informateurs ne m’a signalé de cours d’eau du côté de Koupéla ; il y a donc lieu de supposer que la Schirba a son origine vers Mani et Boussomo. Cette hypothèse donnerait à cette rivière, de sa source à Bossébango, un cours d’environ 200 à 300 kilomètres, qui a tout l’air de concorder comme proportions avec sa largeur. A ce propos il s’est glissé une erreur sur certaines cartes : la Schirba n’a pas 300 mètres de largeur, comme on l’indique. Dans le texte allemand de Barth, sa largeur est de 100 schritt, c’est-à-dire 60 à 75 mètres.
Les eaux de la région Sansanné-Mangho, que je croyais former la branche est de la Volta Blanche que j’ai traversée aujourd’hui, et dont le confluent avec la Volta Noire est à Daboya, coulent vers le sud en contournant Yendi et Salaga ; elles forment la rivière Oti ou Sabran, qui n’atteint la Volta qu’à deux journées de marche en aval de Krakye.
Il résulte de mes informations et surtout de mon voyage de Bobo-Dioulasou au Mossi que les diverses branches de la Volta ont un cours considérablement plus long qu’on ne le supposait jusqu’à présent. Il est assez[27] curieux de voir tous ceux qui ont parlé de la Volta répéter, les uns après les autres, que ce fleuve prend ses sources à trois ou quatre jours de marche au nord de Salaga, après avoir au préalable dit qu’il avait 200 à 300 mètres de largeur en moyenne aux environs de Salaga.
Avant mon départ, il était notoire pour moi que ce cours d’eau, qui, entre le 8e et le 4e degré et demi de latitude nord, a une moyenne de 700 mètres de largeur, devait avoir de nombreux affluents importants dont le cours excédait sûrement quatre ou cinq jours de marche (150 à 200 kilomètres).
Deux hommes cependant, Johnston et Paulitsche, ne se sont pas laissés aller à cette appréciation fantaisiste, et, en 1882 et 1884, ils n’ont pas hésité à soutenir que par la Volta on peut pénétrer bien avant dans la boucle du Niger, ce que confirme mon voyage.
La pirogue qui fait le service du passage ici, est tout ce qu’il y a de plus primitif : un tronc d’arbre à peine équarri et creusé au feu. Elle peut transborder trois personnes à la fois ou deux charges d’ânes. Nulle part je n’ai vu de pirogue aussi mal conditionnée. Avant d’embarquer, il faut régler le prix du passage avec le délégué du chef d’Arago. Ces prix sont fixés à 1100 cauries par cheval, 550 par âne avec sa charge, 200 par porteur avec sa charge. Le personnel ne transportant pas de marchandises est traversé gratuitement.
Comme la somme à payer pour mes six ânes et mes deux chevaux s’élevait à 5500 cauries et que je n’en possédais plus qu’un millier, il fallut conclure un arrangement de façon à faire accepter des marchandises en place. Au bout d’un débat laborieux, le préposé accepta en payement dix coudées d’étoffe avariée, quatre pierres à fusil et quelques hameçons.
Tout semblait se passer normalement, quand le passeur refusa le service, prétextant que je devais payer 600 cauries pour les trois femmes. Cette discussion ne semblait pas devoir prendre fin, lorsque l’intervention de deux vieillards d’Arago, qui prirent fait et cause pour moi, aplanit les difficultés que soulevait cet irascible piroguier.
Les femmes ne portant, en fait de bagages, que des calebasses, ustensiles de cuisine ou peaux de bouc de leur mari, j’étais absolument dans mon droit en protestant.
L’opération du passage de la rivière dura cinq heures, presque le triple de ce qu’il faut pour faire traverser le Niger avec le même personnel. Sur l’autre rive attendaient une trentaine de Mossi avec trois ânes ; ils revenaient de Oual-Oualé avec des kolas (environ 300 kilos) et des charges de cauries. Ce sont les premiers indigènes que je rencontre ; je n’en ai du reste pas vu d’autres dans la suite de mon voyage jusqu’à Oual-Oualé.
[28]Malgré l’heure avancée, je quittai les bords du fleuve. Le débordement de deux torrents avait inondé les rives sur une profondeur de près de 2 kilomètres, et ce n’est qu’avec beaucoup de difficulté que nous sortons de ce terrain fangeux, après avoir déchargé encore plusieurs fois les ânes. A la nuit tombante nous atteignons un petit plateau rocheux où l’on trouve un peu d’eau dans les creux des roches. Nous installons là le campement.
Le lendemain de bonne heure nous arrivons à Nabari, premier village mampourga, où les habitants m’affirment que j’atteindrai facilement Oual-Oualé avant midi ; mais, mes ânes n’en pouvant plus, je dus m’arrêter à un petit village nommé Zangom, à 4 kilomètres au nord de Oual-Oualé.
Dans la banlieue de Nabari et de Zangom il y a de nombreuses plantations d’ignames. De loin, les échalas, assez correctement alignés et couverts de liserons verts, me rappellent nos vignes de France.
Les cultures d’ignames par le 11e degré de latitude nord (comme limite extrême nord) correspondent sensiblement à celles que j’ai observées vers le Kénédougou : ainsi, Kotédougou, situé par 11° 10′ environ, est en effet le dernier village vers le nord où l’on cultive avec un peu d’activité cette racine.
Dans le Gourounsi, jusque vers le 12e degré de latitude nord, il y a aussi dans quelques rares villages de petites plantations, mais l’igname n’entre pour ainsi dire pas dans l’alimentation des Gourounga de cette région.
Vendredi 10 août. — A Zangom, nous avons trouvé à acheter un panier de mil, une calebasse de haricots et quelques poignées d’arachides d’une variété spéciale[3].
Les habitants de ce village sont de braves gens et rendent service avec complaisance. Le matin, avant de nous mettre en route, quelques-uns nous accompagnèrent jusqu’à mi-chemin de Oual-Oualé.
Du plateau qui sépare Zangom de Oual-Oualé on découvre un très beau panorama. Tandis que vers le nord les derniers contreforts du petit massif de Naouri se meurent lentement, vers l’est court, dans une direction presque sud-nord, un grand soulèvement continu, de hauteur uniforme, qui vient se terminer par un cône de déjections en face et non loin du massif de Naouri, mais sans le rejoindre ; ces deux soulèvements sont séparés par une trouée de quelques kilomètres, qui livre passage à la Volta Blanche.

Passage de la Volta Blanche.
Ce soulèvement n’est éloigné de nous que d’une quinzaine de kilomètres ;[31] avec ses parois verticales, baignées à la base par une mer de brume et surmontées de mamelons bien arrondis dépourvus de végétation, il rappelle assez exactement les côtes du Portugal et d’Espagne telles qu’on les aperçoit, par échappées, du pont du navire entre l’embouchure du Tage et le cap Roxo. Par la pensée, je me suis immédiatement transporté sur un paquebot des Messageries maritimes faisant route vers l’Europe.
Ce doux rêve m’avait fait oublier toutes mes fatigues et laissé indifférent à la vue des premières cases de Oual-Oualé, lorsqu’un « marhaba » prononcé par un Dagomba, en guise de bonjour, vint me rappeler que j’étais au Soudan et me faire songer à un gîte. Je demandai donc à être conduit près de l’imam Seydou Touré.
Les gens auxquels je m’étais adressé, après m’avoir offert dans une calebasse le bombo[4] au piment et quelques kolas, me firent conduire par un enfant à l’imamy-iri[5].
J’arrivai bientôt au banan[6] de l’imam, où l’on me pria de mettre pied à terre en attendant que l’on me préparât un logement. Quelques minutes après, mon gansoba (hôte) vint me prendre et me donner une case pour moi et mes bagages, un boulou (case d’entrée à deux ouvertures) pour mes hommes, et une grande case-écurie pour mes deux chevaux.
Pendant que mes hommes s’organisaient, j’allai rendre visite à l’imam, qui habite un groupe de cases voisin.
Ce vieillard me reçut très poliment ; il me demanda discrètement d’où je venais et où je comptais me rendre ; quand je lui eus tracé à grandes lignes l’itinéraire que j’avais suivi pour venir, il me manifesta, ainsi que toute l’assistance, son profond étonnement. Il ne comprenait pas comment j’avais pu traverser le Gourounsi sans une imposante escorte de marchands ou de Mossi. Je terminai mon premier entretien en manifestant à l’imam le désir de me rendre à Salaga, afin de gagner une route sûre me ramenant vers Kong. Il me dit qu’à son grand regret il ne pourrait satisfaire à mon désir que dans trois ou quatre jours, le chemin habituel étant impraticable pour le moment, à cause d’une guerre qui venait d’éclater entre les Dagomba de Savelougou et ceux de Kompongou.
[32]Hélas ! je ne demandais pas à partir sur-le-champ ; mes ânes étaient éreintés et mes bagages presque moisis : je ne les avais jamais ouverts pendant la route, dans la crainte d’exciter encore davantage la cupidité des naba gourounga. Moi-même j’étais dans un état de santé qui réclamait un traitement et du repos. Un commencement de dysenterie et une perte d’appétit dont je ressentais les premières atteintes en quittant Waghadougou, et dont j’attribue les causes au chagrin que j’avais eu en me voyant fermer les chemins par Naba Sanom, ne firent qu’empirer pendant ma traversée du Gourounsi. Dès les premiers jours, la perte et le vol du sac qui renfermait ma petite provision de riz et de sel me força de me nourrir, comme mes indigènes, de denrées crues ou mal préparées et de viande boucanée non assaisonnée. A partir de Koumoullou, il me fut impossible de me procurer quoi que ce soit en fait de vivres. Nous avons vécu exclusivement d’épis de maïs cuits au feu, et bien souvent crus. Non seulement le mil et le sorgho font défaut, mais encore la volaille : il n’y a pas, de Koumoullou à Korogo, une seule poule ou pintade. A ces privations venaient s’ajouter le séjour au soleil pendant toute la journée, les tribulations avec les chefs et les guides, la vermine[7] et la surveillance constante dont il fallait s’entourer. Toutes ces raisons m’empêchaient de prendre le plus petit repos. Il m’échoua aussi un surcroît de besogne me forçant d’entrer dans tous les détails de service. Diawé, mon premier domestique, auquel ils incombaient d’ordinaire, était atteint d’une affreuse maladie, sorte de lèpre connue par les Mandé sous le nom de massara dimmi (mal d’Égypte). Couvert de plaies, le malheureux, en arrivant à l’étape, ne pouvait vaquer à rien et était forcé de se coucher.
Ma dysenterie m’avait considérablement affaibli. En arrivant sur les bords de la Volta Blanche, je n’eus pas la force de gravir seul la berge opposée ; il me fallait l’aide de mes hommes pour me hisser sur le talus, monter et descendre de cheval.
L’accueil bienveillant de la famille dagomba chez laquelle je reçus l’hospitalité, les soins que me prodigua Adissa, mon hôtesse, les potions que je tirai de ma modeste pharmacie, me mirent sur pied au bout de vingt-cinq jours. L’ictère seul n’était pas guéri ; mes remèdes étaient restés impuissants. Je m’adressai aux indigènes ; on m’apporta bientôt des feuilles que je devais faire bouillir pour prendre des bains de vapeur et des bains chauds deux fois par jour. Je reconnus dans cette plante le[33] bantamaré[8] des Wolof, ce qui me donna pleine confiance. Les Wolof boivent de la décoction de racine de bantamaré à chaque léger dérangement du foie et surtout lorsqu’ils sont atteints de panda, sorte de jaunisse qui précède la maladie du sommeil si fréquente sur la Petite Côte[9].
Dès le troisième jour je ressentais un mieux sensible, et le sixième tout était fini. Ce remède indigène m’avait guéri.
El-Hédi, mon hôte, parvint aussi à guérir Diawé. Les indigènes de cette région m’ont semblé beaucoup plus versés que dans d’autres pays sur l’emploi des plantes médicinales ; ce qui leur manque, c’est d’en connaître le dosage exact et de savoir approprier la médication à tel ou tel tempérament. C’est ainsi que les enfants sont souvent traités comme de grandes personnes.
Il n’y a guère qu’une maladie contre laquelle les noirs sont impuissants : c’est la dysenterie ou la diarrhée chronique. Ils ont bien une médication à ordonner, mais ils ne veulent et ne peuvent observer la diète. Jamais je n’ai vu les noirs se résigner à ne pas manger ; ils sont persuadés que la nourriture seule sauve de la mort.
Les plantes médicinales sont partout très nombreuses, aussi bien dans la région du Soudan que nous occupons depuis longtemps que dans celles que je viens de visiter. Il est malheureusement regrettable que nous ne nous en occupions pas davantage. N’est-il pas triste de penser que l’Européen se trouve tout à fait désarmé contre la fièvre en Afrique, et qu’il ne possède pas un moyen prophylactique contre ce terrible mal dont le noir est exempt ou à peu près.
Les analyses des remèdes indigènes sont faites assez souvent dans nos hôpitaux des colonies, mais la conclusion est à peu près toujours la même ; on vous répond invariablement : « Nous avons l’équivalent en chimie minérale ». On croirait réellement que l’usage des substances organiques doit être prohibé. Et nous en restons là.
Dès que mon état de santé me le permit, je fis quelques visites à l’imam. Ce vieillard, qui est né dans le pays, aurait certes pu me donner de bons renseignements sur cette région. Malheureusement, il était difficile de me trouver seul avec lui. Mes entretiens devaient donc se borner aux choses banales de la vie, d’autant plus que nous ne nous comprenions qu’avec beaucoup de difficulté. La langue que l’on parle ici se nomme dagouna,[34] dagomsa, dagomba et mampoursa ; elle diffère assez sensiblement du mossi[10] pour qu’on ne la comprenne qu’au bout d’un séjour assez long. Je ne pense pas que, même si j’avais été très au courant du dagomba, j’aurais pu tenter grand’chose auprès des indigènes. Ayant un jour posé à l’imam une question qui lui parut indiscrète, il me demanda si j’avais quelque chose de commun avec l’Européen qui était arrivé pendant le ramadan à Gambakha, venant de Salaga, et qui fut forcé de s’en retourner sans avoir obtenu la permission de pousser plus loin[11].
Tous les habitants de cette région vivent dans la crainte de voir occuper leur pays par les Anglais, qu’ils redoutent. Ils n’ont pas de griefs sérieux contre eux ; ils les détestent tout simplement parce que leurs captifs sont réfugiés chez les Anglais, et que ces derniers les conservent et les enrôlent pour être soldats.
Je n’eus pas de peine à prouver que j’étais Français, un homme de Salaga, qui vint me rendre visite, leur ayant affirmé que je n’avais rien de commun avec les Anglais qu’il avait vus à Accra. Dans la suite, lorsque, pour réaliser les cauries nécessaires à l’achat de plusieurs ânes, je fis vendre quelques tissus et autres objets de fabrication française par mon hôte, tout le monde fut d’accord pour en déclarer la supériorité et affirmer hautement que mes marchandises n’étaient pas à comparer à celles des Anglais.
Mon hôte, El-Hédi Touré (El-Hédi veut dire Dimanche), me fit faire connaissance avec trois jeunes gens de ses amis, nommés Alfa Boukary Touré, Tahéri Touré et Kalifa Sissé. Les deux premiers sont Dagomba ; l’autre, d’origine mandé, est fixé ici depuis une vingtaine d’années. Après leur avoir fait quelques cadeaux et rendu de nombreuses visites, nous sommes arrivés à être d’excellents amis. C’est grâce à leur complaisance et en échange de renseignements sur l’Europe et les coutumes européennes, que j’ai obtenu quelques renseignements sur le Gourounsi, le Mampoursi et le Dagomba.
★
★ ★
On entend désigner par Gourounsi l’ensemble des territoires limités à l’est par le Mampoursi et le Dagomba, au sud par le Gondja et les États de[35] Oua, à l’ouest par le Lobi et le territoire des Niéniégué, au nord par le Dafina, le Kipirsi et le Mossi.
Ce territoire est arrosé par les trois cours d’eau qui forment la Volta et par ses affluents. La végétation y est plus luxuriante que dans les terrains ferrugineux de la vallée du Niger. Le sol, moins perméable et moins spongieux, conserve plus longtemps l’humidité ; on y rencontre souvent des flaques d’eau, auprès desquelles la végétation est de toute beauté. C’est un pays couvert, légèrement ridé, offrant des sites bien curieux et souvent sauvages. C’est une région de culture par excellence, mais impropre à l’élevage à cause de l’humidité et des insectes nuisibles au bétail.
La population, tout hétérogène, qui peuple cette vaste région paraît avoir été refoulée dans ces bois par des peuples plus avancés qui l’environnent. Parlant des dialectes différents, vivant en constante hostilité entre elles et toujours sur le pied de guerre, elles ont empêché les voies de communication de se développer, de sorte que le réseau en est peu compliqué. Il existe bien, comme partout, des sentiers sauvages reliant les villages les uns aux autres, mais ils sont tellement peu fréquentés, que l’on ne peut y circuler que difficilement sans guide. En dehors des deux itinéraires reliant le Dafina au Mossi décrits plus haut, et les chemins qui se dirigent de Sati sur Oua, on peut dire qu’il n’existe pas de voies de communication. Les noirs eux-mêmes, marchands et autres, ne parlent qu’avec un certain effroi du Gourounsi et de ses habitants.
La région nord-ouest du Gourounsi est habitée par un peuple qui nous a paru avoir beaucoup d’analogie avec les Niéniégué. Dans le Dafina on les nomme Nonouma, mais parmi les autres Gourounga et dans le Mossi on désigne les Nonouma par un autre nom qui nous a échappé. A propos de notre passage de Boromo à Bouganiéna, nous avons eu l’occasion de décrire la façon dont les Nonouma s’incisent les joues et se tatouent, nous n’y reviendrons pas dans ce chapitre. Leurs principaux centres sont : Baporo, Poura et Ladio.
A côté des Nonouma, mais plus à l’est vers Dallou, Sapouy, Baouér’a et Pouna et jusque vers le Kipirsi, habite une autre fraction des Gourounga, celle des Youlsi, ou Tiollé. La majeure partie de cette fraction n’a pas de marques ni de tatouages, quelques-unes de leurs familles ont cependant les deux marques caractéristiques du Mossi (l’entaille parlant de chaque côté du nez pour venir mourir à hauteur de la deuxième molaire, et deux entailles partant de chaque côté de la bouche pour venir mourir près de l’oreille. Ces entailles sont semblables à celles des Mandé-Dioula, mais au nombre de deux entailles seulement sur chaque joue).
[36]A l’ouest des Youlsi et entre eux et les Kassanga de Sati habite la fraction des Talensi ; ils se distinguent de leurs voisins par un tatouage bien original. Sur chaque joue, à l’aide de toutes petites incisions disposées sur trois rangées parallèles, ils forment un Z majuscule vu à l’envers.
Plus au sud et à l’ouest de Oual-Oualé habite la fraction des Tiansi ou Boulsi, qui se tatouent de trois façons différentes. Ils offrent cela de singulier, c’est que deux des tatouages ont la particularité suivante, que je n’avais pas remarquée : les yeux eux-mêmes sont environnés de six petites entailles.
Encore plus au sud, on trouve les Nakaransi ; ils se distinguent des autres Gourounga par une incision qui part de la naissance des cheveux, fend le front et le nez en deux parties égales. Perpendiculairement à cette incision longitudinale, il en part, chez certains types, une de chaque côté du nez, ou bien encore chez les uns à droite du nez, chez les autres à gauche.
Entre les Tiansi et les Nakaransi et la Volta occidentale habitent les Lama, ou Lakhama, ou Nakhalakha, Nokhorissé ou encore Nokhodossi. Ces tribus sont rarement tatouées. J’ai cependant vu quelques sujets ayant de chaque côté de la bouche deux incisions semblables à celles des Mandé-Dioula de Kong, mais moins longues.
De l’autre côté du fleuve, ils ont pour voisins les Dagari et les Dagabakha, qui me paraissent être un seul et même peuple. J’en ai vu à plusieurs reprises : ils ne sont point tatoués. On rencontre chez eux des couleurs de peau très foncées, approchant du noir des Wolof ; ils se prolongent jusque sur la rive gauche de la Volta occidentale et forment une importante colonie, qui, mélangée avec des Mandé-Dioula, forme le fond de la population de Oua.
Les Oulé, autre fraction des Gourounga, semblent être appareillés aux Lakhama ; ils habitent au nord des Dagari et Dagabakha, et entre leur territoire et celui des Bougouri. Les gens du Dafina classent les Bougouri dans la famille des Niéniégué et des Nonouma.
Ces divers peuples, qui constituent la population du Gourounsi, n’offrent pas de grandes différences de mœurs entre eux. Ils vivent depuis trop longtemps en voisins. Il est cependant notoire qu’ils appartiennent à des groupes ethnographiques distincts : les uns se rattachent au groupe Mossi, les autres à celui des Bimba ou Mampourga-Dagomba, du Gondja et même de l’Achanti. L’examen sommaire de quelques-uns de leurs dialectes et idiomes m’en a donné l’intime conviction. On ne pourra en opérer le classement rationnel qu’après en avoir étudié la linguistique.
[37]Les habitations gourounga sont à peu près toutes analogues à celles que j’ai décrites au cours de ma route du Dafina au Mossi et du Mossi à Oual-Oualé. Les costumes ne diffèrent pas beaucoup entre eux : les Gourounga, hommes et femmes, sont à peu près complètement nus ; dans quelques rares districts seulement et dans les villages situés sur les voies de communication fréquentées, on rencontre des indigènes vêtus de quelques loques en cotonnade, mais c’est l’exception ; ces gens-là semblent plutôt affectionner les peaux pour se couvrir ou cacher leur nudité. Quelques femmes des tribus du sud-est ont la lèvre supérieure percée et traversée par un roseau ou un piquant de porc-épic leur montant le long du nez. C’est tout le luxe féminin que j’ai eu l’occasion de constater.
La religion des Gourounga semble être le fétichisme. Ils ont des constructions rondes en terre, qui sont sacrées ; je les ai vus aussi invoquer Dieu, qui porte le même nom que le soleil (ouindi). Les constructions sacrées affectent un peu toutes les formes et dimensions, et sont souvent revêtues de dessins géométriques : cercles, losanges, carrés, etc., peints à l’ocre rouge ou noire, ou, encore, elles sont bariolées de gris obtenu à l’aide de cendres délayées dans de l’eau. A Pakhé, un soir, en me promenant devant une de ces constructions, je m’étais mis machinalement à siffler. Tout le village s’était attroupé et se lamentait ; je venais, paraît-il, de profaner les lieux saints. Il m’a fallu leur faire expliquer, pendant une bonne heure, qu’un tel acte commis par un Européen n’avait pas du tout la même portée que quand il était commis par un indigène.
Dans la région nord du Gourounsi on exploite beaucoup l’aloès ; avec les fibres on fait des fils. La feuille elle-même, pilée, sert à faire une sorte de feutre avec lequel on confectionne les bourres de fusil. On en extrait également une sorte de teinture qui, mélangée à du sable, sert de cosmétique pour les cheveux et les rend plus noirs.
Sa racine, grillée, pilée et délayée dans de l’eau, est employée comme collyre. Cette préparation, posée comme disque autour des yeux, sert de remède pour les yeux dans toutes les régions du Soudan. L’aloès s’emploie aussi chez les noirs pour raviver la chair des ulcères, et surtout dans la médecine vétérinaire, comme en France.
Le territoire de la rive gauche de la Volta Blanche se nomme Mampoursi[12]. Ses deux centres les plus importants sont Oual-Oualé et Gambakha, qui ont chacun 2500 à 3000 habitants. Le Mampoursi est actuellement[38] un tout petit État, limité au nord par le Mossi, au nord-est par le Gourma, à l’est par le Boussangsi, au sud par le Dagomba, à l’ouest par le Gourounsi.
Le territoire des Dagomba commence déjà sur la rive gauche de la rivière de Nasian, à 20 kilomètres au sud de Oual-Oualé. Le Mampoursi n’a donc qu’une profondeur de 20′ en latitude, mais il s’étend assez loin en largeur. Le souverain du Mampoursi est un Traouré (d’origine mandé) et réside à Nalirougou, village situé à quelques kilomètres de Gambakha ; il porte le titre de Mampourga naba. Il y a environ deux siècles, le Mampourga naba réunissait sous son autorité, outre le Mampoursi actuel, la région Sansanné-Mango et tout le Gourounsi jusqu’à la Volta Rouge. Il prétend encore, même aujourd’hui, que son territoire est limité par cette dernière rivière.
Comme dans le Mossi, l’organisation du pays était féodale et le pouvoir était entre les mains de nombreux naba plus ou moins puissants.
On raconte que, vers 1730, le naba de Nalirougou était devenu assez puissant pour qu’il cherchât à s’affranchir de la tutelle de Mampourga naba qui résidait à Gambakha ; ses troupes étant nombreuses et son village bien fortifié, le Mampourga naba convia les Gondja de Daboya et le Gottogo à venir s’emparer de Nalirougou, qui avait la réputation de renfermer le plus de captifs de la région. Aux gens du Gottogo se joignirent quelques Mandé de Groumania (Anno). Le siège et la prise du village étant terminés, les Ouattara du Groumania demandèrent à se fixer dans le pays. En récompense des services rendus, le Mampourga naba leur concéda le territoire actuel de Sansanné-Mango, et les Mandé y fondèrent ce dernier village. Aujourd’hui encore, le chef de Sansanné est un Ouattara. On y parle un dialecte agni et le mandé. Contrairement à ce que Barth a avancé, Sansanné-Mango ne veut pas dire « Camp de Mahomet », cela signifie : camp de Mango. Les Haoussa et souvent les Mandé désignent par l’appellation « Mango » Groumania, capitale de l’Anno.
Comment le Mampoursi a-t-il été rogné et réduit à ses limites actuelles ? Je l’ignore. Toujours est-il qu’en ce moment son chef ne commande pas grand’chose. Gambakha s’est affranchi et obéit aux ordres de l’imam Baraga. Oual-Oualé est entre les mains de l’imam Seydou Touré, et le reste du pays est commandé par quantité de naba et de nabiga plus ou moins puissants, tels que ceux de Zango et de Ouango aux environs de Oual-Oualé.
Le Gourounsi est ravagé depuis six ans par les troupes de Gandiari et de ses successeurs, et il y a déjà longtemps que les plus petites confédérations[39] se soucient fort peu des Traouré au pouvoir à Nalirougou. Beaucoup d’entre elles étaient soumises à El-Hadj Mohammadou, prédécesseur de Karamokho Mouktar, chef de Ouahabou, qui était en train d’annexer tout le Gourounsi quand la mort vint le surprendre. A mon passage à Koumoullou, le naba me raconta qu’il avait obtenu la protection du marabout de Ouahabou, ce qui prouve que son pouvoir s’étendait jusqu’aux limites extrêmes Est du Gourounsi.
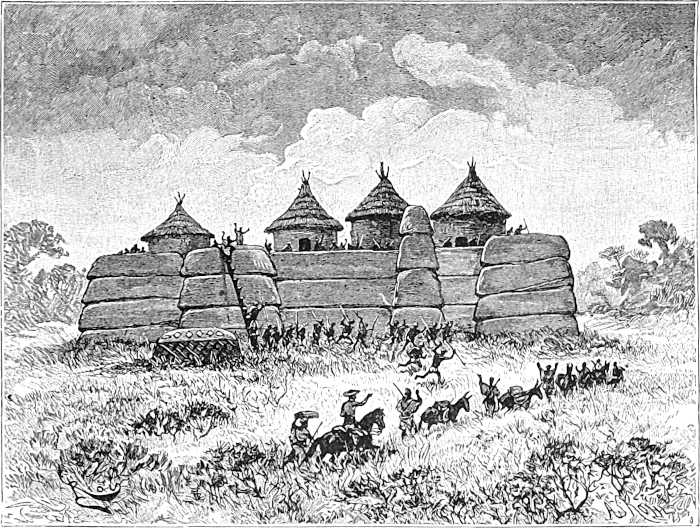
Construction sacrée de Gourounga.
La population du Mampoursi me paraît composée de trois éléments, que je classe ici par ordre d’ancienneté d’occupation, de la façon suivante :
1o Les autochtones ou ceux que l’on peut considérer comme tels ; ils sont marqués d’une seule entaille partant de la narine gauche et coupant la joue pour se terminer à hauteur de la première molaire : cette marque offre de l’analogie avec celle des Mor’o ou Mossi ;
2o Une autre population, également très ancienne dans le pays, mais certainement d’origine mandé, comprenant des Traouré, Diabakhaté et Kamara. C’est elle qui a encore actuellement le pouvoir ; elle est marquée, comme les Mandé-Bambara de la vallée du Niger supérieur, de trois longues cicatrices partant des tempes pour se terminer au menton.
[40]3o D’immigrants du Haoussa, dits Dagomba, venus dans la région à la suite des guerres d’Othman dan Fodia, au commencement de ce siècle. Ceux-ci aussi sont d’origine mandé, et ne sont peut-être venus se fixer dans le pays que parce qu’ils savaient déjà des leurs au pouvoir ici. Ils ont pour diamou : Sissé, Touré[13], Mandé. Leurs marques diffèrent de celles des Haoussa, elles sont moins nombreuses et se croisent à hauteur de l’oreille, tandis que celles des premiers partent du cuir chevelu pour se terminer à la mâchoire.
Tous les Touré et Mandé portent en outre trois grandes entailles sur la poitrine, le ventre, les cuisses, les mollets, le cou-de-pied, le gras du bras, l’avant-bras, le dos de la main, les omoplates, etc., de sorte qu’un membre de Dagomba, même séparé du tronc, peut être reconnu très facilement. On ne voit cette façon de se marquer que chez les Mandé-Magaza, que l’on rencontre surtout dans le Baguié (Kaarta).
La présence des Traouré, antérieure à la création de Sansanné-Mango, prouve que dans ce pays il y avait déjà de nombreuses colonies mandé, et que Sansanné-Mango est au contraire un établissement mandé, relativement récent. Ce qu’il y a de très curieux, c’est que dans le Mampoursi on appelle la langue mandé : sahersi, sakhaiersé ; de sahelé (nord). Les premiers Mandé seraient donc venus du nord ?
Dans le Mampoursi, on désigne rarement les Haoussa sous le nom mossi de Zanwéto ; on les nomme, comme le font les Mandé, Marraba, Mallakha, et Marraka, ou Marrakha ; il est assez curieux de rapprocher ici la dénomination de Marka, que donnent les Mandé aux Sonninké.
C’est du mélange des langues de ces trois éléments qu’est né le dialecte dagomsa. Il se rattache certainement au groupe de langues dont fait partie le mossi, mais renferme d’autres termes, d’autres expressions, tout en conservant les mêmes constructions grammaticales. Comme dans la langue mossi, il y a de nombreux mots mandé ; mais en surplus des mots empruntés au haoussa il y a, comme dans le mossi, des expressions wolof. J’ai en particulier relevé les mots : tanga, chaud ; bobchi, chose de la tête, diadème ; de bob, tête en wolof ; mouss, chat ; pendé, pagne ; le radical gan (hôte), et ce qu’il y a de plus curieux, l’auxiliaire défa, avec l’a sourd qui est si souvent employé en wolof.
[41]Il serait assez curieux de faire un rapprochement entre le mossi, le dagomsa et le wolof ; on arriverait peut-être, par une étude très approfondie de ces langues, à découvrir le berceau de cet intéressant peuple wolof, qui devait se trouver, il y a des siècles, à côté des Mossi et sûrement beaucoup plus à l’est que le Oualo et le Fouta actuel, qu’on leur assigne souvent comme pays d’origine. Ce qui tendrait à prouver que les Wolof habitaient plus à l’est, c’est qu’ils ont conservé jusqu’à nos jours l’expression dioulandé, pour désigner le sud. Dioulandé veut dire « pays des Dioula » ; or, comme les Mandé-Dioula n’ont fait irruption vers la côte qu’à une époque récente, et qu’il faut admettre que les peuples, même ceux qui ont une langue très pauvre en mots, ont de tout temps eu besoin de désigner les quatre points cardinaux, on peut en déduire que les Wolof habitaient au nord des Mandé-Dioula. Et comme le berceau des Mandé-Dioula est dans la boucle du Niger, il s’ensuit que les Wolof y habitaient aussi.
Les Wolof ont du reste emprunté aux Mandé de nombreux mots se rattachant surtout aux habitations, aux cultures et aux produits du sol, quoique la langue wolof soit une des plus riches du Soudan. Il est en outre à remarquer que parmi tous les peuples que j’ai visités, je n’ai trouvé des couleurs de peau aussi foncées que celle des Wolof que chez les habitants de Oua, chez les Dagomba de l’ouest, vers Oua, et isolément chez quelques Mossi et Mandé-Dioula.
Mais revenons à notre population mampourga pour parler un peu des femmes et des enfants. J’ai constaté avec plaisir que la coutume barbare du tatouage tend à disparaître chez le sexe faible. On ne rencontre que fort peu de femmes défigurées. En revanche, elles ne se privent pas de se faire faire une incision en long, ou en oblique, sur le nez et les joues. Elles se font aussi des dessins en bleu sur le front et les joues. Je ne dirai pas que c’est beau, mais ce n’est pas trop laid, et au moins original.
Voici quelques-uns de ces tatouages.
Rafraîchir ces petits dessins pour qu’ils paraissent toujours bien foncés, constitue une sérieuse occupation pour la femme mampourga. Munie d’une petite glace, elle étend la couleur noire sur le tatouage avec une fine barbe de plume en forme de pinceau ; puis, en guise de vernis, elle passe là-dessus un pinceau beurré, ce qui donne une teinte très brillante. Ce noir est fourni par un arbuste nommé bourinké en mandé. Les femmes en calcinent le fruit et le pilent, en y mélangeant un peu d’eau de cendre. C’est de cet arbuste qu’on tire le charbon à poudre à fusil. Il est très répandu dans le pays. Partout il constitue la flore rabougrie des terrains[42] ferrugineux, et ressemble par son bois et son fruit au gardénia sauvage, en compagnie duquel on le rencontre toujours.
Après chaque repas, la femme se teint en rouge la lèvre inférieure, de façon à faire croire qu’elle a mangé force kolas dans la journée : il faut supposer que c’est un charme de plus. Elle l’obtient en mâchant une tige d’un autre arbuste, nommé guénou en mandé. La femme dagomba ou mampourga n’a pas une coiffure qui lui est propre ; elle arrange ses cheveux tout aussi bien en cimier qu’en petites tresses collantes, comme les Mandé et les Siène-ré, mais elle a un talent tout particulier pour se coiffer d’un bobchi, foulard ou tout autre morceau de calicot imprimé. Roulé négligemment autour de la tête, et un peu penché, ce petit turban est vraiment coquet. Les femmes âgées se coiffent aussi du madras, en s’enveloppant toute la tête comme les femmes haoussa. Pour vêtement de corps, c’est, comme un peu partout, le pagne de couleur et le langana (voile) des femmes dioula de Kong, dans lequel elles se drapent assez coquettement. On voit peu ou point de langana d’étoffe européenne ; ils sont tous en cotonnade rayée bleu et blanc, ou bleu, blanc et rouge, ou encore blanc et rouge. Ces étoffes sont fabriquées dans le Mampoursi ou le Dagomba, à l’aide de dix-sept bandes de 2 m. 50 chacune. Ce châle est nommé ici pakha kinkina (linge pour femme).
On voit ici des femmes et surtout des fillettes relativement jolies, surtout lorsqu’on vient du Mossi et du Gourounsi, où l’on n’est pas gâté sous ce rapport. Elles rappellent beaucoup le type mandé-dioula des filles de Kong.
Les enfants, portés dans le dos comme chez presque tous les Soudaniens, à l’exception des Mossi, sont assez bien soignés. Malheureusement, quelques mères ont adopté le système des Gourounga, dont j’ai déjà parlé, martyrisant les enfants sous prétexte de leur donner des soins de propreté.
Le mariage d’une jeune fille donne lieu à des réjouissances au tam-tam, qui durent plusieurs jours. Comme chez les Mandé-Dioula, toutes les jeunes filles viennent prendre chez les parents de la mariée la dot de la jeune femme, qui est portée en chantant par tout le village. Il faudrait bien trois pages pour énumérer tous les riens qui composent la dot. A côté de quelques pagnes enroulés avec soin, on voit triomphalement perché le bâton à faire le tô ; ensuite, dans l’ordre le plus baroque, viennent des chaudrons, des piments, des corbeilles, du soumbala, un tabouret, des balais, des foulards, des calebasses, un collier de perles, du poisson sec, etc. Il y a déjà du progrès avec les Bobofing, les Niéniégué et les Mbouin(g), chez qui la dot se résume en deux séko (nattes), ou encore en tabac à priser, ou, chez les gens riches, à 4000 cauries.
[43]La polygamie existe dans le Dagomba, comme dans tout le Soudan.
On croit généralement que le noir est polygame parce que la religion musulmane permet la polygamie.
Il est peut-être vrai que cette tolérance du Coran engage beaucoup les musulmans à avoir plusieurs femmes, mais quand on voyage au Soudan, on constate bien vite que la polygamie existe également chez les peuples fétichistes.

Jeunes filles portant la dot.
La cause n’en est donc pas exclusivement au Coran, et l’on est forcé de reconnaître que la polygamie a une autre cause que l’islamisme. Les noirs n’ont pas été sans en reconnaître souvent les inconvénients ; fréquemment des guerres et des dissensions se sont élevées à cause de successions. L’avènement d’un nouveau chef ne manque jamais d’élever des compétitions entre les fils de femmes différentes d’un même chef, mais les noirs ne se corrigent pas pour cela de la polygamie.
Les causes qui engendrent la polygamie sont multiples :
Chez les Soudanais, les soins du ménage incombant à la femme sont si nombreux, qu’il est pour ainsi dire impossible à une seule femme de suffire à cette besogne.
L’eau se trouve quelquefois à une assez grande distance dans certains villages : une femme est spécialement chargée de cet approvisionnement.
[44]La manutention des céréales et la préparation des aliments prend un temps infini. On délivre aux femmes le grain en épis ; il faut le battre, le vanner, puis le piler dans un mortier en bois, ou le moudre entre deux pierres, pour le réduire en farine.
Enfin il faut cuire la nourriture.
Cette préparation est tellement laborieuse que, dans certains pays, les femmes, pour ne pas être en retard, doivent commencer à piler le matin avant le jour.
Tous les aliments se servent dans de la vaisselle en bois et dans les calebasses ; il faut, après chaque repas, la porter à la rivière ou au puits et procéder à un récurage, qui est très long, si l’on veut manger dans des récipients propres.
Enfin, il faut fabriquer la graisse, le savon, les condiments, et ce ne sont pas de vaines opérations.
Ce sont aussi les femmes qui font certaines cueillettes, celles du coton et de l’indigo par exemple.
Enfin, la femme participe largement au travail des champs ; c’est elle qui va chercher le bois.
Si l’on veut s’habiller, il faut préparer le coton, en extraire la graine, le carder, le filer, etc.
Il faut aussi laver le linge.
S’il y a des enfants, il y a surcroît de besogne.
Enfin, chez tous les peuples fétichistes ou musulmans il existe la coutume suivante :
Dès qu’une femme est enceinte, son mari n’a plus aucun rapport avec elle ; il en est de même pendant tout le temps que l’enfant n’est pas sevré.
Comme dans tous ces pays l’enfant n’est sevré que vers l’âge de trois ans, on peut estimer à quatre ans, avec la gestation, le temps où le mari n’a pas de rapports avec sa femme.
Dans ces conditions, le noir prend une autre femme quand il en a les moyens.
Comme une femme ne peut avoir un enfant que tous les quatre ou cinq ans, elle en a rarement plus de cinq, mais il en meurt à peu près la moitié, faute de précautions hygiéniques et pour d’autres raisons trop longues à développer ici ; de sorte que si un homme désire avoir une nombreuse famille, il lui faut prendre un grand nombre de femmes.
Il ne faut pas croire que tous les maris possèdent plusieurs femmes. Non, on en rencontre même beaucoup qui n’en ont qu’une, surtout dans les classes peu aisées.
[45]Les favorisés sont ceux qui, dans une aisance relative, ont eu les moyens d’acheter une seconde ou une troisième femme ou de payer une nouvelle dot à une nouvelle famille.
Les femmes du Soudan, étant donnés les conditions dans lesquelles on les marie et le rôle qu’elles sont appelées à jouer dans le ménage, ne sont pas précisément heureuses ; et cependant, malgré le nombre de rivales avec lesquelles elles sont obligées de vivre, on n’entend pas souvent des discussions s’élever entre elles. La bonne intelligence règne, au moins en apparence, et elles obéissent toujours à la première femme, à la plus ancienne dans le ménage.
A propos de jalousie entre femmes du même mari, on m’a raconté la petite légende suivante, que je ne puis m’empêcher de transcrire :
« Deux sina (femmes d’un même mari) ayant chacune quelques captifs s’occupaient toutes deux des cultures de leur mari momentanément absent.
« L’une des sina, la plus jolie, était jalouse de l’autre, préférée par le mari pour ses qualités de bonne ménagère, de femme d’ordre et d’excellente mère de famille.
« Depuis longtemps la plus jolie cherchait à se venger de la favorite, lorsque l’occasion s’en présenta fortuitement dans les circonstances suivantes.
« L’époque des semailles du riz étant arrivée, la préférée, atteinte d’une maladie d’yeux, pria la plus jolie de trier son riz et de veiller aux semailles.
« — Avec plaisir », répondit-elle. Elle emporta le riz, le pila de façon à le réduire en farine, puis elle le sema elle-même dans le champ de la favorite, se disant en elle-même : « Me voilà vengée ; le riz ne lèvera pas, notre maître[14] sera furieux contre elle, je n’aurai qu’à en bénéficier. »
« Mais Dieu ne voulut pas laisser s’accomplir cette vilaine action et fit venir une variété de mil très blanc, d’une qualité supérieure, auquel les captifs, qui étaient au courant de la chose, donnèrent le nom de sina goué malo[15].
« La légende ajoute que le mari, pour punir sa femme, la fit vendre à des Maures, pour qu’elle ne revînt plus jamais dans le pays. »
[46]Le 18 août, on célébra à Oual-Oualé la grande fête, ou fête du sacrifice des moutons, dite العيد الكبير ce qui me donna l’occasion de voir le luxe déployé par les musulmans du village. Le costume des hommes rappelle assez celui des Mandé de Kong, mais il y a moins de grandes coussabes et peu de burnous. On porte beaucoup la coussabe à taille du Mossi. L’imam seul et quelques musulmans aisés étaient vêtus de la belle coussabe blanche du Haoussa, dite zangousso.
Ce vêtement est confectionné en bandelettes de 5 centimètres de largeur et brodé en lomas avec de la soie blanche ; c’est le linge le plus fin que j’aie vu jusqu’à présent ; il coûte de 30000 à 50000 cauries, suivant qu’il est doublé ou non.
A l’occasion de la fête, plusieurs musulmans, sans que je les connusse, m’envoyèrent des mets tout préparés. Je dois du reste dire à la louange de Oual-Oualé que sa population est très hospitalière, bienveillante et fort polie. Pendant ma maladie, des musulmans envoyèrent prendre dans les villages aux environs du lait et des œufs pour me les offrir ; la femme de mon diatigué eut la complaisance d’envoyer une captive jusqu’à Gambakha pour m’acheter du beurre frais ; lorsque je sortais, hommes et femmes s’accroupissaient sur mon passage pour me saluer, comme l’ordonne la bienséance ici.
Oual-Oualé est construit dans une petite dépression où coule un ruisseau qui en cette saison a son écoulement vers l’est-sud-est, mais en saison sèche il ne forme que quelques amas d’eau stagnante dont l’absorption immodérée donne la filaire de Médine. Comme les villages mossi, Oual-Oualé se compose d’une série de petits villages plus ou moins espacés, que les habitants ont réunis pour la dénomination en trois groupes principaux : celui de l’ouest se nomme Tampouloung-o, celui de l’est Fang-ana (c’est là que résident l’imam et les Dagomba) ; et enfin celui du sud Bokodouré, qui signifie « de l’autre côté du marigot ». Ce groupe est habité principalement par les Mandé, Sissé, Diabakhaté, Kamara, Traouré et quelques familles haoussa.
Le marché quotidien se tient à Fang-ana. C’est un marché à condiments, niomies, tabac, etc. ; on y trouve aussi à acheter à un prix élevé de la viande de bœuf, tous les deux ou trois jours. Le grand marché se tient tous les trois jours à Bokodouré, sous un splendide banian ; on y trouve, outre les choses essentielles à la vie, du coton, de l’indigo, de l’étoffe de couleur fabriquée ici, et quelquefois des vêtements confectionnés, boubous, bonnets, etc. Somme toute, Oual-Oualé n’est pas dépourvu de ressources et les vivres n’y sont pas hors de prix. J’y dépensais environ 2500 cauries par[49] jour, pour la nourriture de mes hommes et de mes animaux, en donnant de temps à autre un repas de viande à mes indigènes. L’igname, étant la base de la nourriture, ne se vend pas cher : quatre ou cinq belles ignames coûtent 100 cauries, les œufs de 10 à 20 cauries, et la volaille 400 à 500 cauries pièce. Sur le grand marché on apporte souvent des environs quelques marmites de dolo ; cette boisson est bien moins bonne que celle qu’on fabrique dans le Mossi ; elle est mal filtrée et tient toutes sortes de matières en suspens, ce qui ne la rend pas précisément appétissante. S’il y a peu de dolo à Oual-Oualé, il y a beaucoup de mil germé ; les musulmans et les idolâtres s’en servent pour préparer le bakha, sorte de bouillie peu épaisse, consommée toujours le matin de bonne heure. C’est un des seuls mets que les indigènes mangent à l’aide d’une cuiller. Sans être nourrissante, cette préparation est saine, surtout quand il entre dans sa composition du piment et du tamarin.

Sous le banian.
A Oual-Oualé on mange beaucoup un tubercule nommé bouré en dagomsa ; il ressemble, à s’y méprendre, à la pomme de terre nouvelle de moyenne grandeur. C’est le Tacca involucrata. Réduit en granules et cuit au jus de viande, ce fruit est mangeable ; mieux préparé, il serait peut-être très bon. Son goût est assez difficile à définir ; je lui ai cependant trouvé de l’analogie avec l’orge perlé, dont il a le gluant. Cette racine n’est pas cultivée, elle croît parmi les herbes dans la brousse. Un jour que j’étais allé me promener à Zango, petit village dans le nord-ouest, Alfa Boukary, qui m’accompagnait, m’a fait voir la plante ; j’en donne le croquis à la page 51.
La fleur est d’un vert jaune et la graine ressemble à celle de la pomme de terre. Les enfants et les femmes vont déterrer cette racine, qui n’est réputée comestible que lorsqu’elle ne se compose que d’un tubercule par pied. Il faut laver beaucoup ces tubercules avant de les cuire, sans cela ils sont indigestes ou même vénéneux. J’avais déjà vu cette plante aux environs de Médine, en me promenant, mais j’ignorais qu’elle était bonne à manger, je crois même que les Kassonké eux-mêmes ne la récoltent pas, mais ils en connaissent le nom et l’appellent sanga-tamba.
On vendait aussi sur le marché un petit tubercule noir, allongé, sorte d’igname minuscule. En mandé, on le nomme ousou-fing (patate noire). C’est probablement le tubercule aérien du Dioscorea bulbifera....
Le commerce et l’industrie dans le Mampoursi est entre les mains des Dagomba, des Mandé et de quelques Haoussa. Les autochtones, ou plutôt ceux que je considère comme tels, s’occupent de culture et un peu d’élevage de bétail.
[50]La teinturerie est représentée par vingt et un puits à indigo en activité, et le tissage par une cinquantaine de métiers seulement, répartis par tout le village, mais dont le nombre est plus considérable en saison sèche. Cette population a été assez intelligente pour abandonner la fabrication peu rémunératrice du vulgaire koyo blanc, pour se livrer au tissage de cotonnades rayées bleu et blanc, de divers dessins, rouge et blanc et rouge blanc et bleu, qui rapportent beaucoup plus. Ces étoffes ne peuvent malheureusement être livrées qu’à un prix très élevé ; il leur est impossible de soutenir la lutte avec les tissus de provenance du Haoussa, ni avec ceux de Kong.
Ainsi le to pakhé, étoffe bleu et blanc ou blanc et rouge, n’est livré ici qu’à raison de 2000 cauries le mètre carré, tandis que Kong fournit le même genre, mais plus lourd, à 1500 cauries. Le siriféba, couverture de Kong, bleu et blanc, bordé d’un galon en coton blanc, orné de longues franges et d’une largeur de 1 m. 80 sur 2 m. 50, vient jusqu’ici par Salaga, et se vend facilement de 12000 à 15000 cauries, tandis qu’à Kong elle en vaut 6000 seulement ; les Dagomba n’ont malheureusement aucun article à lui opposer.
Les autres dessins de bleu de diverses nuances avec quelques filets de coton rouge (coton rouge de provenance européenne) reviennent ici à 4000 cauries le mètre carré. C’est le même prix que les beaux el-harotaff de Kong, qui sont supérieurs en dessin, en qualité, et qui ne contiennent presque exclusivement que des fils venant d’Europe.
Les Dagomba arrivent cependant à écouler leurs tissus, en les faisant porter dans les villages éloignés des routes fréquentées par les Haoussa et les gens de Kong, mais ils trouvent surtout à en faire le placement auprès des Mossi, en échange de bœufs et de moutons.
Quand ils sont forcés de les écouler sur Salaga, Krakye, Kintampo ou Daboya, ils n’obtiennent, pour un pagne d’une valeur de 8500 cauries à Oual-Oualé, que 10000 à 10500 sur ces derniers marchés. Les bénéfices sont très restreints.
Le coton et l’indigo viennent par petits lots des villages des environs ; je n’ai jamais vu 50 kilos de coton ou 10 kilos d’indigo sur le marché, tandis qu’à Léra, d’où les gens de Kong tirent beaucoup ces deux produits, il y en avait de grosses quantités.
Ce n’est ni l’industrie du tissage ni celle de la teinture qui donnent aux gens de Oual-Oualé une aisance relative, c’est plutôt le commerce de transit du kola qui leur procure quelques bénéfices. La situation géographique de Oual-Oualé est excellente entre le Mossi central, Salaga et le Gourounsi.
[51]1o Un des principaux articles d’échange de Oual-Oualé est le sel. Il est tiré de Salaga (sel marin venant de la Côte) ou bien de Daboya. Les indigènes de Daboya l’extraient des eaux d’une mare ou plutôt d’un lit secondaire de la Volta Blanche en communication en hivernage avec Daboya. On arrive à livrer ce produit au même prix que Salaga livre le sel marin d’Accra. Le sel de Daboya ressemble à notre sel gris qu’emploient les tanneurs, mais il est un peu plus menu. A Oual-Oualé, le kilo vaut environ 1300 cauries au[52] détail, mais il est probablement à meilleur marché quand on en achète une ou deux charges. Celui de Salaga vient ici en sacs de fabrication européenne, celui de Daboya dans des peaux de bouc ou encore dans des sacs tressés en feuilles de rônier. Le sel n’étant guère plus cher ici que le sel en barres à Waghadougou, les gens de Oual-Oualé peuvent le livrer à meilleur marché dans la partie sud-est du Gourounsi, où ils l’échangent contre du bétail et surtout des captifs.
2o Viennent ensuite les kolas, tirés de Salaga, Krakye, Kintampo, où ils sont achetés 500 à 800 cauries le cent ; ils sont revendus en temps ordinaire aux Mossi, qui viennent les prendre à Oual-Oualé à raison de 1500 à 2000 cauries l’ouroufié-kili, le cent. Actuellement, les communications directes sur Salaga et vers le sud étant interrompues à cause de la guerre qui vient d’éclater entre les gens de Savelougou et de Kompongou, le cent se vend 4000 à 4500 cauries, pris à Oual-Oualé.
3o Le koyo blanc, dit taro ou pendé, est tout ce qui se fait de plus commun en cotonnade dans tout le Soudan. Cette étoffe est fabriquée par les Mossi de la partie sud du Mossi, des environs de Béri et de Koupéla, et leur est payée à raison de 100 cauries les 1 m. 70 par les Dagomba, qui la revendent, principalement sur les marchés de Savelougou et de Kompongou, à raison de 100 cauries les 1 m. 30. Cette étoffe, comme je l’ai dit, n’est pas fabriquée dans le Dagomba ; elle sert à doubler certaines coussabes, à confectionner de grossiers effets de travail et à vêtir les captifs de cases.
4o Quelques bœufs, moutons et ânes apportés par les Mossi. Ces animaux sont payés : les bœufs 25000 à 30000 cauries, les moutons 5500 à 6500 et les ânes de 30000 à 35000 cauries.
En échange de ces produits, les Mossi remportent du cuivre en barres pour bracelets, des kolas, de la cotonnade de couleur de Oual-Oualé et surtout des cauries.
Pendant mon séjour ici, il est arrivé deux fois des Mossi, dont une partie est venue camper chez mon hôte El-Hédi Touré. Rien n’est curieux comme l’arrivée d’une bande de ces gens-là, car on ne peut qualifier cela de caravane.
Précédés d’un lounga, griot jouant du petit tam-tam à cordes qui se tient sous le bras, les Mossi, au nombre d’une trentaine, portant chacun sur la tête un rouleau plus ou moins volumineux de taro, se bousculent et se précipitent dans le village en poussant de véritables cris de fauves pour annoncer leur arrivée. Ils font irruption dans tous les boulou inoccupés. Le plus ancien va saluer l’hôte qu’il a choisi et lui offre pour se faire bien venir la traditionnelle boule de soumbala.
La vente ne commence que le deuxième ou troisième jour, les gens de[53] Oual-Oualé se gardant bien de se presser à acheter leur cotonnade, ils retardent le plus possible leurs demandes, de façon à pouvoir leur extorquer quelques centimètres de plus par 100 cauries sous des prétextes plus ou moins fondés. Enfin, arrivés à leurs fins, ils enlèvent tout dans une journée, en ayant soin de ne leur donner en payement que de grosses cauries. Leurs achats terminés, les Mossi, auxquels il reste de trop lourdes charges de cauries, sont forcés de convertir les grosses cauries en petites, de façon à pouvoir les emporter, ce qui donne lieu à un agio de 10 pour 100, 1100 grosses cauries n’en valant que 1000 petites.
Les Mossi sont considérés par les Dagomba comme des brutes, ils les trompent dans le décompte des cauries, ce qui n’est pas difficile ; un Mossi mettant presque une journée entière pour compter quelques milliers de cauries.
Et Dieu sait si les Dagomba sont naïfs cependant.
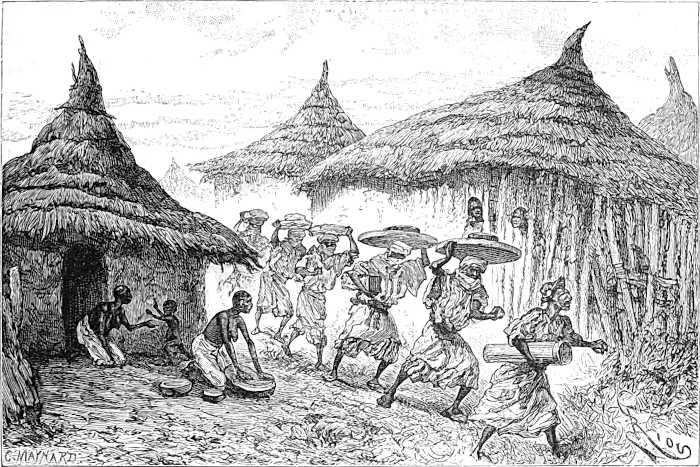
Arrivée d’une bande de Mossi.
A ce propos, je me souviens d’une aventure qui m’a bien amusé à Oual-Oualé.
A Ladio, après la perte de mes ânes, en refaisant mes charges, je m’aperçus que la plupart de mes cadenas, en tôle légère, étaient dépourvus de clefs : comme leur prix en France n’excédait pas 10 ou 15 centimes, je m’empressai de les jeter pour nous alléger d’autant.
[54]Mes hommes, qui ne laissaient rien perdre, eurent vite fait de les ramasser et de les serrer dans leurs peaux de bouc.
Je n’y pensais plus, lorsqu’en me promenant sur le marché de Oual-Oualé, je vis Fondou, un de mes hommes, assis sous un arbre, ayant un foulard étendu devant lui par terre, sur lequel s’étalaient trois cadenas sans clefs.
De nombreux curieux faisaient cercle autour de lui et examinaient les cadenas, mais Fondou, tout à fait indifférent, semblait ne pas tenir à les vendre.
Un des curieux, cependant, finit par s’informer du prix ; Fondou, après s’être fait prier, en demanda une somme de cauries équivalant à 2 francs.
Tout le monde se récria, disant que le prix était exorbitant, d’autant plus qu’il n’y avait même pas de clef.
Fondou les laissa parler, puis leur dit d’un air calme :
« Je ne vous ai jamais parlé de clef, et je ne vous ai pas demandé de m’acheter mes cadenas ; laissez-les, d’autres plus avisés que vous seront bien heureux de me les acheter. »
Cinq minutes après, un individu apporta les cauries demandées et prit les trois cadenas !
Le noir est si enfant, qu’il suffit souvent de ne pas tenir à vendre un objet pour qu’il veuille à toute force l’acheter.
★
★ ★
Les animaux achetés au Mossi et les captifs de provenance du Gourounsi sont évacués sur Salaga, Kintampo et Daboya avec un bénéfice de 10000 à 15000 cauries par bœuf, 3000 à 4000 par mouton, une fois engraissé. Ce sont encore les captifs qui donnent le plus beau bénéfice : il n’est pas rare de voir réaliser 100 pour 100 sur des lots de choix, jeunes filles ou jeunes femmes. De Salaga, outre les kolas, on rapporte naturellement les perles, le corail, les foulards, étoffes imprimées, la coutellerie et un peu de poudre, marchandises faciles à écouler. L’eau-de-vie de traite (le gin) a fait ici son apparition, mais elle est bue en cachette : Oual-Oualé contenant une forte proportion de musulmans, l’individu qui boit le barasou est mis à l’index.
Comme après l’hivernage il y a beaucoup de Haoussa se rendant aux marchés à kolas, une partie d’entre eux — presque toujours les mêmes — afin d’écouler plus rapidement leurs étoffes et ouvrages en cuir, et se procurer quelques animaux de transport de plus, se détournent du chemin direct pour venir jusqu’ici. Les routes par le Gourma et le Boussangsi,[55] peu sûres, ne sont pas très fréquentées. Les Haoussa préfèrent se rendre à Salaga par le Yorouba et le Noufa, Dandoui, Dendi et Yendi.
Oual-Oualé n’a pas non plus de relations avec Oua.
Il existe aussi un petit mouvement commercial entre Sansanné-Mango et Oual-Oualé. Sansanné est éloigné de dix jours de marche ; il vient de temps à autre un ou deux porteurs avec du soumbala et du tabac moulé en petits pains ou emballé dans un tissu de feuilles de rônier.
Le tabac qui vient de Sansanné-Mango est à très bon marché, environ 200 cauries le kilo, comme celui du Gourounsi, mais il est de qualité tout à fait inférieure ; cela tient probablement à sa préparation, qui laisse à désirer : il n’est pas fumable pour un Européen, même habitué aux tabacs du Soudan. Il se vend en navettes cannelées allongées, de 50 centimètres, du prix de 120 à 150 cauries, tandis que celui du Gourounsi se vend en pains plats ovales.
La culture du tabac à Sansanné-Mango semble avoir quelque extension ; il s’en exporte beaucoup, m’a-t-on dit, sur Kotokolé, Dandoui et vers le Yorouba. Le pagne de Kotokolé, qu’on apporte également sur les marchés du Dagomba, est une étoffe à jours en cotonnade blanche, d’une largeur de 1 m. 30 à 1 m. 50 environ ; il est tissé d’une seule pièce ou alors les bandes sont adroitement raccordées au crochet : c’est ce qui doit constituer les jours. J’en ai vu plusieurs à des femmes de Oual-Oualé. Le prix de ce pagne varie entre 6500 et 8500 cauries.
Kotokolé est un grand village situé à une dizaine de jours de marche dans le sud-est de Oual-Oualé. Pour s’y rendre, on passe entre Sansanné et Yendi. Kotokolé ne se trouve pas éloigné de Zogo ou Sokho, porté au nord de l’itinéraire Skertchly.
Alpha Boukary m’a amené un jeune homme ayant été à Kotokolé. Celui-ci m’a affirmé que le travail des pagnes est exclusivement fait par les femmes, qu’on ne parle à Kotokolé ni le dagomba, ni l’achanti, ni le mandé, ni le gondja, que la région est très montagneuse, et qu’au loin dans la même direction il y a des montagnes très hautes. Je n’ai pu obtenir d’autres renseignements : au delà de Karaga il ne se rappelait le nom d’aucun village, il ne se souvenait que du passage d’une grosse rivière coulant vers le sud, probablement la rivière Oti ou Sabran.
Comme dans presque tous les pays où il y a un petit mouvement commercial, on voit un peu d’argent porté en bagues ou en bracelets. Le prix d’un thaler de Marie-Thérèse (5 fr. 50) est de 4000 cauries. On le nomme ici réal.
Oual-Oualé, qui n’est encore qu’un gros village, pourrait rapidement se[56] développer et acquérir beaucoup plus d’importance si sa population était un peu plus remuante.
Certainement les Mampourga sont bien au-dessus des Mossi au point de vue intellectuel, mais il ne faut pas oublier que l’impulsion est donnée par les Mampourga dits Dagomba et par les Mandé. Il semblerait que ce peuple se soit laissé un peu engourdir par son contact avec les Mossi, je l’ai constaté à maintes reprises. Ainsi, actuellement, au lieu de profiter de la hausse extraordinaire des kolas, causée par la guerre de Savelougou et de Kompongou, et d’envoyer toutes les forces vitales et moyens de transport à Salaga chercher ce fruit, ils prétextent que c’est l’époque des cultures et qu’il est impossible de disposer des captifs pour aller à Salaga. Or, si jamais j’ai vu des cultures négligées, c’est bien ici. En allant me promener aux environs, j’ai été écœuré de voir que les lougans de l’imam seuls et les cultures d’ignames étaient en état ; les champs d’arachides, de mil, sont envahis par les herbes et l’ivraie. Du reste, aucun propriétaire ne visite ses lougans, les captifs ne sont pas surveillés, les maîtres sont d’une coupable négligence. Il y a quelques années, il y avait dans le village de nombreux citronniers et quelques orangers : tout a péri faute de soins.
Cependant, cette population ne manque pas d’esprit d’ordre et d’économie. C’est ainsi que les cultures sont délimitées soigneusement à l’aide de bornes marquées au noir[16] d’une croix ou de tout autre signe pour la distinguer de celle du voisin, et que les femmes se livrent activement au petit commerce de kolas, tabac, niomies, etc. Mais, comme je l’ai dit plus haut, ce peuple est moins actif que le Mandé Dioula, et par conséquent les affaires sont moins prospères que celles de ce dernier peuple.
Il n’y a pas non plus de griots, et, comme chez les Mandé Dioula, on renvoie impitoyablement tout individu de ce genre qui tenterait d’exercer sa verve. Malheureusement les gens de Oual-Oualé font à tort subir aux ouvriers en cuir le même sort qu’aux griots, de sorte qu’il est impossible de se procurer une simple sandale dans le pays : tous les ouvrages en cuir sont de provenance haoussa.
Les gris-gris jouent aussi un grand rôle. Mon diatigué, qui avait une femme et un enfant à Savelougou, se lamentait tous les jours sur le sort de sa famille : je lui donnai le sage conseil d’aller lui-même ou d’envoyer un de ses captifs à Savelougou pour chercher sa femme, puisque le village n’était pas assiégé. Il semblait vouloir se ranger à mon avis et s’était décidé[57] à partir, lorsqu’un musulman lui vendit un gris-gris pour attacher au cou d’un coq blanc. Il devait amarrer ce coq dans sa propre case et lui donner à boire l’encre d’un verset du Coran transcrit sur une tablette en bois — ce qui fut ponctuellement exécuté. De ce jour toutes les inquiétudes de mon hôte disparurent, sa conscience était tranquille, il avait fait son devoir.
Une autre fois, j’ai vu vendre à un Mossi un gris-gris destiné à le rendre invulnérable. Afin de bien faire ressortir la valeur de cette amulette, le vendeur se livra à l’opération suivante : L’amulette, enveloppée dans un chiffon, fut attachée sous l’aile d’un poulet, soigneusement enduit de savon. Ce poulet, muni du gris-gris et attaché par une patte à la porte d’une case, devait être invulnérable. Le Mossi, muni de son arc et placé à environ 20 mètres de cette cible vivante, fut convié à lancer trois flèches sur l’animal, le marabout le défiant de l’atteindre. Naturellement, ce poulet, qui avait déjà servi de cible dans les mêmes occasions, dès qu’il vit l’archer en position, se tint sur ses gardes et, au lieu de rester tranquillement en place, se débattit et bondit autant que le petit bout de corde le lui permettait. Bien entendu, les trois flèches ne l’atteignirent pas. Des compères qui assistaient à cet exploit offrirent au fabricant d’amulettes l’un 3000, l’autre 4000 cauries, et finalement le miraculeux gris-gris fut adjugé au crédule Mossi pour 2500 cauries, presque une fortune pour ce malheureux !
Dès que je sentis mes forces revenir, je songeai à organiser mon départ pour Salaga. Deux de mes ânes étant morts de fatigue en arrivant, et deux autres se trouvant hors de service pour le moment, je dus m’occuper de les remplacer. Dans ce but je faisais vendre un peu d’étoffe imprimée, du galon blanc pour diadème, des hameçons, des aiguilles et surtout du corail d’un modèle dont jusqu’à présent je n’avais pu trouver le placement. Je réunis ainsi en peu de jours 250000 cauries, avec lesquelles j’achetai cinq ânes[17] et quelques moutons pour la route.
J’étais très embarrassé sur le choix d’un itinéraire, voulant éviter de suivre la route qu’avait suivie à l’aller et au retour le lieutenant von François qui vint à Gambakha pendant le ramadan. J’appris qu’il était venu par la route de Savelougou. Il m’était facile d’éviter de prendre cette route, puisque actuellement elle était même réputée dangereuse à suivre. On ne sut m’affirmer s’il était venu directement de Salaga à Gambakha ou par l’itinéraire Yendi-Gambakha. D’autre part, les chemins de l’ouest ne sont praticables qu’avec beaucoup de difficulté : la Volta Blanche ne reçoit[58] pas moins de cinq affluents non guéables de Oual-Oualé à Dokonkadé ; je me décidai donc pour un chemin légèrement Est, afin d’atteindre Karaga, où l’imam Seydou Touré se chargeait de me faire conduire à son collègue religieux. Prétextant le mauvais état des chemins, je ne précisai pas que j’avais l’intention de suivre ultérieurement telle ou telle direction, voulant me réserver le choix de la route Yendi ou directe Salaga, suivant le cas où l’explorateur de Gambakha serait venu par l’un ou l’autre de ces chemins.
Le départ fut arrêté au 17 septembre, le 16 étant dixième jour de moharem, fête de la Nativité du Prophète.
Avant de quitter Oual-Oualé, il me reste quelques mots à dire sur Gambakha et les environs. Gambakha est situé à une forte journée de marche dans l’est-nord-est de Oual-Oualé, 30 à 35 kilomètres. Sa population n’est pas supérieure à celle de ce dernier village ; son commerce et son industrie sont les mêmes ; on y fait cependant des nattes et de la vannerie. Ce village est situé sur le chemin Waghadougou-Salaga, que j’aurais bien voulu prendre si Naba Sanom me l’avait permis. Les Mossi comptent vingt jours de marche de Waghadougou à Salaga.
| De Waghadougou à Koupéla | 5 | jours. |
| De Koupéla à Tenkoulor’o | 3 | — |
| De Tenkoulor’o à Gambakha | 4 | — |
| De Gambakha à Salaga | 8 | — |
| Total | 20 | jours. |
Ce sont de très fortes journées de marche, comme celles que font les Mossi seulement et qui correspondent au trajet d’hommes peu ou point chargés. Avec des porteurs ou des animaux de bât, il faut compter le tiers en plus, c’est-à-dire environ trente jours.
Les Mossi nomment aussi Gambakha : Gambakha Natenga, « capitale du Gambakha », quoique ce village ne soit plus depuis longtemps la résidence de Mampourga Naba.
Gambakha n’a pas de relations avec les Bimba (Gourma) et fort peu avec les Boussanga. Ces deux peuples ont une aussi mauvaise réputation que les Gourounga. Les Boussanga viennent cependant de temps à autre vendre quelques chevaux aux Mampourga. Ces animaux sont réputés très vigoureux et d’une taille élevée. Je n’ai pas eu l’occasion d’en voir ; à Oual-Oualé et aux environs, il y a bien quelques chevaux, mais ils sont tous en mauvais état et d’une race dégénérée.
Les Foulbé du Boussangsi viennent également à Gambakha vendre du beurre et quelquefois du bétail.
Comme l’étymologie de son nom l’indique, Gambakha ou Gambaga[59] semble avoir été fondé ou au moins longtemps habité par des étrangers. Gamba ou Diamba signifie, dans beaucoup de langues ou dialectes de cette partie du Soudan, « étranger » ; ga n’est qu’un suffixe qui veut dire « gens de, peuple, nation et même pays ». En mandé, en mor’, en dagomsa et même en wolof, quantité de noms de peuples ont cette terminaison. Point n’est besoin d’imaginer toute une histoire et un dialogue pour prouver l’étymologie de Galam et de Ganar (voir Bulletin de la Société de Géographie de 1886).
Galam signifie « gens, pays, peuple du Lam » (souverain du Fouta-Toro), et Ganar « peuple ou pays des Nar » (nar signifie « Arabe » en wolof). Cette terminaison ga se change en haoussa en ba. Exemple : Dagomba, Yarrouba, Barba, Bimba, etc.

Retraite aux flambeaux.
A la fin du siècle dernier il y avait même des Maures établis à Gambakha. Bowdich (1817) cite ce village comme lieu de naissance de Bimba, chef des Maures de Koumassi.
La présence de Foulbé non musulmans, assez nombreux dans le Boussangsi et les régions avoisinantes, semble confirmer le dire de Duncan qui signale un peuple ayant le caractère du Peul et buvant du dolo. Barth a peut-être porté un jugement un peu sévère sur ce voyageur. — Que dans son itinéraire les distances franchies soient excessives et le chiffre de la population[60] des villages exagéré, je l’admets ; mais l’emplacement d’Assafouda, de Babakanda, etc., ne doit pas être loin de celui qui leur est assigné sur la carte du Dépôt de la Guerre, puisqu’on m’a signalé une région montagneuse à l’est de Kotokolé. Barth dit qu’il n’a pu se faire citer un seul nom de l’itinéraire de Duncan : cela n’a rien qui doive surprendre, moi non plus, et pourtant je suis relativement à côté de ces régions, en comparaison de l’éloignement de Barth. Ceci tient à ce que Oual-Oualé n’a pas de relations avec cette région, qui est plutôt en communication avec le Yorouba, peut-être aussi ces villages sont-ils actuellement détruits ou sans importance ou voir même mal orthographiés ; ce qu’il y a de sûr, c’est que par ici il n’existe aucun centre ayant 10000 ou 12000 habitants.
17 septembre. — La population a été sur pied une partie de la nuit à l’occasion d’un tam-tam suivi d’une retraite aux flambeaux. Enfants et grandes personnes, munis de torches en paille, ont parcouru les rues et sont allés ensuite achever de brûler leurs torches sous les arbres aux abords du village. On voyait des centaines de feux errer en désordre par les champs ; ils s’arrêtaient, puis reprenaient leur course, éclairant d’une lueur terne des groupes de faces noires et de torses nus : sous prétexte que l’on pourrait brûler ses effets, hommes, femmes, enfants, circulaient tout nus.
Le son du tam-tam et d’un ou deux boudofo (corne de dagué) achevaient de donner à cette scène un caractère étrange.
Comme le tam-tam avait résonné presque toute la nuit, le matin tout le monde était engourdi ; aussi mon départ de Oual-Oualé n’eut pas lieu de bonne heure. Ce fut au milieu d’une nombreuse affluence de curieux et d’amis que le vieil imam Seydou Touré me recommanda à son captif qui devait m’accompagner jusqu’à Karaga. Le brave vieillard s’était mis en grande tenue pour me faire ses adieux. Sur la place du petit marché, après une courte prière récitée pour nous, il prit congé, me souhaitant bon retour vers ma patrie.
[61]CHAPITRE XI
Départ de Oual-Oualé. — Voyage dans des terrains inondés. — Karaga. — Incidents de voyage, difficultés causées par les pluies. — Arrivée à Pabia. — Les Dagomba. — Passage de la rivière de Palari. — Entrée dans le Gondja. — Dokonkadé. — Arrivée à Salaga. — Les pèlerins de la Mecque. — Bakary, mon hôte. — Position de Salaga. — Les habitations. — Les quartiers de la ville. — Le marché. — Le commerce d’eau et de bois. — Articles d’importation et d’exportation. — Valeur de l’or et de l’argent. — Nouvelles de Kong. — Je communique avec la Côte des Esclaves. — Renseignements sur le cours du Comoë. — Les Ligouy. — Arrivée de quelques caravanes de Haoussa. — Les mulets du Haoussa.
De Oual-Oualé trois chemins conduisent à Karaga. Celui de l’est, le plus long, passe à Gambakha ; celui du centre, le plus direct, passe à Porogo ; mais, le service du batelage n’y étant pas assuré et le terrain absolument inondé, on me conseilla de prendre le chemin de Savelougou. Jusqu’à Nasian, ce chemin, quoique plus long que le précédent, est celui où il y a le moins d’eau à cette époque. El-Hédi voulut m’accompagner, il ne me quitta qu’en arrivant au petit village de Louaré. Au delà du marigot de Louaré, qu’on ne peut traverser qu’en déchargeant les animaux, le sentier n’est plus qu’un ruisseau et la campagne environnante est complètement couverte d’eau ; la marche y est extrêmement pénible, aussi n’atteignons-nous Nasian que dans l’après-midi. A 1 kilomètre au sud du village coule la rivière que nous avons à traverser demain et qui sert de limite entre le Mampoursi et le Dagomba, placé sous l’autorité du naba de Yendi.
18 septembre. — Ce matin de bonne heure nous sommes réveillés par une violente tornade, la première de cette année ; elle fut accueillie avec joie par tout mon personnel, car c’est un indice certain de la prochaine fin des pluies d’hivernage.
Dès que le temps fut calmé, nous nous acheminâmes vers la rivière dont la veille déjà nous avions reconnu le point de passage. Ce cours d’eau, qui vient de l’est-nord-est, coule dans une plaine dépourvue d’arbres. Ses[62] rives mêmes sont privées de végétation. Actuellement il a environ 75 mètres de largeur, mais son lit n’a que 15 mètres, autant que l’on peut en juger par quelques sommets de buissons semés par-ci par-là au milieu des eaux et qui délimitent assez nettement l’emplacement des berges. Le service du passage est assuré par deux petites pirogues en bon état et très bien travaillées ; elles appartiennent au chef de Nasian, qui fait percevoir, comme partout, des droits payables en cauries. Mes hommes manœuvrant très bien les embarcations indigènes — plusieurs d’entre eux sont des pagayeurs émérites, — ils ont effectué à eux seuls le passage des animaux et des charges. Pour cette raison, le chef de Nasian eut la générosité de ne pas me réclamer de droits de passage ; je fis cependant donner 2000 cauries aux piroguiers comme pourboire.
Sur la rive gauche, une petite ride de terrain d’une dizaine de mètres de largeur seule n’est pas inondée ; elle est couverte de trois lengué (arbre fournissant un bon bois de construction), et permet de recharger les animaux, car au delà le terrain n’est qu’une immense nappe d’eau dissimulée par de hautes herbes. Cet endroit est très difficile à traverser pour les animaux : le terrain, fangeux, est défoncé par de jeunes hippopotames[18] qui viennent y pâturer la nuit.
A 500 mètres de la rivière on quitte le chemin de Savelougou pour prendre un sentier moins large qui a une direction presque Est. Il longe à peu de distance la rivière. De temps en temps on aperçoit sur la gauche de grands amas d’eau qui sont en communication avec la rivière.
Le sol, constitué d’argile recouverte d’agglomérés de roche ferrugineuse, est tout à fait imperméable ; le sentier, damé par les piétons en saison sèche, est praticable quoique couvert partout de 10 à 15 centimètres d’eau ; mais dès qu’on s’en écarte pour une raison quelconque, on glisse ou s’embourbe. De la rivière à Niombong-o, on voyage dans une mer de hautes herbes desquelles émerge de temps à autre la cime de quelque gardénia sauvage ou de cé rabougri ; on fait environ 2 kilomètres à l’heure ; c’est dans ces conditions que l’on débouche brusquement dans un lieu plus favorisé par la nature, au milieu duquel s’élève le petit village de[63] Niombong-o. Jamais personne ne supposerait l’existence d’un lieu habité par ici.

Marche dans la prairie inondée de Louaré.
Il est deux heures de l’après-midi quand nous arrivons ; les trente cases qui composent le village semblent désertes ; par cette chaleur, pas une poule ne circule autour des cases. Si quelques pieds de gombo et quelques lianes de giraumont grimpant sur les toits des cases ne trahissaient la présence de l’homme, on se croirait dans un village abandonné. Il y règne un silence de mort, on n’entend même pas le gazouillement des oiseaux ou le cri de quelque toucan ou de quelque tourterelle égarée ; cela me rappelle les villages de Samory sur la route du Baoulé à Sikasso ; il ne manque que les cadavres dans les cases.
Mon guide m’installe dans le premier boulou que nous rencontrons, et bientôt après deux ou trois grandes personnes et quelques enfants arrivent des champs et viennent un peu égayer et rendre la vie à ce lieu déshérité.
Mes hommes ont capturé, en route, une iguane terrestre grise dite koûto en mandé, et une petite tortue de terre à carapace à charnière, nommée kouta. Tout joyeux, ils m’apportent ces deux animaux en me disant que c’est de très bon augure. « Notre chemin sera bon », se répètent-ils à l’envi. Quant à moi, je suis loin de partager leur enthousiasme, je vois le moment où je ne pourrai plus continuer ma route : les chevaux et les ânes ne peuvent[64] longtemps supporter de telles fatigues. Avec des animaux robustes, au début d’une exploration, le voyage pendant la saison des pluies est à préconiser ; c’est en effet pendant l’hivernage seulement que l’on peut juger de la richesse d’un pays et le voir dans toute sa splendeur, avec tout le luxe de sa végétation. Mais quand on a des animaux éreintés et que soi-même on est fatigué, les voyages en hivernage sont excessivement pénibles.
19 septembre. — Les cultures de Niombong-o s’étendent vers l’est, sur une profondeur de 500 mètres ; elles sont dans un état splendide ; les arachides surtout sont d’une grosseur extraordinaire, ce qui me fait supposer que les cultures ont à peine deux ans d’existence. Le chemin, tout en étant moins noyé que dans l’étape précédente, est dans un état tel que ce n’est qu’après de grandes fatigues que nous atteignons Pizzoukhou, après avoir traversé l’ancien emplacement d’un village. Je suis bien accueilli, quelques Dagomba et le chef m’offrent des ignames et un poulet. La population est polie et très serviable.
20 septembre. — La route, en quittant Pizzoukhou, se dirige vers le sud-est. Quoique le terrain se relève un peu de temps à autre, on traverse encore de nombreux endroits fangeux et surtout des emplacements inondés qui doivent alimenter la rivière Koualzi. Trois petits villages, Zan, Langokho et Ton, se distinguent par leurs cultures soignées et surtout variées ; on aperçoit, à côté de beaux sorghos, des calebasses, des piments, du chanvre indigène dit dafou en mandé, des gombo, des arachides, des haricots de plusieurs variétés, un peu d’indigo et du coton dans les sillons des ignamières.
Un Mandé qui m’offrit le bombo à Zan m’apprit que ces tanga[19] sont placés sous l’autorité du naba de Ton, le plus gros des trois villages.
Dans l’après-midi nous atteignons Karaga ; l’imam m’installe chez un de ses élèves, non loin de sa propre demeure.
Je dus m’arrêter un jour à Karaga, autant pour laisser reposer mes animaux que pour prendre discrètement des renseignements sur l’itinéraire suivi par l’explorateur venu à Gambakha. Mon hôte était très communicatif : il m’apprit de suite que j’étais le second Européen qui venait à Karaga et que von François, mon prédécesseur, était venu de Yendi par Patenga, et avait fait retour par le même chemin. Je sus aussi que trois autres chemins partant de Ga se dirigent sur Salaga et rejoignent, à une ou deux journées de marche au nord de Salaga, soit l’itinéraire Oual-Oualé,[65] Savelougou, Yendi, soit l’itinéraire Yendi, Salaga. Un quatrième chemin partant de Patenga rejoint l’itinéraire Yendi à Zankoum ou Dokonkadé. Je me décidai pour ce dernier, qui devait être le moins inondé, car je le supposai le moins éloigné de la ligne de partage entre les eaux des affluents de la Volta Blanche et celles des affluents de la rivière Dako ou Probondi.
L’imam de Karaga me reçut fort bien et se chargea de me faire obtenir du naba la permission de prendre le chemin dont j’avais fait choix, et de me faire donner un guide pour m’accompagner jusqu’à Salaga ou au moins pendant trois ou quatre jours de marche.
Karaga est un village presque aussi gros que Oual-Oualé. La majeure partie de la population est musulmane, mais il n’y a pas de mosquée ; du reste, dans toute cette région on ne m’a signalé de mosquée qu’à Yendi et à Kompongou.
L’industrie de Karaga est, comme un peu partout, réprésentée par la teinture et le tissage de deux spécialités :
1o Une cotonnade blanche rayée en travers de filets de coton rouge, dont le prix du mètre carré s’élève à environ 1500 à 1800 cauries.
2o Une cotonnade toute blanche, très fine, presque aussi fine que celle fournie par les Haoussa. Le prix du mètre carré est de 1000 cauries environ. La largeur des bandes varie, comme partout, de 9 à 12 centimètres.
Le commerce est le même à peu près qu’à Oual-Oualé. Karaga est cependant tributaire de ce dernier village pour le taro, cotonnade blanche ordinaire, et les animaux de boucherie, les Mossi ne dépassant Oual-Oualé que pour se rendre alors à Salaga. D’autre part, Karaga fournit des kolas et du sel soit aux gens de Gambakha, soit à ceux de Oual-Oualé, quand ces deux articles leur font défaut.
On élève aussi un peu de bétail ici. Les bœufs sont en assez bon état ; quant aux moutons, la race est tout à fait dégénérée ; un beau mouton de Karaga ne peut pas donner plus de 4 à 5 kilos de viande.
Je rendis visite au naba dans la matinée ; il me reçut dans une case ronde à deux entrées, dite boulou, de dimensions extraordinaires et plus grande que les cases élevées dans certains villages de la rive droite du Niger pour y recevoir Samory lors de son passage. Ce boulou avait 12 mètres de diamètre.
L’assistance était nombreuse. Le naba, vêtu simplement mais sans luxe, était assis sur un siège un peu élevé. Après m’avoir fait souhaiter la bienvenue, il me dit que, selon mon désir, il me ferait conduire par Patenga à Salaga.
[66]Le naba de Karaga me paraît jouir d’une certaine influence dans la région. Quoique son pays fasse partie du Dagomba de Yendi, il occupe une position un peu indépendante, fait la guerre pour son propre compte et semble se soucier fort peu du naba de Yendi. Il n’a pas peu contribué au succès de Gandiari en marchant de concert avec lui et les gens de Daboya contre quelques villages gourounga. Lorsqu’il s’est retiré avec les gens de Daboya, la fortune de Gandiari était faite, quantité de gens préférant au commerce de kolas le pillage et la chasse aux esclaves, beaucoup plus rémunératrice. Ces aventuriers restèrent auprès de lui et constituèrent le noyau des bandes qui ravagent encore la région.
22 septembre. — En quittant Karaga on traverse successivement deux petits villages de culture appartenant au naba, puis d’eux tanga dépendant de Karaga, mais dont je n’ai pu apprendre le nom. Dans l’un deux, il y a une dizaine de puits à indigo et quelques métiers à tisser en activité. Les cultures de ces tanga sont aussi très variées : outre les calebasses, l’indigo et le piment, il y a quelques belles cotonnières. Pendant cette étape, on traverse huit ruisseaux affluents de la Volta Blanche, rivière Nâbo et autres. Leur passage est très facile, ils sont peu importants et tous à fond de roche, schiste marneux ou grès friable ; leur origine doit se trouver à peine à quelques kilomètres dans l’est sur la ligne de partage des eaux.
Il est évident que c’est sur la ligne de partage des eaux que les indigènes auraient dû frayer leur chemin ; il aurait été plus long, mais au moins praticable en toute saison ; mais le noir ne réfléchit pas, et l’absence de villages a dû le rebuter : le gîte pour lui est tout. Quoique à flanc de coteau, ce chemin est encore en partie inondé ; les animaux n’arrivent à Patenga qu’à trois heures et demie de l’après-midi.
Le naba est frère cadet du naba de Karaga. Il m’envoie, dès mon arrivée, quelques ignames et me fait dire qu’il me recevra vers cinq heures.
Le naba, qui a une physionomie tout à fait intelligente mais très rude, me reçut devant sa case. Dès mon arrivée il commença par me rudoyer et me parler d’un ton très autoritaire ; il me dit qu’il me fallait remporter mon cadeau pour venir le lui offrir dans la matinée du lendemain. Avec ménagements, j’expliquai à ce potentat noir qu’il parlait à un Européen, qui partout où il passe a droit à des égards, et, pour terminer, je lui signifiai que, parti depuis longtemps de ma patrie, je ne pouvais, pour une raison futile, remettre de jour en jour mon départ ; j’étais donc décidé à partir le lendemain. Loin de se fâcher, il me tendit la main en signe de[69] conciliation et offrit de mettre également à ma disposition un guide, comme l’avait fait son frère de Karaga.

Visite au naba de Karaga.
Dimanche 23 septembre. — A Patenga on quitte la route se dirigeant sur Yendi pour prendre un sentier faisant du sud-ouest dès la sortie de Sampiémo, petit village situé à 3 km. 500 de Patenga. Ce sentier est passable jusqu’aux approches de Sagoué ; mais avant d’entrer dans ce village il faut traverser un petit ruisseau qui a transformé la plaine en marais sur une profondeur de plus de 500 mètres. Ce passage est tellement difficile en cette saison, que non seulement tous les ânes, mais encore leurs conducteurs, sont tombés dans les flaques d’eau. En arrivant au village, après une journée déjà fatigante, il fallut ouvrir tous les bagages pour faire sécher les marchandises complètement mouillées et encore s’en occuper pendant la nuit en les plaçant auprès des feux.
Lundi 24 septembre. — Cette étape est un peu plus longue que la précédente ; il est malheureusement difficile de la scinder en deux. Le sentier est privé de villages et les endroits où il y a de l’eau sont impossibles. C’est en vain que je cherchai un campement ; on ne trouve d’endroit sec un peu élevé que lorsqu’on arrive près de Zang : là le terrain se relève, on suit même pendant quelques kilomètres la ligne de faîte de cette région de collines. A plusieurs reprises nous coupons de petites ravines se dirigeant alternativement vers l’est ou vers l’ouest.
Les arbres sont moins rabougris par ici ; il semblerait que la végétation va devenir bientôt plus belle. Les cés atteignent une hauteur moyenne, mais ne doivent pas donner de brillantes récoltes. Le terrain est composé de grès ferrugineux et de grès friables dans lequel sont incrustés des galets de diverses variétés. Cette région doit être privée d’eau en saison sèche ; elle ressemble en cela au pays des Dokhosié et des Komono, dont elle a la même latitude. Ce qui surprend, c’est qu’il n’y a ni bambous, ni palmiers par ici ; dans les villages, je n’ai remarqué qu’un seul finsan, quoiqu’il soit commun sous les mêmes latitudes dans les pays de l’ouest ; les mimosées sont aussi excessivement rares.
Je n’ai vu que peu de traces de gibier ; en revanche, il y a beaucoup de grands aigles au plumage blanc et noir nommés ban ou gan en mandé ; ils ont de l’analogie avec l’aigle blanc pêcheur, mais sont beaucoup plus puissants et ont d’autres mœurs.
Zang, comme Sagoué, est un petit village de cent cinquante habitants environ. Son naba dispose de deux fusils et possède un cheval qui n’en porte que le nom, tellement il est laid et difforme.
En arrivant, il me désigne comme logement l’habitation d’un de ses[70] griots. C’est au milieu des tam-tams de tous les modèles et dimensions connus que nous trouvons à nous installer. Je croyais cette sotte profession de griot bannie de toute la région, comme à Oual-Oualé, où l’on a ces instrumentistes en horreur, mais c’est tout simplement parce que là-bas il n’y a pas de naba, tandis qu’ici, comme chez tous les peuples en retard, il y a beaucoup de chefs et alors beaucoup de griots.
Dès mon arrivée ici, j’ai eu à constater que la population n’était pas précisément complaisante. Ayant demandé à acheter des ignames et du mil pour mes animaux, on me fit d’abord répondre que le village était sans ressources ; puis, peu à peu, on m’apporta ce que je demandais, mais en me le faisant payer le triple de sa valeur. Le naba m’envoya dans la soirée une charge d’ignames et 400 cauries pour m’acheter de la viande et du sel ! Acheter où ? je me le demande. J’abandonnai naturellement les cauries à mon guide et je fis remercier ce généreux chef en lui envoyant un petit cadeau.
J’aurais bien voulu quitter le lendemain ce village inhospitalier ; malheureusement j’étais arrivé ici avec deux ânes mourants et deux autres hors de service. Je ne pouvais songer à me remettre en route dans ces conditions ; il me fallut bon gré mal gré laisser reposer mes autres animaux sous peine de les perdre dans une future étape.
Voyant mon embarras, le chef me proposa bien de me vendre un âne (le seul du village) ; mais comme, au plus bas mot, il ne voulait s’en défaire que pour la modique somme de 125000 cauries, je renonçai à conclure ce marché et me décidai à rester ici trois ou quatre jours.
Non seulement ces Dagomba, pour la plupart fétichistes, ne sont pas complaisants, mais encore ils sont peu sociables. Il ne s’est pas passé un jour sans que les gars du villages vinssent chercher noise aux âniers pour les pâturages. Le dernier jour, la querelle se changea en rixe qui menaçait de mal tourner, les hommes du village étant venus avec des haches et des pioches à défaut d’autres armes. Mes hommes, de leur côté, avaient pris les trois fusils ; j’arrivai juste à temps pour mettre le holà. Deux musulmans raisonnables ayant de leur côté prêché raison, cette scène se termina par une distribution de horions reçus de part et d’autres, et n’eut pas de suites fâcheuses.
Samedi 29 septembre. — Mes ânes, quoique un peu remis, ne se trouvaient pas dans un brillant état : deux d’entre eux étant morts, il ne m’en restait que cinq en état de porter.
Dans le chemin que je suis, les villages sont éloignés de plus de 20 kilomètres les uns des autres ; ce sont des étapes trop longues pour des animaux[71] fatigués ; je dois donc, à mon grand regret, abandonner le chemin suivi précédemment. Je cherche à faire le plus de sud possible, afin de gagner au plus vite la route de Yendi à Salaga, où les étapes sont plus courtes et les lieux habités plus nombreux. Je me dirige à cet effet sur Pabia et m’arrête à Feullé. La route est bonne : trois kilomètres avant d’arriver au village, on traverse un torrent impétueux, mais peu profond ; il est l’origine de la rivière de Palari, premier affluent sérieux de la rivière Dako ou Probondi (cette rivière a son confluent avec la Volta (fleuve principal) en aval de Tamkrankou (route de Salaga à Krakye).
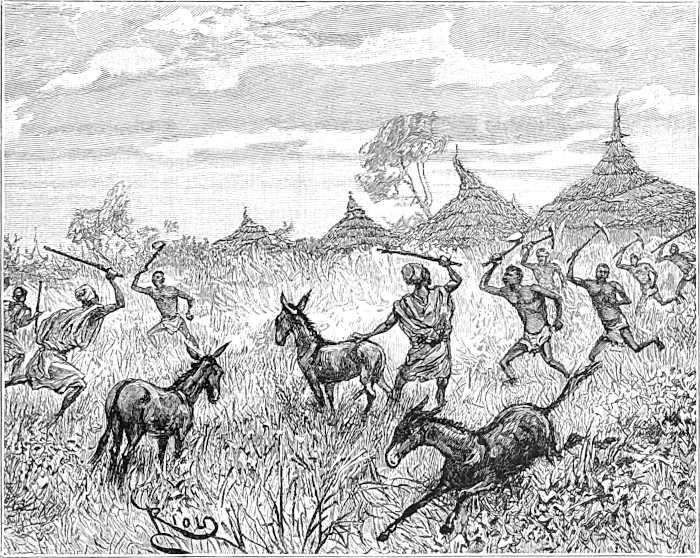
Rixe menaçante.
A Feullé, les Dagomba sont fort aimables. Bien que ce soit un tout petit village (une centaine d’habitants environ), il s’y tient un marché, ce qui donne un peu d’animation. Il n’y a cependant rien qui mérite d’être mentionné. Les produits ne sont pas variés : un peu de sorgho, du savon, du beurre de cé, des condiments, du tabac à priser et du mauvais dolo, dont un habitant m’offrit une calebasse, croyant me faire plaisir. Les ignames ici sont presque données : pour 200 cauries on m’en a apporté quinze belles.[72] Les étrangers payent toujours un peu plus cher — comme partout du reste. J’estime qu’une belle igname ne coûte ici que 10 cauries.
Ce village possède deux beaux citronniers. Je me suis empressé de faire cueillir quelques-uns de ces fruits, afin de corriger l’eau, qui n’est pas bien bonne dans cette région. Le citronnier avait déjà fait son apparition à Zang, mais, négligé, il ne donnait que de tout petits citrons, tandis qu’ici ils sont d’une grosseur raisonnable et bien juteux ; il y a aussi par-ci par-là dans le village quelques papayers chargés de fruits, mais ce n’est pas encore l’époque de la maturité, ce que je regrette, la papaye étant toujours pour moi un excellent dessert.
Dimanche 30 septembre. — Le terrain, qui insensiblement commence à s’abaisser à partir de Zang, continue à s’affaisser. Le chemin n’est cependant pas trop noyé, et l’étape se fait d’autant plus facilement que nous passons d’abord entre deux petits villages, Batenga et Badouré, pour traverser ensuite un troisième, nommé Ngouensi, ce qui fournit l’occasion aux habitants de nous voir passer et de m’adresser la parole, qui en mossi, qui en dagomsa, qui en haoussa. Comme cela se borne en salutations, je riposte de mon mieux, ce qui étonne et amuse ces braves gens.
Pabia (Kwobia de la carte anglaise du capitaine Lonsdale) est par exception un village groupé ; pour un peu je me croirais en présence d’un village wolof. Comme ceux-ci, il possède cette verdure trompeuse qui fait espérer au voyageur un fouillis d’arbres pour se reposer, mais au fur et à mesure qu’on s’approche, on voit la verdure faire place au chaume. L’illusion a été produite par les papayers, les lianes de giraumont, les tiges de gombo et de dadian (textile) et surtout par le même acacia au maigre feuillage qui est placé, comme à Dakar, en bordure dans tous les jardinets de Pabia. La ressemblance est frappante même une fois entré dans le village, les habitations étant délimitées, comme chez les Wolof, par des tapades en tiges de mil et en sekko.
Il y a cependant en dedans et autour des villages quelques banans, ficus et doubalé, et au centre se trouve un emplacement où croissent pêle-mêle des herbes, de la pourguère et un peu d’indigo et de tabac. Pabia, qui n’a pas plus de 200 à 300 habitants, possède une construction carrée en terre servant de mosquée et deux écoles musulmanes. Les femmes font presque toutes le salam. Sauf les captifs, qui m’ont paru assez nombreux, je crois que tout le monde est musulman, ce qui n’empêche pas le village d’avoir la réputation justifiée de contenir beaucoup de voleurs.
Dans la soirée, quand mon diatigué me prévint de ce détail, un de mes hommes s’était déjà laissé voler sa couverture. En faisant le tour du village[73] j’ai constaté qu’il y a ici plusieurs familles haoussa qui s’occupent de tissage et de teinture ; j’ai compté huit puits à indigo.
Pabia est le point culminant de cette région (570 mètres). L’horizon est presque aussi nettement limité que celui de la mer, et la ligne n’est brisée de temps à autre que par le sommet d’un bombax ou d’un finsan qui marque l’emplacement de quelque lieu habité.
L’imam m’ayant envoyé quelques ignames, je lui rendis visite en lui faisant cadeau d’un petit carnet, ce qui lui fit bien plaisir. Il me demanda quelques nouvelles sur les pays que je venais de traverser, ensuite il me causa religion. Comme beaucoup de noirs, ce brave homme croit que les israélites ont les paupières coupées (je dis croit, car, quoique je lui aie affirmé que ce n’était pas, je ne pense pas l’avoir convaincu). Une fois que ces gens-là ont une idée logée dans leur étroite cervelle, il est difficile de l’en faire sortir.
Pabia est le dernier village dagomba que l’on rencontre dans cette direction, le village suivant faisant déjà politiquement partie du Gondja. En traversant le Dagomba, j’ai été frappé par le caractère de ressemblance qu’offre la population de cette région avec celle du Mampoursi. Je n’hésite pas à leur assigner une étroite parenté. Je pourrais presque dire que les Dagomba et les Mampourga ne font qu’un seul et même peuple. La seule différence que j’aie constatée réside dans le degré de civilisation, les habitants du Dagomba m’ayant paru moins façonnés, moins sociables et de mœurs plus sauvages que leurs frères du Mampoursi. Ainsi, en quittant Karaga, j’ai vu, entre les mains d’hommes et de jeunes gens qui se rendaient dans les cultures, des côtes d’animaux et des omoplates ayant un côté biseauté en forme de tranchant. Ces os affûtés leur servaient de couteaux et de haches. Les arcs dont ils sont armés sont moins bien conditionnés que ceux que j’ai vus jusqu’à présent, moins puissants que ceux des autres peuples ; ils possèdent une corde en boyau qui, une fois mouillée, ne doit plus être tendue et rendre par conséquent l’arme impropre.
A côté de ces armes primitives on voit aussi quelques fusils à silex, tous à un coup, le boucanier femelle de nos Rivières du Sud. Ces armes sont entre les mains de deux ou trois hommes par village, qui chassent, mais doivent le plus souvent ne rien rapporter.
Nulle part je n’ai vu les trophées de cornes dont le noir se plaît toujours à faire parade pour en orner l’entrée principale de sa demeure, ou encore le tronc de quelque arbre remarquable du village ; du reste, comme je l’ai dit plus haut, le pays est peu giboyeux.
En dehors des tatouages que j’ai signalés chez le Mampourga, je n’en ai[74] relevé que deux autres ; ils consistent en petites incisions sur les tempe, descendant jusqu’à hauteur du lobe de l’oreille, et peuvent très bien n’être que des ornements au lieu de marques de tribus ou de familles.
Les femmes sont marquées comme les hommes, ce qui les défigure beaucoup plus que les femmes mampourga ; elles ont en outre presque toutes l’habitude de chiquer. Le tabac en poudre ou en feuilles est placé entre la lèvre inférieure et les dents, comme font beaucoup de Mandé Dioula et surtout les Mossi.
La danse, semblable à celle des Mampourga, est loin d’être gracieuse ; par son originalité elle mérite cependant d’être décrite.
Au son de deux malheureux tam-tams, ne battant même pas en mesure, se forme un cercle, duquel se détachent, des deux points diamétralement opposés, deux danseuses ; elles tournent deux ou trois fois sur elles-mêmes, de façon à se donner un bon élan et à se rencontrer au centre en heurtant le plus violemment possible leur postérieur l’un contre l’autre. Ce choc ne manque pas quelquefois d’être très douloureux, car le plus souvent une des deux coryphées se retire en traînant la jambe et en plaçant la main sur l’endroit meurtri, ce qui ne manque jamais d’exciter l’hilarité de l’assistance et de provoquer un redoublement d’enthousiasme et de claquements de mains en l’honneur du vainqueur de cette joute.
Les villages dagomba, comme ceux du Mampourga et du Mossi, sont disséminés par groupes d’une ou deux familles. Les cases sont les mêmes que celles de ces deux peuples et des Mandé Dioula : cases rondes en terre à toits coniques en paille. L’intérieur est peu ou point aménagé, c’est à peine si l’on y trouve un clou en bois pour y suspendre un objet. Dans celles qui servent de cuisine, il règne le désordre le plus complet, on n’y voit pas de foyers pour la cuisine, ni d’urnes fixées à demeure. Le seul ornement consiste à enguirlander la porte d’entrée d’une mosaïque (?) de fragments de poterie de couleur au sommet de laquelle trône un morceau d’assiette ou de saladier en faïence de provenance européenne. Dans une ou deux cases de naba j’ai relevé des dessins à l’eau de cendres représentant des guerriers à pied et à cheval qui se suivent en file indienne. J’en ai donné page 67 un facsimilé.
C’est tout ce qu’il y a de plus primitif, comme on le voit : un enfant européen de cinq à six ans fait déjà beaucoup mieux que cela.
L’industrie du Dagomba ne diffère pas de celle que j’ai signalée à Karaga. Je mentionne cependant la confection de quelques chapeaux de paille en deux couleurs, blanc et rouge, fabriqués avec beaucoup d’adresse par les gamins. Ces couvre-chefs sont presque aussi ridicules par leur forme que[77] ceux des Dokhosié. Le bord entre autres, au lieu d’être large, pour préserver du soleil, n’a que 4 à 5 centimètres.

La danse.
Le Dagomba, dans la partie où je l’ai traversé, est un pauvre pays, qui doit être privé d’eau pendant une bonne partie de l’année. A l’exception de l’igname, les cultures sont négligées. Je n’ai vu que deux variétés de sorgho, le blanc et le rouge, et fort peu de mil, qui se réduit à une variété, le sanio. Ce mil, cultivé sur une trop petite échelle, se vend un prix exorbitant, environ 30 centimes le kilo actuellement. Les petites cultures d’indigo, de coton, piments, calebasses, appartiennent pour la plupart aux Haoussa, qui quelquefois joignent à leur profession de teinturier celle de maître d’école. Un ou deux voyages par an à Salaga ou à Kintampo les mettent dans une situation brillante. C’est aussi eux qui s’occupent de la culture et de la préparation du tabac. La variété cultivée par ici a très bon goût à l’odorat, mais ce tabac est trop fort pour être fumé. Une fois préparé et mis en mottes, il paraît noir. Il se vend très cher, environ 1500 cauries le kilo (3 francs). Beaucoup d’indigènes lui préfèrent le tabac du Boussangsi, qui vient ici par Gambakha. Ce tabac est moins fort, d’un beau brun et plus agréable à la pipe. On le vend par morceaux de 100 cauries, pesant environ 50 grammes. Il est tressé en câbles à deux brins.
Les textiles, qui semblent venir très bien ici, ne sont presque pas cultivés ; on voit cependant quelques pieds de dadian disséminés dans les ignames ou en bordure autour de quelque carré de gombo, près des cases.
A Pabia j’ai vu à deux reprises un petit arbuste dans les jardinets. Un Haoussa m’a dit qu’il donnait de très bons haricots, dont il devait m’apporter un échantillon, ce qu’il s’est naturellement bien gardé de faire.
On cultive autour de quelques villages des lots de pourguère, dont on emploie la graine à faire du savon, comme dans certains villages mandé, dans le Ouassoulou par exemple, où on le nomme bakhani safouna.
Ce savon est très apprécié, et on le préfère à celui qu’on extrait du fruit du diala (cailcédra).
J’ai vu également fabriquer du savon à l’aide des noyaux du séné[20] et surtout avec le cé et l’arachide.
Mais partout le savon qui semble le plus prisé est celui qu’on tire du fruit du kobi, grand et bel arbre qui donne un fruit analogue au mangot. Il existe en quantité dans le Yorouba, l’Achanti, le Bondoukou et plus à[78] l’ouest, dans le Ouorocoro et le Ouorodougou. C’est le Carapa guineensis. Dans les Rivières du Sud, on nomme l’huile qu’il fournit touloucouna (graisse empoisonnée).
Les indigènes disent que ce savon renferme un poison suffisamment violent pour faire crever les mouches qui en mangent. Dans la plupart des pays soudanais on s’en enduit le corps pour se garantir des insectes. Je ne sais si réellement il renferme du poison, mais il contient sûrement une grande quantité de potasse. L’écorce du kobi renferme beaucoup de tanin et sert de fébrifuge. La graisse et le savon du kobi sont noires.
Si l’industrie et l’agriculture ne sont pas très prospères, l’élevage du bétail l’est encore moins. Il n’y a presque pas d’animaux. L’espèce bovine est celle du Follona. Le mouton est tout ce qu’il y a de plus malingre ; c’est le même que celui de Karaga. Les chèvres, également rares, sont plus belles et d’une variété qui ne diffère de celles que j’ai vues jusqu’à présent que par la robe ; cette robe est presque toujours grise, et semblable à celle des chèvres dites du Thibet, mais à poil très ras.
La situation peu florissante du Dagomba ne peut être attribuée qu’au caractère apathique de ses habitants. Bien situé pour faire du commerce, ce pays devrait prospérer d’autant plus qu’il est peu soumis aux vicissitudes de la guerre.
Quoique nominalement sous la dépendance du naba de Yendi (un Traouré), le Dagomba est divisé en quantité de petites confédérations, ayant un naba plus ou moins indépendant de Yendi. Les plus puissants de ces chefs sont ceux de Karaga, Savelougou, Kompongou, Gouziékho et Mengo ou Sambou. C’est, à mon avis, le gouvernement qui convient le mieux à ces peuples peu avancés. J’ai toujours vu les noirs plus heureux dans les petits pays que dans les grands États comme ceux de Samory et de Tiéba, qui sont constamment en expédition sur leurs frontières. Pour que dans ces conditions heureuses de gouvernement le Dagomba ne se développe pas plus et soit si peu habité, cela tient évidemment aux causes que j’ai signalées : la pauvreté du sol, le manque d’eau et surtout le caractère engourdi de ses habitants.
J’ajouterai, pour terminer, que le dagomsa tel qu’on l’entend parler par ici semble renfermer bien moins de racines mandé que le mor’. S’il est hors de doute pour moi que le dagomsa et le mor’ appartiennent au groupe de langues dont font partie les idiomes gourounga, bimba et boussanga, il m’est difficile de me prononcer sur la question de savoir de quelle langue mère sont dérivés les dialectes. Est-ce du mor’ ou du dagomsa ? Je suis tenté d’opter pour le dagomsa, qui m’a paru beaucoup plus riche en mots[79] que le mor’, et ne considérer ce dernier que comme un dialecte dérivé du dagomsa, du mandé et du wolof. Si j’en ai plus tard le loisir, j’essayerai d’approfondir cette intéressante question.
Les Dagomba nomment les Mandé : Wangara et Saher’si ; les Mossi : Mosséri ; les Gondja : Sabakhsé ; les Achanti : Kambossi ; les Diammoura : Pantara.
Lundi 1er octobre. — Une dizaine de kilomètres seulement séparent Pabia de Palalé ou Palari. C’est le chemin direct de Salaga à Yendi. Je m’attendais à trouver un sentier mieux frayé et beaucoup plus large ; il ne diffère cependant pas en cela du chemin suivi précédemment, et, si l’on ne trouvait une ou deux carcasses d’ânes morts à la peine, on ne se croirait pas sur une grande voie de communication, car il n’existe actuellement aucun mouvement vers Salaga ou Yendi. Depuis notre départ de Oual-Oualé, nous n’avons rencontré que quelques hommes venant de Pabia[80] et se rendant à Gouziékho, au nord de Karaga, pour y acheter du beurre de cé. A Zang, nous avons été dépassés par deux hommes de Salaga venant de Oual-Oualé avec onze moutons.
A quelques centaines de mètres avant d’atteindre Palalé, nous traversons un lieu de campement composé de cinq groupes d’une vingtaine de petits gourbis, au centre desquels des ânes avaient campé. C’est le campement de la dernière caravane de Haoussa qui, venant du sud, se rendait dans le Haoussa, principalement avec des kolas. « Elle est passée ici dans la seconde quinzaine de juillet, me dit mon diatigué de Palalé, et comprenait à peu près 200 personnes, conduisant environ 100 ânes. » Je ne crois pas que ce chiffre soit loin de la vérité, chaque gourbi, quoique très petit, pouvant avoir abrité deux hommes. Mon hôte, du reste, doit être bien informé : c’est lui qui assure avec ses captifs le passage de la rivière. Étant à Oual-Oualé, Alfa Boukary m’a souvent dit que les Haoussa se réunissaient toujours pour ce trajet, surtout quand, pour une raison quelconque, ils devaient passer dans le Boussangsi ou le Gourma, pays qu’on ne peut traverser qu’à la condition d’être assez nombreux et de posséder suffisamment d’armes à feu pour ne pas craindre les exigences des naba.
Palalé ou Palari est le premier village du Gondja ; il ne comprend que vingt-huit cases, abritant trois familles, dont l’une est celle du naba, qui est en même temps passeur de la rivière. C’est chez ce dernier que me conduisit mon guide et que je passai la journée, la pluie m’ayant forcé, à mon grand regret, de remettre le passage au lendemain matin.
La rivière coule à 800 mètres au sud du village ; on l’aborde à un endroit où la rive n’est pas inondée, sur un petit tertre d’une superficie d’une vingtaine de mètres carrés à peine et dominant le reste du terrain de 50 centimètres environ. Le cours d’eau vient du nord-nord-ouest et coule vers l’est-sud-est, autant qu’on peut s’en rendre compte, car partout on est environné de hautes herbes ; il faut grimper sur un des arbres de la rive pour juger approximativement de la direction que la rivière prend en aval, car le passage a lieu dans un coude. Quoique ce cours d’eau ne soit encore qu’un méchant torrent quand on le traverse avant d’arriver à Feullé, il a déjà pris les proportions d’une rivière. Par son lit obstrué de branchages et couvert en partie de hautes herbes et son fort courant, il constitue un obstacle très sérieux pour ceux qui se rendent à Yendi avec ou sans animaux. Actuellement, sa largeur est d’une vingtaine de mètres, le lit proprement dit n’a qu’une profondeur de 3 mètres environ, et 8 à 10 mètres de largeur. Il est extraordinaire que sur cette route, qui me paraît très fréquentée au moins encore dans les premiers mois de l’hivernage,[81] on n’ait pas songé à construire un pont. A l’aide des grosses branches de quelques arbres qui croissent presque dans le lit de la rivière, il serait facile à édifier. Les indigènes, cependant, n’ont pas l’air de s’en soucier ; je crois même que dans toute cette région le pont est inconnu. Bien mieux, il n’y a même pas de pirogue, le passage des bagages et des gens ne sachant pas nager se fait à l’aide d’un tchilago (mot emprunté au haoussa).
Le tchilago consiste en une peau de bœuf soigneusement bourrée d’herbes sèches de manière à former une sorte de bouée sur laquelle on dispose les colis et où l’on s’assied pendant qu’un nageur la pousse doucement devant lui.

Un tchilago.
Pour confectionner le tchilago, on dispose, dans un trou rond ayant 30 centimètres de profondeur sur 80 de largeur et creusé sur la rive, une peau de bœuf bien souple percée de trous sur tout son pourtour ; puis on place dans la peau deux ou trois bottes de paille sèche sur laquelle on trépigne afin d’obtenir un volume réduit.
Lorsque la bouée est à peu près pleine, on passe dans les trous du pourtour une corde d’environ 3 mètres de longueur, qu’on serre par un nœud coulant afin d’obtenir un cercle d’un mètre de diamètre. Les bords de la peau sont soigneusement repliés et roulés sur eux-mêmes en dedans et maintenus en dessous de la corde à l’aide de bouchons de paille plus forte[82] destinés à former un solide bourrelet et à maintenir aussi l’autre paille en place.
Cette opération terminée, le tchilago est retiré du trou et serti au milieu à l’aide d’une solide corde, de manière à lui conserver la forme ronde. Une fois à flot, on y place sur la paille deux ou plusieurs colis (d’un poids total de 60 à 80 kilos) et le nageur le pousse devant lui en plaçant le bord inférieur de l’appareil entre l’épaule droite et la tête, qui servent ainsi de point d’appui ; cela permet au passeur d’avoir les mouvements des bras tout à fait libres pour nager.
Le passage prit beaucoup de temps. Ce système fonctionne bien, mais il faut d’abord porter les colis à environ une centaine de mètres en aval avec de l’eau jusqu’aux aisselles, dans un chenal taillé dans les hautes herbes. C’est à cet endroit seulement que le tchilago fonctionne. Sur la rive droite, ce n’est que sur un parcours de 300 mètres dans les hautes herbes inondées et des terrains glissants qu’on trouve un endroit sec permettant de placer les colis à terre. Si cet appareil ne laisse rien à désirer pour le passage de gens ou de colis, il n’en est pas de même pour les animaux, surtout pour les ânes. Ces pauvres bêtes, tout en sachant nager, luttent avec peine contre les courants un peu forts. Quand, à l’aide d’une corde, on ne leur maintient pas la tête en dehors de l’eau, elles se laissent aller au courant et risquent de se noyer. Avec le tchilago, cette précaution n’est pas possible ; on ne peut s’en servir que difficilement pour traverser des animaux ; aussi j’eus à déplorer la perte d’un de nos ânes, fatigué, qui se noya ; un autre mourut épuisé en arrivant sur l’autre rive. La perte de ces animaux ne me contraria pas outre mesure, aucun d’eux ne portant de colis. Je dus mettre mes autres animaux en route avant moi, retenu par l’inévitable discussion avec les passeurs. Après avoir fixé le prix du passage à 3000 cauries, ils en réclament 2000 en sus sous prétexte qu’il y a plus de colis qu’ils n’en avaient compté.
Dès qu’on a quitté les terrains bas qui bordent la rivière, le sol change d’aspect : à la végétation rabougrie du Mampoursi et du Dagomba succède une flore puissante ; on voit de temps à autre quelques groupes de beaux arbres lengué, sounsoun et diala ; mes hommes reconnaissent certains arbustes qu’on ne trouve en abondance que dans les environs de Kong ; ils ne les avaient pas rencontrés depuis notre première traversée du Gourounsi, où ils existent, mais en petit nombre.
La rivière de Palalé reçoit sur sa rive droite deux petits affluents sans importance en saison sèche, mais qui actuellement, gonflés par les pluies, nous forcent de décharger les ânes et de transborder à deux reprises[83] les colis à dos d’hommes, pendant un parcours d’une cinquantaine de mètres ; aussi, quand nous arrivons à Ourouké-iri, « village de l’homme du chien », il n’est pas loin de midi.
Ourouké-iri est aussi nommé Yansala, mais il est moins connu sous ce nom que sous le premier. C’est un village comprenant trois ou quatre familles et offrant peu de ressources. Avec mon choix de perles et de bibelots pour femmes j’ai cependant réussi à me procurer du mil pour mes animaux et quelques ignames.
Mercredi 3 octobre. — De Ourouké-iri à Bintiri-Iri (Yangali de la carte anglaise Lonsdale) les marchands et gens du pays ne comptent qu’une étape ; mais, tenant à ménager la force des cinq ânes qui me restent, je résous de scinder l’étape et de m’arrêter à Zankom, petit village contenant trois familles.
Là non plus il n’y avait pas de ressources en vivres ; j’obtins cependant d’un musulman qui habite le village quelques provisions moyennant un peu de papier.
Jeudi 4 octobre. — De Zankom à Bintiri-Iri, l’étape est très agréable. La végétation est plus belle que précédemment, et à un peu plus de mi-chemin on trouve un joli lieu de repos sur les bords d’un ruisseau (1 mètre d’eau) bordé de beaux arbres, le premier que nous voyions depuis fort longtemps. Les autres cours d’eau affectent par ici pour la plupart la forme de marais et n’offrent que l’ombre d’arbres rabougris qui sont loin d’inviter le voyageur au repos.
Dans l’après-midi, quelques porteurs venant de Salaga avec des kolas ont l’amabilité de me prévenir qu’à Bougouda-iri (Tourou), où ils ont couché, il n’est pas possible de se procurer quoi que ce soit, ce qui m’oblige à faire des provisions en ignames et en mil pour le lendemain. Les hommes du village auxquels je m’adresse ne veulent rien vendre ; ce n’est qu’en exhibant quelques grains de corail et des petites perles en cuivre que les femmes du village m’apportent presque en cachette, qui deux ou trois litres de mil, qui trois ou quatre ignames.
Vendredi 5 octobre. — Un temps couvert pendant une partie de la matinée nous permet de faire sans fatigue l’étape, qui est un peu plus longue que les précédentes. La route, tout en étant inondée sur une grande partie du trajet, est bonne. On traverse deux ruisseaux insignifiants et l’on passe à portée de l’emplacement d’un village abandonné nommé Djampa ou Damba-iri. Les habitants se sont retirés à quelques kilomètres plus dans l’est, afin de n’être pas gênés par la trop grande quantité d’étrangers qui avaient fait de Djamba leur point de halte habituel, ce village[84] étant à peu près situé à mi-distance entre Bougouda-iri et Bintiri-iri.
Bougouda-iri ou Tourou ne comprend que deux familles. Les cases, au nombre de quinze, sont dans un état d’abandon qui menace ruine, aussi beaucoup de marchands préfèrent-ils camper aux environs, surtout un peu au nord du village, près d’un bas-fond marécageux duquel les habitants tirent leur eau.
Arrivé d’assez bonne heure à Bougouda-iri, j’eus la chance de trouver une bonne case pour mettre mes bagages à l’abri et m’offrir un refuge en cas de pluie. Les quelques porteurs venant de Salaga ou des environs de Savelougou durent camper à portée du village et se dresser des abris en paille pour y passer la nuit. Le village est situé à cheval sur les chemins de Salaga à Yendi, de Salaga à Karaga par Ga, de Salaga à Karaga par Garoué et Ga et enfin sur le chemin Salaga Oual-Oualé par Savelougou.
Pendant la saison sèche il doit présenter une certaine animation. Bien qu’il soit sans ressources et qu’il ne compte que sept ou huit habitants, ce point restera lieu de halte. Il est situé à peu près à égale distance de Dokonkadé que des villages au nord. On est forcé de s’y arrêter pour l’eau d’abord, et ensuite parce qu’il est impossible de doubler une étape déjà longue. Quelques gens actifs et intelligents se fixant à ce point arriveraient certainement à tirer profit de cette situation exceptionnelle ; malheureusement les Gondja et les Dagomba se soucient peu de cela, ils aiment mieux végéter dans quelques villages éloignés, que d’être dérangés et d’en tirer profit.
Samedi 6 octobre. — A partir de Bougouda-iri, le chemin s’élargit, on voit qu’il est plus battu. Nous rencontrons six porteurs avec des fusils, de la poudre et du sel, se rendant à Savelougou ; les gens qui font route dans le même sens que nous transportent des paniers, du beurre de cé et d’autres produits, tabac et indigo, destinés au marché de Salaga.
Nous ne traversons pas moins de six fara (torrents ou bas-fonds pleins d’eau) que la pluie a changés en véritables rivières. Ces eaux vont toutes rejoindre un petit affluent de droite du Dako qui coule à peu de distance dans l’est. A quelques kilomètres au nord de Dokonkadé, ce cours d’eau fait un coude. Du chemin on aperçoit les inondations qu’il a occasionnées ; elles couvrent plusieurs kilomètres d’étendue. Les cultures sont noyées, au-dessus de la nappe d’eau émergent seulement les sommets de quelques arbustes ou le tronc d’un stérile arbre à cé.
Nous entrâmes dans le village par une pluie battante. Ne trouvant personne dans les rues, il nous fallut errer pendant un bon quart d’heure avant de trouver l’habitation de Bémadinn Bakary, auquel l’imam de Oual-Oualé[85] m’avait engagé à demander l’hospitalité. Bakary était parti le matin même pour Salaga, où il a une partie de sa famille. En son absence, je fus hébergé par son frère Lousiné, qui mit à ma disposition deux bonnes cases où brillaient de bons feux, et m’envoya tout ce qui était nécessaire à la subsistance de mes hommes et de mes animaux. Bakary et sa famille sont d’origine mandé-dioula ; ils viennent de Sansanné-Mango. Tout le monde chez lui parle et comprend le mandé. L’hospitalité de cette famille est proverbiale : le chaudron et le bâton à remuer le tô qui surmontent le toit de l’entrée de son habitation ne sont pas de vains emblèmes.
Dokonkadé est un village de 400 à 500 habitants et un lieu de culture important. Beaucoup de gens de Salaga y sont installés avec leurs captifs afin de se livrer aux cultures pendant le mois d’hivernage. Il s’y tient un petit marché où l’on trouve à acheter des vivres ; les ignames y tiennent naturellement la première place, comme dans toute cette région. Le sorgho ne se vend pas sur le marché, mais il suffit de s’adresser à un habitant pour s’en procurer à loisir et à très bon compte.
Dimanche 7 octobre. — Bien que le temps ne promette rien de bon, je me décide à me mettre en route. Le chemin passant à portée de plusieurs petits villages, on peut s’y arrêter si l’on veut et s’y abriter. Nous dépassons successivement Kolibini et Palaga, mais, l’orage s’étant déchaîné de toutes parts, il fallut nous abriter à Masaka et attendre la fin de la pluie. C’est en vain que nous attendons une éclaircie, il nous faut passer la journée dans le village. J’en profite pour faire dans la soirée une petite excursion aux environs, et tirer quelques pintades, qui pullulent ici. Les environs de Masaka sont bien cultivés et les cultures sont variées ; malheureusement elles ne sont pas prospères, les terrains sont usés et tout est chétif : il n’y a guère que l’igname qui soit d’un bon rapport. Comme à Dokonkadé, tous les captifs que j’ai aperçus par le village sont Gourounga ; toutes les familles et tribus de ce peuple y sont représentées. Il est très curieux d’observer un groupe de badauds : autant d’individus, autant de tatouages différents.
Lundi 8 octobre. — De Masaka à Salaga on ne traverse pas de villages, mais on passe à portée de Bélimpé ou Bouroumpé, d’Abd-er-Rahman-iri, de Gourounsi-iri et de nombreux petits groupes de culture dépendant de Salaga, villages de captifs se livrant aux cultures sous la surveillance d’une partie de la famille du propriétaire. Ces groupes de culture portent le nom de leur propriétaire, auquel on ajoute iri, sou, pé ou kadé, suivant que l’on parle dagomsa, mandé ou gondja, cette terminaison signifiant dans les trois langues : « village, habitation ».
[86]Aussitôt après avoir traversé un torrent nommé Bompa, le terrain se relève légèrement et l’on aperçoit quelques arbres qui indiquent l’emplacement de Salaga. Les environs sont absolument dénudés dans un rayon de plusieurs kilomètres et l’on est tout heureux de revoir un peu de verdure ; on ne s’y trompe cependant pas, car au fur et à mesure que l’on s’avance on s’aperçoit que les arbres entrevus ne sont que les traditionnels bombax et doubalé qu’on rencontre dans la plupart des villages nègres.
Un captif de Bakary m’attend à l’entrée de Salaga ; il me conduit auprès de son maître, qui, prévenu, se tient à l’entrée du groupe de cases qu’il me destine.
Après m’avoir serré la main et demandé mon nom, il présida à mon installation, et me confia à son jeune frère Aboudou ; il me demanda la permission de s’absenter pendant deux jours, ses affaires l’appelant à Dokonkadé. Il n’avait différé son départ que parce que mon arrivée lui était annoncée.
L’arrivée d’un blanc à Salaga n’est plus un événement depuis longtemps. Après Bonnat et Golberry, qui y sont entrés en 1870-71, quantité d’Européens venant de la côte ont passé ici. Presque chaque saison sèche y amène de nouveaux officiers anglais ; employés de commerce, missionnaires et explorateurs s’y succèdent : aussi ne fus-je pas importuné par les curieux les deux premiers jours, mais quand le bruit se répandit que j’étais Français et que je venais des établissements de l’ouest du continent, ma case fut assiégée par les curieux, et les questions commencèrent.
Parmi les nombreux visiteurs que je reçus, je dois signaler le chérif Ibrahim (de Tombouctou), El-Hadj Mahama Hatti (un Logoné du Bornou) et El-Hadj Djébéri (originaire du Haoussa). Ces trois personnages qui, comme leur titre l’indique, ont fait le pèlerinage à la Mecque, ont acquis par leur voyage des notions en géographie que les autres noirs ne possèdent pas. Ils connaissaient par ouï-dire la France, Marseille et savent que nous avons de vastes possessions musulmanes dans le nord et dans l’ouest de l’Afrique, aussi nous désignent-ils souvent par le titre d’« amis du sultan de Stamboul ». El-Hadj Hatti a visité la Tripolitaine et la Tunisie, et El-Hadj Djébéri, après avoir séjourné à Constantinople, s’est même rendu à Bagdad et Irâk.
En fait de géographie, ils connaissent surtout l’existence de l’empire turc avec sa capitale, Stamboul, Béled-Béni-Israïl (probablement Jérusalem), le Caire, Alexandrie et l’Égypte, qu’il nomme Massara, de Misraïm[21].[87] Ils connaissent surtout Djedda, le port de la Mecque, puis Médine.
Tout bon musulman possède dans un sachet en cuir l’itinéraire de son pays à la Mecque ; il est sommairement libellé, et comprend des indications dans le genre de celles-ci, que j’ai vues entre les mains de Mahmadou Lamine, ez-Znéin de Ténetou :
« En quittant Sakhala du Ouorodougou, on marche onze jours pour atteindre Kanyenni, dans le Kouroudougou. Après on peut passer à Bânou et dans le Diammara, ou bien par le chemin de Kong, où il y a aussi beaucoup de musulmans », etc.
Ces itinéraires conduisent, en général, par le Haoussa, le Bornou, le Wadaï, le Darfour, le Kordofan à El-Obeïd. La route va ensuite rejoindre le haut Nil à Khartoum, descend sur Berber, puis atteint la mer Rouge à Souakim, où l’on s’embarque pour Djedda.
D’autres itinéraires mènent par Tombouctou et le désert sur Ghadamès, Kairouan et la Tunisie. Les pèlerins mettent, au minimum, sept ans pour effectuer leur voyage aller et retour. Ils ne voyagent pas vite et sont souvent obligés de travailler en route pour se créer des ressources, afin de pouvoir continuer leur voyage.
Certains d’entre eux ne reviennent pas directement ; c’est ainsi que dans les dix pèlerins que j’ai rencontrés sur ma route, un d’entre eux était allé à Mascate et en Perse, d’autres à Malte et en Tunisie, enfin la plupart ont entièrement visité l’Égypte et le Yémen.
Les trois personnages que j’ai cités plus haut s’empressèrent de fournir des explications sur les peuples de l’Europe et surtout sur notre puissance sur terre et sur mer et vinrent apporter un nouveau témoignage à l’appui du dire de quelques gens du Ségou et de Djenné établis ici qui vantaient la bonne qualité de nos marchandises. Parmi tous les peuples noirs qui, par leur commerce, sont en relations avec les comptoirs européens, nous avons la réputation de ne vendre que des tissus de bonne qualité, d’excellente poudre et surtout d’être très loyaux dans nos transactions. Cette réputation est certainement justifiée, car ce n’est pas nous qui fournissons aux nègres l’affreux gin et les mauvaises cotonnades ; les indigènes s’en rendent très bien compte. A Salaga on sait distinguer les poudres et les étoffes de Krinjabo et d’Ago (Porto Novo) de celles d’Akkara (Accra) et de Ga (Christianbourg).
J’eus pour ces raisons d’excellentes relations avec la population de Salaga. Des Haoussa que j’avais rencontré, à Dioulasou, et les gens de Kong établis ici depuis longtemps me firent également bon accueil.
Sur le conseil de Bakary, mon hôte, je rendis visite aux personnes qui[88] jouissent de quelque considération ici, soit par leur piété, soit par leur fortune. Je reçus à cette occasion quelques cadeaux en ignames et en mil et même plusieurs fois de la viande.
Les nombreux Européens qui ont visité Salaga sont loin d’être d’accord entre eux sur la position géographique de cette ville.
Je ne signalerai que les travaux les plus récents pour montrer l’écart sensible qui existe entre eux.
| Carte du Dépôt de la Guerre. — Tirage 1882-83 : | |||
| Longitude ouest : 2° 18′ | (méridien de Paris). | Latitude nord : 7° 56′ | environ. |
| Capitaine Lonsdale (anglais) : | |||
| Longitude ouest : 3° 9′ | — | Latitude nord : 8° 10′ | — |
| Missions de Bâle : | |||
| Longitude ouest : 3° 14′ | — | Latitude nord : 8° 25′ | — |
| Enfin mes travaux lui assignent : | |||
| Longitude ouest : 2° 20′ | — | Latitude nord : 8° 51′ 30″ | environ. |
| Bowdich, en 1816, fixe sa longitude à 2° 25′ 14″ ouest de Paris. | |||
Si cet écart entre mes travaux et ceux de la carte anglaise du capitaine Lonsdale et des missions de Bâle est si considérable, cela tient à ce que les uns ont copié les erreurs des autres. La carte du docteur Mæhly (mission de Bâle) est postérieure aux travaux anglais. L’Afrique explorée (p. 85) vante l’exactitude des travaux des missionnaires et cite ceux des officiers anglais comme entachés d’erreurs grossières, même près de la côte. Il ne m’appartient pas de juger les uns ni les autres, je me bornerai seulement à constater : 1o que la carte du capitaine Lonsdale est construite de la côte à Koumassi (et peut-être dans d’autres parties aussi) à l’échelle de 1/622222e, tandis que dans la partie Yendi-Salaga je trouve que, pour la distance Pabia-Salaga, ce même officier a employé l’échelle qu’il indique sur sa carte : Scale, 15 miles to 1 inch, ce qui fait presque les 1/100000e, exactement 1/950000e ; 2o que la carte des missionnaires de Bâle est incomplète dans la partie Salaga-Krakye (la seule que je puisse vérifier par renseignements), vu qu’il existe trois chemins également fréquentés pour se rendre de Kroupi à Badjamsou, et que la distance qui sépare Salaga de Krakye, mesurée sur leur carte, ne donne que 88 kilomètres, tandis que les indigènes mettent sept jours pour se rendre de Salaga à Krakye, ce qui, d’après mes calculs, équivaut à 112 kilomètres (moyenne 16 kilomètres par jour). D’après eux, les étapes ne seraient que de 12 kilomètres. Or, pour qui a tant soit peu voyagé avec et chez les noirs, il est incontestable que l’étape est plutôt supérieure à 16 kilomètres. Le capitaine Lonsdale est presque d’accord en cela avec moi : la distance qu’il indique entre ces deux points est de 105 kilomètres.
[90]
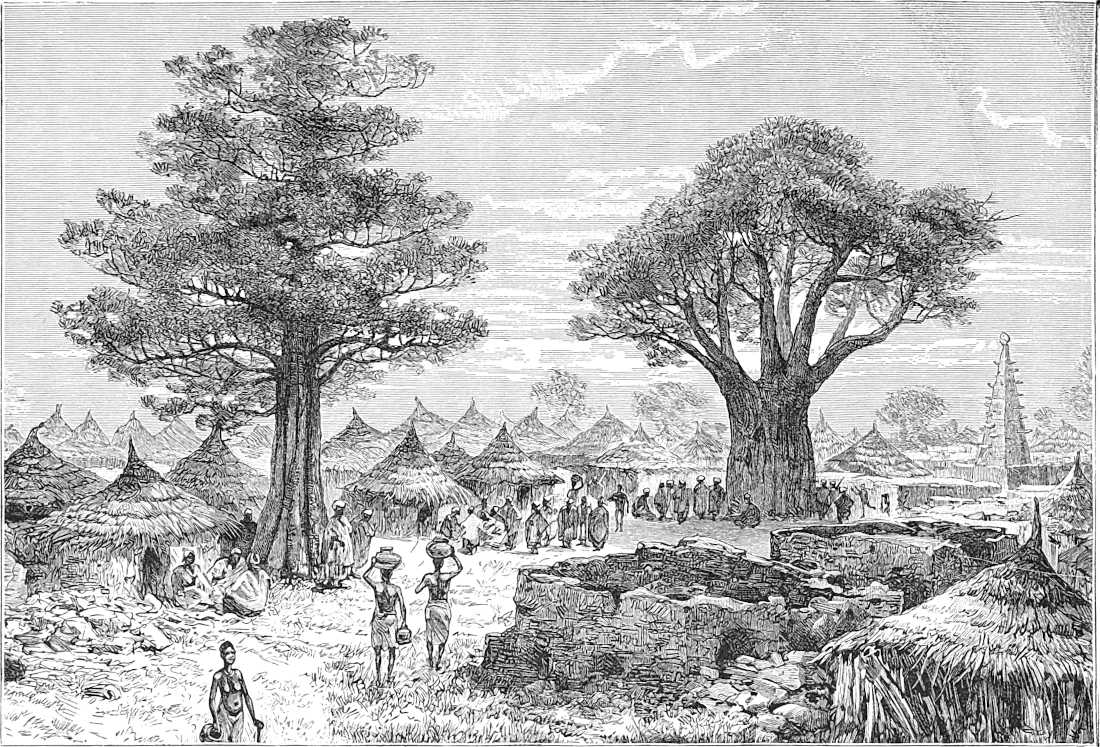
Salaga.
[91]De ces observations, il résulte qu’il est difficile de s’appuyer actuellement sur un des documents précités et de se prononcer avant que j’aie fait retour à Kong, où mon polygone devra se reformer si mon levé est exact.
Salaga en dagomsa veut dire : boueux, glissant. Si c’est là l’étymologie du nom, elle est bien trouvée, car je n’ai guère vu que Ouolosébougou et Ténetou qui puissent rivaliser pour la malpropreté avec la ville principale des Gondja.
Bâtie très irrégulièrement en quartiers séparés les uns des autres par des terrains vagues parsemés d’excavations pleines d’eau croupie ou par des enclos de culture, Salaga offre au voyageur le triste coup d’œil d’un village presque en ruine. Rien n’est si lamentable que ces cases sans toits et ces pans de mur à demi écroulés. Les ruelles, très étroites, ne sont que des amas d’ordures et d’eaux puantes, et les terrains vagues et petites places servent, pendant la nuit et jusque vers six heures du matin, de latrines aux habitants. Aux abords du petit marché (dit Sokoné lokho) et du grand marché, il est impossible de circuler sans se boucher le nez ; ce serait un mauvais conseil à donner, que celui de faire, en attendant le repas, un tour de promenade à l’un des deux marchés. Heureusement que Dieu a donné aux noirs le douga (urubus charognard), car, sans les travaux de vidange qu’opère cet oiseau, il y a longtemps que les habitants de Salaga seraient décimés par les épidémies.
Les habitations, en général circulaires, en terre, à toit en paille sont celles des Mandé Dioula et des Dagomba. On voit cependant quelques grandes cases rectangulaires, à toits en paille, construites par les Haoussa. Aucune de ces habitations n’a été construite avec le moindre goût, et même neuves elles ne devaient pas offrir beaucoup de confortable. L’orientation de la porte d’entrée a généralement été laissée au hasard et quantité d’entre elles font face à l’est ; de sorte que pendant les orages l’eau entre partout, fait du sol un bourbier et rend la case inhabitable.
Si l’on pénètre dans la case de quelque personnage aisé, on se trouve en présence d’un curieux amalgame d’objets de toute provenance : en dehors du lit, qui consiste en un châssis en fortes tiges de mil, supporté par quatre pierres, pour l’élever au-dessus du sol, et de peaux de bœufs servant de siège aux visiteurs, on aperçoit, rangés sur des barils de poudre vides, des chandeliers en faïence, des bouteilles et des boîtes vides de toute dimension, quelquefois une grande glace fêlée ou à moitié dépolie, de vieilles cartouchières ou gibernes appendues au mur, un fusil à tabatière sans mécanisme, dans un coin des bouteilles de gin pleines et quelques[92] sacs de sel. J’ai même trouvé une pendule qui ne marchait pas et une lanterne à pétrole !
Dans les cases des femmes ce sont des chaudrons en cuivre, des tasses, bols, saladiers, cuvettes, saucières, vases de nuit en faïence à fleurs, — vaisselle de luxe seulement, car on ne s’en sert jamais, n’en connaissant pas l’emploi.
En faisant de l’œil ces perquisitions, j’ai trouvé chez chérif Ibrahim une boîte de 300 grammes de thé qu’il m’a cédée pour 20000 cauries (environ 27 francs), et 1 kil. 500 de sucre portugais que j’ai acheté pour 1500 cauries, puis une ombrelle non recouverte que j’ai achetée 10000 cauries : ce n’est pas la plus mauvaise acquisition, car j’ai trouvé un nègre du Brésil, venu d’Acera avec du cuivre en barres, qui me l’a recouverte avec une solide blouse de roulier que j’ai mise à sa disposition.
Ce Brésilien est fort bien élevé : on voit qu’il a été longtemps au service d’Européens. Comme il n’a rien voulu accepter pour le service qu’il vient de me rendre, je lui ai donné une lime, deux gilets de flanelle, une paire de ciseaux, des aiguilles et du fil, ce qui m’a valu son amitié et tous les jours sa visite ou celle de son fils, qu’il m’envoie pour prendre de mes nouvelles.
Les mosquées sont au nombre de cinq, dont une en ruine. Ce sont des bâtiments carrés ou rectangulaires, de 4 à 5 mètres de côté ; ils ne comportent pas de minarets et menacent ruine. Le croyant qui se hisse sur le toit pour appeler les fidèles à la prière a le mérite de risquer sa vie tous les jours. Celle du quartier de Lampour a ses portes en menuiserie travaillées par des ouvriers achanti et ses diverses parties ajustées à l’européenne avec des clous et des pointes provenant d’Europe. Les habitants vous font voir ces portes comme des chefs-d’œuvre. A les entendre, on croirait avoir affaire à la porte Jean Goujon de l’église Saint-Maclou de Rouen. Un apprenti wolof de quatorze à quinze ans ferait certes mieux que cela en menuiserie.
Salaga est divisé en huit quartiers, portant des noms différents. Le quartier nord, nommé Bémadinn-sou, où je logeais, est habité principalement par des Mandé venus de Sansanné-Mango, du Bondoukou[22] et de Kong. Les quartiers de Kapété, Kaffaba, de Kopépontou et de Lampour sont habités par des Gondja, tandis que ceux du centre, Ouniobopé, Sokoné, Kindi, situés aux abords des marchés, contiennent les étrangers de toutes les nationalités.
[93]Voici le dénombrement de la population de Salaga :
Les Gondja entrent dans la proportion pour quatre dixièmes ;
Les Mandé Dioula de toutes origines, pour deux dixièmes ;
Les Haoussa, pour deux dixièmes ;
Enfin les autres étrangers : Dagomba, Nago du Yorouba et de la Côte, Achanti, Foulbé, gens de Dandawa, Ligouy (triangle Boualé, Bondoukou, Kintampo), Bornou, Barba, Pakhalla de Bouna, et Ton du Bondoukou, etc., pour les deux autres dixièmes.
Il faut aussi compter dans les trois éléments les plus nombreux leurs captifs, tous Gourounga. La population fixe doit être de 3000 habitants environ.
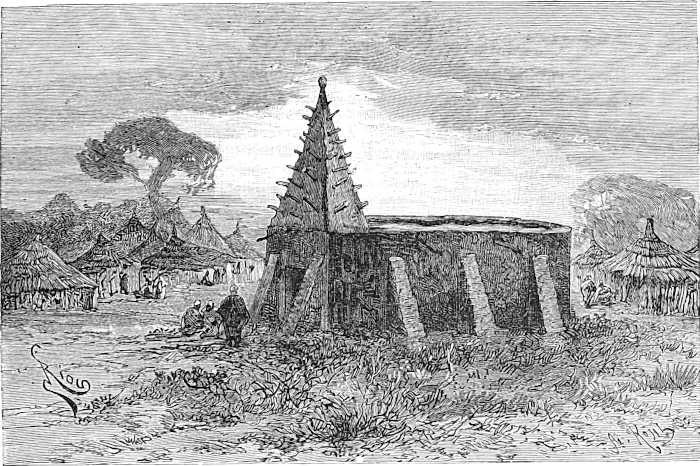
Une mosquée de Salaga.
Ce mélange excessif de la population a fait des habitants de véritables polyglottes. Le gondja et le mandé sont parlés respectivement par ces deux peuples ; mais, quand il s’agit d’adresser la parole à un inconnu, de débattre un marché, de se dire bonjour, c’est toujours dans la belle langue haoussa. J’ai souvent éprouvé un vrai plaisir en entendant converser ensemble deux Haoussa. La bouche recouverte par l’alfouta (lemta), ils parlent doucement et posément, en prononçant toutes les lettres. Le el-hamdou lillahi est plein de charme dans leur bouche.
Je n’ai jamais su par qui l’autorité était exercée à Salaga ; il y a cependant[94] un chef de village qui réside dans le quartier de Kopépontou et qui se fait appeler Salaga Massa ; mais chaque quartier vit sous l’autorité du plus ancien musulman et a son propre imam. Le quartier de Lampour a même un roi, qui prend le titre pompeux de Lampour-massa ou Lampour-éoura. Je crois cependant que Salaga dépend du chef de Pambi ou Kwambi, gros village situé à 4 kilomètres dans le sud-est. Ce chef exerce aussi son autorité sur quelques autres petits villages des environs. Pendant mon séjour, les hommes de Sokoné (quartier du petit marché) s’étant emparés d’un voleur, il fut conduit devant le chef de Pambi. Ce monarque a près de lui trois ou quatre soldats indigènes anglais dont la compagnie est à Kpandou (ou Pantou, comme on prononce ici). Le rôle de ces militaires ne m’a pas paru bien défini. Vêtus d’une veste en loques, d’un pantalon en cotonnade et coiffés d’une sale chéchia, ils rôdent parfois par le marché armés d’une trique, sans cependant se mêler de rien, car la population ne se soucie pas de leur présence : c’est à peine si l’on se doute qu’ils sont soldats.
Le roi de Pambi a pour titre ouroupé, titre qui a dû lui être donné par les Mandé quand jadis ils percevaient un droit de 100 kolas par charge (ouroufié) et a dû lui rester. Les Gondja le nomment Eoura ou Pambi-éoura.
C’est le matin à partir de sept heures qu’il commence à régner une certaine animation par les ruelles de Salaga. C’est l’heure à laquelle les vendeurs vont s’installer au marché. On rencontre successivement des Dagomba porteurs d’un pain conique de beurre de cé de 5 à 6 kilos, de provenance de Gouziékho et de Gambakha ; des individus avec des nattes renfermant un sac qui contient quelques méchantes verroteries, des colporteurs avec un peu de calicot écru sur la tête et un ou deux foulards rouges à la main, des marchands de fusils, des femmes portant du sel et des condiments dans une calebasse où trône majestueusement un petit tabouret.
Puis viennent les marchands d’akoko, le bakha des Mandé (bouillie liquide de mil) ; les vendeuses de to qui répètent à l’infini, en haoussa, le cri de « aroua ndoua é ! » ; les fillettes vendant des kolas et de la viande cuite ; des porteurs de marmites d’ignames cuites à l’eau, saupoudrées de piments et de sel, qui se reconnaissent au cri de : « Sira ma yara yara ! » puis c’est un cavalier se rendant aux cultures monté sur un cheval étique qu’il essaye en vain de faire caracoler. A une heure plus avancée on apporte les ignames des environs — quand il ne pleut pas, — et vers midi les captifs porteurs de charges de bois qu’ils sont allés chercher à 12 ou 15 kilomètres dans la campagne.
[95]Si nous suivons tous ces gens-là au petit marché dit de Sokoné, nous trouvons, par les chemins qui aboutissent à la petite place du marché, les femmes occupées à vendre et à ranger leurs petits lots de 10 cauries de sel ; les marchandes de kolas et de vivres préparés héler les passants ; des ménagères disputer aux marchands une ou deux cauries ou une pincée de sel. Là où la largeur du chemin le permet, on a installé des goua, hangars recouverts en paille où se tiennent des barbiers occupés à raser des patients ; des cordonniers recouvrant des gris-gris ou confectionnant une gaine de couteau. Plus loin ce sont des tailleurs et des fabricants de bonnets, des marchands de tabac à fumer et à priser ; puis des hangars où sont appendus quelques coudées d’étoffe imprimée, des foulards rouges ; sur les nattes trône aussi de la vaisselle en faïence peinte, un ou deux fusils, de temps à autre une mauvaise pièce de calicot écru marquée au bleu : Deutsche Faktorei, J. K. Viétor ; ou encore : Basel mission factory.
Les colporteurs n’ayant pas trouvé de goua libres circulent avec leur marchandise sur la tête : étoffes du Dagomba, couvertures de Kong dites siriféba, coussabes et pantalons plus ou moins usés. Trouvent-ils quelqu’un qui demande à voir leur marchandise, le vêtement est déplié au milieu[96] de la ruelle, et il se forme aussitôt un attroupement pour assister au débat du prix. Le vendeur, toujours Haoussa, en demande 20000 cauries quand il serait enchanté d’en obtenir 5000. Le chiffre fixé par le vendeur importe du reste fort peu à l’acheteur : qu’il n’en demande que 100 cauries, l’autre répondra par le al-barka traditionnel (merci) ; puis, pour ne pas se trouver volé, il offre le vingtième de ce que demande le vendeur ; enfin, après des pourparlers qui n’en finissent plus et où chaque oisif place son mot, le visiteur se retire sans rien acheter, n’ayant peut-être pas un cent de cauries à sa disposition ; mais il a parlé, débattu le prix de quelque chose, attiré sur lui le regard des passants — il s’en va satisfait.
Du marché de Sokoné au grand marché, il y a une suite presque ininterrompue de vendeurs installés derrière une natte, sur laquelle s’étale du coton rouge en écheveaux, du soufre en canons, de l’antimoine, des bracelets en cuivre rouge, des perles dites rocaille, quelques feuilles de papier, des couteaux de boucher, une ou deux boîtes d’allumettes amorphes, des bouteilles de gin vides, etc.
Sur le grand marché ce sont les mêmes articles, plus la viande. Les bœufs, tous les jours, au nombre de deux ou trois, sont égorgés sur place. C’est au milieu de bandes de vautours charognards que les bouchers déchiquètent la viande par petits morceaux et l’entassent en lots de 100 cauries, le tout couronné par un morceau de suif ou de nerf, en guise de graisse. Les acheteurs, après avoir tripoté avec leurs mains sales toute cette viande, finissent par faire l’acquisition d’un lot de 100 cauries, en exigeant du boucher l’emballage de la viande dans une feuille.
De mil, il n’y en a que fort peu sur le marché, et les bananes et citrons ne s’y voient que rarement.
A en juger par l’animation qui règne sur les deux marchés, on pourrait croire qu’il s’y traite de sérieuses affaires : il n’en est rien, ce mouvement n’est que factice. Le soir, vous voyez tous ces gens-là rentrer et compter leurs cauries. Les heureux ont vendu pour un ou deux milliers de cauries ; les autres doivent se contenter d’une recette de 200 à 500. Les marchands ambulants n’ont quelquefois fait aucune vente et ont été forcés de céder à prix coûtant pour vivre. Cet état de choses est la cause de nombreux vols : il ne se passe pas un jour où quelque étranger trop confiant ne se fasse enlever ou ses marchandises ou ses cauries, soit que l’on pénètre chez lui de nuit ou pendant son absence, soit encore qu’on lui achète quelque chose à crédit, ce qui revient au même, car à Salaga on ne paye pas facilement les dettes.
[97]

Le marché de Salaga.
[99]Si le petit commerce est plongé dans un semblable marasme, c’est bien la faute des indigènes, qui, au lieu de varier les produits européens qu’ils se procurent aux comptoirs de la Côte, s’en tiennent toujours à une même série d’articles, lesquels finissent naturellement par être dépréciés. Il arrive alors que l’acheteur, connaissant trop bien le prix de revient à la Côte, marchande tellement sur le prix d’achat que le vendeur, qui a besoin d’argent, se trouve forcé de céder à vil prix ce qu’il a été chercher au loin croyant réaliser de beaux bénéfices.
Actuellement c’est la morte saison pour les gens de Salaga. Les Haoussa se rendant à Kintampo pour acheter des kolas ne sont pas encore arrivés, mais dans un mois ou deux le petit commerce des femmes revendeuses de kolas, de sel et de mets préparés va prendre de l’extension. Elles attendent toutes la saison sèche avec impatience. A l’aide des ressources qu’elles se créent ainsi, elles peuvent se procurer quelques verroteries, corail, linge, foulards, etc., voire même un peu d’argent monnayé qui sera transformé en bagues.
On m’a dit qu’en dehors de ce commerce honnête les beautés de Salaga en font un autre plus intime avec les étrangers, commerce qui est certainement plus lucratif pour elles que celui de niomies, de beurre de cé et de mèches en coton.
La vente du bois procure aussi quelques cauries aux propriétaires. Les captifs ne sont pour ainsi dire employés qu’à chercher du bois. Une charge se vend 500 cauries. Mais c’est surtout l’eau qui est une source de revenus pour les habitants de Salaga pendant la saison sèche. Quoique le village soit percé comme une écumoire et que l’on y trouve plus de deux cents puits répartis dans les propriétés, ruelles, places et abords du village, l’eau devient très rare à la fin de décembre, et les propriétaires des puits vendent le canari de 8 litres 100 à 150 cauries. Si l’eau était bonne, ce ne serait pas trop cher, mais il est facile de se faire une idée de ce qu’elle peut être : on la trouve à une profondeur de 1 m. 20 en moyenne ; elle reçoit les infiltrations de toute l’eau croupie, de la boue et des immondices du village ; j’aurai tout dit en ajoutant qu’on enterre les morts dans le village même, à une profondeur qui excède rarement 50 centimètres et souvent à moins de 2 mètres des puits.
A partir du 1er février les puits sont à sec. A cette époque, toutes les femmes et tous les enfants qui ont la force de porter se mettent en route vers cinq heures du matin pour aller faire provision d’eau pour le ménage et pour la vente. On va chercher cette eau au Goulbi n’ Barraou, « marigot des Voleurs » en haoussa, à quelque distance à l’est de Masaka, où le[100] cours d’eau se trouve plus rapproché que directement dans l’est de Salaga. Le canari se vend alors de 200 à 300 cauries.
Actuellement j’envoie chercher l’eau pour boire au torrent « Boumpa », à 3 kilomètres au nord de Salaga.
Les gens de Salaga tirent aussi quelque profit de l’hospitalité qu’ils offrent aux étrangers ; car s’ils ne se font pas payer directement, ils réussissent toujours à se faire donner quelque cadeau de leur locataire momentané. Ils trouvent aussi quelques bénéfices dans le courtage : intermédiaires forcés entre le vendeur et l’acheteur, ils tirent toujours un petit profit du vendeur d’un côté, de l’acheteur de l’autre, sous prétexte qu’ils viennent de leur faire faire une bonne affaire. Cette spéculation a donné naissance à la propriété de l’immeuble cases et écuries, qui se cèdent à des prix quelquefois élevés suivant la proximité du marché.
Comme à peu près partout dans le Soudan, la coutume de donner des arrhes quand on fait un achat est en vigueur à Salaga. Les arrhes sont fixées à 700 cauries, payables par l’acheteur au vendeur pour un âne, 1000 cauries pour un cheval, 300 pour un esclave mâle, 400 pour une femme esclave, 500 pour un bœuf, 150 pour un mouton. Les Mandé appellent cette coutume la da « coucher la parole, cesser les pourparlers, le marché étant conclu ».
A vrai dire, je croyais trouver un centre commercial de l’importance de notre Médine du Soudan français, mais j’ai été vite désillusionné : Salaga n’a même pas l’importance de Bobo-Dioulasou, et le chiffre d’affaires qui s’y traite est bien inférieur à celui de la place d’entrepôts de Djenné et de Kong que je viens de citer.
Voici les différents articles qui se vendent ici, cités par ordre d’importance :
1o Le sel est acheté soit à Akkara (Accra), soit dans les divers gros villages échelonnés sur la rive gauche du fleuve sur la route qui met Salaga en communication avec la Côte. Le prix de revient d’une charge de 20 à 25 kilos est d’environ 3000 cauries, à la mer ; rendue à Salaga, la même charge se vend de 12 à 15000 cauries ; bénéfice : 10 à 12000 cauries pour un trajet d’une quarantaine de jours aller et retour.
Le sel est beaucoup vendu dans la partie est du Dagomba et n’entre en concurrence avec le sel en barres de Taodéni, venu par le Mossi, qu’au nord du Gambakha et du Gourounsi. Il est vendu ou échangé dans les régions nord de ces pays contre le beurre de cé et les esclaves ; dans la partie sud, contre les animaux de boucherie. Dans le Dagomba ouest, le sel marin se trouve en concurrence avec Daboya, qui arrive[101] à fournir son sel au même prix à Oual-Oualé et dans le Gourounsi sud.
Daboya ne pouvant pas procurer le sel en assez grande quantité, Salaga arrive à en placer avantageusement à Boualé et surtout à Oua, où l’on trouve beaucoup de captifs, provenant de prises faites par les bandes de Babotou, qui continuent à guerroyer chez les Gourounga.
Une partie du sel va aussi sur Kintampo ; car ce marché est très souvent coupé de ses communications directes avec la mer à cause des guerres que se livrent entre elles les tribus achanti à cheval sur la route Atéobou et Abétifi par Konkronsou et sur celle de Kintampo à Koumassi par le Coranza. Les marchandises sont aussi soumises à des droits parfois élevés chez les divers cabocir achanti, de sorte qu’il y a avantage à faire passer le sel par la route de Salaga, qui est sûre et toujours libre. On rapporte de Kintampo le kola rouge de l’Okwawou et du Coranza. Le sel est porté jusqu’à Bitougou (Bondoukou).

Captifs portant du bois.
Les Ton de cette région sont hostiles aux habitants de l’Anno, qui reçoivent à très bon compte le sel marin de Grand-Bassam[23] par pirogues jusqu’à Attacrou.
L’Anno ne livre pour cette raison que peu de sel sur Bitougou. Rendu[102] dans cette dernière ville, le sel de Salaga ne se vend que 24000 cauries la charge, étant en concurrence avec le sel de Grand-Bassam. On rapporte de Bitougou soit le kola blanc de l’Anno, soit de la poudre d’or ou de la cotonnade rayée bleu et blanc de Djimini.
2o La poudre de guerre est de quatre provenances : Ago (Porto Novo), Krinjabo (provenant d’Assinie et de Grand-Bassam), Dioua (Cape Coast) et enfin Accra. La poudre d’Accra n’est pas estimée, mais les poudres de provenance française sont très recherchées.
Actuellement la poudre est portée sur Oua pour la colonne de Babotou et sur Savelougou et Kompongou dans le Dagomba. Ces deux centres se font la guerre depuis près de trois mois. L’objet d’échange pour la poudre est l’esclave, naturellement, les chefs n’ayant d’autres revenus que ceux que leur procure la guerre.
3o Les armes, fusils à silex à un coup, de provenances belge et anglaise, viennent d’Accra et de Ga (Christianborg). Elles prennent le même chemin que la poudre, mais ne sont pas expédiées sur Oua, qui reçoit ses armes de Krinjabo par Bondoukou, l’Anno et Boualé (ces localités fournissent le boucanier mâle au prix minime de 12000 cauries, environ 25 francs).
4o Les kolas.
Quoique Salaga, par sa latitude, se trouve relativement peu éloigné des pays de production de ce fruit, la ville n’est pas régulièrement approvisionnée de kolas, et les transactions dont ce produit est l’objet à Bobo-Dioulasou sont infiniment supérieures à celles auxquelles il donne lien à Salaga. Cette ville n’est pas ou ne peut être considérée comme entrepôt de cette marchandise. Cela tient à plusieurs raisons.
Le kola rouge, qui est le plus estimé par les noirs du Soudan, est récolté dans l’Okwawou, aux environs d’Abétifi et d’Atéobou. Sans faire entrer en ligne de compte le caractère turbulent des divers peuples qui habitent l’Achanti, il y a une autre cause bien plus importante, c’est que Salaga n’a pas les matières d’échange qu’exigent les producteurs de kolas. Ceux-ci demandent surtout les bestiaux, bœufs et moutons, l’esclave, l’or et un peu le beurre de cé et les étoffes indigènes rayées bleu et blanc. Or Salaga n’est pourvu de bestiaux par le Mossi et le Dagomba que pendant la saison sèche. L’esclave est d’un prix trop élevé ici ; l’or est récolté dans l’ouest, le Lobi, Boualé, le Bondoukou et l’Anno ; quant au beurre de cé et aux étoffes, elles ne sont pas abordables comme prix une fois rendues ici. Les Mandé de Kong et ceux de Boualé qui sont à Bouna, Bondoukou, étant les producteurs de tissus, s’adressent directement aux Ligouy fixés à Kintampo.
[103]Les kolas d’une grosseur moyenne valent, en gros, 3200 à 3500 cauries le cent, 32 cauries pièce, chiffre excessif quand on se rapporte à Bobo-Dioulasou, où le même fruit de même provenance est vendu de 25 à 30 cauries au maximum. Au détail, le kola rouge vaut ici de 70 à 160 cauries suivant la grosseur. Le kola blanc vient de l’Anno, pays situé à l’ouest du Bondoukou et sur la rive droite de la rivière Comoë ou d’Abka. Ce fruit est à très bon marché sur les lieux de production : son prix est de 1 à 2 cauries le kola. Il est surtout acheté par les gens de Kong, qui portent dans l’Anno de la ferronnerie de Dioulasou et le beurre de cé des Komono.
Les gens de Salaga ne possédant pas non plus ces deux articles, il en résulte que la vente du kola blanc, qui produit de très beaux bénéfices, leur échappe en partie et est monopolisée par Kong. De Kong on le transporte jusqu’à Salaga, où en gros il se vend de 20 à 22 cauries et au détail de 40 à 100 suivant sa grosseur.
5o La poudre d’or est rare à Salaga. Actuellement il y en a fort peu. J’ai cependant réussi à m’en procurer un peu ainsi que de l’or ouvré, en payant le barifiri (4 mitkal) 40000 cauries. L’or est apporté ici par les Ligouy et les Mandé et est de provenances diverses. Tandis qu’il en vient un peu seulement par Kong et Bouna, du Niéniégué, du Lobi et du Gourounsi dans le voisinage du Dafina[24], il en arrive surtout de Boualé, du Bondoukou et de l’Anno. Dans ces régions, les 4 mitkal se payent de 20000 à 24000 cauries, prix normal. A Salaga, le même poids ne se vend jamais au-dessous de 32000 et atteint parfois 45000 cauries le barifiri. C’est surtout pendant la saison sèche que les Wangara (Mandé) apportent l’or ici, et généralement c’est pour se procurer des chevaux auprès des Haoussa. Ces derniers rapportent le métal précieux dans leur pays, ou vont le porter aux comptoirs de la Côte, là on leur paye près de 80000 cauries le barifiri. En séjournant toute la saison sèche à Salaga, on arriverait, d’après mes évaluations et le dire de Bakary mon hôte, à acheter 500 à 750 barifiri d’or, c’est-à-dire 2000 à 3000 mitkal (de 12 à 13 kilogrammes).
J’ai déjà dit, en parlant de l’or à Kong, que les marchands se servaient de poids plus ou moins exacts, consistant surtout en vieilles ferrailles ou cuivreries. Il est difficile de savoir exactement ce que doit peser dans l’esprit des noirs le barifiri. J’en ai vu de 17 gr. 5, de 17 gr. 75 et aussi de 18 grammes. D’après Roland de Bussy, le mitkal (متڧال) est une mesure[104] arabe pour les essences, les pierres fines, les métaux précieux, etc. Sa valeur est de 4 gr. 669, ce qui porterait le barifiri, c’est-à-dire les 4 mitkal, à 18 gr. 676. Jadis il est probable que le barifiri pesait exactement ce poids, mais, faute de poids exacts, il s’est peu à peu perdu et est tombé à 18 grammes et quelquefois moins.
Ebn Khaldoun dit, dans son Histoire des Berbères, que le mitkal pèse une drachme et demie ou 1/8 d’once (l’once pesait 32 grammes).
Il est très curieux d’observer et d’assister à un marché qui se conclut en or. Je passe sous silence les débats préliminaires pour arriver au moment critique où le vendeur du cheval, du captif, etc., ne veut plus diminuer et le marchand d’or ne veut plus augmenter. C’est alors que l’intelligent Ligouy ou Wangara essaye de fasciner son client par la vue de l’or. Sans mot dire, il étale devant lui les 3 ou 4 barifiri enroulés dans un chiffon, enlève lentement le fil de coton qui ferme ce sachet improvisé, étend le métal précieux dans une petite main en cuivre en y promenant, sans se presser, un aimant afin d’extraire les parcelles de fer s’il y a lieu. Il force l’autre à examiner l’or, le palper, le peser, faisant mine d’en retirer une parcelle si le poids paraît un peu fort, puis il remet la poudre d’or dans les chiffons, emballe le tout dans un foulard qu’il serre dans la poche de son boubou et dit : « A ko di ? qu’est-ce que tu dis (décides) ? » et, sans attendre la réponse, il a l’air de se retirer. L’autre, n’ayant peut-être jamais de sa vie possédé un mitkal, est ébloui par la vue de quelques grammes d’or, se voit d’un coup à la tête d’une fortune et, croyant que s’il laisse partir le marchand tout est perdu, il finit par céder.
Si nous comparons le prix de l’argent à celui de l’or, nous trouvons que le thaler de Marie-Thérèse (poids 27 gr. 5, valeur 5 fr. 50) coûte 5000 cauries, et que pour la même somme de cauries on peut se procurer 2 gr. 25 d’or, soit, à 3 francs le gramme, 6 fr. 75. Pour 11 francs d’argent monnayé on peut donc obtenir 13 fr. 50 d’or.
Les autres monnaies d’argent que l’on voit ici sont : quelques piastres mexicaines et des États-Unis, le florin anglais, le shilling et les pièces de 6 et 3 pence.
Toutes ces monnaies sont excessivement rares. Ce n’est que par hasard que l’on trouve une ou deux pièces entre les mains de gens réputés riches.
6o Les animaux de boucherie, dont nous avons vu la provenance et la destination.
7o Le beurre de cé, rendu ici, revient trop cher pour être dirigé vers[105] le Bondoukou et l’Anno, qui le reçoivent des Komono, par Kong, à très bon compte.
8o Les ânes, provenant du Mossi, se vendent plus ou moins cher, suivant que le stock de kolas est plus ou moins abondant à Kintampo, et atteignent parfois le prix exorbitant de 90000 à 120000 cauries, tandis qu’en temps ordinaire ils ne se vendent que 25000 à 40000 cauries.

Marchand fascinant un client.
9o Les chevaux, amenés par les Haoussa de leur pays et du Boussangsi. Prix variant de 140000 à 300000 cauries. Il se vend environ 50 chevaux par an à Salaga.
10o Les étoffes en bandes du Dagomba, du Kong, de Boualé, qui se vendent très cher ici, Salaga ne produisant ni étoffes ni teintures. Le taro ou pendé du Mossi se trouve en concurrence sérieuse avec les cotonnades grossières du Djimini et de l’Anno. De même qualité, mais rayées de[106] bleu, elles sont vendues sur la place avec une différence de prix si légère qu’on les préfère aux taro des Mossi. Une bande de 1 m. 50 d’étoffe rayée bleu et blanc de Djimini coûte 150 cauries.
11o Les articles de provenance d’Europe, parmi lesquels figure en première ligne l’elephanten gin. Prix de la fiole : 3500 cauries.
Le calicot écru blanc, la pièce de 30 mètres (métrage lu sur la pièce), 15000 cauries, ce qui, comparé à la valeur de l’or (le gramme : 3 francs), met la pièce de 15 mètres à 9 francs.
Il est triste de constater que ce sont les Allemands et les Anglais qui fournissent ce tissu ici, tandis que nous pourrions avantageusement lutter contre ce produit. J’ai acheté à Paris[25] du très beau calicot apprêté à raison de 4 fr. 25 la pièce de 15 mètres. A Kong, on me suppliait d’en céder quelques pièces à raison de 12000 cauries, ce qui équivaut à 2 mitkal d’or ou 27 francs. Ici j’ai vendu la même étoffe 8000 cauries la pièce (12 fr. 80). Nous pouvons donc fournir mieux au même prix.
Le coton rouge en écheveaux se vend ici 900 cauries l’écheveau et à Kong 1400. C’est avec ce fil que les gens de Kong font les jolis el-harrotafe expédiés sur Djenné et Tombouctou.
La verroterie très commune.
Le foulard rouge en pièces, affreuse marchandise qui ne sera bientôt plus demandée par les noirs. Prix de vente : 400 à 500 cauries pièce.
Les étoffes imprimées, à très bon marché.
Pas de verroterie de luxe, pas de corail, enfin rien en dehors de ce que je viens de citer, sauf quelques grossiers couteaux et du laiton en baguettes.
12o Je citerai les articles apportés par les Haoussa, qui les reçoivent viâ Ghadamès ou bien des factoreries du Bas-Niger, du Yorouba et du Noufé.
Ces articles sont le papier, les chapelets, l’antimoine, des parfums, des sabres. A ces objets il faut joindre la maroquinerie haoussa, les étoffes confectionnées du Haoussa et du Noufé, le konri, sel de soude (?), et d’autres médicaments ou ingrédients servant de remèdes.
13o Enfin quelques Barba et Nago du Yorouba apportent ici de l’huile de palme et les pagnes de Kotokolé dont j’ai parlé à Oual-Oualé.
Les relations avec Koumassi sont nulles ; il n’existe aucun trafic entre la capitale de l’Achanti et celle du Gondja.
J’ai remarqué à Salaga un article nouveau qu’on essaye d’importer de la côte : c’est un tissu de coton (imitation pagne des noirs) d’une largeur de[107] 50 à 55 centimètres, se vendant environ 1 franc le mètre. Cet article est en concurrence avec les étoffes que les indigènes arrivent à fabriquer à des prix excessivement bon marché (voir Kong et Oual-Oualé) ; aussi les indigènes préfèrent les leurs en bon coton et de bon teint, supportant bien les lavages. Tous les noirs savent avec leurs étoffes mieux confectionner ce dont ils ont besoin, le dispositif en bandes très étroites les y aidant beaucoup. Une pareille concurrence ne peut nous donner de beaux bénéfices. Je pense qu’en outre il serait inhumain de tuer la seule industrie des noirs, tissage et teinture, qui donne le pain quotidien à des milliers d’individus. Il serait au contraire généreux de notre part de favoriser et d’aider au développement de cette industrie presque dans l’enfance, à l’aide de laquelle les noirs un peu civilisés peuvent se procurer des ressources. Le commerce du tissage est certainement un moyen d’arriver à la fortune, plus humain que les expéditions et les razzias. Quand le noir sera bien convaincu qu’il peut se procurer une existence aisée par le travail, il ne s’enrôlera plus avec enthousiasme dans les bandes des Gandiari et autres, car ce n’est qu’à défaut de ressources qu’il s’embauche pour faire la guerre.
Salaga, par sa position entre les pays du nord et les lieux de production de kolas au débouché des routes venant du Mossi, du Dagomba, du Boussangsi et du Haoussa, avait, il y a une trentaine d’années, une grande importance comme rendez-vous des marchands. De là ils pouvaient, à leur choix, se rendre à la côte ou à Bondoukou, suivant qu’ils désiraient se procurer des produits européens, des kolas ou de l’or. Au lieu de tirer profit de cette situation favorisée en achetant les produits des uns des autres, les gens de Salaga ont laissé le commerce se faire chez eux sans y prendre directement part et ont abandonné ainsi les bénéfices que donne le commerce de transit. Les profits faits ici ne sont pas en effet pour Salaga, ils sont emportés par les étrangers qui les ont réalisés. D’actifs intermédiaires qu’ils auraient pu devenir entre les produits européens, le kola, l’or, et les produits du nord, ils sont descendus, par leur inaptitude, au triste rang d’aubergistes ou de courtiers véreux ; ils n’ont même pas su se créer l’industrie du tissage et s’occuper de teinture, de sorte que cette population est presque pauvre. On ne trouve de gens aisés que parmi les Mandé Dioula et les Haoussa. Quantité d’hommes jeunes et vigoureux se contentent de faire le salam et de mâcher quelques kolas mendiés ou escamotés à une de leurs femmes. Ce sont elles qui travaillent pour nourrir celui qui devrait pourvoir à leurs moindres besoins.
Cet état de choses n’a pas échappé à la clairvoyance de quelques Mandé venus de l’ouest, de Bobo-Dioulasou et de Bouna ; ils ont successivement[108] fait prendre de l’extension à Kété, Krakye et Kintampo, au détriment de Salaga, qui dans un avenir prochain sera réduit au rang de petit village.
Pendant mon séjour ici, j’ai reçu des nouvelles de Kong par Karamokho Mory, fils d’Ouçman Daou ; il m’apprit que Diarawary Ouattara, le chef du village, était mort, et que Karamokho Oulé, mon protecteur, attendait mon retour avec impatience. Je profitai de l’occasion pour donner de mes nouvelles à Kong et annoncer par un petit mot mon prochain retour.
Un Peul originaire du Macina et venant de Porto Novo, avec quelques marchandises, m’apprit que le lieutenant commandant le poste d’Agoué s’était informé de moi et lui avait recommandé, dans le cas où il me rencontrerait en souffrance, d’avoir à me ramener vers notre établissement. Je remercie ici vivement ce brave compatriote dont j’ignore le nom[26] qui a bien voulu se souvenir qu’un camarade parcourait ces régions, et s’intéresser à ses tribulations.
Je comptais trouver auprès de ce Peul quelques renseignements sur les chemins qui mènent de Salaga à Porto Novo, chemins que je supposais contourner le nord de la lagune Avon. Nos possessions, d’après cet indigène, ne seraient pas en relations avec l’intérieur par cette voie, et les marchands qui se rendent de Salaga à la côte des Esclaves suivent la rive gauche de la Volta jusqu’à Kpando (garnison anglaise la plus septentrionale) puis de là se dirigent vers la côte par l’Ewéawo et le Krépé sur Baguida (Bagdad), Porto Séguro, les Popo et Wydah à Ago (Porto Novo).
Un de mes premiers soins en arrivant à Salaga fut de lier connaissance avec quelques Mandé Dioula ayant voyagé et connaissant la région que je me proposais de parcourir pour effectuer mon retour à Kong. Je ne tardai pas à être servi à souhait par de réels amis, gens sans défiance, qui se mirent à ma disposition. J’acquis ainsi la certitude que les rivières de Léra et de Lokhognilé, qui ont leur confluent près de Ouasséto, au nord de Kong, forment bien la rivière Comoë et qu’après avoir contourné le pays de Kong, ce cours d’eau se dirigeait vers le sud, laissant Bondoukou à l’est et Groûmania (Mango, capitale de l’Anno) sur sa rive droite. Ce n’est donc pas la Volta Noire, comme je l’avais supposé pendant quelque temps, et je me trouve bien en présence d’une rivière absolument française, car elle débouche près de Grand-Bassam.
J’appris également qu’à quelques journées de marche au sud de Mango se trouve un village nommé Attacrou et que les indigènes de ce village vont en pirogues chercher le sel à Grand-Bassam. Si le croquis de la rivière[109] donné par renseignements par le commandant Bouët-Vuillaumez dans les revues coloniales de septembre 1840 et suivantes est exact, cette escale se trouverait par 7° 30′ de latitude nord, à peu près à la même place que lui assignent nos propres renseignements. Dans tous les documents on se borne à dire : « La rivière d’Abka n’est navigable que jusqu’aux cataractes d’Abouessou ». Ce qu’il y a de certain, c’est que le Comoë nous permet de nous approcher en pirogue jusqu’à quinze jours de marche de Bobo-Dioulasou, qui avec Djenné sont les deux seules villes importantes de la boucle du Niger, après Kong. Les indigènes de l’Anno et du Bondoukou la nomment Coumouy, Comoë ; il n’y a donc plus de doute, puisque nous la connaissons sous le nom de Comoë. J’appris aussi que Bondoukou, Bottogo, Gottogo, Bitougou ne sont qu’un seul et même centre. Comme les gens de Kong m’avaient donné l’itinéraire de Kong à Bitougou, qu’ils appellent Gottogo et Bottogo, j’ai pu ainsi construire un réseau d’itinéraires que je donnerai plus loin, lorsque ma route m’aura permis de fixer un ou deux points, tels que Boualé et Kintampo.
Voici aussi quelques renseignements sur les Ligouy, dont j’ai parlé à propos de kolas :
Les Ligouy habitent la région située entre Boupi, Boualé, Kintampo et Bitougou. Ils font partie politiquement du groupe de pays que les Mandé Dioula de Kong nomment le Gottogo (nom tronqué de Bitougou ou de Bondoukou, centre principal de la région). Leur centre principal se nomme Fougoula et est situé à environ une trentaine de kilomètres dans le nord-est de Bitougou.
Ethnographiquement ils n’appartiennent ni aux Pakhalla, qui sont leurs voisins dans le nord-ouest, ni aux Ton, qui limitent leur territoire dans le sud-ouest. Aucun lien de parenté ne les rattache non plus aux Achanti. Physiquement ils ressemblent aux Mandé Dioula. Ils se distinguent de ceux-ci par de larges incisions qui contournent la nuque et quelquefois par une entaille partant de la bouche et allant mourir à hauteur de la dernière molaire.
Très actifs, et occupant une position centrale entre les pays du Nord, d’où l’on tire le bétail, et la région mandé de Kong, ils se livrent eux-mêmes à l’exploitation des gisements aurifères de leur région et produisent beaucoup de tissus. Ils sont devenus les seuls intermédiaires entre les producteurs de kolas achanti et les peuples des environs. Quand j’aurai dit qu’ils appartiennent à la fraction la plus intelligente de la race mandé, aux Veï, j’aurai tout dit.
A ce propos, il m’est arrivé une drôle d’aventure qui a fait les frais de[110] conversation des oisifs de Salaga pendant plusieurs jours. Un jeune homme Ligouy, nommé Mouméni, habitant Salaga et parlant fort correctement le mandé, venait à peu près tous les jours me dire bonjour. Ma connaissance du mandé et quelques notions sur d’autres langues soudaniennes faisaient son admiration, lorsqu’un beau jour il me dit à brûle-pourpoint : « Tu as certainement bonne mémoire et tu retiens facilement le parler des Mossi, Dagomba, Haoussa et Gondja, mais si tu séjournais, même un an, chez les Ligouy, tu ne comprendrais rien du tout ; aucun étranger ne connaît notre langue, que tout le monde s’accorde à dire très difficile. » Je lui répondis que pour s’en convaincre il n’avait qu’à tenter l’épreuve et commencer aujourd’hui par me citer les noms de nombre ligouy. Il ne se fit pas prier et récita : dondé, féra, etc. ; à dix je l’arrêtai. C’était en veï qu’il comptait ; pour plus de sécurité je pris dans ma petite bibliothèque la brochure de Norris et la grammaire veï de Koelle. J’acquis ainsi la certitude que les Ligouy parlaient le veï à peu près pur. La construction des phrases est la même, il n’y a que, par-ci par-là, un mot altéré légèrement.
Sa surprise se changea bientôt en un profond étonnement. Tout le monde connaissant l’itinéraire que j’avais suivi pour venir de Kong ici, on savait très bien que je n’avais jamais traversé le territoire des Ligouy. Toutes les explications que je lui fournis sur les Veï de la république de Libéria ne le convainquirent point ; il attribua ce fait à quelque chose de surnaturel, continua à venir me voir, mais il me tendit toujours la main avec quelque méfiance.
Le mauvais temps et les pluies continuelles m’ont obligé d’attendre patiemment ici le retour de la belle saison ; dans ces régions, l’hivernage est en retard de deux mois sur le bassin du Niger. Tandis que dans la vallée de ce dernier fleuve les mois les plus pluvieux sont juillet et août, dans le bassin de la Volta le gros hivernage comprend les mois de septembre et d’octobre. Du 1er au 28 octobre il est tombé vingt-quatre fois de l’eau, ce qui fait à peu près tous les jours. Dans ces conditions, on peut dire qu’il est presque impossible de voyager. De Salaga à Bouna il n’y a pas moins de cinq cours d’eau à traverser, et, sur la route de Salaga à Kintampo, la Volta, avec ses débordements, est dangereuse à faire traverser par des animaux. On risque, du reste, de se voir arrêté, par le mauvais état des chemins, dans quelque petit village sans ressource où l’attente est plus pénible que dans un centre où il règne un peu d’animation comme à Salaga.
Le 1er novembre arrivèrent quelques Mandé de Baoulé et la première[111] caravane des Mossi, amenant 4 bœufs, 6 moutons, 2 ânes, du taro et des poulets. Ces gens n’apportèrent pas de récentes nouvelles de leur pays, ayant dû s’arrêter devant les pluies persistantes, les uns dans le Gondja, les autres dans le Dagomba.
Le 3 arrivèrent de Yendi les premiers Haoussa, au nombre d’une vingtaine, avec quelques ânes et deux superbes mules ; le croisement du cheval indigène avec l’âne du Mossi donne réellement un beau produit. Ce mulet, quoique de petite taille (1 mètre à 1 m. 10) est bien proportionné, vigoureux et bien en forme. Ces animaux doivent rendre de réels services à leurs propriétaires, qui ne veulent s’en défaire à aucun prix. Désirant les envoyer comme spécimens à Bammako et les offrir au commandant supérieur du Soudan français, j’ai cherché à en faire l’acquisition ; malheureusement le propriétaire n’y a pas mis la bonne volonté que j’attendais et n’a pas voulu céder ses deux animaux pour la somme de 200000 cauries par tête, ce qui, ici, correspond à un cheval de prix. Voyant que j’y tenais, il ne voulut les céder qu’à raison de 400000 cauries, ce qui fait 800000 cauries ou sira ourou nani en mandé, somme qu’il m’aurait été impossible de réunir sans compromettre mes ressources pour le retour. Il est même certain que je ne serais parvenu à trouver cette somme qu’au bout de plusieurs semaines de transactions.

Mules du Haoussa.
[112]Les Haoussa tiennent fort probablement des Arabes l’industrie mulassière. En haoussa on nomme cet animal al-fadara et en mandé bakhalé, ce qui est le mot arabe estropié بڧل. On m’a affirmé qu’on a vu des caravanes de Haoussa passer ici, pour aller prendre des kolas à Kintampo, avec quarante mulets. Si ce fait est vrai, c’est que l’élevage s’est accru très rapidement et a pris un développement extraordinaire ; car, il y a quarante ans, au moment du séjour de Barth dans le Haoussa, ce voyageur ne signale pas cet animal, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, puisqu’il en parle dans le tome II pour dire qu’il ne se voit que rarement chez les peuples noirs.
[113]CHAPITRE XII
Les Gondja. — Leur histoire. — Insalubrité de Salaga. — Choix d’un itinéraire. — Superstitions des indigènes. — Départ pour Kintampo. — Sur les bords de la Volta. — Traces du passage de von François. — Mesure du temps chez les indigènes. — Belle végétation. — Les droits de douane. — Marais de Konkronsou. — Végétation splendide. — Arrivée à Kounchi, premier village achanti. — Kâka. — La feuille à emballer le kola. — Kintampo. — Mon hôte Sâadou. — Diawé à la recherche de miel. — Une visite chez le chef achanti. — Curieuses habitations. — Le marché. — En marche avec les Haoussa. — Avenir de Kintampo. — Départ pour Bondoukou. — Itinéraire de Takla à Koumassi. — Territoire des Diammoura. — Sur les bords de la Volta. — J’apprends l’arrivée d’un blanc qui est à ma recherche. — Arrivée à Tasalima (village ligouy). — Massif de Kourmboé. — Encore la Volta. — Les Dioumma ou Diammou ou Diammoura. — Deux étapes dans la brousse. — Tambi. — Sorobango. — Entrée à Bondoukou. — Nouvelles de Treich-Laplène.
Les Gondja de Salaga et des environs, et du reste tous ceux que j’ai vus par la suite, offrent tellement peu de différence avec les Mampourga et les Dagomba que je n’hésite pas à leur assigner la même origine, quoiqu’ils ne parlent ni le dagomsa ni le mandé et qu’actuellement ils emploient une langue qui me paraît être un dialecte achanti (les missionnaires l’ont appelé le guang, mais les Mandé et les Haoussa le nomment gouannia et eux-mêmes nomment gouenn) ; ce peuple est d’origine mandé.
Ses diamou (nom de famille et de tribu) sont empruntés en partie aux Mandé-Bamba et aux Mandé-Mali, comme on peut s’en rendre compte tout de suite. Les chefs se nomment tous Diarra ou Traouré, et parmi les autres noms les plus répandus j’ai noté : Dambélé, Konaté, Kamata, Kouroubari, Dioubaté ; ils sont marqués de trois longues cicatrices partant de la tempe pour se terminer au menton, tatouages très généralisés chez ces deux familles mandé et que les Mampourga et les Dagomba ont conservés, comme j’ai eu l’occasion de le dire plus haut ; mais en plus beaucoup d’entre eux ont toutes les parties du corps empreintes de trois cicatrices semblables à celles des joues. Les Gondja ont cela de commun avec eux.
J’ai trouvé aussi chez eux, en dehors des différents types de cases[114] mandé, les gris-gris en tumulus des Siène-ré, la pioche à igname des Siène-ré du Follona, du Kénédougou et des Mandé-Dioula de Kong. Cet instrument est caractérisé par un fer rond et une monture en bois munie d’une poignée. Cette pioche se manie à deux mains : l’une maintenant le manche, l’autre la poignée. J’ai aussi constaté, dans le Gondja, l’emploi très fréquent de la teinture rouge brun, dite bassila, qui a pour moi, comme pour beaucoup de voyageurs, une valeur presque ethnographique. Frappé de tant de ressemblances, j’ai interrogé quelques vieux Gondja : ils m’ont dit qu’ils savaient par tradition qu’ils sont d’origine mandé, mais que leur établissement dans le bassin de la Volta est tellement ancien qu’ils ne connaissent plus aucun détail à ce sujet.
Probablement, à l’époque de l’arrivée des Mandé-Dioula par le Ouorodougou et le Mianka sur Kong, les fractions mandé qui constituent actuellement en partie la population du Mampoursi, du Dagomba et totalement celle du Gondja se sont portées sur Bouna, Oua et Boualé, et se sont répandues sur les deux rives de la Volta. Les fractions méridionales de cet important groupe ont été rendues tributaires par les Achanti, tandis que celles situées plus au nord ont fui devant les conquérants et sont allées occuper les régions au sud du Boussangsi et du Mossi, régions probablement à peu près désertes à cette époque, car encore aujourd’hui la densité de la population n’est pas considérable et l’on voit fort peu de vieux bombax ou de vieux baobabs. (Lorsqu’on trouve ces arbres isolés ou groupés par trois ou quatre dans la campagne, ils marquent toujours l’emplacement de lieux autrefois habités.)
Pendant fort longtemps les fractions mandé qui se sont mélangées aux Mampourga n’ont dû avoir aucune relation avec les familles du Gondja. C’est ce qui explique qu’ils ne parlent pas une même langue. Ils ont même dû ménager entre eux de grands espaces inoccupés non frayés par des chemins, pour servir de barrière entre eux et l’Achanti. Cet état de choses devait même encore exister il y a un siècle à peine, car Bowdich (1817) et Dupuis (1820), qui se sont occupés exclusivement de la géographie de cette région, signalent les grands déserts de Gofan, de Gofati, de Ghomaty, etc., qu’ils placent dans la région séparant le Gondja du Mossi.
Ce peuple gondja a dû vivre pendant plusieurs siècles sous le joug des Achanti ; il a conservé le stigmate de la servitude ; il est plutôt rampant que fier ; je ne l’ai pas vu se livrer une seule fois à quelque réjouissance, et, pendant les clairs de lune, c’est à peine si quelques enfants battent des mains au son du tam-tam. A Salaga, en général, on semble avoir peu de goût pour ces fêtes nocturnes, qui sont tant en honneur chez les Mandé[115] libres, et les nuits silencieuses ne sont troublées que par quelque nago venu de la côte avec un méchant harmonica, duquel il tire quelques sons, toujours les mêmes.
Depuis que la puissance des Achanti a été abattue par les Anglais, les Gondja ont cependant gravi quelques échelons de l’échelle sociale. Dans beaucoup de villages, et entre autres à Salaga, hommes et femmes se vêtent proprement et cherchent à imiter les Mandé et les Haoussa. Leurs femmes recherchent beaucoup le corail et les fichus en soie ; celles qui sont trop pauvres se ceignent le front d’un fattara en calicot imprimé de quelques centaines de cauries, et en guise de corail s’introduisent dans le lobe de l’oreille un morceau de moelle de mil cylindrique trempé dans du jus de kola — c’est une imitation de corail que l’on peut, en effet, se procurer à peu de frais.
Salaga est loin d’être un sanatorium ; c’est un des points les plus malsains que j’aie visités. Quoique relativement élevé, le plateau ferrugineux sur lequel s’élève la petite ville n’est pas balayé par les vents. La malpropreté qui y règne et les émanations provenant des eaux stagnantes en font un séjour peu salubre pour les Européens et même pour les noirs étrangers et les animaux. A peine Diawé rétabli par les soins de mon diatigué de Oual-Oualé, j’eus quatre de mes hommes atteints de furoncles qui les rendaient impropres à tout service. C’est ici également que je perdis mes quatre derniers ânes de Bakel. Ce fut donc avec une véritable joie que je vis dans les premiers jours de novembre la campagne se couvrir de buées pendant les heures chaudes : les Mandé considèrent ce phénomène comme un indice certain de la prochaine fin des pluies. Je me mis tout de suite à la recherche de quelqu’un pour m’accompagner sur Kong par Bitougou. Je m’adressai à cet effet à Bakary, mon diatigué, et à Karamokho Yousouf Touré de Kong, qui se proposait de faire retour vers sa ville natale.
Ce dernier projetait de prendre la route parallèle à la Volta, en suivant sa rive gauche, pour se diriger de Boualé sur Kong par Bandagadi et Bitougou. Bien qu’il y ait quatre cours d’eau à traverser, et probablement à subir les exigences de deux chefs qui ne sont pas réputés commodes[27], je m’étais décidé à suivre ce musulman, lorsque, au dernier moment, il abandonna son projet. Comme cette route est moins fréquentée que celle de Kintampo, il m’aurait peut-être fallu prolonger mon séjour ici. Il m’était aussi plus facile de trouver un guide pendant huit ou neuf jours pour me conduire à Kintampo que d’en trouver un pour vingt à trente[116] jours de marche. Bakary me confia alors au fils d’un Haoussa, notable de Kintampo, qui faisait retour avec du sel vers ce marché, et lui adjoignit un de ses propres captifs, auquel je promis de donner une charge de kolas à mon arrivée à Kintampo. Ce dernier point a été traversé par l’explorateur Krauss et visité par un Anglais venu de la côte pour y acheter des chevaux. Je pense que le voyage sera cependant aussi intéressant pour moi que celui de Boualé. Du reste, je n’aurais peut-être pas traversé cette route, car celle de Bitougou incline au sud-ouest à Dakourbé et évite ce centre. Boualé est bien moins important que Kintampo, où il se vend de tout, tandis que Boualé, depuis l’expédition du Gourounsi, a fait sa spécialité de la vente des captifs et négligé l’exploitation de ses terrains aurifères. Ces terrains, quoique bien moins riches que ceux de la région Bitougou, fournissent l’or aux Ligouy qui vont chercher le kola dans l’Achanti.
L’itinéraire Salaga-Boualé-Bouna-Kong m’est du reste suffisamment connu pour me permettre de le tracer presque avec certitude une fois que j’aurai l’emplacement de Kintampo et de Bitougou.
L’apparition de la nouvelle lune exerce sur l’esprit des Soudaniens une influence beaucoup plus considérable que nous ne nous l’imaginons. Si c’est pendant le dernier quartier que la mise en route se décide, le départ est toujours ajourné au premier jour de la nouvelle lune. Il n’y a pas de chef qui oserait entreprendre une expédition et mettre ses guerriers en route avant l’apparition du croissant. Il en est de même des marchands et de tout individu qui a besoin de se déplacer.
A côté de cette coutume, les jours fastes, néfastes et les quantièmes du mois jouent un rôle non moins considérable. Tel ou tel peuple, tel ou tel individu, ne se mettra jamais en route un dimanche, un mardi ou un vendredi. D’autres, au contraire, les choisissent, à la condition toutefois que ces jours tombent chez les uns sur un quantième pair, chez les autres sur un quantième impair. Ceux qui n’ont pas de conviction bien arrêtée à ce sujet prennent l’avis du kéniélala, des marabouts, ou encore s’en rapportent aux décisions de réussites qu’ils font avec des cauries. Ils prennent au hasard trois poignées de coquillages, qu’ils comptent. S’ils amènent plusieurs fois un nombre pair, ils opteront pour un quantième pair de la lune : ce sera le deuxième, le quatrième, le huitième jour ; ou bien le troisième, le cinquième, le septième, etc., si le nombre des cauries amenées est impair. Chez beaucoup de gens cette décision est irrévocable, et l’on perdrait son temps à essayer de leur faire changer d’avis.
Lundi 12 novembre. — Mon jour de départ, que j’avais fixé au lundi 12, tombe sur un des jours favoris des noirs, le septième jour de la lune.[117] Aussi, dès la sortie de Salaga et par tous les sentiers débouchant sur le chemin principal, y a-t-il des groupes de porteurs attendant quelques retardataires de leur compagnie pour se mettre en route. J’ai compté 102 porteurs, hommes et femmes, chargés d’environ 2000 kilos de sel et se rendant tous à Kintampo pour y prendre des kolas ; outre mes propres compagnons, que m’avait adjoints mon hôte Bakary, je ne manquais donc pas de société.
Le sentier serpente dans une grande plaine monotone couverte de hautes herbes coupée par le torrent Bompa et deux de ses petits affluents, puis traverse un petit village de culture qui se distingue par une belle plantation de tabac. Les femmes étaient assises sur le bord du chemin et vendaient aux porteurs des portions de to (lakh lalo) de 10 et 20 cauries. A 6 kilom. 500 de là se trouve le lieu d’étape Kakouchi, village gondja comprenant trois familles. La petite population de ce village semble avoir compris qu’elle pouvait tirer profit du passage des marchands chez elle, car dès notre arrivée les femmes du village apportent des mets préparés et surtout des ignames, qui, malgré leur prix élevé, sont enlevés en un clin d’œil.
Mardi 13 novembre. — De Kakouchi on se rend directement sur les bords de la Volta, en s’arrêtant au deuxième village de Kaffaba le temps nécessaire pour y faire provisions d’ignames. Ce petit village est ombragé par quelques finsans, et autour des habitations on voit des groupes de bananiers. On peut facilement s’y approvisionner en ignames, mais il n’en est pas de même pour le mil ou la volaille, dont les habitants ne veulent se défaire à aucun prix.
Arrivé sur les bords de la Volta, j’allai voir le chef des piroguiers pour débattre le prix du passage et essayer de le gagner par un petit cadeau afin de lui faire opérer le transbordement de suite, mais ce personnage ne me fit pas précisément bon accueil ; il me demanda 12000 cauries, au lieu de 7000 que je devais payer d’après le tarif appliqué aux indigènes, et, pour comble, ne voulut me traverser que le lendemain. Heureusement le chef, auquel j’avais rendu visite, envoya son fils pour me dire que je payerais au piroguier ce que bon me semblerait et qu’il allait immédiatement s’occuper de nous embarquer. Étonné d’un si brusque revirement, j’interrogeai un piroguier, captif siène-ré du Follona, qui m’apprit que le passage d’un Européen ici, avec lequel le chef avait eu des démêlés, l’avait mal disposé en faveur des blancs ; mais comme ce chef terrible avait appris que j’étais un blanc de l’Ouest accompagné par des Wangara (Mandé), et non par des noirs du bord de la mer, il voulait me témoigner sa bienveillance en ne se montrant pas exigeant.
[118]C’est probablement le même Européen qui involontairement, par sa présence à Gambakha lors de mon arrivée dans le Mossi, m’a fait fermer les routes vers le nord et l’est par Naba Sanom. Il est venu ici à son retour, a traversé la Volta et s’est rendu jusqu’à Tourmountiou (village à 10 kilomètres du fleuve sur sa rive droite), puis il a fait retour à Kaffaba, où il a cherché à acheter des pirogues pour remonter le cours de la Volta. Sur le refus du chef de livrer ses embarcations, ce voyageur fit abattre des arbres et commencer à creuser des pirogues, puis, abandonnant subitement son projet, il se dirigea dans l’est au nord du Dahomey. C’est du lieutenant allemand von François qu’il s’agit. A l’aide des renseignements donnés par les piroguiers et avec un laborieux travail de dates, j’en ai acquis la certitude.
La mesure du temps laisse beaucoup à désirer chez la plupart des peuples soudanais. Aussi je crois utile de donner ici quelques explications sur ce sujet, qui sera toujours intéressant pour les explorations futures.
Elle n’est guère exacte que chez les musulmans lettrés et chez les Mandé-Dioula. Les premiers se servent des noms de mois arabes. Les seconds divisent également l’année en douze mois lunaires qui portent des noms spéciaux :
| NOMS MANDÉ-DIOULA | |
|---|---|
| 1 | Diombé (ce mois correspond au mois arabe Moharrem). |
| 2 | Domma ma Konong (celui-ci correspond au mois arabe Safar). |
| 3 | Domma. |
| 4 | Kourouko. |
| 5 | Kourouko fla. |
| 6 | Kamdouma ma Konong. |
| 7 | Kamdou. |
| 8 | Sounkaro ma Konong. |
| 9 | Sounkaro. |
| 10 | Minkaro. |
| 11 | Dongui ma Konong. |
| 12 | Dongui. |
Mais chez les peuples plus ignorants une date précise est laborieuse à trouver. Ils comptent généralement par lunes, mais il arrive fréquemment qu’un indigène compte pour trois mois ou trois lunes la fin d’une lune, une lune entière et le commencement de la lune suivante. Le temps écoulé est bien à cheval sur trois lunes, mais ce ne sont pas trois mois complets.
Les années se comptent souvent par hivernage ; les Siène-ré, eux, comptent par époques où l’on brûle les herbes, etc.
D’autres comptent par saisons :
| Samien ou Sâmama : | Cette saison correspond aux premières nuits fraîches suivant l’hivernage (du 15 novembre au 15 décembre). |
| [119]Founéné : | Nuits froides, mois de décembre et de janvier (vallée du Niger), époque où l’on brûle les herbes. |
| Taratli : | Fortes chaleurs avant l’hivernage, mars, avril au 15 mai, époque où l’on travaille la terre. |
| Kandara : | Premières pluies de l’hivernage, saison des semis ; correspond aux mois de mai et de juin. |
| Sâmanfara : | Gros de l’hivernage, fin juin, juillet, août. |
| Foubonda : | Derniers mois de l’hivernage, septembre et commencement d’octobre. |
| Koutoté ta tougou : | Saison des buées pendant les heures chaudes, annonçant la fin de l’hivernage, fin d’octobre et commencement de novembre. |
Cette manière de mesurer le temps est souvent bien commode, et je crois même qu’on en abuse quelquefois.
Ainsi, tant que l’absence d’un mari n’excède pas dix-huit mois à deux ans, une femme enceinte est bien tranquille ; il y a tant de dates à donner et à embrouiller qu’elle arrive toujours à prouver ce qui n’est pas.
Du reste, j’ai remarqué que chez ces peuples une grossesse de douze à quinze mois est admise. Ils ne prétendent pas que ce sont des cas normaux, mais ils affirment avec un grand sérieux qu’ils se présentent encore assez souvent.
★
★ ★
Ce n’est pas sans discussion que s’effectue le passage d’une centaine de porteurs, car beaucoup de ces gens-là cherchent à se soustraire à la pénible obligation de payer les droits de passage, fixés à 500 cauries par porteur ou mouton, 1000 par âne, bœuf ou cheval.
Comme tout ce monde veut passer à la fois, chacun se rue sur la pirogue qui aborde ; des femmes, des charges tombent à l’eau, et les piroguiers n’ont raison de tout ce brouhaha qu’en distribuant de temps à autre quelques coups de pagayes bien appliqués aux passagers trop entreprenants.
Pendant que les musulmans, durant la traversée, chantent une louange à Dieu, les griots frappent à coups redoublés sur leurs tam-tams. Enfin, à six heures du soir, les quatre petites pirogues ont transbordé tout le monde sur l’autre rive sans autre incident que la perte d’un bœuf. Un musulman, qui parvient à le ramener mort sur la rive, s’empresse de lui couper le cou, sachant bien qu’il en trouverait le débit.
Un petit cadeau au chef de Kaffaba et 5000 cauries distribuées aux piroguiers n’ont pas peu contribué à faire exécuter mon passage avec célérité, et tandis que tout ce monde-là, de crainte de coucher sur les bords du fleuve, se met en route pour Tourmountiou, j’installe mon campement sur la rive droite pour y passer la nuit.
[120]La Volta est un beau fleuve de 350 mètres de largeur. Ses deux rives sont boisées sur une profondeur de 50 mètres. Actuellement rentrée dans son lit, elle coule silencieusement vers le sud-est. Ses eaux sont unies comme un miroir, et dans la soirée, quand tout le tumulte a cessé, sa surface n’est troublée que par le sillage de quelque caïman remontant le courant ou par le remous produit par les hippopotames, qui se rendent par trois ou quatre à un pâturage favori. Cela nous donne l’occasion d’exercer notre adresse au tir pendant une bonne partie de la soirée.
Le gibier n’est pas abondant : à part le tintan, oiseau pêcheur brun très criard, animal peu comestible, on ne peut guère tirer que des singes verts et surtout des rats palmistes, dont Diawé réussit non sans peine à abattre une paire. Cet animal, qui ressemble beaucoup à l’écureuil, est aussi adroit que lui pour se dissimuler sur les branches.
Mes deux baromètres m’ont donné aujourd’hui, l’un 230 mètres au-dessus du niveau de la mer et l’autre 150 au-dessous du niveau de la mer(?). J’avais déjà constaté à plusieurs reprises pendant le cours de mon voyage des erreurs assez sensibles indiquées par ces deux instruments, c’est pourquoi je ne donne la cote 270 pour Salaga que sous toutes réserves.
Mercredi 14 novembre. — En quittant les bords du fleuve, on traverse encore de nombreux terrains inondés qui rendent la marche difficile et même parfois dangereuse pour les animaux. Deux petits ruisseaux embarrassés de branchages et que l’on traverse non loin de leur confluent avec la Volta sont encore pleins d’eau. De l’un de ces ruisseaux on aperçoit une grande nappe d’eau, qui ne doit être qu’un coude très prononcé du fleuve ou alors un débordement de sa rive droite, le fleuve n’ayant pas suffisamment baissé pour permettre l’écoulement des eaux.
Le village de Tourmountiou, ou Zourmountiou, se distingue par six banans séculaires qui sont autant de jolis campements. Les cases du village, au lieu d’être du type rond, sont rectangulaires, à toits en chaume, dans le genre de celles de quelques villages dokhosié et komono des environs de Kong, construites en belle terre glaise rouge. Ces habitations constitueraient un bel ensemble par leur alignement sur deux lignes, entre lesquelles est ménagée une large rue ou plutôt une cour commune, mais leurs toits sont en si mauvais état que, si l’on ne voyait pas les habitants, on croirait le village abandonné depuis plusieurs années.
A peine arrivés au campement, mes hommes se sont mis à danser une véritable sarabande. Je m’inquiétai de ce qui causait leur joie, ne demandant pas mieux que de la partager, lorsque Boukary vint me dire : « Nous[121] y en a danser et faire tam-tam, parce que ça bon village : il y a beaucoup poisson ». Il n’en fallait pas davantage à mes hommes pour être heureux.
Ils furent désagréablement surpris quelques instants après, quand le chef, accompagné de deux autres individus ivres et sentant l’eau-de-vie de traite, vint m’apporter une seule brochette de poissons secs et quelques ignames, en ajoutant que ce village était totalement dépourvu de ressources. J’ai cependant vu apporter deux belles tortues d’eau, qu’on a refusé de me vendre. Le mil aussi fait défaut. Pour quelques grains de corail je réussis pourtant à m’en procurer deux petites calebasses.

Les cases de Tourmountiou.
Jeudi 15 novembre. — En quittant Tourmountiou on traverse une grande plaine où les beaux arbres sont rares. Cependant, aux abords de quelques ruisseaux, qui ont conservé un filet d’eau, la végétation est plus belle ; elle est même très luxuriante à environ 9 kilomètres de Tourmountiou, où le sentier traverse une oasis charmante — amas d’arbres splendides et de lianes inextricables. Malheureusement, on ne jouit de ce spectacle que pendant une demi-heure, ce qui est trop court pour chasser la triste impression que laisse cette trop monotone végétation de la région Oual-Oualé Salaga.
Tout en me demandant pourquoi le chemin faisait aujourd’hui du nord et du nord-ouest, j’arrivai à Diatopé ou Dasia-Kopé, ou Gari-n’diato, comme le nomment les Haoussa. Là je vis tout le monde poser bagages et se mettre à compter des cauries. Le chemin fait tout simplement ce circuit[122] pour passer au village du nommé Diato, qui perçoit pour le chef de Kôlo un droit de 400 cauries par charge de porteur, et 800 par âne. Comme à Gari-n’diato débouche un autre chemin venant de Salaga par Bakhabakha et Alkhamessa, où il laisse la route Boualé pour couper la Volta à Kôlo, je me disais que le chef de Kôlo, pour ne pas perdre les bénéfices du droit de passage des pirogues et engager les marchands à passer par son village, ne devait prélever le fitto (droits de douane, en haoussa) que sur ceux qui traversent le fleuve à Kaffaba, mais pas du tout : que l’on passe chez lui ou ailleurs, qu’on vienne de Salaga ou de Kintampo, de Kaffaba ou de Kôlo, il faut s’exécuter chez Diato ; et bien mieux que cela, à 2 kilomètres plus loin, à Gourmansi, le lieu d’étape, la scène se renouvelle : on paye une seconde fois, toujours pour le chef de Kôlo — 300 cauries par charge, 600 par âne !
Ainsi, à moins de 100 kilomètres de Salaga, les marchands ont déjà acquitté trois fois des droits, dont la somme s’est élevée par charge à 1200 cauries. La perception du fitto m’a paru cependant arbitraire et j’ai cru remarquer que les Wangara (Mandé) et quelques porteurs, captifs de gens influents de Salaga, s’y soustrayaient complètement ou payaient bien moins que les Haoussa, qui s’y soumettent assez facilement. Ce n’est qu’à ce prix-là, m’ont-ils dit, qu’ils peuvent voyager sans armes et avec sécurité dans le pays. Si ces chefs sont exigeants, il faut en effet leur rendre cette justice, c’est que l’on peut circuler sur cette route sans courir le danger d’y être attaqué. Des femmes seules et des enfants font souvent le trajet de Salaga à Kintampo, et jamais il ne leur est arrivé rien de fâcheux, attaques ou vols.
Arrivé à Gourmansi, les coups de fusil et les pleurs des femmes nous annoncent la mort de quelqu’un. Cet incident nous force à attendre jusqu’à six heures du soir pour faire nos provisions en ignames et en mil, car on campe dans la brousse le lendemain.
Gourmansi est construit en cases rectangulaires, comme Tourmountiou. Le village où nous passons la nuit est tout petit, mais aux environs il y a de nombreux petits groupes de cases de culture qui dépendent du village, dont la population totale doit être de 200 habitants au maximum. On y trouve des cultures d’ignames, de tabac, d’une sorte de tomates amères, nommées diakhatou en mandé. Il y a très peu de mil.
Vendredi 16 novembre. — Après avoir été empêché de dormir pendant une bonne partie de la nuit par un tam-tam organisé à l’occasion du décès d’un habitant, nous nous mettons en route et traversons au petit jour un groupe de quelques cases que les Haoussa nomment Gari-n’seïdi, et les[123] Mandé : Seïdidougou. Le chemin incline ensuite vers le sud. La végétation, plus forte que celle des terrains ferrugineux, est fort belle dans quelques terrains humides. On ne voit cependant pas de palmiers, ni au bord du ruisseau à eau courante que l’on traverse à mi-chemin, ni dans les bas-fonds.
Le campement de Tourmi, où nous faisons étape, est aussi connu sous le nom de Dadjintirimi et de Kouloukou ; il est formé d’un groupe de paillotes disposées autour d’un netté stérile à environ 200 mètres au nord d’un bas-fond d’où l’on tire de l’eau. A ce campement habite une famille dont le chef, qui semble s’être constitué gardien de ce lieu, prête, moyennant une petite rétribution, des marmites et autres ustensiles de ménage aux voyageurs.
Aux alentours du campement poussent au hasard quelques pieds d’indigo, de piments, de bananiers sans régimes, des ricins et surtout des papayers, dont une bonne partie ont été abattus et gisent couverts de fruits autour des cases.
Par tout le Soudan on peut admirer le ricin, qui paraît venir à l’état spontané ; il y en a plusieurs variétés, et certains pieds sont de véritables arbustes.
Le papayer ne croît pas à l’état spontané, comme je l’ai supposé pendant quelque temps, on le rencontre souvent en dehors des villages, dans des lieux plus ou moins écartés ; mais en cherchant bien on finit presque toujours par découvrir qu’on se trouve sur l’emplacement d’une ruine ou bien sur le parcours de gens qui ont mangé des papayes en route et en ont jeté les graines.
La papayer du Soudan est le Papaya carica ; il est représenté par deux variétés : l’une aux graines abondantes, l’autre aux graines rares ou sans graines. Cette variété est plus délicate que la précédente.
L’arbre atteint de 3 à 4 mètres et ne porte des feuilles qu’à la couronne.
Les fruits poussent le long du tronc et sont de la grosseur de belles poires. La chair du fruit est jaune, parfumée et très délicate, on la mange comme dessert ou comme le melon, avec du sel.
Le fruit renferme des graines coriaces et d’un vert foncé ressemblant aux câpres ; elles ont un goût fort et une saveur piquante ; on les emploie comme vermifuge. L’arbre, le fruit et les feuilles laissent exsuder une matière laiteuse possédant les mêmes propriétés que la pepsine. La pulpe du fruit est employée par les jeunes filles pour se frictionner la peau et enlever les taches de soleil. Enfin les femmes emploient les feuilles dans[124] les lessives. On pourrait en faire d’excellents fruits confits et même en tirer de l’eau-de-vie.
Samedi 17 novembre. — Du campement de Tourmi à Konkronsou, l’étape n’est pas d’une longueur exagérée, mais elle est des plus fatigantes. Pendant les premiers kilomètres le sentier traverse un ruisseau et deux bas-fonds, dont l’un est tellement défoncé qu’il est impossible de le faire passer aux animaux chargés ; l’autre provient des débordements d’une rivière de 15 à 20 mètres de largeur qui vient du sud-ouest et coule vers le nord-est. Dans son lit croît une variété de palétuviers qui par leurs racines et basses branches enchevêtrées rendent son passage difficile, quoiqu’il n’y ait que 1 m. 20 d’eau à l’endroit le plus profond. Sa rive droite, sur une profondeur de plusieurs centaines de mètres, est couverte d’une luxuriante végétation, fouillis de lianes et de plantes grimpantes qui font les délices de gros singes verts, les seuls habitants de ces lieux charmants. Un kilomètre plus loin commencent les marais de Konkronsou[28], qui s’étendent presque sans solution de continuité pendant près de 5 kilomètres. La partie Est de ce marécage est couverte de hautes herbes. L’eau s’étend, autant que l’on peut en juger, à 3 kilomètres vers le nord et autant vers le sud. Le milieu est traversé par un ruisseau de 5 à 8 mètres de largeur dont le courant est très rapide et la profondeur de 1 mètre à 1 m. 50. La partie ouest, séparée du premier marais par une petite plaine légèrement boisée, est une oasis de palmiers ban ayant de l’analogie avec les nyayes du Cayor et du Diander. Cette oasis est traversée par trois ruisseaux qui, gênés dans leur cours par les racines et les palmes mortes, répandent leurs eaux partout et rendent ainsi la marche difficile aux piétons et à peu près[127] impossible aux animaux. Pour franchir la distance qui sépare Tourmi de Konkronsou (23 kilomètres), les porteurs mettent douze heures, et les femmes ou les personnes peu habituées à faire ce trajet arrivent à la nuit tombante à Konkronsou. A ce village les porteurs se reposent en général vingt-quatre heures, un ou plusieurs des leurs se trouvant toujours le lendemain trop fatigués pour continuer la route ; d’autres, dont les charges de sel sont tombées à l’eau, sont aussi forcés de faire séjour pour sécher leur marchandise.

L’oasis marécageuse.
Pour ces diverses raisons, on trouve toujours à Konkronsou quelques étrangers. Des Haoussa ont profité de cela pour s’y fixer et y vendre de la viande, du maïs pilé, des ignames et d’autres provisions aux porteurs de passage. Le village, groupé autour de trois ou quatre bombax et d’un tamarinier sur lesquels sont juchés quantité de nids de cigogne à tête rouge, ressemble à un campement. La population, fixe ou flottante, habite dans de méchants gourbis en paille, plus sommairement construits que ceux que nous font nos tirailleurs dans le Soudan français, lorsque le séjour doit se prolonger plus de vingt-quatre heures dans le même endroit. Autour de ces méchantes habitations s’élèvent quantité de papayers et des bouquets de bananiers chargés de beaux fruits ; il y a aussi des citronniers. Aux[128] environs se trouvent quelques groupes de cases de culture qui approvisionnent le petit marché journalier en ignames et condiments. Outre la ressource de pouvoir écouler à un prix élevé les produits du sol, les habitants se livrent à la préparation des palmes de ban, qu’ils font sécher et dont ils enlèvent les arêtes et les piquants pour les travailler et les vendre aux vanniers, qui en font des nattes, des paniers, des sacs, etc., servant à l’emballage des kolas et du sel.

Le village de Konkronsou.
Le chef de Konkronsou prélève le fitto sur les Haoussa, à raison de 400 cauries par charge de porteur pour le compte du chef de Pambi (près Salaga). Cet ouroupé avec celui de Kôlo qui fait percevoir les droits à Gari-n’diato et Gourmansi et celui de Tourrougou qui rançonne sur la route de Boualé constituent le trio qui exerce le pouvoir sur tout le Gondja.
Lors de mon séjour à Salaga et pendant la journée que j’ai passée à Kronkronsou, je me suis informé de l’emplacement du lac Bouro, dont Bowdich dit : « Il est situé au nord de Yobati et n’est éloigné que de trois heures de marche de la Volta. Pendant la saison des pluies, ce lac est alimenté par une rivière qui prend sa source dans une montagne située entre le Banna et le désert de Ghofan ; il est très poissonneux ; les poissons sont apportés vivants à Salaga. »
Je m’empresse de dire que je n’ai pas été très heureux dans mes investigations. En dehors des débordements que j’ai mentionnés sur la rive droite de la Volta en me rendant du fleuve à Tourmountiou et des marais de Konkronsou, on m’a signalé sur l’une et l’autre rive de ce fleuve de nombreux terrains inondés, mais aucun d’eux ne porte le nom de Bouro, et jamais Salaga n’est alimenté de poisson frais : on n’apporte que des poissons secs des villages riverains ou pêchés dans les petits cours d’eau, et encore est-il rare d’en trouver sur le marché.
Aux environs de Kété (à quelques kilomètres au nord de Krakye), sur la rive gauche du fleuve, il existe des amas d’eau sur les bords desquels, à certaines époques de l’année, les chefs de Pambi[29] se rendent et font tuer un bœuf ou des moutons. Une partie de la viande est jetée dans les eaux, tandis que l’autre est mangée sur place, après une cérémonie sur laquelle je n’ai pu obtenir de détails.
Lundi 19 novembre. — Je ne puis dire à quelle heure eut lieu le départ de Konkronsou, puisque depuis longtemps je ne possède plus ni montre ni chronomètre et que la lune n’était pas visible. Je fis partir mon monde dès[129] que la pluie qui vint nous surprendre eut cessé de tomber. Au petit jour, nous dépassions un groupe de cases de culture appelé, par les Haoussa, Rafinfa, parce qu’il n’est pas éloigné d’un joli ruisseau (râfi) que nous traversons un peu en amont d’une chute. La campagne est splendide. La végétation, très puissante, est gênante pour la marche ; on circule dans maints endroits sous une voûte de hautes herbes où disparaissent ceux qui marchent devant vous ; ce n’est qu’en se hélant qu’on ne risque pas de s’égarer dans les pistes d’éléphants qui coupent et recoupent le sentier. Bientôt le sentier entre dans une magnifique forêt où la cime des bombax se perd au-dessus d’arbres d’une essence inconnue, mais que je crois cependant avoir vus dans les belles forêts de la Casamance.
Plus loin on se trouve dans une véritable forêt de rôniers. Le rônier est appelé par les Mandé sébé ou sibo. Son nom scientifique est Borassus Æthiopum ; Barth le signale souvent sous le nom de déleb palm.
Il y a des rôniers mâles et des rôniers femelles. Les premiers n’ont pas de fruit, mais fournissent un bois d’une densité extraordinaire. Le tissu du bois est composé d’une quantité innombrable de fibres, de telle sorte que lorsqu’on regarde une section faite dans le tronc, on peut la comparer à un immense câble composé de milliers de fils.
Ce bois a l’avantage de ne pas pourrir dans l’eau et de ne pas être attaqué par les termites.
Les troncs des rôniers femelles sont creux. Fendus, ils sont employés à faire des palissades, des bancs, etc. La feuille offre des ressources très grandes : on l’emploie pour couvrir les cases, à la fabrication d’éventails, de sacs, de nattes, de paniers ; avec les fibres des feuilles on fait des cordages. On peut même s’en servir comme papier pour écrire. Le cœur du jeune rônier fournit d’excellentes salades ; on peut même le confire dans le vinaigre et en manger en guise de cornichons avec la viande.
Dans beaucoup de pays, entre autres aux environs de Bobo-Dioulasou, on en récolte le suc, qui n’est autre chose qu’un vin de palme pouvant rivaliser avec les vins qu’on tire des autres palmiers.
Le fruit est de la grosseur et de la forme d’un coco, mais il renferme trois noyaux. A moitié mûr avec les noyaux encore mous, c’est un fruit agréable à manger. A maturité complète, il faut bouillir le fruit ou le cuire au feu, pour sucer la pulpe qui entoure les noyaux. C’est une opération longue et agaçante pour les dents : la pulpe est enveloppée dans des tissus enchevêtrés à l’infini. L’odeur de ce fruit cuit est excessivement forte. Quand on en mange un dans le campement, il est impossible de le dissimuler.
[130] Le liquide des fruits verts est diurétique. Enfin la pulpe du fruit mûr sert à guérir par applications les maladies de la peau.
Le mâna, qui ressemble à s’y méprendre au cé, atteint une hauteur de 15 à 20 mètres, tandis qu’aux environs de Kong et de Salaga on ne le rencontre encore qu’à l’état d’arbustes. Le soulabatando (arbre à tabatières), appelé ainsi parce qu’il donne un fruit de la grosseur d’une orange, duquel les noirs font des tabatières et qui n’atteint dans le bassin du Niger que 2 à 3 mètres de hauteur, est ici un splendide arbre de haute futaie. Le baobab, le cé et le netté sont excessivement rares dans cette région ; les quelques exemplaires que j’ai vus sur la rive droite de la Volta restent stériles. Le bombax (banan en mandé) et un arbre à tronc blanchâtre ressemblant au hêtre sont les rois de ces végétations vierges ; ils atteignent des hauteurs prodigieuses et se perdent bien au-dessus des autres arbres, dont le tronc mesure en moyenne 15 mètres de hauteur jusqu’aux basses branches.
2 kilomètres environ avant d’arriver à Kounchi, au milieu de cette végétation qui fait non seulement mon admiration, mais encore celle de mes noirs, on atteint une petite rivière de 8 mètres de largeur qui sert, à cet endroit, de frontière entre le Gondja et le Coranza (Achanti). Cet endroit est une suite de sites charmants. Le soleil et le vent sont impuissants à percer cette verdure. Entre les troncs des rôniers et leurs basses branches, que personne n’est venu couper, poussent de jolies fougères ; ailleurs courent de gigantesques lianes ornées de feuilles de toutes dimensions ; plus loin on pourrait se croire dans quelque lieu retiré d’une belle forêt de France, si la présence d’un magnifique Sterculia (arbre à kolas) ne rappelait l’Afrique. On est tenté de camper partout, malheureusement fourrages et vivres font défaut et il faut abandonner ces lieux enchanteurs pour gagner Kounchi, où nous arrivons vers midi.

La forêt de Konkronsou.
Au milieu d’une vaste clairière parsemée de bouquets d’arbres, de bananiers, de papayers, s’élève un groupe de cases construites en branches de palmier, à peine couvertes de feuilles de rôniers et d’herbes ; c’est le village achanti de Kounchi. Sur une petite place, une perche où flotte un vieux chiffon indique l’emplacement d’un fétiche : c’est simplement un cercle, moulé en terre, protégé par un petit palanquement. A côté, sous un hangar, un fils du cabocir perçoit 400 cauries par porteur pour le compte de son père, recette à partager avec le chef de Coranza, dont dépend Kounchi. Autour de ce représentant de l’autorité, auquel je fis visite, quelques jeunes gens s’amusaient à couvrir de verroteries une poupée (fétiche) en bois à tête en méplat. On me demanda quelques grains[133] de corail, dont ces grands enfants s’empressèrent d’orner les seins du fétiche.
A Kounchi, en fait de vivres on ne trouve que du maïs en épis et du manioc sec. Les ignames font défaut, les Achanti de cette région ne cultivant que juste pour leurs besoins. Aussi ce fut avec plaisir que j’accueillis l’envoyé du chef m’apportant une corbeille de bananes, des papayes et une gourde en calebasse contenant environ deux litres de vin de rônier frais.
Ce n’est pas une petite besogne que de se procurer pour vingt-quatre heures de vivres, il faut y employer presque toute la journée, et ce n’est qu’avec beaucoup de patience et en faisant quelques petits cadeaux qu’on arrive à trouver de quoi ne pas mourir de faim le lendemain, car l’étape suivante doit se faire dans la brousse.
Mardi 20 novembre. — Notre passage matinal dans les oasis, entre Kounchi et Kâka, jette l’épouvante parmi les hôtes de ces lieux charmants : les oiseaux perchés aux abords des sources qui jaillissent de tous côtés s’envolent en poussant des cris perçants ; des bandes de cynocéphales d’une espèce au museau ladre, mais de la taille de ceux du bassin du Niger, hurlent en fuyant dans les lianes et les arbustes. Le tableau a quelque chose de féerique. On chemine parfois dans l’obscurité la plus profonde, puis tout à coup le sentier est éclairé par un pâle rayon de la lune mourante. A chaque pas c’est un décor nouveau. Malgré soi on s’arrête, extasié par le luxe que la nature a prodigué à ces lieux ignorés.
Kâka n’est habité que par deux familles achanti. Ce village se fait remarquer par la propreté de ses habitations crépies en terre et badigeonnées au gris cendre. Ses habitants ont poussé le luxe jusqu’à se construire des waterclosets, ma foi fort bien compris. Ce qui gâte tout, c’est qu’ils sont placés en évidence en bordure du chemin. On s’est bien gardé de les entourer d’une feuillée : aussi voit-on de drôles de choses en passant par là.
De ce village part un chemin qui mène par Tchoulepey à Boupi, rive gauche de la Volta, communication qui serait très utilisée par les gens de Kintampo pour se rendre en hivernage à Salaga, si les chefs des villages[134] qu’on traverse étaient plus raisonnables et ne faisaient pas payer des droits de passage exorbitants aux marchands.
A 8 kilomètres dans le sud-sud-ouest se trouve le campement de Diongara ou Zongo-n’dasi[30], où l’on fait l’étape. Ce lieu, situé sur la lisière d’une oasis où coule un joli petit ruisseau, est pourvu de gourbis mal construits au milieu desquels se trouve un mortier en bois et deux pilons pour permettre d’écraser les ignames. La proximité du ruisseau me permit, tout en établissant mon campement au même endroit que les Haoussa, d’aller passer les heures chaudes à l’ombre et de jouir pendant l’après-midi du spectacle de cette belle forêt. Dès que le soleil se couche, il est prudent de s’en aller ; il règne là une humidité funeste à la santé de l’Européen, et les serpents pullulent. S’il est facile de se préserver des reptiles en dégageant bien les abords du campement, il n’en est pas de même pour la fourmi à mandibules nommée magnan et kourra en mandé, que rien n’arrête dans ses migrations. Sa piqûre douloureuse et la ténacité avec laquelle elle s’acharne après quelqu’un rendent sa présence insupportable et souvent dangereuse pour les hommes et les animaux.
A l’état isolé, cet insecte serait peu ou point dangereux, mais la variété dont il fait partie voyage par d’innombrables légions, précédées d’éclaireurs et de flanqueurs ; c’est une armée qui s’avance. Quelquefois la colonne a un développement d’une centaine de mètres et marche sur une largeur de 10 à 20 centimètres, et tellement dense qu’on pourrait compter plusieurs milliers d’insectes par décimètre carré ; il y en a souvent 10 à 15 rangs superposés les uns sur les autres.
Malheur au voyageur blessé ou au gibier pris au gîte ! S’il ne peut fuir, il est sûr d’être dévoré. Contre de tels ennemis la lutte n’est pas possible. Ils s’attaquent aux muqueuses, en un clin d’œil ils pénètrent dans le corps de leur victime, déchiquettent les yeux et la bouche ; c’est la mort la plus affreuse que l’on puisse imaginer. Quarante-huit heures après la mort, un cadavre que les fourmis ont dévoré présente l’aspect d’un squelette aussi bien nettoyé qu’après une préparation anatomique de plusieurs jours. La plante des pieds seule résiste, à cause de sa semelle cornifère chez les noirs, mais les os des orteils sont nettoyés ; le squelette a l’air d’être chaussé de sandales en corne.
Quand on est valide, l’arrivée de ces fourmis n’est que gênante ; il suffit de se déplacer et de creuser autour du campement un simple petit sillon à l’aide d’une branche d’arbre : les fourmis longeront l’obstacle sans chercher[135] à le traverser. Il suffit également, pour les mettre en déroute, de se pencher au-dessus de leur parcours et de siffler sur elles d’une façon aiguë : immédiatement elles changent de direction et battent en retraite. Elles ont pour ennemi mortel un certain oiseau qu’elles semblent craindre plus que l’eau et le feu.
Mercredi 21 novembre. — Du campement à Kintampo il n’y a que 12 kilomètres. Malgré cela, tous les porteurs se mettent en route de bonne heure, impatients d’arriver au terme des fatigues et de pouvoir goûter quelques jours de repos, bien mérités. Après un trajet de deux bonnes heures on arrive sur les bords d’un joli ruisseau auprès duquel nous apercevons pour la première fois les feuilles servant à emballer les kolas. Cette feuille, de la largeur de deux mains, se distingue de la fausse feuille, qu’il faut faire bouillir avant de l’employer et qui se trouve un peu partout dans le Soudan, par une bordure de 2 centimètres de largeur d’un vert plus foncé. Cette bordure, peu apparente lorsqu’on examine la feuille à l’endroit, est visible à l’envers ; elle n’existe que sur le côté gauche de la feuille (tenue par la tige et examinée à l’envers, la bordure se trouve à droite).
Pendant un court repos que j’accordai à ma monture, je fis une promenade d’une centaine de mètres autour d’épais fourrés parmi lesquels je trouvai quelques jeunes pousses de bambou, des joncs d’une grosseur de 1 centimètre et de très belles fougères et bruyères répandant un délicieux parfum.
Mon hôte Sâadou, prévenu la veille de mon arrivée, envoya un vieillard au-devant de moi pour me souhaiter la bienvenue et m’offrir de sa part dix beaux kolas rouges. Je rencontrai cet homme sur les bords du ruisseau, où il m’attendait depuis quelques instants déjà. Sous sa conduite, je franchis rapidement les 2 kilom. 500 qui me séparaient de Kintampo et gagnai l’habitation de Sâadou. On m’installa avec mon petit personnel dans deux cases neuves chez son fils.
Sâadou, que les Haoussa désignent aussi sous le nom de Mâdougou[31], est l’homme le plus riche de Kintampo. Toute la partie sud de Kintampo est plus ou moins sous ses ordres. Ses captifs sont très nombreux. Contrairement à ce qui se passe toujours chez les noirs, où c’est l’homme le plus riche qui est le chef, Sâadou ne commande pas à Kintampo. Cela tient à ce qu’il n’y a que peu d’années qu’il est arrivé ici. Le pouvoir est exercé par un autre Haoussa, du nom de Mahama, qui porte le titre de zerki n’zongo (chef du pays), mais son pouvoir est très limité et ne s’exerce[136] pour ainsi dire que sur ses compatriotes haoussa, les autres étrangers ayant à leur tête leurs chefs propres.
Je me souviendrai toujours de l’inquiétude dans laquelle Diawé nous a tous plongés le jour de notre arrivée ici. Sous prétexte d’aller couper quelques perches, il s’enfonça dans l’épaisse forêt qui environne la ville. Tout en rôdant pour chercher son bois, il trouva un oiseau bien connu de tous les noirs et dont la présence indique la proximité d’abeilles et de miel. Il suivit cet oiseau pendant un certain temps et finit par découvrir du miel ; à l’aide de sa hache il s’en empara. Mes hommes, que j’avais envoyés à sa recherche, n’avaient pu le trouver. Enfin, vers la nuit, Diawé rentra tranquillement avec ses perches et son miel emballé dans des feuilles de bananier. J’en prélevai une petite part pour sucrer mon thé, et le reste fut mangé par mes hommes d’une façon si gloutonne que je ne pus m’empêcher de leur reprocher leur voracité.
Je fus bien étonné quand ils me répondirent que non seulement le miel était bien agréable parce qu’il est sucré, mais encore que c’était pour eux un bon médicament, à la condition d’en manger beaucoup. Diawé conclut ainsi : « Quand noir il y en a mangé beaucoup miel, ça qui trop bon, parce qu’il balaye ventre ».
Je fus admirablement reçu par Sâadou, qui m’envoya de nombreux cadeaux en vivres tout préparés, autres provisions, viandes et ignames et beaucoup de kolas. Sous sa conduite je fis visite au zerki n’zongo, aux notables, chefs des Mandé et des Ligouy, et enfin au cabocir achanti. Ce dernier, assis devant sa case, ayant à sa droite et à sa gauche quelques vieillards, fit disposer devant lui une rangée de tabourets et de chaises en palmier ban, et nous pria de nous asseoir. Les assistants du cabocir vinrent ensuite défiler l’un après l’autre devant nous en faisant le simulacre de donner la main à chacune des personnes qui m’accompagnaient, mais en réalité moi seul eus le privilège d’une poignée de main. L’un des assistants m’adressa la parole pour me souhaiter la bienvenue, et nous quittâmes ces gens-là sans prendre congé. — Drôles de coutumes !
En venant de Salaga, on débouche sur Kintampo par un sentier bien entretenu et débroussaillé qui bientôt s’introduit dans une série de jardinets clôturés où sont cultivés des haricots, des condiments, du maïs, et où poussent des groupes de papayers et de bananiers chargés de fruits. Ces jardinets sont disposés sur les versants d’une petite ravine où coule un joli ruisseau à eau claire et limpide alimenté par des sources jaillissant d’un sable blanc très fin. Dans quelques-uns de ces jardinets sont disposés des puits à indigo, qui chôment actuellement. Le chemin menant du[137] ruisseau au village court à l’ombre d’arbres splendides qui ont, grâce à leur développement gigantesque, échappé à la hache destructrice des noirs.
Le quartier des Dandawa (village situé vers le Yorouba et dont beaucoup d’habitants sont fixés à Salaga) et celui des Haoussa, par lequel on débouche, se font remarquer par leur propreté. Nulle part on ne rencontre des immondices, et les excavations desquelles on a extrait l’argile rouge ayant servi à la construction des cases ne renferment ni eau croupie ni ordures. Cette propreté des rues fait plaisir à voir, surtout quand on sort de l’affreux bourbier que l’on nomme Salaga.
Kintampo, qui figure déjà dans les itinéraires rapportés par Bowdich et Dupuis sous le nom de Kantano, ne devait être à cette époque qu’un misérable village achanti où quelques Ligouy ou Mandé de Boualé venaient s’approvisionner en kolas. Ces fruits sont apportés par les gens de Coranza, situé à égale distance de Salaga, Boualé et Bitougou. Le kola arrive à maturité à deux petites journées de marche dans le sud.
Autour de la place du marché, qui se distingue par le gigantesque tronc d’un arbre mort dépourvu de branches, se sont groupés avec assez d’ordre et de symétrie les divers quartiers habités chacun par les gens de même nationalité.
Les habitations sont disséminées et chaque propriété est délimitée par des haies en pourguère ou des clôtures en tiges de mil qui englobent quelques jardinets où poussent papayers et bananiers. Quelques habitations[138] renferment aussi des jeunes arbres à kolas, arbres de luxe seulement, car ils ne produisent pas autre chose que des fleurs, et ce n’est qu’à une quarantaine de kilomètres dans le sud que l’on rencontre quelques exemplaires donnant des fruits.
Autant de quartiers, autant de villages différents, chaque peuple ayant conservé son type de case national et sa façon de grouper ses habitations. A côté des cases mandé et dagomba que j’ai déjà eu souvent l’occasion de décrire, on voit les grandes cases rectangulaires à toits couverts en feuilles de rônier habitées par les Ligouy, puis les élégantes maisonnettes des Achanti, consistant en une cage rectangulaire en bambou recouverte d’un léger torchis badigeonné en gris cendre. Percées de portes assez hautes pour pouvoir y pénétrer sans se baisser et quelquefois de petites fenêtres carrées ressemblant à des sabords, elles sont aussi placées avec assez de symétrie, et leur alignement forme des rues perpendiculaires entre elles. Ce village achanti ressemble ainsi un peu à ce que nous autres Européens construirions si nous venions dans ce lieu comme Robinson Crusoé chacun avec une hache et un couteau.
Ce sont les Haoussa surtout qui ont voulu se distinguer dans l’art de construire. Je puis dire qu’à côté de quelques habitations plus confortables que celles que l’on trouve d’ordinaire chez les noirs, j’ai vu ce que l’on peut appeler des maisons. Je citerai d’abord la mosquée, vaste bâtiment rectangulaire, sorte de hall percé de portes partout et entouré d’une galerie d’environ 1 m. 50 formant véranda.
Puis vient l’habitation de Mahama, le zerki n’zongo ; elle ressemble comme distribution à quelques maisonnettes de Gorée ou de Dakar ; il ne manque même pas le petit escalier en bois qui mène sous une véranda étroite protégée des rayons du soleil par des nattes appendues aux piliers.
Enfin, pour terminer, la maison de Sâadou, mon hôte, grande construction en terre comme les deux précédentes ; elle est surmontée d’un immense toit en chaume qui forme dans la partie est un vaste hall où se tiennent les femmes ; l’autre partie consiste en une seule grande chambre percée d’ouvertures près du plafond pour donner de l’air et dans laquelle on pénètre par une sorte d’antichambre voûtée du style arabe. Dans le fond, en guise de rosace, sont disposés quatre rayons de formes diverses.
A côté de cette population hétérogène et de ses captifs de toute nationalité, Kintampo possède, dès que les pluies ont cessé, une population flottante que l’on peut évaluer à 700 ou 800 étrangers, ce qui donne à ce village un aspect tout à fait bizarre. Chaque peuple ayant conservé sa propre langue, on entend parler sur le marché les dialectes[139] et idiomes les plus variés. Cependant j’ai cru remarquer que le haoussa, le mandé et l’achanti étaient les trois langues les plus entendues.

Kintampo et le tronc gigantesque.
La population fixe de Kintampo ne dépasse pas 3000 habitants, y compris les petits villages de culture des environs ; encore, au moment de mon passage, à la suite d’un différend entre les Ligouy et les Mandé, bon[140] nombre de ces derniers se retiraient dans les villages situés sur la route de Boualé.
J’ai déjà dit combien la végétation qui couvre les abords de Kintampo était luxuriante. Entre les mains d’Européens, ce village au bout d’un an pourrait devenir le lieu le plus charmant que l’on puisse rêver. Il est malheureusement à craindre qu’au contraire, dans la suite des années, les noirs, chez lesquels l’esprit de destruction semble être aussi fortement inné que chez les cynocéphales, ne transforment cette contrée privilégiée et n’en fassent un lieu aussi désolé que la plupart des villes soudaniennes que j’ai visitées. Les orangers, les citronniers poussent au hasard et sans soins. L’ananas se trouve dans la brousse ; on ne prend même pas la peine de récolter ce délicieux fruit pour le vendre sur le marché. Quand je désirais en manger, Fondou, un de mes hommes, allait m’en cueillir un ou deux aux environs. Le bakha (ananas) a du reste une mauvaise réputation chez les noirs de cette région, ils prétendent qu’il occasionne des diarrhées dangereuses. Il n’en est rien quand on se contente d’en manger une ou deux belles tranches ; ce n’est qu’en en faisant, comme certains indigènes, une trop grande consommation à la fois, qu’on paye cher sa gourmandise.
L’espèce palmier est représentée ici par le rônier et le palmier ban ; les palmiers doum, à huile, dattier font absolument défaut. J’ai aussi trouvé le cé, la pourguère, le caïlcédra, la petite prune sauvage et le kobi. Les noirs extraient du kobi un savon noir placé comme qualité bien au-dessus des savons obtenus avec l’arachide. Nous en avons parlé au chapitre XI.
Les cultures dominantes sont le maïs, l’igname, le manioc, un peu de petit mil (sanio) et fort peu de sorgho ; à mon passage, il n’était pas possible de se procurer cette dernière céréale et les autres denrées étaient fort chères. Les étrangers porteurs de sel allaient s’approvisionner dans les villages aux environs, où ils obtenaient l’igname à meilleur compte.
Kintampo occuperait une situation fort avantageuse dans cette région, si les chefs achanti devenaient moins exigeants et n’entravaient pas les communications avec la Côte. En effet, une ligne presque droite partant de Ga (Christianbourg), passant par Koumassi, Coranza, relie Kintampo à Boualé, pour de là se bifurquer et se rendre, celle de l’ouest par Bouna, le Lobi à Dioulasou et Djenné, celle de l’est sur Oua, Oua-Loumbalé, Sati à Waghadougou, Mani, Douentsa et le Djilgodi — deux grandes artères par lesquelles les kolas se rendent jusqu’à Tombouctou, et, avec les kolas, les produits européens. Malheureusement, pour le sel, Kintampo est tributaire[141] de Salaga, qui arrive à le livrer à meilleur compte que les Achanti, la voie fluviale étant utilisée jusqu’à Krakye ; et, pour les produits d’Europe, Kintampo ne les reçoit que par Bitougou, de sorte que je n’ai pas trouvé ce marché dans l’état florissant que je lui supposais.
Comme dans presque tous les villages commerçants, ce n’est pas en faisant le tour du marché qu’on peut juger de l’importance des transactions : on n’y voit en effet rien de ce qui constitue le principal trafic ; c’est dans les cases qu’il faut rôder, vivre de la vie des habitants, passer des heures à siester en compagnie des diatigués en mâchant force kolas, et observer ce qui se dit et se passe autour de vous.

Kintampo, quartier achanti.
Sur le marché il y a quantité d’échoppes où causent des badauds et où ne se traitent que de petites affaires. On y voit des aliments préparés, des vivres, du maïs, des ignames, du sanio, de la viande, des fruits, des condiments et surtout des ouvrages en ban, de la vannerie, des paniers et châssis, sacs et nattes servant aux transports. Le bouakha, ce traditionnel châssis allongé de 1 m. 10, que l’on rencontre sur la tête de tous les porteurs, se vend ici 200 cauries, et la natte servant à le garnir intérieurement, 200 cauries. Très léger, ce panier constitue certes le mode d’emballage et de transport le plus pratique que j’aie vu jusqu’à présent ; il est employé principalement par les hommes, les femmes se servant du[142] sibo-ségui (panier en feuille de rônier dont se servent les femmes pour les transports). On trouve aussi un peu de linge indigène de provenance boualé, kong et djimini, et presque rien, pour ainsi dire, en fait d’articles d’Europe, lesquels se résument en quelques coudées de calicot écru, des perles très communes, un peu de fil de coton rouge et toujours quelques foulards à 200 cauries !
Voici maintenant la liste des articles importés, leur lieu de provenance ainsi que les articles d’importation qui sont payés en échange, car à Kintampo, les cauries étant excessivement rares, on a recours aux échanges directs. Le prix est cependant fixé en cauries pour l’évaluation.
On dit ainsi : La calebasse de sel vaut 2000 cauries, le cent de kolas 1000 cauries : je te donnerai donc 200 kolas pour une calebasse de sel.
Articles d’importation :
1o Le sel, de provenance salaga, se vend par calebasses, dont le prix subit des fluctuations assez sérieuses, surtout en hivernage, lorsque les communications directes avec Salaga sont interrompues à cause des marais de Konkronsou et des inondations du fleuve entre Kâka et Boupi. Il faut alors se rendre de Kintampo à Boualé et de Boualé à Salaga, ce qui correspond, en évitant de passer à Boualé et en prenant au plus court, à un trajet de vingt jours de marche. Actuellement une charge de porteurs, 25 à 30 kilos de sel, se vend de 16 à 20000 cauries.
2o Les bœufs, de provenance dagomba et mossi, venus par Salaga, sont vendus de 50 à 70000 cauries pour être abattus et débités à Kintampo même.
3o Les esclaves, provenant du Gourounsi, actuellement vendus par Oua et Boualé.
4o Et, comme articles secondaires, le beurre de cé, de provenance dagomba et kong ; le tabac, provenant de Boualé et du Gourounsi ; le soumbala, provenant de Sansanné-Mango, venant par Salaga.
Avec ces articles, qui sont payés en kolas, les marchands se procurent à Bitougou, avec le sel et quelques articles d’Europe, les étoffes à bon marché du Djimini ou bien les étoffes mieux conditionnées de Kong et de Boualé à l’aide desquelles ils payent les kolas aux Achanti du Coranza[32].
Kintampo est le point où l’or atteint le maximum de sa valeur ; il n’est possible de se procurer ici le barifiri qu’à raison de 55000 à 60000 cauries, et encore ne pourrait-on en trouver qu’en petite quantité.
Je suis loin de regretter d’avoir opté pour cette route Kintampo au lieu[143] de celle de Boualé ; cela m’a fourni les moyens de juger de l’importance de ce marché et m’a aussi donné l’occasion de voyager en compagnie de cette autre race marchande, rivale de la race mandé, qui tient entre ses mains tout le monopole du commerce de la partie est de la boucle du Niger — je veux parler de la race haoussa. Ces gens m’ont paru travailleurs, sobres, et possédant les qualités nécessaires pour faire d’excellents marchands ; ils possèdent en outre l’esprit d’association à un très haut degré, s’entr’aident entre eux et sont même très serviables pour l’étranger. Moins curieux, moins méfiants et moins audacieux que les Mandé, les Haoussa sont en même temps plus soumis et plus faciles à gouverner.
A côté de ces qualités, le Haoussa a certes bien des défauts : il est léger, frivole à l’excès, peu économe dans beaucoup de cas et possède la passion du jeu au plus haut degré. Ces défauts peuvent être habilement exploités, car il n’est pas rare de trouver quelques Haoussa ruinés par le jeu, et un léger acompte peut les mettre pour longtemps à la disposition de l’Européen, soit comme travailleurs, soit comme soldats.
Les bénéfices des Haoussa qui font le commerce du sel et du kola entre Salaga et Kintampo ne sont pas excessifs, comme on peut en juger :
Un porteur d’une charge de sel achetée à Salaga 8000 cauries la vend à Kintampo environ 16000, et les kolas qu’il rapporte à Salaga lui portent son capital à environ 30000 cauries, lorsqu’il a eu soin d’emporter les cauries nécessaires aux frais de route et qu’il a introduit sa charge de sel intacte à Kintampo.
Il serait donc à la tête de 30000 cauries dans le cas le plus avantageux, mais il a dépensé en route :
| Passage de la Volta | 500 | cauries. | ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ |
3000 | cauries. |
| Fitto à Gari-n’diato | 400 | — | |||
| — à Gourmansi | 300 | — | |||
| — à Konkronsou | 400 | — | |||
| — à Kounchi | 400 | — | |||
| Nourriture à raison de 100 cauries par jour | 1000 | — | |||
| Dépenses, nourriture pendant le séjour de quelques jours à Kintampo | 1000 | cauries. | |||
| Frais de retour semblables à ceux de l’aller | 3000 | — | |||
| Total général | 7000 | cauries. | |||
Ce qui réduit son capital à 23000 cauries et porte les bénéfices réalisés pour 25 jours d’absence, de privations et 18 rudes journées de porteurs à 15000 cauries, c’est-à-dire 600 cauries par jour, soit 90 centimes environ[33].[144] Quand on doit encore se vêtir là-dessus, il faut compter qu’un porteur devra faire environ dix voyages pour arriver à gagner la valeur d’un captif, c’est-à-dire travailler un an comme une bête de somme. Ce simple calcul n’excuse-t-il pas un peu le noir, que nous accusons de se jeter si bénévolement dans les bras d’un marabout ou d’un aventurier qui entreprend une guerre ou part pour razzier des captifs[34].
J’ai constaté pendant toute la durée du trajet de Salaga à Kintampo que je n’ai pas rencontré un seul animal de transport marchant dans un sens ou dans l’autre ; mon étonnement ne fut que de courte durée cependant, car dès le quatrième jour, deux de mes ânes, sur quatre que je possédais, étaient morts à la peine. Les nombreux circuits, les endroits marécageux, les hautes herbes, le manque de mil, sont autant d’éléments qui transforment une étape de 20 kilomètres en terrain ordinaire en une étape de 30 kilomètres et font correspondre une étape de 25 kilomètres à une de 40 kilomètres. Dans ces conditions, l’âne, si robuste et si peu chargé soit-il, est forcé de succomber. De Salaga à Kintampo et de ce dernier point à Bitougou, les animaux de transport ne sont utilisés que pendant une très courte période, quand les herbes ont été brûlées, et que le sorgho vient d’être récolté, période qui correspond par cette latitude aux mois de février et mars ; plus tard, quand le sorgho manque, il ne faut plus songer à effectuer ce trajet avec des animaux, il ne reste plus que le porteur. En ayant fait moi-même l’expérience, j’organisai mes hommes en porteurs en achetant des bouakha à Kintampo, et, en supprimant malles et ballots, emballages inutiles, je réussis à faire répartir mes bagages de façon à n’avoir besoin d’aucune augmentation de personnel.
Un homme de Sâadou qui avait fait route avec nous de Salaga à Kintampo et qui parlait fort correctement le mandé consentit à m’accompagner à Bitougou moyennant une charge de sel que je lui achetai avant le départ, car il désirait la porter à Bitougou pour l’échanger là-bas contre des étoffes du Djimini. Je me procurai le sel et les cauries nécessaires à la route en vendant à Sâadou 2 mètres de tricotine et une pièce de calicot blanc, ce qui me procura pour 10000 cauries de sel et 20000 autres cauries. Ici encore, notre excellent calicot blanc, que j’ai payé 4 fr. 25 les 15 mètres à Paris, était enlevé sans marchander à 15 francs la pièce.
Lundi 26 novembre. — J’ai toujours constaté que je me mettais en route légèrement indisposé, mais la satisfaction d’ajouter un nouveau[145] lambeau à mes itinéraires, de voir d’autres pays, d’autres gens, me rend promptement la vigueur et la santé. C’est toujours avec une vive satisfaction que je vois arriver le jour du départ.
En quittant Kintampo, qu’on se dirige soit sur Boualé, soit sur Bitougou, on prend une route commune au moins jusqu’à Takla, de là on a le loisir d’opter pour un des deux chemins qui mènent vers le Diaman (Gaman ou Bondoukou). Les renseignements obtenus à Kintampo n’étant pas suffisants, je me proposai, une fois rendu à Takla, de prendre de plus amples renseignements afin de me décider pour la route future.
Dès la sortie de Kintampo et quelques centaines de mètres seulement après avoir dépassé les quartiers mandé et ligouy, on commence à descendre le plateau et à s’enfoncer dans de petits chemins creux caillouteux qui mènent à une ravine dans laquelle on ne peut descendre à cheval qu’en faisant un circuit. Cette ravine et d’autres dépressions du sol sont l’origine de petites rivières qui se rendent vers le sud. Le cours d’eau dans lequel elle se jette a de 7 à 8 mètres de largeur. Son lit est peu profond et ses eaux roulent des cailloux et des grès assez gros. On n’atteint cette rivière qu’à 2 kilomètres de Takla, au moment où toute la nappe d’eau se précipite en cascade d’une hauteur de 30 mètres dans une ravine pleine de végétation. Cette chute, à peine éloignée d’une centaine de mètres du sentier, est splendide. On peut s’en approcher à cheval et la contempler à son aise. Actuellement, la nappe d’eau n’a guère que 30 centimètres de profondeur et la chute par elle-même n’a rien de grandiose ; les eaux tombent en cascade et le jet n’est pas direct ; mais en hivernage, quand les eaux abondent et qu’elles se précipitent d’une hauteur de 30 mètres dans cet abîme, le coup d’œil vaut la peine qu’on se dérange un peu de sa route.
Takla est une colonie ligouy (vei) qui est venue se fixer ici à la suite de la guerre livrée à ce peuple par Ardjoumani, chef du Bondoukou, et de la destruction de leur capitale Fougoula (en achanti, Banda). Les Ligouy habitaient le bassin de la rivière Tain[35] et l’avaient peuplé de villages fort prospères. Se sentant un peu en force, ils cherchèrent il y a quatre ans à s’affranchir des Ton (habitants du Gaman). Très intelligents, intrigants à l’excès, et par cela même peu loyaux dans leurs transactions, ils ont négligé de se concilier l’amitié des colonies mandé-dioula de Bitougou : naturellement celles-ci, au lieu de les seconder, se sont au contraire[146] mises du parti des Ton, ce qui n’a pas peu contribué à achever la défaite des Ligouy ; aussi actuellement sont-ils dispersés un peu de tous côtés. Leurs principaux villages sont Takla, Soso et Tasalima. Les rapports semblent cependant se détendre, et j’appris à mon passage à Takla qu’Ardjoumani venait de les autoriser à revenir dans le Fougoula.
Takla est un village fort prospère. On y trouve des bœufs, beaucoup de moutons et des provisions à bon compte sur le petit marché. Ses habitants s’occupent activement du commerce du kola, et bon nombre de gens de Kong et de Boualé viennent y faire provision de ce produit, qu’ils trouvent à aussi bon compte qu’à Kintampo. Leur séjour ici étant moins onéreux que le séjour dans ce dernier marché, et la distance peu considérable, ils ont la facilité de s’y rendre aussi souvent que bon leur semble. Takla n’est éloigné de Kintampo que d’une dizaine de kilomètres.
Précisément à cause de leurs relations avec le pays des kolas, les Ligouy sont d’excellents informateurs pour le voyageur ; le tout est de les amener à jaser. L’un d’eux, lors de la guerre que leur fit Ardjoumani, fut envoyé par le chef de Fougoula en courrier rapide à Koumassi pour réclamer l’intervention des Achanti. Il quitta Fougoula (Banda) le matin et coucha le premier jour à Wonki, le deuxième à Akoumadai ; le troisième il quitta le chemin principal pour prendre un sentier plus à l’ouest et plus direct, il coucha à Finsou ; le quatrième à Baramani, et le cinquième jour entra à Koumassi.
A vol d’oiseau, Fougoula est à 200 kilomètres de Koumassi, mais avec les circuits et lacets que décrit le sentier on peut estimer la distance parcourue à 300 kilomètres, ce qui porte sa moyenne de marche à 60 kilomètres par jour. Auprès des Ligouy cet homme passe pour avoir fait quelque chose d’extraordinaire.
Je profitai de cette circonstance pour lui demander des renseignements sur le chemin qui relie Takla à Bitougou. Très direct, ce chemin, après avoir quitté Soso (colonie Ligouy), ne traverse que des ruines. Comme il n’est plus fréquenté, il se perd en mains endroits, et les hautes herbes sont un puissant obstacle pour la marche. Quant à la rivière Tain, son passage se fait sans difficulté, l’eau n’ayant que 1 m. 40 environ de profondeur. De toutes les raisons que le Ligouy me donna, je n’en vis qu’une de sérieuse, c’est celle des vivres ; il est en effet, à cause du poids, impossible de transporter des ignames pour cinq jours, et il n’y a pas d’autre nourriture dans le pays. Je dus donc renoncer à prendre ce chemin direct pour en choisir un autre qui traverse deux fois la Volta et qui fait un grand circuit vers le nord.
[147]

Chute d’eau de Takla.
[149]Mardi 21 novembre. — Nous continuâmes à suivre pendant la moitié de l’étape la route de Boualé. Ce n’est qu’après avoir dépassé le petit village de Tintingansou qu’on laisse le chemin de Boualé à droite pour se diriger sur Mantiala, que l’on atteint deux heures après. Tintingansou et, du reste, presque tous les villages situés sur les parcours des Haoussa portent deux autres noms que leur ont octroyés les marchands de ce peuple ; ainsi Tintingansou porte aussi le nom de Bouka-Bouka et de Marraraba[36].
A Tintingansou on entre dans une région habitée par un peuple en partie tributaire des Ligouy, en partie libre et obéissant au chef de Longoro, gros village situé un peu au nord de Tintingansou et non loin du fleuve. Ce peuple, sur lequel je reviendrai un peu plus loin, est nommé Diammou et Diammoura par les Mandé, Laffateré par les Haoussa et Pantara par les Gondja.
Mantiala[37] est un gros village possédant un troupeau de bœufs, quelques moutons et chèvres. Le chef, nommé Adama, est un frère du chef de Longoro. En arrivant, j’allai lui rendre visite. Je le trouvai en nombreuse compagnie, occupé à vider quelques bouteilles de gin. Dans la soirée, après s’être remis un peu de son ivresse, il vint m’apporter quelques ignames et une tranche de poisson frais ; il me recommanda de ne pas laisser approcher mes chevaux du bosquet de soulabatando, splendide groupe d’arbres à tabatières, leur présence en ce lieu devant attirer les plus grands malheurs sur son village.
Mercredi 28 novembre. — De Mantiala à la Volta il n’y a que 8 kilomètres. Défoncé en hivernage, ce chemin est très praticable à cette époque ; le seul obstacle que l’on rencontre est la rivière de Takla, que l’on coupe à 1 kilomètre avant d’atteindre Gouéré, le village des passeurs. Cette rivière a 8 mètres de largeur et 1 m. 20 d’eau. On la passe sur un tronc d’arbre jeté en travers de la rivière. Une liane courant d’une rive à l’autre sert de garde-fou. Les porteurs, de crainte de faire un faux pas sur ce pont improvisé, jugent prudent de se déshabiller et de traverser la rivière à gué.
Au village de Gouéré[38] je fus fort bien reçu. Le chef des passeurs m’offrit de suite son amitié, et sur ma demande il se mit aussitôt en devoir de s’acheminer vers le fleuve, qui coule à environ 1 kilomètre et demi dans le nord.
[150]Arrivés à la Volta, nous y trouvâmes sur les deux rives une quinzaine de personnes attendant depuis plus de vingt-quatre heures que les passeurs voulussent bien les faire traverser ; aussi ce n’est pas sans une certaine satisfaction qu’ils me virent arriver au fleuve accompagné des piroguiers. La Volta, à cet endroit, vient du sud-ouest et prend à une centaine de mètres du lieu de passage une direction presque nord. Ses rives sont peu boisées en cet endroit et son lit est profondément encaissé ; elle a baissé déjà de 15 mètres, mais elle est loin d’être guéable : avec de longues perches on n’atteint pas encore le fond. J’estime sa largeur à environ 220 mètres, et d’après mes calculs l’altitude au sommet des berges doit être de 200 mètres.
Boukary, mon domestique cuisinier, ayant coupé le cou à un poulet sur cette rive, le chef des passeurs fut sur le point de refuser de nous traverser, sous prétexte que dans ces circonstances cela portait malheur. Mon guide, sur mes instances, expliqua à ce brave homme que « si, pour les noirs du pays, un pareil acte était téméraire, il n’en était pas de même chez les blancs : eux, au contraire, tuaient toujours un poulet avant de passer les fleuves ». Ce naïf mensonge persuada les passeurs ; l’opération eut lieu de suite et sans incidents. Les droits de passage pour mon personnel s’élevèrent à 3500 cauries.
Sur la rive gauche je rencontrai des connaissances de Bobo-Dioulasou venant de Boualé par Fougoulabanancoro et Tasalima ; ils me donnèrent des nouvelles de quelques gens de Dasoulami et m’apprirent que Samory avait, au commencement de l’hivernage, levé le siège de Sikasso, que Tiéba n’avait pas jugé à propos de le poursuivre, mais s’était contenté de brûler les neuf diassa qui restaient debout.
Les terrains de la rive gauche du fleuve, bien moins élevés que ceux de la rive droite, sont encore en partie inondés, et pendant 3 kilomètres sur 5 qui séparent le fleuve de Bampé, on chemine dans des terrains fangeux. Bampé, où l’on fait étape, est un tout petit village comptant une cinquantaine d’habitants ; on trouve cependant à s’y procurer quelques ignames.
Je rencontrai dans ce village deux jeunes gens de Kong : ils m’apprirent qu’ils avaient vu à Bitougou un de mes compatriotes venant de Krinjabo qui me réclamait par tous les échos. Arrivé depuis longtemps, il était décidé à se rendre jusqu’à Kong s’il ne recevait pas de mes nouvelles d’ici quelque temps.
Jeudi 29 novembre. — De Bampé à Tasalima c’est une longue et monotone étape ; on chemine dans des terrains pauvres agrémentés d’une chétive végétation. Un petit village sur la route nommé Dakourbé est sur pied au[151] moment de mon passage. Les vieux me prient de descendre de cheval, m’offrent de l’eau et un peu de tabac. Ces gens et en particulier tous les Diammou m’ont paru bien affables : un peu effarouchés à mon approche, ils s’apprivoisent très rapidement, la terreur des femmes se change bientôt en curiosité, et toute cette population vient se grouper autour de moi pour m’examiner. Comme beaucoup d’entre eux parlent le mandé, ils ne se privent pas de me questionner sur les nombreux pays que j’ai traversés et sur la future route que je compte suivre.
Vers midi nous atteignons Tasalima ou Soukoura (« village neuf »), créé depuis à peine quatre ans par les Ligouy de Fougoula. Ce village se distingue par sa propreté et la disposition de ses coquettes cases rectangulaires formant des rues qui aboutissent à une grande place de 200 mètres de côté où l’on a eu soin de planter deux rangées de jeunes doubalé (ficus banian). Un groupe de Ligouy que j’abordai sous un hangar me conduisit, sur ma demande, chez le chef du village. Ce vieillard, après m’avoir offert à boire et interviewé comme il est de coutume dans ces pays, mit à ma disposition tout un corps de bâtiment pour m’abriter avec mon personnel. L’habitation de ce brave homme est presque une caserne ; il y a chez lui de quoi loger 200 à 300 personnes sans être gêné. Après avoir goûté d’un léger repos, je reçus de nombreuses visites. Ces gens me racontèrent qu’après avoir évacué Fougoula (Banda), détruit par Ardjoumani, tandis qu’une partie des leurs allaient s’établir à Kintampo, Takla et Soso, eux, sous la conduite d’un vieil imam, vinrent faire choix de cet emplacement et y créer le village. C’est pourquoi encore aujourd’hui les Haoussa nomment Tasalima : Guidda l’Imamy (« village de l’imam »).
Les Ligouy de Tasalima ont pour diammou Bamba ; ils savent qu’ils font partie du groupe mandé veï, et les vieux m’ont dit qu’ils venaient de l’ouest. Beaucoup des leurs habitaient, disent-ils, non loin de la mer, bien loin derrière le Ouorodougou — ce sont probablement les Veï du cap Sestos de la république de Liberia, ceux dont Kœlle[39] et Norris ont étudié la langue et le système d’écriture.
Ce village, si de nouvelles guerres ne surviennent pas, est appelé à un avenir qui peut devenir brillant. Admirablement situé dans le triangle Boualé-Bitougou-Kintampo, à la porte de l’Achanti qui produit le kola, les Ligouy, très remuants, pourront facilement attirer à eux une partie du[152] commerce qui se fait dans ces trois localités. Actuellement déjà le village a un air de prospérité ; ses habitants sont aussi proprement et luxueusement vêtus que les gens de Kong : ils possèdent même une dizaine de chevaux, ce qui, pour un village soudanien, surtout dans cette région, est un signe d’aisance manifeste. Ce sont les gens de Tasalima qui accaparent une bonne partie de l’or tiré des environs de Ouosipé et de Sanoudinkara (États de Boualé).
Vendredi 30 novembre. — L’étape d’aujourd’hui est des plus intéressantes. Dès la sortie de Tasalima on commence à s’élever et à franchir la croupe qui termine un soulèvement de 500 mètres d’altitude orienté assez sensiblement nord-sud ; puis on franchit un large col très aplati dans lequel prennent naissance deux jolis petits cours d’eau aux rives ornées de palmiers ban. De l’autre côté de ces ruisseaux, sur la base d’un autre soulèvement, s’élève Diamma, gros village de 500 à 600 habitants, tous Diammou. Le chemin s’engage ensuite dans une large vallée bornée par deux soulèvements en forme de pâtés allongés orientés sud-ouest-nord-ouest. Le sentier, au lieu de suivre le thalweg, se rapproche au contraire de la montagne de Diamma (800 m.) et enserre fortement la base. Ce soulèvement, à pentes assez raides, est bien boisé et semble s’être peu désagrégé, car on ne rencontre que peu d’éboulis. Cette vallée est entièrement défrichée. Les cultures sont bien entretenues et consistent surtout en manioc, petit mil et cotonnières appartenant tant aux gens de Diamma qu’à ceux des petits villages de Loubié et de Kourmboé, qui se trouvent vers l’extrémité du vallon, près du fleuve.
C’est à Kourmboé que se trouvent les passeurs. Dès mon arrivée dans le village je leur manifestai le désir de traverser le fleuve dans la journée même, car je savais par expérience combien il est difficile de les décider à se lever de bon matin. Ces gens étant pour la plupart sous l’influence du gin, je résolus de camper dans le village en attendant que leur ivresse se dissipât un peu. Comme de l’autre côté du fleuve on ne rencontre pas de village pendant 50 kilomètres, je fis des provisions en vivres pour quarante-huit heures et me procurai les cauries nécessaires au prix de passage en vendant une dizaine de chaînettes en cuivre qui furent enlevées en un clin d’œil. Je crus aussi opportun de faire un petit cadeau en calicot à un vieillard qui semblait jouir de quelque autorité dans ce village, ce qui me valut la promesse de me faire transborder sur l’autre rive de la Volta dans l’après-midi. Vers trois heures en effet ce brave homme mit deux captifs et deux pagayes à ma disposition et je m’acheminai vers le fleuve. Comme sur l’autre rive deux jours auparavant, une quinzaine de malheureux venant[153] de Bitougou étaient campés depuis plus de vingt-quatre heures, attendant en vain que les passeurs voulussent bien les transborder.
Pendant que peu à peu l’unique pirogue calfatée en terre de toutes parts effectuait le transbordement de mes bagages et de mes hommes, je procédai à une reconnaissance sommaire du fleuve.
La Volta Noire, que j’ai traversée en sortant du Dafina pour entrer dans le Gourounsi (entre Boromo et Baporo), et qui déjà à cet endroit coule du nord au sud en séparant le Lobi du Gourounsi et Bouna de Boualé, vient se heurter près de Kourmboé à un épais massif de grès et de granit qui lui barre le passage et la force à quitter la direction nord-sud pour prendre une direction presque ouest-est. En aval du point de passage, elle vient une seconde fois se heurter à un pâté montagneux qu’elle n’a pu entamer, mais dont elle a fortement érodé la base tout en prenant pendant 2 kilomètres une direction sud-nord jusqu’à ce qu’elle atteigne la base du soulèvement de Diamma. Là, le fleuve s’engage dans le défilé formé par ces deux montagnes, entre lesquelles il s’est creusé un lit étroit et profond, n’ayant pas plus de 40 à 50 mètres de largeur ; mais dès qu’il a pu se dégager, il s’épanouit dans la plaine de Dakourbé-Bampé et il reprend sa largeur normale, qui est de 150 à 200 mètres, comme nous l’avons vu à Gouroué deux jours avant.
Au point de passage des pirogues la profondeur du fleuve doit être considérable. Cet énorme volume d’eau, resserré dans un lit de 60 mètres de largeur à peine, n’a baissé encore que de 1 m. 50 à 2 mètres, et le passage à gué en cet endroit ne peut s’effectuer que vers le mois d’avril seulement, à la grande satisfaction des gens de Kourmboé, qui ont ainsi un beau revenu d’assuré pendant presque toute l’année.
A ce propos j’ajouterai que les Dioumma, ou Diammou[40], comme ils se dénomment eux-mêmes, ne m’ont pas paru aussi sauvages qu’on me les avait dépeints avant que j’eusse fait connaissance avec eux. A part les chefs, qui malheureusement s’adonnent au gin avec passion, le reste de la population m’a semblé se livrer avec soin aux cultures. Dans les quelques villages où j’ai été en contact avec eux, je les ai trouvés plutôt affables et soumis qu’enclins au mal et sauvages comme les Gourounga. Je ne suis pourtant pas éloigné de leur assigner une parenté avec ce dernier peuple et en particulier avec les Youlsi ou Tiollé, qui, comme eux, ne sont pas tatoués. D’une taille élevée comme ces derniers, je leur ai trouvé comme type une certaine ressemblance avec quelques adultes que j’ai bien[154] observés à Mantiala (Gari Adama) et qui m’ont particulièrement frappé. Le village que je viens de citer est disposé par groupes de cases comme les villages youlsi, et les cases elles-mêmes sont semblables aux habitations que j’ai vues partout lors de mon passage chez les Gourounga : formes extérieures, dispositions intérieures, tout est pareil. Dans les autres villages on rencontre bien par-ci par-là une habitation de ce genre, mais le toit plat en terre est remplacé par un toit en chaume, et toutes les autres cases sont construites sur le type de celles des Ligouy, leurs suzerains. Ceux-ci affirment que les Diammou sont apparentés aux Achanti, et donnent comme seule raison qu’outre leur langue propre ils comprennent tous l’achanti. Pour moi, ce n’est pas une raison suffisante : ces gens-là, captifs des Achanti pendant peut-être plusieurs siècles, ont naturellement appris cette langue, dont ils ne font du reste usage qu’en parlant aux étrangers.
La même manière de construire les cases n’est pas une raison suffisante pour apparenter deux peuples. Des gens de même origine habitant des pays différents, sous d’autres latitudes, ayant d’autres matériaux à leur disposition, peuvent très bien adopter la manière de construire des aborigènes ou des voisins. Les Arabes vivent aussi bien dans des gourbis, sous la tente et dans des habitations en terre ou en pierres. Les Wolof, dans le Cayor, optent pour la case en paille, ceux qui deviennent traitants se construisent des habitations plus confortables en terre, et à Dakar et à Saint-Louis même, beaucoup habitent des cases en planches.
Mon avis a toujours été que les Gourounga viennent du sud. J’ai trouvé chez eux, à une latitude où les autres ne les cultivent plus depuis longtemps, l’igname d’une part et le finsan de l’autre. La population du Gourounsi est tout à fait hétérogène, parlant des dialectes et peut-être même des langues diverses. Quantité de fractions, entre elles, ne se comprennent pas du tout. Il est du reste intéressant d’observer que tous les peuples qui constituent ce que les noirs appellent le Gourounsi sont disposés en bandes étroites parallèles entre elles et orientées sensiblement nord-sud, ce qui ferait supposer que ces peuples ont remonté les vallées de la Volta noire, rouge et blanche, et se sont établis sur une rive ou sur l’autre et le long de ses affluents.
Dire que les Diammou ou Dioumma peuvent être ethnographiquement rapprochés des Achanti ne peut se soutenir un seul instant. Les Achanti, tels que je les ai vus partout dans cette région, sont d’une taille plutôt petite que moyenne, avec de grands yeux sortant de l’orbite et une tête peu volumineuse, tandis que le peuple dont il s’agit est d’une forte taille, bien[155] charpenté et musclé ; on ne voit pas chez eux de membres grêles, ils sont tous de robustes et vigoureux gaillards.
Dès à présent et sans attendre que de nouveaux explorateurs fassent plus ample connaissance avec les Dioumma, étudient leur langue et leurs mœurs à fond, je pense que ce n’est pas se hasarder que de nier tout lien de parenté entre eux et les Achanti.
Samedi 1er décembre. — Désireux de relever les principaux sommets du massif montagneux dans lequel j’allais cheminer, je ne me mis en route que lorsque le soleil fut déjà assez haut sur l’horizon pour dissiper la brume épaisse qui couvrait la campagne. Malgré le sacrifice que je m’imposais de faire toute l’étape en plein soleil, je fus mal servi, car non seulement pendant la matinée mais encore pendant le reste de la journée les sommets restèrent noyés dans les nuages, de sorte qu’il me fut impossible de me livrer à un travail sérieux ce jour-là.
Aussitôt après avoir dépassé l’ancien emplacement d’un village, la direction générale paraît être un pic que l’on aperçoit assez distinctement dans le sud-ouest, mais qui, au fur et à mesure que l’on s’en approche, semble se dédoubler, et bientôt ce que l’on prenait pour un bonnet de police n’est plus que l’extrémité d’un soulèvement en forme de pâté, de l’altitude de 1000 mètres environ.
Au pied du pic coule une petite rivière aux berges fortement érodées. Le sous-sol, que j’ai examiné en plusieurs endroits en cheminant dans son lit, est constitué de calcaire marneux et d’argile schisteuse. Sur sa rive droite se trouvent une dizaine de gourbis : ce lieu sert de campement.
Le massif, dont on longe la base pendant 6 kilomètres, est tantôt à parois verticales, tantôt à pente assez douce pour en permettre l’ascension : une végétation très dense mais rabougrie couvre son flanc, duquel se sont détachés de nombreux blocs de granit gris veiné de blanc qui gisent épars de-ci de-là et qui forcent le sentier à faire quantité de détours. Auprès d’une des nombreuses sources, dont quelques-unes sont ferrugineuses, la présence de quelques bombax marque encore l’ancien emplacement d’un autre village qui paraissait plus grand que celui traversé précédemment.
Vers son extrémité sud, le massif semble s’être affaissé et écroulé. On gravit des croupes et des monticules placés en désordre dont les strates de grès, disposées sous un angle de 45 degrés, prouvent suffisamment qu’ils proviennent du massif même et ne constituent pas, comme on pourrait le supposer de prime abord, de boursouflures distinctes.
Dans ce chaos et à mi-côte se trouve, près d’un petit ruisseau, un autre[156] groupe de gourbis, campement peu fréquenté à cause de son exiguïté et de l’éloignement du bois. Ce n’est que 3 kilomètres au delà, près d’un joli petit ruisseau bordé de bambous et à quelques centaines de mètres d’une ruine, que se trouve le campement habituel des gens qui font le trajet entre Bitougou et Kintampo. A cet endroit il y a une trentaine de gourbis, un mortier pour écraser les ignames et deux marmites qui permettent de faire cuire les aliments. Comme il était près de deux heures de l’après-midi, je me décidai à m’y arrêter, quoique n’ayant pas parcouru la moitié de la distance qui sépare la Volta de Tambi, premier village Pakhalla, que l’on rencontre en marchant vers Bitougou.
Dimanche 2 décembre. — Comme je n’avais pas fait assez de chemin la veille, ce fut une longue et pénible étape. En quittant le campement, on gravit quelques petits mamelons qui se rattachent à la chaîne de droite. Du point culminant de l’un d’eux, le guide me fait voir dans le sud-est un petit massif mamelonné au pied duquel se trouvent les ruines de Fougoula (Banda, en achanti), ex-capitale des Ligouy. De ces hauteurs sortent quantité de ruisseaux, tous affluents de gauche de la rivière Tain ; les uns sont sans eau, les autres bordés d’une belle lisière de palmiers ban (Raphia vinifera) et de palmiers épineux à petites dattes, des marais salés (Phœnix spinosa). A proximité des ruisseaux qui ont de l’eau, on distingue l’emplacement de villages dont il ne reste comme trace que les bombax et les baobabs. Les Haoussa qui voyagent sur cette route y ont construit quelques gourbis servant de campements.
Cette région n’est pas très giboyeuse ; j’ai cependant vu des antilopes, des bandes de cynocéphales et entendu les appels de poules de rocher, mais sans avoir l’occasion de tirer aucun de ces animaux. La végétation n’est plus celle que l’on rencontre de Konkronsou à Kintampo. La rivière de Takla sert de limite nord à ce que l’on peut appeler la végétation dense ; au delà, c’est la triste flore du Dagomba et des environs de Salaga.
L’absence totale de cultures et le groupe des banans de Tambi que l’on aperçoit de fort loin font paraître l’étape d’une longueur atroce. Ce n’est que vers deux heures que nous rencontrons les premiers chemins conduisant dans les lougans, ce qui donne quelque courage à mes porteurs, en route depuis quatre heures du matin.
Tambi se compose de trois groupes de cases qui s’élèvent sur un vaste plateau à peu près dénudé sur lequel poussent quelques groupes de beaux bombax et de baobabs. Ce village est habité par des Pakhalla, qui semblent vivre dans une certaine aisance : ils possèdent un beau troupeau de bœufs, des moutons et des chèvres. Nous trouvons à acheter des poulets[157] et des ignames à un prix raisonnable. Le tabac à fumer d’assez bonne qualité s’obtient les 300 grammes pour 100 cauries.
Les gens du village, dont beaucoup parlent le mandé, sont affables et prévenants. Comme j’étais désireux de camper près du chemin à suivre le lendemain, on me fit préparer une case bien propre à proximité, et l’on ne voulut pas tolérer que je campasse sous l’arbre dont j’avais fait choix.
Lundi 3 décembre. — Un chemin bien entretenu et débroussaillé mène de Tambi à Sorobango ; il traverse un grand village nommé Bounou, puis un second, ne comprenant que trois ou quatre familles, nommé Pankouloudougou. Les cinq petits ruisseaux que l’on traverse se rendent à la rivière Tain.

Campement dans la brousse.
Sorobango est situé, comme Tambi, sur un plateau inculte ; à part les magnifiques banans du village, rien n’y pousse, si ce n’est une herbe courte et mince toute desséchée par le soleil. C’est pourtant cet endroit qui sert de lieu de pâture au troupeau de Sorobango, que j’évalue à 400 têtes de bétail.
Ces bœufs, de même race que ceux du Follona, se distinguent par leur sobriété. Ici personne ne s’en occupe ; les animaux ne sont ni conduits en pâture ni menés à l’abreuvoir ; le soir ils viennent se parquer sur les places[158] du village et dans les carrefours ; on en trouve partout. Les chèvres aussi sont nombreuses.
Dans le village, dont j’évalue la population à 800 ou 1000 habitants, il règne une certaine animation, occasionnée par le passage de gens se rendant à Bouna, Boualé ou Kintampo. Au centre, sur une place qui sert aussi de marché, s’élève une mosquée bien crépie en terre blanchâtre, dont les minarets sont surmontés de deux grands flambeaux en verre argenté ; extérieurement et intérieurement elle est exactement semblable à la mosquée de Lokhognilé (route de Léra à Kong).

Mosquée de Sorobango.
Derrière l’habitation de mon hôte il y a un splendide cocotier chargé de fruits, dont les habitants ignorent l’emploi. Rapporté de la côte, ce coco, planté dans les ordures, a poussé sans soins. Personne ne songe à en planter d’autres. Les habitants que j’ai interrogés m’ont dit qu’ils vendaient le coco scié en deux aux gens qui s’occupent de la vente de la poudre et qui s’en servent comme mesure : c’est tout ce que les noirs savent tirer de cet arbre précieux !
On appelle ici le coco : nasara-tin (palmier des chrétiens).
Mon personnel étant devenu presque insuffisant par la perte de mes[159] ânes, je n’ai pu durant la route détacher personne pour prévenir le compatriote de Bitougou de ma prochaine arrivée. Ayant trouvé des gens complaisants à Sorobango, je priai mon hôte de me donner un courrier pour porter un petit mot à Bondoukou afin d’annoncer mon arrivée. Le jeune homme revint dans la nuit et m’informa que l’Européen qui me réclamait était parti il y avait cinq jours pour se rendre à Amenvi y saluer Ardjoumani, le souverain du Diamman ; que Sitafa, l’hôte de mon compatriote, avait de suite mis un homme en route pour Amenvi afin de prévenir de mon arrivée.
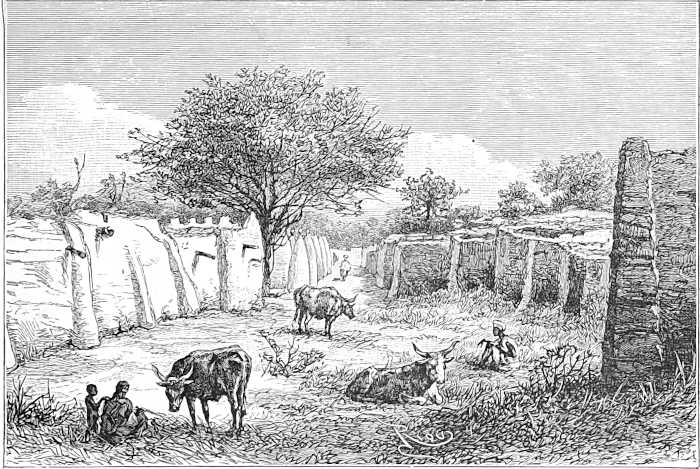
Une rue de Bondoukou.
Mardi 4 décembre. — De bonne heure tout mon personnel est debout et l’on ne se fait pas prier pour se mettre en route. Nous allons enfin entrer dans un centre où mes noirs pourront exercer leur verve ; il y a si longtemps qu’ils n’ont pas trouvé l’occasion de parler leur langue, le mandé-dioula, et tout le long de la route on n’entend que « Mokho ta lon, fo sonkourou soro la Gottogo », ce qui équivaut à « Qui sait ! peut-être trouverons-nous quelque bonne amie à Bondoukou ».
Kanguélé ou Kangara, gros village que nous traversons, est sur pied pour me voir passer ; il en est de même à Soumbala, petit village sur les bords du Tain, qui n’est encore ici qu’un méchant ruisseau.
A Bitougou, où mon arrivée a été annoncée par le jeune homme de[160] Sorobango, les gens me font cortège. « C’est le frère aîné du blanc qui est parti pour Amenvi. Conduisons-le chez Sitafa, qui était le diatigué de son frère. »
Quelques heures seulement après mon arrivée chez Sitafa, je fus violemment secoué par un accès bilieux qui me força de garder la chambre pendant toute une semaine.
Je reçus de nombreuses visites de gens de Kong, qui me donnèrent un peu des nouvelles de toutes les personnes que j’y connais ; un captif de Diarawary arrivé le même jour que moi m’annonça qu’il avait croisé l’Européen à Panamvi (route de Kong). Le lendemain, le courrier de Sitafa revenait d’Amenvi et me confirmait le départ de M. Treich-Laplène[41] pour Kong. Je me décidai donc à envoyer un courrier à M. Treich-Laplène pour lui annoncer mon prochain départ pour Kong, bien résolu, malgré mon état de santé précaire, à me mettre en route dès que mes forces me le permettraient. M. Treich-Laplène était arrivé à Bondoukou dès le commencement de septembre ; les gens auxquels il s’était adressé pour avoir de mes nouvelles, et entre autres Sitafa mon hôte, ont été d’une coupable négligence dans cette occasion. Mon arrivée dans le Mossi annoncée à Kong, la nouvelle s’était vite colportée et les gens de Bondoukou savaient tous que j’étais dans ce pays. Il suffisait d’informer mon compatriote qu’en venant du Mossi on débouche soit à Boualé, soit à Salaga, pour qu’il envoyât de suite un courrier dans ces deux directions ; mais ces gens-là sont apathiques au dernier degré, et quand ils se sont reposés sur la volonté divine par le fameux « in chi allaho », tout est dit, il est inutile de prendre aucune mesure. N’obtenant pas de renseignements, M. Treich s’est dirigé de suite sur Kong afin de récolter de plus amples détails sur la route que je suivais. C’était le plus sage parti à prendre. Le jour de mon entrée à Bondoukou, M. Treich était à Panamvi, attendant ses guides, qui devaient le rallier à ce point.
Au fur et à mesure que les forces me revenaient, je faisais quelques petites promenades vers le marché et dans l’intérieur de la petite ville, car chez Sitafa, dont l’habitation est tout à fait située dans le sud et sur la lisière de la forêt, on est un peu isolé et il est difficile de se rendre compte exactement du mouvement commercial de Bondoukou.
[161]CHAPITRE XIII
Les divers noms du Bondoukou. — Son histoire. — Description de la cité. — Le marché. — Insalubrité de l’eau. — Des diverses sauces. — De l’or, du mitkal et de ses subdivisions. — Articles d’importation et d’exportation. — Départ pour Amenvi. — Les États d’Ardjoumani. — Un village où l’élément féminin domine. — Arrivée à Amenvi. — Une audience d’Ardjoumani. — Bizarre moyen de locomotion employé par les chefs agni. — Ethnographie. — Costumes. — Habitations. — Coutumes. — Départ pour Kong. — Beauté de la végétation. — Arrivée à Panamvi. — Rencontre avec des gens de connaissance de Kong. — Arrivée sur les bords du Comoë. — Encore un village où il n’y a que des femmes. — 1er janvier 1889. — Des singes. — Mines d’or de Samata. — Koniéné et Kolon. — Retour à Kong. — Rencontre avec Treich-Laplène. — Visites à mes amis. — Nous signons un traité. — Envoi de courriers. — Nouvelles d’un courrier parti à ma recherche. — Adieux de la population. — Visite de l’almamy. — Recherches ethnographiques. — Entrée dans le Djimini. — Départ de Diawé.
Les Achanti, les Ton et les Pakhalla appellent les territoires soumis à Ardjoumani : Gaman ou Diamman, les Mandé les nomment Bottogo ou Gottogo, et les Haoussa et gens de Salaga : Bitougou.
Bondoukou ou Bitougou est plus ancienne que Djenné : sa fondation est antérieure à 1043. D’après Ahmed Baba, qui la désigne sous le nom de Bitou, c’est en faisant le commerce du sel de Téghasa et de l’or de Bitou que Djenné s’est enrichie. Il suffit, du reste, de se promener dans Bondoukou pour acquérir la certitude qu’on est en présence d’une des plus vieilles cités soudaniennes : les cendres, détritus et ordures atteignent plusieurs mètres d’épaisseur. C’est en vain qu’on chercherait des terres servant à la confection des briquettes pour faire les cases ; aussi les habitants extrayent la terre nécessaire aux cases à plusieurs centaines de mètres de l’emplacement actuel de la petite ville, ce qui est excessivement loin, lorsqu’on songe que le noir est de son naturel très fainéant. D’autres indices, tels que des ruines qui s’étendent assez loin, prouvent que le village était jadis très grand ou qu’il s’est plusieurs fois déplacé.
Actuellement, la plupart de ses habitations menacent ruine ; on trouve un peu partout des pans de murs écroulés et des rues passant sur l’ancien[162] emplacement de lieux habités dont il reste des piliers et des poutres formant portiques.
Dans quelques ruines, j’ai vu un ou deux orangers, dont j’ai réussi à me procurer quelques fruits. Ces arbres, non soignés, sont redevenus sauvages, et leurs fruits ressemblent plutôt, comme goût, au citron qu’à l’orange d’Algérie.
Les quartiers du centre, dans le voisinage du grand marché, sont habités par des Mandé d’origines diverses, mais venant principalement de Kong, de Bouna et de Boualé ; ceux du nord sont occupés par les Marraba (Haoussa), qui s’occupent de la teinture à l’indigo ; et ceux de l’est, par les Pakhalla et quelques Ton.
Les quartiers mandé portent, pour les distinguer les uns des autres, les noms du kémokhoba (notable qui y exerce quelque autorité). On peut donc ajouter au quartier des Haoussa celui des Pakhalla, et ceux des Mandé Kamakhaté, Timité, Ouattara, Diabakhaté.
A part l’habitation de Sitafa Ouattara, mon hôte, et deux ou trois autres, ainsi que la mosquée neuve, Bondoukou n’est qu’un amas de masures. Les deux mosquées sont construites sur le style de celles de Kong et de Lokhognilé que j’ai déjà décrites ; seule l’habitation de Sitafa mérite une mention. Bâtie en terre dans le style des habitations arabes d’El-Arouan (voir Lenz et Caillié) et comprenant une cour unique sur laquelle donnent les ouvertures de toutes les chambres, cette habitation, bien crépie en terre blanchâtre, surmontée d’un couronnement dentelé, avec un minuscule minaret à chaque coin, fait très bon effet. Malheureusement, la population qui grouille là dedans laisse à désirer sous le rapport de la propreté : si l’extérieur est engageant, l’intérieur de quelques chambres ne répond pas au luxe et à la propreté que l’on s’attend à y trouver.
La population de Bondoukou s’élève à environ 2500 à 3000 habitants. L’autorité n’y est pas exercée par un chef de village, comme à Kong ; chaque quartier reconnaît l’autorité du plus ancien notable. Il y a en outre un chef religieux, l’imam, vénérable vieillard qui tranche les différends sérieux entre musulmans, et un chef de village pour les Pakhalla, que l’on désigne sous le nom de bambara massa (roi des infidèles).
Quoique à Bondoukou il y ait un grand marché et plusieurs petits, les ressources en vivres ne sont pas grandes ; on peut cependant s’y procurer tous les jours du bœuf à un prix élevé, des papayes et quelquefois des bananes ; les ignames et la farine de maïs se vendent assez cher pour que les étrangers, comme à Salaga et Kintampo, soient forcés de faire leurs provisions dans les villages des environs. Quant à se procurer des poulets,[163] pintades, du sorgho ou du petit mil, il ne faut pas y songer. Ce défaut de ressources rend le séjour peu agréable pour l’Européen.
Mais ce qu’il y a surtout de mauvais, c’est l’eau ; son absorption même modérée occasionne des coliques et de fortes diarrhées aux étrangers ; elle est tirée du ruisseau qui coule à l’ouest et au sud de Bondoukou et qui est bordé d’une végétation très dense, parmi laquelle j’ai remarqué le talli.
Cet arbre a le tronc assez lisse et blanchâtre, et une feuille semblable au netté. Il empoisonne les cours d’eau quand ses racines y baignent ou que ses feuilles ou fleurs y séjournent quelque temps. Il croît à peu près sous toutes les latitudes et est bien connu par la plupart des peuples noirs, qui emploient son écorce pilée, mélangée à de la farine de mil, comme mort-aux-rats.

Habitation de Sitafa (vue extérieure.)
L’emploi du filtre est sans effet contre ce poison. Les habitants, pour combattre les coliques et les malaises occasionnés par l’eau, emploient dans leurs sauces de to des baies très amères cueillies sur un arbre nommé damsa ou gamsa. On en fait un usage constant ; on voit quantité de ces fruits sur les petits et le grand marché, et les ménagères ont soin d’en mettre dans tous leurs plats.
En fait de condiments et de sauces, on emploie aussi le ndatou, fait avec de la graine de chanvre, ou encore avec de l’oseille. Cette sauce, conservée,[164] est surtout employée dans le Kaarta et le Bakhounou. Je l’appréciais beaucoup, et partout où j’en ai trouvé j’en faisais usage de préférence à toute autre.
On fait aussi du banantou, sauce fabriquée avec des graines de bombax. On l’emploie surtout dans le Mampoursi, le Dagomba et le Gondja. Dans beaucoup de régions on prétend que son emploi journalier prédispose à la surdité, mais je ne puis rien affirmer à cet égard ; j’en ai mangé pendant des mois en m’en trouvant très bien.
Enfin le siradinn tou ou kondoro, fabriqué avec les graines de baobab. Employée à Kong quelquefois, cette sauce n’est nulle part bien appréciée ; on n’en fait usage qu’en cas de disette, et surtout chez les Bambara du Kaarta.
Dans le Mossi et en général dans la plupart des pays que j’ai visités, on se fait aussi un régal des sauces préparées à l’aide de chenilles séchées. Ces chenilles, qui sont vertes, ne se nourrissent que de la feuille de cé : c’est pourquoi on les nomme cé tombo. J’ai plusieurs fois, par curiosité, goûté à ces sauces en mangeant mon to traditionnel : je n’ai trouvé cela ni bon ni mauvais, probablement parce que la ménagère qui m’a préparé mon plat a été très parcimonieuse. Du reste, les chenilles sont au préalable réduites en poudre, de sorte qu’on peut en manger sans s’en apercevoir. Ce que je puis affirmer, c’est que je n’ai nullement partagé l’enthousiasme de nos amphitryons.
Si le marché est sans importance, il n’en est pas de même du commerce qui se fait dans l’intérieur des cases.
Ayant déjà longuement parlé, aux chapitres Kong, Salaga, Kintampo, du commerce qui se faisait entre ces marchés et Bondoukou pour le sel, le kola, les étoffes indigènes de Kong, du Djimini, de Boualé, et des captifs d’origine gourounga, je pense pouvoir passer sous silence la revue de ces articles pour arriver au commerce de l’or et des objets d’Europe, chapitre beaucoup plus intéressant pour nous. Bondoukou peut sans contredit prendre le titre d’entrepôt d’articles d’Europe, et sous ce rapport il a une importance beaucoup plus grande que tous les marchés que j’ai visités jusqu’à présent, ces derniers, y compris Kong et à l’exception de Salaga, tirant leurs articles d’Europe de Bondoukou. Mais, avant de parler des objets manufacturés, je crois utile de dire quelques mots sur l’or ; cela me permettra de fixer le prix avec ce métal précieux qui sert ici presque exclusivement comme payement des marchandises d’Europe.
Comme nous l’apprend Ahmed Baba dans son Tarich es-Soudan, Bitou (Bondoukou) était déjà renommé au XIe siècle pour son commerce de l’or.[165] Actuellement encore on y trouve beaucoup ce métal. Il m’en coûte certainement d’employer la phrase vague qui précède et il serait préférable de pouvoir fixer un chiffre. Malheureusement il m’est impossible d’évaluer ce mouvement, et je crains de me tromper et d’induire en erreur. Je puis cependant affirmer que toute personne à Bondoukou possède au moins une balance à or avec ses birita (poids) et qu’il ne s’est pas passé un jour où je n’aie vu faire des payements en or, soit chez mon diatigué, soit dans la première case venue et même dans la rue.
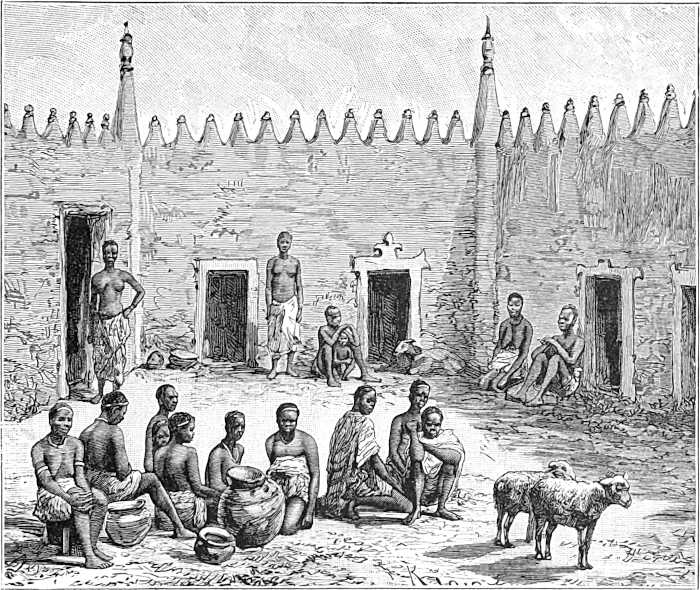
Habitation de Sitafa (vue intérieure).
A Bondoukou, le mitkal a quantité de subdivisions, et le plus petit payement qui peut se faire en or est de 150 cauries ou 0 fr. 225[42]. Pour peser cette quantité, on se sert d’une petite graine rouge corail qui porte une[166] tache noire. L’arbuste qui produit cette graine donne une liane après laquelle poussent des grappes de cosses renfermant les graines. Il est très répandu en Casamance, et les Diola s’en servent pour orner leurs casques de guerre. On nomme ce poids damma.
2 damma valent une graine de bombax, banan-kili = 300 cauries.
4 banan ou banan-nani se nomment diappa-kili = 1200 cauries.
Le diappa est un terme peu usité. On se sert plus volontiers de l’expression banan-nani, et l’on est convenu de compter en banan jusqu’à 8 banan, ce qui se nomme banan-ségui ou safan-kili.
Le safan-kili ou 1 safan est exactement le tiers du mitkal et vaut 2600 cauries.
3 safan se nomment indifféremment mitkal-kili ou diappa-ouoro. Le mitkal vaut à Bondoukou 8000 cauries.
| 1 mitkal plus 1 safan | se nomme | tenkoro. | ||
| 1 mitkal et demi | — | diouassourou. | ||
| 1 mitkal et 2 safan | — | nanféssourou. | ||
| 2 mitkal | se nomment | soussou | 16000 | cauries. |
| 3 mitkal | — | diouggou | 24000 | — |
| 4 mitkal | — | barifiri | 30000 | — |
Mais dès qu’il s’agit de plusieurs barifiri, on change les dénominations et l’on ne dit plus barifiri fla, saba, etc., 2, 3, 4 barifiri, etc., mais manna fla, saba. Le pluriel de barifiri est donc manna.
L’étalon du mitkal est égal à 24 graines de banan ; cependant, comme au delà de 7 banan on ne se sert plus de graines, mais d’objets quelconques en cuivre, fer, corne, os, faïence, etc., les poids se perdent peu à peu.
C’est ainsi que j’ai observé que le barifiri pesait exactement 17 gr. 6, poids inférieur à deux fois le soussou (2 mitkal), qui pèse 9 grammes. Cela devrait porter le barifiri à 18 grammes. Les petits poids sont du reste tous trop forts, et j’explique cette anomalie ainsi : Les gens de Bondoukou vendent aux villageois qui exploitent l’or de petits objets, pioches, foulards, calicot, verroteries, grains de corail, couteaux, etc., dont la valeur ne dépasse jamais 1 ou 2 mitkal d’or ; ils achètent donc l’or avec des poids forts, et le vendent avec des poids faibles aux étrangers mandé ou achanti.
J’ai, un peu plus haut, parlé du peu de probité des Ligouy dans leurs transactions ; je porte le même jugement sur les Mandé de Bondoukou. Pendant mon séjour chez Sitafa, il ne s’est pas passé vingt-quatre heures sans que j’aie vu ce dévot musulman manquer à sa parole de commerçant et nier ce qu’il avait avancé la veille, ou bien renoncer le soir à un marché conclu le matin. A des Achanti de Dioua (Cape Coast) descendus chez lui,[167] il faisait des payements de 1 barifiri à raison de 30000 cauries, puis, quand ces derniers furent sur le point de partir, il tira profit de leur embarras en ne leur faisant céder (comme intermédiaire ou courtier) le barifiri qu’à 32000 cauries !
L’or se porte à Bondoukou soit serti dans de petits chiffons noués avec un fil, soit dans des étuis fabriqués à l’aide de plumes de gros oiseaux, bouchés avec un tampon en bois. En général, l’or est en poudre ; on trouve cependant assez souvent des pépites variant de 1 gramme à 18 grammes. J’en possédai moi-même une de 44 grammes et j’en ai vu une entre les mains de Sitafa du poids de 130 gr. 5.
Mon désir était d’acheter cette pépite de 130 gr. 5, et je me proposais de faire un sacrifice de 50 francs en plus pour me la procurer, mais Sitafa n’a pas voulu s’en défaire, et m’a donné comme raison que tout le village lui connaissait cette pépite ; que s’il la vendait, cela ne lui porterait pas bonheur, car il la tenait de son père. Un autre riche musulman auquel je me suis adressé et qui en possède une de la même grosseur à peu près n’a pas non plus voulu me la vendre. Les pépites de cette grosseur sont en effet assez rares, et cela s’explique facilement : les indigènes ne lavent pour ainsi dire que les alluvions et terres tout à fait à proximité des cours d’eau,[168] ils sont bien trop paresseux pour porter de l’eau à une certaine distance, et puis il faudrait piocher le sol, couper le réseau serré des racines qui en couvrent la surface : ce serait une besogne trop fatigante pour des gens qui n’aiment pas le travail.
Par ici, et contrairement aux bassins aurifères du Lobi et du Gourounsi, l’or ne se trouve que dans les terrains boisés que nous sommes convenus d’appeler la végétation dense. Ils s’étendent du Diamman aux environs de Krinjabo. C’est certainement sous cette végétation vierge qu’on doit trouver les filons dont les eaux désagrègent les morceaux friables, les petites parcelles et pépites de faible poids, pour les entraîner dans les cours d’eau.
La valeur en cauries que j’ai donnée en regard des divers poids d’or ne s’applique qu’à Bondoukou même : dans tous les villages où l’on exploite l’or, le damma ne vaut que 125 cauries et le banan 250, ce qui porte le mitkal à 6000 cauries seulement au lieu de 8000 qu’il se paye à Bondoukou.
Les articles d’Europe qui font l’objet des échanges les plus importants sont au nombre de sept, savoir :
1o Le foulard rouge, dessin noir et blanc, se vend, les 15 douzaines, 1 barifiri, en chiffres ronds 50 francs, c’est-à-dire un peu moins de 28 centimes pièce ;
2o Le coton rouge filé qui entre dans la confection des étoffes indigènes et surtout des el-harrotafe de Kong : 60 à 65 écheveaux pour 1 barifiri, environ 75 centimes l’écheveau.
3o Le drap rouge dit mourfi, les 12 mètres carrés : 1 barifiri, ou 4 fr. 16 le mètre carré.
4o Le cuivre en baguettes de 1 mètre, suivant la grosseur, le cent : 50 francs à 62 fr. 50.
5o Les colliers en corail, brins, tout petits, d’une valeur de 28 centimes en France ; le cent : 50 francs.
6o Une brocade blanche bien apprêtée, largeur 75 à 80 centimètres, pliée en piécettes des 10 yards : 12 à 14 piécettes pour 1 barifiri ou 50 francs. Le mètre environ, 40 centimes.
7o Une sorte de tissu rouge, d’une largeur de 35 centimètres, dont j’ai perdu le métrage : 38 à 40 piécettes pour 1 barifiri.
Ces articles, de monnaie courante à Bondoukou, sont presque tous de provenance étrangère, anglaise ou allemande, et viennent de Dioua (Oqoua ou Cape Coast) par Koumassi, et d’Assinie et Grand-Bassam par Krinjabo. Ils sont apportés à Bondoukou par des Achanti marchands, désignés sous le nom de galli (du verbe mandé gallo, « vendre, échanger, trafiquer »).[169] Ces galli constituent une société à part ; comme les dioula dans le Soudan, ils passent partout ; ainsi, actuellement, tout Achanti non galli s’aventurant dans le Diamman a le cou coupé par les Ton, tandis que les Achanti dits galli passent partout.
L’inimitié semble avoir régné depuis une époque reculée entre l’Achanti et le Gaman ou Diamman. Bowdich nous parle d’une invasion du Gaman par Saï Apokou, souverain de l’Achanti, vers l’année 1720, puis le même auteur signale une autre guerre entre les deux puissances en 1819. Le Gaman n’a jamais été tributaire de l’Achanti.
Très actifs, ces galli sont en outre sobres et économes : jamais ils n’ont fait chez Sitafa plus d’un repas par jour, et encore ne se composait-il que d’une très petite quantité de to d’ignames. Leur unique vêtement consiste en un grand plaid en calicot de couleur, qui leur sert aussi de couverture la nuit.
Il n’y a que ceux qui n’ont pas l’expérience suffisante qui se laissent prendre au change des cauries ; les anciens sont impitoyables et n’acceptent en payement que de l’or de préférence, ou bien des captifs, du beurre de cé, des étoffes de Kong (couvertures siriféba) ou des étoffes de Djimini et de Boualé.
Les Galli apportent aussi de la côte de menus objets, gros couteaux, glaces, verroteries, etc., puis les piments longs dits kani et le piment dit Niamakou que les gens de Kong portent sur Djenné.
Comme industrie, il y a le tissage et la teinture, mais la production ne dépasse pas la consommation locale ; nous avons vu plus haut que ses habitants, sous ce rapport, sont tributaires de Kong, Boualé et Djimini. Bondoukou est aussi près de Krinjabo que d’Oqoua ou Dioua (Cape Coast), et nous pourrions y vendre beaucoup de nos produits, malheureusement nous n’avons pas de traitants noirs à la côte, c’est ce qui nous fait défaut. Sans nous avilir à fabriquer et imiter ces objets manufacturés allemands et anglais que j’ai cités, nous pourrions y écouler, avec de beaux bénéfices, des satinettes, des florences, des étoffes de laine légère, des vêtements confectionnés arabes, haïks, turbans, gandouras, culottes, selles de prix, etc., sans compter les livres saints musulmans et quantité d’autres articles dont je me propose de donner la nomenclature dans un chapitre spécial.
Comme à Bondoukou je ne me trouvais éloigné que de deux jours de marche d’Amenvi et que j’ignorais si mon compatriote avait réussi oui ou non à y faire accepter notre pavillon, je me mis en mesure d’aller visiter le chef Ardjoumani afin de traiter au besoin avec lui dans le cas où mon compatriote ne l’aurait pas fait. L’importance qu’a pour nous la région[170] Bondoukou ne peut échapper à personne. Ce pays et ceux de la rive droite du Comoë sont les portes par lesquelles nos produits de France devront passer pour entrer dans les États de Kong, dont la population intelligente, active et commerçante se chargera de les drainer par toute la boucle du Niger.
Jeudi 20 décembre. — Comme les relations de Bondoukou avec Amenvi, résidence royale d’Ardjoumani, sont à peu près nulles au point de vue commercial, l’état des chemins s’en ressent. A 1 kilomètre de Bondoukou, dès que l’on a quitté le chemin de Kong par Bondou, il n’existe plus qu’un affreux sentier qui se perd en maints endroits. Le sentier entre dans la végétation dense dès la sortie de Bondoukou. Une belle petite rivière au courant rapide et ses affluents, que l’on traverse, nous obligent par leurs berges à pic à tailler des rampes d’accès pour y faire passer mes deux chevaux. Ces cours d’eau prennent leur source dans un petit massif mamelonné duquel sortent aussi la rivière Tain et quelques-uns de ses affluents. Quoique le relief des sommets principaux ne dépasse pas 50 à 60 mètres, les pentes excessives du sentier mal tracé et les pierres roulantes rendent la marche très pénible pour les hommes et les animaux. Aussi ce n’est qu’à midi que nous atteignons Kouffo, tout petit village perché sur le sommet d’un de ces mamelons. Ce petit village ne se trouvant pas tout à fait à moitié chemin d’Amenvi, je me décide à pousser jusqu’à Sapia, situé à 3 ou 4 kilomètres plus loin.
Entre ces deux villages coule une petite rivière de 6 mètres de largeur dont les abords et le lit sont percés de puits à or, ce qui rend son passage difficile. J’eus l’imprudence de vouloir la traverser sans mettre pied à terre. Mon cheval s’embourba de telle façon, qu’il me fallut près d’une demi-heure pour dégager ses jambes de derrière. Le bain forcé que je pris me fit perdre une boussole de rechange à fond lumineux, que je serrais dans les fontes et qui m’était fort précieuse dans les marches de nuit.
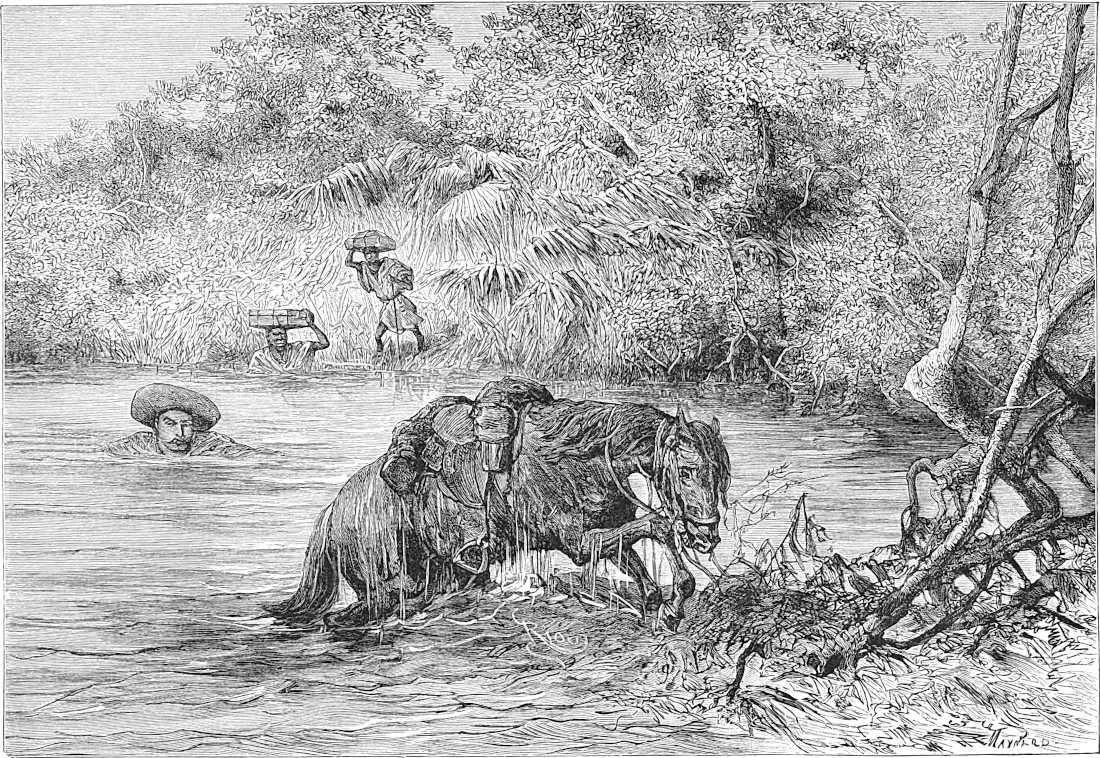
Bain forcé.
A Sapia, où nous arrivons vers deux heures de l’après-midi, nous ne trouvons pas d’hommes ; ils sont tous partis dans les lougans. Les femmes me conduisent chez le chef de village. C’est une jeune veuve, parente d’Ardjoumani ; elle donna des ordres afin de me faire installer rapidement. Je fus très bien reçu dans ce village, où l’élément féminin commande et domine. Le lendemain matin il me fallut me démener pour partir : on voulait nous forcer à passer la journée dans le village. Sapia est le premier village ton que l’on rencontre en marchant vers l’ouest.
Vendredi 21 décembre. — De Sapia à Amenvi on peut dire qu’il y a un chemin. Les villages de Zerré, Iéguéla, Tabaye et Barakody, peu éloignés les uns des autres, ont des relations entre eux, de sorte que cette étape se fait[173] sans trop de fatigue. A Tabaye, où réside un parent d’Ardjoumani, que je vais saluer, on me donne, sans que je le demande, un guide jusqu’à Barakody, afin que je ne m’égare pas dans les nombreux sentiers qui vont dans les cultures et les villages voisins.
Les collines ont fait place à de belles vallées verdoyantes, couvertes d’une épaisse végétation de grands ajoncs, nommés sangandié en mandé. Les hautes terres sont parsemées de splendides rôniers qui fournissent le vin de palme à toute cette région.
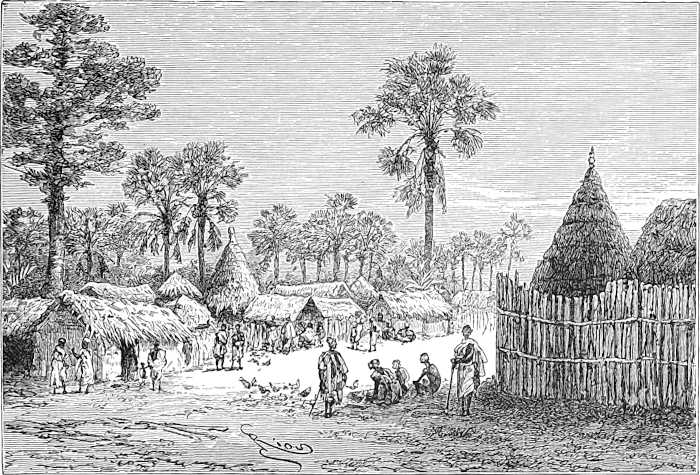
Un coin d’Amenvi.
C’est au milieu d’une de ces clairières de rôniers que s’est fixé Ardjoumani. Son village porte, outre le nom d’Amenvi, celui de Zaranou ; il n’a rien qui puisse faire supposer la résidence d’un souverain commandant à des États dont la superficie est de près de 50000 kilomètres carrés. Un amas de cases, tant rectangulaires que rondes, entourées de clôtures en roseaux et couvertes de toits en feuilles de rôniers, comprenant une rue centrale orientée à peu près nord-sud, dans laquelle circulent des bœufs et quelques ânes fétiches en liberté, constitue la capitale de cet important pays.
Ardjoumani, dès qu’il fut prévenu de mon arrivée, me fit installer dans un groupe de cases proprettes, et le soir vers cinq heures il me fit dire qu’il me recevrait.
[174]A l’heure indiquée, son porte-canne étant venu me chercher, j’allai saluer notre nouvel allié, devant la case duquel je vis flotter nos chères couleurs nationales.
Sous un immense parasol bleu, entouré d’une large bordure flottante en drap garance, Ardjoumani, drapé dans un pagne amarante galonné or et rouge, était assis sur une chaise en bois ornée de clous en cuivre et fumait une pipe en terre fort bien culottée. Il me fit signe de m’asseoir à droite et devant lui.
Comme il est de rigueur ici, j’allai d’abord saluer d’un geste les princes, fils, petits-fils, neveux, etc., assis sur des tabourets à la gauche du chef, puis les vieux, conseillers, captifs influents, assis à sa droite. Devant lui, deux jeunes gens, porteurs de l’épée royale, faisaient face au groupe. L’épée, ou plutôt le sabre d’Ardjoumani, est une longue lame en forme de yatagan de 1 m. 20, munie de dents comme une scie ; elle est surmontée d’une poignée en or fondu, creuse, comprenant une double pomme (d’un poids d’environ 1 kilogramme). Elle est dépourvue de dessins, mais ornée d’un quadrillage assez bien tracé.
Cette première entrevue, fort courtoise, ne fut qu’une visite de politesse, dans laquelle je me bornai à demander au chef un plus long entretien pour le lendemain. Ardjoumani me fit l’éloge de M. Treich-Laplène, qu’il disait mon jeune frère, et m’informa que les hommes qui devaient lui porter ma lettre datée de Sorobango n’avaient pu le joindre et étaient revenus, lui disant que M. Treich devait être actuellement à deux ou trois marches de Kong.
Samedi 22 décembre. — Dans ma visite du lendemain, Ardjoumani, mis par moi sur la question du traité, m’apprit qu’il venait d’en signer un avec M. Treich-Laplène, et me montra l’expédition laissée entre ses mains ; il renouvela devant moi les engagements pris avec mon compatriote, protesta hautement de son amitié pour la France et de son désir de voir les routes s’ouvrir vers la Côte ; de son côté, il promettait de faciliter le voyage vers la mer à tous les marchands qui voudraient passer chez lui. L’entretien se termina par l’examen de mes deux fusils Beaumont et un tir au revolver dirigé sur les cocos des rôniers.

Ardjoumani et ses fils, roi de Bondoukou.
★
★ ★
Limité à l’ouest par le Comoë, qui le sépare de l’Anno et des États de Kong, le pays d’Ardjoumani s’étend au nord jusqu’au Lobi, à l’ouest jusqu’à la Volta, englobe le Fougoula (pays des Ligouy) pour toucher à[177] l’Achanti entre Kwobyne et la rivière Tain et au Sahué, à quelques kilomètres au sud des sources du Mézan. Enfin, les États du Bondoukou donnent la main à nos pays de protectorat, qui comprennent dans cette direction : l’Indénié ou Ndénia, l’Alangoua, le Bettié, l’Akapless et le Sanwi (pays de Krinjabo).
Politiquement, les États d’Ardjoumani comprennent :
I. La partie sud, touchant à l’Indénié et au Sahué, qui porte le nom générique d’Abron ou d’Abonno, mais que l’on désigne aussi souvent sous le nom d’Asikkaso (endroit de l’or) lorsqu’on veut spécialement désigner la région aurifère qui s’étend d’Annibilékrou à Krobo.
On y parle la langue d’Agni et le ton (dialecte achanti).
Le point le plus important de l’Abron est Annibilékrou. C’est ce village qui est la clef des communications de la région ; il est en relation :
1o Avec Krinjabo et Assinie par Diambarakrou et Iaou.
2o Avec Bettié et Grand-Bassam par Abengourou, Zaranou et l’Alangoua.
3o Avec le Morénou et l’Attié par Abengourou et Aniasué.
4o Avec le Baoulé par Yacassé, Ammoaconkrou (capitale de l’Indénié) et Eléosou et Attakrou.
5o Avec l’Anno et Kong par Tenkoualan, Abé sur Zanzanso, Gouènedakha (Mango), le Djimini et Kong.
6o Avec l’Anno et Kong par Tenkoualan, Duhinabo, Kottobo et Gouènedakha (Mango).
7o Avec le Barabo par plusieurs chemins qui aboutissent à Talagnini et Sandui et qui se dirigent de ces deux points par Kourounza sur le Djimini et Kong ou par le territoire des Pakhalla sur Bouna et le Lobi.
8o Sur Amenvi ou Zaranou (capitale d’Ardjoumani) et Bondoukou par Annofonto et Voirabo d’une part et Denba et Sikkaso de l’autre.
9o Sur Bondoukou par Dadiasi et Darbri.
10o Sur Cape Coast par le Sahué et la vallée supérieure du Mézan.
L’Abron et l’Asikkaso sont arrosés par la rivière Ba et ses affluents et la rivière Yéfou qui se jette dans le Ba un peu avant son confluent avec le Comoë, à quelques kilomètres en amont de Duhinabo.
II. La partie centrale, appelée Diamman ou Gaman, mais mieux connue sous le nom de Gottogo ou Bottogo non seulement par les Mandé, mais encore par tous les peuples de la boucle du Niger. Le centre principal est Bondoukou (Bottogo, Gottogo, Bitougou, etc.), dont nous avons déjà eu l’occasion de parler. On y fait usage du mandé pour les affaires, mais on se sert aussi du dialecte achanti des Ton, et du Ngouala (langue des Pakhalla). Le Diamman est arrosé par le cours supérieur[178] du Tain, les sources de la rivière Ba et quelques affluents de la Volta.
III. Le Fougoula ou pays des Ligouy ; on y parle le vei, le mandé-dioula, le diammoura et l’achanti.
IV. Le Barabo, région qui s’étend de l’Abron le long du Comoë jusque vers le district de Nasian. Il est peuplé d’une colonie mandé très nombreuse, venue du Diammara et du Tagouano, qui a rendu tributaires quelques autochtones (Pakhalla). Ses centres les plus importants sont : Sandui, Yoroboudi et Talagnini.
V. Le territoire des Pakhalla.
Ardjouma ou Adjimani ou Ardjoumani (Vendredi) est originaire d’une famille de l’Abron, de race bouanda-agni, venue d’un pays appelé Demma, sur les confins de l’Achanti.
Il a succédé à Héba ou Héboï, qui, lui-même, a succédé à Fofié : c’est le plus ancien roi dont on ait conservé le souvenir. Ce Fofié a été tué dans une guerre contre l’Anno, sur les bords du Comoë, à une centaine de mètres du village de Moroukrou (Anno) (voir chapitre XIV).
Bowdich raconte que Saï Apokou, le roi de l’Achanti, qui acheva Koumassi, fit une invasion dans le Gaman. Le roi qui régnait alors au Gaman se nommait Abo. Bowdich dit que, devant les troupes achanti, Abo prit la fuite et se réfugia dans les États de Kong. Ceci se passait en 1720.
Le même auteur nous apprend que les pays tributaires de l’Achanti étaient le Sahué, l’Akim, l’Assin et le Ouarsâ ; que le Coranza était exempt de charges pour services rendus à la guerre ; et enfin que l’Inta (région de Salaga) et le Dagomba payaient annuellement un faible tribut à l’Achanti.
D’après l’auteur précité, ni l’Anno ni le Gaman n’auraient jamais relevé de l’Achanti. Ceci concorde absolument avec les renseignements que j’ai obtenus en traversant ces pays — ce qui ne manque pas de donner du poids aux renseignements rapportés par le voyageur anglais du commencement de ce siècle.
Mais revenons à Ardjouma et aux prétendants éventuels à sa succession.
Le premier héritier du trône s’appelle Adoukadjou ; il habite Adoukadjoukrou.
Le deuxième héritier se nomme Andrufi ; il est chef de Bambaso. Les autres chefs influents sont : Annibilé, chef d’Annibilékrou, Papey et Boitène, qui résident près de Bondoukou.
Le mode de succession est analogue à celui de tous les peuples de race agni-achanti et le trône se transmet aux neveux, fils de sœur ; la charge de premier intendant du royaume est occupée par le fils aîné du roi régnant.
[179]Cette charge est actuellement remplie par Diassy, fils aîné d’Ardjouma ; il habite dans un petit village près de Bambaso.
A la suite de nombreuses exactions commises par Diassy, tout un parti s’est rallié à l’ancien intendant du royaume, au fils aîné d’Héba, qui se nomme Cocobo. Cet état de choses a engendré une lutte entre ces deux fonctionnaires ; ils mettent à sac alternativement des villages du royaume.
Ardjouma ne sévit que mollement ; il n’ignore pas que son fils Diassy a de grands torts ; comme père il lui pardonne, et sa faiblesse pour ce fils l’empêche de le mettre à la raison.
Cocobo, l’ancien intendant, a un frère qui jouit aussi d’une assez grande influence dans le pays, mais qui reste en dehors de toutes ces chicanes ; il se nomme Couassy Sékré et habite Tabaye (entre Bondoukou et Amenvi).
★
★ ★
Comme Ardjoumani me priait avec instance d’attendre le retour ici de M. Treich, je crus bien faire, pour éviter de le froisser, de ne pas brusquer mon départ, et je lui promis de prolonger mon séjour de vingt-quatre heures. C’était déjà pour moi un grand sacrifice, Amenvi n’étant pas précisément bien agréable. Ce village n’a pas de cultures, et toutes les provisions se tirent des environs ; ce n’est qu’avec les plus grandes difficultés que l’on peut s’y nourrir, et si les vivres ne vous viennent pas du chef on risque d’y mourir de faim. Les parents, amis ou captifs de la famille royale, tout en vivant un peu aux dépens d’Ardjoumani, se créent des ressources en or, soit comme part de prise dans les razzias de captifs que fait ce souverain sur les frontières de l’Achanti, soit dans la perception de l’impôt, qui doit se faire, comme chez tous les peuples noirs, d’une façon plus ou moins arbitraire.
Au moment de mon passage à Bondoukou et pendant mon séjour à Amenvi, les chefs ou agents d’Ardjoumani partaient précisément, en vue de la perception de l’or. Rien n’est curieux comme le départ de ces personnages. Assis dans un long panier porté sur la tête de quatre esclaves, et précédés de deux ou trois tam-tams, suivant son rang, le chef essaye de se donner un air d’importance en faisant flotter son plaid en étoffe voyante sur les flancs du panier, et tournoyer son ombrelle dans tous les sens. Le cortège se complète par les captifs porteurs de la chaise ou du tabouret du chef, auquel est presque toujours fixée une sonnette ; puis les porteurs de gris-gris, — queues de bœufs, de chevaux ou d’éléphants, — et enfin le ou les porte-épée ou porte-canne, qui transmettent les paroles du chef.
[180]J’ai vu aussi monter à âne à Amenvi, mais ce n’est que l’exception ; ceux que j’ai vus n’étaient pas des chefs. Ceux-ci doivent, ou se faire porter en panier, ou bien monter à cheval ; mais comme cet animal ne vit pas ici, le pays ne produisant ni sorgho ni graminées propres à sa nourriture, c’est le mode de transport en panier qui est le plus pratique et le plus usité.
Dans le Diamman (Bondoukou et ses environs), la population, à l’exclusion des colonies mandé fixées à Bondoukou et dans quelques gros villages, est composée à peu près de gens de même race que les Achanti. On les désigne sous le nom de Ton. D’une taille un peu plus élevée que les Achanti du Coranza et les galli qui viennent commercer à Bondoukou, il est facile de reconnaître chez eux les caractères physiques de la race achanti, avec laquelle je les crois fortement apparentés. La langue qu’ils parlent est l’achanti presque pur. Plus au sud, à environ une journée de marche d’Amenvi, dès que l’on entre dans l’Abron, les Ton sont déjà fortement mélangés à des gens qui semblent de même race que les Sanwi (gens de Krinjabo) et que l’on désigne sous le nom de Bouanda ; ils parlent la langue de Krinjabo, — la langue agni. Les Ton, qui vivent à côté des Bouanda, dans l’Abron, ont conservé le dialecte des Ton du Diamman, mais la plupart comprennent l’agni ; cette langue, dans l’Asikkaso déjà, est seule en usage, et s’étend par le Sahué et le Sanwi jusqu’à Assinie.
Les Ton, tels que je les ai vus dans le Diamman, sont d’une propreté excessive ; ils passent plusieurs fois par jour un temps très long à se savonner, se baigner et se frictionner à l’aide de fibres de palmier en guise d’éponge, après quoi vient le graissage de tout le corps, au beurre de cé ou à l’huile de palme. Comme l’usage d’une coiffure quelconque, bonnet ou chapeau, leur est absolument inconnu, leur chevelure est l’objet de soins très minutieux. Rarement ils se rasent la tête : ils se coupent les cheveux à l’aide de ciseaux et les peignent soigneusement avec des peignes en bois fabriqués par eux ou des peignes en corne venus de la côte. Leur vêtement consiste en une bande d’étoffe portée comme ceinture et passant entre les jambes. Avec cela, ils portent un pagne en cotonnade de couleur voyante de provenance européenne ou fabriqué dans le pays, dans lequel ils se drapent fièrement comme dans un plaid.
Comme bijoux, ils se parent volontiers de colliers et de jarretières en pierres ou perles ordinaires, auxquels est souvent suspendu, en guise de médailles ou de pendeloques, un petit morceau d’or, travaillé dans le pays.
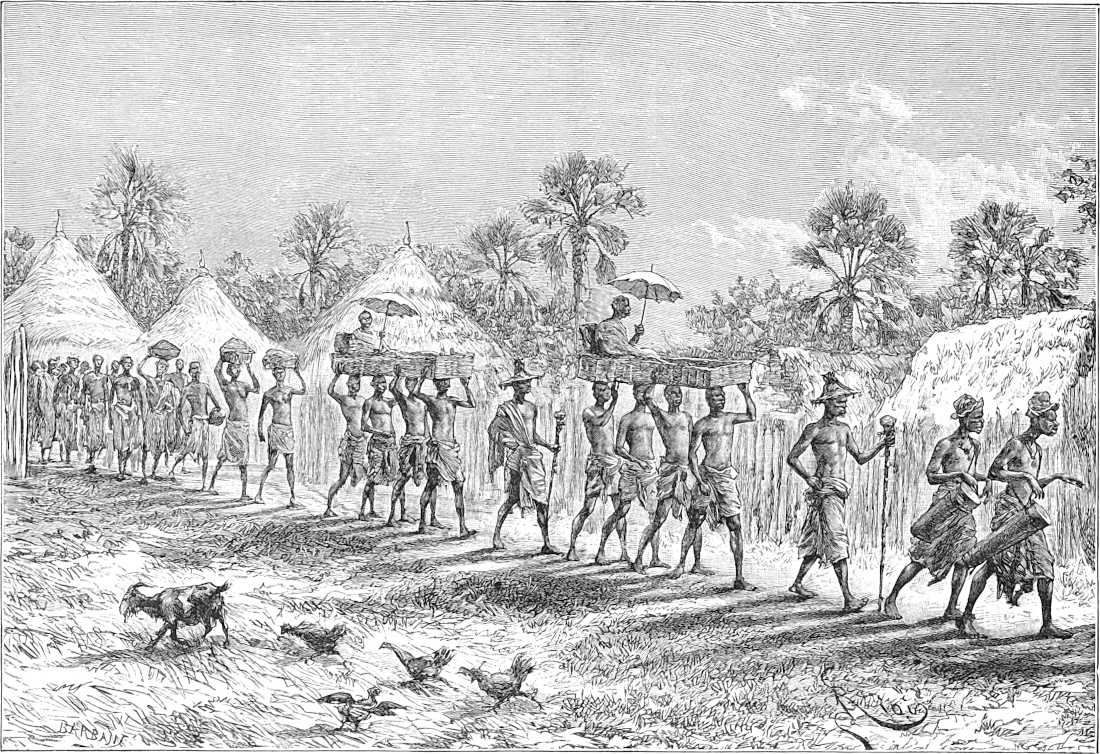
Départ des agents d’Ardjoumani.
Ainsi accoutrés et munis d’une ombrelle, les Ton tranchent sur les[183] autres peuples noirs et surtout sur les musulmans, auxquels ils n’ont pas cru devoir emprunter les vêtements confectionnés. Comme chez les Achanti, ni hommes ni femmes ne sont tatoués.
Le costume de la femme ne diffère pas, pour ainsi dire, de celui des autres Soudaniennes ; elles portent le châle ou voile et se ceignent les reins d’un pagne qui est porté par-dessus une tournure assez volumineuse en forme de traversin, comme en ont les femmes mandé-dioula de quelques pays que j’ai visités.
Les habitations en usage chez les Ton sont de plusieurs types : rondes, rectangulaires ou carrées ; elles sont construites en bambou ou branches de palmier ban, légèrement enduites de béton ou terre glaise et badigeonnées en ocre rouge ou noire.
Presque toutes sont recouvertes en feuilles de rônier et en chaume. J’ai remarqué que les cases rondes étaient généralement réservées aux femmes, tandis que les carrées ou rectangulaires constituent le home des jeunes gens ou des maris. Tous ces types de cases se distinguent des constructions des autres Soudaniens par des ouvertures larges et spacieuses en guise de portes et par leur surélévation au-dessus du sol.
Quelques cases rectangulaires d’Amenvi, de Tabaye et de Marawi ont leurs façades ornées de piliers et de dessins en creux moulés sur des lianes ou brins de bambou disposés en arcs, en cercles, triangles, losanges, etc. Rarement on les trouve isolées ; on les rencontre toujours par groupes de quatre cases formant un carré et une petite cour centrale. Ainsi disposés et munis de toits assez élevés, ces logements sont agréables à habiter, surtout pendant les heures chaudes, puisque deux d’entre eux sont toujours au moins à l’abri du soleil.
L’ameublement consiste en nattes, chaises de divers modèles, tabourets, peaux de singes servant de sièges, quelques bassins en cuivre et des cruches en grès de provenance d’Europe. Au plafond est généralement suspendue une lampe en fer, à l’aide de deux chaînettes.
Les occupations des Ton sont les cultures, l’extraction de l’or, la récolte du vin de palme, le tissage.
S’il m’est difficile d’édifier le lecteur sur l’état des cultures de cette région, il m’est encore moins facile de le renseigner sur l’extraction de l’or : ce dernier travail n’ayant lieu que pendant l’hivernage, je n’ai pas eu l’occasion d’assister à des lavages.
Ce qui m’a frappé, c’est que depuis mon dernier passage de la Volta je n’ai pas vu un seul lougan ; il semblerait que les Ton et les Pakhalla, leurs tributaires, aient pris un soin jaloux de cacher leurs diakha (champs[184] d’ignames). Ces champs doivent se trouver à de très grandes distances des lieux habités, les travailleurs ne rentrant jamais que longtemps après le coucher du soleil. Dans les jardins aux abords des villages, on peut cependant voir un peu de maïs, du manioc, des papayes et surtout des bananiers ; l’indigo et le coton sont inconnus par ici.
Le coton, qui leur vient des régions plus au nord, est filé par les femmes. J’ai vu quelques Ton, très entendus dans le tissage, faire des dessins assez symétriques en damiers ou en raies. On peut cependant dire que cette industrie est peu prospère. Les Ton tirent leur linge de la Côte, ou bien ils se servent d’étoffes indigènes fabriquées par les peuples voisins.
La religion des Ton me paraît offrir quelque analogie avec le culte des Mandé-Bambara et Malinké ; comme eux, ils ont dans un lieu écarté du village une case à fétiche (namabong, en mandé) soigneusement préservée des regards des profanes par une clôture en aloès et des arbres dans lesquels sont disposés des chaudrons sur lesquels on sacrifie les poulets.
Ils possèdent aussi toute la série des sorciers mandé dits soubakha (maîtres de la nuit), et pendant la nuit on entend rôder dans le village les koma et les dou, déguisés avec des vêtements en fibres de palmier et tirant de cornes d’animaux des sons qu’on ne peut comparer à aucun cri connu ; ils se servent pour cela de grandes cornes de bœufs sauvages d’une variété connue par les Mandé sous le nom de minnaba.
Ce peuple a aussi de nombreux tenné (fétiches). Ainsi tel ou tel bois apporté dans le village, ainsi que la vue de tel ou tel animal, peuvent entraîner les plus grands malheurs sur le pays. Beaucoup de Ton ont pour fétiche les chèvres, d’autres les escargots, etc.
Si leur religion se bornait à l’observation et à la pratique de ces mœurs ridicules, les Ton ne seraient pas à blâmer, mais malheureusement, comme les Sanwi, les Achanti et les peuples du Dahomey, ils se livrent à la cruelle pratique des sacrifices humains, non seulement à la mort de leur souverain, mais encore à propos de la mort de tout individu ayant joui de quelque influence.
Le décès d’un personnage de marque donne lieu à des sacrifices humains qui atteignent quelquefois des proportions plus fortes qu’on ne se l’imagine, et à des orgies qui, sans se renouveler souvent, sont menées tellement à fond qu’elles occasionnent la famine de toute une région. Les convives ont le droit de s’inviter eux-mêmes et de piller partout ; quand une bande semblable s’abat sur un village, c’en est fait de lui : tout ce qui n’est pas à l’abri, bœufs, moutons, volailles, ignames, bananes, est dévoré ;[187] le village n’est évacué que lorsqu’il n’y a plus rien à manger et à voler. Je suppose que c’est la raison pour laquelle tous les villages, tant Ton que Pakhalla, dissimulent si bien leurs cultures, car de la Volta à Bondoukou et de ce point au Comoë, je n’ai jamais eu l’occasion de voir un lougan.

Types de Ton avec leur ombrelle.
Cette coutume des sacrifices semble avoir été instituée pour préserver les chefs et personnages influents des morts violentes, le poison jouant dans ce pays un rôle considérable.
A l’avènement d’un roi, on rassemble sa maison civile et militaire et toutes les personnes qui, de près ou de loin, approchent le souverain, et on leur tient le langage suivant : « Vous avez tout intérêt à prolonger la vie de votre maître ou souverain, de veiller à son entière sécurité et d’empêcher qu’il ne soit empoisonné ou tombe dans une embûche quelconque. Votre vie est entièrement liée à la sienne : le jour où il mourra, vous serez tous décapités. »
C’est en effet ce qui a lieu : une partie des esclaves sont exécutés. Ces sacrifices humains, sans atteindre les chiffres fantastiques dont parlent souvent les publications, s’élèvent cependant encore à un nombre de victimes qui varie de 8 à 20. Ce nombre s’accroîtrait certainement si l’esclave n’avait pas, dans cette région déjà, une valeur assez forte pour qu’il n’existe pas en grande quantité comme dans le Mossi et les pays limitrophes.
Treich m’a dit avoir assisté, lors de son passage, à un massacre de ce genre, à l’occasion de la mort d’un personnage influent de Bondoukou. Les Mandé m’en ont aussi souvent parlé, mais moi-même je n’ai jamais eu l’occasion d’assister ni de près ni de loin à une semblable scène de sauvagerie.
Si nous nous reportons de dix-huit siècles en arrière, nous trouvons que nos ancêtres les Gaulois avaient des coutumes à peu près aussi barbares ; aujourd’hui nous semblons l’avoir complètement oublié. Pourtant nous lisons dans notre histoire :
« Tout ce que le défunt a chéri pendant sa vie, on le brûle après sa mort, même les animaux. Il y a peu de temps encore, pour lui rendre les honneurs complets, on brûlait ensemble les esclaves et les clients qu’il avait aimés », etc.
Dimanche 23 décembre. — Dans l’après-midi, je me disposais à aller voir Ardjoumani pour lui demander de me faire partir le lendemain afin de rallier Kong. A la même heure me parvint un courrier de M. Treich-Laplène daté du 15 décembre. Il m’informait que, depuis quelques jours, arrêté à Nabaé, sur les bords de la rivière Comoë, pour attendre la réponse[188] du chef de Kong, il venait d’apprendre par un marchand mon arrivée à Bondoukou.
C’était afin de s’assurer de la vérité de la nouvelle qu’il me dépêchait un courrier ; il m’informait également que, s’il recevait l’autorisation de se rendre à Kong, il pousserait jusque-là en attendant qu’il pût se mettre à ma disposition.
Je saisis avec empressement cette occasion pour faire accepter mon départ par Ardjoumani ; il ne fit du reste aucune difficulté et me laissa partir en mettant avec complaisance un guide à ma disposition.
Lundi 24 décembre. — Sous cette latitude et tant que l’on se trouve dans la région de la végétation dense, l’heure du départ, même pour les marches longues, peut être retardée sans inconvénient ; le matin jusque vers dix ou onze heures il brouillasse assez fortement pour que sous bois on se croie surpris par une pluie fine, et le soleil ne paraît guère avant une heure et demie ou deux heures de l’après-midi. Dans ces conditions et même lorsque le tracé du sentier laisse à désirer, on peut faire du chemin ; aussi les Ton, qui sont de véritables « hommes de brousse », comptent-ils par étape 25 à 30 kilomètres en dehors des lacets et circuits. D’Amenvi à Krinjabo, par exemple (250 kilomètres à vol d’oiseau), ils comptent 9 à 10 jours de marche ; en réalité il y en a bien 25.
De l’autre côté de la petite rivière, en pleine forêt, se trouvent deux villages de culture, autour desquels il y a un peu de maïs, du manioc, des bananiers et des papayers ; mais ces cultures sont étouffées par la végétation, on les dirait presque abandonnées des habitants, qui, peut-être par paresse, ne s’en occupent pas. Ces deux lieux de culture portent le nom de Mandadiasisim et Iatiésisim, ce qui veut dire en ton « case de culture de Mandadia, de Iatié ».
Plus loin, on traverse deux villages plus importants, Tengouvini et Maravi, également situés en forêt, mais dans d’assez grandes clairières. A Maravi, où je m’arrêtai quelques instants, les habitants m’offrirent des bananes, des papayes et du vin de palme ; c’est le dernier village ton que l’on rencontre dans cette direction. Zeppo, que nous traversons trois heures après, et Dinnokhadi, où nous faisons étape, sont déjà peuplés exclusivement de Pakhalla.
Dinnokhadi est un village de 200 à 300 habitants. J’y fus très bien accueilli ; le chef, comme le reste de la population masculine, était sous l’impression du vin de palme. En faisant le tour du village, aux abords duquel se trouvent quantité de cases à gris-gris et d’arbres fétiches sous lesquels sont entassés chaudrons et marmites, je vis deux ivrognes invoquer[189] avec ferveur un de ces fétiches. Ce village m’a du reste paru jouer un certain rôle comme village fétiche, à l’instar de quelques villages mandé-bambara et mandé-malinké de la vallée du Niger. Il possède un féticheur dont la réputation est connue dans toute la contrée.
Le guide qui m’accompagnait m’a appris qu’Ardjoumani n’était jamais venu dans ce village, par crainte de ces féticheurs ; il aurait peur d’y mourir.
Mardi 25 décembre. — Au nord de Dinnokhadi coule une petite rivière de 8 mètres de largeur qui, m’a-t-on dit, recevrait la rivière d’Amenvi. Ce cours d’eau est un affluent de gauche de la rivière Comoë. Actuellement il n’a que 20 centimètres d’eau, mais en hivernage il est profond et a un courant très rapide. Au delà de cette rivière et jusqu’à Donfaé existe une sorte de flore de transition qui, sans être la flore commune au Soudan, n’est cependant plus la végétation dense ; elle comporte plus de clairières et presque pas d’arbres remarquables. En revanche, c’est le pays du vin de palme par excellence : les palmiers à vin et à huile abondent, et Donfaé, par toute la région, est renommé pour son vin.
Précisément au moment de mon entrée dans le village, débouchaient par tous les chemins des femmes portant de gigantesques boulines de ce vin, et, cinq minutes après, les hommes du village s’installaient autour des marchands. Je ne me fis pas prier par les convives, et comme le vin était très frais, j’en absorbai plein une petite calebasse.
Dès que les habitants furent convaincus que je n’étais pas musulman, il m’arriva des calebasses de toutes parts. Bon gré, mal gré, il me fallut goûter à chacune d’elles et en avaler quelques gorgées, de sorte qu’en quittant ces braves gens je me sentais tout guilleret.
Un chemin qui va de Bondoukou dans le Mangotou ou pays d’Anno, après avoir quitté à Bondou le chemin de Kong, traverse Donfaé pour se diriger par Kouanna, Taoudi, etc., sur la rivière Comoë. Ce chemin est fréquenté aussi par les gens de Baoulé, qui le prennent pour aller chercher le kola blanc de l’Anno, de sorte qu’il y a des jours où il règne une grande animation dans ce village hospitalier.
A 7 kilomètres au nord de Donfaé, à quelques centaines de mètres d’un petit village nommé Panamvi en ton et en pakhalla, et Birindara[43] en mandé, on atteint la route de Bondoukou à Kong.
Le jour même de mon arrivée à Panamvi, je préparai une lettre destinée à M. Treich-Laplène dans laquelle je l’informais de ma prochaine arrivée et lui donnais quelques conseils sur la façon dont il fallait agir avec la population[190] de Kong. Je confiai ce pli à Diawé[44], mon premier domestique, pensant que sa présence à Kong pourrait être utile à mon compatriote.
Mercredi 26 décembre. — De Panamvi à Nasian il y a 30 kilomètres à vol d’oiseau, mais avec les nombreux circuits que fait le sentier il faut compter 38 à 40 kilomètres. Les marchands chargés sont obligés de camper à mi-distance, sur les bords d’un des nombreux ruisseaux qui sillonnent cette vaste plaine, et dont quelques-uns ont encore, à cette époque, conservé quelques flaques d’eau.
En quittant Amenvi, j’ai laissé un de mes chevaux mourant à Ardjoumani ; je comptais fermement pouvoir, avec l’autre, gagner Kong ou au moins le Comoë, mais en arrivant ici il était dans un tel état que je dus renoncer à m’en servir.
Il me fallut donc faire l’étape à pied. Affaibli par un violent accès bilieux qui m’avait pris à Bondoukou, je ne me sentais pas trop vaillant ; cependant je franchis à peu près sans trop de fatigue la moitié du chemin. Vers midi nous prîmes un peu de repos, et comme à deux heures je me sentais dispos, je proposai à mes hommes de nous mettre en route pour Nasian : en marchant bien, nous arriverions avant la nuit.
Arrivés à une dizaine de kilomètres de Nasian, il me fut impossible de pousser plus loin. Cette marche au soleil m’avait considérablement affaibli, j’avais la bouche sèche et je ne pouvais plus plier mes pauvres jambes, et pourtant, comme Européen et comme chef d’expédition, je ne pouvais me laisser aller à un acte de faiblesse et tomber sur le bord de la route. Heureusement qu’un violent incendie de la brousse nous enveloppa à hauteur des ruines de Boropoé ; il fallut s’arrêter, l’éteindre et camper.
J’étais sauvé, mes noirs ne m’avaient pas vu faiblir à la marche.
Jeudi 27 décembre. — Arrivé de bonne heure à Nasian, je comptais pouvoir gagner le même jour Deknion, mais l’homme laissé en arrière avec mon cheval n’est arrivé que dans l’après-midi : je dois donc remettre mon départ à demain.
Mon pauvre cheval était mort un peu plus qu’à mi-chemin. Son palefrenier me rapporta la selle.
Nasian est un très vieux village, qui jadis devait être beaucoup plus grand qu’il n’est actuellement. Son chef jouissait de quelque influence avant l’avènement d’Ardjoumani : il s’est retiré dans l’ouest, vers la rivière Comoë ; il habite un village à côté du Barabo, nommé : Nasian-Massadougou.[191] Nasian est le même village que Bowdich mentionne sous le nom de Naséa.
28 au 30 décembre. — Pendant ces trois journées de marche je fis successivement étape à Deknion (Dépakhé ou Dégouékhé), à Dédi ou Lédi, et enfin, le 30, à Kagoué.

Femmes portant de gigantesques bonbonnes de vin de palme.
De Kalbo, petit village insignifiant situé entre Nasian et Deknion, part sur Amenvi un chemin qui évite la longue étape Panamvi-Nasian et traverse les villages pakhalla de Pakhady, Pon, Kiramsi, Taoudi et le village ton de Kimbédi. Moins direct que le précédent, ce chemin est cependant fréquenté par quelques marchands qui se rendent dans ces villages pour y acheter des peaux de singes noirs, principalement portées sur Dioua (Oqoua ou Cape Coast) par les gens de Bondoukou. De Deknion et de Bavanvy (entre Dédi et Kagoué) partent sur Bouna des chemins par lesquels vient presque tout le coton employé dans le Bondoukou et les régions avoisinantes.
Dimanche 30 décembre. — Kagoué se distingue des autres villages pakhalla par quelques beaux arbres à campement. J’y trouvai des gens de Kong se rendant pour la plupart à Bondoukou avec du beurre de cé et des étoffes afin d’y acheter des kolas et des piments de l’Achanti, qu’ils se proposaient de porter ensuite sur Djenné et Bandiagara. D’autres, mais[192] en petit nombre, se dirigeaient par le Barabo sur le Djimini et l’Anno ; j’appris par ces derniers que, depuis mon départ de Kong, la paix était rétablie entre les gens de Kong et ceux de Djimini, grâce à l’intervention de Karamokho-oulé auprès d’un de ses neveux, Bakary-Ouattara, qui réside à Kawaré, rive gauche du Comoë et qui de temps à autre se livrait à des brigandages sur la frontière.
Ces gens ne suivaient pas la route directe (celle de la rive droite du Comoë), tout simplement pour trouver un placement plus avantageux de leurs charges d’outils en fer (haches et pioches) qu’ils venaient de chercher chez les Tousia, à l’ouest de Bobo-Dioulasou. Cette nouvelle ne manqua pas de me causer un certain plaisir : je me proposais depuis longtemps de traverser le Djimini pour me rendre dans l’Anno, d’où je comptais descendre, sinon le cours de la rivière même, tout au moins le pays de sa rive droite en y touchant le plus souvent possible.
Lundi 31 décembre. — De Kagoué au Comoë il n’y a que 10 kilomètres. Au point où l’on atteint la rivière se trouve un petit village nommé Nabaé ou Nambaye, dont le chef s’occupe du transbordement des gens et des marchandises venant de la rive gauche. Quand on vient de la rive droite, ce sont les gens de Timikou qui font ce service.
C’est de Nabaé que M. Treich-Laplène envoya demander au chef de Kawaré (États de Kong) l’autorisation de se rendre à Kong ; mon compatriote avait fait dans ce village un séjour de dix jours, aussi j’y fus bien accueilli. Le chef, voulant m’éviter le passage du gué, qui se trouve à 500 mètres en amont, mit avec empressement sa pirogue à ma disposition, de sorte que de bonne heure j’arrivai à Timikou, petit village de passeurs situé à 2 kilomètres de la rivière et sur sa rive droite.
Le Comoë a, au point de passage, 70 à 80 mètres de largeur. Quoique son niveau ait considérablement baissé et que du haut de ses berges on domine la rivière d’environ 15 mètres, elle est encore assez profonde pour qu’on ne puisse passer la pirogue qu’avec les pagayes, les perches étant insuffisantes pour le milieu du lit. Ce bief, semblant s’étendre fort loin en aval, est barré en amont par une nappe de grès qui ne laisse qu’un chenal de 1 m. 20 de profondeur contre la rive droite. C’est là que se trouve le gué.
★
★ ★
La rivière sert ici de limite entre les États d’Ardjoumani et le pays de Kong. C’est là que se termine le territoire des Pakhalla. Ce territoire, est très étendu ; il est limité au nord par les districts sud du Lobi et le petit[193] pays de Bouna, à l’est par la Volta Rouge, au sud-est par le Fougoula (pays des Ligouy), au sud par le Diamman ou pays de Bondoukou et à l’ouest par le Barabo, colonie mandé, riveraine du Comoë, dont le centre principal est Sandouy (ou Sandui) et qui fait également partie des États d’Ardjoumani.
Ce vaste pays est habité par une race unique nommée Pakhalla, elle parle une langue qui lui est propre et que l’on appelle ngouala. Ce nom semble avoir pour étymologie dagoua et gouada, qui veut dire « bonjour ». Cependant, à côté de cette langue, beaucoup de Pakhalla savent parler le dialecte achanti des Ton et le mandé.
Suivant les régions de leur territoire, les Pakhalla emploient comme habitations les cases ligouy, ton, achanti ou mandé ; leur costume se ressent aussi de la proximité de ces quatre peuples ; on peut cependant conclure qu’ils ont une tendance à imiter le Ton plutôt que les autres peuples. La raison en est bien simple : ce peuple est depuis fort longtemps tributaire des Ton, qui les gouvernent ; ces chefs ton sont nommés par Ardjoumani.
Ils ont cependant emprunté aux Mandé de nombreux usages : celui de marquer l’entrée de leur chemin de culture par deux petits tertres, par exemple, et de cultiver le tabac contre le village même. Leurs ustensiles offrent plus d’analogie avec ceux des Mandé qu’avec ceux des Ton, mais cela tient à ce qu’ils ont des relations très fréquentes avec les Mandé ; la région est sillonnée par les marchands mandé de Kong, de Bouna, Boualé, du Bondoukou et du Mangouto.
Intellectuellement, ils sont si inférieurs aux uns et aux autres, que je crois téméraire de les apparenter à une de ces familles ; je les rattacherais plus volontiers aux Diammoura de la vallée de la Volta et par suite aux Gourounga.
Comme quelques fractions de Gourounga, ils ne sont pas tatoués ; ils enterrent aussi leurs morts à l’extérieur du village et ont des tombes en forme de tumulus, comme j’en ai vu dans quelques villages du Gourounsi. A côté de cela, ils sont superstitieux à l’excès, comme les Gourounga. Dans les étapes, on risque de se créer des désagréments en employant telle ou telle variété de bois mort pour la cuisine, en plaçant un fusil contre tel ou tel arbre. Certains individus s’informent avant de vous parler si vous mangez de l’escargot ou telle ou telle variété de poisson ; dans l’affirmative, il ne faudrait pas songer à une entrevue, ce serait peine perdue. Le chef de Kagoué ne voulut pas avoir de relations avec moi... parce que je mangeais de la chèvre : hélas ! il le fallait bien, souvent je n’avais pas le choix, et je mangeais ce que je trouvais.
[194]Fort peu de Pakhalla sont musulmans ; leur culte paraît avoir beaucoup d’analogie avec celui des Mandé-Bambara et avec celui des Ton ; je n’ai cependant vu, tant dans ma marche sur Bondoukou que dans celle sur Kong, des cases à fétiches qu’à deux reprises : à Sorobango et à Dinnokhadi, situés tous deux sur la limite de la région habitée par les Ton.
Comme pratiques dignes d’être mentionnées, je signalerai l’usage du tocsin pour annoncer les incendies et, dans quelques villages, un carillonnage pour le réveil et le couvre-feu.
Quelques villages pakhalla de la région méridionale m’ont paru vivre dans une aisance relative ; ils possèdent un troupeau, ont des ressources en vivres, et s’occupent activement de la culture du tabac. D’autres sont plongés dans une noire misère ; on voit des malheureux estropiés et des gens couverts de plaies ; cela tient un peu au pays ingrat qu’ils habitent, car, dès que l’on a abandonné la zone méridionale où croît le palmier, on entre dans une contrée desséchée, arrosée par des ruisseaux insignifiants qui sont à sec pendant une bonne partie de l’année. Le granit fait sa réapparition et avec lui la couche de terre végétale diminue, le terrain et les cultures sont brûlés par le soleil, la campagne a un aspect triste et désolé. Les terrains ferrugineux, que l’on trouve assez fréquemment, ne sont pas assez riches en minerai pour que l’on puisse songer à en extraire le fer ; aussi ce pays, ainsi que celui qui est sur la rive droite du Comoë, est tributaire pour ses outils et les balles de fusil de la région Bobo-Dioulasou. Cela donne lieu à un commerce très actif de la part des gens de Kong.
La configuration de toute cette région, ni accidentée ni coupée, permet d’y porter facilement la guerre et d’y faire la chasse aux esclaves ; aussi elle n’a pas échappé aux Ton, qui en ont fait pendant longtemps leur pays de prédilection pour les razzias. Peu à peu la situation de ces malheureux Pakhalla s’est modifiée, les Ton ne leur font plus la guerre depuis longtemps, et s’ils se contentent actuellement de leur faire payer un lourd tribut, il est vrai de dire aussi qu’ils les autorisent à venir dans le Diamman et l’Abron pour extraire et laver l’or pour leur compte pendant la saison des pluies. Si les Pakhalla veulent s’en donner la peine, ils peuvent prospérer.

Village pakhalla.
★
★ ★
Deux chemins mènent de Timikou à Kong. Celui du sud, qui passe à Binimona, est fréquenté par les marchands, de préférence à l’autre, parce que les villages se trouvent plus rapprochés, ce qui permet de faire de[197] petites étapes. Les hommes de Kong, portant de très lourdes charges, redoutent les étapes qui dépassent 15 kilomètres (à vol d’oiseau).
Quoique très fatigué par la marche, je pris de préférence le chemin du nord, qui passe à Koniéné, afin de gagner deux étapes et de voir en passant les terrains aurifères que l’on m’avait signalés aux environs de Samata.
Comme le trajet de Timikou à Gaouy est trop fatigant pour être fait en une seule étape, je me décidai à partir le même jour et à aller coucher à Son ou Sou, petit village d’une dizaine de cases, où j’arrivai à huit heures du soir seulement.
Mon entrée tardive jeta un peu l’émoi dans cette petite population, qui actuellement ne se compose que de femmes. Mais, dès qu’on m’entendit parler le mandé, je fus reconnu pour le blanc de Kong et l’on procéda à mon installation. Le manque de maris dans ce village me valut la visite de trois jeunes femmes qui me demandèrent un gris-gris pour avoir des enfants.
Je n’eus pas de peine à leur expliquer qu’il fallait d’abord songer à trouver un mari, et les renvoyai à mes hommes pour plus amples informations !
Le lendemain de bonne heure, deux de ces jeunesses, auxquelles j’avais donné quelques perles, s’armèrent résolument d’un bâton de route, comme l’auraient fait leurs maris absents, et nous accompagnèrent jusqu’aux environs de Koulla.
Inutile de dire que l’accueil plus que bienveillant de ce village féminin fut le sujet de conversation de mes braves compagnons de route, qui ne regrettaient qu’une chose, c’est de ne pas trouver souvent de villages semblables sur leur chemin.
1er janvier 1889. — Ce n’est pas sans un certain émoi que j’inscris cette date sur mon calepin de route. Tout en priant Dieu de me conserver la santé et de me ramener à ma patrie, je reprends courage en me disant : « Peut-être dans quatre, cinq, six mois, aurai-je le bonheur de revoir la France ! »
C’est plein d’espoir et confiant dans l’avenir que j’atteignis Gaouy.
Ce village, dont j’évalue la population à 200 habitants, respire un air de prospérité ; j’y trouvai des poulets, de la viande boucanée, des bananes, des papayes et même des tomates, que je n’ai rencontrées que deux fois, pendant mes pérégrinations.
Situé à 3 ou 4 kilomètres du Comoë, Gaouy avait quelque importance il y a un an, quand les communications de Kong avec Bouna se faisaient[198] par cette route. De là on se rendait à Balabolo, rive gauche du Comoë, et ensuite à Kousso et Bouna ; mais, depuis, les villages intermédiaires entre Balabolo et Kousso se sont déplacés, de sorte qu’actuellement les marchands traversent le Comoë entre Timikou et Nabaé et se rendent soit à Bavanvy, soit à Deknion, pour y prendre une des deux routes qui mènent de ces points à Bouna.
Mercredi 2 janvier. — De Gaouy à Samata il n’y a pas de villages ; on traverse une grande plaine coupée un peu plus d’à mi-distance par un soulèvement en arc de cercle qui, d’après ce que j’ai pu voir, se prolonge de l’autre côté du Comoë et semble faire suite au pic des Komono, auquel il paraît se rattacher. Cette ligne de hauteurs, dont les plus importants sommets n’ont que 100 mètres de relief environ, se prolonge dans le sud ; on la coupe également en prenant la route de Timikou par Gouroué sur Sipolo.
Les grès dénudés des hauteurs et la végétation rabougrie de cette région achèvent de donner à la plaine un aspect désolé. Les bords des ruisseaux seuls ont conservé un peu de verdure. Les autres arbres et les herbes ont été incendiés. Si ce n’était la grande chaleur, on se croirait dans une campagne de France pendant l’hiver, avec cette différence que le manteau de neige est remplacé par une couche d’herbes brûlées et des troncs d’arbres à moitié calcinés.
La proximité du fleuve rend cependant ce pays très giboyeux ; on y rencontre à peu près toutes les variétés d’antilopes et de gazelles, des cynocéphales, des singes noirs, le sanglier, l’éléphant et l’hippopotame. A Samata j’ai vu des carapaces de tortues et une peau de singe blanc que l’on avait tué aux environs. Cette variété de singes, que nous appelons vulgairement le dominicain, est appelée par les Mandé soula massa (roi des singes), parce qu’elle est excessivement rare par ici. Les noirs le croient de la même espèce que le singe noir à queue blanche, et ajoutent avec sérieux : « Il n’y a que les chefs de cette espèce qui sont blancs ».
Le perroquet gris se voit aussi quelquefois dans la région, mais fort rarement ; il ne quitte généralement pas la forêt dense, et les sujets isolés qui ont été tués ici ont remonté la bande de verdure qui longe le Comoë.
C’est à 2 kilomètres avant d’arriver à Samata, autour d’une ruine, que se trouvent les terrains aurifères. Dans un rayon de 1 kilomètre le sol est absolument à jour ; les puits ou mines sont très rapprochés ; quelques-uns ont près de 3 mètres de profondeur. Pour avoir été ainsi fouillé, il faut que ce terrain soit très riche en or. L’eau faisant défaut dans les environs, les gens de Samata la tirent de puits taillés dans le conglomérat[199] ferrugineux et atteignant de 3 mètres à 3 m. 50 de profondeur. J’ignore les causes qui ont fait cesser l’exploitation de cette mine. A Kong, on m’a dit que le village avait dû se déplacer à la suite d’une épidémie et que les gens de Samata, qui étaient venus élever leur village près de cette ruine, ont dû abandonner l’exploitation de l’or, après quelques essais, faute de connaissance du lavage. Ce n’est pas la première fois que je rencontre des terrains aurifères aux environs de Kong même. Pendant mon premier séjour dans cette ville, comme je parlais à mon hôte Bafotigué Daou de terrains quartzeux situés sur la route de Limono, celui-ci me raconta qu’on avait en effet trouvé de l’or dans plusieurs endroits, précisément dans les parages que je lui citais et entre autres près d’un petit tertre situé à gauche de la route en marchant sur Limono, mais, faute d’eau, les gens de Kong ont dû abandonner l’extraction, le travail devenant dans ces conditions par trop fatigant.
Samata est très bien situé, au milieu d’un bouquet de végétation. Récemment, il a été abandonné par une partie de ses habitants, qui ont émigré sur Diadié, village plus près du Comoë, et ne comporte en ce moment que quatre familles.
Je fus reçu cordialement par un vieux musulman, qui, le lendemain, mit son fils à ma disposition pour m’accompagner jusqu’à Kolon.
Jeudi 3 janvier. — En quittant Kolon, le guide nous fit traverser deux villages sans importance, Dadougou et Toura, où nous nous arrêtâmes quelques instants pour satisfaire à la curiosité des habitants. A Koniéné, qui est un grand village composé de plusieurs groupes, il me fallut rester une bonne demi-heure, les habitants voulant me faire boire du lait. A mon arrivée, le chef, ou celui qu’on me montra comme tel, me conduisit chez un pèlerin de la Mecque qui a fixé sa résidence ici, quoiqu’il soit originaire de Djenné. Ce musulman, qui est un homme fort bien élevé, m’accueillit de son mieux et voulut me forcer à accepter l’hospitalité chez lui ; mais, mon personnel ayant dépassé le village, j’eus un prétexte tout trouvé pour obtenir ma liberté et continuer ma route sur Kolon, où je n’arrivai, par suite de ces retards, que vers une heure de l’après-midi.
A Kolon, qui est également un gros village, je fus presque choyé, y ayant rencontré des jeunes gens dont j’avais fait connaissance près de Léra et à Kong même ; ils se souvenaient encore fort bien de mon nom et le répétaient à tous les curieux.
Les Mandé de toute cette région me connaissent sous le nom de lieutenant Binger, et prononcent : iétenan Binzé. Ces amis furent sans pitié, et malgré mon extrême fatigue il fallut leur raconter mon voyage de a à z,[200] sous peine de les froisser. C’est tout au plus si on me laissa quelques instants pour mettre mon levé au net.
Vendredi 4 janvier. — Les marchands chargés mettent trois jours pour se rendre de Kolon à Kong ; ils font étape à Déléguédougou et Kongolo. Suffisamment entraîné à la marche, et ne craignant plus les étapes trop longues, je me décidai à brûler Déléguédougou et à aller coucher à Kongolo. En route, je fis la rencontre de deux hommes de M. Treich qui venaient au-devant de moi avec un âne, que je m’empressai d’utiliser. A part la question de la selle, qui était très primitive, ce bourriquot, de belle taille et très vigoureux, constituait à défaut de cheval une excellente monture. Il me porta gaiement à un petit campement, un peu au delà de l’emplacement d’un village où s’embranchent les chemins qui viennent de Kawaré et de Korobita. A ces lieux de halte, où l’on s’arrête généralement pour laisser passer les heures chaudes, je trouvai à acheter des papayes, des bananes et des ignames auprès des femmes qui se rendaient au marché de Kong, de sorte que, sans trop de privations, nous passions deux ou trois heures à l’ombre des arbres d’un des deux ruisseaux qui font leur jonction un peu plus au nord. De là à Kongolo il n’y a qu’une bonne heure de marche. Le chef de village auquel je demandai l’hospitalité me connaissait depuis mon premier passage à Kong : je fus fort bien reçu par lui et ses gens ; ils m’offrirent tout ce qu’ils pensaient m’être agréable. Aussi, le lendemain, après une bonne nuit de repos, je ne fis qu’un saut de Kongolo à Kong, où j’entrai à huit heures du matin.
Samedi 5 janvier. — A trois kilomètres de la ville, je rencontrai Diawé qui venait au-devant de moi avec un cheval de M. Treich. Impatient de rejoindre mon compatriote et de prendre connaissance des nouvelles de notre chère France, je traversai au galop Marrabasou, répondant de mon mieux à tous les teinturiers qui me saluaient, et me dirigeai sur l’habitation de mon ancien hôte, chez lequel M. Treich était descendu. Arrivé, grâce au cheval, presque en même temps que le courrier qui devait annoncer mon arrivée, je surpris M. Treich au moment où il se disposait à aller à ma rencontre.
L’émotion que je ressentis est difficile à décrire. Je tombai dans les bras de ce brave compatriote, qui, à peine remis d’un long séjour à la Côte de l’Or, s’était spontanément offert pour aller me ravitailler. Il m’apportait, en plus d’une lettre de ma mère, des nouvelles de quelques bons amis, qui me firent oublier toutes mes fatigues et privations.
Pendant que je faisais honneur au pâté et au biscuit que m’offrit M. Treich, il me mit au courant des événements saillants qui s’étaient[201] déroulés en Europe pendant mon absence. Quelques minutes après, un spectateur nous aurait pris pour d’anciennes connaissances ; cette amitié spontanée, propre aux gens d’Afrique, avait déjà fait de nous deux amis.

M. Treich-Laplène.
J’appris que pendant plusieurs mois le bruit de ma mort avait circulé en France. Un courrier que j’avais expédié des environs de Kong le 10 mars 1887, parvenu à Bammako fin juin, avait heureusement fait tomber ces fâcheux bruits et rendu un peu d’espoir à ma famille et à ceux qui s’intéressaient à moi.
Sur l’initiative de M. Verdier, armateur à la Rochelle, propriétaire des comptoirs français d’Assinie et de Grand-Bassam, et par le concours généreux de M. de la Porte, sous-secrétaire d’État aux colonies, et de M. le Ministre des affaires étrangères, un convoi de ravitaillement fut organisé à la Côte de l’Or et confié à M. Treich-Laplène.
Le concours de M. Treich-Laplène ne pouvait que m’être précieux. Il venait de faire un long séjour à la côte, et remplissait avant son départ les fonctions de résident de France à Assinie. En cette qualité, il fit vers l’intérieur deux voyages successifs qui ont abouti en 1887 à la conclusion de deux traités (ces traités plaçant le Bettié et l’Indénié sous notre protectorat). M. Treich m’apportait en outre un stock de marchandises qui pouvaient m’être utiles pour le retour.
Les trois jours qui suivirent mon arrivée à Kong furent employés aux visites qui sont absolument de rigueur dans cette cité soudanienne, sous peine de passer pour un mal élevé. Karamokho-oulé, les chefs des qbaïla, tout le monde enfin me fit bon accueil. Je dus un peu partout[202] raconter les péripéties de mon voyage, aucun peuple n’égalant le Mandé-Dioula en curiosité.
Pendant mon absence, Diarawary était mort : j’allai donc faire une visite à son frère et successeur Lansiri, visite de condoléance et de félicitations.
A cet effet, j’emmenai avec moi, comme il est de coutume, un musulman pour réciter une oraison funèbre ; d’autre part, une bonne partie de mes voisins m’accompagna, de sorte que cette visite revêtit presque le caractère d’une cérémonie.
Pendant la prière funèbre on se frappe le front de la main droite en disant « amina » (amen) chaque fois que l’auditoire le prononce, puis la famille vous dit : « ini-sé » (merci). A ce moment, le visiteur répond : « Allah ma lour souna sira ! » (Que Dieu vous laisse dormir en paix dans votre case !) Cette phrase dite, on donne un cadeau de 1000 cauries quand on est dans l’aisance, ou moins dans le cas contraire.
Cette visite et une lettre en arabe que j’avais composée à coups de dictionnaire et de phrases empruntées, avec quelques modifications, aux ouvrages de Bel Kassem ben Sédira, et que j’avais fait parvenir de Salaga à Kong quelques jours avant mon arrivée, me valurent l’amitié de toute la population ; mes derniers ennemis se rangèrent du côté des gens sages : je ne comptais plus que des amis à Kong. L’entrée facile de M. Treich et l’accueil qu’on lui fit en sont les meilleurs garants. Cette population, qui comptait tant de gens hostiles lors de mon premier passage, était complètement gagnée à notre cause ; elle n’avait pas oublié le nom de France que je lui avais appris avec tant de patience et me faisait l’accueil qu’elle aurait fait à un de ses propres enfants.
Une population aussi bien disposée ne pouvait manquer d’accepter les ouvertures au sujet d’un traité, cette question ayant, grâce à la campagne menée par les amis que j’avais laissés à Kong, fait du chemin pendant dix mois.
Dès mon premier séjour on était décidé à traiter ; mais, devant l’hostilité marquée de certaines gens, Karamokho-oulé crut prudent de laisser les esprits s’apaiser. « Quand tu reviendras, disait-il au moment où je partais pour le Mossi, la question sera vite réglée, laisse-moi faire, l’imam et mes amis nous aideront ».
Depuis deux mois on ne parlait que du traité à signer et de mon retour. M. Treich avait été conduit par les guides d’Ardjoumani au chef de Kawaré (petit village situé à une forte journée de marche à l’est de Kong). Dès son arrivée, Bakary, le chef de ce village, arrière-petit-fils de Sékou-ouattara, et par suite petit-cousin de Karamokho-oulé, avait entretenu Treich[203] de la question du traité : tout faisait donc prévoir une issue favorable. A Kong, mon compatriote engagea cette question avec Karamokho-oulé. Comme on me savait sur la route du retour, il fut décidé qu’on attendrait mon arrivée pour terminer cette importante question. Aussi, dès que j’eus quelques instants à moi, je rédigeai les clauses et les discutai avec Karamokho-oulé. Le 10, les signatures étaient données, et une expédition accompagnée d’un pavillon fut remise à notre nouvel allié.

Visite de condoléance chez Lansiri, à Kong.
Karamokho-oulé a plusieurs cousins (petits-fils de Sékou comme lui) établis sur les principales routes rayonnant sur Kong. Il me pria d’aller avec M. Treich rendre visite à Dakhaba, qui habite Limono. Comme ce n’est qu’une courte étape, et que ce fut ce même Dakhaba qui me fit entrer à Kong, j’accueillis de bonne grâce ses propositions, et le départ fut décidé pour le surlendemain.
Dakhaba et Sabana, le fils de Iamory, dont j’ai parlé lors de mon premier passage, nous reçurent de leur mieux. Notre visite fit grand plaisir à ce vieux brave homme ; Kérétigui, frère de Karamakho-oulé, et Bafotigué, notre hôte, qui nous accompagnèrent, lui ayant appris la signature du traité, Dakhaba s’en réjouit et il fallut lui promettre de revenir ou d’envoyer tous les ans quelqu’un des nôtres à Kong : « Vous pouvez même venir beaucoup (ce qui veut dire en nombre) : tu sais que vous serez toujours bien reçus. »
[204]La nouvelle de cette visite fut fort bien interprétée par les gens de Kong et considérée comme une marque de déférence donnée par nous à celui qui doit par son âge et son rang prendre le pouvoir à la mort de Karamokho-oulé si les choses se passent régulièrement.
La question du traité étant réglée, je songeai à envoyer de nos nouvelles en Europe. M. Treich étant arrivé à Kong avec un personnel plus que suffisant[45], je renvoyai Fondou et Birama, mes deux plus vieux serviteurs, accompagnés de leurs femmes gourounga, porteurs d’un courrier adressé au commandant supérieur du Soudan français par l’entremise du commandant de Bammako. Je leur confiai également deux charges d’effets confectionnés et d’étoffes fabriquées tant à Kong que dans le bassin du Niger, destinés au sous-secrétaire d’État aux colonies. Pour plus de sécurité, il fut en outre décidé que M. Treich, de son côté, enverrait un courrier sur Krinjabo et Assinie par Bondoukou.
Mes hommes quittèrent Kong le 16 janvier, et ceux de M. Treich le 17. Quelques jours après leur départ, j’appris, par un homme de Bobo-Dioulasou qui vint me rendre visite, qu’un captif d’El-Hadj Mahmadou Lamine, de Ténetou, était arrivé à Dioulasou un mois après mon départ de cette ville, porteur d’un courrier qui m’était destiné. Cet homme, atteint de la filaire de Médine, dut prolonger son séjour à Dioulasou jusque dans le courant de juillet et quitta cette région avec la certitude que j’avais fait route pour le Mossi. Ce courrier, en partant de Bammako, s’était dirigé par les régions soumises à Dioma, par le Mianka ou Menguéra sur Bobo-Dioulasou en contournant au nord les États de Samory et de Tiéba[46].
Désireux de continuer ma route de retour par la rive droite du Comoë, je fis part aussitôt de mon désir à Karamokho-oulé, qui s’empressa d’y satisfaire. Les quelques jours qui précédèrent mon départ furent employés par lui à faire prévenir les régions avoisinantes de mon prochain passage. Nos préparatifs ne furent pas longs. Le départ de Kong fut fixé au 21 janvier.[205] Dans les visites d’adieu que je fis avec M. Treich, j’eus la satisfaction de constater que tout le monde à Kong n’avait plus qu’un seul désir, celui de voir les chemins s’ouvrir vers la côte le plus vite possible. Active et laborieuse, cette population comprend qu’une voie sûre vers le golfe de Guinée lui rapportera de grands bénéfices et lui ouvrira un nouveau débouché pour son industrie. Partout on ne songe qu’à cela à Kong. Tributaire pour les articles d’Europe des gens de Bondoukou, de Salaga et de l’Anno, la population attend avec impatience le jour où elle pourra s’affranchir et entrer directement en relations avec nous.
A sept heures et demie du soir, la veille de notre départ, l’imam Sitafa Sakhanokho vint, accompagné de son frère et de quelques amis, me faire ses adieux, me souhaiter bon retour et me prier de saluer de leur part « le Président de la République et tous les anciens de France », pour me servir de son expression.
La démarche de cet homme, qui jouit par sa situation comme chef religieux d’une grande considération à Kong, et qui s’était jusqu’à présent tenu sur un terrain de neutralité à mon égard, prouve jusqu’à quel point la population est gagnée à la France. Nous serions bien coupables de ne pas profiter de ce mouvement vers nous, si nous ne continuions à entretenir de bonnes relations avec les gens de Kong, car je les place bien au-dessus des autres peuples que j’ai eu l’occasion de visiter dans mon voyage. Il est de notre devoir et de notre intérêt de conserver leur amitié, qui nous est offerte bien loyalement et dans le seul désir de voir la civilisation et le bien-être pénétrer chez eux.
★
★ ★
Quelques jours avant notre départ, il m’est arrivé une histoire bien plaisante qui n’a pas manqué de nous procurer de l’agrément à Treich et à moi.
On se souvient que, dans le sauf-conduit des gens de Kong on parle d’une femme laissée par moi à Kong. Je dois ici en dire deux mots :
Nion, c’est le nom de cette jeune femme, était marchande de niomi (galettes de farine de mil ou de maïs) sur le marché de Tiong-i. Mes hommes lui en achetaient de temps à autre, et presque tous les matins elle nous envoyait quelques galettes, attention pour laquelle Diawé ou un autre de mes hommes allait lui porter de ma part quelques perles ou un peu d’étoffe.
Un beau jour elle disparut, et mes hommes vinrent me rapporter que son père, qui habitait Fourou, venait de mourir, et que le chef des sofas[206] avait confisqué sans autre forme de procès toute la famille du défunt sous prétexte de se couvrir d’une dette.
Ce procédé barbare n’existe pas généralement pour les gens du pays même, on n’en use qu’à l’égard des étrangers. — Nion était originaire de Ngokho dans le Follona et appartenait à une famille tagoua : c’est ce qui explique pourquoi l’on avait agi avec si peu de scrupules.
Quelques jours après sa disparition de Tiong-i, Nion arriva à Fourou avec une caravane d’esclaves : elle était comprise dans un lot d’esclaves destiné à servir à l’achat d’un cheval.
Je n’avais jamais vu cette pauvre femme, mais comme mes hommes semblaient avoir de l’affection et de la pitié pour elle, j’allai voir le chef de la caravane, décidé à faire ce qui était possible pour qu’on lui rendit la liberté.
Diawé plaida sa cause avec chaleur, me persuada qu’elle serait utile pour préparer la nourriture indigène, blanchir mon linge, et qu’elle rendrait en outre un service signalé à notre convoi, car elle parlait parfaitement le siène-ré.
J’entrai donc en pourparlers pour l’acheter et fis venir le chef de la caravane, qui y consentit à la condition que je lui donnasse une autre femme à sa place et que je lui payasse une différence.
Un des deux Haoussa résidant à Tiong-i me proposa de faire l’échange avec une de ses captives que je lui payerais 6 pièces de calicot à 4 fr. 30, soit 25 fr. 10, et deux blouses de rouliers, plus dix-sept pierres à fusil. Je ne sais pas à quel trafic le Haoussa se livra, mais le soir j’étais en possession de la jeune femme, que je m’empressai de libérer devant mes hommes.
« Ne m’abandonne pas ici, me dit-elle en pleurant, car demain on me reprendrait : je suis seule et sans défense, tandis que si je t’appartiens, je serai sûre que personne ne me réclamera plus. Je préfère être ta propriété. Les blancs sont bons, je l’ai entendu dire, et je veux être à toi. Tu seras content de moi, je ne demande qu’à travailler, à te faire la cuisine et à te chasser les mouches quand tu dormiras, et puis je porterai des bagages. »
Je l’habillai proprement avec quelques coudées d’étoffe, lui donnai un peigne, du corail et quelques verroteries.
Basoma, mon hôte, qui était forgeron, lui confectionna deux boucles d’oreilles à l’aide de deux pièces de 50 centimes en argent.
La pauvre fille était heureuse comme une reine. Basoma lui fit voir le côté heureux de sa nouvelle situation, et au bout de quelques jours elle était tout à fait habituée à nous.
[207]Deux jours après, nous allions à Fourou, où personne ne l’inquiéta.
Elle tomba bientôt légèrement malade.
Elle avait du vague dans les yeux et l’air souvent abattu. Je lui demandai si elle était malheureuse, et bientôt, pressée de questions, elle m’avoua en pleurant qu’elle était enceinte, que pendant les deux nuits qu’elle avait passées comme prisonnière, un des sofas de Samory en avait abusé et qu’elle ne savait même pas son nom.
Je la consolai, ce n’était pas bien difficile : l’incident en lui-même ne la chagrinait pas trop, c’était seulement la crainte de déplaire qui l’avait attristée.
Rassurée sur ce point, elle retrouva sa gaieté. Elle me soigna admirablement au moindre petit malaise et nous rendit, à mes hommes et à moi, de réels services pendant nos nombreuses étapes.
Arrivé à Kong et craignant de ne pas avoir le temps de finir mon voyage avant le dénouement et de voir la pauvre femme malade en route, je demandai au chef de Kong de garder Nion pendant notre absence. A cet effet je lui donnai des ressources pour pourvoir à ses dépenses pendant environ un an.
Lorsque Treich arriva à Kong, fin décembre 1888, Diawé, qui m’avait devancé, lui présenta l’enfant de Nion, né pendant mon absence, en disant : « Ça il y en a petit Binger ».
Treich, en voyant l’enfant, d’un beau noir d’ébène, renia naturellement pour moi la paternité de cette progéniture, persuadé, sans m’avoir jamais vu, que je devais avoir la peau beaucoup plus claire que celle de l’enfant de Nion.
A mon retour à Kong, Nion vint en pleurant se jeter à mes pieds, me présenta une calebasse avec de l’eau et me lava les mains. Puis elle se mit à boire cette eau sale pour me prouver sa joie de me revoir. Le petit fut choyé par toute mon escorte et je l’embrassai devant tout le monde, comme s’il était réellement mon fils. Je pensais qu’accepter la paternité de ce petit être ne tirait pas à grande conséquence dans ces pays et que, sans inconvénient, je pouvais aux yeux de tous passer pour son père.
Tout allait pour le mieux : on me consultait sur l’époque de la circoncision, je payai l’opérateur et la femme qui traitait l’enfant, en un mot j’acceptai avec plaisir toutes les charges qui incombent en cette circonstance à un papa nègre.
Vint le jour du baptême.
Karamokho-oulé, accompagné d’un instituteur et de quelques notables, vint annoncer qu’on allait baptiser mon fils et me pria de choisir un nom.[208] Je lui demandai de bien vouloir lui servir de parrain, et l’on commença la cérémonie. Après les prières d’usage et tous les vœux de réussite et de prospérité, on distribua des cauries aux malheureux, et les dragées de France furent remplacées par une bonne provision de kolas, suivant l’usage à Kong.
Tout semblait aller pour le mieux, lorsque au cours de la cérémonie il se produisit un incident qui ne laissa pas de m’inquiéter pendant quelques instants. Le perruquier, après avoir, suivant la coutume, rasé la tête de l’enfant, se mit en devoir de m’en faire autant ; je protestai naturellement, trouvant que la charge de père avait quelquefois des inconvénients, lorsque Karamokho-oulé, de son ton calme, donna l’ordre au perruquier de raser la tête à un des spectateurs. Comme il fut dit, il fut fait. C’est ainsi que le jeune fils de Nion a, outre son véritable père, qui est inconnu, le père auquel on a rasé la tête, et moi, qui, tout en étant son papa honoraire, passerai toujours pour le vrai. Quoi qu’il en soit, l’enfant s’appellera Karamokho-oulé-Binger.
A Kong il m’aurait été difficile de faire croire le contraire : ces gens-là, n’ayant jamais vu de mulâtres, sont persuadés qu’une femme noire ne peut jamais avoir qu’un enfant noir ou albinos, quand même le père de l’enfant serait blanc ; et inversement, une femme blanche ne peut, d’après eux, n’avoir jamais qu’un enfant blanc, même si son père est noir.
★
★ ★
Lundi 21 janvier 1889. — Quoique notre départ eût lieu au clair de lune, Karamokho-oulé, accompagné de son frère et de quelques amis communs, tint à nous faire la conduite. Sous un arbre, au bord d’un petit marigot qui limite Kong au sud, il nous fit des adieux bien sincères, me recommanda de saluer le Président de la République de sa part et de l’assurer de son entier dévouement, puis il nous remit entre les mains de Bafotigué Daou et de son frère, qui devaient nous accompagner jusque dans le Djimini.
La route de Djimini en quittant Kong se dirige vers le sud-est pendant les premières étapes et est presque parallèle à la route du Gottogo. Le premier village que l’on rencontre se nomme Ténenguéra. Presque inhabité (environ 200 habitants), ce village était jadis très grand et a joué un rôle considérable dans l’histoire de Kong. C’est de Ténenguéra que la fraction des Mandé-Dioula comportant les familles Ouattara, Barou et Daou vint s’établir lorsqu’elle quitta les pays mandé. L’ancêtre des Ouattara, nommé Fatiéba (le père Tiéba), commença une série d’expéditions qui[209] devaient rendre sa famille maîtresse de toute cette région jusqu’à la rivière Comoë. Occupée par une population hétérogène composée de cinq éléments différant assez sensiblement entre eux, cette conquête paraît cependant avoir été assez laborieuse pour occuper tout le règne de Sékou Ouattara. Ce prince, successeur de Fatiéba, termina son règne par une série de massacres qui finirent par rendre les Mandé-Dioula maîtres de Kong même, où s’étaient réfugiés les derniers éléments de résistance (voir chapitre Kong).
Cette population, dont on retrouve encore des vestiges dans toute la région, est connue actuellement par les Mandé-Dioula sous le nom de Sonangui, nom qui veut plutôt désigner les captifs armés, c’est-à-dire ceux qui peuvent être utilisés en cas d’expédition, car les Mandé-Dioula musulmans ne font la guerre que tout à fait exceptionnellement, à la dernière extrémité.
Les Sonangui comprennent :
1o Une fraction de Pakhalla, qui habitent quelques petits villages de la rive droite du Comoë ;
2o Une autre fraction des Pakhalla, qui se dénomme Nabé, habitant surtout Gaouy et Koulla ;
3o Quelques familles Zazéré, qui, tout en se rattachant ethnographiquement aux Pakhalla, semblent s’être détachées depuis plus longtemps de cette famille. Ces Zazéré, contrairement aux Pakhalla et Nabé, sont tatoués ; ils portent sur les joues une volute ;
4o Au nord de ces trois peuples se trouve, disséminée dans quelques villages, une fraction des Komono, qui s’appelle Miorou ; elle parle le komono et a conservé le tatouage de ce peuple ;
5o Enfin, vers le sud-ouest et autour de Kong, on trouve encore quelques Fallafalla (fraction des Tagoua). C’est à eux qu’appartenait Kong, ou plutôt le village sur l’emplacement duquel s’élève actuellement la ville, car la cité actuelle a été créée par les Mandé-Dioula.
A Ténenguéra habite un arrière-petit-fils de Sékou Ouattara (Massa Gouli) ; il est le fils puîné de Pinetié, qui a quitté le pays et est établi actuellement au nord de Bobo-Dioulasou, chez les Tagouara. Ce parent de Karomokho-oulé n’étant pas levé au moment de notre passage, cela nous épargna une visite et nous permit d’arriver de bonne heure à Mélenda, après avoir traversé le petit village de Gougollo.
A Mélenda réside Dabéla, le frère aîné de Massa-Gouli. C’est chez lui que Bafotigué nous fit descendre. De même que beaucoup de noirs, fils de chef, ce jeune homme se figure que, comme descendant de Sékou, il doit[210] s’abstenir de travailler : aussi vit-il presque dans la misère et ne put nous recevoir que fort modestement.
Mardi 22 janvier. — Dabéla nous dirige sur Bogomadougou, où habite Badioula, huitième petit-fils de Sékou Ouattara. En l’absence de ce chef, parti aux funérailles d’un ami, à Sokolo (route du Gottogo), nous sommes reçus par Sory, son chef de captifs, qui nous donne quelques provisions en ignames et mil, et nous facilite l’achat d’une chèvre au prix de 1750 cauries.
Mercredi 23 janvier. — Kourou, où nous faisons étape, est le dernier village des États de Kong dans cette direction. Au delà on entre dans le pays de Djimini, qui est indépendant. A Bougou, petit village au nord de Kourou, on me fait faire un détour avec le cheval, cet animal étant considéré par ce village comme un tenné (fétiche qui porte malheur).
Pour le pays de Djimini et l’Anno (Mangotou), c’est l’âne qui répand la terreur ; aussi les marchands, quand ils viennent du nord, ne peuvent-ils dépasser Kourou avec les ânes, et quand ils viennent de l’est, de Bondoukou ou de Baoulé, doivent-ils les laisser à Tenko (rive gauche du Comoë).
C’est pour cette raison que nous avons été forcés de nous défaire de l’excellent âne de M. Treich qui aurait pu nous rendre de réels services. N’ayant qu’un cheval pour nous deux, nous faisons nos étapes moitié à pied, moitié à cheval.
A quelque chose malheur est bon : cela nous obligeait à nous refaire un peu à la marche, car bientôt il faudrait aussi nous défaire du cheval. Le sorgho n’est plus cultivé au delà du Djimini, et le climat du pays d’Anno est aussi funeste aux chevaux que celui du Diamman, où j’ai perdu mes deux dernières bêtes. D’autre part, je ne crois pas que, même avec une grosse provision de grain pour les chevaux, on arriverait à traverser la forêt.
Les sentiers qui existent ne sont que des pistes à peine visibles pour des gens exercés ; ils sont difficiles à suivre à cause des nombreux troncs d’arbres tombés en travers ; les lianes ne permettent même pas aux porteurs de passer avec des charges sur la tête ; ils doivent agencer leurs colis en forme de hotte afin de pouvoir se faufiler à travers la brousse, qu’ils ne peuvent franchir le plus souvent qu’accroupis.
Les racines enchevêtrées font saillie sur le sol ; le cheval marcherait avec difficulté, même sans cavalier. Enfin les ravins sont souvent érodés et ont des berges à pic, dans du terrain argileux et détrempé, et il faudrait, comme cela m’est arrivé dans mon itinéraire de Bondoukou à Amenvi, s’arrêter plusieurs fois pendant une étape afin de tailler des rampes d’accès et débroussailler pour livrer passage au cheval. D’autre part, le fourrage[211] fait absolument défaut ; les rares clairières que l’on traverse sont couvertes de chaume clairsemé et aqueux, que les chevaux refusent, et, sous bois, le sol n’est tapissé que de jeunes pousses d’arbres mêlées à des fouillis d’ananas. L’humidité extraordinaire qui règne dans la forêt est également un important facteur avec lequel il faut compter.
Diawé, mon premier domestique, avait quitté Dogofili, son village, y laissant une jeune fille qu’il devait épouser. Ce brave garçon songeait continuellement à s’en retourner, mais par délicatesse il n’osait m’en parler, ayant pris l’engagement de m’accompagner jusqu’à la fin de la campagne. Désirant le récompenser pour le dévouement dont il avait fait preuve pendant toute la durée de nos pérégrinations, une fois arrivés à Kong je lui offris de s’en retourner vers Bammako avec les deux hommes chargés du courrier. Il refusa et ne consentit à me quitter que sûr de me voir en bonne route, de sorte qu’il m’accompagna jusqu’à la frontière des États de Djimini. Là, il fit retour avec Bafotigué, dont le frère devait, sur les instructions de Karamokho-oulé, nous accompagner jusqu’à Ouandarama et nous remettre entre les mains de Péminian.
★
★ ★
Le 16 mars dernier, une dépêche adressée au sous-secrétaire d’État aux colonies m’apprenait la mort de M. Treich-Laplène, le courageux jeune homme qui s’était offert pour aller du golfe de Guinée au-devant de moi.
M. Treich-Laplène était revenu épuisé par les émotions et les fatigues qu’il avait eu à supporter pendant ce trajet de sept mois. Hélas ! le courage et l’audace ne sont pas seuls nécessaires dans ces contrées : il faut un tempérament de fer pour résister aux privations et au reste.
A peine rentré en France, le Gouvernement, confiant dans le tact et l’énergie de Treich, le renvoya à la côte avec mission d’organiser administrativement notre nouvelle colonie de Grand-Bassam. C’est dans l’accomplissement de cette mission que la mort est venue nous le ravir.
Ayant souffert avec lui et partagé ses peines pendant plusieurs mois, j’ai été à même d’apprécier tout ce que son caractère renfermait de généreux, de désintéressé : il ne connaissait que le devoir. Dans les deux dernières lettres que Treich a écrites à sa mère, il se sent malade, mais ne veut à aucun prix abandonner son poste : « Ma présence est nécessaire ici, dit-il : je ne quitterai qu’à la dernière extrémité ».
J’avais beaucoup d’affection et d’estime pour Treich ; la nouvelle de[212] sa mort a été bien pénible et bien douloureuse pour moi. J’avais pour lui la plus profonde amitié, celle qui est basée sur des souffrances communes, et je l’estimais infiniment.
Treich était un vaillant, un patriote et, par-dessus tout, un modeste. Si sa mère pleure aujourd’hui, à l’amertume de ses larmes doit se mêler un consolant souvenir de légitime fierté, celui que son fils est estimé et regretté par tous ceux qui l’ont approché, et que sa belle conduite et le vaillant patriotisme dont il était animé ne l’ont jamais écarté du sillon du devoir.
[213]CHAPITRE XIV
Dans le Djimini. — Ethnographie. — Dakhara. — Industrie, commerce. — Les régions limitrophes. — Kamélinsou. — Le Comoë. — Premières plantations de kolas. — Arrivée dans la capitale de l’Anno. — Honnêteté proverbiale des habitants de l’Anno. — Industrie, commerce, agriculture. — Départ pour Aouabou. — La marmite fétiche. — Populations de l’Anno. — Mœurs, coutumes, armes, ustensiles. — Un mot sur Sansanné-Mango. — Entrevue avec Kommona Gouin. — Palabres. — Histoire de l’Anno. — Routes commerciales. — Un animal inconnu. — Appellations agni pour l’or. — Départ d’Aouabou. — Entrée dans la grande forêt. — Un mal gênant. — Les mines d’or. — Le fouto. — Rencontre de Gan-ne. — Voyage en hamac. — Bizarre médication indigène. — Comment on voyage dans la forêt. — Longues et pénibles étapes. — Arrivée sur les bords du Comoë.
Jeudi 24 janvier. — Le pays de Kong est séparé du Djimini par une zone inhabitée de 25 kilomètres de profondeur, coupée par une petite rivière de 7 à 8 mètres de largeur nommée Kenguéné, qui sert de frontière entre les deux États. Pendant cette marche j’ai observé plusieurs soulèvements de grès ou de granit de 30 à 50 mètres de relief environ, et, vers le sud, un autre groupe de collines peu élevées. D’après leur orientation, ces petites boursouflures et poussées semblent se rattacher au système du pic des Kommono, auquel elles se relient par les hauteurs de Gouroué-Gaouy-Samata.
Tout près de Ouandarama, il y a du splendide granit bleu, qui émerge des deux côtés de la route, ce qui force les habitants à étendre leurs cultures assez loin.
A Ouandarama, notre logeur, un brave musulman nommé Karamokho Sirifé, nous fit admirablement recevoir par Péminian, chef des trois villages qui constituent Ouandarama ; il nous donna des poulets et plusieurs charges d’ignames et refusa absolument de nous laisser quitter son village le lendemain.
Les trois groupes qui forment Ouandarama sont respectivement habités par des Mandé-Dioula, des Mandé-Ligouy (Veï), que l’on appelle ici Kalo-Dioula, et enfin par les autochtones, ou plus anciens occupants, les Kipirri.[214] Ces derniers ne sont qu’une fraction des Siène-ré, comme je l’ai de suite constaté, beaucoup de femmes ayant la lèvre supérieure percée, et les jeunes gens portant des plumes blanches dans les cheveux. Par la forme de leurs briquettes et leur façon de construire les cases rondes, par leur tatouage, la variété de leurs bœufs et surtout l’idiome qu’ils parlent, ils sont plutôt à rattacher aux Siène-ré du Follona, qui diffèrent assez sensiblement des Siène-ré du Kénédougou, du Pomporo et du Mienka.
Péminian était frappé de ce que je saisissais une partie de sa conversation avec un de ses amis, mais lorsque je lui eus expliqué que j’avais traversé le territoire d’un peuple qui parle leur langue et qui se trouve dans l’ouest, il me raconta avoir déjà entendu dire par des vieux qu’il existait des gens de leur race dans l’ouest, mais il ignorait si ses ancêtres sont venus de l’ouest ou si ce sont les Follona qui ont émigré du Djimini vers le Kénédougou.
Il est plus simple de supposer que quand les Tagoua sont venus se fixer dans le Tagouano, la poussée qu’ils ont produite a séparé les Siène-ré en deux tronçons, dont le moins important a été rejeté dans le Djimini. Les Kipirri ont un village très propre et des cases en fort bon état. On peut en dire autant des Mandé-Dioula et des Ligouy, qui font tous les deux usage de constructions rectangulaires à toit en chaume. L’ensemble de ces villages ne laisse que le regret de n’y rencontrer aucune physionomie féminine passable. J’ai rarement vu le sexe faible aussi mal partagé que dans ce pays.
Ouandarama est très riche en bœufs ; ce n’est qu’un immense parc, dont j’estime le nombre à deux ou trois cents têtes de bétail.
Samedi 26 janvier. — Péminian, qui jouit d’une certaine influence dans cette partie du Djimini, nous donna un de ses captifs devant nous conduire à Domba Ouattara, chef du Djimini, nous recommander à lui de la part du chef de Kong, et le prier de nous faire conduire au chef de l’Anno ou Mangotou.
Précédés du guide, nous suivîmes pendant quelques kilomètres la route qui conduit dans le Diammara par Dabakala, autre village important du Djimini, puis nous nous dirigeâmes sur Koroniodougou et Kangransou, deux villages mandé très propres où l’on semblait s’occuper avec activité du tissage et de l’élevage du bétail, partout fort prospère. Nous fîmes ensuite une petite halte dans un village kipirri nommé Samasokhosou (« village des perceurs d’éléphants ! ») où le chef nous fit un cadeau de 200 cauries ! regrettant, disait-il, que nous ne vinssions pas lui demander l’hospitalité. De là à Dombasou il n’y a que deux petits villages à traverser.
[215]Le village où réside Domba-Ouattara, chef du Djimini, est connu sous trois noms différents. On l’appelle indifféremment Dombasou, Dakhara ou Kaffoudougou.
Dombasou veut dire « village de Domba ». Dakhara signifie « campement, lieu où se trouvent le chef et l’armée, quartier général ». L’autre nom, Kaffoudougou, est tiré d’un village du Kipirri, qui est situé à quelques kilomètres dans l’ouest et qui, primitivement, servait de capitale au Djimini.
Dakhara n’est pas de création récente, à en juger par ses habitations délabrées et les ordures entassées à portée du village ; aussi le séjour n’en est-il pas précisément agréable. On peut cependant faire quelques promenades dans les sentiers menant à un fourré qui limite le village au sud et sur la bordure duquel poussent quelques citronniers et des pourguères (Jatropha curcas), que je n’ai vu nulle part atteindre un pareil degré de vigueur. J’ai trouvé des pieds ayant 25 centimètres de diamètre, de véritables troncs. On cueille les fruits pour en faire du savon ; les graines sont un violent émétique, l’huile qu’elles renferment purge à la dose de 10 à 12 gouttes : c’est un purgatif violent ; à dose élevée, c’est un poison. Les feuilles de la pourguère sont rubéfiantes dans quelques espèces. On ne se sert de la pourguère pour faire du savon qu’à défaut du cé, qui ne produit plus sous cette latitude, et de l’arachide, qui n’est cultivée que sur une trop petite échelle.
Dakhara étant un des derniers villages où l’on cultive le sorgho et pour ainsi dire la limite sud où le cheval peut vivre, je fis mettre en vente la jument de M. Treich. Il ne manquait pas d’amateurs, la bête étant plus belle que celles du village ; la grande question était d’en obtenir en payement autre chose que des cauries. Comme il n’y a que peu d’or, qui vient de l’Anno, il nous fallut accepter trois captifs, un homme déjà âgé et deux femmes de trente à trente-cinq ans, gens dont M. Treich se proposait de doter l’école d’Elima, près d’Assinie.
Domba-Ouattara est un petit vieillard dont la période d’activité est presque terminée, mais il a un frère, Brahima-Ouattara, qui a la physionomie et toutes les allures d’un vieux militaire : c’est à lui que reviendra le pouvoir. Le trouvant fort bien disposé à notre égard, j’usai de son influence pour amener son frère Domba à placer le Djimini sous notre protectorat.
Le vétéran, comme l’avait baptisé Treich, fut pour nous un excellent auxiliaire, et la veille de notre départ il décida son frère à signer le traité et à prendre notre pavillon.
Jeudi 31 janvier. — Domba nous fit diriger sur Iaousédougou et nous[216] adressa au chef du village kipirri qui est à l’ouest du village mandé.
Cette région est bien peuplée ; nous traversâmes successivement Samasokhosoufittini, Djimbaladougou, Sandiokhosou, appelé aussi Sibicoro (qui signifie « à côté des rôniers »), gros village sur la rive droite d’un ruisseau à eau courante, aux abords marécageux, qui porte le nom de Songounkô, puis Agouadougou, Natéré et Gouérécoro.
Tous ces villages ont un troupeau de bœufs, des chèvres et quelques moutons. On semble y cultiver avec succès le coton et le riz.
Dans le Djimini on fabrique beaucoup de poterie, réputée dans toute la région, à cause de sa parfaite cuisson, qui est exclusivement faite avec l’écorce du mana. Cette plante, arbuste dans certaines régions et arbre dans d’autres, ressemble comme écorce et feuilles au cé. Elle est bien connue de tous les indigènes, qui se servent des petites branches comme bois à frotter les dents. Sans la cuisson à l’écorce de mana et le vernis au sounsoun, la poterie n’a pas de valeur chez les ménagères soudaniennes.
Vendredi 1er février. — Entre Iaousédougou et l’Anno ou Mangotou, le Djimini porte le nom de Bandokho. Ce nom, comme je le supposais d’abord, ne correspond pas à un ou deux villages ; on peut dire qu’il s’applique à tout le district sud du Djimini, dont il fait partie et dont il est séparé par une ligne de collines peu élevées, traversées par de mauvais sentiers.
Comme j’étais mal renseigné et que le guide m’avait fait changer d’itinéraire, je perdis un jour, en faisant des étapes trop courtes. Par suite de ce malentendu, je campai le 1er à Konwi, le 2 à Niamaniondougou, et ce ne fut que le 3 que j’atteignis Kamélinsou, premier village de l’Anno.
Le Djimini m’a paru fort bien peuplé. J’estime la densité de sa population à 12 habitants par kilomètre carré. Elle est composée mi-partie de Kipirri (de race siène-ré), mi-partie de Mandé et de Kalo-Dioula (veï) venus de Diammara. On y cultive surtout le coton, à l’aide duquel on fabrique des étoffes toujours rayées bleu et blanc, d’un bon marché exceptionnel. Ces étoffes sont connues dans toute la boucle du Niger et donnent lieu à un mouvement d’affaires très important pour le Djimini ; elles se vendent presque à aussi bon marché que les cotonnades blanches du Mossi, auxquelles elles font, dans la région de Salaga, une très sérieuse concurrence. Les gens du Djimini s’occupent aussi de la vente du kola blanc, qu’ils vont prendre chez les producteurs mêmes ; ce fruit est cultivé avec succès dans l’Anno, comme nous le verrons plus loin. A l’aide du kola et des cotonnades, ils se procurent du sel et des captifs, qu’ils échangent, dans l’Anno, l’Indénié ou le Baoulé, contre de la poudre et des fusils ; ils alimentent[217] d’armes et de munitions les guerriers d’un Mandé nommé Morou, parti de Sakhala (Ouorodougou), qui ravage depuis quelques années le Tagouano. Je n’ai pu obtenir de renseignements précis sur cet aventurier ni sur le pays qu’il occupe, ce Morou n’ayant pas de résidence fixe et errant dans la région à l’instar des colonnes qui opèrent dans le Gourounsi.
Ce que l’on m’a affirmé, c’est que pour se rendre chez Morou on trouve d’abord une assez grosse rivière, nommée N’do, qui se jetterait dans un fleuve que les noirs appellent Isi et que l’on traverserait également. S’agit-il d’un affluent du Bagoé, ou de ce cours d’eau lui-même, ou bien d’affluents de droite du Comoë ? de la rivière de Dabou, ou même du Lahou ? c’est ce que je me suis demandé bien longtemps.
Pendant mon séjour à Aouabou chez Kommona Gouin j’ai obtenu quelques détails sur cette région et les cours d’eau qui la sillonnent. La rivière Ndo traverse le Diammara, colonie mandé de la famille veï, originaire du Ouorodougou et venue par le Kouroudougou et le Tagouano. Les familles ouattara de Diarawary, chef de village à Kong, et de Domba, chef du Djimini, viennent également du Diammara (qui veut dire « pays des étrangers »). Le Ndo, qui est peu important, se jette dans une grosse rivière nommée Nji et Isi, guéable en été, mais impossible à traverser pendant les hautes eaux ; on m’a dit qu’elle rejoignait la rivière de Mouoso (Grand-Bassam), mais c’est faux. Les indigènes identifient la lagune Ebrié avec le Comoë. Des gens qui connaissent Dabou m’ont affirmé que la rivière de Dabou porte le nom d’Isi ; elle traverse le Tagouano et le Bahouri ou Baoulé, auquel elle a donné un de ses noms, car l’Isi est connue aussi par les Mandé sous le nom de Baoulé.
Le Kouroudougou est arrosé par une rivière encore plus importante que l’Isi et qui porte le nom de Bandamma ; on la dit navigable et on la passe en pirogue presque toute l’année pour se rendre à Kanyenni. Les uns m’ont dit qu’elle recevait l’Isi, d’autres qu’elle rejoignait la mer (?) ; d’autres, enfin, m’ont assuré que c’est un cours d’eau distinct. Dans ce cas-là, ce serait la rivière de Lahou (voir le chapitre XVI).
Par suite de la route indirecte que j’ai suivie, je n’ai pu observer à loisir le mouvement commercial entre Kong et l’Anno, les marchands passant généralement par une route plus à l’ouest, celle qui traverse Koumarasou. Je puis cependant dire que l’article le plus importé par cette voie est le beurre de cé des Komono et surtout la ferronnerie de la région Bobo-Dioulasou. Le kola blanc, rapporté en échange, va beaucoup sur Kong, qui l’exporte sur Léra, Niélé et Bobo-Dioulasou ; ce fruit a son débouché plutôt vers l’est, car il s’en évacue de grandes quantités sur Bouna, Boualé,[218] Bondoukou et Salaga, qui fournissent en partie le sel à cette région.
Dimanche 3 février. — Kamélinsou, comme je l’ai dit plus haut, est le village frontière de l’Anno quand on vient du Djimini ; il est habité exclusivement par des Gan-ne, et porte pour cette raison aussi le nom de Gan-nesou. Nous fûmes reçus par un beau vieillard à barbe blanche qui s’empressa de nous faire installer de son mieux, car les cases de ce village sont fort mal entretenues. Les femmes et les jeunes filles se sont toutes crues obligées de nous faire un cadeau, de sorte que le riz, les ignames, bananes, papayes et poulets ne nous ont pas manqué.
Ce village, quoique d’un aspect misérable, a la réputation d’être riche. Beaucoup d’habitants en effet portent comme bijoux des pépites d’or. Ils m’ont aussi paru travailleurs et possèdent des plantations de kolas. Les femmes s’occupaient de la cueillette du fruit et triaient les kolas par grosseurs et par qualités. J’ai vu aussi à Kamélinsou préparer du savon avec le fruit du kobi, qui est assez commun par cette latitude.
Lundi 4 février. — Le chef de Kamélinsou, au lieu de nous faire conduire directement sur Mango (Gouènedakha), nous fit mener à Moroukrou ou Moroudougou, où résident deux chefs parents du roi de l’Anno. Comme ce détour me rapprochait du Comoë, sur lequel je voulais me procurer quelques renseignements, je ne fis aucune observation et me laissai conduire à Moroukrou[47], où nous fûmes bien accueillis par Lendou et Gouami, les chefs de l’endroit.
Le Comoë (rivière d’Akba) a ici plus de 100 mètres de largeur ; il est très fortement encaissé ; actuellement encore, il n’est pas guéable, et les perches ne peuvent servir à manœuvrer les pirogues que sur les rives. Les gens du village viennent y prendre leur eau ; les femmes descendent, pour la puiser, par un sentier presque à pic, qu’elles remontent avec adresse leur potiche sur la tête, ce qui serait presque un tour de force pour des Européennes.
D’après le dire de toutes les personnes que j’ai eu l’occasion d’interroger, le Comoë, dans la partie entre Nabaé à Moroukrou et de ce point à Attakrou[48], n’offrirait pas de difficultés à la navigation en pirogue ; les indigènes n’utilisent pas le fleuve pour leurs communications ; ils donnent comme raison qu’ils ne sont pas experts dans la fabrication des pirogues ; en cela je suis absolument d’accord avec eux : les embarcations que j’ai[219] vues sont toutes grossières, massives et peu maniables ; avec de telles pirogues il ne faut pas songer à naviguer, elles sont tout juste bonnes à traverser la rivière.
En revenant du Comoë, les gens du village nous firent voir l’endroit où les guerriers de l’Anno ont vaincu ceux du Bondoukou, il y a environ soixante ans, sous le règne de Diané, qui, dans cette affaire, tua Sofié, le chef du Bondoukou, un des prédécesseurs d’Ardjoumani.

Femmes puisant de l’eau au Comoë.
Mardi 5 février. — Le lendemain, Gouami nous fit faire étape dans le centre le plus important de l’Anno. S’il existe une question embrouillée pour le voyageur, c’est bien celle de la dénomination de ce marché. Beaucoup de Mandé désignent le centre commercial de la région par Mango, et la région sous le nom de Mangotou (brousse de Mango) ; l’un et l’autre de ces noms sont impropres, car le pays est appelé par ses habitants Anno depuis Kamélinsou jusqu’aux frontières de l’Indénié, et le centre commercial désigné sous le nom de Mango en mandé se nomme ou Groûmania ou Gouènedakha : Groûmania est le nom agni ; Gouènedakha, le nom gan-ne. D’autres appellent aussi Mango Koffésou, quoique ce nom ne se rapporte en réalité qu’à une sorte de faubourg habité par les autochtones.
[220]C’est dans ce faubourg de Koffésou ou Koffikrou (en agni) que l’on nous fit loger. Il n’est éloigné de Groûmania que de quelques centaines de mètres, ce qui me permit d’y aller pendant la grosse chaleur. Des amis que j’y rencontrai me conduisirent chez quelques notables mandé et eurent l’obligeance de me présenter et de me recommander au personnage le plus influent de la ville, à Ahmadou Sakhanokho, dont l’amitié me fut très précieuse lorsque le moment vint de traiter avec le chef de l’Anno.
Groûmania, ou Gouènedakha, ou Mango, ou Koffésou, est composé de trois agglomérations d’habitations.
Au nord, et séparés du village principal, se trouvent deux groupes de cases habités par quelques Gan-ne et quelques gens de race agni ; c’est une espèce de faubourg, nommé Koffésou en mandé ou Koffikrou en agni (Koffi est le nom du chef, et la terminaison dans les deux langues veut dire « maison de »).
Cette ville, irrégulièrement bâtie, comme presque tous les centres de ces régions, est bien située, et entourée de plantations ; on y trouve quelques cocotiers et un ou deux orangers. Groûmania est dans la zone de transition, entre la végétation peu couverte de la région Kong et celle, si dense et si touffue, du bassin inférieur du Comoë. Aux environs, on voit de fort beaux sites, surtout sur les bords du Comoë, près de Siripon et d’Assouadé. En quittant Moroudougou ou Moroukrou, surtout, je fus agréablement surpris en traversant de grandes oasis boisées d’essences rappelant nos hêtres et nos frênes, avec le sol tapissé de petites pousses de toute nuance, produisant un amalgame de tous les verts que l’on puisse rêver.
On ne saurait croire combien une plante ressemblant aux nôtres peut agir sur le moral de ceux qui, depuis longtemps, ont quitté l’Europe : tout se réveille, la patrie vous apparaît, la famille, les amis, le cœur bat fort ; bien que faible, exténué, on se sent revivre ; ces joies sont trop courtes, hélas ! et pendant qu’avec ce brave Treich nous nous laissions aller aux doux rêves du retour, devant nous défilaient, comme pour nous rappeler à la réalité, les troncs dépouillés des arbres à fou, dont l’écorce sert à confectionner les vêtements des Gan-ne et des Agni. De temps en temps, une échappée laissait entrevoir des friches de bananiers, des fouillis d’ananas ou encore une plantation de kolas ; plus loin apparaissaient de petites clairières à peine couvertes d’un chaume rabougri et de quelques termitières avec un gigantesque bombax, dernier survivant d’un village peut-être jadis prospère, mais dont le nom même a échappé aux habitants.
Je ne veux pas quitter Groûmania sans donner au lecteur une idée du[221] mouvement commercial de ce lieu, qui passe pour le plus honnête du monde noir. La loyauté des gens de l’Anno est proverbiale : on peut laisser un colis en souffrance dans un chemin quelconque, il ne sera sûrement pas volé ; l’habitant s’en charge volontiers et le remet consciencieusement à son chef de village, qui jamais n’en disposera et sera toujours prêt à le faire remettre à son destinataire à la première réquisition de ce dernier.
L’industrie de Groûmania consiste surtout en tissage et teinture. On semble s’être spécialisé à fabriquer l’article si avantageux du Djimini : la cotonnade commune blanche à raies bleues, qui fait une si sérieuse concurrence aux produits similaires blancs du Mossi.
Les Mandé de Kong, de Bouna, de Boualé y importent beaucoup de ferronnerie tirée des pays siène-ré et de la partie nord des États de Kong ; en échange, ils se procurent les tissus dont je viens de parler, ou bien alors le kola blanc. Son abondance et son bon marché excessif lui permettent de supporter trente jours de transport et d’atteindre Bobo-Dioulasou ou Salaga en donnant de très gros bénéfices. Dans les villages du Mangotou (alentours de Groûmania), ce kola ne se paye qu’une caurie pièce ; rendu à[222] Salaga, il se vend en gros 25 cauries, et en détail jusqu’à 40. En échange, on prend généralement, dans ces deux autres centres, du sel, qui se vend à Groûmania un prix exorbitant, les communications avec le littoral du golfe de Guinée étant devenues très difficiles, pour des raisons que nous indiquerons dans la suite de notre relation.
A côté de ce mouvement commercial très actif, l’Anno produit le fou en quantité considérable. Le fou est l’écorce d’un arbre qui atteint de grandes dimensions ; le tronc a l’aspect d’un tronc de hêtre. C’est peut-être le même arbre que Schweinfurth signale dans l’Ouganda, l’Oungoro et chez les Monbouttou. Ce voyageur le nomme rokko. C’est probablement l’Urostigma Kotschyanum. La façon de préparer le fou est bien originale : avant de détacher l’écorce du bois, on la bat avec un maillet allongé couvert d’encoches formant des rainures. Cette première opération a pour but de détacher l’enveloppe extérieure de l’écorce, la partie rugueuse qui constitue, à proprement parler, l’épiderme. Ce travail terminé, l’écorce, qui a un aspect rougeâtre, est battue avec des maillets plats sans encoches, afin de la détacher du tronc ; puis, par une série de battages, on arrive à la rendre tout à fait souple et malléable.
Elle présente alors l’aspect d’un grossier tissu dans le genre des nattes en fibres de palmier tressées sur le littoral, ou des tapa des mers du Sud, mais son épaisseur varie entre 3 et 5 millimètres.
Le prix du fou est proportionné à sa surface : j’en ai vu de 3 à 4 mètres carrés.
On en confectionne presque tous les vêtements, surtout le pagne pour femmes, des sacs, des musettes, des bonnets, etc., que l’on teint soit en rouge brun, soit en bleu indigo. Les petits morceaux, les déchets, sont utilisés comme serviettes. Dans le pays de Kong, personne ne sort sans une bande de fou, avec laquelle on éponge la sueur et on se lave. Les très gros morceaux sont utilisés comme emballage, et servent à l’occasion de stores, de portes, de nattes pour dormir, et le plus souvent à réparer les toits que les intempéries ont endommagés.
Les femmes s’occupent beaucoup d’exploiter les feuilles d’ananas, en confectionnant du fil avec ses fibres. Mis en écheveaux, il est vendu écru ou teint en rouge minium à l’aide du kola, ou en bleu avec l’indigo, ou encore en jaune avec le souaran. Ce fil sert aux musulmans à broder les coussabes, les bonnets, les pantalons. A Bobo-Dioulasou, un écheveau d’une douzaine de fils de 1 mètre coûte près de 500 cauries.
Enfin, une des spécialités des marchands de l’Anno est de fournir les armes et surtout les poudres à petits grains, qu’ils tirent d’Assinie et[223] de Grand-Bassam et qui sont les plus appréciées dans toute la boucle du Niger.
Malheureusement, il y a souvent pénurie, les communications vers la mer laissant toujours à désirer et les pays Sanwi étant surtout trop protectionnistes. On peut dire qu’il est presque impossible aux hommes de l’Anno d’arriver à nos comptoirs. Quand nous leur aurons ouvert une route sûre vers la mer, le chiffre d’affaires de nos compatriotes de la Côte se quintuplera.
Mercredi 6 février. — Koffi refusa absolument de nous introduire auprès de Kommona Gouin ou Cabran Gouin, chef de l’Anno, qui réside à Aouabou. Il faut nous rendre au préalable à Boniadougou, où réside Diamdiane, un chef qui jouit de quelque considération dans la région. J’avais bien peur d’être forcé d’accepter son hospitalité, et de subir de nouveaux retards, mais ce brave homme, en nous voyant, Treich et moi, n’a insisté que mollement. La vue des visages pâles a eu l’air de l’impressionner assez fortement pour ne lui permettre de nous regarder qu’à la dérobée. Après l’avoir salué et pris congé de lui, nous nous dirigeons vers le sud-est sur Aouabou, qui n’est éloigné de Boniadougou que de quelques kilomètres.
Aouabou, résidence du souverain de l’Anno, est un bien misérable village, comprenant une trentaine de cases rectangulaires qui abritent la famille royale et quelques captifs de Kommona Gouin.
Sur une place, devant l’habitation royale, se trouvent deux baobabs entre lesquels est une grosse pierre qui supporte un chaudron en cuivre de 1 m. 20 de diamètre. Il y a bien un mois qu’on me berce de cette douce surprise : « Voir la marmite d’Aouabou, qui est tombée du ciel ».
J’ai beau m’évertuer à l’examiner, jamais je ne pourrai me persuader que je suis en présence d’un aérochaudron : il a bel et bien été fabriqué en Europe et même à une époque qui ne doit pas être reculée de plus de deux cents ans. Quel est l’individu qui a pu avoir la constance de le charrier de la mer ici ? Je l’ignore ; toujours est-il qu’il est là, et qu’il fait et fera encore l’admiration de plus d’une génération. Une pierre en guise de billot qui se trouve à côté indique suffisamment qu’il y a à peine une trentaine d’années, au temps où les mœurs achanti étaient encore en vigueur, la pierre et la marmite servaient de lieu de sacrifice. Actuellement, et depuis que l’islamisme s’est infiltré dans la région par les Mandé, ce chaudron n’a plus que le rôle d’oracle : les sorciers du roi le consultent la nuit quand il y a de graves décisions à prendre.
Il n’est pas étonnant que les gens d’Aouabou considèrent plutôt ce[224] chaudron comme tombé du ciel que fabriqué par des Européens, puisque dans la plupart des pays que j’ai visités on ne nous croit pas assez adroits pour faire des fusils. A peu près partout on regarde l’Européen comme un simple intermédiaire entre le noir et des êtres surnaturels habitant dans les profondeurs de la mer qui, seuls, seraient, aux yeux de ces populations ignorantes, capables de fabriquer un canon de fusil ou des soieries.
Cela tient à une fausse interprétation des ouvrages musulmans qui ont pénétré chez les peuples noirs. On y dit : « De l’autre côté de la mer habitent les blancs ». Le noir ne comprend pas qu’il s’agit d’une distance en largeur, il est persuadé que c’est après avoir traversé une couche d’eau considérable en profondeur, qu’on atteint les pays peuplés de blancs. J’ai déjà eu l’occasion de raconter plus haut que l’on me croyait amphibie. Le seul fait de prendre mon tub une fois par jour et de saisir souvent ce prétexte pour éloigner les êtres gênants qui ne me laissaient pas de répit, faisait dire à ces braves gens que pour moi l’existence n’était possible qu’à la condition de passer une partie de la journée au fond de l’eau dans une grande calebasse en toile.
A Aouabou, Treich et moi, nous fûmes reçus royalement. Nous avons été hébergés et nourris par les soins de Kommona Gouin, qui nous fit donner à plusieurs reprises du mouton, et, quelques jours avant notre départ, un bœuf qu’il envoya prendre dans un de ses villages.
Dès la seconde entrevue, et après lui avoir fait un joli cadeau, auquel il répondit du reste en m’envoyant trois pépites d’or, je crus devoir le pressentir sur l’importance qu’il y avait pour lui à se placer sous notre protectorat — comme venaient de le faire le Bondoukou, les États de Kong et le Djimini. Dans une première réunion, qui ne comprenait que quelques chefs des villages voisins, il me demanda de nouveaux délais afin de pouvoir réunir tous les personnages influents de son pays. Pressé par moi, il fit cependant diligence en expédiant de suite des courriers ; de sorte que je n’eus à séjourner en tout que douze jours à Aouabou. Ces lenteurs me donnèrent le temps d’étudier un peu la région et ses habitants.
L’Anno est habité par trois peuples de races distinctes.
Les plus anciens sont les Gan-ne. Ils semblent n’avoir jamais habité que les épaisses forêts de la région où viennent le kola et le palmier à huile. Leur type est caractérisé par une taille au-dessous de la moyenne, une figure ronde et pleine, une peau d’un brun chocolat. J’en ai vu trop peu pour les esquisser comme je le voudrais ; on n’en rencontre guère que quelques-uns par-ci par-là dans les villages, ou encore dans la forêt, portant des charges de fou, de kolas ou d’amandes de palme.
[225]
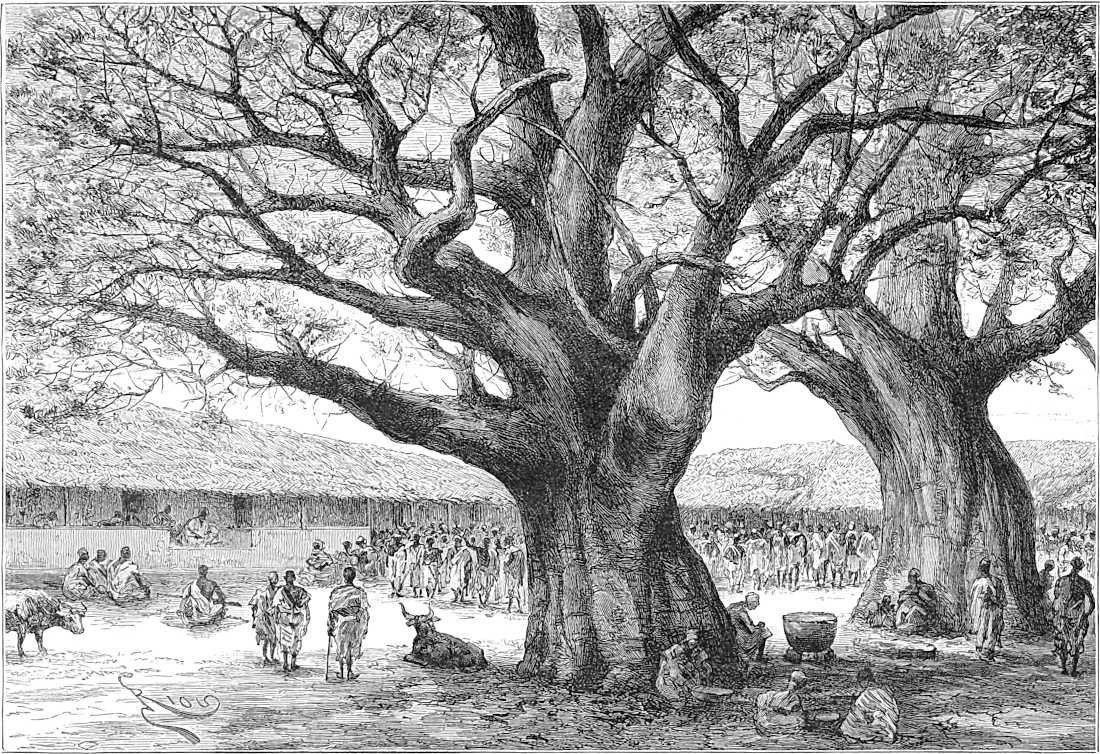
Aouabou : la demeure royale.
[227]Dans ces forêts épaisses, presque dépourvues de sentiers, on ne peut songer à employer des animaux pour les transports, ils ne pourraient passer : tout transport doit se faire à dos d’hommes, sinon en pirogue.
Du reste le cheval et l’âne ne pourraient y vivre. La végétation est tellement vivace, que les graminées atteindraient hauteur d’homme quelques jours après les semailles. La tige serait gigantesque, mais ne produirait pas de graines ; il faudrait se livrer à des défrichements perpétuels ; les lianes et les jeunes pousses envahiraient les cultures et étoufferaient les graminées. Le sol est tapissé de jeunes pousses d’arbres et de bouquets d’ananas, mais on n’y voit pas un brin d’herbe.
Les lianes sont très nombreuses, les branches enchevêtrées les unes dans les autres ; il est impossible de porter sur la tête, les charges tomberaient à tout instant. C’est pourquoi les Gan-ne organisent leur fardeau en hotte — deux lianes servent de bretelles. De cette façon ils ont les mains libres et peuvent se frayer un passage en écartant les lianes ou en les coupant à l’aide d’un long couteau qu’ils portent toujours à la main. Ces couteaux sont de différents modèles. La lame varie de 35 à 50 centimètres de longueur. Les Gan-ne se servent de cette espèce de sabre d’abatis avec une grande adresse. Quelquefois ils fabriquent une grossière gaine en cuir pour y mettre l’arme, et généralement ils l’ornent de deux ou trois coquilles d’huîtres teintes en rouge, qui proviennent de la Côte.
La coiffure des hommes et des femmes gan-ne est celle des Siène-ré. Les hommes ont la chevelure arrangée de toutes les façons et très souvent ornée de perles et de pierres, de petites cordelettes à nœuds et autres ornements.
Les Gan-ne habitent surtout les confins du Baoulé et semblent s’être retirés devant l’arrivée des migrations agni dans l’Anno. Les Agni de l’Anno ont une origine commune avec les Agni de l’Abron (le Bondoukou méridional), de l’Indénié, du Morénou, de l’Alangoua, du Bettié, du Sahué, du Sanwi (pays de Krinjabo), de l’Akapless, des confins de l’Ahua (Apollonie), et même de ceux qui habitent le cours inférieur de la rivière Bandamma (rivière de Lahou), aux environs de Tiassalé (voir le chapitre XVI).
Les Mandé appellent Ton ces gens de race agni ; c’est une appellation impropre : les Ton habitent le Bondoukou central et parlent l’achanti presque pur, tandis que les Agni de l’Anno parlent la même langue que les gens de Krinjabo ; en un mot, ils sont de même famille que les habitants de l’Abron et de l’Assikaso, qu’on nomme Bouanda. Le vrai nom, le nom des indigènes par lequel ils désignent et le peuple et sa langue, c’est Agni.
[228]Les hommes de cette race sont très propres ; ils passent une bonne partie de la journée à se baigner et à se savonner en se servant de fibres d’arbres ou de fou comme éponge. Après chaque bain ils se graissent le corps avec du beurre de cé dans lequel ils introduisent volontiers du musc ou toute autre forte odeur. Il est très rare que les gens de race agni se rasent la tête ; ils ont tous une coupe de cheveux à peu près uniforme : cheveux coupés courts (environ 2 centimètres), de façon à pouvoir les peigner, ce qui est une de leurs grandes occupations.
On peut dire que ces gens tiennent le milieu entre l’Achanti et le Gan-ne. Ils se distinguent surtout de ces derniers par un plus grand luxe dans les vêtements ; en général, ils ne se servent que des cotonnades mandé, tandis que les Gan-ne, à part le fou, ne portent guère que des vêtements en coton teints en bassi (rouge brun). Cette couleur, qui peut être presque considérée comme un indice ethnographique, me paraît importée chez eux, et l’on aurait tort d’y voir un lien de parenté avec la race mandé. Ces derniers, qui ont beaucoup de relations avec les régions productives du kola, ont fort probablement introduit cette teinture chez eux ; en tous cas, l’arbuste nommé bassi n’existe pas dans cette région.
Les peuples de race agni et les Gan-ne semblent, à force d’avoir vécu en commun, s’être adonnés aux mêmes pratiques superstitieuses. Quantité d’objets et d’animaux, et en général tout ce qui est blanc, est fétiche et sacré : les œufs, les poules blanches, certains arbres, etc. Cette coutume s’étend même souvent à des femmes et à des hommes qui, pour se distinguer des profanes, se bariolent de blanc avec de la cendre délayée dans de l’eau.
Ces individus voués au fétiche sont consultés comme oracles dans beaucoup de cas ; ils sont maîtres en l’art d’empoisonner et pratiquent la médecine.
Lorsqu’un malade a besoin du ministère d’un de ces médecins-sorciers, il le fait mander.
L’homme de l’art pose d’abord un fétiche devant le malade, généralement une statuette en bois représentant un homme ou une femme grossièrement exécutée, à laquelle il ne manque jamais les détails anatomiques intimes. Puis le médecin bariolé de blanc danse une sarabande désordonnée autour du malade, et se fait montrer le siège du mal. Après un court massage, il ne manque jamais de retirer du membre malade une éclisse ou un fragment d’os qu’il avait eu soin de dissimuler dans une de ses mains. Le malade ne manifeste aucun étonnement de se voir retirer de sa jambe ou de son ventre un corps étranger, sans incision apparente,[229] et — ce qu’il y a de bien curieux — neuf fois sur dix il se dit guéri !
Si la religion de ces peuples se bornait à ces sottes pratiques, elle serait bien inoffensive, malheureusement les sacrifices humains existent encore chez eux. Ils ont cependant la pudeur de les cacher aux yeux des Européens.
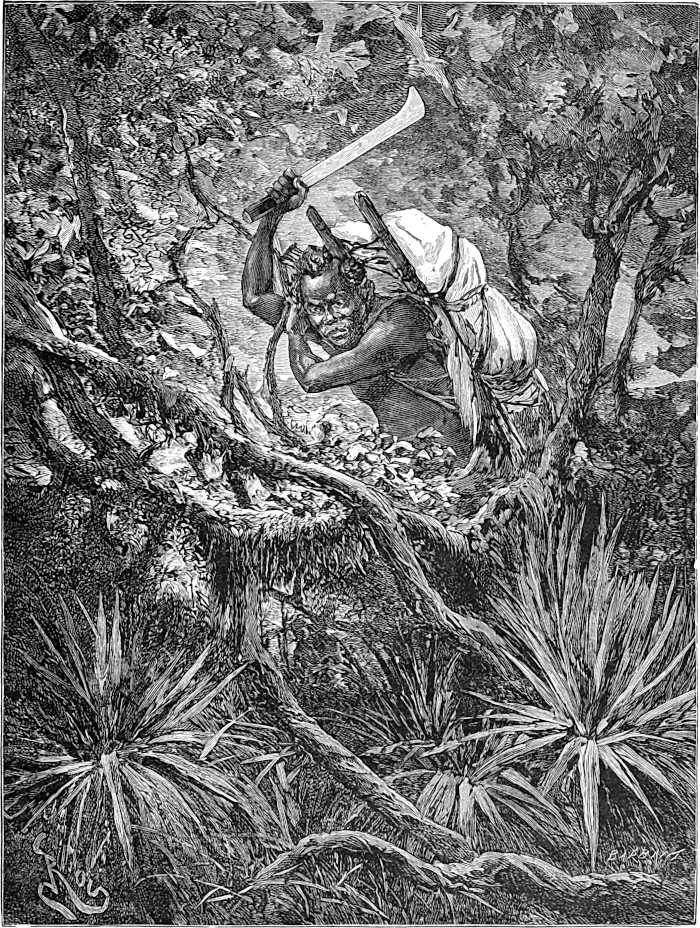
Un Gan-ne dans la forêt.
[230]A la mort de tout souverain ou personnage de marque, on immole quelques victimes, généralement une partie des esclaves du défunt ; puis, pour fêter sa mémoire, ses parents et amis se livrent à des orgies qui ne prennent fin que quand ils ont mangé et bu tout ce qu’ils ont trouvé dans le pays.
On tue les bœufs et les moutons ; le vin de palme et le gin coulent à flots.
Très fréquemment aussi, j’ai vu des femmes porter une poupée en bois serrée dans le dos comme si c’était leur enfant. C’est, paraît-il, un remède infaillible contre la stérilité. Chez d’autres peuples, les Wolof par exemple, les jeunes filles portent aussi quelquefois, en guise d’enfant, un tibia d’animal orné de perles. Je n’ai jamais manqué l’occasion de demander à mon domestique Diawé ce que cela signifiait, afin de m’attirer cette réponse qui me faisait sourire chaque fois : « Ça il y a trop bon pour gagner petit ». Quels heureux peuples que ces noirs : ils ont des remèdes pour tout.
Le blanc est toujours une couleur fétiche. C’est ainsi qu’il y a des pierres et des arbres fétiches, et que certaines îles des lagunes près de Grand-Bassam sont considérées comme telles, à cause de quelques roches blanches qui s’y trouvent.
Les poules blanches sont d’excellents fétiches, et en avaler un œuf est toujours de bon augure.
Dans toute cette région, quand les indigènes ont à vous remercier pour un cadeau que vous leur avez fait, toute la famille et les amis viennent vous dire merci et déposer devant vous un petit caillou, une motte de terre ou encore une paille ou un morceau de bois, en disant « Naçio ».
Dans le Gourounsi j’avais déjà vu une pratique de ce genre ; les indigènes, pour vous demander un cadeau, vous mettent dans la main un de leurs instruments ou outils, ou bien vous le suspendent à l’épaule.
Les villages gan-ne et agni de l’Anno sont presque tous construits d’après un même type, et forment généralement une grande rue unique. Les habitations et leur ameublement sont analogues à ceux décrits dans le Bondoukou, mais construits avec moins de soin et mal entretenus. On trouve, dans presque tous les villages, un ou deux bancs d’une dizaine de mètres de longueur sur lesquels on s’assied pendant les veillées ; ces bancs sont aménagés tout simplement à l’aide de deux troncs d’arbres montés sur un chevalet ; l’un sert de siège et l’autre de dossier.
Les Gan-ne et les Agni ont aussi le banan ou benteng des Mandé, ce fameux hangar où les oisifs viennent se reposer pendant les heures chaudes. Le grenier de ces hangars sert de magasin à ignames ou à maïs.
L’Anno ne se nourrit pour ainsi dire que d’ignames et de bananes,[231] les céréales n’y viennent pas. Ce pays a aussi fort peu de bétail ; cinq ou six villages à peine possèdent quelques vaches, les autres n’ont guère que des moutons et des chèvres.
Les abords des villages sont couverts de broussailles et de bois dans lesquels circulent d’étroits sentiers conduisant aux défrichements, jardins à bananes, à manioc, ou champs d’ignames. Ces deux végétaux forment la base de l’alimentation des peuplades forestières de l’Anno.
Aux quatre points cardinaux du village se trouve un endroit aménagé pour y servir de watercloset ; ou bien c’est une sorte d’échafaudage fait de troncs d’arbres, ou encore un arbre coupé, le long duquel on a creusé un fossé, ou bien encore de véritables fossés avec feuillée, tels qu’on les fait construire dans les campements par les troupiers. Ces endroits se nomment bacaso en langue agni, ce qui veut dire : « l’endroit du morceau de bois ».

Un indigène de race agni faisant sa toilette.
On trouve peut-être ces détails un peu oiseux, mais il est si rare, dans ces pays, de rencontrer des gens propres, qu’il serait injuste de ne pas leur rendre justice.
J’ai vu aux abords d’Aouabou et de plusieurs autres villages, généralement dans le coin de quelque bananeraie, des tombes, au-dessus desquelles est disposé le plus souvent un petit hangar en clayonnage[232] recouvert de chaume, ou bien encore la tombe est dissimulée par une série de branches qui se croisent au sommet.
Dans une ou deux cases, un peu à l’écart du village, se retirent les femmes à une certaine époque. Pendant tout ce temps la femme est considérée comme impure et aucun homme n’a de commerce avec elle.
L’Anno comprend aussi quelques colonies mandé venues du Diammara, du Kong et du Kouroudougou, qui se sont surtout fixées à Groûmania. Ces colonies ont toujours été très puissantes ; elles ont fourni de nombreux contingents lors des guerres qu’ont soutenues le Dagomba, le Mampoursi et le Gondja contre le souverain de Nalirougou.
On sait, comme je l’ai dit plus haut, que les guerriers mandé de Groûmania sont restés sur le théâtre de la guerre et ont obtenu de grandes concessions de terrains sur la route de Yendi au Haoussa, où ils ont créé un centre très important encore et dont l’existence nous a été révélée par les itinéraires par renseignements de Barth. Cette ville s’appelle toujours « le Camp de Mango », Sansanné[49]-Mango. Les chefs actuels de Sansanné Mango sont encore des Ouattara.
Quand la puissance achanti est tombée, d’autres Mandé ont quitté l’Anno et ont fondé des colonies dans le Barabo (rive gauche du Comoë, à l’est de l’Anno). Cette colonie mandé du Barabo est placée sous l’autorité d’Ardjoumani, comme nous l’avons vu.
Pendant notre séjour à Aouabou je me rendais souvent chez Kommona Gouin pour le saluer, lui parler de la France et du commerce des Européens, ce qui l’amena à me confier que depuis longtemps il avait le désir d’entrer en relations avec nos comptoirs de Mouoso (Grand-Bassam). Voici à peu près en quels termes je l’ai engagé à traiter :
« La protection que nous avons accordée à Amatifou (ex-chef du Sanwi) et que nous continuons à son successeur Aka Simadou, est un sûr garant que nous ne voulons pas la guerre et que nos intentions sont tout ce qu’il y a de plus pacifique. Ce que je suis venu faire dans ces régions, tous, vous l’avez compris : je veux vous aider à vous passer des nombreux intermédiaires et courtiers qui vous enlèvent le plus gros de vos bénéfices, et, par un accord entre nous, vous faciliter l’accès de nos comptoirs. » Il s’engagea à ouvrir une route suffisamment large de Groûmania à Attakrou (premier village de l’Indénié) et ne concéda le droit de venir commercer dans son pays qu’à nos nationaux.
[233]
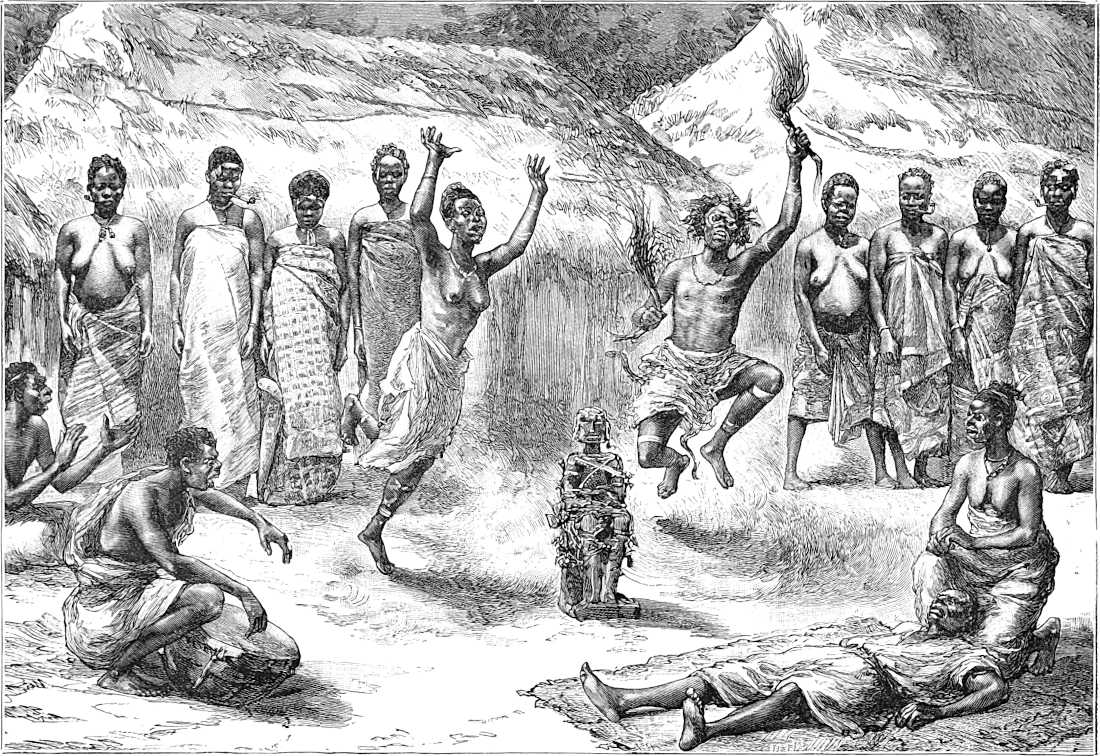
Un malade en consultation.
[235]Cet homme, comme généralement tous les chefs âgés, est un brave et digne homme ; il a toute ma sympathie. Il est retiré dans son petit village d’Aouabou, à la porte de Groûmania, et a l’air d’administrer honnêtement son pays ; partout on nous a fait l’éloge de sa probité et de sa façon de gouverner. Sa bonté est proverbiale.
Son intérieur est très modeste : il se tient presque toujours dans un hall formé de quatre petites cases rectangulaires. L’une renferme le panier dans lequel le transportent quatre vigoureux gaillards quand il se déplace, quelques lances, des fusils à silex et une belle peau de panthère, cadeau du chef de Bouna. Une autre case contient toute une série de tam-tams autour desquels sont amarrées quantité de mâchoires humaines, derniers trophées de la guerre que Diané, ancêtre du chef, livra à Fofié, un des prédécesseurs d’Ardjoumani, qui fut tué à Moroukrou deux jours après avoir traversé le Comoë. La mâchoire de Fofié est attachée au plus gros tam-tam.

Type d’un village gan-ne ou agni.
Cette demeure royale n’est ni gaie ni séduisante, et ce n’est pas la présence de Kommona Gouin qui l’égayera. Habillé en musulman, coiffé d’une grande chéchia rouge, il est toujours assis sur une sorte de chaise, entouré d’un ou deux de ses enfants. Le pauvre roi est presque aveugle ; il porte une barbe blanche à peine cultivée dont l’extrémité (la barbiche),[236] teinte en rouge au henné ou avec du jus de kola, est roulée sur elle-même et forme une assez grosse pelote, ce qui lui donne un air tout à fait grotesque.
Le cadre d’un palabre n’augmente guère le faste royal de la cour d’Anno. Le public est plus nombreux cependant, et c’est un peu plus original, la parole n’étant portée que par les porte-canne, sorte de factotums qui ont en main une canne sculptée et ne font que répéter les paroles du roi ou des intéressés qui viennent solliciter une mission ou en rendre compte. Dans ces palabres souvent il y a aussi des individus faisant fonction d’huissiers : ils indiquent les places à occuper par les assistants, leur font donner des tabourets, en un mot s’occupent de l’ordre des préséances, etc. ; on reconnaît ces individus à une tête de singe qu’ils portent suspendue au cou : c’est la chaîne de nos huissiers.
Comme je logeais chez Acra, le premier porte-canne de Kommona Gouin, et qu’il parlait mieux le mandé que son souverain, je réussis à me procurer les noms des chefs qui ont précédé le roi actuel.
Le plus ancien en date dont on se souvienne dans l’Anno se nommait Diâné ; c’est celui qui a tué Fofié (roi du Bondoukou). D’après l’âge de deux vieillards qui disent l’avoir vu quand ils étaient enfants, il devait régner vers 1823.
| Puis vinrent : | Morou, jusqu’en 1835 ; |
| Diamdiâne, jusqu’en 1842 ; | |
| Bomma, jusqu’en 1849 ; | |
| Famissa, jusqu’en 1856 ; | |
| Bomma Koummonaba, jusqu’en 1875 ; |
Et enfin Kommona Diaou, ou Kommona Gouin, ou Cabran Gouin, chef actuel.
A ce dernier succédera son frère Diangoué, qui est le prince héritier.
Depuis l’avènement de Diâné, les chefs de l’Anno ont toujours été musulmans. Avec l’avènement de ce chef et sa conversion à l’Islam il s’est produit une grosse perturbation dans le mode de succession au trône. Avant, le prince héritier était toujours, comme chez les peuples de race agni, le neveu (fils de sœur) du roi, tandis qu’en ce moment la succession, tout en étant latérale aussi, comprend d’abord les frères par rang d’âge, puis l’aîné des fils de frère, — quand les choses se passent normalement, car très souvent le pouvoir est usurpé, comme dans tous les gouvernements nègres.
Situation politique. — Avant la décadence de l’Achanti, l’Anno était l’allié de la cour de Koumassi et agissait de concert avec elle contre le[237] Bondoukou et l’Abron, de sorte que jamais l’Anno n’a vécu en bonne intelligence avec ses voisins de la rive gauche du fleuve ; ils ne se font cependant pas la guerre, grâce à la médiation des Mandé musulmans de Groûmania et du Barabo : il n’y a jamais de gros conflits ; leur animosité mutuelle ne se traduit que par des confiscations de marchandises qui s’opèrent généralement dans l’Indénié.

Kommona-Gouin.
L’Anno a aussi de temps à autre des démêlés avec le Baoulé, mais ces querelles ne sont que locales et ne s’étendent guère qu’aux gens du Baoulé qui habitent Amakourou, à deux étapes dans l’ouest de Ndiénou. En somme, ce pays est très tranquille ; il est même fort heureux pour nous que l’Anno ne soit pas l’allié du Bondoukou, chacune de ces régions ayant une importance considérable par ses voies de communication qui débouchent de l’Indénié. En cas d’hostilité ou de guerre dans l’un des deux pays, on peut prendre ou la rive droite ou la rive gauche du Comoë.
J’ai donné, au chapitre Bondoukou, les principales routes de l’Abron et du Bondoukou par la rive gauche du Comoë ; voici d’autre part les communications qui existent entre l’Anno et l’Indénié par la rive droite de ce même fleuve.
En dehors de la route que je me propose de suivre, par Ndiénou et[238] Zouépiri sur Attakrou ou Béniékrou (premier village de l’Indénié), communication la plus occidentale, il existe une autre route assez fréquentée également, qui mène presque, en longeant le Comoë, de Groûmania à Annibilékrou (Assikaso, partie méridionale de l’Abron). Ce chemin passe à Ahouan et traverse le Comoë près de Duhinabo, un peu en aval du confluent de la rivière Yéfou.
D’autres sentiers mènent des villages situés entre Zanzanso et Zouépiri par Abé (passage du Comoë) également sur Annibilékrou. Ces chemins, dépourvus de villages et occupés par des chefs quelquefois très exigeants pour les marchands, ne sont pas très sûrs, de sorte qu’en général on préfère se diriger sur Attakrou ou Eléso[50], où commence la navigation en pirogues du Comoë. De ces deux points, on peut descendre le fleuve en pirogue ou bien faire la route à pied.
Vendredi 15 février. — Le séjour à Aouabou, qui commence à me peser d’une façon excessive, tire heureusement à sa fin. Dans l’après-midi, pendant un grand palabre, on a accepté tous les articles du traité que j’ai présenté. Les dernières hésitations ont été levées grâce à l’intervention de mon ami Ahmadou Sakhanokho, le notable mandé de Groûmania, qui a voulu signer à côté de Kommona Gouin.
Le soir, on a fait un tam-tam de quelques heures et l’on s’est séparé après de nombreuses poignées de main. Le roi voulait me faire prolonger mon séjour de quelques jours encore, et le lendemain je dus faire usage de tous les arguments possibles pour lui démontrer l’importance que j’attachais à un départ prochain.
A notre très grande satisfaction à tous, il se décida pour le dimanche suivant. Cette vie d’attente était insupportable ; nous avions tous hâte d’atteindre la mer, que je faisais entrevoir à mes hommes depuis deux ans comme le terme final de nos tribulations.
Samedi 16 février. — Depuis hier soir nous vivons dans l’abondance ; les gens du village viennent de nous amener un bœuf et des moutons, cadeau de Kommona Gouin. Nous avons tout fait abattre par notre hôte Acra, le porte-canne du roi, qui est musulman, pour pouvoir offrir de cette viande au roi et à sa maison. Nous nous réservons seulement un mouton, auquel je fais couper le cou par un de mes hommes non musulman afin de ne pas en distribuer, ou, pour parler franchement, ne pas être obligé d’en offrir, car nous allons bientôt n’avoir que du poisson sec et du singe boucané.
[239]

Palabre à Aouabou : signature du traite.
[241]Un chasseur a rapporté une antilope qu’il venait de tuer dans un champ d’ignames ; c’est une variété que je n’avais pas encore rencontrée et qui ne vit que dans les grandes solitudes boisées du Comoë.
Très bas de jambes, les cornes tout à fait inclinées en arrière, de manière à ne donner aucune prise aux branches ni aux lianes, cet animal semble avoir été créé exprès pour vivre dans les fourrés. Il mesure environ 70 centimètres au garrot. Son pelage est très foncé et ne comporte que des poils très courts et clairsemés. La chair est fortement musquée.
Nous en avons acheté un gros morceau pour nos dernières 400 cauries, car Aouabou est le dernier village vers le sud où ces coquilles aient cours : ailleurs la monnaie consiste en poudre d’or et en pépites ; mais les dénominations des poids et valeurs ont changé : on emploie déjà ici le système de Krinjabo, d’Assinie et de Grand-Bassam, qui diffère de celui de Bondoukou, de Salaga et de Kong.
A première vue et sans approfondir les étymologies, les poids et appellations de cette région semblent n’offrir aucune relation avec le mitkal, ses subdivisions et ses multiples, qui sont, comme j’ai eu l’occasion de le dire plus haut, d’importation et d’origine arabe.
Cependant on est frappé de voir que là aussi l’unité des forts payements correspond au barifiri des Mandé (4 mitkal) ; en effet, en agni, 16 grammes d’or ou demi-once se nomme anraé, et l’once (32 grammes) se dit anra niua, mot à mot : anra deux : anraé est donc un radical. Cela prouverait bien que, dans le principe, le barifiri des Mandé, qui est peut-être un peu supérieur en poids à 17 ou 18 grammes, devait être le anraé des Agni. La diminution de poids et la réduction de cette unité de poids à 16 grammes s’expliquent très facilement : à force de voyager, d’être pesé et surtout nettoyé aux factoreries, le barifiri ne donnait plus que 16 grammes.
Dans les factoreries, on se sert de l’once de 32 grammes (96 francs or) et de ses subdivisions pour les affaires que l’on traite en or.
Chaque once vaut 16 ackés à 6 francs.
Chaque acké vaut 12 takou à 50 centimes.
Voici les appellations agni pour l’or :
| Pouassaba (commun aux Mandé), valeur décomptée à 3 francs le gramme | 0f | 125 |
| Damma (commun aux Mandé) | 0 | 25 |
| Dé, égal au banankili mandé, ou takou (au pluriel dé se dit ba) | 0 | 50 |
| Dé n’damma | 0 | 75 |
| Bâa (ne pas confondre avec le ba court, pluriel de dé) | 1 | » |
| Bâa n’damma | 1 | 25 |
| Ba san (ba pluriel de dé ; san, trois) | 1 | 50 |
| [242]Ba na (4) | 2 | » |
| Ba nou (5) | 2 | 50 |
| Ba sien (6) | 3 | » |
| Ba nso (7) | 3 | 50 |
| Ba mokué (8 fois 50 centimes) | 4 | » |
| Ba ngouna | 4 | 50 |
| Ba bourou | 5 | » |
| Ba bourou n’takou (0,50 × 10 + 0,50) = 5,50 | 5 | 50 |
| Méttéba ou Méttéva ou 1 acké | 6 | » |
| Mettéba n’takou | 6 | 50 |
| Njunia | 7 | » |
| Mokué | 8 | » |
| Essoba | 9 | » |
| Nzonzan | 10 | » |
| Nzonzan bâa | 11 | » |
| Zamalfan (moitié) | 12 | » |
| Enzouazan | 13 | » |
| Enzouazan bâa (terme peu usité et chiffre peu employé par superstition) | 14 | » |
| Tuabo | 15 | » |
| Nzarazué ou encore : tuabo ani ba san | 16 | 50 |
| Bandézui | 18 | » |
| Anu zui | 19 | » |
| Taraé | 21 | » |
| Zémaré | 24 | » |
| Baré | 27 | » |
| Essan (ce devrait être : nzonzan essan, l’usage a fait tomber le premier terme) | 30 | » |
| Bagoua n’déa | 33 | » |
| Étéa | 36 | » |
| Anrué ou anrui | 39 | » |
| N’dua | 42 | » |
| N’dua (ni) ba sien (42 + 3) | 45 | » |
| Anraé (demi-once, le barifiri des Mandé) | 48 | » |
| Etté sui | 54 | » |
| Assé nua (essan nua ou 30 × 2) | 60 | » |
| Bagoua ndé nua (33 × 2) | 66 | » |
| Ba ndéa | 72 | » |
| Anumia | 78 | » |
| Ndua niua (42 × 2) | 84 | » |
| Ndua niua mettéba (42 × 2 + 6) | 90 | » |
| Anra niua (48 × 2) (1 once) | 96 | » |
| Anra niua mettéba (48 × 2 + 6) | 102 | » |
| Attatué | 108 | » |
| Anrué san (39 × 3) | 117 | » |
| Ndua san (42 × 3) | 126 | » |
| Anra san (48 × 3) | 144 | » |
| Ta | 162 | » |
| Banna (2 onces) (96 × 2) | 192 | » |
| Banna (suivi d’un autre chiffre qui le multiplie, banna n’est plus qu’une once ; ainsi, dans le chiffre suivant : banna ani niua, c’est comme si l’on disait 1 once + 2 = 3 onces) | 288 | » |
| Anra niua bourou, ce qui revient à dire 1 once 10 fois = 10 onces ou | 960 | » |
Dimanche 17 février. — Les adieux à la population d’Aouabou et à Kommona Gouin, auquel nous promettons de revenir, nous prennent une[243] bonne heure. Enfin, à six heures vingt notre petite troupe de porteurs s’ébranle, précédée d’un guide de Kommona Gouin qui, à l’approche de Bookrou et de Prompokrou, souffle dans une trompe d’éléphant à laquelle sont fixées deux mâchoires humaines, trophée d’une guerre contre les Ton du Gaman. A Prompokrou, où nous faisons une halte de dix minutes pour laisser respirer nos porteurs, nous trouvons une délégation de gens de Dionkrou, petit village sur notre flanc gauche, qui vient pour nous inviter à camper chez eux, et nous ne pouvons nous remettre en route que lorsque le guide leur affirme que par ordre du roi nous devons coucher à Iaoukrou, où nous arrivons vers dix heures du matin. Nous n’avons rencontré dans cette étape qu’une dizaine de Gan-ne, revenant de Iaoukrou porteurs de kolas.
Leur tatouage a quelque analogie avec celui des Tagoua : il se compose de trois petites entailles presque parallèles de chaque côté de la bouche.
La végétation est très puissante dans cette région : de grosses branches servant de pieux pour les enceintes et clôtures poussent avec autant de facilité qu’une bouture de pourgère dans le Cayor. Dans la case où nous habitons, un jeune homme émonde le petit palanquement qui entoure le fétiche accra. Ce fétiche, très répandu dans l’Agni, se retrouve dans toutes les maisons. C’est généralement un arbuste planté au milieu de la cour, au pied duquel on voit un ou deux vieux chaudrons vides en terre cuite, un autre contenant de l’eau et une quantité d’œufs ou de coquilles d’œufs. Le tout est entouré par un petit palanquement qui sert de protection contre les animaux, poules, chèvres, moutons, etc., car les enfants et les grandes personnes se gardent bien d’y toucher. J’ai demandé souvent quelle était la vertu de ce fétiche sans jamais rien apprendre. Cadia, un Agni de Krinjabo, interprète de Treich, se contentait de me répondre... que c’est une coutume du pays et qu’il n’en savait pas plus long.
Nous avons été bien accueillis à Iaoukrou. C’est la première fois que nous réussissons à nous procurer du vin de palme depuis notre départ du Bondoukou, ce qui est très agréable, car l’eau est mauvaise dans toute la région.
Lundi 18 février. — Un quart d’heure après avoir quitté Iaoukrou, nous atteignons un petit village nommé Tobiéso. Une marche fatigante à travers la forêt nous mène à Babraso, où nous goûtons un bon repos de vingt minutes, avant de repartir pour Pirikrou, où nous devons faire étape.
Les étapes sont pénibles. Quelques sections du chemin sont cependant relativement bien débroussaillées, mais une partie située entre deux chemins[244] de culture est excessivement difficile ; le sentier fait des méandres à n’en plus finir et toutes les dix minutes on est forcé de franchir des troncs d’arbres qui sont en travers de la route, déracinés par les ouragans en hivernage ou tombés de vétusté. A Babraso, assis sous un hangar, le chef de village se livre à des démonstrations d’amitié ; il veut nous garder, nous offrir l’hospitalité. On est presque tenté d’accepter, mais la raison reprend vite le dessus : un jour perdu peut en entraîner d’autres, on en perd déjà assez mal à propos, et bon gré mal gré on se met en route, satisfait, en arrivant à l’étape, de voir qu’on s’est rapproché d’une journée de marche de la mer.
En quittant Babraso, nous traversons de splendides plantations de kolas. Ces arbres sont plantés en quinconces alternant avec des palmiers à huile.
Cette variété de sterculia produit le kola blanc et le kola rose. Le tronc ressemble un peu comme écorce à notre hêtre ; et la feuille, au ficus ; mais ce qui m’a frappé, c’est qu’à 1 mètre de terre tous les troncs se bifurquent. Les branches ne sont pas émondées quand elles sont jeunes, de sorte que dès que l’arbre commence à prendre de la vigueur les indigènes sont forcés d’étayer les branches pour les empêcher de se briser.
J’ai vraiment éprouvé un sensible plaisir en voyant le nègre se livrer à une culture dont le rendement n’est pas immédiat. Hélas ! partout où je suis passé, j’ai trouvé les noirs si indolents, si peu prévoyants ! C’est à peine s’ils plantent de temps à autre un bombax sur la place du marché ; ils n’ont pas encore eu l’idée de multiplier l’arbre à cé et le néré, qui sont cependant d’un bon rapport, même dans les pays d’origine. Les quatre indigènes qui me restaient et auxquels je faisais remarquer que les Gan-ne étaient plus prévoyants qu’eux, se promirent bien de les imiter en rentrant, et de planter des cé et des néré. Ceux de Treich rapportaient même des graines de quelques arbres de la zone Kong, tellement ils étaient pleins de zèle. Ils n’en feront rien, je les connais : un tam-tam dans leur village leur aura tout fait oublier. Le noir est enfant, il le restera encore longtemps.
Dans l’état actuel de la société noire, où l’organisation du pays, la forme du gouvernement, la fortune sont si peu stables, il est bien difficile de porter un jugement absolument partial sur le degré d’intelligence ou de perfectibilité intellectuelle du Soudanais.
Des causes diverses mettent les noirs dans une situation d’infériorité souvent si accusée, qu’on est forcé, dans bien des cas, de les excuser. Il y a cependant des caractères généraux qui les dépeignent assez bien.
Ainsi, comme dispositions arithmétiques, ils nous sont toujours inférieurs. Ils ne peuvent embrasser d’un seul coup d’œil que des chiffres très[245] restreints ; au-dessus de cinq, ils se trompent souvent, s’ils n’ont pas soin de ranger les objets comptés d’un même côté. Ce défaut de coup d’œil les prédispose à l’exagération : au-dessus de cinq ou dix, ils traduisent les nombres par : A ka sia, « Il y en a beaucoup » ; quand c’est de centaines qu’il s’agit, ils disent : A nté ban, « A n’en plus finir ».
Souvent le noir ne se rend pas compte de ce que c’est que le devoir : pour lui, quand on est libre, on doit pouvoir facilement se dégager d’une tâche tracée à l’avance. Combien de fois ne me suis-je pas entendu traiter de fou, d’insensé, tout simplement parce que, sans être surveillé, étant libre de mes actes, je m’astreignais par devoir à une besogne topographique qui, par son aridité, me mettait quelquefois hors de moi.

En route pour Attakrou.
Ce qui manque aussi souvent au noir, c’est l’amour de la patrie.
La patrie, a fortiori le drapeau, n’existe pas pour lui ; on cite trop souvent l’exemple de noirs qui, au lieu de se rendre, eux et la place dans laquelle ils étaient assiégés, préféraient se suicider. Ce n’est pas par le même sentiment que nous qu’ils agissent ainsi : derrière cet acte d’héroïsme se cache le plus souvent le simple désir d’échapper au supplice qui leur serait réservé.
Mais si le noir ne sert pas son pays, on ne peut pas lui reprocher de ne pas servir une idée, et surtout un homme. Quand il a su lui inspirer la[246] confiance, un chef peut attendre de son subordonné tout ce qu’il obtiendrait d’un être européen bien policé et civilisé. Nous en avons eu des exemples frappants dans nos compagnies de tirailleurs, et moi-même je puis affirmer que mes noirs m’ont servi avec abnégation, dévouement, sans arrière-pensée d’intérêt ou de lucre.
Ont-ils réellement du courage ? Je le crois par moments, et pourtant je ne puis l’affirmer. Quand ils se lancent dans une mêlée à tête perdue, quand ils se jettent dans une rivière infestée de caïmans, est-ce un courage spontané ou réfléchi ? Pour moi, c’est l’un et l’autre, mais amoindri par le fait que ces gens-là se croient indemnes ou invulnérables, soit par les prédictions d’un kéniélala ou le port d’une amulette.
A côté d’actes tout à fait louables, car ces gens-là — je parle de mes serviteurs ou de tirailleurs, tous gens connus — ont de beaux faits à leur actif, on en voit qui sont remarquablement lâches ; il y en a dont le père a été, non pas tué à l’ennemi, mais exécuté, et qui servent le meurtrier de leur père.
Quelle incohérence dans l’étude de gens aussi bizarrement doués, dont les facultés ont été tronquées par les superstitions, les croyances et une morale qui n’est pas la nôtre, et combien il est difficile, même pour ceux qui, comme moi, ont longtemps vécu parmi eux, de discerner la vérité !
L’enfant, par suite des travaux multiples et fatigants auxquels la mère est forcée de se livrer, est bien en retard sur celui des pays civilisés. Porté sur le dos jusqu’à l’âge de deux à trois ans, époque à laquelle il est sevré, le bébé ne peut rien apprendre, la mère ne lui causant jamais, de sorte qu’il ne commence réellement à parler qu’à trois ans et demi ou quatre ans. A partir de cette époque, son intelligence se développe avec une rapidité surprenante : il a une mémoire extraordinaire et il est capable d’apprendre tout ce qu’on lui enseigne ; il est aussi bien doué que les enfants européens de son âge. Malheureusement, aussitôt qu’il atteint l’âge de la puberté, tout développement intellectuel cesse.
Cet arrêt complet se produit presque brutalement : non seulement son intellect reste stationnaire, mais je dirai qu’il diminue ; la mémoire s’en va ; d’éveillé et d’intelligent qu’il était, il devient sot, méfiant, vaniteux, menteur ; dans cette période, qui quelquefois dure deux ou trois ans, il n’est assimilable qu’à un être tout à fait inférieur. A cet arrêt intellectuel doit correspondre, dans ces régions, la soudure de la boîte cervicale : le développement du crâne s’arrête et empêche le cerveau de se dilater davantage.
Il n’est pas rare de trouver des adultes doués d’une façon exceptionnelle ;[247] on rencontre aussi parmi eux des gens moins bien doués, mais qui ont le bon esprit de s’en rendre compte, ce qui prouve qu’ils sont intelligents.
Malheureusement, ces deux catégories d’adultes sont noyées dans une troisième, composée de gens à intelligence ordinaire, au-dessous de la moyenne, mais qui ont la sotte prétention de se croire des êtres supérieurs.
C’est dans cette catégorie d’individus que l’on trouve les tribuns, les demi-savants : ce sont des gens qui croient savoir ; ils sont prétentieux, fats, difficiles à manier, et il est dangereux de se trouver aux prises avec eux. Quand on a le malheur de tomber sur un individu de ce genre comme interprète ou intermédiaire pour régler quelques affaires graves, on a de la peine à s’en tirer avantageusement.
Dans les conversations de longue haleine, ils perdent le fil de la discussion, ne se souviennent plus du but à atteindre ; au lieu de vous rendre service, ils vous causent préjudice.
Quand ils mentent, ils le font grossièrement, maladroitement, et répondent toujours évasivement aux questions qu’on leur pose ; ils ont tout un vocabulaire de locutions et d’exclamations à l’aide desquelles ils se tirent d’affaire sans se compromettre.
Quelle différence avec le brave vieillard, chez lequel, en général, on trouve l’intelligence, la sagesse et la logique réunies ! Les anciens à barbe blanche sont de véritables patriarches, honnêtes, sérieux, calmes, ouverts ; il est possible de causer avec eux et de leur faire comprendre les choses les plus difficiles. Ce sont des gens sensés, dont le jugement sain m’a toujours frappé.
On peut, il est vrai, les accuser d’esprit d’imprévoyance dans maints cas, mais ils sont excusables : cela tient aux défauts de leur organisation sociale, au peu de sécurité qu’offre leur gouvernement et aux vicissitudes des guerres qui désolent ces pays.
★
★ ★
Depuis mon départ d’Aouabou je souffrais cruellement d’une grosseur dans l’aine droite ; je me demandais si c’était une hernie ou une adénite. Les gens, me voyant souffrir ainsi et me traîner péniblement par les chemins en m’appuyant sur un bâton, ne manquaient pas de me demander ce qui causait mon infirmité. Je dus, bon gré mal gré, faire voir cette grosseur aux bonnes femmes de Pirikrou, qui, après avoir palpé le mal, s’en allèrent par la forêt chercher des médicaments. Dans la soirée, une[248] femme médecin, accompagnée d’une jeune femme, vint dans ma case, et, après avoir mâché chacune une ou deux variétés de feuilles et d’herbes, elles me crachèrent la préparation sur le mal. Ce remède m’ayant permis de dormir sans fièvre, je faisais ramasser des herbes par mes hommes, qui, tous les jours, en arrivant à l’étape, me soignaient de cette façon. J’aurais enduré cette horrible souffrance plus volontiers si elle ne m’avait privé de rôder aux abords des villages ; malheureusement je dus me borner à lever la route suivie et limiter mes excursions à 50 mètres du village, le repos m’étant indispensable pour achever ma guérison et me permettre de repartir le lendemain.
A Pirikrou, derrière ma case, qui était tout contre la brousse, les indigènes avaient disposé une quantité de pièges à singes. Ces animaux pullulent dans la forêt ; avec l’antilope que j’ai décrite plus haut et deux autres variétés plus petites, ainsi que des sangliers et quelques rongeurs, ils constituent la faune de cette région.
Le manque d’eau se fait bien sentir partout ; on n’en trouve que dans quelques méchantes mares. Le cours de l’Isi étant parallèle à celui du Comoë et relativement très rapproché explique le manque d’affluents de droite et leur cours limité.
Beaucoup d’habitants, comme à Waghadougou, sont atteints de la filaire de Médine, cet affreux mal dont tous mes noirs ont été successivement atteints et auquel je n’ai échappé que grâce à ma sobriété et en n’absorbant que de l’eau bien reposée dans les villages, eau puisée depuis assez longtemps pour que toutes les matières organiques et animales aient pu se précipiter au fond du récipient.
Mardi 19 février. — Encore une étape bien pénible que celle d’aujourd’hui : quatre longues heures de marche appuyé sur mon bâton ! Le sentier est très mal entretenu et serpente à l’infini. J’ai franchi plus de 50 troncs d’arbres. Heureusement que l’étape est intéressante : nous traversons une région aurifère excessivement riche, à en juger par la façon dont elle est fouillée. Le terrain est composé de deux tiers de quartz semé de rose et d’un tiers d’argile sablonneuse couleur d’ocre jaune. Les puits à extraction sont creusés à 5 ou 6 mètres de profondeur et atteignent environ 70 centimètres de diamètre.
Pour permettre à l’ouvrier d’y descendre facilement, on a ménagé dans la paroi du puits un bourrelet assez solide qui y descend en hélice. Afin d’empêcher l’hélice de se dégrader trop facilement en y appuyant les pieds et les mains pour la descente et l’ascension, les bourrelets sont revêtus d’une couche de terre glaise qui les solidifie.
[249]Le manque d’eau pendant une partie de l’année donne lieu à deux façons d’extraire l’or qui diffèrent essentiellement entre elles. En saison sèche, les indigènes exploitent les puits à côté des ruisseaux, lavent les alluvions et en tirent la poudre d’or et la petite pépite en assez grande quantité pour que ce métier soit très rémunérateur pour tous les gens des environs. Les habitants de villages situés à plusieurs jours de marche au nord sont aussi autorisés à se livrer à ce travail moyennant une légère redevance à payer au moment de s’en retourner chez eux.
Pendant la saison des pluies, l’or est seulement exploité par les gens du village. C’est alors qu’ils creusent des puits profonds et qu’ils concassent les quartz, se bornant à rechercher les pépites. Ce procédé fait que toute la menue poudre, est perdue faute d’eau et par conséquent de lavage.
C’est un des placers réputés les plus riches, avec ceux de l’Alangoua (région située sur la rive gauche du Comoë entre le fleuve et le confluent du Mézan). Bien dirigée, et entre les mains de gens plus pratiques, cette exploitation pourrait donner un beau rendement, surtout si l’on amenait par des conduits l’eau du Comoë sur les lieux mêmes.
Dans toute cette région, il n’est pas un homme qui ne possède de l’or ; ainsi, à Ndéré-Kouadioukourou, où nous faisons étape, nous sommes rejoints par un habitant de Bahirmi, village que nous avons traversé à huit heures et demie. Cet individu vient nous prier de nous intéresser à un vol de 20 onces d’or dont il venait d’être victime (20 onces d’or représentent 2000 francs environ). Et encore cet homme disait qu’heureusement le voleur n’avait trouvé que cela.
Les gens de Krinjabo, et entre autres Cadia, qui était venu faire la traite de la poudre d’or par ici, m’ont affirmé qu’ils avaient vu des pépites pesant 5 ou 6 onces d’or (de 500 à 600 francs). J’avoue que la plus grosse que j’aie vue ne pesait que 400 francs, mais, toute exagération à part, je crois qu’il y a de l’or en quantité, soit en poudre, soit en pépites. Dans les conversations on entend parler de sommes prêtées s’élevant à 10, 15, 20 onces ; des amendes infligées pour adultère s’élèvent à 3 ou 4 onces, ce qui prouve que parler de 300 ou 500 francs d’or ici n’a rien d’excessif.
Ndéré-Kouadioukourou est le premier village où les cases ne sont plus couvertes en chaume. Les clairières sont rares, l’herbe fait défaut, ce qui a forcé les indigènes à devenir industrieux et à couvrir les cases avec de larges feuilles d’arbres de 20 centimètres de long sur 15 centimètres de large. Ils les disposent à peu près comme nous les ardoises, mais ils en mettent naturellement une épaisseur de 5 à 6 centimètres pour se garantir de la pluie et du soleil.
[250]Les cases sont assez bien entretenues et comportent quelques grossières peintures à l’ocre jaune, rouge ou cendre. J’ai vu également deux portes sculptées assez originales.
Les dessins ne sont pas très réguliers, mais ils font assez bon effet. Le système de ferme-tube consiste en deux pilons et un cadenas de fabrication européenne.
Dans tous ces villages nous avons été bien reçus ; la population est paisible et bienveillante. Presque toujours, on nous offre quelques ignames, des bananes, des œufs, un ou deux poulets et des graines de palme pour préparer le fouto.
La graine de palme est ici la base de toutes les sauces, comme ailleurs le gombo, la feuille de baobab et, dans le Mossi, le soumbala.
Pour en indiquer l’emploi, il me faut parler du fouto, le plat national des gens de race agni.
Tous les Européens de la Côte sont persuadés que fouto est un mot agni ; c’est une erreur : fouto est un mot mandé employé surtout par les Bambara du Ganadougou. Ce mot a été importé à la Côte de l’Ivoire par les tirailleurs, qui, par analogie à leur fouto national, ont donné ce nom au plat si succulent qu’on nomme en langue agni : arié et non fouto.
La base du fouto est « l’huile de palme », que fournit en abondance, dans toute la région à végétation dense, l’Elæis guineensis, ou vulgairement le palmier à huile. Ce palmier croît à l’état spontané ; il est aussi beaucoup cultivé, mais pas autant qu’il pourra l’être du jour où le Comoë sera ouvert à la navigation jusqu’à Groûmania. Les indigènes habitant entre le 8e degré de latitude nord et le littoral du golfe de Guinée se livrent tous à l’industrie de l’huile de palme, mais aujourd’hui ils ne peuvent l’écouler faute de communications faciles avec la côte.
Le palmier à huile produit deux régimes par an. Dès qu’il est à maturité, le régime est coupé. Les amandes, enveloppées dans une sorte de matière fibreuse rouge, sont extraites des alvéoles du régime et bouillies dans de l’eau. On les bat ensuite dans des mortiers en bois afin de détacher l’amande de son enveloppe ; puis on fait bouillir de nouveau le sarcocarpe fibreux qui enveloppe l’amande. Le corps gras qu’il renferme, dans une proportion de 65 à 70 pour 100, surnage, et est recueilli dans des cuillers en bois. Cette graisse est d’un beau rouge orange, et fraîche elle a un goût aromatisé auquel on s’habitue volontiers.
L’huile fraîche étant obtenue, on en arrose du poisson sec, du poulet, une viande quelconque, mais surtout du singe fumé, préalablement cuit à l’eau, et l’on replace à nouveau sur le feu. Quelques plantes aromatiques[251] cueillies dans la forêt et surtout une bonne poignée de piments en font un mets délicieux, qui, fortement assaisonné, excite beaucoup l’appétit.
Avec cette sauce on mange soit de l’igname bouillie, soit de la banane verte cuite à l’eau et pilée pour en former un pain consistant.
Pour bien savourer le fouto, ou arié, pour parler agni, il faut le manger sans fourchette : on prend avec les doigts une motte de pain de bananes que l’on trempe dans la sauce, tout en rongeant une cuisse ou une aile de poulet. Moyennant quelques perles ou tout autre petit cadeau, on trouve toujours une femme assez complaisante pour vous préparer un fouto ; elles y mettent même un certain amour-propre, et c’est avec une véritable fierté qu’elles vous regardent savourer leur plat national.
C’est cette huile de palme qui donne lieu à un si important commerce d’échange sur toute la côte occidentale d’Afrique. Elle est expédiée en tonneaux de 500 à 600 kilogrammes, appelés ponchons, sur les marchés de Marseille, de Liverpool et de Hollande.
Les alcalis, tels que la potasse et la soude, la saponifient et forment avec elle des savons jaunes, blancs ; on en obtient même de la bougie.
A Kong cette huile se nomme tintoulou.
Le palmier à huile fournit encore une autre graisse, qui est extraite de l’amande concassée. Le rendement est moins considérable et ne doit pas dépasser 40 pour 100. A Kong et dans les pays mandé on nomme cette huile tingolotoulou.
Vers la côte, les indigènes se bornent à vendre l’huile de palme rouge aux factoreries et à y apporter les amandes, qui sont expédiées en sacs vers l’Europe, où elles sont traitées pour la saponification, la stéarine et même souvent pour le beurre.
La coque de l’amande, découpée en rondelles par les indigènes, leur sert à se fabriquer des colliers.
Mercredi 20 février. — Nous traversons Kouadioukrou et Adikrou, gentils petits villages où les habitants ont l’air très bienveillants. Dans cette[252] région, l’or est aussi exploité ; mais j’ai cependant remarqué bien moins de puits sur le chemin même : l’exploitation a lieu dans des endroits situés à quelques kilomètres du sentier que nous suivons à l’est et à l’ouest. Nous arrivons à Ndiénou vers neuf heures et demie du matin. Il était temps, mon mal n’avait fait qu’empirer, et c’est exténué que je me jetai sur ma natte dans la case que le chef du village mit à notre disposition.
Ndiénou est un village assez important par sa situation. Du village part un chemin par Ahouan et Duhinabo sur Annibilékrou dans l’Assikaso (en agni « lieu de l’or »). Un autre chemin non moins important mène par Assonakrou et Bankokrou à Amakourou, village important du Baoulé, où réside un chef influent, nommé Kabana Mpokou, qui a souvent des démêlés avec l’Anno ; mais actuellement une paix profonde semble régner.
Il y a à Ndiénou une petite caravane de Gan-ne du Baoulé qui ont les bras et les jambes ornés d’anneaux en cuivre creux à l’instar des Mossi ; j’y ai vu aussi quelques coiffures originales.
Les femmes Gan-ne se bornent à se rouler de toutes petites mèches espacées de 3 ou 4 centimètres. Les jeunes gens, en revanche, ont quelques mèches sur le front et les tempes, les cheveux coiffés en arrière et ramassés en touffe sur le sommet de la tête.
Très souvent ils portent un peigne en bois fabriqué par eux.
Jeudi 21 février. — Il m’est impossible de continuer ma route : mon mal n’a fait qu’empirer. La grosseur dont je suis affligé est dure et plus grosse que le poing ; elle m’occasionne une fièvre très intense qui me fait délirer, malgré les fortes doses de quinine que j’absorbe. Ce brave Treich me force à rester couché, et nous remettons le départ au lendemain. La journée est occupée par un palabre dans lequel nous engageons huit hommes pour porter nos bagages ; cela permettra à huit de nos porteurs de se relayer pour mon transport dans un hamac dont M. Treich avait eu la bonne idée de se munir à son départ d’Assinie.
Pour l’installer, il ne s’agissait que de trouver une solide perche longue et légère et d’y amarrer les extrémités.
Le chef de Ndiénou mit une grande complaisance à nous procurer des hommes ; il fut convenu qu’ils seraient payés à raison de 2 takou (1 franc) par jour et par homme, payables en poudre d’or, et, pour chaque journée de retour, 1 takou. Ces hommes prirent l’engagement de nous servir jusqu’à Attakrou, premier village de l’Indénié, sur la rive gauche du Comoë.
Vendredi 22 février. — Cette étape, tout en apportant un grand soulagement à mon état, a été bien fatigante. Mes huit porteurs ne savent pas encore manœuvrer habilement le hamac ; ils portent deux par deux, un à[253] chaque extrémité, et se relèvent de demi-heure en demi-heure. Le sentier serpente tellement qu’il faut user des plus grandes précautions pour tourner avec une perche de 2 m. 50 supportant un hamac. Les lianes et les branches vous battent la figure, des branches mortes vous tombent sur la tête, et enfin à maintes reprises on risque de s’empaler sur de jeunes arbres coupés à 1 mètre du sol. Dans ces conditions, le voyage d’un malade dans un hamac n’offre qu’un seul avantage, celui de le transporter ; quant à lui éviter la souffrance, il n’y faut pas songer. J’étais calé par un coussin et des couvertures, ce qui me permettait de faire usage de ma boussole et de noter mes azimuts. Je puis le dire, jamais la mise au net de mon levé topographique n’a subi un retard de plus de vingt-quatre heures.

Dans le hamac, au milieu des fourrés.
De Ndiénou à Tiokonou, où nous faisons étape, nous n’avons traversé qu’un seul village, qui se nomme Benzi, et aux environs duquel se trouvent des exploitations aurifères.
A Tiokonou, une femme médecin essaye de me persuader que le seul remède à mon mal serait de prendre un lavement au piment.
[254]C’est un procédé bien primitif, auquel cependant j’ai cru devoir me soustraire, n’entrevoyant pas du tout l’effet que cela aurait pu produire sur une maladie du genre de celle qui m’affligeait.
Cette médication est très usitée chez tous les peuples achanti et agni, et personne ne voyage sans un irrigateur (si l’on peut appeler cela ainsi). Cet instrument primitif consiste tout simplement en une calebasse de la forme d’une poire allongée, percée d’un trou carré au sommet de la partie sphérique. C’est par là qu’on introduit la préparation. La tige de la calebasse sert de canule, et le médecin, appliquant sa bouche sur le trou carré, souffle de toute la force de ses poumons pour faire prendre le lavement au malade.
Ce lavement n’est pas précisément émollient ; il faut y être habitué très jeune pour pouvoir le supporter, car il entre en général plus de 100 grammes de piment pilé et macéré dans 50 centilitres d’eau. Pour un Européen, une telle médication doit produire une inflammation intense ; mais les indigènes s’administrent cela aussi aisément que nous avalons une pastille ou un bonbon. On peut dire que la calebasse à injections fait partie du costume de ces gens-là ; ils la portent ostensiblement suspendue à la ceinture ou dans leurs bagages, et quand on a, comme Treich, la bonne fortune de posséder un cuisinier, la place indiquée de la calebasse à injections est toujours le panier à provisions ou à vaisselle !
Samedi 23 février. — Les porteurs, déjà un peu habitués, m’ont moins fatigué aujourd’hui ; ils commencent à savoir faire évoluer le hamac assez facilement à travers les innombrables détours de la forêt. De plus Kwaoukrou et Iaoukrou, séparés l’un de l’autre par une petite heure de marche, nous font paraître le temps moins long et l’étape moins fatigante. A neuf heures, nous entrons à Zanzanso, grand village neuf qui vient récemment d’être déplacé ; il s’élève dans une belle friche encore fumante, au milieu d’une splendide végétation.
Il y a là partout des arbres magnifiques et d’essences inconnues au-dessus de 8° 30′. Le kola ne semble plus être cultivé ici. La seule occupation de cette population est l’extraction de l’or et la culture des bananiers et du manioc. Les ananas existent à profusion, mais les indigènes ne semblent pas en être bien friands. Je crois qu’ils font plutôt leurs délices de quelques variétés de singes et surtout du kouamé (nom agni), sorte de cynocéphale à poil blanc sale très rare, à la figure ladre. Ce singe est gratifié de callosités, au postérieur, de dimensions extraordinaires. Les femelles sont parfois d’un aspect hideux. Ce singe, quoique comestible, est un des moins appréciés pour sa viande, parce qu’il se nourrit beaucoup[255] de fruits, et sa peau n’a aucune valeur marchande. Il existe encore d’autres variétés de singes, dont j’aurai plus loin l’occasion de parler.
Dimanche 24 février. — Il est impossible de se rendre compte de ce qu’est un sentier dans cette forêt. Deux de nos hommes munis de sabres d’abatis coupent les lianes et les branches ; le sentier contourne les moindres petits obstacles, arbres trop rapprochés, troncs d’arbres en travers du chemin, lianes trop grosses pour être coupées. Nous marchons ainsi plus de quatre heures pour ne faire à vol d’oiseau que 11 à 12 kilomètres. Il n’y a pas de village sur notre route ; on ne traverse qu’un groupe de cases nommé Akannda, à 1 kilomètre avant d’arriver à Apposo, où nous avons décidé de faire étape.
Le chef d’Apposo nous reçoit moins bien que les chefs des villages que nous venons de traverser ; il nous envoie cependant neuf ignames, quelques bananes et un poulet. Le cadeau que nous lui faisons, et qui consiste en un rasoir, une glace, un bonnet de velours, un foulard et quelques chaînettes, ne semble pas le séduire, et finalement il refuse de l’accepter.
Je ne me suis expliqué cette façon d’agir que parce que son désir était de nous voir lui faire un second cadeau, pour le chef d’Abé (village situé sur le fleuve), de l’autorité duquel il semble relever.
Lundi 25 février. — J’ai fait donner les cadeaux refusés par le chef à quelques gens du village, qui les acceptent avec reconnaissance. Le chef lui-même, auquel je fais visite le matin de bonne heure avant le départ, ne fait plus allusion à rien, et c’est en nous donnant une bonne poignée de main que nous nous quittons. Une heure après notre départ nous atteignons Benti-Kouassikrou, et à huit heures et demie nous arrivons à Zouépiri, le village suivant étant trop éloigné pour que nous songions à l’atteindre sans exténuer nos porteurs. De ces deux derniers villages partent également deux sentiers sur Abé et le Comoë, pour de là se diriger par Tenkoualan sur Annibilékrou (Assikaso).
Mardi 26 février. — C’est bien curieux : si je n’avais rencontré des gens venant d’Attakrou, je me serais imaginé que les indigènes cherchent à me tromper. Au lieu de faire aujourd’hui, comme les jours précédents, du sud avec un peu d’est, nous passons, dans l’étape d’aujourd’hui, à l’ouest-sud-ouest. J’ai eu le secret de cette anomalie en causant, dans une halte, avec des gens de l’Indénié qui se rendent à Groûmania : ils m’ont expliqué que, la région n’étant pas peuplée du tout par ici, le chemin faisait un grand détour pour gagner Adiouakrou, afin de permettre aux voyageurs de se ravitailler. Le pays est aussi sauvage que plus au nord, mais je n’y ai remarqué aucune trace d’exploitation d’or.
[256]Le chef d’Adiouakrou nous reçoit tant bien que mal et a cependant l’air mécontent du cadeau que nous lui faisons. Treich y ajoute une petite bêtise, une brassée d’étoffe, ce qui nous réconcilie. Tout le monde s’occupe des provisions, car demain il faut coucher dans la brousse, et l’on n’arrivera à Attakrou qu’après-demain dans la journée, en marchant bien.
Mercredi 27 février. — Nous quittons le village à six heures. En route, nous dépassons un endroit où l’on peut bivouaquer et où l’on trouve un peu d’eau ; après y avoir fait une halte de vingt minutes, et vers midi, nous atteignons un autre endroit où l’on campe d’ordinaire, près d’un petit ruisseau qui a un bief contenant un peu d’eau croupie.
Rien n’est plaisant comme l’installation d’un campement quand on est bien portant et d’humeur joyeuse. J’ai toujours éprouvé un certain bonheur à choisir un bon emplacement pour y passer les heures chaudes, puis à en faire préparer un autre pour la nuit. Ici, malgré ma douleur et mon impotence, je me fais organiser une petite retraite à l’ombre d’un edia baca, (arbre à fou). Les lianes me servent à amarrer les couvertures qui doivent me protéger du soleil. En face de moi, de l’autre côté du petit ruisseau sans eau, Boukary nettoie deux emplacements pour la natte de Treich et la mienne, que nous séparons de l’intervalle nécessaire à l’établissement d’un feu de bivouac.
Nous avons déjeuné d’un riz préparé je ne sais trop comment, et le soir, avant de nous coucher, nous avons mangé une boîte de corned beef, de l’igname et du maïs grillé. Une tasse de thé et une cuiller à café d’élixir de la Grande-Chartreuse achèvent de nous donner l’illusion d’un excellent dîner. Je me suis endormi ce jour-là avec une quiétude parfaite sur l’issue de notre voyage. Hélas ! j’étais bien bas. Ce brave Treich m’a avoué depuis que plus d’une fois il s’était relevé la nuit pour sentir si mon cœur battait encore.
Jeudi 28 février. — Dieu, quelle étape ! Nous avons surtout fait du sud. Et que de circuits ! comme cela fatigue ! cette même flore, ces mêmes plantes, ce pays uniforme, mais joli quand même ! Mes porteurs de hamac sont sur les dents, ils n’en peuvent plus, les malheureux. Quelques Gan-ne nous laissent entrevoir que nous n’allons pas tarder à atteindre le fleuve.
A une heure trente-cinq, nous arrivons sur les bords du Comoë. Ma dernière pensée a été de prendre ma boussole, d’y faire une visée en amont et en aval, avant de m’affaisser épuisé, rendant grâce à Dieu de m’avoir laissé les forces nécessaires pour atteindre les pirogues qui devaient nous permettre de regagner la Côte.
[257]CHAPITRE XV
Attakrou. — En quête de pirogues. — Descente du Comoë. — Incidents de navigation fluviale. — Séjour à Kabrankrou. — Départ par terre pour Aniasué. — Toujours l’imposante forêt. — Illusion d’ouïe. — Aniasué. — Les singes de l’Indénié. — Départ des pirogues. — L’Indénié, limites, population. — Nous longeons le Morénou et l’Attié. — Cérémonie funèbre agni. — L’Alangoua. — Abandonnés par les piroguiers. — Bettié et Bénié Couamié. — Une maison à l’européenne. — Mon premier verre de vin. — Départ pour Malamalasso. — Chutes et rapides. — Daboisué. — Deux étapes à pied. — Malamalasso. — Arrivée de Baoto. — Difficultés constantes nées de coutumes bizarres. — La société agni. — Pénible navigation de nuit. — Nous atteignons le Diamant. — Arrivée à Grand-Bassam. — Accueil à la factorerie Verdier. — Le capitaine au long cours Bidaud. — Mes compagnons noirs.
Devant Attakrou le Comoë a environ 100 mètres de largeur. Sur les rives émergent des grès et quelques bancs de sable. Au milieu, le fleuve a 1 m. 20 de profondeur. Les berges sont assez élevées pour permettre à une crue de 8 à 10 mètres de se manifester sans danger pour le village, qui est construit le long de la rive gauche, dans un fouillis de bananiers, de palmiers et d’ananas. Le chef actuel se nomme Bénié, ce qui fait qu’on appelle aussi Attakrou : Béniékrou, krou voulant dire « village » en langue agni.
Par ordre de Bénié, on nous avait installés et l’on nous avait approprié deux cases dans lesquelles étaient disposés trois ou quatre tapis en fou, l’un sur l’autre, recouverts eux-mêmes de couvertures très propres et bien blanchies. C’était un semblant de lit qui n’était pas à dédaigner. Treich rencontra une femme médecin des environs de Bettié qu’il connaissait ; elle se mit aussitôt en devoir de nous préparer un excellent fouto. Deux heures après, Bénié et notre hôte nous firent cadeau de bananes, d’ignames, de manioc et d’une cinquantaine d’ananas délicieux.
A propos d’ananas, il est intéressant d’examiner les ressources que le commerce des ananas pourrait offrir pour nos possessions de la côte d’Afrique.
Actuellement les ananas frais qui arrivent sur notre marché (du mois[258] de novembre à fin juin) proviennent des Açores, d’où les navires anglais les transportent à Londres : c’est donc de ce dernier pays qu’ils sont réexpédiés et qu’ils sont livrés à la consommation à des prix relativement élevés (4 à 8 francs pièce, suivant la grosseur et la finesse).
Nous croyons que les ananas de la Côte de l’Or pourraient lutter avantageusement avec ceux des Açores, étant donné que la traversée s’effectuerait dans un laps de temps qui, n’étant pas beaucoup plus long, permettrait aux fruits d’arriver dans de bonnes conditions aujourd’hui, grâce aux nouvelles lignes de paquebots.
Voici d’ailleurs, sur le mode de préparation actuellement employé pour ces sortes d’envois, des renseignements puisés à bonne source et que nous croyons utile de porter à la connaissance de nos lecteurs.
Les fruits sont cueillis avant d’être mûrs, de façon à supporter le voyage ; on leur laisse une longueur de tige de 15 à 20 centimètres, et comme ornement le petit bouquet de feuilles qui les termine.
Pour l’emballage, on les couche dans de grandes caisses mesurant de 1 m. 20 à 1 m. 30 de long sur 80 centimètres de large et 25 centimètres de hauteur. Chaque caisse est divisée en deux compartiments par une cloison ; les ananas doivent être entourés de feuilles de maïs. L’emballage étant la question capitale, il faut éviter, en le faisant, de casser les tiges et le petit bouquet de feuilles, et remplir avec soin les vides, afin d’empêcher tout mouvement du fruit dans la caisse.
Les ananas existent à l’état spontané en si grande quantité dans les forêts, qu’on pourrait se les procurer, rendus à Grand-Bassam, à 25 centimes pièce, au grand maximum.
★
★ ★
Après avoir pris quelque repos et procédé à une toilette sommaire, Treich et moi, nous allâmes faire visite à Bénié. Sur une petite place devant son habitation, au pied d’une sorte de ficus, il nous attendait assis sur une chaise. A côté de lui, un jeune homme le garantissait du soleil avec un parasol. Bénié a environ une quarantaine d’années. Sa figure inspire plutôt la sympathie que la défiance. Il parle peu, d’une façon bien calme et tout à fait digne. A notre arrivée, ses musiciens, au nombre de cinq, nous saluent d’une aubade qui avait l’air d’être prisée par tout le monde, sauf par nous. Cette musique se composait de deux tam-tams, une clochette, une trompe en ivoire et un clairon en cuivre rouge de fabrication européenne. Pendant que la musique nous écorchait les oreilles, quatre[259] jeunes gens munis de queues d’éléphant (emblème royal) éventaient le seigneur d’Attakrou et lui chassaient les mouches.
Bénié nous souhaita la bienvenue en termes fort courtois et offrit à notre escorte cinq litres de gin, que s’administrèrent les gens de Treich, les miens, quoique fétichistes, ne voulant pas boire d’eau-de-vie.
Dans l’Anno et l’Indénié, où nous venons d’entrer, les villages sont construits à peu près de la même façon. Attakrou ne se distingue des villages de l’Anno que par sa population plus nombreuse, 700 à 800 habitants, tandis que la moyenne des autres varie entre 100 et 300.
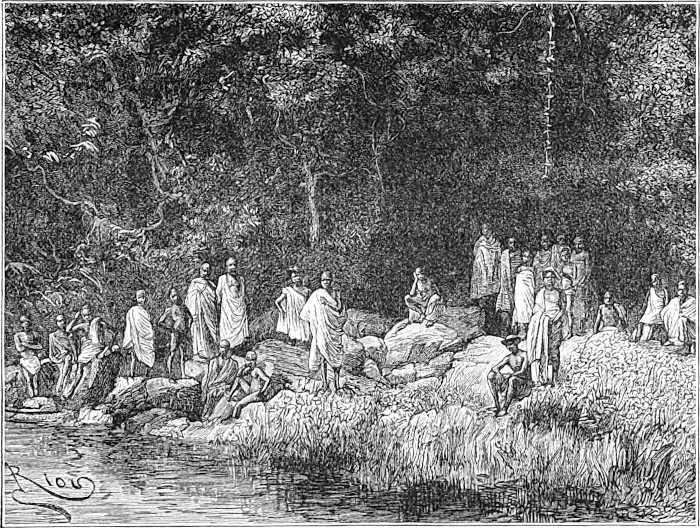
Bords du Comoë à Attakrou.
Sa situation sur le Comoë comme terminus[51] de la navigation fluviale, à proximité des chemins du Baoulé, du Morénou, de l’Anno, du Barabo et de l’Abron, y a attiré quantité de marchands Zemma (Apolloniens) qui viennent s’y fixer avec des produits de nos factoreries d’Assinie, de Grand-Bassam et de la colonie anglaise de Dioua (Cape-Coast). Ces Apolloniens,[260] qui sont très remuants et marchands par excellence, aussi intelligents que les Mandé et les Haoussa, ont installé, par les rues et dans les cours des habitations, des boutiques volantes avec étalage où dominent surtout les fusils à pierre, dits boucaniers mâles et femelles, des barils de poudre, des caisses de gin, du sel en paniers, fabriqué par les riverains du littoral, quelques étoffes à très bon marché, des perles en rocaille, et quantité d’autres objets, tels que cadenas, colliers de corail, couteaux, sabres d’abatis, etc.
Le mouvement commercial, tant par le Comoë que par la voie de terre, semble assez développé, et pendant notre route de Groûmania à Attakrou nous avons rencontré presque tous les jours quelques charges de produits européens. Malheureusement mon état de santé ne m’a pas permis de noter les charges aussi soigneusement que je l’ai fait pour Kong. Ce calcul n’aurait, du reste, offert qu’un tableau bien médiocre de l’importance commerciale, les marchandises bifurquant surtout à leur arrivée à Attakrou ; en effet, de là, les Mandé du Barabo et du Bondoukou quittent la route de l’Anno, passent à Eléso en amont d’Attakrou et de là remontent au nord par la vallée du Bâ.
Vendredi 1er mars. — Encore deux visites à Bénié, visites de remerciements et visites intéressées ; il s’agissait en effet de le décider à nous procurer des pirogues et des pagayeurs et d’obtenir de lui qu’ils nous conduisissent le plus loin possible. On croirait que c’est tout simple, car les pirogues ne font pas défaut, il y en a plus que nous n’en avons besoin ; malheureusement l’autorité de Bénié est méconnue à deux jours de marche d’ici, et il craint qu’il n’arrive des désagréments à ses piroguiers. Dans toute cette région il existe en effet une bien drôle de coutume : c’est celle de rendre solidaires les uns des autres les gens d’un même village quant aux dettes. Ainsi, parce qu’un homme d’Attakrou devait une certaine somme à un citoyen d’Aniasué, aucun des autres habitants ne pouvait s’y aventurer sans craindre d’avoir ses pirogues confisquées ou d’être retenu en otage jusqu’à extinction de la dette ; bon gré mal gré il fallait en passer par là, trop heureux encore de ne pas se voir refuser leur concours. Les pirogues ne nous sont promises que pour après-demain.
Samedi 2 mars. — Je ne m’en plains pas trop, ce repos forcé nous est bien nécessaire ; je souffre encore beaucoup, et ce brave Treich est sur les dents ; tout le service repose sur lui : réveil, organisation du convoi, ravitaillement, etc. ; mon état ne me permet de m’occuper que du journal de marche et des levés.
Il est quatre heures environ. Je suis dans des transes terribles. Le calme,[261] ou plutôt le peu d’empressement et d’activité de ces gens-là me crispe. Je songe à demain, à ce départ tant désiré, aux heures que nous allons perdre pour rassembler nos huit malheureux piroguiers ; encore, il n’y a même pas à songer à emmener tout notre monde en pirogue : Bénié trouve d’excellentes raisons pour leur faire faire la route à pied ; la moitié seulement de nos bagages et de nos hommes pourra partir avec nous.
Dimanche 3 mars. — Ce matin à trois heures et demie, nous étions debout. Une heure après, nous savourions un fouto au singe, réchauffé de la veille, et quelques bananes grillées. Tout était prêt, soi-disant, mais à six heures et demie les pagayeurs couraient encore après leurs pagayes et nous ne quittions la rive qu’à sept heures un quart.
Quel soulagement quand, en signe d’adieu, j’ai agité mon chapeau de feutre en loques, et quel bonheur pour moi d’être momentanément dispensé de ce fatigant voyage en hamac !
Boukary, mon domestique, m’avait installé dans la pirogue une couverture sur laquelle je me suis étendu en ayant le haut du corps appuyé contre des bagages en guise d’oreiller. Ma grosseur dans l’aine ne me fait plus autant souffrir, mais je sens que la fièvre va me reprendre. J’ai à côté de moi mon carnet, mes deux boussoles et mon ombrelle, qui m’a été bien utile dans la journée.
En quittant Attakrou, le fleuve coule presque en arc de cercle, mais la direction générale est sud. Partout il y a du fond. Au bout d’une heure environ nous laissons sur la rive droite un énorme banc de sable, puis, un quart d’heure après, on atteint un joli îlot boisé en face duquel et sur la rive gauche se trouve le petit village d’Akhiékrou ou Akhiékourou.
Deux femmes qui lavent vont appeler le chef de village, il nous apporte deux bouteilles à gin pleines de vin de palme frais. Point n’est besoin de manœuvrer habilement pour accoster : le chenal est tellement peu profond (à peine 10 centimètres d’eau) que la pirogue s’échoue d’elle-même, ce qui nous permet de déguster à loisir ce bon vin de palme.
Quelques instants après avoir dépassé l’îlot et le village, nous passons sur la rive droite, devant l’embouchure d’une petite rivière d’environ 4 mètres de largeur, qui coule dans un véritable berceau de verdure. Au moment où je m’étonnais de la façon calme dont s’effectuait notre descente, la rivière fait brusquement un coude, elle forme une boucle et nous franchissons successivement trois barrages assez difficiles. Le premier se passe assez aisément, le chenal étant juste au milieu ; mais, pour les deux autres, il faut habilement manœuvrer pour trouver le chenal, qui est presque contre la rive gauche. A peine sortis de ces barrages, nous atteignons un[262] point nommé Ebohoré, situé à peu près à mi-chemin entre Attakrou et Satticran. Cet endroit est un véritable chaos de roches et de bancs de petites huîtres. On met juste une bonne heure pour franchir ce passage difficile ; mais il n’y a ni rapides, ni endroits dangereux, ce ne sont que de fréquents échottages et des manœuvres d’une rive à l’autre pour passer les pirogues avec le moins de dégâts possible. Une demi-heure après, on franchit à peu d’intervalle deux barrages moins importants : le premier par un chenal au milieu ; le second, qui s’appuie sur un îlot, n’est praticable qu’en serrant de près la rive droite. Là s’étale un beau bief, bien profond, où l’on fait du chemin. Nous brûlons, sur notre rive gauche, le village de Mangokourou, en face duquel se trouve un atterrissage fréquenté par les gens du Morénou. Ce joli bief est limité en amont de Satticran par un barrage facile, à cheval au milieu, puis par un grand îlot en face d’un ruisseau de 3 mètres de large (rive droite) qui a son confluent à la fin de l’île. Quelques bons coups de pagayes bien rythmés nous font doubler un banc de sable de la rive gauche, et, quelques instants après, nous arrivons à Satticran, où nos hommes nous attendent depuis deux heures environ ; il est quatre heures et demie de l’après-midi au moment d’accoster. Il n’est pas possible de s’imaginer ce qu’un voyage de dix heures en pirogue est fatigant ; aussi, au lieu d’aller me promener autour du village, me suis-je mis de suite à transcrire notre premier jour de navigation, pour pouvoir plus à mon aise et l’esprit tranquille m’allonger et reposer mes reins courbaturés.

Couché dans la pirogue.
Sur la recommandation du chef d’Attakrou, nous sommes très bien reçus à Satticran. Les habitants nous offrent de la canne à sucre, des ananas, des bananes et des ignames, qui, avec un gros quartier de singe boucané, nous font un dîner succulent ! Mes hommes se fabriquent un gigantesque fouto avec de la viande de biche boucanée emportée d’Attakrou.
Dans la soirée, des gens d’Angoïkhé, petit village situé à 1 kilomètre en aval du fleuve, viennent nous voir. Quoique éreinté, je prends des renseignements sur la route à suivre le lendemain par nos porteurs, qui doivent se rendre à pied par la forêt à Aniasué et doubler l’étape ; ils suivront le fleuve d’Angoïkhé à Assémaone et n’ont à traverser qu’une rivière large de 5 à 6 mètres, qui passe entre Ammoaconkrou, la résidence du chef de l’Indénié, et le village de Zébédou, traversé par Treich en 1887. Demain, huit de nos hommes doivent revenir à Kabrankrou pour me transporter en hamac de cet endroit à Aniasué.
Tous les détails pour le lendemain étant réglés, nous essayons de dormir. Hélas ! mon mal me donne une fièvre qui me fait délirer malgré la quinine[265] préventive. Agité toute la nuit, non seulement je ne puis reposer, mais encore ce bon Treich ne ferme pas l’œil, prévenant mon moindre désir et me demandant, chaque fois que je me retourne un peu brusquement, si j’ai besoin de quelque chose.
Lundi 4 mars. — Au petit jour nos porteurs se mettent en route. Treich et moi, nous nous embarquons dans notre frêle embarcation, emportant quelques bananes grillées au feu qui doivent composer notre déjeuner. Un bief profond, limité par un petit barrage facile, à hauteur de la rivière de Zébédou, et le barrage d’Assémaone nous permettent de naviguer assez rapidement ; malheureusement, de ce dernier village à Darou — situé à un coude à angle droit que forme la rivière, — le lit est obstrué d’une suite de barrages dont les passes, situées tantôt à droite, tantôt à gauche, nous font perdre un temps précieux. Devant Darou, le fleuve est presque à sec, et des habitants le traversent à gué pour se rendre dans le Morénou, dont le sentier qui y mène se détache de la rive droite, en face du village.
De Darou à Kabrankrou il n’y a qu’un seul barrage, facile à franchir. Nous atterrissons à onze heures vingt.
A Kabrankrou, le fleuve se dirige sur Aniasué, par une série de méandres très longs à franchir. La navigation n’est pas interrompue, quoiqu’il y ait de nombreux barrages. A Kabrankrou même, il en existe un assez difficile, élevé de 2 mètres au-dessus des eaux, dans lequel se trouve une petite passe contre la rive droite.
Sur ce parcours en méandres de Kabrankrou à Aniasué, il n’existe qu’un seul village, sur la rive gauche, à mi-chemin ; il se nomme Bourouattakrou. D’après nos piroguiers, le chef de ce village aurait une belle pirogue à vendre ; il en demanderait 2 à 3 onces d’or (de 90 à 120 francs). Notre premier soin en débarquant est naturellement de nous informer si cette pirogue n’a pas encore trouvé acquéreur. Le soir, nous étions fixés : elle avait été vendue deux jours auparavant à des gens d’Arikokrou ; il n’y a donc plus à y songer.
C’est jusqu’à Kabrankrou que les pirogues d’Attakrou devaient nous conduire. Benié ne peut communiquer avec le chef d’Aniasué, avec lequel il vient d’avoir un différend au sujet d’une dette. D’autre part, comme je l’ai dit plus haut, le trajet en pirogue par Bourouattakrou est très pénible aux basses eaux. Il faut nous résigner à gagner Aniasué à pied. A cet effet nous nous installons à Kabrankrou, village comprenant une seule famille venue récemment du Morénou.
Treich, me laissant avec son domestique et un de ses hommes, part le[266] lendemain de bonne heure pour Aniasué, afin de me renvoyer les huit porteurs qui doivent me prendre avec le hamac.
Mardi 5 mars. — Quelle longue et affreuse journée ! Je souffre tellement de cette espèce de hernie, que je m’évanouis en voulant faire quelques pas. La douleur est intolérable. Une vieille femme du village, très compatissante, est allée, sans qu’on le lui demande, chercher des feuilles pour me faire un cataplasme, de sorte que dans l’après-midi je suis un peu soulagé.
Dans cette région les cases sont couvertes, comme dans l’Anno, de larges feuilles d’arbres et surtout de feuilles servant à emballer les kolas. Ces toitures sont faites avec un grand soin. Les feuilles sont maintenues sur les branches qui forment la cage de la toiture par de petites fiches en bois. Pas une fissure ne laisse pénétrer le soleil. C’est ici aussi que j’aperçois la première couverture en palmes. Elle est arrangée et combinée avec beaucoup de savoir, et disposée par lots de cinq à six palmes bien assujetties ensemble. Non seulement cette toiture est bonne et solide, mais elle est encore élégante.
Kabran, le chef de famille qui a donné son nom à cet embryon de village, est un chasseur de profession. A deux reprises différentes il est parti pendant dix minutes environ pour revenir, la première fois avec une biche, et la seconde avec un gros singe noir à queue et tête blanches, de l’espèce appelée, en agni, foé. C’est le singe le plus répandu. Son long poil noir luisant fait rechercher sa fourrure en Europe. Il est beaucoup acheté par les Apolloniens qui viennent dans la région et qui payent une belle peau jusqu’à 50 centimes en or. Ces fourrures ne sont pas achetées par les factoreries d’Assinie et de Grand-Bassam, pour une raison que je ne m’explique pas et que l’on n’a pas su me donner à Grand-Bassam ; elles vont toutes sur Cape Coast.
Nos hommes ne sont de retour d’Aniasué qu’à une heure déjà avancée de la soirée. Comme ils n’ont pas mangé et que, d’autre part, il est impossible de dormir à cause des moustiques, ils passent la nuit à préparer de la viande que nous vend Kabran.
Mercredi 6 mars. — Il est impossible de songer à se mettre en route ; mes malheureux porteurs sont incapables de refaire la route en me portant dans le hamac ; aussi n’ai-je pas de peine à faire remettre le trajet à demain.
Si dans certains endroits des régions que j’ai parcourues le moustique fait totalement défaut, il y en a d’autres où cet insecte pullule, et c’est le cas pour Kabrankrou. Je n’ai jamais eu, ou très rarement, à en souffrir,[267] ayant toujours eu soin de faire établir ma moustiquaire. C’est une excellente précaution, car, même quand il n’y a pas de moustiques, ce faible tissu vous préserve non seulement de la forte rosée, mais encore des fourmis, araignées et autres insectes malfaisants.

Habitation à l’européenne avec couverture en palmes à Bettié.
Jeudi 7 mars. — Nous sommes partis ce matin dès qu’il a fait jour, à cinq heures trois quarts. Il est impossible de se rendre compte de la fatigue qu’éprouve un malade voyageant en hamac. Malgré toute la bonne volonté des porteurs, on est cogné, par suite des sinuosités du chemin, contre les arbres et les lianes, le long du sentier. Les indigènes, pour se faciliter un passage, ont coupé de jeunes arbres à environ 80 centimètres ou 1 mètre du sol : ce sont autant de pieux sur lesquels on manque de se faire empaler. Les lianes, les arbres, contre lesquels on heurte le hamac dans les tournants, font tomber des bois morts, des nids de termites logés dans les arbres, des feuilles sèches et des rameaux pourris, qui vous aveuglent. On peut encore s’estimer très heureux de n’être pas blessé, estropié par quelque bois mort volumineux qui, suspendu dans les airs à une hauteur[268] de 20 mètres, s’effondre au moindre choc. De soleil, point ; il règne dans cette forêt de trente jours de marche une sorte de demi-obscurité qui fatigue. On a soif de voir le jour, de voir de l’herbe, car ici le sol n’est tapissé que de jeunes pousses d’arbres et de fouillis d’ananas. Pas de fougères, pas de fleurs, rien qui réconforte, qui parle au cœur, à l’âme — la monotonie est terrible dans ces régions. Et cependant, comme toute cette forêt est grandiose et mystérieuse ! Comme on s’y promènerait volontiers si l’on n’avait la préoccupation du lendemain ! Comme ce silence est imposant ! Ni le vent ni le soleil ne pénètrent dans cette immensité. A 100 mètres d’un village, on est isolé du monde. C’est à peine si l’on aperçoit les oiseaux : ils vivent dans les cimes, goûtant à la fois le soleil et l’ombre ; leur babil n’arrive pas jusqu’au sentier, étouffé par les coups de sabre des indigènes qui frayent le chemin en coupant des lianes et des arbres qui ont quelquefois 20 centimètres d’épaisseur. De temps à autre on entend cependant fuir un gibier, qui en se sauvant paraît briser tout sur son passage ; ce n’est pourtant qu’une toute petite gazelle, de la grosseur d’une chèvre. Dans les haltes, quand, assis dans le sentier, tout le monde se réconforte d’une igname bouillie, froide, ou de quelques bananes, il passe à 20 ou 30 mètres au-dessus de vous une joyeuse bande de singes dont les cris sont étouffés par le craquement de bois morts qui tombent en plein sur votre tête et vous forcent à vous garer.
Ces forêts sont tellement imposantes, que la vue d’un sentier à peine ébauché qui coupe le vôtre vous cause une joie infinie ; on se dit : « Il y en a donc d’autres aussi qui traversent ces solitudes ». Quand ces sentiers se représentent souvent et surtout quand ils se dirigent dans le sens opposé à celui que l’on suit, le courage se ranime, les forces reviennent, la tête de la caravane annonce « un chemin de jardin » : c’est l’indice de la proximité d’un village ; mais, hélas ! il faut quelquefois marcher encore pendant deux mortelles heures pour l’atteindre.

La forêt.
Quel bonheur ! comme le cœur bondit ! comme on se sent vivre, quelques instants après, à la rencontre d’un tronc à demi creusé qui doit fournir une pirogue ; puis peu à peu les plantations de palmiers à huile, un sentier élargi, une bananeraie, et, après, ces sommets de toits à couleur incertaine recouverts de feuilles mortes ou de palmes bistres, le chant du coq, ou ce bruit de crécelle rythmé qui révèle la présence d’un tisserand.
Oh ! ce chant du coq, quelle douce illusion il m’a produite ! Fatigués, avançant avec peine, ne sachant si nous rencontrerions bientôt le village, l’oreille au guet, nous croyions l’entendre bien souvent. « Comment serons-nous accueillis ? » nous disions-nous. Hélas ! le désir d’arriver à[271] l’étape nous faisait prendre pour la réalité ce qui n’était qu’une illusion de notre cerveau fatigué. Quand après deux nouvelles heures de marche nous arrivions au village tant envié, le coq dormait ainsi que les habitants.
Aujourd’hui, à part les chemins de bananeraie aux abords de Kabrankrou et d’Aniasué, nous n’avons rencontré que le sentier d’Assémaone, auprès duquel nous avons fait une halte d’un quart d’heure. Une demi-heure avant d’arriver à Aniasué, quelques habitants venus au-devant de moi ont voulu à toute force aider mes gens, et c’est porté par eux que j’entrais à Aniasué vers midi.
Treich, depuis son arrivée à Aniasué, n’était pas resté inactif : il avait engagé des pourparlers avec le chef, de sorte que pour le surlendemain les pirogues étaient promises. Le nom de ce chef est assez difficile à retenir : ce seigneur s’appelle Kakou Anougoua.
Vendredi 8 mars. — Bien accueilli dans le village, qui est assez grand (700 à 800 habitants), et avec l’appui du chef, Treich arrive à engager les piroguiers nécessaires pour nous conduire jusqu’à Bettié. Ce trajet doit se faire en quatre jours ; mais les piroguiers ne veulent pas dépasser l’Alangoua ; cependant, sur nos instances, et après avoir promis au chef d’Aniasué qu’il n’arriverait rien de fâcheux aux piroguiers, ce dernier leur donne l’ordre de nous conduire jusqu’à Bettié. Le marché fut conclu et le prix débattu jusqu’à Bettié inclusivement.
Pour me soulager, et profitant de cette journée de repos, Treich me confectionna, avec un morceau de cuir souple, des chiffons et le fer-blanc d’une boîte à sardines, un bandage destiné à soutenir cette espèce de hernie qui me fait tant souffrir et m’empêche de marcher. Deux courroies provenant de bretelles de fusil servent à le fixer. Muni de cet appareil, je peux, sans trop souffrir, me promener une heure par le village, qui est construit comme ceux de l’Indénié. Il me semble riche ; tous les habitants paraissent y vivre dans l’aisance. La moitié de sa population est composée de Zemma (Apolloniens), qui viennent y acheter des peaux de singes et de l’or de l’Alangoua, en remplacement de gin, de poudre, d’armes, d’étoffes qu’ils apportent de la Côte par le Sahué.
Les habitants se livrent beaucoup à la chasse. Dans ce village, la viande de biche et de singe boucanée ne fait pas défaut ; en tirant les mères, les indigènes s’emparent des petits singes vivants. Dans presque toutes les habitations, on en voit un ou deux en liberté ou attachés avec une ficelle, de sorte qu’on peut les examiner à loisir.
On trouve dans cette région neuf variétés de singes :
[272]1o Le cynocéphale, qui est connu dans presque tout le Soudan et dont je me dispense de faire la description ;
2o Le foé, ce singe noir à poil long et à tête et queue blanches dont j’ai fait la description plus haut ;
3o Le kouamé, genre de cynocéphale à poil gris très clairsemé. Ce singe, qui est très laid avec sa face ladre, se distingue surtout par des callosités prononcées aux fesses ; il passe pour être aussi intelligent que le cynocéphale, dont il doit être proche parent ;
4o L’assibé, singe de taille moyenne, à la fourrure d’un vert jaune avec le ventre gris blanc et la figure noire ; il ressemble au singe que nous appelons au Sénégal singe de Podor, mais son pelage est beaucoup plus clair ;
5o L’adéré, presque de la même couleur que le précédent, mais portant sur le bout du nez une belle tache toute blanche qui l’a fait surnommer par les Européens pain à cacheter ;
6o Le kômo, de petite espèce, pelage foncé à reflets noirs, verts et bleus ; il pousse fréquemment un cri qui l’a fait surnommer kômo ;
7o Le tah-hié, au pelage noir à long poil, avec la figure et le ventre rouge brun. Cet animal est un des plus intéressants que je connaisse ; il fait des sauts étonnants en largeur sans se servir de ses mains, simplement en se ramassant sur son arrière-train, qui se contracte et se détend comme un ressort ; en retombant, il lève les bras en l’air en appliquant les principes de gymnastique qu’on nous enseigne au régiment et à Joinville ;
8o Le tié, le plus joli des singes que l’on puisse rêver. Sa robe est d’un gris irisé, et son dos dans le sens de l’épine dorsale est partagé en deux par une bande de poils rouge feu. Il a le ventre blanc, et sa tête est encadrée d’une belle barbe blanche se terminant par une longue barbiche, blanche également, qu’il se laisse volontiers caresser quand il est apprivoisé.
9o Enfin le chimpanzé, qui est rare[52].
Les peaux les plus marchandes sont, dans l’ordre de préférence, celles des foé, tié, tah-hié, assibé, adéré et kômo ; celles du cynocéphale et du kouamé sont utilisées par les indigènes pour les usages domestiques.
Au premier abord on pourrait croire que l’on éprouve une certaine répugnance à manger la chair de ces animaux, et qu’elle doit être très[273] coriace. Le fait est vrai pour quelques variétés de singes, surtout pour le cynocéphale, qui est peu comestible ; mais dans ces forêts le singe ne vit pas exclusivement de fruits, il se nourrit surtout de jeunes pousses d’arbres, et quelques-uns d’entre eux, tels que le tah-hié et le foé, n’arrivent à manger des fruits qu’après un acclimatement progressif.
Ces deux variétés de singes offrent également une particularité, c’est qu’ils ne sont munis que de quatre doigts aux mains : le pouce a totalement disparu. Chez certains d’entre eux il y en a cependant trace. Dans ce cas, il a à peine 3 ou 4 millimètres de longueur.
Samedi 9 mars. — Nous avons pu quitter ce matin Aniasué à sept heures. Tout notre monde est réparti dans trois pirogues de 6 à 7 mètres de longueur. A sept heures dix, nous saluons, en passant, les habitants d’Amangouakourou, puis nous franchissons trois barrages offrant des passes commodes vers la rive droite ; et à huit heures et demie, après avoir dépassé un îlot boisé en face duquel débouche la rivière Betti, qui vient de Yacassé (Indénié), nous atteignons Inguérakon. Nous restons à ce village jusqu’à onze heures sous un prétexte que je ne saisis pas trop, et nous faisons un déjeuner de fouto.
Le danger ayant disparu (c’étaient des gens de l’Attié, avec lesquels nos piroguiers avaient eu maille à partir, qui nous observaient dissimulés dans la végétation sur la rive droite), nous franchissons les trois barrages d’Inguérakon et atteignons à midi et demi Kommokourou, situé un peu en aval du confluent de la rivière d’Abengourou.
De Kommokourou à Ahinikourou, où nous devons passer la nuit, le fleuve est obstrué par une série d’îlots et deux barrages qui en rendent la navigation pénible, surtout en cette saison ; enfin, vers deux heures et demie, nous atteignons Ahinikourou, habité par une colonie de l’Attié, pays situé en face de nous sur la rive droite du Comoë et s’étendant dans l’ouest jusqu’au Baoulé.
Ce village n’ayant que quatre cases, nous campons sur la rive. J’en suis d’autant plus satisfait que pendant le trajet j’ai cru comprendre, dans une conversation des piroguiers, qu’ils seraient enchantés de nous planter là et de repartir de nuit avec leurs pirogues vides pour Aniasué, ce qui nous gênerait considérablement.
La descente du fleuve est très intéressante : le cours accidenté et la végétation qui borde le Comoë ne ressemblent pas au Sénégal.
En quittant Attakrou, les rives s’affaissent insensiblement ; au lieu d’être abruptes, elles s’abaissent doucement et, par une pente douce, viennent mourir dans l’eau. Point de ces longs villages comme dans le Fouta et le[274] pays sonninké de Bakel, où toute la population est sur la rive pour vous voir passer. Ici les lieux habités sont cachés dans la végétation ; leur présence ne se révèle que par le vert tendre des plantations de bananiers et un ou deux toits qui émergent en bordure sur une toute petite clairière.
D’autres fois, le village, enfoui sous la végétation, n’est deviné que par un chemin d’atterrissage et une ou deux pirogues au mouillage. Pas de bruit, le silence n’est troublé que par les piroguiers qui se stimulent d’instant en instant avec le cri souvent répété de : « Diakha ! Diakha ! » qui veut dire : « Pagayons ! pagayons ! »
Les bancs de sable sont dépourvus des oiseaux aquatiques que l’on trouve par milliers sur les bancs du Sénégal. C’est à peine si de temps en temps on aperçoit deux ou trois paires de sarcelles. Pas d’ibis, pas de spatules, encore moins de pélicans ou de marabouts. Les caïmans et les hippopotames sont rares également. Dans les biefs, l’eau est calme : le courant, cependant, est encore d’environ 1 nœud à l’heure.
Dans la journée, pendant la grosse chaleur, il est difficile de rechercher l’ombre des rives : elles sont défendues par des bois morts et des racines qui rendent la navigation difficile. Je regrette bien mes joyeuses fusillades sur les bords de l’île à Morfil (Sénégal), où toute la journée on peut s’amuser à tirer des singes, des oiseaux aquatiques, des caïmans ou des hippopotames. Ici, rien, ou à peu près ; le fleuve paraît mort, on croirait qu’il n’est pas habité ; les seuls indices qui dénoteraient la présence d’hommes consistent en petites pêcheries dans le lit des affluents qui se déversent dans le Comoë, près de leur embouchure. Aujourd’hui, cependant, Treich a tiré deux coups de fusil sur des tintans, oiseaux pêcheurs bruns, à huppe, qui poussent des cris perçants en prenant leur vol, et sur un aigle pêcheur à tête blanche, perché sur la cime d’un arbre mort.
Nous sommes ici sur la frontière de l’Indénié.
Ce pays, qui limite le Sanwi au nord, est borné à l’est par le Broussa, l’Aowin et le Sahué, au nord par l’Assikaso, « pays de l’or », province du Bondoukou, et par l’Anno. A l’ouest il confine au Baoulé, au Morénou, à l’Attié et au Bettié.
Ammoacon, le souverain de l’Indénié, a fixé sa résidence à une journée de marche dans l’est d’Attakrou ; elle porte son nom, auquel on ajoute krou : Ammoaconkrou.
Les autres centres dont les chefs, tout en référant à l’autorité du souverain, jouissent par eux-mêmes de quelque influence, sont ceux d’Attakrou, d’Aniasué et d’Abengourou, dont nous avons donné les noms plus haut.
[275]L’Indénié est peuplé de gens de race agni, avec quelques colonies du Morénou et de gens de l’Attié, mais ce pays est surtout envahi par les Zemma ou Apolloniens, qui y ont accaparé tout le commerce.
L’Alangoua, situé au sommet du triangle formé par le Comoë et le Mézan, est autant sous la protection de l’Indénié que du Bettié. M. Treich a cependant, en 1887, cru prudent de le lier à nous par un traité spécial qui reconnaît en fait son autonomie.
L’Indénié est très avantageusement situé pour les transactions commerciales : il occupe une position relativement rapprochée de la Côte (8 journées) ; on peut rayonner aisément vers l’Abron, le Bondoukou et Kong, l’Anno, le Djimini et le Kong, et les tribus du Baoulé et du Morénou voisines du Comoë peuvent également venir s’y approvisionner.
Dimanche 10 mars. — Quel miracle ! nous avons réussi à quitter avec nos trois pirogues Ahinikourou à cinq heures et demie. Ici, comme ailleurs du reste, quand on est à la merci des indigènes et des piroguiers, il est difficile de rassembler ceux qui doivent vous accompagner à un titre quelconque ; on peut se considérer comme ayant une fière chance quand on réussit à se mettre en route avant sept heures du matin ; aussi nous sentons-nous tout heureux, mon compagnon et moi, de partir avant le lever du soleil.
Le trajet est assez agréable, il n’offre pas trop de difficultés ; cependant, après vingt minutes de navigation, nous atteignons un îlot relié à la terre ferme par un amoncellement de rochers qui forme barrage, mais qui se franchit facilement. Vers six heures un quart nous passons devant le village abandonné de Zaoccra et atteignons Batouatu (colonie attié). En aval du village existe un barrage assez facile, puis le fleuve présente un joli bief assez profond qui nous mène devant un second village attié nommé Amiakassikrou, auprès duquel commence une longue île boisée se terminant entre Iapiatuin et Aricokrou, les deux premiers villages attié construits sur la rive droite. Le chenal passe entre la rive droite du Comoë et l’île, et n’est barré qu’une fois. Au delà d’Aricokrou, le bief se continue libre de tout obstacle ; seule une roche de 4 mètres s’élève au milieu du fleuve à hauteur d’une petite rivière de 4 mètres de large, venant de l’ouest ; puis on rencontre une autre roche entourée d’un banc de sable et un petit barrage également facile, situé à l’embouchure d’une rivière de 4 mètres de largeur, qui arrose l’Alangoua. Les rives du fleuve s’inclinent en pente douce : pas de berges escarpées, rien qui dénote de grandes inondations pendant les fortes crues ; cependant les piroguiers m’ont fait voir sur la rive même un gigantesque bombax qui est entaillé à la hache[276] à 7 ou 8 mètres au-dessus du niveau actuel des eaux. C’est, paraît-il, le point le plus élevé qu’aient atteint les plus grandes crues des trente dernières années.
Au delà du confluent de cette petite rivière de la rive gauche dont j’ai parlé, et près d’un barrage assez long, mais facile pour nos embarcations légères, commence l’Alangoua.
Ce petit pays est très riche en terrains aurifères ; il comprend une vingtaine de villages, habités tant par des gens de l’Attié et de l’Indénié que par des colonies de Bettié et surtout de l’Ahua (Apollonie). Au sud, l’Alangoua est limité par la rivière Mézan, dont nous parlerons un peu plus loin.
Vers midi nous atteignons Adoukassikrou (rive gauche), où nous nous décidons à passer la nuit, nos piroguiers nous demandant de ne pas pousser jusqu’à Blékoum, le village suivant, à cause du passage de Dabiabosson, qui, paraît-il, est très dangereux à franchir et demande surtout une grosse dépense de forces physiques.
Adoukassikrou offre suffisamment de cases pour nous abriter ; nous sommes cependant forcés de camper sur la rive, à cause de nos piroguiers, qui cherchent à nous abandonner et dont l’envie de s’en retourner se manifeste de plus en plus. Par surcroît de précautions, je leur fais laisser les pagayes dans les pirogues et ordonne à une partie de mes hommes d’y coucher.
Dans ce village nous n’avons trouvé à acheter des provisions qu’à une heure fort avancée de la soirée, par suite d’un enterrement.
Cette cérémonie est assez curieuse pour que je la décrive.
Le cortège funèbre était précédé de la veuve du défunt ; elle portait une calebasse de fouto. Le cadavre était renfermé dans un cercueil en bois creusé dans un tronc d’arbre et fermé par un couvercle fixé avec de fortes ligatures en cordes et en lianes. Comme le défunt était un étranger, on chargea le cercueil dans une pirogue qui devait le conduire à son village, situé en aval du fleuve. Des femmes, munies de poteries et de paniers renfermant probablement la fortune que laissait le défunt, suivaient en pirogue.
Les indigènes m’ont dit qu’au moment où la bière est descendue en terre, les assistants demandent par trois fois au mort de revenir, puis on jette une poignée de terre sur le cercueil.
L’anniversaire de la mort est célébré pendant trois ans ; cette cérémonie est suivie d’un festin et d’une visite à la tombe avec des mets préparés en l’honneur du défunt. Le deuil consiste pour toute la famille à avoir la[277] tête rasée pendant plusieurs mois. La veuve obtient la permission de se remarier six ou sept mois après la mort de son mari.
Quand le défunt est de famille royale ou un personnage de distinction, l’enterrement donne lieu à des scènes de sauvagerie et à des sacrifices humains, dont j’ai parlé dans le chapitre de Bondoukou.
Une partie de l’après-midi fut employée à acheter des provisions. Les ignames font presque défaut, et celles qui existent sont d’une bien médiocre qualité. On peut dire qu’à partir de l’Alangoua, la base de la nourriture consiste exclusivement en bananes vertes cuites à l’eau, pilées ensuite et préparées en fouto avec des sauces de piment, du singe ou du poisson sec.
Les payements ne se font qu’en poudre d’or. Nous avons cependant réussi à nous procurer quelques régimes de bananes par l’échange direct de menus objets. Nous aurions désiré un peu de viande fraîche, mais ce village, comme plusieurs autres de la rivière, ne possède pas de bœufs ; cependant il y a des moutons, des chèvres et quelques poulets.
Les indigènes nous réclamaient surtout du tabac en feuilles, qui fait absolument défaut par ici : il n’est cultivé que dans les pays situés au nord de 8° 30′ de latitude. J’avais une belle collection de tabacs, environ une trentaine de qualités ; l’humidité entre Salaga et Kintampo l’a fait moisir : j’ai dû tout jeter en arrivant à Bondoukou. — Voici quelques renseignements sur la culture du tabac :
On choisit de préférence des terrains boisés, où l’on abat et brûle les arbres en décembre. On défriche, on enlève les mauvaises herbes et les pierres, on assure l’écoulement des eaux, on détruit les insectes nuisibles en recouvrant le sol de paille brûlée, on ensemence en juin et octobre, et l’on récolte en mars et avril.
Les terrains les plus favorables paraissent être les terrains boisés formés d’une couche sablonneuse recouverte d’une couche de terre grasse. Les terrains pierreux, sans profondeur, ceux où l’eau s’écoule mal, sont impropres.
En vue d’une répartition égale, la semence est mélangée de sable et de cendre de bois aussi blanche que possible. Il est bon qu’elle germe pendant deux ou trois jours sur des toiles humides, puis on recouvre de paille la surface du sol ensemencé. Pendant la première quinzaine il faut arroser deux fois par jour, une seule ensuite.
Au bout de quelques jours on enlève cette couverture. Vingt-cinq jours après, les plantes sont transportées dans les champs, préparés pour les recevoir. En cas de sécheresse, on les arrose jusqu’à ce qu’elles aient pris[278] racine. Soixante jours plus tard, la cime se couronne d’une tige de fleurs, qu’on tranche avec les ongles. Les rejetons qui naissent entre la feuille et la tige sont coupés de la même manière.
La récolte arrive deux ou trois semaines plus tard.
Les soins de culture, comme on peut s’en rendre compte, sont bien donnés ; mais là où le planteur de tabac est inférieur à celui de Java et des Antilles, c’est quand il s’agit de la préparation.
Le séchage n’existe pas ; la fermentation n’est pas ordonnée. L’aération et l’obturation du jour, qui sont d’une importance capitale dans la préparation des tabacs, leur sont inconnues.
Il suffirait d’initier les Soudanais à ces minutieux détails, pour obtenir d’eux des qualités de tabac pouvant rivaliser avec les meilleures de Java ou des Antilles.
Pour donner une idée de l’extension qu’a prise la culture du tabac à Java, nous citons ci-dessous un passage d’un correspondant du Temps, qui ne manquera pas de jeter un jour favorable sur ce que peut devenir une exploitation bien ordonnée :
« En 1865, quelques planteurs de Java conçurent l’idée d’étendre le champ de leurs opérations de culture de tabac à Sumatra. Les trois premières années ne donnèrent pas de grands résultats ; mais, à partir de la quatrième, on passait de 200 balles à 1000, et en 1870 on en produisait 3000 (la balle pèse de 75 à 80 kilos). En 1888 on est arrivé à 140000 balles, représentant 60 millions de francs. En vingt-quatre ans, les ventes à Amsterdam et à Rotterdam produisaient ensemble plus d’un demi-milliard. Le marché des États-Unis, d’abord réfractaire au nouveau produit, en prend annuellement aujourd’hui 40000 balles. »
★
★ ★
Le bandage improvisé confectionné à Aniasué me permettait de rôder un peu aux alentours. Je me promenais à quelques centaines de mètres du village avec mon fusil pour essayer de tirer quelque oiseau. Ma chasse ne fut pas bien brillante : je revins avec un malheureux rat palmiste qui n’était qu’un bien faible appoint pour notre modeste gamelle. J’étais tellement affaibli, que le recul de mon fusil de chasse m’avait, en tirant, jeté à la renverse. Dans de telles conditions physiques je ne pouvais songer à de plus brillants exploits cynégétiques. Pourtant les perroquets gris à queue rouge abondent sur la rive ; il y a des palmiers où l’on trouve trente à quarante de ces oiseaux en train de jacasser et n’ayant pas l’air bien sauvages.
[279]Les nuits dans ces forêts sont plus tristes qu’en pays découvert. Pas d’étoiles visibles, c’est à peine si l’on aperçoit à travers les éclaircies du feuillage quelques pâles rayons de lune. Les moustiques abondent, il est impossible de fermer l’œil sans moustiquaire.
Le profond silence de la nuit n’est troublé que par le murmure continu de quelque chute d’eau et le cri perçant des musaraignes, en chasse dans les cimes élevées des arbres de la forêt. C’est triste, je dirai même presque lugubre. Tout s’en mêle, jusqu’au feu, qui, au lieu de flamber, ne fait que se consumer à cause de la grande humidité dont le bois est imprégné. Je regrette bien des fois le haut pays de Kong et du Mossi avec son soleil, ses beaux clairs de lune et nos gais feux de bivouac.
Lundi 11 mars. — Aujourd’hui nous avons eu une bien pénible journée. Embarqués à cinq heures un quart ce matin, nous ne sommes arrivés à Abradine qu’à trois heures de l’après-midi. Malade et épuisé comme je le suis, ces dix heures de navigation sous un soleil de plomb m’ont exténué. Je ne veux cependant pas m’endormir sans avoir transcrit mes notes de voyage.
A six heures, nous avons franchi le passage de Dabiabosson. Ce passage, amas d’îlots et de roches, est très dangereux ; il comprend de petites chutes et des rapides pendant quelques centaines de mètres. A cet endroit le fleuve fait un coude assez prononcé vers le nord, pour reprendre près de la rivière Bosson-Mutua sa direction nord-sud.
Dans les rapides, un piroguier à l’avant, l’autre à l’arrière, munis de longs bambous, sont en permanence occupés à parer les roches entre lesquelles passe le rapide. Un faux mouvement peut non seulement briser la pirogue, mais dans cette descente vertigineuse, avec la vitesse acquise, on s’écraserait certainement contre les roches. Mais ces gens-là sont très adroits et il ne nous arrive rien de fâcheux. En aval de la rivière Bosson-Mutua nous passons devant le village de Blékoum, rive gauche, et la rivière Affroasué, qui vient, nous dit-on, d’Abengourou. Au delà, le fleuve est parsemé de groupes d’îlots entre lesquels on passe assez facilement, mais à partir de Bouadikadjoukrou commence un barrage presque continu qui prend successivement le nom de passage d’Aouamlan et d’Adiammalan. Ce dernier se termine à Iapokourou (village de la rive droite).
Ces barrages, difficiles en cette saison, sont bien plus dangereux pendant les hautes eaux. Nous trouvons dans les roches qui les constituent quantité de pirogues brisées et suspendues dans toutes les positions. Dans le passage d’Adiammalan j’en ai compté jusqu’à sept, ce qui prouve que pendant une certaine époque de l’année cet endroit doit être très dangereux[280] à franchir, même pour les gens qui connaissent bien la rivière.
En quittant Iapokourou, on laisse sur la rive gauche l’embarcadère d’Akobakrou, puis, après avoir passé devant Etiapo ou Mbaso (rive droite), on atteint l’embouchure du Mézan. Cette rivière prend sa source dans l’Indénié, aux environs d’Annibilékrou ; elle a été recoupée près de ses sources en 1882-83 par l’Anglais Lonsdale, pendant sa route de retour sur Cape Coast. Treich-Laplène l’a franchie en trois endroits différents en 1887 et en 1888. Son cours est donc à peu près défini. Elle a environ 6 à 8 mètres de largeur près du Comoë et serait navigable pour les pirogues jusqu’en amont de Diangobo, si son lit n’était obstrué par des troncs d’arbres. Elle sert de limite entre l’Alangoua et le Bettié et reçoit sur sa rive droite de nombreux affluents insignifiants, dont les alluvions contiennent beaucoup d’or. Aux environs de Béboum et d’Agirikrou, les indigènes ont des puits à galerie pour l’extraction de l’or, qui est surtout exploité par les Apolloniens.
Après le confluent du Mézan la rivière fait deux coudes très prononcés et reprend sa direction nord-sud à l’extrémité d’une île allongée. Quelques instants après, on atteint Abradine, en face de l’embouchure d’une petite rivière de 4 mètres.
Abradine est situé sur une berge élevée de 6 mètres au-dessus du niveau actuel du Comoë. A l’atterrissage sont amarrées une douzaine de bonnes pirogues de différentes dimensions, servant, les unes au transport des marchandises, les autres à la pêche. C’est ici que nous rencontrons les premières pêcheries sur le fleuve même. Plus en amont, ce ne sont que de petites pêcheries à l’embouchure des ruisseaux, simples barrages en bambou, dans lesquelles sont disposées des nasses.
Le chef d’Abradine se nomme Bourbé, de sorte que son village est aussi désigné sous le nom de Bourbékrou. Nous sommes fort bien accueillis par Bourbé, qui ne nous laisse manquer de rien : volailles, fouto, bananes et vin de palme nous arrivent en abondance.
Mardi 12 mars. — J’ai passé une bien affreuse nuit : cette grande fatigue d’hier ne m’a pas permis de reposer, j’étais très agité, et ce matin en me réveillant je me suis trouvé presque aussi exténué qu’en me couchant hier soir. Pour comble de malheur, les piroguiers ont tout l’air de nous avoir abandonnés. Comme les embarcations étaient gardées par mes Mandé armés de mes deux fusils, ils n’ont pu se sauver de nuit par eau. Une rapide inspection des cases du village me permit de mettre la main sur les pagayes, que je distribuai aux gens de Treich ; ils habitent pour la plupart les environs de la lagune Aby et savent s’en servir.[281] Bourbé, nous voyant décidés coûte que coûte à partir pour Bettié, essaye de rallier les piroguiers, mais ces derniers refusent d’embarquer : ils craignent, disent-ils, que les gens de Bettié ne les retiennent comme otages, leurs concitoyens d’Aniasué ayant laissé des dettes à Bettié. Ne voulant pas perdre un temps précieux, je fais pousser les pirogues au large, et nous voilà partis, laissant nos piroguiers à Abradine.
La descente s’opère plus aisément que nous ne pensions. Nos hommes, qui savent que Bettié est un point important à atteindre, redoublent d’ardeur. Bientôt nous arrivons à Ediéna, point de départ d’un chemin fréquenté sur l’Indénié, et nous doublons la boucle sur laquelle est situé ce village. A partir de ce point, le fleuve, quoique coudé, reprend sa direction nord-sud. Nous franchissons trois barrages constitués par des roches striées verticalement, et atteignons Attiéréby, village dépendant de Bettié et situé sur la rive droite du fleuve. Treich demande de nous arrêter quelques instants afin de serrer la main au chef de ce village, qu’il connaît. Je me range d’autant plus volontiers à son avis que nous pouvons mettre nos pirogues à l’ombre et profiter de cette halte pour manger quelques bananes.
Une demi-heure après, nous nous remettons en route. Le bief est profond, on y fait du chemin, et bientôt nous sommes devant Attrasou et Beniékassikrou. A partir de ce dernier village, le Comoë est obstrué de nombreux îlots, mais laisse cependant, dans le barrage qui les longe, un chenal praticable assez facile. A une heure nous apercevons sur la rive droite les toits de Bettié : nous sommes à cinq étapes de Grand-Bassam ! — et sûrs de trouver ici un fidèle allié.
Mercredi 13 mars. — Il fait bon aujourd’hui se reposer et écrire, les préoccupations sont moindres, je me crois presque au terme de mon voyage.
En arrivant hier, et au moment d’accoster, des gens de Bettié placés sur la rive nous prièrent de ne pas débarquer de suite, et d’attendre un instant, pour donner le temps à Bénié Couamié, le chef de Bettié, de nous recevoir avec le cérémonial qui convient.
Dix minutes ne se sont pas écoulées que le tam-tam résonne, les olifants jettent leurs notes plaintives, des cris partent un peu de tous côtés, et Bénié Couamié paraît au haut de la berge, précédé d’un pavillon tricolore et de sa musique. Il est proprement vêtu et drapé dans un plaid en soie et laine de fabrication européenne. N’ayant pas de cheval, il se sert comme monture d’une sorte de cheval en bois porté à bras par quatre hommes. Après nous avoir souhaité la bienvenue et serré la main, il nous engage à[282] le suivre et nous conduit à son habitation. S’il m’était réservé une surprise, c’est bien celle de trouver ici une construction à l’européenne et installée très confortablement ; cette maison a un étage, et elle comporte des escaliers et des vérandas très bien conditionnés.
Le rez-de-chaussée sert de magasins ; c’est là que Bénié Couamié met ses marchandises, car ce chef est un des plus importants traitants de la région. Une des chambres sert d’atelier de menuiserie, et l’autre de logement au menuisier charpentier qui construit les escaliers, balustrades, portes et volets, et veille à leur entretien. Ce menuisier est un Apollonien venu de Cape Coast, c’est en même temps le gardien des marchandises et l’homme d’affaires de notre hôte.
On monte au premier par deux escaliers en bois fort bien construits, avec balustrade à jour en bois façonné. Les escaliers mènent à un vaste palier servant de chambre d’audience, qui donne par une large ouverture sur une petite salle couverte de nattes, dans laquelle se trouvent deux tables et quelques sièges, chaises ou fauteuils fabriqués en palmier. Une carafe et deux verres à pied bleu, une image de la Vierge[53] et une grande glace, dans des cadres en bois, complètent le décor de ce petit vestibule-salon.
De chaque côté de cette salle, et séparées par une cloison et des rideaux en étoffe du pays, se trouvent des alcôves formant chambre à coucher, sur lesquelles donne de chaque côté une autre petite chambre.
L’ameublement des alcôves consiste en une chaise et un lit en bois, sorte de châssis grossièrement fait, semblable aux lits des Wolof de Saint-Louis. Chaque couchette est munie d’une bonne paillasse bourrée de paille de maïs, et d’oreillers, le tout recouvert de tapis en cotonnade du pays ou de pagnes de Rouen. Les vérandas sont protégées par une toiture en palmier artistement tressée qui les met à l’abri du soleil et de la pluie.
Je laisse à penser si, après avoir couché pendant plus de deux ans par terre, sur une natte, généralement en pleine brousse, j’ai dû trouver cet intérieur charmant !

Réception de Bénié Couamié.
Non seulement nous étions très bien installés, Treich et moi, dans chacune de ces alcôves, mais encore nous avons trouvé à notre adresse une petite caisse contenant six bouteilles de vin, quelques boîtes de conserves et une quarantaine de biscuits, c’est-à-dire plus qu’il n’en fallait pour nous faire oublier nos souffrances. A l’unanimité il fut décidé qu’on[285] goûterait au vin pour le dîner, dont le menu ne laissait rien à désirer :
- Potage julienne.
- Fouto au singe.
- Petits pois au lard.
- Biscuits.
- Vin.
- Thé sucré.
- Pipes et tabac.
Nous avons si bien dîné que le lendemain nous avons eu quelque peine à nous lever. Je me sentais, ainsi que mon compagnon, la tête un peu lourde, et cependant nous n’avons bu, à nous deux, que 75 centilitres de vin environ,... mais il y avait si longtemps que j’en étais privé ! Une autre joie nous était réservée : la délicate attention des employés de la maison Verdier de Grand-Bassam ne s’était pas bornée à la nourriture corporelle : il y avait encore, enveloppant les biscuits, une demi-douzaine de journaux de Bordeaux et de la Rochelle (de trois mois de date) que nous avons lus et relus plusieurs fois sans en perdre un seul mot, annonces comprises, ce qui m’a permis de constater une fois de plus qu’on a beau s’absenter des années, on est toujours heureux de lire et relire même les choses les plus insignifiantes, pourvu que cela vienne de son pays.
Bénié Couamié nous fit un excellent accueil, de nombreux cadeaux en vivres, bananes et viande, et me pria d’accepter une bague en or surmontée de deux petits canons. Il parle d’une façon assez correcte le mandé, que lui ont appris des esclaves et surtout un musulman qui a été son hôte pendant plusieurs années. Sa propre habitation est moins luxueuse que celle qu’il a mise à notre disposition : elle comporte plusieurs cases construites autour d’une cour centrale, à l’instar des habitations des gens du Bondoukou et de l’Anno, décrites plus haut.
Dans l’une d’elles se trouve cette sorte de châssis en bois, découpé en forme de cheval, muni de brancards, sur lequel Bénié se fait porter dans les villages de son domaine quand il ne peut se servir de la voie fluviale comme moyen de locomotion. De même qu’Ardjoumani, chef du Bondoukou, un parasol achève de le rendre tout à fait grotesque sur cette monture plus primitive que le cheval de bois d’un gamin de six ans.
Ceci n’empêche pas Bénié d’être un brave et digne chef, aimant les Français. Son intelligence m’a paru supérieure pour un noir. Ce qui m’a surtout frappé chez lui, c’est qu’il est actif, nerveux, et presque emporté,... tout à fait Français d’allure.
Son village, que l’on nomme aussi Kodjinna, a environ 500 à 600 habitants.[286] Il est situé dans une position qui lui permet d’intercepter à son gré la navigation sur le Comoë. Les roches et les îlots en amont et en aval permettent à des tireurs, même armés de fusils à pierre, d’empêcher qui que ce soit de passer. Bourbé, chef d’Abradine, avait voulu, il y a quelques dizaines d’années, forcer les passes de Bettié, mais Bénié et ses gens lui ont tué beaucoup de monde et fait sa flottille prisonnière.
Depuis ce jour Bourbé a reconnu la suzeraineté de Bénié Couamié, en devenant son plus fidèle allié et ami.
Bourbé se plaît lui-même à raconter ce fait d’armes de son vainqueur.
A Bettié il se fait un grand commerce de sel, provenant des villages agni du littoral entre Grand-Bassam et Assinie ; on y vend aussi des armes, des peaux de singes de toute espèce, de l’or, du gin et des étoffes. L’huile de palme, quoique abondante, ne descend pas à la Côte ; on n’en fabrique que pour les besoins locaux, et le palmier n’est recherché que pour en extraire le vin de palme, qui forme ici, avec le gin, le fond de la boisson.
Jeudi 14 mars. — Cette journée a été bien employée. Nous avons réglé dans un palabre différentes questions politiques en litige avec Bénié. Ce que ce dernier réclame surtout de nous, c’est une protection efficace du fleuve en aval de Bettié ; il se plaint que les gens de Krinjabo établis à Cottokrou, ainsi que le chef de l’Akapless et du Grand-Alépé, entravent les communications, ce qui lui cause un grand préjudice. Le fleuve, qui appartient à tout le monde, n’est pas libre : tout le monde y commande. « Moi-même, ajoute-t-il, je me fais fort de vendre cinquante fois plus de marchandises que je n’en écoule, s’il y avait une autorité réelle qui tienne en respect les populations turbulentes de la rivière. » Bénié Couamié m’a instamment prié d’envoyer une garnison française dans son village ; il en ressent si bien la nécessité qu’il m’a donné à entendre qu’il ferait tout ce qu’il est possible pour faciliter son installation. « Le traité que j’ai signé avec les Français, dit-il, est un sûr garant que votre gouvernement me veut du bien, mais pourquoi ne donne-t-on pas suite au programme qui s’impose, celui de la protection de la rivière et des marchands qui y naviguent ? »
Je n’ai pu qu’approuver le désir de ce brave allié et lui ai promis que je m’emploierais auprès du gouvernement, à ma rentrée en France, pour activer une solution si désirée, et pour lui, et pour ceux qui ont des intérêts dans la rivière.
Quelques heures après notre arrivée à Bettié, les piroguiers d’Aniasué arrivaient avec des pirogues empruntées à Bourbé, chef d’Abradine. Craignant[287] de voir leurs embarcations confisquées, ils avaient cru prudent de nous suivre. Comme nous avions traité à forfait avec eux pour la descente du fleuve et qu’ils n’avaient pas exécuté les conventions de l’accord intervenu entre nous et leur chef, je les fis venir devant Bénié Couamié et Bourbé et défalquai de leur solde acquise une journée de route à l’aller, ce qui leur parut logique ; après leur règlement je demandai à Bénié de les laisser s’en retourner. Avec la somme qui leur fut payée, ils achetèrent du gin, du sel, de la poudre, des armes et des étoffes, et nous quittèrent, heureux de s’en tirer à si bon compte.
Ces différents détails réglés, il fut convenu avec Bénié qu’il nous accompagnerait le lendemain avec ses pirogues jusqu’à Daboisué ; que, de là, nous gagnerions par terre Malamalasso, et que ses pirogues nous conduiraient jusqu’à Annocankrou, faisant partie d’un groupe de villages que les indigènes désignent sous le nom générique de Nzakourou.
Vendredi 15 mars. — Ce matin, nous ne sommes partis que vers neuf heures, par déférence pour Bénié. Il nous était impossible de protester.
Du reste ce brave chef y mettait tellement du sien, que nous ne pouvions réellement lui tenir rigueur du retard que nous éprouvions.
La grosse pirogue de Bénié Couamié, qui peut contenir une trentaine d’hommes, fut mise à l’eau. A l’arrière, amarré à un long bambou de 5 mètres, flottait notre pavillon, celui que Treich avait remis à Bénié en 1887. Bénié s’y embarqua muni de son parasol et y installa la musique de Bettié (4 tam-tams et 3 olifants) ainsi que l’escorte réglementaire, sorte de garde du corps composée de sept ou huit guerriers armés de fusils, qui accompagnent toujours Bénié. D’autres embarcations plus petites nous transportaient, Treich et moi, avec nos bagages et notre personnel.
Dès que l’on a dépassé Bettié, on rencontre une série d’îlots boisés, bordant le fleuve, tant sur sa rive droite que sur sa rive gauche. Une demi-heure après, on atteint le barrage et la chute d’Amenvo.
Cet endroit est difficile et dangereux à franchir. Le fleuve est barré par une série de grosses roches ne laissant qu’un couloir étroit, dans lequel tombe une chute de 3 m. 50 de hauteur. Pour passer les pirogues en descendant le cours d’eau, on décharge les bagages, qui sont portés à dos d’hommes de l’autre côté du barrage, puis les pirogues sont traînées sur les roches et lancées dans le rapide, d’où elles gagnent avec une rapidité vertigineuse l’extrémité d’une île où on les recharge après avoir, au préalable, vidé l’eau dont elles se remplissent dans ce trajet dangereux. Deux hommes munis de perches gouvernent dans la descente et parent les roches avec leurs bambous.
[288]Pour remonter le fleuve, l’opération est un peu plus laborieuse : les pirogues doivent être traînées sur un long parcours rocheux, le rapide étant trop difficile à remonter. Bénié Couamié, que j’ai interrogé, m’a assuré que pendant les hautes eaux il existe un chenal profond et calme entre l’île et la rive gauche, par lequel la navigation se fait absolument sans danger.
Du barrage d’Amenvo à Daboisué la navigation n’offre que des difficultés bien faciles à vaincre : ce sont trois hauts-fonds de gravier sur lesquels ne subsiste que peu d’eau. Pour nous les faire franchir, les piroguiers se mettent à l’eau et tirent les pirogues, et une série de vigoureux efforts en ont raison. A Akouakourou, petit village de la rive droite, les difficultés cessent ; bientôt on atteint Kokourou, rive droite, et ensuite Daboisué, sur la rive gauche d’un ruisseau qui a donné son nom au village.
Les gens de Daboisué, auxquels nous avions été recommandés et qui nous attendaient, avaient préparé des provisions et nettoyé quelques cases pour nous permettre de passer confortablement l’après-midi et la nuit. Accra, le digne cuisinier de Treich, nous prépara un festin composé de plusieurs plats dont le menu nous a bien amusés. Par moments, il avait du talent et savait vous nourrir avec bien peu de chose. Ce jour-là, n’ayant que du foie de bœuf et des bananes, il nous servit successivement du foie en brochettes, rôti, sauté, et des bananes frites : cela nous faisait quatre plats bien variés, comme on le voit.
Samedi 16 mars. — De Daboisué à Toria, petit village situé à 5 ou 6 kilomètres en aval, on peut profiter du fleuve pour voyager ; mais à partir de Toria la navigation du Comoë est interrompue jusqu’à Malamalasso. Bénié et les indigènes que j’ai interrogés m’ont dit que sur tout son parcours le fleuve s’était frayé un chemin sinueux à travers des couloirs de roches situées si près les unes des autres, qu’aucune pirogue, même de petites dimensions, ne peut les franchir. Je regrette bien de n’avoir pas eu assez de vigueur pour aller visiter ce chaos, d’autant plus que Bénié s’offrait pour m’accompagner. Treich était également trop souffrant pour entreprendre cette exploration, de sorte qu’à notre grand regret nous ne rapportons rien de précis sur cette partie du fleuve.
Cependant, dans le trajet de Daboisué à Malamalasso, nous avons franchi une série de collines rocheuses qui s’étendent perpendiculairement au cours du Comoë et doivent constituer une série de rapides ; peut-être même quelques-uns de ces bourrelets ont-ils dû s’effondrer, minés à leur base par les eaux, et faire présenter ainsi à ces roches leurs stries verticalement : c’est ce qui expliquerait l’existence de couloirs tels que Bénié Couamié me les expliquait.
[289]

La flottille au départ.
[291]A Daboisué on se trouve encore et toujours dans cette même forêt, qui commence avec l’Anno, à quelques étapes au sud de Kong, pour ne se terminer qu’à la mer. Le chemin, quoique fréquenté par des porteurs, n’est qu’un étroit sentier dont le tracé sinueux ne laisse rien à envier aux autres sentiers du haut Comoë ; il coupe le ruisseau Blagaso un peu avant l’embranchement du chemin qui va à Toria, puis on atteint un autre petit cours d’eau nommé Abradé Dabré. Celui-ci, d’après la légende, doit être franchi dans le plus profond silence : celui qui parlerait en le traversant risquerait de tomber de mort foudroyante.
Pour respecter les croyances de nos indigènes agni, nous nous sommes mis à l’unisson, et c’est sans parler que nous avons traversé ce ruisseau imposant et mystérieux. D’autres cours d’eau aussi peu importants que les précédents, venant également de l’est, et la proximité du fleuve rendent cette forêt d’une humidité extrême. Pendant le trajet et surtout pendant les repos, il est prudent de se couvrir pour ne pas se refroidir.
A dix heures et demie nous arrivions au campement d’Aponkrou, où l’on a l’habitude de passer la nuit afin de pouvoir sans trop de fatigue gagner le lendemain Malamalasso.
Ce campement est situé près de deux ruisseaux à eau courante et occupe l’emplacement d’un village qui a disparu il y a quelques années. Nous y trouvons cinq ou six hangars bondés de marchandises : barils de poudre, caisses de gin et paniers de sel. Personne n’est là pour les garder ; dans la région on ne s’inquiète pas des voleurs. Les marchands arrivés à Malamalasso transportent en plusieurs jours leurs marchandises à Aponkrou, et de là les font parvenir à Toria, où ils se procurent d’autres pirogues. Les habitants, quoique aimant à boire, ne touchent jamais au gin ni à ce qui ne leur appartient pas.
A côté de ces hangars il en existe trois autres vides, servant d’abris aux voyageurs. On trouve également un mortier, des pilons et quelques marmites en terre, permettant de préparer un repas sommaire, fouto de bananes ou d’ignames. Le campement est situé au milieu d’une petite clairière, d’une centaine de mètres de diamètre. Les cases sont entourées de quelques cocotiers, de citronniers, de quelques papayers et de nombreux pieds d’arum (le taro de Calédonie) et de piments, mais on n’y trouve pas d’orangers. Je n’en ai du reste jamais vu depuis mon départ de Bondoukou.
Rien n’impressionne autant que de camper dans ces solitudes boisées ; la lumière y pénètre à peine dans la journée, et l’obscurité de la nuit y est intense ; les gens qui circulent autour des feux du bivouac ont l’air de fantômes et de spectres.
[292]Le silence profond qui vous environne n’est troublé la nuit que par le cri aigu de quelque musaraigne ou d’un gibier effrayé qui s’enfuit en brisant tout devant lui ; le moindre animal effarouché fait penser à un troupeau de fauves traversant la forêt ; l’écho se répercute d’une façon étonnante : on se croirait dans un autre monde.
Au petit jour, ce sont des centaines de singes qui voyagent dans les cimes des arbres en poussant des aboiements et en faisant dégringoler les branches mortes sur leur passage.
Quand on peut alterner les étapes en pirogue avec celles à pied à travers la forêt, on y trouve un charme tout particulier. L’Européen, tout en aimant les sensations violentes, tient surtout à voir le jour, et les rares blancs qui ont voyagé pendant plusieurs jours de suite en forêt n’ont jamais manqué de saluer les rayons du soleil avec un enthousiasme qu’il est facile de concevoir.
Dimanche 17 mars. — Il a plu une partie de la nuit, les feux sont éteints, et ce matin nous avons eu toutes les peines du monde à nous réchauffer. En raison de ce vilain temps, nous ne nous mettons en route qu’à huit heures. Comme je me sens un peu plus vigoureux, je vais essayer de faire l’étape à pied, autant pour me réchauffer que pour ne pas être trempé par l’eau qui imprègne le feuillage et qui tombe à chaque heurt du hamac contre les lianes et les troncs d’arbres. Le chemin est passable jusqu’à la petite rivière Zanda, que l’on atteint après avoir traversé trois autres ruisseaux. Cette rivière Zanda serpente à l’infini et suit la même dépression que le sentier, qui la traverse onze fois. En cette saison on peut la franchir en sautant : elle n’a pas plus de 1 m. 50 à 2 mètres de largeur, et sa profondeur n’est que de 20 à 50 centimètres.
En arrivant près de son origine, on atteint quelques bourrelets rocheux, terrains de grès mêlés de quartz, qui s’étendent perpendiculairement au cours du Comoë. Ce sont certainement ces arêtes qu’il franchit et qui rendent la navigation en pirogue impossible sur ce parcours.
Quelques-unes de ces petites collines sont à pentes très raides, ou du moins elles m’ont paru telles à cause de la grande fatigue que j’éprouvais ; aussi, un peu au delà du Zanda, je dus me résigner à reprendre le hamac. La pluie, qui tombait de nouveau, m’avait traversé, j’étais mouillé jusqu’aux os ; il fallut m’arrêter pour changer de linge en pleine forêt, car je commençais à sentir le froid me gagner.
Enfin, vers midi, après avoir franchi un dernier ruisseau, nous avons gravi une petite croupe au sommet de laquelle on débouche comme par enchantement sur Malamalasso et le Comoë.
[293]

Chutes d’Amenvo.
[295]De ce point on jouit d’une vue splendide. Le village, qui n’est en quelque sorte qu’un point occupé par deux ou trois familles de gens dévoués à Bénié Couamié, est bâti en amphithéâtre sur le fleuve. Le coup d’œil est ravissant. N’était la grande quantité de palmiers, les couronnes des bananiers et surtout les troncs élancés d’arbres qui atteignent des hauteurs prodigieuses, on se croirait presque en face d’un paysage des bords de la Meuse, entre Mézières et Givet. Les berges mamelonnées sont presque des collines. Leur pied, qui vient mourir sur la rivière, est formé de gros blocs de roche, placés par la nature symétriquement dans quelques endroits, jetés pêle-mêle et au hasard dans d’autres. De gentils ruisseaux, simples filets d’eau, viennent tomber en cascades dans le fleuve à quelque distance du village.
Bénié, là aussi, a une habitation à l’européenne, mais elle ne comporte qu’une seule chambre au rez-de-chaussée et un grenier dans lequel sont serrées quelques marchandises, et surtout des caisses vides qui nous servent à installer un lit de camp pour nous mettre à l’abri de l’humidité. La porte est munie d’une serrure, et les fenêtres sont closes par des volets conditionnés comme en Europe.
Lundi 18 mars. — L’intendant de Bénié, qui habite Malamalasso, s’occupe aujourd’hui de nous trouver des pirogues et les gens nécessaires à leur armement. Le départ ne doit s’effectuer que demain. Bénié, du reste, doit envoyer ses instructions en même temps que des pagayeurs. Ces gens-là arrivent en effet dans la soirée et se mettent à notre disposition. Au même moment nous entendons notre personnel faire une véritable manifestation à Baoto, l’interprète de la factorerie Verdier de Grand-Bassam, qui vient d’accoster avec sa pirogue.
Notre arrivée prochaine ayant été signalée à la Côte, autant par les marchands que par les courriers que Treich avait successivement envoyés de Kong et d’Attakrou, nos compatriotes avaient cru bien faire en nous envoyant leur homme de confiance en même temps que de nouvelles provisions.
Baoto est un jeune homme fort aimable, bien élevé pour un noir et sachant parler correctement le français. Il était vêtu d’un immaculé complet en coutil blanc et coiffé d’un élégant panama ; dans un tel accoutrement il avait l’air, comparativement à nous, d’un riche planteur nous ayant à son service. En remontant le fleuve, il avait prévenu les villages de notre prochain passage et obtenu d’eux que l’on mît partout des pirogues à notre disposition.
Mardi 19 mars. — Nous avons peu dormi la nuit dernière, mon compagnon[296] et moi, agités par la joie que nous causait notre prochaine arrivée à Alépé, où Baoto avait laissé le Diamant, chaloupe à vapeur de l’État, qui venait au-devant de nous, expédiée à notre rencontre par le résident de France à Grand-Bassam. Ne pouvant dormir, nous avons bu quelques verres de vin chaud et mangé des biscuits jusque vers une heure du matin.
A cinq heures nous étions sur pied et en plein dans nos préparatifs de départ. A cinq heures et demie nos trois pirogues poussaient au large. La navigation par ici est facile ; les barrages sont aisés et comportent chacun au moins un chenal bien praticable.
Le paysage est à peu près semblable à celui de l’Alangoua, mais plus mamelonné, et aussi plus riant. Les berges sont constituées par des collines de 30 à 40 mètres de hauteur ; elles sont bien boisées ; les palmiers à huile abondent. Aux abords des villages il y a quelques défrichements, des champs de manioc et des bananeraies. Le cocotier, qui plus au nord n’existe qu’à l’état de curiosité[54], se multiplie devant tous les villages, et près des embarcadères il y en a de nombreuses touffes. Les habitants possèdent plus de pirogues que dans l’Indénié, et tous les villages semblent se livrer avec ardeur à la pêche.
Les oiseaux les plus répandus dans cette partie de la rivière sont : le perroquet gris à queue rouge, les toucans de toutes les variétés et un oiseau au plumage métallique que l’on nomme tourako.
Nous passons de bonne heure devant Aboisou et Eloubou, deux villages de la rive gauche, ainsi que devant deux villages abandonnés, abris pour pêcheurs et lieux de culture, que Baoto qualifie avec emphase du titre pompeux de petites maisons de campagne. A neuf heures nous atteignons Annocankrou, village faisant partie d’un groupe de lieux habités, connu sous le nom de Nzakourou, où quelques-uns de nos hommes sont arrivés depuis la veille avec une pirogue et en ont fait préparer d’autres, car deux de nos embarcations doivent ici faire retour sur Malamalasso.
Après avoir déjeuné d’une boîte de sardines et d’une boîte de corned-beef apportées de Grand-Bassam par Baoto, nous repartons, accompagnés du chef d’Annocankrou, qui se charge de nous conduire avec des pirogues jusqu’à Cottokrou.
La navigation est toujours très facile ; le bief est profond : en trois heures (de 11 heures à 1 heure) nous atteignons Cottokrou. Les habitants de Nzakourou, Aloso, Tafesso, Akotoune et Kandakari nous saluent au[297] passage. Quelques hommes de l’escorte de Treich y trouvent des gens de connaissance. Tout nous fait augurer que nous ferons du chemin aujourd’hui.
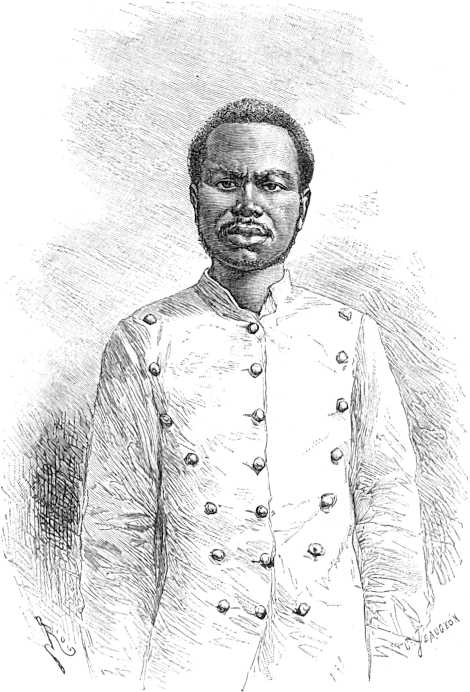
Baoto.
Cottokrou est un gros village, possédant une vingtaine de pirogues. Treich et Baoto se multiplient pour en faire presser l’armement. Il fait une grande chaleur, un temps orageux très lourd, qui inquiète les indigènes ; ils hésitent à se mettre en route. Je commençais déjà à désespérer, assis au pied d’un splendide ficus sur la rive même, lorsque, vers deux heures et demie, tout semble s’arranger à notre grande satisfaction, et à trois heures dix nous arrivons à nous embarquer.
Ce sont toujours les mêmes scrupules qui arrêtent les habitants ; ils sont, en somme, bienveillants : ce qui les ennuie, ou plutôt ne les porte pas à accepter de descendre le cours du fleuve, c’est qu’ils ont tous quelque créancier récalcitrant en aval et qu’ils craignent, ou d’être retenus comme otages, ou de voir saisir leurs pirogues.
Ces créances sont, pour la plupart, des amendes en or à payer pour adultère : chez les Agni il y a peu de villages où je n’aie entendu parler de différends engendrés pour ce motif.
Quand l’adultère est commis avec une femme de souverain, l’homme est dépouillé de tout ce qu’il possède ; s’il n’a rien, il est mis à mort. Jamais l’homme trompé ne demande le divorce et ne répudie sa femme : il se contente de réclamer des dommages-intérêts à son rival.
[298]L’amende à payer varie entre 2 ou 3 onces pour une épouse ordinaire, mais elle s’élève à 5 ou 6 onces lorsqu’il s’agit d’une femme médecin.
Si le coupable ne peut payer l’amende que lui inflige le chef devant lequel les deux parties ont comparu, il va le plus souvent trouver un notable quelconque, le prie de payer la somme à laquelle il est condamné et en échange se constitue comme otage ; il a ainsi un rôle de demi-esclave, duquel il ne sort quelquefois jamais. Sa fortune est liée à celui qui l’a aidé et il ne cherche nullement à s’affranchir de la tutelle qu’il s’est imposée. Cette situation se continue même par hérédité.
Les indigènes parlant le français désignent ces captifs volontaires par le titre de boy. De sorte que la société agni se compose de quatre éléments : les chefs, les hommes libres, les esclaves, les boy (qui ne peuvent être aliénés).
Ce qu’il y a de bien curieux, c’est que généralement la femme elle-même, de son propre mouvement, va raconter à son mari qu’elle l’a trompé, et lui désigne son amant.
« Faute avouée est à moitié pardonnée », se disent-ils, et puis on est très philosophe. Les chefs appelés à juger n’incriminent que le séducteur. Comme me le disait Cadia, l’interprète de Treich, « si les hommes ne faisaient pas la cour aux femmes, elles resteraient honnêtes ». Chez les Agni la femme est souvent considérée comme inconsciente.
Si le mari ne réclame pas souvent le divorce, il n’en est pas de même de la femme. Dans ce cas, la somme payée aux parents de la mariée au moment du mariage est perdue pour l’homme, moins 4 acké (24 francs) que la famille rembourse.
L’adultère pour les hommes est sévèrement puni dans les familles royales. On raconte que la princesse Elua, sœur d’Amatifou, qui a encore sa cour à Krinjabo, ayant surpris son mari en adultère, fit exécuter la femme et circoncire son mari, ce qui, chez les Agni, est le plus grand affront que l’on puisse faire à un homme.
En quittant Cottokrou, le Comoë est obstrué par un nombre considérable d’îlots de toutes dimensions, reliés entre eux par une série de barrages, ou plutôt par un barrage continu avec petits rapides s’étendant au delà d’Attrasou.
A partir de ce village, et après avoir navigué dans une quantité de pêcheries, on prend le long de la rive droite un chenal d’une dizaine de mètres de largeur et d’environ 1 kilomètre de longueur, qui constitue un rapide très dangereux. Les pirogues descendent avec une vitesse vertigineuse, on embarque des paquets d’eau, encore bien heureux de ne pas chavirer ou de n’être pas lancé contre les roches.
[299]De l’autre côté de ce rapide se trouve une série d’îles devant lesquelles s’élève un gros village nommé Cassi-Amonkrou, que les indigènes nous signalent en passant.
Ce rapide nous mène devant Yacassé, où nous rencontrons le premier représentant officiel du royaume de Krinjabo. C’est un porte-canne d’Aka-Simadou ; il est sur la rive, précédé d’un homme portant un pavillon français ; lui-même, en signe d’autorité, tient à la main une canne de 1 m. 50, munie d’une pomme comme celle des tambours-majors ; cette canne est recouverte d’une bande de papier d’argent ou d’étain.
Après les politesses d’usage, nous recommandons à ce fonctionnaire les piroguiers de Cottokrou qui doivent nous accompagner. Il nous promet de ne pas entraver leur retour, ce qui les décide à continuer la route. Je croyais les incidents terminés, lorsque vers six heures du soir — trois quarts d’heure après avoir quitté Yacassé — les piroguiers veulent à toute force gagner la rive et refusent de nous conduire plus loin. Devant Kouassikourikourou, l’obstination augmente ; décidé à ne pas tolérer une semblable mutinerie, je prends un de mes fusils Beaumont et menace de tirer sur le premier qui manifeste l’intention d’atterrir : cela les décide à continuer.
Vers six heures et demie il fait nuit noire. Les pirogues se trouvant prises dans les pêcheries, nos hommes doivent y faire des passes à coups de sabre et à coups de hache, puis nous atteignons un profond bief où il y a de nombreux hippopotames ; à chaque instant un de ces monstres surgissait de l’eau à côté de notre embarcation. Nous avons failli chavirer vingt fois. C’est peut-être le moment le plus dangereux que nous ayons eu à passer dans notre descente. Si un de ces pachydermes, en nageant ou en plongeant, nous avait chavirés, nous étions sûrement noyés, Treich et moi, n’ayant pas la force nécessaire pour gagner la rive à la nage. L’obscurité était si profonde qu’on ne distinguait rien ni devant soi, ni autour de soi, les berges étaient invisibles. Il nous aurait été impossible de savoir dans quelle direction il fallait nager. En prévision d’un semblable accident, et pour sauver mes documents, j’avais fait un ballot de mes rouleaux en fer-blanc, contenant mes cartes, levés et journal de marche, enveloppé le tout dans une moleskine, et amarré soigneusement ce précieux paquet à l’aide de cordes à ma pirogue. C’était un terrible moment à passer, pendant lequel les âmes les mieux trempées se livrent à d’anxieuses réflexions.
Vers sept heures et demie nous n’entendions plus les autres pirogues ; on avait beau se héler, on s’était distancé sans s’en apercevoir. Au loin, dans[300] cette affreuse nuit, on percevait le son d’un tam-tam, et vers huit heures un de nos hommes, ayant cru reconnaître les berges, nous affirma que nous n’allions pas tarder à atteindre Pétépré.
Baoto, heureusement arrivé avant nous, avait allumé un feu sur la berge, et nous héla au passage ; enfin, à huit heures et demie nous étions tous réunis.
Pétépré est un très gros village à cheval sur les deux rives du fleuve ; il porte aussi le nom d’Édiékrou, et s’appelait dans le temps Akba. Ce point a été longtemps le terminus de la partie explorée de la rivière ; il a fait appeler le Comoë par les Européens : rivière d’Akba. Le premier Européen qui ait remonté le Comoë est M. Lartigue, capitaine au long cours de la maison Régis et Fabre ; il alla plusieurs fois à Pétépré (Akba) et fit des sondages à quelques kilomètres au-dessus.
Plus tard, par ordre du commandant Bouet-Willaumez, on refit le même voyage sans dépasser ce point. Enfin, en 1850, Hecquard, sous-lieutenant de spahis, se disposait à gagner par cette voie le Ségou, mais, abandonné par ses guides entre Akba et Yacassé, il dut revenir à la Côte sans rapporter de nouveaux renseignements sur le cours du Comoë.
A cette époque le chef d’Akba se nommait Mouné, et celui de Yacassé Miessa.
A Pétépré je trouvai deux hommes sachant parler le mandé et ayant fait, il y a quelques années, des voyages jusque dans l’Anno. L’un d’eux, Aka Simadou, parent du souverain de Krinjabo, m’affirma que le Diamant était mouillé depuis deux jours devant le Petit-Alépé et que, quand la lune se serait levée, nous pourrions facilement, en une heure et demie, gagner son mouillage.
En attendant que la lune veuille bien nous éclairer, nos hommes et nous faisons un sommaire repas. Un peu avant dix heures, la lune étant assez haute au-dessus de l’horizon, nous nous remettons en route.
Nous distinguons très bien Koumasi et Mamodji, villages de la rive droite, et bientôt après nous atteignons le confluent de la rivière Tossan, puis Aouassakourou. Enfin, à onze heures et demie, au delà du tournant, nous apercevons la silhouette blanche du Diamant.
Ce n’est pas sans de bien douces impressions que je posai le pied sur le petit bâtiment français, dont le premier maître chargé du commandement s’empressa de mettre la cambuse sens dessus dessous pour nous recevoir le mieux possible : nous étions sauvés !
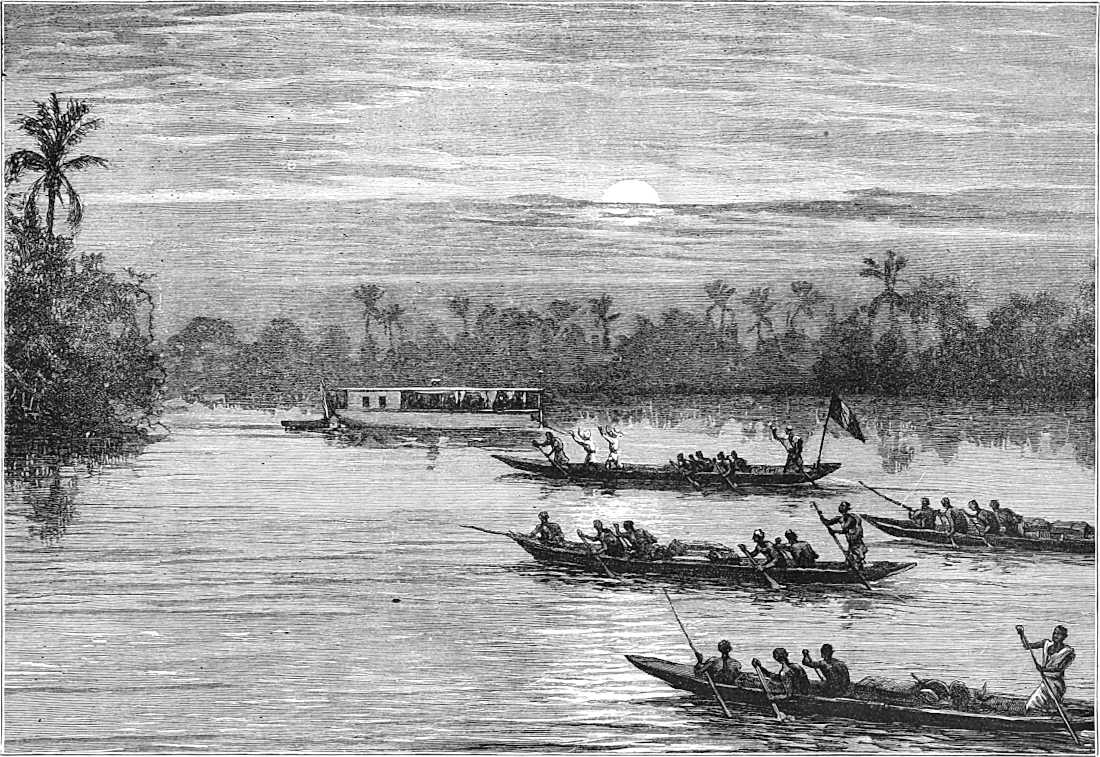
Arrivée au Diamant.
Deux matelas installés dans le rouf nous permirent de passer une bonne nuit. Hélas ! nous l’avions bien gagné. Ceux-là seuls qui ont voyagé en[303] pirogue peuvent se représenter ce qu’est une navigation ininterrompue d’une dizaine de jours et une dernière étape de vingt heures, dont dix sous le soleil dans une frêle embarcation comme la nôtre.
Nos hommes, après avoir amarré les pirogues le long du bord à l’aide de faux-bras, allèrent coucher à terre, au village de Petit-Alépé, en se servant du youyou du bord pour s’y rendre.
Mercredi 20 mars. — Au lendemain de cet heureux jour succéda la descente sur Grand-Bassam.
Le Diamant est une belle chaloupe à vapeur non pontée, comprenant un équipage de 4 blancs et 8 ou 10 laptots sénégalais ; elle a un toit autour duquel, pour la nuit, on borde un rideau en toile afin de mettre l’équipage à l’abri de l’humidité. Le premier maître, commandant du bord, a un rouf sur l’arrière. L’armement du Diamant consiste en un hotchkiss. Les hommes sont tous armés de kropatscheks.
Ce petit bâtiment file environ 6 à 7 nœuds à l’heure et gouverne très bien. Installé à l’avant avec ma boussole, en compagnie du pilote, ce n’est pas sans une certaine satisfaction que je me disais : « Enfin j’en suis à mon dernier topo ».
La navigation est facile, il n’y a que quelques précautions à prendre en quittant Alépé, à cause d’un banc de roches qui se termine par le travers de Sibadou, et où l’on voit encore l’épave de l’aviso l’Ebrié, qui s’y est perdu il y a une trentaine d’années et où se sont jadis échoués le Serpent et le Guet-N’dar, deux avisos qui ont une belle page dans la conquête de ces pays. A partir de ce point, le Diamant, qui cale un peu plus de 1 mètre, chargé comme il l’était, peut naviguer sans danger : le fleuve a partout environ 200 mètres de largeur et il y a du fond. Les rives sont bien peuplées ; les villages, très grands, se touchent presque. Nous stoppons devant Abokayébi, afin de permettre à Baoto de faire dans un palabre restituer des marchandises volées à un homme de Grand-Bassam, puis de là nous allons faire de l’eau douce au village d’Ono, à l’entrée de la lagune qui porte ce nom.
A partir d’Ono, les villages se trouvent sur la rive gauche, qui est plus élevée et moins marécageuse. Le plus important d’entre eux est Impérié. Ce village est sous l’autorité d’Amangoua, sorte d’aventurier originaire de l’Akapless, qui pille de temps à autre la rivière. Comme Bénié Couamié, ce seigneur a une belle maison à un étage, bâtie à l’européenne. Le passage de la canonnière a dû quelque peu le troubler : on ne voit personne sur la plage. Ces gens-là, qui tous ont quelque acte de brigandage à se reprocher, ont cru prudent de s’éloigner à notre approche ; sous des cocotiers se[304] trouvent bien une vingtaine de chargements de pirogues, consistant en sel, poudre et gin, mais d’habitants, on n’en voit aucun.
Au delà d’Impérié se trouvent Yaou, puis l’embouchure de la rivière ou lagune Kodiouboué, dont l’entrée, comme celle d’Ono, est barrée par des troncs d’arbres charriés par les eaux.
Impérié et Yaou ont toujours été des centres turbulents, dont les chefs, agissant soit pour leur propre compte, soit pour le chef de l’Akapless, qui réside à Bounoua, dans l’intérieur, fermaient complètement le Comoë aux transactions. A plusieurs reprises il fallut châtier ces villages. En 1849, l’amiral Bouet-Willaumez, avec 250 marins et laptots, tirés de la Pénélope, du Caïman et de l’Adour, infligea une sérieuse défaite à Aka, l’ancien chef de l’Akapless[55], et plus récemment on a encore dû châtier Impérié. Depuis quelques années, de nouveaux traités conclus avec le roi de Bounoua ont assuré une paix qui n’est troublée de temps à autre que par des rapines exercées par Amangoua, chef d’Impérié.
Vers midi nous atteignons l’entrée de la lagune d’Ébrié, et nous passons presque à raser terre devant Mouosou (Grand-Bassam village) ou Blé ; le chef nous fait force salutations avec son pavillon. Quoique encore éloigné des factoreries, je me tenais à l’avant, en vigie, guettant la mer ; enfin, vers une heure, je vis par le travers les lames déferler sur la plage et notre cher pavillon national flotter au-dessus de la factorerie Verdier.
Quelques semaines après, ce devait être le Sénégal, la France et Paris !
Le Diamant, tout fier de nous ramener, avait pris un air de fête et arboré un beau pavillon neuf, en arrivant au mouillage. En moins de temps qu’il n’en fallut pour accoster, prévenus par le sifflet, les trois employés de la factorerie Verdier, M. Bidaud, l’agent principal, en tête, vinrent nous prendre à bord. Quelle fête pour nous et pour eux ! car nos braves compatriotes paraissaient aussi heureux que nous de nous voir arriver. On mit tout à notre disposition : logement confortable, nourriture exquise, journaux, lettres qui nous attendaient, je ne sais plus, j’étais si heureux sur le moment, que je ne me souviens plus bien.
M. Bidaud est capitaine au long cours. Après avoir conduit plusieurs bateaux à Grand-Bassam pour le compte de M. Verdier, l’armateur et négociant si désintéressé qui envoya M. Treich à ma rencontre, il devint agent principal des factoreries Verdier à Grand-Bassam et Assinie. Au moment où nous arrivions, il remplissait les fonctions de résident de France à la Côte de l’Or. C’est un de ces braves modestes, ayant comme titre[305] une carrière toute d’abnégation. Je me liai de suite d’amitié avec lui. Aujourd’hui surtout je me rappelle avec bonheur nos conversations sur le banc de quart de la terrasse de la factorerie, et ses théories pleines de bon sens sur l’avenir et la politique des pays qu’il administrait de son mieux, avec les modestes moyens mis à sa disposition par la métropole.

M. Bidaud.
Et comme il me soignait et prévenait mes moindres désirs ! Je me rappellerai toujours avec quelle prudence il modérait mon appétit, qui était devenu de la voracité ; son gros rire quand il me traitait de naufragé de la Méduse, et qu’il me prévenait que progressivement seulement, il me tolérerait les plats réputés indigestes.
Qu’il reçoive ici l’expression de ma bien sincère reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour moi, tant en son nom qu’au nom du brave Français qu’il représentait, M. Verdier.
En arrivant, je télégraphiai de suite au gouverneur du Sénégal notre arrivée, et le surlendemain je recevais la dépêche suivante :
« Gouverneur Sénégal à Résident Grand-Bassam. Gouvernement me charge transmettre félicitations pour succès mission à Binger et Treich. »
En arrivant ici, mes quatre indigènes mandé qui me restaient, avec Arba, femme gourounga mariée à Mamourou, un de mes hommes, vinrent me remercier de les avoir conduits à la mer. « Ce que tu nous disais depuis si longtemps était vrai. Les blancs n’ont qu’une parole. Tu nous avais dit que tu nous mènerais à la mer, et nous nous en éloignions tous les jours puisqu’elle est à Saint-Louis et que nous allions vers le soleil levant, mais tu en sais plus long que nous, et ce que tu disais était vrai, à moins que toute la terre ne se soit retournée. — Dieu est grand et toi tu sais beaucoup[306] de choses. — La mer, nous n’y connaissons rien, puisque nous ne l’avions jamais vue, mais puisque tu nous dis que nous ne sommes qu’à dix jours de Saint-Louis, nous embarquerons avec confiance avec toi. Tu es notre père et notre mère, et nous sommes heureux que tu ne sois pas mort en route. »
Ces braves gens, durant notre séjour à Grand-Bassam, passaient leur temps accroupis sur la plage à regarder la mer déferler, ne pouvant s’expliquer ce phénomène. Probablement ces gens simples, étonnés eux-mêmes du voyage qu’ils ont fait, pensent avoir été le jouet d’un être surnaturel dont j’ai été en quelque sorte l’instrument. En cela, ils n’ont pas tout à fait tort. Dans leur simplicité, mes braves noirs, qui ont autant souffert que moi, se rendent bien compte que de telles tribulations surmontées ne sont pas dues exclusivement au hasard, à l’intelligence et au savoir : comme moi, ils pensent que le Tout-Puissant nous a aidés à surmonter tous les obstacles.
Mon personnel m’a rendu bien des services. Quand j’ai pris ces noirs, ils n’étaient même pas dégrossis ; en rentrant, ces pauvres gens étaient presque civilisés. A la fin, ils savaient tous bien tirer et étaient devenus des chasseurs émérites.
En route ils avaient pris le goût du commerce. Au lieu de leur donner comme argent de poche des cauries, je leur abandonnais quelques marchandises, et c’était à qui d’entre eux en tirerait le meilleur parti. J’ai raconté plus haut une histoire bien simple à propos de cadenas, je pourrais en ajouter bien d’autres et faire certainement rire en racontant comment ils exploitaient les autres nègres en leur vendant des gris-gris pour la chasse, contre les voleurs, etc. Quand j’aurai ajouté qu’ils se créaient des ressources en fabricant de la vannerie, des bobines à filer le coton, et d’autres menus objets, et qu’à Salaga ils m’ont recouvert une ombrelle aussi bien que le ferait un marchand de parapluies, j’aurai tout dit. Si jamais j’ai l’occasion de les revoir, ce n’est pas en domestiques que je les traiterai, je leur donnerai une bien cordiale poignée de main d’ami dévoué.
[307]CHAPITRE XVI
Arrivée de l’aviso l’Ardent. — Détails sur Grand-Bassam. — La barre. — Les piroguiers. — L’embouchure du Comoë et les mouillages. — L’Akapless. — Le Sanwi et la rivière Bia. — La lagune Aby. — Krinjabo. — Le Tanoé ou Tendo. — L’Ahua ou Apollonie. — Départ pour la lagune Ebrié. — Abra. — L’Ebrié. — Abidjean et les pêcheries. — Rivière Ascension. — Arrivée à Dabou. — Visite au poste et au jardin. — Rivière Isi. — Les Bouboury. — Le Bandamma ou Lahou. — Renseignements sur la côte de Krou et sur les peuples de l’intérieur. — Le Baoulé, l’Attié, le Morénou. — Départ de Dabou, les Jack-Jack. — Petit Bassam. — Treich est gravement malade. — Retour à la factorerie. — Nous sommes nommés chevaliers de la Légion d’honneur. — Nous nous embarquons sur la Nubia. — Retour en France.
Délivré de tout souci, heureux d’avoir accompli consciencieusement ma mission, je ne tardai pas à reprendre rapidement des forces. Mon mal dans l’aine disparut comme par enchantement.
Peu de jours après notre arrivée, l’aviso de l’État l’Ardent vint mouiller devant Grand-Bassam pour procéder à la relève des hommes libérables du Diamant ; je comptais profiter de l’aimable offre du commandant Delalande, qui m’invitait à prendre passage à son bord, lorsque, par dépêche, cet aviso reçut l’ordre de se rendre à El-Mina, pour y prendre à sa remorque le Goéland, avarié.
Aucun paquebot français ni anglais ne devant passer à Grand-Bassam avant une dizaine de jours, je profitai du temps qui me restait pour mettre mes notes à jour et consigner les renseignements que j’ai pu recueillir sur Grand-Bassam et la Côte de l’Or française.
★
★ ★
La souveraineté de Grand-Bassam a été concédée à la France en 1842, par traité des chefs du pays avec l’amiral Fleuriot de Langle — M. le commandant Bouet-Wuillaumez était alors gouverneur du Sénégal, — mais la prise de possession de la France n’a eu lieu qu’à la fin de l’année 1843, par une expédition commandée par le lieutenant de vaisseau de Kerhallet.
[308]A l’ouest et près de l’embouchure du Comoë ou Akba, ou encore Costa, comme l’appelaient les anciens, on construisit un établissement qui prit le nom de fort Nemours. C’était un carré palissadé, flanqué à chaque angle d’un bastion en pierre, armé d’une caronade de 30. L’établissement possédait en outre trois obusiers de montagne.
Les factoreries se trouvaient, à l’origine de l’occupation, à l’intérieur de l’enceinte ; les magasins et la poudrière à l’extérieur, à portée du poste et des factionnaires.
Des baracons en planches et en maçonnerie servaient de logement aux Européens ; les travailleurs habitaient dans des cases indigènes.
Grand-Bassam, comme chef-lieu de la colonie, centralisait les services ; on y avait construit un bel hôpital en pierre de taille.
Les premières factoreries qui vinrent se fixer sur la côte appartenaient à la maison Régis, de Marseille, puis à la maison Monk, et enfin à la maison Swanzy, de Londres, et Verdier, de La Rochelle, à laquelle on céda notre établissement, lorsque après les revers de 1870 le gouvernement décida qu’il n’y aurait plus de garnison. La garde de la colonie fut confiée à M. Verdier, qui remplissait les fonctions de résident.
La maison Verdier a fait de l’ancien hôpital une très confortable maison d’habitation. Dans l’une des ailes est installé le télégraphe ; dans l’autre, les agents et les bureaux des deux employés blancs de la factorerie. Le rez-de-chaussée sert de magasins ; et une des chambres de caserne aux marins blancs du Diamant, qui viennent y coucher quand leur bâtiment est au mouillage.
D’autres magasins, aux alcools et aux poudres, sont à portée du poste, à côté d’une petite mare à eau saumâtre, qui n’a aucune communication apparente avec la mer.
Une allée de cocotiers menait jadis de la factorerie au mouillage de la lagune ; actuellement la plupart des arbres ont été coupés et employés à la construction de wharfs et d’appontements pour les chalands.
L’amiral Fleuriot de Langle dit qu’il a fait planter plusieurs centaines de ces arbres ; il en existe à peine une vingtaine en ce moment ; tout a été saccagé. Pourtant il n’y a qu’à mettre un coco dans un trou de 50 centimètres de profondeur, le décapiter et placer dessus une poignée de sel pour le faire germer ; la plage entière devrait être plantée de cocotiers et depuis longtemps n’être qu’une splendide forêt.
Actuellement, en dehors de la factorerie Verdier, il y a une factorerie anglaise (Swanzy, de Londres) et une factorerie libérienne.
La forme générale de toute la côte qui borde nos possessions est remarquablement[309] droite ; elle est due à un courant marin venant de l’est. C’est ce courant qui a fait disparaître les baies et les contours accidentés de la côte, en entraînant avec lui et en déposant parallèlement à son cours les alluvions apportées par les nombreux cours d’eau venant de l’intérieur.
L’absence d’anfractuosités sur la côte en rend l’accès difficile dès qu’il y a une forte houle. Les grandes lames venant du large déferlent sur la plage et se brisent quand elles arrivent vers les fonds de 7 et 8 mètres. Ce phénomène est appelé la barre sur toute la côte d’Afrique.
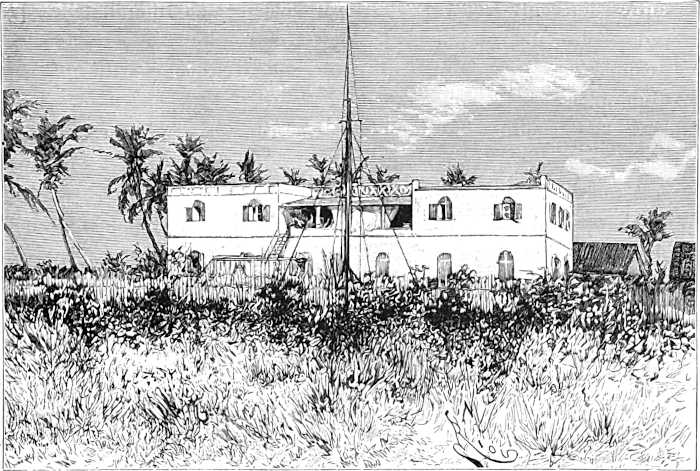
Factorerie Verdier à Grand-Bassam. (D’après une photographie de M. Ch. Alluaud.)
La barre se modifie suivant la force des vents et celle des raz de marée. Devant Grand-Bassam, la barre se forme par les fonds de 7 à 10 mètres, et vient briser à une vingtaine de mètres de la plage. Ce mouvement de brisants perpétuels, accompagné de raz de marée, rogne ou augmente la largeur de la plage, de sorte que la distance de la factorerie à la mer varie tous les ans.
Il y a trois ans, la baraque en bois des télégraphistes employés au câble a été placée exactement à 100 mètres de la crête de la plage ; aujourd’hui elle n’est plus qu’à 17 m. 50 ; la mer aurait donc gagné en trois ans 82 m. 50. Comme ce mouvement ne se continue pas uniformément, et que le contraire se produit assez fréquemment, on ne s’en inquiète pas plus que cela ;[310] M. Bidaud, qui est depuis très longtemps à la Côte, prétendait même que, si l’on voulait faire, pendant deux ou trois ans, des observations, on arriverait à connaître la marche mathématique de progrès ou de recul de la mer, tellement elle lui paraît bien réglée.
Le courant marin et la barre ont bouché ainsi un grand nombre de rivières, ensablé les embouchures des fleuves et transformé les baies et anfractuosités de la côte en lagunes séparées de l’eau salée par une étroite bande de sable, sur lesquelles se sont élevées les factoreries.
Les lagunes ainsi formées sont de formes variables : les unes sont perpendiculaires à la côte, comme les lagunes de Potou, d’Assinie et d’Ehy ; les autres, au contraire, s’allongent parallèlement au littoral, telles que les lagunes du Lahou, de Grand-Bassam et du Tendo.
Il semble que la Providence ait voulu donner une compensation à cette côte inhospitalière en permettant au commerce de naviguer en dedans, à l’abri de la grosse mer, et de drainer ainsi sans danger les produits vers le mouillage.
C’est aussi probablement grâce au phénomène de la barre que les embouchures des rivières se bouchent si facilement et d’une façon si inopinée ; peut-être même arrivera-t-on plus tard à expliquer la formation des lagunes et à prouver que, dans le temps, les rivières qui s’y jettent tombaient directement dans l’Océan, en même temps qu’on expliquerait pourquoi, près du village de Petit-Bassam, il existe une singulière dépression dans le fond de la mer, dépression profonde de 340 à 360 mètres, que les marins appellent Vallée sous-marine. Elle est formée sans aucune cause apparente, car on n’y voit ni bouillonnements des eaux, ni tourbillons.
La barre, constituée, comme nous l’avons dit plus haut, par une multiple rangée de brisants parallèles, est très dangereuse à traverser certains jours ; je crois qu’il serait imprudent, même à des matelots expérimentés, de tenter son passage : il y a des jours où les Kroumen eux-mêmes n’osent pas s’y hasarder.
Les factoreries se servent, pour le service de la barre, d’embarcations très solides, arrondies à la quille et à l’avant. On les nomme baleinières, ou encore surfboats.
Les Kroumen, les Apolloniens d’El-Mina et les gens de Guet-N’dar ont la réputation de connaître le mieux la conduite de ces embarcations, qui sont armées de dix pagayeurs et d’un homme de barre qui gouverne à la godille. C’est ce patron de barque qui dirige et stimule les pagayeurs ; il observe le rythme avec lequel les lames se succèdent, et choisit celle qui devra le porter en mer ou le faire arriver sans chavirer à la plage.
[311]C’est un spectacle bien émouvant que de voir franchir la barre aux baleinières des factoreries et aux pirogues indigènes, même par une mer relativement belle et avec des piroguiers expérimentés. Il ne se passe pas de semaine où embarcations et pirogues ne soient chavirées par les grosses lames qui viennent se briser en volutes à quelques brasses de la côte. Heureusement que la mer est clémente : elle rejette tout sur la plage quelques instants après ; aussi le danger ne réside-t-il pas absolument dans le fait de tomber à la mer, mais surtout dans la violence avec laquelle les embarcations sont enlevées et roulées sur la plage. A la côte on le sait très bien, et les piroguiers n’hésitent pas à se jeter résolument à la mer quand ils peuvent prévoir le danger.
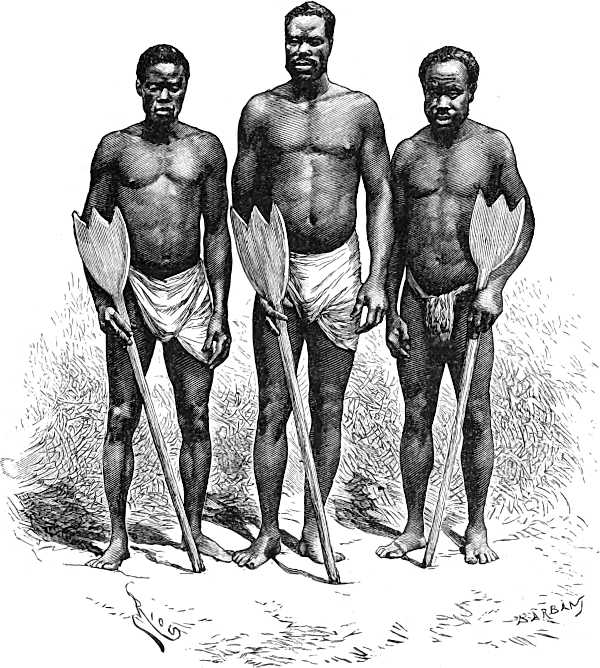
Piroguiers kroumen. (D’après une photographie de M. Ch. Alluaud.)
Les Jack-Jack qui vont à la pêche traversent ces brisants dans de toutes petites pirogues ; ils sont généralement deux, un homme et un gamin. Pour aller au large, c’est le plus fort qui manœuvre la pirogue et se tient à l’arrière. Une fois la barre passée, c’est ce même homme qui pêche, et le[312] gamin suffit à manœuvrer la pirogue. Il leur faut donc changer de place, et comme il est à peu près impossible de remuer sans chavirer, chaque homme pique une tête et ils regrimpent dans la pirogue, l’un à tribord, l’autre à bâbord, en se faisant contrepoids pour ne pas chavirer.
Ce sont ces grosses difficultés qui ont donné aux maisons de commerce une excellente idée, celle d’avoir constamment au mouillage un bateau-ponton, sur lequel les steamers peuvent de suite transborder leurs marchandises, au lieu d’attendre qu’il y ait une barre favorable pour les décharger directement sur la plage.
Les marchandises étant provisoirement à l’abri, on les débarque au fur et à mesure en profitant des barres favorables.
Le Comoë est navigable, pour les vapeurs d’un faible tirant d’eau, jusqu’à Petit-Alépé. Les indigènes le remontent en pirogues pendant 200 kilomètres. Le point terminus de la navigation est Attakrou. Cela ne veut pas dire que la rivière n’est plus navigable, elle l’est encore pendant plus de 300 kilomètres, mais les indigènes du cours supérieur ne l’utilisent pas. Ils ne sont plus de même race que ceux du bas-fleuve et ils semblent peu experts dans la navigation fluviale.
Ils ont en effet d’autres occupations que le transport des marchandises : ils se livrent à l’exploitation des terrains aurifères, qui couvrent la presque totalité du cours moyen du Comoë.
Les goélettes ne calant pas plus de 3 mètres peuvent passer la barre de la rivière pendant les deux tiers de l’année.
La barre fut franchie la première fois par des bâtiments de l’État en mars 1849, par Auguste Bouet avec le vapeur Serpent et la goélette Marigot.
Autrefois il y avait un poste de pilotes à la barre. De 1842 à 1868 on a observé que la profondeur de la barre, après l’hivernage, s’est maintenue entre 3 m. 50 et 4 mètres. Quelquefois le courant rapide de la rivière, qui atteint 6 à 7 nœuds, engorge également la barre et permet même de la passer à gué, comme cela s’est produit pendant mon séjour ici.
La population a soutenu que ce phénomène était dû au mauvais esprit d’un féticheur des Jack-Jack qui, de temps à autre, bouchait la barre par plaisir et aussi par intérêt, puisque ce brave loustic se fait donner ainsi une certaine quantité d’onces d’or par les gens de Grand-Bassam pour la lui faire déboucher.
Après avoir attendu plusieurs jours, le temps de laisser la barre se modifier, il vient, jette quelques fétiches à l’eau, et, la barre se trouvant naturellement débouchée plusieurs jours après, on crie au miracle.
[313]Le Comoë a dû souvent changer de lit, ou au moins, dans les grandes crues, avoir plusieurs embouchures ; du côté ouest j’ai pu relever plusieurs traces d’anciens lits.
Les eaux décolorent la mer à 4 ou 5 milles au large. Les marins considèrent qu’il est prudent, pour mouiller, de se tenir à environ 1 mille dans l’est ou dans l’ouest de l’embouchure du Comoë par des fonds de 16 à 20 mètres.
Le mouillage de l’ouest est indiqué par l’alignement des factoreries et de l’ancien poste. Celui de l’est, nommé mouillage d’Alassam (village situé à l’est de l’embouchure du Comoë), était jadis fréquenté par les bâtiments marchands anglais et leurs traitants noirs, mais actuellement les vapeurs mouillent près des pontons, qui, la nuit, portent un feu de position.
Le mouillage d’Alassam est réputé par les marins plus favorable aux débarquements : le rivage y est en pente plus douce qu’à celui de l’ouest et, par suite, d’un accès plus facile pour les pirogues et les baleinières.
Quoique n’ayant pas visité la région située entre l’Indénié et la côte (rive gauche du Comoë), je ne crois pas inutile cependant de donner quelques notions sommaires sur cette région.
Entre Grand-Bassam et le pays d’Assinie, la côte est presque en ligne droite, et d’Alassam à l’entrée de la rivière d’Assinie les villages sont très nombreux et à peine éloignés de 2 à 3 kilomètres les uns des autres.
Alassam, Akapless et Anoua sont les plus importants de ces villages, qui ont tous la même industrie, la préparation du sel marin, qui en entraîne une autre, celle de la confection des paniers coniques qui servent à le transporter.
A l’ouest de la rivière d’Assinie et à une certaine distance à l’intérieur on aperçoit, du large, une chaîne de collines nommée par les marins Sueiro da Costa[56]. Les monts Church et Horn, qui en sont les sommets les plus élevés, ont l’un 165 mètres, l’autre 139 mètres d’altitude. A l’est de la rivière d’Assinie et comme leur faisant suite se trouvent les collines d’Assinie. Leur point culminant est à l’ouest et se nomme Grotto.
C’est entre ces deux lignes de collines que se trouve le bassin de la rivière Bia ou rivière de Krinjabo. Cette rivière a été recoupée par Treich près d’Atiébendékrou (Indénié) en 1883, et dans le Sahué par Lonsdale, en 1883. Elle prend sa source dans le même massif de collines que la rivière Mézan (affluent de gauche du Comoë), et semble courir approximativement[314] entre l’Indénié et le Sahué ; elle entre dans la lagune Ahy un peu en aval de Krinjabo.
Au sud, en sortant de la lagune Ahy, ses eaux passent entre six îles, dont quelques-unes sont habitées par des pêcheurs, et forment la rivière d’Assinie. Ce dernier cours d’eau coule pendant environ 8 milles vers l’ouest, parallèlement à la côte, ne laissant entre lui et la mer qu’une langue de terre boisée d’une largeur de 100 à 200 mètres. L’entrée de la rivière est plus difficile que l’entrée du Comoë, la barre de brisants est également réputée très mauvaise. La rivière Bia n’est navigable que jusqu’à Aïnboisou, un peu en amont de Krinjabo.
Le premier établissement créé à Assinie se nommait fort Joinville ; il était situé sur le bord de la mer, en face du coude est de la rivière. Ce blockhaus a été abandonné en 1849 et remplacé par un carré palissadé, bastionné, établi à un mille du village de Mafia, près de la pointe est de la rivière, mais sur la rive droite.
Toute la région située entre le Sanwi (pays de Krinjabo), la mer, le Comoë et la lagune Ahy se nomme Akapless. Nous avons eu déjà l’occasion d’en parler à propos d’Impérié et de Yaou, nous ajouterons seulement que c’est un pays dans lequel il n’est pas aisé de porter la guerre, à cause des nombreuses lagunes et flaques d’eau qui rendent les communications difficiles. Au sud, l’Akapless est limité par les lagunes d’Hébé, de Kodioboué et le marigot de Ganda-Ganda, et au nord par la lagune Ono, et les petits cours d’eau marécageux qui s’y déversent.
La lagune Aby ou d’Ahy s’étend dans les terres sur une profondeur d’une trentaine de kilomètres, et sa largeur moyenne est de 15 à 20 kilomètres. Ses rives sont parsemées de villages qui se livrent beaucoup à la pêche.
Ceux d’entre eux qui ont le plus de relations avec nous sont situés sur la rive gauche de la lagune, aux environs d’Élima, où la maison Verdier a une plantation de café d’une centaine d’hectares, et où il existe une école française fréquentée par une quarantaine de jeunes gens des différents villages de la lagune.
Toute cette région, que nous désignons improprement, sur la plupart de nos cartes, sous le nom de royaume d’Amatifou[57], se nomme Sanwi. Pour parler des gens du pays de Krinjabo, on dit : Sanwi Cottoko, c’est-à-dire hommes du Sanwi. La capitale de ce pays se nomme Krinjabo ; elle est[315] située à une dizaine de milles à l’intérieur de la rivière Bia, et sur sa rive gauche ; de l’embarcadère au village il y a un quart d’heure de chemin.

Castor, interprète du gouvernement à Assinie.
Tous les Européens qui sont venus à Assinie connaissent Krinjabo, dont ils évaluent la population de 2000 à 6000 habitants. Nous ne nous étendrons pas davantage sur la description de la ville, que nous ne connaissons pas, en renvoyant ceux que cela intéresse particulièrement aux nombreuses publications qui en parlent.
Le Sanwi est limité : au nord et à l’est par l’Indénié, le Sahué et le Broussa ; à l’ouest par le Bettié, l’Attié et l’Ébrié ; au sud par l’Akapless, les lagunes Ahy ou Aby, de Tendo, d’Éhy, le cours du Tanoë et l’Ahua ou Apollonie.
Les habitants du Sanwi[58] sont en majeure partie de race agni, et de même origine que ceux de l’Indénié, de l’Anno et de l’Abron ; ils seraient venus il y a environ cent cinquante ans, sous la conduite d’un chef nommé Amana, des régions du Sahué, et se seraient emparés du territoire de Bettri et Aby, deux peuples paraissant les autochtones et ayant un air de famille avec les Zemma ou Ahua Cottoko (gens de l’Ahua), ou Apolloniens. Aujourd’hui les Bettri et Aby se réduisent à[316] quelques villages de pêcheurs établis sur la lagune et se sont fondus aussi avec les gens de l’Akapless, qui paraissent être fixés également depuis longtemps dans le pays.
Dans le Sanwi la succession au trône a lieu d’oncle à neveu, fils de sœur ; Aka Simadou, le roi actuel, est le neveu, fils de la sœur aînée d’Amatifou.
Le premier héritier se nomme Couassy ; viennent ensuite les autres prétendants, Amouy et Aka Simadou (homonyme du chef). Chez les gens de race agni, il est de règle que le fils aîné du chef occupe la charge de premier intendant. C’est généralement un personnage avec la haute influence duquel il faut compter. Le fils aîné d’Aka Simadou, premier intendant actuel, se nomme Cabranca, mais son influence est fortement contre-balancée par l’ancien premier intendant, Azémia, fils d’Amatifou, qui est un homme remarquable par son intelligence et qui a toujours su conserver l’influence qu’il s’était acquise pendant le long règne d’Amatifou.
A la lagune Aby ou Ahy fait suite une autre lagune, qui est, elle, parallèle à la côte ; nous l’appelons lagune de Tendo, mais elle a été longtemps désignée sous le nom de lagune d’Apollonie ; elle se termine vers le 5e degré de longitude par deux lagunes en forme de poche, de moindre importance : les lagunes Éhy et Ouani. Entre ces deux rivières, le Tanoë ou Tendo se fraye un jour à travers une série d’îlots pour venir se jeter dans la lagune Tendo.
Le commandant Dubourquois, chef d’état-major de l’amiral Bouet-Willaumez, a fait en 1849 la reconnaissance du Tendo. Le Guet-N’dar a remonté la rivière jusqu’à Alacouaba (Alancabo).
Il signale sur la rive droite du Tanoë le territoire d’Anka, gouverné par une femme nommée Ankara. Sa capitale serait Noassou (Ennousou, actuellement en ruines). Cet exemple d’une femme exerçant une certaine autorité sur un pays n’est pas isolé : à Krinjabo encore aujourd’hui la sœur cadette d’Amatifou, la princesse Élua, est considérée comme une sorte de souveraine. Moi-même, dans ma route de Bondoukou à Amenvi (résidence d’Ardjoumani), j’ai couché dans un village dont le chef était une femme. Comme Élua, elle était stérile — serait-ce là une condition sine qua non ? Je l’ignore.
Au nord de l’Ankara, M. Dubourquois signale le district d’Afuma, tous les deux placés sous la suzeraineté du roi du Sanwi (Amatifou), actuellement Aka Simadou.
A Alancabo, limite d’exploration de M. Duburquois, le Tanoë reçoit un[317] grand affluent de droite. Exploré et remonté en 1884 par le lieutenant Pullen, ce cours d’eau semble identique à la rivière Soui, recoupée en 1883 par Lonsdale un peu au nord de Tanoëso (itinéraire de Cape Coast à Annibilékrou).
Quant au Tanoë[59] lui-même, il a un cours beaucoup plus considérable : après avoir traversé le Sahué, il entre dans l’Achanti ; ses sources sont situées au nord de la végétation dense, près des ruines de Tékima, sur la route de Bondoukou à Koumassi, à une journée de marche au sud de la rivière Tain.

Plantation de café d’Elima, sur la lagune Aby. (Photographie de M. Ch. Alluaud.)
La partie nord du district Sanwi, située entre la rivière Bia et la rivière Tanoë, a été visitée en détail en 1882 par MM. Brétignière et Chaper, qui ont consigné leurs observations sur la flore et la faune dans les Archives des Missions scientifiques, publiées sous les auspices du Ministre de l’instruction publique.
Actuellement le commerce est entre les mains des gens de Grand-Bassam,[318] de l’Akapless, de Krinjabo et de l’Apollonie. Très intelligents, ces peuples ne tiennent pas à laisser arriver à nos comptoirs les gens de l’intérieur, parce qu’ils sentent très bien que, du jour où tout le monde pourra se servir soi-même à nos comptoirs, le plus clair de leurs bénéfices actuels leur échappera. Cet état de choses est très préjudiciable aux intérêts de nos commerçants, en ce sens qu’il limite les transactions aux efforts et à l’activité déployés par un nombre de traitants bien inférieur à ce qu’il pourrait être.
Ces peuples, jaloux de voir tout le monde faire des affaires, tiennent les rivières et les chemins et ne laissent passer les marchands de l’intérieur qu’après avoir prélevé sur eux un impôt ou des droits assez élevés pour les forcer à employer leur intermédiaire dans des achats de marchandises de provenance européenne.
Par le Comoë, la route est plus libre que par l’Akapless et le Sanwi, mais les chemins sont à peine tracés, et il est difficile d’utiliser le cours du Comoë, pour les raisons que nous avons données plus haut : à savoir que les gens de race agni rendent responsables et solidaires les uns des autres les gens d’un même village quant au règlement des dettes et des amendes : ce sont quelquefois des compromis qui existent depuis plusieurs générations, auxquels se mêlent des successions, de sorte que les jurisconsultes les plus éminents ne pourraient plus dire quel est celui des deux partis qui a le droit pour lui. Cet état de choses donne lieu à des palabres interminables qui durent parfois très longtemps et après lesquels les deux partis sont forcés de se séparer sans avoir obtenu une solution.
Les gens de Kong, dont j’ai donné plus haut une évaluation du chiffre d’affaires, feraient promptement augmenter nos transactions, qui en quelques années ne manqueraient pas de se quintupler.
Depuis vingt ans nous n’avons plus de garnison sur la Côte de l’Or ; ce pays est livré à la seule garde de la maison Verdier, qui a réussi non seulement à défendre l’intégrité de nos possessions contre les agissements des puissances étrangères, mais encore à maintenir dans le respect toutes les populations voisines.
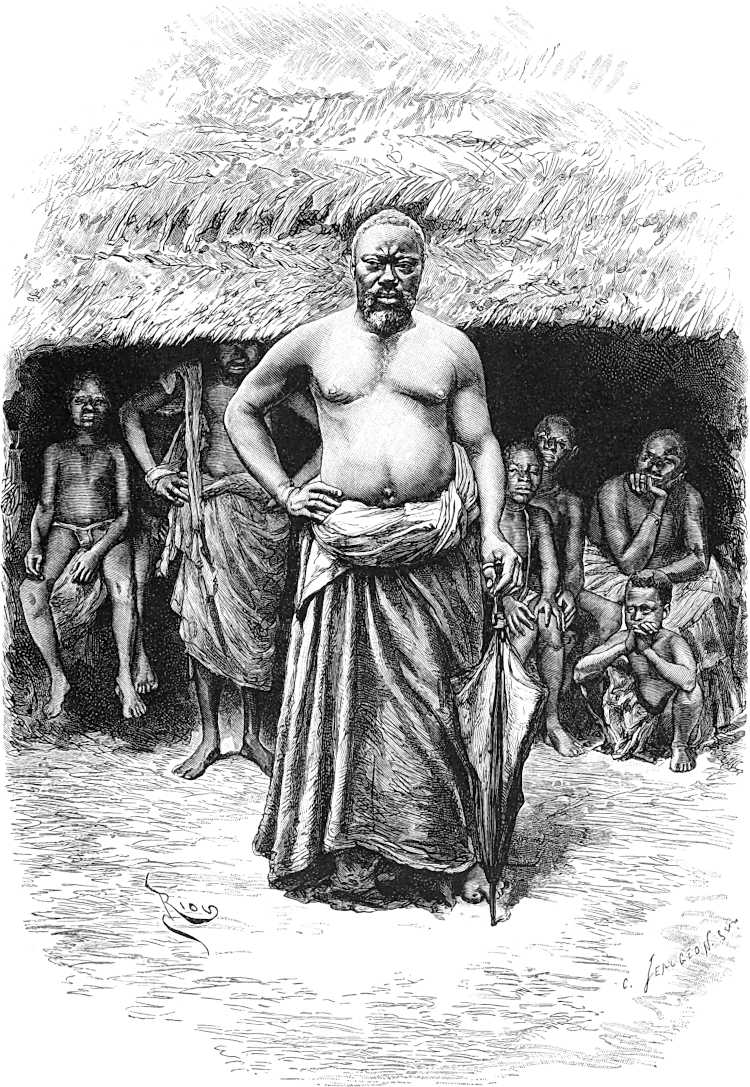
Un traitant de la Côte de l’Or. (Photographie de M. Ch. Alluaud)
Si des gens de l’intérieur venaient à nos comptoirs, ils verraient nos magasins, et y trouveraient un grand assortiment de marchandises ne leur donnant que l’embarras du choix. Un bel étalage séduit au moins autant un nègre qu’un blanc et l’engage à acheter bien des objets dont il ne connaissait même pas l’existence, mais dont il a reconnu l’utilité, trouvé l’emploi, ou même entrevu le moyen de s’amuser. Nous ne nous appesantirons pas plus sur l’avantage d’attirer le noir vers nous ; il saute[321] aux yeux que, rendu à nos comptoirs avec ses produits, l’indigène est forcé de nous les vendre au prix que nous voulons bien les lui acheter.
Beaucoup de ces peuples nous seraient certainement reconnaissants de proclamer et de faire respecter la liberté du commerce ; sachant qu’ils peuvent écouler leurs produits, ils en fabriqueraient davantage.
Dans la lagune d’Ébrié, nous avons constaté que, quand les traitants ne vont pas avec des chalands mouiller devant les villages, les indigènes ne viennent pas apporter beaucoup d’huile aux factoreries, le trajet en pirogue étant long, pénible et quelquefois dangereux pour eux.
Les maisons de Grand-Bassam s’en sont bien aperçues, et elles entretiennent des magasins flottants sur plusieurs points de la lagune. Tous les habitants font des affaires. Il n’y a qu’à envoyer des remorqueurs et des récipients vides, ils reviennent toujours avec leurs ponchons pleins.
Ces peuples ne demandent qu’à faire du commerce, c’est à nous d’en profiter et de sortir un peu de notre torpeur.
J’ai constaté avec peine que l’on ne vend presque exclusivement que des produits anglais à la Côte. Cela tient à ce qu’au moment où je suis passé à Grand-Bassam aucune ligne française ne desservait la Côte, et surtout à ce que nous nous bornions toujours à y vendre les mêmes articles.
Est-il besoin de faire ressortir que cette trop restreinte variété d’articles rend les opérations moins lucratives et quelquefois très préjudiciables : ainsi, un article vendu tous les jours finit forcément par être déprécié ; malgré tout, son prix de vente baisse de jour en jour et bientôt il ne laisse que de médiocres bénéfices, tandis qu’un autre assortiment, de nouvelles marchandises plus séduisantes par leur nouveauté, se vendraient plus facilement, laisseraient aussi de plus beaux bénéfices ; mais pour cela il faudrait faire l’article, se donner de la peine — en un mot il faut savoir vendre.
Je suis persuadé que l’on peut se défaire à bon compte de tout ce que l’on veut, j’en ai fait moi-même l’expérience pendant le cours de mon voyage, pour lequel je n’ai emporté pour ainsi dire que des objets inconnus au noir et tous de fabrication française.
J’ajouterai même que nos tissus français sont réputés meilleurs que ceux d’autres provenances et qu’il n’est pas difficile de faire primer nos marchandises sur celles de nos voisins ; nous pouvons fournir mieux et au même prix. Partout le commerçant français est réputé pour son honnêteté dans les transactions : nous n’avons donc qu’à profiter d’un état de choses existant déjà.
Si les gens de Kong descendent à la Côte, ils achèteront tout ce qu’ils[322] verront, depuis des étoffes à 40 centimes le mètre jusqu’à des soieries de 8 et 10 francs le mètre, des draps de couleur, des effets arabes, burnous, haïks, etc. Celui qui aurait l’idée de vendre de la librairie arabe serait sûr d’avoir pour clientèle la boucle entière du Niger, et ce ne serait pas la plus mauvaise.
Certains articles anglais, tels que les armes et la poudre, peuvent plus difficilement être substitués par des articles français, mais ce n’est pas impossible. En conservant le mode d’emballage, la couleur de l’étiquette, et, je dirai mieux, surtout le granulage de la poudre, elle sera toujours acceptée.
J’insiste sur le granulage : c’est une question très importante, et qui nous paraît insignifiante parce que nous achetons la poudre au poids. Le noir la vend à la mesure : il faut donc, tout en ayant l’apparence d’être fine, qu’elle soit assez anguleuse pour présenter peu de poids sous un gros volume. Toute la question est là.
En somme, celui qui veut s’en donner la peine peut faire des affaires bien plus facilement qu’en France ; les noirs demandent à vendre et à acheter ; la main-d’œuvre, on peut se la procurer à bon compte, et, avec un peu d’activité, mener de front le commerce, l’agriculture et même l’industrie minière ; la seule difficulté, c’est qu’il faut des capitaux pour les premiers frais d’installation et la mise en valeur des friches et plantations de café.
La France se trouve à la Côte de l’Or dans des conditions excessivement favorables. Elle a affaire à des populations particulièrement douces, très maniables et ne demandant qu’à faire du commerce avec nous. Celles de l’intérieur, aussi actives que celles de la Côte, nous réclament des voies de pénétration ; elles veulent écouler leurs produits.
Les différents peuples avec lesquels nous sommes en contact fournissent d’excellents marins et manœuvres ; ils travaillent volontiers pour le compte des Européens. Leur concours nous serait assuré pour l’exploitation des immenses forêts vierges qui s’étendent sur environ 300 kilomètres de profondeur et parallèlement à toute la côte.
Les gens de la lagune de Krinjabo travaillent très volontiers dans les plantations de café établies par la maison Verdier.
Les factoreries ont fort peu de personnel européen ; pour les employés subalternes, on a recours aux noirs, qui s’acquittent très bien de toutes les fonctions secondaires.
Les gens de Grand-Bassam, d’Assinie et de Krinjabo sont d’excellents courtiers ; les Kroumen, les Jack-Jack et les Apolloniens sont des piroguiers[323] experts et d’excellents travailleurs, parmi lesquels les factoreries trouvent à recruter des mécaniciens des tonneliers, des menuisiers et jusqu’à des ouvriers assez habiles pour construire, sans être dirigés, des habitations à l’européenne. Avec de tels éléments dans une population, il est difficile de ne pas arriver à la prospérité.
Il nous reste quelques mots à dire sur le pays situé entre Assinie et le cap des Trois-Pointes. Le nom réel de ce pays est Ahua, mais il a été baptisé par les Européens du nom d’Apollonie, parce que, dit un navigateur ancien, on a reconnu que les nègres de cette partie de la Côte sont remarquablement beaux et bien faits. Sans mériter cependant le titre d’Apollons, les habitants de la côte, les Zemma, pour les appeler comme dans le pays, sont mieux faits que les autres noirs ; ils portent plus volontiers la barbe et ont un air plus prospère, plus civilisé que les Kroumen et les Agni.
Ce peuple parle un dialecte agni ; la plupart d’entre eux emploient en outre un mauvais anglais. Ce sont les meilleurs commerçants et traitants de la Côte. Comme leur pays n’est pas bien riche, ils émigrent volontiers dans des régions plus prospères ; on les trouve surtout dans l’Indénié, où ils sont de zélés agents anglais. Je considère le Zemma comme très intelligent et possédant l’esprit d’implantation aussi développé que le Mandé.
L’Ahua ou Apollonie était, au moment de l’occupation française de la Côte de l’Or, un véritable foyer de bandits ; leur chef le plus redoutable s’appelait Kako-Aka ; c’est lui qui se rendit coupable de l’assassinat du lieutenant de Thévenard, commandant d’Assinie, et des laptots qui l’accompagnaient dans une excursion dans la lagune. Fait prisonnier plus tard par les Anglais, Kako-Aka fut conduit en Angleterre et pendu. Ce chef eut pour successeur Asino-Kao, et, depuis, le pouvoir semble être partagé entre le chef de Bayine et celui d’Attarboé, villages situés à proximité d’Axim, où réside un commandant de district anglais. Cette région est tout à fait tranquille actuellement, et les gens du Sanwi n’ont plus que rarement des différends avec leurs voisins zemma de l’Apollonie.
★
★ ★
25 mars. — Aucun bâtiment n’est signalé venant d’Accra ; je trouve le temps horriblement long ; depuis hier, je caresse le désir d’aller faire une excursion dans la lagune : je ne tiens plus en place à la factorerie. Treich partage mon idée et en fait part à M. Bidaud. Comme celui-ci avait justement besoin d’aller surveiller ses agents noirs qui traitent dans la lagune, il s’offrit de nous prendre à son bord.
[324]Le départ sur l’élégant petit vapeur Paul Bert, de la maison Verdier, fut presque une fête pour moi. C’est bien curieux ce que j’éprouvais, mais tout ce que j’avais vu dans mon voyage ne m’avait pas rassasié : je voulais voir encore. Cette exploration me souriait d’autant plus que, telle qu’elle s’organisait, ce n’était plus qu’une charmante excursion avec tout le confort désirable : vivres, pain, vin, café, etc.
Sans énumérer tous les travaux des officiers qui ont fait la reconnaissance de la lagune de 1849 à 1870, il est cependant utile de citer l’exploration du lieutenant de vaisseau Cournet, qui, sur le Guet-n’Dar, s’avança jusqu’au fond de la lagune, vers le Lahou. Il était accompagné de MM. Boullay, commandant du poste de Grand-Bassam, Leydet, chirurgien-major, et de deux négociants, MM. Audric et Lartigue. C’est en commémoration de ce voyage que les principales îles de la lagune ont été baptisées[60] — pour l’époque, c’était une véritable exploration.
M. Cournet se proposait de rechercher la communication que les indigènes disaient exister par eau entre la lagune d’Ébrié et le Lahou ; mais, au moment d’arriver au terme du voyage, le chirurgien Leydet mourut, et, comme il avait demandé de se faire enterrer à Grand-Bassam, il fallut revenir en toute hâte et interrompre les recherches.
Depuis 1871, époque à laquelle les garnisons ont été retirées de nos possessions de la Côte de l’Or, la géographie et l’hydrographie de la lagune n’ont pas fait de progrès. Il était donc intéressant pour moi de voir jusqu’à quel point les cartes en usage étaient à jour, et de vérifier si les rivières que l’on m’avait signalées comme arrosant le Baoulé étaient connues sous les mêmes noms à leur embouchure dans la lagune.
Le mouillage de la petite flottille de commerce de Grand-Bassam se trouve dans une petite crique de la lagune Ouladine, à 300 mètres derrière les factoreries. Dès qu’on l’a quitté et que l’on entre dans le Comoë, on est frappé par l’aspect grandiose du fleuve, par cette perspective des eaux teintées et ombrées à l’infini, encadrée par les rives du cours d’eau, et des îlots couverts d’un épais rideau de palétuviers, derrière lequel s’étagent en gradins les cimes d’arbres d’essences qui me sont absolument inconnues. Cette épaisse végétation cache à l’œil le plus exercé le relief du terrain et les villages qui pourraient se trouver derrière ; au delà, c’est l’inconnu.
Jusqu’à Abra, la navigation est facile ; le chenal se trouve sur la rive[325] droite de la lagune ; on peut, ou passer entre les deux îles Vitrié, ou bien le long de la rive gauche de la lagune. Une fois l’embouchure du Comoë dépassée, le courant est insignifiant.
Les marées se font sentir encore régulièrement un peu au delà de l’île Vitrié ; plus haut, l’eau est à peu près douce, mais les indigènes ne la boivent pas : elle est réputée malsaine. Dans les villages, les indigènes creusent des trous de 1 à 2 mètres de profondeur, y enfoncent des barriques vides, pour maintenir les parois du puits.
Près d’Abra débouchent les eaux de la lagune Potou et Aguien. Cette lagune est alimentée par des ruisseaux insignifiants, au cours très limité ; ils sont analogues à ceux qui se déversent un peu partout dans les criques et anses de la rive septentrionale de la lagune.
Les populations de la lagune sont très variées ; elles ont probablement été rejetées de l’intérieur vers la côte, et je ne serais pas éloigné de croire qu’on retrouvera plus tard, quand on aura exploré le Baoulé, sinon des restes de leur famille, au moins quelque tradition ou légende rappelant leur passage.
Au nord de l’embouchure du Comoë, vers Abra, nous rencontrons la population lacustre du Potou et de la lagune d’Aguien.
Ces indigènes, appelés, dans les rapports de M. Lartigue de (1845 à 1849), Baloos, sont nommés Batôo par les Agni. C’est un peuple de pêcheurs, qui a fondé des colonies le long du Comoë, depuis la rivière Tossan jusqu’à Ono.
Ils parlent l’agni et un dialecte semblant tenir à la fois de l’Attié et des Ébrié, qui limitent leur territoire au nord et à l’ouest. C’est un peuple misérable, habitant un pays marécageux, triste et insalubre, dans lequel l’Européen serait vite aux prises avec le paludisme. La traite de l’huile de palme se fait avec les Batôo, surtout sur le Comoë, à Aloqoua et à Abra ; rarement les Européens se rendent dans le Potou, et encore moins dans l’Aguien.
A l’ouest du Potou habitent les Ebrié, une des plus puissantes confédérations de la lagune, à laquelle nous avons dû plusieurs fois faire la guerre, entre autres en 1853 (amiral Baudin) et en 1887 (campagne du Goéland).
L’Ebrié, dont la capitale Adjamé est située à une journée de marche au nord de l’anse d’Abata, est alliée au Yapogon et au Songon. Son territoire est limité à l’ouest par la rivière Ascension.
Abra cependant n’en fait pas partie. Ce village avec quelques autres s’est détaché jadis de Grand-Bassam et forme une confédération à part. Il en est de même des gens d’Abidjean, qui sont de même race que les gens[326] de Petit-Bassam, et qui parlent un dialecte un peu différent de l’Ebrié.
Les maisons de commerce de Grand-Bassam ont plusieurs goélettes mouillées devant Abidjean, à Yopogon, à Songon et à Abréby, et les traitants m’ont dit n’avoir qu’à se louer de leurs relations avec les indigènes.
En quittant Abidjean on s’aperçoit qu’on arrive dans la région des eaux douces, car le palétuvier fait place au palmier. D’autres plantes, qui semblent se complaire autant dans l’eau qu’en terre ferme, vous mènent sans transition à la flore majestueuse de ces régions, où l’on rencontre à côté d’essences pour la plupart inconnues encore, aux gigantesques troncs qui servent à fabriquer les pirogues, le palmier à huile. L’Elæis guineensis est le trésor de la lagune ; tout en poussant sans soins, il donne à ces populations privilégiées deux récoltes par an.
C’est la forêt vierge, l’imposante végétation tropicale, où il est presque impossible de circuler. Il existe bien des sentiers, mais pas comme nous les comprenons en Europe : ce sont à peine des pistes frayées et tortueuses en travers desquelles viennent s’enchevêtrer les immenses racines d’arbres gigantesques.
Les basses branches de ces végétaux commencent à 15 ou 20 mètres du sol et leur couronne se perd dans les cieux. Aux branches sont suspendues d’immenses lianes tordues qui atteignent bien souvent un diamètre de 10 à 15 centimètres.
Quand un de ces colosses muni de lianes s’est effondré, vaincu par les années, ou qu’il a été renversé par la foudre, le voyageur est forcé de contourner son gigantesque tronc ou de le franchir, de sorte que chaque sentier a un développement quintuple de ce qui lui serait nécessaire. Le nègre, avec les moyens dont il dispose, ne songe même pas à déblayer le passage.
Pour se frayer un sentier dans de semblables forêts, on est forcé de se faire précéder par des équipes de nègres chargés de couper avec des sabres les lianes et les arbustes qui barrent le passage.
A mesure que nous avançons dans la lagune, nous apercevons les villages qui s’allongent au sommet des berges comme pour rechercher le soleil ; les arbres aquatiques ont été rasés et remplacés par de belles plantations de cocotiers qui donnent un cadre plus riant et plus civilisé à ces lieux habités. Au mouillage d’Abidjean, une belle flottille de pirogues, autour de laquelle s’agite une remuante et active population de pêcheurs ou de marchands d’huile de palme, donne une idée tout autre de cette gent lacustre qu’on serait un peu tenté de prendre pour des anthropophages, si l’on s’en rapportait aux récits.
[327]
★
★ ★

Village sur la lagune. (Photographie de M. Ch. Alluaud.)
J’avoue que j’ai toujours eu grand’peine à me représenter les noirs anthropophages ; je dois le dire, je n’en ai jamais rencontré ; Dieu sait si cependant j’ai vu des peuples assez inférieurs pour être suspectés de cannibalisme ! On m’a signalé à maintes reprises des peuples s’adonnant à ces coutumes barbares : chaque fois que je suis arrivé dans leur pays, j’ai toujours constaté qu’ils n’étaient pas assez gourmets pour sacrifier les années de travail d’un esclave au plaisir relativement court d’un repas de chair humaine. Quand, dans une guerre, un peuple fait des prisonniers et qu’il égorge une partie de la garnison dont il a réussi à s’emparer, le massacre généralement est limité aux meneurs, aux influents, mais ils ne sont pas mangés. Les noirs se servent de cette coutume barbare pour jeter l’épouvante, pour réduire plus tôt le pays. S’ils étaient sûrs d’une paix honorable et durable, s’ils n’étaient pas convaincus que plus tard ces mêmes chefs chercheront l’occasion de recommencer à lutter, la clémence existerait dans maintes circonstances. Les chefs qui ont fait grâce de la vie à des rebelles ou à des vaincus, ce sont les chefs forts. Les faibles, pour inspirer la terreur, ont recours à cette barbare institution, et encore dans une certaine mesure, car les prisonniers ont une valeur : c’est[328] avec eux qu’ils récompensent les services de leurs sous-ordres et qu’ils achètent la poudre et les armes — c’est ce qui limite les exécutions capitales.
Dans le cours de mon voyage on m’a signalé, entre autres peuples, les Lô — dont j’ai parlé à propos du Ouorodougou — comme ayant la réputation d’être anthropophages, mais je ne les ai pas visités. D’après les renseignements que j’ai obtenus, ils vivraient entre la lagune et le Ouorodougou, au nord des Kroumen et des peuples du Baoulé. J’en doute donc, puisque beaucoup d’autres que j’ai vus et qui en avaient la réputation ne l’étaient pas.
Je dois cependant dire que le capitaine au long cours Lartigue, agent de la maison Régis et Fabre, qui avait fondé des comptoirs en 1843 au début de l’occupation française de la Côte de l’Or, signala à sa maison le cas de six ou huit laptots sénégalais qui avaient disparu et qu’on disait avoir été mangés par les Ébrié. D’autre part, l’amiral Fleuriot de Langle nous dit que dans le dossier de Piter[61], le chef de Grand-Bassam qui nous concéda nos droits sur cette région, il releva cette mention qui laisse peu de doute sur le goût de ce seigneur noir pour la chair humaine :
« Je lis dans le dossier de Piter cette affreuse note : « Condamné à 10 onces d’or d’amende pour avoir mangé un esclave. »
Les gens de Bouboury et de Tiakba, d’après les mêmes voyageurs, auraient également quelques-uns de ces forfaits à leur actif.
Si la chose a réellement existé, il est notoire que cela n’a plus lieu.
J’ai toujours compris que des insulaires, n’ayant pas de ressources en viande, éprouvent le besoin d’en manger, mais dans des pays où pullulent le singe, les antilopes, où existent le bœuf, la chèvre, le mouton, le chien, les poulets et les canards, sans compter les oiseaux, les caïmans et une quantité prodigieuse de poissons, il me paraît difficile que l’homme ait besoin de manger son semblable.
★
★ ★
Aux abords d’Abidjean les eaux de la lagune ont creusé d’innombrables criques et baies, dans lesquelles les indigènes établissent des pêcheries dont les dispositions sont étudiées d’une façon presque savante. On peut dire que la lagune n’est qu’une immense pêcherie ; tous les villages en[329] possèdent et elles sont toutes disposées à peu près de la même façon.
A l’aide de pieux en palmes ou en bambous les pêcheurs barrent presque entièrement la lagune, et quelquefois dans des endroits où elle a plusieurs milles de largeur. De distance en distance, 200 en 200 mètres, la palissade forme un labyrinthe ; le poisson, en y entrant, passe d’un compartiment spacieux à un compartiment plus petit. Au fur et à mesure qu’il cherche à traverser, s’il ne repasse pas exactement par les mêmes passes où il est entré, il s’égare, et en fin de compte est forcé de rester prisonnier. Aux issues d’aval ou d’amont (alternativement) sont disposées des nasses, et dans ces compartiments, véritables viviers, les indigènes prennent le poisson à l’aide de filets à main. Pour se rendre compte si le moment est opportun, les pêcheurs versent à la surface de l’eau de l’huile de palme, pour que l’eau devienne transparente. Quand ils ont acquis la certitude qu’il y a beaucoup de poissons, ils bouchent les issues avec les nasses, plongent avec un filet dans chaque main et prennent ainsi tout le poisson qui se trouve dans la pêcherie.
Quand ce poisson dépasse la quantité nécessaire à l’alimentation du village, il est séché et vendu contre de l’huile de palme ou de l’or aux villages de l’intérieur, qui en sont très friands.
La pêche est fétiche deux jours sur trois ; c’est-à-dire que, par une sage mesure, les chefs l’ont réglementée et ne l’autorisent qu’un jour sur trois dans la lagune.
Dans un même ordre d’idées, l’igname est fétiche jusqu’à la récolte. C’est comme la vendange chez nous. On commence à ne récolter que le jour indiqué par le roi, ce qui donne lieu à des fêtes bien souvent décrites par les voyageurs de l’Achanti.
La première rivière un peu importante que l’on puisse remonter pendant quelques milles en pirogue se déverse dans la lagune entre la grande île Leydet et l’île Lartigue. Les indigènes la nomment rivière Layou, et nous rivière de l’Ascension. Ce cours d’eau, qui me paraît bien limité comme cours, pourrait très bien n’être qu’une bouche de la rivière Agniby ou Ayéby, qui se déverse dans la lagune en face de l’île Leydet.
A hauteur de l’île Leydet, la marée est insignifiante ; cependant l’eau de la lagune est de qualité médiocre, elle conserve une saveur saumâtre ; je ne suis pas éloigné de croire que les infiltrations d’eau de mer se produisent surtout aux endroits où la lagune n’est séparée de la mer que par une langue de sable insignifiante, comme à Petit-Bassam et aux Jack-Jack.
Après avoir doublé les pointes d’Alafa et d’Ilaf, nous entrons dans la baie de Dabou. Beaucoup de pirogues sont mouillées dans les anses de la baie ;[330] au fond, à une portée de fusil de l’ancien fort, que l’on aperçoit à travers les arbres, près de l’atterrissage, flotte au bout d’un mât le pavillon français.
Le Paul Bert ne peut mouiller qu’à 100 mètres de la plage et nous débarquons en pirogue.
La maison Verdier a des traitants à Dabou, aussi fûmes-nous très bien reçus.
Pendant qu’on nous préparait un bon fouto, MM. Bidaud, Treich et moi allâmes visiter ce qui reste du poste.
On s’y rend par une magnifique allée de manguiers, arbres splendides et couverts de fruits, dont le feuillage ne laisse passer aucun rayon de soleil. Près de la porte d’entrée, il fallut se frayer un sentier à coups de sabre à travers la végétation. Partout ce sont des haies de goyaviers, des corosoliers, des avocatiers, des pommes-cannelle, des orangers et des citronniers splendides. C’est le cœur serré que j’ai pensé à tous nos braves camarades de l’infanterie de marine, qui sont, hélas ! à peu près tous morts aujourd’hui et qui ont dû avoir tant de peine à importer, planter et soigner ces pauvres fruitiers. Rien n’est triste comme de voir des vestiges de civilisation, des ruines inhabitées, un poste encore solide, dont les murs semblent vouloir résister, malgré vingt ans d’abandon, aux ventouses de gigantesques lianes qui cherchent à tout envahir, et qui comme d’affreux serpents sont enroulées autour des poutres et des pans de mur, qu’elles finissent par étouffer et désagréger.
Pauvres camarades qui reposez dans les cinq parties du monde, c’était bien la peine de vous dévouer, de planter, cultiver et greffer, de vouloir créer un bien-être pour vos successeurs, d’aimer et d’adorer ce pays où vous avez peut-être été plus souvent malades que bien portants, où, dans vos séjours de trois ou quatre ans, vous avez reçu deux courriers par an, où, loin de tout le monde, ignorés de tous, vous avez fait si bien votre devoir, en voulant prouver que, de ces pays qu’on disait déshérités, on arriverait avec de la patience à faire des lieux enchanteurs : vous ne vous doutiez pas que d’un simple trait de plume tout cela retournerait à néant, que votre beau jardin de Dabou serait abandonné, que votre poste serait évacué, qu’on ne s’inquiéterait même pas de celui qui en aurait la garde momentanée !
Si d’aucuns d’entre vous sont encore en vie, et que vous veniez visiter Dabou, on vous dira comme à moi, quand vous demanderez où sont passés l’ameublement, les portes et les fenêtres : « Ce sont les Jack-Jack qui ont meublé leurs appartements avec... ».
Qu’on ne vienne plus dire que le Français est un indifférent en matière[331] coloniale et que le soldat ne sait que faire la guerre. Allez voir Dabou : peut-être y trouverez-vous encore des vestiges de cerisiers et de pommiers, de la figue et de la vigne. En tout cas, je défie à tout homme de cœur de ne pas déplorer que de tels résultats aient été sans raison abandonnés.

Jeune fille de la lagune. (Photographie de M. Ch. Alluaud.)
C’est à la suite de l’expédition de l’amiral Baudin, en 1853, que fut décidée la construction d’un poste fortifié à Dabou, dans l’Ébrié. Ce fut le commandant Faidherbe qui fut chargé de sa construction. Les pierres furent tirées des îlots de la lagune et en particulier de la petite île Boullay.
Le poste consistait en une maison carrée, entourée d’un mur d’enceinte bastionné ; il était construit à 200 mètres de la lagune sur un monticule qui commande le pays à 1000 ou 1200 mètres à l’entour. Dabou est situé à 40 milles de Grand-Bassam. En une demi-journée on s’y rend aisément avec une embarcation à vapeur.
Derrière le poste, on voit une immense plaine ondulée qui s’étend à perte de vue vers l’intérieur ; la forêt a fait place aux hautes herbes, les bois séculaires aux bouquets d’arbres rabougris ; on se croirait sur les bords désolés de la Volta, dans le pays des Dioummara. Cette immense clairière cesse avant d’arriver à Débrimou ; là recommence le rempart de végétation qui s’étend de l’Anno à la mer. C’est même une des parties de la lagune les plus riches en huile de palme. Au delà de Débrimou et à une journée de[332] marche au nord, se trouve un gros village nommé Acrédiou, qui fait partie de la même confédération et parle la même langue que les gens de Dabou ; c’est le même dialecte que celui dont on se sert dans l’Abidji (district au nord de l’Adjessi) et dans plusieurs confédérations du Baoulé.
De Débrimou et d’Acrédiou partent des chemins se dirigeant par la vallée de l’Isi vers l’intérieur (le Baoulé et le Kouroudougou). Dabou est en relations avec Tiassalé (village du Lahou) par un chemin qui traverse le territoire de Bouboury et de Toupa.
Entre la rivière Ascension et Dabou, la lagune reçoit la rivière Agniby ou Isi, ou Baoulé. Cette rivière prend sa source par 9° 30′ de latitude nord, coule du nord au sud et arrose le pays des Pallaga, le Tagouano, le Baoulé ; pendant son cours supérieur, elle prend le nom de Nji et d’Isi ; elle reçoit un important affluent de gauche, le Ndo, qui arrose le Diammara, et au nord de Dabou on lui connaît un affluent de droite que les indigènes nomment Biéchai.
La rivière Isi a un cours d’environ 400 kilomètres ; elle subit une crue considérable en hivernage, ce qui rend son cours torrentueux ; en temps ordinaire, son embouchure est presque barrée et ne laisse de chenal que pour les petites embarcations et les pirogues. Les indigènes de Dabou m’ont affirmé qu’elle était navigable, mais que son cours moyen était obstrué par les herbes. A plusieurs reprises, paraît-il, des Européens auraient essayé de la remonter en embarcation, mais ils ont toujours dû y renoncer à cause de l’emploi de l’aviron, qui en s’empêtrant dans la végétation finissait par faire renoncer à pousser plus loin les investigations de nos compatriotes.
Entre Dabou et la rivière Bandamma ou Lahou est située la région des Bouboury ; elle comprend trois confédérations de race à peu près semblable, parlant une même langue, et qui se sont groupées autour des trois plus grands villages du pays. Ce sont Bouboury, Toupa et Tiakba. Ces districts, comme je l’ai dit plus haut, avaient au début de notre occupation, en 1843, la réputation d’être anthropophages.
Nos traitants y vont faire du commerce. Il y a toujours des chalands ou des goélettes de mouillés à Tiakba et à Toupa, et il n’arrive jamais rien de fâcheux à nos protégés. D’après les gens que j’ai interrogés, si cette coutume a existé, il est avéré que, depuis bien longtemps, on n’a pas entendu parler de scènes de cannibalisme.
Les anses de Bouboury reçoivent quantité de petits cours d’eau, dont cinq d’entre eux paraissent être assez importants, puisque les indigènes m’ont signalé qu’on les traversait à gué et en pirogue pour se rendre de Dabou à Tiassalé sur le Bandamma ou rivière Lahou.
[333]La plus importante d’entre elles est la rivière Sira ou Ira, ou de Cosroë, qui se déverse dans la baie de Tiakba. La région des Bouboury est limitée à l’ouest par la rivière Bandamma ou Lahou, qui prend sa source entre Dioumanténé et Oumalokho. Au point où je l’ai traversée, dans ma route sur Niélé, elle avait 2 mètres de largeur et coulait dans un lit profondément encaissé. Elle arrose le Tagouano, le Kouroudougou, le Baoulé, le Souamlé et l’Adou. Dans le Kouroudougou, en hivernage, elle est difficilement guéable, et son cours serait navigable en pirogue sur un long parcours. Le Bandamma n’a été remonté que jusqu’à Tiassalé, gros village de race agni, situé à une quarantaine de milles à l’intérieur, et point de départ d’une route fréquentée vers l’intérieur. Elle se jette dans la mer par une embouchure très étroite et reçoit à droite les eaux de la lagune Lozo. La mer brise sur son embouchure avec une telle violence qu’il est impossible de la franchir en canot. Les pirogues des gens d’Afé (grand Lahou) et de Brafé, rive gauche, chavirent fort souvent aussi en la traversant.
Aujourd’hui on ne sait pas encore si le Bandamma ou Lahou ne communique pas avec la lagune Ébrié ; des marigots, amorcés de part et d’autre sur la lagune et sur la rive gauche du Lahou, laissent supposer que, si la communication existe, personne ne l’a jamais explorée.
La configuration de la lagune s’est tant soit peu modifiée depuis une vingtaine d’années ; quelques baies se sont creusées plus profondément, des pointes se sont rognées, de nouvelles criques se sont formées ; j’ai essayé, dans la mesure du possible, de modifier ce qui me paraissait indispensable et de rectifier quelques emplacements de village ; telle que je la donne, ma carte, complétée avec les renseignements fournis par le premier maître commandant le Diamant, sans offrir l’exactitude d’une bonne carte hydrographique, est un document à jour et utile à consulter.
Le district de Tiassalé, sur le Lahou ou Bandamma, au nord de Bouboury, parle l’agni. Il est habité par des gens de même race que ceux de Grand-Bassam, d’Assinie, de Krinjabo, etc. Mais vers l’embouchure du fleuve, dans l’Adou, les gens parlent un idiome se rattachant au groupe des langues de la côte de Krou. A l’ouest de la rivière et vers son embouchure, les habitants se nomment Gléboé, Grébo ou encore Gléboy ; ils sont de même famille que les Kroumen qui habitent la côte entre les Gléboé et les Libériens, avec lesquels ils sont souvent en guerre.
Notre influence s’étend vers l’ouest jusqu’à quelques kilomètres à l’est du cap des Palmes ; elle est marquée par la rivière Cavally. Nos droits sont incontestables sur cette région ; ils s’étendent même sur l’enclave de[334] Garoué, à l’ouest du cap des Palmes. La côte entière nous appartient, du Cavally au Tanoë ; elle a une étendue de près de 5 degrés en longitude, et nos droits à l’intérieur sont incontestables.
Pendant l’occupation de cette région, l’amiral Fleuriot de Langle a cherché à avoir des renseignements sur l’intérieur. Voici ce qu’il écrit dans le Tour du Monde (deuxième semestre 1873) :
« La rivière de Grand-Bassam, celles connues sous le nom de rio Fresco, Saint-André, Biribi, Cavally, seraient les déversoirs d’une lagune intérieure, recevant toutes les eaux qui s’écoulent des monts Kong. Les Grébo nomment cette lagune Glé ; ils affirment que ses eaux sont profondes, qu’elle a 4 milles de largeur et que les naturels la parcourent depuis les Lahou jusqu’au-dessus de Biribi et de Cavally.
« Une population blanche, à laquelle les gens de Biribi donnent le nom de Paï-pi-bri, fait sa demeure sur la rive nord ; les Paï-pi-bri se confondent probablement avec les tribus qui sont désignées sous le nom de Paw par les missionnaires anglais du cap Mesurado et du cap des Palmes, et qu’ils disent être de couleur claire. »
D’autre part l’amiral nous dit dans cette même relation, page 378 :
« Baouré est situé sur une grande lagune large de 7000 à 8000 mètres, les naturels la nomment Gindé.
« On peut aller de la rivière Comoë à Baouré. Les escales sont au nombre de sept. On met huit jours à exécuter le voyage. Il faut remonter jusqu’à Goffin (?), appelé aussi Costrine (?). Si l’on veut éviter le détour, on s’arrête à Agnasoui (Aniasué), ou l’on gagne Baouré à pied en un jour.
« Agnima, chef d’Abidjean, né à Baouré, déclara également que la rivière de Baouré est large comme la lagune devant Dabou, qu’on peut aller de Dabou à Baouré en quatre jours et qu’on passe huit marigots dont l’un est aussi large que la lagune de Grand-Bassam.
« La rivière de Gindé va se jeter au cap Lahou. Il y a cinq stations, deux par eau et trois par terre, entre Débrimou et Baouré.
« La ville de Baouré est traversée par le Gindé. La partie située au nord se nomme Brafombra. La lagune de Gindé reçoit la rivière torrentueuse de Nji, dont le lit est parsemé de roches. Nji, sur laquelle est située la ville de Bathra, qui est considérable, vient de Kong. »
De tout cela, il n’est guère possible de tirer des conclusions. Un fait paraît acquis à l’amiral, c’est qu’au nord de Glébo se trouverait une lagune semblable à celle d’Ébrié, mais plus petite. Je n’y crois pas. A l’intérieur, d’après la configuration des pays que j’ai traversés à l’est, l’existence d’une sorte de bassin lacustre me paraît douteuse. Je pense au contraire[335] que les rivières du Cavally au Lahou ne traversent pas une lagune et qu’elles ont un cours semblable non seulement au Saint-André, qui est connu, mais encore au Comoë, à la rivière Bia et au Tendo.
Quant à cette population blanche des Paï-pi-bri, elle est peut-être tout simplement d’une couleur plus pâle que les autres ou renferme dans une grosse proportion des nègres blancs ayant perdu leur pigmentum.
L’amiral Fleuriot de Langle nous cite à ce propos son passage à Cosroë, dans le nord de Tiakba, au fond de la lagune, où il trouva toute une tribu de nègres blancs aux yeux bleus et aux cheveux rouges « qui sautillaient à travers le sable et se roulaient dans l’eau ». Ce sont des albinos, chose qui n’est pas rare et qui se localise dans quelques villages d’une tribu sans qu’on puisse se rendre compte des causes qui ont engendré ces noirs-blancs, comme les appellent mes noirs.
A propos du Baouré dont parle souvent l’amiral, il est facile de se rendre compte que la plupart des voyageurs confondent le nom du pays avec celui de la capitale. C’est du reste facile à comprendre, car un indigène lorsqu’on l’interroge ne dit jamais ou bien rarement qu’il vient de tel lieu habité ; la réponse qu’il fait peut correspondre à celle que nous faisons quelquefois nous-mêmes, en disant : « Il est originaire du Midi ». Or le Midi est grand et le Baoulé ou Baouré aussi. J’ajouterai qu’à ma connaissance il n’existe pas de centre portant ce nom. Ce pays est très vaste : d’après mes renseignements, il est limité au sud par les peuples de la lagune que je viens d’énumer ; à l’est il tient à l’Attié, au Morénou, à l’Indénié ; au nord il est borné par l’Anno, le Djammara, le Tagouano ; à l’ouest, par le Kouroudougou et les pays appelés par les Mandé : Ouorodougou.
Nos renseignements sont bien conformes à ceux de l’amiral pour la distance qui sépare Aniasué du Baoulé. Quant à l’autre itinéraire, celui qui part de Goffin ou Costrine, il ne m’a pas été possible d’en tirer une conclusion, n’ayant pu identifier aucun de ces noms à des villages que je connais.
La rivière de Baouré, d’après les indigènes interrogés par l’amiral, serait large comme la lagune devant Dabou. Cela est peut-être exagéré, cependant la Volta a des débordements de plusieurs kilomètres sur ses rives dans son cours moyen, et le même fait pourrait bien se produire aussi pour la rivière Bandamma, ou Lahou, ou Baoulé, comme on l’appelle, suivant les régions qu’elle traverse.
De Dabou on peut également aller dans le Baouré en quatre jours, en prenant une route partant de Débrimou ou d’Acrédiou ; on traverserait[336] huit marigots, dont l’un très large. Tout cela me paraît absolument fondé : puisque de Dabou à Tiassalé on traverse déjà six marigots pour se rendre plus haut dans le Baouré, il est certain que l’on doit recouper deux affluents de plus.
La rivière de Gindé, dont parle également l’amiral, doit être le Baoulé ou Bandamma. Gindé est probablement un village important arrosé par ce fleuve. Nous savons en effet que dans beaucoup de pays soudanais la rivière ou le fleuve prend souvent le nom du village qu’elle arrose ; au Sénégal même, il arrive souvent d’entendre dire aux indigènes : le fleuve de Bakel, ou de Podor, pour désigner le fleuve Sénégal.
De tous ces renseignements si précieusement glanés par nos devanciers, ne peut-on tirer un utile enseignement ? c’est que les détails les plus insignifiants en apparence arrivent toujours à être coordonnés à un certain moment, et qu’il faut bien se garder de négliger de les transcrire, même s’ils ne sont pas absolument précis.
Voici d’autre part les renseignements que j’ai obtenus à Dabou et dans l’Anno sur les régions qui nous occupent :
Le Baoulé, dont j’ai indiqué plus haut les limites, serait arrosé par le Lahou, ou Bandamma, ou Baoulé, ou Gindé, ainsi que par le Nji ou Isi, ou rivière Agnéby ou de Dabou ; cette rivière recevrait elle-même comme affluent de gauche le Ndo, qui arrose une partie du Djammara.
Il pourrait aussi se faire que le Nji ne soit pas à identifier avec l’Isi. L’amiral Fleuriot de Langle affirme que les indigènes le disaient affluent du Bandamma, mais je crois que c’est peu probable. Comme je l’ai dit plus haut, les indigènes considèrent la lagune comme un fleuve et ils disent volontiers (dans le Bondoukou et l’Anno) que le Comoë, qui pour eux est la même chose que la lagune, reçoit l’Isi et le Bandamma, etc.
Voici quels seraient, d’après mes renseignements, les villages les plus importants du Baoulé : Aoussoukrou, Congo-Dahoukrou et Ammakrou, appelé aussi Kabana-Mpokoukrou. Mais je n’ai pu me procurer aucune notion sur l’emplacement exact ni sur l’importance de ces centres.
Les chefs les plus influents du Baoulé seraient : Alagoua et Anancocoré, chefs souverains, puis viendraient Aoussou et Kabana-Mpokou.
La population serait composée en majeure partie de Gan-ne, dont nous avons eu occasion de parler plus haut, et de quelques colonies agni. Ce pays semble ne pas être placé sous l’autorité d’un seul chef et paraît plutôt vivre en confédérations.
Le Morénou, beaucoup moins étendu, a pour limites au nord et à l’ouest le Baoulé, à l’est le Comoë et l’Indénié, et au sud l’Attié.
[337]Ce pays n’aurait qu’un seul chef, nommé Tanqouao, et l’héritier présomptif se nommerait Cassiqouao.
Les villages principaux du Morénou, d’après mes informateurs, sont : Abangua, Créby, Daresso, Andé et Arrah, qui serait la résidence de Tanqouao.
L’Attié, qui s’étend le long du Comoë, au sud du Morénou et à l’ouest du Bettié, est un pays sur lequel il m’a été à peu près impossible de trouver des renseignements. Limité à l’ouest par le Baoulé et au sud par l’Ébrié et le Potou, ce peuple vit à peu près isolé de tout le monde et semble n’avoir que des rapports d’hostilité avec ses voisins. Embusqués avec leurs pirogues dans la végétation, le long de la rive droite du Comoë, le long de l’Indénié et de l’Alangoua, ils tombent à l’improviste sur les pirogues de marchandises qui remontent isolément le fleuve. Il doit être difficile de porter la guerre dans leur pays, puisqu’on ne le connaît pas. Les gens d’Aniasué et d’Abradine m’ont dit que la poursuite était impossible chez eux, qu’on ne pouvait les châtier qu’en s’emparant d’eux sur le fleuve. C’est pour cette raison que je n’ai pu obtenir aucun détail sur leurs villages importants et sur les chefs qui les commandent. Le dialecte qu’ils parlent diffère de celui des Gan-ne du Baoulé, de l’Agni et de l’Ébrié.
Nous n’avons pas voulu quitter Dabou sans parler de l’intéressante peuplade des Jack-Jack, qui habitent en face de Dabou sur l’étroite langue de terre qui sépare la lagune de la mer. Mon brave camarade Treich est excessivement fatigué ; il a une forte fièvre depuis que nous sommes à Dabou ; il nous paraît dangereux, à M. Bidaud et à moi, d’aller accoster en face chez les Jack-Jack. Nous faisons donc retour en côtoyant la rive gauche de la lagune sans accoster aux villages jack-jack, à mon grand regret. Nous allons cependant consigner les renseignements que nous avons eus sur eux.
Ce peuple se nomme Aradian. Jack-Jack n’est qu’un surnom donné par les Européens. Leur pays commence à l’ouest à Morphi et se termine dans l’est un peu au delà d’Afougou (Half-Ivory Town).
Chaque village de la plage a un port ou village correspondant sur la lagune. Les atterrissages de la lagune les plus fréquentés sont : Alindja-Badou, qui est le port intérieur d’Alindja ou Grand-Jack. Abra est le port sur la lagune d’Amaqoua ou Half-Jack. Il est séparé d’Abra par une petite lagune guéable que le chemin traverse. C’est Half-Jack (Amoqoua) qui semble être le village le plus important situé sur la côte entre la rivière Lahou et Grand-Bassam ; on y trouve des maisons à l’européenne, habitées par les principaux commerçants jack-jack.
[338]Au début de notre occupation de la Côte, ce peuple voyait d’un très mauvais œil notre établissement dans ces régions, mais actuellement il se rend très bien compte que notre influence lui assure une grande sécurité dans son commerce avec l’intérieur ; il existe toujours un grand mouvement, surtout avec Dabou. Les pirogues dont les Jack-Jack se servent sont de petites dimensions ; ils naviguent volontiers à la voile, qu’ils manœuvrent très adroitement, d’autant plus qu’il y a une assez grosse houle dans la lagune et qu’on sent toujours une bonne brise du large aux environs de Dabou.
Les Jack-Jack font un commerce considérable d’huile et d’amandes de palme ; ils en chargent annuellement sur une trentaine de navires à voiles, tous anglais. C’est un peuple très actif et très commerçant ; ils trafiquent sans l’intermédiaire de nos négociants français et font venir directement leurs marchandises d’Angleterre, par l’intermédiaire des capitaines de bateau. On évalue à une dizaine de millions le chiffre d’affaires qu’ils traitent annuellement, tant à l’importation qu’à l’exportation.
Ce sont les Jack-Jack qui alimentent le sud du Ouorodougou, le Kouroudougou et le Tagouano, en armes et en poudre, et Tiassalé, Toupa, Tiakba, Dabou et Débrimou semblent être les escales où résident leurs courtiers qui font les transactions avec les gens de l’intérieur, car les Jack-Jack ne voyagent pas.
Dans cette tribu, qui parle un dialecte à part, presque tout le monde sait parler anglais, quoique les capitaines anglais ne descendent que bien rarement à terre.
Quelques Jack-Jack ont fixé leur résidence près des factoreries de Grand-Bassam, où ils se livrent à la pêche pour les employés noirs, auxquels ils vendent le poisson pour quelques manilles[62].
Après avoir longé le territoire des Jack-Jack, nous laissons au sud les îles Boullay et de Petit-Bassam ; il n’existe pas de villages sur la rive nord de l’île de Petit-Bassam ; les villages sont situés sur les deux rives du canal de Petit-Bassam (entre l’île et la côte) ; le groupe s’appelle Ayouré ou Petit-Bassam et les habitants sont de même race que ceux d’Abidjean. Comme je l’ai dit plus haut, situé en face de l’Ébrié, très avantageusement à cheval sur la mer et sur la lagune, ce point pourrait devenir très[339] prospère et les habitants pourraient s’y livrer avec avantage à la traite, tous leurs transports pouvant s’effectuer par eau ; malheureusement les gens de Petit-Bassam sont moins entreprenants que leurs voisins, et la guerre qu’ils ont soutenue jadis les a affaiblis et leur a enlevé le peu d’initiative et d’élan dont ils étaient doués.
La fin de notre excursion sur la lagune ne fut marquée d’aucun incident. A partir de l’île des Chauves-Souris il y a peu ou point de villages sur la rive sud de la lagune ; elle est fortement déchiquetée ; les anses sont très nombreuses et s’enfoncent en certains endroits profondément dans les terres. Dans un avenir peu éloigné, les baies et criques se relieront à la lagune Ouladine et formeront une vaste île de la presqu’île qui supporte le village indigène de Grand-Bassam (Mouoso en agni).
Je suis bien heureux d’avoir eu la bonne fortune, grâce à l’extrême obligeance des agents de la maison Verdier, de faire connaissance avec les pays si peu connus de la lagune. A cette satisfaction venait s’ajouter le double bonheur de nous savoir, mon compagnon et moi, nommés chevaliers de la Légion d’honneur.
La dépêche était ainsi conçue :
« Gouverneur Sénégal à Résident Grand-Bassam.
« Suis heureux vous annoncer que par décret du 1er avril Binger et Treich sont chevaliers de la Légion d’honneur. »
Ce brave Treich, malheureusement, n’eut pas la satisfaction de toaster avec nous : une heure après notre rentrée à la factorerie, il avait dû s’aliter, pris par un violent accès de fièvre bilieuse hématurique qui mettait sa vie sérieusement en danger. Pendant huit jours mon pauvre ami était entre la vie et la mort et aucun paquebot n’était signalé. Enfin le 4 avril le câble annonça le prochain passage de la Nubia, de l’African Steam navigation Company, et le dimanche 7 nous eûmes non seulement la bonne fortune de voir le vapeur au mouillage, mais encore d’avoir une mer qui, sans être bonne, nous permettait d’espérer de passer la barre avec des chances de ne pas chavirer.
Treich, installé dans une baleinière, soutenu par deux Kroumen, était sans connaissance ; je pris place à côté de lui. Une autre baleinière portait mes quatre fidèles compagnons de route noirs avec Arba, une des femmes gourounga, mariée à Mamourou.
Un jeune Apollonien, né à la factorerie Verdier, avait désiré prendre place dans ma baleinière. Ce garçon m’avait pris en affection et tenait à faire fétiche pour notre heureuse traversée. Placé à l’avant, il écartait les bras en prononçant quelques paroles à l’approche des lames qui enlevaient[340] notre embarcation. La Providence était avec nous. Cinq minutes après, nous étions hors de danger.
Treich était dans un tel état de faiblesse qu’on le hissa à bord à l’aide d’un tonneau sans qu’il eût connaissance de son embarquement.
En arrivant à bord, nous avions bien piteuse mine ; mon compagnon était à moitié mort et mon costume n’était pas brillant : je portais un veston en coutil et un pantalon taillé et cousu à Kong. Les passagers, intrigués, nous regardaient d’un air de pitié.
L’isolement m’avait rendu peu communicatif. Du reste, à peu près tout le monde à bord était anglais ; seule une jeune dame désireuse de savoir qui nous étions, mon compagnon et moi, m’adressa la parole en français.
Cette dame était française, et mariée au colonel Colvile, commandant du régiment de grenadiers de la garde anglaise. Dès qu’elle sut qu’il s’agissait d’un officier français, elle mit tout en œuvre pour nous prodiguer, à mon compagnon et à moi, non seulement tous les soins, mais encore les marques de la plus grande déférence. A la noblesse du nom elle a su joindre cette noblesse de sentiment et de générosité que toute Française porte gravée dans le cœur.
Deux jours après, Treich allait mieux, l’air frais de la mer avait produit son effet salutaire, mon malade était hors de danger.
Après avoir fait escale sur tous les points importants de la côte de Krou, à Monrovia et Sierra Leone, nous atteignîmes Gorée, où je débarquai, laissant mon compagnon de route, trop faible, continuer sur Liverpool.
A Saint-Louis je rendis compte de ma mission au gouverneur du Sénégal, ainsi que des derniers événements qui s’étaient déroulés dans nos possessions du golfe de Guinée. Le 3 mai je m’embarquai à Dakar sur la Provence, vapeur de la Société des transports maritimes, qui me débarquait le 11 mai 1889 à Marseille. Le 12 j’étais à Paris, au milieu de ma famille et de mes amis.
Et maintenant, voulez-vous que je vous dise bien sincèrement quel souvenir je garde de mon voyage ?
Ces expéditions ne se font pas sans fatigue ni danger, mais elles sont par cela même attrayantes et elles offrent des compensations et des satisfactions qu’il n’est pas donné à tout le monde de goûter.
En Afrique, l’homme vit réellement ; livré à lui-même, toujours en face de situations difficiles ou compliquées, il peut donner largement cours à son initiative, il se sent vraiment quelqu’un sur terre.
[341]Le bonheur est certainement toujours relatif, mais croyez-vous que tous ceux qui, avant moi et comme moi, ont abandonné tout pendant plusieurs années pour augmenter un peu notre prestige loin de la mère patrie, et qui ont élargi un tant soit peu le cercle de nos connaissances géographiques, ne sont pas heureux à leur manière !
Certainement oui, ils le sont, je l’affirme pour eux et pour moi.
Avoir des souffrances de temps à autre est encore le meilleur moyen de se sentir vivre.

Sierra Leone.
[343]CONCLUSION
Étendue de nos possessions. — Causes de la dépopulation. — Moyen d’y remédier. — Résultats à attendre de la pénétration. — Richesse de notre domaine colonial. — Moyen de l’exploiter.
L’examen de la carte ci-jointe montre que le programme si éminemment élaboré par les généraux Faidherbe et Brière de l’Isle a été pleinement rempli. Tandis que le général Borgnis-Desbordes, les colonels Boilève, Combe, Frey, Gallieni et Archinard, nos commandants supérieurs du Soudan français, assuraient notre influence entre le Sénégal et le Niger et plaçaient une partie de la rive droite de ce fleuve sous notre protectorat, nous avons eu la bonne fortune, Treich et moi, de relier par des traités nos établissements du Soudan français à ceux de la Côte de l’Or française.
On peut aller aujourd’hui du cap Blanc au golfe de Guinée et du cap Vert à Say sans quitter le territoire soumis à l’autorité française.
Sans faire entrer en ligne de compte les territoires qui relient l’Algérie au Sénégal et concédés à notre influence par la récente convention franco-anglaise, notre domaine colonial noir comprend une étendue à peu près égale à quatre fois la superficie de la France, c’est-à-dire de plus de deux millions de kilomètres carrés.
Seules, dans cet océan de terres, se noient les enclaves anglaises de la Gambie, de Sierra Leone, de la Guinée portugaise et de la république de Liberia.
L’heure est sonnée ; il faut maintenant et avant tout songer à l’extension de notre commerce national et exploiter pour le mieux de nos intérêts ces vastes régions.
La densité de la population est bien diversement répartie dans les contrées qui nous occupent. Tandis que les États les plus populeux ont une densité de 25 habitants par kilomètre carré, il y en a d’autres moins favorisés qui[344] n’ont que 8 à 10 habitants par kilomètre carré, et enfin malheureusement un tiers environ n’en a que 3 ou 4.
Il paraît donc sage, à moins de nécessités impérieuses bien justifiées, de mettre un terme aux luttes avec les indigènes, et indispensable d’enrayer les guerres que les souverains indigènes de la boucle du Niger se font entre eux.
Combien de provinces fertiles et populeuses ont été ainsi réduites en solitudes ! Notre domaine se dépeuple progressivement, et, dans une époque qui ne paraît pas éloignée, si nous n’y prenons garde, la dépopulation complète nous surprendra.
C’est une grave question, d’autant plus grave qu’une fois la population détruite, l’exploitation deviendra impossible au blanc ; du jour où les bras indigènes feront défaut, l’Afrique sera à tout jamais perdue, et ceux qui auront fondé des espérances sur ces pays éprouveront de graves déceptions.
Aussi ne devons-nous pas oublier que le fait de prendre possession de cet immense territoire nous a créé des obligations, je dirai même des devoirs impérieux. Le plus puissant de ces devoirs, le plus immédiat, est celui de rétablir le développement normal de la population.
Les souverains indigènes, n’ayant pas l’écoulement de leurs produits naturels du sol, ne peuvent les utiliser pour se créer des ressources.
Il faut pourtant qu’ils s’entourent d’un certain faste, qu’ils rétribuent les services, qu’ils entretiennent une force armée pour se mettre à l’abri de leurs turbulents voisins.
Par quels moyens ?
En rétribuant et en payant à l’aide de captifs, de prisonniers de guerre. Les richesses naturelles du pays n’ayant aucune valeur puisqu’on ne peut les écouler, c’est l’esclave qui fixe la richesse accumulée du Soudanais. C’est par leur nombre qu’est déterminée la position sociale de chacun.
Leur entretien ne coûte rien au propriétaire ; ils cultivent et constituent pour leur maître une force qui le fait respecter.
Les routes de pénétration s’imposent donc ; il faut que des voies sûres permettent aux noirs de l’intérieur d’arriver à nos comptoirs et d’échanger leurs produits contre nos marchandises manufacturées.
A quoi servirait-il aux noirs de cultiver le tabac, les textiles, le coton, l’indigo, etc., d’exploiter les arbres à graisses végétales, de faire des plantations d’arbres, puisqu’ils ne peuvent en écouler les produits ?
Ouvrons-leur donc des débouchés, et nous verrons immédiatement leur état social s’en ressentir ; les chefs se feront payer des impôts en nature, puisque, par l’ouverture de voies de communication, ils acquerront[345] une valeur ; ils auront ainsi un budget et ils renonceront à la guerre.
La pénétration aura forcément pour effet :
1o De restreindre les guerres et d’arrêter le dépeuplement économique ;
2o De nous créer des relations économiques avec les indigènes ;
3o D’introduire notre civilisation ;
4o D’éteindre progressivement l’esclavage.
Chaque voie de communication terrestre ou fluviale, chaque tronçon de chemin de fer, chaque vapeur, chaque établissement commercial aura pour conséquence naturelle le développement du commerce.
Les relations commerciales entraînent, avec l’échange des produits, l’échange des idées, des institutions et des progrès de notre vie sociale, car, une fois sur le terrain des intérêts communs, on arrive promptement à une conciliation et à une identité de vues.
C’est donc dans l’ouverture des voies de pénétration que se trouve le salut du Soudan, c’est par elles seulement que nous trouverons aussi les compensations commerciales aux sacrifices que nous nous sommes imposés.
Le commerce, que nous considérons comme un des plus puissants auxiliaires de la civilisation, n’a encore effleuré que les bords de ce vaste continent ; il faut lui permettre d’y pénétrer jusqu’au cœur.
Le Sénégal d’une part, les Rivières du Sud d’autre part, se livrent à d’actives transactions, mais une simple inspection de la carte des régions qui nous occupent montre que presque toute la boucle intérieure du Niger occupe une position trop excentrique par rapport à ces deux bases d’opérations commerciales. Les régions que nous avons visitées ont un champ d’action commercial qui leur est propre ; le chemin le plus court qui mène au cœur de ces riches possessions ne part ni du Sénégal, ni des Rivières du Sud, mais bien de la Côte de l’Or.
La voie commerciale la plus importante de nos nouvelles possessions est jalonnée par le Comoë, Kong, Bobo-Dioulasou et Djenné, et pour y accéder les voies les plus rationnelles ont leur origine au golfe de Guinée.
C’est sur cette côte, qui du Cavally au Comoë a un développement de 600 kilomètres, que se trouve la base d’opérations commerciales sur laquelle notre commerce devra s’établir, c’est là qu’il récoltera de suite les fruits des sacrifices qu’il s’imposera.
L’examen des recettes douanières et l’excédent des recettes de la Côte de l’Or suffisent à faire ressortir la prospérité de nos possessions du littoral du golfe de Guinée et les espérances que nous sommes en droit de fonder sur elles.
Comment en serait-il autrement ?
[346]De la côte au Djimini, sur une profondeur de plus de 300 kilomètres, s’étend une forêt vierge renfermant de riches essences, bois de menuiserie, de charpente, d’ébénisterie de couleur, tinctoriaux, fibreux. Cette grande forêt se prolonge le long de tout le littoral ; elle a une superficie de 180000 kilomètres carrés, le tiers de la France.
Les indigènes y exploitent le caoutchouc, l’huile de palme et d’autres graisses végétales. Ils y cultivent l’arbre à kolas, et l’ananas y pousse à l’état spontané. On y trouve du miel, de la cire. Les singes y fournissent de la pelleterie très recherchée.
Enfin partout, sous cette puissante végétation, les indigènes exploitent le sous-sol. L’or est très abondant ; il y a des gisements aurifères exploités par les indigènes dans tout le bassin du Comoë et de la Volta.
Sans vouloir préciser, nous pensons qu’il n’existe pas dans le monde entier de pays où l’on rencontre autant de poudre d’or et de pépites entre les mains des indigènes.
Avec les connaissances que nous avons et les moyens dont nous disposons, l’extraction de l’or atteindrait certainement un rendement cinq ou six fois plus rémunérateur que celui des orpailleurs indigènes.
Le bassin entier du Comoë n’est qu’un immense placer à peine entamé. De Grand-Bassam et d’Assinie à Groûmania et Bondoukou, toutes les transactions se font en or.
Au nord de ces opulentes et riches régions on entre dans la zone des céréales et des graisses végétales. Le cé, la pourguère, le ricin abondent. Au delà, ce sont les riches pâturages du Mossi, les plantations de tabac, de coton, d’indigo, de textiles.
La plupart de ces produits sont cultivés sur une petite échelle parce que les indigènes n’en trouvent pas l’écoulement. Notre établissement chez eux ferait quintupler le rendement de leurs terres.
La fertilité excessive de ces terrains vierges permettrait d’y acclimater des produits qui, sous un faible volume, représentent une grosse valeur.
Les plantations de café de Liberia, celles de la maison Verdier à Élima, nous dispensent de nous étendre davantage sur les espérances que nous sommes en droit de fonder sur nos nouvelles possessions.
On peut ajouter à ces produits les bananes, ananas et papayes, avec lesquels on peut fabriquer des conserves et de l’eau-de-vie, les tabacs, l’indigo, le coton, le cacao, la vanille, les poivres, qui peuvent fournir d’importants éléments d’échange.
Enfin, pour prouver qu’on peut faire des affaires considérables sur la Côte, nous faut-il citer à nouveau l’exemple des Jack-Jack, qui, illettrés,[347] seuls, sans intermédiaires, traitent directement avec les maisons de Liverpool, et font en moyenne 10 millions d’affaires par an !
Cette partie de la Côte se prête d’une façon admirable à la pénétration. Une dizaine de cours d’eau s’y déversent ; ils sont tous navigables pour les pirogues et ouvrent ainsi, vers le cœur de la boucle du Niger, des voies d’accès variant de 100 à 600 kilomètres vers l’intérieur.
Voilà ce qu’est notre domaine colonial du Soudan occidental. Il nous reste maintenant à examiner si l’État seul peut mener à bien la pénétration et exploiter, pour le mieux des intérêts de nos nationaux, ces immenses et riches régions.
Nous ne le pensons pas.
L’État ne peut pas exploiter directement à l’aide de ses propres agents, il lui faut des auxiliaires, et sans l’initiative privée nos colonies ne seront rien.
Est-il bien nécessaire que l’État s’immisce jusque dans les moindres détails dans l’administration des colonies naissantes ?
Nous pensons que l’intervention directe de l’État sera toujours funeste. Bien avant l’établissement de nos nationaux, la colonie naissante sera bondée de services administratifs, judiciaires, pénitentiaires, militaires, etc. ; l’initiative privée ne pourra plus construire une factorerie, un appontement, créer un chemin, couper du bois, sans que les représentants du gouvernement interviennent.
La colonisation sera entravée, enserrée par les règlements administratifs. Le commerce renoncera à se fixer dans nos colonies et préférera s’établir à l’étranger et travailler sous la tutelle des Anglais ou des Allemands.
Est-ce à dire que l’État ne peut et ne doive intervenir ? Si. Mais son action doit s’exercer autrement. Il doit chercher à favoriser l’établissement de nos nationaux dans nos colonies par tous les moyens.
Pourquoi ne pas concéder l’exploitation de notre colonie de la Côte de l’Or à des sociétés particulières ou à des concessionnaires isolés, sous certaines garanties ?
L’État y aurait tout à gagner, sans de lourdes charges pour son budget ; il aurait ainsi une colonie prospère, dont les revenus seraient de beaucoup supérieurs aux dépenses.
Point n’est besoin de revenir absolument aux grandes compagnies ; on pourrait y apporter le tempérament nécessaire à nos nouvelles institutions.
En conférant des droits, l’État peut exiger en échange des compensations, par exemple :
L’établissement de dépôts de charbon et de vivres ;
[348]La construction de wharfs facilitant le débarquement de son personnel et de son matériel ;
La création d’écoles ;
L’organisation du service postal local ;
Des facilités d’établissement pour nos braves missionnaires.
L’État doit surtout ne pas se montrer trop exigeant : l’établissement dans ces régions est souvent pénible ; à la période de début succèdent souvent des années de tâtonnements laborieux, des essais infructueux.
Il faut donc de grands encouragements et, avant tout, l’exonération des droits d’entrée pour les machines industrielles ou agricoles destinées à un premier établissement.
La Côte de l’Or française se prête admirablement au système des concessions ; nous y possédons neuf cours d’eau dont chaque vallée pourrait, avec la portion de côte correspondante, faire l’objet d’une concession.
Nous verrions ainsi nos nationaux créer leurs établissements principaux au Cavally, aux Bériby, à la rivière San Pedro, au rio Sassandra, au Fresco, au Lahou, aux Jack-Jack avec le bassin de l’Isi, à Grand-Bassam avec le bassin du Comoë, à Assinie avec le bassin du Tendo et la rivière Bia.
De proche en proche, chaque compagnie gagnerait du terrain vers l’intérieur, créerait de nouvelles factoreries avec des écoles, et la civilisation pénétrerait ainsi comme un coin jusqu’au centre de la boucle du Niger.
Parallèlement à l’action des compagnies, marcheraient les missionnaires ; une fois sur le terrain des intérêts communs, on arriverait facilement à s’entendre pacifiquement avec les peuples de l’intérieur.
Avec le commerce s’échangent les idées ; notre civilisation pénétrerait lentement, mais sûrement.
La violence et la force ne peuvent mener qu’à un désastre ; seul le lent mouvement du progrès peut imposer nos idées et nos mœurs aux indigènes.
Que l’on fasse profiter les noirs des connaissances que nous avons acquises, rien de mieux ; mais n’espérons pas leur faire exécuter en cinquante ans une étape que nous avons mis près de vingt siècles à franchir.
Travaillons avec méthode et patience et nous verrons nos efforts couronnés de succès ; ne rêvons pas la transformation trop brusque de l’Afrique, employons la méthode lente, mais sûre, de la pénétration commerciale, et nous réussirons — nous en avons la ferme, intime et bien sincère conviction.
[349]APPENDICE I
Notice sur mes travaux topographiques et l’établissement de la carte. — Valeur de certaines terminaisons et énumération de quelques termes géographiques usités en mandé, en haoussa, en mossi, etc. — Permutation des consonnes.
Voici les documents sur lesquels j’ai pu m’appuyer pour la construction de ma carte d’ensemble :
Le cours du Niger de Siguiri à Koulicoro, d’après les travaux les plus récents exécutés par les officiers employés au Soudan français.
Le cours du Niger de Koulicoro à Mopti, par le lieutenant de vaisseau Caron, et l’itinéraire du même de Mopti à Bandiagara.
Au sud, le littoral d’après les cartes marines françaises. Enfin, entre le cours du Niger et la mer, il existait les travaux suivants, que j’ai utilisés :
| Itinéraire de la mission Gallieni, de Touréla à Nango | (1881) | 222 | kil. |
| — — Péroz, de Siguiri à Bissandougou | (1886) | 150 | — |
| — de la colonne Borgnis-Desbordes, de Falaba à Kéniéra | (1882) | 36 | — |
| — du lieutenant Bonnardot, de Siguiri à Niako | (1887) | 100 | — |
Au nord-est, j’ai utilisé une partie de l’itinéraire Barth (1853) de Say à Tombouctou, mais, par suite de la nouvelle position assignée à Tombouctou par le lieutenant de vaisseau Caron (presque 1 degré de latitude de différence), il a fallu descendre d’autant l’itinéraire de Barth.
L’itinéraire de René Caillié, tel qu’il a été construit par Jomard, Vallière et le commandant de Lannoy de Bissy, a dû être rectifié par suite de la nouvelle position de Kankan, qui, d’après les travaux du capitaine Péroz, est à reporter de 17 minutes au nord et de 20 minutes dans l’ouest de son ancienne position. La nouvelle position de Kankan m’a paru exacte, car en reconstruisant l’itinéraire Diécoura-Maninian-Timé-Tengréla j’ai trouvé que la position de Maninian répondait mieux à ce que j’en avais déduit par renseignements. Enfin mon arrivée à Tengréla m’a confirmé que dans les itinéraires de Caillié la position de Tengréla était beaucoup trop au sud.
Je n’ai trouvé, en faisant le report de mes travaux et de l’itinéraire de Caillié rectifié (avec Kankan comme nouveau point de départ), qu’une erreur de 3 kilomètres en latitude ; on peut donc dire que la position de Tengréla est exacte à 2 minutes près.
J’ai recoupé cinq fois l’itinéraire Caillié entre Tiola et Bangoro ; il me paraît bien fixé à présent pour cette région.
[350]Comme conséquence de la différence de latitude de Tengréla qui était à reporter à 20 minutes au nord de l’emplacement assigné par de Lannoye, la distance de Tiola à Djenné était devenue trop courte, il fallait réduire toutes les étapes pour contenir l’itinéraire. Renseignements pris, j’ai trouvé que le lac marécageux Syenço-Somou de Caillié n’est qu’un débordement du Mahel Balével, et qu’à partir de ce point Caillié n’a fait que longer le fleuve sans le savoir et quelquefois à des distances ne dépassant pas 8 à 10 kilomètres, comme c’est le cas pour les villages de Koroni, Kirina, Fondouka, etc.
J’ai, du reste, eu la bonne fortune de rapporter sur la région Djenné d’excellents renseignements qui me paraissent d’une réelle exactitude.
Les itinéraires de Caillié ne m’ont pas été d’un grand secours : la plupart des noms de villages sont tronqués et mal orthographiés, et comme noms de contrées il n’en a pas rapporté. Quant aux peuples qu’il a traversés, il les a réduits à trois : les Mandé, les Bambara et les Dioula, et il n’a parlé ni des Siène-ré, ni des Bobo, quoiqu’il en entretienne le lecteur sous le nom de Bambara.
Au sud et en partant de la mer, j’ai utilisé l’itinéraire de Pullen sur le Tanoé, de Nougoua à Enchy (60 kilomètres), et j’ai tiré parti des itinéraires de Treich-Laplène de Bettié à Zaranou par Annibilécrou en les reconstruisant et en les faisant coïncider avec mes travaux et ceux de Lonsdale.
Lonsdale a rapporté une carte qui comprend Cape Coast, Koumassi, Salaga, Yendi et son itinéraire dans le Sahué et le Gaman.
Ce travail est à l’échelle de 1 inch pour 15 milles, ce qui fait au 1867500. En vérifiant la distance Koumassi-Cape Coast, j’ai trouvé qu’on avait employé l’échelle du 1875000, tandis que, pour la distance Yendi-Salaga, dont j’ai fait et vérifié une partie du trajet, je trouve que l’auteur de la carte a employé l’échelle du 1625000. Dans ces conditions il ne m’a été possible que d’accorder une confiance limitée au document précité.
Le peu d’exactitude de l’hydrographie de cette même région ne m’a également pas permis de m’en servir avec tout le respect qu’un explorateur consciencieux doit avoir pour tous les documents de ses devanciers.
J’ai du reste relevé de grandes inexactitudes dans l’itinéraire de Salaga à Krakye par Badjamsu ; de Salaga à Kintampo, les renseignements des indigènes sont absolument contradictoires avec la carte.
La carte de la Côte de l’Or du docteur Mähly (1884), quoique ayant toutes les apparences d’un travail consciencieux, offre également entre Krakye et Salaga de grandes lacunes ; beaucoup de noms de villages sont omis, et il n’y a que les cours d’eau importants qui figurent sur ce document.
En somme, je n’ai pu m’appuyer sérieusement que sur les travaux de nos officiers de marine et des explorateurs français.
Les peuples et les pays de la boucle du Niger n’étaient révélés à l’Europe civilisée que par les itinéraires de Barth, établis sûrement avec beaucoup de conscience, mais offrant des lacunes bien compréhensibles. La base d’opérations de Barth était beaucoup trop éloignée pour que ce voyageur pût rapporter sur les régions qui nous occupent des itinéraires par renseignements d’une grande exactitude. Il a également confondu quelques noms de pays avec des noms de villes, et inversement, de sorte que le tout, au lieu de bien renseigner, ne fait que jeter une perturbation dans l’esprit du voyageur.
Les seuls qui auraient pu m’édifier sur la géographie de la boucle du Niger sont Duncan, Buonfanti et Krausse.
Or, jusqu’à présent, il a été impossible de reconstituer les travaux de Duncan. Ni Barth ni moi n’avons pu identifier les noms de localités et de pays rapportés par ce voyageur avec les localités existantes.
[351]Quant à Buonfanti, il règne une telle obscurité dans ses récits, qu’il est permis de douter qu’il ait jamais visité ces régions[63].
Enfin, le dernier, Krausse, qui a poussé jusqu’à Bandiagara en 1886-87, à travers le Gourounsi et le Mossi, ne nous éclaire pas davantage. Jamais ses travaux n’ont été livrés à la publicité. Ses renseignements devaient être incomplets, car ses compatriotes n’en ont rien publié. Il a donné à l’Institut de Gotha les grandes lignes de son voyage, mais il n’a révélé aux géographes qu’une dizaine de noms de centres importants sans apporter un levé à l’appui, ni préciser la position des lieux visités sur la route suivie.
Les 4000 kilomètres de levés à la boussole que je rapporte s’appuient sur 14 observations astronomiques complètes et 4 observations en latitude seulement.
En voici la liste :
| LATITUDE. | LONGITUDE. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouolosébougou | 11° | 54′ | 8″ | 9° | 57′ | 40″ |
| Ténetou | 11° | 13′ | 46″ | 9° | 41′ | 54″ |
| Sikasso | 11° | 12′ | 38″ | 7° | 34′ | 21″ |
| Bénokhobougou | 11° | 1′ | 9″ | 8° | 29′ | 55″ |
| Fourou | 10° | 31′ | 37″ | 8° | 3′ | 33″ |
| Niélé (Togada) | 9° | 47′ | 28″ | 7° | 17′ | 30″ |
| Logkognilé | 9° | 42′ | 3″ | 6° | 16′ | 21″ |
| Kong | 8° | 54′ | 15″ | 6° | 9′ | 45″ |
| Niambouambo | 9° | 35′ | 36″ | 5° | 57′ | 46″ |
| Dasoulami | 10° | 53′ | 7″ | 6° | 1′ | 15″ |
| Boromo | 11° | 32′ | 52″ | 4° | 43′ | 36″ |
| Bougagniéna | 11° | 42′ | 14″ | 3° | 42′ | 34″ |
| Waghadougou | 12° | 14′ | 42″ | 3° | 29′ | 5″ |
| Oual-Oualé | 10° | 28′ | 7″ | |||
| Karaga | 9° | 56′ | 57″ | » | ||
| Salaga | 8° | 34′ | 16″ | » | ||
| Kintampo | 8° | 4′ | 50″ | » | ||
| Boundoukou | 7° | 50′ | 12″ | » | ||
A partir de Waghadougou, mes chronomètres n’ont plus marché qu’avec irrégularité, et bientôt après il m’était impossible de m’en servir.
Les variations de température sont si brusques que presque tous les instruments, même les mieux construits, finissent par se détériorer.
Pour en donner une idée, je citerai le fait suivant : dans l’écrin d’un de mes chronomètres se trouvait un compartiment dans lequel était enfermé un ressort de rechange. Ce ressort était serti dans un fil de laiton. Quand je l’ai examiné dans le Mossi, ce ressort était brisé en plus de cent fragments, absolument comme s’il avait été écrasé par un énorme marteau.
Mes deux montres venaient du Dépôt des cartes et plans de la marine ; elles ont été repassées soigneusement avant mon départ ; et en quittant Bordeaux et pendant mon[352] séjour sur le paquebot j’avais observé et noté avec soin leur marche diurne. Elles ont fonctionné régulièrement pendant environ dix-huit mois.
Pour les thermomètres (à fronde), j’étais moins heureux : ils n’ont donné des résultats que pendant un an.
Quant aux baromètres, l’un anéroïde, l’autre holostérique, j’ai pu m’en servir pendant près de deux ans.
Pour les levés, j’ai fait usage de la boussole Peigné, et dans les endroits difficiles, où la population était trop méfiante, d’une petite boussole à main d’un diamètre moindre. Deux boussoles à fond lumineux m’ont rendu de grands services quand je me mettais en route de très bon matin, ou que, par suite de circonstances indépendantes de ma volonté, j’étais forcé de voyager de nuit.
Tous les jours de marche, à la sortie du village je ne manquais jamais de me faire indiquer à la main par le guide ou les indigènes la direction générale de la route à suivre, et je la notais. C’est une bonne précaution à prendre : au moins, si en route on perd le guide, on a une excellente donnée générale. Je n’ai jamais manqué de tracer cette direction générale sur mon dessin en arrivant à l’étape. La plus grosse erreur d’angle que j’aie constatée était de 9 degrés. On peut donc en inférer que le noir a une idée très nette de la position relative des villages entre eux.
Mes azimuts étaient soigneusement notés avec les heures. Le détail à droite et à gauche de la route était ou décrit en regard ou bien dessiné sommairement. Quant aux cours d’eau, j’ai toujours noté leur direction en amont et en aval, car on a souvent une tendance à les placer perpendiculairement à la direction que l’on suit. Parce que l’on traverse le cours d’eau perpendiculairement à son cours (en un point seulement), il n’en résulte pas que sa direction générale soit perpendiculaire à la route suivie.
Je recoupai également souvent les villages et les hauteurs à droite et à gauche de la route quand ils étaient visibles et même par renseignements indigènes.
L’appréciation des distances parcourues est facile à l’aide d’une montre : on se rend compte à quelle allure on marche quand on a un peu de pratique.
Au bout d’un certain temps on a l’intuition de la réduction des distances à l’horizon.
Voici le degré d’exactitude auquel je suis arrivé :
En quittant Kong j’ai décrit à l’est de cette ville un polygone passant à Dioulasou, Waghadougou, Salaga, Bondoukou, Kong, d’une longueur de 110 étapes, représentant à vol d’oiseau 1500 kilomètres. L’erreur totale sur ce trajet a été de 27 kilomètres en latitude et 27 en longitude.
J’ai complété mon travail topographique en reliant ma route aux points déjà connus par un réseau d’itinéraires par renseignements. Beaucoup d’entre eux offrent une grande exactitude. Relier deux points connus ne peut en effet donner que des erreurs de longueur d’étapes entre elles, mais la distance totale est toujours exacte.
La plupart de mes itinéraires ont été contrôlés dans des pays différents et dans des langues différentes. C’est précisément parce que j’ai voulu faire un travail consciencieux que l’on trouvera encore quelques blancs sur ma carte. J’ai supprimé les itinéraires qui m’ont paru tronqués en les contrôlant : il vaut mieux ne rien mettre que de charger un travail de données hypothétiques. C’est un mauvais service à rendre aux successeurs que de le charger d’inexactitudes, il s’en glisse déjà assez involontairement.
Quoique je rapporte plus de 50000 kilomètres de levés par renseignements, je ne suis pas aussi satisfait qu’on pourrait le croire : j’aurais voulu en rapporter beaucoup plus. Malheureusement je n’ai pas traversé souvent des centres intellectuels comparables à Djenné, Tombouctou, Kano, Sokoto, Kouka, etc., et à part la population de Kong, j’ai voyagé presque toujours chez des gens qui étaient peu ou point lettrés. Je n’ai rencontré[353] que deux fois, dans ce long voyage, des hommes assez instruits et ayant des vues assez larges pour pouvoir leur avouer que mon voyage avait aussi un but géographique.
J’ai bien des fois envié Barth, qui, lui, a eu la bonne fortune de voyager souvent chez des peuples aussi civilisés et aussi instruits que ceux de Kong, ce qui lui a procuré la douce satisfaction de rapporter beaucoup de renseignements sur l’histoire des régions qu’il a visitées.
On m’a demandé pourquoi j’ai noté les noms de ruines. Outre l’intérêt historique que peuvent offrir ces noms, il y a l’intérêt géographique. Ils aident à retrouver des itinéraires et à les contrôler. Quand un indigène vous a donné un itinéraire, vous le reportez sur votre carte et vous vous apercevez qu’il recoupe un de vos itinéraires levés à la boussole ; mais où le recoupe-t-il ? Puisqu’il ne vous a pas cité de nom de village, c’est que le recoupement a peut-être lieu dans une ruine que l’indigène a oublié de vous citer. Dans ce cas on est bien heureux de la lui citer pour s’assurer qu’on ne se trompe pas.
On ne saurait croire combien la connaissance des langues est utile dans ces pays pour l’étude de la géographie ; je dirai même que pour faire de bonne besogne il faut connaître les étymologies de tous les termes géographiques.
Voici les principales :
Cours d’eau : en mandé ba, ko ; en haoussa goulbi.
Sur la rive : en mandé badara ; en haoussa baki n’goulbi.
Pays, contrée : en mandé dougou ; en mossi tenga.
Capitales : en mandé massasou, massa-dougou, fama-dougou ; en mossi natenga, na-iri ; en haoussa serki-gari.
Lieux habités de moindre importance : en mandé sou, bougou ; en mossi tenga, iri ; en gondja kadé ; en achanti et agni krou, kourou, kroum ; en agni, endroit, lieu, so ; en haoussa gari, guidda.
La brousse, la campagne : en mandé kongo, birînga ; en haoussa n’dazi.
La végétation dense : en mandé tou.
Camp, campement : en mandé biringa, dakha ; en haoussa sansanné.
La terminaison coro, kolo, khoto veut dire en mandé : vieux et à côté.
Les villages et lieux de culture : en mandé konkosou ; en siène-ré togoda ; en mossi tanga, tenkaï et wouiri ; en foulbé ouéré ; en agni sisim.
Bifurcation : en mandé farako, faraka ; en haoussa marraraba.
Montagnes et mouvements de terrain : kongo, konkili, kourou, béré en mandé.
La permutation des consonnes joue également un grand rôle dans les diverses langues des pays dont j’ai fait la description ; il est bien utile d’en connaître les principales afin de permettre l’identification de certains noms.
| Ex. : | D = L = R |
| B = G | |
| P = K | |
| P = F = H | |
| T mouillé = K | |
| M redoublé = B | |
| S = CH | |
| V = B | |
| D mouillé = G | |
| L = N | |
| D mouillé = Z |
[354]APPENDICE II
Renseignements sur l’organisation de la mission. — Énumération des achats faits avant le départ. — Dépenses de la mission.
Si je publie ces notes, c’est autant pour édifier ceux qui seraient tentés de croire qu’il faut des sommes fabuleuses pour exécuter un voyage ayant donné des résultats, que pour détromper ceux qui croient que l’on peut faire œuvre utile sans ressources.
Il faut éviter de tomber dans l’une ou l’autre exagération. L’histoire des explorations nous offre pour cela d’utiles renseignements. Sans rappeler le budget de toutes les expéditions ni entreprendre l’examen détaillé de l’emploi des fonds, on peut hardiment avancer, sans être contredit, que les missions qui ont dépensé et coûté le plus d’argent ne sont pas celles qui ont donné les meilleurs résultats.
L’utilisation des ressources et le parti que l’on en tire dépendent essentiellement de l’homme qui entreprend l’exploration.
S’il est bien préparé au voyage, s’il a étudié tous ses devanciers, l’explorateur qui se dispose à partir aura sûrement su calculer ce qu’il dépensera approximativement, et il s’arrêtera à un chiffre de dépenses que l’on peut évaluer presque mathématiquement.
La première question à se poser est la suivante :
Dois-je partir avec ou sans escorte ?
La réponse est bien facile à trouver :
Si l’on ne peut entreprendre le voyage que protégé, il faut se protéger suffisamment, il faut, ou bien imposer sa volonté par la force, ou bien subir dans une certaine mesure celle des peuples que l’on visite, quitte à la modifier par une diplomatie habile, par un grand esprit de persuasion, et surtout par beaucoup de circonspection.
Dans le premier cas, il faut partir avec des forces imposantes, il faut pour une mission comme celle que je viens de terminer 300 hommes bien armés avec des munitions ; ou alors, si la mission est à plus grande envergure, il faut faire comme Stanley. Ce sont des missions qui se chiffrent alors par une dépense de plusieurs centaines de mille francs, voire même un ou deux millions. Elles ont presque toujours pour résultat de fermer le pays à la civilisation au lieu de l’ouvrir.
Il n’y a pas de milieu ; 20, 30, 50, 100 hommes d’escorte ne sont pas suffisants : si les indigènes ne veulent pas vous laisser passer, cette force sera impuissante pour lutter.
La portée des armes, le perfectionnement des munitions, la valeur des soldats, ne peuvent entrer en ligne de compte dans ces pays. Si les indigènes le veulent, ils empêcheront toujours de passer, ils feront tomber la mission dans un guet-apens, attaqueront au moment où l’on passe un cours d’eau, un marais ; s’ils ne possèdent pas le courage nécessaire pour attaquer, ils évacueront le pays et feront le vide devant vous. Les vivres faisant défaut, il faudra bien renoncer à avancer.
Ce n’est donc pas un mode d’exploration à préconiser. Mieux vaut marcher seul avec le[355] personnel nécessaire au transport des marchandises d’échange et n’emporter que deux ou trois fusils, juste ce qu’il faut pour faire voir aux indigènes que tout en marchant pacifiquement il faut pouvoir résister à quelques voleurs à l’occasion.
C’est le système pour lequel j’ai opté.
On me dit bien souvent : « C’est vous qui avez inauguré ce système pacifique de voyager ». A la vérité, ce n’est pas absolument exact. J’ai un peu étudié tous les voyageurs : en rejetant le système de Mungo-Park et celui de Flatters, je n’ai pas voulu tomber dans celui de Lenz et de Caillié, dont les résultats politiques ont été nuls, et me suis arrêté à un terme moyen se rapprochant de celui auquel le docteur Barth a été ramené par la perturbation que la mort de ses compagnons de route a jetée dans l’organisation primitive de sa mission.
Pour voyager ainsi que je l’ai fait, il faut s’imposer l’obligation de vivre sur le pays et savoir parler une ou plusieurs langues indigènes. Pour un voyage de deux ans environ, avec un excellent choix de marchandises d’échange, il faut compter sur un poids d’une tonne à transporter. Les moyens de transport sont subordonnés à la nature des pays à traverser :
Au désert : les chameaux.
Au Soudan : les ânes ou les bœufs porteurs.
Dans les pays boisés : les porteurs.
On en arrive aux nombres suivants :
| Ou | 5 | chameaux | ( | 5 | conducteurs et | 2 domestiques). |
| Ou | 10 | bœufs | ( | 10 | conducteurs et | 2 domestiques). |
| Ou | 20 | ânes | ( | 10 | conducteurs et | 2 domestiques). |
| Ou | 40 | porteurs | ( | 40 | hommes plus | 2 domestiques). |
Ce sont des types de convois d’une mobilité suffisante, faciles à protéger, avec lesquels on peut passer partout sans éveiller la cupidité des peuples que l’on visite et sans leur inspirer de crainte. La nourriture et les ressources sont également faciles à se procurer.
L’emploi d’un de ces quatre types de convoi est toujours à préconiser.
Voici les proportions des achats que j’ai effectués comme objets d’échange :
| Corail de différents types | 1000 | fr. | |
| Armes d’échange ou de cadeaux avec lesquelles j’ai acheté mes animaux, 20 ânes, 1 cheval | 5000 | ||
| Étoffes à bon marché, calicot, guinée, étoffes imprimées[64] | 700 | ||
| Foulards en soie et soie et coton | 100 | ||
| Perles, colliers, verroterie | 800 | ||
| Aiguilles, hameçons | 200 | ||
| Objets en solde, étoffes, galons, boutons, blouses, papier, etc. | 1000 | ||
| Étoffes riches, algériennes, soieries | 1000 | ||
| Effets arabes, burnous, chéchias, haïks, gandouras, etc. | 500 | ||
| Tapis de selle arabe, velours et or, pour cadeaux | 300 | ||
| Pacotille assortie, quincaillerie, articles de Paris | 2000 | ||
| Total | 12600 | fr. | |
| [356]Pharmacie | 300 | ||
| Campement | 250 | ||
| Transport des marchandises par chemin de fer et bateau, douane | 400 | ||
| Livres, vocabulaires, cartes, papeterie | 230 | ||
| Semences[65] | 20 | ||
| Armes : 2 fusils de guerre, 1 de chasse, 1 revolver et munitions | 500 | ||
| Batterie de cuisine, ustensiles divers | 150 | ||
| Instruments | 500 | ||
| Total | 2350 | fr. | |
| Total | 14950 | fr. | |
| Quelques boîtes de viande (endaubage) | 250 | ||
| Total | 15200 | fr. | |
| Personnel pendant 28 mois | 8000 | ||
| Total général | 23200 | fr. | |
A cette somme de 23000 francs il convient néanmoins d’ajouter mon passage à bord du paquebot, aller et retour, et ma solde (solde des officiers de mon grade employés dans le Soudan français) pendant toute la durée de mon absence de France.
En cours de route, j’ai dû me procurer, avec des marchandises, deux bœufs porteurs, un cheval et onze ânes de remplacement. Mes serviteurs, à deux exceptions près, ont été achetés par moi au début de la campagne à l’aide d’étoffes et d’armes, et libérés. J’ai, en plus, affranchi en route quatorze esclaves sur les fonds de la mission.
Quand on songe, d’autre part, que j’ai dû faire des cadeaux importants à six souverains (cadeaux variant de 200 à 500 francs en France) et faire journellement des cadeaux aux chefs de village, à mes hôtes, aux guides, aux gens qui m’ont rendu des services, fourni des renseignements, à la famille des chefs, aux personnes qui, dans maintes circonstances, ont préparé les aliments à mes hommes, et qu’en outre il a fallu assurer notre subsistance pendant vingt-huit mois, payer quelquefois de lourds droits de passage aux riverains, on se rendra certainement compte que si avec si peu de marchandises on peut subvenir à tant de dépenses, c’est que leur valeur augmente considérablement au fur et à mesure que l’on avance à l’intérieur. A Kong, les 10000 francs de marchandises qui me restaient valaient plus de 40000 francs.
C’est ce qui explique comment avec la modique somme de 23000 francs j’ai pu me tirer d’affaire, payer largement les services rendus par les indigènes et laisser derrière moi le souvenir d’un homme généreux — appartenant à une nation qui ne compte pas, et où, comme le disent les indigènes, tout le monde est riche !
[357]APPENDICE III
Bulletin météorologique. — Tableau comparatif des pluies entre le bassin du Niger et celui de la Volta. — Saisons. — Observations sur le climat.
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
| 1887, | avril. | Bassin du Sénégal. | — Quelques tornades sèches. |
| — | mai. | — | — 6 pluies dans la deuxième quinzaine. — Température maxima à l’ombre, 42 degrés Réaumur. |
| — | juin. | — | — 14 pluies. — 39 degrés. |
| — | juillet. | Bassin du Niger. | — 22 jours de pluie sur 31 jours. Durée d’une demi-heure à quatre heures. Trois pluies torrentielles. Presque pas de tonnerre, peu de vent, quelques éclairs seulement. |
Températures observées à l’ombre d’un bombax :
| 7 heures du matin. | 2 heures après-midi. | 6 heures soir. | |
|---|---|---|---|
| Maximum | 27° | 38° | 29° |
| Minimum | 24° | 34° | 27° |
La nuit, à l’intérieur des cases, jusqu’à dix heures, 28 degrés ; vers quatre heures du matin, 19 degrés.
| 1887, | août. | Bassin du Niger. | — Sur 31 jours, 23 jours de pluie d’une durée variable, dont une dizaine torrentielles. — Même température qu’en juillet. |
| — | septembre. | Id. | — Sur 30 jours, il a plu 16 jours, une forte pluie tous les quatre jours environ ; les autres pluies étaient des orages d’une demi-heure ou d’une heure seulement. — Même température qu’en août. |
| — | octobre. | Id. | — 6 fortes pluies ; 6 pluies de courte durée ; 4 tornades sèches. — Température très supportable, comme les mois précédents. Rosées abondantes la nuit. |
| — | novembre. | Id. | — Une seule pluie, le 2. — Température élevée à la fin du mois. Maximum à l’ombre, 42 degrés. |
| — | décembre. | Id. | — Pas de pluie. — Très bonne température ; maximum à l’ombre, 30 degrés. — Commencement des nuits froides. Vers quatre heures du matin, à l’intérieur des cases, la température s’abaisse à 13 degrés. |
| [358]1888, | janvier. | Bassins du Niger et du Comoë. | — Pas de pluie. — Bonne et saine température le matin jusqu’à sept heures. Dans la journée, température maximum à l’ombre : 34 degrés. La nuit le thermomètre à l’intérieur des cases, vers quatre heures du matin, descend à 12 degrés. Une seule fois j’ai observé 8 degrés ; c’est la température la plus basse que j’aie constatée. |
| — | février. | Bassin du Comoë. | — Du 20 au 29, 4 fortes pluies. Plus de thermomètres. — La température est très élevée, au moins 42 degrés à l’ombre. Dans la première partie de la nuit il est impossible de dormir à l’intérieur des habitations, elles sont trop surchauffées pendant la journée ; ce sont de véritables étuves. |
| — | mars. | Id. | — 7 pluies de durées variables. — Température très élevée, vers la fin du mois surtout. On voyage avec difficulté dans la journée, heureusement que le pays est assez élevé (700 à 800 mètres d’altitude) et qu’il fait un peu d’air. |
| — | avril. | Id. | — 10 pluies. — Température presque insupportable de neuf heures du matin jusqu’à deux heures et demie. On bénéficie d’un peu de vent. |
| — | mai. | Bassin de la Volta. | — 6 pluies et 4 fois quelques gouttes d’eau seulement. La température devient plus supportable ; la verdure commence et empêche beaucoup la réverbération. |
| — | juin. | Id. | — 12 pluies dont 2 insignifiantes. — Température très supportable. Abaissement de 12 degrés après chaque orage. |
| — | juillet. | Id. | — 15 pluies dont 7 insignifiantes. Température supportable. |
| — | août. | Id. | — 14 pluies dont 7 insignifiantes et 3 fois quelques gouttes d’eau seulement. — Les fortes pluies ont lieu au changement de lune. |
| — | septembre. | Id. | — 20 pluies. 4 fois il a plu toute la journée ou toute la nuit ; 10 fois de une heure à trois heures, et 6 fois c’étaient des orages insignifiants. |
| — | octobre. | Id. | — 22 pluies dont 4 insignifiantes. — Température très supportable. |
| — | novembre. | Id. | — 1 seule pluie, le 16. Quelques tornades sèches. |
| — | décembre. | Bassin du Comoë. | — Température supportable. Pas de pluie. |
| 1889, | janvier. | Id. | — 3 fortes pluies. Température supportable. |
| — | février. | Id. | — Pas de pluie. — Température supportable. |
| — | jusqu’au 20 mars. | Id. | — 5 pluies. — Température supportable. |
TABLEAU COMPARATIF DES PLUIES
| Sénégal et Niger. | Volta. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | » | » | |||
| Février | » | » | |||
| Mars | » | » | |||
| Avril | » | » | |||
| Mai | 6 | 6 | |||
| [359]Juin | 14 | 12 | dont | 2 | insignifiantes. |
| Juillet | 22 | 15 | — | 7 | — |
| Août | 23 | 14 | — | 10 | — |
| Septembre | 16 | 20 | — | 6 | — |
| Octobre | 12 | 22 | — | 4 | — |
| Novembre | 1 | 1 | » | ||
| Décembre | » | » | » | ||
| Totaux | 94 | 90 | dont | 29 | insignifiantes. |
De ce tableau comparatif il résulte que dans le bassin du Sénégal et du Niger il tombe environ 90 pluies pendant l’hivernage, avec une durée variant entre une heure et trois heures, et que dans le bassin de la Volta il tombe un nombre égal de pluies, mais dont le tiers est à classer parmi les orages insignifiants.
Dans le bassin du Niger l’hivernage réel comprend les mois de juillet, d’août et de septembre, tandis que dans celui de la Volta il ne comprend que septembre et octobre : il est donc en retard de deux mois sur le bassin du Niger.
Au point de vue des saisons, elles se répartissent comme il suit dans les deux bassins :
| NIGER. | VOLTA. |
|---|---|
| Grosses chaleurs. — Avril, mai. | Grosses chaleurs. — Avril, mai. |
| Semailles. — Juin (pluies rares, mais assez régulières). | Semailles. — Juin, juillet, août (pluies irrégulières, mais très rares). |
| Hivernage. — Juillet, août, septembre. | Hivernage. — Septembre, octobre. |
| Récolte. — Octobre et novembre. | Récolte. — Novembre, décembre. |
| Saison fraîche. — Décembre et janvier. | Saison fraîche. — Janvier, février. |
| Époque où l’on brûle les herbes. — Février, mars. | Époque des incendies. — Mars. |
L’hivernage et les saisons en général paraissent bien mieux établis dans le bassin du Niger que dans celui de la Volta. Dans ce dernier bassin, l’hésitation est longue, l’hivernage n’arrive pas franchement ; les habitants s’y préparent pendant trois mois, appelant de tous leurs vœux les pluies qui ne viennent pas. Dans tout le Dafina, le Gourounsi et le Mossi j’ai partout reçu des députations qui venaient me demander d’user de toute mon influence auprès du Tout-Puissant pour leur faire avoir des pluies abondantes.
Pour le passage des rivières les observations peuvent avoir une grande utilité. Je n’ai pas séjourné assez longtemps sur les bords d’un cours d’eau pour observer méthodiquement sa crue. Mais on peut cependant déduire ceci : c’est que dans les premiers jours d’août, le 4 ou le 5, la Volta orientale était encore guéable, et que vers cette époque le Niger atteignait déjà sa plus grande hauteur, comme nous l’apprend Mage :
| 1er | juin (crue du Niger devant Ségou) | 0m,22 |
| 4 | août | 3m,78 |
| 15 | août, la crue atteint | 4m,52 |
| 7 | septembre, maximum de la crue | 5m,43 |
| 26 | septembre | 5m,15 |
La baisse se continue progressivement jusqu’en décembre.
Quant au régime des pluies du bassin du Comoë, il est tout différent de celui de la Volta et du Niger.
[360]L’hivernage commence deux mois avant la saison des pluies des bassins précités. Les pluies commencent en mars à la côte, puis elles remontent lentement vers l’intérieur.
En mars j’ai constaté dix pluies ; en avril elles sont déjà plus fréquentes, ce qui fait qu’entre le 5e et le 7e parallèle on peut considérer les mois de juillet et d’août comme les mois d’hivernage de la région.
A ce propos, il serait très curieux de tracer sur une carte les courants qui amènent les pluies dans tout le Soudan occidental ; les tracés ainsi obtenus donneraient, à coup sûr, une idée d’ensemble qui ne manquerait pas de jeter un jour plus complet sur les courants atmosphériques et la marche des tornades. On ne serait certes pas en mesure d’en déduire des données absolument mathématiques, le relief du sol et les cours d’eau jouant un grand rôle dans cette question, mais on obtiendrait des données qui, à l’aide d’observations ultérieures plus précises, deviendraient intéressantes à consulter.
J’ai adopté pour la division de l’année six saisons au lieu de quatre, c’est la même classification dont se servent les indigènes. Je suis arrivé à l’employer parce qu’elle me permettait de préciser, à défaut de noms de mois qui manquent chez certains peuples, l’époque de mon passage dans telle ou telle région.
Du reste cette classification en six saisons comporte des températures bien différentes, qui méritent d’être examinées chacune isolément ; c’est ce que nous allons faire :
Saison des fortes chaleurs. — Elle correspond aux mois d’avril et de mai. Les températures sont très élevées : de neuf heures à trois heures de l’après-midi, il y a généralement 40 à 42 degrés Réaumur à l’ombre et à l’air libre. Au soleil la chaleur est très intense ; il est extrêmement pénible de voyager pour l’Européen, et même pour les animaux porteurs, qui cherchent à s’arrêter chaque fois qu’ils rencontrent de l’ombre.
Avec un thermomètre il n’est pas possible de se rendre exactement compte de la chaleur que l’on supporte. Elle doit atteindre 60 degrés dans les lieux où la chaleur zénithale se cumule avec la réverbération du sol dépourvu d’herbes et quelquefois de la réverbération de murs d’enceinte de maisons ou même de parois verticales des grès de certains soulèvements.
Le soir les parois des habitations en pierres et en terre sont très surchauffées ; on est tenu de coucher dehors et de ne rentrer que dans la nuit, après que les murs sont refroidis.
Saison des semailles (juin). — La verdure commence à tapisser le sol. On prépare les cultures pour les semailles, qui se font après les premières pluies. Il fait encore bien chaud, l’air est lourd, saturé d’électricité, on a tout l’ennui de l’approche de l’orage, sans avoir le bénéfice qui résulte de l’abaissement de la température après chaque pluie.
Hivernage. — Excellente saison pour l’Européen ; c’est presque une chaleur de pays tempérés. La pluie donne des abaissements brusques de température de 10 à 15 degrés desquels il faut se méfier en se couvrant. Si le mauvais état des chemins et la grosseur des cours d’eau n’étaient des obstacles sérieux pour les voyages, il faudrait toujours profiter de cette saison pour aller visiter un pays. La végétation est splendide, il y a de la verdure partout, l’œil se repose, et le voyageur peut réellement juger de la richesse d’un pays.
Récolte (octobre et novembre, et, pour quelques produits, décembre). — La verdure subsiste encore, c’est l’époque des fortes rosées. La chaleur est très supportable ; vers la mi-novembre, cependant, il y a quelquefois des journées excessivement chaudes.
Les eaux commencent à se retirer et les marigots et flaques d’eau sont asséchés. L’air est dans ces endroits chargé de miasmes qui engendrent le paludisme. Il est bon pour s’en préserver de ne jamais se mettre en route à jeun et de faire usage des kolas.
Saison fraîche (décembre et janvier). — Très bonne saison pour les Européens. Les nuits sont très fraîches, il n’est pas rare d’avoir 16 degrés de chaleur seulement dans la nuit. Dans la journée la chaleur est supportable. Les convalescences sont extrêmement rapides en cette saison.
[361]Époque où l’on brûle les herbes (février et mars). — Les hautes herbes séchées sont allumées, le Soudan entier est en feu. Vers cette époque il tombe aussi quelques pluies, qu’on appelle le petit hivernage. L’eau tombée et les cendres des herbes servant d’engrais donnent un regain à la végétation : on aperçoit des jeunes pousses aux arbres, et le manteau noir dont est recouvert le sol se trouve pendant quelques jours émaillé de verdure. C’est la meilleure saison pour les voyages : les rivières deviennent guéables ; mais on ne peut pas se rendre compte de la valeur et de la beauté du pays que l’on traverse : juger le Soudan en février et mars, serait juger la France en décembre et janvier.
Le climat des régions que j’ai visitées n’est pas aussi insalubre qu’on le proclame en France.
Quelques pessimistes viennent, dès qu’on parle de colonisation, vous opposer l’inclémence du climat. Tout cela est bien exagéré.
Nous n’avons pas la prétention de faire croire que le climat est aussi salubre que celui de la France, mais ce que nous affirmons bien hautement, c’est que l’Européen peut vivre partout à la condition de s’entourer d’un certain confort. Sur la côte même, les agents français de nos factoreries résistent bien et supportent gaillardement des séjours prolongés à la condition de pouvoir venir se retremper tous les deux ans pendant quelques mois en France. Il ne nous serait pas difficile de citer des Français qui y ont séjourné pendant de nombreuses années, qui sont très valides et dont l’intelligence est loin d’être atrophiée, comme on nous le raconte trop souvent. Il est des peuples, pour ne citer que les Anglais, les Hollandais, les Portugais, qui vont plus volontiers dans les colonies que nous, et ces races ne périclitent pas, loin de là.
Trop souvent on nous renvoie à des statistiques, en disant qu’à l’époque de l’occupation de la côte par des troupes françaises la mortalité était d’un pour cent trop élevé pour songer à s’y établir.
Il y a une différence considérable dans l’état de santé des hommes qui vont dans ces régions dans un but déterminé, pour y faire du commerce ou se livrer à des études intellectuelles, et un malheureux troupier qui y vient sans objectif. De quoi peut-il s’occuper, à part les heures d’exercice, de service ? L’oisiveté dans laquelle vit le soldat engendre chez lui la mélancolie ou le prédispose à noyer son chagrin dans des libations funestes à la santé. C’est pourquoi il ne faut voir de statistique vraie que dans celles qui comprennent des sujets occupés par un travail quelconque qui chasse l’ennui.
Nous avons toujours constaté qu’au Sénégal et dans nos postes du Soudan français, les officiers les mieux portants sont ceux qui s’occupent le plus, en usant modérement de la chasse, du cheval, et se livrent à un travail intellectuel quelconque, de façon à trouver à employer leur temps. On peut très bien se conserver une bonne santé, à part quelques malaises passagers qui n’ont aucune gravité.
Pendant le cours de mon exploration j’ai été deux fois très gravement malade, mais comment en serait-il autrement ?
Mon voyage s’est effectué dans des conditions excessivement pénibles : on ne reste pas impunément deux ans sans vin ni pain, ni rien de ce que nous mangeons en France.
Il faut aussi traverser des marais et des rivières à la nage, on est exposé à toutes les intempéries sans pouvoir changer de linge. J’aurais fait mon voyage dans de semblables conditions en France, j’aurais certes eu autant de jours de malaise et de maladie.
Mais quand on a une installation confortable, on peut très bien conserver une bonne santé.
« Un excellent moral et la volonté de vivre sont les meilleurs facteurs pour se bien porter. »
[362]APPENDICE IV
Flore et faune.
Il est impossible de donner des renseignements utiles sur la flore et la faune d’un pays sans tomber dans une fastidieuse énumération des divers produits. — Il faut cependant dire ce que l’on a vu, et il est indispensable de signaler les ressources qu’offre l’immense pays que j’ai visité.
En céréales nous avons observé :
Deux variétés de mil hâtif dit souna (Penicillaria spicata), ou mil chandelle.
Deux variétés de mil tardif dit sanio.
Quinze variétés de sorgho, qui peuvent se répartir au point de vue botanique en deux espèces, le Sorghum vulgare et le Sorghum saccharatum. Ces variétés remarquées ne sont peut-être qu’une seule forme infiniment variée par la culture et la sélection depuis les temps les plus reculés.
Six variétés de maïs.
Le maïs a été certainement importé d’Égypte. Dans presque tous les dialectes, langues et idiomes du Soudan occidental, cette graminée porte un nom rappelant la Mecque ou l’Égypte.
Exemple : Kaba (pierre sainte de Médine), Maka, maka nion (mil de la Mecque), daou n’Massara (mil d’Égypte), etc.
Sa culture doit être récente au Soudan et date peut-être seulement d’un siècle. Ce qui est notoire, c’est qu’à la fin du XVIe siècle on ne signalait pas le maïs en Égypte, et que Forskal, à la fin du XVIIIe siècle, mentionnait le maïs comme encore peu cultivé en Égypte, où il n’avait pas reçu un nom distinct des sorghos. De Candolle a prouvé que le maïs est originaire du Nouveau Monde. Nous pensons donc que pour le Soudan central il a dû venir par l’Égypte, apporté par les pèlerins revenant de la Mecque, et aussi par la côte occidentale d’Afrique, apporté par les négriers et les commerçants européens.
Quatre variétés de riz. Strabon, qui avait vu l’Égypte comme la Syrie, ne dit pas que le riz fût cultivé de son temps en Égypte, mais il ajoute que les Garamantes le cultivaient.
Il existe encore au Soudan une autre graminée dont le nom scientifique est Panicum filiforme (Paspalum ægyptiacum). En mandé on la nomme fini ou fonio. C’est une graminée plus petite que le plantain. La tige qui porte l’épi est très fine et a une légère odeur de foin. Elle est employée et préparée d’une façon différente des mils et des sorghos. Afin d’enlever la pulpe du grain, on le fait griller, puis le grain est vanné ; il est ensuite cuit à l’étouffée. C’est une excellente semoule.
Nous en connaissons trois variétés, qui ne diffèrent entre elles que par la grosseur de la graine et leur teinte plus ou moins foncée.
[363]L’arachide ou pistache de terre est représentée par trois variétés.
Sloane, dans Jamaïca, page 184 (cf. de Candolle, Organes des plantes utiles), dit que les négriers chargeaient leurs vaisseaux d’arachides pour nourrir les esclaves pendant la traversée, ce qui indique une culture alors très répandue en Afrique. D’autre part, des graines d’arachide ont été trouvées dans les tombeaux péruviens d’Aucon, d’après Rochebrune, ce qui fait présumer quelque ancienneté d’existence en Amérique. De Candolle n’est pas éloigné de croire à un transport du Brésil en Guinée par les premiers négriers, et c’est aussi notre avis. Nulle part dans nos voyages nous n’avons trouvé l’arachide à l’état spontané. Au Brésil on en compte une dizaine de variétés, et au Soudan nous n’en avons observé que trois : arachides de Casamance, du Cayor, et rouge.
Nous avons aussi trouvé six variétés de haricots arachides, c’est-à-dire de haricots qui croissent de la même façon que l’arachide. C’est le voandzou de Madagascar (le nom latin est Voandzeia subterranea). Il est très estimé dans le Gourounsi ; on le cultive aussi au Congo.
Les haricots sont représentés par une dizaine de variétés ; ils sont constitués par une série de plantes très différentes des nôtres (doliques, cajans, etc.). C’est une réelle ressource pour l’Européen. On les mange secs et verts ; les indigènes utilisent aussi les feuilles pour les sauces de to.
L’oignon n’est représenté que par deux variétés, qui semblent dégénérées.
L’igname est représentée par une douzaine de variétés. Elle croît également à l’état spontané. Je l’ai trouvée fréquemment et dans des lieux où le doute sur la spontanéité n’est pas permis.
Une variété de cresson pousse à l’état spontané sur les berges de certaines rivières et principalement sur les bords du Sénégal (à la Laoussa entre autres).
Le pourpier pousse partout à l’état spontané.
La chicorée et l’épinard sont représentés par des plantes offrant de l’analogie avec nos plantes d’Europe, mais elles ne sont pas semblables.
L’oseille est représentée par trois espèces de malvacées acides qui jouent le rôle d’oseille.
L’Hibiscus cannabinus est acidulé dans toutes ses parties.
L’Hibiscus sabdariffa a des fleurs rosées ou plutôt des calices employés comme oseille. Il y a une autre malvacée sans fleurs qui est beaucoup employée.
Enfin les Asparagus ne sont pas rares en Afrique, mais ce n’est pas notre asperge ordinaire ; elles sont parfois mangeables, mais souvent amères.
Deux variétés de tubercules, le Tacca involucrata et le Dioscorea bulbifera, se trouvent à l’état spontané.
Les fourrages sont représentés par une variété infinie de graminées et plusieurs variétés de bambous.
L’Indigofera tinctoria et l’Indigofera argentea s’y rencontrent à l’état spontané.
Le henné est cultivé et spontané (Lawsonia inermis).
Nous connaissons aussi trois variétés de textile, sorte de chanvre sauvage employé par les indigènes, connu sous le nom de dadian, dafou, etc.
La canne à sucre (importée des Antilles).
Plusieurs variétés de poivre à l’état spontané.
On y rencontre à l’état sauvage le caféier ; mais l’oranger, le mangotier, le citronnier et le jujubier semblent importés des Antilles.
Une vigne à tiges annuelles et à souches vivaces, cette fameuse vigne à propos de laquelle Lécart a fait tant de bruit il y a peu d’années.
Plusieurs variétés de concombres, melons, pastèques.
Et enfin au moins une trentaine d’espèces de tabac, dont quelques-unes sont excellentes.
Le tabac semble être originaire du Soudan ; il porte dans les pays mandé le nom de taba.[364] Nous avons trouvé dans l’Histoire de la dynastie saadienne du Maroc par El-Oufrani, traduction de O. Houdas, professeur à l’École des langues orientales, le passage, suivant que nous donnons intégralement :
« En l’année 1001 (8 octobre 1592-27 septembre 1593) on amena à Elmansour un éléphant du Soudan. Le jour où cet animal entra dans le Maroc fut un véritable événement : toute la population de la ville, hommes, femmes, enfants et vieillards, sortit de ses demeures pour contempler ce spectacle.
« Au mois de ramadhan 1007 (28 mars-17 avril 1599) l’éléphant fut conduit à Fez. Certains auteurs prétendent que c’est à la suite de l’arrivée de cet animal que l’usage de la funeste plante dite tabacco s’introduisit dans le Maghreb, les nègres qui conduisaient l’éléphant ayant apporté du tabac qu’ils fumaient, et prétendant que l’usage qu’ils en faisaient présentait de très grands avantages. La coutume de fumer, qu’ils importèrent, se généralisa d’abord dans le Drâa, puis à Maroc, et enfin dans tout le Maghreb.
« Les docteurs de la loi émirent, à l’époque, des avis contradictoires au sujet du tabac : les uns déclarèrent son usage illicite, d’autres licite, et d’autres enfin s’abstinrent de se prononcer sur la question. Dieu sait ce qu’il faut penser à cet égard ! »
M. Houdas a encore eu l’amabilité de nous donner la note ci-jointe, qui confirmerait bien que le tabac est, sinon originaire du Soudan, au moins qu’il y est connu depuis les temps reculés.
« A Koubacça, le tabac sert aussi de monnaie. Par une singulière homophonie avec le nom européen, les habitants du Dârfour l’appellent, dans leur langage, taba. Bien plus, ce nom de taba est commun dans tout le Soudan. Au Fezzan et à Tripoli de Barbarie, on l’appelle tabgha.
« J’ai lu une cassidah, ou pièce de vers, composée par un Bakride ou descendant de la famille du khalife Abou Bakr, afin de prouver que fumer n’est pas pécher. Ces vers, je crois, datent d’environ le milieu du IXe siècle de l’hégire. En voici quelques-uns :
« Dieu tout-puissant a fait sortir du sol de notre pays une plante dont le vrai nom est tabqha.
« Si quelqu’un, dans son ignorance, te soutient que cette plante est défendue, dis-lui : « Comment prouves-tu ce que tu avances ? Par quel verset du Coran ? »
« Le taba de Kouça, employé comme monnaie, est en forme d’entonnoir. On cueille les feuilles encore vertes, on les pile dans un mortier de bois jusqu’à les réduire en une masse pâteuse ; on en façonne alors des entonnoirs ou cônes vides que l’on fait sécher et qu’ensuite on met en circulation au marché. Ce taba a une odeur tellement forte, qu’en le flairant on éprouve parfois une sorte de vertige. Les cônes de tabac diffèrent de volume ; les grands sont comme de grosses poires, et les autres comme de petites poires. »
( Voyage au Dârfour, par le cheikh Mohammed ebn Omar el-Tounsy, traduit de l’arabe par le Dr Perron. Paris, MDCCCXLV. Pages 318 et 319.)
| Le ficus, plusieurs variétés. | ||
| Le bananier (plusieurs variétés), importé des Antilles (?). | ||
| Les dattiers, importés de l’Afrique septentrionale. | ||
| Le cotonnier, importé d’Égypte. | ||
| Le ricin (plusieurs variétés), | ⎱ ⎰ |
à l’état spontané. |
| La pourguère (plusieurs variétés), | ||
| Le cocotier (importé des Antilles). | ||
| La patate (plusieurs variétés), | ⎱ ⎰ |
importés d’Amérique. |
| Le manioc (plusieurs variétés), | ||
| Le diabéré se voit aussi dans certains villages à l’état isolé ; c’est une aroïdée, le Colocasia esculenta, ou taro, de la Nouvelle-Calédonie. | ||
| [365]La pomme cannelle, | ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ |
importés des Antilles et de l’Amérique par les négriers. |
| Le corrosol, | ||
| Le pommier d’acajou, | ||
| Le goyavier, | ||
| L’avocatier, | ||
| Le papayer, | ||
| Le gombo, | ⎫ ⎬ ⎭ |
viennent à l’état spontané. |
| Le piment arbrisseau, | ||
| L’ananas (plusieurs variétés), | ||
| La tomate doit leur venir d’Amérique. Les petites tomates (tomates cerises) constituent une espèce bien distincte de la grosse tomate que nous cultivons en Europe. | ||
| Enfin, on trouve plusieurs variétés de champignons comestibles. | ||
A toute cette nomenclature il convient d’ajouter les ressources qu’offrent l’arbre à beurre, le baobab, le néré (Parkia biglobosa), le bombax, le finsan, les palmiers, etc., l’arbre à kola, les lianes à caoutchouc, arbres desquels nous avons déjà entretenu le lecteur, ainsi qu’une cinquantaine de variétés de bois de construction et d’arbres à écorce de fibres qu’on peut utiliser comme textiles.
Après avoir lu une nomenclature de produits aussi riche que celle que nous donnons ci-dessus, il ne faut pas en conclure que dans tous les pays que j’ai parcourus on puisse se procurer aisément ces produits. Hélas ! non. L’état social des noirs, le peu de sécurité dans l’avenir et le manque de débouchés entretiennent l’inertie complète chez ces peuples.
Certains d’entre eux ne cultivent que deux ou même une seule variété de céréales. D’autres, ruinés par les guerres, ne s’occupent plus que des cultures hâtives, dont elles mangent les récoltes au fur et à mesure de leur maturité, se contentant d’employer comme condiments quelques feuilles d’arbre, des graines de cucurbitacées sauvages, des chenilles, etc. C’est ce qui explique comment j’ai dû me nourrir pendant plusieurs mois de la même variété de mil, accommodée tous les jours de la même façon.
Dans les pays où règne la tranquillité, les indigènes, en cultivant toujours les mêmes lieux, ont épuisé leurs terres, qui, jadis si fertiles, ne produisent plus aujourd’hui que des produits dégénérés dont les indigènes abandonnent peu à peu la culture. Malgré les remarques que font les indigènes pour les terrains bordant le village et engraissés par les détritus du village, ils ne s’occupent pas du fumage des champs pour augmenter leurs récoltes. Cette remarque ne s’applique cependant pas à tous les peuples noirs que j’ai visités : les Soninké, les Mandé, les Peul fument leurs terres en y parquant des troupeaux.
L’indigène ne jouit pas des produits de sa basse-cour ; quantité d’œufs se perdent ; on ne s’y entend pas pour faire couver ; c’est à peine si, de temps à autre, le chef de famille peut mettre une poule dans son fricot.
Pourtant les animaux de basse-cour pullulent.
J’ai remarqué 4 ou 5 variétés de poules,
2 variétés de canards,
Des pigeons domestiques,
Et 10 variétés de pintades domestiques.
Les animaux de boucherie ne font pas défaut non plus ; nous avons eu occasion de parler plus haut des diverses races bovine, ovine, caprine, chevaline et asine ; on y élève plusieurs variétés de chiens qui pour eux sont comestibles.
Le gibier ne leur fait pas non plus défaut.
Je n’entrerai pas dans la riche nomenclature d’animaux de toute espèce qui peuvent fournir des ressources en vivres.
[366]Je me bornerai à dire que le gibier d’eau abonde et est représenté par une vingtaine de sortes de canards sauvages, oies, poules d’eau, râles, etc.
Les échassiers sont représentés à l’infini.
Les outardes, pintades, perdrix grises et poules de rochers se trouvent un peu partout, ainsi que les oiseaux à plumage brillant, les perruches et les perroquets.
Parmi le gibier à poil, nous citerons le lièvre, les belettes, fouines, sortes de furets, les porcs-épics, hérissons, la loutre, le sanglier et le phacochère. Toutes les variétés de gazelles et d’antilopes (au moins 20 espèces).
Les girafes et les bœufs sauvages (7 ou 8 variétés).
2 espèces d’éléphants.
L’hippopotame, le lamantin, le caïman et 8 ou 10 espèces de poissons, les tortues, les lézards et les iguanes.
Enfin, quand nous aurons cité les fauves, hyènes, chats-tigres, onces, panthères, lions et une belle collection de serpents, nous aurons fait connaître tout ce que nous avons vu pendant le cours de notre exploration.
Ces animaux ne font courir aucun danger. Il n’y a que les imaginations exaltées qui peuvent narrer des scènes comme celles qu’on lit trop souvent. J’affirme ici que, dans le cours de mon voyage, et depuis huit ans que je suis constamment au Soudan, je n’ai jamais entendu parler d’un indigène dévoré ou blessé par un fauve ; que chaque fois que j’en ai vu, ils ont pris la fuite, de sorte qu’il est très rare de pouvoir en tuer un.
Quant aux serpents, qui inspirent une terreur si irréfléchie à beaucoup de personnes, ils ne sont pas plus à craindre, surtout pour l’Européen, qui marche toujours chaussé. Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui soit mort d’une morsure de serpent. Les gros serpents, boas, etc., ne quittent pas les fourrés impénétrables ; il est difficile d’en voir. J’en ai vu en tout quatre ou cinq, et encore n’avons-nous pas réussi à les tirer. Quand on songe que tous les indigènes circulent à peu près nus dans les hautes herbes et dans les fourrés les plus impénétrables et qu’il n’arrive pas d’accidents, ou presque jamais, on peut conclure avec moi que les fauves, les serpents et les animaux nuisibles sont bien moins dangereux qu’on ne le proclame un peu partout.
APPENDICE V
Liste des rois sonr’ay de la première dynastie. — Liste de la deuxième dynastie. — Notes sur l’histoire générale de la dynastie sonr’ay-mandé. — Famille mandé. — Famille sonni-nké. — Famille mandé-bammana. — Famille soso ou sousou — Famille mandé-mali. — Famille mandé-dioula.
PREMIÈRE DYNASTIE
Les historiens arabes nous apprennent les noms de presque tous les rois dits du Sonr’ay. On en trouve la liste complète dans Rolfs (Beiträge zur Geschichte, etc.), dans la Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Band IV, 1855. Je la donne ci-dessous :
[367]
| 1. | Le premier roi sonr’ay (سغى) ? était Za al-Yamin (vers 771 ? ; d’après moi, en chiffres ronds, 800). | |||
| 2. | A lui succéda | زكى Za Zakajâ ou Za Zaki. | ||
| 3. | — | اتَكىْ ou تكى Za Atakaï ou Taki. | ||
| 4. | — | اكَىَ Za Akaya. | ||
| 5. | — | اكِرُ (اكو) Za Akirou (Kérou ?) | ||
| 6. | — | على بُى (على بنى) Za Ali Boy ou Boya, ou encore Ali Bana (Bani). | ||
| 7. | — | بِيَرُ (بيرو كومَىْ) Za Biyarou ou Barou Koumaya ? (Barou ?) | ||
| 8. | — | بِى (ابى) Za Abi ou Aba. | ||
| 9. | — | اكُىِ Za Akouyi. | ||
| 10. | — | يُم كَروَىَ Za Youma Karaouaya. | ||
| 11. | — | يُم دُنكُ Za Youma Dounkou. | ||
| 12. | — | يُمَ كيبعَ (كبيع) Za Youma Kiba’a ou Kibakha ou Kabaya. | ||
| 13. | — | كوكِرىَ Za Koukirya. | ||
| 14. | — | كِنْكِر Za Kinkira. | ||
| Aucun de ces rois ne croyait en Dieu et à ses prophètes. | ||||
| Le premier qui embrassa l’islamisme fut : | ||||
| 15. | Za-Kasi كَسى 400 de l’hégire (1009 à 1010), il régna jusqu’en 1020. | |||
| 16. | A lui succéda | كُسُرْ دارى Za Kousour Dari, peut-être Diara (1020 à 1038). | ||
| 17. | — | اهِرْ كَرُنْك دُمْ Za Ahir Karounkou Doum (1038 à 1062). | ||
| 18. | — | بيىْ كى كَيْمَ Za Bayouky Kayma (1062 à 1078). | ||
| 19. | — | يُمَ داعُ (نتاسنى) Za Youma Da’ou (Natanansi) (1078 à 1100). | ||
| 20. | — | بَيىَ كَيْرِ كِنْبَ Za Baya Kayri Kinba (1100 à 1119). | ||
| 21. | — | كُيى شيبيب (كين شنبيب) Za Kouyi Chibiba, ou Kayan Chanbib (1119 à 1140). | ||
| 22. | — | اتيبا (تب) Za Atiba ou Taba (1140 à 1158). | ||
| 23. | — | تنبا سِنَى Za Tanba (Tenéba) Sinay (1158 à 1176). | ||
| 24. | — | يُمَ داعُ Za Youma Da’ou (1176 à 1200). | ||
| 25. | — | فدازو (فدزر) Za Fadazou ou Fadazara (1200 à 1218) ; ce règne correspond à celui de Baramindana. | ||
| [368]26. | — | على كِرُ Za Ali Kirou (1218 à 1235), correspondant au règne de Mari Diara. | ||
| 27. | — | بير فَلك Za Birou, ou Bayarou Falaka, correspondant au règne de Mansa Wali. | ||
| 28. | — | باسبيى ? Za Basabia, ou Basabi (Yasabi), correspondant aux règnes de Mansa Wali, Mansa Kalifa et de Mansa Abou Bakr. | ||
| 29. | — | درر ? Za Darar, Za Dazara ? | ⎫ ⎪ ⎬ ⎪ ⎭ |
Serki Diara, Gao, Mohammed, Abou Bakr, Mansa Mouça, noms des rois mandé correspondants. |
| 30. | — | زنك بار Za Zanaki, Barou. | ||
| 31. | — | بسا فار Za Basa Farou ou Fara ou Basi-Fara. | ||
| 32. | — | فد Za Fada, Za Fa-Dé. | ||
DEUXIÈME DYNASTIE
Les Sonni. — 1331 (date mentionnée sous le règne de Mansa Magha, par Ahmed Baba).
| 33. | Sonni Ali Kilnou. |
| 34. | Sonni Silman Nar. |
| 35. | Sonni Ibrahim Kiba ou Kibya. |
| 36. | Sonni Ousman Kanou ou Kanwa. |
| 37. | Sonni Basakin Aukabaya ou Bara Kina Abaky. |
| 38. | Sonni Mouça. |
| 39. | Sonni Boukar Zanka ou Zanaka ou Zoniké. |
| 40. | Sonni Boukar Dal Binba. |
| 41. | Sonni Barou Kouya. |
| 42. | Sonni Mohammed Da’ou. |
| 43. | Sonni Mohammed Koukia. |
| 44. | Sonni Mohammed Barou. |
| 45. | Sonni Mari Koul Khoum ou Mari fi Koul Khoum. |
| 46. | Sonni Mari Râkar. |
| 47. | Sonni Mari Aranadan. |
| 48. | Sonni Souleyman Da’ou. |
| 49. | Sonni Ali. |
| 50. | Sonni Bara ou Barou, appelé aussi Abou Bakr Da’ou. |
| 51. | Askia Thouré : El-Hadj Mohammed (1500 ?). |
La première dynastie est celle des Za, titre dont nous donnons l’origine à propos de l’histoire des Sonni-nké.
Cette dynastie se divise en deux moitiés, dont la première, la plus ancienne, ne comprenait que des rois païens (infidèles). Ils sont au nombre de 14. Za al-Yamin, le premier dont le nom soit connu, devait, d’après nos calculs, régner vers l’an 800 de l’ère chrétienne. Le quatorzième, Za Kinkira, a dû mourir vers l’an 1000.
L’énumération des noms des rois de cette première moitié de la dynastie des Za nous rappelle peu de noms propres mandé ; on ne peut y relever que ceux du cinquième souverain, nommé Akirou, nom qui rappelle le diamou mandé-dioula Kérou, et celui du septième souverain, dans lequel on trouve le nom Birou, qui rappelle le mandé-dioula Barou.
Mais nous ne tenons pas pour une preuve suffisante ce rapprochement de noms pour en[369] déduire que réellement les cinquième et septième souverains de cette dynastie étaient d’origine mandé.
Il n’en est pas de même pour la deuxième moitié de la dynastie des Za. Elle comprend 18 rois, tous musulmans. Le premier d’entre eux qui embrassa l’islamisme (le quinzième de la dynastie des Za) se nommait Za Kasi.
El-Békri rapporte que la date de sa conversion remonte à l’an 1009-1010.
Si, en dehors de la conversion de Za Kasi, les historiens arabes ne rapportent aucun événement sur le règne des 18 rois musulmans Za, nous apprenons par la liste de leurs noms que neuf d’entre eux, c’est-à-dire la moitié, portaient des noms ou surnoms mandé. C’est là un point très important pour l’histoire de ces peuples. Il prouve tout simplement que pendant cette deuxième moitié de dynastie les Mandé sont au pouvoir dans le Sonr’ay. Ainsi le 16e roi de la dynastie des Za est un Diara ; le 19e et le 24e, deux Da’ou ; le 26e, un Kérou ; le 27e, un Birou.
Le 29e est écrit دزر. En haoussa c’est l’expression Diara. Le di ou d mouillé se change toujours en z. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à croire que le 29e roi était un Diara. Le 30e était un Barou. Le 31e porte un surnom mandé, Basi-Fara. Le 32e est nommé Fa-Dé, le père Dé.
Nous avons dit plus haut que l’histoire ne nous apprend que la date de la conversion de Za Kasi (1009-10), nous devons ajouter qu’El-Békri annonce qu’en l’an 1153 (548 de l’hégire), la domination des Mandingo ou Wangara s’étendait jusqu’à Tirka ou Tirekka (environs de Bourroum), même Kougha dépendait des Wangara, dit-il, seule Gogo était libre et indépendante. Il est curieux d’observer que précisément l’année 1153 correspond avec l’apparition des noms mandé dans la chronologie des rois sonr’ay de la dynastie des Za musulmans, et probablement au règne du roi Za Youma Da’ou II (à ce roi ne succèdent que des souverains portant des noms mandé).
Doit-on en déduire que ce n’est qu’en 1153 que les Mandé ont fait leur apparition dans le nord de la boucle de Niger ? Nous ne le pensons pas. Les Mandé devaient être là depuis beaucoup plus longtemps. Leur aile gauche, comme nous l’avons constaté, occupait déjà vers les IVe et Ve siècles de l’hégire le Ghanata, il n’y a pas de raison pour ne pas les trouver sur le même parallèle plus à l’est vers le Sonr’ay. Mais là comme ailleurs ils n’arrivent au pouvoir qu’après la domination et l’affaiblissement des Senhadjô (des Berbères). L’avènement des premiers rois mandé au trône sonr’ay ne dut avoir lieu que vers la fin du XIe siècle, mais ils ne devinrent réellement puissants au détriment des Sonr’ay que dans le courant du XIIIe siècle ; ce n’est du reste que vers cette époque que les historiens arabes en font mention avec méthode et suite. On peut donc en inférer que les empires sonr’ay et mandé se sont longtemps confondus.
El-Békri nous apprend que les Mandé étaient déjà puissants dans l’est en 1153, mais il omet de nous donner le nom de leurs souverains. Le premier souverain qu’il cite est Baramindana ou Sérbendana ; il le mentionne parce qu’il est le premier qui ait embrassé l’islamisme ; sa conversion date de l’année 1213.
Au commencement du XIIIe siècle la situation est donc la suivante :
A l’ouest : le pouvoir appartient aux Sousou ou Soso, fraction des Mandé, de 1203 à 1235.
Au centre : Baramindana, premier roi musulman du Mali, règne de 1213 à 1235.
A l’est : un empire ou royaume dit Sonr’ay, gouverné par des rois pour la plupart mandé.
De 1235 à 1260. — Mari Diara Ier, roi de Mali, successeur de Baramindana, absorbe le royaume de Ghanata et subjugue les Sousou.
A dater de cette époque il n’existe plus que deux pouvoirs : le Mali et le Sonr’ay.
Mari Diara Ier eut pour successeur son fils, Mansa Wali Ier, qui fit le pèlerinage de la Mecque, sous le règne du sultan Bibars ; il régna de 1260 à 1276.
[370]1276-77. — Mansa Wali II, frère du précédent, règne très peu de temps.
1277 à 1311. — Mansa Khalifa, successeur de Mansa Wali II, est pauvre d’esprit et tué par son peuple.
Puis vient Mansa Abou Bakr, neveu, fils de la sœur de Khalifa.
Le trône est occupé ensuite par un usurpateur nommé Sakoura ou Sabkara, qui entreprend un pèlerinage à la Mecque au temps d’El-Malik é Nassir.
A lui succèdent Serki[66] Diara, Gao, Mohammed, Abou Bakr, Mansa Mouça.
1311. — Avènement de Mansa Mouça, dit Konkour Moussa.
1311-1331. — Mansa Mouça Ier (Konkour Mouça) arrive au trône ; il devient le plus grand roi de Melle. Il réunit sous son sceptre toute la puissance militaire et politique de ce royaume, qui, selon Ahmed Baba, constitua une force sans mesure ni limites. Tout en étendant sa domination sur tous les peuples noirs environnants, il se ménagea d’amicales relations avec Abou’l-Hassan du Maghreb (Maroc). Mansa Mouça plaça sous sa domination :
1o Le Baghena, y compris le Tagant et l’Adrar ;
2o Sagha et le Tekrour occidental, capitale Silla ;
3o Tombouctou ;
4o Et enfin le Sonr’ay avec sa capitale, Gogo. Ahmed Baba le dit formellement : Konkour Mouça est le premier roi de Mali, suzerain du Sonr’ay.
Djenné, grâce à sa position dans une île, semble ne pas avoir été annexé.
1326. — Mansa Mouça entreprend un pèlerinage à la Mecque. Tous les auteurs anciens parlent d’une façon détaillée de l’escorte du roi pèlerin, des richesses qu’il emportait et de l’armée qui l’accompagnait.
D’après Ahmed Baba, traduction de Rolfs, « il emmena 60000 guerriers (?). Partout où passait le sultan, il se faisait précéder de 500 esclaves dont chacun portait une canne en or pesant 500 mitkal d’or » (6 kil. 500 d’or). Ces données sont évidemment exagérées, elles offrent cependant un certain caractère de vérité, puisque plusieurs peuples que j’ai visités ont conservé la coutume des porte-canne. Ardjouma, chef du Bondoukou, se fait précéder d’un sabre à pomme d’or pesant environ 1 à 2 kilogrammes.
D’après Ahmed Baba, le poids total de ces cannes aurait représenté une valeur intrinsèque de 100 millions ! Ce n’est guère possible.
« En allant à la Mecque, il prit le chemin de Walata et traversa le Touat. Dans ce dernier pays, ajoute l’historien, il dut abandonner beaucoup de son monde. Atteint d’une maladie dans les jambes, qu’ils nomment dans leur langue touat (?). » C’est probablement la filaire de Médine.
L’historien ajoute même que c’est parce que les gens de Mansa Mouça se fixèrent dans ce lieu qu’il a conservé le nom de Touat.
Barth ajoute que cette circonstance est bien connue des habitants du Touat, dont une grande partie se dit d’origine sonr’ay.
Les Orientaux du Caire et de la Mecque, dit Ahmed Baba, furent éblouis par sa puissance et sa munificence. Le peuple sonr’ay lui fit sa soumission dès qu’il entreprit son pèlerinage.
A son retour de la Mecque, il passa par le Sonr’ay.
Ebn Batouta nous apprend que Mansa Mouça ou Konkour Mouça campa dans le jardin de Sirakh ed-Din ben el-Kouwaïk, notable commerçant d’Alexandrie, établi dans un lieu nommé Birket-el-Khabas, dans la banlieue du Caire.
C’est pendant son voyage d’aller et probablement avant de se diriger sur Oualata que Mansa Mouça soumit Tombouctou et plaça la ville sous sa suzeraineté.
[371]Il y fit construire un palais, actuellement détruit, que l’on nommait Mâ dougou et élever un minaret de la grande mosquée.
1331-35 (732-36). — Mansa Magha Ier succède à son père Mansa Mouça.
C’est sous son règne que Sonni Ali Kilnou et Silman Nar, deux jeunes Sonr’ay, otages du roi de Mali, s’enfuirent de la cour de Mali, retournèrent dans leur pays et s’emparèrent du pouvoir sonr’ay.
Sous le règne de Mansa Magha, le Mali perdit de sa grandeur et de son prestige. La mort au bout de quatre ans de règne vint délivrer le pays de ce triste régent.
1335-1359. — Mansa Sliman ou Suleyman, frère de Mansa Mouça ou Konkour Mouça, et oncle de Mansa Magha Ier, arrive au pouvoir et rétablit la puissance du Mali un moment ébranlée.
1351. — D’après Makrizi, un roi de Mali entreprend à cette date un pèlerinage à la Mecque. Le nom de ce monarque ne nous est pas parvenu. Nous avons tout lieu de croire qu’il s’agit de Mansa Sliman.
Sous le règne de Mansa Sliman, le sultanat de Mali s’étendit bien loin, et sa domination se fit sentir jusque vers Tombouctou.
L’étendue de son royaume força Mansa Sliman de procéder à une répartition de son territoire en trois grandes provinces, dont Ahmed Baba nous donne la nomenclature et les noms des gouvernements.
Ces trois provinces étaient :
1o Le Kala, le Kalari actuel, avec Ségou ;
2o Le Bandouk, le Bendougou ;
3o Le Sabardougou (?).
Dans chacun de ces trois pays il y avait douze sultans.
En ce qui concerne le Kalari, huit sultans régnaient en même temps sur cette presqu’île.
Le premier d’entre eux régnait tout contre le Djenné.
Il se nommait Ouarraba Koy (Ouarraba est le synonyme de Diara).
| Les sept autres étaient : | 1o | وتر كى Ouattara Koy. |
| 2o | Le Koma Koy كُمَى كى. Koma veut dire : grue couronnée ; cet oiseau est fétiche pour tous les Mali-nké. | |
| 3o | فَدْكَ كى appelé aussi فَركَ كى Fadka Koy ou Farka Koy. | |
| 4o | كُرْكَ كى Kourka Koy. | |
| 5o | كَو كى Kawa Koy ou Kaba (nom de famille sonni-nké). | |
| 6o | فَرَما كى Farama Koy. | |
| 7o | زر كى Zara Koy. |
Les quatre autres sultans régnaient au nord du fleuve.
Le premier d’entre eux régnait contre le domaine de Zago, vers l’ouest ; il s’appelait كوكِرِ كى Koukiri (peut-être Kou Kérou Koy).
| 2o | يارَ كى Yara Koy, peut-être سر كى Sara Koy, ou bien بار كى Barou. |
| 3o | سَامَ كى Sama Koy. |
| 4o | وفال فرن Wafala Faran. |
Ce Wafala Faran était celui qui avait le pas sur les autres dans les audiences ou les visites de corps chez le sultan de Mali.
[372]Tous les sultans du Bendougou régnaient au sud du fleuve.
Le premier d’entre eux régnait à côté de Djenné ; il se nommait كو كى Kawa Koy.
| 2o | كَعَر كى Ka’ar Koy peut-être Kamara كمَرَ ? |
| 3o | سَمر كى Samar Koy. |
| 4o | داعُ كى Da’ou Koy |
| 5o | تَعب كى Taba Koy. |
1359-60. — Mansa Ebn Sliman, fils de Mansa, qui ne règne que neuf mois.
1360-73. — Mansa Diara, fils de Mansa Magha Ier, prend le pouvoir ; il envoie une ambassade à Abou el-Hassan, sultan du Maroc.
1373-87. — Mansa Mouça II, fils de Mansa Diara, laisse, par sa faiblesse, usurper le pouvoir par son vizir Mari Diara.
1387-88. — Mansa Magha II, frère du précédent, lui succède au trône et est assassiné après un an de règne.
1388-90. — Un autre usurpateur détient le pouvoir.
1390-1400. — Mohammadou ou Mansa Magha III, un descendant de Mari Diara Ier, règne 10 ans.
1400. — A dater de cette époque, Ahmed Baba ne mentionne plus la chronologie des rois du Mali.
En lisant attentivement la chronologie, on s’aperçoit immédiatement qu’en dehors de Konkour Mouça et de Mansa Souleyman, le Mali n’a guère possédé de rois brillants. Le dernier acte important à enregistrer date du règne de Mansa Diara, qui envoya une ambassade à Abou el-Hassan, sultan du Maroc.
Avec la mort de Mansa Diara (1373) commence pour le Mali l’ère de la décadence ; le sultanat se maintient cependant jusqu’au commencement du XVe siècle. Puis, sous le règne de Sonni-Ali, fils de Sonni Mohammed Daou, en 1465, le Mali fut complètement bouleversé. Enfin, à l’avènement d’Askia Mohammed (1492), la décadence était complète. Celui-ci et ses successeurs firent si souvent la guerre au royaume de Mali qu’il succomba.
Il faut donc reporter la désagrégation du sultanat de Melle ou Mali vers l’année 1540, c’est-à-dire à cinq ans après la mort d’Askia.
1540 environ. — « Alors, dit Ahmed Baba, le sultanat de Melle se disloqua en trois royaumes ayant chacun son propre sultan, puis les deux gouverneurs militaires[67] institués par Konkour Moussa se soulevèrent à leur tour et se taillèrent chacun un royaume. » De sorte que Melle divisé a donné lieu à cinq nouveaux groupements, qui seraient, selon nos recherches :
1o Les Bambara, avec les Samokho et les Sama-nké ;
2o Les Mali-nké ;
3o Les Sousou ;
4o Les Sonni-nké ;
5o Les Dioula.
Un essai sur l’histoire mandé proprement dite n’est donc pas chose aisée. Les matériaux à notre disposition sont excessivement rares. Les chroniques arabes, pleines d’omissions, sont confuses. Les historiens musulmans ont apporté trop de négligence dans leurs[373] relations pour permettre d’écrire une histoire fidèle et de retracer avec soin les vicissitudes traversées par les nombreux États nègres habités actuellement par les Mandé.
Jusqu’aujourd’hui on a désigné ce peuple sous le nom de Mandi-nké, Mandénga, Mandingue, Mali-nké, et leur royaume très souvent sous le nom de Mali, Melli et Malal.
La racine du mot est mandé[68].
Mandi-nké, Mandinga, veulent dire « hommes du Mandé », et Mandingue n’est qu’une altération de ces deux premiers noms. Chaque fois que j’ai demandé avec intention à un Mandé : « Es-tu Peul, Mossi, Dafina ? » Il me répondait invariablement : « Je suis Mandé ».
C’est pourquoi, dans le cours de ma relation, j’ai toujours désigné ce peuple par le nom de Mandé, qui est son vrai nom.
D’après les informations que j’ai recueillies, Ndé était le nom sous lequel on désignait le pays d’origine mandé. Jadis, ont-ils ajouté, le berceau de la race mandé était divisé en deux : la partie arrosée par le Niger moyen et ses gros affluents était désignée sous le nom de Ma-ndé parce que les peuples qui l’habitaient adoraient pendant la période païenne le lamantin (Manatus, désigné encore aujourd’hui sous le nom de ma). Le restant du pays, la partie sud, éloignée des grands cours d’eau, portait seulement le nom de Ndé.
El-Edrizi et El-Békri rapportent d’autre part, en parlant de l’origine de la première dynastie des rois du Sonr’ay, que « pendant la période païenne Dieu apparaissait aux populations du Niger sous la forme d’un serpent ; il leur donnait des ordres et ils l’adoraient.
« Un étranger le tua devant la population, et par ce fait il devint leur roi. En montant sur le trône il prit pour cette raison le titre de za, et ses successeurs firent toujours précéder leur nom de celui de za. » (Za, sa, en mandé, veut dire « serpent »).
On pourrait supposer que cet incident ne se rapporte qu’aux peuples sonr’ay : nous ne le pensons pas, car nous trouvons, précisément dans la chronologie très complète de la première dynastie des rois sonr’ay que les historiens arabes nous ont conservée, que Za Kasi, le héros de cette légende et premier roi sonr’ay, a eu de nombreux successeurs mandé, parmi lesquels nous citerons :
Da’ou II, Za Fa Dazou, Za Ali Kirou, Za Zank barou, Za Basa-Fara, et enfin Za Fa-Dé, dernier roi de la première dynastie des rois sonr’ay, mort vers l’an 1350 de l’ère chrétienne.
Da-ou, Kirou, Barou, sont des noms de famille mandé qui se sont conservés jusqu’à nos jours ; ils constituent encore aujourd’hui presque un titre de noblesse ; les plus belles familles portent actuellement ce nom. Enfin Za Fa Dé veut dire Za père des Dé.
Dans le Mossi on désigne les Mandé et en général les étrangers par le mot dé. Exemple : Ia dé r’a, « ceux-ci mandé sont ».
Nous retrouvons également le mot ndé en wolof pour désigner le sud ; ils disent : Dioula ndé, ce qui veut dire : « Pays des Dioula, endroit des Dioula. »
Dans l’étude qui va suivre nous nous sommes basé sur tous les éléments qui pouvaient nous éclairer : ce sont des résultats d’interrogatoires laborieux, de longues recherches dans le pays même, et, comme canevas, les relations fournies par les historiens arabes.
Raconter fidèlement l’histoire de ce peuple est donc très difficile ; sa langue n’est pas écrite, et les traditions ne remontent pas assez loin pour permettre d’en tirer des conclusions bien nettes ; du reste, chacune des branches de la race mandé a sa propre histoire.
Ce peuple est mélangé à l’infini. La superposition des races, le mariage et la promiscuité dans laquelle il vit avec ses esclaves, sont autant de causes qui font que l’anthropologie n’a pu étendre avec fruit ses recherches sur les peuples qui nous intéressent.
[374]Le tatouage et les incisions m’ont souvent guidé pour formuler une opinion, malheureusement les enfants d’esclaves se font tatouer comme leur maître. Certains peuples vaincus ont adopté le tatouage et les incisions du vainqueur. Dans d’autres circonstances c’est le contraire qui s’est produit, ce sont alors les immigrants qui ont pris le tatouage des peuples chez lesquels ils sont venus s’établir, afin de leur inspirer la confiance et de s’assimiler plus promptement à eux.
C’est ainsi que les Mandé de Kong ont adopté le tatouage des Komono et Dokhosié, les Mandé du Mossi quelquefois le tatouage mossi, les Dagomba un tatouage mixte se rapprochant du mandé et du haoussa, enfin les Foulbé du Ouassoulou, du Ganadougou, de Fourou, de Ouahabou, celui du peuple chez lequel ils vivent, etc. Là encore il est difficile de trancher sans hésiter la question d’origine.
La linguistique semble aussi offrir de grandes ressources, mais bien des fois on se trouve en présence de peuples qui, quoique manifestement d’une race différente des autochtones, ont perdu leur propre langue et adopté celle des indigènes avec lesquels ils se trouvent en relation. Conquis ou conquérants parlent souvent un même dialecte, bien que de races bien différentes. Exemple : les Foulbé du Ouassoulou, du Ganadougou, etc., qui parlent le mandé et ont oublié le poular ; les Zénaga, qui ont oublié le berbère pour parler l’arabe.
Si l’on se rejette sur la numération, on éprouve également souvent des déceptions : les cinq premiers nombres paraissent devoir donner une indication, puisqu’un peuple aussi sauvage et aussi barbare qu’il est doit toujours savoir compter au moins les cinq doigts de sa main. Malheureusement j’ai constaté dans beaucoup de régions que les peuples, au fur et à mesure que leurs relations commerciales se développent, et qu’ils s’élèvent d’un degré dans l’échelle sociale, abandonnent rapidement leur numération primitive, qui leur donnait peu de ressources, pour adopter celle des peuples avec lesquels ils se trouvent en relations commerciales, et leur permet de compter rapidement avec les marchands ou peuples voisins plus avancés.
Exemple : chez les Bobo-fing, où la langue n’a aucun lien de parenté avec le mandé, on compte :
1 pilé, 2 fa, 3 sa, 4 na, 5 ko ; — chez les Bobo-Niénigué : 1 pilé, 2 pala, 3 sa, 4 na, 5 ko ; — en mandé : 1 kilé, 2 foula, 3 saba, 4 nani, 5 loulou.
Les meilleurs résultats que l’on obtient dans ces régions pour l’ethnologie le sont par l’étude des noms de famille ou diamou ; mais là aussi on ne peut exclusivement s’y appuyer : beaucoup d’esclaves adoptent ceux de leur maître, et certains peuples qui n’ont pas de noms de tribu ou de famille, tels que les Komono et Dokhosié, n’hésitent pas en se civilisant à adopter ceux de leurs voisins plus policés qu’eux. Aussi ce n’est qu’avec une certaine réserve qu’il faut noter les analogies et les similitudes de noms de tribu ou de famille ; mais il ne faut pas pour cela rejeter ce mode d’informations, qui à mon avis est certainement le meilleur qui soit à notre portée.
En résumé, mes observations m’ont porté à ne me prononcer catégoriquement sur l’origine et la parenté de deux peuples que lorsque certaines coutumes originales, les armes et les habitations offrent de l’analogie entre elles, et lorsqu’il y a en plus similitude des tatouages et des noms de tribu.
Tout jugement ne s’appuyant que sur une seule ressemblance est téméraire ; il faut donc ne donner un avis qu’avec beaucoup de circonspection.
Ce qui a jeté beaucoup de confusion dans l’histoire de ces pays, c’est que des traducteurs d’ouvrages aussi importants que ceux d’Ebn Khaldoun, El-Edrisi, El-Békri, Ahmed Baba, etc., ont quelquefois négligé de citer à côté du texte français les noms propres en lettres arabes.
[375]Dépourvus assez fréquemment de points diacritiques, les noms peuvent être lus de plusieurs manières, ce qui ne manque pas de jeter la confusion. C’est un peu ce qui s’est produit pour Gago, Gogo, Koukou, Koukia, Kouka, etc., et pour beaucoup d’autres noms propres.
Il faut laisser au géographe et à l’explorateur la faculté de lire le nom en arabe et de l’interpréter. Sa connaissance du pays, des mœurs, sa familiarité avec les noms propres indigènes, le mettent à même d’affirmer avec plus d’exactitude et lui permettent d’en confirmer la lecture.
FAMILLE MANDÉ
La famille mandé se divise en de nombreuses branches, que nous allons énumérer avec leurs noms de famille.
Nous avons vu au début la famille ndé, divisée en Ndé et en Ma-ndé, ces derniers ayant pour tenné (idole ou fétiche) le lamantin, qui était à la fois leur bon et leur mauvais génie.
Aux Ndé se rattachent les Dioula ou Dioura et probablement les Sousou.
Chez les Mandé, auxquels se rattachent aussi les Sonni-nké, les tenné étaient et sont encore :
1o Le caïman ou bamba, bamma. Cette famille porte actuellement le nom générique de Bammana. Dans le Soudan français nous leur donnons le nom de Bambara, c’est une appellation impropre en mandé ; dans tous les pays que j’ai visités, le mot Bambara est synonyme de kafir, infidèle.
2o L’hippopotame ou mali. Cette famille porte le nom générique de Mali-nké. Elle comprend les Mali-nké proprement dits, les Kagoro, les Tagoua.
3o L’éléphant ou sama. Cette famille porte le titre générique de Sama-nké.
4o Le serpent ou sa. Cette famille porte le titre générique de Sa-mokho.
Cette division en tenné a donné lieu à plusieurs grandes familles, qui sont : les Bammana, les Sousou ou Soso, les Mali-nké, les Sama-nké et les Sa-mokho.
Ces grandes familles ont eu chacune leur propre histoire ; elles étaient groupées en tribus ayant chacune un ou plusieurs tenné et un diamou particulier (diamou, nom de tribu).
Certaines de ces tribus se sont même scindées et figurent à la fois dans deux ou plusieurs des cinq grandes familles, telles les Diara, Kouroubari, Sissé, etc. ; elles se désignent actuellement non seulement par leur diamou, mais elles y adjoignent quelquefois pour se différencier entre elles le nom de leur tenné particulier.
1o Famille des Bamba, dite Bammana (caïman).
| Familles royales. | ⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ |
Kouroubari | Massa-si, | ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ |
Tenné : les calebasses fêlées et souvent le chien. |
| Kouroubari | Kalari, | ||||
| Kouroubari | Daniba, | ||||
| Kouroubari | Mana, | ||||
| Kouroubari | Mou siré, | ||||
| Kouroubari | Sira, | ||||
| Kouroubari | Bakar, | ||||
| Diara | Kounté, | ⎫ ⎬ ⎭ |
Tenné : le lion, le chien, le lait de fauve. | ||
| Diara | Fissanka, | ||||
| Diara | Barlakao, | ||||
| Famille de forgerons. | ⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ |
[376]Konéré ou Koulankou, | ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ |
Tenné : le bandougou (condiment), le koban, singe vert, le chien. | |
| Sokho, | |||||
| Dambélé, | |||||
| Traouré, | |||||
| Niakané, | |||||
| Mériko, | |||||
A cette famille se rattachent deux autres, dont les membres sont :
a. Celle des Sama (éléphant), désignée par le nom de Sama-nké. Elle comprend des Touré, des Sissé, des Traouré, des Dambélé.
b. La famille des Sa (serpent), dite Sa-mokho. Elle comporte des Kouloubari et des Sokhodokho.
2o Famille des Mali (hippopotame), dite Mali-nké.
| Famille royale. | ⎧ ⎨ ⎩ |
Keïta, Koïta, | ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ |
Tenné : le rat palmiste des arbres, la panthère. |
| Bakhoyokho, | ||||
| Kamara, | ||||
| Autres Familles. | ⎧ ⎨ ⎩ |
Kourouma, | ||
| Konaté, | ||||
| Sissokho, | ||||
| Familles de griots. | ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ |
Kouyaté, | ⎫ ⎪ ⎬ ⎪ ⎭ |
Tenné : l’iguane. |
| Diabakhaté, | ||||
| Dombia, | ||||
| Dioubaté, |
2e subdivision des Mali-nké : les Kagoro, qui comprennent :
| Les Toungara, | ⎫ ⎪ ⎬ ⎪ ⎭ |
Tenné : le serpent boa, le campagnol (rat des champs), le serpent trigonocéphale. |
| Les Magaza, | ||
| Les Konaté, | ||
| Les Touré, |
3e subdivision des Mali-nké : les Tagouara, qui comprennent :
- Des Traouré,
- Des Diarabasou,
- Des Konné,
- Des Bamma.
Puis vient l’ancienne famille des Ndé, qui avait le lamantin pour divinité, et dans laquelle nous avons classé les Sonni-nké, les Dioula et les Sousou ou Soso.
Ces trois groupes n’ont dû se scinder que vers l’an 1350, au moment de la fin de la première dynastie sonr’ay, à l’avènement du roi sonr’ay Sonni Ali Kilnou.
Les uns ont voulu suivre la fortune du nouveau roi et ont pris le titre de Sonni-nké (hommes de Sonni).
D’autres, au contraire, comme les Sousou, n’ont pas voulu perdre leur autonomie et leur nationalité. Et enfin les descendants des Da’ou, Barou, Kérou (familles royales de la première dynastie sonr’ay) ont, pour se distinguer des partisans des Sonni et des Sousou, pris le titre de Diou-la, « couche, souche du trône ».
L’avènement de cette nouvelle dynastie, celle des Sonni, sur le trône sonr’ay-mandé, a donc donné naissance aux trois groupes suivants :
[377]3o La famille Sousou[69] ou Soso, dont je ne possède aucun diamou (nom de famille), ni aucun tenné.
4o Les Sonni-nké ou Saracollé, ou Séré-Khollé, ou Marka-nké, qui se subdivisent en :
- Bakiri,
- Sissé,
- Sillé,
- Diabi,
- Doukouré,
- Kaba,
- Sakho,
- Niakhaté,
- Diawara,
qui eux-mêmes se subdivisent en Diawara-Sagoné et Diawara-Dabo.
5o Enfin la famille Mandé-Dioula, dont nous parlons page 393.
Parmi ces diverses tribus, qui constituent le grand peuple Mandé, on rencontre par-ci par-là des groupes de familles qui ne portent d’autre titre que celui de Fofana.
Ils ne constituent pas, à proprement parler, une famille unique, ou un groupe comme les Bammana, les Mali-nké, les Sonni-nké, les Sousou, les Dioula. Ils vivent mélangés parmi les autres Mandé et forment une sorte de caste.
Aucun caractère extérieur ne les désigne particulièrement et ils sont musulmans ou fétichistes.
J’ai souvent interrogé sur leur origine, Diawé, qui est un Fofana ; il n’a pas pu me renseigner ; je dois donc me borner à dire ce que j’ai appris par moi-même.
Les Fofana observent le dimanche comme jour férié, et chez eux l’histoire d’Adam et d’Ève ne diffère en rien de la nôtre ; ils n’ont pas la pomme et le serpent, mais un autre arbre fruitier et le serpent, ce qui revient au même.
Chez eux, le vendredi est un jour néfaste.
Une autre particularité à signaler, c’est qu’ils sont par tout le Soudan réputés comme d’une honnêteté à toute épreuve et que personne ne s’aviserait de les faire captifs, sauf les Maures.
L’étymologie de Fofana m’échappe ; fo cependant veut dire parler, et fana ensemble. Ils n’ont pourtant pas de langue qui leur soit propre, et leur famille se divise, comme les autres familles mandé, en tenné, c’est-à-dire en divinités particulières, dont les pratiques sont plus ou moins respectées. Pour se différencier entre eux, ils ajoutent généralement à leur titre de Fofana celui de leur tenné.
Voici leurs subdivisions :
Les Fofana-Kagoro, qui ont comme tenné la panthère ;
Les Fofana du Nouroukrou, qui ont comme tenné l’éléphant ;
Les Fofana de Nyamina, du Bakhounou, du Ouorodougou, qui ont comme tenné le lion, la panthère et une variété de serpents ;
Et enfin les Fofana Souransa, qui ont le boa (maninian) comme tenné.
J’ai même observé des Fofana qui se disent Sonni-nké et d’autres qui se vantent d’être Toucouleur ou même Dioula.
Je n’ai parlé jusqu’à présent que des grandes divisions de la famille mandé, comme on le verra ci-dessous dans l’énumération des travaux philologiques. Il y a quantité d’autres peuples qui se rattachent à cet important groupe.
[378]Voici une liste à peu près complète des ouvrages linguistiques qui ont été publiés sur les langues et dialectes mandé, liste empruntée en partie à ma propre bibliothèque, en partie à l’énumération des travaux philologiques de M. René Basset, dans ses Mélanges d’histoire et de littérature orientales (Louvain, Lefever frère et sœur, 1888) :
1o Grammar and vocabular of the Susoo language. 1802, in-8.
2o A spelling book for the Susoo. Edimbourg, 1802, in-12.
3o First, second, third, fourth, fifth and sixth Catechism in Susoo and English. Edimbourg, 1801-1802, 4 vol. in-12.
Ces ouvrages ne sont pas signés. Steinthal croit devoir les attribuer à Brunton.
4o Allah hu Feï Susuck bé fe ra (Religious instructions for the Susoos). Edimbourg, 1801, in-12.
5o Journal of American-Oriental Society. T. I, p. 365, qui contient un vocabulaire de Wilson.
6o Outlines of a Grammar of the Susu language. Londres, 1882, in-12, par Duport.
7o Idiomes du Rio Nunez, par le Dr Corre. Paris, in-8.
8o Catéchisme français-soso, avec les prières ordinaires, par le R. P. Raimbault. Vicariat apostolique de Sierra-Leone, 1885.
9o Dictionnaire français-soso et soso-français. Mission du Rio Pongo, 1885, in-12.
10o The New Testament in Soso. London, in-8.
11o The first seven chapters of the Gospel according to Saint Matthew in the Susoo language, by the Rev. John Godfrey Wilhelm. London, 1816.
12o Grammar of the Mandingo language, with vocabularies, by the Rev. R. Maxwell Macbrair. London.
13o Du même auteur, Issa l’anjilo kila matti ye men safe Mandingo Kangoto. Macbrair. London.
14o African Lessons, Mandingo and English. London, 1827.
15o Guinea Portugueza (Boletin da Sociedade de Geographia de Lisboa. IIIe série, 1882, p. 726).
16o Vocabulaire et phrases mandingues de Caillié. T. III.
17o Vocabulaire mandingue de Mungo-Park.
18o Dictionnaire français-wolof et bambara, par Dard. Paris, 1825, in-8.
19o Essai sur la langue bambara, par L.-G. Binger. Paris, 1886, Maisonneuve et Leclerc, in-12. — Cf. aussi Bulletin de correspondance africaine, 5e année, fasc. I et II, p. 156-160.
20o Éléments de grammaire bambara. Saint-Joseph de Ngasobil, 1887. Ouvrage publié par les missionnaires du Sénégal.
21o Outlines of a grammar of the Vei language together with a Vei-English vocabulary, and an account of the discovery and nature of the Vei mode of syllabic writing, by S. W. Koelle. London, 1854.
22o Despatch communicating the discovery of a native written character at Bohmar, on the western coast of Africa, near Liberia, etc., by lieut. F. E. Forbes, R. N., with notes on the Vei language and alphabet, by E. Norris, esq. Londres, 1849.
23o Narrative of an expedition into the Vy, country of West Africa. London, 1849, in-8.
24o Fac-similé d’un manuscrit en langue veï et en caractères particuliers. London, 1851, in-8.
25o Polyglotta africana. Londres, 1851, où Koelle traite le kisi-kisi, le solima, le bambara et ses dialectes, le veï, le diallonké, le sambouyah, le mandé, le kono, le téné, le gbandi, le landoro, le gbese, le toma, le mâno et le jyio.
26o Outline of a Vocabulary of a few of the principal languages of Western and Central Africa compiled for the use of the Niger Expedition. London, 1841.
[379]27o The Negroland of the Arabs. Cooley, p. 67, note 18.
28o Grundriss der Sprachenwissenschaft, t. I, 2e partie. Vienne, 1877, in-8, p. 143. Fr. Müller.
29o Nubische Grammatik, de Lepsius, p. XXXVI et XXXVII.
30o Notes de linguistique africaine. Londres et Vienne, 1887, in-8. Grimal de Guiraudon.
31o Comparative vocabularies of some of the principal negro dialects of Africa. New-Haven, 1849.
32o Notes sur les trois langues sonni-nké, bambara et malinké (Revue de linguistique et de philosophie, 1887, p. 130). Dr Tautain.
33o Vocabulaire sonni-nké. Faidherbe (Annuaire du Sénégal, 1864).
34o Langues sénégalaises : wolof, arabe-hassania, sonninké et sérère. Faidherbe. E. Leroux, 1887, Paris.
35o Die Mandeneger-Sprachen, physiologisch und phonetisch betrachtet. Steinthal, Berlin, 1867.
Ce dernier est l’ouvrage le plus consciencieux que l’on puisse trouver. L’auteur a réussi à s’assimiler ces langues d’une façon remarquable, il en a fait une étude sérieuse qui sera encore consultée longtemps avec fruit.
Il m’a été d’un grand secours dans mes recherches sur la langue mandé ; je me propose du reste de le traduire en y ajoutant mes propres observations et en complétant les lacunes inévitables qui s’y sont introduites, Steinthal n’ayant fait son livre qu’à l’aide des documents assez confus à sa disposition à cette époque (1867).
A cette trop longue nomenclature il convient encore d’ajouter :
36o Vocabulaire diallonké. Mage, Voyage dans le Soudan occidental. Paris, 1868, in-8, Appendice.
37o Note sur la rivière Manéah, par Braouzec (Bulletin de la Société de géographie de Paris, mars 1867, p. 253).
38o Njia yekpei Kina marki nyegini (Evangile selon saint Marc). Londres, 1871, in-8.
Njiei yekpei na Johani nyegini (Evangile selon saint Luc). Londres, 1872, in-8.
To-bela ti we hindeisia (Actes des Apôtres). Londres, 1872, in-8.
Paulu to-moi ngi golo nyegingoi Romi bela-ye. London, 1872, in-8.
Ouvrages publiés par la Mission américaine ; en 1882 et 83 par M. Schoen.
39o Der verlorene Sohn in der Sprache von Shetun ku Sefe oder der Azarareye Sprache (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft), t. IX, 1855, p. 846 et 847.
Pendant mon voyage j’ai essayé de faire une classification de tous les mots mandé par peuple ; mais j’ai dû bien vite y renoncer ; pour mener à bien ce travail, il faudrait y travailler sans relâche pendant plusieurs années.
Pour qu’on en ait une idée, je vais donner succinctement l’énumération des divers idiomes mandé non étudiés qui offrent d’assez grandes différences pour être notés :
Dialecte des Kassonké ;
- — Malinké Sissokho du Nouroukrou et du Gangaran ;
- — Malinké Dabo du Bambouk et du Bondou ;
- — Malinké de Kita, Maréna, Dogofili et des Kagoro ;
- — Malinké du Fouladougou ;
- — Bammana du nord du Kaarta et du Bélédougou ;
- — Malinké du Birgo, du Manding, du Bouré ;
- — Bammana du Ségou ;
- [380]— Bammana du Bolé, Baninko, Diédougou ;
- — Malinké du Gouana, Gouandiakha, Baniakha, Lenguésoro et du Ouassoulou en général.
- — Malinké du Torong, du Kounian, du Ouorocoro ;
- — Malinké des Foulbé Soumantara du Ganadougou ;
- — Dialecte parlé dans le voisinage des Siène-ré ;
- — Idiomes des dioula de Kong, de Tengréla, du Kénédougou, et du Ouorodougou des Bobo-Dioula et des Dafing, etc.
Bien entendu, je ne parle ici que de ceux que je connais et j’omets avec intention ceux du Sankaran, du Kissi, du Toucoro, du Soulimana, du Kouranko, du Baléya, etc., que je n’ai pas visités, ainsi que le Bullom, le Nalou, etc., qui ont été plus ou moins étudiés.
Il est certain que lorsque la linguistique de tous les peuples des Rivières du Sud sera connue, beaucoup d’entre eux seront encore à rattacher à cette grande famille ethnographique.
Il est à regretter que les dialectes de ces divers peuples n’aient pas été l’objet d’études philologiques approfondies, ces études ne manqueraient certes pas de jeter un nouveau jour sur un peuple aussi intéressant que le peuple mandé.
FAMILLE SONNI-NKÉ
Pendant toute la période où chacun des groupes Bammana, Mali-nké et Dioula était intimement lié à un autre, faisant partie d’un même empire avec les Sonni-nké et les Sousou, il est facile de les suivre dans leur histoire.
Il n’en est pas de même dès que ces groupes s’affranchissent les uns des autres, en rêvant chacun de reconstituer à leur propre profit un nouvel empire sur les bases de celui qui vient de s’écrouler.
C’est une tâche bien aride. Nous allons néanmoins essayer de démêler l’histoire de chaque groupe, en nous aidant des légendes que nous avons recueillies. Nous n’avons pas la prétention de donner des renseignements absolument exacts et à l’abri de la critique, mais nous pensons qu’en construisant un canevas grossier avec tout ce que nous avons pu apprendre, nos successeurs pourront utilement le remplir et me sauront gré d’avoir commencé une œuvre qu’ils seront certainement heureux de compléter.
LES SONNI-NKÉ
De Saint-Louis au Macina et de Walata et Tombouctou au cap des Palmes, on trouve des Sonni-nké. Tantôt, comme vers Bakel, dans le haut Sénégal, ils constituent l’élément principal de la population dans des pays entiers, tantôt ils forment des villages épars au milieu des populations de nationalités différentes.
A l’exception de quelques pays où ils vivent en maîtres, les Sonni-nké subissent partout la suprématie des divers conquérants, préférant toujours aux luttes à main armée la tranquillité de leur commerce, qu’on leur fait payer souvent bien cher. Ils sont aussi de remarquables agriculteurs.
C’est ainsi que s’exprime le docteur Quintin, dans le Bulletin de la Société de Géographie de Paris de septembre 1881 ; aussi je lui emprunte bien volontiers cette succincte esquisse. Mais là où je ne suis plus d’accord avec lui, c’est quand il dit que les Sonni-nké sont des Sonr’ay.
Les Sonr’ay sont un peuple dont la langue a été étudiée par Barth, qui n’y a trouvé aucune ressemblance avec le sonni-nké. Ce dernier peuple est un peuple essentiellement mandé, comme nous le verrons un peu plus loin.
[381]Est-ce à dire que je sois en désaccord complet avec le docteur Quintin ? Pas absolument, car je suis tout aussi persuadé que lui que les Sonni-nké ont fait partie de l’empire son’ray et qu’ils y ont joué un rôle très grand, mais à côté de cela j’affirme qu’ils sont mandé.
Quant à l’argument qu’apporte le même auteur en disant qu’une importante tribu de Sonni-nké se nommant Sisé serait descendante de Sa, le fondateur de la première dynastie des rois sonr’ay, ce n’est pas à soutenir, et en cela je suis absolument d’accord avec le docteur Tautain. Du reste, même en négligeant la voyelle a de Sa, et en admettant que sa et sé soient le même mot, cela ne prouverait pas du tout que Sisé veut dire « enfant de Sé ». Pour que ce fût vrai, il faudrait écrire Sési, car on dit massa-si, fama-si en mandé, et non si-massa, si-fama, comme le pense le docteur Quintin.
L’existence d’un empire sonr’ay aussi puissant que l’ont décrit les auteurs arabes restera toujours une énigme pour le monde savant, s’il n’admet pas comme moi que, sous le titre d’empire de Ghanata, de Sonr’ay, de Melli ou Mali, il faut comprendre comme facteur principal et élément le plus puissant la race mandé. Les preuves que j’ai avancées en citant les noms des rois dits sonr’ay, qui étaient pour la plupart purement des Mandé, dans la première dynastie au moins, doivent être concluantes. Du reste, comment expliquerait-on aujourd’hui que cette race sonr’ay, jadis si puissante, n’existe pour ainsi dire plus ? On ne trouve actuellement que fort peu de Sonr’ay répartis dans les environs de Djenné et dans la Yatenga, et quelques tribus isolées confinées dans le nord de la boucle du Niger et aux environs de Gogo, sur la rive gauche du même fleuve (dans le Zamberma, au nord du Sokoto). Il n’est pas possible qu’une race ayant joué un rôle aussi important dans l’histoire des peuples qui nous occupent ait disparu ainsi sans cataclysme. Il faut, d’autre part, bien admettre avec moi que, devant une race aussi imposante par ses divisions et le nombre de ses familles, comme c’est le cas pour la famille mandé, on ne peut penser qu’une chose, c’est que les trois empires de Ghana, du Sonr’ay et de Melle ont toujours été peuplés de Sonr’ay et de Mandé, dont les sujets, en arrivant alternativement au pouvoir, par droit ou par usurpation, faisaient changer la dénomination du royaume. Ce qui est notoire, c’est que si quelquefois les deux royaumes existaient simultanément, jamais l’empire dit sonr’ay n’a puisé ses propres forces dans l’élément sonr’ay seul et que d’importantes fractions de mandé y ont toujours joué un rôle considérable.
El-Edrizi écrit en 1153 (548 de l’hégire), en parlant de la description des richesses des peuples habitant Silla et Tekrour (Sagha), que Tirka ou Tirekka (lieu situé aux environs de Bourroum), au coude oriental du Niger, appartenait aux Wangara[70]. « Même Kougha, ajoute-t-il, était tributaire des Wangara. Seule Gogo était ville libre, et ne dépendait de personne. »
Ce qui est indiscutable, c’est que les peuples qui plus tard ont pris le titre de Sonni-nké ont depuis les temps les plus reculés (c’est-à-dire les temps historiques arabes) habité le nord des régions qui nous occupent.
La première mention que nous trouvons dans Ahmed Baba date de 1040-41 (432 de l’hégire). « Ouar Diabi, l’apôtre musulman du Tekrour, meurt. Il convertit entre autres à l’islamisme les habitants de Silla (près Djenné). »
A première vue, cette mention peut passer inaperçue ; elle a cependant une importance considérable, car les Diabi constituent encore aujourd’hui une tribu noble parmi les Sonni-nké.
Nous voyons en outre, dans René Basset (Mélanges d’histoire et de littérature orientales,[382] p. 13), que, sous le nom de Tekrour, les Melli sont soumis en l’an 320 de l’hégire (932-33) par l’émir mîknaséen de Fas, Mouça ben Abi l’Afya, qui s’empara de la ville et du pays de Tekrour.
L’identité des Tekrour et des Melli est prouvée par ce fait que Maqrizy donne au premier roi des Tekrour le nom de Serbendanah, qui paraît être le même que Bermendana, porté, suivant Ebn Khaldoun, par le premier roi des Melli. Puis, d’après El-Békri, en l’an 460 de l’hégire (1067-68) les rois de Ghana étaient encore païens. Ouaqaïmagha, fondateur de cet État, avait pour fonctionnaires les Ouakoré (Ouakoré, Wangara, noms sous lesquels certains peuples, entre autres les Haoussa, désignent aussi aujourd’hui les Mandé) ; il eut pour successeur Tonka-ménin. El-Békri nomme un des rois régnants : Kanda. Là également nous trouvons trois noms mandé. Ouakoré est aussi, de nos jours, employé un peu partout. Tonka est encore aujourd’hui le titre que prennent les souverains sonni-nké, et le mot Kanda se retrouve également dans ce même dialecte ; il signifie « pays », royaume et quelquefois chef.
En 1885-1886 j’ai collaboré avec mon regretté maître le général Faidherbe à un ouvrage intitulé Langues sénégalaises, comprenant l’étude du wolof, de l’arabe-hassania, du sonni-nké et du serère (Leroux, Paris, 1886). J’ai sans difficulté réussi à me convaincre que le sonni-nké est un dialecte mandé dans lequel rentrent en outre dans la proportion de 25 pour 100 des mots arabes et poular. Ce contact avec les Arabes et les Foulbé prouve que c’est dans le Bakhounou (l’ancien Baghéna) et sur le cours moyen du Niger que les Sonni-nké ont dû vivre avec les Arabes et les Foulbé. Ce qui tendrait encore à le prouver, c’est que le shetou, parlé à Tichit, près de l’Adrar, et dont Barth a donné un spécimen dans la Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, t. IX, 1855, p. 846 et 847), n’est autre chose qu’un dialecte sonni-nké. Cette note est intitulée : Der verlorene Sohn in der Sprache von Shetun ku Sefe oder der Azarareye Sprache.
Ce qui est certain, et Barth est formel sous ce rapport avec El-Bekri, c’est que les Wakoré (Mandé), comme ils les appellent, constituaient l’élément principal de la population du renommé royaume de Ghanata (Baghéna)[71].
Se trouvant dans une région aussi près de celle des Maures et des Foulbé, il n’est donc point extraordinaire que les familles régnantes ou dirigeantes appartenaient ou étaient mélangées de sang peul. En tenant compte de cette promiscuité d’éléments nègres, berbères, arabes ou peul, il est facile de comprendre pourquoi Léon l’Africain dit en parlant de leur origine : della stirpe di Libya, et que cet historien les fait correspondre aux Leucoæthiopes de Ptolémée[72].
De ce que nous venons de dire, il ressort clairement que le Ghanata était habité par des Wakoré (Mandé), et que, d’après nos propres recherches, leurs noms de familles, titre de roi, etc., se retrouvent actuellement sans altération dans la famille des Sonni-nké[73].
[383]Il est aussi certain qu’à cette époque cette famille ne portait pas encore le nom de Sonni-nké.
En 1607, El-Békri, après avoir cité Ouqaïmagha, parle de Tonka-Ménin et d’un autre chef nommé Kanda, ce qui prouve que les Wakoré, qui étaient fonctionnaires à la cour de ce premier chef, sont arrivés peu d’années après au pouvoir ; ils devaient même encore y être en 1076 au moment de la conquête du Ghanata par les Senhadja. El-Békri ajoute qu’à la suite de cette conquête une grande partie de la population est forcée par les Merabétin d’embrasser l’islamisme, ainsi que de nombreux districts nègres voisins.
Que sont devenues les familles mandé pendant la domination des Senhadja ? L’histoire nous le dit : musulmanes ! mais elle est muette quant à ce qui leur advint d’autre part.
C’est probablement pendant la période de domination berbère, de 1076 à 1203, que quelques-unes de leurs familles allèrent se fixer à Tichit et dans l’Adrar pour plus tard venir envahir le Kaarta, le Diafounou et le Guidimakha.
Mais cette migration n’a pas dû être bien importante, et il est presque certain que l’influence mandé ne disparut pas du coup, car, cent vingt-sept ans après la conquête du Ghanata par les Senhadja, le pouvoir passe de nouveau entre les mains d’une famille wakoré ou mandé. El-Békri est formel (1203—4, an 600 de l’hégire) : « Le Ghanata, très affaibli, est pris par les Sousou, une des tribus parentes des Wakoré[74]. »
Entre 1235 et 1260, les Sousou sont eux-mêmes subjugués par Mari-Djata, roi du Melle ou Mali, qui s’empare du Ghanata.
Que sont devenus les premiers Mandé, puis les seconds, les Sousou ? l’histoire ne nous en apprend pas grand’chose. Ce que nous pensons, c’est que les uns et les autres ont dû à peu d’exceptions près accepter la nouvelle domination. N’étaient-ils pas de même race, ne parlaient-ils point la même langue ? Pour eux la conquête se réduisait au changement de la famille royale et à l’arrivée au pouvoir de gens de même race qu’eux, mais ne portant pas le même nom.
A cette époque les Mandé étaient maîtres partout, dans toute la partie nord de la boucle du Niger. Les Sousou, les Mali de Mari-Diata ou Diara étaient Mandé. Plus à l’ouest, l’empire sonr’ay lui-même était gouverné par des Mandé.
Pendant cette période on peut donc dire qu’il n’y a eu que des déplacements de peu d’importance, des migrations de peuples de même race ; les Mandé étaient au pouvoir partout.
Cet état de choses se continua ainsi fort probablement jusqu’à ce que la dynastie des Za, tributaire de Melle (première dynastie dite sonr’ay), succédât à celle des Sonni.
A la dynastie des Za (première dynastie des Sonr’ay) succéda celle des Sonni.
Le premier roi sonni fut Sonni Ali Kilnou, et son successeur fut Sonni Silman Nar.
Voici ce que l’on sait sur eux d’après Ahmed Baba :
Sonni Ali Kilnou et Sonni Silman Nar étaient deux frères ; ils résidaient comme otages ou avaient été donnés comme gage de fidélité au roi de Melle[75]. Cette coutume existe encore dans le Soudan : chaque fois que des États reconnaissent pour leur suzerain un État plus puissant qu’eux, les États vassaux envoient à la cour de leur suzerain un ou plusieurs de leurs enfants.
Lorsque ces enfants deviennent adultes, quelques-uns rentrent dans leur pays, d’autres prennent des emplois de haut serviteur, de page à la cour du suzerain.
[384]Ali Kilnou ne se plaisait pas à la cour du roi de Melle et nourrissait secrètement le désir de regagner sa patrie. A cet effet, il se procura peu à peu les chevaux et les armes nécessaires, et un beau jour il quitta avec son frère Silman Nar furtivement la cour du roi de Melle.
Dès que leur fuite fut connue, on envoya des guerriers à leurs trousses avec ordre de les ramener morts ou vifs. Les deux frères furent rejoints plusieurs fois par les gens du roi de Melle, mais réussirent toujours à se dégager en combattant et gagnèrent finalement leur patrie.
Ali Kilnou en rentrant fut proclamé par son peuple sultan du Sonr’ay et prit le titre de Sonni Ali Kilnou.
Pendant son règne il affranchit son pays de la suzeraineté du Melli. Et à sa mort, son frère Suleyman Nar lui succéda, avec le titre de Sonni Suleyman Nar.
C’est de ce moment-là, de l’avènement de Sonni Ali Kilnou (vers 1331), que date vraisemblablement l’origine de l’appellation Sonni-nké. Et je l’explique comme il suit. Sonni Ali Kilnou ayant réussi à affranchir dans une certaine mesure son pays de la domination de Melle, il lui fallut des partisans, car les Sonr’ay, à eux seuls, n’étaient pas assez puissants pour soutenir le roi qu’ils venaient de se donner. Ce furent donc un certain nombre de familles wakoré ou mandé qui embrassèrent sa cause, et par ce fait furent nommées Sonni-nké, « hommes de Sonni ». D’autres Mandé, au contraire, soutinrent l’ancienne dynastie, celle des Za, dans laquelle ils comptaient de nombreux parents, les Barou et Kérou. Ceux-là, au lieu d’être partisans des Sonni, restèrent partisans des Za, et pour le prouver ils prirent le nom de Diou-la, comme je l’ai dit au chapitre précédent, « qui sont du trône, de la souche ».
Sonni Ali et ses successeurs luttèrent en vain contre les autres Mandé (le royaume de Melle) ; ils ne réussirent que longtemps après à s’affranchir totalement.
Ce fut le seizième roi de la nouvelle dynastie, qui portait également le nom de Sonni Ali, auquel était réservée la gloire d’affranchir son pays.
Son avènement date de 1465.
En 1469 il s’empare de Tombouctou sur le Mali,
Fait le Bakhounou tributaire,
Hâte et provoque la chute de Melle,
S’empare de Djenné, qui avait toujours résisté aux Mali.
Fonde Agadès.
Enfin, en 1492, Sonni Ali II se noya en revenant d’une expédition contre le Gourma.
L’armée du défunt roi quitte Bé-naba (capitale du Gourma), pour se diriger sur Dangha, et Abou Bakr Da’ou, fils de Sonni Ali II, monte sur le trône.
Puis Ahmed Baba dit : Mohammed ben Abou Bakr, un indigène du Sonr’ay (cette remarque prouve que la famille royale des Sonni n’était pas sonr’ay et par conséquent mandé ; ce qui le prouve encore, c’est que le fils de Sonni Ali II est désigné par le nom de Abou Bakr Da’ou), officier de Sonni, marcha avec ses troupes contre le nouveau roi et le battit complètement.
Mohammed ben Abou Bakr monta sur le trône avec le surnom de e Thouri (Touré)[76] et le titre d’Émir el-Mouménin et de Khalifa el-Moslémin, mais comme roi il se nomma : Askia ou Sikkia.
[385]De cette époque, dit le docteur Quintin (et nous nous associons pleinement à sa façon de voir), date l’émigration des principales familles qui soutenaient l’ancienne monarchie du Sonr’ay, celle des Sonni.
Les Bakiri et Diawara, entraînant d’autres familles, se détachèrent de l’empire sonr’ay, émigrèrent dans l’empire de Melle ou Mali et continuèrent à être désignés dans la suite par le nom de Sonni-nké.
On remarquera que Sonni Ali II avait soumis et réuni sous sa couronne tous les peuples et royaumes de la boucle nord du Niger, et qu’il les ravagea presque tous. Seul le Baghéna ou Bakhounou ne fut rendu que tributaire. Cet acte est encore un indice sérieux de l’influence dont jouissaient les familles sonni-nké dans ce pays. Ayant dans son armée beaucoup de guerriers de cette famille, il dut leur faire quelques concessions : ce n’est qu’ainsi que l’on peut expliquer cette mesure de clémence envers le Bakhounou.
A partir de l’avènement d’Askia, il est impossible de suivre la famille sonni-nké ; elle a, comme les autres peuples mandé, subi à la fin du même siècle le joug des conquérants marocains et passé par les mêmes vicissitudes que l’empire de Mali.
Les Sonni-nké ont pendant longtemps sourdement lutté pour arriver au pouvoir ; leurs velléités d’affranchissement ne se sont manifestées ouvertement que de 1748 à 1751 dans la célèbre lutte entre Sagoné et Dabo.
Comme nous l’apprennent les légendes chantées par les griots diawara du Ségou, les uns avaient pris parti pour Dabo, les autres pour Sagoné, ce qui a donné lieu à une nouvelle division dans la famille sonni-nké et à de nouvelles migrations.
La lutte se continua encore à la fin du XVIIIe siècle entre les Diawara Sagoné et les Diawara Dabo, mais ils durent tous les deux se retirer devant les Bambara du Bélédougou, qui forcèrent les Sagoné à s’établir au nord du Kaarta, à Diawara-Melle, et les Dabo dans le Kingui, au sud du Nioro.
El-Hadj Omar battit successivement de 1854 à 1860 les Diawara Sagoné et Dabo et les força de rentrer dans le Ségou, mais sous le règne d’Ahmadou une partie d’entre eux fit retour dans le Kingui.
Aujourd’hui il n’existe dans le Ségou qu’un seul village diawara dabo, c’est Fogny, point de passage du Niger entre Yamina et Ségou, et trois villages diawara sagoné : ce sont Mokottyka, Samboka, Aïsaka.
Quoique ces deux partis ne soient plus en lutte ouverte, ils restent toujours divisés, et dans les guerres d’Ahmadou les Sagoné ne campent jamais avec les Dabo.
De cette époque datent aussi les migrations vers la Haute-Gambie et la formation des colonies sonni-nké de la Casamance, enfin, plus récemment, pendant les guerres d’El-Hadj Omar, les Sonni-nké se sont encore désagrégés davantage.
Aujourd’hui on les trouve à l’état de familles compactes dans le Guidimakha, le Diafounou, le Kaarta, le Nioro, le Guoye, le Kaméra, le Bondou, le Bambouk, le Bakhounou et le Ségou dans le Soudan français, et à l’état isolé un peu disséminés, partout jusque dans le Dafina.
En 1885-1886, un des leurs, El-Hadj Mahmadou Lamine, trop connu par ses menées et l’insurrection des Sonni-nké dans le Haut-Sénégal pour que je m’étende plus longuement sur lui, a essayé de reconstituer à son profit un nouvel empire sonni-nké et il n’a pas fallu moins de deux campagnes au colonel Gallieni pour détruire sa puissance et s’emparer de lui.
FAMILLE MANDÉ-BAMMANA
Nous avons vu dans les chapitres précédents comment, à la suite des conquêtes de Mohammed Askia, l’empire de Mali se trouvait divisé en cinq gouvernements ou groupements[386] distincts. A cette même époque beaucoup d’autres peuples qui faisaient partie de ce vaste empire s’en détachèrent. Tels sont les Siène-ré, les Tagoua, les Bobo-Dioula, etc., et en particulier les Gondja.
Enfin les Soso disparurent également et s’éloignèrent du théâtre de ces événements. L’arrivée des troupes marocaines du pacha Diodar en 1587 et la conquête de l’ancien empire sonr’ay par les troupes marocaines permirent aux peuples de race mandé d’espérer un moment la reconstitution de leur royaume. Aussi une fraction d’entre eux ne tarda pas à se lever en masse et à chercher à s’emparer du pouvoir.
Cette fraction est celle des Bammana. Ayant concouru autrefois, au même titre que les autres, à former l’empire de Mali, elle cherchait tout simplement à le reconquérir à son profit.
Ce mouvement des Bammana eut lieu vraisemblablement dans la première moitié du XVIIe siècle : les données que nous possédons sont précises à cet égard. On peut, sans commettre une erreur de plus d’une dizaine d’années, estimer que c’est en l’an 1650 que les Bammana apparaissent sur le haut Niger (dans le Ségou) sous la conduite de Kaladian Kouroubari.
D’où venaient ces Bammana ? Le docteur Quintin dit qu’ils viennent du Torong d’après la tradition ; c’est ce qu’on nous a appris aussi ; mais là où nous différons d’avis, c’est que nous pensons que les Bammana habitaient déjà depuis de longues années des régions beaucoup plus rapprochées du Ségou que le Torong, et qu’on les trouvait aussi nombreux qu’aujourd’hui dans le Baninko, le Bolé, le Ganadougou et le nord de l’empire de Samory[77]. Le docteur Quintin ajoute que c’est pour la seconde fois qu’ils fuyaient l’Islam.
Quel est donc le peuple qui aurait cherché à les convertir à l’Islam ? C’est vainement que nous nous sommes posé cette question.
Il n’existe aucun peuple, à notre connaissance, qui à cette époque-là aurait été à même de faire des conquêtes religieuses, si ce n’est les Mandé eux-mêmes, c’est-à-dire les Mandé-Mali et les Mandé-Dioula. Ce sont donc ces deux fractions de la race mandé qui par leur zèle pour la religion et leur fanatisme auraient provoqué un déplacement chez la fraction des Bammana. Cela peut exister, et nous y croyons bien volontiers, mais nous pensons que là n’est pas la seule cause qui ait déterminé les Bammana à se remuer, c’est surtout le désir d’arriver à leur tour au pouvoir, la soif d’indépendance qui les a portés sur le Ségou.
Ce pays était occupé par des Sonni-nké au moment de l’arrivée des Bammana ; et ces derniers ont dû s’y établir sans lutte, car ni les légendes que je connais, ni les traditions rapportées au docteur Quintin lors de son séjour à Ségou, ne font mention de luttes violentes.
Ce que l’on sait, c’est que Kaladian Kouroubari, premier chef bammana, qui avait six fils, en établit cinq sur la rive droite du Niger et un, l’aîné, à Sountian, près de Mourdia, en plein Bélédougou.
Kaladian, pendant son règne, reconstitua en partie l’ancien empire de Mali.
A la mort de Kaladian, vers 1680, succéda une période de gouvernement oligarchique pendant laquelle l’influence des Bammana diminua au profit des Sonni-nké.
Vers 1700, Bittou, appelé aussi Tigui-Ton, arrière-petit-fils de Kaladian Kouroubari, et petit-fils de Danfasari, réussit à mettre tous les districts bammana sous son pouvoir.
Il fit fortifier Ségou-Koro, dont il était le chef, fit la guerre à la plupart de ses cousins,[387] héritiers de Boufouné et de Sakhaba, mais la tradition ne dit pas s’il réussit à les rendre tributaires, ou s’il se borna simplement à piller leurs domaines.
Bittou régna plus de trente ans. Il eut quatre fils : Diécoro, Bagny, Bakary, Diatalaké.
1732. — Diécoro, fils aîné de Bittou, succéda à son père ; il fixa sa résidence à Ségou-Bougou, et fonda pendant son règne Ségou-Sikoro.
Ce chef, se voyant déborder par ses captifs influents, chefs de districts institués par son père, résolut de se défaire des plus influents, mais son plan fut découvert et il fut assassiné par ses captifs avant d’avoir pu le mettre à exécution.
1740. — Bakary, troisième fils de Bittou, succède à son frère Diécoro, mais ce roi disparut quinze jours après son avènement sans que personne sût ce qu’il était devenu. Avec lui finit la dynastie des Kouroubari.
Les chefs des villages importants et les captifs influents élevèrent au pouvoir un des leurs, de la famille des Diara. Il régna sous le nom de Tomassa Diara et mourut en 1743.
De 1743 à 1746 règne un métis peul nommé Kanoubagnouma Mbari ; il est élevé au pouvoir par les captifs de la couronne. Ce roi meurt également après trois années de règne.
1746-1748. — Kafadiougou ne règne, lui aussi, que trois ans.
De 1748 à 1754. — A la mort de Kafadiougou survinrent une période d’anarchie et une série de guerres entre les chefs influents bammana et sonni-nké qui cherchaient à arriver au pouvoir. Barth[78] dit que les deux principaux chefs qui se mirent à la tête chacun d’un parti se nommaient Dabo et Sagoné et étaient fils du faran ou farba Mahmadou.
Le souvenir de ces luttes s’est perpétué chez les noirs, et surtout chez les Diawara du Ségou, mais les généalogies de Dabo et Sagoné sont perdues. Ce que je puis affirmer, c’est que les griots diawara dans leurs chants ne considèrent pas Dabo et Sagoné comme des frères, mais comme de simples chefs ayant cherché à accaparer le pouvoir. Dans la tradition on désigne souvent Dabo sous le nom de Ngolo, et Sagoné sous le nom de Sangué. Ces noms se retrouvent aussi dans l’ouvrage du docteur Quintin.
Cette lutte pour le pouvoir dura trois longues années et ne se termina que grâce à la mort de Sagoné, qui fut tué près de Ségou-Sikoro en 1754 ; elle eut pour résultat :
1o De consolider les Bammana dans le Bélédougou, le Nioro et le Ségou ;
2o De permettre aux Ahel-Semborou, fraction de Foulbé, de s’établir dans le nord du Bakhounou ;
3o De fixer les Ouled-Masouk, fraction des Ouled-Mbarek, sur les limites du Bakhounou.
Ce fut Hennoun ben Bohedel ould Mebarek, qui avait conduit les Ouled-Masouk à la guerre, qui fut, d’après les traditions, investi du pouvoir et proclamé régent du Bakhounou. Barth nous a rapporté le nom des successeurs de Hennoun, et comme l’un d’eux a été visité par Mungo-Park en 1796-1797, et que nous savons que précisément celui-là régna près de 40 ans, nous pouvons facilement déduire les dates approximatives de l’avènement des autres.
Ainsi Ali ould Omar régna près de 40 ans et reçut la visite de Mungo-Park peu de temps avant sa mort. Mungo-Park y était en 1797 : la date probable de la mort du chef est donc environ 1800 ; s’il a régné près de 40 ans, mettons 38 ans, la date de son avènement serait 1762.
[388]Le prédécesseur d’Ali ouled Omar fut Omar ouled Hennoun, puissant chef qui donna son nom à cette dynastie (celle des Ouled-Omar ou Loudamar, comme les nomme Mungo-Park). Nous estimons qu’il a régné de 1754 à 1762, c’est-à-dire 8 ou 9 ans.
Quant au prédécesseur d’Omar ouled Hennoun, c’est précisément Hennoun ben Bohedel ouled Mbarek, celui qui mena les Ouled-Masouk à la guerre. Celui-là régna de 1751 à 1754, fort probablement ; nous arrivons donc à une concordance de dates qui laisse peu à désirer comme exactitude.
Les fractions sonni-nké-siawara qui prirent part à cette lutte sont aujourd’hui dispersées, cependant nous avons pu retrouver leurs traces. (Voir page 381, au chapitre Sonni-nké.)
L’autre fraction sonni-nké, celle des Ahel-Massa ou Sâro, se retira en partie vers Djenné, où on la trouve encore disséminée aux environs de Sâro même ; elle parle un dialecte mandé-sonr’ay dont on m’a souvent entretenu, mais dont je n’ai pas eu la bonne fortune de rapporter de vocabulaire.
Quant aux Mandé-Mali-nké qui prirent part à la lutte, ils se replièrent à travers le Gangaran et le Bambouk, vers le Bouré et le sud en général. Quelques-unes de leurs tribus ont conservé jusqu’aujourd’hui le surnom de Mali-nké-Dabo ou Ngolo.
1754 à 1787. — Ngolo ou Dabo, resté seul maître du pays, fixa sa résidence à Ségou-Sikoro et répartit le commandement de son royaume entre ses cinq fils[79] :
Nji, l’aîné, commanda à Bammabougou ; Mansong, le second, à Mbébala ; Nianancoro, le troisième, à Ségou-Koro ; Diakélé, le quatrième, à Kéréniou ; enfin Mamourou, le plus jeune, vivait avec son père.
C’est sous le règne de ce souverain et pendant la guerre entre Sagoné et lui, que se produisit un important mouvement des Foulbé, qui s’acheminaient lentement à travers la boucle du Niger et s’avançaient jusque dans le nord du Bélédougou.
Hennoun ben Bohedel ould Mebarek avait concédé aux Foulbé l’occupation de quelques villes dans le Bakhounou, mais son fils, Omar ouled Hennoun, leur enleva ce privilège et les chassa de la région. Ngolo, lui aussi, en purgea son territoire et les força à s’installer dans le Ganadougou et le Ouassoulou, où, mélangés aux Mandé, ils ne tardèrent pas à se noyer parmi eux. Du Peul ils n’ont conservé que vaguement les traits et leurs noms de tribus.
Ngolo, disent les traditions, établit son autorité de Bammako à Tombouctou et fit pendant huit ans la guerre aux Foulbé du Kalari.
C’est peu de temps après la fin de son règne que le Macina fut fondé par le Peul Ahmadou Amat Labbo (en 1790), qui s’empara du pouvoir sur Galadjo, chef tombo (autochtone). Le nouvel État, d’après les indigènes que nous avons interrogés, fut érigé sous la suzeraineté du royaume bammana du Ségou. Ce qui tendrait à le prouver, c’est que Ngolo était maître du Niger jusqu’à Tombouctou, et qu’en 1810 Da Diara, son successeur, avait encore à sa cour un des fils d’Ahmadou Amat Labbo comme otage.
On dit également qu’il fit deux expéditions contre les Mossi. Ce fut dans la dernière qu’il trouva la mort au bout de six semaines de maladie.
« Son armée, dit le docteur Quintin, rentra à Ségou, emportant avec elle les restes de son chef, qui furent placés, selon la coutume du pays, dans la peau d’un bœuf noir tué tout exprès pour la circonstance.
« A Ségou, on fit à Ngolo des funérailles magnifiques, mais ce qu’il y a de plus flatteur[389] pour ce souverain, c’est qu’il fut très aimé de ses sujets et qu’il laissa de vifs et sincères regrets dans son pays. Il avait régné 33 ans. »
1787-1808. — Nji, fils aîné de Ngolo, étant mort dans les expéditions contre les Foulbé, ce fut Mansong, deuxième fils de Ngolo, qui succéda à son père.
Niancoro, troisième fils, conteste le pouvoir à Mansong, marche contre lui avec ses partisans et appelle à son secours Daisé Kouroubari, roi du Kaarta.
Niancoro fut fait prisonnier et son parti mit bas les armes. Ce conflit et l’intervention de Daisé Kouroubari[80] servirent de prétexte à Mansong pour envahir le Kaarta et le mettre à sac.
Mansong expéditionna aussi dans le Fouladougou, le ravagea presque entièrement, mais ne réussit pas à s’emparer de Bangassi, sa capitale, qui était défendue par Séré-Noumou.
Mansong[81] mourut vers l’année 1808, après 21 ans de règne.
1808 à 1830. — Da Diara, deuxième fils de Mansong, succède à son père. Pendant presque tout le règne de Mansong, Ahmadou Amat Labbo fut chef du Macina. Ces deux pays ne vivaient pas en absolue bonne intelligence. Le Macina, jeune État, n’osait pas encore attaquer les Bammana, il attendait cependant une occasion propice pour se mesurer avec son voisin et s’affranchir de sa tutelle.
Une circonstance fortuite, querelle d’un fils d’Ahmadou Amat Labbo avec des gens de Ségou, fut le prétexte d’une guerre qui éclata en 1810[82] et dans laquelle Da fut assez heureux pour conserver comme tributaire le Fouta, c’est-à-dire la partie du Macina située sur la rive droite du Niger, tout en maintenant sa suzeraineté sur le Macina proprement dit, situé sur la rive gauche du Niger, avec Ténenkou comme capitale. Cependant, en 1828, Ahmadou Cheikh, fils d’Ahmadou Amat Labbo, conquit, dans des circonstances qu’on n’a jamais pu nous expliquer, le Djenné sur le Ségou.
Da fut le dernier roi du Ségou qui fit la guerre aux Kouroubari du Kaarta. La paix termina heureusement une série de guerres qui, commencée sous le règne de Nji, vers 1796, ne se termina que vers 1829, quelques années avant le voyage d’Anne Raffenel.
L’origine de ces guerres entre les Bammana-Kouroubari et les Bammana-Diara date, comme nous l’avons vu, de 1796, époque où Daisé, roi du Kaarta, voulait prêter main-forte à Nianancoro contre Mansong, mais la querelle sourde, l’hostilité permanente, date de l’arrivée au pouvoir des fils de Kaladian.
On se souvient que le roi institua souverain d’une partie du Bélédougou son fils Sakhaba, qui résida à Sountian, près de Mourdia. Sakhaba sut conserver le pouvoir et le transmit à ses fils, lorsque vers l’an 1700 Bitton ou Tigui-Tou, petit-fils de Dansafari, fils de Kaladian, voulut réunir sous son sceptre tous les États Bammana et fit la guerre aux descendants de Sakhaba.
Foulikoro, petit-fils de Sakhaba, fut tué dans un combat contre Bitton, et le frère de Foulikoro, nommé Seybammana, dut s’enfuir devant Bitton et se réfugier dans le Khasso, où il fut élu roi.
Il ne restait donc personne pour gouverner le Kaarta. C’est alors que les Kouroubari se donnèrent comme chef Sébé Kouroubari, connu surtout sous le nom de Sébé Massa[83].[390] Ce chef donna son nom à la dynastie. Il régnait à Nioro en 1754 et eut comme successeur Daisé Kouroubari, qui régnait dans le Kaarta lors du passage de Mungo-Park en 1796. Les noms des successeurs de Daisé nous ont été transmis par Raffenel, ainsi que l’histoire moderne détaillée du Kaarta. Nous nous bornerons à ajouter que les Massa-si ont conservé le pouvoir jusqu’à l’apparition d’El-Hadj Omar. A cette époque c’était Mahmady Kandian Kouroubari Massa-si[84] qui gouvernait Nioro. Ses descendants se sont réfugiés depuis sur la rive gauche du Sénégal, et Mari Ciré Kouroubari Massa-si, héritier présomptif, habite encore un village près de Fatafi, sur les confins du Gangaran.
1830 à 1842. — Tiéfolo, fils aîné de Mansong, succède à son frère. Il n’arrive au pouvoir qu’après le cadet, à cause d’une question de priorité d’heure d’arrivée des courriers. Tiéfolo était né le même jour que Da, mais était fils d’une autre mère, réputée de moins bonne famille que la mère de Da.
C’est pendant que Tiéfolo était au pouvoir qu’El-Hadj Omar passa à Ségou revenant de La Mecque. Tiéfolo fit arrêter le pèlerin et le fit mettre aux fers, mais il dut céder aux instances des musulmans influents qui lui représentaient cet acte comme devant lui porter malheur et mettre El-Hadj en liberté. Tiéfolo mourut après 12 ans de règne.
1842 à 1848. — Kériengolé, dont nous ne connaissons pas le degré de parenté avec Mansong, succéda à Tiéfolo. Son règne, qui dura 7 ans, ne fut troublé que par une guerre qu’il soutint contre le nord du Bélédougou et principalement avec Mourdia.
1848 à 1849. — Nialouma Koua, frère de Kériengolé, ne régna que 9 mois. Il eut pour successeur :
1849 à 1855. — Massala Demba, qui régna 6 ans.
1855 à 1859. — Le septième fils de Mansong, Torocoro Mary Diara, monte sur le trône. Pendant son règne il entra en pourparlers avec des émissaires d’El-Hadj Omar, déjà très puissant, pour la soumission du Ségou, ce qui fit naître un mécontentement général dans le Ségou et coûta la vie à Torocoro, qui mourut empoisonné en 1859.
1859 à 1861. — Aly Diara, huitième fils de Mansong, succède à son frère Torocoro Mary Diara.
Ce prince lutta avec énergie contre El-Hadj Omar, et, malgré la soumission du Kaarta que le prophète venait d’obtenir sur Mahmady Kandian Kouroubari, Aly Diara résista.
Il se fortifia dans Oïtala, mais El-Hadj Omar, après des alternatives de revers et de fortune, s’en empara et occupa Sansanding.
A ce moment Aly Diara obtint d’Ahmadou Cheikhou, fils d’Ahmadou Cheikh et petit-fils d’Ahmadou Amat Labbo, une armée de 15000 hommes qui lui arriva sous les ordres d’un oncle d’Ahmadou Cheikhou, nommé Ba Lobbo. Mais l’armée bambara-macinienne fut battue, et cette victoire donna l’entrée du Ségou à El-Hadj Omar (10 mars 1861).
El-Hadj Omar procéda immédiatement à la réorganisation du Ségou, et institua Ahmadou, son fils aîné, roi du Ségou. C’est lui que visitèrent Mage et Quintin, Gallieni, Soleillet, etc., et que le colonel Archinard vient de battre successivement à Ouosébougou, Kalé, Koniakary et Nioro.
A la prise du Ségou, au commencement de 1890, Ahmadou, coupé du Ségou, habitait le Kaarta et le Nioro, et son fils aîné, Madané, gouvernait le Ségou. A l’approche des troupes du colonel Archinard, Madané prit la fuite et se réfugia dans le Macina.
Quant à Ahmadou Cheikhou, l’allié d’Aly Diara, battu à Saëwel par El-Hadj Omar, il[391] s’enfuit vers Tombouctou et fut fait prisonnier peu après par Alpha Oumar, lieutenant d’El-Hadj, qui le fit décapiter. La dynastie d’Ahmadou Amat Labbo et celle de Ngolo Diara furent donc toutes les deux anéanties par El-Hadj Omar, qui donna le Ségou à son fils Ahmadou, tandis que le Macina tomba entre les mains de Tidiani, son neveu.
FAMILLE SOUSOU OU SOSO
LES SOUSOU OU SOSO[85]
Actuellement le pays où habitent les Soso est compris entre le rio Pongo au nord, les rivières Scarcies au sud, l’Océan à l’ouest ; le Benna, le Tambourka et quelques autres provinces les plus occidentales du Fouta-Djallo forment sa limite à l’est.
Il est traversé, dans toute son étendue, par la chaîne des monts Soso, qui le divise en deux parties bien distinctes : le bas pays, compris entre le versant occidental et la mer ; le haut pays, formé par les plateaux et le versant oriental.
Les Soso ne sont pas autochtones. Leur occupation ne remonte pas bien loin dans le passé ; leurs dernières invasions sont même de date relativement récente ; ce qui ressortirait assez d’ailleurs, à défaut d’autres preuves, de l’attitude orgueilleuse, conquérante et hostile qu’ils ont conservée envers leurs voisins, anciens maîtres du sol, dépossédés par eux. Qui étaient-ils ces Soso vainqueurs ? D’où étaient-ils venus ? A quel grand groupe des noirs soudaniens appartenaient-ils ? Et par quelle série de migrations sont-ils devenus définitivement les maîtres du haut et du bas pays ? Autant de questions qu’il paraît d’abord bien difficile de résoudre.
La première mention que font les historiens arabes des Sousou ou Soso se trouve dans Ebn Khaldoun, tome II, page 110 : « On rapporte, dit-il, que, du côté de l’Orient, les Ghana avaient pour voisins les Sousou ou Ceuseu ».
Puis, nous trouvons dans El-Békri, an 1203-4 (600 de l’hégire) : « Le Ghanata, très affaibli, est pris par les Sousou, une des tribus parentes des Wakoré ».
D’après ces auteurs, il serait donc établi qu’au commencement du XIIIe siècle, les Sousou habitaient à l’orient du Ghanata et qu’à cette époque ils s’emparèrent de ce pays.
Puis nous savons également, par Ahmed Baba, que pendant le règne de Mari Diara Ier, entre les années 1235 et 1260, ce dernier s’empara sur eux du Ghanata, ce qui réduit leur domination à une cinquantaine d’années environ.
D’où venaient ces Sousou ou Soso, voisins du Ghanata, dont parlent Ebn Khaldoun, El-Békri et Ahmed Baba ? L’histoire ne nous l’apprend pas, et nous ne pouvons que conjecturer sur leur origine.
Ils sont Mandé ; leur langue a été étudiée, il est impossible d’en douter. Il est fort probable qu’ils vivaient parmi les autres Mandé depuis fort longtemps déjà. Nous sommes cependant porté à croire que dans les temps les plus reculés les Soso vivaient dans le Sankaran, où l’on retrouve leur trace, et que ceux dont nous parlent les historiens arabes n’étaient qu’une fraction. Ils ont dû remonter le Niger, s’établir vers la limite des Senhadja, puis, profitant de l’affaiblissement des peuples berbères et aidés des Mandé (qui[392] plus tard ont formé les Sonni-nké), ils ont dû s’emparer du Ghanata et y prendre le pouvoir.
Chassés par Mari Diara, à la tête de conquérants de même race qu’eux, qu’ont-ils pu devenir ?
A partir de cette époque, et à mesure que ces peuplades s’éloignent des centres musulmans, les historiens arabes deviennent muets.
Toutefois, si l’on considère, d’une part, qu’il leur fut certainement impossible de continuer leur migration vers le nord, défendu par les Berbères-Touaregs, et que pour se diriger vers l’est ils auraient dû traverser les peuples mandé qui venaient de les subjuguer ; si, d’autre part, on considère que de nos jours la Haute-Gambie, la vallée du Bakhoy et du Bafing sont peuplées par des hommes d’origine soso, on est obligé de conclure que les Soso vaincus se portèrent vers l’ouest.
Le docteur Quintin et le général Faidherbe nous apprennent du reste que dans le courant du XIIIe siècle les Soso émigrèrent sur le Haut-Sénégal et qu’ils y restèrent jusqu’au moment de l’invasion du Fouta par les Dénianké (esclaves peul métissés de Mandé), sous les ordres de Koli. Ces Dénianké, poussés eux-mêmes par les Sonr’ay vainqueurs, refoulèrent les Soso ou Socé à travers le Bondou, le Bambouk, le Ferlo, le Sine, et le Saloum, vers la Haute-Gambie et la Casamance (cela se passait vers la fin du XVe siècle ou le commencement du XVIe). Peut-être même les Diallo-nké se rattachent-ils aux Soso ou Socé ? Je l’ignore. Tant que l’on n’aura pas étudié les noms de famille (diamou) de l’une et de l’autre famille, il me paraît impossible de se prononcer avec quelque certitude.
Nous avons dit plus haut qu’une partie considérable des Soso, au lieu de remonter au nord, en suivant le cours du Niger, avait dû rester dans les environs du Sankaran. Cette fraction importante, devenue musulmane, s’est peu à peu portée vers l’ouest ; nous avons pour nous guider des traces manifestes laissées par elle dans le Solimanah, le Kimba, le Tamisso, le Tambourka et le Benna. On peut observer sa marche lente, mais victorieuse, refoulant devant elle les tribus fétichistes des Timéné, des Landouman, des Nalou, des Baga, des Boulam, etc., auxquelles nous n’hésitons pas à assigner une origine commune. C’est-à-dire que nous pensons qu’elles ne sont pas autre chose que des tribus détachées de la grande famille mandé.
L’époque et les causes de leurs migrations remontent assez haut dans le passé pour que la filiation semble se perdre dans cette obscurité du temps, mais les caractères linguistiques nous aident singulièrement à rétablir la chaîne interrompue.
Vers la fin du XVIe siècle, les Soso eurent des luttes terribles à soutenir contre les peuples que nous venons d’énumérer ; le souvenir en est encore conservé par leurs griots. Enfin, ils luttèrent également contre les Foulbé du Fouta-Djallo, et leur soumission (?) ne date que du siècle dernier.
FAMILLE MANDÉ-MALI
L’histoire des Mandé-Mali-nké est l’histoire générale des peuples de même origine qui ont concouru à la formation du puissant empire de Mali.
Par son nombre, cette fraction semble pourtant avoir occupé une situation prépondérante dans l’empire de Mali, auquel elle a donné son nom.
Au moment de la désagrégation du royaume de Mali sous le règne du roi sonr’ay Askia Mohammed (commencement du XVIe siècle) nous avons vu plus haut que le Mali se divisa en cinq groupements ou gouvernements autonomes.
Les Mali-nké, dispersés un peu partout dans les pays tributaires du Mali, durent probablement chercher à se concentrer et se retirèrent vers les pays où habitaient les gens de[393] la même fraction qu’eux, c’est-à-dire vers le Haut-Niger et les pays qui constituent actuellement les provinces méridionales des États de Samory.
Seules quelques fractions de Malin-ké étaient encore fixées le long du Niger, vers Ségou, et occupaient les rives du Bakhoy et le Fouladougou.
Elles prirent même part à la lutte mémorable entre Ngolo et Sagoné, lutte qui mit le Soudan occidental à feu et à sang pendant plusieurs années vers le milieu du XVIIIe siècle.
Plus tard, vers la fin du XVIIIe siècle, Mansong, roi des Bammana du Ségou, vint attaquer sans succès Bangassi, leur citadelle du Fouladougou, puis ni l’histoire ni la tradition ne nous transmettent plus de faits saillants jusque vers la première moitié du XIXe siècle, époque des luttes de Kankan Mahmady avec les Siène-ré du Tengréla et le Ouassoulou (voir le chapitre États de Samory).
FAMILLE MANDÉ-DIOULA
Nous avons vu comme l’avènement de la dynastie des Sonni sur le trône sonr’ay-mandé a donné naissance à la famille dioula en 1350.
Cette fraction ne paraît pas avoir été bien nombreuse à l’origine, disent les Dioula eux-mêmes ; ils ne comptaient que cinq familles : les Da’ou, les Kérou, les Barou, les Touré[86] et les Ouattara.
La tradition conservée par les gens de Kong dit que les Dioula voulaient bien faire partie des gens de Mansa Sliman, mais dans leur adhésion il y avait une clause par laquelle ils n’abandonnaient pas leurs droits au commandement. C’est probablement pour cette raison que nous les voyons, sous le règne de ce sultan, gouverner plusieurs provinces.
Ahmed Baba mentionne dans la presqu’île un des gouverneurs sous le nom de Ouattara Koy ; deux dans le Bendougou sous les noms de Touré Koy, Da’ou Koy ; et enfin un autre sur la rive nord du Niger sous le nom de Barou Koy. Un Kérou Koy est mentionné également par l’historien arabe ; mais comme l’orthographe du nom laisse à désirer et que sa lecture n’est pas absolument sûre, nous n’avons cru devoir le citer que pour ordre.
A ces familles se sont jointes, au moment de la scission avec les Sonni-nké, diverses autres familles :
Une deuxième famille ouattara, les Sakhanokho, les Sissé, les Kamata, les Kamakhaté, les Timité, les Daniokho.
Les deux familles ouattara et Sakhanokho se disent apparentées aux Diawara ; elles ont le même tenné que les Diawara Sagoné : la tête de chèvre.
Les Dioula sont à classer parmi les premiers peuples mandé qui ont adhéré à l’islamisme. Habitant les environs de Djenné, région qu’on pourrait appeler le berceau de la civilisation musulmane du Soudan, les Dioula se sont adonnés principalement au commerce ; ils s’érigèrent peu à peu en ligue commerciale, fondèrent de nombreuses colonies et acceptèrent dans leur sein d’autres Mandé comme adhérents.
On trouve parmi eux des Diara, des Kouroubari, des Sakho, des Bamba, des Diabakhaté, des Traouré.
A l’époque de la désagrégation du Mali, vers 1500, à la suite des victoires de Mohammed Askia, et plus tard vers la fin du XVIe siècle au moment de la conquête marocaine, de[394] nombreuses fractions de Mandé-Dioula quittèrent le Bendougou, le Mianka et le Kénédougou et vinrent se fixer dans le Follona, le Kouroudougou, le Tagouano et surtout le Ouorodougou.
La plupart des Dioula prirent parti pour Sagoné dans la lutte contre Dabo ou Ngolo, de 1748 à 1754. Mais, à la mort de Sagoné, craignant les représailles du parti vainqueur, les colonies qui occupaient le Ségou avec une partie des Dioula du Bendougou émigrèrent à travers le Dafina et se fixèrent dans le Mossi.
Ngolo, n’ayant pas réussi à entraver le mouvement d’émigration et voyant échouer tous ses moyens de conciliation, se décida à aller leur faire la guerre pour tâcher d’obtenir des Dioula leur retour sur le Niger.
La première expédition fut impuissante et nous savons que Ngolo tomba malade et mourut pendant la seconde, en 1787.
Quand Mansong succéda à son père Ngolo, les premières années de son règne furent occupées à se disputer le pouvoir avec son frère Niancoro, puis à expéditionner contre Daisé Kouroubari et les Mali-nké du Fouladougou. Ces circonstances ayant porté, pendant près de quinze ans de règne, le théâtre des opérations de guerre vers l’ouest, il est tout naturel de voir Ahmadou Amat Labbo fonder le Macina et Sékou Ouattara créer un empire dioula à Kong ; 1790 est en effet la date de la prise de Kong par Sékou Ouattara.
Aujourd’hui les Dioula ou Dioura constituent en quelque sorte un peuple. Tous les Mandé qui ne sont pas musulmans sont pour eux des Bambara, ce qui équivaut à infidèle, mais il ne faudrait pas croire que s’il s’agissait de s’emparer du pouvoir, ils renieraient leurs compatriotes mandé et qu’ils ne seconderaient pas les Bammana ou les Mali-nké.
A part l’État mandé-dioula de Kong, il existe des régions entières peuplées de Dioula et de nombreuses colonies disséminées un peu partout. Le Djennéri, le Macina, le Mossi, le Mianka[87], le Bendougou, le Kénédougou, le Follona, le Diammara, le Tagouano, le Kouroudougou et le Ouorodougou renferment des colonies dioula très puissantes. Dans toutes les autres régions et surtout dans les centres commerciaux on trouve toujours des familles de Dioula : il y en a qui se sont infiltrées jusque vers le golfe de Guinée. On en rencontre quelques-unes à Krinjabo, et j’en ai vu une à Yacassé sur le Comoë et une autre à Mouosou (Grand-Bassam).
Quand on sait parler le mandé il est rare de ne pas trouver de gens pouvant vous servir d’interprète, surtout dans les pays où il existe un mouvement d’affaires. Le voyageur qui avec le mandé saurait parler le haoussa et l’arabe serait à même d’aller sans interprète du cap Vert en Égypte.
Le Dioula est en général musulman ; il ne s’occupe que de commerce, d’industrie et de culture. En principe, il ne fait la guerre que pour défendre l’intégrité de son territoire ou pour se venger de rapines, d’exactions ; rarement la guerre a pour but la chasse à l’esclave.
Les Dioula n’ont pas à proprement parler de tenné, et ceux qui en ont n’observent pas les sottes coutumes qui se rapportent à ces pratiques.
Ils conviennent, à Kong, que ceux qui ont imaginé la coutume des tenné étaient des gens bien simples, voire même des malins, disent-ils, car on ne trouve jamais comme tenné le bœuf, le mouton ou tout autre animal comestible, à moins qu’il ne soit d’une rareté telle qu’il soit introuvable, comme un bœuf absolument noir, n’ayant pas un poil de blanc !
[395]Quelle douce privation, en effet, que de se passer de la fantaisie de manger ou de toucher :
- Un merle métallique,
- Du vautour urubus,
- Un petit-sénégalais (oiseau),
- Du boa,
- Du trigonocéphale,
- Du lion,
- Un légume sauvage qui ne rentre jamais dans l’alimentation courante,
- Du lait de fauve,
- Ou une certaine variété de mouche !!
Les Dioula l’ont si bien compris, qu’ils ont laissé tomber les tenné dans l’oubli.
Ils se sont également affranchis de la tyrannie des griots, ces chanteurs qui pullulent à la cour du moindre souverain, et qui par les rues chantent les grossières louanges de leur maître. Aussi n’en voit-on chez eux que bien rarement, ce qui prouve un état de supériorité bien marqué sur les autres branches de la famille mandé.
Les Mandé-Dioula se marquent tous d’une façon uniforme : trois larges entailles partant des coins de la bouche et se terminant en éventail à hauteur de l’oreille. Certains d’entre eux, les Barou entre autres, ajoutent une petite virgule sur la joue gauche et quelquefois sur la joue droite. (Consulter aussi le chapitre Kong.)
NOTES :
[1]Le bonnet dit mafou a la forme d’une toque ; il est en coton brodé en losanges, de couleurs diverses. C’est la coiffure favorite de Naba Sanom et des nabiga de Waghadougou.
[2]En quittant le Soudan français je ne savais parler que le bambara, dialecte mandé sur lequel j’avais publié un petit essai en 1886 ; j’ai dû par la suite me perfectionner dans cette langue, et en arrivant à Kong je le parlais très bien. Entre temps j’avais appris le siène-ré, et en arrivant dans le Mossi je ne possédais qu’un vocabulaire d’une cinquantaine de mots mossi, ce qui était loin d’être suffisant pour s’exprimer. Mon court séjour dans ce pays et la pénurie d’interprètes m’empêchèrent de m’y perfectionner autant que je l’aurais désiré, de sorte que je ne parlais qu’imparfaitement le mossi et comprenais peu ou pas le gourounga. J’ai essayé de me constituer un vocabulaire, mais la diversité des idiomes et les nombreuses préoccupations de tout genre m’en ont empêché. Dans certains villages j’étais très embarrassé et bien moins fier que dans le Mossi, où je servais d’interprète à mes hommes.
[3]C’est la seconde fois que je trouve des arachides de cette espèce ; la première fois c’était à Niélé. Les coques sont bien pleines, comme des arachides du Cayor et de la Casamance, mais elles se différencient par leurs dimensions, qui se rapprochent des arachides de bas prix du Bas Sénégal, et par leur couleur, qui est d’un rouge sang très accentué qui les fait reconnaître immédiatement.
[4]Le bombo est une farine de petit mil passé au feu avant d’être moulu et mélangé de piments rouges pilés et délayés dans de l’eau. Cette boisson est offerte comme bienvenue aux voyageurs. Dans tous les pays du Soudan où les gens sont tant soit peu civilisés, il est de règle de ne vous poser de question sur votre voyage que lorsqu’on a bu le bombo.
[5]En mossi et en dagomba : habitation de l’imam.
[6]Le banan est un hangar couvert en chaume où se tiennent les réunions d’oisifs pendant certaines heures de la journée. Dans beaucoup de villages, ce hangar est remplacé par un échafaudage placé au pied d’un bombax (banan). C’est par extension que le hangar porte le même nom que l’arbre.
[7]Pendant cette saison il est très rare de trouver un arbre ou un endroit à portée du village pour y établir un campement ; tous les terrains sont cultivés.
[8]En mandé : sérouba.
[9]Au Sénégal on donne le nom de Petite Côte à la partie du littoral comprise entre Rufisque et l’entrée de la rivière Saloum.
[10]En mampoursa on appelle le mor’ (langue du Mossi) : moteri. Ex. : a oum la moteri, « il entend le mossi ».
[11]Il s’agit du lieutenant allemand von François.
[12]Dans le Mampoursi, on appelle le mor’ (langue du Mossi) : moteri. Ex : a oum la moteri « il entend le mor’ ».
[13]Touré est bien un diamou mandé, car il est porté par des fétichistes kagoro qui n’ont jamais mis le pied dans le Haoussa. Je fais cette observation pour les étymologistes qui pourraient dire que Touré vient de Ba-touré, homme étranger, en haoussa. On pourrait en effet supposer que le ba est tombé par l’usage, comme devant Ba-Haoussa, homme du Haoussa ; mais ici ce n’est pas le cas, Touré est bien un diamou mandé.
[14]L’expression maître est très souvent employée par les femmes à l’égard de leur mari. Jamais elles ne se permettent de l’appeler par son nom ou de l’appeler : mon mari ; quand elles parlent de lui, elles l’appellent lui, l’hôte, celui-ci, s’il n’a pas de titre connu, chef de village ou instituteur, etc. Elles disent en parlant de lui : c’est l’homonyme de Moussa, de Mouktar, etc.
[15]Ce qui veut dire : « riz blanc des deux femmes du même mari ». Cette variété de riz est bien connue dans tout le Soudan et elle est très appréciée.
[16]La propriété foncière n’existe pas : elle n’est que momentanée, la terre étant réputée appartenir au naba de Nalirougou, personne ne peut l’aliéner.
[17]Le prix des ânes varie à Oual-Oualé entre 30000 et 50000 cauries.
[18]Il pourrait très bien se faire que ces traces relativement petites soient celles d’une variété de petits hippopotames et non de jeunes animaux comme je le suppose. Cependant les noirs de tous les pays que j’ai visités citent comme mœurs particulières de l’hippopotame que dès qu’une femelle a mis bas un jeune mâle elle est forcée de fuir avec le petit pour échapper aux mâles adultes, qui tueraient le jeune. Comme à côté des petites traces je n’ai jamais observé celles de la mère, j’en conclus que si l’on n’est pas en présence d’une variété plus petite, la femelle doit abandonner son petit dès qu’il est sevré pour retourner auprès des mâles adultes, qui se tiennent dans les grands cours d’eau seulement.
[19]Mot dagomsa qui correspond à « hameau », en opposition à tenga, qui est toujours la résidence d’un naba.
[20]Le séné est un petit arbuste qui porte des fruits offrant de la ressemblance avec la mirabelle, c’est le Ximenia americana. L’épicarpe du fruit est astringent, et la pulpe est légèrement purgative. Le noyau est lisse, et l’amande douce et bonne à manger.
[21]Voyez Macrizi, Histoire des Coptes, avec traduction et annotations de Ferd. Wüstenfeld, 1845 ; Gœttingue.
[22]Bondoukou est désigné à Salaga par le mot haoussa « Bitougou ».
[23]Le sel de Grand-Bassam n’est pas très prisé par les indigènes, ses cristaux étant trop menus.
[24]L’or de ces régions est dirigé surtout sur Djenné. Tout le courant se détourne au profit de cette ville et au détriment de la côte de Guinée.
[25]Maison J. Deville, rue des Jeûneurs.
[26]J’ai appris, depuis, que c’était M. Colombel, lieutenant d’infanterie de marine.
[27]Ceux de Tourrougou et de Siripé.
[28]En gouannia : Kampantiourou ; en haoussa : Toulouwa.
[29]La famille du chef de Pambi a exercé pendant longtemps le pouvoir à Kété et aux environs. Elle s’est peu à peu retirée vers Salaga pour échapper aux exigences toujours croissantes de leur suzerain achanti.
[30]Appellation haoussa qui veut dire « village de la brousse ».
[31]Mâdougou veut dire, en haoussa, « chef de caravane, homme respectable, chef de quartier »
[32]De Kintampo à Coranza on compte trois ou quatre jours de marche, et de Coranza à Koumassi neuf ou dix, ce qui porte, d’après mes calculs, Coumassi à environ 220 kilomètres à vol d’oiseau de Kintampo.
[33]Beaucoup de Haoussa se livrent en route à la confection de nattes fort jolies en ban, ornées de dessins divers noir et rouge. Le prix d’une natte s’élève de 2000 à 3500 cauries ; elles offrent de l’analogie, comme travail, avec celles de Mourdia (Bélédougou), seulement ces dernières sont confectionnées en paille de mil au lieu de ban.
[34]Voyez, pour les causes qui engendrent l’esclavage, Esclavage, Islamisme et Christianisme du même auteur. (Paris, 1891, Société des Éditions scientifiques, 4, rue Antoine-Dubois).
[35]J’écris Tain au lieu de Tyn, comme l’écrit le capitaine anglais Lonsdale, le nom de cette rivière se prononçant partout Tain et non Tyn, qu’on est tenté de lire Tine.
[36]Marraraba ne veut pas dire en haoussa : « à mi-distance, à moitié chemin », comme l’affirme Barth. La traduction de ce mot en mandé est sirafara, « bifurcation, endroit où le chemin se partage ».
[37]Mantiala est connu par les Haoussa sous le nom de Gari Adama, « case d’Adama ».
[38]Appelé par les Haoussa : Baki n’goulbi, « bords du fleuve ».
[39]Kœlle, Grammaire vei.
Despatch communicating the discovery of a native written character at Bohmar on the western coast of Africa, near Liberia, by Lieut. Forbes R. N., with notes on the Vei language and alphabet by E. Norris Esq., London, 1849.
[40]Dans le Gondja, on désigne les Dioumma par le nom de Pantara.
[41]J’ai su le nom de mon compatriote par une de ses cartes, que j’ai trouvée entre les mains d’un marchand de Bondoukou.
[42]Plus dans le sud, dans le centre des régions aurifères, il existe encore une division plus petite, la moitié du damma : 0 fr. 10 ou 0 fr. 11 ; on pèse cette quantité avec une autre petite graine nommée pouassaba. Quand cette graine fait défaut, on se sert de grains de riz non décortiqués de grosseur moyenne, trois grains étant égaux au damma ; on en coupe une en deux, et un grain de riz et demi constitue alors le pouassaba ou kouassaba.
[43]Birindara veut dire « à l’entrée de la brousse ».
[44]Diawé partit le soir même de mon arrivée à Panamvi, 25 décembre, arriva à Kong le 29 de bon matin, ayant parcouru une distance de 200 kilomètres à vol d’oiseau en moins de quatre jours.
[45]Treich était parti d’Assinie avec 50 hommes, dont 25 miliciens armés ; en arrivant à Bondoukou, il dut renvoyer les miliciens pour cause d’indiscipline ; ils firent retour sous les ordres d’un mulâtre qui avait accompagné Treich. Les 25 autres hommes qui restaient à Treich étaient en lutte ouverte avec lui. A mon arrivée à Kong, il ne pouvait plus se faire obéir, je dus sévir énergiquement, et les mutins et meneurs, au nombre de 15, furent renvoyés sur mon instigation quelques jours après mon arrivée à Kong.
[46]Depuis j’ai appris qu’à la suite des bruits alarmants qui avaient couru sur mon compte, le colonel Galliéni, alors commandant supérieur du haut fleuve, et les officiers de Bammako ont employé tous leurs moyens d’information pour savoir la vérité sur mon sort. C’est ainsi que l’on s’était adressé à El-Hadj Mahmadou Lamine, de Ténetou, pour avoir de mes nouvelles. Comme on le voit, son envoyé est arrivé jusqu’à Bobo-Dioulasou.
[47]La terminaison krou ou kourou correspond, en lange agni, aux terminaisons sou et dougou des Mandé. L’une et l’autre veulent dire : « village de, habitation de », etc.
[48]Attakrou est le premier village de l’Indénié que l’on rencontre en venant de l’Anno.
[49]En haoussa, sansanné veut dire « camp », et Mango dans plusieurs langues, notamment en mandé, est le nom sous lequel on désigne Groûmania.
[50]Elé veut dire en agni « lieu des pirogues », et so « lieu ».
[51]Il ne faut pas en conclure que la navigation est impossible au delà. Les indigènes des villages en amont d’Attakrou ne fabriquent que les pirogues nécessaires pour passer d’une rive à l’autre et pêcher le long des rives ; elles sont trop informes pour servir à de longs trajets : c’est la seule raison pour laquelle le fleuve n’est pas utilisé.
[52]Pendant ma descente du Comoë j’ai pu me procurer toute la collection des singes vivant dans la région ; je me promettais de l’offrir au muséum de Paris, mais les uns sont morts en arrivant à Grand-Bassam, les autres à bord, et le dernier, un magnifique tié que j’avais confié à mon ami Dupuy, vétérinaire aux saphis, est mort à Dakar.
[53]Personne n’est chrétien dans cette région. Bénié Couamié possédait cette sainte image tout simplement parce que, pour lui, elle personnifiait la femme européenne.
[54]J’ai vu un cocotier à Sorobango, près Bondoukou, deux à Aniasué sur le Comoë, et deux au campement d’Aponkrou, près de Bettié.
[55]L’Akapless était appelé aussi royaume d’Aka et Atakla.
[56]On sait que Costa est l’ancien nom sous lequel on désignait le Comoë ou Akba ou rivière de Grand-Bassam.
[57]Amatifou est le chef de Krinjabo qui nous a cédé ses droits en 1842. A cette époque il avait environ trente-cinq ans ; il est mort en 1886 et a eu pour successeur son neveu Aka Simadou.
[58]En langue agni on désigne les Européens sous le nom de Borofoé et les peuples de l’intérieur en général sous le nom de Zorofoé.
[59]Dans la convention de délimitation franco-anglaise du 10 août 1889, la frontière française part à 1000 mètres à l’ouest d’Afforénou ou Newtown, sur le bord de la mer, suit la rive droite de la lagune Tendo et Éhy, puis la rive droite du Tanoë jusqu’à Nougoua. A partir de ce point, la ligne frontière suivra le 5e degré de latitude en tenant compte des traités passés et en suivant exactement la limite des États à cheval sur le 5e degré.
[60]Les noms de plusieurs d’entre ces îles ont été, par suite des reproductions successives, ou changés, ou légèrement tronqués. C’est ainsi que la petite île Leydet se nommait île Jonnon. L’île Audric, située en face de la baie de Dabou, avait été baptisée île Aubry, etc.
[61]Piter est un surnom. Ce chef s’appelait, en langue agni, Atékébré. C’est lui qui nous concéda nos droits sur Grand-Bassam. Son successeur se nommait Assama, auquel succéda le chef actuel Blé, d’origine zemma (Apolloniens).
[62]La manille est une monnaie qui a cours dans toute la lagune d’Ébrié et dans le Comoë près de son embouchure ; elle n’a pas cours à Assinie. C’est un bracelet en alliage de cuivre et d’étain que l’on fabrique à Manchester et à Nantes ; il a une valeur de 20 à 23 centimes. Quand on achète des produits aux indigènes, on les paye en manilles, qu’ils viennent ensuite échanger contre des marchandises aux factoreries au fur et à mesure qu’ils en ont besoin.
[63]Buonfanti a fait une conférence sur son voyage à la Société de géographie royale belge à Bruxelles. Elle est publiée dans son Bulletin de 1884. Accusé d’imposture, Buonfanti n’a jamais pu se disculper de l’accusation lancée contre lui, et n’a jamais pu donner des preuves sérieuses sur la véracité de son récit. Il est mort récemment au Congo.
[64]C’est avec intention que je n’ai pris des objets connus des indigènes que dans une aussi faible proportion. Rien ne flatte le noir comme de recevoir un cadeau ou d’acheter un objet ou une étoffe que l’on ne peut se procurer nulle part. Le noir, comme nous du reste, aime les nouveautés, il se laisse séduire par tout ce que son voisin ne pourra peut-être jamais se procurer. Il est heureux de pouvoir dire : « J’ai acheté un objet dont personne ne connaît le nom ».
[65]J’avais emporté, en prévision d’une captivité chez un des rois de l’intérieur, des semences des principaux légumes d’Europe, afin de me permettre d’améliorer mon ordinaire.
[66]Serki veut dire « chef » en haoussa.
[68]Les Mandé sont aussi désignés par d’autres peuples sous le nom de Wakoré, Wangara, Sakhersi, Sakhayerski, etc., et surtout par le nom générique de Dioula.
[69]C’est à tort qu’on écrit Sousou, Soussou, Sozo ou bien encore Susu ; le vrai nom des habitants du Rio Pongo est Soso (prononcez Soço). (Note du R. P. Raimbault, Catéchisme français-soso. Mission du Rio Pongo, 1885.)
[70]Nom par lequel les Haoussa désignent les Mandé.
[71]Nous pensons que la dénomination Ghanata ne s’appliquerait pas exclusivement au Baghéna ou Bakhounou actuel ; l’empire était à cheval sur les deux rives du Niger. Dans le Mossi on m’a souvent désigné la région de Douentsa sous le nom de Garnata.
[72]Barth et d’autres écrivains, tels que Léon l’Africain (traduction de Jean Temporel), appellent souvent les Wakoré (plus tard Sonni-nké) du nom d’Assouanek ; il ne faut pas trouver dans ce nom l’étymologie de Sonni-nké, car ce nom ne leur a été octroyé que plus tard, comme nous le verrons par la suite, mais il faut le traduire par اسّوع نك, c’est-à-dire Assoua-nké, « hommes de l’Assoua ». L’Assoua est encore une province voisine du Fermagha (rive gauche du Niger au sud de Tombouctou).
[73]Encore aujourd’hui les Sonni-nké se désignent par le nom de Séré-khollé, hommes blancs, nom qui, corrompu, est devenu le Sérewoulé, Serécollé ou Sarakollet.
[74]Ebn Khaldoun, tome II, page 110, dit au sujet de cette nouvelle famille ; « On rapporte que du côté de l’Orient les Ghana avaient pour voisins les Sousou ou Ceuseu صوصو سوسو »
[75]Le sultan de la cour duquel les deux frères s’échappèrent était vraisemblablement, d’après Barth et Rolfs, Mansa Magha Ier. Sonni Ali Kilnou est donc arrivé au pouvoir vers 1335 et 1340 : et la fin de la première dynastie de Za remonte donc à cette même époque.
[76]Touré est un nom de famille que l’on retrouve non seulement dans les familles Mali-nké-Kagoro, mais encore chez les Dioula, et surtout chez les Haoussa. Les Touré et les Sissé sont encore fort nombreux dans les provinces nord du Sokoto, sur les confins du Zamberma ou Zaberma.
[77]Sous le règne de Mansa Sliman, en 1359, il existe déjà dans le Ségou un Ouarraba Koy, ce qui veut dire un chef diara ; ouarraba, lion, fauve, étant le synonyme de Diara. A la même époque nous y voyons aussi un Sama Koy, c’est-à-dire un chef sama-nké, c’est-à-dire d’origine bammana.
[78]Le parti de Ngolo ou Dabo était composé : 1o de Bambara ; 2o des Ouled-Masouk, tribu noble des Ouled-Embarek ; 3o des Ahel-Semborou, fraction de Foulbé (qui venaient de se fixer dans le Bakhounou) ; 4o d’importantes fractions de Sonni-nké Diawara.
Le parti de Sagoné était composé : 1o des Rouma, conquérants marocains qui occupaient une partie du pays et s’étaient mariés et fusionnés avec les indigènes ; 2o des Zénagha ; 3o des Ouled-Alousch, la fraction la plus guerrière des Ouled-Embarek ; 4o des Ahel-Massa ou gens de Saro, fraction de Sonni-nké ; 5o de Mandé-Mali-nké. Voyez Barth, tome V, édition allemande, appendice I, page 511.
[79]Docteur Quintin. — Étude ethnographique sur les pays entre Sénégal et Niger. — Société de Géographie de Paris.
[80]C’est ce même Daisé Kouroubari qui régnait dans le Kaarta à l’époque du passage de Mungo-Park (1796), et l’on peut voir dans la relation de voyage de Park que ce pays était en guerre avec le Ségou.
[81]Mansong régnait à Ségou au premier et au second voyage de Mungo-Park.
[82]Cf. docteur Quintin.
[83]Massa dans beaucoup de pays mandé veut dire « roi ». A Kong on ne se sert aussi de ce titre pour désigner le souverain.
[84]Comme il y a de nombreuses familles portant le nom de Kouroubari, les membres de la famille royale descendant de Sébé Kouroubari font suivre leur nom du titre massa-si (graine de roi, descendant de roi).
[85]Nous avons souvent pensé que les Sousou des historiens arabes ne seraient peut-être autre chose que les Sissé. A ce sujet, nous avons demandé à M. René Basset de vouloir bien consulter les textes anciens. Le savant professeur, après examen, a conclu que, les points diacritiques ne faisant pas défaut, il fallait rejeter cette hypothèse.
[86]Touré veut dire « éléphant » en sonni-nké ; leur tenné est l’éléphant comme les Sama-nké chez les Bammana.
[87]Caillé en traversant le Mianka dit : « Ce pays est habité par des Mandingues Diaula ou Yola », ce sont les Dioula ; du reste, toutes les régions que je viens d’énumérer sont aussi connues sous le nom générique de Diouladougou.
[397]
[398]
[399]
[400]
[401]
[402]
[403]
[404]
[405]
[406]
PROFILS.

10o. De Sagoué à Tourmountiou
11o. De Tourmountiou à la Volta Noire
12o. De la Volta Noire à Nasian
[407]
PROFILS.

13o. De Nasian au Camp de Kinguéné
14o. Du Camp de Kinguéné à Zanzanzo
15o. De Zanzanzo à Attakrou
[408]
[409]
[410]
[411]
TATOUAGES No.4.
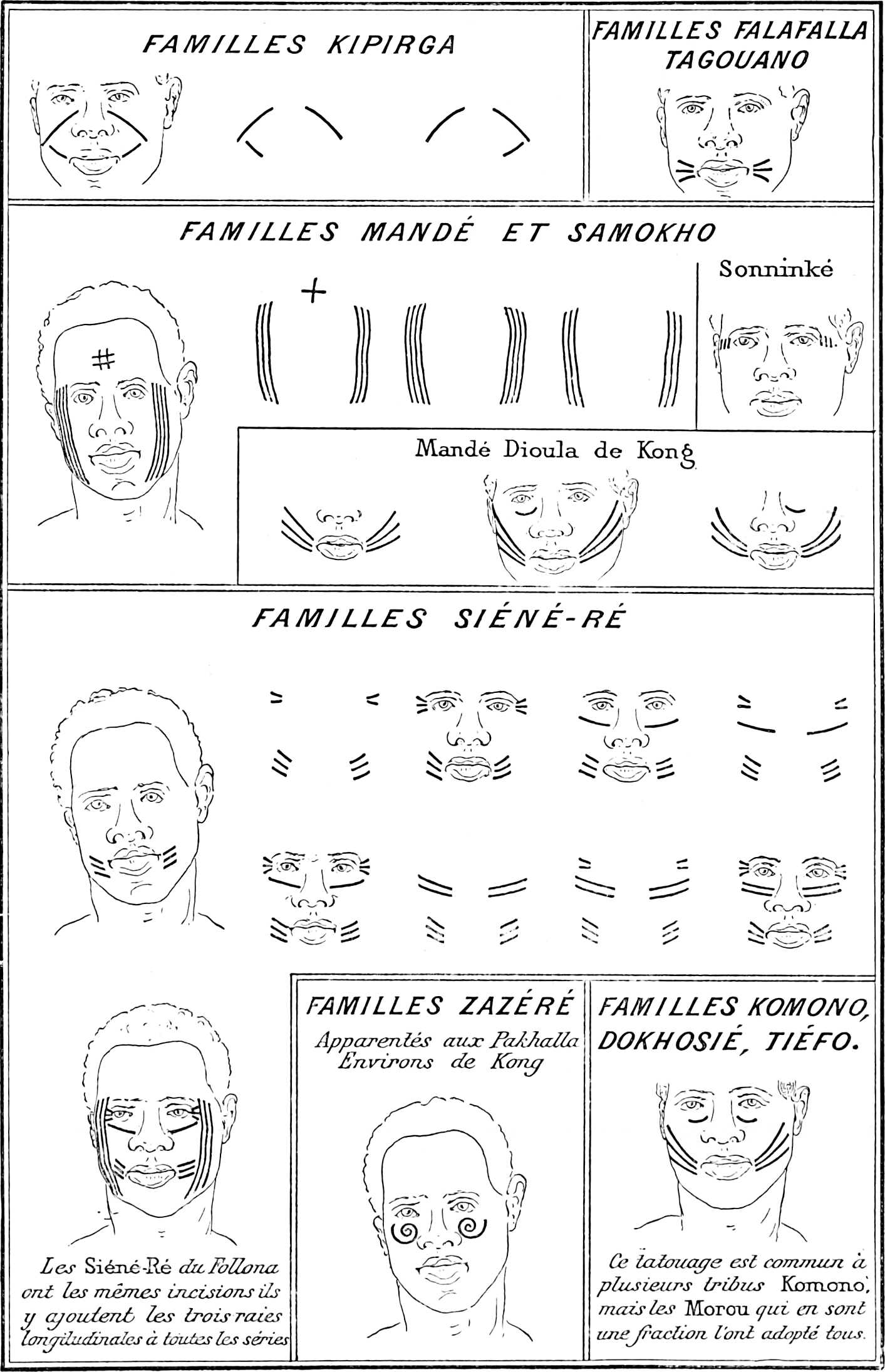
FAMILLES KIPIRGA — FALAFALLA TAGOUANO — MANDÉ ET SAMOKHO — SIÉNÉ-RÉ — ZAZÉRÉ — KOMONO, DOKHOSIÉ, TIÉFO
CARTE
DU HAUT-NIGER AU GOLFE DE GUINÉE
PAR LE PAYS DE KONG ET LE
MOSSI
levée et dressée de 1887 à 1889
par L. G. BINGER, Capne. d’Infrie. de
Marine
par ordre
de m. ETIENNE, Sous-Secretaire d’Etat des Colonies.
Carte des lagunes
DE GRAND BASSAM ET D’ASSINIE
d’après les travaux du Capitaine BINGER
et les travaux hydrographiques les plus récents.
1889
COURS INFÉRIEUR
DE LA
RIVIÈRE COMOÉ OU AKBA
levé à la boussole
par le Capitaine G. BINGER
1889
| BINGER — DU NIGER AU GOLFE DE GUINÉE. | HACHETTE & Cie. |

| Gravé par Erhard Fres., 35bis. Rue Denfert-Rochereau, Paris. | Imp. Dufrenoy, 49, rue du Montparnasse, Paris. |
(Agrandissement : p. sup. gauche — p. sup. droite — p. inf. gauche — p. inf. droite)
[413]TABLE DES GRAVURES
| Iguanes dans le village | 3 |
| Le naba de Koumoullou et ses griots | 7 |
| Ces sauvages nous suivent presque en rampant | 13 |
| L’un des hommes saisit la bride du cheval de Diawé | 19 |
| L’ombrelle | 21 |
| Diawé et trois ânes entraînés par le courant | 23 |
| Passage de la Volta Blanche | 29 |
| Construction sacrée de Gourounga | 39 |
| Jeunes filles portant la dot | 43 |
| Sous le banian | 47 |
| Tacca involucrata | 51 |
| Arrivée d’une bande de Mossi | 53 |
| Retraite aux flambeaux | 59 |
| Marche dans la prairie inondée de Louaré | 63 |
| Visite au naba de Karaga | 67 |
| Rixe menaçante | 71 |
| La danse | 75 |
| Touloucouna (Carapa guineensis) | 79 |
| Un tchilago | 81 |
| Vue de Salaga | 89 |
| Une mosquée de Salaga | 93 |
| Plan de Salaga | 95 |
| Le marché de Salaga | 97 |
| Captifs portant du bois | 101 |
| Marchand fascinant un client | 105 |
| Mules du Haoussa | 111 |
| Les cases de Tourmountiou | 121 |
| Konkronsou | 124 |
| L’oasis marécageuse | 125 |
| Le village de Konkronsou | 127 |
| La forêt de Konkronsou | 131 |
| La poupée de Kounchi | 133 |
| Kintampo | 137 |
| Kintampo et le tronc gigantesque | 139 |
| Kintampo, quartier achanti | 141 |
| Chute d’eau de Takla | 147 |
| Campement dans la brousse | 157 |
| Mosquée de Sorobango | 158 |
| Une rue de Bondoukou | 159 |
| [414]Habitation de Sitafa (vue extérieure) | 163 |
| Habitation de Sitafa (vue intérieure) | 165 |
| Bondoukou | 167 |
| Bain forcé | 171 |
| Un coin d’Amenvi | 173 |
| Ardjoumani et ses fils, roi de Bondoukou | 175 |
| Départ des agents d’Ardjoumani | 181 |
| Types de Ton avec leur ombrelle | 185 |
| Femmes portant de gigantesques bonbonnes de vin de palme | 191 |
| Village pakhalla | 195 |
| M. Treich-Laplène | 201 |
| Visite de condoléance chez Lansiri, à Kong | 203 |
| Femmes puisant de l’eau au Comoë | 219 |
| Croquis de Mango | 221 |
| Aouabou : la demeure royale | 225 |
| Un Gan-ne dans la forêt | 229 |
| Un indigène de race agni faisant sa toilette | 231 |
| Un malade en consultation | 233 |
| Type d’un village gan-ne ou agni | 235 |
| Kommona Gouin | 237 |
| Palabre à Aouabou : signature du traité | 239 |
| En route pour Attakrou | 245 |
| Portes sculptées | 251 |
| Dans le hamac, au milieu des fourrés | 253 |
| Bords du Comoë à Attakrou | 259 |
| Couché dans la pirogue | 263 |
| Habitation à l’européenne avec couvertures en palmes à Bettié | 267 |
| La forêt | 269 |
| Réception de Bénié Couamié | 283 |
| La flottille au départ | 289 |
| Chutes d’Amenvo | 293 |
| Baoto | 297 |
| Arrivée au Diamant | 301 |
| M. Bidaud | 305 |
| Factorerie Verdier à Grand-Bassam. (D’après une photographie de M. Ch. Alluaud.) | 309 |
| Piroguiers kroumen. (D’après une photographie de M. Ch. Alluaud.) | 311 |
| Castor, interprète du gouvernement à Assinie | 315 |
| Plantation de café d’Élima, sur la lagune Aby. (Photographie de M. Ch. Alluaud.) | 317 |
| Un traitant de la Côte de l’Or. (Photographie de M. Ch. Alluaud.) | 319 |
| Village sur la lagune. (Photographie de M. Ch. Alluaud.) | 327 |
| Jeune fille de la lagune. (Photographie de M. Ch. Alluaud.) | 331 |
| Sierra Leone | 341 |
| Croquis de Waghadougou | 397 |
| Densité de population | 398 |
| Religions | 399 |
| Peul et Mandé | 400 |
| Voies commerciales | 401 |
| Limites de culture | 402 |
| Profil | 403, 404, 405, 406, 407 |
| Tatouages | 408, 409, 410, 411 |
[415]TABLE DES CHAPITRES
| Chapitre X. — En route pour le Gourounsi. — Baouér’a. — Arrivée à Koumoullou. — Habitations gourounga. — Une audience chez le naba de Koumoullou. — Une scène de carnage. — Deux fables mandé. — Une étape dans les hautes herbes. — Ruines de Zorogo. — Hostilité des habitants de Kalarokho. — Arrivée à Tiakané. — Chef de village peu commode. — Départ pour Kapouri. — Nous sommes dans une triste situation. — Attaque à main armée entre Kapouri et Pakhé. — Encore des exigences du chef de Mîdegou. — Abandonné par les guides. — Étape à Sidegou. — Arrivée sur les bords de la Volta Blanche. — Renseignements sur cette branche de la Volta. — Arrivée à Oual-Oualé. — Entrée dans le Mampoursi. — Une grave indisposition me retient à Oual-Oualé. — L’almamy, mon hôte et les habitants. — Encore le Gourounsi. — Population. — Religion. — Le Gambakha. — Population du Mampoursi. — Oual-Oualé et son commerce. — Dispositions pour le départ sur Salaga. | 1 |
| Chapitre XI. — Départ de Oual-Oualé. — Voyage dans des terrains inondés. — Karaga. — Incidents de voyage, difficultés causées par les pluies. — Arrivée à Pabia. — Les Dagomba. — Passage de la rivière de Palari. — Entrée dans le Gondja. — Dokonkadé. — Arrivée à Salaga. — Les pèlerins de la Mecque. — Bakary, mon hôte. — Position de Salaga. — Les habitations. — Les quartiers de la ville. — Le marché. — Le commerce d’eau et de bois. — Articles d’importation et d’exportation. — Valeur de l’or et de l’argent. — Nouvelles de Kong. — Je communique avec la Côte des Esclaves. — Renseignements sur le cours du Comoë. — Les Ligouy. — Arrivée de quelques caravanes de Haoussa. — Les mulets du Haoussa | 61 |
| Chapitre XII. — Les Gondja. — Leur histoire. — Insalubrité de Salaga. — Choix d’un itinéraire. — Superstitions des indigènes. — Départ pour Kintampo. — Sur les bords de la Volta. — Traces du passage de von François. — Mesure du temps chez les indigènes. — Belle végétation. — Les droits de douane. — Marais de Konkronsou. — Végétation splendide. — Arrivée à Kounchi, premier village achanti. — Kâka. — La feuille à emballer le kola. — Kintampo. — Mon hôte Sâadou. — Diawé à la recherche du miel. — Une visite chez le chef achanti. — Curieuses habitations. — Le marché. — En marche avec les Haoussa. — Avenir de Kintampo. — Départ pour Bondoukou. — Itinéraire de Takla à Koumassi. — Territoire des Diammoura. — Sur les bords de la Volta. — J’apprends l’arrivée d’un blanc qui est à ma recherche. — Arrivée à Tasalima (village ligouy). — Massif de Kourmboé. — Encore la Volta. — Les Dioumma ou Diammou ou Diammoura. — Deux étapes dans la brousse. — Tambi. — Sorobango. — Entrée à Bondoukou. — Nouvelles de Treich-Laplène | 113 |
| Chapitre XIII. — Les divers noms du Bondoukou. — Son histoire. — Description de la cité. — Le marché. — Insalubrité de l’eau. — Des diverses sauces. — De l’or, du mitkal et de ses subdivisions. — Articles d’importation et d’exportation. — Départ pour Amenvi. — Les États d’Ardjoumani. — Un village où l’élément féminin domine. — Arrivée à Amenvi. — Une audience d’Ardjoumani. — Bizarre moyen de locomotion employé par les chefs agni. — Ethnographie. — Costumes. — Habitations. — Coutumes. — Départ pour Kong. — Beauté de la végétation. — Arrivée à Panamvi. — Rencontre avec des gens de connaissance de Kong. — Arrivée sur les bords du Comoë. — Encore un[416] village où il n’y a que des femmes. — 1er janvier 1889. — Des singes. — Mines d’or de Samata. — Koniéné et Kolon. — Détour à Kong. — Rencontre avec Treich-Laplène. — Visites à mes amis. — Nous signons un traité. — Envoi des courriers. — Nouvelles d’un courrier parti à ma recherche. — Adieux de la population. — Visite de l’almamy. — Recherches ethnographiques. — Entrée dans le Djimini. — Départ de Diawé | 161 |
| Chapitre XIV. — Dans le Djimini. — Ethnographie. — Dakhara. — Industrie, commerce. — Les régions limitrophes. — Kamélinsou. — Le Comoë. — Premières plantations de kolas. — Arrivée dans la capitale de l’Anno. — Honnêteté proverbiale des habitants de l’Anno. — Industrie, commerce, agriculture. — Départ pour Aouabou. — La marmite fétiche. — Population de l’Anno. — Mœurs, coutumes, armes, ustensiles. — Un mot sur Sansanné-Mango. — Entrevue avec Kommona Gouin. — Palabres. — Histoire de l’Anno. — Routes commerciales. — Un animal inconnu. — Appellations agni pour l’or. — Départ d’Aouabou. — Entrée dans la grande forêt. — Un mal gênant. — Les mines d’or. — Le fouto. — Rencontre de Gan-ne. — Voyage en hamac. — Bizarre médication indigène. — Comment on voyage dans la forêt. — Longues et pénibles étapes. — Arrivée sur les bords du Comoë | 213 |
| Chapitre XV. — Attakrou. — En quête de pirogues. — Descente du Comoë. — Incidents de navigation fluviale. — Séjour à Kabrankrou. — Départ par terre pour Aniasué. — Toujours l’imposante forêt. — Illusion d’ouïe. — Aniasué. — Les singes de l’Indénié. — Départ des pirogues. — L’Indénié, limites, population. — Nous longeons le Morénou et l’Attié. — Cérémonie funèbre agni. — L’Alanguona. — Abandonnés par les piroguiers. — Bettié et Bénié Couamié. — Une maison à l’européenne. — Mon premier verre de vin. — Départ pour Malamalasso. — Chutes et rapides. — Daboisué. — Deux étapes à pied. — Malamalasso. — Arrivée de Baoto. — Difficultés constantes nées de coutumes bizarres. — La société agni. — Pénible navigation de nuit. — Nous atteignons le Diamant. — Arrivée à Grand-Bassam. — Accueil à la factorerie Verdier. — Le capitaine au long cours Bidaud. — Mes compagnons noirs | 257 |
| Chapitre XVI. — Arrivée de l’aviso l’Ardent. — Détails sur Grand-Bassam. — La barre. — Les piroguiers. — L’embouchure du Comoë et les mouillages. — L’Akapless. — Le Sanwi et la rivière Bia. — La lagune Aby. — Krinjabo. — Le Tanoé ou Tendo. — L’Ahua ou Apollonie. — Départ pour la lagune Ebrié. — Abra. — L’Ebrié. — Abidjean et les pêcheries. — Rivière Ascension. — Arrivée à Dabou. — Visite au poste et au jardin. — Rivière Isi. — Les Bouboury. — Le Bandamma ou Lahou. — Renseignements sur la côte de Krou et sur les peuples de l’intérieur. — Le Baoulé, l’Attié, le Morénou. — Départ de Dabou, les Jack-Jack. — Petit-Bassam. — Treich est gravement malade. — Retour à la factorerie. — Nous sommes nommés chevaliers de la Légion d’honneur. — Nous nous embarquons sur la Nubia. — Retour en France | 307 |
| Conclusion. — Étendue de nos possessions. — Causes de la dépopulation. — Moyen d’y remédier. — Résultats à attendre de la pénétration. — Richesse de notre domaine colonial. — Moyen de l’exploiter | 343 |
| Appendice I. — Notice sur mes travaux topographiques et l’établissement de la carte. — Valeur de certaines terminaisons et énumération de quelques termes géographiques usités en mandé, en haoussa, en mossi, etc. Permutation des consonnes | 349 |
| Appendice II. — Renseignements sur l’organisation de la mission. — Énumération des achats faits avant le départ. — Dépenses de la mission | 354 |
| Appendice III. — Bulletin météorologique. — Tableau comparatif des pluies entre le bassin du Niger et celui de la Volta. — Saisons. — Observations sur le climat | 357 |
| Appendice IV. — Flore et faune | 362 |
| Appendice V. — Liste des rois sonr’ay de la première dynastie. — Liste de la deuxième dynastie. — Notes sur l’histoire générale de la dynastie sonr’ay-mandé. — Famille mandé. — Famille sonninké. — Famille mandé-bammana. — Famille soso ou sousou. — Famille mandé-mali. — Famille mandé-dioula | 367 |
22062. — Imprimerie Lahure, 9. rue de Fleurus, à Paris.
Note du transcripteur :
- Page 145, " .ambeau à mes itinéraires " a été remplacé par " lambeau "
- Page 146, " il se perd en mains endroits " a été remplacé par " maints "
- Page 177, " le non d’Asikkaso " a été remplacé par " nom "
- Page 189, " et ui donnais quelques " a été remplacé par " lui "
- Page 200, " pour aller me raviltailler " a été remplacé par " ravitailler "
- Page 205, " servir de son expresssion " a été remplacé par " expression "
- Page 206, " Haoussa résidant à Tong-i " a été remplacé par " Tiong-i "
- Page 216, " ’Indénié ou le Baoulé " a été remplacé par " l’Indénié "
- Page 330, " meublé leurs apppartements avec " a été remplacé par " appartements "
- Page 364, " 28 mars 17-avril 1599 " a été remplacé par " 28 mars-17 avril 1599 "
- Page 364, " le tasert aussi de monnaie " a été remplacé par " le tabac sert aussi "
- Page 366, " gros sepents, boas " a été remplacé par " serpents "
- Dans l’Appendice V, quelques mots mal transcrits à partir de la source citée au début ont été laissés tels quels.
- Page 371, " Mansa Mouça ou Koukour Mouça " a été remplacé par " Konkour "
- Page 371, " Koma veut : dire " a été remplacé par " Koma veut dire : "
- Page 372, " dehors de Koukour Mouça " a été remplacé par " Konkour "
- Page 381, " trouvons dans Ahmel Baba " a été remplacé par " Ahmed "
- Page 382, " il eut pour succcesseur " a été remplacé par " successeur "
- Page 382, " du wolof, de l’arabe-hassiana " a été remplacé par " l’arabe-hassania "
- De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d’orthographe ont été apportés.
- La page de couverture, créée expressément pour cette version électronique, a été placée dans le domaine public.