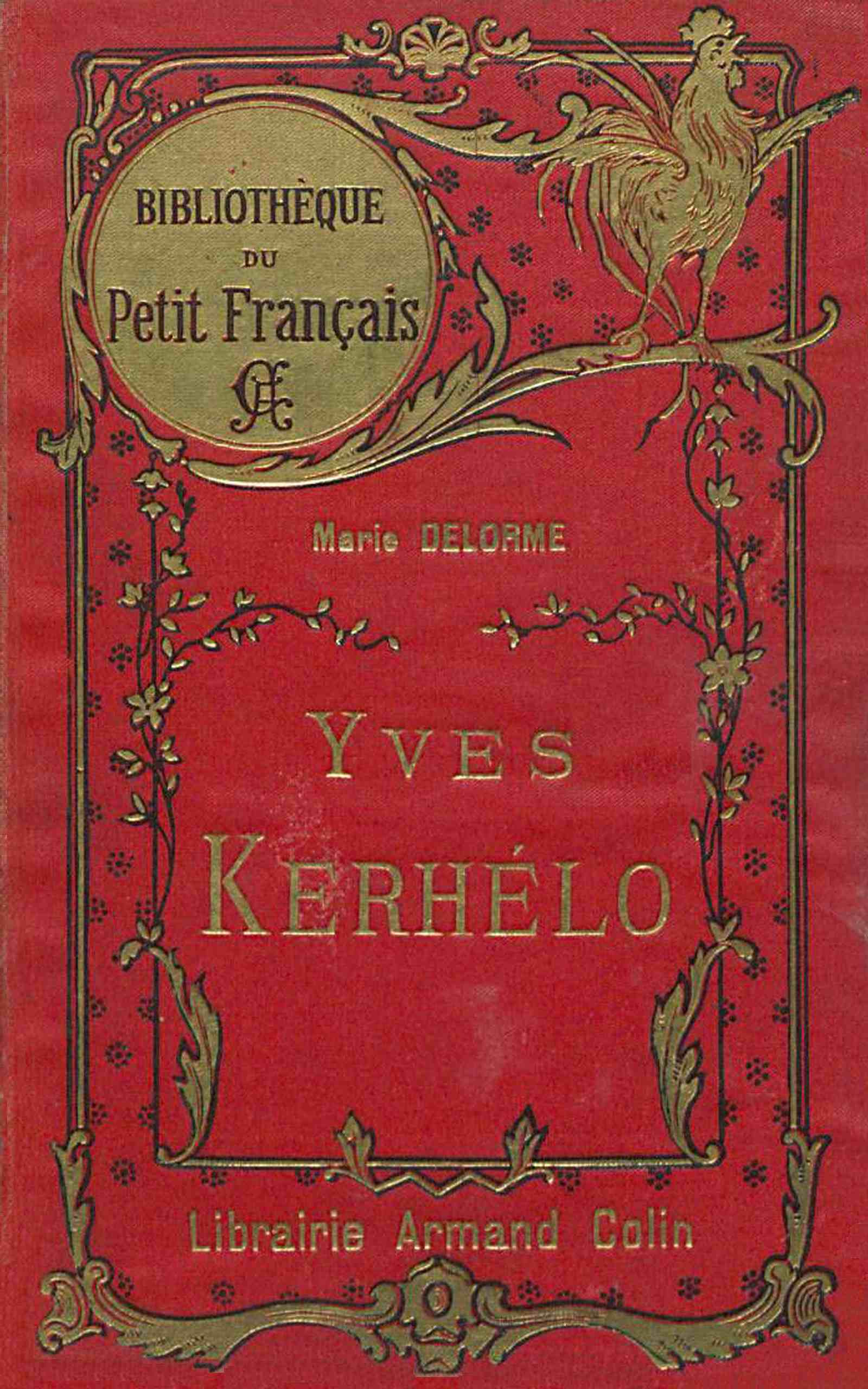
Title: Yves Kerhélo
Author: Marie Delorme
Illustrator: Georges Scott
Release date: December 12, 2024 [eBook #74884]
Language: French
Original publication: Paris: Armand Colin, 1904
Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the bibliothèque numérique de l'Université Clermont Auvergne)
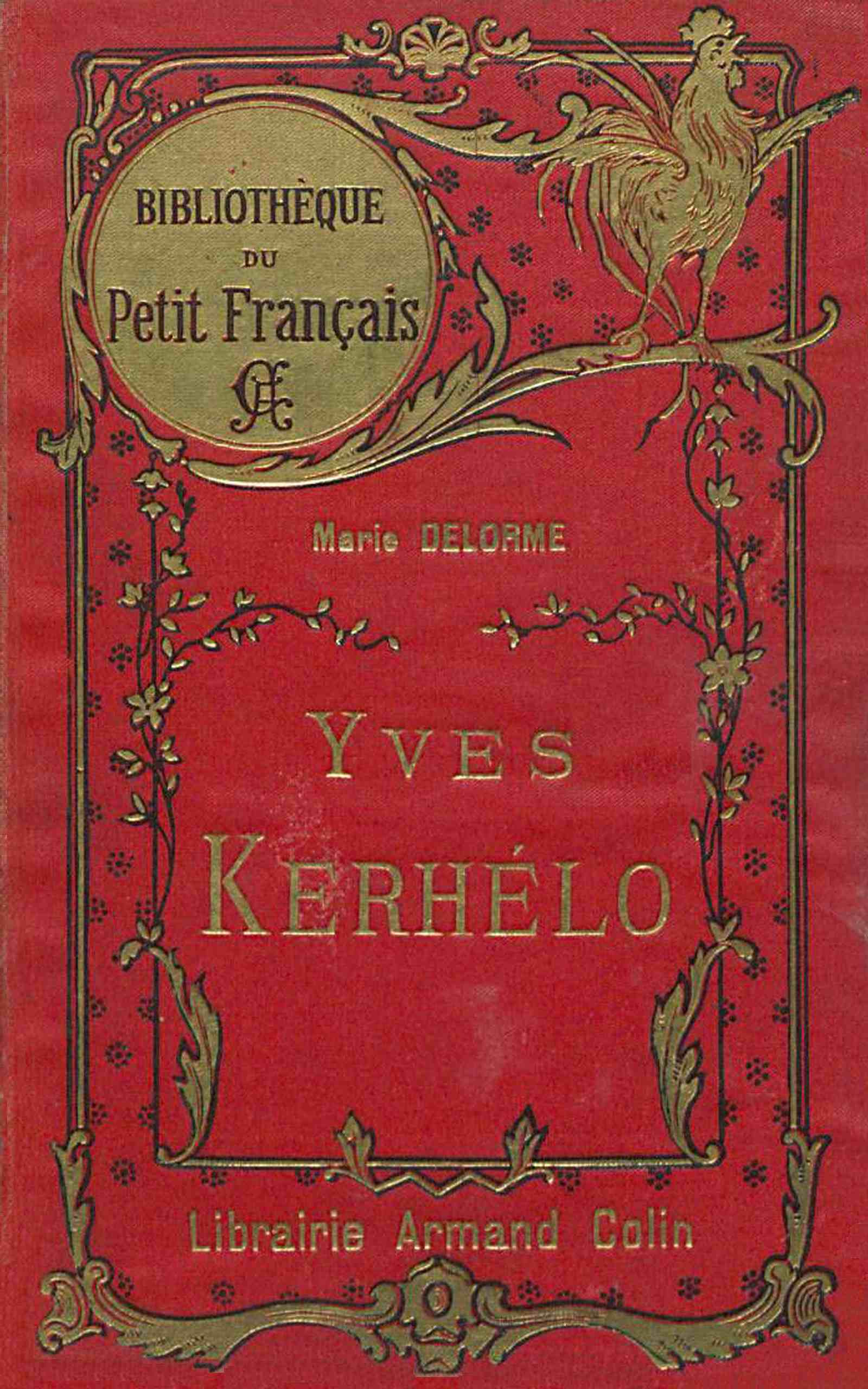
Marie DELORME
Illustration de G. SCOTT
TROISIÈME ÉDITION
LIBRAIRIE ARMAND COLIN
PARIS, 5, RUE DE MÉZIÈRES, 5
1904
Tous droits réservés.
BIBLIOTHÈQUE DU PETIT FRANÇAIS
Volumes in-18 jésus, brochés : 2 fr. ; reliés toile, tranches dorées : 3 fr. Richement illustrés.
Envoi franco, sur demande, du Catalogue Bibliothèque du Petit Français.
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays, y compris la Hollande, la Suède et la Norvège.
A
M. HENRI V…
Enseigne de vaisseau.
Mon cher enfant,
Il m’est très doux — et il n’est que juste — d’inscrire ton nom en tête de ce petit volume qui t’appartient autant qu’à moi.
Une anecdote racontée par toi m’en a fourni le sujet ; tes souvenirs et tes observations ont dicté les traits de mœurs ; tes descriptions ont su me montrer le paysage comme s’il était devant mes yeux.
Ensemble, pendant des heures charmantes, nous avons lu, relu, corrigé notre œuvre jusqu’à ce qu’elle nous semblât parfaite et surtout sans ombre d’inexactitude ou même d’invraisemblance. En l’offrant à la jeunesse de notre cher pays, nous pouvons dire comme le vieux Montaigne :
Quimper, 1891.
YVES KERHÉLO
Sur un ciel bleu, très bleu, des nuages légers, d’un gris doux et lumineux, s’envolaient, poussés par le vent d’est ; les ajoncs aux fleurs d’or embaumaient la lande de leurs senteurs aromatiques, et le gai soleil d’une matinée de juin commençait à boire les gouttes de rosée tremblant aux brins d’herbe. Là-bas, dans le clocher à jour de la vieille église, les cloches tintaient gaîment pour saluer le petit cortège qui venait d’arriver. C’était pour un baptême… En avant, marchaient le parrain et la marraine parés de leurs plus beaux atours, puis le poupon, dans les bras d’une bonne femme toute ridée, sa grand’mère sûrement, et enfin le père, un robuste pêcheur hâlé par le vent de mer ; il donnait la main à une fillette de six à sept ans, gentille à croquer, avec sa jolie petite figure ronde et rose, sortant de la large collerette plissée des Fouesnantaises. Elle portait, comme la marraine, la coiffe aux larges ailes, le petit corset de drap, lacé de cordons bariolés et le jupon en drap noir, lourd et épais, avec son bourrelet à la taille et ses gros plis, tombant tout droit. Elle trottinait à côté de son père dont elle serrait la main bien fort, car l’idée de la cérémonie qui allait se passer lui causait une certaine anxiété.
— Qu’est-ce qu’on va faire au petit frère ? demanda-t-elle d’une voix timide, quand on eut pris place dans l’étroite chapelle, auprès des fonts baptismaux : une cuve de granit qui, depuis bien des siècles, avait vu sur ses bords les enfants du pays, à leur entrée dans cette vie.
— Chut ! lui dit son père. Regarde et tais-toi.
Le petit frère fut très sage, et tout se passa à merveille, le parrain et la marraine se montrèrent généreux ; les bambins réunis devant le portail se partagèrent fraternellement les dragées et les taloches, et Yves Kerhélo n’eut qu’à se louer de ses premiers pas sur la scène de ce monde où il devait connaître de si étranges vicissitudes.
C’était pour le moment un beau poupon qui promettait de devenir un joli gars. Sa naissance avait comblé de joie toute la famille : Stenic[1] Kerhélo était si désolé de n’avoir qu’une fille ! On fêta joyeusement le baptême, on vida force pichets de cidre, force verres de vin, sans oublier des coups d’eau-de-vie réitérés. On avait acheté des gâteaux de toutes sortes chez les pâtissiers de Quimper, et Corentine, la petite sœur, n’oublia jamais les magnificences de ce régal princier.
[1] Étienne.
Ce brillant souvenir effaça même celui du grand mal de cœur et d’estomac dont elle avait souffert toute la nuit pour y avoir trop fait honneur.
Pendant bien des années le temps marcha d’un pas uniforme pour la famille Kerhélo. Le père, hardi marin, faisait bonne pêche ; la mère cultivait le petit champ, tenait la maison en ordre, menait la vache au pré, lavait, raccommodait ; Corentine allait à l’école et s’y montrait si travailleuse, si intelligente, que ses maîtresses l’avaient prise en amitié et poussaient vivement ses études. Quant à notre ami Yves, il avait passé des robes aux culottes, des culottes aux pantalons, sans perdre sa bonne figure joufflue, toute couronnée de cheveux bruns bouclés. Il suivait l’école, lui aussi, apprenait vite et bien ce qu’on lui montrait et sa vie se serait écoulée sans grands soucis, s’il n’avait eu des goûts aventureux qui le conduisaient parfois à de fâcheuses extrémités. Les jours de congé surtout étaient désastreux. Trop bon écolier pour faire l’école buissonnière pendant la semaine, il se rattrapait largement le dimanche. Aussitôt sorti de la messe, il courait chez lui se munir d’un gros croûton de pain ou d’une douzaine de crêpes, et partait pour ne plus revenir qu’à la tombée de la nuit ;… dans quel état, grand Dieu !
Un jour, son camarade Alain et lui — il était accompagné dans toutes ses expéditions par le plus fidèle, le plus docile, le plus dévoué des amis, Alain Le Pennec, fils du charron — étaient rentrés trempés de la tête aux pieds, ruisselants d’eau de mer, les mains écorchées, les pieds ensanglantés ; il était neuf heures du soir !
Le mère Kerhélo et Katel Le Pennec les attendaient à moitié folles d’inquiétude, et Corentine, en larmes, égrenait son chapelet avec une ardeur fiévreuse, à genoux sur la pierre, devant la bonne Vierge en faïence attachée au grand lit fermé.
— D’où venez-vous, bandits ?
— Qu’est-ce que vous avez fait, mauvais gars ? s’écrièrent les deux mères furieuses, et une grêle de soufflets bien appliqués vint tomber sur les oreilles des délinquants.
— Nous venons de Kerbaader, dit Alain à moitié suffoqué.
— Non, de Mousterlin, balbutia Yves, reprenant haleine entre deux bourrades.
— Qu’est-ce que vous êtes allés tracasser par là ?
— C’est un bateau ! gémit Alain dont les dents commençaient à claquer.
— Un bateau superbe ! s’écria Yves, ou plutôt un morceau de bateau. C’est moi qui l’ai découvert l’autre jour à marée basse dans les roches. Il y a de tout ! du bois de teck[2], du cuivre, du fer ! on ferait un canot avec ce qui reste ! Il est envasé, et je ne suis pas assez fort pour le tirer d’où il est ; alors j’ai dit à Alain de venir avec moi et d’apporter des outils. Nous allons le dépecer. Nous avons commencé tantôt, mais c’était grande marée, la mer a monté si vite et si fort que nous ne nous en sommes pas aperçus, et puis, tout d’un coup, elle a soulevé l’épave : nous avons culbuté, — il fallait voir ça ! — une grosse lame, oh ! grosse comme je n’en ai jamais vu, a passé par-dessus moi… zzzounnn ! Je me suis cramponné au rocher, j’ai crié à Alain : « Tiens-toi bien ! » et il a tenu bon, et nous voilà !
[2] Bois des Indes très dur qu’on emploie dans la construction des navires.
— Oui, vous êtes de jolis garçons ! et beaux à regarder !
— Oh ! j’ai mes souliers ! dit Yves, je les ai rattrapés au fond de l’eau et je les ai rapportés sur mon cou, parce que je ne pouvais plus mettre les pieds dedans, ils étaient tout retirés.
— Jésus ! ma Doué ! s’écria Katel Le Pennec, s’il n’y a pas de quoi mourir à entendre des choses pareilles ?
— Maman, dit Corentine, ils ont froid, regardez comme Alain tremble ! et Yves n’a pas un fil de sec sur lui. Donnez-moi, s’il vous plaît, la clef du coffre qu’il puisse changer de tout.
— Il fera mieux d’aller se coucher sans souper, gronda la mère. Il l’a bien mérité !
— Et mes habits secs serviront à Alain pour retourner chez lui, dit tranquillement le petit garçon.
Corentine avait étalé sur la table la chemise de grosse toile, le pantalon des dimanches, le gilet brodé, la veste bordée de velours, mais Alain ne se pressait pas de sortir du coin où il se tenait blotti, sur le banc, tout au fond de la grande cheminée ; un feu clair, alimenté par une large brassée d’éclats de sapin, qui brûlaient et crépitaient en exhalant une odeur résineuse, commençait à le pénétrer d’une bienfaisante chaleur, et ses vêtements mouillés laissaient échapper une buée intense : on le tira pourtant de son refuge et il dut aller se vêtir de pied en cap dans l’angle obscur formé par le lit où Yves s’était déjà inséré entre deux couettes de balle.
Les deux mères, emportées par la violence du caractère breton, n’avaient que momentanément oublié l’état pitoyable de leurs rejetons ; l’instinct maternel se réveilla bientôt.
— Au lieu de les quereller, nous ferions bien mieux de leur donner à boire quelque chose de bon pour leur remonter le cœur, dit la grande Sezic Le Pennec. En attendant que leur soupe chauffe, je m’en vais courir à la maison chercher une fiole que je garde pour mes défaillances. Mettez toujours de l’eau à bouillir pour faire un drog, comme dit M. l’adjoint ; il n’y a rien de meilleur pour vous ressusciter après des coups comme ça ! Nous en prendrons aussi une petite goutte, vous et moi, ça nous fera du bien !
Une heure après, Yves Kerhélo dormait à poings fermés entre ses deux paillasses de balle d’avoine et rêvait qu’il était monté sur un superbe navire dont un coup de vent furieux renversait et brisait le grand mât. Le mouvement qu’il fit pour se garer de la chute des vergues l’éveilla : il était dans son lit à hautes parois et non sur un navire, et au-dessus de lui, dormait sa sœur Corentine ; mais le bruit du vent, ce n’était pas un rêve. On l’entendait par rafales, tantôt gémir, tantôt siffler, tantôt gronder sourdement, puis éclater en rumeurs sauvages, en frénétiques hurlements.
« Quel temps ! pensa l’enfant. Et papa qui est en mer ! les bateaux ne sont pas rentrés à la marée montante, ils n’auront pas pu, bien sûr, à cause de la tempête ; ils sont sans doute par là-bas du côté des Glénans. »
Et, là-dessus, il se retourna et se rendormit, l’enfance est si confiante dans la destinée !
Le lendemain au soir, des groupes de femmes et d’enfants stationnaient nombreux sur la petite place devant l’église. On parlait beaucoup, — les Bretonnes sont loquaces, — mais à l’air, à la voix, aux gestes des assistants, on devinait un malheur dans l’air.
La foule s’écarta pour laisser passage à un ecclésiastique ; c’était le recteur[3], suivi du clerc[4] ; il marchait le front baissé et semblait péniblement affecté. Les femmes n’osèrent pas l’arrêter, mais l’une d’elles retint le clerc au passage.
[3] Le curé.
[4] Le sacristain
— Est-ce que c’est fini, Fanche Cadiou ? dit-elle.
Le clerc inclina la tête affirmativement.
Un concert de lamentations s’éleva aussitôt.
— Ah ! ma Doué ! quel malheur ! des gens qui étaient si bien chez eux ! et comment est-ce arrivé ?
— Le gros temps de cette nuit a chassé la barque sur un caillou[5], elle s’est ouverte ; le mât a cassé. Stenic Kerhélo et le mousse l’ont détaché à coups de hache et se sont mis dessus pour se sauver ; mais il ventait dur, la mer était démontée, ils étaient encore loin de terre ; quand ils ont été jetés à la côte, là-bas sur la grève de Cap-coz, le mousse était expirant et Kerhélo ne valait guère mieux. Le pauvre petit gars est mort tout de suite ; l’autre a pu être transporté chez lui, embrasser sa femme et ses enfants, raconter ce qui s’était passé, recommander son âme à Dieu et sa famille à M. le recteur, et puis, les prières finies, il a passé, juste comme un fanal qui s’éteint. Il avait eu trop de peine à se battre avec la lame… il était tué…
[5] Un écueil.
Un silence de mort, rompu seulement par quelques sanglots, succéda à ce récit navrant, trop fréquent, hélas ! au bord de la mer.
— Et voilà Marie-Josèphe veuve avec deux enfants, dit une femme.
— Heureusement qu’elle a de quoi les faire vivre, reprit sa voisine.
Le clerc haussa les épaules.
— Pas tant que vous croyez, dit-il, et c’est bien ce qu’il y a de plus triste dans l’affaire. Kerhélo, il y a cinq ans, avait acheté une barque neuve ; il s’était endetté pour la payer, et au lieu de s’adresser à de braves gens qui l’auraient bien conseillé, il s’était laissé endoctriner par le bonhomme Laz et il lui avait emprunté sur billet une assez forte somme. Une année, la pêche a été mauvaise ; une autre, il a perdu dans un coup de mer son grand trémail[6] ; une autre, on lui a volé ses casiers[7]. Enfin, c’était toujours une chance noire, ou une autre qui le poursuivait. Le père Laz, sachant qu’il y avait un peu de bien dans la maison, ne pressait pas pour se faire rembourser les intérêts ; ils s’ajoutaient au capital, et puis après cela les intérêts des intérêts. Je crois bien que les pauvres gens n’ont plus rien à eux sans qu’ils s’en doutent, et qu’avant un mois tout sera aux enchères. La barque et les filets sont au fond de la mer, le père dormira demain dans le cimetière ; il n’y a plus là rien, ni personne pour répondre de la dette, et le père Laz n’est pas homme à se laisser apitoyer. Mais en voilà assez là-dessus, faites-moi place, il faut que j’aille tinter le glas.
[6] Grand filet.
[7] Sorte de panier qu’on mouille au large pour prendre des homards.
Dans une toute petite chaumière, devant un triste feu de bruyère sèche, la famille Kerhélo est rassemblée. La mère, assise sur la pierre du foyer, les coudes sur ses genoux, la figure cachée dans ses mains, pleure toutes ses larmes. Corentine, accroupie près d’elle, le front baissé, les mains jointes, est l’image de la douleur muette. Yves, soucieux, regarde sa mère et sa sœur, et parfois aussi, le misérable intérieur qui a remplacé leur confortable logis de jadis. Plus de grand coffre au large couvercle, plus de banc à dossier sculpté ; plus de lit à moulures luisantes, plus d’armoire aux portes constellées de clous de cuivre ; plus de crédence joyeuse où s’étalent les faïences de Locmaria, et les petits cadres brillants des portraits de famille. Tout cela a été vendu la veille, vendu par le père Laz, le plus impitoyable des créanciers. Vendu aussi le courtil plein de fleurs et de ruches ; vendue la bonne vache noire, l’amie de la maison ; vendus le pré où elle paissait, l’étable où elle dormait ; vendu le toit de ses maîtres, vendus les meubles, les outils, les provisions…
— Ah ! mes pauvres enfants ! il ne nous reste rien ! s’écrie, dans un sanglot, la veuve désespérée, je voudrais être là où est mon Stenic. Au moins, je ne verrais pas votre misère !
— Il nous reste cela, mère, dit Yves en étendant ses deux bras vigoureux.
— Et l’aide de Dieu, dit Corentine.
La veuve se signa.
— C’est peut-être péché que de parler comme j’ai fait tout à l’heure, dit-elle, mais mon cœur est en morceaux, et j’ai l’esprit tout chaviré. Qu’allons-nous faire ?
— J’ai treize ans, je sais lire, écrire et compter, je n’ai plus besoin d’aller à l’école. Je vais aller à la pêche, reprit le jeune garçon. Corentin Lanmeur cherche un mousse.
Sa mère se leva frémissante, ses yeux noirs, encore pleins de larmes, lançaient des éclairs.
— Yves ! Yves Kerhélo ! mon fils ! je te le défends ! La mer m’a pris ton père, c’est assez ! il n’y aura plus de marin dans la famille, du moins tant que je vivrai !
— Il faut pourtant travailler et gagner notre pain, répondit le gars, et notre loyer aussi… puisque nous sommes chez les autres ! ajouta-t-il d’une voix altérée.
Je vais chercher à faire des journées, dit la mère, pendant l’été, au moins. Il vient du monde pour les bains de mer, je trouverai bien à m’employer, et toi, Yves, tu iras servir les maçons. Je connais l’entrepreneur qui bâtit l’hôtel Bellevue, il te prendra par amitié pour nous.
— Et moi ? maman, dit timidement Corentine.
Yves se tourna brusquement vers elle : — Toi, Corentine, tu seras maîtresse d’école, comme c’était convenu du temps de notre père.
— Nous sommes trop misérables pour cela, mon pauvre Yves, je dois aider notre mère, je sais coudre et repasser, j’aurai de l’ouvrage chez les baigneurs, et vous verrez, maman, — elle embrassa sa mère, — qu’avec du courage, et la Providence aidant, nous sortirons de peine.
— Et je vous rachèterai votre armoire de mariage, dit Yves en lui caressant les mains.
— Et moi, la crédence, reprit Corentine.
— Vous êtes de bons enfants, dit la veuve, c’est une grande consolation dans mon malheur. Soupons puisqu’il y a encore sur notre table un peu de lard et du pain. Demain, le bon Dieu nous enverra le moyen de gagner notre vie, espérons-le.
Et la famille désolée s’assit devant le repas du soir.
L’été passa sans trop de privations pour les Kerhélo. Les deux femmes avaient du travail, et le peu qu’elles gagnaient suffisait à la vie de tous les jours. Yves était moins bien partagé. On ne bâtit pas beaucoup dans les villages, et surtout on ne paye guère les petits aides qu’on appelle mousses, aussi bien chez le menuisier, le couvreur ou le maçon que dans les barques de pêche. Le brave enfant s’ingéniait pourtant de cent façons pour apporter quelques sous. Dès la première aube du jour, il allait pêcher aux crevettes, chercher des palourdes, ramasser du goémon ; il faisait des commissions, portait du pain aux habitations de baigneurs éparses sur la côte, gardait les chevaux des voitures en excursion, servait de guide aux voyageurs. Infatigable, agile, adroit, honnête et poli, toujours de belle humeur, il était parfois bien payé par des touristes généreux, mais ces bonnes aubaines étaient rares. Avec l’hiver, elles disparurent complètement. Il en fut de même pour les journées de Corentine qui se brûla très gravement en maniant son fer à repasser, et faillit perdre la main droite, la brûlure, mal soignée, s’étant envenimée. Au mois de janvier, tout allait de mal en pis pour la pauvre famille, elle était sans pain, sans feu, elle allait être sans asile, car le loyer n’était pas payé. Yves avait cherché vainement du travail dans tous les environs, partout il avait rencontré la même réponse :
« L’ouvrage ne donne pas, nous n’avons pas seulement de quoi occuper nos ouvriers. »
Il revenait alors au logis, le cœur gros, la tête basse, prétendait n’avoir pas faim pour ne pas diminuer la petite pile de galettes de blé noir ou la chétive portion de bouillie de sa mère et courait à la grève où les moules, les bigorneaux, les patèles lui fournissaient un repas à peu près suffisant.
Plus d’une fois, il se serait couché sans souper, si son ami Alain, à force d’insister, ne lui eût fait partager son croûton de pain noir.
Un soir, la veuve Kerhélo rentra en se plaignant d’un violent mal de tête et d’un point de côté. Depuis trois jours, malgré un gros rhume, elle faisait la lessive dans une maison du voisinage et son malaise augmentait de plus en plus.
Dans la nuit, un frisson terrible vint la saisir, le délire la prit ; les yeux égarés, les lèvres tremblantes, les joues empourprées, elle appelait son mari, lui parlait, se croyait revenue dans leur ancienne demeure, — ses enfants épouvantés ne savaient que faire. Dès que le jour parut, Yves courut chez les sœurs de charité qui soignent les malades à Fouesnant, car il n’y a pas de médecin dans le bourg. Mais aucun secours humain ne pouvait sauver la pauvre femme ; une congestion pulmonaire l’emporta en quelques heures. Un peu avant de mourir, elle avait repris connaissance. D’une voix entrecoupée, elle fit ses adieux à ses enfants, leur recommanda de rester honnêtes et pieux, de ne jamais mentir ni tromper, ni voler, et mourut en les bénissant.
Yves et Corentine étaient maintenant seuls dans le vaste monde, sans parents, car Stenic Kerhélo et sa femme n’avaient pas de proches dans le pays, sans un sou vaillant, et même sans un métier sérieux. Ils vendirent tout ce qui restait encore dans la maison pour en payer le loyer et aussi pour faire à leur mère des funérailles décentes. Où aller ? ils n’en savaient rien… Une vieille demoiselle, habitant le bourg, eut pitié de leur abandon et les recueillit. Elle n’était pas riche la bonne Mlle Martineau, mais elle avait un grand cœur, et du très peu qu’elle possédait, savait encore tirer parti pour faire la charité. Après quarante ans de travail, comme institutrice, elle avait amassé une petite aisance suffisante à ses habitudes modestes et vivait dans une jolie maisonnette, cultivant son jardin, s’occupant de bonnes œuvres, de travaux manuels et même encore un peu d’instruction. Elle aimait beaucoup Corentine et Yves qui lui rendaient de petits services, et elle avait plus d’une fois aidé la malheureuse famille depuis ses infortunes.
— Venez chez moi, mes pauvres enfants, avait-elle dit, quand le frère et la sœur, après avoir vu partir les derniers assistants de la lugubre cérémonie, étaient restés agenouillés sur la tombe de leur mère, secoués par les sanglots. J’ai un petit lit pour Corentine et Yves couchera dans le grenier, sur les bottes de paille. Demain, nous verrons ce que l’on pourra faire pour vous ; ce soir, il faut vous reposer, vous nourrir, reprendre des forces pour la bataille de la vie. Vous la commencez seulement, mes enfants ; ayez confiance en votre Père des cieux, il n’abandonne pas les orphelins. Viens aussi, toi Alain, ajouta la bonne demoiselle en voyant le jeune garçon, qui, les joues baignées de pleurs, se tenait appuyé à la grande croix de bois. Viens souper avec ton camarade ; c’est quand on est dans le chagrin qu’on sent la douceur d’avoir de bons amis…
Les beaux yeux de Corentine se tournèrent vers Mlle Martineau avec une expression si éloquente qu’elle suppléait à tout autre discours et les trois enfants, quittant le cimetière, suivirent en silence leur dévouée protectrice.
— Voulez-vous que je vous donne un coup de main, patron ?
— Ma foi, oui ! mon gars, ce n’est pas de refus, mon mousse vient d’attraper une entorse, en sautant du quai sur le bateau, et voilà la mer qui a fini de monter ; si tout notre bibelot n’est pas arrimé avant la marée descendante, c’est un jour de perdu, et de l’argent dépensé à Concarneau.

— Voulez-vous que je vous donne un coup de main ?
Des deux interlocuteurs, l’un était un homme d’une quarantaine d’années dont la figure hâlée respirait la franchise et la bonté, non sans mélange d’une certaine rudesse ; l’autre, un joli garçon de quatorze à quinze ans, robuste, bien bâti, à l’air avenant. Sous les boucles épaisses de sa chevelure brune scintillaient deux grands yeux noirs pleins de feu et d’intelligence ; la bouche, d’un dessin ferme, le menton large et carré, annonçaient la résolution poussée jusqu’à l’entêtement.
L’enfant était vêtu proprement, mais pauvrement, ses pieds nus étaient poudrés de sable de mer, et sa main droite balançait un béret de gros drap bleu qu’il avait ôté pour saluer le patron de chasse-marée.
Celui-ci avait jugé tout de suite que notre ami Yves Kerhélo (on l’a reconnu) n’était pas d’une pâte ordinaire, aussi la connaissance fut-elle bientôt faite entre eux et il le mit sur-le-champ à l’ouvrage. Le jeune gars maniait si adroitement les caisses de bois blanc pleines de boîtes de conserves, il était si vif pour les prendre, si attentif à les tendre au bon moment à l’homme chargé de les empiler à fond de cale que la besogne marcha rondement.
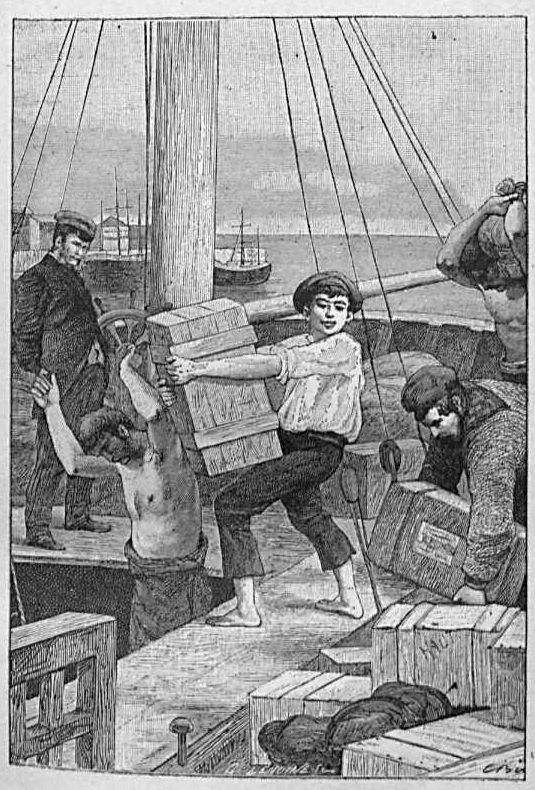
L’enfant maniait adroitement les caisses.
— Tu vas déjeuner avec nous, dit le capitaine Jaouen, enchanté de son nouveau serviteur, tu vas goûter la soupe au poisson qu’on cuisine à bord de la Belle-Yvonne[8], et, si elle te va et que tu sois libre, je t’emmène à Nantes. Comment t’appelles-tu ?
[8] Il est d’usage en Bretagne, dans les fermes, que les serviteurs, avant de se louer, viennent goûter la soupe, c’est-à-dire prendre un repas.
— Yves Kerhélo, capitaine, et je serai bien content d’aller avec vous.
— D’où es-tu ?
— De Fouesnant.
— Qui sont tes parents ?
— Ils sont morts… Je n’ai plus que ma sœur Corentine, elle demeure à Fouesnant avec Mlle Martineau qui va lui montrer à devenir maîtresse d’école…
— Bon, bon ! Et toi, que comptes-tu faire ?
— Travailler pour gagner ma vie honnêtement !
— C’est bien dit, mon gars, et je te crois. Écoute, mon mousse ne sera pas remis d’ici à quelques semaines, tu peux prendre sa place. Je vais à Nantes porter une cargaison de sardines à l’huile. Quand nous serons là-bas, je ne te laisserai pas dans l’embarras, je trouverai bien un coin pour toi dans un bateau ou un autre. Ça te va-t-il ?
— Oh ! oui, capitaine, merci ! Seulement…
— Seulement quoi ?
— Si vous ne partez pas tout de suite, je voudrais bien aller dire adieu à Corentine et à Mlle Martineau qui a été si bonne pour nous depuis la mort de ma mère,… et aussi à Alain Le Pennec, mon camarade.
— C’est trop juste ; combien de temps te faut-il ?
— Deux bonnes heures pour aller, autant pour revenir, une heure pour rester, cela fait cinq heures ; je courrai tout le temps.
— Mais tu as travaillé toute la journée, tu es las ?
— Oh ! ça ne fait rien, je courrai tout de même pour ne pas manquer le départ de la Belle-Yvonne.
Un large sourire éclaira la figure du marin.
— Tu es un courageux petit gars, dit-il, et un bon cœur aussi. Va voir ta sœur et sois ici à minuit. Nous ne partirons qu’au jusant[9] du matin, à trois heures.
[9] Jusant, la marée descendante.
Au flot vert de l’Océan venait se mêler le flot boueux de la Loire, il ventait dur devant Saint-Nazaire et la Belle-Yvonne dansait ferme. Yves regardait de tous côtés, un peu désappointé de ne voir d’abord qu’une vieille petite ville et une vieille petite église. En 1872, les grands travaux qui ont transformé le port de Saint-Nazaire n’étaient pas encore terminés, néanmoins le service des paquebots transatlantiques y avait déjà son point de départ et notre mousse ouvrit de grands yeux en voyant passer à une centaine de mètres, un de ces vastes monuments nautiques auprès desquels le petit chasse-marée semblait un jouet d’enfant.
La marée montante aidant, on filait assez lestement sur Nantes. Paimbœuf, le Pellerin passèrent rapidement devant les regards d’Yves, mais il fut fort intéressé par les grands établissements de l’île d’Indret où se fabriquent les machines à vapeur de la marine française. La côte basse, humide, grisâtre, les hautes cheminées couronnées d’un lourd panache de fumée noire, les ateliers, alignés en longs bâtiments parallèles, étonnaient le jeune garçon, habitué aux aspects riants et pittoresques du paysage cornouaillais. A sept heures du soir, la Belle-Yvonne accostait au quai de la Fosse, et Yves, stupéfait, voyait s’étager, sur la colline, les maisons de Nantes, constellées de points lumineux, s’allonger sur le quai la double ligne du chemin de fer et du tramway, et se perdre dans la brume les îles, toutes chargées d’habitations, de magasins, de hangars.
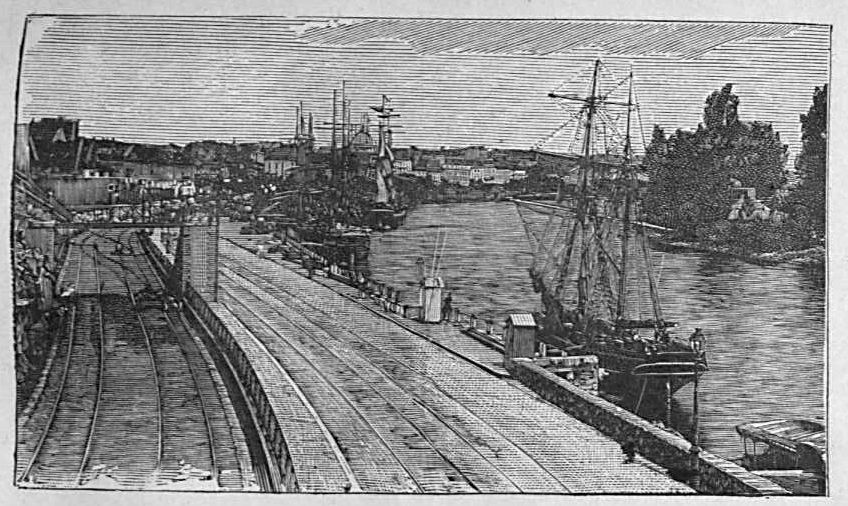
Vue de Nantes. — Le quai de la Fosse.
— Que de monde il y a par ici ! dit-il au patron qui se tenait près de lui, sur le point.
— Cent vingt mille habitants, au moins.
— Cent vingt mille ! c’est bien plus qu’à Concarneau et même qu’à Quimper ! Il faut bien travailler pour gagner son pain là ! et bien se priver aussi, sûrement ! Qu’est-ce qu’en dirait Alain qui aime tant la lande et la grève, s’il était obligé de vivre dans ces chambres que que je vois là-haut, éclairées par de petites lampes ? J’aime mieux être mousse que de m’enfermer là dedans. C’est vrai qu’on attrape quelquefois des coups de mer qui ne sont pas drôles, mais on respire tout son content (et il aspira l’air à pleins poumons). Pouah ! comme le brouillard sent mauvais ! je vais aller me chauffer à la cambuse[10] en épluchant des pommes de terre !
[10] La cuisine.
Le matin suivant, après que toutes les formalités de l’arrivée au port eurent été remplies par le capitaine, le déchargement commença, et Yves fit connaissance avec l’intérieur de la ville en poussant les brancards de la petite charrette à bras qui portait les caisses de sardines aux docks. La vue des passants affairés, des grands magasins remplis d’objets de luxe, des beaux hôtels à balcons ouvragés, l’amusa d’abord, mais l’attrait de la nouveauté une fois disparu, il ne sentit plus que la fatigue de sa pénible besogne, et, le soir, se jeta sur sa mince couchette, plus las qu’après une journée de manœuvres pendant la tempête.
Le lendemain étant un dimanche, aussitôt le service du bord terminé, il obtint de son bienveillant patron, congé pour toute la journée. Il tira de son petit coffre ses vêtements les plus propres ; à grand renfort d’eau claire et de savon de Marseille, il nettoya son visage et ses mains, jusqu’à ce qu’ils fussent luisants de propreté, brossa ferme sa crinière brune dont les boucles rebelles résistaient à tout effort pour la discipliner, et, les pieds nus cachés dans de gros souliers bien cirés, le chapeau à la main, vint saluer le capitaine Jaouen. Celui-ci, mis de bonne humeur par la mine résolue et franche du jeune garçon, lui tapa sur l’épaule d’un air amical.
— Comme te voilà brave ! mon petit gars ! Tu as bien travaillé, va bien t’amuser. Voilà une petite pièce pour faire le garçon, ne la dépense pas en eau-de-vie surtout !
— Merci, capitaine ! merci bien, dit Yves, les yeux brillants à la vue d’un trésor si inattendu. Vingt sous ! — que d’argent ! Soyez tranquille ! je n’achèterai pas seulement cinq centimes d’eau-de-vie, ni du tabac, ni rien de ces mauvaises choses-là ; le plaisir qu’elles font est tout de suite passé, il ne reste rien après. J’achèterai du papier et un timbre-poste pour écrire à Corentine, et puis, des boutons pour mes habits, et du fil et des aiguilles pour raccommoder parce que je ne veux pas être en loques ; et puis, peut-être bien que je me paierai un petit régal de quatre sous, pas plus, et je garderai cinq sous sur moi : — on ne sait pas ce qui peut arriver !
— Voilà un garçon diantrement sensé, il fera son chemin dans le monde, c’est moi qui le lui prédis, dit une grosse voix joviale.
— Tiens ! c’est toi, Simon ! et qu’est-ce qui te savait ici ? Je te croyais encore en Angleterre pour huit jours au moins, s’écria le capitaine Jaouen en donnant une cordiale poignée de main au nouveau venu, un grand, gros homme avec d’énormes favoris roux, et une figure couleur de bronze foncé.
— Nous avons chargé bien plus vite que je ne pensais, la mer était belle, la Vendée est venue de Cardiff en deux jours ; nous partons demain ou après-demain au plus tard pour Saïgon. Veux-tu venir avec moi, mousse ? Ça te fera voir du pays.
Yves consulta son patron du regard…
— Vas-y, mon garçon, — vas-y gaîment, dit le bon Jaouen. Mon camarade Simon est la perle des braves gens ; — pas commode tous les jours, non !
— Faut bien que le bateau marche, grommela le dit Simon.
— … Et puis pas liardeur, on est bien nourri sur son bateau, bien traité, — bien taloché aussi, mais pas méchamment, c’est rien que de la vivacité. Je ne peux pas te garder avec moi ; mon ancien mousse était un bon enfant, et mon propre cousin par-dessus le marché. Ce ne serait pas juste de lui faire perdre sa place parce qu’il a attrapé une entorse à mon service. Tu n’as plus ni père, ni mère ; tu es ton maître. Va courir un peu le monde, tu es du bois dont on fait les gens qui réussissent. — Tu peux le prendre sans crainte d’avoir à t’en repentir, Simon. C’est un petit gars courageux, travailleur, honnête et rangé ; ça n’est ni menteur, ni répondeur, et ça ne plaint pas sa peine. Je lui souhaite bonne chance de tout mon cœur.
— C’est bien, dit le capitaine Simon, affaire conclue ! Hein, mousse ? Comment t’appelles-tu ?
— Yves Kerhélo.
— Eh bien ! Yves Kerhélo, lundi matin tu seras inscrit au rôle d’équipage de la Vendée, capitaine Simon, en partance pour Saïgon avec chargement de houille de Cardiff. Donne-moi tes nom, prénoms, date de naissance, domicile etc., sur un bout de papier pour que je fasse régulariser toutes les paperasses. Tu sais lire et écrire ?
— Oui !
— Bon ! sois lundi à dix heures au bureau de l’inscription maritime et lundi soir devant la gamelle de la Vendée. Maintenant laisse porter[11] et file vent arrière. J’ai à causer avec l’ami Jaouen.
[11] Éloigne-toi.
A Mlle Corentine Kerhélo, chez Mlle Martineau, à Fouesnant (Finistère).
Port-Saïd, 6 mars 1872.
Ma chère Corentine,
Me voilà en terre ferme, après une bien longue traversée. Du petit café où je l’écris, on voit l’entrée du canal, le ciel bleu, les quais tout blancs sous le soleil : un soleil ardent qui ne ressemble guère à celui de notre Bretagne. Ah ! que je suis loin du pays ! loin du clocher de Fouesnant, loin de ma grande sœur, la seule parente qui me reste ici-bas, la personne que j’aime le mieux au monde. Mais ne crois pas que je sois triste et découragé, — au contraire ! Plus je vais, plus je me dis : le monde est si grand qu’il n’y manque pas de place pour ceux qui veulent se remuer. Dans dix ans d’ici, je reviendrai chez nous avec un joli magot ; nous rachèterons la maison de nos parents, et tous nos meubles, et le courtil, et tout ce que nous avons perdu après la mort de notre père ; et tu tiendras mon ménage si tu n’es pas mariée.
Pour le moment, je travaille de mon mieux et je ne suis pas à plaindre. Le capitaine Simon est vraiment un bien bon patron ! Il m’a pris en amitié parce qu’il voit bien que je fais tout mon possible pour le contenter ; il s’intéresse à moi. — « Je ne veux pas que tu t’abrutisses, m’a-t-il dit, et que tu oublies ce que tu as appris à l’école. » — Aussi le dimanche, et même dans la semaine, quand le service est fini, il me prête des livres et m’entourage à m’instruire. Aujourd’hui j’ai tout mon temps parce que la Vendée attend son tour de passage pour entrer dans le canal de Suez. Le canal n’est pas assez large pour que deux bateaux puissent y passer de front et on est forcé de prendre la file pour s’y engager.
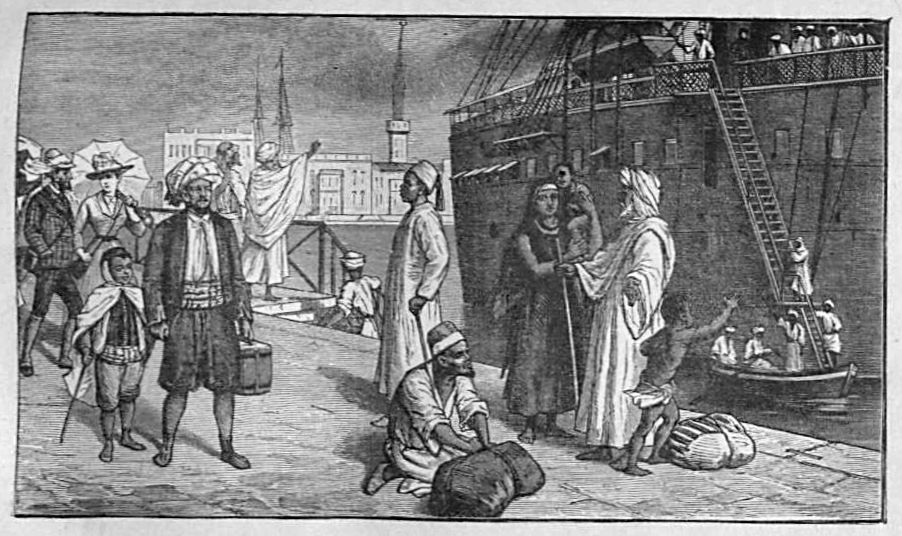
Dans le port de Suez.
Il faut que je te raconte mon voyage jusqu’ici. Tu dois avoir reçu une lettre datée de Nantes où je te disais comment mon premier patron, le capitaine Jaouen, m’avait recommandé au capitaine Simon et placé sur la Vendée qui porte à Saïgon un chargement de houille de Cardiff. C’est une cargaison lourde, mais peu embarrassante ; une fois qu’elle est casée, elle n’a pas d’avarie à craindre. Nous avons eu beau temps pour la traversée du golfe de Gascogne ; nous avions bon vent, ce qui a soulagé la machine, et nous avons marché lestement. En traversant le détroit de Gibraltar, j’ai bien regardé les côtes qu’on voit très nettement quand le temps est clair. Du côté de l’Afrique, ce sont des montagnes abruptes, baignant leur pied dans la mer ; la côte d’Europe est plus basse, mais le roc de Gibraltar s’avance et forme un promontoire qui se détache de la terre comme un immense bloc de rocher. Nous avons suivi le littoral de l’Algérie, mais de trop loin pour que j’aie rien pu voir. Le capitaine est pressé d’arriver dans la mer des Indes ; il a toute sa provision de vivres et d’eau ; nous ne nous arrêtons nulle part, à mon grand regret ; ici, nous voilà bien forcés de rester tranquilles, bon gré mal gré. Nous sommes amarrés dans un grand bassin, au milieu de navires de tous les pays et de toutes les sortes, montés par des équipages de toutes les couleurs aussi. Il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des Français, des Danois, des Portugais, des Anglais, — oh ! beaucoup d’Anglais ! — des Grecs, des Italiens, des Chinois, des Malais. Tous ces gens-là crient, chantent des chansons de leur pays, font la lessive, pendent leurs drôles de guenilles sur le pont pour les faire sécher, ou cuisinent des ragoûts dont le chien d’Alain ne voudrait pas.
Ce matin, nous avons reçu la visite d’un bonhomme qui portait une belle calotte rouge très molle avec un long gland de soie bleue, une sorte de redingote, à longue jupe, serrée à la taille et boutonnée jusqu’au cou, et des pantalons larges d’en haut et étroits d’en bas. C’était un médecin égyptien qui venait pour l’inspection sanitaire. Il s’est assuré qu’il n’y avait à bord ni choléra, ni petite vérole, ni fièvre jaune. Comme nous étions tous en parfait état, il a visé notre patente de santé, et nous a laissés descendre. J’ai une grande impatience de traverser le canal de Suez, j’y ai pensé si souvent du temps où j’apprenais la géographie à l’école ! Il me semble que je vois encore la ligne rouge qui le dessinait sur la carte murale, entre les fenêtres ; — et dire que j’y suis pour de vrai !
Adieu, ma chère sœur, il faut bien te quitter et expédier cette grande lettre. Je t’en écrirai une autre d’Aden, et puis après, tu seras longtemps sans recevoir de mes nouvelles, car l’océan Indien n’est pas bagatelle à traverser. Écris-moi à Saïgon poste restante. J’ai été bien heureux de trouver ici la bonne lettre avec le petit mot d’Alain, — ce brave Alain, mon bon camarade ! Je lui envoie une cordiale poignée de main. Présente, je te prie, tous mes respects à Mlle Martineau, et aussi l’expression de toute ma reconnaissance pour ses bontés. Combien j’ai le cœur soulagé en pensant qu’elle te garde auprès d’elle, et que tu vas pouvoir, tout en lui rendant service dans son petit ménage, continuer tes études avec elle, et devenir une institutrice, comme elle l’a été elle-même pendant si longtemps et comme notre père et notre mère le désiraient !
N’oublie pas de faire mes compliments et amitiés à tous les gens du pays qui te parleront de moi, et, quand tu m’écriras, dis-moi si tu passes bientôt ton examen de brevet simple. Je t’embrasse de tout mon cœur, de toutes mes forces.
Yves Kerhélo.
Mlle Martineau, à Fouesnant (Finistère).
Aden, 16 mars 1872.
Mademoiselle,
Je prends la liberté de vous écrire pour vous exprimer toute ma gratitude et vous assurer que jamais je n’oublierai ce que vous avez bien voulu faire pour ma sœur et moi. Le souvenir de tout ce que je vous dois ne me quitte pas, et m’encourage à bien faire, afin de me montrer digne de votre amitié. Quant à Corentine, elle vit près de vous, elle a le bonheur de pouvoir vous témoigner son affection à chaque instant par les petits services qu’elle vous rend. Moi, qui ne suis qu’un pauvre mousse, je veux pourtant tâcher de vous être agréable à mon tour, en vous donnant quelques détails sur ce que j’ai déjà vu d’intéressant.
Nous sommes partis de Port-Saïd le 7 mars à huit heures du matin ; le temps était très beau, et il n’y avait pas trop de chaleur. Nous avions pris un pilote à bord, car il n’est pas permis de diriger soi-même la marche de son bateau dans le canal. Pendant la saison chaude, c’est-à-dire pendant six mois, on est obligé aussi de prendre des chauffeurs arabes pour les machines ; la température est telle que les Européens ne peuvent la supporter. « C’est comme une fournaise embrasée », me disait le capitaine Simon qui répond assez volontiers aux questions que je lui fais, quand il est de bonne humeur. On va doucement, doucement, tant qu’on est dans le canal, pour ne pas trop agiter l’eau, ce qui ferait écrouler les berges de sable. Que de sable, mon Dieu ! il n’y a que cela ; ni arbres, ni rochers comme chez nous, rien que du sable, une mer de sable. Quand le soleil donne là-dessus, on en est ébloui ; on voit des points rouges en fermant les yeux. Il paraît que lorsque le vent souffle, il pousse devant lui des vagues de cette poussière d’un blanc jaunâtre ; si le vent est très fort, les grains de sable brûlants qu’il enlève viennent vous cingler le visage et pénètrent dans les cheveux, sous les paupières, entre les lèvres, s’incrustent dans la peau, c’est un petit supplice. Dans la mer Rouge, autre supplice : la transpiration qu’amène l’excessive chaleur est si âcre qu’elle fait sortir sur tout le corps une quantité innombrable de petites rougeurs qu’on appelle les bourbouilles et qui vous cuisent comme une brûlure. Nous n’avons pas souffert de ces misères-là à cause de la saison d’hiver.
Le canal de Suez, c’est très beau, très curieux ; quand on pense que ça réunit deux mers, on est très fier de se dire que c’est un Français aidé de l’argent et de la confiance des gens de la France qui a fait cela ; mais pour l’agrément, franchement, il n’y en a guère à le traverser. — Vers le milieu, il y a une ville qu’on appelle Ismaïliah, construite dans une oasis ; elle est déjà assez jolie, mais je crois qu’elle sera plus belle dans une quinzaine d’années, quand les jardins auront plus d’ombrages et qu’il y aura un plus grand nombre de palais.
Dans les Lacs amers, nous avons été obligés de stationner pendant toute une journée pour laisser passer une longue file de bateaux qui venaient du côté de Suez, car c’est comme sur un chemin de fer qui n’a qu’une voie, il y a des endroits de garage où on doit se retirer pour éviter les rencontres.
A Suez, nous avons dit adieu au canal, mais non aux sables, on ne voit que cela tout le long de la mer Rouge. Je n’aurais donc rien de bien intéressant à en dire s’il ne m’était arrivé là une petite aventure qui, du reste, a tourné tout à mon profit, comme vous allez le voir, mademoiselle.
Nous avions stoppé à Suez pour y attendre un jeune homme qui devait venir nous y rejoindre et prendre passage à bord de la Vendée jusqu’à Saïgon. Il s’appelle M. Émile Gerbier et va retrouver son père qui est entrepreneur là-bas. Le capitaine était allé à terre avec le canot pour amener à bord son passager et j’étais avec lui. Personne sur la cale ! — Nous attendons un quart d’heure, — vingt minutes, — une demi-heure, — le patron commençait à se fâcher ferme ; — un quart d’heure se passe encore. Il fallait entendre le capitaine ! Il criait, il jurait, il était dans une colère terrible ! Enfin, au bout d’une heure environ, M. Gerbier arrive en courant, rouge, essoufflé, trempé de sueur.
— Je suis en retard ! dit-il au capitaine.
— Si vous êtes en retard !! Mille millions de noms d’un tonnerre de Brest ! — Je pense bien que vous y êtes ! J’allais filer sans vous. Allons, pousse, toi ! — cria-t-il d’une voix retentissante au matelot.
Celui-ci pousse avec sa gaffe, juste comme M. Gerbier sautait dans le canot. Le pauvre garçon perd l’équilibre, se rattrape au bordage d’une main, et son portefeuille, qu’il tenait dans l’autre, lui échappe et tombe dans l’eau.
Il poussa un cri ! ah ! un cri ! je l’entends encore ! Il voulait se jeter à la mer ; on le retint. Tout en sueur comme il était, il aurait attrapé sa mort. Moi qui sais bien nager, j’ai tout de suite plongé ; heureusement, l’eau était claire et l’on voyait le portefeuille sur le sable du fond, je l’ai vite ramassé et, d’un bon coup de pied, je suis remonté à la surface. Le canot n’était pas loin ; j’y suis rentré tout trempé, mais M. Gerbier n’a pas pensé à se plaindre de ce que je mouillais ses habits ; il était comme fou de joie.
Il m’embrassait en pleurant :
— Ah ! mon enfant, m’a-t-il dit, tu ne peux imaginer l’étendue du service que tu me rends ! Ce portefeuille contient mes papiers, mes portraits de famille, — et deux cent mille francs pour mon père qui les attend là-bas avec la plus vive impatience. C’est pour les avoir que je m’étais si fort mis en retard. Je suis venu de France par Alexandrie. Comme je voulais visiter le Caire et les Pyramides, je n’ai pas trouvé prudent d’emporter tant de valeurs sur moi, de crainte de vol ou d’accident. J’ai laissé mon portefeuille chez un banquier du Caire qui devait me le faire parvenir à Suez par le courrier d’Indo-Chine. Je ne suis arrivé que depuis une heure ; j’ai eu à peine le temps de déjeuner au galop, de courir à la poste où on m’a fait mille difficultés. Aussitôt que j’ai eu enfin recouvré mon trésor, je suis accouru en toute hâte vers la Vendée ; — tu sais le reste. Embrasse-moi encore, mon garçon, et sois sûr que tu as un ami dévoué en moi.
Je ne savais que répondre, mais j’étais bien content d’avoir fait tant de plaisir à un honnête homme. Ce bon monsieur m’a donné un billet de cent francs ! C’est une somme énorme, n’est-ce pas, mademoiselle ? Je l’ai remise au capitaine Simon pour qu’il me la garde, car je n’ai pas de chambre à bord, pas de tiroir, pas un coin grand comme la main, à moi, pour y serrer quelque chose. Quand j’aurai une occasion bien sûre, je vous l’enverrai, mademoiselle ; vous aurez la complaisance de le mettre de côté. Cela servira pour racheter la maison, — il en faut beaucoup plus, bien sûr ! mais c’est un petit commencement.
Je vous prie, mademoiselle, de vouloir bien embrasser Corentine pour moi et de recevoir l’expression de mon amitié respectueuse et dévouée.
Yves Kerhélo.
En rivière de Saïgon, le 7 avril.
Ma bonne petite sœur,
Un canot va porter le courrier à terre ; j’en profite pour faire un paquet de toutes les feuilles que j’ai écrites depuis Aden et te les envoyer. Tu vois que ton frère devient un fameux écrivain. Je dois ma science en littérature (vois comme je sais faire de belles phrases maintenant !) à ce bon M. Gerbier, qui depuis que je lui ai repêché son portefeuille est plein de bontés pour moi. Toutes les fois que j’ai quelques heures de libres, il me fait venir près de lui pour travailler ; il m’apprend le français, l’anglais, un peu d’histoire et de géographie, et aussi l’arithmétique. Il m’a même dit, l’autre jour, que je faisais beaucoup de progrès et que, si le métier de mousse ne me va pas, il me fera entrer dans les bureaux de son père, comme petit employé. Tu penses bien que j’aime mieux cela que de servir les maçons ou de carguer des voiles. Je suis donc plein d’espérance et de courage. En attendant mieux, je ne néglige pas la besogne du bord. Je vois bien que le capitaine Simon est content de moi parce que, de temps en temps, il me tire l’oreille, — si fort qu’il me fait crier, — mais ça me fait plaisir tout de même. Il faut que je termine ma lettre, car nous allons partir dans un moment. Je t’embrasse très vite, très fort, et je te prie de présenter mes respects à Mlle Martineau.
Surtout n’oublie pas mes amitiés pour Alain.
Yves Kerhélo.
NOTES DE VOYAGE
Je n’ai pas vu Suez de près, car j’étais resté dans le canot avec le capitaine. Aussi ne puis-je t’en faire une longue description.
La ville s’étend au milieu d’un vaste désert de sable, au pied de grandes montagnes tristes et dénudées. Le mont Sinaï, si célèbre dans l’histoire des Hébreux, s’aperçoit quand on entre dans la mer Rouge. Je ne sais pourquoi on l’appelle la mer Rouge. Ce n’est sûrement pas la couleur de ses eaux qui lui a fait donner ce nom, car elles sont d’un beau vert d’émeraude. Les bords, c’est du sable, et toujours du sable, jusqu’à ce qu’on approche du détroit de Bab-el-Mandeb. Nous avons rasé de très près l’île de Périm, roc absolument aride où les Anglais ont une garnison qui change tous les trois mois. Le manque d’eau et la chaleur y rendent la vie intolérable. Les hommes deviendraient fous s’ils y restaient plus longtemps.
De Périm à Aden, la côte est très pittoresque ; elle est formée par des montagnes rocheuses fort élevées et découpées d’une façon tout à fait bizarre. Nous sommes arrivés le 16 au soir à Steamer-Point, qui est le port d’Aden ; il faisait un clair de lune magnifique, et M. Gerbier a voulu descendre à terre pour aller voir Aden. Il a demandé au capitaine la permission de m’emmener, et comme celui-ci a des affaires qui le retiendront à Steamer-Point toute la journée de demain, il y a consenti ; tu penses si j’étais content ! Nous voilà partis tous deux dans une bonne voiture, marchant au galop de deux chevaux vigoureux. Au bout d’une demi-heure de ce train-là, nous arrivons à une porte fortifiée gardée par des Anglais. M. Gerbier leur a si bien parlé qu’ils nous ont laissé passer et nous entrons dans un défilé de dix mètres de large, entre des rochers à pic de cinquante mètres de haut, au moins. Il m’a semblé d’abord qu’il y faisait très noir ; peu à peu mes yeux se sont habitués à l’obscurité et j’ai commencé à distinguer sur le bord de la route des masses grisâtres qui étaient des maisons. A la sortie du défilé nous étions devant Aden. Une petite ville toute blanche, sous les rayons de lune, des constructions basses et carrées à un seul étage, s’étendant sur une plaine entourée de tous côtés par des collines rocheuses très hautes. On nous a dit que, pendant le jour, ces rocs taillés à pic renvoient la chaleur comme les parois d’un four. Il n’y a ni source, ni rivière à Aden. Pour donner de l’eau à la ville, on a construit de vastes réservoirs qui se remplissent pendant la saison des pluies et peuvent contenir la provision d’eau pour trois ans. Nous avons été les voir le matin après avoir passé quelques heures à dormir à l’hôtel. On a profité, pour les établir, d’une sorte de crevasse très évasée, creusée contre deux immenses rochers, dont la pente est telle, que toute l’eau qui tombe sur les rochers voisins la suit et vient s’écouler au pied. Pour l’empêcher de se perdre et créer ainsi une sorte de bassin, on a cimenté les parois du rocher et construit, du côté qui regarde la ville, une énorme digue en maçonnerie.
Nous avons déjeuné à Steamer-Point. M. Gerbier a eu la bonté de me faire déjeuner avec lui. J’étais d’abord un peu embarrassé ; il y avait sur la table un tas de choses que je n’avais jamais vues et dont j’ignorais l’usage, car le service de la table dans un hôtel anglais ne ressemble pas à la gamelle de la Vendée, mais je me suis souvenu de nos repas chez Mlle Martineau, et comme elle nous apprenait à nous bien tenir et à manger convenablement. — Pour le reste, c’est-à-dire pour les choses nouvelles, j’ai regardé faire M. Gerbier et j’ai tâché de faire comme lui, le moins maladroitement possible.
Nous sommes revenus à bord vers une heure et nous avons trouvé le bateau entouré de petites pirogues creusées dans un tronc d’arbre et montées par des enfants indigènes qui criaient comme des mouettes. Je ne comprenais pas d’abord ce qu’ils disaient ; c’était : A la mer ! à la mer ! dgita ! dgita ! (jette), et puis ils piquaient une tête, plongeaient et remontaient dans leurs pirogues.
M. Gerbier qui connaissait leurs talents a jeté une petite pièce blanche de monnaie du pays valant environ 20 centimes. Aussitôt une douzaine de gamins couleur de bronze se précipitent pour la rattraper pendant qu’elle coule ; et voilà des batailles, des empoignées à trois ou quatre mètres sous l’eau… on les voyait très distinctement, la mer étant d’une limpidité extraordinaire. Le vainqueur, revenu enfin sur l’eau, a montré sa pièce d’un air triomphant et l’a fourrée dans le coin de sa bouche, tout prêt à recommencer un nouveau combat.
A trois heures, la Vendée appareillait, et nous nous sommes dirigés entre Socotora et Guardafui. Là nous avons pêché un requin. Oh ! la vilaine bête avec son immense gueule, presque sous le ventre, et ses dents tranchantes qui vous coupent une jambe ou un bras en une seconde. Brrr…, cela fait frémir rien que d’y penser ! On n’ose pas se baigner en mer à cause de ces gaillards-là, qui vont après le navire comme les mendiants de chez nous, après les enterrements. Pour les prendre, on jette à la mer un émerillon[12] fixé solidement au bout d’une chaîne et amorcé avec un gros morceau de lard. Le requin happe tout avec avidité, le croc s’engage dans ses entrailles, on laisse filer la chaîne et le monstre suit le bateau en faisant des bonds, des soubresauts si violents que l’eau de mer rejaillit jusqu’au bordage. Quand il a épuisé ses forces, on le hale sur le pont ; mais il faut avoir la patience d’attendre qu’il soit bien mort ou, au moins, mourant. Le nôtre ne l’était qu’à moitié, il donnait encore des coups de queue terribles. On l’a éventré et dépecé ; nous avons fait la soupe avec des morceaux de sa chair ; ce n’était pas un régal, tant s’en faut ! On a gardé la peau qui est très résistante et sert à confectionner beaucoup d’objets utiles.
[12] Hameçon très fort.
Le 19 nous avons passé devant le cap Guardafui, et nous sommes entrés dans l’océan Indien. Le 25, nous avons vu à quelque distance les îles Laquedives et Maldives. Le 27, nous étions au sud de Ceylan, les 28, 29, 30 rien que le ciel et l’eau ; le 31 au soir, un feu a brillé à l’horizon, c’était celui du phare qui s’élève à la pointe nord de Sumatra. Le lendemain nous entrions dans le détroit de Malacca. Oh ! que c’est beau à voir ! on ne se lasse pas de regarder ! Du côté de la Malaisie, d’immenses forêts, couvrant les montagnes, descendent jusqu’à la mer. Sur les eaux, flottent des troncs d’arbres, des branchages, des lianes et même des îlots mouvants qu’ont formés les mousses, les gazons, les herbes détachées du rivage : des milliers d’oiseaux, fatigués sans doute d’avoir traversé la mer des Indes, s’y reposent. De loin en loin, on voit, au milieu de la verdure, des groupes d’habitations, ou, sur quelque petit promontoire, un phare entouré d’une haute muraille comme une forteresse. M. Gerbier m’a expliqué que ces murs sont faits pour défendre les gardiens contre les tigres, très nombreux dans ce pays-là. Il m’a, à ce propos, raconté une histoire très drôle arrivée à un de ses amis, employé des postes. Ce jeune homme, le jour même de son arrivée à Saïgon, était allé vers deux heures de l’après-midi à l’estacade pour chercher un canot et s’amuser à faire un tour de rivière. En approchant de l’appontement, il aperçoit une énorme masse étendue en travers. C’était un tigre qui dormait au soleil le plus paisiblement du monde. Le voyageur n’eut garde de le troubler ; pris d’une terreur folle, il s’enfuit à toutes jambes et courut s’enfermer dans sa chambre à l’hôtel.
3 avril. — Depuis hier, nous naviguons dans les eaux de Singapoor. Notre bateau suit des petits canaux qui font mille détours, passe entre des îles parées d’une végétation splendide ; il y a là des arbres, des fleurs dont je n’ai jamais vu les pareils. Je suis dans l’émerveillement. Et quel beau temps ! quel beau ciel ! quelles belles vagues claires et vertes !…
Demain, nous serons dans la mer de Cochinchine, et dans quelques jours à Saïgon.
Mes notes cessent ici, car mon voyage maritime est presque terminé.
A M. Alain Le Pennec, chez M. Le Pennec, charpentier à Fouesnant (Finistère).
Saïgon.
Mon cher Alain,
C’est toi que je charge cette fois-ci de donner de mes nouvelles à Corentine ; elle n’en sera pas jalouse, car elle sait bien quel ami tu es pour moi. Je te rends bien ton amitié, va ! Je pense tous les jours à toi, et plus d’une fois par jour. Quand je vois quelque chose d’intéressant, je me dis tout de suite : Ah ! si Alain était là ! Mais comme tu n’y es pas, je veux que de loin tu puisses voir par mes yeux, autant que possible, ce pays si différent de notre Bretagne. Il est six heures du matin, nous sommes à dimanche, tu n’en es encore qu’à samedi. Nous avons vu le soleil sept heures avant toi. Pendant que je t’écris, tu dors à poings fermés sur ta couette de balle ; quand tes yeux s’ouvriront, ils verront la grande cheminée avec son banc, le coffre et l’armoire, et par la petite fenêtre, les poiriers du courtil tout couverts de fleurs blanches. Les miens pour l’instant regardent les rizières verdissantes, les palétuviers baignant leurs racines dans l’eau boueuse de la rivière, et les bosquets de bambous et de palmiers entourant les petites cases rouges à toits de chaume. C’est qu’il y a plus de la moitié du monde entre toi et moi, et le soleil nous montre sa face rayonnante bien longtemps avant qu’il se lève sur la France.
Hier nous sommes entrés dans la rivière de Saïgon ; il faut la remonter pendant quatre-vingts kilomètres pour arriver à la capitale de la Cochinchine ; elle coule entre des berges basses qui, sans cesse, s’écroulent, et, délayées dans l’eau, lui fournissent de la vase dont celle n’a certes pas besoin. A Saïgon même, il n’y a pas de quais à cause du peu de solidité de la rive[13].
[13] Dans tout ce qui va suivre il faut remarquer que le récit dépeint l’Indo-Chine il y a vingt ans ; ce n’est que dans les derniers chapitres qu’il parlera de choses contemporaines.
A peine notre bateau était-il mouillé, que nous avons été entourés d’une foule de petits sampans, c’est-à-dire de petites barques du pays qui venaient chercher des passagers pour les transporter à terre.
M. Gerbier étant très pressé d’aller voir son père, n’a pas voulu attendre un des canots du bord ; il est donc descendu dans un sampan et m’a pris avec lui à ma grande joie.
Imagine-toi une barque assez longue avec une voile en paille, oui, en paille tressée comme un paillasson, et deux petites plates-formes, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière. Sur celle de devant se tenait un homme qui faisait marcher la barque avec un seul aviron ; sur celle d’arrière, sa femme manœuvrait un autre aviron, et, tout en le maniant, elle dirigeait très adroitement le gouvernail avec son pied. Sous un toit de paille, une paillotte, comme on dit ici, dans un petit espace de deux mètres de large, sur trois mètres de long environ, était blottie toute sa nichée. Ils étaient là dedans, je ne sais combien d’enfants de tous les âges et de toutes les tailles ; on ne voyait que des têtes ; pour les bras et les jambes, je ne sais vraiment pas où ils avaient pu trouver de la place pour se loger. Les sampans — comme chez nous les barques — servent à une foule d’usages. On y fait la pêche ; on y transporte des personnes, des animaux, des pierres, des briques, du riz, du sel, des légumes, des poteries, enfin tout ce qu’on veut envoyer d’un endroit dans un autre. Comme il n’y a que peu de routes, pas du tout de chemins de fer[14], et, qu’au contraire, les cours d’eau (qu’on appelle arroyos) abondent, il est bien plus facile de se servir de barques que de voitures et de chevaux pour les transports. M. Gerbier, qui a beaucoup voyagé, m’a dit qu’en Hollande et à Venise, il en était de même. Les treschuyten et les peate[15] sont les sampans européens.
[14] Yves écrit en 1872.
[15] Le treschuyt est le bateau hollandais, la peata le bateau vénitien.
Aussitôt débarqué à Saïgon, nous avons couru chez M. Gerbier père. Il habite un petit hôtel tout près de son chantier.
Pendant que M. Émile était avec sa famille je suis resté à l’attendre tout en regardant travailler les ouvriers, qui sont pour la plupart des gens du pays. Au bout d’un quart d’heure, environ, un domestique est venu me chercher pour me conduire auprès de M. Gerbier. J’étais un peu intimidé, mais la vue de son fils qui se tenait près de lui, l’air tout joyeux, m’a donné de l’aplomb. Ces messieurs ont été excellents pour moi et m’ont dit de revenir les trouver demain vers dix heures du matin. Ce soir, je suis retourné à bord de la Vendée que je ne quitterai pas sans regret, car j’aime beaucoup le capitaine Simon.
Adieu, mon brave Alain, je suis ton ami pour la vie.
Yves Kerhélo.
Sur le pont de la Vendée, Yves, le béret à la main, son petit sac posé à côté de lui, se tenait debout devant le capitaine Simon, et, très ému, lui faisait ses adieux.
— Je suis content de toi, mon garçon, et te donne bien volontiers le certificat que tu me demandes, disait le capitaine. Je regrette de ne pouvoir te garder, mais tu es trop avisé pour te condamner à faire toute ta vie le métier de matelot, et puisque M. Gerbier t’offre une bonne position qui peut t’ouvrir un joli avenir, n’hésite pas, accepte-la tout de suite. Voilà ton billet de cent francs, prends garde de le perdre ou de le laisser voler, et voilà aussi une pièce de vingt francs que je te dois bien pour le service que tu m’as fait à bord. Maintenant, une bonne poignée de main. Allons ! c’est de tout cœur, de ton côté aussi bien que du mien ; voici tes papiers, ne les perds pas. Bonne chance, et n’oublie pas le capitaine Simon.
Et le rude marin se moucha bien fort, — si fort qu’il en devint cramoisi, — pour ne pas laisser deviner que ses yeux s’étaient tout à coup trouvés humides, ce qui sied mal à un capitaine au long cours.
Yves, le cœur un peu gros, mais l’esprit fort en éveil, à son ordinaire, prit congé de ses camarades de bord, portant sur son dos le sac qui contenait toute sa chétive garde-robe, il sauta dans un sampan et, de nouveau, se dirigea vers cette ville de Saïgon qu’il avait vue l’avant-veille en compagnie de M. Gerbier.
Il était sept heures du soir, le soleil s’enfonçant à l’horizon, dans une sorte de nuée poudreuse, jetait sur les rizières des reflets rougeâtres ; les buffles rentraient du labourage[16], hideux avec leurs gros yeux farouches, leurs ventres énormes souillés de boue, leur pelage couleur de cendre. Très doux avec les gens du pays, ces bêtes colossales ont l’horreur des étrangers et l’on court de véritables dangers en passant près d’eux. Le matin surtout, quand, au lever du jour, on ouvre les barrières du parc où ils sont renfermés pendant la nuit, ils se précipitent avec fureur, tous ensemble, écrasant tout ce qui se trouve sur leur passage. La troupe entière passe comme une trombe, faisant voler la poussière sous les sabots qui piétinent le sol. Il n’y a pas de force humaine qui puisse résister à cet élan sauvage.
[16] Les troupeaux de buffles employés au dépiquage des rizières appartiennent non pas à des particuliers, mais à des villages en communauté et l’ordre des travaux est réglé par les anciens du pays, de façon que chaque rizière ait à son tour une part équitable du travail de ces formidables laboureurs. Le riz étant la grande richesse et la base de la nourriture dans l’Indo-Chine, il importe à tout le monde que sa culture soit prospère, et il n’y a ni rivalités ni contestations entre voisins. Quand la récolte est faite, on lâche dans les rizières les buffles qui arrachent les pieds de riz pour les manger. En très peu de temps le sol, débarrassé des racines, est tassé par leurs pieds et prêt pour l’irrigation. On inonde alors les rizières en ouvrant de petites vannes qui laissent pénétrer l’eau du fleuve ou des arroyos. Elle séjourne sur le terrain pendant une quinzaine de jours. Quand la terre détrempée n’est plus que de la boue, sur une épaisseur de quinze à vingt centimètres environ, on y repique les plants de riz. Ce sont presque toujours les femmes qui font ce travail assez pénible, car il oblige à passer des journées entières les jambes dans la vase et le corps constamment courbé. On ne se sert ni de bêches ni de plantoirs, il suffit de prendre dans la main quelques tiges de replant, puis on creuse la boue avec la main fermée, et on laisse le petit paquet d’herbes dans le trou ainsi creusé ; Il se ferme de lui-même et emprisonne le replant ; On espace les trous de 20 à 30 centimètres ; les Annamites sont si habiles à aligner leurs plants qu’on les croirait tirés au cordeau. Quand la rizière est bien verdoyante, elle présente l’aspect d’un beau champ de blé ; plus tard, elle se couronne de légers panaches de graines d’un joli effet.
Pour le moment, ils paraissaient fort paisibles et n’avaient pour conducteurs que de jeunes enfants, à demi nus, assis entre leurs deux cornes, ou allongés paresseusement sur leur vaste dos.
— Où vais-je gîter pour cette nuit ? se disait Yves, en jetant un regard inquiet sur les paillottes d’aspect assez misérable qui s’alignaient le long des berges. Il n’y a pas là, il me semble, d’auberges comme à Concarneau, où, pour une pièce de vingt sous, on peut avoir bon dîner et bon coucher. Quant aux grands hôtels, ils ne sont pas faits pour un mousse de mon espèce. Et puis, si j’allais mal tomber, et me faire voler, et peut-être étrangler, par quelqu’un de ces petits diables à face brune, enjuponnés comme des femmes, que je vois accroupis devant leurs portes. Je sais ce que je vais faire ! je vais aller au chantier, il y a sûrement du monde pour le garder ; on me renseignera, je l’espère du moins.
En effet, il ne se trompait pas ; un conducteur des travaux qui n’avait pas fini sa besogne, veillait encore dans le bâtiment destiné aux bureaux. Il reçut avec assez de bienveillance le jeune garçon.
— J’ai ton affaire, lui dit-il, et tu ne pouvais mieux tomber ; mon beau-frère tient tout près d’ici une auberge pour les ouvriers, tu seras là très bien. Vas-y de ma part, ou plutôt, attends ; je vais te conduire moi-même, voilà que j’ai terminé mes comptes.
Yves le remercia avec effusion, et le suivit. Au bout de cinq minutes, ils arrivèrent devant une maison d’assez médiocre apparence, bâtie en briques noires faites avec de la vase séchée au feu. Un toit de tuile, porté sur des charpentes vermoulues dont le bout se relevait au coin et, en haut du toit, une crête bizarrement découpée indiquaient une maison chinoise. Elle était habitée par le beau-frère et la belle-sœur du contremaître, qui en avaient fait un cabaret avec logements au-dessus, rien de plus. Yves leur fut présenté et s’arrangea avec eux pour une chambre ou plutôt un petit galetas sous le toit à raison de 1 piastre 50 cents[17] par semaine. Puis, pensant qu’il serait convenable de reconnaître la complaisance du contremaître par une politesse, et aussi de se mettre bien avec lui, il lui offrit de prendre quelque chose.
[17] Environ 7 fr. 50. On compte dans tout l’Extrême-Orient par piastres et cents (prononcez sènnts). La piastre est censée valoir cinq francs et se divise en cent cents, — mais elle suit le cours de l’argent et sa valeur varie de 4 fr. 50 à 3 fr. 80.
— Très volontiers, dit celui-ci. Jacques, donne-nous une bouteille de ta fameuse bière ; M. Kerhélo ne sera pas fâché de faire connaissance avec.
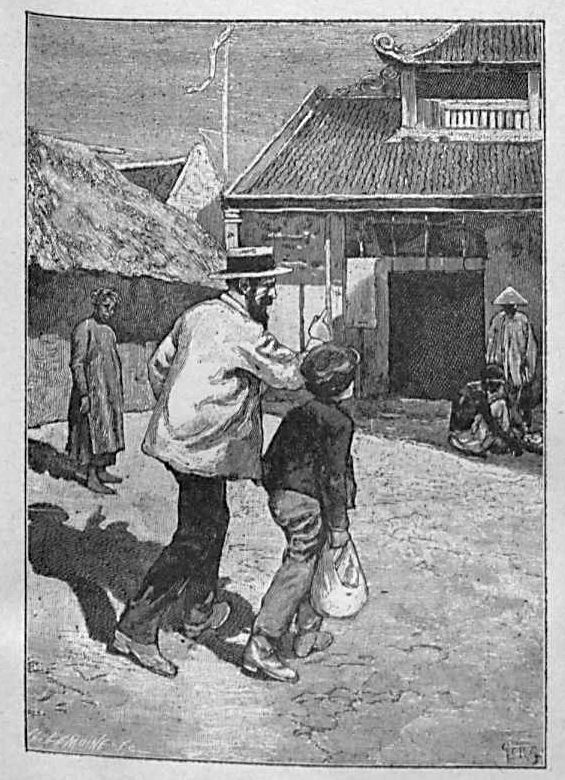
Ils arrivèrent devant une maison de médiocre apparence.
Monsieur Kerhélo ! Jamais Yves n’avait entendu rien de pareil de sa vie. Il devint tout rouge de plaisir et pour se montrer digne du brevet de gentleman qu’on lui accordait, invita l’hôtelier à prendre sa part du régal, puis il se fit servir à souper, mangea de bon appétit, souhaita le bonsoir à ses hôtes et monta dans son grenier où il dormit d’un profond sommeil jusqu’au lendemain matin.
Aux premiers feux du jour qui pénétrait difficilement à travers le papier huilé tendu sur sa petite fenêtre, il se mit sur son séant, se frotta les yeux, tout étonné de ne pas se trouver dans son hamac à bord de la Vendée et regarda autour de lui : la pièce où il avait passé la nuit, sorte de galetas sans plafond autre que le toit, n’était meublée que de sa couchette, d’une chaise boiteuse et d’une table éclopée. Il n’y avait pas même de cuvette et de pot à l’eau.
Il se leva, s’habilla, descendit dans la cour où quelques ablutions à la pompe complétèrent sa toilette du matin ; puis il entra dans la salle basse. Elle était déjà remplie d’une foule bigarrée : ouvriers européens à la figure bouffie et pâle, décolorée par l’anémie ; marins à face bronzée, au parler brusque, aux gestes énergiques ; soldats en tenue de campagne, matelots anglais, moroses et revêches ; Annamites vêtus de coton bleu ou brun, avec de grands chapeaux coniques ; Chinois corrects et actifs avec leur mine rusée, leurs yeux bridés, leurs lèvres minces, leur teint jaune, et la longue tresse noire, moitié soie, moitié cheveux, qui leur pend presque jusqu’aux talons.
Tout ce monde buvait, mangeait, concluait des marchés, sans grand bruit toutefois, et les éclats de voix des marins et des soldats, leurs jurons, leurs appels pour se faire servir dominaient la mélopée chantante des conversations en langue annamite.
Yves regardait d’un œil surpris ce mélange bizarre d’hommes et de races. Il se sentait si étranger, si perdu au milieu d’eux, que la voix de l’aubergiste qui l’interpellait en français le fit tressaillir.
— Nous avons notre petit compte d’hier soir à régler, monsieur Kerhélo, disait l’homme d’une voix goguenarde. Je n’ai pas encore l’avantage de vous connaître assez pour vous faire un long crédit ; vous savez, ici, on a bien de la peine à gagner sa vie, il y a des pertes à chaque instant avec du monde de toutes les sortes, comme il en vient.
— C’est bon, dit Yves, que l’air et l’accent de l’hôte agaçaient ; qu’est-ce que je vous dois ?
L’aubergiste releva les chiffres portés sur une ardoise :
— Eh bien ! il y a la chambre pour un mois, c’est six piastres.
— Mais c’est par semaine que je l’avais louée !…
— Oui, mon petit homme, à 1 piastre 50 cents par semaine, mais je ne loue jamais pour moins d’un mois ; et à payer d’avance encore. Mon beau-frère le sait bien, vous n’avez qu’à lui demander, vous allez le voir au chantier dans un instant, puisque c’est lui qui va être comme qui dirait votre maître d’équipage, eh ! eh ! eh !…
Et l’homme se mit à rire d’un mauvais rire insolent. Ceci arrêta court la colère d’Yves qui allait se fâcher. Il réfléchit qu’en effet, à son début dans un pays où il n’avait ni amis ni connaissances, il ferait prudemment de ne pas se mettre mal avec l’employé principal du chantier.
— Passons pour la chambre ; après ?
— Il y a la bouteille de bière, 50 cents.
— 2 fr. 50 ! Fichtre ! on en aurait six de pareilles à Concarneau pour ce prix-là.
— Ah ! c’est qu’ici il faut payer le transport, et puis la douane, et puis la casse. Et les pertes donc ! la chaleur qui nous fait tourner tous nos vins, l’eau qui entre chez nous dans les crues de la rivière ; en une heure tout est submergé, et nos caisses de bouteilles flottent comme des coquilles de noix, et puis quand l’eau est retirée, il y a un pied de vase dans la boutique ; avant qu’on ait tout nettoyé, il y en a pour des journées et des journées et la moisissure, après cela, qui se met dans les bouchons. Ah ! si vous croyez que c’est un métier à s’enrichir ! ajouta plaintivement le cabaretier.
— Pourquoi le continuez-vous alors ? dit Yves brusquement.
— Que voulez-vous, mon garçon ? on y est, on y reste… Ta piastre ne vaut rien, cria-t-il tout à coup en refusant une pièce d’argent qu’un client venait de jeter sur le comptoir.
Celui-ci était un petit homme robuste et trapu dont la figure hâlée et la chevelure inculte révélaient les habitudes de vie au grand air ; les instruments qu’il tenait d’une main le faisaient reconnaître pour un piqueur des ponts et chaussées.
— Comment ma piastre est mauvaise ? dit-il, qu’en sais-tu ?
— Écoute ! dit le cabaretier, en l’essayant à la manière chinoise, c’est-à-dire en la posant sur l’index replié, et en la faisant sauter avec l’ongle du pouce, comme fait un enfant pour lancer une bille. Elle sonne faux ! C’est du plomb.
— C’est du plomb ? ma foi ! je ne suis pas si habile que toi, car je me suis laissé mettre dedans par quelque voleur d’Annamite.
— Ah ! si on ne faisait pas attention à ces gueux-là, ils vous prendraient tout votre bien, reprit l’hôte ; rien que sur les pièces fausses, On perd la moitié de son bénéfice.
— Vous n’avez pas l’air si malheureux que vous le dites, remarqua Yves en regardant autour de lui.
— Lui ? malheureux ? s’écria l’homme à la piastre, allons donc ! il aura sa fortune faite avant dix ans d’ici, à moins qu’il n’ait le cou tordu par les pauvres misérables à qui il extorque leurs derniers sous. C’est un usurier fini, et la moitié des marchands du quartier lui doivent tout ce qu’il y a dans leur maison et leur maison aussi. Pas plus, par exemple ! Jacques n’est pas homme à prêter un centime au-dessus de la valeur de son gage.
— Eh bien ! faites comme moi, vous vous enrichirez, dit le cabaretier qui paraissait décidé à ne pas prendre en mauvaise part les coups de boutoir du piqueur.
— Moi ! non certes ! je suis un honnête homme, et si j’ai bien du mal à gagner quelques piastres, je veux, au moins, pouvoir me dire, quand je marche sous la maudite pluie de ce pays-ci, dans la boue, dans la vase même, trempé jusqu’aux os, inondé de sueur et harcelé par les moustiques : « François Midan, mon gars, tu es tout seul avec toi-même, tu es en bonne compagnie ! Là-dessus, bonjour, les amis ! »
Et rejetant la musette sur son dos, il saisit son bâton de rotin, et partit d’un bon pas, en sifflant entre ses dents comme pour rythmer sa marche.
— Tout ça, c’est de la jalousie, grommela l’aubergiste ; quand on réussit, on ne peut pas plaire à tout le monde, et si je prête de l’argent aux petits colons je leur rends service. Continuons notre compte.
— Qu’y a-t-il encore ? dit Yves qui commençait à s’inquiéter.
— Le souper, mon garçon, le souper, vous l’avez trouvé à votre goût, car les assiettes étaient nettes ; c’est 50 cents, et puis la bougie que vous avez demandée pour voir clair à ranger vos affaires, c’est 10 cents, — la bougie est hors de prix à Saïgon.
Yves bondit.
— Allez-vous me faire payer aussi l’eau que j’ai tirée au puits pour me laver la figure ? dit-il.
— L’eau, non, mais il y a le service ; c’est 20 cents.
— Quel service ?
Le service de votre chambre. Est-ce que Vous croyez que les draps de votre lit s’y étaient mis tout seuls ? Nous disons donc, hum… hum… hum… c’est 7 piastres 30.
Yves poussa un gros soupir, tira de sa poche un mouchoir à carreaux dans le coin duquel un nœud fortement serré retenait la belle pièce d’or du capitaine Simon et la déposa sur le comptoir.
— 7 piastres 30 cents, répéta l’aubergiste dont les yeux brillaient de convoitise devant le précieux métal, ce n’est pas assez de 20 francs ; la piastre est à 4 fr. 50, ce qui nous fait 33 francs.

— Ce n’est pas assez de 20 francs.
Yves devint rouge, puis pâle, devant une telle catastrophe. Il fallait changer son billet ! son orgueil, sa joie, son espérance !
— Du train que j’y vais, pensait-il, je n’en aurai pas pour longtemps et il faut vivre jusqu’à ce que je touche ma paie, et si l’on ne paie qu’à la fin du mois, que vais-je faire ?
Il paya l’hôte, empocha d’un air sombre ce qui lui fut rendu, et remontant dans sa chambre, tira de sa trousse de matelot son matériel de couture. Avec beaucoup d’adresse, il fabriqua un petit sac attaché à la ceinture de son pantalon et y mit son argent, car il ne voulait pas le laisser à l’auberge dans la crainte de se voir volé ; puis il s’achemina vers le chantier, le cœur moins léger que la veille au soir. Bien qu’il fût à peine six heures du matin, on y travaillait déjà avec activité, et M. Gerbier lui-même inspectait les travaux. Le jeune garçon s’approcha de lui, sans gaucherie, et le salua poliment.
— Te voilà, mon brave ! je ne t’ai pas oublié, dit l’entrepreneur d’un air assez gracieux. Attends-moi là un moment, je m’occuperai de toi tout à l’heure ; et il s’éloigna avec le contremaître, à qui il expliquait quelque chose de difficile à comprendre à en juger par ses gestes.
Yves, embarrassé de sa personne, regardait autour de lui. Les ouvriers étaient en majeure partie des Annamites et des Chinois. Ils travaillaient sans bruit, sans hâte, mais sans interruption, avec adresse et intelligence. Ils avaient des vêtements de coton amples et légers qui ne gênaient pas leurs mouvements et leurs pieds nus étaient chaussés de sandales en paille de riz tressée.
— Allons, viens par ici ! dit une voix jeune et gaie.
Il se retourna, M. Émile Gerbier était derrière lui. Un éclair de joie illumina les grands yeux bruns d’Yves et, chemin faisant, tandis qu’il suivait son bienveillant conducteur vers la maison des bureaux, il lui raconta ses récentes mésaventures.
— C’est là ce qui attend tous les nouveaux arrivés, dit M. Émile. Nous sommes aussi rudement exploités dans les grands hôtels que vous l’êtes dans les auberges, mais avec le temps, tout ceci changera ; les concurrences naîtront et les consommateurs ne seront plus à la merci des gargotiers. Mais, mon enfant, il ne faut pas s’imaginer qu’on vit ici comme à Concarneau. Ta santé et ta bourse en pâtiraient. Tâche de t’habituer à la vie des habitants du pays, c’est ce qui réussit le mieux quand on est assez robuste pour n’en pas souffrir, et la dépense est alors très minime. C’est peu à peu que tu t’y feras. Aie soin surtout de boire le moins possible, et jamais d’eau pure ; l’abus des boissons et le froid humide donnent la dysenterie. Il faut que tu achètes de grosse flanelle anglaise dont tu feras une ceinture de deux mètres de long sur 0,50 cent. de large, environ ; tu la porteras sur la peau. Avec cela et des vêtements de toile de coton, tu braveras la saison des chaleurs qui va commencer. Un régime sage et quelques précautions permettent de supporter très bien le climat de ce pays-ci. Voilà cinq ans que mon père y est ; ni lui ni moi, n’avons jamais été malades et nous avons beaucoup d’ouvriers dans le même cas ; mais ceux qui boivent, qui s’absinthent, qui fument de l’opium, qui couchent dans des paillottes humides ou qui ne portent pas de laine sur eux sont pris par les fièvres ou par le choléra, emportés en quelques heures ou réduits à un tel état de faiblesse qu’il faut les renvoyer en France. Voici mon père, nous allons savoir ce qu’il veut faire de toi…
— Mon fils veut que je t’emploie, dit M. Gerbier. A quoi es-tu bon ?
Yves ne se déconcerta pas.
— Je tâcherai d’être bon à tout ce que vous voudrez que je fasse, monsieur, dit-il d’un air résolu. Si je ne sais pas, j’apprendrai, et je ferai tout mon possible pour vous contenter.
— Tu n’as pas ta langue dans ta poche, mon garçon, eh bien ! tu me plais, tu as rendu un fameux service à la maison Gerbier, je ne te laisserai pas là, mais je veux qu’on se débrouille. Tu sais bien lire, écrire et compter, m’as-tu dit l’autre jour ?
— Oui, monsieur.
— Et tu es un honnête garçon : sous ce rapport, tu remplaceras avec avantage mon boy qui me vole. Tu vas être attaché aux bureaux pour faire des commissions dans le chantier, en ville et au port ; il faut donc que tu apprennes à parler annamite très couramment. Tu auras dix piastres par mois, mais tu ne pourras faire rien autre chose que mon service, car je veux t’avoir sous la main. Demain matin tu seras ici à ton poste. Profite de ton après-midi pour voir la ville et faire tes petits achats.
Yves salua et se retira assez en peine de ce qu’il allait faire. Lancé sans guide dans un pays nouveau pour lui, craignant d’être volé ou dupé, ne sachant où s’adresser, il était fort perplexe et suivait machinalement la grande rue de Saïgon. Tout à coup il s’entendit héler :
— Yves ! Yves Kerhélo ! eh ! mousse, accoste ici !
Sous la véranda d’un petit café annamite il vit deux matelots de la Vendée attablés devant une bouteille de bière. C’étaient de braves gens avec lesquels il avait toujours eu de bons rapports. Comme il lui semblait que tout cela était déjà loin derrière lui ! la Vendée, la vie de mousse, le capitaine Simon et ses bourrades, le poste et la gamelle plantureuse ! L’inconnu a, sans doute, de grands attraits pour les esprits hardis, mais il y a toujours quelques moments où l’on s’effraie un peu de ce qu’il cache sous ses voiles. Yves se sentit tout réconforté par la vue de ses camarades de bord ; il les mit au courant de ses affaires, et l’un d’eux, très honnête homme, qui connaissait bien Saïgon, l’ayant déjà visité plusieurs fois, s’offrit pour le piloter dans ses démarches. Il lui indiqua les magasins où il pouvait avoir à bon compte les vêtements nécessaires dans le pays, et le mena dans une petite pension d’ouvriers, où la nourriture mi-française mi-annamite n’était pas mauvaise. Mais au désespoir d’Yves, les achats, les repas, les politesses aux camarades firent une brèche notable dans ce qui restait du billet de cent francs, et quand il se coucha ce soir-là, fatigué de corps et d’esprit, il ne s’endormit pas, comme de coutume, en posant la tête sur l’oreiller.
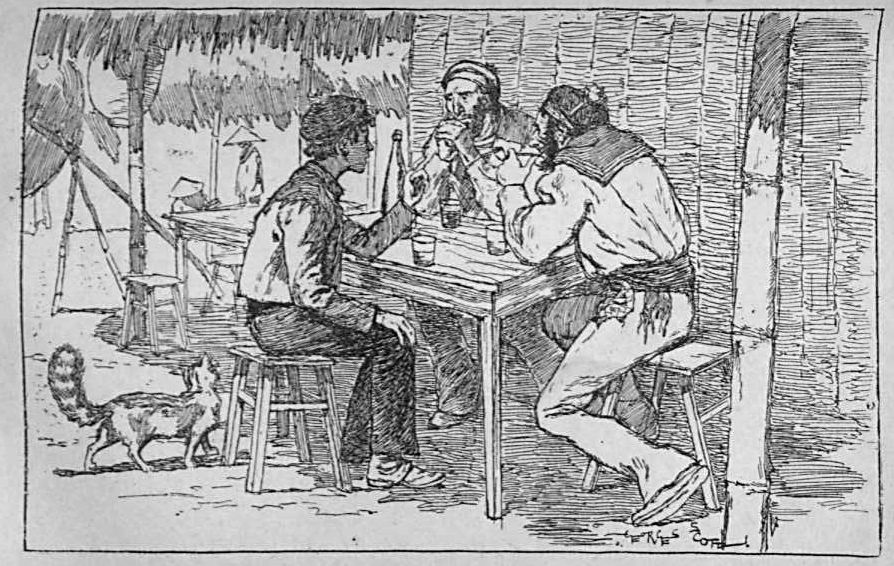
Yves mit les deux matelots au courant de ses affaires.
Le souci de sa destinée le tenait éveillé.
Chez sa mère, chez Mlle Martineau, à bord de la Belle-Yvonne, à bord de la Vendée, il s’était toujours senti protégé, une volonté supérieure réglant sa vie, il s’y soumettait et tout marchait droit. Mais maintenant il était libre ! libre à quinze ans ! Il ne devait compte à personne de ses actes, il répondait de lui-même ! Un grand sentiment de solitude vint l’envahir, et l’amertume en était si forte que ses yeux se remplirent de larmes.
— Que je suis loin de la France et de tous ceux que j’aime ! pensait-il. Si je mourais dans ce pays étranger, qui est-ce qui s’en soucierait ? Peut-être un peu M. Émile, mais il va bientôt partir, et alors… Ah ! ma Bretagne et mon clocher à jour ! et les tombes du cimetière avec leurs petits jardins, les reverrai-je jamais ?
Un tintement doux et triste vint frapper son oreille,… l’angélus du soir sonnait à la chapelle de la Mission. Yves se signa.
— Dieu est partout ! dit-il, il est à Saïgon aussi. Je l’ai un peu oublié tous ces jours-ci. C’est lui qui est mon père et ma mère, puisque je suis orphelin !
Il murmura le Pater, et s’endormit paisiblement.
Il n’était pas dans le caractère d’Yves Kerhélo de se laisser aller au découragement et à la mélancolie. Sa vigoureuse nature réagissait promptement contre les impressions alanguissantes ; il ne restait pas longtemps sous la vague, comme il disait en mémoire d’un souvenir d’enfance, et relevait promptement la tête. Trois jours après son entrée au chantier, il en connaissait les coins, les recoins, les allées et venues, le service, les occupants, les bâtisses, les machines, et jamais son patron n’avait besoin de lui répéter ou de lui expliquer un ordre. Au bout de huit jours, il savait Saïgon par cœur. Au bout d’un mois, il en aurait remontré à un vieux colon sur les ressources du pays et les moyens de déjouer les ruses des naturels. Il baragouinait l’annamite avec un succès prodigieux, et M. Gerbier se félicitait tous les jours de l’excellente recrue qu’il avait faite dans ce petit Breton alerte et débrouillard. Aussitôt qu’il l’avait pu, il avait quitté le cabaret de Jacques, et, fort ingénieusement, s’était installé un petit réduit dans un coin du chantier. Deux ou trois vieilles caisses dues à la générosité de M. Émile Gerbier, quelques briques de rebut en avaient fourni les principaux matériaux. Le toit, recouvert d’un paillasson en feuilles de latanier, ne laissait pas de passage à l’eau ; un autre grand paillasson, retombant de lui-même par son poids, formait la porte, et la construction, adossée dans l’angle formé par un mur d’un côté, et la maisonnette des bureaux de l’autre, se trouvait solidement étayée. Pour tout meuble, il avait un escabeau et une table, fabriqués avec des bouts de planches ; quant au lit, c’était tout simplement le lit annamite, c’est-à-dire une claie attachée par les quatre coins à quatre gros bambous fichés en terre. La literie est peu compliquée, matelas et couvertures sont du superflu dans un pays où il fait une chaleur de 30 degrés pendant six mois de l’année. Une natte sur la claie, une natte pour se couvrir, c’est tout et c’est assez. Yves aimait un certain confortable, il voulut y joindre le luxe d’un oreiller moins dur que l’oreiller annamite, qui est un simple tabouret de bois, et, un jour qu’il déballait une caisse de vins de France pour M. Gerbier, il obtint le cadeau des coiffes en paille entourant les bouteilles. Coudre un morceau de toile de coton pour en faire un sac n’était pas une affaire pour lui. Le sac fini, il le bourra de paille et se procura un traversin qui ne laissait rien à désirer. La question du loyer et du mobilier étant réglée ainsi d’une façon tout à fait économique, celle du vêtement fort simplifiée depuis qu’il portait la blouse et le pantalon en tissu de coton grossier, le chapeau conique en feuilles de latanier et les sandales en paille tressée, restait la grosse affaire de la nourriture. Pendant une quinzaine de jours, il avait pris ses repas dans la petite pension indiquée par le matelot de la Vendée, mais, quoique les prix fussent modérés, ils étaient encore au-dessus des ressources du jeune garçon. Il avait essayé de ne faire qu’un bon repas par jour, mais sa vie active, sa croissance qui n’était pas terminée lui donnaient bon appétit, et il s’aperçut bientôt que ne pas manger son content, ne pas réparer ses fatigues et laisser diminuer ses forces est une mauvaise économie. Il craignit de tomber malade et chercha un moyen de concilier les exigences de son estomac avec les ménagements dus à l’état de ses finances. Il ne fut pas long à le trouver. Sous une paillotte, à l’extrémité du chantier, les coolies[18] se réunissaient pour faire leur cuisine et l’odeur qui sortait des marmites avait plus d’une fois tenté Yves de goûter à leurs ragoûts.
[18] Travailleurs chinois.
Moyennant une poignée de sapèques[19], il obtenait bien par-ci, par-là, une écuelle de riz ou de poisson bouilli ; mais, le plus souvent, les coolies n’en avaient pas trop pour eux-mêmes, ou le regardaient avec défiance et lui répondaient par un refus.
[19] Monnaie chinoise. C’est un rond de cuivre ou de zinc, percé d’un trou au milieu. On les enfile en chapelets qu’on appelle ligatures. Il y a 60 sapèques en cuivre ou 600 sapèques en zinc par ligature. Une ligature vaut 80 centimes, c’est la sixième partie d’une piastre environ.
— Il faut que je fasse ma cuisine chez moi, se dit-il. Aussitôt que j’aurai touché ma paie du premier mois, j’achèterai de la vaisselle et du charbon de bois, et je mangerai mon content sans me ruiner. Il ne me reste plus qu’une pièce de 20 francs sur mon pauvre billet. Il est temps de faire des économies sérieuses.
Un fourneau annamite n’est pas un objet coûteux ; pour une demi-piastre, on peut s’en procurer un. C’est une sorte de plat en terre cuite supportant sur trois crampons une jatte en terre, ou un bassin de cuivre. On allume un petit feu de charbon ou de menus morceaux de bois, et cet appareil peu compliqué suffit à la confection des aliments fort simples qui composent la nourriture populaire : c’est-à-dire du riz cuit à l’eau avec ou sans sel, des patates[20], du poisson frit dans l’huile d’arachide, et, comme régal, de loin en loin, du porc coupé en petits morceaux et cuit dans sa graisse.
[20] Pommes de terre un peu aqueuses.

Yves faisait la cuisine devant sa paillotte.
Yves consacra une piastre à monter son ménage, et, sur une planche de sa cai-nha (cagna)[21], vinrent s’aligner : trois jattes de terre, quatre boîtes de conserves ramassées vides auprès de l’hôtel, deux petites tasses en porcelaine grossière, une théière en faïence, et une boîte de fer-blanc pour enfermer le thé, seul objet de luxe qu’il se fût permis. Tout cela était soigneusement astiqué, rangé, et tenu en état. Il aimait naturellement l’ordre et la propreté, et le capitaine Simon, fort sévère sous ce rapport, lui avait fait contracter des habitudes rigoureuses qu’il ne perdit jamais. Mais, pour nettoyer, il faut des torchons et des serviettes, et le trousseau de notre gars n’en contenait guère. Son ingéniosité suppléait à ce déficit. Tous les bouts de serpillière, de cordages, de toiles d’emballage, qui, avant lui, se perdaient dans le chantier, trouvèrent leur emploi. Le soir, quand sa journée était finie, ou le matin avant l’ouverture des bureaux, il s’occupait de son intérieur. Il s’était fabriqué des balais avec de la bruyère (doux souvenir de Bretagne !), des brosses avec des cordes détordues ; il récurait au sable ses fers-blancs et les rendaient luisants comme de l’argent ; il lessivait ses vêtements de toile de coton, n’y laissant ni trou ni tache, et sa vie était si bien remplie qu’il s’étonnait qu’on pût trouver le temps d’aller s’abrutir dans les fumeries d’opium ou perdre son argent dans les maisons de jeux, comme le faisaient la plupart de ses camarades. Ceux-ci le jalousaient un peu ; ils lui reprochaient sa sauvagerie, et ce qu’ils appelaient son avarice. Mais le petit Breton tenait bon, laissait dire et, chaque mois, ajoutait une piastre ou deux au trésor qu’il avait confié à M. Émile Gerbier.
[21] Case-maison.
Il n’avait point d’ami intime, ce qui est un peu triste pour un jeune garçon, mais quand les bateaux de France arrivaient, il trouvait souvent parmi les matelots ou les soldats quelque compatriote, — la Bretagne fournit tant de marins ! — et alors, il passait de bons moments à parler du pays, à demander des nouvelles des uns et des autres, et comme il était bon et serviable, il s’ingéniait à rendre service aux nouveaux arrivants.
Un dimanche matin qu’il flânait sur le port sans trop savoir que faire de son jour de congé, il s’entendit appeler par son nom, et, à sa grande joie, reconnut un gars de Fouesnant un peu plus âgé que lui, dont les parents demeuraient tout près de chez Mlle Martineau. Il lui sauta au cou, et l’excès de son émotion lui coupa tout d’abord la parole. Après l’avoir embrassé à plusieurs reprises, il reprit un peu de sang-froid et assaillit son camarade d’un déluge de questions :
— As-tu vu Corentine ? et Alain ? et Mlle Martineau ? et qu’y a-t-il de neuf là-bas ? et qu’es-tu venu faire à Saïgon ? etc., etc., etc.
Guillerm Menez répondait de son mieux, sans grande chaleur cependant. C’était un garçon d’une vingtaine d’années environ, peu communicatif, sa physionomie sournoise ne prévenait pas en sa faveur, et, si notre ami Yves, au lieu de se laisser emporter par le plaisir de revoir un compagnon d’enfance, avait remué à fond ses souvenirs, il y aurait trouvé celui d’une formidable paire de claques reçue de sa mère, un jour qu’il avait employé tout un jeudi à jouer à pile ou face avec Guillerm, et la défense formelle de fréquenter le dit Guillerm. Mais tant de choses s’étaient passées depuis ce temps-là ! Et puis, à trois mille lieues de son pays, on oublie tout ce qui n’est pas la joie de se retrouver !
— Tu vas venir déjeuner avec moi, dit Yves, le cœur bondissant de plaisir et, pour aujourd’hui, je dis adieu à ma cuisine. Je sais un petit restaurant annamite où je mangeais les premiers temps de mon arrivée ici, et où l’on n’est pas mal du tout. C’est moi qui régale.
— Et moi, je t’offrirai le café, dit Guillerm, chez Lambert, sur le port.
— Tu connais donc Saïgon ?
— Parbleu, c’est la troisième fois que j’y viens ! deux fois avec un bateau marchand et cette fois-ci avec l’Européen, où je fais mon service.
— C’est vrai ! tu as le col bleu, et Européen en lettres d’or sur ton béret. Et tu as pu descendre à terre ?
— Oui, jusqu’à ce soir.
— Eh bien ! allons dire deux mots aux poulets frits de ma cambuse, tu verras que ça se laisse manger.
— Très volontiers, mais d’abord prenons l’absinthe, c’est de rigueur.
Et les deux jeunes gens partirent bras dessus, bras dessous.
Deux heures plus tard, attablés sous l’auvent de toile du café Lambert, ils savouraient une tasse de café, où, il faut l’avouer, l’eau-de-vie entrait pour une bonne moitié. Yves, peu habitué aux boissons alcooliques, commençait à être plus qu’émoustillé. Il avait les joues ardentes, les yeux brillants ; il parlait, parlait sans arrêter, invitait les survenants à prendre quelque chose pour fêter son pays, « son bon camarade, son ami d’enfance, Guillerm Menez, — ce bon Guillerm », répétait-il la langue pâteuse et la voix attendrie.
Celui-ci ne sourcillait guère et continuait à boire et à fumer presque sans mot dire. Trois ou quatre matelots de sa connaissance étaient venus s’asseoir à la même table que lui ; après quelques pipes fumées et quelques verres d’absinthe bus, la conversation devint languissante et Guillerm proposa de faire un trois-sept[22]. L’idée fut reçue avec acclamation ; on apporta un paquet de cartes graisseuses, et la partie commença.
[22] Jeu de cartes pour lequel les Bretons sont passionnés.
Yves aimait le jeu, comme tout vrai Breton. Bien des fois, il s’était arrêté à regarder les Annamites jouant au Ba-couan[23]. Il avait parfois risqué de petites sommes, mais sans jamais perdre son sang-froid, s’arrêtant après le gain, et ne cherchant point à forcer la veine. Il était même un peu vaniteux de sa supériorité en ce genre et de la force d’âme qu’il déployait pour limiter la perte, de sorte qu’elle ne dépassât en aucun cas la somme qu’il avait prévue. Que de fois, les mains dans ses poches, il avait haussé les épaules devant les désespoirs, les cris de rage, les fureurs des joueurs malheureux.
[23] Ce jeu a quelque analogie avec celui de la roulette. Il est tenu par un banquier qui a devant lui une table sur laquelle sont écrits en croix les chiffres 1, 2, 3, 4. Dans un coin se trouve un tas de sapèques. Le banquier en sépare un certain nombre sous une tasse renversée, puis les joueurs misent sur un des quatre chiffres. On découvre les sapèques, on les compte ; suivant que leur nombre est un multiple de 4 plus 1, 2, 3 ou 4, c’est le chiffre 1, 2, 3 ou 4 qui gagne. Dans tous les cas, le banquier paie 3 fois la mise.
« Faites comme moi, disait-il. Quand j’ai gagné deux piastres, j’en retire une du jeu, et je joue avec l’autre ; si je gagne encore, je mets de côté la moitié de mon gain, si je perds, je m’en vais et tout est dit. »
M. Émile Gerbier, un jour que le jeune garçon lui expliquait sa théorie, et, comme preuves à l’appui, lui montrait un petit revolver qu’il avait acheté avec le produit de ses gains, avait froncé le sourcil.
— Prends garde à toi, Yves, avait-il dit, tu es sur une mauvaise voie ; elle va en pente rapide, on ne peut pas toujours s’y arrêter, et quand on glisse, on tombe si bas qu’on se casse le cou. Tu dis que tu es assez fort pour te retenir à temps, tu n’en es pas sûr. Quand la fièvre du jeu vous saisit, elle vous affole, on n’est plus maître de soi. J’en sais quelque chose, je ne suis pas joueur, pas du tout. Eh bien ! un soir à Monte-Carlo, j’ai perdu cinq mille francs, tout ce que j’avais sur moi, et il m’a fallu engager ma montre pour payer ma dépense à l’hôtel. Et puis, en mettant tout au mieux, en supposant que tu gagnes toujours, crois-tu que cela soit une chose honorable de s’enrichir des dépouilles d’autrui ? L’argent du jeu est un bien mal acquis : c’est le fruit du vice et non le produit légitime du travail. Un honnête homme n’a point de plaisir à s’en servir pour se faire des cadeaux.
Yves avait baissé la tête, et s’était éloigné mécontent de M. Gerbier et de lui-même, mais au bout de quelques pas :
— Il a beau dire, je n’en ai pas moins ce bijou-là, sans qu’il m’en coûte rien, pensa-t-il en faisant jouer la gachette de son revolver, — et toute envie de se corriger disparut absolument.
La nuit descendait, amenant la fraîcheur sur la rivière ; les feux allumés pour le souper tachaient de grands points lumineux les masses sombres des sampans déjà groupés ; les cris des femmes, les rires ou les pleurs des enfants, les aboiements des chiens sur les rives, jetaient une note vivante non dépourvue d’un charme étrange.
Peu à peu, cependant, le mouvement cessa, le bruit fit place au calme, le sommeil vint régner sur la terre et sur l’onde, et la lune, qui brillait dans un ciel pur, répandit ses rayons paisibles sur le fleuve silencieux…
Yves et ses compagnons jouaient encore. Ils étaient rentrés dans l’intérieur du cabaret, et, à la lueur d’une lampe fumeuse, au milieu du nuage épais sortant de leurs pipes, ils échangeaient d’une voix rauque les termes du jeu, coupés par de violents jurons. Yves était dégrisé depuis longtemps ; un vice avait chassé l’autre, d’ailleurs il n’était pas buveur, mais le démon du jeu l’avait saisi dans ses griffes. D’abord gagnant, puis perdant, puis regagnant encore, poursuivant la chance qui semblait à chaque instant lui faire de séduisantes avances, il oubliait tout, dans l’enivrement d’un espoir avide, sans cesse renaissant et sans cesse déçu. Il avait affaire à forte partie : trois de ses adversaires étaient des joueurs de profession, rompus à toutes les ruses du jeu ; à minuit, quand on mit tout le monde dehors pour fermer boutique, il avait dépensé tout ce qu’il avait d’argent sur lui et perdu sur parole une centaine de francs.
— Tu auras ton argent demain, dit-il d’un ton brusque à Guillerm qui lui offrait une revanche et insistait pour la lui faire accepter. Que te faut-il de plus ? Toi et tes camarades vous m’avez dépouillé ce soir de tout ce que j’avais mis de côté à grand’peine depuis six mois, mais tant pis pour moi, je n’avais qu’à ne pas jouer. J’ai perdu, je paierai, mais laissez-moi tranquille !
Ceci fut dit en d’autres termes et d’une façon si énergique, que les matelots qui avaient commencé à se moquer de lui, cessèrent leurs plaisanteries grossières et échangèrent un regard d’intelligence.
— Il n’est pas commode, le petit gars, dit l’un d’eux à demi-voix.
— Bah ! s’il nous paie, c’est l’essentiel, mais je crois bien qu’il n’y a plus rien à tirer de lui.
Guillerm donna à Yves une poignée de main très peu cordiale et s’éloigna avec ses camarades pour regagner le bord.
Notre héros avait fait bonne contenance tant qu’il s’était trouvé en compagnie, mais une fois seul, n’étant plus soutenu par son orgueil, ses nerfs se détendirent, il se laissa tomber sur un monceau de bambous à quelques pas du fleuve, et… faut-il l’avouer ! se mit à pleurer amèrement. D’humiliation, d’abord ; lui qui se croyait si fort, qui se moquait des joueurs imprudents, n’était-il pas descendu à leur niveau maintenant ? Qu’elle s’était promptement réalisée, la prédiction de M. Émile Gerbier ! Ah ! la pente ! comme elle était glissante ! comme elle vous entraînait ! Et puis quel désastre dans sa vie ! Ce pauvre petit pécule, amassé sou à sou avec des soins de fourmi diligente, au prix de tant de privations, où était-il ?… disparu, en quelques heures,… anéanti comme s’il s’était englouti dans l’eau vaseuse qui formait des remous à ses pieds.
Et ce n’était pas tout ! il avait perdu plus qu’il ne possédait, — dix-huit francs de plus ! Où les trouver ? tout son mobilier ne valait pas deux piastres. Et cependant, les dettes de jeu on les paie tout de suite, tout le monde sait cela. La loi ne les reconnaît pas, c’est pour cela qu’on les appelle des dettes d’honneur. Certes, c’est un nom qui ne leur convient guère, car il n’y a point d’honneur à se livrer à ses passions, mais quand on a promis, il faut tenir : c’est là que l’honneur est en question, et quand on s’assied devant une table de jeu et qu’on commence une partie, il est convenu qu’on paiera si l’on perd ; c’est une parole donnée d’avance ; si on y manque, on est un coquin. Yves avait entendu un jour le capitaine Simon et M. Gerbier causer sur ce sujet et ce qu’ils avaient dit s’était gravé dans son esprit…
La fraîcheur le gagnait ; il se leva, se secoua, et se mit à marcher à grands pas le long de la rivière.
— C’est assez pleurer comme cela, se dit-il, je ne suis plus un enfant ! Ce n’est pas avec des pleurs que je mettrai ordre à mes affaires. J’ai fait une sottise, il faut que j’en subisse les conséquences. C’est comme le jour où nous avions été, Alain et moi, pour dépecer l’épave et où nous avons failli y rester. J’en suis sorti et j’ai même tiré mes souliers du fond de l’eau, mais je crois bien que cette fois-ci je ne tirerai pas même mes souliers, car il faudra tout vendre au Juif pour avoir ces dix-huit francs ! Et mon argent qui est chez M. Gerbier ! Je serai forcé d’aller le lui demander, et lui dire pourquoi encore ! C’est ça qui sera une rude corvée !
Les édifices en construction dessinaient leurs masses noires sur la nuit claire. Yves les considéra et poussa un gros soupir.
— Oui, dans quelques heures, je serai là, au pied de ces bâtisses, — pas fier ! oh ! non ! — à la porte du bureau, attendant M. Émile pour lui faire ma confession. Ah ! hier matin, quand je me suis levé si joyeux, que j’ai mis mes habits du dimanche avec tant de plaisir, qui m’aurait dit qu’aujourd’hui ils ne seraient plus à moi ! car il faudra bien que je les vende aussi… Dix-huit francs ! c’est une grosse somme ! Personne ici ne peut me la prêter ; et puis, quand la rendrais-je ? Mais je n’ai rien fait pour être renvoyé du chantier, je n’ai pas perdu ma place ; en travaillant bien et en économisant, je me referai un petit magot, et celui-là je ne le perdrai pas au jeu ! ah ! mais non, par exemple !
La campagne était déserte, les sampans réunis en groupes compacts faisaient de grands espaces noirs sur l’eau du fleuve, où tremblotaient les rayons de la lune. Le silence n’était rompu que par les aboiements des chiens annamites ou la courte et lugubre mélopée des matelots de quart à bord des navires de l’État, annonçant toutes les demi-heures : bon quart à tribord ! — bon quart devant ! — bon quart à bâbord ! — bon quart derrière.
— Quand je rôderais là toute la nuit comme un malfaiteur, pensa Yves, à quoi cela m’avancera-t-il ? Je serai éreinté demain et hors d’état de faire mon service. Ce ne sera pas le moyen de me rendre agréable à M. Gerbier. Allons dormir !
C’est bientôt dit : « Allons dormir ! » ce n’est pas aussitôt fait quand on a la conscience troublée. Jamais notre gars n’avait trouvé son oreiller si dur et son lit si peu confortable. Jamais les moustiques ne l’avaient tenu éveillé ainsi avec leur intolérable zomm, zomm.
En temps ordinaire, moulu de fatigue, il dormait à poings fermés, mais le sommeil, cet ami bienfaisant, ne clôt pas les yeux brûlés par l’alcool, la fumée des tabagies, les regards fiévreux sur les cartes. Les heures sonnaient à l’horloge du chantier ; qu’elles semblaient longues au pauvre Yves !
Enfin, une bande claire, d’un gris rougeâtre, étendit une zone lumineuse à l’horizon : les coqs chantèrent, les coolies commencèrent à arriver…
C’était la vie de tous les jours qui reprenait son cours.
A huit heures, Yves, dans sa tenue la plus soignée, frappait à la porte du bureau de M. Émile.
Par un sentiment de délicatesse inné chez lui, il avait deviné que, dans un cas aussi grave, il n’était plus Yves, le boy, arrivant avec ses sandales de paille et son costume de coton, pour se mettre aux ordres du patron, mais Yves Kerhélo, déjà presque un homme pour la raison si ce n’est par l’âge, venant avouer ses fautes et demander aide et protection à un ami.
— Entrez, dit une voix, et, le cœur serré d’une angoisse très douloureuse, Yves poussa la porte et s’arrêta sur le seuil.

Yves poussa la porte.
M. Gerbier le regarda avec étonnement…
— Comme te voilà beau ! mon garçon ! s’écria-t-il. Est-ce que tu es de noce ? Tu viens demander une piastre ou deux, je gage ? Ton petit trésor est là, nous allons y puiser.
Yves devint très rouge.
— Monsieur, dit-il d’une voix altérée, vous êtes bien bon pour moi… C’est vrai que je viens vous demander de l’argent… Mais ce n’est pas pour ce que vous croyez…
Alors, sans faiblir, sans biaiser, sans chercher à atténuer ses torts, avec un grand accent de sincérité, il raconta les scènes de la veille et comment il avait perdu au delà même de ce qu’il possédait. Il dit aussi son intention de vendre le peu d’objets de valeur qui lui appartenaient pour se libérer immédiatement.
M. Gerbier l’avait écouté sans l’interrompre, le front soucieux et l’air attristé…
— Je pense que tout reproche serait inutile, lui dit-il. Ta conscience a dû t’en faire d’assez cuisants depuis hier soir, et tu as reconnu par une dure expérience où conduit l’entraînement du jeu. Tu es resté cependant, et resteras, je n’en doute pas, un honnête garçon ; ta courageuse franchise en est une preuve convaincante. M’as-tu dit toute la vérité ?
— Oh ! oui ! toute ! toute !! monsieur.
— Tu ne dois rien de plus que la somme dont tu me parles ?
— Rien, rien au monde, je vous en donne ma parole.
— Eh bien ! je veux te venir en aide, — pas par un cadeau fais-y bien attention, — mais par une avance. Il ne faut pas que tu vendes tes souliers ni tes habits du dimanche. Tu n’en trouverais qu’une somme dérisoire et tu risquerais de perdre les habitudes de tenue décente que t’ont données tes parents et qui sont une si bonne chose dans la conduite de la vie. Tu ne vendras pas non plus ton revolver. C’est une arme utile en pays étranger, et puis sa vue sera pour toi une continuelle leçon ; elle te rappellera ce que valent les gains du jeu…
Voici ton argent et voici cinq piastres, car tu ne peux rester sans un sou devant toi. Tu vas aller payer ton matelot tout de suite, et me jurer que d’ici à ce que tu m’aies rendu mes cinq piastres, tu ne toucheras pas une carte…
— Ni après non plus, monsieur Gerbier, je le jure ! devant Dieu qui m’entend.
— C’est bien, je te crois. Pour me solder ta dette, tu laisseras tous les samedis, sur ta paie, une demi-piastre ; cela te gênera un peu, mais il est nécessaire que tu sentes le poids de ta chaîne, cela t’empêchera d’oublier que tu l’as forgée toi-même. Maintenant, donne-moi une poignée de main, tu n’as rien perdu dans mon estime… Mais ne recommence plus !
Yves, les yeux humides de reconnaissance, serra timidement la main qui lui était tendue, et partit le cœur déchargé d’un grand poids ; mais pendant bien des jours les coolies s’étonnèrent de ne plus l’entendre siffler comme un oiseau des bois, dans ses courses à travers le chantier.
Le temps avait passé rapidement pour notre ami Yves Kerhélo ; il devenait un jeune homme robuste et bien pris dans sa taille un peu courte, et comme il avait gardé ses cheveux bruns bouclés et ses beaux yeux brillants, c’était un fort joli garçon, et, ce qui vaut mieux, un brave garçon.
La parole donnée à M. Émile Gerbier avait été scrupuleusement tenue, — Yves n’avait plus touché une carte ; il avait payé toutes ses dettes, rempli sa malle de linge et de vêtements, augmenté peu à peu le confortable de son logis et même amassé de petites économies.
Il n’avait qu’un regret, — celui d’être si loin de sa sœur, et qu’un chagrin, — chagrin profond et sans remède, il est vrai — : un accident d’enfance en lui faisant perdre un doigt de la main droite, l’avait rendu impropre au service militaire. Il avait cru qu’il pourrait entrer dans la marine de l’État, — la mutilation de sa main ne lui enlevant ni force, ni adresse ; mais son illusion fut cruellement dissipée lorsqu’il se présenta pour se faire inscrire comme engagé volontaire. Il sortit la tête basse et le cœur navré des bureaux du commissariat maritime ; toutefois sa nature énergique reprit promptement le dessus. « Si je ne puis pas être un bon soldat ou un bon marin, rien ne m’empêchera d’être un bon Français, se dit-il, et quant à ce qui est de se battre, il n’y a pas besoin d’avoir dix doigts pour tirer un coup de revolver, et donner un coup de hache bien tapé, — au besoin je le ferai voir ! »
Cependant le souci de son avenir commençait à l’inquiéter.
Les travaux du chantier touchaient à leur fin, M. Gerbier père était déjà rentré en France, son fils ne tarderait pas à le suivre, et puis ce travail de boy, bon pour un enfant, était au-dessous des forces d’un homme. Yves désirait faire mieux et gagner davantage. Mais faire quoi ?… Il ne savait aucun métier ; entrer en apprentissage à son âge, c’était assez dur, et puis quelle perte de temps ! Se placer dans les bureaux ne lui souriait guère, lui si actif, si alerte, si habitué à la vie en plein air, il mourrait d’anémie s’il lui fallait rester assis et enfermé.
… Un soir qu’il rêvait à tout cela en préparant le souper sur son petit fourneau annamite, un de ses camarades qui passait se planta devant lui comme s’il avait tout à coup pris racine et reniflant fortement s’écria :
— Ça sent diantrement bon ta cuisine ! Fichtre ! tu te nourris bien ! Qu’est-ce que tu fricasses là ?
— Un poulet, dit Yves flatté de l’hommage rendu à ses talents.
— Un poulet ! quel luxe !
— Pas tant que ça ! — j’en ai acheté une demi-douzaine pour une demi-piastre (2 fr. 30), je les nourris avec mes restes et du riz, ils sont plus gras que ceux du marché. — Si seulement j’en avais deux, je t’inviterais à dîner[24], mais viens dimanche et je te régalerai à ma façon.
[24] Les poulets annamites sont très petits.
— Bien volontiers, dit l’autre qui était un bon garçon ; j’apporterai le dessert, des bananes et des ananas — je connais un Annamite qui en a de fameux — et puis nous irons prendre le café chez Lambert…
— Non ! non ! dit Yves en tressaillant comme si un serpent l’eût piqué, pas de ça ! — Je ne t’invite pas pour que tu me rendes tout de suite ma politesse, mais si ça t’ennuie de ne rien m’offrir, apporte du café et du sucre, j’ai les bibelots qu’il faut ; nous serons bien mieux chez nous, tu verras, que dans toutes leurs sales baraques !
— Comme tu voudras ! à dimanche sans faute !…
Une invitation mène beaucoup plus loin qu’on ne pense. Yves rencontra justement, le dimanche matin, ce matelot de la Vendée qui lui avait rendu si grand service le jour de son début à Saïgon. « Puisque je donne un dîner, pensa-t-il, je mettrai un poulet de plus, et nous serons plus gais à trois qu’à deux. Pierre est un bon camarade, et un honnête homme, il ne sera pas de trop » ; et il le pria de venir souper chez lui, ce que le matelot étonné et ravi accepta avec enthousiasme.
Tous les tracas d’une jeune maîtresse de maison qui va donner son premier dîner, vinrent alors assaillir notre homme. — La table serait-elle assez grande ? oui, on pourrait même y dîner à quatre, mais le dessus n’était guère joli ; on avait beau la raboter, les planches jouaient, il y avait des fentes lamentables. Que ce serait beau d’avoir une nappe ! Ici Yves tomba dans une profonde méditation. Il n’était pas assez novice pour ignorer que le linge ouvré venant de France, coûtait un prix fou, et pourtant quelle bonne tournure donneraient au festin une nappe et des serviettes !…
Une idée merveilleuse lui traversa l’esprit. « Avec six mètres de cotonnade annamite j’aurai tout ce qu’il me faut », pensa-t-il, je n’ai pas besoin de faire des ourlets, je ferai une frange au bout comme il y en a aux serviettes de toilette de M. Émile Gerbier dans le bureau, ça ne me ruinera pas ; pour une piastre, j’en verrai la fin. Je pense bien en dépenser deux pour recevoir mes amis ; puisque j’ai de l’argent de côté, il me restera encore bien assez pour acheter deux verres et trois assiettes, et même deux couverts de fer battu… Comme ils vont être surpris !!
Le dimanche vers sept heures, Joseph Roy et Pierre Postel, les invités d’Yves, arrivaient ; tous deux s’étaient faits beaux. Joseph portait d’une main une corbeille annamite d’où débordaient les grappes de bananes, et de l’autre, pressait sur son cœur un petit paquet de papier bleu exhalant l’arome du moka ; Pierre avait sous le bras une bouteille à cachet d’un brun rouge, à étiquette jaune, sur laquelle on pouvait lire : fine champagne. — Tous deux poussèrent un cri d’admiration à la vue du couvert d’Yves. Il l’avait disposé en plein air, sous un bosquet de bambous, à quelques pas de sa case. La table, avec sa nappe, ses serviettes, ses fourchettes étincelantes et le charmant bouquet de fleurs qui ornait le milieu, offrait un coup d’œil hospitalier et gracieux, et le parfum succulent qui s’échappait des écuelles posées sur les fourneaux de terre, promettait aux conviés des satisfactions d’un ordre plus solide.
— Mâtin ! qu’il fait bon chez toi ! Yves, dit le marin en se laissant tomber sur une escabelle et en s’essuyant le front. Tu as toujours été un débrouillard ; je me rappelle, sur la Vendée, tu avais déjà une foule de petites inventions pour arrimer ton bagage, mais ici tu es au large ! Alors voilà ta case là-bas, — et tous ces meubles-là ?…
— C’est moi qui les ai faits ! dit Yves, et ils sont solides, je m’en flatte ! Allons, Joseph, assieds-toi là, et à la besogne !
Le festin débutait par une assiette de camarons, grandes crevettes d’un goût moins délicat que leurs pareilles d’Occident, mais les convives n’étant point difficiles y firent fête. Vinrent ensuite un plat de poisson bouilli assaisonné de nhoc-man[25], puis un ragoût de porc bien rissolé dans sa graisse et entouré d’une couronne de haricots verts, enfin les fameux poulets, frits dans du saindoux et relevés, eux aussi, d’un peu de nhoc-man. Quel régal ! — C’était plaisir d’entendre les exclamations, de voir les mines gourmandes des invités. Les plats étaient vides jusqu’à la dernière miette, et Yves accablé d’éloges.
[25] Le nhoc-man, très en usage dans toute l’Indo-Chine, est une liqueur faite avec du poisson séché et réduit en poudre. C’est un condiment d’une forte saveur.
— Je vous traite à l’annamite, disait-il modestement ; vous avez du thé pour boisson, et du riz au lieu de pain ; je ne suis pas millionnaire, et ici, il faut être riche pour se payer du pain et du vin.
— Ton thé est excellent, dit Pierre.
— Et ton riz est si bien cuit à point ! reprit Joseph, il est aussi bon que celui des Annamites.
— Ah ! c’est que je fais bien attention à ne pas mettre trop d’eau et à le laisser se gonfler, et crever tout doucement à petit feu.
— Où as-tu appris à devenir si bon cuisinier que cela, donc ?
— En regardant faire des Annamites ; et puis à bord de la Vendée, tu sais bien, Pierre, que le capitaine Simon n’aimait pas qu’on fît de la gargote. Il avait l’œil à la cambuse !
— L’œil ! tu peux bien dire le nez plutôt ! Une fois que j’étais de quart dans ces parages-là, et que j’avais laissé brûler le rata, il l’a senti, il était dans une colère ! ah ! nom de nom !
— Et nos fruits ! dit Joseph, est-ce qu’on ne va pas leur dire deux mots ? La cong-gaï[26] les a cueillis tout frais pour moi.
[26] Femme du peuple, paysanne.
— Tiens, ils auront la place d’honneur, dit Yves en enlevant le bouquet qu’il remplaça par la corbeille, et ils la méritent bien ! qu’ils sont beaux ! voilà deux ananas gros comme ma tête, et des mangues ! oui ! ma foi, de belles mangues dorées ! Tu fais des folies ! camarade, on ne voit ça que sur la table du patron. Tu les as payées au moins quatre cents la pièce ?
— Ne pense pas à ce que je les ai payées, c’est pas ton affaire ; quand on se régale entre bons amis, on peut bien se permettre un petit extra, n’est-ce pas ?
— Sûrement, sûrement, et voilà aussi quelques petites douceurs : des bonbons et des gâteaux de chez Lan-long, le fameux marchand du port.
— Toutes leurs sucreries, ça ne me va pas, dit Pierre ; leurs bonbons, c’est de la mélasse et de la farine, j’aime encore mieux les gâteaux, ils ressemblent aux craquelins de chez nous.
— Où vas-tu comme ça, Yves ?
— Faire le café donc ! Joseph a apporté tout ce qu’il faut, nous allons prendre notre café chez nous, dans nos tasses, comme des bourgeois.
— Et voilà de la fine champagne, et de la bonne ! je m’en flatte, s’écria Pierre ; ce n’est pas de la drogue comme on en vend ici dans les boutiques ; — que ça fait mal au cœur à un vrai matelot de donner son bon argent pour pareille chose ! Celle bouteille-là elle vient de La Rochelle, du pays de l’eau-de-vie, je la gardais pour une bonne occasion, — on n’en peut pas trouver une meilleure. — A ta santé, Yves !
— A ta santé, répéta Joseph,
— Merci bien, merci bien, dit Yves en trinquant, — à la vôtre !
Une heure plus tard, la table était débarrassée, et nos trois braves gens, tout en fumant leur pipe, savouraient à tout petits coups leur tasse de choum-choum[27], liqueur délicieuse, d’un parfum léger qui rappelle celui du kirsch et d’une saveur douce et traîtresse. On la boit sans défiance, mais, comme tous les alcools de grains, elle amène promptement l’ivresse, et une ivresse assez dangereuse. Yves et ses hôtes la connaissaient assez pour s’en défier, et rien ne vint troubler leur parfaite harmonie.
[27] Eau-de-vie de riz.
— Tu nous as donné un fameux souper, mon gars, dit Pierre, en tapotant doucement, pour la vider, sa grosse pipe en bruyère, dont le fourneau à demi carbonisé attestait les longs services ; tu ferais ta fortune si tu voulais t’établir restaurateur.
— Tiens ! pourquoi pas ? dit Joseph, c’est une idée, ça ! je te promets ma pratique et celle de bien d’autres. Le patron va partir, on ne sait pas qui le remplacera, tu es trop grand aussi pour faire ce métier de commissionnaire avec un autre que M. Gerbier ; tu as amassé un petit magot, si j’étais toi, je me mettrais à faire une popote et à vendre des portions aux ouvriers, aux soldats et aux marins.
— Seulement, dit Pierre, il ne faudrait pas rester dans ce coin-là, c’est trop retiré.
— Et puis, je ne pourrais pas à cause des bureaux, dit Yves, qui était devenu tout rêveur.
— Écoute, dit Joseph, ma paillotte est bien trop grande pour moi qui suis seul, elle est à mi-chemin entre le port et le chantier ; viens t’établir là, je ne te tracasserai pas, je suis bon garçon, et d’ailleurs, tu sais bien que je suis retenu ici depuis le matin jusqu’au soir ; pourvu que j’aie une place pour mon lit et mon coffre, ça me suffit, tu ne paieras pas de loyer, tu me nourriras avec tes restes, ça te va-t-il ?
— J’y penserai, dit Yves…
A la Renommée du poulet frit.
Yves Kerhélo
Une banderole de toile de coton attachée à deux bambous étalait cette majestueuse inscription au-dessus de la porte d’une paillotte d’assez grande dimension, située sur le bord du chemin de la cathédrale à la rivière ; elle était répétée en caractères annamites et chinois sur deux pancartes suspendues à des mâts de bambous ; plus d’un passant, attiré par la curiosité, était retenu par les effluves appétissants sortant des marmites, et se faisait servir une portion de un, deux, trois ou quatre cents suivant l’état de sa bourse. Il fallait aller jusqu’à dix cents pour goûter au fameux poulet frit, honneur de l’établissement ; mais de l’avis général, on ne regrettait pas l’argent dépensé chez Yves Kerhélo tant la cuisine était bonne, et les parts bien servies. Devant la porte, sous l’auvent[28], quatre grands fourneaux, toujours en activité, supportaient trois vastes jattes de terre où mijotaient des ragoûts variés, porc, légumes et poissons, et un grand bassin de cuivre rempli de riz ; enfin une énorme bouilloire, entourée de petites tasses, se tenait prête à verser le thé, et les consommateurs ne manquaient pas.
[28] Les portes des paillottes sont des claies en bambou garnies de feuilles. Le jour, on les relève en auvent soutenu par deux piquets de bambou.
Le petit trafic d’Yves réussit au delà de ses espérances ; mais aussi, c’est qu’il ne plaignait pas sa peine ! Avant l’aube du jour, il courait au-devant des Annamites pourvoyeurs du marché, choisissait bien, achetait à bon compte, et revenait au plus vite allumer ses fourneaux. De grand matin, les ouvriers trouvaient chez lui du thé bien chaud et du riz bien cuit ; plus d’un qui, autrement, se serait contenté d’un petit verre d’eau-de-vie, préférait se lester l’estomac avant le travail ; la besogne n’en allait que mieux et la santé aussi. Et quand les matelots descendaient à terre, la bourse bien garnie, se payer un régal à la Renommée des poulets frits était un de leurs plaisirs. Ils ne marchandaient pas, prenaient double ou triple portion et amenaient une clientèle sans cesse renouvelée, par conséquent, facile à satisfaire.
Au bout de six mois, non seulement Yves avait payé ses premiers frais d’installation, mais encore, il possédait une centaine de piastres. De plus, il se trouvait au large, son camarade Joseph ayant quitté le pays. Il en profita pour étendre son commerce et vendre une foule de petits objets de mercerie et bimbeloterie d’un usage courant : aiguilles, fil, épingles, lacets, boutons, couteaux, miroirs, brosses, cirage, blanc à astiquer, etc. Plus tard, il y joignit la vente de l’épicerie ordinaire, mélasse, sucre, café, bougies, boîtes de sardines et même de la bière et de l’eau-de-vie. Ses affaires devinrent si prospères qu’il dut prendre un boy pour l’aider, et que, parfois, il avait peine à suffire aux demandes des clients, chaque jour plus nombreux. Pendant deux ans, il régna seul sur la route du port, mais la ville augmentait d’importance, les colons arrivaient en foule, les Chinois toujours à l’affût des bonnes occasions, commençaient à élever de tous côtés leurs bizarres maisons en briques noires, cloisonnées de lignes blanches, couvertes de toits en tuiles dont la charpente se recourbe aux angles. Le faîte est orné de dragons de faïence, bleus, rouges et verts, portant des antennes et des queues en spirale toutes garnies de clochettes que le vent secoue avec un tintement étrange. La paillotte Kerhélo semblait bien modeste au milieu de toutes ces splendeurs exotiques ; néanmoins sa renommée lui restait fidèle, et sa clientèle ne diminuait pas trop en ce qui touchait la cuisine. Pour la vente d’épicerie et de mercerie, un déficit notable finit par s’accuser et s’accentuer de jour en jour, et Yves se demandait s’il n’allait pas employer ses économies, à se faire construire une vraie maison, une vraie boutique avec comptoir et devanture. Il n’avait jusqu’alors modifié en rien la simplicité de ses habitudes ; ses fourneaux de terre, quelques tables pliantes, quelques étagères en planches ou en bambous formaient tout le mobilier de son établissement, et le seul meuble meublant qu’il possédât était un coffre annamite qu’il avait acheté à un Chinois pour quelques piastres. Ces coffres, fort primitifs, ne sont qu’une caisse en bois dur et épais, plus ou moins orné de moulures suivant la richesse du propriétaire, et clos par un solide cadenas en cuivre. Ils mesurent environ un mètre de long sur soixante-dix centimètres de large, et portent sur quatre roues, ce qui rend leur transport plus facile en cas d’incendie, événement qu’il faut toujours prévoir, une paillotte flambant en quelques minutes. La lourde machine remplie de vêtements précieux, de bijoux (sans compter le coffre à sapèques et les barres d’argent)[29], serait impossible à enlever à bras ; avec un coup d’épaule, elle roule hors du brasier.
[29] Les barres d’argent sont fort usitées pour les transactions commerciales importantes et pour l’accumulation des économies. Leur valeur n’est point conventionnelle, on l’estime au poids et au cours de l’argent. Ce sont d’ailleurs de véritables lingots marqués de caractères chinois. Il y en a depuis 3 piastres jusqu’à 15 piastres.
Un soir, Yves assis sur le seuil de sa paillotte se reposait et pensait. Il était dans une mauvaise veine et les contrariétés, grandes et petites, pleuvaient sur lui depuis quelque temps. Il n’avait pas de nouvelles de France, le dernier courrier n’ayant pas apporté de lettres ; deux ou trois habitués auxquels il avait fait des crédits un peu longs étaient partis sans payer, on ne savait ce qu’ils étaient devenus ; la chaleur avait fait tourner une centaine de bouteilles de bière ; son boy l’avait volé, il avait fallu le congédier ; celui qui le remplaçait était bête et maladroit, enfin un concurrent, le matin même, venait d’ouvrir une auberge à la française toute flamboyante de peinture et portant pour enseigne : A la Renommée du bon Lapin sauté. Sur cette enseigne, un peintre avait figuré, avec une grande hardiesse de touche, un fourneau entouré de flammes rouges, surmonté d’une casserole où s’élançait un animal à quatre pattes et à longues oreilles. « Ça ne peut pas continuer comme ça, se disait Yves, il n’y aura bientôt plus de place pour moi ici. Ah ! que les temps sont changés !… Autrefois, tous les passants s’arrêtaient devant ma paillotte et lisaient en riant ce qu’il y avait d’écrit sur la banderole, maintenant, c’est le bon lapin sauté qu’ils regardent, et c’est là aussi qu’ils porteront leur argent… La vente va toujours baissant, je le vois bien sur mon livre… »
Il alla prendre ses registres de commerce qu’il tenait avec beaucoup d’ordre et de netteté ; mais la nuit était venue, il ne pouvait distinguer les chiffres…
— Boy, allume la lampe, cria-t-il. Eh ! bien, qu’est-ce que tu attends ? Elle est vide ? Entêté petit drôle, je l’ai dit cent fois que je ne voulais pas qu’on la remplisse le soir, laisse-la, je prendrai une bougie…
Un jet de flamme lui coupa la parole ; le pétrole débordant de la lampe venait de tomber sur un fourneau encore incandescent. L’enfant effrayé s’enfuit, jetant la lampe derrière lui, elle se cassa en touchant le sol… En moins de cinq minutes tout était en feu ! Yves lança ses livres sur la route, se précipita dans l’intérieur, et, avec une force centuplée par le péril, attira son coffre vers la porte et le poussa dehors. Il était temps ! les barils d’eau-de-vie faisaient explosion, les provisions d’épicerie offraient un aliment terrible au feu qui grandissait toujours, empourprant les alentours de ses lueurs sinistres.
Cependant les voisins accouraient ; l’eau manque à Saïgon quand on est loin de la rivière, et d’ailleurs, est-ce qu’on peut lutter contre l’embrasement d’une paillotte ?
Quand le jour se leva, Yves debout devant les tristes épaves de ce qui avait été sa petite fortune, se demandait comme trois ans auparavant : que vais-je faire ? Il ne lui restait de toutes ses marchandises qu’une trentaine de boîtes de conserves placées dans un coin défendu contre les atteintes du feu par l’écroulement de la paillotte. Il avait sauvé, comme nous l’avons vu, ses livres et son coffre, mais presque tout son avoir en argent allait être mis à réquisition pour solder des traites dues à la fin du mois.
Pour comble de malchance, le pauvre garçon venait de renouveler ses approvisionnements, et l’incendie avait dévoré le plus clair de son capital.
Il lui faudrait donc pour reconstruire une demeure, racheter du matériel et des marchandises, emprunter, — mais à qui ? sur quelles garanties ? à quel prix ?
Et puis les circonstances rendaient le succès de moins en moins probable, il avait maintenant tant de rivaux mieux outillés que lui !
— J’ai réussi à Saïgon quand il n’y avait que peu de concurrence, se dit-il, après de longues et pénibles réflexions, je réussirai ailleurs dans les mêmes conditions. Le Tonkin est sous le protectorat français depuis un an ; les marins m’ont raconté des merveilles sur Haï-phong, Hanoï et toutes ces villes si peuplées et si commerçantes ; il n’y a plus de place pour moi ici, et pour tant faire que de reprendre tout à nouveau, autant essayer dans un pays neuf. Me voilà encore une fois sous la vague ; avec un vigoureux effort, j’en sortirai, s’il plaît à Dieu. Allons, c’est assez rêvasser sur ces décombres, — je ne suis ni estropié, ni blessé, ni malade, — je n’ai perdu que de l’argent. Mon courage et mon travail m’aideront à en gagner d’autre ! A l’œuvre !
Appuyé au bastingage du paquebot, Yves regardait d’un air pensif le pays nouveau où il allait encore une fois tenter la fortune.
On approchait d’Haï-phong, après trois jours de navigation. A l’horizon, moins monotone que celui de Saïgon, se découpaient en bleu sombre, sur le ciel d’un gris doux, les montagnes dentelées du Yu-nam. Sur les rives, s’étendaient les éternelles rizières, animées pour l’instant par la présence de nombreux travailleurs occupés au repiquage du riz ; les palétuviers bas, un peu rabougris, bordaient la rivière de leurs massifs d’un vert glauque d’où s’élançaient les troncs grêles des cocotiers ; les bananiers étalaient au soleil leurs larges feuilles déchirées par les bords, et les palmiers, leurs éventails découpés en lanières. Partout, car le pays est très peuplé, les villages annamites entourés de bosquets de bambou, montraient leurs toits jaunâtres au milieu de la verdure ; les sampans allaient et venaient avec une activité incessante, échangeant ces appels doux et inarticulés qui répondent au cri de « gare ! gare ! » dans nos rues encombrées de voitures.
Un coup de sifflet fendit l’air et fit tressaillir Yves…
Une canonnière de l’État, toute peinte en blanc, passa rapide, fendant les flots boueux et laissant derrière elle un long sillage. A sa corne, flottaient fièrement les trois couleurs !…
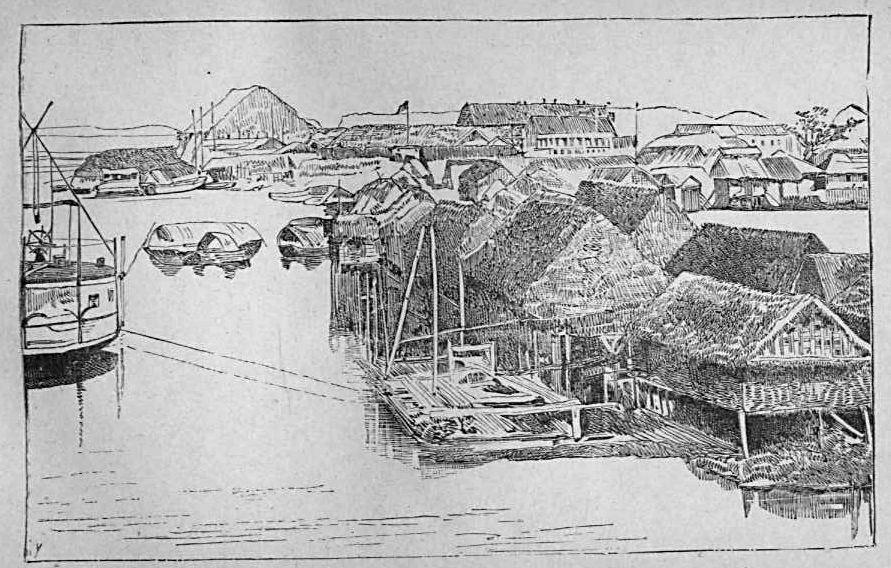
Vue d’Haï-phong.
— C’est là la France, pensa-t-il… et moi aussi, je porte un peu du pays avec moi ! Ma jeunesse, ma force, mon intelligence, je vais tout dépenser sans compter, pour fonder dans ces terres lointaines un établissement français. Grand ou petit, qu’importe ! ce sera toujours un coin de patrie. D’autres feront comme moi, sans doute, et, dans vingt-cinq ans, Haï-phong sera une ville grande et prospère comme Saïgon !… Et il se découvrit gravement tandis que la canonnière répondait au salut de l’Aréthuse en amenant ses couleurs[30]…
[30] Amener ses couleurs, c’est faire descendre lentement le pavillon jusqu’à demi-hauteur de la drisse (la corde sur laquelle il est attaché). Tout bateau de commerce doit le premier le salut aux bateaux de guerre.
Une heure plus tard, il débarquait du sampan qui l’avait pris à bord pour l’amener à terre.
Il n’y avait à cette époque ni quais ni appontements ; le fleuve — (Haï-phong est à trente kilomètres de la mer) — ronge incessamment ses berges. On l’a vu, en deux mois, à Hong-Yen, reculer le rivage de huit mètres au moins. On essaie avec des claies de bambou, liées solidement à des piquets, d’opposer une digue à ses ravages, mais quand arrivent ces fortes crues qui, deux fois par an, aux époques de syzygie, couvrent d’eau des espaces de cinq à six kilomètres de part et d’autre de la rivière, tout est emporté, et la vase demeure maîtresse de la terre et de l’eau.
En 1878, le Tonkin, ouvert aux Français depuis deux ans seulement, n’avait encore aucune empreinte de civilisation étrangère. Haï-phong, la belle ville, qui offre maintenant aux étrangers des boulevards, des promenades, des rues larges et bien dessinées, des magasins élégants, des hôtels confortables, n’était qu’une bourgade annamite, alignant sans grande rigueur les cai-nhas en paillotte de chaque côté des ruelles boueuses. Quelques maisons chinoises ou européennes, seules, rompaient la monotonie des lignes basses en dressant leurs murs blancs au-dessus des toits de chaume.
Yves regarda autour de lui, se demandant par où il allait débuter. Des soldats d’infanterie de marine flânaient sur le port, l’air ennuyé et tout endormis par la chaleur ; il s’enquit de la résidence, on lui indiqua une grande pagode isolée. Un essai de jardin l’entourait et contrastait avec l’aspect dénudé de la ville qui n’avait guère d’arbres à cette époque. Yves fut bien reçu dans les bureaux où on se montra sympathique au jeune Français, et on lui promit de faire régler en peu de jours sa situation de colon.
Le sol des pays de protectorat, Annam et Tonkin, n’appartient pas à la France ; il est resté la propriété de l’empereur d’Annam, qui est considéré par ses sujets comme le seul maître de tout l’empire. Moyennant une redevance, soit en espèces, soit en nature, il prête ou il loue pour ainsi dire le territoire aux habitants des villes et des villages. Lorsqu’un colon veut obtenir une concession, il s’adresse au résident français, qui lui assure, dans les conditions réglées par les traités, les terrains demandés. Depuis 1888, les villes d’Haï-phong, Hanoï, Quin-hone et Tourane, et une certaine zone du territoire environnant sont devenues possessions françaises.
Quelques jours s’écoulèrent avant que notre ami Yves Kerhélo, reconnu comme colon sérieux et citoyen d’Haï-phong, pût planter le premier pieu de la palissade qui devait enclore sa concession. Le choix de l’emplacement n’avait pas été une mince affaire, mais, dans cette circonstance, le bon sens d’Yves et son esprit judicieux et avisé l’avaient encore une fois servi à souhait.
Les grands travaux n’étaient pas commencés à cette époque ; donc point de chantiers, point d’ouvriers étrangers, désireux d’une nourriture plus substantielle et plus soignée que celle des naturels. Un incident fortuit le mit au courant de ce qu’il y avait à tenter pour s’assurer une clientèle régulière.
Harassé de fatigue, après une journée de courses dans la ville, énervé par l’incertitude, anéanti par l’humidité chaude qui s’élève du fleuve comme une buée, il s’était laissé tomber lourdement sur le gazon, au bord d’un petit étang situé derrière la résidence, le seul endroit d’Haï-phong où il y eût un peu de verdure et un semblant de fraîcheur. Deux soldats, couchés à quelques pas de lui, causaient nonchalamment et d’un ton maussade.
— Viens-tu ? dit l’un deux en se levant.
— Où ça ? répondit l’autre sans bouger.
— Chez le père Pillot, donc !
— Ah ! ma foi non ! on n’y vend qu’à boire, ça coûte trop cher, et puis, ce n’est pas soif que j’ai, c’est faim.
— Où veux-tu trouver à manger ?
— Je n’en sais rien. La popote annamite me dégoûte, rien que de la regarder. Ah ! si j’avais un bon morceau de lard aux choux comme chez nous !… Satané pays ! va !…
— C’est pas la peine de crier après le pays ; nous y sommes, faut y rester jusqu’à ce que le service soit fini.
— Et mourir de misère, hein ? Si seulement nous avions ici, comme à Saïgon, un gargotier installé à la porte de la caserne ; sans sortir aux heures défendues[31], on pourrait, pour une poignée de sapèques, avoir de quoi se mettre sous la dent.
[31] A cause de la chaleur, on ne permet la sortie aux soldats qu’avant 10 heures du matin et après 8 heures du soir.
Yves se rapprocha des soldats.
— Bonjour, camarades, dit-il. Sans le vouloir, j’ai entendu ce que vous disiez, et vous pouvez me donner un bon avis. Entre compatriotes, on se doit ça, quand on est si loin du pays.
Les deux troupiers étaient de bons garçons, ils répondirent à Yves avec beaucoup de cordialité. Celui-ci leur raconta ses aventures et ils lui fournirent quelques détails utiles sur la façon de vivre à Haï-phong, si bien que, dès le soir même, il les accompagna jusqu’à la porte de la caserne, c’est-à-dire de la réunion de paillottes où les troupes s’étaient installées tant bien que mal, — plutôt mal que bien. A quelques pas de l’entrée principale, se trouvait un espace de terrain d’une étendue plus que suffisante aux projets du jeune colon. Il n’y avait guère de concurrence en ce temps-là pour disputer les bonnes places ; il obtint sans la moindre difficulté la permission de s’y établir, et trois jours après son arrivée à Taï-phong, il avait la vive satisfaction d’entrer en possession de son petit domaine.
Le 7 juin 1878, à cinq heures du matin, le cœur plein d’une certaine fierté, il traçait sur le sol un rectangle de 4 mètres sur 5 mètres, plan de sa future habitation ; un Annamite, pendant ce temps, déchargeait d’un sampan six poutrelles en bois dur, hautes de 2 mètres, et grosses de dix centimètres carrés environ, plus une vingtaine de pieux moins gros, et enfin une grande quantité de bambous longs et flexibles.
On enfonça solidement quatre des six grands pieux aux quatre coins du rectangle et les deux restant, de part et d’autre de l’endroit où devait se trouver la porte ; puis, sur la ligne des murs, on planta les montants, écartés d’une distance d’environ quarante centimètres. Il ne restait plus alors qu’à entrelacer les bambous fendus, de façon à faire un clayonnage serré.
Le soir du second jour, ce travail était terminé et même on avait posé l’enduit des murs : une sorte de mortier fait avec la boue du fleuve et de la paille hachée.
Le lendemain fut occupé entièrement par la confection du toit, c’est-à-dire de la charpente en bambou sur laquelle s’appliquent le chaume, ou les feuilles de latanier ou de palmier qui leur serviront de couverture. Cette charpente, aussi légère que solide, est faite sans clous ni chevilles. En effet on ne peut percer le bambou que difficilement ; c’est un grand roseau qui se fend au lieu de résister ; on se contente de lier les pièces de la charpente entre elles avec des ligaments de rotin.
Le rotin est une liane d’une flexibilité et d’une ténacité extraordinaires ; on la découpe en lanières plus ou moins larges suivant l’usage auquel on les destine ; elles tiennent lieu de cordes, de ficelles, de clous, de vis, de tout ce qui sert à faire tenir ensemble des pièces juxtaposées. Les Annamites ont une dextérité merveilleuse dans l’art de nouer, de croiser, d’enlacer le rotin ; ils savent en tirer les services et les effets les plus variés.
Mais revenons à Yves que nous avons laissé en contemplation devant sa case enfin couverte. La porte seule restait à faire, mais l’aide du menuisier et du serrurier sont inutiles dans ce cas, au Tonkin ; une porte de paillotte ne demande ni planches, ni gonds, ni serrures, ni verrou, pas même un simple loquet. Elle ne s’ouvre point, comme nos portes européennes, sur un plan vertical, mais on la relève de bas en haut, et on la maintient sur deux hauts piquets de bambou, de façon à en faire une sorte de grand auvent protégeant le seuil à l’extérieur durant le jour. Le soir on retire les piquets, la porte retombe, on est chez soi. Cette porte n’est d’ailleurs qu’une claie en bambou bourrée de feuilles de latanier et de paille de riz comme le reste de la construction.
L’emménagement ne fut pas long. Après avoir bien battu la terre qui allait être le sol de sa demeure, Yves installa dans un coin, comme jadis à Saïgon, un lit annamite, c’est-à-dire une claie posée sur quatre pieux ; dans un autre, sa malle, bien peu remplie, hélas ! dans le troisième quelques planches montées en étagère et soutenant un peu de vaisselle grossière ; enfin près de la porte, le fourneau de terre fondement de sa future prospérité…
A l’heure présente, l’état de sa fortune n’était pas brillant. L’achat du bois et des bambous pour sa paillotte, l’argent donné aux ouvriers qui l’avaient construite montaient à une dizaine de piastres. Les quelques objets mobiliers dont il avait dû faire emplette, sa nourriture et son logement pendant une semaine avaient achevé d’épuiser son petit stock de monnaie ; il lui restait en tout, le 10 juin au soir, cinquante cents : une demi-piastre ! C’était peu pour fonder un commerce de restaurateur !… Il soupa d’une portion de riz qui lui coûta deux cents, se refusa même du thé pour ne pas entamer davantage son minuscule trésor, se coucha avec le soleil, et se leva avec lui.
Il n’avait guère dormi ; l’inquiétude le tenait éveillé, et pourtant c’était avec un sentiment de sécurité qu’il se disait : « Je suis chez moi, dans mes quatre murs, je ne suis pas un vagabond, le toit qui m’abrite m’appartient, et nul n’a le droit de me l’enlever. »
L’avenir, pour qui est jeune et vaillant, semble rarement redoutable, mais quelle somme d’énergie allaient réclamer les débuts ! Il n’était plus là comme à Saïgon en pays connu, entouré d’amis et de camarades, soutenu par la bienveillance et l’estime publiques. Il allait falloir conquérir tout cela peu à peu, à force de travail, de probité, sans faiblir, sans se lasser, sans se décourager.
Fidèle à ses habitudes d’esprit pratique et sensé, il ramena ses pensées sur le présent. « Commençons par le commencement, se dit-il. Que ferai-je demain, pour gagner quelque argent, puisque je n’en ai pas assez pour acheter du charbon et des provisions et pour mettre en train ma cuisine ? Attendons la chance ou plutôt l’aide que la Providence m’enverra, je suis bien sûr qu’elle ne me laissera pas dans la peine… »
Le jour était venu pendant sa longue insomnie ; il se leva et courut au bord de l’eau pour attendre les sampans. Le premier qui arriva était tout chargé de bananes et d’ananas superbes faisant plaisir à voir. Yves les marchanda. Le sampanier, petit Tonkinois actif et entendu, comprenant très bien l’avantage qu’il y avait pour lui à se débarrasser promptement de sa cargaison, se montra peu exigeant pour le prix. Yves déchargea lui-même son achat afin d’éviter que les fruits ne fussent maltraités, et après avoir disposé artistement ses plus beaux ananas dans une corbeille, il alla se présenter à la résidence. Le cuisinier chinois, connaisseur émérite, admira les fruits et, après avoir fortement marchandé suivant sa coutume, finit par en offrir un prix qui assurait à Yves un petit bénéfice ; celui-ci eut la sagesse de s’en contenter et revint, la corbeille vide, rechercher une provision de bananes qu’il vendit presque immédiatement aux maîtres d’hôtel des canonnières, parmi lesquels il retrouva d’anciennes connaissances de Saïgon. Les braves gens se récrièrent bien fort en apprenant les malheurs dont venait d’être accablé l’ancien propriétaire de la Renommée des poulets frits ; ils lui promirent de s’intéresser à son nouvel établissement et de lui envoyer des pratiques.
Avant midi, notre ami avait écoulé tout son achat de fruits du matin, et avec une partie de son gain s’était procuré une nouvelle provision dont il se débarrassa très facilement chez ses voisins des casernes. Le lendemain, il allumait deux petits fourneaux et débitait aux troupiers enchantés des portions de riz et de ragoût de porc. Il n’avait pas oublié ses amis du bord du lac et leur avait offert généreusement un festin d’inauguration, c’est-à-dire deux écuelles remplies jusqu’au bord de morceaux choisis. Cette générosité bien placée lui avait valu la visite de nombreux amateurs, désireux de s’assurer par eux-mêmes si les récits enthousiastes des camarades à l’endroit du nouveau colon français et de sa cuisine reposaient sur un fond de vérité…
Trois mois plus tard, grâce à son énergie et à son savoir-faire, Yves Kerhélo, par une belle matinée de septembre, arborait triomphalement une large banderole, sœur jumelle de celle de Saïgon, et les quatre fourneaux de rigueur envoyaient largement aux passants leurs parfums succulents. Mais que d’efforts, que de travail, que de privations, que de prudence il avait fallu pour en arriver là ! Pendant deux mois, il n’avait vécu que de riz, de patates et de thé, trop heureux de vendre jusqu’au fond le contenu de ses marmites. Du gain de chaque journée, il faisait trois parts : l’une pour l’achat des denrées, l’autre pour l’augmentation de son matériel, l’autre enfin réservée en cas de perte ou de maladie. Il gagnait peu, mais son commerce ne chômait pas, c’était l’essentiel. A Haï-phong, comme partout ailleurs, sa probité, sa bonne humeur, son obligeance lui avaient fait des amis et attiré l’estime générale. Il vivait donc aussi heureux qu’il pouvait l’être, si loin de sa sœur et de son pays ; et puis, il n’avait pas le temps de se faire des idées noires : les achats, la cuisine, la vente, occupaient toutes ses heures, et la nuit, accablé de fatigue, il dormait d’un sommeil de plomb.
A une cinquantaine de mètres environ de la paillotte d’Yves, se trouvait un café modeste mais bien achalandé, et tenu par un fort honnête homme, un ancien aubergiste bourguignon, ruiné sans qu’il y eût de sa faute, par des malheurs de famille, et qui était venu s’établir à Haï-phong où son beau-frère était interprète à la résidence. Il avait amené sa femme ; mais la pauvre créature, déjà brisée par les chagrins et par le voyage, n’avait pu résister à un climat si différent de celui où elle avait toujours vécu : elle était morte de la dysenterie, laissant à son mari pour tout soutien, et toute consolation, une fillette d’une quinzaine d’années. Celle-ci, petite Bourguignotte active et capable, s’était faite à la vie coloniale d’une façon vraiment surprenante ; sa nature bonne, franche et dévouée la défendait d’ailleurs contre les rêveries vides et sentimentales ; elle aimait son père de tout son cœur et avait juré à sa mère de ne jamais le quitter. Jeanne ou Jeannette, comme on l’appelait, était une de ces âmes droites et fortes qui vont au bien tout naturellement et haïssent le mal comme une souillure ; et puis le désœuvrement, mauvais conseiller, n’avait point de place dans sa vie. Du matin au soir elle s’occupait de la maison, y faisant régner une rigoureuse propreté et un ordre parfait, dirigeant les boys, surveillant les tables et tenant les comptes. Son père n’avait pas voulu qu’elle servît les clients ; mais, de son petit comptoir en bois, elle avait l’œil à tout et ne laissait oublier à aucun consommateur la désagréable nécessité de faire tomber les cents dans la fente du tiroir.
Le père Pillot avait vu avec un peu d’inquiétude l’installation d’Yves ; il n’augurait pas grand’chose de bien de cette paillotte, de ces fourneaux, et puis ce garçon brun aux yeux brillants d’où venait-il ? Qui était-il ? Qui sait si ce n’était pas quelque vaurien, ami du bruit et des disputes, quelque individu n’ayant rien fait de bon dans la mère patrie et venant recommencer au Tonkin ?
Ses craintes ne furent pas de longue durée : le nouveau voisin évidemment était travailleur, rangé, discret, et même un peu sauvage, semblait-il. Jamais il ne venait prendre un verre de bière ou faire une partie avec les sous-officiers et les marins. Le bruit se répandait qu’il faisait très bien ses affaires ; en effet, les abords de sa paillotte étaient toujours fort animés, et même, le va-et-vient des amateurs de poulet frit avait amené un très notable regain de clients au Café de la Nouvelle-France : tel était le nom pompeux dont le père Pillot avait décoré son établissement. Et puis, il ne se contentait plus de vendre des aliments ; il avait élevé près de sa porte un petit appentis très ingénieusement fabriqué avec des planches, et disposé comme les boutiques des marchands forains : il y étalait de la mercerie, des bibelots, de la papeterie ordinaire, tout cela propre, soigné et rangé avec goût sur les étagères en bambou.
Le cafetier prit un intérêt toujours croissant aux faits et gestes de son jeune voisin, et bientôt un échange de petits services, de bons procédés, de causeries amicales s’établit entre eux. Yves trouvait une grande douceur à l’affection quasi paternelle que lui témoignait le brave Bourguignon et ne manquait pas une occasion de lui être agréable. Quant à Mlle Jeannette, il osait à peine lever les yeux sur elle et devenait fort rouge, rien que pour la saluer et répondre à ses remarques sur la chaleur, la pluie, les désagréments des moustiques ou la fraîcheur des ananas.
La veille de Noël, au soir, enfermé dans sa paillotte, à la lueur d’une petite lampe, il écrivait une longue lettre à Corentine, maintenant institutrice adjointe à Concarneau. Il lui donnait de minutieux détails sur son genre de vie, lui parlait de sa prospérité renaissante, lui demandait des nouvelles de tous les amis du pays, puis, par un retour bien naturel sur lui-même, il comparait son isolement aux réunions joyeuses du pays breton à pareil jour ; deux larmes qui obscurcissaient sa vue depuis un moment tombèrent sur son papier, il les regarda sécher, triste, le cœur serré d’un sentiment pénible… Des voix qui l’appelaient au dehors le tirèrent de sa rêverie, il courut soulever sa porte, le père Pillot entra.
— Toujours à l’ouvrage, voisin Yves ? dit-il. Quel garçon laborieux vous êtes !
— J’écrivais à ma sœur Corentine. Que de temps ma lettre mettra à lui arriver ! je l’écris la veille de Noël, elle ne l’aura peut-être qu’au commencement du carême ! C’est dans des jours comme ceux-ci qu’on sent tout ce qu’il y a de dur à être si loin des siens…
— C’est ce que je me suis dit, il y a un moment, reprit d’un ton compatissant le brave cafetier. J’ai pensé que vous étiez là tout seul, sans amis, ni parents… Moi j’ai ma fille, ma Jeannette, ça va, ça vient, ça rit, ça chante, ça caresse son papa, ça met de la gaîté dans la maison ; et puis mon beau-frère et sa femme sont de bonnes gens, on s’entend bien en famille, on se voit tous les jours, on a toujours quelque chose à se dire, quelque souvenir de là-bas à rappeler… Mais vous ce n’est pas de même… Enfin, mon garçon, pour tout dire en un mot, je viens vous inviter à souper demain avec nous.
— Je vous remercie bien, monsieur Pillot, balbutia Yves, mais…
— Il n’y a pas de mais…, il ne faut pas à votre âge vivre comme un ours ; on se fait des idées noires, on devient sombre et morose avant le temps. C’est très bien d’être rangé et travailleur, mais un petit moment de délassement honnête, de temps à autre, ne fait que du bien à la santé et même à la besogne ; on a plus de cœur pour s’y remettre après…
— Certainement j’aurais un grand plaisir à passer la soirée avec vous… Seulement…
— Seulement quoi ?
— Je suis devenu si sauvage… Et Mlle Jeannette…
Le père Pillot eut un gros rire.
— Ah ! Mlle Jeannette, avez-vous peur qu’elle vous mange ? Est-ce qu’elle ne sait pas ce que c’est qu’un colon ? On n’a pas des habits comme les beaux messieurs et les belles dames qui vont à la musique sur l’Arquebuse[32], bien sûr, mais qu’est-ce qu’on en ferait ici ? et puis vous avez tout ce qu’il vous faut pour être bien mis, ce n’est donc pas cela qui vous arrête ; et quant à être sauvage, voilà justement la chose à éviter. Dans des pays comme ceux-ci, on oublierait vite tout ce qu’on a été si on ne se tenait pas un peu. Toute la semaine, je tracasse comme un autre avec mes pantalons de coton et ma blouse annamite ! mais le dimanche, j’aime bien à être rasé de frais et à mettre un veston de coutil bien repassé. Eh bien ! est-ce décidé ? venez-vous, oui ou non ?
[32] Très belle promenade à Dijon.
— Oui, monsieur Pillot, dit Yves un peu confus de s’être tant fait prier, je viendrai ; je vous remercie de tout mon cœur de votre bonté ; — et il serra énergiquement la main de son visiteur.
— Bon ! bon ! je savais bien qu’il fallait vous secouer. Je connais la jeunesse, toujours extrême dans ses idées. On fait cinquante folies, ou bien on vit comme un loup. Mais bonsoir ! à demain, à six heures, et apportez-moi un bel appétit…
On n’a maintenant que l’embarras du choix entre les boutiques de coiffeurs à Haï-phong ; mais, en 1878, l’embarras était tout opposé. Yves, fort soucieux de sa toilette pour une occasion aussi solennelle qu’un dîner en ville, se mit à la recherche d’un figaro. Il finit par découvrir dans la grande rue Chinoise[33] un jeune Français qui alignait sur une table de bambou, devant sa paillotte, une demi-douzaine de fioles de vinaigre de Bully et même d’eau de Lubin, autant de boîtes de savon et quelques cravates d’un goût plus ou moins irréprochable. Un client était un oiseau rare, aussi M. Arthur Cabassis se montra-t-il aussi bavard qu’officieux. Il raconta au silencieux Breton tous ses déboires et comment il s’était embarqué pour faire fortune avec une pacotille de parfumerie extra-fine (selon lui), — comment il n’avait eu que des misères dans ce pays de malheur où il n’y avait rien à faire pour un élève du Grand Léonidas Lestoupez, le premier coiffeur de Marseille, c’est-à-dire du monde entier, — comment il avait dépensé pour vivre et s’installer tout le petit héritage de son oncle Isidore, et qu’il ne lui restait plus qu’à se jeter dans le Song-tan-Back[34] à moins que… et d’un air plein de sous-entendus il laissa sa phrase en suspens.
[33] La rue commerçante d’Haï-phong.
[34] Cours d’eau qui passe à Haï-phong.
Mais Yves n’était pas d’humeur à provoquer les confidences. Voyant cela, M. Arthur poursuivit…
— A moins que la chance tourne ! Un bon mariage peut me remettre à flot. Il y a votre voisine, Mlle Jeannette Pillot, une jolie brunette, ma foi !
Les noirs sourcils d’Yves se contractèrent.
— Qu’est-ce que je vous dois ? dit-il d’un ton rogue.
— Ce sera une demi-piastre pour la coiffure, autant pour la cravate, et autant pour le mouchoir puisqu’il est chiffré, — ça fait une piastre et demie.
— Peste ! comme vous y allez ! — Je ne m’étonne plus si vous ne faites pas d’affaires. Quand on écorche la pratique, elle crie, elle s’exécute, et ne revient plus.
Il jeta 7 fr. 50 sur le coin de la table et partit comme un trait.
« Il n’est pas aimable, — le jeune homme, — dit le bel Arthur en frisant sa moustache d’un geste prétentieux. Et fier comme Artaban ! se mêler de me donner des conseils ! à moi ! Un méchant gargotier qui ne devrait parler que de ses casseroles ! Son argent est bon tout de même, il arrive bien à propos pour remplir mon porte-monnaie. Bah ! ma journée est faite, je n’ai pas besoin de rester ici à me griller, je vais rentrer mon bibelot, aller dire deux mots à la bière du père Pillot, et faire la partie de Simounin à qui je dois une revanche. »
Arthur Cabassis était un de ces colons amateurs qui se plaignent de tout et de tout le monde, à qui rien ne réussit : commerce, industrie, agriculture, parce qu’ils ne font rien pour amener le succès. Ils partent étourdiment, à l’aventure, sans s’être renseignés, sans s’être préparés à la rude vie de pionniers. Ignorants, vaniteux, entêtés, ils s’imaginent que le monde entier est fait comme leur petite ville, et quand la réalité vient les désabuser et les éclairer, au lieu d’ouvrir les yeux, de se rendre compte des choses et des circonstances, et d’en tirer le meilleur parti possible, ils préfèrent maudire le sort et se laisser aller à la dérive.
Au bout de quelques années, parfois de quelques mois, leurs ressources sont épuisées, leur santé compromise par les fatigues, les privations… ou les excès ; ils meurent d’anémie, ou sont rapatriés par les soins du Gouvernement ; — tristes épaves de la vie coloniale, contre laquelle leur insuccès ne prouve rien d’ailleurs…
A six heures sonnantes, M. Kerhélo franchissait le seuil de la Nouvelle-France. Il était beau comme un astre, avait repris toute sa bonne grâce, et sauf un peu d’embarras, rappelait Yves d’autrefois, le gentil compagnon de M. Émile Gerbier. La famille Pillot l’accueillit avec une si franche cordialité qu’il se sentit tout de suite à l’aise et contribua pour sa part à la gaîté de la petite fête.
Le dîner était plantureux et excellent ; le père Pillot tira du fin fond de ses armoires une bouteille de vieux mâcon que la traversée avait respecté. Le café apporté de Moka même par M. Royer, l’interprète, était exquis, et le choum-choum couronna dignement le régal. Yves, qui avait une fort jolie voix, chanta deux noëls bretons, M. Royer, des noëls normands ; mais le triomphateur de la soirée fut le père Pillot, qui alla chercher dans ses souvenirs de vieux noëls bourguignons pleins de verve et de bonne humeur. Il les disait d’une manière si drôle, avec des airs, des gestes, des éclats de voix si amusants, qu’il mit tout son monde en joie, et à minuit bien passé, on répétait encore en chœur les refrains du temps jadis. Jeannette avait préparé du vin chaud, précaution indispensable pour braver l’air humide de la rivière, et après qu’on y eut fait honneur, on se sépara gaîment en se disant : « au revoir. »
— Quel temps étouffant, voisin Kerhélo ! on suffoque ! Il n’y a pas un souffle d’air, et quelle chaleur ! — trente-quatre degrés, à l’ombre, — dit le père Pillot en regardant le thermomètre pendu au-dessus du comptoir.
— J’en ai bien trente-neuf dans ma paillotte, répondit Yves, peut-être quarante, elle est moins grande que votre café, l’air s’y renouvelle moins aisément. Je n’ai pas fait grande cuisine aujourd’hui, tout se gâte, par ce temps orageux, et d’ailleurs personne n’a le courage de se promener ni même de manger.
— Pour moi, j’ai déjeuné avec une tasse de café noir et un croûton de biscuit, reprit M. Pillot, et je n’ai de cœur à rien. Jeannette est chez sa tante, elle passe là tout son temps depuis la naissance de sa filleule ; vous savez comme elle est ! Elle soigne la mère, elle dorlote le poupon, elle range la maison, elle fait marcher le ménage au doigt et à l’œil. Pendant ce temps-là, je suis seul au logis, et ce n’est pas gai ! — Ouf ! ouf ! — ouf ! et le bon homme s’éventait avec son large chapeau de paille annamite.
— Ça ne sert à rien de s’éventer par un temps pareil, dit philosophiquement Yves, c’est de la chaleur qu’on rabat sur soi. Mais voyez-vous ces nuages là-bas comme ils s’amassent ? Eh ! on dirait que le vent se lève.
— Ce ne serait pas trop tôt ! on me trouvera mort sur la porte de la Nouvelle-France si cette chaleur-là continue.
— Comme Théodore Meunier, qu’on a ramassé ce matin sur le quai.
— Bah ! Meunier est passé de vie à trépas ? d’une insolation alors ?
— Et puis de trois verres d’absinthe qu’il avait bus coup sur coup, pour se rafraîchir, disait-il.
— Il a été rafraîchi pour de bon. C’est tout de même bien triste de mourir comme ça tout de suite, sans avoir le temps de se reconnaître, et si loin des siens. Vous êtes donc allé en ville ce matin ?
— Oui, j’avais une commission pour Midan, l’employé des ponts et chaussées. Il est ici maintenant, et bien installé dans une paillotte neuve, solidement amarrée avec des liens de rotin retenus par des piquets.
— Oui, crainte des typhons ; vous auriez dû en faire autant à la vôtre qui est isolée et offre de la prise au vent.
— Je regrette de ne pas l’avoir fait quand je l’ai construite. Tous les jours, je me dis qu’il faut m’y mettre, et puis vous savez comme je suis occupé ; le temps passe, et les choses restent comme elles sont.
— Oui, le temps passe ! voilà bientôt six ans que je suis arrivé avec ma pauvre femme. Jeannette avait quinze ans, elle court sur ses vingt et un…
— Et moi, il y a trois ans que j’ai débarqué là-bas, un beau soir de juin, avec une demi-piastre pour tout avoir.
— Et aujourd’hui, vous êtes à la tête d’un bon petit établissement.
— Qui grandira, j’espère…
— Vous faites bien vos affaires, vous avez de l’argent de côté ; ce n’est pas comme Durand le marchand de liqueurs qui n’a pas tenu douze mois, et Arthur Cabassis, le coiffeur de la rue Chinoise qui est parti en laissant des dettes de tous les côtés. Il m’a fait perdre une vingtaine de piastres, cet animal-là.
— Durand buvait son fonds, et Cabassis est un écervelé, joueur et paresseux. On n’arrive à rien sans peine, ici comme ailleurs, ici plus qu’ailleurs même. Mais sentez-vous comme le temps changé depuis un instant ? le vent s’est levé ; il souffle du nord.
— Du nord ! de l’est plutôt, je le sens sur ma joue droite.
— Ma foi, on le croirait du midi ; voyez-vous comme le drapeau de la caserne flotte ? Bon ! le voilà revenu au nord.
— Et la pluie commence.
— Je rentre chez moi, j’y ai à faire. Bonjour monsieur Pillot.
— Bonjour, Kerhélo.
Yves, aidé de son boy, s’empressa de mettre à couvert son étalage et ses fourneaux, et n’ayant pas de besogne pressée pour l’instant, se mit à regarder tomber la pluie ; c’était une occupation peu divertissante, mais un lourd malaise pesant sur lui le rendait nerveux et incapable de tout travail suivi. Il décrocha son surtout ciré, s’en enveloppa et retourna à la Nouvelle-France demander si l’on n’avait pas besoin de ses services pour quelque coup de main d’extra ; mais là aussi, tout le monde était à la somnolence et au farniente, jusqu’à Jeannette elle-même, qui, étendue dans une berceuse de rotin, jouait nonchalamment avec la longue queue de son joli chat gris[35]. Quant au père Pillot, debout devant son baromètre, il considérait d’un air soucieux la colonne de mercure, arrêtée au plus bas de l’échelle.
[35] Les chats annamites, doux et gracieux, ont une queue très longue.
— Savez-vous ce que ceci nous annonce ? dit-il, en tapotant du bout de son gros doigt sur le tube de verre. Un typhon, et pour bientôt, pour ce soir peut-être.
— Croyez-vous ? la pluie semble diminuer.
— Mais le vent souffle !…
— J’ai tout fermé chez moi, je ne risque rien, ce n’est pas la première fois qu’un typhon passe sur ma paillotte.
— Celui-ci sera fort, écoutez…
Une sorte de grondement continu rugissait sourdement, et l’averse recommençait.
Il plut toute la nuit, et le lendemain matin, le jour naissant éclaira un ciel gris, chargé de lourdes nuées, rayé obliquement par les ondées que le vent chassait avec une violence toujours croissante. Par instants, une rafale furieuse balayait le sol, emportant dans son tourbillon tout ce qu’elle rencontrait sur son passage et les murs frêles des paillottes tremblaient sous son brutal coup d’aile.
A mesure que la matinée avançait, le ciel s’obscurcissait davantage ; une sorte de crépuscule sombre enveloppait la ville d’une teinte sinistre, la pluie et le vent faisaient rage. A midi, le typhon était dans toute sa grandiose horreur, la tempête éclatait en hurlements sauvages, entrecoupés de sifflements, de roulements de tonnerre, de coups sourds et redoublés. Parfois quelques minutes d’accalmie se produisaient, il semblait que l’ouragan fît provision de nouvelles forces. Alors, quand il reprenait, c’étaient des catastrophes soudaines, brusques, irrésistibles ; les toits des paillottes, enlevés comme des plumes, allaient tomber cent mètres plus loin ; les constructions en planches, disjointes en une seconde, s’écroulaient ou couvraient l’espace de leurs débris dispersés. On voyait çà et là courir quelque être humain affolé, le visage meurtri par les grains de sable que le vent incrustait dans la peau, cherchant un abri et ne le trouvant que pour le perdre un instant après.
La Nouvelle-France, solidement construite et bien assujettie par des cordes de liane, tenait bon, mais une formidable bourrasque s’abattit sur les casernes, fit une rafle complète des toits et souffleta si rudement la paillotte d’Yves, qu’elle chancela, se disloqua sous l’effort qu’elle avait fait pour résister, et s’affaissa tout entière d’un côté, comme arrachée du sol par une force surnaturelle. C’était, semble-t-il, le dernier méfait du typhon, celui par lequel il couronnait son œuvre de destruction. La violence du vent se ralentit par degrés ; vers trois heures, une lueur pâle éclaira le ciel, du côté d’où le monstre était venu, les rafales s’éloignèrent tout en devenant moins fortes ; le soir, après douze heures de durée, le cyclone[36] avait disparu, allant porter ailleurs les ravages, la désolation et la mort.
[36] Typhon est le nom chinois du cyclone.

La paillotte s’affaissa tout entière.
Le bon M. Pillot n’avait pas attendu jusque-là pour s’inquiéter de son jeune voisin. Aussitôt qu’il avait pu ouvrir la porte et faire quelques pas dehors, il avait chaussé ses énormes bottes de marais et, couvert d’un caoutchouc, s’était dirigé vers la paillotte renversée. Heureusement ni Yves ni son boy n’étaient blessés, et tous deux, à grand’peine, essayaient de se frayer un passage à travers l’inextricable enchevêtrement des bambous, des pieux, de la charpente du toit. Ils y parvinrent enfin, avec l’aide de quelques soldats qu’on envoya de la caserne, et, trempés de pluie, les mains et la figure ensanglantées par les écorchures, bleuies par les contusions, les vêtements souillés de boue et ruisselants d’eau, ils vinrent se réfugier à la Nouvelle-France, où leur excellent hôte aurait voulu les retenir ; mais Yves, aussitôt qu’il eut avalé un grog bouillant et repris un peu ses sens, retourna sur le lieu du sinistre pour voir ce qu’il pouvait sauver.
Après beaucoup de travail et d’efforts, il tira des décombres sa malle, son coffre (celui de Saïgon), quelques caisses de marchandises : le reste écrasé, couvert d’eau et de boue n’avait plus aucune valeur. Le père Pillot donna asile à ces épaves de la catastrophe et recueillit chez lui le pauvre Yves.
Celui-ci était brisé de corps et d’âme. Encore une fois, la destinée venait de l’arrêter cruellement sur le chemin de la fortune. Il n’avait pourtant pas tout perdu, comme dans l’incendie ; en quelques jours sa paillotte pouvait être reconstruite, son mobilier reconstitué, sa clientèle lui restait et il lui suffirait du gain de trois mois pour se remettre à flot. C’est ce que lui répétait le bon cafetier, après un souper auquel ni l’un ni l’autre des convives n’avait fait honneur.
— Allons, Kerhélo ! mon garçon ! du courage ! lui redisait-il pour la centième fois. Quand on n’a perdu ni bras ni jambes dans des coups pareils, il faut encore s’estimer heureux, que diable ! Vous êtes jeune, bien portant, c’est l’affaire d’une huitaine de jours pour tout réparer. Cette fois-ci, vous me ferez le plaisir de construire solidement votre paillotte ; dans ce pays maudit, on vous a des typhons tous les six mois ; vous le savez aussi bien que moi ; il est prudent, il est indispensable de s’y prendre de façon à leur résister ; voyez ce que j’ai fait pour la Nouvelle-France… Mais le pauvre garçon ne m’entend pas ; — il dort…, il est épuisé, éreinté, — il y a bien de quoi, certes ! Il a une triste mine ; — c’est drôle comme il est changé ! — Yves ! donc ! Yves Kerhélo !!!
Il dormait en effet, d’un sommeil lourd et douloureux. Il rêvait qu’il était là-bas, au pays, sur les côtes de Bretagne. Sa mère et Corentine, debout sur un rocher, lui tendaient les bras : il voulait s’élancer vers elles, mais ne le pouvait pas, ses jambes étaient retenues par les madriers d’une épave, — cette épave qu’il avait cherché à dépecer autrefois, il y avait bien longtemps, avec Alain, quand ils étaient enfants ; — il faisait de vains efforts pour se délivrer de cette dure étreinte, et la lame furieuse venait rouler sur lui, remplissant ses yeux de sable et ses oreilles de bourdonnements. Il se courbait, elle passait, puis une autre arrivait, aussi lourde, aussi froide, aussi brutale, et une autre encore,… et une autre encore,… il tentait de remuer,… respirer,… crier,… impossible !… Il entendit sa mère l’appeler, fit un effort désespéré pour lui répondre, se réveilla,… ouvrit les yeux,… se leva,… un nuage passa devant sa vue, une nausée subite lui fit monter un peu d’écume aux lèvres, un frisson de mort courut dans ses veines, tout sembla tourner autour de lui ; il essaya de marcher,… le sol se dérobait sous ses pas ; il étendit les bras, poussa un faible cri et vint tomber comme une masse aux pieds de M. Pillot.
C’était le début d’un accès de fièvre pernicieuse.
On le transporta à l’hôpital. Pendant trois jours il fut entre la vie et la mort, mais la jeunesse a des ressources infinies, et puis, c’est le privilège des vies sobres, saines et sages, de conserver au corps toute sa force de résistance contre la maladie. Un débauché eût été emporté au second accès. Yves avait le sang pur et vigoureux ; il absorba, sans en trop souffrir, la quinine à doses massives, suivant l’énergique expression en usage, et le quatrième jour, comme au sortir d’un rêve, il se vit couché dans un lit blanc, un vrai lit, sous une longue paillotte où s’alignaient des lits semblables. Un médecin de la marine lui tâtait le pouls d’une main, tenant de l’autre sa grosse montre à secondes ; une sœur de Saint-Vincent-de-Paul, sous sa blanche cornette, regardait le malade avec compassion.
— Quatre-vingts, quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux… Ce gaillard-là est sauvé, ma sœur, mais il revient de loin ! Il nous a donné du fil à retordre avec son délire ! Il faut maintenant qu’il reprenne des forces, il en a rudement besoin ! Me reconnaissez-vous, mon garçon ?
— Oui, docteur, dit Yves d’une voix faible qui semblait venir de bien loin, vous êtes M. Bathelin, le médecin de la Comète, c’est vous qui m’avez dit, l’autre jour, de faire toujours bouillir l’eau pour…, pour…, ah ! je n’y suis plus…
— Bon ! bon ! ne vous fatiguez pas ; — pour tuer les microbes ; — je suis bien aise de voir que vous ne m’avez pas oublié. Allons ! ça va bien, faites tout ce que la sœur vous dira et vous serez sur pieds d’ici peu.
Ceci était plutôt un encouragement bienveillant qu’une prédiction. Il se passa un long mois avant qu’Yves pût quitter l’enceinte de l’hôpital. Il était resté pendant plus d’une semaine faible comme un petit enfant, ne pouvant se servir de ses membres, ayant peine même à suivre le fil de sa pensée, et plus grand’peine encore à la formuler. Puis les forces étaient lentement revenues, mais sans ramener le désir de l’action. Il ne trouvait jamais trop longues les heures passées dans son lit ; il prenait un singulier plaisir à attendre l’heure du repas, à regarder les sœurs allant de droite et de gauche, distribuer des soins, des consolations, des paroles caressantes comme celles des mères.
Des amis venaient le voir ; tous les jours, la bonne face du père Pillot apparaissait au seuil de la salle. Il racontait les histoires de la ville, les désastres causés par le typhon, le vide que faisait l’absence d’Yves, et comment les soldats se lamentaient de ne plus avoir leur restaurateur.
Il n’ajouta pas, cependant, qu’un Chinois bien avisé avait déjà établi près de la caserne une maisonnette de briques fort ornementée de dragons de faïence, où il débitait une cuisine digne de rivaliser avec celle d’Yves. « Les mauvaises nouvelles se savent toujours assez tôt », pensait le digne homme, et d’ailleurs, ce n’est peut-être pas un mal. Ce brave garçon-là a trop de mérite pour faire toute sa vie ce métier de petit traiteur. J’ai mon idée, j’ai mon idée !…
Une épidémie de dysenterie vint frapper les soldats, mal défendus contre l’humidité dans leurs paillottes défoncées, au sol fangeux, aux murs crevassés. Chaque jour amenait à l’hôpital des fournées de nouveaux malades ; Yves, à peu près remis, dut céder la place, et recourir à la bonne hospitalité du père Pillot.
La chaleur avait cessé, la saison des pluies commençait, il ne faisait pas bon à vivre en plein air, surtout pour un convalescent. Assis devant un feu de bois auquel il présentait ses mains blanches et amaigries, le pauvre garçon regardait d’un air sombre la flamme qui léchait les parois de la cheminée et s’envolait en fines étincelles. Il se sentait faible, incapable, sans courage, même sans espoir. Des larmes qu’il n’avait pas la force de retenir coulèrent sur ses joues creuses, et un soupir, une sorte de sanglot souleva sa poitrine.
Jeannette Pillot, qui allait et venait pour mettre le couvert, s’arrêta devant lui, toute bouleversée de cette grande douleur mal contenue.
— Il ne faut pas vous décourager ainsi, monsieur Kerhélo, dit-elle d’une voix plus douce que de coutume. Vous avez déjà eu bien des traverses dans votre vie, vous les avez surmontées, vous ferez de même cette fois-ci.
— Les autres fois, mademoiselle Jeannette, j’avais de la jeunesse, de la force, de la santé et de l’énergie, mais aujourd’hui…
— Eh bien ! aujourd’hui, vous avez toujours la jeunesse, la force reviendra, la santé aussi, et, quant à l’énergie,… si elle ne veut pas revenir toute seule,… aidez-la un peu ! dit-elle avec un petit coup de tête résolu.
— Je ne demanderais pas mieux si je pouvais, dit Yves d’un ton dolent, mais je ne me reconnais plus, je suis fini…
— A vingt-trois ans ! Voilà bien les hommes ! Aussitôt qu’ils sont un peu malades, ils se croient perdus, ils sont tous des poules mouillées !… Ah ! si les femmes étaient comme eux !
— Si vous aviez eu un accès de fièvre pernicieuse, mademoiselle Jeannette, reprit Yves, que les reproches de la jeune fille tiraient un peu de son apathie, vous ne traiteriez pas si facilement les gens de poules mouillées !
— Si vous croyez que je n’ai jamais rien eu ! J’ai été très, très malade de la dysenterie ; c’était du temps où vous viviez comme un ours et où vous ne veniez jamais nous voir, c’est pour cela que vous ne le savez pas. Voilà une maladie qui vous enlève les forces ! Mais je ne me suis pas effrayée, j’ai pris sur moi tant que j’ai pu, parce que je savais combien mon pauvre cher papa avait besoin de moi. J’ai pourtant bien été six semaines sans pouvoir m’occuper activement du ménage, mais je travaillais tout de même ; aussitôt que j’ai pu remuer les doigts, je me suis mise à faire de la charpie pour nos soldats blessés, et les sœurs en étaient bien contentes ! Et puis, quand j’ai été plus forte, j’ai repris mon tricot et mon ouvrage au crochet. J’ai fait vingt-trois carrés de ma couverture ! c’est ça qui l’a avancée !
— Mais moi, je n’ai pas de couverture au crochet à faire, et dites-moi un peu si je suis capable de reconstruire ma paillotte avec ces mains-là ? Elles ont assez abattu de besogne, certes ! mais maintenant, que voulez-vous qu’elles fassent ?
— N’importe quoi, — des écritures, des choses tranquilles.
— C’est ça ! je vais demander une place dans les bureaux, et j’irai gratter du papier à la résidence.
— Mon oncle, et bien d’autres le font, dit Jeannette d’un ton grave ; mais il ne s’agit pas de cela.
— Je ne peux cependant pas rester à la charge du père Pillot, à mon âge, comme si j’étais un vieillard infirme, dit Yves amèrement.
— A la charge ! Quel vilain mot ! vous n’êtes pas une charge pour nous, et quand même vous le seriez, — ce qui n’est pas, — dit la jeune fille avec un air d’autorité, est-ce qu’on ne doit pas s’entr’aider dans ce monde et secourir ceux qui sont dans la peine ? Vous y êtes aujourd’hui, et nous vous aidons de notre mieux, et de tout cœur ; — qui sait si nous n’y serons point demain ? et alors ce sera votre tour de nous aider. Mais voilà ! jusqu’à présent, vous vous êtes tiré d’affaire grâce à votre force, à votre habileté, et vous croyiez qu’il en serait toujours ainsi, que vous seriez toujours le maître de votre vie, et Dieu vous a envoyé la maladie pour vous faire voir que l’homme ne doit pas compter sur lui seul et qu’il est à la merci des événements.
Yves ne répondit pas ; il regardait avec une admiration respectueuse la jeune fille qui lui parlait avec cette téméraire franchise. Ses yeux noirs, brillants, éclairaient sa jolie figure, elle était, dans sa noble simplicité, la personnification même du courage moral.
— Vous avez vraiment raison, mademoiselle Jeannette, dit enfin le jeune homme, vous m’avez parlé comme l’aurait fait Corentine ou Mlle Martineau, et je vous en remercie. Je ne veux plus vous donner le droit de m’appeler poule mouillée, — je vais tâcher de me secouer. — Je ne peux pas vous offrir de fendre du bois comme dans mon pays, d’abord je n’en aurais pas la force, et puis, ici, on ne fend pas des chênes ; je ne peux même pas laver des bouteilles, je craindrais de les casser, — mais je vais, si vous voulez bien, m’occuper de vos livres de comptes ; je sais que ça ne vous amuse pas toujours de tenir les écritures, vous êtes si vive ! Moi, je ne m’en tire pas mal parce que j’y ai bien souvent travaillé du temps où j’étais chez M. Gerbier ; ce sera un vrai plaisir que de vous rendre un petit service. Vous m’en rendez de si grands ! Voulez-vous me permettre de vous serrer la main d’amitié ? Ça me fera du bien.
— Volontiers, monsieur Yves, dit Jeannette en rougissant, je serai bien sûre alors que vous m’aurez pardonné de vous avoir dit des choses… si… dures.
Elle lui tendit sa petite main brune, pas trop déformée vraiment pour une main qui faisait tant de besogne…
Les semaines succédaient aux semaines, les mois aux mois, et Yves Kerhélo ne quittait pas la Nouvelle-France… D’abord, il avait été longtemps trop faible pour reprendre son trafic, puis le père Pillot avait été malade pondant six semaines, d’une furonculose[37]. Criblé de clous, ne reposant ni jour ni nuit, il était hors d’état de diriger sa maison. Sa fille le soignait avec une tendresse infatigable et Yves le remplaçait de son mieux. Puis Haï-phong se peuplait rapidement : colons, ouvriers, employés, soldats y arrivaient en foule, autant de clients pour le café Pillot qu’on avait dû agrandir. Yves s’était rendu fort utile pour les travaux, pour l’aménagement, pour la surveillance, devenue plus compliquée, par suite de l’affluence des consommateurs et de l’augmentation du personnel des boys. Sous sa direction jeune et ferme, tout marchait rondement et la gaîté était revenue au logis…
[37] Maladie commune au Tonkin.
— Eh bien ! Yves, voilà le beau temps tout à fait solide, dit, un joli matin d’avril, le père Pillot qui fumait béatement sa pipe, allongé dans un fauteuil de rotin, tandis que son compagnon, après avoir terminé le rangement de toute une cargaison de bière, arrivée dès l’aube du jour, se reposait, assis sur une natte à la manière annamite. Est-ce que tu ne me parles pas de tes projets pour l’avenir ? (Il le tutoyait paternellement.)
— Mes projets ? Je ne sais pas trop si j’en ai… Je suis si heureux avec vous qu’il me semble que je ne pourrais plus vivre content hors d’ici.
— Hem ! hem ! fit le bonhomme en tirant une grosse bouffée de sa pipe, c’est très bien, mon garçon : ce que tu me dis là me fait grand plaisir ; moi aussi, je t’aime beaucoup et tu me rends de fameux services, mais enfin, ça ne peut pas toujours continuer ainsi. Tu es jeune, il faut penser à te pousser dans le monde, et à mettre de côté quelque chose pour tes vieux jours. Tu ne gagnes rien avec nous, je ne puis pas te payer ce que tu vaux, je n’en ai pas le moyen ; tu n’es ni mon domestique, ni mon associé, ça ne te fait pas une position, mon enfant. Je parle dans ton intérêt, car, enfin, j’aurai gros cœur quand tu nous quitteras, mais on doit aimer ses amis pour eux et non pour soi, n’est-ce pas, boy ?
— Certainement, monsieur Pillot, je sais que c’est pour mon bien tout ce que vous me dites, répondit Yves d’un ton où il entrait beaucoup plus de conviction que d’enthousiasme.
— Et puis, on ne sait qui vit, qui meurt. Si je m’en allais retrouver là-haut ma pauvre Geneviève, qu’est-ce que deviendrait la Nouvelle-France ? Jennnette ne pourrait pas la gouverner toute seule, il faudrait donc vendre, et le nouvel acquéreur…
— Quant à ça, s’écria Yves, subitement ranimé, si ce malheur-là arrivait, l’acquéreur ne serait pas loin. J’ai un petit fonds de quelques centaines de piastres, je reprendrais la Nouvelle-France et vous savez bien que je paierais jusqu’au dernier sou tout ce qui reviendrait à Mlle Jeannette. Ce n’est pas moi qui voudrais lui faire tort d’un centime, certes ! Je me mettrais au feu pour elle !
Un sourire malin éclaira la figure du bon homme ; il cligna de l’œil, tout en débourrant sa pipe avec un soin tout particulier.
— Oui, je le sais, mon ami ! J’en suis bien sûr, mais il y à encore une grosse épine. — Ce petit bijou de fille-là est à marier ; on me l’a déjà demandée plus d’une fois, et même j’ai trouvé pour elle des partis très avantageux. Elle dit toujours non ; mais, un jour ou l’autre, elle dira oui, tu comprends, et alors, quand il y aura un gendre dans la maison…
— Je n’y resterai sûrement pas une minute, s’écria Yves en bondissant. Vous n’avez pas tort, père Pillot, de me parler si franchement, et je vous prouverai tout de suite que je sais faire mon profit d’un bon avis. Pour ma paillotte, il n’y faut plus penser. Le Chinois a pris toute ma clientèle et puis les choses ont tant changé depuis trois ans ! Il y a maintenant des maisons de commerce de bien des sortes à Haï-phong, je n’y pourrais réussir qu’en vendant des boissons, je ne veux pas vous faire concurrence. Je m’en vais partir pour Hanoï, j’en ai entendu parler ces jours-ci, peut-être bien que j’y monterai un petit café ; je l’appellerai la Nouvelle-France, — ce sera un souvenir d’ici, ajouta-t-il d’une voix tout à fait lugubre.
M. Pillot le regarda en dessous d’un air de bonhomie narquoise.
— Qu’est-ce que tu as besoin d’aller devenir patron d’une Nouvelle-France à Hanoï quand tu en as une sous la main ? dit-il.
— Comment ! balbutia Yves, vous voulez vous retirer, monsieur Pillot ?
— Me retirer ? pas du tout ! mais je m’alourdis, je ne suis plus ce que j’étais autrefois, un associé jeune et actif m’irait tout à fait, et puisque nous nous entendons si bien toi et moi, pourquoi ne serais-tu pas cet associé ?
— Mais,… monsieur Pillot,… mais… le gendre ?
— Si le gendre et M. Kerhélo ne font qu’un, crois-tu qu’ils se battront ?
— Jézuz ma Doué ! s’écria Yves, — revenant au langage breton dans l’excès de son émotion. Est-il bien possible ? Vous êtes bon comme le bon Dieu, monsieur Pillot ! Tout mon sang ne serait pas de trop pour payer ce bonheur-là !… Mais Mlle Jeannette !
— Est-ce que je t’aurais parlé comme ça, si je n’étais pas d’accord avec elle ? Il y a longtemps que vous vous connaissez, que vous vous estimez, que vous vous aimez tous deux. Tu es le mari qu’il lui faut, elle est la femme qui te convient ; moi je t’ai vu à l’œuvre, dans la prospérité et dans la peine, tu sais faire face à l’une et à l’autre, tu es un homme de cœur, tu rendras ma fille heureuse.
— Ah ! monsieur Pillot !… monsieur Pillot, dit Yves éclatant en sanglots, et il se sauva suffoquant sous une joie trop lourde à porter.
La noce fut superbe. « Je veux que rien n’y manque et qu’on se croie dans notre pays dijonnais, avait dit le vieux Bourguignon. Il y aura bal, festin et tout le tremblement. Jeannette sera vêtue de soie blanche et couronnée d’oranger et deux violons conduiront le cortège. »
On parla longtemps à Haï-phong des splendeurs de cette fête-là. M. et Mlle Pillot étaient allés faire les emplettes à Saïgon. Yves s’était fait habiller de pied en cap par un tailleur chinois d’un talent hors ligne. M. et Mme Royer avaient accompli des prodiges d’élégance ; la flotte, l’armée, la résidence avaient fourni un personnel tout à fait éblouissant au point de vue des uniformes, et on avait pu se procurer les violons, chers au père Pillot, parmi les matelots d’un bateau en rade ; un cornet à piston et une clarinette étaient même venus apporter un appoint très notable aux flons-flons de l’orchestre. Le plus fameux cuisinier chinois d’Haï-phong prêta ses talents au repas de noces, qui fut sans pareil pour la variété des mets, la dimension des plats et le nombre des bouteilles vidées.
Le bal dura jusqu’au jour ; il avait lieu sous une tente fort joliment ornée de fleurs, de feuillages, de draperies et surtout de ces lanternes en papier que l’imagination des Orientaux, infiniment plus féconde que la nôtre sous ce rapport, sait varier de mille façons, tant pour la forme que pour la couleur.
La Nouvelle-France en était toute enguirlandée. De grands mâts en bambou plantés de distance en distance étaient reliés par des chaînes de feuillages auxquelles pendaient de grandes étoiles lumineuses ; les arbres étaient chargés de ballons rouges, verts, bleus, violets, semés à profusion dans leur verdure sombre. A dix heures du soir, un feu d’artifice vint inonder de sa pluie de feu les eaux du Song-tan-Back, au ravissement des indigènes accourus en foule pour contempler ces merveilles, et une large distribution de sapèques mit le comble à l’allégresse générale.
Le mariage d’Yves Kerhélo fut le début d’une période d’années heureuses pour lui et sa famille. La Providence récompensait enfin son courage, son honnêteté, toutes les grandes vertus dont il avait donné la preuve pendant les temps difficiles. Parfaitement heureux en ménage avec sa chère femme, qui partageait toutes ses idées et lui en fournissait même de nouvelles au besoin, traité comme un fils par son excellent beau-père qui lui laissait une entière liberté dans toutes ses entreprises, il avait pu donner l’essor à tout ce que son esprit inventif lui suggérait pour attirer la clientèle et étendre son commerce.
La Nouvelle-France n’était plus reconnaissable. A la paillotte avait succédé une construction en briques presque élégante. Ce n’était encore qu’un rez-de-chaussée, mais les murs étaient solides, le toit de chaume bien peigné, les fenêtres garnies de volets, le sol pavé de briques, nettoyé à fond et sablé de frais tous les matins, comme dans les petits cafés flamands. Devant la porte, Yves avait fait établir une chaussée, en briques également (la pierre est fort rare dans le pays), ce qui évitait les amoncellements de boue, et rendait plus facile le maintien de la propreté à l’intérieur.
Aux alentours, un joli jardinet alignait ses plates-bandes entourées de petites palissades en bambou. Mme Kerhélo qui adorait les fleurs le soignait avec amour. Elle avait même fait venir des graines de France et se montrait justement fière de ses corbeilles de zinias, d’œillets de Chine, de chrysanthèmes. De belles touffes de cycas, cette plante splendide qui rappelle les forêts des temps primitifs, décoraient de leurs majestueuses palmes vertes l’entrée du café et même l’intérieur ; des aralias, des lataniers formaient des massifs verdoyants, et un jeune banyan[38], planté par Yves la veille de son mariage, promettait de nombreux rejets pour l’avenir.
[38] Arbre singulier dont les branches poussent de longs rejets qui en touchant terre y reprennent racine.
Les officiers de marine avaient pris à gré le gai café Pillot et leurs instances décidèrent Yves à joindre un restaurant à son débit de boissons.
Il avait trop à surveiller chez lui pour faire la cuisine lui-même ; d’ailleurs, il était maintenant M. Kerhélo, notable commerçant d’Haï-phong, et préférait laisser le détail de la besogne à son personnel. Mais il est toujours bon, quand on commande, d’avoir, comme on dit, mis soi-même la main à la pâte ; on se fait mieux obéir et on évite bien des écoles. Il attacha à son établissement un excellent cuisinier chinois, et comme il veillait minutieusement au choix des provisions et aux menus des repas, il eut, en peu de temps, la vive satisfaction de voir renaître à la Nouvelle-France l’ancienne vogue de la Renommée des poulets frits.
— Sais-tu, Yves, ce que me disait tantôt le commandant Verdier ? demanda, un beau jour, Mme Jeannette à son époux.
— Comment veux-tu que je le sache ? Parle sans tant de préparations.
— Eh bien ! il prétendait que tu devrais loger pour la nuit les officiers du bord quand ils viennent à terre.
— Loger pour la nuit ? c’est-à-dire avoir un hôtel garni ? Hum ! c’est un peu gros pour nous, ma chère femme, et si nous ne réussissions pas ?
— Qui te parle d’un hôtel ? Bien sûr que ce serait trop de frais, quant à présent. Mais, comme le disait M. Verdier, pourquoi n’aurions-nous pas une demi-douzaine de petites chambres, simples mais propres, un peu gentilles, où ces messieurs pourraient passer la nuit au lieu de retourner à bord le soir, ce qui les ennuie à cause du mauvais temps.
— C’est une idée ; — tu as peut-être raison ; — mais que de dépenses pour commencer ! Il faudra faire faire un étage à la maison, penses-tu à ce que cela fera d’embarras et d’argent ?
— Pourquoi faire élever un étage ? Allonge le bâtiment au rez-de-chaussée, tel qu’il est.
— Ça ne sera pas bien joli.
— Qu’est-ce que ça fait ? Crois-tu qu’on s’attend à trouver à Haï-phong l’hôtel du Louvre comme il est sur les catalogues ? La brique n’est pas chère dans ce pays-ci, les journées d’ouvriers non plus ; avec quelques centaines de piastres pour la bâtisse et le mobilier, nous en verrons la fin.
— Oui, mais après ?
— Après, quoi ?
— Si les clients ne viennent pas, nous en serons pour nos frais.
— Ils viendront. Et puis quand ils seront là, ils prendront des consommations au restaurant et au café, ainsi nous gagnerons de trois côtés.
Yves ne répondit pas : il réfléchissait silencieusement, selon son habitude.
— Il y a du bon à prendre dans tout cela, finit-il par dire à Jeannette. J’y penserai à loisir. J’ai entendu dire ce matin que nous allons avoir plusieurs bateaux de l’État, dans un mois, ce serait une bonne occasion pour débuter.
— Alors, occupe-toi dès demain de l’affaire, je vais me mettre en quête du mobilier.
— Doucement, ma femme, doucement. Je vais d’abord me renseigner un peu sur ce que cela me coûterait, puis sur les chances que j’aurais de réussir. Tu sais que je ne fais rien à la légère.
… M. Kerhélo réfléchissait, calculait, combinait en toute conscience, — mais quand Mme Kerhélo avait décidé une chose, la chose se faisait généralement vite et bien. C’est ce qui arriva encore cette fois. Quinze jours après la conversation ci-dessus, une nouvelle construction prolongeait les bâtiments du café, et un mois plus tard, on pouvait voir sous une sorte de véranda dallée en briques, couverte en paillotte, des officiers de marine confortablement étendus sur leurs chaises de rotin, fumer leur pipe à côté d’une petite table portant verres, flacons, et l’indispensable seau à glace.
Par les fenêtres ouvertes, on apercevait leurs chambres coquettement meublées d’une façon un peu fantaisiste, mais parfaitement appropriée au climat. Les murs tendus d’étoffes de coton à dessins voyants, le lit enveloppé de sa vaste moustiquaire, la natte servant de tapis, les tables et sièges en bambou, les colonnes de grosse faïence supportant de larges vasques où fleurissaient des plantes vertes, la lanterne chinoise pendue au plafond formaient un ensemble attrayant pour le regard. Les tables de toilette étaient chargées de ces belles garnitures de porcelaine de Chine, considérées en France comme un objet de grand luxe, mais d’un prix beaucoup plus accessible qu’on ne le croirait lorsqu’on les achète en Indo-Chine. La prophétie de Jeannette s’était donc promptement réalisée et l’affluence des clients ne tarda pas à prendre de telles proportions qu’avant un an écoulé, Yves Kerhélo se décidait à entreprendre la construction d’un véritable hôtel.
— Ah ! si M. Émile Gerbier me voyait, pensait-il en surveillant ses ouvriers, que dirait-il en retrouvant son ancien boy en train de se faire élever une maison ! Il serait bien content, j’en suis sûr, il est si bon ! Que de services il m’a rendus ! que de sages conseils il m’a donnés ! et comme je me félicite de les avoir suivis ! Sans lui, je me serais peut-être abandonné à ma passion pour le jeu, et j’aurais fini comme ce malheureux Guillerm dont j’ai vu le nom l’autre jour parmi ceux des condamnés à la déportation. Tandis que moi ! — ah ! j’ai bien des grâces à rendre au bon Dieu et à tous les braves gens que j’ai rencontrés sur mon chemin. Mlle Martineau, d’abord, et puis le capitaine Simon. Que j’ai eu de plaisir à le recevoir le mois dernier ! et que Jeannette a été gentille pour lui ! Quelle perle de petite femme j’ai ! Et ce bon père Pillot, et mon beau poupon ! Allons ! la vie est bonne quand on a la conscience nette, et l’âme et le corps vaillants !
— Y en a monsieur, vouloir parler madame, dit un boy en entrant dans la chambre de Mme Kerhélo qui dodelinait son premier-né, un superbe garçon âgé de six semaines environ.
— Un monsieur ? Quel monsieur ?
— Un monsieur capitaine[39].
[39] Les Annamites appellent tous les officiers : capitaine.
— Et c’est à moi qu’il veut parler ?
— Oui ; lui avoir dit vouloir parler à Mme Yanesse Kélélo[40].
[40] Les indigènes de l’Extrême-Orient ne peuvent prononcer ni l’r qui n’existe pas dans leur langue, ni la finale te avec l’e muet.
— C’est singulier ! Tu peux l’aller chercher.
Et, en un tour de main, Jeannette fit disparaître le semblant de désordre qui déparait sa chambre.
Un pas incertain, mal rythmé, ébranla les marches de l’escalier, puis la porte s’ouvrit et un lieutenant d’infanterie de marine s’arrêta sur le seuil le casque à la main[41]. C’était un homme d’une trentaine d’années, de taille moyenne, d’une figure énergique et sérieuse. Il s’appuyait sur une canne et semblait à peine convalescent de quelque grave maladie.
[41] Les officiers et soldats au Tonkin portent toujours le casque blanc, léger, indispensable dans les pays chauds pour garantir des insolations.
Jeannette, interdite, le regardait avec une inquiétude mêlée de pitié.
Il fit deux ou trois pas.
— Six mois de campagne et deux blessures changent donc bien terriblement un homme, dit-il d’une voix qu’il s’efforçait de rendre gaie. Est-ce que tu ne reconnais pas ton cousin François, Jeannette ?
— François ? — François Pillot ! — Est-il possible ? — Il y a plus de quinze ans que nous ne nous sommes vus, il n’est pas étonnant que je ne t’aie pas reconnu tout de suite ! Je te savais au Tonkin, — tu nous l’avais écrit ; mais tu étais là-bas, du côté de Lao-Kai ;… et puis, tu nous avais laissés sans nouvelles ; — comme papa va être content ! et Yves aussi ! Je vais te présenter mon mari ! Tiens voilà mon bébé, mon gros Émile, il a les beaux yeux noirs de son père, — n’est-ce pas, bijou ? — et elle embrassa le poupon. Il commence à rire, vois-tu ?… Mais assieds-toi ; tu as l’air fatigué, tu viens d’être malade ? — Tu vas prendre quelque chose,… je vais te faire apporter à déjeuner.
— Merci, j’ai déjeuné à bord, mais j’accepterai avec plaisir un verre de vin d’Espagne. La course m’a paru longue, du port ici.
— Tu as été blessé ?
— Oui, une balle dans le genou, et une autre dans l’épaule ; on les a retirées toutes les deux, mais l’hôpital ne vous refait pas vite, tu sais !
— Ah ! oui, je sais ! nous en voyons tant de ces pauvres officiers qui n’en finissent pas de se remettre. Yves et moi nous les soignons bien, les meilleurs plats et les meilleurs vins sont pour eux.
— J’en suis convaincu ; mon oncle Pillot est bien la meilleure pâte d’homme qui soit au monde. Tu tiens de lui, ma petite cousine, et ton mari est digne de toi, paraît-il. Il me semble que vous faites joliment vos affaires !
— Yves est si capable, si travailleur, si rangé !… mais il va venir, il est près d’ici, au port, avec papa, je vais les faire prévenir de ton arrivée.
Quelques instants après, M. Pillot et son gendre accouraient et, à leur tour, faisaient l’accueil le plus cordial au nouvel arrivant. Quelques petits verres d’excellent xérès avaient ranimé ses forces et il put répondre au déluge de questions dont il était assailli.
Le bruit de la mort du commandant Rivière s’était répandu à Haï-phong depuis peu de jours seulement et sans aucun détail. Les colons n’étaient pas encore revenus de la douloureuse stupéfaction où les avait jetés cette nouvelle qui présageait de terribles événements et, comme un coup de foudre, était venue troubler les espérances et les projets de la colonie naissante.
— Que va-t-il en advenir ? que pensez-vous qu’il en résulte ? dit Yves inquiet.
— Je n’en sais rien ; rien du tout. Dans tous les cas, on ne peut laisser les choses où elles en sont, répondit le lieutenant. L’audace de nos ennemis s’accroîtrait chaque jour ; la situation des Français, civils et militaires, deviendrait insoutenable. Il faut qu’on agisse, et promptement et avec fermeté.
— Mais enfin, qu’est-il donc arrivé ? Comment tout cela s’est-il passé ? Nous voyons tous les jours accourir ici de malheureux négociants d’Hanoï à demi affolés ; — ils ont été pillés, leurs maisons incendiées ; le commandant Rivière et plusieurs officiers tués ; cinq cents hommes hors de combat ; voilà ce qu’ils racontent… mais leurs récits sont si décousus !
— Et exagérés évidemment, sauf en ce qui concerne le pillage et l’incendie qui ne sont que trop réels. — Après la triste affaire du Pont de Papier, — dont je puis vous parler en connaissance de cause, car j’y étais, — les Pavillons-Noirs sont entrés à Hanoï, les habitants ont presque tous pris la fuite et il y a eu des milliers de cases brûlées. Quant à nos pertes en hommes, en voici le chiffre exact.
Et le lieutenant, tirant de son portefeuille un petit papier, lut tout haut :
Combat du 19 mai :
Morts : le commandant Rivière, trois officiers, — vingt-neuf soldats.
Blessé mortellement : le commandant Berthe de Villers.
Blessés : six officiers, quarante-quatre soldats. Pertes de l’ennemi : cent treize hommes.
— C’est un désastre, un vrai désastre, s’écrièrent Yves et M. Pillot consternés.
— Oui, nous n’avons même pas pu emporter nos morts, le corps du commandant Rivière a été enlevé et emmené par les ennemis.
— Mais vous n’étiez donc pas en nombre ?
— En nombre ? Nous étions quatre cents contre quinze, vingt mille gredins peut-être, — et bien armés, ils avaient des fusils à tir rapide, des remingtons, des revolvers, — je m’en suis bien aperçu !
— Mais comment est-on allé se fourrer ainsi dans la gueule du loup ?
— Est-ce qu’on les savait là ? Dans ce pays-ci avec les talus des rizières, les digues, les touffes de bambous, on peut dissimuler toute une armée de tirailleurs. — Ils nous avaient déjà attaqués dans les derniers jours de mars, à deux lieues environ d’Hanoï ; le pauvre commandant de Villers les avait repoussés. Rivière était revenu de Nam-Dinh, et, pendant cinq semaines, on avait été assez tranquille ; mais on se méfiait tout de même, et on avait bien raison ; le 9 mai ils arrivèrent tout à coup avec de nombreuses troupes et de l’artillerie et se mirent à canonner la concession française. Nous n’étions pas assez de monde pour tenter une sortie ; il fallait bien cependant se débarrasser de toute cette engeance de Pavillons-Noirs ; à chaque heure il en arrivait de nouveaux, ils étaient bien commandés par le général Hoang, et le bruit se répandait que nous allions être investis. C’est ça qui n’aurait pas été drôle ! Alors le commandant s’est décidé à demander à l’amiral Meyer de lui prêter ses compagnies de débarquement.
L’amiral a envoyé une compagnie de la Victorieuse, une du Villars et puis trois pièces de campagne qui étaient conduites par un lieutenant de vaisseau, et l’aspirant Moulin, un tout jeune homme qui est resté là-bas avec Rivière.
— Ah ! nom de nom ! — un gros soupir souleva la poitrine du lieutenant et une larme coula sur ses joues creuses.
Ils arrivèrent à Hanoï le 13 au soir ; on fut bien content de les revoir comme vous pensez, on les laissa se refaire un peu, et puis le 14 on se remit en mouvement sur la rive gauche. — Nous entrions dans les villages, on n’y trouvait presque personne, on enclouait les pièces, on tuait un Pavillon-Noir par-ci par-là, mais ça n’avançait pas à grand’chose, et même l’ennemi avait, du 16 au 19, attaqué la Mission aux portes mêmes de la ville, brûlé les bâtiments et rasé les arbres.
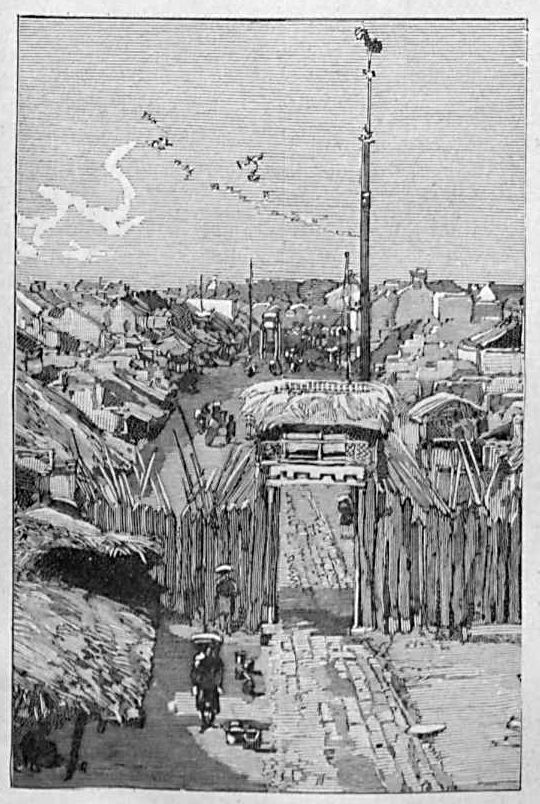
Une rue à Hanoï.
Il fut décidé que nous irions déblayer la rive droite, et le 19 au matin, à quatre heures et demie, la colonne commandée par le commandant Berthe de Villers se mit en marche vers la pagode de Balny. A huit heures et demie nous y arrivons, et nous passons un joli pont, appelé, je ne sais trop pourquoi, le Pont de Papier. Jusque-là on avait vu clair ; mais de l’autre côté du ruisseau que nous venions de traverser, c’étaient des rizières, des roseaux, des bambous, on ne s’y reconnaissait plus. Le commandant Rivière allait devant, tâtant le terrain avec sa canne, car c’était le fond d’un ravin et presque un marais.
Tout à coup la fusillade éclate, à droite, — à gauche, — en avant. M. Moulin est tué raide, M. de Villers tombe grièvement blessé, nos servants de pièces aussi ; les Pavillons-Noirs se précipitent sur nous de tous les côtés et veulent s’emparer de nos canons ; alors on s’est battu corps à corps ; c’était une terrible empoignée ! Le capitaine Jacquin s’est fait hacher sur sa pièce ; le commandant Rivière a été percé de coups, moi je me trouvais à quelques pas de lui, — c’est un peu après que j’ai été blessé. Les lieutenants de vaisseau Brisis et de Ravinères ont réussi à dégager nos canons, on les a ramenés comme on a pu à Hanoï, — je ne peux pas dire que ce soit en bon ordre, car on se tirait de là plutôt mal que bien. Et puis avec ma balle dans le genou, je ne pouvais plus faire un pas ; les camarades m’ont transporté, à demi mort, et ma blessure à l’épaule me causait de si cruelles souffrances, que je ne savais plus où j’étais. Il faisait une chaleur atroce, je me souviens seulement que je n’avais qu’une pensée : de l’eau, de l’eau fraîche à boire. Heureusement les Pavillons-Noirs ne nous ont pas poursuivis. Mais quelle amertume que de rentrer à Hanoï presque en déroute et sans le corps de notre chef ! Mais tout n’est pas fini ! Nous n’en resterons pas là ! on va nous envoyer de France des renforts et nous réglerons le compte de ces brigands-là ; il sera lourd à payer. A votre santé, cousin Pillot !
Et le lieutenant vida le reste du xérès dans son verre.
Six mois plus tard, à l’assaut de Son-Tay, le brave lieutenant gagnait brillamment ses épaulettes de capitaine. Entré parmi les premiers, il avait eu la joie d’enlever bon nombre de drapeaux ennemis, plantés sur les défenses de la place, et de voir sa compagnie infliger aux Pavillons-Noirs les représailles sanglantes qu’il appelait de tous ses vœux.
Une troisième blessure était venue malheureusement lui ôter toute possibilité de continuer une carrière active. Il est maintenant vice-résident dans un poste de la province d’Hanoï. Quand il y est arrivé, ce n’était qu’une sorte de village, ramassis de huttes en paillotte. Grâce à son dévouement, à sa persévérance, à sa fermeté, à sa modération, il a obtenu des prodiges de ses administrés, et sa bourgade est devenue une petite ville des plus prospères. Il trace des rues… et les baptise, ce qui est une vive satisfaction pour lui ; il dessine des places, il crée des écoles, il fonde des foires et marchés. Avant dix ans, du train dont il va, il aura là une résidence de première classe.
Ma-Kung (Pescadores).
Juillet 1885.
Mon cher Yves,
La date de cette lettre t’apprendra que nous ne sommes plus séparés par la moitié du monde. Je suis presque dans ton pays, et, peut-être, aurai-je le bonheur de t’embrasser dans quelque temps, si les hasards de la guerre me conduisent de ton côté. Depuis six mois, je fais partie de l’équipage de la Triomphante. — Un beau nom, n’est-ce pas ! — Et si tu savais comme nous l’aimons, notre bateau, comme nous en sommes fiers ! Il vient de faire une fameuse campagne, mais tu la connais, car certainement tu as entendu parler de Fou-Tchéou, où l’amiral Courbet — je ne puis écrire son nom sans un serrement de cœur, — sa mort a été pour nous comme une blessure, et elle saigne encore… — où l’amiral Courbet l’a vue déboucher au bon moment dans la rivière Min, faisant gronder ses gros canons de vingt-quatre.
Moi, je n’étais pas là malheureusement : je ne suis arrivé que peu de jours avant notre départ pour les Pescadores. C’est un groupe d’îles situé au sud de Formose. Jamais je n’oublierai que c’est là que j’ai reçu le baptême du feu, comme nous disons, et c’est un beau moment dans la vie d’un marin.
Le 29 mars, à cinq heures du matin, aussitôt après le déjeuner de l’équipage, les bateaux se sont mis en mouvement. C’étaient le Bayard, la Triomphante, le d’Estaing, le Duchaffault et l’Annamite ; à six heures cinquante-cinq, chacun est venu prendre sa place devant le fort ou la batterie qu’il était chargé de démolir ; le nôtre était celui de l’île Plate. Nous n’avons pas eu grand’peine tout d’abord, il nous a tiré quelques obus, nous avons répondu, il a cessé le feu, et alors nous sommes allés aider le Bayard qui avait grosse besogne. Là, par exemple, il a fait chaud ; jusqu’à dix heures, le tir n’a pas ralenti un moment. J’avais eu la chance d’une bonne place, j’étais dans la hune de misaine pour faire le service des hotchkiss[42] ; nous allions un train d’enfer, bim ! boum ! piff ! paff ! ça pleuvait comme grêle sur les Chinois. On était joliment bien là-haut pour voir tout ce qui se passait, et notre aspirant, M. Henry, en a profité pour prendre des croquis des forts. Il y en avait cinq en tout ; nous ne les avons lâchés que lorsqu’ils ont été démolis à fond ; mais le soir, vers huit heures, les Chinois, profitant de l’obscurité, sont revenus dans les ruines ; ils ont tiré deux coups de canon qui ont pris la Triomphante en enfilade et sont venus tomber à une cinquantaine de mètres derrière elle. Pour éviter le retour de petits agréments de ce genre, toute la nuit, de demi-heure en demi-heure, nous dirigions sur le fort un coup de hotchkiss.
[42] Petits canons-revolvers.
Pendant la journée, l’infanterie de marine avait occupé l’intérieur de l’île. Nous pensions, nous autres, qu’on allait tout bellement entrer en rade de Makung, mais nos officiers en savent plus long que nous ; il y avait un barrage en travers de la rade, — un long barrage formé d’une chaîne soutenue de distance en distance par des barriques, et l’on craignait que ces barriques ne fussent des torpilles, car les Chinois avaient fait fortifier les Pescadores par un Américain nommé Nelson qui s’entendait bien à son métier.
Aussitôt qu’il a fait nuit noire, une baleinière[43] du Bayard[44] est partie sous la conduite d’un capitaine de frégate pour aller reconnaître ce qu’il en était. Elle se glissait dans l’obscurité, et, pour l’empêcher d’être vue par l’ennemi, on nous fit les signaux d’éteindre nos projecteurs électriques qui éclairaient la rade de temps à autre. La reconnaissance terminée sans encombre montra que nous n’avions pas à craindre d’être torpillés ; alors vers six heures du matin, un canot du Bayard apporte un ordre à la Triomphante, — c’était nous qu’on chargeait de relever le barrage ! Nous voilà bien contents ! — Tout de suite, on met à l’eau le canot à vapeur avec son canon-revolver, la chaloupe et deux canots avec une quarantaine d’hommes dont j’étais, et nous voilà partis pour la rade. De Makung, on commence à nous tirer dessus, comme tu penses bien, — mais ils ne sont pas forts pour viser, paraît-il, — les projectiles tombaient autour de nous sans nous atteindre ; notre petit canon-revolver ripostait tant qu’il pouvait, et envoyait des obus sans se lasser. Enfin nous arrivons au barrage, et on se met à le relever, empilant la chaîne dans les canots et prenant les barriques à la remorque. Notre aspirant, M. Henry, un tout jeune homme qui n’a pas vingt ans, était à bord du canot à vapeur. Il commandait bien tranquillement : « faites ceci, faites cela, faites comme ci, faites comme ça » ; nous autres, nous faisions notre petite besogne, sans nous presser, tout comme si nous avions été dans la Penfeld[45] à arrimer des câbles, — et ces enragés qui tiraient toujours ; mais, bien sûr, ils ne faisaient pas mouche à tous coups, leurs dragées n’arrivaient seulement pas à cinquante mètres de nous.
[43] Baleinière, petite embarcation dont la marche est sûre et rapide.
[44] Le vaisseau amiral.
[45] La rivière qui forme le port de Brest.
Mais voilà où la chose se complique, — c’est qu’il y en avait terriblement de cette gredine de chaîne, et lourde ! et encombrante ! Nos canots ont été pleins en très peu de temps ; alors nous sommes allés porter tout notre bibelot à bord, on a hissé le tout sur le pont, et nous sommes repartis à la provision, lestes comme une ménagère qui à son panier vide. Quand on a eu enlevé une centaine de mètres du barrage, la marée qui montait a repoussé à droite et à gauche les deux bouts avec les barriques qui les soutenaient ; cela a fait un beau passage, et le Bayard a pu entrer en rade pour achever la destruction des forts. Malheureusement, en revenant de notre second voyage, nous avons perdu un de nos camarades ; un projectile lui est entré dans la poitrine, il n’a pas seulement poussé un cri, il est même resté sur son banc… Deux ou trois soupirs, une figure toute bleue, et puis pan ! il s’est affaissé. Pauvre garçon ! Il avait au plus vingt-cinq ans : c’est jeune pour mourir, mais quand on va à la guerre, il faut bien s’attendre à quelque mauvais coup. Et puis mourir pour son pays, en faisant son devoir, c’est une belle mort.
Le 1er avril, à onze heures du matin, les compagnies de débarquement sont descendues à terre ; on a parcouru toute l’île en combattant, mais la résistance n’a pas été longue et à cinq heures du soir, le pavillon français était hissé sur les débris du fort principal.
Alors, à bord de tous les bateaux, les clairons ont sonné, les tambours ont battu, saluant les couleurs nationales, pendant que la musique du Bayard jouait la Marseillaise. C’était un beau moment, vois-tu, ami Yves ! et jusqu’au dernier jour j’en garderai la mémoire ; il faisait oublier tout ce qu’on avait souffert : le terrible hiver de Formose, les nuits de tempête, les jours de fatigue sans relâche, les privations, les maladies, les deuils sans cesse renouvelés. Nos officiers étaient aussi émus que nous, et tous les cœurs, depuis le dernier matelot jusqu’au commandant, battaient de fierté et d’admiration pour notre illustre chef, celui dont je ne prononcerai plus le nom sans me découvrir,… l’amiral Courbet !…
Qu’allons-nous devenir sans lui maintenant ? La paix est signée, beaucoup d’entre nous vont retourner en France, la Triomphante ira d’abord se refaire au Japon, à Nagasaki. Elle a rudement souffert de sa campagne, elle ne pourrait pas entreprendre la traversée d’Europe dans l’état où elle est.
Je ne sais pas si j’irai de ton côté, je crois que non ; je voudrais pourtant bien t’embrasser, mon vieux camarade, toi et tes jolis enfants, et faire connaissance avec ta femme. Tu as sûrement des nouvelles du pays par Corentine, ta sœur ; elle aussi est très bien mariée et a une charmante famille.
Au revoir, mon cher Yves, je dis au revoir car, dans la vie de marin, il ne faut jamais désespérer de revoir ses amis, même quand ils sont à mille lieues de vous.
Alain Le Pennec.
Il y avait dix ans qu’Yves était marié. Pierre et Émile, ses fils, étaient deux solides gars, élèves intelligents et suffisamment laborieux de l’école d’Haï-phong. Corentine, sa mignonne fillette, restait auprès de sa mère et s’initiait peu à peu aux mystères de la lecture, aux redoutables écueils de la table de multiplication et à la pratique des ourlets et du tricot. Grand-papa Pillot, tout à fait vieux maintenant, mais toujours bon et gai, ne quittait guère le comptoir du café que pour fumer sa pipe sous la véranda en compagnie des officiers auxquels il racontait les traditions du temps jadis à Haï-phong, à l’époque où l’hôtel Kerhélo (on l’appelait alors la Nouvelle-France) n’était qu’une vaste paillotte secouée par les typhons et inondée par les grandes pluies qui, de temps à autre, se faisaient jour à travers la toiture en feuilles de latanier.
Mme Jeanne Kerhélo, devenue un peu rondelette, maîtresse respectée et enviée du plus bel hôtel d’Haï-phong, dirigeait tout un peuple de boys avec une rare maestria. Quant à M. Kerhélo, juge au tribunal de commerce, conseiller municipal, un des grands négociants de la ville, il avait pris un air et des manières de tout point conformes à sa brillante situation. Il avait ajouté à son hôtel un entrepôt de vins et de liqueurs en gros et demi-gros ; à mesure que la ville augmentait et se peuplait, il voyait ses affaires prendre plus d’extension. Il fournissait la plupart des maisons riches et presque tous les débitants d’Haï-phong. La Vendée naviguait pour lui et le brave capitaine Simon lui apportait deux fois par an des cargaisons de fûts et de barils remplis des vins de France, d’Espagne et d’Italie. C’était plaisir de voir la rude figure du vieux marin grimacer un sourire tout rayonnant de bonne humeur à l’adresse de Mme Kerhélo ou de sa filleule Corentine qu’il chérissait. Plaisir aussi de voir à son bord Émile et Pierre, s’essayant pendant quelques minutes au métier de mousse que leur père avait fait autrefois sur le même navire.
— Oui, mes enfants, disait le capitaine, vous voyez là toutes ces barriques marquées Y. K., n’est-ce pas ? et aussi tous ces hommes qui les déchargent et ces sampans qui les attendent, et vous êtes fiers de penser que c’est pour la maison de votre père que la vieille Vendée a traversé les mers et que tant de monde travaille ? Eh bien ! il y a vingt ans, voilà comme était Yves Kerhélo, — tout pareil à ce petit gars qui tire là un seau d’eau pour la cambuse, pieds nus, et vêtu d’un pantalon de toile bise et d’une chemise de laine déteinte. — Et tout gros monsieur qu’il est devenu, il n’en rougit pas, certes ! parce qu’il est un brave homme.
Et s’animant : vous êtes de jolis garçons, — il était aussi joli que vous, nom d’un tonnerre ! — vous êtes de jolis garçons, bien vêtus, bien nourris, bien couchés. J’ai vu l’autre jour votre chambre, avec de petits lits à la mode de France, et des moustiquaires de tulle, et des tables de toilette à dessus de marbre, et ceci, et cela, et le diable et son train pour vous bichonner… Regardez ! voilà les clous où votre père pendait son hamac, — et là, dans ce petit coin, que de fois je l’ai vu, — bien fatigué, car il ne s’épargnait pas, — se courber sur ses livres et sur ses cahiers pour ne rien perdre des leçons que lui donnait M. Émile Gerbier !… Et à ce souvenir, la voix du capitaine Simon devint subitement enrouée ; — il l’éclaircit en toussant une ou deux fois et reprit : Vous qui avez toutes vos aises, vous grognez quand votre leçon est longue, comme Émile le faisait ce matin, ou vous réclamez si l’on vous sert deux fois du riz dans la même semaine. Ah ! je voudrais bien vous tenir un peu ici à manier le faubert[46] ou à haler sur le filin[47], c’est pour le coup que vous ne penseriez pas à vous plaindre de la nourriture !
[46] Le faubert est le balai de corde avec lequel on frotte le pont.
[47] Tirer sur un câble.
— Je ne demande pas mieux que d’aller avec vous, capitaine ! s’écria Pierre. Emmenez-moi sur la Vendée. Ça me plairait bien plus que de barbouiller du papier et d’apprendre la chronologie.
— Mon garçon, tu ne sais pas ce que tu demandes là. Tu n’as pas, grâce à Dieu et à tes parents, passé par les épreuves qu’a connues ton père. Ta mère et lui ont bien travaillé pour que leurs enfants puissent avoir une bonne éducation, tu dois en profiter. Pourquoi, puisque tu peux servir ton pays comme officier, veux-tu rester dans les rangs comme simple soldat ? Il n’en manque pas qui, ne pouvant faire plus, sont bien forcés de se contenter de leur lot, mais toi et ton frère, vous avez de l’intelligence, les moyens de la cultiver, vous seriez des paresseux et des ingrats si vous ne répondiez pas aux vues de vos excellents parents. L’an prochain, vous entrerez au lycée de Saïgon, et j’espère bien, au voyage d’été de la Vendée, voir le nom de Kerhélo sur le tableau d’honneur !
Mme Kerhélo, assise sur sa petite chaise favorite, visitait avec soin (c’est le terme consacré) les innombrables serviettes entassées dans des corbeilles autour d’elle. Corentine, déjà très débrouillée pour son âge, l’aidait consciencieusement, élevant la pièce de linge entre ses yeux et le jour, ou la tenant bien déployée, et cherchant les trous, les clairs et les déchirures. Elle était tout à fait charmante avec ses jolis bras nus à fossettes, tendus devant elle, et l’air de gravité répandu sur son visage mutin. Yves entra, les mains pleines de papiers, le front soucieux.
— C’est le courrier, dit-il, vois quelle nouvelle il m’apporte ! Et il jeta sur les genoux de sa femme une lettre dépliée.
Celle-ci la parcourut d’un regard rapide et inquiet, elle pâlit légèrement, et leva les yeux vers son mari.
— La perte est importante ! dit-elle. Qu’allons-nous faire ?
— Une bonne vingtaine de mille francs au moins !
— Je t’avais bien dit que ce Vivian ne m’inspirait aucune confiance, il n’avait pas l’air d’un homme sérieux.
— Il m’offrait des garanties que je croyais solides.
— Et tu lui as fait de trop fortes livraisons à crédit.
— Que veux-tu ? il n’y aurait pas de commerce possible si on vendait toujours au comptant, surtout dans ce pays-ci.
— Est-ce que la faillite est déclarée ?
— Non, mais elle va l’être ; relis la lettre.
— C’est vrai ; — si, au moins, tu pouvais rentrer dans une partie de tes fournitures ou faire quelque arrangement pour ne pas tout perdre ?
— C’est ce que je pense faire. Il faut que je parte immédiatement pour Hanoï ; il se trouve que le stationnaire d’Haï-phong, l’Éclair, y va justement demain, le commandant me prendra à bord, sans aucun doute, il me connaît très bien ; — je serai dans trois jours là-bas.
— Et pour revenir ?
— Je trouverai bien un bateau quelconque, une jonque ou même un sampan ; prépare-moi une valise avec une provision de linge et de vêtements pour une quinzaine de jours, je ne crois pas que mon voyage dure plus longtemps.
Le cœur bien gros, Mme Kerhélo se mit en devoir d’obéir à son mari. Bien qu’elle fût accoutumée à ce qu’il fît de fréquentes absences pour son commerce, ce n’était jamais sans craintes qu’elle le voyait partir. Le pays était encore de temps à autre troublé par les incursions des pirates, et puis la fièvre, la dysenterie, le choléra, ne guettaient-ils pas les voyageurs, fatigués par les mauvaises routes, la chaleur humide, la nourriture insuffisante ou mal préparée ?
Quant à Yves, malgré le but très désagréable de son excursion, il n’était pas fâché de voir du pays, et de contenter une fois de plus les instincts aventureux qui s’alliaient chez lui à une si rare prudence. Le chagrin de quitter une famille si tendrement aimée s’apaisa donc assez promptement, et en mettant le pied sur le pont de l’Éclair, il se sentit plus jeune de quinze ans. La machine envoya un vigoureux coup de sifflet et les deux roues s’ébranlèrent, soulevant les ondes boueuses du Song-tan-Back qui retombaient en cascades rougeâtres.
Ce cours d’eau, d’une largeur peu considérable, est une sorte de canal naturel réunissant le Cua-Cam au Taï-phong ; il traverse des rizières, des champs de tabac, des plantations de millet ; sur le bord de l’eau, les briqueteries élèvent leurs grands fours couleur de terre cuite et leurs empilements de briques. Des habitations semi-terrestres, semi-aquatiques s’avancent sur pilotis jusque dans le fleuve : elles sont occupées par des pêcheurs principalement.
En approchant du Taï-Binh, le cours du Song-tan-Back se courbe en deux replis très accentués et passe auprès de la montagne de l’Éléphant, colossal bloc de calcaire, qui doit son nom à sa forme bizarre. De loin, en effet, il ressemble à un éléphant gigantesque promenant sa lourde masse sur la pente qui descend jusqu’au fleuve.
Du Taï-Binh, on passe dans le canal des Bambous qui conduit au fleuve Rouge. Autrefois on remontait le Cua-Cam jusqu’au grand canal de Bac-Ninh ou des Rapides, qui arrive devant Hanoï, mais des ensablements ont rendu maintenant le trajet impraticable par cette voie.
Le pays est très peuplé, les habitants sont actifs, industrieux, et habiles à tirer parti des richesses du sol. A mesure qu’on approche d’Hanoï, le mouvement augmente, le fleuve est sillonné de sampans de toutes les tailles ou couvert de ces immenses radeaux qui viennent apporter dans le delta les bois des forêts, et les gros bambous servant aux constructions[48].
[48] « Les Annamites de la plaine, dit le docteur Hocquard, surtout les habitants du delta, ont une peur affreuse des bois. Ils se les figurent habités par des esprits méchants qui ne se laissent pas piller impunément et se vengent tôt ou tard des audacieux venus pour troubler leurs retraites. J’ajouterai que les tigres, hôtes habituels des grandes forêts, et les fièvres pernicieuses contribuent beaucoup à entretenir ces craintes chez les indigènes. »
Sur ces radeaux, longs parfois d’une centaine de mètres, vit toute une population. Ce sont de véritables villages flottants.
Les familles ont leur cai-nha ou cagna en paillotte, on y fait du feu, on y couche, on y mange, on y travaille ; une fourmilière de marmots demi-nus ou même sans le moindre vêtement, court sur les troncs au risque de faire un plongeon, se démène, se chamaille, pleure, rit, chante, tandis que les mères, parfaitement insoucieuses de leur progéniture, tant elles sont familiarisées avec les dangers qui la menacent, surveillent la cuisson du riz, filent du coton, et surtout, bavardent avec leurs voisines, tout comme leurs sœurs de terre ferme.
Hanoï, hôtel des Voyageurs.
Ma chère Jeannette,
Je suis arrivé hier soir à Hanoï, en très bon état, cela va sans dire, puisque le voyage à bord de la canonnière ne pouvait être que fort agréable. Nous avons eu néanmoins un petit accroc tout près de la montagne de l’Éléphant, dans cette partie du Song-tan-Back qu’on appelle le Nœud de cravate. L’angle formé par la rivière y est si étroit que l’Éclair est allé donner du nez contre une des berges. Il a reculé, et est entré par l’arrière dans la rive opposée. Il a fallu le pousser, le tirer ; nous en avons eu pour une bonne heure avant de franchir ce mauvais pas. Le commandant m’a dit qu’un bateau de plus de trente mètres de long n’aurait pas pu tourner là.
Nous avons pris le Canal des bambous, ses rives verdoyantes sont d’un effet charmant, on ne voit que panaches de verdure sur les rives ; c’est d’un aspect plein de fraîcheur auquel nous ne sommes pas accoutumés de notre côté.
J’ai parcouru ce matin cette belle grande ville d’Hanoï, si vivante, si intéressante et si peu semblable à notre Haï-phong.
C’est jour de foire, et une foule bruyante remplit les rues. Partout s’étalent les paniers de fruits, les cages de volaille, les poteries, les étoffes. Les marchandes, abritées sous leur immense chapeau de latanier, se tiennent accroupies auprès de leur marchandise, devant les portes, sous les larges auvents des paillottes, les étalages sont plus considérables et les produits exposés plus riches et plus variés. On y voit de beaux bronzes couleur de cuivre, des objets incrustés de nacre cloisonnée de filigranes argentés, des meubles ornés du même décor, des armes, des bijoux d’argent curieusement ciselés, des broderies en soie de couleurs vives, des tasses et des théières de porcelaine, des éventails, des parasols multicolores, un assemblage de formes, de lignes, de teintes à ravir un peintre ou un collectionneur.

Une foule bruyante remplissait les rues d’Hanoï.
Je marchais à petits pas, sans me presser, m’arrêtant à chaque instant pour admirer, ayant peine d’ailleurs à me frayer un passage dans ces rues étroites, encombrées de piétons, de pousse-pousse[49], de coolies portant des fardeaux, dans une sorte de longue balance appuyée sur l’épaule, de brouettes bizarres, mais admirablement imaginées pour obéir aux lois de l’équilibre, et alléger le poids de la charge.
[49] Petites voitures tirées à bras d’homme.
J’ai fait bien du chemin avant de trouver la maison de Vivian. C’est dans la rue des Sauniers ou marchands de sel. Il faut te dire qu’à Hanoï, la plupart des rues ont le nom des industriels qui y demeurent. Ainsi, j’ai vu la rue des Tisserands, la rue des Cordiers, la rue des Marchands de bois, la rue de la Saumure, où se vend le nhoc-mam, la rue du Change, une des plus belles d’Hanoï. C’est tout près de là que se trouve la rue du Chanvre, où habitait le résident avant qu’on eût construit son palais. J’ai été fort poliment reçu à la Résidence, on m’y a donné tous les renseignements que je demandais, mais malheureusement, on n’a pu m’y indiquer un moyen sûr et expéditif de revenir chez moi. Je crois que je vais me décider à m’arranger avec un riche Chinois, propriétaire d’une belle jonque qui va partir après-demain au matin pour porter à Haï-phong toute une cargaison de soie et de thé. Il a l’air d’un très brave homme, j’ai fait sa connaissance chez Vivian, dont il est aussi l’un des créanciers. L’affaire n’est pas aussi mauvaise que je le craignais, il y aura une sorte de liquidation et je ne pense pas avoir moins de 60 à 70 p. 100 sur ma créance. En somme, j’ai très bien fait de venir à Hanoï, sans compter le plaisir du voyage.
Je te quitte, car voici justement l’heure d’un rendez-vous chez l’avoué. Mille tendresses pour tous, un gros baiser à ma mie Corentine.
Ton mari affectionné,
Yves Kerhélo.
P.-S. J’espère que mes garçons tiennent la promesse qu’ils m’ont faite d’être très sages, très obéissants et aussi très attentifs pour leur maman.
Les jonques chinoises ne sont point faites comme les sampans. Étroites et basses à l’avant, elles ont l’arrière très haut et très large, formant une sorte de maison où vit le propriétaire du bateau. Les jonques de rivière ne sont point mâtées, elles marchent à l’aviron. Une grande jonque de vingt à trente tonneaux a douze rameurs, six de chaque côté : ils ne sont pas assis sur leurs bancs comme les nôtres, mais debout, et, pour régler les mouvements, ils frappent du pied en cadence sur un rythme très marqué. Le gouvernail en bois sculpté est très grand, très large et découpé d’une façon très bizarre. La jonque où Yves avait pris passage, appartenant à un riche marchand, était décorée avec un certain luxe : l’arrière était embelli d’ornements peints de couleurs vives, rehaussés de dorures, et un autel supportait un grand Bouddha en bronze doré devant lequel un vase de porcelaine, rempli de sable, attendait les cierges qu’on y pique pour faire acte de dévotion. Autour de l’autel, étaient suspendus des objets en papier : lanternes, animaux fantastiques, offerts au Bouddha pour attirer ses bénédictions sur la jonque.
Au moment de partir, l’équipage brûla des pétards en quantité si considérable que le bruit des détonations ressemblait au crépitement d’une fusillade. Alors, sur une mélodie lente et plaintive, chantée par les rameurs qui, de leurs talons nus, marquaient la mesure en frappant le pont de coups réguliers, la jonque s’ébranla lentement, puis peu à peu, cédant à l’action du courant, se laissa emporter au fil de l’eau…
Les bords couverts de bambous, de banyans, de palmiers aréquiers, offraient un spectacle charmant. Les villages entourés de hauts talus plantés de cactus, de bambous et de lianes, sont défendus comme des forteresses par cette muraille végétale. Ils sont très nombreux d’ailleurs, car le pays est riche et peuplé. La culture du thé, du bétel, du maïs, du sorgho, du ricin occupe beaucoup de bras, et les industries diverses de la contrée offrent un large débouché aux travailleurs qui ne se consacrent pas à l’agriculture.
La jonque, bien dirigée, avait mis peu de temps à descendre le fleuve, elle s’engagea dans le canal des Bambous vers le soir du premier jour, et, après une nuit passée au mouillage, arriva vers le coucher du soleil au pied de la montagne de l’Éléphant, qu’Yves salua avec bonheur comme une vieille connaissance.
La nuit était belle, mais sombre et chaude ; étendu sur une chaise longue en rotin, il fumait cigarette après cigarette, et, à demi endormi, se voyait déjà au milieu des siens entouré des caresses de ses enfants.
« Encore vingt-quatre heures, pensait-il, et j’embrasserai tout ce petit monde-là. C’est ma mignonne Tina qui sera contente de revoir son papa chéri ! Va-t-elle ouvrir de grands yeux devant la belle robe de soie brodée de fleurs que je lui rapporte d’Hanoï. Et Mme Jeannette Kerhélo ! que va-t-elle dire de son coffre à ouvrage incrusté de nacre ? Elle me grondera, bien sûr, pour avoir fait une si grosse dépense, mais elle sera contente tout de même, car elle aime les jolies choses et s’y connaît… »
… Un clapotis d’avirons s’élevait du fleuve. Yves tendit l’oreille.
— C’est singulier, dit-il au patron de la jonque, j’entends un bruit de rames. Il n’y a pas de sampans à cette heure-ci et dans un endroit si désert.
— Y a pas sampans venir ici la nuit, dit le Chinois d’un air inquiet. Y en a beaucoup pirates dans la montagne. Quand ça sampans, venir la nuit ici, y en a tous fin tiet[50]. Y en a messie résident Hanoï dire : tous pirates partis pour le haut fleuve, alors, moi, beaucoup pressé, moi partir quand même et…
[50] Tous les équipages sont tués.
Il n’acheva pas sa phrase : une fusillade bien nourrie vint rompre violemment le silence de la nuit, et, de derrière une pointe, déboucha subitement une flottille de petits sampans.
— An-cap ! an-cap !![51] crièrent les hommes de la jonque, et, affolés, ils se précipitèrent la face contre terre, devant l’autel du Bouddha, tandis qu’une horde de brigands, plus semblables à des démons qu’à des hommes, envahissaient la jonque par tous les côtés à la fois.
[51] Les pirates !
Yves avait saisi son revolver, et, au hasard, tira les six coups, mais le nombre des assaillants était trop considérable pour qu’il pût résister. En quelques minutes, malgré une lutte désespérée, il était garrotté et mis dans l’impossibilité de remuer. Quant à l’équipage, il n’avait pas fait la moindre tentative pour repousser l’attaque et s’était contenté de redoubler les cris, les prosternements et les supplications.
L’aube du jour éclaira un spectacle étrange et sinistre : les matelots de la jonque entassés dans un coin, bras et jambes liés, se répandaient en gémissements ; le malheureux patron, enchaîné étroitement, assistait impuissant au pillage de toutes ses richesses, et Yves, la mort dans l’âme, se voyait encore une fois le jouet de la destinée.
— Que vont-ils faire de nous ? demanda-t-il au Chinois.
Celui-ci, assis à terre, sa figure jaune devenue livide, les yeux distendus par l’angoisse, branlait la tête d’un mouvement machinal en répétant : — fini, tout ! — fini, tout !!
— Vont-ils nous tuer ? reprit Yves.
— Moi n’a pas connaître, moi n’a pas connaître, — fini, tout ! répondait le pauvre homme.
— Ils n’y gagneraient rien ; ne croyez-vous pas qu’ils nous garderont prisonniers jusqu’à ce qu’on leur envoie une grosse somme d’argent pour nous faire mettre en liberté ?
— Vous, riche. Y en a encore beaucoup piastres, mais moi, fini, tout ! Y en a faire tiet.
— Et où vont-ils nous conduire ?
— Moi, pas connaître. Y en a pirates beaucoup méchants ; fini, tout ! fini, tout !
Il n’y avait évidemment rien à tirer de cet infortuné Chinois. Yves s’abandonna donc tout entier à d’amères réflexions et n’en fut distrait que par ce qui se passait sur la jonque.
Le partage des dépouilles terminé, les pirates avaient rejoint leurs petits sampans, le chef seul était resté à bord. Après une conversation assez longue avec son second, il s’approcha de l’endroit où gisaient les matelots chinois. Il prononça d’une voix de commandement quelques brèves paroles, et, à la grande surprise d’Yves, on commença à débarrasser les prisonniers de leurs liens. Ceux-ci, étirant leurs membres endoloris, firent de grandes génuflexions en actions de grâces devant leur ennemi devenu libérateur, et, courant à l’autel de Bouddha, allumèrent des papiers dorés qu’ils jetaient tout enflammés dans le fleuve, en signe de reconnaissance envers les dieux.
— Mon tour va venir, pensait Yves. Quelle alerte ! espérons que j’en serai quitte pour la peur et ma malle volée.
Mais il se trompait cruellement. Sur un signe du chef, deux hommes le saisirent, et le jetèrent au fond d’un grand sampan, sous la paillotte duquel on avait déjà entassé des caisses de marchandises et divers objets précieux provenant du pillage de la jonque. Le Chinois, toujours ligotté, vint l’y rejoindre un instant après ; puis ceux des pirates qui montaient les petits sampans abandonnèrent la jonque, et, pour s’éloigner au plus vite de parages trop fréquentés, s’enfoncèrent dans l’un des nombreux arroyos qui sillonnent cette partie du delta.
A mesure que la matinée s’avançait, la chaleur, les moustiques, la gêne causée par les liens, la soif, devenaient pour les captifs une source de réelles souffrances. Vers midi, leur situation était presque intolérable. Yves, à force d’insistance auprès de ses gardiens, finit par obtenir d’être conduit auprès du chef. Dans un discours habile et véhément à la fois, il lui fit craindre d’abord des représailles terribles de la part des Français, et ensuite, lui laissa entrevoir l’espoir d’une riche rançon, s’il traitait bien ses prisonniers. Le pirate l’écouta en silence, clignant ses petits yeux mauvais d’un air insolent ; pourtant, il se dit sans doute qu’il pouvait y avoir beaucoup de vrai dans tout cela, et, toute réflexion faite, il donna l’ordre de délier ses victimes, et leur fit apporter du riz, du thé et quelques fruits.
Yves, pensant avec raison que cet homme n’avait pas d’intérêt à les empoisonner, au contraire, ne fit aucune difficulté de partager avec le Chinois ce frugal repas. A peine était-il terminé que l’on posa devant eux des tablettes et des pinceaux avec de l’encre de Chine délayée dans un godet carré, et le chef leur expliqua très nettement qu’il voulait avoir un engagement écrit et signé de leur main pour l’énorme rançon de dix mille piastres chacun. Le Chinois, avec un lamentable gémissement, repoussa les tablettes ; mais Yves, le prenant à part, lui fit comprendre que la première, l’unique chose à faire en ce moment, était de garder la vie sauve.

On posa devant eux des tablettes et des pinceaux.
— Nous pouvons être reconnus par nos familles, rencontrer des colonnes françaises, lui dit-il, tant qu’il y a de la vie, il y a de la ressource, Il eût ajouté sa phrase favorite : « Nous sommes sous la vague, nous en sortirons », si son compagnon eût pu en saisir le sens.
Celui-ci se laissa persuader, et, en geignant bien fort, finit par tremper le pinceau dans le noir liquide et écrire : 1o l’engagement demandé ; 2o une lettre à sa femme racontant ses malheurs et les exigences de son persécuteur. Yves fit de même, et, quelques instants plus tard, deux pirates, montés dans un sampan, emportaient leur correspondance.
La journée se passa sans trop de misères. Les deux prisonniers reprenaient confiance en voyant qu’on ne les maltraitait pas et que même on leur laissait une sorte de liberté relative. Évidemment ils étaient considérés comme de précieux objets d’échange et leur vie n’était point menacée. Le soir, on leur fit la gracieuseté d’un souper très confortable auquel les provisions d’Yves avaient largement contribué. Tout en soupirant le brave Chinois y fit honneur.
— Y en a beaucoup, ça bon manger, dit-il, pas tout laisser méchants pirates moi…
Et il acheva le reste du poulet.
Contre l’habitude ordinaire des Annamites, le sampan marche toute la nuit. Elle fut très pénible pour Yves, cette longue nuit passée dans l’atmosphère étouffante de la paillotte où il avait été de nouveau enfermé et étroitement gardé. Ne pouvant s’étendre, à demi couché, à demi assis sur des caisses, des sacs, des paniers, il changeait sans cesse d’attitude sans trouver le repos.
Un peu avant le lever du soleil, la barque quitta les arroyos et déboucha dans le Cua-Cam, qu’elle traversa rapidement pour s’engager dans une série de canaux intérieurs, la plupart complètement déserts. Cette seconde journée fut en tout pareille à la précédente. Avec le jour, les prisonniers furent laissés libres d’aller et venir dans le sampan. Ils n’avaient d’ailleurs à se plaindre ni de mauvais traitements de la part de leurs gardiens, ni du manque de nourriture.
Vers le soir, on arriva au pied de l’île des deux Songs, massif montagneux à l’entrée du Song-Kin-Tay. C’est un repaire de pirates, et le dot Van[52] y avait son principal dépôt. Le sampan vint donc atterrir auprès d’une sorte de caverne, moitié naturelle, moitié creusée de main d’homme et défendue par d’épais fourrés qui en masquaient l’entrée. C’est là que les hommes allaient décharger leur butin. Ils commencèrent par lier leurs prisonniers de façon à leur ôter toute possibilité de s’échapper, puis ils procédèrent d’une façon très méthodique au déménagement de la paillotte. Le Chinois se serait arraché les cheveux, si sa queue avait été à sa portée, et si ses mains n’avaient été garrottées. Yves restait silencieux. A quoi bon des cris et des emportements ?
[52] Chef de bande.
Il méditait un plan d’évasion, plan hardi, téméraire même, et qui demandait, pour réussir, le concours de circonstances presque invraisemblables, sinon impossibles.
Vers le matin du troisième jour, le sampan, allégé de presque toute sa cargaison (on n’y avait laissé que deux ou trois caisses et la malle d’Yves, que le chef avait voulu garder), marcha plus rapidement, et, au soleil couchant, sous une pluie battante, arriva dans la baie d’Along. Yves avait bien souvent entendu vanter ce merveilleux paysage ; il lui parut sinistre. Les rochers gris, sortant de la mer en masses colossales, en tours crénelées, en piliers rongés à la base semblaient appartenir à un cimetière de géants. Leurs ombres bizarres faisaient de grandes taches noires où le sampan entrait tout entier pour en ressortir l’instant d’après. Il se glissait entre de sombres colonnades, contournant parfois quelque îlot montagneux, rasant les pics inaccessibles dont une demi-obscurité exagérait les proportions. Ces aspects fantastiques, ces noirs fantômes s’élevant du sein des flots, ce silence, cet horizon voilé de brume saisissaient l’âme comme d’une impression surnaturelle et pesait sur elle comme un cauchemar.
Yves ne dormit pas plus cette nuit-là que les autres. Vers le matin, pourtant, ses paupières appesanties se fermèrent, le sommeil le gagna, et pendant une heure ou deux, il oublia les angoisses de sa situation…
Lorsqu’il se réveilla, il ne put retenir un cri de surprise devant l’admirable spectacle qui s’offrait à ses regards.
Un soleil radieux, brillant dans un ciel du plus bel azur, faisait étinceler la crête des petites vagues et sa lumière, traversant les eaux transparentes, pénétrait jusqu’au sable du fond[53]. Les rochers découpaient hardiment leurs étranges silhouettes et leurs aiguilles de marbres gris. Quelques-uns, couronnés d’arbustes, enguirlandés de saxifrages, piqués de plantes grasses dans toutes les anfractuosités du roc, semblaient de gigantesques vases de verdure. Tout était vie, mouvement, lumière ; de beaux oiseaux volaient à tire-d’aile, des poissons aux robes chatoyantes nageaient en troupes dans l’eau limpide, et, sur les rochers, des singes en gaieté se poursuivaient avec des cris stridents.
[53] La baie d’Along est remarquable par l’extraordinaire limpidité de l’eau de mer.
Le sampan, habilement conduit, évoluait contre les massifs rocheux avec une aisance singulière, et chaque instant amenait de nouvelles perspectives toutes plus variées et plus intéressantes.
Vers dix heures, on s’arrêta près d’un grand rocher fort escarpé, où une petite plage de sable se nichait entre deux pointes aiguës. Les pirates descendirent, allumèrent du feu pour faire griller leur pêche, et, mis de bonne humeur par la réussite de leur expédition, permirent au prisonnier de descendre à terre avec eux.
Ils semblaient d’ailleurs en pleine sécurité et ne remontèrent à bord que dans l’après-midi. Ils s’éloignèrent alors à quelques centaines de mètres du rivage, et, étendus sous la paillotte, se donnèrent le plaisir d’une sieste.
Elle avait duré une couple d’heures, quand un cri aigu tira brusquement les dormeurs de leur repos. En un clin d’œil, tous furent sur pied. Le chef, la figure enflammée de colère, debout sur l’avant, montrait le sud d’un geste éloquent. Yves regarda, ses yeux se voilèrent,… son cœur battit à rompre sa poitrine…

Le chef montrait le sud.
A l’extrémité sud-ouest de la baie, sur l’horizon gris clair, un bateau français dessinait sa forme élégante, couronnée d’un léger panache de fumée !
C’était le salut, peut-être,… l’espoir certainement.
Mais qu’elle était loin cette petite canonnière venue pour faire la chasse aux pirates ! Comment penser que dans ce labyrinthe inextricable, elle allait choisir et suivre une route la mettant face à face avec le sampan ?
La nuit était claire et calme ; les pirates, voulant éviter une lutte de vitesse où ils n’auraient pas eu l’avantage, étaient venus se cacher dans l’ombre épaisse projetée par la masse de rochers où ils avaient débarqué la veille. Yves restait libre de ses mouvements, — on avait jugé sa fuite impossible au milieu de ces rocs taillés à pic, — il se glissa doucement, lentement, jusqu’à l’arrière du sampan et s’y assit. Personne ne bougeait ; les matelots, abrutis d’opium, dormaient d’un lourd sommeil. Avec des précautions infinies, il fit glisser sous lui une des longues planchettes posées sur les bords. — Il s’était assuré dans la journée que ni chevilles ni liens d’aucune sorte ne la retenaient. — Elle se déplaça sans bruit et découvrit un espace assez grand pour laisser passer le corps d’un homme ; Yves, se cramponnant des deux mains au bordage, inséra ses deux jambes dans l’ouverture, et peu à peu descendit dans l’eau sans que le moindre clapotement eût révélé son audacieuse entreprise ; alors, lâchant une main, puis l’autre, il plongea, fit quelques brasses sous l’eau et alla ressortir à cinquante mètres plus loin dans la direction de l’îlot. Il nageait avec vigueur et avançait rapidement ; il atteignit sans encombre la petite plage ; elle était noyée dans une ombre épaisse ; il y aborda en toute sécurité, s’étendit sur le sable et reprit haleine ; il en avait grand besoin !
Une fusée traversa le ciel !… et un cri de fureur s’éleva du sampan. La canonnière approchait !… Les pirates firent force de rames,… chaque minute les ramenait plus près de l’îlot.
La lune se levait et commençait à éclairer la baie ; sa lueur blanchâtre glissait déjà sur les rocs et contournait peu à peu le coin obscur où Yves avait trouvé un refuge. Blotti dans un angle, il suivait avec angoisse les mouvements du sampan qui longeait le rivage et les progrès de la tache lumineuse qui allait toujours grandissant.
Tout à coup, une dentelure du rocher laissa passer une clarté vive, qui inonda toute la plage et Yves se vit perdu…
Devant lui, la mer, le sampan près d’aborder et vingt bandits pour le ressaisir ; — derrière lui, une muraille de marbre à pic de cinquante mètres de haut, — à droite, des rochers creusés à la base, au faîte surplombant, — à gauche, des éboulis hérissés d’arêtes tranchantes et de pointes aiguës. C’est par là pourtant qu’il allait tenter d’échapper à ses persécuteurs.
Harassé de fatigue, gêné par ses vêtements mouillés, les pieds meurtris, les mains tremblantes, il s’accrochait aux aspérités, se hissait sur les pentes, disputait jusqu’à la dernière minute sa vie et sa liberté.
Une pierre se détacha sous son pied, il trébucha, voulut se retenir à un fragment de roc ; ses forces l’abandonnèrent, il tomba…
Un petit plateau à mi-hauteur avait amorti sa chute. C’est là que, les pirates le trouvèrent à demi mort et hors d’état de leur résister. Ils l’emportèrent et le déposèrent dans le sampan, sous la paillotte.
Quand Yves sortit de son évanouissement, le jour était venu, mais il ne s’en aperçut que par les lueurs qui pénétraient entre les fentes de la paillotte, car celle-ci était absolument fermée. De violentes douleurs dans les membres, un sentiment de lassitude, de brisement, d’épuisement physique et moral, fut le premier effet de son retour à la vie. Mais à mesure qu’il se rappelait les terribles événements de la nuit, son anxiété devenait plus cruelle. Avoir été si près de la délivrance et s’en trouver si loin ! Et ce bateau français, où était-il ? Que faisait-il ? Ah ! si au moins on pouvait voir la mer !
En se tournant péniblement sur le côté, il essaya de regarder par l’entre-bâillement de la natte…
Un éclair rapide, un nuage de fumée blanche, une détonation… La canonnière est là et fait parler ses pièces !
Des coups de fusil lui répondent ; un projectile vient trouer la natte au-dessus de la tête d’Yves, un autre fait rejaillir l’eau jusque par-dessus le bordage. Les pirates poussent des hurlements sauvages : ils se démènent, tirent sans relâche… Tout à coup, les cris cessent, le bruit des avirons battant l’eau succède au crépitement de la fusillade, une nuit subite s’étend sur le sampan, une odeur humide et fraîche, comme celle des parois d’une cave, remplace celle de la poudre.
Au son des échos qui répétaient le clapotement de l’eau en le grandissant, Yves jugea qu’on était sous une voûte de rochers. Il avait déjà entendu parler par les officiers de marine, de ces antres profonds où les pirates se réfugient pour échapper aux recherches.
Le sampan allait-il y être bloqué jusqu’à ce que la faim ou le désespoir décidât son équipage à une sortie ?
Rester dans cette incertitude, ne pouvoir ni remuer, ni voir, et sentir le secours à portée était une torture.
A force de frotter énergiquement les liens de ses mains contre un angle de caisse, le prisonnier usa la corde suffisamment pour qu’un effort violent pût la briser ; il y réussit, mais ses poignets endoloris, ses doigts gonflés lui refusaient tout service. Quelques frictions ramenèrent la circulation du sang ; il parvint à saisir et à manier un couteau de poche qu’il avait gardé sur lui et, à l’aide de ce faible outil, il essaya alors de couper les cordes entourant ses pieds, mais celles-là étaient plus grosses et plus dures que les premières, elles lui offrirent plus de résistance ; une fièvre violente d’ailleurs diminuait ses forces, sa gorge brûlait d’une soif ardente, il étouffait sous la paillotte close…
Il abandonna son travail de sciage et se servit de son couteau pour entamer la natte qui formait un toit bas au-dessus de lui. Il y arriva, non sans peine, élargit l’ouverture, y passa la tête et, à sa grande surprise, aperçut une lueur blanchâtre du côté de l’avant. La grotte était un tunnel et non un souterrain fermé !
Le jour allait en augmentant, à chaque coup d’aviron ; bientôt il éclaira les parois de marbre, s’y jouant en mille effets d’ombre et de lumière. Une grande échappée ensoleillée vint éblouir les yeux d’Yves,… il entrevit, comme dans une apothéose, la mer verte et argent, le ciel d’un bleu lumineux,… puis un nuage de fumée blanche s’étendit sur tout cela comme un rideau et deux coups de canon se répercutèrent bruyamment sous la voûte sonore.
La canonnière avait tourné l’îlot et découvert la ruse des pirates[54] !
[54] Historique.
Les cris, le tumulte, la fusillade recommencèrent. Deux canots montés par une vingtaine d’hommes s’étaient détachés du bord et avançaient courageusement sous une grêle de balles. Yves s’était traîné jusqu’à l’entrée de la paillotte, et, ayant soulevé la natte qui la fermait, pouvait suivre tous les détails du combat. Il ne fut pas de longue durée ;… atteint d’une balle en pleine poitrine, le chef tomba à la mer. Plusieurs de ses compagnons sautèrent dans l’eau ; ils nageaient avec une si extraordinaire vitesse qu’ils échappèrent aux Français. D’autres se défendirent jusqu’à la dernière extrémité et l’un d’eux, poursuivi par les matelots qui venaient d’aborder le sampan, courut se réfugier derrière une caisse, à côté d’Yves. Celui-ci cependant criait à tue-tête : — « A moi, les amis ! par ici ! au secours ! à moi ! à l’aide ! »
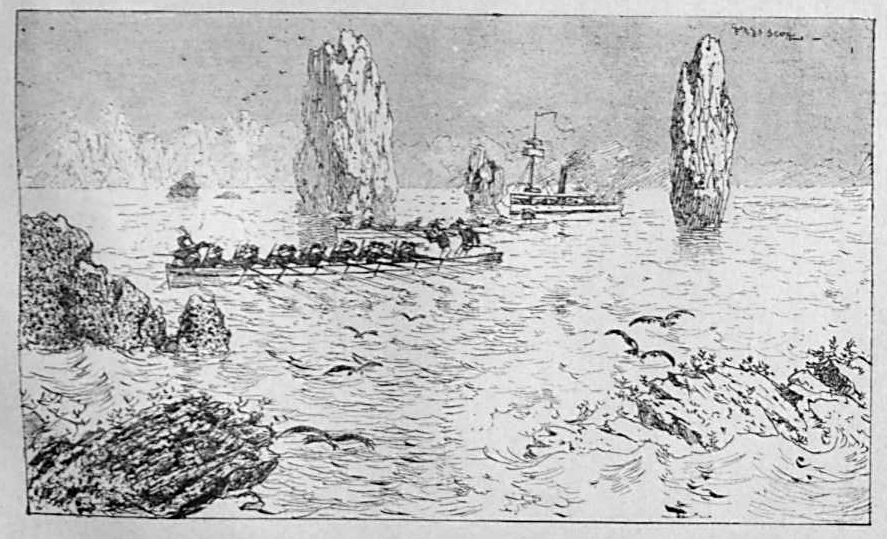
Deux canots s’étaient détachés de la canonnière.
Le bandit sortit de sa cachette et s’élança sur lui le coupe-coupe à la main. Yves était robuste et le désespoir centuplait ses forces ; il tenta de désarmer son assaillant, mais ses jambes entravées paralysaient tous ses efforts, il devait succomber dans une lutte aussi inégale.
La terrible lame allait s’abattre sur son cou,… du fond du cœur, il recommandait son âme à Dieu et envoyait un dernier et tendre souvenir à sa famille,… quand le bras levé s’abaissa subitement, laissant échapper l’arme, le pirate tourna sur lui-même et tomba tout d’une masse,… une balle à la tempe l’avait foudroyé.
Un marin, le revolver à la main, sauta dans le sampan, fouilla des yeux l’intérieur de la paillotte.
— Qui êtes-vous ? dit-il à Yves.
— Un Français, Yves Kerhélo, négociant à Haï-phong.
— Yves Kerhélo ! cria le marin d’une voix de tonnerre, est-il possible ? Je suis Alain Le Pennec, ne me reconnais-tu pas ?
— Alain !… s’écria Yves, et, vaincu par la fatigue, l’émotion, les angoisses, il se laissa aller en sanglotant dans les bras de son ami.

Alain Le Pennec.
Le délier, le porter à bord du canot, — car il ne pouvait se tenir debout, — ce fut l’affaire d’un instant. Aussitôt à bord de la Rafale, la canonnière dont l’intervention venait de le délivrer, il fut couché sur un matelas étendu au ras du pont, et soigné avec la plus active sollicitude.
Il en avait grand besoin, et une sorte de torpeur morale et physique succéda tout d’abord à l’état d’excitation violente où il avait vécu depuis quelques jours ; mais, sa bonne constitution aidant, il se remit plus promptement qu’on n’aurait osé l’espérer après tant et de si rudes secousses, et une semaine plus tard, arriva à Haï-phong assez bien rétabli. Sa femme, heureusement, n’avait rien appris, les pirates, qu’il avait chargés de son premier message, n’ayant pu remplir leur mission.
Sa caisse et ses papiers restés dans le sampan lui avaient été rendus et le pauvre Chinois, recueilli aussi par la canonnière, avait même pu rentrer en possession de certain coffre bien rempli de barres d’argent, dont la réapparition allégea grandement ses chagrins.
Avec quelle joie Yves fit les honneurs de son logis à son cher Alain, cela se devine sans peine, et quelles longues causeries les deux amis échangeaient entre eux, cela se devine aussi ; ils avaient tant de choses à se dire ! Alain ne se lassait pas d’entendre les récits de son vieux camarade, d’admirer ses enfants, sa maison, sa prospérité, et surtout la haute estime dont M. Kerhélo était entouré à Haï-phong.
— Te souviens-tu, Alain, dit un soir le riche négociant à son ami, te souviens-tu du jour où tu m’as dit adieu à bord de la Belle-Yvonne ?
— Si je m’en souviens ! Ah ! nous n’étions pas fiers tous les deux ! et j’ai pleuré de bon cœur en voyant ton petit bateau disparaître derrière Trévignon. Il me semblait que jamais plus je ne te reverrais.
— Et moi donc ! qui partais du pays sans un sou dans ma poche, sans pouvoir me dire : j’y reviendrai quelque jour.
— Et maintenant, te voilà marié, père de famille, gros commerçant…
— Et toi, tout près de devenir premier maître, et sûr d’un petit ruban rouge sur la poitrine un jour ou l’autre. A cœur vaillant rien d’impossible !… J’ai lu cela quelque part et m’en suis toujours souvenu.
— C’est vrai, Yves. A cœur vaillant rien d’impossible !
— Avec l’aide d’en haut ! ajouta gravement Mme Kerhélo.
Les cloches tintent, sonnent, carillonnent dans le clocher de Fouesnant. Cette fois c’est pour un mariage. Voici le cortège qui s’avance en bon ordre sous les rayons d’un brillant soleil de juin.
Le marié, un bel homme dans la force de l’âge, porte avec aisance l’uniforme des premiers maîtres de la marine. La mariée, jolie blonde aux yeux bleus, à l’air raisonnable et gracieux, paraît très fière de s’appuyer à son bras ; ils ont signé sur le registre à la sacristie : Alain Le Pennec et Yvonne Le Bihan. Derrière eux, nous voyons défiler une longue suite de visages connus : la mère de la mariée d’abord, Corentine Le Bihan, née Kerhélo, institutrice en titre à Fouesnant, mariée à M. Le Bihan, clerc de notaire, fort honorablement posé dans le pays. Elle donne le bras au père Le Pennec, tout blanc de barbe et de cheveux, mais encore bien tourné dans sa robuste vieillesse. Elle a gardé ses beaux yeux et sa physionomie grave et douce, Corentine, et c’est plaisir de la voir si heureuse et si prospère. Derrière elle, Yves, M. Kerhélo, sert de chevalier à la sœur du marié, une belle Bretonne, dont la taille élégante fait ressortir le splendide costume des Fouesnantaises. Mme Kerhélo, richement vêtue, vient ensuite au bras d’un lieutenant de vaisseau qui a bien voulu accepter d’être le témoin d’Alain. Ses fils ont trouvé dans le joli troupeau des cousines de tout degré, des partenaires assorties à leur âge et Corentine, le bijou de la noce, tout pimpante au milieu d’un froufrou de soie crème et de dentelles, prend des airs d’importance tant elle est ravie de son garçon d’honneur, un joli lycéen de quinze ans, fils de M. Le Bihan.
Le repas, très nombreux, a lieu dans une maison de modeste apparence, mais décorée pour la circonstance avec un grand luxe de fleurs et de draperies blanches et rouges. Deux longues tables, brillamment éclairées, sont chargées des mets les plus appétissants, et la dimension des gâteaux bretons fait ouvrir de grands yeux de convoitise à la jeune partie de l’assistance. On se dit, entre voisins de table, que c’est M. Kerhélo qui s’est chargé des frais de la noce et qu’il a bien fait les choses.
Au dessert, un peu avant le champagne, Yves se leva. Un profond silence s’établit aussitôt, et, d’une voix distincte, malgré l’émotion contenue qui la faisait un peu trembler au début, il prononça les paroles suivantes :
Mes chers parents et amis,
Bien des années se sont écoulés depuis le jour où je franchissais le seuil de cette maison, entre ma mère désolée et ma sœur orpheline. La mort de mon père nous avait réduits à la plus noire misère, puisque, pour payer ce que nous devions, il avait fallu tout vendre. Ma sœur s’en souvient, je lui dis : « Ne pleure pas, Corentine, quand je serai grand, je deviendrai riche, je rachèterai tout : la maison, les meubles et l’armoire de mariage de notre mère. » L’armoire ! la voici, — il l’indiqua de la main, — j’ai eu la bonne chance de la retrouver dans le village ; demain, elle sera portée chez Mme Yvonne Le Pennec (et il sourit à la jeune mariée). La maison : nous venons de célébrer sous son toit l’heureuse fête qui fait entrer mon plus cher ami dans ma famille. Elle m’appartient depuis hier, M. Quinio, son propriétaire, ayant bien voulu me la vendre, ce dont je le remercie.
Avec l’assentiment de ma femme, de ma sœur, de mes enfants, j’en fais le don à la commune de Fouesnant, à condition qu’elle serve à loger gratuitement une veuve chargée d’enfants orphelins dont le père aura péri en mer.
La Providence a béni mes efforts et mon travail, je reviens dans mon pays riche et heureux. Je veux, avant de le quitter pour retourner dans cette nouvelle France, devenue ma patrie d’adoption, laisser ici un souvenir durable d’Yves Kerhélo ; ce nom-là rappellera aux enfants du pays que : A cœur vaillant rien d’impossible !
FIN
Paris. — E. Kapp, imprimeur, 83, rue du Bac.