![[Image de couverture]](images/cover.jpg)
Title: Lettres à Françoise
Author: Marcel Prévost
Illustrator: Albert Guillaume
Release date: January 10, 2025 [eBook #75078]
Language: French
Original publication: Paris: Lemerre, 1910
Credits: Laurent Vogel, Hans Pieterse and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
MARCEL PRÉVOST
Illustrations d’Albert Guillaume
PARIS
ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR
23-33, passage Choiseul, 23-33
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE LIVRE
10 exemplaires numérotés sur papier de Chine.
Avril 1902
Vous trouverez ici réunies, Françoise, les lettres que je vous écrivis de quinzaine en quinzaine durant votre dernière année de pension.
Les plus récentes de ces lettres sont presque d’hier, tandis qu’en relisant les premières j’avais la sensation de remuer d’assez vieilles cendres. C’est tout juste si elles ne sont pas du siècle dernier: vous les reçûtes quand l’Exposition illustrait à Paris le début du XXe siècle. Et l’Exposition, n’est-il pas vrai, ma jolie nièce, cela nous paraît déjà très loin, très loin?...
Il m’eût été facile, au moyen d’un léger maquillage, d’effacer ces traces d’actualité, devenues en si peu de mois des marques d’âge. Les vérités que j’essayais de vous exposer, les conseils que je vous II donnais alors sont, en somme, de tous les temps. Chaque fois qu’il s’est rencontré par le monde un oncle un peu sermonneur et une jeune nièce assez patiente pour l’écouter, celle-ci a pu recueillir les mêmes propos. On les eût appelés, suivant l’époque: «Lettres à Eucharis» ou: «Lettres à Blandine», ou plus près de nous, il y a quelque cent ans: «Lettres à Sylvie».
Mais, de même que votre nom charmant de Françoise, si national, évoque un certain pays et une certaine époque, de même les conseils contenus dans les pages qui suivent, utiles au besoin pour Eucharis, Blandine ou Sylvie, intéressent tout de même plus spécialement une jeune fille française achevant ses études au début du XXe siècle.
Le XXe siècle! Quel attrait dans ces trois mots, pour un esprit de votre âge!
Comme au temps où le poète de Mantoue chantait la naissance de l’Enfant, un grand ordre nouveau s’élabore. Les peuples sont travaillés par de puissants remous où la vieille idée de conquête et la jeune idée de justice dessinent plus nettement que jamais leurs efforts opposés... La science, qui a mis au XIXe siècle le globe entier à portée des yeux et des pas de chacun de nous, va nous ouvrir le domaine de l’air... Le devoir des heureux envers les déshérités sort de la charité pure pour se fixer dans le Code. Enfin, et surtout! la Femme, qui, suivant le mot profond du prince de Ligne, fait les mœurs III tandis que les hommes font les lois»—la Femme affirme la volonté d’élargir sa place dans la société future. C’est elle, n’en doutons pas, qui sera le principal objet des transformations inattendues. Elle en sera aussi la plus active ouvrière, car elle apporte des réserves intactes d’espoir et d’énergie. Elle est, dans le sein des nations lasses, un grand peuple neuf.
La jeune fille moderne pressent les destinées de son sexe. Au moment d’entrer dans le monde, elle entrevoit ce qui demeure confus même pour ses éducateurs: que l’instant historique est solennel. La jeune Française surtout, éduquée d’après les méthodes qui ne se sont pas sensiblement modifiées depuis plusieurs siècles, perçoit aussitôt le désaccord entre son éducation et sa fonction dans la vie. Élevée dans une pénombre quelque peu claustrale, ses yeux, d’abord éblouis, soudain se dilatent. Le champ de son idéal s’agrandit; en même temps elle prend plus nettement conscience des nécessités pratiques. On dirait qu’une aube très pure l’inonde: l’horizon s’étend, et les plus proches objets précisent leurs contours.
Toutes les fois que je me suis entretenu avec vous, Françoise, de vos espoirs, de vos rêves, de vos incertitudes même et de vos anxiétés,—j’ai entrevu cette aube dans vos yeux... S’il s’en égare un reflet sur les pages qui suivent, ce sera leur meilleure parure. Aux premiers feux du matin, un grossier filet de pécheurs, séchant sur les galets, semble par instant un tissu d’or.
IV Voilà pourquoi j’ai voulu que ces pages, traitant d’humbles vérités indépendantes du temps, gardassent l’indice clair, immédiat, de l’époque où j’entrepris de les écrire: l’époque où la foule cosmopolite se pressait aux abords de la Tour Eiffel; l’époque où le patriarche Krüger commençait son pèlerinage d’Europe.
Maintenant, ces humbles vérités, banales comme la plupart des vérités utiles,—notées, commentées d’abord à votre intention, était-il opportun de les coudre en un assez gros livre, de les imprimer, de les offrir à la foule?
Je ne l’aurais pas fait si, parmi ceux qui les avaient parcourues en même temps que vous, de très nombreux lecteurs n’avaient demandé avec instance qu’on leur donnât le même texte sous une forme plus commode. Naïvement, je vous confesse que de telles demandes m’ont ravi. Avoir diverti son public, c’est quelque chose; lui avoir paru nécessaire, avoir éveillé en lui le désir de garder votre pensée à portée de son oreille,—combien c’est mieux!... Je prétends sérieusement qu’un auteur a le devoir de satisfaire à de si précieuses requêtes.
V J’ai donc cédé. Voici le volume. Je sais bien qu’il restera pour vous un ami, chère Françoise aujourd’hui libre de la tutelle des pensionnats, Françoise en plein bonheur d’épousailles. Mais, déjà, il n’est plus à vous seule. Que dis-je? Mon vœu serait qu’il fût aussitôt à toutes les autres jeunes filles d’un âge approchant du vôtre. Si la chose était possible, je le leur enverrais à toutes, avec une jolie dédicace et un billet leur disant:
«Jeune fille, ce livre est pour vous. Vos yeux n’y rencontreront rien qui puisse choquer votre modestie ni troubler votre cœur... Lisez-le d’abord comme un récit, comme un roman de la vie courante. Hardiment, je vous annonce qu’aucun roman ne traite un sujet plus beau. C’est l’histoire d’une jeune fille comme vous, qui, pendant sa dernière année de pension, s’éprend d’un jeune homme, se fiance et se marie. Si vous me faites observer que ce beau sujet n’est pas des plus neufs, je vous répondrai que j’en étais averti, et que cependant je l’ai préféré à tout autre.
«Quand vous aurez lu ainsi l’aventure de Françoise, en passant ce qui vous ennuiera, ce qui vous semblera encombrer le récit (c’est la meilleure façon de lire un roman),—ne jetez pas le livre au rebut, je vous en prie. Gardez-le dans votre chambre à portée de votre main. D’abord, en l’ouvrant au hasard des loisirs, vous y trouverez des sujets de réflexion, de méditation. Votre jeune finesse féminine VI saura mettre en œuvre ces matières arides bien mieux que je ne sus le faire. Puis, lorsque vous discuterez avec une amie sur l’éducation, sur la toilette, sur les bals, sur les sports, sur le mariage, ouvrez encore le livre amical. Il vous donnera son opinion: et une tierce opinion départage parfois les contradicteurs, ne fût-ce qu’en leur suggérant ce cri unanime: «Peut-on dire pareille sottise?» En un mot, je ne vous recommande pas les «Lettres à Françoise» comme un bréviaire,—mais tout simplement comme un inventaire des choses qui intéressent votre vie. Le plus important dans le livre n’est pas l’avis que j’expose, mais le sujet que je traite: vous.
«Si, voyant ce livre entre vos mains, l’on vous dit: «Il n’y a rien de nouveau ni de curieux là-dedans», tombez-en d’accord; mais suppliez le dénigreur de vous signaler un livre, bien fait celui-là, où les mêmes questions soient agitées. Vous m’en direz le titre aussitôt, et je courrai l’acheter chez mon libraire, car je l’ai cherché minutieusement et ne l’ai point trouvé.
«Si ce livre bien fait n’existe pas, ce sera l’excuse du mien, qui a du moins la vertu d’exister. Sans VII nulle fausse modestie, je vous assure que je le juge très imparfait, très loin de mon rêve. Voulez-vous m’aider à le rendre meilleur? Notez vos critiques, marquez les lacunes, suggérez des corrections, et envoyez-moi le tout. Je vous répondrai un grand merci et je vous promets bien que d’édition en édition, grâce à des collaboratrices telles que vous, les «Lettres à Françoise» s’approcheront du mieux...»
Telle est, chère nièce, la façon dont je voudrais que ce petit volume fût reçu et utilisé par ses lectrices naturelles. Qu’elles le prennent ainsi, et j’en serai plus fier que d’un roman à cent mille exemplaires.
M. P.
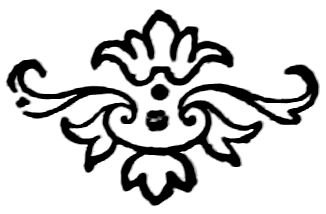
Lettres à Françoise

Quand je vous quittai, avant-hier soir, ma petite amie, dans le parloir de cette célèbre institution Berquin, rue du Ranelagh, où je vous remis aux mains de Mme Rochette, vous me dites ces mots que ma mémoire a conservés 2 dans leur ordre, ou, si vous voulez, dans leur désordre gracieux:
—Merci, mon oncle! Ah! voilà Lucie Despeyroux!... Cette grande, là-bas, vous voyez? avec de gros cheveux blonds... Elle a un frère à Saint-Cyr, qui est si bien, si bien!... N’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Écrivez-moi de temps en temps... Oh! je suis contente! je vous répondrai... Seulement, aurez-vous le temps de m’écrire?... Lucie! attends-moi!... Au revoir, mon oncle: je monte me coucher; j’ai sommeil... J’aime beaucoup quand vous venez dîner à la maison et quand vous «me rentrez»... Je n’aime pas quand c’est mon oncle Roger.
—Vrai? Pourquoi ça?
—Il ne sait causer de rien. Et puis, il a l’air trop jeune.
Ces propos, avec le ton et la mine dont vous les prononçâtes, servirent de thème à mes méditations, tandis que de la rue du Ranelagh je regagnais mon logis, sur les hauteurs du Trocadéro. Vous connaîtrez un jour, dans une vingtaine d’années, peut-être un peu plus tôt, car vous êtes femme, ces étranges malaises qui envahissent l’âme aux approches de la quarantaine, quand un incident quelconque nous rappelle brusquement que notre jeunesse est abolie. Rien au dedans de nous ne nous avertit encore: nos goûts, nos espoirs, nos appétits sont demeurés à peu près les mêmes qu’à vingt-cinq ans. La vigueur de 3 nos muscles nous semble plutôt accrue. Habitués à voir les glaces nous renvoyer quotidiennement notre image, il ne nous paraît pas que cette image ait sensiblement changé. Nous avons besoin d’un effort de raisonnement pour nous démontrer à nous-mêmes que le temps a marqué sa trace sur nous comme sur toutes les choses environnantes,—que nous avons, en un mot, vieilli d’un jour par jour. La clairvoyance d’autrui nous y aide, heureusement, et corrige notre erreur par des rappels—utiles, s’ils sont désagréables.
C’est ainsi que lorsque je rentrai chez moi, petite amie Françoise, je ne songeais plus au succulent dîner que j’avais fait le soir même à votre table, place Possoz, assis entre votre maman et vous,—ni aux importantes confidences que ce dîner nous avait values de vous, sur la façon dont, à dix-sept ans et demi, vous comprenez la vie,—ni à l’Institution Berquin, à la respectable Mme Rochette, à Lucie qui a de gros cheveux blonds et un joli saint-cyrien de frère, ni presque à vous-même,—mais seulement à cette triste chose que je suis le plus vieux de vos deux oncles et que vous le proclamez avec une joyeuse franchise.
En de telles méditations, ma jolie nièce, je fumai une cigarette dans le jardin, car, s’il vous en souvient, la température de cette soirée de septembre s’attiédissait d’une singulière douceur. Mon jardin, vous le connaissez: 4 plusieurs fois vous y êtes venue, avec votre mère, respirer et moissonner des fleurs. Il domine la place du Trocadéro. En temps d’Exposition, les feuillages des acacias, les géraniums, les bégonias, les asters des massifs se parent du reflet des coupoles et des tourelles illuminées: par intervalles les projections lunaires de la tour Eiffel les balayent de larges rais bleuâtres... Le gravier des allées craquait discrètement sous mes pas, tandis que je rêvais au temps où j’étais moi-même quelque chose d’analogue à ce que vous êtes aujourd’hui: l’être humain adolescent, au seuil de la vie, encore enclos pour un an dans la chrysalide de l’internat et déjà rêvant aux joies de la prochaine liberté. Vingt années ont passé depuis: ces vingt années me représentaient alors toute la vie qui valût la peine de vivre. Les voilà écoulées, et il se trouve, hélas! que ma curiosité de la vie n’a pas été épuisée par leur expérience ni par leurs déceptions. Si je me jugeais moi-même, je me jugerais à peine plus mûr qu’en ce temps-là: seulement l’opinion de mes contemporains, et la vôtre en particulier, chère Françoise, est que je ne suis plus jeune. Vous me l’avez dit en propres termes au moment de me quitter. Mais, tandis que nous faisions à pied la route de la place Possoz à la rue du Ranelagh, vous aviez déjà glosé sur l’idée.
—Voyez-vous, mon oncle, me disiez-vous, j’aime bien à causer avec vous parce que je peux vous parler de choses dont je ne parlerais 5 pas à maman, dont je n’aurais même pas parlé à mon pauvre papa, il me semble, s’il avait vécu,—et parce que, malgré ça, je suis avec vous comme avec un frère qui serait bien, bien plus âgé que moi... Je n’aime pas qu’on me fasse la cour... Plus tard, probablement, cela m’amusera. Mais, pour le moment, cela m’assomme. Et avec vous je suis bien tranquille.
Sur ce dernier mot, votre rire éclatant résonna dans le silence de Passy: l’imagination que votre oncle, le plus vieux de vos deux oncles, pourrait faire la cour à Françoise, vous paraissait évidemment très comique.
Vous avez raison, Françoise. Auprès de moi, vous êtes en sûreté. L’idée de vous courtiser ne me viendrait même pas: je n’en ai aucune envie. Moi aussi, sans même avoir besoin d’évoquer ma parenté d’oncle ni les graves fonctions de subrogé tuteur dont je suis investi depuis que vous êtes orpheline, je vous considère comme une petite sœur très chère. J’ai rassemblé sur votre tête enfantine l’amitié que je portais à votre père et celle que j’ai pour votre mère. Je n’ai nulle envie de vous faire la cour, bien que vous ayez dix-sept ans passés et que, demain, vous deviez être une femme. Cela ne m’empêche d’ailleurs ni d’être sensible à la préférence que vous me témoignez ni de goûter à l’extrême—sous les agréments extérieurs, encore un peu indécis, de votre personne—le charme de votre nature 6 curieuse et ardente, tempérée par un certain esprit pratique, par une honnêteté, une bonté héréditaires.
Cependant, quand j’eus regagné mon cabinet de travail, après la cigarette fumée au jardin, je me pris à regretter l’imprudente promesse que je m’étais laissé arracher par vos gentilles instances: celle de vous écrire à des intervalles réguliers, pendant votre dernière année de pension. Pour obtenir de moi cette promesse, vous aviez su improviser d’excellentes raisons, notamment dans la rue Mozart, tandis que nous descendions la chaussée vide, déjà semée de feuilles sèches.
Vous me disiez:
—Les mois de pension, n’est-ce pas? c’est peut-être indispensable, mais ça n’est pas suffisant pour vous préparer à la vie. (De quelle voix ardente et charmante vous prononcez ce mot: la vie!) On nous apprend l’arithmétique, la géographie, la couture; mais il ne faudrait pas demander à cette bonne Mme Rochette ni à aucune de nos maîtresses des renseignements sur la vie. Je vous assure qu’elles n’y entendent guère plus que moi. Or, moi, je ne suis pas destinée à être une espèce de religieuse laïque comme Mme Rochette et les dames de l’institution Berquin. J’ai l’intention d’aller le plus possible dans le monde dès que je serai sortie de pension, et de ne pas rester vieille fille. Croiriez-vous que ni maman ni ces dames de l’institution ne semblent penser 7 jamais que mon avenir sera celui d’une Parisienne mariée? Ne serait-il pas sage de me préparer un peu à cette épreuve du monde, plus redoutable assurément que le brevet supérieur? Eh bien! si je disais à maman ce que je vous dis là:—que je veux savoir un peu à l’avance ce qui m’attend hors de la pension—je l’épouvanterais et je la ferais pleurer. Si je le disais à Mme Rochette, elle me répondrait que j’ai «mauvais esprit». Pourtant, je tiendrais beaucoup à être renseignée sur tout ce qui n’est pas matière à examens... Il me semble que je suis si ridiculement ignorante! Je n’ai lu que des livres de classe, je n’ai entendu que des conversations nulles; on ne me conduit jamais au théâtre... Quand on me mènera dans le monde, pendant six mois au moins je n’oserai rien dire, je serai comme au milieu de gens qui ne parleraient pas la même langue que moi... Sans doute, je finirai par me former, mais cela m’ennuiera de perdre du temps.
Goût merveilleux de vivre! Vous avez peur, chère enfant, de quelques «mesures pour rien» dans la musique de la vie mondaine... Plus tôt que vous ne le pensez, vous vous lasserez de cette musique-là! Cependant, j’avoue que l’éducation qu’on vous donne, pour respectable qu’elle soit, et malgré qu’elle soit celle de la majorité des petites Françaises, ne me paraît pas des plus sensées. Quand vous dites qu’on vous apprend tout à l’école, sauf 8 l’essentiel, vous ne faites pas preuve d’un si mauvais esprit. L’école est bonne, mais il y faudrait adjoindre un professeur informé et sûr, qui vous renseignât, en se mettant à votre portée, sur les choses de la vie ambiante.
Une ville, une société, une nation, une époque, sont autour de vous, et vous en êtes séparée par une véritable cloison étanche, qu’on lèvera brusquement un jour, parce que vous aurez passé heureusement certain examen classique. Je conviens que c’est absurde.
Mais suis-je donc qualifié pour être, moi, votre «professeur de vie ambiante»?
J’ai peur que non.
—Si! si! me répondiez-vous. Nous avons de si bonnes causeries pendant les vacances, quand vous venez dîner à la maison, rien qu’avec maman et moi!
Vous êtes un auditoire d’une indulgence excessive, Françoise; faut-il vraiment que vous soyez dénuée de truchements plus érudits et plus éloquents entre le monde et vous pour me proclamer un truchement idéal! Cette préférence sur l’oncle Roger m’ôta sans doute la prudence: aux abords de la rue du Ranelagh vous m’aviez fait promettre que je continuerais 9 par lettres les propos de nos dîners de vacances.
A la réflexion, je déplorai ma faiblesse. Que vous écrire, en somme? Et d’abord par quelle voie vous écrire? Toutes les lettres que vous recevez à la pension passent sous les yeux de vos maîtresses, et il me déplairait d’être en contradiction, même accidentelle, avec la respectable Mme Rochette sur quelque point d’éducation ou d’enseignement. D’autre part, vous ne supposez pas un instant que je m’autorisasse de ma qualité de subrogé tuteur pour correspondre avec vous à l’insu de votre mère?...
Je me mis au lit fort perplexe, laissant au sommeil le soin de débrouiller le chaos de mes idées et de mes résolutions. C’est un bon moyen. Ce qui demeure en nous de pensée durant le sommeil est à la fois inconscient et instinctif: les résolutions qu’il nous fournit ont l’infaillibilité de l’instinct. Au réveil, outre que je m’accommodai fort gaîment d’avoir dix années de plus que l’oncle Roger, je vis clairement la solution de ce problème de correspondance. Je m’habillai, et, par la tiédeur d’un joli matin, je m’acheminai vers le logis de votre mère.
Je trouvai cette femme exquise dans l’appartement de la place Possoz, si agréablement provincial de site, d’aspect et de mobilier... Il était onze heures environ. Mme Le Quellien, vêtue de noir, chaussée de bottines, ses bandeaux grisonnants soigneusement lissés de 10 chaque côté de sa figure reposée et toujours jeune, me reçut dans sa chambre, une chambre qu’on devinait avoir été faite, cirée, parfumée de verveine dès sept heures du matin. Entre les deux fenêtres, le petit bureau d’acajou Louis-Philippe était ouvert, et votre maman, assise à ce bureau, quittait, pour me tendre la main, une forte plume d’ébonite et un gros cahier de comptes domestiques écrit tout entier par elle-même. Une Journée du chrétien, avec une petite image pieuse fichée dans les tranches en guise de signet, voisinait avec le cahier de comptes.
Et, dans son cadre de peluche verte, on apercevait aussi (photographie album coloriée, prime du Soleil) les cheveux châtains, les yeux gris-bleu, le teint éclatant de Mlle Françoise.
—Vous, si matin? J’espère qu’il n’est rien arrivé à la petite?
Je rassurai les alarmes de Mme Le Quellien. Elle sut que je vous avais remise, pleine de santé, entre les mains de Mme Rochette. J’exposai alors l’objet de ma visite: notre conversation de la rue Mozart, votre envie de recevoir de moi des «Lettres sur les choses» qui vous enseigneraient ce que les pensions de demoiselles n’enseignent pas. Je m’attendais à voir votre mère s’inquiéter, discuter le projet. Il n’en fut rien.
Elle ne fit qu’une objection:
—Évidemment, ce serait très désirable... Je me rends bien compte que je ne suis plus assez au courant de mon époque pour diriger 11 utilement cette petite... Mais c’est folie de vous demander cela... Vous n’avez pas le temps.
J’affirmai à Mme Le Quellien que j’avais le temps et que, même, cela m’amuserait. Seulement, je ne voulais pas que mes lettres fussent lues par Mme Rochette: la nuit m’avait suggéré de les adresser directement à votre mère, qui, elle, les lirait d’abord et vous les remettrait au parloir.
—Parfait! s’écria Mme Le Quellien. D’ailleurs, je trouve bien inutile de les lire à l’avance. Cela humilierait Françoise, et j’ai pleine confiance en vous, mon ami. N’êtes-vous pas le subrogé tuteur de la petite et ne vous traite-t-elle pas, un peu, comme un père?...
Elle aussi, l’excellente femme, me rappelait innocemment à la juste appréciation de mon âge!... Entendu, je suis un oncle de tout repos,—je suis presque un père. Voilà une promotion qui met un homme à l’aise pour correspondre avec une jeune demoiselle de pensionnat!
Allons, petite Françoise, c’est décidé: l’oncle de tout repos vous écrira chaque quinzaine. Il tâchera de compléter ex partibus l’éducation que vous distribuent Mme Rochette et ses acolytes... Toutefois, aujourd’hui, daignez vous contenter de ce billet. Ce n’est pas trop de quinze jours de méditations, si oncle et si père que je sois, pour me préparer à catéchiser dignement selon le monde une jeune personne fringante et ironique comme Mlle Françoise.
Quand on a votre âge, amie Françoise, on ne ressent aucune mélancolie de voir finir les choses autour de son propre commencement, si gai, si vivace. Des choses qui ont l’impertinence de fleurir, de disparaître, alors que vous n’êtes pas encore sortie de pension, ne méritent que votre dédain; elles ne sont pas, à 13 parler franc, vos contemporaines, et vous êtes très justement convaincue que la seule époque digne d’intérêt passionné s’inaugurera vers la fin de 1901,—quand vous entrerez dans le monde.
J’observai cette heureuse disposition de votre esprit certain vendredi soir qui précéda votre rentrée d’octobre à l’institution Berquin. Vous étiez venue, avec votre mère, passer un bout de la soirée dans mon jardin. C’était fête à l’Exposition: toutes les tours, tous les clochetons, toutes les pointes architecturales de l’éphémère cité s’embrasaient de lueurs féeriques. Mme Le Quellien exprima le regret de voir disparaître si tôt un tel concours de merveilles. Je renchéris: je me lançai dans une période assez bien tournée, pensais-je, sur la disproportion entre l’effort qu’avait coûté l’Exposition de 1900 et le bref loisir qui nous fut donné pour nous y complaire.
Vers le dernier contour de ma période, un regard de vous m’arrêta net; il me sembla que vous aviez envie de rire. Je vous demandai, par contenance:
—Et vous, Françoise, ne regretterez-vous pas l’Exposition?
Votre réponse fut, textuellement:
—Oh! moi... l’Exposition, je l’ai assez vue!
Toutefois, la dureté de ce trait se corrigea aussitôt par l’addition d’une phrase courtoise à l’adresse de la pauvre Exposition finissante:
—Du reste, ajoutâtes-vous, elle était très 14 bien, celle-ci... Il y avait surtout les rétrospectives et le Petit Palais...
«Elle était très bien... Il y avait les rétrospectives...» D’une inflexion de votre voix délibérée, vous enterriez déjà dans le passé la ville merveilleuse qui flamboyait sous vos yeux!... Cette attitude imposa sans doute à votre mère comme à moi, car nous renonçâmes à nos doléances, et, ce soir-là, il ne fut plus parlé de l’Exposition de 1900.
Mais vous n’imaginez pas, Françoise, combien vos moindres propos, dans leur netteté ingénue, m’offrent de matières à méditer. Lorsque Mme Le Quellien fut partie, vous emmenant, je demeurai assez longtemps encore à contempler, de mon jardin, la foire du monde. J’y demeurai même si longtemps qu’elle éteignit peu à peu ses feux de Bengale, ses rampes de gaz, ses boules électriques, jusqu’à n’être plus enfin qu’un noir chaos, une chose vide, morte déjà et comme abolie, tandis qu’au-dessus d’elle l’illumination éternelle des étoiles, naguère invisible dans le reflet excessif de tant de clartés terrestres, resplendissait de nouveau sur un ciel purifié.
Tout le quartier du Trocadéro, si bruyant, si vivant durant la soirée, retombait à la paix provinciale des temps ordinaires. Le silence et le clair-obscur reconquis favorisaient la réflexion.
Je méditai sur le bref jugement que vous aviez porté tout à l’heure. Non que ce jugement 15 fût en soi quelque chose de très piquant ou de très profond: il m’intéressait comme indice spontané de l’effet produit par le suprême effort du XIXe siècle sur un jeune être du XXe. Car vous êtes vingtième-siècle, Françoise: vous serez jeune fille, épouse, mère au XXe siècle. Le XIXe siècle n’aura eu de vous que votre enfance.
De vos deux sentences successives il résultait:
Premièrement, que le «Suprême effort» ne vous a pas... «épatée», oserai-je dire, employant à dessein une locution qui parfois s’égare sur vos lèvres.
Secondement, que vous y reconnaissez cependant une réussite méritoire, puisque vous lui accordez indulgemment la note très bien.
Troisièmement, que vous faites bon marché des attractions, voire de la partie industrielle et scientifique; que même la partie artistique contemporaine ne vous touche guère. Il vous fallait «les rétrospectives et le Petit Palais», c’est-à-dire la face historique de l’énorme exhibition, les objets et les œuvres d’art qui racontent d’une manière éclatante l’histoire de votre pays.
Et ceci me parut vraiment digne de remarque. Vous êtes une jeune personne résolument moderne. Si peu instruite du monde que vous vous prétendiez, votre perspicacité, toujours en éveil, profite adroitement des occasions pour se renseigner sur les modes du jour. Vous querellez cette excellente Mme Le Quellien 16 touchant la forme de ses chapeaux et de ses manteaux; vous-même, sans aucune affectation intempestive, savez fort adroitement vous faire coiffer et vêtir. Dans l’appartement de la place Possoz, pur Louis-Philippe, votre chambre étonne par le clair papier de tenture, semé d’iris, les meubles genre anglais, laqués de blanc. Vous aimez le brillant luminaire usité aujourd’hui: vous souhaiteriez un logis pourvu de «tout le confortable moderne». (Ce fut même, un jour, entre nous, un sujet de querelle). Vous m’avez confié que, si vous étiez riche et libre, vous auriez plaisir à circuler en automobile. Vous êtes, en un mot, très «de votre siècle», qui est le XXe. Et cela ne vous a point empêchée d’élire spécialement, au milieu d’un spectacle universel, quelques-unes des plus belles choses du temps passé.
Si je vous demandais pourquoi, vous seriez probablement incapable de me répondre. Mon expérience d’oncle va tâcher de vous expliquer à vous-même.
Votre «modernité», d’abord, est un bon signe d’équilibre physique et mental. Il serait fâcheux qu’à dix-huit ans vous n’eussiez point les yeux fixés sur l’avenir. Il est juste, il est expédient que les choses contemporaines vous paraissent spécialement amicales, que vous les habitiez avec plaisir, comme il est naturel que vous viviez parmi des compagnes de votre âge! Oh! gardez ce goût de la nouveauté, cet espoir du lendemain, cette foi instinctive dans 17 le meilleur devenir du monde! Foin des petites névrosées revenues de tout avant d’être allées nulle part! Essayez bravement les modes de votre temps, soyez curieuse de votre époque: vous avez tout le loisir d’être réactionnaire, un jour...
Seulement, chez vous, grâce à un heureux équilibre des facultés et aussi à la bonne fortune d’être née d’une vieille famille française, bourgeoise depuis plus de deux cents ans, ce goût volontaire du moderne s’accommode d’une tendresse mystérieuse pour les merveilles antérieures de votre pays. D’abord parce qu’elles sont belles, et belles d’une façon adéquate aux hérédités qui se composèrent dans votre personne, belles d’une beauté que vous comprenez tout de suite, sans éducation artistique spéciale. Puis parce qu’elles sont le passé français, qu’elles furent pensées, exécutées par des Français d’autrefois, et que des Français d’autrefois les ont fait servir à leur existence: parce qu’en un mot elles sont nationales. Entre ces délicieux meubles des siècles échus, entre ces merveilleux bibelots, ces faïences rares, ces bijoux, et vous, Françoise, il y a une parenté qui vous émeut à la première rencontre. Le berceau du roi de Rome, bien que prêté par l’empereur d’Autriche, est un peu à vous, et aussi l’armoire de Marie-Antoinette; la moindre parure campagnarde, le plus humble vêtement de droguet miraculeusement épargné par le temps et suspendu aux vitrines des «rétrospectives», 18 témoignent devant vous de l’antiquité de votre race et par là vous intéressent autrement qu’une armure espagnole ou les reliques d’un potentat hindou.
En sorte que le colossal musée où vous avez dépensé en tout, cette année, une quinzaine de vos journées, pourra bien ne laisser pour l’ensemble qu’une impression assez confuse dans votre mémoire; vous déclarez vous-même l’avoir assez vu. Mais le Petit Palais et ses brillantes succursales historiques, disséminées dans les sections diverses, n’auront pas vainement frappé vos yeux. Ce que vous y avez vu, vous l’avez regardé du regard qui imprime l’image dans le cerveau: ces images font partie de vous, désormais, de votre esprit, de votre jeune érudition. Et de même les émotions de fierté nationale, les sympathies esthétiques qu’elles vous ont suggérées, ayant été spontanées et profondes, ne s’aboliront pas avec le temps. Elles vont, au contraire, s’enraciner et se fortifier en vous, concourir à former votre goût, votre sensibilité.
Réfléchissez quelque peu à tout cela, Françoise, notamment pendant ces classes de couture dont vous m’avez dit qu’elles seraient assommantes si l’on n’avait pas le droit d’y penser à autre chose. Voyez là l’exemple et la 19 preuve que nulle éducation ne saurait être fructueuse si elle n’enfonce des racines dans le passé, dans la tradition, dans l’histoire de la race. Imitant en cela votre charmant génie de jeune fille, l’éducation doit être traditionnelle par instinct et volontairement curieuse de modernité. Cette vérité compte au petit nombre de celles qui me guident lorsque, si gracieuse, vous me demandez des «leçons sur les choses». Elle présidera à l’enseignement que voudraient vous apporter mes billets de quinzaine. Est-elle connue, est-elle appliquée par les dames excellentes que Mme Le Quellien à chargées de votre éducation scolaire, dans la célèbre institution Berquin? Est-ce le système de votre directrice Mme Rochette? D’après ce que vous m’avez confié, j’ai peur que non. Mme Rochette et ses acolytes ont bien de l’expérience et une indéniable bonne volonté: seulement leur doctrine est que l’éducation d’une petite Française en 1900 doit ressembler trait pour trait à l’éducation d’une petite Française de 1855, date où elles-mêmes fréquentaient l’école. C’est pousser un peu loin l’amour de la tradition. Vous trouverez d’ailleurs, par le monde, des fantaisistes qui soutiennent que le devoir de l’éducateur est de faire de la petite Française une petite Américaine ou une petite Anglaise. Ceux-ci sont très dangereux. Le système de Mme Rochette n’est pas dangereux. Il n’est qu’inutile.
Je voudrais, petite amie, mettre à mon doigt le cercle d’or qui rend invisible et vous suivre, 20 vous et vos compagnes, dans votre journée d’écolière, depuis la prière du matin jusqu’à la prière du soir. Malgré votre confiance en moi, vous ne me raconterez jamais tout ce que vous enseignent vos maîtresses en classe, ni tout ce que vous dites entre élèves durant les récréations, ni tout ce qui circule dans votre cervelle pendant les silencieuses heures d’étude. La franc-maçonnerie féminine scellera vos lèvres sur ce qui serait le plus divertissant à connaître... Mais mon expérience d’ancien écolier me suffit. Je sais à quel point une pension française ordinaire est un petit monde bizarre et vieillot, et quelles pauvretés y sont parfois gravement apprises... Votre jeune perspicacité s’en est rendu compte, puisqu’elle a souhaité un supplément d’informations sur la vie. Gardez-vous cependant, moderne Françoise,—et c’est par là que je veux conclure,—gardez-vous de mépriser en bloc tout le système d’éducation de l’institution Berquin. Il contient toute une partie de tradition et de principes qui est vénérable, admirable, et à coup sûr absolument appropriée à l’éducation d’une jeune fille de votre pays. C’est à vous, si fine et désormais avertie, de distinguer ce qui est réellement beau et utile dans ce mélange de traditions et de routines. Les merveilles que vous admiriez, colligées et mises en ordre dans votre cher Petit Palais, vous n’ignorez pas qu’il fallut, pour la plupart, les extraire de greniers encombrés, parmi la poussière et le fatras d’objets quelconques où 21 furent longtemps relégués les legs artistiques des siècles derniers... Eh bien! vous aussi, dans le fatras d’idées et d’habitudes léguées par les anciennes éducatrices, vous devez, à la veille d’entrer dans le monde, faire un triage judicieux. Les idées et les traditions dignes d’être conservées, vous les connaîtrez, d’abord à leur beauté, à leur noblesse intrinsèque et aussi à leur caractère vraiment, profondément national. Vous composerez ainsi peu à peu—nous composerons, car je vous y aiderai—un musée de ce qui fait la spécialité charmante, glorieuse, de la femme française. Et de même que, sans compromettre de votre précieuse modernité, vous preniez des leçons de goût au musée des Champs-Élysées, vous ne risquerez nullement de n’être plus une jeune personne bien vingtième-siècle en visitant de temps en temps cet autre Petit Palais imaginaire, meublé de traditions et de souvenirs.
Demain, chère Françoise, l’institution Berquin, cette douce prison, accorde un jour de liberté à ses prisonnières. Mais ce sont des vacances graves, fidèlement dispensées au culte des morts... L’aînée de vos compagnes a beau n’avoir pas vingt ans, il n’en est guère, parmi vous, qui n’ait à s’associer au grand deuil liturgique 23 par un deuil personnel. Pour vous, par exemple, le traditionnel pèlerinage au cimetière n’est déjà plus seulement une pieuse promenade. Il y a, dans l’énorme ville sépulcrale du Père-Lachaise, un coin du sol qui est vôtre, où sont réunis les derniers disparus de votre famille, votre aïeule maternelle, son mari, et, enfin, votre père, mort il y a huit ans.
Quand vous irez, demain, fleurir de chrysanthèmes la pierre unie sous laquelle dorment vos parents, quand vous aurez laissé s’épancher cette émotion imprécise, ce vouloir obscur que les absents soient heureux dans leur séjour inconnu, ce désir passionné de les retrouver un jour, qui sont assurément la meilleure des prières, évoquez de toutes les forces de votre jeune esprit la mémoire de votre père. Faites-vous raconter sa vie par Mme Le Quellien; quand il mourut vous étiez trop jeune pour la bien connaître. Puis, le soir, dans l’appartement de la place Possoz, avant de rentrer à l’institution Berquin, demandez à votre mère de vous montrer, de commenter pour vous les modestes archives de la famille. Méditez-en les enseignements quand vous serez de nouveau prisonnière. Je vous parlais l’autre jour de l’importance qu’il y a, pour une petite Française, à bien connaître le legs historique que transmet à sa génération le passé de la France. Il lui importe non moins de connaître le passé prochain de sa propre famille, ce que lui transmettent immédiatement les êtres humains dont le sang anime ses veines.
24 Votre famille, chère enfant, est née du sol national, du sol de la province française. A trois où quatre générations en deçà de la vôtre, on y trouve des paysans, possesseurs de petits domaines qu’ils cultivaient eux-mêmes, les uns en Poitou, les autres en Gascogne. Je vous prie d’être très fière de cette origine et de la proclamer hautement à travers la vie, quand on vous la demandera. Toute vraie noblesse s’enracine dans la terre, dans le sillon tracé par les aïeux. Osez vous glorifier de votre sang pur de tout mélange: telles familles réputées grandes et portant d’illustres titres ont, en somme, le sang le plus mêlé, traversé de courants étrangers au hasard des riches alliances. Apprenez d’ailleurs que ces libres laboureurs, vos aïeux à la fin du dernier siècle et au commencement de celui-ci, vous ont transmis, par l’économie intellectuelle de leur vie, des facultés neuves, des puissances prêtes à servir, que nul effort antérieur n’a usées: c’est là un phénomène aujourd’hui démontré par la science. Ils ont vécu, ils sont morts sans renommée, ils dorment obscurément dans leurs cimetières de village, où demain personne n’ira peut-être fleurir leur tombe feutrée d’herbe. Mais c’est parce qu’ils furent de sobres paysans, parce que leur cerveau n’assuma pas d’excessifs labeurs, que vous arrivez, vous, petite Françoise, à l’aube du XXe siècle, l’esprit si vivace, si alerte,—en même temps que si saine et si robuste de corps.
25 Un seul, parmi vos humbles ancêtres, vous a laissé une marque notable de son existence, alors pareille à celle de beaucoup de ses contemporains, mais qui, par le recul du temps, non moins, hélas! que par la diminution de notre prestige guerrier, nous apparaît comme extraordinaire et héroïque. Un de vos arrière-grands-pères fut soldat du premier empire. Il fit toutes les campagnes de Napoléon de 1806 à 1814, celle-ci comprise. Il fut à Iéna et à Friedland, à Wagram, à la Bérézina, à Champaubert. De tant de gloire et de tant de périls, il rapporta tout simplement le grade de sergent-fourrier: fallait-il qu’en ce temps-là l’héroïsme fût chose commune! Il rentra alors dans la vie civile et obtint un modeste emploi aux douanes de son département. Le reste de sa vie est absolument effacé par le temps. Mais votre mère a hérité de lui ce bout de papier jauni sur lequel ses campagnes sont mentionnées et où il est affirmé que «Louis-Pierre-Edme Le Quellien a servi sa patrie avec courage et loyauté». C’est tout...
Le fils de ce héros fut négociant: humble et probe négociant comme Louis-Pierre-Edme avait été un soldat humble et fidèle. Il ne fit pas fortune; pourtant il réussit à donner à son unique enfant une éducation libérale. Par lui, Françoise, l’intellectualité a pénétré dans votre famille. Le sujet de cette première expérience se trouva, par bonheur, être exceptionnellement intelligent. Ce fut votre père, Jean Le Quellien. Je l’ai pratiqué surtout après qu’on 26 l’eut nommé, à Paris, sous-chef au ministère des Finances. J’ai rencontré peu d’hommes d’une érudition aussi ample et si diversement compréhensifs. Qu’il vécût enfermé dans un bureau et occupé d’ingrates besognes que cent autres, moins doués, auraient pu faire aussi bien que lui, cette anomalie toujours m’irrita. Vous le rappelez-vous bien, cher enfant, cet honnête et savant homme, si modeste, si timide même que ses chefs ne se sont jamais doutés de la supériorité qu’il gardait sur eux? Moi j’évoque souvent son image, sa carrure un peu massive, son visage coloré où le dessin net des traits et la vivacité des yeux affinaient l’hérédité rurale. Il savait tout, il entendait tout. Sa conversation était un enchantement. Il avait discipliné sa maison au goût des longues lectures. Et je me souviens du spectacle si digne et si charmant que j’eus certains soirs, en venant chez vous du temps qu’il vivait. Autour de la table de la salle à manger, desservie aussitôt le repas achevé et recouverte de son tapis de drap vert-mousse, M. Le Quellien, Mme Le Quellien, et la mignonne gamine de neuf ans que vous étiez alors vous-même, lisaient chacun un bon livre, sous la lueur jaune de la grosse lampe...
Cet homme éminent et excellent avait un défaut que je ne veux pas vous cacher, car il vous est utile de le connaître et il ne diminuera pas dans votre mémoire le respect du cher disparu. Il était, dans l’action, hésitant et timide. Cela par grande modestie naturelle 27 d’abord, par une instinctive défiance de soi; sans doute aussi par l’influence d’une hérédité de fortunes médiocres. En somme, parmi ceux de sa famille, personne n’avait «réussi» de façon éclatante. Pourquoi se fût-il reconnu des droits à un sort plus brillant? Son emploi actuel suffisait à son ambition. Un poste élevé l’eût effrayé. Il se jugeait heureux: votre mère, en même temps que le parfait bonheur intime, lui avait apporté en dot l’équivalent de son traitement. Rien ne manquait à la simple aisance du foyer. Il ne souffrit jamais de l’obscurité de ses destins, de leur disproportion avec ses facultés.
Ainsi, l’historien qui remonterait votre lignée paternelle, amie Françoise, y trouverait aisément les origines de votre esprit ouvert et de votre belle santé physique; il n’y rencontrerait pas l’explication de votre tempérament curieux, oseur, résolu à l’entreprise. Il y a bien le sergent-fourrier de Napoléon; mais je devine qu’il fut homme d’action par entraînement et par devoir, non par caractère. Si le hasard eût fait de votre père un soldat, il eût été, lui aussi, soldat excellent; il ne fût pas devenu pour cela un homme d’action dans le vrai sens du mot, c’est-à-dire ayant en soi, 28 dans sa volonté, dans son initiative, le principe d’action... Ce n’est pas non plus la douce Mme Le Quellien qui vous a façonné cette âme vingtième-siècle, éprise de nouveau, gentiment volontaire avec un grain d’entêtement. «Pauvre maman!...» me dites-vous volontiers en parlant d’elle. Et c’est dit si drôlement, et je sais si bien que vous êtes une fille docile, en somme, et respectueuse, que j’oublie de vous rappeler à l’observance des formalités filiales. «Pauvre maman!...» Cela veut dire, dans votre pensée, qu’il y a un tas de choses par le monde qui vous passionnent et ne l’intéressent pas, que les livres qu’elle aime, la musique qu’elle goûte, vous semblent également fades. Son expérience même de la vie apparaît si innocente à vos dix-huit ans que l’idée ne vous viendrait même pas de la consulter aux cas confidentiels... Il y a du vrai dans tout cela. A la veille de sortir de pension, vous commencez déjà, Françoise, à être un peu plus âgée que votre mère. Votre génération montre une maturité hâtive qui contraste étrangement avec l’honnête inertie où se complut la génération de vos mères. Pour Mme Le Quellien, il faut en outre tenir compte de l’influence qu’eut sur elle un mari adoré, puis des circonstances singulières de sa jeunesse. Et nous touchons là au point le plus intéressant peut-être de votre histoire généalogique.
La famille de votre mère, encore que d’origine rurale, fut aisée et bourgeoise plus tôt 29 que celle de votre père. L’aïeule qui repose au Père-Lachaise naquit presque riche. Une invention mécanique, le brevet,—comme on disait autrefois chez vous, tout court,—avait fait la soudaine fortune de votre arrière-grand-père maternel, simple contremaître. (Et déjà admirez ici l’esprit d’entreprise!) Sa fille unique se maria de bonne heure, contre le vœu—quoique avec l’autorisation de ses parents. C’était une aventure d’ordre sentimental. L’homme qu’elle avait choisi lui donna le bonheur et la ruine, dans une suite d’entreprises financières probes et folles. Leur souvenir fait encore trembler votre mère, qui prit là, par contre-coup, l’horreur de toutes les affaires, même avant d’épouser le mari le moins homme d’affaires du monde... Une dot modeste, pour elle, fut seule sauvée. Le reste du «brevet» disparut, laissant à votre aïeule de quoi subsister. Celle-ci, d’ailleurs, restée longtemps veuve, porta jusqu’au bout sa demi-misère héroïquement. Elle me disait, elle disait à qui voulait l’entendre qu’elle ne regrettait rien, que la vie avait été bonne pour elle, puisqu’elle avait aimé et qu’elle avait été aimée.
Cette gracieuse personne mourut en 1883. Je me rappelle fort bien son caractère et son visage. Elle se plaisait dans la société de la jeunesse et conversait volontiers avec moi, qui en ce temps heureux avais moins de vingt ans. Feuilletez l’album de photographies de votre mère, cet album qui porte en relief sur 30 son plat de cuir un Faust et une Marguerite devisant amoureusement:—vous trouverez deux ou trois images de celle que j’appelais: tante Brigitte. Vous n’aurez pas de peine à y reconnaître votre propre ressemblance. Vous êtes son portrait, comme on dit, bien qu’un peu moins grande, avec de plus beaux yeux, un menton plus ferme et aussi (dût en souffrir votre coquetterie) un peu plus lourd, avec des traits moins réguliers et plus amusants, avec, en somme, un rien de plus tenace et de moins sentimental à la fois sur la physionomie. Tout de même, en ce triage mystérieux des types ancestraux auquel se livre la nature lorsqu’elle fabrique un être nouveau, elle a gardé sur le crible, pour le mêler à l’argile délicate dont est modelée Mlle Françoise Le Quellien, pas mal d’éléments de sa grand’mère Brigitte. Elle y a mêlé beaucoup de l’intelligence et quelques traits de la physionomie paternelle, un peu, vraiment peu, de la douceur candide de Mme Le Quellien: et, sur ce tout convenablement fondu et pétri ensemble, elle a soufflé l’étincelle vitale. Il en est résulté une petite personne ayant des défauts et des qualités, mais assurément armée en perfection pour la lutte d’existence, et, à tout prendre, assez agréable à voir et à écouter.
Je compte bien, chère enfant, que les souvenirs familiaux évoqués par cette lettre vous accompagneront demain dans le pèlerinage vers la tombe de vos morts... Vos morts! il en 31 repose un bien petit nombre sous la pierre où vous vous agenouillerez. En payant à ceux-ci votre dette de souvenir, n’oubliez pas ceux qui dorment dans d’autres coins de la terre de France, et dont la vie, telle qu’elle fut, a contribué à ce que sera votre vie. C’est doubler sa force individuelle que la maintenir en contact permanent et avec le passé national et avec ce rameau de la race qui s’appelle la famille. Élargissez donc, par une évocation consciente et sereine, le sens religieux de cette fête des Morts. Au delà du brave et éminent homme, votre père, et de votre exquise et sentimentale aïeule, faites remonter la piété de votre hommage jusqu’aux plus lointains de vos ancêtres, jusqu’au soldat de Napoléon, jusqu’aux ignorés manieurs de charrue qui, il y a des cent ans et des cent ans, parlaient déjà la même langue que vous, avec quelque chose de votre accent.
Dans mon courrier, je trouve ce billet, dont l’écriture nette et pointue m’avait à l’avance révélé l’origine:
«Quelle bonne après-midi j’ai passée l’autre jour à courir les magasins avec vous, mon oncle! C’est bien plus amusant qu’avec maman, parce qu’au fond, maman, ça l’ennuie. 33 Vous, vous êtes patient et complaisant comme tout; seulement, à présent, je suis prise de remords. Ne vous ai-je pas fait perdre du temps? Rassurez-moi!—Françoise.»
Soyez rassurée, chère petite amie, je ne considère pas comme perdue cette après-midi où, Mme Le Quellien étant fatiguée, je fus promu à l’honneur de vous accompagner dans «les magasins». Les magasins, cela désigne, en votre langage de jeune fille, exclusivement ce qui contient, ce qui vend de quoi vous vêtir, vous coiffer, vous orner. A la veille d’un changement de saison, il paraît que cette enquête sur la mode ne saurait être négligée, même par une élève de l’institution Berquin. En effet, l’institution n’impose pas d’uniforme; on veut seulement que les élèves soient vêtues «de nuances foncées, sans excès d’ornement». Il s’agit de tricher avec ce règlement; il s’agit aussi d’être un peu gentiment mise les jours de sortie. Vous vous y employez de votre mieux. Vous m’avez avoué que vous aimeriez à être très élégante—mais là, très!—et que le même souci agite la plupart de vos compagnes. Un petit nombre, parmi celles-ci, sont riches, et déjà se fournissent dans les grandes maisons. Les autres, les plus nombreuses, tâchent de suppléer par l’ingéniosité à l’insuffisance du budget: telle votre amie Lucie Despeyroux (celle dont le frère est un si joli saint-cyrien)—et vous-même.
Lucie a une théorie qu’elle a bien voulu 34 énoncer un jour en ma présence. Elle ne s’adressait pas à moi; même, dans la chaleur d’une discussion avec vous, elle avait oublié ma présence.
—Ma chère,—s’écria cette agréable personne de dix-sept ans, dont la taille souple et ronde se dessinait sous un costume de drap bleu marine,—quand on n’a pas cent mille francs par an à dépenser dans sa toilette, il faut s’en tenir aux robes «tailleur» et aux blouses. Et puis, tu sais, les hommes n’aiment que les costumes tailleur.
Assez souvent j’ai rencontré Lucie place Possoz, et vous m’en avez suffisamment parlé pour que j’aie attribué tout de suite cette façon de s’exprimer décidée, avertie, à son extrême et charmante innocence. Rien n’est plus touchant que d’entendre votre amie juger le monde, la vie, et, comme elle dit, les hommes. Les hommes, pour elle, c’est tout justement ce merveilleux saint-cyrien, son frère, Maxime Despeyroux, qui fait parfois des entrées sensationnelles au parloir de Berquin. Du propos de Lucie, j’ai conclu que le séduisant Maxime avait le goût exclusif des costumes tailleur. Vous, Françoise, après avoir réfléchi quelques secondes, vous avez fait cette réponse profonde:
—Les costumes tailleur dont j’aurais envie sont tout de même horriblement chers. Ah! comme il doit être agréable d’avoir assez d’argent pour s’arranger comme on voudrait!
—Françoise!... a interrompu, moitié sourire, 35 moitié gronderie, la douce Mme Le Quellien.
Vous avez rougi; vous avez fait cette moue, menton tendu, lèvres pincées, qui vous rend si drôle... et l’on a abandonné le chapitre des costumes.
Mme Le Quellien s’alarme, en effet, de votre penchant à la coquetterie. Je la rassure de mon mieux; pourtant, de vous à moi, je puis vous l’avouer: je vous trouve extrêmement occupée de toilette. Cela ne vous empêche pas, je le sais, d’avoir du goût pour les choses sérieuses, pour l’étude, pour les arts, ni d’être, au fond, sensible et bonne. Mais vos goûts sérieux, votre bon cœur, s’accommodent d’un penchant à vous parer. L’après-midi que j’ai passée avec vous, en vue de vous documenter sur les modes de l’hiver prochain, me fut singulièrement instructive à cet égard.
D’abord, j’ai constaté que vous connaissez le nom et le lieu de tous les grands faiseurs parisiens. J’ai admiré votre aisance à entrer dans une maison de modes, à vous faire voir des modèles en abondance, puis à vous défiler au dernier moment sans acheter rien, emportant la forme enviable dessinée dans votre mémoire de dix-huit ans. J’ai vu le tressaillement de votre regard quand une «chose de beauté»—s’il en est vraiment parmi ces fanfreluches de la toilette—vous frappait au passage. Hélas! Françoise,—je vous dois cette dure vérité,—malgré tous vos dons précieux de 36 nature, vous êtes évidemment susceptible de devenir un simple être de luxe si vous êtes riche un jour, ou de souffrir de votre médiocrité si vous ne l’êtes point. Voilà pourquoi notre course aux chapeaux et aux corsages m’a laissé une certaine anxiété dont il faut que je vous fasse part. Si, le faisant, je vous importune un peu, ce sera pour compenser cette agréable humeur dont j’accompagnais vos emplettes.
Avez-vous observé que le mot de coquetterie a deux sens, comme la chose a, si l’on peut dire, deux degrés? Une femme est coquette qui se pare pour elle-même, parce qu’elle s’intéresse à ses propres charmes, les cultive, les accroît et les décore. Une femme est coquette qui veut et cherche des hommages masculins, les hommages du plus grand nombre possible d’admirateurs... Vous vous récriez. Vous me dites: «Je me soucie fort peu des hommages, on m’ennuie quand on me fait la cour...» C’est vrai, je l’ai constaté, vous êtes coquette au premier degré. Les fadeurs débitées face à face vous irritent. Les admirations masculines trop prochaines vous troublent et vous froissent. Êtes-vous bien sûre, cependant, de ne jamais franchir, à l’usage du monde, le degré qui sépare la coquetterie inoffensive de la dangereuse coquetterie? Ce désir d’être parée peut bien, en ce moment, avoir pour unique objet d’admirer vous-même, vous seule, l’image que votre glace vous renvoie. Mais n’est-ce pas parce que vous 37 considérez votre existence actuelle comme une période d’attente—les «mesures pour rien», c’est votre mot?... Il vous plaît de vous voir élégante, parce que cette vue rassure vos prévisions d’avenir. Une voix (que vous étouffez sans doute) murmure alors en vous: «Quand je voudrai!...» Votre impatience à souffrir les admirations des hommes, votre déplaisir du flirt? Ne faites pas là-dessus trop de fond. Les femmes sont volontiers disposées, quand il s’agit d’elles-mêmes, à appeler vertu ce qui n’est que timidité. «Mais je ne suis pas timide, mon oncle!» Justement, voilà pourquoi je demeure inquiet. Votre timidité devant les courtisans n’est, au fond, qu’un défaut d’habitude, le résultat d’une éducation familiale, pure à merveille. Je ne lui donne pas trois mois de vie mondaine pour s’évaporer. Et alors, le goût de parure inné en Mlle Françoise s’accroissant du même coup, comment garantir que le degré ne soit jamais franchi entre la première et la seconde coquetterie?...
Vous protestez? Mettons, s’il vous plaît, que vous vous en tiendrez à la coquetterie égoïste. Vous vous parerez pour vous, c’est entendu, pour vous voir belle et élégante dans les miroirs... Seulement, vous verrez aussi, par le monde, les autres femmes, coquettes au premier ou au second degré. N’aurez-vous pas envie de lutter avec elles pour la primauté somptuaire? A Paris, de nos jours, cette gageure des toilettes s’exaspère jusqu’à la folie, et l’on ne sait vraiment où cela s’arrêtera, car 38 la manie du «record» s’en mêle. Quelques procès, de fournisseur à cliente, nous ont fait connaître le jupon, en mousseline de soie, de 900 francs; il ne peut être porté qu’une fois. Tout Paris sait le nom de la mondaine—d’ailleurs exquise—qui se commande au moins une robe par jour... J’ai passé cet été une quinzaine de jours sur une plage assez fréquentée. Une des joies de cette plage, pour les oisifs, était de contempler les toilettes d’une aimable personne du meilleur genre cosmopolite. Elle en faisait trois par jour, et quelles! Il fallait bien regarder chacune d’elles, car on ne la devait plus revoir, non plus que le chapeau qui la couronnait... Spectacle divertissant pour le sexe en veston et en smoking, mais spectacle atroce pour les autres élégantes de la plage. Une femme en mal d’élégance doit, en effet, être la plus élégante, ou bien son élégance lui semble inutile, manquée... Le corsage qu’elle ajustait amoureusement dans son cabinet de toilette, tout à l’heure, lui brûle les épaules dès l’instant qu’une autre femme, sous ses yeux, en porte un autre plus admirable... O Françoise, imaginez quelles douleurs se prépare celle dont la fortune n’est pas indéfinie, dont les caprices se heurtent tout de suite aux bornes d’un étroit budget, et qui veut s’engager dans la course au luxe moderne! J’en ai vu, j’en vois plusieurs autour de moi. Elles sont touchantes et désolantes. Toutes connaissent, bien entendu, une première de chez Virot qui trahit en leur 39 faveur le secret professionnel et leur livre pour 30 francs le modèle de 200. Toutes ont déniché la «petite couturière» adroite comme une fée, qui a «refusé d’entrer chez Dœuillet», et qui cependant façonne des robes pour trois louis, sans doute par philanthropie. Toutes rognent sur le budget de la table, du service, des enfants même, pour payer ces frais de vêture, énormes malgré tout, malgré le temps passé à faire chez soi des plissés, des garnitures de paillettes, voire de la peinture sur étoffes. Et, le grand jour ou le grand soir arrivé, quand enfin cette laborieuse toilette s’exhibe à quelque fête, au milieu de cent autres, celle qui la porte a soudain le cœur pincé d’une angoisse. Elle a regardé autour d’elle; elle s’est comparée; elle s’est jugée. Le vrai chapeau de Virot, la vraie robe de Dœuillet sont là, devant elles, portés par une autre femme. Et, rien qu’à les voir, la malheureuse se rend compte que son chapeau, que sa robe à elle, proclament pour tout œil exercé (quel œil de femme ne l’est pas en cette matière?) la contrefaçon anxieuse, l’économie dans le luxe, c’est-à-dire quelque chose 40 de plus choquant que l’indigence!... Cela n’empêchera pas la coquette pauvre de recommencer son effort, de courir à de nouvelles angoisses et à d’autres déceptions. A ce jeu, la bonté du cœur s’use ou s’aigrit vite. La catastrophe de l’honnêteté, que le romancier met d’ordinaire au bout de pareilles destinées, ne s’accomplit pas toujours. Mais la vie n’en demeure pas moins à la fois tragique et méprisable. Coquette et honnête! Quel sujet de roman pour un psychologue. Je ne me souviens pas qu’un écrivain l’ait traité. La vie réelle le traite tous les jours.
Je vous entends, je vous vois, froissant ce papier en vous écriant: «Oh! le méchant! l’injuste! il peut croire que je serai pareille à de telles femmes!...» Non, Françoise, je ne le crois point. Je sais que votre nature heureusement équilibrée répugnera toujours aux excès. Je voudrais vous épargner l’épreuve douloureuse, vous guérir tout de suite d’un léger défaut peu à peu accru... En ce moment, vous avez une coquetterie spontanée, innocente, amusante, à laquelle vous m’avez vu me prêter l’autre jour volontiers moi-même. Mais demain? Dans le monde? Au cours de la vie? Il faut pourtant savoir où l’on va, et, comme dit le philosophe, vouloir sa volonté. A quoi bon se surcharger à l’avance d’un poids qui vous rendra le chemin plus pénible, et dont cependant vous ne vous débarrasserez qu’avec effort?...
41 —C’est entendu, mon oncle... je ne serai plus coquette.
Gardez-vous-en bien, chère enfant. Je ne vous ai parlé aujourd’hui que de deux coquetteries: la mauvaise, qui ne sera jamais la vôtre, et l’inoffensive, qui est la vôtre—aujourd’hui inoffensive en effet, demain dangereuse. Il y en a une troisième. Oui, Françoise, il y a la bonne coquetterie, l’utile, la recommandable coquetterie... La preuve en est que le plus fâcheux service à rendre à une femme est de répandre ce bruit: «Elle n’est vraiment pas coquette...» Les hommes (comme dirait votre camarade Lucie), les hommes n’ont aucun goût pour les personnes dont on dit cela: demandez plutôt au joli saint-cyrien, amateur de costumes tailleur.
Il faut éviter cette réputation d’excessive vertu, et pour cela il faut être coquette d’une certaine façon. Peut-être la devinez-vous déjà? je vous la dirai en détail dans ma prochaine lettre... Et, comme les plus graves problèmes contemporains n’effrayent pas notre ingénuité, nous tâcherons, dans la même lettre, de pronostiquer l’avenir de la coquetterie féminine au cours du siècle qui va commencer.
J’aiguisais ma plume pour vous écrire, lorsqu’on m’annonça la visite de votre mère, la douce Mme Le Quellien. Il était environ dix heures du matin.
—Mon ami, me dit-elle sitôt qu’elle fut assise en face de moi dans mon cabinet de travail, je veux m’ôter un souci qui, cette nuit, a gâté mon sommeil. N’est-ce pas aujourd’hui 43 que vous avez coutume d’écrire à la petite?
Je répondis qu’en effet, chaque mardi de quinzaine, je m’imposais cet agréable devoir.
—Eh bien! je voudrais, j’aimerais... Mon Dieu!... comment vous dire cela, cher ami, sans vous contrarier?...
Je suppliai Mme Le Quellien de ne point se gêner et de m’avouer tout uniment ce qui la tourmentait.
—Vrai? vous ne serez pas froissé?... C’est que, voyez-vous, je voudrais le moins possible intervenir dans votre correspondance avec Françoise... Seulement, avant-hier, quand j’allai la voir à la pension, je la trouvai si assombrie et si anxieuse en même temps que je dus la confesser... Votre dernière lettre, où vous gourmandiez un peu sa coquetterie, lui avait causé un gros chagrin. «S’il me juge si sévèrement, lui qui me connaît bien, s’écria-t-elle, comment doivent me juger les autres, qui ne voient de moi que les apparences?...» Elle me dit encore que vos critiques l’avaient plongée dans l’incertitude et le désarroi. «Que faire?... Je ne peux pas pourtant choisir les nuances d’étoffes que je trouve ridicules et les formes de chapeaux qui ne me vont pas?... Qu’il les choisisse lui-même avec toi, cela m’est bien égal, au fond! Je croyais que cela vous faisait plaisir à tous les deux, de me voir gentiment mise...»
Ainsi parla Mme Le Quellien. J’étais confondu, navré.
—Chère Françoise, murmurai-je. Si j’avais 44 cru lui faire de la peine, j’aurais jeté ma lettre au feu. Dois-je tout de même lui écrire aujourd’hui?
—Sûrement! Elle attend votre lettre avec une impatience fébrile, parce que, paraît-il, vous lui avez promis d’y indiquer la bonne façon d’être coquette. Écrivez-lui donc, mais, je vous en prie, cette fois du moins, ne soyez pas trop sévère... ne la faites pas pleurer. Elle est si jeune, la pauvre chérie, et vous savez comme son cœur est sain!...
Quand votre mère m’eut quitté, rassurée, emportant la promesse que «je ne vous ferais plus pleurer», je méditai quelque temps sur moi-même et je me maltraitai fort. Ainsi, ma dernière lettre, que je croyais affectueuse, vous avait chagrinée. J’avais prétendu simplement éveiller votre sensibilité, et voilà que je l’avais meurtrie! Hélas! chère enfant, ce n’est pas la première fois que pareille infortune m’échoit, sinon avec vous, du moins avec le public. Quel écrivain n’a pas été stupéfait de l’interprétation excessive donnée à ce qu’il suppose avoir écrit du ton le plus modéré? C’est que, voyez-vous, les indifférents systématiques mis à part, chacun de nous cherche dans ce qu’il lit un aliment pour ses passions politiques, sentimentales ou autres. Et la lecture passionnée de ma récente lettre, qui vous a tant bouleversée, me flatte au fond... Tout de même, «vos beaux yeux ont pleuré»; j’en ai quelque remords. Et, puisque je fus si maladroit 45 que de vous chagriner, je passe la parole—pour rentrer en grâce auprès de vous—au plus doux des prédicateurs: à Fénelon.
Fénelon vous dit,—parlant précisément des jeunes filles:
«Les véritables grâces ne dépendent point d’une parure vaine et affectée; mais on peut chercher la propreté, la proportion et la bienséance dans les habits nécessaires pour couvrir nos corps.»
Sans même en appeler à cette haute autorité, nous concevons aisément qu’il soit expédient à une femme d’être un joli spectacle pour les yeux. Bien plus, il est dangereux qu’elle soit tout à fait indifférente à son propre aspect physique. Ce n’est pas sans raison que le suave conseiller de la duchesse de Beauvilliers inscrit en tête des coquetteries permises le mot de «propreté». La propreté, cette demi-vertu,—ainsi l’appelaient nos aïeules,—devient trop aisément indifférente à qui repousse toute envie de plaire. Or, rien n’est moins séduisant qu’une femme dont on dit: «Elle n’est pas soignée.» Les femmes entre elles le savent bien; aussi est-ce une des accusations qu’elles lancent le plus volontiers et le plus perfidement contre des rivales... C’est faux, très souvent, surtout de nos jours, à Paris, où même la plus humble bourgeoisie française commence à se familiariser avec les habitudes hygiéniques du Nord. Avouons cependant qu’il reste encore à faire, beaucoup à faire en province. 46 Ils sont nombreux, les chefs-lieux d’arrondissement où l’habitant répondrait—comme à un fonctionnaire de mes amis étonné de ne point trouver d’établissement de bains dans sa nouvelle résidence:
«Oh! monsieur le sous-préfet... vous savez... dans notre petite ville, on donne si rarement des bals!...»
... L’observance, sans plus, de la «demi-vertu», serait d’ailleurs une pauvre règle d’économie féminine. Dans la société contemporaine, le rôle de la femme, s’il n’est plus (par bonheur!) uniquement de plaire, est encore de plaire, parmi d’autres devoirs. Des révoltées, des femmes précurseurs peuvent abdiquer dès aujourd’hui cette mission: vous n’avez point, Françoise, un tempérament de révoltée. Soyez consciente du mouvement puissant, indéniable, qui va transformer peu à peu la coquetterie féminine dans le sens que je vous dirai tout à l’heure; mais, née en 1882, demeurez tout simplement une femme de votre époque. Fénelon vous suggère encore un excellent moyen de vivifier votre coquetterie en la réglant: il prononce le mot de proportion. Glosons sur ce mot à la façon des géomètres.
Théorème.—Toute mauvaise coquetterie est une erreur de proportions.
Erreur de proportion, l’extravagance des formes, l’accouplement hurlant des couleurs. Erreur de proportion, l’excès des ornements surajoutés au vêtement essentiel. Erreur de 47 proportion, l’amas ostentatoire des bijoux... Poussons plus avant l’application de notre théorème. Nous dirons encore: erreur de proportion, le luxe de la toilette en désaccord manifeste avec la fortune de celle qui la porte; erreur de proportion, l’obstination d’une femme mûre à se vêtir en jeunesse.
Vous, Françoise, vous avez reçu de la nature un sens heureux de l’harmonie. Vos toilettes sont donc agréables à regarder, parce qu’elles vous encadrent, si l’on peut dire, et vous expliquent. La seule erreur de proportion qui vous pourrait menacer serait de ne point mesurer toujours votre parure à l’effet que vous en souhaitez. Ne pleurez point, cette fois; je suis prêt à proclamer que rien n’est plus charmant ni plus honnête que vous! Promettez-moi seulement, chaque fois que vous choisirez une toilette ou que vous agencerez une parure, de vous adresser cette question: «Qu’est-ce que je me propose en m’ornant ainsi?» Comme vous êtes intelligente et franche, vous vous répondrez la vérité. Si cette réponse est: «Je me propose d’étonner les gens» ou bien: «Je me propose d’être mieux que Louise, Lucie, Jeanne, etc...» ou encore: «Je désire qu’on me croie très riche...» repoussez hardiment la tentation: c’est de la mauvaise coquetterie. Ce sera de la bonne, de la recommandable coquetterie si vous pouvez loyalement vous répondre à vous-même: «Je veux profiter autant que possible de mes avantages naturels pour être un objet agréable à 48 tous les yeux, et surtout aux yeux que j’aime; je veux en outre que mon extérieur renseigne le mieux possible ceux qui me verront sur mon âge, mes goûts, ma condition, afin que, si l’on vient à m’aimer, ce soit moi que l’on aime, et non pas un personnage travesti.» La distinction, n’est-il pas vrai? est aisée à faire. Voilà pour le présent. Regardons vers l’avenir.
Vous êtes née vers la fin du XIXe siècle, chère Françoise, et votre vie de femme fleurira principalement durant le XXe. Il est sage, par conséquent, que vous vous inquiétiez un peu, par avance, de ce que deviendront, au XXe siècle, les mœurs féminines. On peut prévoir qu’elles changeront beaucoup et que la différence sera plus sensible de 1950 à 1900, par exemple, que de 1900 à 1850. Jamais l’esprit de la femme n’a fermenté comme à cette heure. La femme reprend par devers soi le souci de son bonheur, au lieu de le confier à l’homme. Qu’on goûte ou non cette évolution, il est nigaud de la nier: vous n’avez d’ailleurs qu’à évoquer le nom de ceux qui la nient! Quant au sens de cette évolution, point n’est besoin non plus d’être grand clerc pour l’apercevoir. La femme, au cours des prochaines années, tendra de plus en plus à rapprocher sa condition de celle de l’homme. Et les habitudes, les apparences même des deux sexes inclineront de plus en plus à se confondre.
Mme de Maintenon écrivait à Mme de 49 Fontaines: «On m’a dit qu’une des petites (de Saint-Cyr) fut scandalisée au parloir parce que son père avait parlé de sa culotte; c’est un mot en usage, quelle finesse y entendent-elles?...» Je sais de nos jours quelques grandes personnes que la chose, sinon le terme, scandalise, et qui poussent de hauts cris sur la culotte des femmes cyclistes. Soit!... Admettons que l’assimilation des vêtements féminins aux vêtements masculins n’ira jamais jusqu’à troquer la jupe contre la culotte. Ce qui me paraît dès à présent hors de doute, c’est que vous assisterez, jeune Françoise, dans la toilette des femmes, à un changement analogue à celui qu’a subi depuis une centaine d’années la toilette des hommes. Avant la Révolution, le vêtement d’un homme de qualité coûtait plus cher que celui de sa femme. De nos jours, on cite comme une exception certain brillant Parisien qui dépense 20.000 francs l’an chez son tailleur, son bottier et son chemisier. Tous les hommes s’habillent avec une telle uniformité qu’un Huron transporté à Paris ou à Londres ne distinguerait pas le maître du valet. Tel sera certainement, dans un avenir plus ou moins proche, le sort du costume féminin. Du jour où le genre «tailleur», cher à votre 50 amie Lucie et à son frère, s’inaugura parmi les femmes, la révolution a commencé. Un célèbre artiste de la couture, que je consultais à ce propos, déplorait récemment devant moi qu’il n’y eût plus, à proprement parler, de toilette de ville. «On fait des visites comme l’on est, monsieur!» s’écriait-il désespéré. Il m’avoua d’ailleurs que ce «comme l’on est» revenait encore, pris chez lui, à cinquante louis. N’importe, c’est un progrès. Croyez que le temps n’est pas éloigné où l’on abolira du même coup la toilette de courses, la toilette de théâtre, la toilette de soir... ou plutôt, comme pour les hommes, cette toilette deviendra une manière d’uniforme. Il y aura un «complet habit» féminin qui coûtera soixante francs aux Batignolles et cinq cents rue de la Paix; et, la révolution accomplie, vainement on tentera, comme pour le frac des hommes, de retourner en arrière. La raison aura triomphé.
—Alors, mon oncle, dans ce temps-là il n’y aura plus de femme élégante?
—Quelle erreur, Françoise! Vous qui (je m’en suis aperçu) n’êtes pas indifférente à la toilette des hommes, diriez-vous que parmi eux il n’est pas d’élégance? «La propreté, la proportion, la bienséance», dont vous parle Fénelon, ne sont pas exclues par l’uniformité des costumes masculins, déplaisante seulement pour quelques agités. Il en va de la toilette comme du langage. Nous parlons tous avec les mêmes mots; disons-nous tous la même chose? Vienne le temps où, femmes, 51 vous n’aurez comme nous à choisir qu’entre la redingote, la jaquette et le veston, je suis bien assuré de reconnaître entre mille la souple silhouette et l’adroit ajustement de Mlle Françoise Le Quellien.
Préparez-vous à cet avenir, mon enfant, en simplifiant dès maintenant votre vêture, en cherchant l’élégance dans la beauté des tons et l’harmonie des formes plutôt que dans le nombre, la singularité et le prix d’ornements inédits. Et, puisque, ne me fiant pas à ma mémoire pour le citer, j’allai chercher tout à l’heure un Fénelon dans ma bibliothèque, j’y veux prendre encore, pour conclure, cette jolie phrase prophétique où se trouve sans doute dessiné le schéma du futur costume féminin:
«Je voudrais faire voir aux jeunes filles la noble simplicité qui paroît dans les statues et dans les autres figures qui nous restent des femmes grecques et romaines; elles y verroient combien des cheveux noués négligemment par derrière, des draperies pleines et flottantes à longs plis sont agréables et majestueuses...»
Dimanche dernier, chère Françoise, passant sur la place de la Madeleine vers les trois heures après midi, je m’avisai qu’on y devait prêcher, et l’envie me prit d’entendre à mon tour quelques bons propos de morale,—moi que vous accusez ironiquement de tourner, en vieillissant, à l’oncle prêcheur. 53
L’ample basilique, oserai-je dire, faisait ce jour-là le maximum en matinée, et le moindre siège était pourvu d’un fidèle—ou d’une fidèle. Quelques-uns, quelques-unes sommeillaient. N’en va-t-il pas ainsi dans toute assemblée où parle une seule voix humaine? Ce n’était pas, à coup sûr, la faute de ladite voix, nette et claironnante, ni du sujet, palpitant d’actualité. Imaginez que le prédicateur traitait en chaire, avec une éloquence aisée et abondante, la question du féminisme. Je n’eus pas le loisir d’écouter toute son homélie; mais, durant le quart d’heure que j’y consacrai, je pus constater qu’elle ne recommandait pas l’égalité absolue des sexes, du moins sur la terre. «Le même paradis attendait les âmes libérées du corps, au delà de la vie, que ces âmes fussent féminines ou masculines. Mais, en ce bas monde, il importait que le faible sexe eût des attributions distinctes et ne prétendît pas à des fonctions d’hommes pour lesquelles il n’avait pas d’aptitudes.» D’ailleurs, ajoutait l’ecclésiastique, «ce serait enlever à la fleur sa grâce et son parfum». J’avais déjà entendu cette théorie: j’appris avec intérêt que c’est celle de l’Église, tout au moins de l’église de la Madeleine.
La Madeleine est une paroisse élégante et riche; on y écoute silencieusement le prédicateur. S’il m’était advenu d’ouïr le même discours dans quelqu’une de ces chapelles populaires où le fidèle est admis à discuter avec le 54 conférencier, j’aurais volontiers posé une objection—j’aurais (c’est, vous le savez, le terme consacré pour de telles conférences contradictoires) «fait le voyou»:
«Monsieur l’abbé, aurais-je dit, expliquez-nous comment la femme, incapable d’après vos doctrines, et aussi d’après nos mœurs et nos coutumes actuelles, de remplir convenablement les fonctions directrices attribuées à l’homme, pourquoi cette femme, dis-je, qui ne saurait être utilement médecin, avocat, ingénieur, qui ne peut pas participer à un conseil d’administration,—peut être REINE, avec l’approbation de l’Église, et reine excellente? Dans le catalogue des souverains passés ou présents, les femmes, moins nombreuses, font assurément aussi bonne figure que les hommes. Pour n’en citer qu’une, la reine Victoria me paraît avoir assez heureusement gouverné pendant une soixantaine d’années les destinées de son pays. Cependant, cher abbé antiféministe, vous confesserez bien que l’Angleterre est une lourde affaire à mener, plus lourde qu’une maison de commerce, qu’une assemblée politique, qu’une compagnie de chemin de fer, qu’un ministère?... Alors?...»
Entre nous, Françoise, je crois savoir ce que l’abbé aurait répondu au «voyou». Il aurait répondu qu’il est des grâces d’état, dispensées par la Providence à ceux qui en ont un besoin spécial... La science dit la même chose en d’autres termes lorsqu’elle assure que «la 55 fonction crée l’organe». J’aime fort la doctrine des grâces d’état. L’abbé se doute-t-il qu’elle est merveilleusement féministe? Car, s’il est des grâces d’état pour souveraines, comment admettre que la Providence en refusera d’adéquates aux femmes avocats, aux femmes ingénieurs, aux femmes députés ou ministres? La juger si capricieuse serait bien téméraire... Quant à l’argument de la fleur qui perd son parfum, il est trop poétique pour être sérieux. J’ai toujours observé, au contraire, que l’intelligence et l’activité peuvent seules faire oublier la disgrâce physique chez une femme; en revanche, elles parent d’un attrait singulier une jeune femme jolie, à proportion même de sa jeunesse et de sa beauté. Un exemple charmant nous en fut montré un jour par cette délicieuse reine Wilhelmine de Hollande, de qui toute la France, toute l’Europe, sont unanimement amoureuses, n’en déplaise au blond cuirassier mecklembourgeois qu’elle a choisi comme époux.
Vous-même, Françoise, m’avez confié que «cette petite Wilhelmine vous plaît beaucoup...» Et, presque aussitôt, non sans avoir laissé un instant votre front se plisser méditativement, vous avez ajouté:
—Ça doit être agréable d’être reine à cet âge-là?
—Pourquoi, Françoise?
—Parce qu’on peut faire beaucoup de choses.
Ces «choses» que peut faire une reine de 56 vingt ans, je ne vous ai pas demandé de me les détailler. Peut-être n’en aviez-vous vous-même qu’une entrevision confuse. Mais je vous connais assez pour comprendre que vous enviiez à la fois, à la jeune souveraine des Pays-Bas, et le divertissement d’être maîtresse absolue de ses actes, et le pouvoir d’accomplir des actes très importants, très utiles, très bienfaisants. Avouez que vous vous sentez capable de tels actes et que, même au sortir du sermon de la Madeleine, si l’on était venu vous proposer de gouverner, de votre main délicate, quelques millions d’êtres humains, vous n’auriez pas hésité bien longtemps avant de répondre: «J’y vais!...»
Or, vous avez raison, chère petite. Dussent vos aptitudes n’être qu’égales à celles de la moyenne des gouvernants—pauvre apanage!—vous apporteriez sûrement au gouvernement des hommes ce dont la plupart d’entre eux ont perdu le secret, le culte de la beauté morale, la foi dans la justice, quelque audace dans le bien... Vous apporteriez cela avec votre féminéité, avec votre sexe même. Victor Hugo a écrit là-dessus un vers célèbre, que je ne vous cite pas, parce que vous le savez. Par cela seul qu’elle est femme, une femme rénove la fonction qu’elle prend à un homme. Qu’il est donc malencontreux, le trope métaphorique du prédicateur sur la fleur qui perd son parfum! C’est le contraire qui serait vrai: la fleur apporte son parfum dans le vase inerte 57 et l’assainit. Une reine de vingt ans est montée sur le trône des Pays-Bas: et voici que les froides tulipes de Haarlem sentent bon, soudain, comme des roses.
Réfléchissez qu’un roi du même âge, assis sur le même trône au lieu de cette aimable reine, n’eût probablement pas fait ce qu’elle a fait. Premièrement, il ne l’eût pas voulu. C’eût été, comme tous les souverains masculins du moment (sauf, peut-être, le mystérieux Russe) un utilitariste déterminé. Souverain d’un petit État, il eût niaisement pris comme type idéal Guillaume II ou Joe Chamberlain. L’État maison de commerce, la destinée d’un peuple réglée comme celle d’une entreprise financière, voilà la doctrine qui prévaut aujourd’hui dans les cours. «La garantie des droits de chacun réside dans la force qu’il possède.» Ce fut dit hier à la tribune du Reichstag. Il en résulte que, tant qu’il existe quelqu’un de plus fort que vous, vos droits n’ont pas de garantie. Beauté de la morale monarchique, patronnée par les rois contemporains!...
La reine Wilhelmine, tout simplement parce qu’elle est une jeune femme, guidée par les instincts purs et sincères d’une jeune femme, n’a pas pris pour modèle Guillaume ni Chamberlain. Quand le souverain allemand a refusé de recevoir Krüger, avec le ton d’un gros richard satisfait qui rebute un pauvre pour ne pas dégrafer sa pelisse, elle a senti son cœur se crisper. Elle a senti qu’il fallait à tout prix 58 que Lear errant trouvât au moins asile chez Cordelia. Et, malgré la pression des puissants voisins, elle l’a reçu.
C’est son cœur féminin qui en a décidé ainsi, et j’ajoute—second point digne de remarque:—«C’est parce qu’elle est femme qu’elle a pu mener à bien son généreux propos.» Un prince, à sa place, se fût incliné devant le geste du kaiser: et peut-être, après tout, eût-il dû s’incliner, en vertu de l’axiome cité plus haut «que la garantie des droits de chacun réside dans la force qu’il possède». La Hollande est un petit peuple: ses droits sont donc faiblement garantis... Le geste de Wilhelmine tendant la main au proscrit ne met pas en péril les Pays-Bas; il n’est pas injurieux pour le kaiser, par cela seul que c’est un geste féminin. A ne pas le faire, Wilhelmine eût abdiqué sa qualité de femme. Je suis bien sûr que Lohengrin, souriant sous les crocs de sa moustache, s’est dit comme nous tous: «Elle est adorable, cette petite reine!» Et quand toutes les voix se taisent en Europe, craignant de prononcer un mot trop sympathique à l’infortune, si la voix de cette reine s’élève dans le silence, soyez assuré qu’on la laissera parler, qu’on l’écoutera, parce que c’est une voix féminine. Je ne dis pas qu’elle obtiendra l’objet de sa demande; mais tout de même, s’il n’y avait eu que des rois sur les trônes européens, aucune protestation n’eût surgi contre l’abus de la force!...
Oh! oui, Françoise, vous avez bien raison 59 de penser qu’une reine—plus encore qu’un roi—peut «faire des choses...»!
N’en déplaise au prédicateur de la Madeleine, cette puissance d’accomplir, dans les fonctions d’hommes, ce que les hommes n’y sauraient faire, n’est pas limitée aux fonctions souveraines. Aujourd’hui, l’aptitude des femmes à être médecins, avocats, ingénieurs, n’est guère plus discutée; les hommes n’osent plus trop revendiquer les capacités exclusives. Paul Hervieu me contait un jour qu’Alphonse Daudet, soutenant qu’un romancier peut, à l’occasion, faire de bon théâtre, concluait par cet apophtegme familier: «Tout ça, voyez-vous, mon ami, roman ou théâtre, c’est toujours la même blague...» Gardons-nous, comme l’illustre auteur de l’Arlésienne et du Nabab, de nous prendre trop au sérieux. Confessons au sexe aimable que toutes nos fonctions, professions libérales, métiers industriels, carrières politiques, sont, en somme, toujours la même blague. Sans outrecuidance, les femmes peuvent espérer qu’elles nous y égaleront.
L’objection qui subsiste dans la plupart des esprits se résume dans le facile: «A quoi bon?» A quoi bon des femmes médecins, puisque déjà trop d’hommes sont médecins? Le barreau regorge d’avocats, à quoi bon le grever d’avocates? Dix mille jeunes Français postulent chaque année des places administratives, à quoi bon allonger la queue aux portes des ministères?
60 L’objection serait péremptoire si une femme, mise à la place d’un homme, y faisait exactement la même chose que cet homme. Mais il n’en va pas ainsi. Une femme fait, si l’on ose dire, «autrement la même chose» qu’un homme. On peut s’en convaincre dans les métiers exercés de tout temps par les deux sexes. Le couturier et la couturière, le chef et la cuisinière, le coiffeur et la coiffeuse ont des partisans adverses. La virtuosité artistique des femmes diffère de celle des hommes. Aucun peintre ne comprendra, n’exprimera jamais la poésie des fleurs comme Madeleine Lemaire; aucun acteur n’eût créé à la façon de Sarah Bernhardt le personnage du duc de Reichstadt. Cette irréductibilité du tempérament féminin et du tempérament masculin, Françoise, seuls des énergumènes la contestent; loin de la nier, les bons esprits y trouvent la raison de souhaiter que, de plus en plus, les deux sexes se partagent l’activité universelle. Beaucoup de femmes échoueront dans leur concurrence avec l’homme, soit. Celles qui n’échoueront pas feront autrement ce qu’un homme eût fait à leur place. A quoi bon Jeanne d’Arc? A mener une campagne où le plus grand capitaine eût brisé inutilement son effort. A quoi bon Wilhelmine, reine des Pays-Bas? A défendre, seule parmi les porteurs de couronne contemporains, les droits de la pitié et de l’humanité—qu’un roi, à sa place, n’aurait pas pu défendre...
Voilà ce que vous devrez répondre, chère 61 Françoise, à celles de vos pimpantes camarades qui disputent avec vous sur ces graves questions durant les récréations à l’institut Berquin. L’autre jour, m’avez-vous dit, la discussion fut ardente sur ce point, à propos de certaine femme avocat qui vient, la première, de prêter serment d’avocate. La plupart des pupilles de la digne Mme Rochette tenaient contre elle; un faible nombre l’approuvait. Vous, Françoise, je crois vous définir assez justement en disant que vous êtes antiféministe pour vous-même et volontiers féministe pour autrui. Que cent autres soient avocates, vous n’y contredirez pas; mais, pour Dieu! comme dit Panurge, vous ne voudriez l’être. Cependant, mignonne amie, réfléchissez que tout le joli sexe ne peut pas s’asseoir sur un trône ni se coiffer d’une couronne. Tout le monde ne peut pas être Wilhelmine. Alors?... Ce désir généreux de faire «des choses», qui vous anime quand vous pensez à l’aimable souveraine des Hollandais, est-il si capricieux que, seule, une chimère puisse l’exciter?... Dans l’ordre de réalités plus prochaines, ne croyez-vous pas qu’une jeune 62 fille comme vous peut, elle aussi, faire «des choses» moins éclatantes que l’acte royal de Wilhelmine,—belles, utiles, glorieuses cependant?...
Méditez là-dessus. Le délicieux Satan de Milton déclare, avec assez d’esprit pour un ange congédié, que notre paradis est partout où nous sommes. Il est non moins vrai et plus ordinairement utile de croire que nous portons notre royaume avec nous.
Il y eut peut-être un temps, Françoise, où les jeunes personnes de votre âge, glissant le 24 décembre leurs souliers dans la cheminée, croyaient d’une foi sincère que le bonhomme Noël ou le petit Jésus, en tournée bienfaisante, y déposeraient nuitamment des cadeaux... Peut-être, aussi, un temps viendrat-il 64 où les demoiselles de dix-huit ans se garderont comme d’une superstition ridicule de mettre leurs bottines dans l’âtre, même s’il est convenu implicitement (c’est votre cas) que leur mère ou leur oncle se chargent de les remplir...
Vous, Françoise, la destinée vous fit naître à une époque intermédiaire. La tradition vous touche encore assez fortement pour que vous aimiez—par sympathie respectueuse—les gestes que vos grand’mères accomplissaient avec ferveur. Votre pensée intime semblerait probablement à ces respectables aïeules bien libre, bien émancipée, et tout de même vous agissez en apparence exactement comme elles. J’estime que vous avez raison. Dans toutes les circonstances où s’exerce souverainement l’arbitre mystérieux de la conscience, une femme, une jeune fille, doit, sans abdiquer l’esprit critique, apporter une bonne grâce tolérante. Il lui sied d’être à la fois curieuse de vérité et amicale aux traditions.
La tradition religieuse, la tradition populaire, s’unissent pour faire de cette dernière semaine de l’année quelque chose à la fois de grave et de gai, une période où l’esprit trouve des minutes pour se divertir et d’autres pour méditer. Soyez sûre que, parmi les plus indépendants, les plus froids d’entre nous, il n’en est pas un qui ne sente passer sur son cœur, pendant cette suprême huitaine, des espoirs et des regrets, des nuages mélancoliques et de chaudes effusions de clarté. On a beau se dire 65 que l’année commence tous les jours, que le calendrier, tel qu’il est, résulte d’une fantaisie combinée de géomètres et de papes: la force des habitudes héréditaires est si impérieuse que, pour tout le monde, entre le 25 et le 31 décembre, le poids du passé se fait plus lourd, tandis que l’avenir s’impose à notre attention plus attrayant, plus inquiétant. C’est comme une halte prolongée entre hier et demain; elle force à réfléchir ceux-là mêmes qui ont le plus coutume de vivre au jour le jour... Cette fois nos réflexions s’aggravent de ce que le siècle finit en même temps que l’année. On va, semble-t-il, vieillir de cent ans. Tout naturellement, de ce dernier palier où nous voilà, on s’arrête pour considérer un plus long bout de la route. Les actifs reporters, habituellement satisfaits quand ils sont venus demander aux écrivains leur opinion sur l’année échue, prétendent en l’occasion nous arracher un jugement «sur le siècle». Et vous-même, Françoise, ne m’avez-vous pas dit que, l’autre jour, à l’institution Berquin, on vous proposa, comme composition de «style», une sorte d’inventaire des conquêtes morales, scientifiques, artistiques, du XIXe siècle?
Je vous ai demandé, à ce propos, de me laisser parcourir votre travail.
—Jamais de la vie, m’avez-vous répondu. D’abord, j’ai déchiré ma copie dès qu’on me l’a rendue. Et puis, je n’avais rien su trouver d’intéressant. J’ai parlé des inventions célèbres; j’ai cité des noms de poètes et de 66 savants, entre autres Victor Hugo et Pasteur. Mais, au fond, je ne me sentais pas de force pour traiter la question.
Vous fûtes en cela modeste, mais avisée. Rien n’est plus malaisé que de juger un temps où l’on a vécu. Même en vous, qui y avez vécu si peu d’années, il a mis trop de ses mœurs pour que vous puissiez l’apprécier de sang-froid. Et moi comme vous, encore que le siècle m’ait ouvert vingt ans plus tôt un crédit sur ses années... Discutons donc comme il nous plaira le bilan du siècle; mais sachons que nos conclusions seront certainement bouleversées par les philosophes de demain. Offrons-leur nos idées là-dessus comme un document sur l’opinion contemporaine, et rien de plus.
A ce point de vue, je regrette l’accès de mauvaise humeur qui vous fit détruire votre composition de style. Si le hasard y avait mis quelque complaisance, on pouvait espérer que, vers l’an 2000, un érudit, dénichant ce précieux inventaire, l’eût publié comme un témoignage de l’état d’esprit féminin vers la fin de 1900. Plus curieux encore eût été le document si votre maîtresse de «style» eût posé la question de façon moins vague, de façon à vous permettre d’exprimer directement votre tempérament et votre esprit.
A sa place, j’aurais dicté le sujet ainsi:
«Une jeune fille achevant ses études au cours de l’année scolaire 1900-1901 examine 67 ce que le siècle finissant lui laisse d’idées nettes, de souvenirs historiques précieux, de sentiments dominants; et elle cherche à prévoir comment elle utilisera au siècle suivant un tel héritage.»
Vous eussiez traité la question, j’en suis sûr, avec beaucoup d’agrément. Et, comme je vous connais assez bien, je devine à peu près ce que vous auriez dit... Vous hochez la tête? Vous me mettez au défi de faire votre composition? Je tiens la gageure. Un instant je vais m’imaginer que je suis Françoise Le Quellien, assise devant son pupitre noir, tout au fond de cette classe aux murs vert d’eau que vous m’avez montrée furtivement, l’an dernier, après la distribution des prix... Quand je vous reverrai, vous me direz si vous eussiez consenti à signer cette copie.
INSTITUTION BERQUIN
Composition de Mlle Françoise Le Quellien
«Les idées nettes que lègue le XIXe siècle à mon esprit?... Grave problème. Il me semble que beaucoup d’idées ensemble meublent ma tête, et que ces idées ne devaient pas être toutes, ni dans le même ordre, logées en une tête de jeune fille, il y a cent ans. Mais ces idées nombreuses manquent de netteté et d’harmonie. En matière religieuse, j’ai encore de la piété; mais j’ai le goût de la discussion. En politique (c’est un peu ridicule à dire quand 68 on n’a pas dix-neuf ans), je suis d’avance sceptique et dégoûtée. Le faible écho qui m’arrive des discussions parlementaires me semble confus et discordant, et je vois avec surprise des gens d’apparence raisonnable se haïr parce qu’ils ne s’entendent pas sur la valeur du ministère. Restent les grands principes généraux de morale et d’humanité, dont il fut beaucoup parlé, assure l’histoire, à plusieurs reprises dans le courant du siècle. Ce goût de la pitié pour les humbles que je sens en moi très impérieux, peut-être en effet est-ce un legs dont je suis redevable au siècle où je suis née. Seulement, aujourd’hui que je commence à m’informer des événements accomplis sur la surface du globe, je suis frappée du démenti que les faits donnent aux idées, et cela m’irrite contre mon temps. Les rois et les peuples mêmes me semblent animés d’un esprit d’égoïsme sauvage tellement contraire et aux appétits de mon cœur et à ce qu’on m’enseigna comme principe de civilisation! Ma bonne foi, mon désir ingénu du bien, sont déroutés.
«Exemple: il y a deux ans, les mandataires de tous les peuples se réunissent à la Haye: ils préconisent la paix et l’arbitrage, ils signent 69 une convention par laquelle le pillage est interdit. Deux ans plus tard, deux guerres impitoyables mobilisent un demi-million d’êtres humains, deux guerres aussi atroces qu’il en fut jamais. L’un des belligérants demande l’arbitrage. Les puissances se gardent bien de l’aider à l’obtenir; elles font la sourde oreille et conversent d’autre chose. En revanche, elles s’unissent, d’un accord bien plus parfait que celui de la Haye, pour piller en famille les particuliers de la Chine... Comprend-on le désarroi où de tels événements jettent l’ingénuité de mes dix-huit ans?
«Autre legs du siècle, me dit-on: les conquêtes de la science. Je les vois de mes yeux: chemin de fer, télégraphe, téléphone, éclairage électrique, becs incandescents, automobiles, découvertes pastoriennes, critique historique... J’ai, de ce progrès universel, une notion assez claire. Mais puis-je ignorer que des esprits considérables proclament, au bout de tant d’efforts, la banqueroute de la science? Il paraît que le merveilleux instrument de conquête légué par le XVIIIe siècle à son successeur s’est faussé à l’usage. On comprendra qu’il n’appartienne pas à une petite demoiselle de dix-huit ans de prononcer la sentence et de dire qui a raison, des «scientistes» ou des «antiscientistes». Mais on accordera en même temps que je ne doive accepter que sous le bénéfice d’un inventaire minutieux un héritage aussi décrié...
«Il y a encore un héritage artistique, littéraire, 70 etc... Je n’ai pas de compétence pour l’estimer par moi-même. Si je m’en rapporte aux critiques, je suis fort en peine. Une anarchie intellectuelle absolue me paraît être leur régime. Ils jugent beaucoup d’après leurs amitiés personnelles et leurs passions politiques: la preuve, c’est que je sais d’avance comment tel critique appréciera l’œuvre nouvelle de tel écrivain. Eux-mêmes se lamentent entre eux sur la décadence de la critique et son absence totale d’influence. Aussi n’aperçoit-on plus ces «grands courants» de la littérature et de l’art, signalés (soyons érudite!) par Georges Brandès... Donc, je ne demanderais pas mieux que de me passionner, comme au temps du romantisme, du naturalisme, du wagnérisme... Mais pourquoi se passionner? J’ai des sympathies pour telle ou telle œuvre, pour tel ou tel artiste; mais je n’ai, en conscience, aucune doctrine artistique. En cette manière, le siècle ne me lègue rien du tout. C’est des jours à venir que j’espère l’enthousiasme.
«Quant aux grands souvenirs historiques, ils m’inspirent, malgré mon âme tendre, une défiance extrême. Ce n’est pas que je sois défiante par nature; mais on a détruit une à une toutes mes croyances. D’abord, en bloc et en détail, on m’assure que la Révolution a fait faillite. C’est-à-dire que la base même du siècle s’écroule. D’autre part, tous les principes idéalistes, qui semblaient constituer l’essence même de l’esprit du XIXe siècle, sont officiellement honnis aujourd’hui... Il faut réviser les 71 jugements portés par l’historien depuis cent ans. Les faits et les principes sont également discutés. Déclaration des droits de l’homme: niaiseries. Volontaires de 92: légende. Napoléon Ier: une résultante. Mouvement social de 48: clownerie. Principe des nationalités: aberration d’un maniaque. La France champion du droit: criminelle duperie. Le siècle était parti dans un mouvement de fraternité, de justice; il s’achève dans l’apothéose de l’argent et de la force. La plus grande nation est celle qui gagne le plus d’argent et qui peut commettre impunément le plus d’iniquités. Voilà la morale de 1900.
«En somme, de quelque côté que je regarde, je ne vois que des faillites. Sur toute la ligne, le XIXe siècle liquide avec perte. Dieu me garde d’accueillir un si dangereux héritage!—Va-t’en achever ta liquidation dans la fosse commune du passé, vieux siècle qui n’as tenu aucun des engagements de ta jeunesse! Merci pour les dix-huit années de vie que tu m’as données: mais je suis bien aise d’offrir les suivantes à des temps nouveaux...
«... J’écris cela... et il me semble que le pauvre vieux siècle agonisant me répond d’un ton de reproche: «Tu es injuste. Je meurs en pleine faillite, c’est vrai, et j’ai une laide agonie; mais toi seule, jeune fille, devrais t’interdire de m’accuser. Car, au milieu de ma triste vieillesse, j’ai pensé à toi, je t’ai aimée. Ce qui me restait de goût et de force pour l’idéal, je te l’ai consacré. Si tu es 72 demain plus libre, plus respectée, plus utile, ce sera grâce à l’héritage que je te laisse, car, durant les dix-huit années que je t’ai données, tu as pris de ta force, de tes droits, de ton avenir, une conscience que n’avaient pas tes aînées. Porte donc dans le siècle nouveau la vigueur d’espoir, le désir du bien, la foi en la justice que les hommes de ce temps ont perdus. Tu représentes la seule énergie ascensionnelle qui subsiste, tendue vers l’idéal. N’est-ce pas un grand rôle?»
Peut-être bien, chère Françoise, si vous aviez remis cette composition à Mme Rochette, vous eût-on classée la dernière, ou accusée de mauvais esprit. Mais je suis bien certain que vous eussiez exprimé l’intime pensée de votre cœur, qui est aussi ma pensée intime. Oui, dans le dégoût et le désordre de tout, le seul mouvement généreux, fécond, c’est celui qui porte la femme de notre temps vers une collaboration avec l’homme, plus efficace, plus libre, plus égale. En vous empruntant vos énergies,—jeunes filles, jeunes femmes,—peut-être l’humanité se sauvera-t-elle de la banqueroute définitive...
Prenez au sérieux votre mission de demain, ironique Françoise; méditez-la pendant la halte séculaire de cette dernière semaine. «Vous êtes le sel de la terre, comme disait le divin enfant de Noël. Si le sel perd sa saveur, par quoi le remplacer?»
Il vous souvient, chère Françoise, que vendredi dernier je fus chargé par vous d’une mission de confiance, dont je ne m’acquittai pas sans fierté. Mme Le Quellien, qui a la gorge délicate, vous avait paru un peu souffrante lors de votre récente sortie. Depuis, le médecin lui interdisait de quitter la chambre par 74 les jours assez froids que nous traversons, et vous n’accordiez pas une foi absolue aux lettres rassurantes qu’elle vous écrivait. Un petit bleu signé de vos initiales me pria donc d’aller m’enquérir de visu de l’état réel de Mme Le Quellien et de vous en apporter le jour même un fidèle bulletin au parloir de votre pension, où je serais, par faveur spéciale, admis à vous voir pendant la récréation méridienne.
Il vous souvient aussi que j’eus seulement avec vous un très court entretien. A peine arriviez-vous au parloir que sonna la fin de la récréation. Ma commission, heureusement, ne fut pas longue à faire; je vous rassurai en deux mots, je vous embrassai paternellement sur le front; comblé de vos gentils remerciements, je vous vis, avec trois de vos compagnes appelées aussi au parloir à titre exceptionnel, vous éloigner bien vite et regagner les bâtiments de l’école.
Je n’eus donc pas le temps de vous raconter que je vous avais attendue bien près d’une demi-heure. Sans doute, l’on vous avait mal cherchée, ou bien la préposée au parloir avait requis des autorisations supplémentaires pour vous convoquer ainsi un vendredi, hors des circonstances officielles... Ne me plaignez pas. Assurément, j’aurais préféré jouir plus longtemps de votre compagnie, mais, en vous attendant, je ne m’ennuyai guère. J’aime fort le parloir de l’institut Berquin, agréablement isolé des bâtiments principaux, installé en 75 plein parc dans un vieux petit hôtel daté de 1840, sage caprice de quelque bourgeois de jadis. On dut l’acheter tout meublé quand on l’annexa à l’institution, car les fauteuils et les chaises d’acajou plaqué, décorés de reps à bande de tapisserie faite à la main, le piano, boîte rectangulaire posée sur deux X, avec la pédale montée sur une lyre, et les prétentieuses gravures appendues aux murailles, composent un style parfaitement harmonieux... De l’un ou de l’autre des deux salons du rez-de-chaussée, la vue est agréable, soit qu’on découvre le jardinet bien entretenu de l’entrée ou le bosquet du fond, un peu sombre et humide, grâce à une trentaine de vieux arbres tels qu’il n’en reste plus beaucoup à Paris.
Chaque fois qu’il m’arrive de vous attendre en ce lieu discret, je parcours les tableaux d’honneur qui y sont affichés; les noms qu’ils exposent me sont aujourd’hui familiers. J’applaudis aux succès de Mlle Louise Leleu, major incontestable de la classe nacarat-uni. Dans la classe verte, Fernande du Saussoy défend énergiquement le premier rang en histoire. Quant à Françoise Le Quellien, elle tient une place enviable dans les mentions de la classe supérieure, préparatoire aux examens: mon orgueil d’oncle s’en émeut. Que si d’aventure l’attente se prolonge, il ne tient qu’à moi d’ouvrir un des trois volumes, toujours les mêmes, déposés sur le guéridon, et de m’y rafraîchir la mémoire touchant l’histoire du Canada français, consignée en fort bon langage par un 76 certain M. Bonafoux, vraiment trop peu connu pour son mérite.
Il y avait dix minutes environ qu’assis dans le parloir du fond je relisais ainsi les derniers moments de M. de Montcalm, quand des pas vifs montèrent l’escalier du perron, puis un bruissement de soie égaya le silence de la pièce d’entrée. Sans me déranger de mon refuge, je vis, reflétée dans une glace d’angle, la gracieuse silhouette d’une jeune femme vêtue avec une élégance recherchée, et dont le profil perdu me parut agréable. Elle ne m’aperçut pas, ne pénétra même pas jusqu’à la salle où je me trouvais, distraite aussitôt par trois autres silhouettes qui apparurent dans le parloir d’entrée, silhouettes de pensionnaires, celles-ci, que mes yeux connaissaient déjà. Des prénoms furent prononcés avec des rires, de petits cris, des baisers, des exclamations de surprise et de tendresse. «Yvonne!... Juliette!... Suzanne!... Madeleine!...» Durant cinq bonnes minutes, les trois pensionnaires et l’élégante visiteuse parlèrent et rirent tout à la fois, et toutes à la fois, ce qui est un privilège charmant de la conversation féminine.
Quand ce premier feu s’apaisa, la visiteuse—Yvonne—donna des renseignements volubiles sur sa situation présente, qui ne semblait pas lui déplaire. Je compris—car j’entendais tout sans avoir besoin d’écouter—qu’elle avait quitté quelques mois auparavant l’institut Berquin pour se marier, qu’elle avait fait un 77 voyage de noces «oh! merveilleux, mes chéries!...» en Espagne, qu’elle rentrait tout justement à Paris et s’installait, en ce moment même, dans un appartement ultra-moderne de l’avenue Malakoff. Les mots «mon mari» revenaient à chaque seconde dans sa pétulante conversation, mais presque toujours comme régime de phrases inaugurées par le pronom: je... «J’ai dit à mon mari... J’ai envoyé mon mari... J’ai demandé à mon mari... Je ne permettrais pas à mon mari...» etc... En sorte que ce personnage absent m’apparut sous la figure d’un modeste et docile complément, soucieux à bon droit de son accord avec le sujet.
—Au fond, il est très gentil, conclut la jeune femme. Pas très, très fort... d’ailleurs, j’aime mieux ça. Il ne me fallait pas un mari trop intelligent. Il m’adore et fait tout ce que je veux.
—C’est l’idéal, dit Juliette.
—Tu en as eu, une veine! soupira Suzanne.
—Avec cela, il est très bien de sa personne, insinua Madeleine.
—Oh! très bien, corrigea Yvonne, c’est trop dire. Il n’est pas mal, surtout depuis que je l’habille. Mais ce n’est pas absolument mon type. Il lui manque deux centimètres et il a une tendance à engraisser: j’ai horreur de ça. Aussi je lui interdis de boire à ses repas... Mais, au fait, à propos de jolis garçons, le délicieux Maxime vient-il toujours au parloir?
A peine ces mots: «le délicieux Maxime» 78 furent-ils prononcés que le tumulte des quatre voix recommença. Le délicieux Maxime passionnait tout le monde... Oui, il venait presque chaque dimanche rendre visite à sa sœur, Lucie Despeyroux. Et, pour le voir, ces demoiselles, principalement celles des deux classes supérieures, employaient mille ruses. Celles qu’on n’appelait point au parloir trouvaient moyen d’y venir sous prétexte de transmettre quelque commission. Les plus hardies se risquaient à parler à Lucie, afin d’approcher plus près de Maxime. Hélène Cantemerle avait composé pour lui une pièce de vers: on ne croyait pas, toutefois, qu’elle la lui eût envoyée.
—Enfin, vous êtes toutes amoureuses de lui, conclut Yvonne en riant,—comme de mon temps!... Moi aussi, j’ai eu pour lui ma petite toquade. Mais cela m’a passé.
—Tu pourrais le revoir sans émotion? dit Suzanne.
—Mais oui... Je suis une vieille femme mariée, maintenant. C’est bon pour vous, petites perruches, de vous surexciter comme cela en cage.
Cette réflexion d’Yvonne me parut très juste. J’étais en train d’en faire d’analogues, à part moi.
79 «Certes, me disais-je, tout ce que viennent de dire librement ces jeunes filles, qui ne se savent pas entendues, est absolument innocent et prouve même, par l’impétuosité naïve des propos, leur foncière innocence. Tout de même, trois petites jeunes filles anglaises ou américaines ne parleraient pas ainsi. Elles analyseraient plus froidement les mérites du joli Maxime Despeyroux et le considéreraient au point de vue exclusif des chances matrimoniales qu’il leur offrirait. Il ne deviendrait pas pour elles une sorte de personnage mythique, un Lohengrin ou un Amadis. Les cœurs ne se consumeraient pas d’une flamme si romanesque dans le silence des dortoirs et des études... Dieu!... que cette éducation claustrale, à l’écart du monde, isolée soigneusement de tout rapport avec les jeunes gens, échauffe l’imagination et trouble le cœur des pauvres petites demoiselles! Si, depuis leur enfance, les trois que voilà jouaient aux barres ou faisaient de la bicyclette avec divers saint-cyriens ou aspirants de Saint-Cyr, comme avec des frères ou des cousins, elles regarderaient Maxime Despeyroux d’un œil plus tranquille...»
J’interrompis mes réflexions. Yvonne disait, répondant à de pressantes questions:
—Oui... on me fait pas mal la cour... Mais vous savez, mes mignonnes, à Paris les très jeunes femmes n’ont pas beaucoup de courtisans. Et puis, moi, je suis sérieuse!
80 «Hum! pensai-je... Voilà qui va bien, et le mari-complément a de la chance de posséder une si grave moitié!... N’importe! celle-ci me paraît bien brusquement promue à l’état d’épouse et bientôt, sans doute, de mère de famille, car il lui reste, à l’évidence, dans le cerveau, pas mal des fumées qui obscurcissent l’entendement des trois petites pensionnaires... Dire que celles-ci aussi seront peut-être des épouses dans un an, des mères dans deux ans!... L’amour, la liberté, le devoir, l’ordre, l’autorité, il faudra qu’elles apprennent tout cela d’un coup, pauvres gamines!... Décidément, l’éducation claustrale, préludant au mariage impromptu, est tout ce qu’il y a de plus absurde... N’est-ce pas désolant que personne, à ces fillettes tourmentées par leur imagination, ne soit ici désigné pour leur parler précisément de ce qui les attend demain, pour leur donner d’avance un peu de sérénité et de discernement dans la lutte avec l’autre sexe, pour les préparer, en un mot, à être des femmes?... Mais non, ce rôle ne tente personne. Toutes les dignes maîtresses qui président à l’enseignement des deux cents élèves de Berquin ignorent que la moitié de l’école est toquée d’un uniforme.»
J’en étais là, chère Françoise, et de nouveau je prêtais l’oreille au bavardage de mes quatre voisines, quand vous parûtes à votre tour dans le parloir d’entrée. On vous fit fête. La fringante Yvonne vous demanda:
81 —Et toi, Françoise, es-tu toquée aussi de Maxime Despeyroux?
Je vous vis, dans la glace, rouge jusqu’au front, ce qui est bien naturel après une question aussi saugrenue. Mais votre réponse fut parfaite.
—Oh! dites-vous... Je suis tellement liée avec Lucie, vous savez!... Pour moi, Maxime est comme une sorte de parent.
—Oui, ma chère, appuya Suzanne avec véhémence.—A-t-elle de la chance, cette Françoise. Elle voit Maxime de près... Elle va chez lui... Elle lui parle!...
—Et elle n’en perd pas la raison!... s’écria Juliette.
—Tiens, tu n’as pas de cœur, résuma Yvonne.
—Excusez-moi, fîtes-vous en souriant... Mon oncle est là qui m’attend.
Là-dessus, lestement, vous prîtes congé du petit groupe, qui se mit à chuchoter, assez penaud d’apprendre que l’entretien avait eu un témoin, indiscret par profession.
Chère Françoise, vous ne sauriez croire combien il m’a plu de ne pas vous entendre divaguer sur le compte du joli saint-cyrien, de concert avec vos quatre toquées d’amies. Elles disent que vous n’avez pas de cœur: moi, je n’en crois rien. Seulement, ce cœur innocent n’a encore battu pour personne. Mais, le jour où il battra, j’espère bien que le secret de cette grave chose sera gardé par vous 82 soigneusement, confié à des conseillers rares et fidèles,—et non dispersé, divulgué au hasard, comme les toquades des trois petites perruches de Berquin et de l’inquiétante Yvonne.
Je vous ai promis, Françoise, ma jolie nièce, quelque chose de plus précis, sur le système idéal d’enseignement, que les prudentes généralités où se cantonnent d’habitude les détracteurs des systèmes en usage. Il ne suffit pas de clamer à tout bout de champ: «Dieu! que ces programmes sont mal faits! 84 que de peine perdue! que de temps gaspillé!» Il ne suffit même pas de donner les raisons de son dégoût: il importe de proposer un régime nouveau et de prouver qu’il serait préférable. Or, les ministres succèdent aux ministres, les commissions se renouvellent: rien de sensiblement meilleur n’apparaît dans l’art d’enseigner les jeunes gens—garçons ou filles. Comme les ministres ne sont pas des sots ni les commissions des paresseuses, il faut croire que le cas est incommode.
—Mais alors, mon oncle, puisque vous prétendez m’offrir un système excellent, définitif, vous vous jugez plus fort, à vous tout seul, que les ministres et les commissions?
—Non, ma nièce. Je sens et je déplore mon infirmité. Ma seule supériorité, pour résoudre ce problème, consiste précisément à n’être point ministre et à ne faire partie d’aucune commission.
Autre chose est d’élaborer un plan d’études, parmi les soucis de la politique, dans un bureau officiel où l’on est à chaque instant dérangé par un huissier, par un chef de cabinet, par des membres du Parlement, par ses collègues,—autre chose est d’être assis, comme je le suis en ce moment, chez soi, dans une maison dont on paye le loyer et dont nul revirement politique ne peut vous expulser, à une table sur laquelle, il est vrai, ni Duruy ni Cousin n’écrivirent, mais qui vous appartient en propre et n’appartiendra à d’autres qu’après votre mort. Autre chose surtout est 85 de tenir sa porte rigoureusement consignée aux importuns, de goûter l’indépendance sereine d’un meunier de Sans-Souci...
Tel est mon cas, Françoise. Je médite, j’écris pour vous en un plein repos, comme dit Pascal. Devant moi, les arbres, les petits massifs de mon jardin, me masquent Paris: j’aperçois seulement les deux tourelles du Trocadéro, lesquelles, ainsi vues de profil, dans la buée du matin, font vaguement songer à une double image de la Torre del Mangia, de Sienne... A portée de mes mains, nul dossier indigeste, nul texte menaçant d’interpellation, nul rapport de bureaucrate à parcourir; mais bien le Corpus Poetarum, édition de Francfort, 1621,—le troisième volume des œuvres morales de Plutarque, traduites en français par Bétolaud,—des vers d’Henri de Régnier, le dernier numéro de la Revue de Paris... Comprenez-vous, chère enfant, que l’esprit, en de telles conditions, s’exerce plus librement à la méditation pure, à l’élégance des solutions?
Profitons de cette paix, de cette sécurité, de la légèreté de l’air et de la clémence du ciel pour étudier ce grave sujet: l’enseignement secondaire des jeunes filles.
L’enseignement secondaire des jeunes filles! Quelle association barbare de deux mots charmants avec deux vocables pédantesques! Il me semble entendre Baron ou Coquelin Cadet vous demander avec leur voix de comiques: «Mademoiselle, que pensez-vous de l’enseignement secondaire?» Vous leur ririez au 86 nez en disant: «Je m’en moque...» Prenez garde, cependant, Françoise, ma nièce. L’enseignement secondaire vous touche directement, puisque vous «en faites» en ce moment, aussi inconsciemment peut-être que M. Jourdain faisait de la prose. Et toutes les têtes de votre âge, blondes, châtain, rousses ou brunes, qui se penchent comme la vôtre, à l’heure qu’il est, sur les pupitres de l’institut Berquin, «font» de l’enseignement secondaire. Souffrez donc que je vous explique ces deux mots pesants et, par la même occasion, quelques autres du même poids.
Vous n’eûtes pas encore le temps, Françoise, de vous occuper à planter des arbres. Moi qui suis un vieux campagnard, j’en ai planté pas mal dans ma vie, notamment des pêchers, ayant un faible pour les pêches. Or, quiconque n’a jamais eu, comme vous, de rapport avec des pêches que pour les manger n’imagine pas le soin qu’on doit prendre d’un pêcher pour le décider à porter des pêches mangeables.
D’abord il faut greffer le sauvageon de la pépinière, c’est-à-dire incorporer à une plante qui naturellement ne produirait jamais aucun fruit viable l’aptitude à en produire. Quelquefois la greffe réussit; souvent elle avorte: dans ce dernier cas le sauvageon restera sauvageon toute sa vie.
Ensuite il faut ôter le pêcher greffé de sa pépinière, le transplanter dans l’endroit où il devra vivre, grandir, fructifier avec le temps. Il ressemble alors à un simple bâton portant à 87 un bout trois ou quatre ramilles de la longueur d’un doigt, et à l’autre quelques filaments de racines. N’allez pas croire qu’on se contente de ficher ce bâton en terre et de lui dire: «Pousse, maintenant; débrouille-toi!» Il faut d’abord creuser un large trou, très large, très profond, le plus large et le plus profond possible, et remplir ce trou, destiné à recevoir les racines de l’arbrisseau, d’une terre composée à dessein, particulièrement légère, nourrissante, assimilable: car les radicelles du pêcher sont trop faibles et trop inexpérimentées encore pour extraire spontanément leur nourriture d’un sol quelconque. Ce n’est pas tout. Il faut, à côté de la tige du jeune arbre, planter une forte perche pour la soutenir, pour la forcer à monter en ligne droite; comme on a imposé à l’arbre ses aliments, on lui impose sa route aérienne. Ce n’est pas tout encore. Quand, au cours des saisons, le pêcher adolescent allongera ses rameaux, débourrera ses feuilles, s’ornera même de quelques fleurs, n’imaginez pas qu’on le laissera vaquer à ces fantaisies décoratives. On lui coupera bon nombre de rameaux, rognant impitoyablement ceux qui ne concourent pas à l’harmonie de l’arbuste. Que dis-je? On aura le triste et nécessaire courage de lui arracher ses fleurs, presque toutes, car elles useraient inutilement la sève et ne donneraient pas de fruits dignes de ce nom... Et ce traitement barbare se prolongera jusqu’à ce que l’arbre soit considéré comme formé.
88 Alors seulement on le débarrassera de son tuteur: le tronc, déjà fort, continuera tout seul à pousser droit. Déjà les racines, peu à peu développées, atteignent les limites de la niche souterraine qu’on leur avait préparée; elles vont pénétrer dans une terre grasse ou maigre, sable, argile, humus, cailloux même. N’importe: elles sont assez robustes désormais, assez intelligentes et assez volontaires pour choisir leur nourriture, pour tourner les obstacles. Au besoin, elles sont assez patientes pour fendre lentement les pierres. De même on laissera les fleurs s’épanouir librement et librement se transformer en fruits. L’arbre adulte suffit maintenant au labeur de sa fructification. Le jardinier n’a plus qu’à l’émonder en hiver, à le fumer au printemps, à l’arroser en été et à faire, dans la saison, la récolte des pêches.
Eh bien! Françoise, les trois états que je viens de vous décrire ressemblent, à peu de chose près, aux trois périodes de la formation complète, lorsqu’il s’agit non plus d’un pêcher, mais d’un élève.
Le temps de pépinière, où l’on greffe le sauvageon, c’est l’enseignement primaire;—la délicate période qui suit la transplantation correspond à l’enseignement secondaire;—l’enseignement supérieur, c’est la troisième période, où l’arbre adulte commence à respirer, à croître, à fleurir et à donner des fruits sous le regard encore vigilant du jardinier.
Votre clair esprit a tout de suite deviné que 89 la période la plus délicate de la culture, pour l’élève comme pour le pêcher, c’est la période secondaire. Alors, en effet, le sujet commence à manifester son impulsion propre vers la croissance, vers la vie, et cependant cette impulsion ne suffirait pas à assurer la croissance et la vie. La période secondaire est donc toujours une période d’éducation, de ferme tutelle. Mais cette tutelle éducatrice serait mortelle au sujet si elle aboutissait à contrarier la loi de son développement naturel, à le surmener ou à le rabougrir.
Faut-il donc s’étonner que, des trois enseignements, le secondaire soit celui qu’on essaie de réformer le plus souvent et qui laisse encore aujourd’hui, chez nous comme ailleurs, le plus à désirer?
Si cela peut vous intéresser, Françoise, je vous dirai en passant que nous avons en France un fort bon enseignement supérieur. Quant à l’enseignement primaire, il a fait de tels progrès depuis une trentaine d’années qu’il est aujourd’hui à peu près excellent. Dans un village près duquel j’habite quelques mois au printemps et à l’automne, il m’arrive parfois de passer un moment à l’école primaire, où le maître veut bien m’admettre. Filles et garçons y consomment en commun la manne scolaire. Eh bien! je suis émerveillé de l’ingénieuse façon dont on enseigne à ces petits, à ces petites, la lecture, l’écriture, le calcul, la géographie. On était, de mon temps, loin de ce sens pratique, de cet ordre intelligent. 90 L’homme qui, apprenant à lire aux enfants, inventa de leur faire appeler R, «re», F, «fe», Q, «que», me paraît avoir possédé une sorte de génie... Et cet autre aussi qui imagina de commencer l’enseignement de la géographie en traçant à la craie, sur le tableau, le plan de la classe, avec les bancs, la chaire et la bibliothèque, puis autour de ce plan celui de la maison d’école, puis celui de la placette, des rues du village, de la commune... Si je pouvais découvrir le nom de ces deux initiateurs, je tâcherais qu’on leur élevât aussitôt deux statues...
La réforme de l’enseignement primaire a été accomplie, sans fracas et sans heurt, en quelques années, après la terrible guerre de 1870. C’est que nos paysans n’ont pas, comme les bourgeois, des idées personnelles—et quelles idées!—sur la façon d’enseigner leur progéniture. On disposa d’une «matière scolaire» malléable. On put, sans que nul protestât, inaugurer des méthodes nouvelles, non seulement de didactique, mais de pédagogie. C’est ainsi—peu de gens le savent—que, dans le tiers des écoles communales de France, la coéducation des deux sexes s’est acclimatée sans le moindre inconvénient.
Par l’esprit des parents, retenez cela, Françoise, doit commencer la réforme de l’enseignement secondaire: c’est le seul enseignement où les parents prétendent intervenir. L’élémentaire ne les intéresse pas, et le supérieur excède trop évidemment leur compétence.
91 Aussi est-ce à Françoise bientôt émancipée, bientôt mariée, et dans quelques années mère d’une charmante petite Françoise II, que ma présente lettre s’adresse. Si cette lettre vous ennuie aujourd’hui, ou si vous n’y découvrez point de profit direct, mettez-la de côté, conservez-la pour la relire au temps utile,—quand Françoise II aura fait sa dentition seconde.
Nous supposerons, chère Françoise, le jeune objet de l’enseignement secondaire en possession—à dix ans—de toutes les connaissances que nos pères résumaient en ces termes: lire, écrire et compter. Avec quelques notions sur la figure de la terre, la place et le nom des grands pays, les divisions générales de l’histoire, nous aurons un enseignement primaire très suffisant. Et encore, à tout prendre, j’accepterais une élève qui ne saurait rigoureusement que lire, écrire et compter... Quelques mères se récrient:
—Quoi! à dix ans, une fillette ne saurait que lire, écrire et compter?... La mienne, monsieur, n’a pas neuf ans et demi, et déjà elle commence le latin; déjà elle fait des «styles».
Fort bien, madame. Moi, je m’en tiens à mon programme, en y ajoutant, pour utiliser la 92 mémoire et le souple gosier de l’enfance, la pratique usuelle, sans grammaire, d’une langue étrangère (l’anglais est décidément indispensable) et les éléments du solfège. Sachant ainsi couramment lire, écrire et compter, jabotant l’anglais usuel, connaissant ses notes de musique, notre petite demoiselle arrive devant le maître et lui offre sept années de sa vie. Qu’allons-nous lui apprendre durant ces sept ans?
Rappelons-nous nos principes de bon jardinier. L’enseignement secondaire est une éducation, une tutelle. La petite Françoise II, qui sait lire, écrire et compter, a appris tout cela beaucoup plus par la mémoire que par le raisonnement. La petite Françoise II ne sait pas encore, en somme, ce que c’est que de travailler et d’apprendre. Ce qu’elle sait, on le lui a patiemment inculqué en le lui répétant à satiété; on l’a greffé sur le sauvageon. Elle va se développer maintenant d’un essor personnel; mais, si ce développement n’était surveillé, guidé, accéléré ou ralenti à chaque heure, il risquerait d’aboutir à la stérilité ou à l’épuisement... Heures du travail, objet du travail, tout cela devra donc être préparé et fixé par le maître: la contribution de Françoise II, c’est l’effort de comprendre et d’apprendre. Et non seulement l’enseignement secondaire doit être ainsi initiateur et tutélaire, il doit être au besoin restrictif. Quand le jardinier diligent arrache les fleurs du petit pêcher, le citadin qui passe crie à l’attentat. Laissons 93 crier le citadin qui passe, et persistons, durant les années où la plante se forme, à guider la nature, laquelle ne consent à produire des fruits savoureux que sous la contrainte de l’homme.
Or, une des plus fâcheuses tendances modernes, c’est d’appliquer à l’enseignement secondaire la méthode qui convient au seul enseignement supérieur. On dit aux petits pêchers, tout juste sortis de la pépinière et replantés en pleine terre: «Maintenant, tirez-vous d’affaire!» Et sans doute quelques-uns s’en tirent; mais, il faut bien l’avouer, beaucoup ne donnent que des fruits misérables, ou pas de fruit du tout. L’avortement de l’enseignement secondaire en France n’est guère contesté par personne.
Nous nous garderons soigneusement de compromettre l’instruction de Françoise II par une telle erreur pédagogique. De dix à dix-sept ans, nous ne nous lasserons pas de guider, de protéger son effort. C’est le temps de la formation de l’esprit: l’esprit, en ces précieuses années, prend ses habitudes, et pour attaquer un problème, et pour suivre une démonstration, et pour coordonner et retenir des faits. La source imaginative jaillit, creuse son lit: plus tard, rien ne pourra plus changer ni le débit de la source ni son cours. Disciplinons cette jeune intelligence, afin qu’elle arrive en pleine force, en pleine faculté d’action, à la période signalée par un philosophe comme la plus féconde de la vie humaine, 94 période qui commence un peu avant et finit un peu après vingt ans. «Alors, dit Taine, il y a sept ou huit années de sève montante et de production continue, bourgeons, fleurs et fruits...» A la «période tainienne» s’adaptera l’enseignement dit supérieur. C’est assez pour l’enseignement secondaire de préparer par une juste discipline ce futur épanouissement.
Mais vous n’ignorez pas, Françoise, que l’enseignement supérieur, celui des Universités, des grandes Écoles spéciales, est l’apanage d’un petit nombre d’élèves, et surtout d’un petit nombre de femmes. Pour la plupart de celles-ci, l’époque d’épanouissement et de fructification est celle même du mariage, de la maternité, de la fondation de la famille, et c’est là un épanouissement, une fructification qui en valent bien d’autres. Néanmoins, il en résulte que la plupart des femmes (l’on pourrait dire même: la plupart des élèves des deux sexes) n’accroîtront guère leurs connaissances scolaires à partir de seize ou dix-huit ans. Il faut donc que l’enseignement secondaire ne se contente pas d’éduquer l’élève en l’habituant à de bonnes méthodes: il faut qu’après l’avoir suivi l’élève ait compris ou appris ce que doivent avoir appris ou compris les gens dits «cultivés».
Étudions cette idée et ce mot de «culture», appliquée par la logique du langage à l’éducation de l’esprit, en vertu de l’analogie entre l’élève et la plante.
95 Être cultivé, cela ne veut pas dire être spécialement savant en quoi que ce soit. Un numismate, érudit en sa partie, peut être un homme sans culture s’il ne possède pas cet ensemble de notions grâce à quoi, selon le mot de Térence, rien d’humain ne vous est étranger. La vraie culture est générale; elle est l’opposé de la spécialisation.
L’on vous dira, Françoise, que la spécialisation est seule désirable aujourd’hui, parce que la société a besoin de sujets qui excellent en leur partie. L’on vous dira même qu’elle est seule possible, parce que le trésor des connaissances s’est démesurément accru et que l’esprit humain, s’il veut l’acquérir, se condamne à la banqueroute. Vous répondrez hardiment à ces ennemis de la culture générale que leurs raisons ne valent rien. Il n’est pas vrai qu’un esprit ait plus à comprendre et plus à retenir aujourd’hui qu’au XVIe siècle, par exemple, pour mériter l’épithète de cultivé. Alors comme aujourd’hui, il y avait des théories de physique, de chimie, une science de la terre et des éléments: s’il vous prend la fantaisie d’ouvrir un des livres de ce temps-là, vous verrez que pour être moins fondées sur l’observation ces théories n’en étaient pas plus simples. En outre, la culture générale s’encombrait alors d’un inextricable fatras d’argumentation, aboli de nos jours. Dans l’intérêt de sa paresse, un paresseux ferait mieux, croyez-moi, de suivre les cours du Collège de France sous M. Gaston Paris qu’au lendemain 96 de sa fondation. D’autre part, aujourd’hui comme alors, un spécialiste sans culture générale était un organisme incomplet, réputé pour tel. Et sans doute, à cette volonté de n’ignorer rien, les artistes de la Renaissance durent d’être les plus grands artistes de tous les temps.
Ce qui est vrai, c’est que la société a besoin de sujets qui, leur culture générale achevée, y surajoutent une forte culture spéciale. Le temps de cette culture spéciale, c’est précisément cette «période tainienne» qui pour un Taine s’inaugure à quinze ou seize ans, mais qui, pour la plupart, n’est sensible que vers dix-sept ou dix-huit et s’étend jusqu’aux environs de vingt-cinq ans. Voilà le temps du libre effort vers une science ou un art distincts, préférés... Jusque-là, toute spécialisation est vaine: et là où elle n’est pas imposée par le manque d’argent et la nécessité d’un métier hâtif, c’est presque un crime des parents que d’y soumettre leurs enfants. Les parents s’excusent en disant: «L’enfant montre des dispositions pour telle ou telle spécialité.»—Plaisanterie! Sauf quelques petits Pascals, quelques petits Paderewskis, quels sont les enfants qui témoignent à dix ans d’aptitudes spéciales vraiment indicatrices? Gardons-nous de faire fonds sur les prétendues dispositions des enfants. Tel ne rêve que machines, qui sera poète; tel sera volontairement huissier à trente ans qui, à douze, inquiétait sa famille par des apparences contemplatives et une 97 extrême sensibilité. A ces âges, l’être physique se forme, rien des contours définitifs n’est arrêté. Il ne faut imposer à un cerveau en formation que ce que peuvent supporter tous les jeunes cerveaux.
Vous me direz que, pour Françoise II, tout ce discours n’importe guère. Françoise II n’ira pas au collège de M. Gaston Paris. Françoise ne sera point une spécialiste... Hum!... Qu’en savez-vous? Il y a des femmes qui suivent aujourd’hui les cours du Collège de France. Vers 1920, il y en aura probablement davantage: êtes-vous assurée que Françoise II ne sera pas du nombre? Malgré les incertitudes de l’avenir, une des présomptions les plus vraisemblables est que, de plus en plus, l’instruction des filles devra ressembler à celle des garçons. C’est pourquoi je ne distinguerai guère entre les deux, je vous en avertis, au cours de cette lettre et des suivantes.
Si d’ailleurs Françoise II doit être tout simplement épouse et mère à la mode d’aujourd’hui, c’est bien le cas de ne point spécialiser l’enseignement qu’on lui donnera entre dix et dix-sept ans! A ceux, à celles qui ne recevront jamais de culture supérieure, la culture générale est d’autant plus indispensable. Sans rien préjuger de l’avenir, il nous faut donc faire de Françoise II ce que vous-même, Françoise, souhaitiez être à la fin de vos études secondaires: une femme ayant des clartés de tout, des clartés, vous entendez bien, et non des obscurités ou des pénombres.
98 Résumons avec une simplicité qui exclut tout pédantisme les conclusions de cette lettre:
I. L’enseignement secondaire est une éducation et une tutelle.
II. Il a pour objet la culture générale.
Comment diriger cette tutelle éducatrice? Et comment doser les éléments, comment régler les procédés de cette culture générale? Mes prochaines lettres tâcheront de vous le dire.
Il y a des gens qui se disent cultivés, chère Françoise, et qui, suivant la formule d’un couplet célèbre, ne sont pas du tout cultivés. Ou plutôt, ayant subi une culture plus ou moins défectueuse, ils se contentent de ce réconfortant souvenir. J’ai connu un étudiant qui, durant un an, prit toutes ses inscriptions à la 100 Faculté de droit de Paris; jamais il n’assista à un cours; jamais il n’ouvrit un livre; jamais il ne passa d’examen. Il dit aujourd’hui: «Quand je faisais mon droit...»
Méfions-nous de ce préjugé singulier en vertu duquel la culture d’un esprit consiste à avoir pris des inscriptions, ou même à avoir suivi des cours! Un esprit et une terre méritent l’épithète de «cultivé» quand l’effet de la culture persiste. La campagne romaine fut une des plus fertiles du monde; dira-t-on pour cela que le steppe splendidement stérile déroulé aujourd’hui entre Saint-Jean-de-Latran et les monts Albains est une terre cultivée? Elle le fut, et ne l’est plus. Beaucoup d’entre nous devraient dire, pour parler vrai: «Je fus cultivé.»
J’engage la plupart des gens du monde, et même bon nombre d’intellectuels, à faire sur ce point leur examen particulier. Que l’un de nous s’enferme dans une chambre avec de l’encre, une plume, du papier blanc, et rédige un mémoire de sa science, sur une matière qui ne soit pas sa spécialité, son métier. Qu’un ingénieur, par exemple, résume, sans le secours d’aucun livre, ce qu’il sait d’histoire littéraire, ou un notaire ce qu’il sait de géométrie. Aucun de nous ne remplira cinq pages: et le texte de ces pages déshonorerait un élève de cinquième. Autre expérience: réunissez dix personnes prétendues cultivées, proposez-leur la composition scolaire la plus facile: pas une n’en viendra à bout. Il n’y en a pas une 101 sur cent qui soit capable de retrouver sans préparation le nom et la place des provinces de l’Espagne, la théorie de la multiplication, le sens de cinq vers de Virgile pris au hasard, l’explication du phénomène de la rosée. Pourtant, tous, nous avons suivi des cours secondaires. Nous avons passé des examens. Un certain jour, quand nous prîmes congé de nos maîtres, ils nous dirent: «J’ai enseigné.» Et nous leur dîmes: «J’ai appris.»
Qui trompait l’autre, du maître ou de l’élève?
Ni l’un ni l’autre. Ou plutôt le maître et l’élève se trompaient d’accord, ayant vécu dans une erreur commune, plus ou moins volontaire, sur le sens d’un petit mot essentiel en pédagogie: le verbe SAVOIR.
J’entends, moi, ce mot dans un sens très étroit, très précis: le sens de posséder. Si savoir ne signifie pas posséder, il ne signifie rien du tout. On sait l’anglais, par exemple, quand on peut le comprendre, le parler, le lire et l’écrire sans l’aide du lexique et de la grammaire. Si l’on a besoin d’un recours fréquent au lexique et à la grammaire, on ne sait pas l’anglais, on est en route vers la science de l’anglais. De même, une fois qu’on a défini les notions que contient la géographie élémentaire, on devra dire: «Cette élève sait la géographie élémentaire», quand elle possédera lesdites notions sans le secours du livre et d’une façon définitive.
Ce dernier point aussi est d’importance. De 102 ce qu’une de vos compagnes, Françoise, répond parfaitement en classe sur la leçon du jour, on ne peut pas conclure qu’elle en saura la moindre bribe huit jours après. Et je ne parle pas seulement de la mémoire, mais de la compréhension proprement dite. Il est plusieurs degrés de «comprendre» comme il est plusieurs degrés de «se rappeler». Cela est surtout sensible en mathématiques, où le rôle de l’intelligence est si prépondérant qu’il exclut presque celui de la mémoire. Vous m’avez cité des théories d’arithmétique, chère enfant, que vous avez comprises un jour, et que vous ne compreniez plus. Le déclic intellectuel s’était soulevé un instant, puis était retombé... Il fallait s’efforcer de nouveau pour le faire jouer. Le jour où l’on a trouvé le moyen de soulever ce mystérieux déclic à l’état permanent, on a vraiment compris.
Eh bien! dans la plupart des classes, enseignement officiel ou enseignement libre, il existe entre maîtres et élèves un accord tacite pour vivre dans «l’illusion de comprendre» et dans «l’illusion de savoir». La surcharge insensée des programmes force à courir la poste à travers la science; la nécessité des examens contraint à apprendre pour une date déterminée, tandis qu’on doit apprendre pour toujours. Ainsi la classique image du tonneau des Danaïdes s’applique exactement à l’œuvre de ces pauvres maîtres, versant infatigablement la science dans l’oreille de l’élève—la science 103 qui, selon le mot pittoresque des bonnes gens, «lui ressort par l’autre».
Surtout en matière d’enseignement secondaire, ce procédé est déplorable. Car nous avons vu, Françoise, que le but de l’enseignement secondaire est la culture générale: ce qu’on y apprend est utile à savoir tout le long de la vie. On rencontre souvent des personnes qui vous disent: «A quinze ans, je parlais l’anglais couramment; mais, aujourd’hui, je n’en sais plus un mot.» Elles auraient mieux employé leur temps à ne point l’apprendre, car c’est justement hors de l’école que les langues vivantes sont d’un usage avantageux.
Notre procédé pédagogique sera juste le contraire de celui-là. Nous tiendrons pour nulle et non avenue toute leçon que l’élève n’aura pas définitivement comprise et définitivement retenue. Aucun esprit, pour borné ou léger qu’il soit, n’est absolument réfractaire à la bonne façon d’apprendre: la preuve, c’est que certaines parcelles de nos études secondaires, par hasard mieux apprises et mieux comprises, surnagent malgré tout dans le naufrage général. Au delà d’un certain effort, l’esprit s’assimile définitivement la chose apprise.
Mais, naturellement, pour apprendre ainsi, il faut beaucoup de temps. D’autre part, le programme de la culture générale comprend beaucoup de matières. Si l’on supprime une seule de ces matières, la culture cesse d’être générale. Le problème de l’enseignement secondaire serait-il donc insoluble?
104 Point du tout, ma nièce. La solution consiste tout simplement à ne pas perdre de vue l’objet même de cet enseignement. Être cultivé, ce n’est pas, avons-nous dit, être érudit en quoi que ce soit: c’est n’être, en quoi que ce soit, un ignorant. Il ne s’agit donc pas de faire sur chaque matière de petits savants, de petites savantes; il s’agit de donner à l’esprit adolescent ce que Molière appelait des clartés de tout. Des clartés et non des obscurités ou de confuses pénombres,—comme je vous le faisais remarquer à la fin de ma dernière lettre. Ce que l’enseignement perd en étendue, il le gagne en profondeur: et encore la perte en étendue est-elle seulement apparente, puisque le soi-disant savoir étendu n’est que superficiel et s’efface aussitôt.
Ainsi se définit logiquement le rôle de l’éducateur. Il fournit à l’élève des notions de tout; il les donne très précises, très bien coordonnées; il exige que l’élève les possède, c’est-à-dire les comprenne et les retienne comme les mots de la langue. Mais ces notions ne doivent nullement viser à l’érudition: on en exclura tout ce qui excède le savoir d’une personne moyennement cultivée. Pour en fixer le programme, on se posera toujours cette question: «Que devra savoir l’élève, non pas pour passer un examen plus ou moins arbitraire, mais pour s’accommoder utilement et agréablement de la vie?» Et le programme des connaissances qui doivent rester dans un esprit cultivé, lorsque cet esprit a trente ans, 105 sera le programme de ce que nous enseignerons à l’esprit de quinze ans, sans plus.
Maintenant, chère Françoise, si vous voulez apprécier combien les méthodes en usage sont différentes de celles-là, ouvrez n’importe quel ouvrage pratiqué dans les collèges secondaires de filles ou de garçons. Ouvrez la géographie de Lavallée, les histoires de Dauban, les manuels d’histoire naturelle d’Aubert, les grammaires. Vous tomberez d’accord avec moi qu’une personne qui posséderait un quelconque de ces ouvrages serait, en la matière, véritablement érudite. Et c’est tous à la fois qu’on prétend inculquer à l’élève! Même intelligent et studieux, l’élève ne retient de tout ce fatras scientifique qu’un infime résidu, composé d’éléments disparates... Encore une fois, n’est-il pas plus logique de composer à l’avance ce résidu d’éléments essentiels, bien alliés ensemble, et de s’en tenir là?
Cette doctrine, ma jolie nièce, est d’une évidence presque grossière. Je n’aurai garde, cependant, de négliger les objections.
Les défenseurs de ce que nous appellerons l’enseignement en surface nous disent:
—Il faut offrir à l’élève bien plus de notions qu’il n’en doit retenir, parce que, forcément, il se fait à la longue une déperdition, une évaporation plus ou moins importante dans ce jeune esprit. Vous aurez beau réduire le nombre des notions, il s’en évaporera toujours quelque peu. Avec votre enseignement 106 minimum, l’élève ne conservera presque rien.
Je réponds:
—Il ne s’évaporera rien du tout, parce que l’élève recevra le petit nombre des notions qu’on lui impose à un état de densité et avec une force de pénétration qui ne leur permettent plus de s’évaporer. Dame! il faudra naturellement beaucoup plus de temps pour enseigner ainsi. Aussi cherchera-t-on à enseigner un très petit nombre de choses; mais au moins, une fois enseignées, ces choses feront vraiment et définitivement partie de la fortune intellectuelle de l’élève.
Autre objection, cousine de la première:
—Vous ôtez toute indépendance à l’esprit de l’élève, en lui imposant un programme absolu et en lui défendant de le dépasser, même s’il le trouve trop étroit. Il faut que l’élève choisisse lui-même, au milieu d’aliments intellectuels abondants, ce qui convient à son génie particulier.
Je réponds hardiment:
—Tout cela, indépendance de l’élève, choix des aliments intellectuels, ce sont, pour ce qui concerne l’enseignement secondaire, pures fariboles. L’enseignement secondaire, je l’ai dit et le répéterai, est à la fois une éducation et une tutelle. Ah! si vous me parliez de l’enseignement supérieur, il en irait tout autrement. Alors il convient de respecter le génie de l’élève, de le laisser butiner où il lui plaît, inventer ses méthodes de travail. Mais, de grâce, 107 songez à ce que sont un garçonnet, une fillette de dix ans, ou de onze, douze, treize, quinze ans même! Vous vous imaginez qu’ils vont «choisir» dans le tas des notions dont vous les accablez? C’est le hasard qui choisira pour eux, au petit bonheur de leur attention distraite; ou, pour quelques-uns, en effet, une sorte de génie bizarre qui les porte à collectionner telle série de faits comme ils collectionneraient des timbres-poste... Je me souviens qu’un jour, assistant à des examens de baccalauréat, j’entendis un candidat réciter à l’examinateur les profondeurs moyennes de la Loire, de ville en ville, depuis Orléans jusqu’à Saint-Nazaire. L’examinateur le félicita... Examinateur, j’aurais refusé le candidat; recteur, j’aurais fait révoquer le maître qui avait favorisé ou toléré un si sot usage de la mémoire.
D’ailleurs, qui parle ici d’attenter à l’indépendance intellectuelle de l’élève? Il ne s’agit point de l’empêcher de lire, d’écouter, de réfléchir au delà de ce minimum qu’on lui enseigne. Il s’agit de ne pas lui laisser ignorer ce qui est essentiel, et, le lui ayant appris, de ne pas le lui laisser oublier. Il s’agit de ne pas souffrir qu’il comprenne à moitié ce qui, sous peine de ne plus rien comprendre au delà, doit être compris tout à fait.
Je ne prétends nullement, Françoise, avoir inventé ces principes. Non seulement ils sont très vulgaires, mais ils sont appliqués scrupuleusement par une catégorie de maîtres que 108 les intellectuels regardent comme inférieurs, à cause de l’objet de leur enseignement: les maîtres d’armes et les maîtres d’équitation. Les uns et les autres commencent par enseigner à l’élève un programme de gestes fixes, par exemple: parer le contre de quarte ou faire exécuter au cheval une demi-volte. Ils ne se contentent pas d’indiquer ces gestes à l’élève, bien qu’aucun d’eux ne présente de difficulté ardue. Il les lui font répéter et répéter jusqu’à ce que l’élève les exécute sans même avoir besoin de réflexion, avec l’infaillibilité de l’instinct. Alors seulement l’élève est autorisé à se livrer à son génie: il peut faire assaut ou dresser des cavales indomptées, s’il en a la fantaisie...
Qu’en résulte-t-il? C’est que, dix ans après la sortie de l’école, l’élève d’aptitudes moyennes qui a appris l’escrime ou l’équitation sait toujours l’une et l’autre; le manque d’exercice, l’âge, peuvent avoir diminué sa souplesse, mais un léger effort lui restituera sa maîtrise. Tandis que ce qu’il a appris dans ses classes de lettres ou de sciences, pourtant avec le même cerveau, a radicalement disparu; il n’en reste rien, rien, rien.
Devons-nous en conclure que les maîtres d’armes et de cheval sont supérieurs aux 109 professeurs de mathématiques et de philosophie? Non. Nous devons conclure que, des deux procédés d’enseignement, c’est celui de l’écuyer et du prévôt qui est rationnel. Écuyer et prévôt l’ont découvert, non pas parce qu’ils sont plus intelligents que le mathématicien et le philosophe, mais parce que l’illusion de comprendre, l’illusion de savoir, ne sont pas possibles en escrime et en équitation. On peut s’imaginer à tort entendre un théorème; on peut se croire en possession d’une science dont en réalité on ne possède que des bribes: le cheval qui vous jette à bas, l’épée qui vous bourre les côtes, chassent brutalement toute illusion sur votre force de cavalier ou d’escrimeur.
Voici maintenant la plus forte objection au système de n’enseigner que ce que doit retenir l’élève. Je vous la recommande; elle est spécieuse.
—Monsieur, me dit-on, vous commettez une lourde bévue pédagogique. Vous vous méprenez absolument sur le but de l’enseignement secondaire. On ne se propose pas du tout d’entasser des connaissances dans le cerveau de l’élève. Qu’il retienne seulement une faible partie de ce qu’on lui enseigne, c’est dans l’ordre. Le but principal est d’exercer son esprit. C’est à la gymnastique intellectuelle que nous visons. Que l’élève sorte de nos écoles secondaires avec l’habitude du travail, la pratique des méthodes,—cela nous suffit. Sa 110 culture générale, dont nous lui avons indiqué le procédé, il la poursuivra justement au cours des années de libre effort que vous appelez la période tainienne.
Ainsi, de l’aveu même des fauteurs de l’enseignement en surface, l’élève ne retiendra rien de ce qu’on lui enseigna: la lanterne magique de la science aura joué devant ses yeux, voilà tout. Et l’on s’imagine qu’entre seize et vingt ans il perfectionnera de lui-même sa culture générale? C’est purement un leurre. Leurre pour les garçons: la fin de l’enseignement secondaire marque pour eux la date des études spéciales, de l’apprentissage professionnel, du service militaire. Leurre aussi pour les filles. Je vous indiquerai, un jour, ma chère nièce, comment une jeune personne sortie de pension, comment une jeune femme dans la vie du monde, peuvent et doivent poursuivre leurs études.
Mais vous le sentez bien vous-même: la sortie de pension, l’entrée dans le monde, c’est la fin d’un temps de recueillement et de fructueux loisir que vous ne retrouverez plus dès que votre rôle social ne sera plus limité à ce seul devoir: apprendre... Enfin, le jeune homme ou la jeune fille issus des écoles secondaires eussent-ils et le loisir et la volonté de l’étude,—justement parce qu’ils commencent cette féconde «ère tainienne»,—ce n’est pas la culture générale qui les sollicitera. A douze ans, on fait des mathématiques même 111 à contre-cœur, même quand on n’aime que la poésie. Vîtes-vous jamais au contraire un jeune esprit libéré des écoles secondaires cultiver les sciences qui ne l’attirent pas?... Tout un ordre de connaissances est instantanément renoncé par l’étudiant dès qu’il peut choisir son étude. Et, en somme, l’étudiant a raison, puisqu’il faut à tout prix élire une spécialité si l’on veut exceller. Donc, sorti de l’enseignement secondaire sans culture générale acquise, on est condamné à n’avoir jamais qu’une culture fractionnaire.
Toutefois, l’utilité de la gymnastique intellectuelle n’est pas niable. En apprenant, on apprend à apprendre. Il est fort exact que cet enseignement en surface qu’on vous donne, Françoise, qu’on m’a donné, nous a tout de même rendus plus souples et plus adroits aux jeux de l’esprit... Mais en quoi, pour Dieu! cette gymnastique intellectuelle, puisque gymnastique il y a, serait-elle moins pratiquée dans un enseignement limité et intensif? Notre prétention, justement, est de la rendre infiniment plus sérieuse, plus méthodique, plus «gymnastique» en un mot, plus semblable aux exercices du corps auxquels les pédagogues de l’enseignement superficiel empruntent bien improprement cette image.
Car c’est nous les gymnastes, dans le vrai sens du mot, c’est nous qui voulons des gestes précis, exécutés infailliblement, inoubliables. Et l’abus est étrange d’appeler gymnastique une méthode d’entraînement qui ressemble 112 bien plus à une promenade sans but, à une veule flânerie, qu’à la sévère, stricte, discipline des gymnastes frottés d’huile.
J’énonce en terminant cette lettre, amie Françoise, les deux nouveaux principes acquis, qui font suite aux deux premiers:
III. Le but de l’enseignement secondaire est de mettre l’esprit de l’élève en état de culture, non pour le temps de l’enseignement, mais pour la vie.
IV. L’enseignement secondaire a rempli son rôle quand il a appris à l’élève, sans plus, ce que celui-ci doit retenir.
Vous confesserai-je, Françoise, que mardi, en me rendant chez vous, où je devais dîner entre votre mère et vous, comme c’est mon privilège à chaque jour de sortie de l’institut Berquin, je n’étais pas rassuré tout à fait sur l’accueil que me réservait votre ironie coutumière?
Il me semblait que vous ne failliriez pas à vous moquer de ma dernière lettre. Je n’avais 114 pas voulu la relire, cette lettre, avant de vous l’envoyer, craignant, si je la relisais, de la jeter définitivement au panier, comme un fatras lourd et pédantesque, mal approprié à la grâce juvénile de la destinataire... Je vous l’envoyai cependant, mais ce fut par un scrupule de conscience. Vous m’aviez demandé mes idées sur l’enseignement des jeunes filles; je vous les exposais loyalement. Si l’exposé manquait d’élégance et de légèreté, c’était peut-être un peu la faute du sujet.
J’arrivai donc place Possoz et j’entrai dans votre maison avec un certain malaise. Rien n’est plus sensible aux hommes de mon âge que la moquerie des jeunes filles. Vous avez sur nous trop d’avantages: nous ne pouvons nous défendre.
La porte du salon me fut ouverte, je vous vis, haussée sur la pointe de vos pieds, mettant bon ordre à la révolte d’un abat-jour sur une des bougies de la cheminée. Et nos regards se rencontrèrent dans la glace.
O surprise! Vous quittâtes aussitôt bougie et cheminée, vous vîntes me tendre votre front, et tandis que je posais dessus un baiser vous me dîtes:
—Savez-vous, mon oncle, que vous êtes très gentil?
A parler vrai, je ne le savais pas; mais j’étais tout disposé à le croire si seulement vous me donniez quelques bonnes raisons. Je vous les demandai.
—Vous m’avez écrit une lettre!... 115 répliquâtes-vous, oh! une lettre qui m’a fait tant de plaisir!...
J’interrogeai vos yeux et les lignes de votre visage: non, décidément, vous ne vous moquiez point. L’idée me traversa l’esprit que peut-être la poste avait commis une erreur et vous avait remis une lettre destinée à une autre nièce par un autre oncle. Je vous questionnai timidement.
—C’est... de la lettre... sur... (lâchement j’hésitai devant les gros mots d’«enseignement secondaire») sur... vos études... que vous parlez, Françoise?
—Mais bien sûr, mon oncle. La lettre sur l’enseignement secondaire... où vous m’exposez votre doctrine.
Et, avec une amusante gravité, vous ajoutâtes, comme si vous faisiez une conférence:
—L’enseignement secondaire a pour objet la culture générale de l’esprit: on ne peut donc réduire le nombre de ses matières, puisque alors il ne serait plus général. D’autre part, comme cette culture générale doit persister tout le long de la vie, ce qu’enseigne l’enseignement secondaire doit être appris très à fond, appris pour être su dans le vrai sens du mot, pour être retenu. Il faut par conséquent limiter ledit enseignement aux notions essentielles, aux clartés de tout... Est-ce bien cela, mon oncle?
Si c’était cela! Mais c’était cela divinement, bien mieux que je n’aurais su le dire! Ah! les mots ne vous font pas peur, à vous, Françoise. 116 Jusqu’au moment où l’on servit le dîner, il fut impossible de parler avec vous d’autre chose que de culture, d’époque tainienne, du vrai sens du verbe savoir, de la méthode d’enseignement en surface et des objections que font ses défenseurs à la méthode d’enseignement précis et bref... Le dîner imposa une courte trêve à ces entretiens. Mais ils reprirent ensuite de plus belle, tandis que la chère Mme Le Quellien s’endormait paisiblement sur le tricot de laine commencé pour quelque petit pauvre... Et, quand je vous reconduisis à l’institut Berquin, je dus noter par écrit, à la porte de l’établissement, les sujets que vous dictiez à mes prochaines correspondances.
Ils sont inscrits là, au dos d’une de mes cartes de visite que j’ai placée hier en évidence sur ma table de travail, afin qu’elle me rappelle mes promesses:
Dire ce que doit savoir effectivement une femme cultivée.
Dire comment devraient être faits les livres de classe.
Dire comment il faut apprendre pour retenir, et comment distribuer le temps des études.
Les lignes qui précèdent sont griffonnées de ma main; au-dessous, m’ayant ôté des doigts le crayon et la carte, vous avez ajouté vous-même les quatre mots:
«Avec beaucoup de détails.»
Aujourd’hui, chère enfant, assis à ma table avec le dessein de satisfaire vos désirs, je regarde cette carte, et sa vue m’inspire pour 117 vous, souffrez que je vous le dise, une admiration sincère. Vous m’avez assuré que vos sentiments et vos soucis vous étaient communs avec nombre de vos compagnes. J’admire combien les jeunes Françaises de la nouvelle génération sont peu frivoles, combien est éveillé chez elles le goût des choses de l’esprit et des importants problèmes de la vie. Je ne me trompe pas: quelque chose a réellement changé depuis moins de vingt ans dans l’être qu’on désigne par ces mots charmants et mystérieux: une jeune fille. Il se passe parmi nous, avec moins de fracas et d’excès parce que la France est un pays de liberté et de mesure, un phénomène analogue à ce qu’on vit en Russie quand les jeunes filles de l’aristocratie, désertant les fêtes et les bals, coururent aux Universités. Et pour écrire Mères et Filles, pendant de l’immortel Pères et Fils de l’écrivain russe, il ne manque qu’un Tourguéniev français.
Le romancier qu’une pareille œuvre tenterait pourra lire, à titre de notes sans prétention, les lignes qui suivent. Elles résument une conversation que j’eus le surlendemain du jour où je dînai chez vous, Françoise, avec une charmante femme de la société parisienne, votre aînée d’une quinzaine d’années, ce qui ne la fait pas bien vieille, mais ce qui lui permet cependant de compter déjà deux lustres de mariage et d’habiller de la façon la plus ingénieusement ridicule une fillette de six ans.
118 Par un effet assez étrange, mais que j’ai déjà observé plusieurs fois et que les théoriciens de l’influx psychique expliqueraient sans doute par la télépathie, depuis que, grâce à vous, je médite sur des questions d’éducation, une foule de gens me parlent d’éducation, qui, jusque-là, ne m’en avaient jamais ouvert la bouche. Voici comment nous vînmes, Mme X... et moi, à ce sujet ordinairement inusité entre nous.
Juliette (c’est sa fille) venait de faire dans le petit salon où nous bavardions une entrée et une sortie compassées, sous la garde de la miss quelconque qui préside à son développement intellectuel et moral. Il y eut un instant de silence.
—Juliette est ravissante, dis-je. Elle commence à ressembler à sa mère.
—Oui, elle sera assez bien, je crois, fit Mme X... Elle aura les traits plus réguliers que moi; seulement elle manque un peu d’expression. Vouliez-vous dire qu’elle sera mieux que moi?
—Je n’aurais garde, chère amie. Il faut être mal élevé comme Horace pour faire des compliments à une jeune demoiselle aux dépens de sa mère.
—Horace? Quel Horace? Le poète latin?
—Précisément. Vous savez tout.
—Je ne sais pas le latin, assurément, répliqua Mme X... d’un ton un peu piqué. Je laisse cela aux demoiselles nouveau style que vous vantez dans vos livres.
119 Cela fut dit, vous pensez bien, d’un ton assez malveillant et pour les demoiselles que je suis censé vanter et pour moi-même. Je tâchai de réparer mon impair.
—Mon Dieu, fis-je, soyez assurée, chère amie, que je n’ai aucun goût pour les pédantes. Seulement, je n’ai jamais compris pourquoi les langues anciennes, prétendues indispensables aux hommes cultivés, seraient interdites aux femmes. S’il existe un rapport entre le sexe de l’élève et le fait de connaître un certain langage, ce rapport m’échappe.
Mme X... répliqua:
—Les hommes ont besoin du latin et du grec pour leurs professions.
—Quelles professions?
—Pour être avocats, médecins, pharmaciens, que sais-je?
—D’abord les femmes peuvent être avocates, doctoresses, pharmaciennes...
—Quelques folles!...
—Prenez garde! Ce sera peut-être la vocation de Juliette.
—Si je croyais une chose pareille, je lui défendrais même d’apprendre à lire.
—D’ailleurs, chère amie, il me semble que vous ne vous faites pas une idée exacte de l’objet de telles études. On n’apprend pas le latin et le grec aux hommes pour qu’ils puissent lire dans le texte Justinien ou Aristote, ni pour qu’ils puissent écrire sur des bocaux: «acetum boricum» au lieu d’acide borique.
—Alors, pourquoi?
120 —Si vous tenez à le savoir, je vous dirai, sans vous fatiguer par l’exposé de doctrines courantes, mais incontestables, sur l’hérédité, que nous sommes des Latins, et que toutes les notions générales de vie sociale, d’histoire, de politique et même d’industrie, entrent d’une façon particulièrement aisée dans l’esprit d’un bambin français par l’intermédiaire du latin.
—Mieux que par l’intermédiaire du français?
—Oui, en ce sens que la compréhension est plus large, plus ample, remonte plus avant dans les origines. On peut évidemment acquérir ces notions sans l’aide du latin, mais de la même façon qu’on peut lire un roman dans un volume où manquent les cinquante premières pages.
—Et le grec?
—De grâce, épargnez-moi: et croyez-moi sur parole si je vous dis que le grec, balbutiement divin des premières civilisations, des premiers arts où les nôtres ont pris leur source, est également des plus favorables à la culture complète d’un esprit français.
—Alors, d’après vous, Juliette doit apprendre le latin et le grec?
Je soutins du mieux que je pus le feu du regard un peu méprisant que me jetait Mme X..., et je lui répliquai:
—Laissons la question du latin et du grec: ce n’est après tout qu’un chapitre du programme de la culture. Juliette, si elle veut être cultivée, doit apprendre tout ce qui compose 121 la culture de l’esprit, absolument comme un garçon. A bagage égal, une femme n’est pas instruite et un homme ignorant. Le fait d’avoir des cheveux longs, le teint plus clair, de plus jolis yeux et de porter une jupe au lieu de pantalon n’empêche pas qu’on ignore ce qu’on ne sait point.
Mme X... éclata de rire.
—M. de la Palice ne s’exprimerait pas plus clairement, dit-elle... Mais alors il n’y a pas de raison pour ne pas envoyer Juliette à l’École normale ou à Polytechnique, sous prétexte qu’elle y eût peut-être été si Dieu l’avait créée garçon?
—Non, madame. Ne me faites pas dire ce qui n’est pas ma pensée. Les écoles dont vous me parlez donnent un enseignement spécial, supérieur, qui n’a rien de commun avec la culture générale. Un jour viendra sans doute où filles et garçons recevront indifféremment cette culture supérieure. Pour le moment, tenons-nous-en à égaliser la culture secondaire des deux sexes. Il n’y a vraiment pas de raisons valables pour qu’à seize ans un garçon et une fille n’aient pas acquis les mêmes connaissances.
—Mais alors les filles n’auront pas le temps d’apprendre la couture ni la conduite d’une maison?
—Si fait. Elles y consacreront les heures attribuées par les garçons aux exercices violents: escrime, gymnastique, etc. Il y a là des différences d’éducation nécessaires, indiquées 122 par la nature elle-même, au moins pour le temps présent.
Mme X... médita un instant:
—Et vous croyez sérieusement, me dit-elle, qu’une malheureuse fillette, jusqu’à l’âge de dix-sept ans environ, aura le temps d’apprendre, outre la couture et le ménage, tout ce qu’on enseigne aux garçons, grec, latin, mathématiques, etc.?
—Permettez-moi d’y ajouter encore un métier pratique, facile, tel que la dactylographie, par exemple, ou la reliure. Plus encore certaines notions qui ne figurent dans aucun programme d’enseignement secondaire et qui cependant sont bien plus utiles que la troisième dynastie égyptienne.
—Lesquelles?
—Un peu d’histoire de l’art... Les styles d’architecture, de mobilier, de décoration. L’organisation de la cité, de l’état modernes. L’hygiène usuelle. Voilà qui fait essentiellement partie de la culture générale, c’est-à-dire de celle qui rend l’usage de la vie courante plus utile et plus agréable.
—Dites tout de suite que le cerveau de ces pauvres petits doit être une encyclopédie... Et l’on parle de supprimer le surmenage! Vous n’êtes guère dans le mouvement, cher ami.
Mme X... se leva; sa jupe décrivit sur le tapis 123 un gracieux paraphe; son index pressa le bouton électrique voisin de la cheminée. Un valet de chambre ayant paru, elle lui demanda le thé, qui fut apporté aussitôt sur un petit meuble à tablettes, chargé de petits fours, de brioches et de puddings.
Ces friandises ne me désarmèrent point.
—Madame, repris-je, ma tasse à la main, vous me calomniez. Je suis un ennemi juré du surmenage. Ou plutôt je ne crois point au surmenage, du moins pour la plupart des enfants. Vous pouvez les faire tenir assis devant un pupitre durant treize heures par jour: les faire travailler, c’est autre chose. De mon temps, le surmenage était à la mode. On versait, versait encore dans l’outre des programmes le vin amer de la science; l’outre s’enflait à en crever. Mais je vous donne ma parole que, philosophes impassibles, nous n’en buvions pas une goutte de plus... Si donc j’étais pédagogue, je n’imposerais pas plus de trois heures de travail quotidien à mes élèves.
—Trois heures! avec un programme aussi étendu que le vôtre!...
—Mon programme ne serait pas étendu. Il comprendrait évidemment les douze ou quinze chapitres entre lesquels peut se partager la culture générale d’un esprit. Mais chacun de ces chapitres serait très court. Voulez-vous des chiffres, des nombres de pages, pour fixer vos idées? J’admets que la quantité réelle d’histoire générale, idées et faits, qui 124 peuvent raisonnablement habiter l’esprit d’un homme cultivé non spécialiste n’atteint pas les trois cents pages de ce roman jaune que j’aperçois là, sur le guéridon Louis XVI... Je me charge de faire tenir en trente pages l’arithmétique élémentaire, pratique et théorie. L’histoire naturelle utile et «retenable» vaut à peine cinquante pages (les manuels ordinairement en usage en ont quatre cents pour le moins). Un atlas de quarante pages renferme infiniment plus de connaissances géographiques que la plupart des cerveaux d’intellectuels: d’ailleurs cet atlas existe, signé Foncin...
—Je comprends! interrompit Mme X..., c’est le système du docteur Mattei, le système des granules. Un granule de mathématique, un de géographie, un de grammaire... Tout de même, avec leurs cinquante pages d’histoire naturelle, ils n’iront pas loin, vos élèves.
—Plus loin que vous et moi, madame, qui ne saurions présentement ni expliquer la circulation du sang ni classer de façon satisfaisante une sole ou une araignée.
—Et le latin, et le grec, et les langues vivantes?
—Il n’y a pas de langue, vivante ou morte, qui ne puisse être bien apprise en deux ans. Un garçon de café, une domestique venue de la campagne, n’en mettent pas tant pour posséder le vocabulaire. Et, quand la grammaire générale a été bien enseignée à un enfant, il passe aussi aisément d’une grammaire à une 125 autre qu’un violoniste au violoncelle ou à la cithare... Ah! le tout est de bien enseigner, j’en conviens, et surtout de ne pas changer de méthode tous les six mois.
Mme X... ne répondit pas aussitôt. Elle réfléchissait, ce qui donnait à son agréable visage un charme très nouveau, très piquant.
—Savez-vous, me dit-elle enfin, que j’ai envie de vous confier Juliette? Il est certain que son Anglaise ne lui apprend que des pauvretés, les mêmes d’ailleurs que j’ai apprises moi-même... Pourquoi riez-vous?
—Parce que j’ai déjà deux disciples: une charmante jeune fille de dix-huit ans, ma nièce Françoise, et la fille que celle-ci est bien résolue à avoir un an après son mariage. Nous appelons cette pupille hypothétique Françoise II.
—Eh bien, vous demanderez à Mlle Françoise II si elle veut de Juliette pour compagne d’école.
Je promis de faire la commission, et, comme un visiteur entrait, je pris congé.
Que Françoise II ne soit pas jalouse. Mme X..., j’en suis certain, a déjà oublié son projet et notre conversation. Juliette restera aux mains de son Anglaise, jusqu’au jour où elle suivra des cours réputés pour l’élégance de leur clientèle. Et à moins qu’elle ne s’affranchisse elle-même un jour, comme les petites Russes, elle sera à son tour une madame quelconque, 126 ignorante et compréhensive, frivole et charmante, comme sa mère.
Et c’est vous seule, chère Françoise, qui, lisant le récit de cet entretien mémorable, y picorerez adroitement les indications que je vous avais promises sur la culture d’un esprit féminin.
A plusieurs reprises, chère Françoise, je vous ai exprimé le peu d’admiration que m’inspirent les livres classiques en usage dans les écoles. Le moment est venu de justifier ces critiques. La question a son importance. Pour enseigner l’élève, un bon livre importe autant qu’un bon maître. J’allais dire: il importe plus. Car l’esprit de l’élève (comme celui de tout être humain, d’ailleurs) se distrait moins 128 de ce qu’il lit que de ce qu’il entend. Une fois envolée, la parole du maître est perdue si l’oreille ne l’a recueillie. Au contraire, l’œil revient de lui-même sur le passage difficile, mal compris à première lecture. Le livre est un maître toujours présent, toujours prêt à renouveler sa leçon.
Par malheur, les livres de classe, à peu d’exception près, ont deux défauts habituels.
Le premier, c’est qu’ils n’ont pas l’air de se douter de l’objet pour lequel on les destine. Ce sont des ouvrages que seul un esprit déjà cultivé peut consulter avec intérêt et avec profit.
Le spécialiste qui les a composés, étant par métier très documenté sur la matière, n’a fait grâce à l’élève d’aucun des détails de sa science. Ainsi tel cours d’histoire célèbre, à l’usage des classes de lettres, comprend environ six volumes de cinq cents pages, soit trois mille, d’ailleurs excellentes. Trois mille pages ont dû passer sous les yeux de l’élève pour la seule matière historique, pendant ses classes secondaires. On s’en rapporte à lui pour avoir extrait de ces trois mille pages le résidu qui doit être retenu. C’est cela qui est absurde.
Je répéterai encore une fois, je répéterai opiniâtrement en toute occasion, que l’élève, entre dix et seize ans, n’est pas capable de faire de choix et n’en a pas le loisir. L’heure n’a pas encore sonné où la meilleure manière d’étudier sera pour lui de se laisser guider par sa fantaisie à travers une vaste bibliothèque 129 (ce que nous avons appelé l’«époque tainienne»). Entre dix et seize ans l’enseignement est encore, est surtout une éducation, une tutelle: il doit être résolument protectionniste, au besoin restrictif. Il doit présenter à l’esprit qui se forme un choix élaboré à l’avance des éléments essentiels. Autrement, l’esprit adolescent se perd dans le labyrinthe des idées et des faits, ne sait que choisir, choisit mal ou abdique tout effort de choix, et finalement ne retient rien de précis ni de coordonné.
Le second défaut des livres de classe ordinaires, c’est qu’ils sont trop: et j’avoue que ce défaut-là, il faut plutôt le reprocher à ceux qui les emploient qu’à ceux qui les font. Un élève ou une élève qui ont suivi le cours complet des études classiques ont bien manié, rien qu’en géographie et en histoire, une douzaine de bouquins différents; ils ont pâli sur trois ou quatre grammaires françaises. Chaque éditeur classique envoie ses produits récents aux professeurs, à chaque renouveau scolaire. Pour peu que le bouquin plaise au professeur, voilà l’élève obligé de déménager une chambre de son esprit. Cela aussi est absurde. Un étudiant dont la culture générale est achevée peut avec plaisir, avec avantage, feuilleter des traités divers. Il a dans l’esprit un plan intérieur qu’il compare inconsciemment avec le plan de l’auteur qu’il lit; il décide entre l’un et l’autre, corrige au besoin son plan intérieur et le développe. L’élève de dix ans n’a 130 dans l’esprit qu’une page blanche: si vous tracez dessus dix épures successives, il en résulte un gribouillage où nul dessin ne se reconnaît.
On vous dira, Françoise, qu’il faut bien changer de livre, de temps à autre, parce que le même ne saurait convenir à dix ans et à quinze. N’en croyez rien. Le livre scolaire bien fait convient à tous les âges, moins approfondi d’abord, pénétré plus tard jusqu’au fond. Pour ma part, je lis avec agrément, à un âge où mon adolescence n’est plus, hélas! qu’un souvenir assez reculé, l’histoire de France que M. Guizot racontait à ses petits-enfants. Le modeste atlas de Foncin, signalé dans ma dernière lettre, reste à portée de ma main; et toujours mon ignorance y rencontre le secours qu’elle cherche... L’aptitude à s’adapter aux âges divers de l’écolier, voilà le vrai signe du bon livre scolaire. Il marque également les œuvres de littérature vraiment classiques, vraiment formatrices de l’âme adolescente. Dans les fables de La Fontaine, l’esprit le plus cultivé, voire le plus décadent, trouvera un ragoût sans pareil: et le petit enfant qui commence à lire s’y divertira.
Le patrimoine littéraire de notre pays est riche en œuvres littéraires, classiques dans cette acception essentielle du mot. Mais les livres scolaires proprement dits sont chez nous presque inconnus. Avouons qu’ils sont très difficiles à faire. Pour y réussir il faut joindre 131 deux conditions rares l’une et l’autre, plus rarement conjointes: il faut être un grand savant et un grand pédagogue. Il faut être parvenu à ce sommet de la connaissance d’où l’importance relative des notions apparaît au premier coup d’œil, d’où nul rapport ne vous échappe. En même temps, il faut se souvenir des difficultés qu’on eut à apprendre soi-même. Cette alliance exceptionnelle constitue le «bon professeur». Voulez-vous, Françoise, un souvenir personnel? Durant les deux années que j’ai passées à l’École polytechnique, je n’ai eu, naturellement, que des professeurs éminents; mais deux seulement étaient, à proprement dire, de bons professeurs: M. Sarrau et M. Grimaux.
Je vous exposais dans une précédente lettre, ma nièce, l’avantage qu’il y a, pour élaborer des programmes de réforme, à n’être point ministre. Il n’en va pas de même quand il s’agit d’exécuter les réformes conçues dans le silence du cabinet: et voilà que je me prends, en cet instant précis, à regretter de n’être point, pour quelques semaines, grand maître de l’Université. Car, si je l’étais, je tâcherais aussitôt de découvrir, dans chaque science, un Sarrau, un Grimaux, un Foncin, un Guizot, et je leur commanderais à chacun un précis de leur spécialité. Ce précis ne devrait rien avoir de commun avec une nomenclature. Le précis nomenclature est un mauvais précis. Malheureusement, presque tous ceux qui 132 fabriquent des précis leur donnent la forme d’une nomenclature, qu’ils bourrent d’ailleurs de divisions, de noms, de chiffres et de faits, tant qu’il en tient dans l’espace assigné. Alors, parce qu’ils ont supprimé des membres de phrases, adopté une disposition typographique conventionnelle, tableaux synoptiques ou autres, ils s’imaginent qu’ils ont simplifié la science! Ils ont seulement raccourci l’écriture. Certains micrographes se chargeraient peut-être de faire tenir l’histoire universelle de Cantù dans cent pages d’un volume ordinaire: ce volume n’en serait pas pour cela devenu un précis.
Les précis que, ministre de l’Instruction publique, je demanderais aux maîtres de la science, ne devraient rien avoir de commun avec une table de matières. Ils devraient être des «discours» sur la science.—C’est-à-dire qu’ils devraient être construits en phrases ordinaires, non seulement correctement, mais même élégamment écrites. Ils devraient offrir à l’élève, en même temps que le raccourci de chaque science, un modèle de la façon d’exposer cette science. Ils seraient courts, très courts, aussi courts que possible—non pas parce que l’auteur s’y exprimerait en «petit nègre» ou recourrait à des artifices de typographie, mais parce qu’il aurait éliminé résolument tout ce qui n’est pas essentiel. Cette élimination, ce choix résolu, seul un vrai savant, très savant et très intelligent, ose et peut les pratiquer. Le demi-savant hésitera 133 toujours à sacrifier ceci ou cela, parce qu’il n’est pas certain de l’importance relative des notions.
Une fois constitués pour l’ensemble des matières et tenus au courant des progrès ou des changements de la science, les «précis» magistraux deviendraient la base de l’enseignement officiel. Chacun d’eux serait le seul livre imposé à l’élève, durant toutes ses classes secondaires: sur ce thème unique porteraient les explications et les commentaires. Leurs matières seraient seules l’objet des examens. L’examinateur aurait évidemment le droit de «pousser» l’élève, de s’assurer par des questions latérales qu’il a retenu et compris; mais toute question à laquelle le livre, bien retenu et bien compris, ne donnerait pas la réponse serait interdite.
... N’auriez-vous pas aimé, Françoise, au lieu de ces bouquins indigents de science, vulgaires de style et laids d’apparence, que vous allez abandonner avec dégoût en quittant l’institut Berquin, emporter de vos classes une dizaine de volumes de format, de dimensions semblables, d’aspect élégant et uniforme, typographiés de la même manière, rédigés d’après les mêmes idées générales, et qui résumeraient pour vous l’ensemble de votre acquit scolaire? Des savants, des artistes contemporains auraient créé pour vous une Encyclopédie élémentaire, mesurée à votre jeune esprit et au temps de vos études. Le contenu 134 de ces livres vous serait parfaitement familier: non pas qu’on vous eût imposé l’exercice ridicule d’en apprendre le texte par cœur; on n’aurait fait appel à votre mémoire que pour retenir les faits et leur ordre. Mais la substance de tous ces petits livres serait incorporée à votre cerveau, comme les mots et les tournures de votre langue maternelle. Leur style scientifique, leur procédé d’investigation, leur mode de raisonner, vous pourriez à votre tour les exercer sur des objets analogues. J’imagine d’autre part qu’à la fin de chaque volume l’auteur (par hypothèse très savant) aurait placé quelques pages de bibliographie, indiquant les sources où l’étudiant pourrait puiser s’il voulait plus tard acquérir plus de science. Ces pages ne seraient pas enseignées; l’élève ne devrait pas les apprendre; elles seraient des pages à consulter, lues avec profit dans les loisirs des études. De toute façon, même si vous vous en teniez, Françoise, à votre bibliothèque de «discours sur les connaissances humaines», elle contiendrait vraiment, pratiquement, le résumé de votre culture générale.
Ainsi votre jeune esprit arriverait à «l’époque tainienne» dans les plus favorables dispositions, assez renseigné sur les principes de toutes les connaissances humaines pour diriger sciemment ses préférences, averti des méthodes et des sources, rompu aux procédés du travail, exercé aux discours scientifiques, ayant l’horreur de la phraséologie superflue, 135 le goût et l’habitude d’enclore beaucoup de choses en peu de mots... Est-il un meilleur état pour aborder les études supérieures et spéciales, c’est-à-dire pour commencer à apprendre, non plus ce que tout le monde doit savoir, mais ce qui est l’apanage d’un petit nombre d’esprits, ce que le vôtre choisit d’acquérir?
En vérité, chère Françoise, je ne crois pas qu’on puisse nier de bonne foi les avantages de ce système de culture ramassée et intensive... Elle ne présente d’ailleurs aucune difficulté en ce qui concerne l’enseignement des sciences, sciences de faits ou de raisonnement... Elle paraîtra peut-être d’une application plus délicate en ce qui concerne la culture littéraire. Attardons-nous un peu sur ce point.
Je suis, pour ma part, tellement convaincu de l’inutilité de l’enseignement dispersé, vague, superficiel, que, même en matière littéraire, je ne craindrais pas d’écrire sur le fronton des classes l’adage essentiel: Timeo hominem unius libri. D’illustres exemples recommandent ce système. Blaise Pascal n’avait reçu dans son jeune âge aucune culture littéraire. Adolescent, il lut les Essais de Montaigne: mais il les lut à fond. Toute sa culture antique sort de là: dans les Pensées, elle paraît énorme... La Cyropédie, un livre de l’Iliade et un de l’Odyssée possédés par une élève de seize ans constituent (à mon sens) une rare culture grecque. 136 De même, pour la culture latine, les Mœurs des Germains, un livre des Géorgiques, deux ou trois épîtres d’Horace. Aux pédagogues de l’enseignement vague qui diraient: «Alors l’élève ignorera le plus grand nombre des chefs-d’œuvre littéraires?» je répondrai qu’il en est ainsi même à présent. Rien n’est plus arbitraire (et souvent plus bouffon) que le choix des auteurs imposés alternativement par les programmes. Pourquoi Denys d’Halicarnasse et pas Théocrite? Pourquoi Ovide et pas Juvénal? N’est-il pas inouï, si vous prétendez à un enseignement intégral, qu’un jeune homme ou une jeune fille issus des cours secondaires ignorent Gœthe ou Shakespeare, sauf de nom? C’est pourtant ce qui arrive, selon que l’élève a suivi les cours d’anglais ou ceux d’allemand. Dans les deux cas, l’élève ignore Stendhal, Chateaubriand, Sand, Balzac,—pour ne parler que des Français... Vous voyez bien que vous choisissez. Seulement votre choix est arbitraire, et en somme injustifiable.
Puisqu’il faut se borner, puisque le temps et la capacité intellectuelle de l’élève nous contraignent à choisir, je recommande encore le système du petit livre, du précis, qui prend dans ce cas le nom charmant d’anthologie, choix de fleurs. Oui, résolument, pour l’instruction littéraire de Françoise II, il me plairait toujours, si j’étais ministre, de commander à des maîtres le volume très court qui contiendrait 137 seulement des passages de choix d’auteurs de premier plan.
Le jour où je mettrais pour la première fois cette anthologie entre les mains de Françoise II, je lui dirais:
«Petite Françoise, voici un livre comme il en existe un grand nombre: c’est un livre de morceaux choisis. Le titre n’a pas une très bonne réputation: c’est qu’il y a beaucoup de «morceaux choisis» très mal choisis. Rien n’est plus aisé, en effet, pour un paresseux ou pour un sot, que de fabriquer un bouquin en taillant à tort et à travers dans des œuvres illustres. Le présent recueil a ceci de spécial qu’il a été composé par de vrais érudits, pour un objet déterminé. D’abord le choix des noms d’auteurs n’a rien d’arbitraire. On a systématiquement limité l’érudition qu’on vous impose. Tous les auteurs qui sont nommés ici ou bien sont des maîtres ou bien ont l’importance de faits historiques. Tous les morceaux qu’on a choisis dans leurs œuvres ou bien sont célèbres, habitent traditionnellement la mémoire des hommes cultivés, ou bien sont caractéristiques de la manière des auteurs, ou bien présentent un modèle littéraire particulièrement précieux, ou enfin, si nulle autre raison de choix ne s’est imposée, vous offrent un enseignement historique, géographique, scientifique, outre l’enseignement littéraire...
«Vous comprenez, Françoise, qu’un tel livre a été infiniment difficile à composer. Aussi, pour le composer, nous sommes-nous 138 adressés aux princes de la littérature et de la critique, et non pas à M. Durand, Colas ou Jeannot, payé cent francs pour ce travail par un éditeur rapace.
«Maintenant, petite Françoise de dix ans, sachez bien qu’il y aurait quelque chose de meilleur encore que l’anthologie: ce serait de réunir une bibliothèque contenant l’œuvre complète de tous les auteurs cités dans cette anthologie et de vous faire connaître toute cette œuvre à fond. Ce serait meilleur si ce n’était impossible, et parce que vous êtes trop jeune, et parce que le temps nous presse. Donc ne parlons même pas de cette solution pour la regretter: autant regretter de n’avoir pas double cerveau et vie deux fois plus longue... L’anthologie bien possédée vous acquiert des clartés de tout, rien de plus.
«Afin que votre jeune esprit se rende compte de ce qu’est «une œuvre» à côté de fragments notables, mais isolés, on mettra entre vos mains une ou deux œuvres entières, pas plus, car les journées sont brèves, et vous ne sauriez tout connaître entre dix et dix-huit ans.
«Enfin, on ne cessera pendant les années 139 d’enseignement secondaire de vous exhorter à poursuivre, plus tard, par d’abondantes et libres lectures, les études dont vous apprenez ici les éléments et la méthode.
«Il faut que votre érudition, au sortir de notre enseignement, ressemble à un corps de logis essentiel, bien bâti en pierre de taille, bien distribué, bien aéré, mais faisant partie d’un plan architectonique plus général. Édifice assez solide pour qu’on puisse l’exhausser par d’autres étages, et portant aux chaînes de ses pignons les pierres d’attente où viendront s’encastrer les chaînes des autres ailes, que, dans le cours de la vie, vous construirez librement.»
«Mon oncle, m’écrivez-vous, tout cela va fort bien. Mais vous n’êtes pas ministre de l’Instruction publique. Vous ne le serez jamais. Donc, quand Françoise II arrivera à l’heure de l’enseignement secondaire, les fameux «discours», les précis savants, les merveilleuses anthologies n’existeront pas. 141 Comment donc, hors des hypothèses et dans le réel, éduquerons-nous Françoise II? Votre admirable méthode me paraît ressembler à la jument de Roland; comme ce quadrupède légendaire, elle a toutes les qualités: son unique défaut est de ne pouvoir exister.»
Rassurez-vous, Françoise: notre méthode n’a pas besoin des pouvoirs publics. Je vous ai exposé son application à un enseignement officiel idéal. Pour l’appliquer à Françoise II, il n’est pas indispensable que tous les outils de l’enseignement officiel soient achevés et disponibles. Quelque chose est plus précieux que les outils, c’est la méthode même.
Si le professeur de Françoise II est résolu à appliquer ladite méthode et s’il n’est pas un sot, il fera déjà en bien moins de temps une élève infiniment plus instruite. Seulement il faudra qu’il s’impose à lui-même le soin de préparer à son élève la nourriture concentrée que nous recommandons. Il faudra qu’il prenne le meilleur traité élémentaire de chaque science et que, selon le cas, il le complète ou l’allège. Ainsi Françoise II travaillera sur des textes assurément moins parfaits que nous ne les rêvions; mais du moins on lui imposera d’acquérir une quantité de notions d’avance mesurée, précisée, et ces notions, on les lui fera posséder de façon définitive. Là est l’important de la méthode. L’excellence des textes n’est qu’un surcroît.
Vous m’écrivez encore, ma jolie nièce, qu’un autre souci vous préoccupait tandis 142 que je vous exposais le plan d’enseignement secondaire destiné à Françoise II... Comment devra-t-on distribuer le travail de l’élève pour l’acquisition de toutes ces connaissances? En un mot, comment la méthode s’accommodera-t-elle avec les heures de la journée? Cela importe à définir; tant de méthodes excellentes ne prévoient pas les nécessités pratiques de la vie!...
Afin de vous expliquer cette harmonie de la méthode et des heures, je vais simplement imaginer une journée de Françoise II et la remplir. Soucieux de traiter le cas général, nous supposerons la fillette en pension... Elle a une douzaine d’années, sa santé est moyenne: je veux dire qu’il ne la faut point surmener. Votre amour-propre de future maman ne se froissera point si je prévois à cette hypothétique demoiselle une intelligence et un goût de travail simplement ordinaires.
Le P. Gratry, chère Françoise, dans un très aimable récit de sa propre jeunesse, s’indigne contre l’excès de travail «que les hommes imposent aux enfants, alors qu’ils refuseraient de se l’imposer à eux-mêmes». Le P. Gratry a raison. Un plan de journée dans lequel treize heures, ou même onze heures, sont prévues pour l’effort et deux ou quatre pour la récréation n’a pu être imaginé que par un garde-chiourme de profession ou par un moine tortionnaire. C’est barbare, et d’ailleurs c’est imbécile. On ne travaille pas treize heures, 143 ou du moins on ne fournit pas treize heures de travail intensif, à moins d’être un phénomène promptement voué à l’usure et à la mort (Balzac). Ceux qui imposent treize heures d’étude à l’enfant s’en doutent bien: ils ne sont, en fait, ni des garde-chiourme ni des tortionnaires. Mais ils appliquent au procédé de travail de l’élève les mêmes principes lâches et vagues qu’à la composition du programme d’enseignement. Toujours l’illusion scolaire! Sur les treize heures de prétendu travail, heureux si l’élève n’en consacre que douze à la flânerie, au sommeil furtif ou simplement à cet ennui spécial, dissolvant, qui ronge les pensionnats!
Quand j’évalue le temps que j’ai perdu ainsi, dans le sens absolu du mot, sans profit ni pour mon esprit ni pour mon corps, pendant les années de ma jeunesse, l’envie me prend d’aller demander des comptes au mânes de M. de Cumont, en ce temps-là ministre de l’Instruction publique.
On ne travaille pas treize heures, ma chère nièce, ni dix, ni huit, ni sept. La moyenne des jeunes cerveaux ne peut donner plus de TROIS heures de travail quotidien. Trois heures au lieu de treize: vous voyez que nous ne procédons point par demi-mesures... Savez-vous toutefois que trois heures pendant sept années scolaires cela fait près de six mille heures? Qui de nous a employé utilement six mille heures de son adolescence d’écolier?
J’appelle heures de travail les heures d’effort 144 intellectuel intensif, consacrées soit à écouter un enseignement précis, soit à comprendre des raisonnements, à retenir des faits, soit enfin à s’exercer pratiquement à un art ou à une science: faire une composition française, par exemple, ou résoudre un problème d’arithmétique. Je n’appelle pas heures de travail intensif celles où l’élève écrit une lettre à sa famille,—ni celles où il lit un livre, même sérieux et utile, écoute une conférence même profitable, si les contenus du livre et de la conférence ne sont pas destinés à être sus, possédés par lui.
Tout cela bien établi, voici comment j’imagine distribuée la journée de Françoise II.
Elle ne se lève pas avant sept heures, et guère avant huit heures en hiver. La coutume du lever avant l’aube est un legs des moines: convenable pour des moines, elle ne l’est pas pour de jeunes laïques. Il faut se lever quand la lumière du jour rayonne dans les maisons, et, autant que possible, à peu près à la même heure en toute saison.
Ce n’est pas trop pour une pensionnaire de consacrer soixante minutes, après le lever, à la toilette matinale. La fillette s’habituera ainsi de bonne heure à ne commencer le travail de la journée qu’une fois nette et honnêtement parée. L’habitude lui en restera plus tard, et on ne la verra pas traîner jusqu’à midi, jeune fille, jeune femme, en robe de chambre, les cheveux brouillés.
145 Il est neuf heures. Notre petite Françoise II, sa chevelure bien lissée, sa jeune peau bien brillante et ses idées bien claires, descend au réfectoire, où elle prend son premier repas avec ses compagnes, en pleine liberté de parler, de remuer, de rire. A mon avis, le repas matinal le mieux adapté à l’appétit de l’enfant est le déjeuner anglais, dont le type est: des œufs, de la confiture, arrosés de thé ou café au lait. Vers neuf heures et demie, le déjeuner est fini. Les élèves vont en classe.
Une classe d’une heure est déjà longue. Une classe qui dure plus d’une heure et demie est un non-sens. Hommes faits, accoutumés au travail, nous n’écoutons pas attentivement un de nos semblables s’il parle une heure et demie. On impose aux enfants des classes de deux heures! encore un effet de ce que nous avons appelé l’illusion scolaire.
Nous tiendrons une heure seulement en classe Françoise II et ses mignonnes compagnes. Ou plutôt nous ne limiterons pas la classe d’une façon si étroite. Un laps total d’une heure et demie sera prévu pour elle, mais avec une heure seulement d’effort intensif. La demi-heure restante sera consacrée à la conversation entre le maître et les élèves. Toutes les fois que cette conversation sera jugée inutile, les élèves y gagneront quelques minutes de loisir. Mais l’heure minimum consacrée à la classe sera ce que nous appelons intensive: le maître y fera vivre devant les élèves la science qui est dans leurs livres. Par 146 des explications, par des commentaires, au besoin par des lectures appropriées à l’âge et à l’esprit de son auditoire, il complétera et diversifiera ce qu’un enseignement borné à un livre unique aurait de sec et de monotone.
C’est juste après la classe que je placerais l’heure d’étude consacrée à apprendre ce qui vient d’être enseigné. Une heure intensive y suffira, utilement prolongée par une demi-heure de travail en commun des élèves, où la conversation soit permise, où les plus faibles puissent aller s’asseoir à côté des plus fortes et se faire aider par elles, avec le sentiment de la liberté, de l’effort spontané.
Tout ce bel exercice a mené les fillettes jusqu’aux environs de midi et demi. On leur donne une demi-heure pour faire un brin de toilette, et à une heure on leur sert à déjeuner.
Il n’y a pas à recommander la frugalité aux repas des pensionnats; je tiens de vous, Françoise, quelques renseignements concluants là-dessus, du moins en ce qui concerne l’institut Berquin. De cette frugalité les jeunes filles se plaignent rarement. La jeune fille gourmande, en France, est un phénomène. Tout de même, la nutrition ayant son importance dans l’œuvre de formation des jeunes filles comme dans celle des jeunes gens, il y aurait peut-être lieu que des inspecteurs exerçassent là-dessus un sérieux contrôle, tant dans les établissements libres que dans ceux de l’État... Mais ce n’est pas la question 147 présente... Admettons que vers une heure et demie toutes les petites demoiselles aient déjeuné, bien déjeuné. Qu’allons-nous en faire jusqu’à la fin de la journée?
D’abord nous allons libérer leur esprit de tout travail intensif jusqu’à cinq heures environ. Durant trois heures et demie, pas de cours intellectuels, pas d’études, pas de devoirs. Repos pour la tête. Ce n’est pas trop que trois heures et demie par jour soient consacrées aux exercices du corps, à la lecture libre et agréable, aux arts d’agrément, à la préparation des habitudes ménagères. Sur ces trois heures et demie, j’en prévois une seule par jour, prélevée alternativement pour ceux des exercices corporels qui exigent un enseignement,—la gymnastique, par exemple,—pour les travaux féminins par excellence (couture, 148 cuisine, ménage), pour la leçon d’arts d’agrément. Les deux heures et demie restantes seront laissées à l’élève pour lire, jouer, s’exercer dans les arts qu’elle cultive, coudre si elle veut, mais, j’y insiste—librement. En somme, je veux que pendant l’après-midi la jeune fille fasse, bien entendu sous les yeux et au besoin avec l’aide des maîtres, l’apprentissage de son rôle de femme.
La vie scolaire proprement dite ne recommencera que vers six heures, après un léger goûter. Nous profiterons alors de ce que toute une après-midi de repos intellectuel aura derechef rendu dispos l’esprit des élèves pour placer à ce moment la troisième heure de travail intensif.
Elle sera avantageusement consacrée à un exercice pratique: résoudre un problème d’arithmétique, élaborer une composition française, faire un thème, une version, un résumé d’histoire ou de géographie.
Autant que possible, ces exercices devront correspondre à la classe, à l’étude matinales du même jour. Et quelle qu’en soit la matière on leur appliquera les mêmes méthodes de brièveté et d’intensité. On n’imposera pas trois problèmes, mais un problème: seulement on exigera que la solution soit suivie du rappel, écrit sans livre, de toute la théorie invoquée pour le résoudre. Pareillement une version de dix lignes, à laquelle s’adjoint un commentaire continu, écrit, d’analyse grammaticale, 149 apprend plus à l’élève qu’une traduction approximative de cinquante lignes. Plusieurs fois par semaine, durant l’heure du travail vespéral, l’élève devra tout simplement récapituler au moyen d’un texte précis (toujours écrit sans livre) ce qu’elle sait en telle ou telle matière, depuis les éléments jusqu’aux points où elle est arrivée. Et toujours une rallonge d’une demi-heure, après l’étude du soir, servira à la libre communication des élèves entre elles ou avec la personne qui les surveille.
A sept heures et demie, brin de toilette; dîner.
Je trouve mauvaise la coutume de coucher les élèves à huit heures: c’est encore une coutume de religieuses, qu’elles seront forcées d’abandonner dès qu’elles se mêleront à la vie ambiante. J’aime infiniment mieux leur donner de l’école la sensation de la «soirée», utile ou divertissante, qu’elles auront dans le monde.
N’est-il pas surprenant que les écoles du système courant, en France, école de filles ou école de garçons, ne contiennent pas une pièce commune, destinée à abriter les élèves quand ils ne sont pas en classe, à l’étude, au réfectoire et au dortoir? La cour, l’horrible cour morne et pelée, doit suffire à tout, avec un hangar en cas de pluie, comme pour des moutons ou des poules...
Vous m’interrompez:
—Sachez, mon oncle, me dites-vous, qu’il y a, à l’institut Berquin, une très vaste salle où l’on nous rentre quand il pleut, quand il 150 neige, quand il fait bien froid. Seulement, comme cette salle consiste en quatre murs nus, qu’on ne peut s’y asseoir que par terre et qu’elle est horriblement humide en hiver, nous préférons remonter dans nos études...
Une telle salle, Françoise, ne sert à rien: il faudrait d’abord la chauffer et la meubler. Je prétends que chaque école doit avoir son hall couvert, confortable, où les élèves se comportent, quand ils—ou elles—sont libres de se distraire, comme des gens convenablement élevés dans un salon ou dans un club. Pour des jeunes filles, bien entendu, ce hall pourra être aussi orné, aussi attrayant, aussi féminin qu’on le jugera à propos. Et c’est là qu’elles se tiendront les soirs des mois d’automne, d’hiver et de printemps, quand on ne saurait sortir.
J’aimerais qu’un soir sur deux ce hall servît à une conférence sur des questions pratiques, artistiques, sur des faits d’actualité,—à la lecture d’une pièce célèbre, à une représentation familière. Mais j’aimerais aussi que, certains soirs, l’on y fût tout simplement assis par groupes, à causer, ou isolément, à lire, à faire de la musique comme dans la vie.
A dix heures, coucher.
La prière du soir en commun est d’usage dans la plupart des établissements d’instruction. Il me plairait qu’on la fît précéder d’une sorte de méditation commune—sur l’emploi qui a été fait de la journée finie et celui qu’on propose pour le lendemain. Une élève tirée 151 au sort pourrait être chargée de faire à haute voix cette méditation.—Après quoi élèves et maîtresses s’en iraient reposer jusqu’au lendemain.
Voilà, ma chère nièce, ce que serait une journée de Françoise II. Vous voyez que cette façon de comprendre l’enseignement, loin de restreindre l’initiative de l’élève, la favorise, la développe bien plus généreusement que les méthodes usuelles. Discipline du corps, discipline de l’esprit, sont réduites au strict minimum. En revanche, ce minimum est imposé avec une rigueur absolue.
—Alors, mon oncle, le collège où les heures et les travaux seraient ainsi distribués représente pour vous le collège idéal?
—Non, Françoise. Je vous ai décrit simplement l’application, à un collège ordinaire, d’une méthode que je crois bonne. On peut, sans frais et sans fracas, inaugurer cette méthode dans un établissement quelconque de garçons et de filles, du jour au lendemain, par exemple chez l’excellente Mme Rochette, votre directrice. Mais n’allez pas croire que cela suffit pour transformer l’institut Berquin en un collège idéal. Berquin sera toujours une grande prison, clémente à ses prisonnières, je le sais, aimée d’elles,—un grand couvent, si vous trouvez le mot plus juste.
Or le collège idéal n’est ni une prison ni un couvent: c’est une FAMILLE.
152 Vous êtes cent quatre-vingts élèves à Berquin; il n’y a pas de famille si nombreuse, et, s’il y en avait, on serait forcé de la discipliner à la mode des prisons ou des cloîtres. Ce n’est pas non plus l’ordinaire que les familles, surtout quand elles sont nombreuses, soient composées exclusivement de filles. Il y a des frères et des sœurs, et ce mélange familial influe sur l’éducation de l’un et de l’autre sexe.
A l’époque où il sera temps de mettre Françoise II en pension, existera-t-il en France des pensions constituées sur le modèle de la famille? J’en doute, et ce sera dommage, car peut-être le collège familial donnerait-il en France ses meilleurs effets... La réforme que je préconise est plus facile, n’exigeant aucun bouleversement des mœurs et ne choquant aucune timidité. Une maîtresse de pension un peu énergique peut la tenter sous l’inspiration de quelques mères intelligentes. Tout simplement une mère dévouée à sa fille peut l’accomplir chez elle, sur le sujet vivant que la Providence lui a confié!...
Vous vous arrêterez sans doute à ce dernier parti, Françoise. Tant que les collèges de filles ressembleront à des couvents et les collèges de garçons à des maisons d’arrêt, je crois bien que vous aurez raison.
Et me voilà, ma jolie nièce, au terme de cette longue exposition d’une doctrine un peu sèche, un peu sévère. Il faut être une jeune personne aussi sérieuse que vous pour l’avoir 153 désirée, demandée, suivie d’un bout à l’autre.
Mais le temps est passé, Dieu merci! des Agnès nigaudes et sournoises, et même des petites demoiselles de Labiche, que les parents envoient chercher un peloton de fil dès qu’il est question du mariage et des enfants.
Votre génération a des curiosités plus franches. Jeunes filles, vous voulez qu’on vous parle de votre prochain rôle de femmes. Tandis qu’on achève tant bien que mal de vous instruire, suivant les procédés d’une tradition un peu routinière, vous rêvez déjà d’être des éducatrices mieux avisées, mieux informées,—le jour où une autre fillette, chair de votre chair, levant sur vous ses yeux puérils, vous demandera:
—Mère! comment faut-il apprendre?
La dernière fois que je vous rencontrai chez votre mère, chère Françoise, vos premières paroles furent pour me demander «si j’avais vu la ferme». Ce qui me prouva que les murs de l’institution Berquin ne protègent pas absolument les pensionnaires contre la contagion des tics parisiens. Je ne sais plus 155 par quel artifice oratoire j’évitai le piège dissimulé sous votre question, ce qui vous fit faire la moue... Aujourd’hui, Françoise, nul artifice ne m’est nécessaire pour vous répondre; car, bien réellement, j’ai vu la ferme, je la vois tous les jours, il s’en faut de peu que j’y demeure, l’usage de ce pays d’Albret, d’où je vous écris, étant de séparer simplement par une cour commune l’habitation du maître de celle des métayers. Donc je vois la ferme, ses travaux et ses mœurs. J’en suis tout pénétré, je ne pense guère à autre chose. Et, puisque vos jolies lèvres n’ont pas craint l’autre jour d’emprunter leur langage aux familiers des Buttes-Chaumont, vous n’échapperez pas aujourd’hui à quelques propos rafraîchissants sur la vie rurale.
Aimez-vous la ferme, petite Françoise, ou plus généralement aimez-vous la campagne? Sans doute, vous seriez fort en peine de me renseigner; vous n’en savez rien vous-même. Arrière-petite-fille de paysans, il a suffi de deux générations pour vous embourgeoiser, vous «citadiniser» à ce point que vous ne professez pour la terre ni goût ni dégoût. Vous l’ignorez.
—Mais non, mon oncle...
—Mais si! ma nièce. Toutes les fois que je vous ai entendu parler de la campagne, j’ai déploré votre profonde ignorance. Il semble que vous confondiez la vie rurale et la vie provinciale, et celle-ci vous ennuie. Durant 156 quelques vacances, chez vos parents du Poitou, vous avez vu la sous-préfecture; mais vous n’avez pas vu la ferme. Or je crois qu’il manque quelque chose à l’éducation d’une jeune fille de votre âge, lorsque les choses de la terre lui sont tout à fait indifférentes ou tout à fait inconnues. Je regrette que la digne Mme Rochette n’ait pas installé en pleine campagne une succursale de Berquin. Lorsque, vous et moi, nous élaborerons un programme définitif d’enseignement secondaire, nous n’oublierons pas ce perfectionnement.
Élevée, pour cela du moins, à peu près comme vous élève Mme Rochette, la génération de jeunes femmes qui vous précède immédiatement n’eut, comme vous, aucun contact avec la terre; et ce n’est peut-être pas la moindre des raisons qui valurent à cette génération d’être si frivole, si bibelot, si fragile... En ai-je connu, de vos aînées, en ai-je entendu qui me demandaient avec une stupeur sincère: «Mais enfin, à quoi pouvez-vous bien passer votre temps à la campagne?» Qu’on laissât Paris en pleine saison pour vivre en tête à tête avec les champs et les bêtes, elles n’en revenaient point. La plupart affirmaient qu’elles «avaient horreur de la campagne»; les plus indépendantes d’esprit parlaient avec estime de la campagne anglaise, la campagne des seigneurs, s’entend, avec le somptueux château bourré de confort, le tennis, le golf, les chasses d’automne et, désormais, l’automobilisme... Pour quelques-unes, enfin, la campagne se 157 résumait dans les invitations suburbaines de l’été: Louveciennes, Marly, Saint-Germain... Prendre, au lieu du coupé ordinaire, «le train de quatre heures trente-cinq à la gare Saint-Lazare» et dîner avec les mêmes hommes qu’en hiver, ceux-ci ayant seulement échangé le frac contre un smoking, tel était le symbole de leurs passe-temps ruraux. Je vous le répète, cela nous valut d’assez pauvres âmes, dont Bourget et Maupassant furent les exacts historiens.
A l’honneur du sexe fort et laid, il convient d’observer que souvent, laissant les femmes à leurs intrigues, à leurs chiffons, à leurs occupations de simili-littérature et de simili-art, les hommes du même monde se montraient moins distants de la terre. D’abord, la plupart des Parisiens sont chasseurs, et, même réduite à ce massacre systématique d’innocents lapins, comme celle des Parisiens, la chasse est tout de même une école de vie rurale. Elle force à fréquenter les paysans. Elle enseigne à consulter les présages du temps, à étudier les formes des terrains, la diversité et la date des cultures, les mœurs des animaux rustiques et des bêtes libres... D’autre part, nombre de Parisiens connus, répandus, mondains, ont ajouté à leurs multiples labeurs le souci bienfaisant d’une exploitation agricole: ce qui les force à laisser Paris de temps à autre pour surveiller de près leurs intérêts en province. S’ils n’ont pas réussi à inspirer à leurs compagnes le goût passionné des champs, peut-être 158 l’inspireront-ils à leurs filles. Le perpétuel va-et-vient des mœurs et des goûts permet cet espoir. En sortant d’une époque où la mode féminine fut la complication psychologique et le pessimisme libertin, n’est-il pas possible qu’on assiste à une revanche de la santé, de la simplicité? Naguère, le règne des roués fut immédiatement suivi par les temps idylliques de Florian, de Gessner, de Bernardin de Saint-Pierre. Et Mme du Barry vivait encore alors qu’une princesse de votre âge, Françoise, se complaisait à nourrir les poules et à traire les vaches dans sa ferme de Trianon.
Sans vous demander d’être fermière, je souhaiterais, mon enfant, vous inspirer le besoin et l’habitude de la vie rurale, non exclusive, mais intimement mêlée à votre vie intellectuelle, à votre vie de Paris. Toutes sortes d’enseignements qui manquèrent à la génération féminine de la fin du XIXe siècle, et en firent, confessons-le, une génération manquée, cette vie différente vous les fournira sans que vous ayez même le besoin d’un effort pour en profiter. Les femmes de Bourget et de Maupassant pâtirent d’une extrême agitation nerveuse; elles n’eurent aucune réflexion, aucune vie intérieure; elles furent des égoïstes; enfin elles furent des tristes au fond, elles se complurent dans le découragement. Ce n’est point un paradoxe d’affirmer que «les champs et les bêtes» guérissent de tout cela.
Êtes-vous nerveuse, Françoise? Pas trop, 159 pas habituellement; pourtant, quelquefois, la chère Mme Le Quellien me dit: «Je trouve la petite un peu agitée...» et vous-même, je vous entends dire: «Aujourd’hui, j’ai mes nerfs...» De grâce, chère enfant, si vous avez vos nerfs, ne l’avouez jamais; que personne ne s’en doute; cachez cette misère afin de la mieux combattre. Maladie endémique de la fin du siècle dernier, cette nervosité excessive des femmes pourrait bien s’aggraver dans celui-ci. Car la vie moderne comporte, de plus en plus, trop de choses à faire, à lire, à voir; elle excède les forces de la plupart de vos semblables. Même si les femmes s’affranchissent (et ce sera votre cas, je l’espère) du superflu sentimental dont s’encombraient les héroïnes de Fort comme la mort et de Mensonges, elles risquent d’être assez tôt détraquées rien que par le jeu normal de leur activité. Que dis-je? Cette légitime curiosité qui vous anime, cet appétit de connaissance, ce goût de concourir avec l’effort masculin, tout le «nouveau»—et le plus louable «nouveau» de votre génération—aggrave le péril de votre système nerveux. Savez-vous que la fièvre de l’agitation physique et intellectuelle ravage à ce point vos contemporaines d’Amérique qu’elles en sont réduites à faire, sous la direction de coûteux spécialistes, des cures de lenteur et des cures d’immobilité!... Oui, les malheureuses! il faut qu’on rapprenne à leurs membres et à leur cerveau le rythme normal de la vie!... Eh bien! au lieu de vous astreindre 160 à une gymnastique charlatanesque, au lieu de passer des mois dans l’immobilité et l’obscurité, comme les dames de Boston et de New-York, n’est-il pas préférable de la faire chaque année et plusieurs fois l’an, la cure de lenteur face à face avec l’indulgente nature? Ah! ne lisez pas Jean-Jacques, puisqu’il n’est plus à la mode; mais venez prendre hors des villes des leçons de patience, de méditation, de quiétude. Là seulement vous reposséderez ce que la vie citadine supprime: le temps!... N’être plus en retard de huit jours ou d’un mois sur sa propre vie, comme on l’est toujours à Paris; s’affranchir de la tyrannie d’une énorme activité artificielle; pouvoir compter les heures et se dire: «Aujourd’hui, il m’en reste une pour réfléchir»!... Cette heure unique, où vous ne ferez pas de courses, où vous n’écrirez pas de petit bleu, où vous ne verrez pas à la hâte une pièce de théâtre ou une exposition de peinture, pour le vain avantage d’en pouvoir parler,—cette heure vide est précieuse entre toutes: elle est celle de votre vie intérieure,—et nous ne valons que par là. Or, l’heure quiète, propre à la vie intérieure,—retenez ceci qui n’est point banal malgré les apparences,—ni Paris, ni les bains de mer, ni les eaux, ni les voyages ne la donnent. On n’en jouit que face à face avec la terre. La vie rurale vous la donne, dans l’extraordinaire silence qui succède aux travaux du jour. Là, vous aurez enfin des minutes pour vous demander: «Où en suis-je avec moi-même? 161 Quels sont mes projets? Où vais-je, et en quel point suis-je parvenue?» N’est-il pas douloureux de penser que des jeunesses entières d’hommes et de femmes s’écoulent sans qu’ils aient, sans qu’elles aient une seule fois réservé cette heure de loisir, cette heure de vie intérieure, pour s’examiner et se reconnaître?...
La campagne vous donne cette heure: et du même coup elle vous apprend à en user. On peut railler l’idyllisme et traiter ces grandes vérités de rengaines; il est un enseignement auquel on n’échappe point, qui se dégage de la lenteur et de l’infaillibilité des événements dont se compose l’humble drame annuel de la terre. Cela enseigne à la fois la patience et l’espoir... Quand on a mis une parcelle de son désir dans une pauvre tige de bois nu plantée en terre, qui sera un arbre dans quinze années, on commence à se guérir des envies fiévreuses, au jour le jour, des envies à courte portée qui veulent une satisfaction immédiate ou sinon la crise de nerfs... Quand on a éprouvé que, malgré les intempéries, les gelées, les grêles, les printemps trop hâtifs ou trop lents, les sécheresses et les pluies interminables, chaque cycle de douze mois se referme à peu près sur la même besogne accomplie, et 162 que cinq années prises au hasard portent à peu près la même somme de récoltes que cinq autres années quelconques,—on devient calme devant les brusques catastrophes et l’on acquiert une sérénité quasi scientifique, très différente de l’espoir hasardeux ou de l’optimisme quand même. «Il faut très longtemps pour parvenir à faire quelque chose; mais en revanche, malgré tant d’imprévu, les choses entreprises avec l’effort proportionné s’accomplissent à l’ordinaire.» Tel est l’humble enseignement qu’un peu d’agriculture nous donne. Victor Hugo a exprimé cela en deux vers que j’ai longtemps (je m’en accuse) pris pour une adroite cheville, dans un petit poème célèbre. On sent, dit-il, parlant du Semeur:
La fuite utile des jours!... Dire que l’activité citadine a pour principal objet de faire fuir le temps plus vite, et inutilement!...
Enfin, la campagne est une grande maîtresse d’altruisme, de fraternité sociale, de simplicité. Les auteurs bucoliques insistent surtout sur la leçon de simplicité. Il est profitable, en effet, de constater par ses yeux combien peu de place, peu d’objets sont indispensables à la vie humaine. Mais la leçon d’altruisme est la plus importante. Petite Françoise, vous assisterez probablement dans le cours du siècle qui s’ouvre à des révolutions considérables. 163 Ne vous laissez pas prendre au dépourvu, comme les belles dames de la fin du XVIIIe, pour qui fut inventée l’expression: danser sur un volcan. Quelques mois par an passés à la ferme, j’entends quelques mois d’observation attentive, vous adapteront excellemment aux éventualités. Rien comme la terre ne nous inspire la conviction sincère que les choses, même réputées nôtres, nous sont prêtées provisoirement, et que notre effort n’est qu’un petit élément dans l’effort intégral de tous les hommes. Planter un chêne, c’est faire un acte indiscutable d’altruisme: car d’autres êtres humains jouiront du chêne bien plus longtemps que le planteur, et l’auront plus beau. En revanche, lorsque vous cueillez une châtaigne à un beau châtaigner, vous pouvez vous dire presque à coup sûr que l’homme qui planta l’arbre n’existe plus... De la sorte vous vous sentez relié, à chaque instant, et aux êtres qui vous ont précédé et à ceux qui vous succéderont sur le même sol. Vous sentez que vous n’auriez rien si d’autres n’avaient travaillé pour vous; vous sentez que, même malgré vous, vous ne sauriez limiter à vous-même l’utilité de votre effort... Tout vous enseigne l’esprit de solidarité, tandis que votre pitié s’émeut chaque jour devant la pauvre vie de vos semblables... L’ouvrier rural est de tous le plus touchant; il est le plus sain et le moins rétribué. J’assistais hier à une paye hebdomadaire de terrassiers campagnards. Durant la semaine, je les avais vus, sur le coteau 164 prochain, défoncer le sol où bientôt l’on plantera de la vigne. Leur semaine finie, ils emportaient chacun treize francs vingt-cinq centimes pour prix de leur effort... Avec cela ils devront, pendant sept jours, nourrir, en moyenne, une femme et deux enfants... Je sais, d’ailleurs, qu’en payant à ses ouvriers des salaires aussi bas l’agriculteur a de la peine à vivre lui-même... N’importe, Françoise, de tels menus faits économiques suggèrent aux bourgeois de profitables réflexions et les inclinent à penser qu’une société arrangée de la sorte n’est pas la société idéale.
Santé des nerfs, loisirs de la vie intérieure, leçons de patience, d’espoir et de charité, tout cela dans la ferme?... Oui, tout cela, et bien d’autres choses que ne pourrait enclore cette lettre déjà longue. J’y glisse pourtant un conseil encore, un conseil et un souhait. Je voudrais aux jeunes femmes nouvelles le sens de la vie rurale, mais je le voudrais non exclusif, tempéré par l’activité intellectuelle et la pratique des villes... Ce fut la vie d’une Sévigné. Grâce à la facilité accrue des communications, ce pourrait être aujourd’hui la vie de simples bourgeoises. Hélas! il n’en est rien, et chacun peut en vérifier un signe assez frappant. Dans la plupart des habitations bourgeoises de la campagne française, il y a une bibliothèque; mais, hors les brochures sans importance, cette bibliothèque contient bien peu de livres postérieurs à 1830...
165 Petite Françoise, il faut que votre génération féminine, de ses doigts légers et forts, brise la cloison qui sépare aujourd’hui, en France, au grand détriment de l’une et de l’autre, la vie intellectuelle et la vie rurale.
Tous les gens soucieux de se lever chaque matin un peu moins mauvais que la veille (modeste et excellent programme de vie, ma chère Françoise) ont regretté de n’être pas observés constamment par un impartial témoin de leurs actes, de leurs pensées, des mouvements de leur cœur, qui les évoquerait ensuite à son 167 tribunal comme autant de prévenus à juger. Il y a bien la conscience; mais nous la disciplinons si ingénieusement à tolérer nos faiblesses favorites! Et puis, l’examen de conscience dépend de la mémoire, tellement faillible! Il y a bien l’ange gardien. Mais ce personnage ailé de blanc s’obstine à demeurer aussi muet qu’indiscernable, en sorte que nous ne converserons avec lui qu’au moment où l’entretien n’offrira plus que du charme, sans nul profit. Ah! quel Edison du XXe siècle inventera l’appareil merveilleux, miroir et phonographe combinés, d’où notre vie, enregistrée mécaniquement, pourra ressurgir à volonté sous nos yeux?
Je veux être aujourd’hui pour vous, petite amie, cette mécanique enregistreuse. Certes, je vous sais capable de méditer sur vous-même et de vous apprécier sainement. Mais, à certaines heures (d’ordinaire agréables par leur surexcitation même), n’avez-vous pas remarqué que nous perdons la faculté de nous voir agir et, plus tard, de nous rappeler nos actes? Des forces jouent en nous, dirait-on, émancipées de notre contrôle; elles jouent avec l’harmonie aisée, l’impulsive infaillibilité de l’instinct. Après quoi, il nous semble que nous avons rêvé...
«L’azur du lac veillait derrière les feuillages; à l’horizon s’amoncelaient les sommets de l’Alpe des Grisons; une brise passant et se retirant à travers les saules s’accordait avec l’aller et le venir de la vague; nous ne voyions 168 personne; nous ne savions où nous étions...»
Ainsi s’exprime le vicomte de Chateaubriand, contant une promenade sur le lac de Constance en compagnie de Mme Récamier. Elle approchait alors de la quarantaine; l’auteur d’Atala avait soixante-quatre ans sonnés... Quoi d’étonnant si une jeune personne de votre âge, qui n’a pas écrit les Études Historiques et pas tenu salon d’esprit à l’Abbaye-aux-Bois, perd en certaines circonstances la critique de son activité et, comme les deux passagers de la barque, ne sait plus, un temps, où elle est?...
Ce ne fut pas un paysage suisse qui servit de cadre à ceux de vos gestes et de vos propos que je veux vous rappeler. Les blancs murs stuqués, décorés de tableaux, d’un assez riche salon moderne remplaçaient l’Alpe des Grisons; l’incandescence des boules électriques suppléait à la lumière du soleil, depuis longtemps éteinte; le rythme continu d’innombrables valses eût empêché d’entendre le duo de la brise et de la vague,—quand même vous eussiez dansé cet interminable cotillon dans une villa du lac de Constance au lieu de vous y livrer sous les plafonds d’un appartement parisien. Aux côtés de Mme Le Quellien, j’assistais à cette innocente sauterie, donnée par les parents d’une de vos compagnes de Berquin, à l’occasion des dix-neuf ans de leur fille... Vous dire que la sauterie en soi me divertissait serait mensonger. Il y a beau temps que je ne prends plus une part militante à ces 169 transpirations méthodiques; et, comme spectacle, tous les bals non costumés sont affreux à voir. Les parents de votre amie, notables commerçants vitraillistes, n’avaient point cherché à renouveler la formule. Pourtant, je ne me suis pas ennuyé. Tandis que votre mère et toutes les mères souriaient vaguement et murmuraient: «Comme ces petites s’amusent!»—je vous suivais des yeux obstinément, vous, Françoise. J’étais pour vos actions et vos paroles le vivant appareil enregistreur... Or, maintenant qu’on a tourné les commutateurs et renvoyé les violons rue de Miromesnil; que le vitrailliste est retourné à ses ateliers, les petites Berquin à leur pension, et le délicieux frère de Lucie Despeyroux à Saint-Cyr,—je vais vous faire part de mes observations et de mes réflexions. Leur opportunité est manifeste, puisque vous étiez, cette nuit-là, parfaitement absente de vous-même.
Vous étiez absente de vous-même, et je ne m’en étonnais pas. Cette ordinaire sauterie fut pour vous une sorte d’acompte inespéré et prématuré sur «l’entrée dans le monde» dont une dizaine de mois vous séparent encore, et à laquelle vous rêvez sans cesse. Avisée comme vous l’êtes, vous savez fort bien que le «monde» n’est pas tout à fait ce salon de la rue Miromesnil, ni par le décor, ni par les gens qu’on y rencontre, ni même par les danseurs, choisis exprès, ce soir-là, parmi de très jeunes gens. Mais tant de lumière, de 170 bruit et de mouvement vous grisait; votre imagination, votre plaisir et votre désir de vivre transfiguraient les choses autour de vous... Griserie qui persista jusqu’au bout de la fête, jusqu’au moment où je posai votre manteau sur vos épaules chastement décolletées. Je vous mis en voiture avec votre mère. Vos yeux brillaient, vous parliez abondamment, vous riiez un peu nerveusement... Je rentrai chez moi. Mon cinématographe était si chargé d’observations que j’en notai quelques-unes avant même d’aller me coucher.
—Voici, pensai-je, une des mieux nées, des mieux douées, des mieux élevées entre les jeunes filles de la génération nouvelle. Elle a l’honnêteté dans les moelles; le mal lui fait horreur... Jusqu’ici, elle m’assurait (et cela me semblait véritable) qu’elle n’aimait guère être courtisée. Les courtisans la gênaient, l’intimidaient. Je ne l’ai guère perdue de vue ce soir: et j’ai contemplé avec stupeur une Françoise Le Quellien nouvelle, que j’ignorais... D’abord, sans aucun doute, durant cette nuit mémorable, le commerce des jeunes hommes lui fut agréable. Elle a cru, il est vrai, devoir me glisser à l’oreille, dans l’intervalle de deux valses: «Vous savez, ils sont encore plus nigauds que nous autres, tous ces petits gigolos.» Entre la société d’une «petite Berquin» et celle des danseurs qu’elle appelle tranquillement «des gigolos», elle n’hésitait pas. Elle a écouté sans rougir ni se rebeller des fadeurs (que j’écoutais aussi, indiscrètement) sur 171 l’insuffisante échancrure de son corsage. L’interlocuteur était un grand gaillard blond à monocle, avec un œil fripé, dangereux, sous le monocle. Elle dansa enfin le cotillon avec le frère de Lucie Despeyroux, ce saint-cyrien célèbre au parloir de Berquin pour sa jolie taille et son visage fin. Et, quoi qu’elle m’en dît si je l’interrogeais, ce n’était pas seulement la joie de se trémousser en mesure avec un parfait danseur qui éclairait ses joues et ses yeux... Le plaisir insolite qu’elle éprouvait troublait un peu sa conscience. De temps à autre, ayant remarqué que je l’observais sans relâche, elle me jetait un regard affectueux, comme pour me faire entendre: «Mes vieilles amitiés n’ont à craindre aucune concurrence.» Vers la fin du bal, les regards changèrent d’expression. Ils me télégraphièrent à peu près ceci: «Ah! mais... je fais ce qui me plaît, je suppose? Et je ne veux de leçons de personne...» Puis Mme Le Quellien et moi nous fûmes effacés de la pensée de Françoise, et Françoise, oubliant même de danser, s’isola dans sa conversation avec le joli saint-cyrien.
Je me livrai alors à une invocation intérieure dont je ne fis point part à ma voisine tranquillement souriante, mais que vous entendrez, belle danseuse. «O mères, disais-je, mères honnêtes et chrétiennes qui regardez tout cela d’un air paisible, vous ne comprenez donc rien, vous ne savez donc rien?... Si l’on vous avait proposé, quand vos filles avaient six ans, de les élever dans les mêmes classes, les 172 mêmes préaux et les mêmes études que ces danseurs pimpants, qui s’en allaient alors par la vie en culotte mal ajustée et le nez mal mouché, vous eussiez poussé des cris d’orfraies en croix. Vos filles furent éduquées entre filles, tandis que les petits gamins s’acheminaient entre gamins vers le cigare, le monocle et le reste... Aujourd’hui qu’ils ont de vingt à vingt-trois ans, et elles de seize à vingt, vous trouvez tout simple de faire communiquer les deux compartiments jusque-là étanches, et, comme entrée de jeu, vous autorisez l’aparté et le corps à corps! Vous ignorez donc le principal souci de ces jeunes hommes, le sujet des pensées qu’ils avaient en venant ici, des conversations qu’ils auront tout à l’heure entre eux, quand vous leur aurez repris vos filles et qu’ils fumeront une cigarette en regagnant leur logis? Vous ne savez donc pas qu’élevés, eux aussi, soigneusement à part de l’autre sexe, ils ne songent, une fois émancipés, qu’à rejoindre cet autre sexe et à en jouir! On ne vous a donc pas dit sur quels exemplaires ils apprennent la femme? 173 J’entends vos protestations: «Un salon est un salon, ces jeunes gens sont bien élevés, ils se savent en présence de pures jeunes filles, et d’ailleurs nos filles les remettraient à leur place si...» Comptez surtout sur vos filles, en effet. Il est parfaitement vrai que la plupart d’entre elles rebuteront le danseur maladroitement impertinent. Mais n’est-ce donc rien que de les troubler ainsi à l’improviste et de les exposer? Hier, à la même heure, la froide couchette du pensionnat: ce soir l’étreinte du bras masculin, les moustaches contre les joues, les propos admirateurs. Si le propos devient leste, pourtant? Si l’étreinte se fait caresse, dans le tourbillon de la danse? Votre fille aura beau répliquer sèchement qu’elle «est un peu fatiguée» et se faire reconduire à sa place, elle n’en aura pas moins entendu le propos et subi la caresse. Et neuf fois sur dix elle ne vous en dira rien. «A quoi bon tracasser maman? Un rien l’affole...» Dans le cas le plus heureux, quand les danseurs se tiennent correctement, ce qui est rare, n’est-il pas dangereux de soumettre un tempérament de jeune fille à ces brusques alternatives de froid et de chaud? Songez que peut-être (il me paraît que c’est aujourd’hui le cas d’une demoiselle de ma connaissance) ce jeune tempérament, par un cours plus vigoureux du sang, par l’approche de l’émancipation définitive, par une sorte de disposition printanière, est ce soir mieux préparé à s’émouvoir!... L’enfant innocente, prenant cet émoi de nerfs 174 pour de l’amour, ne va-t-elle pas imprudemment, malgré vous et malgré elle, engager son cœur?»
Ainsi, ce n’était pas vous que j’accusais, chère Françoise, mais bien la mode absurde de l’éducation qui vous fut imposée, et que vous vous garderez, je l’espère, d’imposer à vos filles, si vous en avez.
Les jours qui suivirent cette nuit mémorable, je ne cessai pas de penser à vous avec un peu de tristesse... Car je savais bien que, dans un cœur comme le vôtre, le trouble ne serait pas d’une nuit seulement. Tout ce qui s’apprête en vous de dévouement, de tendresse, était en jeu. Vous n’êtes point de celles qui disent, une fois mariées: «Jusqu’à mon mariage, j’ai eu au moins vingt toquades...» Et vous avez raison, il ne faut pas assouplir son cœur, l’emplir et le vider comme une outre. On ne met pas les essences précieuses dans des outres, mais dans des flacons qu’on ferme aussitôt à l’émeri. Vous voilà donc dans l’alternative ou d’aimer sérieusement le danseur d’une nuit, qui déjà, peut-être, ne songe plus à vous,—ou d’apprendre à traiter légèrement, par cette première expérience, les émotions de votre cœur: périlleux entraînement aux toquades.
Ce ne fut pas votre faute, j’y insiste. Les relations entre jeunes gens et jeunes filles, à la fin du XIXe siècle, et en France principalement, ont été réglées de façon détestable. Par 175 une séparation jalouse, à l’âge où leur réunion ne présente aucun inconvénient, on surchauffe la curiosité des uns et des autres. Chaque sexe prend pour l’autre l’apparence et l’attrait d’un fruit défendu: premier inconvénient. Le second, c’est qu’à l’âge où on les mêle garçons et filles ne savent rien les uns des autres. Toute leur adolescence s’est écoulée dans des travaux et des plaisirs différents. Soyons sincères: ils n’ont en commun qu’une seule préoccupation: l’amour. Amour plus idéal chez les jeunes filles, plus terre-à-terre chez les garçons; soit, mais amour... «Dans les collèges, a dit justement Balzac, on parlera toujours de la femme, et, dans les pensionnats, de l’amoureux.» L’adolescence s’achève, les jeunes gens commencent à retrousser leur moustache, les jeunes filles n’ont plus mains rouges ni corsages plats; vite on profite de cet instant physiologique pour mettre en présence ces deux ignorances curieuses, ces deux timidités ardentes... Il n’y a décidément qu’un mot pour qualifier ce système éducatif: il est idiot.
Le système raisonnable n’est pourtant pas bien malin à découvrir; il nous est indiqué par la nature même, et le raisonnement comme l’expérience sont d’accord avec les indications naturelles. La nature compose les familles de garçons et de filles, au hasard des naissances; il en résulte, entre les frères et les sœurs, un chaste sentiment de confiance et de protection. 176 Que si par fortune un cousin, une cousine du même âge sont élevés avec les frères et les sœurs, cela ne cause aucun trouble. C’est un frère, une sœur de plus... Pourquoi le projet d’élargir tout simplement ce mode familial d’éducation se heurte-t-il en France à une si vive répugnance? La nécessité le fait appliquer au tiers de nos écoles primaires, sans le moindre inconvénient. Mais, dès qu’il s’agit de l’enseignement secondaire et des enfants des villes, on se hâte de revenir aux compartiments étanches. Élever en commun les deux sexes demeure jusqu’à présent le privilège des grandes civilisations nouvelles.
Vous portez, Françoise, la peine de notre vieux système, antinaturel et antimoral. Malgré votre instinct de progrès, votre goût de la liberté, ce clair et curieux regard que vous attachez sur l’avenir des femmes,—une éducation demi-cloîtrée influe sur les mouvements de votre cœur. J’ai constaté, l’autre nuit, que l’atmosphère d’un bal, d’un bal à peine mondain, peut faire de vous pour quelques heures une autre Françoise. Connaissez le péril et soyez armée. Plus heureuses que vous, les jeunes filles de la génération prochaine pourront peut-être aller au bal sans autre pensée que de se divertir. Les danseurs ne seront plus pour elles des compagnons nouveaux «dont le cœur n’est pas sûr». Elles les connaîtront aussi bien que leurs propres compagnes. Vous, il vous faut faire d’abord 177 l’apprentissage de ces compagnons. Appliquez là votre faculté de pénétration et d’ironie. Et jusqu’à ce que vous ayez une idée un peu nette de ce qu’est un jeune homme moderne, de ce qu’il sait, de ce qu’il désire, de ce qu’il vaut, mettez au cran d’arrêt les battements sentimentaux de votre propre cœur...
... J’entends les éclats de rire de Françoise:
—Non! mon oncle... mais ce que vous êtes coco, aujourd’hui!... Parce que j’ai un peu flirté avec le frère de Lucie!...
«Coco» ou pas «coco», je souhaiterais que Mme Rochette enseignât à ses élèves que le mot «flirt», avec son apparence pimpante et inoffensive, est parfois un assez vilain mot.
Il n’est pas interdit, Françoise, de se rappeler en carême les divertissements du carnaval, surtout s’ils furent honnêtes et décents. Ma conscience, sur ce point, ne m’adresse aucun reproche. On ne me vit pas, décoré d’un nez artificiel, sonner de la trompe par les places publiques de la ville, ni, du haut d’un char enguirlandé, éblouir les badauds par un 179 travesti de Pierrot ou de Turc: plaisirs que l’Église condamne, je voudrais bien savoir pourquoi. Rentré à Paris le dimanche gras—oui, j’ai quitté «la ferme»—j’eus la joie de trouver sur ma table de travail des livres qui s’y étaient engerbés pendant mon absence: une moisson de choix. Du coup toute envie de sortir me passa. Et, si je n’avais pas eu l’honneur, hier mardi, de vous avoir à déjeuner chez moi avec Mme Le Quellien et de manger ainsi quelques crêpes que nous fîmes de compagnie, le premier carnaval du siècle ne m’eût laissé que le souvenir d’agréables dégustations littéraires.
Mais les crêpes aussi eurent leur mérite et surtout notre concours à les faire sauter dans la poêle. Mme Le Quellien en manqua une seule: ce qui lui présage, paraît-il, une vieillesse à peu près exempte d’ennui. Moi, j’en réussis tout juste la moitié; je n’aurai donc qu’un bonheur couleur du temps, moitié pluie, moitié soleil, larmes et sourires à doses égales. Quant à vous, Françoise, vous les réussîtes toutes avec une sécurité imperturbable. Un geste sec de vos petites mains gantées, et la crêpe exécutait le saut périlleux comme un chien de cirque sous le fouet du maître. La femme de chambre vous avait, pour la circonstance, prêté son plus coquet tablier à bretelles et à bavette. Avant de vous mettre à l’œuvre, vous aviez goûté la pâte du bout des lèvres, et aussitôt vous aviez réclamé l’addition 180 d’un peu d’eau et d’un verre d’armagnac. Victoire, ma cuisinière, obéit en rechignant: mais il se trouva que vous aviez raison. Jamais je ne goûtai crêpes si aériennes ni si parfumées... Je m’amusais fort à vous regarder: cette petite scène m’affirmait à la fois votre science culinaire et votre aptitude à l’autorité domestique. Double mérite bien important! On a beau faire son entrée dans le monde en 1901 et posséder une conscience très avisée de ses droits, il importe qu’une femme, même moderne, sache conduire son ménage. La différence de nos idées avec celles d’autrefois est seulement qu’on disait naguère: «Il faut cela, et cela suffit...», tandis que nous disons: «Cela ne suffit pas, mais il faut cela.»
Dans cette Amérique dont je vous parle souvent, parce que, n’ayant pas de traditions anciennes, l’Amérique a dû constituer un système d’éducation tout neuf, certains collèges mixtes font suivre en commun par les garçons et les filles les cours de cuisine et de couture, sous le prétexte que, les deux sexes étant égaux et destinés aux mêmes fonctions, il n’y a pas de raison pour qu’ils n’apprennent pas exactement les mêmes choses... Un tel usage serait absurde, en France, à l’heure qu’il est. Votre génération, Françoise, conquerra sans doute de notables avantages sur l’exclusivisme des hommes; mais à l’âge où vous serez épouse, mère, maîtresse de maison, c’est-à-dire dans un petit nombre d’années, il est certain que l’organisation et la conduite d’un ménage 181 français bien ordonné seront encore dévolues à la femme. Il faudra donc que celle-ci soit «ménagère», comme disaient nos aïeux, qui avaient fini (et c’était l’abus) par prendre ce mot dans le sens même du mot «épouse».
Toute maison, pour bourgeoise et modeste qu’elle soit, ma chère enfant, est un petit gouvernement, où chaque ministre d’un grand État (au moins les ministres de la paix) trouverait une image réduite de ses fonctions. Vous y voyez le département de l’intérieur, des finances, des relations étrangères, de l’enseignement, etc... Que l’épouse et l’époux, par un accord tacite ou exprès, se partagent la gestion de ces divers départements, il n’y a rien là que de raisonnable. Le partage devra s’opérer de façon que Monsieur et Madame puissent commodément gérer leur département respectif, voilà tout. Je sais, par exemple, un ménage où la femme est masseuse, tandis que le mari, rendu impotent fort jeune par un accident, fait chez lui des calculs pour une compagnie d’assurances. Comme le métier de masseuse est essentiellement ambulatoire et celui de calculateur en chambre essentiellement sédentaire, la force des choses a imposé au mari la surintendance d’un intérieur où la femme ne passe guère que l’heure des repas et la nuit... Pareillement, si l’habitude s’est implantée chez nous de réserver cette intendance domestique à la femme, cela vient tout simplement de ce que l’homme est à l’ordinaire 182 forcé de s’absenter de la maison pour gagner sa vie. Il est donc juste et prudent qu’une jeune fille de votre âge se prépare à l’avance à un ministère qu’elle a tant de chances d’exercer.
Ce ministère de l’intérieur, c’est le gouvernement des domestiques, c’est l’ordre et la propreté des objets mobiliers, c’est le soin des vêtements, du jardin, de la table. Malheureusement, les arts domestiques ne sont attrayants que dans leurs effets. La propreté, l’ordre des meubles, sont joyeux et flatteurs; mais le balai, le plumeau et la «serviette merveilleuse» sont des outils sans éclat. Jenny l’ouvrière façonne des costumes qui valent des poèmes; mais elle y fane ses yeux et y sacrifie la netteté de ses doigts. Enfin, la Sophie de Rousseau, bien qu’elle n’épargne pas ses soins aux devoirs domestiques, «n’aime pas la cuisine. Le détail en a quelque chose qui la dégoûte: elle laisserait plutôt tout le dîner aller par le feu que de tacher sa manchette, et rien ne la déciderait à toucher aux serviettes sales. Elle n’a jamais voulu, pour la même raison, de l’inspection du jardin. La terre lui paraît malpropre; sitôt qu’elle voit du fumier, elle croit en sentir l’odeur...» Ce qui est plus grave, c’est que la plupart des maris, avec le goût de trouver chez eux les choses en ordre et une bonne table bien servie, ont les mêmes répugnances que Sophie. Ou plutôt ils ont ce goût d’ordre et de bonne chère, uni à ces répugnances, avec une sorte d’exaspération. 183 Libérés du souci d’ordonner une maison, nous ne la trouvons jamais assez ordonnée. N’ayant point coutume d’assister aux préparatifs, ils heurtent davantage nos sens.
L’épouse qui, comme dit Horace, gagnera tous les points à cette partie difficile est celle qui saura ordonner son ménage et sa table en bon metteur en scène, sans rien laisser voir des coulisses au spectateur,—au mari. Quand vous faisiez, Françoise, sauter les crêpes du mardi gras, vous étiez charmante à voir; mais vous n’aviez aucunement l’air d’une cuisinière. Votre tablier de soubrette, vos gants, et cette mantille de blonde que vous aviez jetée sur vos cheveux, les abritant des vapeurs qui ne plaisent qu’au palais, tout marquait bien que vous étiez là comme un général empruntant un instant le mousquet du soldat pour lui apprendre à tirer, ou comme un ingénieur corrigeant la manœuvre du maçon novice. Vous n’éprouviez et vous n’inspiriez, à coup sûr, nulle répugnance... J’en déduis que Sophie était une sotte, avec son horreur des serviettes et du fumier. D’abord elle n’avait qu’à mettre des gants, elle aussi. Et puis (voilà des pensées bien idoines à ce présent mercredi des cendres!) le grand mal si les soins de la terre et de la cuisine nous rappellent de quelle poussière nous sommes faits et parmi quel fumier nous vivons? Il eût fallu enseigner à Sophie—mais Pasteur n’était pas né—que sa propre bouche, telle, nous dit Rousseau, «qu’on n’en pouvait voir de plus belle», était, quelque 184 soin qu’elle en eût, une colonie de ferments n’attendant que le dernier souffle pour pulluler, grouiller, dévorer. Il eût fallu lui expliquer qu’afin d’élaborer le jeune sang de ses veines la nature se livrait à une cuisine infiniment moins ragoûtante que celle de notre Victoire façonnant des crêpes. Seulement, la nature conciliante masquait, en Sophie, toute cette cuisine, tout ce fumier, par de délicieuses apparences. La très laide chimie de la vie ne nous choque pas, parce que nous ne la voyons pas. Ainsi la nature enseigne à la femme le secret d’accomplir ses fonctions ménagères sans cesser pour cela d’être séduisante.
Voici donc comme j’imagine la maîtresse de maison idéale. Elle est d’une compétence magistrale en l’art d’arranger et d’entretenir les objets mobiliers; elle connaît tous les détails de la bonne chère. Elle excelle à choisir, à commander ses gens. Mais de tout cela, gouvernement des domestiques et appareils de la maison et de la table, elle ne parle jamais à son mari. Elle est une fée dont la baguette même est invisible. Deux choses exaspèrent un 185 homme qui rentre chez lui ayant travaillé tout le jour: c’est que sa femme lui soumette une querelle ménagère à juger, ou que le repas ne soit pas mangeable. Et il a raison, cet homme, lorsque, dans son ménage comme dans la plupart des ménages français, le ministère de l’intérieur appartient à la femme. De même l’honorable masseuse dont je vous citais le cas tout à l’heure aurait le droit de se mettre en colère si, rentrant chez soi le soir après avoir fourbu ses phalanges à restaurer des muscles de bourgeoises, elle trouvait que son mari, lequel n’a pas quitté la maison, a mal commandé le dîner, ou qu’il compte sur elle pour morigéner la femme de chambre... Lorsque la netteté des appartements et l’excellence de la table apparaissent comme la floraison éclatante d’un mystérieux travail, la «ménagère» de nos aïeux se transforme en véritable artiste. Tout l’appareil, tout le laboratoire disparaît: on ne voit plus que les résultats, qui sont beaux dans le propre sens du terme, puisqu’ils expriment l’ordre, l’harmonie. La difficulté d’obtenir de tels résultats en rehausse le mérite, car, ne vous y trompez pas, Françoise, tout cela est d’une extrême difficulté. Notre pays est le premier, dit-on, pour le joli aménagement des intérieurs et la qualité de la chère: vous constaterez, cependant, lorsque vous irez dans le monde, que l’on compte aisément, même à Paris, les maisons où l’ordre est parfait et parfaite la table. 186
Je ne suis pas inquiet à votre endroit, Françoise. Toute moderne, tout «en avant» que je vous connaisse, vous gardez la tradition de votre famille, vieille famille française éprise de règle et point ennemie de fine chère. Qui vous a vue mardi goûter, assaisonner votre pâte et tourner vos crêpes, devine la pimpante ménagère que vous serez. Ce n’est pas vous qui infligerez à votre mari ni à vos invités cette effroyable cuisine de cercle qui envahit, hélas! tant de tables honnêtes! Mais ce n’est pas vous non plus qui, dans la plus simple intimité, laisserez voir une manchette tachée. Moins nigaude que Sophie, vous sauriez sauver le dîner qui brûle sans maculer votre linge. D’autre part, ce n’est pas dans vos cheveux châtains que le baiser de votre mari percevra jamais un relent d’office... Enfin, j’en suis sûr, vous aurez ce don merveilleux: l’autorité. De quel air ferme et souple vous commandiez à Victoire, la cuisinière, à Clémentine, la femme de chambre! On sentait qu’il n’y avait pas à résister, pas à biaiser; et en même temps l’on avait plaisir à vous satisfaire. Oui, vous avez reçu ce don rare et précieux, cette faculté d’être obéie, qui s’aide assurément de nos organes, de notre regard, de notre voix, mais que confirme surtout l’ordre qui règne dans l’esprit. Savoir parfaitement ce que l’on veut, n’exiger que ce qui est faisable, connaître le temps qu’il faut à chaque effort pour produire son effet, telle est l’essence 187 même de l’autorité, laquelle n’est ainsi que l’expression de l’ordre mental. Or, votre jeune esprit lucide, Françoise, me parut ce jour-là offrir l’image d’un ordre parfait, comme votre chambre de la place Possoz, comme votre pupitre de Berquin, comme vos vêtements, comme vos cahiers.
Tout cela dans quelques crêpes? Mon Dieu, oui! Françoise... Du moins j’y voyais tout cela, et c’est peut-être l’agréable distraction d’avoir vu tant de choses dans vos crêpes qui fit si mal tourner les miennes...
On m’assure, chère enfant, qu’on utilise en Angleterre, comme porteurs de dépêches, des jeunes filles montées à bicyclette. Ces jeunes filles, nous dit-on, «manifestent plus de promptitude et d’intelligence que leurs collègues masculins»... Voilà un métier féminin qu’on ne prévoyait guère. Et je pensais 189 que, si vous n’aviez mieux à faire dans votre pays, alerte Françoise, vous seriez en terre britannique une petite télégraphiste parfaite: car, pour dénicher une adresse, votre malice rendrait des points à quiconque, et votre aisance, votre endurance, votre sang-froid de cycliste, vous ont valu, vous le savez, l’admiration de tous vos amis, outre la mienne.
De façon générale, vous montrez, Françoise, du penchant aux exercices du corps. C’est trop naturel. On ne se soustrait pas à la contagion des modes et des plaisirs de sa génération. Est-il province en France, pour reculée qu’elle soit, qui fasse encore grise mine aux dames de la pédale? Nommerait-on une sous-préfecture de trois mille âmes qui se refuse le luxe d’un tennis? Il est vrai que le sport des femmes françaises (je parle du grand nombre) ne va guère au delà. Tennis et vélocipède les contentent. Ces sports ont, pour l’économe esprit de la France, l’avantage d’être à bon marché; tout le monde ou presque s’y peut adonner, tandis que le cheval ou l’automobile restent des divertissements de luxe. Vous, ma fringante nièce, je crois que, coûteux ou non, tous les sports vous attireraient. Et comme, après tout, pour que Françoise devienne riche il suffira qu’un agréable millionnaire souhaite un mariage intelligent, je vous verrai peut-être un jour galopant dans l’allée des Poteaux ou cornant votre furia de chauffeuse aux oreilles des simples piétons tels que moi.
190 Prévoyons ce cas éventuel et, tandis qu’il en est temps encore, philosophons un peu sur les sports féminins.
D’abord, convenons que le type de la jeune fille frêle, vaporeuse, délicate de la poitrine, type cher aux conteurs de la période romantique, n’est pas celui dont rêvent aujourd’hui les courtisans de votre sexe. La science moderne, avec ses précisions vulgarisées, est la cause principale du changement. Au lieu de «frêle et vaporeuse», la science dit: «anémique et névropathe»; au lieu de «délicate de la poitrine», elle dit: «tuberculeuse». Ces gros vocables suscitent des images désolantes: le dernier surtout évoque les tableaux usuels de pathologie, le buste humain coupé verticalement avec les organes respiratoires saignants, tachés de microbes... Grâce à la science, le charme principal d’une jeune fille est désormais sa belle santé. Or, l’exercice physique est à la fois une preuve et une sauvegarde de la santé. Lorsqu’on vous voit patiner, Françoise, ou manier la raquette, ou monter une côte à bicyclette, on éprouve la joie de contempler un appareil humain solide, harmonieux, jouant bien de tous ses organes, même sans tenir compte des agréments de l’enveloppe.
Accueillons donc et encourageons les sports; mais soyons avertis des dangers auxquels ils exposent quelques esprits de femme insuffisamment pondérés. Le premier est 191 d’attribuer à des occupations en somme inférieures et accessoires une importance démesurée: ridicule encore plus choquant chez les femmes que chez les hommes. Quel Théophraste vingtième-siècle viendra fixer à propos les traits de la femme que les sports hypnotisent? On entrevoit, n’est-il pas vrai? l’esquisse du portrait qu’il pourrait faire:
«Émilie est de bonne naissance et de fortune suffisante; elle a appris tout ce qu’apprennent les femmes de son rang, elle a un mari intelligent et qui l’adore; elle a d’aimables enfants; mais une seule passion la dévore: obtenir par l’effort de ses muscles des résultats auxquels ne puissent atteindre les efforts musculaires d’aucune autre femme ni de la plupart des hommes. Toute son énergie est asservie à cet objet. Sa vie se divise en deux parties, l’une où elle dispute la maîtrise de la raquette ou de la pédale; l’autre où elle s’entraîne pour ces disputes. Elle a renoncé, naturellement, à tous les attraits ordinaires de son sexe; sa conversation est merveilleusement étrangère aux choses de l’esprit. Ne lui parlez pas d’un livre ou d’un événement d’art récent, ne faites pas allusion devant elle à une crise politique ou à un mouvement social; elle ne lit qu’Auteuil-Longchamps, le Vélo et les pages 2 et 3 de certain journal américain publié à Paris, où sont résumés chaque jour les événements sportifs du monde entier... En revanche, elle parle de ceux-ci avec une abondance de documents et une propriété d’expressions effrayantes; elle ne vous fait grâce d’aucun des termes d’argot spécial, d’aucune des 192 abréviations familières dont usent les professionnels du cheval, du cycle ou du golf. Et l’admirable, c’est qu’elle croit très sincèrement que de tels soucis sont les plus nobles des soucis, et qu’elle regarde du haut d’un dédain sincère les mortels inférieurs dont l’ambition ne se résume pas à faire manœuvrer suivant certaines lois arbitraires et précises l’appareil musculaire de leurs bras ou de leurs jarrets...»
Vous avez bien trop de sens commun, petite Françoise, pour être jamais une Émilie. Mais combien de femmes, sans incarner ce type ridicule, ont la faiblesse de parler trop et trop complaisamment des exercices physiques auxquels elles s’adonnent?... Dans la vie courante de la femme, le souci des exercices physiques ne doit pas plus paraître que celui des soins domestiques, par exemple, ou de la toilette. La femme qui me parle hors de propos de ses prouesses de patineuse ou de chauffeuse m’énerve autant qu’à m’entretenir de ses essayages ou de l’arrangement de son intérieur. Comme la grâce du vêtement, comme l’harmonie de la maison, l’adresse musculaire des femmes doit paraître d’elle-même, sans annonce préalable et sans commentaire rétrospectif, au moment précis où elle est requise. On la voit, on l’admire, et c’est tout.
Un autre ridicule bien moderne de certaines femmes occupées de sport, c’est d’être sportives par ambition d’élégance, par snobisme, 193 comme l’on dit. Ah! la belle matière encore à traiter pour le Théophraste du XXe siècle!
«Julie n’était pas destinée par la nature à concourir avec les professionnels de la gymnastique, et, certes, si elle n’écoutait que le conseil de ses instincts, elle s’adonnerait aux soins tranquilles de la maison, elle se divertirait par des lectures et des promenades modérées. Même elle était douée pour les arts: enfant, ses yeux et ses oreilles se plaisaient aux beaux spectacles, aux belles harmonies. Mais la voici possédée du désir de frayer avec ce que les «Mondanités» des journaux appellent le grand monde, et, comme Julie n’a point une origine illustre ni de grosse fortune, elle s’est rendu compte que d’être exceptionnelle en un exercice physique apprécié des mondains forcerait ces mondains à l’accueillir. En quoi elle ne se trompait point. Grâce à une étude persévérante, à un entraînement poussé jusqu’à la mortification, elle est parvenue à être une golfiste incomparable: et, cette espèce étant encore rare en France et ne se recrutant que parmi des gens de loisir, voilà Julie membre du Golf-Club, avec tout ce que Paris compte de muscles aristocratiques... Un jour, le plus beau jour de sa vie, Julie, figurant dans une partie avec un prince de maison régnante, eut l’honneur d’avoir la cheville à demi brisée par un faux mouvement de l’Altesse! Ce jour-là, il lui sembla que toute sa roture héréditaire était abolie, qu’elle devenait elle-même un peu Sérénissime. Il a fallu pour la faire redescendre de ces hauteurs chimériques la plate nécessité d’un fiacre pour rentrer chez elle, et la 194 vue, au logis, d’un mari qui n’a pas même une heure par jour à donner au «training»,—tout son temps étant pris à gagner, dans le négoce des tissus, l’argent du ménage...»
Ce travers, chère Françoise, me semble encore plus insupportable que celui d’Émilie. Il révèle un esprit plus faux: et je ne sais rien vraiment de si attristant que de voir une bourgeoise honnête chercher parmi l’attirail des sports ce que nos aïeux appelaient une «savonnette à vilains»... C’est de l’humilité à rebours, et de la bassesse sous couleur d’ambition. Certes, même cent dix ans passés après la nuit du 4 Août, on ne saurait prétendre qu’une grande naissance, qu’un opulent train de vie soient des avantages négligeables dans la société contemporaine. Mais ces avantages, quand on en est exclu, il est absurde d’en chercher l’apparence,—pas même! le voisinage; il est absurde de croire qu’on sera presque de l’aristocratie ou presque de la grande vie par le reflet de celle-ci sur sa propre médiocrité. Dans le fait, c’est le contraire qu’on obtient. Julie en est pour ses illusions, et elle reçoit de temps en temps de cruelles rebuffades. Elle ne console son amour-propre qu’en fréquentant ses véritables égales, les bourgeoises comme elle, à qui elle peut dire: «La grande-duchesse me contait hier...» ou bien: «Le prince Paul m’a fait ses adieux... Il est charmant, mais je plains sa jeune femme...»
195 Chère Françoise, avertie par votre sens critique et par votre oncle, vous aimerez les exercices physiques, vous ne les exclurez jamais de votre vie, parce qu’ils sont une condition de santé et d’équilibre; mais vous ne leur permettrez pas d’occuper une place qui ne soit secondaire. On vous dira, je le sais, que les sports tiennent le premier rang outre-Manche, et qu’il faut absolument faire comme les Anglais. Croyez d’abord qu’en Angleterre même les sports féminins, pour la masse de la population, ne sont pas à ce point encombrants. Quant aux sports masculins, ils sont en effet répandus, développés à l’excès. Résultat: une nation où l’on doit admirer l’énergie des hommes, sans qu’il soit possible de dissimuler leur faible culture. Auprès d’un Allemand, d’un Français, d’un Italien de même rang social,—exception faite de l’aristocratie,—un Anglais sincère sera forcé d’avouer l’infériorité de sa culture. La guerre du Transvaal vient d’illustrer ce fait d’une façon mortifiante pour nos voisins. Leur exemple démontre combien il est périlleux de glorifier outre mesure le muscle dans l’éducation. Le muscle est et doit rester l’humble serviteur de la tête. Quand la tête lui enjoint de s’exercer, c’est pour le trouver prêt, au besoin, à exécuter n’importe quel commandement ou pour se distraire elle-même. Et, si le muscle se montre adroit et fort, la tête ne doit pas s’enorgueillir outre mesure. Conduire à quatre, sauter à 196 cheval des haies de «un mètre quatre-vingts», faire du «soixante-dix à l’heure» en automobile ou du «trente» à bicyclette, tout cela est fort gentil évidemment; mais il ne faut pas se dissimuler qu’un grand nombre de gens le font. Cela doit rendre modestes la plupart des amateurs de sports, tous ceux qui sont simplement dans la bonne moyenne, qui font des sports—et c’est le cas général—avec la même maîtrise que les demoiselles de pensionnat font de la peinture. Un autre motif de modestie sportive, c’est que tout enfant de constitution ordinaire, exercé à temps, est apte à faire un sportsman de jolie force. Exemple: presque tous les fils de maîtres d’armes tirent bien. Autre exemple: les familles de gymnastes, ornement des cirques ambulants. Soyons donc pleins d’humilité pour les petits talents de nos muscles: ce sont de faciles talents.
Ayant mis le souci des exercices physiques à la place qu’il doit occuper dans votre vie, vous tiendrez, ma chère nièce, en vous y livrant, à garder l’allure et les façons d’une femme. Là comme ailleurs (j’y reviens obstinément presque dans chaque lettre que je vous écris) une femme peut s’adonner aux mêmes occupations qu’un homme, mais il faut qu’elle s’y adonne autrement. Qu’un bicycliste mâle ait l’air d’un singe agrippé par les pattes de devant au guidon et par les pattes de derrière à la pédale, ce n’est que demi-mal, et si 197 ce singe est, dans cette attitude, extrêmement vite, il sera tout de même un glorieux cycliste. Tandis qu’une femme, si elle bat disgracieusement tous les records du monde, est, en somme, une maladroite femme de sport. Ses triomphes sont autant de défaites. L’aisance harmonieuse des gestes est obligatoire pour le joli sexe. Cela indique aux femmes quels exercices elles doivent exclure et que, dans ceux qu’elles ont élus, elles doivent chercher, puisque c’est le mot, à battre le record de la «grâce robuste».
C’était le souci de vos aïeules, Françoise, car les femmes de l’ancienne France aimaient et cultivaient les sports: lisez sur ce point les belles études de M. Jusserand. De ces charmantes aïeules n’abdiquez point la volonté de grâce—tout en demandant à votre énergie et à vos muscles plus qu’elles ne demandaient et 198 en leur imposant une meilleure méthode... Faites comme elles et mieux. Le secret de l’éducation, c’est la tradition corrigée, adaptée, perfectionnée...
L’autre soir, chère enfant, à une représentation de Quo Vadis? tandis qu’évoluaient sous nos yeux les couples voluptueux de «l’orgie romaine», j’eus une distraction. Je me rappelai qu’un certain mercredi, au parloir de l’institut Berquin, où votre amie Lucie Despeyroux, Mme Le Quellien, vous et moi-même 200 formions un groupe assez bavard dans un coin de la salle du fond, l’entretien était venu au fameux roman de Sienkiewicz. Par-dessus les murs austères bâtis par Mme Rochette, le renom de ce triomphe universel avait pénétré jusqu’aux oreilles des pensionnaires. Quelques-unes avaient lu le livre, profitant d’un jour de sortie: elles en avaient raconté l’intrigue aux autres. Ursus, Lygie, l’Arbitre étaient familiers à Lucie et à vous, qui pourtant n’aviez point tenu le blanc volume entre les mains.
—Vous l’avez chez vous, monsieur? me demanda Lucie en chargeant son regard ambré d’une irrésistible prière.
Je feignis de ne pas comprendre son désir. Je répondis:
—Oui... Je crois.
—Oh! vous me le prêterez?...
Il est difficile de refuser quelque chose aux regards suppliants de votre amie Lucie... Mme Le Quellien me tira d’embarras en me demandant à son tour:
—D’abord, est-ce un livre pour les jeunes filles, ce Quo Vadis?
Lucie éclata de rire, et vous l’imitâtes, Françoise.
—Cette maman! Elle a peur de tout!... Quo Vadis? est un livre tout ce qu’il y a de plus moral, presque un livre de piété... N’est-ce pas, mon oncle?
Je réfléchis un instant. Enfin, pressé par vos questions étonnées, je trouvai cette piteuse réponse:
201 —Que Mme Le Quellien le lise d’abord. Moi, je ne sais pas...
Je dois à la vérité d’ajouter que cet oracle fut salué par les huées unanimes des deux alertes pensionnaires qui me consultaient.
Eh bien! chère Françoise, depuis j’ai parcouru à nouveau Quo Vadis? j’ai vu la pièce qu’on en a extraite; je ne saurais donner un avis plus ferme à la séduisante Lucie, si elle n’avait depuis renoncé à me consulter. Je suis presque certain que Quo Vadis? est une mauvaise lecture pour des collégiens. Je n’oserais affirmer qu’elle en soit une bonne pour de jeunes demoiselles en pension. Et ce que je vous dis là de Quo Vadis? je le pense, avec des aggravations ou des atténuations, de beaucoup de romans dit moraux, de beaucoup de pièces de théâtre «où l’on peut aller en famille». Loin de moi la prétention d’affirmer: «Vous pouvez lire ce roman, vous pouvez voir cette comédie...» Quand on a soi-même essayé d’exprimer sa pensée devant le public, quand on a soi-même eu un certain nombre de lecteurs, quelques-uns de ceux-ci (et combien il faut les remercier!) ont pris la peine de vous renseigner sur l’effet moral qu’ils ressentent de vos œuvres: c’est alors que la contradiction des opinions exprimées démontre l’infinie diversité des âmes!... Voyez-vous, Françoise, chaque âme est une terre qu’il conviendrait d’analyser avant d’y jeter n’importe quel engrais intellectuel. Ici il y a du phosphore en 202 excès, et la chaux manque; à côté, c’est l’inverse. Il faut aiguiser celle-ci d’acide pour la rendre productive; il faut ingérer du sel à celle-là. Et l’on pourrait assez raisonnablement poser ce double axiome:
I.—Il n’y a pas de livre moral pour tout le monde.
II.—Conséquence: il n’y en a guère d’immoral pour tout le monde.
Lorsqu’il s’agit de «grandes personnes» la question des lectures morales n’a pas une importance extrême, car la vie réelle est le plus brutal des romans, et d’ailleurs un âge vient où, comme l’ossature du corps, l’armature morale de l’individu est à peu près définitive. Le cas est plus délicat s’il s’agit de jeunes gens, et principalement de jeunes filles. La jeune fille, respectée par tous, peut être violemment ou insidieusement blessée par un roman. Et le pire est qu’aucun esprit avisé n’oserait affirmer, comme les imprudentes réclames de librairie, que tel roman «peut être mis entre toutes les mains».
Comment faire? Comment répondre à la confiante question d’une jeune fille comme Lucie ou comme vous, Françoise, demandant: «Puis-je lire ce livre?»
Il y a plusieurs doctrines, pour ne parler que des raisonnables.
La première, la doctrine traditionnelle de la France, celle qui régnait encore dans mon enfance, fut d’avoir pour les jeunes filles une littérature expressément neutre. Il y a de cette 203 littérature des exemples célèbres: tels les récits de Mme de Genlis, les proverbes de Mme de Maintenon, les romans de ce Berquin, patron de votre école. Je crois bien qu’une telle littérature est spéciale à notre pays. Je n’en connais pas d’aussi notoirement innocente hors de chez nous. Elle réalise vraiment le maximum d’honnêteté, la plus forte probabilité de non-péril. La jeune fille qui se monterait la tête à lire le Petit Grandisson donnerait la preuve d’un tempérament exceptionnel. Je n’en dirais pas autant, par exemple, des fameux romans anglais dont nos voisins d’outre-Manche nous vantent la moralité. Ni le Vicaire de Wakefield, ni, pour parler de «bons romans» plus modernes, Dodo ou The Manxman, ne sont absolument appropriés à l’âme d’une Agnès de Molière: ils l’inquiéteraient. Et j’accorde qu’Agnès aurait tort; mais, si l’on adopte un système d’éducation, il faut l’appliquer sans défaillance.
Ce système a de moins en moins d’adeptes aujourd’hui. Est-ce faute de Berquins, de Maintenons ou de Genlis? Peut-être. Un magazine se fonda il y a quelques années pour les jeunes filles: les jeunes filles s’y abonnèrent, mais au bout de quelques mois ce fut parmi elles un tollé contre l’insipidité des romans que leur magazine publiait... Nous vîmes en même temps naître un théâtre blanc comme l’âme d’Agnès. S’il existe encore, il ne fait guère parler de lui.
Le principal défaut du système autrefois classique n’est pas, du reste, la difficulté 204 d’offrir à la jeune fille une nourriture romanesque exempte de tout danger et cependant savoureuse. C’est de se fier uniquement à la vigilance du pourvoyeur et de ne faire aucun appel à la volonté, à la probité de la jeune fille. Un beau jour Agnès trouve un vrai roman oublié sur une table. Aguichée par la saveur imprévue de ce ragoût, elle le dévore en cachette. Voilà compromis l’effet du système, et, de plus, voilà l’hypocrisie encouragée.
Un second système, assez en honneur parmi les champions «avancés» de l’éducation féminine moderne, c’est de laisser la jeune fille libre de ses lectures, dès qu’elle n’est plus tout à fait une enfant. Si révolutionnaire, si antitraditionnel et j’ajoute si peu séduisant que nous apparaisse le système, les arguments par lesquels ses partisans le défendent ne manquent pas de force.
«Comment, nous disent-ils, une petite Française peut être légalement épouse à seize ans, mère à dix-sept ans, c’est-à-dire que, dans la pratique de la vie, l’activité sociale de la femme se manifeste près de dix ans plus tôt que celle de l’homme; et c’est la jeune fille que vous tenez le plus longtemps à l’écart de la réalité? N’est-ce pas absurde? Ne doit-elle pas, au contraire, être renseignée sur la vie, armée pour la vie la première, elle dont la responsabilité conjugale, sociale, commence à l’âge où l’homme est à peine bachelier?»
Ces raisons ont leur poids; mais le système 205 de lecture sans frein et sans choix qu’elles recommandent est vraiment trop contradictoire avec le type traditionnel de la jeune fille en France. Qu’Agnès, papillon curieux, brise sa chrysalide, essaye ses ailes au grand air, soit! toute cage est malsaine. Mais que gagnera-t-elle à déflorer prématurément la poussière qui décore ces ailes brillantes? Nous touchons ici, Françoise, à l’une des dangereuses erreurs du féminisme exaspéré. Rendons plus pareille l’éducation des deux sexes, soit, mais en assainissant d’abord, en moralisant celle des garçons. Le résultat serait déplorable d’élever les jeunes filles à l’image de nos collégiens d’aujourd’hui.
—Et votre système, à vous, mon oncle? En avez-vous un, seulement?
—Oui, Françoise, n’en déplaise à votre ironie, j’ai un système.
Je peux hésiter à vous recommander, à vous défendre tel roman, parce que, malgré nos confidences réciproques, vous êtes encore, sur beaucoup de points, chère enfant, un mystère pour moi. Ce n’est pas moi qui vous ai élevée, qui ai formé votre esprit, d’années en années. Mais si cet honneur m’était échu je vous aurais accoutumée à juger par vous-même, autant que possible, de l’opportunité de vos lectures. Du jour où votre curiosité se serait éveillée, nous en aurions conversé ensemble. Je vous aurais avertie que la conscience de la jeune fille, si elle est saine et bien 206 disciplinée, est un fort bon juge. Assurément j’aurais écarté de vos yeux et de vos mains certains livres dont les titres mêmes sont une injure pour une âme délicate, mais, parmi les autres, je vous aurais demandé de me guider vous-même. «Chaque fois, vous aurais-je dit, qu’une page de livre vous cause une inquiétude, un malaise moral, arrêtez-vous à l’instant, fermez le livre et venez me confier votre souci. Peut-être est-il puéril: d’un mot il sera dissipé, et, dès lors, rassérénée, vous continuerez votre lecture. Si, ayant lu un livre d’un bout à l’autre sans que rien vous y ait alarmée, vous vous sentez cependant déprimée, moralement moins active, moins ardente à bien faire, tenez le livre pour mauvais, et ne lisez plus rien de son dangereux auteur. Ainsi, peu à peu, vous vous accoutumerez à faire vous-même le choix de votre nourriture intellectuelle, comme vous faites celui de vos aliments. C’est la sagesse même, car un esprit est aussi mal venu à prétendre imposer ses lois à un autre esprit qu’un estomac à un autre estomac.»
—Alors, mon oncle, si rien ne me choque, je puis lire sans danger toute espèce de romans?
Soyez certaine que votre conscience s’alarmerait bien plus tôt que vous ne le pensez. Et puis, correctif important au système des «lectures responsables», le premier conseil à donner aux jeunes filles est de lire le moins possible de romans. Il n’est nullement indispensable à Lucie ou à Françoise de lire «tout ce qui 207 paraît». L’abondance des lectures romanesques, entre autres méchants effets, empêche la jeune fille de pourvoir à sa véritable économie intellectuelle. Elle se figure être «au courant de la littérature» parce qu’elle peut causer du roman à la mode. Et assurément, surtout en France, le roman est une forme littéraire d’une ampleur merveilleuse; mais, parmi toutes ses importantes qualités, on ne saurait compter celle de former l’esprit et le cœur des jeunes filles... Enfin, durant la période d’éducation, il importe bien plus que la jeune fille apprenne à connaître le style, l’art d’un romancier, que ses romans eux-mêmes. A la place de Mme Rochette, j’exclurais de l’institut Berquin les volumes jaunes, bleus ou blancs à 3 fr. 50; mais j’inaugurerais des cours sur la littérature contemporaine et je laisserais librement entre les mains des élèves des anthologies de nos romanciers, telles qu’en fit, par exemple, Gustave Toudouze pour Daudet... Quant au roman lui-même, il serait proscrit de l’école, fût-il approuvé par Mgr de Tours; le roman est, par excellence, un «objet de divertissement», et, dans le temps des études, le divertissement doit surtout consister à jouer aux barres, au tennis, à faire de la bicyclette et du «footing».
De ce qu’on ne lirait plus de romans, même moraux et recommandés par Mgr de Tours, dans les écoles de demoiselles, il n’en résulterait pas qu’on n’y entretiendrait plus le goût des lectures. Au contraire, on y lirait davantage 208 les choses importantes qu’on ne lit guère plus hors de l’école. L’absence de lecture de nos jeunes filles modernes—malgré l’apparente surcharge des programmes—est désolante. Songez qu’à votre âge, Françoise, une Mme Roland avait lu Vertot, Descartes, saint Jérôme, Diodore de Sicile, Young, Pascal, Montesquieu, Locke, Virgile, Clarke, Homère, Cicéron, Diderot, Pope, d’Alembert, Platon, Machiavel, Xénophon, Réaumur, etc., etc... lu et annoté en faisant des extraits! (Voir Mme Roland, par Oct. Gréard.)—Et vous, Françoise, qu’avez-vous lu? qu’ont lu vos compagnes? En est-il une seule, dans toute l’institution Berquin, qui ait, d’un bout à l’autre, parcouru ce livre, qui fut, en France, le bréviaire de toute une génération: les Hommes illustres, de Plutarque?
Lisez les Hommes illustres, Françoise. Quand vous les aurez bien lus,—si vous avez encore envie de lire Quo Vadis?—nous en recauserons.
Je me préparais, chère enfant, à vous écrire encore quelque tranquille commentaire sur un point d’éducation, quand votre lettre m’arrive et bouleverse mes projets...
Décidément, l’œil clair des jeunes filles ne révèle rien de leurs pensées intimes, même à l’observateur professionnel. Quoi! Françoise, 210 de si graves desseins vous inquiétaient, tandis que je vous croyais exclusivement occupée de sciences, de lectures, de bicyclette ou de toilette? J’en demeure confondu,—sans vous reprocher pourtant d’avoir gardé le secret. Notre cœur, selon le mot de saint Paul, ne doit pas être un vase qui fuit... Et voilà qu’après m’être irrité un instant de votre mystère votre confiance d’aujourd’hui m’embarrasse. Peut-être bien fait-elle lever en moi quelque méchant ferment d’égoïsme. S’entendre dire par une jeune fille: «Je vais vous confier ce que je n’ose dire à ma mère de peur de la troubler à l’avance...» et recevoir ensuite l’aveu du premier sentiment tendre de cette jeune fille pour un homme de vingt-trois ans,—c’est assurément flatteur,—mais cela classe tout de suite le confident, n’est-il pas vrai, dans la réserve de la territoriale? Vous les connaîtrez un jour, Françoise, ces surprises angoissantes que prépare à la jeunesse persistante de notre âme la franchise inconsciente des êtres physiquement jeunes. Vous saurez la mélancolie de cette constatation résignée: «Tiens! cela encore ne m’appartiendra plus...» N’importe! Plions-nous à la loi nécessaire de nos âges respectifs—vous, en souhaitant épouser un jeune homme que vous aimez, moi, en vous donnant paternellement les avis que vous me demandez.
Donc, Françoise, il se trouve que je vous avais à la fois devinée—et un peu calomniée—ce 211 soir de bal où je vous vis danser le cotillon avec le joli saint-cyrien, frère de votre amie Lucie Despeyroux. Je vous avais reproché de risquer votre cœur dans une aventure de coquetterie. J’ignorais que votre cœur était déjà donné et pris. Il paraît que le complot date de près d’une année, ô petite masque; les conspirateurs étaient Lucie, son frère et vous. Ainsi, quand, à la rentrée dernière de l’institut Berquin, vous me demandiez gravement de vous renseigner un peu, par delà les murs de la pension, sur les réalités de la vie—l’avenir de votre vie commençait de se fixer... Et moi qui vous entretenais de livres, de sports, de costumes! Vous deviez lire mes lettres d’un œil bien distrait; et, si j’avais su, je vous aurais parlé d’autres sujets.
Vous plaidez gentiment les raisons de votre silence:
«Songez, mon oncle, comme de telles choses sont délicates à dire, et combien il faut être sûre de son propre sentiment pour le confier, même à un ami aussi cher que vous!... Qu’auriez-vous pensé de moi, si, vous ayant dit il y a six mois: «J’aime le frère de Lucie», j’avais dû vous dire, quelque temps après: «Non, décidément, je ne l’aime pas»? Eh bien! mon oncle, croyez-moi si vous voulez, mais les jeunes filles les meilleures sont exposées à de tels changements. Lucie, par exemple, qui est exquise, a déjà eu trois toquades pour des personnes à qui, d’ailleurs, elle n’a jamais parlé; elle ne les a confiées 212 qu’à moi, et elle a bien fait, car au bout d’un temps qui variait entre quinze jours et deux mois elle s’apercevait qu’elle s’était trompée... Moi, mon oncle, je n’ai jamais eu de toquade. Quand j’ai vu pour la première fois Maxime Despeyroux, il m’a paru si bien de sa personne que j’ai eu un peu d’éloignement pour lui—me comprenez-vous? un peu de timidité à lui parler. J’ai dû me forcer pour vaincre cette timidité; et, comme toutes mes compagnes disaient qu’il est charmant et que quelques-unes le lui laissaient entendre, j’ai été, peut-être par esprit de contradiction ou de défense, un peu désagréable, un peu hostile avec lui. Et puis, insensiblement, toute ma timidité s’est fondue, et ma belle défense s’en est allée à vau-l’eau... Il faut vous dire aussi que c’est un peu la faute de Lucie. Elle est si imaginative, si sensible, si romanesque, cette Lucie! Rien ne la ravissait comme l’idée que son frère et moi nous nous aimerions, nous nous marierions, et qu’elle saurait tout de ce petit roman, qu’elle y vivrait, qu’elle en serait un des personnages... Alors, elle ne cessait pas de me parler de son frère ni de parler de moi à Maxime... J’avais bien un peu d’appréhension, d’abord... Mais Maxime était si respectueux, si discret!... Je vous assure que je n’ai jamais rien appris de ses sentiments pour moi que par cette folle chérie de Lucie... Et, bien que je ne voulusse rien confier des miens à Lucie, qui me pressait, je suis bien sûre qu’elle imaginait de prétendues confidences 213 pour les lui rapporter... Alors, que voulez-vous, mon oncle? Tout doucement, en nous voyant très peu, et sans rien nous avouer,—mais en entendant si souvent parler l’un de l’autre,—nous avons fini par nous aimer... Le soir de ce bal intime après lequel vous m’avez fait de la morale, je vous assure que ni Maxime ni moi n’avons prononcé de paroles définitives. Il m’a seulement parlé de ses goûts et de ses projets de vie... Moi, j’ai dit les miens, et il a bien fallu nous apercevoir qu’ils s’accordaient... Mais il avait l’air encore plus intimidé que moi, et, s’il n’y avait pas eu Lucie pour tirer des confidences à chacun de nous deux, après, il ne serait rien sorti de ce fameux cotillon... Elle a si bien avancé les choses que nous avons su que nous pensions l’un à l’autre, que nous nous aimions... Oh! alors, j’ai bien failli vous écrire; j’étais prise de peur, figurez-vous; il me semblait que nous étions trois enfants qui allions au hasard, et je voulais un conseil de votre sang-froid, de votre expérience... Et puis, cette fois-là encore, je n’ai pas osé... Ce n’est que ces jours-ci, quand Lucie m’a parlé des classements de fin d’année de Saint-Cyr, qui trois mois à l’avance commencent à préoccuper les saint-cyriens; quand j’ai arrêté mon esprit sur le fait que dans si peu de temps Maxime serait envoyé au bout de la France peut-être, peut-être aux colonies... alors j’ai senti au dedans de moi cette grande anxiété, et en même temps cette forte certitude que j’espérais... 214 Pour la première fois j’ai dit à Lucie: «Oh! Lucie, c’est terrible... Voilà que je suis sûre de l’aimer...» Et vous voyez que je n’ai pas attendu longtemps pour vous écrire: juste le lendemain...»
Ne croyez pas, Françoise, que j’aie d’inquiétude ni de reproche pour ce grain de romanesque dont s’assaisonne votre projet de mariage. Assurément, ce n’est pas de cette manière qu’on se conjoint d’habitude dans la bourgeoisie de France, et vous avez raison de me charger de préparer la douce Mme Le Quellien à un tel impromptu. Je sais—mieux que vous peut-être—quels étaient, touchant votre mariage, les projets de cette mère excellente... et attardée. Nombre de fois, elle m’a dit: «Vous qui voyez tant de monde à Paris, vous devriez bien chercher un mari pour Françoise... Hélas! elle n’a pas une grosse dot, mais elle est bonne et instruite; il me semble qu’un homme ayant une situation, approchât-il de la quarantaine, serait heureux de...» Je la laissais dire, la chère femme! Eh parbleu! l’homme approchant de la quarantaine, qui eût été heureux de... je l’aurais peut-être déniché en effet,—mais ce n’était pas là le mariage que rêvait Françoise, j’en étais sûr, et je n’aurais jamais osé le lui conseiller... D’abord parce qu’à mon sens il ne faut pas marier une génération avec la suivante. Je sais bien que certains commencements d’automne ressemblent à certaines fins de printemps; 215 mais le printemps, même tardif, va vers l’été, et l’automne le plus splendide s’achemine à l’hiver. Donc ne marions pas l’automne au printemps: leur accord ne durerait point... Et d’autre part je n’avais pas au même degré que Mme Le Quellien le souci de vous savoir maigrement dotée et le désir de vous attribuer un riche mari...
C’est que, sur le chapitre de la dot, je n’ai pas tout à fait les idées que j’entends défendre et commenter dans les familles. «Les jeunes filles sans dot ne se marient plus,» nous dit-on. J’estime qu’on se trompe. Les différences de dots entre les jeunes filles (à part les dots énormes et par conséquent rares) perdent, au contraire, de plus en plus leur importance. Nous assistons à ce double phénomène que le travail est de plus en plus rétribué et le capital de moins en moins. Un valet de chambre, même honnête, coûte dans une maison le revenu de cent mille francs. Pratiquement, il n’y a plus de grosses dots, il n’y a plus de jeunes filles riches, et, par une heureuse réciproque, il n’y a plus de jeunes filles pauvres ni de 216 petites dots... L’erreur des familles est de chercher obstinément à marier à contre sens les jeunes filles sans dot,—à faire bon marché de l’âge pour se contenter de l’argent ou de la situation. C’est absurde. D’abord les hommes riches de quarante à cinquante ans, épouseurs de jeunes filles pauvres, ne sont pas nombreux, et la jeune fille pauvre vieillit tandis qu’on les lui cherche... Puis on ne réfléchit pas que marier une jeune fille de dix-huit ans à un lieutenant de vingt-huit, par exemple, revient au même que de marier la vieille fille de trente ans au commandant de quarante; à cette différence près qu’ils n’auront pas été pauvres ensemble durant les années où la pauvreté ne pèse exactement rien pourvu qu’on s’aime... Ce qui donne créance à ce bruit fâcheux que les jeunes filles sans dot ne se marient pas, c’est donc qu’on ne tente pas de les marier comme il convient, c’est-à-dire jeunes, avec des hommes jeunes et d’avenir.
—Alors, mon oncle, j’ai raison de vouloir épouser Maxime dès sa sortie de Saint-Cyr?...
Patience, Françoise, je n’ai pas tout dit!... Et avant de m’en aller en ambassade vers Mme Le Quellien je prétends ne pas vous ménager les avertissements.
Oui, c’est charmant d’aimer comme vous, à dix-huit ans, un jeune homme de vingt-trois ans à peine, et, si cet amour est durable, il est possible et salutaire de fonder dessus un bon ménage...
217 —Mais notre amour est durable, mon oncle, vous n’en doutez pas!
... Nous discuterons plus tard ce point délicat: je vous le cède aujourd’hui. J’admets qu’un lien sûr et fort unira toujours votre cœur au cœur de Maxime; un mariage tel que vous le rêvez n’en comporte pas moins de part et d’autre une certaine abnégation et le renoncement à certains avantages qui pour la plupart des gens ont leur prix. Si l’on vous dit qu’avec votre petite dot, la petite dot de Maxime et son traitement d’officier, vous ne pourrez point vivre, vous ne pourrez point élever des enfants, n’en croyez rien, ce n’est pas vrai. On peut toujours. Mais il faut résolument renoncer à toutes les satisfactions d’amour-propre, de situation, de réceptions, etc., et en général à toute joie puisée ailleurs que dans l’amour réciproque et l’amour des enfants... Si l’on fait bien carrément cet acte de renoncement avant le mariage, on n’en souffre pas. Car la jeunesse—j’entends celle qui va de vingt à trente—ne pâtit nullement du défaut de confortable: et l’amour n’est pas vrai qui ne suffit point à emplir les heures d’un jeune ménage entre vingt et trente ans.
Donc, Françoise, dix ans de vie d’étudiants réguliers, voilà ce que vous prépare votre mariage avec le lieutenant Despeyroux; et j’y insiste, vous n’en pâtirez point du tout si, résolument, vous remettez les ambitions, des ambitions sages et mesurées, bien entendu, à une date plus tardive,—par exemple aux 218 environs du grade de commandant. L’erreur de maints jeunes époux est de vouloir cumuler tout de suite le bonheur de l’amour avec les plaisirs de la vanité. C’est qu’ils ne s’aiment pas bien, et qu’ils ne sont pas de vrais jeunes gens; car l’amour sincère et fort est exclusif de l’ambition; la vraie jeunesse ne s’en soucie guère... Plaignons les ménages qui n’ont pas connu l’époque surhumaine où l’amour se suffit à lui-même...
Je sais bien, Françoise, que vous allez me répondre:
—Nous serons, Maxime et moi, le ménage où l’amour se suffira à lui-même, non seulement durant la jeunesse, mais durant la vie entière.
Et je sais bien aussi que vous êtes sincère, qu’il est sincère. Mais vous êtes en pension, il est à Saint-Cyr; vous ne vous connaissez que par les dehors qui sont agréables, les siens et les vôtres, par des mots de tendresse intime à peine balbutiés, et par les entremises optimistes de Lucie. Chère Françoise, le péril est là. Le sort de tout ménage est incertain; mais on peut dire que le plus incertain est celui qui se fonde sur l’attrait, et voilà pourquoi les gens prudents ont fait une mauvaise réputation aux mariages d’amour...
Avant de parler à Mme Le Quellien, il vous faut donc bien réfléchir sur la qualité du sentiment qui vous attire vers le frère de Lucie... Je vous y aiderai dans ma prochaine 219 lettre—encore que ce soit un sujet assez malaisé à traiter avec une jeune fille.
Ah! petite Françoise, comme il m’était plus facile de correspondre avec vous quand je croyais votre cœur tout à fait libre... Il ne me venait pas à l’idée que ce cœur pût accueillir un sentiment ardent... Que j’étais sot!
Ma dernière lettre, chère Françoise, n’a changé ni vos sentiments ni vos projets, et je ne m’en étonne point. Votre cœur n’est pas de ceux qui se donnent sans réflexion, ni qui se reprennent aisément, s’étant une fois donnés. La perspective de quinze ans de vie médiocre qui vous attendent si vous épousez 221 Maxime Despeyroux ne vous effraye pas; vous savez qu’elles vous attendent et vous faites d’avance bon marché des joies d’amour-propre, d’ambition, pour escompter seulement la joie que donne la présence continuelle d’un être aimé... Vous pensez bien que je vous approuve. Il n’y a pas de plaisirs moins réels, ni dont on se lasse plus vite, que ceux de l’extrême confortable ou du moyen luxe, et tant qu’on n’est pas un Rockfeller ou un Vanderbilt, c’est-à-dire un vrai roi par la puissance de l’argent indéfini, il n’importe pas énormément d’avoir dix mille ou cinquante mille livres de rente.
Des gens graves, expérimentés, vous diront cependant: «Prenez garde, mon enfant!... L’argent ne fait pas le bonheur du ménage, mais il y contribue en procurant aux époux une vie plus large, où les deux natures associées se heurtent et se froissent moins aisément...» En termes plus francs, les époux riches appartiennent plus à la société, moins l’un à l’autre, et comme le mariage usuel est fondé chez nous sur l’hypothèse que les conjoints ne s’aiment guère, ou du moins ne s’aimeront pas longtemps, les époux riches seront plus heureux parce qu’ils seront moins époux...
Ni vous ni moi, Françoise, n’acceptons cette conception du mariage. Vous vous mariez pour être la femme réelle et perpétuelle de votre mari: l’association des personnes prime, à votre sens, la communion des intérêts. De 222 la sorte, la question d’argent est secondaire; le couple attend sa félicité du seul fait d’être uni... A la bonne heure!... Seulement il faut la certitude que cet unique bienfait: être uni, procurera une joie assez intense, assez durable, pour suppléer à tout. Et, comme disaient nos pères, voilà le point.
Vous avez cette certitude aujourd’hui, lui également, parbleu! Mais vous êtes trop intelligente pour ne pas comprendre qu’elle ne garantit rien de l’avenir. Analysez bien vos sentiments: au fond, vous trouverez qu’ils se réduisent à une foi violente et aveugle dans un bonheur que vous ne connaissez point! Bien plus: ce bonheur inconnu, vous l’attendez d’un homme que vous connaissez à peine davantage; du moins vous ne connaissez point ses aptitudes à vous donner ledit bonheur... Certes, la foi aveugle, c’est beaucoup; c’est probablement le meilleur guide vers la félicité trouble et charmante que votre innocence devine dans le mariage. Un mystérieux attrait vers une félicité mystérieuse, soit; l’abîme appelle l’abîme. Toutefois, le mariage n’est pas seulement cela, et vous ne l’ignorez pas, bien qu’en ce moment vous l’oubliiez un peu.
Passons gaiement sur la question d’intérêts; vous en faites le sacrifice. Reste encore—reste surtout—la question des aptitudes à vivre en commun, non pas aux moments d’enthousiasme et de délire sentimental, qui sont évidemment exceptionnels, mais dans les 223 moments ordinaires, aussi bien par les temps gris, couverts, que par les temps de soleil ou de bourrasque, en un mot, pour «le bon et le mauvais» de la vie... Que Maxime Despeyroux soit capable de s’accorder avec vous pour ce trantran monotone des jours, ce n’est pas prouvé; qu’il soit capable, par sa seule présence, de transformer éternellement cette monotonie en joie positive, c’est fort incertain. En toute hypothèse, vous n’avez là-dessus aucune clarté. Vous n’avez appris le caractère de Maxime que par les récits de sa sœur, qui est une imaginative et qui, voulant à tout prix marier son frère à son amie, s’est suggéré le plus sincèrement du monde que Françoise et Maxime furent créés l’un pour l’autre.
—Assurément, mon oncle, me direz-vous, je ne suis pas renseignée à fond sur le caractère de Maxime, et je me doute bien que, dans nos rares entretiens, il a quelque peu paré ce caractère... Mais n’est-ce pas le cas inévitable de tous les mariages? A moins de hasards bien rares ou d’unions de cousin à cousine, quelle fiancée connaît à fond l’âme de son fiancé?... Connaîtrais-je, mieux que Maxime, tel autre prétendant qui s’offrirait par la suite? Et Maxime n’est-il pas, au contraire, le jeune homme du monde sur lequel je suis le mieux renseignée?
Il est trop vrai, Françoise... L’usage de notre pays étant de marier les jeunes gens sans qu’ils se connaissent,—parmi tant d’autres unions 224 bâclées en quinze jours, votre union avec Maxime, à laquelle du moins vous songez l’un et l’autre depuis une dizaine de mois, pourrait passer pour une exception. Admirable économie du mariage français! Après avoir tardé indéfiniment à marier sa fille sous prétexte de lui trouver un parti de choix, le bourgeois de France est pris brusquement d’une hâte extravagante; il marie sa fille comme s’il s’agissait de parer à un sinistre. Grâce à cette double absurdité, on est arrivé chez nous, à quoi bon le nier? à jeter un certain discrédit sur le mariage. Ce n’est pas la littérature, ce sont les mœurs qui l’ont peu à peu dépouillé de toute sa parure d’idéal, pour en faire un plat contrat analogue à celui d’honnêtes trafiquants. Et j’accorde que pour certains cœurs privilégiés, hommes ou femmes, le mariage apparaît encore dans sa poésie biblique; mais il faut m’accorder en retour—et c’est l’évidence—que le mariage en France n’est aucunement ce que, par exemple, il est en Angleterre: le réservoir inépuisable de l’idéal, du romanesque, de la poésie; et cela non pas seulement pour les poètes, les romanciers et les philosophes, mais pour la nation entière, pour les seigneurs et les bourgeois, pour les riches et les pauvres, pour la fille de pair du royaume et pour la bar-maid.
Une telle différence dans l’opinion correspond assurément à une différence profonde entre les mœurs de l’un et de l’autre pays. La 225 coutume de la dot, prépondérante en France, est une de ces différences; mais il serait exagéré de dire que toutes les jeunes filles anglaises sont dépourvues de dot. L’argent peut donc, là comme ici, guider le choix des épouseurs pratiques... La différence radicale entre les mœurs matrimoniales des deux pays, c’est que le mot «fiançailles», qui ne signifie absolument rien en France, possède en Angleterre une signification importante, reconnue de tous. Chez nous, deux jeunes gens sont fiancés le 15 mai et mariés le 15 juin; les fiançailles ont duré juste le temps matériel de publier les bans, de rédiger le contrat et de composer la corbeille... Outre-Manche, les fiançailles d’une année sont courtes. On en voit de trois ans, de cinq ans, de dix ans. Elles sont un acte quasi public, transformant publiquement la situation des contractants pendant une période assez longue pour que le jeu imprévu des événements, ou, sans plus, l’action usante de la durée, éprouvent l’engagement et la volonté de ceux qu’il lie.
Vous comprenez, chère enfant, que de telles fiançailles n’ont rien de commun avec le ridicule mois de «cour» à la française, avec les visites froides où, en des attitudes de menuet, le fiancé apporte à la fiancée des bouquets et des friandises; où, si tout se passe pour le 226 mieux, la conversation roule sur le mobilier futur et les projets de voyage du jeune couple... Nulle part autant que dans les procédés préparatoires du mariage nous ne traînons les résidus des coutumes d’autrefois, devenues contradictoires avec les âmes d’aujourd’hui. Votre âme de jeune fille en 1901, petite Françoise, diffère grandement de l’âme de votre arrière-grand’mère à la veille de son mariage. Celle-ci avait été élevée par des femmes, dans un couvent clos, comme une sorte de novice: on la sortait du couvent pour la marier, et elle se mariait comme on prononce des vœux, en se remettant corps et âme au bon plaisir d’un maître souverain. Qu’un tel système fût bon ou mauvais vers 1780, ce n’est pas la question: ce qui crève les yeux, c’est qu’il est absurde de l’appliquer tel quel à une jeune fille moderne. Vous ne voulez pas, Françoise, être mariée à la mode de votre mère-grand. Vous prétendez choisir votre mari.
Fort bien; mais prenez garde!
Si vous le choisissez par simple attrait du cœur, vous abdiquez implicitement votre droit de choisir: le droit de choisir n’est légitime que si le choix est sérieux, réfléchi, la volonté s’accordant avec la conscience et la raison. Or, la conscience et la raison ne se décident pas d’après la forme d’un visage et le timbre d’une voix. Leur opération veut le concours du temps. D’où la nécessité des longues fiançailles.
Les longues fiançailles, avant toute chose, 227 offrent à chacun des fiancés le moyen de s’éprouver soi-même; elles le renseignent sur les aptitudes de son propre cœur, en même temps que sur le sentiment spécial soumis à l’épreuve. La plupart des humains, c’est triste à dire, s’illusionnent étrangement sur leurs facultés d’attachement. Ils croient indispensables à leur bonheur des êtres auxquels ils ne donneraient plus une pensée au bout de huit jours de séparation... Hélas! qu’ils sont vite oubliés, les plus sincèrement pleurés parmi les morts!... Si cruelle que soit cette loi d’oubli, il importe d’en tenir compte et de l’expérimenter sur soi-même. Dites-vous bien, Françoise, qu’il est rare et presque miraculeux de rencontrer à dix-huit ans l’époux indispensable. Vous faites la moue?... Vos yeux deviennent humides?... Bon! je n’ajouterai rien de plus sur ce point délicat. Votre cœur, après tout, peut être sûr de lui, et il est possible que le temps ne fasse que confirmer ses sentiments, ce qui déjà serait un résultat. Mais les longues fiançailles ont d’autres avantages encore, outre l’épreuve de la constance personnelle.
Elles ont l’avantage de faire connaître réciproquement aux deux fiancés leur vrai caractère. On se masque aisément l’un pour l’autre, pendant l’unique mois des visites et des bouquets. Il faut, au contraire, une bien rare maîtrise de soi pour garder le masque seulement une année, quand le fait de la conquête n’est plus 228 en question. Voilà où réside l’admirable de cette invention d’engagements à long terme, usités chez nos voisins. Le temps des fiançailles n’est pas encore la libre vie conjugale, mais déjà il est superflu entre fiancés de prendre une attitude, de «poser» l’un pour l’autre. Qu’y gagnerait-on? On est engagé. Alors, tous les «réflexes» de notre tempérament (si l’on peut oser une telle image) se mettent à jouer en liberté et malgré nous. Le jaloux, l’impérieux, dévoile sa jalousie, son instinct autoritaire. La boudeuse, la coquette, laisse percer sa bouderie, sa frivolité. Dans le cycle complet d’une année, surtout entre deux êtres qui se proposent d’unir leur vie, qui, par conséquent, se regardent avec attention et s’attribuent l’un sur l’autre des droits, il est fort improbable que des sujets de conflit ne surgissent pas: à la façon dont naîtront, évolueront et se régleront ces conflits intimes, chacun des deux, si peu avisé qu’il soit, apprendra le caractère de l’autre. Et ne dites pas: «Si Maxime est en garnison en Bretagne tandis que je demeure à Paris, je n’aurai guère d’occasion de l’étudier.» D’abord, Maxime fût-il en Bretagne et vous à Paris, une fois les fiançailles accomplies vous devenez la personne à laquelle il doit le plus de son temps libre, et cela d’accord avec la famille: en sorte que vous pourrez tout de même passer dans l’année bon nombre d’heures avec lui... Et puis, il y aura la correspondance, qui, banale ou artificielle avant les fiançailles, devient sincère et significative après, toujours 229 par cette raison qu’il n’est plus question de se conquérir et qu’on est conduit par la force des choses à se parler d’événements positifs, de projets réels, voire d’intérêts pressants, au lieu de s’exalter dans le vide des épithètes d’adoration. Fine comme vous l’êtes, Françoise, après six mois de billets échangés avec votre fiancé je mets bien le pauvre garçon au défi de rien vous cacher de son «par-dedans».
Enfin, j’ai gardé pour suprême argument ce dernier avantage des longues fiançailles: elles sont à la fois très moralisantes et très agréables... Je vous fais grâce des lieux communs sur le désir d’un bonheur prochain, plus doux—assure l’expérience des philosophes—que ce bonheur lui-même. Fiancée, une jeune fille passe déjà en importance les autres jeunes filles. Elle a l’orgueil d’avoir été élue, la douce présomption de la sécurité, tout cela acidulé par l’arrière-pensée que l’engagement est en somme conditionnel, qu’il n’y a pas de honte à le rompre si l’essai loyal ne réussit pas... Parce qu’elle est fiancée, la voilà préservée de la tentation de coqueter au hasard et sans but, périlleuse pour les demoiselles sorties récemment de leur pensionnat; la voilà conduite insensiblement aux graves pensées de fidélité, de dévouement, aux rêves de la maternité...
Que de considérations j’ajouterais si c’était à Maxime et non à vous, Françoise, que j’écrivais!... Bien plus que la fiancée, c’est le fiancé que moralise un engagement à long terme. Cet 230 engagement de conscience aère et vivifie ses pensées et ses mœurs: c’est lui surtout qui conservera plus tard, comme un précieux sachet d’aromates, le souvenir des années juvéniles, où, parmi les grossiers divertissements de ses camarades, il rêvait à une jeune fille qui déjà était sa femme par le cœur...
Je me résume. Mariage jeune et longues fiançailles: si contradictoire que cette formule paraisse au premier abord, tel est mon souhait pour une demoiselle de votre âge. Vous êtes déjà résolue au mariage jeune. Si vous vous convertissez à la condition des longues fiançailles—mais dans ce cas seulement—j’accepte d’être votre ambassadeur auprès de Mme Le Quellien.
Selon ma promesse, chère enfant, j’ai pris hier le chemin de la place Possoz dans l’intention d’aller trouver Mme Le Quellien et d’entreprendre auprès d’elle les négociations dont vous m’aviez chargé. 232
Si je vous disais que cette mission m’était fort agréable, vous ne me croiriez pas. D’abord, j’ai horreur du rôle de Providence. La Providence, telle que la conçoivent ceux qui ont foi en elle, connaît les causes lointaines des événements et lit à livre ouvert, dans l’avenir, le sort final des démarches. La vraie Providence peut donc librement s’occuper de mariage. Pour moi, au contraire, comme pour vous, comme pour nous tous, demain s’enveloppe de mystère. Comment oserais-je échafauder votre bonheur sur des conjectures? Et j’ai beau vous répéter que je ne veux être qu’un simple truchement entre votre mère et vous, j’ai beau «faire mon Pilate» (c’est votre mot), je sais bien que votre cœur m’attribuera un jour une part de responsabilité dans l’heur ou le malheur de votre ménage... Voilà l’une des raisons pour lesquelles j’étais d’assez méchante humeur hier, vers deux heures après midi, tandis que par les calmes voies de Passy je me dirigeais vers la place Possoz.
L’autre raison qui me rendait maussade était plus complexe et plus égoïste à la fois. A je ne sais quelle jalousie quasi paternelle contre l’adolescent qui va nous ravir Françoise se mêlait la mélancolie de jouer un rôle de barbon, un rôle de Bartolo ou d’Arnolphe à rebours.—«Avant la quarantaine, c’est un peu tôt, que diable! Et Françoise abuse de ma complaisance...» Comme je vous gourmandais ainsi, le mot de quarantaine évoqua 233 heureusement dans ma mémoire une foule de souvenirs des bons auteurs du siècle dernier, tels Balzac et Sand, qui traitent le quadragénaire comme un vieillard à ses débuts, mais comme un vieillard. Félix de Vandenesse, à quarante ans, montre les façons d’un homme «averti par une longue expérience». Bien mieux, à trente-quatre ans, le Jacques de George Sand appelle sa fiancée Fernande «Ange de ma vie, dernier rayon de soleil qui luira sur mon front chauve!» C’est de nos jours seulement que la nécessité d’un long service militaire, l’encombrement des carrières et l’âpreté de la lutte pour vivre ont allongé la période dévolue par l’opinion aux agréments de la jeunesse. Les journaux appellent froidement «jeune maître» des écrivains, des peintres de cinquante ans, tandis que, par un sentiment d’équité, donnant une rallonge de dix ans à la jeunesse des hommes, on en octroie une de quinze pour le moins à la jeunesse des femmes, principalement des comédiennes. Tout cela est charmant dans les romans et dans les chroniques, mais tout cela n’empêche pas que la vie moyenne des Français soit de quarante-quatre ans, et donc que vers la trente-huitième année on doive être apte aux pensées et aux besognes graves...
Ce fut donc dans l’état de componction résignée le plus idoine à ma mission que j’atteignis la place Possoz, chère Françoise, et qu’un instant après je pénétrai dans l’appartement de Mme Le Quellien. 234
Votre charmante mère, cette après-midi-là, n’apurait point ses comptes de ménage, sur ce cahier dont l’agencement savant et la tenue méthodique excitent votre admiration et la mienne. Elle ne lisait pas non plus un de ses deux livres familiers: l’Introduction à la vie dévote ou l’Imitation... Comme il faisait une tiède journée printanière, elle avait ouvert la fenêtre de sa chambre sur la place ensoleillée, déserte et somnolente comme la place d’une sous-préfecture de province. Assise sur un fauteuil et les pieds appuyés sur un tabouret, son giron plein de menus ustensiles de couture, elle brodait sans la moindre paire de lunettes, un délicieux petit rond de fine batiste fixé sur une piécette de toile cirée verte. Je reconnus un de ces labeurs interminables et délicats que vous désignez, Françoise, sous le nom générique de «travaux de maman». Vous ne les nommez pas ainsi sans ironie, et vous assurez qu’il est bien plus pratique d’acheter, tout faits, dans divers grands magasins de Paris, les objets auxquels Mme Le Quellien consacre tant d’heures patientes. Vous prétendez aussi que ces objets n’ont aucune affectation utile, que quand ils sont achevés on ne sait où les mettre, qu’ils finissent tristement sous quelques vases à fleurs, sous quelques vagues flambeaux, lesquels se passaient fort bien de leur voisinage. Et vous affirmez, pour votre part, la résolution de ne faire jamais concurrence aux «travaux de maman».
Il me parut que Mme Le Quellien n’attachait 235 pas elle-même à son ouvrage une importance infinie, car elle le remisa aussitôt dans la corbeille, avec tout l’attirail de couture.
—Voilà qui est aimable, me dit-elle... Au lieu d’aller vous promener au Bois, où vous rencontreriez de jeunes et jolies femmes, vous pensez à venir bavarder un moment avec votre vieille amie...
Je protestai—ce qui est la vérité même—que l’on ne me ferait pas faire quatre pas pour aller regarder «les jeunes et jolies femmes» du Bois, tandis qu’il m’est toujours agréable de converser avec la mère de Françoise. L’âme de votre mère, Françoise, me donne l’impression d’un beau cristal, et, en outre, d’un cristal dont la forme est devenue presque introuvable. Votre jeune âme, à vous aussi, est agréable à regarder; mais elle est cristallisée dans un «système» qui m’est plus familier, pour employer le jargon des physiciens. Votre mère est un parfait cristal de l’ancien système.
Nous n’avions pas échangé dix répliques que, déjà, la jeune pensionnaire de l’institution Berquin occupait notre conversation. Je dis «occupait» dans le sens tactique du mot, occupait militairement, souverainement, barrant les issues à tout autre sujet. O Françoise, soit dit sans reproche, que votre gracieuse personnalité est envahissante, principalement dans cet appartement de la place Possoz! Même absente, vous y régnez: on n’y pense qu’à vous, on ne parle que de vous. Je n’eus donc aucun effort diplomatique à tenter, 236 aucune transition à chercher, pour amener cette phrase importante:
—... Justement je suis chargé par Françoise d’une mission auprès de vous.
—Une mission!... De quoi s’agit-il, bon Dieu?
Déjà l’affection de votre mère s’alarmait. Je répliquai en hâte qu’il s’agissait d’événements considérés à l’ordinaire comme heureux... Le dialogue qui s’engagea entre votre mère et moi à partir de cet instant m’est, je crois, demeuré mot pour mot dans la mémoire.
MOI
Ne songez-vous pas quelquefois, chère amie, au mariage de Françoise?
MADAME LE QUELLIEN
Oh! Françoise est si jeune!...
MOI
Elle est jeune assurément, mais si elle se mariait dans dix-huit mois, par exemple, elle serait une petite mariée de vingt ans, ce qui est fort raisonnable...
MADAME LE QUELLIEN
Françoise mariée!... Que voulez-vous, mon ami?... je n’aperçois cet événement que dans un avenir éloigné, indistinct... Il me semble qu’il faut que la petite voie un peu de monde, apprenne un peu la vie... Pourquoi souriez-vous?...
MOI
Pardonnez-moi... Je ne crois pas autant que 237 vous à l’enseignement pratique que pourront donner à Françoise, sur «la vie», quelques réunions intimes et quelques sauteries. Et puis, entre nous, Françoise n’est pas si dépourvue de clartés sur les choses... C’est une petite personne d’esprit curieux et lucide, qui, depuis des années déjà, regarde la vie bien en face et cherche à la comprendre.
MADAME LE QUELLIEN
C’est possible. J’oublie toujours qu’il y a quarante années entre Françoise et moi, et que les temps sont changés. A son âge, j’étais une petite nigaude si mal au courant...
MOI
... D’ailleurs il ne s’agit pas de marier Françoise dare-dare au sortir de la pension... Il s’agit de prévoir les événements d’un peu loin, de préparer un peu l’avenir...
MADAME LE QUELLIEN
Mon Dieu, mon ami, vous savez quelle confiance vous m’inspirez. Vous avez un bon parti pour Françoise?
MOI
S’il est bon, vous en jugerez. La vérité m’oblige à dire que ce n’est pas moi qui «l’ai»—ce parti—mais bien Françoise elle-même. Tout l’honneur du choix et de l’initiative lui en revient.
MADAME LE QUELLIEN
Comment!... la petite a eu l’idée de se 238 marier? Elle a choisi? Mais ce n’est pas sérieux, voyons?...
MOI
C’est on ne peut plus sérieux, chère madame. Françoise a eu l’audace extrême de se distribuer à elle-même le rôle principal dans l’organisation de son bonheur. Et je confesse que je ne trouve pas cela coupable. Pour une petite nigaude qui n’entend que le jeu du corbillon, il est évidemment sage que parents et tuteurs prennent les devants et choisissent eux-mêmes... Mais vous m’accordez que Françoise est tout le contraire d’une petite nigaude...
Depuis quelques instants Mme Le Quellien ne m’écoutait plus. Ses jolis yeux gris, toujours jeunes et spirituels, suivaient une image invisible, et sa pensée suivait ses yeux.
Elle m’interrompit:
—Ce n’est pas, j’espère, ce gamin de Maxime Despeyroux dont Françoise s’est entichée?...
(La clairvoyance maternelle, vous le voyez, n’était assoupie qu’en apparence. Mme Le Quellien n’avait pas pris garde à Maxime parce qu’il lui semblait impossible, a priori, que l’initiative d’un projet de mariage vînt de vous. Mais, une fois désabusée, ce fut le nom de Maxime qui surgit tout de suite.)
Mon ambassade, dès lors, fut très malaisée. Quand il me fallut convenir que c’était précisément «ce gamin de Maxime Despeyroux» 239 qu’avait distingué Françoise,—et qu’elle l’aimait, et qu’elle voulait absolument être sa femme, je me heurtai d’abord à un formel refus. Mme Le Quellien appuyait son refus de raisons que j’inclinais à trouver bonnes, vous les ayant déjà données et me les donnant encore à moi-même: entre autres que vous ne connaissez pas Maxime et que personne ne sait ce que Maxime est capable de fournir comme sujet conjugal, vu qu’à vingt-trois ans un homme est un enfant... Faut-il que mon amitié pour vous soit ingénieuse, Françoise! Je trouvai pour vous défendre et pour défendre votre choix des arguments qui jusque-là m’avaient échappé.
—Assurément, répliquai-je, un mari de vingt-quatre ans—l’âge qu’aura Maxime s’il épouse Françoise dans dix-huit mois—n’est pas pris extrêmement au sérieux. Mais n’est-ce pas une mauvaise coutume de notre pays, absolument injustifiable en raison? Si les jeunes gens de vingt-quatre ans ne donnent pas à l’ordinaire l’exemple de la stabilité et de la vertu, n’est-ce pas parce que leur état social est officiellement instable et antivertueux?... «Il faut, nous dit-on, qu’ils apprennent la vie, eux aussi, comme les jeunes filles.» Nous savons ce que cela signifie. Tandis que les demoiselles sont censées l’apprendre dans les bals et les tennis, les messieurs doivent l’étudier en malsaine compagnie... Pourquoi ne l’apprendraient-ils pas dans le mariage même, 240 et par les nécessités quotidiennes du ménage?... D’autre part, ne craignez-vous pas qu’à force de vouloir mettre de la maturité et de la sécurité dans le mariage de vos enfants vous ne dépouilliez l’institution de toute grâce et de tout attrait?... Maxime et Françoise, s’ils sont célibataires dans dix ans, auront, en effet, probablement d’autres idées qu’aujourd’hui sur le mariage, et de plus graves, et de plus pratiques. Seulement, il est fort possible que ces graves et pratiques idées les conduisent simplement à ne pas se marier du tout!...
Mme Le Quellien, dont l’intelligence est vive et pénétrante, ne niait pas la force de ces objections; mais elle répondait avec fermeté par des considérations pratiques, lesquelles n’étaient pas sans force, elles non plus.
—Tout cela est bel et bon en théorie, mais, dans la réalité des faits, vous voulez marier Françoise à un sous-lieutenant sans fortune, qu’elle connaît peu, et dont nous ignorons tout, sauf sa jolie figure et ses bonnes façons... Eh bien! je dis que c’est là une entreprise incertaine par trop de côtés pour que j’y risque le bonheur de ma fille... Vous me trouvez arriérée et bourgeoise? Peut-être! Mais vous aurez beau mettre, comme vous dites, de la grâce et de l’attrait dans le mariage, vous n’empêcherez pas que ce soit une association où des intérêts matériels importants sont en jeu. Si nous négligions ces intérêts, nous ferions une faute aussi grave que si nous négligions 241 absolument l’accord des sentiments... Voilà pourquoi il faut que les parents, qui sont de sang-froid, interviennent dans le mariage des enfants. Ils jouent dans l’affaire, si vous voulez, le rôle du Sénat: les enfants jouent celui de la Chambre. Pour que la décision ait force de loi, il faut qu’elle soit votée par la Chambre et le Sénat, en bonne harmonie.
Je trouvai la comparaison divertissante, et je m’en emparai.
—Eh bien! répliquai-je, la Chambre, représentée par Maxime, Lucie et Françoise, nous envoie un projet de loi, médité depuis près d’une année. Vous et moi, qui composons le Sénat, nous devons au moins l’examiner... Étudions de plus près Maxime Despeyroux, ses chances d’avenir, sa vraie situation de fortune. Vous-même, causez avec Françoise, accablez-la d’objections, éprouvez sa résistance. Quand le projet et ses inconvénients et ses conséquences nous seront ainsi devenus familiers, nous déciderons...
Cette solution dilatoire fut tout ce que ma diplomatie put obtenir de Mme Le Quellien. Je ne voulus pas insister outre mesure: car la séance avait un peu usé les nerfs de la chère femme, et, par moments, ses yeux se remplissaient de larmes. C’était l’idée du mariage de Françoise, du départ de Françoise, aujourd’hui ou demain, avec ce promis-là ou un autre, qui commençait à travailler la tendre jalousie maternelle. 242
Et voilà comment, chère Françoise, le Sénat, avant de vous retourner votre amendement accepté, modifié ou rejeté, a décidé un supplément d’enquête et de discussion.
Parce que vous avez le mariage en tête, petite Françoise, et que vous m’avez chargé de plaider votre cause, je n’entends pas abdiquer mes vieilles fonctions d’oncle prêcheur... Laissons Mme Le Quellien et les Despeyroux déblayer la carrière où vous rêvez de vous élancer en compagnie de Maxime, et revenons, pour cette fois, à nos exercices 244 familiers. Aussi bien vous n’êtes pas encore mariée...
—Mais, mon oncle, je ne pense plus qu’à mon mariage!...
Voilà justement l’excès à éviter. Tout être humain traverse, au cours de la vie, un certain nombre de crises qu’on pourrait appeler des crises d’attente, pendant lesquelles un événement qui ne dépend pas de lui, mais qui le touche, est en suspens... Et la tentation est forte, pendant de telles crises, de tout laisser là, de renoncer à l’effort, de ne pas vivre, en un mot, jusqu’au moment où l’événement s’accomplit.
Eh bien! c’est une mauvaise hygiène de l’âme.
La bonne hygiène est au contraire de s’appliquer, par le temps de crise, à ne négliger aucune des habituelles occupations de la vie courante, travaux, lectures, délassements... Actuellement, Françoise, cette discipline vous est facile, car votre journée à l’institut Berquin est réglée heure par heure, et vous n’avez qu’à faire exactement et minutieusement ce qui vous est imposé pour que le temps coure assez vite et que l’activité amortisse l’anxiété... Plus tard, quand vous serez maîtresse de vos journées et que nulle règle imposée n’en distribuera les heures, le point sera d’assurer vous-même cette distribution, puis, vous étant ainsi imposé une règle, d’y obéir. Ainsi vous parerez au péril de voir votre volonté se dissoudre par les tourmentes 245 morales, et les périodes de paix seront défendues contre l’ennemi sournois de la quiétude: l’ennui.
L’absence de règle dans la vie fut longtemps considérée comme une marque d’indépendance d’esprit, et le désordre comme le compagnon nécessaire du génie. On est revenu aujourd’hui de cette fantaisie romantique. Un artiste fort pénétrant, Georges de Porto-Riche, a écrit franchement dans une curieuse pièce: «Les vrais artistes sont des réguliers.» L’observation est juste: Gœthe, Hugo, George Sand, furent des réguliers, en ce sens du moins que nulle crise de leur vie n’arrêta leur labeur. Leconte de Lisle écrivait quatorze vers chaque jour, quitte à les déchirer le lendemain s’il les trouvait mauvais. L’œuvre énorme d’un Zola n’est humainement possible que lorsque l’écrivain (et c’est le cas de l’auteur de Travail) s’impose quotidiennement l’effort d’un certain nombre de pages.
Ce qui est vrai de tels artistes, petite Françoise, l’est à plus forte raison des gens qui ne travaillent pas pour la gloire et dont la modeste activité se borne aux limites de la maison, du foyer. Une vie désordonnée qui a produit un chef-d’œuvre n’est pas entièrement perdue; mais à quoi aura servi une vie médiocre si elle fut, en plus, désordonnée? Or, la règle, l’ordre, sont encore plus universellement absents de la vie des femmes que de celle des hommes. Dans la classe à laquelle 246 vous appartenez, chère enfant, l’homme a d’ordinaire une fonction sociale, un métier comportant des heures laborieuses, des rendez-vous d’affaires, des nécessités périodiques de bureau et de démarches... La femme au contraire est, chez elle, maîtresse de son temps. Elle a autant de devoirs que l’homme, mais ces devoirs ne lui sont dictés que par sa conscience. Elle a plus d’indépendance et plus de loisirs... Hélas! l’usage qu’elle fait de cette liberté est rarement satisfaisant. Les plus frivoles se laissent simplement vivre; des sous-ordres accomplissent tant bien que mal le gros œuvre domestique; la maîtresse du logis n’intervient que par quelques impatiences et quelques colères... Sa vie a deux parts: les divertissements plus ou moins fréquents qui la distraient d’elle-même, et les intervalles de ces divertissements, où elle s’ennuie... Quant aux femmes plus sérieuses, à celles qui vraiment s’occupent de «leur intérieur», de leur mari, de leurs enfants, leur péché est souvent l’excès opposé: elles se laissent envahir par les menus soucis, par la collaboration superflue à toutes les intimes besognes de la maison. Elles ne réservent rien de leur journée pour ce devoir impérieux de tout être humain: connaître sa personne morale et la diriger vers le mieux.
Si quelques-unes de ces «femmes sérieuses» lisaient les lignes que je vous écris en ce moment, ma mignonne amie, je suis bien sûr qu’elles hausseraient les épaules.
«Il est bon, vraiment, ce psychologue, avec 247 sa personne morale et sa direction vers le mieux!... On voit bien qu’il n’a pas de ménage à surveiller ni d’enfants à élever...»
Eh bien! le psychologue insiste; il affirme qu’une femme n’est pas obligée d’être ou étrangère aux soins de son foyer ou abrutie par ces mêmes soins. Souci du perfectionnement personnel, soins de l’intérieur, tout cela peut trouver place dans la même vie féminine, à la condition que cette vie connaisse l’ordre et s’astreigne à la règle. «Il faut, disait un chimiste dont le nom m’échappe,—Sainte-Beuve le cite dans son article sur Louvois,—il faut commencer quatre fois plus de choses qu’on n’en peut accomplir.» La phrase est paradoxale, mais la vérité en est toute proche, et c’est que «chacun de nous peut accomplir quatre fois plus de choses qu’il n’en commence». Car presque personne, sorti du collège, n’a de règle et d’ordonnance dans sa vie, sinon celles qu’imposent les événements et le métier. Or, la vraie règle est celle qu’on s’impose à soi-même, la règle de sa propre liberté.
Comment régler sa vie, Françoise? ou, pour préciser, comment régler votre vie, le jour prochain où vous cesserez d’être une pensionnaire disciplinée pour devenir, d’abord une jeune fille maîtresse de ses heures, puis une épouse? Considérez cette vie indépendante, qui va bientôt être la vôtre, comme un canevas solide et nu: quelle étoffe allez-vous broder dessus? Sera-ce un simple fouillis de 248 points analogues aux tapisseries que font les enfants pour se divertir, ou sera-ce une broderie savante, conduite avec méthode sur un dessin médité et soigneusement tracé à l’avance?... Votre choix est fait, n’est-ce pas? Vous voulez broder d’harmonieuses arabesques sur le canevas de votre vie de femme?
Étudions ensemble les procédés pratiques, jolie brodeuse.
Il faut d’abord bien fixer le dessin, c’est-à-dire (parlons sans figure) bien déterminer l’objet de votre activité. J’ai eu assez souvent le plaisir de m’entretenir avec vous pour connaître vos penchants, vos aptitudes, un peu de vos rêves. Vous avez le goût des choses de l’esprit, avec une tendance aux sciences d’observation, au document sur les réalités modernes. Vous prisez les arts, sans passion, cependant avec une ferveur spéciale pour la musique, un peu d’indifférence pour la poésie ou même la littérature pure... Vous aimez les humbles, les pauvres, les ignorants, et leur situation inférieure dans la vie sociale vous préoccupe, vous émeut, ce qui est fort bien... Vous avez besoin, pour vous bien porter, d’exercices physiques, et vous y êtes leste et résistante. Enfin vous êtes ménagère adroite. Aucun de ces principes d’activité ne devra être exclu de votre vie, et le dessin de la fameuse broderie devra associer, sans les embrouiller, les traits distincts auxquels chacune de vos aptitudes, chacun de vos goûts, fournit le départ et l’essor.
249 Les nécessités quotidiennes, d’abord chez votre mère et plus tard dans votre ménage, vous offriront l’occasion d’employer vos capacités de gouvernement domestique. Il ne s’agira pour vous que de limiter le temps que vous y consacrerez. Quand une femme vous dit: «Mon intérieur ne me laisse pas un instant de repos», n’en croyez rien. Il n’y a pas d’intérieur si compliqué, si surchargé, dont une femme intelligente ne puisse assurer le fonctionnement avec deux heures d’effort bien employé par jour, en temps normal. A ces deux heures de travail domestique, si vous ajoutez le temps nécessaire à la toilette, aux courses indispensables, aux repas, vous constaterez vite que huit heures vous sont prises quotidiennement par le devoir courant, par votre «métier de femme». Restent seize heures à partager entre le sommeil et le loisir.
Ce partage, chacun doit l’effectuer suivant son tempérament; mais l’usage ordinaire est de ne pas l’effectuer du tout, de laisser le hasard, la veulerie accidentelle, faire la répartition des heures entre la veille et le repos. Or, on peut affirmer comme une loi générale que toute vie humaine où les heures du sommeil ne sont pas fixes est une vie désordonnée. Notez qu’il ne s’agit pas de se lever à telle ou telle heure, de dormir un plus ou moins grand nombre d’heures, mais simplement que ces heures soient invariables. Balzac dormait de six heures du soir à minuit; mais il travaillait de minuit à six heures du lendemain. Levez-vous à midi s’il 250 vous plaît, mais alors levez-vous toujours à midi, et que votre vie soit organisée sur le lever méridien. Dans la pratique, il est évidemment préférable de se lever au moment où commence à fonctionner la vie autour de soi: il est donc naturel qu’un citadin quitte son lit plus tard qu’un paysan...
D’autre part, toute une vie intense, une vie de sociabilité et d’intellectualité, à Paris, se vit le soir; l’activité parisienne s’apaise entre minuit et une heure du matin; elle recommence vers huit heures. Je ne dis pas qu’une Parisienne doive se lever à huit heures et se coucher à minuit. Je dis seulement qu’elle dépensera beaucoup de temps inutilement et perdra beaucoup du bénéfice social de la grande capitale si elle se couche à neuf heures du soir pour se lever à cinq heures du matin. Un grand principe d’harmonie vitale est de vivre en conformité avec son milieu. Si cette conformité semble impossible au tempérament, mieux vaut changer de milieu résolument.
Le temps du sommeil utile, c’est trop évident, varie suivant les natures et les âges. Un vieil adage latin disait:
Vix pigris septem, nemini concedimus octo!
Ce qui signifie: «Sept heures pour les paresseux—et encore!—huit heures pour personne...» Je dirais plutôt qu’il faut, là-dessus, que chacun fasse sur soi-même un 251 essai loyal. Couchez-vous quinze jours durant exactement à la même heure: la nature se chargera d’établir l’heure moyenne de votre réveil, qui doit être celle du lever... Le sommeil est presque le seul besoin physique dont on puisse mesurer ainsi quasi mathématiquement l’intensité.
J’admettrai, Françoise, qu’à votre jeune âge les huit heures refusées par l’hexamètre ci-dessus aux paresseux soient excusables. Cela vous permet encore de vous coucher à onze heures pour vous lever à huit. Ma préférence est pour ces deux dernières heures. Non pas que je vous conseille de passer toutes vos soirées au théâtre ou dans le monde: si vous épousez Maxime, il n’y faudra pas songer, et d’ailleurs ce n’est guère enviable. Mais la soirée au logis, dès qu’elle est organisée, est un des moments les plus agréables et les plus fructueux de la vie. Convenons que presque dans aucun ménage parisien elle n’est organisée. Dépenser sa soirée dehors jusqu’à deux heures du matin, ou se coucher à neuf heures si l’on ne sort pas, voilà le régime de nos concitoyens. Il est imbécile. Entre neuf heures du soir et cette heure du coucher qui se place fort bien de onze heures à minuit, il y a pour les âmes soucieuses de leur progrès personnel 252 un laps de temps précieux. Sans crainte d’être dérangé ou distrait on peut alors lire, écrire, ou simplement méditer, bien mieux que dans le brouhaha fiévreux de la journée parisienne. N’usât-on que deux fois par semaine de ces heures nocturnes, songez, Françoise, qu’elles suffiraient, dans l’espace de deux années, à un esprit prompt comme le vôtre, pour apprendre une langue usuelle, pour connaître les chefs-d’œuvre d’une littérature, pour accomplir un progrès décisif dans une science, dans la technique d’un art. Oh! je vous en prie, chère enfant, ne supprimez pas de vos projets l’usage studieux de quelques soirs par semaine! Quand certaines femmes que je connais, et qui sont d’honnêtes et charmantes femmes, regardent en arrière et se remémorent les soirs de leur vie entre vingt-cinq et trente-cinq ans, il me semble qu’elles doivent rougir d’avoir si vainement jeté au vent une monnaie précieuse...
Me voilà, Françoise, au bout de mon papier; c’est donc ma prochaine lettre qui vous proposera une règle des heures diurnes.
Les inévitables incidents qui surgissent autour de tous les projets humains, dès qu’ils exigent le concours de plusieurs volontés, encombrent et retardent les décisions définitives. Voilà-t-il pas, chère enfant, que la grand’mère de notre saint-cyrien—personne autoritaire avec d’autant plus de raison qu’elle résume les espérances dotales de Maxime—s’avise d’avoir un accès de goutte rhumatismale! Sa jambe, 254 allongée dans un soigneux emmaillotage sur un tabouret articulé, barre provisoirement la route à vos communes espérances. La vieille dame ne veut s’occuper que de son mal tant qu’elle souffre. Que faire, Françoise? Je vous l’ai dit au cours de ma dernière lettre: continuer le labeur et le perfectionnement quotidiens avec plus de minutieuse application que jamais.—Sans rêver?... Non pas; mais en ordonnant, en réglant votre rêve même. Bientôt, vous serez libre, vos études achevées; bientôt, peut-être, vous serez épouse, vos souhaits accomplis... Achevons d’établir ensemble le plan utile de ces heureuses journées que vous trouvez lentes à venir, mais qui accourent vers vous cependant, de l’horizon de la vie, aussi rapides qu’elles s’enfuiront lorsque vous voudrez les retenir.
Nous sommes d’accord, Françoise, sur ce point qu’il n’est pas de vie régulière compatible avec l’irrégularité de dormir. Nous avons, élargissant la mesure concédée par l’hexamètre latin, réservé huit heures au sommeil. Ces huit heures pourront être parfois diminuées par un coucher plus tardif; mais l’heure du lever doit être constante, tout au moins au cours de chaque saison. Restent à distribuer les seize heures de veille entre les travaux imposés, les travaux choisis et les divertissements.
J’appelle travaux imposés ceux qui sont la conséquence du rôle social: et le plus humble, 255 la plus humble d’entre nous, ont leur rôle social comme les plus marquants.
Dans votre temps et dans votre pays, quel est le travail imposé par son rôle social à une jeune fille telle que vous, une fois sortie de pension?
C’est, d’abord, l’apprentissage direct des fonctions de maîtresse de maison... Rien de plus charmant, pour l’œil d’un ami familier, si cet ami est tant soit peu observateur, qu’un foyer où commence à se manifester, à travers les habitudes maternelles, l’influence toute neuve de la fille de la maison, fraîche émoulue des pensionnats. Très vite, le mobilier, l’arrangement, la table, les réceptions prennent une autre allure... Les coutumes traditionnelles se tempèrent d’un goût instinctif de réforme, de progrès. Toutes sortes de menus inconvénients d’installation auxquels les parents s’étaient résignés, par ennui de l’effort, choquent l’impatiente jeunesse de la nouvelle venue: pour qu’ils soient abolis, elle se charge aussitôt de l’effort, et la voilà pour la première fois aux prises avec la réalité des œuvres domestiques,—la voilà responsable pour la première fois... Si les objets ont ces larmes que leur prête le poète, combien la venue souveraine de la jeune fille doit être redoutée par les confortables acajous, par les reps côtelés, par les pendules cubiques de marbre noir sur lesquelles s’assied un personnage de faux bronze—par les salles à manger assombries de boiseries moroses, telles que les aimaient 256 les architectes du siècle dernier jusqu’au présent renouveau de l’art décoratif!... Voici que s’affirme le goût moderniste: les meubles pesants sont expulsés; de claires tentures remplacent les papiers sombres ou fanés; les vieux rideaux jaloux qui barraient l’accès du jour sont décrochés, remplacés par des soies ou des toiles légères, transparentes; les boiseries noirâtres de la salle à manger s’étonnent de leur vêtement neuf, blanc, vert pâle, gris clair; l’art, la jeunesse et la lumière pénètrent ensemble dans l’antique logis...
Précieux courage d’innover, même s’il en coûte quelques erreurs! Ce courage ne sied vraiment qu’à l’adolescence. Les vieux sont fatigués ou sceptiques. La jeune fille rajeunit l’organisation et la direction du ménage; et c’est vraiment là un travail qui lui est imposé par le bon sens... Toutefois, Françoise, se contenter de l’accomplir et se divertir ensuite serait tout de même encore gâcher de belles heures. La part du travail choisi doit être large pour la jeune fille qui, comme vous le ferez bientôt, habite un temps la maison paternelle entre la sortie de pension et le mariage.
Cet intervalle qui sépare la vie scolaire de la vie mariée, les jeunes filles y pensent sans tendresse et ne rêvent, avant et pendant, que de l’abréger... Vous-même, chère enfant, si clairvoyante et de tempérament si bien équilibré, je sais bien que vous m’envoyez au diable—in petto—lorsque je vous dis que c’est un 257 temps fructueux, béni, et que, s’il convient de marier jeunes les jolies pensionnaires émancipées, il ne faut pas pour cela sacrifier le stagese confondre—avec celles que je vous donnais naguère pour préconiser les longues fiançailles... Oui, Françoise, les deux ou trois années passées par la jeune fille dans la famille, ses «études» proprement dites achevées, sont extrêmement profitables si elles sont bien employées. La jeune fille y apprend son métier de maîtresse de maison, et, en même temps, elle y complète, elle y refait l’éducation de son esprit. Taine dit quelque part (je vous ai déjà cité ce propos) que l’esprit de l’homme pousse ses fleurs les plus belles entre seize et vingt-trois ans. La floraison intellectuelle de la jeune fille commence à peu près en même temps, mais elle est plus rapide et plus courte: vers vingt et un ans sa «période tainienne» est achevée: l’esprit ne donnera plus ensuite que les fleurs d’arrière-saison, rares et vite déchues. On peut le dire hardiment: toute femme qui s’est mariée sans avoir, avant son mariage, étudié et réfléchi librement pendant une ou deux années (selon la promptitude de l’esprit) n’aura jamais de culture... La vie d’une épouse est trop aisément dévorée par les devoirs ou les divertissements pour qu’elle puisse y commencer un régime d’effort intellectuel. Voilà pourquoi tant de petites demoiselles qui ont eu des succès de cours ou 258 de concours, qui ont décroché des brevets, fussent-ils supérieurs, à leurs examens, se muent rapidement en bécasses ignorantes et paresseuses ou en insupportables snobettes parlant de tout sans rien savoir au fond.
Donc, Françoise, tandis que, s’il plaît à Dieu et à votre famille, vous jouirez, l’an prochain, du doux temps des fiançailles, il conviendra de distribuer avec méthode les heures que laisseront libres les soins de la maison, les ingénieux labeurs de couture—confection de blouses ou de chapeaux—les relations sociales et la correspondance. Tout cela vaut, en bloc, à peu près cinq heures: deux pour la maison, deux pour la vie sociale, une pour les chiffons; si vous ajoutez quatre heures pour les repas et la toilette, il subsiste encore sept heures pour le loisir et les travaux de choix. Donnez trois heures au loisir: c’est encore quatre heures qui restent, quatre libres heures que vous pouvez utiliser pour votre perfectionnement quotidien. Quatre heures! On ne peut guère fournir par jour un plus long effort intellectuel intensif... Quatre heures par jour de méditation et de notes,—voilà de quoi avoir écrit au bout de la vie les mémoires de Saint-Simon...
Ces quatre heures précieuses, Françoise, comment les emploierez-vous?... Il serait fâcheux, je vous en avertis d’avance, de vouloir y loger une réduction du système d’enseignement pratiqué à l’institut Berquin, l’enseignement à la fois encyclopédique et superficiel... 259 Vous admettrez donc qu’il vous a fourni «des clartés de tout»—quitte à contrôler et à compléter vos connaissances générales à mesure que les questions surgiront devant vous... Le procédé que je vous recommande est d’étudier tel art ou telle science qui vous sollicitent, pour lesquels votre éducation scolaire vous démontra vos propres aptitudes, et de vous perfectionner dans cet art, dans cette science, en ne négligeant aucune documentation latérale à son propos. Bientôt vous vous apercevrez qu’il n’y a guère moyen d’être vraiment érudite en ceci et ignare en tout le reste,—qu’une connaissance complète de certaine application de l’esprit humain conduit à l’intelligence de beaucoup d’autres. Ainsi votre culture générale se groupera, se distribuera autour d’une culture spéciale, plus importante et plus poussée, ce qui est le principe d’une bonne culture—même au réel et toute figure à part.
Exemple: vos goûts personnels et vos dons naturels ont toujours fait de vous, à Berquin, la plus «forte en histoire» de la classe... Que l’étude approfondie de l’histoire serve de nervure centrale à votre système de travail libre. A propos de l’histoire, quantités de notions de géographie, d’art, de sciences, de littérature, s’imposeront tour à tour: et, comme vous les épinglerez sur des notions fortement acquises, elles s’incorporeront à leur tour à votre patrimoine intellectuel. Dans l’étude de l’histoire, un système identique se recommande: 260 choisir une époque qui soit la nervure principale sur laquelle se grefferont les études successives des autres époques. Procédé assurément recommandable, parce qu’il nous est enseigné par l’infaillible nature...
Vous joindrez à l’étude documentaire préférée la culture de l’art que vous goûtez le plus: c’est pour vous, Françoise, la musique, et vous y êtes assez douée pour qu’il vaille de ne la pas abandonner. Si vous n’aviez de goût pour aucun art principal, je vous dirais: «Abstenez-vous...» Rabattez-vous plutôt sur quelque art secondaire, où la bonne volonté suffit: la photographie, la tapisserie, voire la reliure... Il est toujours inutile de fabriquer de mauvais tableaux, de plates poésies, inutile d’écorcher des chefs-d’œuvre de la musique avec le larynx ou avec les doigts. Maltraiter un grand art—fût-ce en famille—est besogne ingrate et niaise.
Puisque, au contraire, petite Françoise, vous avez l’intelligence et le goût de la musique, ne laissez pas, comme tant d’autres, s’atrophier peu à peu votre aptitude dans l’indifférence 261 et la paresse. Peut-être, de tous les arts, la musique est-elle le plus précieusement consolateur: c’est le seul, il me semble, où l’exécutant jouisse sur-le-champ de son effort, à mesure qu’il s’efforce. De cette simultanéité de l’effort et de la sensation naît une faculté singulière de s’exciter ou de s’apaiser les nerfs, pour ainsi dire à volonté... Heureux qui sent et qui possède cet art, le plus vénérable à coup sûr puisqu’il est le plus antique,—sans doute le premier de tous!
Enfin, pour clore ce programme par un dernier conseil pratique, faites une place, Françoise, dans vos occupations de choix, à quelque modeste besogne qui ne demande pas grand effort intellectuel, mais qui vous offre, aux mauvaises heures, la facilité de la cure par le travail. Je range dans ce groupe toutes les collections, tous les recueils de notes, les classifications de fiches, et—préférablement à tout cela—l’étude d’une langue morte ou vivante. Lire un livre étranger, le vocabulaire à portée de sa main, en inscrivant dans la marge chacun des mots qu’on a dû chercher,—voilà un calmant merveilleux pour les heures où l’intelligence anxieuse se dérobe... Et, au bout d’un an de ce régime, on est tout surpris d’avoir appris la langue.
... Il ne faudra pas montrer cette lettre à vos compagnes, chère enfant. Quelques-unes—les frivoles—la trouveraient terre à terre 262 et se moqueraient de nous deux... Laissez-leur les prétentions à la fantaisie et au romanesque, qui aboutissent d’ordinaire à la banalité des intrigues bourgeoises. Vous, gardez la foi dans l’ordre, dans la règle qu’on s’impose librement à soi-même. Ni l’ordre ni la règle n’empêchent, croyez-moi, l’imprévu de la vie intérieure: seulement, ils l’ennoblissent... Dans la nature aux lois immuables, les orages, les cataclysmes même ont de la beauté.
Dimanche dernier, chère Françoise, vers les trois heures après midi, comme j’étais en train de constater que le thermomètre de mon jardin marquait, à l’ombre, vingt-neuf degrés centigrades, j’entendis résonner le timbre de ma porte... Je regagnai aussitôt mon cabinet de travail et m’y trouvai face à face avec un 264 jeune homme que l’on venait d’y introduire. Il était vêtu d’un complet gris fort ordinaire, mais que sa taille avantageuse rendait élégant. Sous ce vêtement, j’hésitai un instant à le reconnaître: d’ailleurs je ne l’avais pas vu très souvent, même paré du costume plus éclatant qui lui est habituel.
—Monsieur, me dit-il d’une voix parfaitement assurée, mais où la volonté de plaire s’exprimait dans je ne sais quelle inflexion déférente, monsieur, je suis Maxime Despeyroux, le frère de Lucie... J’espère que je ne vous dérange pas?...
—Vous ne me dérangez nullement, monsieur, répliquai-je. Asseyez-vous, et dites-moi ce qui me vaut l’avantage de vous voir chez moi.
Il s’assit, face à la clarté des grandes fenêtres, tandis que je choisissais un siège à contre-jour, propice à l’observation. Aussitôt assis, il commença une phrase adroitement tournée, ma foi, et qui ne sentait en rien la préparation. Il me dit que, peut-être un peu imprudemment, il s’était décidé à profiter d’une de ses sorties de Saint-Cyr pour venir me voir; je n’ignorais pas assurément quels intérêts chers à son cœur étaient en question à l’heure présente; il savait, de son côté, l’influence que j’exerçais sur Mme Le Quellien et sur sa fille; enfin, il espérait entendre de ma bouche que j’étais, bien franchement et sans nulle réserve, un allié pour ses projets de mariage.
265 Tandis qu’il parlait, je le regardais avec attention, et j’écoutais sa voix plus que ses propos. J’admirais d’abord la force juvénile que montrait ce visage sans ride et sans boursouflure, ces yeux d’ambre pâle, si clairs, ce teint net et sain sous le hâle des manœuvres, ces dents de loup adolescent, tout ce corps nerveux assoupli par les exercices physiques quotidiens. Belle et brève jeunesse, si propice aux hardies entreprises! Je lui donnai cet instant d’admiration un peu jalouse, et je fis, je ne sais pourquoi, un retour sur moi-même.
Je me vis, à peu près à l’âge de ce saint-cyrien, allant remercier le père Sarcey d’un bon article écrit spontanément sur mon premier roman... L’exclamation de Sarcey me chanta aux oreilles, l’exclamation presque irritée dont il me salua alors: «Ah! bon Dieu!... que vous êtes jeune!...» En considérant Maxime, je compris soudain ce qu’il y a de désobligeant dans un air trop évident «d’avoir une vingtaine d’années». C’est comme si un milliardaire vous rendait visite, portant son milliard dans un sac, bien en évidence... Puis je pensai à vous, Françoise, et je me dis que d’avoir su vous plaire et d’être pour vous le complice rêvé de l’avenir heureux—c’est une fortune autrement rare que de publier un roman loué par Sarcey ou d’être M. Pierpont Morgan, le célèbre milliardaire américain...
Toutes ces pensées se succédèrent bien plus vite que je ne le puis raconter; Maxime Despeyroux m’en laissait le loisir en développant 266 avec abondance les raisons de sa visite, qu’il entremêlait de compliments sur mes livres... Et j’eus même encore le temps de remarquer la grâce réelle de ses gestes et l’adresse insinuante de sa phrase: ce jeune homme a bien tout ce qu’il faut pour plaire. Je me sentais contre lui, d’abord, une âme étrangement prévenue... Mais il n’était pas assis devant moi depuis dix minutes, enfilant d’agréables périodes où votre nom revenait fréquemment, que je songeais en moi-même:
«Toi, mon ami, tu feras de moi ce que tu veux, ou plutôt ce que veut cette futée de Françoise. Et cependant j’aperçois ce qu’il y a d’artificiel dans les choses gracieuses que tu me dis, et je sais pourquoi tu me les dis. Tu te moques de ma littérature comme de ton premier pompon; tu traites—in petto—de rabâchages ridicules mes correspondances avec ta fiancée. Si tu te maries avec Françoise, ton premier soin sera de la soustraire à ce que tu appelles «ma précieuse influence sur elle...» Je sais tout cela; je t’en veux d’ailleurs d’avoir vingt-trois ans et de nous voler Françoise;—cependant je ferai ce que tu souhaites. Je me dépenserai en démarches. J’essayerai de donner à Mme Le Quellien une confiance dans l’avenir que je n’ai pas moi-même absolument. Je me laisserai mener par toi—comme je me laisse mener par Françoise—parce que tu possèdes, comme elle, la force inflexible de la jeunesse en marche vers le bonheur!»
267 ... Donc, chère enfant, votre fiancé m’expose en fort bons termes l’état des négociations qui vous concernent tous les deux. L’aïeule rhumatisante, qui, par son accès de goutte, tenait depuis plusieurs semaines tout en suspens, commençait enfin à marcher, redevenait abordable. Les conciliabules de famille avaient repris leur cours; cette lutte, touchante au fond parce qu’elle s’inspire d’un sentiment altruiste,—la lutte des intérêts entre les parents pour l’avantage des enfants,—se poursuivait avec des incidents divers. On était, en somme, à peu près d’accord... Mme Le Quellien avait inopinément annoncé qu’elle augmenterait de près d’un quart la dot modeste dont vous vous saviez pourvue: admirable Mme Le Quellien, exemple de cette robuste économie française que nul déboire, nulle médiocrité ne lassent! Là-dessus, l’aïeule aux rhumatismes s’était piquée d’honneur, avait ouvert plus largement la veine par où elle se saignait au profit de son petit-fils le saint-cyrien... En résumé, tout allait au mieux sous le rapport des négociations d’intérêt, mais il restait cette terrible question de jeunesse sur laquelle Mme Le Quellien se montrait intraitable: «Françoise est trop jeune pour se marier avant deux ans, déclarait-elle. Et Maxime lui-même profitera très utilement de ces deux ans pour bien apprendre—à l’abri des distractions et des préoccupations d’un ménage—le métier qu’il doit exercer toute sa vie.»
Or, Françoise,—ce que je vous dis là ne 268 vous causera pas d’étonnement,—notre ami Maxime ne partage pas sur ce point l’avis de votre mère ni le mien. Il n’a pas le goût des longues fiançailles, cet apprenti héros. Il ne m’a pas caché que le but principal de sa visite était de m’acquérir à son idée.
—Voyons, monsieur, s’est-il écrié, est-ce raisonnable de dire à Françoise et à moi: «Vous vous aimez; vos parents sont d’accord; votre mariage est décidé en principe: maintenant, retournez chacun chez vous, soyez, vous un bon officier, elle une bonne petite demoiselle: on vous unira dans deux ans!...» Mais on ne comprend donc pas que deux ans de remise sont proprement, pour Françoise et pour moi, de la vie perdue? Qu’est-ce que je vais faire de ces deux ans, moi, par exemple? M’exercer dans mon métier?... On s’imagine que j’y prendrai goût, à mon métier, alors que je ne penserai qu’à une seule chose,—savoir: que Françoise est loin de moi et que je voudrais être à ses côtés?... Ce n’est pas d’être heureux qui m’empêcherait de travailler, au contraire!... Je ne ferai rien de bon tant que j’aurai ce tourment au cœur. Je vous en prie, monsieur, usez de votre influence sur Mme Le Quellien... J’admets qu’on attende pour nous marier que je sois sorti de l’École et que Françoise soit sortie de pension... (Il accorde cela! cher Maxime! Est-il raisonnable!...) Mais je crois, moi, que notre mariage doit être le premier acte de notre liberté. Oui ou non, le but de notre vie est-il le bonheur à deux? 269 Alors pourquoi ne pas nous mettre en route sur-le-champ? Les gens qui se proposent d’aller en Amérique attendent-ils deux ans le départ du paquebot avant de s’embarquer?
Maxime s’animait, et je constatais avec un certain contentement d’oncle qu’il marquait une bien autre conviction, une passion bien plus ardente que tout à l’heure, quand il me parlait de mes livres. Évidemment, Françoise, ce jeune guerrier ne vous considère pas avec indifférence. Je crus devoir, cependant, diriger son attention sur quelques réalités pratiques et morales qu’il me semblait négliger.
—Mon cher monsieur, lui dis-je, vous venez de prononcer quelques paroles qui me plaisent sur le bonheur à deux. Votre impatience même m’est sympathique. Cependant, puisque nous voilà en tête à tête et que ni Françoise ni sa mère ne nous écoutent, souffrez que, d’homme à homme, je vous pose une question. Croyez-vous sérieusement que l’organisation de ce bonheur à deux doive être le but principal de votre activité?
Maxime Despeyroux n’hésita pas une seconde et répliqua:
—Oui, monsieur, c’est mon avis.
—Vous ne pensez pas, repris-je, qu’un homme de votre âge a tout de même d’autres devoirs et doit nourrir d’autres ambitions que celles dont la famille occupe et limite le champ? Par exemple, vous êtes soldat; vous aimez votre métier?...
—Beaucoup.
270 —Eh bien! dans ce métier, vous avez des projets, je suppose? Vous désirez être quelque chose de distingué, de brillant?...
Maxime hocha la tête:
—Ma foi! monsieur, si vous voulez ma vraie pensée, je vous avoue que je ne me monte pas la tête sur le point de ma carrière d’officier. Ou bien j’aurai la chance d’une guerre, et alors ce sera bien le diable si je ne fais pas un bond en avant; ou bien il n’y aura pas de guerre, et je ne connais pas de moyen sûr pour avancer plus vite et plus loin que les camarades... Ce n’est la faute de personne, remarquez-le bien... Toutes les grandes armées font à peu près la même situation à l’officier. N’empêche que je vous dirai aujourd’hui, sans me tromper de trois ans sur l’ensemble, à quelle date je serai lieutenant, capitaine, commandant... toujours le cas de guerre excepté... Où voulez-vous qu’il y ait place, là-dedans, pour l’ambition?... Reste à faire son métier en conscience: je vous répète que mon métier me plaît.
Je réfléchis un instant, puis je repris:
—Soit! Mettons à part l’ambition professionnelle... Vous n’êtes pas seulement un officier, vous êtes un homme. Vous devez avoir le désir de cultiver votre esprit, de devenir journellement meilleur—dans le sens le plus large du mot—que vous ne l’étiez la veille... C’est, à proprement dire, un devoir que de se perfectionner ainsi. Ne croyez-vous pas que ce soit un but de la vie aussi important 271 que d’être «heureux à deux», selon votre mot?
Maxime eut un sourire un peu ironique.
—Je crois, monsieur, répliqua-t-il, que l’on peut travailler à son perfectionnement individuel tout en étant heureux en ménage.
—Trop de félicité intime rend paresseux à l’effort... Et puis, vous éludez ma question... Qu’est-ce qui vous importera le plus: être heureux ou être «meilleur»? A quoi travaillerez-vous le plus: à votre culture ou à votre quiétude?
—Franchement, monsieur, je chercherai d’abord à être heureux, par des moyens que, d’ailleurs, je juge honorables:—par la famille et l’accomplissement régulier de mon travail. Ai-je tort?... Si j’ai tort, pardonnez-moi la sincérité de mes réponses et ne m’en veuillez pas.
... Non, jeune homme, je ne vous en veux pas. D’abord, vous êtes un adroit séducteur, et vous avez compris tout de suite que mieux valait me dire votre vraie pensée plutôt que de soutenir quelque belle théorie où votre bonne grâce eût été mal à l’aise. Et puis, nous avons 272 assisté à de telles faillites, dans ma génération, qui parlait beaucoup d’énergie—(vers 1890, il n’était si humble revue, si pauvre journal, où l’énergie ne se professât couramment)—que nous finissons par nous demander si les vrais hommes d’action ne sont pas hommes d’action à leur insu. Craignons de partir pour la bataille de la vie costumé en Tartarin tueur de lions et de revenir avec quelques modestes alouettes pour tout butin... Qui sait, ô Maxime, tranquille et lucide jouteur, si le prix de la lutte ne vous est pas réservé? Rostand ne raconte-t-il pas que, dix ans avant Cyrano, il ne songeait même pas à la gloire littéraire?...
Et tout à coup, en regardant l’aimable visage de cet adolescent qui voulait une seule chose,—épouser Françoise, mais qui le voulait avec l’absolutisme de l’instinct,—j’eus la pensée que ce serait peut-être lui, un jour, le grand victorieux que ce pauvre pays de France, impatient de gloire, espère depuis si longtemps.
Rassurez-vous, Françoise, et rassurez-le: je tâcherai d’obtenir de Mme Le Quellien que le temps de vos fiançailles soit réduit à une seule année.
Que vous disais-je, Françoise? Rien qu’à laisser faire le temps et ceux qui vous aiment, voilà que peu à peu tout s’arrange pour vous contenter. L’on est d’accord, côté Despeyroux et côté Le Quellien, sur l’opportunité d’unir ma jolie nièce avec l’homme qu’elle a distingué. 274 Comme décidément vous êtes l’un et l’autre extrêmement jeunes, la sagesse de vos ascendants vous impose seulement une année d’attente... De quel air gentiment soumis et même reconnaissant je vous ai vue, l’autre jour, accepter ce délai—réduit à une année sur mes instances, et pour vous complaire! J’en fus moi-même surpris et je pensai: «La raisonnable petite fiancée!...» Il est vrai que quelques instants plus tard, comme nous causions sans témoin, vous m’avez dit: «Vous comprenez, mon oncle, j’aime mieux avoir l’air de dire comme eux pour avoir la paix. Mais si leur année dure seulement six mois je vous dois une discrétion!...» Petite masque!... Décidément vous n’êtes pas l’Ève nouvelle, qui dédaignera la ruse des faibles, même innocente...
Vous voilà donc rassurée. Le petit mois qui nous sépare maintenant de votre examen et de votre sortie de l’institut Berquin sera un mois de fête pour votre cœur. Souffrez que «l’oncle prêcheur», qui vous recommandait l’ordre et la règle comme préventif et calmant de l’anxiété, vous y incite encore dans la joie...
Faut-il donc apprendre à être heureux?
Mais oui, Françoise! Plus nombreux qu’on ne croit sont ceux que la joie déséquilibre, désarçonne. Depuis le savetier de La Fontaine jusqu’à cette pauvre servante dont les journaux nous contèrent l’histoire et qui mourut de saisissement en apprenant qu’elle gagnait 275 un gros lot, combien de gens valent moins dans le succès qu’ils ne valaient dans la peine ou dans l’effort! L’effort est salutaire en soi, parce qu’il nous élève à chaque instant un peu au-dessus de nous-même. La joie, pour la plupart des êtres humains, est une cause de détente et de stagnation. Je ne veux pas, ma jolie nièce, que vous ayez la joie stagnante. Jours de soleil et jours de pluie, jours où l’âme est angoissée et jours où elle est comblée, tous sont également profitables au perfectionnement personnel, si l’on sait bien les employer.
Et pour cela il n’est pas besoin de chercher de bien ingénieux procédés: il faut simplement faire soigneusement et sans retard, dans l’anxiété comme dans le contentement, sa besogne quotidienne. Si le savetier de La Fontaine avait tranquillement continué à marteler ses semelles; si la servante, à l’annonce de son gros lot, avait eu l’âme assez disciplinée pour se dire: «Fort bien! mais ne laissons pas brûler notre rôt...» leur bonne aventure n’aurait pas abouti à une si pitoyable fin... Poursuivez donc, chère Françoise, vos exercices de chaque jour, absolument comme si de sûres et douces promesses ne vous avaient pas été faites. Votre bonheur n’en sera pas amoindri: on ne se distrait pas de son propre bonheur. Il s’accroîtra de chacun de vos efforts; il gagnera en solidité et en durée. Et par là vous échapperez à cette sensation de vide, d’inquiétude vague, d’ennui inavoué et, disons le mot: de déception, qui guette la plupart de vos 276 semblables dès l’heure où la fortune leur a donné ce qu’ils souhaitaient.
Votre devoir quotidien, à l’heure présente, c’est de préparer votre examen... Je vous dirai la prochaine fois ce que je pense du programme officiel imposé aux jeunes filles, brevet élémentaire et brevet supérieur... Que ce programme soit ou non raisonnable, ce n’est pas pour vous la question intéressante aujourd’hui. On vous a imposé de conquérir le brevet supérieur après le brevet élémentaire; votre devoir actuel est de travailler de votre mieux à cette noble conquête. Vous ne vous imaginez pas, à coup sûr, que le résultat de cet examen donnera l’exacte mesure de votre science. Vous avez trop lu et trop entendu la doctrine moderne qui court les journaux et les revues: que l’examen est absurde et qu’il faut le supprimer... Plus les gens soutiennent cette doctrine avec âpreté, plus on peut être sûr qu’ils sont ignorants des choses pédagogiques et dépourvus de réflexion. La vérité, c’est que le programme de tel ou tel examen peut être mal conçu, c’est que l’importance du résultat peut être exagérée par les mœurs scolaires. Mais, avec mille défauts inhérents à l’application bien plus qu’au principe, l’examen demeure un précieux adjuvant d’étude, et c’est chimère que d’en rêver la suppression.
Le principe de l’examen est excellent, parce que c’est le principe de l’inventaire. L’inventaire 277 est le complément, le contrôle de toute opération de longue haleine entreprise en vue d’un gain, gain de science ou gain d’argent. Il faut, de temps à autre, arrêter les échanges, faire son bilan, chiffrer son doit et son avoir. Et, sans doute, le meilleur et le plus sincère inventaire est celui qu’on établit soi-même et pour soi, sans dissimulation comme sans majoration, ce qu’Ignace de Loyola appelait l’examen particulier. Mais combien d’écoliers sont capables de ce sage et franc inventaire? Rien n’est agaçant, en vérité, comme de lire les divagations de quelques illuminés là-dessus. «Il faut, disent-ils, lâcher l’élève à travers la science, bride sur le cou; il ira naturellement à ce qui lui peut profiter.» On oublie que la plupart des élèves, comme la plupart des hommes, ont pour unique souci de passer le temps en fournissant le minimum d’effort. On oublie que le mot même d’éducation implique l’idée de conduite, de direction. Si, dans une classe, il existe un élève capable de faire chaque soir, chaque semaine ou même chaque année, l’examen particulier de sa science acquise, oh! celui-là n’a plus besoin de pédagogues ni de régents; on peut lui ouvrir les portes du gymnase et le renvoyer à ses parents. Il dirigera lui-même, mieux que personne, la culture de son champ intellectuel. Mais quel éducateur, familier avec l’esprit et les mœurs des jeunes écoliers, oserait proposer un tel système comme méthode générale? Il faut que l’inventaire soit dicté par le maître à l’élève, et cela 278 le plus souvent possible, de façon que l’élève sache à toute heure «où il en est» et du même coup mette un peu d’ordre dans le tas des notions amassées au jour le jour de la vie scolaire.
L’examen est utile comme inventaire; il est précieux aussi comme «alerte». Vous savez, Françoise, ce qu’est l’alerte... Au milieu de la nuit, le clairon sonne à l’improviste dans le quartier endormi... Vite les hommes se lèvent, s’habillent, s’équipent; on selle les chevaux; la section, la batterie, le régiment, s’assemblent... Cela ne va pas sans bousculade: tous les vices d’ordre, toutes les malfaçons apparaissent. L’organisme brusquement secoué résiste de toutes ses forces d’inertie; mais l’alerte permet de juger la puissance d’effort et d’exécution que le régiment possède réellement à l’état disponible... Eh bien! pour l’étudiant, pour l’étudiante, l’examen est cette alerte. Même préparé, même à date fixe, le tête-à-tête avec l’examinateur force l’élève à ramasser soudain, devant la question à brûle-pourpoint, tout son disponible de pénétration, de mémoire, de science, d’éloquence. Et cette rencontre est, en somme, assez analogue aux futures circonstances de la vie, où il faudra effectivement utiliser tout d’un coup ce même disponible. Quiconque a passé des examens—et quel Français n’en a pas passé un grand nombre?—se rappelle telle ou telle question inattendue, qui lui révéla son ignorance 279 sur un point qu’il croyait parfaitement posséder... Le maître ordinaire, le pédagogue, qui vous enseignèrent ne peuvent pas suppléer à ces alertes. Dans l’escrime intellectuelle comme dans celle des salles d’armes, il y aura toujours la leçon et l’assaut; et l’assaut n’est profitable qu’avec des adversaires inaccoutumés.
Donc, chère Françoise, le principe de l’examen est très raisonnable et l’examen est un ingénieux auxiliaire de l’enseignement... Comment se fait-il donc que peu à peu—sans parler des casse-cou qui détruisent au hasard—tant de bons esprits aient été mis en défiance contre un procédé si rationnel, si profitable?... Tout simplement parce que le principe a été appliqué à faux, et cela de plus en plus, jusqu’à perdre absolument de vue l’objet proposé, ou plutôt jusqu’à confondre le moyen avec le but.
L’examen est un inventaire et une alerte, disions-nous. Mais le but du négociant n’est pas seulement d’établir promptement de justes inventaires; le but du colonel n’est pas seulement de mettre son régiment en état de défier les alertes. En dehors des inventaires et des alertes, il importe de progresser; il faut que le négociant accroisse son négoce et que le colonel entraîne son régiment... Or, dans l’école contemporaine, l’habitude est prise aujourd’hui de considérer l’examen comme la raison dernière de l’enseignement: on enseigne pour mener à l’examen, au lieu de mener à l’examen 280 pour aider et fortifier l’enseignement. C’est un renversement si manifeste de l’ordre naturel que tout le monde en est choqué, les parents, les élèves, et les maîtres qui préparent à l’examen, et les examinateurs qui le font passer. Tous, juges et justiciables, s’accordent à déclarer ce système absurde: et tout le monde, par une merveilleuse contradiction, s’emploie à le fortifier... Il y a tous les jours plus d’examens et plus de candidats... Je laisse de côté, pour cette fois, la question des programmes, sur laquelle je reviendrai dans quinze jours; vous aurez alors conquis votre brevet, et je n’aurai plus de scrupule à vous dégoûter de la nourriture que vous absorbez de force en ce moment. Mais vous savez comme moi qu’une contradiction semblable préside à la confection de ces malheureux programmes; tout le monde se plaint de leur surcharge et de leur incohérence, et chaque année les fait plus chaotiques et plus lourds.
Au milieu de ce désordre, ma mignonne nièce, que doit faire une jeune personne de votre âge et de votre monde, que sa famille et ses maîtres incitent à conquérir un diplôme? 281 Mon Dieu! elle doit se comporter comme le bon citoyen qui voit le défaut des lois existantes et s’y conforme par respect pour l’ordre et par amour pour la cité... Préparez-vous de votre mieux et passez l’examen aussi brillamment que possible; ne mettez d’ailleurs nulle passion dans le désir d’un succès de brevet et n’en tirez aucune vanité. Ce n’est pas votre génération qui profitera de la révolution scolaire désirée et prévue par nous tous.
Eh bien! Françoise, le voilà passé, ce rébarbatif examen, et vous voilà nantie du brevet supérieur! Vous vous êtes, ma foi, fort adroitement tirée de l’épreuve. Sans aucun souci d’étonner le jury par des connaissances démesurées, vous avez sur-le-champ donné l’impression que vous étiez très intelligente et 283 cultivée suffisamment. Et puis, il n’y a pas à dire, vous avez ce don merveilleux qui ne s’acquiert pas: l’autorité. Je vous observais, debout dans votre costume tailleur gris foncé, coiffée d’une toque de paille élégante,—pas trop élégante,—alors que vous exposiez votre science à la perspicacité de l’examinateur. Tandis qu’il proférait sa question, le regard de vos prunelles gris clair ne le quittait pas. Ce regard n’était pas effronté, loin de là! Il était moins encore timide ou implorant. Il marquait à la fois la curiosité et l’assurance. Il disait: «Mon cher monsieur, ne vous imaginez pas que, parce que vous m’examinez, je me considère comme livrée à votre bon plaisir... Je dois être reçue. Vous ne me troublerez pas et vous me recevrez... Par conséquent, inutile d’aller puiser au fin fond de votre sac à malices une de ces questions ingrates auxquelles on ne saurait congrûment répondre... Je veux une bonne question moyenne bien nette...» Et, ma foi! le docile universitaire obéissait... Il cessait d’être tatillon, nerveux, taquin. Votre épreuve semblait être pour lui un repos. Il vous laissait parler, sans vous tourmenter, sans chercher non plus à vous faire briller. Il pensait évidemment: «Celle-ci sera admise; ne nous fatiguons pas...» L’examen s’achevait: vous et lui échangiez un salut d’augures, et c’était tout. Heureuse Françoise!
Il n’en alla pas de même pour toutes les jeunes personnes qui, ce même jour, subirent 284 cette épreuve... Une surtout attira mon attention et ma pitié; tandis que vous-même attendiez la proclamation des résultats, je me pris à suivre sa lamentable odyssée de candidate...
C’était une jeune fille de votre taille, chère enfant, je veux dire ayant à peu près les mêmes dimensions que vous; mais le divin potier, s’il vous avait à toutes deux consacré la même quantité de pâte, s’était donné une peine inégale pour modeler l’une et l’autre. Mlle Alexandrine F...—je vis son nom sur les listes affichées—ressemblait à certaines paysannes du Berry; petit visage aux traits indécis, au teint brouillé, aux cheveux blond-jaune; buste plat rejoignant les hanches sans amincissement apparent; grands pieds, lourdes mains. Tous les gestes qu’elle ébauchait, même en conversant avec sa mère ou ses compagnes, étaient gauches et manqués; la main, le bras, s’arrêtaient en route, revenaient au point de départ, comme s’ils n’avaient fait qu’une tentative de geste, ou qu’un instinct décourageant leur eût soufflé: «Non, ce n’est pas encore ce geste-là... Renonçons-y!...» Vêtue d’une robe vert-olive et coiffée d’un chapeau de velours sous lequel son front suait à gouttes pressées, Alexandrine s’isolait volontiers pour rouvrir fiévreusement ses cahiers de notes et ses manuels. Courbée en deux sur les pages, on voyait qu’elle comblait à la hâte les failles de sa science, qu’elle mastiquait tant bien que mal les fissures de sa mémoire, comme un entrepreneur en retard à la veille 285 de l’inauguration... J’avais envie d’aller à elle, de lui ôter des mains son compendium, de lui dire: «Mais reposez-vous donc, ma petite! L’appoint de connaissances que vous acquérez actuellement est nul, et vous dépensez une force nerveuse qui vous fera cruellement défaut tout à l’heure...» Cette revision suprême de ses pauvres connaissances l’absorbait à ce point qu’elle n’entendit pas l’appel de son nom quand arriva son tour d’être examinée. Il fallut qu’une de ses compagnes la secouât par le bras, la réveillât comme d’un pesant sommeil, pour qu’elle se rappelât où elle était, qu’elle s’en vînt, trébuchante et l’œil écarquillé, jusqu’au tribunal scientifique où le juge, déjà, s’impatientait...
Au regard qu’il dirigea sur Alexandrine, je compris que les choses allaient tourner ardument pour la candidate... Ce fut un regard presque hostile,—le regard de l’homme excédé à qui l’on vient de voler une minute de son temps,—et tout de suite après j’observai une détente ironique de la physionomie qui signifiait: «Toi, je vais te faire un peu payer ma fatigue et mon ennui; nous allons nous distraire...» Hélas! tant qu’il y aura des juges et des examinateurs, pourquoi faut-il que certains candidats et certains prévenus soient infailliblement des bêtes noires, des souffre-douleurs sur lesquels professeur et magistrat «passent leurs nerfs» sans s’imaginer un instant qu’ils pèchent contre l’équité?...
286 Alexandrine faisait un effort pénible pour sourire, gracieusement et humblement, à son bourreau... Une grimace déplaisante résultait de cet effort.
—Veuillez, mademoiselle, dit l’examinateur d’un ton extrêmement poli, m’expliquer la division en classes des arthropodes?
Le visage d’Alexandrine se décomposa: il s’y peignit un véritable désespoir. Les arthropodes! quelle question allait-on dénicher pour elle!... Elle fit cependant un effort, ramassa tout ce qui lui restait de lucidité et de salive, murmura:
—Les arthropodes... les arthropodes... sont les hannetons... les écrevisses... et les... (un temps, puis, piteusement:) et les hannetons.
L’examinateur sourit sèchement et répliqua:
—Non, mademoiselle...
Ce «non» brusque acheva de désarçonner la pauvre fille. Il y eut un silence pénible. Alexandrine reprit d’une voix de déroute:
—Les hannetons... les écrevisses... et les... crustacés... sont des arthropodes.
L’examinateur se contenta de hausser les épaules. Puis, prenant son couteau à papier de buis, il se mit à l’examiner de tout près, comme si c’eût été un objet d’art extrêmement curieux. Alexandrine, plus à l’aise maintenant qu’il ne la regardait plus, reconquit un peu d’assurance.
—Les hannetons, proféra-t-elle sans s’apercevoir que les spectateurs eux-mêmes commençaient à ricaner lâchement, sont des 287 insectes qui passent successivement par plusieurs métamorphoses. Ils sont d’abord œuf, puis larve, puis nymphe, puis insecte parfait... L’œuf du hanneton...
Elle continua ainsi, d’abord troublée, peu à peu avec une volubilité et une assurance croissantes, décrivant d’un ton de récitation les métamorphoses du hanneton. Elle ne s’arrêta qu’au bout de sa science.
—C’est tout? demanda l’examinateur d’un ton détaché.
Elle fit signe que oui, que c’était bien tout.
—Vous apprenez des manuels par cœur, mademoiselle, déclara l’homme au coupe-papier. Mais le morceau que vous venez de me réciter n’a aucun rapport avec ce que je vous demandais... (Il dessina lentement une note sur la feuille placée devant lui.) Voyons... 288 Voulez-vous me dire ce qui se passe quand vous ajoutez un même nombre aux deux termes d’une fraction?
Cette fois, ce fut la débâcle de la triste Alexandrine. Elle essaya bien d’énoncer quelques théorèmes sur les fractions, mais on l’arrêta net, la ramenant au cas spécial proposé, qu’elle était évidemment hors d’état de traiter... On vint à la physique: elle dit quelques mots du prisme à réflexion totale, mais s’embrouilla dans le dessin explicatif du phénomène, qu’on exigea d’elle. Et, quand le «Je vous remercie» traditionnel eut été prononcé, elle garda juste assez de forces pour aller se trouver mal dans les bras de ses maîtresses et de ses compagnes...
—Voilà, pensai-je, le vice cruel des examens publics et de leurs programmes. Cette pauvre fille a évidemment une culture secondaire très ample; elle est considérée comme une bonne élève dans son école; cependant elle sera refusée parce que, faute de souplesse d’esprit et de toupet, elle a mal répondu sur le prisme à réflexion totale, sur un point très spécial de la théorie des fractions et sur les arthropodes. Or, les arthropodes et le prisme à réflexion totale sont absolument oubliés de la plupart des gens cultivés, l’époque de leurs examens révolue. Des fractions, l’on connaît à peu près la pratique des opérations, et c’est tout... Donc il est bien inutile de savoir ces trois questions; donc on 289 a tort d’examiner et surtout de refuser là-dessus... On devrait se faire une loi de n’interroger que sur quelques questions très générales, très importantes, en poussant l’élève à fond pour s’assurer qu’il les a bien comprises... Pourquoi, d’ailleurs, pourquoi enseigner aux élèves des choses qu’ils ne peuvent ni ne doivent retenir?
J’en étais là de mes réflexions, quand une main légère se posa sur mon épaule, tandis qu’une voix bien timbrée me disait:
—Mon oncle, si vous voulez, nous pouvons partir... Je suis reçue... Et ici il fait un peu chaud.
C’était vous, Françoise, toujours calme, aussi calme que la veille, aussi calme que pendant l’examen.
—Reçue?... m’écriai-je. Mais le résultat ne sera connu que dans deux heures?...
—Oui, mon oncle. Mais j’ai dit à ce bonhomme que vous voyez là, au garçon de bureau, à cette espèce d’huissier, enfin... de s’arranger pour savoir mes notes... Les voilà...
Vous me tendîtes un papier sur lequel, d’une grosse écriture maladroite et appliquée, le garçon de bureau avait écrit vos notes,—excellentes,—à côté du nom de chaque examinateur.
J’admirai une fois de plus votre maîtrise à manier la volonté des hommes, quels qu’ils fussent... Je vous demandai:
—Vous ne tenez pas, alors, à entendre proclamer votre gloire? 290
—Mon oncle, répliquâtes-vous avec un sourire, je n’ai pas besoin de vos conseils pour estimer cette gloire à son prix!
Un fiacre découvert nous ramena, par la chaude splendeur du Paris d’été, vers la place Possoz, où Mme Le Quellien nous attendait, infiniment moins calme que sa fille. Vous, Françoise, malgré votre admirable équilibre, la joie d’être délivrée d’une sotte épreuve, et sans doute aussi la pensée de votre prochaine émancipation, animaient votre visage et vous incitaient à parler plus et plus gaiement que de coutume... Je remarquai que nul passant ne vous croisa sans recevoir au vol, comme un reflet envoyé par un miroir, le coup de lumière de votre joyeuse jeunesse. Plus d’un sans doute envia ma place à côté de vous, sans se douter qu’il souhaitait honnêtement d’être votre oncle. J’avoue que vous étiez exquise à voir: un charmant objet de fraîcheur, de vigueur, de bonheur. Et peut-être fus-je le seul, parmi ceux qui vous admirèrent entre la place Saint-Sulpice et Passy, à sentir cette admiration se mêler d’un peu de mélancolie... Car je songeais, en égoïste et presque malgré moi, que bientôt un autre que moi serait votre chaperon officiel et que la situation d’oncle sans nièce est dépourvue de prestige... Votre succès, votre amusante loquacité, votre bonne grâce, me faisaient aussi penser, par une naturelle évocation, à la pauvre Alexandrine... J’imaginais son retour dans sa famille et son 291 entrée dans la vie,—humble être disgracieux, malchanceux, maladroit... Combien ce mot unique «la vie» signifie une réalité variable selon que le caprice de la nature nous fit le cerveau ou même le nez de diverse façon!... Et quelle place étroite et incommode la société laisse aujourd’hui à la femme laide!...
Cependant votre intelligent babillage berçait mes réflexions:
—... Vous comprenez, mon oncle, j’aimerais bien mieux quitter Berquin tout de suite, puisque voilà mon examen passé... Mais vous savez que Mme Rochette tient énormément à l’usage de la maison: faire faire une retraite de huit jours à l’élève qui va quitter la pension pour entrer dans le monde.
—Je ne trouve pas cela si bête, répliquai-je. Est-ce une retraite dans le sens religieux du mot?
—Il y a de cela, naturellement... Mais c’est aussi un temps de méditation sur la vie qu’on va mener dans le monde, sur le mariage, sur la conduite d’une maison. Un peu le sujet des lettres que vous m’écrivez, mon oncle... C’est Mme Rochette qui dirige les méditations.
—Pourquoi riez-vous en disant cela, Françoise?
—Parce que cette brave Mme Rochette, qui ne fut jamais autre chose qu’une maîtresse d’école, est tellement ignorante de la vie, tellement innocente!... 292
Je vous regardai sur ce mot, Françoise: et votre œil lucide, fixé sur moi, et le son de votre voix, et je ne sais quoi de toute votre allure, me démontrèrent qu’en effet Mme Rochette n’aurait pas beaucoup de clartés à vous donner sur «la vie»...
—Eh bien! répliquai-je, c’est vous qui l’instruirez. Vous proposerez à Mme Rochette une série de méditations sur la jeune fille du XXe siècle et sur la nécessité de marcher avec son époque.
Cette idée vous plut, vous fit rire... Nous arrivions à la place Possoz. Je vous laissai aux félicitations émues de Mme Le Quellien, et je m’en retournai chez moi.
Je n’étais pas très joyeux, je vous l’avoue. Je regardais sans complaisance les arbres et les fleurs de mon jardin, qui, eux, vivaient avec énergie sous le soleil de cinq heures, déjà moins ardent. Je me disais que quelque chose de ma vie allait prendre fin—cette correspondance de quinzaine, qui, peu à peu, m’était devenue précieuse... Dans quinze jours, vous serez sortie de pension définitivement, la fameuse retraite finie... Vous n’aurez qu’à regarder vous-même les choses autour de vous, de ces yeux gris-bleu qui voient si bien. Le truchement de l’oncle deviendra superflu... Bien vite, d’autres plaisirs et d’autres soucis que de correspondre avec moi s’imposeront à vous... Ainsi, ce qui vous apparaît comme un commencement prometteur 293 m’apparut, à moi, comme un morne achèvement...
Je me rappelai le soir où, dans ce même jardin, notre échange de lettres avait été décidé... Je comptai les mois... Il y en avait tout près de douze. Et ces douze mois de plus me pesèrent lourdement sur les épaules.
Ma lettre, chère enfant, ira vous trouver aux bords de la mer normande, où votre mère vous emmena quinze jours après l’examen passé, pour vous y faire goûter un repos bien acquis... Moi, je vous écris de Paris, toujours... Cela n’est guère élégant, en plein été... Mais que voulez-vous? Cette année, je ne puis me 295 décider à boucler mes malles, comme de coutume. Ailleurs, je n’aurais pas mes livres, ma table de travail, l’arrangement familier de ma maison, la fraîcheur de mon jardin,—et, pas plus qu’à Paris, je n’aurais Françoise... Recommencer une fois encore la nuit de sleeping-car, l’arrivée dans le first-class hotel, les excursions tarifées, les visites de convenance aux paysages et aux chefs-d’œuvre... non, décidément, j’ai beau me gourmander moi-même, le désir n’en ressuscite pas cette fois dans mon cœur.
Et très probablement je laisserai couler le temps des «vacances» dans ce coin de Paris, un peu provincial, où j’ai du moins le plaisir de passer, presque chaque jour, devant vos fenêtres fermées.
Il y avait bien le projet de vous rejoindre à Rosny-sur-Mer. Mme Le Quellien m’y conviait, et vous m’en renouvelez très gentiment l’invitation... Eh bien! tout réfléchi, j’aime encore mieux regarder d’en bas, à Passy, le visage endormi de votre appartement... Si vous étiez seules, votre mère et vous, à Rosny-sur-Mer, peut-être me serais-je décidé. Mais les Despeyroux ont loué une villa près de vous. Sans compter le brillant Maxime, vous êtes accaparée par la famille de votre fiancé, notamment par Lucie, l’une des jeunes personnes les plus infatigables dans la conversation qu’il m’ait été donné de rencontrer... Quel personnage viendrait jouer, avec ses conseils et ses doctrines 296 sur la vie, «votre oncle prêcheur» parmi tout ce monde uniquement occupé d’un grand bonheur immédiat?... La plupart m’enverraient secrètement au diable. Vous-même, chère Françoise, qui feriez tout votre effort pour être gracieuse avec l’oncle, et qui le seriez, j’aurais des remords à vous faire perdre quelques minutes de votre ferveur enthousiaste, de votre libre joie.
Votre cœur est si charmant que mon refus va vous faire un peu de peine, je le sais... Peut-être froisserez-vous ma lettre, d’un de ces mouvements spontanés qui ne sont pas la moindre de vos grâces. Peut-être murmurerez-vous comme naguère, quand je vous grondais un peu de votre coquetterie: «Méchant!... Méchant!...» Puis votre front s’assombrira, vos yeux gris s’immobiliseront; vous méditerez...
«Pourquoi refuse-t-il de nous rejoindre? Est-ce qu’il est fâché?...» Probablement vous ajouterez: «Serait-il jaloux?»
A cette dernière question, je puis d’autant mieux répondre, amie Françoise, que je me la suis déjà posée à moi-même... Je m’empresse de vous dire la réponse: aucune jalousie ne me ravage. J’ai, Dieu merci, trop de bon sens et d’équilibre sentimental pour que les billevesées d’un Bartolo me soient déjà venues à l’esprit. Mais, vous voyant seule dans la vie avec votre mère,—qui ne sait guère la vie,—je m’étais accoutumé à considérer que je jouais auprès de vous un rôle quasi paternel... 297 J’étais le seul ami un peu mêlé au monde extérieur qui pénétrât dans l’appartement de la place Possoz. Par la force de cette habitude, et à votre insu, des façons de voir les choses, des idées qui sont miennes, ont peu à peu conquis votre jeune intelligence et votre sensibilité. Vous n’êtes pas, tout à fait, la même Françoise que si vous ne m’aviez pas connu. Votre cerveau, peut-être votre cœur, me doivent quelque chose de leur forme présente. Ainsi je suis pour une part mystérieuse, mais importante, un des collaborateurs de l’ouvrage exquis que vous êtes... N’est-il pas naturel, dès lors, que j’aie pour vous quelques-uns des sentiments d’un père—ou plus exactement d’une mère?... Il y a beaucoup d’analogie entre ma façon de vous chérir et celle de Mme Le Quellien. Comme elle je veux votre bien, jusqu’à le vouloir malgré vous. Comme elle, tout ce qui vous a fait peu à peu grande fillette, puis jeune fille, m’inspirait un sentiment de tristesse égoïste que j’avais de la peine à combattre. Comme elle enfin je regarde votre fiancé d’un œil extrêmement lucide, dont nulle présomption favorable ne diminue la clairvoyance. Maxime en doit prendre son parti: il aura deux belles-mères.
L’âme de belle-mère que je me suis découverte depuis vos fiançailles, j’emploie en ce moment pour l’analyser tout ce que j’ai d’habitude psychologique. Et je m’étonne que la coutume des écrivains ait été jusqu’à présent 298 de ridiculiser ce type, car il est surtout pitoyable. Mal du souvenir, sensation de l’abandon, constatation de sa propre lente destruction par les années, tristesse des illusions effeuillées, angoisse du lendemain: l’âme de la belle-mère contient tout cela. C’est un musée de mélancolies.
Les souvenirs! Oh! chère Françoise, quelle collection m’en offre ma mémoire, de souvenirs qui vous touchent, où votre jeune personnalité, peu à peu accusée, joue le rôle d’héroïne!... Quelques-uns remontent au temps où vous aviez les cheveux sur le dos, les jambes nues et une robe princesse: nous les échangeons pieusement, Mme Le Quellien et moi, quand nous conversons en tête à tête...
Un entre mille.
Vous aviez sept ans, vous habitiez déjà place Possoz; moi je demeurais, en ce temps lointain, au numéro 8 de l’avenue Percier. Dans cette avenue, le numéro 8 est doublé d’un numéro 8 bis. Infailliblement, les cochers parisiens, qui ne sont pas très attentifs, s’obstinaient à me débarquer au 8 bis quand je rentrais chez moi; j’avais pris mon parti de les avertir à l’avance.
Or, ce matin-là, j’étais allé place Possoz vous enlever à votre maman, car j’étais toqué déjà de votre babillage pittoresque. Sur la place, nous hélâmes un fiacre; quand il fut près de nous, je donnai mon adresse au cocher: 8, avenue Percier, et j’ajoutai: 299
—Prenez garde! il y a un 8 bis.
Alors, vous, petite Françoise, vous serrant contre moi, effarée, vous eûtes ce cri:
—Où qu’il est, l’huit bis?...
«L’huit bis», devant votre imagination enfantine, surgissait évidemment comme un monstre extraordinaire et périlleux, dont il fallait se garer au plus vite... Je ne sais pas si cette historiette puérile est vraiment divertissante en soi, mais je sais qu’elle a bien des fois diverti votre mère et votre oncle. Aujourd’hui, en la rappelant, je n’ai pas envie de rire.
... Puis, je vous évoque à douze, à treize ans, à ces âges prétendus ingrats où je trouvais gracieuses, moi, votre gaucherie et votre timidité mêmes. Alors vos prunelles gris-bleu commençaient de se poser sur les choses, sur les êtres, avec une curiosité intelligente. Alors votre jeune esprit se tournait vers moi et recevait avidement ce que j’essayais de lui donner... Bien des fois, sous les acacias de mon jardin, devant le grand espace de ciel où se profilaient les tours du Trocadéro, bien des soirs nous réunirent alors, Mme Le Quellien, vous et moi! Souvent, ces soirs-là, Mme Le Quellien s’endormait doucement dans son fauteuil d’osier, et nous poursuivions notre entretien à demi-voix, pour ne pas troubler son sommeil. L’âge de transition que vous traversiez vous rendait par instants inquiète et nerveuse; moi, j’étais encore presque un jeune 300 homme... Mais quelle douce confiance nous avions l’un dans l’autre! Comme vous vous sentiez en sécurité près de moi! Comme je laissais grandir en moi ce sentiment quasi paternel, ou, si vous voulez, maternel, que les années ont affermi!...
Des jours, des jours passèrent encore; on vous mit à l’institut Berquin, vous apparûtes jeune fille, votre caractère se dessina. Ce fut la Françoise bien moderne, sérieuse et pratique, sachant ce qu’elle voulait et ne voulant rien au hasard, nullement asservie aux anciennes formules et pourtant avertie des périls d’un excessif affranchissement. Mais ce caractère aux vives et nettes arêtes n’excluait point une relative docilité aux conseils de votre oncle: ce dont je demeurai fier plus que vous ne le sauriez croire... Je continuais cependant d’exercer ma paternité par ces lettres bi-mensuelles, où vous vouliez bien recueillir quelques règles de vie, quelques directions morales... Mon illusion—véritable illusion de belle-mère—fut de m’imaginer que cela durerait toujours ainsi, que toujours vous auriez besoin de mon expérience et de mes méditations, que toujours je serais ce qu’on appelait au XVIIe siècle votre «directeur»!... Illusion absurde,—c’est évident: vous étiez, comme toutes les jeunes filles, destinée à l’amour et au mariage, et votre directeur naturel serait fatalement, un jour, votre mari.
301 Mais est-il des illusions raisonnables?
Ce ne fut pas, je le confesse, sans une douloureuse émotion que je connus, que je mesurai mon erreur. Ce ne fut pas sans angoisse que je distinguai, si vite, si vite, l’autre influence qui se glissait dans votre esprit. Maxime Despeyroux, que vous avez vu à peine une dizaine de fois depuis cet hiver, a déjà modifié Françoise plus que ne l’avait fait son oncle en quinze ans. C’est dans l’ordre—Dieu me garde de vous le reprocher!... Mais avais-je tort de signaler cette horrible sensation de l’abandon, qui devrait suffire à rendre les vaudevillistes pitoyables aux belles-mères?
Une autre sensation douloureuse, commune aux belles-mères et à votre oncle, est celle de la mise à la retraite... On a eu un emploi, et quelqu’un s’y substitue à vous. On servait à quelque chose, et l’on devient inutile... Rien de plus injurieux que la mise à la retraite; c’est un avertissement officiel de sénilité, de décrépitude. Être mis à la retraite, c’est mourir un peu. Or, me voilà retraité, Françoise, de mon préceptorat moral. L’emploi sera tenu désormais par un plus jeune, 302 qui a devant lui les années que je vous ai consacrées: il est demain et je suis hier... Savez-vous que certains fonctionnaires, amoureux de leur état, ne peuvent pas supporter l’idée que leur bureau, leur fauteuil, leur table, serviront à d’autres qu’à eux-mêmes, et se mettent à dépérir dès que le rond-de-cuir leur est ravi? Combien la privation est plus cruelle lorsque ce qu’on perd, c’est Françoise! Et que vais-je devenir, moi que les événements dépouillent d’une fonction si précieuse: recevoir les confidences d’un cœur de jeune fille et lui donner des conseils?
Voilà, chère enfant, mes raisons de mélancolie, et voilà pourquoi je veux rester seul à Paris, afin de m’en bien repaître, sans faire supporter à personne ma méchante humeur. Avec toutes ces tristesses, cependant, ne craignez pas que mes méditations arrivent à fabriquer de la jalousie... La jalousie est un sentiment vilain où il y a du désir de nuisance: et vous savez que je veux le bonheur de Françoise... Ma petite amie, ma petite élève, je souhaite que vos heures de fiançailles soient remplies d’une félicité sans mélange. Goûtez bien ce temps d’enthousiasme: il est fugitif; les illusions mêmes en sont adorables. Soyez toute à l’heureux conquérant que vous avez élu: c’est la règle, c’est le devoir. Nous vous aimons assez, Mme Le Quellien et moi, pour nous arranger encore un semblant de joie avec le surplus de votre joie... Évidemment, 303 pendant ces jours exceptionnels, vous ne penserez pas énormément à votre oncle. C’est la règle encore, et je ne vous en veux point... Toutefois, il y a, même dans les périodes les plus gaies de la vie, des quarts d’heure d’arrêt et de recueillement. On ne résisterait pas à l’enthousiasme continu. Eh bien! ce que je vous demande, Françoise, c’est de me donner de temps en temps un de ces quarts d’heure. La meilleure façon de converser avec moi sera de reprendre le paquet de nos vieilles lettres, celles surtout que je vous écrivis de quinzaine en quinzaine, depuis un an... Peut-être, en les relisant, trouverez-vous mes conseils surannés ou maladroits; vous avez désormais, pour les contrôler, les conseils d’un autre. Mais cette comparaison même vous sera profitable. Elle vous suggérera des réflexions personnelles: entre Maxime et moi, vous jugerez en dernier ressort.
Cependant, je penserai à vous, mignonne petite amie; je formerai des vœux pour votre joie... De temps en temps, quand le souvenir de Françoise m’obsédera, j’irai regarder les volets clos de sa maison. Je m’accommoderai de mon automne en rêvant à votre printemps, dans ce Paris peu à peu désert, où les feuilles jaunes des marronniers commencent à choir, tandis que certains lilas poussent, çà et là, des bouquets tardivement refleuris.
Hôtel Adriatique, à A... près Trieste.
Novembre 1901.
On ressent parfois, chère Françoise, un vif plaisir à être grondé. Il faut pour cela que la personne qui gronde vous soit très chère, que l’objet même de la gronderie soit une preuve de l’intérêt qu’elle vous porte; il faut aussi que la conscience ne vous tourmente pas trop cruellement... Si l’on n’est pas coupable du 305 tout, la gronderie devient quelque chose de presque voluptueux: l’on s’écrierait alors volontiers, avec l’épouse de la comédie: «Il me plaît, à moi, d’être battu.»
Votre lettre, chère enfant, m’a valu ce plaisir raffiné. Vous avez grondé votre oncle, de verte façon. «N’avez-vous pas de honte? vous écriez-vous. Regardez un peu le calendrier; mesurez la longueur du temps écoulé depuis que je n’ai pas reçu une ligne de vous... Votre dernier billet date du milieu de l’été: nous voici à la fin de novembre; vous gardez toujours le silence. Ne vous imaginez pas, au moins, que je compte à votre actif trois lignes glissées, par-ci, par-là, à mon intention, dans votre correspondance avec ma mère. Ah çà! qu’est-ce que cela veut dire?... Est-ce que, parce que je suis hors de pension, nous ne devons plus nous écrire? Est-ce que, parce que je suis fiancée, je ne suis plus votre nièce?»
Oh! les douces meurtrissures que me fit votre petite main fâchée, Françoise!... Quoi! mes lettres vous manquent un peu? Je n’osais le croire. Il est vrai que vous vous en apercevez huit jours après que votre fiancé Maxime, nommé sous-lieutenant à Châteauroux, a quitté Paris pour rejoindre son régiment. Tant qu’a duré la villégiature de Rosny-sur-Mer, où Maxime et sa famille habitaient une villa voisine de la vôtre, et même un mois et demi après, vous ne semblez pas avoir souffert de 306 ce silence que vous me reprochez... N’importe: n’eût-on que le second rang dans votre cœur, on est fier de l’avoir gardé, mademoiselle. Et pour cela votre gronderie m’est précieuse.
Elle est injuste, d’ailleurs, ce qui, suivant la règle énoncée tout à l’heure, double mon plaisir. N’avez-vous pas remarqué, en effet, que si trois mois et plus s’écoulèrent depuis ma dernière épître, moi non plus, durant quinze longues semaines, je n’ai rien reçu de vous?... Sans la fidèle Mme Le Quellien, qui m’eût renseigné sur Françoise?... Que les reproches féminins sont donc divertissants, et que vous êtes donc femme, ma nièce!
Maintenant, voulez-vous mon avis? Nous eûmes parfaitement raison de ne point nous écrire durant ces mois d’été et d’automne. Et de façon générale, quand on n’a rien à se dire et que d’ailleurs on ne sent pas un impérieux besoin d’entrer en communication avec l’absent, il n’est pas bon de se forcer à aligner des phrases sur un papier qui ne demandait qu’à rester vierge et à ne point voyager. J’observe ce principe dans ma propre correspondance. Il m’a fait quelques ennemis; pourtant je m’y tiens. Écrire pour écrire m’est odieux. La lettre de convenance me semblerait un manque d’honnêteté et de franchise si je la signais; elle me cause un malaise et me prévient défavorablement contre le signataire quand je la reçois... Je me méfie instinctivement des gens qui, sans affaires, vaquent à une longue 307 correspondance quotidienne: ils ont une âme de banalité. Je ne réclame aucune part dans la distribution de leur amabilité postale.
Vous avez senti cela d’instinct, chère Françoise, durant les semaines où Maxime était près de vous presque à toute heure du jour: son image, sa pensée, fermaient pour ainsi dire toutes les issues de votre âme. De quelles pauvres lettres vous m’eussiez alors gratifié, grand Dieu! si vous aviez eu le tort de vous contraindre à rompre un instant l’enchantement. Vous n’auriez pas voulu tracer sur la feuille blanche ces mots cent fois répétés: «Je l’aime... Je l’aime!...» Et pourtant c’eût été la seule lettre sincère. Votre pudeur sentimentale préféra ne pas l’écrire: moi, je préfère ne l’avoir pas reçue. Car cela ne m’eût rien appris de nouveau; et, comme l’humain égoïsme rapporte tout à soi-même, j’aurais instinctivement traduit les mots de la phrase écrite, par d’autres, très mélancoliques.
N’allez pas croire, cependant, ma jolie nièce, que mon humeur soit aussi grognonne qu’au dernier été. Quand je pense à votre fiancé, je me sens encore, de temps en temps, quelque peu «l’âme de belle-mère», mais d’une belle-mère traitable, voire bienveillante. A Maxime je sais gré d’aimer Françoise et d’être aimé d’elle assez pour lui donner du bonheur. Ce n’est aucunement par bouderie que je ne vous ai pas écrit. C’est parce que, moi aussi, tant que Maxime fut près de vous et vécut 308 dans une intimité quotidienne avec vous, je n’avais positivement rien à vous dire... Les sujets de vos entretiens avec lui étaient évidemment ce qui vous intéressait le plus: ma lettre n’aurait eu d’autre effet que de vous interrompre. Or ce rôle d’interrupteur est des plus sots. Et le sort aveugle qui mène les lettres à leur destination les fait parfois arriver au but en des instants si mal choisis!
Aujourd’hui, il n’en est pas de même. Vous êtes seule, de nouveau, avec Mme Le Quellien, dans le provincial logis de la place Possoz; plus seule que jamais, puisque vous n’avez plus auprès de vous ni les compagnes de pension, comme l’an passé, ni le fiancé, comme durant les vacances et jusqu’à ces derniers jours. Assurément, Maxime ne manque pas de vous écrire fréquemment. Assurément, les projets d’avenir et les soins pratiques qui préparent cet avenir vous occupent, outre tout ce qui peut distraire un esprit cultivé comme le vôtre. Mais, enfin, une présence absorbante, dominatrice, n’est plus là, et, justement parce qu’elle fut absorbante et dominatrice, elle laisse en s’éloignant un large vide et un peu de froid. 309 Alors, tout naturellement, les autres objets frappent de nouveau votre vue... Je suis sûr que, depuis une semaine, Mme Le Quellien a reçu de vous des baisers plus tendres, des enlacements plus passionnés que depuis bien longtemps. Et plus loin qu’elle, à l’horizon de vos pensées, vous avez soudain retrouvé votre oncle, l’ami de votre enfance et de votre adolescence, le sermonneur qualifié de votre dernière année de pension.
Ne vous en défendez pas, Françoise. C’est trop naturel. Votre mère, votre oncle, sont pour vous des amis, et le rôle de l’amitié est de s’effacer devant l’amour (on peut prononcer ce grand mot aujourd’hui devant vous, puisque vous êtes fiancée). Mais l’amitié a ses revanches. Moins exaltée, moins égoïste aussi que l’amour, elle occupe sans brusquerie les heures que laisse inoccupées celui-ci. Elle est le recours fidèle, sûr, infaillible, contre les peines causées par l’amour, et l’amour en cause inévitablement, par cela même qu’il est un sentiment exalté, un enthousiasme quelque peu orageux. Donc vous avez eu raison, dans votre première peine d’amour, causée par l’absence de l’être aimé, de vous tourner vers les affections qui peuplent des régions plus tranquilles de votre cœur: celle de Mme Le Quellien et la mienne.
La mienne ne vous manquera pas dans votre nouvel état, mignonne amie. Parce qu’elle s’était faite à dessein silencieuse durant les 310 derniers mois, ne croyez pas qu’elle fût abolie. La lampe brûlait toujours: j’avais seulement posé devant sa flamme un écran discret, pour ne point importuner de son reflet le rêve où vous viviez... Car l’amitié sincère est prévenante et pense toujours à autrui: une amitié égoïste ne mérite pas le beau nom d’amitié. Un jour, sans doute, vous goûterez à votre tour le charme de cet altruisme; on ne l’apprécie bien qu’après avoir passé la première jeunesse. La première jeunesse ne connaît point la joie de l’amitié active. Si elle consent à se laisser aimer, nous lui en savons un gré infini. Si parfois elle va jusqu’à nous dire: «Aimez-moi!» nous nous sentons comblés.
Il y a un peu de cette charmante prière dans l’appel que je reçois de vous, mon enfant: et j’en ai le cœur tout réchauffé. Certes, je continuerai «à vous aimer comme avant» (ce sont vos expressions), à vous écrire, aussi, tant que je serai loin de vous, puisque vous le souhaitez et que votre fiancé n’y voit pas d’obstacle. Peut-être pas aussi souvent et aussi régulièrement: il n’y aurait plus de raison à ces lettres de quinzaine qui avaient pour objet de vous faire communiquer avec le monde extérieur tout en vous offrant quelques préceptes utiles. Aujourd’hui, le monde vous est ouvert. Vous le voyez avec vos yeux, qui savent très bien voir. Quant aux préceptes, aux propos d’oncle prêcheur, ils ne seraient plus à leur place dans des lettres adressées à une grande 311 jeune fille sortie de pension, nantie de ses brevets, et qui a maintenant un directeur tout indiqué, pourvu d’un joli galon d’or sur sa manche.
—Alors, mon oncle, vous ne me donnerez plus votre avis sur les choses?
—Que si! que si! ma nièce... Je voudrais me l’interdire que je n’y réussirais pas, tant l’habitude de prêcher est incommode à perdre. Seulement je suis bien résolu à ne prêcher désormais que sur des matières choisies par vous-même. En d’autres termes, je répondrai de mon mieux aux questions qu’il vous plaira de me poser, sans plus. J’abdique les fonctions de mentor. Je ne veux plus, je ne dois plus ambitionner qu’une voix consultative aux délibérations de votre conscience et de votre cœur. Que mon rôle même soit encore plus modeste: il me suffit d’être pour vous un lexique moral, bien en désordre, hélas! bien imparfait. Feuilletez-moi à votre loisir et à votre fantaisie.
Ainsi les lettres que nous échangerons éviteront ce banal caractère de lettres de convenances pour lequel je vous disais tout à l’heure mon dégoût. Puisque vous me consulterez sur des objets qui vous intéressent, vous ne vous ennuierez point à m’écrire. Et moi qui me divertis toujours à bavarder avec vous, je garderai un peu d’espoir que vous lirez mon bavardage sans trop d’impatience,—l’ayant provoqué.
Hôtel Adriatique, décembre 1901.
Votre première lettre-consultation, ma chère Françoise, porte sur le point délicat du voyage de noces. A l’occasion de son mariage, Maxime obtiendra de ses chefs un congé de six semaines, qu’on pourra prolonger un peu grâce à la faveur du colonel. A quoi emploierez-vous ces six semaines? Votre mère 313 conseille le traditionnel voyage de noces: Maxime est de son avis. Lucie, la sœur de Maxime, prétend au contraire que le voyage de noces est une coutume surannée. «Lorsqu’on n’a pas de château pour y passer sa lune de miel—dit Lucie—le plus chic est de s’en aller tout simplement, incognito, dans un bon hôtel de Paris, comme si l’on était des étrangers... Les voyages sont inconfortables et bien vite ennuyeux. Le voyage de noces est, en plus, ridicule... Toutes mes amies mariées sont d’accord là-dessus...» Ainsi parle Lucie du haut de sa charmante inexpérience. Vous, ma nièce, vous hésitez. Le voyage vous tente, mais les propos de Lucie vous alarment. Et vous me dites: «Mon oncle, vous qui, par goût, êtes si souvent sur les routes, conseillez-moi... Les voyages sont-ils vraiment à ce point décevants? Et le voyage de noces, en particulier, est-il une coutume si grotesque?»
J’aurais mauvaise grâce, Françoise, à dauber sur les voyages en général, puisque à l’heure présente je vous écris d’une station d’hiver de l’Adriatique et qu’un timbre autrichien sert de passe-port à ma réponse. Toutefois, je sais ce qu’on reproche aux voyages en général, et moi-même, à certaines minutes de mauvaise humeur, je le leur ai reproché. Au commencement de l’été dernier je m’étais bien juré de laisser passer la belle saison sans monter ni dans un sleeping-car ni dans l’ascenseur d’un hôtel étranger. Je vous avais informée de ce beau projet... Pourtant, ce ne sont pas les 314 kobolds qui m’ont transporté ici... Cela prouve qu’il ne faut jurer de rien. Cela prouve aussi que quiconque a une fois introduit dans sa vie l’habitude des voyages sentira infailliblement, de temps à autre, la nostalgie de l’«ailleurs», la manie d’essayer d’être un autre homme sous d’autres latitudes... Quant au voyage de noces, il possède les attraits et les défauts des voyages ordinaires à la dixième puissance, pourrait-on dire. Il est le voyage par excellence, le plus voyage de tous les voyages. C’est pourquoi il a des détracteurs et des fauteurs passionnés. Je vous dirai mon avis sur ce qui le concerne en particulier. Traitons d’abord la question des voyages en général.
On a dit à Lucie que tous les voyages étaient décevants. Ils le sont en effet. Peut-être est-ce la faute des illusions que nous nous forgeons à l’avance, sur la foi des récits que nous font d’autres voyageurs, sur la lecture des livres, même sur l’inspection de ce qui semble pourtant un témoin irrécusable: les photographies. Livres et voyageurs mentent en général, ou du moins exagèrent: c’est trop naturel. Faire un récit en prévenant d’avance qu’il est dépourvu d’intérêt, c’est provoquer l’objection: «Pourquoi le faites-vous?» Rien n’est plus assommant qu’un voyageur proclamant son dégoût et son dédain: tandis qu’un léger ton de gasconnade ou une pointe d’accent marseillais ne messied point au conteur revenu de loin... Les gravures, les tableaux, les 315 photographies elles-mêmes mentent aussi. Quiconque a manié la plaque sensible et la poire de caoutchouc connaît «les trucs» au moyen desquels on approfondit une perspective, les choix ingénieux d’éclairage, les points de vue transformateurs. On flatte la nature, on flatte l’œuvre d’art en les reproduisant, comme on flatte un visage humain.
Ainsi tout conspire pour tromper le voyageur au départ. Mais ce qui le trompe le mieux, c’est encore son imagination. Il y a de la magie dans ces mots: «Voyage... Partir...» Selon le vers du poète latin:
Nous ne vivons jamais, nous attendons la vie...
Or, partir, voyager, il semble que ce ne soit plus attendre quiètement la vie, mais courir au-devant d’elle. Comme notre vie est habituellement réglée, et, par là, doucement monotone, nous imaginons qu’en sortant soudain des lieux et des habitudes de cette vie quotidienne nous allons pénétrer aussitôt dans un monde d’imprévu et d’aventures.
Il se trouve qu’en réalité presque rien de tout cela ne se réalise. L’imprévu et l’aventure du voyage sont supprimés depuis qu’il est aussi aisé (sauf la question de temps) d’aller de la gare de l’Est à Irkoutsk que de la même gare à la place du Trocadéro. Dans les deux cas, il suffit de s’asseoir dans un véhicule et de laisser faire... Tout pèlerin sincère conviendra d’ailleurs que le premier tête-à-tête avec un chef-d’œuvre, un monument, un 316 site célèbres comporte presque toujours une déception. Ce n’est pas la faute du chef-d’œuvre ou du site: c’est la faute de notre rêve qui les a parés à l’avance d’irréalisables attraits. C’est tellement peu la faute du chef-d’œuvre ou du site qu’au second pèlerinage il n’y a plus de déception. Mais que de gens ne font point, ne peuvent point faire ce second pèlerinage au même lieu!
Heureusement, et c’est un trait notable de la psychologie du voyageur, il est bien rare que celui-ci garde rancune aux œuvres d’art et aux paysages. Une sorte de pudeur l’empêche d’avouer sa déception au moment où il l’éprouve: il s’impose alors une factice admiration, d’accord avec les guides. Puis, dès que l’objet n’est plus sous ses yeux, l’impression décevante commence à s’effacer. Une harmonie spontanée se fait entre le sentiment personnel et l’opinion courante. Enfin, le voyage fini, le voyageur rentré dans ses foyers, l’imagination recommence sur le canevas du passé la broderie de Pénélope dont elle avait décoré l’avenir. Comme on avait rêvé à l’avance des émotions irréalisables, on se suggère qu’on en éprouva. Le souvenir, ingénieux et illusoire, réédifie lentement et secrètement le décor qu’avait dressé l’espérance, en sorte que le voyageur est sincère lorsque à son tour, vous contant son voyage, ses mensonges vous préparent des illusions.
Eh bien! cette double excitation du sens 317 imaginatif, avant et après, suffisent, à mon avis, pour recommander les voyages: et à ce même titre le voyage de noces me semble un usage digne d’être maintenu... Dans quelques mois, Françoise, en même temps que vous partirez pour quelque pays étranger en compagnie de Maxime, vous commencerez un voyage bien autrement aventureux, celui de la vie conjugale. Ce voyage-là, vous y rêvez comme à l’autre; comme l’autre vous l’ornez à l’avance de toutes sortes d’émotions et de plaisirs. Vous avez beau être une petite personne d’esprit lucide et pratique, je vous défie d’imaginer dans votre avenir avec Maxime autre chose que de la joie... La solitude avec Maxime, joie. Attendre à la maison Maxime qui va rentrer du quartier, joie. La maternité, joie. Maxime lieutenant, capitaine, décoré, joie... Et ainsi de suite... En fait, la vie conjugale, même entre deux êtres qui s’aiment, est un mélange de félicité et de peine, et sans doute, devant la réalité, vous éprouverez souvent, Françoise, la déception du voyageur en présence du site ou du chef-d’œuvre vantés... Alors, ne vous arrêtez pas à cette déception; selon le mot des casuistes, n’y consentez point... Ayez confiance: dites-vous que l’éloignement dans le passé vous rendra bientôt le mirage auquel l’éloignement dans l’avenir avait accoutumé votre âme... Quand votre mère songe à ses propres fiançailles, à son propre voyage de noces, à tous les événements de l’existence étroitement unie qu’elle 318 mena avec votre père, elle revoit un pays aussi enchanteur, aussi chimérique que celui dont vous rêvez aujourd’hui. Pourtant votre mère a vécu, et vous allez vivre! Oh! la merveilleuse réserve d’espoir enchanteur, de souvenir illusoire, que chaque génération transmet à la suivante, et qui est comme le sel de la vie!
Le mérite du voyage de noces, c’est d’accroître cette dose d’espoir et d’enthousiasme si nécessaire à deux êtres qui vont ensemble s’avancer dans la vie. C’est de parer de mystère et d’imprévu les premiers pas du couple nouveau. Qu’importe s’il amène les petites déceptions, inévitables dès que la réalité vient contrôler un rêve?... Rentré dans la vie courante du ménage, le jeune époux, la jeune épouse, aboliront instinctivement la mémoire de ces déceptions. De nouveau le voyage de noces apparaîtra dans un halo de joie, de tendresse, d’enthousiasme. Il demeurera, en même temps qu’un symbole charmant de la vie conjugale, la porte de lumière par où le jeune couple fit son entrée dans cette vie.
Donc, chère Françoise, non seulement je suis partisan du voyage de noces, mais je conseillerais volontiers à tous les époux de le recommencer de temps à autre. J’entends que deux êtres qui s’aiment font sagement de s’isoler parfois des spectacles et des personnes qu’ils voient habituellement, et de s’essayer au tête-à-tête, comme dans les premières 319 semaines du mariage. Tant de couples perdent insensiblement l’habitude de vivre réellement en commun! Cependant, le goût de la vie à deux, le besoin réciproque de la présence, sont les vrais biens du mariage, ceux qu’aucun incident ne saurait briser. Le voyage à deux permet aux époux de se rendre compte de la solidité, de la tension de ces liens. Le voyage à deux, c’est, dans la vie mariée, l’équivalent de la «retraite» dans le célibat monastique.
Aussi les gens du monde, les ironistes et les philosophes de salon raillent-ils les voyages conjugaux, en particulier le voyage de noces: car philosophes de salon, ironistes et mondains ont l’horreur, la peur de la «retraite», et, en général, de la vie intérieure.
Je vous le demande, Françoise, quelle retraite, quelle halte dans la vie peut comporter un banal séjour de quelque vingt-quatre heures 320 dans un hôtel parisien, avec le bruit familier de la capitale autour de soi et tout l’appareil de dissipation inséparable de Paris? Ah! la laide coutume, imaginée à coup sûr par des viveurs éreintés et des demoiselles désabusées à l’avance!
N’y cédez pas, Françoise. A l’aube du mariage, faites comme votre mère, comme vos aïeules, le traditionnel pèlerinage vers l’inconnu, vers la solitude à deux, vers le rêve. Sans doute la vie est un tissu de joies et de peines; il faut se fortifier le cœur à l’avance pour soutenir tous les chocs qu’elle nous destine. Est-ce une raison pour refuser, dès le commencement de la route, le meilleur viatique: l’espoir—dût à cet espoir se mêler une dose d’illusion?...—Les sages, voyez-vous, ma jolie nièce, se gardent bien de chasser l’illusion de leur vie, sous prétexte d’éviter les déceptions. Pour eux, c’est la réalité, c’est la déception même, qui ne durent point; elles masquent un instant l’illusion, puis disparaissent. L’illusion demeure; elle est éternelle. Aimez l’illusion.
Hôtel Adriatique, janvier 1902.
Je vous ai suivie par la pensée, chère Françoise, dans l’expédition que me narre votre lettre. Je vous ai vue prenant avec Mme Le Quellien et Lucie le train de Châteauroux, débarquant à la gare de cette modeste capitale. J’ai imaginé votre joie à retrouver Maxime, 322 à pénétrer dans son garni de sous-lieutenant, à déjeuner dans son hôtel. Moi-même, il y a quelque quinze ans, j’ai habité le chef-lieu du département de l’Indre; mes souvenirs ont su évoquer d’une façon précise les places, les rues, les allées que vous avez parcourues tous les quatre à la recherche du logis où s’abritera, dans quelques mois, votre jeune félicité d’épouse.
Il paraît que Lucie poussait les hauts cris: «Dieu! que cette ville est laide!... Que ces maisons sont inconfortables!... Faut-il que Françoise t’adore, Maxime, pour consentir à vivre dans un pareil trou!... Moi, mon parti est arrêté: je ne me marierai qu’avec la condition d’habiter Paris!...» Entre nous, Lucie, malgré ses airs entendus, malgré qu’elle soit de cinq mois votre aînée, est une enfant qui parle à tort et à travers, infiniment plus enfant que vous, Françoise. En dépit de ses préoccupations et de ses propos romanesques, elle ne sait pas ce que c’est que d’aimer... Plus raisonnable et mieux renseignée, ma chère nièce, vous n’avez pas éprouvé la sensation d’un exil en pays barbare, parce que des maisons un peu moins hautes, pourvues de magasins un peu moins brillants, bordaient des rues un peu moins larges qu’à Paris... Sans doute vous ne pouviez exagérer la complaisance jusqu’à admirer Châteauroux. Mais c’était la ville où les nécessités de la vie fixaient votre fiancé; vous la visitiez pour la première fois dans l’allégresse de marcher côte à côte avec 323 lui; surtout vous pensiez que là s’inaugurerait votre vie à deux. Cette espérance vous rendit intéressant et presque cher le décor banal d’une préfecture de province française.
«Est-ce drôle, mon bon oncle! me dites-vous, Châteauroux n’est pas le séjour que nous aurions choisi, ni Maxime ni moi... La ville est mélancolique; tout ce que Maxime nous a fait visiter en fait de logements est médiocre, plutôt laid... Pourtant, revenue place Possoz, je me sens un violent désir de ce grand village morne, de ces vieilles maisons mal bâties... Et je crois que, si d’ici à mon mariage Maxime était inopinément nommé à Paris, j’en aurais un peu de regret...»
Voilà, Françoise, d’excellentes dispositions pour vous adapter à la vie de femme d’officier. Je partage d’ailleurs pleinement votre avis sur le dernier point: je considérerais comme fort regrettable pour vous et pour Maxime que celui-ci fût nommé à Paris en ce moment. Vous n’obtiendriez pas de moi, malgré ma faiblesse et vos séductions, une démarche pour aider à ce changement. Cela vous étonne? Je vais vous dire mes raisons, et du même coup je répondrai à diverses questions que vous me posez sur le point de votre installation pratique, et sur le problème d’accorder le légitime désir d’un intérieur agréable, voire élégant, avec un budget limité.
Prenons les choses d’un peu haut.
Il y a, Françoise, une philosophie, ou, plus 324 modestement, une hygiène du bonheur. Elle n’est codifiée nulle part, et c’est dommage: car la plupart des gens gâchent leurs facultés d’être heureux bien plus imprudemment encore que leur santé. Je ne prétends pas tenir dans ma tête ni dans mes cartons le code de cette hygiène. Mais j’en sais au moins quelques principes que la méditation m’avait enseignés et qu’a confirmés pour moi l’expérience. L’un de ces principes, qu’on devrait sans cesse répéter aux nouveaux époux, est: que le bonheur d’un jeune ménage est tout entier dans le fait d’être jeunes à deux, et que non seulement il n’emprunte rien aux avantages de situation, de relations, de fortune, de luxe, mais que ces divers avantages, s’ils sont excessifs, empiètent sur lui et l’amoindrissent.
J’exclus, bien entendu, le cas où le jeune ménage manque du nécessaire: l’absence de souci, a dit Saint-Augustin, est la première condition du bonheur. Mais j’affirme que pour être, à vingt-cinq ans (l’âge de Maxime), parfaitement conscient de la joie d’être votre mari, Françoise, il vaut mieux avoir huit mille francs de revenu total que cent mille; il vaut mieux être un insoucieux lieutenant qu’un homme célèbre ou un important brasseur d’affaires; il vaut mieux habiter sur les allées de Déols, à Châteauroux, une humble maison provinciale, qu’un hôtel princier sur l’avenue Montaigne...
Observez que je n’invoque pas de vagues 325 et plates théories sur les joies de la médiocrité. Je dis une chose plus précise et mieux circonscrite. Quand Maxime aura quarante ans et vous trente-trois, jolie Françoise, je vous tiendrai un tout autre langage... Ce que je prétends, sans plus, c’est que la médiocrité de la fortune, de la situation, c’est que le silence et l’humilité du milieu sont propices, presque indispensables au bonheur de deux nouveaux mariés qui, dans le sens total du mot, s’aiment. C’est que le jeune amour, quand il est vraiment jeune et vraiment amour, se suffit à lui-même; qu’il est une joie tellement rare, tellement essentielle, que toute joie autre et simultanée diminue la somme totale du bonheur.
J’ai dit: le jeune amour. Car, Françoise, vous pouvez bien espérer que l’amour ne désertera jamais votre foyer: mais la jeunesse le désertera certainement. Et donc il viendra un temps où, sans aimer moins Maxime, vous l’aimerez d’autre façon. Votre amour vieillira comme son visage et le vôtre: se le dissimuler est pure vanité et puérilité. L’amour ne dévorera plus toutes les minutes de votre vie. Vous ne lui ferez plus de tort en donnant de votre pensée, de vos loisirs, de vos efforts, à autre chose qu’à lui. Alors, s’occuper avec Maxime de son avancement, de votre fortune, du luxe de la maison, sera une façon nouvelle de vous aimer, adéquate à votre âge. De cette adaptation progressive aux saisons de l’amour résultent l’harmonie et le bonheur du ménage. Le bonheur à deux est, alors, un fruit naturel 326 mûri dans sa saison. Les fruits hâtifs, les fruits tardifs sont de mauvais fruits.
J’éprouve une pitié sincère pour la plupart de ces couples de «grands mariages» dont Paris nous offre le spectacle presque quotidien. Pauvres jeunes gens! En additionnant leurs âges, à peine ils dépassent la quarantaine, et déjà on les condamne à vivre dans le maximum du luxe et du confort, avec un nombreux appareil domestique, le harassement de recevoir et d’être reçus, le souci d’avancer dans la fortune, dans les places ou simplement dans le monde. On leur impose les soins et le régime qui conviennent merveilleusement, mais exclusivement à la maturité. En somme, on leur escamote la jeunesse, la précieuse, irremplaçable, divine jeunesse. On leur vole dix ou quinze ans de vie sentimentale, pour leur offrir en échange dix ans de la vie d’affaires, dont ils connaîtront toujours assez tôt le vide décevant. On les prive, même dans cette vie d’affaires, du seul condiment qui l’assaisonne: la sensation de grandir, de progresser. Tout de suite, ils ont tout.
Je plains aussi, Françoise, les couples plus modestes qui installent leur foyer à Paris. Pour droits que soient leurs cœurs et si fort qu’ils s’aiment, la foire au luxe qui les environne suffit à leur tourner l’esprit s’ils ne l’ont solide. En ai-je vu, de ces pauvres couples que l’envie du luxe impossible hantait au point de gâter leur joie de jeunes époux! Le moyen pour deux petits oiseaux d’être 327 heureux, s’ils dédaignent leur nid? Souvent, d’ailleurs, ce dédain du nid trop modeste part d’un bon sentiment, d’un sentiment altruiste: en le grattant bien, on trouverait de l’amour dessous. Le mari pense: «Comme le luxe lui siérait bien! Cet écrin médiocre à ce bibelot rare, quel contresens!...» La femme pense: «Je serais tellement plus jolie dans les robes, dans le salon de madame X...! Et qu’il m’aimerait mieux!...» Ah! les nigauds! ils ne se doutent pas que nulle parure n’accroît le charme de l’extrême jeunesse, et que ce charme n’a pas besoin d’un cadre luxueux, au contraire. Mettez une collerette d’or à une rose, sera-t-elle plus belle? Nullement, et elle sera moins une rose. Vérités que tout le monde proclame, la jeunesse passée. Il n’y a que les jeunes gens pour n’en pas être convaincus.
Aussi, chère Françoise, je considère sans paradoxe que c’est un grand bonheur pour Maxime et pour vous de n’être point riches, de n’être nullement des personnages en vue, et d’installer votre foyer dans une des plus insignifiantes villes de la province française... La miséricordieuse destinée vous préserve même de la tentation somptuaire. Avec vos huit mille livres de revenu et les commodités de la vie militaire, vous ne saurez souffrir, à Châteauroux, de comparaisons humiliantes: mais aussi ne pourrez-vous entreprendre d’étonner l’Indre par l’éclat de votre luxe. Donc il ne sera pas question de luxe dans votre nid. Il ne sera pas non plus question d’ambition, hors 328 celle—modeste—que Maxime soit en temps utile maintenu au tableau... Heureux enfants! Vous n’aurez qu’à penser l’un à l’autre, à vous aimer sans distraction! Heureux, trop heureux enfants!
Pour en venir aux conseils pratiques que vous sollicitez sur votre installation et même (faut-il que je sois assez un vieil oncle de tout repos!) sur votre trousseau, je recommande, naturellement, une grande simplicité, conforme à votre âge et à vos ressources. Mais qui dit simplicité ne dit pas laideur ou vulgarité, et sur la façon d’être simple il faut encore s’entendre.
Prenons, par exemple, la question du trousseau. Comment simplifier le trousseau? Premièrement, en excluant le linge, les toilettes et les bijoux d’un prix excessif, d’un prix en désaccord trop manifeste avec votre jeunesse et votre revenu. Je vous préviens que si j’aperçois dans ledit trousseau «le jupon de cinq cents francs» dont périodiquement nous entretiennent les gazettes je le déchire sous vos yeux.
Seconde manière de simplifier le trousseau: en diminuer la quantité. Ce moyen, le plus sûr et le plus facile, vous permet, malgré vos ressources restreintes, de n’acquérir tout de même rien de laid. Jamais, jamais, sauf le cas d’indigence, on n’est excusable d’acheter pour son usage quelque chose de laid. Réduisez donc au large nécessaire, sans plus, votre 329 lingerie et vos costumes. Grâce à cette réduction, ne composez l’un et l’autre que d’éléments choisis et jolis,—sinon de grand luxe et de grand prix.
Le même principe vous guidera dans l’installation du foyer. Choisissez une petite maison, mais agréable à l’œil et bien située. Vous avez déjà constaté, pendant les mois de Rosny-sur-Mer, qu’un très grand bonheur peut tenir en très peu d’espace. Je veux que votre jeunesse, votre amour, votre qualité de «débutants dans la vie» soit exprimée par l’exiguité relative du logis. A quoi bon tant de place, si le bonheur consiste à être tout proches l’un de l’autre?... D’ailleurs une petite maison exige moins de meubles, moins de tentures, moins de rideaux, et le service en est plus aisé. Votre maison sera donc mieux tenue avec le personnel domestique restreint dont vous disposez, et,—comme pour le trousseau,—achetant moins de choses, vous pourrez n’en point admettre de laides ni de vulgaires.
Pour vous guider dans vos choix, je vous propose une règle très simple. Choisissez les 330 objets de votre ménage nouveau, de façon qu’ils ne déparent jamais la maison, quand celle-ci sera plus ample et que vous, les habitants, serez plus vieux et plus considérables. Il est aisé, soit avec les exemplaires simples des styles anciens, soit avec ceux des styles modernes qui ne visent pas à l’extravagance, de s’entourer à peu de frais d’un décor agréable et durable. Durable: c’est important. Méprisons les gens qui changent à tout propos de mobilier! Ils n’ont pas le sens du foyer. N’installez que trois pièces de votre maison si l’argent vous manque, mais n’y tolérez rien de vulgaire, sous prétexte de provisoire. D’ailleurs, avec une personne de votre goût, on peut être tranquille. Je ne verrai pas dans votre salle à manger le buffet Henri II du faubourg Saint-Antoine, orné de perdreaux en saillie sur les panneaux, ni les affreux rideaux en faux velours, ni les imitations de tapisseries, ni tout le luxe à bas prix, aussi répugnant que les «complets confection» des grands magasins. Vous ne choisirez que des choses jolies. Il suffit de vous mettre en garde contre la tentation de les choisir trop luxueuses ou d’en vouloir trop.
Donc, trousseau restreint, ne contenant nulle pièce vulgaire,—mais dont nulle ne vise à étonner par son prix excessif; logis point trop grand, dont les dimensions et le décor expriment l’état de fortune, l’âge et la situation des habitants,—mais où chaque objet soit, 331 autant que possible, adaptable à l’accroissement progressif du ménage; telle me paraît être la formule qui convient au cas du jeune couple Despeyroux. Vous éviterez ainsi l’effort ridicule, malsain, de paraître au-dessus de vos ressources, ce qui est une faute d’harmonie et par suite une laideur. Vous éviterez cette autre erreur de goût et de sentiment dont témoigne l’installation «provisoire» de certains nouveaux mariés. Le foyer, fût-il d’un militaire, doit exclure le provisoire. Les choses destinées à être témoin de votre premier bonheur d’épouse méritent d’être ensuite précieusement conservées: donc il les faut assez jolies dans leur simplicité pour qu’elles vous tiennent compagnie toujours, sans vous déparer jamais.
Hôtel Adriatique, février 1902.
Dans ce coin privilégié de l’Europe d’où je vous écris, chère Françoise, l’hiver est venu si doucement—à pas de voleur—qu’on se croirait toujours au milieu de l’automne. L’heureux goût des habitants, ou peut-être l’artifice des hôteliers et des entrepreneurs de casinos, a garni les promenades, les parcs, jusqu’aux 333 horizons prochains, d’arbres et de plantes qui ne connaissent pas la caducité annuelle. Comme le soleil rayonne presque toujours d’un ciel inaltérable, projetant sur le sol sec l’ombre des éternels feuillages, la nature ne prend jamais le deuil de l’été disparu. Et le temps semble s’arrêter, devenir immobile lui-même, ainsi que la verdure des magnolias, des fusains arborescents, des poivriers et des mimosas.
Beaucoup de gens sont venus ici, comme moi, chercher cette illusion de ne point vieillir nous-mêmes que suggère la jeunesse persistante des choses, autour de nous. Ce sont, pour la plupart, des gens riches et oisifs, qui ne sont de nulle part, suivent les «saisons» mondaines partout où il y en a, et toujours, selon le mot de Stendhal, reviennent de Cosmopolis ou s’y rendent. Rien de plus effacé, de plus banal, de moins curieux en somme que cette population errante; rien de moins estimable que son caractère et ses mœurs. En observant ces femmes trop parées, ces jeunes filles trop libres, ces hommes à l’oisiveté insolente, on se rend compte du peu de joie vraie qu’ils goûtent à être là, riches et maîtres de leur vie, dans ce lieu paradisiaque... Malgré moi, je les regarde: je songe à toutes les humbles tireuses d’aiguille, à tous les mornes employés de magasins et de bureaux qui, à la même heure, se fanent dans le brouillard et la neige de Paris... Comme ils seraient extasiés et transfigurés, ceux-là, par une quinzaine de 334 jours vécus ici, quinze jours de soleil et de verdure en plein hiver! Hélas! hélas! Les petites ouvrières, les mornes employés ne goûteront pas cette joie, et les cosmopolites, qui ne savent plus en jouir, s’en gorgeront inutilement. Le monde, inégal, est plein de contradictions irritantes.
... Trois jeunes filles de ce monde cosmopolite vinrent hier s’asseoir à quelques pas de ma fenêtre,—j’habite au rez-de-chaussée de l’hôtel,—et se mirent à converser. Leur bavardage me valut un instant d’impatience; j’attendis. Elles n’en finissaient pas de causer. Je pris alors mon parti, je repoussai mon papier, je déposai ma plume, je m’approchai de la fenêtre à demi fermée et j’écoutai. C’était indiscret?... Sans doute! J’attends de vous les mêmes reproches qu’une semblable conduite provoqua naguère, lorsqu’un certain vendredi, dans le parloir de Berquin, je surpris la conversation de trois élèves et d’une de leurs amies. Oui, c’était indiscret: mais quiconque veut raconter les mœurs de son temps n’est-il pas forcé d’être indiscret? Et puis, que ne restaient-elles à distance, ces trois perruches, et de quel droit me venaient-elles troubler?
Il m’était impossible de les voir sans révéler ma présence, mais je les reconnus à leurs voix. C’étaient, dans toute la force du terme, trois petites cosmopolites, trois petites «saisonnières». Elles avaient dû naître dans un first-class hotel, au Caire, à Péra, à Rome, à Ostende, ou sur la Riviera. Deux d’entre elles 335 étaient sœurs, sans se ressembler, encore que brunes de chevelure pareillement. Pepa, l’aînée, était grasse, et même, comme l’on dit familièrement, un peu boulotte, avec d’agréables yeux bleus assez niais; la seconde, Concha, très jolie de visage, fine, un peu grêle, faisait penser à ces élégants et sveltes insectes qui volent l’été sur les nénuphars, les roseaux et les iris, et qu’on appelle des demoiselles... Les noms de ces deux sœurs signifiaient assez clairement leur origine espagnole; mais de quelle Espagne ou de quelle Amérique? Je l’ignorais. Et cela n’avait aucune importance, vu que toute trace de leur nationalité s’était depuis longtemps effacée. Elles s’entretenaient en français et en anglais,—les deux langues cosmopolites, les deux langues d’hôtel,—passant de l’une à l’autre sans même s’en apercevoir. Elles les parlaient avec une correction parfaite, mais avec cette absence d’accent des gens qui ne savent plus en quelle langue ils pensent. Leur interlocutrice, à laquelle elles prodiguaient des marques d’amitié excessives, était une autre jeune fille d’allures fort indépendantes, dont elles avaient fait la connaissance à l’hôtel et qui, depuis, ne les quittait guère,—une jeune Roumaine vraiment belle, installée ici avec sa mère pour toute la saison. Elle est fiancée à un officier autrichien qui, chaque semaine, vient passer la journée du dimanche auprès d’elle. Je ne sais quel est son vrai prénom: ses deux petites camarades l’appellent Lily, en prononçant le 336 diminutif à l’anglaise, comme il convient. Je ne puis la voir sans songer à vous, Françoise, à cause de la similitude de vos situations de fiancées «militaires».
Lily, Pepa et Concha commencèrent par parler toutes ensemble, et naturellement il me fut impossible, dans ce concert où deux idiomes et trois voix se mêlaient, de distinguer autre chose que le nom de Rodolphe: ainsi s’appelle le fiancé de Lily. Peu à peu, cependant, l’entretien s’ordonna. On dirait que certaines jeunes filles, lorsqu’elles se rencontrent, ont ainsi un trop plein de loquacité dont elles se débarrassent au plus vite et simultanément: à ce prix seulement elles peuvent ensuite imiter à peu près les procédés de conversation des personnes raisonnables.
—Moi, déclara Concha dans un instant où ses deux amies se taisaient, je n’en veux pas du tout, jamais.
—Moi, fit Pepa d’un ton moins décisif, je crois que cela ne m’ennuierait pas... seulement quand je serai un peu vieille, vers trente ou quarante ans.
—Vous exagérez, répliqua Lily avec le ton d’autorité d’une personne d’expérience. Mais je ne suis tout de même pas de l’avis de Rodolphe, et, plutôt que de lui céder sur ce point, j’aime mieux tout casser.
De quoi s’agissait-il? Et quelles pouvaient bien être les exigences de Rodolphe pour que la délicieuse Lily songeât à «tout casser», quoiqu’il fût baron et riche?
337 —C’est déjà bien assez, reprit la jeune Roumaine, d’être condamnée à passer plusieurs mois par an dans la garnison de Rodolphe, un coin de province à cinquante lieues de Trieste! Je n’ai pas envie d’être enchaînée toute l’année... L’exemple de ma sœur aînée me suffit... Depuis son mariage, elle est comme prisonnière au fond d’une campagne perdue, en tête à tête avec son mari et ses deux bébés... Le troisième est annoncé... Est-ce une existence, voyons?
Pepa convint que ce n’en est pas une. Pourtant elle insinua «qu’on pourrait peut-être les emmener avec soi en voyage»... Et je commençai à comprendre qu’il ne s’agissait pas de bagages ordinaires.
—Les emmener en voyage! s’exclama Lily... Tu ne sais pas ce que c’est, ma pauvre chérie! D’abord un hôtel convenable n’admet pas des gens traînant après eux des bébés qui piaillent, qui dérangent tout le monde, qui tombent malades pour un oui ou pour un non, car c’est très fragile, tu sais, les bébés!... Et puis, une femme n’a aucun succès quand elle arrive flanquée d’un côté par le mari, de l’autre par la nourrice... Ça éloigne les flirts comme le feu...
—Du reste, fit observer Concha, je ne comprends pas ce qu’on trouve d’intéressant aux enfants. Ce sont des poupées bruyantes et pas propres, voilà tout.
—Il y en a de gentils, risqua Pepa.
—Tu crois ça parce que tu les vois dehors, 338 pomponnés, lavés, et qu’on les ôte de devant toi dès qu’ils deviennent insupportables, répondit Concha. Mais ce que ça doit être rasant chez soi!... Moi, les enfants des autres me suffisent. Quand je me marierai, je poserai à mon futur la condition de s’en passer. Et il faudra bien qu’il l’accepte.
—Je ne suis pas si absolue avec Rodolphe, reprit Lily. Je comprends parfaitement qu’il désire un fils, à cause de la fortune et du nom... Mais je veux au moins trois ans de répit après mon mariage, pour jouir un peu de ma liberté. Ensuite je consens à sacrifier dix mois... Une femme doit accepter ça comme une maladie nécessaire, voilà tout.
—S’il refuse, c’est un tyran, dit Pepa.
—Et tu feras bien de l’envoyer promener, lui et sa progéniture hypothétique, conclut Concha... Ouf! il fait chaud ici, le soleil nous gagne. Allons-nous à la beach?
—Allons!
Elles se levèrent, et bruissantes, froufroutantes comme un vol de perdrix, partirent ensemble vers ce qu’elles appellent en leur jargon: la beach, c’est-à-dire la plage.
La tranquillité de ma chambre me fut ainsi rendue, amie Françoise, et j’en profitai pour relire votre dernière lettre, la lettre où vous discutez mes conseils sur la question de l’installation à Châteauroux. Vous me croirez si vous voulez, mais je sentis mes yeux un peu humides en arrivant à cette phrase de ladite 339 lettre, qui contrastait si heureusement avec les propos que je venais de recueillir:
«... Oui, mon oncle, je suis d’accord avec vous, il faut peu de place pour être heureux à deux: une maison très exiguë contiendra le bonheur de Maxime et le mien. Cependant il me semble que vous oubliez quelque chose d’assez important, à quoi je pense souvent, pour ma part: dans cette maison si petite ne faut-il pas préparer une place à nos enfants?...»
«Nos enfants!...» Françoise bien chère, je vous embrasserais volontiers pour ces deux mots, si simplement dits. Bravo! Bravo! c’est ainsi qu’une jeune fiancée à la veille de mariage doit parler de son espoir d’être mère, hardiment, tranquillement. Malheur aux douteuses demoiselles qui souhaitent le mariage sans la maternité. Foin des fausses Agnès telles que les glorifie l’odieux répertoire de Labiche,—vous savez? celles qui rougissent quand on parle d’enfants, ou que leur mère envoie chercher leur tapisserie plutôt que de leur laisser entendre que, mariées, elles deviendront mères à leur tour. Grâce à Dieu, il me semble que le XIXe siècle a emporté les derniers vestiges d’une éducation si absurde, si immorale même. Quoi! le plus grand devoir et la fonction suprême de la femme, c’est d’être mère: et lui faire entrevoir, souhaiter à l’avance cette fonction, ce devoir, serait chose dangereuse? L’on devrait marier les jeunes filles en leur 340 faisant accroire qu’il s’agit d’une sorte de promenade à deux, d’une contredanse un peu plus intime?...
J’estime pour ma part que, s’il reste en France quelques représentants de cette doctrine, on doit les pourchasser comme des malfaiteurs, comme des empoisonneurs publics. C’est eux, en somme, qui furent responsables de cette faillite du mariage signalée par tous les historiens des mœurs, en France, durant les dernières années du siècle passé. A force de faire silence autour de la jeune fille sur les devoirs de la maternité, on lui préparait des terreurs, des dégoûts, des déceptions. Ou bien elle demeurait vraiment ignorante, se mariait à l’aveuglette—les parents se prêtaient à ce crime de lèse-personnalité!—et alors elle courait dix chances contre une de devenir l’ennemie de son mari, quand ses yeux seraient dessillés. La littérature a étudié vingt fois ce cas. Vous le lirez, mariée, dans l’Ami des Femmes, de Dumas, et aussi dans un livre plus récent, très curieux, très sincère, écrit par une femme: l’Autre Amour, de Claude Ferval. Ou bien la jeune fille levait en cachette le rideau qu’on tendait entre elle et la réalité. Alors, masquée d’ignorance, dévorée de curiosité, elle était condamnée à l’attitude la plus hypocrite, tandis que son imagination battait la campagne vers les horizons interdits. Ce fut la race des demi-innocentes, qu’on m’a reproché d’avoir dépeintes et flagellées, Françoise, dans un livre que vous lirez aussi après 341 votre mariage. Je vous confesse que je suis fier de l’avoir écrit... C’est la race des Pepa, des Concha, des Lily, de la plupart des petites cosmopolites, et, grâce à Dieu, d’un nombre extrêmement restreint de petites Françaises.
Vous, Françoise, vous êtes dans la vraie tradition de notre pays, laquelle fut fâcheusement corrompue au dernier demi-siècle. Vous êtes de la lignée de l’Henriette de Molière. Votre œil candide est sincère aussi, et brave. Fiancée, vous n’avez pas de fausse honte à aimer, de tout votre être, le fiancé que vous avez choisi. L’ayant choisi, vous déclarez bravement que le désir d’être mère s’unit dans votre cœur au désir d’être épouse. Et, quand vous installez le foyer, vous vous préoccupez déjà qu’il soit assez grand pour contenir les enfants.
Cela me réchauffe le cœur, ma mignonne nièce, et je crois vraiment qu’un mariage ainsi préparé ne peut donner que la félicité. C’est tout le contraire du mariage impromptu et à l’aveuglette, du mariage à la Labiche. Un sentiment spontané chez les deux époux en fut l’origine. Un intervalle de fiançailles l’a précédé, assez long pour que, dans la présence et dans l’absence, les deux fiancés aient pu apprendre à se connaître, pour qu’ils se soient vus en une autre posture que celle de soupirant. Enfin, le désir d’avoir des enfants l’ennoblit; il se mêle intimement à l’amour de la fiancée pour le fiancé; il n’est point remis à un terme plus ou moins indéterminé; il plane 342 sur les projets immédiats, sur les soins de l’installation immédiate.
... Ah! petite Françoise, que j’ai hâte de vous dire ma joie pour ces présages favorables! Ce ne sera plus dans bien longtemps: car je vais quitter ces jours-ci les bords de l’Adriatique et me diriger vers la patrie. Vous m’annoncez, pour votre prochaine lettre, une «grande nouvelle...» Vous me la direz de vive voix: avant la fin de la semaine je serai à Paris. Et, voyez si je suis perspicace! j’ai idée que la grande nouvelle se rapporte à votre mariage. Je n’ai pas oublié, petite masque, que vous vous faisiez fort, naguère, d’abréger un peu les fameuses «longues fiançailles»... Et je n’avais pas douté une minute que vous n’y réussissiez. Un mot de Mme Le Quellien semble m’indiquer qu’elle fléchit. Elle me consulte 343 mollement. Me croyez-vous le cœur assez dur pour répondre contre vos désirs? Non, n’est-ce pas? Je hâterai votre mariage d’un cœur tranquille. Vous êtes prête à faire une brave petite épouse, une brave petite maman...
Et voilà sans doute, chère Françoise, la dernière lettre qu’écrit votre oncle à «Mademoiselle Françoise Le Quellien»...
Une carte postale m’apporte, avec la figure du petit roi d’Espagne sur son timbre rouge, l’image de la cathédrale de Burgos et ces trois lignes:
«Bonjour, mon oncle. Je suis heureuse.
Mais il faut m’écrire.
«Françoise Despeyroux...»
Hum!... Pour les motifs que je vous ai détaillés déjà, chère madame toute neuve, je n’aimerais point à vous interrompre d’être heureuse, et, cette fois, le temps des conseils 345 est fini, fini.—Afin de vous obéir sans manquer à mes principes, et puisqu’il vous faut absolument une lettre, je m’en vais copier quelques pages sur mon journal intime et vous les envoyer. Ces pages furent écrites le 17 mars dernier, en rentrant chez moi après le très intime dîner de contrat qui eut lieu chez vous ce soir-là. Si vous avez gardé mes autres lettres, épinglez celle-ci à la fin de la collection, en manière d’épilogue.
«... Dernière soirée passée auprès de Françoise jeune fille. A pareille heure, demain elle sera loin de nous, emportée par son heureux mari. Dure loi, juste loi... Ah! que cette chère enfant soit heureuse!
«Pendant toute cette soirée, où j’ai peu parlé, je n’ai guère cessé d’observer Françoise quand elle ne causait pas avec moi. Je pensais à elle, avec un mélange de mélancolie et de joie, où dominait la joie. Je pensais aussi un peu à moi. Je repassais dans ma mémoire les conseils que je lui avais donnés, les espérances que j’avais tâché de lui inspirer... Je faisais, en somme, l’examen de ma conscience de directeur de conscience...
«Quiconque assume la tâche de diriger une jeune conscience a deux devoirs: il ne lui est 346 pas permis de tromper, et il ne lui est pas permis de se tromper.
«Que je n’aie jamais trompé sciemment Françoise, je ne le discute même pas. Le charme de sa jeunesse ne m’aveuglait pas au point que je désirasse lui plaire par des conseils uniquement agréables et flatteurs. D’ailleurs, ma propre jeunesse n’est pas encore assez loin de moi pour aciduler mes conseils du regret de n’être qu’un oncle, ni pour que toute intelligence d’une âme de dix-huit ans me fût ôtée. J’ai bien dit à Françoise ce que je pensais sur les choses, sur les doctrines, sur elle-même. Le chemin que je lui ai montré est vraiment celui que je crois le meilleur.
«Maintenant ne me suis-je pas trompé moi-même?
«Il y a une idée qui m’est chère: c’est que, depuis quelques années, la femme française, plus particulièrement la jeune fille, est en pleine évolution, que de jour en jour elle se transforme, et que cette transformation est salutaire. Il me semble qu’elle prend un sentiment plus net de ses droits et de ses destinées, qu’elle rompt les bandelettes où on la momifiait; qu’elle est plus sérieuse et plus laborieuse, qu’elle s’évade du souci exclusif des chiffons et du plaisir. Il me semble que ces changements sont visibles en France, à Paris même, depuis une courte période, mettons depuis dix ans... Il me semble que le type de la fausse innocente n’apparaît plus dans la 347 bourgeoisie qu’exceptionnellement, qu’il se réfugie dans le monde cosmopolite, dans l’étroit troupeau des «jeunes filles de plages», pour l’agrément de quelques rastaquouères faisandés.
«Est-ce vrai, cela?
«N’est-ce pas de ma part une pure illusion, une apparence toute littéraire? Ne vois-je pas cela parce que, littérairement, je désire le voir, parce que cela courbe harmonieusement une doctrine de la jeune fille au début du XXe siècle? Ou bien encore, ne suis-je pas victime d’une erreur analogue à celle du voyageur qui, de son train, regarde un autre train engagé sur la voie parallèle? Le mouvement que j’attribue au train où je ne suis pas, n’est-ce point le mouvement du train où je suis? N’est-ce pas mon évolution, en un mot, où je crois voir l’évolution de la jeune fille?
«Tachons d’étudier une fois de plus ce problème à la façon d’un chimiste qui fait une analyse et ne désire nullement trouver tels ou tels éléments au fond de ses alambics.
«Quels sont les motifs essentiels de ma conviction,—motifs de raisonnements, motifs d’observation?
«Voyons... Il y a d’abord une grande raison générale, qui règle les mouvements sociaux comme les phénomènes mécaniques. Dans ce dernier quart du XIXe siècle,—je ne parle que du temps que j’ai vu,—l’éducation féminine eut pour principe fondamental: «Défense à la jeune fille d’être une personne.» 348 Sous cette contrainte, la jeune fille n’eut d’autre ressource que l’hypocrisie ou la nullité. Voyez dans la littérature: Augier, Dumas, Feuillet, etc. Pas une seule jeune fille vraie, pas une!... La réaction contre un tel système était infaillible comme le retour du soleil après la pluie. Il était infaillible que des parents, que des éducateurs, et aussi que des jeunes filles voulussent un jour briser ce mauvais cadre, émanciper l’éducation.
«Outre cette raison de mécanique sociale (principe de réaction égale à l’action), il y a une raison spéciale à notre époque: l’effort du sexe féminin tout entier vers plus de liberté, plus d’initiative, vers la parité de droits et de devoirs avec les hommes. On peut déplorer cela, on peut en rire. On ne peut pas le nier. La femme veut être «sa» personne, et non le reflet de telle ou telle personnalité masculine. Elle le veut et elle l’obtient de la loi, de plus en plus, à l’étranger et chez nous. Il est naturel, immanquable, que la jeune fille subisse le contre-coup de cet effort, tende aussi à affirmer sa personnalité, et par suite à avoir son caractère propre, sa morale propre, ce qu’on lui interdisait autrefois.
«Donc, il est probable a priori que la jeune fille a changé, évolué, comme disent les pédants. L’observation des faits vient-elle corroborer ces probabilités, mon observation, par exemple?
«Hélas! le champ est bien étroit où un seul observateur peut étudier ses contemporains. 349 Et les jeunes filles sont des sujets particulièrement malaisés à connaître, peu mêlées encore à la vie ambiante.
«La seule que j’aie vue de près et constamment suivie est cette chère Françoise. De celle-ci je suis sûr. Ce n’est pas l’oie blanche, la petite niaise des comédies de Labiche. Ce n’est pas le petit hussard (expression de Taine) des comédies d’Augier ou de Dumas. Ce n’est pas non plus une fausse Agnès. C’est un type nouveau, qu’aucune littérature ne nous a présenté, un type transitionnel. Elle a subi sans se plaindre la contrainte de l’ancienne éducation, mais elle a émancipé spontanément son esprit, en pleine contrainte officielle. Éduquée dans une institution des plus arriérées, des plus vieux jeu, elle n’a perdu aucune occasion de s’instruire ailleurs. Destinée par sa mère au mariage de convenance cher à la bourgeoisie française, elle a choisi son mari, à peine plus âgé qu’elle et sans fortune. Elle ne cherche pas dans le mariage l’argent, la situation, ni même la liberté. Elle y cherche, sans plus, d’être épouse et d’être mère. Et sans doute quelques-unes des bandelettes de l’antique momie entravent encore ses gestes. Il y a encore un peu de coquetterie, un peu de ruse, un peu de sensiblerie dans cet attrayant personnage. Ce n’est pas sa faute. Elle est transitionnelle. Mais quel progrès accompli déjà dans une Françoise!
«... D’autres jeunes filles?
350 «Oui. J’en connais quelques-unes.
«Je pense en ce moment à deux sœurs, filles d’un fonctionnaire supérieur de l’État, lequel m’a confié ceci. Ses deux filles, récemment, vinrent le trouver et lui dirent: «Père, voilà l’une de nous qui a passé vingt-cinq ans; l’autre va y atteindre. Il est probable que nous ne pourrons jamais nous marier, étant peu riches et d’ailleurs résolues à épouser seulement un homme que nous nous sentirions capables d’aimer... Enfin, notre jeunesse va passer... La vie fausse, inutile et sans but que nous menons nous excède. Voulez-vous nous permettre d’apprendre un métier et de gagner notre vie?» Le père a permis.
«Autre fait d’observation personnelle. A la suite d’un livre que j’avais publié il y a deux ans, je reçus, signée d’un nom inconnu, une lettre me disant en substance:
«Monsieur, j’ai dix-huit ans, je vis seule avec ma mère, comme votre Frédérique ou votre Léa. Je veux, comme elles, me libérer, être une personne, gagner ma vie (toujours, c’est le nœud de la question). Que faire?...»
«Je lui conseillai la sténographie-dactylographie. Trois mois plus tard, une dame à cheveux grisonnants se présenta chez moi, accompagnée d’une ravissante petite personne de dix-huit ans. Celle-ci était ma correspondante inconnue.
«—Monsieur, me dit-elle, j’ai suivi vos 351 conseils. Voici mes diplômes de sténographe-dactylographe...»
«Je réussis à la placer dans les bureaux d’une grande entreprise industrielle. Au bout d’un an, elle voulut spontanément partir pour l’Angleterre, afin de se perfectionner dans la langue du pays. Elle en est revenue récemment, fiancée, de son propre choix; mais, durant l’intervalle des fiançailles, elle continue à travailler. Elle vient d’entrer dans les bureaux parisiens d’une grande compagnie d’assurance américaine, où elle gagne 250 fr. par mois... Et ce n’est nullement «une manœuvre». C’est une jeune fille du monde, accomplie, jolie, élégante, pratiquant tous les arts dits d’agrément...
«Autre exemple encore. Tout près de chez moi, habite une jeune institutrice qui, elle 352 aussi, est venue un jour me consulter sans me connaître. Elle gagne 75 francs par mois! Elle est sage. Elle n’attend rien du mariage, sur lequel elle ne compte pas. Ses joies sont la lecture, le spectacle de Paris, la maigre liberté dont elle jouit, ses leçons finies. De temps en temps elle me rend visite: elle m’affirme qu’elle ne désire rien, qu’elle est heureuse, parce qu’elle est libre de sa pensée, parce qu’elle est «une personne».
«Ce ne sont que des cas isolés!... dira-t-on...
«Pourquoi se sont-ils groupés sous mes yeux depuis quelques années seulement?
«Enfin, dans les milieux dits mondains, où toujours plus longtemps les vieux errements d’éducation persistent, pourquoi les jeunes filles, quand je les interroge, protestent-elles de leur volonté de choisir leur genre d’existence et leur mari? Pourquoi la mode n’est-elle plus de la fausse ignorance? Pourquoi les flirteuses clandestines se font-elles moins audacieuses et deviennent-elles tout à fait décriées?
«Si je me trompe, je me trompe de bonne foi, et les motifs de mon erreur tromperaient un plus avisé. Et puis, je ne me trompe pas! Pourquoi douter de sa raison et de ses yeux? Quelque chose de nouveau s’élabore vraiment: la jeune fille française renaît. Elle n’est déjà plus une «expression psychologique» 353 comme dans les livres du dernier quart de siècle... Si elle porte encore la marque de l’éducation opprimante d’hier, elle a déjà les yeux fixés sur demain. La transformation continue. Celles de demain n’auront peut-être plus la grâce double d’une Françoise, encore traditionnelle et pourtant émancipée. Elles seront tout à fait, sans effort et naturellement, des «personnes»... Les hommes de demain, qui se seront modifiés avec elles, les aimeront ainsi...»
LA RÉPONSE AUX FRANÇOISES
Janvier 1903.
Au mois d’avril dernier, chère Françoise, quand je me décidai à réunir en un seul cahier les feuillets des lettres que je vous avais écrites, je vous avouai combien je jugeais imparfait le livre ainsi composé. Je souhaitais alors, en toute franchise, que diverses Françoises, celles de la promotion virginale qui suit tout juste la vôtre, fillettes encore penchées sur les pupitres, et rêvant, parmi les études, de liberté et de mariage, me signalassent les défauts de ce livre, m’en montrassent les défaillances et les vides.
A vrai dire, j’exprimais là un vœu platonique, et je ne comptais guère qu’il fût suivi d’un 355 effet notable. C’est que, pour ma part, je ne me souviens pas d’avoir jamais écrit à un auteur touchant les questions traitées dans son livre. Quand j’essaye de démêler les raisons de cette abstention, j’aperçois vite que la première est une incurable paresse. S’il m’arriva jamais de pousser mon dessein épistolaire jusqu’à installer le papier devant moi et à piquer l’encre de ma plume, une timidité bizarre m’empêcha d’aller plus avant. J’imaginais ma lettre touchant à destination, nichée dans le tas d’autres lettres attendues, elle, petite intruse, malgré ses intentions amicales!... Plus je la concevais laudative, émue, plus je redoutais pour elle l’indifférence, la lecture pressée, incomplète, au vol des yeux, l’oubli pur et simple, et surtout l’ironie!... Pendant que ces imaginations m’occupaient, l’encre était déjà sèche au bout de ma plume, qui n’avait rien écrit. Je repoussais plume et papier, j’allumais une cigarette, et je me contentais d’offrir à l’auteur, par la pensée, l’oraison jaculatoire de mon admiration.
Il n’y a pas là de quoi se vanter, Françoise. Paresse et respect humain, ce sont les vilains motifs pour quoi je m’abstenais. Je confesse ma faute, et je n’en suis que plus disposé à remercier les plumes actives qui contribuèrent à ce gros tas de réponses que j’ai sous les yeux dans le moment où je vous écris. Réponses de petites Françoises inconnues, qui voulurent bien me choisir pour oncle momentané, aux divers points de la France ou de l’Europe. 356 Réponses de mamans, de papas, voire de futurs époux de toutes ces Françoises. Il y en a! il y en a!... Jamais aucun de mes livres ne m’en fit engerber une telle moisson. Et cela ne s’arrête pas: mon courrier de ce matin m’en apporte deux nouvelles, une de Paris, une de Mulhouse. Vous souriez? Vous trouvez que j’ai l’air de faire état de toutes ces lettres, de dire: «Admirez le succès de mes discours!» Oh! Françoise très chère! Que j’aurais de chagrin si vous croyiez que telle est ma pensée! Je sais si bien que la cause de tant de répliques, ce n’est pas la qualité, mais bien le sujet du livre!...
Mon projet primitif fut de répondre en détail à chacune. J’y ai bientôt renoncé pour deux raisons. La première est leur nombre même: à moins de me borner à trois mots de remerciements, mon temps n’y suffirait pas... L’autre raison est plus décisive: ces lettres posent souvent des questions, des objections d’un intérêt réel, général, qui valent une réponse méditée, détaillée. Les mêmes questions, les mêmes objections se reproduisent d’une lettre à l’autre. Enfin je crois que quiconque, ayant lu les Lettres à Françoise, s’est donné la peine d’écrire à l’auteur, lira volontiers ce que répond l’auteur, non seulement à sa lettre, mais aux lettres écrites par d’autres dans le même propos.
J’ai donc colligé ce volumineux courrier; je l’ai classé suivant un ordre analytique; j’en 357 ai, si l’on peut dire, extrait l’essentiel; je vais tâcher d’y répondre de mon mieux. Ce post-scriptum me semble, l’avouerai-je?... d’importance presque égale au livre lui-même. Il en sera le commentaire pratique. Le livre professe l’opinion d’un seul. Le post-scriptum place en parallèle l’opinion de tous.
Mes citations sont scrupuleusement exactes. J’ai omis les noms par un sentiment de discrétion qui sera compris et approuvé. J’ai supprimé le plus possible les passages purement gracieux pour l’auteur. Ce n’est pas qu’ils ne m’aient charmé, mais ils contribuent à mon seul plaisir; et puis, entre nous, Françoise, il convient de garder un certain sens du ridicule. Cependant j’ai tenu à noter les adhésions à la méthode et aux idées: elles importent, comme confirmation de la doctrine.
Mon but unique a été de rendre plus complète, plus utile, plus vivante, cette nouvelle édition des Lettres.
C’est sur ce point (le mode d’apprendre recommandé, Françoise) que se rencontrent le plus d’assentiments.
D’abord les élèves proclament l’insuffisance de leurs études et paraphrasent sur des tous divers la devise: «Nous ne savons rien...» Voici l’excellent commentaire d’une jeune Française, en train de pratiquer l’allemand aux bords du Rhin:
358 «... Comme toutes les jeunes filles qui ont terminé leur éducation au commencement du siècle, j’ai beaucoup lu... Que m’en reste-t-il? L’année où j’ai passé mon brevet simple, nos bonnes religieuses, pensant bien faire, m’ont fourré dans la tête presque tout le contenu de mes livres, sous prétexte qu’on pouvait me demander telle ou telle question à l’examen... J’ai eu d’excellentes notes... Maintenant, de ce que j’ai su et appris, il ne subsiste qu’un vrai chaos, d’où je tire à grand’peine quelque chose de bon...»
Une jeune Nantaise:
«... Votre opinion est très juste sur les examens: on nous fait trop apprendre et nous apprenons mal. Comme Françoise, j’ai passé mon brevet supérieur... Hélas! que m’en reste-t-il?»
«Que nous reste-t-il de ce que nous avons appris?» Telle est la formule quasi universelle de ces plaintes d’élèves studieuses. Écoutons maintenant l’opinion des maîtres.
Une «vieille éducatrice», qui dirige une institution à Neuilly-sur-Seine, écrit (et ceci vous servira pour Françoise II):
«... D’après mon expérience, la gymnastique intellectuelle préconisée par les Lettres à Françoise pour l’enseignement secondaire peut s’employer même avec les plus jeunes enfants... Ils sont ravis, ces petits, lorsqu’on les amène à découvrir eux-mêmes ce qu’ils doivent apprendre...»
De Metz, une institutrice française, chargée d’instruire et d’élever quatre fillettes:
«... J’ai été très heureuse, et un peu fière, de voir préconiser le système que j’applique et qui me 359 semble le plus raisonnable. Les Lettres à Françoise m’encouragent à le mettre en pratique: elles me montrent les améliorations à y apporter...»
Quand je vous disais, Françoise, que je n’inventais rien! L’institutrice de Metz avait sans doute, comme votre oncle, aimé les pêches et médité sur la culture du petit pêcher.
Une autre «vieille éducatrice», de Bruxelles:
«... Il ne suffit pas de bourrer le cerveau, d’y accumuler matière sur matière, il s’agit d’y faire entrer peu à peu ce qui devra le pénétrer, s’y graver et n’en plus sortir. Et, si l’éducateur le veut, c’est si facile, même en tenant compte des programmes et des examens!...»
Vous entendez, Françoise? Une institutrice qui a trente-trois ans de métier déclare que l’application de notre système est facile!... Ai-je dit autre chose?
Sur le point spécial des précis, un correspondant, du sexe fort cette fois, ingénieur civil, se distingue parmi l’approbation générale. Je veux citer en partie sa lettre, d’une belle chaleur.
«J’approuve hautement le système des précis... Mais, monsieur, faire voir n’est pas tout: il faut agir. Je suis bien convaincu que ce n’est pas de gaîté de cœur ni par goût que Jules Lemaître a laissé les lettres pour courir la politique; il croyait devoir le faire. Vous, quoique le métier d’éditeur n’ait rien de réjouissant pour vous, vous devez l’entreprendre!... Il faut prêcher d’exemple. A côté de ces terribles publications pédagogiques exécutées par un tas de malheureux sous la direction du célèbre 360 M. Untel, il faut que vous preniez la direction effective d’un ensemble classique de livres d’instruction comme vous les comprenez. Vous l’avez bien dit, vous avez pour cela l’avantage de n’être pas ministre. Il faut que vous preniez l’initiative de créer les livres de classe de Françoise II, et même de Maxime II. Ce n’est peut-être pas bien amusant, mais c’est un grand devoir à remplir. Vous ne pouvez l’éluder.
«Trouvez des collaborateurs dans les diverses connaissances nécessaires: qu’ils s’inspirent de vos idées pour écrire, chacun, sur la matière qu’ils connaissent le mieux et dans l’ordre tracé par vous, le livre des connaissances minimum. Surveillez-en l’exécution en les dirigeant, en uniformisant l’esprit de cette publication. Vous aurez ainsi rendu le plus éminent service.»
Je répondrai à ce correspondant (en le priant de croire que je ne fais pas ici de fausse modestie) que je me sens radicalement incapable de diriger une telle publication scolaire. L’œuvre requiert une expérience pédagogique, une érudition aussi, auxquelles je ne prétends point. Tout au plus serais-je en état d’exécuter un volume, entre autres, de l’encyclopédie des précis... A chacun son métier: les livres d’enseignement doivent être faits par des maîtres. Notre rôle, à nous autres, est de méditer les questions générales et d’y proposer des solutions. C’est ce que j’ai tâché de faire.
Voici l’une des thèses les plus controversées par mes correspondantes.
361 Il est assez facile de répondre à l’objection émise par quelques-unes d’entre elles, que «la coéducation habitue seulement la jeune fille aux jeunes gens élevés avec elle, que les autres sont toujours pour elle l’inconnu, le danger...» En vérité, peut-on nier que ce danger d’inconnu ne soit largement atténué si l’on ne pratique pas dès l’enfance, entre les deux sexes, une cloison étanche, qu’on renverse brusquement aux approches de la vingtième année?
De plus importantes critiques sont formulées par une institutrice. Je ne puis citer sa lettre tout entière à cause de son extrême précision, mais j’en indiquerai du moins l’esprit.
«Je parlerai de ce que j’ai vu moi-même. Sans aller jusqu’en Amérique, on trouve des classes formées de jeunes garçons et de jeunes filles. Nous avons en Suisse, où j’ai fait mes études, la coéducation des sexes presque partout dans les écoles primaires (la fréquentation de l’école est strictement obligatoire jusqu’à quatorze ou quinze ans, suivant les cantons) et en maint endroit dans les écoles, dites secondaires, qui correspondent aux écoles primaires supérieures en France.
«C’est dans ces conditions-là que j’ai suivi des cours depuis l’âge de dix ans jusqu’à quinze ans et demi. J’ai été, en dernier lieu, élève d’une de ces classes dans un grand village du Jura bernois. Nous étions une vingtaine, jeunes garçons et jeunes filles, âgés de quinze, seize et même dix-neuf ans.
«Je puis vous assurer que cette promiscuité donnait lieu à des abus déplorables, dont les professeurs étaient certes loin de se douter.
362 «Ainsi, un jour, entrant dans une classe pendant la récréation, une amie et moi, nous apercevons un groupe très animé et très gai. Nous approchons. Un jeune garçon faisait une lecture à haute voix. A la première phrase qui parvint jusqu’à nous, la rougeur nous monte au front et nous nous éloignons au plus vite: c’était Daphnis et Chloé, de Longus, qu’on lisait ainsi.
«... A côté de la question de morale, on pourrait encore faire d’autres objections au système de la coéducation. Je n’ai vraiment pas remarqué que les jeunes gens devinssent efféminés; mais ils ont pour les jeunes filles, au sujet des leçons, des complaisances qu’ils n’auraient pas entre eux, et vice versa. Que de fois n’ai-je pas vu, avant une leçon, des jeunes filles copier prestement sur le cahier d’un voisin le problème qu’elles auraient dû avoir fait! Le voisin ne se faisait jamais prier. Et je me souviens d’une jeune fille qui tenait son livre ouvert derrière elle sur ses épaules, afin que l’honnête garçon assis au banc suivant pût lire, au lieu de la réciter, la leçon qu’il ne savait jamais. Le professeur était myope et n’y voyait que du feu.
«Car vraiment, de toutes ces choses, les professeurs et les parents ne savent rien. Les élèves acceptent cela sans songer qu’il pourrait en être autrement. Moi-même, du reste, très occupée alors à préparer un examen, je m’inquiétais fort peu de ce qui se passait autour de moi et je ne songeais nullement à me demander si le système était bon ou mauvais. Ce n’est que plus tard que j’ai pesé le pour et le contre et que j’ai désiré me faire une opinion.
«... Comment pourrait-on obvier aux inconvénients de la coéducation? comment les faire disparaître?»
363 Je vais tâcher de répondre succintement à ces graves objections.
1o Ma correspondante déclare que le système de la coéducation est pratiqué dans la plupart des écoles primaires de Suisse. Or la Suisse est précisément un des pays réputés comme modèles pour l’instruction primaire. Le résultat obtenu, quels que soient d’ailleurs les défauts du système, est donc excellent. N’est-ce pas un argument d’importance?
2o Sur le point de la moralité, je répliquerai que toute agglomération d’enfants est dangereuse si elle n’est étroitement surveillée. Quelques élèves peuvent lire Daphnis et Chloé dans un collège exclusivement féminin, ou exclusivement masculin, absolument comme dans le collège mixte du Jura bernois. Mais une école où un groupe d’élèves lit habituellement Daphnis et Chloé (ou tout autre livre analogue) sans que les maîtres s’en doutent est une école mal surveillée.
Mettons, si l’on veut, que le collège mixte exige une plus étroite surveillance. Si par ailleurs les avantages sont réels, le maître doit-il y renoncer afin d’épargner son effort?
3o De même pour la question des complaisances. Ma correspondante croit-elle sérieusement qu’un tel inconvénient soit spécial aux écoles mixtes?... Là encore elle nous donne la réponse: «Le professeur était myope et n’y voyait que du feu.» Un professeur ne doit pas être myope, pas plus qu’il ne doit être bègue. Pourquoi pas aveugle?
364 En résumé, je ne trouve signalé dans cette controverse (par ailleurs si intéressante) aucun vice inhérent au système de la coéducation. Et ma correspondante n’en nie pas, d’ailleurs, les avantages.
La question des lectures préoccupe bon nombre de jeunes demoiselles, et la discussion générale à laquelle nous nous sommes livrés ensemble sur cet objet, ma jolie nièce, n’a pas suffi à éclairer leur choix. J’ai même la tristesse de n’avoir pas été compris par plusieurs, qui me demandent carrément «une liste de livres à lire».
Je ne puis que renvoyer ces trop dociles catéchumènes aux Lettres elles-mêmes (lettre XVIII). J’y expliquais de mon mieux que presque aucun livre n’est ni bon pour tout le monde ni mauvais pour tout le monde... Il est donc particulièrement impossible de dresser une liste de lectures utiles à toutes les jeunes filles.
—Pourtant, me direz-vous, il est bien désirable que les jeunes filles puissent s’initier, au cours de leurs études, à la beauté littéraire?
Assurément. Et pour chaque élève, ou, si l’on veut, pour chaque groupe d’élèves, il y aura un choix de lectures recommandables; c’est au maître à les choisir. Enfin on signale certaines anthologies bien composées. Quant à me décider à publier une liste de «livres 365 pour demoiselles», non! cent fois non! Pourquoi pas une liste d’aliments convenant à tous les estomacs de jeunes filles?
Un problème plus délicat, que mes correspondantes m’ont prié de préciser, est celui de savoir jusqu’à quel point la jeune fille contemporaine a le droit d’être... une oie blanche. Et que la question soit ainsi posée, cela montre combien celles qui la posent sont encore éloignées de concevoir la jeune fille comme vous et moi la concevons, ma Françoise.
Car ce n’est point l’IGNORANCE d’Agnès, plus ou moins dosée, qu’il faut recommander à la jeune fille: c’est la FRANCHISE. Ce que la vie lui a appris, elle doit professer qu’elle le sait et ne pas se retrancher derrière des mines et des rougeurs. Ce qu’elle ignore, elle doit dire simplement: «Je l’ignore.» Certes, elle garde le droit de ne pas vouloir être documentée comme un carabin; mais toute curiosité qui n’ose s’avouer est malsaine. Il se forme alors dans l’âme comme des dépôts, des engorgements analogues à ceux qui minent l’organisme physique. Et la santé même de l’âme en est compromise.
Il faut, comme mes correspondantes, l’appeler par son nom, quoique j’aie évité autant que possible de le nommer dans les Lettres elles-mêmes, non par timidité ni par hostilité, mais parce qu’en somme je ne sais pas très 366 bien ce que le mot signifie. Va pour «féminisme», si cela veut dire le souci d’une condition féminine meilleure dans la vie sociale, dans la vie sentimentale, dans la vie intellectuelle.
Constatons d’abord que la différence entre la présente génération et celle-ci m’est signalée de toutes parts, et par les filles et par les mères. «Il me semble toutefois,» écrit une femme d’officier, très sensée, jeune mère de plusieurs enfants, «qu’entre ma génération et celle de mes filles la différence d’habitudes, d’idées, de goûts, est déjà moins grande qu’entre nos mères et nous.»
Parmi mes correspondantes voisines de la vingtième année, je note avec joie une quasi unanimité sur la volonté d’être des personnes, d’assurer leur liberté au prix du travail. Je constate, en revanche, une fâcheuse tendance à demander aux arts, et, hélas! hélas! surtout à la littérature, les moyens de vivre. A ces néophytes je répéterai obstinément que les difficultés de gagner sa vie dans les arts, avec un talent moyen, sont extrêmes. Qui veut gagner sa vie doit apprendre un vrai métier, un métier dont la «demande» soit courante... Si par ailleurs on a quelque talent artistique, il trouvera bien moyen de réclamer impérieusement du temps et de la place.
Plusieurs jeunes filles, et je m’en réjouis, parmi celles qui m’écrivirent, ont d’ailleurs compris cela. L’une veut étudier la médecine; l’autre simplement l’art de garder les malades. 367 Mais elles insistent sur les difficultés qu’elles rencontrent dans leur milieu et même dans leur famille. Pauvres familles! Pauvres âmes directrices auxquelles manque le sens de la direction!... Être des parents et se rebeller contre l’effort d’énergie de ses enfants! Que c’est bizarre, et que c’est triste!
... Voici, d’autre part, une question assez singulière: «—Puis-je rester une femme du monde en devenant une femme qui gagne sa vie?» interroge une jeune dame après avoir développé le programme de son existence actuelle.
—Mon Dieu!... S’il s’agit, madame, du monde purement aristocratique, l’idée qui y domine est assurément qu’on déchoit en travaillant, fût-on un homme... (Chacun pourra examiner à quel état d’importance et de vitalité, en France, une telle doctrine a conduit ce monde-là.) Je dois à la vérité d’ajouter que même dans le «surmonde», pour ainsi dire, certains esprits hardis osent braver l’opinion et travailler. Je citerai, dans des genres différents, le marquis de Dion et la comtesse de Noailles.
Des quatorze lettres reçues où est traitée principalement ou incidemment la question du féminisme, une seule proteste contre l’évolution qui porte de plus en plus le sexe faible à faire autrement les mêmes choses que le sexe fort. Si l’auteur de ce billet, d’ailleurs aimable 368 et charmant, mais très parfumé, un peu trop parfumé, ne l’avait pas écrit au moment où elle n’avait lu encore (elle l’avoue) que les six premières des Lettres à Françoise, elle eût sans doute glané dans les lettres suivantes quelques réponses à ses objections—et sur la moindre grâce des femmes qui travaillent, et sur l’incapacité physique du joli sexe à supporter les fatigues d’un métier de docteur, d’avocat, d’ingénieur... Nous avons répliqué à tout cela, n’est-il pas vrai, ma nièce? Et puis, voyez-vous, la meilleure réplique, c’est qu’il y a tout de même aujourd’hui des femmes avocats, des femmes médecins, voire des femmes ingénieurs; il y en a maintenant qui exercent depuis des années. Elles ne sont pas mortes à la peine et elles sont restées des femmes. Contre le fait aucun argument ne prévaut. S’il est clair que toutes les femmes ne sont pas armées pour de pareils efforts, ma correspondante parfumée accordera que la situation d’une femme avocat, médecin ou ingénieur est plus enviable que celle de la plupart des femmes qui, n’étant point riches, ne travaillent pas.
La plus forte et la mieux présentée des objections m’a été proposée par un correspondant. Je ne le nommerai pas, mais je donnerai sa lettre presque tout entière. Elle est fort bien écrite:
«... Parmi les exemples particuliers, me dit-il, que vous offrez à l’appui de votre thèse, vous citez 369 une jeune fille qui, grâce à la sténo-dactylographie et à la connaissance de l’anglais, est arrivée à se créer une position très honorable.
«Sténo-dactylographe, polyglotte moi-même, j’ai depuis une dizaine d’années, au cours du soir où je suis professeur, dirigé vers cette carrière un assez grand nombre de jeunes filles, auxquelles j’ai été heureux de procurer de la sorte, avec le gagne-pain, un bien plus précieux encore: l’indépendance.
«Mais toute médaille a son revers. Certaines de mes élèves, par leur zèle, leur activité, leur faculté d’assimilation bien féminine, sont arrivées à occuper dans les maisons ou les administrations où je les ai casées des postes très rémunérateurs. Filles d’artisans ou de petits employés, leur maigre dot (et toutes n’en auraient pas eu) n’attirait pas autour d’elles beaucoup d’épouseurs; mais leurs appointements, souvent supérieurs à ceux de leurs collègues masculins, n’ont pas manqué d’accroître l’attirance de leurs gracieux visages. Mes vierges fortes, suivant en cela l’impulsion de la nature, se sont mariées pour la plupart. Presque toutes (je vois fort peu d’exceptions), malgré leur mariage et les enfants qui ont suivi, ont continué à occuper leur place.
«Je me suis toujours élevé contre le travail, au dehors, de la femme mariée; mais ma croisade a produit fort peu d’effet dans mon entourage. Mes jeunes couples prétendent avoir de la sorte une vie plus large, plus facile, et bien des fois la femme préfère être au bureau plutôt que de s’occuper des soins du ménage, dont elle se décharge sur quelques vagues mercenaires. Ceci ne se passe certainement pas dans le monde que vous avez sous les yeux; mais parcourez les magasins, les bureaux et les ateliers 370 parisiens: vous verrez la place énorme tenue par la femme mariée. Les enfants, lorsqu’on n’a pu les éviter, sont envoyés en nourrice en province; la femme rentre fatiguée à la maison; rien n’est prêt pour le repas du soir, et bien souvent, à déjeuner, chacun a mangé de son côté. Ce n’est vraiment pas la vie de famille comme je la conçois; c’est une simple association entre collègues.
«Vous devez connaître suffisamment l’Angleterre pour savoir que le travail de la femme mariée hors de son intérieur est pratiquement nul. A Londres, les administrations publiques ou privées occupant un personnel féminin n’admettent que des veuves ou des célibataires; la femme mariée, qui a un protecteur légal travaillant pour elle, doit rester au foyer.
«Voilà ce que je voudrais voir établir en France, et je croirais mal vous connaître si je doutais un seul instant de votre avis à ce sujet. Ne pourriez-vous pas, dans une de vos prochaines œuvres, ou lorsque l’occasion s’en présentera, signaler cette mauvaise compréhension de la vie à deux, combattre ce danger qui menace l’existence même de la famille, mettre en garde l’Ève d’aujourd’hui contre des propositions matrimoniales trop souvent guidées par l’intérêt?»
Si mon correspondant veut dire qu’un labeur qui entrave la vie à deux dans le ménage est fâcheux pour une femme mariée, il est clair que je suis avec lui.
Mais:
1o Il admet lui-même le travail au dehors pour les veuves et les vieilles filles. Or il y a beaucoup de veuves (les femmes se mariant plus jeunes et vivant plus longtemps que les hommes); le célibat est aussi la condition 371 forcée d’un grand nombre de femmes, d’un nombre qui va croissant.
2o Un employé de bureau, absent de chez lui toute la journée (sauf l’heure du repas méridien), jouira-t-il d’une vie conjugale moins intime si sa femme a elle-même des heures de bureau qui, naturellement, coïncident à peu près avec les siennes? Une femme est-elle plus séparée du mari absent parce qu’elle-même travaille au dehors? Notez que dans bien des cas, au contraire (les postes, les banques, etc.), le mari et la femme peuvent s’employer au même lieu, et alors se voient plus que si la femme ne travaillait pas.
Cette solution du travail en ménage n’est-elle pas l’idéal des travailleurs mariés?
3o Reste la question de l’intérieur et des enfants. Parlons d’abord des ménages sans enfants. Mon correspondant s’illusionne s’il croit que je vis exclusivement dans le monde riche et oisif. J’en demande pardon à quelques lectrices que je vais certainement choquer un peu; mais du temps que j’étais fonctionnaire en province et à Paris j’ai constaté que la plupart des ménages moyens, ménages d’employés, de petits professeurs, etc... sont tenus de façon assez ordinaire, assez neutre, pour qu’une mercenaire qualifiée, surveillée par la maîtresse de la maison aux heures que celle-ci passe chez soi, puisse prétendre à faire aussi bien.
S’il y a des enfants, c’est autre chose: une mère n’est nulle part mieux placée qu’auprès d’eux. Mais encore faut-il qu’elle puisse y demeurer, 372 car avant tout il importe de nourrir, de faire vivre ces enfants! C’est en de tels cas de nécessité que le travail de la femme au dehors, non seulement se justifie, mais s’impose.
Une réflexion, pour finir:
Quand on discute la question des enfants élevés chez leurs parents, il ne faut pas se payer de paroles. On doit juger l’état de choses existant, non pas d’après l’intérieur idéal qui correspond à cet état de choses, mais d’après l’intérieur réel, d’après la moyenne des ménages. Et je demande à mes correspondants si, à peu près une fois sur deux, une honnête pension n’est pas pour la jeune plante humaine, au point de vue de toutes les hygiènes, un meilleur milieu que la maison paternelle. Qu’on me réponde franchement!
«Voulez-vous mon avis? m’écrit une spirituelle petite Parisienne. Je regrette que vous l’ayez lâchée trop tôt, votre nièce. Il n’y a pas beaucoup de vies de jeunes filles aussi unies que la sienne. Aussitôt sortie de pension, pan! mariage d’amour!... C’est exquis! Mais elles auraient bien besoin d’un conseil affectueux et intelligent, les jeunes filles qui veulent choisir un mari, l’aimer et en être aimées. On est tiraillée par des parents qui souhaitent telle ou telle position: on s’en fiche un peu (sic) de la position: on veut un peu d’amour et de bonheur durable... Je vous assure qu’on est parfois inquiète et énervée. Moi, dans ces cas-là, pour me calmer, je fais des divisions avec des chiffres décimaux...»
373 Ce dernier trait (de ceux qu’on n’inventerait pas) n’est-il point charmant, bien jeune fille, bien «Françoise»?
Tandis que cette lettre m’arrivait de Paris, la suivante m’était adressée de Saint-Étienne:
«Votre livre me sera d’autant plus cher que je suis dans le cas de votre Françoise. Sans fortune ou à peu près, j’aime un officier sans fortune. Si, comme Françoise, je deviens l’heureuse femme d’un mari résolument aimé, je n’irai pas vous le dire: mon bonheur sera de ceux qui fuient la grande ville; mais je vous en serai reconnaissante, car je suis persuadée que Françoise y aura contribué.»
La petite Parisienne de tout à l’heure saurait-elle aimer aussi «résolument» que cette jeune Stéphanoise? C’est déjà une question. N’importe! ce rapprochement des deux lettres prouve une fois de plus que l’amour souffle où il lui plaît: il y a des privilégiées, des déshéritées de la vie sentimentale. L’une trouve tout de suite son bonheur à Saint-Étienne; l’autre le cherche vainement à Paris. Cruelle vérité, confirmée par nombre de lettres de vieilles filles, si touchantes, si palpitantes d’espoir inquiet à travers leur désespérance!
Cela n’empêche pas que le mariage, enthousiaste ou simplement sage et loyal, doive être la règle pour la jeune fille. Il faut qu’elle s’y destine, tout en acceptant l’éventualité du célibat et en s’armant l’âme et l’esprit pour que le célibat lui soit tolérable. Je demande pardon de me citer moi-même, mais enfin, puisque 374 c’est mes idées sur quoi l’on m’interroge, je me permets de renvoyer au discours de Pirnitz, dans Frédérique. A part l’extrême conclusion (qui est la partie romanesque), c’est bien là mon sentiment.
Sur la nécessité des longues fiançailles, assentiment unanime, sauf, d’une maman, cette boutade, trop drôle pour que je ne la cite point:
«Depuis que votre livre a paru, monsieur, les jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans viennent annoncer à leur famille qu’ils se décident pour les longues fiançailles, et les petites cousines sont là toutes prêtes pour les encourager...»
Eh bien! chère correspondante très mûre (c’est vous qui le dites), quel inconvénient voyez-vous à cet accord? S’il y a danger à laisser longtemps fiancés les cousins et les cousines, à qui faut-il s’en prendre? Sans doute à qui les éleva? Faites bien vite votre meâ culpâ!
Cette même correspondante est d’ailleurs d’accord avec de nombreuses autres pour dauber sur «les jeunes gens contemporains».
«La génération des hommes de trente à trente-cinq ans a pris pour idéal les femmes troublantes de Bourget, tout au moins en province... Il faut dix ans pour préparer une génération d’hommes assez réfléchis pour voir dans la fiancée de leur choix la mère destinée à élever leurs enfants, non la poupée plus ou moins poétisée par les artifices de toilette...»
375 Encore sur les jeunes gens.—Opinion d’une jeune fille:
«Je trouve qu’en général les jeunes gens d’aujourd’hui ne sont pas à la hauteur des jeunes filles. Bien peu songent à modeler convenablement, à agrandir, à élever leur être intime, à développer leur volonté, tandis que cette préoccupation est constante chez beaucoup de jeunes filles.»
Opinion d’une autre jeune fille:
«Énormément de jeunes gens mal élevés, surtout dans ce qu’on appelle le grand monde...»
Les jeunes gens sont-ils en vérité si chenapans que cela? Je n’en sais rien; mais je persiste à conseiller aux Françoises du XXe siècle de les épouser tout de même, ces vilains jeunes gens, et d’avoir bien vite des fils qu’elles élèveront de manière que ceux-ci, du moins, soient d’irréprochables gentlemen vers l’âge nubile.
L’avertissement est toutefois caractéristique, et les jeunes gens actuels feraient bien de le méditer. La génération mariable des jeunes filles les juge avec une sévérité unanime. Et cela encore prouve que la jeune fille moderne est plus critique, plus consciente que ses aînées.
J’arrive aux reproches.
Il paraît que j’ai péché par omission.
L’on m’accuse d’avoir négligé de parler de 376 deux sujets importants: 1o la Charité; 2o la Religion.
Il est vrai, chère Françoise, que je n’ai pas traité dans mes lettres, isolément et directement, ce beau sujet: la charité. Et je pourrais me tirer de ce pas par une pirouette, en citant deux amusantes répliques empruntées au Fils de Giboyer:
Madame de la Vieuxtour.—Le père Vernier a été admirable ce matin... Il a eu sur la charité des pensées si nouvelles, si touchantes!
Giboyer.—A-t-il dit qu’il ne fallait pas la faire?
Il n’est pas aisé, en effet, de dire des choses neuves sur la charité, fût-on le père Vernier. Certaines vertus sont si évidemment nécessaires à l’équilibre, à la santé morale, qu’il semble superflu de les recommander lorsqu’on n’est pas, comme le père Vernier, choisi pour faire périodiquement l’inventaire et le blanchissage des âmes de ses ouailles. Cependant, pour les lectrices qui aiment à entendre des choses touchantes, sinon nouvelles, sur la charité, je veux insérer ici, tout simplement, la lettre d’une des leurs. Je ne saurais mieux faire, ni surtout mieux dire. Je prendrai la citation d’un peu haut, d’abord parce que la lettre est charmante, puis parce qu’elle montre gentiment combien est naturel, chez la femme, le passage du simple désir d’aimer à la charité:
«... Je n’ai plus l’âge de Françoise, hélas! Quoique jeune fille, j’ai déjà une épingle dans ma 377 coiffe... Mais qu’importe? J’ai gardé quantité d’illusions; c’est un avantage, n’est-ce pas? Sœur aînée de cinq frères, n’ayant plus de mère, je suis maîtresse de maison absolue. Je ne pourrai jamais avoir le sort enviable de Françoise, et pourtant l’ai-je espéré, désiré de toute mon âme! J’aurais voulu, comme elle, être la compagne d’un être aimé; l’éducation que j’ai reçue de ma mère ressemble en tous points à celle que l’oncle donne à sa nièce. Et, si la Providence avait voulu qu’il y ait une Ellen II, votre livre aurait été mon bréviaire...
«Il y a pourtant une légère lacune: vous avez oublié les pauvres, et mademoiselle Françoise n’y songe pas non plus. Moi, l’humanité souffrante a toutes mes sympathies, et, si j’avais le temps, je lui consacrerais plusieurs heures par jour. Il est doux de faire l’aumône de sa pitié. Un sourire sur des lèvres flétries, un regard reconnaissant, valent toutes les récompenses. Les confidences des malheureux sont si intéressantes, ils aiment tant qu’on les écoute!...»
Encore un coup, peut-on mieux dire? Bien qu’il n’y soit plus question de la charité, je ne résiste pas au plaisir de citer la fin de la lettre:
«Je suis une petite campagnarde, j’aime la nature. Elle m’aide à vivre, et c’est avec elle que j’ai les rapports les plus agréables. Perchée sur les flancs du Môle, notre petite habitation domine la vallée de l’Arve... Notre panorama est superbe. Si vous aimez vraiment à boucler votre malle, oncle de Françoise, mettez-vous en route pour... (ici le nom d’une station d’été très connue); arrêtez-vous dans notre ville; puis ayez l’amabilité de vous faire conduire à... (ici le nom de la maison). Vous y trouverez une petite demoiselle heureuse de causer un instant...
378 «... Huit pages! je vous prie, monsieur, de m’excuser...»
Voilà, ma chère Françoise, une de ces lettres qui découragent les écrivains d’écrire des «Lettres de Femmes».
Pour ce qui est de cet autre grand sujet,—la religion,—je ne m’étonne pas que des lectrices me reprochent de ne l’avoir pas traité.
«... Pourquoi, me dit une mère, dans un programme si juste d’éducation omettre sciemment la place que doit tenir l’élément religieux?»
Trois jeunes filles, qui signent côte à côte: Yvonne, Louise, Marguerite, m’écrivent:
«... L’éducation de la jeune fille moderne, sérieuse et instruite, nullement asservie aux anciennes formules et pourtant avertie des périls d’un excessif affranchissement, nous paraît idéale et absolument complète, en ajoutant toutefois à l’ensemble de ses perfections l’idée religieuse comme motif dominant.»
Une des rares lettres non signées professe:
«Que vos lettres soient lues dans tous pays, c’est là mon grand désir. Avec cette saine morale, et en plus la grande pensée de Dieu, notre créateur, il y aura moins de ménages malheureux, beaucoup moins de souffrances morales et matérielles pour les femmes. Je ne dis rien des hommes, parce que ceux-là trouvent toujours le moyen de souffrir gaîment.»
Ainsi parlent quelques lectrices; mais une autre leur répond, en me répondant:
«Un peu plus âgée que Françoise, mais jeune fille 379 encore, même pour ceux qui mettent la limite à vingt-cinq ans, j’ai reçu l’éducation et l’instruction dans un couvent de religieuses cloîtrées où les idées sont absolument traditionnelles...
«Assurément, je rejette beaucoup de ce que je croyais alors, ou je le crois différemment. Et de là ce peu d’empressement que je mets à retourner au couvent... On m’a reproché cette abstention: est-il vrai que je sois moins bonne que d’autres plus fidèles? Je ne puis le croire. Il est certain que je suis différente, comme piété par exemple. J’ai aujourd’hui, avec assez d’indifférence, le goût de la discussion...»
Il suffit qu’il y ait des âmes d’honnêtes jeunes filles comme cette dernière pour que les autres m’excusent de ne pas avoir traité la question religieuse. D’ailleurs, pour professer la religion ou les religions, il y a des ministres qualifiés. Quelle autorité porterais-je, moi laïc et profane, en une telle matière? Si respectueux qu’il soit de ce mystérieux attrait, la Foi, qui aimante et dirige les âmes à travers l’inconnaissable,—un laïc comme moi estime que l’enseignement exclusivement fondé sur le sentiment religieux ne saurait avoir un caractère de généralité. Il peut blesser les consciences désaimantées de la Foi. Il peut au moins leur paraître inutilisable. Or les Lettres à Françoise doivent servir à toutes les Françoises. C’est donc systématiquement que j’ai traité les seules questions inscrites en marge de la Foi... Si mes idées sur ce point intéressent les lecteurs ou les lectrices, ils les 380 trouveront dans d’autres de mes livres. Je ne les ai jamais cachées.
Et me voilà, ma nièce, au bout de cette revision de ma correspondance. Ce n’est pas sans allègement. Je me sens moins coupable envers tant de charmantes âmes qui voulurent bien me donner de leur pensée, de leur temps. Plus que jamais, je les supplie de rester mes collaboratrices. Ne voient-elles pas que leur concours n’a pas été superflu? Elles vont sans doute, à d’autres Françoises, faire un peu de bien. Il y a là de quoi les satisfaire, et cela vaut mieux pour elles, à tout prendre, qu’un remerciement banal confié à la poste.
Cela vaut mieux... et pourtant ce n’est guère. Certes, je ne me juge pas quitte avec elles! Je regarde le tas des papiers épars sur ma table de travail, si divers de nuance, d’aspect, d’origine, couverts d’écritures variées comme les âmes qui les inspirèrent et les mains par qui elles furent tracées. Je pense que chacun de ces précieux billets représente une heure de méditation, un petit acte d’énergie volontaire, un désir touchant d’être écoutée et conseillée... N’est-il pas un peu triste que le temps trop court et l’espace trop vaste m’interdisent à jamais de les voir, ces correspondantes inconnues, de leur parler, d’apprendre davantage de leur cœur et de leur sort? Que de grâce, d’espoir, quel chaste désir de goûter les joies de la vie, quel parfum de jeunesse, pour tout dire, s’exhalent de 381 ces feuillets entassés! A l’instant de les enfermer de nouveau, me voici tout ému.
Ah! puissent-elles être heureuses, ces enfants! Puissent-elles comme vous, Françoise, comprendre, vouloir, posséder leur destinée de femmes!
| Lettre Liminaire | I |
| I.—L’Institution Berquin.—Première apparition de Lucie et de Françoise.—L’invitation à la maturité.—Ce que suggèrent le jardin, la table à écrire et le lit.—On réclame un professeur de «vie ambiante».—Mme Le Quellien.—L’oncle de tout repos. | 1 |
| II.—Impressions de trois spectateurs un soir de fête à l’Exposition.—Le sentiment de Françoise sur le suprême effort du XIXe siècle.—Petit Palais et rétrospectives.—Françoise, quoique résolument moderne, se plaît au passé national.—D’une loi de l’éducation.—Projet d’un Petit Palais imaginaire. | 12 |
| III.—Le jour des morts.—Pèlerinage.—Vers le passé familial.—Les aïeux.—Laboureurs et soldats.—Le sergent-fourrier de Napoléon.—De la timidité et de l’esprit d’entreprise.—La grand’mère Brigitte.—L’argile de Françoise | 22 |
| IV.—On rend visite aux nouveautés de l’hiver.—Opinion de Mlle Lucie sur «les hommes».—Françoise 384 aime la parure.—Des deux degrés de la coquetterie.—La course au luxe.—Angoisses de la contrefaçon somptuaire.—Il y a une coquetterie recommandable. | 32 |
| V.—Une visite de Mme Le Quellien.—Retour à la question de la coquetterie.—Théorème d’après Fénelon.—L’avenir du costume féminin.—«Complet habit» pour femmes.—Encore Fénelon. | 42 |
| VI.—Visite édifiante.—L’éloquence de la chaire et le féminisme.—Histoire de la fleur qui perd son parfum.—Une tulipe de Hollande.—Wilhelmine.—Gestes féminins que ne peut faire un roi.—Une avocate.—Notre paradis et notre royaume. | 52 |
| VII.—Noël: traditions de la dernière semaine de l’année.—La fin d’un siècle.—Réflexions sur l’opportunité des inventaires.—Une composition de style.—Faillite de tout.—Ce qu’objecte le vieux siècle pour sa défense.—Espoir en la femme.—Le sel de la terre. | 63 |
| VIII.—Mission confidentielle.—Le parloir de L’Institut Berquin.—Yvonne, Madeleine, Juliette et Suzanne.—Le mari-complément.—Toquades de pensionnaires.—Un joli saint-cyrien.—Excellente attitude de Françoise.—Réflexions sur la vie claustrale des pensionnats. | 73 |
| IX.—Ministres et Commissions.—Singulier avantage de n’être point ministre.—L’enseignement secondaire.—Histoire d’un petit pêcher.—Françoise à dix ans.—Quel genre d’enseignement convient à cet âge.—La période tainienne.—La culture supérieure et la culture générale.—Objet de l’enseignement secondaire. | 83 |
| X.—Les gens qui se disent cultivés.—Deux expériences pour les ramener à la modestie.—On ne sait rien.—Pacte d’illusion entre le maître et l’élève.—Le vrai sens du mot «savoir».—Les clartés de tout.—Ce qu’on nous objecte.—Éloge du maître d’armes et de l’écuyer.—Gymnastique intellectuelle: la prétendue; la vraie. | 99 |
| 385 XI.—Petites anxiétés.—L’abat-jour.—Françoise n’est point frivole.—Conversation avec une dame.—Le latin, le grec, les mathématiques et la culture féminine.—Le surmenage.—Juliette. | 113 |
| XII.—Les livres de classe.—Leurs deux grands défauts.—Des précis: les bons et les mauvais.—Si j’étais ministre!—Enseignement littéraire: les anthologies.—Conseils à Françoise II. | 127 |
| XIII.—La jument de Roland.—Notre méthode se passe du ministre.—Comment l’appliquer dans la pratique?—Distribution d’une journée d’élève.—Lever, toilette, repas, classes, études, temps de repos.—Le bon problème, la bonne version.—Soirée, coucher.—Le collège idéal. | 140 |
| XIV.—La ferme.—Nécessité d’une succursale de l’institution Berquin à la campagne.—Ce que fut la génération féminine de la fin du dernier siècle.—Cure de lenteur.—Les enseignements de la terre.—Le chêne et le châtaignier.—Treize francs vingt-cinq!—La vie intellectuelle et la vie rurale. | 154 |
| XV.—Une découverte oubliée par Edison.—Les heures où l’on ne se voit pas agir.—Chateaubriand, Mme Récamier et Françoise.—Sauterie chez d’honnêtes gens.—Le cotillon.—L’«autre» Françoise.—Bienfaits de l’éducation: la pensionnaire et le saint-cyrien.—Système des compartiments étanches.—Françoise proteste. | 166 |
| XVI.—Les crêpes.—Concours culinaire.—De l’importance des soins ménagers.—La masseuse et le calculateur.—Goûts et dégoûts de Sophie.—Leçons de mise en scène que nous donne la nature.—La maîtresse de maison idéale.—Autorité domestique de Françoise. | 178 |
| XVII.—Les demoiselles du télégraphe.—Pédales et dépêches.—Une carrière pour Françoise.—Les sports féminins.—Caractères de femmes sportives.—Émilie.—Julie.—Importances respectives de la tête et du muscle.—Le vrai «record» féminin.—Nos aïeules. | 188 |
| 386 XVIII.—Le parloir de Berquin.—Quo Vadis?—Doit-on le lire?—Difficultés de se prononcer sur la moralité des livres.—Les jeunes filles et les romans.—Système traditionnel.—Mme de Maintenon; Berquin.—Système révolutionnaire.—Système des lectures responsables. | 199 |
| XIX.—Une surprise.—Le secret de Françoise.—Beauté et mélancolie du rôle de confident.—Les raisons du cœur.—Quel rôle joua Mlle Lucie.—Mariage d’amour; mariage bourgeois.—Il n’y a plus de jeunes filles riches.—L’âge de l’amour et l’âge du confortable. | 209 |
| XX.—Françoise persiste.—Diverses façons d’envisager le mariage.—Raisons du cœur et raisons de la raison.—Les fiançailles des deux côtés de la Manche.—Françoise et sa mère-grand.—Trois avantages des longues fiançailles.—Les conditions d’une ambassade. | 220 |
| XXI.—La visite à Passy.—Méditation sur les approches de la quarantaine.—Félix de Vandenesse et Jacques.—Les «travaux de maman».—Cristallisations variées.—Françoise est si jeune!—Maxime est si jeune!—La question des intérêts matériels.—Chambre et Sénat.—Le sort d’un amendement. | 231 |
| XXII.—L’attente.—Utilité d’une vie réglée dans les moments de crise morale.—L’ordre imposé; l’ordre choisi.—La plupart des vies féminines sont désordonnées.—Comment régler sa vie?—Examen des aptitudes personnelles.—La veille et le sommeil.—Un vers latin.—Le profit du soir. | 243 |
| XXIII.—La jambe d’une dame âgée.—Reprise du programme: les heures de veille.—Influence de la jeunesse sur le mobilier.—Les travaux choisis.—Système de la nervure centrale.—L’art consolateur.—Beauté et noblesse de la règle. | 253 |
| XXIV.—Un dimanche de printemps.—Maxime en civil.—La jeunesse et Sarcey.—Un séducteur.—L’état des négociations.—Quelqu’un 387 qui n’aime pas les longues fiançailles.—Discussions sur l’énergie.—L’ambition de Maxime.—Promesse d’alliance. | 263 |
| XXV.—Tout s’arrange.—Pourquoi Françoise fut si docile.—Temps joyeux.—L’art de supporter le bonheur.—Encore la règle.—Le brevet de Françoise.—Faut-il des examens?—L’inventaire et l’alerte.—Comment évoluera l’enseignement secondaire.—Le lumignon et le fanal. | 273 |
| XXVI.—L’examen.—Excellente attitude de Françoise.—Une autre candidate.—Les disgrâces d’Alexandrine.—Arthropodes, fractions, prisme.—Comment Françoise mène le sexe laid.—Retour par une après-midi d’été.—Rayonnement de Françoise.—La retraite.—Innocence de Mme Rochette.—Un commencement et une fin. | 282 |
| XXVII.—Paris et Rosny-sur-Mer.—L’oncle n’est point jaloux.—Étude sur l’âme des belles-mères.—Les souvenirs.—Les illusions.—La mise à la retraite.—Souhaits de bonheur pour Françoise.—Feuilles sèches et lilas tardifs. | 294 |
| XXVIII.—Le charme des gronderies.—Trois mois sans lettres.—Réflexions sur la correspondance.—Lettres utiles.—Lettres de convenance.—L’amour et l’amitié.—Rôle de la jeunesse dans l’amitié.—Protocole des lettres futures.—Le mentor.—Le lexique. | 304 |
| XXIX.—Première consultation.—Idées de Lucie.—La question des voyages.—Sont-ils décevants?—Le rêve et le souvenir.—Le voyage de noces: il est symbolique.—De la retraite et de la vie intérieure.—Utilité des illusions. | 312 |
| XXX.—Excursion dans l’Indre.—Le choix de la maison.—Opinion de Lucie sur la province.—Opinion de Françoise.—Opinion de l’oncle.—Un chapitre de la philosophie du bonheur.—Que la médiocrité de la fortune et du séjour est bienfaisante aux jeunes époux.—Conseils pratiques sur le trousseau, sur le mobilier.—Point de luxe.—Point de provisoire. | 321 |
| 388 XXXI.—Une station d’hiver.—L’inutile verdure et l’inutile soleil.—Petites cosmopolites.—Pepa, Concha, Lily.—Indiscrétion professionnelle.—Les enfants.—Système de l’aveuglette.—Système de la demi-innocence.—Système de Molière.—Françoise est dans la tradition nationale.—On peut hâter le mariage. | 332 |
| A Madame Maxime Despeyroux | 344 |
| Post-Scriptum.—La réponse aux Françoises.—Le système d’études.—La coéducation.—Les lectures. Agnès.—Le féminisme.—L’amour et le mariage.—Les omissions. | 354 |
Au lecteur
L’orthographe d’origine a été conservée et n’a pas été harmonisée, mais quelques erreurs clairement introduites par le typographe ou à l’impression ont été corrigées. Les mots ainsi corrigés sont soulignés en pointillés. Placez le curseur sur ces mots pour faire apparaître le texte original.
Cliquez sur une image pour l’agrandir. Pour revenir au texte, utilisez la fonction retour de votre navigateur.