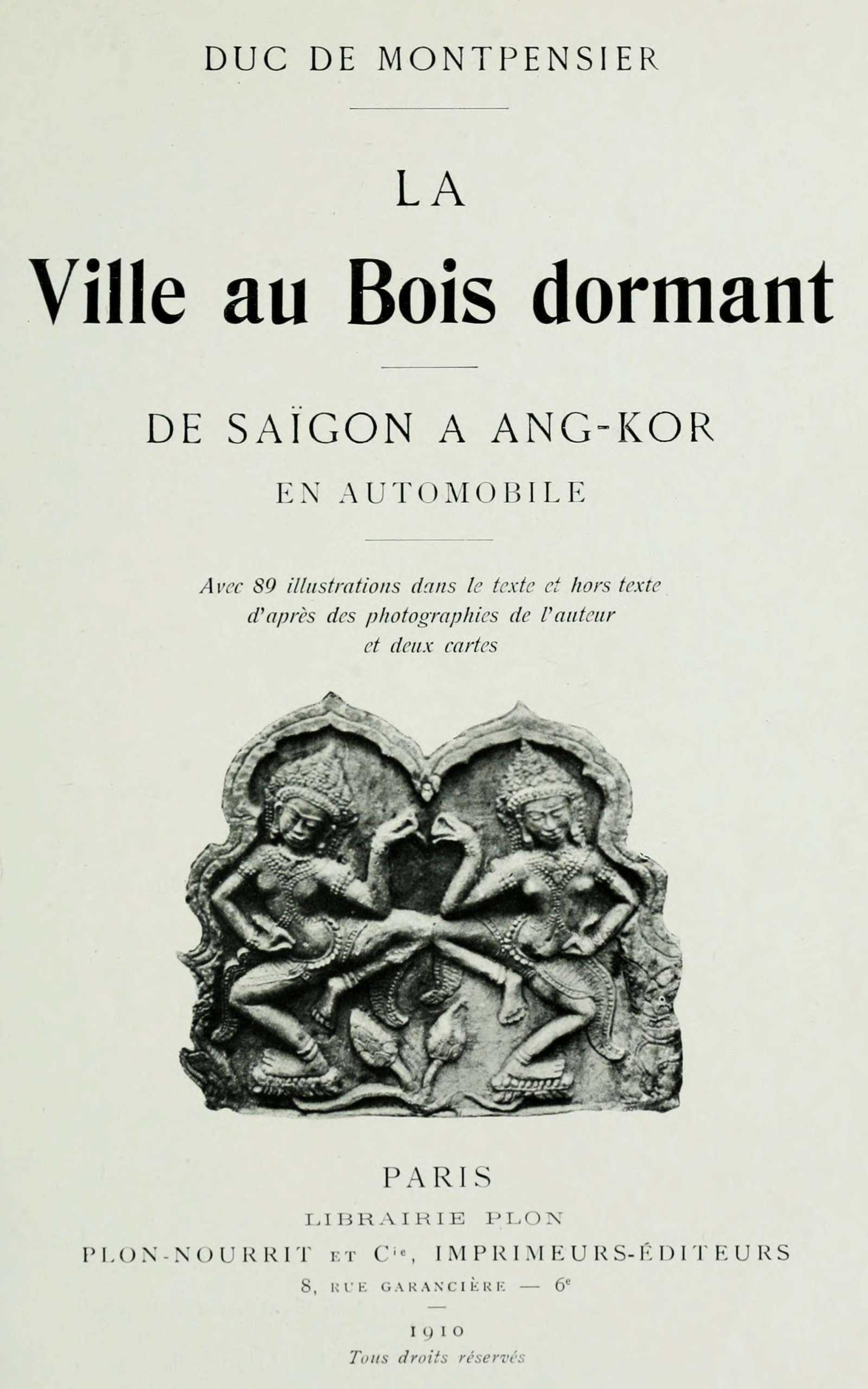
Title: La Ville au Bois dormant
De Saïgon à Ang-Kor en automobile
Author: duc de Ferdinand François Philippe Marie d'Orléans Montpensier
Release date: January 14, 2025 [eBook #75106]
Language: French
Original publication: Paris: Plon, 1909
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
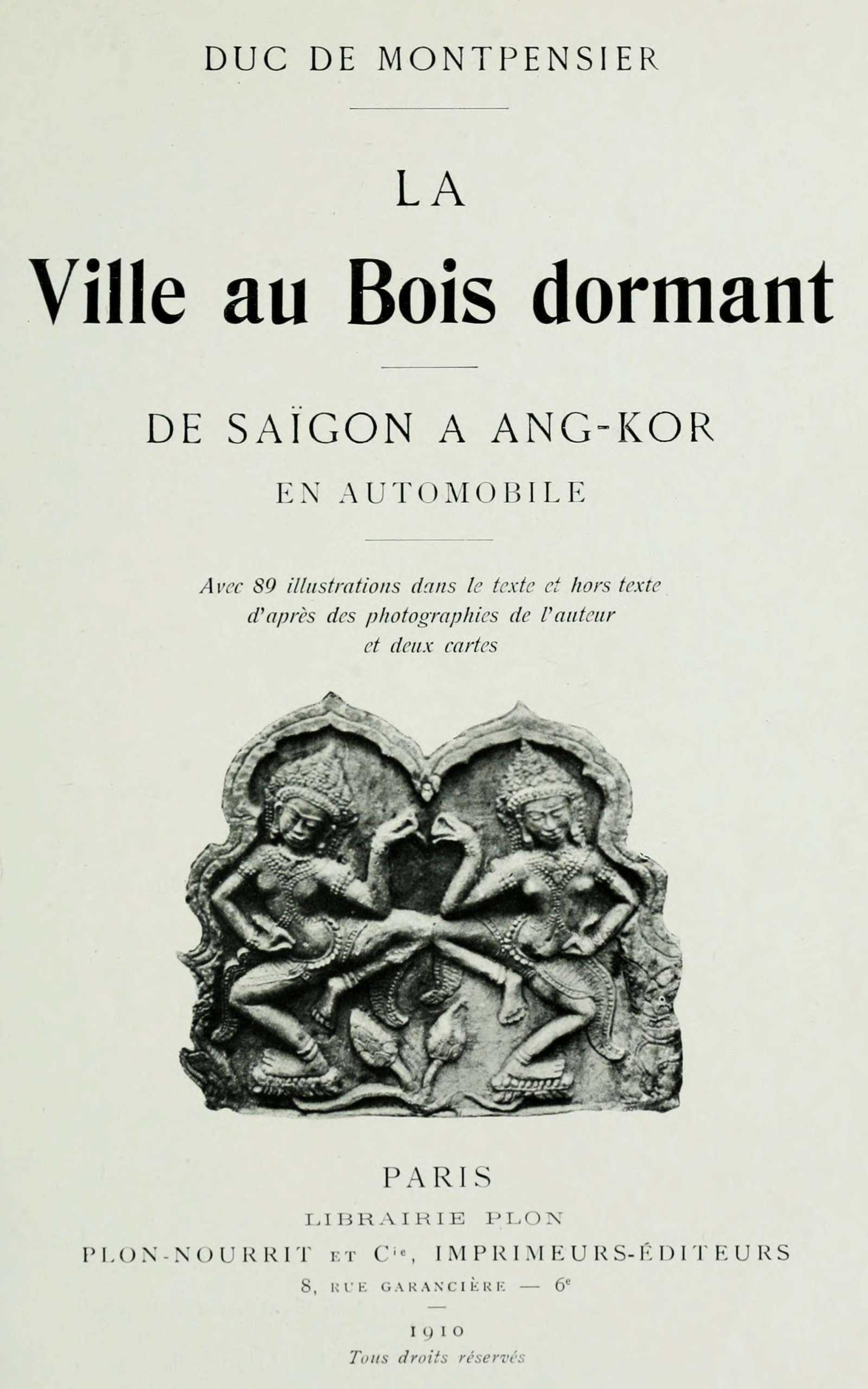
DUC DE MONTPENSIER
DE SAÏGON A ANG-KOR
EN AUTOMOBILE
Avec 89 illustrations dans le texte et hors texte
d’après des photographies de l’auteur
et deux cartes

PARIS
LIBRAIRIE PLON
PLON-NOURRIT ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8, RUE GARANCIÈRE — 6e
1910
Tous droits réservés
Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays.
Copyright 1909 by Plon-Nourrit et Cie.
Malgré son titre de « la Ville au Bois dormant », ceci n’est pas un conte de fées, encore moins un livre prétentieux, un ouvrage à thèse ; c’est un simple cahier de route rédigé au jour le jour par de jeunes fous qui ont conduit l’automobile, cette avant-dernière conquête bien française de l’industrie, à un pèlerinage difficile devant les ruines de la plus ancienne, de la plus merveilleuse des civilisations asiatiques.
Dû à la collaboration de tous les écervelés du pèlerinage, ce journal n’a subi aucune correction et je suis obligé de le signer seul, mes compagnons se refusant à prendre la responsabilité des plaisanteries et des propos risqués qui ont égayé notre route souvent pénible et dangereuse.
Mais le temps passe ; et, en remaniant ces notes pour en faire une relation sévère et grave, je craindrais trop de perdre mon avance, devant les étonnants progrès de l’Aviation, cette étonnante dernière conquête de la France, toujours !
Je veux montrer que nous lui avons ouvert la voie.
En avant ! toujours en avant !
DUC DE MONTPENSIER
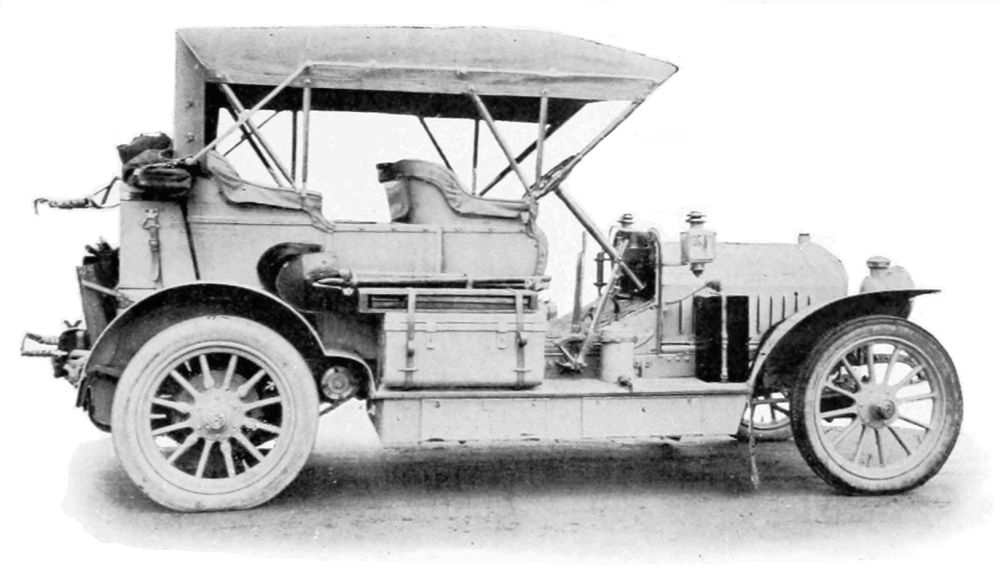
28 février 1908.
Saïgon ! Enfin !
Depuis l’aube, à mesure que le Polynésien remontait la rivière, la silhouette de la ville s’est précisée, blanche et rouge sur le fond vert du paysage cochinchinois. Partout autour de nous, sur les deux rives du fleuve, jusqu’aux confins de l’horizon, du vert, rien que du vert, toute la gamme des verts, du vert nuancé des rizières, au vert profond et comme vernissé des arbres aux feuilles immobiles. Toute cette nature semble peinte par un impressionniste truculent ! « C’est une symphonie en vert majeur », eût-on dit aux temps anciens (déjà) du naturalisme…
Dois-je avouer, pourtant, que cette symphonie ne suffit pas à distraire mon inquiétude ?… Décidément, par ce clair et chaud matin, l’automobiliste remplace en moi l’amant de la nature exotique ; à chaque tour d’hélice, mon angoisse grandit et s’exaspère : et tous mes états d’âme se pourraient résumer en trois mots (Mané, Thécel, Pharès du chauffeur !)
— Et la voiture !?!?
… La chère et précieuse voiture laissée voilà quinze jours déjà aux soins du brave Guérin qui nous a précédés ici… La Diétrich dont je n’ai plus de nouvelles depuis le Caire.
Dans quel état allons-nous la retrouver ? Comment a-t-elle supporté sa dernière étape de paquebot ? Pourvu, mon Dieu, qu’il ne lui soit rien arrivé ! Sans elle, c’en serait fait de tout l’imprévu, de tout le charme, de tout le nouveau et l’inédit de ce voyage… de cette randonnée vers la sublime et mystérieuse ville morte, vers Ang-Kor, à travers la Cochinchine et le Cambodge.
Mais le Polynésien vient de stopper. Parmi la foule blanche massée sur l’appontement, je reconnais le fidèle Guérin. Sous le casque colonial, son front me paraît soucieux… Est-ce que par hasard ?…
De loin, Guérin me semble esquisser des gestes sémaphoriques, mais incompréhensibles : des signes de détresse sans doute !
Mon anxiété redouble… j’ai beau me répéter fortement la maxime de Calderon : « Le pire n’est pas toujours certain ! » je me sens en proie aux plus sombres pressentiments, tel un héros de roman… feuilleton !
Enfin, voici Guérin qui monte à bord !
Ce que je craignais est arrivé. Le poète espagnol a tort contre M. de Talleyrand qui a dit si justement :
— Il faut toujours s’attendre à de l’imprévu.
… Et tout notre voyage, du reste, ne sera qu’un long commentaire de cette parole… épiscopale et prophétique !
Les contingences, ces satanées contingences, contre quoi mon professeur de philosophie me mit si fort en garde, se sont acharnées sur ma pauvre voiture…
En débarquant de l’Annam la caisse qui contenait le si précieux fardeau, le câble a cassé par deux fois et laissé tomber le tout à fond de cale, d’une hauteur que Guérin croit pouvoir évaluer à 10 mètres…
Un mètre de plus ou de moins… la conclusion est qu’il faut s’y mettre. A quoi bon se demander s’il sied de voir en cet accident un mauvais présage ? La volonté déjoue le destin ! Le mal est fait, il faut le réparer. A l’œuvre !
Forgerons, carrossiers, mécaniciens, tout le monde s’en est mêlé… et, au bout de quelques jours, il n’y paraît plus.
Toutefois, la Justice… (et la Vérité donc !) me font un devoir, d’ailleurs agréable à remplir, de reconnaître hautement que, sans la solidité extraordinaire de la voiture, notre voyage se serait terminé avant d’avoir commencé !… En effet, rien dans le châssis ni dans le mécanisme n’a gardé trace du choc effroyable dont ils avaient eu à souffrir. Bravo pour les Diétrich !
1er mars 1908.
Et maintenant, il s’agit… d’agir : mais on n’entreprend pas un pareil voyage sans un itinéraire bien établi.
Puisque aussi bien, grâce à l’initiative de Guérin, le malheur est en bonne voie de réparations (… et ce pluriel n’est pas involontaire), nous allons consacrer les deux ou trois jours qu’exige la mise en état complète de la voiture à recueillir des renseignements sur les chemins — si l’on peut appeler ainsi les voies de… non-communication qui nous séparent, bien plus qu’elles ne nous en rapprochent, des fameuses ruines d’Ang-Kor !
J’interroge d’abord Guérin, qui depuis quinze jours a eu le temps de se documenter : sa réponse concilie la netteté avec la concision. Ici tout le monde est unanime à déclarer que notre entreprise relève de la folie furieuse, et qu’il est matériellement impossible de tenter un pareil voyage en automobile.
— C’est de l’automaboulisme, a déclaré un fonctionnaire facétieux, et il faudrait avoir l’âme chevillée aux records…
Ces à peu près, de mauvais augure, ne me découragent pas : je m’attendais à de telles prédictions.
Hervé de Bernis tente une suprême démarche et va rendre visite au Résident supérieur, M. Outrey… Il revient accablé : un désespoir tranquille se lit dans son œil bleu.
Ainsi, tous les renseignements concluent à nous conseiller de reprendre le prochain courrier et de laisser Ang-Kor à d’autres… Je commence à en avoir assez des renseignements !
Ils sont trop !… quand il n’y en a plus… il y en a Ang-Kor.
La voiture est prête… qu’importe tout le reste ?
Je me rappelle les beaux vers de Baudelaire :
Le mouvement se prouve en marchant !
Enfin, je veux bien consentir à tenter une dernière chance.
Puisque les renseignements sont si décourageants ici, allons en chercher ailleurs !
Notre itinéraire passe par Tay-Ninh, Kompong-Cham, Kompong-Thom, Siem-Reap, Ang-Kor !… Commençons toujours par aller voir le Résident de Tay-Ninh. Un bout de causette, après un bout de route.
… Après quoi, nous reviendrons à Saïgon nous occuper des ravitaillements. Et ensuite, ma foi, à la grâce de Dieu !
2 mars 1908.
Donc, à six heures du matin, nous montons en auto, Gustave de Bernis, Guérin, « le compagnon », un interprète annamite, et moi au volant.
Encore que l’interprète annamite se fût présenté de lui-même et dans les meilleurs termes, je ne crois pas qu’il soit inutile de le présenter à mon tour. A l’entendre, c’était une perle. Par la suite, il m’a fait souvent songer à l’humble origine de ce précieux bijou… Son nom ? Le fidèle Guérin l’avait surnommé Brin-d’Amour et jamais nous ne l’avons appelé autrement !
Sur « le compagnon », je ne puis dire qu’une chose… oh ! bien peu !… c’est que, tout le temps de ce long et pénible voyage, aux heures de lassitude ou de désespoir, nous trouvions toujours dans ses paroles un réconfort ou un encouragement. Merci de tout cœur « au compagnon ».
Un bagage est nécessaire !… a dit Victor Hugo.
Cette juste parole ne fut jamais plus de circonstance…
Nous emportons donc deux jours de vivre, des pneus de rechange, des provisions d’essence, et la seule carte de la région qui nous paraisse mériter ce nom, une belle carte en vérité, de dimensions imposantes, fortement entoilée, toute bariolée de noms et de références ; elle n’a qu’un défaut : c’est que l’on n’y trouve jamais ce que l’on y cherche. Mais les cartes servent-elles jamais à autre chose qu’à inspirer le goût des voyages à ceux qui restent chez eux ? Quand on les consulte à tête reposée, à la clarté des lampes, il semble que le paysage se déroule sous les yeux : on se sent envahi d’une délicieuse nostalgie. Il en est autrement, hélas ! quand on leur demande un renseignement net et précis. La route, qui paraissait si droite et si belle, se hérisse d’obstacles et ne conduit plus nulle part : on éprouve alors combien la réalité diffère du rêve.
Ainsi, je m’étais composé à grand’peine un joli petit itinéraire, dont la première étape devait nous conduire jusqu’à Tracop, et tout fier de ma science, j’eus le tort de vouloir l’étaler aux yeux bridés de Brin-d’Amour… Une longue discussion s’ensuivit… une discussion en annamite bien entendu… en fin de quoi, notre guide-interprète-cuisinier voulut bien conclure que j’avais raison sur toute la ligne et que nous pouvions marcher.
Nous voilà donc partis à pleine allure, sur une route admirable : les routes sont toujours belles quand on part ! Au bout d’un quart d’heure nous trouvons une rivière et un bac… Je ne m’y reconnais plus, nous stoppons : je consulte la carte ; par miracle le bac et la rivière y sont indiqués… et j’y découvre que nous sommes juste à 15 kilomètres… en sens opposé de Tracop.
Mon juste courroux s’exprime en un vocabulaire choisi mais véhément contre Brin-d’Amour qui demeure impassible (ah ! certes… impassible n’est pas français). Après quoi, nous nous résignons à faire demi-tour. Et nous voilà repartis sur une autre belle route… qui aboutit, elle aussi, à une rivière… la même peut-être ! avec cette différence pourtant que cette fois-ci nous n’y trouvons pas le moindre bac. C’est déjà mieux !
… Je cherche de nouvelles épithètes à l’adresse de Brin-d’Amour, mais ma provision commence à s’épuiser.
En désespoir de cause, nous essayons de parlementer avec quelques indigènes qui sont venus se grouper à distance respectueuse — autour de la machine, dont l’immobilité, sans doute, les rassure.
Quelle cacophonie, mon Dieu !
Enfin, Brin-d’Amour veut bien condescendre à remplir ses fonctions d’interprète… Toutes les mains se tendent, d’un accord unanime, vers une longue suite d’ornières, là-bas, tout là-bas !… qui évoque l’idée d’une percée de labourage à travers la forêt vierge : il paraît que, décidément, c’est notre route et, cette fois-ci, la bonne !
Nous sommes quand même enchantés de faire sa connaissance. Il va sans dire que les paysans nous préviennent charitablement qu’elle est impraticable en auto… Du moins, nous apparaît-elle ainsi comme pavée de bonnes intentions. Et voilà si longtemps que nous la cherchons, que, pour rien au monde, nous n’y voudrions renoncer !
Un coup d’accélérateur… et la brave Diétrich bondit en avant comme un coursier sous l’éperon.
De cette nouvelle route, nous ne savons rien, sinon qu’elle s’annonce mal et qu’elle a la réputation de conduire à Tracop : mais, mon professeur de philosophie m’a appris à me défier du consentement unanime des peuples. Cette route inconnue n’a pour elle jusqu’ici… que le suffrage annamite ; et, je ne sais pourquoi, cela ne me rassure qu’à demi.
Qu’allons-nous trouver au bout ?
Peut-être Tracop, peut-être une rivière, peut-être pire ?
Nous verrons bien…

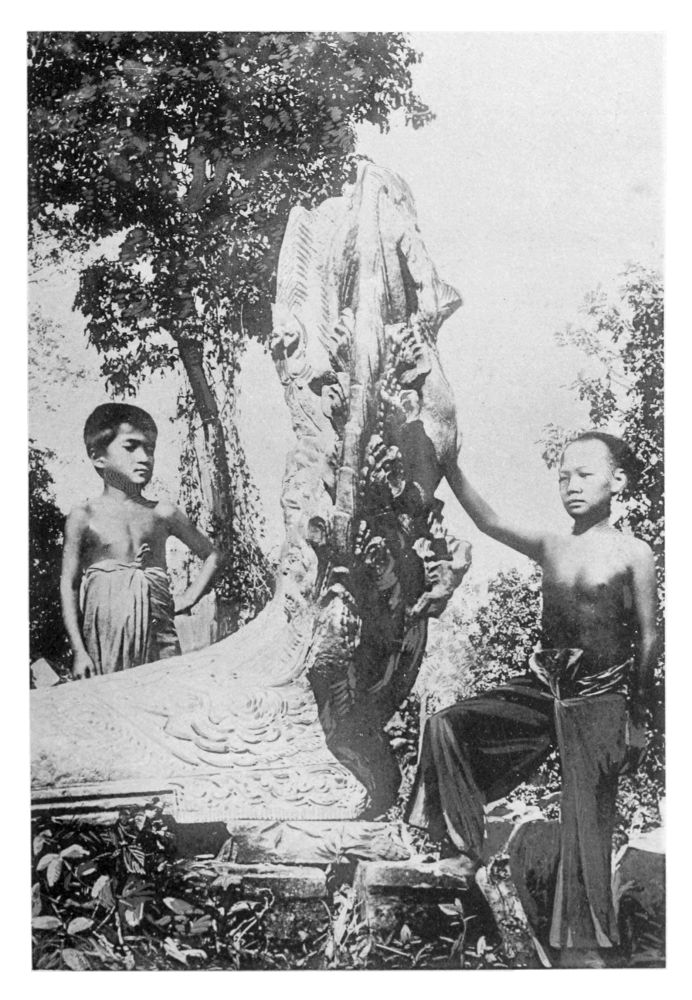

2 mars 1908.
Les premiers mètres ne valent pas grand’chose, mais en revanche les suivants, et ils sont beaucoup !… deviennent bientôt abominables : c’est une consolation.
Les ornières se creusent, sous nos roues, de plus en plus profondes et sablonneuses : le carter commence à donner des signes d’inquiétude — en quoi il semble se conformer à ma triste pensée. Toutefois, nous continuons en première vitesse et nous arrivons à un carrefour, où trois chemins s’offrent à nous. L’absence de poteau indicateur ne nous surprend pas autrement. A tout hasard nous prenons le moins mauvais… si l’on peut établir des comparaisons dans le pire !
Maintenant la route s’enfonce dans la forêt. On se croirait dans un tunnel… un tunnel végétal. Le grand mystère de la forêt nous enveloppe, les branches et les lianes s’entre-croisent au-dessus de nos têtes. A maintes reprises nous nous couchons presque dans la voiture pour éviter une branche, car la capote n’est pas encore adaptée à la carrosserie.
Le chemin devient si étroit que les marchepieds éraflent les troncs d’arbres et les bords du sentier aux places où il est encaissé.
Et le tunnel se complique d’un labyrinthe, c’est un tunnel en spirale ! Comme nos roues, ce maudit sentier tourne, tourne toujours — et son étroitesse rend la direction très pénible. Honneur aux virages malheureux !
Il ne faut point s’en étonner toutefois, c’est un trait commun à tous les sentiers de charrettes, de mépriser la ligne droite : ils rappellent en cela ce classique « Panthéon — Place Courcelles » immortalisé par Courteline. Ils font consciencieusement le tour de tous les obstacles. Souvent même, ils tournent pour rien, pour le plaisir.
Crac ! ça y est… Tout d’un coup, dans une clairière, les roues d’arrière restent prises dans un trou plus profond, tandis que celles d’avant travaillent à faux, s’inclinent d’une façon peu rassurante ; le réservoir touche et le moteur cale.
Mais nous ne calons pas, nous. Vite à bas de nos sièges, nous entamons la lutte avec le spectre terrible de la panne ! A l’aide d’une hachette, Gustave de Bernis creuse deux tranchées devant les roues d’arrière et dégage le réservoir. Cependant, le sort des roues d’avant me remplit d’une juste crainte !
Enfin, le travail s’achève. On remet en marche, et en poussant un peu, nous parvenons à gagner une bonne suée et le côté du chemin.
Sauvés pour cette fois !… J’ai comme un vague pressentiment que nous ne sommes pas au bout de nos peines.
Il est onze heures. Brin-d’Amour ignore éperdument à quelle distance nous nous trouvons du fameux Tracop… Nous ne savons rien, sinon qu’il fait une chaleur étouffante, que nous avons très faim et encore plus soif : le déjeuner s’impose.
Après avoir mis la voiture à l’ombre, nous l’imitons et nous nous installons sous un gros arbre, qui ferait fortune à Robinson ; puis nous attaquons joyeusement le menu, bien qu’il ne rappelle ni Voisin, ni Paillard, ni le Café Anglais !
Quand nous sortons de table, si l’on peut s’exprimer ainsi, nous constatons que la chaleur communicative des banquets n’est rien auprès de celle qui tape sur la Cochinchine… Mais il est une heure, et ces considérations atmosphériques ne sauraient nous empêcher de repartir à la découverte de l’introuvable Tracop. Nous secouons Brin-d’Amour qui déjà s’apprêtait à goûter la douceur d’une sieste réparatrice. Notre guide interprète se résigne, non sans peine, à suivre ces Européens dont l’activité paraît lui inspirer quelque mépris ; et nous remontons dans la voiture.
Enfin, à deux heures, nous arrivons en vue d’une hutte isolée… (disons une canha pour répandre un peu de couleur locale sur ces pages sévères). Les habitants sont sur le seuil, attirés sans doute par ce besoin de voir passer les voitures qui est commun à toute l’humanité, et qui, chez eux, semble d’ailleurs tout naturel… Je donne un coup de sirène en guise de bonjour : ils s’enfuient épouvantés et se perdent dans le paysage.
Nous arrêtons devant la canha et nous avons toutes les peines du monde à ramener nos fugitifs : enfin, grâce à l’éloquence de Brin-d’Amour qui leur crie des phrases rassurantes et leur affirme sans doute la pureté de nos intentions, ils s’apprivoisent peu à peu et reviennent autour de la machine. Et la conversation s’engage !
… Ces pauvres gens commencent par nous avouer que, de toute leur vie, ils n’ont encore vu qu’un seul blanc… voilà sept ans de cela : c’était un garde principal ! Je ne sais si nous leur inspirons autant de respect, toujours est-il que nous ne semblons pas leur déplaire. Ils ont fini par se convaincre que nous ne sommes pas des génies malfaisants : et ils s’humanisent au point de nous offrir l’hospitalité. Le plus cordialement du monde, ils nous régalent de cocos et de pastèques, et nous voilà bons amis.
Je leur fais demander par Brin-d’Amour des nouvelles de cet invisible Tracop qui semble se reculer comme un mirage à mesure que nous avançons…
— Tracop ! nous traduit Brin-d’Amour, sans marquer aucun étonnement, mais vous y êtes !
Je crois rêver… Ainsi ce gros village, que nous promettait la carte, se réduit à cette pauvre canha !
Nous nous amusons un instant de notre déconvenue.
Désormais, la géographie nous inspirera quelque méfiance…
A deux heures et demie, après avoir pris congé de nos hôtes, nous nous remettons en marche par le même chemin qui nous a amenés au but de notre expédition. Les choses vont à merveille maintenant que la route est déblayée par notre passage… Elles vont même si bien, et la voiture aussi, qu’à trois heures et demie nous nous arrêtons à l’entrée de Tay-Ninh, devant la boutique d’un Chinois, dans l’intention de nous rafraîchir un peu. Puis, nous allons, Gustave de Bernis et moi, rendre visite au Résident, M. Prère. Nous trouvons près de lui le plus gracieux accueil et, du reste, l’amabilité semble vraiment l’apanage de tous les administrateurs. J’ose mettre la sienne à contribution et je lui demande les renseignements indispensables pour notre voyage vers Kompong-Cham. Il ne nous dissimule pas que nous sommes les premiers à tenter pareille aventure et qu’il n’a jamais envisagé la possibilité d’une excursion à Ang-Kor en automobile ! Il déplore de n’en pas savoir beaucoup plus long que nous sur ces voies de communication que sont les sentiers à charrettes… de sorte qu’au bout d’une demi-heure de conversation, entrecoupée de regards éplorés sur la fameuse carte, qui paraît si renseignée et qui partage notre ignorance, je ne suis pas plus avancé qu’au départ de Saïgon.
Il ne nous reste qu’une seule ressource, et M. Prère est assez aimable pour nous l’offrir, sous la forme d’un topo qu’il nous fera établir par le télégraphe, dont la ligne va jusqu’à Kreck… Il ne s’exagère point d’ailleurs l’exactitude de ce vade mecum, mais enfin, ce sera toujours un topo ! Et il nous promet encore de nous fournir un guide jusqu’à Kreck.
Nous repartons pleins d’espoir… et de vastes pensées.
Est-ce que vraiment la philosophie de M. Alfred Capus aurait cours de l’autre côté de la terre ? Et serait-il donc vrai qu’ici, comme dans notre Europe trop civilisée, tout s’arrange. Ainsi, nous aurons un topo ! — joie ineffable ! — et un guide, et quoi encore ? Avec tout cela, si nous n’arrivons pas, ce sera une vraie honte !
Nous rentrons à Saïgon, tout fiers d’avoir si bien employé notre journée d’essai : nous y retrouvons Hervé de Bernis et, pour mettre nos idées en ordre, nous nous réconfortons d’un bon dîner au « Continental ».
3 mars 1908.
Aujourd’hui, je fais envoyer à Kompong-Cham par les voies les plus rapides (et je frémis en y songeant !) toutes les grosses pièces de rechange qu’un accident peut rendre nécessaires : roues, direction, ressorts, six enveloppes munies de semelles Michelin et toute une provision d’essence, d’huile, de carbure, etc… Voilà pour les ravitaillements.
Et maintenant, mes lecteurs n’échapperont point à la description de la voiture ! Je m’en voudrais trop d’oublier cette brave et fidèle amie. Tous les automobilistes me comprendront : ils savent qu’un vrai chauffeur s’attache à sa machine comme un bon cavalier à son cheval et qu’il finit, pour ainsi dire, par la considérer comme un prolongement de sa personnalité.
Celle qui fut l’âme de ce voyage mérite bien une mention honorable au début de ce cahier de route.
Représentez-vous par la pensée (ce qui n’exige pas d’ailleurs un bien grand effort !) une bonne 24/30 H. P. Lorraine Diétrich à châssis américain très renforcé et dont les énormes ressorts sont faits pour supporter le poids total de 3700 kilogrammes et surtout les chocs, les cahots, les secousses et les cent mille avanies que nous réservent les fameux sentiers à charrettes.
Par coquetterie, j’ai fait mettre des pignons de treize dents afin de pouvoir à l’occasion goûter un peu les joies de la deuxième vitesse.
Dans un voyage comme celui que nous entreprenons, on ne s’étonnera pas trop que je m’arrête aux détails de la carrosserie. Peut-être ne paraîtront-ils pas inutiles à ceux qui, comme je l’espère, voudront nous imiter et boire l’obstacle ailleurs que sur la route nationale de Paris à Trouville.
Donc, la carrosserie, un double phaéton très court (pour laisser place par derrière à deux malles, à quatre lits pliants, à quatre pneus de rechange et à la tente indispensable), ne présente qu’une seule porte, l’autre côté servant de dépôt aux cartouches ; sur le marchepied de droite, un grand treuil avec 40 mètres de câble en acier, destiné à désembourber la voiture ou à lui permettre de remonter une pente trop raide : ce treuil se fixe à un arbre ou à un piquet assez solide au moyen d’un appareil complémentaire disposé sur le marchepied de gauche. Puis, viennent un extincteur, le générateur en acier bleui et une grande caisse en tôle contenant tout le matériel de cuisine : une table et trois chaises pliantes, trois pioches et trois pelles.
A gauche, sur l’aile d’arrière, une boîte contenant deux lampes portatives à acétylène. Sur le marchepied, la réserve de 50 kilogrammes de carbure, en un tonnelet absolument étanche, et l’appareil du treuil.
Devant le radiateur, trois fortes haches.
Enfin, une grande capote en toile grise, qui non seulement nous garantira du soleil, mais nous servira surtout à écarter les branches et ainsi à nous ouvrir un chemin à travers la forêt. On conçoit que pour bien remplir un tel rôle (qui de prime abord ne paraît pas de son emploi), il faut à cette capote une solidité en quelque sorte granitique.
Du reste, tous les organes de la voiture, châssis, moteur et carrosserie, seront soumis à une rude épreuve.
Pour la machine, je suis tranquille : son nom seul me dispense d’en dire plus long. Et quant à la carrosserie, je me fie au travail de Berton-Labourdette ; je connais et j’apprécie hautement le fini et la solidité des voitures qui sortent de chez lui et je crois pouvoir répondre que celle-ci fera honneur à sa maison.
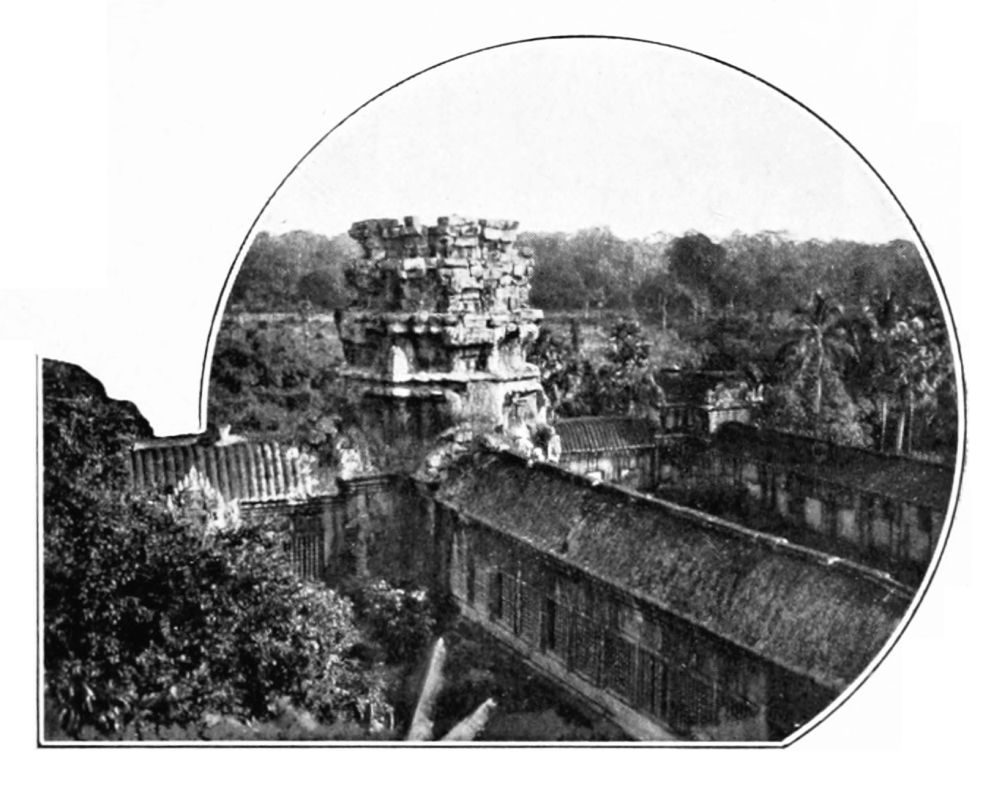

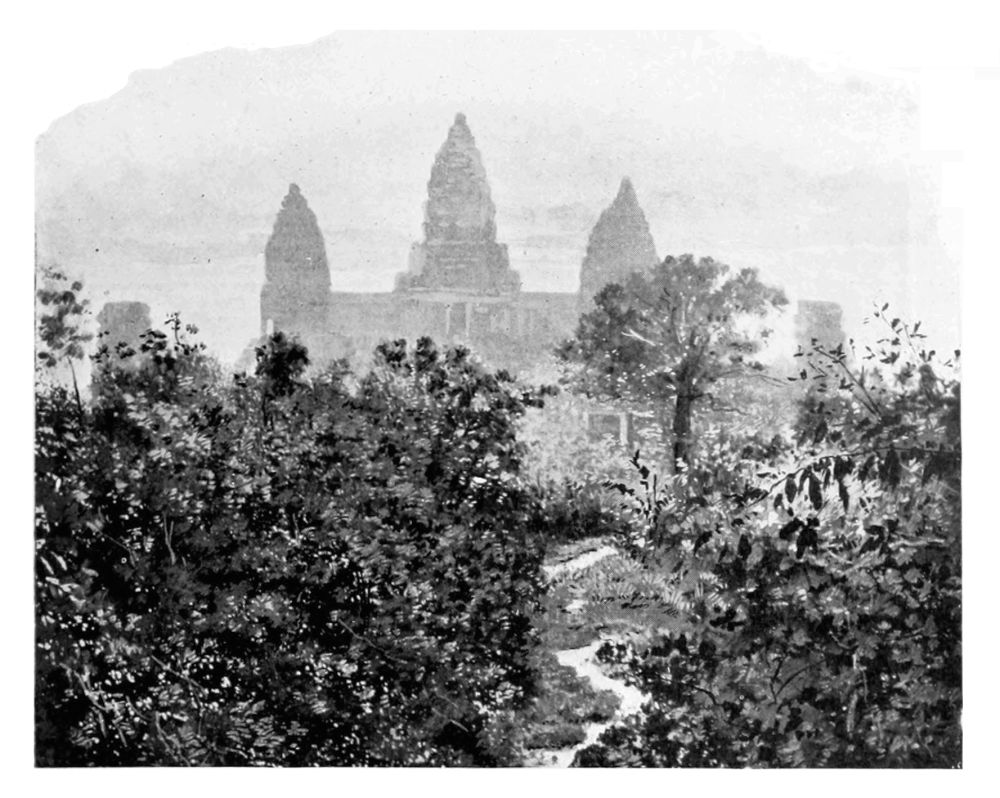
8 mars 1908.
Le départ est fixé au dimanche 15 mars dans l’après-midi. Nous irons coucher à Tay-Ninh où M. Prère est assez aimable pour nous offrir l’hospitalité. Déjà, il nous a donné une preuve, et bien précieuse, de l’intérêt qu’il porte à notre tentative, car il a tenu sa promesse et le fameux topo est arrivé. Je le dévore des yeux, j’y voudrais lire d’avance toutes les péripéties de ce voyage, mais peut-être vaut-il mieux ignorer l’avenir et garder « les longs espoirs et les vastes pensées ».
Les premiers renseignements du topo m’enchantent !
J’y vois que d’ici à Kreck nous n’aurons à traverser qu’un seul torrent où l’eau n’atteint que 40 centimètres… quelque chose comme une rue de Paris pendant la fonte des neiges : il nous suffira, comme disent les Angevins, de « guécher. »
La distance de Tay-Ninh à Kreck serait, d’après le topo, de 90 kilomètres environ…
90 kilomètres ? Mettons 200 pour ne pas risquer une amère désillusion, car la distance indiquée par mon topo est évaluée… à vol de télégramme ! C’est en effet la longueur du fil télégraphique qui réunit les deux villages, et à moins de le suivre en aéroplane (ce que nous ferons peut-être un jour !), cette route aérienne bénéficie de tous les avantages que les géomètres s’accordent à reconnaître à la ligne droite : elle ignore les malicieux sentiers qui tournent sur place et ne conduisent jamais où l’on voudrait aller.
Mes lecteurs pourront voir eux-mêmes ce fameux topo que je dois à l’obligeance de M. Prère. Ils se rendront compte aussi que Kreck est séparé de Kompong-Cham par 70 gentils kilomètres qu’il nous faudra avaler pêle-mêle avec les obstacles, sans savoir comment… à moins toutefois que le Résident de Kompong-Cham, M. Beaudoin, ne veuille bien venir à notre aide et nous tirer d’embarras, en nous donnant un autre guide. Je lui écrirai à cet effet, et je dois dire que le sens de sa réponse ne m’inquiète nullement. Je suis tranquillement sûr qu’il fera tout son possible pour nous seconder, car M. Lalande de Caland, que j’ai connu ici l’année dernière, puis revu en France, m’a vanté maintes fois l’amabilité de M. Beaudoin. Je sais déjà qu’elle est proverbiale.
Et puisque le nom de M. Lalande de Caland vient sous ma plume, je tiens à dire ici combien je regrette l’absence de ce compagnon charmant et de grande valeur. J’avais espéré qu’il pourrait venir en Cochinchine cette année et prendre part à notre voyage. Hélas ! des raisons indépendantes de sa volonté l’ont retenu en France. Il m’eût été si agréable de l’avoir près de nous, que j’ai ressenti une vraie peine en lui disant adieu à Paris, et je ne m’en console pas.
9 mars 1908.
Encore un contre-temps ! Les Messageries fluviales ne peuvent pas prendre mes colis de pièces de rechange pour Kompong-Cham. Et le temps passe… comme s’il n’avait rien de mieux à faire ! Nous devrions être partis depuis dix jours déjà, sans l’accident du débarquement !
Enfin, après nous être consciencieusement cassé la tête, nous n’avons trouvé pour tourner la difficulté qu’un seul moyen… et qui réalise à merveille le type du pis-aller : ce sera de nous résigner à nous faire suivre d’étape en étape par plusieurs charrettes à bœufs. Ainsi, nous marcherons bœufs à bœufs, côte à côte !
Cette résolution désespérée est tout naturellement suivie d’une dépêche à M. Prère pour lui demander quatre charrettes et un milicien comme surveillant.
La réponse ne se fait pas attendre, comme je l’avais espéré de l’infatigable obligeance de M. Prère ; j’aurai charrettes et soldat !
14 Mars 1908.
Il ne nous reste plus maintenant qu’à dénicher l’oiseau rare, le merle blanc… le cuisinier interprète, mais il faut croire que maître Jacques n’existe que dans Molière.
Toutes nos recherches demeurent vaines, et, en désespoir de cause, nous en sommes réduits à nous contenter de l’indéracinable Brin-d’Amour. Comme pis-aller, celui-là ne craint personne.
Il ne nous reste plus qu’à partir… et peut-être ne semblera-t-il pas inopportun, ni importun, de préciser le but et les raisons de ce voyage, que je souhaiterais plus utile qu’un « voyage d’agrément » et dont je voudrais que notre belle colonie pût tirer parti.
Oh ! je ne songe point à accomplir des exploits qui me classent d’emblée parmi « les hardis pionniers de la civilisation ». N’allez pas croire que je prétende égaler les Livingstone, les Stanley, les Francis Garnier, ou les Savorgnan de Brazza ! Je ne cherche même pas à éclipser mes glorieux émules de la grande confrérie des chauffeurs, ces héros de la course Péking-Paris dont les exploits ont, à tant de titres, étonné les deux mondes ! Ces audacieux coureurs, qui ne boivent que l’obstacle et ne dévorent que l’espace, n’ont point à s’inquiéter de ma modeste concurrence… Et quelle rivalité pourrait-on craindre quand on fait du 40 à l’heure à travers les rochers sur une auto, d’ailleurs traînée par des Chinois (car enfin, on ne peut pas voyager sans coolies ni bagages !) et quand on franchit des torrents et des rivières en quatrième vitesse ? Nul ne peut songer à renouveler de telles prouesses. Je ne cherche pas à établir un record et je ne veux pas lutter de vitesse avec des chauffeurs qui marchaient d’un train qu’on eût pu croire parfois transsibérien…
… Je ne veux tout simplement que voir ce que l’on peut faire avec un bon mécanicien et une bonne machine livrés à eux-mêmes dans des chemins jugés impraticables ! Et tout en poursuivant cette expérience, je serais heureux de parvenir à démontrer qu’il serait possible, sinon facile, d’établir un moyen de communication entre Saïgon et les merveilleuses ruines d’Ang-Kor-Thom et Ang-Kor-Vat, aujourd’hui inabordables pendant la saison sèche, et qui, pour cette raison, restent presque ignorées, alors qu’elles devraient être un de ces lieux de pèlerinage artistique, où, de tous les pays, viennent se réunir les Amants de la Beauté.
C’est devenu un lieu commun — et comme tant d’autres lieux communs, malheureusement trop vrai et trop souvent constaté — de répéter que les Français ignorent les beautés de leur propre pays et ne font rien pour les mettre en valeur. Cette indifférence s’étend, à plus forte raison, à notre empire colonial, dont il semble que l’on commence à peine à soupçonner l’existence.
Faudra-t-il donc attendre que des étrangers viennent nous révéler qu’un récent traité avec le Siam a enrichi notre Indo-Chine d’une des merveilles du monde ? Sans doute, l’élite de nos savants et de nos artistes sait bien que ces temples et ces palais d’Ang-Kor surpassent les plus belles ruines de l’Inde, mais tandis que l’Angleterre a su attirer à Bénarès, à Lahore, à Delhi, à Agra, tous les touristes qui visitent l’Asie, il ne s’est trouvé jusqu’ici que quelques audacieux (d’adorateurs zélés à peine un petit nombre !) pour risquer ce voyage d’Ang-Kor qui mériterait d’être classique. Cela tient à ce que, dans les circonstances actuelles, ce voyage garde les apparences peu encourageantes d’une expédition coûteuse et difficile. Pour aller à Ang-Kor il faut presque une âme d’explorateur ! Jugez-en plutôt.
Le pèlerin passionné qui a conçu le dessein de visiter les illustres ruines se trouve d’abord contraint de choisir la saison où il y a de l’eau dans les rivières et qui s’étend de juillet à janvier.
S’étant ainsi mis d’accord avec les éléments, le touriste prendra à Saïgon un bateau des Messageries fluviales qui le conduira jusqu’à Pnom-Penh, capitale du Cambodge. Cela représente déjà une petite traversée de quarante heures.
De Pnom-Penh, le touriste devra continuer jusqu’à l’entrée de la rivière de Siem-Reap : soit encore vingt-quatre heures de voyage ; après quoi les difficultés ne font que commencer, car, une fois parvenu à l’entrée de cette rivière, le touriste impénitent est déposé dans un sampan qui le conduit en vingt-quatre heures à trois ou quatre kilomètres de la ville de Siem-Reap.
Une fois là, il ne lui reste plus qu’à fréter une charrette à bœufs qui veuille bien le conduire jusqu’aux ruines. Et c’est encore l’affaire de plusieurs heures, en admettant que tout marche à souhait.
Tout cela ne serait rien encore, s’il ne fallait pas prendre la précaution indispensable d’emmener un cuisinier et d’emporter des conserves, des lits pliants, des bougies… en un mot, tout ce qu’il faut pour vivre pendant plusieurs jours sous un toit de quatre piquets décorés du nom de sala ; car ce voyage incertain et mal commode se complique de toute une partie de camping, fort dispendieuse, et qui exige un travail de préparation ; de sorte que les touristes qui n’ont pas pris le parti désespéré de mourir en route risquent fort d’arriver au terme du voyage harassés de fatigue, déprimés et furieux et dans un état d’âme et de corps… tout à fait incompatible avec l’enthousiasme et l’admiration.
Dans des conditions pareilles, l’on ne saurait s’étonner que les ruines d’Ang-Kor soient moins visitées que les Chutes du Niagara, l’Acropole ou le Tadj-Mahal !…
Comme certains grands artistes, elles sont d’un abord difficile.
Pour leur attirer une foule immense d’admirateurs, il suffirait de construire une route entre Saïgon et Ang-Kor et d’installer, à Ang-Kor même, un hôtel confortable et pratique.
Rassurez-vous !… Je ne demande pas que l’on déshonore ces ruines sublimes par le voisinage d’un de ces caravansérails luxueux et encombrants comme on en a trop construit, ces dernières années, au centre de Paris. Mais il n’est pas nécessaire de condamner à mourir de faim et de soif, de fatigue et d’épuisement les voyageurs qui voudront connaître les beautés de l’art cambodgien ! Et je souhaite seulement qu’un Français avisé ait l’idée d’ouvrir, à distance respectueuse des palais et des temples, un hôtel simple et propre qui permette aux touristes de séjourner le temps qu’il leur plaira entre Ang-Kor-Thom et Ang-Kor-Vat et d’admirer, tout à leur aise et sans crainte d’inanition, une des plus authentiques merveilles du monde.
Cet hôtel ne risquerait pas de manquer de voyageurs, mais encore faudrait-il une route pour les y conduire !
Cette route serait une belle œuvre d’utilité publique et mieux encore d’utilité française, et je voudrais que ce voyage servît à démontrer qu’elle n’est pas irréalisable.
On a beaucoup travaillé en Indo-Chine depuis quinze ans : car, si trop de Français ignorent les colonies, du moins ceux qui viennent s’y fixer ne perdent pas leur temps.
Quelques politiciens grincheux et qui, d’ailleurs, n’ont jamais quitté leur fief électoral, auront beau répéter que « les Français ne sont pas colonisateurs ! » C’est là une assertion gratuite et qui, pour cette raison, ne devrait plus trouver cours dans la presse. Et notre immense empire colonial suffit à lui donner un démenti assez rassurant.
Sur la vaste terre, comme dans leur propre pays, les Français se sont toujours montrés, entre autres choses, d’admirables constructeurs de routes. L’Indo-Chine leur doit déjà un réseau de grandes voies qui surpassent les plus anciennes et les plus belles de l’Extrême-Orient.
Espérons donc que la sage et méthodique activité de nos compatriotes s’emploiera bientôt à ouvrir ce grand chemin d’intérêt mondial qui reliera Saïgon, métropole de la riche et belle Cochinchine, aux ruines sublimes d’Ang-Kor-Vat et d’Ang-Kor-Thom : ce serait un immense bienfait pour la colonie et pour l’Art…
Mais voici assez de phrases, il s’agit de partir… et d’arriver. Tout est prêt, enfin ! Les pièces de rechange sont rendues à Tay-Ninh, d’où nous prendrons demain notre essor. Là, je les ferai charger sur les charrettes qui doivent nous accompagner.
C’en est fait, nous partons demain.
Tous nos amis sont d’ailleurs unanimes à déclarer que nous n’arriverons jamais ; ils ne nous cachent point l’agréable espérance de nous voir revenir au bout de quelques jours.
Nous verrons bien…
Dimanche 15 mars 1908.
Nous allons donc refaire aujourd’hui cette route de Saïgon à Tay-Ninh qui nous est déjà familière. Pour nous, le vrai départ ne datera que de demain, où nous nous élancerons dans l’inconnu.
Ce matin, nous sommes tous allés à la messe.
A deux heures, le cœur un peu serré tout de même à la pensée de quitter nos amis de Saïgon que nous reverrons Dieu sait quand ! nous nous rendons au garage d’Hippolito, où nous rejoignent le commandant Bertrand et M. de Mayréna.
La voiture est toute prête, en tenue de campagne. Rien ne manque, pas un boulon…
Nous disons adieu à Gustave de Bernis qui voudrait bien nous accompagner, mais qui se trouve forcé de rentrer en France, et nous serrons les mains de nos deux autres amis.
Allons ! nous prenons place, le fidèle Guérin au volant.
Le moteur ronfle ; il semble, en vérité, qu’il fredonne l’Invitation au Voyage. Nous démarrons, nous sommes partis ! Dès cinq heures, nous arrivons à la résidence de l’aimable M. Prère qui nous a offert l’hospitalité.
A Tay-Ninh, les charrettes nous attendent… et aussi les caisses qui contiennent les pièces de rechange.
Qu’elles sont belles, ces caisses ! mais qu’elles sont imposantes : elles atteignent des dimensions gigantesques, où je reconnais cette noble folie des grandeurs, qui est le péché mignon d’Hippolito. Notre première impression est que jamais tout cela ne pourra tenir dans les charrettes… et l’événement la justifie bientôt… Le contenant et le contenu refusent absolument de s’accorder. Tout est à refaire ! Il faut démolir les caisses, et empiler dans les charrettes, en équilibre instable, tous les accessoires : pneus de rechange, bidons d’essence, pneus de réserve, etc… Ce diable d’Hippolito aurait bien pu tout de même avoir le coup d’œil un peu plus juste. Sa mégalomanie nous contraint à une besogne de déménageurs qui nous prend toute la soirée.
Enfin, tant bien que mal, l’arrimage est achevé.
Les charrettes partent à la nuit, elles iront attendre notre passage à Kreck.
Après un bon dîner nous allons nous coucher… dormir, rêver peut-être. A demain les grandes émotions ! Et que saint Christophe nous protège !
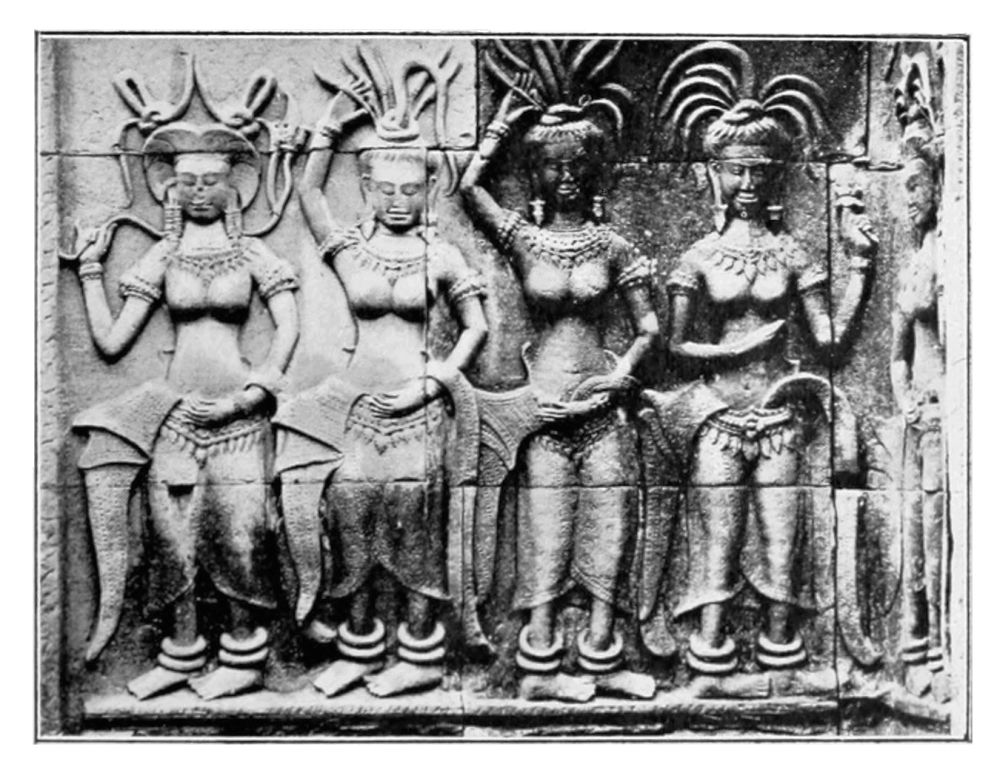


Lundi 16 mars 1908.
Cette fois-ci, c’est le vrai départ… le départ à l’aventure, l’embarquement pour ailleurs !
A six heures et demie du matin, après avoir fait nos adieux à M. Prère dont l’affectueux dévouement nous laissera toujours un si agréable souvenir, nous quittons la Résidence de Tay-Ninh… et les bienfaits de la civilisation. Jusqu’ici, il restait encore, pour ainsi dire, un peu d’Europe à nos semelles (Michelin) ; désormais, la vieille et mystérieuse Asie va nous prendre tout entiers.
Toutefois, nous n’abandonnons pas Tay-Ninh sans emporter encore une dernière preuve de l’amabilité de M. Prère… sous la forme de deux coqs qui ornent l’arrière de la voiture et d’une provision de cocos pour étancher notre soif de l’inconnu !
A peine partis, nous faisons connaissance sur la route de Tracop avec les émotions inséparables d’un premier début.
Nous n’avons pas fait cinq cents mètres que le moteur commence à pétarader, comme pour protester contre la dure besogne que nous allons exiger de lui.
Cette manifestation intempestive nous contraint à nous arrêter pour resserrer la tige d’allumage d’un des cylindres qui vient de se dérégler. (Voilà, je pense, ce que les reporters, dans leur langage un peu spécial, appellent : des précisions !)
Une demi-heure de réflexions et nous repartons !
Après quelques kilomètres parcourus sans encombre, nous laissons à droite la route de Tracop et nous prenons le chemin de Sockiet.
C’est déjà fini de rire !… Nous n’avançons plus qu’avec beaucoup de peine. De tous côtés, nous sommes envahis par cette végétation que tous les explorateurs s’accordent à qualifier de luxuriante : nous plongeons dans une vraie mer de feuillages, nous fonçons dans un inextricable lacis de branches…
Par bonheur, la solide capote remplit glorieusement ses fonctions d’éperon, elle brise et arrache tous les obstacles : elle plie, mais ne rompt pas.
Bon ! voilà maintenant que nous marchons ventre à terre : cela ne signifie pas, hélas ! que nous dévorons l’espace, mais que la machine touche ! Elle se heurte à toutes les aspérités de ce sol inégal et raboteux. Tant et si bien qu’il faut s’arrêter et se résigner à lui frayer la route, puisqu’elle ne peut pas l’emporter.
Et nous nous transformons en terrassiers… Ah ! comme l’on comprend que ces modestes travailleurs aient élevé la grève à la hauteur d’une institution… Encore ignorent-ils la rigueur implacable de cette atmosphère qui règne dans l’ombre chaude de la forêt. Ici le sabotage est interdit : et nous nous escrimons de notre mieux avec notre arsenal de pelles et de pioches.
Enfin ! la voie est ouverte ! Hervé de Bernis, ruisselant et joyeux, sifflote un air allègre… il appelle cela siffler au disque.
Nous remettons en marche… Pas pour longtemps !
Il nous faut bientôt faire connaissance avec un autre genre d’obstacle : l’enlisement ! Les roues se refusent obstinément à tourner dans le sable où la voiture s’enfonce jusque au-dessus des essieux.
De terrassiers, nous voilà devenus bûcherons. Dans la forêt qui nous enveloppe, nous coupons, taillons et abattons de menues branches feuillues. Cela fait un magnifique tapis d’une longueur de 200 mètres que nous étendons devant l’auto récalcitrante. Cet aimable procédé la décide à repartir.
Mais ne chantons pas victoire… la forêt nous ménage encore d’autres surprises, on dirait vraiment qu’elle se défend contre nous et se plaît à nous tendre des pièges.
A peine désensablés, un arbre nous barre la route. Et quel arbre ! Un phénomène végétal comme on n’en voit qu’ici !
A nous les haches et les scies ! Mais vraiment les bûcherons improvisés que nous sommes se sentiraient quelque velléité de jeter le manche après la cognée, si nous n’étions soutenus par la ferme volonté d’arriver et par l’horreur naturelle du demi-tour !
Enfin, le géant tombe sous nos coups, et nous repartons tout fiers… jusqu’à un autre arbre, qui semble nous dire ironiquement : On ne passe pas !
Il est d’ailleurs très pittoresque, ce second adversaire ! Négligemment incliné au-dessus de la route, mais retenu par la cime à un fouillis de lianes, il symbolise à merveille le déraciné de Maurice Barrès ! Le mal est que la voûte naturelle qu’il forme nous surplombe d’un peu trop près… Je passe quand même, mais la capote s’accroche à une liane, la secousse ébranle tout ce portique végétal, le déraciné se décroche et vient s’écraser à quelques centimètres de l’arrière de la voiture avec un fracas épouvantable. Nous l’avons échappé belle !
Pour nous redonner un peu de cœur, voici maintenant que les ornières se creusent et se multiplient sous nos roues. Il faut encore avoir recours à notre arsenal de pelles et de pioches et reprendre notre dure besogne de terrassiers… et nous n’avons à compter que sur nous-mêmes, pauvres Robinsons de la brousse. Autour de nous, c’est la solitude absolue… pas le moindre indigène, pas le moindre coolie.
Il est vrai que notre horizon est plutôt borné.
La triomphante inutilité de Brin-d’Amour s’affirme davantage à chaque obstacle. Sans doute, nous connaissions par ouï-dire la nonchalance orientale, mais elle pourrait passer pour la plus fiévreuse activité auprès de cette inertie « extrême-orientale » !… Ah ! non ! Brin-d’Amour ne pratique pas le culte de la vie intense ! Dans cette cité future dont nous menace le socialisme, Brin-d’Amour trouverait tout de suite une sinécure, il serait Inspecteur du Travail ou Ministre des Repos particuliers. Personne ne s’entend comme lui à regarder travailler les autres !
D’ailleurs, l’inaction même le fatigue. Et tandis que nous piochons, il va s’étendre à l’écart, en déclarant d’une voix lassée qu’il n’en peut plus et qu’il meurt de soif… On aurait mauvaise grâce à lui répondre qu’il n’est pas le seul : Brin-d’Amour n’en croirait rien !
Toutefois, je ne voudrais pas insinuer que notre boy représente toutes nos vaillantes populations indo-chinoises et je ne cherche pas à l’élever à la dignité de type général, quoique ce soit un type bien particulier ! Je me méfie des synthèses hâtives où les voyageurs se laissent trop souvent entraîner. Brin-d’Amour est un Cochinchinois qui ne veut rien savoir, il faut bien le constater, mais de là à conclure que tous les Cochinchinois sont paresseux, il y a loin !
Et la meilleure preuve que Brin-d’Amour ne doit pas suffire à jeter le discrédit sur toute sa race, c’est que le brave guide que nous a confié M. Prère fait tout ce qu’il peut pour nous venir en aide, malgré ses soixante ans bien comptés.
« Son Indolence Indo-chinoise » Brin-d’Amour devrait bien prendre exemple sur son courageux compatriote… Ce bon vieux, sec et noueux comme un sarment de vigne, montre une activité endiablée. Il est partout, il se multiplie, que dis-je ? il s’élève au carré.
Enfin, au moment même où nous reprenons notre route… (car, elle est bien à nous, puisque nous la frayons à mesure que nous avançons), un pénible accident vient attrister cette matinée, déjà si mouvementée. Pendant que nous nous servons de la voiture comme d’un bélier, pour nous ouvrir un passage à travers le fouillis de la forêt, notre pauvre Guérin a la main prise entre une grosse branche et la carrosserie. Au premier abord, je crains qu’il n’ait tous les doigts écrasés. Par bonheur, tout se borne à une forte contusion. Mais notre courageux blessé a beau tenter de nous rassurer, en nous faisant observer gaîment que « c’est la main gauche et que, par conséquent, ça n’a aucune importance ! » nous voyons trop qu’il souffre affreusement et nous déplorons de ne pouvoir mieux le soulager. Nous avançons en silence.
A une heure de l’après-midi, nous nous arrêtons près d’une mare. Ce serait le moment de déjeuner, mais nous sommes trop fatigués pour manger. En revanche, nous mourons de soif !
Une heure de repos nous rend quelque énergie.
Nous repartons. La chaleur se passe de commentaires ! Hervé de Bernis trouve la température « résolument ambiante ». Ce n’est pas trop dire.
Quant à moi, j’ai entamé dans mon for intérieur une lutte vaine et désespérée. Je me débats entre les incertitudes de la topographie dans l’espace, j’appelle de tous mes vœux le génie bienfaisant (les légendes locales en sont pleines) qui me dirait à quelle distance nous nous trouvons exactement de Sockiet, où nous aurons une rivière à traverser. J’avais d’abord espéré que nous pourrions arriver ce soir même à Kreck. Hélas ! je commence à pressentir qu’il va falloir en rabattre et remettre à un autre jour notre entrée triomphale dans cette ville !
Ma seule consolation me vient de la tenue admirable de la voiture à travers cette forêt… désenchantée : elle continue à rouler, puissante et régulière, sans donner signe de fatigue ni de chauffement. Vraiment, je conçois qu’un fervent de l’auto puisse en arriver à aimer sa machine, comme un cavalier aime son cheval. Et il ne faudrait pas beaucoup me pousser pour me faire avouer que les machines doivent avoir une espèce d’âme obscure, qui leur fait à chacune une personnalité mécanique. J’ai connu d’affreux tacots qui me paraissent assez représenter la canaille de l’automobile, de braves moteurs alertes, francs, mais malicieux comme des gavroches, d’autres solides et réguliers comme de bons bourgeois. Cette voiture-ci est vraiment une voiture de race !
Ah ! si les machines pouvaient parler, elle nous renseignerait mieux que l’inutile Brin-d’Amour ! Elle nous dirait peut-être combien de temps il nous faut marcher encore, pour arriver à Sockiet…
Tout à l’heure, je l’ai demandé à notre vieux guide : il m’a répondu de son ton le plus tranquille :
— Six heures !
J’en suis resté abasourdi… Six heures ! Comment ? Voilà sept heures que nous sommes partis : la distance de Tay-Ninh à Sockiet, ne dépasse pas, s’il faut en croire l’autorité du topo, 27 kilomètres, et il nous faut marcher pendant six heures encore ! J’ai beau me répéter que, selon la formule kantienne, le temps et l’espace sont des conditions subjectives de notre pensée, vraiment cette consolation métaphysique ne me suffit pas. Il me semble pourtant que nous avons, depuis ce matin, dépassé la vitesse moyenne de 2 kilomètres à l’heure !
Mais attention ! Une seconde !… voici du monde ! comme on dit chez Fursy. Quels sont ces inconnus qui s’avancent à notre rencontre ?
L’œil exercé et d’ailleurs perçant d’Hervé de Bernis les reconnaît pour des Cambodgiens. Je constate seulement qu’ils sont beaucoup et paraissent animés des meilleures intentions. Bientôt, ils entourent la voiture et profèrent à l’envi ces paroles confuses que l’Officiel qualifie de rumeurs en sens divers.

Brin-d’Amour daigne sortir de son apathie, pour prendre langue avec eux.
Ce sont, paraît-il, des habitants de Sockiet et des environs envoyés par le Résident pour nous aider à traverser la rivière.
Qu’ils soient les bienvenus et que la rivière nous soit propice, mais je ne la croyais pas si proche !
La voilà pourtant, cette rivière de Sockiet, qui va compléter notre liste d’obstacles pour cette première journée.
J’arrête sur les bords de la berge, presque à pic en cet endroit.
Et, comme à Paris, « tout le monde descend ».
Nous commençons par considérer notre nouvel adversaire ; au premier abord, elle ne semble pas bien terrible. Paisible et lente, elle n’a en ce moment que très peu d’eau, mais elle se distingue des rivières civilisées par l’absence de pont, qui donne quand même à réfléchir. Il va nous falloir la traverser par nos propres moyens avec la voiture qui ne s’en tirera pas sans un « bain d’essieux »… que je prévois avec quelque inquiétude.
Bernis et le fidèle Guérin partent en éclaireurs. Ils montent dans une barque et vont reconnaître le chemin à parcourir pour aborder, à la sortie du gué, sur la rive opposée.
Cette sortie ne se trouve pas précisément en face de la descente de notre côté, ce qui va nous forcer à traverser en biais 20 ou 25 mètres dans 40 centimètres d’eau.
Nos deux éclaireurs reviennent enchantés. Et, en effet, la difficulté ne semble pas jusqu’ici insurmontable.
Seul, le perfide Brin-d’Amour arbore un mystérieux sourire qui ne rappelle en rien celui de la Joconde. Est-ce que par hasard il pressentirait une de ces déconvenues qui le remplissent parfois d’une joie sournoise ?… Nous ne perdons pas notre temps à le questionner, bien sûrs d’ailleurs qu’il ne répondrait rien. Et chacun se met à l’œuvre.
On attache des cordes à l’avant de la voiture. De sa main valide, Guérin saisit le volant : les braves gens de Sockiet s’attellent à la besogne et aux cordes et tirent d’un effort unanime et soutenu par des onomatopées gutturales.
Plouf ! Voilà la Diétrich à l’eau !
Ses débuts aquatiques sont tout à fait rassurants. Tout va bien, je commence à respirer… quand tout à coup, au beau milieu de la rivière, la voiture s’arrête et manifeste l’intention la plus évidente de s’enfoncer : elle aura rencontré un de ces fonds de grève, comme il y en a tant dans le cours de la Loire, et le sable fin aura cédé sous un tel poids.
Le désespoir s’empare de nous : car nous assistons vraiment au naufrage de nos espérances ! L’eau monte à vue d’œil et menace de tout inonder : déjà le réservoir et la première malle ont disparu entièrement. Encore quelques minutes et c’en est fait de notre voyage.
Dans un tel désarroi, une première mesure s’impose : décharger la voiture. J’essaie de le faire comprendre à Brin-d’Amour, mais il se recueille dans son sourire qui ne traduit plus qu’un abrutissement complet.
Résistant au désir naturel de le jeter dans les 40 centimètres d’eau de la rivière, je saute dans la barque et m’adressant aux hommes de bonne volonté, je me mets à pousser des cris inhumains, auxquels répondent à la fois soixante Cambodgiens et Annamites. Nous hurlons tous en même temps et cela forme une cacophonie à décourager tous les véristes italiens !
Enfin, sans qu’on puisse savoir pourquoi, Brin-d’Amour se décide à comprendre. Il parle au peuple et l’on se met à exécuter mes ordres ; mais pendant ce temps, la voiture s’est enfoncée un peu plus.
Je revivrai toujours ces moments d’angoisse… Je reverrai toujours ce brave Guérin, de l’eau jusqu’aux genoux, cramponné désespérément au volant et ne se souciant plus de sa blessure. Il symbolisait vraiment le devoir et rien ne lui aurait fait abandonner sa machine.
Enfin, à force de hurler et de tirer sur les cordes, les indigènes finissent par amener sur la rive opposée une masse grise et ruisselante… qui, sous le soir qui tombe, ressemble à la fois à un chat mouillé et à un vieux parapluie. Il faut un effort d’imagination pour reconnaître notre vaillante Diétrich dans cette chose informe et pitoyable. A l’intérieur tout ruisselle, mes jumelles, le télescope de ma carabine, un kodak qui n’a plus rien d’humain ! Les cartouches sont en bouillie et l’eau se précipite en cataractes de la machine, comme d’un moulin à eau.
Comment pourrons-nous jamais réparer de tels dégâts ?
Mais ce n’est pas l’heure de s’attarder à ces tristes réflexions.
La nuit vient avec cette rapidité que connaissent bien tous ceux qui ont voyagé en Extrême-Orient.
Nous ne pouvons pas rester là : il faut gagner le village le plus proche.
Renseignements pris, c’est Tapang-Prey, dont nous sommes encore éloignés de 6 kilomètres.
Mais aucun de nous ne veut se résigner à abandonner la voiture ! Cela nous paraîtrait une sorte de trahison !
Je demande si l’on peut trouver dans les environs des bœufs ou des buffles pour traîner la machine. On me répond qu’il n’y en a qu’au village, où il n’est plus temps d’aller les chercher… Évidemment, à cette heure-ci, les coccinelles sont couchées et tout porte à croire que les bœufs en ont fait autant. Ces braves bêtes ne sont guère préparées à un service de nuit ! Il reste bien la main-d’œuvre annamite ! Et si les soixante indigènes qui entourent la voiture et la considèrent avec une admiration craintive voulaient la tirer jusqu’au village… Mais comment entamer les négociations ? Là se manifeste encore l’influence providentielle de M. Prère !
Après cinq minutes d’inutiles palabres avec celui qui me paraît le chef de toute cette foule, je me décide à sortir de ma poche un papier précieux que je brandis victorieusement. A son seul aspect, mon bonhomme change de visage : il le lit en donnant toutes les marques extérieures du respect et le fait lire à ses compagnons qui poussent des grognements approbatifs et révérencieux.
Voici la teneur exacte de ce talisman qui va changer la face des choses et des hommes :
Chang’h, Bo. Quan’
Ordre aux chefs et sous-chefs des cantons et aux notables des divers villages de la province de Tay-Ninh qui s’y conformeront.
M. le duc de Montpensier a l’intention de se rendre à Kreck et de continuer ensuite son voyage d’exploration jusqu’à Kompong-Cham (Grand Fleuve).
Si en route, il a besoin de coolies, de charrettes à bœufs ou à buffles, de chevaux ou de bœufs, il faut les lui fournir le plus vite possible.
Je vous prie de faire savoir aux coolies, propriétaires de charrettes, de chevaux et de bœufs, qu’ils seront largement payés par M. le Duc. Je leur promets que si M. le Duc ne les payait pas, je les paierai de mon propre argent.
Les autorités cantonales et communales qui ne se conformeraient pas à cet ordre seront très sévèrement blâmées.
Tay-Ninh, 14 mars 1908.
L’Administrateur,
Signé : Prère.
Ah ! que l’on serait mal venu à nier l’influence morale de la littérature ! Aussitôt qu’il eut pris connaissance de ce précieux document, le chef se répandit en lays, ce qui veut dire en protestations de dévouement ; et sa réponse, d’une prolixité extrême-orientale, peut se résumer ainsi :
— C’est parfait ! Je vais faire tirer la voiture jusqu’à Tapang-Prey par ces messieurs (et son large geste embrassait toute la multitude) à raison de cinquante cents par homme…
Le prix du cent n’a de valeur fixe que dans le répertoire de l’Ambigu. Ici il représente le centième d’une piastre et les prétentions du bonhomme s’élèvent donc à une demi-piastre par tête. Étant donné le nombre de ces modestes auxiliaires, dont les deux tiers n’auront absolument pour toute besogne qu’à regarder travailler les autres, à moins de les gêner par un zèle encombrant et intempestif, la petite note paraît, si l’on peut dire, au-dessus de la portée !… Mais, ma foi tant pis ! Devant la joie de sortir d’embarras, j’accepte sans discuter.
Et, maintenant tranquille, je laisse la voiture sous la garde d’Hervé de Bernis et du fidèle Guérin, et nous nous mettons en route gais et contents, le compagnon et moi.
Chemin faisant, ayant eu l’heureuse idée d’emporter ma carabine-fusil, j’abats, à travers la nuit qui descend sur la forêt, plusieurs coqs sauvages et un magnifique singe, au grand amusement des Cambodgiens qui nous servent d’escorte.
Et nous avançons lentement à la lueur des torches qui réveillent les oiseaux sur les branches.
Enfin, nous nous arrêtons devant la canha qui doit nous servir de logement.
Mon Dieu ! ce n’est pas un château des bords de la Loire ! (et peut-être fallait-il s’y attendre quelque peu). Pourtant la simplicité de sa construction ne laisse pas que de nous plaire. Par un effort d’imagination à la portée des intelligences les plus primaires, qu’on se représente quatre gros piquets surmontés d’un toit en paillote (paille de riz). Cela rappelle ces kiosques champêtres que les braves épiciers en retraite font dresser au fond de leur jardin.
J’ajouterai, avec une précision géométrique, que notre kiosque a la forme d’un rectangle de six mètres environ sur trois.
Un immense lit bas, qui peut servir aussi de table, remplit presque tout l’intérieur.
Dans un coin, nous découvrons une pièce de bois dont la forme singulière nous intrigue. C’est, paraît-il, une cangue pour les prisonniers. On ne saura jamais ce qu’elle peut bien faire là. Je la soupèse, elle me semble d’une légèreté tout à fait engageante. Au fond, cet instrument de supplice sur lequel on a versé tant de littérature humanitaire ne doit pas être beaucoup plus gênant qu’un faux col fortement empesé. On l’inflige plutôt aux prisonniers comme une marque d’infamie dont ils paraissent d’ailleurs se soucier tout autant qu’un poisson d’une banane. A mon vif regret, je ne puis donc en tirer des effets de terreur pour mes lecteurs bénévoles.
Quant aux murs de la canha, la description que j’en ai tentée suffit à démontrer qu’ils sont remplacés par la plus franche cordialité.
Sous le toit de paille que soutiennent les quatre piquets, tous les vents peuvent circuler librement. Du reste, on peut être tranquille : ils n’abuseront pas de la permission.
Nous n’avons même pas de mur Guilloutet pour nous dérober aux regards indiscrets — et ces bons Cambodgiens, comme tous les peuples d’Extrême-Orient, sont encore plus badauds que les gavroches parisiens ou les cockneys de Londres. Aussi, notre vie privée risque fort d’attirer l’attention. Enfin, je ferai poser les toiles de tente et des nattes contre les piquets.
En attendant l’arrivée de l’auto, nous commençons à nous installer. Quelques braves Cambodgiens nous apportent des noix de coco, des œufs et du riz, de quoi faire tous les frais d’un banquet de végétariens.
Pendant que nous le préparons, une rumeur lointaine nous annonce que notre pauvre machine approche, traînée par les coolies… Cela grandit, grandit, puis éclate en un vacarme étourdissant qui participe à la fois de l’émeute… et de la meute. Une assemblée parlementaire ne parviendrait pas à faire tant de bruit, même en renversant un cabinet. Je me précipite au-devant de ces virtuoses.
Quelle vision d’enfer !… aux flammes vacillantes des torches qui empourprent la foule hurlante, la Diétrich semble un dragon monstrueux capturé par tout un peuple et ramené en triomphe. Tirée, poussée, traînée, bousculée par cent bras, elle oscille, roule et tangue au-dessus de ces flots humains et l’on dirait maintenant un navire en détresse.
Enfin le cortège, Guérin au volant, s’arrête près de la canha.
Nous nous précipitons à l’assaut de la voiture pour en retirer les malles, la cuisine, les sacoches.
Hélas ! la malle à effets est transformée en aquarium ! Et quant à la cuisine, c’est à croire que tous les mauvais génies de la forêt s’en sont servis comme d’alambic pour composer une bouillabaisse ensorcelée… le thé, le curry, le sucre, la farine et le sel se confondent en une sauce indescriptible.
Par une chance dont il faut se louer, la malle supérieure qui contient la pharmacie et les conserves a échappé au naufrage.
Quant à notre pauvre machine, elle ne gagne pas à être vue de près.
Elle rappelle ces choses dont Bossuet a parlé quelque part (d’après Tertullien, d’ailleurs !) et qui n’ont plus de nom dans aucune langue.
Mais les nécessités immédiates du campement ne nous laissent point le loisir de nous attarder à déplorer notre infortune… Il faut encore, après tous les avatars de cette journée funeste, nous transformer en cuisiniers…
D’un geste empreint d’une mâle décision, j’ouvre deux boîtes de tripes et, brandissant une casserole, je me mets à faire chauffer notre dîner. Oh ! ce n’est pas que l’appétit nous talonne : nous sommes bien trop tristes et trop fatigués pour que notre pauvre repas nous semble un plaisir. Rien ne prête d’ailleurs à ces douces causeries qui sont le charme et l’excuse des joies gastronomiques.
Enfin, cette formalité vite expédiée, nous faisons disposer des malles et des tentes autour de notre canha qui manque vraiment d’intimité. Une fois à l’abri des regards indiscrets et indigènes, nous montons nous-mêmes les lits pliants sur la grande table centrale. Prévoyant qu’il nous faudra rester ici plusieurs jours, pour nettoyer la machine et vider l’eau des réservoirs, je fais envoyer un coolie à la recherche du milicien qui nous ramènera les charrettes.
Enfin, nous nous couchons, brisés de fatigue.
Mais la fatigue n’a pas toujours cette vertu dormitive que les médecins de Molière reconnaissent à l’opium. Devant mes yeux ouverts dans l’obscurité de la canha, passent et repassent tous les événements de cette triste journée. Vraiment ce voyage entrepris de si bon cœur aurait mérité de mieux commencer. Je comptais bien sur les émotions inséparables d’un premier début ! mais je ne les avais prévues ni si variées ni si désagréables. Je rêve tout éveillé aux merveilles d’Ang-Kor… Elles me paraissent lointaines et comme irréelles. Quels nouveaux obstacles vont se dresser devant nous avant que surgissent au-dessus de la forêt mystérieuse les tours des palais et les coupoles des temples ? Et verrons-nous jamais la Ville au Bois dormant ?
Le voyageur s’interroge avec angoisse… et l’automobiliste lui répond avec une précision tout arithmétique :
— Nous avons roulé une journée entière… et comment !… à travers la brousse cochinchinoise. Et après tant d’efforts qu’avons-nous fait ? 40 kilomètres !… et avec une voiture qui, sur une route ordinaire, n’eût pas mis une demi-heure à parcourir le même trajet.
Or, tout permet de présumer qu’à mesure que nous avancerons les routes deviendront plus impraticables, en admettant même qu’il y en ait.
Donc…
Par bonheur, mes yeux se ferment avant d’avoir entrevu la conclusion de ce syllogisme désenchanté.

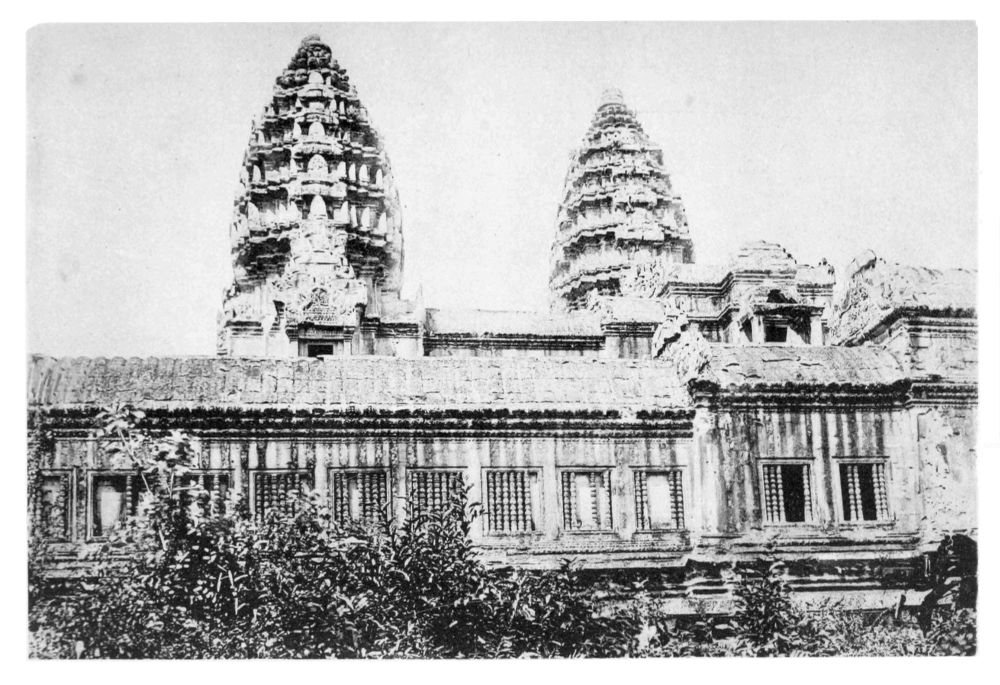

17 mars 1908.
Quelle nuit !… Et quand je pense qu’il se trouve à Paris ou à Londres de braves gens qu’incommode le sifflet lointain d’une locomotive ou que réveille en sursaut le fracas de la voiture du laitier ! Nous avons laissé en Europe des amis qui nous envient peut-être, qui se disent de nous parfois :
— Oui, leur voyage sera plein de péripéties, de fatigues… mais quel délicieux repos une fois arrivés à l’étape ! Quel sommeil profond et sans rêves dans le grand silence de la campagne indo-chinoise ! Là, pas de tramways, pas de fiacres, pas de pianos, pas de phonographes, pas de sirènes d’automobiles !
Ah ! s’ils pouvaient connaître leur bonheur ! O fortunatos nimium, sua si bona norint !
Ce matin, nous en sommes à regretter tous ces bruits qui bercent le sommeil des grandes capitales européennes. Roulements de fiacres, sifflets des gares, timbres des tramways matinaux, trompes d’autos, cela n’est que rumeur berceuse et discret murmure auprès du concert asiatique et barbare, mais gratuit et obligatoire, que nous ont donné toute la nuit les chiens des environs.
Aucun vacarme humain ne se peut comparer à cette cacophonie diabolique. Si encore les roquets de ce pays-ci menaient leur musique sans discontinuer, s’ils hurlaient toute la nuit, peut-être finirait-on par s’y habituer, comme le meunier au tic-tac de son moulin, et par ne plus les entendre… Mais ces terribles tapageurs nocturnes ignorent les charmes de la mélodie continue ; ils ne sont pas même wagnériens, ils prennent des temps, ils font des pauses : au moment même où leurs auditeurs bénévoles se sentent le cerveau près d’éclater, ils s’arrêtent comme par un secret accord et l’on jouit alors délicieusement de ce silence qu’on n’espérait plus : on se laisse aller aux premières douceurs du sommeil… Mais, tout à coup, un des exécutants reprend sa partie ; sa voix excite tous les autres et le concert recommence, crescendo et rinforzando jusqu’à l’ensemble final qui s’exaspère en un indescriptible charivari…
Et qu’ils soient cambodgiens ou cochinchinois, ces virtuoses à quatre pattes ne se contentent pas d’aboyer bruyamment mais décemment, comme tout chien qui se respecte. Leur infatigable gosier émet un cri étrange, intraduisible même en polyphonie canine, un son qui décourage l’onomatopée et participe à la fois du miaulement du chat et du grognement du cochon… Comme ne craindrait pas de le dire M. Edmond Rostand :
Cela vous entre dans le cerveau comme la vrille dans une planche et vous taraude l’entendement jusqu’aux limites de la folie furieuse.
Ah ! le voilà, le voilà bien le grand silence de la campagne indo-chinoise !
Dans de pareilles conditions, l’on ne s’étonnera point que nous ayons ce matin devancé l’aurore aux doigts de roses… N’ayant pu fermer l’œil de la nuit, malgré toute notre fatigue, nous n’avons pas même eu la peine de nous réveiller.
La tête lourde, les yeux rouges et les membres engourdis, nous quittons pourtant sans regret nos lits pliants, soutenus par l’espoir de nous réconforter avec le petit déjeuner dont la préparation toute sommaire fut commise hier soir aux soins de Brin-d’Amour.
A ce seul nom, plein de promesses, le lecteur perspicace aura deviné l’effet de cette confiance exagérée : pas plus de petit déjeuner que de restaurants aux environs !
Interrogé sans aménité, Brin-d’Amour semble trouver que notre enquête affamée frise l’indiscrétion : et à toutes nos questions, il se contente d’opposer cette ironique et paisible fin de non-recevoir, bien indo-chinoise :
— N’a pas moyen !
En effet, ce doux philosophe n’a rien préparé, ni feu, ni eau pour faire cuire notre café, ce précieux café, qui, lui du moins, fut sauvé des eaux… et qui d’ailleurs continue !
Vraiment Brin-d’Amour réalise, au delà de toute espérance, le type du boy à tout faire !
Par bonheur, notre fidèle compagnon se propose pour remplir l’intérim et suppléer aux défaillances de notre cuisinier. Nous acceptons avec joie et nous facilitons de bon cœur cette transmission de pouvoirs.
Tandis que l’eau bout, nous sortons de la canha, Hervé de Bernis et moi ; puis, aidés par de braves Cambodgiens, plus débrouillards que Brin-d’Amour, nous tendons des cordes entre l’auto et les piliers de notre demeure improvisée pour y suspendre notre linge et nos effets qui restent tout trempés de la baignade d’hier. Cela ressemble aux préparatifs de quelque fête locale et nous pavoisons de notre mieux ! Guérin, lui, procède à une revue d’installage en règle, c’est-à-dire qu’il vide les coffres de la voiture et dispose toutes les pièces sur l’herbe pour les faire sécher. On dirait un véritable bazar, mais notre brave mécanicien ne semble pas s’affoler parmi tout ce bric-à-brac.
J’envoie un coolie à cheval, avec la mission de réunir ici toutes nos charrettes. Elles représentent nos troupes de réserve et désormais elles nous suivront prudemment, car notre première journée fut pleine d’enseignements, comme tous les ennuis de ce monde, et nous tâcherons au moins d’en profiter.
Le fidèle compagnon ayant réussi à merveille dans la préparation de ce café qui commençait à nous paraître illusoire, nous reprenons quelques forces, et, munis d’un nouveau courage, nous nous mettons à démolir la magnéto, les réservoirs d’huile et nous vidons l’essence dans de grandes jarres. L’eau a pénétré partout, c’est à croire que notre pauvre voiture est restée aussi longtemps submergée que les galions qui dorment dans la baie de Vigo… Comme nous les donnerions tous de bon cœur pour la voir repartir !
Cependant, le compagnon, encouragé par le succès, s’occupe activement de la cuisine : il prépare des merveilles. En effet, l’un des coqs dont M. Prère nous fit le généreux présent ayant rendu son âme sonore, va faire les frais d’un déjeuner sardanapalesque… Ce sera la dernière de Chantecler. Déjà !
Je ne parle pas de la chaleur… mais rassurez-vous, elle est toujours là : comme l’impôt dans un régime parlementaire, elle augmente. On se demande avec quelque inquiétude ce qu’elle deviendra vers midi… Notre brave Guérin, lui, ne paraît guère s’en soucier. Étendu sous la machinerie de la voiture, il ne songe pas même à déplorer l’absence d’une fosse qui faciliterait son travail : non, ce qu’il lui faut, c’est du fer, du plomb… et puis des clefs anglaises. De temps en temps, sa voix nous parvient étouffée et profonde comme si elle sortait d’un puits. Et cette voix impérieuse réclame des tas d’instruments compliqués et bizarres. Pour les lui passer il faut prendre la précaution de les envelopper d’un chiffon… puis de les laisser tomber dans un baquet d’eau froide : car, telle est la curieuse propriété de l’acier, il exagère toujours sur la température ! Tous ceux qui ont fait l’exercice savent qu’en hiver ce diable de flingot trouve toujours moyen d’être plus froid que l’air extérieur et de vous geler les doigts pendant la manœuvre. Ici, comme dirait le fusilier Pitou, c’est la même chose, excepté que c’est tout le contraire ! Ces gredines de clefs anglaises ou françaises, quelle que soit leur nationalité, ramassent toute la chaleur du soleil et la concentrent si bien qu’elles deviennent intangibles. La femme de Barbe Bleue s’y serait brûlé les doigts et cela eût évité du reste bien des ennuis à son époux !
Enfin, à force de clefs et de patience, voici entre nos mains cette petite âme mystérieuse de la voiture : la magnéto. Il ne s’agit plus que de la démonter entièrement et de la nettoyer à fond. Nous nous tirons avec une aisance dont nous sommes fiers de cette besogne compliquée ; toutefois le remontage ne se fait pas sans hésitations et nous gardons quelques doutes sur notre habileté professionnelle. A l’épreuve nous verrons bien.
Mais quel déjeuner réconfortant et consolateur ! Le coq de M. Prère réunit tous les suffrages ; il pourra se vanter, si la métempsychose lui ménage une autre existence, d’avoir eu les honneurs d’une belle oraison funèbre. Et comme nous nous applaudissons d’avoir destitué ce malencontreux Brin-d’Amour, à qui Guérin vient de décerner le nouveau surnom de Bec-dans-l’huile !
La chaleur tient toutes ses promesses du matin. Je ne l’évaluerai pas en degrés centigrades de peur de ne pas être pris au sérieux.
Nous serions bien tentés de nous livrer aux douceurs de la sieste… ce point d’orgue de la vie coloniale, mais nous avons trop à faire. Le soldat que j’avais envoyé en mission vient de rentrer avec toutes nos charrettes. Il va falloir installer un véritable campement.
Pourtant, comme nous ne pouvons pas vivre uniquement de conserves, Bernis s’offre à la corvée de viande fraîche et part pour la chasse avec quelques Cambodgiens qui cumulent les fonctions de guides, de piqueux et de rabatteurs.
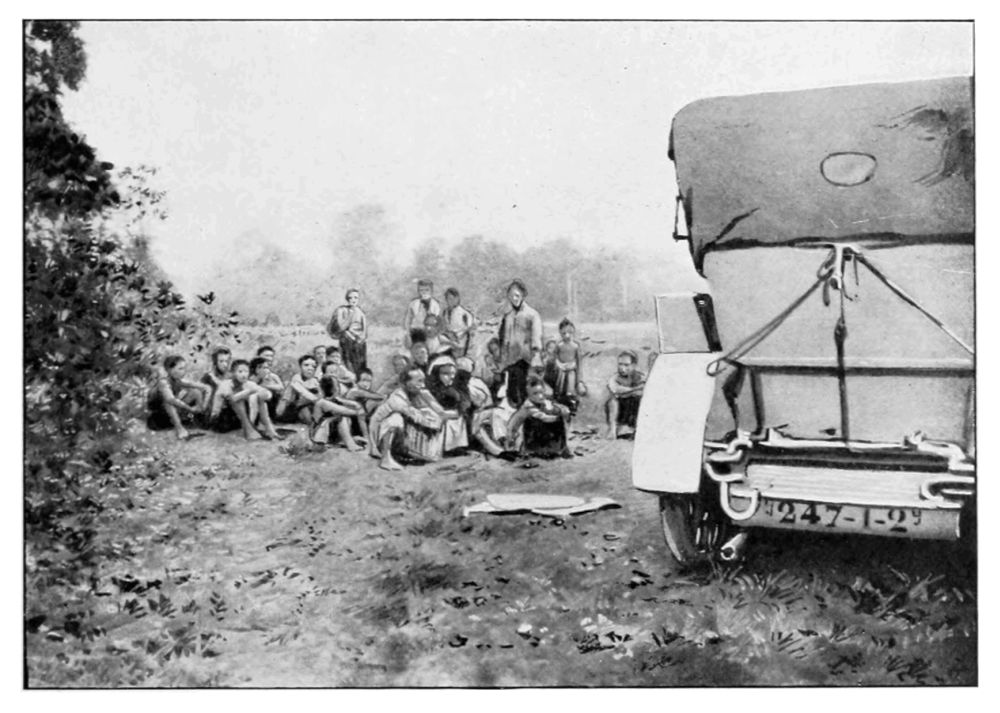
L’après-midi nous ménage un agréable intermède. Le chef du village, accompagné de plusieurs femmes aux yeux bridés et malicieux, vient nous rendre visite et nous apporte en cadeau de bienvenue des œufs et du riz. Cette petite cérémonie se passe le mieux du monde et, comme disent les reporters mondains, la plus franche cordialité ne cesse de régner.
Le chef parti, nous nous remettons au travail ; car, puisqu’il est à prévoir que nous serons forcés de passer quelques jours ici, le camping devient une nécessité.
Sous la ferme direction du compagnon, la canha commence à prendre un autre aspect. Sans doute on n’y saurait trouver cette intimité qui fait la gloire de la Hollande et même de quelques maisons françaises : cela manque de tableaux, de gravures, de bibelots et de livres familiers, mais tout de même, notre repaire a presque l’air habitable. Nos lits pliants sont perchés sur cette vaste estrade qui sert de lit de camp aux indigènes, les fusils et les cartouches sont alignés en bon ordre sur une espèce de table, les provisions s’empilent dans un coin en parfaite symétrie avec la toilette et la pharmacie qui se dressent en face ; et les deux lampes à acétylène accrochées aux colonnes qui soutiennent la toiture verseront des torrents de lumière dans notre paisible intérieur.
Comme il n’est point de bonheur parfait, voici une nouvelle inquiétude : notre pauvre Guérin se plaint de sa main blessée. Et c’est encore le compagnon, qui, ne craignant pas de se livrer à l’exercice illégal de la médecine, révèle un excellent « libre panseur ». Ses soins intelligents parviennent à calmer la souffrance de notre brave mécanicien (ceci n’est pas une réclame).
L’heure du dîner approche… et nous comptons fortement sur le retour de notre Nemrod pour corser le menu qui n’est pas des plus variés. Il se fait bien attendre… mais c’est sans doute que le produit de sa chasse l’encombre et retarde sa marche.
Enfin, les cris des Cambodgiens nous annoncent son approche.
Nous nous précipitons à sa rencontre, le cœur en fête… et l’estomac en liesse ! Hélas, sa triste mine nous dispense de le questionner. Il n’a point cette allure triomphale qui convient au chasseur heureux.
Il ne nous rapporte en effet que… ce que les Espagnols appellent : la Bota, c’est-à-dire en bon français qu’il rentre bredouille.
Le dîner se ressent un peu de cette désillusion et notre nuit blanche commence à nous peser.
Pourtant, comme il nous répugne de nous coucher au sortir de table, nous prolongeons la veillée en organisant, pour l’ébahissement des indigènes, la petite fête d’une illumination. Il nous suffit pour cela d’installer sur le devant de la cabane un des phares à acétylène… Jamais Ruggieri n’a obtenu un tel succès. Et nous connaissons la joie de faire acclamer les merveilles de la science par une population éclairée… à giorno ! L’enthousiasme enfantin de ces braves gens leur vaudrait la sympathie d’un syndicat d’instituteurs primaires : ils y verraient le symbole de la raison dissipant les ténèbres de l’obscurantisme. Mais en fait de symboles, les peuples d’Extrême-Orient ont trouvé mieux que cela… et depuis longtemps, et je ne pense pas qu’ils soient sur le point de renier leurs dieux pour adorer l’acétylène ou le magnésium. Quels barbares !… Enfin, ils se sont bien amusés, c’est l’essentiel… Ils ne se fatiguent pas du spectacle, ils en voudraient encore, toujours ! Et leurs cris de joie se prolongent jusqu’à ce que nous soyons étendus sur nos couchettes où j’espère que l’excès de la fatigue va enfin nous procurer le sommeil.
18 mars 1908.
… J’avais compté sans Tay-Ninh !… C’est ainsi que nous avons surnommé le survivant des deux coqs offerts par M. Prère. Dès les premières lueurs de l’aube, Tay-Ninh, qui partage notre canha, la remplit des cocoricos les plus véhéments : sans doute il pense qu’il y va de l’honneur de sa race et remplit en conscience son rôle de réveille-matin. Il ne se décide à se taire que quand il voit tout le monde debout. Tout le monde… sauf moi, hélas, qui souffre d’un accès de fièvre et me résigne à profiter de ce silence inespéré pour faire la grasse matinée.
Il faut bien en convenir et donner raison au librettiste de Galathée :
Les yeux fermés, j’entends à travers une vague somnolence les pas assourdis de mes compagnons et les bruits légers du dehors. Je me reproche ma paresse, mais le sentiment même de mon inaction ne va pas sans volupté et durant quelques heures je jouis délicieusement de ce sommeil conscient, que la fièvre anime de rêves précis et rapides. Je me crois arrivé au but de notre voyage et je vois se dresser les pagodes d’Ang-Kor… oui ! je les vois, et d’une vision si nette que plus tard la réalité ne me paraîtra pas plus vraie. Puis ce sont des visages amis, des paysages de France et d’Angleterre qui défilent avec une vitesse de cinématographe.
La voix de Bernis qui clame que le déjeuner est prêt m’arrache à mes rêves. Honteux et confus, je saute à bas de ma couchette. Mais tout mon rôle de convive se borne à regarder manger mes compagnons, tout en enviant leur appétit.
Et je ne résiste pas ensuite à la tentation d’une petite sieste, tandis qu’Hervé de Bernis et Guérin démontent péniblement la voiture.
Vers quatre heures, mon accès de fièvre passé, je me retrouve plein des résolutions les plus viriles. Je n’ai que l’embarras du choix… je choisis la chasse, non seulement parce que c’est un de mes passe-temps préférés, mais parce que, comme sur le radeau de la Méduse, les vivres commencent à manquer.
Après une sortie de deux heures, je suis assez heureux pour rapporter un lièvre et une superbe biche… Je me dérobe aux félicitations. Cependant, notre linge ayant profité de la température pour devenir sec comme de l’amadou, je retrouve mes amis affairés, en train de le ranger dans l’immense malle… qui, suivant l’exemple de toutes les malles connues (depuis la malle des Indes jusqu’à la valise diplomatique), se trouve à présent trop petite pour tout contenir. Enfin, on parvient à la fermer par la force du raisonnement, aidé de solides ficelles.
Et, malgré les splendeurs gastronomiques de notre dîner, je ne me console pas de cette journée perdue.
19 mars 1908.
Morphée n’a point touché le seuil de la canha !… Le concert cynégétique a pris cette nuit les proportions d’un festival monstre. Les hurlements ont alterné avec les glapissements et tous les roquets des alentours ont donné de la voix.
Stimulé par la concurrence, notre Chantecler Tay-Ninh s’est mis de la partie et depuis trois heures du matin n’a cessé de lancer à intervalles égaux son cri perçant et joyeux.
Décidément il faut aller dormir ailleurs ! Nous en avons assez ! Coûte que coûte nous partirons après déjeuner. Le brave Guérin, tenant du moins à tirer parti de son insomnie, se lève avec le soleil pour faire le graissage de la machine. Il croit pouvoir affirmer que tout ira comme sur des roulettes. Mais à peine notre décision prise de quitter Tapang-Prey et ses virtuoses nocturnes, voici que se rouvre l’ère des complications : un de nos conducteurs de charrettes vient de tomber malade et me demande de le laisser partir. Le fait est que le pauvre diable arbore une pâleur aussi navrante que son teint le lui permet… une pâleur qui ne lui permettrait même pas de figurer honorablement dans un syndicat de jaunes !… Je m’en sépare à regret et nous voilà donc réduits à trois charrettes au moment précis où nous nous trouvons obligés de soulager la voiture qui risque de tourner au bazar ambulant. Il faut donc absolument louer deux autres véhicules qui transporteront les lits, la cuisine et une malle. La matinée se passe à ces négociations, qui ne marchent pas toutes seules ; enfin nous convenons que les deux dernières charrettes n’iront que jusqu’à Kreck et que nous en prendrons d’autres de village en village. Mais encore faudra-t-il assurer nos relais.
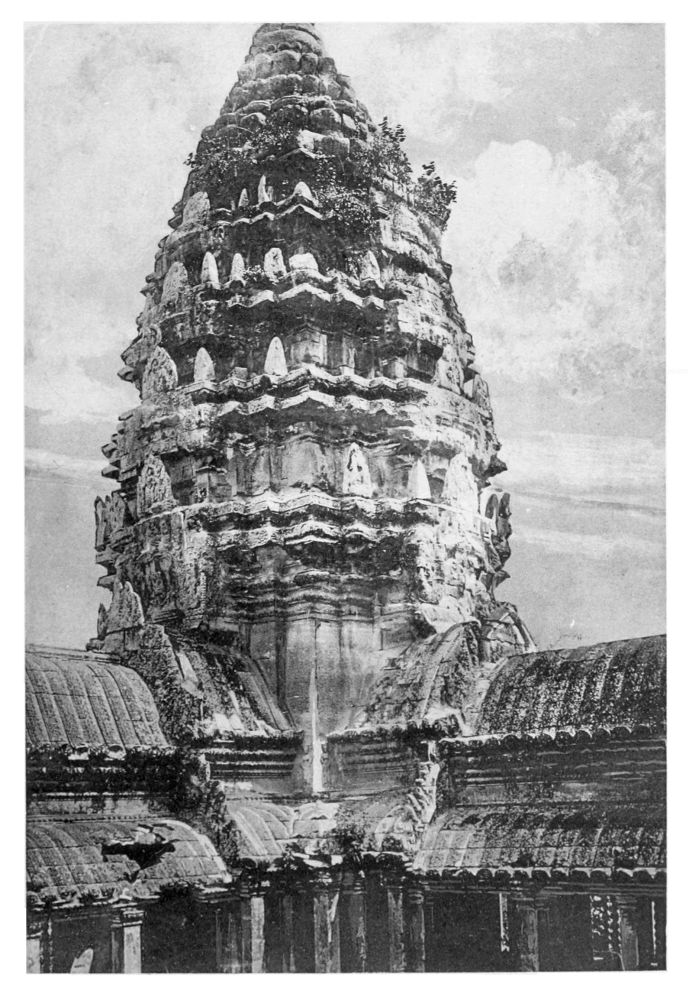
Nous déjeunons vite, mais mal ; et, après avoir fait ces derniers paquets où l’on oublie toujours quelque chose, nous partons enfin. Oui, je n’ose y croire, nous partons !
A deux heures et demie, devant toute la population rangée sur notre passage, nous démarrons fièrement, suivis de nos cinq charrettes, aux accords nostalgiques de la sirène qui provoque les acclamations de la foule. C’est un beau spectacle fait à souhait pour le plaisir des yeux, sinon des oreilles…
Au sortir de Tapang-Prey, le chemin très étroit serpente sous les branches et nous le trouverions ravissant s’il n’était ensablé au point de rendre la seconde vitesse plus que réglementaire.
Pendant deux kilomètres tout va bien, si bien même que, sans faire part de mes impressions à mes compagnons de voyage, je me dis à part moi :
— C’est trop beau pour que ça dure !
Mon pessimisme a raison et, tout à coup, sans motif apparent, le moteur s’arrête net.
Je ne lui ménage pas les commentaires les plus sévères, mais on connaît la sombre hostilité des objets inanimés : elle n’est rien auprès de celle des machines !
Guérin, qui sait combien les paroles sont inutiles en pareil cas, prend le parti de descendre sans rien dire : mais que son silence est éloquent ! Il ouvre le capot. Comme il arrive toujours quand c’est sérieux, tout a l’air d’être en bon état. Notre brave mécanicien lève au ciel un regard désespéré…
Enfin, en inspectant le carburateur, il découvre qu’au lieu d’essence, c’est de l’eau pure qui arrive ! Or, les moteurs à essence manifestent à l’égard de l’eau pure une aversion qu’on peut comprendre sans être pour cela alcoolique soi-même. Le mien ne fait point exception à la règle : ce liquide anodin ne lui dit rien qui vaille, et il vient de se mettre en grève.
Il y a là de quoi désespérer les automobilistes les plus fervents, mais pas nous ! Une fois de plus nous faisons contre infortune bon cœur ! Aussi bien, il ne nous reste qu’un parti à prendre : la retraite. Mais nous sentons très vivement que nous ne sommes pas là pour nous amuser…
Par bonheur, si je puis dire ainsi, un grand nombre d’indigènes nous ont fait escorte et semblent compatir à nos souffrances. Je parlemente avec ces bonnes gens : leur dévouement nous est acquis, il suffit d’y mettre le prix ! Quarante coolies s’attellent à la voiture et nous reprenons le chemin de notre canha, dans une disposition d’esprit qu’il est superflu d’indiquer.
Et, c’est la rage au cœur, mais toujours le sourire sur les lèvres, que, rentrés à Tapang-Prey, nous refaisons les préparatifs de notre installation pour la nuit.
Pour tuer le temps et me détendre les nerfs, je retourne à la chasse pendant qu’Hervé de Bernis et Guérin redémontent le réservoir et le carburateur. C’est un travail qui demande du temps… et surtout beaucoup de patience : je sens que j’en manquerais et que mon concours serait plus nuisible qu’utile.
Je me déploie donc en tirailleur…
Un coq et une poule sauvages au tableau… mais ce n’est pas une consolation.
A mon retour la nuit tombe, nos deux travailleurs n’ont pas encore pu enlever les tuyaux du réservoir ; bon gré mal gré, il faut remettre à demain le reste de la besogne.
Demain ! Toujours demain ! et nous n’avançons pas ! et il va nous falloir encore subir la symphonie nocturne de la meute indo-chinoise…
20 mars 1908.
Levés dès l’aube (et pour cause ! : les aboyeurs se sont surpassés), nous nous remettons à démonter la tuyauterie ; en soufflant avec une pompe nous parvenons à chasser l’eau perfide qui était restée au fond. Il en sort deux ou trois litres : la protestation du moteur n’était donc que trop légitime.
Enfin, cette fois-ci tout est prêt… (Touchons du bois, comme dit Guérin) et peut-être allons-nous pouvoir quitter définitivement cet endroit de malheur.
Le déjeuner vite expédié, nous nous mettons en route tout comme hier, avec le même appareil et la même solennité. Pourtant (serait-ce une illusion ?) les acclamations me paraissent moins nourries et moins éclatantes… Les ironiques indigènes commenceraient-ils à douter des merveilles de la science européenne ?
Nous reprenons le joli chemin creux qui fuit en zigzag à travers la forêt… Hélas, le joli chemin creux se conduit comme un cul-de-sac. Impasse et manque ! Évidemment il ne peut nous supporter… Après quelques tours de roue, nous voilà si bien ensablés qu’il est impossible d’aller plus avant.
Comme le chef du village a eu la gentillesse de nous accompagner (peut-être prévoyait-il notre nouvelle panne ?), je lui fais demander, en désespoir de cause, quatre buffles pour nous traîner jusqu’à Tampho.
Nous ne sommes pas très renseignés sur la distance qui nous sépare de ce village… 10, 15, 20 kilomètres ? Notre ignorance n’a d’égale que celle des indigènes pour qui le système métrique est plein de secrets… Nous ne savons qu’une chose, c’est qu’il n’y a pas d’autre village sur notre route avant ce vague Tampho et que, pour rien au monde, nous ne voulons retourner coucher à Tapang-Prey !
Le chef semble se conformer à mes tristes pensées…
Il commence à nous déclarer qu’il n’y a pas de buffles, mais il entame le plus vif éloge de quatre bœufs de sa connaissance qui, à l’en croire, feront tout à fait notre affaire !
Té, les bœufs ! comme dit Tartarin…
Va pour les bœufs ! On les envoie chercher. Ils ont, ma foi, de braves et honnêtes figures. Tout à fait des bœufs de chez nous ! Ils ont l’air d’avoir inspiré Pierre Dupont ! Leur premier abord est tout à fait rassurant. Les quatre bonnes bêtes se laissent paisiblement atteler… mais refusent nettement d’avancer. Nous ne tarissons pas de bonnes paroles et d’encouragements. Les quatre bœufs nous laissent dire et finissent par se coucher ! On sent que rien désormais ne saura les décider à mettre un pied devant l’autre : ils ont une façon de ne rien savoir irréductible et décisive, et manifestent leur haine du mouvement qui déplace les lignes par une immobilité lapidaire.

… Cette situation se prolonge jusqu’aux limites de notre exaspération ! Cependant le temps passe et nous n’avons guère fait que 4 ou 5 kilomètres…
Le buffle s’impose ! Il nous faut absolument des buffles !
Eux seuls auront la force et le courage de nous tirer de là !
Devant notre désespoir, le chef du village finit par convenir « que peut-être tout de même, en cherchant bien, il n’est pas dit qu’on ne finirait pas par en trouver… » (Est-ce que, par hasard, les Normands auraient aussi jadis conquis l’Indo-Chine ?)
… Je fais donner « la cavalerie de saint Georges »… et en effet, sans qu’on sache d’où ni comment, au bout d’une heure à peine les buffles sont là !
On les attelle en hâte et nous repartons.
… Ici commence un voyage dont aucun de nous ne perdra jamais le souvenir… Rien ne saurait donner une idée de ce qu’on souffre à se sentir traîné d’un pas tranquille et lent par quatre buffles qui cassent leurs traits de quart d’heure en quart d’heure. Ah ! pouvoir faire du 90 de moyenne et subir cette allure de 2 kilomètres à l’heure, tout le long d’un interminable sentier étroit, tortueux, sans cesse barré de souches et de branches, qu’il faut couper pour ne pas détériorer le carter… c’est un des pires supplices qu’ait jamais enduré un chauffeur et cela nous vaudra, j’espère, d’être inscrits au Martyrologe de l’automobilisme.
Selon l’expression vive et imagée de Guérin :
— On se fait du mauvais sang à l’heure !
Et quelles secousses, quels accrocs, quel roulis, quel tangage ! L’auto-buffle pourrait devenir, sous la direction d’un manager entreprenant, une nouvelle attraction pour les fêtes foraines : les personnes qui aiment à trépider sur les manèges y trouveraient les joies combinées du toboggan, des montagnes russes et de la balançoire.
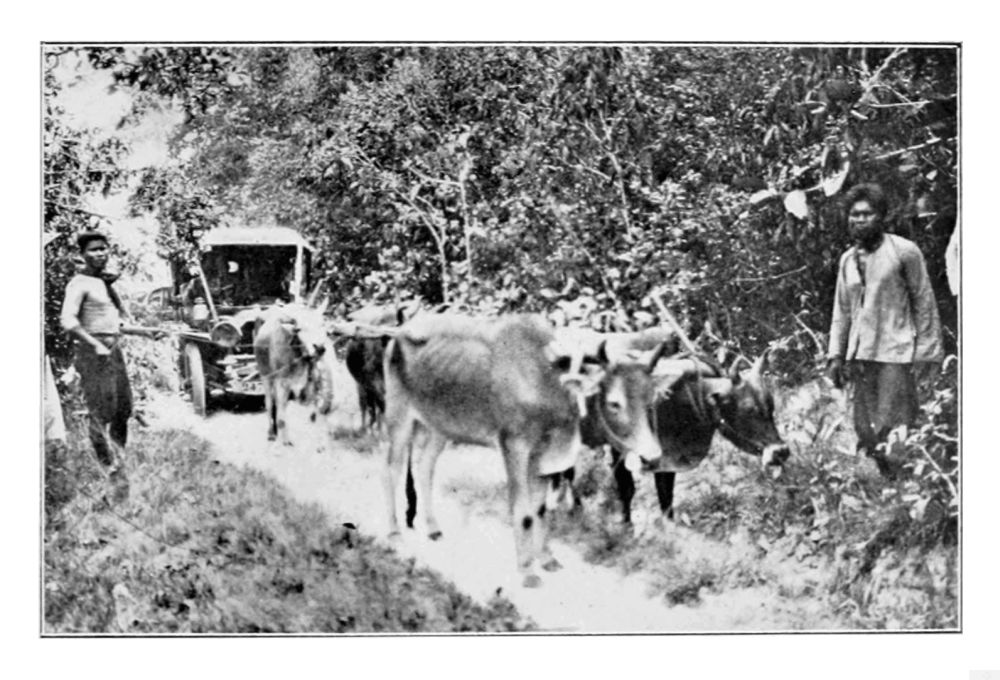
Quant à moi, je m’exaspère à voir onduler les dos énormes et paisibles de ces quatre bonnes bêtes, qui font pourtant tout ce qu’elles peuvent.
Enfin, vers six heures, la forêt paraît devenir moins inextricable, de grands pans de ciel apparaissent entre les branches et nous débouchons dans une vaste clairière. Nous en ressentons d’abord une impression d’allégement et il nous semble respirer plus à l’aise… Mais un bruit sec nous rappelle à la réalité, c’est un des jougs qui vient de se casser, et contre cela il n’y a rien à faire, sinon d’en fabriquer un autre.
Heureusement, les indigènes se montrent très adroits et nous en sommes quittes pour une halte d’une demi-heure, ce dont nos buffles profitent sagement en prenant leur bain dans une mare.
Ils nous reviennent rafraîchis et dispos ; nous remontons dans notre auto-buffle et nous quittons cet endroit que la carte désigne sous le nom de Tasia.
Mais, selon son habitude ancienne et extrême-orientale, le soleil se couche sans faire précéder sa retraite d’aucun crépuscule et la nuit tombe comme un voile noir qui s’abattrait sur toutes choses.
Nous avançons à pas comptés, à travers toutes les ornières qui deviennent de plus en plus profondes. A chaque pas il faut s’arrêter et descendre pour mettre la main à la pioche.
La nuit s’épaissit encore et nous retire jusqu’à cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Guérin et le guide indigène, l’un portant une hache et l’autre une torche, marchent devant la voiture.
A neuf heures, après mille difficultés, la clairière est traversée et nous rentrons en forêt ; cela ne semble pas faire l’affaire de nos quatre buffles qui commencent à donner des signes évidents de fatigue.
La faim, que nous avions oubliée, se rappelle cruellement à notre souvenir : elle en arrive à ce point où elle devient une souffrance. Pour me consoler, j’évoque des festins pantagruéliques, mais le remède me paraît vite pire que le mal.
Où sommes-nous ?

Je fais demander au guide si nous approchons de Tampho ?
Sa réponse est tout à fait rassurante :
— Si vous tirez d’ici un coup de fusil, les gens du village l’entendront !
A cette promesse du gîte prochain et de la soupe probable une vive allégresse nous saisit et nous en profitons pour chanter en chœur des airs connus : Frère Jacques, Viens Poupoule, et naturellement La Petite Annamite qui ne fut jamais mieux de circonstance. Nos voix se perdent dans le silence formidable de la nuit et notre gaîté tombe avec nos chants.
Dix heures et demie !… nous ne chantons plus, mais en revanche nous sommes ensablés jusqu’aux essieux, les buffles ne veulent plus tirer… et le voudraient-ils qu’ils ne pourraient plus, les pauvres ! On a beau taper dessus, ils ne trouvent de force que pour lancer des ruades… et pour charger leurs conducteurs… Voilà ce qu’on gagne à se faire remorquer !… Sans doute leur rôle commence à les humilier, mais moi, je commence à me demander comment nous sortirons de là.
A tout hasard, je prends des décisions énergiques, c’est toujours un soulagement en pareil cas !
Et d’abord, j’envoie en avant le petit soldat de l’escorte qui s’est jusqu’ici montré serviable, actif et débrouillard : à pied il ira toujours plus vite que nous et nous enverra des renforts. Puis je fais décharger un peu la machine et j’expédie les charrettes et les provisions dans la direction de Tampho : car nous n’avons rien mangé depuis onze heures du matin et la préparation du dîner commence à prendre une place prépondérante parmi mes préoccupations ! Enfin, je fais partir sur deux des charrettes Hervé de Bernis et le compagnon, et je reste seul avec Guérin pour ramener la voiture.
A nous deux et avec l’aide des indigènes nous tentons un dernier essai loyal de démarrage. A force de cris, de coups sur les dos immenses des buffles… et surtout en prenant la sage précaution de disposer des nattes sous nos roues, nous parvenons contre toute espérance à nous désensabler.
Hip ! Hip ! Hourrah ! Chic ! Banzaï ! Eljen ! Bravo !
Nous voilà repartis !
Je reste au volant… cependant que Guérin qui marche devant la voiture, en brandissant sa vaillante hache, m’arrête à chaque minute pour couper une souche ou élaguer un tronc d’arbre sans se retenir d’ailleurs de déclarer « que c’est à se fiche dans la douane ! » Mais des cris, des voix, des pas sortent du fond vertigineux des bois !… des pas de buffles, si je ne m’abuse. Qu’ils sont doux à nos oreilles !
C’est le petit soldat débrouillard qui a su remplir à merveille sa mission : il revient avec six buffles qu’on attelle immédiatement près des quatre premiers. — Six et quatre, dix ! nous commençons à marcher d’un train de sénateurs, c’est-à-dire presque honorable.
Bientôt nous arrivons dans une passe de rochers qui se dressent comme une immense digue au milieu d’une mare dont les eaux scintillent sous les étoiles reparues.
A toute autre heure, et dans d’autres circonstances, je m’arrêterais pour admirer un tel site que je devine merveilleux. Mais hélas, la nature nous taille une trop dure besogne pour que nous ayons le loisir de la contempler. Chauffeur errant il faut marcher sans trêve, avancer coûte que coûte et ce n’est pas trop de toute notre attention : car, après une courte montée, voici que cette digue de rochers s’enfonce brusquement… sans qu’aucune plaque indicative du Touring Club nous en ait avertis (je ferai une réclamation en rentrant), et le pire est que la roche est taillée en gradins, de sorte que la voiture rebondit comme sur les marches d’un escalier. On en a, comme dirait Guérin, « plein les mains ! »
Une secousse plus forte brise la glace d’un des phares…
Le réservoir grince sur la pierre : heureusement qu’il est bardé d’une tôle protectrice.
Enfin, nous arrivons au bas de cette descente sans autre avarie. Des cris nous parviennent à travers la nuit : c’est le village, Tampho et la soupe enfin !
Point du tout ! et il nous faut prendre notre parti d’une nouvelle désillusion.
Tout ce vacarme, ce n’est rien… qu’une de nos charrettes en panne, celle de Bernis dont les bœufs se sont couchés en travers du chemin. Le malheureux Hervé a tout fait pour vaincre l’apathie de ces animaux réfractaires. Il a usé de tous les moyens, même des banderillas de fuego… ingénieusement remplacées par une torche posée au bon endroit. Ce procédé, qui risque de lui attirer les plus sévères observations de la S. P. D. A., lui restera sur la conscience. Les bœufs indo-chinois en ont vu bien d’autres et leur impassibilité ne s’émeut pas pour si peu.
Nous nous arrêtons (encore une fois !) ; j’envoie tout mon monde au secours de la charrette en panne. On s’agite, on crie, on hurle, comme toujours en ce pays quand il y a quelque chose à faire (et cela ne le différencie pas d’autres pays qui se croient plus civilisés !) : enfin, l’on se décide à atteler d’autres bœufs et nous reprenons notre triste voyage, la rage dans le cœur et l’estomac dans les talons.
Crispé sur mon volant pour corriger les écarts des dix buffles qui tirent les uns à hue, les autres à dia, étourdi par la faim qui me bourdonne aux oreilles… je ne sais plus très bien ce qu’il arrive.
Notre morne cortège avance lentement aux lueurs des torches.
Enfin, nous arrivons au village.
Mais comme toute joie trop attendue, la vue de Tampho me laisse indifférent.
Il y a, paraît-il, une canha, une cabane pour les voyageurs. Allons, tant mieux ! mais je consentirais volontiers à coucher à la belle étoile pourvu que je puisse me reposer un peu.
Pourtant je conduis la voiture jusqu’à l’entrée de cette canha.
Le compagnon, qui pense à tout, a fait préparer du feu, nous allons donc pouvoir nous laver à l’eau chaude.
Un peu réconfortés par ces ablutions, nous ouvrons enfin une boîte de conserves.
Minuit et demi ! Nous sommes éreintés, mais la faim nous tient éveillés et nous retrouvons pour nous mettre à table l’énergie des hommes de l’époque du silex taillé et de l’âge de la pierre impolie.
Nous mangeons sans parler, ce qui pour des Français bien nés est le comble de la sauvagerie.
Ce repas farouche et silencieux nous rend les forces nécessaires pour procéder à notre indispensable installation. Nous faisons les lits, nous défaisons les malles et quand nous nous couchons enfin, morts de fatigue, il est plus d’une heure et je pense sans aucun plaisir qu’il nous faudra être debout et prêts à repartir, ce matin avant six heures.
… En fermant les yeux, il me semble encore entendre la voix du guide :
— Si vous tirez un coup de fusil ici, les gens du village l’entendront !
… Il était exactement neuf heures quand fut prononcée cette parole d’espoir et nous avons marché jusqu’à minuit et demi !
Il aurait fallu remplacer le fusil par une batterie d’artillerie.
21 mars 1908.
Cinq heures et demie du matin… Il n’y a pas à dire ! nous ne sommes pas très dispos : pour ma part, il me semble que je dormirais bien encore une douzaine d’heures : le compagnon s’étire avec mélancolie ; Bernis prétend qu’il entend crier ses articulations et Guérin réclame une clef anglaise pour s’ouvrir les yeux.
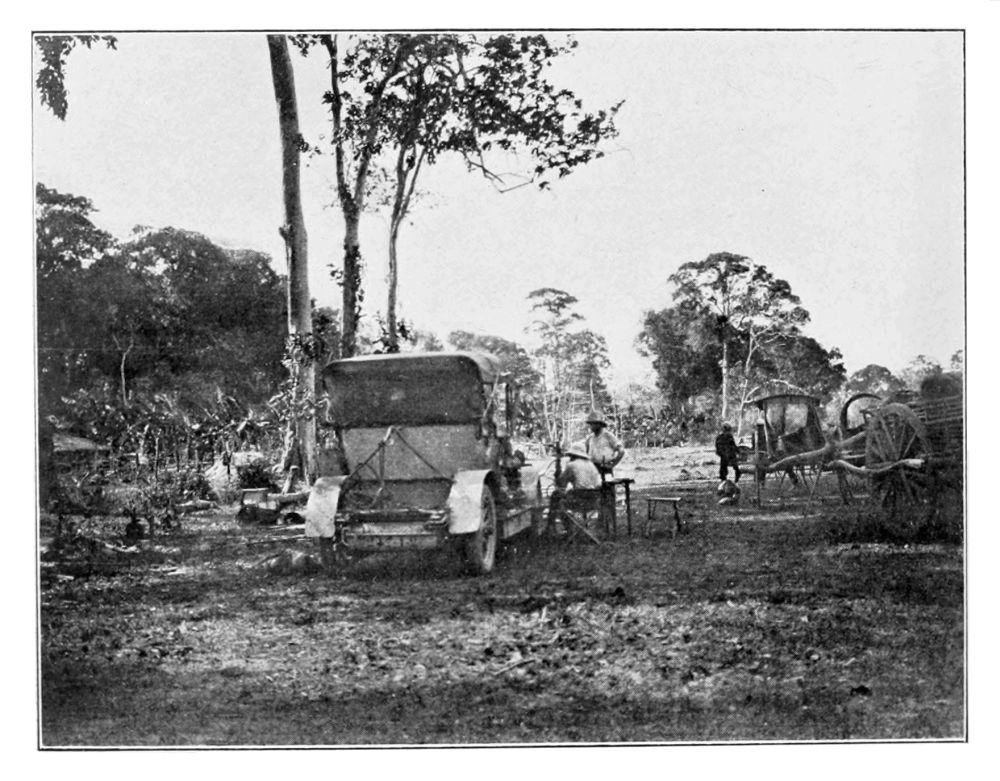
Enfin, l’eau froide ruisselle et le savon mousse dans des récipients de fortune et dans les tubs en caoutchouc : et nous voilà presque frais.
Bien nous en prend, pour la cause de la dignité européenne : car à peine sommes-nous présentables que les notables du village envahissent notre canha.
Ce sont des gens très bien : ils nous apportent les cadeaux d’usage (dont il faut d’ailleurs les remercier largement, car les lays ne sont qu’un échange de bons procédés).
Ces cadeaux d’ailleurs, ne manquent pas d’agrément. Aujourd’hui, parmi les bananes, les œufs, les noix de coco… et autres légumes, se distingue un petit cochon de lait, gras à souhait, appétissant et rebondi qui apportera dans notre ordinaire un élément de variété et de gaîté tout à fait appréciable.
Nous faisons comprendre aux notables toute notre reconnaissance, puis on plie bagage et tous nos impedimenta reprennent place dans l’auto et dans les charrettes.
Je prends quelques renseignements sur la route à suivre… Comme il fallait bien s’y attendre ils ne sont pas fameux ! La route, si route il y a, est, paraît-il, très sablonneuse et très étroite jusqu’aux abords de Kreck où nous devons coucher et nous reposer un jour ou deux.
Voilà qui nous promet de l’ouvrage, et les buffles, dont j’espérais me séparer, vont nous être encore indispensables.
Je me résigne à en laisser atteler trois paires à la voiture.
Une quarantaine de coolies sous les ordres d’Hervé de Bernis partent en éclaireurs pour déblayer autant que possible le chemin à travers la forêt.
A six heures, tout est prêt et nous démarrons… au pas des buffles. Nous devons ouvrir le passage aux cinq charrettes qui marcheront derrière nous.
A peine entrés en forêt, nous recommençons comme hier à nous battre avec les lianes, les troncs d’arbres, les ornières… et surtout avec les buffles. Mais du moins, il fait jour et le spectacle est si beau que nous ne regrettons pas la lenteur de notre allure. Rien ne saurait dire la beauté de cette forêt du Cambodge (car depuis Tampho nous sommes en territoire cambodgien). On s’y sent comme enveloppé d’une vie frémissante et multiforme : c’est vraiment la nature profonde et mystérieuse que les anciens ont divinisée sous le symbole de Pan et les pauvres humains y sont ramenés à la conscience de leur petitesse et de leur infirmité. Cela fait, si l’on peut dire, partie de la nébuleuse.
Sous cet enchevêtrement prodigieux de branches entrelacées de lianes inextricables, l’on ne peut se défendre d’une sorte d’émotion sacrée et l’on conçoit toute la justesse de la comparaison que les poètes ont établie entre la Forêt, œuvre divine, et la Cathédrale, œuvre humaine sans doute (et, pour notre gloire, œuvre française !), mais tout inspirée de la grandeur de Dieu. La vie universelle triomphe ici dans le frisson innombrable des feuilles, dans le jaillissement éperdu des branches, jets de verdure qui ne sont pas retombés, dans le chant de mille oiseaux d’espèces inconnues dont le plumage éclate comme une symphonie de couleurs ; et la forêt apparaît plus mystérieuse encore et plus sublime peut-être que l’Océan, qui, lui, cache dans ses profondeurs tous les êtres dont il est peuplé. De toutes parts la forêt vibre et palpite comme un organisme immense, et c’est vraiment selon la noble expression d’Henri de Régnier :
« Le Tourbillonnement des formes de la vie. »
Peut-être certains dessins de l’admirable Gustave Doré donneraient-ils quelque idée de ces paysages sylvestres ; mais ce qu’il faudrait, pour traduire cette féerie de formes et de couleurs, c’est un Corot tropical ! Qu’un grand peintre, puisqu’aussi bien il nous en reste encore, ait donc l’heureuse inspiration de tenter ce voyage : il en rapportera une beauté nouvelle.

… Tout pénétrés de la volupté qui s’exhale de ce sous-bois vert et touffu, nous oublions les difficultés de la route, elles nous paraissent beaucoup moins pénibles qu’hier. Pourtant nous avançons bien lentement.
Et ce n’est pas seulement la nature qui nous arrête, et la forêt qui nous retient dans ses liens ! Cette matinée nous ménage une rencontre imprévue et pittoresque, celle d’un collège de bonzes qui habitent une pagode enfouie sous les arbres.
Ils s’avancent vers nous avec des gestes de bon accueil : ce sont de superbes bonshommes drapés d’étoffes jaunes, la tête et les sourcils entièrement rasés. Pour saluer notre passage ils nous apportent des œufs et des régimes de cocos que nous empilons dans le fond de la voiture… et bien entendu nous laissons quelques piastres à ces généreux donateurs qui nous manifestent toute leur reconnaissance en phrases incompréhensibles, mais où nous devinons la plus « franche cordialité ».
Bizarre coïncidence, le sac de piastres que j’ai toujours sous la main en prévision de cas semblables se dégonfle et s’aplatit à vue d’œil, comme un Cent kilos qui suivrait un traitement sévère contre l’obésité. Ce qu’il en coûte dans ce pays-ci de recevoir des cadeaux !
Vers les neuf heures, nous nous arrêtons près d’une mare pour laisser notre attelage se reposer et se baigner. Les braves bêtes prennent en conscience leur tub et nous reviennent fraîches et luisantes… Mais nous n’avons que faire de leurs loyaux services ! Car voici que s’ouvre devant nous, à perte de vue, une magnifique clairière, qui se déroule comme un beau ruban d’argent à travers la verdure opaque de la forêt.
Nous allons donc pouvoir marcher par nos propres moyens. Ce n’est pas trop tôt. Nous commencions vraiment à oublier que nous étions en automobile !
Guérin pompe un peu de pression au réservoir d’essence, tourne la manivelle, et le moteur ronfle à la grande joie de notre escorte indigène qui s’habitue au monstre.
Quelle joie ! Plus de buffles !! Comme nous allons avaler cette clairière qui semble à la fois nous inviter et nous narguer, telle une jolie femme en humeur de flirt.
Tout est prêt : je vais démarrer… quand Hervé de Bernis me crie d’arrêter le moteur.
Quoi encore ??
C’est le tuyau du remplissage d’arrière qui s’est dessoudé et laisse échapper un mince filet d’essence dès qu’il y a de la pression (je sens toute la barbarie de ces termes techniques… mais ils sont nécessaires pour m’attirer la compassion de tous les chauffeurs, qui sauront comprendre mon état d’âme).
Cette fois c’en est trop !… je sens grandir en moi la tentation de tout envoyer promener et je l’exprime en termes choisis, mais dont la violence épouvante notre escorte.
Mes compagnons sont consternés. Il y a de quoi ! car il faut pour réparer l’avarie enlever la tôle protectrice du réservoir, le vider complètement et refaire la soudure : or, en pleine forêt, c’est tout à fait impossible et, d’ailleurs, nous n’avons rien pour mettre l’essence.
Allons ! il ne nous reste qu’à rappeler les buffles… les buffles ironiques dont les fanons épais me semblent secoués de ce rire énervant qu’on voit aux vaches dessinées par le spirituel animalier Schüsler !!
Vraiment, nous reculons les limites de la déveine ; une telle série à la noire ne semble pas naturelle et c’est à croire qu’un mauvais génie nous poursuit de ses maléfices ! Aurions-nous donc affaire aux faunes malicieux de la Forêt ?
On rattelle les buffles… et nous repartons tristement sans oser parler ni même nous regarder, comme inquiets de nous découvrir tout à coup d’autres visages ou de voir surgir entre nous la face effroyable d’un Satyre.
Et nous marchons au pas lourd de nos buffles, nous marchons encore et encore, tout le long de cette clairière poudreuse et desséchée qui reflète la lumière aveuglante du soleil et la diffuse en éclats métalliques dont nous avons les paupières brûlées.
Et je ne parle pas de la chaleur qui devient de plus en plus communicative et qui, à midi, fait le maximum !
Nous marchons toujours… Vers une heure, Guérin commence à parler fortement du déjeuner, je feins de ne pas l’entendre… Il insiste… mais je refuse d’arrêter et notre brave mécanicien s’enferme dans un silence boudeur. Ce Guérin, quel mauvais caractère tout de même !
A une heure trois quarts, comme nous passons devant quelques huttes, Guérin recommence ses litanies et nous menace de s’évanouir s’il ne mange rien !
C’est qu’il le ferait comme il le dit, l’entêté !

Je me résigne à m’arrêter et nous installons notre campement au pied d’une touffe d’arbres gigantesques.
Avec les cinq charrettes, l’auto, les buffles et l’escorte, nous jouons à merveille la halte de Bohémiens : on apprendrait sans étonnement que nous allons donner ce soir une grrrande Représentation, avec la permission des autorités locales !
… Les coolies allument un feu immense pour rôtir le cochon de lait, chauffer les boîtes de choucroute… et réconcilier les œufs que le compagnon vient de brouiller.
Sous le soleil qui nous accable de ses rayons incandescents ce feu semble vraiment faire double emploi… Guérin, tout ragaillardi par la vue de ces préparatifs culinaires, déclare qu’il fait un temps à ne pas mettre un thermomètre dehors et conclut :
— Ça n’est pas pour me vanter : mais je n’ai jamais eu si faim depuis la guerre !
A trois heures nous avons fini de déjeuner, et comme notre cochon de lait est à peu près cuit (on le serait à moins), nous l’enveloppons dans des feuilles de bananier et nous repartons.
Le courage nous reprend bientôt à la nouvelle que nous approchons enfin de ce fameux Kreck.
Bernis marche en avant pour tirer d’inoffensives tourterelles ; je lui prédis que décidément il s’attirera à son retour les foudres de la Société protectrice des Animaux : mais il ne m’écoute point, uniquement soucieux de se créer parmi les indigènes une réputation de tireur émérite.
… A quatre heures et demie nous faisons notre entrée dans Kreck, gros village composé d’une centaine de canhas.
Sans doute il y aurait quelque exagération à prétendre que cette entrée fut triomphale et rappela celle de Charles-Quint à Anvers, mais, enfin, ce fut une entrée tout à fait honorable et de nature à faire valoir le prestige européen ! En tous les cas, nous remportâmes un admirable succès de curiosité : les canhas s’étaient vidées comme par enchantement, toute la population se tenait sur le pas des portes et nous avions pris pour la circonstance un air digne et solennel qui fit, je crois, la meilleure impression. Mais ne nous laissons pas griser par la vanité ! Ce qui me paraît surtout agréable, c’est qu’on nous arrête devant une belle cabane construite sur pilotis et ornée d’une vérandah en bambous des plus majestueuses. Cela dépasse nos plus folles espérances !
Tandis que les coolies s’occupent de décharger les bagages avec cette cordiale brusquerie qui n’est pas le propre des déménageurs européens, nous courons au télégraphe : car c’est ici le premier poste depuis notre départ, encore que les fameuses cartes si bien renseignées ne fassent aucune mention de Kreck.
Nous y sommes accueillis le plus gentiment du monde, par une jolie Annamite, deux singes et deux petits cochons. Celle-là nous fait comprendre qu’elle est la femme du télégraphiste et que son mari est parti à notre rencontre avec plusieurs députés. Cette délégation se sera égarée en route !
En attendant le retour de cet aimable postier, j’écris à Gustave de Bernis, à M. Prère et à Mayréna pour leur annoncer notre arrivée ici. Et, comme je viens de terminer mes lettres, l’employé annamite du bureau, qui parle très bien le français, m’apporte justement des télégrammes de Gustave et de Mayréna et un autre du commandant Bertrand nous demandant de nos nouvelles. Hervé en reçoit un de M. Jeantet, directeur du journal La Cochinchine française, le priant de le tenir au courant de nos aventures.
Enchantés d’avoir ainsi repris contact avec nos amis, nous rentrons nous installer à la canha et préparer le dîner.
On allume les phares de la voiture qui remportent auprès de la vaillante population de Kreck leur succès accoutumé et nous mangeons de fort bon appétit un morceau de notre cochon de lait, accompagné de riz en guise de pain.
Toutefois (car il n’est pas de bonheur parfait ici-bas !) nous faisons une fâcheuse découverte… à savoir que notre magnifique vérandah dont nous étions si fiers manque de solidité et que l’on passe à travers avec une facilité déplorable.
Après le dîner, le petit soldat si dévoué et si débrouillard dont nous avons eu plus d’une fois à nous louer vient nous annoncer qu’il retourne à Tay-Ninh et nous faire ses adieux.
Je lui prouve ma reconnaissance en bonnes paroles et en piastres et je le renvoie avec une lettre pour M. Prère. Je regrette vivement le départ de ce brave et intelligent garçon.
Je me sépare aussi de notre vieux guide devenu inutile, M. Beaudoin, résident de Kompong-Cham, averti de notre prochain passage, ayant été assez aimable et prévenant pour mettre à ma disposition un autre soldat cambodgien.
Et nous nous couchons plus tranquilles.
La journée de demain sera employée à réparer le réservoir et à vérifier la machine. Voilà qui nous promet des joies paisibles.
22 mars 1908.
Décidément les chiens cambodgiens nous ont pris en grippe et tiennent à nous rendre insupportables les nuits chaudes de leur pays. Ceux-ci nous ont donné un concert qui dépasse encore le vacarme de Tapang-Prey et le sommeil nous fut rigoureusement interdit pendant l’exécution des morceaux.
Il y eut même une variante. Vers minuit, comme nous ne dormions pas, un effroyable tintamarre éclatant tout à coup à l’intérieur de la canha nous fit croire à une invasion de pirates ou à un tremblement de terre. Ce n’était qu’une dégringolade de casseroles, provoquée par un visiteur nocturne qui s’intéressait vivement aux reliefs de notre cochon de lait. Nous voulûmes reconnaître son identité, et nous ne fûmes pas peu surpris de nous trouver en présence d’un chien, un échappé du concert qui avait tenu à venir nous rendre ses devoirs à domicile. Cet animal avait trouvé le moyen, je ne saurai jamais comment, de grimper à l’échelle de la vérandah pour pénétrer dans notre cabane : un tel numéro ferait la fortune d’un Music-Hall. Il fut pourtant reçu assez fraîchement et redescendit l’échelle plus vite qu’il ne l’avait montée : mais notre intervention tardive ne sauva point, hélas ! les restes si précieux… et si comestibles de notre cochon de lait…
Je dois déclarer d’ailleurs, qu’à la suite de ce pillage nocturne, la Némésis canine qui nous poursuit parut satisfaite : le concert s’apaisa par degré, tout rentra dans le plus profond silence et nous pûmes achever en paix notre nuit.
… Ce matin, Guérin, aidé d’Hervé et de deux des conducteurs qui ont amené les charrettes de Tay-Ninh, arrange la magnéto, démonte et nettoie les soupapes, prépare enfin les armes qui nous conduiront, je l’espère, à la victoire !
Cependant, je reçois en grande cérémonie le chef du village.
Il nous apporte son petit cadeau : c’est un bœuf entier dont l’énormité me remplit d’une reconnaissante confusion.
Demain ce sera probablement un éléphant !
Après-demain… je ne sais pas prévoir les bonheurs de si loin et, d’ailleurs, la série animale me semble épuisée.
Le chef parti, je fais comparaître le nouveau guide que M. Beaudoin nous a si gracieusement envoyé : c’est un Linh de physionomie ouverte, intelligente et vive, et sa figure prévient en sa faveur : mais hélas, il ne parle absolument que cambodgien.
Que deviendrions-nous sans notre vieux Brin-d’Amour !
Voilà quelque temps déjà que nous n’avions pas parlé de lui… C’est qu’il s’enfermait dans une prudente réserve : ses qualités ayant été une fois reconnues, il ne sentait plus la nécessité de les faire valoir.
Mais aujourd’hui, les circonstances le ramènent au premier plan.
Brin-d’Amour va sauver la situation. Il va se révéler comme l’interprète idéal !
Je l’envoie chercher en toute hâte. On le trouve étendu, les yeux clos, à l’ombre d’un manguier, en train de chercher un compromis entre le sommeil de la nuit et la sieste de l’après-midi. On l’arrache non sans peine à sa rêverie et on me l’amène.
Mis en présence du Cambodgien, il l’observe sans rien dire à travers ses paupières bridées. Il attend sans doute que l’autre fasse les premiers frais…
Je brusque la présentation et le Linh se décide à prendre la parole. Brin-d’Amour le laisse dire, se dandine, regarde la terre avec une attention soutenue et ne répond rien.
Le Linh insiste, je crie, Brin-d’Amour garde le silence le plus hermétique. Selon la forte expression de maître Rabelais : « On n’en saurait tirer non plus qu’un pet d’un âne mort ! »
Enfin, après avoir, en bon comédien, pris son temps et ménagé son effet, notre interprète déclare avec une tranquillité souriante qu’il ignore absolument le cambodgien et que d’ailleurs il compte se renfermer désormais dans ses fonctions de cuisinier.
Un humanitaire l’aurait tué ! Je me contente de le bousculer comme il le mérite, mais décidément Brin-d’Amour a le sourire et il ne le perd pas pour si peu. Il semble soulagé de m’avoir fait cet aveu et se forge sans doute une félicité à la pensée des loisirs qu’il va pouvoir se donner désormais…
… Il n’en reste pas moins que nous voilà sans interprète. Ce qui va singulièrement compliquer nos embarras.
Je n’ose pas trop y songer et pour m’étourdir je vais interroger le télégraphiste sur la nature et les difficultés de la route que nous allons avoir à suivre jusqu’à Kompong-Cham. Il nous la promet sablonneuse et malaisée et nous laisse prévoir que nous en aurons au moins pour trois ou quatre jours !… Dans ce pays où une portée de fusil équivaut à une vingtaine de kilomètres, trois ou quatre jours doivent signifier quelque chose comme l’éternité.
Pour compenser la défection du fâcheux Brin-d’Amour, nous élevons à la dignité de chef de convoi l’un de nos conducteurs de charrettes : Nam-Ay, qui a fait preuve en toutes circonstances d’une intelligence et d’un dévouement absolus : il paraît fort sensible à cet honneur qui pourtant lui imposera de graves devoirs, car il lui faudra désormais répondre du contenu des malles et de la régularité des transports.
Notre provision de cognac et de whisky est épuisée… et comme les alcools européens n’ont pas encore envahi ce pays (qui s’enivre provisoirement, depuis quelques siècles, avec le choum-choum, eau-de-vie de riz nationale !) nous allons nous trouver désormais réduits à l’eau et au thé. Déjà je m’entraîne pour me créer cet état d’âme (ou tout au moins d’estomac !) qui nous a valu les teatotalers, ces irréductibles adversaires de l’alcoolisme.
Mais qu’importe ! La machine est prête et cela suffit à nous consoler de tout le reste. Demain nous partirons pour Kodorum, village éloigné d’une trentaine de kilomètres ; nous espérons y coucher… si nous y arrivons, car nous ne sommes qu’au début de nos peines et nous n’en avons pas encore fini, sans doute, avec l’hostilité des choses et la Némésis indo-chinoise.



23 mars 1908.
Au revoir, Kreck !
… Toute la matinée a été consacrée aux derniers préparatifs. Les essais du moteur justifient les plus belles espérances, les coolies sont chargés, les colis arrimés (ou vice versa), il ne reste plus qu’à partir. Nous emportons de Kreck un bon souvenir, de la viande froide, du riz et des œufs pour notre déjeuner.
Notre départ suscite un grand concours de populaire ! Tout le village est dehors pour voir démarrer l’auto, qui a reçu ici le glorieux surnom de Voiture de feu… (un bien joli titre pour un roman d’aventures) !
Je fais demander au guide de monter sur le marchepied pour nous indiquer la route. Mais sa dignité s’y refuse. Cavalier avant tout, il ne veut pas entendre parler de confier sa monture à qui que ce soit. Et sans doute il se méfie de nos trente chevaux vapeur, qui ne lui disent rien qui vaille.
Cette difficulté m’embarrasse quelque peu… mais pas longtemps : car une foule d’indigènes se pressent autour de la voiture et lèvent les mains en agitant leurs doigts comme des écoliers qui implorent de leur maître la permission de quitter la classe pendant quelques instants. Je ne me méprends pas sur le sens de cette pantomime. Visiblement nous sommes entourés d’hommes de bonne volonté qui ne demandent qu’à remplacer notre centaure obstiné : tous donneraient un picul de riz pour monter dans la voiture de feu. Parmi la foule des candidats, j’en choisis un dont les yeux bridés pétillent de désir et d’intelligence. Tout joyeux, il s’installe aux pieds de Guérin et je prévois que ce guide improvisé saura se montrer à la hauteur de ses fonctions. Comment reviendra-t-il à Kreck ? Il ne paraît guère s’en préoccuper, et j’avoue que son insouciance me gagne et calme tous mes scrupules.
Un tour de manivelle et en route !
Au bruit du moteur la foule s’écarte brusquement, comme la mer sous la proue d’un navire. Hommes, femmes et enfants se dispersent à toutes jambes, en poussant des cris où l’épouvante se mêle au plaisir d’avoir peur… des cris tout pareils à ceux des midinettes de Paris « quand elles se paient les montagnes russes ». Le cheval du guide désaffecté n’a garde de perdre une si belle occasion de s’emballer. Il part à fond de train… et son cavalier doit commencer à regretter le marchepied qu’il a refusé si dédaigneusement tout à l’heure… car il ne se maintient en selle que grâce à une acrobatie méritoire et son équilibre me paraît bien instable.
Quant à nous, nous retrouvons enfin la joie de passer de la première à la seconde vitesse et l’agréable ronflement du moteur, qui règle bien, rythme nos espérances et nous annonce une bonne journée. Ce sera la première, s’il plaît à Dieu, et nous l’aurons bien méritée !
Au sortir de Kreck, nous rentrons dans la forêt, mais elle nous semble moins impénétrable et moins hostile. Les arbres sont plus clairsemés et ne nous opposent plus une muraille de verdure. Les rayons du soleil éclairent le sous-bois. La route même nous paraît accueillante. Il est évident qu’en prévision de notre passage, on l’a débarrassée des souches, des lianes et de tous les obstacles qui nous avaient jusqu’ici coûté tant de peines… et de pannes. Ces soins intelligents nous révèlent déjà l’amabilité de M. Beaudoin et nous y sentons comme l’invisible présence d’une main amie. Combien nous bénissons, sans le connaître encore, ce Résident providentiel qui nous évite tant de fatigues et de retards. Déjà, nous ressentons pour lui la même reconnaissance émue que les naufragés de l’Ile Mystérieuse pour le capitaine Nemo ! Il n’a pu empêcher pourtant que le chemin soit toujours tortueux, ce qui rend difficile la conduite de la voiture ; mais qu’importe, nous marchons et c’est l’essentiel !
Je constate même que certains passages assez mauvais ont été marqués par des branches coupées. C’est à n’y pas croire… et le Touring-Club n’aurait pas fait mieux.
Les arbres s’espacent de plus en plus et bientôt nous voici dans la clairière. La forêt semble s’écarter pour nous laisser passer. Nous quittons « l’âpreté des hautes solitudes » : à chaque instant on aperçoit de jolies canhas entourées de cocotiers ; des rizières verdoient, parsemées de flaques d’eau qui miroitent au soleil ; des bœufs, des buffles et des chevaux s’ébattent dans les prés. Tout cela forme un paysage riant et donne une impression de gaîté laborieuse et sereine qui rappelle les tableaux de l’école hollandaise. On se sent dans une région très riche, abondante et peuplée.
Et la route devient si belle que la troisième vitesse s’impose. Hourrah ! Nous y voilà… Nous roulons comme en France ! Le vent de la course nous rafraîchit le visage… On respire, les poumons s’élargissent, le sang circule, et nous en oublions le soleil de plomb qui tape sur nos têtes… Nous nous croyons les maîtres de l’espace.
Mais voici qui va rabattre notre fatuité ! Si nous ne risquons guère de rencontrer par ici des agents cyclistes pour constater notre excès de vitesse, la faune locale ne s’accommode pas d’un tel délit.
Elle nous apparaît, la faune locale, sous la forme imposante de trois vaches que le bruit du moteur empêche de ruminer paisiblement. Sans doute les vaches cambodgiennes n’ont pas encore acquis cette habitude de regarder passer les trains qui a comme cuirassé d’indifférence les vaches européennes. Celles-ci trouvent que nous sommes de trop dans le paysage et en même temps, par un regrettable illogisme, elles trouvent que nous le traversons beaucoup trop vite. N’écoutant que leur courage, elles se précipitent devant la voiture… puis lui tournent le dos et se mettent à trotter en nous barrant le chemin. J’ai beau donner des coups de trompe pour les effrayer, elles se contentent de prendre un petit galop de chasse et les soubresauts de leurs grosses croupes règlent notre allure et nous imposent des débrayages exaspérants.
— Y a pas à dire, opine Guérin, elles se fichent de nous.
… Mais il faut s’avouer vaincus ! Nos trois éclaireurs soulèvent un tel nuage de poussière que nous en sommes aveuglés et nous voilà réduits à stopper, en attendant que nos entêtées consentent à regagner le pâturage. La fatigue finit par les y contraindre et nous reprenons la seconde vitesse.
Oh ! sans doute, la troisième nous plairait bien davantage, mais nous roulons maintenant sur une couche de sable très profonde et qui exige des précautions. Toutefois le moteur tire bien et nous avançons. Vers une heure, en traversant une grande plaine nous avisons un village où, d’un consentement unanime, nous décidons de nous arrêter pour déjeuner ; je demande à notre guide bénévole le nom de cet endroit, il me répond laconique et précis :
— Kodorum !
Ces trois syllabes, aux consonances latines, me plongent dans un tel étonnement que je n’en puis croire mes oreilles.
Kodorum, où nous ne devions arriver que pour coucher ! Une telle chance me laisse défiant et sceptique.
Je fais répéter au guide ce nom inespéré : il s’obstine et ses affirmations, accompagnées d’une pantomime expressive, ont bien l’accent de la vérité… Elle nous est confirmée, d’ailleurs, par les habitants du village qui viennent à notre rencontre… et qui, tout de même, doivent savoir à quoi s’en tenir.
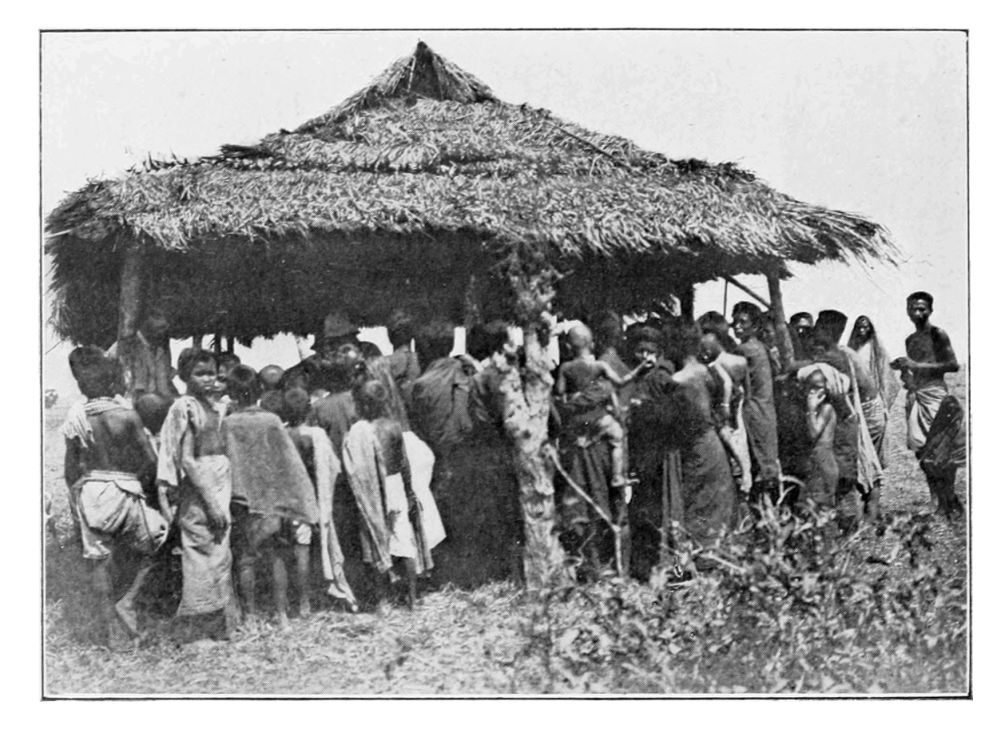
Nous sommes donc bien à Kodorum et il faut prendre notre parti de cet incroyable bonheur.
Les automobilistes ont souvent eu l’occasion de constater que rien ne pousse à aller vite comme la certitude qu’on est en avance. Conformément à cette disposition d’esprit commune à tous les chauffeurs, nous décidons, puisque nous venons de gagner du temps, d’en gagner encore davantage et nous déjeunons… contre la montre, entourés de tous les habitants de Kodorum qui semblent respectueusement étonnés que des êtres humains puissent se repaître avec une telle rapidité. Mais nous ne songeons qu’à repartir sans perdre une minute.
Les décisions sont aussi rapides que les bouchées !… Nos charrettes ne sont pas là ? N’importe ! Nous ne nous morfondrons pas à les attendre ! Il faut pourtant payer les deux conducteurs de Kreck et les remplacer. C’est une occasion unique d’utiliser les talents épistolaires de Brin-d’Amour. Incontinent je l’élève aux fonctions de scribe, ce dont il paraît très flatté, et je lui fais écrire une lettre en chinois pour Nam-Ay, notre chef de convoi : il s’agit de lui expliquer qu’il aura à payer et à renvoyer les deux charrettes et à en prendre deux autres jusqu’à Suong où il devra arriver dans la nuit. La lettre écrite, nous la remettons avec le prix des charrettes au chef du village ; et nous repartons.
Trois ou quatre « autorités locales » nous accompagnent à cheval et cette escorte improvisée nous prête l’importante apparence d’une cavalcade historique, qui serait destinée à célébrer le « Progrès des Moyens de Transport à travers les âges ».
Après avoir quitté Kodorum nous rentrons dans la brousse. Le chemin est de plus en plus sablonneux et les ornières de plus en plus profondes. Partout la prévoyance de M. Beaudoin a disposé des coolies, armés de coupe-coupe qui travaillent à déblayer la route devant nous.
Mais les pires difficultés viennent de la nature du sol ; les ornières font de leur mieux pour nous arrêter, et vraiment elles se surpassent !
Les ressorts de la voiture battent tous les records de souplesse et de résistance : à chaque cahot je m’attends à un effondrement… Non ! cela tient encore — et cela tient du prodige.
Aïe, nous voici bloqués !… Renonçant à nous décourager par ses ornières que nous franchissons si allégrement, la route a pris le parti de faire le gros dos, autrement dit de se bomber, de s’arrondir sous notre châssis : le carter protecteur touche la terre, il nous faut reprendre notre besogne de terrassiers et enlever avec les pioches tout le milieu de la route.

Ce travail fait, et non sans peine, nous retombons en pleine brousse… Décidément les obstacles se renouvellent avec une constance et une variété qui ne permettent pas de s’ennuyer un instant. Aidés des coolies nous débroussaillons… à coupe-coupe que veux-tu. Après une demi-heure de travail acharné et d’ailleurs encouragé par une distribution de piastres aux vaillants bûcherons, nous repartons gaîment. Encore la forêt… mais le sol est beaucoup plus dur et nous n’avons aucune peine à maintenir une allure avouable et régulière. C’est tout au plus si, de temps en temps, une souche malencontreuse arrête notre essor.
Vers cinq heures nous débouchons… ou plutôt nous « débuchons », comme on dit en style de vénerie, dans une immense plaine toute couverte de rizières (heureusement sèches, sans quoi nous risquerions de rester embourbés).
A l’horizon, dans un bouquet d’arbres, se groupent de pittoresques canhas, à demi cachées par les branches. C’est Suong !
Encore un coup d’accélérateur, beaucoup de cahots, de sauts, de bonds et de secousses et nous arrivons.
On semble nous attendre. Une délégation d’indigènes vient à notre rencontre et nous escorte jusqu’à la bonzerie, destinée, paraît-il, à nous recevoir. Ce trajet, à travers les rues étroites et tortueuses, et naturellement pleines de badauds, exige toute une série d’embrayages, de débrayages, de virages, de marche avant et de marche arrière, après quoi le jury le plus sévère nous accorderait un permis de circuler enthousiaste.
Enfin, nous stoppons contre l’échelle de la bonzerie.
Nous sommes bien heureux… Mais il fait rudement chaud.
Guérin constate avec fierté que nous n’avons pas perdu notre temps.
En effet, voilà une journée bien remplie, je suis forcé d’en convenir. Tout permet d’espérer que demain nous serons à Kompong-Cham et cette perspective ne laisse pas que de nous émouvoir quelque peu : car ce sera la première résidence que nous rencontrerons depuis notre départ de Saïgon et elle marquera presque le tiers du voyage. Seulement, voilà, de quoi demain sera-t-il fait ?
Nous y penserons plus à loisir… quand nous aurons dîné : c’est la première question qui se pose ! La joie d’avoir si bien marché ne nous a point coupé l’appétit… au contraire ! et nous n’avons rien à manger.
Je détache Brin-d’Amour en fourrageur avec la délicate mission de nous rapporter, moyennant finances, du riz et si possible un poulet ; puis, en guise d’apéritif, nous procédons à nos ablutions.
Pendant cette bienfaisante opération, un Annamite vient prévenir Guérin que le directeur des douanes l’attend chez lui.
Il faut dire que Suong, dont le nom ne figure pas sur la carte, n’en est pas moins une ville très importante et l’un des centres de l’alcoolisme cambodgien (ce qui tendrait à prouver que ce vice-là, du moins, n’est pas d’importation européenne… et que la civilisation extrême-orientale n’a rien à nous envier !). On trouve donc à Suong une grande distillerie de choum-choum (eau-de-vie de riz). Elle appartient au gouvernement qui remplit son rôle en exploitant les besoins de ses protégés et cela nécessite naturellement la présence d’un directeur des douanes.
Mais en quoi ce haut fonctionnaire peut-il bien avoir affaire avec Guérin ? Et pourquoi l’a-t-il fait demander ? Nous sommes tous très intrigués… Notre fidèle mécanicien se serait-il livré à quelque contrebande mystérieuse ? A-t-il dissimulé dans les coffres de la voiture une provision clandestine de Fine Champagne 1847 ? Nous nous amusons à le taquiner un peu. Le brave garçon ne sait à qui entendre… il est aussi étonné que nous et en arrive à se demander s’il n’a pas, par hasard, commis quelque délit involontaire…
— Ça doit être pour l’essence ! conclut-il… Tant pis, j’y vais, on verra bien !…
Et, n’écoutant que son courage, il part avec le mystérieux Annamite.
Un bon point pour Brin-d’Amour ! Contre toute espérance il apporte du riz et deux petits poussins et, pour une fois, manifeste l’intention de préparer le dîner… Nous n’avons garde de modérer cet accès de zèle inaccoutumé.
A sept heures, la table est mise et Guérin ne revient pas ! Qu’a-t-il pu lui arriver ? Son absence commence à nous inquiéter et nous allons partir aux renseignements quand nous le voyons reparaître la mine joyeuse et chargé comme un brick hollandais, serrant contre sa poitrine quatre bouteilles de bière, une bouteille d’absinthe et… luxe inappréciable ! aubaine inattendue ! manne providentielle !… du pain, du vrai pain à la croûte dorée !
Son retour lui vaut un accueil triomphal et tout s’explique : à bord du Tonkin, qui l’avait amené quinze jours avant nous à Saïgon, Guérin avait fait la connaissance du directeur des douanes et celui-ci, ayant gardé le meilleur souvenir de son compagnon de traversée, s’était empressé de le prévenir à l’annonce de notre arrivée à Suong.
Je laisse à penser si toutes les provisions sont les bienvenues et si nous portons un toast à cet excellent fonctionnaire.
Nous dînons le plus gaîment du monde ; cette petite fête, qui se prolonge assez tard, s’achève par une promenade exquise autour du temple, sous un clair de lune à faire rêver les imaginations les moins romanesques. Puis nous rentrons nous coucher.
Comme les charrettes ne sont pas encore arrivées, notre cantonnement se trouve réduit… au triste nécessaire, c’est-à-dire que nous sommes contraints de nous étendre sur le plancher de la bonzerie avec les coussins de la voiture en guise d’oreiller. Cette literie primitive est un peu dure, sans doute, mais il faut bien s’en contenter et nous en prendrions notre parti… s’il y avait un peu de silence autour ! Mais nous avions compté sans nos hôtes… A peine couchés et les lumières éteintes, voilà que les élèves bonzes commencent à chanter leurs prières dans la cabane située à notre droite : et peut-être cette lente mélodie, aux accents doux et monotones, nous servirait-elle de berceuse, si les chiens, les inévitables chiens ne jugeaient à propos d’en fournir l’accompagnement ! Soit en manière de protestation, soit pour rendre hommage eux aussi à quelque divinité, ils hurlent à intervalles inégaux et remplissent la nuit de leurs glapissements. Cela dure une bonne heure et, quand nous commençons à jouir enfin du silence rétabli, la mélopée des élèves bonzes reprend à notre gauche et leur concert spirituel suscite un nouveau concert cynégétique à démolir les tympans les plus résistants.
Notre insomnie nous permet du moins d’assister à l’arrivée des charrettes qui entrent à grand fracas dans Suong, vers une heure du matin. Il faut d’ailleurs qu’elles aient bien marché et Nam-Ay mérite des éloges que je ne lui ménage pas.
Nous profitons de la présence des charrettes pour y prendre nos oreillers et quelques couvertures, car la fraîcheur de la nuit contraste vivement avec la chaleur étouffante du jour.
Oreillers ! Couvertures !
Nous rentrons nous installer dans la bonzerie, les chantres se sont tus, les chiens aussi. Un silence profond enveloppe enfin toutes choses et nous nous endormons heureux et tranquilles.
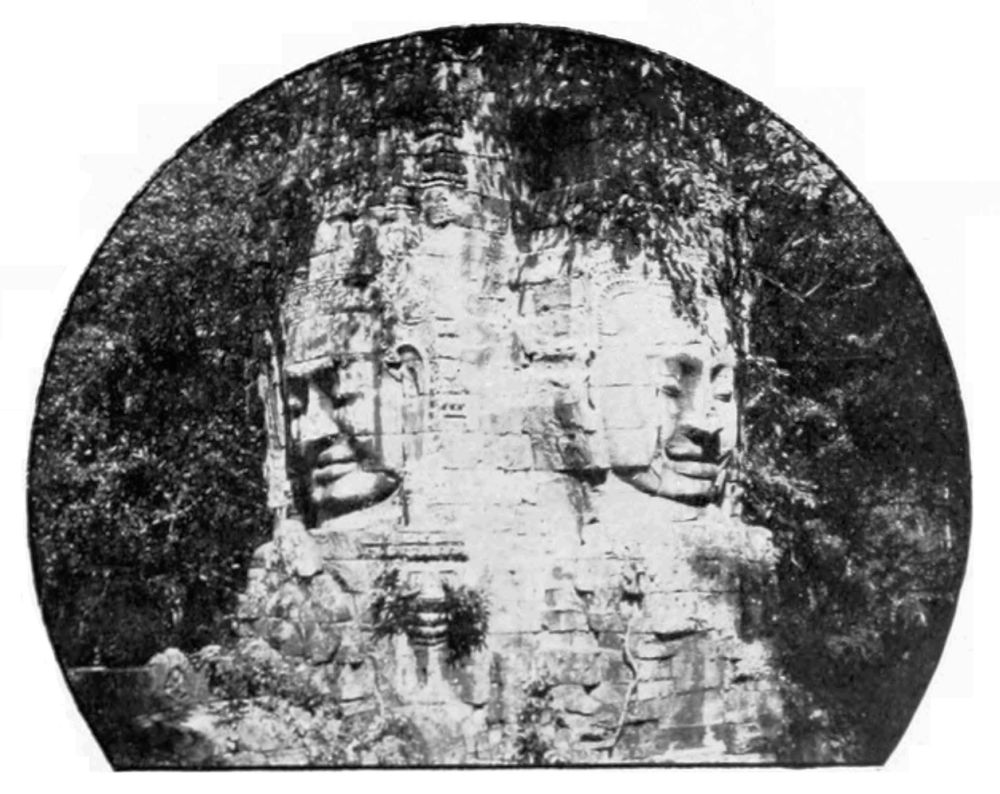
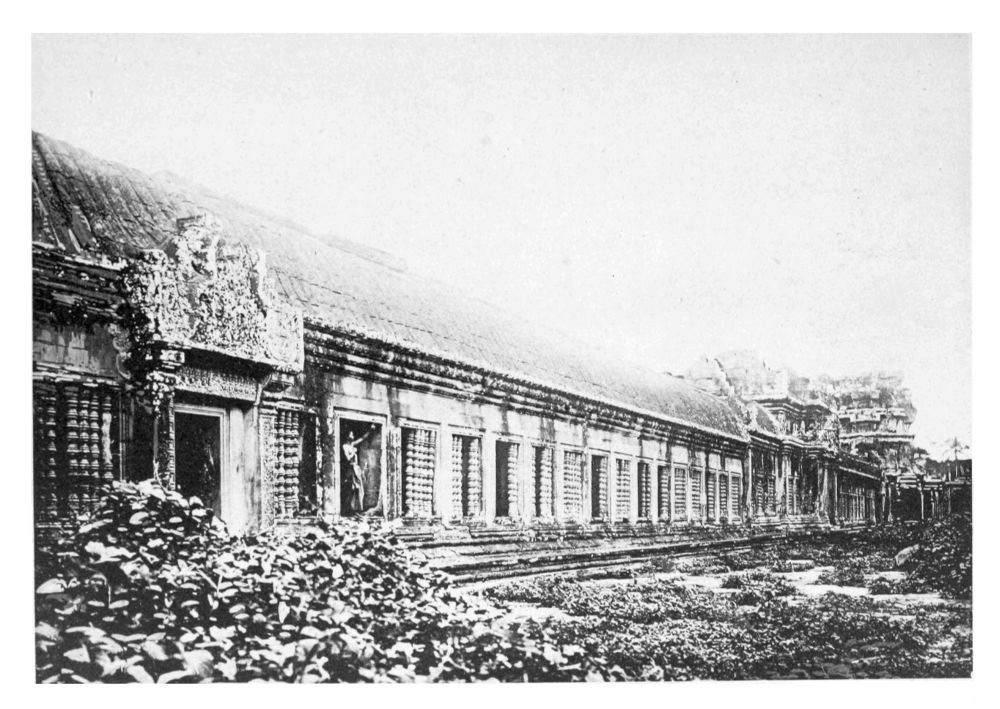
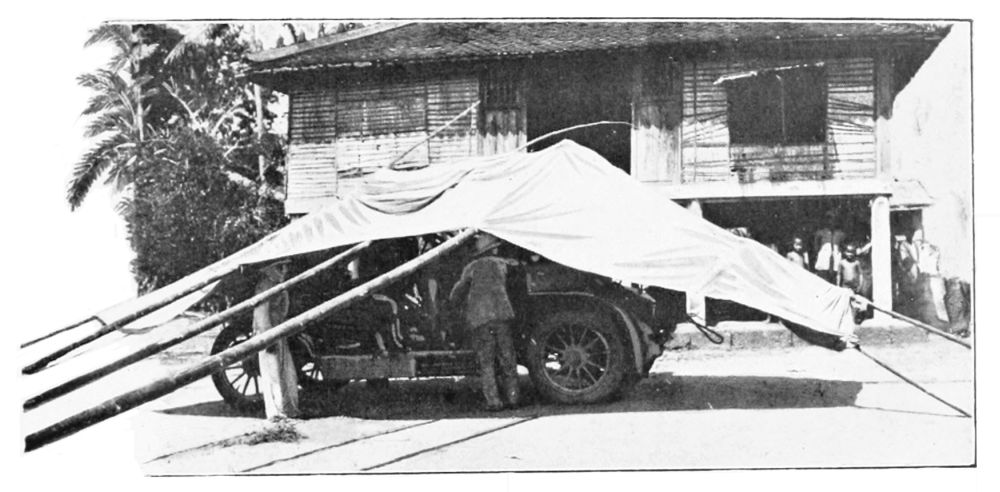
24 mars 1908.
Aux premières lueurs de l’aube, Guérin ausculte la machine et l’examine en détail jusque dans ses moindres organes. Il est à craindre en effet que les cahots continuels de la journée d’hier, qui ont mis à la plus dure épreuve toutes les pièces de la machine et surtout les essieux, les roues et la direction, n’aient infligé à notre vaillante compagne une de ces secrètes meurtrissures qui brisent à la longue les moteurs, tout comme les vases.
Nous suivons les opérations de notre habile mécanicien presque avec la même angoisse que nous inspirerait l’examen d’un malade par un praticien célèbre.
Mais le calme de Guérin nous rassure ; nous ne le voyons brandir aucun de ces instruments terribles qu’exige une opération sur l’organisme compliqué d’une auto.
La revue s’achève par un cri de triomphe ! Tout va bien, rien n’a bougé ! Toutes les pièces ont merveilleusement résisté au terrible travail que nous leur avons imposé.
Après un simple graissage, nous allons pouvoir repartir.
A dix heures et demie nous démarrons de devant la bonzerie, non sans que le grand prêtre soit venu nous rendre visite.
Je dois avouer que cette entrevue ne contribuera pas à nous initier aux mystères de la religion bouddhique. La causerie a manqué de cette animation qui fait éclore les idées générales. Une poignée de main, un sourire, et c’est tout ! C’est assez du moins, pour nous rappeler que les Français et les Chinois sont les deux seuls peuples qui aient inventé une politesse, et l’on pourrait soutenir que tout l’effort des civilisations se résume dans un geste aimable. Mais nous n’avons pas le temps !
En route pour Kompong-Cham !
… Nous avons pris un nouveau guide, laissant celui d’hier retourner avec les deux charrettes à Kodorum, puis à Kreck.
Et nous roulons !… Du sable, toujours du sable : mais en maintenant une deuxième vitesse modeste et prudente, nous pouvons avancer sans aucun risque et en toute sécurité. Le linh envoyé par M. Beaudoin nous fait escorte avec deux ou trois notables de Suong qui nous ont accompagnés à cheval. Ils caracolent joyeusement et nous suivent ou nous précèdent suivant notre allure.
Parfois, nous sommes encore obligés de stopper pour arranger la route et nous perdons alors un peu de temps qu’il nous faut rattraper…
En avant la troisième, puis la quatrième vitesse…
Oui, la quatrième ! Quelle ivresse… nous osons à peine y croire. Faire de la vitesse à travers le Cambodge, cela dépasse toutes nos plus folles espérances. « Pourvu que ça dure », comme disait le couvreur qui tombait du sixième ! Nous semons les notables. Le linh aussi nous abandonne. Le galop de son cheval ne pouvait tenir contre la concurrence…
D’ailleurs, nous nous résignons sans peine à une défection qui semble tant humilier cet infortuné cavalier : il était plus décoratif qu’utile et nous ne sommes pas là pour étonner les populations par l’apparat des défilés et des cavalcades.
Elles se font rares du reste, les populations ! Depuis Suong nous n’avons guère aperçu que quelques canhas isolées.
Vers midi nous entrons dans la grande forêt.
Disons, à son avantage, qu’elle se présente bien ! Sans parler de la splendeur de cette végétation que je qualifierai de tropicale pour ne pas manquer aux habitudes des explorateurs, la grande forêt cambodgienne nous offre une route à souhait pour le plaisir des pneus !
Nous ne roulons plus désormais sur une piste étroite et ensablée, mais bien sur une grande chaussée, belle comme un vrai chemin de France, droite et large de plus de 20 mètres. C’est l’ancienne route khmer encore en bon état et bien entretenue… Si nous n’en trouvions que de semblables, notre expédition deviendrait une partie de plaisir… Et pourtant, il nous faut encore faire connaissance avec un nouvel ennemi : la poussière !
Sans doute ce fléau n’est pas spécial au Cambodge et les routes européennes nous en avaient déjà donné quelque idée. Toute la planète n’est pas encore goudronnée, ni westrumitée, et nous devions bien nous y attendre…
Le mal est que la poussière d’Extrême-Orient, comme beaucoup de choses de ce pays, dépasse vraiment la mesure : il y en a trop ! Elle n’a pas seulement l’inconvénient d’être excessive, inhumaine et pénétrante ; elle trouve encore le moyen d’être rouge. Cela nous paraît tout à fait impardonnable et nous regrettons cette belle poussière blanche comme de la farine qui s’élève des routes craquantes et sèches de la Provence.
… Cette poussière infernale couvre la route d’une couche épaisse d’environ 30 centimètres, et dissimule traîtreusement, de place en place, des trous perfides qui ralentissent notre marche ; nous n’en faisons pas moins du trente à l’heure, enveloppés d’un nuage qui nous transforme en Peaux Rouges !… Nous avons du moins la consolation de ne plus nous voir qu’à de lointains intervalles.
Le malheureux guide juché sur le marche-pied en prend, comme dit Guérin, « pour son grade et en ramasse plus avec sa figure qu’avec une pelle ! » Je le prends en pitié et je lui donne une paire de lunettes, ce dont il manifeste une joie enfantine… Mais cela ne fait point l’affaire de Brin-d’Amour dit Bec-dans-l’huile, qu’une telle faveur, donnée à un autre qu’à lui, remplit d’une fureur barbare. Notre boy à tout faire proteste en plusieurs langues (je suis même étonné qu’il en sache autant !), il trépigne et pleure de rage… Mais peut-être faut-il attribuer beaucoup de ses larmes au picotement que provoque cette poussière si fine et si ténue qu’on dirait de la poudre.
Brin-d’Amour occupe pourtant une situation privilégiée : il est assis dans le fond de la voiture, près de Bernis qui s’amuse de le voir en fureur, de sorte que Guérin et moi lui servons d’écrans. N’importe ! Brin-d’Amour ne décolère pas et sa mine piteuse en dit plus long que ses paroles, qui me semblent dépourvues d’aménité à notre égard.
Mais la route nous ménage bien d’autres soucis ! Tout à coup, nous la trouvons coupée par le lit d’un torrent desséché dont les berges sont presque à pic…
Que faire ? Ma foi, nous ne prenons pas le temps de la réflexion et, au lieu de nous arrêter à chercher une décision, nous ne nous arrêtons pas du tout ! Le guide n’en mène pas large et Brin-d’Amour crie d’épouvante… La machine fonce droit devant elle et dévale en trombe un côté pour remonter courageusement l’autre pente, aux joyeuses acclamations de tous… et, je crois, de Brin-d’Amour lui-même.
Les personnes aventureuses qui naguère ont bouclé la boucle à l’ancien Pôle Nord n’auront aucune peine à comprendre la nature de l’émotion un peu spéciale qui précéda ce plongeon dans le vide. La profondeur du torrent la rendait assez vive, mais elle n’alla point sans plaisir.
Tout à fait aguerris par l’expérience, nous recommençons plusieurs fois ce petit jeu, car le torrent n’était que premier d’une série et nous éprouvons que maintenant rien ne nous arrêtera plus.
Rien… sauf le déjeuner !… car il est près d’une heure et notre héroïsme ne va pas jusqu’à risquer de mourir d’inanition.
Nous nous arrêtons près d’une canha pour avoir de l’eau… et nous remportons auprès des habitants notre succès habituel. Ils nous accueillent de fort bonne grâce et nous aident de leur mieux ; le riz est vite cuit, et nous mangeons de fort bon appétit le poulet froid et les œufs que nous avions emportés.
Tout cela est bien un peu saupoudré de poussière rouge, mais nous en sommes quittes pour nous imaginer que c’est du poivre de Cayenne et nous n’en buvons que mieux l’eau fournie libéralement par nos hôtes.
A deux heures nous repartons, mais dès les premiers tours de roues nous constatons avec tristesse que notre belle route a perdu tous ses charmes. La chaussée est en si mauvais état, que nous en sommes réduits à rouler humblement sur le côté, dans un sentier étroit et sablonneux, tout encombré de grandes herbes et de petits arbustes qui se dressent sournois et tenaces entre les ornières.

De temps en temps, le carter grince, c’est une branche un peu plus forte qui vient de le toucher. Nous ne nous en inquiétons guère, car nous ne sommes plus qu’à six ou sept kilomètres de Kompong-Cham et la plus franche gaieté ne cesse de régner, selon la formule des reporters mondains. Une joie débordante s’est emparée de nous : après avoir vu tout en rouge, nous voyons maintenant tout en rose.
Encore quelques minutes et nous serons arrivés.
Nous pourrons nous reposer à l’aise, nous laver commodément, manger dans des assiettes, nous asseoir sur des chaises, dormir dans des lits, enfin retrouver un peu du confort perdu depuis neuf jours. Il y a comme cela dans la vie des heures où le chocolat du matin vous apparaît dans une apothéose.
Nous filons ! Tout va bien… La troisième ronfle à ravir, quand tout à coup un choc violent suivi d’un bruit sinistre arrête net la voiture.
C’est la panne, la redoutable panne imprévue et soudaine.
Guérin ne fait qu’un bond de sa baignoire à terre, se penche, relève un visage angoissé et me dit :
— Marche arrière !
Je recule d’environ quarante centimètres, et le moteur cale !
Nous descendons en désordre et nous voilà tous à plat ventre, dans cette position humiliante qu’impose aux automobilistes la recherche des causes… La cause, en l’espèce, c’est une souche, une jolie souche d’environ 20 centimètres de diamètre que l’épaisseur des herbes ne nous a pas permis d’éviter.
Quant aux effets, ils sont déplorables : la barre d’accouplement de la direction est tordue, la roue de gauche a renoncé à son parallélisme (si nécessaire !) avec celle de droite, tout le carter protecteur est arraché et réduit à l’état d’accordéon ; pour comble de malheur, la souche malencontreuse empêche absolument soit d’avancer soit de reculer.
— Nous voilà frais ! dit Guérin.
Et cette constatation, que la chaleur ambiante devrait pourtant nous rendre si agréable, nous plonge dans un abîme de désespoir.
Nous sommes consternés. Il y a de quoi. Mais puisque le mal est fait, il ne nous reste qu’à le réparer ! M. de la Palisse lui-même, qui est la plus parfaite incarnation de la raison pratique, ne penserait pas autrement.
Après un coup d’œil navré sur le désastre, notre brave Guérin endosse la blouse et se met, sans mot dire, à démonter la barre. Puis, muni d’un gros marteau, il la frappe à coups redoublés pour tenter de la redresser.
Cependant, à l’aide d’une scie articulée, nous débitons la souche de malheur et nous parvenons enfin à l’arracher des entrailles de la voiture. La souche enlevée, la barre redressée ou à peu près, nous pouvons repartir…
Vraiment je ne saurais dire assez mon admiration pour le courage et l’adresse de ce brave Guérin qui, par cette chaleur accablante, couché dans le sable brûlant, ne perd pas une minute sa gaîté et sa bonne humeur. C’est un vrai Français… et je ne sais pas de plus bel éloge. Avec des hommes de cette trempe-là on peut tenter l’impossible et l’on n’a jamais le droit de désespérer.

La réparation si vite faite nous rend tout notre entrain. Nous retrouvons même l’affreux courage de commettre quelques mauvaises plaisanteries sur notre carter accordéon, que nous emportons soigneusement d’ailleurs, espérant qu’il nous servira dans la suite à autre chose qu’à accompagner la complainte que méritent nos infortunes ! Et nous reprenons plus prudemment cette fois la course si fâcheusement interrompue… D’abord, nous entendons bien sous nos pieds quelques bruits de casserole et de ferraille, et ce fracas de ferblanterie nous semble de mauvais augure, mais peu à peu le moteur se remet à régler et tout rentre dans l’ordre.
Déjà nous apercevons les rives du Mé-Kong et cette présence du grand fleuve remplit le paysage d’une solennelle beauté. Mais hélas ! nous n’avons pas le loisir de nous laisser aller à l’admiration… il est écrit que ça n’ira jamais tout seul et que jusqu’au bout nous aurons des difficultés.
La dernière (pour aujourd’hui !) se présente sous l’aspect désagréable et peu encourageant d’un torrent (encore un !) qu’il nous faut passer dans des ornières très profondes. Juste au milieu de la descente l’essieu touche la terre… mais la proximité du but nous donne des ailes. Un coup de marche arrière, un coup de pioche ! et en route ! Nous longeons maintenant la rive gauche du fleuve, entre les huttes d’un petit village : sur l’autre rive se dresse la ville de Kompong-Cham et nous pouvons voir d’ici l’édifice blanc de la Résidence.
Un autre guide, envoyé à notre rencontre, nous fait arrêter la voiture à l’endroit où la berge est le moins escarpée et juste en face de la maison de M. Beaudoin, dont nous ne sommes plus séparés que par la largeur du fleuve ; mais, selon la forte expression de Guérin, « ce n’est pas une cuvette ! »
Il est quatre heures. Hervé de Bernis et Guérin prennent un sampan pour aller prévenir le Résident de notre arrivée.
Nous en profitons, le compagnon et moi, pour faire un brin de toilette, au petit bonheur, sur le bord de l’eau : nous mettons une cravate et une veste.
Une chaloupe à vapeur se détache de l’appontement qui nous fait face et se dirige vers nous.
M. Dessenlis, chancelier de la Résidence, en descend avec Bernis et Guérin. Il vient très aimablement, de la part de M. Beaudoin, nous souhaiter la bienvenue et nous emmener loger à la Résidence, avec armes et bagages. Nous acceptons de grand cœur cette gracieuse hospitalité.
Quant à la voiture, elle va rester ici, toute la nuit, sous la garde de deux linhs et de l’inévitable Brin-d’Amour qui se distingue surtout dans les fonctions sédentaires et de tout repos. Demain matin, on la passera sur l’appontement de la douane, remorquée par la chaloupe de la Résidence. Les charrettes qui viennent d’arriver resteront aussi sur le bord du fleuve jusqu’à demain.
Nous embarquons dans la chaloupe et nous traversons le Mé-Kong, un vrai bras de mer !
M. Beaudoin, qui ne nous attendait que demain, nous reçoit avec la plus charmante cordialité, nous fait faire le tour du propriétaire, nous montre nos chambres et une salle de douches. C’est, pour le moment, la salle de la Résidence qui nous inspire le plus d’admiration.
Après tout ce que nous venons de traverser, une douche bienfaisante nous semble une volupté inexprimable… Et pouvoir se changer, enfin !…
Il va sans dire que nous n’avons ni smoking, ni costumes blancs, le blanc n’étant pas précisément la couleur de l’automobilisme.
Notre garde-robe se réduit à un complet culotte à peu près présentable. Enfin, puisque M. Beaudoin veut bien excuser notre négligé, nos remords ne nous empêchent pas de faire honneur au dîner… et rarement il nous fut donné d’en faire d’aussi gai et d’aussi agréable.
M. de Caland nous l’avait bien prédit. Tout de suite, grâce à l’aimable accueil de M. Beaudoin, nous nous sentons à l’aise et vraiment sous le charme. Nous jouissons avec délices de l’heure exquise, de la causerie délicate et légère, en un mot, nous retrouvons la France…
Rentré dans ma chambre, je refais par la pensée tout le chemin déjà parcouru et j’établis le petit bilan de notre voyage.
Voici neuf jours que nous avons quitté Saïgon… et nous ne sommes encore qu’à 200 kilomètres du lieu de notre départ. Nous avons fait en moyenne 22 kilomètres par jour. Il n’y a pas à se le dissimuler, une telle vitesse ne suffirait pas à nous classer dans un circuit et nous n’avons battu aucun record… si ce n’est pourtant le record de l’obstacle. Mais tel n’était pas notre but. Si lentement que nous avancions, nous arriverons toujours les premiers à Ang-Kor et rien ne sert de courir.
Je m’estime déjà fort heureux que nous ayons gagné un jour sur les prévisions de M. Beaudoin qui connaît le pays mieux que personne, qui comprend si bien l’intérêt de notre tentative et qui se rend compte des difficultés que nous traversons.
… Mais ma joie la plus vive et la plus réelle est encore de coucher ce soir dans un grand lit… où il fera bon rêver de la Ville au Bois dormant !
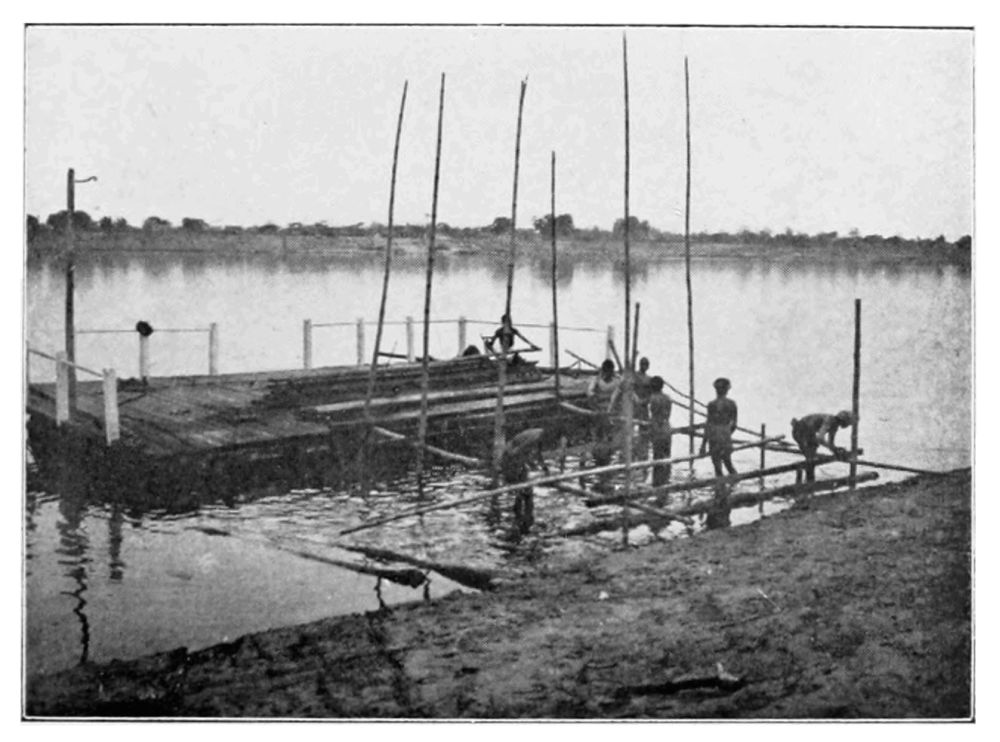

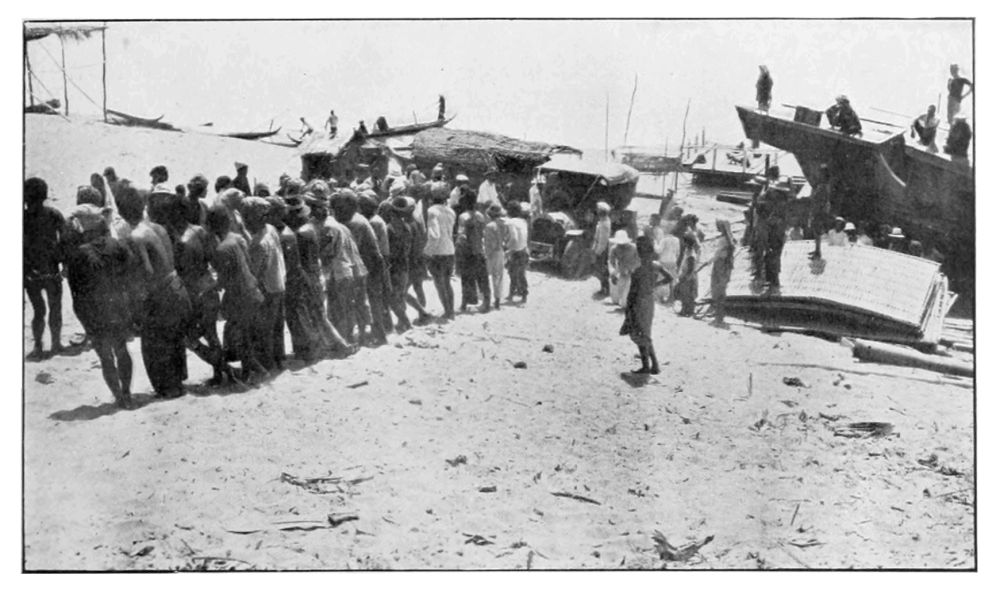
25 mars 1908.
Cette matinée va être employée au repêchage de la voiture qui a passé, elle aussi, une bonne nuit… mais de l’autre côté du fleuve !
Après tant de torrents passés « à pneus secs », notre vaillante compagne va traverser le Mé-Kong et malgré toutes les précautions prises, je ne suis pas sans inquiétude : une personne de son poids et de son importance ne voyage à l’aise que sur les grands paquebots et toute la flottille de Kompong-Cham ne suffirait pas à la transporter, sinon en pièces détachées. (A vous, Comiot !)
Donc, dès sept heures et demie, Bernis et Guérin s’embarquent avec l’interprète de la Résidence, sur la chaloupe qui remorque l’appontement ; ils emportent des planches et des bambous pour construire une amorce de pont, de la rive au radeau, car la principale difficulté consiste à embarquer et à débarquer la lourde voiture sans trop de secousses. Une fois en pleine eau et bien installée sur l’appontement, elle n’aura qu’à se laisser remorquer, mais le plus dur est de l’y mettre.

L’appontement et la chaloupe abordent près de la rive gauche du Mé-Kong… En quelques instants, avec une rapidité et une adresse qui me rassurent pleinement, les indigènes ont établi la passerelle. L’auto la franchit sans encombre. La voilà sur l’appontement ! La chaloupe revient vers la rive droite où les mêmes travaux sont exécutés à merveille. Des cordes sont attachées à l’avant de la voiture. Deux cents prisonniers s’y attellent ; ces pauvres gens y vont de tout leur cœur et semblent s’amuser de cette besogne imprévue. On dirait des gamins en récréation. Leur pittoresque bousculade évoque l’idée d’un jeu bruyant, bien plutôt que d’une corvée.

D’ailleurs, ça ne traîne pas ! Sous leur vigoureuse impulsion, la voiture a vite fait de gravir la berge escarpée et sablonneuse, tandis que je prends deux ou trois photographies de cette manœuvre.
Un tour de manivelle et nous rentrons à la Résidence où nous remercions M. Beaudoin d’avoir donné des instructions si utiles et si précises pour le passage du fleuve.

Après le déjeuner, vers les trois heures, nous prenons place tous les trois, M. Beaudoin, le compagnon et moi, dans la victoria de la Résidence pour aller visiter les ruines de Vat no Kor situées à environ 4 kilomètres de Kompong-Cham.
La route qui nous y conduit, œuvre du Résident actuel, mérite les plus vifs éloges. C’est elle que nous suivrons lorsque nous partirons pour Kompong-Thom. Près de 15 kilomètres sont déjà terminés. Dans un an ils auront fait des petits et seront 30, 40 peut-être. Voilà de bonne et utile besogne et j’y trouve une fois de plus la preuve que si les Anglais sont d’incomparables constructeurs de ports, les Français n’ont pas de rivaux pour installer des routes et bâtir des villes. Saïgon et Hanoï le démontrent assez et si tous les Résidents imitent M. Beaudoin, l’Indo-Chine française offrira d’ici peu d’années un réseau de communications qui contribuera plus que tout au développement et à la prospérité de la colonie.
… Les ruines cambodgiennes sont imposantes et nous donnent un très agréable avant-goût des merveilles qui nous attendent à Ang-Kor.
Après une promenade délicieuse, nous rentrons à la Résidence, où je demande à M. Beaudoin les renseignements nécessaires sur les étapes que nous avons à parcourir d’ici à Kompong-Thom. Il me donne l’itinéraire que l’on trouvera reproduit dans ce livre.
Le Résident de Kompong-Thom, M. Chambert, est prévenu de notre passage. De plus, tous les villages ont reçu des instructions pour déblayer la route, autant que possible.
Dans la province de M. Chambert où nous aurons une grande rivière à traverser, un pont provisoire doit être établi par les soins de ce Résident ! Nous ne saurions assez dire combien nous sommes touchés de tant de prévenances et de bons procédés. Nous y trouvons le plus précieux encouragement et la réconfortante certitude que nous avons été compris, et que tous ceux qui aiment ce pays ne nous ménageront pas leur concours et favoriseront de leur mieux la réussite de notre expédition.
Ainsi, dorénavant, notre route est tracée et tout y semble savamment étudié et prévu. Nous ne marcherons donc plus dans l’inconnu, et pour ainsi dire, à la découverte des obstacles et au petit malheur !
26 mars 1908.
Chacun sait par expérience que rien n’est plus occupé ni souvent plus fatigant qu’une journée de repos !… et que l’on se donne plus de mal pour son plaisir que pour son profit.
Conformément à cette règle générale nous avons décidé de nous adonner en ce jour au noble plaisir de la chasse.
Dès six heures du matin, nous partons donc, M. Dessenlis, Bernis et moi pour chasser en forêt.
Aussitôt placés la battue commence.
Elle rabat peu de gibier : un gros singe, deux coqs et une civette que M. Dessenlis s’adjuge d’un coup de fusil magistral.
A force de marcher, nous arrivons jusqu’à un étang d’où s’envolent à notre approche des cormorans serpentins et des canards. Faute de mieux, nous en tirons quelques-uns et nous rentrons déjeuner, non sans avoir donné un coup d’œil à la voiture qui reste le principal objet de nos préoccupations.
Elle nous paraît se porter à merveille. Guérin l’a soignée de main de maître. Il a changé contre une neuve la barre de connexion tordue. Le carter sera arrangé et remonté demain. Les pneus sont bons, bien qu’usés jusqu’à la corde sur les côtés extérieurs.
Toutes les munitions, l’essence, l’huile, le carbure, ainsi que les grosses pièces de rechange sont prêtes à être chargées dans les charrettes. A quatre heures, rassurés par cette inspection, nous retournons tous à cet étang qui nous a paru mériter une seconde visite, mais cette fois-ci, nous prenons une barque et nous nous glissons à travers les roseaux d’où notre invasion fait sortir des poules sultanes, des poules d’eau, des hérons, des canards, des cormorans, toute une volière.
Nous nous livrons à un massacre ornithologique et les victimes pleuvent autour de nous. Tous les chasseurs comprendront cette joie… elle est si vive que la nuit nous surprend et qu’il nous faut rentrer précipitamment à la Résidence, où nous arrivons tout juste pour le dîner.
Ce soir, Brin-d’Amour fait les frais de la conversation.
M. Beaudoin s’amuse de l’ignorance encyclopédique étalée en toute occasion par notre interprète-gâte-sauces, mais à entendre le récit des méfaits accomplis par ce personnage encombrant et désastreux, l’aimable Résident finit par nous prendre en pitié et nous propose, avec sa bonne grâce ordinaire, d’emmener un de ses boys chinois dont il nous vante l’intelligence et qui parle, en plus de sa langue, l’annamite, le cambodgien, et même le français !
Un si précieux cadeau nous semble inestimable et nous sommes ravis à l’idée de ne plus voir la figure chagrine et renfrognée du vilain petit babouin qui fut jusqu’ici le mauvais génie de l’expédition.
Les charrettes sont parties tantôt pour Baraï, village situé à près de 100 kilomètres. Elles doivent nous y attendre le samedi 28 au soir.
27 mars 1908.
Sic transit gloria mundi !… Brin-d’Amour est en prison ! Telle est la nouvelle que nous annonce M. Beaudoin à l’heure de l’apéritif ! Il paraît que, pour occuper ses loisirs, notre bête jaune s’est exercée à ce sport que les doux anarchistes appellent « la reprise individuelle »… J’ai comme une idée qu’il n’en est pas à son coup d’essai et je m’explique la disparition de quelques objets depuis notre départ. Toujours est-il qu’ici Brin-d’Amour a voulu travailler dans le grand et qu’il a volé hier une montre au boy chef de la Résidence. Mais ce digne serviteur ne s’est point laissé faire : il a pris Brin-d’Amour sur le fait et par la peau du cou, et la montre volée marquera l’heure de la séparation et de notre délivrance.
Puisse Brin-d’Amour, dit Bec-dans-l’huile, trouver dans cet incident regrettable le principe de sa régénération, et que la retraite lui inspire des méditations salutaires ! C’est la grâce que nous lui souhaitons !
… La voiture est tout à fait prête. Elle tend à devenir une célébrité indo-chinoise, et elle emportera de Kompong-Cham un nouveau surnom. Les administrés de M. Beaudoin l’ont appelée le « Dragon » et un artiste local a calligraphié sur le radiateur en beaux caractères chinois ce redoutable pseudonyme. Il lui vaudra, espérons-le, le respect superstitieux des populations…
Nous avons gardé les trois charrettes de Tay-Ninh, elles nous accompagneront jusqu’à Ang-Kor sous les ordres du fidèle Nam-Ay, dont nous n’avons jamais eu qu’à nous louer.
L’après-midi, nous retournons faire une partie de chasse aquatique sur « notre » étang et nous y prenons le plus vif plaisir.
L’aimable chancelier de la Résidence, M. Dessenlis, s’est vraiment multiplié pour nous amuser pendant notre séjour ici et ce nous est un devoir agréable de reconnaître qu’il y a pleinement réussi. Sa parfaite gracieuseté est pour beaucoup dans le souvenir ému et reconnaissant que nous emportons de ces trois jours à Kompong-Cham.
Demain matin, nous partons pour Baraï, où nous devons coucher. M. Beaudoin a pensé à tout. Tous les ordres sont donnés.
Nous avons comme interprète celui même de la Résidence. Il est d’origine portugaise et s’appelle Lopez, et nous emmenons Tiam, notre nouveau boy, dont la physionomie mobile et fine m’inspire dès l’abord beaucoup de sympathie. Il nous fera sans peine oublier son malencontreux prédécesseur.
… Tout de même cette étape de demain, d’ici Baraï, me semble quelque peu hardie. Cent kilomètres en un jour ! cela paraîtrait presque honorable sur de bonnes routes en pays civilisés… Enfin, M. Beaudoin nous assure que cela ira tout seul. Il oublie sans doute tout ce qu’il aura fait pour nous faciliter un si beau record. Il ne nous reste qu’à l’établir. Ayons confiance !

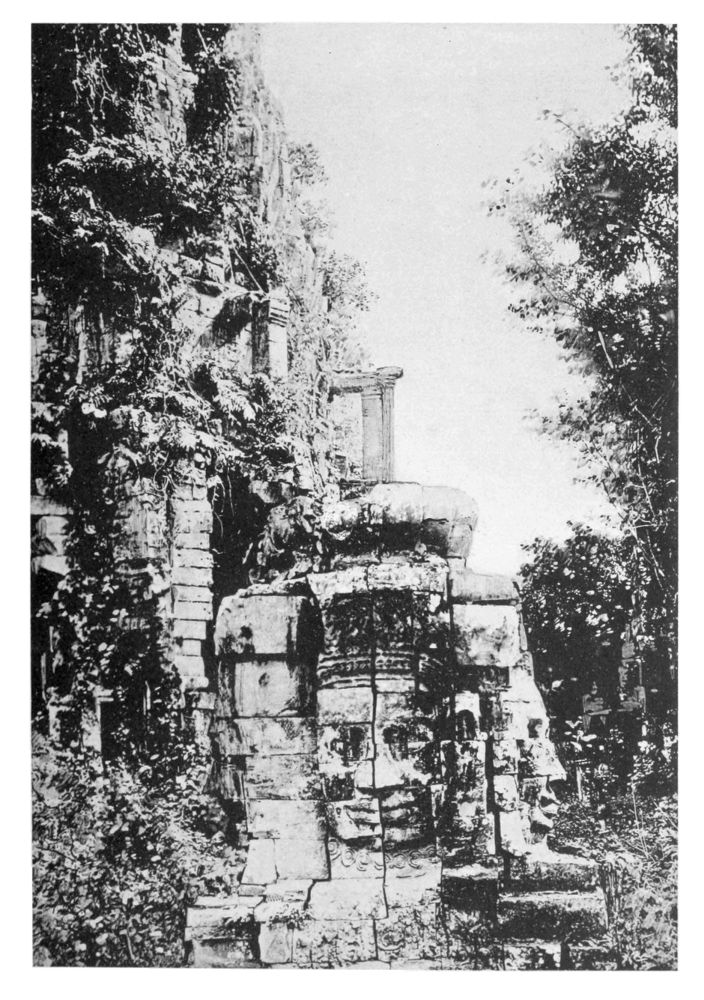
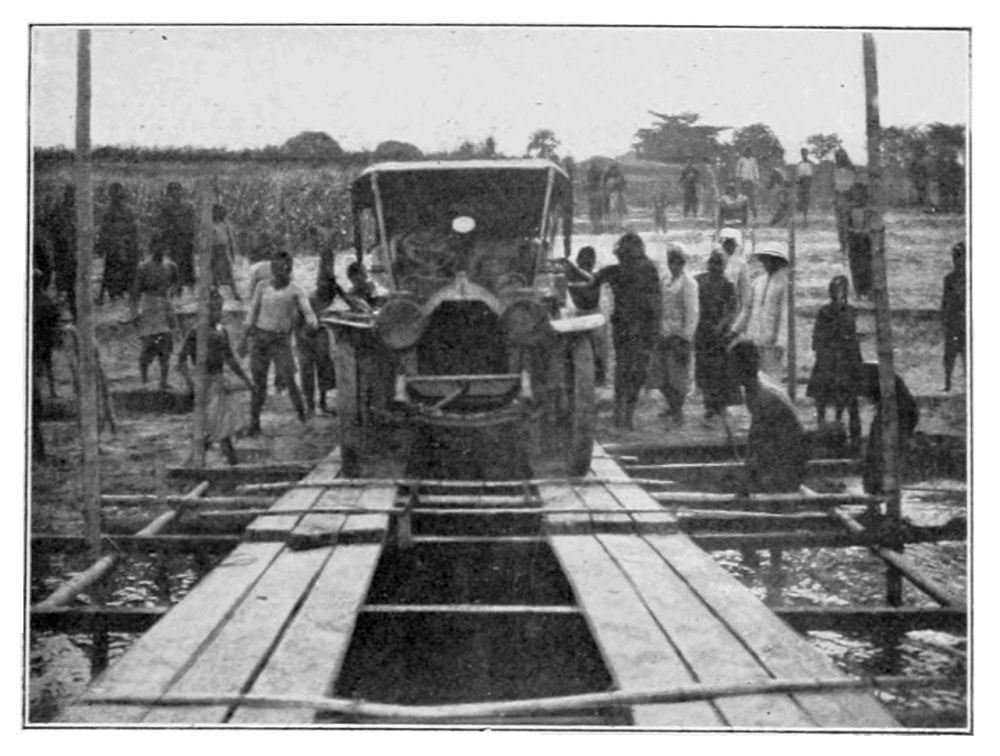
28 mars 1908.
Allons ! Il faut nous résigner à quitter cette résidence où nous avons reçu un si charmant accueil. Ce matin, dès six heures et demie, les bagages sont chargés sur l’auto, tout le monde est prêt… et nous faisons nos derniers adieux à M. Beaudoin et à M. Dessenlis. Vraiment il nous semble que nous quittons des amis que nous aurions toujours connus et nous voudrions mieux leur dire toute notre gratitude.
Pour la première fois, depuis notre départ de Saïgon, nous démarrons tristement et sans enthousiasme.
Nous refaisons d’abord la route déjà parcourue jusqu’aux ruines et nous la suivons jusqu’au 15e kilomètre où l’a poussée l’initiative de M. Beaudoin. C’est donc encore à lui que nous devons notre magnifique allure. A partir du 16e kilomètre la face des choses devient rébarbative ! Nous suivons à travers la forêt un chemin accidenté, ce qui fait dire à Guérin « qu’il ne faut pas pousser la sensibilité jusqu’à se désoler devant des accidents de terrain. » (!!!) Nous franchissons deux montées naturellement suivies de deux descentes rocailleuses, puis une quantité de petits ponts en bois… dont la solidité mérite les plus grands éloges, car tous résistent victorieusement à la dure épreuve que leur impose le poids de la voiture et nous nous étonnons joyeusement qu’ils n’aient pas craqué à notre passage.
Au sortir de la forêt, nous trouvons une vaste plaine que traverse une route sablonneuse. Cela ne nous dit rien qui vaille, mais le moteur travaille ferme et nous avançons sans encombres. Bientôt, par bonheur, cette route se sépare en deux et nous suivons celle de droite dont le sol est gazonné. Alors nous roulons sur le velours. A nous la quatrième vitesse. Cette route idéale est toute jalonnée de perches en bambous que couronne une touffe de feuilles : ce sont nos poteaux indicateurs.
— Tout un corps de balais, dit Guérin, et il ajoute :
— Quand on a été à la peine, c’est bien le moins qu’on soit jalonneur !
Je le regarde sévèrement, car je crois bien me rappeler que j’ai déjà lu cela quelque part… dans les œuvres complètes de Willy, sans doute !
Tout d’un coup, sans qu’on sache pourquoi, cette belle chaussée se termine dans une rizière.
Adieu la vitesse ! Voilà les bêtises qui recommencent.
N’importe ! nous avons gagné une fameuse avance sur notre horaire, il n’est que dix heures et nous avons déjà avalé 75 kilomètres, c’est-à-dire les trois quarts de ce record inespéré que nous promettait hier M. Beaudoin.
Maintenant nous roulons à travers des rizières, dont les indigènes ont coupé de place en place les remblais séparateurs afin de nous laisser passer. Malgré cette aimable attention, le terrain est très dur et nous retombons aux cahots : c’est la promenade des mille secousses.
Les fameux balais nous précèdent toujours et nous indiquent notre chemin.
A dix heures et demie, nous rentrons en forêt. La route est tortueuse et terriblement étroite, mais nous n’avons pas le droit de nous plaindre, car les coolies ont coupé les branches et les lianes qui auraient gêné notre passage. Et après les tristes aventures de ces derniers jours, nous nous estimons trop heureux de ne pas avoir à nous arrêter toutes les cinq minutes pour déblayer le chemin.
Néanmoins, les tournants sont d’une brusquerie tout à fait blâmable ! A chaque virage les coffres des marchepieds accrochent… et crient leur souffrance. Les pneus ne disent rien, mais ils n’en pensent pas moins. A onze heures et demie, nous retrouvons la plaine… Là-bas, tout là-bas à l’horizon, se dresse un bouquet de cocotiers que l’interprète nous montre d’un geste large et fier.
Baraï ! c’est Baraï ! où d’après nos prévisions les plus audacieuses nous ne devions arriver qu’à la nuit tombante. Nous avons peine à le croire… mais il faut bien se rendre à l’évidence. Si impossible que cela paraisse à notre modestie nous avons fait, en plein Cambodge, cent kilomètres avant déjeuner. M. Beaudoin serait fier de nous ! et ma foi, nous le sommes aussi un peu, tout de même !
… Mais un petit accident nous rappelle à la réalité, une branche accroche et arrache la valve du pneu arrière qui s’empresse de s’aplatir. Tant pis, nous n’en sommes plus à nous émouvoir à de pareilles vétilles ! Et aussi bien, puisque la route est sablonneuse, nous ne risquons rien et nous ne daignons même pas nous arrêter. Un peu plus loin, dans une ornière profonde, le carter touche avec force. Guérin descend, se couche sur le dos et travaille à le démonter, mais nous voyons la terre promise et l’espérance nous soutient.
Enfin, nous repartons et nous entrons dans Baraï en première vitesse, à midi et demi. J’aurais préféré midi juste ! mais le sable et le pneu nous ont quelque peu retardés.
Nos charrettes, elles aussi, ont fait de la vitesse, sous l’habile conduite de Nam-Ay ; elles sont là depuis le matin. On dirait vraiment que la Némésis indo-chinoise a renoncé à nous dresser des embûches.
Le gouverneur indigène de Baraï nous reçoit avec des honneurs qui ne laissent pas que de nous intimider quelque peu et la « Voiture de feu » lui inspire un mélange de crainte, de respect et d’admiration qui se traduit par des politesses à n’en plus finir.
Après mille protestations de dévouement, il nous remet une lettre du Résident de Kompong-Thom.
Bien persuadé que jamais nous ne pourrons parvenir avec la voiture jusque dans sa province, M. Chambert a la bonté de nous envoyer cinq chevaux pour nous et quatre éléphants pour nos bagages !
Tant de prévenances nous désempare. Certes, nous n’en voulons nullement à l’aimable Résident d’avoir douté de nous ; c’est qu’il ne sait pas encore de quoi nous sommes capables. Mais nous allons bien le lui faire voir ! Un grand complot se forme pendant le déjeuner, nous décidons à l’unanimité que non seulement nous arriverons à Kompong-Thom, et bien entendu avec la voiture, mais que nous y arriverons ce soir même !!
(Chœur des Conspirateurs, trémolo à l’orchestre.)
Le même enthousiasme nous soulève tous et le feu sacré de l’automobilisme nous pénètre. Nous nous sentons capables des plus grandes choses. Le déjeuner en souffre… mais qu’importe. Mange-t-on quand on a des ailes ?
Nous sortons de table en proie au plus généreux délire.
En hâte, Guérin, le plus emballé de nous tous ! remet une chambre à air neuve et fait les pleins d’huile et d’essence pendant que l’on charge les éléphants avec les caisses des deux charrettes de Kompong-Cham. Les braves bœufs venus de Tay-Ninh resteront ici sous la garde du gouverneur. En effet, le voyage ne leur a pas réussi, et les pauvres bêtes se ressentent de leurs fatigues. Elles sont maigres et efflanquées à faire pitié. Le village nous en fournira six autres.
… Ici se passe une chose bizarre et qui déroute toutes les notions que l’on peut avoir de l’arithmétique : nous avions en arrivant à Baraï cinq charrettes pour porter tous les bagages, nous en déchargeons deux pour en mettre le contenu sur le dos des éléphants (qui, comme on sait, ont le dos bon !…) et voilà qu’il faut, paraît-il, prendre cinq autres charrettes supplémentaires !… C’est une de ces combinaisons indo-chinoises où les quatre règles se mêlent et s’enchevêtrent pour le désespoir des Occidentaux. Si nous avions le temps, j’aurais plaisir à élucider ce problème, mais nous sommes pressés de partir ! Aussi je renonce à y rien comprendre et, en désespoir de cause, nous laissons Nam-Ay se débrouiller. Son intelligence chinoise lui fournira les ressources nécessaires pour s’en tirer tout seul à son honneur et à son profit… sinon au nôtre !
A trois heures et demie, nous quittons Baraï, escortés par une vingtaine d’habitants à cheval. Notre nouveau boy Tiam s’est, lui aussi, procuré une monture et caracole de son mieux. Je remarque encore dans notre cortège une étrange petite voiture cambodgienne composée d’un siège perché sur deux roues et qui s’appelle norgélette.
C’est, nous dit-on, un moyen de locomotion merveilleux pour le pays, car il permet de traverser sans encombre les terrains les plus mauvais. Je ne sais pourquoi, je préfère quand même notre Diétrich.

… Au sortir de Baraï, nous roulons dans une plaine immense qui s’étend à perte de vue devant nous. Le sentier que nous suivons est sablonneux et creusé çà et là d’ornières perfides qui se dissimulent sous les hautes herbes. Ces pièges perpétuels ralentissent notre marche et nous maintiennent dans un état d’exaspération constante.
La fâcheuse panne semble nous guetter à chaque tour de roue…
Enfin, nous l’évitons à force de prudence et, vers cinq heures, nous arrivons à Pnow où nous attend un obstacle de tout premier choix.
En effet, nous avons à traverser ici une rivière qui a le triple talent (pour citer une chanson de France !) d’être à la fois large, profonde et de courant très fort.
Avec cette extrême obligeance, dont nous trouvons les preuves à mesure que nous avançons dans sa province, M. Chambert a fait établir une passerelle qui semble se tendre vers nous comme une amie. Cette passerelle « de fortune » est construite avec des branches et des bambous qui supportent des planches très longues, mais assez minces.
Nous commençons par l’examiner avec soin, comme les grands acrobates des music-halls inspectent les agrès sur lesquels ils doivent exécuter un exercice périlleux.
De prime abord, la solidité de ce léger édifice nous inspire quelque inquiétude : un brusque plongeon dans la rivière ne vaudrait rien pour notre voiture… et deux sûretés valent mieux qu’une ; aussi enlevons-nous quelques planches du centre pour renforcer les côtés où passeront les roues de la voiture.
Le temps nous manque pour prendre d’autres précautions. Si nous voulons arriver ce soir à Kompong-Thom, il faut se hâter et ne pas se perdre en hésitations.
Tout le monde descend et je reste seul à la direction.
Bernis et Guérin se tiennent en avant sur le pont improvisé pour m’avertir au cas où les roues ne suivraient pas la bonne voie… une voie de bois marquée par des planches supplémentaires qui font les fonctions de rails.
… De plus en plus, j’ai l’impression d’être un de ces numéros « sensationnels » pour qui le manager réclame le silence au public… et je crois entendre une voix solennelle prononcer la phrase qui fait passer un petit frisson dans le dos des spectateurs…
« L’exercice auquel va se livrer devant vous l’illustre professeur X… étant des plus dangereux, le public est instamment prié de ne pousser aucun cri et de ne troubler l’opérateur par aucune manifestation !… »
Are you ready ?? — Go !!
J’appuie sur la pédale d’accélérateur.
La voiture s’engage en première vitesse sur la passerelle fléchissante qui craque et plie, comme je m’y attendais d’ailleurs.
Je me rappelle alors cet épisode du Tour du monde en quatre-vingts jours où un railway, lancé à toute vapeur, franchit un précipice sur un pont tremblant qui s’écroule aussitôt après son passage.
A moi ! Mânes illustres de Philéas Fogg et de Passe-Partout !
J’accélère… la voiture bondit en avant. De sombres craquements retentissent de toute part, je m’attends au plongeon…
Mais déjà la voiture escalade la berge. Sauvé !!!!!
Mes compagnons applaudissent… la foule trépigne et hurle, je sens que d’un seul coup je viens de conquérir à l’automobilisme « les couches profondes » de la population cambodgienne. J’en ressens une légitime fierté… mais je suis surtout heureux d’avoir passé sans encombres, car je puis bien me l’avouer à présent, dans tous les sens du mot, « je n’en menais pas large !! » Mais rien ne réconcilie avec le danger comme de l’avoir bravé et je recommencerais volontiers… si nous ne devions pas arriver ce soir à Kompong-Thom.
Je me dérobe à une ovation et je remercie le gouverneur cambodgien, non sans lui demander de conserver le pont pour notre retour.
Et nous repartons.
Quand on vient de passer un obstacle, la vitesse devient un besoin impérieux. Nous le satisfaisons donc et nous roulons en troisième à travers champs. Les notables de Baraï, qui s’amusent comme de grands enfants, nous suivent dans un tourbillon de poussière, au galop précipité de leurs chevaux qui n’en peuvent mais… l’un d’eux même, enivré de vitesse, court à bride abattue devant la voiture. Il nous force à modérer notre allure et nous aveugle de sable. Nous avons beau donner des coups de trompe, faire mugir la sirène, lui crier de s’écarter, rien n’y fait ! Le cheval affolé n’en galope que plus vite !
Alors, exaspérés, nous prenons la quatrième vitesse et au risque de tout casser, commence une course effrénée… dont nous sortons glorieusement vainqueurs.
Cette randonnée ne se termine qu’en entrant à Tang-Krassang où nous passons sur un superbe pont — un vrai celui-là ! — haut de vingt mètres et long de cent vingt. Passage sans accident, bien entendu ! Tout marche à souhait.
Nous traversons Tang-Krassang parmi les cris des habitants. Notre escorte est semée depuis une demi-heure et nous continuons notre route, toujours guidés par les balais qui nous continuent leurs bons offices de muets indicateurs.
A six heures et demie, en pleine clairière, nous nous ensablons jusqu’aux essieux. Il faut descendre et pousser pour aider le moteur…
Plus loin, la voiture touche… et nous voilà armés de pioches, en train d’aplanir le milieu de la route. Guérin travaille ferme en grommelant que, si nous arrivons jamais, nous pourrons nous vanter, à plus d’un titre, d’avoir fait la route de Saïgon à Ang-Kor.
Pendant qu’il nous prodigue ces encouragements, la nuit tombe tout à coup avec son habituel manque de politesse et de crépuscule. Et nous allons nous trouver obligés d’allumer les phares, non par crainte d’une contravention, mais parce que nous n’aurons que leur lumière pour nous guider. Le malheur est que les phares se sont mis en grève et ne veulent plus rien savoir… comme il arrive d’ailleurs dans toutes les circonstances où l’on a besoin d’eux. Les projecteurs se refusent énergiquement à fonctionner. Enfin, à force de discuter nous parvenons à obtenir de l’un des phares, celui dont la glace est du reste cassée depuis Tampho, qu’il consente à nous donner quelque lumière.
Nous repartons donc avec une voiture borgne, en tremblant à chaque instant qu’un souffle de vent n’éteigne notre œil unique !
Le palefrenier de la Résidence de Kompong-Thom qui avait amené les chevaux de Baraï vient de nous rejoindre ; je le fais monter sur le marchepied pour nous indiquer le chemin, car il fait noir comme dans un drame de l’ancien Ambigu et nous ne distinguons plus rien. Toujours du sable, toujours la forêt… et cette nuit profonde dont peuvent se faire une idée seulement ceux qui se sont trouvés seuls dans un pays ignoré, sous un ciel lourd sans étoiles et sans lune.
Cette route nous semble interminable, chacun de nous s’avoue à part soi qu’il n’est peut-être pas très prudent de se lancer dans l’inconnu en pleine nuit, mais nous nous gardons bien de nous confier nos impressions… Nous nous sommes juré de ne nous arrêter qu’à Kompong-Thom. Coûte que coûte, nous y arriverons ! Enfin, nous sortons de cette forêt ténébreuse ! Il n’en fait pas plus clair d’ailleurs, car de gros nuages couvrent le ciel… Mais nous sommes en plaine et nous n’avons plus à craindre de heurter quelque chose ou de rester accrochés par des lianes, ces pieuvres de la forêt ! La plaine dans laquelle nous roulons ne nous rappelle en rien la route de Paris à Trouville. Elle est couverte de grandes herbes, hautes de plus d’un mètre, qui se couchent sur notre passage, si bien que nous avons l’impression d’avancer sur une mer.
… Cette impression devient d’autant plus vive que tout à coup nous faisons un plongeon perpendiculaire dans un trou noir qui s’ouvre sous nos roues. Un cri d’effroi retentit au fond de la voiture… Mais déjà nous voilà remontés de l’autre côté de ce trou, qui n’était heureusement qu’un ravin. Nous commençons à prendre l’habitude de ce genre d’obstacles !… C’est égal, la nuit aidant, nous avons traversé en même temps que le ravin une seconde d’angoisse !
Nous en sommes tout de suite payés par une émotion délicieuse !! Là-bas, quelques points d’or étoilent l’obscurité. Notre guide pousse des cris de joie : il vient de reconnaître les lumières de Kompong-Thom !
Un enthousiasme unanime accueille cette bonne nouvelle. Il est, hélas ! de courte durée.
Sans doute c’est bien Kompong-Thom et nous voyons le but, mais nous en sommes séparés par des marécages qu’il nous faut tourner un à un, de sorte que nous avons beau avancer, la distance ne diminue pas. Tantôt à droite, tantôt à gauche les lumières de Kompong-Thom clignent comme de petits yeux pleins de malice et semblent se moquer de nous. Nous sommes en proie à cette exaspération qui saisit les derniers voyageurs de la ligne Panthéon-Place Courcelles, quand cet omnibus légendaire (et déjà cité !) fait le tour de tous les monuments qu’il rencontre. Je pense à Courteline… Mais je n’en suis pas moins furieux ! Enfin, le chemin devient praticable et se dirige droit sur la ville… quand, par une suprême ironie du sort, nous sommes arrêtés par l’obstacle le plus inattendu : une ligne de flammes qui jaillit brusquement devant nous, puis nous enveloppe et nous entoure de toutes parts ! Cela pourrait sembler un phénomène surnaturel, dû à l’intervention des génies qui gardent cette contrée et nous serions donc Dragon contre Dragon ! Mais non, nous n’aurons même pas la consolation que le merveilleux se mêle à nos aventures ! Cet incendie n’est pas dû à la malveillance, même divine, mais tout simplement à la prévoyance des indigènes qui ne nous attendaient pas si tôt et qui ont mis le feu à la plaine pour détruire les herbes.
… Cet obstacle a du moins cet avantage qu’il ne permet aucune hésitation. Il faut passer et tout de suite, sous peine d’être rôtis comme de simples poulets, car le vent attise le feu qui nous environne d’un cercle toujours plus étroit.
En avant donc !… Nous nous ruons en troisième vitesse au milieu des flammes qui semblent s’ouvrir sous notre assaut, puis, entraînées par l’appel de l’air, s’élancent à notre poursuite comme une immense vague prête à nous engloutir. Nous les gagnons de vitesse, mais nous en gardons tout de même une certaine chaleur entre les omoplates !
Aucun de nous ne pourra jamais oublier ces minutes-là.
Et si l’essence surchauffée avait pris feu, quelle terrible explosion nous eût dispersés dans le paysage !
Enfin, nous voilà bien vivants, grâce à Dieu… et toujours en vue de Kompong-Thom !
Nous tournons encore, nous tournons dans tous les sens… et nous nous trouvons soudain au pied d’un mur que la lueur de l’unique phare semble faire sortir de la nuit !… Une telle obstination du destin contraire finit par nous inspirer quelque gaîté.
Mais de bonnes paroles du guide apaisent nos rires sardoniques. Il paraît que ce mur n’en est pas un… et que nous nous trouvons au pied de la chaussée de la route en construction. Encore faut-il y grimper ! Et cela ne se fait pas sans peine, embrayages, débrayages, marche arrière et tout le diable et son train de pneus ! Enfin, d’un suprême élan nous escaladons cette chaussée abrupte (Bravo, la Diétrich !) et nous roulons enfin sur une route carrossable et bien entretenue.
Quelques instants après nous entrons dans Kompong-Thom et en suivant le cours de la rivière Stung-Sen nous nous arrêtons devant le perron de la Résidence… Deux ombres affolées le descendent, agitant les bras, et se précipitent vers nous : c’est M. Chambert, suivi de son chancelier, M. de Conchy.
Le Résident ne nous cache pas sa stupéfaction. Il ne peut pas croire que nous sommes bien là, devant lui, avec une automobile, quand ce matin nous étions encore à Kompong-Cham. Il nous accable de questions. Il nous avoue que ses notions du temps et de l’espace sont bouleversées… et d’ailleurs nous prouve le plus aimablement du monde qu’il n’en est rien : car il est le premier à s’aviser que huit heures et demie viennent de sonner et que nous devons mourir de faim. Nous sommes forcés d’en convenir. Il nous conduit alors à nos chambres, de magnifiques chambres situées au premier étage de la Résidence, et nous fait servir un excellent dîner, ainsi qu’à Guérin qui loge dans une maison voisine entièrement à son usage.
La voiture, sous la garde de deux linhs, reste devant la Résidence entourée de son public habituel d’admirateurs ! On la garera demain.
Et chacun s’en va se coucher, car nous sommes très fatigués, moi surtout qui de toute la journée n’ai pas quitté mon volant.
Les dernières heures de cette route dans la nuit ont été les plus dures que nous ayons encore passées, les plus exaspérantes aussi. Mais nous sommes si heureux et si fiers d’avoir accompli un vrai tour de force !
Pour des gens qui ne cherchent pas (et pour cause !) à faire de la vitesse, nous pouvons nous vanter de détenir un joli record. Nous avons tenu notre serment. La surprise de M. Chambert nous récompense de tous nos efforts et nos ennuis sont vite effacés par la joie d’être arrivés, non pas par les moyens mis si gentiment à notre disposition, mais par nos propres forces et dans notre bonne voiture !
… Je ne ressens d’ailleurs aucune confusion à avouer que mes propres forces personnelles sont bien déprimées et que j’ai besoin d’une bonne nuit pour me remettre d’aplomb.

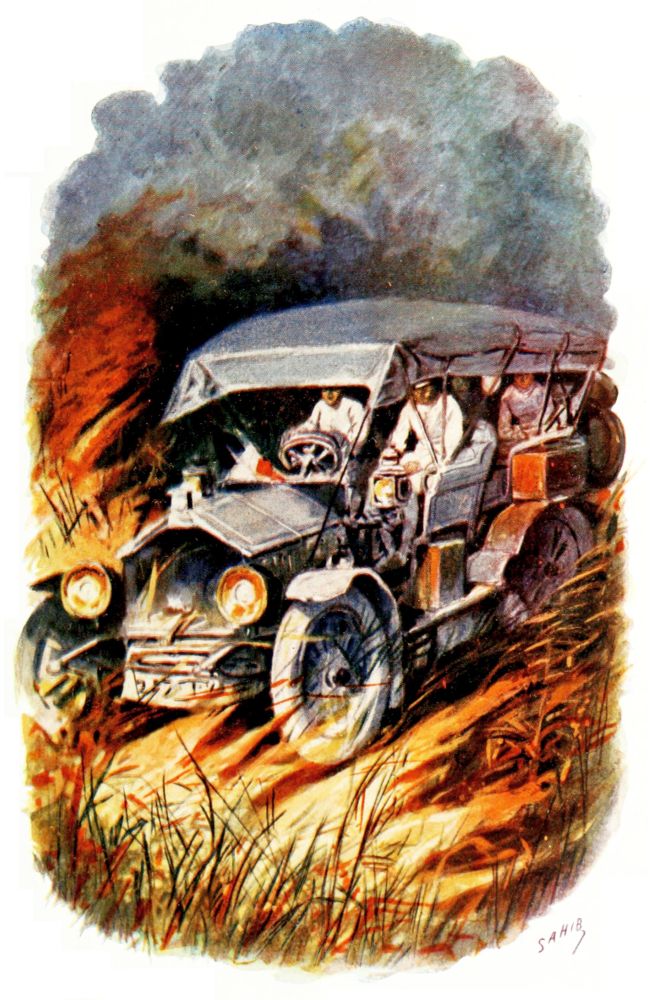

25 mars 1908.
Ayons l’affreux courage de l’avouer : nous avons fait la grasse matinée !… C’est tout juste si nous sommes prêts à l’heure du déjeuner. La confusion que nous en éprouvons est singulièrement adoucie par le bien-être que nous a laissé cette nuit réparatrice. Nous avons dormi longtemps, beaucoup… et beaucoup à la fois — mais pas très vite, il faut le reconnaître, et nous ne nous sentons pas la force de le regretter.
Ma première pensée est pour la voiture. On l’a garée sous un hangar et Guérin lui tâte le pouls, l’examine en détail, resserre un écrou par-ci, un boulon de la carrosserie par-là. A part ces petits accrocs inévitables, rien n’a bougé, tout va bien ; il faut le voir pour le croire !
A une heure, les éléphants arrivent, sans se départir de cette solennelle lenteur qui leur est coutumière. Mais point de charrettes.
Pour nous conformer à une habitude coloniale, que nous n’avons guère imitée jusqu’ici, nous faisons la sieste : c’est une occupation pleine d’agréments, mais qui m’exaspérerait, je crois, si elle devenait quotidienne. Pour une fois, je m’en accommode le mieux du monde.
Après la sieste nous faisons une promenade à cheval de l’autre côté de la rivière.
M. Chambert nous fait gentiment part de la forte résolution qu’il a prise de ne nous laisser partir qu’à la dernière extrémité ! Comme je lui ai laissé voir ma passion pour la chasse, il tient à nous garder le plus longtemps possible, afin que nous chassions tous les jours dans les environs. Et déjà il arrange une grande battue pour demain matin ; nous serons à dos d’éléphants, ce dont nous nous réjouissons fort.
Les quelques jours que nous devons passer à la Résidence s’annoncent pleins d’agrément et de charme.
30 mars 1908.
A la demande générale, la chasse est remise à demain pour laisser reposer les braves éléphants revenus de Baraï et qui gardent encore dans les jarrets quelque fatigue du voyage.
Nous remplaçons la chasse par une promenade à cheval : j’en suis fort heureux, car l’automobilisme ne m’a aucunement brouillé avec l’équitation. En matière de sports surtout, il faut pratiquer le plus large éclectisme ; l’homme d’un seul sport risque de devenir un redoutable « Fâcheux », Molière s’en était avisé déjà. Aujourd’hui, les fâcheux sont devenus des raseurs, leur nom seul a changé.
… Des instructions sont données aux gouverneurs pour faire déblayer notre route le plus possible jusqu’à la province de Battambang.
M. Chambert écrit au Résident de cette province pour lui demander de bien vouloir en faire autant dans sa juridiction ; je ne puis dire assez combien je suis touché de cette aimable collaboration que nous avons trouvée partout jusqu’ici, et j’en reste très fier, car elle me prouve que notre voyage peut être utile à la colonie.
J’ai un itinéraire détaillé jusqu’à Siem-Reap.
Un pont sera établi ici, pour nous permettre de passer la rivière et nous n’en prévoyons pas d’autre sur toute la route. Nous n’aurons à traverser que deux grandes mares très peu profondes.
Espérons que nous en avons fini avec ces pannes aquatiques, qui ont déjà failli nous être si fatales, et que dorénavant la chance nous favorisera jusqu’au bout.
31 mars 1908.
A cinq heures et demie du matin, Guérin vient m’avertir que les éléphants sont là !
Nous les escaladons, grâce à une gymnastique sévère, et nous nous installons tant bien que mal, plutôt mal que bien dans les paniers pendus à leurs flancs.
Puis, les énormes bêtes s’ébranlent. Le sol tremble. On redoute un cataclysme, on a l’impression de se trouver juché sur une colline pendant un tremblement de terre.
Les paniers nous coupent les jambes, les secousses nous coupent la respiration et Guérin insinue sournoisement que « nous n’y couperons pas pour une courbature ! »
Après des oscillations qui n’ont rien d’isochrone, nous arrivons sur le terrain de chasse. Une véritable surprise nous y attend ; en effet, les rabatteurs ont eu la singulière idée de faire la battue à l’envers et d’envoyer le gibier dans la direction exactement opposée à celle où nous sommes venus l’attendre… Ont-ils voulu par là se distinguer ? ou la pratique du sabotage aurait-elle déjà envahi l’Extrême-Orient ? Toujours est-il que les effets d’une telle manœuvre ne comportent pas de commentaires. Ils se devinent aisément.
Navré d’une telle déconvenue, je passe ma juste fureur sur un aigle qui plane au-dessus de nos malheurs et je l’abats d’un coup sans lui laisser le temps de comprendre pourquoi !
Guérin déclare que, décidément, l’éléphant n’est pas un moyen de transport et que ça ne vaudra jamais l’auto. A l’appui de cette déclaration véhémente, il prend le parti de revenir à cheval.
1er avril 1908.
Dès six heures du matin, nous repartons pour la chasse mais sans emmener cette fois ni Bernis ni Guérin et surtout sans rabatteurs.
Toute notre stratégie consiste à marcher en ligne avec les cinq éléphants à travers l’inextricable fouillis d’herbes qui nous submerge et où nous disparaissons presque entièrement.
De temps en temps, cette sorte de mer végétale se creuse d’un remous ou se plisse d’un sillage qui révèle le passage d’un cerf, d’un chevreuil, d’un sanglier, peut-être même d’une panthère.
Juchés sur nos vastes montures, nous avons l’impression d’être embusqués dans la tourelle d’un cuirassé que menacerait une escadre de torpilleurs… ou de sous-marins. Et le mouvement des petites herbes frôlées, qui s’inclinent et se redressent, s’entr’ouvrent et se referment, nous permet de deviner la présence du gibier. Il faut donc tirer vite et au jugé… Mais ce qui rend la comparaison plus exacte encore entre nos éléphants et les bateaux de guerre, c’est que le roulis de nos montures nous rend le tir très difficile. Nous entretenons un feu de salve nourri qui jette le désarroi autour de nous. La mer verte de l’herbe ondule et frissonne en vagues inégales. On sent que là-dessous des bêtes affolées s’enfuient de toutes parts, mais elles nous demeurent invisibles et nous ne pouvons compter que sur la chance. Elle me favorise enfin, et l’une de mes balles abat un beau chevreuil. En rentrant à la Résidence, M. Chambert photographie notre voiture entourée des éléphants, et cela forme une espèce d’allégorie de « l’Anachronisme ».
Le pont qui doit permettre à l’auto de traverser la rivière est déjà assez avancé pour que nous puissions fixer notre départ au 3 avril, après le déjeuner.
Mais voilà que Guérin, en travaillant à la voiture, vient d’écorcher la plaie de sa main qui était presque entièrement guérie et cet accident ne laisse pas que de m’inquiéter : je me rends compte que le pauvre garçon souffre beaucoup plus qu’il ne veut le laisser voir.
Il finit par m’avouer qu’il ressent des élancements très douloureux. Notre compagnon et M. Chambert le pansent de leur mieux. J’espère qu’il sera rétabli demain. En cas contraire il serait imprudent de poursuivre notre voyage.
2 avril 1908.
Le pont est terminé ! C’est un travail splendide et qui fait honneur à la main-d’œuvre cambodgienne. Il semble qu’un train de marchandises y passerait sans accident et, pour que rien ne nous retarde demain, nous allons l’utiliser dès à présent…
Comme nous l’espérions, tout marche à souhait : au passage de l’auto, pas un craquement, pas un fléchissement… et pas la moindre émotion. La seule difficulté consiste, une fois passés, à remonter la berge à la fois escarpée et sablonneuse ; il y faut le concours bruyant des nombreux coolies qui ne parviennent pas sans peine à tirer la voiture du sable où elle s’est enlisée jusqu’aux essieux. Là encore, la main-d’œuvre cambodgienne finit par triompher et nous sortons sans plus d’encombres de ce mauvais pas. Mais, si la main-d’œuvre cambodgienne est excellente, le malheur est que la main de Guérin ne va pas mieux aujourd’hui, au contraire ; ses douleurs n’ont fait qu’augmenter durant la nuit et notre inquiétude s’accroît d’heure en heure. De tous les déboires que nous avons eu à subir, la souffrance de l’un des nôtres est encore le pire et celui que nous avions le moins prévu.
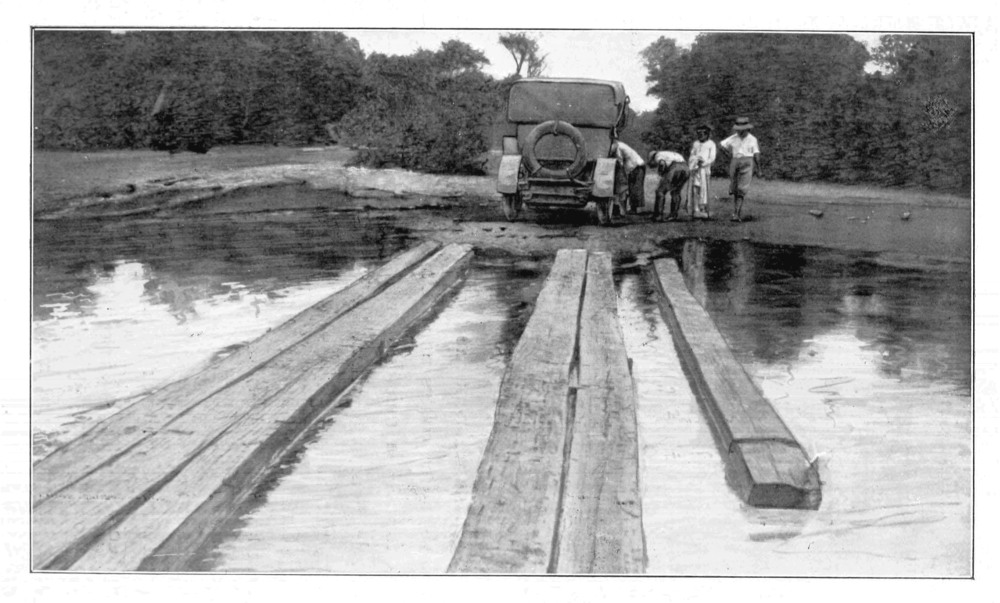
3 avril 1908.
Il semble vraiment que le mauvais sort s’acharne et que tout se tourne contre nous. Un si violent accès de fièvre m’a terrassé la nuit dernière que je ne me sens pas en état de partir aujourd’hui. Mais cet accablement passager n’est rien auprès de la souffrance qu’endure le malheureux Guérin dont le bras enfle malgré les cataplasmes et dont la plaie prend un mauvais aspect. Les douleurs sont devenues intolérables et lui donnent une fièvre intense : il lui serait impossible de partir et son état exige les soins immédiats d’un bon médecin. Mais hélas, il n’y a pas de médecin à Kompong-Thom. On n’en peut trouver un qu’à Kompong-Chnang et les moyens de communication, surtout pour un blessé, ne sont pas faciles ; le seul pratique est la voie fluviale.
M. Chambert a la bonté de mettre sa jonque à notre disposition et à dix heures du soir, Guérin part accompagné d’Hervé de Bernis et plus désolé de ce triste contre-temps que de sa blessure elle-même. Je ne puis dire avec quelle tristesse je vois s’en aller nos deux compagnons. Il me semble que notre expédition se disloque et qu’il va falloir renoncer à notre voyage.
4 avril 1908.
Ce matin, pour m’occuper et m’entretenir dans l’illusion que tout n’est pas perdu sans retour, je ramène l’auto à son garage et je nettoie les soupapes.
… Notre beau pont est déjà presque tout à fait démonté, le Chinois qui avait prêté les planches les ayant réclamées dès hier.
M. Chambert nous entoure d’intentions si aimables que nous nous félicitons que la fortune adverse nous retienne auprès de lui, car il sait nous consoler de notre tristesse.
Il trouve que nous avons eu assez de malheurs et cherche à nous persuader de renoncer à la fin de notre voyage…
Ne pas aller à Ang-Kor ! En sommes-nous là vraiment ? Hélas ! il faut bien s’avouer que si notre pauvre Guérin met trop longtemps à se rétablir nous nous verrons forcés de repartir sans lui. Une perte de temps trop prolongée peut tout faire échouer, car la saison des pluies approche et dès qu’elles commenceront à tomber, les plaines que nous avons à traverser ne seront plus qu’un immense lac infranchissable.
Jamais encore, depuis notre départ de Saïgon, nous ne nous sommes trouvés dans un aussi cruel embarras.
Nous attendons avec anxiété une dépêche de Bernis qui nous renseignera sur l’état de ce malheureux Guérin.
5 avril 1908.
Nous avons fait ici la connaissance de M. Colin qui s’intitule, non sans une légitime fierté « le seul colon du Cambodge ». Lui aussi s’intéresse à notre expédition et dans l’aimable intention de me distraire et de me faire oublier les ennuis de mon inaction, il m’a très gentiment offert de me mener à la chasse.
Ce matin donc, à sept heures, je pars avec lui et le compagnon pour certain endroit qu’il connaît et où se trouvent, paraît-il, beaucoup d’élans qui sont, comme nul ne l’ignore, de grands cerfs, faits pour remplir d’enthousiasme un Nemrod européen. En route, pour me faire la main, je tire à balle un chacal et un marabout.
Après trois heures de marche, nous arrivons à une pagode, aux abords de laquelle les élans ont coutume de se donner rendez-vous… Mais ils n’y viennent que vers quatre heures et il nous faut attendre leur bon plaisir…
Or, nous mourons de faim et de soif, et nous n’avons pour toute nourriture et pour tout breuvage que les noix de coco qui pendent à notre portée.
Dans une pareille disette je ne vois d’autre secours que l’inépuisable générosité de M. Chambert et je lui dépêche un indigène avec un mot griffonné à la hâte pour le supplier de nous envoyer le plus vite possible à boire et à manger… Et nous attendons dans une canha en regardant les bonzes de la pagode déguster leur riz.
A une heure, Tiam arrive à cheval suivi d’une escorte de coolies qui fléchissent sous le poids des flacons et des victuailles. M. Chambert a répondu sans perdre une minute à notre attente et nous a envoyé en hâte tout ce qu’il avait de prêt… c’est-à-dire de quoi repaître plusieurs Gargantuas. Nous occupons donc à déjeuner les loisirs que Messieurs les Élans veulent bien nous laisser.
Mais nous finissons par trouver que ces loisirs se prolongent trop. Les indigènes nous font une battue…
Décidément, ils n’ont pas « la manière ».
Les élans, qui ne veulent rien savoir, se sont enfuis.
Pour se consoler, le compagnon tire mélancoliquement un autre chacal et nous rentrons à pied pour dîner.
J’ai la joie de trouver à la Résidence une dépêche rassurante de Bernis qui me donne de bonnes nouvelles du blessé et m’annonce leur arrivée.
6 avril 1908.
Encore une journée de repos forcé.
Dans l’après-midi je reçois de Kompong-Chnang un second télégramme. Il m’annonce l’arrivée de Bernis qui rentre à cheval ; quant à Guérin, heureusement opéré du phlegmon qui l’a tant fait souffrir, il revient en jonque accompagné par le docteur Dupont.
Ces bonnes nouvelles me consolent de notre inaction et me rendent enfin l’espérance. Nous allons donc pouvoir reprendre notre voyage et partir pour Siem-Reap.
7 avril 1908.
A trois heures, Bernis arrive. Il est très fatigué de sa longue et dure chevauchée, mais il reprend courage en nous la racontant !
Il nous dit aussi toutes les péripéties du triste voyage qu’il a fait en jonque avec le blessé ; ils s’échouaient à chaque instant et n’avaient, pour toute nourriture et pour toute boisson, que ces sempiternelles noix de cocos… qui semblent remplir ici le rôle bien connu des briques dans l’alimentation européenne.
Notre pauvre Guérin a terriblement souffert. Mais grâce à Dieu, le voilà hors de danger : ce n’est plus maintenant qu’une question de soins pour laver et désinfecter la plaie. Auprès de nous ils ne lui manqueront pas.
8 avril 1908.
Comme il nous faut repasser le fleuve en quittant Kompong-Thom et que par la mauvaise volonté du Chinois qui nous loua ses planches, notre pont a rendu son tablier, nous nous trouvons dans un certain embarras.
M. Colin s’offre gracieusement à nous en tirer.
Il veut bien se charger de faire rétablir le tablier pour le passage de l’auto. Et, sous sa direction, des indigènes se sont déjà mis à l’œuvre.
Mais le grand événement du jour, c’est la rentrée de Guérin ! Il arrive après déjeuner, accompagné de l’excellent docteur Dupont qui l’a si vite et si bien opéré — et qui ne veut pas se séparer de son malade avant de le savoir tout à fait hors d’affaire.
En nous revoyant, ce brave Guérin retrouve sa gaîté et sa bonne humeur. Il ne parle que de repartir et demande à reprendre son service… et tout de suite ! J’essaie de le calmer et de modérer son ardeur : mais j’admire son courage : car il n’a pas encore fini de souffrir. Sa plaie n’a pas bon aspect. Elle est très profonde et creusée en trois endroits sous les nerfs.
Pourtant le docteur nous affirme qu’il n’y a plus aucun danger et donne des instructions au compagnon qui devra deux fois par jour faire au blessé des lavages d’eau phéniquée, au moyen d’une seringue spéciale. Moyennant quoi, Guérin pourra repartir avec nous dès demain. Je veux protester, mais notre rescapé insiste si vivement, il se reproche avec tant d’amertume de nous avoir retardés que, sur un signe du docteur, je finis par lui donner raison. Je sais bien d’ailleurs que nous ne pourrons pas partir demain et que ce ne sera pas trop de la journée pour achever le tablier du pont, en éprouver la solidité et faire passer la voiture de l’autre côté du fleuve. Mais je suis si heureux du retour de Guérin que les difficultés me paraissent bien peu de chose : notre groupe est reconstitué, voilà l’essentiel.
9 avril 1908.
Notre pont a repris un aspect tout à fait coquet : il sera terminé tantôt et M. Colin m’affirme que la voiture pourra le franchir en troisième vitesse !… Je m’en garderai bien, mais tantôt vers cinq heures, j’essaierai modestement de faire traverser l’auto sur l’autre rive… Guérin a passé une bonne nuit et se désespère de ne pas quitter dès ce matin Kompong-Thom. Il n’a plus d’autre fièvre que la fièvre du départ.
Je viens d’envoyer en avant les six charrettes, qui restent sous la conduite habile de Nam-Ay. Elles se dirigent vers Kompong-Chen où elles devront nous attendre demain soir.
Après déjeuner, nous faisons une courte promenade dans la Diétrich avec MM. Chambert et de Conchy et le gouverneur cambodgien… qui ne trouve pas de mots, même dans sa langue, pour exprimer son admiration… Puis j’amène la voiture au pont.
A première vue je ne partage pas toute la confiance de M. Colin dans la solidité des planches. J’envisage sans enthousiasme l’éventualité d’un plongeon qui compromettrait la cause de l’automobile aux yeux des populations massées sur la rive et qui pourrait terminer un peu brusquement la carrière de notre héroïque voiture. Aussi je ne m’engage qu’avec une extrême prudence. Et bien m’en prend !… car mes prévisions sceptiques ne se justifient que trop… A peine la Diétrich a-t-elle avancé de trois mètres que les roues d’avant passent au travers des planches qui craquent avec un fracas ironique : le tablier est défoncé et le moteur repose sur les piquets. Voilà notre auto sur pilotis.
Des coolies se précipitent et s’accrochent aux roues d’arrière : ils parviennent à ramener notre pauvre voiture sur la rive. Une fois de plus, tout est à recommencer !
Par bonheur, M. Chambert, à qui nos malheurs inspirent une commisération active et dévouée, donne des ordres pour faire remplacer les planches perfides par d’autres plus épaisses.
Je me reprends à espérer que nous pourrons partir demain.



10 avril 1908.
Tout est prêt enfin !
Le pont rendrait des points à celui d’Avignon… On y danse… tout autant et sans plus de péril : la voiture le traverse en toute sécurité et comme des planches ont été disposées sur le sable de l’autre côté du fleuve, nous franchissons la berge dans un style tout à fait impressionnant.
A huit heures et demie, nous prenons congé de M. Chambert et nous quittons Kompong-Thom dont il nous a rendu le séjour si agréable, malgré les coups du mauvais sort.
Nous revoilà donc en route et presque étonnés d’entendre ronfler le moteur et de nous retrouver en bon ordre de marche.
Guérin a repris toute sa bonne humeur et ne veut plus entendre parler de sa blessure. Elle doit pourtant le faire souffrir encore, mais il s’efforce si courageusement de nous la faire oublier qu’il semble vraiment l’oublier lui-même.
Nous marchons à bonne allure.
A neuf heures, nous traversons la mare de Saloniet sur des poutres très solides… mais fort étroites, ce qui nous contraint à des prodiges d’équilibre et à des prouesses de direction pour maintenir une roue sur chaque poutre : car la moindre déviation entraînerait des conséquences… sur lesquelles, à l’exemple de la voiture, il vaut mieux ne pas s’appesantir.
Le paysage est merveilleux : la verdure et les fleurs nous entourent d’un immense jardin naturel et la route est passable sinon carrossable. Tout marche assez bien jusque vers dix heures, où nous retrouvons cet imprévu décevant et sournois qui semble en vérité nous attendre à tous les détours du chemin : la voie des charrettes, qui se confondait avec celle de l’auto, se rétrécit brusquement d’au moins 15 centimètres, de sorte que notre voiture se trouve réduite au rôle de charrue et forcée de s’ouvrir le passage en écartant la terre des deux côtés.
Je commence à me demander quel nouveau genre d’obstacles nous allons bien pouvoir trouver d’ici Ang-Kor. Serait-il donc écrit que nous aurons toutes les déveines ?
Nous n’avançons plus qu’en deuxième vitesse, puis en première.
Enfin, la route daigne s’élargir un peu et nous roulons maintenant à une honnête vitesse à travers une vaste plaine.
Mais la chaleur devient telle et le moteur chauffe à tel point que l’essence s’évapore avant d’arriver à l’admission et que les explosions se font irrégulières : puissent ces détails techniques nous valoir la sympathie attendrie et d’ailleurs rétrospective de tous les chauffeurs pour qui sont écrites ces notes… Ils comprendront que, comme nous, notre radiateur a besoin de quelque rafraîchissement.
Nous nous arrêtons donc près d’une mare pour le réconforter d’une douche nécessaire.
Pendant cet arrêt, je prends ma carabine et j’ai la chance d’abattre un chevreuil qui broutait à 400 mètres de nous. Ce bel exploit plonge notre nouveau guide et notre boy Tiam dans une stupeur admirative où il entre un peu d’épouvante ! Évidemment, cela ne leur paraît pas naturel… Ils nous contemplent, ma carabine et moi, avec des yeux hagards en se demandant auquel de nous deux attribuer ce miracle : j’en rends grâce à la précision extraordinaire de mon arme.
Nous déjeunons sous une touffe de bambous, et tandis que nous nous reprenons à reparler d’Ang-Kor, comme des gens bien décidés à y arriver, voilà que tout à coup Guérin nous apparaît coiffé d’un bonnet extraordinaire qui semble lui avoir poussé sur le crâne par une sorte de magie : c’est un nid de fourmis rouges qui vient de s’abattre sur lui ! Notre brave mécanicien se refuse à voir un don du ciel dans cette coiffure mouvante et pittoresque et s’en débarrasse avec une vivacité en somme excusable.
L’émotion générale étant apaisée, nous repartons et nous avons la joie de retrouver une route suffisamment déblayée et jalonnée par les fameux balais indicateurs… discrets et silencieux comme d’utiles amis.
Nous sommes bien un peu inquiets de ne pas trouver d’obstacles, car l’habitude nous manque !… mais nous avançons rapidement : le moteur, lui, n’a pas de mauvais pressentiments.
A trois heures, nous faisons halte auprès d’une autre mare pour remettre de l’eau dans la machine… et aussi pour nous reposer un peu. Je m’étends à l’ombre d’un immense banian avec la ferme intention de m’y pausoler, selon l’heureux néologisme qu’inventa Pierre Louÿs à l’usage du plus aimable des « Rois fainéants ».
Et comme je considère l’envers des feuilles doucement agitées au-dessus de moi, un objet extraordinaire frappe mes regards…
Quelquefois, en levant les yeux j’aperçois au ciel une étoile : il semble même difficile qu’il en soit autrement, quand le ciel reste clair ! Mais jamais, au grand jamais, il ne m’était arrivé en levant les yeux d’apercevoir une boîte aux lettres ! Cette tirelire à secrets se trouve généralement à portée de la main : à trois mètres au-dessus du sol et solidement fixé au tronc d’un arbre gigantesque, un pareil objet étonne le voyageur ; il se demande s’il s’agit d’une convention postale ignorée, d’un rite religieux ou d’une simple plaisanterie.

Je m’informe et l’on m’apprend que c’est « fait exprès », car la saison des pluies transforme les plaines que nous traversons en un lac immense dont les eaux sont si hautes que les transports s’y font en jonques, et qu’alors, cette boîte aux lettres de Tantale se trouve remise à la portée des facteurs indigènes qui n’ont plus qu’à se baisser pour faire la levée ! Guérin en conclut justement que pendant la saison sèche « la correspondance est à l’impériale ».
Nous ne trouvons pas d’autres curiosités locales jusqu’à Kompong-Chen où nous arrivons à cinq heures.
Nos charrettes nous y attendent et la sala qui nous est réservée répond à toutes les exigences du confort asiatique : il diffère sans doute un peu du confort européen, mais nous commençons à savoir l’apprécier. Nous avons pour y passer la nuit ces matelas cambodgiens qui se replient comme des paravents et qui sont durs et frais ainsi qu’il sied sous ce climat accablant.
Guérin souffre beaucoup moins de sa main et la voiture se porte à merveille. On fait un pansement à l’un et l’on resserre un boulon à l’autre. Je ne les sépare point, car notre vaillant mécanicien se soucie plus de sa voiture que de lui-même et tout lui semble aller pour le mieux quand son carburateur ou son radiateur ou son moteur ne lui donnent pas de tracas.
Avant le dîner nous recevons la visite du gouverneur indigène. Il nous apporte gracieusement des drapeaux français que nous attachons sur la voiture… Tous ceux qui ont vécu trop longtemps loin de leur pays comprendront combien nous sommes touchés de cette attention délicate et charmante.

Ce brave homme nous apparaît comme un messager de paix et de bon augure. Il m’annonce que notre route est toute préparée et que nous n’aurons donc aucune difficulté pour franchir la grande mare qui nous inquiétait un peu.
Et pour que rien ne manque à notre joie, le gouverneur nous apprend encore que ce soir il donnera, à notre intention, des danses cambodgiennes et une pantomime. Toute la lyre !
Tant de félicités nous ont ouvert l’appétit et nous dînons superbement et magnifiquement d’un cuissot de chevreuil, le reste de la bête ayant été partagé entre le gouverneur et notre fidèle Nam-Ay.
Après dîner, danses et pantomime. Le programme est un peu chargé, mais on ne saurait trop encourager les Arts… et la fête se prolonge fort avant dans la nuit.
Nous avons fait aujourd’hui cinquante kilomètres.
Aussi les matelas cambodgiens et surtout le silence qui suit le tintamarre des musiciens nous semblent tout à fait délicieux.
11 avril 1908.
… Notre première démarche matinale est de rendre visite en auto à notre excellent gouverneur : il nous reçoit, entouré de toute sa famille, avec une parfaite bonne grâce et nous invite à boire : on se croirait vraiment chez un hobereau des bords de la Loire ; c’est le même accueil simple, cordial et franc, la même politesse attentive et gentiment familière.
Puis nous repartons pour la sala où nous prenons Tiam et le guide qui doit nous conduire jusqu’à Siem-Reap.
Les charrettes sont déjà en route.
Après avoir passé le pont de Kompong-Chen, nous nous engageons dans la prairie…

Ici, au lieu de boucher et de combler les ornières, les coolies ont fait mieux : ils ont simplement fauché les herbes sur une largeur de trois mètres et presque en ligne droite. Le résultat nous apparaît tout à fait louable… car nous roulons sur un terrain un peu cahoteux sans doute, mais d’une dureté propice à la vitesse et nous avançons rapidement.
Ce n’est pas pour nous vanter, comme dit à peu près le vaudevilliste, mais il fait terriblement chaud ! Le moteur lui-même en souffre quoiqu’il ne manque pas une goutte d’eau au radiateur. Mais il en a vu de plus dures, et son malaise ne se traduit heureusement par aucune panne.
A midi, nous entrons (sans frapper) dans un bouquet d’arbres et nous débouchons sur la grande mare entourée de cabanes de pêcheurs.
Le site est ravissant et, selon la formule des écrivains du dix-septième siècle, « fait à souhait pour le plaisir des yeux ». Ce frais paysage nous repose, après la monotonie de l’interminable plaine. Nous descendons une légère pente, puis nous contournons la mare pour aller la traverser à l’endroit le moins large, sur un pont formé de planches posées sur les pirogues.
Nous commençons d’abord par nous arrêter pour remercier le chef du village qui nous a préparé la route et pour le prier de ne pas faire démolir cette confortable et solide passerelle que nous comptons bien retrouver en revenant d’Ang-Kor.
… Je ne sais pourquoi, cette prévision du retour me fait espérer que nous arriverons !
La passerelle se comporte très vaillamment.
De l’autre côté de l’eau, nous remontons une berge assez escarpée et nous retrouvons la plaine qui s’étend à perte de vue devant nous.
Le chemin tracé par les soins des gouverneurs nous permet de goûter cette joie ineffable : « la quatrième vitesse ! »
Nous nous enivrons d’espace, et cette boisson symbolique nous rafraîchit un peu, malgré la chaleur qui continue de se surpasser.
A une heure après-midi, nous nous arrêtons devant une pittoresque canha que sa position nous autorise à qualifier de lacustre, car elle s’élève sur pilotis à 3 mètres au-dessus du sol. Nous garons l’auto dessous, puis nous déjeunons et prenons un peu de repos jusqu’à trois heures.
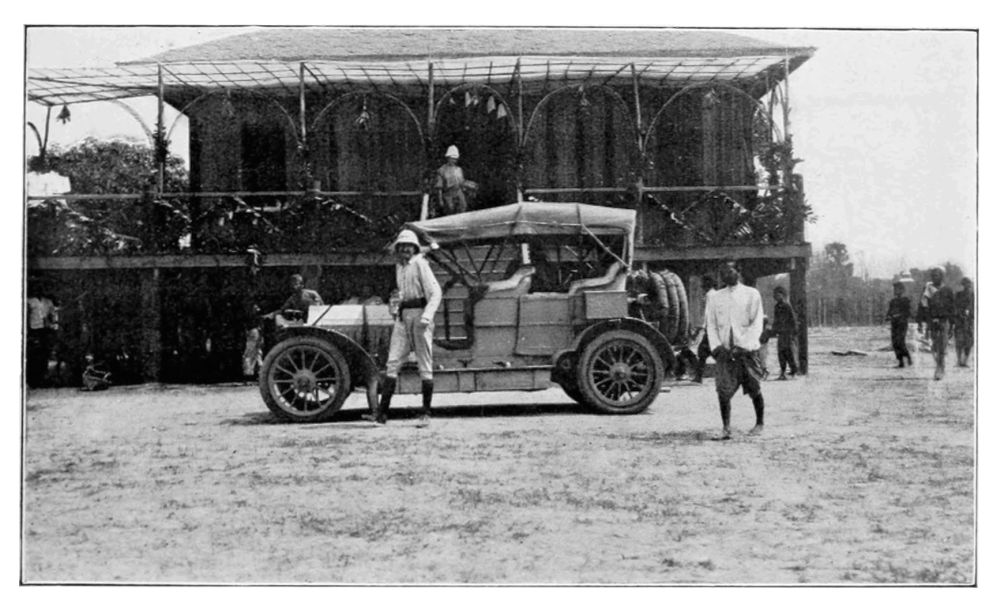
A trois heures et demie, nous rentrons en forêt et, après avoir traversé une clairière, nous nous trouvons brusquement devant la maison du gouverneur indigène de Chick-Reang… Notre arrivée est saluée par des pétarades, des détonations et tout un bombardement : c’est un feu d’artifice que l’on tire en notre honneur ! Nous ne songeons pas à lui reprocher d’être diurne. Sans doute il y perd un peu, mais il n’y a pas de sa faute : on ne nous attendait pas si tôt. D’ailleurs, cet accueil pyrotechnique regagne en vacarme ce qu’il perd en couleur, et nous en demeurons quelques instants confus mais assourdis.
Le gouverneur qui nous a fait cette surprise nous reçoit solennellement chez lui : il a mis des fleurs partout et pavoisé sa demeure avec des branches de palmiers fort artistement arrangées.
Cette gracieuse réception nous va droit au cœur. Ce nous est une vraie joie de penser que les populations indigènes, aussi bien que les administrateurs français, s’intéressent à notre voyage.
Nous avons fait depuis ce matin 50 kilomètres.
La direction a dû être un peu faussée lorsque l’avant passa à travers le pont de Kompong-Thom et a pris beaucoup de jeu.
Nous demandons au gouverneur de nous faire creuser une fosse ; cette exigence lui semble un peu prématurée et sa politesse se refuse à admettre que nous en soyons réduits à une telle extrémité ! Mais nous lui faisons comprendre que « c’est pour la voiture » et en quelques instants notre fosse est prête. Il ne reste plus qu’à y descendre…
Hervé et Guérin disparaissent sous la voiture et, quoique notre pauvre mécanicien n’ait encore qu’une seule main de libre, tous deux s’escriment si bien qu’en deux heures le mal est réparé (en fourrant des pièces de 50 centimes dans la direction !).
Mais il est bien trop tard pour repartir et d’ailleurs notre aimable gouverneur s’y oppose formellement : il nous tient, il nous garde. Ah ! Mais !
Pour que rien ne manque à son hospitalité il nous conduit dans une pièce de sa maison qui nous remplit d’enthousiasme : c’est une magnifique salle de bains où nous nous isolons avec délices, pendant que Tiam prépare le dîner.
Les charrettes arrivent à six heures sous la conduite de l’habile et toujours exact Nam-Ay !
Tout marche donc à souhait. Et reposés, propres et affamés, nous nous apprêtons à faire honneur au dîner.
Hélas ! à peine sommes-nous à table qu’une pluie d’insectes s’abat sur nous : il en sort de partout… il nous en entre surtout dans les yeux, dans la bouche, dans les narines. Et, comme c’est la lumière qui les attire, nous nous trouvons forcés de continuer notre repas dans l’obscurité. Mais ce petit inconvénient nous paraît de bien peu d’importance après tout ce que nous avons souffert, et la gaîté générale n’y perd rien, au contraire…!
La main de Guérin va de mieux en mieux, quoiqu’il lui soit encore impossible de s’en servir, mais son autre main en vaut deux ! Néanmoins, il faut encore le panser chaque soir avec beaucoup de soins et cela ne va pas sans souffrances : mais à sentir que nous approchons du but, notre blessé oublie son mal et il est le seul à ne pas s’en plaindre.
12 avril 1908 (Dimanche des Rameaux).
Départ à dix heures et demie.
En sortant de Chick-Reang nous avons à traverser une petite rivière presque sans eau et que nous considérons comme inoffensive.
Les indigènes y ont élevé une étroite digue en terre qui va nous permettre de passer à gué…
Pleins d’une présomptueuse assurance, nous nous engageons sur notre digue de fortune… mais la terre encore molle et mal tassée s’effondre du côté droit. Notre lourde voiture prend des libertés dangereuses avec la ligne droite. Elle penche, elle penche… à rendre des points à la tour de Pise… Je sens que nous allons chavirer ! Par bonheur, un changement de vitesse rapide et opportun remet tout en place et nous tire de peine.
— Encore un obstacle « qui ne nous aura pas ! » dit Guérin.
C’est égal, nous retrouvons la terre ferme avec un certain soulagement.
Elle est très ferme en effet, et la route d’une dureté aussi engageante qu’hier. Aussi, nous roulons en quatrième vitesse à la grande joie des populations, qui nous regardent passer comme une trombe. L’absence de vaches nous humilie un peu, mais on ne peut pas tout avoir !
Après Roum nous quittons la province de M. Chambert pour entrer dans celle de M. Lorin.
L’approche du but nous donne des ailes !
Vlan ! Tout à coup, un piquet se dresse au milieu de notre belle route qui s’arrête brusquement… Dans la langue muette mais énergique des piquets, cela veut dire : Halte-là, on ne passe pas !
Nous sommes consternés… Mais que faire ? Continuer notre route, c’est le parti auquel nous nous arrêtons ; nous nous y arrêtons même très peu et nous repartons de plus belle à l’aventure !

Évidemment les ordres de Battambang ne seront pas arrivés à temps ! car rien n’a été fait et pendant 10 kilomètres nous nous dirigeons d’après l’inspiration… intermittente du guide qui cherche à retrouver le sentier des charrettes dans la direction de Siem-Reap.
Enfin, nous arrivons tant bien que mal à une petite sala, où nous déjeunons. Il faut bien vivre !
Puis nous repartons mélancoliquement et nous suivons les ornières jusqu’à Siem-Reap… où nous parvenons enfin, à quatre heures et demie, après nous être ensablés six fois !
Siem-Reap ! Ce nom-là nous chante aux oreilles comme une fanfare de victoire… car voici notre dernière étape !
Siem-Reap… c’est déjà presque Ang-Kor. En effet, nous ne sommes plus qu’à 5 kilomètres de la ville et des temples et les 5 kilomètres qui nous en séparent sont relativement praticables.
Nous sommes reçus à Siem-Reap par le gouverneur chef chez qui je remise l’auto et par M. Amand, garde principal. Nous nous installons dans la grande « sala » située de l’autre côté de la rivière, mais encore faudra-t-il faire passer l’auto que son poids nous empêche d’embarquer sur un sampan. Le gouverneur va faire construire un pont et, demain, nous pourrons nous offrir le luxe d’une entrée triomphale dans les fameuses ruines, avec notre vaillante et solide voiture que nous tenons à conduire jusqu’à l’apothéose !
Nous retrouvons, chez M. Amand, le même accueil charmant et la même bonne grâce qui nous ont tant secondés au cours de ce dur voyage. Il se multiplie pour nous installer et nous fournir tout ce qui nous manque.
Notre dîner retentit d’une gaîté débordante et un peu fébrile ; nous avons besoin de nous répéter que nous sommes tout près du but, car nous pouvons à peine croire au bonheur d’être arrivés et nous restons un peu ahuris d’avoir pu mener à bien une expédition tant de fois compromise.
Il y a exactement vingt-huit jours que nous avons quitté Saïgon. Nous parlions alors de « la Ville au Bois dormant » comme d’une cité de rêve, lointaine et mystérieuse, où nous tendions de tous nos vœux, mais dont nous nous sentions séparés par tant d’obstacles, qu’au départ de ce voyage nous espérions seulement en retirer le seul honneur de l’avoir entrepris.
Ce jour inespéré de la réussite, le voilà arrivé pourtant, grâce à une persévérance que l’on peut sans nous blesser qualifier d’entêtement… Décidément, rien ne vaut, pour aller loin, une volonté bien arrêtée.
Mais nous devons aussi le succès de notre expédition à ce bon Guérin qui, malgré ses souffrances, n’a cessé de prodiguer à notre robuste Lorraine Diétrich les soins les plus actifs et les plus intelligents. Au nom de mes compagnons et au mien, je le remercie bien sincèrement ici de ses loyaux services et je rends grâce à son courage, à son entrain et à son infatigable bonne humeur.
… Et ce soir, tandis que mes chers compagnons de route devisent joyeusement, il me revient en mémoire, je ne sais pourquoi, ces deux admirables vers que Malherbe adressait à Henri IV :


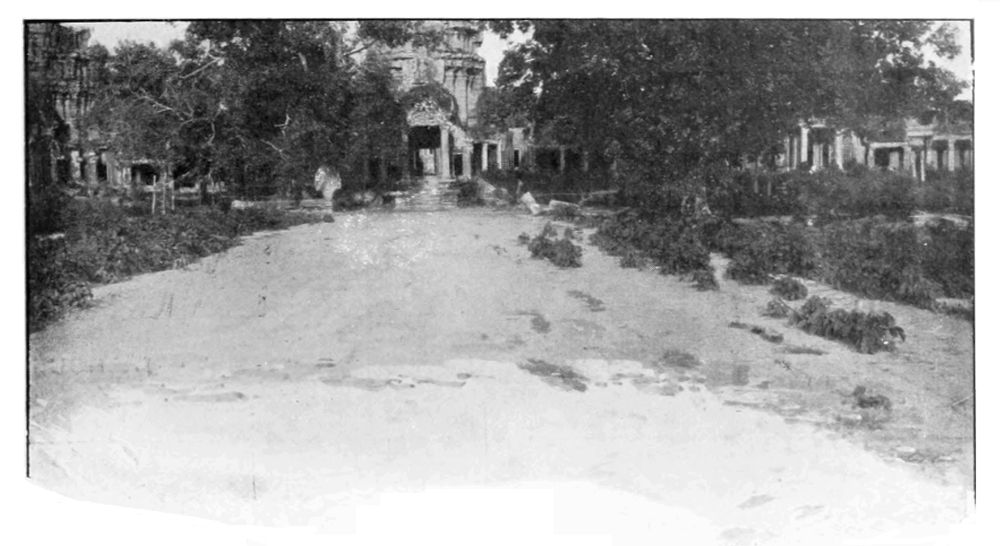
13 avril 1908.
Malgré les fêtes du Têt (ou jour de l’an cambodgien), le gouverneur a pu trouver assez de coolies et de matériaux pour faire construire, pendant la nuit, une passerelle d’une solidité à toute épreuve : aussi, dès dix heures du matin, la voiture, ayant traversé la rivière, est garée derrière notre sala sous un abri provisoire.
A quatre heures et demie, nous partons pour Ang-Kor, en compagnie de M. Amand. Un quart d’heure après, nous faisons halte devant la digue qui mène aux ruines dont nous ne voulons pour aujourd’hui que prendre une vue d’ensemble, comme on regarde un tableau à distance avant de l’analyser dans tous ses détails.
Nous ressentons une émotion profonde en apercevant à travers les branches les trois gigantesques tours Khmer… C’est pour ainsi dire notre rêve qui se dresse devant nous réalisé. Et cette réalité sublime dépasse tout ce que nous avions imaginé.

Rien ne saurait exprimer la splendeur surhumaine et comme sacrée de ce paysage où la main divine se mêle à l’œuvre de l’homme, où l’arbre s’unit à la pierre et la végétation la plus luxuriante à l’architecture la plus somptueuse ; on ne sait où commence la ruine, où finit la forêt. Devant ces monuments sublimes que la nature semble vouloir reprendre et qu’elle anime d’une vie végétale et mystérieuse, on admire autant le génie des hommes disparus que l’œuvre des siècles et le travail du temps… « ce grand sculpteur ».
Mais, hélas ! après avoir donné à ces palais et à ces temples la parure incomparable de la ruine, la nature inconsciente aurait bientôt fait de les anéantir… Le mélange de la pierre et des arbres a atteint un point de perfection qu’il ne saurait dépasser : il faut maintenant disputer la ville endormie à la forêt envahissante, sinon, dans quelques années, il ne restera plus rien de ces ruines uniques au monde. Il faut sauver Ang-Kor ! Ce sera l’œuvre de la France ;… quand il s’agit d’Art et de Beauté, notre pays n’est jamais trop loin.
En rendant au Cambodge la province d’Ang-Kor il a assumé le noble devoir de perpétuer ces souvenirs sacrés… Par bonheur, M. Comaille, le futur conservateur d’Ang-Kor, qui nous fait les honneurs de « la Ville au Bois dormant », a compris toute la grandeur de la mission qui lui incombe : il professe un véritable culte pour ces merveilles dont il a la garde ; il leur a consacré toutes ses forces, toute son intelligence. En l’écoutant, nous avons l’impression que la France est arrivée à temps : encore, faut-il qu’elle vienne en aide au parfait artiste qui la représente : M. Comaille est seul pour mener à bien cette œuvre, non pas de restauration, mais de salut qui intéresse le monde entier… et ses ressources sont bien minimes.
Puisqu’il s’est fondé une Société des Amis de Versailles, pourquoi ne créerait-on pas une Société des Amis d’Ang-Kor ! Il ne faudrait pour arracher ces temples à la dégradation et à la mort que la centième partie, la millième peut-être de ce que l’on a dépensé pour enlaidir Paris depuis vingt ans. Le prix d’une de ces monstrueuses bâtisses qu’on élève à tort et à travers suffirait à sauver une des plus authentiques merveilles du monde. Et l’on pourrait construire enfin cette route dont nous sommes fiers d’avoir été les pionniers et qui amènerait ici, de tous les points de l’univers civilisé, tous les pèlerins passionnés de la Beauté ; nous l’avons dit déjà au début de ces notes, mais nous le redirons sans nous lasser : ce serait là une belle action, artistique et patriotique et, par surcroît, une bonne affaire pour la colonie[1].
[1] Depuis que ces lignes ont été écrites, la Société des Amis d’Ang-Kor est formée… et la route est commencée.
… Est-il besoin de dire que nous trouvons ici en M. Comaille le plus précieux des alliés et le plus érudit des cicérones ?
Demain nous reviendrons visiter en détail, sous sa direction, les temples et les ruines. Ce sera la plus agréable récompense de tous les efforts que nous avons faits pour arriver jusqu’ici.
14 avril 1908.
… C’est le grand jour !… Notre brave et bonne voiture va connaître enfin les joies du triomphe. Il va lui être donné d’accomplir un exploit que nulle autre voiture ne pourra plus lui disputer.

Dès sept heures du matin, quand nous arrivons à la grande chaussée de l’étang, des milliers de Cambodgiens y sont groupés déjà pour voir passer la fameuse voiture à feu.
Je crains d’abord que la solennité de notre entrée ne soit un peu compromise aux yeux des populations, par ce fait que la route du temple, celle qui doit conduire la voiture à l’apothéose, n’est pas précisément une route en palier ! Il va nous falloir gravir quelques marches, des marches larges sans doute et pas très élevées, mais enfin, des marches tout de même !… Puisse la montée vers l’apothéose ne pas trop disloquer notre pauvre auto. Évidemment ce serait un symbole à la fois sublime et profitable, mais nous préférons, je ne sais pourquoi, ne pas contribuer à établir ces vérités premières…
En avant !… La voiture escalade sans peine les deux marches d’accès de la chaussée et roule vers le temple.
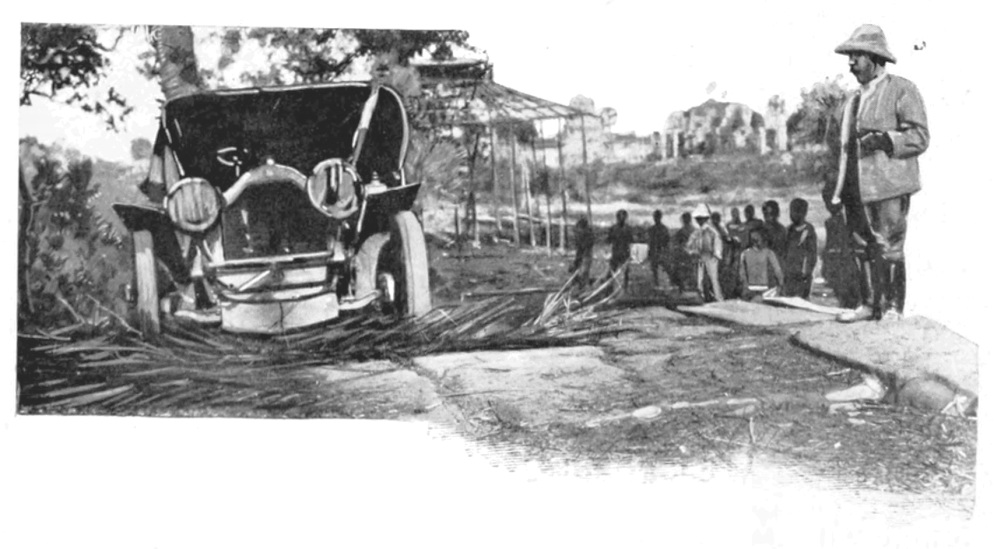
Guérin joue avec une autorité inattendue le rôle du chœur antique. Tandis que l’auto avance vers l’apothéose, il court derrière, enthousiaste et bondissant et crie à tue-tête sur des rythmes qu’il invente…
— Ça y est ! Nous y sommes ! Nous sommes à Ang-Kor !
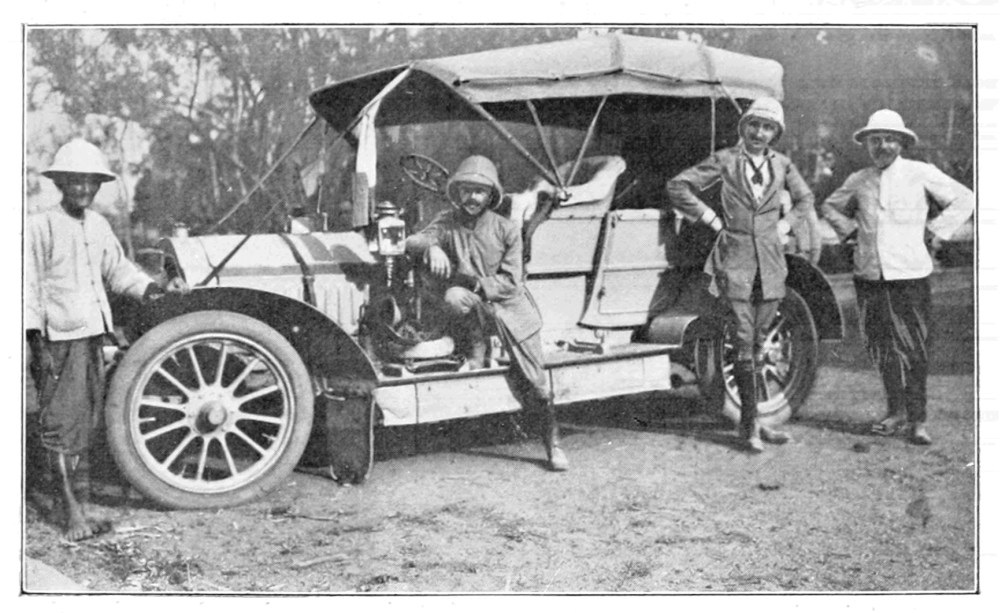
Enfin, la voiture entre dans l’enceinte sacrée par cette glorieuse porte des Éléphants qui, pendant des siècles, ne vit passer que les somptueux cortèges des souverains et des grands prêtres.
Une foule de Cambodgiens nous observent… Beaucoup d’entre eux attendent peut-être que la foudre, éclatant soudain dans le ciel clair, vienne châtier les impies qui osent troubler ainsi la paix et le recueillement de ces édifices sacrés.
Mais les Bouddhas qui gardent le seuil des palais et des temples ne paraissent point se soucier de notre approche. Et que leur importe tout cela… qui n’est pas éternel ?
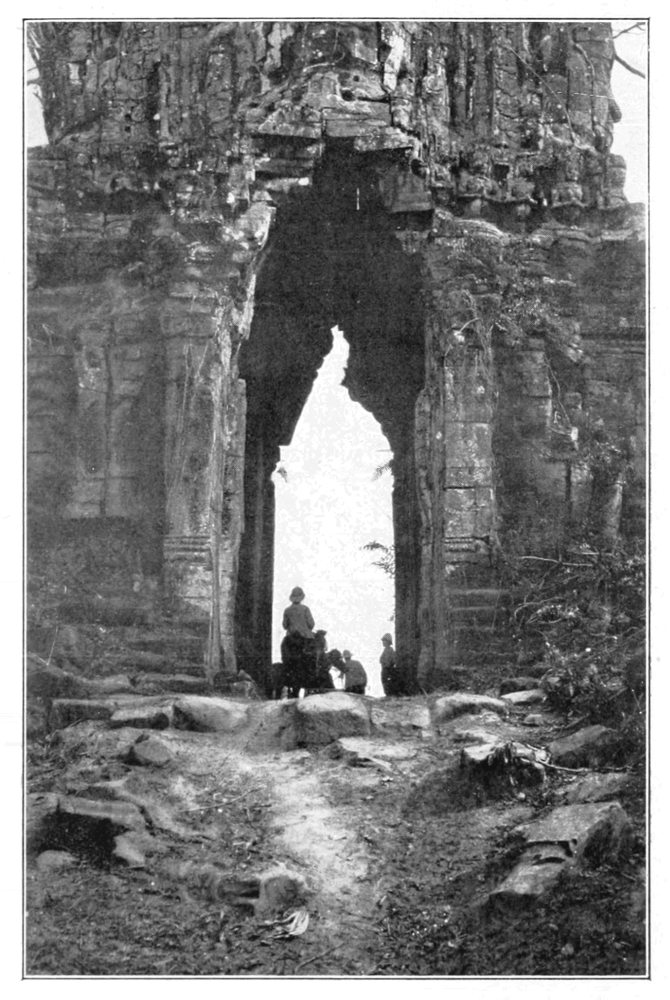
Nous traversons l’enceinte. Pour arriver au pied du grand temple il faut encore que la voiture gravisse, par ses propres moyens, un escalier de cinq marches et cela ne va pas sans m’inquiéter un peu. Pauvre auto ! si elle arrive intacte après tant de secousses, c’est qu’elle a vraiment l’âme chevillée au moteur et que tous ses organes sont cuirassés d’un triple acier !… Du reste elle ne paraît aucunement se conformer à ma triste pensée ; après s’être révélée, pendant tout le cours de ce dur voyage, comme une marcheuse incomparable, elle semble vouloir montrer, en arrivant au but, que la voltige et l’acrobatie n’ont pas de secrets pour elle… et elle escalade ses cinq marches, dont la dernière est la Marche à la Gloire ! dans un style magistral et sans rien perdre de sa dignité, non plus que de ses boulons…
Une légitime fierté se mêle à l’allégresse que nous ressentons, mes chers compagnons de voyage et moi : nous avons mené à Ang-Kor la première automobile et aucune autre ne pourra jamais pénétrer plus loin dans les temples. Cette minute de joyeux triomphe nous paie de toutes les mauvaises heures et de toutes les fatigues qu’il nous a fallu supporter.
Nous demandons à la photographie de fixer et de consacrer cet épisode de l’automobilisme et nous prenons des instantanés de la voiture et de tout le monde.
Puis nous franchissons à pied le seuil du temple que nous allons visiter en détail sous la conduite de l’incomparable cicérone qu’est M. Comaille.
Il ne m’appartient pas de décrire les merveilles de ces ruines. Ce sera l’œuvre des artistes et des poètes qui viendront rêver et travailler ici… quand cette route (dont nous aurons été les pionniers tout de même !) sera enfin construite et leur épargnera les frais et les fatigues d’une véritable expédition. Peut-être un jour se formera-t-il une école de peintres orientalistes, l’école d’Ang-Kor, peut-être quelque romancier de génie tentera-t-il une reconstitution des épopées qui se sont déroulées à l’ombre de ces tours ?…

On ne saurait souhaiter un cadre plus prestigieux et les plus beaux décors que le théâtre ait réalisés n’en sauraient évoquer la splendeur.
Mais je craindrais d’attenter à la beauté de ces ruines sacrées en essayant de les décrire et je me contenterai donc d’en donner un court historique que je dois à la science et à l’amabilité de M. Comaille, le bon génie de ces lieux enchantés.
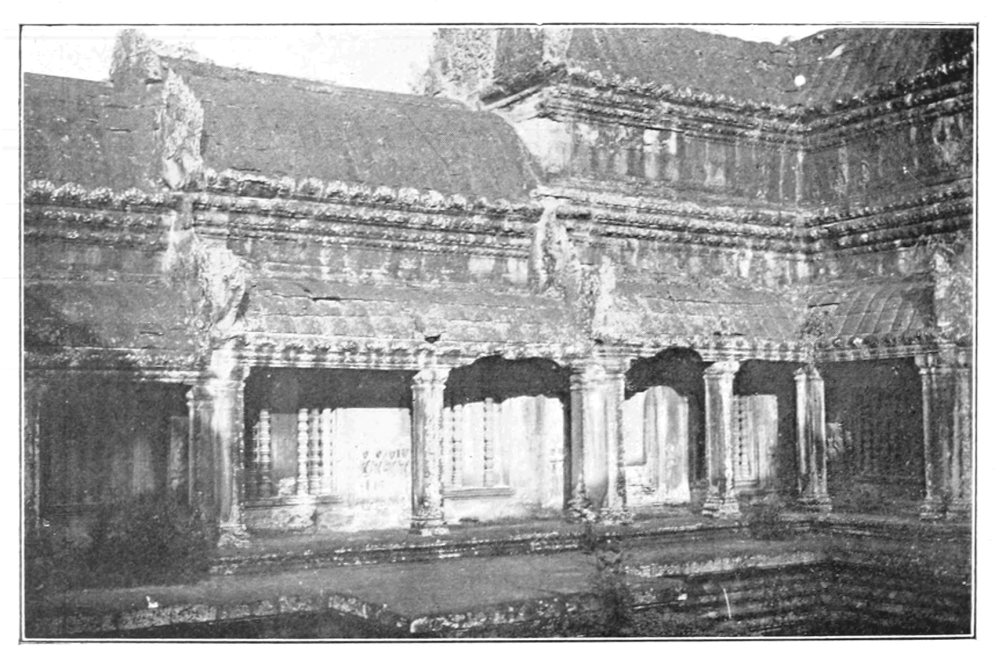
Les monuments d’Ang-Kor-Thom ont été terminés au huitième et ceux d’Ang-Kor-Vat au neuvième siècle de l’ère Çakya. L’ère de Çakya-Mouni est de mille vingt-sept ans plus récente que l’ère chrétienne.

Comme tous les anciens Temples cambodgiens, ceux du groupe d’Ang-Kor furent construits par des brahmanes venus de l’Inde ; les rois du Cambodge étaient également brahmanes, c’est-à-dire qu’ils appartenaient à cette caste brahmanique qui représente encore de nos jours l’aristocratie de l’Inde. Quand ils envahirent le territoire cambodgien, les brahmanes guerriers amenèrent avec eux leurs prêtres et les artistes qui ont construit ces Temples. Mais pour exécuter cet immense travail, ils employèrent toute la population autochtone à l’exploitation des carrières de pierres, au transport des matériaux et probablement même à leur mise en place.
Dès que les Temples furent construits, les rois les érigèrent en Abbayes au bénéfice des prêtres brahmanes et les indigènes qui peuplaient les alentours devinrent d’office les esclaves des abbés ; les inscriptions sanscrites trouvées dans les Ruines nous apprennent par exemple que tel abbé avait droit à dix mille esclaves, à quatre cents livres de beurre par jour, à cinq mille bœufs par an, à deux mille buffles, etc., etc…

Donc, non seulement les esclaves travaillaient pour les brahmanes, mais les populations libres passaient leur temps à remplir les exigences des chantres des divers Temples.
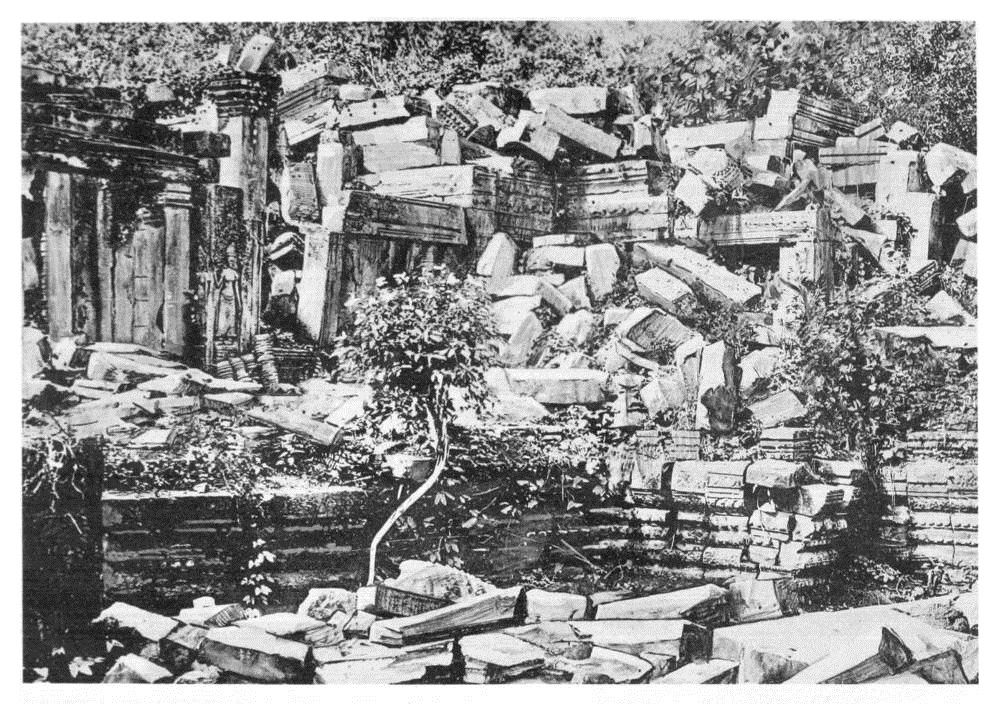
La pierre était apportée des montagnes de Koulen, situées à 30 kilomètres d’Ang-Kor. On peut estimer qu’il n’a pas fallu moins de deux cents ans pour construire Ang-Kor-Vat et que ce travail exigeait la main-d’œuvre de deux mille hommes par jour. La moitié au moins des travailleurs mourut sans doute à la peine…

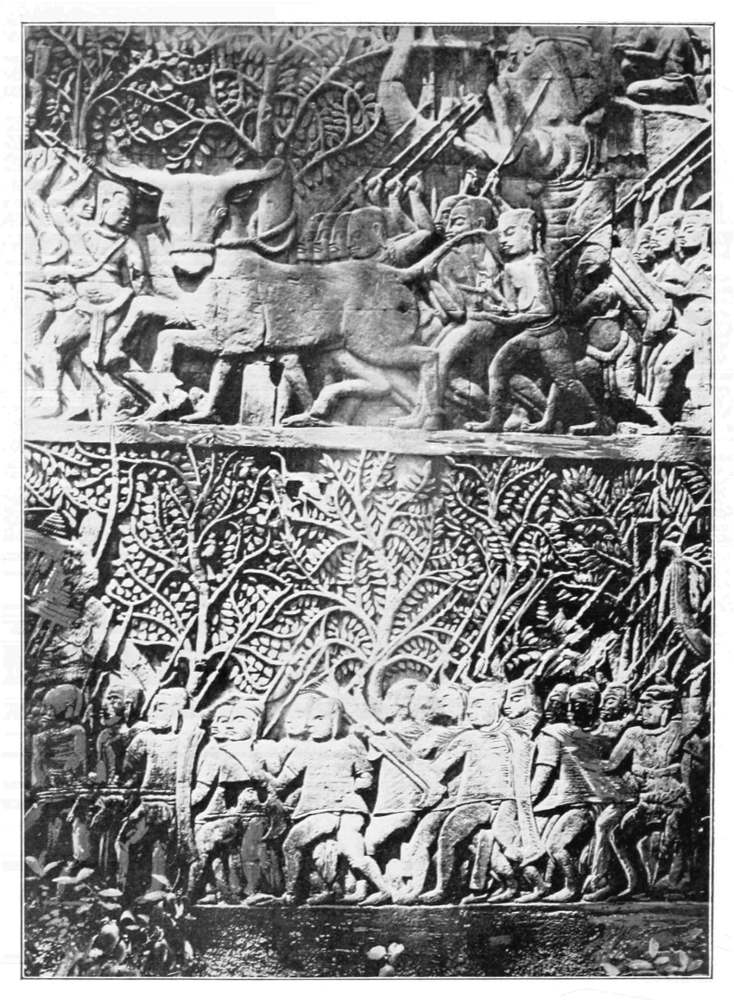
Nos libres penseurs, qui ont l’étonnement facile et l’indignation débordante, trouveraient là l’occasion de jérémiades bien originales sur le cléricalisme et l’obscurantisme, considérés comme « articles d’exportation »…

Au treizième siècle, les Siamois (les Taïs) commencèrent à envahir le pays et battirent les brahmanes sous les murs d’Ang-Kor-Thom : les Cambodgiens en profitèrent pour se révolter contre les oppresseurs qui les avaient si longtemps maintenus sous leur joug et les chassèrent ou les tuèrent. Et comme les Révolutions n’épargnent pas plus les monuments que les hommes et s’attaquent volontiers à l’architecture, les anciens esclaves tournèrent leur fureur contre les Temples auxquels ils reprochaient d’avoir abrité des Dieux défavorables. Cette crise de vandalisme explique l’état de dégradation des monuments. Ils ne sont pas pourtant très anciens ; mais les hommes détruisent plus vite que le temps…
Ainsi l’histoire se recommence partout et toujours et cette vérité déjà plusieurs fois constatée se passe de commentaires.

… Après avoir admiré ce qui reste des bas-reliefs et des inscriptions d’Ang-Kor-Vat, nous laissons la voiture près de la Bonzerie et nous partons, les uns à pied, les autres à cheval, pour Ang-Kor-Thom.
A 2 kilomètres se trouve une des portes de l’enceinte (longue de près de 12 kilomètres) qui entoure les Temples d’Ang-Kor-Thom.
M. Comaille a déjà entrepris la lutte, dont il sortira vainqueur, contre la forêt envahissante : à travers le fouillis des branches et des lianes, il a fait, d’après ses études, rouvrir les deux grandes avenues à la place même qu’elles occupaient jadis, et bientôt les Temples seront enfin déblayés de la brousse et de la végétation parasite qui les recouvrent entièrement, disjoignant les pierres et lézardant les murailles. On peut entrevoir le jour prochain où la beauté d’Ang-Kor sortira de ses voiles. Ce que M. Comaille a pu déjà réaliser avec un budget insuffisant permet d’espérer une résurrection sublime si l’on veut l’aider dans son œuvre.

Mieux que toutes les descriptions dont je me suis abstenu, les quelques photographies qu’on trouvera reproduites dans ce livre donneront une idée assez exacte, encore que bien incomplète, de ces ruines uniques au monde…
Nous revenons à Siem-Reap où nous dînons en compagnie de notre aimable guide. Puis, aussitôt après, comme pour nous remplir les yeux de ce paysage que peut-être nous ne reverrons plus, nous retournons contempler les ruines ; le clair de lune leur prête un aspect plus mystérieux encore et plus féerique.
Ah ! qu’il vienne donc le poète qui pourra traduire ce que nous avons ressenti là !

15 avril 1908.
Et voici déjà qu’il faut songer au retour !
La saison des pluies approche et nos heures sont comptées. Le moindre retard nous forcerait à abandonner l’espoir de ramener à Saïgon notre voiture triomphante… et la logique irréfutable de M. de La Palisse nous rappelle que nous ne sommes encore qu’à moitié chemin… puisque toute la route reste à refaire.
Nous consacrons donc cette journée à nous reposer pour reprendre des forces. Retourner aux Temples ? A quoi bon ?… Cela ne ferait qu’aviver nos regrets de nous en éloigner et nous voulons garder le souvenir de la vision sublime de cette nuit.
Et puis, la voiture est là, qui réclame nos soins et qu’il importe d’inspecter en vue de notre départ.
M. Amand est parti pour Battambang avec la moitié du détachement de tirailleurs.
… Tiens, le télégraphe est coupé !
Qu’est-ce que cela peut bien signifier ?
16 avril 1908.
Avant l’aube, nos charrettes sont parties et doivent nous attendre à Kompong-Chen avec le gros des bagages et ce qu’il nous reste d’essence. Pourvu, mon Dieu !… que la provision de combustible soit bien arrivée chez M. Chambert, où nous comptons la retrouver !
A une heure, le délégué du Commissaire royal cambodgien et le télégraphiste arrivent affolés… et nous comprenons pourquoi le télégraphe ne fonctionne plus !… C’est tout simplement parce que la région est infestée de pirates. Une lettre que M. Amand envoie par un porteur vient confirmer cette bonne nouvelle.
Des pirates !… O Fenimore Cooper, ô Gustave Aimard, ô Louis Boussenard ! C’est plus que nous n’osions espérer… et rien n’aura manqué à notre joie ; car nous comptons bien les rencontrer en route et couronner le voyage par cet épisode imprévu et divertissant.
Mais en attendant, il faut agir… Il faut faire quelque chose ; et la seule chose que nous puissions faire, c’est d’avertir M. Comaille, seul Européen de la région, afin qu’il puisse se mettre sur ses gardes et prendre les dispositions nécessaires.
Nous lui envoyons donc une lettre et, dès quatre heures, la réponse nous arrive. M. Comaille se trouvant dans l’impossibilité de venir à cheval me prie d’aller le chercher à Ang-Kor demain matin avec l’auto et de le ramener à Siem-Reap pour prendre le commandement des forces… qui se composent de dix indigènes.
Impossible donc de partir aujourd’hui… mais nous nous en consolons bien vite : car non seulement notre vaillante voiture aura accompli un raid réputé irréalisable, ce qui déjà vaut bien quelque admiration, mais encore elle aura bien mérité de la Patrie !
Rien ne manque à sa gloire.


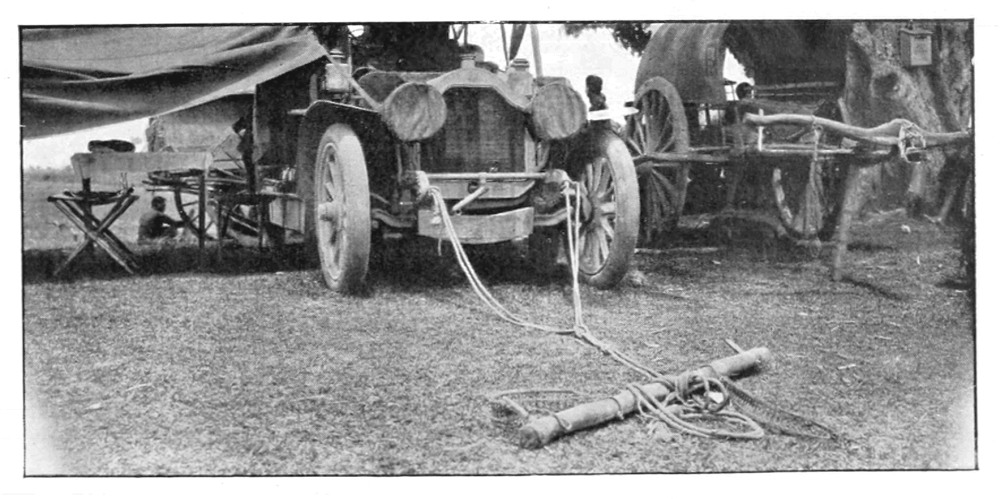
17 avril 1908.
Donc, à cinq heures du matin, je pars avec Guérin pour Ang-Kor d’où nous revenons avec M. Comaille… Hélas ! pas l’ombre de pirates ! Ces messieurs auraient-ils peur de nous ? Et faut-il renoncer à faire leur connaissance ?
M. Comaille nous ayant assurés que nous pouvons le laisser sans aucune crainte, nous décidons de partir à la rencontre de ces invisibles bandits. Et non sans avoir remercié tout le monde et payé le pont qui nous supporta si vaillamment, nous quittons définitivement Siem-Reap à sept heures.
En route pour Saïgon !… Quels nouveaux obstacles allons-nous rencontrer ? Et notre bonne voiture parviendra-t-elle à boucler la boucle ? reviendra-t-elle indemne à son point de départ ? Chacun de nous se le demande à part soi.
Nous roulons.
Toujours pas de pirates, mais du sable. A neuf heures, nous faisons halte pour changer l’eau du radiateur. Nous nous apitoyons sur l’aspect lamentable de notre capote que les branches ont écorchée et déformée au point qu’elle ressemble à un chapeau d’Allemande. Heureusement, nous allons maintenant pouvoir rouler en plaine…
Une surprise plus qu’agréable nous attend : grâce aux ordres donnés par M. Lorin, et bien exécutés par les coolies, les herbes ont été coupées sur notre passage ; aussi pouvons-nous filer en quatrième vitesse.
C’est d’ailleurs le seul moyen que nous puissions employer pour lutter contre la chaleur qui défie toute concurrence. Le vent de la course nous rafraîchit un peu. Et nous commençons à ressentir les premières joies du retour : ainsi, non seulement nous aurons réussi à atteindre Ang-Kor, mais aussi à en revenir, ce qui nous paraît doublement méritoire ! Mais toutefois, comme disent les feuilletonnistes, n’anticipons pas sur les événements.
Tout en roulant, nous ne pouvons nous empêcher de songer à l’opinion de la presse indo-chinoise. Que vont dire en nous voyant revenir les journaux de Saïgon, très sceptiques et un peu moqueurs au moment du départ ? Nous pouvons nous en faire quelque idée déjà d’après les dépêches reçues à Kompong-Thom et qui nous disaient l’étonnement des Saïgonnais à mesure que nous avancions. Nous serions curieux de lire les feuilles le lendemain de notre rentrée dans la belle capitale de la Cochinchine. A ces causes et pour quelques autres raisons, le retour sera pour nous tous une joie immense, et un touriste n’a-t-il pas écrit quelque part que l’heure du retour est la plus agréable d’un voyage !
Pendant que nous nous communiquons ces réflexions, en phrases entrecoupées par la vitesse de l’auto qui fait maintenant du cinquante à l’heure, nous tombons dans une bande de plus de trente élans… qui arrêtent le nôtre, si j’ose risquer ce jeu de mots en la circonstance.
Je bloque les freins… Mais le temps de saisir ma carabine, ces jolies bêtes au pied léger nous brûlent la politesse. Moi je brûle une cartouche, résultat : un blessé (c’est un élan que je veux dire) !
Et les pirates ?… Ils s’obstinent à briller par leur absence et nous sommes un peu déçus de ne pas rencontrer ces fameux bandits qui font trembler les populations. Ces notes de voyage auraient certainement gagné à tourner au roman d’aventures au lieu de rester le récit exact de nos mésaventures incessantes ! Mais le souci de la vérité nous interdit de sacrifier à la fantaisie. Nous n’avons pas vu les pirates : nous en avons seulement beaucoup entendu parler. Et peut-être la réciproque est-elle vraie ?… eux aussi, sans doute, auront beaucoup entendu parler de nous et surtout de cette voiture de feu, de ce dragon, dont la vitesse et le bruit eussent très probablement suffi à les tenir en respect. Quoi qu’il en soit, ces messieurs n’ont point jugé à propos de se montrer. Je le regrette pour ma carabine et pour mes lecteurs.
Nous atteignons donc Chick-Reang sans combattre, mais non sans nous ensabler en traversant la digue de la rivière… cette même digue qui, déjà à l’aller, nous avait joué un si vilain tour et avait si bien failli nous faire verser.
Par bonheur, nous retrouvons là notre charmant ami le gouverneur indigène. Il se précipite à notre secours, accompagné d’une bande de coolies qui, sous sa ferme et habile direction, ont vite fait de nous tirer de ce mauvais pas.
Et, comme dit Guérin : « Nous n’y coupons pas pour le feu d’artifice ! »
En effet, notre ami pratique toujours l’hospitalité pyrotechnique… et c’est au milieu des plus accueillantes pétarades que nous pénétrons dans sa demeure où nous déjeunons à la hâte, malgré toute son insistance pour nous garder. Mais le temps presse. Et si nous avons mis vingt-huit jours pour venir de Saïgon à Ang-Kor, nous sentons grandir en nous le secret désir de battre notre propre record.
Donc, dès une heure vingt, nous prenons congé de notre aimable hôte et nous repartons avec l’intention un peu hardie d’arriver le soir même à Kompong-Thom.
Aux approches de Kompong-Chen, nous trouvons le terrain détrempé et boueux. Il a dû pleuvoir énormément depuis notre passage. Cette simple constatation nous remplit d’inquiétude… La série de nos déboires aquatiques va-t-elle donc recommencer, et allons-nous donc nous trouver contraints de reprendre la lutte avec l’eau, notre pire ennemie… Cette crainte légitime ne doit rien à l’alcoolisme ! Mais si nous devons, après avoir élargi le chemin en venant, nous trouver arrêtés par la boue, voilà qui risque de compromettre notre retour.
Cela n’empêche point qu’à deux heures nous arrivons à Kompong-Chen, ce qui nous permet de déclarer modestement que nous avons marché à une allure merveilleuse.
L’excellent gouverneur indigène voudrait bien nous décider à passer la nuit chez lui, mais nous sommes résolus à ne pas écouter la voix des sirènes (sauf celle de notre voiture !…) et nous donnons ordre à Nam-Ay de faire aller les charrettes jusqu’à Kompong-Thom.
Un dernier adieu au brave Cambodgien et nous démarrons majestueusement.
D’abord tout marche à merveille.
Mais hélas ! nos tristes pressentiments ne tardent pas à se justifier… Peu à peu la route mollit sous nos pneus. Nous franchissons quelques kilomètres dans des flaques de boue et, tout à coup, la voiture refuse nettement d’aller plus loin. Le moteur, affolé, tourne comme un derviche et perd toute action sur les roues qui patinent. Les antidérapants ne mordent plus l’argile des ornières.
Tout le monde descend.
Avec les pioches et les piques, nous reprenons tristement notre besogne de terrassiers sans autre effet d’ailleurs que de faire une sorte de bouillie rougeâtre à dégoûter des Spartiates !
Nous en sommes réduits aux stratagèmes les plus désespérés, comme par exemple à casser les termitières pour remplir de leurs débris les sillons qui semblent se creuser davantage à mesure que nous les comblons.
Après une demi-heure de travail, nous tentons un démarrage timide… Dix mètres plus loin, nous nous embourbons de nouveau… et cela sous les yeux étonnés et voire un peu méprisants d’un groupe d’indigènes qui sont accourus au passage de la voiture et qui ne paraissent pas regretter leur dérangement. Nous en sommes humiliés comme il convient et il est évident que le prestige européen n’en mène pas large.
Mais que faire ?…
Les indigènes qui, pour comble de confusion, commencent à nous prendre en pitié, nous font comprendre qu’il est impossible de trouver ni bœufs ni buffles dans la région.
Et la nuit arrive. Une nuit escortée de gros nuages noirs qui envahissent rapidement tout le ciel et qui ne présagent rien de bon.
Nous ne pouvons cependant pas coucher là !
… Pourtant, je devine que, moyennant finances, la commisération des indigènes qui nous entourent ne demanderait qu’à devenir active : c’est d’une psychologie très simple, mais infaillible.
Nous entamons donc les négociations. Le résultat ne se fait pas attendre ! La loi de l’offre et de la demande s’affirme une fois de plus, si bien qu’au bout de quelques minutes, Guérin ayant fixé aux ressorts d’avant deux cordes longues de plus de vingt mètres, tous les badauds, hommes, femmes et enfants, s’y attellent courageusement, tout joyeux de la bonne aubaine.
Et nous avançons, en demi-première vitesse…
Où sont nos belles allures de ce matin ?
Je me renseigne sur un abri pour la nuit ; car nous n’avons rien avec nous, tout notre campement étant resté sur les charrettes. Il paraît que nous trouverons une pagode auprès de ce fameux arbre postal où nous avons fait halte en venant…
Maintenant il fait nuit noire. Des éclairs éblouissants qui se succèdent presque sans interruption nous montrent du moins la route. Les phares projettent deux faisceaux lumineux sur les épaules luisantes des coolies. Et toute cette scène prend un aspect fantastique, dont nous jouirions peut-être… sans la pluie qui nous aveugle. Et quelle pluie !… Avec nous, le déluge. C’est à se demander si notre voyage ne devient pas sous-marin !
Enfin, nous stoppons devant la palissade de la pagode.
Les coolies ruisselants lâchent les cordes.
A la hâte, on extrait de la voiture la malle et les provisions et Guérin repart avec notre guide garer l’auto sous l’arbre postal décidément bien précieux. Le guide y passera la nuit et les phares allumés avertiront le cortège des charrettes, qui s’arrêtera pour nous attendre.
Notre aimable compagnon veut bien remplir les fonctions de cuisinier où il excelle d’ailleurs et, avec l’aide de Tiam, se met à préparer le dîner.
Guérin revient trempé jusqu’aux « eaux » (suivant sa propre expression). Nous mangeons vite et sans rien dire, puis nous nous couchons sur des nattes.
Et je constate une fois de plus que le bruit de la pluie est éminemment soporifique.
18 avril 1908.
… Dès cinq heures du matin, nous ouvrons les yeux… et la plus vive stupéfaction se peint dans nos regards.
— Y a du monde ! s’écrie Guérin !
Et en effet, la pagode abandonnée s’est peuplée pendant la nuit ! En face de nos nattes, sont accroupis une dizaine de bonzes et autant d’indigènes. Toute cette assemblée garde le plus profond silence et la plus hiératique immobilité.
Ne voulant pas paraître moins flegmatiques, nous nous décidons à nous habiller publiquement… Personne ne dit rien, de part ni d’autre.
— « Je crois tout de même qu’ils sont épatés ! » murmure Guérin.
En quelques minutes nous sommes prêts et laissant là tous ces gens, nous sortons de notre pagode.
Dehors, un même cri de joie nous échappe devant la splendeur du ciel nettoyé et d’un beau bleu tout neuf !… Un soleil éclatant darde ses rayons sur la terre détrempée. Puisse-t-il sécher notre route et nous permettre ainsi d’avancer par nos propres moyens sans avoir recours à ce brave mais maudit animal… « l’animal nécessaire » : le buffle !!!
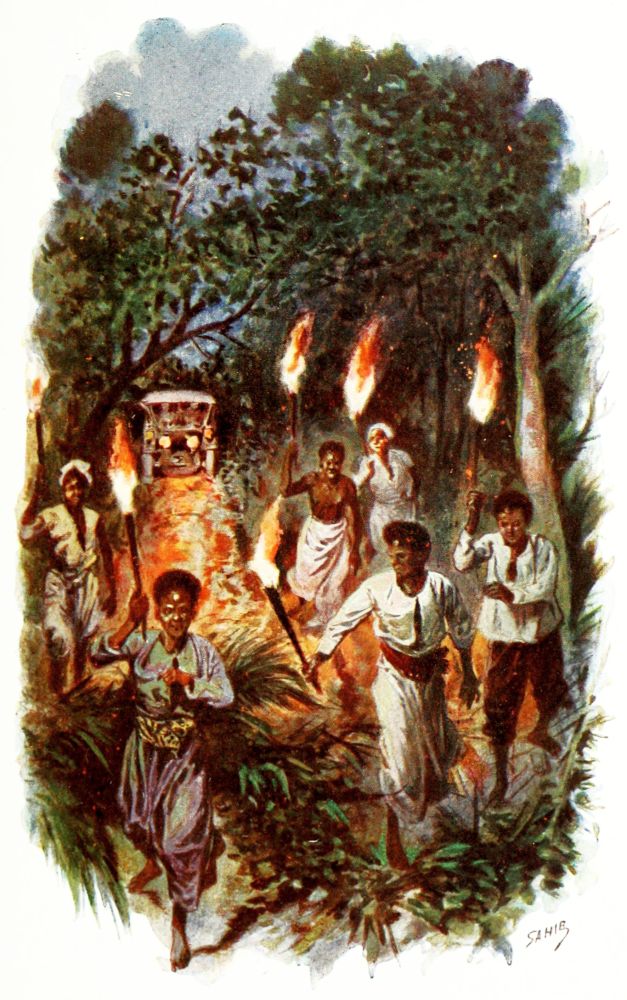
Nous nous rendons à pied jusqu’à l’arbre postal sous lequel notre voiture a passé la nuit : le terrain résiste sous nos semelles : nous commençons à espérer.
Les charrettes sont arrivées dans la nuit, sous la conduite du sûr et fidèle Nam-Ay.
Une petite discussion s’engage pour décider si nous partirons seuls ou traînés. Cette dernière alternative nous répugne profondément, mais nous savons trop par expérience qu’il ne faut négliger aucune précaution, et pour plus de sûreté, j’envoie Bernis et Guérin reconnaître le chemin à pied tandis que nous préparons le déjeuner sous la tente, car le soleil fait déjà des siennes !
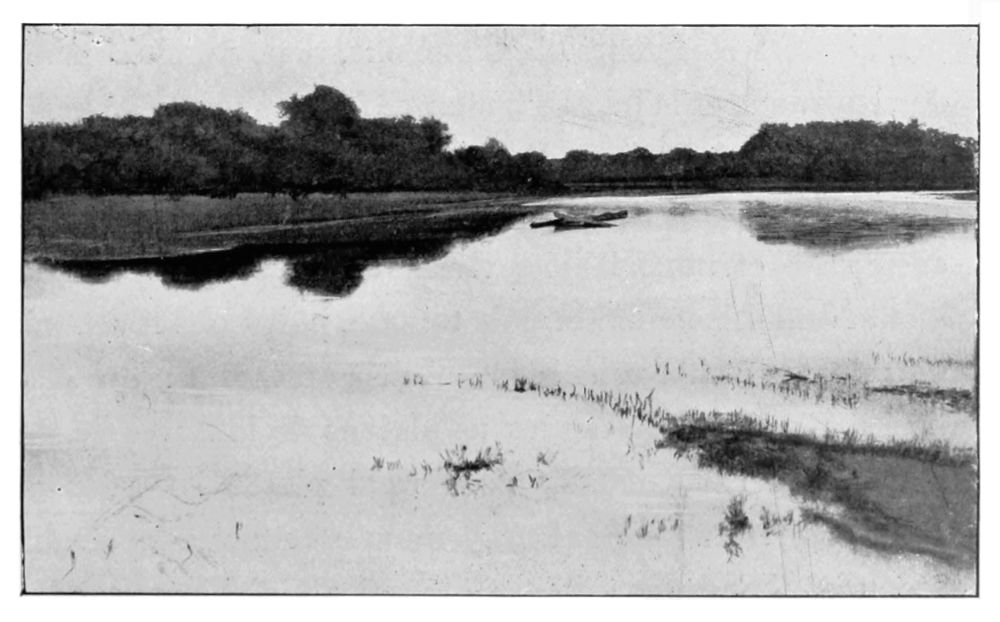
Au bout d’une heure, les deux « scouts » reviennent enchantés et rapportent la bonne nouvelle que l’on peut y aller carrément. Toutefois, nous attendons jusqu’après midi pour laisser le bon soleil accomplir son œuvre.
Afin de varier un peu l’ordinaire du menu, nous tuons le temps, Bernis et moi, en tuant trois canards sur la mare. Le temps s’en remettra vite, mais les canards difficilement.
A une heure, nous sommes prêts. En route !
Le chemin est bon, car le sable qui nous retenait à l’aller avec un déplorable acharnement reste encore humide de la pluie diluvienne d’hier soir et offre à nos roues une bonne prise (à vos souhaits !) une si bonne prise même qu’à deux heures et demie nous arrivons en face de la Résidence de Kompong-Thom.
Nous espérons retrouver à Kompong-Thom le pont qui nous permit de passer la rivière à l’aller… Autre déconvenue (mais nous n’en sommes plus à les compter !) notre pont a été enlevé par la crue des eaux. Aussi force nous est de laisser l’auto chez M. Colin.
L’aimable Résident, M. Chambert, nous reçoit comme de vieux amis et la joie qu’il montre à nous revoir se mêle de quelque admiration. Il nous avoue que jusqu’à notre entrée dans Ang-Kor il avait douté du succès de notre entreprise et nous félicite vivement de l’avoir menée à bien. Nous faisons un brin de toilette, puis nous revenons près de notre charmant hôte qui déjà se met à notre disposition pour organiser les opérations de la traversée du fleuve, que l’absence de pont rend plutôt hasardeuse. Pour gagner du temps et couper au plus court, nous avons recours aux moyens primitifs : le radeau, d’ailleurs solide, qui sert d’appontement à la douane sera maintenu par deux grosses pirogues. Nous voulons espérer que ce ponton improvisé supportera le poids de l’auto… Mais encore faut-il prendre les dispositions nécessaires et nous ne pourrons tenter le passage que demain.
Dimanche 19 avril 1908.
C’est aujourd’hui le saint jour de Pâques et nos cœurs sont pleins de nostalgie. Il nous semble entendre, à travers la vaste terre, l’écho lointain des carillons joyeux et des chants d’allégresse qui saluent la résurrection du Sauveur. Là-bas tout est en fête… Ici, rien que les aboiements des chiens cambodgiens, de ces affreux chiens dont les hurlements lugubres nous ont exaspérés durant tant de jours et surtout tant de nuits.
Grâce à l’intelligente organisation de M. Chambert, et à l’activité des coolies, le ponton se trouve prêt dès la première heure du matin. Guérin, plein de confiance, part aussitôt levé pour faire passer la voiture. Je ne sais pourquoi, je ne puis partager cette belle sérénité… L’eau perfide nous a ménagé tant de surprises désagréables que je me sens envahi de sombres pressentiments ; mais je n’en veux rien laisser voir à Guérin et je le laisse donc partir seul.
Le temps passe. Guérin ne revient pas plus que Marlborough !
Mon inquiétude s’accroît si bien qu’à neuf heures, craignant quelque mésaventure, je me précipite au débarcadère accompagné de M. Chambert qui prend mon angoisse en pitié. Enfin, nous apercevons notre Diétrich. Elle est de notre côté mais encore amarrée sur le radeau. Des coolies travaillent à construire une amorce de planches du rivage au ponton.
… Tout à coup, au moment où l’auto, tirée par une vingtaine d’hommes, va démarrer, la pirogue de droite qui a déjà embarqué beaucoup d’eau coule à pic et entraîne avec elle le radeau et la malheureuse machine dont l’arrière plonge entièrement. Dans cette position d’équilibre instable, elle menace de se renverser tout à fait et de sombrer : or, il y a plus de deux mètres d’eau.
… Malgré la distance qui nous sépare, il me semble vraiment que je sens le cœur de ce brave Guérin battre à l’unisson du mien. La même angoisse nous a saisis à la pensée de voir couler sous nos yeux notre vaillante machine. Il faut agir ! (c’est ce que l’on se répète toujours dans les cas désespérés… mais sans rien trouver à faire). Pourtant, je crie les ordres qui me passent par la tête et l’on commence par couper vivement les amarres de la pirogue de droite. Puis M. Chambert qui, lui aussi, a la décision prompte, envoie chercher ses quatre éléphants domestiques tandis que je demande à notre ami le gouverneur cambodgien de faire venir sans retard le plus de coolies possible.
Car il n’y a qu’un moyen de sauver notre pauvre machine, c’est de lui faire franchir d’un bond l’espace de deux mètres qui sépare le ponton du rivage. Jamais la solidité de la voiture n’aura été mise à pareille épreuve. Et, en admettant qu’elle veuille bien consentir à ce saut périlleux, je me demande comment elle se recevra… et si elle survivra à la secousse.
Voici les quatre éléphants de la résidence. Leur galop fait trembler la terre… leurs cornacs les arrêtent et les attellent au bout d’un gros câble fixé à l’auto… Le long de ce câble, je fais disposer cent cinquante coolies non sans avoir essayé de leur expliquer ce que j’attends d’eux. Leur chef stylé par le gouverneur cambodgien, qui veut bien nous servir d’interprète, leur transmet mes indications… Ils semblent comprendre et se laissent placer dans l’ordre que je prescris.
Enfin, au signal donné, hommes et éléphants unissant tous leurs efforts, tirent violemment, d’une seule secousse brusque. Mon cœur s’arrête une seconde. Je vois la voiture soulevée quitter le ponton et pour ainsi dire prendre son élan… Est-ce la fin de notre expédition ?
Non ! D’un saut formidable et que je n’aurais pas cru possible, l’auto, enlevée, retombe avec un bruit mat sur la terre ferme.
Je me jette sur elle un peu comme je me jetterais sur le corps d’un ami qui viendrait de faire une chute terrible. Il me semble bien qu’aucun organe essentiel n’est atteint, mais j’ai besoin de l’entendre dire par Guérin… je le consulte du regard.
— Rien de cassé ! me dit-il du ton dont un chirurgien décréterait que la malade est sauvée !…
Pourtant il me faut une preuve suprême…
Vite un coup de pompe pour la pression d’essence, un tour de manivelle et le moteur ronfle ! Ivre de joie, je saute sur le siège et je démarre majestueusement… Cette fois-ci, je puis bien le dire (en style d’obélisque !) : aux acclamations d’un peuple immense !
C’est égal, il faut vraiment que toutes les pièces de la voiture soient d’une solidité invraisemblable pour avoir résisté à un pareil choc… venant après tant d’autres secousses.
Enfin, nous voilà une fois de plus sauvés des eaux. Pareille au canard légendaire, notre auto les a bien passées !… Les charrettes aussi sont là. Demain matin, nous partirons pour Kompong-Cham. Fasse le ciel que notre route ne soit pas trop détrempée.
… Une mauvaise nouvelle vient déjà gâter notre joie : la provision d’essence n’est pas arrivée et Guérin m’annonce qu’il n’en reste plus que cent litres dans les réservoirs.
Si la route est bonne peut-être arriverons-nous !
Mais si elle est mouillée nous resterons en panne !
Et quelle panne ! sans essence en plein Cambodge !
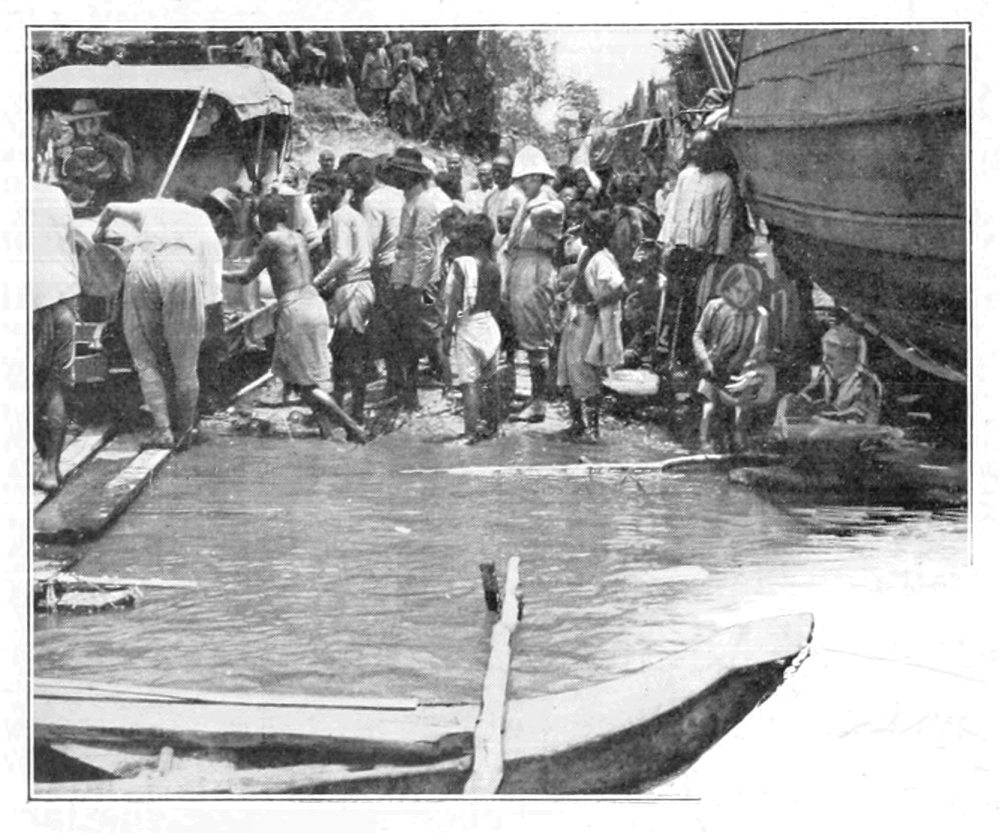


20 avril 1908.
Dès six heures ce matin, Bernis est parti à cheval avec un guide : très inquiété par la mauvaise nouvelle d’hier soir, je l’ai envoyé en avant pour reconnaître la route, marquer les mauvais endroits et nous procurer des secours en cas de besoin.
A sept heures, je quitte la Résidence en compagnie du fidèle et courageux compagnon, de Guérin et de Tiam. Nous emmenons un guide. En démarrant, dans l’allée même, nous nous ensablons d’un côté… Je le sais bien, ce n’est là qu’un incident sans importance. Pourtant j’y crois voir un mauvais présage.
Enfin, après de nombreux efforts, nous repartons… et nous avons du moins la consolation de passer en vitesse devant le personnel de la Résidence qui nous envoie un dernier adieu.
… Ici, commencent les pires difficultés de notre voyage. Nous pensions avoir désarmé la déveine : elle nous attendait au retour. Quelque suspects que soient les éloges qu’on se décerne à soi-même, je m’en voudrais au moins pour mes vaillants compagnons de ne pas reconnaître qu’il nous a fallu vraiment une endurance et une ténacité presque sauvages pour ne pas tout abandonner et continuer notre voyage jusqu’à la résidence de M. Beaudoin.
Mais la suite du récit le démontrera mieux, je l’espère, que ce témoignage « d’auto-satisfaction » !
Donc, à peine sortis de la ville et entrés dans la grande plaine, nous commençons par nous embourber. Heureusement, à cet endroit, de nombreux coolies travaillent à la chaussée. Ils lâchent leur travail avec une joie mal dissimulée pour venir à notre aide. Tirés, poussés, cahotés, nous avançons à grand’peine… Enfin, nous retrouvons un terrain moins traître et nous nous plaisons à croire que notre tribut au malheur est acquitté et que désormais ça marchera tout seul.
En effet, nous parcourons 500 mètres à très bonne allure. Nous n’osons croire à tant de chance — et nous avons trop raison, car nous voici embourbés de nouveau !… Tout le monde descend et se met à pousser consciencieusement. Je reste seul à la direction, tandis que mes pauvres amis… de concert avec les indigènes s’évertuent à faire avancer la voiture. Elle se décide enfin à démarrer et si brusquement que le compagnon, Guérin et les indigènes, entraînés par la force de la vitesse mal acquise, s’étalent pêle-mêle de tout leur long dans la boue. Ils prennent le parti d’en rire.
Un peu plus loin, même comédie !… Elle nous amuse déjà moins. Je sens que nos malheurs frisent le ridicule… mais le comique de notre situation ne m’en paraît que plus douloureux. Je m’énerve et je tourne ma fureur contre Hervé de Bernis à qui j’en veux de son absence prolongée… Que fait-il ? Pourquoi n’est-il pas là ?… J’en profite du moins pour l’attraper de la bonne manière ! Pense-t-il donc que c’est pour faire l’école buissonnière que je l’ai envoyé en avant ? Se rappelle-t-il seulement notre existence ? Nous croit-il en automobile ou en bateau ? Ah mais… Ah mais…
Bernis ne se défend pas, et pour cause !
Guérin, plus calme, me fait remarquer que notre éclaireur a sûrement passé par là, car il a fidèlement laissé quelques piquets, qui seuls, de loin en loin, indiquent les passages qu’il aura jugé difficiles. La belle avance ! et que me font ces piquets dans l’état d’exaspération où je suis ?
Notre précieuse essence diminue et nous n’avançons pas…
De guerre lasse, je finis par faire demander des buffles et, en attendant, je descends tirer à la carabine des grues antigones qui pullulent autour de nous.
J’en sacrifie trois aux mânes de Bernis qui continue d’être absent, comme il n’est pas permis de l’être !!
Enfin les buffles arrivent, de leur pas tranquille et lent. Ils sont quatre et paraissent résignés à tout. Je les envie.
On les attelle et nous repartons cahin-caha.
Crac !… Dans une secousse les cordes cassent.
Tout le travail de l’attelage est à refaire !
Les cahots sont si durs et la boue si tenace que nous remplaçons les cordes par le câble en acier du treuil.
Il est plus de midi maintenant.
Et nous n’arrivons pas même en vue de Kracka… C’est-à-dire qu’en cinq heures, nous n’avons pas fait 14 kilomètres !!!
La voilà bien l’ivresse de la vitesse !
Enfin, après mille et une péripéties dont le récit deviendrait fastidieux, nous apercevons sur la lisière de la forêt les premières canhas de cet intangible village de Kracka.
Cependant le ciel se couvre comme le président d’une réunion politique, quand il sent que ça va mal tourner : en effet, tout permet de prévoir une de ces pluies dont le ciel garde le privilège à ces régions bénies de l’Extrême-Orient. Dieu sait pourtant que nous n’avons nul besoin d’une nouvelle averse pour contrecarrer notre marche… Mais que faire ?
Nos coolies, qui s’intéressent à la voiture à feu, nous disent de marcher par nos propres moyens et de faire une entrée sensationnelle dans le village ! Sans doute, ils seraient flattés de se trouver associés à notre triomphe éventuel… Cette soif de gloire n’est pas pour nous déplaire. Malheureusement le terrain ne se prête guère à une si belle ambition, car maintenant nous roulons sur du sable et notre allure n’a rien de bien triomphal.
Pourtant nous défilons devant les cahutes en deuxième vitesse et à grand renfort de sirène, ce qui ne laisse pas que de faire son petit effet habituel sur les foules accourues et nous nous arrêtons sous la sala (je dis bien : sous, car elle est perchée sur pilotis à plus de trois mètres du sol !)
Nous montons déjeuner… et le gouverneur indigène nous apporte en cadeau un paon magnifique ! Mais hélas, ce noble gibier exhale un tel relent de pourriture que toute la sala en est infectée. Je n’en remercie pas moins avec effusion le brave gouverneur, car il paraît que le goût du faisandé est ici une élégance ! je crains seulement que le donataire ne se croie forcé par politesse d’assister à notre repas. Nous nous regardons tous avec inquiétude, car le bonhomme prolonge sa visite et se répand en protestations… Si seulement le paon pouvait s’inspirer de la conduite de ce fromage dont parle Courteline et qui « profitant d’un moment d’inattention avait déjà gagné la sortie » ! Mais non : le paon reste là, bien en évidence, il semble symboliser, par son immobilité posthume et par son redoutable parfum, la Politique dite « avancée ». Enfin, le gouverneur se décide à prendre congé ! Nous en ressentons un réel soulagement. Le paon fera le bonheur des trois coolies qui le regardent avec des yeux avides.
Délivrés de l’affreuse extrémité où la politesse a failli nous réduire, nous nous mettons à table… Et Bernis continue à ne pas être là.
Il se décide enfin à paraître à la fin du repas. Il ne montre aucun embarras et nous dit avec le plus grand flegme qu’il est très étonné que nous ne l’ayons point rejoint… Non ! Vraiment… ces cavaliers ne doutent de rien !
Les renseignements qu’il rapporte sur la route sont parfaitement décourageants. Mais enfin, on ne peut tout de même pas lui en vouloir.
Vers deux heures la pluie commence à tomber… que dis-je ? à crouler. J’ai déjà vu pleuvoir dans plusieurs pays, mais rien ne se peut comparer à ce déchaînement de cataracte : ce ne sont plus des gouttes, mais des jets d’eau ininterrompus, une véritable nappe liquide qui noie tout. On se croirait dans un aquarium. Cette inondation s’accompagne, comme il sied, d’éclairs livides et de roulements de tonnerre assourdissants.
Ce déluge ne nous décourage pourtant pas. Et nous nous remettons en route, regrettant seulement de ne pas avoir à notre disposition le Parapluie de l’Escouade. Guérin seul a le parapluie du chauffeur, mais il renonce à le déployer pour ne pas nous humilier et aussi parce que le déchaînement de la bourrasque ne lui permettrait pas de le tenir ouvert.
Sous la trombe, nous traversons la forêt en troisième vitesse ; c’est d’ailleurs de la folie pure ou du moins la rage du désespoir, car il est impossible de voir la route qui disparaît sous 40 centimètres d’eau. Nous roulons à moitié submergés, trempés, aveuglés… Et quelles secousses ! quels cahots ! quels bonds désordonnés sur les perfides racines, les trous, les ornières et toutes les variétés d’accidents de terrain. Il ne nous en arrive pas d’autres pourtant… Au bout d’une demi-heure la pluie cesse brusquement et dans la détente qui suit, sous le soleil reparu, nous marchons à merveille : nous nous embourbons bien un peu en vue de Tang-Krassang, mais pour repartir aussitôt. A trois heures, nous traversons en vitesse le pont du village et nous arrêtons pour saluer le gouverneur.
Il nous invite aimablement à passer la nuit chez lui et nous fait valoir les meilleures raisons de ne pas continuer notre route. Nous le remercions de son obligeance, mais nous ne voulons rien entendre ! Nous nous sommes mis en tête de coucher à Baraï. Nous coucherons à Baraï.
Et nous repartons, enthousiastes…
Pan ! à peine nous avons fait 30 mètres que le moteur s’arrête net… et pour la plus forte raison du monde : il ne reste plus une goutte d’essence.
— Ça y est ! Je l’avais bien dit ! constate Guérin avec cette exaspérante suffisance de ceux qui ont toujours prévu tous les malheurs.
Eh ! sans doute ! il l’avait bien dit… mais il n’empêche pas que nous voilà propres !… Plus d’essence, et encore 120 kilomètres à faire !
Si nous attendons ici que la provision arrive, nous risquons d’être bloqués par l’eau qui de plus en plus envahit la plaine et l’aura bientôt transformée en un immense lac… Agréable perspective !… Il est écrit que nous aurons établi le record de la panne !
Un seul parti se présente (et qui n’a pas de quoi affoler une Américaine) : envoyer en toute hâte un messager à cheval vers M. Chambert pour lui demander si l’essence est arrivée et le prier, en ce cas, de nous l’envoyer le plus rapidement possible… Sinon, il nous faudra prendre des buffles à Tang-Krassang et nous faire tirer jusqu’à Kompong-Cham. L’homme part avec la lettre.
Et nous revenons tout penauds chez l’aimable gouverneur qui se montre ravi de nous recevoir, le brave homme !
En attendant l’heure du dîner, nous nous installons sur le pont pour tirer les cormorans à cou de serpent et les hérons qui remontent la rivière. Après en avoir abattu plus de cent pour la plus grande joie de la population réunie, nous allons dîner avec notre ami le gouverneur et nous passons la nuit dans sa maison, un peu réconfortés par la bonne grâce de son hospitalité.
21 avril 1908.
Dès la première heure arrive un soldat à cheval, porteur d’une très aimable lettre de M. Chambert.
Hélas, la précieuse essence n’est pas arrivée chez lui, mais il a télégraphié à son voisin, M. Beaudoin, pour lui demander de nous l’expédier si, par hasard, elle se trouvait à Kompong-Cham.
… Sans doute, pour le bon philosophe Spinoza qui considérait l’essence comme un mode de la substance (ou le contraire… je ne sais plus très bien !…) de telles contingences ne mériteraient pas qu’on s’y arrêtât !… Mais cette résignation métaphysique nous manque. Et à la pensée qu’il ne nous reste plus qu’à nous faire traîner par des buffles, une affreuse tristesse nous accable.
Il faut pourtant vaquer aux préparatifs de ce douloureux voyage. A dix heures, tout est terminé.
Et, tirés par trois paires de buffles à la carrure imposante et massive, nous nous mettons en route, suivis de nos charrettes et entourés d’une dizaine d’indigènes à cheval.
Évidemment c’est très joli à voir : et pour un spectateur désintéressé notre caravane offrirait un aspect pittoresque à souhait… mais le spectateur désintéressé n’est pas même là !
Et rien n’est monotone et exaspérant comme cette marche lente et intermittente.

Pour comble de détresse, les conducteurs ont une peur terrible de leurs animaux : ils n’osent les frapper pour hâter leurs pas et ils ne les accablent que de prévenances… tant et si bien qu’ils les ont attelés de façon qu’au premier écart, le buffle rebelle puisse se sauver ; et l’on pense qu’il n’y manque point.
Je me demanderai toujours où nous avons pu trouver la patience nécessaire pour voyager dans de pareilles conditions.
… Enfin, à onze heures trois quarts, nous atteignons le pont de Pnow. A mesure que nous en approchions, je me sentais plus inquiet, les ponts nous ayant presque toujours ménagé de mauvaises surprises…
En allant reconnaître celui-là, je passe de l’inquiétude à la crainte la plus précise et j’ai le sentiment très net qu’un désastre nous attend. En effet, une crue énorme a depuis notre passage élargi la rivière qui roule des eaux rapides et boueuses. Le pont s’étant trouvé trop court, les indigènes l’ont allongé par un procédé très simple ; en prenant des planches indispensables pour supporter le poids de la voiture et en les posant sur des pirogues. De la sorte le pont a perdu de sa solidité tout en gagnant de la longueur.
Je fais demander d’autres planches, il n’y en a plus !
Pourtant il faut passer à tout prix et nous n’avons pas le choix entre deux partis. Je laisse la direction de l’auto à mon brave Guérin et je me mets en devoir d’organiser l’opération.
La rivière étant peu profonde, j’y fais descendre un cordon d’indigènes pour soutenir le plancher. Ces vivantes cariatides semblent du reste s’amuser de tout leur cœur, en barbottant comme des gamins à la mer.
Cent autres traînent la voiture.
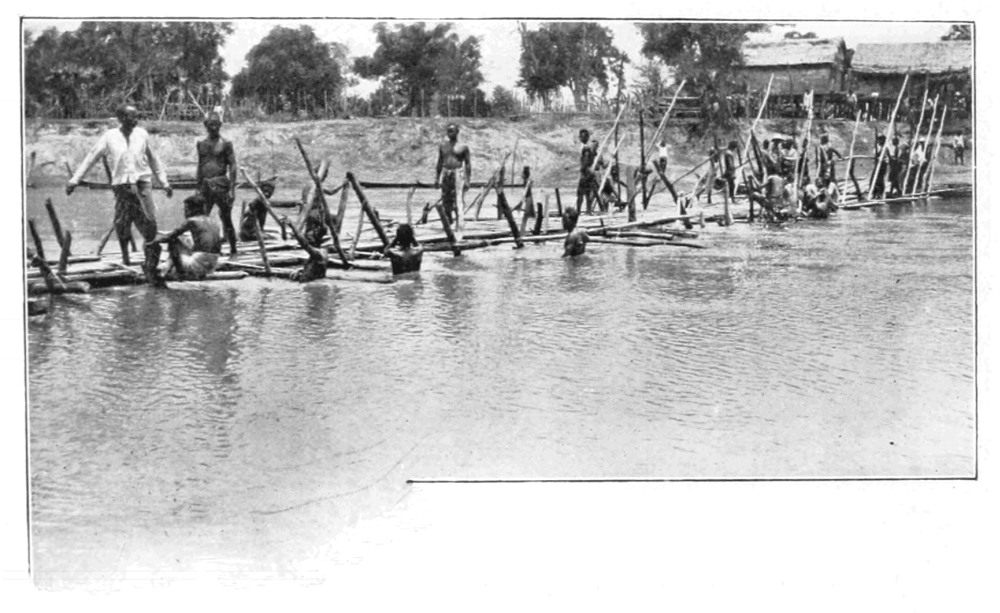
Je traverse le pont en proie à une indescriptible angoisse, je suis sûr qu’il ne supportera pas le poids de l’auto et des hommes et je m’attends au pire.
Enfin, comme à regret, je donne le signal du départ.
Les coolies me répondent par des cris sauvages et halent vigoureusement sur le câble d’acier.
Guérin au volant, la voiture avance. Le pont craque, mais résiste. Au moment même où je me reprends à espérer, un craquement plus fort me rend toutes mes craintes : c’en est fait ! les planches qui soutenaient les roues arrière viennent de céder en se relevant du bout et l’arrière touche sur les pieux en bambous, qui arrêtent sa chute… mais pour combien de secondes ?
Je ne pense pas que de tout notre voyage, nous ayons vécu une minute plus affreuse.
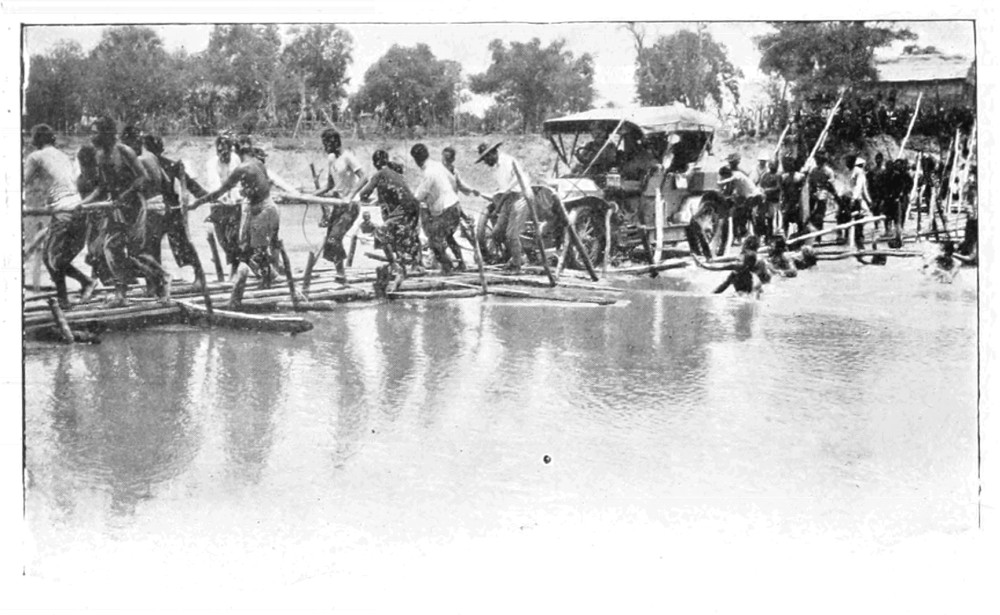
Affolé, je me jette au-devant des coolies pour les faire tirer de toutes leurs forces. Ma physionomie angoissée leur en dit sans doute plus long que les encouragements : d’un effort unanime, presque surhumain, ils parviennent à faire avancer l’auto sur les piquets… car les roues arrière chassent devant elles les planches au lieu de rouler dessus.
La voiture parcourt ainsi une dizaine de mètres…
Avec beaucoup d’à-propos, les « cariatides » (qui par bonheur ne participent point de l’immobilité des statues !) parviennent à retenir les planches transversales qui se dérobent et à les glisser de nouveau sous les roues arrière. Ainsi soutenue, la voiture roule… pour retomber d’ailleurs une seconde fois, mais si près de la rive que la bande hurlante des braves Cambodgiens qui se passionnent pour leur travail parvient à la tirer hors de l’eau.
Je n’ai jamais poussé un « ouf » plus convaincu !…
Dès que la voiture touche terre, ce pauvre Guérin, blanc comme un linge, quitte son volant et bondit sous les châssis pour constater les dégâts causés par les piquets du pont.
… Que va-t-il découvrir, mon Dieu ?… Je tremble de le voir reparaître.
Au bout d’une minute il se redresse tout rayonnant.
— Je n’ai jamais vu ça ! crie-t-il enthousiasmé… Les ressorts qui portaient à faux n’ont pas bougé et il n’y a qu’une petite bosse dans la tôle protectrice du réservoir… Et ce qui m’épate encore bien plus, c’est que la boîte des vitesses ait résisté !!!
Si nous étions près d’un bureau de télégraphe, j’enverrais mes éloges aux constructeurs d’une pareille voiture…
Nous nous félicitons naturellement de l’avoir une fois de plus échappé belle… et surtout d’avoir entrepris ce hasardeux voyage avec une machine à décourager l’obstacle !
Je remercie les vaillants Cambodgiens qui nous ont aidés avec tant de courage, d’entrain et d’intelligence et je leur laisse la bonne récompense qu’ils ont bien méritée. Cela nous vaut une explosion de reconnaissance qui nous va au cœur.
Mais l’estomac aussi a ses exigences !… Tant d’émotions nous ont ouvert l’appétit et incontinent nous nous mettons à table (si l’on peut dire !) sur le bord de la rivière… car, tandis que nous nous agitions dans l’affolement, l’impassible Tiam n’a pas perdu une minute pour faire cuire les inévitables œufs et l’inévitable riz qui composent notre ordinaire. Nous faisons honneur à ce maigre repas… et nous nous reprenons à croire que nous avons fatigué la chance contraire.
Hélas ! à peine avons-nous fini de rassembler nos chaises, notre table et notre batterie de cuisine que le ciel adverse (et à verse !) rouvre sur nous toutes ses cataractes… En une minute la terre a disparu sous une nappe d’eau.
Nous nous réfugions dans la voiture, mais malgré la capote nous sommes trempés.
Autant repartir tout de suite !
Mais tel n’est pas l’avis des buffles qu’on vient d’atteler au petit bonheur sous cette trombe d’eau : ils refusent nettement de tirer. Nous nous demandons avec intérêt qui l’emportera de la pluie ou de leur obstination !…
C’est la pluie qui se fatigue la première.
Sans paraître vouloir céder tout à fait, elle diminue pourtant peu à peu et devient une pluie humaine et supportable.
Les buffles reniflent de satisfaction et se décident enfin à repartir. La plaine est déjà couverte d’eau : et c’est par une sorte de bruine fine et froide (le crachin, comme disent les marins) que nous arrivons vers huit heures du soir à Baraï, trempés, harassés, mourant de faim et donnant nos buffles aux cent mille démons de la mythologie bouddhique !
22 avril 1908.
Je crois pouvoir affirmer que malgré notre fatigue aucun de nous n’a fermé l’œil de toute la nuit, car les chiens ont tenu à nous donner un dernier concert et on peut leur rendre cette justice qu’ils se sont vraiment surpassés.
Et le pis est que les indigènes se sont mis de la partie : soit pour faire taire la meute hurlante, soit pour leur plaisir personnel, ils nous ont prouvé qu’en fait de tapage nocturne ils n’ont pas de rivaux dans la vieille Europe… Enfin, dans les rares moments où bêtes et gens se résignaient à un silence relatif, le cri du lézard entretenait notre insomnie ! Cet innocent reptile qui, chez nous, peut passer pour un modèle de discrétion, s’est découvert (grâce à l’influence du milieu sans doute !) une voix redoutable, non qu’elle soit éclatante et claire, mais si rauque et si lugubre qu’on en reste énervé même après qu’elle s’est tue…
Nous nous levons donc de mauvaise humeur, avec la noire perspective d’une journée entière d’auto-buffle !
La pluie a cessé et nous ne voulons pas nous attarder ici, car nous nous rappelons avec tristesse notre entrée triomphale à Baraï le mois dernier et nous nous sentons profondément humiliés.
Tout cela par la faute de la poste ou des Messageries Fluviales qui ont certainement commis une erreur de nom de province dans l’envoi de notre essence. Rien n’est plus exaspérant que de subir les conséquences d’une faute dont on n’est pas responsable. Tout était si bien prévu, nos dispositions si bien prises… Et voilà toute la fin de notre voyage et ce retour dont nous nous faisions fête, compromis par une négligence anonyme et contre quoi nous ne pouvons rien. Nous sommes d’autant plus désolés que maintenant la route est bonne et praticable… Quand je dis la route, le mot de sente serait plus exact sans doute, mais nous avons franchi tant d’ornières que nous n’en sommes plus à cela près… et si nous avions seulement un peu d’essence nous pourrions rentrer à Saïgon en deux ou trois étapes !
Enfin, il faut nous résigner… De nouveaux buffles nous entraînent hors de Baraï. Leur lenteur ne les distingue point de ceux qui nous traînaient hier… c’est toujours le même pas inégal et lourd, les mêmes à-coups, les mêmes cahots.
Nous nous arrêtons pour déjeuner auprès d’une petite pagode en pleine forêt : je laisse le volant à Guérin et vais en avant tuer quelques malheureux volatiles sur lesquels je passe ma mauvaise humeur.
A cinq heures, nous atteignons le village de Poungro où nous nous disposons à passer la nuit.
Nous avons parcouru dans toute cette journée vingt kilomètres !
Cela se passe de commentaires… sauf celui de Guérin :
— Il y a de quoi donner sa démission !

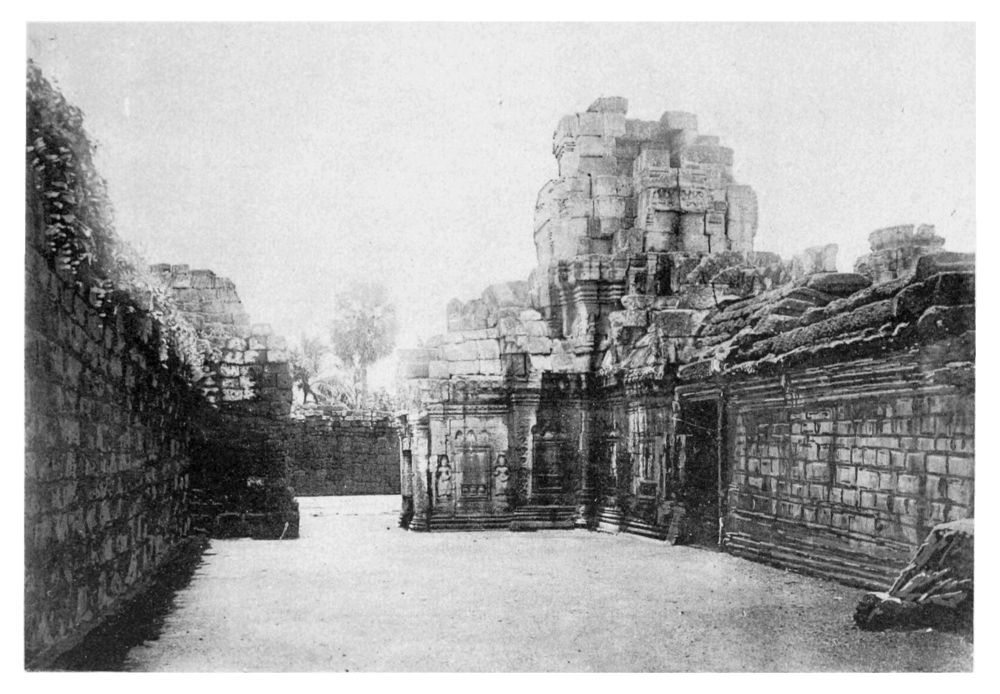

23 avril 1908.
Nous quittons Poungro à huit heures du matin.
Devant le moteur (impuissant hélas) trois paires de buffles balancent leurs grosses têtes ornées de cornes monumentales… j’ai beau me raisonner, je ne puis m’habituer à cet attelage incohérent et anachronique !
Le départ est plutôt de mauvais augure… Dès les premiers pas de nos buffles, nous nous embourbons dans une rizière et il faut le concours de tous les indigènes qui unissent leurs efforts à ceux des six nobles bêtes à cornes pour nous faire avancer péniblement, car les roues sont enfoncées dans la vase jusqu’au moyeu…
Enfin, après des efforts dérisoires, nous atteignons un terrain plus résistant. Désormais nous allons pouvoir rouler à la vitesse de trois kilomètres à l’heure.

Le soleil fait « une rentrée » éclatante !… mais, comme les grands premiers rôles, il charge trop ses « effets » ! Vraiment il abuse. Nous en sommes presque à regretter la pluie et nous ruisselons tout autant qu’hier.
Les buffles eux-mêmes sont incommodés de la chaleur et leur gêne se traduit par des signes de rébellion manifeste. Sans doute ils rêvent d’une sieste sous l’ombrage… Et nous donc !
A midi nous rencontrons un arbre qui se dresse fort à propos dans la plaine. Il paraît souffrir de sa solitude. Autant pour le distraire que pour déjeuner, nous nous arrêtons à l’ombre de ses branches. Cependant, bêtes et gens vont prendre un repos bien nécessaire, car la chaleur est devenue intolérable.
A deux heures on attelle à nouveau les buffles et nous repartons sans qu’il me soit possible d’obtenir des renseignements précis sur l’endroit où nous ferons l’étape. Cette incertitude ne contribue pas à nous égayer…
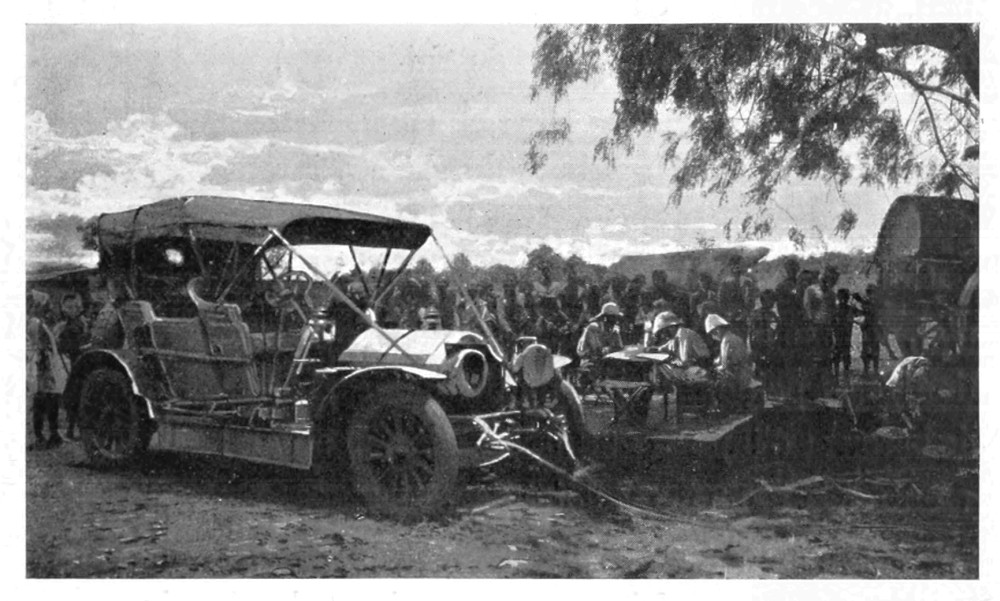
Pour varier les plaisirs, voilà que, vers deux heures et demie, les deux buffles d’arrière, tenant à manifester leur volonté de ne plus rien savoir, se mettent à ruer dans leurs traits, brisent un phare et finalement se détellent.
La chaleur aidant, je commence à bouillir et je donne des ordres au petit soldat envoyé par M. Chambert, afin qu’il fasse mettre un homme de chaque côté de ces « bovidés » rebelles que Guérin traite dédaigneusement « de moteurs à bouse » !
Tout l’attelage étant ainsi encadré, nous repartons.
Mais le même incident se renouvelle un peu plus loin, car les conducteurs craignent tellement les bêtes qu’ils n’osent les frapper et n’ont donc aucun argument valable pour les faire rentrer à leur place.
… La même cérémonie recommence toutes les dix minutes. Je finis par prendre la mouche et tant bien que mal, mais d’un accent dont la véhémence se passe de traduction, je fais comprendre au soldat que, si les conducteurs ne font pas avancer leurs buffles et ne les empêchent pas de se sauver à tout bout de champ, je prends ma plus grosse carabine et je tire dans le tas.
Cette tartarinade porte à merveille. Ma menace (que je n’ai, comme bien l’on pense, nulle envie de mettre à exécution !) est à peine formulée que les buffles, harcelés de coups de bâton et d’injures gutturales, partent au grand trot, sans montrer la moindre velléité de résistance. Nous sommes secoués comme dans un panier à salade, mais, enfin, nous avançons et nous faisons ainsi un bout de chemin.
… Tout à coup, de ce même ton enthousiaste dont les éclaireurs des Dix Mille saluèrent jadis l’apparition de la mer, Bernis s’écrie :
— Une charrette ! Une charrette et une lettre ! l’essence ! l’essence !
A ce mot magique, l’attelage, qui sans doute n’attendait que cela, s’arrête instantanément… Tout le monde saute à bas de l’auto par toutes les ouvertures et se précipite en une folle débandade à la rencontre de la charrette… Je crains un instant que nous ne courrions à une suprême désillusion. Mais non ! c’est bien l’essence !… notre provision tant désirée que les Messageries Fluviales avaient adressée par erreur à Kompong-Cham au lieu de Kompong-Thom… et que M. Beaudoin, sur la dépêche de M. Chambert, a l’obligeance de nous renvoyer.
Notre joie ne peut se décrire… Fini l’auto-buffles !
Enfin nous allons donc pouvoir rouler et faire de la vitesse !
Guérin exécute un cavalier seul, nous poussons des vivats en l’honneur des deux aimables résidents… puis, tels des pirates à l’abordage, nous nous ruons en brandissant nos haches pour éventrer l’emballage des bidons.
Le paisible Tiam nous croit atteints de folie subite… Ses yeux bridés se plissent d’inquiétude, il s’approche avec méfiance. Mais nous lui faisons comprendre que « c’est même chose Chum-Chum pour faire marcher dragon ! » Notre ivresse de pétrole le gagne à son tour. Les réservoirs sont remplis en un clin d’œil et les buffles (qui n’en reviennent pas !) dételés en un tour de main.
Mais une dernière question se pose :
— Après tant de chocs, tant de cahots, tant de bains, le moteur voudra-t-il fonctionner ? Ne va-t-il pas, lui aussi, faire le buffle ? Cruelle énigme !
Guérin, un peu pâle, se met à la manivelle et commence à moudre un café illusoire.
Un tour, deux tours !
Le moteur ronfle comme au sortir de l’usine… Son joyeux et puissant ronronnement accompagne les éclats bruyants de notre joie.
Vite, nous prenons la caisse d’huile attachée sur le marchepied et sans regarder, nous versons à flots le liquide dans le réservoir, tandis que Guérin remplit de graisse les diverses boîtes.
Tout est paré !… et nous ne demandons qu’à nous en aller.
A tour de bras nous payons les conducteurs de buffles, les coolies, la charrette qui vient pour ainsi dire de nous sauver.
Je me mets à la direction ! Guérin prend place à ma gauche, sur le marchepied s’installe le fidèle Compagnon qui ne craint ni les secousses, ni les douches (car il va nous falloir encore rouler dans l’eau). Dans le fond de la voiture se prélassent Tiam… et Bernis qui vient de mettre en marche. Et nous démarrons !…
La sirène épouvante les bêtes et les gens… mais son bruit strident résonne à nos oreilles comme une musique exquise…
Il me semble bien que le moteur pétarade un peu trop… peut-être tient-il aussi à exprimer sa joie de repartir… dans quelques instants il se calmera.
Il se calme en effet, dès que j’embraye en seconde vitesse. Il se calme même si bien qu’il n’a plus la force de nous faire avancer. Ce brusque arrêt fait tomber toute notre joie !
Qu’est-ce encore ?… Une soupape encrassée ? un inflammateur déréglé ? Nous sommes si habitués à prévoir le pire !
Guérin descend, inspecte et se redresse en riant. Ce n’est que le décompresseur, que dans la hâte de repartir, Bernis a tout simplement oublié de rentrer.
Il peut se vanter de nous avoir fait une belle peur !
Nous repartons magnifiquement !
Le moteur tourne à merveille et tire de toute sa puissance dans les flaques d’eau que nous traversons. Nous filons parmi les éclaboussures, sans même nous en apercevoir.
Mais soudain, Guérin me dit d’arrêter !… Quoi !… Ce n’est pas fini ! Oh ! ce Guérin, je le tuerais !… C’est égal : auparavant mieux vaut stopper quand même : selon sa détestable habitude, notre prudent mécanicien doit avoir encore raison !
Allons bon !… cette fois-ci, c’est de l’eau dans le graisseur. En effet, le bidon à demi plein fixé sur le marchepied, ayant perdu son bouchon (l’imbécile !), s’est rempli d’eau pendant les pluies et tout à l’heure, en versant trop précipitamment, nous ne nous sommes pas avisés de ce détail.

Il est écrit vraiment que nous épuiserons toute la liste des pannes ! Nous n’avons qu’à démonter et à vider entièrement le graisseur pour le remplir d’huile pure… Et en route !
Maintenant, nous roulons à toute vitesse dans une véritable trombe d’eau et de boue. On se croirait sur un torpilleur par grosse mer ! Mais notre brave machine semble vouloir rattraper le temps perdu. Elle marche comme elle n’a jamais marché.
Bientôt nous prenons la chaussée qui conduit à Kompong-Cham. Nous roulons presque constamment en quatrième vitesse : nous sommes couverts d’une eau jaune qui nous rend méconnaissables, mais qu’importe !… C’est un bain de couleur locale !
Par moments des secousses terribles nous font craindre de voir la carrosserie se briser ou les ressorts céder… Mais non ! les voyageurs en sont quittes pour rouler et tanguer ferme, c’est tout… rien ne casse ; et à cinq heures du soir, nous nous arrêtons devant la résidence, un peu fatigués sans doute et sales à faire peur, mais tout joyeux d’avoir si bien marché.
Malheureusement M. Beaudoin est absent et nous en éprouvons une grosse déception.
C’est M. Dessenlis qui vient nous recevoir. A notre vue il s’arrête interdit ; il ne nous attendait pas si tôt.
Après nous avoir comblés de félicitations étonnées et qui nous sont d’autant plus précieuses, il nous fait les honneurs de la résidence. Nous procédons à une toilette minutieuse… non sans besoin, et nous sommes tout juste prêts pour nous mettre à table.
Nous trouvons à dîner plusieurs invités, entre autres l’administrateur de Swaikléang, M. Voitel, qui avec amabilité nous invite à venir chasser chez lui.
Et nous nous retirons de bonne heure, car nous sommes tous un peu fourbus.
24 avril 1908.
La voiture est aujourd’hui livrée aux prisonniers ; ils lui font une toilette en règle… qu’elle a bien gagnée elle aussi.
Guérin, qui préside à ces ablutions, me dit dans son rapport que pas un seul boulon n’a bougé, j’en reste émerveillé !
L’après-midi se passe à chasser sur l’étang.
Plusieurs canards et poules sultanes au tableau.
25 avril 1908.
Une dernière déception nous attendait, qui va gâter notre retour. Ces pluies continuelles ayant amené une crue considérable des eaux, il nous devient naturellement impossible de revenir, comme nous le désirions tant, par le chemin de Kreck-Tay-Ninh.
Et la triste conséquence de cette hostilité des éléments, c’est qu’il va falloir nous séparer de notre bonne voiture et l’embarquer pour Pnom-Penh sur une chaloupe des Messageries Fluviales.
Nous irons nous-même par eau… puisque les bateaux sont maintenant les seuls moyens de transport possibles.
Ainsi, notre voyage va s’achever de la façon la plus monotone et la plus aquatique !… Desinit in piscem !…
… Dès ce matin, Guérin est allé reconnaître le chemin que devra suivre la voiture pour descendre sur la berge du Mékong jusqu’à la chaloupe. Comme cette berge est à pic, cela nous ménage encore quelques émotions.
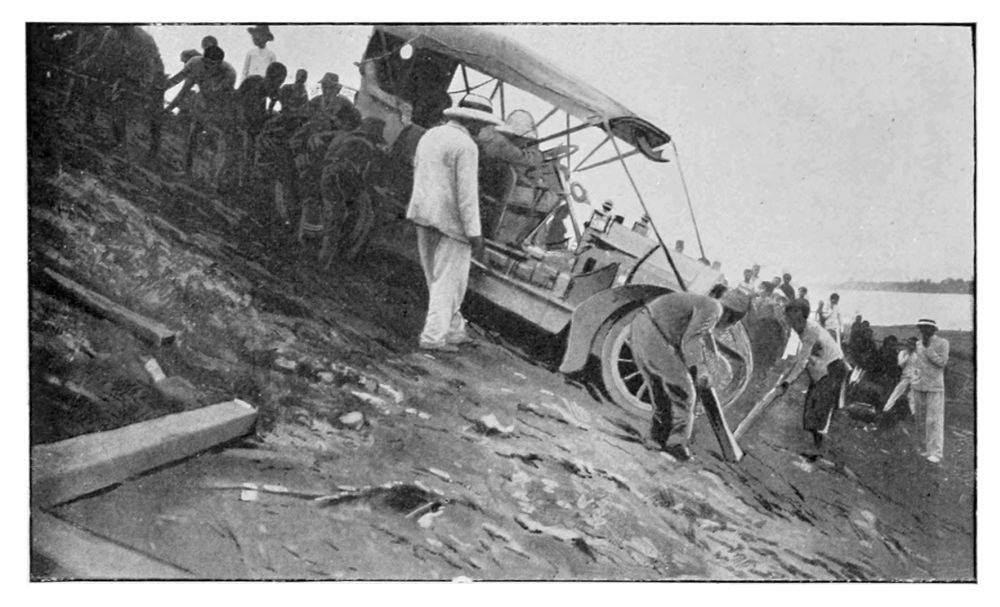
Même jour, six heures.
Enfin… c’est fait… et malgré de terribles difficultés, sans accrocs ni dommage, grâce à la parfaite amabilité de M. Dessenlis et de tous les Européens présents que je tiens à remercier ici de leur concours si bienveillant et si gracieux.
Pour descendre la berge escarpée du fleuve, il a fallu retenir la voiture par une chaîne à l’arrière, caler les roues de devant avec des madriers… et laisser glisser lentement l’énorme masse jusqu’à la chaloupe. La moindre imprudence pouvait avoir les suites les plus néfastes. Enfin, tout s’est bien passé.
Guérin, que rien ne saurait décider à quitter sa voiture, vient de s’embarquer sur la même chaloupe. Il nous attendra à Pnom-Penh.
28 avril 1908.
M. Voreau, inspecteur des douanes, a l’amabilité de mettre à notre disposition sa chaloupe qui va nous conduire à Pnom-Penh (à la Capitale, comme on dit ici, tout naturellement d’ailleurs !). Ainsi, nous serons comme chez nous et confortablement installés.
Et nous liquidons !… C’est-à-dire que, dans l’après-midi, je paie et renvoie les trois charrettes qui nous ont suivis (et au besoin précédés, dirait M. Joseph Prudhomme !) depuis Tay-Ninh.
Le brave Nam-Ay et ses deux camarades avaient les larmes aux yeux en nous quittant. Je les regrette vivement, car ce sont trois fidèles et sûrs compagnons qui nous ont rendu bien des services pendant ce pénible voyage.
Après le dîner, au moment où nous embarquons, M. Dessenlis nous comble de joie en nous donnant plusieurs splendides trophées de buffles et de cerfs qui, joints à ceux que M. Chambert a eu la bonté de nous offrir, seront, pour des chasseurs impénitents comme nous, le plus agréable souvenir de notre séjour au Cambodge.
A dix heures, nous partons après un dernier adieu à Kompong-Cham et à notre charmant hôte.
… N’oublions pas pourtant, en quittant cette ville, de consacrer une mention peu honorable à notre ex-boy-interprète-guide-cuisinier, le fâcheux Brin-d’Amour qui, toujours en prison, continue de méditer sur les bienfaits de l’automobile et les méfaits de l’horlogerie européenne.
27 avril 1908.
Après une nuit paisible sur le grand fleuve, une de ces nuits où le sommeil bercé par le chant monotone des sampaniers que l’on croise devient une véritable volupté, nous débarquons à six heures du matin et nous nous rendons au Grand-Hôtel où nous devons descendre pendant notre séjour à Pnom-Penh. Guérin, arrivé d’hier au soir, a mis la voiture au meilleur garage de la ville (c’est d’ailleurs le seul !).
A l’œil du chauffeur, la capitale du Cambodge est fort en retard sur celle de la Cochinchine où l’automobilisme est déjà populaire.
Ici, on ne rencontre que quelques rares tacots, bruyante et malodorante quincaillerie, dont les rues sont empoisonnées. On peut bien penser si notre belle Lorraine a fait son petit effet, surtout après les exploits qu’elle vient d’accomplir et qui lui valent déjà une renommée indo-chinoise… Je crois même pouvoir insinuer que les ronflements sonores et réguliers de son moteur ne sont pas sans faire naître quelque jalousie ! Car pour être chauffeur on n’en est pas moins homme !
28 avril 1908.
Nous allons consacrer cette journée et celle de demain à visiter la ville et les environs. Les quartiers indigènes, avec leurs boutiques et leurs bazars hétéroclites et bizarres et leurs théâtres bruyants, font de Pnom-Penh une capitale grouillante et joyeuse, et des monuments comme le Palais d’Argent et le pont des Nagas lui donnent une physionomie originale et rare.
29 avril 1908.
Encore un désappointement !… Il y a quelques chances pour que ce soit le dernier, mais nous n’en restons pas moins furieux !… Une dépêche de Mayréna m’annonce que la crue des eaux et le manque de ponts rendent absolument impraticable la route de Mytho à Saïgon… Ainsi nous voilà forcés de revenir jusqu’à Saïgon avec le bateau, au lieu de faire par nos propres moyens cette rentrée triomphale qui eût consacré le progrès de l’automobilisme en Indo-Chine… Jusqu’au bout de notre voyage l’eau sera donc notre continuelle ennemie.
Dans l’après-midi, puisqu’il faut renoncer aux joies du retour en auto, nous embarquons la voiture sur l’Atalo des Messageries Fluviales… Je viens de la voir solidement amarrée sur le pont, dont elle occupe toute la largeur. Demain nous prendrons le même bateau et nous accompagnerons tous jusqu’à Saïgon notre solide et vaillante compagne.
30 avril 1908.
A dix heures du matin, nous occupons nos trois cabines. Elles nous paraissent bien étroites et nous y étouffons… Aussi nous empressons-nous de monter sur le pont. Mais il est encombré de Chinois, d’Annamites, de bagages, de cages à poules, à tel point que, ne sachant où nous mettre pour trouver un peu d’air et de tranquillité, nous prenons le parti de nous installer sur les sièges de la voiture. Cela nous rappelle nos longues journées d’auto buffles… Et nous restons là tout le jour, causant et devisant, tandis que les berges du grand fleuve se déroulent lentement sous nos yeux.
1er mai 1908.
Saïgon !
Ainsi, malgré la fortune adverse et tant de pannes et tant de déboires, nous sommes rentrés en quinze jours.
On accoste à onze heures du matin. Mayréna prévenu par dépêche est là, dominant toute la foule de sa haute taille, il nous félicite vivement de cette belle randonnée qu’il a suivie passionnément, à mesure que nous avancions vers Ang-Kor. Notre bonne voiture est roulée sur une large passerelle jusqu’à la terre ferme.
Nous y prenons tous place, un tour de manivelle et l’on part… jusqu’à l’Hôtel Continental : ce n’est pas la plus longue de nos étapes ! mais c’est sûrement la plus agréable.
Comment dire notre joie de nous retrouver dans cette belle et bonne ville de Saïgon, après avoir mené à bien une entreprise qui nous paraissait, ainsi qu’à bien d’autres, irréalisable et folle !
Mayréna nous apprend que, d’un commun accord, tous les automobilistes de la capitale avaient formé le projet de venir à notre rencontre sur la route avec des drapeaux et de la musique pour nous faire une réception enthousiaste.
Nous maudissons une fois de plus cette eau hostile et perfide qui nous prive encore d’un accueil dont l’idée seule nous flatte et nous émeut.
Et maintenant, il ne me reste plus qu’un devoir bien doux à remplir, celui de remercier les trois fidèles compagnons à qui j’offre ces notes en souvenir reconnaissant des heures (pas toujours gaies) que nous avons passées ensemble. Jamais, aux pires instants de découragement, leur endurance n’a faibli ; jamais leur amitié ne m’a fait défaut.
C’est à Guérin surtout que je dois la réussite de ce voyage. Et je ne saurais trop louer son intelligence, son courage et son activité. J’admire surtout cette inaltérable bonne humeur, qu’il conservait même lorsqu’il lui fallait se coucher dans le sable brûlant pour examiner les dessous de sa voiture. Malgré la blessure qui le faisait terriblement souffrir, il ne prenait de repos que lorsqu’il avait tout vérifié, jusqu’au plus petit boulon, jusqu’au dernier ressort. Et jamais il n’a murmuré contre tant de mésaventures : cette gaîté-là, si alerte et si française, c’est la parure du courage. Grâce à Guérin, la voiture a pu accomplir les véritables prodiges qu’exigeaient les chocs ménagés par les sentiers, les plaines, les rizières et les ponts qu’il nous a fallu traverser pendant cette expédition sans route.
Je voudrais dire aussi toute la reconnaissance que je garde au charmant Compagnon qui n’a point hésité, malgré son goût pour le confortable et la paix du chez soi, à me suivre dans une aventure qui ne pouvait guère passer pour une partie de plaisir. La bonne grâce, l’enjouement, la gaîté spirituelle du « Compagnon » ne se sont jamais démentis « aux plus mauvais jours de notre histoire ! » Son aimable sourire fut la clarté et la joie de ce voyage, et je lui sais gré de ce qu’il a su mettre de gentillesse dans son dévouement.
Et je n’ai pas besoin d’ajouter que je remercie de tout cœur le bon et fidèle Hervé de Bernis. Je le connais de longue date : il sait toute l’affection que je lui porte, et qu’il mérite si pleinement par la droiture de son caractère, et par toutes les qualités chevaleresques qui sont inséparables de sa race et de son nom.
Un dernier mot encore pour les constructeurs de Lunéville et en particulier pour M. le Baron Adrien de Turckheim, qui s’est lui-même si gracieusement intéressé à fournir une machine capable de supporter jusqu’au bout, sans jamais manifester la moindre fatigue, ce long voyage plein d’incidents imprévus. Lorsqu’au retour, notre voiture a été entièrement démontée, on a constaté que pas une pièce n’avait pris de jeu et qu’aucun engrenage ne laissait voir la moindre trace d’usure. Pendant un mois encore, je m’en suis servi journellement sur les excellentes routes de la Cochinchine et à mon départ je la renvoyais intacte à Paris.
Quant aux pneus Michelin, ils ont bu l’obstacle !
… Le raid Saïgon-Ang-Kor est terminé et c’est avec une profonde reconnaissance que je vous redis :
Merci, chers compagnons ! Merci !
Puissions-nous avoir, au sens propre du mot, montré la route, cette route d’Ang-Kor qui serait si nécessaire au développement de notre belle colonie. Puissions-nous ainsi avoir servi, dans la mesure de nos moyens, la cause de la plus grande France !

Pages. | |
| Préface | |
CHAPITRE PREMIER | |
| Arrivée à Saïgon. | |
CHAPITRE II | |
| Le voyage d’essai à Tracop. — Début de la Diétrich dans la brousse. | |
CHAPITRE III | |
| Le chant du départ. — Une route pavée des meilleures intentions. | |
CHAPITRE IV | |
| La première journée dans la brousse. | |
CHAPITRE V | |
| Concert nocturne. — « Camping » forcé à Tapang-Prey. — Tampho. — La forêt. — Kreck. | |
CHAPITRE VI | |
| Départ de Kreck. — Un peu de vitesse. — Arrivée à Suong. | |
CHAPITRE VII | |
| De Suong à Kompong Cham. — Un incident. | |
CHAPITRE VIII | |
| Séjour à Kompong-Cham. | |
CHAPITRE IX | |
| Départ de Kompong-Cham. — Le pont de Pnow et Tang-Krassang. — Le feu dans la prairie. — Ensablés. — Arrivée à Kompong-Thom. | |
CHAPITRE X | |
| Séjour à Kompong-Thom. — Chasses. — Faux départ. — On opère Guérin. | |
CHAPITRE XI | |
| Départ de Kompong-Thom. — Arrivée à Kompong-Chen. — Chick-Reang. — Plus de route. — Arrivée à Siem-Reap. | |
CHAPITRE XII | |
| Arrivée aux ruines d’Ang-Kor-Vat. — Entrée de l’auto par la porte des Éléphants. — Visite d’Ang-Kor-Vat et d’Ang-Kor-Thom. | |
CHAPITRE XIII | |
| Départ. — Chick-Reang. — La boue et la pluie cambodgiennes. — En détresse sous l’orage. — Kompong-Thom. — Terrible angoisse. — Dernier saut de la voiture. | |
CHAPITRE XIV | |
| Départ de Kompong-Thom. — L’auto aquatique. — Plus d’essence : auto-buffle. | |
CHAPITRE XV | |
| Révolte de buffles. — L’essence. — Arrivée à Kompong-Cham. — Embarquement. — Pnom-Penh. — Retour à Saïgon. | |
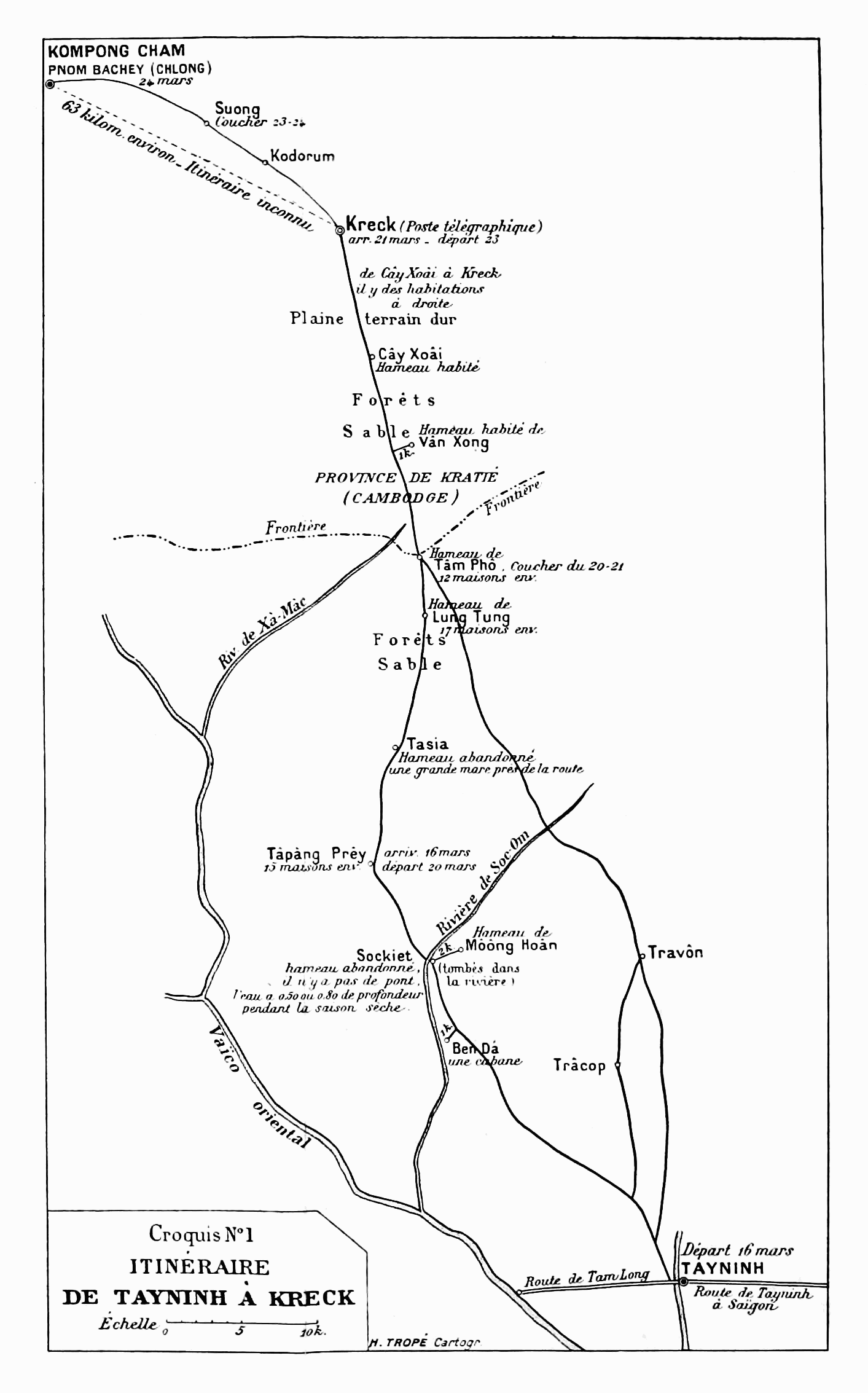
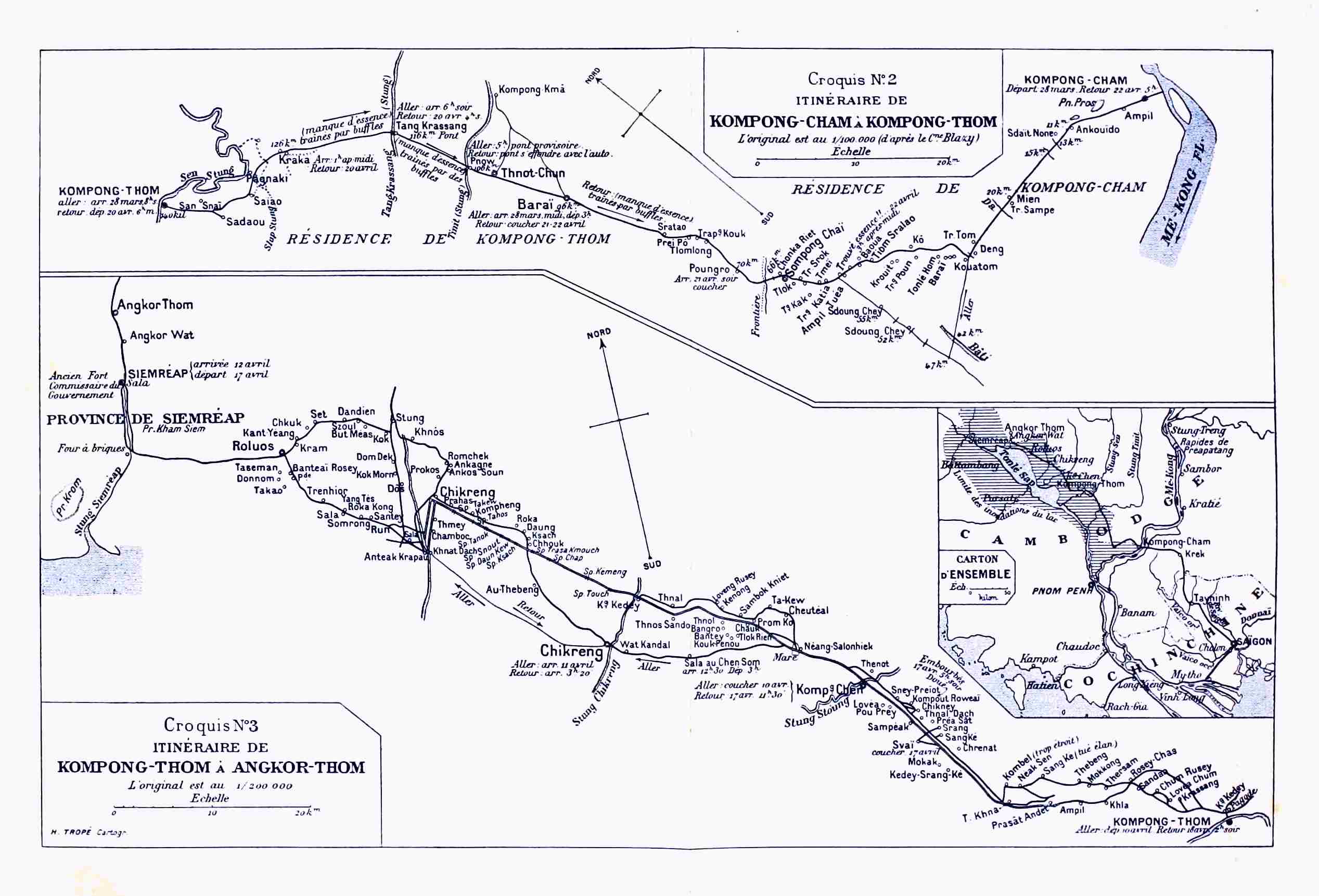
PARIS
TYPOGRAPHIE PLON-NOURRIT ET Cie
Rue Garancière, 8