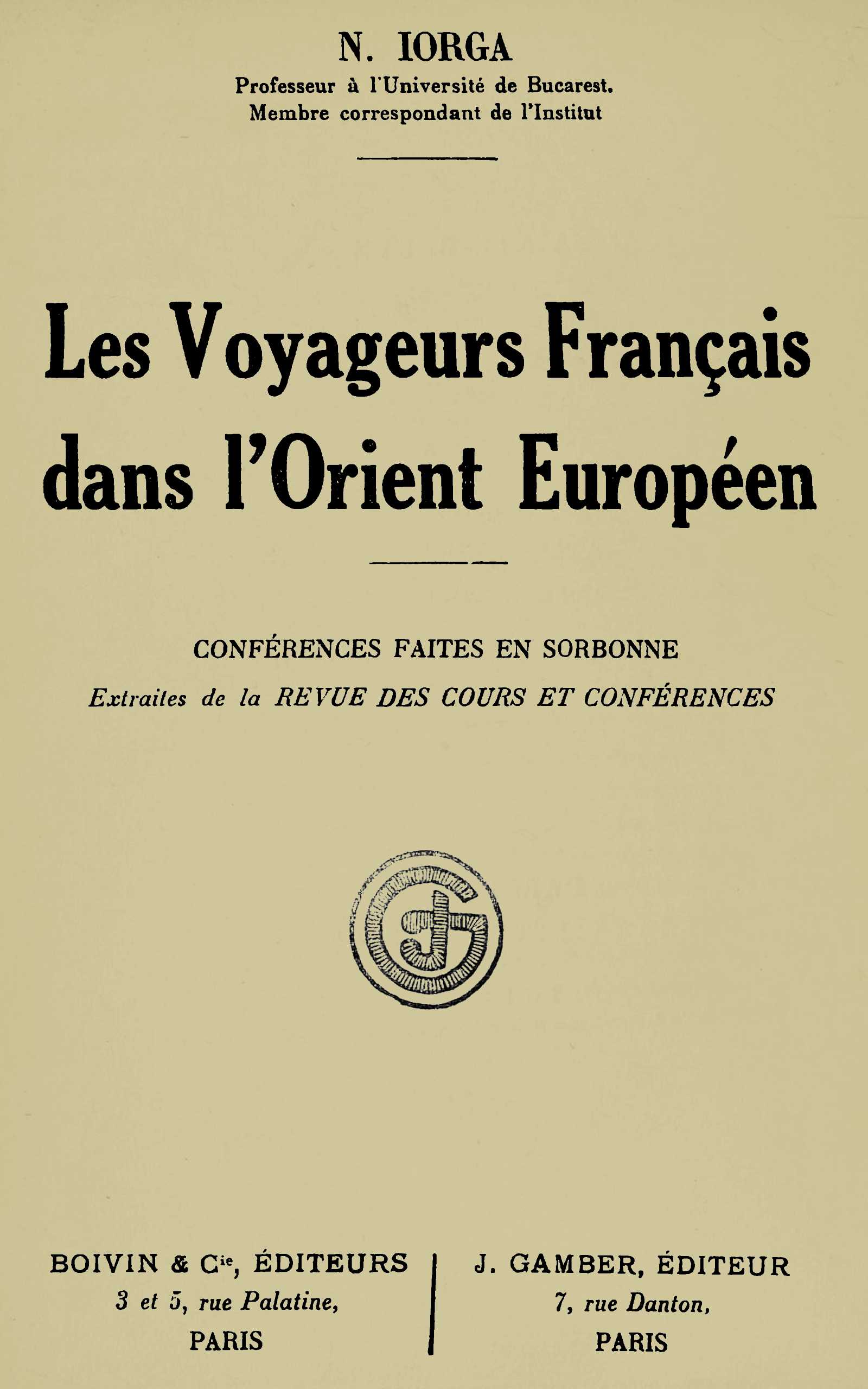
Title: Les voyageurs français dans l'Orient européen
conférences faites en Sorbonne : extraites de la Revue des cours et conférences
Author: Nicolae Iorga
Release date: February 10, 2026 [eBook #77907]
Language: French
Original publication: Paris: J. Gamber, 1928
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Biblioteca Centrală Universitară Carol I in Bucharest)
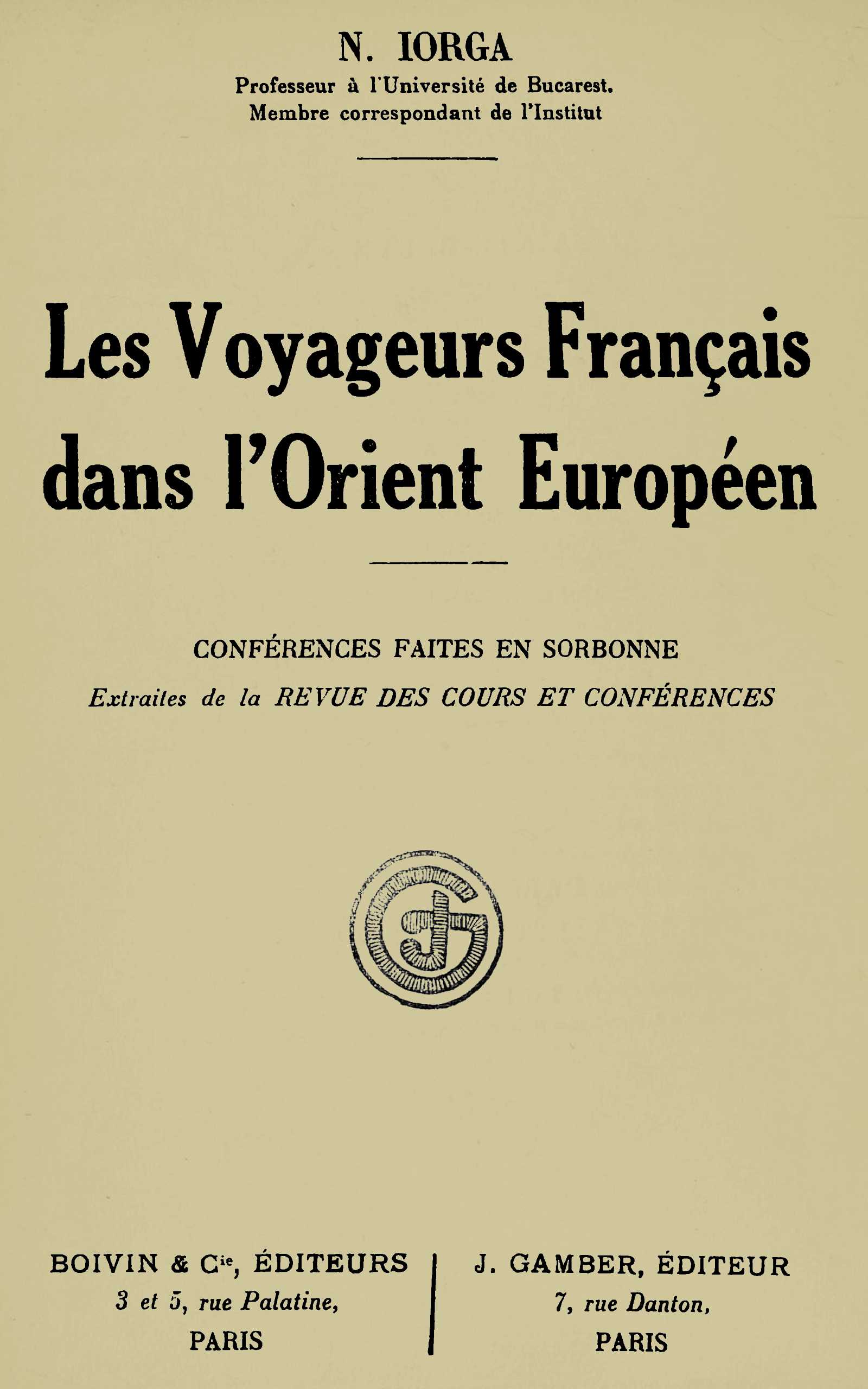
N. IORGA
Professeur à l’Université de Bucarest
Membre correspondant de l’Institut
CONFÉRENCES FAITES EN SORBONNE
Extraites de la REVUE DES COURS ET CONFÉRENCES
BOIVIN & Cie, ÉDITEURS
3 et 5, rue Palatine,
PARIS J. GAMBER, ÉDITEUR
7, rue Danton,
PARIS
PRINCIPAUX OUVRAGES DE N. IORGA
(LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE J. GAMBER)
Pages | ||||
| Chapitre | I. |
— XVe | Siècle | |
— |
II. |
— XVIe | — |
|
— |
III. |
— XVIIe | — |
|
— |
IV. |
— XVIIIe | — |
|
— |
V. |
— XIXe | — |
|
LES VOYAGEURS FRANÇAIS DANS L’ORIENT EUROPÉEN
Les voyageurs français nous apportent mainte précision nouvelle sur ce XVe siècle, où l’Orient change complètement de caractère.
Le XVe siècle, pour l’Orient européen, c’est la conquête ottomane, qui est dépeinte généralement de façon absolument inexacte, inexacte au point de révolter la conscience de l’historien qui descend aux sources. Il est impossible de parler, à ce propos, de hordes à l’assaut d’une civilisation, de bandes barbares s’abattant sur les splendeurs de la Rome d’Orient, de destruction d’États en pleine vitalité par l’ondée sanglante de l’invasion turque. Ce n’est pas moi d’ailleurs qui me ferai l’avocat de ces Turcs de l’époque de Bajazet, de Mohamed Ier et de Mourad Ier : ce seront les voyageurs français qui ont visité les régions d’Orient, à cette époque.
Ceux-ci ne nous donnent pas seulement de nouveaux renseignements sur l’Orient d’Europe, et accessoirement, pour la première époque, sur l’Orient asiatique auquel je toucherai de temps en temps. Ils ont encore un autre avantage.
Un voyageur est très souvent préférable à un chroniqueur, de même que l’auteur d’une lettre privée est préférable au rédacteur d’un document officiel. Non seulement pour la nouveauté du fait, vu sans aucune préoccupation et rendu sans aucun souci d’intérêt particulier, mais parce qu’il nous permet de voir, en même temps que l’objet, ce qui se passe dans l’âme du sujet, du voyageur lui-même. Or, il y a certains phénomènes d’âme dans une société qui ne peuvent être vraiment aperçus qu’en mettant en rapports un représentant de cette société avec un autre monde.
En France, au XVe siècle, il y a eu des changements d’âme. Pour connaître ces changements, il ne faut pas s’arrêter aux documents proprement dits, aux narrations, dans lesquels une forme ancienne se perpétue ; il faut s’adresser à ces sources toujours spontanées, parfois naïves, quelquefois ridicules, que sont les récits de voyages.
Nous remarquons ainsi l’abandon des préoccupations purement religieuses du moyen âge. Il se trouvera des voyageurs pour ne plus penser uniquement aux reliques, pour ne plus se demander seulement, dans telle ou telle ville, quelle est l’église qui conserve le plus grand nombre de corps de saints, qui n’éprouveront pas, non plus, le plus grand plaisir à obtenir, de la part d’un empereur ou d’un prince, un crucifix ou quelque autre souvenir sacré.
Et, en même temps, nous relevons des préoccupations d’humanisme ; je crois qu’il y a quelque intérêt à corriger cette idée courante, que l’humanisme et la Renaissance sont choses d’Italie, du XIVe et du XVe siècle, et que la France, bien tard, ne s’est initiée que par les guerres d’Italie, à ces changements d’attitude morale. Pour penser ainsi, il faut négliger l’immense œuvre de traduction, du latin ou du grec par le latin, accomplie à l’époque de ce roi Charles qui mérite bien de rester, parmi les rois de son nom, qualifié de « Sage ». On verra donc de pauvres pèlerins du commencement du XVe siècle, mettre, à côté des préoccupations religieuses de leur petit livret de voyageurs à Jérusalem, quelques réminiscences de l’antiquité classique.
I. — On peut considérer comme un recueil de notes de voyage (rédigées beaucoup plus tard) ce livre de la description des pays, dont l’auteur, Gilles le Bouvier, dit Berry, auteur aussi d’une chronique de France comprise par Godefroy dans son Histoire de Charles VII[1], avant d’être nommé premier roi d’armes de son souverain (1420), lorsqu’il n’avait que seize ans, partit en pèlerin, dès 1402, afin surtout de « prendre délectation à voir et parcourir le monde, ainsi que sa complexion s’y trouvait beaucoup encline »[2].
[1] Paris, 1661, p. 369 et suiv.
[2] Préface de la chronique. L’ouvrage a été publié par le Dr E.-T. Hamy, Paris, 1908.
En effet, la description, exception faite de paragraphes intercalés, comme celui de l’Italie, suit les traces du jeune voyageur de jadis. Il part, sans doute, de Venise, la première ville marchande du monde chrétien, dit-il, atteint la Crète, où il y a des « Grès… vestus de futaines, de Jaquettes », houssés « pour se défendre de la piqûre des herbes empoisonnées » ; Chypre, où « la plus part des nobles et d’aultres gens de bien parlent françois et aussi le roy, lequel fait grant reconfort aux nobles qui vont au Saint Sépulcre et donne du sien et son ordre, s’ilz le demandent ». Sans dire un mot de Byzance, dont il sait la dynastie régnante parente de celle de Trébizonde, le pèlerin parle de la Syrie « gouvernée par crestiens regniés en jeunesse » et y place ses premières observations sur la façon de vivre des Musulmans : « Ils ont tant de femmes qu’ils veulent, mais qu’ils aient de quoy les norir, et peuvent selon leur loy prendre leurs parentes, seurs ou cousines. Ilz sont misérables gens et vivent pourement, sans avoir grans mesnaiges… Tout ce que’ilz veullent mengier le vont achater tout cuit. Ces genz sont vestus de robe comme sont les diacres en France, quand ils veullent chanter la messe. » Les femmes se voilent : « Elles voient bien les gens, mais les gens ne voient point leur visaige… Hommes et femmes menuisent à terre, sans table. Les hommes ne portent nulles braies, se ilz ne chevauchent, mais les femmes les portent et, quand elles sont en leurs maisons, elles les mectent à la perche et en font parement ». « Y a de riches gens et de poures, comme par deçà », mais, en général, les Syriens sont « faulces gens et maulvais à courrocier et frappent en traïson, car ilz sont couares ». L’auteur paraît avoir poussé jusqu’à Damas, d’où les marchandises venant du « païs de prestre Jehan », conçu ici comme l’Inde, sont achetées pour la Turquie, la Hongrie, la Pologne, et, « toutes les haultes Alemaignes », la riche ville vendant elle-même le « drap de damas et de soie, ainsi que des pierreries ». Ses regards se sont dirigés, c’est l’époque de la bataille d’Angora, vers la terre de Tamerlan, « le Taborlen », « persecuteur de ceulx de la loi mahométane, jasoie que il en soit, comme eulx » ; et voici une occasion pour présenter les guerriers tatars « accroupis sur leurs selles et chevauchant à cours estriers…, vestus longs…, leurs testes entortillées de toilles et à leur arçon ung tabourg de cuivre et une masse en leur main, de quoy ils frapent du manche sur le tabour » ; bons archers, « bien stillez de la guerre, plus que nulz aultres Sarazins ». Ce n’est pas non plus par ouï-dire qu’il connaît l’aspect des autres Tatars, du « Grant Can », de « Candon », « la plus grande ville du monde », « tous camus et les visaiges roulz et très pou barbe…, faulz et mauvaises gens, sans nulle pitié ».
Le voyage a été poussé jusqu’à Tana, d’où les Vénitiens apportent « pennes, pierreries, dens d’olifans, dont on fait les pignes d’iviere », à Caffa, qui vend du vin de « Rommenie et martres, sebelines, vair et gris », et jusqu’au voisinage de la Géorgie, où « est la saincture Notre Dame » ; et de l’Arménie conquise par les Turcs, le dernier roi venant mourir à Paris. Mais le voyageur observe que dans le « païs des Sarasins », il « n’y a pas tant communiqué que en la crestienté ».
Les notions sur le « Grant Turc » prouvent cependant une connaissance de première main. Ses sujets sont « freches gens là où ilz s’adonnent et sont les plus honnestes gens de tous les Sarazins et meilleurs gens de guerre…, les plus fors hommes de toutes les nations ». Le sultan dispose d’une « garde » de 20.000 hommes, et ces guerriers sont présentés « l’arc et les flèches de courue ou de nerfs, et le tabour de cuivre ou de leton, la masse et l’espée, et robe rouge de toille, et de coton, ou de soie…, et la toque de toille blanche sur la teste bien entortillée… et leurs bottes jaunes, rouges ou blanches et bons chevaulx bien courans »[3].
[3] Il n’y a rien d’important dans Le voyage de la sainte cyté de Hiérusalem avec la description des lieux (par G. Villey) cotez et autres passages fait l’an mil quatre cens quatre vingts, destant le siège du Grand Turc à Rhodes et regnant en France Loys onzième de ce nom, éd. Ch. Schéfer, 1882 ; assez peu dans le Voyage de Georges Lengherand mayeur de Mons en Haynaut, à Venise, Rome, Jérusalem, le mont Sinay et le Kayre (1485-1486), publié par le marquis de Godefroy Méniglaise, Mons, 1861. Après une très bonne description de Venise, où il voit les églises et assiste aux cérémonies (il passe à Rome), après des appréciations sur ces riches dames vénitiennes qui n’ont qu’un défaut : « On leur voit depuis le boult de la teste jusques au dessoubz des mamelles », il décrit « Jarre » (Zara) « Gybeny » (Sebenico), « Sarragouse » (Raguse), les îles Ioniennes, mentionne l’Heximilion de Morée, les « Albaniens » confondus avec les Tziganes, les vins de Crète et de Romanie (« Malvisées, Rommenies et aultre vins doulz »), le siège de Rhodes par les Turcs, qu’on tolère encore dans la ville, « chose mal affréant », l’arrivée en Chypre de la mère de la reine Catherine, pour aller en Syrie et en Égypte, où les ambassadeurs du « prêtre Jean » paraissent apportant « arc et flesches d’or ».
II. — Voici maintenant un autre de ces voyageurs, le plus modeste : le seigneur de Caumont, dont le voyage d’outre-mer a été publié à Paris, en 1858, par le marquis de la Grange[4]. Ce seigneur de Caumont porte le nom imposant de Nompar : Nompar II, dans la série des seigneurs de Caumont. Presque contemporain de Philippe de Mézières, le créateur de la Chevalerie de Jésus-Christ, le grand animateur des croisades du XIVe siècle, il a créé aussi un ordre de chevalerie : celui de l’Écharpe, — ayant été fait lui-même chevalier à Jérusalem par un autre chevalier, qu’il avait eu la précaution d’amener avec lui, pour ne pas être pris au dépourvu. Cet ordre de l’Écharpe n’a jamais eu, du reste, de membres, ce qui pouvait arriver à une époque où l’on était moins avide de ces distinctions qu’à la nôtre. Le seigneur de Caumont a lu des ouvrages classiques et, lorsqu’il arrive en Grèce, il parle de Minos, de Minotaure et du nommé « Théseu » (qui est Thésée lui-même). Mais il ne nous apprend rien sur la Grèce de l’empereur Manuel, sur l’empire byzantin de cette époque, régenté par celui que les Occidentaux appelaient « Carmanoli » ou « Kirmanoli », accolant à Manuel le préfixe kyr ou « seigneur ». En fait de Grèce, il ne parle que de monastères de « gallogères » grecs, c’est-à-dire de moines grecs. Il est bien sûr que Ramah, en Palestine, a donné naissance à saint Georges et à saint Martial, dont il a pu voir les reliques à Limoges, et il n’oublie pas de donner la détermination exacte de la province où se trouve Limoges, ce qui était peut-être superflu pour ses lecteurs français. Il est furieux contre les Sarrasins, parce qu’ils ne montrent pas de componction, lorsqu’ils sont présents au moment où est célébrée la messe, et il les traite de « faux chiens » qui n’ont de respect que pour « Baffomet », qui est Mohammed. Il n’a que des idées très vagues sur les Arabes, qu’il appelle Alarabes, « qui ne portent vestir que les chemizes longes jusque à terre. » Quant à la nation turque, il en donne cette définition nuageuse : « Une généracion de gens qui s’appellent Turcz, lesquelz sont contre la foy et la loy de Dieu Nostre Seigneur », ce qui est une réminiscence des croisades[5]. Il s’intéresse un peu aux choses de l’Orient ; autrement, il n’aurait pas appris que les Turcs sont régis par « un empereur ho roy de Turquie » qui s’appelle Creissi. Creissi, c’est Kirichdschi, c’est-à-dire gentilhomme, messire. Tous les sultans turcs s’appellent des kirichdschi, comme tous les empereurs byzantins s’appellent des kyrs, des seigneurs, et il arrive que tel de ces sultans porte, en même temps, le titre de Kirichdschi et celui de tschélébi, c’est-à-dire celui de gentilhomme et celui de chevalier.
[4] Voyaige d’Oultremer par le seigneur de Caumont l’an MCCCCXVIII, publié par le marquis de la Grange, Paris, 1858.
[5] P. 44.
III. — Les observations naïves de Caumont sur le Creissi et la génération turque sont très loin de la manière dont voit l’Orient un autre écrivain qui n’a pas voyagé lui-même, mais qui résume plusieurs voyageurs. Il les résume avec cette bonne foi, avec cette candeur d’âme qui distingue l’époque, avec cette admirable mémoire qui rend capables les hommes du moyen âge de se rappeler exactement toutes les circonstances dans lesquelles ils ont vécu, combattu et souffert bien des années auparavant, ce qui est impossible dans notre vie enfiévrée, tandis que leur vie calme, si peu ornée d’événements, si peu traversée de passions, pouvait être revécue par le souvenir après de longues années.
Nous voulons parler d’une œuvre qui, par ses qualités de style, mériterait d’être rééditée, pour un assez large public, le « Livre des faits du bon messire Jean Le Maingre, dit Bouciquaut ».
L’ouvrage, qui a été publié aussi dans le « Panthéon Littéraire » de Buchon, suscite, au premier contact, certains scrupules d’authenticité, qui ne sont nullement justifiés. Mais c’est un si beau livre, qui se distingue tellement de tout ce que nous trouvons à la même époque, que cela pourrait laisser supposer un remaniement. Il n’en est rien ; le livre a été écrit à l’époque par quelqu’un qui a aimé Boucicaut et qui a voulu lui consacrer une biographie. Je croirais volontiers que cette biographie est inspirée par une coutume qui n’existait pas autant alors en France qu’en Italie. Boucicaut a été gouverneur de Gênes et ses plus grandes batailles ont été livrées pour la République génoise. Or l’Italie dressait des statues à ses grands hommes dès la fin du moyen âge ; elle considérait plus volontiers d’une façon biographique ceux qui collaboraient au développement de son histoire.
L’auteur dont l’érudition fait voisiner des réminiscences de l’antiquité classique avec Tristan et Lancelot, commence par dire que son livre s’appuiera sur deux « piliers sans faille ». Ces deux « piliers sans faille » sont : chevalerie et science. Et il ajoute que ces deux éléments, qui domineront son livre, « moult bien conviennent ensemble ». Car de la science vient la loi, et, s’il n’y a pas de loi, alors l’existence serait bestiale. Il faut donc penser aux « assemblées chevalereuses », aux « joutes grandes et plainières », à la « vaillantise » et alors on arrivera à ressembler à Hercule, à Hector, à Achille et à Alexandre le Grand. Admirateur des lettres, l’anonyme dit à chaque moment que c’est par les livres qu’on vit, « afin que le bienfaict des vaillans ne soit mie amorty, que ils soyent mis en perpétuelle souvenance au monde, c’est à savoir au registre de livres ». En effet, « le rapport des tesmoings des livres » donne la « mémoire authentique » et le « nom authorisé ».
Parlant avec admiration des « lettres et escriptures, lesquelles sont le premier membre de science », l’« introduction de lettres et de livres » lui semble un devoir à l’égard des bienfaiteurs de son époque. Pensant à celui qui, le premier, a inauguré la tradition des lettres, de la remembrance des événements par les lettres, il dit : « Moult devons louer science et ceulx qui les sciences nous donnèrent. »
Ce sont des idées qui n’appartiennent pas, certes, au XIVe siècle. C’est déjà un homme de la Renaissance qui s’exprime dans le plus délicieux langage du temps passé.
Cet homme présentera la vie de Boucicaut d’après les relations des « plus notables en vaillance et chevaliers qui fussent ». Et il ajoute que, si ces chevaliers n’ont pas voulu donner leur nom, c’est pour empêcher qu’ils ne soient considérés par les envieux comme capables de flatterie. A chaque moment, il dit qu’il n’y a rien ajouté de lui-même, « sans rien du sien, en parlant de luy, adjouter » et que les rapports de contemporains de Boucicaut ont été non seulement employés, mais reproduits. Comme ces contemporains ont pris part à l’expédition de Boucicaut en Turquie, tous les païens sont, pour l’auteur, des Sarrasins. Dans ce royaume de Lithuanie, dans le royaume de « Hecto », il y a des Sarrasins. Mais il parle surtout des chevaliers qui ont accompagné le même Boucicaut dans la chevauchée du comte d’Eu en Hongrie, des guerriers qui ont pris part à la grande tragédie de Nicopolis, pour laquelle ce « Livre des Faits » est la principale et la plus délicieuse des sources, des collaborateurs de Boucicaut pour la défense de Constantinople contre les Turcs, à la fin du XIVe siècle et au commencement du XVe, de ceux qui ont renouvelé avec lui l’épopée inoubliable ; et tous les voyageurs se la rappellent alors, l’épopée du roi Pierre de Chypre conquérant, dans cette moitié du XIVe siècle, Alexandrie et Tripolis. Car on n’a pas assez observé que le dernier chapitre des voyages armés de Boucicaut ne fait que reproduire cette légende épique du vaillant roi de Chypre que l’Occident français connaissait par le dévouement que lui a porté, jusqu’au bout et même après la mort du héros, Philippe de Mézières, chancelier de Chypre.
Suivons d’une entreprise à l’autre, — car ces entreprises sont nombreuses et la description en est copieuse, — suivons, par saillies, les impressions que le bon serviteur de Boucicaut rassemble, arrange et reproduit de façon authentique dans sa biographie.
D’abord, la vision, la courte vision de la société ottomane à l’époque du sultan Mourad, que les Français, à l’époque de Philippe de Mézières, nommaient l’Amorat-baquin (Mourad-beg).
Pour Venise, l’Amorat-baquin était un ami, un allié, que le doge et le sénat employaient pour combattre les Byzantins, ennemis perpétuels des intérêts vénitiens dans la péninsule de Morée et dans les régions voisines. Voyons de quelle façon le « beg » se présente dans les récits de nos chevaliers. « Amurat, père du Basat », dit l’anonyme, « qui estoit adonc en Grèce près de Galipoli », est un homme charmant. Ce n’est plus le barbare cruel, l’infidèle toujours disposé à offenser les sentiments religieux des chrétiens, ce n’est plus la bête féroce que les propagateurs de croisades décrivent. Lorsque les voyageurs français se présentent devant lui, il les accueille avec « grand feste » et leur fait « très bonne chère ». Ces mêmes chevaliers traitent avec Mourad de la possibilité d’une expédition commune contre les Sarrasins ; à ce moment-là, les Turcs ne sont pas, pour les informateurs du biographe, une canaille ou, pour employer son terme, une « chienaille ». Plus tard, toute cette turquerie sera une « chienaille » : il répète le mot plusieurs fois, mais, pour le moment, ce sont des chevaliers d’un autre drapeau, d’un autre État, d’un autre Dieu, mais de vrais chevaliers, des preux, avec lesquels on peut traiter et à côté desquels on peut combattre. Car voici ce qu’il dit : « Et ils luy présentèrent leur service en cas qu’il feroit guerre à aucuns Sarasins. Si les en remercia moult Amurat, et demeurèrent avec luy environ trois mois. Mais, pour ce qu’il n’avoit pour lors, guerre à nul Sarrasins, ils prirent congié et s’en partirent, et il les fit convoyer secretement par ses gens, par le pays de Grèce et par le royaume de Bulgarie et tant qu’ils furent hors de sa terre. »
Cette terre de Mourad même n’est pas une terre sauvage ; bien au contraire. Il y a de « bons villages », de « beaux maisons », et de « riches palais », des « murs qui à merveilles sont forts et beaux ». Ci et là, quelque « grand village champêtre ». En Asie même, on trouve de « moult beaux palais, grandes maisons et beaux jardinaiges ». Ceux qui paraissent à l’arrivée des croisés sont ornés de « beaux parements ».
C’est une société civilisée et anciennement civilisée, ce monde ottoman qui s’abreuve à deux sources de très archaïque et très solide culture : celle de Byzance et celle de l’Extrême-Orient.
Arrivant maintenant au conflit dû à l’idée de la reconquête chrétienne, lorsqu’il présente la bataille de Nicopolis, le biographe conteste les assertions de certains témoins qui prétendent que, du côté des chrétiens, il n’y a eu que des rencontres isolées, sans ordonnance, « comme bestes…, puis dix, puis deux, puis vingt, et que par ce furent occis par troupeaux au feur que ilz venoient, que ce n’est mie vray. » Il présente l’action de l’armée croisée, dans laquelle les Français dominaient, comme celle d’une armée ordonnée. Mais aussi, de l’autre côté, il voit une sorte de tradition romaine, avec ces janissaires qui sont des légions, avec ces spahis qui correspondent aux « ailes » des armées romaines, avec le profond dévouement qu’on portait au sultan, avec cette tactique héritée des meilleurs maîtres de la guerre.
On voit donc l’armée des chevaliers qui se trouve non pas devant une mêlée barbare, ne connaissant ni ordre, ni chemin, ni but, mais se brise devant l’armée la mieux ordonnée de l’époque. Ainsi l’auteur constate que l’armée hongroise du roi Sigismond s’est empressée de s’enfuir au moment décisif de la bataille, que les chevaliers français ont été sacrifiés, pour ne pas avoir eu, au moment requis, l’appui de ces connaisseurs des localités et des coutumes militaires turques qu’étaient les guerriers hongrois. « Les Hongres, communément, si comme on dit, ne sont pas gens arrestés en batailles et ne savent grever leurs ennemis, si n’est à cheval tiraire de l’arc devant et derrière, toujour en fuyant. » Sauf le « grand comte de Hongrie » qui est Nicolas de Gara, c’est, en somme, l’action d’une armée de « lasches et faillis ». Et, devant le sacrifice total de l’armée française abandonnée, on s’écrie : « Ha ! noble contrée de François ! Ce n’est mie de maintenant que les vaillans champions se monstrent hardis et fiers entre toutes les nations du monde. » Et devant chaque chevalier qui fait son devoir, au moment où la bataille est notoirement perdue : « Ha Dieu ! Quel chevalier ! Dieu lui sauve sa vertu ! »
IV. — Passons du biographe de Boucicaut à une autre source longtemps ignorée des chercheurs : les « Anciennes chroniques » de Jean de Wavrin, en dialecte picard.
Ce Jean de Wavrin avait un neveu, Valerand, qui a participé à la croisade danubienne de 1445, et tout un livre de ses Anciennes chroniques d’Angleterre[6] est consacré à cette expédition, qui est un des épisodes les plus inattendus de l’histoire européenne du XVe siècle. Au moment où l’esprit même des guerres pour la croix paraissait faiblir, grande catastrophe à Varna en 1444 : le jeune roi de Hongrie et de Pologne, dans un combat contre le sultan Mourad, succombe au moment où la victoire était déjà décidée en sa faveur ; le cardinal Saint-Ange se noie dans le Danube… Le pape et le duc de Bourgogne, qui était, à ce moment, le porte-étendard de la croisade, le représentant des aspirations chrétiennes d’Occident pour la délivrance des Lieux saints, dont le prélude devait être l’expulsion des Turcs d’Europe, le pape et le duc de Bourgogne donc organisent une croisade, arment une flotte qui, par les Détroits, entre dans la mer Majeure (la mer Noire). Une partie de ces vaisseaux va jusqu’à Caffa en Crimée ; l’autre visite les ports roumains de Lycostomo (le « Licocosme » du chroniqueur) ou Kilia, de Braïla (qui est Brilago, pour Wavrin) et de la « cité blanche » de l’embouchure de Dniester, qui est Moncastro. Ensuite, en attendant l’apparition de Jean de Hunyadi, le chef, Roumain de race, de la résistance chrétienne par la Hongrie et par les principautés roumaines contre l’envahissement turc, cette flotte pénètre jusqu’à Nicopolis, où, si les Turcs ne s’étaient pas retirés, il y aurait eu grande bataille, vengeant la défaite de Varna.
[6] Anchiennes cronicques d’Engleterre par Jean de Wavrin, éd. de Mlle Dupont, dans la collection de la Société de l’Histoire de France, et de M. Hardy, dans celle du Master of Rolls.
Tout ceci est exposé avec des détails que j’ai été en mesure de vérifier sur les lieux, avec des renseignements tout à fait nouveaux sur la Valachie de cette époque. On voit les Roumains valaques venant en grand nombre, 25.000, avec leurs deux bombardes, pour ajouter à l’action des croisés l’indispensable connaissance des lieux ; on les voit participer à l’attaque de ce « Trieste » danubien, qui est, en latin, Silistrie, Durostorum pour les Romains, Dârstor, Drstr pour les Bulgares. On les voit devant « Tourturcain » ou « Chasteau Turquans » (Turtucaia), devant « la Géorgie », la ville roumaine de Giurgiu, devant « Rossico », qui est Roustschouk, et devant Nicopolis, où le souvenir de 1396, gardé avec fidélité, est communiqué avec émotion par un vieux témoin roumain.
Des détails militaires tout nouveaux se trouvent dans cette chronique de belle allure, qui donne des visions inoubliables de ces rencontres sur le Danube, rencontres sanglantes entre les croisés de Bourgogne et les Turcs du sultan Mourad.
Au cours de cette longue narration, jamais un mot de blâme à l’égard de l’ennemi ; il n’y a même pas la « chienaille » du biographe de Boucicaut. Les ennemis se respectent. Le monde ottoman qui surgit devant les croisés est déjà une société splendide. On voit un prétendant turc, engagé pour soutenir l’effort des croisés, Saoudschi, paraître orné de pourpre « atout ung gros pommeau doré et par dessus VI lambeaux tous vermaux, ventelans au vent », et, dans la ville qu’on assiège, les Turcs légitimistes, ceux qui défendent le trône de Mourad, arborant cette même pourpre impériale. Cette Turquie du XVe siècle n’est décidément qu’une nouvelle forme, une forme musulmane de l’empire byzantin.
Enfin c’est par ce Français qu’on a la première vraie vision des Roumains de la fin du moyen âge : curieux, bruyants, « gens de grant languaige », ayant tous, depuis leur chef, « Velacquede » (Vlad) Voévode et son fils, le « fils de la Valaquie », jusqu’au dernier des paysans, un sincère désir de prêter aide chrétienne aux vengeurs de la croix venus de si loin et parlant tous français et italien, — et les Roumains s’étonnent de ces langues sensiblement apparentées à la leur.
V. — Guilebert de Lannoy[7], Bourguignon, appartient à une autre catégorie de voyageurs. Si Caumont n’est qu’un pèlerin ; si, pour le biographe de Boucicaut, il ne s’agit que d’introduire un chapitre oriental dans la biographie complète de son héros ; si, pour Wavrin, il y a la souvenance de rares séjours passés sur le Danube lointain, d’une vision turque inattendue, messire Guilebert est une sorte d’ambassadeur. S’il a fait aussi la croisade de Prusse, s’il a désiré voir Jérusalem, l’Espagne de Saint-Jacques de Compostelle, si l’on a pu parler de ses quarante-six ans de croisades et de combats, il est, surtout, un missionnaire politique. La Turquie de 1420, qu’il décrit, offre des avantages à ses alliés. Ainsi le duc de Milan, combattant les Vénitiens, a intérêt à ce que le sultan attaque Venise ; cette Turquie, qui peut être employée en vue de buts intéressant les relations internationales de cette époque, commence donc à attirer des ambassadeurs. Voyons maintenant comment cet ambassadeur présente la société turque, qu’il a pratiquée un peu, ainsi que certains pays du voisinage.
[7] Œuvres publiées par Poitvin, Bruxelles.
Guilebert de Lannoy a commencé — nous l’avons dit — par la croisade de Prusse ; puis il s’est dirigé vers la Russie : c’est pourquoi sa description de voyage a été éditée et traduite en polonais, avec des annotations, d’une rare érudition, par le grand historien de la Pologne, Lelevel. Il a connu Novgorod, « la grand Noegarde » aux trois cent cinquante églises. Il parle des boïars et des femmes que, dans ce pays-là, l’on achète en place publique. Il se plaint du grand froid qui y règne et dont il fait des tableaux pittoresques : « les froidures qu’il y faisoit, car il me failly partir pour le froit…; on y oyoit crocquier les arbres et fendre du hault en bas, de froit. Et y vëoit-on les crottes de la fiente des chevaulz estoient sur la terre engellées saillir contre mont de froit. » On s’y réveillait, « sa barbe et ses sourcieux et paupières engellées de l’alaine de l’homme, et plaines de glachons ».
Ensuite, comme il veut se diriger vers Constantinople, étant chargé d’un cadeau précieux du roi d’Angleterre, que, du reste, il a dû rapporter à celui-ci, n’ayant pu le donner au sultan Mohammed qui mourait à ce moment, le roi de Pologne l’avertit que les changements de Turquie sont dangereux pour les voyageurs, qu’il y a une guerre civile entre Mourad et son parent Moustapha, et qu’il faut prendre une autre route[8].
[8] « Ung prince turcq nommé Moustaffa, et l’avoit fait (l’empereur Manuel) par son sens et puissance empereur de la Turquie, vers la Grèce après la mort de Gurici Chalaby, son frère, par devant empereur de la Turquie. »
Celui qui connaissait bien les Tatars, les « Tartres, vrais Sarasins », qui « ont ung langaige à part, nommé le tartre » et emploient des « cousteaux tatarisques », à vendre en « grants florins de Tartre », des « flesches et tarquois de Tartarie », s’en va donc vers la Moldavie ou « Wallackie la petite ».
Il passe par la ville de Lemberg, le Lwow des Polonais, où il est très bien accueilli par les Arméniens : « les Hermins… me donnèrent ung drap de soie et me firent danser et faire bonne chière avecq les dames ».
Il visite le prince Alexandre, qui prend lui-même le titre de Moldovalachie, dans sa capitale de Suceava, est arrêté par des brigands dans la Bessarabie méridionale.
Ensuite, le voici arrivé à Caffa, ville de trois « fermentez », où on lui offre, « confiture, torses (torches), chandelles de cire, un tonnelet de malvoisie ». Il s’informe sur les deux empereurs tatars : l’empereur de Slhat, c’est-à-dire de Sorgat, et le « grant Kan, empereur de Louroou » : Louroou, c’est la horde, la grande horde tatare.
A Caffa, le voyageur trouve les vaisseaux vénitiens de Tana, qui le mènent à Péra, la colonie génoise de Constantinople.
L’empereur Manuel et son fils accueillent gracieusement celui qui vient avec la nouvelle de la paix d’Occident et avec des cadeaux, manifestant « le désir qu’ilz avoient de avanchier l’union d’entre les Esglises rommaine et grégeoise ». Il y aura des chasses, des banquets à la campagne. Guilebert verra des reliques, des « merveilles et anciennetez » ; il recevra trente-deux aunes de velours blanc. Il désirerait voir le combat entre les deux sultans turcs, mais l’empereur l’en empêche et, après sa visite à Jérusalem et en Égypte, il s’en retourne avec l’horloge d’or qu’il devait donner au sultan Mohammed et qu’il ne pouvait faire descendre en son tombeau.
VI. — Maintenant, voici Bertrandon de la Broquière, le plus remarquable, sans doute, de tous ces voyageurs[9]. Cet autre Bourguignon est un homme d’esprit simple. Parti de Gand en février 1432, lorsqu’il arrive à Rome, il n’a aucune émotion devant la première Renaissance. Il parle des belles choses qui se trouvent dans cette « ville telle que chascun scet », d’après les « vrayes escriptures », et s’étonne des « statues d’hommes et de chevaux ». « Est une merveilleuse chose à veoir et à penser comment elles avaient été faictes et dreciées. »
[9] Le voyage d’Outremer de Bertrandon de la Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, publié et annoté par Ch. Schefer, Paris, 1892.
C’est tout ce qu’il voit en Italie ; et il passe en Orient, par mer, sans rien connaître de ce monde nouveau.
Il y arrivera bien convaincu que, parmi les Musulmans, il y en a, les plus prudents, qui se font baptiser pour faire disparaître une certaine odeur qui sert à les faire reconnaître : « Tous les plus grands se font là baptiser afin qu’ils ne puent point. » Et, en fait de mahométisme, il s’informe là-bas. Il demande à un Turc qui était ce Mahomet et où est son corps — on voit bien le chrétien amateur de reliques — et on lui donne une information qu’il s’empresse de consigner : « Ce corps gît en une chapelle toute ronde et y a grand pertuis dessus. Et ceux qui voient le corps de Mahomet ne peuvent plus voir autre chose. Alors ilz se font crever les yeulx. » Il assure même qu’il a vu ces pèlerins musulmans qui revenaient aveugles après avoir fait le sacrifice de leur vue au tombeau de Mahomet.
Il ne connaît aucune langue orientale et il déclare que son ignorance est égale en fait « d’arabique, de turc, d’hébreu vulgaire et de grec ». Mais, cependant, il arrive à apprendre le turc et il trouve que c’est une langue facile à apprendre et très agréable : « très beau langaige et brief et assés aysié pour apprendre ». Il doit la connaissance de cette langue à des camarades de voyage d’une extraordinaire amabilité, qui ne se lassaient pas de lui répéter le mot jusqu’à ce qu’il le retînt.
Il venait aussi en pèlerin et il a donc souffert tout ce que pouvaient souffrir les pèlerins à cette époque, y compris le droit de représailles qui régnait partout, et surtout en Orient. Des vaisseaux musulmans avaient été arrêtés dans le pays du Soudan, c’est-à-dire du dominateur de Syrie et d’Égypte. A Damas, où il y avait des Français (Jacques Cœur, le futur argentier de Charles VII, qui lui parle du vaisseau de Narbonne, qui allait à Alexandrie et faisait escale ensuite à Beyrouth), il a été arrêté pour que les marchands musulmans soient dédommagés des pertes que leur avait causées la piraterie du prince de Tarente. Très malade là-bas, il est soumis à un traitement médical oriental, au massage, à cette époque où l’Occident n’en connaissait pas le secret : « me pestrirent et me pincherent », dit la victime, reconnaissante. A la fin, comme les suites de cette rencontre entre les pirates italiens et les navigateurs musulmans lui ont prouvé ce que peut subir un coreligionnaire des pirates, il s’est décidé à prendre la voie de terre, avec « les camelz » ou plutôt, étant donné que ces animaux « ont trop grant branle », avec des ânes. Il a la bonne fortune de trouver la caravane turque de la Mecque qui revenait, les chameaux ornés de drap d’or, avec une dame turque, parente de Sultan ; il s’entend avec ces camarades d’une autre nation, d’une nation dont il ne parlait pas le langage, qui s’obligent à le faire aller jusqu’à Brousse, l’ancienne capitale des Turcs ottomans. Il n’aura qu’à se louer de ses associés.
D’abord, il faut cependant qu’il se revêtisse à la façon turque, c’est-à-dire qu’il prenne un chapeau turc, des habits blancs, un képéneg, c’est-à-dire un manteau, des bottes rouges qui lui vont au-dessus du genou, une selle turque ; il emporte en plus tout ce qui est nécessaire pour se nourrir en route, c’est-à-dire cette serviette de cuir, la sofra, qu’il décrit minutieusement et dont il apprécie l’utilité parce que, après avoir mangé, on la serre, on en fait une bourse, et alors rien de ce qui reste n’est dispersé. Et, muni d’armes turques, dans la compagnie d’un ami qu’il n’oubliera jamais, il fait l’énorme voyage de Damas à Brousse, un des plus remarquables qu’eût fait un Occidental. Il lui arrive parfois d’être reconnu, mais il y a toujours une bonne chance qui lui fait éviter tout danger.
Les impressions qu’il a recueillies au cours de cet extraordinaire voyage, surtout en ce qui concerne la valeur des nations qu’il a connues, me paraissent extrêmement remarquables.
D’abord, il reconnaît que le pays habité par ces nations a des avantages que l’Occident ne connaît pas encore : ces caravansérails, où n’importe qui est reçu ; un seul gardien les défend, et personne ne touche à ce que ces hôtels gratuits contiennent[10] ; cette habitude de distribuer toujours aux pauvres une partie de ce qu’on mange, et il ajoute : « ce que nous ne ferions point » ; ces grandes routes bien entretenues, ces juges, ces cadis qui s’empressent, après avoir reconnu un étranger, de le faire passer par-dessus toutes les complications de la jurisprudence musulmane. Ce sont des choses qui rappellent, dans l’histoire des croisades, les ménagements de Saladin à l’égard des chrétiens, ménagements qui n’étaient pas payés de retour, et surtout cette délicieuse scène du siège d’Acre, où, parce que le roi de Jérusalem venait de se marier, le chef des Musulmans donna l’ordre de ne pas tirer du côté de la chambre des amours.
[10] « Il n’y avait que ung varleton qui le gardoit… Il n’y eust oncques si hardy d’en prendre une poignié sans payer. »
« Ilz sont moult charitables gens les ungs aux aultres et gens de bonne foi. » Ils sont « liés et joyeulx et chantent volontiers chanson de geste. Et qui veult vivre avec eulx, il ne fault point estre pensif ni mélancolieux, ains fault faire bonne chière. Ilz sont gens de grant paine et de petite vie. » Il se rappelle « ce bon compagnon qui faisoit pour moy ainsy que pour luy et pour mon cheval ainsy que pour le sien… Je escrips cecy afin que il me souviengne que ung homme hors de nostre foy, pour l’onneur de Dieu, m’a faict tant de biens. »
Comme armée, la manière de marcher et de se comporter des Turcs est tellement discrète que « cent hommes d’armes des chrestiens feront plus de bruyt que ne feront Xm Turcz… D’une poignée de farine, ilz font une brouée pour vivre eulx VI ou eulx VIII pour ung jour ». « Et n’en sont point les Turcz, à mon entendement, tant à craindre ne à redouter que j’ay autreffois ouy dire et que j’eusse cuidié, combien que je ne les vueil pas blasmer, car je les ay trouvé franches gens et loyaux. » Parmi les soldats, « qui a espée, il n’a point d’arc et plusieurs y en a qui n’ont que ung baston… » « De dix l’ung n’avoit arc et espée ensemble… Et me semble que c’est grant pitié que la crestienté soit soubzmise par telles gens et est moins de chose beaucoup que l’on ne cuide d’eulx et de leur fait. »
Maintenant, si l’on veut savoir son opinion concernant d’autres nations, voici pour les Grecs dont, du reste, il estime l’empereur et admire, en bon chevalier, l’impératrice, qui lui apparaît à cheval, trois plumes d’or au chapeau, « jeune et blanche », mais « le visaige paint » outre mesure : « Autant que j’ay hanté les ditz Grecz et que m’a peu touchier et que j’ay eu affaire entre eulx, j’ai plus trouvé d’amitié aux Turcz et m’y fieroye plus que aux ditz Grecz. » Ceci bien que les courtisans s’informent sur la prise de Jeanne d’Arc, qui leur paraît « chose impossible ». Pour les Hongrois aussi : « Autant que je les ay hantés je me fieroys plus en la promesse d’ung Turc que je ne ferois d’un Hongre. »
Mais ce despote serbe, Georges Brancovitsch, qu’il voit en chemin, est, malgré son âge d’environ soixante ans, « très beau prince et grand personne » et il admire les siens, « moult belles gens et grans, et portent longz cheveulx et grand barbe ».
Avec ces deux voyageurs, l’Occident est arrivé à connaître les régions orientales dominées par la conquête turque. A chaque pas, les pèlerins trouvent, du reste, les leurs. A Damas, comme en Palestine, à Constantinople, il y a sans cesse des Occidentaux ; toute cette société est envahie et pénétrée d’occidentalisme.
De fait, la conquête turque n’a pas écarté tant Byzance que ce monde latin de l’Occident qui avait pénétré Byzance par toutes les pores. Et cet esprit occidental était italien ou français.
A Brousse, il y a un Florentin ; Pierre de Naples habite Péra, marié à une femme d’Abyssinie ; un envoyé du duc de Berry s’en va avec un autre Français et un Espagnol chez le prêtre Jean, roi d’Abyssinie ; Andrinople loge des Vénitiens, des Génois, des Florentins, des Catalans ; des Juifs d’Orient parlent le français et, sur le Danube, des Français bâtissent les défenses de la Hongrie contre les Turcs. Bertrandon en arrive à soupçonner que le vaillant Khan Barkok lui-même était « du royaulme de France ».
Les Turcs ne sont donc pas si méchants qu’on se l’imagine. Cette vie politique qui s’est fondée sur les bords du Bosphore n’est donc pas un accident destiné à disparaître bientôt. Là-bas s’est formée une force politique durable et d’autres voyageurs vont maintenant chercher à se rendre compte de l’utilité que cette forme musulmane de la Rome orientale pourra avoir pour la vie diplomatique et militaire de l’Europe occidentale au XVIe siècle.
Le XVIe siècle constitue, dans l’évolution historique de l’Orient soumis aux Ottomans, une phase nouvelle : celle de l’impérialisme. La civilisation byzantine, s’affranchissant de l’orthodoxie, a su prendre à la religion musulmane ce qu’il fallait pour que, dans Constantinople, dure encore Byzance.
Avant d’arriver à nos voyageurs, je crois qu’il est nécessaire de dire quelques mots de la transformation totale et profonde qu’a subie le monde ottoman au commencement du XVIe siècle, et surtout depuis l’avènement du sultan Soliman.
Soliman a été plus grand, dans un certain sens, que son contemporain, Charles-Quint ; son action a été plus révolutionnaire, le monde ottoman en est sorti beaucoup plus transformé que ne l’a été le monde de l’Europe centrale sous l’impulsion parfois capricieuse, et le plus souvent chimérique, du grand empereur romain germanique.
Dès le premier contact, du reste, les deux sociétés se sont mêlées, musulmane et chrétienne. Alors que les Turcs n’étaient pas même encore à Andrinople, que la conquête de Constantinople ne pouvait être prévue et prédite par personne, — car la conquête de Constantinople a été un acte personnel de Mohammed II, et qui n’était pas nécessairement liée au développement logique de l’État ottoman[11], — deux des membres de la famille d’Osman ont épousé des princesses byzantines ; comme, du reste, au XVe siècle, une princesse de Trébizonde avait épousé le chef touranien de la Perse, Ouzoun Hassan (Hassan le Long) et avait vécu, chrétienne, auprès de son mari musulman ; ainsi les princesses byzantines, l’une Cantacuzène et l’autre Paléologue, ont-elles continué à appartenir à leur religion.
[11] La première forme d’occupation des Turcs s’est assouplie à l’aspect féodal du monde qu’ils ont trouvé dans les Balkans. Mourad II, le père du conquérant de Constantinople, était si peu empereur qu’il avait abdiqué avant l’attaque chrétienne de 1444, qui seule fut capable de le ramener au pouvoir. Il désirait passer en derviche le reste de ses jours.
Mais, cependant, ce n’est pas par un mariage, puisqu’il n’y avait plus ni la dynastie byzantine, ni celle de Trébizonde, que Soliman entend réaliser l’Empire, un Empire qui était pour lui ce qu’était, pour les Occidentaux, cet Imperium orbis qu’ambitionnaient tant de dominateurs au moyen âge et de souverains modernes. Il a copié, je dirai même qu’il a plagié Byzance, et il s’est inspiré de toute une tradition étrangère à sa race. Ainsi c’est avec ce monde transformé, et non pas avec le monde de l’invasion, continuellement poussé en avant, c’est avec l’Empire établi, capable de vivre sous cette forme byzantine, forme romaine, que les voyageurs dont nous parlerons maintenant ont été en rapport et, disons-le dès le commencement, ont entretenu des rapports d’une intimité, d’une sincérité, d’une franchise, d’une intelligence mutuelle remarquables.
C’est pourquoi leurs récits sont supérieurs même aux relations, prônées à juste titre, mais qui ne correspondent pas toujours à leur réputation, rédigées par les baillis de Venise[12].
[12] Les Relazioni al senato veneto ont été publiées par Albèri pour le XVIe siècle, par Barozzi et Berchet pour le XVIIe. Nous nous en sommes servis, à l’exclusion des sources françaises, cependant supérieures, comme nous nous en apercevons maintenant, dans notre Geschichte des osmanischen Reiches.
Les baillis écrivent en effet pour un gouvernement, dont ils sont les fonctionnaires, les agents diplomatiques. Ils ne connaissent pas la société turque, et pourtant il y a une différence essentielle entre cette société turque et la société ottomane, ou, plutôt, entre la masse populaire de la société ottomane qui ne s’est pas affranchie de son passé, et ce monde de dominateurs, de vizirs, de pachas, de beglerbegs, de cadiliskers, c’est-à-dire de commandants de province et de juges, composé, en grande partie, de renégats appartenant à presque toutes les races chrétiennes de ces régions. Beaucoup sont Grecs, beaucoup Slaves, — pas de Bulgares, mais des Serbes, — au point qu’à l’époque de Soliman, il y avait trois langues diplomatiques à Byzance : le turc, le grec, le slavon. Les archives de Venise sont pleines de pièces diplomatiques venant de Constantinople ou des différentes régions et rédigées en grec vulgaire de cette époque.
Les baillis ne regardent que le monde officiel auquel ils ont affaire, ils ne s’éloignent pas de Constantinople ; — à l’exception de la route qu’ils ont suivie et des procès qu’on leur a présentés, — ils ne connaissent pas les provinces. Les voyageurs français, au contraire, et particulièrement trois d’entre eux, ont une connaissance intime du pays tout entier et de la vie morale du peuple. Et il est bien explicable qu’un de ces voyageurs, Guillaume Postel, penseur distingué mais qui finit dans des rêves bizarres, comme celui d’une religion dont le chef aurait été une femme, une Italienne, la mère Giovanna, ait même pensé à la fusion des deux religions[13].
[13] Voy. Un ex-libris de Guillaume Postel, dans les Mélanges offerts à M. Émile Picot, I, Paris, 1913, p. 323 et suiv. Cf. Desbillons, Nouveaux éclaircissements sur la vie et les ouvrages de Guillaume Postel, Liége, 1773 ; G. Weill, De Gulielmi Postelli vita et indole, Paris, 1892 ; E. Picot, Les Français italianisants au XVIe siècle, I, Paris, 1906, p. 313 et suiv.
I. — Je commence par la source la moins importante, mais la plus curieuse : il s’agit d’une description, je ne dis pas de la société ottomane, puisque l’auteur est un voyageur de passage, un voyageur d’aventure, mais de ses propres pérégrinations ; ceci en vers, bien qu’en très mauvais vers. Le livre est rare et cette manière de relater un voyage en vers elle-même peu fréquente.
C’est Le discours du voyage de Constantinoble, envoyé dudict lieu à une damoyselle francoyse, publié « à Lyon en rue Mercière, par Pierre de Tours », en 1541. L’auteur, dont le nom n’était pas divulgué, a été depuis longtemps découvert : il s’appelle La Borderie.
La Borderie, le poète, a connu beaucoup de femmes en Orient, mais il déclare avec énergie qu’aucune n’a été capable d’arrêter ses regards, puisqu’il pensait, pendant tout ce temps, uniquement à sa damoiselle française de Lyon. C’est pourquoi il lui dédie l’ouvrage.
Il accompagnait le chef d’une flotte française — c’était à l’époque de François Ier que certaines nécessités politiques avaient orienté du côté turc — qui se dirigeait vers Corfou pour soutenir l’armée ottomane attaquant la colonie des Vénitiens[14]. La Borderie déclare, du reste, que le but de l’expédition n’a pas été atteint par suite de la retraite du sultan, de sorte que les vaisseaux français sont, heureusement, arrivés trop tard.
[14] Combat d’André Doria avec le Pacha de Rhodes à Ste-Maure, p. 16.
Sur un des vaisseaux de Saint-Blanquart : « Sainct-Blanquart, chef, qui mieulx fourny se cuyde », se trouve La Borderie.
Notre écrivain arrive par delà « la bossue Albanie », devant Corfou, ce qui lui permet de dire qu’il n’aime guère les Vénitiens, « les Venitiens de condition vile », ni cette île qui est une « ingrate contrée ». La flotte turque, au contraire, suscite son admiration :
Cette flotte ottomane, les vaisseaux du roi la saluent :
La Borderie n’aime pas non plus les Turcs, au fond :
Après une dizaine de jours passés dans cette région où son chef « a traicté les affaires — Au bien public de nous tous nécessaires », après un retour involontaire sur les côtes de la Barbarie, on avance du côté de Modon et de Coron, qui avait été conquise par les Impériaux, puis abandonnée. Le voyageur s’imagine découvrir de loin Athènes :
Mais maintenant c’est :
Il y a même une brève description de cette ville :
Il arrive ensuite à l’île de Chio : celle-ci est, au XVIe siècle, l’objet d’une sympathie toute particulière de la part des voyageurs français, qui proclament que là sont les plus belles femmes du monde et les plus accueillantes :
A l’arrivée des Français paraissent : « femmes au bruit craintifves et tremblantes », vieillards, tout un monde un peu offusqué par les « habitz courtz ».
« Avec, dans les narines, — un air de terre, une doulceur bénigne. » La Borderie admire cette population féminine :
Tout le monde
Il a connu aussi un coin d’Asie, de « Minerasie ». Il y a vu les caravanes :
A Magnésie, voici le fils de Soliman :
Sous ce gouvernement :
Enfin le voyageur arrive à Constantinople, qu’il trouve digne d’être comparée à Paris,
Il décrit les quatre mosquées impériales et s’arrête surtout à Sainte-Sophie — « ce subiect toutes langues surmonte » — dont il regrette que les belles mosaïques aient disparu sous l’horrible badigeon des Turcs.
II. — Deux voyageurs appartiennent à une autre catégorie. L’un représente le type du jeune noble voyageant pour se distraire, mais les yeux ouverts à toute scène et cérémonie, à tout aspect inattendu de ce monde si différent et ne négligeant ni la plaisanterie, ni l’esprit d’à-propos.
Philippe du Fresne Canaye († 1593)[15], qui se rendit en Orient l’an 1573, peu favorable à ces tyrans turcs, qui aiment à se moquer de l’intrus chrétien, a connu cependant la description archéologique de Gyllius et celle de la vie turque qu’avait donnée l’Italien Ramberti. Rencontrant à Raguse, habitée par des « singes », des Vénitiens et digne d’être considérée aussi à cause des belles dames honnêtes et discrètes, sans fard et timides, qui paraissent derrière les vitres, l’évêque d’Acqs, ambassadeur du roi, revenant de Constantinople, il s’accroche à cet ecclésiastique qui retourne vers la capitale turque. Le voyage est fait par terre, à travers la Bosnie, où çà et là il y a quelques Ragusains, et le pays des belles femmes serbes, bien parées. Arrivé à Constantinople, après quarante-six jours de route, il prend part aux audiences chez le grand vizir et le sultan Sélim II, lui-même, l’œil trouble et mauvais, les joues bouffies par la boisson, sous les longues moustaches blondes, pauvre « ombre et souffle de Dieu », dont tout dépend et devant lequel tout soldat doit jeter les armes. Il assiste au « petit baïram », au passage de Sélim à la mosquée, Cigala, le renégat, près de lui, tout un monde suivant, avec de très beaux chevaux, dont le vieux coursier de Soliman le Magnifique. Il aperçoit « l’ombre et le souffle de Dieu » dans les jardins, où le bostandschi-bachi lui offre un bouquet de fleurs, alors que muets ou nains gambadent autour de lui. Il voit partir la flotte de Piali-Pacha, les femmes, parmi lesquelles une sultane, venant dans les caïques pleurer la séparation. Il a parlé à tel Turc ayant fait trois fois fonction d’ambassadeur en France, « Aschlih-Murath, bey en Barbarie », qui accuse le Pape d’être responsable des guerres de religion en France et propose qu’on en finisse avec Condé, l’invitant à quelque solennel banquet, et, quand il serait venu sans défiance dans le palais du roi, l’introduire seul en quelque chambre et l’y étrangler. Son récit est comme une chronique de Stamboul, jusqu’à l’exécution du prophète contre l’Islam, regretté par cinq cents janissaires gagnés à sa doctrine. Il a vu passer le patriarche grec, avec son chapeau de damas bleu à croix de velours noir, avec sa robe noire aux trois bandes de damas bleu. Il a pris part peut-être à la noce de la fille de Piali, où il a admiré les girandoles, et certainement à celle du Pérote Scudi.
[15] Le voyage du Levant de Philippe du Fresne Canaye, publié et annoté par H. Hauser, Paris, 1897.
Dans son Itinéraire d’Antibes à Constantinople (1544), Jérôme Maurand, d’Antibes[16], donne plutôt la chronique des entreprises de Barberousse, le terrible amiral de Soliman Ier, sur la côte occidentale de l’Italie : témoin des dévastations et de ces massacres inhumains accomplis par les Barbaresques, la pire engeance de toute la Turquie — il paraît qu’une superstition insensée et infâme leur fit tuer dans une église des vieillards pour prendre leur fiel, nécessaire à des incantations — il ne pouvait que qualifier de « plus que tigres » les bandes du « roi d’Alger ». On trouve chez lui cependant des notes intéressantes sur les familles levantines de Péra, un Compiano à leur tête, et surtout sur les différentes apparitions du sultan, dont il sera question dans la suite[17].
[16] Publié par Léon Dorez, en 1901. La Cosmographie de François des Belle-Forest, en partie d’après celle de Sébastien Münster, ne contient (Paris, 1575) que des détails pris dans les livres. L’auteur dit cependant qu’il a été lui-même voyageur (préface du volume II).
[17] Il a eu jadis entre les mains « uno libreto… del signor Johani, gentil homo peroto et drogamano de la Maestâ cristianissima », qui lui fut pris par l’évêque Pelicier ; p. 252. Texte italien et traduction française.
Mais un voyageur qui n’a ni attaches, ni devoirs, est ce sieur Jean Palerne, Forésien, dont le récit, d’une charmante simplicité rieuse, ne parut qu’en 1606[18]. Ancien compagnon de guerre de son maître, ce gentilhomme, dans la compagnie d’un Melïnoys anonyme, s’en va, en dépit de deux naufrages, stoïquement supportés et abondamment racontés, en 1581, à Alexandrie, où il apprend « qu’est-ce que caravane », comment on couve les œufs d’une façon artificielle et on s’égratigne, pour se faire aimer, sous la fenêtre d’une belle musulmane, sans compter une infinité de détails sur la société musulmane d’un peu partout. Curieux de tout apprendre, il est informé en Chypre qu’on avait découvert, avec les Vénitiens, « la sépulture de Vénus, où il y avoit quelques charactères qui avoyent esté interpretez », prouvant que ce ne fut pas « une chose feincte », mais bien « une grande courtisanne », adorée ensuite parce qu’elle avait été belle ; un « magnifique » garde même pieusement à Venise la tête de la pécheresse. Une large description, pleine de couleur et d’entrain, des fêtes pour la circoncision du fils aîné de l’empereur turc, « beau ieune prince », passant sur « le plus riche » cheval, pendant que la musique faisait « retentir l’air et la terre » et que les aspres pleuvaient sur la foule, avec les scènes de guerre, de victoire turque qui fait fuir, dans les cités prises, les pourceaux que sont les chrétiens, avec les « bastelleries » et « choses estranges » des « danseurs sur la corde », des « pellians » (pechlivans) ou athlètes, avec les feux d’artifice « comme si tous les tonnerres, foudres et esclairs y fussent esté », avec les « comedies, tragedies, meslées de danses, sauts, gambades, vireuores, tourdions, fissaignes, remuements, morisques et chansons accompaignées de ioustes, tournois et masquerades…, combats et escarmousches, batteries, assauts, mines, contremines, feux d’artifices, villes forcées, esclaves à la chaisne », finit ces pages qui ne sont guère négligeables pour l’historien des mœurs de l’Empire ottoman à une époque où la splendeur du règne de Soliman éclairait encore un présent amoindri.
[18] Pérégrinations du s. Jean Palerne, Foresien, secretaire de François de Valois, duc d’Anjou et d’Alençon, etc., où est traicté de plusieurs singularités et antiquités remarquées es provinces d’Égypte, Arabie déserte et pierreuse, Terre Saincte, Surie, Natolie, Grece et plusieurs isles, tant de la Mer Mediterranée que Archipelagues, etc., Lyon, 1606.
A côté d’elles, les quelques notes sur la Syrie et l’Égypte de Villamont, — chevalier maltais qui se rend en Orient en 1588[19], avec le regret de ne pas pouvoir rivaliser dans ses futurs récits avec les « grands et rares esprits et sçavans cosmographes et chorographes qui florissent auiourd’huy en la France » — , apparaissent bien maigres.
[19] Voyages du seigneur de Villamont, chevalier de l’Ordre de Hierusalem, gentilhomme du pays de Bretaigne, Paris, 1595. Il lui arrive de piller Belon, comme aux fol. 233-234.
III. — Le voyage purement pittoresque, de simple curiosité naïve, est représenté à cette époque par le baron de Fourquevaux, François Pavie, âgé à peine de vingt-deux à vingt-trois ans. Se trouvant à Venise, qu’il ne croit pas devoir décrire, il s’associe à un Biancourt, et plus tard à deux autres compagnons français, Montalais et de Fontaines-Milon, et à un Allemand de Bavière destiné à mourir en Terre Sainte, pour entreprendre un pèlerinage. Tout en citant Homère et en parlant, d’après Justin, de « l’escole publique de paillardise » tenue par Vénus, qui « permit à tous ses subjects de se veautrer », et d’autres anciens, il s’intéresse beaucoup au cours de la traversée, agrémentée de tempêtes, aux « petits raisins » de Zante, « d’assez de resqueste en France », aux caloyers grecs, aux salades de « beccafigues » en Chypre, à la variété de peste qui y est la petequi. Puis aux « religieux chrestiens de la ceinture » que sont les « nazerans », aux « courtoisies moresques », qui consistent à lui dire qu’il « n’estimoit ny moy, ny le consul non plus qu’un crachat qu’il me jetta au visage », aux chrétiens forcés en Syrie de devenir empaleurs des condamnés. Échappant à la fièvre d’Alep, où il est traité par « sire Pierre Vien, marchand françois », et par un Vénitien, il s’en va, avec deux jeunes Niçois en quête de raisins, à Damas, charmé de voir en chemin les gazelles qui, « sans s’espouvanter, paissent l’herbe assez pres des passants », les petits chevreaux plus jolis que « ces petits chiens de Lion dont nous faisons tant d’estime ». Il y découvre le café, « un bruvage qui se fait d’une graine noire portée des Indes…, laquelle ils brisent et font bouillir avec de l’eau, la prenant dans des petites escueles de terre blanche, presque pareille à la porcelène, le plus chaut qu’ils le peuvent humer, exprimentant ceste boisson souveraine pour garder de dormir, propre à descharger les defluctions de la teste, ayder à la digestion, tuer les vers et faire beaucoup d’autres effects…, et y a par toutes les villes des maisons ordonnées où ils le vont boire » sans compter des plaisirs d’un autre ordre, qui indignent à juste titre le voyageur, les « bateleurs et saltimbanques » y étant une préparation : « on est assis et rangé comme à un sermon ». La caravane d’un sandschac le mène à Jérusalem, d’où, en dépit des « demi-diables » arabes, il arrivera à Damiette, au Caire, à Alexandrie pour admirer chameaux, « cocodrilles », caméléons et ichneumons, Abyssins, « bedoïnes », c’est-à-dire « vilageoises ou paisantes », et chercher des « petites statues de pierre bleue » dont il fit l’achat, qui sont bonnes pour les « estonnements et grandes cheutes ». Il a la surprise de trouver dans cette Babyloine d’Égypte des huguenots de France, observant pour leur culte les édits de restriction décrétés chez eux, et la douleur d’y rencontrer des prisonniers de sa race, anciens pirates maltais. Rhodes, où on relègue les chrétiens de passage hors des murs, Chio sont passées en revue, et dans la seconde de ces îles on retrouve, avec le mastic qu’elles « machent et remuent » dans leurs « babines » à l’église, ces femmes dont « la beauté à la vérité est grande et se voyent pas de païs où les femmes soient en general si belles, ayant les Ciotes, oultre ce don de nature, si bonne grace et tant d’affeterie de leur langue grecque que bien heureux est celuy qui peut eschaper de leurs mains, mesmes les estrangers, qu’elles s’efforcent de faire toutes les sortes de faveurs qu’elles peuvent ». A Constantinople, Fourquevaux trouve comme « agent pour le Roy », « le sieur Bertier de Lion…, personage digne de sa charge et qui faisoit très bien l’honneur de son maistre ». Çà et là, des renseignements nouveaux sur ce monde turc dans lequel le Pacha d’Alep lui paraît « aucunement » le parent de la dynastie. Le voyageur français entend le cri des muezzins qui rivalisent de voix au point qu’il y en a tel qui crève ; il contemple les exercices des « schaenobates ou funambules » ; qui « marchent et font mille singeries sur une corde » ; il fréquente tel Juif parlant français et se disant de France, « lequel avoit la barbe si longue que le bout, quoy qu’il fut de mediocre stature, luy touchoit et trainoit à terre, laquelle il trouvoit ordinairement à une proportionnée longueur et entourtilloit au tour de son col, bien plié dans un linge le reste » ; il aperçoit Mourad III, qui « se laisse voir peu souvent, ne bougeant guère de son palais, du tout adonné aux femmes » ; dans les églises il rencontre des Turcs qui « sans violence ny mespris regardoient attentivement cette difference de ceremonies », alors que le vendredi saint des chrétiens « donnoient en passant des bouquets et des confitures aux belles Perotes » ; il décrit l’arrivée du nouvel ambassadeur de France, Lancosme. Puis il conte plus rapidement son voyage de retour par la Roumélie, la Bulgarie, le désert bessarabien au-dessus du poissonneux Danube, riche en « boutargues », ce désert où les Cosaques font rage, détroussant tout voyageur qui ne marche pas en caravane, puis les chemins moldaves traversés par les chars à bœufs où les belles filles juchées sur des pyramides d’œufs maintenus intacts s’en vont, des fleurs au chignon, vendre leurs marchandises dans la bourgade voisine, par la capitale de Jassy, près de laquelle un prince débonnaire, Pierre le Boiteux, juge ses sujets sous une « frescade » à la façon de saint Louis. Et, comme déjà le monde dominant des renégats commence à pourrir dans la jouissance indolente du pouvoir, Fourquevaux taxe sévèrement, d’après ce qu’on lui en a dit, l’ignorance des Turcs, indifférents aux grands vestiges de l’antiquité, l’avidité des dignitaires qui « avec des presens peuvent escorcher sans crainte de punition les villes ou les provinces…, lesquelles leur sont baillées pour y aller commettre toutes sortes de cruautez et d’extoursions », la décadence de cette « secte qui ne se peut gagner qu’en les soulant de bonne chere ou bien de presens[20] ».
[20] Ms. nouv. acq. franç. de la Bibliothèque nationale de Paris. La partie concernant les Roumains dans nos Actes et fragments, I, Bucarest, 1896.
La cour voisine de Valachie est décrite sous le règne du prince Alexandre, en 1574, — sous un de ses successeurs, un mignon de Henri III, Pierre « Boucle d’Oreille », Cercel ; après 1580, c’est Jacques Bongars, l’ambassadeur érudit, qui voyage, notant particulièrement, jusqu’au Danube, les incidents de sa route, — avec les séances du Conseil des boïars, avec les banquets où on boit « à la santé de Dieu » d’abord, avec le voyage des chars princiers, les carres dominesques, qui portent le tribut à Constantinople ; tout cela est conté par Pierre Lescalopier, ancien étudiant de Padoue, avocat de Paris. Lescalopier, dont le voyage est en grande partie inédit, a vu aussi Constantinople et les régions voisines[21].
[21] Sur le récit du premier (voy. plus bas) ; celui du second dans la collection roumaine des Documents Hurmuzaki, XI. Cf. notre Histoire des relations entre la France et les Roumains, Paris, 1918, p. 47 et suiv.
Il part de Venise en février 1574 avec des conationaux et le Polonais Michalowski, agent de l’aventurier Albert Laski, et arrive à Zara pour y voir « les masques » et « la comédie ». A Spalato, il se rappelle des lectures qui l’ont instruit que là était le palais de Dioclétien : la première description archéologique s’intercale. A Raguse, il constate la fierté des « superbes » républicains. Comme beaucoup d’autres voyageurs il critique le vêtement féminin et l’isolement dans lequel on tient femmes et filles, surtout ces dernières. Mais, au lieu de se rembarquer, le Parisien prend la voie de terre par Trébinié, et fait aussitôt la connaissance des caravan seraïs, qu’il décrit longuement. Suivant la route habituelle, Lescalopier touche au monastère de Saint-Sabbas, où on lui « fit baiser ung grand os du bras du saint », — et Juifs et Turcs font la même chose, — il voit les femmes bulgares, « de grands plateaux sur la teste ainsi que celles qu’en France on nomme égyptiennes », et il assiste à la danse des fillettes, probablement pour demander au ciel la pluie. Sofia lui apparaît avec ses marchands turcs, juifs et ragusains. Plus loin, pendant le baïram des musulmans se font « brandiller », « tendant la main pour atteindre des fruits, des ceintures, jartières et autres bagatelles », qui pendaient d’une grande toile tendue au-dessus de la « brandilloire ». On lui raconte entre Philippopolis et Andrinople l’histoire de « Tucassim Mresich », « roy de Moldavie » (le Kral serbe Voucachine). Les mosquées de Sélim et de Mourad dans la dernière de ces villes excitent son admiration ; dans une chapelle un prêtre ragusain dit la messe ; à Loulé-Bourgas, ce qui attire l’attention c’est l’édifice, auquel est réuni un caravan seraï, qu’est en train de faire bâtir le grand vizir Mohammed Sokoli. A Tschorlou est la place de plaisance de « la sultane Rousse », de la Roxolane du grand Soliman. Arrivé en avril à Constantinople, le voyageur est abandonné par le tschaouch impérial qui était dû à son compagnon Massiot, secrétaire de l’ambassadeur de France, François de Noailles, évêque d’Acqs. Celui-ci sauve ses conationaux des ennuis de la douane. Une chronique de la capitale ottomane suit : audience de l’évêque au vizir, préparatifs de l’attaque contre Tunis et la Golette avec l’empalement des retardataires ; passage du sultan à la mosquée et aux jardins de Scutari ; arrivée du vicomte de Tavannes et d’un sieur Dugué, venant de Pologne ; spectacle des chevaux du sultan menés « aux herbes ». Les « bastelleries » ne sont pas oubliées par ces visiteurs de mosquées et de curiosités. Mohammed Sokoli se montre tout « étonné de la curiosité des François qui sans affaire expresse et pour ung plaisir qui estoit plus tost un malaise venoient si loing ». Péra apparaît au Français pareille à Orléans « en grandeur », ses « Pérotins » établis aussi à Galata, dont le nom viendrait de « gala », en grec : le lait, portent « de longues robes et rubans et en teste raze une calotte et par-dessus une toque de drap ou de Mantoue » ; le luxe des femmes, qui se « fardent au possible et employent tout leur avoir à se vestir et parer, avec forces anneaux aux doigts et pierreries sur la teste, la plus part desquelles fauces », est aussi relevé.
Pendant que d’autres Français, dont un d’Harcourt, font le pèlerinage de Jérusalem[22], Lescalopier prend la même voie du Nord que Fourquevaux, mais en se dirigeant par la Valachie vers la Transylvanie, où il croit pouvoir négocier lui aussi, avec le sieur Normand, le mariage du jeune prince Jean Sigismond Zapolya avec une dame de la cour de France, Mlle de Châteauneuf[23].
[22] Un renégat français, Adam, ancien calviniste, à Constantinople.
[23] D’après un ms. de la Faculté de médecine de Montpellier, Edmond Cleray, dans la Revue d’histoire diplomatique, XXXV (1921), p. 21 et suiv.
Parmi les descriptions de pèlerinages, celle de Possot et Charles Philippe (Le voyage de la Terre Sainte, éd. Schéfer, 1890), en 1532, contient de nombreux détails sur la splendide et dévote Venise, des notes sur Chimaira d’Albanie, Castel Tornese, Patras, Coron et Modon, Chypre et Crète, sur les Français qu’on dit combattre sous le drapeau turc, sur le commerce vénitien en Turquie (« marchandant ensemble lesdicts Turcs et Veniciens comme font les marchans de Paris avec ceulx de Rouen ») (Schéfer reproduit aussi des passages du Grand Insulaire et pilotage d’André Thevet, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris, fr. 15.452-15.453). De ces descriptions, celle de Jehan Thenaud (Voyage et itinéraire de oultre-mer) a paru en seconde édition en 1884 ; celui de Jacques le Sage (Gistes, repaistres et depens ; 1515) de Cambrai vers 1520, puis en 1851 ; celles, en latin, de Barthélemy de Salignac (Itinerarum Terrae Sanctae) à Lyon en 1525. Celui d’Arfagart (Le voyage de Hierusalem, Bibl. Nat., français 5642, fol. 334 et suiv.) et de Gachi (dans une collection privée) sont encore inédits. Thenaud a fait partie d’une mission au Soudan, en 1511, et son récit, de la plus haute importance, mérite une analyse séparée que nous entreprendrons bientôt. Voy. aussi Le voyage de Hierusalem fait l’an mil cing cens quatre-vingt-treize, contenant l’ordre, despence et remarques notables en iceluy, par Nicolas de Hault, etc., Rouen, 1601.
IV. — Nous allons parler maintenant d’un autre groupe de voyageurs, d’un groupe cohérent et solidaire. Ils ont connu la société ottomane à l’époque où la France était représentée à Constantinople par d’Aramon, c’est-à-dire vers 1550. On y rencontre à côté des représentants du roi de France des gens de leur suite dont certains étaient de médiocres lettrés ; d’autres cependant peuvent être comptés parmi les principaux représentants de l’esprit de la Renaissance à cette époque, comme ce Gyllius[24] qui a donné la première description circonstanciée des antiquités de Constantinople, dans un ouvrage latin qui a eu une grande fortune et la méritait, car l’auteur peut être considéré comme le créateur de l’archéologie byzantine.
[24] De topographia Constantinopoleos et de illius antiquitatibus, Lyon, 1561. Thevet (voy. plus loin) mentionne (p. 76) « Monsieur maître Pierre Gillius, homme de bon savoir ».
Nous trouvons d’abord le « Journal » (1547-1548) de Jean Chesneau, Le voyage de M. d’Aramon, ambassadeur pour le Roy en Levant, escript par noble homme Jean Chesneau, l’un des secretaires dudict seigneur ambassadeur (Paris, 1887), publié par Ch. Schéfer, puis la Lettre écrite d’Alep en Surie par Jacques Gassot, à Jacques Thiboust, seigneur de Quantilly, contenant un voyage de Venise à Constantinople, de là à Tauriz en Perse et son retour audit Alep (éditions 1550, 1606, 1684). En troisième ligne, la Briefve description de la Court du Grand Turc et ung sommaire du regne des Othmans, avec un abregé de leurs folles superstitions, ensemble l’origine de cinq empires yssus de la secte de Mahomet par F. Anthoine Geuffroy, ce chevalier de Malte, admirable connaisseur du monde turc, et le seul qui en connaisse parfaitement la langue. Ajoutons qu’il a pris part à la croisade des Impériaux du côté de Modon et de Coron, qu’il a dû vivre en Turquie pendant longtemps, qu’il n’y a pas une ligne de lui qui n’ait de valeur géographique, ethnographique ou historique et que la tentative qu’il a faite d’écrire une histoire des Ottomans jusqu’à la moitié du XVIe siècle peut être considérée comme réussie : il emploie, en même temps, Froissart et des résumés d’histoire de France dans son exposé, à côté de récits oraux, qui doivent lui venir du milieu turc.
Il y a, en quatrième ligne, avant la traduction et le remaniement, par Belleforest, — comprenant l’Orient roumain, slave, grec, turc, — de la célèbre Cosmographie de Sébastien Münster, cette autre « cosmographie », du Levant seul, par André Thevet, d’Angoulême, publiée à Lyon en 1544. Celui-ci est aussi un témoin tout à fait remarquable.
Rien ne dépasse cependant Les Observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges, redigées en trois livres par Pierre Belon du Mans, dont il existe plusieurs éditions (1553, 1554-1555, 1558, 1588, traduction latine 1589).
Belon, parti de Rome en 1549, est un grand naturaliste et, en même temps, un observateur infatigable de la vie populaire. Il n’y a pas de domaine de cette vie des masses profondes de l’Empire ottoman : paysans, pêcheurs, bouviers, pâtres, etc., dont il ne connaisse les moindres détails. Tout cela se trouve pêle-mêle dans ses chapitres avec la description de tel poisson ou de tel animal plus ou moins fantastique.
Il revient plusieurs fois sur le même sujet, et il y aurait lieu dans une édition nouvelle de présenter l’ouvrage de Belon de manière à écarter toutes les notes inutiles sur la religion mahométane, qu’il connaît plus ou moins, ainsi que sur les superstitions et les illusions qui régnaient à ce sujet en Occident et à introduire un certain ordre ; on obtiendrait un texte tout à fait remarquable au point de vue de l’information historique en même temps que de la valeur littéraire[25].
[25] Voy. aussi Les portraits d’oyseaux, animaux, serpens, herbes, arbres, hommes et femmes d’Arabie observez par P. Belon du Mans.
Mérite une place à part le voyage de Nicolaï, les Discours et histoires véritables des navigations, pérégrinations et voyages faits en la Turquie avec 60 figures au naturel (1568). Il nous dit qu’ayant certaine difficulté à se procurer ces « certaines figures au naturel », il s’est adressé à un ami, qui est allé au « bésestan », au bazar, y trouver des femmes qui se sont offertes comme modèles, ce qui était encore une occupation plus honorable que celle qu’elles pratiquaient habituellement ; pour une certaine somme elles ont consenti à se laisser habiller de vêtements brillants et à poser.
Nous avons aussi, de Postel, la Republique des Turcs et, là où l’occasion s’offrira, des meurs et loy de tous Muhamedistes, par Guillaume Postel, cosmopolite, 1560.
En dehors du récit latin du voyageur, Nicolas de Mofeu, jadis prisonnier, pendant trois ans, dans le château de Gran[26], sans importance, et de celui de Gyllius, voici donc quels sont les personnages pour la plus grande partie groupés, comme je l’ai dit, autour de d’Aramon, qui nous fournissent de nouvelles informations.
[26] Soltani Solymanni, Turcarum imperatoris, horrendum facinus scelerato in proprium filium, natu maximum, Soltanum Mustapham, parricidio, patratum, authore Nicolao à Moffeu, Burgundo, Paris, 1556. Blessé en 1552 en Bulgarie, il fut mené en captivité où il resta assez libre cependant.
Et d’Aramon est glorifié par l’un d’entre eux, Belon, pour avoir favorisé ces observations :
« Il a tant aimé à faire plaisir à tous ceulx de la nation françoise ou qui estoient du party françois, qu’il n’arriva onc homme à Constantinoble, de quelque condition qu’il fust, s’addressant à luy, qu’il ne l’ait humainement receu et faict traiter en son logis. » Il délivre des prisonniers. « Et, quand quelques François viennent à Constantinople, oultre ce qu’il leur fait donner tout ce qui leur est nécessaire, aussi les fait revestir s’ils n’ont des habillements… Et, quand un François est ennuyé d’estre en ce pays-là, il luy donne de l’argent selon son estat, autant qu’il luy en fault pour retourner en France. Et, s’il congnoist qu’il soit de race noble, après l’avoir traité honorablement comme soy-mesme, finablement il luy fait donner montures et autres choses necessaires. Et, comme il ne s’ennuya iamais de la despense qu’il luy ait convenu faire pour l’arrivée des plus grands personnages, tout ainsi il ne desdaigna iamais de faire plaisir aux plus petits compaignons[27]. »
[27] Fol. 69. Cf. fol. 75 vo.
Mais tâchons de préciser cette attitude commune du groupe qui se trouve autour de d’Aramon, à part la curiosité inextinguible des choses orientales qui fait le charme de leurs récits.
Ils se distinguent essentiellement de leurs prédécesseurs du XVe siècle. Le pèlerinage, les lieux saints ont pour eux un intérêt médiocre ; ils retrouvent, çà et là, quelque chose de ce qui formait, pour les autres voyageurs, l’attrait principal de l’Orient : ils parlent de la citerne de Joseph, « un oratoire où son père le venoit plorer », du tombeau de David, du monastère de Sainte-Anne, « dont la seur de Godefroy de Billon a été abesse ». Mais, quand il s’agit d’évoquer d’une façon plus approfondie ces souvenirs religieux, alors l’auteur que nous citons, Chesneau, dira qu’il en laisse la dispute à « Messieurs les théologiens ». Et ailleurs : « Je puis dire qu’il n’est pas besoing d’aller en Hierusalem pour trouver Jesus-Christ, parce que le trouve bien en sa maison qui veut et continueray d’escrire d’autres lieux qu’avons veuz, encore que ce ne soit chose qui fut d’ediffications. Mais, d’autant que l’on les monstre à tous pellerins qui y vont, leur declarant les pardons qu’ils mesritent à les visiter, je ne veux les obmettre. » Et Belon dit, à propos de Sainte-Sophie : « Quiconque l’aura veue ne prendra plus d’admiration de regarder le Pantheon de Rome, qu’on nomme en vulgaire Saincte Marie Rotonde. » A Brousse il croit retrouver, cependant, « la grand espée de Roland[28] ».
[28] Chesneau, p. 113, 123, 124, 131.
Donc, c’est parce qu’on montre les vestiges religieux qu’ils en parlent, mais aucun sentiment ne les dirige vers ces souvenirs, parfois enfantins, comme celui qui, en Égypte, s’attache à la Vierge Marie, non seulement « lorsqu’elle fuyoit la fureur d’Hérode », mais aussi à la place « où l’on dict que la dicte Vierge lavoit le linge de Nostre Seigneur, près de laquelle y a une petite fenestre où elle se cachoit »[29].
[29] II, p. 203.
Il leur arrive parfois de faire de la morale à leurs contemporains, parlant d’autres temples que ceux des chrétiens, des mosquées, signalant le grand silence et l’ordre parfait qui y règnent. Et ils ajoutent que : « ce seroit une mauvaise recepte pour ceux qui font l’amour aux églises »[30].
[30] De même, cf. Gassot : « mauvaise recepte pour ceux qui vouloient faire l’amour » (p. 10).
Il n’est pas besoin de dire que tous ces voyageurs sont attirés tout particulièrement vers les choses de l’antiquité. Il n’y a pas de localité de l’Europe ou de l’Asie où ils ne cherchent d’anciens murs, des médailles. Leur langage même se ressent de ce changement d’âme.
Nicolaï parlera ainsi, dans sa préface, d’Adam l’archétype du genre humain ; il proclamera l’homme « prince des animaux » ; il parlera de la « sphère lunaire », du « septentrion meridian », racontant la coutume des Turcs qui habituellement ne boivent pas de vin, mais « quand ils le prennent aux Juifs, aux Grecs, aux Arméniens, s’en enivrent » ; il intitulera le vin « doulce liqueur septembrale et bacchique », et montrera les Turcs « se plongeant iusques au chef au sang de la terre », la boisson.
Mais, ce qui doit être signalé en même temps, chez tous ces voyageurs, c’est une curiosité ardente. Ils partent avec le désir de voir le plus possible de choses nouvelles et curieuses et, en même temps, avec un orgueil humain, avec une conscience de la puissance de l’homme que leurs prédécesseurs du XVe siècle n’ont jamais connus.
Voici ce que dit Thevet : « Quel est ce nouveau Anacharse ou Cosmographe qui, après plusieurs auteurs tant anciens que modernes, peult inventer quelques choses nouvelles ? Mais ie leur demande : nature s’est-elle tellement astreinte et assugettie aux escris des anciens qu’il ne lui fust loisible au temps à venir varier et donner alternative vicissitude aux choses dont ils auroient escrit ? Seroit-il raison que ce de nouveauté que de iour en iour elle produit en diverses contrées qui n’a esté aux anciens inconnu pour n’estre avenu de leur tems, et à la plus part des modernes, pour en avoir fait la recherche, deust estre supprimé en silence[31] ? »
[31] P. 3-4.
Ils ne cherchent donc pas seulement les traces des anciens, mais, se rendant compte qu’il y a eu des changements depuis la fin de l’antiquité, ils entendent parler de ces nouveautés et donner à leurs récits un autre cachet que celui d’une reproduction archéologique. La nature, ayant une fois produit, peut-elle rester « à iamais ocieuse et stérile » ?
Ils sont parfois indignés de ne pas trouver de guides dans leurs recherches, et combien sont touchantes ces paroles de Gyllius, qui, s’adressant aux Grecs, les trouve indifférents et même haineux, pour des motifs de religion ou par ignorance, à l’égard des Latins, des Francs : « Que puis-je faire, moi, un étranger, que n’ont pas informé les vestiges des édifices anciens, ni les statues, ni les inscriptions, ni les monnaies, ni les habitants préoccupés d’antiquité, lesquels en sont au plus haut degré éloignés, et empêchent plutôt celui qui fait une enquête, de sorte que je n’ai rien osé librement mesurer, ni rien demander, non seulement des barbares, mais pas même des Grecs, auxquels rien n’est plus étranger que les lettres, rien de plus ennemi qu’un latin, qu’ils mordent comme des chiens ? »
Après avoir rendu compte de l’attitude de nos voyageurs et laissant de côté ce qu’ils disent, et qui est pourtant fort intéressant, sur les curiosités et les belles choses anciennes ou modernes qu’ils trouvent en voyage, — voici pour la première fois des descriptions de Venise, que leurs prédécesseurs du XVIe siècle ne considéraient que comme un point d’embarquement, — arrivons maintenant à la manière dont ils décrivent les populations chrétiennes qu’ils observent avant de finir par le plus important : leurs considérations sur la valeur politique et morale du monde turc.
Lorsqu’ils traversent à pied la péninsule des Balkans, les voyageurs y trouvent des Serbes. Ils s’arrêteront avec intérêt aux costumes populaires des habitants slaves de ces régions et ils admireront les chemises ornées que ces populations savent broder. Ceci bien qu’on soit un peu déconcerté en voyant le « chapeau faict de drapeaux, sans aucune forme, ne façon », « les patenostres de verre et quelques pieces d’argent et anneaux aux oreilles », et qu’ils s’effraient un peu devant l’« ancienne coustume ou hypocrysie » d’hurler des lamentations aux funérailles[32]. Et Thevet donne cette description de la race : « Or sont les Esclavons gens de haute stature et bien douez, de ce que nature peut conferer pour rendre la creature belle en perfeccion », mais « fort adonnez à gourmandise et yvrongnerie… Les femmes sont plus petites, vetues plus à la legere et ne s’enyvrent pas si facilement, à cause de la grande humidité qui abonde en leur sexe, comme il appert par le cuir doux et resplendissant. Touchant leur langage, certes, il est fort sauvage et difficile à comprendre. »
[32] Chesneau, Thevet et Gassot. Belon parle de ces femmes « eschevelées et espoitrinées, monstrant leur belle charnure ».
Ils admirent, tous, ces femmes de Chio que nous évoquions plus haut, encore libre jusqu’à l’expédition de 1566 de l’amiral turc Piali, ces « belles femmes et filles chioises qui userent à noz endroits de toute courtoisie et honneste liberalité ». « Tout leur plaisir et estude ne tend qu’à se bien parer et farder à fin de se monstrer plus aggreables aux hommes. » Leur « beauté, bonne grace et amoureuse courtoisie » gagnent tous les visiteurs enclins à la galanterie. Elles leur paraissent telles qu’« on les iugeroit plustost nymphes ou deesses que femmes ou filles mortelles ».
Et Nicolaï donne même cette étymologie : Chio viendrait de χιὼν; ainsi ce nom serait dérivé de la neige, tant les femmes y sont blanches[33]. Thevet est du même avis flatteur : « Il n’y ha nacion, soit en chrestienté, ou autre part (que i’aye connue) plus secourable, ne qui, avec plus grande civilité, s’offre à faire plaisir… Les dames d’apparence et d’honneur et qui sont bien douées d’excellens dons de nature sont de leurs maris avouees à faire bon recueil aux estrangers et, principalement, aux François, ausquelz il est permis de deviser privément avec elles en langue genevoise, sans crainte quelconque. Car la chasteté des femmes de Chio n’est pas moins renommée que celle de Padouë[34]. » Ainsi finirent, écrit du Fresne-Canaye, « la superbe mollesse et les voluptés chiotes ». On verra qu’il s’était bien trompé[35].
[33] Nicolaï, p. 51-52.
[34] P. 44.
[35] Cf. Belon, fol. no 85 : « Il n’est autre ville où les gens soient plus courtois qu’ilz sont à Chio. Aussi est-ce le lieu de la meilleure demeure que ie sache à mon gré et où les femmes sont plus courtoises et belles… Les hommes aussi y sont fort aimables. »
Il y a aussi, dans Nicolaï, une description des luxueuses bourgeoises de Péra qui sont catholiques, Italiennes, Levantines, ainsi qu’une critique acerbe des grandes dépenses qu’elles font pour se faire valoir, par les « ornemens de teste eslevés en coqueluche » et les « chausses avalées jusques aux tallons ». « Souvent, portent sur elles tout leur vaillant, et, lorsqu’elles vont par la ville à leurs eglises ou aux bains, il n’y a si petite bourgeoise ou marchande qui ne porte les robbes de velours, satin cramoisy ou damas, enrichies de passemens et boutons d’or ou d’argent, et les moindres, de taffetas et soyes figurées de Bursie (Brousse), avec force chaines, mailles ou larges bracelets, carquans, pendants et afficquets, garnies de diverses pierreries, les unes fines et les aucunz de peu de valeur[36]. »
[36] P. 78.
Et il qualifie ceci de « brillant attirail de la volupté et de l’impudicité, car, si le mary ne peut ou ne les veut entretenir parées, selon leur volonté et desirs, elles feront un ou plusieurs amys pour fournir à l’appointement »[37].
[37] Ibid.
« Les Greques », dit Belon[38], « principalement en Péra de Constantinoble, ont plus de liberté qu’ès autres villes subiectes au Turc, car elles vont par la ville avec une grande parure, et, principalement si leurs maris sont quelque peu riches, seront tant fardées et ornées de parures qu’elles auront les doigts chargez de bagues quasi iusques dessus le bout des ongles, et ont tousiours mille petits fatras penduz au col avec plusieurs chaines tant faulses que vrayes, et seront ceinctes de quatre ou cinq ceinctures, les unes de fine soye, les autres d’or, les autres entournées de pierreries tant bonnes que mauvaises. Elles sont richement vestues de soye, tellement qu’elles portent toute leur richesse sur eulx pour la monstrer. Mais on ne les voit en telz habitz que les iours de festes, quasi en mesme equipage que celuy du iour de leurs nopces, et diroit-on à les veoir aller par la ville que ce sont espousées. » Et Postel, tout aussi ébloui, est d’avis que, pour « la bravetté des Perottes », « il faudroit une royne ancienne pour comparaison »[39].
[38] II, fol. 199.
[39] P. 14.
On trouve en même temps, dans les récits de nos voyageurs, des tableaux ruraux de toute beauté. Ainsi cette description de fête, en un village de Crète. « Me trouvant », écrit Belon, « en un village champestre, au logis du seigneur Jean Antoine Baroczo, assez pres de la ville de la Sphachie, ie vey les paisants des villages d’alentour assemblez à une feste, les uns avec leurs amoureuses, les autres avec leurs femmes, tellement qu’il y a avoit moult grande compagnie. Et, apres avoir bien beu, ilz se mirent à danser au plus grand chauld du iour, non pas en l’ombre, mais au soleil, encor que ce fust le plus ardent iour de tout le mois de iuillet. Et, combien que les ditz paisans fussent chargez d’armes, toutes fois ne cesserent de danser jusques à la nuict[40]. » Ou bien ce sont les moines de l’Athos au travail. « Ne pensez pas », dit Belon, « qu’il y en y ait un oyseux, car ilz sortent de leurs monasteres de grand matin, chascun avec son oustil en la main, portants du biscuit et quelques oignons en un bissac dessus l’espaulle, l’un une houe, l’autre un pic, l’autre une serpe… Les uns beischent les vignes, les autres buschent le bois, les autres fabriquent les navires… Les uns sont cousturiers, les autres massons, les autres charpentiers, les autres d’autres mestiers, travaillants tous en commun[41]. »
[40] I, p. 22. C’est bien le même écrivain qui se rappelle, en entendant crier les muezzins, les pastourelles qui chantent ès landes du Maine autour Nouel (c. II, fol. 19 vo).
[41] « L’on trouvoit anciennement des bons livres grecs, escrips à la main, en ladicte montaigne… Maintenant il n’y en ha plus nuls qui sachent rien, et seroit impossible qu’en tout le Mont Athos l’on trouvast en chasque monastere plus d’un seul caloiere sçavant… A peine en pourroit-on trouver deux ou trois de chasque monastere qui sachent lire et escrire » ; fol. 37 vo. Cf. pour les Grecs en général : « Tous les Grecs… sont pour le iour d’huy en si merveilleux regne de ignorance qu’il n’y ha aucune ville en tout leur pays où il y ait université et aussi ne prennent aucun plaisir à apprendre les lettres et sciences. »
Puis, après les Esclavons et les Esclavones, les Chiotes, les Pérotes grecques et latines, les Crétois, il va parler même de pâtres roumains de la péninsule des Balkans : « Nous trouvasmes des pasteurs… qui faisoient rostir des moutons entiers, excepté la teste, pour vendre aux passants ; lesquels ils avoient embrochez dedens des perches de saule, mais ils en avoient vuydé les tripes et avoient recousu le ventre. »
Voici une recette orientale de rôti, très variée, on va en juger : ouvrir le ventre d’un bœuf pour y introduire un mouton ; ouvrir le ventre du mouton pour y introduire une poule ; ouvrir le ventre de la poule pour y introduire un œuf : on s’arrête là.
Les Albanais, les ergates qui font la récolte des Turcs paresseux et de petit travail au labourage, « lents, tardifs et qui temporisent grandement en leurs affaires », sont présentés revenant en bandes, comme des savoisiens ou plutôt des « estourneaux » : « genre de petite demeure et de grand travail »[42].
[42] Belon, fol. 61 vo. La même observation chez le gentilhomme forésien mentionné plus haut.
Quant aux Juifs, ils sont « cauteleux plus que nulle autre nation » et ils ont « tellement embrassé tout le traffic de la marchandise de Turquie que la richesse et revenu du Turc est entre leur main » : « c’est la nation la plus fine qui soit et la plus pleine de malice »[43].
[43] Belon, II, fol. 181.
Les Turcs, eux, leur paraissent avoir des qualités que l’Occident ne connaît pas encore. Je passe par-dessus le récit des magnificences orientales. Il y a ainsi dans Gassot une description splendide du palais de Tébriz et il le trouve infiniment supérieur à tout ce qu’il a vu en Occident ; tous les châteaux des rois de France à cette époque ne pourraient être mis en comparaison avec ces richesses persanes de Tébriz[44].
[44] Fol. 24 vo.
Plus intéressant est l’éloge que ces témoins font de la masse populaire turque que certains d’entre eux ont pu réellement voir, pénétrer et apprécier.
La race est belle, la race des campagnes, qui n’est pas abâtardie par le harem de la polygamie : « Il n’y a femme », dit Belon, « de quelque laboureur ou rustique qui soit en Asie qui n’ait le teinct fraiz comme rose, la chair tant delicate et blanche comme laict et le cuir si bien tendu et une peau si bien polie qu’il semble toucher à un fin veloux… Car elles ne sont point touchées de la lune ne du soleil et ne sortent des maisons sinon quand elles se vont laver aux baings ou vont au cemitiere prier pour ses morts. » Il les a vues sur « les terrasses des maisons où elles demeurent tout le iour et chantent à leur mode en compaignie de leurs voisines »[45].
[45] Belon, II, fol. 197.
De plus, ce sont, au point de vue hygiénique, « les plus nettes gens du monde »[46]. Parlant des bains qu’on trouve partout, jusque dans la dernière des localités (il n’y a pas de vizir, comme Ibrahim, qui, voulant payer sa dette envers le sort qui l’a favorisé, n’emploie une partie de sa grande fortune pour des routes nouvelles, pour des fontaines, pour des caravanséraïs, pour des khans, pour des auberges, et pour des bains). Postel s’écrie : « Je désire la pareille oportunité du bain aux grans personnages et grandes cités de la chrestienté, comme chose très saine[47]. »
[46] Ibid., p. 199.
[47] Belon, fol. 30.
Les voyageurs signalent aussi la simplicité qui règne dans tout ce monde : « Tout ainsi que les Turcs sont issus de vachiers et de bergiers semblablement, ils en retiennent toutes les enseignes en leur façon de vivre[48]. » Ils sont restés « rustiques et paysans », « champestres » de naissance. Leur dépense est minime et ceci les engage à rester patriarcalement honnêtes : un « homme et deux esclaves et trois chevaux ne despendent chasque iour en tout, l’un portant l’autre, plus de six aspres, qui valent six carolus »[49]. Cette simplicité s’étend au domaine des armes : il n’y a pas de point d’honneur, comme chez les Espagnols de cette époque. Au contraire, les plus braves des Turcs sont ceux qui le montrent le moins. Ils ont une discrétion, sous ce rapport aussi, que l’on prise hautement : « Les Turcs ne deffinent pas la vaillantise ainsi comme nous, car en Europe, si quelqu’un est touiours prest à se batre et scait tourner les yeux en la teste et est balafré, iureur et colère, et n’a gaingnié le point d’avoir dementi un autre, icelui sera mis en perspective d’un homme vaillant, loué homme de bien. Mais les Turcs en temps de paix se monstrent modestes et posent leurs armes en leurs maisons pour vivre pacifiquement et ne voit-on point qu’ils portent leurs cimeterres allants par la ville, mais, quand ils vont à la guerre, lors scavent-ils mettre couteaux sur table quand il est temps et font apparoistre leur vaillantise sur leurs ennemis, et ne sauroit leur dire qu’ils se seront batuz entre eux. Et, s’il advenoit que l’un eust batu son compagnon, pour cela ne sera il estimé vaillant. Il ont une coustume moult seante de punir les délinquants à coups de baston. » Et voici l’éloge de la bastonnade : « qui est la vraie façon d’umilier les superbes et de punir ceux qu’on ne veult pas tuer »[50]. Donc il n’y aura pas de draps, de lit de plumes, de « grasse » tous les jours, de souppe chaude « et de vin comme chez les chrétiens, en temps de paix comme pendant la guerre, où ils supportent tout mieux que « ne souloyent faire les légionnaires et soldats romains »[51].
[48] Ibid., II, p. 191.
[49] Ibid., fol. 195.
[50] Ibid., p. 185.
[51] Belon, fol. 185 vo 186.
Cette simplicité, ils l’observent aussi dans la façon de tenir la maison. Jamais, dans cette société ottomane, on ne verra la maîtresse de céans « nette, lavée et parfumée », du reste, portant tout un trésor de clés à la ceinture et on ne l’entendra jamais donner des ordres ; il subsiste entre maîtresse de maison et servante quelque chose de l’ancienne égalité dans cette société d’une si charmante modestie[52]. Combien sont loin de cette attitude religieusement discrète les « braves, testonnés, perruquets parfumés et hommes-femmes de deçà », s’écrie Postel, ennemi des coutumes efféminées de « la Cour médicéenne de Paris »[53].
[52] « Aussi n’est-ce pas la coustume en Turquie de dire : Madame a commandé cela ou dire : Elle veult qu’il soit fait ainsi. Elles ne portent pas de nos claviers penduz à leur ceinture pour acquerir le nom de bonnes mesnagieres… Il suffit à un Turc… avoir un tapis par terre pour s’asseoir. » Belon, II, fol. 184 vo. Cf. Postel, p. 14.
[53] Postel, p. 7-68.
Ils montrent, en même temps, une hospitalité et un esprit de charité dont nos voyageurs, Postel en première ligne, sont obligés de faire l’éloge. Les plus pauvres, ne pouvant pas donner d’argent, s’engagent à travailler gratuitement aux routes et aux fontaines ; les riches appellent chez eux les voyageurs, qu’ils voient exténués sur la route[54]. Du reste, c’est une ancienne coutume qui s’étend à l’Orient tout entier. Il m’est arrivé de voir, en Transylvanie (et il n’y a jamais eu de Turcs dans les villages roumains), un seau rempli d’eau devant la maison, avec un verre pour le premier passant venu qui désire se rafraîchir.
[54] P. 60-61.
Postel constate que, quand ils reçoivent quelqu’un en leur maison, « ils le traittent comme eus-mesmes ». Et nous, s’écrie-t-il, « qui n’avons point de honte qu’en tant de provinces de ce royaume il y a tant de mille et mille pauvres mourant de faim par la grande cherté »[55].
[55] P. 63.
Et un détail charmant, à cette occasion, chez le même voyageur : lorsque des Turcs arrivent à Venise, ville riche, splendide, mais dure d’âme, parce que ville marchande, ils font passer leur aumône d’une façon discrète sous les ponts, pour qu’on ne les observe pas, ne pouvant pas souffrir, à côté d’eux, le spectacle de la misère matérielle de l’humanité.
Ils sont, dit le même Postel, « d’une fidélité et d’une loyauté sans exemple de nulle chose en ce monde ». Il préfère se fier « à la simple foy d’un Turc naturel »[56]. Et Belon assure qu’« un Turq naturel ne moleste pas volontiers un chrestien, ains plustot lui fera caresse et bon recueil »[57].
[56] Fol. 69. Cf. Belon, fol. 28 vo. « Les Turcs ne font aucune difficulté de converser avec les chrestiens », fol. 28 vo. L’accueil de Thevet chez un Turc de Gaza, p. 161-162.
« Je dis les Turcs naturels et simples gens, car citoiens et courtisans sont au contraire » ; Postel, fol. 69-71. Cf. Belon, II, fol. 191 vo.
[57] Belon, II, fol. 184 vo.
On voit la distinction. « Le Turc naturel » n’est pas le renégat, le renégat qu’on n’invite pas à renier. Et si c’est un renégat qui se vend pour passer à la religion mahométane, il est méprisé, dit encore un de nos voyageurs.
L’esprit démocratique n’a pas cessé de dominer depuis le début de la société ottomane qui maintenant a sous sa domination une si large part de l’Orient et de si riches provinces de l’Occident chrétien.
Leur travail, leurs « marchandises et labeurs » seront donc « si très exquisement faits et si durables (fors les maisons) qu’ici ne reçoivent aucune comparaison », tellement ils sont honnêtes dans l’âme.
Cette simplicité règne dans la famille. « Si un Turc », dit Belon, « avoit espousé la fille d’un Grand Seigneur et qu’il fust aussi marié avec une des filles d’un plus pauvre homme mechanique, toutes fois fauldra que la fille du mechanique soit compaigne à la fille du Grand Seigneur »[58]. Elle régit l’État : « Celuy entre les Turcs tiendra la première dignité après le Grand Seigneur qui ne sçait dont il est, ne qui sont ses pere et mere, ains quiconque est payé de soulte (solde) de Turc s’estime estre autant gentil homme comme est le Grand Turc mesme[59]. »
[58] Ibid., fol. 152 vo.
[59] Postel, fol. 69. Belon dit aussi que « les coustumiers de Turquie, si l’on faict comparaison de leurs ouvrages à ceux qui sont connuz en Europe, cousent toutes besongnes mieux et plus élégamment » ; aussi « les cordonniers et selliers », II, fol. 203.
« Les esclaves en Turquie » — ceci est un des passages les plus remarquables, car la sentimentalité chrétienne de l’Occident a été souvent exploitée, quant à la dure condition de ces esclaves qu’on vend en place publique et qu’on accable de travail, qu’on nourrit d’injures et de coups — « sont aussi bien traictez comme les serviteurs de nostre Europe, car ilz participent de la felicité, selon le maistre qu’ilz servent. S’ilz sont avec un bon maître qui les aime bien, ilz sont traictez comme luy-mesme »[60].
[60] Belon, II, fol. 192-192 vo.
Et le même Belon rappelle la prescription légale qui permet à n’importe quel esclave de s’adresser au cadi, et le cadi a le courage de décider en sa faveur, s’il ne s’agit pas d’un très grand et très puissant personnage de Constantinople. Ils ont le droit de s’adresser au cadi et de demander qu’on leur fixe la somme qu’ils doivent payer pour être délivrés, ou bien qu’on leur impose un travail considéré comme équivalent à la rançon. Et il dit que souvent après une année, une seule année de travail opiniâtre, ils arrivent à regagner leur liberté.
L’amour pour l’instruction, dit le voyageur, est tellement général, que, dans chaque village, il y a une école religieuse. « Les filles aussi y sont apprises par les femmes et n’y a si petit village où il n’y ait de tels porches ou appentiz où iournellement tous les garçons du village s’assemblent[61]. »
[61] Ibid., II, fol. 180 vo.
Mais ce qui excite plus que tout l’admiration des voyageurs français, c’est l’ordre parfait, la discipline sévère qui règnent dans ce peuple. A plusieurs reprises, ils déclarent que les mouvements des armées ottomanes sont imperceptibles, parce qu’ils ne font aucun bruit, ainsi que le remarquait, du reste, un voyageur du XVe siècle : une armée se met en mouvement sans qu’on entende autre chose que le « trac des chevaux »[62] sur le pavé ; pas une parole n’est perçue au moment du départ, et ces immenses masses de plusieurs milliers de soldats s’ébranlent et poursuivent leur route dans un silence d’église. « Combien qu’il y eust vingt ou trente hommes aux portes de la ville…, c’estoit avec si grand silence et modestie qu’on n’y oyoit non plus de bruist que s’il n’y eust eu personne, et sembloit plustot que ce fussent artisants que gents de guerre[63]. » Un « homme seul avec un baston est plus craint et redouté que n’est le capitaine du guet de Paris avec tous ses archers »[64]. « A peine les assistans osent cracher ou tousser[65]. » Il y a au moins une dizaine de témoignages dans ce sens. Ainsi ce voyageur, qui devait être accompagné par des soldats, cherche à droite et à gauche ses compagnons, se réveille, et ne les trouve plus : sans avoir eu nullement l’intention d’épargner son sommeil, ils étaient partis en faisant si peu de bruit qu’il ne s’en était pas aperçu[66]. Ils ne touchent guère, en chemin, à l’avoir du paysan, même du chrétien, du « pauvre peuple » en général.
[62] Thevet, p. 61.
[63] Belon, fol. 91.
[64] Chesneau, p. 48. Cf. ibid., p. 108 ; Gassot, fol. 21.
[65] Gassot, fol. 63.
[66] Belon, fol. 68-69 vo.
L’empire lui-même, cet empire dans lequel règnent cependant les renégats, pas les « Turcs naturels » — et ce sera la cause de sa déchéance — est l’objet de vives louanges.
On y célèbre d’abord la paix profonde, la paix romaine qu’il impose partout. Voici ce qu’en dit Belon : « Un vieillard grec, natif de Lemnos, disoit que iamais l’isle n’avoit esté si bien cultivee, ne plus riche, et n’y a eu plus de peuple qu’il n’y en a maintenant, laquelle chose il faut attribuer à la paix de longue durée qu’ilz ont eue sans estre molestez[67]. »
[67] Ibid., fol. 26 vo.
Et cette tyrannie turque ne mène pas à la pauvreté : tel voyageur nous présentera toute une société villageoise, vivant d’une façon assez gaie et parée de vêtements qui auraient pu provoquer la convoitise des maîtres du pays, lesquels, cependant, ne touchent pas à cet héritage de la population soumise à leur domination. Ils ne détruisent rien, et un autre voyageur nous dit que lorsque, en Occident, à l’époque du mouvement calviniste, des statues ont été détruites, des peintures ont disparu, les Turcs en ont ressenti un mouvement d’indignation[68]. « Je veul dire », assure Belon, « en oultre, que les Turcs ont tousiours en ceste coustume que, quelque chasteau ou fortresse qu’ilz aient iamais pris, est demeuré au mesme estat en quoy ilz l’ont trouvé, car ilz ne demolissent iamais rien des edifices et en graveures[69]. »
[68] « Je ne puis empescher de dire que les Turcs ne sont pas si meschans qu’estoient iadis les heretiques », dit de Villamont, « parce que les Turcs ne prennent plaisir à ruiner les eglises, ains au contraire les retiennent pour leur servir de mosquee ou pour les vendre aux chrestiens. »
[69] Belon, fol. 90.
La tolérance turque est constatée par tous les voyageurs, même par Geuffroy, dont le désir de croisade sera évoqué dans le chapitre suivant : « Il seuffre et permet chascun vivre en ses lois et sans contraindre personne de la renyer et laisser. » « Les Turcs ne contraignent personne à vivre à la mode turquoise. Ils souffrent et permettent chascun vivre en sa loy[70]. » Lorsqu’une province est conquise, on fait la conscription des habitants, on inflige, comme seule punition de la résistance, le paiement du kharadsch ; rarement on colonise, du côté de Constantinople, puis, de même que dans le système byzantin qui n’imposait aucune règle, chacun vit selon l’ancienne coutume ; et on peut dire qu’avant le partage de la Turquie, en Macédoine, en Albanie, et surtout dans les vallées où s’étaient conservées les mœurs archaïques, on vivait un peu comme à l’époque antérieure, non pas seulement à la domination ottomane, mais encore à cette forme précédente d’Empire qu’avait été Byzance.
[70] Ibid., II, fol. 180.
On trouve aussi quelques critiques à faire, mais qui ne touchent qu’à des coutumes qui paraissent ridicules, les maisons de bois, les dégoûtants « friteaux de paste… suintant bien la vieille gresse », les « eunuques ou garde-couches »[71], l’accoutrement des délis, des « téméraires » de l’avant-garde, aux « grandes aeles faictes de tres belles plumes attachées dessus leurs espaules, comme ont ceulx qui iouent les anges à des moralitez en Europe », et au « hault diademe », « faict comme le chaperon d’une damoiselle, excepté qu’il est hault encruché », de sorte qu’ils ressemblent « proprement à un Sainct Michel en peincture »[72], ou le soupirant qui, « ayant apperceu celle dont il est serviteur, il haulse la teste et met la main à la gorge, se pinsant la peau du gousier en l’estendant un peu, luy denonçant part le signe qu’il est son esclave enchesné »[73], la mauvaise musique, assez bruyante « pour rompre la teste et les oreilles au plus gros bouvier de France »[74]. Elles ne touchent pas aux Turcs et regardent surtout les Arabes et les Maures, « les pires canailles et plus infidelles et trahitres »[75], les renégats, dont la cupidité, l’insatiabilité provoquent l’indignation des voyageurs[76]. Geuffroy prétend même que ces « presomptueux », « venteurs », « outrecuydés » gens, « lourdz, grossiers, paresseux, nonchallans », « ne vont à la guerre que par force et à coups de baston ».
[71] Postel, fol. 406-7.
[72] Ibid., fol. 18.
[73] Belon, II, fol. 189 vo-190.
[74] Ibid., fol. 183 vo.
[75] Postel, fol. jj.
[76] « Il n’y a gueres qui donnent, mais prennent volontiers » (Chesneau, ibid., p. 139-140). « Ilz ne font plaisir, mais pour argent comptant » (Belon fol. 28 vo).
Quant au sultan lui-même, à Soliman, qui lit Aristote en arabe et demande que, trois jours par semaine, on lui narre l’histoire de ses prédécesseurs, avec interdiction formelle d’en faire l’éloge, ce prince, qui est au moins aussi empereur que les Paléologues du XIVe et du XVe siècle, les voyageurs français en parlent avec une admiration qui compense ce que les contemporains et d’autres ensuite ont, bien injustement, trouvé à redire à l’action parallèle (et non l’alliance) de la France de François Ier, de Henri II et de la Turquie de Soliman, dans le but d’empêcher un événement plus imminent et plus dangereux que l’existence d’un État ottoman en Europe, je veux dire l’impérialisation de l’Europe par Charles-Quint et la destruction de ce sentiment de noble liberté qui anime l’œuvre des grands voyageurs français du XVIe siècle[77].
[77] Voir surtout le beau portrait de Soliman par Geoffroy : « Long de corps, de menuz ossemens, maigre et mal proportionné, le visage brun et bazanné, la teste rase, fors un touppet de cheveulx au sommet, le front élevé et large. »
Nous avons remarqué, au cours du XVIe siècle, une curiosité passionnée, un désir d’apprendre, une spontanéité d’attention et de sentiment, un fourmillement d’individualités différentes dont chacune considère l’Orient à sa façon ; on ne rencontrera plus guère tout cela pendant le siècle suivant.
Celui-ci est grand à d’autres points de vue. Il a créé une langue littéraire à peu près définitive ; il a fait la gloire d’une royauté qui n’a pas manqué d’attirer sur elle toute la lumière et de se parer de tout le prestige. Mais cette royauté a un peu amoindri l’élan de la nation ; ainsi à ce domaine de la connaissance de l’Orient, on ne trouve qu’un intérêt de plus en plus faible ; avant 1600 déjà, l’importance des rapports entre la France et l’Empire ottoman allait en décroissant, à cause des guerres de religion.
La forte personnalité d’un d’Aramon, accompagnant le sultan Soliman en Perse avec toute une cour, sa grande influence dans le monde turc, son don tout spécial d’attirer autour de lui tout un monde de voyageurs, se prévalant de l’ambassade, mais ajoutant eux-mêmes à la valeur politique de cette ambassade leur élan de chercheurs et leur qualité d’écrivains, ne se rencontrera plus à l’ambassade de Constantinople.
Les ambassadeurs qui ont représenté les rois de France à l’époque de ces guerres civiles vivent dans des conditions difficiles, souvent humiliantes. A l’époque de Soliman, on ne se serait pas permis, à l’égard du représentant de celui qu’on appelait le padichah, l’« empereur » de France, les gestes qui sont coutumiers vers 1560, jusqu’à l’époque de Henri IV, et même pendant le règne de ce restaurateur du pouvoir monarchique qui n’a pu rétablir l’ancien prestige de la France dans la capitale des Ottomans.
Si les ambassadeurs vivent dans des conditions très modestes, s’ils doivent recourir parfois aux expédients, façon de vivre qui nuit essentiellement à leur prestige, il est vrai qu’il n’y a pas de voyageurs pour le constater : les chercheurs d’aventures en trouvent ailleurs que par ce voyage d’Orient ; le drame qui se joue en France même y retient les grands tempéraments et les grandes hardiesses, de sorte qu’il faut arriver jusqu’au commencement du XVIe siècle pour reprendre la série de nos voyageurs[78].
[78] Le pauvre « bourgeois de Paris », Antoine Regnault, qui fit imprimer à Paris, en 1573, son « Discours du voyage d’Outremer », est un simple porteur de bourdon, qui, en dehors de son souci de pèlerin, ne s’occupe que de la « medicine contre gli pidocchi » qu’on était occupé en voie « à tuer et jetter en mer ».
I. — Les premiers que l’on trouve sont bien modestes, mais, parfois, plus intéressants dans leur naïveté, dans leur charme, dans leur sincérité, que ceux qui vont suivre. Mais, entre ces voyageurs et leurs prédécesseurs du XVIe siècle, il y a une différence : autant, pendant le XVIe, l’attrait religieux du voyage s’est effacé (on ne s’arrête aux lieux de pèlerinage que parce que c’est la coutume, parce qu’il y a toujours quelque capucin, quelque cordelier qui attire l’attention du voyageur sur les reliques qu’il faut nécessairement visiter et qu’il est séant de révérer), autant, au commencement de cette nouvelle époque, à l’intérêt pour les curiosités littéraires, artistiques et même scientifiques, vient s’ajouter un renouveau d’intérêt pour les choses pieuses, une reviviscence du catholicisme et, de plus en plus, sous l’égide des Pères Jésuites. On va entreprendre le voyage en Orient comme, jadis, au moyen âge, comme au XIVe siècle, pour visiter les Lieux Saints et les places de pèlerinage : on va donc se diriger surtout vers Jérusalem et l’Égypte.
Des régions d’Europe soumises au sultan, on ne voit qu’une faible partie : ce qui se trouve sur la route de l’Adriatique à Constantinople, ce que l’on peut observer dans les îles. Les pèlerins se permettent de temps en temps une petite excursion du côté de ces îles, mais l’attention se reporte principalement sur la Palestine et ses dépendances égyptiennes. De ce côté, on va à Alexandrie, à Rosette, à Damiette, on descend jusqu’au « Grand Caire », on explore, à la façon des touristes d’aujourd’hui, le cours du Nil, on décrit les Pyramides, on passe quelquefois du côté du mont Sinaï pour voir le couvent de Sainte-Catherine. Vers la foi naïve qui fait le charme du moyen âge se tourne de nouveau l’esprit de nos voyageurs.
Suivons-en quelques-uns, jusque vers 1630, avant de nous attacher à ceux qui ont des buts politiques, et sont de nouveau, en relation avec l’ambassade de France à Constantinople. D’ailleurs, chez ceux-là aussi, la préoccupation religieuse domine : elle est à la base de la politique courante, car la France est protectrice de tout le monde catholique d’Orient, de ce monde des îles de l’Archipel, de Péra et des Lieux Saints, qui s’appuie avant tout sur le prestige nouveau de la royauté française, d’un Louis XIII et, surtout, d’un Louis XIV.
Voici, dès le commencement du XVIIe siècle, un Parisien, « chevalier de l’ordre du Saint-Sépulchre de Nostre Seigneur » ; ces chevaliers étaient sacrés à Jérusalem même, d’après de très anciens statuts que nous connaissons. Le sieur Benard fait en 1600 un pèlerinage qu’il publie en 1621, avec un portrait. Le livre ne contient rien d’intéressant sinon tel rappel des croisades, où il est question du « genereux et vaillant Godefroy de Bouillon », que les visiteurs de l’Orient, au XVIe siècle, avaient totalement oublié. Il a eu des rapports avec de Brèves et était de son ambassade[79].
[79] P. 338 et suiv., 343-344.
Suit le voyage à Jérusalem d’un moine, Henri Castella, « Tholosain, religieux observantin », voyage publié à Bordeaux en 1603[80]. Il n’est remarquable ni au point de vue de l’information, ni à celui du style, mais çà et là, on peut y glaner des connaissances qu’on ne trouverait pas ailleurs, comme les premières notes sur les Maïnotes, ces prétendus descendants des anciens Lacédémoniens, quelques milliers de Grecs vivant près de la pointe de la péninsule moréote et arrivés à échapper à la condition de raïas, de sujets absolus du sultan, à laquelle sont soumis les autres Grecs.
[80] Le Sainct Voyage de Hierusalem et Mont Sinay, faict en l’an du grand iubilé, 1600…, par le R. P. F. Henry Castella, Tholosain, religieux observantin.
Il a des comparaisons qui valent mieux que le style si châtié des voyageurs de la seconde moitié du XVIIe. Ainsi il nous présente les Maïnotes plus « chargez d’armes qu’un hérisson d’espines ». Ailleurs, lorsqu’il s’agit de la façon d’annoncer l’arrivée du convoi de condamnés au pal, en Égypte, le moine évoque le « cornet semblable à ceux que portent les pasteurs en Gascogne pour se faire entendre l’un à l’autre ».
A part ces quelques trouvailles de langage, à part une réminiscence antique à propos de Troie (« c’est la ville, dit le moine, qui a esté autrefois partie de la gloire du monde »), on ne retiendra qu’une belle description de Raguse : il nous montre cette petite cité de la côte adriatique vivant maintenant d’une vie qui n’est plus celle de l’Italie voisine, car un esprit slave ou, pour employer la langue du temps, un esprit esclavon s’y forme : le voyageur, qui a été appelé à dire la messe, déclare que, ne pouvant pas employer, après le latin, le slavon, il a fallu avertir les fidèles, car autrement il y aurait eu du scandale dans l’église. Les femmes sont « familières à tout le monde » comme en France, et « dissolues » seulement quant au vêtement. Quant aux hommes de Raguse, ils sont « habillez à la vénitienne », sauf les manches, qui sont moins larges, portant des manteaux longs jusqu’aux talons, avec la bonnette comme les nobles de Venise.
La relation journalière du voyage du Levant, « faict et descrit par haut et puissant seigneur Henri de Beauvau », volume publié à Nancy en 1615, mais fait en 1604-1605, a déjà un intérêt politique : Beauvau, qui est noble, n’a pas seulement les préoccupations purement religieuses de son prédécesseur, il pense aussi à l’activité de l’ambassadeur de France à Constantinople, à cette époque, de Brèves, puis Salignac[81]. Il décrit l’audience que donne à l’ambassadeur le sultan, nous renseigne sur les antiquités, la cour ottomane, l’armée. Les directives sur l’action nouvelle de la diplomatie française, chargée de défendre les intérêts de la religion apostolique et romaine en Orient, se trouvent notées dans ce voyage.
[81] Note 3 de la p. 35.
La même année, était publié à Paris anonymement un Pèlerin véritable de la Terre Saincte, dont je n’ai vu que la seconde partie, reliée dans l’exemplaire de la Bibliothèque nationale de Paris au récit d’Antoine Regnaut : le permis d’imprimer porte la date du 2 janvier 1615.
Avec des notes sur Constantinople (où le voyageur est guidé par un moine), sur le sérail, les « eunuques et gardes-couches », il y a toute une série de paragraphes d’un grand intérêt sur les « bastelleurs et charlatans », sur les coutumes de droit, sur la nourriture et la boisson, le vin étant qualifié de « pissat du diable », sur les officiers de l’Empire, sur le clergé musulman, sur l’armée ou la marine du sultan « Acmet ou Mecmet »[82], etc. Le Parisien fait des observations sur les Turcs qui correspondent à celles des grands voyageurs de l’époque précédente. Mettant toujours en regard les défauts de la société chrétienne, le « pèlerin » présente les sujets de l’empereur ottoman comme des gens calmes : « Les plus grandes inimitiez d’entre eux se terminent à beaux coups de poing, posant les armes bas, qu’il faut réserver, disent-ils, contre les chrestiens ennemis de leur loy ; pour les cartels de deffy, il n’y va que de la teste à qui en fait la première ouverture. Ha, que n’en faisoit de mesme en nostre France : nos affaires iroient trop mieux, et n’y verroit-on pas regner tant de malheurs » ; il signale leur bonne hygiène qui leur fait chasser hors de la ville les tanneurs ; leur excellente discipline d’armée ; les punitions inévitables devant frapper quiconque « s’escarte tant soit peu pour aller voller et picorer au village », leur prompte justice, « sans aucun advocat et prolongeur de cause ». Et, traitant durement cette « canaille retaillée », ces « esclaves maladroicts aux armes qui, combattans en chemise, comme ils font, on en faict littiere dans les champs de bataille », il ne croit pas à l’avenir d’un État « bigarré de toutes sortes de religions : aussi se verroit-il à la necessité de caller voille, s’il estoit serré de près ». Il ne faudrait à la chrétienté qu’un grand effort, se réveillant du fatal « sommeil d’airain », pour marcher sous « l’authorité pauline » du pape Paul II, qui donnerait l’épée au roi de France « contre les Ottomans déchus ». « Ha ! que nous sommes froids, s’écrie-t-il avec indignation, et stupides au respect de nos adversaires et de toutes autres notions à nous ressentir d’une honteuse iniure[83]. »
[82] Agé de vingt-huit ans, il est « vaillant et cruel ».
[83] P. 523 et suiv.
II. — Puis, un quatrième voyageur, dont les descriptions sont plus variées et dont la préface elle-même est curieuse[84]. C’est un pèlerin pittoresque et poétique que le père Boucher, mineur observantin.
[84] Dans la préface : « La cause de mon dessein fut la curiosité, la fin de me rendre plus capable de servir mon prince. »
Le religieux a publié ses souvenirs sous ce titre : « Bouquet Sacré, composé des plus belles fleurs de la Terre Sainte ». Dès le commencement, le voyageur, qui publie son récit de pèlerinage en 1620, introduit des éléments de couleur et de pittoresque qui ne sont pas coutumiers dans ces récits. On le voit sur son vaisseau, en compagnie d’un pèlerin russe, et il rapporte même la prière slave de ce dernier qui, pendant tout le voyage, répète « miloï hospodi », et dans celle d’un camarade musulman : « un demy-More, Turc, tout pouilleux, à la barbe fourchue, rude, droicte, confuse et meslée de rouge, de blanc et de noir » ; il parle de « demarches semblables à celles d’un senateur de Venise quand il va au Palais de Saint-Marc ».
Le père raconte la chasse aux crocodiles et expose les mésaventures de tel Anglais dérobé par ces « canailles d’Arabes ». Et, lorsque, en Égypte, aux « campagnes fromenteuses, blondissant d’espics », il est poursuivi par les enfants musulmans, il trouve des expressions charmantes pour se dire assiégé par « ces petits fripons égyptiens…, comme un essaim d’abeilles sur un rameau fleury ou comme un troupeau d’estourneaux dans une aire froumenteuse ».
Il n’a jamais échappé, du reste, à ses avanies et, pendant son voyage de Terre Sainte, le pauvre fut sans trêve poursuivi par « l’insolence arabesque, compagnie sauvage et tigresse, desquels l’un, en se jouant, me donnoit un soufflet, l’autre, en riant, me tiroit la barbe, l’autre, en s’esbatant, m’abatoit mon bonet et le remplissoit de saletez, l’autre, pour passer son temps plus ioyeusement, me crachoit dans les yeux, l’autre, pour eviter oysiveté, me donnoit quelques coups de baston, de pierre ou de pied, et les autres, pour passer leurs fantaisies, me disoient mille poltronneries, m’appelant… ennemy de Dieu, pourceau, traistre, meurtrier, volleur, meschant, excommunié, infame, maquereau, bastard, chien chrestien ». Il fit donc le voyage dans ces régions de souvenirs sacrés, « tousiours chargé de quelque coup de baston, de pierre ou de poing, ou coiffé de quelque soufflet, ou voilé de quelques crachats dans la face »[85].
[85] P. 587-589.
Il y a quelque mérite, comme on le voit, à faire de cette façon le voyage de Jérusalem. Du reste, le franciscain dénonce, d’après une révélation du secrétaire de l’ambassadeur de Brèves, le noble Hongrois qui recommandait aux Turcs d’amener à composition les Occidentaux catholiques en interdisant formellement le pèlerinage[86].
[86] Note 1 de la p. 36.
III. — Nous trouvons aussi à cette époque la première Histoire de l’Empire ottoman rédigée en français, et assez convenablement : c’est celle de Michel Baudier[87]. Ce Languedocien paraît avoir visité lui-même Constantinople, puisque son « Histoire de la Cour du roy de la Chine », publiée à Paris en 1624, comprend, dans le même petit volume, une « Histoire du sérail et de la Cour du Grand Seigneur, empereur des Turcs »[88]. L’auteur est, du reste, comme, en 1564 déjà, Antoine du Pinet, auteur des Plantz, Pourtraitz et descriptions de plusieurs villes et forteresses, tant de l’Europe, Asie et Afrique que des Indes et Terres Neuves, un prôneur de l’idée de croisade, qui, sous la conduite du roi de France, peut facilement chasser les Turcs « iusques dans la Scythie, d’où ils sont sortis pour servir de fléau aux chrestiens »[89].
[87] Inventaire de l’histoire generale des Turcz… jusques en l’année 1617, tiré de Chalcondile, Athenien, Paul Jove, Lenuclavius, Lonicerus et aultres, avec la mort et belles actions de plusieurs chevaliers de Malte et aultres gentilhommes et seigneurs francois par cy devant obmis, adioustez par le mesme autheur, Paris, 1617.
[88] Un paragraphe s’occupe des « amours du grand Seigneur » (p. 44 et suiv.).
[89] P. 840-841.
Beaucoup d’événements contemporains sont bien rendus ; on a parfois l’impression d’entendre un témoin oculaire. On peut donc admettre que les renseignements qui se trouvent, aussi bien dans l’« Histoire » que dans cette description du sérail du sultan, sont dus à un visiteur de la Turquie d’Europe. Baudier a eu, lui aussi, des rapports avec l’ambassade de France à Constantinople : à un certain moment, il raconte l’aventure d’un gentilhomme placé auprès du nouvel ambassadeur, M. de Sancy, qui, abordé par une femme turque et se refusant à une entrevue qu’il juge dangereuse, en subit des conséquences désagréables[90].
[90] Histoire du Sérail, p. 150-151 ; cf. Inventaire, p. 611. Sur de Brèves, Inventaire, p. 722-723.
Enfin, avant l’époque des voyages que nous pouvons appeler politiques, voici un autre religieux, un carme déchaussé cette fois, dont l’œuvre a été publiée, d’abord en latin, puis en français par un autre moine, sous le titre de « Voyage d’Orient du Reverend Père Philippe de la Tres Saincte-Trinité », en 1669. Mais le voyage lui-même est de beaucoup antérieur : de 1629-1630.
Ce voyageur, qui est accompagné par un Italien élevé à Avignon, s’excuse, dans la préface, d’avoir écrit un livre de cette sorte, à une époque où il y a des « exercices plus sérieux que n’est celuy d’écrire un Voyage d’Orient, mais il ajoute qu’il a vu lui-même presque toutes ces choses qu’il rapporte », et, en étant prié par « certaines personnes de la fidelité desquelles il ne pouvoit douter sans temerité », il a été amené à décrire un voyage qui s’étend jusqu’à « Babiloine », donc jusqu’à Bagdad, jusqu’à Ispahan, jusqu’aux Indes. Il semble que l’exemple du livre de Belon, au XVIe siècle, lui a suggéré l’idée d’écrire de petits chapitres sur des sujets d’histoire naturelle. Il y en a sur les rivières, sur les quatre monarchies, sur les mœurs des chrétiens d’Orient, sur les Grecs et les Nestoriens, sur les martyrs de l’ordre des Jésuites (avec portraits), et sur toute sorte de sujets qui ne se rapportent qu’indirectement à celui du pèlerinage.
Nous arrivons maintenant, vers 1630, aux voyageurs qui poursuivent des fins politiques ; le premier de ceux-ci qui furent en relations avec l’ambassade de France à Constantinople dit très nettement quelles sont ces fins.
Au commencement du XVIIe siècle germe l’idée — à laquelle on n’assigne d’ailleurs aucune base sérieuse — que l’Empire ottoman est en décadence depuis l’époque de Soliman. Quelle serait donc l’origine de cette décadence ?
Soliman, ayant des filles mariées, donc des gendres, a cherché à créer pour ceux-ci de grandes situations, et, suivant leur exemple, d’autres favoris du sultan ont accaparé les provinces ; ils y ont introduit des exactions qui n’existaient pas auparavant, ils ont mécontenté leurs sujets chrétiens, et, en même temps, ils ont amené une diminution de la valeur de l’armée.
Ainsi le malaise de l’État ottoman, qui nous est tant de fois attesté au XVIIIe et au commencement du XIXe siècle, était déjà bien diagnostiqué par ces voyageurs du commencement du XVIIe. Mais ils n’en trouvent pas l’explication, cette explication que leurs prédécesseurs du XVIe avaient su fixer avec tant de netteté : il y a deux sociétés turques, qui ne se ressemblent pas, ou, pour mieux dire, il y a une société turque à côté de la société ottomane, une société turque qui descend, comme on l’a vu, des anciens Turcomans, pasteurs, agriculteurs. C’est la société qui travaille, qui vit d’une façon modeste, qui perpétue encore les vertus des ancêtres. Et cette société n’est pas encore complètement remplacée par la société dominante ; ce n’est que pendant le XVIIe siècle, que celle-ci arrivera à tout accaparer ; et ceci, sans que de nouveaux renégats viennent lui apporter un sang vivace. Ce n’est qu’alors que les renégats dominent, eux qui n’apportent que des vices, et, d’abord, ceux de la défaite et de l’esclavage. Ces vices ne sont pas d’origine chrétienne, ni même inhérents à la race slave ou à la race grecque. Cette même race slave, cette même race grecque, vivant dans la liberté, agissaient bien autrement et se présentaient d’une tout autre manière au jugement des moralistes. Tandis que, aussitôt que ces races eurent été abaissées par la défaite et démoralisées par l’esclavage, certains de leurs représentants, qui voulaient devenir vizirs, pachas de l’Empire ottoman, se convertissent ; cela ne contribue guère à diminuer ces vices dus à la façon de vivre de la nation entière après la conquête turque.
Devant cette décadence ottomane, l’idée de croisade se réveille. Dès la fin du XVIe siècle, elle commence à gagner des adhérents dans cette société française, qui n’est plus occupée par les guerres de religion. On forme même le grand projet de créer, pour le duc de Nevers, dont le traducteur de Calcocondyle, Blaise de Vigenère, montrait les droits, multiples, à la couronne de Constantinople, dès 1577[91], un empire de Constantinople ; les agents de ce prince franco-italien descendant des Paléologues traversent les Balkans, se mettent en relation avec les Albanais et avec d’autres peuplades de la péninsule ; ainsi, quelqu’un qui fut plus tard prince de Moldavie, Gaspard Gratiani, a été de ceux que la propagande faite pour la croisade de Nevers avait momentanément attirés.
[91] En latin à la fin des De rebus turcicis commentarii duo accuratissimi Joachimi Camerarii, Pabepergensis, a filiis nunc primum collecti ac editi, Francfort, 1598, p. 94 et suiv.
Un Brèves, un Salignac, plus tard un troisième ambassadeur de France, Sansy, un quatrième, Marcheville, dont le voyage à Constantinople (1631) a été publié dans le Mercure de France de l’an 1633[92] (mais celui-ci, envoyé expressément pour renouveler « l’alliance de la France envers le Grand Seigneur », se place au point de vue de la protection des chrétiens catholiques en Orient, auxquels il apparaît en protecteur comme à Chio), s’imagineront pouvoir provoquer un mouvement occidental, destiné à délivrer les Lieux Saints et même à faire disparaître l’Empire ottoman.
[92] XVII, p. 806 et suiv. Avec lui aussi un « sieur Belon, très expérimenté en ces mers ».
La correspondance de Jean de Gontaut-Biron, baron de Salignac, de 1605 à 1610, a été publiée par un de ses descendants, en deux volumes, à Paris, en 1889[93].
[93] Ambassade en Turquie…, Paris, 1889 (Journal de Dangus et lettres dans les Archives historiques de la Gascogne, XVIII et XIX).
Elle se rapporte surtout aux événements politiques sans nous donner d’aperçus de caractère général, ni de jugement sur la société ottomane. Autant les faits y sont nombreux, autant l’utilité d’information de cette correspondance est grande, autant elle décevra ceux qui recherchent ces deux éléments essentiels : l’attitude du voyageur à l’égard de l’Orient, la situation même de l’Orient.
Le secrétaire de Salignac, qui devait mourir en 1611 de la douleur d’avoir perdu son maître royal[94], Angusse, a cependant raconté brièvement ce voyage, encore inédit, sauf des fragments introduits çà et là dans l’ouvrage que nous venons de citer[95] ; il y a ajouté quelques actes diplomatiques, deux anecdotes et un journal précis, mais sans valeur littéraire.
[94] Il écrit au roi que Henri IV, au ciel, « prie sa divine bonté de vouloir me retirer de ces miseres et que ie luy aille tenir compagnie » (ms. cité dans la note suivante, fol. 326 vo).
[95] Premier volume, comprenant le « Voyage à Constantinople, séjour en Turquie », Paris-Auch, 1888. Le manuscrit porte le no fr. 1192 à la Bibliothèque nationale.
Un négociant, François Arnaud, qui avait déjà fait le voyage d’Athènes et de Constantinople en 1602, rédige une autre série de notes en 1605. A Athènes, il charge des marchandises sous les « estatues de marbre » ; ailleurs il reconnaît la capitale de « la belle Hellayne », jusqu’à ce que, à l’audience de Salignac, ce nouvel ambassadeur, il voit « le grand seigneur… assis avecq les jambes en croix, apuyé sur ung cuissin tout enrichy de pierreries et à son turban pourtoict deux panaches d’heron, ayant ung petit poignard à sa ceinture, le fourreau d’or gravé tout de pierreries »[96].
[96] Publiée par M. Omont, dans le Florilegium Vogüé, Paris, 1909, p. 462 et suiv.
Mais le meilleur récit des aventures de cette mission diplomatique, qui finira d’une si triste façon, avec tous les spectacles qui se présentent à ses yeux, avec tous les incidents qu’elle provoque, toutes les splendeurs qu’elle rencontre et toutes les offenses et souffrances qu’elle subit, nous est conté par le bonhomme Bourdier, Périgourdin, grand amateur de lévriers, de chaïns et ispirits, c’est-à-dire faucons et gerfauts, de délassements, d’excursions, de risques et de périls, qui, longtemps après la perte, profondément ressentie, de son maître, écrivait à Alep en 1626 ses souvenirs dont il n’entend pas refréner l’abondance. On les voit, ces « diplomates », descendant à Venise par « Minquen » (München, Munich), Bolza (Bolzano) et sur l’Athèse (l’Adige) à Venise, magnifique jusqu’au détail de son « artificieuse orloge », de sa « Seque » (la Zecca), de son Bucentaure comme « celuy d’Argos des Argiens ». On s’embarque à Venise, on passe par Raguse, où l’on est accueilli par le résident de France, Nicolas Bourdin, « et un banquet avec des excellents vins » dans « certain grand vase d’estin », — « et il n’y eust nul de nous qui ne se ressenty de la teste ou du soupé », puis, au bout, on atteint Milo, où la « canaille de Grecs » est durement traitée, l’ambassadeur devant faire évêque de cette île son aumônier, Hesdos. Chio est un merveilleux endroit, rappelant les jardins d’Amadis des Gaules. L’« incomparable et naïfve beauté » de femmes « acortables » autant que belles rend prisonnier tout ce petit monde de pèlerins. Il y a dans les « gentilles maisonnettes », pendant des journées entières, l’accord des « musettes, hautbois, fluttes, timballes, tambours de basques et autres instruments » ; on danse sous les orangers comme aux « carolles des festes de village de Beauce » et on fait des « mimeries et mascarades », — celle-ci étant dans ce domaine, parmi toutes les nations, la « superlatifve ». Les dames et demoiselles de ces îles fortunées portent un costume comme celui des statuettes crétoises, les hommes ont « la cape », le « manteau en escharpe » de leur patrie génoise et, les étrangers au milieu, caressés et flattés, on tourne dans « un branle clos et rond », « façon de gavotte ou serebante…, avec tant d’agileté et galantise qu’en France, où la dance est au periode de sa perfection ». Comme si on avait su les goûts du seigneur français et de sa suite, ils sont accueillis à Abydos par des Turcs amenant « trois laisses de levriers » et un cheval : aussi courra-t-on à loisir par les campagnes phrygiennes. Les ambassadeurs, Lello, l’Anglais, Ottaviano Bon, le Vénitien, les officiers impériaux s’empressent autour des nouveaux venus, et le bon Périgourdin assiste à l’audience solennelle de l’envoyé du roi chez ce sultan qui « ne se mouve non plus qu’une statue ». Cependant on délivre des captifs français, on installe les jésuites, on protège tous les moines catholiques, mineurs de l’Observance, de Sainte-Marie, jacobins de Saint-Pierre, Pères de Saint-Antoine et ceux de Saint-François[97] ; on visite même le patriarche Néophyte, « homme très humble et de belle prestance »[98], dont la messe est troublée par la présence opiniâtre du chien de l’ambassadeur, « fort beau chien » ; on court le lièvre, on joue aux échecs et aux cartes, « à la barrette » et « quelqu’autre jeu » ; on fait des excursions, mais pas aussi loin que celle que Baudier risque à Trébizonde et même chez les Tatars, jusqu’en Géorgie, en Mingrélie, et enfin à Erzéroum. Jusqu’à ce que la triste « melancolie » de Salignac mène toute la compagnie, y compris le « jeune medecin parisien » Du Vivier, devenu huguenot en Angleterre et vivant sous la protection de l’ambassadeur anglais, aux bains de Brousse, « ou plustôt d’Yalovve », d’où l’ancien camarade de Henri IV revint mourant ; son frère récemment converti à la foi catholique, de Carlat, devant le suivre au tombeau[99].
[97] P. 122.
[98] Bibl. nationale de Paris, fr. 18.076, p. 112 et suiv.
[99] Théodore de Gontaut-Biron n’a donné dans son ouvrage qu’une partie du récit qui se trouve dans ce ms. 18.076 de la Bibliothèque nationale de Paris.
Le manuscrit, de proportions énormes, qui contient aussi le récit d’un pèlerinage ultérieur en Terre sainte, en Égypte, à Sainte-Catherine du Mont Sinaï, abonde en renseignements des plus variés et très souvent du plus haut intérêt quant à l’armée turque, sa composition, son ordre de bataille, sa discipline, ses gendarmes, voleurs et ses plaignants qui pleurent sur ses traces, puis l’approvisionnement, la valeur des armes, le montant des revenus de l’Empire, les ordres mendiants, les distractions des Turcs : « basteleurs et filles baladines, salanjacs ou brandilloires, roues tournantes, jeux du dard, marettes, échecs, réunions ou toman hanés » où « chascun dit ou raconte nouvelles en beuvant le cavé, ils seront deux ou trois cens ensemble à caqueter…, prenant le tabac et parfums, au son de plusieurs instruments ». Les Grecs d’à présent, les Juifs ont aussi leur part, ainsi que le régiment français passé, de Hongrie où on ne paye pas les soldes, au service du sultan, qui les envoie jusqu’à Trébizonde. Des chapitres entiers forment une vraie chronique, très circonstanciée et absolument digne de foi, de cette époque de crise de l’Empire ottoman.
Un jésuite de l’école de Saint-Benoît, Canillac, prend, lui, des notes journalières. Il est émerveillé comme les voyageurs du XVIe siècle, de la discipline ottomane, « les soldats estant avec tant de modestie et de silence que vous eussiez dit estre plus tot celles d’anachorettes que retraicte de gens de guerre », et dans le divan du vizir « l’on parle si bas, voire quand le Bacha n’y est pas, que c’est chose digne de marque »[100]. Dans ses lettres, écrites aussi au nom de ses camarades Gobin, Levesque, Colomb, on voit les discordes de l’Église grecque, le changement des patriarches, si appauvris par ces rivalités que celui de Constantinople a engagé sa mitre, puis les cérémonies impériales, le travail à l’école qui réunit aux enfants des moines grecs. Après lui, Louis de Moranvilliers, docteur de Sorbonne, François Blaireau, fondateur, avec l’aide de « Benizelos, fils de Demitri », d’un Mavroïeni et d’autres, de Turcs mêmes, qui prisent cet « astrologue », de la Maison de Chalkis et de celle d’Athènes, en 1642, envoient des rapports qui sont de véritables récits de voyage.
[100] Relations inédites des missions de la Compagnie de Jésus à Constantinople dans le Levant au XVIIe siècle, publiées par le P. Auguste Carayon, Paris, 1864.
Ce n’est qu’en 1628 qu’on publiait à Paris la Relation des Voyages de M. de Brèves tant en Grèce, Terre Sainte et Égypte, qu’aux royaumes de Tunis et Alger.
Cette fois, nous trouvons dans ces notes concernant une ambassade de vingt-deux ans, jusqu’à ce que le nouvel envoyé arrive en 1605, l’idée de la croisade très clairement exprimée par le prédécesseur de Salignac, et avec une conviction profonde. Il n’y a, bien entendu, plus rien de l’enthousiasme sentimental du moyen âge, mais, rarement l’idée de la possibilité d’évincer les Turcs a été exprimée d’une façon plus énergique et plus logique que dans ces voyages de de Brèves. On trouve, dans ce petit volume, dont la partie descriptive (Troie, Chypre, Lieux saints, Égypte) n’a aucune importance, tout un chapitre qui s’appelle « Discours abbrégé des asseurez moyens d’aneantir et ruiner la monarchie des princes ottomans ». La charge de remplir cette fonction est attribuée, naturellement, en première ligne, à la France.
Le secrétaire de de Brèves, qui vivait dans l’atmosphère de l’ambassadeur et partageait ses vues, est absolument sûr que l’Empire ottoman est condamné, que rien ne peut le sauver, qu’il faut s’empresser de saisir un rôle et de prendre une place dans ce qui se prépare. « Tout y est vendu et donné au plus offrant, voire mesmes jusques aux offices les plus vils et petits. Ils font des concussions insupportables sur le peuple. »
Dès le règne de Soliman a commencé la décadence. Il faut donc appeler les sujets chrétiens à la lutte de délivrance, se saisir du Danube, gagner des janissaires, fils de chrétiens, allécher les anciens ennemis qui sont les Persans, les Géorgiens, pendant que le roi de Pologne et tous les « princes de l’Empire » marcheront de leur côté[101].
[101] Mais aussitôt après on lit un « Discours sur l’alliance qu’a le Roy avec le Grand Seigneur et de l’utilité [du commerce, de protection de la foi catholique] qu’elle apporte à la chrestienté ».
Dans tout ce récit, qu’y a-t-il qui corresponde à la réalité ?
L’activité impériale de Soliman a été si vaste et s’est étendue de tant de côtés, — expéditions d’Asie contre les Persans, attaque contre Rhodes et contre l’île de Malte, incursions en Hongrie, conquête de la capitale du royaume, Bude, expansion ottomane de l’autre côté de la Tisa vers la Transylvanie, soumission définitive de la Moldavie, pénétration en Autriche jusqu’à Vienne, — qu’on peut se rendre compte qu’une société disposant même de moyens militaires aussi importants que ceux qui existaient à Constantinople à cette époque a dû dépasser ses forces. C’est donc la dépense des forces ottomanes à cette époque, plus que la corruption, qui a déterminé un ralentissement d’activité.
Et puis il y a un autre élément que les voyageurs n’apercevaient pas : dans cet empire où il y avait un maître d’hommes, où tous étaient légalement ses esclaves, se trouvant sur le même plan, bien qu’ayant toutes les perspectives d’avancement démocratique et pouvant commencer par des fonctions manuelles pour finir, soit comme grand vizir, soit de mort naturelle ou bien plutôt, étranglé entre deux portes : dans cet empire, dont tout dépend du maître, le seul homme libre, lorsque ce maître ne monte plus à cheval, lorsqu’il ne fait plus lever les drapeaux (à la date de la Saint-Georges qui, à l’époque ottomane comme à l’époque byzantine, représentait le commencement de l’année militaire), lorsqu’il boit et mange dans son sérail, où il s’entoure d’esclaves et de favoris, laissant le pouvoir, de fait, entre les mains des femmes, lorsqu’on a des sultans de l’espèce d’un Sélim qu’un voyageur allemand présente comme mourant par suite de ses excès de mangeaille et de boisson : « il a mangé trop de saucisses de mouton et a versé trop de vin sur son repas » ; comme Mourad, le second successeur de Soliman, pauvre épileptique qui ne peut pas sortir à la tête de ses armées, — le ressort unique de cette société ne fonctionne pas. Une société plus centralisée que n’importe quelle autre, puisque dépendant de la volonté, des talents, de la discipline d’esprit d’un seul homme, fléchit lorsque cet homme n’est pas capable de remplir sa mission.
Dans la suite d’un nouveau diplomate, Des Hayes, envoyé pour contrecarrer à Jérusalem l’usurpation des autres confessions et y installer un consul, ainsi que pour amener la réconciliation turco-polonaise, acheminée, voici un anonyme qui signe « le sieur D. C. » : son voyage a été publié à Paris en 1624, sous le titre de « Voyage du Levant fait par le commandement du roi ».
Il s’excuse d’avoir publié ses mémoires : « Je n’ay que trop vescu parmy ceux qui se meslent d’escrire pour ne pas apprehender les peines que ceste sorte d’exercice traine continuellement avec soy. » Et, tout en s’excusant ainsi de donner encore un ouvrage sur l’Orient, il ajoute qu’il le fait « sans vanité », qu’il n’a pas l’intention d’« ennuyer » les lecteurs de « choses vulgaires et cognues de tout le monde ».
On trouve, çà et là, les détails nouveaux qu’il promet[102], mais le point intéressant de son récit est que, pour la première fois, un voyageur insiste largement sur l’importance de l’élément catholique parmi les chrétiens d’Orient.
[102] Sauf la mention des efforts de la diplomatie française pour faire oublier l’attaque contre les Turcs d’un Virginio Orsini : de 50-60 Turcs qu’il y avait auparavant on en compte cependant 4.000 (p. 273-274, 312).
Si les renseignements du secrétaire de Marcheville sur Chio, où dorénavant les capucins mentionneront à la messe le nom du roi, ne sont pas continués l’anonyme ne se gêne pas, comme Postel, dans le passage sur les Albanais, pour copier des vieux voyages :
« Je me suis esloigné tant que j’ay pu de ceux qui ont escrit devant moy sur ce sujet, sans m’éloigner pourtant de la vérité. »
Il ne parlera ni des Lieux saints, ni de l’antiquité, ni de la nature, mais du « gouvernement des provinces et des estats », de « l’importance des villes », des « interests des princes ». Lorsque le nouveau voyageur, qui prend la voie de l’Allemagne, arrive à Péra de Constantinople, il rappelle aussitôt l’activité de cet ambassadeur de France, Marcheville de Césy, qui a eu des rapports jusqu’avec les princes roumains de Bucarest et de Jassy, auxquels il envoyait des moines dont la mission était d’amener à la confession catholique ces orthodoxes du bas Danube[103].
[103] Voy. nos Actes et fragments pour servir à l’histoire des Roumains.
Il est question aussi du rôle joué par cet envoyé à l’égard de la profonde transformation de la foi grecque qu’avait préparée l’ambassadeur des provinces unies de la Hollande, Cornélis Haga. A un certain moment, les calvinistes ont cru gagner l’Église orthodoxe, rêve qui se poursuit encore, et un grand patriarche, le plus grand d’entre eux et peut-être le premier des nationalistes représentant les souvenirs et les aspirations de la nation grecque, Cyrille Lucaris, dont une partie de la correspondance est conservée à Genève, avec laquelle il a été en rapport, avait publié un catéchisme nettement réformé. Contre cette tendance de l’orthodoxie grecque vers la Réforme calviniste s’est levée l’ambassade de France, avec Césy qui, tout en soutenant, en même temps, les catholiques à Jérusalem, est arrivé à faire disparaître cet ennemi de l’influence catholique qu’était le patriarche.
Notre voyageur, parlant de cet incident si important dans la carrière diplomatique de Césy, donne des chiffres sur l’élément latin à Constantinople et dans l’Empire et montre, ce qu’aucune source ne dit et ce qui a un certain intérêt, l’habitude du clergé grec de faire des études chez les jésuites. Il remonte dans son exposition jusqu’à de Brèves, qui était arrivé à arracher aux Turcs l’église de Saint-François, devenue déjà mosquée. On voit ce secrétaire ou homme de suite accompagner le ministre du roi de France à Jérusalem, où ils font une entrée solennelle habillés à la française, pour y passer vingt-deux jours, accueillis de façon très honorable par le représentant du sultan dans la ville sainte. Enfin on se rend chez l’émir Facardin — premières relations politiques avec la Syrie.
D. C., l’anonyme, constatant que « dans les États du Grand Seigneur, il y a plus de 80.000 catholiques », « qui vivent avec autant de liberté, pour ce qui est de leur conscience, que s’ils estoient au milieu de la chrestienté », fait ainsi un nouvel éloge de la constance des Turcs dans un principe qu’ils s’étaient fixé dès le commencement de leur conquête.
Ce catholique militant demandera que le roi de France continue son alliance avec le sultan, parce que par son influence se conserve cette catholicité orientale. « Le roy donc ne pourroit se departir de ceste amitié qu’il ne fist tort à la chrestienté et à toutes ces pauvres âmes qui seroient contraintes de se mettre sous l’Église grecque pour vivre en liberté[104]. »
[104] P. 275.
Il y a là tout le programme de grande action française en Orient, appuyée sur l’organisation catholique, qu’on chercherait vainement au XVIe siècle. Plus tard, dans le voyage d’Antoine Galland, un des grands voyageurs du XVIIe siècle, dans son journal si riche, qui a été plusieurs fois publié, la dernière fois à notre époque par Charles Scheffer[105], on voit l’ambassadeur de France, de Nointel, arriver dans l’île de Chio et, aussitôt, tout ce monde catholique se met en branle pour l’accueillir. Il se rend chez les jésuites et se présente de la façon la plus imposante, devant cette population qui doit être habituée à révérer de plus en plus le grand protecteur d’Occident qu’est maintenant Louis XIV. Il est accompagné de « six palefreniers en robe rouge et bonnets à la grecque, menant par deux, trois chevaux de main richement harnachés à la française et à la turque ». Et Galland poursuit : « J’avois immédiatement devant moi huict drogmans. Le consul marchoit à mon côté, les marchands me suivoient, et le reste de ma maison venoit ensuite. Et, pour donner dans les yeux des Chiottes et satisfaire leur curiosité et la familiarité des dames, dont le grand nombre, quoyque les fenestres fussent pleines partout, rendoient les rues plus étroites, l’on observoit un grand ordre dans la marche, en leur donnant le loisir de remarquer la magnificence des habits, et mesme d’y toucher. » Et le témoin de cette magnificence présente toutes les variétés de la classe des religieux, entourant le voyageur diplomatique : il y a des Dominicains, il y a ce qu’il appelle des « Soccolens », c’est-à-dire des Zoccolanti, et des Capucins. On donne à l’ambassadeur un repas avec « musique, trompettes, violons, Vive le roy et boëttes », où il y a « un lieu particulier pour les dames », dont deux peintres font les portraits ; et des Turcs sont même admis à regarder cette grande manifestation chrétienne et française.
[105] Publication de la Société de Géographie.
On a attribué une très grande importance à un écrivain qui, à la même époque, a fait le voyage d’Orient, mais dont le récit, pour ces régions d’Europe, a un intérêt fort restreint ; de même, d’ailleurs, quant à son importance historique. Et, puisque je suis en train de le diminuer, disons qu’au point de vue littéraire aussi, il y aurait des réserves à faire sur la valeur des Six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, en Turquie, en Perse et aux Indes, publiés très tard, à Rouen, en 1713[106], mais qui ont été commencés en 1630.
[106] Voy. aussi Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux de J. B. T…, qui n’ont point esté mis dans ses premiers voyages, Paris, 1702 ; Nouvelle relation de l’interieur du Serrail du Grand Seigneur contenant plusieurs singularitez qui jusqu’icy n’ont point esté mises en lumière, Paris, 1675. Cf. sa Relation en Turquie, l’Histoire de la conduite des Hollandais en Asie et Quellenburgh, Vindiciae batavicae, Amsterdam, 1684. Il y a des traductions anglaises, allemandes, italiennes des œuvres d’exploration de Tavernier. Voy. sa biographie par Joret.
Le célèbre voyageur s’est targué, avec raison, d’avoir rendu de très grands services au commerce français en ouvrant la route vers les pays du diamant. Il est vrai qu’il a bien poussé jusqu’aux îles de la Sonde. Mais, en employant le voyage de Tavernier, il faut tenir compte des motifs de critique suivants : d’abord, ce ne sont pas des mémoires, ce ne sont pas des notes prises au fur et à mesure de ses six voyages ; c’est une œuvre rédigée très tard, dont la précision peut être mise en doute. Ensuite, on a découvert telle lettre de Tavernier dont le style est bien différent de celui de ses ouvrages, et l’on sait bien quelle a été la personne, plus tard brouillée avec Tavernier, à laquelle a été confié le soin de rédiger les vagues souvenirs de ce voyageur.
Je préfère de beaucoup aux renseignements donnés par Tavernier ceux qui se trouvent dans un livre totalement oublié, celui d’un voyageur qui a été pendant longtemps consul en Égypte, où il a vu l’exportation de momies à Venise, à partir de 1638, et dont les informations sont très nettes et très nombreuses. Il s’appelle Jean Coppin et son livre est intitulé, d’une façon très prétentieuse : Le Bouclier de l’Europe ou la Guerre Sainte, contenant des avis politiques et chrétiens, qui peuvent servir de lumière aux Rois et aux Souverains de la chrétienté, pour garantir leurs États des incursions des Turcs et reprendre ceux qu’ils ont usurpés sur eux, avec une relation de voyages faits dans la Turquie, la Thébaïde et la Barbarie. L’ouvrage, fondé sur des mémoires présentés à Louvois, dès 1665, et à Rome, où l’auteur a passé deux ans et demi, a été publié à Lyon en 1686[107].
[107] Voy. p. 49. En 1645, il était à Damiette (ibid.). Souvenirs de 1644, p. 201, 483, 487. Fêtes au Caire pour la prise de Candie, en 1639, p. 277-278. Départ en 1647.
Avec ce vieux religieux qui a vu « plus de trente moissons dans le désert », on peut être bien certain que tous les renseignements viennent de la meilleure source. C’est un homme qui s’est bien trouvé au milieu de la population musulmane, et il nous dit que, dans cet empire, apparaît un phénomène encore plus inquiétant que ceux que j’ai déjà cités, c’est-à-dire la décadence de la classe dominante, l’infériorité de la nouvelle armée, qui, pour l’Asie, ne vaut plus rien[108], le mécontentement des populations chrétiennes à cause des exactions, la variété des nations qui se détestent[109], la déchéance de la population des villes. « Ce peuple est fort diminué de nombre et celui de ceux qui sont marquez pour soldats est très petit[110]. »
[108] P. 50.
[109] P. 5. Le frère du sultan même collabore à la chute de l’Empire (ibid.)
[110] Le Caire donne à peine 6.000 janissaires et 1.000 spahis (p. 495).
Et, ce que d’autres voyageurs, du reste, notent aussi dans leurs récits, janissaires et spahis ne sont plus des soldats. On se fait faire janissaire pour jouir des privilèges de cette armée d’élite ; alors, les marchands se font inscrire à prix d’argent dans le registre du corps.
La seconde partie de l’ouvrage est un vaste projet de croisade, recommandant de tenter d’abord un coup sur Constantinople qu’un groupe de seuls « dix-sept » Cosaques a pu mettre en flammes[111].
[111] Ibid., p. 90 et suiv., p. 103-105.
Je ne pourrais pas passer à côté du voyage du sieur de Laboullaye-Legouz[112], « gentilhomme angevin », publié à Paris en 1633, sans dire que ce voyage se distingue par la richesse de l’illustration[113]. On a à faire cette fois avec un très bon dessinateur, et les énergiques croquis du monde oriental qu’il a mêlés à un récit très maigre méritent toute attention. Le voyage du sieur du Loir (Paris, 1654)[114] contient une brève vue d’ensemble de ce monde oriental en 1639.
[112] Les voyages et observations, etc.
[113] Montconys (voy. plus loin) trouve à Tebriz « M. de la Bouloye, François, lequel avoit dessin de passer aux Indes », mais y renonce (I, p. 465 ; novembre 1648).
[114] Le voyage du sieur du Loir, contenu en plusieurs lettres écrites du Levant, etc., avec la relation du siège de Babylone, fait en 1633 par Sultan Mourat, Paris, 1654.
On y voit pour la première fois, bien avant des voyages dont il sera parlé dans la suite, une émotion sincère pour cette Grèce décriée à cause de sa pauvreté, son humiliation et son ignorance. « Bien qu’il soit vray », dit du Loir, « que la Grèce soit reduite dans un estat si deplorable qu’on la recherche en elle-mesme et qu’à peine on puisse la reconnoistre, elle ne laisse pas d’avoir encore de quoy se faire estimer et de quoy se faire plaindre. » Taxant ses prédécesseurs de simples collectionneurs de renseignements divers fournis par les janissaires et les conducteurs de caravanes, il les compare à « un Turc voyageant en France » qui s’informerait « chez un soldat des gardes ou des marchands en route », alors que lui il parlait « la turque comme la françoise, qui est la plus universelle du Levant » ; et pour preuve il donne en lettres latines la description de la prise de Bagdad par le terrible Mourad IV. Ami du fils de l’ambassadeur de Césy, il a eu tous les loisirs de regarder à droite et à gauche dans ce monde original jusqu’aux femmes turques « très mignonnes », « galantes sans estre brutales », qu’il ne compare pas aux inoubliables « nymphes du Pont-Neuf de Paris ». En Grèce il trouve les femmes « très iolies », mais n’oublie pas d’ajouter : « Je n’en ai approché pas une de fort près. » Il a vu Nègrepont, où les Arnautes lui rappellent des « paysans de France » ; il a gravi les pentes du Parnasse, est entré dans les maisons des raïas, a fait à Athènes la connaissance « d’un gentilhomme nommé Benizelly » et s’est arrêté devant le temple « qu’ils nous asseurent estre celuy de Minerve ». Il ira à Thèbes, verra le couvent de Saint-Luc en Phocide, visitera Mégare, Corinthe et Lépante, pour revenir par Zante et Raguse. Partout le souvenir de son pays le poursuit. Il voit chez les Grecs des « toques comme (celles) des pensionnaires des colleges de Paris », des « vestes comme celles de Messieurs de la Chambre des Comptes » ; il définit l’étendue de Raguse par les proportions de la Place Royale. A une époque où quatre associés érudits : Fermanel, conseiller au Parlement de Normandie, Fauvel, maître des Comptes, Baudouin, sieur de Launay, et le gentilhomme flamand Stochove, sieur de Sainte-Catherine, accumulaient, dans leurs Observations curieuses sur le voyage en Levant fait en MDCXXX (Paris, 1668) de simples renseignements archéologiques, mêlés à des notes exactes, surtout pour les provinces, mais assez banales sur la vie présente des Turcs, du Loir a le courage d’écarter résolument le fatras sur le passé hellénique pour écrire ces lignes sur les femmes de Thèbes : « Les beautez vivantes à mon advis valent bien des pierres et des tombeaux, et il faut que ie vous advouë que iamais en aucun lieu ie n’ay esté touché de la veuë des dames comme ie l’ay esté de celles que nous vismes à Thebes, particulierement des Juifves, qui certainement sont plus belles du monde. Quelque curiosité que nous eussions pour visiter le dehors de la ville, le dezir de les voir de plus prez qu’aux fenestres où elles avoient paru, l’emporta[115]. »
[115] P. 331.
Le grand coureur de pays qu’a été Montcenys[116] avait déjà vu comme ancien étudiant, à peine sorti de Lyon, l’Espagne, où il s’assit sur les bancs de la vieille et célèbre Université de Salamanque, bien avant d’être un grave conseiller d’État et privé, un lieutenant criminel dans cette même ville de Lyon, lorsqu’il entreprit, avec le rêve d’une excursion dans le lointain indien et chinois, son voyage de Turquie, en décembre 1646. Il s’initia aux choses d’Égypte, dont il rapporte « une mumie, deux crocodiles, un dab, deux stinx (sic), trois poissons, un abucardan, des fruits, une teste de mumie et quelques idoles » ; il adora les reliques de sainte Catherine et fit ses dévotions au couvent du Mont Sinaï, il huma un café dans un cahvéneh de Damas, cherchant partout de l’inconnu dans la nature, du rare dans les œuvres humaines comme tel « vieil livre persien dont les feuillets au nombre de dix estoient doré, avec des feüillages et des animaux ». A Constantinople, il apprécie la « propreté des rues » et la « gentillesse des boutiques de ciergiers et des vendeurs de verreries ». Très superstitieux, malgré son zèle de chercheur scientifique, en quête de découvertes, il s’en va consulter, fût-ce même seulement pour les confondre, devins ou devineresses, comme la Juive « qui voyoit dans une phiole pleine d’eau ». Il s’en va chercher des Turcs « curieux en astronomie », des Juifs « sçavants en médecine, philosophie et mathématiques » et s’occupe d’« horloges chymiques ». Il vérifie sur une poule dont il brise l’os du pied, la vertu de la « momie de Perse ». Friand de beaux spectacles, il admire un cavalier vêtu de velours rouge, « qu’il faisoit bien voir en cette posture ». Il découvre dans telle « salle où a esté tenu un concile » le portrait, qu’il dessine, d’un empereur byzantin et de sa famille. Certains spectacles de la vie turque le remplissent d’horreur, comme le marché d’esclaves, les exécutions : celle de l’amiral dont il vit la tête exposée, les confiscations barbares, ruinant toute une fortune comme celle de la « femme nommée Chequer Paré, c’est-à-dire Morceau de sucre, laquelle avoit appris au sultan les plaisirs de l’amour et luy fournissoit des divertissements nouveaux ». Dans les îles il parlera aussi des femmes de Chio et surtout de cette dame Dameric, chez laquelle il est invité à dîner ; il observe à cette occasion que, réunissant au charme des indigènes la « grâce des Françoises », elle « est l’une des plus belles qu’il ait vues en Levant ». Enfin, c’est dans ce récit qu’il faut chercher une vision vraie et forte du malheureux sultan à demi idiot Ibrahim qui tue pour rafler l’argent de ses dignitaires, qui se fait offrir des pelisses, des caftans et des bourses d’argent rien que pour avoir passé quelques minutes dans un office où il s’est mis à l’abri de la pluie, qui pense à condamner à mort un vizir qui lui avait donné une mauvaise indication topographique, qui dépouille le bézestan et les trésors des mosquées. « Je vis, dit Montcenys, le Grand Seigneur souper dans son lit, mangeant beaucoup et des deux mains, avidement, gesticulant ou parlant par signes, pissant debout dans un pot d’argent… Le Grand Seigneur prenoit en plein jour ses esbats avec les femmes au bruit de quantité de tambours d’airain, plus gros que des tonneaux. » Puis on le voit détrôné, enfermé avec sa Hasséqui ou sultane épouse, la porte plombée derrière lui et « ses deux petits enfants allant pleurer à l’entour ». « Il ne faisoit que se mordre dans la prison et se cogner la teste contre les murailles », jusqu’à ce qu’on lui jette un manteau sur la tête et on l’étourdit, lui frappant la tête contre la muraille pour pouvoir l’étrangler, — scène qui ressemble aux plus atroces dans ces vieilles annales de la Byzance chrétienne.
[116] Cf. Les voyages de Balthasar de Moncenys, documents pour l’histoire de la science avec une introduction, par M. Charles Henry, Paris, 1887. — Le Journal des voyages publié par le fils de l’auteur, le sieur de Liergues, a paru à Lyon en 1665, dans plusieurs volumes, dont le premier seul intéresse l’Orient. 2e édition en 5 vol., 1695 ; traduction allemande en 1697.
Au même groupe de voyageurs que du Loir et Montcenys appartient Thévenot Cadet, neveu de celui qui a publié, en 1696, une « relation de divers voyages recueillis dans des manuscrits traduits et mis ensemble ». Mais Thévenot le Cadet, dont le voyage a paru en 1664, sous le titre de « Relation d’un voyage fait au Levant », est lui aussi une personnalité particulièrement intéressante par son manque total de prétention.
Parti de Rome le 31 mai 1655, il montre, dès sa préface, quelle est son attitude à l’égard de ces choses que d’autres considéreront sous des rapports très supérieurs, mais sans être capables du même charme.
Il voulait aller à Jérusalem, cette ville, dit-il, qui n’est plus qu’« un tableau de commisération », et il a cru nécessaire de revêtir le costume des Orientaux dans lequel il est portraicturé au commencement du volume, et même à côté d’une poésie turque à son usage par l’interprète de « langue turquesque » du roi, avec, à côté, une légende en vers conçue de cette façon :
Et il est vraiment « très parfait » dans son costume oriental, ayant l’air d’un page du sérail.
Il déclare n’avoir pas voulu faire un livre. Ce qu’il avait à sa disposition, c’étaient de simples remarques, « des brouillons en papiers séparés », et de longues années se sont passées depuis son voyage lorsqu’il a pensé à mettre ensemble ces observations qu’il entendait retenir pour lui et pour un cercle d’intimes.
Il mentionne avec beaucoup d’éloges ses prédécesseurs, c’est-à-dire de Brèves, Deshayes, celui qui se cache sous les deux initiales D. C., du Loir, lui-même et l’introuvable Opdam. Il s’excuse d’avoir écrit ces pages en disant qu’il n’y a point de livre de voyage qui intéresse ; celui-ci, il « l’a fait à la haste », sans aucune prétention ni à l’information, ni au style ; il ne connaît pas l’« élocution plus polie », et, faisant la critique de ses prédécesseurs, il dit ces quelques paroles de vérité :
« Je connois des personnes pour lesquelles il faudroit composer des livres entierement semblables à ceux auxquels ils ont croyance, si on vouloit qu’ils donnassent foi aux nouveaux et qui veulent faire passer pour mensonge tout ce que ceux-là ne disent pas. Et j’en sçay d’autres qui donnent si fort dans la bagatelle qu’ils ne trouvent de beau que ce qui est à peine croyable. »
Or lui, il déclare nettement « se moquer de ceux qui disent qu’il faut hâbler ou mentir pour estre creu ».
Son récit abonde en scènes pittoresques. Voici dans l’île d’Andros, avec ce charme simple, secret bientôt perdu, l’évêque catholique passant par les rues et « tout le monde se jette à terre et tous estendent des tapis, des fleurs, des herbes et des autres choses aussi odoriférantes, dont n’est pas le tapis, et, comme ils se tiennent à terre, l’évesque ne sçauroit passer qu’il ne les foule aux pieds ». Les habitants « sont civils et leur langue est plus literalle que celle des autres Grecs ; leurs femmes, fort honnestes, parlent bien, mais leur habillement est fort messeant. Les habitants de la ville sont fort laborieux, sont gens de bonne chere et de passetems et les païsans y sont plus industrieux ». Il y a donc tout un monde bien séparé du monde de Péra, du monde de l’Épire, de la Thessalie et de la Roumélie. Ce sont des hommes libres vivant sur la base de leurs privilèges, selon la vieille coutume ancienne conservée par Byzance et la domination latine. Car il y a, sous le Grec insulaire de cette époque, le souvenir du Grec de la domination vénitienne ou de celui ayant vécu sous cette autonomie qui était représentée par les ducs de l’Archipel ; si les femmes de Chios se présentent de la façon qui encore une fois sera constatée, on voit bien qu’elles descendent d’une lignée habituée à la liberté. Il y a çà et là même un conseil d’indigènes qui administre à côté du représentant du sultan. A Chios, parmi ceux qui appartiennent à l’Église catholique, il y a des descendants de très grandes familles génoises, dont les Giustiniani, qui continuent à y jouer un rôle, conservant, dans de modestes archives, des parchemins et des diplômes qui appartiennent à l’époque de la domination de la République de Saint-Georges.
Thévenot a passé aussi quelque temps, huit mois, à Constantinople et, même, cette visite s’est faite dans des conditions un peu différentes des voyages habituels. Très bien reçu par l’ambassadeur de France, il l’a accompagné à l’audience du vizir, du moufti. Il raconte très rarement des déplaisirs, parce qu’il constate que cette population turque de Constantinople est très bien élevée. C’est, de fait, la population byzantine, avec une autre religion, un maître d’une autre origine, mais la même masse bruyante, demandant son pain et ses plaisirs, prête aux révoltes, cependant, avec la bonne tenue de la plèbe d’une métropole. Il lui est arrivé seulement quelquefois de recevoir quelque « trognon de pommes » de la part des enfants turcs de Constantinople, et, au moment où il devait partir, l’ambassadeur l’a même vivement félicité sur sa déclaration qu’on ne l’avait pas forcé d’ôter son chapeau ou qu’on ne le lui avait pas jeté par terre.
Vivant à Constantinople pendant ces huit mois, connaissant cette population et même cette populace de Constantinople qui l’a épargné, Thévenot a fait connaissance, à une époque où on ne buvait pas de café en France, avec cette liqueur, déjà découverte par Fourquevaulx. Dans le « cavéhané », dit-il, « il y a une assez plaisante musique de humeurs. Cette boisson est bonne pour empescher que les fumées ne s’eslevent de l’estomach à la teste et, par consequent, pour en guerir le mal et, par la mesme raison, il empesche de dormir. Lorsque nos marchands françois ont beaucoup de lettres à escrire et qu’ils veulent travailler toute la nuit, ils prennent, le soir, une tasse ou deux de cahvé ; il est bon aussi pour conforter l’estomach et ayde à la digestion. Enfin, selon les Turcs, il est bon contre toute sorte de maux et, assurément, il a au moins ce qu’on attribue au tay. Quant au goust, on n’en a pas bu deux fois qu’on s’y accoutume, on ne le trouve plus desagreable ». On le prend sans sucre. Cependant, observe-t-il, « d’autres y adjoutent du sucre, mais ce meslange, qui le rend plus agréable, le fait moins sain et profitable ».
Et voici la musique : « Il y a ordinairement, dans ces cavehanez, plusieurs violons, ioüeurs de flustes et musiciens, qui sont gagez du maistre du cavehané pour iouer et chanter une bonne partie du iour, afin d’attirer le monde. » Il arrive même qu’on invite des amis au cahvéné, et, au moment où on leur sert la consommation, on prend sur soi le compte : lorsqu’on leur présente du cavé, il n’a qu’à crier : « giaba », c’est-à-dire : gratis.
Le voyageur connaît les jeux de hasard, qui ne demandent jamais une dépense d’argent, de la population turque : les échecs, les dames, qu’il appelle, dans son langage, « les dames poussées », la « merelle ». Il a assisté au jeu des marionnettes et en est scandalisé. Il reconnaît cependant que les « chansons en turc et en persan sont belles, mais que le sujet en est tres sale, n’estant remply que de brutalitez deshonnestes ». La danse des Tziganes ne lui est pas inconnue.
Il y a donc pour la première fois, au XVIIe siècle, un contact entre un voyageur et ces classes inférieures de Constantinople. On n’a pas seulement le passager qui veut voir à la hâte quelques monuments, qui parle du sérail sans en avoir la moindre idée, sans en avoir touché au moins le seuil, et qui continue son chemin. Cette fois, c’est un curieux, dans le genre du XVIe siècle, dans le genre de Belon et des autres, qui cherche à connaître une population jusqu’à ses représentants les plus humbles, qui n’en sont pas moins les plus authentiques.
Il était impossible que Thévenot, visitant les îles, ne s’arrêtât pas à Chios, où on « ayme bien plus la domination des Turcs que des chrestiens ». Il constate que les habitants sont un peu fourbes, les habitants masculins, et qu’« on a besoin de ses deux yeux quand on traite quelque affaire avec eux ». Il ajoute, cependant, qu’ils n’en restent pas moins agréables, bien que « fort adonnez à leurs plaisirs et à l’yvrognerie ». « Enfin, ils sont Grecs, de nation », ce qui lui paraît être une définition morale. Il parle du visage des femmes, « blanc comme le plus beau iasmin qu’elles portent ordinairement à leur teste ». Il regrette seulement qu’« elles ne prennent pas plus de soin à se conserver le visage », et non seulement le visage, mais autres parties apparentes de leur corps. Et il ajoute qu’à Chios il y a une décadence au point de vue du luxe, parce que, auparavant, « iusques à la femme d’un savetier qui ne voulut avoir de beaux souliers de velours qui coustoient cinq ou six écus, des colliers et brasselets d’or en quantité, et leurs doigts pleins d’anneaux ». Il a assisté à des danses, qu’il trouve de tous points pareilles aux danses de France. Et il ajoute que si quelqu’un peut parler à ces femmes de la façon qui lui plaît le plus, elle « rira avec luy aussi librement que si elle vous connoissoit depuis plusieurs années ».
C’est en 1616 déjà que le père capucin Thomas entreprit un voyage à Constantinople, où il devait finir ses jours en 1671 après une longue et féconde activité de prédicateur, d’administrateur et aussi de conseiller pour toute une série d’ambassadeurs de France. Appelé par Césy, le grand fauteur de la propagande catholique, protégé aussi par l’ambassadeur d’Angleterre, Ross, qui avait été élevé en France, employé par le délégué du patriarche latin résidant à Rome, il crée des écoles, comme à Chios, distribue des aumônes, catéchise, se querelle un peu avec les Jésuites. Il a connu Césy, mêlé à des affaires de douanes égyptiennes et devenu insolvable, traité en « ambassadeur manzoul », puis Gournay de Marcheville, venu en octobre 1631 et non reconnu par la Porte, qui finit par l’intituler « Henri fils de Renault ambassadeur du bey de France » : la Porte l’accepta en 1637, mais fit pendre sans cérémonie son drogman et finit par renvoyer le maître aussi, de force ; Césy fonctionna en son nom comme vicaire jusqu’en 1641, lorsque de la Haye Vautelet paraît « presque à l’improviste ». Le clergé italien se moque du français, que tel des évêques nomme « poule bonne à usures et à faire assassiner et manger les marchands », mais le clergé grec cherche dans ses malheurs un refuge à l’ambassade, l’en remerciant ensuite par des visites solennelles et par des offres d’union avec Rome et de soumission à un roi qui est « leur roi ». En 1646, les Turcs de la guerre de Candie refusent le caftan à l’envoyé de Louis XIV, intitulant ce de Varennes « celuy qui est venu de France ». Comme on découvre une correspondance de la Haye avec le bailli vénitien enfermé à Andrinople, dont il avait sollicité la délivrance, une série d’injures ordonnées par le duc grand vizir de l’offensive incessante, Mohammed Keupruli, commence. Le fils de l’ambassadeur est « maltraité de coups et de paroles » et mis dans une fosse obscure. S’étant rendu à Andrinople dans des conditions médiocres, le père fut aussi emprisonné, avec quatre des siens, en 1658. Sous l’effet de l’indignation du roi, père et fils furent libérés. Après un ordre de se retirer sur les vaisseaux de France, de la Haye revient à Andrinople, où il « parle fort et hautement », mais sans résultat. Il ne peut pas s’en aller et cependant le vizir s’écrie : « Il y a vingt ans qu’il est icy : c’est trop ; on devroit renouveler tous les trois ans ». On trouve même que les lettres royales envoyées par poste sont blessantes. Comme des marchandises pour le sérail s’étaient perdues sur des vaisseaux français, l’ambassadeur est enfermé aux Sept-Tours, en octobre 1660. Il dut se faire racheter avec 31.000 piastres l’année suivante, très malade. « Qu’il aille mourir chez lui », maugrée le dur vieillard. L’ambassadeur partit en juillet suivant. Son fils, qui le remplaça en 1665, goûta cependant de pareilles injures encore longtemps. « Le livre est remply et il falloit qu’il s’embarquoit », lui disait-on en 1669, avec de nouvelles menaces d’emprisonnement. En décembre, le vaisseau qui porte le diplomate si éprouvé fait voile enfin et un envoyé turc se rend pour des explications à Paris, où le roi s’obstine à maintenir l’alliance. Tout cela passe devant nos yeux avec une rapidité cinématographique dans les pages naïves du bon père, qui nous ont été révélées en 1913 par une analyse[117].
[117] Bruno, Ambassadeurs de France et capucins français à Constantinople au XVIIe siècle, d’après le journal du P. Thomas de Paris, dans les « Études franciscaines », XXIX-XXXI.
Or nous avons, à côté du verbeux capucin de Péra, un autre moine voyageur, qui accompagna en 1665 le jeune de la Haye venant occuper le poste que son père avait dû, ou plutôt pu, quitter après de si longues et douloureuses avanies de la part d’un vizir qui avait une revanche personnelle à assouvir contre l’ambassadeur chiche de présents et fier de son importance[118]. C’est un témoin naïf et souriant des événements qui distinguent une période de reviviscence de la société ottomane sous l’impitoyable impulsion du rude Albanais, période riche en triomphes, en brutalités et en illusions d’avenir. On assiste aux malentendus provoqués par l’entrée pompeuse des vaisseaux du roi sous les yeux du sultan, le grand chasseur sauvage Mohammed IV, vers lequel, se méprenant sur un geste, ose se diriger le capitaine du Grand César. On voit le jeune ambassadeur, mal accueilli par le puissant ministre, jetant sur le sofa du vizir le sachet aux firmans, ce qui est considéré comme une profanation digne d’être payée de mort, s’il n’y avait pas eu la crainte d’une nouvelle guerre avec les chrétiens d’Occident. On participe d’esprit au voyage d’Andrinople, destiné à faire renouveler les capitulations qui ne devaient l’être que plus tard, par de Nointel. Au cours de ce voyage, le moine français admire les « fontaines de bonne eau » pour les passants, le soin des particuliers turcs à retirer les pierres du chemin, « afin de le rendre plus aisé, et on y voit rarement des ornières », les khans, grands comme des églises « qui sont ouverts à tous, sans distinction de fortune, de religion et de race ». Çà et là quelque récit prouvant l’admirable soumission des officiers impériaux devant une sentence capitale. Le Messie juif Sabataï Sévi se fait recevoir à Andrinople par les siens comme l’annonciateur du salut prédit par les Écritures et finit par devenir un fidèle musulman. La description de Constantinople rappelle la fraîcheur et l’innocence des grands pèlerins du siècle passé : un visiteur sans prétentions et sans idées préconçues nous fait voir les mosquées, la « colonne historiale », la « grande aiguille » de l’obélisque, le sérail, qu’il ne juge pas assez beau, étant « sans ornements, ni curiosité », les Sept-Tours, contenant comme prisonniers Morosini et des « seigneurs tant français qu’allemands qui s’y morfondent depuis vingt-trois ans », le « grand Baigne » où le père remplit ses fonctions de prêtre, les châteaux des Dardanelles. Sur le Bosphore, il s’est senti le cœur faiblir devant les transports d’esclaves venant du Nord tatar. Il a été accueilli et régalé par des caloyers dans leur couvent. En Thessalie, où chasse le sultan, des enfants esclaves arrivent dans des paniers. Au cours d’un voyage dans l’Archipel apparaît l’ermitage, la « chaumine » d’un solitaire turc sur une colline « toute remplie de lauriers-roses, qui pour lors étoient tout fleuris », on entend des Turcs aimables invoquer contre la tempête la madonna Santissima et on les surprend à donner du pain à la mer furieuse ; sur les ruines de Troie on goûte du fort bon vin, mais près de Smyrne des fouilles ordonnées par le grand vizir lui-même mettent au jour le frontispice d’un temple d’Apollon, au « mortier si consommé que l’on voit jour entre deux pierres ».
[118] Un voyage en Turquie et en Grèce du R. P. Robert de Dreux, aumônier de l’ambassadeur de France (1665-1669), publié et annoté par Hubert Pernot, Paris, 1925.
Tout cela finit par l’ordre du retour, un peu retardé aussi par des conflits entre les Français qui arrivent sur les vaisseaux du roi et les Turcs, conflits dont l’un donne au capitaine de la flotte l’envie « de foudroyer le grand Sérail ». Mais, en chemin vers Larissa, où est le Nemrod impérial, toute une partie de la province turque se révèle d’une façon charmante. Partout les gens les plus doux et les plus serviables du monde, dans cette race « maudite de Dieu et des hommes ». Des inscriptions sont recueillies sur la route. La description de Salonique est très ample, dépassant tout ce que peut offrir cette littérature. La chasse du sultan avec les vingt mille hommes qui le servent est magnifiquement présentée. Les splendeurs du petit baïram impérial sont vues à Larissa : le capucin provoque, sortant devant le sultan qu’il désire bien imprudemment contempler, un cri de surprise du fils de Mohammed, soutenu à cheval à cause de son tendre âge, et les yeux du chasseur sans repos s’arrêtent sur le moine tout interdit. « Cela est bien opposé, s’écrie-t-il, à la pratique de France, où chacun s’empresse de voir passer le Roi et de crier : Vive le Roi ! » Le cortège solennel du sultan défile aussi devant le voyageur tapi derrière des planches et très ému par le spectacle d’une telle richesse : maintenant tout croyant de l’Islam peut contempler, les bras croisés sur la poitrine, l’idole. Une messe grecque observée avec curiosité clôt le chapitre. Le suivant est dédié à Pharsale, à Thèbes et à Athènes, où le P. Robert trouve le moyen d’aller avec un Paléologue : le moine met un zèle presque religieux à voir ces antiquités païennes qui, comme on le verra, suscitaient en France à cette époque, de nouveau, le plus haut intérêt. Entre les pierres des méchants enfants turcs il fait ses dévotions archéologiques, mêlées de quelques souvenirs chrétiens sur saint Paul et saint Denis. De là, par Corinthe, le pèlerin du passé ira retrouver à Cérigo les vaisseaux de France, en toute hâte, à cause de la participation des Français à la défense de Candie. En mettant par écrit ces vicissitudes, le Père pèlerin ne se rendait guère compte qu’il donnait le « Voyage » le plus sincère, le plus varié et le plus instructif de toute son époque.
Aux voyageurs qui font partie de ce premier groupe dans la seconde moitié du XVIIe siècle, au moment où le prestige diplomatique de la France était le plus déchu, il faut ajouter ce « Monsieur P. Q. », c’est-à-dire Poulet, dont les Nouvelles relations du Levant paraissaient à Paris en 1667.
Encore un révolté contre la routine, qui ne veut pas de descriptions archéologiques. Les Levantins, lisant les récits des Occidentaux, sourient sur leur naïveté d’antiquaires, « comme si dans un meschant bourbier et en une place qui n’est connue que par le nom de quelque chasteau rompu, de quelque puits comblé ou de quelque pont à moitié ruiné nous avions dessein d’y venir un iour chercher un thresor ». Il n’entend pas proposer des identifications de géographie historique, « n’ayant pas le genie assez subtil pour la controverse » et le « mélange de cailloux » ne l’incitera à aucune nouvelle hypothèse. Ce qui l’invite à parler c’est la conscience d’avoir suivi « une route continuelle de neuf ans par terre dans toutes les parties de la Turquie, de la Perse et de quelques-unes au delà ».
Il est parti d’après les suggestions du Persan Séït-Aga et d’un marchand français d’Ispahan, étant indifférent aux risques[119]. La compagnie de l’interprète royal Quiclet contribue aussi à sa décision, bien que ce dernier, dont le malheureux sort et l’œuvre restée incomplète seront signalés dans la suite, dût abandonner le projet du voyage commun. A Venise, on le soupçonne de vouloir porter aux Turcs, qu’on y hait plus que « les diables », des « instrumens de mathématiques », mais on le laisse partir. En Dalmatie, il écoute les chants religieux, « moitié en latin, moitié en leur langue », des paysans « esclavons » et il décrit leurs danses, dans lesquelles ils « se soustiennent plus de l’epaule que du coude et joints aussi près qu’il leur est possible » : c’est enfin « un bransle de quatre ou cinq heures sans se reposer, au chant d’un texte qui contient tout l’Ancien Testament ou l’histoire des Turcs », jusqu’à un enthousiasme maladif et bruyant. A Raguse, il constate la « politesse », l’ambition historique d’une très ancienne noblesse, l’élan d’un commerce qui porte les citoyens de la petite république tributaire jusqu’à Andrinople ; il admire les femmes « belles et parfaitement bien faites », mais outrageusement fardées et lourdement attifées, « depuis les ailerons on ne voit qu’un gros derriere et point de corps ». Le carnaval ragusain l’enchante, avec les dames aux fenêtres jetant aux cavaliers des œufs de cellulose, pleins de parfums.
[119] « M’estant au reste autant indifferent de mourir à Paris qu’à Bourg-la-Reine. »
Le voyage de Turquie est fait cette fois par terre, à cheval, le Français s’accoutrant en Ibrahim-bey, qui est son nom d’emprunt. Il fume et hume son « cafvé » comme un bon Musulman ; il paraît enclin même à une certaine polygamie, souhaitant qu’en France aussi on introduise la coutume de devoir coucher avec la femme dont « on a touché la main ». Par Bosna-Séraï, où il trouve des marchands inscrits chez les janissaires en vue de certains avantages, par le passage de Vacarel (Vakarita-dervendi), où il voit des paysannes bulgares « délicates et presque égales à nos Françoises », paraissant « courtoises » parce qu’elles offrent des aliments ; par la Roumélie, où il a « la larme à l’œil » devant la décadence des Grecs ; par Andrinople, où est enfermé le fils de l’ambassadeur de France, il arrive à Constantinople. Et c’est le premier qui en a une vision pour ainsi dire moderne, lorsqu’il écrit ces lignes : « Cet abord perpétuel de navires, cette confusion de coloris, ce désordre de petits monts et de vallées, de maisons diversement peintes, de clochers et de temples tournez en colonnes et en dômes, ombragées partout de verdure et construits de la forme d’un amphitheatre, cette union de deux mers qui se développent à gros boüillons dans ce port ou se vont rompre contre les murailles de cette ville qu’elles blanchissent par tout de leur escume. »
Il y voit, à côté des Turcs marchands ayant appris des Grecs, des Arméniens, des Juifs que le commerce vaut bien « le maniement d’une épée », il voit une armée facile à vaincre, après « la defaite des janissaires » par le terrible vieillard Keupruli, ces janissaires rebelles « desquels nous avons veu les puits remplis et les rivieres rouges de leur sang » ; le grand vizir lui apparaît féroce avec les « deux dens qui lui avançoient de la bouche comme les defenses à un sanglier » et deux fois il a pu apercevoir le sultan qui se rend à la mosquée.
Ce n’est pas, du reste, à cette époque le seul amateur de pittoresque. Le pauvre Quiclet l’était aussi à sa façon. Ses voyages, publiés par sa famille en 1664, après son exécution mystérieuse dans le palais de l’ambassade de France, où il fut jeté du haut des murs pour avoir trahi des secrets diplomatiques au moment le plus gênant, comprennent une vivante image de Raguse en carnaval : les dames que l’indiscret observateur présente grossièrement comme « des gros culs épouvantables, tant elles ont de jupes et de cotillons », jetant des fenêtres « des citrons de cire contrefais, plains de fleurs, de confitures, de petits oyseaux vivans, et des petites boules aussi de cire plaines d’eau de senteur fort agreable, en signe d’amitié » sur le passage de ceux qu’elles affectionnent. La route par terre, vers Borna-Séraï, puis vers Belgrade, pour descendre sur Andrinople, est d’une grande valeur au point de vue de la géographie, aussi bien qu’à celui des mœurs, car le voyageur, reçu par les commandants turcs, qui se préparent en 1658, à la guerre de Transylvanie, sait le turc, le parle, s’intéresse de tous côtés, note tout ce qu’il saisit au passage et use de son déguisement oriental pour pénétrer partout où un autre aurait été empêché. A partir d’Andrinople, l’éditeur a ajouté un complément de simple compilation.
Dès 1665, un prêtre français, l’abbé Jacques-Paul Babin, avait visité non seulement la Grèce classique, où il allait chercher un complément au recueil de Gruterus, mais aussi Constantinople et Smyrne, d’où il envoie une lettre à l’abbé Pecoin, de Lyon, que Spon, médecin de cette même ville, publia en 1674. Il est question surtout d’Athènes, où l’attention du voyageur est attirée, en dehors des antiquités dont il a le culte, par la vie religieuse des Grecs et des Latins, dirigés par les capucins ; il ne manque pas cependant de s’initier à cette vie de famille de la classe plus élevée qui « s’occupe maintenant à amasser un peu d’argent qui tombe enfin presque tout dans les mains des Turcs » : il est le premier à mentionner cet Athénien plus cultivé — alors que l’archevêque orthodoxe détruit des statues anciennes, — Démètre Beninzeles (Vénizélos) qui donne seul des leçons, à quelques enfants dans ce nid d’ignorance et d’oppression[120].
[120] Sur les vicissitudes de ce petit ouvrage, voy. comte de Laborde, Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1854. — Dans une lettre publiée par M. Omont (voy. plus bas), il déclare avoir vécu deux ans à Nègrepont, passant cinq fois à Athènes, où du reste il n’est resté que cinq semaines en tout (p. 18). Cf. aussi le voyage de François Arnaud (1602-1605), publié par Ch. Omont, dans le Florilegium Vogüé, Paris, 1909.
De la Guilletière, dont les notes sur Athènes ancienne et moderne, puis sur Lacédémone ancienne et nouvelle, ont été publiées à Paris en 1675 et 1676, par son frère Guillet, qui promettait aussi une « Description de Delphes et celle du mont Parnasse », présente les souvenirs d’un prétendu prisonnier français, ayant passé deux ans en Hongrie, quatre à Tunis, qui est arrivé à se trouver dans le camp turc du siège de Candie, héroïquement défendue par les Vénitiens (1669). L’auteur, un avocat, n’a eu qu’une ambition, celle de présenter la Grèce telle qu’elle était dans sa vie populaire, d’un jour à l’autre, en y mêlant aussi le plus grand nombre d’anecdotes turques que possible, dans lesquelles quelque fait réel est noyé dans une longue exposition sentimentale du genre de celles qui à cette époque avaient pour théâtre « le pays du Tendre ». Il sera question de l’amoureux Anglais Hedges, de la belle Emina et de la belle Jahahi, du Juif Cahen, de l’aventure du grand « avdechi » qu’est le sultan Mohammed IV avec une fillette de paysan en Thessalie, la jolie Nahani. Ce qui n’empêche pas que, à côté de cette prose poétique, il n’y ait une vue souvent assez juste des réalités. Le passage sur le Maïnote Libéraki, celui sur le vizir Achmed, sur le projet de coloniser des Maïnotes en Corse le prouvent bien. Et il faut signaler tout spécialement l’intérêt que l’auteur porte aux couvents grecs, si injustement méprisés, dont il loue l’architecture et les fresques, mentionnant les esquisses aux crayons qu’il en a faits et que malheureusement nous n’avons pas conservés[121]. Il ne faut pas négliger non plus, dans un jugement d’ensemble sur cet écrivain si souvent critiqué et jouissant d’une très mauvaise réputation, — à ce point qu’on a contesté le voyage et l’existence même de son auteur, car Guillet de Saint-Georges, personnage dont on a refait la biographie, n’aurait fait que mettre ensemble des notes envoyées en France par les capucins d’Athènes[122], — l’information et aussi la clairvoyance qui distinguent le prétendu discours du hiéromonaque Damaskinos et du didascale, dans lesquels sont présentés tous les titres des Grecs modernes à l’estime de l’Occident, des humanistes du XVe siècle aux soldats qui défendirent sous le drapeau de Saint-Marc Crète contre l’attaque musulmane ; de la Guilletière a même entrevu cette idée d’un nouvel impérialisme byzantin sans aucune diminution qu’aurait pu réaliser le passage du sultan et des siens à la religion chrétienne[123].
[121] « Enfin l’édifice merite bien que vous l’admiriez un jour parmy mes crayons plûtôost que sur ces memoires » ; p. 449.
[122] Laborde, ouvr. cité, I, p. 231, note 1, 235. Guillet a publié aussi l’Histoire de Mahomet II et celle des Keuprulis.
[123] P. 238 et suiv.
Quelques années plus tard, un Lyonnais, « agrégé » dans sa ville natale, Jacob Spon, entreprenait, dans la compagnie de l’Anglais Wheler, qui devait publier séparément son voyage[124], et de deux des conationaux de celui-ci[125], une excursion à buts scientifiques, surtout pour l’archéologie, dans ces régions et le résultat des observations recueillies et des études faites sur place paraissait dans le Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, fait aux années 1675 et 1676. Bien qu’il parle de « l’air de la province », dont il est « infecté » et de « la poussière du cabinet » qu’il ne peut pas s’empêcher de prendre avec lui, bien qu’il eût désiré avoir plus de « santé, de rentes et de loisirs », il croit pouvoir fournir « la connaissance des monumens antiques des pays qu’il a vus », cherchant même à donner une continuation aux inscriptions de Gruterus. Parti de Venise le 20 juin 1675, Spon passe légèrement sur les incidents d’un voyage qui ne se distingue pas de l’ordinaire, espérant s’arrêter longuement en Morée, en Grèce continentale et dans les îles, sur les traces de l’antiquité. Emmené par ses Anglais à Constantinople, à l’époque où le jeune Keupruli Achmed, avait remplacé comme vizir son père, il parle d’une façon incidente des maîtres de l’empire, du patriarche grec Parthénios, du médecin interprète Alexandre Maurocordato, « qui a écrit quelque chose sur l’usage du poulmon, qu’il a derobé à nos auteurs », de certaines coutumes et modes comme celle du café, pour s’arrêter sur les pierres et aussi sur les livres que lui fournissent le renégat polonais Albert Bobowski, devenu Ali-beg, et le chirurgien de l’Atméidan, Mohammed-Bacha. Le retour par les îles le ramène en Morée, où il s’essaie à composer une chanson grecque. Cette fois le récit gagne en extension, en variété et en vivacité. A côté des notes de l’antiquaire improvisé, qui s’intéresse aussi à l’art byzantin, on a des informations sur les « gros mylords turcs », sur les archontes grecs, « Paléologues, Limbonas, Péroulis, Cavalaris, Chalkokondyles », etc., déjà énumérés par le rival de Spon, — le consul d’Angleterre, Giraud, ayant épousé une Paléologue, — sur les noces chrétiennes, le commerce, sur les Juifs, les Albanais, les Valaques et, bien entendu, sur les quelques Français, capucins, gens de métier, consuls, qu’il rencontre en chemin. Il cherche à être utile à ceux qui imiteront son exemple en donnant un dictionnaire du grec vulgaire, essai hardi et unique. Le troisième volume contient cette « récolte » scientifique dont il parlait dans sa préface.
[124] A journey into Greece, Londres, 1682 ; traduction française, 1689, 2 vol. Cf. Laborde, ouvr. cité, II, p. 54-55.
[125] Voy. leurs noms à la page 153.
Ayant attaqué La Guilletière, le frère de ce voyageur lui répondit aussitôt dans un factum littéraire ironique d’un assez mauvais goût[126], qui eut le don de l’irriter. Se jetant contre l’« homme qui escrit sur des mémoires mandiés », et ceci avec la participation de Babin lui-même, qui se moque du « roman d’Athènes »[127], il répond patiemment à chacune des objections présentées par son critique dont il énumère ensuite toutes les bévues et toutes les erreurs.
[126] Lettres escrites sur une dissertation d’un voyage en Grèce, publié par M. Spon, médecin antiquaire, Paris, 1679.
[127] Cf. aussi Journal des Savants, année 1676, p. 158 et suiv., et H. Omont, Athènes au XVIIe siècle, relation du P. Robert de Dreux, de Jacob Spon et du P. Babin, dans la Revue des Études grecques, année 1901.
Autour de l’ambassade de Nointel qui réussit à amener les Turcs, battus par les Impériaux avec un concours français, à la confirmation des anciens privilèges et qui fit lui-même de grands voyages d’exploration au cours desquels il recueillit des inscriptions et fit exécuter, à Constantinople et à Athènes, de remarquables dessins, des toiles même, par les peintres de sa suite, Rombaut Faydherbe et Carrey[128], un nouveau groupement de voyageurs français se produit après 1673.
[128] Voy. Laborde, ouvr. cité, p. 109, note, p. 111, 146, note 1, p. 165, note 2. Cf. Albert Vandal, L’Odyssée d’un ambassadeur, Les Voyages du marquis de Nointel (1670-1680), Paris, 1900, p. 280 et suiv.
Disons d’abord que le grand voyageur en Perse, Chardin, dont l’œuvre a été publiée en 1687, appartient à la seconde moitié du XVIIe siècle, mais la plupart de son information qui commence en 1671 est, en ce qui concerne l’Empire Ottoman, de faible importance, pour la partie européenne.
Les autres représentent, autour de l’ambassade de France, à partir de 1672, un peu ce que représentait au XVIe siècle le groupe qui s’était formé autour de d’Aramon.
On a cette fois des voyageurs d’une information très vaste, d’une pénétration toute particulière, d’un certain prestige de style.
En première ligne, il faut mettre Antoine Galland, dont le séjour à Constantinople, de 1670 à 1673[129], lui donna l’occasion de présenter le monde ottoman sous tous ses aspects.
[129] Ed. Schéfer, dans les publications de la Société de géographie de Paris, M. Omont signale, dans son grand ouvrage sur les Missions archéologiques françaises en Orient, un nouveau voyage, à caractère scientifique officiel, en 1679, p. 207 et suiv. (avec Guilleragues, Nau, auteur d’un voyage, et le Père Besmier).
A côté de ce secrétaire érudit, un orientaliste célèbre par sa traduction des Mille et une Nuits, il y en a un autre, dont l’œuvre est très étendue, mais qui ne touche pas, dans une partie de cette vaste enquête orientale, à la Turquie d’Europe : il s’agit de d’Arvieux, l’organisateur des festivités pour la réception de Soliman-Aga, l’ambassadeur en France de Mohammed IV et le modèle du mamamouchi de Molière[130].
[130] Voy. le chapitre vivant que lui consacre Vandal, dans l’ouvrage cité.
D’Arvieux, marchand, a été chargé de plusieurs missions par le roi de France. Car tous ces nouveaux voyageurs tournent autour de la France officielle, autour de la royauté ; ils présentent leurs rapports à Louvois ou à Colbert, ils les dédient au roi, et si, dans tout ce qu’ils disent, on voit le souci de donner des choses nouvelles, en même temps il y a celui de faire plaisir à cette royauté qui les incite, qui les protège et dont ils attendent des faveurs pour leur dépense de temps et pour le risque qu’ils ont encouru.
On trouvera dans d’Arvieux, qui connaissait déjà Damas en 1662[131], une bonne description d’Andrinople et de Constantinople et, ensuite, l’aspect de l’armée turque pendant la guerre contre la Pologne, avec une vision du sultan Mohammed à trente-huit ans, surgissant au milieu de ses janissaires, de ses spahis, de sa cour nombreuse et variée, avec « ses yeux tannés, très gros et presque sortans de la tête », avec sa « barbe claire et par bouquet », et le portrait de l’homme d’État de cette époque, Ahmed Keupruli, tout aussi grand politique que son père, mais ayant ce que son père n’avait pas, une compréhension de la politesse, des besoins de la civilisation : « Il parloit », dit d’Arvieux, « peu et d’un ton assez bas. Il étoit sérieux comme il convient à un grand vizir, mais d’une manière assûrée, quoique doulce ».
[131] Il y a vu le vizir Ahmed ; IV, p. 563.
Le secrétaire de Nointel, Delacroix, différent, comme on l’a montré, d’un homonyme, fils de l’interprète royal qui faisait des vers en l’honneur de Thévenot, a été d’une fécondité littéraire inépuisable. Cet homme, qui fut accusé plus tard d’infidélité envers l’ambassadeur et même de lui avoir pris des mémoires inédits[132], a mis par écrit, dans son journal assez étendu, ses pérégrinations à travers les Balkans, la Dobrogea et la Moldavie, à la suite de l’armée impériale partie contre les Polonais[133]. Il s’est occupé de l’état de l’Église grecque et autres et de leurs cérémonies dans une brochure pleine de détails exacts[134]. Il a rédigé un rapport sur l’« estat de la marine othomane »[135]. Et, enfin, on a de lui des Mémoires imprimés[136].
[132] Laborde, ouvr. cité, I, p. 169, note, 173, note, p. 173-175, note : « fort gueux et misérable… Mémoires qu’il avoit dérobé à son maistre ».
[133] Il se conserve aujourd’hui dans la collection Philipp de la Bibliothèque de Berlin ; les extraits dans nos Actes et fragments, II.
[134] État présent des nations et églises grecque, arménienne et maronite en Turquie, Paris, 1715 (données d’environ 1673 ; familles nobles grecques, p. 7). Cf. le ms. 4.438 et le ms. 10.528 de la Bibliothèque nationale de Paris (« Mémoires du sieur de la Croix…, contenant l’estat présent de l’église grecque et les révolutions du royaume de Tunis »). Cf. nos Actes et fragments, I-II.
[135] Mss. 681, 682, 6.ioi de la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris.
[136] Memoires du sieur de la Croix, cy-devant secretaire de l’ambassade de Constantinople, contenans diverses relations tres curieuses de l’Empire Othoman, 2 vol., Paris, 1684.
Se targuant des dix ans passés à l’ambassade, ce qui lui permet de regarder de haut les voyageurs qui fondent leur récit sur des témoignages étrangers, il veut montrer par son exposé que Louis XIV peut « réprimer l’orgueil othoman », comme « fils aîné de l’Église et protecteur du christianisme dans l’Orient » : « l’Archipel est ouvert…, toute la côte de Syrie n’est pas mieux deffendue », le courant seul défend les détroits. « Je desire seulement détromper ceux qui ont conçu des idées de l’Empire Othoman plus grandes qu’il ne faut, en leur faisant connoistre qu’il est beaucoup déchû », de sorte que dans bref il faudra que les Turcs « implorent la clémence » du roi et « luy demandent son amitié ».
Suivant les traces de l’ambassade de son maître, l’ancien secrétaire parlera des îles de l’Archipel, avec leurs festivités latines. Il exposera la façon dont Nointel a été accueilli à Constantinople et dont il a fait, au début de l’année 1671, son entrée dans l’ancienne capitale d’Andrinople, où l’attend le vieux Mohammed Keupruli, rouge de visage, marqué de la petite vérole, la figure féroce ombragée d’une barbe noire, puis l’audience au sultan errant, la marche de l’armée ottomane, qui ne peut pas rivaliser de luxe et de splendeur avec celle du roi, les négociations pour le nouveau traité. Toute une partie est consacrée à l’analyse de la société turque, qu’il juge de la façon qui sera présentée un peu plus loin.
Et n’oublions pas, pour la même époque, qui diffère assez de la précédente, ce « Miroir de l’Empire ottoman ou l’état présent de la cour et de la milice de (sic) Grand Seigneur », qui a été publié à Paris en 1678[137]. C’est un livre imprimé, mais, cependant, on peut le considérer comme absolument inédit, car personne n’a recouru à ces deux petits volumes qui dépassent de beaucoup toute la littérature contemporaine concernant l’Orient.
[137] La seconde édition corrigée par un Français, la première ayant paru, comme le révèle la préface, « dans un païs étranger ».
On y trouve l’expérience de quelqu’un qui a passé des années dans le milieu musulman ; il cache son nom, de sorte que je crois qu’il s’agit d’un renégat qui ne voulait pas indiquer la situation malheureuse et humiliante dans laquelle il a passé. Mais lorsqu’il dit qu’il a été, « pendant cinq ans et demy, esclave des volontez » du sultan, lorsqu’il se montre ayant le privilège d’apporter du vin, lorsqu’il se présente comme malade du froid qu’il a senti lorsqu’il a passé la « Toundscha », près d’Andrinople, d’après l’ordre du même, lorsqu’il mentionne son lévrier que ledit sultan lui avait demandé, lorsqu’il dit même qu’il « eut l’honneur, en 1674, de recevoir un présent de la main du Sultan », on peut se rendre compte combien était rare l’information de ce commensal du maître[138].
[138] I, p. 181, 192, 197, 198, 212.
Sans aucune attache avec ce monde diplomatique, un anonyme qui est Grelot décrit d’une large façon magistrale la société turque avant 1680, quand parut à Paris la Relation nouvelle d’un voyage à Constantinople, dédiée elle aussi au roi, avec une pointe contre ceux qui ne rapportent de l’Orient, comme Tavernier, que « des perles et des diamants ». S’il a recueilli de ses pérégrinations des dessins, dont il parle dans sa préface, il en a ramené surtout les impressions d’un homme qui, sous l’habit des Turcs, a traversé une grande partie de leur Empire, « feignant estre du pays et d’avoir esté en France à la suite de Mustapha-Aga, qui en estoit de retour il y avoit près d’un an ». Il n’exagère pas les splendeurs de Constantinople, où il a vécu en indigène, prenant son café dans des « flingeans », et affirme que les jardins du sérail ne valent pas « celuy des Thuilleries, de Versailles, de Fontainebleau, ou mesme des jardins de plusieurs particuliers de France », que les palais n’ont rien « de semblable au Louvre ou à l’Escurial ». Il ne prétend pas avoir vu le sérail, car il lui « auroit coûté ce qu’il estimoit beaucoup davantage que tout l’Empire du Grand Seigneur », ainsi qu’il l’a dit en guise de plaisanterie à Louis XIV lui-même pour expliquer ensuite à la reine qu’il s’agit de la « religion chrétienne que l’on fait abjurer à ceux qui entrent en cet endroit du Serrail », ajoutant néanmoins qu’il y aurait eu aussi « le dommage irreparable qu’une precaution aussi cruelle qu’infame leur fait souffrir auparavant ». Mais la Sublime Porte, qui est visible, « n’a rien de magnifique et elle ressemble plutost aux portes de quelques monasteres anciens et eloignez des villes ou à celles de quelque métairie ». Un pourboire discrètement glissé lui permet de voir Sainte-Sophie et même d’y prendre des esquisses, tout en se nourrissant de saucisson de Boulogne et en l’arrosant de vin. Il a connu aussi les îles, avec leurs églises grecques où pendant l’office le prêtre traite ses bruyantes ouailles de « maudits » et de « gibier de potence », en les invitant à se taire (les imprécations sont en grec), avec leurs danses, leurs chansons populaires, avec les rondes des enfants, les exorcismes contre puces et punaises. Il est allé avec un Vaillant, un Bellocier de Saint-Sauveur et deux autres Français à Brousse et il préparait un nouveau voyage d’Orient. On pourra apprécier sa liberté d’esprit par les jugements qu’il porte sur ce monde étranger dont il connaît les langues.
Le récit est plus sec dans le récit de l’ambassade de Guilleragues et de Girardin, dont le voyage a été publié dans Le Mercure d’août 1687[139]. On y assiste à la conclusion des capitulations nouvelles entre les mains du premier de ces ministres et au départ, en 1685, de l’autre. Les renseignements tirés sont des mémoires d’« un homme d’esprit qui par curiosité fit le voyage de Constantinople avec feu Mr. de Guilleragues » et y « a demeuré pendant trois années », donc 1680[140].
[139] P. 286, 292. Voy. Ambassades de M. le comte de Guilleragues et de M. de Girardin auprès du Grand Seigneur, Paris, 1687.
[140] Voyages en divers États d’Europe et d’Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine, Paris, 1692.
Si le jésuite d’Avril, cherchant le chemin de la Chine[141], parti en 1685, a vu Chypre, Alep, Diarbekr, Etschmiazin, résidence du patriarche arménien, la Géorgie et la Tatarie, Astrakhan et Moscou, il n’a traversé, avec le P. Beauvollier, des provinces européennes, que la Moldavie, qu’il qualifie d’« une des plus belles et des plus agréables provinces de l’empire », malgré l’effroi des paysans cachés dans des taudis souterrains, et il est émerveillé de s’entendre traiter par le prince moldave inculte qui est Constantin Cantemir comme « deux sujets et deux mathématiciens du plus grand monarque de l’univers ». Il est délivré par Girardin de l’arrestation dans le camp du séraskier qui « sçavoit un peu de géométrie et d’astronomie » ; il passe par les embouchures du Danube avec le vaisseau qui porte la femme de l’ambassadeur.
[141] Le jésuite Villote, auteur des Voyages d’un missionnaire de la Compagnie de Jésus en Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie et en Barbarie (Paris, 1730), qui n’a passé que trois semaines à Constantinople, mais qui dès le début admire la langue turque, « douce, énergique et plus facile à apprendre qu’aucune autre de nos langues d’Europe » (p. 17-18), paraît appartenir à cette époque, car il présente les vaisseaux anglais et hollandais fêtant à Constantinople la naissance du fils de Jacques II (p. 19).
Enfin Du Mont, auteur des Voyages en France, en Italie, en Allemagne, à Malte et en Turquie (2 vol., La Haye, 1699) a assisté à l’audience du nouvel ambassadeur Châteauneuf. Il a vu l’entrée solennelle du sultan. Il a fait le parcours des îles. Son exposition est plus riche en détails historiques modernes qu’en souvenirs de l’antiquité[142].
[142] Le volume II est celui qui regarde ces régions.
Tous ces voyageurs constatent que l’Empire conservait encore les plus essentielles de ses anciennes vertus.
Dans Galland, on voit les villages grecs vivant dans une parfaite autonomie, sous leurs prêtres, sous leurs anciens protogères ou kéhaïas, les « vecchiardi » d’Athènes, les représentants du sultan, les sousbachis, se bornant à demander des grains, de l’argent et le prêtre ayant le « quillet de bled » annuel, la taxe sur « les confessions, les mariages et les signatures »[143]. « Les hommes », dit-il ailleurs, parlant d’un village de la Turquie d’Europe, « estoient tous proprement habillés et les femmes surtout, qui avoient des vestes fourrées, des coeffures brodées, des ceintures enrichies d’argent et des vestes de satin, de sorte qu’il estoit aisé de juger que les habitants du village estoient assés commodément »[144].
[143] P. 105.
[144] I, p. 174.
Donc, il n’y a guère le village appauvri, le village persécuté, cette pauvre vie chrétienne toujours à la disposition de n’importe quel agent du pouvoir, qu’on s’imagine trop facilement.
Dans les îles surtout, la prospérité des Grecs continue. D. C. « la constate à Chios, à Samos, qui a aussi ses belles femmes »[145]. Seulement les hommes paraissent, à Constantinople, « glorieux, paillards et ils abhorrent le travail au-dessus de tous les hommes », les femmes, « assez enjouées avec leurs amans » n’ayant pas « la propreté des Turques »[146]. Delacroix décrit les sujets orthodoxes du sultan à Péra ne nourrissant leurs gens « que d’un peu de pain mal cuit, de ris, de lait aigre, d’oignons, d’ail et très rarement de viande », alors que leurs femmes babillardes envahissent les églises comme « un bureau d’adresse où se distribuë tous les dimanches les nouvelles de ce qui s’est passé pendant la semaine chez les unes et les autres »[147]. On voyait même du côté de la Bulgarie de beaux costumes anciens, des chemises « brodées à l’entour des fentes de fil de diverses couleurs »[148].
[145] P. 108.
[146] P. 313-314, La Boullaye-le-Gouz, p. 394.
[147] D. C., ouvr. cité, p. 73-74.
[148] « Quant à la personne du Grand Seigneur, il faut convenir que des émeraudes, des rubis, des diamans sales et le pierotage dont les queues de ses boutons sont garnies ne répondent point à l’ornement que pourroit avoir un si grand empereur. Adjoutez… qu’il n’a point de gardes, ny de cavalerie qui le suive et que toute sa Cour consiste en six personnes qui ont chacun douze ou quinze valets plus ou moins » ; I, p. 107. Il parle ailleurs des « revendeurs, chinquelliers, merciers, tailleurs, trouppe risible…, Louvre ambulant », p. 271, 293.
La société militaire ottomane conservait l’ordre admirable que Galland constate et qu’un autre des voyageurs de cette époque, Delacroix, conteste uniquement pour faire mieux valoir la richesse et la splendeur de la force militaire française à cette époque et de la cour de Louis XIV. « Ils estoient », dit Galland (les janissaires), « assés proches l’un de l’autre, dans un très grand silence et dans une modestie qu’on auroit peine à rencontrer parmy la soldatesque de Sa Majesté. »
Sa Majesté, ce n’est pas, bien entendu, Louis XIV, mais encore le sultan. La discipline, la soumission à l’égard du sultan se conservent encore, et c’est ce qui a contribué à rendre capable de défense cette société ottomane, menacée par tant d’ennemis.
Ailleurs, le même Galland décrit ainsi le cortège impérial : « Je n’avois rien veu qui approchât de la beauté, de l’éclat et de l’apparence surprenante de la sortie hors d’Andrinople que Sa Hautesse fit en ce jour pour se mettre en campagne. Toutes les descriptions d’entrées, de triomphes, de tournois, de carouzels, de macareades et des jeux faits à plaisir que je me souviens avoir leues dans les romans n’ont rien qui doive les faire entrer en comparaison avec la pompe de celle effective que je considéray exactement avec tous les estrangers chrestiens qui s’y trouvèrent… J’ay de la peine à croire que, dans aucune cour de l’Europe, si on excepte celle de France, on puisse rien entreprendre de plus beau. Il n’y a point d’éloquence assés forte ni d’arrangement de paroles assés bien ordonné qui la puisse faire concevoir à l’esprit humain… Il faut l’avoir veu soy-mesme pour le pouvoir comprendre[149]. »
[149] P. 123.
L’ancienne vertu de tolérance se conserve intacte et les porteurs de chapeau sont acceptés comme des étrangers auxquels on témoigne toute la « condescendance souhaitée »[150]. « Bien souvent, dit Grelot, dans les caravanes c’estoit à qui me feroit le present de quelques fruits, de quelques tassées de café ou de sorbet, et je me souviens mesme de n’avoir jamais guère mieux passé le tems que durant les quinze jours de caravane que je mis au voyage depuis Alep jusqu’à Dierbeker[151]. » On chante en turc, en arabe ; on rit sans malice lorsque le voyageur, prié, entonne une chanson française[152]. La « netteté » se conserve aussi : « On ne voit point dans l’Orient ce qui arrive et qui se souffre dans toutes nos villes, sçavoir les dehors des temples infectez de l’urine et des autres excremens de ceux qui ne devroient s’en approcher qu’avec crainte et respect[153]. » On mange peu et l’« épargne qu’ils font sur leur bouche enrichit les familles ». La religiosité ancienne se maintient : « Il seroit à souhaiter », écrit le même voyageur, « que tous les chrétiens qui manquent de respect pour les temples et qui n’ont aucune attention aux prieres qu’ils y font pûssent quelquefois observer de quelle maniere les Turcs s’acquittent de l’étroite obligation que tous les hommes ont de prier Dieu avec beaucoup d’humilité et d’attention[154]. »
[150] P. 144.
[151] P. 225.
[152] Ibid., p. 225-226.
[153] Ibid., p. 241-242 (avec des détails curieux sur les précautions d’hygiène des Turcs).
[154] P. 253.
Un noble français, vivant dans la suite de l’ambassadeur d’Angleterre, trouve en 1687 que les Turcs, « generalement, sont bons, droits, affables, inviolables dans leur parole, intéressez veritablement, mais non assez pour mériter le nom d’avares, dont on les qualifie ordinairement ». Il constate qu’« ils se rendent exactement les uns aux autres ce qu’ils se doivent ». Et ailleurs : « Ils ne sçavent ce que c’est que des dez, des cartes, de jouer pour de l’argent, etc…, jeux qui gâtent, disent-ils, l’amitié ou la société. Les jeux de coquille ou d’une espèce d’échecs sont leurs innocents passe-temps[155]. »
[155] Le Mottraye, Voyages (voy. plus loin), p. 92-93, 228, 259-260.
Il est vrai cependant que, depuis longtemps déjà, comme nous l’avons déjà signalé, la défense de cet énorme empire est considérée, malgré les succès de la guerre de Crète, comme insuffisante. Dès la moitié du siècle, D. C. constate que la paix est tellement goûtée qu’on ne veut plus aller aux armées. Dans telle expédition de Pologne, « il sembloit que l’on y trainast les capitaines et les soldats, tant ils y alloient contre leur volonté. Quelques-uns des plus grands d’entre eux offroient de l’argent pour en estre exempts, les autres faisoient voir qu’ils rendroient plus de service demeurant dans le païs que s’ils alloient à l’armée ». Les janissaires sont devenus des rebelles qu’il a fallu massacrer[156]. En Chypre, on promène les troupes, on leur fait faire du bruit pour cacher le défaut des hommes[157]. A Constantinople même, en 1619, des Français, des marchands durent collaborer à défendre la capitale contre les pirates cosaques. Et cet écrivain croit qu’après une victoire aux frontières on pourrait marcher à la tête d’un soulèvement des chrétiens jusqu’aux murs délabrés de Constantinople[158].
[156] P. 253-254.
[157] Loc. cit., p. 340.
[158] Ibid., p. 199-200.
Aussi l’idée de la croisade, sous les auspices de laquelle le siècle avait commencé en France, est-elle très vivace dans les premières années de la majorité de Louis XIV. Il y a eu, sans doute, vers 1660, pendant le siège de Crète, et plus tard même, lorsque les vaisseaux français ont paru devant les Détroits, à l’époque où les Turcs n’étaient guère aimables à l’égard de certains ambassadeurs français un courant de croisade, qui était lui-même en relation avec l’idée qu’a eue, au commencement du siècle, le duc de Nevers de ressusciter pour lui l’empire byzantin[159], et en même temps avec la participation très fréquente et enthousiaste des cadets de familles de France à ces entreprises de piraterie dans la mer Méditerranée, qui avaient un caractère officiel, puisque c’était le grand-duc de Toscane et les chevaliers de Malte qui les organisaient. On peut faire une longue liste de chevaliers français, descendant d’assez grandes lignées de province, qui s’inscrivaient parmi les croisés pirates et certains d’entre eux, plus tard, se sont fait porter sur les registres de la marine officielle française.
[159] Cf. Les Mémoires de M. le duc de Nevers, prince de Mantoue, pair de France, enrichis de plusieurs pièces du temps, Paris, 1665, 2 vol.
Dans les notes ajoutées à l’édition définitive du voyage de Choiseul-Gouffier, dont il sera question, dans la suite, il est fait mention d’un travail qui se conserve à la Bibliothèque nationale et dont le titre dira combien les préoccupations de croisade étaient sérieuses pour les ministres de Louis XIV, même à une époque assez éloignée : « Estat des places que les princes mahométans possedent sur les costes de la mer Méditerranée, et dont les plans ont esté levez par ordre du Roy à la faveur de la visitte des eschelles du Levant, que Sa Majesté a fait faire les années 1685, 1686 et 1687, avec les projets pour y faire descente et s’en rendre maistres[160]. » Il est dû vraisemblablement à la mission officielle d’Otières et de Plantier, à un moment où des Couches envoyait son Voyage au Levant (1686), avec des notes sur les Détroits[161].
[160] Laborde, ouvr. cité, p. 58, note, et 59, note 1.
[161] IV, p. 33 et suiv. Le ms. porte la cote Suppl. français, no 19.
Le siècle finissait donc par des croisades en l’air, mais sur la terre il y avait un commerce rémunérateur qui les empêchait de se déclencher.
Le XVIIIe siècle commence par la publication du livre le mieux illustré sur le Levant qui eût jamais paru, livre qui n’est pas dû, cependant, à un Français ; il a été traduit du hollandais de Corneille le Bruyn, et publié en 1700-1702, en Hollande, à Delft. Il s’appelle « Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux endroits de l’Asie mineure, dans les isles de Chio, de Rhodes, de Chypre, etc., de même que dans les plus considérables villes d’Égypte, de Syrie et de la Terre Sainte ». Les illustrations sont de toute beauté. (La traduction porte le nom de « Lebrun ».)[162].
[162] Il mentionne d’Arvieux « personne fort civile, de qui j’ai receu toutes sortes de bons offices », p. 333.
Le voyageur avait emmené avec lui deux peintres d’un grand talent et, par les légendes des illustrations, on voit bien qu’ils appartenaient à deux nations : il y avait un Flamand et il y avait un Italien[163]. Et il serait de tout avantage pour l’histoire de l’art de réunir ensemble des illustrations dues aux voyageurs du XVIe au XVIIIe siècle, avec un léger texte d’explication, partant de Nicolas de Nicolaï pour ne pas s’arrêter à le Bruyn, mais pour continuer par le splendide album français dont les grandes planches se rapportent à l’ambassade de de Ferriol, à cette époque du début du XVIIIe siècle.
[163] A la même époque, on donne aussi la traduction du grand ouvrage de Dapper sur les îles de l’Archipel, Description exacte des isles de l’Archipel traduite du flamand, Amsterdam, 1703.
En fait de voyages français, les premiers qui se présentent sont dus à des envoyés officiels dont la mission, bien précise, est de chercher des médailles, des monnaies, de rassembler des inscriptions, de contribuer ainsi à la connaissance de l’antiquité[164].
[164] Voy., pour les conditions de leur travail, H. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1902. Un récit du voyage de Laisné, « très succinct et avec fort peu d’intérêt », p. 47 (ms. fr. 10.775 de la Bibl. nationale de Paris). Des lettres et notes de Vansleb dans Omont, loc. cit., et dans les mss. 17172 et nouv. acq. fr. 4193 de la même Bibliothèque (voy. Omont, ouvr. cité, p. 64, note 3. On lui doit l’Histoire de l’Église d’Alexandrie, Paris, 1677). Ses renseignements sur Chio, p. 150 et suiv. Cf. Antoine des Barres, Estat present de l’Archipel, Paris, 1678. Des notes d’un chevalier de Constantin en 1685, ms. fr. 14682 de la même Bibliothèque ; voy. Omont, ibid., p. 191, note 1. Le voyage de Toulon à Constantinople du P. Braconnier au ministère des affaires étrangères ; sa description de l’Athos dans l’Appendice du volume de M. Omont, qui cite aussi le voyage au Levant de Louis Chevalier, ms. 3511 de la Bibl. de l’Arsenal.
Ceci forme la troisième attitude de la royauté de Louis XIV à l’égard des Turcs. La seconde était caractérisée par des préoccupations de commerce, alors que, après 1680, la croisade commence à être abandonnée (mais en 1685 encore, d’Estrées paraissait devant Tripoli de Syrie)[165]. Les soucis scientifiques, constatés déjà à l’époque d’un Richelieu et Mazarin, par les explorations d’un Harlay de Césy après 1612, par l’envoi d’un Orgeville à la recherche de manuscrits et continués aussi par un Dorval, un Vansleb, auteur du Journal d’un Voyage fait en Égypte (Paris, 1677), par un Besnier, par Monceaux et Laisné (1667 à 1675), par un Vaillant, un Père Braconnier, n’apparaissent pas encore : d’Arvieux et Tavernier, avec sa route du diamant, lui appartiennent.
[165] La Motraye, Voyages, I, p. 106.
Mais il y a, à la fin de ce grand règne, une tendance pareille à celle qu’on retrouvera à la fin du siècle, lorsqu’il y aura la grande mission scientifique d’Égypte qui a dévié un peu sur la Turquie aussi.
I. — Parmi ces voyageurs, le premier est Paul Lucas, dont le volume a paru à Rouen en 1704[166]. Le voyageur était cependant en Orient dès 1688-1696, et, dans le récit, dont il sera bientôt question, d’un Français ayant plutôt des relations en Angleterre et qui a publié, dans deux splendides volumes, le résultat de ses explorations, La Motraye, il y a une note sur Paul Lucas, à la date de 1702 : « Paul Lucas, jouaillier, medailliste et medecin, avec pension et commission de la Cour de France, pour la recherche des raretés de l’antiquité ».
[166] Voyage du sieur Paul Lucas au Levant. Autres éditions en 1710, 1712, à Rouen, 1719-1720, 1724. Sur ses trois voyages et les trois personnes différentes qui leur ont donné une forme littéraire, Omont, ouvr. cité, p. 317 et suiv. Le premier a eu lieu en 1688-1696.
Et on ajoute qu’il habitait à Constantinople, chez une dame qui s’appelait la « Kératsa Magdalena », c’est-à-dire Madame Madeleine, qu’on surnommait ordinairement « La Belle Hôtesse, parce qu’elle avoit assez de beauté »[167]. Et c’est là qu’il a découvert un jeune Paléologue, qui ne l’était pas, probablement, mais qu’il a amené en France, pour le présenter à la duchesse de Bourgogne, voulant en faire une espèce de prétendant au trône de Constantinople : il a mal tourné et on en a fait un abbé dont on n’a plus de nouvelles.
[167] I, p. 295-296.
Dans sa préface, Paul Lucas montre très nettement quel est son but. « Destiné à voïager dès sa plus grande jeunesse », dit-il, il se rend bien compte qu’il y a déjà un très grand nombre de voyages « qui ont été imprimez dans les deux derniers siecles », et il ajoute que son voyage à lui a été commandé : « Je n’ai eu d’autre dessein dans mes voïages que d’exécuter les ordres dont le feu roi » (Louis XIV était mort au moment où il rédigeait sa préface) « de glorieuse mémoire, m’avoit chargé, et je me suis toujours appliqué à la recherche des médailles, des pierres gravées et des autres monuments dont il vouloit enrichir sa bibliotèque et son cabinet, et Sa Majesté, ainsi que ses ministres ont toujours paru contents de ce que j’en avois rapporté. »
Dans ce but le missionnaire royal ira jusqu’à Larissa, où il est retenu par les troupes turques allant en Morée (1715), et à Salonique, au Mont Athos.
La préface est adressée au régent. On peut bien s’imaginer que le récit, très étendu, ne s’occupera qu’en passant des réalités actuelles, comme la coutume des filles de tel village grec d’« inviter les voyageurs à venir chez elles boire du vin du païs qui est excellent » ou les fourberies des Juifs changeurs, « sans doute les plus rusez et les plus intéressez négocians qui soient dans le monde », qu’il cherchera, avant tout, la découverte des trésors monétaires, des pierres gravées qu’il prise beaucoup plus que n’importe quelle observation sur le milieu vivant. Or, pour quiconque poursuit dans les voyageurs, avant tout, leur attitude à l’égard de ce monde étranger et le caractère essentiel de ce monde lui-même, il y a toute perte. D’autant plus que Lucas donne une chronique de Constantinople, où comme médecin il a pu pénétrer jusque chez la sœur du sultan, et qu’il a essayé une histoire de l’empire ottoman à partir de 1703. Pour l’archéologie cependant, cela a été une mine avant des études beaucoup plus sérieuses, et surtout avant l’emploi de méthodes plus scientifiques.
Le pli était déjà pris, et après Paul Lucas il y aura toute une série de voyageurs, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, qui suivront la même voie.
Voici qu’en 1717 paraît à Paris le voyage de Pitton de Tournefort, Relation d’un Voyage du Levant. Le but de Tournefort est fixé dans la préface : il a été chargé par un ministre, de caractère scientifique, de la royauté française, par Pontchartrain, qui avait le soin des Académies, d’aller, avec un médecin et avec un peintre, Aubriet, dans le même but d’enrichir les collections du roi et, aussi, celles de l’Académie.
En même temps qu’il décrit les coutumes populaires des Crétois, « de fort bons humains », et qu’il s’arrête sur le peuple des îles de l’Archipel avec la scène des vendanges à Naxos et la présentation des costumes de Mycone, il rapporte des documents antiques vraiment intéressants, mais, cette fois encore, notre curiosité est déçue. Nous préférons un naïf comme Thévenot, qui regarde de tous côtés, qui voit, qui note chaque chose, qui est en perpétuelle émotion de curiosité devant l’inédit qu’il rencontre sur son chemin, à ces savantissimes personnages dont le but est si nettement déterminé qu’ils s’interdisent toute recherche à côté.
Le troisième des voyageurs de cette époque, La Motraye, qui part d’Angleterre, où il a toutes ses relations, est un très grand chercheur de curiosités de tout genre pendant « plus de vingt-six ans » (ailleurs il parle d’une absence de vingt-sept ans de France). Il a traversé la Turquie plusieurs fois, et, dans ses deux gros volumes admirablement imprimés, avec la contribution pécuniaire des grands seigneurs de l’Angleterre, des riches marchands de ce côté-là et aussi d’autres connaissances dans le monde occidental[168], il y aura en plus, des notes sur l’Europe centrale, sur cet Occident même dont il vient. Il est en Turquie au commencement du XVIIIe siècle, et il y sera encore en 1714, quand il visitera à Bender (Tighinea) le roi de Suède, Charles XII, qui s’y était réfugié, et obtiendra même certaines confidences des siens. Puis, lorsque le roi de Suède a eu le désir de revenir dans ses États et qu’il a traversé toute la péninsule des Balkans et, en même temps, la Valachie, parmi les personnes qui l’ont accompagné, il y avait la Motraye, de sorte que, pour le séjour en Turquie du héros scandinave, ce voyageur est, sans doute, une source de tout premier ordre. J’ajouterai aussi qu’il est un très bon témoin — à côté des inscriptions qu’il recueille, à côté des dessins qu’il fait faire, et il y en a qui sont vraiment très beaux, — de tout ce qui se passe dans la société turque de Constantinople et d’ailleurs. Ce protestant vagabond espérait même y former un établissement[169]. Introduit par un horloger français, système que d’autres ont aussi employé avant lui, il peut visiter même le sérail, avec ses pendules anglaises et le chaos de belles choses, et le sérail de glaces de la sultane mère. Il y a même tout un chapitre d’histoire à partir d’Ahmed IV.
[168] Voyages du sieur A. de la Motraye en Europe, Asie et Afrique, La Haye, 1727.
[169] I, p. 175.
La vie misérable du pauvre « roi de Hongrie » Tököly, qu’il ira chercher jusqu’en Nicomédie, où, bien que buvant moins que sa femme, la reine, l’exilé finit par se tuer en rasades, peut être reconstituée aussi par le moyen des récits de cet inlassable fureteur et bavard[170].
[170] I, p. 229, 281 et suiv., 308-309, 317, 377 et suiv.
II. — L’arrivée en France de l’ambassadeur turc Tschélébi Méhémed-Effendi, favori du vizir Ibrahim, après la mort duquel on l’envoya finir ses jours en Chypre[171], fournit à un anonyme, au moment où on frappait des médailles pour commémorer cette extraordinaire visite, entourée d’une pompe lui correspondant, l’occasion de présenter, en même temps, dans la Nouvelle description de la ville de Constantinople avec la Relation du voyage de l’ambassadeur de la Porte ottomane et du séjour à la Cour de France (Paris, 1721), toute une description de la vie à Constantinople qui est de l’information la plus intime et la plus sûre, dépassant de beaucoup tout ce qui avait été donné jusque-là sur ce sujet. Cette œuvre dont on ne pourrait pas découvrir l’auteur — il paraît avoir été contemporain de Mourad IV, au règne duquel, « sage et vaillant et fort grand œconome », s’arrêtent la plupart des détails, sauf qu’on a ajouté çà et là quelque chose sur le sultan régnant alors, Achmed, — présente longuement et avec compétence les monuments de la capitale ottomane, redressant plus d’une fois les opinions courantes. On apprend ainsi qu’à la prison des Cent Tours, considérée comme une terrible « Bastille », on abritait aussi des princes ottomans, comme, en 1660, les deux fils du roy de Thunes et le roy d’Yémen et que les prisonniers, libres de se promener dans l’enceinte des ruines, avaient « des logemens très beaux et quatre domestiques chacun ». Tout le spectacle de la Stamboul du XVIIIe siècle passe devant le lecteur, avec les pehlivans qui font leurs tours de force devant la mosquée de Bajazet, avec le monde des boutiques et les fidèles des mosquées. Au sérail, sont énumérés les dignitaires de tout rang, rangés par groupes de trente : pour la chemise, pour le pourpoint, pour la « petite soutane étroite », pour la « jupe de dessous », pour la « robe fourrée de peau », pour le turban, pour les chausses et les chaussettes, les souliers, le lit, pour « ranger la chambre » et pour « avoir le soin de la tenir nette ». Le sultan apparaît sous la voûte du Trésor secret pour sceller du sceau traditionnel, dont est donnée l’archaïque inscription en turc, les « sacs de cuir, chacun de quinze mille ducats ». Assis sur ses pieds, il tend, lui, le grand lecteur qu’était Achmed, la main vers les deux armoires aux vitrines de cristal où sont ses livres d’histoire. L’auteur, qui a dû poser souvent des questions à l’ambassadeur, dont le fils reviendra en France, parlant le français comme un indigène du pays, sait où sont les monnaies neuves que le maître donne à ses bouffons, à ses muets et aux pauvres, où se cachent les « livres fort curieux, de toutes sortes de langues, écrits à la main, et particulièrement cent vingt volumes de Constantin le Grand, chacun long de deux brasses et environ large de trois paulmes, faits d’un parchemin si délié qu’il semble de la soie », écrits en lettres d’or et couverts d’argent doré, avec des pierres précieuses d’un « prix inestimable » et contenant le Vieux et le Nouveau Testament et autres histoires et Vies de « saints ». Il sait où est recueillie la farine, la « fleur de farine », dont, avec du « lait de chèvres que l’on nourrit exprès pour ce sujet dans les bois du Serail », on pétrit le pain de l’idole impériale, les « vingt pains de quatre livres chacun », dont ne goûtent que les plus grands et les plus rapprochés du prince. Il pénètre dans les offices et les « cloistres » qui abritent 3.400 personnes tournant autour de l’ombre de Dieu sur la terre. Il fait le compte exact des gens de l’Arsenal, des janissaires, des différents corps de l’armée et des artisans, jusqu’aux tailleurs et aux « poulaillers du Sérail ». Il introduit le lecteur dans les appartements d’Achmed, le fait voir au milieu de ses femmes, dont la Hassé qui a une couronne, alors que dans son antichambre est déposé le sceptre de son époux et le montre sortant pour le vendredi, des prières ou le voyage d’Andrinople.
[171] Relation de l’ambassade de Mahomet-Efendi à la Cour de France en MDCCXXI, écrite par lui-même et traduite du turc. A Constantinople et se trouve à Paris, 1757.
Presque au même moment, le sieur de Pellegrin, adonné à la poésie et au bavardage, faisait son Voyage en Morée[172], où il avait été nommé vice-consul à Modon, présentant la population, comme assez laide de visage, sauf les coquettes de Chio, insolente quant aux Turcs, ignorante en général, mais sachant retenir mieux que les Occidentaux l’argent qu’elle a gagné.
[172] Relation du voyage du sieur de Pellegrin dans le royaume de la Morée ou recueil historique de ce qui s’est passé de plus remarquable dans ce royaume dépuis (sic) la conquête que les Turcs en ont fait sur les Vénitiens, Marseille, 1722.
Dès 1728, l’ambassadeur étant de Bonnac[173], l’abbé Sevin, académicien, se trouvait en Turquie, où il a une audience chez le grand vizir, ne s’y présentant « guère plus avantageusement monté que le fameux héros de la Manche », ce qui expliquerait pourquoi « on l’a chassé vilainement de la chambre ». Il travaille à « déterrer » des manuscrits avec l’aide de Saïd-Effendi, « adorateur d’Aristote », et du médecin juif Fonseca, bien connu aussi par ailleurs, sans lui communiquer cependant toutes ses intentions.
[173] Voy. ses Mémoires historiques sur l’ambassade de France, éd. Ch. Schéfer, Paris, 1894, avec les rapports de la Haye, de Chateauneuf, de Ferriol, de Désalleurs.
C’est le premier qui, avec l’abbé Bignon, pénètre dans les mystères des bibliothèques turques, pouvant noter une Histoire de l’Abyssinie en sept volumes, une autre, tout aussi vaste, de l’Égypte, une Histoire de l’Arménie, même, à la Mosquée de Sélim, trois ou quatre mille volumes orientaux, des registres vénitiens : tels manuscrits auraient été brûlés par ordre de Mourad IV, beaucoup d’autres avaient passé dans la bibliothèque du prince Constantin Maurocordato. Revenant, avec non moins de 600 manuscrits pour la Bibliothèque royale, Sevin parle d’« un dépôt qui se conservait à Boccara, ville des Tartares Usbegs : c’est là que Tamerlan avoit transporté les manuscrits des peuples divers que ses armes lui avoient assujetis ».
Le patriarche de Constantinople donne facilement de précieux manuscrits. L’abbé trouve cependant que c’est le « plus vilain pays qui fut jamais », sans en excepter les femmes à « doubles culottes ». Ce qui ne l’empêche pas de donner la chronique de Stamboul[174] avec des appréciations sur le sultan « détesté » et la description de l’entrée des envoyés afghans, « mal peignés »[175].
[174] Lettres sur Constantinople de M. l’abbé Sevin, de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, écrites pendant son séjour dans cette ville, au comte de Caylus. Les lettres de Lironcourt (Égypte, 1749), de Carbeltane (Constantinople, 1746), des deux Peyssonnel (voy. plus loin) y sont ajoutées. Elles sont tirées de l’Hist. de l’Académie des Inscriptions, VII. Une riche correspondance de Sevin et de Fourmont, dans Omont, ouvr. cité, p. 393 et suiv., 1078 et suiv.
[175] P. 35.
L’abbé Fourmont, le compagnon de Sevin, chargé de recueillir des monnaies en 1729 et 1730, n’a pas publié son récit de voyage, mais son neveu, interprète du roi pour les langues orientales et surtout pour l’arabe, est auteur d’une Description historique et géographique des plaines d’Héliopolis et de Memphis (Paris, 1755). Ajoutons que le comte de Caylus lui-même, auquel s’adressent ces correspondants, avait fait, avec le comte de Bonnac, ambassadeur du roi, un voyage à Constantinople, en 1716, qui n’a pas été publié[176].
[176] Lettres de Sevin, p. 403 et suiv. Sur les splendeurs byzantines de l’intérieur du Sérail, p. 405 et suiv. Voy. Omont, loc. cit., et surtout p. 1085 et suiv., 1126 et suiv., 1144 et suiv. (introduction de son ouvrage). Les lettres de l’érudit Villoison (1785) employées dans les notes du second volume de Choiseul-Gouffier (voy. plus loin), sont restées inédites (ms. 1490 de la Bibliothèque nationale de Paris).
III. — De Saumery, dont les Mémoires et avantures secretes et curieuses d’un voyage au Levant ont paru à Liége en 1732, est un sujet de l’empereur dans les Pays-Bas, qui dédie ses deux volumes au bourgmestre de sa ville natale. Ayant passé trois ans dans l’empire ottoman, dont il veut présenter le développement dès 1715, il promet au public des choses inédites et particulièrement savoureuses, comme « la fête des fleurs », la soirée des tulipes, « les agréments et les beautés du petit Belgrade, de la vallée de Quelquana », etc. Des innovations introduites « au retour de Tschélébi Méhémet Effendi, envoyé en France en qualité d’ambassadeur, qui apporte un plan du canal de Versailles » (et Saïd, son fils, futur directeur de l’imprimerie turque, l’amour du vin, une mauvaise maladie due aux belles dames qu’il a fréquentées ; on avait parlé du voyage prochain du fils du sultan en France)[177]. Deux autres volumes furent publiés sur l’histoire de l’empire entre 1715 et 1723, avec la révolution qui en 1721 détruisit la prospérité de la florissante Chio, avec un dialogue entre un renégat et un ministre protestant, sans compter les historiettes d’amour et les anecdotes comme celle du prince arménien qui « passoit pour avoir cinq cens ans » et « du renégat Galiot, arrivé aux plus hautes faveurs », et enfin la description du retour par Smyrne et les îles ; le quatrième volume n’a jamais été publié.
[177] III, p. 160.
Parti en décembre 1719, arrivé à Constantinople en mars 1720, ce simple curieux, qui ne se pique pas de connaissances archéologiques, ne manque pas de relever la beauté des femmes de Chio, « courtoises », mais aussi « libertines » et, ce qui est encore pis, « presque toutes attaquées du mal françois » ; il n’y entend pas seulement les « cris affreux des monstres marins » (sic), il ne subit pas seulement l’ivresse qu’on lui impose amicalement, il s’intéresse aux Occidentaux qu’il y trouve : un Provençal, un cabaretier français, le consul de France n’étant qu’un Grec, « pauvre comme Job ». Si, à Constantinople même, il s’en va chercher le prince Rákóczy, prétendant de Hongrie, qu’il découvre, avec « ses habits pauvres, son air négligé, une grande barbe qui lui descend jusqu’à la ceinture », s’il se prend d’amitié avec Boissonet, le joaillier du sérail, il fouille partout, avec un sens rare pour le pittoresque et l’inattendu. Il a assisté en 1721 à la cérémonie de la circoncision des trois jeunes sultans, devant 20.000 janissaires et la multitude de la plèbe, à laquelle on jette 100.000 écus, à l’entrée de l’ambassadeur de Pologne, au départ de l’empereur, à la parade de la reine de Géorgie et de l’envoyé de Mirvéis, son ennemi. Il a contemplé les Turcs jouant à la coquille, sans risquer leur argent et trouvant qu’« il faut être possédé… pour en agir comme les Francs » ; il a eu les « oreilles écorchées » par les chansons turques. Et, plus d’une fois, il a passé des heures agréables dans la belle maison de cet ambassadeur de Hollande, Collyer, qui se ruine à satisfaire les caprices de sa femme grecque, ou dans celle de son neveu La Fontaine. Il s’est défendu contre les charmes, qu’il juge irrésistibles, des belles dames de Constantinople, qu’il ne faut pas cependant offenser d’un refus.
Tollot, auteur du Nouveau voyage fait au Levant ès années 1731 et 1732, contenant les descriptions d’Alger, Tunis, Turquie, Tripoly de Barbarie, Alexandrie en Égypte, Terre Sainte, Constantinople, etc. (Paris, 1742), est un voyageur qui tient qu’on sache que, bien différent de ceux « qui, sans sortir de leurs cabinets, ont donné au public des voyages qu’ils ont dit avoir fait au Levant » (il emploie Gassot), il a parcouru toutes ces contrées, à partir de la côte de Barbarie, où les Mores lui paraissent, avec raison, bien différents des Turcs qu’il a dûment étudiés dans leur capitale, ajoutant à ses impressions personnelles l’histoire de la révolte de Patrona-Khalil, dont il a vu le dernier acte, les exécutions d’une trentaine de rebelles par jour, et l’« histoire de Tophal (Topal) Osman ». Après avoir visité l’Égypte et la Syrie, fait son pèlerinage à Jérusalem et vu les îles de Chypre et de Rhodes, plus Samos, et avoir constaté à Smyrne combien est libre la vie des Francs, qui « ont des maisons de campagne et vont à la chasse quand bon leur semble », Tollot présente à Constantinople l’entrée d’un ambassadeur russe, Chtscherbatov, qu’il accompagne lui-même, et se moque à cette occasion de la garde impériale, qui n’a pas l’air composée de vrais soldats, mais plutôt de « masques », les babouches aux pieds, « un couteau de ceinture », la « calote rouge et verte avec un boudet d’étoffe blanche à l’entour et devant » et « une plaque de cuivre jaune » supportant la cuiller de « pelau » (pilav) des janissaires, puis des cérémonies rituelles des bizarres derviches, reproduisant les coutumes orgiastiques de la très vieille Asie. Et on a par ce témoin intelligent l’« empereur » lui-même, pris au vif dans cette image : « Le Sultan n’avoit rien de magnifique dans son habillement ; il n’y avoit que son turban, dont l’aigrette étoit de perles et de petits diamants et, de plus, devant un diamant, de la grosseur d’une petite noix qui avoit un brillant des plus beaux ; on en voyoit un autre en haut du turban et un derrière ; la poignée de son sabre étoit garnie d’or et de diamants, ainsi que sa masse d’armes qui étoit portée par le chef des eunuques… Il est brun, beaucoup marqué de petite verole, les yeux fort beaux, le nez aquilin, le visage plus oval que rond ; sa taille m’a paru médiocre, n’en pouvant décider positivement ne l’ayant vu qu’à cheval ».
Un voyageur d’un caractère peu commun est ce Jean-Claude Flachat qui publiait en 1766, à Lyon, ses Observations sur le commerce et sur les arts d’une partie de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et même des Indes Orientales, s’intitulant « directeur des établissements levantins et de la manufacture royale de Saint-Chamond, associé de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon » et dédiant son ouvrage en deux volumes à un ministre.
Ce « négociant », qui était aussi un homme de science appliquée, un inventeur, un fabricant même de ces choses curieuses qui lui gagnèrent l’entrée dans les harems et la faveur du tout-puissant « aga des filles », du Kizlar-Aga, principal ministre de l’empire ottoman, présente une suite parfois déconcertante, mais toujours pleine de visions nouvelles, de notes de voyage, d’informations historiques, de considérations générales, très souvent inutiles, et de dissertations de physique, chimie et botanique. Bazarguidan, « fournisseur du Sérail même », titre officiel qui lui suscita beaucoup d’envie impuissante, ce créateur de poupées mécaniques irrésistibles pour un monde désœuvré de pauvres femmes curieuses, ignorantes et naïves, se mêle de projets de commerce que, plus tard, il paraît avoir pu réaliser en partie comme fonctionnaire royal.
Après une longue traversée de l’Europe centrale et de la Hongrie, le voici d’abord en Valachie, où le prince « philosophe », fils et petit-fils de lettrés, Constantin Maurocordato, lui apparaît comme un homme extraordinaire qui aurait été capable, sur un théâtre plus large et avec plus de liberté, d’entreprendre avec succès l’œuvre réformatrice de Pierre le Grand. Il y trouve des amis grecs, un Andronaki, un médecin, Michel, un Antoine, qui lui dit à l’oreille, au moment de se séparer sur la frontière du Danube, combien périclitée et destinée à une issue fatale est la situation de ce dominateur entouré dans sa fragilité politique d’une pompe qui est celle des empereurs de Byzance. Pour échapper à ces surprises qui attendent le prince et tous ses serviteurs, Flachat se rend à Constantinople, et la route qui y mène à travers les Balkans est décrite minutieusement. Partout sont relevés, comme on ne l’avait pas fait depuis Belon, les procédés archaïques usités dans la vie populaire, comme le battage du blé en Grèce.
« Rien n’égaloit », dit-il, « l’impatience que j’avois de voir Constantinople ». Son « compatriotisme, s’il est permis de parler ainsi », est satisfait par la façon dont l’accueille l’ambassadeur de France, de Castellane. Bien qu’attiré par l’idée d’un voyage en Asie ou au moins jusqu’à Rhodes, il prend racine dans cette capitale qu’il décrit à la façon des voyageurs habituels auxquels il ne ressemble guère par sa hardiesse, son esprit d’entreprise, son désir ardent de réaliser quelque chose. Collaborant aux fêtes turques, il ose écrire que « la description qu’on nous fait des fêtes que Louis XIV donnoit à Versailles n’ont rien que l’on n’ait au moins égalé sous le règne de Mahamout » et il décrit « la fête des tulipes dans le sérail Tziragan », qu’il est le premier à révéler, avec les milliers de lampes qui éclairent discrètement dans la nuit les parterres des fleurs rares, d’une infinie variété. Ce qui suit est la meilleure histoire, restée jusqu’ici inutilisée, de l’empire ottoman avant et après la mort, en 1754, du sultan Mahmoud et sous la dictature de Hadschi-Bektach, le Kizlar-Aga. Le fournisseur des belles dames du sérail qu’il a eu une fois le privilège unique d’abriter dans sa maison de Péra, l’intime des architectes qui, comme Ali-Effendi, travaillent aux nouveaux palais et pavillons de Béchictach, d’Aga-Bactchessi et de Top-Kapou, y est non seulement témoin, admis à tout voir, mais acteur même des drames qui se passent dans ce monde turc, des faveurs inattendues et des sanglantes sanctions : « il n’y a nulle comparaison », s’exclame-t-il avec satisfaction, « entre les anciennes maisons impériales et les nouvelles ». En revenant en France, dès 1756, pour innover dans le commerce du Levant, il apporte avec lui « deux teinturiers d’Andrinople, deux étameurs de Constantinople, dont l’un faisoit des caffetieres, un fileur persan et l’arçonneur de Smirne », sinon aussi, comme il le voulait, « l’Indien brodeur au tamis », « les faiseurs de vitriol de Chypre » qui répondront plus tard à son appel. C’est, du reste, le moment où la Porte venait d’avoir un « envoyé plénipotentiaire » en France, Saïd-Effendi, un des intimes de Flachat[178].
[178] II, p. 362. Il assure que « le seul négoce du Levant suffiroit à la nation » ibid., p. 501.
IV. — Un voyageur qui présente d’une autre façon l’érudition mérite vraiment d’être signalé. Il s’appelle Guys : c’est un médecin de Lyon qui, s’associant un camarade de voyage, entreprend une expédition en Orient, où il reste pendant longtemps, sa famille elle-même étant intéressée dans le commerce de ces régions, car il parle de son beau-père Magy, qui y est mort, d’un autre membre de sa famille qui a fini ses jours en Égypte[179], de sorte qu’il était un peu chez lui là-bas.
[179] I, p. 132 et 132 note.
Il ne présente pas des observations de voyage au cours même de ses excursions. Son but — et ceci donne un caractère de profonde originalité à ses deux petits volumes, charmants de présentation, comme ils le sont aussi en ce qui concerne leur contenu — est de montrer que, pour connaître la vie des Grecs anciens, il faut s’adresser aussi aux coutumes populaires de la Grèce moderne[180]. C’est la première fois, et je crois aussi la dernière, au moins au XVIIIe siècle, qu’on a eu cette idée. Connaissant admirablement l’antiquité, ayant sur fiches tout ce qui concerne les coutumes de l’Hellade, il le met toujours à côté de ce qu’il a observé. Il y a dans son livre, — après la mention des « tragoudi » dans la Guilletière, — des chansons grecques[181] ; il y a aussi des chansons turques (car il connaissait les deux langues). L’auteur y ajoute des notes sur les différentes façons de danser. On peut dire que c’est le premier folkloriste qui dirige ses regards vers l’Orient.
[180] Il sait que les Grecs modernes gagnent jusqu’à Bassora, aux Indes, en Russie, à Venise, en Hollande, mais aussi à Martinique ; les drapiers grecs travaillent à Constantinople pour le Languedoc ; I, p. 326 et suiv. Sur les étoffes de Chio, p. 333.
[181] Un ἀκρόστειχον εἰς τραγοῦδι, I, p. 135.
Le style est tellement agréable, il touche d’une main si légère à ces observations délicates, à ces rapprochements fins que ce serait un très bon livre de lecture, même maintenant[182].
[182] Voyage littéraire dans la Grèce, ou Lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallèle de leurs mœurs, par M. Guys, négociant, de l’Académie de Marseille, Paris, 1771. Il y a une autre édition, avec des illustrations soignées.
Et on est ému par les quelques lignes de sa préface où il dit en s’adressant à ses enfants : « Quand vous serez sur les bords du Canal qui sépare l’Europe de l’Asie, ou dans la forêt de Belgrade, ou qu’en sortant de Péra, vous vous asseoierez sur les marches du cimetière des Arméniens et des Grecs, j’aime à me flatter, mes chers enfans, que vous direz, avec un même plaisir, et avec le sentiment que j’éprouve en parlant de vous : « C’est ici que mon père, seul avec un livre ou accompagné d’un ami, a passé les plus doux momens de sa jeunesse. »
Oserait-on comparer Guys, le pauvre marchand, pauvre au moins comme situation, qui n’était que membre de l’Académie de Marseille, avec un autre qui a été membre de celle de Paris et qui portait un grand nom, qui a joué un rôle de premier ordre dans la société contemporaine, Choiseul-Gouffier, auteur d’un Voyage pittoresque qui n’est guère pittoresque, je m’empresse de le dire, du célèbre Voyage Pittoresque dans l’Empire Ottoman, en Grèce, dans la Troade, les îles de l’Archipel et sur les côtes de l’Asie Mineure[183] ?
[183] La première édition du premier volume est de 1782. La seconde édition du même, complétée, est de 1842. La première partie du volume II ne fut publiée qu’en 1849.
Voici ce que présente ce diplomate, créateur d’une imprimerie franco-arabe à Constantinople et éditeur en 1787 des Éléments de la langue turque du P. Viguier[184], qui a visité toutes les îles de l’Archipel et qui a bien connu Constantinople, où il a été ambassadeur, y faisant un très long séjour, y restant même après la fin de la politique qu’il représentait, car il n’a pas voulu quitter cette capitale ; il alla enfin en Russie d’où il ne revint que lorsque l’ordre eut été de nouveau établi en France. Son information archéologique est extrêmement riche.
[184] Voy. Omont, dans la Revue des Bibliothèques, 1895, p. 236.
Son enthousiasme pour l’ancienne Hellade, bien qu’il doive défendre la politique de l’intégrité ottomane, est sans bornes. Son style peut être plus châtié que celui du marchand, mais, cependant, il n’a rien de cette spontanéité, de cette curiosité passionnée, de cette finesse extrême d’un style pourtant si simple, qui distingue le livre de Guys.
D’autant moins pourrait-on demander ces qualités au simple archéologue et à l’archéologue simple qu’a été l’abbé Le Chevalier, qui, devenant secrétaire du prince de Moldavie, a disparu obscurément pendant la guerre russo-turque ouverte en 1788. Son Voyage de la Propontide (Paris, 1800) n’est qu’un assez long effort d’arriver à des identifications de localités anciennes, surtout dans la Troade, le bon ecclésiastique étant obsédé du souvenir du beau-père royal de la belle Hélène. Mais toute une partie de l’ouvrage parle des monuments turcs de Constantinople, de la façon de vivre de la population et de ses mœurs, de la défense de la capitale, des églises grecques et du Phanar, des Français qui, comme Lafitte, exécuté par la Révolution à Perpignan, font des travaux militaires à la frontière russe.
V. — Entre Guys et les voyageurs philosophiques et politiques de la fin du XVIIIe siècle, se placent deux voyages nettement caractérisés : l’un d’eux est le voyage du sieur Charles de Peyssonnel (né en 1727, avocat en 1735 à Constantinople, revenu en 1790 ; mort à la même date)[185]. Cet homme très savant, consul de France en Crimée, puis en Crète et à Smyrne, était lui aussi un archéologue. Guys même, qui a été son ami et son correspondant de commerce, donne une quantité de notes sur lui ; une lettre de ce voyageur lui est dédiée et, en même temps, on publie un travail de lui sur telle inscription qui a été trouvée sur les murs de Byzance[186].
[185] Sa biographie dans Omont, ouvr. cité, p. 740, note 2.
[186] II, p. 162-163 (à Andros, en 1748), 185 et suiv., 193 et suiv., 196 et suiv.
Peyssonnel, historien de l’île de Crète aussi, a recueilli des observations extrêmement précieuses sur les Tatars, à l’époque où ils avaient déjà des relations avec l’Occident : relations de commerce avec la France à côté de relations, un peu forcées, vers la Russie, qui avait commencé par proclamer hautement qu’elle voulait rendre la liberté à la nation tatare et qui, après leur avoir rendu la liberté, s’est empressée de l’annexer, au cours d’une beuverie extraordinaire, à laquelle avaient été conviés tous ces adversaires du vin de par la décision du Coran ; acclamée par les Tatars ivres, la tzarine, Catherine II, a déclaré alors que la liberté tatare finit par un acte « d’auto-détermination ».
Le consul auprès du Khan Krim-Guiraï avait rassemblé des observations de commerce, qui lui ont été d’abord volées par son secrétaire parisien, pour en donner une édition subreptice en Hollande, avec une préface dans laquelle le vrai auteur ne figure que par son initiale comme consul en Crète, à côté de différents Orientaux imaginaires : un médecin de Constantinople qui s’appelle Brossard, un Juif de Caffa, un Arménien qui a visité le Couban, un Grec revenant de Trébizonde, un Géorgien de Perse, des patrons grecs[187].
[187] Observations sur le commerce de la Mer Noire et des pays qui la bordent, auxquelles on a joint deux mémoires sur le commerce de Smyrne et de l’isle de Candie, Amsterdam-Leyde-Rotterdam-Utrecht, 1787, p. XX.
A la fin, le pauvre auteur de tout cela s’est empressé, après avoir vu cette contrefaçon de Hollande, de publier son propre ouvrage, qu’il a fait paraître, sous le même titre, à Paris, en deux volumes, cette même année 1787.
Peyssonnel, qui était dès 1755 à la cour des Khans[188], est un indicateur du commerce pratiqué et du commerce qu’on pourrait faire dans ces régions. Il s’occupe aussi de la Moldavie, de la Valachie, de la Bulgarie. Comme information commerciale, c’est un travail de tout premier ordre et, dans la littérature européenne sur l’Orient, il n’y a rien qui puisse être mis à côté de cette étude que complète le Mémoire sur l’état civil, politique et militaire de la Petite Tartarie, envoyé en 1755, aux ministres du roi[189].
[188] Il succédait à Venture de Paradis. Le chirurgien Ferraud avait demandé le poste dès 1720 ; Saumery, ouv. cité, III, p. 188.
[189] A la fin des observations, II.
VI. — Il y a un autre bon connaisseur de l’empire ottoman à la même époque, un voyageur très curieux, par son origine : fils d’un réfugié hongrois de la suite du prétendant Rákóczy, par sa tournure d’esprit enjouée, par sa mission d’instructeur militaire des Turcs de Sélim III et de fondateur d’une fabrique de canons, bien que n’étant pas Français de naissance, mais élevé en France, il avait toute l’attitude, sinon la mentalité entière, d’un Français. Il s’appelle de Tott. Il a passé chez les Tatars et, dans une partie de ses Observations sur les Turcs et les Tatars, il décrit largement la Crimée. Puis il a entrepris un voyage à travers la Moldavie et la Valachie, oppressées et dégradées par la dernière forme de la suzeraineté ottomane, à une époque de déchéance de l’empire ; enfin il se dirige vers Constantinople, où il remplit sa mission toute spéciale. Sélim III voulait introduire à ce moment les coutumes européennes, espérant, par une réforme, spécialement dans l’armée, qu’on arriverait à vaincre les Russes.
On traduisait Vauban en turc à cette époque. Malgré ses démêlés avec les Turcs, qui ont fini par lui pardonner le service qu’il leur a rendu, de Tott est arrivé à doter l’armée ottomane des moyens de la technique occidentale.
Son livre, qui a eu trois éditions et dont il y a eu aussi des traductions, est intéressant aussi à un autre point de vue, qui est le suivant :
A Constantinople, à côté des Turcs, des Grecs, des Arméniens et des Juifs, il y avait une population de Levantins et de Phanariotes, que personne n’a décrits. Dans la Motraye, on voit seulement ce petit groupe d’exilés qui entourent encore de leurs services et de leur dévouement l’ancien roi de Hongrie, mais pas le monde grec du Phanar. Il y a eu là-bas, au Phanar, une vie intérieure, et une admirable vie de famille, avec le profond respect des enfants pour le père, avec les relations d’une intimité très sincère entre le mari et la femme, avec, aussi, de très belles amitiés. Et tout cela, qu’on ne peut pas constater par d’autres voyageurs, on le découvre la première fois par de Tott, accueilli dans la maison du prince Jean Callimachi, ancien voévode de Moldavie, qui avait laissé un de ses fils sur son trône de Jassy. Il a passé la nuit dans cette maison, et il se plaint même du fait qu’on l’a fait dormir sur un oreiller tellement brodé que le dessin lui en est resté sur la figure, le matin.
On a ainsi, par de Tott, la seule vision, tant soit peu courte, mais, tout de même précieuse, de ce monde phanariote.
VII. — Après les antiquaires, les consuls de commerce et les conseillers techniques, les voyageurs, dans la seconde moitié du siècle sont des philosophes. Seulement les philosophes ne sont pas aussi bien représentés qu’on le croit. Je n’en connais que deux, avant les grands voyages d’exploration scientifique de la fin du XVIIIe siècle qui rentrent plutôt dans une nouvelle époque.
Un de ces voyageurs est d’Hauterive. Engagé pour être secrétaire d’un prince de Moldavie, il commence par rédiger un journal de voyage jusqu’à Bucarest, qui a été publié dans la Revue de Géographie, en 1877, par un profond connaisseur de la Turquie et des pays danubiens, Ubicini.
La fonction de secrétaire, facilement acceptée, offre, dès le commencement, certains attraits pour le jeune homme. Le principal attrait, ce n’est pas le salaire, ce ne sont pas les avantages du voyage, parce qu’il a dû passer une partie de son temps dans des taudis affreux, mangé par les punaises et par des insectes encore plus dégoûtants à travers la Bulgarie qu’il a traversée — et même il y avait des puces roumaines, d’une énergie extraordinaire, qu’il n’oublie pas de consigner dans ses notes. Il lui est arrivé de dormir sur une planche, de monter sur une échelle pour choisir, parmi plusieurs planches branlantes, celle qui l’était le moins, dans une espèce de grenier avec de vagues fenêtres auxquelles les vitres avaient toujours manqué. Il y a cependant des avantages. Hauterive était jeune ; c’était un gentilhomme de la cour. Dès le commencement, il voit une princesse phanariote, « belle comme le jour » ; il lui offre du vin et se prive de la moitié d’un poulet qu’elle dévore. Lorsque la princesse se trouve devant une image sainte, ses lèvres s’y appuient ; il n’oublie pas de dire qu’il aurait préféré être à la place du bienheureux Grec qui recevait cet acte d’adoration. Il ne dédaigne pas non plus les demoiselles de village en Bulgarie. A Fakir-Oumour, les femmes arrivent en dansant pour jeter sur le cortège princier des « poignées d’orge », et, çà et là, apparaît, à côté du vieillard presque centenaire qui berce l’enfant de trois mois, l’« hôtesse complaisante, active, propre et jolie ». Telles autres paysannes « s’enfuient comme une volée d’oiseaux, puis reviennent un moment après, avec des restes de frayeur dont elles rient de fort bonne grâce ». Et il y a, après l’éloge d’une « fort douce et fort jolie hôtesse », qui n’est pas « heureusement ensevelie sous les paniers des grandes dames de Versailles », une jeune fille de Moldavie, qu’il décrit comme égalant la grâce des duchesses, ajoutant qu’il a été totalement désarmé par la sérénité angélique de son hôtesse, « une Madone du Corrège »[190]. Il est, sans doute, un peu révolté par le laisser-aller qu’il trouve dans certaines maisons sur sa route ; il trouve que ces maisons pourraient être mieux soignées, et que son sommeil en aurait été meilleur ; qu’il aurait goûté beaucoup plus facilement aux mets qu’on lui présentait s’ils avaient été accommodés d’une autre façon. Il finit en philosophe, se jetant, à la première occasion, contre le clergé grec et contre tout ce qui lui rappelle la « religion » et tout ce qui a trait à la « tyrannie »[191].
[190] Voy. le passage dans notre Histoire des relations entre la France et les Roumains, p. 100-101.
[191] Guys lui-même assure que les Mores de Barberie ne peuvent pas devenir de riches marchands « parce qu’ils sont esclaves du despotisme » (Guys, ouvr. cité, I, p. 12-13).
Il reconnaît enfin — et c’est un point extrêmement important à l’époque où le Turc était considéré comme le tyran et le chrétien comme la victime, où on ne voyait qu’une classe dominante, même chrétienne, dans les principautés roumaines, qui abusait de ses droits et de sa force, et une multitude appauvrie, humiliée, foulée aux pieds — qu’il y avait dans les Balkans des villages où on vivait beaucoup mieux qu’en Occident, les maisons, misérables d’apparence, étant toutes pleines de belles choses à l’intérieur et les personnes en haillons pendant la semaine sortant, le dimanche et les jours de fêtes, attifées d’une façon dont le pauvre paysan de la Beauce et des Flandres n’aurait pas pu se valoir. « J’ai vu partout des poules, des oies, plus ou moins de chevaux et de bœufs, des brebis et des chèvres, des chiens et des chats qui vivent du superflu des maîtres. » A un certain moment, il dresse même la liste, qui est authentique, de ce qu’un paysan de Valachie ou de Moldavie peut donner à sa fille lorsqu’il la marie[192], et on voit que c’est toute une petite fortune. Si on pense aussi à ce fait que la terre était, pour les trois quarts, non cultivée, et que quiconque en prenait une partie recevait les remerciements du propriétaire, plutôt théorique, qui n’était pas là pour l’exploiter, on voit bien qu’il y avait des possibilités d’être riche et d’être heureux qu’on ne trouvait pas ailleurs.
[192] « Une ou deux vaches, une robe de laine grossière pour tous les jours, une camisole pour les fêtes, dans laquelle il entre un peu de soie, quatre chemises, un coffre de quinze paras pour garder ces richesses et un miroir. Le mari ajoute un mouchoir et des souliers ; le beau-père fournit des chevaux, une charrue, un tonneau. Les parents, en deux fois vingt-quatre heures, ont bâti la maison des nouveaux époux. » Dans une maison moldave : « des murs blancs, un plafond d’un rouge clair, un pavé souvent balayé, une cheminée, une table même ».
Combien ces constatations tranchent-elles avec les critiques superficielles d’un Carra, secrétaire princier à Jassy, qui a voulu donner plus qu’un récit de voyage dans sa brève, mais prétentieuse Histoire de la Moldavie et de la Valachie, qu’il feint d’avoir publiée à Jassy en 1777[193] !
[193] Revue de Géographie, loc. cit., p. 283.
D’Hauterive, qui a joué plus tard un grand rôle en France, ne ressemble pas à ce superficiel de Salaberry, auteur aussi d’une Histoire de l’Empire Ottoman, et qui a publié un Voyage en Turquie, au cours duquel il ne connaît sur le Danube que la Valachie, occupée par les Autrichiens, avec les caporaux allemands, les bals donnés par les boïars, de gros boïars ressemblant à des « héros du pays de Cocagne », mais qui a pu voir, cependant, à Bucarest, un Cantacuzène très cultivé, ayant des idées comme celles des philosophes du XVIIIe siècle, qui avait protesté en toute forme contre la violation des droits de son pays, sans se soucier de ce que le général autrichien pouvait entreprendre à son égard pour s’en venger. Même d’Hauterive, un esprit ouvert, a fini par donner le plus beau livre qui eût jamais été écrit sur la race roumaine, cette Moldavie en 1785, qui a été publiée, il y a une vingtaine d’années, par l’Académie roumaine, d’après un manuscrit qui lui a été donné par le feu roi Carol. Une profonde connaissance de ce qu’il y avait de plus honnête dans la boïarie roumaine, une information précieuse en ce qui concerne la façon de vivre, de sentir et d’agir des paysans, sont les grandes qualités de ce livre unique. Dès le début il avait prédit[194] l’union des Principautés : « les mêmes vicissitudes, les mêmes malheurs, la même histoire ont réduit les Valaques et les Moldaves à l’uniformité physique et morale la plus absolue ».
[194] Voy. notre ouvrage cité plus haut, p. 88 et suiv., 106, 112.
VIII. — Donc, tandis qu’auparavant on ne voyait que Grecs et Turcs, l’époque est venue, dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, où on découvre les autres populations chrétiennes vivant sous le sceptre, ou, pour les Roumains, sous l’égide seule du sultan. Il n’est plus question seulement des belles femmes « complaisantes » de Chio, « assises à leurs portes pour prendre l’air ou se promenant sans façon hors des villes avec des jeunes hommes comme on le pourroit pratiquer en France »[195], du costume de celles de Pathmos, des danses présentées dans les dessins de La Motraye[196], des contes et des chansons qu’on entend à Tinos[197]. Le cercle de vision des voyageurs est devenu plus large, et ceux qui s’arrêtaient jusque-là aux détails de l’archéologie, aux splendeurs des cérémonies turques, qui s’accrochaient, de temps en temps, à quelque détail insulaire de la vie des Grecs, ont maintenant une vue intégrale de cet Orient.
[195] Guys, I, p. 25, note 2 ; La Motraye, I, p. 195 ; Du Mont, II, p. 169 et suiv., 191, 193-194.
[196] I, p. 177, 194.
[197] Choiseul-Gouffier, ouvr. cité, II, p. 71-72, III, 142 et suiv.
Mais au fond de toutes ces critiques et de tous ces éloges l’appréciation du bon Turc « natif » reste la même. Dans La Motraye, on voit les marchands courir après le client qui s’est trompé en leur donnant plus que ce qu’il leur devait et le chercher jusqu’au quartier lointain où il habite, preuve d’une « probité unique » qui se distingue du « manque de parole » des Grecs[198]. En Morée, devenue un moment vénitienne, on lui fait l’éloge de ce Turc, même fonctionnaire, auquel on se rachetait pour trois à dix écus par an, étant défendus contre tout abus, même celui d’un soldat qui aurait pris un fruit dans leur jardin sans le payer aussitôt[199]. « L’humanité et la droiture » restent les mêmes[200]. A Péra on vit comme en chrétienté : « on y court en masque pendant le carnaval, on y chante, on y boit, en un mot on y fait tout ce qu’on veut » ; à Stamboul même les voyageurs, s’ils ont une tenue convenable, peuvent entrer à Sainte-Sophie et tout y voir pour les deux écus donnés au gardien[201].
[198] I, p. 258-259. Cf. ibid., p. 92.
[199] Ouvr. cité, p. 234.
[200] Ibid., p. 175.
[201] Ibid., p. 203-204. Cf. p. 189 et suiv. pour Chio.
La pompe ancienne se conserve malgré les défaites et les démembrements. « Rien n’égale », écrit Paul Lucas, « la majesté de ce prince à cheval », « ses chevaux de main sont les plus beaux qui soient au monde…, avec des harnois en broderie, semez de perles » et « couverts de boucliers d’or et de vermeil doré, garnis de pierreries ». « Quant à la variété et la magnificence des habits, la beauté des chevaux et la richesse des harnois, le nombre prodigieux d’officiers, le caractère différent des troupes ne rendroient pas ces sortes de marches les plus superbes qu’on puisse voir, la gravité de ceux qui la composent, le bon ordre, le silence qui y règnent en rendroient le spectacle le plus curieux et le plus amusant du monde[202]. »
[202] I, p. 71-73. Les Turcs ne comprennent pas « cette manière de nous promener en allant et venant à diverses reprises dans une même allée ou dans une même salle » (La Motraye, ouvr. cité, I, p. 265). Cf. Tournefort, ouvr. cité, p. 474 : Paris paraîtrait beaucoup moins peuplé si l’on « ne rencontroit pas toute la journée dans les ruës des femmes de toute sorte d’âge et de condition ». Il fait aussi, par rapport à la liberté de mouvements des femmes turques, la critique des « machines de fer ou de baleine » qui en Occident cherchent à redresser la taille (ibid., p. 93).
Mais les mêmes témoins signalent, dès 1715, les pillages des armées en mouvement, même dans la capitale[203]. Les Russes accumuleront les coups contre une armée de plus en plus démoralisée. Le régime des « effendis », des bureaucrates sédentaires, ayant à leur tête des sultans bibliophiles ou idéologues, produira bientôt ses dernières conséquences de formalisme résigné à la défaite. La race des renégats, qui n’est plus renouvelée depuis que les nations chrétiennes vivent pour leur avenir de liberté qu’elles entrevoient de plus en plus prochain, s’épuise dans la fainéantise et la corruption, malgré les nobles efforts du savant vizir Raguib et du romantique sultan Sélim. Le Juif, « souple et actif »[204], l’Arménien sont maîtres de la vie économique, alors que l’intrigue phanariote prépare la Byzance grecque dans laquelle le Turc ne sera plus qu’un dur soldat, pareil au barbare germain dans l’empire des Romains dégoûtés de la guerre. Déjà Guys avait écrit : « On a trop méprisé les Grecs d’aujourd’hui parce qu’on ne les a pas assez étudiés[205]. »
[203] Paul Lucas, ouvr. cité, I, p. 75.
[204] Guys, ouvr. cité, I, p. 11-15.
[205] Ibid., II, p. 225.
Mais cet avènement des sujets finira par tuer dans le Sud-Est européen cet Orient de très ancienne civilisation particulière qui, depuis les ambassades à Vienne, à Paris, à Berlin et les réformes de Sélim III est attaqué dans son centre turc même de Stamboul.
Le nombre des voyageurs en Orient au XIXe siècle est considérable, et il serait impossible de les énumérer et d’en donner une analyse plus ample et vraiment profitable. Mais le but précis de ces études rend plus facile la tâche.
L’Orient, au XVIe, au XVIIe et même au XVIIIe siècle, est quelque chose d’unitaire. Donc, la Turquie, comprenant la Grèce, retenant dans des liens de vassalité la Moldavie et la Valachie, cette Turquie dont font partie les provinces bulgares et serbes, forme une unité, une unité pour l’Asie et pour l’Europe. Pour cette Europe, dont il est question ici, l’Orient représente un seul pays pour les voyageurs ; tandis qu’au XIXe siècle, des faits interviennent qui brisent le caractère unitaire du monde oriental, de sorte qu’on ne peut plus parler de voyages en Orient de la façon dont on en parlait avant le commencement du XIXe siècle.
La Serbie ne s’en détache pas en 1804, au moment de sa révolution, parce que la formation de la Serbie comme province autonome n’est qu’incomplète ; les liens entre la principauté de Miloch Obrénovitsch et entre l’empire ottoman, qui continue l’empire byzantin, sont des liens encore assez étroits, de sorte qu’on a seulement un régime particulier dans une ancienne province. Mais il y a la Grèce qui, à partir de 1821, par une autre révolution, qui tendait à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste que la constitution d’un petit royaume moréote, à savoir, à restaurer un empire chrétien international, dont la capitale aurait été Byzance, combat et vit pour elle-même. Le mouvement a changé aussitôt de caractère, il n’a pas correspondu aux intentions des initiateurs ; ceux qui ont combattu en Morée le faisaient pour les libertés de leur propre province, pour une vie bornée à un territoire national bien déterminé, de sorte que l’illusion byzantine, le rêve de Constantinople ressuscitée comme capitale de l’internationalisme chrétien dans la péninsule des Balkans s’est évanoui et, par-dessus cette idéologie un peu démodée, il y a eu autre chose : ce sens des réalités des clephtes, des armatoles, des chefs du clergé grec dans le Péloponèse, qui ont limité aussitôt le mouvement en lui donnant une vie qu’il n’aurait pas eue sans cela.
Mais, dès que le mouvement se prononce, et quel que soit le sort qui l’attend, on peut dire que le voyageur qui se dirige de ce côté-là ne fait plus fonction de chercheur de pittoresque en Orient. Et même, comme il s’agit d’un phénomène révolutionnaire contemporain, on ne pense pas autant qu’auparavant au grand souvenir du monde hellénique.
Donc deux choses qui sont mises ensemble jusqu’au commencement du XIXe siècle, dans les préoccupations des voyageurs et dans leurs écrits, se dissocient. Il y a dissociation entre les préoccupations des archéologues, des amateurs de l’antiquité, des hellénistes et entre tout un mouvement libéral qui, ne pouvant pas se manifester avec énergie, ne pouvant pas conduire une lutte et arriver à une victoire dans les pays mêmes de l’Occident, recherche un pays de révolution, dans un territoire sur lequel se lève un drapeau de révolte au nom des mêmes droits élémentaires de toute nation. Et on peut dire que la Grèce, à partir de 1821 et de plus en plus jusqu’au quasi-avènement de Capo d’Istria, « gouverneur » de la Grèce révolutionnaire, et jusqu’à l’avènement du roi Othon, imposé par l’Europe, est aussi la patrie active du libéralisme. C’est la place où tendent et arrivent à se rassembler une grande partie de ceux qui combattent pour l’idéologie révolutionnaire, pour le credo libéral.
Il faut laisser de côté, décidément, tous ceux qui viennent en Grèce, non pour la Grèce elle-même, mais pour leurs idées, pour les idées du pays dont ils partent et auquel ils continuent à appartenir ; il faut abandonner tout ce qui ne touche pas à l’Orient dans la Grèce elle-même, et, d’autant plus, tout ce qui touche à l’Occident sous cette forme d’une contribution de soldats, de poètes entourés de prestige comme Byron[206].
[206] Voy. pour une bibliographie, du reste incomplète et superficielle, E. Lovinesco, Voyageurs en Grèce au XIXe siècle, Paris (thèse).
Et puis, après que la Serbie sera arrivée à transformer son autonomie première, et à être beaucoup plus que ce que désirait Miloch, qui se serait contenté jusqu’à la fin de ses jours d’avoir établi une espèce de pachalik chrétien, sans rompre les liens dont je parlais avec l’empire ottoman, voyager du côté de la Serbie aussi n’est plus voyager en Orient. D’autant plus que tous ces pays qui se détachent de l’empire ottoman prennent aussitôt un coloris qui n’est plus celui de la tradition orientale : ce sont, des pays modelés d’après les coutumes de l’Occident ; ils cherchent tous à se donner une constitution ; ils se forment une administration réglée d’une autre façon que l’administration du passé ; ils en arrivent à abhorrer tout ce qui est oriental, parce que ceci paraît leur rappeler la domination turque.
Avec une Constitution qui s’appuie sur les Droits de l’Homme, comme chez les Roumains, avec une administration de type napoléonien, ces pays perdent, même en dehors du fait qu’ils n’appartiennent plus à cette unité orientale qui est brisée, leur caractère oriental, et ils ne peuvent plus intéresser quiconque suit les traces de ces voyageurs pour voir la façon curieuse, intéressante au point de vue scientifique, dont on regarde les choses orientales.
Ce qui reste à présenter, ce sont les voyageurs qui viennent en Orient pour l’Orient, et qui, dans ces régions, distinguent entre ce qui est resté oriental sous l’aspect extérieur et sous celui de la vie intime, et ce qui est séparé complètement d’un passé pour lequel on n’a plus aucun sentiment de piété, un passé qu’on se pardonne à peine d’avoir eu.
Il y a aussi un autre motif d’éviter une prolongation inutile de cette exposition, et le voici.
Après 1860, disons même après 1840, l’Orient est beaucoup moins intéressant, parce que la Turquie elle-même se transforme, et on arrivera, par le témoignage de certains de ces voyageurs, à saisir le sens dans lequel l’Orient plus limité, surtout celui de Constantinople, s’est transformé sous la même poussée occidentale.
Dans les provinces, surtout dans celle d’Asie, l’âme orientale est bien restée cette âme qui ne pourrait disparaître ou se transformer qu’au moment où la religion elle-même aurait été abandonnée, et je doute que, malgré les réformes actuelles de M. Moustapha-Kémal, malgré sa personnalité et malgré son système, l’Orient, qui est resté musulman, soit complètement identifié à cet occidentalisme qu’on veut imiter à tout prix. Des sanctions sont prononcées actuellement contre ceux qui se refusent à cette transformation à vue, mais il y a des choses qui viennent d’une longue histoire et que l’homme le plus génial d’énergie, ou d’intelligence et de hardiesse, n’arrivera jamais à faire disparaître. Et il y a des choses qui reviendront, et reviendront avec ce sentiment âcre de la revanche qui fait qu’après un progrès improvisé, il y a un opiniâtre retour vengeur vers le passé ; la transformation officielle constantinopolitaine dont je parlais est ce qu’on appelle l’ère du tanzimat. Le tanzimat, c’est l’ensemble des réformes imposées à l’empire turc par trois personnages qui ont joué, dans l’histoire de la Turquie au XIXe siècle, un rôle éminent ; ils ont été très appréciés et très critiqués, selon le point de vue, par leurs contemporains, mais ils ont donné à l’empire ottoman un aspect extérieur totalement différent de la grande tradition qui commence au XVe siècle et qui s’est poursuivie jusqu’à cette date d’environ 1830-1840. Il s’agit de ce triumvirat, formé d’anciens diplomates, dont l’un avait été envoyé pour féliciter la reine d’Espagne Isabelle, au moment de son avènement, dont le second avait été secrétaire d’ambassade pendant longtemps à Paris et dont le troisième avait eu aussi des rapports très étroits avec le monde parisien. Ils s’appellent, en commençant par le premier, par l’initiateur, par le plus courageux : Réchid, Aali et Fouad.
Avec ces trois représentants des nouveaux courants, l’ère du tanzimat s’est installée sans résistance de la part des Turcs, et je dirai même sans profit de la part des chrétiens, dont les avantages étaient tout à fait apparents. Il y avait eu des droits réels qui étaient maintenant perdus, pour l’ombre des avantages constitutionnels promis par la célèbre déclaration de Gul-Haneh, de la « Maison des Roses », installant le régime occidental en Turquie. Un Français a donné, dans quelques ouvrages de description et de statistique, une image optimiste de cette Turquie nouvelle, Ubicini, l’auteur du volume sur les Principautés danubiennes dans l’Univers pittoresque.
Puis, pendant la guerre de Crimée, il y a eu une autre déclaration, celle du sultan Abdoul-Medjid, qui accordait, en apparence encore, aux chrétiens la participation plénière aux droits dont jouissait jusqu’alors l’aristocratie de religion des Turcs.
Enfin, voici la troisième tentative, en 1876. La Russie était représentée alors par un diplomate d’une hardiesse et, disons même, d’une insolence extraordinaire, Ignatiev, qui parlait à chaque moment aux Turcs du partage prochain de leur empire, au moment où la Russie demandait des droits pour les Slaves, et où elle préparait, avec l’affranchissement complet de la Serbie, de plus larges limites pour cet État et l’établissement d’une Bulgarie. Alors un grand vizir innovateur, Midhat, encore un occidentalisé, plutôt sous l’influence anglaise que sous l’influence française, fit proclamer à Constantinople une Constitution qui renouvelait les promesses du premier et du second acte de modernisation de la Turquie. Seulement, Abdoul-Hamid est revenu ensuite et a rétabli, sous la forme prestigieuse du califat, l’ancien régime. Et, comme c’était un homme énergique, pendant qu’on l’a laissé régner, l’autoritarisme de Soliman, sans les vertus du XVIe siècle, a été rétabli en Turquie.
Or, cette nouvelle Turquie, cette Turquie des réformes, qui, dans tous les domaines, innove, abandonnant complètement le passé, qui a des ministres, — je ne dirai pas des ministres responsables, parce que ce serait faire injure à la vérité, mais qui a un conseil des ministres, — cette Turquie qui a des préfets, des sous-préfets, des communes, avec les maires de ces communes, cette Turquie qui a des cours de justice et des tribunaux tout comme l’Occident, qui improvise un enseignement commençant par l’école primaire pour arriver à la faculté de médecine et projette une grande université à Stamboul (il ne lui manquait qu’une académie), cette Turquie qui laisse traverser son territoire par de nouveaux chemins de fer, qui change son système de douanes, qui établit un crédit nourri par le capital étranger, représenté par la Banque ottomane, enfin cette Turquie qui a totalement changé le caractère de son armée (car les janissaires ont été détruits par le sultan Mahmoud dans une action d’une violence sanglante sans exemple, rappelant les temps les plus tragiques de l’empire byzantin, pour former les nizams, l’armée de réforme, avec des généraux portant de vagues redingotes bleues et des pantalons collants qui avaient seulement le désavantage de ne pas trop tenir aux jambes), cette Turquie n’est plus l’Orient. Et ce que j’avais l’intention de présenter, ce n’était pas un État réglant sa marche d’après des normes qui ne sont plus celles de sa tradition, de sa race dominante, mais bien la façon dont deux manières d’être tout à fait différentes, celle des Occidentaux et celle de l’Orient, se rencontrent, se jugent, se condamnent, se critiquent, se pardonnent pendant des siècles.
Car l’Orient, ce n’est pas un territoire géographique, ce n’est pas un ensemble de races. C’est une manière d’être, et, aussitôt que cette manière d’être disparaît, il n’y a plus intérêt à observer les voyageurs qui partent de l’Occident, pour aller chercher la caricature de cet Occident dans une autre région où tout ce qui est de surface est emprunté, mais où ce qui est d’essence intime ne peut pas être encore assimilé parce qu’il ne correspond ni au développement historique, ni aux qualités de la race, ni aux nécessités impérieuses du moment qu’on traverse.
Maintenant, arrivons à ces voyageurs, en éliminant ceux qui, à l’époque du roi Othon ou du roi Georges, vont visiter la Grèce pour voir la façon dont on se vêt dans l’armée à la manière bavaroise, la façon dont M. de Rudhart, originaire de Munich, dote d’institution ses sujets les Grecs ; éliminons aussi les voyageurs français, très nombreux, qui voyagent du côté de la Moldavie, de la Valachie et de la Roumanie de 1859, et, il y en a d’éminents, dont les écrits forment une des bases de l’information que j’ai présentée dans mon ouvrage Histoire des Relations de la France et des Roumains ; éliminons également, bien qu’il n’y ait pas de travail semblable, ceux qui se dirigent vers la Serbie libre et la Bulgarie qu’il s’agissait de libérer.
D’abord, il y a les voyageurs de l’époque de la Révolution française. On s’attendait à des Jacobins arrivant en Orient avec des buts de propagande, décrétant hautement que cet empire turc des « tyrans » est un État déchu et que le devoir de tout ami de l’« humanité », de tout partisan des Droits de l’Homme, est de collaborer à cette disparition d’un monde condamné.
Or, ce n’est pas précisément le cas. Bien que l’état d’âme de ces voyageurs fût, au fond, celui-là, il y avait deux motifs qui les empêchaient de présenter toute leur idéologie, idéologie qui devait être ennemie des Turcs et très amicale à l’égard des Grecs et des nations soumises.
Les relations avec les Turcs, presque ou pendant toute l’époque de la Révolution française, ont eu un caractère très mêlé. D’une part, il y avait l’invasion de l’Égypte, qui était, en droit international, une terre turque. Bonaparte, débarquant en Égypte, avait averti les Turcs qu’il ne s’agissait pas d’un acte d’inimitié à leur égard, mais d’une simple mesure de précaution à l’égard de certains projets anglais, et qu’on se prémunissait contre une attaque future en faisant descendre des armées sur cette vieille terre des Pharaons. Les Turcs ont fait semblant de le croire, et on ne sait jamais, au cours de l’histoire ottomane, quel est le moment où le Turc croit vraiment et celui où il feint de croire.
Puis, sous la poussée de l’Angleterre et de la Russie, il y a eu une action de représailles contre les Français. Les Français ont été partout arrêtés. Ruffin a été retenu comme prisonnier, celui que, pendant longtemps, les voyageurs considéraient comme le « Nestor de l’Orient », comme le vrai chef de leur nation. Flûry, consul à Bucarest, est allé lui aussi aux Sept-Tours. Il y a eu tout un groupe de Français qui ont subi, pendant longtemps, les rigueurs de l’emprisonnement turc, très dur, étant donnée cette vieille pierre humide qui n’est pas le logis le plus désirable. Il y en a qui y sont morts. La façon dont les Français ont été traînés par toutes les voies de la péninsule des Balkans pour en arriver là, fut ignoble.
A côté, il y avait des diplomates, il y avait aussi des voyageurs qui rejetaient la responsabilité de ces représailles sur certains individus, et, avant tout, sur les Anglais et les Russes qui avaient poussé à ces mesures, mais au Turc, au fond bon enfant, ils gardaient les sentiments d’amitié traditionnelle. Et puis il était très utile, car, revenu à de meilleurs sentiments, on pourrait l’employer pour une politique utile à la France.
En second lieu, dans les sympathies qu’on prodiguait aux Grecs, il y avait quelque chose qui empêchait l’enthousiasme.
Pour ces Grecs, les voyageurs de l’époque de la Révolution française, dont je dirai bientôt les noms, avaient, en effet, observé ceci : lorsqu’il s’agissait de se choisir des amis, ils préféraient les Russes. Les Français, sortant des Sept-Tours, ont pu entendre souvent les acclamations qui accueillaient les armées du tsar lorsqu’elles débarquaient à Constantinople ou lorsque les vaisseaux de l’empereur orthodoxe se dirigeaient vers Corfou conquise sur les Français : l’amiral russe Ouchakov entendait se borner à cette conquête qui n’a pas été trop difficile, étant donné le faible contingent militaire dont la France pouvait disposer dans les îles Ioniennes, alors que le commandant de la flotte turque se targuait hautement, dans ce monde franc de Constantinople, que, puisque Corfou était conquise, il n’y avait qu’une petite route à faire jusqu’au grand port français de Marseille, et, une fois là, imposer à la France la sanction la plus correspondante aux offenses que l’empire ottoman avait subies en Égypte.
I. — Parmi les voyageurs du XIXe siècle, il faut mettre en première ligne Olivier, qui a fait son Voyage dans l’Empire Ottoman, l’Égypte et la Perse, « par ordre du Gouvernement », — ceci est dit dans le titre même — au cours des six « premières années de la République ». Ajoutons que le récit de ce voyage est accompagné d’un album très bien fait, et devenu très rare, qui a été publié, à Paris, l’an IX de la République.
Ce naturaliste commence par une déclaration intéressante. Après Choiseul-Gouffier et après la longue série des voyageurs érudits qui venaient pour recueillir des inscriptions, pour s’intéresser à l’art ancien, pour essayer l’identification de localités helléniques, cet homme, dont l’activité de savant était consacrée en première ligne aux sciences naturelles, entend prendre un autre chemin, et il le dit franchement : « Je me suis interdit, dans cette relation, toute anecdote singulière, tout récit plaisant, plus propre à amuser qu’à instruire. Je n’ai pas voulu employer ces couleurs trop brillantes qui peuvent séduire un instant, mais dont l’effet est passager. » Il ajoute, et c’est la partie la plus intéressante de cette préface : « La vue d’un champ abandonné couvert de myrte, celle d’un jardin confusément planté de dattiers ou d’orangers n’ont jamais pu enflammer mon imagination, et j’ai souvent considéré sans étonnement des chapiteaux écornés, des tronçons de statues… » Ce qui intéresse ce voyageur, c’est d’abord le monde politique qu’il trouve à Constantinople et dont il est un très bon témoin.
Il trouve, en 1793, une France presque annihilée sous le rapport du prestige. Le représentant de la République, Sémonville, avait été écarté et remplacé par Descorches, et Descorches lui-même avait été arrêté, et gardé en prisonnier à Travnic, ville de la Bosnie, étant remplacé, un moment, par le drogman Fonton. Fonton ayant dû démissionner, les intérêts du commerce français étaient représentés enfin uniquement par les « députés » de ce commerce et par leur chef provisoire élu. Olivier assiste à l’entrée des Russes à Constantinople. Il voit la façon dont la cocarde tricolore était poursuivie non seulement par les agents de ce qu’on peut appeler la police turque (qui étaient sans doute entre le vrai agent de police et le brigand), mais, en même temps, par les représentants de l’ambassade de l’Internonciature, pour l’appeler par son nom, de l’Autriche. On ne pouvait pas sortir dans la rue sans se voir arracher cette cocarde, et Olivier, habitant chez un traiteur français « sot et ivrogne », qui avait épousé une Grecque, était menacé à chaque moment d’être jeté dans la rue, parce que la présence d’un Français dans la maison rendait la famille de cette Grecque suspecte. Parmi ceux qui dominaient la situation, parmi les 2.000 Occidentaux qu’il y avait à Constantinople, bien peu osaient proférer des sentiments de sympathie pour le nouveau régime français.
Les Turcs ne pouvaient pas lui apparaître très sympathiques, et alors il parle de l’« orgueil national », de l’« ignorance » et du « fanatisme » des Musulmans. Il trouve les Grecs « gais, spirituels et adroits », mais, cependant, après avoir vu leur sympathie indissoluble à l’égard des Moscovites, il n’entend pas les considérer comme des appuis pour la politique de la France en Orient.
Olivier, à son retour, par les îles, peut se rendre compte que les femmes de Chio, qu’attendait, en 1821, un si terrible sort, continuent à « agacer les passants » ; il a recueilli un grand nombre d’observations du plus haut intérêt, de sorte que, pour une autre direction que celle de l’archéologie et des études classiques, c’est, sans doute, une source de tout premier ordre.
Mais une source tout aussi intéressante est celle qui est formée par les deux grands travaux d’un voyageur qui s’appelle Félix de Beaujour. Beaujour a publié d’abord un Tableau du commerce de la Grèce, vers 1800, mais son voyage a été fait vers 1790.
Il a visité aussi, à ce qu’il paraît, toutes les frontières de l’empire ottoman. On peut s’apercevoir qu’il a été chargé d’une certaine mission secrète[207], à l’époque où il y avait des officiers français en grand nombre en Albanie, sous Ali-Pacha, à Vidine, sous le rebelle Pasvanoglou, et, où la fonderie de canons, l’école de mathématiques militaires de Constantinople étaient sous la direction de Français ; l’architecte même de Sélim III, peu avant la Révolution, était lui-même un Occidental qui pouvait introduire les voyageurs dans des régions du sérail ordinairement interdites à la curiosité des Occidentaux. Le second livre de Beaujour s’appelle Voyage Militaire dans l’Empire Ottoman (1800). Il n’y a pas seulement la constatation de la situation qui existe à toutes les frontières, il y a autre chose : il y a des propositions formelles pour fortifier toutes ces frontières jusqu’à celle du Danube, jusqu’à celles du Pruth et du Dniester. Quelles que soient ces propositions, dont certaines peuvent être vraiment intéressantes, quelqu’un qui a vécu pendant de longues années en Turquie, et qui connaît son commerce et l’état de ses places fortes, est, sans doute, un témoin de tout premier ordre.
[207] Cf. dans la préface du livre dont il est question : « J’allais pendant la Révolution française dans la Grèce pour y chercher des ruines et des souvenirs. J’y portai des illusions charmantes et je les perdis toutes en arrivant. Il fallut alors m’occuper de tout autre sujet. »
Voici un autre témoin appartenant à la même époque, mais qui a un caractère bien distinct des deux autres : c’est un artiste. Ce voyageur, faisant partie d’une mission française, s’appelle A.-L. Castellan. Il a publié, en 1808-1811, des Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et Constantinople, faisant suite aux Lettres sur la Morée. Les gravures sur acier de Castellan sont tout à fait remarquables et, quant à son texte, il est très vivant, s’attardant parfois pour raconter des épisodes romantiques, de sorte qu’il y a en lui, je ne dirai pas un littérateur, mais un artiste qui s’égare parfois dans les sentiers fleuris de la poésie. Ce n’est pas, en tout cas, une source pour les archéologues.
Mais celui qui a nourri pendant longtemps, non seulement les archéologues (qui ont formulé, à juste titre, des réserves contre son témoignage et surtout contre ses conclusions, d’une érudition très facile et visiblement empruntée et confuse), mais, en même temps, tous les ethnographes et qui forme aujourd’hui, avec les ouvrages de trois Anglais, Hughes, Holland et Hobhouse[208], la base pour toute étude concernant les Shkipétars ou Albanais, qu’il a bien connus, est un médecin, le docteur F.-C.-H. L. Pouqueville, qui a commencé par un ouvrage plus restreint, puis a publié, en 1805, le Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman.
[208] Ce dernier a donné lui aussi d’admirables illustrations en couleurs, représentant des vues de monuments, et des costumes : A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810, Londres, 1813.
Il ne venait pas chargé de mission, et il n’était pas un « pèlerin d’archéologie ou de pittoresque ». Faisant partie de la mission d’Égypte, le moment critique dans les relations entre la France et la Turquie et surtout son état de santé l’ont contraint à abandonner sa destination, et celui qui n’était que membre de la Commission des sciences et des arts d’Égypte a dû aborder sur la côte de Morée. Il voulait aller à Zante, mais le corsaire qui s’était saisi du bâtiment sur lequel il naviguait a trouvé bon de le déposer sur cette côte.
Aussitôt à Navarin, il a été arrêté. On l’a transporté à Tripolitza, alors que d’autres Français prenaient une autre voie, beaucoup plus longue et plus pénible, pour aller à Constantinople, où ils se sont rassemblés tous, s’échappant tour à tour, dans des circonstances qui dépendaient de la situation, des relations, de l’habileté de chacun d’entre eux.
Il était arrivé dans des dispositions enthousiastes à l’égard de l’antiquité : « Apollon, roi des Ménades, divinités de l’Eurotas, vallons aimés des Muses et des chœurs célestes, quels chants barbares affligent maintenant les échos de vos montagnes ? ».
Un instinct d’archéologue, une ambition de savant s’étalent réveillées en lui. Le prisonnier de Tripolitza avait tout de même la faculté de visiter à droite et à gauche les provinces voisines, jusqu’à la lointaine Maïna, en pleine effervescence, pas tant en qualité de Français, que parce qu’il était médecin et que, en Turquie, on a toujours couru après les médecins et, même, considéré comme médecins des personnes qui ne l’étaient guère[209]. Il a été donc introduit un peu partout ; il a visité jusqu’à des harems. Il en a vu les habitantes, — des jeunes et surtout des vieilles, — et y a recueilli une certaine expérience qui n’est pas réservée aux profanes, quand ils ne sont pas médecins.
[209] « Tout ce qui a chapeau ou bien calpak est médecin », p. 423.
Mais, partageant les opinions, connues, d’un de Pauw, il croit que « les descendants de Miltiade et de Cimon, aujourd’hui courbés sous le double despotisme des Turcs et des papas, ne sont guère capables de concevoir et de soutenir une de ces entreprises généreuses et hardies qui pourraient leur rendre l’existence politique », la religion étant la seule chose qu’ils prisent. Cependant il prétendra, plus tard, avoir bu à Tripolitza « à la liberté de l’Hellade » et écrira l’Histoire de la régénération de la Grèce, où toute une littérature néo-hellénique y est présentée sous un jour intéressant et exact. Tout en accusant Guys de partialité, il s’est pris de sympathie pour les Grecs opprimés. « J’ai vu le dernier des Turcs descendre de cheval, arracher un Grec de sa boutique, le charger de son bagage et le faire suivre, sans que cet homme, capable de se venger, osât seulement murmurer. J’ai vu de jeunes Musulmans frapper les têtes blanchies par l’âge et lever la main sur des vieillards. »
Dans son second ouvrage, les Roumains des Balkans trouvent pour la première fois cette faveur inattendue d’intéresser un voyageur français.
Constantinople est présentée à l’époque la plus défavorable pour les Français, qui laissèrent mille huit cent un morts dans les prisons du sultan. Sous l’instigation anglaise, on va jusqu’à profaner le tombeau de l’ambassadeur Aubert du Bayet. Des portraits très vivants sont donnés, comme celui du sultan, droit et humain, d’Isaac-bey, le confident du grand amiral Hassan, cet Isaac qui, élève de l’école fondée par de Tott, se rendit à Marseille, à Lyon, à Paris, passa en Barbarie, parut un moment à Constantinople, puis visita l’Europe centrale et l’Italie, se fixa en Russie jusqu’en 1782, et revint deux fois encore en France avant de réintégrer définitivement sa patrie.
Dans ce premier ouvrage, Pouqueville a mis ensemble sa propre expérience, celle de ses compagnons, puis des choses prises un peu à droite et à gauche, au cours de son voyage. Or, cet ouvrage a rencontré un très bon accueil. Et, comme on en demandait une nouvelle édition, Pouqueville est revenu dans la péninsule des Balkans, mais, cette fois, avec une qualité officielle, ayant été nommé consul de France à Ianina, la capitale d’Ali-Pacha, qui était au moment culminant de sa carrière. Plus tard, comme ce consulat, à la mort d’Ali-Pacha, a été supprimé, on donnera à l’écrivain, devenu célèbre, un autre poste à Patras ; seulement son information sur la Morée est infiniment moins sérieuse que celle qui concerne la partie occidentale des Balkans.
Dans ce second ouvrage[210], il parle d’une façon certainement par trop familière des archéologues, dont il ne fait pas partie. Il est bien certain qu’il se mêlait de choses qu’il ne connaissait pas, et que, se présenter en connaisseur encyclopédique du passé et du présent de ce monde, c’était trop.
[210] Voyage de la Grèce par F.-C.-H. L. Pouqueville, Paris, 1826.
Mais, néanmoins, les six gros volumes de Pouqueville sont, sans doute, un événement dans la série des voyages, et ils dépassent de beaucoup tout ce qu’on avait donné auparavant[211]. Les Roumains peuvent lui être reconnaissants d’avoir étudié leurs frères du Pinde dans toutes leurs provinces.
[211] Il déclare avoir déposé à la Bibliothèque du roi un dictionnaire albanais-grec dicté par le héros révolutionnaire Botzaris ; I, p. XXXVII, note 1. Cf. III, p. 291 : « J’ai vécu au milieu d’eux, je me suis identifié à leurs coutumes, afin d’en pénétrer la raison. »
Je remarquerai encore, dans cette œuvre, une innovation.
Les voyageurs antérieurs oublient complètement la large part que l’élan français du moyen âge a eu dans la vie de toutes les régions de l’Orient. Courant après les traces les plus insignifiantes de l’antiquité, ils négligeaient ce que le féodalisme français du XIIIe siècle, XIVe et XVe siècles a donné à ces régions, des choses dont les traces existent encore aujourd’hui. Et, pour la première fois, on voit cet homme, dont ce n’était pas le métier, de s’initier à des sources médiévales inconnues, recourir aux Byzantins, découvrir aux Météores une chronique de ces régions occidentales de la péninsule des Balkans, s’adresser à cette chronique de Morée et esquisser une fresque qui sera complétée par bien d’autres marchant sur ses traces.
Les Promenades[212], écrites presque à la même époque par Pertusier, « officier du corps royal de l’artillerie, attaché à l’ambassade de France près la Porte Ottomane », élève de Ruffin, et parues à Paris en 1815, sont un très beau travail. Elles représentent, non pas l’expérience superficielle du voyageur, mais celle, plus large, d’un homme qui a vécu dans le pays. L’auteur, « peintre de portraits », s’est proposé de « saisir la physionomie morale et physique du pays ».
[212] Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore.
Le livre de Melling, « architecte de l’Empereur Sélim III et dessinateur de la Sultane Hadidgé, sa sœur », ce Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore (Paris, 1819) n’a pas dans ses planches[213] l’extraordinaire splendeur des dessins coloriés d’un voyageur qui a connu Pouqueville et qui s’appelle Dupré[214]. Celui-ci a donné, sans doute, les plus magnifiques planches en couleur qui furent jamais publiées, non seulement pour Constantinople, mais pour tout ce monde grec et même, en partie, pour tout le monde roumain, voisin.
[213] L’atlas de Pertusier avec des dessins de Dréat est de 1817.
[214] Voyage à Athènes et à Constantinople ou collection de portraits, vues et costumes grecs et ottomans par Louis Dupré, élève de David, Paris, s. d. Le texte du dessinateur, qui accompagnait en Albanie trois Anglais, est souvent plein de choses nouvelles. Il augure à la Grèce, un réveil, au Pirée désert une résurrection (p. 36-37). Cf. le livre roumain, récent, de M. G. Opresco, sur Les Pays roumains vus par des artistes français, Bucarest, 1926.
Un autre récit de voyage, admirablement imprimé, est dû à Firmin Didot, élève de Coraï, qui a visité l’Orient en 1816 et 1817 (Notes d’un voyage fait dans le Levant, sous le nom d’Ambroise-Firmin Didot). L’auteur a tenu, ayant des lettres de recommandation du grand Grec, à aller aussi bien à Cydonie que dans l’île de Chio et à prendre part à cet enseignement grec, proposant même, par une résolution qu’il a publiée, résolution rédigée comme un acte de l’antiquité inscrit sur marbre, de ne plus s’appeler Jean, Georges, Nicolas, mais bien Aristide, Thrasybulle, Ménélas.
Les observations du comte de Forbin touchent surtout l’Orient asiatique[215]. Le vicomte de Marcellus, un « ancien ministre plénipotentiaire », ne parle, dans ses Souvenirs de l’Orient (Paris, 1839), que des îles, où il a eu la bonne fortune de découvrir cette Vénus de Milo dont une planche ouvre son récit. Au retour il dit quelques mots de la Bulgarie et de la Valachie, qu’il a traversées.
[215] Voyage dans le Levant en 1817 et 1818 par le comte de Forbin, Paris, 1819. Il a été conduit à Athènes par le consul Fauvel, bien connu (p. 18 et suiv.).
Le premier ouvrage de Pouqueville précède le fameux Itinéraire de Chateaubriand (1806).
II. — Il est inutile de dire la grande fortune qu’a eue ce voyage. Il y a des critiques qui le considèrent comme une innovation. Personne ne pense à nier la grande valeur littéraire que peut avoir cet écrit d’un des chefs du mouvement de rénovation littéraire en Europe. Seulement, au fond, il n’y a rien de nouveau dans Chateaubriand, comme direction, ni comme état d’esprit : c’est la même érudition à bon marché, qui commence par une histoire de la Grèce et de l’Empire byzantin, par une histoire de la Terre sainte, avec l’indication des sources, à chaque moment. Il y a la même course effrénée vers l’inédit archéologique ; il y a les mêmes erreurs, très explicables, lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui faisait ses premières armes à l’occasion de ce voyage, et, sauf quelques belles pages, comme celle qui fait passer devant nos yeux, à Athènes, « les ailes noires et lustrées, glacées de rose par les premiers reflets du jour, les colonnes de fumée bleue et légère, les sculptures de Phidias frappées horizontalement d’un rayon d’or », la partie littéraire elle-même, au moins en ce qui concerne l’Europe, est assez maigre. Il y a dans cet ouvrage trois quarts de cette érudition à peine lisible et un quart de réflexions personnelles.
Le grand écrivain déclarait, du reste, que ce voyage n’était pas destiné à produire une œuvre littéraire, et qu’il n’avait fait que rassembler des matériaux pour ses « Martyrs ».
Il y a, au contraire, des notes sur Constantinople, sur la nouvelle vie politique de la Grèce, dans le Voyage en Orient de Lamartine, de beaucoup postérieur.
Le spectacle de l’assemblée néo-hellénique, siégeant dans un « hangar de bois », couvert de planches, avec des pierres comme sièges au lieu de bancs et des députés venant à cheval, de ce « campement » des « chefs d’un peuple héroïque qui tiennent encore à la main le fusil ou le sabre », ne peut pas manquer d’intéresser celui qui recherche dans l’observateur l’attitude et dans le sujet la nouveauté. Mais la rareté de ces détails utiles s’explique par des déclarations comme celle-ci : qu’il méprise « ces vieilleries historiques et politiques » qui « ont perdu l’intérêt de la jeunesse et de la vérité » ; qu’il veut « voir seulement une vallée d’Arcadie » : « J’aime mieux un arbre, une source sous le rocher, un laurier-rose au bord d’un fleuve sous l’arche écroulée d’un pont tapissé de lianes que le monument d’un de ces royaumes classiques, qui ne rappellent plus rien à mon esprit que l’ennui qu’ils m’ont donné dans mon enfance. » Et, comme le poète romantique prétend que son récit est fait de poésie et de philosophie, il dit ouvertement aux amateurs d’archéologie ceci : « J’abhorre le mensonge et l’effort en tout, mais surtout en admiration. La beauté historique ou critique, celle-là aux savants ; à nous, poètes, la beauté évidente et sensible. »
Mais on est vraiment presque peiné lorsqu’on entend dire : Tout ce qu’on voit sur la côte de l’Attique et à Athènes même, est « terne et nuageux, comme dans une gorge de la Savoie ou de l’Auvergne, aux derniers jours de l’automne » (il voyageait au mois d’août). Le Parthénon ne correspond pas « à ce qu’on en attend », « les pompeuses paroles des voyageurs, peintres ou poètes, vous retombent tristement sur le cœur quand vous voyez cette réalité si loin de leurs images », ces « vieilles murailles noirâtres, marquées de taches blanches ».
Poujoulat, chargé d’un voyage en Orient pour donner du pittoresque à l’histoire des Croisades de son associé Michaud (1830), présente dans ses Lettres d’Orient des souvenirs de lectures. Mais il faut s’incliner profondément devant l’œuvre de J.-A. Buchon, qui découvre presque à la même époque des horizons. Le livre de Buchon sur La Grèce continentale et la Morée, voyage, séjour et études historiques en 1840 et 1841 (Paris, 1843) dépasse de beaucoup celui, presque contemporain, d’Edgar Quinet, cependant d’une belle allure et risquant des jugements sur la Grèce contemporaine qui sont ordinairement justes. Cet ouvrage de Buchon, dédié à la duchesse d’Orléans, dit dès le commencement que l’auteur entend voir avant tout ce que les autres n’ont pas voulu voir : la gloire française au moyen âge. Les pages du grand érudit et du grand initiateur dans ce domaine sont une introduction à la Grèce médiévale qu’on peut lire avec fruit et avec plaisir même aujourd’hui.
Le livre de Brayer, médecin à Constantinople[216], est presque une révélation. Ce chercheur de notes sur la peste d’Orient a donné, sur la façon de vivre des Turcs, qu’il a étudiée d’après des catégories toutes personnelles et passablement ridicules, une mine de renseignements inédits et de jugements. « Moi je représente », dit-il, « le Turc lorsque rien ne compromet l’honneur de son gouvernement et l’existence de sa religion, lorsque son fanatisme n’est pas exalté pour la défense de l’un et de l’autre, je le représente… comme généralement bon, sincère, charitable, hospitalier sans faste et sans hypocrisie et, quoique profondément attaché à sa croyance, tolérant envers tous les cultes, probe non seulement envers les siens, mais encore envers l’étranger et propre sur sa personne et ce qui l’entoure à un degré inconnu dans toute autre partie de l’Europe. » Et sa description de Constantinople a parfois le brillant des meilleures pages qu’eût données sur ce sujet la littérature française.
[216] Voyage en Bulgarie, Paris, 1843.
Un voyage infiniment plus intéressant est celui qui, à la même époque, a été entrepris par Blanqui, en Bulgarie (1843). Par lui, on a la vision de la Serbie de Miloch, et en même temps des idées tout à fait personnelles sur la vie turque à Constantinople, où l’auteur a fini par aboutir[217].
[217] Pour les voyages d’érudits, rien n’est comparable à celui de l’île de Chio, récemment décrit par M. Hubert Pernot, et que les notes de Fustel de Coulanges dans les Archives des missions scientifiques et littéraires, V (1856), p. 181 et suiv.
En fait de littérature de voyages, il faut dire que les pages fantastiques de Gérard de Nerval ne représentent qu’une réalité totalement transformée par une rare imagination. La Constantinople de Théophile Gautier est, non seulement un ouvrage étincelant, coloré, mais, en même temps, bien informé. Il a saisi d’instinct des choses que n’a guère retenues l’attention, cependant fortement dirigée, de Lamartine et de Chateaubriand.
Et, s’il s’agit des voyages d’une époque ultérieure, je crois qu’on a malmené sans raison le voyage de celui qui a osé présenter aux Occidentaux — mais les Orientaux l’ont lu aussi — la tragi-comédie de la Grèce du roi Othon. L’ouvrage d’Edmond About sur la Grèce contemporaine est un très beau livre : s’il est hostile aux coutumes germaniques de la cour de ce roi qui n’était pas le mari, mais la « femme » de la reine Amélie, s’il ne ménage pas les ironies à l’égard de cette pauvre royauté bavaroise et mecklembourgeoise qui devait disparaître enfin d’une façon si stupide, il n’est pas un acte d’inimitié contre la Grèce.
Il y a, pendant la guerre de Crimée, des observations tout aussi piquantes, et justes, sur les Turcs, dans le récit de voyage, sans prétentions, du docteur Félix Magnard (Impressions de voyage, Paris, 1855), récit qui a été publié par Alexandre Dumas père.
Je m’arrête à cette date, 1860, jusque au delà de laquelle je ne veux pas avancer. Il y aurait tant de choses à dire sur les voyages de M. Joseph Reinach, de M. Charles Diehl dans ces régions. Mais, puisque je dois mettre un peu d’« inédit », je dirai que ce qu’a publié, dans un style très familier, qui, évidemment, n’est pas celui d’un érudit, ni celui d’un littérateur, quelqu’un dont les livres datent presque d’hier, et qui a l’avantage d’avoir passé en Turquie toute une vie, M. Bertrand Barrères, forme un des meilleurs livres qui aient été écrits sur la vie populaire des Turcs.
Et, s’il s’agit des voyageurs futurs qui voudraient chercher les restes d’Orient qui survivent en ce moment, — il faut se presser un peu, parce qu’ils sont en train de disparaître, — l’historien de l’empire ottoman que j’ai été peut leur donner un conseil : Ce serait de ne pas répéter une poésie archéologique que nous savons par cœur et de ne pas ajouter des teintes pittoresques sur des tableaux suffisamment bien brossés par les plus grands coloristes du XIXe siècle pour qu’on puisse trouver une nuance nouvelle à ajouter ; je les engagerais à ne pas s’adresser seulement à l’art byzantin, qui est très en vogue, et qui mérite, sans doute, d’être relevé dans ses dernières traces, mais de présenter surtout, en tant que Français, cette grande contribution de la féodalité française à l’Orient à travers trois siècles, qui forme, pour celui-ci, un magnifique souvenir et, pour la France, un inappréciable trésor.
Poitiers. — Société Française d’Imprimerie. — 1928.