

A ma vieille mère,
en témoignage de filiale et
respectueuse affection.
Depuis son retour d'Allemagne, l'auteur a reçu de tous les coins du Canada et de plusieurs endroits des États-Unis d'innombrables invitations pour conférences, discours, etc.
A peu d'exceptions près, il lui a été impossible naturellement d'accéder au désir si chaleureusement exprimé de part et d'autre.
D'un autre côté un grand nombre de personnes dont il s'honore de l'amitié lui ont fortement conseillé de publier, sous une forme quelconque, quelques mémoires et de son séjour en Belgique—c'est-à-dire depuis son mariage à Capellen, près d'Anvers, en 1914, jusqu'à son arrestation en 1915—et de sa captivité en Allemagne les années subséquentes.
C'est pour satisfaire au désir des uns et au conseil des autres qu'il offre au public la narration, écrite à la diable, qui suit.
Si l'on y cherchait de la philosophie, un effort littéraire, des considérations d'ordre politique ou social ou même des jérémiades... on serait déçu.
L'auteur n'a eu d'autre intention que celle de relater, sans efforts et sans prétention, des incidents et des événements, cocasses, indifférents ou tristes auxquels il a été mêlé; de faire voir superficiellement ce qu'est la vie d'un prisonnier de guerre derrière des murailles élevées sous la garde médiate ou immédiate de Prussiens authentiques.
Là s'est borné son effort.
H. B.

Ce jour-là, une atmosphère de religiosité enveloppait l'imposante chaîne de montagnes qui séparent l'Espagne de la France. Le Congrès Eucharistique, qui prenait fin, avait réuni, à Lourdes, un nombreux clergé et un peuple immense venus de tous les coins du monde. Tous—fidèles par centaines de mille: laïques, prêtres, prélats, évêques, princes de l'Eglise —avaient, la veille au soir, mêlé leurs voix dans les chants pieux de l'inoubliable et grandiose procession aux flambeaux en face de la Basilique, pendant que là-haut, au sommet du Pic du Gers, la croix flamboyante se détachait dans la nuit profonde. Cette croix de feu, au fond de la nue, semblait rappeler la parole angélique d'il y a deux mille ans: Pax hominibus bonae voluntatis.
C'était le 26 juillet 1914, un dimanche. Nous nous promenions, ma femme et moi, dans le parc d'un village pyrénéen. Le soleil dardait ses rayons chauds et vivifiants, incendiant toute la vallée du Gave. Soudain, un camelot s'approche de nous portant sous son bras un paquet de journaux. Le gamin criait à tue-tête:—"C'est la guerre! C'est la guerre!" Nous lui coupons la parole en posant cette question:
—Quelle guerre?...
—Mais la guerre entre l'Autriche et la Serbie, monsieur. Vous aurez tous les détails en achetant mon journal: la Liberté du Sud-Ouest.
En effet, ce matin-là, toute la presse européenne publiait le texte de l'ultimatum, désormais fameux, que l'Autriche venait de lancer à la petite Serbie.
Le lendemain, dans le rapide qui nous ramenait de Bordeaux à Paris, nous trouvions, à chaque gare importante, les plus récentes éditions des quotidiens français où était commenté à profusion, avec passion et nervosité, le document diplomatique qui menaçait de troubler la paix de l'Europe.—On discutait fiévreusement dans le compartiment où nous étions:—"C'est bien encore et toujours la perfide Autriche!..." D'autres ajoutaient:—"C'est encore plus l'ambitieuse et traîtresse Allemagne qui inspire l'Autriche!"
Nous nous hâtions de retourner à Anvers, en ne faisant à Paris qu'une halte de quelques jours. Nous étions surpris de constater que dans cette tourmente diplomatique qui allait s'accentuant d'heure eu heure, l'énorme capitale conservait un calme remarquable. On discutait bien dans les cafés, sur les grands boulevards, dans les omnibus, mais non pas avec cette agitation fébrile, cette verbosité, ce mélange de blague, d'enthousiasme, d'emballement, et de contradiction que l'on a l'habitude d'observer chez un public parisien.
Lorsque, au débotter, j'essayai d'envoyer une dépêche en Belgique, on me répondit que les lignes télégraphiques étaient déjà entièrement, et exclusivement, à la disposition des autorités militaires, et que ma dépêche pourrait bien être retardée de vingt-quatre heures.
Le jour de mon départ de Paris pour Anvers, j'étais allé rendre visite à l'hon. M. Roy, à qui je posai la question:—"Que pensez-vous de la situation diplomatique?" L'éminent représentant du Canada me fit part de sa grande anxiété et de ses réelles appréhensions. Il me sembla plutôt pessimiste, redoutant une guerre entre l'Allemagne et la France.
Le 30 juillet, à midi, nous prenions, ma femme et moi, le rapide Paris-Amsterdam à destination d'Anvers, et nous traversions ce territoire de France et de Belgique qui à peine deux mois plus tard était le théâtre des horreurs de la guerre. Nous étions alors loin de penser que ces cités, véritables fourmilières industrielles, et ces campagnes couvertes à cette époque d'une moisson dorée invitant la faux du moissonneur seraient, avant quelques semaines, dévastées, saccagées, pillées et incendiées.
A Anvers, grande agitation. La garde civique a été appelée, et la rumeur circule, ce soir-là, 30 juillet, que l'Allemagne a des intentions sinistres, qu'elle se dispose à violer la neutralité de la Belgique. La seule mention d'un acte si contraire aux lois internationales soulève l'indignation de tous ceux que nous rencontrons. Nous traversons la ville et nous nous rendons à Capellen, village situé à six milles au nord de la ville d'Anvers, sur la grande chaussée Anvers-Rotterdam.
Le samedi, 1er août 1914, nous nous rendions d'Anvers à Bruxelles, puis à Ostende, où nous devions occuper une villa au bord de la mer, exactement à Middelkerke. Middelkerke est une place charmante qui vient justement d'être évacuée par les Allemands, et qui est située à mi-chemin entre Ostende et Nieuport. C'est des environs de Nieuport que partait la ligne de séparation entre les armées alliées et les armées teutonnes pendant les quatre années de la guerre.
Je me permettrai d'ouvrir ici une parenthèse afin de raconter un incident qui pourra jeter quelque lumière sur les intentions de l'Allemagne envers la Belgique.
Au moment où le train à destination d'Ostende sortait de la gare de Bruxelles, un couple entrait dans notre compartiment déjà rempli. Ce brave homme et sa femme s'excusèrent de leur mieux de pénétrer ainsi dans un compartiment encombré. On leur pardonna de bonne grâce, vu qu'à ce moment le trafic était déjà fortement congestionné.—C'était M. L. F... et sa femme, habitants de Gand, et voici l'aventure—leur aventure—qu'ils racontèrent aux six autres occupants du compartiment.
Comme je l'ai dit plus haut, c'était samedi, le 1er août. Or, la veille, 31 juillet, ce monsieur gantois et sa femme rentraient en Belgique, de retour d'une excursion en Allemagne. Dans un village d'Allemagne situé tout près de la frontière belge, ils furent arrêtés et leur automobile fut saisie par les autorités militaires locales, malgré leurs protestations. Notre Gantois et sa femme durent passer la nuit dans un petit hôtel de ce village, et dormir dans une chambre du rez-de-chaussée.—De toute la nuit, dit madame F..., il nous fut impossible de clore l'oeil; ce fut un défilé continuel de troupes allemandes allant vers la Belgique. Ces soldats passaient en chantant, tambours battants, et faisant un tapage infernal. Ils chantaient: "Deutschland, Deutschland, uber alles!" —Le lecteur est prié de remarquer que ceci se passait le soir du 31 juillet, et dans un village qui n'était qu'à deux ou trois kilomètres de la frontière belge, et que l'ultimatum de l'Allemagne à la Belgique n'était présentée que le 2 août.
Au cours de ce voyage de Bruxelles à Ostende, qui dura près de six heures par suite des retards occasionnés par la foule des passagers qui s'empressaient de rentrer dans leurs foyers,—plus ou moins effrayés qu'ils étaient par les rumeurs en circulation, —un autre incident eut lieu qui me semble assez intéressant pour être raconté un peu en détail.
Dans le compartiment que nous occupions, ma femme et moi, il y avait,—en outre de l'intéressant couple gantois,—quatre autres passagers, dont trois dames autrichiennes, une mère et ses deux filles, et un grand propriétaire de chevaux de course des environs de Charleroi. Ces dames autrichiennes semblaient appartenir à la meilleure société. Elles se rendaient à Ostende, avec l'intention de passer en Angleterre. La mère prétendait que son fils y était étudiant. La discussion s'engagea, on ne sait trop comment, entre le propriétaire de chevaux et les dames autrichiennes. Depuis quatre jours déjà, l'Autriche avait déclaré la guerre à la Serbie. La proposition anglaise suggérant de faire régler l'imbroglio austro-serbe au moyen d'une conférence était dans tous les esprits, et le monsieur de Charleroi qui, soit dit en passant, n'avait pas froid aux yeux, disait carrément son fait à l'Autriche. La dame autrichienne plaidait tout naturellement pour son pays; elle prétendait que les Serbes étaient fourbes et conspiraient constamment contre l'Autriche.—"Les Serbes, disait le propriétaire de chevaux, je l'admets, ne sont pas intéressants, Madame, mais il y a quelque chose de moins intéressant que les Serbes, ce sont les horreurs de la guerre. L'Autriche est l'instrument de l'Allemagne, et cette guerre que vous venez de déclarer à un petit peuple, cette guerre est peut-être entreprise, Madame, par votre gouvernement dans le but d'arrondir son territoire balkanique, mais elle est avant tout dictée par l'autocrate de Postdam."—La brave Autrichienne qui, il faut le reconnaître, apportait dans cette discussion une certaine dose de modération, s'obstinait à ne pas voir dans cette guerre la main de l'Allemagne.—"Nous verrons un peu", disait le propriétaire de chevaux, "nous verrons un peu; attendez une fois seulement que la France, la Russie et l'Angleterre se donnent la main, et il m'est avis que l'empereur Guillaume regrettera d'avoir compromis le confort du fauteuil royal sur lequel il se prélasse depuis 25 ans!..."
Nous arrivions à Gand, et nous prenons congé de ce malheureux couple gantois qui le matin même avait dû passer à pied la frontière de Belgique, et faire encore quelques milles de plus pour prendre un train à destination de Bruxelles.
A Middelkerke, le 2 août, il y avait grande animation sur la digue. Les journaux venaient justement de publier le texte de l'ultimatum de Guillaume II au gouvernement et à la nation belge. L'indignation était à son comble:
"Comment, disait-on, cet, empereur Guillaume, que nous avons fêté à Bruxelles il y a quelques mois, cet empereur Guillaume, qui a été l'hôte de notre roi, l'hôte de la nation belge, c'est lui-même qui vient nous jeter à la face cette sanglante injure!..."
De la villa que nous habitions, nous pouvions voir des groupes de 15, 20 et 30 personnes assemblées ça et là sur la plage. A un certain moment, plusieurs de ces groupes se réunissent, forment un contingent imposant et se rendent processionnellement devant la porte d'un certain estaminet. J'ai oublié le nom du propriétaire de cet établissement. Quoi qu'il en soit, c'était un Allemand. La façade de l'imposante gargote était ornée, à chacun de ses trois étages d'une inscription,—en allemand naturellement; c'était une réclame en faveur de quelque bière allemande, brune ou blonde. Ce ne fut qu'un jeu, et l'affaire d'un moment de descendre la première enseigne, celle du premier étage. Pour celle du second, on alla chercher une échelle, et elle fut descendue assez prestement aux acclamations bruyantes de la foule qui, à ce moment, avait pris des proportions formidables. Quand vint le tour de l'affiche du troisième étage, on constata que l'échelle était trop courte. Une délégation fut envoyée à l'intérieur pour sommer le propriétaire boche de grimper à l'étage supérieur, et de faire disparaître lui-même son écriteau...
Les pourparlers durèrent quelques minutes pendant lesquelles la foule, de plus en plus houleuse, manifestait son impatience par des cris et des menaces. Enfin, à la grande réjouissance de tous les manifestants, on vit le boche ouvrir une fenêtre et décrocher son enseigne. Toute la plage retentit des acclamations de la foule qui pouvait bien, à ce moment, représenter un millier de personnes. Immédiatement on se met en marche, on va quérir la fanfare, et dix minutes plus tard, la foule, toujours grandissante, revenait, fanfare en tête vers la plage qui retentit des accords d'une musique joyeuse. Enfin, les manifestants s'arrêtent sur un "square" où l'harmonie joue l'air national belge, la Brabançonne, puis des partitions musicales, et toute la jeunesse se met à danser.
Le lendemain, la fière et noble réponse du roi et du gouvernement belge à l'ultimatum allemand était publié. Un héraut en lisait le texte à tous les coins de rues aboutissant à la digue. Une troupe bruyante de jeunes gens suivaient le héraut, et chaque fois que la lecture du document était terminée, un tonnerre d'acclamations sortait de ces jeunes poitrines.
Cependant les nouvelles les plus alarmantes couraient de bouche en bouche: on disait que Visé était en feu, qu'Argenteau avait été détruit, que des civils avaient été exécutés; que c'étaient, dans la région située à l'est de la Meuse, la terreur et la dévastation; que les Allemands, sans même attendre la réponse faite par la Belgique à leur sommation provocante, en avaient envahi le territoire. Cette violation du territoire belge ne me surprit pas énormément après les révélations qui nous avaient été faites par ce monsieur et cette dame de Gand sur le train qui nous avait amenés à Ostende.
On s'imagine quelles angoisses ces sinistres nouvelles créaient chez nous, chez nos amis de la plage, comme chez tous les belges en villégiature, à Middelkerke, à Ostende, et dans les environs. Je me rappelle encore la cruelle anxiété dans laquelle se trouvait cette pauvre dame Anciault, dont la résidence habituelle était aux environs de Liège. Elle était sans nouvelles de son mari et de quelques-uns de ses enfants demeurés dans l'est de la Belgique.
Voyant la tournure inquiétante que prenaient les événements, nous décidons de retourner immédiatement à Anvers, puis à Capellen.
Nous avions quitté Middelkerke armes et bagages.—Quand je dis armes, ce n'est qu'une façon de parler, car pour ce qui est des armes que nous avions à Middelkerke,—quelques fusils de chasse,—ils avaient été confisqués par l'autorité municipale et déposés à la maison communale. Cette précaution a été prise dans toutes les communes de la Belgique. Les autorités civiles et militaires voyant l'indignation si explicable de toute la population belge devant l'invasion allemande, et redoutant l'intervention de civils armés, firent tout en leur pouvoir pour prévenir ce qui, en droit international est contraire aux lois de la guerre. Un édit fut donc publié enjoignant à tous les civils de remettre aux autorités municipales leurs armes de tous genres et de tous calibres. On peut donc affirmer sans crainte que des les premiers jours de la guerre, les civils belges sauf de très rares exceptions, se trouvaient désarmés. Je crois donc de mon devoir d'affirmer ici que les autorités allemandes, lorsqu'elles ont prétendu que le gouvernement belge était complice des civils accusés d'avoir tiré sur leurs troupes, ne cherchaient, mais en vain, qu'une excuse pour justifier les actes inhumains dont ils se rendirent coupables en Belgique.
Donc, le 5 août, nous prenions le train à Ostende pour revenir à Anvers. L'état de guerre existait alors entre l'Allemagne et la Belgique. Nous étions dans notre compartiment exactement cinq personnes, trois enfants, ma femme et moi. Au moment où le train quittait la gare, un nouveau passager, tout essoufflé, se cramponnant à la porte du compartiment, l'ouvre, et faisant irruption à l'intérieur, dit en anglais à quelqu'un demeuré en arrière:
—"Thank you."
Il répéta plusieurs fois son: "Thank you", en agitant celle de ses mains qui était libre.
Notre homme s'assied à la place qui n'était pas occupée.
Je lui demande:—Are you English?... (Êtes-vous anglais)
—No, I am American, me répondit-il. (Je suis Américain).
—"Alors, si vous êtes Américain, nous sommes du même continent, car je suis Canadien." Il ne me paraissait pas très enchanté d'avoir rencontré un compagnon si loquace. Comme il se tournait de préférence du côté de la portière, j'en conclus qu'il trouvait beaucoup plus intéressant le paysage qui se déroulait devant ses yeux.
—"Et où allez-vous donc, lui demandai-je (toujours en anglais)—si je puis me permettre de vous poser cette question"?
—"En Russie, me répondit-il".
—"Comment pourrez-vous vous rendre en Russie, l'Allemagne vient de déclarer la guerre à la Belgique?"
—Oh! dit-il, "j'ai l'intention de passer par la Hollande."
Le laconisme de ses réponses m'indiquait qu'il prenait peu d'intérêt à la conversation que je tentais d'entamer avec lui. Je commençais à avoir quelques soupçons, lorsque ma femme, assise en face de moi me fit comprendre par un clin d'oeil qu'il y avait quelque chose d'anormal chez notre compagnon de route. Le train filait à bonne allure, et quelques minutes plus tard, nous arrivions à Bruges. Sur le quai de la gare, il y avait une foule considérable. On se coudoyait, on avait l'air de chercher quelqu'un en regardant dans toutes les fenêtres du convoi... Notre compagnon prend sa valise pour descendre du convoi. Il avait à peine ouvert la porte du compartiment que de cinquante bouches à la fois sortit cette exclamation:
—"C'est lui! C'est lui!"
Il descendit et fut immédiatement entouré par la foule. Trois ou quatre gendarmes survinrent qui lui posèrent cette question directe et ad rem:
—"Êtes-vous Allemand?"
Il fit un signe affirmatif. La foule devenant alors très menaçante, voulut s'emparer de lui malgré les gendarmes.... Quelques-uns criaient:
—"Tuez-le"!
D'autres lui lançaient des brocarts assez mal sonnants dont je fais grâce à mes lecteurs.
Les gendarmes agirent avec une dignité et une correction irréprochables. Ils protégèrent le sujet allemand contre les violences de la foule. Ils l'emmenèrent en dehors de la gare, et j'ignore encore ce qu'il advint de lui. Le moins que l'on dut faire fut sans doute de l'interner... Je me suis souvent demandé quel était cet homme. Peut-être un voyageur attardé à Ostende, ou un espion allemand demeuré en Belgique jusqu'au dernier moment pour se rendre compte des sentiments du peuple après la déclaration de la guerre?.....
Mystère!
Je suis enclin à croire qu'il faisait partie de cette pieuvre immense qui s'appelle le service d'espionnage allemand. S'il rentre jamais dans son pays, il ne manquera pas de faire à ses compatriotes un tableau saisissant de l'indignation dont fit preuve la noble nation belge en face de l'outrage infligé à son honneur par le grand empire du centre.
Il est absolument inutile d'insister sur le patriotisme dont fit preuve la nation belge. Le même esprit d'héroïsme et de sacrifice régnait dans toutes les classes de la société, et tous sans distinction d'âge de sexe ou de condition s'offraient pour renir en aide à la cause nationale menacée par le monstre germanique.
De tous côtés, dans les premiers jours d'août 1914, on m'abordait en me posant la question suivante:
—"Monsieur Béland, que pensez-vous de la situation?... Que va faire l'Angleterre?"
Je n'hésitais pas à répondre que si l'Allemagne mettait à exécution son plan de violer la neutralité belge, l'Angleterre lui déclarerait la guerre.
Je me rappelle une démonstration qui eut lieu sur la digue à Middelkerke, le jour où fut publié l'ultimatum de l'Allemagne. Au large, dans la mer du Nord, une escadre anglaise croisait. D'énormes nuages de fumée étaient perceptibles même à l'oeil nu, et les lunettes des promeneurs, braquées sur l'horizon leur en révélait la véritable nature. Un rassemblement se fit, et l'on nous annonça que c'était réellement la flotte anglaise qui croisait au large.
L'espoir de ces braves gens semblait se fixer sur cette formidable puissance navale. J'eus l'honneur de provoquer, en cette occasion, les acclamations de cette foule à l'adresse de la flotte britannique.
Du moment qu'il fut connu en Belgique que l'Allemagne avait signifié à l'Angleterre sa détermination d'entrer dans le conflit pour revendiquer l'honneur des traités, la confiance sembla renaître et une atmosphère de sérénité régna,—momentanément, du moins,—dans tout le pays... Dès lors, devenant, par ma qualité de citoyen britannique, un allié de la brave nation belge, je me rendis à Anvers pour offrir mes services en entrant dans le corps médical. Ai-je besoin d'ajouter qe mon offre fut immédiatement acceptée. J'entrai tout de suite en fonctions à l'hôpital Sainte-Elisabeth sous la haute direction du célèbre chirurgien anversois, le docteur Conrad.
Cet hôpital avait pour infirmières des dames religieuses. Je ne me rappelle plus le nom de leur congrégation. Le dévouement de ces nobles femmes est au-dessus de tout éloge, et tout ce qui a été dit, à leur sujet, chez tous les peuples et dans toutes les langues, n'exprime qu'une bien faible partie de leur immense mérite.
Ce n'est que vers le milieu d'août que les premiers blessés arrivèrent à notre hôpital. Ils venaient du centre de la Belgique. Nous en avions eu un, venant de Liège, qui n'a cessé, je ne l'oublierai jamais, de nous divertir par sa verve endiablée, et son intarissable faconde.
Tous les médecins de l'hôpital, à part moi, faisaient partie de l'armée, du moins depuis le début de la guerre.
C'est le 25 août, si j'ai bonne mémoire, qu'un premier "raid" aérien eut lieu au-dessus de la ville d'Anvers. On peut facilement imaginer l'émotion créée par l'apparition d'un Zeppelin au-dessus de la ville. Onze civils, hommes femmes et enfants furent victimes de cette monstrueuse attaque. Le lendemain, un journal d'Anvers, "La Métropole", publiait un entrefilet où il était proposé d'inhumer les corps de ces victimes à un certain endroit de la ville, et d'y élever un monument avec l'inscription suivante: "Assassinés par la brutalité allemande le 25 août 1914."
L'indignation était à son comble. Les citoyens allemands qui se trouvaient à Anvers, sentant que leur position devenait intenable, se "défilèrent" pour la plupart.
Chaque jour j'arrivais à l'hôpital avec le "Times" de Londres. Dans nos moments de loisir, mes collègues m'entouraient pour entendre la lecture des principaux articles que je leur traduisais.
Bruxelles était depuis le 18 août occupée par les Allemands. Anvers devint le centre de la résistance belge et le siège du gouvernement et du grand état-major. Nous, coloniaux britanniques de langue française, nés dans la démocratique et libre Amérique, nous n'avons pas eu souvent occasion, de voir,—et j'oserais dire de coudoyer,—un roi et une reine authentiques, aussi, il nous est difficile de nous faire une idée de la très grande popularité dont jouissent le roi Albert et la reine Elisabeth. Cette popularité fut pour moi toute un révélation, au point que ce couple royal nous a toujours semblé absolument unique entre tous.
Un jour, ayant appris qu'un détachement de soldats allemands faits prisonniers par les Belges allaient traverser la ville, j'étais sorti en toute hâte de l'hôpital, et je m'étais rendu dans le voisinage des quais pour voir défiler ces soldats prisonniers. Ce fut en vérité un spectacle inoubliable: toute la population d'Anvers était dans la rue, on se pressait vers les grandes artères pour tâcher d'apercevoir ces ennemis qui avaient envahi le sol sacré de la patrie belge.
En coupant court à travers certaines rues, j'eus l'avantage d'arriver en temps dans le voisinage des quais où il me fut donné de pouvoir observer de près et les prisonniers et la foule menaçante qui les regardait passer. Des trottoirs et des fenêtres des maisons, on lançait à ces Allemands les invectives les plus malsonnantes. Ces prisonniers, couverts de boue et de poussière, paraissaient exténués. On eut dit des condamnés à mort.
A mon retour, je m'engageai dans une rue très étroite aboutissant à un petit escalier menant vers la cathédrale. Je remarquai à ce moment une dame d'assez petite taille, mise très humblement, et qui tenait par la main un petit garçon de huit à dix ans. Un groupe de gamins, visiblement mieux renseignés que moi, s'arrêtèrent et se mirent à crier à tue-tête: "Vive la reine Elisabeth!" et "Vive le petit prince!" La reine,—car c'était la reine Elisabeth elle-même,—les remerciait par un aimable sourire.
Ces cris des enfants, se répercutant dans la rue, attirèrent la foule; en peu d'instants, une centaine de personnes se trouvèrent assemblées, les vieillards enlevaient leurs chapeaux, et les enfants criaient toujours: "Vive la reine Elisabeth!" Je la suivis quelques minutes jusqu'à sa rentrée au Palais, place de Meir, et tout le long du parcours, c'était le même cri: "Vive la reine Elisabeth!" La petite reine saluait gentiment, et souriait gracieusement.
Dans les derniers jours du mois d'août, et les premières semaines du mois de septembre, les troupes belges, concentrées dans la position fortifiée d'Anvers, tentèrent plusieurs attaques contre les Allemands qui occupaient déjà Bruxelles, et qui occupèrent Malines peu après. Nous étions confidentiellement avertis, à l'hôpital, de ces sorties de l'armée belge, et le lendemain nous nous préparions à recevoir de nombreux blessés.
Pauvres blessés!—Ils nous arrivaient, six par voiture, dans des ambulances automobiles. Ceux qui n'étaient pas très gravement atteints, mais dont les blessures avaient donné lieu à une forte hémorragie, nous arrivaient dans un état pitoyable. Le sang qui avait coulé à travers leurs vêtements, et qui s'était coagulé, nous portait d'abord à croire que le pauvre soldat avait été complètement déchiqueté. Heureusement, il nous arrivait le plus souvent de constater, après un examen plus minutieux, qu'il s'agissait seulement d'une petite artère tranchée par une balle, et que sauf la perte de sang un peu considérable, l'état du blessé n'offrait rien de sérieux.
Les plus horribles blessures sont celles qui sont causées par les éclats d'obus de fort calibre lancés par la grosse artillerie. On conçoit facilement quelle profonde lacération des tissus doit faire un de ces éclats de projectiles pesant de 50 à 200 livres. Mais de ces blessures si graves et si pénibles à voir, nous n'en avons guère eu avant le siège d'Anvers.
Je sens qu'il est au-dessus de mes forces de narrer d'une manière convenable les événements militaires qui ont accompagné l'attaque et la prise d'Anvers par les Allemands.
Les diverses histoires de la guerre publiées en français ou en anglais, depuis 1914, en ont relaté les principales phases dans les plus grands détails. Je me bornerai tout simplement à mettre le lecteur au courant de certains incidents dont j'ai été témoin.
Anvers était, comme on le sait, réputée imprenable. La ville elle-même était entourée de murs et de canaux. A une certaine distance en dehors de ces fortifications, il y avait une première ceinture de forts dits forts intérieurs. A une distance un peu plus grande se trouvait une seconde ceinture de forts que l'on appelait forts extérieurs.
C'est vers le 26 ou le 27 septembre 1914, qu'il devint évident à Anvers que les Allemands se préparaient à mettre le siège devant la ville du côté de Malines.—Malines est située à mi-chemin entre Anvers et Bruxelles, à 5 ou 6 milles seulement de la ceinture des forts extérieurs.
On a souvent discuté, chez les critiques militaires, les raisons qui ont induit le grand état-major allemand à entreprendre le siège de cette fameuse place fortifiée. Il semble que ce qui a le plus contribué à faire prendre cette décision aux Allemands a été la nécessité où ils se sont trouvés de faire disparaître chez leur peuple la pénible impression causée par la retraite de l'armée allemande lors de la fameuse bataille de la Marne.
C'est entre le 4 et le 12 septembre que les Allemands abandonnèrent les deux rives de la Marne pour remonter sur l'Aisne, et l'attaque d'Anvers, pour les raisons mentionnées plus haut, ou pour d'autres, fut décidée et commencée vers le 26 ou le 27 septembre.
A la distance ou nous sommes aujourd'hui de ces premiers faits de la guerre, il nous paraît évident que si les Allemands avaient le dessein de s'emparer de la Belgique et de la garder, ils ne pouvaient guère permettre à une ville fortifiée, comme l'était Anvers, de demeurer en possession de l'état-major belge.
Malines fut d'abord occupée ainsi que quelques villages situés au sud-est de cette ville. On s'est demandé pourquoi les Allemands avaient attaqué Anvers par ce côté. Il nous semble que s'ils avaient attaqué par l'ouest, il leur eut été beaucoup plus facile de couper la retraite à l'armée belge sur le littoral de la mer du Nord. En effet, entre Termonde et la frontière hollandaise, il n'y a qu'une étroite lisière du territoire belge, que les Allemands, disposant alors d'énormes effectifs, pouvaient investir en un clin d'oeil.
On m'a assuré que les Allemands, après avoir pris possession d'un village appelé Hyst-op-den-Berg, n'eurent qu'à faire tomber les murs d'une maison pour trouver toute prête une large base en béton sur laquelle ils purent asseoir leurs pièces d'artillerie les plus lourdes. Était-ce là une manoeuvre d'avant-guerre dont on voulait profitera Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, il était possible aux grosses pièces de l'artillerie allemande de bombarder, de cet endroit, les forts de Waelem, de Wavre-Sainte-Catherine et de Lierre. Ce sont ces forts qui furent les premiers détruits par l'artillerie allemande.
Tous les jours, à cette époque, nous recevions, à l'hôpital, de nombreux blessés. Chaque fois que les médecins ambulanciers nous amenaient des charges de blessés, nous nous empressions de leur demander des nouvelles, et dans chaque cas, malheureusement, les rapports étaient de moins en moins encourageants. Tel fort était détruit, puis tel autre. Nous avons eu des officiers d'artillerie retirés à peu près inconscients des forts où ils avaient été atteints par les gaz asphyxiants. Enfin, on nous rapporte que certains détachements allemands ont traversé la rivière Nette, et que bientôt les pièces moyennes d'artillerie seront en état de bombarder la ville elle-même.
Je me rappelle en particulier un lieutenant d'artillerie qui me fit un récit de ce qui s'était passé, pendant le bombardement, dans le fort où il se trouvait. Tout habitué qu'il était aux détonations formidables des canons de tout calibre, il ne pouvait trouver d'expressions assez fortes pour me donner une idée adéquate de ce qu'était la puissance d'explosion d'un projectile sortant de la bouche d'un howitzer de 28 centimètres, ou d'un canon de 42.
Je crois que c'est samedi, le 3 octobre, que la nouvelle se répandit, comme une traînée de poudre, que M. Winston Churchill, alors premier lord de l'Amirauté anglaise, se trouvait dans les murs d'Anvers. Quelques heures plus tard on nous rapporte que M. Churchill est parti en assurant aux autorités belges que des renforts leur seraient immédiatement envoyés. En effet, le lendemain et le lundi suivant, nous vîmes défiler, au milieu de l'enthousiasme débordant de toute la population, ces braves marins anglais. Ils traversèrent la ville depuis les rives de l'Escaut jusqu'aux forts du sud-est où ils prirent place dans les tranchées belges.
Dans la forteresse assiégée, la confiance un moment ébranlée sembla renaître plus vivace que jamais. Il nous fait plaisir d'affirmer que la conduite de la brigade anglaise a été au-dessus de tout éloge. Elle fut tout simplement héroïque. Je n'ignore pas les critiques que l'on fit en pays anglais, dans la presse quotidienne et dans les grandes revues au sujet de l'envoi non judicieux—comme on l'écrivait—de ces marins. Il me semble qu'ils ont joué un rôle très important tant dans la défense d'Anvers que lors des dernières heures de la résistance.
Certes, ces brigades anglaises n'ont pas empêché la chute de la ville, mais par leur résistance héroïque, acculées qu'elles furent sous les murs d'Anvers, elles remplirent le rôle de troupes de couverture, et favorisèrent la retraite de l'armée belge, à travers la ville d'abord, puis, de l'autre côté de l'Escaut, dans le pays de Waes, vers Saint-Nicolas, Gand et Ostende, Elles se retirèrent les dernières, dans la nuit du 8 au 9 octobre. Peu de ces marins tombèrent aux mains des Allemands, quelques-uns passèrent en Hollande, où ils furent internés, mais la plupart, purent suivre l'armée belge dans sa retraite.
La ville proprement dite subit un bombardement d'environ trente heures: commencé dans la soirée du mercredi, 7 octobre, il prenait fin le vendredi matin, 9 octobre, vers sept heures; bombardement violent au cours duquel environ 25,000 obus de tous calibres s'abattirent sur la grande ville secouée jusque dans ses fondements.
Le jeudi, veille de la prise d'Anvers, il ne restait plus, à l'hôpital, sauf mes collègues et quelques bonnes religieuses, qu'un très petit nombre de blessés. Nous avions fait transporter tous les autres à Ostende. J'étais sur le point de quitter l'hôpital lorsque, soudain, un projectile, visiteur peu attendu, entra et fit explosion au milieu même des chambres de stérilisation et d'opération. Une parcelle de l'obus me fit une insignifiante égratignure. Je quittai l'hôpital ce jour-là pour n'y plus revenir qu'en passant.
Jeudi 8 octobre, comme je pédalais,—on pédalait alors beaucoup en Belgique,—à travers le rues désertes de la ville, me dirigeant vers le nord, j'entendis, au-dessus de ma tête, comme un formidable bourdonnement d'abeilles. C'était le sifflement d'innombrables projectiles lancés dans la direction du grand quartier général belge. C'est surtout vers ce but que les artilleurs allemands semblaient avoir pointé leurs canons.
Le grand quartier général belge était à l'hôtel Saint-Antoine, au Marché aux Souliers, dans une petite rue qui va de la place de Meir à la place Verte. Quand, le lendemain de la prise de la ville, j'y revenais sur une bicyclette,—je m'étais fait à ce mode rapide de locomotion,—pour constater de visu jusqu'à quel point la ville avait souffert du bombardement, quelle ne tut pas ma surprise de trouver l'hôtel Saint-Antoine absolument intact, tandis que tout le côté opposé de la rue était une masse de ruines fumantes. Vraisemblablement, les obus avaient frôlé le toit d'abord puis étaient allés faire explosion de l'autre côté de la rue.
La nuit du 8 au 9 octobre fut une nuit sinistre. Du haut du toit de la maison que nous habitions, à Capellen, toute la famille réunie observait le spectacle lugubre d'une grande ville qui périt dans les flammes.
De l'endroit où nous étions, il semblait que la ville toute entière était en feu; les réservoirs de pétrole brûlaient; et des nuages de fumée s'élevaient des quartiers les plus éloignés. Au milieu de cette masse de flammes, comme un doigt colossal dirigé vers le ciel, on voyait, toujours dressée, la magnifique tour de la grande cathédrale. Elle apparaissait et disparaissait tour à tour au milieu des énormes jets de flamme qui montaient vers la nue. Plus loin, dans la direction du sud, et dans l'obscurité, jaillissaient à jet continu les éclairs produits par le feu de toute l'artillerie allemande qui vomissait la mitraille sur la ville qui flambait.
Spectacle épouvantable qui dura toute la nuit! Secousses terrifiantes causées par les explosions répétées à raison de 300 par minute! Enfin, à 7 heures du matin, vendredi, le 9 octobre, un silence lugubre descendit sur la grande ville. En tant que place fortifiée belge, Anvers n'existait plus.
Quel spectacle que celui de l'exode de tout un peuple vers un pays étranger! Nous en avons été les témoins navrés. A mesure que les Allemands s'approchaient de la ville d'Anvers du côté sud et du côté est, la population de Malines et des environs, les habitants de Duffel, de Lierre, de Contich, de Vieu-Dieu et de cinquante autres villes et villages situés entre la ligne extérieure et la ceinture intérieure des forts, se déversaient dans la ville d'Anvers. Lorsqu'il devint évident, le mardi et le mercredi, que la ville dans laquelle ils s'étaient réfugiés et où ils avaient cru trouver un sûr asile, devait elle-même subir le bombardement de l'artillerie allemande, toute cette population et celle d'Anvers—peut-être 500,000 personnes en tout—se ruèrent de tous les côtés pour échapper au feu menaçant. 200,000 environ traversèrent l'Escaut vers Saint-Nicolas et le territoire hollandais au sud de la rivière; 250,000 à 300,000 débordèrent sur la grande route Anvers-Rotterdam.
Dans les derniers jours de l'agonie d'Anvers, j'ai été le témoin constant de ce lamentable exode. Le matin, me rendant en bicyclette de Capellen à Anvers, je remontais pour ainsi dire le flot des réfugiés, et le soir, en revenant à Capellen, je suivais le même flot, sans cesse s'augmentant et fuyant interminablement.
Comment décrire ce spectacle, grandiose s'il n'eut été si lugubre, et d'un pathétique dont il y a peu d'exemple dans l'histoire; des vieillards, des femmes et des enfants, portaient sur leur dos, dans leurs bras, traînaient dans des brouettes, dans des véhicules de toute description, du linge, des objets de piété, des meubles petits ou grands, des lits, des matelas, des chaises, enfin, tout ce que l'on avait pu emporter... D'autres, j'oserais dire plus fortunés, emmenaient la vache et la chèvre, le vieux cheval, un mouton ou le chien fidèle... Tous allaient tête basse, harassés, déprimés, affaissés.
Je n'oublierai jamais ce pauvre vieillard qui vint, un soir, nous demander asile. Il poussait péniblement, et depuis combien de temps, une brouette dans laquelle était assise sa vieille épouse impotente et paralysée! Il en fut ainsi tous les jours pendant le siège. A la résidence de Capellen, des centaines et des centaines de réfugiés entraient dans le parc et dans le jardin, et s'improvisaient un gîte pour la nuit, sous les arbres et dans les buissons. D'autres, les vieillards, les femmes ou les malades, étaient admis dans la maison. Les chambres, les corridors, les greniers et les caves, tout était rempli.
Le lendemain matin, ces pauvres réfugiés reprenaient leur marche vers la Hollande, et c'était de nouveau le triste défilé de cette longue et lamentable théorie de nécessiteux allant tout droit devant eux, sans but, en quête d'un foyer étranger qui daignerait leur être hospitalier!...
Le vendredi, jour de la prise d'Anvers, les troupes allemandes entrèrent dans la ville vers 9 heures du matin.
Afin de faire un récit, le plus exact, possible de la manière dont l'année allemande procéda à l'occupation d'Anvers, j'utiliserai certaines confidences que me fit un officier allemand, qui fit partie de l'armée d'invasion, et qui logea chez nous pendant environ trois mois après la prise de la ville.
Lorsque la résistance belge eut cessé, c'est-à-dire dans la nuit du 8 au 9 octobre, les Allemands, comme je l'ai dit plus haut, continuèrent le bombardement de la ville jusqu'à 7 heures le lendemain matin. A 9 heures, les premiers régiments allemands reçurent l'ordre de pénétrer à l'intérieur des murs. Toute l'armée allemande était sous l'impression que la ville serait défendue, pied à pied, à l'intérieur des murs... On croyait que l'armée belge, forte de 90,000 à 100,000 hommes, y était demeurée.
Les Allemands, qui n'avaient à leur disposition que 55,000 hommes,—si j'en crois mon officier,—redoutaient une prise corps à corps dans les rues de la ville. L'ordre fut donné, comme je viens de le dire, de pénétrer dans la ville par les portes du sud-est. Régiments après régiments entrèrent par la porte de Deurne, baïonnette au canon, marchant comme on pourrait dire, sur le bout du pied, et s'attendant à voir surgir, derrière les murs des maisons, toute une armée de fantassins.
Ils ne trouvèrent personne! La ville était à peu près déserte; il n'y restait que très peu de civils, et pas un seul militaire. Les troupes prirent place devant l'Athénée, et on délégua auprès du quartier général belge un groupe d'officiers pour demander des explications. Au quartier général belge, on ne trouva qu'un concierge, qui, naturellement, ignorait tout au sujet de l'armée. La députation se dirigea alors vers l'Hôtel de ville, où on trouva les principaux officiers municipaux, mais là comme au quartier général, on ne put obtenir de renseignements satisfaisants.
Les parlementaires demandèrent la reddition de la ville, mais on leur répondit qu'elle était sous commandement militaire, et que les autorités civiles n'avaient pas reçu les instructions de la rendre. C'est ce qui explique comment cet officier allemand, que nous avons rencontré, dès le surlendemain, à Capellen, pouvait nous dire que la situation, à Anvers, était très précaire. Cela signifiait, à son point de vue, que les Allemands étaient entrés dans la ville, mais qu'elle ne s'était pas rendue.
La ville et la province d'Anvers étaient tombées sous le talon de l'Allemand. L'armée belge retraita dans la direction d'Ostende, longea la côte jusqu'aux environs de Nieuport où elle prit position. On sait quel rôle important elle a joué derrière les écluses de l'Yser, en barrant la route de Calais.
Vendredi, le 9 octobre 1914, fut pour la ville d'Anvers et pour les villages situés dans la zone des forts extérieurs, une journée d'anxiété et de crainte. L'Allemand était, c'est bien le cas de le dire, dans nos murs. Entré dès le matin, dans la ville même, il s'était vite répandu, par toutes les routes de l'est, de l'ouest et du nord, dans la forteresse et dans les environs.—Quand arrivera-t-il à Capellen? C'est la question que tout le monde se posait.
Dans les groupes disséminés un peu partout, dans les allées du parc du Starrenhof (résidence de la famille Cogels), sur la grande chaussée Anvers-Hollande, en face de la maison communale, on se demandait: "Quand aurons-nous les Allemands?" Et la crainte se peignait sur toutes les figures, car les rapports qui nous étaient parvenus des villages du centre et de l'est de la Belgique étaient loin de nous rassurer sur la conduite probable de la soldatesque allemande.
Des réfugiés du village d'Aerschot, qui logeaient à la ferme du château, nous avaient fait une peinture saisissante des tragiques événements qui s'étaient déroulés à cet endroit: le meurtre et l'incendie y avaient régné en maîtres pendant plus d'un jour. Enfin, toute la population de Capellen, et tous les réfugiés qui s'y trouvaient, étaient dans le plus grand état de nervosité.
Le soir tomba sur Capellen et les campagnes environnantes, avant que les Allemands y eussent fait leur apparition. Vers neuf heures et demie, alors que nous étions à causer en famille, une forte détonation se produisit. Qu'est-ce que cela pouvait être? Chacun exprimait son opinion, et l'on était généralement d'avis qu'un zeppelin avait survolé le village et laissé tomber une bombe dans la cour. Ce n'était pas tout à fait cela. Nous avons appris, peu après, que l'explosion avait eu lieu au fort d'Erbrandt, situé à peine à un kilomètre du château que nous habitions. Le commandant de la garnison avait décidé de le faire sauter, en l'évacuant. Le secousse fut si terrible qu'une lampe à pétrole, posée sur la table de la pièce ou nous causions, fut éteinte, que des fenêtres furent ouvertes et d'autres brisées. Le bombardement de la ville avait détruit les fils transmetteurs de l'énergie électrique ainsi que les tuyaux de l'usine à gaz, de sorte qu'en fait de luminaire, il ne nous restait que les lampes à pétrole et la bougie.
On conçoit facilement que cette formidable explosion contribua fortement à nous rendre encore plus nerveux. Toute la famille se réunit dans une grande pièce pour y passer la nuit; on improvisa des lits, et chacun se blottit aussi bien que possible dans son coin.
Il était bien une heure du matin, dans la nuit du vendredi au samedi, lorsqu'une servante frappa à ma porte et me dit que quelqu'un désirait me voir. Je me rendis à la porte où ce citoyen attendait. C'était un Belge ou, plus exactement, un soi-disant Belge qui venait me donner le conseil de partir immédiatement pour la Hollande avec toute ma famille. Il ajoutait que les Allemands avaient quitté Anvers quelques heures auparavant, en gros détachements, qu'ils s'avançaient à grands pas vers Capellen, qu'ils étaient rendus au village d'Eccheren, et qu'ils mettaient tout à feu et à sang sur leur passage. Il prétendait être lui-même en route pour la Hollande avec sa vieille mère.
—D'où êtes-vous? lui demandai-je.
—De Contich.
—Où est votre mère?
—J'ai laissé ma mère dans une maison de paysans, à quelques pas d'ici, et je vais immédiatement la rejoindre.
—C'est très bien, lui dis-je, et merci de vos bons conseils.
En me quittant, il insista de nouveau, disant:
—Il n'y a pas de temps à perdre, la vie de votre femme et de vos enfants est en danger.
Enfin il me quitte. Je ferme la porte et je donne instruction à la servante d'éveiller tout le monde dans la maison, les enfants et les parents venus d'un peu partout qui logeaient chez nous depuis le commencement du siège, et nous tenons un conseil de famille, qui fut aussi, c'est bien le cas de le dire, un conseil de guerre. Tout le monde semblait d'avis que nous devions filer en Hollande. Le bon vieux curé de Schooten, qui était un petit peu de la famille, partageait également cet avis. Je propose alors que ma femme et les enfants partent avec tout le bagage qu'il leur était possible de porter à la main, tandis que moi je resterais avec le vieux Nys, serviteur au château depuis plus de trente ans. Le vieux serviteur était bien consentant, mais, comme on le suppose bien, ma femme s'y objecte.—"Nous resterons tous, ou nous partirons tous."—Je propose enfin d'aller consulter un vieux Capellois, Monsieur Spaet, homme de grande expérience, allemand d'origine, mais devenu citoyen belge depuis une cinquantaine d'années. Cette proposition fut agréée de tout le monde.
Je me rendis donc chez M. Spaet, à travers la foule de fugitifs qui encombraient encore la chaussée à cette heure tardive. Je trouvai M. Spaet chez lui, et il me dit simplement qu'il n'avait pas de conseils à me donner, mais que si je lui demandais ce qu'il allait faire lui-même, il n'hésiterait pas à me répondre qu'il retournerait dormir aussitôt que j'aurais quitté sa maison. Je revins donc, quelque peu rassuré, et en entrant au château, en présence de toute la famille, et de tous les amis de la famille réunis,—et prêts à partir pour la Hollande, je dis: "Chacun retourne à son lit", et je fais rapport de ma visite à M. Spaet. On se remit au lit, mais comme on le pense bien le sommeil fut lent à fermer les paupières.
Une autre formidable détonation eut lieu peu après. C'était un second fort, celui de Capellen, qui venait de sauter. L'immense maison que nous habitions en fut secouée comme une simple feuille d'arbre. Quelques minutes plus tard, la servante vint de nouveau me dire que le visiteur qui était venu une heure auparavant était encore là et désirait me parler. Je me rends auprès de lui. C'était bien le même. Comme il insistait de nouveau pour nous décider à partir, je lui posai cette question:
—Que font tous les autres de Capellen?...
—Tous les autres sont partis, me dit-il.
—Et M. Spaet, lui?...
—M. Spaet?... mais il est en Hollande comme les autres.
Constatant que mon interlocuteur était un menteur, et qu'étant menteur, il pouvait bien également être un voleur, j'en vins à la conclusion qu'il s'agissait d'un plan sinistre organisé par un de ces chacals qui suivent ou précèdent les armées, pour piller le château après notre départ. J'indiquai la porte à ce louche personnage, et l'incident fut clos... Mais quelle nuit nous avions passée!
Bientôt le jour parut: un soleil radieux se levait et dorait le feuillage déjà jauni par l'automne. En ouvrant une fenêtre, je constatai qu'un grand nombre de femmes et d'enfants dormaient encore dans les allées du jardin. Les Allemands n'étaient pas encore arrives, mais cela ne pouvait tarder.
A neuf heures du matin, le 10 octobre, un messager se présentait chez moi pour m'inviter, de la part d'un groupe de citoyens, à me rendre à la mairie. De quoi pouvait-il s'agir?... Je l'ignorais. Je me rendis donc à la maison communale, et sur une distance d'environ un kilomètre, je remonte le flot des réfugiés qui continuent leur marche pénible et lente vers la Hollande.
A la mairie, je rencontre quelques citoyens de Capellen qui m'invitent à me joindre à eux pour recevoir les officiers allemands lorsqu'ils se présenteront. Nous les attendions d'un moment à l'autre. Je savais parfaitement combien tous ces soldats teutons avaient accumulé de haine dans leur coeur contre les Anglais, depuis le commencement de la guerre. L'Angleterre n'avait-elle pas été la cause de leur premier échec? L'Angleterre n'avait-elle pas été l'obstacle à cette promenade militaire que, depuis quarante ans, l'on avait rêvé de faire de la frontière allemande jusqu'à Paris? Le plan initial du haut commandement allemand avait échoué, et l'Anglais, sur la neutralité duquel on avait trop compté, était tenu responsable de cet échec!
Je dis à mes nouveaux concitoyens que ma qualité de sujet anglais ne saurait leur être de quelque utilité, mais qu'au contraire elle pourrait leur causer des ennuis, et à moi-même également. On me répliqua,—et je trouvai ce raisonnement assez juste,—que les officiers allemands ne seraient pas au courant de ma nationalité, que dans cette première entrevue, il s'agissait surtout de faire nombre, etc., etc. Nous n'étions que quatre ou cinq, tous les autres citoyens de Capellen, à très peu d'exceptions près, ayant passé la frontière. Enfin, nous tombons d'accord.
A dix heures, un quidam entre en courant dans la salle où nous étions réunis, et dit simplement:
"Messieurs, l'officier allemand est là." J'avais bien vu quelques soldats allemands, prisonniers de guerre, défiler dans les rues d'Anvers, avant la chute de la ville, mais je n'avais jamais vu, de près ni de loin, un véritable officier prussien. Je confesse que ma curiosité se trouvait fortement piquée par l'annonce de sa venue. Avant même que nous eussions eu le temps de sortir de la salle pour aller à sa rencontre, l'officier allemand fit irruption au milieu de nous, saluant de la main et nous adressant la parole en allemand. Il portait le casque à pointe et l'uniforme ordinaire d'un officier d'artillerie. Il avait le grade de capitaine, et, comme il l'expliquait quelques instants plus tard à M. Spaet, au cours d'une conversation en allemand, il était, au civil, avocat pratiquant à Dortmund. Il regardait tour à tour chacun de nous et très attentivement comme s'il eut voulu scruter le fond de nos âmes et découvrir les sentiments particuliers qui s'y cachaient. Il parut fort surpris de rencontrer en M. Spaet un Belge parlant si parfaitement l'allemand. M. Spaet lui donna, à ce sujet, et d'une manière franche et loyale, les explications désirées. Puis il lui demanda:
—Que devons-nous faire?
—Rien, dit-il, d'ailleurs ce n'est pas avec moi que vous aurez à traiter, je ne suis en vérité qu'un précurseur, c'est avec le major X..., qui viendra tout à l'heure, que vous aurez à vous entendre.
Il nous quitta, et quelques minutes plus tard nous arriva, en automobile, un véritable officier supérieur prussien, accompagné d'un jeune officier très élégant. Ce major réalisait à mes yeux le type idéal de l'officier prussien. Il était vêtu d'un uniforme resplendissant, et coiffé d'un casque métallique, si je ne me trompe, encore plus étincelant. Enfin, il avait des moustaches blondes très à la Guillaume.
A ce moment, comme pendant les jours précédents, il y avait une foule considérable en face de la mairie qui est située sur le grand chemin conduisant d'Anvers à la Hollande. La place publique était encombrée de réfugiés venus de tous côtés. Le major sembla très ennuyé de ce rassemblement et nous demanda:
—Où vont-ils?
—En Hollande.
—Et pourquoi?
M. Spaet lui répondit:
—C'est pour fuir le canon.
—Mais il n'y a plus de canon, puisque Anvers est tombée; dites-leur de retourner dans leurs foyers, et qu'ils ne seront pas inquiétés.
Nous redoutions les réquisitions, et c'était là ce qui nous préoccupait le plus. Le major nous laissa entendre que, pour le moment, il se bornerait aux réquisitions de chevaux. Nous lui expliquons de notre mieux qu'à Capellen il n'y avait, à bien dire, que les chevaux des paysans et qu'ils étaient indispensables pour terminer les travaux des champs... Après quelques pourparlers supplémentaires on parvint à s'entendre, et le major nous annonça qu'il serait envoyé à Capellen une seule compagnie d'infanterie, et que les officiers devraient être bien traités; quant aux hommes, on pourrait les loger, par exemple, à la maison d'école.
Le major prussien était très anxieux de savoir dans quel état se trouvaient les forts situés dans les environs de Capellen. Nous étions sous l'impression que ces forts avaient été détruits par les garnisons au moment de l'évacuation. Afin de se rendre compte de visu, il prit deux d'entre nous avec lui dans son automobile et fit le tour des forts de Capellen, d'Erbrandt et de Stabrock, pour revenir ensuite à la mairie, puis disparaître. Celui-là, nous ne l'avons jamais revu.
Dans l'après-midi de samedi, 10 octobre, une compagnie de fantassins arriva à la maison communale. Un bref commandement est donné: deux militaires se détachent, entrent à la mairie, et quelques minutes plus tard, la foule sur la place publique assiste à la cérémonie humiliante et souverainement douloureuse de la descente du drapeau belge, qui flottait là depuis près de cent ans. A sa place montait le drapeau allemand. Capellen était définitivement soumis à l'occupation teutonne. Comme ce village est le dernier au nord de la place fortifiée d'Anvers. il s'ensuit que le drapeau allemand flottait alors sur toute la terre belge, depuis la frontière de France jusqu'à celle de Hollande.
"Hâtez-vous, Monsieur et Madame, de rentrer chez-vous, car les Allemands sont là." C'était un gamin qui nous apostrophait ainsi, sur la chaussée, entre l'église et le château. Nous revenions, ma femme et moi, du service religieux, lorsque ce petit garçon nous apprit que des Allemands nous attendaient à la maison. Nous pressons le pas, et quelques instants plus tard nous constatons, en passant la grande grille, qu'une automobile stationnait devant notre porte. En entrant, nous nous trouvons en présence d'un officier allemand, le casque à pointe sur la tête, et qui nous saluait, ma femme et moi, en s'inclinant très bas. A la porte, il avait laissé, dans son automobile, trois autres militaires. Cet officier, qui parlait assez bon français, était venu nous demander à loger. Cette proposition tout à fait inattendue nous laissa passablement perplexes: il était assez difficile de refuser, et il ne nous était pas agréable du tout d'accepter! Nous essayons de lui faire comprendre que la maison est remplie, que de nombreux réfugiés, parents de la famille, logeaient chez nous depuis plus d'une semaine, et qu'il est fort difficile, sinon impossible, de lui faire place. Mais il insiste en nous disant que les trois militaires qui l'accompagnaient, un chauffeur, une ordonnance et un palefrenier, pourraient loger dans la remise aux autos, et que lui seul exigerait une chambre dans la maison même.
Croyant qu'en lui dévoilant ma nationalité il me serait plus facile de le dissuader, je lui dis simplement:
—Mais j'ai l'intention de quitter la Belgique avec ma famille pour retourner au Canada, car je suis canadien, et par conséquent sujet britannique.
—Je sais cela, me dit-il, je sais cela.
Je confesse que je fus assez étonné de constater qu'il connût si bien ma nationalité. Quel merveilleux service d'espionnage ont ces gens!
—Si, ajouta-t-il, vous ne devez pas quitter absolument la Belgique, rien ne vous empêche de demeurer ici, quoique sujet anglais. J'ai appris que vous êtes médecin, et que vous avez fait, en cette qualité, du service à l'hôpital d'Anvers. Vous n'avez; donc rien à craindre en demeurant ici, étant protégé par les lois et par l'autorité militaire.
J'échange un regard avec ma femme, et nous fûmes d'accord en un instant. Nous acceptions cet officier et ses hommes et nous restions. Cet arrangement nous allait d'autant mieux que Capellen, à cette époque, ne possédait plus de médecin, quelques-uns d'entre eux étaient rendus à l'armée, et les autres en Hollande. Dans ces circonstances, je pouvais me rendre très utile. Ma femme se trouvait à la tête d'une société de bienfaisance établie depuis assez longtemps à Capellen, et qui prenait, à cause de la guerre, une importance et une utilité inaccoutumées. Malgré les circonstances pénibles où nous nous trouvions par suite de l'occupation allemande, il nous sembla préférable, à tout prendre, de continuer à mener tranquillement la vie de famille dans notre foyer,—comme firent d'ailleurs la plupart de nos amis qui n'avaient pas eu le temps ou n'avaient pas voulu s'expatrier,—et à donner des soins aux malades et des secours aux pauvres.
Cet officier allemand devenu notre hôte était du Brunswick, et se nommait Goering. Il avait été attaché à l'ambassade allemande en Espagne pendant deux ans, et à celle du Brésil pendant huit ans. Il possédait, il faut le reconnaître, beaucoup de vernis international, parlait assez bien le français et l'anglais et n'avait, naturellement, aucun doute au sujet de la victoire définitive des armées allemandes. C'était aussi l'opinion des trois autres militaires qui l'accompagnaient. A ce moment, Anvers venait de tomber entre leurs mains, et ces bons Prussiens s'imaginaient que, dans quelques semaines au plus, leurs troupes débarqueraient en Angleterre. D'Ostende où ils entraient justement, il leur semblait qu'il n'y eût plus qu'un pas à faire.
Cet officier nous quitta à la fin de décembre après avoir demeuré avec nous environ trois mois. Je dois dire que je n'ai pas trouvé en lui le type de l'officier prussien, et cela se comprend facilement lorsque l'on songe que, depuis dix ans, il avait vécu en pays étranger, et en contact avec les diplomates et les attachés d'ambassade de tous les pays du monde. Son cosmopolitisme semblait l'avoir sauvé dans une certaine mesure, mais il n'en croyait pas moins à l'immense supériorité de la race allemande; il vantait la civilisation germanique et croyait que l'industrie allemande était destinée à accaparer tous les marchés de l'univers. Enfin, il prétendait que la France était dégénérée, que l'Angleterre n'avait pas et ne saurait jamais avoir d'armée puissante, que la prise de Calais et de Dunkerke n'était plus qu'une question de semaines, etc.
Durant les mois d'octobre et de novembre de cette année-là, il était encore possible, bien que la frontière fût gardée par des soldats allemands, de passer en Hollande sous un prétexte quelconque. On pouvait y aller pour acheter des provisions, pourvu que les sentinelles eussent l'assurance que nous ne partions pas pour ne plus revenir. Vers la Noël (1914), la frontière entre la ville d'Anvers et la Hollande fut fermée hermétiquement, si je puis me servir de cette expression. A un kilomètre environ de la frontière, où le fil de fer barbelé court d'un fort à l'autre, on avait installé un poste d'inspection et de contrôle. Le jour de Noël même, le contrôle des passe-ports se faisait, et personne ne pouvait passer à moins d'être muni d'un permis régulier émanant des bureaux de l'administration allemande à Anvers. Nous étions donc, de ce moment-là, privés de toute communications postales ou autres avec le reste du monde.
L'hiver était arrivé: la misère était grande en Belgique, et sans les secours en vivres et en vêtements venus des États-Unis et du Canada, une très forte portion de la population belge eut péri au cours de la froide saison.
Il convient de faire mention ici d'une société de bienfaisance dite de Saint-Vincent de Paul à laquelle nous avons donné notre humble concours et qui avait comme principales zélatrices, à Capellen, madame Geelhand, madame la comtesse Le Grelle, madame la baronne Osy, madame Guillet, madame Tinchant, madame de Waelhens, mademoiselle Linen, madame Joseph Cogels et, de Hollande, madame la comtesse van der Steegen.
C'est au sein de cette société, dont la charité et le dévouement ne se sont jamais démentis, que les pauvres et les malades trouvaient les secours et les consolations.
Vers la fin du mois d'octobre 1914, doux ou trois semaines après l'occupation de la forteresse d'Anvers par les Allemands, Son Éminence le cardinal Mercier adressa à son clergé et à ses ouailles une lettre pastorale célèbre dans laquelle il invitait particulièrement les Belges qui s'étaient réfugiés en Hollande pendant le bombardement de la région nord de la Belgique, à rentrer dans leurs foyers.
Cette lettre pastorale contenait une allégation particulière dont nous nous rappelons encore parfaitement. Son Éminence y disait qu'à la suite d'une conférence qu'il avait eue avec les autorités allemandes, et a'appuyant sur les assurances qu'on lui avait données, il croyait de son devoir d'inviter les citoyens belges réfugiés en Hollande à revenir chez eux, leur représentant et affirmant qu'ils seraient exempts de tout ennui, et que dans aucun cas ils ne pourraient être molestés ni tenus responsables collectivement de tout délit particulier. L'autorité allemande, ajoutait le cardinal, nous donne l'assurance que dans le cas de délits particuliers, commis contre l'autorité occupante les coupables seraient recherchés, mais dans le cas ou ils ne pourraient être découverts, la population civile n'en serait pas tenue responsable.
Ce document épiscopal fut publié et répandu, naturellement dans toute la Hollande, et par suite, des milliers et des milliers de fugitifs belges réintégrèrent leurs foyers.
Vers le 15 décembre de cette même année, c'est-à-dire à peine deux mois plus tard, deux gamins de Capellen montèrent sur une locomotive laissée libre en face de la gare par le mécanicien et le chauffeur qui étaient allés dîner. Les gamins s'amusèrent à faire jouer le volant, et à faire bouger la locomotive dans un sens ou dans l'autre. Ils furent surpris par des militaires qui les arrêtèrent et les conduisirent à Anvers, où tous deux furent condamnés à trois semaines de prison après un procès sommaire.
Ce petit incident paraissait clos, et personne ne semblait s'en être ému plus que de raison, et cependant, dès le lendemain, M. le major Schuize, si je ne me trompe, commandant à Capellen, invitait M. le bourgmestre à lui fournir une liste de vingt-quatre citoyens de la commune, dont le curé, M. Vandenhout, et l'ancien bourgmestre, M. Geelhand. Ces vingt-quatre citoyens formeraient trois équipes de huit personnes, et chaque équipe, à tour de rôle, aurait à faire la garde de la voie ferrée, pendant toute la nuit, de six heures du soir jusqu'à sept heures du matin, et cela, jusqu'à nouvel ordre. Ce fut un tollé général dans la commune.
On disait avec raison: Mais les délinquants ont été pinces et punis, et le crime, en vérité, n'était pas grand. Il s'agissait, comme il a été dit plus haut, de deux galopins qui s'étaient amusés à faire jouer le volant d'une locomotive.
Tout le monde avait encore à la mémoire ce document épiscopal qui donnait à tous l'assurance, d'après les promesses de l'autorité allemande, qu'aucun délit particulier ne saurait entraîner de représailles contre la population civile. Mais que faire?... On tint conseil de tous côtés. Les notables s'assemblèrent secrètement, et l'on décida de soumettre le cas au gouverneur d'Anvers, le général Von Huene.
Rien n'y fit: les vingt-quatre citoyens de Capellen durent monter la garde durant les nuits froides de décembre et de janvier devant la gare de Capellen.
La veille de Noël, c'était le tour de l'équipe dont faisait partie le vieux curé, M. Vandenhout, âgé d'environ 70 ans, et qui dut passer la nuit, sous une pluie battante et froide, à faire les cent pas devant la gare avec ses sept compagnons. Le lendemain il était alité, malade. Vers le 15 janvier, un ordre venu d'Anvers mettait fin à ce règlement arbitraire des autorités locales.
A peu près vers ce temps-là, un nouvel officier s'était présenté au château pour se faire héberger Celui-là fut d'un commerce beaucoup moins agréable que son prédécesseur; il n'avait habité ni l'Espagne ni le Brésil, mais il nous venait en ligne droite de la Prusse orientale. C'est dire qu'il était une manière de "surboche". Violent et arrogant, il traitait son ordonnance avec une rigueur assommante. La maison en tremblait lorsqu'il se mettait en frais de le morigéner, et cela arrivait assez souvent. Il nous quittait au bout de trois semaines, et Dieu sait dans quelle mesure nous l'avons regretté!... Nous étions donc encore une fois délivré de tout Allemand, du moins au point de vue domestique.
L'un des médecins de Capellen était depuis peu revenu de Hollande. Après avoir consulté toute la famille, nous décidons, ma femme et moi, de faire les démarches nécessaires pour sortir du pays occupé avec l'intention de passer en Amérique.
Au commencement de février 1915, après le départ du dernier officier allemand que nous ayons eu à héberger, nous étions, ma femme et moi, au bureau central pour l'émission des sauf-conduits, à Anvers, et nous soumettions aux deux officiers en charge de ce bureau notre demande de l'autorisation nécessaire pour quitter la Belgique.
—Où voulez-vous aller? demanda le premier officier.
—En Hollande.
—Pour quoi faire?...
—Pour aller en Amérique.
—Pourquoi aller en Amérique?
—Pour retourner chez-nous, en Canada, où j'habite.
—Alors, vous êtes sujet anglais?...
—Oui.
Étonnement de l'officier qui se retourne du côté de son compagnon, et qui nous regarde ensuite, des pieds à la tête, ma femme et moi.
—Vous êtes sujet anglais? reprit-il.
—Vous l'avez dit!
—Depuis combien de temps êtes-vous ici?
—Je suis arrivé en Belgique quelques jours, je crois, avant vous, c'est-à-dire en juillet 1914.
—Que faites-vous ici?...
Il s'engagea alors, entre ces deux officiers et nous, un colloque qui dura quelques minutes seulement, mais qui suffit à faire comprendre à ces messieurs, et sans trop de difficulté, que ma présence en Belgique n'avait rien de mystérieux, pas même pour un Allemand.
Apparemment convaincu qu'il n'avait pas affaire à un espion à la solde du gouvernement anglais, le premier officier confessait qu'il ne voyait pas d'objection sérieuse à ce qu'un permis de quitter la Belgique nous fût donné, mais ses instructions étant catégoriques en ce qui concernait les sujets britanniques, il ne pouvait, sans l'autorisation de son chef militaire, le major Von Wilm, donner le sauf-conduit demandé. Il nous conseilla d'aller voir ce major. Nous nous rendons immédiatement à son bureau. Chemin faisant, je faisais simplement remarquer à ma femme qu'une fois entré dans ce nouveau bureau où l'on nous envoyait, il pouvait bien se faire que je n'en sortisse jamais. Le major Von Wilm nous reçoit avec une certaine affectation de civilité et écoute attentivement l'histoire que nous lui racontons.
Il fut convaincu lui aussi, en apparence, qu'il n'avait pas affaire à un espion. Il ne prévoyait pas d'obstacle à l'émission d'un sauf-conduit, mais il devait en causer, au préalable, avec le gouverneur de la place fortifiée. Il nous engageait à retourner à Capellen, et y attendre un mot de lui.
Quelques jours plus tard, une lettre du major nous arrivait, conçue en ces termes:
(TRADUCTION)
Anvers, 8 février 1915.
Monsieur et Madame Béland,
Starrenhof, Capellen.
Monsieur et Madame,
Nous référons à notre conversation d'il y a quelques jours passés.
J'ai l'honneur de vous dire qu'un sauf-conduit vous sera donné à deux conditions: la première, c'est que M. Béland devra s'engager formellement à ne jamais porter les armes contre l'Allemagne pendant toute la durée de la guerre, et ensuite que toutes les propriétés que vous avez en Belgique, en territoire occupé, seront soumises, après votre départ, à une taxe décuplée.
Signé: VON WILM,
Major.
Il nous restait donc à décider ce que nous avions à faire. Il nous parut opportun de retourner à Anvers, pour discuter plus longuement avec le major cette question du décuplement de la taxe. Après un long entretien que nous eûmes avec lui, après les assurances renouvelées qu'il me donna que je pourrais demeurer en territoire occupé sans crainte d'être ennuyé, molesté ou emprisonné, eu égard précisément à ma profession et aux services médicaux que je rendais à la population, nous décidâmes d'attendre jusqu'au mois d'avril. C'est à cette époque que les taxes devaient être payées, et alors, ce haut officier allemand, fonctionnaire important de la province d'Anvers, s'engageait à discuter avec les autorités financières allemandes, de Bruxelles, la question de savoir s'il ne serait pas possible de faire disparaître les conditions particulièrement onéreuses qui consistaient à soumettre à une taxe multipliée par dix toutes les propriétés que nous avions en Belgique.
Au mois d'avril, les taxes furent payées au taux ordinaire, et je me rendais de nouveau à Anvers, chez le major, pour l'engager à entrer en négociations avec les autorités financières allemandes au sujet de la majoration des taxes.
Il me promit de considérer la chose aussitôt que ses nombreuses occupations lui en laisseraient le loisir. Enfin, il me renouvela l'assurance de sa haute protection, me conjurant de vivre en parfaite sécurité, qu'il ne saurait être, à mon sujet, question d'un internement.
Quant à la question des taxes, il n'en avait aucun doute, elle serait réglée à notre entière satisfaction.
Au printemps de 1915, les mesures de surveillance policières acquirent une recrudescence de sévérité. Une promenade sur la chaussée, une visite à domicile, soit chez un parent, soit chez un pauvre, soit chez un malade, tout cela était observé et minutieusement épié.
Au cours d'une simple promenade à travers les allées d'un jardin, il n'était pas rare d'apercevoir derrière soi un oeil inquisiteur percer comme une flèche à travers le feuillage. Incessamment, nous nous sentions talonnés de tous côtés.
L'infraction la plus insignifiante aux règlements de l'autorité occupante,—et Dieu sait s'il en était affiché sur tous les murs de ces règlements!—était punie de fortes amendes ou de prison.
Le torpillage du Lusitania eut lieu vers cette époque. En cette occasion, une aigreur nouvelle, pour ne pas dire plus, s'était fait jour dans l'âme de l'Anglais, tandis que chez l'Allemand ce qui perçait, au contraire, c'était un sentiment d'orgueil et de domination plus accentué. De même que l'on venait de déchaîner le terrorisme sur mer, de même on voulait semer la terreur dans tout le territoire occupé. Tout cela contribuait à nous faire désirer plus ardemment encore de sortir de la Belgique et de revenir au Canada, d'autant qu'un des médecins de Capellen était rentré.
Le 15 mai (1915), à 9 heures du matin, un messager vint me dire que ma présence était requise à la maison communale. Ce n'est pas sans appréhension que je m'y rends. Dans le bureau du maire, je me trouvai en présence du maire lui-même et d'un sous-officier allemand. Le maire, qui était un de mes bons amis, et qui savait parler du regard, me dit, en me lorgnant d'une certaine manière:—"Ce sous-officier désire vous parler."
—Qu'y a-t-il? demandai-je au sous-officier boche.
—Vous devez, me répondit-il, vous rendre immédiatement à Anvers.
—Très bien, je vais m'y rendre, à la minute, sur ma bicyclette.
—Non, reprit le sous-officier, vous faites mieux de laisser votre bicyclette ici, à la mairie, et je vous prie de m'accompagner.
Quelques minutes plus tard, nous arrivions à la gare, transformée en poste militaire comme toutes les gares du pays occupé. Le sous-officier m'indiqua une salle d'attente ou j'entrai et me trouvai au milieu d'un groupe de soldats causant et fumant.
Un de ces soldats reçut un bref commandement: il se leva, s'affubla du casque à pointe, passa la bande de sa carabine à son épaule, et me dit simplement: "Commen sie mit." Ce qu'avec raison j'interprétai comme voulant dire: "Venez avec moi." Pour la première fois, j'avais l'honneur de parader dans les rues avec un disciple de Bismarck.
Les gens de Capellen, qui me connaissaient déjà assez bien, se plaçaient sur le seuil de leur porte pour me voir passer. Quelques minutes plus tard, nous étions à Anvers. Je fus conduit à la Bourse, immense édifice qui avait eu l'honneur de recevoir une bombe lors du raid aérien du 25 août (1914).
Les Allemands avaient installé dans la Bourse un bureau de contrôle pour les étrangers. Je l'ignorais alors, mais je l'appris en assez peu de temps... Je fus introduit dans une certaine pièce sur la porte de laquelle j'avais lu le nom de l'officier en charge, le lieutenant Arnim. Je prie le lecteur de croire que je n'oublierai jamais ce nom, pas plus que le personnage qui le portait.
A l'intérieur de ce bureau se trouvait une table assez longue, à l'extrémité de laquelle deux militaires étaient assis; à gauche, un officier de taille exiguë et mince de figure, et. à droite, un sous-officier de corpulence respectable.
En m'apercevant, l'officier m'apostropha d'une manière violente:
—Monsieur, dit-il, vous vous seriez évité l'ennui d'être amené ici, sous escorte militaire, si vous vous étiez "rapporté" comme c'était votre devoir de le faire!
—J'ignorais, Monsieur, qu'il fût de mon devoir de me "rapporter".
—C'est faux, reprend l'officier en haussant le ton notablement, c'est faux. J'ai fait afficher dans toutes les communes de la province d'Anvers un avis enjoignant à tous les sujets des pays en guerre avec l'Allemagne de se "rapporter" dès avant telle date. Vous ne pouviez pas l'ignorer.
—Assurément, je l'ignorais!... Où donc, à Capellen, avez-vous fait afficher cet avis?
—A la maison communale.
—Eh! bien, j'habite à un kilomètre de la maison communale et je n'y vais jamais.
—Il est inutile de tenter une explication, vous vous êtes sciemment et volontairement soustrait à la surveillance militaire, et remarquez, dit-il, que cela est très sérieux.
—Monsieur, lorsque vous affirmez que je me suis soustrait à la surveillance policière, vous vous mettez en contradiction avec les faits. Ce que vous dites là n'est pas conforme à la vérité.
Comme poussé par un ressort, l'officier était debout:
—Comment?... dit-il. Qu'est-ce que vous voulez dire?
—Simplement ce que je dis. Que je n'ai jamais eu l'intention d'éviter de me conformer aux règlements que vous avez affichés.
—Vous le prenez de haut. Croyez-vous donc que nous ignorons que vous êtes sujet britannique?
—Je ne l'ai jamais pensé.
—Vous êtes sujet britannique, n'est-ce pas?... Vous êtes sujet britannique?
—Vous l'avez dit.
—Alors, si vous me permettez, je reprends l'accusation que vous avez portée contre moi, et je vous ferai une simple question: s'il était établi que le chef de police militaire allemand, ici même, à Anvers, me connaît personnellement; qu'il m'a rencontré plusieurs fois; que nous avons échangé de longues conversations; qu'il connaît ma nationalité; qu'il sait sous quelles circonstances je me trouve être en Belgique; pourquoi j'y suis venu; ce que j'y fais; et enfin, ce que j'ai intention de faire, seriez-vous toujours d'opinion que j'ai enfreint volontairement les règlements en ne me "rapportant" pas à ce bureau?
Mon officier, visiblement décontenancé, attrape le téléphone, et se met en communication avec le chef de police. Il obtint évidemment satisfaction, car il en rabattit considérablement, et dans son ton menaçant, et dans son attitude hautaine.
Bien, me dit-il, vous deviez pourtant savoir qu'en votre qualité d'étranger, il ne vous était pas permis de circuler sans une carte d'identification. Nous vous donnerons donc votre carte, et vous devrez vous "rapporter" ici toutes les deux semaines.
L'officier devait décharger sa colère sur quelqu'un. Il se tourna du côté du soldat qui était toujours là, planté comme un as de pique, lui lança le plus brutalement possible le commandement de se retirer: "Los!" ("Sors!")
Le soldat, pauvre esclave, se frappe les talons, frappe ses cuisses de ses mains, regarde fixement l'officier, son maître, fait demi-tour à droite et enfile la porte.
Une heure plus tard, pas trop ennuyé, en vérité, de mon excursion, je rentrais à Capellen où j'étais immédiatement entouré de ma famille et d'un groupe d'amis qui désiraient savoir le court et le long des événements de la journée.
Muni de ma nouvelle carte, j'étais apparemment en toute sécurité, et je pouvais circuler librement au milieu de mes malades. Au bout de deux semaines, je me "rapportai" de nouveau à Anvers. On visa mon passeport, et je continuai de respirer, du moins pour un certain temps, l'air de la liberté.
On conçoit que le voyage que j'avais dû faire à Anvers, en compagnie d'un soldat allemand, m'avait un peu humilié. J'écrivis à ce sujet une longue lettre de reproche au major Von Wilm lui-même dans laquelle je lui relatais tous les incidents de cette journée.
Quelques jours plus tard, je recevais de ce haut officier allemand une réponse à ma lettre dans laquelle il me disait que mon arrestation provisoire avait été causée par une dénonciation (?), qu'il avait donné tous les renseignements désirés et désirables à la préfecture de police allemande, que tout était maintenant en ordre, et il terminait en me donnant de nouveau l'assurance que je ne serais jamais plus inquiété.
Voici la réponse du major Von Wilm:
Antwerpen, 21-5-15.
Werter Herr Beland!
In diesem moment erhalte ich Iren freundlichen Brief vom 19. Ich hoffe, dass Ihre Vorladung beim Meldeamt, ein befriedigendes Resultat gehabt hat; ich habe nochmals mit dem Vorstand des Meldeamtes gesprochen und höre, dass Sie diese Unanehmlichkeiten einer Denuntiation zu verdanken haben. Die Sache ist jetzt in Ordnung und wird sich nicht wiederholen.
Ergebenst.
VON WILM,
Major.
(TRADUCTION)
Anvers, 21 mai 1915.
Honoré M. Béland!
Je reçois à ce moment même votre lettre du 19. J'espère que votre comparution au bureau de police a eu un résultat satisfaisant; j'ai de nouveau conversé avec le chef de ce bureau et j'apprends que vous devez ce désagrément à une dénonciation.
Tout est maintenant en règle et la chose ne se renouvellera plus.
Sincèrement,
(Signé) VON WILM,
Major.
J'ai réussi à ne jamais me départir de cette lettre pendant les trois années de ma captivité en Allemagne, et même à lui faire franchir, à mon retour, la frontière allemande, à la barbe de la censure boche la plus ombrageuse et la plus soupçonneuse qui soit.
C'est un document que je considère de la plus haute importance: le chef de la police allemande à Anvers y déclare, sous sa signature, que je n'ai pas à prendre d'inquiétude, que je jouirais toujours d'une parfaite immunité.
Cette sécurité, toutefois, devait être de courte durée. Le trois juin (1915), alors que je n'appréhendais pas sérieusement de nouveaux ennuis, deux soldats se présentent chez moi et m'enjoignent de les accompagner de nouveau à Anvers. Je m'imaginai que, cette fois encore, il s'agissait d'une nouvelle visite à un bureau quelconque, et que tout cela ne saurait avoir de conséquence fâcheuse.
Je partis donc sans la moindre hésitation, ne craignant nulle chose, ayant pour tout arme et bagage, ma canne. J'étais bien loin de me douter que ce voyage serait aussi long qu'il a été,—et même aujourd'hui, de retour dans mon beau Canada, à la fin de l'an de paix et de grâce 1918, je ne saurais m'imaginer quand et dans quelles circonstances il me sera donné de revoir ce petit village de Capellen, où j'ai vécu peu de jours, mais qui est tout plein de souvenirs précieux et impérissables.—L'un des soldats qui m'accompagnaient parlait le français. Il feignait de croire qu'il ne s'agissait que d'une formalité insignifiante, que le soir même je serais de retour à Capellen.
A Anvers, les soldats me conduisirent rue des Récollets, et me laissèrent dans une salle basse et sombre au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin de la Kommandantur, et dans lequel le major Von Wilm lui-même avait son bureau. Dans cette salle, je remarquai un grand nombre de personnages à l'apparence peu rassurante. Il y avait là des hommes et même des femmes, aux allures plus ou moins louches.
Abandonné là par mes deux soldats, je regardais tour à tour les hommes, les femmes, et le sous-officier de service. Je m'efforçai de découvrir quelle était la nature du lieu où je me trouvais. N'y réussissant qu'à demi, je me décidai à apostropher le sous-officier.
—Eh! bien, pourquoi suis-je ici?... Qu'y ai-je à faire?... Que me veut-on enfin!... Il levait les épaules tout bêtement, et ne répondait rien. Il avait l'air de ne pas comprendre ou de ne rien savoir. Ma carte que je lui tendis avec un mot pour le major réussit a le mettre en mouvement. Il sortit un instant, puis, quelques minutes plus tard, un officier se présenta et je fus invité à le suivre.
Ce fut bien chez le major Von Wilm qu'on m'introduisait cette fois.—"M. Béland, me dit-il, je suis vraiment désolé. Des instructions nouvelles viennent d'arriver de Berlin, et je dois vous interner." Je n'avais pas encore eu le temps d'ouvrir la bouche pour laisser échapper une parole de protestation qu'il ajoutait: "Mais vous serez un prisonnier d'honneur; vous logerez ici, au Grand Hôtel, et vous y serez très bien traité."
—Mais tout cela ne fait pas beaucoup mon affaire. D'abord ma femme et mes enfants ignorent complètement ce qui m'arrive. Je dois retourner les prévenir, à tout événement, et aussi prendre le linge dont j'aurai besoin dans cet hôtel.
Visiblement embarrassé, ne pouvant pas accorder la demande que je lui faisais de rentrer à Capellen, ne fut-ce que pour une heure, et ne voulant pas me refuser, il ne savait trop que dire. Il hésita, fit quelques pas devant son pupitre, puis, le Prussien qui était en lui reprenant le dessus, il me dit:—Non, Monsieur, je ne saurais vous permettre de retourner à Capellen. Écrivez seulement un mot à Madame, prévenez-la de ce qui arrive, et j'enverrai un messager porter la lettre. C'est ce qui fut fait.
Le major s'évertua à me convaincre que ma détention serait de courte durée; qu'il suffirait évidemment d'établir ma qualité de médecin pratiquant; qu'aussitôt que cette preuve documentaire serait entre les mains de l'autorité allemande, je serais libéré et rendu à ma famille.
On croit facilement ce que l'on désire ardemment: je me berçai donc de l'illusion que mon séjour dans les murs de cet hôtel ne serait que provisoire.
Un jeune officier fut chargé de m'accompagner jusqu'au Grand-Hôtel. En chemin, il me fut permis de m'arrêter chez un libraire pour prendre quelques volumes. Chez le libraire, je connus vraiment l'embarras du choix. Étant donné le peu de temps que j'avais à ma disposition, et les circonstances particulières dans lesquelles je me trouvais, je fus assez heureux dans mon choix, et j'emportai les deux ouvrages suivants: Les États-Unis au XIXe siècle, par Leroy-Beaulieu, et Henri Heine, penseur, par Lichtenberger.
Quelques instants après, j'étais au nombre des pensionnaires du Grand-Hôtel.
Toutes les salles de cet hôtel, ordinairement à la disposition du public voyageur, avaient été converties en bureaux pour les militaires. Mon officier ayant échangé quelques mots avec certains de ces messieurs, on se mit à me regarder comme une bête curieuse.—Ce serait donc un Anglais, pensait-on.—Oui, c'était un Anglais. Un Anglais d'une variété spéciale, d'origine et de langue française, mais un Anglais tout de même. Tous ces sur-boches, chacun leur tour, me dévisagèrent de leur regard peu sympathique.
Enfin, on me conduisit à l'étage le plus élevé; on m'indiqua une chambre; on plaça à la porte une sentinelle allemande qui eut bien soin de faire un tour de clef au moment où elle fermait la porte sur moi. On avait eu l'extrême obligeance de me laisser savoir que je devrais prendre mes repas dans la chambre même que j'habitais; que je devrais payer les frais de la chambre et de la nourriture: Sa Majesté allemande refusait de nourrir son prisonnier d'honneur.
Le lendemain, vendredi, 4 juin (1915), ma femme arrivait au Grand-Hôtel d'Anvers où je me trouvais détenu. Elle était plus morte que vive, comme on le conçoit bien. Elle avait pu obtenir de la Kommandantur la permission d'occuper la même chambre que moi.
Enfin, comme il faut subir avec philosophie ce qui est inévitable; comme c'était la guerre; comme des millions et des millions d'êtres humains étaient beaucoup plus malheureux que nous pouvions l'être dans notre captivité, nous acceptâmes avec une résignation parfaite les petits inconvénients auxquels nous étions condamnés.
Le samedi, les enfants étaient arrivés à l'hôtel. Des fenêtres de la chambre que nous occupions, nous avions pu les voir traverser la cour intérieure et se diriger vers un bureau situé de l'autre côté de cette cour. Au moment où ils sortaient du bureau où, évidemment, ils s'étaient rendus pour obtenir la permission de nous voir, nous entrons en conversation avec eux du haut de notre quatrième étage.
Une première parole était à peine tombée de nos lèvres qu'une tempête éclata: deux de ces militaires étaient sortis et nous lançaient, à bouche et gorge que veux-tu, toutes sortes d'invectives à nous, là-haut, parce que nous avions adressé la parole à nos enfants, et aux enfants parce qu'ils avaient eu l'audace de nous répondre. Terrible provocation, en effet, que celle d'enfants échangeant quelques paroles avec leurs parents!
Les enfants furent éconduits on ne peut plus cavalièrement, et nous fûmes privés de les voir ce jour-là. Le lendemain, une permission spéciale leur fut donnée de venir passer quelques minutes avec nous. C'était, je crois, le dimanche avant-midi.
Ce jour-là, vers midi, le major Von Wilm nous rendit visite dans cette chambre d'hôtel convertie en cellule de prison. Un nuage semblait obscurcir sa figure: il était mal à l'aise, ses traits, son attitude même décelaient l'anxiété et le malaise. Il nous apportait une terrible nouvelle:—"Je suis désolé, disait-il, je suis désolé, mais M. Béland doit partir aujourd'hui même pour l'Allemagne."
On imagine quelle consternation ce fut pour ma femme et pour moi. J'ose protester. Je rappelle à la mémoire du major toutes les assurances qu'il m'a données; je répète qu'il était entendu qu'en ma qualité de médecin je ne pouvais être privé de ma liberté; je lui demande comment il se fait que les autorités compétentes, à Berlin, n'aient pas été mises au courant des services médicaux que je rendais à l'hôpital, ainsi que chez la population civile depuis le début de la guerre; enfin, je fais tout un plaidoyer. Consterné, très embarrassé, le major balbutie quelques explications: les instructions lui étaient venues d'une autorité supérieure à la sienne; il avait tenté de donner des explications à mon sujet, mais l'on n'avait voulu rien entendre. Des ordres formels lui enjoignaient d'interner tous les sujets britanniques, et de les envoyer en Allemagne sans délai.
On avait disposé de mon cas en haut lieu: toute récrimination était peine perdue. Le major avait pris, pour l'occasion, une attitude un peu hautaine que je ne lui avais jamais connue auparavant.—"A deux heures aujourd'hui, ajoute-t-il, vous devrez partir. Un sous-officier vous accompagnera jusqu'à Berlin et de là à Ruhleben, camp d'internement des civils de nationalité anglaise."
Après son départ, un voile de tristesse envahit cette lugubre chambre d'hôtel. Nous ne savions que dire. Nous avions encore deux heures à demeurer ensemble, ma femme et moi. Ma femme avait insisté pour m'accompagner en Allemagne. Refus catégorique. Le major avait même eu la délicatesse (?) de la prévenir que sa présence à côté de moi, dans le court trajet entre l'hôtel et la gare, n'était pas désirable.
A deux heures donc, le 6 juin (1915), le sous-officier se présente dans cette chambre d'hôtel, à laquelle nous étions un peu habitués, depuis trois jours que nous l'habitions, et où nous avions rêvé de nous faire un petit home. Les enfants n'étant qu'à quelques milles de nous, pourraient venir nous voir une ou deux fois par semaine... Tout était prêt pour le départ: moment solennel, profondément triste!... Je me séparais à ce moment de ma femme, ignorant —et c'était peut-être heureux qu'il en fût ainsi—que je la voyais pour la dernière fois.
A trois heures, le train entrait en gare de Bruxelles. Nous devions attendre à cette gare un train direct allant de Lille à Libau, Russie. Il entra portant en inscription au-dessus des fenêtres des wagons les mots: Lille—Libau... Les limites du nouvel empire allemand!
A quatre heures, nous étions en route vers Berlin. Le convoi filait à bonne allure à travers les belles campagnes de la Belgique. Nous traversâmes Louvain dévastée et incendiée. Nous traversâmes également un grand nombre de villes et de villages qui portaient l'empreinte du bombardement et autres horreurs de la guerre.
Dans la soirée, nous traversâmes Liège, Aix-la-Chapelle, et vers 9 heures, nous étions en gare de Cologne, l'estomac vide et l'âme imprégnée d'une profonde tristesse.
Après la triste nouvelle qui nous a été communiquée, à midi au Grand Hôtel d'Anvers, le jour de mon départ, il nous avait été impossible de déjeuner,—ce qu'ici nous appelons plutôt dîner. Dans la soirée, la voix de la faim se fit entendre, et comme le train qui nous emportait avait un wagon-restaurant, je suggérai à mon sous-officier d'y aller prendre quelque chose.
Mon compagnon et gardien ne savait pas un mot d'anglais ni un mot de français, et comme à cette époque je n'avais pas encore eu l'occasion d'avoir appris l'allemand, la conversation a nécessairement langui tout le long du voyage.
Par toutes sortes de signes et de gestes, qui devaient être souverainement comiques pour les voyageurs qui nous coudoyaient, je vins à bout de faire comprendre à mon homme qu'il fallait nous mettre quelque chose sous la dent. Au wagon-restaurant, où nous étions parvenus à nous glisser, nous ne pûmes obtenir que très peu de renseignements et d'encouragements et rien à manger. Le préposé au buffet nous expliqua, si j'ai bien compris que ce wagon-restaurant était pour l'usage exclusif des officiers ou des personnes accompagnées par des officiers, or, comme mon gardien n'était que sous-officier, nous fûmes poliment éconduits.
A Cologne, toute tentative de nous approcher du buffet, de la gare échoua déplorablement. Il y avait grande foule. Mon sous-officier était naturellement un peu craintif. J'aurais pu, je pouvais lui échapper dans cette cohue, et il en aurait été sévèrement puni. Alors, il n'y eut rien à faire.
Quelle nuit, dans ce compartiment de wagon, au milieu de voyageurs allemands taciturnes ou ronflants! Heureusement, une nuit de juin est courte. Dès les petites heures du matin, l'aube s'annonçait radieuse, et j'assistai à un merveilleux réveil de la nature. Dès quatre heures, je pouvais me remettre à ma lecture.
A 9 heures, nous étions à Berlin, et je vis pour la première fois la capitale de l'empire allemand. Sur le quai de la gare, un personnage dont j'ai toujours ignoré le nom, s'était glissé près de nous. Il était en civil. Après avoir échangé quelques mots avec mon sous-officier, avec lequel il me sembla d'intelligence, ce fut lui qui donna les ordres et indiqua la direction de la marche que nous devions suivre.
En sortant de la gare, ce monsieur allemand en civil, qui devait être un officier d'un assez haut rang, m'invita à monter dans une automobile, et me dit comme ça: "C'est la première fois que vous venez à Berlin?" en excellent français.—"Oui", que je lui répondis.—"Berlin est un très jolie ville", continua-t-il. Je n'eus rien à dire à l'encontre. Nous allions ainsi à travers les rues de la capitale, et il m'était impossible de me rendre compte du but que pouvait avoir notre course. J'étais toujours sous l'impression que l'on me conduisait à Ruhleben, camp d'internement de civils de nationalité anglaise, et cette promenade a travers Berlin me laissait espérer que nous allions descendre à quelque hôtel, ou maison de pension quelconque où les prisonniers sont hébergés en cours de route. C'était chez moi, à ce moment, une véritable obsession: je supposais, et j'espérais surtout, que l'on prendrait quelque part une légère collation, il y avait vingt-quatre heures bien comptées que je n'avais pris aucune nourriture. Mon sous-officier avait bien grugé durant le trajet une croûte tirée de son knapsack, mais, soit pour obéir à sa consigne, ou soit par manque de civilité, il avait négligé de m'en offrir la moindre parcelle.
L'automobile descendait une superbe avenue: c'est, me dit mon nouveau compagnon, l'avenue Unter den Linden (Sous les Tilleuls), la plus belle de Berlin. On peut être anti-allemand, mais on ne peut s'empêcher de reconnaître que cette avenue ne manque pas d'un certain charme. Elle va de la porte de Brandebourg jusqu'au palais de l'Empereur, situé sur la rivière Sprée.
Nous contournons le palais de l'Empereur et immédiatement après, nous nous engageons dans des rues plus étroites. Après une course d'environ un quart d'heure, nous arrivons devant un édifice immense, aux murs gris sale. Inutile d'en faire plus de mystère, c'était une prison, et j'étais enfin parvenu à destination.
C'est en face de la Stadvogtei que vient de s'arrêter l'automobile dans laquelle on m'avait fait monter à la gare. C'est une prison bien connue en Allemagne. En temps de paix, elle sert à la détention des prisonniers politiques, et en général de tous ceux qui attendent le moment de comparaître en Cour d'Assises. Située sur la rue Dirksen, à environ 200 verges de la place dite Alexandre, elle est attenante à la préfecture de police. C'est un immense édifice de forme triangulaire dans son ensemble.
C'est là que l'on me prie de descendre. On me fait entrer dans un bureau où se trouvent deux militaires: l'un sergent-major et l'autre sous-officier.
Je dois dire qu'à ce moment-là j'ignorais encore complètement où j'étais, et quel pouvait être le caractère de l'institution où l'on m'avait introduit. J'étais encore sous l'impression que ce pouvait être un hôtel d'un genre particulier, réservé aux prisonniers de passage à Berlin,—les justes récriminations de mon estomac m'obsédaient de plus en plus,—car j'avais toujours à l'esprit la déclaration qui m'avait été faite à Anvers, à savoir que je serais conduit à Ruhleben. Je me berçais de la douce illusion qu'à cet endroit où nous venions d'arriver on me servirait à dîner, et qu'après une honnête sieste nous continuerions notre route jusqu'à ma destination définitive.
En attendant, je promenais mes regards tout autour de ce bureau, et j'examinais tour à tour les deux militaires de service. Mes deux compagnons, le sous-officier et le civil, étaient entrés en conversation avec eux en allemand. Le sous-officier tira de sa poche un papier quelconque, le remit au sergent-major qui, après l'avoir vérifié puis signé, le remit à mon sous-officier qui fit le salut militaire et disparut.
Le personnage en civil dont j'ai toujours ignoré le nom, le rang ou la profession, me pressa la main et prit congé de moi, avec civilité et même déférence, pendant que les deux militaires du bureau se tenaient debout dans cette attitude de respect et de crainte qu'ont pu si souvent observer tous ceux qui ont visité l'Allemagne.
Immédiatement après le départ du monsieur en civil, le sous-officier de service m'invita à le suivre. Nous parcourons une longue suite de corridors très sombres, nous grimpons deux escaliers, pour déboucher dans un autre corridor, et pénétrer enfin dans une cellule du second étage, où se trouvaient déjà trois personnes.
De plus en plus ahuri, je me demandais où je pouvais bien entrer. Toutes sortes d'idées me traversèrent rapidement l'esprit, mais aucune d'elles n'eut le temps de s'y fixer définitivement. Les trois personnes au milieu desquelles on m'avait jeté me regardèrent attentivement. Je crus d'abord qu'ils étaient allemands. Je leur adressai la parole en français mais on ne me comprit pas. Alors, je leur parlai anglais et, cette fois, je fus compris.
Voyant qu'ils parlaient anglais, je leur fis les questions suivantes:
—Êtes-vous Anglais?
—Oui, répondirent-ils.
—Et que faites-vous ici?
—Ici, dirent-ils avec un léger sourire, nous sommes en prison.
—En prison! en prison! dis-je. "Et moi?" sur un ton interrogatoire assez prononcé.
—Et vous,—dirent-ils toujours en souriant,—apparemment, vous êtes également en prison.
Ces trois Anglais, comme je l'appris aussitôt, étaient M. Robinson, un jockey qui vivait en Allemagne depuis de nombreuses années, et qui parlait parfaitement l'allemand; M. Aaron, Anglais naturalisé, Sémite d'origine tout probablement, et courtier de profession, né en Autriche, et qui habitait Berlin lors de la déclaration de la guerre. Quant au troisième, M. Stuhr, d'Anvers,—presqu'un compatriote pour moi,—parlait très bien l'allemand, mais assez mal le français et l'anglais. C'était, je crois, un mécanicien.
Mon estomac ne voulant pas abdiquer, je demandai à mes trois nouveaux compagnons de chambre s'il ne me serait pas possible de me procurer à déjeuner, leur expliquant que je n'avais pris aucune nourriture depuis plus de vingt-quatre heures.
—Bien, me dit Robinson, le pain a été distribué ce matin à huit heures, et il est probable qu'il n'y en aura pas d'autre distribution avant demain matin à la même heure.
—C'était, on l'admettra, assez peu encourageant.
—Mais enfin, repris-je, on ne m'a assurément pas amené ici, sachant qu'aucune occasion ne me serait donnée de prendre la moindre collation en cours de route, avec l'intention de me laisser mourir de faim. Il doit y avoir moyen de se procurer ici quelque nourriture!
Tous trois, en souriant tristement, manifestèrent un doute par leur attitude. Ils me regardèrent, haussèrent les épaules, en me faisant comprendre qu'il était impossible de se procurer quoi que ce soit.
—Toutefois, dit l'un d'eux, il me reste un morceau de pain de ce matin, je vous le donnerai et Robinson vous fera du café.
Pour une fois, je me permis de conclure du particulier au général, et je pensai: heureux pays que ceux dont les jockies et les courtiers sémites peuvent se montrer si secourables!... Le petit Robinson, ses manches de chemise retroussées jusqu'aux coudes, tira de sous la table une lampe à alcool, plaça dessus, une petite casserole de fer-blanc avec de l'eau, et se mit à préparer le café. Nous étions loin du confort des grands hôtels. Enfin, vers 9.30 heures, je prenais mon premier repas en prison: il consistait en une croûte de pain noir avec une tasse de café sans lait ni sucre. Mais j'avais faim, et ce premier morceau de pain de guerre me sembla aussi succulent que la meilleure soupe aux pois au lard salé que j'aie jamais dégustée dans ma bonne province de Québec. Je n'eus que des paroles de gratitude pour remercier comme il le fallait mes nouveaux compagnons d'infortune.
Pendant que j'étais à table, dégustant mon frugal repas, mes yeux se promenaient tout autour de la chambre. C'était bien une cellule de prison: un cachot. Une fenêtre partait du plafond et descendait jusqu'à environ six pieds du plancher. De l'endroit où je me trouvais assis, je pouvais voir, à travers cette fenêtre, un tout petit coin du firmament au-dessus du mur intérieur de la prison. De solides barres de fer fermaient cette unique ouverture par laquelle nous pouvions avoir de l'air et de la lumière. Il y avait, dans cette salle, quatre lits disposés deux à deux, l'un au-dessus de l'autre, la table sur laquelle je prenais mon repas, et quatre petits bancs de bois, sans dossiers ni bras d'appui. Les murs étaient blanchis à la chaux. La porte, toute en fer, était énorme, et il y avait, dans la partie supérieure, une petite ouverture d'environ un pouce de diamètre pour permettre aux gardes de voir à l'intérieur.
L'inspection de la prison se faisait tous les jours vers dix heures. C'était un sergent-major, celui-là même auquel j'avais été remis, à mon arrivée, qui s'amenait à chaque étage, se faisait ouvrir la porte de chacune des cellules par un sous-officier, et promenait un regard scrutateur et hautain sur la cellule et ses occupants.
Personne ne m'avait prévenu qu'une inspection aurait lieu peu de temps après mon arrivée dans la cellule que l'on m'avait assignée: assis à la table, ayant le dos à demi tourné à la porte, absorbé dans un monde de pensées diverses, et distrait par la dégustation de mon pain noir, je n'avais pas entendu ouvrir la porte. Je remarquai que le petit Robinson, s'approchant ou plutôt se glissant près de moi, tirait légèrement ma manche comme pour m'inviter à me lever. Comprenant enfin que quelque chose se passait derrière moi, je me levai et me tournai à demi. Le sergent-major, triple boche, Prussien et demi, se tenait sur le seuil de la porte raide et droit comme un i.
C'était le sergent-major Götte,—un nom et un personnage que je n'oublierai jamais. Quand il vit que tout le monde était debout, il cria d'une voix de stentor: "Guten morgen!" A mon oreille, cela sonnait plutôt comme une injure que comme un salut matinal.
—Qu'est-ce qu'il dit?, demandai-je à M. Aaron, lorsqu'il fut parti.
—Il nous dit: Bonjour, dit M. Aaron.
Mais cet homme, lorsqu'il nous dit: Bonjour, reprit un autre, c'est tout comme s'il nous disait: "Allez au diable!"
La section de la Stadvogtei où j'étais enfermé pouvait donner asile à deux cent cinquante prisonniers, distribués dans environ 150 cellules, dont quelques-unes enfermaient jusqu'à huit prisonniers. Une grande partie de ces cellules ne mesuraient que douze à quinze mètres cubes, les prisonniers qui les occupaient étaient obligés de laisser leur fenêtre ouverte pour se procurer la quantité d'air voulue.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, la prison, dans son ensemble, était triangulaire, et à l'intérieur de chacune des sections,—également triangulaires,—se trouvait la cour où les prisonniers avaient accès pendant quelques heures dans l'après-midi. Toutes les cellules avaient une fenêtre s'ouvrant sur cette cour intérieure. Longeant chacun des côtés du triangle, se trouvait un corridor dont les fenêtres ouvertes sur l'extérieur étaient opacifiées de façon à couper le regard. Toutes les fenêtres étaient barrées de fer. L'édifice était à cinq étages dont un rez-de-chaussée. C'est dans ce rez-de-chaussée que se trouvaient les cellules sombres ou cachots. Il y en avait quatorze. Les fenêtres de ces cellules étaient munies en dehors, c'est-à-dire du côté de la cour, de contrevents s'appliquant exactement sur les croisées. On y enfermait les prisonniers, de nationalité anglaise surtout, qui s'étaient échappés de Ruhleben et avaient eu le malheur d'être repris au cours de leur fuite vers la Hollande ou la Suisse.
Une entente avait été conclue entre l'Angleterre et l'Allemagne au sujet de la punition à infliger aux prisonniers civils qui s'échapperaient de leurs camps de détention respectifs. En vertu de cet arrangement, tout prisonnier repris après son évasion devait être détenu au secret pendant deux semaines.
La Kommandantur de Berlin, c'est-à-dire le capitaine Wolf qui semblait en être le grand manitou, avait pris sous son bonnet d'interpréter à sa manière cette clause de l'arrangement. Nous vîmes alors arriver dans la cour une équipe d'ouvriers qui fabriquèrent les dits contrevents. Tous les prisonniers anglais qui s'évadèrent par la suite furent jetés dans un de ces cachots. Pendant les quatre premiers jours ils étaient tenus dans l'obscurité la plus complète et nourris au pain et à l'eau. La cinquième journée, on abaissait quelque peu le contrevent, afin de laisser pénétrer un faible jet de lumière et, en outre du pain, on servait à ces prisonniers les deux soupes réglementaires, et douteuses, dont les autres étaient gratifiés. Les quatre jours d'éclipse totale et de pain sec recommençaient, suivis d'une autre journée de lumière et de soupe. Enfin, quatre autres jours d'obscurité complète terminaient la période totale de quatorze jours. Alors, ces malheureux devenus libres relativement, c'est-à-dire comme nous, avaient la permission de circuler dans les corridors et les cellules des différents étages, avec accès à la cour pendant quelques heures de l'après-midi.
La vie de prison est monotone au suprême degré. Une de nos distractions favorites était le départ et l'arrivée des prisonniers et les potins divers que ce remue-ménage occasionnait. Dix prisonniers, en moyenne, étaient élargis chaque jour, et il en arrivait un nombre à peu près égal pour les remplacer.
Cette section de la Stadvogtei où nous étions confinés était sous la direction suprême de la Kommandantur de Berlin, qui était représentée à la prison elle-même par un officier. Pendant les trois ans de mon incarcération, l'officier représentant la Kommandantur fut toujours le même: l'ober-lieutenant Block. Sous cet officier se trouvait un sergent-major, et sous ce sergent-major, sept sous-officiers, un portier, lui-même sous-officier. Deux sous-officiers se tenaient au bureau, au rez-de-chaussée, et un sous-officier était chargé de la surveillance à chacun des cinq étages. Le sergent-major avait la surveillance générale et faisait son inspection chaque jour. Quant à l'officier Block, sa dignité le retenait au rivage, et ce n'est que deux ou trois fois par semaine qu'il daignait passer à travers les corridors, aux différents étages.
Une manie qui paraît générale chez les officiers et les sous-officiers allemands, c'est de parler très fort, et dans les termes les plus violents, lorsqu'ils s'adressent à leurs subalternes, simples soldats ou prisonniers. Pauvres Polonais! ce qu'ils en ont enduré de gros mots et d'injures de toutes sortes! Nos gardes-chiourmes ne laissaient pas passer un seul jour sans faire résonner les échos de la vaste prison de leurs cris et de leurs vociférations.
Je fais mention spéciale des Polonais, parce que c'est la Pologne qui, pendant ces trois années où j'ai été en captivité, a fourni à cette prison de la Stadvogtei le plus grand nombre de ses pensionnaires. Sur 250, il y en avait bien les deux-tiers qui étaient d'origine polonaise. Les autres prisonniers étaient des Anglais, des Français, des Italiens, des Russes, des Portugais, enfin, toutes les nations en guerre avec l'Allemagne y étaient représentées. Nous avons même eu quelques Arabes, des Hindous, des nègres, des Japonais et des Chinois.
Je surprendrai peut-être un peu le lecteur en lui disant que les quatre nations du centre, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Turquie, étaient constamment représentées à cette prison par quelques-uns de leurs sujets. L'Allemagne, en particulier, en avait toujours cinq ou six, prisonniers politiques pour la plupart, et réputés dangereux pour la sécurité de l'Empire. J'aurai occasion, un peu plus loin, de parler plus particulièrement de deux de ces prisonniers, députés au Reichstag.
Non seulement l'Allemagne et ses alliés, ainsi que les pays ennemis de l'Allemagne étaient représentés à la Stadvogtei, mais encore, à différentes époques, tous les pays neutres de l'Europe, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Hollande, la Suisse et l'Espagne. Comment cela se fait-il? me demandera-t-on. Ce n'est pas plus difficile à expliquer que l'internement des sujets allemands eux-mêmes. Un Danois, un Hollandais ou un Suédois, de passage à Berlin, entrait en conversation avec quelques Allemands autour de la table d'un café. S'il avait l'imprudence de critiquer un tant soit peu la politique extérieure de l'Allemagne, ou la conduite des opérations militaires ou navales, son sort était scellé. Il retournait à son hôtel ne craignant nulle chose, et dormait paisiblement, ignorant qu'une épée était suspendue au-dessus de sa tête. A sept heures du matin, le lendemain, un casque à pointe quelconque venait le réveiller, et l'invitait poliment à le suivre jusqu'à la préfecture de police. De là, il passait à la Stadvogtei, le véritable clearing house de l'Allemagne. On laissait ignorer au prisonnier lui-même la cause de son emprisonnement, et ce n'est qu'après des semaines de protestations et à la suite de nombreuses correspondances avec la légation ou l'ambassade de son pays qu'il obtenait d'être soumis à un interrogatoire de la part de ces messieurs de la Kommandantur. Si on décidait en définitive de le relâcher, on venait le prendre à la prison, et il était immédiatement dirigé vers la frontière de son pays, sans qu'il lui fût même permis de passer à son hôtel pour y prendre ses effets.
La manière dont les prisonniers de guerre et les internés civils ont été nourris dans les prisons et les camps d'internement de l'Allemagne a donné lieu, on le sait, à des plaintes amères de la part des internés, et à des polémiques acerbes dans la presse de tous les pays. Que les prisonniers eux-mêmes se soient plaints dans des correspondances envoyées en Angleterre, et dans des lettres à l'ambassade américaine, cela est généralement connu.
Voici un petit incident qui ne manquera pas d'intéresser: Parmi les internés anglais à la Stadvogtei se trouvait Monsieur F.-T. Moores, un ingénieur qui faisait des travaux dans le Luxembourg lors de la déclaration de la guerre et de l'invasion des troupes allemandes. Malgré tous les efforts qu'il fit pour sortir en temps du territoire envahi, il ne put échapper à la griffe des troupes d'invasion.
Monsieur Moores fut d'abord interné à Trêves et tenu au secret pendant plusieurs mois, puis il passa en Cour martiale sous accusation d'espionnage, et enfin, fut envoyé à la prison de Berlin où nous eûmes l'avantage de nous lier d'amitié avec lui.
Durant la première année de son internement, M. Moores avait écrit à sa femme, en Angleterre, une carte postale qui restera fameuse, dans laquelle il lui donnait d'abord des nouvelles de sa santé, et ajoutait un mot au sujet de la nourriture que l'on nous servait. Voici en quels termes il s'exprimait:—"The feed we are getting here is unspeakable; it is enough to keep a man from dying, but it is not sufficient to keep a man living!" (La nourriture que nous recevons est affreuse, elle nous permet d'exister, mais elle n'est pas suffisante pour nous faire vivre.) Il fallait, on le reconnaîtra, une certaine dose de hardiesse pour confier au courrier une carte ainsi conçue. Dès le lendemain, le censeur faisait son apparition à la prison et se rendait tout droit à la cellule de M. Moores, avec la carte compromettante. Il lui représenta qu'il était vraiment imprudent de sa part d'envoyer en Angleterre une correspondance de cette nature. Lorsque M. Moores lui fit remarquer qu'il n'avait exagéré en rien, que tout ce qu'il avait dit était l'exacte vérité, le censeur crut devoir lui expliquer, en manière d'excuse, que si l'Allemagne ne donnait pas à ses prisonniers une nourriture plus substantielle, c'est qu'elle en était empêchée par le blocus maintenu contre elle par la mère-patrie même de celui qui se plaignait.
Le menu de la prison, tel que je l'ai connu et pratiqué pendant les trois années de ma captivité, n'a pas beaucoup varié, et il était détestable. Dire qu'un menu qui varie un tant soit peu a quelque chance de devenir plus acceptable qu'un menu qui ne varie point, c'est dire une vérité de La Palisse. Ce menu ne varietur consistait en un morceau de pain noir de huit onces qui était distribué chaque matin à huit heures. A onze heures avait lieu la distribution de certain potage douteux, et l'on affublait ce salmigondis du titre pompeux de mittag-essen (repas du milieu du jour). A cinq heures de l'après-midi, le sous-officier se présentait de nouveau accompagné de deux Polonais portant un bidon d'une autre soupe quelconque. Il y a soupe et soupe; celles qui nous étaient servies le midi et le soir ne sauraient être rangées dans la catégorie des soupes qui sont des soupes. Si on insiste pour savoir quelle était la formule de ces potages, je vous dirai qu'une analyse succincte y révéla la présence de divers ingrédients et plus particulièrement des légumes tels que navets, trognons de choux, et quelques rares fèves.
S'il est possible de faire un choix dans le médiocre, j'avouerai que la soupe du midi me parut généralement plus acceptable que celle du soir. Maintes fois ai-je entendu les Polonais qui se présentaient à ma cellule pour me demander soit un biscuit, soit un morceau de pain, déclarer que la soupe qu'on venait de leur servir n'était que de l'eau colorée. Pour ma part, je n'ai jamais goûté à cette soupe du soir. Sa couleur comme son odeur ne me disait rien qui vaille, et je crois que tous les Anglais internés dans cette prison en agissaient de même.
Durant l'année 1915, les conditions économiques de l'Allemagne n'étaient pas trop défavorables. Apparemment, on ne regardait pas comme alarmante la situation générale, au point de vue du ravitaillement, puisque l'on permettait encore aux prisonniers de donner chaque jour des commandes au dehors pour des provisions de toutes sortes. Ceux qui avaient des ressources pécuniaires pouvaient donc se procurer des vivres en quantité suffisante ou à peu près. Ce ne fut qu'au commencement de l'année 1916, que la plus grande partie des comestibles furent rationnés à Berlin. Vers le mois de mars (1916), un avis fut affiché dans tous les corridors de la prison, défendant à qui que ce soit de faire apporter des vivres de l'extérieur. Nous fûmes alors tous réduits au menu dont j'ai parlé plus haut.
Nous primes des mesures pour nous mettre immédiatement en communication avec les autorités en Angleterre. Je communiquai en particulier avec Sir George Perley, le Haut Commissaire canadien à Londres. Il nous fallait adopter des formules euphémiques (?) assez habiles pour faire comprendre à nos amis, en Angleterre, que nous étions réduits à une famine relative, sans toutefois le dire trop haut, car nos lettres eussent couru le risque d'être jetées au panier par ces messieurs de la censure.
Chacun de nous intrigua de la manière qui lui parut la plus efficace, dans les circonstances, pour se soustraire au maigre régime de la prison. Le service postal que l'état de guerre avait laissé subsister entre pays belligérants, très lent et peu sûr, était le seul mode de transport à notre disposition. Nous nous étions bercés de l'illusion que les vivres envoyées d'Angleterre nous parviendraient dans trois semaines tout au plus. Nous dûmes attendre plus de trois mois avant d'être mis en possession des précieux colis contenant les provisions tant désirées.
C'est pendant ces trois mois que nous avons pu concevoir quelles souffrances la faim fit endurer à ces pauvres Polonais qui étaient presque tous privés des secours du dehors. Des volumes ne suffiraient à raconter leurs tortures et leurs supplications... Combien de fois n'ai-je pas vu nombre d'entre eux aller ramasser, dans les cuvettes destinées aux déchets, les pelures de pommes de terre que nous y avions jetées: ils les couvraient d'un peu de sel et les dévoraient.
Au début de cette époque de grande disette, un avis avait été affiché sur les murs de la prison et de la petite cour triangulaire, nous enjoignant de jeter, à l'avenir, les pelures de pommes de terre dans un récipient spécial placé au bout du corridor. L'avis ajoutait que ces pelures avaient une valeur considérable, et qu'on les destinait à nourrir les animaux en général, et les vaches en particulier.
Le jour même où cet avis fut promulgué, nous étions cinq ou six prisonniers anglais occupés, à la cuisine, à confectionner une soupe quelconque, lorsque le sergent-major pénétra dans notre pièce. C'était un homme qui, par sa démarche, sa voix, ses gestes, semblait être pour ainsi dire un type fiévreusement nerveux. Il nous demanda si nous avions lu le fameux avis qu'il venait de faire afficher.—"Vous savez que désormais vous ne pourrez plus jeter vos pelures de pommes de terre où vous aviez habitude de les jeter, un récipient est placé à tel endroit, dans lequel vous devrez les déposer; elles sont très précieuses pour les animaux, car le grain et le fourrage se font excessivement rares à Berlin."
Absorbés que nous étions tous dans la préparation de notre fricot, nous avions à peine levé les yeux sur notre interlocuteur. Il regardait tour à tour chacun de nous, attendant une réponse, mais aucune réponse ne venait.—"Vous avez bien compris, messieurs?... Vous avez bien compris?... J'espère que vous ne me forcerez pas à vous punir pour avoir désobéi à cet ordre!" Personne ne semblait disposé à répondre quoi que ce soit, lorsque l'un de nous, M. M..., plus hardi peut-être que les autres, et certainement doué de plus d'humour, se tourna du côté du sergent-major et lui dit:—"Monsieur le sergent-major, je vous demande pardon, mais je mange mes pelures moi-même!" Un fou rire nous prend, mais nous nous contraignons par respect pour l'autorité. Le sergent-major, qui ne savait trop comment interpréter cette boutade, nous regarda l'un après l'autre, sembla esquisser un sourire, mais comme nous avions tous pris un air mystérieux et énigmatique, il ne crut pas devoir insister, tourna les talons et sortit prestement de la cellule.
Du mois de juin 1916 jusqu'au jour de ma sortie d'Allemagne, je pus recevoir, sinon régulièrement, du moins en quantité suffisante, les vivres qui m'étaient envoyées d'Angleterre et quelquefois du Canada, On m'a souvent posé cette question:—"Ces colis qui vous étaient adressés, vous étaient-ils ponctuellement remis?" Je crois pouvoir répondre affirmativement en tant que je suis concerné. Il semble que les employés du service postal commettaient moins de vols que ceux du service des messageries. Nous avons constaté assez souvent que des colis avaient été ouverts, et que quelques boîtes de conserves en avaient été enlevées. Certains colis ne nous sont jamais parvenus. Il nous était assez facile de contrôler la livraison de ces colis parce que tous portaient un numéro.
Certains prisonniers recevaient des provisions en quantité assez considérable par chemin de fer, c'est-à-dire par les messageries. Ces caisses étaient naturellement de dimensions plus grandes que les colis postaux. C'était la grande exception lorsqu'elles arrivaient intactes; de quatre à six livres de provisions en avaient été enlevées, et la caisse hâtivement refermée indiquait, même à première vue, qu'un vol avait été commis.
A ce sujet, il n'est pas hors de propos de dire que certains journaux allemands firent remarquer qu'au cours de l'année 1917 les réclamations contre les compagnies de messageries, en Allemagne, s'étaient élevées à 35 millions de marks, tandis qu'elles avaient à peine atteint quatre millions l'année précédente, ce qui prouve que les vols commis prenaient des proportions gigantesques, et en raison directe de la difficulté du ravitaillement.
En 1916, nous avions obtenu de l'inspecteur des prisons la permission de faire installer à nos frais un poêle à gaz dans l'une des cellules à notre disposition. C'est là que, chaque jour, entre onze heures et midi, on pouvait voir réunis tous les prisonniers de nationalité anglaise qui venaient fricoter. Cette cuisine était sous la direction de l'un de nous. Chacun y pouvait faire cuire ses ragoûts moyennant une faible redevance pour défrayer le coût du gaz. Nous avions même un contrôleur chargé de tenir les comptes, et surtout de veiller à ce que le gaz ne fût pas gaspillé. Ce surveillant gardait toujours de l'eau chaude en quantité suffisante pour suffire aux demandes de tous les prisonniers, et il la vendait à raison de un pfenning le litre (ce qui équivaut à un quart de sou la pinte suivant notre manière de compter). Les pauvres Polonais, surtout durant les mois d'hiver, venaient chez nous acheter de l'eau chaude. J'ai vu bien des fois ces misérables prisonniers retourner à leur cellule avec leur litre d'eau chaude aussi joyeux que si nous leur eussions fait présent d'un bifteck—ils avaient trouvé là une façon peu coûteuse de rétablir la circulation dans leur estomac vide.
Toutes les cellules occupées par les prisonniers anglais étaient chaque jour assiégées par les mendiants. Nos principaux clients étaient les Polonais. Après avoir été témoin de la générosité inlassable de tous mes compagnons de captivité de nationalité anglaise, je suis certain que ces milliers de Polonais, qui, au cours des quatre années de guerre, ont séjourné à la prison, auront gardé un souvenir impérissable de la charité et de la compassion de tous ceux qui étaient assez favorisés de la fortune pour recevoir des colis. Quand ils seront enfin de retour dans leur pays dévasté et pillé, ils témoigneront devant leurs compatriotes de leur reconnaissance envers ceux qui se sont empressés de soulager leurs souffrances et leurs privations.
Il était naturellement impossible de subvenir aux besoins, même les plus urgents, de tant de nécessiteux. Nous étions là une moyenne de dix à quinze Anglais, et l'on pouvait compter, en tout temps, pas moins de cent cinquante Polonais. Les autorités anglaises du camp de Ruhleben méritent une mention spéciale pour l'intérêt constant qu'elles ont porté non seulement aux prisonniers de nationalité anglaise enfermés à la Stadvogtei, mais encore aux Polonais et aux Belges en particulier.
Lorsque j'étais à la tête du comité des secours, à la prison, j'ai reçu, à maintes et maintes reprises, du camp de Ruhleben, d'énormes caisses de biscuits et d'autres provisions, destinées à soulager les plus nécessiteux, non seulement ceux de nationalité anglaise, mais également tous les ressortissants des pays alliés de l'Angleterre. Je m'étais adjoint un Suisse pour m'aider à faire cette distribution. J'aurai occasion, un peu plus loin, de dire un mot au sujet de ce M. Hintermann.
Pendant mes trois années de captivité à la prison de Berlin, j'ai pu pratiquer ma profession de médecin assez librement. Les soins médicaux étaient censés être donnés aux prisonniers par un vieux praticien de Berlin qui venait à la prison chaque jour, de neuf heures à dix heures de l'avant-midi. Les malades,—quand ils pouvaient marcher,—se rendaient à son bureau, accompagnés par un sous-officier. A dix heures, le vieux médecin quittait la prison pour n'y revenir que le lendemain à la même heure, de sorte que pendant 23 heures, chaque jour, j'étais le seul médecin auquel on pouvait avoir recours dans la section de la prison où se trouvait ma cellule.
L'une des trois sections triangulaires de la prison était exclusivement occupée par les soldats allemands accusés d'avoir manqué à la discipline. La plupart attendaient là le moment de passer en Cour martiale. A plusieurs reprises, j'ai été prié d'aller donner mes soins à quelques-uns d'entre eux. Durant le jour, je faisais la visite des malades en allant de cellule en cellule, mais durant la nuit, comme toutes les portes des cellules étaient fermées à clef, depuis sept heures du soir jusqu'à huit heures le lendemain matin, il fallait qu'un sous-officier vînt me quérir. Ces cas se présentaient assez souvent. J'étais encore appelé chaque fois qu'un prisonnier avait attenté à ses jours. J'ai pu constater, une dizaine de cas de suicide: les uns au revolver, d'autres au moyen d'un rasoir, ou par la strangulation. Bien n'était plus triste qu'une détonation entendue au milieu de la nuit dans cette sombre prison; les murs en étaient secoués; tous les prisonniers étaient arrachés à leur sommeil, et chacun se demandait quel pouvait être le malheureux qui venait, d'attenter à ses jours. Quelques minutes plus tard, invariablement, ma cellule était ouverte, un sous-officier se présentait, et j'étais prié de l'accompagner, soit pour constater la mort, soit pour donner des soins à un malheureux agonisant.
Les soins médicaux que je pouvais donner à tous les prisonniers sans distinction, et même aux sous-officiers, quand ils les requéraient, avaient naturellement disposé en ma faveur la plupart des surveillants, et la liberté de mouvement dont je jouissais comme médecin à l'intérieur de la prison,—que l'on n'a jamais ou à peu près jamais tenté de restreindre, —me permit de rendre beaucoup de services à des prisonniers miséreux, soit en leur apportant des médicaments, soit en leur fournissant des vivres. J'ai toujours été en cela généreusement secondé par mes compagnons de captivité, surtout ceux de nationalité anglaise. On n'avait qu'à faire un appel en faveur d'un prisonnier souffrant ou trop délaissé, pour voir accourir vers sa cellule plusieurs détenus apportant l'un du thé et des biscuits, l'autre du pain et de la margarine... enfin, autant de choses qui pouvaient soulager dans une large mesure les souffrances dont nous étions quotidiennement les témoins.
Un des cas les plus tristes dont j'aie été le témoin est celui de Dan Williamson. Dan Williamson s'était échappé deux fois du camp de Ruhleben. Lors de sa première évasion, il fut capturé et interné à la Stadvogtei où il demeura environ un an. Il fut alors interné de nouveau au camp de Ruhleben. Quelques mois plus tard, il réussissait, avec son compagnon Collins, de tromper encore une fois la vigilance des gardes prussiennes, et à prendre la direction de la frontière de Hollande. Tous deux furent repris et ramenés à la prison de Berlin.
C'était au temps où les prisonniers qui tentaient de s'évader étaient punis de deux semaines de cachot; Williamson et Collins furent donc jetés chacun dans une de ces cellules sombres du rez-de-chaussée dont j'ai parlé plus haut. Un jour, vers les cinq heures du soir, un bruit formidable se produisit. On entendait distinctement la résonance de coups frappés avec violence contre les murs. On pouvait aussi entendre plus ou moins distinctement des paroles de menace. Un sous-officier se présente à ma cellule, m'apprend que Williamson a tenté de se suicider, qu'il est couvert de sang, et qu'on lui a enlevé son rasoir. Pendant que le sous-officier me parlait, le bruit causé par les assauts répétés contre les murs et la fenêtre nous parvenait assez distinctement. Le sous-officier me dit:—"C'est Williamson qui fait tout ce tapage."—Je pensai qu'il n'était pas en danger de mort immédiat puisqu'il pouvait faire ainsi vibrer les énormes assises de l'édifice. A la demande du sous-officier, je me rendis en face de la cellule de Williamson. Je me décidai de lui adresser la parole par cette petite ouverture ronde d'à peu près un pouce de diamètre, ménagée au centre de toutes les portes de cellules. Je n'avais pas encore fini de lui adresser la parole, qu'il porta un coup formidable tout près de l'endroit où j'étais. D'un mouvement instinctif je reculai, et le sous-officier fut d'avis, comme moi, qu'il ne serait pas prudent d'ouvrir la porte immédiatement. Williamson avait évidemment une arme quelconque à la main. Nous présumions qu'il était venu à bout de détacher une pièce de son lit en fer. Je suggérai alors au sous-officier de téléphoner à la préfecture de police pour demander l'aide de deux constables. Le sous-officier sortit puis revint quelques minutes pins tard avec deux constables et deux autres sous-officiers de la prison. Je propose au sous-officier d'ouvrir d'abord la cellule de Collins, compagnon de Williamson, et qui se trouvait tout à côté. Collins, que l'on laissa sortir dans le corridor, avait tout entendu le tapage fait par Williamson. Nous lui demandons de se tenir près de la porte lorsqu'elle sera ouverte afin de parler le premier à son ami, et tâcher de le calmer. La porte est enfin ouverte et comme un tigre Williamson se précipite au dehors, saisit son ami Collins, le jette sur le parquet, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, il était déjà sur lui. Le pauvre Collins eut été mis en chair à pâté (?) si tous, officiers, constables et prisonniers, nous n'eussions, par une prompte intervention, réussi à maîtriser Williamson qui semblait privé de la raison. Je lui adresse de nouveau la parole, et pour tout réponse il me dit:—"Donnez-moi donc mon rasoir que j'en finisse." Ses vêtements étaient couverts de sang, et il avait au bras une blessure, pas très profonde mais assez étendue, qui avait été faite avec un instrument tranchant. Pendant qu'on le maîtrisait, je cours chercher des pièces de pansement, et je lui donne les soins chirurgicaux que requérait son état. On met les menottes au pauvre malheureux, et on va l'enfermer dans une cellule capitonnée, au sous-sol, en un endroit assez isolé. On referme sur lui les deux portes, et il en a pour toute la nuit de solitude absolue.
Avant de le quitter, je lui avais demandé s'il ne me serait pas possible de faire quelque chose pour lui. Il me regarda d'une façon assez étrange, mais ne dit pas un mot. Malgré mes instances, il me fut impossible de tirer un mot de lui.
J'avais été préoccupé toute la nuit au sujet de ce pauvre homme. Le lendemain matin, aussitôt que ma porte fut ouverte, je demandai au sous-officier s'il voulait bien m'accompagner à la cellule de Williamson. Il fallait pour cela passer dans une autre section de la prison, et il fallait être accompagné. Je pris donc du thé, quelques biscuits, et nous nous dirigeâmes vers le sous-sol. Les portes ouvertes, nous trouvons Williamson debout au milieu de la cellule, les yeux hagards. Je lui dis:—"Bonjour!... Comment allez-vous?..." Pas un mot de réponse.—"Avez-vous bien dormi?..." Pas un mot—"Je vous ai apporté du thé et des biscuits, si vous désirez autre chose, il m'est permis de vous l'apporter." Pas un mot: il me regarde fixement, et n'a pas l'air de comprendre ce que je lui dis. Je dépose le thé et les biscuits sur le matelas, car à part le matelas, il n'y a absolument rien dans cette cellule dont le parquet et les murs sont capitonnés. Après quelques tentatives supplémentaires et inutiles pour en tirer quelques paroles, je me retire avec le sous-officier. A neuf heures, je fis mon rapport au médecin de la prison qui ordonna de transporter Williamson à l'hôpital.
Après trois semaines d'absence, Williamson revint à la prison. Il semblait un peu mieux, mais dès la première nuit qu'il passa avec nous, je fus appelé auprès de lui par un sous-officier. Je le trouvai à côté de son lit en pleine crise épileptique. L'attaque passée, nous le replaçons sur son lit et je demeure une heure à causer avec lui. Il me donne des nouvelles des blessés et des prisonniers de guerre anglais qu'il a rencontrés à l'hôpital de la rue Alexandrine où il avait passé les trois semaines précédentes. J'eus l'idée de présenter une requête aux autorités allemandes pour obtenir la permission d'aller chaque jour à cet hôpital, faire les pansements chez les prisonniers anglais. Je demandai à Williamson ce qu'il pensait de mon idée. Il me répondit:
—Vous pouvez bien présenter votre requête, docteur, mais la permission vous sera refusée.
—Pourquoi donc?
—Parce que ces gens seront, d'avis que vous pourrez y voir trop de choses.
Il avait raison, ma requête fut rejetée.
Le lendemain, Williamson avait encore une crise épileptique dans la cellule de M. Hall, un autre détenu anglais. C'était entre cinq et six heures du soir. Tous les sous-officiers étaient accourus. Effrayés de la gravité de ce cas très intéressant, et trop encombrant, ils décidèrent de faire conjointement rapport à l'officier qui eut à ce sujet une entrevue avec le médecin.
Maintenant qu'une lettre de Williamson lui-même, datée d'Édimbourg, Écosse, m'est parvenue il n'y a plus de danger à dire toute la vérité. Mon compagnon de captivité simulait et la maladie et la folie. C'est à son retour de l'hôpital, au cours d'une conversation que j'eus avec lui qu'il me mit au courant de son stratagème. Il jouait son rôle à la perfection, et cela jusqu'au moment où sur ma recommandation expresse et pressante il fut versé au Sanatorium. Car c'était là qu'il voulait arriver: de cet endroit il était relativement facile de s'évader.
La lettre que je viens de recevoir est souverainement amusante. Williamson m'écrit qu'il s'est évadé au commencement d'août et que le 14, après bien des péripéties, il réussissait à franchir la frontière de Hollande. Il ajoute en post-scriptum: "Je serais curieux de savoir si Herr Block (l'officier) est toujours sous l'impression que j'ai perdu la raison!"
Une nuit, nous fûmes tirés de notre sommeil par une série de détonations qui semblaient venir du dehors. Nous nous demandions ce que cela pouvait bien être? Comme la prison était située au centre de Berlin, il nous sembla d'abord que ce pouvait être une émeute, ou bien encore des ouvriers en grève aux prises avec les gendarmes. Nous ne fûmes pas longtemps avant de savoir ce qui en était: on vint me prier d'aller constater la mort d'un soldat que l'on amenait du front de bataille allemand pour l'enfermer à la Stadvogtei en attendant sa comparution en Cour martiale.
D'après le rapport fait par ses deux gardes, ce soldat réfractaire, qui s'était montré assez docile au cours du trajet depuis les Flandres jusqu'à Berlin, avait attendu d'être en face de la porte de la prison pour prendre la fuite à toutes jambes. Les gardes lui donnèrent aussitôt la chasse. Après avoir tourné le premier coin et pris une ruelle sombre longeant le mur de la prison, haut de 75 pieds, il était sur le point d'échapper à ses gardes quand ceux-ci se décidèrent de faire feu. Cinq coups de feu furent tirés. Le fuyard fut atteint et on ne rentra qu'un cadavre à la prison. Je n'eus qu'à constater la mort, ce que je fis en présence du portier, du surveillant de nuit, d'un sous-officier et de deux gardes. Le lendemain, à 9 heures, une ambulance pénétra dans la cour, et tous, du premier au dernier, nous étions montés sur nos chaises, allongeant le cou à travers les barreaux de nos fenêtres pour tâcher de voir ce qui se passait: on venait chercher le cadavre du soldat que ses compagnons avaient tué.
Parmi les nombreux prisonniers, de nationalités diverses, qui furent mes compagnons d'infortune, à la Stadvogtei, pendant mes longues années de captivité, il en est quelques-uns qui méritent une mention spéciale.
Au début de l'année 1916, il nous arrivait assez souvent d'entendre, lorsque le silence régnait par les cellules et les corridors, une musique très douce, et qui nous semblait très lointaine. Nous ne savions qui remercier pour ces concerts gratuits: les uns prétendaient qu'il devait y avoir, dans un endroit assez éloigné de la prison, un musicien prisonnier comme nous, d'autres croyaient que cette musique nous venait plutôt du dehors.
Certain jour, le sergent-major, en faisant son inspection, me fit part d'une permission qui m'avait été accordée de visiter un prisonnier français dans une partie de la prison assez éloignée de celle où se trouvait ma cellule. Il s'agissait du professeur Henri Marteau. Ce nom était resté dans ma mémoire: je me rappelais vaguement que ce fameux violoniste avait visité le Canada, il y a une vingtaine d'années. Le sergent-major ajouta:—"Lorsqu'il vous conviendra d'aller rendre visite au professeur Marteau dans sa cellule, un sous-officier vous y accompagnera, mais quand vous serez dans la cellule du professeur, la porte sera fermée à clef vu qu'il est au secret. Il a, lui aussi, la permission d'aller vous visiter chez vous, mais lorsqu'il y sera, votre porte sera également fermée à clef."
J'étais naturellement très anxieux de rencontrer ce Français si distingué, et dès le lendemain je me faisais conduire à sa cellule. Je rencontrai là un des hommes les plus charmants qu'il soit possible de connaître.
Le professeur Henri Marteau est un homme d'environ 45 ans. Il a en tout l'apparence d'un vrai artiste: son maintien, sa parole, ses gestes, tout chez lui porte un cachet artistique du meilleur aloi. Voici, en somme, ce que m'a raconté, au sujet de son aventure, le brave professeur.
Au début de la guerre, il enseignait le violon au conservatoire de Berlin. Sa qualité de sujet français lui valut d'être interné à Holzminden, où se trouvait le camp d'internement des civils de nationalité française. Après quelques mois de captivité, il fut remis en liberté sur l'ordre exprès de l'empereur, et revint à Berlin.
Monsieur Marteau avait épousé une Alsacienne. Comme toutes les habitantes de cette province, ses sympathies étaient acquises à la France.
Le professeur et Madame Marteau étaient recherchés par la meilleure société de la capitale de l'Allemagne. Quelque temps après l'entrée de la Bulgarie dans la guerre, du côté de l'Allemagne, au cours d'une réunion dans le grand monde, Madame Marteau avait carrément exprimé son mécontentement de voir la Bulgarie se ranger avec les ennemis de la France.
Ces paroles de Madame Marteau, ayant scandalisé les oreilles teutonnes, furent immédiatement rapportées à l'autorité militaire. Le lendemain ou le surlendemain, deux détectives se présentaient à la résidence du professeur avec l'ordre de l'interner de nouveau ainsi que Madame Marteau. Madame Marteau fut enfermée dans une prison destinée aux femmes, et lui-même fut amené à la Stadvogtei, et mis au secret.
Lorsque nous posions au professeur la question suivante:—"Comment se fait-il que vous, professeur au conservatoire de Berlin, on vous ait interné?" Il répondait, avec un fin sourire dans lequel il était impossible de lire un reproche:—"C'est à cause de ma femme"... C'était, comme s'il nous eut dit:—"J'ai une femme qui parle hardiment, mais tout doit lui être pardonné, car c'est l'amour de la France qui déborde chez elle!"
Le lendemain de cette première visite, invité à venir de notre côté, le professeur arrivait à ma cellule accompagné d'un sous-officier qui, obéissant aux instructions formelles qui lui avaient été données, fermait la porte à clef sur nous. Le professeur avait apporté avec lui son merveilleux instrument. On lui avait donné la permission de faire de la musique dans sa cellule, et c'est cette délicieuse musique qui avait charmé nos oreilles les jours précédents.
A ma cellule, il nous joua du Gounod, du Bach, etc., etc., et nous tint sous le charme plus d'une heure. Nous avions beau être anti-boches, enfermés dans une prison de Berlin, la musique des maîtres allemands nous ravissait tout comme celle des maîtres français ou autres. L'Allemagne a produit beaucoup et de très grands musiciens, cela est indéniable. Ce serait une erreur grave de croire que ce pays est exclusivement peuplé de ces junkers prussiens bottés, sanglés et éperonnés. Les Polonais, férus de musique, comme tous les Slaves d'ailleurs, étaient à leurs fenêtres, captivés par les sons de cette musique enchanteresse. A la fin de chaque morceau, c'était un tonnerre d'applaudissements, auxquels se mêlaient quelques bravos. Cela fit sensation.
Le lendemain vers la même heure, alors que le professeur était encore à ma cellule, nous charmant de sa belle musique, la porte s'ouvre et le sergent-major fait irruption en coup de vent. Sans se donner la peine de rendre le salut gracieux qui lui est fait par le professeur, il s'écrie à la prussienne, c'est-à-dire d'une voix de tonnerre;—"Vous n'avez pas la permission de jouer ici!" Il se retire comme il était venu, et la porte se referme. Il est inutile de rapporter ici les remarques que nous avons échangées au sujet de procédés aussi incivils à l'égard d'un homme aussi distingué et aussi poli que le professeur Marteau.
Ce brave homme était père de deux charmantes fillettes respectivement âgées de quatre et de cinq ans.
Or, durant ses trois mois de réclusion à la Stadvogtei, et malgré ses instances réitérées, la Kommandantur refusa catégoriquement de laisser ces fillettes rendre visite à leur père ou à leur mère.
Quelques mois plus tard, le professeur recouvrait un simulacre de liberté. On lui permit d'aller habiter un village du Mecklembourg, où il devait chaque jour faire acte de présence à la mairie, mais il lui était absolument interdit de franchir les limites de la commune.
Nous avons bien des fois fait part au professeur Marteau du bonheur que nous éprouverions de le voir visiter le Canada et les États-Unis après la guerre, et nous n'avons pas hésité à lui prédire le plus grand triomphe artistique qu'il soit possible d'imaginer, même pour un homme de son immense talent.
Deux prisonniers également très intéressants que nous avons eus comme compagnons, l'un pendant trois mois, et l'autre pendant cinq mois, furent M. Kluss et M. Borchard, députés socialistes au Reichstag. Nous avons moins connu M. Borchard que M. Kluss. D'abord, il fut moins longtemps avec nous, et il fut au secret la plus grande partie du temps.
Nous avons toutefois gardé de cet excellent député allemand un bon souvenir, et en plus la copie d'une lettre qu'il avait adressée à l'empereur. Cette lettre, véritable chef-d'oeuvre, est le résumé de tout ce qu'un homme talentueux, et de sa nuance politique, peut accumuler d'arguments contre le système de gouvernement autocratique tel que pratiqué en Allemagne. J'ignore si c'est cette lettre qui lui valut plus tard son élargissement.
Quant à M. Kluss, il fut notre compagnon de captivité pendant beaucoup plus longtemps. Plus ou moins lié avec tous les prisonniers, il errait nonchalamment d'une cellule à une autre pour le plaisir de causer, et sa conversation était des plus intéressantes. C'était un homme très instruit, érudit même. Nous avons bien des fois, et durant de longues heures, causé avec lui des institutions politiques de l'Allemagne.
Durant la captivité de cet intéressant député, il s'est passé un incident qui mérite d'être relaté. Nous avions chaque année, à la prison, la visite du général Commandant de la ville de Berlin. A cette époque, c'était le général Von Boehm, un homme d'environ 70 ans, et sourd comme un pot.
Le général nous était arrivé au cours de la matinée, entouré de ses myrmidons, c'est-à-dire un colonel, une couple de majors, quelques capitaines, et quantité de lieutenants. Leur approche nous était signalé à l'avance par un imposant cliquetis de fourreaux, d'épées et de sabres, faisant résonner les marches des escaliers et le parquet des corridors. Le général s'arrêtait à la porte de chaque cellule et demandait:—"Avez-vous à vous plaindre?"
A cette question, je répondis comme suit:—"J'ai à me plaindre d'être interné quoique médecin. Je ne cesse de demander ma mise en liberté..." Il me dit:—"Très bien!" et continua son chemin.
Ainsi qu'il est dit, plus haut, la même question était posée à chaque cellule. La plupart des prisonniers ne disaient rien, mais lorsqu'il s'en trouvait un qui disait:—"Oui, j'ai à me plaindre", le général ajoutait:—"Rendez-vous dans la cour." Lorsque la tournée par tous les corridors fut terminée, il se trouva bien une dizaine de prisonniers ayant répondu affirmativement, rendus dans la cour. Parmi eux se trouvait le député socialiste Kluss, qui, va sans dire, avait répondu affirmativement à la question.
Le général, son inspection terminée, se rendit dans la cour, suivi de sa camarilla, et invita chacun des prisonniers à parler. Intimidés, tous demeurèrent silencieux à l'exception du petit député socialiste qui s'avance au milieu de la cour et commence un réquisitoire formidable contre les autorités militaires allemandes et contre les règlements arbitraires dont il est victime. Kluss sait très bien que le général Von Boehm est sourd. C'est pour lui une excellente raison d'élever la voix. Aussi nous assistons à une vraie harangue de tribune, prononcée d'une petite voix nasillarde niais très prenante.
On imagine combien nous étions tous amusés de cet incident dont nous pouvions être témoins en regardant à travers nos fenêtres. Le général écoutait, paraissait entendre, et faisait de la tête quelques petits signes affirmatifs. Au cours de sa harangue, Kluss fit une remarque des plus blessantes à l'endroit de l'autorité militaire allemande, comparant les méthodes employées contre lui aux méthodes les plus barbares du moyen-âge. Un officier qui, lui, n'était pas sourd, «tenta de lui imposer silence, mais rien ne pouvait arrêter le tribun lancé au plus fort de son éloquence. Il ignora la protestation de l'officier et continua sa harangue.
Quand il eut fini, le général qui, évidemment, n'avait rien compris, dit simplement:—"Ah! oui! Très bien!..." puis se disposa à se retirer. Kluss, ne voulant pas lui permettre de s'éclipser ainsi, se lança à sa poursuite en criant:—"Quelle réponse me donnez-vous? Une réponse, s'il vous plaît!..." Le général, s'apercevant qu'il est de nouveau apostrophé, se retourne et dit:—"Ah! oui! Très bien!" Il rentre, cette fois dans l'intérieur de la prison, et nous ne l'avons plus revu. Kluss était furieux. Il reçut les félicitations de tous ceux qui, tout en étant sujets allemands, se considéraient comme les victimes d'une injustice flagrante de la part de leur gouvernement.
Kluss, entre parenthèse, était un fervent admirateur de Herr Karl Leibknecht. Il mourut quelques mois seulement après son élargissement.
Ces deux noms de prisonniers rappellent à mon esprit un des épisodes les plus tragiques de ma vie de prisonnier. Maclinks était déjà à la Stadvogtei quand j'y arrivai, en juin 1915. La porte de sa cellule indiquait qu'il était sujet britannique. Il parlait parfaitement l'anglais. Il prétendait avoir habité Vienne pendant de longues années à titre de correspondant du London Times.
Selon toutes les apparences, Maclinks était un loyal sujet britannique. Il était très bien vu dans les cercles anglais. Il recevait beaucoup d'Anglais dans sa cellule et allait leur rendre visite à son tour. Il ne manquait certainement pas de talent et d'intelligence.
Vers la fin de 1915, arrivait à la prison un jeune homme également de nationalité anglaise et nommé Russell. Russell avait été arrêté à Bruxelles où il habitait. Dès son entrée en prison, il se lia d'amitié avec Maclinks. Ils étaient presque toujours ensemble. Un bon jour, ou plutôt un mauvais jour, on vînt prévenir Russell qu'il devait partir immédiatement pour une destination inconnue. On ne lui permit pas de mettre ordre dans ses papiers, il devait prendre son pardessus et sa casquette et suivre le sous-officier qui l'attendait à la porte. Il nous est enlevé dans l'espace d'une minute. Cet incident créa une vive sensation au milieu de nous tous. De quoi pouvait-il s'agir?... Pour quelles raisons venait-on ainsi chercher Russell, et sans aucun avis préalable?... Ce qui augmentait encore nos appréhensions, c'est qu'au bas du dernier escalier on avait remarqué deux sentinelles armées, avec casques à pointe, qui s'étaient emparé de lui et l'avaient conduit hors de la prison.
Ce même jour, le capitaine Wolff, un des officiers de la Kommandantur, était venu à la prison et l'on savait que Maclinks avait eu une entrevue avec lui. Nos soupçons se portèrent unanimement sur Maclinks. Pourquoi? Pour une infinité de raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici. Tous les Anglais cessèrent leurs rapports avec lui. M. Kirkpatrick fut le seul d'entre nous qui continua à lui adresser quelques rares paroles.
Croyant peut-être que Kirkpatrick demeurerait toujours son ami malgré tout, Maclinks lui fit, quelques jours plus tard, une confession: il lui montra une lettre qui n'était que la copie de celle qu'il disait avoir adressée aux autorités militaires. Kirkpatrick prit connaissance de cette lettre, et, monstrueuse réalité, c'était une dénonciation formelle de Russell: il y était dit que Russell avait servi, en Belgique, comme espion aux gages du gouvernement anglais.
Étonnement et indignation de Kirkpatrick. Maclinks, sans attendre les remarques que pouvait lui faire Kirkpatrick, lui expliqua, comme pour se justifier, qu'en sa qualité d'officier de réserve autrichien (!) il ne pouvait se soustraire à son devoir, et que c'était pour obéir à sa conscience qu'il avait dénoncé Russell. On conçoit aisément l'état d'âme dans lequel se trouva M. Kirkpatrick. Il se leva et menaça Maclinks de le frapper s'il ne sortait pas immédiatement de sa cellule.
Cet incident, qui fut connu immédiatement par toute la prison, y créa une atmosphère que je ne saurais décrire. Ce soir-là, tout, était lugubre autour de nous: nous ne savions vraiment de quel côté regarder. Il nous semblait que chaque cellule recelait un ennemi. Une pareille affaire ne pouvait-elle arriver, un jour ou l'autre, à chacun de nous? Le spectre des oubliettes et la perspective d'une exécution sommaire nous hantait horriblement. La position de Maclinks, que nous considérions comme un véritable espion, devint intenable, et il dut demander un changement. Quelques semaines plus tard, il sortait de la prison pour n'y plus revenir.
Il y a ceci de particulier en Allemagne,—terre classique de l'espionnage,—c'est qu'on se défie formidablement de tous ceux qui ont pu, occasionnellement, servir d'espions au service même du pays.
Maclinks, il est vrai, sortit de la Stadvogtei, mais des renseignements précis qui nous vinrent du dehors nous apprirent, par la suite, qu'il était loin d'être en liberté. L'officier de réserve autrichien doit être utilisé pour faire le tour des prisons de l'Allemagne.
Quant à Kirkpatrick, le plus âgé de nous tous, il demeura, malgré ses hésitations au sujet de Maclinks, toujours fort respecté et profondément estimé: tous le considéraient comme un sage et un philosophe. Son humour écossais était du meilleur aloi. Nous voyait-il attablés, deux ou trois, avec du boeuf en conserve et du pain devant nous, qu'il s'écriait:—"Je ne puis comprendre en vérité comment il est possible en bonne humanité de se livrer à un tel luxe de table lorsque le pauvre peuple allemand de cette ville est martyrisé par la faim! Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes ici à purger une sentence mille fois méritée?..." C'est ce même Kirkpatrick qui, un 31 décembre, alors que nous lui demandions comment il espérait franchir le seuil de la nouvelle année, nous répondit simplement:—"Vous entendrez parler de moi avant demain!" Que voulait-il dire? Nous l'ignorions entièrement. Nous n'avons pas été longtemps sans le savoir, car un peu plus tard, à minuit, alors que les cloches de l'église la plus voisine lançaient à tous les échos les douze coups, signal de la nouvelle année, une fenêtre s'ouvrit dans l'obscurité et une voix de stentor entonna le Rule Britannia!!!
La chanson patriotique était à peine terminée qu'une autre fenêtre s'ouvrit, celle du sous-officier de service qui, avec force cris et jurons, commanda de faire silence. Le lendemain, lorsque certains de mes compagnons se présentèrent à ma cellule, je leur posai à chacun la question suivante:—"Est-ce vous qui avez chanté Rule Britannia, la nuit dernière?" Tous, invariablement, répondaient:—"Non." Kirkpatrick lui-même fit son apparition vers les 9 heures. Il avait tout-à-fait le même air que de coutume, et il nous fit ses souhaits de bonne année. Faisant allusion à l'incident de la nuit précédente, je lui demandai s'il n'avait pas chanté. Il répondit d'un petit signe de tête négatif, avec un sourire qui en disait fort long sur sa culpabilité. Nous étions justement à dire, entre nous, qu'il serait préférable de faire le silence autour de l'incident, lorsqu'un sous-officier se présente et demande à chacun de nous, à l'exception toutefois de Kirkpatrick, si nous n'étions pas l'auteur de ce qui était arrivé durant la nuit. Chacun en répondant la franche vérité, pouvait nier positivement. On interrogea tous les Anglais, l'un après l'autre, de cellule en cellule. C'était la même réponse partout. Le seul auquel on ne se hasarda pas à poser la question fut Kirkpatrick dont l'apparente gravité ne pouvait prêter aux soupçons. Nous en avons beaucoup ri!
Un des cas d'internement qui fera le plus de bruit, après la guerre, sera certainement celui de M. Hintermann, un Suisse. En mentionnant ce cas dans une publication du genre de celle que je fais en ce moment, je dois garder une certaine réserve et m'abstenir de livrer au public certains détails qui jetteraient une lumière trop vive sur les agissements de quelques employés du Ministère des Affaires Étrangères en Suisse.
M. Hintermann était suisse de naissance. Il n'avait jamais renoncé à sa nationalité en ce sens qu'il n'avait jamais été naturalisé dans un pays étranger. Il habitait Londres avec sa famille et était en relations d'affaires avec une firme importante de cette ville.
Venu en Suisse au cours de l'été 1915, pour certaines affaires, il décida de se rendre à Berlin. Il lui fallait pour cela un sauf-conduit signé par le ministre allemand à Berne. Il obtint ce sauf-conduit sans la moindre difficulté, mais son départ pour Berlin, qui devait être fixé, naturellement, par le ministre allemand, fut retardé de quelques jours. Enfin, M. Hintermann put quitter la Suisse sur un train à destination de Berlin, mais à la première gare sur le territoire allemand, il fut appréhendé au corps par deux casques à pointe. On l'emmena dans la gare, et là, M. Hintermann, en promenant ses regards un peu partout, remarqua sur la table du chef de gare une dépêche venant de Suisse le concernant. On l'emmena à Berlin où il fut enfermé dans la prison de la rue Dirksen. Nous étions là.
Sur la porte de sa cellule, on avait écrit: H. Hintermann, englander, c'est-à-dire sujet britannique. Ce ne fut pas long avant que M. Hintermann eût rayé le mot englander et y eût substitué la désignation correcte de sa nationalité qui était suisse. On changea plusieurs fois la carte servant à le désigner, et qui était collée sur sa porte, mais le mot englander y était toujours mystérieusement effacé et remplacé par le mot propre.
J'ai connu M. Hintermann intimement. Je sais qu'il n'a jamais été naturalisé en Angleterre, mais le gouvernement suisse et le gouvernement allemand ont été mis sous l'impression, facilement je dois le dire, qu'Hintermann était devenu sujet britannique. Il ne m'est pas permis de dire, du moins en ce moment, par quels procédés le gouvernement suisse et le gouvernement allemand ont été mis sous cette fausse impression.
Durant les trois ans que j'ai connu M. Hintermann, je puis affirmer qu'il n'a cessé de réclamer sa mise en liberté, et qu'il a maintes et maintes fois mis le gouvernement suisse et le gouvernement allemand en demeure de démontrer qu'il était sujet britannique. La seule réponse catégorique qu'il ait jamais reçue, à ce sujet, de la Légation Suisse à Berlin, fut que le ministère des Affaires Étrangères d'Allemagne était pertinemment renseigné, et qu'il possédait dans ses archives la preuve documentaire que M. Hintermann avait été naturalisé en Angleterre. M. Hintermann a toujours taxé de fausseté ces prétendus documents.
Je ne saurais en dire davantage, mais il est certain que cet internement d'un sujet neutre, d'un des hommes les plus braves et les plus honorables que j'aie connus, internement qui n'avait pas encore pris fin lors de mon départ d'Allemagne, et qui a causé, tant au point de vue de la santé qu'au point de vue de la finance, un tort incalculable à celui qui en a été victime, aura une certaine répercussion dans le monde politique après la guerre.
M. Hintermann était un homme d'une très grande valeur. Il était estimé et vénéré de tous les prisonniers. Dans notre petit monde, dont la grande majorité était composée de miséreux, il a déployé envers tous une charité inlassable. Parlant également bien l'anglais, le français et l'allemand, il était en état de se mettre au courant des misères et des souffrances des prisonniers de quelque nationalité qu'ils fussent.
Tous ceux qui l'ont connu, au cours des trois années qu'il a passées à la Stadvogtei, garderont un bon souvenir de son grand coeur et de sa belle intelligence.
Le sujet des déportations belges a fait les frais de nombreuses polémiques dans la presse mondiale, pendant un certain temps, et je ne saurais ajouter rien de nouveau à tout ce qui s'est dit. La presse allemande a concédé, avec hésitation et répugnance, que des déportations de Belges en Allemagne avaient eu lieu. Les faits, toutefois, crevaient tellement les yeux qu'il eut été impossible de le cacher plus longtemps.
Nous avions, à la prison, un grand nombre de ces déportés qui avaient refusé de travailler... pour le roi de Prusse. D'autres ayant accepté du travail afin d'améliorer la position pénible dans laquelle ils se trouvaient placés au camp de Guben, étaient si maltraités et si mal nourris, qu'ils quittaient tout bonnement leur usine ou les puits de mine de charbon. Ils étaient alors amenés à la Stadvogtei.
Nous en avons eu des quantités. Je ne saurais passer sous silence le cas d'un Belge nommé Edouard Werner. Werner était un homme de 25 ou 26 ans, doué d'un physique très remarquable: il était très grand et très fort. Avant la guerre, il habitait Anvers où il était à l'emploi de la compagnie du Pacifique Canadien qui a un bureau dans cette ville.
Son père et sa mère étaient allemands; lui-même était né à Anvers, mais à l'âge de 18 ans il avait opté pour la nationalité belge. Il avait satisfait à toutes les lois du pays au point de vue militaire. Il n'était pas enrôlé dans l'armée belge, mais il était porteur de papiers établissant son exemption.
Anvers, comme on le sait, était occupée par les Allemands depuis le 9 octobre 1914. Quelques mois plus tard, Werner reçut un avis d'avoir à se rapporter au commandant d'un district militaire de Westphalie. Il refusa de se conformer à cet ordre, malgré les instances de sa vieille mère qui, allemande elle-même, aurait voulu voir son fils dans les rangs de l'armée du Vaterland.
Après deux mois, un second avis lui était adressé, lui enjoignant de se rapporter sans délai au commandant de ce même district militaire dont il est fait mention dans le paragraphe précédent. Werner, malgré les supplications de sa mère, refusa encore de se rendre. Enfin, un dernier avis lui fut envoyé avec menace de mesures de rigueur à son endroit s'il n'obtempérait pas.
Plutôt pour ne pas affliger sa vieille mère que par crainte des menaces qu'on lui faisait, Werner décida de se rapporter mais il se munit, avant son départ d'Anvers, de tous les papiers d'identification possibles, démontrant sa nationalité belge, et démontrant également qu'il avait satisfait à toutes les exigences de la loi du service militaire belge.
Arrivé en Westphalie, il subit un interrogatoire, naturellement:
—Pourquoi ne vous êtes-vous pas rapporté plus tôt? lui demanda-t-on.
—Parce que je suis Belge, répondit Werner.
—C'est faux! c'est faux! vous êtes Allemand! Votre père et votre mère sont Allemands.
—Je n'y contredis point en ce qui concerne mon père et ma mère, mais quant à moi, j'ai opté pour la nationalité belge, et je suis en possession de tous les papiers le démontrant.
—Laissez voir ces papiers?...
Aussitôt en possession de tous ces papiers, l'officier lui annonce qu'il ne saurait être question de le considérer comme sujet belge, qu'il était dès lors enrôlé dans l'armée allemande, et qu'il doit partir incessamment pour Berlin. Là, on le conduisit à la caserne du fameux régiment Alexander, le plus beau régiment de Prusse,—à ce qu'ils disent,—et dans lequel on n'accepte aucun sujet qui ait moins de six pieds de taille. Werner, pour sa part, avait six pieds et deux pouces.
On lui met l'uniforme, et il commence son entraînement. Comme il possède le français, l'allemand et le flamand à la perfection, on l'emploie au bureau du sergent-major, pour les écritures et la traduction. Il devient plus ou moins populaire parmi les officiers et les sous-officiers. On le croit même sincèrement converti aux idées allemandes.
Peu de temps après avoir été enrégimenté malgré lui, Werner demande un congé pour aller voir ses parents à Anvers. Le major lui répond qu'il est absolument impossible d'accorder un congé pour aller en Belgique, mais que s'il a des parents en Allemagne, on lui permettra volontiers d'aller les visiter. Ce à quoi Werner répondit qu'en effet il avait une tante à Hambourg.
C'était un jour de fête: il devait partir dans la soirée, et dans l'après-midi, revêtu de son uniforme de gala, coiffé de son casque à plumet, il fit une promenade dans la ville avec un compagnon. Il laisse voir a son compagnon son permis tout en exprimant le regret qu'il ne fût pas valable pour aller à Anvers. Son compagnon, après lui avoir enlevé le permis des mains, et en moins de temps qu'il n'en faut à Werner pour déguster sa chope de bière, sort et revient quelques minutes après avec le permis tout transformé: c'est à Anvers et non plus à Hambourg que le porteur du dit permis peut se rendre.
Werner décide donc de prendre le train à destination d'Anvers au lieu de se rendre à Hambourg. Le long du trajet, particulièrement à Cologne et à Aix-la-Chapelle, tous les militaires doivent faire viser leurs permis de voyager. Il est contraire aux règlements militaires, en Allemagne du moins, de voyager en uniforme de gala, excepté dans des circonstances spéciales. On s'étonne à Cologne, on s'étonne à Aix-la-Chapelle de voir notre Werner avec son uniforme de gala, et on lui pose certaines questions à ce sujet.
Il répond qu'il veut faire plaisir à sa mère devant laquelle il ne s'est jamais présenté avec cet uniforme. On le laisse passer. Il arrive à Anvers, visite sa vieille mère qui l'embrasse et,—en bonne Allemande, —affirme qu'elle ne l'a jamais vu aussi beau.
Werner conçoit le projet,—si toutefois il ne l'avait conçu auparavant,—de se débarrasser de son uniforme, de revêtir un habit de civil, et de déserter en se sauvant en Hollande. Pour cela, il lui faut le concours d'un de ses cousins qu'il va visiter à ce sujet. L'affaire est immédiatement arrangée: l'habit de civil lui est fourni, et Werner,-précaution qui surprendra le lecteur,—fait un paquet de son uniforme de grenadier et l'adresse au régiment Alexander, à Berlin. Enfin, dans la soirée, on se met en marche vers Capellen pour, de là, passer la frontière au cours de la nuit si c'est possible.
A Capellen, Werner et son cousin tombent dans un piège. Un espion aux gages de l'autorité militaire occupante les amène dans un certain estaminet. Là, on leur conseille d'aller passer la nuit chez le maire, parce que toutes les chambres sont occupées, et le lendemain ils pourront passer la frontière. La maison du maire était un véritable guet-apens, car elle était occupée par des officiers allemands, ce que Werner et son compagnon ignoraient. Ils étaient tout bonnement pris au piège, et retenus jusqu'au lendemain chez Monsieur le maire. On leur fit alors subir un interrogatoire très minutieux au cours duquel on découvrit, il n'y avait pas à en douter, que ces messieurs désiraient passer en Hollande. On les ramena à Anvers, à la Kommandantur. Le cousin fut examiné le premier et se dégagea facilement; on le remit immédiatement en liberté. Werner se flattait déjà de partager l'heureux sort de son cousin, mais à peine eut-il donné son nom que l'officier l'interrogeant parut songer un peu plus longtemps qu'il ne faut. Il court au téléphone, et revenant après quelques minutes, dit à Werner:
—N'êtes-vous pas Edouard Werner?
—Oui.
—N'êtes-vous pas déserteur?
—Non!
—N'étiez-vous pas d'un régiment à Berlin?
—Oui.
—Et alors, comment se fait-il que vous soyez ici, et en habit de civil?...
Et sans attendre la réponse de Werner, l'officier rugit, écume, donne des ordres à faire trembler tout le monde, et fait jeter Werner en prison.
Peu après, on vient le chercher, à cette prison, pour le faire comparaître tout d'abord devant le commissaire de police allemande qui le menace des plus terribles châtiments, et lui dit, entre autres choses:—"Vous verrez ce que c'est que d'avoir affaire à l'autorité militaire prussienne. Je ne donne pas grand chose pour votre peau!" On le renvoie à la prison, et quelques jours après, il est ramené à Berlin. Là, il est mis dans un cachot, et le lendemain on le fait comparaître devant le major du régiment, ce même major qui lui avait octroyé un permis pour aller à Hambourg. En apercevant Werner, le major est près d'étouffer de rage: il peste, il jure, et il enjoint à Werner de disparaître immédiatement, et de ne revenir devant lui qu'après avoir remis son uniforme.
On trouve dans un coin, à l'étage inférieur, quelques vieux uniformes. Werner en passe un et on le ramène devant le major qui s'exclame, se fâche, frappe la table de ses poings, menace Werner des punitions les plus sévères, et même de le faire coller au mur, et enfin, ayant un peu repris ses sens, il lui demande ce qu'il a fait de son uniforme. Werner répond qu'il l'a renvoyé au régiment.
—Mensonge! Mensonge! reprit l'officier.
—Il est facile d'en faire la preuve dit Werner, demandez si on n'a pas reçu un uniforme renvoyé au régiment?
On s'empresse de faire enquête, et on découvre qu'en effet un colis contenant un uniforme de grenadier est arrivé, quelques semaines auparavant, venant d'Anvers. C'était l'uniforme de Werner.
On renvoie donc Werner en prison en attendant que l'on fasse son procès en Cour martiale. On lui offre un défenseur: il refuse. Traduit devant les juges de la Cour martiale, on le somme d'expliquer sa conduite avant que jugement ne soit rendu contre lui. Werner s'exprime à peu près en ces termes:
"Je suis Belge. En conscience, il m'était impossible de prendre les armes contre mon pays. A la première occasion qui s'est offerte, je n'ai pas déserté l'armée allemande, mais je suis rentré dans mon pays, d'oû j'avais été tiré contrairement aux lois. A mon point de vue, porter les armes dans les rangs de l'armée allemande est un acte de félonie et de haute trahison; je n'ai fait qu'obéir à la voix de ma conscience. Vous pouvez maintenant décider de mon sort: mon plaidoyer est fini."
Les officiers se consultèrent. L'un d'eux dit:—"On ne saurait lui donner plus de quinze ans." On le renvoie à son cachot. Werner attend avec anxiété le jugement que l'on va porter contre lui. Il attend en vain, mais quelques semaines après, on vient le chercher dans sa cellule, et il est amené à la Stadvogtei. C'est là que nous avons fait sa connaissance, et c'est lui-même qui nous a relaté ces divers incidents qui nous ont paru souverainement intéressants.
Il resta à la prison pendant cinq ou six mois, après quoi on le sollicita de nouveau de rentrer dans les cadres de l'armée allemande. Il refusa catégoriquement et enfin, on lui fit tenir un document officiel émanant des plus hauts tribunaux militaires de l'Empire, l'exonérant de l'accusation de désertion qui avait été portée contre lui.
Werner fut alors transféré au camp de Holzminden, et quelques mois plus tard, un prisonnier venu de ce camp, et que j'interrogeais au sujet de Werner, me dit:—"Il y a longtemps déjà qu'il a déserté. Il a même réussi à passer en Hollande, et nous avons appris par correspondance qu'il était dans l'armée belge, combattant ceux qui ont voulu l'enrégimenter de force."
Dans la vie de prison, la question de s'évader est constamment à l'ordre du jour: tous les prisonniers caressent l'espoir de reconquérir leur liberté par force ou par ruse; mais, même parmi les plus audacieux et les plus habiles, il en est peu qui réussissent. Au cours des trois années que j'ai passées à la Stadvogtei, plusieurs évasions sensationnelles ont eu lieu. Il serait trop long d'en entreprendre ici le récit détaillé. Je ne ferai mention que des cas les plus exceptionnels, comme ceux de MM. Wallace Ellison et Eric Keith qui s'échappèrent deux fois du camp de Ruhleben, et une autre fois de la prison même où j'étais.
Au début de la guerre, ces deux Anglais habitaient l'Allemagne. L'un, M. Ellison, était employé de la United Shoe Machinery Company à Francfort. Quant à M. Keith, dont j'ignore quelle fut l'occupation ante bellum, il était, si je me rappelle bien, né en Allemagne de parents anglais.
La première évasion de ces deux prisonniers eut lieu du camp de Ruhleben à peu près vers le même temps mais pas exactement au même moment, chacun agissant de sa propre initiative. Mais tous deux eurent la malchance de tomber entre les mains des gardes prussiennes au moment où ils allaient atteindre la frontière hollandaise. Ramenés à la prison, à Berlin, ils écopèrent une sentence de plusieurs mois de cellule. M. Ellison, en particulier, fut quatre mois et demi au secret, et ne pouvant recevoir d'autre nourriture que celle qui était distribuée chaque jour, laquelle consistait en un morceau de pain avec les deux soupes traditionnelles.
Malgré les démarches nombreuses qu'ils firent auprès des autorités allemandes pour être de nouveau transférés à Ruhleben; ils durent demeurer à la Stadvogtei parce qu'ils refusaient de déclarer qu'ils ne feraient plus aucune tentative d'évasion, une fois retournés a Ruhleben. Pendant les années 1915 et 1916, ils firent des plaintes nombreuses et adressèrent force requêtes tant à la Kommandantur qu'à l'ambassade américaine à Berlin. Tout fut inutile.
Au mois de décembre 1916, une évasion longuement et minutieusement préparée fut mise à exécution de la manière la plus habile. On était parvenu à à se procurer les services d'un serrurier expert, lui-même prisonnier, qui fabriqua une clef ouvrant la porte qui donnait accès à la rue Dirksen.
Tout avait été prévu: ou avait même trouvé moyen d'expédier des vivres au dehors, et de les faire déposer à certains endroits connus seulement des prisonniers qui devaient s'évader. Au moment choisi pour opérer la sortie, onze prisonniers, tous de nationalité anglaise, se promenaient dans la cour par groupes de deux ou trois, comme il était permis de le faire chaque jour, entre cinq et six heures de l'après-midi. Le portier, dont la cellule est voisine de la porte extérieure, était à ce moment occupé à causer avec un sous-officier. La conversation avait pris visiblement un caractère assez intéressant, et les deux Allemands semblaient y être absolument absorbés.
Ce fut à la faveur de cette distraction du portier que la clef libératrice fut introduite dans la serrure par l'un des onze. Un instant suffit pour ouvrir la porte, et les fugitifs disparurent dans les rues de Berlin. MM. Ellison et Keith étaient parmi les fuyards.
Ce fut une grande sensation dans la prison lorsque l'on découvrit, quinze minutes plus tard, que la porte avait été ouverte. Tous les prisonniers furent immédiatement renfermés dans leurs cellules respectives, car c'était là le seul moyen de savoir exactement combien d'internés manquaient à l'appel.
L'officier, qui se retirait généralement vers quatre heures de l'après-midi, avait été prévenu par téléphone, et s'amenait en grande hâte, et tout excité. Son premier geste fut de mettre le portier au cachot: on venait de découvrir qu'il manquait onze Anglais. Le service de la sûreté fut prévenu, et des dépêches furent lancées sur toutes les gares et toutes les frontières d'Allemagne. Le corps entier des policiers et les sentinelles des frontières étaient sur les dents.
A notre grand regret, de ces onze prisonniers évadés, dix furent repris: seul, M. Gibson réussit à se tenir au large. Quant à MM. Ellison et Keith, ils ne tombèrent entre les mains des Allemands qu'une dizaine de jours plus tard, après des marches de nuit épuisantes. La température était alors très froide, et on imagine les souffrances que durent endurer ces prisonniers en route vers les frontières des pays neutres.
Les dix prisonniers capturés furent, les uns après les autres, ramenés à la prison. Les règlements devinrent beaucoup plus sévères, et il ne pouvait être question, pour eux, de retourner à Ruhleben. Toutefois, vers le mois d'août 1917, une convention avait été conclue entre l'Angleterre et l'Allemagne au sujet du traitement à infliger aux prisonniers divers qui avaient essayé de s'évader. Une des clauses de cet arrangement stipulait que tous les prisonniers coupables de tentative d'évasion, et détenus dans les prisons, seraient immédiatement renvoyés dans leurs camps respectifs. Nous avions à peine lu, dans les journaux allemands que nous recevions, soir et matin, les diverses clauses de cet arrangement, que déjà la plupart des prisonniers entrevirent des possibilités nouvelles de conquérir leur liberté. MM. Ellison et Keith me prévinrent que ce ne serait pas long, à Ruhleben, avant qu'ils n'entreprissent le voyage de Hollande.
En effet, dès le mois de septembre, ils s'échappèrent le même jour du camp de Ruhleben, mais séparément, puis se retrouvèrent dans les rues de Berlin, et cette fois,—troisième évasion,—parvinrent à passer en Hollande.
Une carte postale qui me fut adressée par M. Ellison, de Hollande même, me mit au courant, sans beaucoup de détails naturellement, du succès de son entreprise. Ce fut une réjouissance générale chez tous les prisonniers qui avaient été, pendant de si longs mois, leurs compagnons de captivité.
C'est à Londres, au mois de juillet dernier (1918), que j'eus l'extrême bonheur de rencontrer MM. Ellison et Keith, et c'est là également, au cours d'une soirée inoubliable passée ensemble, qu'ils me racontèrent par le menu les péripéties de cette troisième évasion, leur course de Berlin à Brème, de Brème jusqu'à la rivière Ems, puis dans les marécages qui avoisinent la frontière germano-hollandaise, à quelques milles de là, et enfin leur visite, à trois heures du matin, chez un paysan hollandais où ils apprirent qu'ils étaient réellement et définitivement sortis d'Allemagne.
Rien de plus amusant que d'entendre raconter par ces deux ex-prisonniers les scènes de réjouissance qui eurent lieu dans la maison du paysan hollandais. La brave Hollandaise, femme d'une soixantaine d'années, s'était levée, à cette heure extra matinale, pour souhaiter la bienvenue aux deux héros de la poudre d'escampette. On alluma le poêle, on prépara un plantureux réveillon à la fin duquel les deux Anglais dansèrent, avec le vieux et la vieille, le cotillon de la délivrance.
M. Ellison fait maintenant partie de l'armée anglaise et M. Keith est dans l'armée américaine.
M. Keith m'adressait tout récemment de France une lettre dans laquelle il me disait que de la façon dont allaient les choses (à cette époque), il comptait pouvoir, avant peu, pénétrer avec une compagnie américaine dans la rue Dirksen et ouvrir les portes de cette fameuse prison où lui, tout comme moi, avait été détenu des années.
Une autre évasion sensationnelle fut celle d'un Français nommé B... Ce Français, soldat à l'armée, avait été, avec le peloton dont il faisait partie, cerné dès le début de la guerre dans un petit bois près de la frontière française, en Belgique. Pour ne pas tomber entre les mains des Allemands, lui et quelques-uns de ses amis s'étaient réfugiés chez des paysans belges, avaient dépouillé l'uniforme et revêtu un habit de civil.
M. B... avait tenté de passer en Hollande, par le nord. Il fut pris et amené au camp de concentration des Français en Allemagne. Après quelques mois, il parvenait à s'évader de ce camp, avec l'uniforme d'un soldat allemand; il avait même à sa boutonnière le ruban de la Croix de fer. Il fut pincé de nouveau, et jeté dans une cellule à la prison de Berlin. Il y fut tenu au secret pendant des mois, puis il obtint la permission de circuler, comme nous, dans les divers corridors. Il forma le projet colossal de s'évader par le toit, car il occupait une chambre au cinquième.
Les fenêtres des cellules du cinquième sont situées immédiatement sous le toit qui surplombe légèrement, mais n'offre aucune prise à la main. Le plan de notre Français était de scier une des barres de fer de la fenêtre, de sortir par l'étroite ouverture ainsi pratiquée, et de grimper sur le toit. Cette opération, dont je devais être témoin, fut parfaitement exécutée. C'était, il faut l'admettre, un tour de force mirobolant et une véritable réussite d'acrobatie.
Dès le matin, j'avais été prévenu par le prisonnier lui-même qu'il allait tenter son évasion vers onze heures du soir. A l'heure dite, je me tenais debout, sur ma chaise, ayant la tête au niveau de ma fenêtre. Ma cellule se trouvant au même étage que la sienne, je pouvais facilement observer tous les mouvements qu'il faisait au cours de son évasion.
La barre de fer préalablement sciée, fut d'abord écartée de son point d'appui par le bas, ce qui donna l'espace nécessaire pour permettre au prisonnier de sortir. Au moyen d'une serviette solidement attachée aux autres barreaux, il se préservait de toute chute éventuelle qui eut été fatale, puisque sa fenêtre était à soixante pieds au-dessus de la cour inférieure, entièrement pavée.
Il s'était fait un point d'appui au moyen d'une petite planchette qu'il avait glissée, au sommet de la fenêtre, entre les briques et la barre de fer horizontale, à laquelle sont fixées les barres verticales. Cette planchette faisait saillie d'environ un pied en avant du toit. La manoeuvre entière était d'un chic incroyable, et ce ne fut pas long avant que, appuyé d'une main sur la planchette, il pût, de l'autre, atteindre et saisir une gouttière qui se trouvait sur le toit à une faible distance du bord. En un instant, et par un magnifique élan, il allait rouler dans l'obscurité supérieure.
Mais celui qui est sur le toit n'est pas sorti du bois, surtout lorsqu'il s'agit d'un édifice dont les murs ont soixante-quinze pieds de hauteur. Notre Français s'était muni d'une corde d'une soixantaine de pieds de longueur faite de draps de lit et d'autres ficelles tirées de droite et de gauche. Il attacha solidement l'une des extrémités de cette corde au paratonnerre, et se laissa glisser tout du long du mur, puis tomber le plus doucement possible quand il fut au bout.
On ne l'a jamais revu: on n'en n'a jamais entendu parler. S'il eut été repris quelque part, on n'aurait pas manqué de le ramener à la prison. Nous avons tous été d'accord, y compris l'officier commandant, que cette évasion demeure une des plus renversantes qui soient.
C'était au mois de mai 1916: j'étais depuis un an prisonnier à la Stadvogtei. Malgré toutes les démarches que j'avais faites moi-même par l'entremise de l'ambassade américaine, à Berlin, et malgré celles qui avaient été entreprises par le gouvernement anglais et le gouvernement canadien, démarches restées sans résultats,—mes nombreuses suppliques étaient demeurées sans réponses,—je m'étais fait à l'idée que je serais interné jusqu'à la fin de la guerre.
Un soir, après sept heures, alors que les portes de toutes les cellules avaient été refermées sur nous, un sous-officier, employé au bureau de la prison, se présente chez moi disant qu'il est porteur d'une bonne nouvelle:
—Quelle nouvelle?...
—Vous serez libéré!...
—Quand?...
—Après-demain, samedi. Cette nouvelle a été téléphonée, H y a un instant, de la Kommandantur, et j'ai reçu instruction de vous en faire part.
Je n'ai pu m'empêcher de saisir la main de ce sous-officier pour le remercier de la bonne nouvelle qu'il m'apportait. Ma porte n'était pas encore refermée que j'étais monté sur une chaise, appelant de ma fenêtre ceux de mes compagnons de captivité avec lesquels j'étais quotidiennement en relations. Je leur annonçai la bonne nouvelle: je reçois de nombreuses félicitations, et tous semblent heureux de ce qui m'arrive. Le lendemain est grand jour de fête; tous les Anglais partagent ma joie; l'on décide de faire une réunion plénière à ma cellule, et même d'y organiser un déjeuner. C'était en 1916. A cette époque, toutes les victuailles étaient rationnées à Berlin, et nous étions soumis au régime de la prison, c'est-à-dire qu'il nous était absolument défendu de faire venir quoi que ce soit du dehors. Préparer un déjeuner convenable, dans de telles circonstances, n'était pas un problème de mince envergure.
Des invitations, cependant, avaient été lancées: tous les Anglais avaient été priés d'assister à un déjeuner qui aurait lieu le soir au salon(!) No 669, dans l'Hôtel International de la Stadvogtei, pour rencontrer M. Béland à l'occasion de son prochain départ pour l'Angleterre. Ces cartes d'invitation portaient en post-scriptum:—On est prié d'apporter son assiette, son couteau, sa fourchette, sa tasse à thé, son verre et son pain; quant au sel, on le trouvera sur les lieux.
Ma table avait été placée au centre de la cellule, et on l'avait recouverte de petites serviettes en papier. On était parvenu à se procurer un peu de viande en conserve, entreprise qui, à cette époque, tenait du miracle. Va sans dire que le déjeuner fut très gai: il y eut des santés de proposées, des discours très à la hauteur des circonstances, prononcés en réponse aux dites santés, des chansons patriotiques, etc., etc.
L'après-midi de ce jour inoubliable j'avais obtenu la permission de sortir en ville pour aller magasiner. Pour la première fois, après douze mois d'incarcération, il m'était donné de mettre le pied dans la rue. C'était vers la fin du mois de mai; la végétation était luxuriante et les feuillages verdoyants; les plates-bandes regorgeaient de fleurs odoriférantes dans le square voisin de la prison. Jamais la nature ne m'avait paru si merveilleusement belle! J'étais tenté de sourire même aux Allemands,—et aux Allemandes,—qui se pressaient de tous côtés, dans la rue.
Ma promenade avait duré une couple d'heures. En rentrant à la prison, j'appris que mon départ, fixé au lendemain, avait été retardé parce que, disait-on, un certain document n'avait pas encore reçu la signature d'un personnage quelconque faisant partie du haut commandement. Ce ne pouvait être qu'une affaire de formalité, vu que tout était décidé. Force me fut donc d'attendre à la semaine suivante, au mercredi, jour que l'on avait définitivement fixé. Le mardi, j'étais absolument prêt, et mes malles étaient bouclés, quand on vint de nouveau me prévenir que le fameux document n'était pas là, que je devrais attendre encore quelques jours. Naturellement, je fus très ennuyé de ce nouveau retard, et je m'exerçais de mon mieux à la patience depuis deux semaines qui me parurent longues comme deux siècles, quand, enfin, un officier de la Kommandantur, le major Schachian, me fit appeler au bureau. Il venait m'expliquer que la Kommandantur de Berlin avait décidé de me remettre en liberté, et de me permettre de retourner en Belgique auprès de ma famille, et en particulier auprès de ma femme qui, à cette époque, était déjà souffrante depuis six mois, mais... une autorité supérieure avait désavoué cette décision.
On conçoit ma profonde désillusion. Je m'appliquai à faire remarquer à cet officier que j'étais détenu, bien que médecin, et cela en contravention avec toutes les lois internationales; qu'en plus, j'avais à maintes reprises reçu l'assurance, de la part des autorités allemandes à Anvers, que je ne serais jamais molesté; que j'avais pratiqué ma profession, non seulement à l'hôpital, avant la prise d'Anvers, mais encore depuis cette date chez la population civile de Capellen. L'officier n'en disconvenait pas, mais il ajoutait:—"Vous ayez pratiqué la médecine par charité, vous n'avez pas pratiqué régulièrement!" Est-il concevable qu'un homme de sa position puisse faire une remarque aussi saugrenue!... Je n'en revenais pas. Je lui fis l'observation suivante:
—J'ai toujours compris que la liberté des médecins, en temps de guerre, avait été assurée par les ententes et les conventions internationales, parce que le rôle des médecins est de soulager les misères physiques de l'humanité en temps de guerre, et non parce qu'il devait leur être permis de se faire des honoraires.
Voyant qu'il avait mis les pieds dans les plats, comme on dit vulgairement, mon officier tenta d'opérer une retraite en aussi bon ordre que possible. Il était visiblement fort embarrassé: il me quitta sans m'en dire plus long, et je remontai à ma cellule, l'âme toute remplie de l'amère désillusion. Et une autre année toute entière s'écoula avant qu'une amélioration quelque peu substantielle ne se produisit dans mon état de captivité.
J'étais donc depuis deux ans dans cette prison de la rue Dirksen, ne pouvant apercevoir, au dehors, qu'une très petite portion du firmament, et le mur d'en face percé d'une cinquantaine de fenêtres armées de solides barres de fer. Comme il a été dit au chapitre précédent, vers la fin de ma première année de captivité, j'avais eu, un jour, la permission de sortir de la prison, de marcher dans les rues pendant une couple d'heures, et de respirer le libre atmosphère de la cité. Ma santé laissait beaucoup à désirer: je ne pouvais ni manger ni dormir; au moral, j'étais sérieusement déprimé, surtout depuis que j'avais perdu tout espoir de recouvrer ma liberté avant la fin des hostilités. Un jour, le médecin de la prison, M. Bêcher, un très brave homme, vint me rendre visite à ma cellule. Nous avions eu, à maintes reprises, l'occasion de converser ensemble sur des sujets médicaux. Il savait, naturellement, que j'étais appelé auprès des malades pendant les vingt-trois heures où, chaque jour, il était absent de la prison. Il avait même mis à ma disposition sa petite pharmacie. Enfin, au point de vue médical, on peut dire qu'entre lui et moi les relations diplomatiques n'étaient pas rompues.
Il venait donc, cette fois, me rendre visite dans le but de s'enquérir de mon état de santé. Il avait sans doute remarqué que mon apparence générale n'était pas des plus brillantes.
—Comment vous portez-vous?... me dit-il en entrant dans ma cellule.
—Mal!... répondis-je.
—Vraiment, j'en suis fâché! Je remarque, en effet, que vous n'avez pas votre apparence ordinaire de bonne santé.
—Non, je ne dors ni ne mange. Je suis très énervé et je me sens faible et déprimé.
A travers ses lunettes, le vieux praticien teuton me regardait attentivement; il me semblait que je percevais dans son regard une profonde sympathie.
—Mais, dit-il, vous êtes médecin, vous devez peut-être savoir de quoi vous souffrez en particulier?
—Je ne vois pas d'autre chose qu'une privation continuelle, depuis deux ans, d'air pur et d'exercice.
—Mais... vous ne sortez donc pas quand vous le désirez?
—Comment! Voulez-vous dire que je sors de la prison à mon gré?...
—Oui.
—Eh! bien, je ne puis concevoir que vous remplissiez depuis des années les fonctions de médecin de cette prison sans avoir jamais appris que pas un seul prisonnier n'a la permission de sortir dans la rue. Je suis ici depuis deux ans, et la seule occasion que j'aie eue de sortir se présentait il y a un an, alors que j'eus ma permission spéciale d'aller dans les magasins acheter quelques effets. A l'exception de cette unique sortie qui dura deux heures, j'ai été constamment confiné dans ces murs. Vous savez que l'atmosphère de ces corridors est plus viciée qu'on ne saurait le dire, puisque chaque matin des centaines de prisonniers les traversent d'un bout à l'autre, en faisant le nettoyage complet de leurs cellules, et cela après treize heures de réclusion. Et cette cour, où il nous est permis d'aller pendant quelques heures de l'après-midi, vous la connaissez aussi bien que moi: quand on a fait, soixante-dix pas, on a côtoyé les trois côtés du triangle; elle est entourée d'un mur de 75 pieds de hauteur; trente-cinq cabinets d'aisance ouvrent sur elle leurs fenêtres pour opérer la ventilation; il en est de même aussi des cuisines, et en somme, l'air qu'on y respire n'est pas même aussi pur que celui de nos cellules.
Le vieux médecin écoutait tout cela et paraissait fort étonné.
—Eh! bien, dit-il, je suis surpris. Faites une demande aux autorités, réclamez la permission de sortir, et j'appuierai votre requête.
Je crus alors que l'occasion était propice pour moi de dire à ce vieux médecin ce qu'il fallait penser de l'arbitraire des mesures employées contre moi:
—Je vous prie de m'excuser, Monsieur le docteur, mais vous allez me trouver sourd à votre suggestion: il m'est impossible de demander une faveur au gouvernement allemand.
—Pourquoi?...
—Parce que toutes les requêtes justes et raisonnables que j'ai faites ont été refusées,—quand on s'est donné la peine d'y répondre,—et Dieu sait combien de requêtes et de pétitions j'ai adressées à vos autorités depuis deux ans!
—Qu'est-ce que vous avez demandé, en particulier?
—D'abord, j'ai protesté contre mon internement, prétendant qu'il était contraire aux lois de me retenir captif, vu que j'étais médecin. On répondit à cela qu'on n'avait aucune preuve documentaire établissant que j'étais médecin. C'était au début de ma captivité: par l'entremise de l'ambassade américaine, je me suis procuré les certificats, diplômes, etc., tant du Collège des Médecins et Chirurgiens canadien, que de l'université dont je suis gradué, établissant que j'étais bien médecin diplômé, et médecin pratiquant régulièrement ma profession. Ces documents, comme j'en ai été informé au mois d'octobre 1914, ont été remis aux autorités compétentes, ici, à Berlin. J'ai alors réclamé ma liberté; j'ai répété et répété mes requêtes sans autre résultat que de voir, après deux ou trois mois de démarches, un officier de la Kommandantur s'amener à ma cellule où il se contentait de recevoir une déposition établissant pourquoi j'étais venu en Belgique et ce que j'y avais fait, etc., toutes choses que les autorités allemandes connaissaient depuis longtemps. On me faisait signer une procès-verbal insignifiant, et on me quittait presque en se moquant de moi.
Ma femme était malade depuis un certain temps déjà. Pendant des mois et des mois, cette maladie faisait des progrès constants; les nouvelles que je recevais chaque semaine de mes enfants et du médecin m'indiquaient suffisamment que la maladie était fatale. J'ai supplié qu'on me permît de la visiter: on n'a pas daigné répondre à ma demande. Dans les deux dernières semaines de sa maladie, je fus prévenu, par dépêche, que je devais me hâter de me rendre auprès d'elle si je voulais la voir vivante: j'ai assiégé la Kommandantur de demandes quotidiennes pendant tout ce temps, mais toujours sans recevoir de réponse. J'ai offert aux autorités de défrayer les dépenses de deux militaires qui m'accompagneraient de Berlin à Anvers, d'où je m'engageais à revenir dès le lendemain. Cette demande fut encore refusée. On retint ma correspondance; et pendant une douzaine de jours, je fus sans nouvelles de ma famille, en Belgique; après ces douze jours d'angoisses indicibles, un officier venait m'apprendre que ma femme était morte, et lorsque je le pressais d'aller immédiatement auprès de la Kommandantur, afin d'obtenir la permission de m'accompagner jusqu'à Anvers et Capellen, pour assister aux funérailles, il eut pour toute réponse:—Madame est déjà inhumée depuis deux jours!... Vous concevez, M. le docteur, qu'après avoir subi un traitement aussi inhumain que celui-là, il m'est impossible, si je veux garder un certain respect pour ma dignité, de faire aucune nouvelle démarche tendant à obtenir une faveur du gouvernement allemand: on m'a refusé ce qui était juste, je n'ai plus rien à demander!
Le vieux médecin était triste et embarrassé; c'était comme si je lui avais ouvert les yeux sur un côté de cette mentalité allemande qui paraissait lui échapper entièrement. Il hésita quelques secondes, puis me promit tout de même de faire des démarches dans le but de procurer quelque adoucissement au régime dont je souffrais.
Deux jours après, des instructions arrivaient à la prison. On craignait, naturellement, des représailles du côté de l'Angleterre, où l'on savait que ma santé était sérieusement menacée par suite de mon internement. Ces instructions stipulaient que je pourrais sortir, accompagné d'un sous-officier, deux fois par semaine, durant l'après-midi, que ma promenade se ferait au parc, qu'il ne me serait pas permis de parler à qui que ce soit, ni d'entrer où que ce soit, de plus, que le sous-officier et moi nous devrions nous rendre au parc par chemin de fer et en revenir de même.
Je me suis naturellement prévalu de cette permission qui m'était donnée d'aller respirer l'air pur, deux fois par semaine, pendant quelques heures, et cela, je crois, n'a pas peu contribué à me remonter tant au physique qu'au moral.
Quelques semaines après mon entrée en prison, j'étais invité à me rendre au bureau, qui se trouvait au rez-de-chaussée, et là je me trouvai face à face avec un personnage qui m'était entièrement inconnu.
--Je suis, me dit le visiteur, M. Wassermann, directeur de la Banque allemande. Êtes-vous M. Béland?
—Oui, Monsieur.
—Veuillez donc vous asseoir. J'ai reçu, avant-hier, continua-t-il, une lettre d'un de mes amis, un compatriote qui demeure à Toronto. Dans cette lettre, mon ami me dit qu'il vient justement d'apprendre, par les journaux canadiens, que vous étiez interné à Berlin, et il me demande de m'intéresser à vous. Mon correspondant ajoute qu'il n'a pas été ennuyé par le gouvernement canadien. Que puis-je faire pour vous?
—Vous pouvez sans doute me faire remettre en liberté, ce serait un joli commencement.
—Cela, je le voudrais bien, et je ferai tout en mon pouvoir pour vous être utile, mais je ne sais vraiment pas si je réussirai. Puis-je faire quelque chose, en outre de cela?
—Rien que je sache.
—Avez-vous une bonne cellule?...
—J'habite une cellule avec trois autres détenus.
—Vous serait-il agréable d'en avoir une à vous seul?
—Oui, assurément, car je pourrais y travailler beaucoup plus à mon aise.
Après ce court entretien, M. Wassermann prenait congé de moi, et quelques jours plus tard on m'offrait une cellule située au cinquième, c'est-à-dire à l'étage le plus élevé. Là, il y avait une circulation d'air plus considérable, et une plus grande proportion du firmament était accessible à nos regards. C'est cette cellule que j'ai habitée pendant trois ans, le No 669.
La prison était chauffée au moyen d'un système de radiateurs à l'eau, mais durant l'avant-midi seulement. Tout chauffage était abandonné vers les 2 heures après-midi et, généralement, dans la soirée il faisait très froid. Il m'est arrivé assez souvent d'être obligé de me mettre au lit dès 7 heures, au moment où les portes étaient fermées. En utilisant toutes les couvertures disponibles, je parvenais à économiser assez de calories pour ne pas souffrir du froid.
Il nous était permis d'écrire deux lettres et quatre cartes postales par mois. C'est le règlement, qui, en Allemagne, s'applique à tous les prisonniers sans distinction.
Toute lettre adressée à l'étranger était détenue pendant dix jours, mesure militaire. Toute notre correspondance, celle qui partait comme celle qui arrivait, était minutieusement censurée. Durant toute ma captivité, je n'ai jamais reçu un seul journal canadien, bien que plusieurs copies m'aient été adressées.
Des cours de langues,—vivantes,—étaient donnés par des prisonniers chaque jour à la prison. Là, chacun pouvait, suivant son goût, apprendre le français, l'anglais ou l'allemand.
Nous n'avions que très rarement un service religieux, soit protestant, soit catholique. Durant mes trois années de captivité, je ne me rappelle pas avoir été invité à me rendre à la chapelle, située dans une autre division que celle où j'avais ma cellule, plus de deux ou trois fois.
Je surprendrai peut-être un peu mes lecteurs en disant que tous les journaux publiés en Allemagne étaient admis dans la prison sur un même pied d'égalité: qu'ils fussent pangermanistes, libéraux, ou même socialistes de tendance. Mais il nous était défendu de lire ou de recevoir des journaux français ou anglais, bien qu'il nous fût connu, de science certaine, que les grands quotidiens de Paris et de Londres étaient mis en vente tous les jours dans les dépôts de journaux de Berlin.
Cela ne veut pas dire, cependant, que j'aie passé trois années sans lire un seul journal anglais ou français. Il arrivait quelquefois des prisonniers nouveaux qui faisaient leur entrée chez nous avec des journaux de Londres ou de Paris dans leurs poches. Nous avions en outre d'autres petits moyens de nous procurer des journaux des pays alliés.
La fête de Noël est célébrée avec beaucoup d'éclat à Berlin. La veille de Noël, il y avait, à la prison, une petite fête durant la soirée. A cette occasion, on faisait un arbre de Noël,—l'arbre de Noël semble bien être une trouvaille made in Germany dont la mode s'est répandue un peu partout, dans le monde anglo-saxon du moins,—et deux ou trois officiers de la Kommandantur, accompagnés de quelques dames, se rendaient à la prison pour faire une distribution de vivres aux plus nécessiteux.
En 1915, on avait fait une assez bonne distribution de provisions; je veux dire qu'il y en avait assez pour nous permettre de faire un repas. En 1916, on ne pouvait distribuer de vivres, mais on fit cadeau, à chaque prisonnier, soit d'un sous-vêtement, soit d'une paire de chaussettes. En 1917, il y eut bien un arbre de Noël, mais très sec, car on ne distribua rien. La situation économique, à l'intérieur de l'Allemagne, et à Berlin en particulier, était telle qu'il était impossible de faire une distribution quelconque.
Au cours d'une promenade que je faisais au Tiergarten, durant l'année dernière (1917), il me fut donné de voir passer, dans une rue qui longe ce parc, l'idole du peuple allemand à cette époque, le grand général Hindenburg. Il était en automobile, avec un autre officier, et comme j'étais, avec le sous-officier m'accompagnant, sur le bord même de la chaussée, du côté du parc, la figure du célèbre général m'est apparue en pleine lumière. Ce jour-là, en rentrant à la prison mon sous-officier annonça, à coup de trompe, qu'il avait vu, de ses yeux vu: Hindenburg! Les autres sous-officiers le regardaient en ayant l'air de dire:—"Vous vous vantez!" Je dus intervenir pour confirmer son assertion, et je suis sûr qu'à ce moment, moi, simple prisonnier et sujet anglais, je fus considéré comme un des hommes les plus chanceux qui soient, tant ce chef du grand État-Major était entouré de respect, d'admiration et de vénération. Bismarck lui-même, de son vivant, n'a jamais vu son front nimbé d'une pareille auréole.
Le peuple allemand n'est pas démonstratif: il est plutôt taciturne et songeur. Un jour, comme nous étions sur le quai de la gare, attendant le train pour nous rendre au parc, les journaux du midi venaient d'être mis en vente, et tous ces gens les lisaient posément, religieusement, mais sans faire le moindre mouvement indiquant l'impression ressentie au cours de cette lecture. C'était à l'époque de la grande offensive austro-allemande contre l'Italie, en novembre 1917, si j'ai bonne mémoire. Une nouvelle sensationnelle venait d'être publiée: des titres flamboyants annonçaient une grande avance allemande et la prise d'une quarantaine de mille prisonniers. Après avoir pris connaissance de cette dépêche, je me mis à observer les gens qui lisaient dans mon voisinage. Je continuai mon observation au cours du trajet, dans le compartiment que nous occupions, et je n'ai jamais remarqué le moindre sourire de satisfaction se dessiner sur la figure de ces Allemands. Personne ne semblait devoir en causer avec ses compagnons de route. Cela semblait la chose la plus naturelle, ou la plus insignifiante du monde.
Le peuple allemand commençait-il à réaliser que toutes ces victoires remportées par leurs armées depuis trois années ne laissaient entrevoir aucune solution heureuse, ou bien le sentiment de l'enthousiasme s'était-il émoussé chez lui après trois années de luttes, de privations et de sacrifices?... Ou bien encore, entre la bureaucratie gouvernementale, intensément militarisée, et la masse du peuple n'y avait-il plus aucune entente, ni aucun lien de sympathie? Je laisse au lecteur la solution de ce problème.
Je ne me rappelle plus maintenant le nom de cet Américain qui, le premier de sa nationalité, fut interné à la Stadvogtei. C'était un homme maladif. Il nous arriva vers le temps où l'ambassadeur M. Gérard était absent. Cela se passait, je crois, au mois d'octobre ou de novembre 1916. Cet Américain prétendait qu'il n'eût jamais été interné si M. Gérard n'avait pas quitté Berlin. Il nous a souvent exprimé des craintes au sujet de la sécurité de M. Gérard. Il était sous l'impression que l'Allemagne désirait sa perte, et qu'en retournant en Amérique, M. Gérard courait grand risque d'aller au fond de la mer. Il prétendait qu'on le détestait souverainement à Berlin, et qu'on le considérait comme un ennemi des intérêts allemands.
Il ne me semble pas hors de propos de mentionner ici qu'une petite polémique eut lieu, dans les journaux allemands, au sujet de Madame Gérard. Certaines feuilles l'avaient accusée d'avoir ignoré les bienséances jusqu'au point d'attacher la croix de fer au cou de son chien et de s'être promenée, avec son chien ainsi affublé, dans les rues de Berlin. L'affaire fit tellement de bruit, qu'un journal semi-officiel, la Gazette de l'Allemagne du Nord, publia un éditorial à ce sujet. On y disait que les remarques qui avaient circulé à propos de Madame Gérard étaient fausses de toute façon sous tous rapports, et que M. et Mme Gérard, en toutes occasions, avaient été d'une correction irréprochable...
Il se passait rarement un jour sans que l'un des sous-officier de service, à la prison, ne vint près des Anglais internés pour leur faire la question suivante:
—Quand aurons-nous la paix?... A cette question, nous répondions invariablement que nous ne le savions pas. C'était là un moyen, pour le sous-officier, d'entrer en matière puis de prolonger une conversation au cours de laquelle il trouvait le tour de dire que l'Allemagne voulait la paix, mais que l'obstacle était l'Angleterre.
Plusieurs d'entre nous, et en particulier un Belge du nom de Dumont,—qui n'avait pas la langue dans sa poche,—rétorquaient alors:—Mais pourquoi avez-vous donc commencé?... Un jour, le sous-officier protestait, disant que l'Allemagne n'avait ni voulu ni commencé la guerre. Alors Dumont, anti-boche enragé, et violent dans la manière de s'exprimer, se mit à crier:—Vous avez raison, vous avez mille fois raison, ce n'est pas l'Allemagne qui a commencé, c'est la Belgique!!! Éclat de rire général! Le sous-officier, confus et confondu, tourne les talons et quitte la cellule.
Le 19 avril 1918 restera pour moi une date mémorable. Je venais d'être prié de me rendre à la Kommandantur: un sous-officier, qui avait reçu l'ordre de m'y accompagner, m'attendait au rez-de-chaussée. De quoi pouvait-il s'agir?... On avait eu maintes fois l'exemple de prisonniers appelés à la Kommandantur, qui n'étaient jamais revenus chez nous mais avaient été transférés dans une autre prison. Je pouvais être un peu inquiet, mais il n'y avait pas à hésiter, surtout quand il s'agissait d'un ordre donné par l'autorité militaire.
En sortant de la prison, j'entamai avec le sous-officier une conversation un peu vague.
—Mais, me dit-il, savez-vous pourquoi vous êtes appelé à la Kommandantur?...
—Oui, lui répondis-je.
—Qu'est-ce? dit-il.
—Je vais être libéré!...
—Eh! bien, c'est cela, mais je vous prie de n'en pas desserrer les dents, car je serais fortement réprimandé, et même puni pour vous avoir communiqué cette nouvelle moi-même.
C'était la première fois que je me rendais à la Kommandantur. Je fus introduit dans une certaine pièce, où je me trouvai en présence d'un officier, le capitaine Wolff, le même qui venait à la prison, de temps à autre, recevoir les dépositions des prisonniers. En tout ce qui regardait l'administration de la prison, c'est-lui qui semblait faire le chaud et le froid. Cet homme a laissé un souvenir peu enviable chez tous les Anglais qui ont été mes compagnons de captivité. Quant à moi, je lui pardonnerai difficilement d'avoir ignoré et laissé sans réponse des douzaines et des douzaines de suppliques que je lui ai adressées pendant trois années.
Il était là, me regardant et ne disant mot.
—Bonjour, Monsieur, lui dis-je.
—Bonjour!... Je vous ai fait venir pour vous apprendre que vous serez bientôt libéré.
—Quand?...
—La semaine prochaine.
—Quel jour?...
—Jeudi.
—Au moins, est-ce que c'est bien certain?...
—Comment?...
—Je vous demande si, cette fois, ma libération est bien certaine?
—Pourquoi me demandez-vous cela?... Puisque je vous le dis. Puisque c'est décidé!...
—Eh! bien, je me rappelle qu'il y a deux ans vous m'avez communiqué, à la prison, une nouvelle semblable à celle-ci, et cependant je suis demeuré pendant deux ans encore votre pensionnaire.
Il promena vaguement son regard du côté du plafond, sembla chercher dans son passé s'il n'avait pas quelque chose à se reprocher, puis, avec un léger sourire, il admit que c'était vrai, mais qu'en vérité, cette fois-ci, il était question d'un échange entre moi et un prisonnier allemand, en Angleterre.
Les conditions avaient été arrêtées, et l'échange devait se faire incessamment. Je n'avais rien à ajouter si ce n'est de lui témoigner la satisfaction que j'éprouvais de sortir enfin de l'Allemagne. A une question que je lui posai il me répondit que ma qualité de député au parlement et de conseiller privé était cause de ma longue détention.
Il ajouta que tous les documents, papiers, catalogues, livres, correspondances, etc., etc., imprimés ou manuscrits, qui pourraient m'être utiles et que je désirais apporter avec moi devraient être soumis à la censure à Berlin.
De retour à la prison, je me mis donc à faire un triage de mes paperasses, livres et lettres reçues pendant ma captivité. J'en fis un paquet assez volumineux que j'envoyai au censeur. Tout cela fut minutieusement censuré, placé sous enveloppes soigneusement scellées et paraphées, et me fut renvoyé à la prison.
Cela se passait un samedi; le lundi suivant, le premier lieutenant Block, qui commandait à la prison, arrivait à ma cellule en toute hâte, me disant:
—J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement allemand vous fait offrir, par mon entremise, de passer en Hollande par la Belgique, afin de vous donner le plaisir et l'avantage de rendre visite à vos enfants qui demeurent près d'Anvers. On attend de vous une réponse immédiate à ce sujet.
—Ma réponse, lui dis-je, sera courte: j'accepte avec remerciements.
Il y avait alors trois ans que j'avais quitté Capellen et je n'avais jamais reçu la visite de ma fille et des enfants de ma femme qui y étaient demeurés.
—Cela prendra bien encore quelques jours, dit l'officier, vu qu'il faut prévenir les différents postes militaires, en Belgique, par où vous devez passer.
—Je n'ai pas d'objection à attendre une, deux ou même trois semaines pour avoir ce précieux privilège de revoir mes enfants avant de passer en Angleterre.
—Je vais communiquer votre réponse au Ministère des Affaires Étrangères.
Trois jours plus tard, ce même officier m'apprenait qu'il avait été choisi pour m'accompagner à Bruxelles et jusqu'à la frontière de Hollande. Il semblait particulièrement heureux d'avoir été choisi, et quant à moi, je n'avais rien à dire. J'avais eu des relations fréquentes avec cet officier depuis plus de deux ans, et il m'était plus agréable, évidemment, de voyager avec quelqu'un qui m'était ainsi familier, et qui en somme avait uni ses efforts aux miens lorsque j'avais tenté de me rendre au chevet de ma femme mourante.
J'attendis pendant une longue semaine, suivie d'une autre longue semaine, lorsque le même officier se présenta de nouveau, mais avec une figure sombre me laissant assez prévoir qu'une nouvelle tuile allait m'être lancée sur la tête...
—Une mauvaise nouvelle, lui dis-je?...
—Oui, une mauvaise nouvelle, vraiment.
—Je sais ce dont il s'agit: on refuse maintenant de me laisser passer par la Belgique...
—Vous l'avez dit.
Alors, je ne pus réprimer un léger mouvement d'impatience et de contrariété:
—Comment pareille chose peut-elle arriver?... Ne m'avez-vous pas dit que le gouvernement allemand avait décidé de me laisser passer en territoire occupé pour voir mes enfants?...
—Oui, répondit-il.
—Alors, quel est donc ce pouvoir supérieur qui est en position de désavouer une décision prise par le gouvernement?
—C'est l'autorité militaire!!!...
—Eh! bien, lui dis-je, et un peu sèchement, quand partirons-nous pour la Hollande?...
—Aussitôt que vous voudrez.
—Alors, nous partirons ce soir, ou nous partirons demain; enfin, le plus tôt possible.
Le départ fut enfin définitivement fixé au vendredi soir, le 9 mai.
On ne voit pas arriver sans une profonde émotion le moment de quitter une prison où l'on a été reclus pendant trois années, on l'on s'est fait, et où l'on possède encore des amis sincères et dévoués. Un grand nombre de ceux qui avaient été mes compagnons de captivité, pendant ces trois années, avaient déjà quitté la prison, mais il restait encore une dizaine de prisonniers de nationalité anglaise parmi lesquels je comptais, en particulier, trois ou quatre amis qui m'étaient bien chers.
Le jour du départ, vendredi, j'avais obtenu du sergent-major la permission de recevoir dans ma cellule, de 7 heures à 8 heures du soir, tous les prisonniers anglais—on se rappelle que les portes de toutes les cellules étaient fermées dès 7 heures. Mes amis se réunirent donc à ma cellule et nous causâmes, pendant cette dernière heure, des événements de la guerre et de la longueur probable de la détention de chacun. Malgré toute la joie que j'éprouvais à sortir de cet enfer, j'avais le regret d'y laisser plusieurs de ceux avec qui j'avais partagé les ennuis et les privations de la captivité, aux mains de leurs geôliers, privés de liberté, privés de l'atmosphère bienfaisante de la patrie absente.
Le train devait partir à 9 heures, et le départ de la prison même était fixé à 8 heures. A ce moment donc, je me séparai de ces braves garçons, à la porte même de la prison. Nous étions tous sous le coup d'une profonde émotion.
Le train pour la Hollande partait de la gare dite de Silésie. De la prison à cette gare, j'étais accompagné par trois militaires allemands: l'ordonnance, un sous-officier et l'officier qui devait m'accompagner jusqu'à la frontière.
Arrivé à la gare, l'officier me fit part de son intention de réclamer des autorités la jouissance exclusive, par nous, de tout un compartiment. Nous devions passer toute la nuit dans ce train. L'officier eut une entrevue avec le chef de gare, et lorsque le train stoppa, un Monsieur en uniforme bleu,—ce devait être ce chef de gare,—était à nos côtés et s'empressait de mettre à notre disposition un compartiment complet.
L'officier avait dû invoquer, pour obtenir ce privilège, une raison d'Etat: le transport d'un prisonnier de nationalité anglaise en territoire allemand pouvait motiver cette mesure de précaution extraordinaire; les conversations que ce prisonnier anglais entendrait sur le train seraient peut-être compromettantes, et de nature à nuire aux intérêts allemands si elles étaient rapportées en Angleterre?... Quoi qu'il en soit des raisons données par mon officier, le compartiment entier fut mis à notre disposition. Mais afin d'empêcher qu'il ne fut assiégé par les autres passagers, on avait pris la précaution de placer, contre la vitre de la porte ouvrant sur le couloir, un avis conçu en ces termes: Transport d'un prisonnier anglais, et sur une autre ligne, ce seul mot: Gefärlich! dangereux! J'ai lu moi-même ce qui était ainsi affiché à mon sujet, et je n'ai pu m'empêcher d'en sourire.
Un train qui quitte la gare de Silésie, en destination de la Hollande, doit traverser la ville de Berlin et passer en face de la fameuse prison, la Stadvogtei. J'avais été mis au courant de ce fait, et lorsque le train, filant déjà à une assez bonne vitesse, passa en face de la prison, j'étais à ma fenêtre pour laisser tomber un dernier regard sur ces murs gris sombre qui m'avaient séparé, pendant 3 ans, du monde extérieur. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir, au cinquième étage, dans une fenêtre que le nouveau sergent-major,—entre parenthèse, un homme convenable,—avait permis d'ouvrir, mes compagnons de captivité agitant leurs mouchoirs en signe d'adieu.
—Pauvres malheureux, pensais-je!...
Le lendemain matin, à 8 heures, nous arrivions à Essen, la ville fameuse où se trouvent les usines Krupp. Nous devions changer de train, à cet endroit, et il nous fallut marcher pendant quinze ou vingt minutes sur le quai de la gare de cette immense ville. Puis nous prenions le train qui devait nous conduire à la frontière dans le voisinage de laquelle nous arrivions vers midi.
Par suite d'une erreur commise par l'ordonnance dans leur enregistrement, mes bagages furent expédiés à une station frontière beaucoup plus au nord que celle où nous nous rendions. On fit jouer le télégraphe, et l'officier commandant le poste nous encouragea à prendre patience, nous donnant l'assurance que ces bagages seraient de retour le lendemain. Il fallut donc nous résigner à passer la nuit dans ce village.
Ce fut un problème très sérieux que celui de me procurer, le midi et le soir, dans ce petit village allemand de Goch, un repas à peu près convenable, sans être muni de la carte d'alimentation réglementaire. Mais quand on respire l'air à pleins poumons, quand on jouit d'une liberté relative, et que l'heure de la délivrance approche, il est assez facile d'imposer silence à son estomac. Le lendemain, vers midi, mes malles étant arrivées, nous pouvions faire le court trajet supplémentaire de deux ou trois milles pour atteindre la petite station-frontière où je devais subir une certaine inspection.
Ce jour-là, le dimanche 11 mai, j'étais le seul passager à destination de la Hollande. Un train minuscule, composé d'une locomotive et d'un seul wagon, faisait la navette entre le village frontière d'Allemagne et le village frontière de Hollande.
Toutes mes malles, valises, colis, etc., etc., étaient prêts pour l'inspection, régulièrement alignés dans la petite gare de fortune construite à cet endroit.
On avait été averti, ou on avait deviné, que j'étais un prisonnier de nationalité anglaise—oiseau rare en ces parages,—car tous les inspecteurs des deux sexes s'étaient donné rendez-vous autour de mes bagages, et de ma personne. Il y avait des dames: d'ordinaire, on utilise leurs services discrets pour faire les perquisitions chez les passagers du sexe. Elles semblaient n'être venues là, avec les autres, que par simple curiosité, pour orner la scène et égayer l'entrevue.
L'inspection est minutieuse, et je dois le dire, n'est pas faite intelligemment. Le sous-officier qui était chargé spécialement de faire l'inspection de mes bagages s'est révélé souverainement stupide. Dans l'une de mes valises il remarqua un petit calepin couvert en cuir, et portant en petites lettres dorées, repoussées dans le cuir, le mot: Tagebuch, qui veut dire simplement: Journal. Il le mit de côté, apparemment pour le confisquer. Je protestai contre ce procédé, et je lui demandai pourquoi il voulait retenir ce petit cahier qui ne contenait, en somme, rien d'écrit. Le sous-officier me répondit:—"C'est imprimé, et nous avons ordre de retenir tout ce qui est écrit ou imprimé."
Quelle stupidité pensais-je en moi-même! Je lui fis remarquer qu'il n'y avait rien d'écrit, et que le seul imprimé était le titre gravé sur la couverture. Mais cela ne parvint pas à convaincre ce sous-officier obtus qu'il n'y avait aucun danger pour son empire à laisser passer ce mot allemand écrit en lettres dorées.
L'officier Block qui m'accompagnait, et me connaissait très bien, était manifestement ennuyé. Alors je hasardai cette remarque:
—Je regrette énormément ce procédé, car de la façon dont vous y allez, toutes mes chemises, tous mes faux-cols, toutes mes manchettes seront retenus.
Il me regarda et ne parut pas comprendre.
Non, dit-il, non... pourquoi confisquerai-je ces articles?...
—Mais, parce que des mots y sont imprimés: et ce qui plus est, ces mots imprimés sont des noms de firmes anglaises ou américaines!
Mon inspecteur, vexé, embarrassé, rougit jusqu'aux oreilles, prit le calepin, le passa à l'officier Block, sans dire un mot, mais le geste qu'il fit nous indiqua assez qu'il voulait se libérer de toute responsabilité, mais que si l'officier, lui, voulait courir le danger de me remettre le calepin portant un mot imprimé, il était libre de le faire. L'officier n'hésita pas un moment: il me remit le petit cahier, que j'eus la satisfaction d'apporter avec moi.
Un bon nombre de photographies qui m'avaient été adressées, soit de Belgique, soit du Canada, furent retenues, et cependant elles avaient déjà subi la censure ordinaire à Berlin. Un petit nombre d'autres échappèrent à la griffe des perquisiteurs: ce sont celles qu'on trouvera reproduites dans cet ouvrage.
Quant aux autres documents, manuscrits ou imprimés que je parvins à sortir d'Allemagne, j'avais dû, au préalable, c'est-à-dire avant même de quitter Berlin, les soumettre à une censure rigoureuse. Ces documents avaient été placés sous enveloppe scellée et visée par le censeur en chef. Ces deux colis de documents, je fus assez heureux de les passer sans examen additionnel.
Enfin, le moment était venu de continuer ma route. La frontière hollandaise était là, à quelques mètres de nous. On replace tous mes bagages dans mon compartiment, l'officier Block me reconduit jusqu'à la porte du wagon, nous échangeons quelques paroles, une poignée de mains, et nous nous séparons... probablement pour toujours.
Je vais ouvrir ici une parenthèse pour rendre à cet officier,—ober-lieutenant Block,—le témoignage qu'à l'occasion du deuil que j'eus à subir, il a fait tout en son pouvoir pour obtenir des autorités les permissions tant désirées. Nos efforts, comme on le sait, sont demeurées sans succès, mais ce n'est assurément pas de sa faute.
M. Wallace Ellison, qui a publié ses mémoires dans le Blackwood Magazine, de Londres, rend le même témoignage à l'officier Block. Ses relations quotidiennes, pendant deux années, avec les prisonniers de nationalité anglaise lui avaient permis de se former une opinion différente de celle qu'il avait eue de nous jusque là.
Le train se mit en mouvement, et à une heure et sept minutes après-midi nous étions en Hollande, à la gare-frontière où, de la fenêtre de mon compartiment, je pouvais apercevoir, à l'intérieur de la gare, les petits douaniers de la reine Wilhelmine!
J'étais libre!!!... Quel sentiment que celui de la liberté après une captivité de trois années!... Il semble que chaque feuille, chaque plante, chaque maison nous sourit!!!... A cinq heures de l'après-midi, j'étais à Rotterdam.
Durant mon séjour de sept semaines dans ce charmant et plantureux petit pays qui s'appelle la Hollande, au cours de promenades nombreuses que j'ai faites à travers la campagne, et dans les bois et les parcs, combien de fois ma pensée ne s'est-elle pas d'elle-même reportée vers cette prison où je venais de passer trois longues années. Comme en un songe fugace, je voyais sans cesse se présenter à mon esprit des bribes de conversations depuis longtemps oubliées, des incidents et des petits faits négligeables que je croyais pour toujours ensevelis dans les recoins les plus sombres de ma mémoire.
J'ai parlé un peu plus haut de l'officier Block, dont j'ai hautement prisé les procédés courtois à mon égard, en certaines occasions. Il ne faudrait pas s'imaginer, toutefois, que chez lui le Prussien était complètement éteint, c'est-à-dire l'officier prussien, un des membres de cette caste militaire, autocratique et intransigeante.
En 1917, on se le rappelle, le kaiser avant lancé une proclamation annonçant la réforme des institutions parlementaires de la Prusse, et en particulier l'uniformité de la franchise électorale pour tous les citoyens. La crainte du peuple est le commencement de la sagesse.
En Prusse, les représentants du peuple sont élus par trois classes d'électeurs, et lors des dernières élections, bien que les démocrates socialistes eussent enregistré un nombre de votes suffisant pour leur donner une représentation d'environ un tiers de la diète prussienne, ils ne comptaient que quelques rares députés.
Le gouvernement de Prusse, pour donner suite à l'édit impérial, avait présenté un projet de loi accordant la franchise électorale aux classes populaires qui en avaient toujours été privées. La majorité du parlement prussien refusa d'adopter cette mesure. Il y eut à ce sujet, une polémique violente dans la presse allemande.
Il y a, en Allemagne, plusieurs journaux à grande circulation que l'on pourrait appeler libéraux, c'est-à-dire favorisant l'établissement d'un gouvernement réellement responsable, non seulement pour l'empire d'Allemagne, mais également pour la Prusse, et qui luttent chaque jour contre les tendances pangermanistes de cette bureaucratie militarisée qui contrôla tout en Allemagne jusqu'au jour de la débâcle. Je pourrais citer en particulier le Frankfurter Zeitung, le Berliner Tageblatt, et le Vossiche Zeitung, pour ne pas mentionner les journaux socialistes comme le Volkszeitung et le Vorwearts.
Nous recevions, à la prison, tous les journaux allemands. J'étais abonné au Berliner Tageblatt et ce journal était toujours sur ma table. J'avais beaucoup d'admiration pour un publiciste dont le nom est bien connu en Allemagne et en France, M. Théodore Wolff. Il avait tant de fois, au cours de ses fins articles, dit son fait à l'autocratie allemande, qu'il était devenu parmi nous, prisonniers, extrêmement populaire. C'était au point que nous nous attendions, un jour ou l'autre, le voir arriver parmi nous. Nous lui eussions fait une réception!...
L'officier Block, lorsqu'il faisait sa visite, ne manquait jamais de remarquer le Tageblatt toujours sur ma table; cela servait de prétexte, entre lui et moi, à un échange de vues et d'opinions sur la situation politique en général et particulièrement sur les projets de réforme électorale en Prusse, très commentés à cette époque.
Comme il a été dit plus haut, la diète de Prusse venait de refuser d'adopter ce projet de réforme. L'officier fit irruption, ce jour-là, dans ma cellule, la figure toute illuminée. Il se gaudissait: il n'avait pas de phrases assez ronflantes pour exprimer sa satisfaction au sujet de ce qui venait d'arriver. La Prusse allait conserver son ancien système, disait-il, le système autocratique qui lui avait valu la prospérité et la grandeur.
Nous, sujets anglais habitant la libre Amérique, dont les ancêtres ont lutté plus d'un demi-siècle contre les coteries administratives de toute espèce, qui nous efforçons aujourd'hui de pratiquer le système représentatif anglais sous sa forme la plus largement démocratique, il nous est difficile de concevoir l'abdication volontaire de toute participation dans l'administration des affaires publiques, par un citoyen de l'importance de l'officier Block.
Voici un professeur, homme de 35 à 40 ans, qui nous confessait n'avoir jamais enregistré un vote,—il s'en glorifiait même,—et lorsque je lui exprimais ma profonde surprise, et que je lui demandais quels pouvaient être les motifs de son abstention, il me faisait, naïvement mais sincèrement, cette réponse renversante:—N'avons-nous pas notre kaiser, qui est en même temps roi de Prusse, pour gouverner efficacement le pays?
Un autre trait qui peint bien l'état d'âme d'un officier prussien. C'était à l'époque où la mort de Lord Kitchener, noyé dans la mer d'Écosse, couvrit d'un voile de deuil toute l'Angleterre. Cette nouvelle, comme toutes les mauvaises nouvelles, me fut apportée par notre officier avec beaucoup d'empressement. On s'étonnera assurément, comme nous nous sommes tous étonnés à la prison, de ce manque de tact.
—Kitchener, dit-il, est noyé!!!...
Cette nouvelle foudroyante m'arracha une expression de regret:
—C'est regrettable, dis-je...
L'officier se redresse, un éclair traverse son regard, et il me dit:
—Nicht fur uns. (Pas pour nous.) Nicht fur uns.
—Je désirerais seulement vous faire remarquer qu'il est déplorable qu'un militaire de la valeur de Lord Kitchener, au lieu de trouver une mort glorieuse sur le champ de bataille, ait péri de cette manière.
—Nicht fur uns! Nicht fur uns!! répétait le Prussien.
Des mois et des mois s'écoulèrent. L'officier avait évidemment oublié ce colloque qui avait eu lieu entre nous au sujet de la mort de Lord Kitchener. Or il arriva à ma cellule un bon matin avec une figure où la tristesse était empreinte:
—Savez-vous la lugubre nouvelle?... Richthofen est tombé!
Richthofen, on s'en rappelle, était le fameux aviateur qui en était arrivé,—au compte de l'Allemagne du moins,—à sa 75ième victoire aérienne.
—Oui, Richthofen est tombé! N'est-ce pas regrettable?
Je n'hésitai pas un instant, et je lui rétorquai:
—Nicht fur uns!
—Comment pouvez-vous dire cela!... Un tel héros qui disparaît!... N'est-ce pas déplorable?...
—Nicht fur uns... fut encore ma réponse.
Je ne savais trop quelle impression produirait chez mon interlocuteur cette franchise avec laquelle j'exprimais mon opinion.
—Pourquoi parlez-vous ainsi?...
—Mais, je n'ai fait que marcher sur vos traces. Lorsque j'exprimai, un jour, mes regrets au sujet de la mort peu glorieuse de Lord Kitchener, qui eût certes mérité beaucoup mieux, vous m'avez répondu en vous servant de ces mêmes mots: "Nicht fur uns!" Aujourd'hui Richthofen est tombé, mais il est tombé dans l'arène où son génie lui avait fait un nom immortel. Il est sans doute regrettable pour l'Allemagne, je le conçois, qu'elle soit désormais privée de ses précieux services, mais vous ne pouvez pas vous attendre que les sujets des pays en guerre avec elle expriment leurs regrets au sujet de sa disparition.
J'ignore dans quelle mesure mon officier apprécia la correction de mon attitude et la justesse de mes remarques, mais à l'instant même il me quitta... à la prussienne.
J'eus, un jour, une discussion assez vive avec le capitaine Wolff, de la Kommandantur de Berlin. Cet officier était conseiller judiciaire de guerre, et occupait, à la Kommandantur, une position très haute et de beaucoup de responsabilité. Il était investi de pouvoirs considérables, et personne ne le sait mieux que ceux qui, contre leur gré, et malgré leurs protestations, furent détenus pendant des mois et des années à la prison de la rue Dirksen.
Il visitait la prison ce jour-là, et il avait daigné m'entendre. C'est une façon de dire qu'il condescendait à répondre personnellement aux innombrables requêtes que j'avais adressées aux autorités depuis quelques mois. Périodiquement, j'entreprenais contre ces autorités ce que l'on pourrait appeler une offensive de liberté. Cette fois, je soumettais au capitaine Wolff,—parlant à sa personne,—que j'avais été arrêté en pays neutre, c'est-à-dire en Belgique; qu'aucun sujet étranger n'aurait dû être fait prisonnier en ce pays, du moins avant que les autorités militaires n'eussent donné à ces sujets étrangers l'occasion de sortir du territoire.
—Mais la Belgique n'est pas, et n'était pas un pays neutre.
—Je ne vous entends pas, lui dis-je.
—La Belgique était devenue l'alliée de l'Angleterre contre l'Allemagne.
—Je vous entends encore moins.
—N'avez-vous pas lu les documents qui ont été extraits des archives de Bruxelles, documents officiels qui sont une confirmation irréfutable de ma prétention?
En effet, la Gazette de l'Allemagne du Nord, journal semi-officiel, avait publié, au cours de l'hiver 1914-1915, une série de documents que l'on disait avoir été trouvés dans les archives de Bruxelles. Ces documents, qui ont dû être publiés dans tous les pays alliés, établissaient qu'une certaine convention avait eu lieu entre un attaché militaire anglais et un officier belge, au sujet d'un débarquement éventuel de troupes anglaises à Ostende.
J'avais pris connaissance de tous ces documents, et j'avais aussi remarqué, en marge de l'un d'eux, une note écrite par l'expert militaire belge, et ainsi conçue:—"L'entrée des Anglais en Belgique ne se ferait qu'après la violation de notre neutralité par l'Allemagne." Cette note enlevait au document tout entier son caractère d'hostilité envers l'Allemagne.
Après la publication de ces documents, des commentaires de source officielle avaient été publiés dans les journaux, et l'on disait entre autres choses que ces pièces, découvertes dans les archives belges, étaient connues des autorités compétentes en Allemagne, avant la déclaration de la guerre.
Je posai donc à M. Wolff la question suivante:
—N'est-il pas vrai que tous ces documents auxquels vous faites allusion étaient connus des autorités compétentes en Allemagne, avant la guerre?...
—Oui, dit-il.
—Alors, comment se fait-il que le chancelier impérial, M. Von Bethman-Hollweg, ait pu faire, le 4 août 1914, la déclaration suivante au Reichstag:
"Les troupes allemandes, au moment où je porte la parole devant vous, ont peut-être franchi la frontière de Belgique et envahi son territoire. Il faut le reconnaître, c'est là une violation du droit des gens et des traités internationaux. Mais l'Allemagne se propose et prend l'engagement de réparer tous les dommages causés à la Belgique aussitôt que les projets militaires qu'elle a en vue auront été réalisés."
On ne se fait pas d'idée de l'embarras où se trouva cet officier. Il essaya de balbutier quelques mots en guise d'explications:—"Il y a aussi, dit-il, que la Belgique a péremptoirement, refusé de nous laisser passer." Les termes et le ton de cette explication indiquaient suffisamment que le capitaine Wolff capitulait.
On a beaucoup critiqué, dans les journaux pangermanistes surtout, cette attitude de Bethman-Hollweg au Reichstag. On disait qu'une telle déclaration était suffisante pour justifier sa destitution dès le lendemain.
Durant les années 1916, 1917 et la première partie de l'année 1918, l'Allemagne possédait un dieu et une idole: le dieu, c'était l'empereur Guillaume, et l'idole, Hindenburg.
On se rappelle que Hindenburg était un général en retraite qui menait une vie paisible à Hanover, lorsque l'empereur le tira de sa vie relativement obscure pour lui donner le commandement des forces allemandes en Prusse orientale. Les Russes occupaient à cette époque une partie des provinces prussiennes de la Baltique. L'empereur, en examinant les thèses faites par les différents généraux allemands, avait découvert que Hindenburg, un quart de siècle auparavant, avait traité, dans la sienne, de l'invasion de la Prusse orientale. Il fit donc mander Hindenburg et lui imposa la tâche de libérer le territoire oriental de l'Allemagne de l'occupation russe.
On sait que Hindenburg s'acquitta de cette tâche victorieusement et qu'il acquit, surtout à la suite de la fameuse bataille de Tannenberg, une renommée qui surpassait celle de tout autre général prussien. Une pression fut alors exercée sur l'empereur par son entourage, dans le but de placer Hindenburg à la tête de l'état-major, et effectivement, par un geste de sa main, l'empereur Guillaume destitua Von Falkenhayn, qui était chef d'état-major, à cette époque, et le remplaça par Hindenburg.
La victoire de Tannenberg fut suivie de plusieurs autres, entre autres celle de Roumanie, et c'est alors que, ne pouvant contenir plus longtemps son enthousiaste admiration pour Hindenburg, la population de Berlin décida de lui élever un monument colossal, dans un endroit public. Ce témoignage d'estime populaire prit la forme d'une statue de bois de 41 pieds de hauteur, construite au bout de l'Avenue de la Victoire, au pied de l'immense colonne dite de la Victoire, laquelle avait été construite après la guerre de 1871, pour en perpétuer le souvenir.
Il m'a été donné à plusieurs reprises, au cours des sorties qu'il m'était permis de faire, durant ma dernière année de captivité, de voir avec quelle vénération on entourait ce monument informe et sans grâce, au centre du Tiergarten. Deux fois par semaine, comme je l'ai dit plus haut, j'allais faire une marche au jardin, accompagné par un sous-officier, et je ne manquais jamais de diriger mes pas du côté de cette statue. Un grand nombre de personnes, plus particulièrement des vieillards et des femmes accompagnés d'enfants, se pressaient au pied de la colonne près de cette statué de bois. On la regardait on l'examinait, on avait l'air d'en admirer et les proportions et les qualités artistiques. Mais ce qu'il y avait de curieux et d'intéressant, c'était le moyen qu'on avait inventé de prélever, au moyen de ce nouveau cheval de Troie, un fonds quelconque de charité. Un échafaudage entourait la statue, échafaudage qui permettait à chacun de monter jusqu'à la tête et de contempler de près les traits sévères de la figure du grand général.
Au bas de cet échafaudage, était installé un contrôle quelconque où l'on vendait des clous et il était loisible à chacun de se procurer un clou moyennant un mark ($0.25). Tout propriétaire d'un clou recevait un marteau et le grand privilège consistait à enfoncer le clou dans la statue. Les enfants, en particulier, adoraient ce sport. Ils se pressaient bruyamment autour de la statue, attendant leur tour, munis chacun dans sa petite main de la pièce d'argent qui devait payer le clou. La cérémonie de l'enfoncement d'un clou revêtait un caractère particulier de patriotisme. Aussi, il fallait voir avec quel orgueil l'enfant redescendait de son opération. Les vieillards et les mères applaudissaient le gamin.
On a ainsi prélevé des sommes considérables, et c'est le cas de le dire, Hindenburg fut littéralement criblé de clous. On pouvait choisir son endroit particulier, les pieds, les jambes, le tronc, les bras ou la tête. J'ai cru cependant constater que pour la tête on se servait de clous à tête de cuivre, du moins à cette époque où le cuivre n'était pas encore si rare en Allemagne.
Les revues artistiques de Berlin ne s'étaient jamais étendues très longuement sur les qualités artistiques du monument. Il était, en vérité, affreux. Mais une polémique s'engagea un jour dans les journaux entre deux sculpteurs qui prétendaient l'un et l'autre avoir été le père de cette idée géniale. Quelle ambition!
Il n'est pas exagéré de dire que la popularité dont jouissait Hindenburg en Allemagne l'emportait visiblement sur la vénération dont on entourait la personne de l'empereur, et même, j'ai entendu plusieurs sous-officiers me dire, confidentiellement, que Hindenburg était beaucoup plus populaire que l'empereur. Cet ascendant que prenait Hindenburg sur l'imagination populaire ne cessait pas d'inquiéter l'empereur lui-même. Aussi, à chaque nouvelle victoire de Hindenburg, Guillaume s'empressait d'accourir sur le champ de bataille et, de l'endroit, il lançait une dépêche à l'impératrice, comme pour faire comprendre à son peuple qu'il était véritablement le génie stratégique responsable du succès. C'était à ce point que lorsqu'une opération militaire se développait favorablement pour l'Allemagne, soit en Galicie, soit en Roumanie, nous savions prédire, un jour ou deux à l'avance, qu'une dépêche sensationnelle serait publiée dans les journaux, venant du kaiser à l'impératrice. Et nous nous trompions rarement.
Parmi les prisonniers de nationalité anglaise détenus à la Stadvogtei, il s'en trouvait un dont on a bien des fois soupçonné les sympathies exagérées pour la cause de l'Allemagne. Il était devenu fort impopulaire et beaucoup d'Anglais refusaient de lui parler ou même d'avoir avec lui quelque rapport que ce soit.
Un jour, toutefois, M. Williamson, dont il a été question dans un chapitre précédent, avait été appelé au bureau pour y recevoir un colis de provisions justement arrivé d'Angleterre. Au bureau, après l'examen de son colis, on le lui remit et on lui demanda d'apporter, chemin faisant au quatrième étage où se trouvait la cellule de cet autre Anglais, un second colis à son adresse. Williamson, qui parlait un peu l'allemand, refusa formellement de se charger de ce colis, en disant au sous-officier de service, et en présence d'autres sous-officiers: "Je n'apporterai pas ce paquet, je ne veux rien avoir de commun avec ce bloody German." Et il disparut avec son propre colis.
L'affaire fit sensation car les sous-officiers rapportèrent cette remarque peu sympathique faite à l'endroit d'un prisonnier. Le lendemain, tous les prisonniers de nationalité anglaise étaient invités à se rendre à une cellule au rez-de-chaussée, et là, l'officier lui-même, en charge de la prison, nous adressa à tous des remontrances très sévères. Il dit en particulier "qu'il n'espérait pas de nous que nous renonçions ouvertement à nos sympathies pour l'Angleterre, mais qu'il ne tolérerait jamais que l'on fît, à l'endroit de l'Allemagne, une remarque désobligeante". Et il citait, en particulier, le cas de Williamson et aussi celui de M. Keith qui, disait-il, "était né en Allemagne, avait profité de l'hospitalité germanique, avait reçu son éducation dans les écoles publiques de l'Empire et qui cependant manifestait, chaque fois que l'occasion s'en présentait, son antipathie à l'endroit de sa patrie d'adoption". Il nous menaça. Ceux qui se rendraient coupables de ces remarques déplacées seraient sévèrement punis.
Cette démarche de l'officier Block indisposa fortement les prisonniers anglais et deux d'entre eux, dont je désire taire les noms, lui organisèrent ce qu'on est convenu d'appeler, en langage vulgaire, une scie.
Par un stratagème des plus habiles, une des clefs passe-partout avait été chipée à un sous-officier. Cette clef pouvait ouvrir toutes les portes à l'intérieur de la prison, mais ne s'ajustait pas sur la serrure de la porte extérieure. Munis de cette clef, nos deux prisonniers conçurent l'idée d'embêter magistralement l'officier lui-même.
On parvenait avec beaucoup de difficultés, il est vrai, mais on réussissait quand même à se procurer, deux fois par semaine, une copie du Daily Télégraph de Londres, malgré la défense expresse d'introduire un journal anglais ou français dans la prison. Ce journal, ai-je besoin de le dire, faisait le tour des cellules des Anglais et quand tout le monde l'avait lu, l'opération était couronnée par une fumisterie de haut aloi.
Au moyen de cette clef, que l'on gardait soigneusement cachée, la porte de l'officier était ouverte, soit durant le déjeûner, alors qu'il était absent, soit durant les dernières heures de la journée, alors qu'il avait déjà quitté la prison, et le Daily Télégraph était placé sur le pupitre.
La deuxième journée, l'officier entra dans une grande colère et plaça un sous-officier à sa porte pendant son absence. On ne fut pas rebuté pour si peu.
Comme j'ai tenté de l'expliquer antérieurement, la partie de la prison que nous habitions était triangulaire. A sept heures, le soir, un sous-officier commençait à fermer les portes: il fermait d'abord un côté du triangle, s'engageait ensuite, après avoir doublé l'angle, dans le second côté. C'est à ce moment qu'un des prisonniers occupant une cellule au troisième côté, encore ouvert, venait subrepticement avec la fameuse clef ouvrir une porte, donner la clef à l'occupant, et retournait en toute hâte à sa cellule. Tout cela se faisait assez vivement et sans que le sous-officier qui fermait les portes à clef pût s'en apercevoir. Il terminait le troisième côté du triangle, il croyait alors que tout le monde était enfermé, puis il disparaissait de la prison.
C'est durant les heures de la soirée ou de la nuit que le prisonnier anglais, porteur du Daily Télégraph et muni de la clef, parvenait à glisser sa copie de nouveau, sur le pupitre de l'officier qui occupait une chambre au bout du corridor. Il revenait à sa cellule et sa porte restait toute la nuit dans cet état. Le matin, le sous-officier commençait à ouvrir les portes, en rebroussant le chemin qu'il avait fait la veille au soir, invariablement. Le même prisonnier, sortant de sa cellule le matin, se hâtait vers le côté du triangle encore enfermé, recevait la clef de celui qui avait fait l'opération nocturne, donnait un coup à la serrure, revenait à sa cellule, en sorte que, lorsque le sous-officier arrivait au dernier côté du triangle, il trouvait toutes les portes encore fermées!
Ce stratagème dura une dizaine de jours et amusa tous les autres prisonniers de la Stadvogtei plus que je ne saurais le dire. L'officier prit toutes les mesures imaginables pour pincer le coupable, mais, heureusement, n'y parvint jamais. Lorsqu'on put constater qu'une sentinelle était placée en permanence à la porte de l'officier durant la nuit, force fut au propriétaire de la clef d'abandonner la fumisterie.
La Turquie fut notablement représentée à la Stadvogtei pendant une couple d'années. Il s'agit ici de deux Turcs: un nommé Raschid et l'autre Tager.
Raschid était un jeune homme, il pouvait avoir 35 ans. Il habitait une cellule à l'étage supérieur et était en claustration. On l'avait coffré parce que, lors de son passage en Allemagne, il avait manifesté ses sympathies trop ouvertement pour la France. Tout comme M. Tager, il avait reçu une éducation française et avait vécu à Paris un grand nombre d'années. Ce pauvre Raschid, au secret tout le jour, n'avait pas reçu la permission de lire ou de fumer, mais plusieurs d'entre nous, mis au courant de sa grande misère, parvinrent à lui passer des livres français, des cigarettes et aussi de la nourriture. Le professeur Henri Marteau, célèbre violoniste, était particulièrement touché des malheurs de Raschid et le grand artiste, qui avait reçu la permission de jouer dans sa cellule, située dans les derniers temps de sa captivité au côté opposé du triangle où demeurait Raschid, se prêtait de bonne grâce chaque soir à tirer de son instrument de merveilleux accords pour soulager l'âme du pauvre Turc au secret.
Une nuit, j'étais appelé auprès de Raschid: il était fort malade. Et comme je causais avec lui en français, je pus obtenir beaucoup de renseignements, sans que le sous-officier y entendît goutte.
Raschid se croyait oublié entièrement par les autorités militaires. A cette époque-là, il avait été renfermé plus de quatre mois et n'avait jamais été capable d'obtenir une raison quelconque de ce traitement inhumain.
Cinq mois environ après sa claustration, il fut conduit au bureau du général Von Kessel, commandant en chef dans les Marches de Brandebourg. Raschid, avec qui je causais le lendemain de cette entrevue, me relatait les incidents de sa conversation avec le grand général. Von Kessel lui avait annoncé qu'il serait libéré bientôt, qu'il repartirait par l'express des Balkans à destination de Constantinople. Il lui posa entre autres la question suivante:
—Depuis combien de temps êtes-vous à la prison?
—162 jours, répondit Raschid.
—Combien de temps avez-vous été au secret? répartit le général.
—162 jours.
Éclat de rire du général.
—162 jours! s'exclama-t-il, mais comment cela se fait-il?
—Je l'ignore, répondit Raschid.
—Voilà qui est curieux! voilà qui est curieux! voilà qui est curieux! dit à trois reprises le commandant en chef prussien.
Sans plus amples renseignements, il renvoya Raschid à la prison. Enfin, quelques jours plus tard, Raschid nous quittait pour un monde meilleur.
On l'avait oublié!
Quant à M. Tager, c'était un homme d'environ 50 ans qui était venu à Berlin, muni d'un sauf-conduit du ministre allemand en Suisse. Il devait retourner en France, à Paris où il demeurait, mais un beau matin il était appréhendé, on l'amena à la Stadvogtei et il ignora lui-même, durant toute sa captivité qui se prolongea durant des mois, quel était le motif de son internement. Pour ma part, je n'en vois pas d'autre que ses sentiments francophiles.
Un jour, on lui annonça qu'il quitterait la prison pour un camp d'officiers français. Le jour de son départ avait été fixé au 7 décembre 1915. Durant son court (?) séjour, quelques mois parmi nous, M. Tager avait conquis l'estime de tous les prisonniers de nationalité anglaise. J'étais le seul cependant à qui il se soit ouvert d'une confidence, à son sujet. Il m'avait appris un jour, sous le sceau du plus grand secret qu'il était Grand Rabbi du Turkestan. A. juger par la façon dont il prononçait ces mots, on aurait pu croire que ce titre, en pays mahométan, équivalait à celui de Lord, en Angleterre. Il me supplia de n'en desserrer les dents à qui que ce soit.
Toutefois, les Anglais s'étaient réunis dans une cellule et avaient décidé de lui offrir un déjeûner à la prison le jour de son départ. Offrir un déjeûner à la prison, quelle entreprise formidable!
Le jour convenu, une table était préparée à ma cellule pour une quinzaine de couverts. Les assiettes, —ai-je besoin de le dire?—étaient fort rapprochées l'une de l'autre. A une heure, trois d'entre nous se détachent et vont quérir M. Tager qui ne sait du tout comprendre ce dont il s'agit.
Avant le déjeûner, j'avais fait part à mes collègues anglais de mon intention de leur révéler, au moment des toasts, que notre hôte, M. Tager, était Grand Rabbi du Turkestan, et bien que cette appellation fut du grec pour moi comme pour ceux qui m'écoutaient, je ne manquai pas de persuader à chacun de faire à cette déclaration un accueil enthousiaste, enfin toute une démonstration.
Le déjeûner tirait à sa fin, lorsque je me levai pour proposer la santé de M. Tager. Je ne pus terminer mes remarques sans prévenir mes auditeurs que j'allais faire éclater une sensation au milieu d'eux: j'annonce solennellement qu'il était de mon devoir, malgré la modestie bien connue de M. Tager, de faire connaître un de ses titres au respect et à l'admiration universels. "M. Tager, dis-je, est Grand Rabbi du Turkestan, ce qu'il nous a toujours caché."
Là-dessus, tout le monde se lève: grand tapage, des bravos, et selon l'usage antique et solennel, l'un d'entre nous attaque, le For he is a jolly good fellow. Nous avions à peine fini de chanter la première partie que le sous-officier Hufmeyer fait irruption dans ma cellule et nous impose silence. Il était trop tard, nous avions donné cours à notre enthousiasme pour M. Tager.
Il n'y a pas seulement Liebknecht qui ait attiré sur lui les foudres de l'autorité militaire, en 1915, 1916 et 1917.
Je ne saurais oublier le spectacle pathétique de ce brave vieillard qui fut interné avec nous pendant bien des mois: c'était le professeur Franz Mehring, âgé de 71 ans. En avril 1915, Mehring avait lancé une proclamation en faveur de la paix immédiate. Cette proclamation portait non-seulement sa signature mais encore celle de Rosa Luxembourg et de Ledebour. Cela suffit pour lui faire goûter un peu de la Stadvogtei. Mehring était, comme Borchardt, du groupe Spartacus. Très érudit, fin causeur, il nous fit passer avec lui des heures intéressantes, inoubliables. Ces noms de Mehring et de Borchardt, dont je n'avais gardé qu'un faible souvenir, ont pris une importance considérable depuis la révolution en Allemagne. Mehring resta quelque temps avec nous puis fut libéré. Il fut, par la suite, candidat au siège laissé vacant par Liebknecht à Postdam, où il fut défait, mais quelque temps après, sa candidature fut plus heureuse dans une division électorale de la Diète de Prusse. Il y fut élu par une grande majorité et il siège encore aujourd'hui au Parlement.
J'ai déjà parlé, dans un chapitre précédent, d'un officier de la Kommandantur du nom de Wolff. C'était un Juif allemand qui donnait des points aux Prussiens. Il portait force décorations parmi lesquelles on pouvait distinguer l'emblème d'un ordre de Turquie qui se portait en plein abdomen! Nous nous sommes souvent moqués, entre nous, de ce bedonnant officier, précédé d'un croissant quelconque à l'ombilic.
Je désire relater ici un incident, auquel il a été mêlé.
Chaque mardi et chaque vendredi, durant ma dernière année de captivité, j'avais la permission, comme on le sait, d'aller faire une promenade au Tiergarten en compagnie d'un sous-officier de la prison. On évitait soigneusement de désigner, pour m'accompagner, un sous-officier alsacien du nom de Hoch. Dans mes conversations avec Hoch j'avais souvent exprimé le désir de le voir un jour venir avec moi. Il ne demandait pas mieux, mais le sergent-major, en cette affaire, avait tout à dire, et il n'était jamais appelé. Il arriva cependant qu'au mois d'août 1917 il fut choisi pour la promenade au parc.
Les instructions qui avaient été envoyées à la prison à mon sujet étaient très sévères: j'étais censé les ignorer, mais je les connaissais parfaitement. Le sous-officier et moi nous devions quitter la prison à deux heures, nous rendre à la première gare du chemin de fer urbain, c'est-à-dire à environ 300 pieds de la prison, monter dans un train et nous rendre directement au parc. La promenade devait avoir lieu dans le parc même, sans en sortir, sans parler à qui que ce soit et sans entrer où que ce soit.
Nous étions à peine sortis, le sous-officier et moi, que je lui propose de m'accompagner sur la rue pour y acheter quelques cigares. Hoch se prête de bonne grâce à ma demande et nous nous engageons sur la rue Koenig. Nous achetons des cigares, et de cette rue nous traversons à l'avenue Unter den Linden, laquelle conduit directement à la porte de Brandebourg qui s'ouvre sur le Tiergarten. Tout cela pour faire comprendre que nous avions suivi la ligne la plus directe entre la prison et le jardin.
Sur l'avenue Unter den Linden, nous nous trouvons subitement face à face avec le capitaine Wolff, de la Kommandantur. Cet officier me connaissait parfaitement, m'ayant rencontré quatre ou cinq fois à la prison où il se rendait presque chaque semaine pour recevoir les dépositions des prisonniers qui, par requête ou autrement, se plaignaient du traitement qui leur était infligé.
Il s'avança vers moi et m'adressa la parole:
—Vous allez, dit-il, faire une promenade au jardin?
Oui, répondis-je.
Je portais à la main un petit paquet. Il l'avait remarqué.
—Et, dit-il, vous faites quelques petits achats lorsque vous sortez de la prison?
J'ai cru bien faire en répondant affirmativement.
—Au revoir; me dit-il. Et il passa outre.
J'ai bien remarqué que mon Alsacien était très ennuyé de cette rencontre. Il fut taciturne jusqu'à notre retour à la prison.
Deux jours plus tard, l'officier Block se présente à ma cellule, l'anxiété sur la figure.
—Vous êtes sorti, cette semaine? demanda-t-il.
—Oui, mardi.
—Où êtes-vous aller
—Au parc.
Êtes-vous allé ailleurs?
—Non.
—Cela me paraît curieux, dit-il, je viens de recevoir un document de l'Ober Kommando, et ce document contient une seule phrase à mon adresse, ainsi conçue: "Pourquoi les instructions, dans le cas de Béland, ont-elles été outrepassées?"
Je lui fis part de mon ahurissement, je ne pouvais comprendre (?) comment nous avions passé outre les instructions, car, comme je lui faisais remarquer, nous étions allés directement de la prison au Tiergarten.
—Avez-vous rencontré quelqu'un? me demande l'officier.
—Oui.
—Qui cela?
—Le capitaine Wolff, de la Kommandantur.
—Ah! dit-il, voilà toute l'affaire. A quel endroit l'avez-vous rencontré?
—Avenue Unter den Linden.
—Unter den Linden, s'écrit l'officier, Unter den Linden?
—Oui, et quel mal y a-t-il? répartis-je, n'ai-je pas la permission d'aller faire une marche dans les limites de ce parc, et comment puis-je m'y rendre plus directement qu'en suivant l'avenue Unter den Linden?
—Ah! dit-il, tout cela est vrai, mais ce n'est pas conforme aux instructions que nous avons reçues.
Et il m'explique comment je devais m'y rendre avec mon sous-officier par le chemin de fer urbain sans passer par les rues. Il ajoute que je ne suis pas censé connaître ces instructions, mais que le sous-officier devait être puni pour les avoir ignorées. J'exprimai tout mon regret de voir un brave homme comme M. Hoch impliqué dans cette affaire. Il convint avec moi que le sous-officier Hoch était un homme de devoir généralement. Alors il me passe une idée par la tête: celle de sauver Hoch, si c'était possible. Je suggère à l'officier d'attendre une heure avant d'envoyer sa réponse à l'Ober Kommando, et ma suggestion est agréée. Il me quitte et je descends immédiatement à la cellule du sous-officier Hoch.
En me voyant entrer, celui-ci comprit qu'il s'agissait d'une mauvaise affaire:
—Nous avons des ennuis? dit-il.
—Oui, mais ce n'est pas si grave. Voici: il nous arrive un petit embêtement.
Je lui relate ce qui venait de se passer entre l'officier et moi, et le pauvre sous-officier, levant les bras, s'écrie: "Je suis fini." Non, non, je lui assure qu'il n'est pas fini, qu'il y a moyen de se dégager.
—Comment? dit-il.
—Eh! bien, un jour chaque semaine, selon la règle, vous passez l'après-midi en ville: supposons que lorsque les instructions me concernant ont été lues par le sergent-major, supposons, dis-je, que cet après-midi-là vous étiez sorti.
—Ah! reprit Hoch, mais j'étais présent.
—Je ne vous demande pas, lui dis-je, si vous étiez présent. Je vous affirme que vous étiez sorti.
—Très bien, dit-il, mais le sergent-major, lui, se rappellera parfaitement que j'étais présent.
—Cela me regarde, lui dis-je, pour le moment je vous considère comme ayant été absent lors de la lecture des instructions.
Et je le quitte.
Je me dirige vers la cellule du sergent-major. Le sergent-major, à cette époque, était un homme malade qui m'avait consulté trois ou quatre fois au sujet de son affection rénale. Je me présente chez lui. Il s'étonne de me voir et me demande ce que je lui voulais.
—Eh! bien, lui dis-je, vous vous rappelez de ces fameuses instructions à mon sujet... Lorsque vous les avez lues, il y a trois mois, devant les sous-officiers réunis, M. Hoch avait son après-midi de congé?
__C'est vrai, dit-il.
—Eh! bien, avant-hier, lorsque je suis allé faire une marche, je lui ai proposé de passer sur la rue du Roi avec moi, et il a consenti?
—Il n'y a pas de crime, dit le sergent-major.
—Assurément pas, dis-je, il s'agit simplement de donner une petite explication.
Et je parlai d'autre chose, en particulier de sa maladie, puis je le quittai et m'empressai auprès de l'officier Block. Je lui expliquai simplement que lorsque les instructions avaient été lues trois mois auparavant, le sous-officier Hoch était absent.
—Eh! bien, dit-il, je ferai rapport en ce sens.
Et nous attendîmes le résultat de cette explication pendant quatre jours, et durant tout ce temps le sous-officier Hoch était dans des transes terribles: il se voyait condamné au cachot pour quatre ou cinq mois ou renvoyé dans les tranchées où déjà trois de ses frères étaient tombés.
Enfin, après quatre jours, le lieutenant Block venait me faire part de la réponse qu'il avait reçue de l'Ober Kommando. "L'explication, disait le document, est satisfaisante, mais le sous-officier Hoch devra être sévèrement réprimandé."—"J'espère que ces réprimandes ne seront pas trop sévères", lui risquai-je. Il ne voulut pas donner de réponse: Un officier allemand ne se compromet pas quand il s'agit de la discipline!
Il me quitte et, quelques instants après, il commande qu'on lui amène le sous-officier alsacien. Et voici le colloque qui eut lieu entre les deux:
L'officier.—Sous-officier Hoch?
—Oui, mon lieutenant.
—Vous êtes sorti avec le prisonnier Béland, la semaine dernière?
—Oui, mon lieutenant.
—Vous êtes passé par les rues du Roi et Unter Den Linden?
—Oui, mon lieutenant.
—Vous savez que c'est contraire aux instructions que nous avons reçues?
—Oui, mon lieutenant.
—Je vous réprimande sévèrement.
—Très bien, mon lieutenant.
—Allez-vous-en.
—Très bien, mon lieutenant.
Et Hoch fit demi-tour à droite et disparut.
L'instant d'après, il était dans ma cellule et riait sous cape de l'heureuse issue de toute l'aventure.
On voit que dans toute cette affaire il s'agit d'un excès de zèle de la part du fameux Wolff.
Je goûtais depuis deux jours la douce hospitalité de la Hollande, lorsque je fus invité à me rendre au Consulat général anglais, à Rotterdam.
La veille, j'étais allé m'enregistrer à la légation anglaise à La Haye. Je quittai donc mon hôtel, dès neuf heures du matin, pour me rendre au Consulat.
J'y fus informé que j'aurais à quitter la Hollande dès le lendemain, sur un navire-hôpital à destination de l'Angleterre. Je fis remarquer au fonctionnaire de la légation qu'il m'était impossible de partir aussi tôt.
—Pourquoi?... me demanda-t-il.
—Parce que j'ai reçu, à Berlin, l'assurance que ma fille, qui est en Belgique depuis quatre ans, et à qui les autorités militaires allemandes ont, jusqu'aujourd'hui, refusé la permission de partir, recevra un sauf-conduit pour la frontière hollandaise. Je dois donc attendre qu'elle soit sortie de Belgique.
—Mais, répond le jeune officier, cela ne fera pas l'affaire. On s'attend, à la Légation, à ce que vous partiez dès demain matin, et comme nous n'avons à ce sujet que des renseignements incomplets, nous vous suggérons d'aller discuter la chose à La Haye.
Cette après-midi-là, j'arrivais à la Légation anglaise à La Haye, où j'avais le plaisir de rencontrer un charmant officier de marine. Il m'explique donc qu'on s'attendait à mon départ pour l'Angleterre le lendemain matin. Je m'obstine, naturellement, à ne pas vouloir partir. Il insiste.
—Mais, lui dis-je, ne suis-je pas, après tout, le plus intéressé dans cette question de rapatriement. Il est de la plus haute importance que je demeure en Hollande jusqu'à l'arrivée de ma fille, détenue en Belgique depuis trois ans. D'Angleterre, il me sera à peu près impossible de communiquer avec les autorités militaires allemandes en Belgique.
Le brave officier admit bien qu'à ce point de vue il était beaucoup plus avantageux pour moi, sous tous rapports, de demeurer en Hollande au lieu de me rendre immédiatement en Angleterre.
—Mais, ajouta-t-il, vous semblez ignorer que votre cas est un cas spécial: vous êtes échangé avec un prisonnier allemand détenu en Angleterre.
—Je sais cela, répondis-je.
—Eh! bien, repartit l'officier, ce prisonnier allemand qui doit recevoir sa liberté en échange de la vôtre, ne saurait quitter l'Angleterre avant votre arrivée.
Quelque diable peut-être me poussant, je ne pus m'empêcher d'éprouver, lorsque l'officier me donna ces explications, une satisfaction méchante.
—Est-ce bien vrai?... ajoutai-je.
—Assurément!...
—Alors, pourquoi ne le laisserai-je pas fumer un petit peu? Il y a deux ans, j'étais prévenu, à la prison, que je serais libéré. On m'a tenu dans cette anxieuse attente de la liberté pendant deux ou trois semaines, pour ensuite briser tout mon espoir. Je vous approuve d'insister afin que je parte immédiatement pour l'Angleterre, mais, prenez-en ma parole, je n'ai pas l'intention de partir demain, ni après-demain, c'est-à-dire pas avant que les Allemands n'aient relâché ma fille qui est en Belgique. Vous pouvez laisser savoir aux autorités, en Angleterre, qu'étant après tout, en cette question d'échange, le plus intéressé, je me déclare satisfait. Je me considère suffisamment échangé pour qu'il soit permis à l'Allemand de quitter l'Angleterre. Et si, enfin, le gouvernement anglais juge à propos de retenir le dit Allemand jusqu'à mon arrivée, je ne puis vous dissimuler que j'en éprouve une certaine satisfaction.
L'officier sourit et m'assura qu'il allait communiquer par voie télégraphique, aux autorités anglaises, le résultat de notre entrevue.
J'appris cependant qu'une couple de semaines plus tard, M. Von Buelow, le représentant de la maison Krupp, en Angleterre avant la guerre, détenu en ce pays depuis le commencement des hostilités, et que le gouvernement anglais avait consenti à échanger contre moi, venait d'arriver en Hollande, en route vers l'Allemagne.
Trois semaines plus tard, ma fille sortait de Belgique. C'est à Rosendaal que nous nous sommes rencontrés après trois ans de séparation. Les trois semaines que nous avons passées en ce charmant pays, au milieu de cette brave population hollandaise, aux vieilles coutumes et aux costumes étranges, jouissant de la plus entière liberté et d'une température délicieuse furent des jours de bonheur qui demeureront inoubliables.
Toutefois, l'heure de reprendre notre course vers le foyer canadien allait bientôt sonner. Gavés de liberté, d'air pur et l'âme imprégnée du désir de revoir les paysages d'Amérique que depuis quatre ans nous n'avions pu contempler, nous décidâmes de faire les préparatifs nécessaires à la traversée de la Mer du Nord qui nous séparait de l'Angleterre.
Depuis dix-huit mois cette mer était infestée de pirates. Les sous-marins allemands y avaient deux bases principales, celle de la Baie de Kiel et celle de Zeebrugge. De ces deux points, et en particulier de Zeebrugge, les pirates allemands pouvaient en quelques heures pousser une pointe jusqu'à la côte d'Angleterre ou jusqu'à la route maritime Rotterdam-Harwich. C'était leur champ d'opération par excellence.
Nous le savions, certes, nous en avions même longuement causé avec les officiers canadiens internés en Hollande et dont nous avions été les hôtes à Sheveningen où ils avaient réussi à se créer une sorte de petit "Home".
J'y fus un jour invité et présenté par l'excellent major Ewart Osborne, de Toronto. Je garderai un souvenir bien agréable des quelques heures passées au milieu d'eux.
Nous avions parlé sous-marins; nous avions parlé du pays et de l'époque probable, possible de leur rentrée.
L'amirauté anglaise avait l'entière direction du service postal et passager entre l'Angleterre et la Hollande. Des convois allaient, des convois venaient, c'était tout ce qu'on pouvait dire. De l'heure du départ, du point d'embarquement, du nom des paquebots, de la route à suivre, du port d'arrivée, les passagers étaient tenus dans la plus complète ignorance.
Lorsqu'un permis de passer en Angleterre était consenti, le voyageur devait se présenter chaque jour de 11 heures à midi pour recevoir ses instructions. Nous faisions donc visite chaque jour, à cette heure, au Consulat Général d'Angleterre, à Rotterdam. Cela dura une semaine. Un bon jour, il y avait du nouveau! Nous recevions une communication verbale et très discrète de prendre place dans un train à telle gare, à telle heure.
Nous étions enchantés. Nous avions quitté le Consulat depuis cinq minutes à peine lorsque sur le quai d'une gare de tramway où nous attendions, un individu s'approche et s'adresse à moi en un anglais irréprochable, avec l'accent particulier de l'habitant de Londres.
—A quelle heure partons-nous? demande-t-il.
—Que voulez-vous dire?
—Oui, à quelle heure partent les bateaux? J'oublie si c'est cet après-midi ou ce soir...
—Je ne sais, monsieur, à quels bateaux vous voulez faire allusion.
—Je fais allusion, dit-il, aux bateaux qui doivent nous conduire en Angleterre.
La Hollande a été, durant toute la guerre, un pays littéralement couvert d'espions allemands. Nous le savions, car à l'hôtel de Rotterdam où j'avais logé pendant quelques semaines des personnages sympathiques trouvaient toujours moyen, sous un prétexte quelconque, de lier conversation avec moi. J'avais été prévenu lors de ma première visite au Consulat.
A la première question de mon interlocuteur, je fus sur le point de tomber dans le piège. J'allais lui donner le renseignement recherché, quand un soupçon vint me couper la parole.
A sa dernière question je répondis, faisant mine de me départir d'un secret:
—Exactement dans une semaine, à 6 heures du matin.
—C'est ce que j'avais cru comprendre! ajoute mon Anglais truqué.
Je n'eus plus de doute, j'avais affaire à un espion.
Ce jour-là, le 30 juin, tous les voyageurs munis d'une autorisation filaient dans un train vers Koek Van Holland où nous arrivions à sept heures du soir. Cinq bateaux passagers nous attendaient au quai. Nous nous embarquons. A quand le départ? sera-ce dans la soirée ou dans la nuit? Tout le inonde l'ignore, même—à ce qu'on affirmait—les officiers du bord.
La nuit du samedi au dimanche, la journée du dimanche, la nuit suivante s'écoulèrent sans que nous bougions. Un message radiographique seul pouvait nous détacher de Hollande. Apparemment le message vint, car à onze heures, lundi, nous sortions de la Meuse sans tambours ni trompettes. Le convoi de cinq vaisseaux, portant des milliers de passagers de tous âges et de toutes conditions, fit le quart au nord et s'avança lentement en longeant de très près la côte de Hollande jusqu'à Sheveningen. A ce point, le quart à gauche, donc à l'ouest, nos vaisseaux mettent le cap sur la côte anglaise. Nous étions à peine sortis des eaux côtières de Hollande lorsque soudainement un nuage de fumée se dessina à l'horizon en avant de nous.
Qu'est-ce? Nous l'ignorions. N'était-ce pas une escadre allemande?
Le doute fut vite dissipé. Ce point noir, d'abord imperceptible, qui grossissait en s'avançant sur nous, c'était le convoi parti d'Angleterre le matin qui rentrait dans les eaux Hollandaises.
Quel spectacle s'offrait à nos regards!—Vingt-quatre bâtiments disposés sur trois lignes fendaient les ondes, vomissant une épaisse fumée. Au centre précédé d'un hardi croiseur venaient les sept vaisseaux chargés de passagers, de chaque côté huit lévriers de la mer, navires de type particulier sillonnaient la surface dans toutes les directions, comme à la recherche d'un gibier ennemi à dévorer.
Et après un beau désordre apparent, des échanges de signaux, quelques courses à droite à gauche, une affaire de trois minutes, la situation s'était de nouveau éclaircie: sept vaisseaux longeaient la côte de Hollande en sécurité; les navires de guerre, dix-sept, avaient fait volte-face et l'imposant convoi, modelé sur le dernier, entreprenait le passage de la zone la plus dangereuse de la Mer du Nord.
Tout alla bien jusqu'à deux heures après-midi. Mais alors un champ de mines était signalé, quelques-unes, non complètement submergées, laissaient percer à la surface leur tête ressemblant à un chapeau de feutre noir.
Et les croiseurs et les torpilleurs s'en donnaient. Les merveilleux artilleurs pointaient leurs canons, tiraient, puis faisaient feu jusqu'à ce qu'une formidable explosion de la mine, lançant une colonne d'eau vers le ciel vint nous indiquer que le but était atteint.
Feu roulant pendant une heure! Nous avions traversé le champ de mines fraîchement pondues, sans encombres, et nous filions à bonne allure vers l'Angleterre, dont nous aperçûmes les phares vers 9 heures du soir.
Nous étions à l'embouchure de la Tamise; la nuit tombait.
De toutes les bouches s'échappaient des paroles d'admiration à l'endroit de ce merveilleux service de protection, poussé sur toutes les mers du globe, sans relâche, sans répit par l'intrépide marin de la Grande Bretagne.
Nous allions franchir la ligne de réunion de deux phares puissants qui marquaient la fin de la mer fréquentée par les pirates. Les dix-sept vaisseaux de guerre, comme dans un geste d'affection s'étaient rapprochés des nôtres, oh! très près!
Ils échangèrent quelques signaux, puis, prestement, silencieusement ils firent demi-tour et disparurent vers le large, vers la haute mer, dans la nuit, vers une autre mission de protection et d'humanité, chacun de ces braves matelots emportant avec lui l'hommage de notre reconnaissance émue et de notre admiration non mitigée.
Le 2 juillet, nous arrivions en Angleterre, et l'inspection de mes bagages, qui m'inspirait des craintes sérieuses à cause de certaines pièces écrites que j'avais apportées avec moi d'Allemagne, fut des plus simples. Le bureau d'inspection de Gravesend, où j'eus l'avantage de rencontrer quelques-uns des principaux employés, se montra excessivement conciliant et accommodant à mon égard. On ne voulut pas retarder mon voyage vers Londres, et l'on me promit de me faire tenir le lendemain, par l'entremise du Haut Commissaire canadien, tous les papiers, documents, lettres, dont j'avais une malle complètement remplie, et ils tinrent parole.
Durant mon séjour de quatre semaines à Londres, en juillet (1918), je tiens à faire mention de trois événements dont le souvenir restera profondément gravé dans ma mémoire.
Le premier est, naturellement, la gracieuse invitation que j'ai reçue de Sa Majesté le Roi de me rendre auprès de lui, au palais de Buckingham. Le jour fixé, à midi, j'eus le très grand honneur d'être reçu par Sa Majesté avec une courtoisie, une bienveillance qui m'ont profondément touché. Je ne pus m'empêcher de remarquer, toutefois, dans les traits de sa figure, la trace des anxiétés et des inquiétudes auxquelles le souverain avait été en proie au cours de ces dernières années.
C'était au moment de cette nouvelle et terrible offensive des Allemands en Champagne. Cette offensive,—nous l'ignorions alors tout en l'espérant, —devait être le signal de la contre-offensive qui devait conduire les Alliés de succès en succès jusqu'à la culbute définitive de l'Allemagne.
En prenant congé de Sa Majesté je lui demandai la permission de lui exprimer, de la part de ses sujets canadiens-français en particulier, des voeux et des souhaits à l'occasion de son 25ième anniversaire de mariage célébré la veille à la Cathédrale Saint-Paul.
C'est vers ce temps-là qu'il me fut donné de revoir, après quatre années de séparation, mon beau-fils, officier dans l'armée belge, qui avait obtenu, en Flandre, un congé pour venir me rencontrer en Angleterre.
J'avais moi-même, en passant de Hollande en Angleterre, été accompagné par le second fils de ma femme qui avait, au risque de sa vie, franchi la barrière électrique qui séparait la Belgique de la Hollande dans le but d'aller prendre du service dans l'armée belge. Ces deux frères, séparés depuis quatre ans, se rencontrèrent dans une salle d'hôtel à Londres, et quelques jours plus tard, l'aîné repartait pour le front de bataille, emmenant avec lui son jeune frère.
Enfin, quelques jours avant de prendre passage à bord du transatlantique pour rentrer dans mes foyers, je recevais du Général Turner l'invitation de visiter les camps de Frencham Pond et de Bramshot.
A Frencham Pond nous pouvions voir les troupes récemment débarquées du Canada. Elles subissaient, à cet endroit, le premier degré d'entraînement et de formation militaire. Elles étaient ensuite transférées à Bramshot où leur instruction militaire est parachevée.
A ces deux endroits, il me fut donné d'adresser la parole aux troupes canadiennes et aussi d'admirer leur belle tenue qui a soulevé, en Angleterre et en France, l'admiration universelle.
Ce jour que j'ai passé au milieu de nos officiers canadiens et de nos soldats, restera comme l'un des plus beaux de mon existence.
Je n'oublierai jamais l'impression causée par la marche du l0ième régiment de réserves (canadiennes-françaises) devant le colonel Desrosiers. On ne pouvait être témoin de ce défilé sans sentir courir dans tout son être un frisson d'enthousiasme et d'admiration.
Je me suis efforcé de faire part à nos soldats, dans l'un et l'autre camp, de nos sentiments d'orgueil et de notre gratitude, et je leur ai promis, d'apporter avec moi au peuple canadien, le message que je croyais lire sur chacune de leurs figures, et que l'on pourrait ainsi traduire: Courage, patience et confiance en la victoire.
Les exploits de tous ces braves canadiens, au moment où nous écrivons ces lignes, ont été couronnés de succès, et l'histoire de notre pays entourera les noms de ceux qui nous reviendront, comme de ceux qui seront tombés au champ d'honneur, d'une auréole de gloire immortelle.
Pour bien comprendre la mentalité de la nation allemande, il faut jeter un coup d'oeil rétrospectif sur son histoire militaire.
L'Empire d'Allemagne, c'est la Prusse de 40 millions d'habitants, puis quelques petits royaumes: la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, et enfin, une quantité de petits états de moindre importance qu'elle s'était adjoints, en 1871.
En 1864, la Prusse faisait une campagne victorieuse contre le Danemark et lui enlevait les duchés de Schleswig et de Holstein; en 1866, elle est encore victorieuse contre l'Autriche; et en 1870, par suite d'intrigues diplomatiques éminemment astucieuses, qui lui assuraient la neutralité des grandes nations européennes, elle faisait, au moyen d'une falsification de dépêches, naître le conflit franco-germanique.
Elle entraîna les autres états allemands jusque sous les murs de Paris, et fonda, à Versailles, au lendemain de la victoire, l'Empire germanique, 26 états avec le roi de Prusse comme empereur.
Elle était à l'apogée de la gloire. Bismark et Von Moltke, l'un politique et l'autre militaire, devenus demi-dieux par la conclusion d'un traité qui arrachait à la France deux provinces et cinq milliards d'indemnité s'imposaient à la vénération universelle du peuple allemand.
Le sens artistique et l'idéalisme qui avaient comme imprégné l'âme allemande, pendant des siècles, jusqu'à nos jours, et même, ce qui paraît un peu invraisemblable, avait persisté sous le règne de Frédéric II et de ses successeurs, firent place à cet esprit positiviste naissant et ultra-militariste.
Bismark avait dit: "La force prime le droit." "On n'a de droits que ceux que la force autorise." Ces principes et ces maximes avaient fait leurs preuves d'une manière éclatante, en 1864, en 1866, en 1870.
Désormais, pour l'Empereur et son entourage, quelques centaines de mille officiers, la guerre devenait un élément, un agent, l'artisan principal de la grandeur nationale.
Cet esprit dominant chez les grands, il fallait le faire pénétrer dans la masse du peuple. La littérature, les sciences, les arts, furent mis à contribution dans ce travail d'éducation nouvelle; et pardessus tout, l'école et la législation.
Un éminent écrivain français a dit, au sujet de ce système d'éducation tudesque, une phrase lapidaire: "On nous a fait entendre que ce sont les privat-docent qui ont gagné la bataille de Sedan...."
Les vétérans de la guerre de 1870 deviennent alors autant d'éducateurs de la génération qui pousse. On conduit les enfants aux musées—militaires—et on leur fait voir les drapeaux et les canons pris à l'ennemi. Le vieil officier, indiquant ces trophées à ses deux petits-fils, leur demande—"Quel est notre ennemi?..."—"La France! répondent les petiots."—"Nous les avons vaincus, n'est-ce pas?" "Oui!"—"Et nous vaincrons ainsi tous nos ennemis présents et à venir!..."—"Oui!"—"Allez! Vous êtes de bons enfants du Vaterland", disait, avec un geste bénisseur, le vieux vétéran botté.
Tous les livres de lecture dans les écoles sont exclusivement composés de narrations guerrières, de charges de cuirassiers, de citadelles et de redoutes prises d'assaut, de rencontres épiques et flamboyantes à l'arme blanche... Et en conclusion du tout, il est dit que la gloire des armées allemandes a ébloui l'univers. On malaxe ces jeunes intelligences: on les militarise à l'extrême limite de leurs aptitudes.
Et si quelqu'un élève trop la voix contre le sanctus sanctorum, la haute caste privilégiée, née de Bismark, de Von Moltke, on lui impose silence. Germania n'est-elle pas, comme Pigmalion, entourée d'ennemis qui s'apprêtent à fondre sur elle?—Donc, il faut être prêt pour la défense. Tout ce qui se fait, l'énorme mécanisme des casernes et des usines à munitions, ne doit servir qu'à se protéger. Contre qui?...—Contre un monde d'ennemis, spectre que la presse pangermaniste agite devant les populations frappées de terreur. Pour la masse, la prochaine guerre ne sera qu'une guerre défensive.
Toutefois cette caste militaire et civile,—qui peut compter un demi-million d'adultes,—tout en s'évertuant à donner le change sur ses véritables intentions, à tromper le bas peuple et les étrangers, se réclame de Bismark. On en a fait le grand héros national. Mais que dit Bismark?... "La force prime le droit", d'abord. Et ensuite: "La guerre est la négation de l'ordre". Pourquoi dit-il ceci? Tout le monde le sait: c'est un lieu commun. Attendez. L'Homme de fer a un but. Lisez plus loin: "Le moyen le plus efficace de forcer la nation ennemie à demander la paix, c'est de dévaster son territoire et de terroriser la population civile..."
Cette nouvelle théorie, née des succès remportés en 1870, au moyen des procédés de destruction mis alors en honneur ne rencontre que peu ou point d'objections en Allemagne.
C'est monstrueux, mais c'est ainsi. Les disciples de Bismark ayant élaboré toute une théorie de justification à propos des actes et des paroles les plus condamnables du fameux chancelier, le bon peuple allemand, d'abord un peu scandalisé, s'est laissé faire une douée violence. Peuple bonasse en somme, il s'est laissé bercer et porter sur cette vague militariste qui déferlait jusqu'aux endroits les plus reculés du territoire.
Pour la haute bureaucratie militariste et administrative, cette énorme préparation militaire de quarante années était destinée à rendre l'Allemagne maîtresse de l'Univers; pour la masse du peuple, c'était un instrument de défense et de protection. Celle-là cachait à celle-ci ses sinistres desseins, et les rares esprits clairvoyants qui, du milieu du peuple lisaient dans le jeu des meneurs de l'Empire, se gardaient bien de faire des objections ou de demander des raisons; on est gouverné ou on ne l'est pas... Et ils étaient gouvernés!
Et d'ailleurs, pourquoi se troubler la conscience? Ce système n'avait-il pas fait ses preuves en 1870? Ces deux provinces, ces cinq milliards extorqués à la France, n'était-ce pas là deux causes déterminantes du formidable essor commercial et industriel qui assurait au peuple allemand la prépondérance sur tous les marchés du monde?
Le militarisme intensif était devenu religion d'état. Les philosophes, les littérateurs, les historiens, ayant donné dans le mouvement, les savants ne pouvaient manquer d'avoir leur tour. Chaque découverte dans le domaine de la mécanique, de l'optique, de la chimie surtout, est soigneusement étudiée, par son auteur lui-même, au point de vue spécial de son utilité pratique dans l'oeuvre de destruction de la vie humaine et de la propriété.
Les oeuvres d'art également portent l'empreinte de l'atmosphère ambiante; les bronzes équestres et "kolossaux", reproduisant, pour en faire l'admiration du peuple, le galbe de tous les Hohenzollern passés, présents et futurs, ornent les parcs et les avenues de toutes les villes de l'Empire, sans oublier Strasbourg et Metz.
Et l'on descend même au cabotinage le plus vulgaire; ne voit-on pas un jour, la fille unique du Kaiser, s'exhiber en costume,—assez collant,—de hussard de la Garde, ou de la mort, pendant que son auguste père pérore sur le thème de la Poudre sèche.
Un jour, sur ses domaines, à l'époque de la moisson, se promenant en veston et en souliers plats, il se sent pris d'une folle admiration à l'aspect des millions d'épis dorés:—"Cela me rappelle, dit-il, les mers de lances de mes uhlans."
Une autre fois, au cours d'une randonnée qui l'avait amené tout près de la frontière française, entouré d'adulateurs et de flagorneurs aux uniformes resplendissants, le grand Cabotin couronné, se plante sur ses éperons, bien en face de la frontière, tire son épée à demi puis la rentre avec fracas, en laissant échapper cette parole mystérieuse et formidable;—"On a tremblé en Europe!"—Puis il éclate de rire.
Venons-en maintenant à la décade précédant la guerre mondiale:
L'Allemagne rejette la proposition anglaise de limiter de part et d'autre l'armement naval, enfin de faire une halte.—Convaincue à ce moment, que son immense machine militaire était non-seulement invincible, mais irrésistible dès le premier choc, elle s'applique fiévreusement à se rendre également intangible du côté de la mer, en donnant un essor inouï à sa construction navale.
Tout est prévu en cas de conflit: l'Angleterre sera tenue en respect, peu importe par quel moyen, l'alliance franco-russe sera annihilée en quelques semaines, et ce sera l'affaire de quelques jours supplémentaires, pour assurer à l'Allemagne la domination continentale. De là à l'hégémonie universelle, il n'y aurait plus qu'un pas.
Voilà ce que ruminait la caste militaire: c'est-à-dire le Kaiser, le Kronprinz, et les 400,000 à 500,000 officiers, fonctionnaires et civils,—tous rudement bottés et éperonnés,—recrutés dans la noblesse, la haute société, les professions, et le peuple instruit.
La foule, elle, la masse, s'endormait chaque soir convaincue que des ennemis s'apprêtaient à fondre sur elle sournoisement.
La grande préoccupation du gouvernement de 1908 à 1914, a été de faire éclater la guerre sans que l'Allemagne parût l'avoir provoquée.
Mais, comme nous le répétait si souvent ce brave Suisse, M. Hintermann, interné avec nous, les finesses allemandes sont cousues de gros fil blanc. Et tout l'agencement des événements qui ont précédé l'invasion de la Belgique quelque astucieux qu'il soit, n'empêchera pas l'histoire de "rapporter" contre Guillaume Hohenzollern et son entourage, un verdict de culpabilité.
L'entrevue de Postdam, du 5 juillet 1914, à laquelle assistait le Kaiser et les délégués de l'Autriche; l'ultimatum à la Serbie; le refus de l'Autriche d'accepter la réponse si satisfaisante, et si conciliatrice de la Serbie, et cela, ostensiblement, sans consultation préalable avec l'Allemagne,—tout n'était-il pas effectivement décidé depuis le 5 juillet?—le rejet par l'Allemagne de la proposition de conférence faite par Sir Edward Grey, ministre des Affaires Étrangères d'Angleterre, les hésitations, les faux-fuyants de M. Von Jagow, devant M. Cambon, l'ambassadeur de France; l'entrée en Belgique de troupes allemandes, le 31 juillet, dans la nuit, c'est-à-dire deux jours avant l'ultimatum de Guillaume au roi des Belges; les correspondances télégraphiques avec le Czar de Russie et le roi Georges V: tout enfin, porte à sa face l'empreinte de la duplicité.
Des artisans ténébreux du complot et du meurtre de Sarajevo, l'histoire impartiale parlera plus tard...
La masse de la population allemande, mise en possession de ces faits historiques, débarrassés de tout camouflage pangermaniste, n'hésitera pas,—et déjà, au moment où nous écrivons ces lignes, il est évident qu'elle n'hésite pas,—à se dresser comme formidable accusatrice des auteurs véritables de la guerre de ceux qui ont été cause de l'aberration collective de la nation.
La fuite en Hollande de la famille impériale et des hauts officiers ne les soustraira pas à l'exécration du peuple allemand. Quel châtiment plus exemplaire en effet, et plus amer à la fois que celui infligé à un souverain par ses sujets!
Une partie de ce peuple laborieux et frugal s'est sans doute laissée tromper par ses gouvernants qui lui parlaient de politique défensive; une autre partie a cédé à l'appas du lucre, de la rapine, de la conquête; quelques-uns d'entre eux se sont peut-être,—faiblesse humaine,—laissés éblouir par des visions de domination mondiale, mais nous voulons croire que la grande majorité a été un instrument aveugle dans la main de militaristes ambitieux.
Les nations alliées ont remporté une victoire complète, décisive, définitive. La dernière tête de l'hydre du militarisme semble avoir été abattue.
Puisse maintenant la paix être à jamais restaurée parmi les hommes de bonne volonté!
Pour qu'elle le soit, il faudra que le drapeau arboré sur la civilisation par la ligue des nations, porte dans ses plis les mots: Justice et Magnanimité!
Justice, c'est-à-dire châtiment pour les coupables, les criminels, les auteurs de la boucherie et de la dévastation.
Justice, c'est-à-dire restitution et réparation...
Justice, c'est-à-dire indemnité aux millions de femmes et d'enfants privés de leur soutien.
Pourquoi, dira-t-on, faut-il ici parler de magnanimité?
Est-ce que tout le peuple de l'Allemagne et des pays alliés à l'Allemagne ne mérite pas la plus sévère condamnation?
Je ne fais ici, en prononçant ce mot de magnanimité, que refléter la pensée exprimée par les chefs des trois grands pays alliés au lendemain de l'armistice,—: Lloyd George, Clemenceau et Wilson.
C'est que, comme le déclarait le 4 juillet dernier à la salle Westminster à Londres, M. Winston Churchill: "Nous sommes liés par les principes que nous avons professés et pour lesquels nous combattons. Ces principes nous permettront de demeurer sages et justes dans la victoire qui doit être, qui sera nôtre."
"Et quelque grande que soit cette victoire, ces mêmes principes protégeront la nation allemande. Nous ne pourrions traiter l'Allemand comme il a traité l'Alsace-Lorraine ou la Belgique ou la Russie, ou comme il nous traiterait tous s'il en avait le pouvoir."
C'est que la population d'un pays se recrute pour plus de la moitié chez les femmes et les enfants et qu'on ne saurait, sans descendre au niveau des méthode employées, en Belgique par exemple, faire la guerre à la propriété, aux femmes, aux enfants.
Il restera à la justice un champ d'opération encore assez vaste si elle se contente d'atteindre les auteurs conscients de la plus horrible guerre de l'histoire, comme aussi des actes inhumains et contraires aux lois internationales qui au cours des quatre dernières années ont à tant de reprises soulevé la conscience universelle.
L'auteur a pensé que les lecteurs de la narration qui précède lui sauraient gré de mettre sous leurs yeux quelques pages extraites des Lettres de l'éminent cardinal Mercier, de Belgique. Il n'a qu'un regret, c'est celui de ne pouvoir reproduire ici en entier ces documents qui forment dans leur ensemble un monument "plus durable que l'airain".
Au sein de la petite Belgique opprimée et indomptable, le grand Archevêque a été le symbole de la résistance nationale.
Il a osé presque TOUT dire aux envahisseurs; à maintes reprises il s'est dressé contre leurs infamies politiques, militaires, administratives; il est resté debout devant les menaces de Von Bissing, de Von Huene, de Von der Golfs.
L'insolente autocratie de ceux-ci a hésité, a reculé devant la troublante majesté d'honneur, de justice et de vérité de celui-là.
H. B.
NOTE
A quatre années de distance, on ne relira pas sans émotion des extraits de la première lettre pastorale du cardinal Mercier après l'invasion allemande. C'est la fameuse lettre Patriotisme et Endurance, écrite à la Noël de 1914 pour consoler les Belges éprouvés, raviver leur foi patriotique et leur indiquer une ligne de conduite vis-à-vis de l'occupant. Elle constitue un énergique réquisitoire contre les atrocités commises en Belgique par l'armée allemande, le premier qu'on ait osé formuler en territoire occupé. Le cardinal Amette, en la proposant en lecture à ses diocésains, écrivait que c'est "une oeuvre admirable de doctrine évangélique, de sollicitude pastorale et de courage patriotique." Elle eut dans le monde entier un immense retentissement; on la traduisit dans à peu près toutes les langues, et elle fut répandue partout par le clergé des pays alliés. Je dois me borner à quelques citations.
Malines, Noël, 1914.
Mes bien chers Frères,
............................................
Lorsque, dès mon retour de Rome, au Havre, déjà, j'allai saluer nos blessés belges, français ou anglais; lorsque, plus tard, à Malines, à Louvain, à Anvers, il me fut donné de serrer la main à ces braves, qui portaient dans leurs tissus une balle ou au front une blessure, pour avoir marché à l'assaut de l'ennemi ou soutenu le choc de ses attaques, il me venait spontanément aux lèvres pour eux une parole de reconnaissance émue: Mes vaillants amis, leur disais-je, c'est pour nous, pour chacun de nous, pour moi, que vous avez exposé votre vie et que vous souffrez. J'ai besoin de vous dire mon respect, ma gratitude, et de vous assurer que le pays entier sait ce qu'il vous doit.
C'est que, en effet, nos soldats sont nos sauveurs.
Une première fois, à Liège, ils ont sauvé la France; une seconde fois, en Flandre, ils ont arrêté la marche de l'ennemi vers Calais: la France et l'Angleterre ne l'ignorent point, et la Belgique apparaît aujourd'hui devant elles, et devant le monde entier, d'ailleurs, comme une terre de héros. Jamais, de ma vie, je ne me suis senti aussi fier d'être Belge que, lorsque traversant Paris, traversant les gares françaises, faisant halte à Paris, visitant Londres, je fus partout le témoin de l'admiration enthousiaste de nos alliés pour l'héroïsme de notre armée. Notre Roi est, dans l'estime de tous, au sommet de l'échelle morale; il est seul, sans doute à l'ignorer, tandis que, pareil au plus simple de nos soldats, il parcourt les tranchées, et encourage de la sérénité de son sourire ceux à qui il demande de ne point douter de la patrie.
................................................
De nombreuses paroisses furent privées de leur pasteur. J'entends encore l'accent douloureux d'un vieillard à qui je demandais s'il avait eu la messe, le dimanche, dans son église ébréchée; voilà deux mois, me répondit-il, que nous n'avons plus vu de prêtre. Le curé et le vicaire étaient dans un camp de concentration à Munsterlagen, non loin de Hanovre.
Des milliers de citoyens belges ont été ainsi déportés dans les prisons d'Allemagne, à Munsterlagen, à Celle, à Magdebourg. Munsterlagen seul a compté 3,100 prisonniers civils. L'histoire dira les tortures physiques et morales de leur long calvaire.
Des centaines d'innocents furent fusillés; je ne possède pas au complet ce sinistre nécrologe, mais je sais qu'il y en eut, notamment, 91 à Aerschot et que là, sous la menace de la mort, leurs concitoyens furent contraints de creuser les fosses de sépulture. Dans l'agglomération de Louvain et des communes limitrophes, 176 personnes, hommes et femmes, vieillards et nourrissons encore à la mamelle, riches et pauvres, valides et malades furent fusillées ou brûlées.
Dans mon diocèse seul, je sais que treize prêtres ou religieux furent mis à mort. L'un d'eux, le curé de Geirode, est, selon toute vraisemblance, tombé en martyr. J'ai fait un pèlerinage à sa tombe et, entouré des ouailles qu'il paissait hier encore avec le zèle d'un apôtre, je lui ai demandé de garder du haut du ciel sa paroisse, le diocèse, la patrie.
..........................................
Qui ne contemple avec fierté le rayonnement de la gloire de la patrie meurtrie?
Tandis que, dans la douleur, elle enfante l'héroïsme, notre mère verse de l'énergie dans le sang de ses fils.
Nous avions besoin, avouons-le, d'une leçon de patriotisme.
Des Belges, en grand nombre, usaient leurs forces et gaspillaient leur temps en querelles stériles, de classes, de races, de passions personnelles.
Mais lorsque, le 2 août, une puissance étrangère, confiante dans sa force et oublieuse de la foi des traités, osa menacer notre indépendance, tous les Belges, sans distinction ni de parti, ni de condition, ni d'origine, se levèrent comme un seul homme, serrés contre leur Roi et leur gouvernement, pour dire à l'envahisseur: "Tu ne passeras pas!"
Du coup, nous voici résolument conscients de notre patriotisme: c'est qu'il y a, en chacun de nous, un sentiment plus profond que l'intérêt personnel, que les liens du sang, et la poussée des partis, c'est le besoin et, par suite, la volonté de se dévouer à l'intérêt général, à ce que Rome appelait "la chose publique" "Res publica": ce sentiment, c'est le Patriotisme.
La Patrie n'est pas qu'une agglomération d'individus ou de familles habitant le même sol, échangeant entre elles des relations plus ou moins étroites de voisinage ou d'affaires, remémorant les mêmes souvenirs, heureux ou pénibles: non, elle est une association sociale qu'il faut à tout prix, est-ce au prix de son sang, sauvegarder et défendre, sous la direction de celui ou de ceux qui président à ses destinées.
Et c'est parce qu'ils ont une même âme, que les compatriotes vivent, par leurs traditions, d'une même vie dans le passé; par leurs communes aspirations et leurs communes espérances, d'un même prolongement de vie dans l'avenir.
.............................................
La Belgique était engagée d'honneur à défendre son indépendance: elle a tenu parole.
Les autres puissances s'étaient engagées à respecter et à protéger la neutralité belge: l'Allemagne a violé son serment, l'Angleterre y est fidèle.
Voilà les faits.
Les droits de la conscience sont souverains: il eût été indigne de nous, de nous retrancher derrière un simulacre de résistance.
Nous ne regrettons pas notre premier élan, nous en sommes fiers. Écrivant, à une heure tragique, une page solennelle de notre histoire, nous l'avons voulue sincère et glorieuse.
Et nous saurons, tant qu'il le faudra, faire preuve d'endurance.
L'humble peuple nous donne l'exemple. Les citoyens de toutes les classes sociales ont prodigué leurs fils à la patrie; mais lui, surtout, souffre des privations, du froid, peut-être de la faim. Or, si je juge de ses sentiments en général, par ce qu'il m'a été donné de constater dans les quartiers populaires de Malines, et dans les communes les plus affligées de mon diocèse, le peuple a de l'énergie dans sa souffrance. Il attend la revanche, il n'appelle point l'abdication.
..............................................
Courage, mes Frères, la souffrance passera; la couronne de vie pour nos âmes, la gloire pour la nation ne passeront pas.
Je ne vous demande point, remarquez-le, de renoncer à aucune de vos espérances patriotiques.
Au contraire, je considère comme une obligation de ma charge pastorale, de vous définir vos devoirs de conscience en face du Pouvoir qui a envahi notre sol et qui, momentanément, en occupe la majeure partie...
Ce Pouvoir n'est pas une autorité légitime. Et, dès lors, dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance.
L'unique Pouvoir légitime en Belgique est celui qui appartient à notre Roi, à son Gouvernement, aux représentants de la nation. Lui seul est pour nous l'autorité. Lui seul a droit à l'affection de nos coeurs, à notre soumission.
.......................................................
Nos malheurs ont ému les autres nations. L'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, la France, la Hollande, les États-Unis, le Canada rivalisent de générosité pour soulager notre détresse. Ce spectacle est à la fois lugubre et grandiose. Ici encore se révèle la Sagesse Providentielle qui tire le bien du mal. En votre nom et au mien, mes Frères, j'offre aux Gouvernements et aux nations qui se tournent si noblement vers nos malheurs, le témoignage ému de notre admiration et de notre reconnaissance.
On n'a pas perdu le souvenir des acclamations qui accueillirent le cardinal Mercier à Rome, dans le voyage qu'il fit au commencement de 1916. Il arriva dans la Ville Éternelle le 14 janvier au soir et y fut reçu comme un roi. C'est sous une véritable pluie de fleurs, au milieu des ovations, qu'il gagna le Collège belge choisi pour sa résidence. Le lendemain, toute l'aristocratie romaine allait s'y inscrire avec les membres les plus éminents de la colonie belge et les représentants des légations alliées.
A plusieurs reprises, Benoît XV reçut le cardinal en audience particulière, comme il reçut aussi Mgr Heylen, dont la visite à Rome coïncidait avec celle du primat de Belgique. La participation aux travaux des Congrégations, les réceptions, les visites absorbèrent le reste de son séjour. De tous côtés des représentants de tous les partis saluaient sa venue en termes empreints du plus profond respect. Les cardinaux de Paris et de Londres, les évêques, les prélats, les Belges exilés, les associations catholiques des pays alliés lui envoyaient des délégations et des adresses pour lui exprimer leur admiration.
À son départ pour la Belgique, à Rome et dans les villes qui marquaient son passage, il fut l'objet de manifestations identiques à celles qui l'avaient accueilli cinq semaines plus tôt.
Le Cardinal est-il allé de lui-même à Rome pour plaider la cause des Belges? Y a-t-il été appelé par le Pape désireux de s'instruire? Il réussit en tout cas à rompre le cordon d'investissement établi autour du Vatican par les agents de l'Allemagne et de l'Autriche. Son voyage eut pour résultat d'aviver les sympathies pour la Belgique, d'éclairer le Vatican et de le rendre plus favorable aux Belges. Mgr Heylen et lui ont eu raison des dernières résistances, plus importantes par la qualité que par le nombre, dont l'entourage du Saint Père était, malheureusement, le retranchement suprême. Rien n'a tenu contre la simplicité, la modération et la force de ces deux confesseurs—le mot n'est pas excessifs—armés de témoignages directs et en état d'opposer des faits authentiques, contrôlés par leurs soins, soumis à une critique impitoyable, aux arguties des avocats de l'Allemagne.
Rentré à Malines, le Cardinal Mercier écrivit pour ses diocésains la magnifique pastorale: "A notre retour de Rome". On lira avec émotion les extraits suivants, en admirant la courageuse fierté avec laquelle son auteur a affirmé, au milieu des baïonnettes prussiennes, les espoirs de son peuple.
Fête de Saint-Thomas-d'Aquin, 1916.
Mes bien chers Frères,
.......................................................
Il y a beaucoup de choses que je ne puis vous dire. Vous me comprenez. La situation anormale que nous avons à subir nous interdit de vous exposer, à coeur ouvert, tout juste ce qu'il y a en notre âme, de meilleur et de plus intime pour vous; ce qui, venant de plus haut et vous touchant de plus près, est à moi mon plus ferme soutien et serait pour vous, si je pouvais parler, votre tout puissant réconfort; mais vous ne douterez pas de ma parole, vous me croirez lorsque je vous assure que mon voyage a été particulièrement béni, et que je vous reviens heureux, très heureux.
....................................................
Vous avez eu déjà des échos, je pense, des acclamations qui, sur tout le parcours de notre voyage, à l'aller et au retour, en Suisse et en Italie, saluèrent le nom belge.
Supposez même, mes bien chers Frères, que l'issue finale du duel gigantesque engagé, en ce moment, en Europe et en Asie-Mineure, fût encore incertaine, un fait acquis à la civilisation et à l'histoire, c'est le triomphe moral de la Belgique. En union avec votre Roi et votre Gouvernement, vous avez consenti à la Patrie un sacrifice immense. Par respect pour notre parole d'honneur; pour affirmer que, dans vos consciences, le droit prime tout, vous avez sacrifié vos biens, vos foyers, vos fils, vos époux, et, après dix-huit mois de contrainte, vous demeurez, comme le premier jour, fiers de votre geste; l'héroïsme vous paraît si naturel, qu'il ne vous vient pas à la pensée d'en tirer gloire pour vous-mêmes. Mais si vous aviez pu, comme nous, franchir nos frontières et contempler à distance la patrie belge; si vous aviez entendu le peuple, "l'homme dans la rue", ainsi que s'expriment les Anglais, je veux dire l'ouvrier manuel, le petit employé, la femme de la classe qui peine; si vous aviez recueilli les témoignages, vivants ou écrits, de ceux qui représentent, avec autorité, les grandes forces sociales, la politique, la presse, la science, l'art, la diplomatie, la religion, vous auriez mieux pris conscience de la magnanimité de votre attitude, vos âmes auraient tressailli d'allégresse et même, je crois, d'orgueil.
........................................................
Vous voudrez bien reconnaître que je ne vous ai jamais caché mes appréhensions. Je vous ai prêché le patriotisme, parce qu'il est une dépendance de la vertu maîtresse du christianisme, de la charité. Mais, dès l'abord, je vous ai fait entrevoir que, selon mon humble pressentiment, notre épreuve serait longue, et que le succès appartiendrait aux nations qui y mettraient le plus d'endurance.
La conviction, naturelle et surnaturelle, de notre victoire finale est plus profondément que jamais ancrée en mon âme. Si, d'ailleurs, elle avait pu être ébranlée, les assurances que m'ont fait partager plusieurs observateurs désintéressés et attentifs de la situation générale, appartenant notamment aux deux Amériques, l'eussent solidement raffermie.
Nous l'emporterons, n'en doutez pas, mais nous ne sommes pas au bout de nos souffrances.
La France, l'Angleterre, la Russie se sont engagées à ne pas conclure de paix, tant que la Belgique n'aura pas recouvré son entière indépendance et n'aura pas été largement indemnisée. L'Italie, à son tour, a adhéré au pacte de Londres.
L'avenir n'est point douteux pour nous.
...................................................
Après le voyage à Rome, il sembla que les autorités allemandes eussent reçu le mot d'ordre de créer le plus de difficultés possibles au cardinal Mercier. La presse allemande avait été déchaînée contre lui; visiblement, elle cherchait à justifier les mesures que le gouverneur général de Belgique pourrait être amené à prendre contre le trop ardent défenseur du bon droit. Elle alla jusqu'à l'accuser d'espionnage et, au mois de mars 1916, on eut la surprise d'apprendre qu'une descente avait eu lieu au Palais archiépiscopal et que le chanoine Loncin avait été arrêté.
Le cardinal, dont la bibliothèque avait été fouillée et la correspondance saisie, adressa sur-le-champ une note de protestation au gouverneur général. Dans cette note, il s'élevait avec vigueur contre la violation du secret que Rome seule peut briser et qui, dans ce cas, fut impuissant à sauvegarder divers cas du forum conscientiae contre l'arbitraire de soldats.
Il signala au Saint-Siège, suprême juge en l'occurrence, cette violation par la force brutale du secret de l'administration et des choses d'Eglise.
Le Gouvernement allemand répondit par une note où il prétendait que la liberté de l'Eglise n'a rien à voir dans cette affaire et que c'est en vain que le cardinal, faute d'avoir des sujets de plaintes légitimes, s'efforçait d'inventer une violation des droits ecclésiastiques par l'Allemagne.
Néanmoins, le chanoine Loncin fut relâché.
Vers la même époque, le cardinal Mercier eut encore à se plaindre des procédés allemands à propos d'un mandement de Carême. A la vérité, il n'y avait pour les Allemands rien de particulier à relever dans ce document d'inspiration purement religieuse, mais le mot d'ordre, nous l'avons dit, était de chercher misère. On releva donc une phrase ainsi connue: "Ni le cheval, ni le chevalier, ni la force des armées ne garantissent le succès final. Est-ce que Dieu ne peut pas anéantir en un clin d'oeil les plus belles espérances d'une nation belliqueuse en déchaînant sur elle une épidémie? C'est entre les mains de Dieu que repose le sort de la Belgique."
Von Bissing écrivit à l'archevêque une lettre grossière où il lui faisait reproche, à l'abri de cette phrase séparée de son contexte, de vouloir soulever la population contre l'occupant.
L'archevêque répondit simplement qu'il n'avait fait, en écrivant ce mandement, qu'exercer son droit d'évêque, et que les Allemands lui avaient déjà, à plus d'une reprise, cherché querelle. Et puis, ajoutait-il, la population belge est toujours restée calme, tout le monde a pu le constater: Que me reproche-t-on de l'exciter?
Le gouverneur général se tint coi.
Lisons maintenant un extrait de l'allocution que le cardinal Mercier a prononcée le 21 juillet 1916 à Bruxelles, dans la collégiale de Sainte-Gudule, au cours de la cérémonie commémorative de la fête nationale. C'est le coeur haletant qu'on la relira, ligne par ligne, comme l'une des choses les plus belles et les plus élevées qui aient jamais été dites.
Nos bien chers Frères,
Nous devions ici nous réunir pour fêter le 85e anniversaire de notre indépendance nationale.
Dans quatorze ans, à pareil jour, nos cathédrales restaurées et nos églises rebâties seront larges ouvertes; la foule s'y précipitera; notre Roi Albert, debout sur son trône, inclinera, mais d'un geste libre, devant la majesté du Roi des rois, son front indompté; la Reine, les princes royaux l'entoureront; nous réentendrons les envolées joyeuses de nos cloches et, dans le pays entier, sous les voûtes des temples, les Belges, la main dans la main, renouvelleront leurs serments à leur Dieu, à leur Souverain, à leurs libertés, tandis que les évêques et les prêtres, interprètes de l'âme de la nation, entonneront, dans un commun élan de reconnaissance joyeuse, un triomphal Te Deum.
Aujourd'hui, l'hymne de la joie expire sur nos lèvres.
Le peuple juif, captif à Babylone, assis en larmes au bord de l'Euphrate, regardait couler les eaux du fleuve Ses harpes muettes pendaient aux saules du rivage Qui aurait eu le courage de chanter le cantique de Jéhovah, sur un sol étranger? "Terre patriarcale de Jérusalem, s'écriait le Psalmiste, si jamais je t'oublie, que ma main droite se dessèche! Que ma langue reste collée à mon palais si je cesse de penser à toi; si tu n'es plus la première de mes joies!"
Le psaume s'achève en paroles imprécatoires. Nous nous interdisons de les reproduire; nous ne sommes plus du Testament Ancien, qui tolérait la loi du talion: "Oeil pour oeil, dent pour dent." Nos lèvres, purifiées par le feu de la charité chrétienne, ne profèrent point de haine.
Haïr, c'est prendre le mal d'autrui pour but et s'y complaire. Quelles que soient nos douleurs, nous ne voulons point de haine à ceux qui nous les infligent. La concorde nationale s'allie, chez nous, à la fraternité universelle. Mais au-dessus du sentiment de l'universelle fraternité, nous plaçons le respect du droit absolu, sans lequel il n'y a pas de commerce possible, ni entre les individus, ni entre les nations.
Et voilà pourquoi, avec saint Thomas d'Aquin, le docteur le plus autorisé de la théologie chrétienne, nous proclamons que la vindicte publique est une vertu.
Le crime, violation de la justice, attentat à la paix publique, qu'il émane d'un particulier ou d'une collectivité, doit être réprimé. Les consciences sont soulevées, inquiètes, à la torture, tant que le coupable n'est pas, selon l'expression si saine et si forte du langage spontané, remis à sa place; c'est rétablir l'ordre, rasseoir l'équilibre, restaurer la paix sur la base de la justice.
La vengeance publique ainsi comprise peut irriter la sensiblerie d'une âme faible; elle n'est pas moins, dit saint Thomas, l'expression, la loi de la charité la plus pure et du zèle qui en est la flamme. Elle ne se fait pas de la souffrance une cible, mais une arme, vengeresse du droit méconnu.
...................................................
Le chef de l'une de nos plus nobles familles m'écrivait: "Notre fils, du 7e de ligne, est tombé; ma femme et moi en avons le coeur brisé; cependant, s'il le fallait, nous le redonnerions encore."
Un vicaire de la capitale vient d'être condamné à douze ans de travaux forcés. On me permet d'aller dans sa cellule l'embrasser et le bénir: "J'ai, dit-il, trois frères au front; je crois être ici pour avoir aidé le plus jeune—il a dix-sept ans—à rejoindre ses aînés; une de mes soeurs est dans une cellule voisine, mais, j'en remercie le bon Dieu, ma mère ne reste pas seule; elle nous l'a fait dire; d'ailleurs, elle ne pleure pas."
N'est-ce pas que nos mères font songer à la mère des Macchabées?
Que de leçons de grandeur morale! Ici même et sur le chemin de l'exil, et dans les prisons et dans les camps de concentration, en Hollande et en Allemagne!
Pensons-nous assez à ce que doivent souffrir ces braves qui, depuis le début de la guerre, au lendemain de la défense de Liège et de Namur ou de la retraite d'Anvers ont vu leur carrière militaire brisée et rongent leur frein; ces gardiens du droit ou de nos franchises communales, que leur vaillance a réduits à l'inaction!
Il y a du courage dans l'élan; il n'y en a pas moins à le contenir. Il y a même plus de vertu, parfois, à pâtir qu'à agir.
Et ces deux années de soumission du peuple belge à l'inévitable? cette ténacité profonde qui faisait dire à une humble femme, devant laquelle on discutait la possibilité d'une prochaine conclusion de la paix: Oh! pour nous, il ne faut rien presser; nous attendrons encore! Comme tout cela est beau et plein d'enseignements pour les générations à venir!
Voilà ce qu'il faut voir, mes Frères: la magnanimité de la nation dans le sacrifice, notre universelle et persévérante confraternité dans les angoisses, dans les deuils, et dans la même invincible espérance; voilà ce qu'il faut regarder, pour estimer à sa valeur la patrie belge.
........................................................
La date prochaine du premier centenaire de notre indépendance doit nous trouver plus forts, plus intrépides, plus unis que jamais. Préparons-nous y dans le travail, dans la patience, dans la fraternité.
Lorsque, en 1930, nous remémorerons les années sombres de 1914-1916, elles nous apparaîtront les plus lumineuses, les plus majestueuses, et, à la condition que nous sachions dès aujourd'hui le vouloir, les plus heureuses et les plus fécondes de notre histoire nationale.
Per Crucem ad lucem; du sacrifice jaillit la lumière!
NOTE
Avec le même courage qu'il avait adressé en 1914 le premier réquisitoire contre les crimes allemands, et plaidé à Rome la cause de la Belgique opprimée, le cardinal Mercier entreprit, aux jours lugubres qui ont marqué la fin de l'année 1916, de sauver ses compatriotes de la déportation vers les usines de l'Allemagne et ses fronts de bataille. On retrouvera ici quelques extraits des lettres épineuses qu'il adressa, dans ce but, aux autorités allemandes à Bruxelles, principalement au gouverneur général von Bissing.
La première est du 19 octobre; le cardinal rappelle en termes sévères les promesses faites antérieurement, de n'astreindre les Belges ni aux prestations militaires, ni aux travaux forcés:
Malines, le 19 octobre 1916.
Monsieur le Gouverneur Général,
Au lendemain de la capitulation d'Anvers, la population, affolée, se demandait ce qu'il adviendrait des Belges en âge de porter les armes ou qui arriveraient à cet âge avant la fin de l'occupation. Les supplications des pères et mères de famille me déterminèrent à interroger M. le Gouverneur d'Anvers, le Baron von Huene, qui eut l'obligeance de me rassurer et de m'autoriser à rassurer les parents angoissés. Le bruit s'était répandu à Anvers, cependant, qu'à Liège, à Namur, à Charleroi, des jeunes gens avaient été saisis et emmenés de force en Allemagne. Je priai donc M. le Gouverneur von Huene de vouloir me confirmer par écrit la garantie qu'il m'avait donnée verbalement, que rien de pareil ne s'effectuerait à Anvers. Il me répondit tout de suite que les bruits relatifs aux déportations étaient sans fondement, et sans hésiter, me remit par écrit, entre autres déclarations, la suivante: "Les jeunes gens n'ont point à craindre d'être emmenés en Allemagne, soit pour y être enrôlés dans l'armée, soit pour y être employés à des travaux forcés."
Cette déclaration écrite et signée fut communiquée publiquement au clergé et aux fidèles de la province d'Anvers, ainsi que Votre Excellence pourra s'en assurer par le document ci-inclus, en date du 16 octobre 1914, qui fut lu dans toutes les églises.
Douter de l'autorité de pareils engagements, c'eût été faire injure aux personnalités qui les avaient souscrits, et je m'employai donc à raffermir, par tous les moyens de persuasion en mon pouvoir, les inquiétudes persistantes des familles intéressées.
Or, voici que votre Gouvernement arrache à leurs foyers des ouvriers réduits malgré eux au chômage, les sépare violemment de leurs femmes et de leurs enfants et les déporte en pays ennemi. Nombreux sont les ouvriers qui ont déjà subi ce malheureux sort; plus nombreux ceux que menacent les mêmes violences.
Au nom de la liberté de domicile et de la liberté de travail des citoyens belges; au nom de l'inviolabilité des familles; au nom des intérêts moraux que compromettrait gravement le régime de la déportation; au nom de la parole donnée par le Gouverneur de la province d'Anvers et par le Gouverneur général, représentant immédiat de la plus haute autorité de l'Empire allemand, je prie respectueusement Votre Excellence de vouloir retirer les mesures de travail forcé et de déportation intimées aux ouvriers belges et de vouloir réintégrer dans leurs foyers ceux qui on déjà été déportés.
Votre Excellence appréciera combien me serait pénible le poids de la responsabilité que j'aurais à porter vis-à-vis des familles, si la confiance qu'elles vous ont accordée par mon entremise et sur mes instances était lamentablement déçue.
Je m'obstine à croire qu'il n'en sera pas ainsi.
Agréez, Monsieur le Gouverneur général, l'assurance de ma très haute considération.
Signé: D.-L. Cardinal MERCIER, Archevêque de Malines.
A la lettre du primat de Belgique, le général von Bissing répondit, le 26 octobre, par un long plaidoyer où il prétendait démontrer que le Gouvernement allemand, en déportant les ouvriers belges, se bornait à user d'un droit et à remplir un devoir dans l'intérêt même du peuple belge. Boche jusqu'au bout, le gouverneur du Kaiser, après avoir ergoté sur la portée des engagements pris jadis, allait même jusqu'à oser écrire qu'il avait lui-même à coeur plus que personne le haut idéal des vertus familiales compromises par la paresse!
A toutes ces tartuferies, le cardinal Mercier a répondu par me lettre où il défend les ouvriers belges contre les calomnies du gouverneur allemand et où il démontre que le plaidoyer de celui-ci n'est fait que de contre-vérités et de misérables arguties.
En voici des extraits:
Malines, le 10 novembre 1916.
Monsieur le Gouverneur Général,
Ma lettre du 19 octobre rappelait à Votre Excellence l'engagement pris par le baron von Huene, gouverneur militaire d'Anvers, et ratifié, quelques jours plus tard, par le baron von der Goltz, votre prédécesseur au gouvernement général de Bruxelles. L'engagement était explicite, absolu, sans limite de durée: "Les jeunes gens n'ont point à craindre d'être emmenés en Allemagne, soit pour y être enrôlés dans l'armée, soit pour être employés à des travaux forcés."
Cet engagement est violé tous les jours des milliers de fois, depuis quinze jours.
Le baron von Huene et feu le baron von der Goltz n'ont pas dit conditionnellement, ainsi que le voudrait faire entendre votre dépêche du 26 octobre: "Si l'occupation ne dure pas plus de deux ans, les hommes aptes au service militaire ne seront pas mis en captivité"; ils ont dit catégoriquement: "Les jeunes gens, et à plus forte raison les hommes arrivés à l'âge mûr, ne seront, à aucun moment de la durée de l'occupation, ni emprisonnés, ni employés à des travaux forcés."
Pour se justifier, Votre Excellence invoque "la conduite de l'Angleterre et de la France qui ont, dit-elle, enlevé sur les bateaux neutres tous les Allemands de 17 à 50 ans, pour les interner dans les camps de concentration".
Si l'Angleterre et la France avaient commis une injustice, c'est sur les Anglais et les Français qu'il faudrait vous venger et non sur un peuple inoffensif et désarmé. Mais y a-t-il eu injustice? Nous sommes mal informés de ce qui se passe au delà des murs de notre prison, mais je suis fort tenté de croire que les Allemands saisis et internés appartenaient à la réserve de l'armée impériale; ils étaient donc des militaires que l'Angleterre et la France avaient le droit d'envoyer dans des camps de concentration.
L'occupant s'est emparé d'approvisionnement considérables de matières premières destinées à notre industrie nationale: il a saisi et expédié en Allemagne les machines, les outils, les métaux de nos usines et de nos ateliers. La possibilité du travail national ainsi supprimée, il restait à l'ouvrier une alternative: travailler pour l'empire allemand, soit ici, soit en Allemagne, ou chômer. Quelques dizaines de milliers d'ouvriers, sous la pression de la peur ou de la faim, acceptèrent, à regret pour la plupart, du travail de l'étranger; mais quatre cent mille ouvriers ou ouvrières préférèrent se résigner au chômage, avec ses privations, que de desservir les intérêts de la patrie; ils vivaient dans la pauvreté, à l'aide du maigre secours que leur allouait le Comité national de secours et d'alimentation contrôlé par les ministères protecteurs d'Espagne, d'Amérique, de Hollande.
Calmes, dignes, ils supportaient sans murmure leur sort pénible. Nulle part, il n'y eut ni révolte ni apparence de révolte. Patrons et ouvriers attendaient avec endurance la fin de notre longue épreuve. Cependant, les administrations communales et l'initiative privée essayaient d'atténuer les inconvénients indéniables du chômage. Mais le pouvoir occupant paralysa leurs efforts. Le Comité national tenta d'organiser un enseignement professionnel à l'usage des chômeurs. Cet enseignement pratique, respectueux de la dignité de nos travailleurs, devait leur entretenir la main, affiner leurs capacités de travail, préparer le relèvement du pays. Qui s'opposa à cette noble initiative, dont nos grands industriels avaient élaboré le plan? Qui? Le pouvoir occupant.
.................................................
Mais l'Allemagne, par divers procédés, notamment par l'organisation de ses "Centrales", sur lesquelles ni les Belges, ni les ministres protecteurs ne peuvent exercer aucun contrôle efficace, absorbe une part considérable des produits de l'agriculture et de l'industrie du pays. Il en résulte un renchérissement considérable de la vie, cause de privations pénibles pour ceux qui n'ont pas d'économies. La "communauté d'intérêts" dont la lettre vante pour nous l'avantage n'est pas l'équilibre normal des échanges commerciaux, mais la prédominance du fort sur le faible.
Cet état d'infériorité économique auquel nous sommes réduits, ne nous le présentez donc pas, je vous prie, comme un privilège qui justifierait le travail forcé au profit de notre ennemi et la déportation de légions d'innocents en terre d'exil.
L'esclavage, et la peine la plus forte du code pénal après la peine de mort, la déportation! La Belgique, qui ne vous fit jamais aucun mal, avait-elle mérité de vous ce traitement qui crie vengeance au ciel?
Il y a deux ans, entend-on répéter, c'était la mort, le pillage, l'incendie, mais c'est la guerre! Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre, c'est le calcul froid, l'écrasement voulu, l'emprise de la force sur le droit, l'abaissement de la personnalité humaine, un défi à l'humanité.
Il dépend de vous, Excellence, de faire taire ces cris de la conscience révoltée. Puisse le bon Dieu, que nous invoquons de toute l'ardeur de notre âme pour notre peuple opprimé, vous inspirer la pitié du bon Samaritain!
Agréez, Monsieur le Gouverneur général, l'hommage de ma très haute considération.
Signé: D.-J. Cardinal MERCIER,
Archevêque de Malines.
Le gouverneur von Bissing ne répondit pas autrement que la première fois. Évitant toute discussion directe, il se borna à reprendre les arguments exposés le 26 octobre. Cela lui valut, de la part du cardinal, une nouvelle protestation pleine de coeur et de dignité:
Malines, le 29 novembre 1916.
Monsieur le Gouverneur Général,
La lettre (1.11254) que Votre Excellence me fait l'honneur de m'écrire, sous la date du 23 novembre, est pour moi une déception. En plusieurs milieux, que j'avais lieu de croire exactement renseignés, il se disait que Votre Excellence s'était fait un devoir de protester devant les plus hautes autorités de l'empire, contre les mesures qu'Elle est contrainte d'appliquer à la Belgique. J'escomptais donc pour le moins un délai dans l'application de ces mesures, en attendant qu'elles fussent soumises à un examen nouveau, et un adoucissement aux procédés qui les mettent à exécution.
Or, voici que, sans répondre un mot à aucun des arguments par lesquels j'établissais, dans mes lettres du 19 octobre et du 10 novembre, le caractère antijuridique et antisocial de la condamnation de la classe ouvrière belge aux travaux forcés et à la déportation, Votre Excellence se borne à reprendre dans sa dépêche du 23 novembre le texte même de sa lettre du 26 octobre. Ses deux lettres du 23 novembre et du 26 sont, en effet, identiques dans le fond et presque dans la forme.
D'autre part, le recrutement des prétendus chômeurs se fait, la plupart du temps, sans aucun égard aux observations des autorités locales. Plusieurs rapports que j'ai en mains, attestant que le clergé est brutalement écarté, les bourgmestres et conseillers communaux réduits au silence; les recruteurs se trouvent donc en face d'inconnus parmi lesquels ils font arbitrairement leur choix.
Les exemples de ce que j'avance abondent; en voici deux très récents parmi une quantité d'autres que je tiens à la disposition de Votre Excellence. Le 21 novembre, le recrutement se fit dans la commune de Kersbeek-Miseom. Sur les 4,323 habitants que compte la commune, les recruteurs en enlevèrent 94, en bloc, sans distinction de condition sociale ou de profession, fils de fermiers, soutiens de parents âgés et infirmes, pères de famille laissant femme et enfants dans la Misère, tous nécessaires à leur famille comme le pain de chaque jour. Deux familles se voient ravir chacune quatre fils à la fois. Sur les 94 déportés, il y avait deux chômeurs.
Dans la région d'Aerschot, le recrutement se fit le 23 novembre: à Rillaer, à Gelrode, à Rotselaer, des jeunes gens, soutiens d'une mère veuve; des fermiers à la tête d'une nombreuse famille, l'un d'entre eux qui a passé les 50 ans, a dix enfants, cultivant des terres, possédant plusieurs bêtes à cornes, n'ayant jamais touché un sou de la charité publique, furent emmenés de force, en dépit de toutes les protestations. Dans la petite commune de Rillaer, on a pris jusqu'à 25 jeunes garçons de 17 ans.
Votre Excellence eût voulu que les administrations communales se fissent les complices de ces recrutements odieux. De par leur situation légale et en conscience, elles ne le pouvaient pas. Mais elles pouvaient éclairer les recruteurs et ont qualité pour cela. Les prêtres, qui connaissent mieux que personne le petit peuple, seraient pour les recruteurs des auxiliaires précieux. Pourquoi refuse-t-on leur concours?
A la fin de sa lettre, Votre Excellence rappelle que les hommes appartenant aux professions libérales ne sont pas inquiétés. Si l'on emmenait que des chômeurs, je comprendrais cette exception. Mais si l'on continue d'enrôler indistinctement les hommes valides, l'exception est injustifiée.
Il serait inique de faire peser sur la classe ouvrière seule la déportation. La classe bourgeoise doit avoir sa part dans le sacrifice, si cruel soit-il et tout juste parce qu'il est cruel, que l'occupant impose à la nation. Nombreux sont les membres de mon clergé qui m'ont prié de réclamer pour eux une place a l'avant-garde des persécutés. J'enregistre leur offre et vous la soumets avec fierté.
Je veux croire que les autorités de l'Empire n'ont pas dit leur dernier mot. Elles penseront à nos douleurs imméritées, à la réprobation du monde civilisé, au jugement de l'histoire et au châtiment de Dieu.
Agréez, Excellence, l'hommage de ma très haute considération.
D.-J. Cardinal MERCIER,
Archevêque de Malines.
Après cette lettre cinglante, le gouverneur général ne dit plus rien. Du moins, à l'heure où s'imprime cette brochure, on ignore encore s'il trouva quelque réponse à y faire.
Malines, le 7 novembre 1916.
................................................
La vérité toute nue est que chaque ouvrier déporté est un soldat de plus pour l'armée allemande. Il prendra la place d'un ouvrier allemand dont on fera un soldat. De sorte que la situation que nous dénonçons au monde civilisé se réduit à ces termes: Quatre cent mille ouvriers se trouvent malgré eux, et en grande partie à cause du régime d'occupation, réduits au chômage. Fils, époux, pères de famille, ils supportent sans murmure, respectueux de l'ordre public, leur sort malheureux; la solidarité nationale pourvoit à leurs plus pressants besoins; à force de parcimonie et de privations généreuses, ils échappent à la misère extrême et attendent, avec dignité, dans une intimité que le deuil national resserre, la fin de notre commune épreuve.
Des équipes de soldats pénètrent de force dans ces foyers paisibles, arrachent les jeunes gens à leurs parents, le mari à sa femme, le père à ses enfants; gardent à la baïonnette les issues par lesquelles veulent se précipiter les épouses et les mères pour dire aux partants un dernier adieu; rangent les captifs par groupes de quarante ou de cinquante, les hissent de force dans des fourgons; la locomotive est sous pressions; dès que le train est fourni un officier supérieur donne le signal du départ. Voilà un nouveau millier de Belges réduits en esclavage et, sans jugement préalable, condamnés à la peine la plus forte du Code pénal après la peine de mort, à la déportation. Ils ne savent ni où ils vont, ni pour combien de temps. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur travail ne profitera qu'à l'ennemi. A plusieurs, par des appâts ou sous la menace, on a extorqué un engagement que l'on ose appeler "volontaire".
Au reste, on enrôle des chômeurs, certes, mais on recrute aussi en grand nombre—dans la proportion d'un quart, pour l'arrondissement de Mons,—des hommes qui n'ont jamais chômé et appartenant aux professions les plus diverses: bouchers, boulangers, patrons tailleurs, ouvriers brasseurs, électriciens, cultivateurs; on prend même de tout jeunes élèves de collèges, d'universités ou d'autres écoles supérieures.
Nous, pasteurs de ces ouailles que la force brutale nous arrache, angoissés à l'idée de l'isolement moral et religieux où elles vont languir, témoins impuissants des douleurs et de l'épouvante de tant de foyers brisés ou menacés, nous nous tournons vers les âmes croyantes ou non croyantes, qui, dans les pays alliés, dans les pays neutres, même dans les pays ennemis ont le respect de la dignité humaine.
Lorsque le cardinal Lavigerie entreprit sa campagne anti-esclavagiste, le Pape Léon XIII bénissant sa mission lui dit: "L'opinion est, plus que jamais la reine du monde; c'est sur elle qu'il faut agir. Vous ne vaincrez que par l'opinion."
Daigne la divine Providence inspirer à quiconque a une autorité, une parole, une plume, de se rallier autour de notre humble drapeau belge, pour l'abolition de l'esclavage européen!
Puisse la conscience humaine triompher de tous les sophismes, et demeurer obstinément fidèle à la grande parole de saint Ambroise: L'honneur au-dessus de tout!
Au nom des évêques belges:
Signé: D.-J. Cardinal MERCIER,
Archevêque de Malines.
Table des matières
AVANT PROPOS.
Chapitre I.—"C'est la guerre!"
Chapitre II.—Le buvetier boche et, la Brabançonne.
Chapitre III.—"Thank You."
Chapitre IV—A l'hôpital.
Chapitre V.—La Prise d'Anvers.
Chapitre VI—L'Exode.
Chapitre VII.—Dans les transes.
Chapitre VIII.—L'Allemand est là!
Chapitre IX.—Un hôte allemand.
Chapitre X.—Parole d'Allemand.
Chapitre XI.—Citoyen britannique.
Chapitre XII.—Ça se corse.
Chapitre XIII.—Un major désolé.
Chapitre XIV.—En Allemagne.
Chapitre XV.—La Stadvogtei.
Chapitre XVI.—La vie en prison.
Chapitre XVII.—Où il est parlé de menu.
Chapitre XVIII.—En ma qualité de médecin.
Chapitre XIX.—Quelques prisonniers intéressants.
Chapitre XX.—Maclinks et Kirkpatrick.
Chapitre XXI.—Un Suisse et un Belge.
Chapitre XXII.—Évasions.
Chapitre XXIII.—Espoir déçu.
Chapitre XXIV.—Un colloque.
Chapitre XXV.—Incidents et remarques.
Chapitre XXVI.—Question d'échange.
Chapitre XXVII.—Vers la liberté.
Chapitre XXVIII.—En pensant à l'Allemagne.
Chapitre XXIX.—D'autres réminiscences.
Chapitre XXX.—Un sous-officier alsacien.
Chapitre XXXI—En Hollande et en Angleterre.
Chapitre XXXII—Le Militarisme et le Militarisé.
Appendice
Extraits de la lettre du Cardinal Mercier: "Patriotisme et endurance".
Le voyage à Rome et la lettre pastorale: "A notre retour de Rome".
Démêlés du Cardinal avec les autorités allemandes.
Allocution du Cardinal Mercier.
Les protestations du Cardinal.
Extraits de la protestation publique.






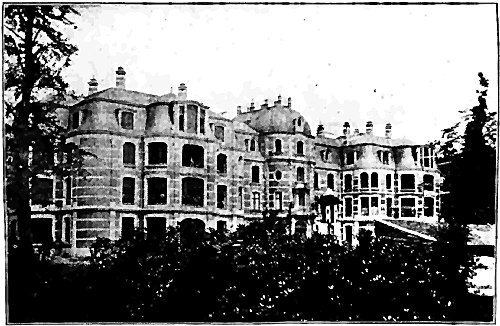

|
LUDENDORF (croix) ET VON BUELOW |
MESDEMOISELLES BÉLAND ET COGELS EN COSTUME DE
|