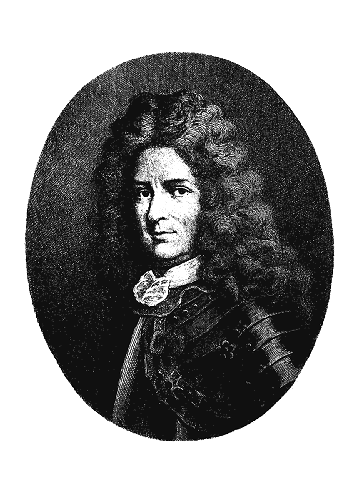
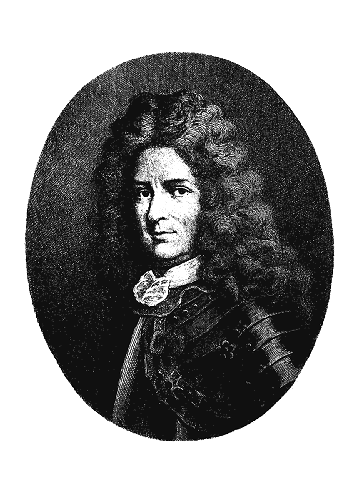
La Nouvelle-France, explorée en 1534 par Jacques Cartier, occupée par Champlain en 1608, estimée à la plus haute valeur par de grands hommes d'État, comme le président Jeannin, le cardinal de Richelien, l'illustre Colbert, avait pu conquérir, dès la fin du XVIIe siècle, une importance considérable.
Et en effet, cette colonie, confinée d'abord sur les rives du Saint-Laurent, était devenue, vers l'année 1700, une domination puissante. Elle s'étendait depuis Terre-Neuve jusqu'aux montagnes Rocheuses, depuis la baie d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique. Ainsi elle formait un immense triangle présentant 900 lieues sur chaque face, c'est-à-dire 400,000 lieues carrées, près de onze fois la surface du la France.
Une si vaste contrée était aussi précieuse par l'abondance de ses produits que par leur variété; elle offrait à la mère patrie une source inépuisable de richesse.
A l'ouest, des forêts sans limites; au nord, la région des fourrures; à l'est, les grandes pêcheries de Terre-Neuve; enfin au sud, un sol fertile, un climat enchanteur, avec les produits incomparables des tropiques.
De plus, la Nouvelle-France avait conquis une vie individuelle éminente sous tous les rapports; elle avait offert une carrière héroïque à des missionnaires intrépides, fourni des saints, recruté des communautés nombreuses et exemplaires; elle avait révélé à l'admiration de la métropole des hommes du plus grand mérite, comme Jacques Cartier, Samuel de Champlain, du Maisonneuve, Le Ber, Talon, de Frontenac, de Tonnancourt, de Montigny, de Boucherville, et enfin, cette admirable famille des Le Moyne, qui ont été jugés dignes d'être salués du nom glorieux de Macchabées du Canada.
A une époque comme la nôtre, où l'on a sagement reconnu l'importance des entreprises coloniales et des établissements lointains; dans un temps on l'on revient à ces oeuvres, on peut trouver intéressant et souverainement utile de considérer comment une domination si grande a été conquise, établie et développée.
Les premiers temps de l'occupation ont été largement exposés dans des ouvrages considérables, comme ceux du P. Charlevoix, de M. Faillon, de M. Garneau, de M. Ferland; enfin dans les oeuvres des premiers navigateurs eux-mêmes: Jacques Cartier, Champlain, et M. de Poutrincourt, qui ont rédigé leurs mémoires. Mais quand on arrive à la période de l'accroissement même de la Nouvelle-France, à partir de 1680, il est nécessaire de réunir, de rassembler les documents innombrables disséminés dans un nombre infini d'ouvrages.
Pour bien connaître ces temps de transition, où la petite colonie du Saint-Laurent atteignit l'étendue d'une domination presque aussi vaste que l'Europe, il faut commencer par étudier quelques-uns des hommes d'État et des hommes de guerre qui ont eu part à ces changements extraordinaires.
Or, incontestablement, l'homme dont il faudrait d'abord s'occuper, c'est celui qui a été le plus remarquable de tous, celui qui a eu la vie la plus aventureuse et la destinée la plus glorieuse, qui a joué le rôle le plus éminent, pendant trente ans, dans les plus grands événements du pays. Celui-là, c'est l'illustre chevalier d'Iberville, de la famille des Le Moyne; et nous croyons qu'il serait indispensable de le faire connaître avant tous.
D'Iberville était né à Montréal, en 1662, dans la maison de son père, Charles Le Moyne, sur la rue Saint-Joseph, où se trouve actuellement le bureau de la Fabrique de l'église Notre-Dame. Il a eu la gloire d'être associé aux plus grands évènements de ces premières années, et on peut dire qu'il y a eu la part principale.
Il s'agissait de conquérir les richesses de cet immense continent, et ces forêts dix fois séculaires qui couvraient au nord des cent mille lieues carrées, et ces régions où se trouvent les pelleteries les plus belles qu'il y ait au monde, et ces courants mystérieux de l'Océan allant porter chaque année sur les côtes de l'Atlantique des millions de bancs de poissons pour la subsistance de l'univers, et enfin ces contrées du sud avec leurs sites enchanteurs, un climat délicieux, une fertilité incomparable et tous les fruits du paradis terrestre.
Or, c'est ce que le chevalier d'Iberville a merveilleusement mis à exécution. A l'âge de 22 ans, en 1684. il conduisit plusieurs expéditions à la baie d'Hudson et prit tous les comptoirs anglais. Dès lors, la France pouvait prétendre au monopole des forêts de l'Ouest et du commerce des fourrures.
Dans son expédition à Terre-Neuve, en 1690, il rendit la mère patrie maîtresse des marchés de l'Europe pour l'exploitation des pêcheries.
Enfin, par ses exploits dans les Antilles et dans le golfe du Mexique, de 1700 à 1705, il avait conquis les plus beaux pays du monde.
N'en est-ce pas assez pour être tiré de l'oubli des années et pour être proposé à l'attention des générations présentes?
Donc, dans l'espoir d'être utile à notre temps, nous voudrions que l'on prît connaissance de cette oeuvre de réparation vis-à-vis d'un colonisateur incomparable et d'un héros trop ignoré. C'est un grand enseignement pour les esprits d'élite qui commencent à estimer l'importance de nos ancienne colonies; c'est une gloire pour la marine française, qui peut citer ce nom sur se même rang que ceux de Jean Bart, Tourville ou Duguay-Trouin; c'est un honneur pour la ville de Montréal, la plus grande cité de la colonie française, que de faire valoir celui qui a été peut-être le plus illustre de ses enfants. On a déjà parlé de lui consacrer, dans sa ville natale, une effigie qui serait si belle avec le magnifique portrait que l'on a conservé de lui; mais, un attendant, ne convient-il pas de montrer combien cet honneur lui est dû?
C'est dans ce but que nous consacrons cette monographie à la mémoire du très illustre Pierre Le Moyne, citoyen de Montréal, sire d'Iberville, chevalier des ordres du roi et commandant de ses vaisseaux.
Christophe Colomb avait accompli sa découverte, le 12 octobre 1492. Le bruit s'en répandit aussitôt en Europe et l'on comprend quelle émotion causa un si grand évènement. En attendant que les gouvernements prissent une décision, plusieurs contrées maritimes songèrent à explorer les régions nouvelles.
Les marins de la Bretagne et de la Normandie furent des premiers à les aborder; ils reconnurent d'abord le banc de Torre-Neuve, et les pays de chasse du Labrador.
Dès 1504 la pêche avait commencé; plusieurs capitaines entrèrent dans le pays et recherchèrent les fourrures.
En 1506, Denys, pilote de Honfleur, revint avec une carte du Saint-Laurent.
En 1508, on amenait en France des sauvages des côtes américaines.
En 1524, le gouvernement français envoyait un explorateur, Verazzani, qui visita les contrées que l'on appela depuis la Nouvelle-Écosse et la Nouvelle-Angleterre.
En 1527, un navire anglais signalait la présence, près de Terre-Neuve, de dix bâtiments bretons et normands.
En 1534, le grand amiral de France, Philippe de Chabot, envoyait un marin expérimenté, Jacques Cartier, qui, en trois voyages consécutifs, explora le cours du Saint-Laurent et prit possession de ces nouveaux territoires au nom du roi de France. Il planta une croix surmontée d'un écusson aux armes royales, et il bâtit un fort près de Québec.1
Note 1: (retour) Bancroft Histoire de l'Amérique, tome 1er.—M. Garneau, Histoire du Canada,—M. Faillon. Histoire de la colonie française en Canada, tome 1er,—M. Ferland.
Les guerres qui survinrent en Europe arrêteront les missions royales, mais les marins venaient toujours pour la pèche, et, en 1578, on compta jusqu'à 150 bâtiments français sur le banc de Terre-Neuve.
En 1594, Henri IV fit reprendre les entreprises coloniales au Canada. Il nomma le marquis de La Roche lieutenant général des possessions américaines. De Monts lui succéda en 1596, puis M. du Pontgravé. Enfin, en 1601, les expéditions furent confiées a un officier habile, homme de science et d'expérience, Samuel de Champlain, qui a mérité le titre de père de la Nouvelle-France.
Champlain vint occuper les rives du Saint-Laurent, pendant que M. de Poutrincourt s'établissait en Acadie.
En 1609, Champlain fonda In ville de Québec, puis il explora le pays.
Il visita la rivière dite depuis de Richelieu, il reconnut au sud un grand lac qui porte maintenant son nom. Il signala la position d'Hochelaga (Montréal), remonta l'Ottawa et vint jusqu'au lac Nipissing, en 1616. Il explora, aux environs du lac Nipissing, un autre lac qui a aussi porté son nom. Enfin, il fit venir les religieux Récollets, qu'il établit en deux missions principales; à Québec et au lac Huron, Entre 1607 et 1635, Champlain avait fait quinze voyages. Il allait exciter le zèle des gouvernants, parlait des ressources du pays; mais en même temps, il faisait connaître les difficultés de l'établissement: le froid excessif décourageait les nouveaux arrivés; le monopole de certaines compagnies tuait le commerce; l'agriculture exigeait de grands sacrifices.
Après tant d'expéditions et de tentatives, Champlain ne voyait à Québec, en 1630, que quelques familles bien établies. Ému de ses représentations, le cardinal de Richelieu prend l'oeuvre en main et veut lu seconder de tout son pouvoir: il fonde la société de lu Nouvelle-France, qui comptait 110 membres choisis parmi les premiers personnages du royaume; il envoie des colons et des religieux. Mais en 1640, au bout de dix ans, tous ces efforts n'avaient réussi qu'à établir 200 personnes dans tout le pays, en comprenant même les prêtres, les religieux, les femmes et les enfants.2
Note 2: (retour) Histoire de la Nouvelle-France, tome Ier, page XX.—Dollier de Casson, Histoire de Montréal, 1640-1641.
Pour avoir un établissement, il fallait d'importants secours de la mère patrie, et il fallait que ces secours fussent désintéressés. De plus, les colons devaient être guidés par des vues de foi et de sacrifice; ils devaient être décidés à supporter le climat, les privations, et des dangers extrêmes, parce qu'il y avait à lutter contre des peuplades nombreuses, implacables, et fournies d'armes à feu par les établissements voisins de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Orange.
Or quand, après la mort de Champlain, tout semblait en détresse, le Seigneur vient en aide a la jeune colonie et lui procure miraculeusement des ressources inattendues, qui devaient assurer un succès jusque-là vainement poursuivi. Des hommes de foi et de dévouement se décidèrent à fournir les moyens d'une nouvelle entreprise, et en même temps des héros s'offrirent pour les seconder, et assurer l'établissement de la religion en ces contrées inhospitalières.
Champlain venait de mourir (25 octobre 1635), et quelques semaines après, le 2 février 1636, un pieux gentilhomme de la Flèche, M. de La Dauversière, étant en prière, reçoit l'avis de fonder un établissement à, une certaine distance de Québec pour couvrir les voies qui conduisaient au centre de ïa colonie française et, pour être plus au milieu des populations que l'on voulait convertir. L'endroit lui est montré de la manière la plus distincte. Cet avis fut répété plusieurs fois. Chose étonnante, il n'était pas le seul qui eût reçu cette indication, et en effet le même jour, 2 février 1636, un jeune ecclésiastique qu'il ne connaissait pas, M. Olier, alors âgé de vingt-six ans, et établi à Vaugirard avec quelques prêtres, est averti qu'il doit se consacrer à fonder un établissement, pour le bien de lu religion, à un endroit du Canada qui lui est montré aussi de la manière la plus distincte, et en même temps il lui est enjoint d'établir une compagnie de prêtres pour prendre soin des intérêts spirituels de l'entreprise.
Or, dans ces deux révélations arrivées le même jour, il s'agissait de la même oeuvre, et l'endroit indiqué était le même. C'est ce que reconnurent ces deux grands serviteurs de Dieu quand ils se rencontrèrent plusieurs années après, vers 1640. Ils ne se connaissaient pas, et furent secrètement avertis de la communauté de leur vocation et de leur mission.3
Note 3: (retour) Le P. Vimont, Lettres des rev. PP. Jésuites, tome 1er, page 15,—La mère de l'Incarnation, ses lettres de 1642,—M, Dollier de Casson, Histoire de Montréal.
Grâce à l'union de leurs efforts, l'oeuvre prit tous les développements désirables; de nobles seigneurs s'y associèrent. Enfin, au moment où la compagnie achetait l'île de Montréal, un gentilhomme, jeune encore, retiré du service, désirant se consacrer À une oeuvre de zèle, se présentait: c'était M. de Maisonneuve. C'est lui qui fut le fondateur de Montréal et qui devait en faire le boulevard de la colonie par vingt années d'un dévouement intrépide et de l'administration la plus nage.
Il fut aidé par des hommes de foi et de courage. Parmi ces auxiliaires, nous nous proposons de faire connaître la famille des Le Moyne, et la part qu'ils ont eue à l'établissement de la Nouvelle-France.
C'est ce que nous allons exposer dans les paragraphes suivants.
Cette famille, établie dans la Nouvelle-France au milieu du XVIIe siècle, devait y conquérir une grande illustration. A la première génération, elle avait fourni des commandants aux armées du roi, des gouverneurs à la Nouvelle-France et à la Louisiane, des intendants aux commandements maritimes de la France.
Elle était originaire de la ville de Dieppe. Depuis Jacques Cartier, Dieppe avait toujours eu beaucoup de relations avec la nouvelle colonie.
C'est de Dieppe que partit M. de Poutrincourt, dont l'ancienne résidence se voit encore aux environs de cette ville, au château de Mesnières.
Un gouverneur de Dieppe, M. de Chattes, son lieutenant, M. de Monts. madame de Guercheville, épouse d'un gouverneur de la ville de Paris sous Henri IV, avec leurs expéditions, avaient fait connaître ces nouveaux pays pour lesquels, à chaque printemps, partaient des flottilles de bâtiments pour les pèches de Terre-Neuve et pour la traite des fourrures.
En 1664, dans un seul mois, on vit partir des côtes de Dieppe et des pays voisins, 65 grands vaisseaux pour le Canada.
Il y avait en cette ville des quartiers consacrés au commerce des produits de l'Amérique, et il existe encore une rue nommée de la Pelleterie, ou résidaient une quantité de marchands de fourrures, qui trafiquaient des envois du Canada avec l'Europe.
M. Paillon, en parcourant les livres des paroisses, a trouvé aux registres de l'état civil un témoignage bien caractéristique des rapports de Dieppe avec la Nouvelle-France. Voici les noms qu'il a relevés à la paroisse Saint-Jacques de Dieppe pour l'année 1630: Duhamel, Hardy, Auger, Aubuchon, Duhuc, Godebout, Davignon, Hébert, Sénécal, Gaudry, Duval, Gervais, Vallée, Lecompte, Godard, L'Écuyer, Leroux, Dumouchel, Viger, Cardinal, Duchesne, etc.: on se croirait dans une paroisse de Montréal ou de Québec.
Il ne faut pas s'étonner qu'au moment où les chefs des nouvelles entreprises recrutaient des volontaires pour la Nouvelle-France, le nommé Duchesne, soldat dans les troupes du roi, se presenta, avec deux de ses neveux: Jacques Le Moyne, âgé de dix-sept ans, et son frère Charles, âgé de 14 ans. Leur père, Pierre Le Moyne. était marié avec Judith, soeur de Duchesne. C'était un ancien soldat qui tenait un hôtel sur la paroisse Saint-Jacques, près de la mer, et qui recevait comme clients ordinaires les marins qui s'embarquaient pour l'Amérique.
Ces familles des côtes de la Manche étaient toujours disposées à, tenter les aventures périlleuses, et la religion présentait cette oeuvre comme digne de coeurs chrétiens; il s'agissait de donner aux populations sauvages le trésor de la foi en échange des biens qu'ils trafiquaient.
M. Faillon a trouvé aussi dans les registres de Dieppe qu'il y avait beaucoup de Le Moyne en cette ville.
Il a compté jusqu'à quatorze chefs de famille de ce nom au commencement du XVIIe siècle, parmi lesquels un capitaine du roi, un procureur, un lieutenant général en l'amirauté de France. «Nous n'osons affirmer, dit M. Faillon, que Pierre fût parent de ces personnages, mais Charles Le Moyne s'est rendu encore plus illustre qu'aucun de ses prédécesseurs, par ses qualités personnelles, par ses exploits et ceux de ses enfants.»
Charles Le Moyne, né en 1626, de Pierre Le Moyne et de Judith Dufresne, sur la paroisse Saint-Rémi de Dieppe, partit donc en 1640 pour le Canada avec son frère aîné, Jacques, et leur oncle. Il avait alors quatorze ans.
Plus tard, deux de leurs soeurs, Jeanne et Marie, vinrent de France et se joignirent à eux.
Charles Le Moyne accompagna d'abord les PP. Jésuites dans le pays des Hurons, et resta avec eux jusqu'à l'âge de vingt ans.
Il devint un guide sûr et un interprète consommé. Il connaissait tous les sentiers du pays, et avait appris plusieurs dialectes. Enfin, il s'était familiarisé avec la tactique des sauvages, à l'égal des colons les plus capables. Il s'habillait comme les sauvages, et se transformait quand il voulait, sans pouvoir être reconnu comme étranger; d'ailleurs il trouvait ce costume plus commode pour la marche et pour la chasse. Il savait parfaitement se servir des raquettes, de la hache et de l'aviron, «sans lesquels on ne peut rien dans ce pays.» Enfin, il était devenu, dans des expéditions continuelles, d'une taille et d'une force extraordinaires. C'est ce qui apparaît dans le portrait découvert à Paris par l'éditeur des documents sur les pays d'outre-mer, M. Margry.
En 1646, M. de Montmagny ayant vu Duchesne et son neveu, voulut tirer parti de leurs bonnes qualités, et il les attacha aux nouveaux établissements français du Saint-Laurent. Il envoya Duchesne à Trois-Rivières et Charles Lu Moyne à Montréal, tous deux comme interprètes.
Montréal, ou Charles Le Moyne se rendit en 1646, était un poste avantageux, et comme une sentinelle avancée à 60 lieues de Québec, au milieu des établissements sauvages. C'est là qu'il devait faire éclater ses qualités hors ligne.
Cette position avait été signalée dès le commencement par Jacques Cartier et ensuite par Champlain. On pensait que ce jugement avait été confirmé par une inspiration divine envoyée à ceux qui devaient être les fondateurs de cette nouvelle colonie: M. Olier et M. de La Dauversière, ainsi que nous l'avons dit précédemment.
La position était favorable. Placée sur une éminence de deux milles de longueur, entre le grand fleuve et une petite rivière, l'habitation était environnée d'eau de toutes parts. Le fleuve la mettait à l'abri de la surprise des ennemis, et on arrière une haute montagne, toute couverte d'arbres séculaires, protégeait contre les vents du nord. 4
Note 4: (retour) Notice sur Montréal. Paris, 1869.
Cette habitation si bien défendue avait en même temps un aspect attrayant. Elle était environnée des plus beaux arbres, plantés si régulièrement entre le rivage et la montagne, que Champlain lui avait donné le nom de place royale, digne avenue du mont superbe que Jacques Cartier avait nommé le mont Royal, nom qui lui est resté.
Enfin, pour ajouter a l'ornement et en faire un site remarquable, on voyait, au milieu du fleuve et en face du lieu de débarquement, deux belles îles chargées de forêts, l'une s'élevant en pyramide, comme un bouquet de verdure, à cent pieds de hauteur, l'autre s'étendant gracieusement sur une lieue de longueur: c'étaient comme deux sentinelles avancées, pouvant servir un jour de citadelles.
Ce site, si fort comme poste militaire, était aussi l'un des plus beaux que l'on puisse citer dans le monde. On pouvait s'en convaincre en le contemplant du haut de la montagne, ou les colons se rendaient souvent en pèlerinage. Au point le plus élevé, il y avait une croix imposante plantée par M. de Maisonneuve. De là, à cinq cents pieds au-dessus du niveau du fleuve, l'établissement paraît dans toute sa magnificence. Depuis le haut du mont descend un amphithéâtre d'une lieue de largeur qui montre des arbres variés et précieux; en bas, d'immenses prairies fertiles étaient des fleurs éclatantes; plus loin se déploie la ceinture splendide d'un fleuve profond, qui n'a pas moins d'une lieue de largeur. Au delà, pour compléter ce beau panorama, des montagnes disposées en cercle jusqu'à dix et vingt lieues dans le sud, forment comme une corbeille de verdure dont Montréal est le centre.
Cette nature apparaissant comme le créateur l'avait formée, sans les modifications du travail de l'homme, pouvait sembler plus pittoresque que nous ne la contemplons maintenant. Mais si l'aspect est un peu changé, tous les souvenirs des premiers temps ne sont pas effacés. La ville est toujours appelée, dans le coeur des fidèles, Ville-Marie, en souvenir de l'indication donnée par la sainte Vierge elle-même. Le mont porte toujours le nom de Mont-Royal, choisi par Jacques Cartier. L'une des îles s'appelle Sainte-Hélène, comme l'a nommée M. de Champlain, en l'honneur de son épouse, Hélène Boullé; l'autre est nommée Saint-Paul, en souvenir de M. Paul de Maisonneuve, premier gouverneur de la colonie.
Le fort de Montréal, élevé en 1642, était tellement couvert par les arbres, que les sauvages, dans leurs excursions sur le fleuve, ne le découvrirent qu'à la seconde année de sa construction. Bientôt ils en comprirent l'importance et le danger pour eux. Ce poste avancé entre plusieurs tribus puissantes pouvait les tenir en échec et leur enlever le libre parcours du Saint-Laurent; aussi le nouvel établissement fut-il bientôt le but de leurs attaques.
M. de Maisonneuve, renfermé dans le fort avec cinquante hommes, comptait avec lui des gens de guerre pleins d'expérience, parmi lesquels les deux frères Le Moyne, qui furent les plus renommés dans la suite. M. de Maisonneuve sut si bien se garder que, malgré les tentatives de milliers d'ennemis qui vinrent reconnaître le terrain, les Français ne perdirent guère qu'une dizaine d'hommes de 1642 à 1650.
Les procédés des sauvages étaient pleins de perfidie. Ils cherchaient à attirer les cultivateurs par des signes de paix, et puis ils se jetaient sur eux pour les faire périr dans d'affreux supplices.5
En 1643, on perdit quatre hommes; en 1644, on en perdit trois, et sur les sept, trois, faits prisonniers, furent cruellement brûlés.6
Au 6 mai 1641, Boudard fut tué par les Iroquois; sa femme, Catherine Mercier, prise près de lui, fut martyrisée pendant deux jours, puis brûlée en refusant héroïquement de renoncer à sa religion.
Note 5: (retour) M. Paillon, Histoire de la colonie, tome II, PP. l51 et 364.
Note 6: (retour) Registre des sépultures de Montréal, 1643-1644.
Charles Le Moyne, arrivé à Montréal en 1646, se montra bientôt un dévoué champion de la mission. Il ne reculait devant aucune entreprise, et se montrait toujours disposé à protéger les colons. Il était d'une bravoure et d'une habileté merveilleuses. Parfois, seul sur la plage, s'il rencontrait des sauvages qui étaient venus tenter quelque coup, il les menaçait de son fusil s'ils essayaient de s'échapper, et il les obligeait à aller se constituer prisonniers au fort. D'autres fois, voyant un canot de sauvages sur le fleuve, il attendait qu'ils fussent engagés dans la force du courant, fondait sur eux comme la foudre, dans son embarcation, et les forçait à venir aborder comme prisonniers.
Un jour, sachant que des travailleurs sont attaqués à la pointe Saint-Charles, il s'y rend avec quatre hommes, se gare à propos derrière des troncs d'arbres, et, avant d'avoir été aperçu, met vingt-cinq ou trente sauvages hors de combat.
On cite aussi une rencontre, où, avec 15 habitants du fort armés de fusils et de pistolets, il alla se présenter en face de 300 sauvages qui se précipitaient sur les colons, et il leur tua 32 hommes à la première décharge, tout le reste s'enfuit épouvanté.
Il se montrait le serviteur dévoué de M. de Maisonneuve, comme le major Lambert Closse, qui proclamait qu'il n'était venu à Montréal que pour offrir sa vie à Dieu.
M. de Maisonneuve avait tant de confiance en Le Moyne qu'il le chargeait de ses messages pour les Indiens.
M. de Maisonneuve le mit aussi à la tête d'une milice qu'il forma, en 1660, parmi les habitants pour la défense de la mission, et qu'il plaça sous la protection de la sainte Famille. Il l'assigna à la défense de Montréal avec le sieur Picoté de Belestre, à un moment où l'on attendait l'arrivée de milliers d'Iroquois soulevés de toutes parts dans les environs du lac Ontario et des rives du lac Champlain. On sait que ces Iroquois furent arrêtés par la défense héroïque, au Long-Sault, de dix-sept Montréalais, sous la conduite de l'intrépide Dollard.
C'est dans ces circonstances que l'on s'appliqua à protéger la ville. Il y avait déjà quarante maisons séparées, mais avec des meurtrières et des créneaux; elles étaient bâties de manière à pouvoir se défendre les unes les autres. Alors, on compléta les forts qui environnaient la ville et qui devaient servir à assister les travailleurs dans les champs environnants.
En même temps qu'il assurait la défense militaire du pays, M. de Maisonneuve s'occupait d'en préparer l'existence à venir, et pour cela il offrait les plus grands avantages à ceux qui voulaient s'y établir et fonder des familles. Il donna à Charles Le Moyne une terre à la pointe Saint-Charles et deux emplacements dans la ville, l'un près de la résidence du gouverneur et des prêtres, pour leur servir de défense; l'autre au bord du fleuve, où se trouve le marché Bonsecours, pour surveiller l'entrée de la ville, et la côte opposée, dont il devait devenir le seigneur.
Vers 1665 arriva un événement que nous tenons d'autant plus à signaler qu'il montra quelle affection Charles Le Moyne inspirait à toute la colonie et en même temps quelle était l'estime qu'il avait su imposer aux populations sauvages.
Comme il ne s'épargnait jamais dans aucune rencontre, il fut fait prisonnier aux environs de Montréal en 1665.
Sa jeune femme, âgée de vingt-cinq ans, et qui avait déjà quatre enfants, était dans la désolation. Elle le recommanda aux prières de tous, et elle-même recourut au Seigneur avec une telle ferveur, que M. Dollier de Casson dit qu'on peut lui attribuer l'espèce de miracle qu'il plut à Dieu d'opérer en faveur de son mari.
Au bout de quelques jours Le Moyne revint; il avait gagné ses ennemis en leur rappelant les bontés qu'il avait eues pour les prisonniers iroquois, et en les menaçant de la vengeance des troupes du roi qui allaient bientôt arriver.
Charles Le Moyne retourna à Montréal. C'est alors qu'il fut sensiblement éprouvé dans ses plus tendres affections, par suite du départ de M. de Maisonneuve pour la France. Il lui était attaché par les liens de l'estime la plus haute et de la reconnaissance la plus tendre; aussi ce départ lui causa-t-il la plus vive douleur, comme la séparation d'avec le père le plus tendre et le plus aimé.
M. de Maisonneuve, de retour en France, resta toujours attaché à son ancien gouvernement. Il s'endormit dans le Seigneur «avec une confiance d'autant plus parfaite dans les récompenses du ciel,» nous dit M. Faillon, «qu'il n'avait rien reçu pour ses services de la terre.» 7
Note 7: (retour) M. Faillon, Histoire de la colonie, tome III, page 115.
Fondée on 1642, la cité de Montréal s'accrut lentement dans ses commencements, mais ensuite l'accroissement fut rapide.
Ainsi, après vingt ans, elle ne comptait que 500 âmes, mais dix ans après, il y en avait plus de 1500.
Ce qui était surtout à considérer dans ces commencements, c'était le zèle pour l'amélioration des pauvres sauvages, et l'énergie des pieux colons.
Le zèle pour la conversion des infidèles était extraordinaire, et le courage pour braver les épreuves et les dangers, au-dessus de toute expression.
«On voyait bien, dit le Père Leclercq, que ces gens-là avaient quitté leur patrie par les mouvements d'un zèle apostolique,» et rien ne pouvait les faire changer de sentiments; ni l'ingratitude, ni la perfidie des sauvages, ni leur défaut de bonne foi, ni leurs cruautés inhumaines, rien ne pouvait éteindre le feu de la charité.
Tout était réglé dans la nouvelle ville comme dans une communauté militaire. A une heure fixée, après la prière et la sainte messe, qui avaient lieu à 4 heures du matin, la population se rendait au travail dans les champs; chacun avait près de soi son fusil caché dans un sillon.
Il ne se passait pas de jour sans attaque. Ceux qui se laissaient surprendre étaient voués à des supplices atroces. On admirait leur courage, on plaignait leurs souffrances, mais on ne renonçait pas à prier pour les bourreaux. Enfin, dès qu'une occasion favorable se présentait, on cherchait à gagner ces pauvres aveuglés. A force d'efforts et de patience, les âmes finissaient par se laisser éclairer, les coeurs étaient touchés, le mal vaincu par le bien.
Ces premiers temps ont été admirables. La ville offrait comme une image de la primitive Eglise. Ces braves gens étaient voués à la piété la plus fervente et à la charité la plus dévouée. Il n'y avait jamais de contestation entre eux; il n'y avait qu'un coeur et qu'une âme, et tandis qu'ils étaient si unis à Dieu, si bons entre eux, ils restaient inébranlables dans le danger. Chaque citoyen se regardait comme une victime offerte à la mort pour la glorification de l'Evangile.
Dans les annales de la soeur Morin, écrites vers ce temps, nous avons les détails les plus touchants sur la vie à Montréal avant l'arrivée des troupes: la piété, la charité, des colons, les privations qu'ils avaient à subir, enfin les cruautés extrêmes qu'ils étaient exposés à éprouver, étant entourés d'ennemis féroces, nombreux et implacables.
Bientôt différentes circonstances favorisèrent les saintes dispositions et le zèle des colons pour la conversion des infidèles.
Plusieurs nations étaient en guerre; l'une d'elles, celle des Iroquois, puissante et implacable, faisait une guerre d'extermination contre ses ennemis.
Leurs victimes venaient implorer la protection des Français. Elles furent accueillies et placées dans des positions retranchées. On compta bientôt plusieurs colonies chrétiennes: à la Montagne, à la Prairie, au Sault-Saint-Louis, au lac Saint-François, au lac des Deux-Montagnes, et enfin à la Petite-Nation, sur l'Ottawa, à vingt lieues de Montréal.
Ces nouveaux chrétiens, disciplinés par les Français, devinrent eux-mêmes comme des apôtres. On en fit des catéchistes zélés et habiles. Ils rendaient de grands services au sein des autres tribus.
Les Français excitaient l'admiration de leurs plus cruels ennemis par leur douceur, leur sollicitude et leurs libéralités inépuisables. Ils établissaient ceux qui se donnaient à eux, leur apprenaient à cultiver, leur livraient des terres, représentaient l'excellence de la vie réglée et civilisée à ces pauvres barbares, et se montraient ainsi bien différents des gens de Boston, qui ne s'étaient jamais occupés des nations qui les entouraient, que pour les détruire et se mettre à leur place.
Au milieu de leur noble mission, les Français acquéraient une habileté merveilleuse pour occuper le pays. Formés par M. de Maisonneuve et par le chef de la milice, Charles Le Moyne, ils étaient devenus des combattants consommés, des explorateurs infatigables. Ils avaient pris les bonnes qualités des sauvages, et y ajoutaient l'esprit de discipline et de tactique des milices françaises.
On a dit que les Français n'avaient pas le génie de la colonisation comme leurs voisins; mais, suivant M. Parkman lui-même, cela n'est point exact. M. Parkman pense que les colons français égalaient les Anglais sous bien des rapports.
Les Français n'avaient pas les vues odieuses des colons de la Nouvelle-Angleterre: ils n'auraient jamais voulu adopter, comme eux, un plan d'extermination contre ces pauvres gens.
Ce qui est affirmé, même par les écrivains anglais, c'est que sous le rapport des qualités morales et des qualités intellectuelles, les colonies anglaises étaient vraiment inférieures à la colonie française, tandis que sous le rapport de l'activité, de l'intelligence et de la bonne organisation, la colonie française égalait toutes les colonies anglaises réunies.8
Note 8: (retour)Le système français avait un grand avantage; il favorisait l'élément guerrier: la population était formée entièrement de soldats et de miliciens (Parkman). L'occupation principale était un continuel apprentissage de la guerre dans les bois. La haute classe regardait la guerre comme la seule occupation digne d'elle, et elle estimait l'honneur plus que la vie. Pour ce qui est de l'habitant, les bois, les lacs, les cours d'eau étaient ses lieux d'étude, et là il était maître consommé. Forestier habile, hardi canotier, toujours prêt pour les entreprises périlleuses; dans les guerres d'escarmouche et d'embuscade au milieu des bois, il y en avait peu qui pussent lui être comparés (Parkman).—«En Canada, comme en Europe, à ce moment, la race française a appris à se connaître. Elle s'est trouvé des forces que les autres siècles ne savaient pas.» Voilà ce qu'a produit l'amour de la discipline et le zèle de la religion.
Les Français n'aspiraient pas à des conquêtes, mais ils voulaient sauver des âmes, et pour arriver à ce but, ils avaient autant de persévérance et d'énergie que leurs voisins en avaient pour les avantages matériels (Saint-Marc Girardin sur l'Amérique du Nord).
Au milieu de terribles épreuves, la colonie s'établissait, avec une réunion des hommes les plus capables: M. de Maisonneuve, le gouverneur; son lieutenant, Lambert Closse; M. d'Ailleboust, un officier de haut grade; son neveu M. de Musseaux; M. Le Moyne, lieutenant; M. Le Ber de Senneville; M. Decelles de Sailly; M. de Montigny; M. de Repentigny et M. de Brassac; de plus, les hommes de la milice, si dignes d'admiration, et dont les descendants remplissent maintenant le pays.9
Note 9: (retour) On trouve encore actuellement en Canada et dans les environs de Montréal des descendants de ces premiers colons, dont les noms sont portés par des milliers d'individus: Prud'homme, Descaries, Hurtubise, Lortie, Beaudry, Dumoulin, Renaud, Laviolette, Désautels, Boudraud, Lavigne, Trudeau, Cadieux, Deschamps, Barbier, Meunier, Dagenais, Leblanc, Jodoin, Toussaint, Beaudry, Laplante, Beauvais, Rolland, Lenoir, etc.
De nobles coeurs assistaient ces bras héroïques: Mlle Mance, de l'Hôtel-Dieu, et ses compagnes; la soeur Bourgeois et ses institutrices; madame Le Moyne, que l'on a appelée la mère des Macchabées; madame Le Ber, qui devait voir une sainte à miracles en l'une de ses enfants; madame d'Ailleboust, et sa soeur, mademoiselle de Boullogne, qui aspiraient dans le monde à la vie religieuse.
La ville était sous la direction de prêtres éminents. M. Gabriel de Queylus, le directeur de la cure de Saint-Sulpice de Paris, était venu s'établir à Montréal; et aussi M. l'abbé François Dollier de Casson, ancien colonel et aide de camp du maréchal de Turenne; M. d'Urfé, ancien curé de la cathédrale du Puy, allié du ministre Colbert et petit-neveu du célèbre M. d'Urfé; M. de Fénelon, frère de l'illustre archevêque de Cambray; M. Souart, un des plus grands prédicateurs de Paris; M. de Belmont, l'un des prêtres les plus riches de France, chargé des missions sauvages; M. Barthélémy, qui explora le lac Ontario.
Ces messieurs étaient en communication continuelle avec les associés de l'oeuvre résidant à Paris, tels que M. le baron Pierre de Fancamp, M, de Liancourt, M. de Renty, M. de Bretonvilliers, M. Legauffre, M. Dubois, madame de Bullion, si généreuse, qui contribuait avec les autres associés pour des sommes si abondantes.
M. Olier, avec la compagnie des associés des oeuvres, avait donné plus de 300,000 livres: M. de Bretonvilliers, successeur de M. Olier, 400,000 livres; M. Dubois, M. de Queylus, M. de Fénelon, M. d'Urfé donnèrent leur fortune, qui était considérable; M. de Belmont, 300,000 livres en une seule fois. On a calculé, dans le temps, que les associés et prêtres du Séminaire avaient fourni, pour l'oeuvre de Montréal, de leurs propres deniers, en trente ans, la somme de 1,800,000 livres, ou environ sept millions de la monnaie actuelle.
Ce qui donna bientôt de la vie à la colonie, et qui assura sa tranquillité, ce fut l'arrivée des troupes, demandées depuis longtemps, et de plus, la détermination que prirent un grand nombre de soldats et d'officiers de s'établir dans des terres concédées suivant le système féodal, afin de mettre la ville à l'abri de toute incursion des sauvages, comme nous le verrons plus tard.
Les officiers et les soldats se distinguèrent autant que les premiers colons par leur esprit de foi et leur dévouement à l'oeuvre entreprise.
C'est au milieu de cette réunion de chrétiens exemplaires, de gentilshommes choisis, de militaires intrépides que s'élevaient les enfants des familles principales de Montréal: Le Ber, Saint-André, de La Porte, Decelles de Sailly, de Jacques et de Charles Le Moyne, de Montigny, de Belestre, de d'Ailleboust de Musseaux, de Prud'homme, de Tessier, de Louvigny, de Le Noir Rolland.
La famille qui se distinguait entre toutes par ses enfants, tant par leur nombre que par leurs heureuses dispositions, c'était celle de Charles Le Moyne, marié à la fille adoptive des Primot. Il y avait là. douze enfants pleins de force et de bonnes qualités. Le troisième, Pierre d'Iberville, se faisait remarquer dès sa jeunesse. Il annonçait un esprit vif et hardi, et il était d'une force extraordinaire pour son âge.
Voici l'ordre des naissances de ces enfants, auxquels Le Moyne, pour les distinguer, donna des noms empruntés aux localités des environs de Dieppe, en souvenir de la patrie absente:
«En 1650, Charles de Longueuil; en 1659, Jacques de Sainte-Hélène; en 1661, Pierre d'Iberville; en 1663, Paul de Maricourt; en 1668, Joseph de Sérigny; en 1669, François de Bienville; en 1670, anonyme; en 1673, Catherine-Jeanne; en 1676, Louis de Châteauguay; en 1678, Marie-Anne; en 1680, Jean-Baptiste de Bienville, deuxième du nom; en 1681, Gabriel d'Assigny; en 1684, Antoine de Châteauguay.»
Ils se distinguèrent par leur mérite et leur dévouement; cinq moururent au service du roi: Sainte-Hélène fut tué au siège de Québec en 1690; de Maricourt mourut de fatigue au pays des Iroquois en 1704; de Bienville 1er fut tué par les sauvages en 1691; de Châteauguay 1er fut tué à la prise du fort Nelson en 1686; d'Assigny mourut des fièvres dans l'expédition du golfe du Mexique en 1700.
Charles de Longueuil fut gouverneur de Montréal; de Bienville, deuxième du nom, fut gouverneur de la Louisiane pendant quinze ans; Antoine de Châteauguay devint gouverneur de la Guyane. Catherine-Jeanne fut mariée au sieur de Noyan, capitaine de la milice; Marie-Anne fut mariée en 1699 au sieur de La Chassoigne, gouverneur des Trois-Rivières.
Voici donc une famille qui est un précieux témoignage de l'état des choses sous l'ancien régime; une famille modeste, mais élevée avec les soins qu'inspire la religion, et qui, grâce à ce secours, fournit tant de sujets remarquables. Le gouvernement était juste appréciateur du mérite, et il n'hésitait pas à mettre les petits-fils d'un humble aubergiste au premier rang, quand il les en voyait dignes.
Nous trouvons sur les registres de Notre-Dame l'acte de naissance de Pierre d'Iberville, notre héros, et nous le transcrivons ici:
Le 20 juillet 1661, ai baptisé Pierre, fils de Charles Le Moyne et de Catherine Primot, sa femme. Le parrain, Jean Grevier, au nom de noble homme Pierre Boucher, 10 demeurant au cap près des Trots-Rivières; et marraine, Jeanne Le Moyne, femme de Jacques Le Ber, marchand.
Signé: PÉROT, curé de Montréal.
Note 10: (retour) C'est ce Pierre Boucher qui a donné une notice intéressante sur la Nouvelle-France. Il devint gouverneur des Trois-Rivières et est l'ancêtre de personnages remarquables: La Vérendrie, qui explora le Nord-Ouest; la soeur d'Youville, fondatrice des soeurs Grises, et enfin M. de Boucherville, premier ministre de la province de Québec de 1874 à 1878.
Tandis que les jeunes filles allaient recevoir l'enseignement de la soeur Bourgeois et de Mlle Mance, les jeunes gens étaient formés par les messieurs du Séminaire, et principalement par M. Souart et M. Pérot.
M. Souart avait organisé une école formée sur le modèle des maîtrises de France, et les enfants, malgré l'éloignement, recevaient l'instruction telle qu'on la donnait dans les meilleures écoles de la mère patrie.
M. Souart était un maître consommé. M. Pérot nous a laissé, dans les registres de la paroisse, des témoignages précis de sa capacité: on remarque une écriture d'une délicatesse comparable à la gravure, une rédaction irréprochable, une connaissance par faite de la langue.
Ceux d'entre les jeunes gens qui, après quelques années d'études, montraient des inclinations pour l'état ecclésiastique, étaient envoyés au collège des Jésuites de Québec; les autres s'exerçaient pour la profession militaire et étudiaient les lettres et les mathématiques. Cette école de M. Souart, étant aussi une maîtrise, devait concourir au service religieux. Les enfants servaient la messe; de plus, ils étaient formés au chant religieux et aux cérémonies ecclésiastiques, comme cela se passe dans toute maîtrise.
On observait le règlement de la paroisse de Saint-Sulpice de Paris pour l'instruction religieuse et la préparation à la première communion. M. de Queylus avait pratiqué cet enseignement à la cure de Saint-Sulpice, ainsi que M. de Fénelon, et ils le continuaient à Montréal, tandis que le frère de M. de Fénelon, le futur archevêque de Cambray, remplissait les mêmes fonctions à la cure de Paris, à laquelle il était attaché.
Le catéchisme dont on se servait venait de Paris; il avait été composé sous la direction de M. Olier, et il a été conservé jusqu'à ce jour en Canada, presque sous la même forme, d'après la rédaction d'un prêtre de Saint-Sulpice, M. Languet, qui devint plus tard archevêque de Sens.
Voici les noms des enfants qui firent la première communion, vers 1674, avec Pierre d'Iberville:
Robutel de Saint-André, Aubuchon, Louis Descaries, Antoine de La Porte, Pierre, Paul et Jean Le Moyne, Paul et Nicolas d'Ailleboust de Manthet, Urbain Tessier, Gabriel de Montigny, Pierre Cavelier, Benoît et Jean Barret, Jacques Le Ber, Zacharie Robutel, et Duluth.
Ces noms sont précieux à conserver, ce sont les noms d'enfants nés sur le sol canadien dès les premiers temps, et qui, à différents titres, ont acquis des droits à la notoriété nationale.
Ainsi Jean, Pierre et Paul Le Moyne allèrent à la baie d'Hudson en 1686.
D'Ailleboust de Manthet parcourut le Nord-Ouest et, dans un mémoire remarquable, fit connaître les richesses de la Louisiane.
Gabriel de Montigny accompagna Pierre d'Iberville à Terre-Neuve en 1686; Jean Barret suivit M. de La Salle dans ses expéditions et périt dans un naufrage.
Duluth explora le lac Supérieur.
Ces enfants s'instruisaient de la religion en même temps qu'ils s'initiaient aux exercices militaires, comme il convient dans une place de guerre. Le dimanche, ils revêtaient les habits de choeur et aimaient à prendre part aux cérémonies; et ensuite, aux jours de congé, ils prenaient le costume des jeunes sauvages et s'en allaient aux environs, avec des arcs et des flèches, chasser le gibier, qui était d'une abondance extraordinaire.
Pierre d'Iberville qui, d'après les mémoires du temps, se distinguait au milieu de tous par sa piété et son heureux caractère, était singulièrement remarquable par un tempérament infatigable et son habileté dans les exercices corporels.
Les écrits et les mémoires qu'ils a laissés et qui sont pleins d'intérêt et du style le plus noble, font voir qu'il avait bien profité des enseignements de M. Souart.
Pierre passa sa jeunesse dans la maison de son père, sur la rue Saint-Joseph. On peut voir encore, près de la sacristie de Notre-Dame, quelques corps de bâtiment de la maison des Le Moyne, et dans le jardin du Séminaire, il restait encore, il y a quelques années, des arbres très anciens qui avaient pu ombrager ses premiers jeux.
Le futur héros était grand pour son âge, d'une figure ovale et agréable, teint clair, très blond, avec des cheveux abondants, digne fils du baron de Longueuil, que les sauvages avaient nommé l'alouette, à cause de son teint et de ses cheveux blonds. Son maintien était noble, mais tempéré par beaucoup de modestie et de douceur.
Il était de ceux dont on a pu dire qu'ils plaisaient au premier regard, mais qu'on les aimait en les connaissant davantage. Ses manières étaient aisées, agréables, et son commerce plein d'ouverture et conciliant.
Il montrait, dès sa jeunesse, tous les signes de ce caractère obligeant et généreux qui le fit tant aimer de ses soldats qu'ils l'auraient suivi jusqu'au bout du monde, disaient-ils; enfin, il avait ce coeur tendre, plein de pitié pour le malheur qui le fit remarquer et adorer des nations sauvages.
Pendant qu'il demeurait chez son père, il put être témoin de différents événements notables: la construction de l'église paroissiale, la division et la dénomination des rues de la ville, et enfin, l'entrée dans Montréal, d'une partie des troupes que le roi avaient envoyées dans la Nouvelle-France. Ces troupes venaient se fixer dans la ville et aux environs pour défendre les colons, Cet événement dut lui faire une grande impression.
L'obligation de lutter continuellement contre les sauvages portait l'attention des colons vers l'état militaire: c'était l'état le plus en vue. Or cette disposition fut singulièrement activée parmi la jeunesse de Montréal lorsqu'on vit arriver dans le pays, avec le régiment de Carignan, la fleur de la noblesse de France et l'élite de ces familles militaires qui vouaient leurs enfants à la guerre.
Après toutes les réclamations des colons contre les attaques continuelles des sauvages, le gouvernement résolut enfin, vers 1666, de transporter en Amérique des forces considérables pour assurer le salut de la colonie.
«Les Iroquois, dit M. Colbert, dans ses lettres à l'intendant Talon, s'étant déclarés les ennemis perpétuels et irréconciliables de la colonie et ayant empêché par leurs massacres et leurs cruautés que le pays ne pût se peupler et s'établir, et tenant tout en crainte et en échec, le roi à résolu de porter la guerre jusque dans leurs foyers pour les exterminer entièrement, n'y ayant nulle sûreté en leur parole.»
Et en effet, le ministre envoyait le général de Tracy avec plusieurs compagnies d'infanterie, et le commandant de Courcelles, avec mille hommes du régiment de Carignan, qui avait suivi Turenne depuis plusieurs années; il venait de se signaler en Hongrie sous les ordres du général Montecuculli qui, en 1664, à Saint-Gothard, aidé par 6,000 Français, accabla l'armée ottomane.11
Note 11: (retour) Dès l'année 1650, ce même régiment de Carignan, sous les ordres de M. de Turenne, s'était distingué par sa bravoure et sa fidélité à l'autorité royale dans les combats contre la Fronde: à Étampes, à Auxerre et enfin à la porte Saint-Antoine.
L'arrivée des troupes à Québec fit un effet merveilleux: la confiance fut ranimée et les coeurs remplis d'espérance dans la sollicitude du gouvernement.
L'entrée des régiments était de l'aspect le plus imposant au milieu des colons séparés depuis si longtemps des splendeurs de la mère patrie. Une bande de clairons et de tambours ouvrait la marche. La fanfare jouait ordinairement la marche de Turenne, composée par Lulli pour M. de Turenne. Après la fanfare venaient les militaires appartenant à deux régiments, avec leurs couleurs distinctives, les officiers habillés richement et comme il convenait à des jeunes gentilshommes des meilleures familles. Ensuite, l'on voyait apparaître les commandants supérieurs: M. de Courcelles, M. de Salières, et en fin M. de Tracy avec ses officiers d'ordonnance. Il avait vingt-quatre gardes toujours attachés à sa personne. (La mère Juchereau, page 271 de L'Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec.)
Quelques compagnies furent envoyées à Montréal. Ces troupes étaient destinées à protéger la ville; elles finirent par s'y établir et aussi dans les environs. Cette garnison donna, une animation toute nouvelle, avec les jeunes officiers dont nous aurons à parler. M. de Salières résolut d'aller attaquer aussitôt les Iroquois. Malheureusement, il se laissa tromper par cette apparence bénigne du froid qui surprend les Européens à leur arrivée en Canada. Comme ce froid sec est moins sensible que le froid humide de l'Europe, il pensa, que ses troupes, aguerries par plusieurs années de la vie militaire, pourraient le braver impunément, et il se mit en route au milieu de l'hiver pour aller attaquer les établissements iroquois aux environs du lac Champlain. Mais il fallut bientôt revenir sur ses pas.
Nos Français ne se découragèrent pas, et quelques mois après, M. du Tracy reprit l'expédition. Il partit au mois de septembre; mais cette fois il avait eu soin de se faire accompagner par des miliciens du pays. Cent vingt hommes parfaitement exercés vinrent de Montréal; ils étaient commandes par des officiers expérimentés, comme Charles Le Moyne et M. d'Ailleboust de Musseaux. Charles Le Moyne, en particulier, rendit les plus grands services, et attira l'attention des officiers supérieurs par sa connaissance de la tactique des sauvages.
Le lac Champlain fut traversé le 15 octobre, et, quelques jours après, on se trouva, en vue des premiers villages iroquois; ils étaient abandonnés. Les sauvages avaient concentré leurs armes et leurs provisions dans le dernier village, environné de plusieurs palissades et où ils prétendaient se mesurer avec les Français.
Les troupes avançaient résolument; elles étaient précédées des clairons et des tambours, au nombre de vingt. Quand ceux-ci commencèrent à jouer leurs fanfares, une panique effroyable se répandit parmi les sauvages et ils se dérobèrent, s'écriant qu'il leur semblait entendre les hurlements des démons de l'enfer. L'effet fut irrésistible.
Les troupes escaladèrent l'enceinte et trouvèrent le village abandonné, mais rempli de provisions et d'armes.
Les soldats purent alors se remettre de leurs fatigues. Après quelques jours de repos, les troupes auraient voulu se mettre à la poursuite des sauvages; mais M. de Tracy, averti par les colons, jugea qu'il ne fallait pas attendre l'hiver, et il revint vers le Canada, en ayant soin de placer les miliciens de Montréal à l'arrière-garde.
Il avait appris à apprécier ces braves miliciens; il mentionnait souvent «ses capots bleus». Il les trouvait habiles pour aller en avant et éclairer la marche, capables pour ramer sur les canots et les conduire sûrement, infatigables pour la marche, et infaillibles pour suivre les traces des sauvages au milieu des bois. Mais tous ces mérites revenaient pour une bonne part à celui qui les commandait et leur enseignait depuis longtemps l'art de la guerre: l'intrépide et habile commandant, Charles Le Moyne.
Aussi, l'on ne doit pas s'étonner qu'il fût compris dans la promotion aux titres de noblesse qui eut lieu l'année suivante, en 1668, et où l'on réunit tous ceux qui avaient rendu les services les plus éminents à la défense et au défrichement pays, comme M. Boucher, M. Hébert, M. Couillard, M. Le Ber et Charles Le Moyne. Ses titres de noblesse sont ainsi conçus:
Désirant favoriser notre cher Charles Le Moyne, sieur de Longueuil, pour ses belles actions; de notre pleine puissance, nous avons, par les présentes, signées de notre main anobli, anoblissons et décorons du titre de noblesse ledit Charles Le Moyne, ainsi que sa femme et ses enfants nés et à naître.
En revenant des expéditions du lac Champlain, le gouverneur assigna à la garde de Montréal et des environs plusieurs compagnies du régiment de Carignan, et il distribua des fiefs aux officiers et des terres aux soldats qui voulurent s'établir sur les fiefs de leurs commandants. Ces officiers sont principalement: MM, les capitaines de Chambly, de Saint-Ours, de Berthier, du Pads, de Varennes, de Verchères, de La Valterie, de La Chesnaye, de Contrecoeur, qui devinrent propriétaires de fiefs, et concédèrent chacun des terres aux soldats de leur compagnie.
Quant aux soldats, ils sont désignés sur les registres par leurs noms de guerre, qu'ils portent encore dans le pays: Lafranchise, Lajeunesse, Latreille, Lefifre, Laflèche, Laroche, Ladouceur, Lafortune, Lafleur, Laviolette, Latulipe, Lagiroflée, Lapensée, Laprairie, Laverdure, Lacaille, Portelance, Tranchemontagne, Lalance, Sanschagrin, Sansfaçon, Sansquartier, Sanssouci, Sanspeur.
Ces noms sont portés actuellement par un grand nombre du familles, en qui on remarque encore toutes les qualités des races militaires.
Maintenant, nous allons relever des faits qui nous paraissent tout à fait intéressants: c'est que la ville ett le pays ont conservé le souvenir de tous ces noms comme au premier jour. Ces noms subsistent depuis deux siècles, malgré les changements inévitables des années, et malgré l'influence de la conquête.
En 1672, M. Dollier de Casson, voyant l'accroissement des constructions de la ville, avisa à établir des rues suivant la direction la plus convenable.
Dans le sens de la largeur de la ville, il traça trois rues parallèles au fleuve. Celle du milieu reçut le nom de Notre-Dame, en l'honneur de la protectrice de la ville; près de la rivière, la rue Saint-Paul, en l'honneur du premier gouverneur, Paul de Maisonneuve; de l'autre coté, la rue Saint-Jacques, en l'honneur de M. Jacques Olier, fondateur de la ville. Ces trois rues parallèles au fleuve étaient coupées par six autres à angle droit. La première, à l'ouest, appelée Saint-Pierre, patron de M. de Fancamp; la seconde, Saint-François, en l'honneur de M. François Dollier de Casson, curé de Montréal; la troisième, Saint-Joseph, parce qu'elle longeait l'Hôtel-Dieu, placé sous ce patronage; la quatrième, Saint-Lambert, patron de M. Lambert Closse, qui avait été tué par les Iroquois a cet endroit; la cinquième, Saint-Gabriel, patron de M. de Queylus; la sixième, Saint-Charles, patron de M. Le Moyne. Tous ces noms ont été conservés, et ces rues sont les plus peuplées et les plus riches de Montréal.
Venons maintenant aux fiefs concédés aux environs de Montréal.
M. de Clarion et M. de Morel furent placés au nord-est. En face de la ville, M. Le Moyne reçut l'île Sainte-Hélène et la rive de Longueuil; M. Le Ber, l'île Saint-Paul; M. Dupuy, l'île au Héron; M. de La Salle, la côte de Lachine. En descendant le fleuve, on trouvait M. Boucher à Boucherville, puis M. de Varennes, M. de Verchères, M. de Boisbriant, M. de Repentigny, M. de La Valterie, M. de La Chesnaye, M. de Contrecoeur. Sur une zone plus éloignée se trouvaient M. de Berthier, M, du Pads, M. de Sorel, M. de Saint-Ours et M. de Chambly.
Ces officiers étaient établis avec des titres seigneuriaux et avec leurs soldats. Toutes ces agglomérations ont formé des paroisses qui existent encore, et qui ont conservé les noms des concessionnaires.
Telle a été l'origine des cantons environnant Montréal: Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Lavaltrie, Repentigny, Chambly, Saint-Ours, Sorel, l'île Dupas, Berthier, etc., etc.
Ces dispositions ont subsisté, et on ne peut faire un pas dans le pays sans trouver des vestiges de ces premiers temps si remarquables. Il n'y a peut-être pas de contrée où l'on ait conservé aussi religieusement les touchants souvenirs des commencements.
La ville avec ses environs est un mémorial vivant de tout ce qui s'est passé aux premiers temps.
Nous avons dit tout ce qui se rapporte à Montréal et a ses environs; maintenant, nous allons voir apparaître de graves événements.
ILE DE MONTREAL.
A 60 lieues de Québec, après avoir traversé le lac Saint-Pierre, on trouve plusieurs agglomérations d'îles, parmi lesquelles est le groupe de Montréal, où l'on compte près de vingt îles; les principales sont l'île de Montréal, avec l'île de Jésus au nord, et l'île Perrot au sud.
L'île de Montréal a une dizaine de lieues de longueur et trois ou quatre lieues dans sa plus grande largeur.
C'est dans cette île que se trouve la ville de Montréal, fondée en 1642. En 1815, elle ne comptait que 15,000 habitants, et elle est arrivée maintenant à près de 250,000. Elle était jadis le siège de la compagnie du Nord-Ouest pour la traite des pelleteries. Le fleuve Saint-Laurent, qui longe l'île de Montréal au sud, a, en certains endroits, jusqu'à deux lieues de largeur.
Les Iroquois du lac Champlain étant soumis, le gouvernement songea à s'assujettir les tribus iroquoises du lac Ontario, et il voulait aussi tendre la main aux peuplades nombreuses de l'Ouest, qui étaient favorables à la France.
A partir de ce moment, des voyageurs français remontèrent le Saint-Laurent et allèrent commercer sur les bords des grands lacs, comme Manthet, Louvigny, Duluth, Nicolas Perrot, qui, en 1671, au Sault-Sainte-Marie, réunit quatorze nations, et obtint d'elles qu'elles se mettraient sous la protection du roi de France.
En même temps, les gouverneurs conduisaient des troupes et fondaient plusieurs établissements sur le parcours du fleuve. Dans ces expéditions, Charles Le Moyne était toujours employé comme intermédiaire avec les peuples sauvages, qui avaient la plus haute considération pour lui. De 1670 à 1680, il accompagna les gouverneurs, M. de Courcelles, M. de Frontenac, et enfin M. de Labarre.
En 1671, M. de Courcelles voulant imposer aux Iroquois, décida d'aller les rencontrer au lac Ontario, que les Français nommaient alors le lac de Tracy, du nom du commandant des troupes. Il était accompagné de M. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières; de M. Pérot, nouveau gouverneur de Montréal; enfin de M. Le Moyne. Il voulut que le curé de Montréal, M. Dollier de Casson, fît partie de l'expédition; il le choisit à cause de sa connaissance du pays.
M. Dollier y consentit, et c'est lui qui est l'auteur de la relation qui a été publiée de ce voyage.
M. Dollier nous dit que plusieurs jeunes gentilshommes accompagnaient l'expédition, d'où quelques-uns ont conclu que ce pouvaient être les enfants de M. Le Moyne, de M. Le Ber et de M. de Montigny, qui étaient de même âge et toujours ensemble.
On partit le 2 juin 1671, avec une vingtaine de canots.
Il y avait à bord des tambours et des clairons pour donner les signaux. Ces instruments de fanfare animaient les canotiers, et firent un effet merveilleux sur les sauvages.
M. Dollier a donne, en commençant, une description du fleuve Saint-Laurent, qui montre que dès lors on avait une connaissance assez exacte du pays: nous en citerons quelques points:
Le fleuve Saint-Laurent est l'un des plus grands fleuves du monde, puisque à son embouchure, située vers le 50e degré de latitude, après une course de 700 lieues, il a près de 30 lieues de largeur. Il se rétrécit par l'espace de 150 lieues jusqu'à Québec, où il a près d'une lieue, et il conserve cette dimension non seulement jusqu'à Montréal, à 60 lieues plus haut, mais même par l'espace de 500 lieues, s'étendant tantôt en des lacs d'une épouvantable largeur, tantôt se rétrécissant dans le lit d'une rivière, mais au moins de la dimension que nous avons dite.
Le premier lac, à 33 lieues au-dessus de Québec, est le lac Saint-Pierre, de 11 lieues sur 3; le second, le lac Saint-Louis, de 7 lieues sur 2; le troisième, le lac St-François, de 10 lieues sur 2. Ensuite arrivent «ces lacs d'une épouvantable Largeur», grands comme certaines mers en Europe; le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, et enfin le plus grand de tous, le lac Supérieur, qui à 190 lieues sur 50, et reçoit douze grandes rivières, qu'il faudrait explorer jusqu'au bout pour trouver la source du grand fleuve.
Or, dans tout ce parcours, il y a des particularités dignes de remarques. Toutes les eaux du nord comprises entre les hauteurs du Mississipi et le faîte des terres opposées à la baie d'Hudson sont inclinées vers le sud et portées à un même centre situé à 1,600 pieds au-dessus du niveau de la mer, et ayant près de 300 lieues de diamètre. Il y a près de 60 affluents qui descendent 900 pieds plus bas, et au fond de cette coupe immense se trouve le lac Supérieur.
Ces premiers affluents, dont quelques-uns sont énormes, comme le Saint-Louis, le Kamanistiquia et le Nipigon, se concentrent d'abord en plusieurs lacs, comme le Nipigon, qui a 25 lieues de longueur, puis ils sortent de ces lacs et continuent leur cours sur une étendue de 10 lieues et vont se jeter dans le lac Supérieur, qui mesure, comme nous l'avons dit, 190 lieues de longueur.
Mais ce n'est là que le commencement des merveilles.
Ces contrées, pendant l'hiver, sont ensevelies sous les neiges et les frimas; les cours d'eau gèlent à près de dix pieds de profondeur; les neiges tombent incessamment et s'accumulent comme des montagnes de glace.
Toute cette étendue est ensevelie sous les brouillards, et souvent des ouragans en bouleversent la superficie jusqu'à l'approche du printemps.
Alors, la température s'adoucit, ces amas se désagrègent, les eaux s'écoulent; mais tout est réglé par la nature avec une économie admirable.
Les terrains, depuis le point de départ jusqu'aux rives de l'Océan, sont disposés en différents étages, et ils présentent l'aspect d'une immense pyramide, dont chaque degré renferme des bassins grands comme des mers.
Ces bassins superposés se déversent les uns dans les autres par des chutes, des cataractes et des rapides qui, moins élevés, sont cependant presque infranchissables.
Au milieu de ces mouvements des eaux, le grand fleuve conserve une admirable transparence et une pureté d'eau de roche continuée jusqu'à la mer.
Voici l'énumération de ces merveilleux mouvements: Les premiers affluents descendent de près de mille pieds, et arrivent au lac Supérieur. Celui-ci, situé à 625 pieds au-dessus de la mer, avec sa masse immense, franchit un second degré, et descend par le saut Sainte-Marie, qui a 1,000 pieds de largeur. Cette grande nappe d'eau s'en va s'épanouir en trois bassins; le lac Michigan, le lac Huron et la baie Géorgienne. Ces bassins sont d'une immense étendue, de 100 lieues sur 50. Le fleuve continue son cours en recueillant plusieurs affluents. Il descend ensuite par la rivière de Détroit, qui a 2,000 pieds de largeur. Ensuite se présente le lac Érié, de 90 lieues sur 45, et à son extrémité sud, il se précipite comme tout entier à 140 pieds de profondeur sur 3,000 pieds de largeur à Niagara, dans le lac Ontario, qui est encore à 225 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Ces 225 pieds sont représentés jusqu'à Montréal par plusieurs rapides ainsi nommés: les Galops, le Long-Sault, les Cèdres, et enfin le saut St-Louis, qui a près de vingt pieds de hauteur, où se trouvent les derniers degrés de cette pyramide de 1,600 pieds de hauteur que nous venons de parcourir. Le fleuve reçoit alors d'immenses affluents: l'Ottawa, le Richelieu, le Saint-Maurice, l'Yamaska, le Saguenay, de 3,000 pieds de largeur, après lequel le grand fleuve atteint 10 lieues, puis 20 lieues, puis 30 lieues de largeur en arrivant à la mer.
Le bateau du gouverneur était d'une grande dimension. Les sauvages furent au dernier degré d'étonnement en voyant les Français manoeuvrer un si grand bâtiment. Ils savaient le sortir de l'eau en un instant, et le porter au delà des rapides avec une remarquable facilité.
M. Le Moyne rendit les plus grands services, et sut faire valoir près des sauvages l'effroi que leur inspiraient la force et l'audace des Français; aussi les sauvages n'osèrent pas attaquer le gouverneur à l'aller ni au retour.
En 1673, deux ans après, nous dit M. Dollier de Casson, M. de Frontenac, le nouveau gouverneur, voulut faire le même voyage, et il emmena avec lui M. Le Moyne, qui devait lui être du plus grand secours. M. Le Moyne pouvait s'assurer des dispositions des sauvages, et ainsi il faisait éviter tout mal entendu; nous le verrons ci-après.
M. de Frontenac arriva à Montréal vers le 20 juin 1673, il fut reçu en grande pompe par le clergé et par la garnison, avec le gouverneur Pérot, qui devait l'accompagner. Il assista, le 24 juin, à la messe à l'église paroissiale: c'était le jour de saint Jean-Baptiste, patron du pays et du ministre Colbert. Le gouverneur fut complimenté dans le sermon donné par M. de Fénelon. Le lendemain, il partit avec 400 hommes et 100 canots. Il avait, en outre, deux grandes berges ornées de couleurs éclatantes pour frapper, disait-il, les sauvages. C'est pour la même raison que son escorte était si nombreuse. Il avait avec lui trois prêtres: M. Dollier de Casson, M. d'Urfé et M. de Fénelon, pour traiter avec les sauvages, dont ils étaient les missionnaires.
M. Le Moyne reçut les sauvages et les présenta à, M. de Frontenac. Il traduisit les allocutions et les réponses, et enfin, il était chargé d'amener chaque jour, à la table du gouverneur, deux ou trois des principaux parmi les Iroquois. Nous pensons que M. Le Moyne avait avec lui ses fils, au moins les trois aînés: Charles, qui avait dix-neuf ans, Jacques, qui avait dix-sept ans, et Pierre, âgé de près de quinze ans.
M. de Frontenac ayant reçu les Indiens, ceux-ci lui adressèrent, un discours de bienvenue par un des principaux chefs, Garakonthié. Ensuite, M. de Frontenac fit une réponse qui fut traduite par M. Le Moyne. Les jours suivants furent employés à la construction d'un fort où M. de Frontenac installa une garnison.
Ensuite le gouverneur revint à Ville-Marie avec ses troupes, et il continua à s'occuper de l'amélioration de son fort, qu'il confia l'année suivante à M. de La Salle, à qui il accorda une garnison de 40 soldats, destinés à protéger les marchands et les traitants qui se fixèrent autour du Fort.
En revenant de cette expédition, M. Le Moyne prit une décision qui devait avoir les conséquences les plus avantageuses pour ses enfants.
Vers ce temps, Colbert employait tous les moyens pour mettre la marine militaire sur le plus grand pied. Dans sa supériorité de vues, il avait compris qu'avec les nouvelles colonies possédées par les autres nations, la marine était appelée à occuper une place considérable dans le monde. Il voyait que le siège de la puissance était déplacé dans l'ordre politique, et se trouvait alors dans le commerce des deux mondes.
Cinq ports furent agrandis et fortifiés: Brest, Toulon, Rochefort, le Havre et Dunkerque. Des vaisseaux furent construits sur un plus grand modèle que ceux de l'Angleterre et de la Hollande. Cent vaisseaux de ligne furent préparés, avec 60,000 matelots, et les commandements furent donnés à des hommes d'un grand génie: d'Estrées, Tourville, Duquesne, Jean Bart et Forbin. Bientôt le pavillon français, jusque-là à peine connu sur les mers, donna la loi aux autres nations.
Colbert voulut assurer ces succès. «Le roi avait demandé à Colbert l'empire de la mer, et Colbert, par les mesures les plus puissantes, sut le lui donner.»
Tels furent, dans les années suivantes, les progrès de la marine que, tandis que la France, en 1672, n'avait que soixante vaisseaux de ligne et quarante frégates avec 60,000 matelots, moins de dix ans après, en 1681, la marine comptait cent quatre-vingt-dix-huit bâtiments de guerre et 160,000 hommes de mer.
Mais pour en arriver là, le ministre avait établi des classes de recrutement pour les marins et des écoles spéciales pour former les officiers, pris dans les meilleures familles. A Rochefort, à Brest, à Dieppe, à Toulon, on avait fondé des écoles où les jeunes gens faisaient leur apprentissage d'officiers.
On y enseignait les mathématiques, l'hydrographie, le service du canon. On assujettissait les pilotes et les artilleurs à apprendre leur métier autrement que par routine, et les élèves de la marine profitaient de cet enseignement.
On voit tout cela réglé et disposé avec la plus grande habileté par le grand ministre dans ses lettres aux intendants maritimes: Amous, Matharel, du Terron, du Seul, dans les années 1661, 1670 et 1671, et enfin dans sa grande ordonnance sur la marine, en 1680. Cotte ordonnance a été conservée, et elle se trouve au deuxième livre du Code du commerce actuellement en vigueur.
Le roi secondait ces mesures de tout son pouvoir. Il avait d'abord fait appel aux principales familles des côtes maritimes, pour leur faire destiner quelques-uns de leurs enfants à la marine; il s'était aussi adressé aux grandes familles des colonies, qui devaient retirer tant d'avantages de l'accroissement des forces navales.
M. Le Moyne répondit à ces invitations en envoyant trois de ses enfants dans les écoles de France: de Sainte-Hélène, d'Iberville et de Maricourt. Il est probable que c'est alors que M. Testard de Montigny envoya aussi son fils, l'ami des jeunes Le Moyne.
D'Iberville, avec ses frères, passa quatre on cinq ans dans l'apprentissage de la vie de marin. Il commença par étudier aux écoles, et ensuite il continua ses travaux avec ses frères sur les vaisseaux du roi en campagne.
C'était le temps des grandes luttes de la France sur les mers avec l'Angleterre et la Hollande. La France remporta alors plusieurs victoires signalées. Nous ne savons pas avec lequel des commandants les jeunes Le Moyne firent alors leur apprentissage; mais l'occasion ne devait par leur manquer, puisque les élèves de marine n'étaient pas plus inactifs que le reste de la flotte.
En 1676, le duc de Vivonne, assisté de Duquesne, lieutenant général de la marine, se rendit en Sicile. Il y trouva les Espagnols et les Hollandais réunis. Ceux-ci avaient pour commandant leur plus grand homme de guerre, l'amiral Ruyter.
Un premier combat, livré près de l'île de Stromboli, fut indécis; mais un second, livré près de Syracuse, fut une complète victoire pour les Français; Ruyter y fut tué. Enfin, Vivonne et Tourville, continuant leur course, atteignirent encore une fois, devant Palerme, les flottes ennemies et les écrasèrent. La France eut dès lors l'empire de la Méditerranée.
Les Hollandais avaient, cette même année, pris Cayenne et ravagé nos établissements des Antilles. Le vice-amiral d'Estrées, avec huit bâtiments, reprit Cayenne et détruisit, dans le port de Tobago, une escadre ennemie de dix vaisseaux. En 1678, d'Estrées enleva cette île, puis il traversa l'Atlantique et prit tous les comptoirs hollandais au Sénégal. Le pavillon français régna alors sur l'Atlantique comme sur la Méditerranée.
D'autres succès suivirent: Duquesne bombarda Alger en 1681 et 1684; Tripoli et Tunis éprouvèrent le même sort, et pendant quelque temps, la Méditerranée fut purgée des corsaires.
Dans l'intervalle, Duquesne avait bombardé Gênes, en 1684. En 1689, le convoi destiné pour l'Angleterre traversa la Manche, et le commandant Château-Renaud battit l'escadre anglaise à Bantry.
Tourville, avec 78 voiles, attaqua l'escadre ennemie sur les côtes de Sussex, et détruisit 18 vaisseaux près de Beachy Hood (10 juillet 1690). Alors la France eut l'empire de l'Océan, jusqu'au désastre de la Hogue, où Tourville, avec 40 vaisseaux, soutint le choc de 80 vaisseaux anglais et hollandais. Mais l'année suivante, cette défaite fut réparée, car en 1693, à la bataille de Lagos, Tourville anéantit les flottes anglaise et hollandaise, et saisit pour 80 millions de marchandises.
Pendant ce temps-là, Jean Bart avait fait connaître son habileté et son audace. En 1691, après de brillants exploits, il avait été nommé chef d'escadre dans la marine royale. Étant sorti de Dunkerque, malgré le blocus des Anglais, il brûla 80 vaisseaux ennemis, débarqua à New-Castle et revint avec un immense butin. En 1694, malgré tous les efforts des ennemis, il alla prendre un convoi de grains, et défit la flotte hollandaise, supérieure en nombre. C'est alors qu'ayant abordé le vaisseau amiral, il tua le commandant et enleva toute l'escadre.
Lorsque les jeunes Le Moyne eurent acquis la science compétente, il paraît qu'ils furent envoyés à Montréal, où le gouverneur méditait des entreprises considérables, comme nous le verrons bientôt.
Vers 1684, les Le Moyne retrouvèrent leur père avançant toujours en mérite et en considération; il n'avait que 50 ans. Ils revirent aussi leur sainte et admirable mère, riche en piété, on tendresse et en vertus: elle était entourée de douze enfants, dont quatre étaient déjà des hommes faits, et elle n'avait alors que 44 ans.
Montréal avait pris, pendant ce temps, un grand développement; la population était arrivée à 1,500 âmes; la ville était protégée par une milice dévouée et intrépide, et elle était environnée de remparts en palissades avec des bastions.
Le gouverneur était toujours M. Pérot, neveu de M. Talon par sa femme, et beau-frère, par sa soeur, de M. le président de Bretonvilliers, frère du supérieur de Saint-Sulpice. Le major était M. Bisard, qui avait épousé la fille de M. Lambert Closse. Le curé était M. Dollier de Casson, résidant à Montréal avec M. Souart, l'ancien instituteur des jeunes Le Moyne.
M. d'Urfé et M. de Fénelon s'occupaient surtout des missions. M. de Belmont était à la tête de la mission de la Montagne.
Les Le Moyne avaient beaucoup de parents dans la ville: M. Jacques Le Moyne et ses fils, madame Le Ber et ses enfants, parmi lesquels Jeanne, cette jeune fille d'une piété si éminente, et qui menait la vie de recluse dans la maison de ses parents.
M. Charles Le Moyne avait quitté sa maison de la rue Saint-Joseph pour aller s'établir sur le quai, près de la rue Saint-Charles. De là, il pouvait se rendre plus facilement à son fief de Longueuil, où il faisait élever un château considérable. M. Le Ber avait aussi quitté la rue Saint-Joseph, et il était venu s'établir sur la rue Saint-Paul, près de la rue Saint-Dizier, où il était plus commodément pour les intérêts de son commerce.
Les principaux citoyens que l'on cite à ce moment dans le recensement étaient les amis ou les alliés de la famille Le Moyne, et ils ont tous eu des descendants nombreux dans le pays. C'étaient MM. Prud'homme, Descaries, Deschamps, Jean Dupuy, Urbain Tessier, de Lamothe, de Brasac, Robert Cavelier, Antoine Primot, François Lenoir, Pierre Robutel, de Hautmesnil.
Les jeunes Le Moyne, en attendant les ordres du gouvernement qu'on leur avait fait pressentir, accompagnèrent encore leur père, qui prit part à deux expéditions, en 1684 et 1685.
D'abord en 1684, M. de Frontenac, voulant établir une ferme confiance parmi les colons contre les entreprises des sauvages, résolut d'aller trouver ceux-ci pour les déterminer à faire une paix durable; enfin, il voulait aussi explorer les nations de l'Ouest pour lier commerce avec elles, et les attirer dans notre parti en cas de rupture avec les Iroquois. C'est alors qu'il détermina d'envoyer, en forme d'ambassade, quelques Canadiens amis des sauvages, pour les assurer de la décision du roi à l'égard de la paix.
Charles Le Moyne fut choisi. Il avait la confiance des sauvages, qui le distinguaient entre tous et l'avaient honoré d'un nom sauvage; ils l'appelaient Akouassen, c'est-à-dire la perdrix, à cause de son agilité extraordinaire et peut-être aussi à cause de son teint normand et vermeil. M. de Frontenac se disposait à partir pour rejoindre les envoyés, lorsqu'il fut remplacé dans son gouvernement par M. de La Barre, qui mit à exécution le projet de son prédécesseur.
M. de La Barre partit de Montréal le 25 juin 1684 avec M. Le Moyne. Il se rendit au lac Ontario, puis à l'embouchure d'une rivière où se trouve maintenant la ville d'Oswégo. Il envoya de là M. Le Moyne chez les Onnontagués, qui paraissaient bien disposés. M. Le Moyne revint avec plusieurs chefs indiens qui entrèrent en pourparlers avec le gouverneur. C'était M. Le Moyne qui interprétait les allocutions de M. de La Barre et les réponses du chef iroquois. Mais ces pourparlers n'eurent pas d'issue, parce que les Onnontagués ne voulaient pas s'engager à part des autres nations, et craignaient de se mettre en butte à leur ressentiment; car ces nations étaient irritées de n'avoir pas été appelées à ces conférences, M. Le Moyne avait prévenu M. de La Barre, qui ne voulut pas l'écouter. Il ne consentit à aucun arrangement, ce qui mit fin à ces entrevues, et il revint mécontent des prétentions des sauvages.
De nouveaux événements tournèrent les esprits vers d'autres intérêts, ainsi que nous allons le voir au chapitre Suivant.
Les circonstances que les jeunes Le Moyne attendaient, se présentèrent enfin vers l'année 1686.
Il y avait longtemps que le gouvernement voulait prendre une décision pour les pays du Nord occupés d'abord par les Français et enlevés depuis par les Anglais.
Colbert avait écrit à M, Denonville, le nouveau gouverneur général, de s'en occuper activement. Ces pays commençaient au 51° de latitude, et comprenaient le Labrador, la baie d'Hudson et les contrées environnantes. Ils étaient très importants par leur position au milieu de tribus nombreuses, et surtout pour le commerce des fourrures, que l'on savait plus belles à mesure que l'on approchait du pôle nord.
Il y avait des années où l'on avait pu recueillir jusqu'à 800,000 pièces. C'était un revenu de plusieurs millions que l'on pouvait percevoir, et, de nos jours, malgré la diminution du gibier, on a recueilli à la baie d'Hudson, en castors, en orignaux, en renards bleus, et en martres, jusqu'à vingt millions de francs par année.
Le centre de ce trafic est la baie d'Hudson, vaste golfe qui est comme une mer de 550 lieues de longueur sur 250 lieues de largeur. On croit que les Français et les Portugais avaient exploré ces côtes à partir de l'an 1500. En 1610, un navigateur anglais, Hudson, en prit possession, et vers 1660, le prince Rupert, oncle du roi Charles II, chef de l'amirauté anglaise, fonda une compagnie de la baie d'Hudson pour l'exploitation des fourrures.
Des marins anglais y furent envoyés, et ils construisirent plusieurs forts pour la traite avec les sauvages, Aussitôt les marchands de Québec établirent une société sous le nom de «Compagnie du Nord», et ils réclamèrent l'appui du gouvernement. Ils alléguaient ce principe, qu'avant l'institution du prince Rupert, les Français possédaient plusieurs établissements qui avaient été livrés aux Anglais par deux renégats, Radisson et de Groseillers.
Le gouverneur, M. Denonville, pressé par Colbert. voulut remédier à cet état de choses. Il fit réunir à Montréal une troupe de cent hommes, à la tête desquels il mit un des anciens officiers de Carignan, le chevalier de Troyes, qui était renommé pour son habileté. Il avait avec lui 30 soldats et 70 Canadiens. M. de Catalogue commandait les soldats, et M. Lenoir Roland était à la tête des Canadiens.
Charles Le Moyne, alors âgé de 60 ans, aurait voulu être de cette expédition, mais ses infirmités ne le lui permettaient pas. Il proposa trois de ses fils, Saint-Hélène, d'Iberville et Maricourt comme volontaires, pouvant servir de guides et d'interprètes. Le chevalier de Troyes demanda qu'on lui donnât le Père Silvy pour chapelain, afin de subvenir aux besoins spirituels des soldats, et pour traiter avec les sauvages, parmi lesquels il avait fait plusieurs missions. C'était un homme éminent, et qui fut du plus grand secours.
Il y avait plusieurs chemins pour se rendre à la baie d'Hudson; le premier, en partant de Tadoussac et en remontant le Saguenay; de là. on arrivait au lac Saint-Jean, puis au lac Mistassini, d'où l'on suivait un affluent de la rivière Rupert qui débouchait dans la mer du Nord.
Le second partait de Trois-Rivières, remontait le Saint-Maurice, puis trouvait plusieurs affluents qui descendaient vers la baie d'Hudson. On fut obligé de renoncer à ces deux chemins. On ne voulait pas donner l'éveil aux Anglais, qui étaient aux environs, et l'on craignait aussi de rencontrer les Iroquois, qui venaient souvent dans ces parages. On choisit alors le chemin de l'Ottawa, à l'ouest de Montréal, qui était éloigné de tout voisinage dangereux et à l'abri de toute surprise.
Le départ fut fixé au 20 mars 1686. Le dégel était à peine commencé, mais il importait d'arriver avant que les vaisseaux anglais du printemps fussent venus ravitailler les stations anglaises et enlever les pelleteries.
L'expédition entendit la sainte messe dans l'église Notre-Dame, qui servait au culte depuis peu. Toute la population environnait les jeunes volontaires, et l'on peut concevoir quels étaient les sentiments des mères, et en particulier de l'admirable madame Le Moyne, âgée alors de 46 ans, et qui voyait partir en même temps trois de ses enfants.
Les soldats étaient équipés de tout ce qui était nécessaire: ils avaient une vingtaine de traîneaux; ils emportaient des vivres et des munitions pour plusieurs mois. Parmi eux il y avait des charpentiers pour établir les campements, des marins pour conduire les embarcations, des canonniers, des mineurs pour saper les fortifications s'il était nécessaire; enfin des sauvages éprouvés et dévoués les accompagnaient: c'étaient des gens appartenant à la mission de la Montagne et à celle de Lachine.
Ils remontèrent le fleuve, purent porter leurs bagages au saut Saint-Louis et aux rapides de Sainte-Anne, puis ils suivirent le cours de l'Ottawa. Les rives étaient couvertes alors de bois sans limites.
Quelques jours après, ils arrivèrent devant le fort de la Petite-Nation, où il y avait une réunion de chrétiens indiens sous la direction des prêtres de la maison de l'évêque de Québec. Ils saluèrent le fort d'une salve de coups de fusils, auxquels le fort répondit par un coup de canon en déployant au haut du rempart le drapeau de la France.
Ils longèrent les chutes de la Chaudière, puis le lac des Chats, et ils arrivèrent on vue de l'île du Calumet et de l'île des Allumettes.
Ils étaient alors au milieu de ces îles si nombreuses qu'on les appelle les Mille-Iles, comme celles que l'on trouve à Gananoque sur le Saint-Laurent, à l'entrée du lac Ontario, et comme celles aussi que l'on rencontre en si grand nombre à l'extrémité ouest de l'île de Montréal.
Arrivés à l'embouchure de la rivière Mattawa au 1er jour de mai, ils ne continuèrent pas dans la direction du lac Nipissing, à travers de lac Champlain et le lac Talon, comme l'avait fait Champlain et plus tard M. de Talon en 1616. Ils remontèrent droit dans le nord par la rivière Mattawa jusqu'au lac Témiscaming.
C'est là, dit M. de Catalogne, dans sa relation, qu'ils se firent des canots et qu'ils les employèrent sur le lac.
Ce lac a 60 lieues de longueur sur 4 de large. Les rives sont bordées des terres les plus fertiles. Sur tout ce parcours, ils rencontraient différentes populations qui, comme toutes les nations sauvages du Nord, étaient ennemies des Iroquois et des Anglais, et étaient en bons rapports avec les Français, qu'elles avaient appris à aimer par les missions infatigables des Pères Jésuites.
Des réceptions solennelles avaient lieu: les tribus apportaient le calumet de paix; elles exécutaient leurs danses en suivant les bateaux; puis elles entonnaient des chants de joie qui se distinguaient surtout pur cette particularité, disent les mémoires, «que c'était à qui crierait le plus fort.»
On débarquait le soir; on tirait les chaloupes à terre.
Alors les gens faisaient du feu et prenaient le repos, que l'on prolongeait parfois pendant plusieurs jours quand les fatigues le demandaient.
Les frères Le Moyne guidaient les miliciens dans le bois, pour se procurer de nouvelles provisions par la, pêche ou la chasse.
Quand on fut arrivé à l'extrémité du lac Témiscaming, on porta les canots pour trouver les affluents de la rivière Abbitibbi, qui se dirige vers la mer du Nord.
Tout ce trajet ne s'accomplissait pas sans de grandes difficultés: souvent l'on trouvait les cours d'eau gelés sur une grande étendue; d'autres fois, il fallait lutter contre les glaçons qui obstruaient le cours du fleuve.
A mesure que l'on avançait dans le nord, les obstacles augmentaient. Les rivières étaient encore gelées sur un long parcours; aussi, malgré la force et l'habileté des hommes, on mit à traverser cette étendue de 900 milles de longueur, un temps bien plus considérable que l'on n'avait pu prévoir; le trajet dura plus de deux mois.
En ce temps, le pays avait un aspect de sévérité et de grandeur qui imposait. Cette perspective austère et sauvage a disparu par suite des défrichements et de la destruction des bois. C'est ainsi que s'expriment les missionnaires:
Nous avons à passer des forêts capables d'effrayer les voyageurs les plus assurés, soit par leur vaste étendue, soit par l'âpreté dos chemins rudes et dangereux. Sur la terre, on ne peut marcher que sur des précipices; sur le fleuve, on ne peut voguer qu'à travers des abîmes où l'on dispute sa vie sur une frêle écorce, entre des tourbillons capables de perdre de grands vaisseaux.
A mesure que l'expédition remontait, elle pouvait contempler, jusqu'aux extrémités de l'horizon, ces forêts immenses qui n'étaient pas encore exploitées et qui présentaient la variété des plus beaux arbres, à l'état plusieurs fois séculaire. Ce que l'on ne trouve plus qu'en remontant à de grandes distances, on le voyait alors à proximité, du Montréal et du lac Chaudière. On trouvait des vallées, des montagnes couvertes de la végétation la plus abondante et la plus extraordinaire, jusqu'à porte de vue, et avec une continuité si suivie dans toutes les directions, qu'elle faisait dire aux voyageurs du temps que «le Canada n'était qu'une foret.» En même temps, la densité de cette masse de verdure était si grande avec son enchevêtrement de branches, de plantes grimpantes et de lianes, qu'on ne voyait sur sa tête, pendant des lieues et des journées entières de marche, qu'un dôme continu d'arbres sans la moindre échappée de ciel.
Depuis ce temps, l'exploitation a commencé à s'étendre, et elle a continué depuis deux siècles avec une activité toujours croissante, en sorte que, actuellement, elle produit chaque année cent millions de francs de revenu. L'aspect du pays a donc pu changer, et, malgré cela, à 20 lieues de Montréal et d'Ottawa et à 10 lieues de Mattawa, on trouve encore des traces de la forêt primitive, avec ses troncs séculaires et ses proportions gigantesques.
Pendant la marche, l'expédition pouvait contempler des variétés singulières. Sur certaines montagnes, au côté sud, on voyait la neige disparue et les premières pousses de la végétation naissante; et pendant ce temps-là, au côté nord, les arbres étaient revêtus encore d'une impérissable blancheur, et couverts de cristaux et de stalactites resplendissant aux feux du jour.
Ce n'était pas sans peine que l'on affrontait ces immensités: tantôt il fallait traverser des berceaux de branches penchées sur la rivière de manière à intercepter la navigation; ensuite, lorsque l'on recourait aux portages, souvent on rencontrait sur les rives des arbres brisés et couchés que l'on ne pouvait franchir qu'en se glissant, en rampant presque, pendant des distances considérables.
C'est là qu'on voyait dans toute leur réalité ces aspects étranges décrits par Parkman:
Ici, des arbres renversés par la tempête servaient de digue aux flots écumants avec leurs débris monstrueux: en même temps, on pouvait contempler les profondeurs des forêts séculaires, obscures et silencieuses comme des cavernes soutenues par les piliers de ces arbres dont chacun est un Atlas supportant un monde de feuillage, et répandant une humidité continuelle à travers leurs écorces épaisses et rugueuses.
Quelques arbres apparaissent pleins de jeunesse; d'autres, au contraire, sont tout décrépits et déformés par l'Age, semblables à des fantômes aux contorsions étranges. Ils sont tout repliés sur eux-mêmes et couverts de veines et d'excroissances; d'autres, entrelacés et réunis ensemble, paraissent comme des serpents pétrifiés au milieu des embrassements d'une lutte mortelle: les mousses apparaissent aussi aux regards, étendant sur les sols pierreux un tapis verdoyant; là revêtant les rochers de draperies ondoyantes: plus loin transformant les débris en remparts de verdure, ou bien enveloppant les troncs brisés comme d'un filet qui les préserve d'une dernière destruction; plus haut, on les voit se suspendre et se déployer en guirlandes et en spirales comme des formes de reptiles, et sur eux resplendit la jeune végétation qui appuie sur des ruines les pousses vigoureuses d'une forêt naissante.
(M. Parkman.)
Lorsqu'on arrivait aux chutes et aux rapides, on contemplait d'autres spectacles saisissants de grandeur.
A l'extrémité des lacs immenses reflétant les clartés d'un ciel étincelant, l'on voyait descendre sur des escaliers de granit les chutes d'un lac plus élevé occupant souvent toute la ligne de l'horizon. Parfois la chute arrivait en tournoyant autour d'immenses sommités, puis au delà, on voyait de nouveaux lacs environnés de rochers surplombant, avec des arbres qui venaient baigner leurs branches dans les eaux profondes. Les rives étaient surchargées de plantes, de lierres qui semblaient disposés avec l'art le plus compliqué. A d'autres endroits, l'immensité des eaux était interrompue par des rochers qui se rapprochaient comme une barrière infranchissable, dont on ne trouvait l'issue qu'après mille détours; et ensuite, au delà, on contemplait de nouvelles nappes d'eau d'une pureté et d'un éclat sans égal.
Avec toutes les difficultés que présentait le parcours de cette nature primitive, il arrivait des événement inattendus, qui arrêtaient la marche et réduisaient l'expédition à une inaction complète. Des brouillards qui s'élevaient du sein des ondes ne permettaient plus d'avancer et environnaient tout d'une obscurité profonde. D'autres fois, un changement de température amenait un dégel si complet que les chemins devenaient comme des fondrières insondables, et l'on ne pouvait porter les canots et les bagages.
D'autres phénomènes propres à ces climats venaient surprendre les voyageurs. Dans la nuit arrivait une pluie abondante qui, en tombant, se changeait en pince, et recouvrait tout comme d'un cristal épais. Alors, les arbres et les buissons semblaient transformés en girandoles. Les troncs, les branches et jusqu'aux moindres brindilles étaient complètement renfermés dans un étui de place. En outre, du haut des rochers pendaient des guirlandes et des aiguilles de cristal; tout cela plus admirable que les effets du givre, qui ne sont que passagers. C'était magnifique, c'était féerique. Les fameux palais de cristal des souverains orientaux ne sont rien comparés a ces merveilles.
Mais toutes ces beautés devaient voir une fin terrible. Il y avait un moment ou les arbres finissaient par céder sous des poids écrasants; les branches commençaient à éclater et à se rompre de toutes parts avec un bruit sinistre. Les voyageurs n'osaient sortir de leurs tentes, ni avancer, ni même lever leurs regards vers ces massifs qui s'ébranlaient et s'écroulaient sur leurs têtes. Et enfin, quand l'oeuvre de destruction était terminée, on pouvait constater l'étendue du mal; des arbres déracinés jonchaient les chemins; d'énormes chênes cassés en tête ou par le milieu formaient des amoncellements et des chaos au milieu desquels il semblait que l'expédition ne pourrait jamais continuer sa marche.
Pendant l'expédition, on put reconnaître quels services rendait le Père Silvy: il instruisait les sauvages, les exhortait au bien, entendait les confessions et administrait le baptême. De plus, il portait les consolations aux malades et aux découragés. Lorsque la fatigue était trop grande et qu'il fallait nécessairement s'arrêter quelques jours, les charpentiers élevaient en quelques heures une chapelle. Les nefs étaient couvertes de branches et de feuillages, et le sanctuaire décoré d'écorce de bouleau. Cet appareil avait, aux yeux de ces hommes de foi, autant de prix que les basiliques les plus belles, ornées de marbres et de porphyres.
Le Père Silvy n'était pas seulement secourable pour le ministère religieux; il était habile pour gagner le coeur des sauvages. Ils l'admiraient comme le représentant de ces héroïques Pères Jésuites qui, depuis cinquante ans, parcouraient sans cesse ces contrées lointaines, en faisant connaître l'Évangile.
Après le Père Silvy, ceux qui avaient pu rendre le plus de services étaient les frères Le Moyne, qui étaient incomparables pour guider l'expédition sur les courants, et pour la conduire dans les profondeurs des forêts. Ils avaient une habileté égale à celle des sauvages pour s'orienter au milieu des solitudes les plus impénétrables; enfin, par leur connaissance des langues sauvages et leur titre de représentants des nations indiennes auprès du gouvernement, ils étaient considérés tout particulièrement.
D'après les mémoires du temps et les portraits des Le Moyne conservés à Paris, on peut avoir une idée de ce qu'étaient alors ces jeunes gens de 22, 24 et 26 ans. Ils étaient grands, forts et d'une habileté extraordinaire pour les exercices du corps.
D'Iberville qui, par la taille, dépassait ses deux frères, les surpassait aussi par la force. A cela près, ils se ressemblaient à s'y méprendre.
Le teint clair, les cheveux abondants et très blonds; les traits grands mais délicats; le front large, ouvert; les yeux bleus et pénétrants; le nez aquilin; la bouche fine et bien dessinée; le menton carré, signe d'une grande fermeté. Ils semblaient bien appartenir à cette admirable race normande qui avait produit les conquérants de l'Angleterre, les champions de la Sicile et les héros des croisades.
Enfin, après deux mois de marche, on put contempler, du sommet des montagnes, une immensité d'eau reflétant les tons pâles d'un ciel froid mais pur; c'était la baie d'Hudson, vaste comme une mer, et s'étendant au loin jusqu'à l'horizon.
Le but de tant de fatigues était atteint; les coeurs furent remplis de joie, mais l'expression on fut contenue, de crainte de quelque surprise. Sur l'invitation du missionnaire, tous les voyageurs se prosternèrent et tirent entendre, mais à, demi voix, un Te Deum d'actions de grâces.
COSTUME DES TRAPPEURS.
Ce costume se composait d'un vêtement de fourrure ou de drap, qui descendait jusqu'aux genoux. Les jambes étaient préservées du froid par des bas de laine foulée qui remontaient jusqu'au-dessus du genou et étaient retenus par de fortes jarretières en peau. Ce vêtement était de différentes couleurs, suivant les localités; les gens de Montréal étaient habillés en bleu, ceux de Trois-Rivières, en blanc ceux de Québec en rouge. Il était ainsi facile de les reconnaître. Leur chapeau était en feutre noir, à grands bords relevés par devant. Le costume était accompagné d'une ceinture en laine, et d'une large cravate qui faisait plusieurs fois le tour du cou.
La baie nommée baie du Nord, se présentait donc il leurs regards dans son immensité.
Cette masse d'eau, qui est vraiment une mer intérieure, n'a pas moins de 300 lieues de longueur sur 250 lieues dans sa plus grande largeur. Au sud, elle se rétrécit en une baie qui a 80 lieues de largeur: c'est ce que l'on appelle la baie James.
Cette partie était occupée par quatre forts: à l'extrémité sud, le fort Monsipi, que les Français ont appelé depuis le fort Saint-Louis; à droite, à quarante lieues, le fort Rupert; à gauche, à quarante lieues, le fort Kichichouane, que les Français nommèrent le fort Sainte-Anne. Plus haut, du même côté, le fort de New Savanne, appelé ensuite fort Sainte-Thérèse. Ce fort était situé sur la rivière appelée des Saintes-Huiles, parce que l'un des missionnaires y avait perdu son bagage.
Enfin, plus loin, à trente lieues au nord, on trouvait le fort Nelson, nommé plus tard le fort Bourbon.
Les Canadiens étaient donc arrivés à leur but, le 20 juin 1686, à ce centre si recherché du commerce des fourrures du Nord.
Nul bruit de leur marche n'avait transpiré. Les Anglais, renfermés dans leurs forts, attendaient la venue des bâtiments du printemps; ils étaient loin de penser qu'une troupe d'hommes chargés de munitions et d'un matériel de siège avait pu franchir, pour les surprendre, 900 milles dans la saison de l'année la plus difficile pour la marche.
On ne songeait donc pas à se garder au fort Monsipi; il n'y avait ni poste d'observation, ni rondes de nuit, ni sentinelles. Les voyageurs attendirent avec une vive impatience le moment fixé par leur chef, et jusque-là, ils pouvaient jouir d'un beau spectacle, comme il arrive souvent dans ces grandes régions du Nord. Des bruits se faisaient entendre au loin. C'était le dégel qui opérait son oeuvre de destruction sur les masses de glace environnantes. Ces amas se détachaient du haut des rives, et se précipitaient ensuite avec un fracas semblable au bruit du tonnerre. La lune, entourée d'auréoles de diverses couleurs, éclairait faiblement. A mesure que l'expédition avait avancé dans le nord, elle avait pu contempler plusieurs fois cette merveille des régions polaires que l'on appelle l'aurore boréale. Presque tous les soirs, le ciel paraît en feu avec des dispositions de lumière qui varient et changent d'instant en instant. Tantôt, l'on voit les degrés d'un portique qui va se perdre dans le sommet des nuages; quelques minutes après, les lueurs paraissent comme des colonnes d'albâtre qui se mettent en mouvement et se croisent en formant des losanges de feu. A certains moments, tout s'éteint, puis les lueurs réapparaissent avec des combinaisons nouvelles. Quelquefois, on aperçoit comme un immense éventail offrant plusieurs cercles d'où s'échappent des rayons de feu qui éclatent dans l'immensité comme des fusées d'artifice. Voilà ce que l'on pouvait contempler presque chaque soir. Ce sont les particularités que l'on observe encore aujourd'hui, et qui viennent rompre la monotonie des longues nuits du pôle.
L'heure étant venue, le capitaine de Troyes prit les dispositions nécessaires pour n'être pas surpris lui-même. Il plaça une vingtaine d'hommes à la garde des canots, puis il s'avança avec le reste du détachement.
Pour expliquer ce qui se passa, M. de La Potherie a donné une description très détaillée du fort;
A trente pas de la rivière, sur une petite hauteur, était un carré de palissades de cent pieds de façade sur le fleuve et de dix-huit pieds de hauteur, avec des bastions à chaque angle.
Les bastions, revêtus de forts madriers, avaient en dedans une terrasse assez large pour placer des tirailleurs. Dans les bastions, il y avait plusieurs canons d'environ six livres de balles. Au milieu de la façade, il y avait une porte épaisse d'un demi-pied, garnie de clous et de ferrements pour qu'on ne pût l'entamer avec la hache.
Au milieu de l'enceinte s'élevait une redoute de troncs d'arbres assemblés et posés pièce sur pièce. La redoute avait trente pieds de longueur et autant de hauteur, avec trois étages et vingt-huit pieds de profondeur. Au sommet, il y avait un parapet et des embrasures pour les canons de la plate-forme.
Le commandant fit approcher, au milieu des ténèbres, deux canots chargés de madriers, de pioches et d'un bélier, tandis que les hommes montaient par un chemin enseveli sous les rochers et les arbres. 12
Note 12: (retour) L'on remarque encore aujourd'hui ce sentier.
Sainte-Hélène et d'Iberville furent désignés pour faire le tour de la place et chercher à pénétrer par la palissade qui regarde le désert. Le sergent Laliberté, du régiment de Carignan, fut envoyé avec ses hommes pour couper la palissade sur le côté et s'en aller tirer sur les embrasures de la redoute.
Le chevalier de Troyes se réservait de faire enfoncer la porte de la façade avec le bélier.
Sainte-Hélène et d'Iberville, en se rendant à leur poste, commencèrent avec leurs hommes à lier les canons de la palissade par la volée avec de fortes cordes attachées à des madriers, de manière que si l'on mettait le feu aux canons, en reculant ils auraient arraché la palissade. Ils escaladèrent la clôture en arrière du fort et ils s'en vinrent aussitôt ouvrir la porte du côté du bois, car elle n'était fermée qu'au verrou, et ils firent entrer leurs hommes; ils revinrent aussitôt vers la porte de la redoute, que le chevalier de Troyes se mettait en devoir de briser avec le bélier.
En même temps, les soldats faisaient feu dans les embrasures de la redoute, avec des cris affreux à l'iroquoise: Sassa Kouès! Sassa Kouès! qu'ils prononçaient au plus haut de la voix, comme les Indiens.
Quelques Anglais, s'étant réveillés au bruit, parurent sur la plate-forme et se mirent à pointer les canons sur les assaillants, qu'ils prenaient pour des sauvages. Sainte-Hélène visa le premier qui se présenta aux embrasures et lui cassa la tête du premier coup de fusil.
Pendant ce temps, le bélier avait commencé à produire son effet. Dès que la porte fut à moitié démontée, d'Iberville, sans calculer le danger qu'il pouvait courir, se jeta dedans, l'épée d'une main et son fusil de l'autre.
Les Anglais, surpris, se précipitèrent sur la porte, qui tenait encore par quelques ferrements, et la refermèrent.
D'Iberville, placé avec les ennemis dans l'obscurité la plus profonde, «ne voyait ni ciel ni terre» il se détendit comme il put avec la crosse de son fusil, puis, entendant descendre de nouveaux assaillants d'un escalier, il tira au hasard. Les Anglais hésitaient, croyant avoir affaire à un grand nombre; mais ils eurent bientôt reconnu leur erreur, lorsque les Français, ayant réussi à briser la porte, se précipitèrent en foule, l'épée à la main, et trouvèrent les Anglais nus et sans armes. Ils avaient été réveillés on sursaut et ne s'étaient pas aperçus des premiers mouvements de l'attaque. Trompés par les cris, ils avaient cru à une fausse alerte des sauvages. Tous se rendirent, sans essayer de combattre, et demandèrent à être renvoyés en Angleterre. On trouva dans le fort douze canons de six à huit livres, trois mille livres de poudre et dix mille de plomb, que les artilleurs canadiens, qui possédaient un moule à boulets, commencèrent à utiliser.
On prit quinze hommes dans ce fort, nous dit le Père Silvy, et on en aurait pris encore quinze autres, sans une barque que nos découvreurs avaient aperçue la veille, mais elle était partie le soir pour le fort Rupert, avec le commandant de Monsipi, qui était désigné pour remplacer le commandant général de la Baie, et qui, en conséquence, était allé faire faire des travaux à Rupert. «Nous fûmes bien fâchés, dit le Père Silvy, de l'avoir manqué, et comme sa barque nous était nécessaire pour porter du canon au fort Kichichouane (qui avait cinquante canons en batterie), on prit la résolution de la suivre et de s'en aller attaquer Rupert, espérant enlever le fort et le vaisseau du même coup».
Il y avait quarante lieues, et elles furent faites en cinq jours, jusqu'au 1er juillet. D'Iberville conduisait une chaloupe portant deux pièces de canon. Quand on fut arrivé à une certaine distance, Sainte-Hélène eut ordre d'aller à la découverte. Il se glissa à travers les arbres et les rochers, et il prit connaissance de la position. Le fort était de la même construction que le fort Monsipi, avec cette particularité que la redoute n'était pas au milieu de l'enceinte, que le toit était sans parapets, et que quatre bastions environnaient la redoute avec huit pièces de canon. En fin, de Sainte-Hélène remarqua une échelle attachée le long du mur de la redoute pour se sauver en cas d'incendie.
Le chevalier de Troyes prit aussitôt ses dispositions: il débarqua des canons, fit faire des affûts et préparer les grenades; on disposa des madriers pour le travail du mineur qui devait aller placer ses pièces d'artifice sous le mur de la redoute.
En même temps, d'Iberville partit avec douze hommes dans sa chaloupe, afin d'aborder le vaisseau au milieu de la nuit. Ils savaient que Brigueur, le gouverneur, devait s'y trouver. Arrivés au vaisseau, ils virent la sentinelle endormie; c'est ce que l'on pouvait prévoir sur une mer éloignée de toute menace d'attaque. On ne laissa pas à la sentinelle le temps de donner l'alarme.
D'Iberville frappa alors du pied sur le pont pour réveiller les gens, comme c'est l'usage sur les vaisseaux lorsqu'il faut que l'équipage se lève pour quelque chose d'extraordinaire. Le premier qui se présenta au haut de l'échelle reçut un coup de sabre sur la tête; un autre qui avait monté par l'avant périt de même. Alors, on descendit; la chambre fut forcée à coups de hache et l'équipage fut réduit en quelques instants. Ils eurent quartier, et en particulier Brigueur, gouverneur de Monsipi, qui s'en allait prendre la qualité de gouverneur général de la Baie.
Pendant ce temps, le chevalier de Troyes avait enfoncé la porte de l'enceinte avec son bélier, et il entourait la redoute avec son monde, l'épée à la main.
Le grenadier, profitant aussitôt de l'échelle placée sur la redoute, arriva sur la plate-forme, et se mit à lancer ses grenades par le tuyau de la cheminé. Tout fut bientôt brisé par cette explosion, et il n'y eut plus moyen de tenir en cet endroit. Une femme, réveillée en sursaut par ce bruit, s'enfuit dans une autre chambre, où elle fut atteinte, ainsi que deux autres, par des éclats de grenade. La garnison se réfugia alors au rez-de-chaussée, mais elle s'y trouva sous le feu des Canadiens, qui tiraient par les ouvertures. Le chevalier, trouvant que le bélier n'allait pas assez vite, fit tirer le canon sur la porte.
Au môme moment, le mineur fit connaître qu'il avait placé ses pièces, et qu'il n'attendait qu'un ordre pour faire sauter la redoute. Ce que les Anglais ayant entendu, ils comprirent qu'ils ne pouvaient plus résister, et ils demandèrent quartier.
Ainsi fut pris le second fort; les prisonniers, placés dans un yacht qu'on trouva amarré près de là, furent dirigés vers Monsipi; ils étaient escortés par le vaisseau qui avait été chargé de toutes les munitions et des pelleteries trouvées dans le fort.
Le chevalier fit alors sauter le fort et les palissades parce qu'il aurait fallu trop de monde pour le garder. Il y laissa d'Iberville pour surveiller cette exécution, et il lui donna la chaloupe pour opérer son retour.
M. du Troyes partit en canot avec quelques hommes. En arrivant à Monsipi, il y trouva les deux bâtiments qui avaient transporté la prise. Il fit emmagasiner les provisions, et il décida alors du sort des prisonniers.
Le chevalier les réunit et les fit transporter à l'autre bord de la rivière, avec des vivres. Il leur donna des filets pour la pêche et des fusils pour la chasse. Il leur enjoignit de ne pas passer outre, sous menace de mort, et il leur dit que s'ils avaient quelque chose à communiquer, ils pouvaient envoyer sur la batture deux hommes qui mettraient un mouchoir au bout d'un bâton pour signal.
Ensuite, le chevalier de Troyes se disposa pour sa nouvelle entreprise. Il fit charger les canons sur le vaisseau pris au fort Rupert, et il mit son monde en plusieurs canots. Les mémoires du temps remarquent qu'il pria alors le Père Silvy, qui était resté à Monsipi, de l'accompagner dans cette expédition, que l'on pouvait penser devoir être plus longue que les premières.
Le Père Silvy pouvait être utile par son expérience en ces contrées; ensuite, rien n'égalait son influence sur les gens, au milieu des peines et des difficultés.
Elles furent très grandes, car il fallait se diriger à trente lieues au nord, sans savoir au juste quelle était la situation du fort. Toute cette côte est environnée de battures qui s'étendent au loin dans la mer et qui ne sont pas navigables. Il fallait donc se tenir à trois lieues de la cote, et, quand la marée était basse, il fallait porter les canots et les bagages à de grandes distances, tandis que, lorsque la marée montait, l'on se trouvait engagé dans les glaces, dont il était difficile de sortir.
Après plusieurs jours de marche et de navigation, on reconnut qu'on avait dépassé la situation du fort sans l'avoir aperçu, et les sauvages qui accompagnaient l'expédition ne savaient plus où ils en étaient, bien qu'ils crussent connaître le pays; mais ils ne se découragèrent pas, tant ils tenaient à se venger des Anglais, qui les avaient accablés de mauvais traitements.
On était dans la plus grande incertitude, lorsque, dans le lointain, on entendit sur la côte sept ou huit coups de canon.
L'expédition vogua dans cette direction, aborda avec armes et bagages à l'embouchure de la rivière Kichichouane, que l'on n'avait pas aperçue d'abord. On parvint à un endroit où il y avait une sorte d'estrapade au haut de laquelle on plaçait une sentinelle pour signaler l'arrivée des vaisseaux. En ce moment, d'Iberville arriva avec Sainte-Hélène dans la chaloupe qui portait tous les pavillons de la compagnie de la baie d'Hudson. Iberville, avec son habileté ordinaire, avait su se diriger en droite ligne en partant du fort Rupert vers l'embouchure de la rivière Kichichouane que l'expédition avait eu tant de peine à rencontrer.
Aussitôt arrivé, Sainte-Hélène fut encore désigné pour reconnaître l'assiette de la place. Il revint bientôt et annonça que le fort était semblable aux deux autres. Il était sur une hauteur, à quarante pas du bord de l'eau, et environné d'un fossé en ruines.
Au centre d'une palissade, s'élevait une redoute de trente pieds de haut, à plusieurs étages, avec une plate-forme au-dessus; mais il y avait, de plus qu'aux autres forts, une artillerie considérable: quatre canons dans chaque bastion, et 25 ou 30 dans le corps principal, placés aux différents étages.
Le chevalier de Troyes, sachant que son arrivée avait été signalée, voulut procéder par voie de conciliation. Il envoya demander au gouverneur qu'il voulût bien lui remettre trois Français qui étaient détenus dans la place. Le gouverneur, qui ne savait pas à quels ennemis redoutables il avait affaire, ne voulut répondre que d'une manière évasive. Aussitôt le chevalier de Troyes décida de recourir à la force.
Il fit établir une batterie de dix canons de l'autre côté de la rivière, sur une hauteur, dans des buissons, et puis il attendit le soir. Alors, ayant reconnu avec sa longue-vue que le gouverneur s'était retiré, avec sa famille, dans sa chambre, qui était sur la façade, il démasqua sa batterie, et envoya une volée sur la table du gouverneur. Tout fut mis sens dessus dessous, mais il n'y eut heureusement personne de blessé.
L'on continua à tirer, et en moins de cinq quarts d'heure, on tira près de cent cinquante coups de canon, qui criblèrent tout le fort.
Les Canadiens, voyant que tout allait bien, se mirent a crier: Vive le roi! L'on entendit en même temps des voix sourdes qui semblaient sortir du soubassement du fort qui en faisaient autant: c'étaient les assiégés, qui s'étaient retirés dans les caves, et qui, ne voulant pas se risquer à aller sur la plate-forme pour amener le pavillon, avaient fait tous ensemble ce signal, pour faire connaître qu'ils voulaient se rendre.
Les Canadiens ne comprirent pas le sens de ces acclamations, et ils se préparèrent à renouveler l'attaque.
Ayant tiré tous leurs boulets, ils s'occupèrent à en faire de nouveaux avec leur moule, lorsqu'on entendit les tambours du fort qui battaient la chamade. Aussitôt on vit paraître un homme avec un pavillon blanc, qui s'embarquait dans une chaloupe.
Le chevalier reçut l'envoyé avec courtoisie, et sur son invitation, il se rendit à mi-chemin du fort, où il trouva le gouverneur. Celui-ci avait fait porter avec lui du vin d'Espagne, et, après avoir bu à la santé des deux rois, on s'occupa d'arrêter les conditions de la reddition. Voici ce qu'elles portaient en substance:
Articles accordés entre le chevalier de Troyes, commandant le détachement du parti du Nord, et le sieur Henry Sargent, gouverneur pour la compagnie anglaise de la baie d'Hudson;
1° Il est accordé que le fort sera rendu avec tout ce qu'il contient, dont on prendra facture pour la satisfaction des deux parties;
2° Il est accordé que tous les serviteurs de la compagnie jouiront de ce qui leur appartient en propre, ainsi que le gouverneur, son ministre et ses serviteurs;
3° Que le dit chevalier de Troyes enverra les serviteurs de la compagnie au fort de l'île Weston, où ils attendront les vaisseaux anglais, et qu'il leur donnera les vivres nécessaires pour retourner en Angleterre;
4° Que les hommes sortiront du fort sans armes, à l'exception du gouverneur et de son fils, qui sortiront avec l'épée au côté.
Ce qui fut exécuté. D'Iberville conduisit les Anglais à l'île Weston, où ils avaient un magasin, puis revint au fort Sainte-Anne.
Ce fort contenait les principaux magasins de la compagnie; on y trouva des quantités de provisions et de munitions, et 50,000 écus de pelleteries. Ce fut le principal fruit de cette expédition, qui rendait les Français maîtres de la partie méridionale de la baie d'Hudson.
Le Père Silvy remarque, dans sa relation, «qu'on entra dans le fort tambour battant et enseignes déployées, le 26 juillet, le propre jour de sainte Anne, c'est-à-dire de la sainte qu'on avait prise pour patronne du voyage et de l'expédition.» Le chevalier de Troyes voulut reconnaître la protection continuelle de la divine Providence pendant toute la durée de l'entreprise. Il donna au fort le nom de la patronne que l'on avait invoquée; ensuite il chargea le Père Silvy d'établir le service religieux dans le fort. L'une des pièces principales fut convertie en chapelle, et décorée en partie avec les drapeaux de la compagnie anglaise. Chaque jour, la sainte messe y était célébrée; la garnison y assistait aux fêtes principales, et il n'était pas difficile de trouver parmi les Canadiens élevés par M. Dollier de Casson, des assistants et des servants pour le saint sacrifice.
L'on a pu remarquer comme le chevalier de Troyes et les messieurs Le Moyne avaient désiré emmener un aumônier avec eux. Ils tenaient aussi à ce qu'il les accompagnât dans leurs différentes expéditions pour les secours qu'il pouvait donner aux hommes malades ou blessés, et on fin pour la célébration des saints mystères. Mais il y avait encore une autre raison qui accompagnait toutes les décisions des hommes de guerre dans la Nouvelle-France: c'est que tout ce qu'on faisait avait pour but principal d'avoir des relations avec les sauvages et de leur donner la connaissance de la vraie religion. Aussi le Père Silvy nous dit, dans sa relation, «qu'il a des rapports avec des sauvages de différentes tribus, qu'il comprend la langue de plusieurs d'entre eux et qu'il espère que Dieu, dans sa bonté, donnera à ces pauvres gens la grâce de se convertir.»
Telle fut donc la première expédition à la mer du Nord, expédition qui, tout en faisant le plus grand honneur au chevalier de Troyes, mit en grand relief les qualités du chevalier d'Iberville et de ses frères.
C'est ce que fait remarquer aussi le Père Silvy: «Voilà, dit-il dans sa lettre à Mgr de Saint-Vallier, le coup d'essai de nos Canadiens sous la sage conduite du brave M. de Troyes, et de messieurs Sainte-Hélène et d'Iberville, ses lieutenants.»
LA BAIE D'HUDSON.
Vaste baie au nord de l'Amérique septentrionale, communiquant avec l'Atlantique par le détroit du même nom; par 51° à 70° de latitude nord, et par 79° à 98° de longitude. Elle baigne la Nouvelle-Bretagne à l'ouest, au sud et à l'est; au nord, elle se réunit à la mer polaire. C'est sur ses bords que se trouvent tous les forts qui ont été le théâtre des exploits d'Iberville. Elle reçoit un grand nombre d'affluents; les rivières Sainte-Anne, des Saintes-Huiles, de Bourbon, de la Rive. Au sud-ouest, le fort de Monsipi, puis les forts de New-Savane, Bourbon; au sud-est le fort de Rupert. C'est là qu'on trouvait les îles Weston, du Retour, Mansfield, de Saint-Charles, et à l'extrémité est, dans le détroit d'Hudson, les îles Button, découvertes par Anscolde, et explorées par Hudson en 1610. La compagnie de la baie d'Hudson s'établit sous Charles II, en 1670, à l'endroit qu'on appela le fort de Rupert.
«Ces deux généreux frères se sont merveilleusement signalés et les sauvages qui ont vu ce qu'on a fait en si peu de temps et avec si peu de carnage, en sont si frappés qu'ils ne cesseront jamais d'en parler partout où ils se trouveront.»
Les sauvages en effet, avaient une admiration particulière pour la modération des Français et leur douceur. Dans leurs expéditions, ils évitaient de verser le sang, et au milieu de leurs succès, ils avaient horreur de ces massacres outrés et odieux qui viennent parfois de l'enivrement et de l'entraînement de la victoire. Ce sont ces sentiments qui ont gagné le coeur de ces barbares, et en ont fait les alliés dévoués de la France.
M. de Troyes, voyant l'expédition terminée, se disposa à revenir à Montréal, comme on le lui avait enjoint à son départ. Il remit la garde des forts au jeune de Maricourt, chargea d'Iberville de courir la mer contre les vaisseaux anglais; enfin, il confia au digne Père Silvy le soin spirituel de la garnison. D'Iberville utilisa ses fonctions avec les deux bâtiments qu'il avait. Il s'empara d'un grand vaisseau anglais qu'il chargea de toutes les pelleteries des forts qu'il avait pris, puis il décida de revenir à Québec pour aller prendre quelques vaisseaux qui lui seraient indispensables pour attaquer les convois anglais l'année suivante.
Il paraît donc qu'il revint aux derniers jours d'automne 1686, avec Sainte-Hélène, et il fut reçu à Montréal comme un triomphateur. Toute la ville savait quelle part il avait eue aux succès de l'expédition. Les citoyens voyaient avec bonheur leur compatriote couvert de gloire. D'Iberville rentra dans Montréal tambour battant et enseignes déployées. Les citoyens acclamaient le vainqueur; et la mère, retrouvant ses enfants après des jours d'inquiétude et encore désolée de son veuvage, combien elle était heureuse de les revoir sains et saufs!
Nous ne pouvons savoir, d'après les documents, la date précise et les circonstances de la mort de Charles Le Moyne, que l'on place en 1685. Nous savons seulement que s'il avait vécu en 1686, il n'aurait eu que 60 ans et aurait encore pu être plein de force et de résolution.
Mais telle était alors la situation glorieuse de cette nombreuse famille qui comptait dix enfants. L'aîné, Le Moyne de Longueuil, était honoré de la confiance des autorités supérieures, et il avait l'affection des nations sauvages, qui l'avaient choisi comme leur représentant près du gouvernement. Sainte-Hélène, de Maricourt et de Bienville étaient des militaires consommés. A l'égard de Maricourt, nous avons un témoignage digne de considération dans une lettre de Mgr de Laval du 12 janvier 1684.
D'Iberville s'était révélé comme commandant capable, et sur mer comme manoeuvrier des plus consommés.
Enfin, les autres fils grandissaient pleins de force, et se montraient d'une habileté extraordinaire dans les exercices militaires.
L'intervalle qui sépare l'année 1687 et l'année 1689 fut occupé par plusieurs incidents où d'Iberville prit part, et il est probable qu'il était à la baie d'Hudson au mois d'août 1689, lorsqu'arrivèrent des événements considérables qui eurent des conséquences si graves sur les destinées du pays.
Il y avait longtemps que les Anglais voyaient avec ombrage le voisinage des Français. Ils étaient inquiets de leur accroissement et de leurs excursions dans l'Ouest. Les sauvages redoutaient les Anglais, et ils aimaient les Français. Ils étaient attirés vers ceux-ci par leurs moeurs agréables, leurs goûts chevaleresques, tandis qu'ils étaient repoussés par l'austérité et la sévérité des puritains anglais.
L'on pouvait donc prévoir que, grâce à cette sympathie et grâce aussi aux travaux des missionnaires, les sauvages se laisseraient gagner, et que bientôt les vastes contrées du Mississipi passeraient sous la domination française. Les Anglais s'en inquiétaient, et la nouvelle de l'entreprise audacieuse de la baie d'Hudson mit le comble aux ressentiments.
Dans ces circonstances, les Anglais et les Hollandais, voyant toute influence leur échapper, se déterminèrent à irriter les Français contre les sauvages en excitant ceux-ci à l'acte le plus odieux vis-à-vis de la colonie de Montréal.
Aux premiers jours d'août 1689, 1400 Iroquois traversèrent le lac Saint-Louis. Pendant la nuit du 5 août, à la faveur d'un orage et d'une pluie torrentielle, ils environnent le village de Lachine, et ils mettent tout à feu et à sang, avec des détails de cruauté que l'on peut à peine rapporter. Le matin, ils avaient égorgé plus de 200 personnes, et ils en emmenaient autant en esclavage, les réservant aux plus affreux supplices. La colonie fut dans la consternation, et ne reprit quelque espoir que lorsque M, de Frontenac revint de France comme gouverneur général. Il succédait à M. de La Barre et à M. Denonville, qui avaient rabaissé le prestige du nom français par leur faiblesse et leur défaut de décision.
Le nouveau gouverneur, informé des derniers événements, se détermina à tirer une vengeance éclatante. Ayant acquis la certitude que les Anglais et les Hollandais étaient les instigateurs de l'expédition des Iroquois, il organisa contre eux quatre expéditions.
L'une devait partir de Montréal avec M. d'Ailleboust et M. de Sainte-Hélène; l'autre, de Trois-Rivières avec M. Hertel et son fils, le lieutenant La Frenière; la troisième avec M. de Portneuf, fils du baron de Bécancourt, de Québec; enfin la quatrième avec les sauvages abénaquis de la mission de Lorette, qui devaient aller rejoindre leurs compatriotes des rives de l'Atlantique.
La première expédition partit de Montréal à la fin de janvier 1690. Les deux commandants, d'Ailleboust et de Sainte-Hélène, avaient avec eux des officiers capables: d'Iberville, qui avait suggéré l'expédition, et de Bienville, son frère; MM. de Montigny, Le Ber du Chesne, le frère de mademoiselle Jeanne Le Ber, et enfin M. de Repentigny.
Ils avaient 210 hommes, dont 90 sauvages, et ils devaient se rendre à Albany. Les ordres de M. de Frontenac étaient absolus; il fallait faire comprendre aux Anglais qu'on était déterminé à en venir aux dernières extrémités. Mais de grandes difficultés survinrent: le temps devint excessivement froid, les chemins étaient affreux, les hommes se trouvèrent accablés de fatigue. Sur les représentations des sauvages, on décida de ne pas aller plus loin que la petite ville de Schenectady, où l'on arriva le 8 de février, au commencement de la nuit. Les habitants reposaient dans la sécurité la plus complète; ils avaient laissé les portes ouvertes, avec deux statues de neige en guise de sentinelles.
Le village fut entouré, les habitations envahies, 60 habitants furent tués et 80 faits prisonniers.
D'Iberville fit épargner le gouverneur, Alexandre Glen, pour le récompenser d'avoir sauvé la vie à des prisonniers français en différentes circonstances. Un seul Français fut tué, et M. de Montigny blessé. Puis les Français, s'étant reposés, jugèrent à propos de revenir sur leurs pas.
Le second détachement, conduit par Hertel, quitta Trois-Rivières le 28 janvier. Il comptait 24 Français et 25 sauvages. Après deux mois de marche, il s'avança jusqu'à Salmon-Falls, au centre de la colonie anglaise, et après plusieurs engagements, il s'empara de cette station, après avoir tué 140 ennemis. Il y eut, du côté des Français, plusieurs blessés et plusieurs tués, parmi lesquels le lieutenant La Frenière.
Le troisième détachement, parti de Québec avec M. de Portneuf, s'avança jusqu'à la baie de Casco avec les Canadiens, les Acadiens et les Abénaquis. Il prit le fort Loyal et extermina la garnison.
Enfin, les Abénaquis situés à Sillery près de Québec, sous la direction des Pères Jésuites, allèrent se réunir à leurs compatriotes de l'Est, qui les attendaient, et tous ensemble se dirigèrent vers la place principale des provinces du Nord, Pémaquid. Cette place avait une grande importance; elle possédait 20 pièces de canon et 500 hommes de garnison. Les Abénaquis, après avoir rasé toutes les habitations qu'ils rencontrèrent sur leur passage, arrivèrent devant Pémaquid, Ils l'investirent, puis échangèrent quelques escarmouches, et enfin, ayant donné l'assaut, ils emportèrent la place après avoir, tué 200 hommes et réduit les autres à demander quartier.
Toutes ces attaques couronnées de succès eurent un effet merveilleux: elles ranimèrent le moral des colons, accablés par les massacres de Lachine; elles abattirent la présomption des Anglais, qui virent que les Français, sans le nombre, étaient encore de redoutables adversaires. Enfin, le prestige du nom français fut tellement relevé auprès des sauvages, que l'on put présumer que les Français auraient bientôt la prépondérance en Amérique.
En effet, sur ces entrefaites et vers la fin de juillet 1,690,800 sauvages de l'Ouest, ayant 110 canots chargés de 100,000 écus de pelleteries, se rendirent à Montréal pour voir le gouverneur. Ils arrivaient avec le désir de s'unir aux Français par les liens les plus intimes.
Frontenac, avec cet esprit décisif et déterminé qui le caractérisait, saisit habilement l'occasion de conquérir l'esprit des sauvages. Il leur fit la plus aimable réception, rendue solennelle par la présence des troupes, et les sauvages purent contempler les plus belles démonstrations militaires. M. de Frontenac écouta avec intérêt les harangues des sauvages. Le chef des Ottawais parla surtout des avantages que leur offrait le trafic avec les Anglais; le chef des Hurons parla des engagements que les Français avaient déjà pris de combattre leurs ennemis les Anglais et les Iroquois, et de les mettre hors d'état de nuire, engagement qui n'avait pas été tenu par M. de La Barre et M. Denoncourt. Ensuite, pour exciter les Français à se prononcer, ils entonnèrent leurs chants héroïques accompagnés de danses de guerre. Frontenac répondit aussitôt qu'il accorderait tout avantage possible de commerce aux sauvages, et qu'il les assisterait de sa protection contre leurs ennemis; enfin, il leur déclara qu'il allait se mettre en campagne, et qu'il ne cesserait la lutte qu'après avoir obtenu que les peaux rouges, qui étaient ses enfants comme les blancs, seraient respectés.
Après ces assurances, il termina son discours, comme les sauvages, par des démonstrations martiales. Il prit une hache, entonna un chant de guerre accompagné de Sassa Kouès, de toute la force de ses poumons et avec le cérémonial ordinaire, c'est-à-dire en dansant et en se frappant la bouche avec la main pour donner plus de force à ses cris.
Cette démonstration eut un effet indescriptible. Les sauvages trépignaient de joie, et Frontenac, voyant le bon effet de sa démonstration, y voulut mettre le comble.
Il fit signe à ses officiers, qui prirent tous des casse-tête, et se mirent à danser et à chanter avec un entrain et une vigueur qui ravissaient les Indiens. L'on eût dit que les Français n'avaient jamais fait autre chose; ils y mettaient cet emportement qui est particulier aux Français, la furia francese, donnant le plus haut caractère à leur mise en scène. «Ils semblaient, nous dit M. de La Potheie, comme des possédés, par les gestes et les contorsions extraordinaires qu'ils faisaient, tandis que leurs voix fortes et vigoureuses faisaient valoir les cris et les hurlements guerriers.»
Les Indiens étaient ivres de joie en entendant ces voix puissantes et exercées, en voyant leurs danses si merveilleusement interprétées par ces nobles gentilshommes qui réunissaient l'entrain à la force, la vivacité à l'élégance, et dont plusieurs avaient figuré dans les carrousels de Louis XIV.
Un repas suivit, à tout boire et tout manger. «Les Indiens, nous dit encore La Potherie, y firent honneur avec une vraie frénésie, et ensuite ils prononcèrent leur serment d'allégeance.»
Comme la navigation était encore possible, Frontenac, pour seconder les derniers exploits, enjoignit à d'Iberville de partir pour aller croiser dans la baie d'Hudson. Celui-ci partit aux premiers jours d'août avec deux bâtiments, la Sainte-Anne et le Saint-François, et le 24 septembre 1690, il abordait près de la rivière Sainte-Thérèse.
Ici se placent différents incidents qui montrent quelles étaient l'habileté et la présence d'esprit de ce grand homme de guerre.
D'abord les Anglais voulurent le prendre par surprise; ils lui envoyèrent des parlementaires pour fixer un lieu de conférence à l'amiable. D'Iberville soupçonna quelque ruse; il accepta l'entrevue et fit explorer les environs par ses hommes. L'on trouva deux canons chargés à mitraille dirigés sur le lieu fixé pour l'entrevue. D'Iberville tua les canonniers sur leurs pièces, puis se mit à la poursuite des parlementaires, qu'il passa par les armes.
Quelques jours après, les Anglais voulurent recourir à la force; ils firent sortir deux de leurs plus grands vaisseaux, l'un de vingt-deux canons et l'autre de quatorze. D'Iberville feignit de fuir devant eux, et ayant exactement calculé l'heure de la marée, il les attira sur la haute mer au moment où la mer se retirait. Les deux vaisseaux anglais s'échouèrent sur les rochers. Alors, avec la marée suivante, d'Iberville revint sur les ennemis et les força d'amener pavillon.
Un troisième vaisseau fut enlevé par un acte d'audace incomparable. D'Iberville avait envoyé quatre hommes pour signaler les bâtiments anglais. Deux des explorateurs turent faits prisonniers. Les Anglais prirent l'un de ces hommes, qui semblait le plus faible et le moins résolu pour les aider dans la manoeuvre. Un jour que presque tous les hommes étaient dans le haut de la mâture, le Canadien, n'en voyant que deux sur le pont, sauta sur une hache et leur cassa la tête, puis il délivra son compagnon; ensuite, armés de toutes pièces, ils montèrent sur le pont et ils couchèrent en joue les autres matelots, les forçant de venir se constituer prisonniers. Alors ils conduisirent sans délai les vaisseaux à la côte, où la cargaison fut d'un grand secours.
Après ces exploits, le fort Sainte-Thérèse se trouvait privé d'une grande partie de ses défenseurs. Alors d'Iberville le fit entourer et dressa ses batteries. Il commença à canonner. Les Anglais, voyant qu'ils ne pourraient résister, mirent le feu au fort pendant la nuit, puis s'en allèrent se réfugier au fort Nelson à trente lieues de distance. D'Iberville entra aussitôt dans le fort, et avec tant de promptitude, qu'il put éteindre le feu et sauver les pelleteries, qui étaient considérables.
Il laissa le fort sous le commandement de son jeune frère, et ayant chargé le plus grand de ses bâtiments, le Saint-François, avec toutes les pelleteries, il se dirigea vers Québec, et entra dans le Saint-Laurent vers le milieu d'octobre 1690. M. d'Iberville se trouvait vers les îles aux Coudres, lorsqu'il fut hélé par un bâtiment qui venait à sa rencontre. C'était son frère, M. de Longueuil, qui avait été envoyé par le gouverneur pour rencontrer les bâtiments qui venaient de France, et pour les prévenir qu'une flotte anglaise assiégeait Québec, et qu'ils devaient entrer dans le Saguenay pour se mettre à l'abri.
C'est alors que M. d'Iberville apprit tout ce qui venait d'arriver. Nous croyons devoir en dire quelques mots. Nous donnerons donc le récit de M. de Longueuil à son frère, sur les événements qui avaient eu lieu pendant le séjour de M. d'Iberville à la baie d'Hudson.
QUÉBEC.
Ancienne capitale du Canada. Port très vaste. Fortifications importantes. Fondée par les Français en 1608, assiégée vainement par les Anglais en 1690, elle resta aux Français jusqu'en 1759. Devant Québec, le Saint-Laurent a environ un mille de largeur, et quoique à 150 lieues de son embouchure, la marée s'y fait sentir. Québec est à la fois une forteresse, un port de guerre, un port de commerce, et un vaste chantier de construction. La citadelle s'élève à 360 pieds de hauteur au-dessus du fleuve.
Lorsque les sauvages de l'Ouest étaient venus à Montréal, comme nous l'avons dit, ils avaient terminé tous leurs pourparlers en prêtant un serment d'allégeance. Cette démonstration excita au dernier point le ressentiment des Anglais, qui jurèrent de faire le plus grand effort qu'ils eussent encore tenté contre la colonie.
Ils envoyèrent à la fois 16,000 hommes par le lac Champlain, et une flotte de 36 vaisseaux partit de Boston, conduite par leur meilleur homme de guerre, l'amiral Phipps. L'armée du lac Champlain se trouva arrêtée inopinément par la petite vérole, qui fit de tels ravages que les troupes revinrent sur leurs pas. Quant à la flotte, elle perdit beaucoup de temps à se consulter, de telle sorte que lorsqu'elle arriva devant Québec, tous les préparatifs avaient été faits pour la recevoir.
Toute l'enceinte était garnie de canons; la ville était fournie de provisions et de munitions; enfin les troupes de Montréal avaient eu le temps de s'équiper pour se rendre à Québec.
L'amiral Phipps envoya un parlementaire. Les Français l'accueillirent et lui bandèrent les yeux, puis ils s'amusèrent à le faire passer par toutes sortes de retranchements, de tranchées, d'inégalités de terrain, pour lui donner l'idée que la ville était munie des plus redoutables fortifications.
Introduit au château du gouverneur, il se vit entouré d'une multitude d'officiers qui, pour la circonstance, s'étaient revêtus de tout ce qu'ils avaient de plus riche en galons d'or et d'argent, en rubans et en plumes, comme dans les réceptions les plus solennelles. L'officier, à la vue d'un concours si nombreux et si imposant, parut interdit et devint presque tremblant. Il se mit alors à lire la dépêche de l'amiral, dont le ton hautain et impérieux contrastait de la manière la plus plaisante avec l'air terrifié du mandataire, et comme l'amiral concluait en demandant qu'il lui fût répondu dans une heure, Frontenac, d'une voix tonnante, s'écria qu'il ne le ferait pas attendre si longtemps et qu'il lui répondrait, non par écrit, mais par la bouche de ses canons. Ceci se passait le 15 octobre 1690.
Le 16, 2,000 Anglais débarquèrent à la rivière Saint-Charles. Vers le soir, on entendit dans la haute ville un grand bruit de roulement de tambours et de fifres: c'étaient les gens de Montréal qui arrivaient, au nombre de 800, avec M. de Longueuil, M. de Sainte-Hélène et M. de Maricourt. Ils étaient accompagnés d'un grand nombre de coureurs de bois et de volontaires chantant et poussant des cris de guerre en entrant dans la ville. Un prisonnier français, à bord du vaisseau amiral, dit a l'amiral: «Vous avez perdu votre chance; ce sont les gens de Montréal qui arrivent.» Le jour suivant, les Anglais campés à la rivière Saint-Charles se mirent en marche, et alors, de plusieurs bosquets de bois partirent des feux de peloton qui écrasèrent les assaillants; il leur semblait que chaque arbre cachait un sauvage armé, et ils ne savaient comment viser leurs adversaires.
Phipps, voyant que cette attaque ne réussissait pas, amena tous les vaisseaux devant la ville et commença à tirer. L'attaque était dirigée avec une telle vigueur que de vieux officiers déclarèrent qu'ils n'avaient jamais entendu une pareille canonnade. Le bruit était répété par les montagnes et se prolongeait comme les roulements du tonnerre, mais l'effet était nul et les boulets se perdaient sur les rocs de la ville.
Sainte-Hélène et Maricourt, qui étaient revenus de la rivière Saint-Charles, dirigeaient le tir des canons de la basse ville, Aux premiers coups, ils atteignirent le pavillon du vaisseau amiral, qui tomba dans le fleuve; le courant le porta sur la rive, et aussitôt un canot d'écorce alla le prendre sous le feu de la mousqueterie des Anglais, et il fut porté à la cathédrale; il y est resté jusqu'en 1760.
Bientôt les vaisseaux anglais furent criblés de coups et désemparés, et l'amiral fut obligé de retirer sa flotte du combat. Alors les ennemis préparèrent une seconde attaque par terre.
Le lendemain les Anglais voulurent commencer une nouvelle descente vers la rivière Saint-Charles. Ils débarquèrent un millier d'hommes avec des pièces d'artillerie; mais ils montraient plus de courage et de bonne volonté que de tactique et de discipline. Ils perdirent encore trois ou quatre cents hommes et ils blessèrent une quarantaine de soldats français et de sauvages. M. de Sainte-Hélène fut atteint d'une balle; la blessure empira malheureusement et l'emporta en peu de jours.
Il était âgé de 31 ans. Nous avons vu comme il se signalait à, la première expédition de la baie d'Hudson et ensuite à l'expédition de Schenectady. Nul ne le dépassait en agilité et en adresse dans les expéditions des bois; ce fut une grande perte pour les Français et une grande douleur pour sa mère.
Les Français environnèrent le camp, et ils se préparèrent à l'attaque au lever du soleil. Les Anglais, renonçant à la lutte, s'embarquèrent en toute hâte, vers minuit, et ils perdirent encore cinquante hommes, pendant qu'ils montaient dans leurs chaloupes.
Le jour étant survenu, on fit transporter à, Québec les tentes et les canons qui avaient été abandonnés.
L'amiral Phipps appareilla pour partir, et aussitôt M. de Frontenac envoya M. de Longueuil avec une chaloupe qui traversa la flotte anglaise et arriva à temps vers l'île aux Coudres pour rencontrer M. d'Iberville qui arrivait du Nord. M. de Frontenac fit alors chanter un Te Deum dans la cathédrale avec toute la solennité possible.
M. d'Iberville repartit dès qu'il put pour la baie d'Hudson, en l'année 1691. C'est alors qu'il revint à Québec, à la fin de la saison de 1691, avec deux navires chargés de 80,000 peaux de castors et de 6,000 livres de pelleteries. Il avait pu reconnaître qu'il n'avait pas les moyens d'attaquer le fort Nelson, et comme M. de Frontenac n'avait pas assez de bâtiments pour l'assister, M. d'Iberville prit le parti d'aller encore en France. C'est dans ce voyage qu'il exposa au ministre l'importance de l'occupation de la baie d'Hudson. Il fut écouté avec faveur, et obtint plusieurs navires dont il reçut le commandement, avec le titre de capitaine de frégate.
Revenu dans l'été de 1693, avec ces vaisseaux, dont l'aménagement avait pris un temps considérable, M. de Frontenac lui représenta que la saison était trop avancée, et il le pria d'employer tous ses moyens à la conquête du fort de Pémaquid, que les Anglais étaient venus réoccuper et d'où ils tenaient les Abénaquis en échec. Cette entreprise décidée trop précipitamment ne put réussir.
D'Iberville, en arrivant en vue de la place, reconnut qu'elle ne pouvait être abordée sûrement; elle était entourée de récifs et de bas-fonds que l'on ne pouvait affronter qu'avec un pilote capable et expérimenté; mais l'on n'en put trouver. Il fallut donc se retirer, et il alla hiverner à Québec.
Sur ces entrefaites, Sérigny arriva à Montréal, au printemps de 1694, avec l'ordre exprès du roi de prendre des hommes et de s'en aller avec son frère, d'Iberville, pour attaquer le fort Nelson.
Ils partirent le 10 août 1694 avec trois vaisseaux de guerre: le Poli, la Salamandre et l'Envieux.
D'Iberville et Sérigny prirent avec eux leurs deux jeunes frères, Maricourt et Châteauguay. Celui-ci était âgé seulement de vingt ans.
Le Père Gabriel Marest fut choisi comme chapelain.
C'était un digne religieux de la compagnie de Jésus, qui devait leur rendre les plus grands services.
Ce père, d'un zèle infatigable, secondé par la dévotion incomparable du brave d'Iberville, donna à cette expédition un caractère exceptionnel d'édification. On voit quel était l'esprit de ces héroïques combattants de la Nouvelle France.
Nous citerons les traits rapportés dans les lettres du Père Marest; c'est intéressant, et cela peint le pays, les gens et l'époque.
Le père dit que l'embarquement eut lieu le 10 du mois d'août, etc. Il se mit aussitôt à exercer ses fonctions, que les Canadiens surtout réclamaient avec instance.
Le 14, le père, embarqué sur le Poli, distribua en l'honneur de l'Assomption, des images de la sainte Vierge, et invita les gens du bord à se confesser. Le lendemain, il célébra la sainte messe avec autant de solennité que possible, et plusieurs communièrent.
Ensuite, l'on continua le voyage, qui n'était pas sans difficultés, car, dit le père, «nous allions dans un pays où l'hiver vient à l'automne.» Le 21 du mois d'août, nous vîmes beaucoup de montagnes de glace flottant sur la mer à l'entrée du détroit de la baie d'Hudson. Il fallait quatre jours pour passer le détroit, qui a 135 lieues de longueur. Du 1er de septembre au 8, le père prépara les gens pour la fête de la Nativité de la sainte Vierge, et plus de cinquante communièrent le jour de sa fête.
Alors, le calme étant arrivé au grand déplaisir des équipages, le père profita de cette circonstance pour suggérer une neuvaine à la bonne sainte Anne, que les Canadiens honoraient beaucoup, surtout depuis l'érection d'un sanctuaire spécial près de Québec par M. l'abbé de Queylus, supérieur du séminaire de Montréal.
Le vent devint favorable, et l'on continua à avancer; mais le 12 septembre, le vent ayant encore tourné, les Canadiens firent un voeu en promettant à sainte Anne une part dans leur premier butin, et presque tous s'approchèrent des sacrements. Les autres matelots et soldats, voyant le zèle des Canadiens, voulurent les imiter, et ils allèrent à confesse. Le Père Marest fait la remarque que M. d'Iberville et les autres officiers se mirent à leur tête. Ce qui est à noter, c'est que le vent reprit aussitôt.
Trois jours après, on se trouvait devant la rivière Bourbon. La joie fut grande. On chanta l'hymne Vexilla régis prodeunt, en répétant plusieurs fois: O crux ave. Nous répétâmes plusieurs fois, dit le Père Marest, O crux, ave, pour honorer la croix dans un pays où elle a été souvent profanée et abattue par les hérétiques.
Près de la rivière Bourbon est la rivière Sainte-Thérèse, où l'on arriva le 24 septembre. Les marins ne manquèrent pas de se mettre sous la protection de cette grande sainte.
Comme la mer était houleuse, on allégea le navire en le déchargeant avec les canots d'écorce qui avaient été apportés de Québec, et «que les Canadiens, dit le père, manoeuvraient avec une adresse admirable.»
Vers ce temps, le jeune Châteauguay étant allé à la rencontre des Anglais, fut blessé d'une balle; aussitôt le père alla l'assister. Il mourut, au grand chagrin de ses frères. Le père remarque encore que tous les malheurs qui survenaient n'abattaient pas le courage de M. d'Iberville. «Il savait toujours se contenir, et ne voulait pas qu'aucun signe d'inquiétude vînt troubler son monde. Il était sans cesse en action, dirigeant tout et pourvoyant à tout: il montrait une présence d'esprit que rien ne pouvait abattre.»
Le 11 octobre, le chemin pour conduire les canons était praticable; le 12 et le 13 on plaça les mortiers en batterie et l'on commença la canonnade. Le 15, jour de sainte Thérèse, les Anglais se rendirent. «Nous admirâmes la divine Providence, dit le Père Marest. Les gens, en pénétrant dans la rivière Sainte-Thérèse, s'étaient mis sous la protection de la sainte, et le jour de la fête, le 15, ils entraient dans le fort.» Comme la saison était avancée, d'Iberville décida de rester jusqu'au printemps.
En attendant, le Père Marest, tout en prenant soin de la garnison, s'occupa des sauvages. Il les plaignait, et gémissait en voyant leur ignorance de la vérité et leur entraînement au mal. Il les accueillait au fort avec toute bonté, et il allait au plus loin les rejoindre. A force d'étudier, il en vint bientôt à comprendre plusieurs dialectes indiens. «Il est impossible, nous dit M. Bacqueville de La Potherie, d'énumérer les actes de zèle et de dévouement du père. Il allait au loin, marchant jour et nuit, se contentant de la nourriture des sauvages; rien ne pouvait le rebuter.»
En même temps, dans ses excursions, il prenait connaissance du pays et de ses ressources. Il nous dit qu'a l'automne et au printemps, on voit des multitudes prodigieuses d'oies et d'outardes, de perdrix et de canards. Il y a des jours où les caribous passent par centaines et par milliers, suivant le témoignage de M. de Sérigny, qui allait souvent à la chasse.
M. d'Iberville, après avoir hiverné au fort, laissa son frère de Maricourt commandant de la place, avec le sieur de La Forêt pour lieutenant, et il revint en France avec deux navires chargés de pelleteries. Il arriva à la Rochelle le 9 octobre 1697, et il se mit aussitôt en devoir de préparer une nouvelle expédition. On pense que c'est dans cet intervalle que le chevalier d'Iberville vint à Versailles pour exposer ses vues au ministre du roi, M. de Pontchartrain.
C'était vers 1696, et lorsque le règne de Louis XIV était dans son plus grand éclat. On venait de construire, sous l'impulsion de Colbert, des monuments qui avaient fait de Paris la première ville du monde. On avait bâti les Invalides, terminé le Val-de-Grâce, les Tuileries, le Louvre, ouvert et planté les grands boulevards depuis la porte Saint-Honoré jusqu'à la Bastille, avec ces belles portes Saint-Antoine, Saint-Martin, Saint-Denis, qui font un si grand effet. Dans le même temps, Versailles était devenu une merveille de grandeur et de richesse.
Au milieu de ces progrès, le roi se trouvait environné des plus grandes illustrations. Il présidait une noblesse dévouée et brillante. Il avait des ministres habiles, des généraux redoutables, des génies merveilleux dans tous les genres. Les finances, par les soins de Colbert, avaient doublé d'importance; l'armée avait été mise par Louvois sur un pied formidable, et avec cette année, le roi avait une nation valeureuse de vingt millions d'âmes.
Malgré la perte de généraux incomparables, la France avait encore de grands hommes de guerre; Luxembourg, Catinat, Boufflers, de Lorges, Tourville, Jean Bart, Château-Renaud, d'Estrées et Duguay-Trouin. On venait de remporter de grandes victoires; sur terre, à Fleurus, à Steinkerke, à Nerwinde, à Marseille et à Staffarde; sur mer, Lagos, qui avait vengé les Français du désastre de l'année précédente à la Hogue. D'Iberville vit ces merveilles; il contempla ces illustrations; il entrevit ce roi qui avait les plus grandes qualités d'un souverain.
Louis XIV possédait un air d'autorité qui imposait le respect, et une égalité de caractère qui gagnait les coeurs. Il savait dire à chacun, en peu de mots, ce qui pouvait lui plaire, et en même temps, il montrait cette délicatesse d'égards qui convient si bien à l'autorité souveraine. Il ne lui arrivait jamais de faire en public, ni railleries, ni reproches, ni menaces. Ouvert et sincère avec tous, il était doué du la mémoire la plus heureuse des faits, des visages et des services rendus.
Tel était le souverain qui présidait aux destinées du la France, et qui ravissait tous les grands génies de son entourage.
D'Iberville, charmé et gagné par tant d'amitié et de grandeur, retourna à ses entreprises, plus dévoué que jamais aux intérêts de la Nouvelle-France et à la gloire de la mère patrie.
TERRE-NEUVE.
Ile de l'Amérique septentrionale, par 47° 52m. de latitude et 55° 62m. de longitude. 600 kilomètres du nord au sud et 295 kilomètres, largeur moyenne. Population 190,000 habitants. Capitale Saint-Jean. Côtes dangereuses. Sur ces côtes, on trouve d'immenses quantités de poissons. Cette île offre une belle race de chiens à poils soyeux, remarquables par leur force, leur taille et leur habileté à nager. La France s'est fait donner, au traité de Paris, en 1763, le droit de pêche. Les établissements français sont au nord et à l'ouest. Il est à remarquer que c'est le confluent des courants du sud et des courants du nord, et c'est ce qui lui donne une si grande importance pour les pêcheries de la France.
L'île de Terre-Neuve est située entre le 47e et le 52e degré de latitude, et entre le 55e et le 70e de longitude; elle occupe toute l'entrée du fleuve Saint-Laurent, sur une étendue de 150 lieues de longueur et de 90 lieues de largeur.
Cette île, signalée par Sébastien Cabot en 1497, sous Henri VII, fut visitée en 1500 par un navigateur portugais nommé Cortéréal. C'est de là que viennent plusieurs noms portugais donnés à différents lieux: le Labrador le Portugal-Cove, Bonavista, la baie des Espagnols, etc.
Le capitaine Denis, de Dieppe, s'y rendit peu après, et fit une carte de l'entrée du Saint-Laurent.
En 1508, un autre Dieppois nommé Thomas Aubert y alla, dit-on, par ordre du roi Louis XII. En 1523, François Ier y envoya Verazzani. Mais, à part ces expéditions officielles, il y en eut bien d'autres dirigées par des particuliers. On pense que depuis longtemps les Bretons et les Basques y faisaient la pêche. Ils avaient signalé la présence d'un banc immense où l'on trouvait le poisson en abondance, et à chaque printemps les pêcheurs y venaient en grand nombre. Dix ans après Verazzani, en 1534, Philippe de Chabot, amiral de France, engagea le roi à reprendre le dessein d'établir une colonie française dans le nouveau monde, et il lui présenta Jacques Cartier, marin très habile de Saint-Malo, qui, le 10 mai, débarqua au nord-est de Terre-Neuve, près d'un cap qui avait été nommé Bonavista, peut-être par Cortéréal. Il conserve encore ce nom.
Ce que nous avons à remarquer par rapport à cette île, c'est qu'elle se trouve au confluent de trois grands courants qui aboutissent au même point: d'une part, le Saint-Laurent vient précipiter ses glaces dans la mer; de l'autre, les courants arrivent du nord avec leurs banquises ou «icebergs», et vont s'attiédir dans une région tempérée; et enfin le Gulf-Stream, partant du golfe du Mexique, monte vers le nord en longeant la côte orientale de l'Amérique. Il arrive chargé d'une quantité d'animaux marins, de mollusques et d'êtres microscopiques.
Au contact des eaux chaudes du Gulf-Stream, les masses de glaces venant du nord se désagrègent, fondent, et les rochers, les matières solides qu'elles contiennent s'en détachent et tombent au fond de la mer, tandis que tous les animaux marins venus du sud sont saisis et détruits par le froid. Leurs débris s'ajoutent aux amoncellements qui se forment et s'élèvent d'année en année dans le fond du golfe Saint-Laurent, et dont le banc de Terre-Neuve est la principale partie.
Ce qui est particulier à ces bancs, c'est qu'ils sont aussi le rendez-vous d'une immense quantité de poissons qui viennent de toutes les rives et de toutes les baies du nord. Ils y arrivent par millions, occupant parfois une étendue de cent milles carrés, sur plus de cent pieds de profondeur; ils se dirigent vers ces confluents et sur les bancs où ils trouvent des eaux plus tempérées et une nourriture assurée, dans l'agglomération des poissons de taille inférieure, qui ne peuvent leur résister.
Cette énorme quantité de poissons, réunis en bancs de plusieurs milles carrés sur des profondeurs si extraordinaires, ne peuvent nous étonner lorsque nous savons que les harengs et les saumons produisent des cent milliers d'oeufs, et la morue, des millions. La plus grande partie, anéantie par la violence des flots, est dispersée par la mer, et des auteurs prétendent que, sans cette dispersion, la masse produite serait si grande qu'elle comblerait les courants d'eau de ce point de rencontre jusqu'à rendre la navigation presque impossible.
Quoi qu'il en soit, la morue en particulier offrait des ressources inépuisables pour la nourriture des populations européennes. En effet, la morue est un poisson d'une grande dimension, fournissant une nourriture forte et substantielle; appréciée du riche et du pauvre, elle est demandée dans tous les pays; son huile est abondante et précieuse. Enfin, par son agglomération, elle rendait ces parages plus riches que les plus grandes mines de l'Inde, du Pérou et du Mexique.
Aussi, peu d'années après Verazzani, les Anglais avaient établi, sur la côte orientale qui longeait Terre-Neuve, un nombre considérable de stations de pêche, entre lesquelles ils avaient placé des communications faciles, par des chemins coupée dans les bois. Les rives étaient couvertes des habitations des pécheurs; en arrière, des fermes d'exploitation étaient construites et avaient rapporté à leurs possesseurs de grands capitaux. Les pêcheries seules rendaient près de vingt millions par an, et les Anglais comprenaient qu'ils pouvaient, avec Terre-Neuve, se rendre les maîtres absolus du commerce le moins dispendieux, le plus aisé et le plus étendu de l'univers.
M. d'Iberville, avec sa haute intelligence, avait compris les conséquences de ce monopole. Il les avait signalées à M, de Frontenac, et, d'après l'injonction du gouverneur, il représenta à la cour que le commerce des Anglais dans Terre-Neuve pouvait les rendre assez puissants pour s'emparer de la colonie française..
Il obtint donc de former une expédition pour attaquer les stations anglaises. En même temps, l'avis fut envoyé à M. de Brouillan, commandant de l'établissement français de Plaisance, au sud-ouest de l'île, de lui laisser tout pouvoir et de l'assister avec ses forces.
Vers le commencement de l'année 1696, M. d'Iberville revint au Canada avec M. de Bonaventure, officier de marine: ils avaient deux vaisseaux.
Il devait trouver réunis une centaine de Canadiens, qu'il avait formés, les années précédentes, aux entreprises les plus périlleuses.
A son arrivée, il les enrôla avec d'autres volontaires qui trafiquaient avec les sauvages dans les pays les plus éloignés du centre. Leur principal mérite était un courage et une hardiesse à toute épreuve: on les appelait les coureurs de bois, mais ils avaient à rencontrer tant d'obstacles et tant de dangers, que les mémoires du temps disent qu'on devait plutôt les appeler des «coureurs de risques».
M. d'Iberville, ayant choisi ses gens, fit annoncer à M. de Brouillan qu'il le rejoindrait aux premiers jours de septembre. Il était au milieu de ses préparatifs, lorsque survint une cause de retard difficile à éviter. Le gouverneur général, inquiet des progrès des Anglais dans l'Acadie, demanda à d'Iberville d'aller prendre part à l'attaque que du fort île Pémaquid, que les Bostonnais, comme nous l'avons déjà dit, avaient établi au centre du pays des Abénaquis, amis dévoués de la France. De là, les Anglais menaçaient sans cesse nos fidèles alliés.
M. d'Iberville et M. de Bonaventure, commissionnés par M. de Frontenac, arrivèrent à la baie des Espagnols le 26 juin 1696. Là, ils trouvèrent M. Beaudoin, missionnaire arrivé récemment de France, qui avait réuni quelques sauvages et qui voulait se joindre à M. d'Iberville.
M. Beaudoin, dont le nom reviendra souvent dans ce récit, avait été mousquetaire dans les gardes du roi. Il entra, jeune encore, au séminaire de Saint-Sulpice de Paris, et y resta plusieurs années sous la direction de M. Tronson; ensuite, il vint en Acadie, ou il évangélisa les sauvages.
Il était allé chercher des ressources en France, l'année précédente, pour ses pauvres ouailles. S'étant présenté à la cour, il fut prié d'accompagner M. d'Iberville à Terre-Neuve.
M. Beaudoin fut donc ainsi amené à faire cette expédition, et c'est à lui que l'on doit surtout d'en connaître les incidents. A son retour, il en écrivit une relation très détaillée, et avec un si grand soin que de La Potherie et le Père de Charlevoix ont pu y trouver, pour leurs ouvrages, les faits les plus circonstanciés et les plus intéressants.
M. Beaudoin était un homme qui avait conservé de son ancien état une vivacité et une résolution extraordinaires. Il dit, dès les premières lignes de son journal:
Nous avons trouvé, en arrivant à la baie des Espagnols, des lettres de M. de Villebon qui nous marquent que les ennemis nous attendent à la rivière Saint-Jean. Dieu soit béni, nous somme résolus de les y aller trouver.
Au bout de quelques jours, c'est-à-dire le 14 juillet 1696, trois vaisseaux de guerre anglais furent signalés; d'Iberville alla aussitôt les attaquer. Avec son habileté ordinaire, il démâta, de quelques volées de canon, le plus grand des vaisseaux, le New-Port, et l'enleva à l'abordage sans perdre un seul homme. Il se dirigea ensuite vers les deux autres bâtiments, qui prirent la fuite et parvinrent à s'échapper, grâce à une forte brume.
M. Beaudoin nous fait ici connaître l'habileté du commandant et les dispositions religieuses des hommes intrépides qu'il commandait. M. d'Iberville avait fait fermer les sabords du Profond, et avait fait coucher ses gens sur le pont, pour donner confiance au vaisseau anglais, qui vint sans défiance aborder le Profond. Aussitôt les sabords sont ouverts, les hommes commencent la mousqueterie sur les deux vaisseaux ennemis, dont l'un est bientôt démâté, et M. Beaudoin fait la remarque qu'il avait bien espéré que Dieu bénirait ces braves Canadiens, qui depuis le départ s'étaient approchés très souvent des sacrements.
Après cet incident, les commandants français se dirigèrent vers Pémaquid, où ils arrivèrent le 13 du mois d'août. Dans le trajet, ils avaient embarqué avec eux deux cent cinquante sauvages alliés, commandés par M. de Saint-Castin et M. de Villebon, deux officiers placés dans l'Acadie. Le Père Simon, missionnaire de l'Acadie, les accompagnait comme chapelain.
M. de Villebon, M. de Montigny et l'abbé de Thury se rendirent sur la côte en canot avec les sauvages. Ils étaient suivis des vaisseaux, qui abordèrent.
Le 15 août, jour de l'Assomption, les troupes assistèrent à la sainte messe, et ensuite M. d'Iberville fit débarquer les mortiers et les canons. On envoya un parlementaire au commandant de Pémaquid, qui répondit à la sommation que «quand bien même la mer serait couverte de vaisseaux et la terre couverte d'Indiens, il ne se rendrait pas, à moins d'y être forcé.»
Dans la nuit, d'Iberville mit le temps à profit: il fit entourer le fort de batteries. Le commandant, voyant qu'il ne pouvait pas résister, demanda à capituler, ce qui fut accordé.
Le fort avait une très belle apparence; il était de figure carrée, avec quatre tours énormes; il possédait un magasin de poudre creusé, dans le roc, et une vaste place d'armes; les murailles avaient 12 pieds d'épaisseur et de hauteur, et enfin il y avait 16 pièces de canon.
On permit aux militaires anglais de s'embarquer sur les vaisseaux de leur pays, et on leur fournit des provisions pour le voyage.
Le but de l'expédition était donc atteint: les Anglais étaient expulsés, et M. d'Iberville, craignant leur retour, fit démanteler le fort pour qu'il ne pût être occupé de nouveau.
Tout étant terminé à Pémaquid, M. d'Iberville partit pour Plaisance, où il arriva le 12 septembre. A sa grande surprise, il trouva M. de Brouillan parti. La cause de cette précipitation fut bientôt connue: M. de Brouillan, mécontent de voir d'Iberville à la tête de l'expédition et ne voulant pas avoir à partager son commandement, avait levé l'ancre avec tous ses vaisseaux pour se rendre à la ville de Saint-Jean, où il devait commencer l'attaque des possessions anglaises de Terre-Neuve.
C'était aller contre les ordres du roi et contre la promesse qu'il avait faite à d'Iberville; c'était méconnaître imprudemment les sages avis que lui avait donnés M. d'Iberville, qui pensait que cette expédition ne pouvait être faite par mer à cause des dangers de la côte et de la force des courants, comme M. de Brouillan put bientôt s'en convaincre.
Arrivé devant Saint-Jean, M. de Brouillan se mit en devoir de canonner la place: mais il ne put se maintenir dans la rade, et fut entraîné par les courants six lieues plus bas au sud. Pour réparer le mauvais effet de cet insuccès, il débarqua ses troupes et s'empara de quelques stations insignifiantes, puis il revint à Plaisance, irrité de se trouver en défaut vis-à-vis de d'Iberville.
C'est alors qu'arrivèrent bien des contradictions, dont le Père Charlevoix nous donne l'explication d'après M. Beaudoin. Il nous dit que M. de Brouillan était un honnête homme, intelligent et d'une bravoure incontestable, mais il était inexpérimenté dans les expéditions de ce genre, et il ne pouvait recevoir d'avis parce qu'il était d'une susceptibilité extraordinaire sur la question de son autorité.
M. d'Iberville, qui ne connaissait pas encore à quel homme il avait affaire, chercha à l'éclairer. Il lui dit d'abord que l'occasion d'agir n'était pas encore perdue, que l'hiver était le temps le plus propice, parce que les Anglais ne seraient plus sur leurs gardes et ne seraient pas appuyés par les flottes du printemps. Il lui représenta encore que l'abord des côtes était impossible, à cause des courants, ainsi que M. de Brouillan avait pu le reconnaître lui-même; que les récifs étaient nombreux, très dangereux et peu connus des pilotes français.
Tout le monde savait, en outre, que le trajet par mer était bien plus long à cause de la multitude des baies et des criques, tandis que, par terre, il était beaucoup plus court, et se trouvait, de plus, facilité par toutes les voies de communication que les Anglais avaient établies depuis longtemps entre leurs stations, à travers les bois.
Tout cela était si raisonnable que, si M. de Brouillan avait voulu y prêter l'oreille, il s'y fût rendu aussitôt. Mais il ne voulut rien entendre, et, sans tenir compte des sages avis d'Iberville, il lui déclara qu'il ne reconnaissait qu'une seule manière d'enlever la place: c'était par mer et par les ressources que lui offraient les vaisseaux dont il disposait, M. de Brouillan termina en disant à d'Iberville d'agir à sa guise, mais qu'il lui enlevait le commandement des Canadiens, et que désormais ils seraient sous les ordres du capitaine des Muys.
Quoique M. d'Iberville fût affligé de cette décision et qu'il souffrît d'abandonner ceux qu'il avait formés et toujours conduits avec lui, il était disposé cependant à se soumettre, par respect pour l'autorité; mais il n'en fut pas de même des Canadiens. A peine eurent-ils connaissance de cette mesure qu'ils jetèrent les hauts cris, disant qu'ils s'étaient engagés à d'Iberville, et qu'ils l'avaient reçu comme commandant de M. de Frontenac. Ils ajoutèrent que s'ils ne devaient pas l'avoir pour chef, ils étaient décidés à se retirer et à retourner dans leurs foyers.
M. de Brouillan n'épargna ni remontrances, ni exhortations; mais voyant qu'il ne devait rien obtenir de ces braves gens, et sachant bien qu'il ne pourrait réussir sans leur secours, il changea sa décision, et envoya M. de Muys dire à d'Iberville qu'il garderait son commandement.
De plus, il consentit a ce qu'il allât par terre, et enfin il reconnut que le butin de Saint-Jean devait être partagé, non par moitié, mais en rapport avec les frais que d'Iberville avait faits pour cette expédition; ce qui était tout à fait juste.
Ils partirent chacun de son côté: M. de Brouillan par mer, M. d'Iberville par terre. Ils devaient se réunir au port de Rognouse, à quelques lieues au sud de Saint-Jean. M, l'abbé Beaudoin accompagnait les Canadiens; il fit tout le voyage a pied, en un mot, en raquettes, comme les combattants; il assista à tous les engagements, et c'est ainsi qu'il a pu recueillir tous les faits qu'il a consignés dans le récit si intéressant que l'on retrouve dans les ouvrages de M. de La Potherie et du Père Charlevoix.
M. d'Iberville partit de Plaisance le 1er novembre. Il parcourut un terrain marécageux, à demi gelé et où il trouva bien des difficultés; mais ce trajet avait aguerri ses gens et les avait habitués à la marche. Il arriva à Rognouse le 12 de novembre et y trouva M. de Brouillan, qui voulut essuyer encore d'une nouvelle contradiction: il déclara donc à d'Iberville qu'il ne lui accorderait que la moitié des prises de Saint-Jean.
Cette décision fut si mal reçue, que M. de Brouillan vit qu'il était à craindre que M. d'Iberville ne se retirât avec ses gens, qui voulaient le suivre a tout prix. Il changea alors de langage, et il déclara qu'il se désistait.
Aussitôt d'Iberville prit les résolutions qu'il jugea les meilleures: c'était d'attaquer par terre les stations où l'on avait un facile accès par les habitations. Après avoir pris les provisions du Profond, il le fit partir pour transporter les prisonniers, tandis que lui-même n'en avait plus besoin, puisque le gouverneur le laissait opérer par terre.
Mais ici, il y eut encore un changement inopiné. Le Profond étant parti, M. de Brouillan ne craignit plus que d'Iberville en profitât pour se retirer s'il était mécontent; alors il déclara que tous les Canadiens seraient sous ses ordres et que les volontaires iraient où ils voudraient avec M. d'Iberville.
Le Père Charlevoix nous fait admirer le noble caractère de d'Iberville. Sans aucune réclamation ni plainte, il supporta en silence cette nouvelle incartade. Il prit le parti de patienter encore et de laisser le gouverneur seul dans son tort. Il ne craignait qu'une chose: c'était de n'avoir pas assez d'autorité sur ses gens pour les empêcher de se révolter après tant de palinodies.
Cette modération fit réfléchir M. de Brouillan, et, très inquiet du ce qui arriverait s'il était privé du concours de d'Iberville, il chercha encore une fois à se débrouiller en envoyant quelqu'un pour déclarer qu'il revenait sur sa décision. C'était la troisième ou quatrième réconciliation.
M. Beaudoin fait cette réflexion: «J'aurais, je vous avoue, Monseigneur, voulu être bien loin dans tous ces grabuges, étant ami de ces messieurs, qui m'ont fait mille fois plus d'honneur que je ne mérite. Nonobstant cela, j'aurais eu au moins autant de peine que le sieur d'Iberville à consentir à tout ce qu'il a accordé au sieur de Brouillan. Ces messieurs sont un peu d'accord; mais j'appréhende que cela ne dure pas.»
Les Canadiens partirent alors avec M. d'Iberville pour aller reconnaître la place en remontant vers le Fourillon, station qui est à six lieues de Saint-Jean.
Au second jour, ils virent un vaisseau marchand de 100 tonneaux, qu'ils emportèrent du premier choc. L'équipage prit les chaloupes et s'enfuit dans les bois.
M. d'Iberville les poursuivit et s'empara de vingt hommes, avec le capitaine du vaisseau qui les accompagnait. Plus loin, il enleva trente Anglais, à l'endroit appelé le Petit-Havre. Ensuite, les Canadiens traversèrent à mi-corps une rivière très rapide, et emportèrent des retranchements tout à pic, où ils mirent hors de combat trente-six Anglais. C'était le 28 novembre.
Ils se mirent alors en marche pour approcher de Saint-Jean. M. Beaudoin a décrit cette marche en témoin oculaire:
M. de Montigny marchait à trois cents pas en avant avec trente Canadiens; M. d'Iberville et M. de Brouillan suivaient avec le corps principal.
Après deux heures de marche, l'avant-garde signala quatre-vingts ennemis retranchés derrière des troncs d'arbres et des quartiers de roche. Aussitôt M. de Montigny fit arrêter sa troupe et se disposa à la lancer sur les retranchements. M. l'abbé Beaudoin harangua les hommes; il les excita à donner leur vie en braves. Ils s'agenouillèrent et ils reçurent l'absolution générale, puis chacun jeta ses hardes et se tint prêt à s'élancer.
M. de Montigny ayant mis l'épée à la main, s'avança à la tête pour attaquer les ennemis au centre; M. d'Iberville devait les prendre Par la gauche, et M. de Brouillan par la droite. La lutte fut acharnée, et, malgré leur nombre inférieur, les Français montrèrent admirablement leur supériorité dans l'emploi des armes et dans la rapidité des mouvements. Au bout d'une demi-heure, les ennemis, après des pertes énormes, durent aller se réfugier dans deux redoutes qui couvraient la porte de Saint-Jean, et la fusillade recommença; mais voyant qu'ils étaient encore trop imparfaitement abrités dans les redoutes, ils se retirèrent dans le fort principal, qui était bastionné et palissadé. Ce fort renfermait une vingtaine de canons qui dominaient la ville. En ce moment une centaine d'Anglais s'étant jetés dans une embarcation, profitèrent d'un vent favorable pour gagner la haute mer; mais dans le désordre de l'embarquement, ils eurent cinquante des leurs blessés à mort.
M. Beaudoin fait remarquer la supériorité des Canadiens dans toutes ces rencontres. Les gens de M. de Brouillan auraient eu besoin d'une ou deux campagnes avec les Iroquois pour savoir se couvrir des ennemis, et pour savoir les surprendre. Si les Canadiens sont plus aguerris, c'est qu'ils l'ont appris à leurs dépens dans leurs rencontres avec les sauvages. Ils savent qu'il ne faut jamais s'épargner dans ces expéditions où tout est à l'aventure; qu'il vaut mieux se faire tuer que de rester blessé, exposé à tomber ainsi au pouvoir d'ennemis implacables, ou à mourir d'épuisement au milieu des frimas.
Il fallut songer à faire le siège de la citadelle, qui avait deux cents hommes de garnison bien équipés, et qui voyait deux vaisseaux de guerre arriver à son secours.
Les Canadiens commencèrent par brûler toutes les maisons qui occupaient les approches du fort, et le fort, complètement démasqué, apparut avec toutes ses défenses.
Ce fort, situé sur une hauteur au nord-ouest, était flanqué de quatre bastions et entouré d'une palissade garnie de canons. Au centre s'élevait une tour à deux étages, également garnie de canons. M. de Brouillan, voyant l'attitude déterminée des assiégés et leurs moyens de défense, envoya chercher les mortiers, que l'on avait laissés à Bayeboulle, et le lendemain il commença la canonnade.
Le gouverneur, espérant toujours l'arrivée des vaisseaux qui louvoyaient en haute mer, envoya, le 30 novembre, jour de saint André, un parlementaire demander un délai. Le commandant français, comprenant son intention, refusa cette demande, et le gouverneur, renonçant à toute espérance de secours, se décida à signer la capitulation.
M. de Brouillan n'eut aucun égard aux services rendus par M. d'Iberville. Il ne lui laissa prendre aucune part aux décisions qui précédèrent la capitulation, et il la signa sans lui. Ce procédé parut tout à fait inconvenant à M. Beaudoin, qui remarque que M. d'Iberville avait eu au moins autant de part à la prise de la place que M. de Brouillan.
M. d'Iberville ne fit aucune observation. Il se réservait de faire connaître plus tard ce qu'il pensait de tous ces manques d'égards.
Voici quels étaient les termes de la reddition de la place:
On convint: 1° que la place se rendrait à deux heures de l'après-midi; 2° que le gouverneur et ses hommes sortiraient sans armes, qu'ils auraient la vie sauve et conserveraient ce qu'ils portaient sur eux; 3° qu'on leur fournirait deux bâtiments et des vivres pour retourner en Angleterre.
Les Français avaient fait 300 prisonniers et ils avaient trouvé 62,600 quintaux de morue, ce qui, joint aux prises récentes, portait le butin jusqu'à ce jour à plus de 110 mille quintaux.
Saint-Jean est un beau havre pouvant recevoir deux cents vaisseaux. Son entrée est de la largeur d'une portée de fusil; elle est dominée par deux montagnes très hautes, avec une batterie de huit canons. Outre cela, il y avait trois forts, comme nous l'avons vu plus haut.
Les fermes, qui suivirent la destinée du fort, étaient au nombre de soixante et occupaient une demi-lieue le long de la rade.
Comme on ne pouvait occuper cette ville, il fallut démolir les forts et brûler les habitations. On conserva quelques maisons pour le soin des malades qu'on ne pouvait transporter.
Le bruit de cette prise se répandit dans toutes les stations anglaises, et y mit la plus grande consternation.
Après cet exploit, M. de Brouillan, se trouvant accablé de fatigue, se décida à retourner à Plaisance, laissant à d'Iberville tous les honneurs et les soucis de l'expédition.
«Le 23 décembre, après ma messe, dit M. Beaudoin, étant auprès du feu, avec M. d'Iberville, M. de Brouillan vint lui dire qu'il était incapable de le suivre dans les voyages sur la neige, telle que doit être la guerre qu'il a eu à faire tout l'hiver, et qu'il veut ramener son monde à Plaisance par le chemin que d'Iberville avait suivi pour venir à Rognouse. M. d'Iberville, voyant qu'il paraissait accablé de fatigue et excédé de tous les mécomptes qu'il s'était attirés par sa faute, ne tenta point de le dissuader, et lui fit ses adieux dans les meilleurs termes. M. de Brouillan partit alors à travers les neiges, qui étaient très hautes, ayant avec lui quatre Canadiens qui devaient lui battre le chemin.»
On était arrivé à la fin du mois de décembre.
Avant de se remettre en marche, M. d'Iberville prit soin de faire célébrer la grande fête de Noël à ses Canadiens, qui étaient aussi fervents chrétiens qu'intrépides combattants. Il y eut solennité religieuse, grâce à la présence de M. Beaudoin, et du Père Simon qui l'assistait: messe de minuit, grand'messe du jour avec fanfares et sonneries des clairons, coups de canons et pièces d'artifices. C'est ainsi que l'on arriva au mois de janvier 1697.
D'Iberville, qui avait conservé tous ses hommes, se disposa a continuer sa marche au nord. Il envoya en avant de Montigny, qui s'empara de deux stations importantes; Kividi et Portugal Cove. Il sa saisit aussi d'une chaloupe qui venait de Carbonnière, et il fit cent prisonniers.
Pendant ce temps, un autre lieutenant de d'Iberville, M. de La Perrière, s'empara de Tascove et du cap Saint-François, à l'extrémité de la baie de la Conception. D'Iberville suivait avec le corps principal; il prit 80 chaloupes, et se rendit maître de 35 lieues de pays sur le coté sud de la baie de la Conception.
Après avoir réuni tout son monde, il se disposa à occuper l'autre côté de la baie; mais avant de partir, il fit fabriquer des raquettes pour ses gens. Depuis plusieurs jours la neige était tombée en si grande quantité que les sauvages disaient n'avoir jamais rien vu de semblable en Canada: elle atteignait dans les vallées jusqu'à vingt pieds de hauteur.
Nous n'avons pas besoin de décrire longuement les raquettes dont les Canadiens avaient tiré tant d'avantages dans leur expédition de la baie d'Hudson. On les nommait ainsi parce qu'elles avaient à peu près la forme des raquettes du jeu de paume, seulement, elles étaient plus grandes. On les attache sous le pied avec une double courroie qui Part du centre de la raquette et qui fixe le pied très solidement. Avec cet appareil, un homme exercé peut franchir les neiges les plus épaisses sans enfoncer, et avec une singulière rapidité.
On partit le 18 janvier, de Montigny marchant toujours en avant; et deux jours après, grâce aux raquettes, on arriva à trente lieues de distance, sur la côte nord, près du fort de Carbonnière et en face de l'île du même nom. C'est là que se trouvait l'une des stations les plus importantes des Anglais.
On navigua plusieurs jours en vue de l'île, en attendant un moment favorable pour débarquer.
Le chevalier s'empara d'abord de plusieurs chaloupes des habitations voisines, et les mit aussitôt en bon état.
Après plusieurs tentatives, on vit qu'il fallait renoncer à cette expédition. L'île était inabordable; toute la côte est revêtue de rochers à pic d'une grande hauteur; le seul endroit au niveau de l'eau est entouré d'une batture qui est pleine de périls pour les embarcations, et qui n'est accessible qu'aux pilotes de l'île.
Voyant ces difficultés, le chevalier ne perdit pas son temps. Il débarqua ses troupes sur la terre ferme, et, au bout de quelques jours, les Français s'étaient emparés de toutes les stations qui occupaient le nord de la baie de In Conception.
Le chevalier commença par le Havre-de-Grâce, l'un des plus anciens établissements des Anglais. Il y trouva 100 hommes et 7,500 quintaux de morue, et des bestiaux en grande quantité. On prit ensuite Porte-Grave avec 116 hommes et 10,000 quintaux de morue; Mosquetti, le poste de Carbonnière, en terre ferme, avec 220 hommes et 22,500 quintaux de morue; New Perlican, Salmon Cove et Bridge, avec 70 hommes et 6,000 quintaux de morue. Après quoi, M. d'Iberville, se dirigeant dans le nord, arriva à la station de Bayever, dont il s'empara. Là, il fit 80 hommes prisonniers et prit 11,000 quintaux de morue. Deux lieues plus haut, à Colicove, il trouva encore un grand nombre d'animaux.
Il y avait là des fermes magnifiques, et plusieurs fermiers possédaient des cent mille livres de capital. Les habitants, fuyant à son approche, s'étaient réfugiés au Havre Content, situé à l'extrémité nord de la baie suivante, nommée la baie de la Trinité. M. d'Iberville s'y rendit aussitôt et obtint que l'on capitulât. Quatre-vingts habitants, venus de différents points, s'y trouvaient avec leurs femmes et leurs enfants.
Au Havre Content, M. Deschauffours, gentilhomme acadien, fut établi avec dix hommes de garnison.
Dans toute cette expédition, cent vingt-cinq Canadiens s'emparèrent, en cinq mois, d'une étendue de pays de 500 lieues carrées, après une marche de plus de deux cents lieues; ils firent 700 prisonniers et tuèrent 200 hommes, n'ayant subi eux-mêmes que peu de pertes, et ils ne saisirent pas moins de 190,000 quintaux de morue.
Après la prise de Havre Content, M. d'Iberville, ayant su que les gens de Carbonnière, de Porte-Grave et de Bridge, auxquels il avait laissé la vie sauve, avaient formé le projet de se réfugier à l'île de Carbonnière, contre la parole qu'ils avaient donnée, revint aussitôt sur ses pas pour les maintenir dans l'obéissance. Il lui fallut passer à travers les bois et par les chemins les plus difficiles. «On avait à chaque instant à traverser à mi-jambe dans l'eau, qui n'est pas trop chaude en cette saison», dit M. Beaudoin. En effet, on était au 10 février. Mais à Carbonnière, les gens se dédommagèrent de leurs fatigues en faisant venir de la viande fraîche du Havre-de-Grâce, où, comme nous l'avons dit, il y avait des bestiaux en grande quantité. M. d'Iberville, pour terminer la conquête de toute l'île, songea dès lors à se rendre à Bonavista, qui est à 100 lieues au nord de Carbonnière, mais auparavant il voulut traiter d'échange avec les Anglais de l'île de Carbonnière.
Ceux-ci répondirent en demandant un Anglais pour un Français et trois Anglais pour un Irlandais. Ils étaient irrités contre les Irlandais, qu'ils regardaient comme leurs sujets et qu'ils avaient trouvés dans les rangs de leurs adversaires. Mais cette demande n'eut pas de suite parce qu'elle fut éludée par les Français.
Sur ces entrefaites, vers le 14 février, on vit revenir les quatre Canadiens que M. de Brouillan avait emmenés avec lui, à la fin de décembre, pour le conduire par terre de Saint-Jean à Plaisance. Ces braves gens revenaient partager les dangers et les fatigues de leurs compagnons d'armes. «Ils nous apprirent, dit M.. Beaudoin, que M. de Brouillan, arrivé à Bayeboulle, à 15 lieues de Saint-Jean, se trouva tellement accablé de fatigue et découragé, qu'il se refusa absolument à continuer par terre, où il n'avait que 25 lieues à faire, et qu'il préféra s'embarquer à Bayeboulle, ce qui faisait une différence de plus de 100 lieues à parcourir par mer.»
«M. d'Iberville eut bientôt occasion de prendre ce chemin de terre, qui paraissait impraticable à M. de Brouillan et à messieurs les Plaisantins, ajoute M. Beaudoin. Il est vrai qu'il n'est pas aussi beau que celui de Paris à Versailles, mais on peut le faire en quatre jours en marchant d'un bon pas.» M. d'Iberville voulait, avant de continuer son expédition, revenir à Plaisance pour avoir des nouvelles de France, d'où il attendait l'escadre qui lui avait été promise pour se rendre à la baie d'Hudson. Enfin, «il avait peut-être à prendre des munitions, et moi des hosties,» nous dit M. Beaudoin, qui l'accompagna dans ce trajet de quelques jours.
Cette expédition avait fait connaître aux Français toutes les ressources de ce pays; ils avaient appris, par la pratique des Anglais, qui étaient de grands chasseurs, la distance qui les séparait des possessions françaises et les voies praticables qui y conduisaient.
PORT DE PLAISANCE DANS L'ÎLE DE TERRE-NEUVE.
La baie de Plaisance a 25 lieues de largeur à son entrée et 50 lieues de profondeur. C'était la résidence du gouverneur français, M. de Brouillan.
Ainsi, du fond de la baie de la Trinité, où d'Iberville avait pris New Perlican, Bayever, Bridge, etc., jusqu'au fond de la baie même de Plaisance, à l'endroit que l'on appelait le port de Cromwell, il n'y a qu'une lieue a traverser, tandis qu'en allant par mer, on trouverait 150 lieues de parcours.
M. d'Iberville s'était donc rendu à Plaisance au mois d'août 1697 pour avoir des nouvelles; et, en attendant, il préparait l'expédition de Bonavista, comme nous l'avons dit plus haut, pour consommer la destruction des établissements de Terre-Neuve.
Au bout de quelques semaines, les gens que d'Iberville avait laissés sur les côtes pour détruire ce qui restait des possessions anglaises, vinrent le rejoindre à Plaisance avec M. d'Amour de Plaine, leur commandant.
Toute la troupe de M. d'Iberville se trouvait réunie autour de lui. Il y avait plusieurs gentilshommes canadiens, quatre officiers des troupes du roi, et enfin des hommes signalés par les exploits les plus aventureux.
C'était la plus intrépide réunion que l'on vit jamais en Canada. Choisis parmi les meilleurs, M. d'Iberville, dans sa nouvelle expédition, les avait formés encore à affronter les plus grandes fatigues. Nous aimons à rappeler ici les noms qui nous ont été conservés dans les relations, et dont plusieurs sont encore dignement portés en Canada:
Le capitaine des Muys, MM. de Rancogne, d'Amour de Plaine, de Montigny, de Bienville, frère du commandant, Boucher de La Perrière, Deschauffours l'Hermite, Dugué de Boisbriant, et enfin Nescambiout, le chef des Abénaquis, qui alla a Versailles quelques années après. Il fut présenté au roi et reçut un sabre d'honneur.
Cette dernière campagne ne les avait pas seulement aguerris, elle leur avait procuré l'abondance. Ils n'en abusaient pas, étant soumis à la plus stricte discipline, mais ils en profitaient pour se préparer aux éventualités de l'avenir, achetant des armes excellentes, des vêtements et les fourrures nécessaires pour les rudes climats du Nord.
Mais ce riche butin amena des difficultés auxquelles on était loin de s'attendre.
M. de Brouillan fit connaître de la manière la plus formelle qu'il prétendait participer aux bénéfices d'une expédition dont il n'avait pas voulu partager les dangers. M. d'Iberville, tout en reconnaissant l'injustice de cette réclamation, était disposé à céder, par respect pour l'autorité; mais il n'en fut pas de même de ses gens, qui refusèrent d'écouter de telles prétentions. Ils déclarèrent que si le gouverneur voulait avoir sa part, il n'avait qu'il aller la chercher lui-même dans les stations où il restait quelque chose. Ils citaient parmi celles-ci le port de Rognouse, où on savait qu'il y avait cent hommes, de défense avec des provisions abondantes.
QUATRIÈME EXPÉDITION A LA BAIE D'HUDSON.
Les bâtiments étaient au nombre de trois principaux: d'Iberville commandait le Pélican, vaisseau de 50 canons et de 150 hommes d'équipage; M. de Sérigny, le Profond, et M. de Boisbriand, le Wesph. L'équipage était réparti sur deux autres petits bâtiments, le Palmier et l'Esquimau, chargés de vivres. L'escadre avait, outre les hommes d'équipage, 250 combattants. Les bâtiments étaient approvisionnés de tout ce qui était nécessaire pour cas expéditions du nord: des mousquets, des haches d'armes, des harpons, des grappins, des couvertures de laine, des fourrures, des armes particulières pour combattre les baleines. La navigation avait cela de particulier que jusqu'à l'entrée de la baie d'Hudson, on pouvait rencontrer les glaces venant du pôle, tandis que, plus loin, ces glaces diminuaient à cause de la chaleur du Gulf-Stream, qui quitte les côtes de l'Amérique en cet endroit pour traverser l'Atlantique.
M. de Brouillan, irrité, fit emprisonner quelques-uns des opposants, et chercha à séparer M. de Montigny de M. d'Iberville. Cela poussa d'Iberville aux dernières limites du mécontentement.
On ne sait ce qui aurait pu résulter de l'entêtement de M. de Brouillan et de l'indignation du capitaine canadien, lorsque arriva un événement qui changea toutes choses.
M. de Sérigny, frère du chevalier, arriva de France le 15 du mois de mai 1698. Il conduisait une escadre qui apportait les ordres les plus pressants de se rendre à la baie d'Hudson.
La cour ayant appris que Terre-Neuve était conquise presque entièrement, enjoignait à M. d'Iberville de se rendre aussitôt a la haie d'Hudson. On pensait que M. de Brouillan suffirait à compléter la conquête par la prise de Bonavista.
Ainsi finit l'oeuvre de M. d'Iberville en Terre-Neuve et il ne lui resta plus qu'à prendre congé de l'irascible gouverneur.
Après cela, M. Beaudoin énumère le résultat de cette année de combats. Il nous fait remarquer que 125 hommes, en si peu de temps, avaient occupé près de 500 lieues carrées de territoire, avaient pris trente stations, fait plus de 1,000 prisonniers, tué 200 hommes, et saisi tant de milliers de quintaux de morue, sans avoir éprouvé d'autre accident que deux hommes blessés.
Le pieux missionnaire ajoute qu'il bénit le Seigneur d'avoir assisté les Français, qui avaient presque tous la crainte de Dieu, tandis que leurs ennemis étaient de moeurs abominables.
Ces Anglais avaient cependant de bonnes qualités: ils étaient des hommes actifs et habiles dans l'exploitation des pêcheries et des chasses; mais ils n'avaient rien des qualités militaires, et ils étaient incapables de résister à des combattants intrépides comme les Canadiens.
De plus, Dieu ne pouvait les favoriser: ils ne faisaient aucune religion, n'ayant pas même de ministre avec eux, Ils étaient, dans leur conduite, pires que les sauvages, abandonnés à l'ivrognerie et à tous les désordres.
M. Beaudoin donne ensuite rémunération des stations prises par les Français, et il les met sous trois divisions distinctes:
Celles prises par M. de Brouillan seul, avant l'arrivée d'Iberville; celles prises par M. de Brouillan réuni à M. d'Iberville; et enfin les stations prises par M. d'Iberville seul, avec le nombre des habitants de chaque place, les chaloupes qu'ils y ont trouvées, et le poisson qu'ils y prennent chaque année.
Il y en a dix dans la première catégorie, trois dans la seconde, et vingt-trois dans la troisième.
Il est à remarquer que M. de La Potherie, qui copie l'énumération, a omis de faire cette distinction, de manière qu'on ne peut comprendre ce qu'il a voulu dire en cet endroit.
Voici la liste donnée par M. Beaudoin:
1° Stations prises par M. de Brouillan avec ses gens: Rognouse, Trémousse, Forillon, Caplini Bay, Cap Reuil, Brigue, Tothcave, Bayeboulle, Aigueforte—490 pécheurs, 54 habitants, 71 chaloupes prises, 25,000 quintaux de morue;
2° Celles prises par M. d'Iberville et M. de Brouillan réunis: le Petit-Havre, la ville de Saint-Jean, le fort de Kividi—420 pêcheurs, 82 habitants, 150 chaloupes, 75,000 quintaux de morue;
3° Stations prises par M. d'Iberville seul: 1° dans la baie de la Conception et la haie de la Trinité: 2° de Portugal Cove, Havremon, Quinscove, Havre-de-Grâce, Mousquit, Carbonnière, Croques Coves, Kelins Cove, Fresh Water, Bayever, Vieux Perlican, Lance-Arbre, Colicove, New Perlican, Havre Content, Arcisse, la Trinité.—1,138 pêcheurs, 149 habitants, 214 chaloupes, 113,800 quintaux de morue.
Total: 2,048 pécheurs, 285 habitants, 435 chaloupes, 263,900 quintaux de morue.
Après le départ de M. d'Iberville, M. de Brouillan se trouva délivré d'une grande préoccupation: il lui semblait qu'il serait plus en mesure d'exercer ses prérogatives, et de prouver qu'il n'avait pas besoin de partager son autorité. Mais les années suivantes ne lui furent pas favorables, et on 1698 les Anglais étaient revenus occuper sans résistances toutes les stations de la côte orientale.
M. de Brouillan ayant été nommé au gouvernement de l'Acadie, fut remplacé par M. de Subercase. Ce dernier se décida d'attaquer les stations anglaises, ce qu'il opéra, avec le commandant de Montigny, en janvier 1707. Ils avaient réuni 450 hommes. Ils prirent plusieurs postes et détruisirent tous les environs de Saint-Jean. L'année suivante, M. de Saint-Ovide, neveu de M. de Brouillan, alla, avec 125 hommes et M. de Cortebelle, occuper le pays; ils enlevèrent Saint-Jean, et se préparaient à de nouvelles excursions, lorsque le gouverneur de Plaisance les rappela, parce qu'il avait appris que les Anglais se préparaient à l'attaquer avec 2,000 hommes.
Les succès furent ainsi partagés dans le cours du XVIIIe siècle; les Anglais finirent par consolider leur occupation, mais ils consentirent à laisser aux pêcheurs français quelques points sur la côte. Il ne reste plus aujourd'hui à la France que deux îles au sud de Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon, qui sont aujourd'hui le contre d'une exploitation considérable.
En 1745, la pêche occupait chaque année dix mille hommes avec 500 navires de Bayonne, de Saint-Jean de Luz et du Havre-de-Grâce.
Aujourd'hui les pêcheries ont une importance plus grande que jamais. Chaque année, près de cent quatre-vingt-dix bâtiments viennent se fixer sur le banc de Terre-Neuve. Ils ne doivent pas, d'après les traités, avancer à plus de vingt lieues du rivage, mais cela suffit pour la pêche. Ils trafiquent avec les riverains de Terre-Neuve, qui leur apportent le menu poisson qui doit servir d'amorce. Pas moins de vingt-cinq à trente mille pêcheurs, largement rétribués, sont ainsi employés à la pêche. Cette occupation est une école tout à fait précieuse pour la préparation de la marine française. Aussi le gouvernement donne-t-il à chaque bâtiment une prime considérable.
Tel est l'état actuel des pêcheries françaises en Amérique, et l'on ne doit pas oublier la part que d'Iberville a prise au développement de cette précieuse industrie.
Tous les préparatifs étant terminés à Plaisance et les équipages de l'escadre ayant été complétés, on mit à la voile le 8 juillet 1697, et l'on avança par un vent du sud-ouest. D'Iberville commandait le Pélican, vaisseau de 50 canons et de 150 hommes d'équipage. M. de Sérigny commandait le Profond et M. de Boisbriant le Wesph. Ces officiers avaient parcouru plusieurs fois les mers du Nord et connaissaient la baie d'Hudson. Enfin, les hommes de guerre qui les secondaient, avaient été déjà leurs compagnons.
Outre M. d'Iberville et ses deux frères, M. de Sérigny, et de Bienville, âgé seulement de quatorze ans et frère chéri d'Iberville, il y avait leur cousin de Martigny, fils de leur oncle, Jacques Le Moyne; les deux MM. Dugué de Boisbriant, de La Salle, de Caumont, le chevalier de Montalembert, de la compagnie du marquis de Villette, M. de La Potherie, qui a publié plusieurs volumes pleins d'intérêt sur la Nouvelle-France et sur les événements dont il avait été témoin; MM. de Grandville et de Ligonde, gardes de la marine; Chatrier. Saint-Aubin, Jourdain et Vivien, pilotes, La Carbonnière de Montréal, Saint-Martin, etc.; enfin, Jérémie, qui a laissé une relation assez complète de tous ces événements. Ils avaient avec eux un aumônier. D'Iberville avait toujours soin d'en associer à toutes ces entreprises, où il fallait toujours être prêt à donner sa vie pour le service de Dieu et du roi. Cet aumônier était M. Fitz-Maurice, de la famille des Kiéri en Irlande, dont d'Iberville estimait tout particulièrement le mérite et le zèle infatigable. Il devait rendre les plus grands services, et il était destiné à subir de grandes fatigues.
L'équipage était réparti sur cinq navires: le Pélican, le Palmier, le Wesph, le Profond, et un brigantin nommé l'Esquimau, chargé de vivres. L'escadre réunissait, outre les hommes d'équipage, 250 combattants. Les bâtiments étaient approvisionnés de tout ce qui était nécessaire pour ces expéditions du Nord; des mousquets, des haches d'armes, des harpons, des grappins pour fixer les navires sur les glaces lorsqu'on ne pouvait plus naviguer, des couvertures de laine et des fourrures pour les jours les plus froids, des armes particulières pour combattre les baleines, qui naviguaient par légions dans le nord, et pour s'emparer de ces populations d'amphibies qui couvraient les rivages parfois jusqu'à perte de vue; sans compter les armes de chasse pour attaquer ces tribus d'oiseaux si nombreux, non encore décimés par les chasseurs: les oies, les outardes, les pingouins, les mouettes, les goélands.
De Plaisance, on longea l'île pour se rendre sur la côte orientale. On passa devant le cap Sainte-Marie, devant lu cap de Rase au sud de l'île, puis on remonta le long du banc de Terre-Neuve. M. d'Iberville avait reçu l'instruction de courir des bordées sur cette côte; mais des brumes très épaisses s'étant élevées, ces instructions ne purent être observées, et l'escadre se dirigea aussitôt vers le nord.
Le 17 juillet, neuf jours après le départ, l'escadre ayant passé le cap Saint-François et le cap Bonavista, on se trouva près de Belle-Isle, en face de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent et par le 52e degré de latitude.
On commença à rencontrer quelques glaces dérivant vers le sud, mais ce n'était rien en comparaison de ce que l'on devait voir plus tard.
Le 18 juillet, l'escadre longea les côtes du Labrador. Le 24, 16 jours après le départ de Plaisance, l'entrée de la baie d'Hudson se présenta: elle était tout obstruée de glaces. On était en face de l'île de la Résolution, et des îles Button, qui conservent encore le même nom. Il fallait se frayer un passage en naviguant vers l'ouest.
D'Iberville, monté sur le Pélican, affrontait les banquises, sachant profiter de toutes les ressources de ces passages, qu'il avait traversés plusieurs fois, et frayant la route aux autres navires.
Il fallait souvent grappiner, c'est-à-dire fixer les bâtiments sur les glaces au moyen de grappins dont on avait un bon nombre.
A cette hauteur, on était au 62e degré de latitude, le soleil était perpétuel, éclairant la nuit comme le jour. On rencontra ensuite les îles du Pôle et de la Salamandre, ainsi nommées d'après les deux bâtiments que d'Iberville y avait conduits dans son voyage précédent de 1694.
Arrivés à ce point, les navigateurs virent marcher contre eux l'immensité des glaces venant du pôle; elles apparaissaient au loin jusqu'à la ligne de l'horizon. C'étaient des masses énormes qui semblaient entassées les unes sur les autres. Enfin, à chaque instant, comme dans la région des nuages, on voyait s'accomplir les mouvements les plus variés.
Certains bancs s'arrêtaient et se disposaient avec ordre comme les quais d'un fleuve. Les autres continuaient à marcher et s'avançaient plusieurs de front comme une flotte gigantesque. Il y avait des blocs de 300 pieds de hauteur. A certains moments, dans cette procession effrayante, il y avait des rencontres, avec des bruits terribles; tantôt c'était comme des coups de tonnerre, d'autres fois comme des salves d'artillerie, ou des feux de file de mousqueterie. A ces rencontres, les blocs de glace, poussés par une force irrésistible, se levaient, se dressaient les uns contre les autres, et menaçaient de s'abattre sur les embarcations.
Il était difficile de braver ces obstacles avec ces petits navires, qui étaient si mal disposés pour supporter les grandes lames de l'Océan. C'est ainsi que s'avançaient ces intrépides navigateurs; ils n'avaient pour appui que des coques de noix; ils étaient dépourvus de ces instruments de précision modernes qui parlent un langage, si infaillible; ils n'avaient pour guide que la boussole et marchaient connue les yeux fermés dans les brumes.
A un certain moment, un vent s'éleva qui ébranla les glaces et les bouleversa. Au milieu de ce conflit, deux bâtiments se rencontrèrent, et un mat d'artimon fut brisé, tandis que le brigantin l'Esquimau, poussé par la violence des courants, fut enlevé et sombra avec son chargement. Tout ce que l'on put faire fut de sauver l'équipage.
Dans ces régions, les tempêtes sont plus effrayantes que partout ailleurs. Le 24 juillet, l'escadre en ressentit une qui dura huit heures.
Les cordages et le pont étaient couverts de verglas, les voiles s'immobilisaient; le veilleur, à son poste d'observation au haut du mat, était comme une stalactite vivante. Les côtes présentaient une masse de pics et de précipices effrayants. Enfin, au milieu de la tempête, le Pélican se vit séparé des trois autres vaisseaux, qui jusque-là l'avaient suivi.
Le 8 du mois d'août, on était entré dans le détroit de la baie d'Hudson; on doubla le cap Haut, puis le cap Charles, à 50 lieues de l'ouverture du détroit.
Le 15 du mois d'août, le Pélican était arrivé à 150 lieues des îles Button et de l'entrée est du détroit. D'Iberville, ne voyant pas arriver les trois vaisseaux français, s'arrêta, quelques jours pour les attendre.
Ils étaient au milieu des splendeurs des mers du Nord. Dans le jour, ils pouvaient contempler un ciel d'un éclat et d'une pureté extraordinaires, qui tranchait sur la blancheur des neiges, et les glaces, qui s'étendaient à perte de vue. Pendant la nuit, les aurores boréales apparaissaient avec leurs lueurs plus blanches que l'albâtre et variant à chaque instant. Autour du navire, tout un peuple d'amphibies, de loups et de veaux marins couvraient les rivages; ils offraient aux chasseurs une proie facile. Dans le ciel, des volées d'oiseaux énormes: les outardes, les goélands remplissaient les airs, et ils étaient en si grande quantité que La Potherie nous dit qu'on pouvait les prendre par milliers.
Tandis qu'on pouvait se livrer à la chasse, on pouvait aussi s'occuper à la pêche, qui offrait une proie abondante.
On était encore sur les glaces lorsqu'on vit arriver une bande de sauvages esquimaux avec qui l'on se mit en rapport. M. de La Potherie donne de grands détails sur ces habitants étranges des mers du pôle. Il nous dit comme leurs vêtements, leurs armes et tous les objets à leur usage sont admirablement adaptés au climat qu'ils doivent habiter.
Ils portent un surtout fait de fourrures très épaisses, avec des gilets et des hauts-de-chausse de peau. Le tout est cousu avec les nerfs les plus délicats des animaux et «avec une perfection dont les couturières européennes n'approchent pas». Par-dessus leurs chausses, ils mettent deux paires de bottes l'une sur l'autre, alternées avec des chaussons de peau. Ils prennent donc plus de précautions contre le froid que les Européens, mais aussi il paraît qu'ils ne connaissent pas les infirmités qui affligent les peuples qui se disent civilisés.
Leurs canots de peaux de loups marins montées sur des os de baleine, sont une invention merveilleuse pour braver la fureur des flots. Ils sont tout couverts sur le dessus, à la réserve d'une ouverture où les navigateurs se mettent; elle est si bien ajustée qu'il n'y entre jamais d'eau. Ils les gouvernent très facilement avec une rame de quatre pieds de longueur, arrondie aux deux extrémités et qu'ils savent manoeuvrer avec une rapidité extraordinaire.
Le Pélican remit à la voile et arriva le 3 septembre en vue du fort Nelson, n'ayant pas de nouvelles des autres bâtiments.
Le 5 septembre, l'on vit arriver trois vaisseaux que l'on prit pour l'escadre: grand mouvement à bord et grande joie. On bat aux champs et l'on arbore les pavillons de bienvenue. Mais, étonnement général lorsqu'on s'aperçoit que les bâtiments signalés ne répondent pas et s'avancent toujours, en silence, à force de voiles. La méprise ne fut pas longue; on avait devant soi trois vaisseaux ennemis qui venaient d'attaquer le Profond dans le nord de la baie, et qui croyaient l'avoir coulé à fond.
Ces trois bâtiments étaient le Hampshire, de 50 canons et de 150 hommes d'équipage; le Derring, de 36 canons et 100 hommes d'équipage, et le Hudson Bay, de 32 canons et plus de 200 hommes d'équipage: total, près de 350 hommes avec 108 canons, auxquels le Pélican ne pouvait opposer que 150 hommes et 50 canons.
D'Iberville comprit aussitôt le danger, mais il jugea qu'il devait le braver. D'ailleurs, il commandait des hommes résolus et qui n'auraient pas voulu entendre parler de retraite.
Aussitôt, il divise son monde en plusieurs détachements. Il met La Salle et de Grandville, gardes de la marine, avec leurs hommes à la batterie d'en bas; il place son jeune frère de Bienville et M. de Ligonde, autre o-arde de la marine, à la batterie du haut, et établit M. de La Potherie, Saint-Martin et La Carbonnière au château dee l'avant, avec les hommes les plus aguerris; lui-même se porte, avec un détachement, au château de poupe, près du pilote, pour tout diriger.
D'Iberville, avec l'intelligence qui le caractérisait, décida qu'un abordage vaudrait mieux que le vain essai de lutter, avec 50 canons, contre trois vaisseaux pouvant tirer de tous côtés en l'environnant comme d'un cercle de feu. Il se dirige donc vers le Hampshire, tandis que les Anglais l'apostrophaient en criant qu'ils le reconnaissaient, «qu'ils le cherchaient depuis longtemps, que son dernier jour était venu et qu'ils ne l'épargneraient pas.» Et sur cela, des cris et des hourras répétés.
Le moment était solennel. D'Iberville avançait toujours; il était d'une impassibilité qui lui était ordinaire dans le danger et qui électrisait ses gens, qui avaient les yeux sur lui.
Il fait sonner l'abordage. Tous ses gens se garent d'abord pour essuyer la première bordée du Hampshire, puis ils se relèvent et montent d'un bond sur les embrasures. Retenus d'une main aux manoeuvres du navire, de l'autre, ils brandissaient leurs haches d'armes. Le navire marchait avec rapidité. Le capitaine du Hampshire, les ayant contemplés quelques instants, jugea qu'il pouvait être anéanti du premier coup avant qu'il pût être secouru par les autres navires. Il fait aussitôt carguer ses voiles, et, virant de bord, il se dérobe à une lutte qu'il n'ose pas affronter.
D'Iberville ne perd pas un instant. Il continue sa course et se dirige entre les deux autres vaisseaux. En passant près du Derring, il le foudroie avec sa batterie de droite. Il se retourne vers le Hudson Bay, et lui envoie sa bordée de gauche, puis il revient vers le Hampshire, qui, voyant le Pélican aux prises avec deux vaisseaux, avait décidé de se remettre en ligne. Les deux bâtiments anglais avaient peine à se rétablir; les manoeuvres étaient hachées, les voiles criblées, les canons renversés, les blessés nombreux.
Cependant, d'Iberville voyant que ce qu'il avait voulu éviter allait se réaliser, si les trois navires se réunissaient, marcha droit sur le Hampshire. Pendant ce temps, les trois navires se remirent en ligne et tiraient à la fois, criblant le Pélican, mais sans blesser beaucoup de monde, les gens d'Iberville étant si exercés à se garer à chaque bordée. Ils jugeaient de la direction des coups, et suivant leur portée, ils montaient dans les manoeuvres avec la rapidité la plus extraordinaire, ou se garaient dans l'entrepont, puis ils revenaient sur le tillac en poussant des cris de défi.
Le Hampshire, voyant l'inutilité de toutes ses volées de canons, se décida enfin à aborder le Pélican, réservant son feu pour frapper son adversaire d'aussi près que possible. Il commença par chercher à prendre le vent pour revenir sur le Pélican avec plus de force, mais, là éclata l'inhabileté des marins anglais; ils ne purent réussir dans cette manoeuvre, et su retrouvèrent côte à côte avec le Pélican, qui les prolongeait et les suivait dans tous leurs mouvements.
C'est alors qu'arriva l'événement le plus considérable du combat.
Les navires étaient si près l'un de l'autre que les hommes s'apostrophaient des deux bords. Les Anglais criaient aux Français qu'ils vinssent leur rendre visite, et, voyant M. de La Potherie qui avait le visage tout noir de poudre, ils s'écrièrent: «Ali! quel beau visage de Guinée.»
Le Hampshire se voyant a portée de pistolet, lança sa bordée, qui n'eut presque pas de prise sur l'équipage étendu à plat sur le pont.
Alors, d'Iberville riposta. Tous ses canons étaient pointés à couler bas, et il envoya si bien sa bordée que le Hampshire ne put faire que quelques brasses et sombra complètement sous voiles, avec tout son monde, qui comprenait 150 combattants.
Les deux autres vaisseaux, voyant ce désastre, ne songèrent plus à faire aucune résistance. Le Derring vira de bord avec la plus grande hâte, et s'enfuit; mais l'Hudson Bay, trop criblé pour en faire autant, amena aussitôt son pavillon, et d'Iberville envoya La Salle avec 25 hommes pour l'amariner.
Tout avait été si bien conduit, que d'Iberville n'avait pas de morts, et ne comptait que 14 blessés; mais les manoeuvres étaient coupées, les voiles percées à jour, les mâts criblés.
Le chevalier du Ligonde avait reçu deux coups de feu; La Carbonnière avait le coude entamé; Saint-Martin, la main fracassée; M. de La Potherie avait reçu plusieurs balles dans ses vêtements, et avait un bras contusionné.
Après ce combat acharné il se passa encore bien dea événements avant l'attaque du fort Nelson. On était parvenu au 7 de septembre, et l'on expérimenta alors la rigueur de ces climats. Il faisait très grand froid; le vaisseau, avec ses agrès et ses mâts, était tout couvert de neige et de verglas. Le vent était très fort, et, la grande ancre s'étant rompue, la désolation fut au comble parmi les blessés et les malades. M. de La Potherie, quelque accablé de fatigue qu'il fût, avait encore assez de liberté d'esprit pour faire la remarque que Horace, qui relève l'audace de celui que le premier confia une nef aux flots, ne s'était cependant jamais trouvé en si fâcheuse conjoncture.
Illi robur et aes triplex
Circa, pectus erat qui fragilem truci
Commisit pelago ratem
Primus, nec timuit proecipitem Africum
Decertantem...
La tempête se déchaîna, ensuite dans toute sa fureur; la galerie fut enlevée, les tables et les bancs brisés dans la grande salle; enfin, vers dix heures du soir, le 7 septembre, le gouvernail fut enlevé. Le vaisseau, secoué et poussé sur les battures, ne put résister et fut ouvert par le milieu. Au matin, il commença à sombrer: il fallut l'abandonner. En ce moment on voyait la terre à deux lieues.
Au milieu de ces épreuves d'Iberville était inébranlable: c'était dans les plus terribles circonstances que se révélaient sa fermeté et la sûreté de ses décisions. Il se mit en devoir de sauver son équipage. Il envoya M. de La Potherie et son cousin de Martigny dans un esquif, chercher un lieu de déparquement, puis il fit disposer des radeaux, et embarqua son monde. Les rigueurs du froid étaient telles que, sur les 200 hommes qui se trouvaient sur le bâtiment et qui eurent à traverser les battures dans l'eau jusqu'à la ceinture, 18 périrent. M. de La Potherie tomba sans mouvement, épuisé de fatigue; quelques Canadiens le sauvèrent. L'aumônier, M de Fitz-Maurice, fut admirable de dévouement, étant, comme nous l'avons dit, d'une force extraordinaire. Il soutenait et même portait ceux qui ne pouvaient se traîner, et il ne les abandonnait pas avant qu'ils fussent arrivés en terre ferme.
De grands feux que l'on fit soulagèrent ces pauvres gens qui étaient légèrement vêtus et tout dégouttants encore du naufrage. Dans tous ces désastres, d'Iberville avait veillé a tout. Il avait sauvé sa provision de poudre, et il put ainsi envoyer ses meilleurs tireurs pour se procurer du gibier. Heureusement, les autres vaisseaux arrivèrent, le Palmier, le Wesph et le Profond, apportant des vivres, des munitions et des vêtements de toutes sortes; il était temps: les plus robustes succombaient, les plus nobles coeurs étaient anxieux. Les fronts s'éclaircirent, mais comme en ces temps la foi accompagnait toutes les émotions, de vives démonstrations de reconnaissance furent adressées à Dieu. D'ailleurs, ces braves gens étaient déterminés à toute tentative suprême et, périr pour périr, ils disaient qu'il valait mieux sacrifier sa vie sur un bastion du fort Nelson que de languir dans un bois avec un pied de neige.
Le 11 septembre, dit M. de La Potherie, nous allâmes faire du feu à la portée du canon du fort et sous le couvert des arbres, pour tromper l'ennemi. La fumée nous attira des coups de canon, mais facilita aux gens le débarquement le long de la rivière. M. d'Iberville, se dirigeant par de petits sentiers couverts, s'en alla reconnaître la place, sur les 11 heures du matin; après quoi il envoya de Martigny en parlementaire pour réclamer deux Canadiens et deux Iroquois qui étaient restés prisonniers l'année précédente. Le gouverneur les refusa: alors on résolut l'attaque.
Après dîner, on dressa une batterie à deux cents pas du fort, et l'on débarqua les mortiers, les canons et les munitions, sous la direction du chevalier de Montalembert, garde de la marine. Le lendemain, le bombardement commença vers 10 heures du matin, et continua jusqu'à, une heure de l'après-midi. Les bombes faisaient un effet merveilleux; les remparts étaient renversés, et les Canadiens envoyés en tirailleurs, voyant les résultats, les saluaient de Sassa Kouès de triomphe. On commença alors, sur la côte opposée du Nord, une nouvelle batterie qui aurait écrasé le fort, mais le gouverneur envoya le ministre, M. Morrisson, proposer une capitulation, qui ne put être acceptée à cause des conditions qui l'accompagnaient. Enfin, le lendemain, 13 septembre, le gouverneur envoya des parlementaires chargé d'accepter les conditions posées par M. d'Iberville.
A une heure de l'après-midi, l'évacuation eut lieu. La garnison sortit tambours battants, mèches allumées, enseignes déployées, avec armes et bagages.
Le fort Nelson, que l'on venait de prendre, est au 59e degré 30 m. de latitude; c'est la dernière place de l'Amérique septentrionale. Il était en forme de trapèze avec quatre bastions. Dans chaque bastion il y avait des fauconneaux et des pièces de quatre et de huit. En tout, deux mortiers de fonte, 34 canons et plusieurs petites pièces.
M. d'Iberville installa ses hommes, puis fit célébrer les offices religieux. M. de Fitz-Maurice fit les offices et ensuite s'occupa de se mettre en rapport avec les sauvages.
Cette campagne rendait la France maîtresse de toute la baie d'Hudson et du toutes ses richesses, qui sont très grandes, car dans un climat si rude la Providence a pourvu merveilleusement à la subsistance des peuples qui y sont établis.
Les rivières sont très poissonneuses, la chasse y est abondante. Il y a des perdrix en si grande quantité qu'on peut en tirer des milliers et des milliers. Elles sont toutes blanches, beaucoup plus délicates que celles d'Europe, et presque aussi grosses que des poules. Les outardes et les oies sauvages y abondent si tort au printemps et à l'automne, que les bords des rivières en sont remplis. Les caribous s'y trouvent presque toute l'année; on les rencontre parfois par bandes de sept à huit cents. La viande en est encore meilleure que celle du cerf.
Les pelleteries sont très nombreuses, très variées, très précieuses, bien plus belles que celles des climats plus doux: les martes, les renards noirs, les loutres, les ours, les loups, les castors sont très abondants et d'une fourrure fournie et très fine. Mais ce qui pouvait surtout attacher les Français à ce pays, c'est que les sauvages sont bons, très désireux d'embrasser la vraie religion, et tout différents des populations iroquoises, qui ont été si acharnées contre les établissements français.
Les sauvages venaient donc un foule au fort Nelson pour se mettre on rapport avec les Français, qu'ils avaient appris à aimer dans leurs rapports précédents. Ils aimaient ardemment le noble caractère d'Iberville; ils estimaient sa franchise, sa noblesse de coeur, sa droiture, qui est la qualité qu'ils estiment le plus, nous dit M. de La Potherie. Ils avaient appris à connaître M. de Martigny et M. de Sérigny, qui, dans les expéditions précédentes, étaient restés plusieurs mois avec eux. Ils savaient d'avance aussi qu'ils devaient mettre toute leur confiance dans le missionnaire, par les vertus qu'ils avaient admirées dans ceux qui l'avaient précédé. Ils n'oubliaient pas le P. Silvy, venu avec d'Iberville dans sa première expédition, et qui, resté avec eux, s'était dévoué jusqu'à ce que sa santé fût épuisée. Le P. Silvy, après ces oeuvres de missions à la baie d'Hudson, fut rappelé à Québec, mais le coup de mort était déjà porté: il mourut au bout de quelques semaines. Les sauvages savaient tout cela, et lui conservaient une filiale reconnaissance.
Ils avaient été attachés encore au nom français par le dévouement sans limites du P. Marest, venu en 1694, et qui était resté plusieurs années avec eux. Le zèle qu'il avait mis à travailler au service de l'équipage, pendant l'hiver même, était grand, mais celui qui l'animait à s'occuper des sauvages était encore plus grand, à cause du besoin où il voyait leurs âmes. Il s'en allait aux plus grandes distances par tous les temps; il passait les rivières à mi-corps, traversait des marais et des savanes, supportant les froids les plus violents, et gagnant ainsi le coeur des sauvages. Ils comprenaient, en le voyant supporter héroïquement ces épreuves, quelle affection il devait avoir pour les âmes. Ce sont des choses que les sauvages ne devaient jamais oublier; ils n'avaient rien vu de semblable chez les ennemis des Français.
M. de Fitz-Maurice, animé par ces exemples, se mit dans les mêmes rapports avec les sauvages. Il allait au loin les trouver dans leurs campements, et passait les ruisseaux, les rivières, les marais, supportant tout. Mais il est bon de rapporter une part du mérite de ces oeuvres à M. d'Iberville, qui s'occupait avant tout du bien spirituel de ses hommes et des sauvages. A bord, il assistait aux prières, aux neuvaines et à la sainte messe, Il secondait l'aumônier dans toutes les dispositions de son zèle. Le P. Fitz-Maurice nous dit qu'il était un des premiers à la confession et à la communion. Nous ne pouvons avoir une trop haute idée de ces héros chrétiens, plaçant au-dessus de tout, le but religieux qui les guidait dans leurs entreprises, et sachant mettre leur conduite en rapport avec leurs pieuses convictions. Ils rappellent les héros des croisades.
M. d'Iberville pourvut ensuite à l'organisation de la nouvelle colonie. Il mit son frère de Sérigny à la tête des stations; il demanda ensuite à M. Fitz-Maurice de se charger de l'administration spirituelle, puis il repartit pour la France, le 24 septembre 1697, bien que la saison fût déjà avancée.
Il avait installé à bord du Profond l'équipage du Pélican, qui avait sombré; il y avait ajouté une partie de l'équipage de l'Hudson-Bay, et enfin la garnison du fort, qu'il devait rapatrier.
Une heure après le départ le Profond échouait, mais ce ne fut qu'une alerte de peu de durée, car la marée survenant, on put continuer la route.
A cette époque de l'année, le soleil baissait sur l'horizon à mesure que l'on avançait vers le nord, et au bout de quelques jours, il ne paraissait plus et l'on ne pouvait plus prendre la hauteur pour se diriger.
Aussi, dit M. Bacqueville de La Potherie, on avançait dans les ténèbres; on ne voyait plus rien, et par surcroît, il arriva une très forte tempête.
Avec tout cela, il fallait trouver le détroit pour sortir de cette mer tempétueuse. Après plusieurs jours d'inquiétude et de tâtonnements, on put reconnaître qu'on était à l'entrée du détroit et en face de l'île de Sasbré. On continua la marche avec plus d'assurance, en allant toujours à l'est, et, le 2 octobre, c'est-à-dire huit jours après le départ du fort Nelson, l'escadre se trouvait à, 50 lieues de l'entrée ouest du détroit, devant le cap Charles, au 63e degré de latitude, presque au milieu du parcours du détroit.
On longea ensuite les îles Bonaventure. Ces îles avaient été ainsi nommées dans une expédition précédente, du nom du capitaine de frégate Bonaventure, qui avait accompagné le chevalier en 1689.
On passa ensuite devant les îles sauvages et devant le cap Dragon, au 62e degré de latitude.
Le 9 d'octobre on longeait les îles Button, et enfin le 10 octobre 1697, on était hors de danger à l'entrée du détroit, où l'on avait passé précédemment le 7 juillet, en se rendant dans la baie d'Hudson.
M. de La Potherie cite alors ces vers d'Horace adressés à Virgile, qui se rendait d'Italie à Athènes avec un vent de nord-ouest:
Ventorumque regat pater,
Obstrictis aliis, proeter Iapyga...
C'était le vent d'Iapyx qui était favorable à Virgile, comme lu vent nord-ouest qui poussait l'escadre vers la sortie du détroit.
Dans cette traversée, M. de La Potherie fait remarquer que les équipages furent rudement éprouvés par le scorbut.
Les hommes étaient exposés à prendre cette terrible maladie par l'usage des viandes salées, par les rafales continuelles qui couvraient d'eau les bâtiments, par l'impossibilité de changer d'habits et de linge qui était en petite quantité. Plusieurs succombèrent.
L'escadre arriva à Belle-Isle le 9 novembre, et deux semaines après, Rochefort, terme de la navigation, était en vue.
En terminant sa relation, M. de La Potherie croit devoir assurer que l'occupation de la baie d'Hudson n'offrait pas assez d'avantages de commerce pour affronter les périls d'une navigation si longue et si difficile dans des climats si rigoureux.
Mais tel n'était pas le sentiment du chevalier d'Iberville, qui savait très bien le parti que les Anglais pouvaient tirer de ce pays.
C'est ce qui a été confirmé par la suite des événements. Les Anglais revinrent plus tard; ils s'assurèrent de tout le pays, favorisèrent des associations puissantes, et ces commerçants, avec les subsides et les primes du gouvernement, établirent deux grandes compagnies qui se mirent à la tête du commerce des fourrures dans le monde entier.
Ce sont les deux compagnies de la baie d'Hudson et du Nord-Ouest, qui, jusque dans les derniers temps, ont réalisé des bénéfices montant presque chaque année à la somme de vingt à vingt-cinq millions de francs.
D'Iberville, à son retour, vit le ministre des colonies, et lui exposa avec force la situation de la Nouvelle-France, et le danger que lui faisait courir le voisinage des Anglais.
Ces représentations eurent un plein succès, et le ministre chargea d'Iberville d'une expédition plus considérable que toutes celles qui lui avaient été confiées jusque-là.
C'est ce que nous verrons dans les chapitres suivants.
M. d'Iberville quitta la baie d'Hudson on 1697 et revint en France. Il rendit compte de sa mission et énonça les moyens qu'il y avait à prendre afin d'en assurer le succès. Il parle ainsi de l'avenir des possessions françaises en Amérique:
«Suivant lui, il fallait s'occuper des dangers qui menaçaient nos établissements. Ces dangers venaient du voisinage de puissances qui étaient redoutables par leur nombre et par une position supérieure à celle des colonies françaises.
«Vis-à-vis de nos colonies du nord, les Anglais et les Hollandais occupaient des pays d'un climat tempéré et d'une production surabondante.
«Ils pouvaient attirer des quantités innombrables d'émigrants; de plus, ils pouvaient les établir avantageusement et les fixer pour jamais.
«Les Français qui viennent dans la Nouvelle-France y sont attirés par quelques avantages: par l'immensité des forêts et des pêcheries à exploiter; mais ils ont à, lutter contre un climat si rigoureux, qu'ils ne songent après avoir amassé quelque bien, qu'à s'en aller le faire fructifier dans la mère patrie. De là, une cause d'infériorité pour les colonies françaises. Les Anglais sont établis dans le sud, sous une zône supérieure à celle de leur propre pays; quand ils en ont joui pendant quelques années, il ne veulent plus partir et contribuent à élever ainsi chaque année le chiffre de leur population.
«Aussi les Français ne se comptent que par vingt mille, et leurs voisins par plus de deux cent mille.
«Pour soutenir la concurrence, il faudrait donc que tout en conservant les possessions si avantageuses du nord, la France songeât à occuper les contrées si favorables du sud, sur les rives du Mississipi et du Missouri, et cela jusques aux bords du golfe du Mexique, où se trouvent les plus beaux pays du monde.
«Et ce serait d'autant plus urgent que les Anglais se préparent à s'établir dans ces immenses contrées du sud.»
Et il concluait par ces paroles:
«Si la France ne se saisit de cette partie de l'Amérique qui est la plus belle, pour avoir une colonie capable de résister aux forces de l'occupation anglaise, celle-ci, qui est déjà très considérable, s'augmentera de manière que dans moins de cent années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l'Amérique et en chasser toutes les autres nations.
«D'un autre côté, la possession du Canada ne peut avoir son prix que par l'extension à l'ouest par le Mississipi, et cette extension n'a absolument d'utilité que par la possession des bouches de ce fleuve, qui mettra le grand Ouest en communication avec les îles françaises des Antilles, et principalement avec Saint-Domingue.»
Vauban, dans ses considérations sur l'avenir des colonies françaises, avait absolument les mêmes idées que le chevalier d'Iberville. Quant à la qualité des établissements coloniaux, disait-il, il n'y a rien de plus noble et de plus nécessaire.
«Rien de plus noble, parce qu'il n'y va pas moins que de donner naissance et accroissement à une immense monarchie qui, pouvant s'élever au Canada, à la Louisiane et à Saint-Domingue, deviendra capable de balancer toutes les autres puissances de l'Amérique et d'enrichir les rois de France.
«Rien de plus nécessaire, parce que, sans cet accroissement, à la première guerre avec les Anglais et les Hollandais, nous perdrons nos possessions sans espoir d'y jamais revenir.»
Dans le même temps on remit à M. de Pontchartrain un mémoire qui avait été rédigé par M. d'Ailleboust, fils de l'ancien gouverneur de Montréal, et qui résume toutes les données fournies par les différents explorateurs de l'Ouest et du Mississipi, comme Marquette, Jolliet, La Salle, de Tonty, etc.
«Le pays où l'on propose à Monseigneur d'établir une nouvelle colonie est d'une richesse admirable et du plus bel avenir. Il est d'une grande étendue, car le Mississipi qui l'arrose a plus de six cents lieues de longueur, allant du 46e degré de latitude au 30e.
«Ce fleuve est alimenté par plusieurs rivières très telles, venant les unes de l'est, comme l'Ohio, le Wabash, le Tennessee, les autres de l'ouest, comme le Red River, l'Arkansas et le Missouri.
«Les seuls habitants sont des sauvages paisibles, hospitaliers et amis des Français. Ils sont relativement peu nombreux. Enfin, c'est une contrée d'une fertilité incomparable.
«Le climat est tempéré, l'air pur, le pays capable de produire toutes les choses nécessaires à la vie.
«Le maïs et les vignes y sont en abondance, ainsi que les arbres à fruits, et produisent deux fois par année.
«La plupart des fruits y sont plus gros et meilleurs que les nôtres. Enfin, il y en a des quantités qui nous sont inconnues: les bananes, les ananas, et bien d'autres.
«Les chanvres ont huit à dix pieds de hauteur, les oliviers poussent jusqu'à trente pieds au-dessous des branches.
«Les chênes sont énormes et comparables à ceux de Norwège. Les pêchers, les pruniers, les figuiers produisent des fruits énormes et mûrissent deux fois par an.
«Les copals, les pins, les cypriers, les ciriers, les châtaigniers abondent, et les marronniers sont aussi beaux que ceux de Lyon. Les melons et les patates sont d'un revenu abondant.
«Le gibier est nombreux en castors, en chevreuils, en cerfs plus grands que ceux de l'Europe. Les boeufs sauvages donnent le plus beau cuir; on les rencontre, ainsi que les chevaux, par groupes de plusieurs milliers. Les prairies et les forêts sont remplies de faisans, de pigeons, d'outardes et de dindons sauvages.
«On peut en tirer une infinité de pelleteries, des cuirs et des laines très fines et très abondantes.
«On trouve des métaux en quantité: du plomb, du cuivre, de l'étain, etc.
«Il y a abondance de bois de construction faciles à transporter par la quantité des rivières navigables. Il y a aussi abondance de bois précieux, de couleurs, et propres à la marqueterie.
«Le tabac, le sucre et le coton y viennent très bien et sont aussi beaux que ceux des tropiques.
«Enfin, c'est un pays de plus grand avenir.
«La position est avantageuse au commerce; à proximité des Antilles d'une part, et de l'autre, du Mexique et du Pérou.»
Ces renseignements concordaient avec les assertions de La Salle et de Tonty. Ces hommes héroïques, au prix de leurs jours, avaient non seulement reconnu la richesse incroyable de ces pays, mais ils en avaient aussi frayé le chemin et reconnu les voies. De plus, ils avaient noué des relations qui n'avaient laissé que de bons souvenirs et avaient fait aimer le nom français.
«Quand on examine les extrémités où ces hommes d'un caractère si élevé se sont réduits pour conquérir des empires à l'Europe, quand on pèse le peu de gloire qu'ils ont acquise à côté des misères qu'ils ont supportées, on s'étonne et on gémit de l'oubli où leur mémoire est tombée. Le nom de La Salle avait disparu de cette terre après que les dernières traces de son expédition furent effacées.»
Ces renseignements, qui concordaient avec plusieurs documents que le ministre avait déjà en sa possession, déterminèrent à exécuter immédiatement ce qui avait été arrêté depuis longtemps. On trouvait le moment urgent: on savait que les Anglais avaient l'intention de se rendre au Mexique.
La décision fut prise. Dès le 15 février 1698, M. d'Iberville fut prévenu de réunir tous les Canadiens qui étaient revenus à la Rochelle avec lui et avec son frère de Sérigny, afin qu'ils pussent se joindre à l'expédition.
Le ministre avait l'estime la plus haute pour ces marins intrépides qui s'étaient distingués à la baie d'Hudson et à l'île de Terre-Neuve. M. de Frontenac avait signalé leur mérite en ces termes: «Je me fais fort de fournir des gens plus habiles qu'aucuns de l'Europe: ce sont les Canadiens. Ils naissent canotiers et sont habitués à l'eau comme poissons.»
Ensuite, on procéda à l'armement des bâtiments. Le 10 juin, le ministre donna la liste des officiers. Il y avait deux bâtiments: la Badine, de 40 canons, le Marin, de 30 canons, et plusieurs felouques.
Liste des officiers devant servir sur la Badine: le sieur d'Iberville, capitaine de frégate; le sieur Lescalette, lieutenant de vaisseau: le sieur Moreau, enseigne: le sieur de Marigny, enseigne en second; de La Gauchetière et de Bienville, gardes de marine.
Officiers devant servir sur le Marin: commandant, le sieur de Surgère, capitaine de frégate; le sieur du Hamel et le sieur de Sauvalle, lieutenants de vaisseaux; le sieur de Villautreys, enseigne, et le sieur de Sainte-Colombe, garde de la marine.
Le 10 juin, d'Iberville adressait un nouveau mémoire, où il exposait ses vues en ces termes:
«Pour faire un établissement sur le Mississipi, il faudrait au moins quatre bâtiments:
«1° Un navire de 50 canons avec 250 hommes d'équipage; 2° une frégate de 20 canons, avec 120 hommes; 3° un bâtiment de 12 canons, avec 65 hommes; 4° un bâtiment de charge monté par 80 hommes, dont 30 soldats; huit mois de vivres, avec faculté d'accoster à Saint-Domingue pour prendre de la viande fraîche, si nécessaire dans les grandes traversées. Je n'arrêterai qu'une dizaine de jours, et il serait bon de ne rien dire du but du voyage à Saint-Domingue, à cause de la proximité de la colonie anglaise de la Jamaïque.
«De là, il faudra longer la côte américaine à 50 lieues de la Floride jusqu'à la baie du Saint-Esprit, qui est à moitié de la distance entre la Floride et la baie Saint-Louis, où La Salle était allé atterrir en son voyage.
«La baie du Saint-Esprit est à 100 lieues de la baie Saint-Louis; de là, j'enverrais un bâtiment à l'Acadie pour ramener 50 Canadiens. Il faut des marchandises pour présenter aux sauvages: haches, chaudières, aiguilles, rassades, clous, etc. Ces objets représentent au moins 20,000 francs de dépenses. Enfin, je demanderais que mes ordres soient généraux, comme à la haie d'Hudson, à cause des inconvénients qui arrivent quand les ordres sont trop bornés, dans une entreprise de cette longueur et de cette importance, où l'on ne peut tout prévoir.»
Le 23 juillet, le ministre envoya au sieur d'Iberville ses instructions, dans lesquelles nous voyons qu'il acquiesce à toutes les suggestions qui lui avaient été énoncées.
OCEAN ATLANTIQUE.
Vaste étendue d'eau qui sépare l'Europe et l'Afrique de l'Amérique. Cet océan forme la mer des Antilles, la Manche, la mer d'Irlande, la mer du Nord, la mer Baltique et la Méditerranée, qui communique avec l'Atlantique par des passes très étroites. Les principaux tributaires sont, en Europe; la Tamise, la Seine, la Loire, la Garonne, etc.; en Amérique, le Saint-Laurent, l'Orénoque, l'Amazone, la Plata. Dans cet océan, il y a plusieurs courants; d'abord, le courant équinoxial, qui se dirige du Sénégal au Yucatan, puis le Gulf-Stream, qui longe la côte est de l'Amérique, entre ensuite dans le golfe du Mexique, puis se dirige vers le nord jusqu'au Labrador, d'où il traverse l'Atlantique pour aller échauffer les côtes de la France et de l'Angleterre jusqu'au cap Nord, au sommet de l'Europe. Au sud-est, on trouve ce qu'on appelle la mer des sargasses, vaste assemblage de plantes marines qui rendent la navigation difficile.
Tous les préparatifs étaient faits avec le soin que d'Iberville mettait à tout ce qu'il entreprenait. Le départ fut fixé pour le 24 octobre 1698.
Il y avait quatre bâtiments; deux frégates: la Badine et le Marin. Il y avait 200 hommes d'équipage, dont 50 Canadiens et le reste moitié soldats et matelots, et près de 100 canons.
M. d'Iberville, comme toujours, avait pris soin des intérêts spirituels de ses hommes. Il avait avec lui un aumônier, et sur l'autre bâtiment, le Père Anastase Douay, qui connaissait les langues indiennes et avait accompagné M. de La Salle en 1682 dans son exploration du Mississipi.
D'Iberville comprenait l'importance de la mission qui lui était confiée; il savait qu'il avait à lutter contre de grands obstacles; la traversée dans des mers inconnues, la jalousie et la haine de deux nations puissantes fortement implantées dans ce nouveau monde: l'Espagne avec le Mexique et le Pérou; l'Angleterre avec les rives de l'Atlantique depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu'à la Caroline.
Mais il mettait sa confiance dans ce souverain Maître qui lui avait donné le succès dans les tentatives les plus aventureuses. C'était ce qui le distinguait tout particulièrement; une audace invincible et un esprit de foi qui lui montrait, au-dessus de toute chose, la divine Providence et les intérêts de la religion.
Nous avons sous les yeux trois relations de ce premier voyage: celle de M. d'Iberville, celle de M. de Surgère, et celle d'un maître charpentier, qui est pleine de détails et qui s'accorde avec les deux autres sur les points essentiels.
Nous remarquons d'abord que le départ de l'escadre ne fut signalé par aucune démonstration publique, et cependant il s'agissait de conquérir un monde. Il y avait une raison à cette absence de publicité; on ne voulait pas donner l'éveil aux Anglais ni aux Espagnols, et M. d'Iberville avait recommandé lui-même d'expliquer son départ par la nécessité d'aller porter des renforts à l'Acadie et à la Nouvelle-France.
L'expédition devait suivre la voie inaugurée par Christophe Colomb dans sa première traversée. Il fallait longer l'Afrique jusqu'aux îles Canaries. La se trouvent ces vents alizés qui, vers le 23e degré de latitude, soufflent avec force de l'est à l'ouest; ensuite l'on devait remonter au nord pour trouver l'île de Saint-Domingue, occupée en partie par les Français et où l'on devait avoir un premier lieu de ravitaillement.
Douze jours après le départ de Brest, on était au 28e degré en vue de l'île de Madère et celle de Porto Santo.
On suivit alors la direction des vents alizés, et l'on traversa cette partie de la mer que l'on voit toute couverte d'herbes et de plantes tropicales apportées par les courants marins qui vont de l'Amérique à l'Afrique.
Le 19, on arriva au tropique du cancer, au 23e degré de latitude, et M. de Surgère nous dit qu'il fallut subir la cérémonie du baptême, qui était déjà dans les traditions des hommes de mer.
C'était le 20 novembre. Tous les matelots, dans les costumes les plus grotesques qui représentaient les divinités de la mer, s'adressaient à ceux qui traversaient la ligne pour la première fois et les obligeaient à passer par une immersion plus ou moins complète, que l'on appelait le baptême du tropique. Il suffisait d'une petite gratification pour en être dispensé.
Au bout de quelques jours on s'aperçut qu'on approchait de contrées nouvelles; les régions tropicales. L'air était plus doux, le ciel d'un éclat ravissant. On y contemplait des nuances claires et profondes qui semblaient révéler quelque chose de l'immensité du firmament. Les doux zéphirs qui répandaient leurs effluves rafraîchissaient et apportaient en même temps l'odeur suave de plantes et de parfums inconnus aux régions que l'on venait de quitter.
A ce signe, M. d'Iberville voyait l'approche des terres bénies qu'il recherchait. Les Canadiens, dont les sens si subtils n'avaient éprouvé jusque-là que les impressions après du nord, saluèrent l'annonce d'une contrée nouvelle, les douces visions du matin, les splendeurs du milieu du jour, les spectacles féeriques du soleil couchant, tout était nouveau pour ces rudes explorateurs des régions du nord.
Enfin, on contempla, les cimes lointaines de la plus belle île de l'archipel Indien; c'était l'île d'Haïti, que les Espagnols, un souvenir de la patrie, avaient baptisée du nom gracieux d'Hispaniola. Cette île, presque aussi grande que l'Irlande, s'élève en pyramide sur l'Océan.
Dans le lointain, l'on contemplait des montagnes qui semblaient étagées jusqu'à la hauteur de 3,000 pieds, elles présentaient les formes les plus élégantes. On pouvait admirer sur l'horizon les cimes bleues des derniers sommets; sur lea penchants, des forêts et une végétation abondante; sur les rives, les dentelures des baies, coupées par des promontoires couverts de mousse et venant apporter jusqu'au sein de la mer des géants de verdure qui baignaient leurs branches au sein des ondes les plus transparentes. Ces eaux reflétaient le pur azur du ciel; au loin, des échappées laissaient contempler des étendues immenses, plantées de palmiers et d'orangers, qui offraient des dispositions régulières comme celles de la main de l'homme.
Les richesses de la nature tropicale resplendissaient partout; des pins et des palmiers énormes, des cactus gigantesques. C'était une succession, non interrompue de prodiges.
Les équipages acclamaient au passage ces visions enchantées, et faisaient retentir les airs de cantiques sacrés que la surface unie des eaux rendaient encore plus éclatants.
«Le 3 décembre, nous voyons le cap Français, qui avait été atteint en 39 jours depuis le départ de Brest. Aussitôt l'équipage se met à l'oeuvre et l'on fait de l'eau, du bois, de la viande fraîche et des volailles pour le soulagement des hommes. On fait du biscuit avec la fleur, parce qu'il n'y avait pas eu de place pour en emporter sur les bâtiments; enfin, l'on monte les embarcations, les biscayennes qui avaient été mises en bottes sur le pont.
M. de Chateaumorand était arrivé le 30 novembre 1698.
C'était le commandant d'un bâtiment du 50 canons, nommé le Français, qui avait été désigné pour venir assister M. d'Iberville dans sa prise de possession des rives du golfe du Mexique. Il était le neveu de M. de Tourville et le parent de M. d'Urfé, prêtre de Saint-Sulpice à Montréal, Enfin, comme M. Ducasse, le gouverneur, ne se trouvait pas au Cap, mais avait été se reposer au sud de l'île, dans le district de Léogane, M. d'Iberville s'y dirigea aussitôt.
M. d'Iberville se mit en rapports avec le gouverneur et obtint tous les ravitaillements qui lui étaient nécessaires. Le gouverneur parut enchanté des vues du commandant et de son air de résolution. Il lui accorda quelques flibustiers pour remplacer les hommes qui avaient succombé dans la traversée; il y avait six Canadiens et deux écrivains de morts, ce qui fait dire a M. d'Iberville: «La maladie n'en veut qu'aux Canadiens et aux écrivains.»
M. d'Iberville dit qu'il partit de Léogane le premier jour de l'année 1699, à midi, étant alors au 78e degré de longitude.
Il savait très bien qu'il ne devait pas suivre le côté nord de l'île de Cuba, à cause des grands courants venant du sud, qui font le tour du golfe du Mexique et qui remontent par le bras de mer situé entre Cuba et la Floride.
Il longea donc avec son escadre la côte sud de l'île de Cuba. Il parcourut toutes ces petites îles qui environnent Cuba au sud, qui sont ravissantes de fraîcheur et de forme, couvertes de palmiers et d'orangers chargés de fleurs et de fruits. Il vit alors ces sites enchanteurs et parfumés que Christophe Colomb avait appelés «les jardins de la reine», à cause des merveilles de leur végétation. Il fallait passer au milieu de ces îles environnées de coraux et de madrépores, où les navires pouvaient échouer; mais le commandant savait trouver son chemin au milieu de tous ces obstacles. Il était d'ailleurs grandement aidé par l'expérience d'un vieux marin nommé M. de Graff, que M. de Chateaumorand avait pris avec lui au Cap, et qui avait navigué pendant plusieurs années au milieu de ces parages.
Le 4 janvier, on était à l'extrémité ouest de Saint-Domingue; ensuite, on arriva à Santiago, ville principale de Cuba. Le 9, on était au cap de Corientes, à l'extrémité ouest de Cuba; et enfin, le jour suivant, en face du cap de Cruz, ainsi nommé parce que Christophe Colomb y avait planté une croix.
Les jours suivants, on entrait dans les eaux de la Floride, et en suivant les courants du sud, l'on avançait vers les côtes est du golfe.
La Badine, le Marin et le Français voguaient de conserve dans le golfe, accompagnés des felouques et des tartanes qui portaient les provisions.
Pour ceux qui connaissaient le but de ce voyage, le spectacle était imposant. C'était une marche comparable à celle de l'escadre de Christophe Colomb, lorsqu'il accosta, non loin de là, aux premières Antilles.
C'était un nouveau monde que d'Iberville allait aborder; il était considérable et était réservé au plus grand avenir.
Actuellement, les Antilles, où s'arrêtèrent les explorations de Colomb, ne comptent pas un million d'habitants, tandis que les pays dont M. d'Iberville allait prendre possession en comptent aujourd'hui près de dix millions, et la dixième partie seule est encore explorée.
Le 2 février, on passa près des îles à l'ouest qui cachent le delta du Mississipi. Elle furent nommées, de la fête du jour, du nom d'îles de la Chandeleur, qu'elles conservent encore aujourd'hui. M. d'Iberville, ni personne de l'équipage, ni M. de Graff, ni le pilote qui lui avait été donné par M. Ducasse, ne connaissaient l'existence de cet immense triangle de détritus, amenés au milieu de la mer par le Mississipi et qui, à partir du trentième degré, s'avance dans la mer et à près de quarante lieues d'étendue.
Il avait calculé que le Mississipi débouchait au 30e degré de latitude, à mi-distance de la baie Saint-Louis et de la Floride, laquelle côte suivait constamment la ligne du 30e degré de latitude. Il ignorait que le Mississipi, arrivé à cette hauteur, avait amené un immense amas d'alluvion, et que son embouchure était reportée à 40 lieues plus loin.
D'ailleurs, il voulait avant tout explorer les rives des possessions espagnoles. Il dirigea donc ses bâtiments vers le 30e degré, en marchant en ligne droite à partir de l'extrémité ouest de l'île de Cuba.
Après avoir dépassé les îles de la Chandeleur, il se dirigea à l'est pour explorer toute la côte, en commençant, du côté de la Floride, par les pays occupés par les Espagnols.
Il aborda d'abord au 90e degré de longitude, et il reconnut Pensacola, station espagnole. Il la croyait considérable, mais il n'y trouva que quelques soldats. Il se dirigea vers l'ouest pour explorer la côte et la débarrasser de toute occupation étrangère.
Il parcourut la côte depuis la Floride à l'est jusqu'aux lacs situés à l'ouest à la tête du delta, examinant et sondant partout. Alors, ayant vérifié qu'il n'y avait ni Anglais ni Espagnols dans tout ce parcours, et de plus ayant appris par les relations des sauvages et par le témoignage des Espagnols qu'il y avait l'embouchure d'un grand fleuve en remontant au sud-ouest, il se décida à prendre connaissance de ces localités.
Il commença par établir un fort dans l'endroit qu'il jugea le plus convenable, à moitié chemin de l'occupation des Espagnols à Pensacola.
Pendant qu'il était occupé à cet établissement, il examina tout le pays d'alentour et accueillit avec empressement la visite des tribus sauvages environnantes.
Quant au pays, il était presque aussi beau que le littoral de Saint-Domingue. L'on voyait des pins et des cypriers sur de grandes étendues, des prairies surabondantes, des arbres à fruits d'une force de végétation inconnue en Europe. Tout était à l'avenant: des outardes ou oies sauvages énormes, des poules d'Inde qui volaient par légions et que l'on pouvait prendre avec la main ou tuer à coups de fusil sans enrayer les autres. Dans ces étendues, des fruits pleins de saveur, des plantes pleines d'arômes, une végétation vigoureuse recelant dans ses profondeurs des milliers d'oiseaux pélagiques: des cormorans, des canards, des flamants; tandis que le vol et les cris des perroquets animaient la solitude.
Le 4 février, M. d'Iberville fit une excursion sur les bords: il vit des quantités de chênes de la plus belle venue, des ormes, des frênes, des pins, des vignes en grand nombre; sur le sol, des herbes vigoureuses semées de violettes, de giroflées, de féveroles, comme à Saint-Domingue; des noyers d'une fine écorce, des bouleaux. Le temps était très beau, l'air très chaud. Il explorait et faisait sonder toutes les embouchures des fleuves principaux qui se rendaient à la mer.
Après l'admiration pour les richesses de cette nature presque tropicale, M. d'Iberville avait une attention particulière pour s'attirer la confiance et l'affection des indigènes, qui entraient pour une grande part dans ses projets d'avenir.
Ceux-ci détestaient les Espagnols, dont ils avaient depuis longtemps éprouvé le caractère violent et implacable; de plus, ils surent bientôt que les Français établis dans les régions du Nord s'étaient toujours attachés à, gagner les Indiens qui les environnaient, par les procédés les plus affectueux et les plus généreux.
Les Biloxis vinrent d'abord saluer les nouveaux arrivés, et il paraît, d'après la relation de Pénicaud, qu'ils purent s'entendre avec plusieurs Canadiens qui connaissaient l'iroquois et qui formaient une forte partie des équipages.
Après les Biloxis, vinrent cinq autres nations situées aux environs du Mississipi: les Bayagoulas, les Chichipiacs, les Oumas, les Tonicas.
Pénicaud raconte les cérémonies qui accompagnaient ces rencontres. Les sauvages arrivaient en présentant, en signe de bienvenue, une énorme pipe longue d'une aune, ornée dans toute sa longueur d'une immense quantité de plumes disposées en forme d'un vaste éventail; c'est ce qu'ils appelaient «le calumet». Ils le chargeaient de tabac, l'allumaient, puis le présentaient au nouvel arrivé. M. d'Iberville, qui n'avait jamais fumé, nous dit-il, n'en pouvait supporter le goût, mais il ne disait rien, fumait et refumait avec la plus grande complaisance. Pénicaud rend compte d'une de ces cérémonies, qui fut plus solennelle que les autres.
Les chefs des cinq nations que nous venons de nommer vinrent au fort avec leurs hommes. Ils chantaient tous. Ils commencèrent par dresser un poteau orné de verdure et de couleurs éclatantes, puis ils dansèrent autour, tandis que plusieurs d'entre eux allèrent chercher M. d'Iberville. Chantant avec leurs instruments et leurs tambours, ils firent monter M. d'Iberville sur le dos d'un sauvage, qui devait servir de coursier, et qui imitait l'allure et les courbettes et même les hennissements d'un cheval d'apparat.
Lorsqu'on fut arrivé au poteau, on fit asseoir M. d'Iberville avec ses gens sur des peaux de chevreuils, puis on commença une danse guerrière pendant laquelle chacun des sauvages, revêtu de ses armes, allait frapper de son casse-tête des coups sur le poteau et racontait ses exploits.
M. d'Iberville répondit à ces démonstrations en faisant venir les présents: des couteaux, des rassades, du vermillon, des fusils, des miroirs, des peignes; de plus, des habillements; des capots, des mitasses, des chemises, des colliers et des bagues. Les Canadiens, qui avaient l'usage de tous ces habillements, en revêtaient les sauvages. Après cela M. d'Iberville servit un repas pour tous les assistants; de la sagamité aux pruneaux, des confitures, du vin, de l'eau-de-vie, à laquelle on mit le feu, ce qui émerveilla les sauvages.
Après cette cérémonie, M. d'Iberville prit ses dispositions pour continuer son exploration. Il savait désormais où était l'embouchure du Mississipi, c'est-à-dire à quinze ou vingt lieues au sud-ouest. Là se trouvait l'embouchure d'un grand fleuve que les sauvages appelaient la Malbanchia, et les Espagnols, la rivière aux Palissades, à cause des arbres qui on barraient l'ouverture, ce qui s'accordait avec les relations de M. de La Salle.
M. d'Iberville avait reconnu qu'il n'y avait ni Anglais ni Espagnols dans le golfe, et qu'il n'avait à craindre aucune rencontre ennemie. Dès lors, il prit congé de M. de Chateaumorand, dont il n'avait plus à réclamer l'assistance. Ils se quittèrent dans les meilleurs termes.
M. de Chateaumorand appréciait hautement la capacité et le zèle de M. d'Iberville, et il le traitait avec la plus grande considération, comme un vrai gentilhomme. Cela formait un contraste sensible avec les duretés que M. de La Salle avait eu à endurer du commissaire de la marine royale qui l'accompagnait, et qui, par son entêtement et son ignorance, avait fait manquer toute l'entreprise. M. de Chateaumorand laissa une centaine de barriques de vin, de la fleur et du beurre dont M. d'Iberville avait besoin, et il partit pour Saint-Domingue, où il pouvait se ravitailler.
M. de Chateaumorand partit le 20 février. M. d'Iberville fit ses préparatifs de voyage. Il était assuré qu'il n'avait aucun obstacle à craindre de la part des Espagnols ni de la part des Anglais. Il savait qu'il pouvait compter sur les bonnes dispositions des sauvages.
Le 27 février, jour fixé, il partit de Biloxi avec deux biscayennes et deux canots, et 50 hommes armés de fusils et de haches. Ils avaient pour 20 jours de vivres. Presque tous ces hommes étaient des Canadiens éprouvés dans les expéditions précédentes, et les autres, des flibustiers de Saint-Domingue.
Il y avait deux pierriers sur les biscayennes pour imposer aux sauvages. M. d'Iberville était sur l'une des biscayennes avec son frère M. de Bienville, et M. de Sauvalle sur l'autre, avec le Père Anastase, Récollet, qui avait sa chapelle avec lui. Les prières se faisaient matin et soir comme sur les vaisseaux, et lorsqu'on pouvait débarquer le dimanche, le père disait la messe.
Le 27 et le 28, on commença à longer à l'ouest une grande île de sable. On passa ensuite devant plusieurs baies environnées d'herbe et de joncs, mais sans bois.
En naviguant, on faisait la plus grande attention à ne passer l'embouchure d'aucune rivière.
Le 1er mars, qui était un dimanche, on aborda à une île, et le père dit la messe pour l'équipage.
L'autel fut dressé sous un bouquet d'arbres, et connue le sol était très humide en quelques endroits, d'Iberville fit couper des branches pour les mettre sous les pieds des hommes, afin de les préserver de toute incommodité. Dans la journée, les gens tuèrent plusieurs chats sauvages: l'île en était remplie, et on l'appela l'île aux Chats, nom qui a subsisté jusqu'à présent.
Il fallait tenir la mer à une certaine distance parce que le vent était violent et pouvait pousser sur les rochers; mais en même temps il ne fallait pas s'éloigner beaucoup, pour n'être pas enlevé par la mer, qui était très forte.
«C'est un métier bien gaillard, dit M. d'Iberville, que de découvrir les côtes de la mer avec des chaloupes qui ne sont ni assez grandes pour tenir la mer quand elles sont sous voiles, ni même quand elles sont à l'ancré, et qui sont trop grandes pour aborder à une côte plate, où elles touchent et échouent à une demi-lieue au large.»
C'est alors qu'étant obligé de gagner la côte, l'équipage, vers le soir du 2 mars, aperçut des rochers très rapprochés les uns des autres et à travers lesquels passait un grand courant.
C'était une rivière, et d'Iberville pressentit que c'était celle qu'il cherchait.
Il s'approcha avec précaution, parce que le courant était rapide à faire une lieue et demie à l'heure. M. d'Iberville reconnut alors plusieurs circonstances qui s'accordaient avec les informations de M. de La Salle.
Les eaux conservaient leur douceur à une grande distance dans la mer, comme l'avait dit M. de La Salle. Les roches étaient très nombreuses, très rapprochées et l'on voyait qu'elles étaient de bois pétrifié avec la vase; elles résistaient à la mer et elles étaient toutes noires; parfois elles étaient espacées de vingt pas et d'autres fois beaucoup plus; mais elles conservaient l'aspect d'une palissade, comme l'avaient affirmé les Espagnols. Le fleuve avait 400 toises de largeur, avec une rapidité extraordinaire.
D'Iberville reconnut que c'était le Mississipi, et qu'il contemplait cette embouchure que M. de La Salle n'avait pu découvrir.
La satisfaction était grande chez tous ceux qui prenaient part à l'expédition. Les gens d'Iberville, qui lui étaient si dévoués, étaient heureux de voir leur chef bien-aimé couronné encore de succès dans une entreprise tentée vainement jusqu'à lui. M. d'Iberville remerciait la divine Providence; il voyait se réaliser toutes ses espérances. Il se trouvait comme en possession d'un nouveau monde qu'il avait promis au roi et à M. de Pontchartrain; enfin, le titre de gouverneur de la Louisiane lui était désormais acquis. Le Père Douay considérait surtout les intérêts spirituels de ce grand continent.
Le lendemain, 3 mars, l'équipage aborda à l'entrée du fleuve; au matin, la sainte, messe fut dite en actions de grâces et on chanta le Te Deum.
L'émotion du Père Douay, qui était un saint homme, était au comble, et il sut la communiquer à son auditoire. «C'était une terre nouvelle, conquise au Sauveur, où son nom serait béni et exalté», et il faut reconnaître que les fervents chrétiens auxquels il s'adressait pouvaient comprendre ces pieux sentiments. Quant à d'Iberville, comme l'avait déjà remarqué le Père Marest dans l'expédition de la baie d'Hudson, il était toujours le premier à donner l'exemple dans les manifestations de la piété.
L'équipage, avant de continuer sa course, resta au repos sous les arbres pour se remettre des fatigues des jours précédents.
«Nous sentons, dit M, d'Iberville, couchés sur des roseaux et à l'abri du mauvais temps, le plaisir qu'il y a de se voir délivrés d'un péril évident.»
Le lendemain, mercredi des Cendres, la messe fut encore célébrée, et les gens reçurent les cendres, avec les officiers en tête.
On commença ensuite à remonter la rivière. A quelques lieues on trouva ce que les précédents explorateurs avaient appelé une fourche, c'est-à-dire une division de la rivière en trois courants différents. C'était une confirmation de toutes les antres indications que M. de La Salle avait données sur l'embouchure du Mississipi.
Après ces assurances, pour faire acte de possession au nom de l'Église, M. d'Iberville fit planter une croix par ses hommes, et le Père Récollet la bénit solennellement, pendant que les matelots l'entouraient à genoux et chantaient le:
Vexilla régis prodeunt,
Fulget crucis mysterium...
M. d'Iberville commença à remonter la rivière. Étant arrive au 30e degré de latitude et au-dessus du Delta il continua sa navigation pour prendre connaissance du pays et de ses ressources.
Il rencontra d'abord le village des Bayagoulas, dont plusieurs habitants étaient venus le visiter au port de Biloxi; là il trouva le meilleur accueil.
Ensuite, il alla au site des Mahongoulas, où l'un des chefs lui vendit, pour une hache, une lettre de M. de Tonty, adressée à M. de La Salle, dans laquelle il lui disait qu'il était venu à son secours, et qu'il avait trouvé toutes les nations des rives du fleuve bien disposées pour les Français.
M. d'Iberville reconnut la vérité de ces dispositions et il continua sa course.
Le pays apparaissait dans toute sa beauté. «Les terres sont les plus belles que l'on puisse jamais voir; elles sont traversées par une infinité de belles et grandes rivières; elles sont couvertes de bois franc, comme chênes, ormes, noyers, de vignes d'une grosseur excessive; des prairies sans fin, les rivières couvertes de canards et d'oies sauvages; les arbres remplis d'oiseaux aux couleurs éclatantes, de perroquets, de geais, d'oiseaux-mouches de toutes sortes.»
Des légions de boeufs sauvages paissent par milliers à travers les prairies.
Voici quel était le plan de M. d'Iberville dans cette exploration. Il voulait choisir un site qui serait au centre des tribus indiennes, pour pouvoir facilement communiquer avec elles, et de plus, qui serait en communication directe avec la mer par l'une des branches du fleuve, de ces fourches dont M. de La Salle avait parlé dans ses relations.
Il trouva d'abord, à 40 lieues de l'embouchure, la nation des Pascomboulas, et au delà, il reconnut qu'il y avait une voie directe vers la mer par ces lacs immenses qui occupent la baie du Delta. Il explora ces lacs, et eu l'honneur des ministres du roi, appela le plus grand du nom de «Pontchartrain», il nomma l'autre «Maurepas».
En remontant, il rencontra une station où se trouvait un mat peint et décoré que les sauvages appelaient Bâton-Rouge. C'était un point de démarcation entre les terrains du chasse des Pascomboulas et de la nation suivante, les Oumas, dont M. d'Iberville voulut visiter le principal village.
Il arriva le 20 mars au village des Oumas. Des chefs l'attendaient sur le rivage avec le calumet de paix. Ils l'entourèrent, le mirent au milieu d'eux et le conduisirent au village en chantant et en dansant. «Arrivés au village, dit M. d'Iberville, nous nous sommes salués et embrassés. Il était une heure de l'après-midi.» Il fallut s'arrêter et recommencer à fumer, «ce qui me fatiguait beaucoup, n'ayant jamais fumé.»
Tout le village était rassemblé. Les tambours et les calebasses accompagnaient le chant, et il y eut plusieurs danses. Ce furent d'abord des danses militaires exécutées par des guerriers revêtus de fourrures, armés de pied on cap et portant sur la fête des mufles d'animaux de toutes sortes, fabriqués avec un rare talent d'imitation.
Ces chants guerriers étaient des sons incohérents, mais non formés au hasard. Les danseurs reproduisaient avec une fidélité parfaite les cris et les hurlements des animaux féroces dont ils mettaient le masque sur leur tête.
Deux bandes de guerriers se plaçaient en présence et, tout en gardant une certaine cadence, ils représentaient un combat, se précipitant et reculant par bonds. Ils brandissaient les casse-tête, se frappaient avec des cris de défi; et, pendant ce temps, les autres guerriers chantaient, en marquant le temps avec des tambours, et en poussant du fond du gosier des cris d'applaudissement, tels que: Hou! Hou! Hou! Hou! ou encore: Ché! Ché! Ché!
Après la danse des guerriers, on passait à des exercices moins effrayants. Les jeunes gens s'avançaient avec les jeunes filles. Ils étaient richement parés à leur manière: ils avaient des diadèmes de plumes qui montaient très haut; leurs ceintures d'orignal brodées en rassades descendaient jusqu'aux genoux; elles étaient ornées tout autour de disques de métal qui retentissaient comme des grelots à chaque mouvement de la danse. Ils étaient peints de rouge, de blanc et de jaune, disposés avec un certain art et figurant des galons et des ornements multipliés. Les jeunes tilles portaient des éventails de plumes dont elles accompagnaient leurs mouvements. Les jeunes gens avaient une sorte de sceptre qui marquait la mesure.
Ces groupes représentaient diverses scènes de la vie sauvage, comme le départ pour la chasse, pour la guerre, le retour, les fiançailles, etc. Les danseurs se lançaient avec une agilité remarquable et en tournant sur eux-mêmes. «Ces danses, nous dit M. d'Iberville, étaient gracieuses et assez jolies, et elles étaient accompagnées de chants pleins de douceur. Quand les sauvages le veulent, ils chantent avec beaucoup d'agrément. Ils ont l'oreille délicate, la voix belle et une disposition remarquable pour la musique.»
Le lendemain, on visita les villages. On vit 150 cabanes, avec une place au centre, de 200 pas de largeur.
Tout autour, on voit s'étendre d'immenses prairies, sans rochers, avec des arbres d'une grande vigueur. Sur les champs s'étalent des fleurs, des citrouilles, des melons et du tabac d'une taille surprenante.»
On alla visiter le temple, qui est au milieu du village. C'est un édifice surmonté d'une coupole; au centre on entretient un feu continuel. A l'extrémité il y a un sanctuaire avec des tables en forme d'autel; sur ces autels étaient disposées des fourrures précieuses et d'autres emblèmes mystérieux.
En revenant à la hauteur de Bâton-Rouge, M. d'Iberville reconnut par ses calculs qu'il était à la latitude de Biloxi, où se trouvaient ses vaisseaux. Alors, il observa les rives et, trouvant au-dessous de Bâton-Rouge un courant d'eau considérable, allant, en droite ligne, du Mississipi dans la direction de l'est, il s'abandonna à ce courant qui, suivant sa prévision, allait se jeter vers la baie de Biloxi. C'est cette rivière que l'on a nommée la rivière d'Iberville, d'après celui qui l'avait découverte. Elle a 25 lieues d'étendue. Elle lui épargna l'immense parcours qu'il lui aurait fallu faire pour descendre le Mississipi avec tous ses détours jusqu'à la mer, au 29e degré, et pour remonter jusqu'au 30e degré à Biloxi. C'était près de 100 lieues d'épargnées. Cette rivière offrait bien des portages, mais elle révélait un pays magnifique, d'une grande abondance en poisson et gibier. On vit passer sur les rives, par centaines, des troupeaux de boeufs au galop.
La rivière su jetait dans le lac Maurepas, qui est la suite du lac Pontchartrain, et de là, M. d'Iberville arrivait le 30 mars à Biloxi, ayant fait 300 lieues environ on 30 jours, y compris les stations aux différentes nations sauvages.
Là, M. d'Iberville écrivit sur son journal: «Depuis un mois de séjour, un peu de curiosité eût dû encourager les personnes qui sont restées, à faire sonder les environs de cette rade avec leurs traversières.» Puis, réfléchissant que cela exprimait un blâme pour ses subordonnés, il a effacé cette phrase pour qu'elle ne fût pas mise dans la copie qu'il devait envoyer au ministre. Les jours suivants, le sondage fut accompli par M. d'Iberville.
Après cette exploration, il jugea qu'il n'y avait pas d'endroit plus convenable que la baie de Biloxi pour l'érection d'un fort, et il fit aussitôt abattre des arbres en quantité suffisante. Ces arbres étaient d'un bois si dur que les haches s'y brisaient. Aussitôt une forge fut établie pour réparer les haches à mesure de l'exploitation.
A la fin du mois, le fort était terminé. Aussitôt on fait descendre les canons avec leurs affûts; on fait aussi installer les vaches et les volailles, puis l'on sème des pois des fèves et du maïs à l'entour du fort. Les Espagnols vinrent alors pour visiter les Français. Ils virent le fort et purent en admirer l'ordonnance.
Cela pouvait leur donner à réfléchir, mais M. d'Iberville s'en inquiétait peu. Il avait jugé ces Espagnols comme des hommes de peu d'importance, et il fait cette réflexion: «Les Espagnols établis dans ces contrées se sont beaucoup nui par leurs alliances avec les Indiens. Les enfants provenant de ces unions, tenaient beaucoup plus du sang sauvage que du sang espagnol: ils étaient chétifs, mous et sans énergie. Je suis certain, ajoutait-il, qu'avec 500 Canadiens, je pourrais enlever le Mexique, où se trouvent tant de trésors.»
Toute cette expédition du Mississipi avait augmenté l'estime que M. d'Iberville avait de ses compagnons d'armes canadiens.
Il les avait vus inébranlables dans les plus grandes fatigues, intrépides, ne reculant devant aucun danger, infatigables dans les marches et dans toutes les manoeuvres. Il avait pu reconnaître avec une sensible complaisance que ses compatriotes étaient au moins égaux à ces flibustiers de Saint-Domingue, que l'on regardait comme les hommes les plus audacieux qu'il y eût alors dans le monde.
De plus, il les avait trouvés d'une ressource précieuse dans les relations avec les sauvages, sachant les gagner par leurs égards et leur amabilité, et pouvant s'en faire comprendre par la connaissance des langues sauvages du Nord, dont beaucoup d'expressions avaient pénétré sur les côtes du golfe. Cela était dû aux Tuscaroras, nation iroquoise établie depuis longtemps dans le voisinage du Mississipi, dans la province de la Caroline.
Le Père Anastase, vu ses fatigues et son grand âge, avait manifesté le désir de revenir en France, ce que M. d'Iberville accorda aussitôt. Il fit venir au fort le jeune aumônier de la Badine. Mais lorsque les fêtes arrivèrent, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux, le 12 avril, le Père Anastase se fit conduire en chaloupe, par M. de Beauharnois, au fort, pour confesser tous ceux qui se présentèrent. Il y revint encore le jeudi saint, y resta jusqu'au jour de Pâques, dit la messe, et le soir, il y eut sermon et vêpres. Après quoi il revint aux vaisseaux pour faire faire les pâques aux gens. Il y eut encore confession, messe et communion.
Tout étant réglé, M. d'Iberville laissa au fort près de 14,000 rations, et de plus, il envoya un traversier à M. Ducasse pour avoir des vivres. Lui-même ne devait pas prendre ce chemin, mais profiter du Gulf-Stream pour sortir du golfe du Mexique.
Il dit: «Le 2 mai, j'ai établi les offices du fort. J'ai fait reconnaître le sieur de Sauvalle, enseigne de vaisseau, pour commander; c'est un garçon sage et de mérite. J'ai mis mon frère de Bienville, âgé de 18 ans, comme lieutenant, et Levasseur-Boussonelle comme major. Je leur laisse 70 hommes, les mousses et, de plus, les équipages des traversières.»
Il laissait les mousses pour séjourner parmi les sauvages afin d'apprendre leur langue. C'est ainsi que son père avait agi autrefois, à Montréal, avec lui et ses autres frères.
Il plut extraordinairement les deux jours suivants, et si abondamment que les eaux de la baie devinrent douces, fait incroyable et cependant réel.
Le 4 mai au matin, on leva l'ancre par un vent du sud-sud-ouest. Au 20 mai ils étaient devant l'île de Cuba, à Matanzas, à dix lieues est de la Havane, et le 23 ils arrivèrent au cap de la Floride.
Le 23 mai, samedi, M. de Surgère avait rencontré trois vaisseaux anglais qui, les prenant pour des forbans, firent mine de tirer sur le Marin. «Ils auraient été bien accommodés s'ils avaient commencé», dit M. de Surgère, qui ne doutait de rien; mais, reconnaissant des vaisseaux français, ils leur firent mille amitiés.
«Ensuite, ils voguèrent de conserve avec nous, et cela heureusement, car ils connaissaient les îles de l'entrée du golfe et ils pouvaient passer le Gulf-Stream, que nous ne connaissions pas.
«Ayant débarqué au golfe le 26 mai, nous remerciâmes Dieu et nous quittâmes les Anglais, car nos frégates allaient mieux que les leurs.
«Nous suivions l'est-nord-est, nous dirigeant vers la France. Nous allions du trentième degré au quarante-cinquième. Là, nous avons été assaillis par une tempête épouvantable; les matelots n'en pouvaient plus. On voulut jeter les canons à la mer, mais on n'osa les déplacer, de peur d'enfoncer le vaisseau. Nous pouvions nous croire à notre dernière heure.
«La Badine n'eut pas les mêmes épreuves, nous ayant devancés.
«Le 1er juillet, arrivée à Chef-de-Bois, puis à l'île d'Aix; et le 2 juillet, entrée dans le port de Rochefort, où nous retrouvâmes la Badine.»
Lorsque M. d'Iberville revint, au mois de juin 1700, de grands changements étaient survenus en France. Louis XIV avait ramené à la paix toute l'Europe coalisée contre lui. Délivré de graves difficultés, il était déterminé à s'occuper exclusivement du bien-être de ses sujets, du développement du commerce et de l'industrie, et enfin des établissements.
Pour bien envisager ces changements, il faut faire quelque retour sur les événements précédents.
De 1690 à 1700, quatre grandes nations: l'Angleterre et la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne et la Savoie s'étaient réunies contre la France, et, malgré ces coalitions et les efforts réunis depuis dix ans, le roi, à force de ménagements et aussi de succès victorieux, était parvenu à se faire accorder une paix qui lui assurait une autorité encore prépondérante en Europe.
Le roi, dès le commencement, avait jugé dans sa sagesse qu'il ne pouvait prolonger indéfiniment une lutte, qui était un si rude fardeau pour ses sujets. Aussi, plusieurs fois il chercha à se faire accorder des conditions convenables d'arrangement, qui furent rejetées avec dédain, par des ennemis fiers de leur puissance et confiants dans leur nombre.
Alors le souverain, déçu dans ses tentatives, résolut de demander à la victoire ce que les voies de conciliation n'avaient pu obtenir, et il y réussit d'une manière inespérée, grâce à cette force et à cette intrépidité qui se révélèrent encore si merveilleusement dans le peuple qu'il gouvernait.
Il put mettre 400,000 hommes sur pied, des troupes aguerries et habituées à vaincre. Il disposa ses forces et ses généraux suivant les centres d'attaque, et, la victoire secondant ses desseins, il inspira à la France un élan et un enthousiasme dignes de la plus grande nation militaire.
Les succès étaient si nombreux, si multipliés, que les coalisés, tout en espérant qu'ils finiraient par lasser la France et l'accabler, pouvaient prévoir qu'ils sortiraient, d'ici là, épuisés et anéantis.
An bout de dix ans de lutte les Anglais et les Hollandais réclamaient la paix. Dans ce laps de temps, les Français avaient remporté plusieurs victoires et enlevé aux ennemis pour près d'un milliard de marchandises.
Les Espagnols ne savaient quel sort attendre: ils avaient été chassés de la Navarre et du Roussillon; ils avaient perdu la Catalogne avec les villes principales: Gironne et Barcelone.
Le roi de Savoie avait perdu plusieurs batailles rangées, et il avait vu succomber dix villes principales.
L'Allemagne avait été chassée de la Flandre, de la Lorraine, de la Franche-Comté, du Palatinat, et, dans toute la confédération, l'on ne savait que prévoir.
La paix de Ryswick, appuyée par les succès des armées de terre et de mer, dans lesquels les exploits d'Iberville au nord de l'Amérique eurent leur part, avait calmé les esprits, et conservait à la France un prestige incomparable.
Le roi avait, fait, il est vrai, de grandes concessions, mais il avait gagné bien des avantages, étant on paix avec l'Allemagne et avec l'Espagne. Il savait en ce moment que, malgré les efforts de l'Autriche, la succession au trône d'Espagne était assurée à l'un de ses enfants.
Il avait reconnu l'autorité du roi d'Angleterre, et n'avait rien à craindre de ce côté.
Débarrassé de ses plus grands soucis, il ne songea plus qu'à rétablir les finances, à procurer le bien-être à ses sujets et à assurer la prospérité des établissements extérieurs.
Il licencia la moitié de ses troupes, réduisit les impôts, suivant les sages traditions laissées par Colbert, et commença à donner le plus grand essor aux Indes Orientales. La France y possédait un territoire immense, avec des points d'une grande importance, parmi lesquels Chandernagor et Pondichéry, qui, en quelques années, devaient compter 50,000 âmes.
Quant aux Indes Occidentales, le roi en comprenait très bien l'importance. Il pensait, d'après Vauban, que l'on pouvait y établir l'un des plus grands royaumes du monde, avec la Nouvelle-France, le cours du Mississipi, la Louisiane, et enfin les Antilles françaises, dont Saint-Domingue formait la partie principale.
Saint-Domingue donnait la clef des possessions espagnoles du Mexique, du Pérou, du Quito, en fournissant l'accès à Carthagène, à Porto Bello et à la Vera Cruz.
Quant à l'embouchure du Mississipi, son occupation donnait l'accès aux richesses de la Louisiane, que Sa Majesté avait fait découvrir depuis plusieurs années, et qui révélaient «dans le nouveau monde un monde nouveau.»
Les nouvelles que M. d'Iberville apportait répondaient bien aux desseins des autorités souveraines. Il arriva en France aux premiers jours de juillet 1699. Il commença par licencier son monde et décharger ses bâtiments, et en même temps il envoyait une copie de son journal à M. de Pontchartrain, ministre de la marine.
Celui-ci lui en accusa aussitôt réception. Il lui demanda de plus amples détails pour la satisfaction du roi, et en même temps il lui fit pressentir la nécessité d'un second voyage.
On destina aussitôt deux bâtiments, la Renommée, de 45 canons, et la Gironde, pour la nouvelle entreprise.
M. de Pontchartrain voyait que les oppositions ne manquaient pas, mais il savait que le roi ne voulait en tenir aucun compte.
Les gens de Montréal, parmi lesquels M. de Longueuil et M. Le Ber, les plus proches parents de M. d'Iberville, avaient écrit que l'occupation, du sud de l'Amérique pouvait nuire gravement aux établissements de la Nouvelle-France.
Le gouverneur de Saint-Domingue, de son côté, voyait avec ombrage cette nouvelle expédition; il pensait que ce serait une disgrâce pour les possessions françaises aux Antilles.
Il disait, dans ses lettres, qu'on allait susciter l'agression des Espagnols. Suivant lui, ils pouvaient mettre 100,000 hommes sur pied et soulever les sauvages, qui étaient au nombre de plusieurs millions, disait-il. «Je crois, ajoutait-il, que M. d'Iberville est un très honnête homme, et bien intentionné, mais il faut se défier de son esprit d'entreprise.»
De plus, des officiers supérieurs de la marine, prévenus contre les succès d'un officier canadien, répandaient le bruit «qu'il ne réussirait pas mieux que La Salle; que son expédition avait été mal menée parce qu'il avait fait trop de retards; qu'il n'avait pas su ménager ses provisions, etc., etc.; enfin qu'il fallait appréhender que les 80 hommes placés à Biloxi ne fussent exposés au même sort que les gens de La Salle.»
M. de Pontchartrain, voulant être à même d'éclairer le roi sur ces objections, demanda à M. d'Iberville de faire un mémoire sur l'importance de son établissement.
M. d'Iberville répondit aussitôt par un factum d'une dizaine de pages. Il avait déjà exposé les avantages que le Canada retirerait de cette entreprise, qui donnerait les moyens de communiquer avec toute l'Amérique centrale par le Mississipi, où les Canadiens avaient déjà des stations importantes. Il montrait ensuite la possibilité de se saisir du Mexique, où se trouvaient des trésors; enfin il affirmait la nécessité d'arrêter l'extension continuelle des Anglais, «déjà trop puissants».
Ensuite M. d'Iberville énumérait les sites occupés par les Espagnols sur le golfe du Mexique, et leur peu de valeur, puis il signalait les conditions favorables pour le commerce des pelleteries et des autres produits.
Il finissait en affirmant que dans ces régions presque tropicales on pouvait récolter les productions des Antilles.
M. de Pontchartrain répondit en recommandant à M. Duguay, l'intendant de la marine à Rochefort, d'activer l'armement des navires destinés à l'expédition.
Il envoyait en même temps la liste des officiers nommés par le roi sur la Renommée, bâtiment de 50 canons: M. d'Iberville, commandant; M. de Ricouard, lieutenant; le sieur Duguay, enseigne; le sieur Desjordy, le sieur de Hautemaison et le sieur de Saint-Hermine, gardes de marine. Dans l'équipage il devait y avoir 50 Canadiens réunis à Rochefort.
M. d'Iberville emmenait avec lui un de ses cousins, M. Lesueur, militaire plein d'expérience, et son frère de Châteauguay, âgé de 14 ans. C'était lui qui était destiné devenir un jour gouverneur de la Guyane.
Sur la Gironde, se trouvaient le chevalier de Surgère, commandant; M. de Villautreys, lieutenant; le sieur de Courcières, lieutenant en second, etc.
M. d'Iberville et M. de Surgère, pour récompense de leurs services, recevaient le titre de chevaliera de Saint-Louis.
Le roi nommait aussi M. de Sauvalle commandant du fort de Biloxi, et M. de Bienville, âgé alors de vingt ans, lieutenant.
En même temps, M. Duguay recevait l'ordre de donner a M. d'Iberville tout ce qu'il avait demandé pour l'armement du fort de Biloxi: 10 pièces de canon, 2,000 boulets, 400 paquets de mitraille, 17,000 livres de poudre à mousquet.
Le départ eut lieu de La Rochelle le 17 septembre 1699, à 8 heures et demie du matin.
Le 11 décembre, c'est-à-dire après 50 jours de navigation, l'escadre arrivait au cap Français, où débarquèrent quatre malades. M. de Galifet, lieutenant du gouverneur, accueillit M. d'Iberville et lui fournit les rafraîchissements nécessaires. On embarqua aussi des volailles et des bestiaux.
Le 22 décembre, départ du cap Français, et, 20 jours après, arrivée au fort de Biloxi.
Le 9 janvier M. de Sauvalle vint à bord, et rendit compte de tout ce qui s'était passé depuis le départ de M. d'Iberville.
Il avait reçu la visite d'un bâtiment anglais commandé par le capitaine Banks, que M. d'Iberville avait fait prisonnier au fort Nelson cinq ans auparavant. Le capitaine, ayant vu le fort de Biloxi, avait dit qu'il reviendrait en force, mais cela n'inquiéta ni M. d'Iberville ni M. de Sauvalle.
Pendant que quelques marchands de Montréal s'inquiétaient de l'établissement de Biloxi, d'autres Canadiens s'en réjouissaient, et y voyaient la source de beaucoup d'avantages pour la Nouvelle-France.
Dès que Mgr l'évêque de Québec avait eu connaissance des succès de M. d'Iberville, il avait envoyé M. de Montigny, son grand vicaire, avec M. d'Avion, missionnaire des Illinois. Ces messieurs parlaient les langues de plusieurs nations sauvages, et ils venaient s'offrir au zèle religieux du chevalier d'Iberville. M. Juchereau de Saint-Denis, oncle de madame d'Iberville, comme nous l'avons vu précédemment, vînt offrir ses services et son expérience; il avait conduit plusieurs hommes avec lui. Il était réservé à plus d'une aventure. Enfin, l'on vit aussi arriver vingt Canadiens commandés par M. de Tonty, qui avait traversé intrépidement toutes les nations sauvages, et qui s'était rendu avec bonheur é cet ancien théâtre de ses premiers exploits. Il était au comble de la satisfaction de voir se réaliser l'oeuvre qu'il avait déjà, tentée avec l'héroïque M. de La Salle.
M. d'Iberville accueillit ces nouveaux auxiliaires avec la plus entière cordialité. Il enjoignit d'abord à M. Lesueur, son cousin, de préparer tout ce qui était nécessaire pour remonter le fleuve avec une vingtaine d'hommes, afin d'aller exploiter aussitôt les mines de cuivre qui lui avaient été signalées au 45e degré de latitude.
Il donna des compagnons à M. de Saint-Denis pour s'en aller explorer les côtes du golfe, à, l'ouest, depuis la Palissade jusqu'à la baie Saint-Louis.
Quant à M. de Tonty, qui connaissait les langues sauvages, ainsi que les Canadiens qui l'avaient accompagné, il lui proposa de remonter le fleuve avec lui. Enfin, il prit aussi avec lui l'aumônier de l'escadre, ainsi que M. de Montigny. Son frère Châteauguay devait être aussi de l'expédition.
Le but de M, d'Iberville était de reconnaître les sites avantageux, de voir quelle était la fertilité de la terre et les productions utiles, enfin de lier des relations avec toutes les tribus sauvages, dont il avait dessein de se servir pour l'exploitation et la colonisation du pays.
Il partit le 1er mars 1700, et en deux jours il atteignit la première île du Mississipi en quittant la mer. Il paraît que c'est alors qu'il commença à être atteint de la fièvre et de douleurs extrêmement vives aux genoux, qui venaient probablement de toutes les fatigues qu'il avait ressenties dans les expéditions précédentes. Il chercha d'abord à vaincre son mal et continua sa marche, mais au bout de quelques semaines, les douleurs furent si vives, qu'il fut obligé de revenir sur ses pas.
Le 3 mars 1700, il débarquait aux Oumas, et renouvelait les arrangements qu'il avait faits avec eux lors de son premier voyage.
Les jours suivants il atteignit le port qui se trouve à l'extrémité nord de la nation des Oumas.
Le 10, il visitait les Natchez, qu'il considérait comme la nation sauvage la plus intelligente, et où il voulait établir une station principale, à laquelle il désirait donner le nom de Sainte-Rosalie, en l'honneur de la patronne de madame la marquise de Pontchartrain.
Le 14 mars, arrivée aux Tasmas, à 15 lieues des Natchez, au 34e degré de latitude. Ce fut le point extrême où se rendit M. d'Iberville. M. de Montigny connaissait la langue de cette nation, et il y fit commencer une église, qu'il devait remettre à un missionnaire du Canada. Lui-même se proposait de résider aux Natchez. Il était capable de rendre les plus grands services aux intérêts do la religion.
M. d'Iberville ayant rempli le principal objet de son excursion, et, se sentant encore plus malade, confia à M. de Bienville la suite des opérations.
Il avait accompli au moins une partie de ce qu'il s'était proposé. Il avait parcouru 200 lieues sur le fleuve, il en avait exploré les rives, et constaté l'abondante fertilité du sol. Il avait noué des relations avec les principales tribus du Sud; il avait pacifié leurs différends, et les avait exhortées à vivre en amitié avec les Français qui allaient s'établir chez eux.
Des missionnaires allaient fonder des sanctuaires et faire connaître les enseignements de la religion, contre lesquels les naturels n'avaient aucune prévention.
M. de Montigny devait s'établir aux Natchez, et un autre religieux devait résider aux Oumas. En même temps, M. Davion allait s'établir aux Illinois, sur l'invitation de ceux-ci, et un Père Jésuite commençait l'érection d'une église aux Bayagoulas.
M. de Tonty, ayant vu les premiers fruits de l'entreprise, reçut une mission particulière. Il devait aller jusqu'aux Illinois, chargé des présents de M. d'Iberville pour concilier les indigènes aux enseignements de M. Davion.
Le 24 mars, M. d'Iberville, revenant vers Bayagoulas, rencontra M. Lesueur, son cousin, qui avait terminé ses préparatifs, et qui allait remonter jusqu'aux chutes Saint-Antoine. Il avait avec lui le sieur Pénicaud, maître charpentier, qui a écrit la relation de cette entreprise. Nous en citerons quelques détails.
Le 25 au matin, M. d'Iberville se dirigea vers Bayagoulas avec son frère de Châteauguay, tandis qu'il envoyait M. de Bienville passer quelques semaines dans les régions de l'Ouest. C'était d'abord son dessein de faire lui-même cette excursion, mais son malaise étant devenu plus grand, il lui fallut confier cette mission à son frère. Il continua son retour en canot, avec deux hommes et le jeune de Châteauguay.
M. d'Iberville, malgré la fièvre qui le tourmentait toujours, et malgré les douleurs qui l'empêchaient de marcher, passa tout ce mois à sonder les passes, à examiner les sites pour les établissements futurs. Enfin, il put recueillir bien des renseignements de la part des sauvages qu'il rencontra.
Il apprit ensuite que des nations sauvages avaient quitté leur position au nord pour s'établir dans un climat plus favorable au sud. Entre autres, il en était ainsi des Tuscaroras, une des cinq nations iroquoises établies près du lac Ontario, qui avaient quitté leurs foyers depuis quelques années, attirés par la douceur du climat du sud, et qui étaient venus se fixer dans la Caroline, et cela, paraît-il, lui suggéra des idées pour l'avenir. Par une disposition particulière, les pays du sud qui étaient les plus doux et les plus fertiles étaient les moins peuplés, et les populations les plus nombreuses étaient au nord. Du golfe du Mexique jusqu'à l'entrée du Missouri, on comptait une vingtaine de petites nations, et ces nations n'étaient composées que de quelques familles, 30 ou 40, et pas davantage.
Pour exploiter tous ces pays, il aurait fallu que les nations du Nord qui sont très nombreuses, comme les Sioux, les Ottawas, les Illinois, fussent déterminées à descendre dans la proximité du golfe, ce qui serait d'un immense avantage pour eux et pour les Français qui voudraient traiter avec eux.
Cette idée, si étrange qu'elle puisse paraître, était déjà venue à plusieurs de ces nations, même les plus sauvages, et, comme nous l'avons dit, les Tuscaroras étaient établis dans la Caroline.
Le 18 du mois de mai, comme il avait été convenu, M. de Bienville, qui avait été en excursion à l'ouest du Mississipi, revint à Biloxi. Il avait fait peu de chemin, et avait rencontré peu d'indigènes. A cette époque de l'année, la fonte des neiges faisait déborder toutes les rivières affluant au Mississipi, qui sortait de ses rives. L'on pouvait à grande peine remonter la force des courants, et l'on ne pouvait aborder, parce, que toutes les côtes étaient submergées à une grande distance. M. de Bienville avait donc peu de renseignements à fournir à son frère.
Le 19 de mai, M. de Montigny et M. Davion arriveront avec deux chefs sauvages des Natchez et des Tonicas.
M. de Montigny était tellement accablé de fatigue, qu'il crut devoir demander de repasser en France. Il pouvait utiliser son voyage en demandant des prêtres à la maison des Missions étrangères à Paris. On pensait néanmoins qu'il était déjà découragé du peu de succès qu'il y avait à espérer parmi ces populations légères et dépravées du Sud.
Le 16 mai, M. d'Iberville donna des instructions à M. de Sauvalle sur ce qu'il y aurait à faire pendant son absence.
«Il insiste sur la nécessité de recueillir toutes ces plantes que connaissent les sauvages, et dont ils se servent pour leurs teintures et pour leurs remèdes.
«Il faut se procurer le plus que l'on pourra de veaux sauvages pour les élever dans les parcs et les domestiquer.
«Il faut rechercher tous les lieux où se trouvent des perles. L'on devra éprouver différents bois en les mettant dans l'eau pour voir quels sont ceux qui ne sont pas attaqués par les vers.
«En attendant que M. Lesueur revienne de son excursion dans le haut Mississipi, il faudra envoyer M. de Saint-Denis pour visiter la rivière de la Marne au pays des Gododaquis.
«Enfin, il faudra s'opposer par tous les moyens à aucune agression de la part des Espagnols.»
Le 28 mai, M d'Iberville ayant fini ses dispositions, partit pour la France avec ses deux vaisseaux. Il était favorisé par un vent sud-sud-ouest.
A partir de 1700, la santé de d'Iberville fut profondément altérée. En 1702, il repassa en France et alla à Paris. Sa femme, née Marie Thérèse de La Pocatière, qu'il avait laissée à La Rochelle, chez son frère de Sérigny, intendant du port de cette ville, vint le rejoindre dans la ville capitale avec Sérigny.
Le 8 octobre 1693, d'Iberville avait épousé a Québec Mlle Marie Thérèse Polette de La Combe-Pocatière, fille de François Polette de La Combe-Pocatière, capitaine au régiment de Carignan Salières, et de dame Marie Anne Juchereau, qui elle-même, à la date du mariage de sa fille avec d'Iberville, avait contracté un second mariage avec le chevalier François Madeleine Ruette, sieur d'Auteuil et de Monceaux, conseiller.
De ce mariage d'Iberville eut deux enfants; Pierre Louis Joseph qui, né et ondoyé le 22 juin 1694, sur le grand banc de Terre-Neuve, reçut le baptême à Québec, le 7 août suivant, des mains de M. Dupré, curé de la cathédrale; le parrain était M. Joseph Le Moyne, sieur de Sérigny, et la marraine, dame Marie Anne Juchereau, épouse de M. d'Auteuil, sa grand'mère; et une fille connue dans le monde sous le nom de dame Grandive de Lavanais.
D'Iberville avait contracté depuis plusieurs années des douleurs rhumatismales, et on ne sait si c'est à cette époque qu'il alla aux eaux de Bourbon-l'Archamhault.
Les bons soins qu'il reçut le remirent en quelques mois. Toute souffrance cessant, il crut pouvoir continuer son oeuvre.
Connaissant les projets de la cour de France sur les colonies des Antilles, il offrit au cabinet de Versailles d'aller surprendre la Barbade et les autres îles occidentales.
On lui accorda ce qu'il demandait. Il partit avec onze vaisseaux de Sa Majesté et trois cents hommes d'équipage. Sur son chemin, en se rendant aux Barbades, il attaqua l'île de Niepce. C'était au commencement d'avril 1706.
Après quelques escarmouches, les habitants, se voyant inférieurs en nombre, et surpris par la rapidité de l'attaque, offrirent de capituler et de se rendre avec tous leurs biens.
Pendant ce temps, la petite armée de d'Iberville parcourait le pays et rançonnait toute la contrée. Elle s'emparait des chevaux, des animaux, des moulins, des serviteurs et des nègres.
M. d'Iberville proposa des conditions de capitulation, elles furent acceptées par le commandant anglais.
La capitulation fut signée le 4 avril 1706. On fit la liste des prisonniers. Elle comprenait le gouverneur, 1758 hommes de guerre, tous les habitants, y compris 7,000 nègres.
D'Iberville s'était en outre emparé de trente navires, les uns armés en guerre, les autres chargés de marchandises.
Les nègres faits prisonniers, s'étant enfuis sur la montagne, à un endroit appelé le Réduit, on stipula que dans les trois mois à partir du jour de la capitulation, on transporterait à la Martinique 1400 nègres, ou la somme de cent piastres par chaque nègre qu'on ne remettrait pas.
Les pertes faites par les Anglais à, Niepce furent immenses.
La conquête de cette île répandit de grandes richesses a la Martinique, où d'Iberville alla déposer ses trophées.
D'Iberville mit bientôt après à la voile pour aller attaquer les flottes marchandes de la Virginie et de la Caroline. Il cingla vers la Havane afin de tomber sur la flotte de la Virginie pendant qu'elle s'assemblait pour retourner en Europe.
Mais, dit M. Guérin, dans son Histoire maritime de la France, cette entreprise importante fut interrompue par la mort prématurée de son chef. D'Iberville, qui avait conservé sa santé pendant vingt années de combats glorieux, de découvertes importantes et d'utiles fondations, fut victime, à la Havane, d'une attaque d'épidémie. M. Guérin affirme que si ses campagnes prodigieuses par leurs résultats avaient eu l'Europe pour témoin, d'Iberville eût en, de son vivant et après sa mort, un nom aussi célèbre que ceux des Jean Bart, des Duguay-Trouin, des Tourville, et serait parvenu, sans conteste, aux plus grands commandements dans la marine.
Depuis longtemps, cet illustre marin était affligé d'une maladie qui lui enlevait toutes ses forces. Il voyait sa santé décliner tous les jours. A un âge qui lui permettait d'espérer une longue existence (il avait à peine 45 ans), il se résigna noblement et il offrit avec générosité le sacrifice de cette existence qu'il avait remplie de tant de faits glorieux et pendant laquelle il croyait pouvoir terminer tant d'oeuvres importantes qu'il avait si admirablement commencées.
Il avait doté son pays de conquêtes immenses, il avait assuré le commerce des produits les plus variés et les plus riches, il s'était rendu maître de tout un immense continent, et était parvenu à détruire complètement le prestige militaire et naval de deux grandes puissances, l'Angleterre et l'Espagne.
D'Iberville voyait la mort arriver à grands pas. Il lui fallait donc renoncer à toutes ses espérances.
Ce qui aggravait sa position, c'était la pensée qu'il abandonnait son oeuvre à des mains qui n'étaient ni assez expérimentées ni assez éprouvées.
A la métropole les affaires étaient dirigées par des hommes d'un mérite incontestable, mais qui ne comprenaient pas l'importance, ni l'avenir de ces pays lointains.
Au centre de ces nouvelles colonies, ceux appelés à les régir se laissaient souvent conduire par des motifs d'intérêt personnel. Il eût fallu, d'une part, des administrateurs parfaitement éclairés sur la valeur des nouvelles conquêtes; d'autre part, une direction désintéressée sur les autorités subalternes.
C'est, dans ces tristes prévisions que le chevalier d'Iberville débarqua à la Havane, étant si malade qu'il ne pouvait plus supporter la mer. Il fut transporté à l'hôpital, où il se prépara sérieusement à recevoir les secours de cette religion qu'il avait si fidèlement observée toute sa vie, et à laquelle il avait toujours eu recours au milieu des plus grands dangers.
D'Iberville expira à la Havane, le 5 juillet 1706, après avoir reçu tous les secours de la religion, comme on en trouve la preuve dans les registres de la paroisse principale de la ville, que nous citons ci-après.
D'Iberville ne fut inhumé que le 5 septembre, dans l'église paroissiale majeure de Saint-Christophe, où on ensevelit plus tard les restes de Christophe Colomb, ramenés de Séville.
Voici comme est relaté l'acte de décès de d'Iberville:
«En la cité de la Havane, le 5 septembre 1706, a été inhumé dans cette sainte église paroissiale majeure de Saint-Christophe, M. Moine de Berbilla, natif du royaume de France, muni des saints sacrements.
«JEAN DE PETTROZA,
«Prêtre de l'église majeure.»
Moine de Berbilla n'est qu'une corruption espagnole de la prononciation de Le Moyne d'Iberville.
Après la mort de son mari, Mme d'Iberville passa en France, et épousa en secondes noces le comte de Béthune, lieutenant général des armées du roi.
Nous voici arrivé au terme de notre oeuvre. Nous avons relaté tout ce qui se rapporte au chevalier d'Iberville. Il nous resterait à faire quelques considérations sur les conséquences de toutes ces grandes expéditions.
D'abord les prévisions de d'Iberville ne se réalisèrent malheureusement que trop. Le gouvernement, au lieu d'accorder sa confiance aux hommes qui avaient donné les plus grandes preuves de dévouement, ne recourut pas à la famille d'Iberville, ni à aucun de ses anciens compagnons d'armes.
La compagnie des Indes, qui s'était emparée de l'administration de la nouvelle colonie, mit à la tête un homme qui ne connaissait pas le pays.
M. de Lamothe-Cadillac fut élu. Il avait quelques faits d'armes à invoquer: l'occupation des lacs, la fondation de la ville de Détroit; mais il était complètement étranger aux intérêts et aux besoins de la Louisiane. M. de Lamothe-Cadillac ne put conserver longtemps sa position de gouverneur, et il s'en alla blâmé par tout le monde.
Après lui, le pays tomba dans les mains de ce qu'on appelait la compagnie du Mississipi, que le malheureux Law avait fondée. Il profita de la mort de d'Iberville pour lancer sur le pavé de Paris une oeuvre qui, au début, eut une étonnante prospérité, et qui aboutit h une épouvantable catastrophe.
Ces deux insuccès rendirent le gouvernement plus prudent et plus attentif, et l'on recourut, dix ans après la mort de d'Iberville, à celui qui l'avait accompagné dans ses expéditions et secondé dans ses entreprises, c'est-à-dire à son frère de Bienville.
Le 4 octobre 1716, M. de Bienville recevait de France des lettres qui le plaçaient à la tête de toute la colonie. Ses mérites avaient été longtemps méconnus, mais on reconnaissait enfin, en ce moment, qu'on ne pouvait se passer de ses services.
Voici comme s'exprimait un intendant français sur les mérites de Bienville, le digne héritier de son frère:
«On ne saurait trop exalter, disait-il, la manière admirable dont M. de Bienville a su s'emparer de l'esprit des sauvages pour les dominer. Il a réussi par sa générosité et sa loyauté; il s'est surtout acquis l'estime de toute la population en sévissant contre toute déprédation commise par les Français.»
Ces paroles peuvent nous faire comprendre la mauvaise foi de M. de Cadillac, qui écrivait alors à, Versailles: «Tous ces Canadiens ne sont que des gens sans respect pour la subordination. Ils ne font aucun cas ni de la religion, ni du gouvernement. Le lieutenant du roi, M. de Bienville, est sans expérience, il est venu en Louisiane à 18 ans, sans avoir servi ni en Canada ni en France.» Ceci est inexact, car M. de Bienville avait alors près de vingt ans de service.
Nommé gouverneur, M. de Bienville s'empressa d'exécuter le projet qu'il avait depuis longtemps d'établir le centre de la colonie à l'extrémité du delta. Il lui donna le nom de Nouvelle-Orléans, en l'honneur du duc d'Orléans, régent du royaume de France. La nouvelle compagnie d'Occident éleva Bienville au commandement général de la Louisiane. Il fut secondé dans son oeuvre par ses frères, les messieurs de Longueuil, qui devinrent successivement gouverneurs de Montréal et de la Nouvelle-France.
Pendant ce temps la colonie se développait. Plusieurs des anciens compagnons de d'Iberville venaient s'y établir chaque année. On voyait y arriver des gens de Montréal, Québec et autres villes.
En 1724, M. de Bienville fut mandé à Paris pour donner des explications sur sa conduite. Il reçut sa démission par suite des rapports calomnieux qui avaient été faits contre lui par des ennemis de la famille de Longueuil. Cinq ans après, en 1731, il fut rétabli dans son commandement; puis ayant terminé son oeuvre, il passa en France, en 1760.
Comme nous l'avons dit en commençant, la France possédait à ce moment presque toute l'Amérique du Nord. Ses possessions, d'une superficie de plus de trois cent mille lieues carrées, s'étendaient de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, et de la baie d'Hudson au golfe du Mexique. Les plus beaux et les plus grands fleuves du monde: le Saint-Laurent, l'Ohio, le Missouri, le Mississipi s'y trouvaient; on y voyait des lacs grands comme des mers: les lacs Érié, Ontario, Huron, Michigan, Supérieur. Nous avons vu toute la part que M. d'Iberville eut à ces merveilleux résultats.
Cette contrée est douée des ressources naturelles les plus diverses et les plus abondantes; ses habitants sont actuellement au nombre de plusieurs millions. Aussi peut-on facilement comprendre la perte immense que fit la France en ne prenant pas les mesures nécessaires pour conserver cet immense territoire, dans lequel elle aurait pu créer un empire d'une incalculable richesse: une France d'outre-mer qui eût imprimé le sceau de son génie sur ce continent.
Quand le sort des armes eut trahi le drapeau des Français, qui luttèrent avec une indomptable énergie, et qui ne succombèrent que sous le nombre, le pays tout entier fut conquis par B'Angleterre. Son gouvernement s'était solennellement; engagé à, respecter tous les droits et privilèges des familles françaises. Néanmoins, beaucoup de ces familles ne voulant pas rester sous la domination des Anglais, émigrèrent sur la rive gauche du Mississipi pour se trouver sur une terre française. Là, ces familles fondèrent les établissements de Saint-Louis, Saint-Ferdinand, Carondelet, Saint-Charles, Sainte-Geneviève, Nouvelle-Madrid, Gasconnade.
Ce mouvement d'émigration vers le nord-ouest se continua, et par suite, les Franco-Canadiens fournirent les premiers groupes de colons de la plupart des États de l'Ouest et de la Rivière-Rouge. Ne s'arrêtant que sur les bords de l'océan Pacifique, ils jetèrent le germe des établissements de Vancouver et de l'Orégon.
Nous les trouvons aussi dans le Nord-Ouest canadien et jusqu'à la baie d'Hudson. La plupart sont dispersés dans les terres, où ils trafiquent avec les indigènes. Des centres qui deviendront vite prospères se sont formés au fort Edmonton, au lac Sainte-Anne, au lac La Biche.
Les Canadiens-Français sont déjà nombreux au Manitoba; ils se sont groupés à Saint-Boniface, à Saint-Norbert, à Sainte-Agathe, à Saint-François-Xavier, à Saint-Laurent.
Dans d'autres États, on rencontre aussi des Canadiens: il y en a dans l'Ohio, l'Iowa, le Dakota, le Montana, le Colorado, l'État de Washington, le Kansas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique.
Dispersés sur un immense territoire, entourés de populations de races différentes, les Canadiens-Français ont conservé leur religion. Dès qu'ils ont pu se rassembler et former des établissements, ils ont demandé des prêtres et ont élevé à leurs frais des temples au Seigneur. La plus grande partie d'entre eux ont conservé comme un trésor précieux leur langue et leurs habitudes nationales.
En 1864, M. E. Duvergier de Hauranne se trouvait dans le Minnesota. «Ce pays, dit-il, est plein de Français. Quelques-uns viennent de la mère patrie, la plupart ont émigré du Canada par les grands lacs. Quand je ne les aurais pas reconnus à, leur langage, leurs plaisanteries, leurs danses, leur gaieté invincible à la fatigue me les auraient désignés.»
«La France a été, jusqu'au milieu du 18e siècle, une des plus grandes puissances coloniales du monde, et l'Espagne seule pouvait lui disputer la prééminence. En effet, au commencement du 18e siècle, elle possédait toute l'Amérique du Nord jusqu'au Mexique sur l'océan Atlantique, et jusqu'à la Californie sur le Pacifique. Le golfe Saint-Laurent, le Canada, les lacs intérieurs, tout le bassin du Mississipi, le Nord-Ouest, l'Orégon et tous les territoires au nord de la Californie et du Mexique, lui appartenaient et formaient deux provinces immenses: le Canada et la Louisiane. Elle avait dans les Antilles plus de la moitié de Saint-Domingue, Sainte-Lucie, la Dominique, Tobago, Saint-Barthélémy, et enfin la Martinique et la Guadeloupe, faibles débris qui lui sont restes de tant de colonies.
«De toutes ces possessions, la plus précieuse était le vaste empire dont elle avait jeté les fondements au nord et à l'ouest de l'Amérique, et qui lui eût assuré une prépondérance incontestable dans le inonde entier.»
Malheureusement, les systèmes erronés, les fausses idées qui présidèrent alors à la direction de ses colonies, firent végéter ces établissements, tandis que ceux des Anglais prospéraient à côté des siens. Mais l'insouciance, l'incapacité de la cour les laissèrent exposés sans défense aux attaques de voisins qui, dix fois plus nombreux que ces malheureux colons, les écrasèrent un dépit d'une résistance énergique.
Ce fut donc sous le règne déplorable de Louis XV que succomba la puissance coloniale de la France: les Anglais lui enlevèrent, on 1763, tout le nord du continent américain. La même année, elle céda à l'Espagne la Louisiane et toutes les régions de l'Ouest, pour éviter de les abandonner aux Anglais, auxquels, dans le même temps, elle dut livrer la Dominique, Saint-Vincent, Tobago.
Ainsi s'accomplit la ruine de l'oeuvre de Richelieu et de Colbert, la ruine coloniale de la France.
Après cette ruine et après les désastres du premier empire, la France ne possédait plus que la Martinique, la Guadeloupe dans les Antilles, et la Réunion dans l'océan Indien; ajoutez les comptoirs de l'Inde, quelques établissements en Guyane et en Sénégal.
A peu près ruinées à la fin de l'empire, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion se sont rapidement relevées, et aujourd'hui, la France peut les mettre en parallèle avec les colonies les plus florissantes. Leur population est beaucoup plus dense que celle du continent européen. La Martinique a près de 160,000 habitants, et elle exporte, rien qu'en sucre, pour plus de 20 millions par an. La Guadeloupe compte 170,000 âmes, la Réunion plus de 180,000, et leurs productions sont supérieures à celles de la Martinique.
Il est à remarquer que par un phénomène rare, la langue et les moeurs de la France, ainsi qu'un ardent amour pour elles, se perpétuent dans celles des anciennes colonies qu'elle a perdues. Témoin, Madagascar; témoin aussi, le Canada. Voilà certes des résultats assez inattendus.
Dans l'Inde, les comptoirs de la France, quoique enclavés dans l'empire indien de l'Angleterre, n'ont pas déchu.
Quant aux établissements du Sénégal, ils se sont développés dans des proportions énormes. La population soumise à la France ne dépassait pas une quinzaine de mille âmes en 1815, et l'on n'y opérait qu'un très maigre trafic. Aujourd'hui la France y a poussé ses postes jusqu'au Niger. Plusieurs millions d'hommes y sont ses tributaires et le commerce du pays, prodigieusement accru, a atteint plus de 50 millions de francs.
L'oeuvre coloniale de la France, dans ce siècle, n'a pas consisté seulement à conserver et à, améliorer les épaves du son ancien domaine; de 1830 à 1847, elle a conquis l'Algérie. L'Algérie ne peut être comparée, ni comme étendue, ni comme fertilité aux immensités de l'Amérique du Nord ou de l'Australie. Mais la France, dans la colonisation de ce pays, a obtenu des résultats précieux. Elle y a implanté plus de quatre cent mille colons européens. Des villes florissantes se sont élevées sur l'emplacement des terrains incultes et des marais fangeux d'il y a quarante ans. Le mouvement commercial atteint cinq cent millions de francs.
A l'Algérie, la France vient d'ajouter la Tunisie, qui rivalisera bientôt de prospérité et de vitalité avec l'Algérie française.
Pour un peuple soi-disant incapable de coloniser, le résultat ne laisse pas que d'être satisfaisant.
En Océanie, la France possède l'archipel de Taïti. La Nouvelle-Calédonie, occupée à une date plus récente, a permis à la France de créer une colonie pénitentiaire dont tout le monde reconnaît l'utilité. Par la Cochinchine, elle a repris pied sur le continent asiatique; et, si ce n'est encore qu'un embrion d'empire colonial en extrême Orient, cet embrion est prodigieusement vivace. Elle paie tous ses frais d'administration, et verse en outre une contribution dans le trésor de la métropole. Sa population est d'un million et demi, et son commerce extérieur très considérable.
De ce qui précède, on peut reconnaître que la France commence à revenir à ces entreprises coloniales qui lui ont fait tant d'honneur au XVIIe siècle.
Dans de pareilles dispositions, le récit de ces grandes oeuvres auxquelles d'Iberville a eu une si large part, ne peut manquer d'intéresser ceux qui se préoccupent de l'agrandissement de la France par les établissements coloniaux.
Le gouvernement français a donné la preuve de ses sympathies particulières pour les anciennes colonies en nommant un des bâtiments nouvellement construits; Le Chevalier d'Iberville.
C'est ce que nous avons appris au moment où nous écrivions les dernières lignes de cette histoire.
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE:
I—De l'établissement de la Nouvelle-France.
II—La famille Le Moyne.
III—Développements de Montréal.
IV—Naissance de Pierre d'Iberville.
V—Les troupes arrivent en Canada.
VI—Expéditions des troupes.
VII—Montréal et ses souvenirs.
VIII—Exploration du fleuve Saint-Laurent.
IX—M. Le Moyne envoie ses enfants en France pour entrer dans la marine.
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE
I—Expéditions à la baie d'Hudson.
II—Aspect de la baie d'Hudson.
III—Expédition dans la colonie anglaise.
IV—Nouvelle expédition à la baie d'Hudson.
V—Siège de Québec.
VI—Nouveaux événements à la baie d'Hudson.
VII—M. d'Iberville à Versailles.
TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE
I—Expédition en Terre-Neuve (1696-1697).
II—Le Gulf-Stream.
III—M. d'Iberville mis à la tête de l'expédition.
IV—Arrivée de M. Beaudoin, aumônier des Abénaquis.
V—Prise de Pémaquid.
VI—Difficultés avec M. de Brouillan.
VII—Prise de Saint-Jean.
VIII—Conquête du territoire.
IX—Énumération des prises, et occupation de 500 lieues carrées en territoire.
X—État actuel de Terre-Neuve, cent bâtiments employés, 20,000 pêcheurs.
QUATRIÈME PARTIE
CHAPITRE
I—IVe expédition à la baie d'Hudson.
II—Arrivée au Labrador.
III—-Rencontre des banquises.
IV—Arrivée dans la baie d'Hudson.
V—Rencontre de trois vaisseaux anglais.
VI—Prise du fort Nelson.
VII—Retour en France.
CINQUIÈME PARTIE
CHAPITRE
I—Expédition du Mississipi.
II—Premier voyage.
III—Arrivée aux Antilles.
IV—Arrivée devant les rives du golfe du Mexique.
V—Voyage à la Malbanchia.
VI—Grands changements on France.
SIXIÈME PARTIE
CHAPITRE
I—Deuxième voyage.
II—Retour en France.
III—Expédition dans les Antilles.
IV—Mort de d'Iberville.
CONCLUSION.