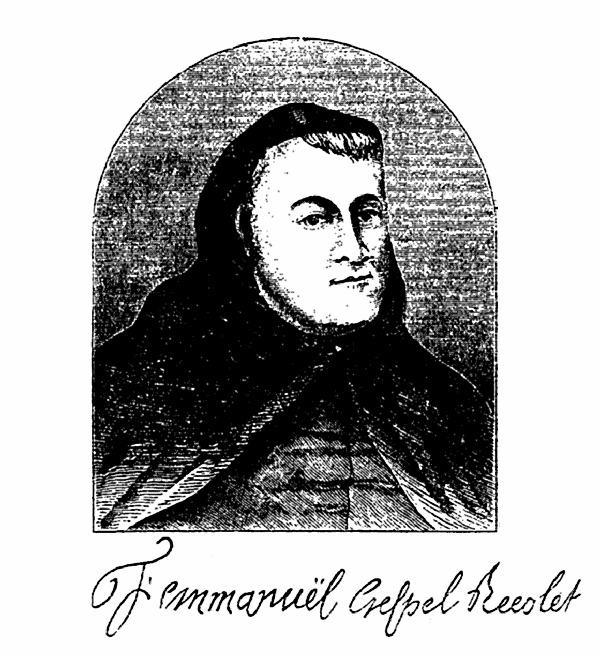
The Project Gutenberg EBook of Les îles
by Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Les îles
Promenades dans le golfe Saint-Laurent: une partie de la Côte Nord,
l'île aux Oeufs, l'Anticosti, l'île Saint-Paul, l'archipel de la
Madeleine
Author: Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice
Release Date: January 28, 2005 [EBook #14828]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES ÎLES ***
Produced by Wallace McLean, Renald Levesque and the Online Distributed
Proofreading Team. This file was produced from images generously
made available by the Canadian Institute for Historical
Microreproductions.
BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE ET NATIONALE
APPROUVÉE PAR Mgr L'ÉVÊQUE DE MONTRÉAL.
2ième SÉRIE IN-8. NEUVIÈME ÉDITION. MONTRÉAL
LIBRAIRIE SAINT-JOSEPH CADIEUX & DEROME
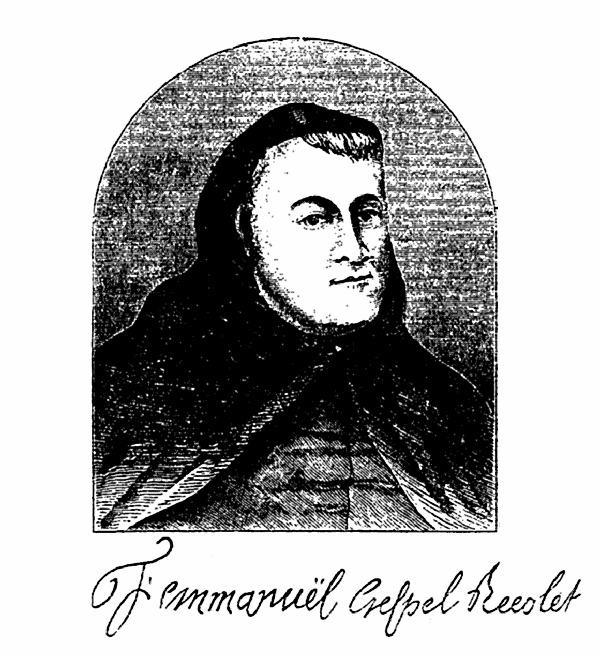

Il me semble encore que les choses que je vais vous raconter se passaient hier; et d'ici, je revois le quai de la Reine tout encombré de pesants colis, de chaînes d'ancres, de rouleaux de câbles, au milieu desquels chuchotaient, riaient et discutaient, bruyants matelots, gens d'affaires et amis venant serrer la main et souhaiter un heureux retour à ceux qui s'embarquaient.
Le steamer sur lequel nous partions était de la taille d'un aviso de première classe, fortement membré, un peu étroit, ce qui—pour les novices—lui faisait trop prêter la bande au roulis, mais à première vue il promettait de se bien défendre à la mer, promesse qu'il nous a noblement tenue. Dans sa cale, sur son pont, le long de ses passerelles, sur son gaillard d'arrière, s'étalait la plus étrange des cargaisons, et dans ce pandémonium indescriptible s'était donné rendez-vous tout ce qui peut servir à un homme qui, sept mois sur douze, se donne le luxe de vivre comme Robinson Crusoë, loin de toute distraction, de toute amitié, de tout secours humain.
Le Napoléon III partait ce matin-là pour ravitailler les phares de la côte et du golfe Saint-Laurent.
Dans les flancs de sa sainte-barbe sommeillaient dix mille livres de poudre à canon qui—affaire nerfs probablement—m'ont toujours semblé être un voisinage peu rassurant pour une centaine de barils de pétrole que nous avions à fond de cale. Des quarts de porc salé et de farine, des ballots de marchandises, des caisses d'épiceries balancées lourdement au crochet d'un fort palan, descendaient et disparaissaient par les écoutilles, pendant que sur le pont on rangeait des cages à poules non loin de deux vaches qui ruminaient mélancoliquement au pied du grand mât, en songeant à ces vertes prairies des plaines d'Abraham qu'elles allaient échanger contre les brouillards de l'Anticosti. Un cochon, insoucieux de son sort, se frottait le dos sur l'affût d'un canon, regardant d'un air satisfait un groupe de matelots qui jetaient de grosses toiles cirées sur des balles de foin destinées à être exposées à l'air, pendant que des camarades empilaient des planches et des bardeaux le long des bastingages. Sur la dunette, une charrette donnait l'accolade à une baleinière. Partout ce n'était que chaos, bourdonnement et travail. L'équipage soigneux et attentif s'empressait de mettre la dernière main aux préparatifs du départ, et l'ordre se faisait vite au milieu de ce tohubohu.
Le carré des passagers faisait bientôt oublier tous ces bruits et cet inextricable fouillis. Le petit salon de l'arrière était simple, coquet avec ses tentures vertes, bien emménagé, et son demi-cercle de divan promettait plus d'une bonne heure de sieste aux coureurs et aux travailleurs de la mer. La salle à dîner où nous devions passer de si douces soirées, se montrait propre, bien éclairée, assez large pour mettre à l'aise quinze personnes. Elle nous permettait d'entrer de plain pied dans des cabines parfaitement ventilées; et c'était plaisir de voir par leurs portières soulevées un lit frais et bien blanc. Tout promettait donc d'aller pour le mieux sur le meilleur des bateaux possibles, et je ne me laissai distraire de toutes ces douces choses que par le premier tour de l'hélice qui nous entraînait vers l'inconnu.
Le temps était superbe, le fleuve calme, mon cigare délicieux, et tout en jetant un regard à ceux qui restaient et qui agitaient leur mouchoir en signe d'adieu, je me mis à examiner curieusement ceux qui devaient être mes camarades de voyage.
Sur la dunette se promenait en paletot gris, le binocle gris d'acier à cheval sur un nez passablement rubicond, un homme à favoris gris dont la tête s'élançait triomphalement hors d'une cravate verte, pour aller s'enfouir sous un chapeau melon. D'une voix bégayante, mais accompagnant chaque mot d'un coup d'oeil dont la vivacité suppléait aux lenteurs de la parole, il donnait des ordres à un colosse qui, debout sur le gaillard d'avant, la moustache en brosse, le teint hâlé, le nez dans le vent, répétait d'une voix de tonnerre chaque monosyllabe tombé des lèvres de son supérieur.
Le monsieur bègue était notre capitaine, un de nos pilotes les plus expérimentés: l'homme au torse herculéen, à la physionomie franche et ouverte qui l'écoutait, n'était que premier lieutenant. Rude tête que celle de LeBlanc, je vous l'assure: il avait le flair des mystères de l'abîme, et sentait une caye, un grain ou un danger à dix lieues à la ronde.
LeBlanc ne savait ni lire, ni écrire, mais sa vie s'était passée sur l'océan. La mer était le livre de cet homme d'airain, et comme la pauvreté et le hasard en lui fermant le chemin de l'école l'avaient jeté loin de toutes connaissances humaines, il avait appris seul, et ne connaissait pour camarades de collège que la tempête et le danger. LeBlanc savait donc par coeur la navigation que nous allions faire, et si de notre époque personne n'eût songé à lui pour en faire un chevalier de la Toison d'Or, du temps de Jason il serait passé d'emblée amiral, et aurait été de force à mener l'expédition des Argonautes.
A tribord, près du capot d'échelle, la casquette galonnée sur le coin de la tête, l'uniforme boutonné jusqu'au col, le teint bronzé, le nez en bec d'aigle, l'oeil doux et profond, Jérôme Savard, notre deuxième lieutenant, s'occupait à transmettre automatiquement les ordres qui pleuvaient du banc de quart à l'adresse de l'homme à la roue.
De la cambuse au capotin qui menait à la salle à manger, notre maître d'hôtel, Raphaël Côté, faisait trottiner son gros ventre tout en transportant fines poulardes, langues salées et grosses pièces de résistance. Cela ne l'empêchait pas, suivant la course qu'il tenait, de lancer un bon mot à William Déchêne, le cordon bleu du bord qui suait et soufflait devant ses fourneaux chauffés à rouge, de saluer obséquieusement un passager qu'il ne connaissait pas, ou de lorgner d'un oeil de fin connaisseur les meilleurs plats du jour. Gai comme pinson, il commençait ce jour là un service agréable pour tous et qui ne se ralentit pas une seconde pendant la durée de nos trois croisières.
Ce va et vient de l'illustre Raphaël faisait pressentir les tintements de la cloche du dîner. Nous étions alors par la travers du phare de Saint-Laurent d'Orléans, et au moment où j'allais me lever, j'aperçus dans la direction du sud scintiller au soleil le clocher de la petite église de Beaumont. Je n'ai jamais pu regarder ce temple agreste et sans prétentions, sans que ma pensée ne repliât ses ailes sur elle-même. Sous cette voûte de bois, étoilée dans le genre du siècle dernier, dans ces vieux murs de 1732, non loin de ces fonts baptismaux à la balustrade en fer forgé et fleurdelysé, dorment la chair de ma chair, les os de mes os. C'est là que mes deux frères Charles et Pierre et que ma chère soeur Joséphine attendent, calmes et impassibles dans la tombe, le jour où il sera du bon plaisir de Dieu de mêler ma poussière à leur poussière.
Personne au milieu de ceux qui prenaient l'air sur le pont et regardaient d'un oeil distrait ce paysage—pour moi le plus aimé, sinon le plus ravissant du monde—ne se serait douté que j'étais en frais de broyer du noir, et déjà autour de moi les manies d'un chacun s'accentuaient.
A deux pas de là, un étudiant en médecine, propriétaire d'un énorme colis de drogues où s'étaient glissés une foule d'instruments aussi utiles que désagréables, tâtait la clientèle du bord, parlant du mal de mer à celui-ci, pronostiquant un rhumatisme à celui-là, faisant à un troisième qui l'écoutait d'un air hagard, le résumé des premiers soins qu'il fallait donner à un noyé, et prévenant chauffeurs et matelots qu'il distribuerait pro bono publico, tout ce qu'exigent brûlures, contusions ou cassures, enfin toute cette série de surprises qui existent entre le perroquet de hune et l'arbre de couche de l'hélice.
Dans les jambes de ce Samaritain anglais, courait et jasait le plus endiablé des gamins, master Birdie, homme de dix ans aux réponses phénoménales, aux théories renversantes, qui un jour, à table, se prit à causer d'histoire naturelle avec un joyeux shérif de ma connaissance, bel esprit, grand parleur, et certes de fil en aiguille ce ne fut pas ce dernier qui eut le beau rôle dans la discussion.
Assis sur un rouleau de chanvre, M. Gagnier, gardien du phare de la pointe aux Bruyères sur l'île d'Anticosti, vrai type du canadien des anciens jours, causait à voix basse avec M. Malouin, jeune homme qui était parti de San Francisco pour aller embrasser son vieux père—autre gardien de phare—et oublier au milieu des joies de la famille sept longues années de travail et d'absence.
Un passager désolé confiait déjà tristement à l'un des ingénieurs qu'il avait eu tort d'oublier son paletot et de partir pour le golfe Saint-Laurent comme on part de chez soi, par une matinée ensoleillée, pour faire le tour du Belvédère. Un autre, debout près du mât d'artimon, chaussé dans ses bottes de sept lieues, coiffé d'une casquette aux formes cosmopolites, le lorgnon ferme sous l'arcade sourcillière, discutait gravement avec son autre compagnon de route, Agénor Gravel, l'importante question de savoir quel était le meilleur temps pour prendre en mer le coup d'appétit, lorsque Raphaël vint mettre tout le monde d'accord eu sonnant vigoureusement la cloche, et clerc médecin, hommes de lettres, gardiens de phare, fils de famille et gamin disparurent en un clin d'oeil du pont, pour aller se mettre en rang d'ognons autour de la table hospitalière du Napoléon III.
Je n'ai pas besoin de dire que ce premier dîner fut assez silencieux. Chacun étudiait la physionomie de son voisin; mais Agénor, qui n'y allait jamais par quatre chemins, et avait déjà la velléité de tutoyer le capitaine, eut bien vite fait circuler parmi les convives cette gaîté chaude et pétillante qui ne cessa de régner entre nous, aux jours de pluie comme aux jours de soleil.
C'était une singulière tête que cet Agénor Gravel, et puisque son nom reviendra souvent sur mes lèvres pendant le récit de ce voyage, j'aime autant vous faire son portrait tout de suite.
Assez grand, large d'épaules, borgne sans le laisser voir le moins du monde, causeur jovial et bon enfant lorsqu'on lui demandait un service ou une anecdote, saupoudrant le moindre récit d'une légère pointe d'exagération gasconne, ce qui n'était pas désagréable, triste comme un saule pleureur dès qu'il approchait une plume de l'encrier, Agénor avait été une foule de choses pendant le cours de sa vie aventureuse. Tour à tour avocat, zouave pontifical, homme de lettres, journaliste, naturaliste, collectionneur, bibliophile, ce nouveau Vichnou avait tout juste conservé de ses différentes incarnations ce qu'il fallait pour véritablement constituer ce qu'on appelle un bon garçon, trois mots dont on fait de nos jours un usage immodéré, et que l'on applique trop souvent à tort et à travers au premier venu.
Railleur sans fiel, hardi par tempérament, serviable et discret par goût, jouissant d'une bonne santé et de l'aurea mediocritas d'Horace, joyeux, bon, prodigue de tout ce qu'il avait, il prenait la vie comme elle se présentait à lui, sans permettre à l'ambition, à l'excès de travail ou à l'envie de lui faire des cheveux blancs, des rides et de la bile avant le temps. Ses ennemis le fuyaient pour ne pas être forcés de devenir ses amis, et sans son incomparable paresse, maître Agénor aurait été de force à courir après eux, pour se les concilier, en ouvrant la conversation par leur dire tout le mal qu'il pensait de lui, et leur faire part de tout le bien qu'il voulait aux autres.
On sait déjà qu'Agénor avait une manière particulière de s'y prendre pour faire causer les gens; aussi ne faut-il pas s'étonner si le lendemain de notre départ, nonchalamment couchés sur une peau de buffle, la tête appuyée sur une bosse de chaloupe, nous étions déjà en frais de prendre des notes sur l'intéressante conversation que nous tenait le gardien d'un des phares de l'Anticosti.
Ceux qui sont habitués aux petites grandeurs, aux grandes misères et aux minces bonheurs des villes, ne sauraient se faire une idée de la vie que mènent là-bas ces braves gens. Obligés de faire cuire leur pain, de tailler leurs habits, de travailler à la menuiserie, de chasser, pêcher, être à la fois médecin, calfat, brasseur, que sais-je? l'été ils n'ont pour distraction que la culture d'un petit carré de terre, si toutefois l'avare récif le permet, l'hiver que d'interminables pipes fumées en tête à tête avec les épaves arrachées à la tempête, et qui flambent tristement dans l'immense âtre en pierre de la cuisine de la tour.
Notre interlocuteur, M. Gagnier, était, un des privilégiés de la bande. Il desservait un phare confortable, spacieux, et lui du moins, pouvait chausser ses raquettes, ou s'acheminer le long des sentiers battus par les ours et les fauves, pour visiter ses voisins et échapper ainsi, cinq ou six fois l'an, au terrible supplice de l'isolement.
—Ah! monsieur, disait-il à Agénor, si vous saviez comme la solitude et le silence amènent l'homme à être serviable et à aimer son semblable. Mon plus proche voisin fit un jour trente-cinq milles à pied pour venir m'apporter une lettre. D'ailleurs, ajouta-t-il en clignant de l'oeil, c'était un rude jarret que celui de mon compère James. Dans un temps de disette il fut onze jours sans pouvoir fumer. Enfin n'y tenant plus, il part, enjambe dix-huit milles par une pluie battante, et me tombe dessus au moment où j'allais souper. Je veux le forcer à passer des habits secs, et à boire un bon verre de rhum. Le rhum, il l'avala sans se faire prier; mais pour ce qui est des hardes et du souper, il fit la sourde oreille, et se mit à battre le briquet et à fumer avec tant d'appétit, qu'une demi-heure après, il était malade, comme un écolier qui a voulu faire l'homme et s'est imbibé de nicotine. Pauvre James! il devait mourir plus tard d'une maladie bien pire que celle-là, et en attendant ce fut lui qui entra l'un des premiers dans la maison de Gamache et le trouva mort, étendu de tout son long sur le plancher, et la main crispée sur l'anse d'une cruche de whiskey.
—Comment Gamache, l'homme aux relations diaboliques, Gamache le mystérieux, Gamache le terrible, le grand Gamache buvait autant que cela? fit d'un ton de profonde commisération maître Agénor, tout en laissant passer un soupir encore tout parfumé par un vieux rhum de Sainte-Croix.
—Oui monsieur, puisque c'est ce vice qui l'a tué, reprit gravement Gagnier. D'ailleurs Gamache n'était pas aussi méchant que nous le fait la légende. Basque, mais bon coeur sous sa rude écorce, il s'était entouré de mystère, et se faisait une réputation de sorcier pour ne pas se voir déranger dans cette vie de liberté et d'isolement qu'il aimait autant que sa gourde et son fusil.
Puis secouant les cendres de sa pipe par dessus la lisse de plat-bord, notre interlocuteur ajouta:
—Nous allons bien, messieurs; voilà que nous sommes déjà par le travers de la Pointe-à-l'Outarde.
Et nous indiquant la terre de la main, Gagnier reprit gravement:
—Voyez-vous là-bas cette maisonnette blanchâtre qui se détache sur les tons gris de la côte? C'est la demeure d'Hawkins, un homme qui a fait une fin bien tragique! Par un de ces temps clairs et froids de décembre, il aperçut un navire abandonné dans les glaces qui montaient lentement avec le reflux. La batture était solide et prise au loin, le temps beau, l'air sec mais sans vent, et, suivi d'un chien, Hawkins partit résolument et se dirigea vers l'épave. Malheureusement le long de la route le vent se fit, la neige fouettée par la brise se mit à poudrer, la mer se prit à travailler sourdement la glace, et bientôt l'infortuné se trouva à la merci d'un îlot flottant. Qu'advint-il? comment et quand le pauvre Hawkins mourut-il? nul ne le sait. Seulement, à quelques jours de là, sa femme voyait revenir au logis le fidèle terreneuve, portant noué au cou, en signe d'adieu et de souvenir, le mouchoir de son maître. Le printemps suivant, Hawkins était retrouvé au large de la Pointe de Mons, gelé, dans l'attitude de la prière, le front, les mains et les genoux scellés encore à sa banquise solitaire!
Pendant que nous écoutions attentivement ces récits de la mer, le Napoléon filait joyeusement dans une forte brise de nord-est. La veille, nous avions ravitaillé le Bicquet; aujourd'hui nous courions dans le nord laissant par tribord les côtes verdoyantes du sud qui, vues de cette distance, paraissent sombres, élevées, ne laissant voir ça et là sur les flancs escarpés des Schick-Shoacks qu'une éblouissante tache de neige, jetée là par l'hiver en signe d'éternel défi au soleil d'été.
Déjà nous avions entrevu Bersimis avec son joli village et son église; vers cinq heures nous doublions la Pointe de Mons1, et l'approche du phare nous était annoncée, en amont, par deux croix de bois qui abritent des tombes de naufragés, et font le plus triste effet sur cette côte montagneuse et boisée, tranchée de fois à autres par des falaises grises, coupées à pic.
Note 1: (retour) La pointe de Mons est ainsi nommée en l'honneur de Pierre du Gua, sieur de Mons, l'infatigable explorateur des côtes de l'Acadie et le fidèle ami de Champlain. L'amiral Bayfield est le seul qui ait maintenu la véritable orthographe de ce nom. Presque toutes les autres cartes indiquent ce lieu sous le nom de Pointe des Monts, ce qui est un non-sens topographique.
Dès sept heures du soir la première chaloupe du steamer était mise à l'eau, et bientôt nous descendions à terre. Debout sur les galets, le maître de céans nous attendait pour nous souhaiter la bienvenue dans son aride domaine, et mettre à notre disposition son fils, dans le cas où nous aimerions à escalader les huit étages du phare, solide construction en pierre qui trône majestueusement au milieu de ses dépendances, de sa poudrière, et de son abri à canon, et qui, de la hauteur de ses 75 pieds, semble narguer les tempêtes de la rose des vents. Nous profitâmes de la bienveillance de notre nouvel ami, montant, grimpant, soufflant, touchant à tout, demandant des explications sur tout, jusqu'à la minute où il nous ramena sains et saufs, mais hors d'haleine sur les galets de la grève.
Le soleil était alors à son couchant, et je n'oublierai jamais le spectacle qui nous ravit ce soir-là. La tour détachait sa façade blanche sur les teintes pourpres de l'occident. Au loin, la mer dormait, et son immense respiration venait mourir au pied des roches moussues que frangeaient de légers flocons d'écume. Debout, dans la porte cintrée du phare, entouré de sa famille qui l'écoutait anxieuse, Ferdinand Fafard, tête nue, la main tremblante, lisait d'une voix qui voulait paraître ferme une lettre que nous lui apportions de l'un de ses fils. Le lecteur pesait gravement chaque mot, savourait à longs traits chaque ligne, s'interrompant pour jeter de temps à autre, par dessus ses lunettes, un regard sur son auditoire attentif.
Cette scène touchante aurait mérité les honneurs de la peinture.
Fermez les yeux et groupez autour de Fafard brunes têtes de fillettes, jeune homme au teint hâlé, profil de vieille et bonne ménagère canadienne; mettez au fond les âpres teintes d'un paysage du Labrador; semez sur l'horizon une poignée de nuages cuivrés qui courent vers le couchant; relisez, avant de crayonner, ce que je viens de vous dire plus haut, et vous aurez un tableau vrai, sinon ravissant.
—Ah! le manque de nouvelles, nous disait le brave Fafard, c'est ce qui nous rend la vie si triste. J'ai bien là, ajoutait-il en montrant sa lettre, de quoi me consoler pour quelques jours; mais mon fils Pierre, qu'est-il devenu? Et mon plus jeune frère, laissé malade dès l'automne dernier, est-il mort? Et ma petite propriété du Saguenay, est-elle brûlée lors des derniers incendies? L'incertitude fait pousser bien des cheveux blancs. Heureux encore si nous n'avons que cela—mais les jours d'hiver se font quelquefois bien longs ici; à preuve ceux de l'an dernier. Figurez-vous que vers la fin de l'automne, dès les premières bordées de neige, ma famille fut attaquée par les fièvres typhoïdes. Les débuts de la terrible maladie eu mirent sept au lit, et bientôt les autres suivirent. J'étais seul valide. Mon plus proche voisin demeurait à vingt milles, et comme les mauvaises nouvelles n'ont pas besoin d'un fort vent pour être portées au loin, le phare était déjà signalé comme un foyer d'infection aux Indiens qui faisaient un détour pour ne pas le trouver sur leur passage. Un seul homme fut touché de mon malheur. Un matin Laurent Thibeau se présenta à ma porte et me fit part de sa détermination de rester avec moi et de m'aider. Tout alla mieux pour quelque temps; mais comme nous étions alors aux derniers jours de la navigation, les brouillards et la neige se mirent de la partie, et nous forcèrent de tirer du canon toutes les demies, quelquefois tous les quarts d'heure. Alors la vibration se faisait terrible dans cette tour haute de 75 pieds. Nos malades ne pouvaient la supporter, et avant chaque détonation, il fallait monter les cinq étages du phare transformés en infirmerie, avertir ces pauvres malheureux, et mettre de la ouate dans les oreilles des plus nerveux. Les jours succédèrent ainsi aux nuits sans apporter autre chose que le chagrin, l'inquiétude et les insomnies. Laurent et moi, nous étions en train de perdre la tête; le service du phare et des malades ne se faisait plus que machinalement, lorsque Dieu prit pitié de nous, et dans sa miséricorde nous envoya le repos et la joie, en déterminant une convalescence générale.
Un mois de tranquillité nous remit frais et gaillards, et comme les grands froids étaient venus, j'eus le plaisir de mener une partie de mon hôpital faire visite à mon confrère de l'Ile-aux-Oeufs. C'est cette île qu'il y a là-bas, à dix lieues sous le vent; le golfe était pris en vive glace, et de ma vie je n'ai fait plus belle course en traîneau. Vous voyez, messieurs, que le bon Dieu nous aime encore, et qu'il ne nous abandonne pas tout à fait, ajouta-t-il sous forme de péroraison, en versant un verre de champagne à maître Agénor, et en lui disant:
—Goûtez ferme, M. Gravel, c'est du meilleur. Je l'ai acheté il y a quinze jours d'un de nos pêcheurs de la Trinité, qui en a sauvé bien d'autres du malheureux naufrage du navire marseillais du capitaine Figueron, venu à la côte en septembre passé.
Puis, comme nous faisions mine de nous retirer:
—Allons, messieurs, une nouvelle tournée à votre prompt retour et à votre bonheur. Quant à vous autres, mes gars, mettez le petit canot à la mer, et faites un brin de conduite à la chaloupe de ces messieurs. Peut-être, avant que l'ancre du Napoléon ne soit levée, auront-ils le temps de trouver dans leurs cabines quelques vieux journaux de par chez nous. Ici, les morceaux en sont bons à lire.
Et ce fut ainsi que par un beau clair de lune, sur une mer splendide, nous quittâmes Ferdinand Fafard de la Pointe de Mons, enchantés de notre nouvelle connaissance, et joyeux d'avoir causé avec lui et de lui avoir donné une bonne minute de distraction. Nos rameurs glissaient gaiement sur le flot, qui s'ouvrait pour nous laisser passer. Au loin, on entendait les ronflements d'une baleine qui venait respirer à la surface: sur nos têtes une aurore boréale s'amusait à couler des tuyaux d'orgue pour les refondre ensuite, et de la terre le grand cyclope de pierre nous regardait aller et disparaître.
Agénor en ce moment eut une inspiration. Sa mémoire était implacable, et il se mit à déclamer aux matelots ébahis le commencement du beau travail de Paul Parfait sur le phare.
—"A l'heure où le soir tombe, invariablement il s'allume; peu à peu l'ombre enveloppe sa tour blanche et l'on ne voit plus surgir au loin qu'un point brillant, étoile factice posée par la main de l'homme au bord des flots. Que la nuit soit claire ou sombre, calme ou tumultueuse, l'étoile luit toujours de son éclat doux, paisible, immuable, pour ne s'éteindre qu'avec le retour de l'aube. Qui pourrait considérer sans émotion cette lueur perdue dans l'espace, en songeant que c'est elle qui, à travers les brumes, sous la pluie qui fouette et le vent qui fait rage, trace au navigateur sa route, lui marque les écueils à éviter ou la passe à gagner?
"Par les nuits étoilées, le phare trace sur la mer un sillon lumineux, et par les nuits noires il montre encore à travers l'ombre son grand oeil vigilant. Qui ne croirait alors volontiers que le phare est vivant? Qui ne s'adresserait à lui comme à un être capable de comprendre?"
D'une oreille distraite j'écoutais. Ma pensée était ailleurs; et la déclamation d'Agénor avait réveillé en moi d'autres idées.
Je songeais à la vie humble, pleine d'abnégation et de dévouement, que menaient les modestes gardiens de ces phares.
—A chacun sa fonction dans le grand rouage humanitaire. Ceux-ci, me disais-je, doivent être premiers ministres, généraux ou millionnaires: ceux-là seront pauvres, méconnus, mais dévoués. S'il en faut des premiers pour guider les états, perfectionner les engins de mort et acheter tout ce qui s'achète sur terre, il en faut aussi des seconds pour accomplir une mission de paix, aider et réconforter ceux qui souffrent et qui sont en péril.
Mais comme même ici-bas, tout se compense, ce n'est pas sur les lèvres de ces déshérités que vient errer le soupir que laissait échapper le cardinal d'Amboise mourant, lorsque se retournant vers son infirmier, il lui disait:
—Ah! frère Jean!... que ne suis-je toujours resté frère Jean!
Il faisait petit jour lorsque maître Raphaël que je ne me rappelle pas avoir vu dormir pendant le voyage, s'en vint sur la pointe des pieds, chuchoter à la porte de nos cabines:
—L'Ile-aux-Oeufs, messieurs! Dois-je vous préparer quelques provisions pour descendre à terre? On arme le canot en ce moment.
—Je le crois bien, nom d'une pipe! s'écria Agénor Gravel, en faisant son apparition dans le carré avec deux bouquins sous le bras. En route mes amis! Nous allons faire aujourd'hui un chapitre inédit de l'histoire du Canada. C'est ici, que l'amiral Sir Hovenden Walker est venu aplatir une partie de sa flotte, sous le spécieux prétexte de mettre le siège devant Québec. Je vous raconterai tout cela sur l'île; et en attendant, qui m'aime s'embarque.
Ce fut ainsi que nous nous installâmes dans la baleinière, et que nous poussâmes au large.
En face gisait une île sauvage et dénudée, longue de trois quarts de mille. Elle était formée par des rochers granitiques divisés en quatre sections très-sensibles, et n'avait pour habitation qu'un petit phare en bois, lavé à la chaux. Bien que le Napoléon III fût mouillé par quinze brasses—en approchant de la falaise on trouve soixante-quinze pieds d'eau—la distance à franchir n'était pas considérable; et bientôt, sous la conduite d'Agénor qui n'aimait pas ce que la brise de mer a de piquant le matin, nous nous installions dans un de ces nombreux trous, fouillés tout le long de l'îlot par les chercheurs de trésors, pendant que l'équipage roulait sur les crans les quarts de pétrole, les provisions et les ballots destinés au Robinson de céans.
Ce ne fut qu'alors que nous fîmes connaissance avec les bouquins d'Agénor Gravel. Il venait de les sortir triomphalement hors d'un sac qui a contenu bien d'autres choses agréables, utiles et mystérieuses, pendant les deux mois qu'il nous tint compagnie, et ils étalaient modestement sur la mousse sombre du rocher leurs titres jaunis par le temps.
Le premier de ces précieux volumes était le journal du malheureux Walker: le second, s'intitulait l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec par la mère Françoise Juchereau de Saint-Ignace.
Quelle relation y avait-il entre ce livre de loch d'un amiral anglais et le pieux récit d'événements dont les échos affaiblis étaient venus s'éteindre sur le seuil d'un monastère? C'est ce qu'Agénor ne devait pas tarder à expliquer à des profanes comme nous; car, il avait déjà commencé par nous dire d'un ton grave:
—Ce fut le 11 avril 1711, à sept heures du soir, que le contre-amiral de l'escadre blanche, Sir Hovenden Walker, accompagné par le brigadier-général l'honorable John Hill, commandant les troupes de débarquement destinées au Canada, vint recevoir au palais de Saint-James les instructions de la reine Anne. Il y a cent soixante-et-deux ans de cela, et comme les historiens se sont contentés d'effleurer le récit d'un des moments d'angoisse les plus terribles de notre passé, je me suis mis en tête de venir ici, pièces en main, vous donner les prémices d'un travail qui méritait d'être fait, et que ma douce paresse aurait désiré ardemment voir mener à bonne fin par un autre. Allons, passez-moi le briquet; et puisqu'un cigare est le meilleur de tous les préambules, j'allume et je commence.
—Les instructions de la reine Anne étaient précises. Après avoir pris rendez-vous à Spithead, l'amiral et le général devaient, au premier vent favorable, faire voile directement pour Boston. Une fois rendu là, Sir Hovenden Walker détachait de l'escadre une nombre suffisant de vaisseaux pour équiper et envoyer les troupes de New-York, du Jersey et de Pennsylvanie qui devaient prendre part à l'expédition du Canada, puis une fois cette mission accomplie, renforcer sa flotte de tous les vaisseaux disponibles et remonter immédiatement le Saint-Laurent, pour se mettre en mesure d'attaquer Québec au plus tôt.
Embossé devant la malheureuse ville, l'amiral anglais avait ordre d'employer toutes les forces suffisantes, tous les moyens connus pour la réduire, pendant que le lieutenant général Nicholson, maintenant en route pour organiser les milices de la colonie anglaise, combinerait un mouvement qui s'exécuterait par terre.
Tout ce qu'il est donné à l'esprit humain de prévoir avait été employé pour assurer le succès de cette campagne, préparée longuement d'avance, et destinée dès l'abord, à être commandée par Sir Thomas Hardy. Les médecins de la flotte avaient été pourvus de douze mois de médicaments. On poussa la précaution jusqu'à embarquer d'énormes grues pour hisser les canons anglais sur les remparts de Québec, et les vaisseaux de Sir Hovenden renfermaient une flottille de flibots à fond plat, destinés à être jetés sur le lac Saint-Pierre pour empêcher l'ennemi de communiquer avec les assiégés, et protéger en même temps—ils devaient être armés en frégate—les canots et les flûtes qui emmenaient les troupes de Nicholson. Les embarras d'argent avaient même été prévus: et l'on avait donné droit à Walker—droit qui lui fut contesté plus tard—de tirer à vue sur les commissaires de la marine, s'il arrivait à ses équipages de manquer de vivres ou de munitions.
En cas de succès,—ce dont, avec le secours du Dieu tout puissant, la reine Anne n'avait aucune raison de douter, puisque tous les préparatifs avaient été faits, les ordres donnés, les moyens pris pour mener à bonne fin cette campagne—une force navale anglaise devait rester dans le Saint-Laurent, pendant que les prises faites sur les Français transporteraient en Europe le gouverneur ennemi, les troupes prisonnières, les religieux et toutes autres personnes comprises dans les articles de la capitulation. Puis, quand ces choses glorieuses seraient passées dans le domaine de l'histoire britannique; lorsque la Nouvelle France aurait pris rang au nombre des vassaux de celle qui s'intitulait alors reine d'Angleterre, de France et d'Irlande,2 un ordre d'embarquement devait être donné aux troupes qui n'étaient plus nécessaires au maintien de la paix, et Sir Hovenden Walker s'empresserait de revenir, non toutefois sans avoir attaqué Plaisance, dans le cas où la saison lui permettrait d'approcher de Terreneuve. Enfin, comme de tout temps il y a eu une pointe de commerce dans les guerres anglaises, sa gracieuse Majesté terminait en disant, qu'une fois ces hauts faits accomplis, l'amiral licencierait les transports dont le service pouvait se passer, et leur donnerait pour mission d'aller dans les îles et les ports du continent américain y prendre cargaison, et alléger d'autant la taxe publique, tout en faisant le bénéfice du Commerce et de la richesse nationale.
Note 2: (retour) Le titre de roi de France, pris pour la première fois par Edouard III d'Angleterre, fut porté par ses successeurs jusqu'en 1801.
Muni de ces instructions royales, l'amiral Sir Hovenden Walker s'empressa de se rendre à Portsmouth, puis à Spithead, où l'attendaient des vents contraires, des calmes plats, des accidents de mâture, enfin toute cette série de contretemps qui s'abattent sur une escadre à voile, et retardent l'appareillage du jour au lendemain.
Une journée, c'étaient les officiers de la flotte qui n'avaient pas encore reçu l'ordre d'obéir à l'amiral, et ne voulaient écouter que Sir Edward Whitaker, plus ancien que lui. Le lendemain, c'était l'impossibilité d'obtenir un transport pour aller chercher l'infanterie de marine à Plymouth. Puis, les vaisseaux n'avaient pas les garnitures d'ancre nécessaires: le gros temps s'en mêlait, et la mer devenait trop forte pour embarquer les mortiers de siège. S'il ventait bonne brise, les navires n'étaient pas encore suffisamment approvisionnés. S'ils regorgeaient de vivres, au moment d'appareiller un grain fondait sur la frégate le Devonshire, et lui rasait tous ses mâts de hunes, pendant qu'une seconde frégate, le Swiftsure, perdait ses mâts de perroquet. Le grain passé, le calme prenait; et pendant que toutes ces contrariétés fondaient à tire d'aile sur la flotte, le secrétaire Saint-John—plus tard lord Bolingbroke—ne cessait de dépêcher courrier sur courrier à l'amiral pour lui dire que c'était le bon plaisir de Sa Majesté de le voir prendre la mer au plus tôt.
Enfin, à force d'écrire, de donner des ordres, et d'éreinter des courriers, tout devint prêt. Ce fut le 29 avril 1711 à quatre heures du matin que l'amiral Walker quitta son mouillage, par un vent frais est-sud-est, pour continuer cette série de contrariétés, d'hésitations et de malheurs qui devait se terminer le long des falaises de l'Ile-aux-Oeufs3.
Note 3: (retour) Les frégates avaient pour six mois d'approvisionnements: les transports pour trois mois.—Livre de loch de l'amiral.
Conformément à ses ordres, l'amiral mettait le cap sur Boston, où il était allé 25 ans auparavant, en 1686.
A bord, sur 12,000 hommes d'embarquement, tous—l'amiral et le général exceptés—ignoraient l'objet de l'expédition. A 153 lieues des îles Scilly, Walker avait fait mettre en panne et distribuer à chacun de ses capitaines un pli cacheté, contenant le nom du lieu où l'escadre devait se rallier. Pourtant ces précautions devenaient inutiles: le précieux secret avait été mal gardé.
Le 2 mai, Walker fut forcé par une saute de vent d'ancrer à Plymouth, pendant que ses transports se réfugiaient à Catwater. Un matelot français embarqué sur le Medway, un renégat qui prétendait avoir fait quatre voyages dans la rivière du Canada, entendit dire dans un des caboulots de la ville, qu'une flotte destinée à la conquête de la Nouvelle-France était de passage en ce moment, et se fit offrir à l'amiral anglais pour la piloter jusqu'à Québec. Walker épouvanté, se prit à dissimuler devant lui, assurant qu'il allait croiser dans la baie de Biscaye, et fit tout de même embarquer cet homme à bord de l'Humber, avec ordre de le bien traiter. Ce qui devait être du goût de ce nouveau Palinure car le colonel Vetch, donnant plus tard des notes sur le compte de ce transfuge, écrivait du détroit de Canso à l'amiral, que le pilote français lui faisait non-seulement l'effet d'un ignorant, d'un prétentieux, d'un cancre et d'un ivrogne, mais encore qu'il était sous l'impression qu'il tramait en sa tête rien qui vaille. Walker comptait beaucoup sur l'expérience de cet homme pour éviter les dangers de la navigation du Saint-Laurent, dangers que son imagination exagérait, au point de croire qu'une fois l'hiver venu, le fleuve ne formait, jusqu'au fond, qu'un bloc de glace. La lettre du colonel venait de détruire une de ses plus chères illusions.
D'ailleurs, les contrariétés continuaient à s'acharner sur le malheureux officier.
A peine en mer, Sir Hovenden s'aperçut d'une impardonnable distraction: le transport Mary avait été oublié à Catwater avec une partie du régiment du colonel Disney. Par une nuit d'orage, le mât de misaine du Monmouth fut emporté comme une paille. La marche de l'escadre se voyait continuellement retardée par les transports qui marchaient comme des sabots; par tous les temps, il fallait leur faire passer péniblement des câbles de remorque. Dans un cas pressé, était-il urgent de communiquer avec le général Hill embarqué sur le Devonshire? celui-ci souffrait trop du mal de mer pour s'occuper de choses sérieuses.
L'indiscipline se mit de la partie. Malgré la défense formelle de se séparer de la flotte et de courir sus aux voiles ennemies, un soir, près du banc de Terreneuve, le capitaine Buttler du Dunkirk et le capitaine Soanes de l'Edgar, deux officiers qui avaient pour consigne l'importante fonction de répéter les signaux de l'amiral aux vaisseaux de l'escadre, se couvrirent de toiles, et appuyèrent vivement la chasse à un petit navire marchand qui louvoyait sur l'horizon. Alors il fallait sévir. Un conseil de guerre se réunissait. Et de ces deux vieux officiers qui auraient pu être si utiles en montrant l'exemple, l'un, le capitaine de l'Edgar—parce qu'il fut constaté que le secrétaire de l'amiral avait oublié de lui communiquer la consigne—se voyait réprimander sévèrement et retrancher trois mois de solde; L'autre—celui du Dunkirk—était renvoyé du service.
Malgré ces déboires, le 25 juin, après cinquante-huit jours de mer, l'amiral Walker vint jeter l'ancre devant Boston, où l'attendaient des fêtes brillantes et de lamentables déceptions. En mettant pied à terre, Sir Hovenden sembla devenir le lion de la Nouvelle-Angleterre. L'ouverture des cours de l'université de Cambridge se faisait le 4 juillet, sous sa présidence. Le 5 et le 10 du même mois il assistait au défilé des troupes d'infanterie de marine, passées en revue sur Noodles Island, par le général Hill. Le 24 il se rendait à Roxbury faire l'inspection d'un régiment de miliciens destinés à l'expédition du Canada. Le 19 et le 23 c'était une série de bals et de dîners donnés à bord de l'Humber—en l'honneur des chefs indiens du Connecticut, ainsi que des Mohocks, reçus à bord du vaisseau-amiral au bruit du canon, des fanfares et des hourrahs de l'équipage. Ces derniers qui formaient partie des cinq nations furent l'objet d'une distinction spéciale. Sir Hovenden Walker voulut bien trinquer avec leurs sachems; et les chefs pour ne pas rester en arrière de courtoisie, portèrent un toast à Sa Majesté, en disant à l'amiral:
—Depuis longtemps nous nous attendions à contempler les merveilles que nous voyons maintenant. Nous sommes dans la joie en songeant que la Reine a pris un tel soin de nous; car, nous commencions à désespérer. Maintenant nous ferons tout en notre possible, et nous espérons que dorénavant les français seront vaincus en Amérique.
Ces raoûts et ces collations fines se succédèrent ainsi à la file, qui à bord de l'escadre, qui chez le gouverneur, qui chez les officiers supérieurs de la colonie, jusqu'au moment où il fallut parler d'affaires sérieuses.
Il s'agissait maintenant de trouver et d'embarquer en toute hâte quatre mois de provisions, pour 9385 soldats et matelots destinés à l'expédition navale contre la Nouvelle-France.
Un seul homme dans Boston pouvait fournir une aussi importante commande. C'était le capitaine Belcher, négociant riche et rusé, qui en peu de temps avait su se rendre maître du marché de la Nouvelle-Angleterre, et le contrôlait à sa guise. Tout en prêtant l'oreille aux propositions de l'amiral, et en gagnant du temps par des promesses, Belcher réussit à accaparer le sel disponible, et prit à sa solde tous les boulangers de la ville: si bien que, le jour venu pour exécuter son contrat, il se trouva eu mesure de faire ses conditions lui-même et d'exiger de l'argent comptant. Les bouchers se mirent de la partie; ils ne voulaient livrer leur viande que contre-espèces sonnantes.
Pendant ces pourparlers, un temps précieux se perdait. La frégate le Chester venait de briser son étambot: il fallut le réparer. Plus de seize pieds de la fausse quille du Humber ayant été emportés, on ne put songer à l'abattre en carène, et deux plongeurs furent chargés de l'examiner et de faire rapport. La frégate Sapphire était expédiée à Annapolis avec deux compagnies de miliciens. Sur la demande du gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, ces troupes étaient destinées à relever l'infanterie de marine; mais sir Charles Hobby, gouverneur de cette dernière ville, gardait le tout, en homme prudent, et malgré des ordres formels, ne laissait pas échapper cette belle occasion de renforcer sa garnison. Soldats et matelots désertaient par escouade; et cet amour de la vie au grand air devenait tellement épidémique, qu'un soir, à bord du transport la Reine Anne, six soldats, parmi lesquels le maître canonnier et le maître d'équipage, commandés par le deuxième lieutenant, mettaient une chaloupe à la mer et s'enfuyaient à force de rames. L'assemblée du Massachusetts effrayée des proportions que prenait ce sauve-qui-peut général, avait—il est vrai—promulgué une loi sévère contre les déserteurs, mais le gouverneur Dudley semblait à tout instant vouloir entraver les projets de Walker.
L'amiral essaya alors de la diplomatie. Un jour, le 9 juillet, il transmet à la flotte le signal de déployer les voiles du petit hunier, pour faire croire aux autorités qu'il commençait l'appareillage, et aiguillonner ainsi le patriotisme des Bostonnais. Cette manoeuvre les laissa aussi froids que le reste, et à bout de patience, Walker finit par écrire vertement au gouverneur Dudley, et par lui dire que le peuple de la Nouvelle-Angleterre vivait comme au temps où il n'y avait pas de roi en Israël: chacun se conduisant à sa guise, et faisant du patriotisme et de la grandeur nationale une question secondaire à ses intérêts.
A partir de ce moment les rapports entre ces deux personnages devinrent de plus en plus aigres.
—"Je suis d'avis, et tous les officiers de la marine et du corps de débarquement partagent mon opinion, écrivait de nouveau l'amiral au gouverneur, que votre gouvernement au lieu d'aider et de hâter le départ de la flotte, l'a entravé autant que possible. Comment pourrez-vous vous défendre contre un aussi grand nombre de témoins et contre des faits aussi évidents? Lorsque le parlement anglais fera une enquête sur votre conduite, et qu'il lui sera démontré le peu d'aide que vous ayez donné à la partie navale de cette expédition, il y aura alors un tel cri d'indignation, que la Nouvelle-Angleterre sera forcée de se repentir de son inaction. Quand avec la protection de Dieu je suis arrivé ici, j'espérais que les instructions royales seraient suivies à la lettre; que les transports et les pataches de cette colonie auraient été armés et approvisionnés de suite; que mes cadres auraient été complétés, et que chacun ferait preuve de patriotisme en me permettant de reprendre la mer au plus tôt. Le contraire est arrivé. Rien n'est prêt; mes hommes m'abandonnent, et avec mes seuls déserteurs j'aurais pu équiper vos transports. Jamais toute l'astuce du gouvernement de la Nouvelle-Angleterre fera croire à la Reine et à son conseil, que la colonie n'a pu me donner 400 matelots. Mon séjour sera court ici; avec la bénédiction de Dieu, j'espère mettre à la voile demain ou lundi au plus tard, et tout ce qui peut m'arriver de malheur, je le mets sur le compte du gouvernement de la Nouvelle-Angleterre—liberavi animam meam."
Enfin, la prise du Neptune, convoyé, à cent lieues et plus du cap au Finistère, par une flotte sous le commandement de Duguay-Trouin, vint ajouter aux transes de l'amiral; et en date du 27 juillet il transmettait au gouverneur une liste des vaisseaux ennemis, tout en lui écrivant4:
«—Je vous donne avis que, dans le cas où je quitterais cette rade en d'aussi mauvaises conditions, et que j'irais me heurter, à monsieur Duguay, comme cela est probable, s'il se propose de venir ici, je mets sur le compte de la colonie tous les accidents qui pourront m'arriver par le manque de matelots.»
Note 4: (retour) Ces vaisseaux étaient le Lys de 78 canons, le Magnanime de 76, de l'Apollon de 72, le Brillant de 74, le Glorieux de 68, le Fidèle de 70, l'Aigle de 74, le Protée de 68, et le Jason de 48 canons.
Néanmoins, à force de correspondre, de rager et de se faire du mauvais sang, l'amiral Walker était à la veille de voir sa flotte en mesure de se mettre en campagne, lorsqu'une dernière humiliation fondit sur lui. Les pilotes recrutés à grands frais dans toutes les criques et baies de la Nouvelle-Angleterre se faisaient tirer l'oreille, et prétendaient ne plus connaître le golfe et le fleuve Saint-Laurent. Bref, ils se cachaient ou refusaient d'embarquer, et il fallut un warrant royal pour les consigner à bord.
Ce fut dans ces tristes circonstances, et après avoir épuisé toutes ses ressources à se chicaner comme un clerc d'huissier, que l'amiral sir Hovenden Walker appareilla le 30 juillet 1711. Une flotte splendide le suivait: et derrière lui soixante et dix-sept navires de haut-bord sortirent des passes de Nantasket, et prirent orgueilleusement la haute mer5.
Note 5: (retour) Voici une liste exacte de cette flotte. Vaisseau amiral, l'Edgar 70 canons: le Windsor 60 canons, le Montague 69 canons, le Swiftsure 70 canons, le Sunderland 60 canons, le Monmouth 70 canons, le Dunkirk 60 canons, le Humber 80 canons, le Devonshire 80 canons. Transports: Recovery Delight, Eagle, Fortune, Reward, Success Pink, Willing Mind, Rose, Life, Happy Union, Queen Anne, Resolution, Marlborough, Samuel, Pheasant, Three Martins, Smyrna Marchant, Globe, Samuel, Colchester, Nathanael et Elizabeth, Samuel et Anne, George, Isabella Anne Catherine, Blenheim, Chatham, Blessing, Rebecca, Two Sheriffs, Sarah, Rebecca Anne Blessing, Prince Eugène, Dolphin, Mary, Herbin Galley, Friend's increase, Marlborough, Anna, Jérémie et Thomas, les Barbades, Anchor and Hope, Adventure, Content, Jean et Marie, Speedwell, Dolphin, Elisabeth, Marie, Samuel, le Basibé, la Grenade, Goodwill, Anna, Jean et Sarah, Marguerite, Dispatch, Four friends, Francis, Jean et Hannah, Henriette, Blessing, l'Antilope, Hannah et Elizabeth, Friend's adventure, Rebecca, Marthe et Annah, Jeanne, l'Unité, et le Newcastle, L'Entreprise de 40 canons, le Saphire de 40, le Kingston de 60, le Léopard de 54, et le Chester de 54 canons, ainsi qu'une prise, le Triton, rejoignirent l'amiral dans le golfe. Quant au Leostoff et au Feversham, frégates de 36 canons qui faisaient partie de l'escadre, personne n'en entendit plus parler.
A bord tout était dans la joie. Le temps était clair; il ventait frais et bon comme disent les marins, et Dieu daignait enfin sourire à cet amiral anglais qui, malgré la paix existante alors entre la reine Anne et le roi très-chrétien, s'en allait, pour satisfaire un royal caprice, porter la torche et l'épée dans le pays de nos pères. Dans ces temps hélas! le paradoxe était une arme subtile entre les mains du pouvoir. Anne n'était pas femme à rester en arrière, et dans un jour de spleen, elle s'était mise en tête que les Français établis au Canada et obéissant aux prétendus titres de Sa Majesté le roi de France, étaient tout autant ses sujets que s'ils fussent nés dans la Grande-Bretagne ou en Irlande. Ces beaux sentiments trouvèrent un écho fidèle chez l'amiral Walker; et il s'était occupé à les consigner dans une ronflante proclamation, bien longtemps avant que sa flotte, âpre à son oeuvre de destruction, se fût mise à courir toutes voiles dehors, la poulaine tournée vers Québec.
A la hauteur du Cap-Breton, l'Edgar sur lequel était hissé le pavillon amiral, fut rejoint par le Chester qui mit à son bord le capitaine Paradis. Ce dernier commandait le Neptune de la Rochelle, petit navire de 120 tonneaux, armé de 10 canons, portant 70 hommes, dont 80 destinés à la garnison de Québec. Il avait été amariné quelques jours auparavant par le capitaine Matthews. Vieux loup de mer qui avait fait deux naufrages dans le golfe, et en était rendu à son quarantième voyage au Canada, le capitaine Paradis connaissait son Saint-Laurent par coeur; et décidément, le ciel semblait se ranger du côté de l'amiral, en jetant sur sa route pareil pilote. Une récompense de cinq cents pistoles—soit deux cent cinquante louis—dont cent pistoles d'arrhes, fut promise au capitaine Paradis s'il voulait se faire le lamaneur de la flotte: une fois rendu à Québec, le prix du Neptune lui serait payé en entier, et sa vieillesse mise à l'abri du besoin.
Pour être juste envers le prisonnier de Walker, les mémoires et les documents du temps ne mentionnent pas s'il accepta ou refusa. La seule chose qui soit parvenue jusqu'à nous, c'est que Paradis, au dire même de l'amiral, ne se gêna nullement pour lui faire un sombre tableau des misères et des intempéries qui attendaient la flotte anglaise dans les eaux de la Nouvelle-France. Ces avis concordaient avec ce que le premier lieutenant du Neptune, expédié à Boston à bord de la prise du Chester, avait déjà assuré à l'amiral:
—Si vous vous aventurez dans le Saint-Laurent avec pareille flotte, lui disait-il, vous y perdrez tous vos vaisseaux.
Sur le moment, Walker crut que ces paroles n'étaient qu'une ruse de la part d'un Français qui voulait sauver son pays de l'invasion. Bientôt, l'idée d'être obligé d'endurer peut-être les rigueurs d'un hiver canadien se prit à hanter continuellement le cerveau de l'amiral, et plus tard, ce cauchemar lui faisait écrire une de ses meilleures pages. Mais en ce moment, tout entier à ce que lui disait Paradis, et se rappelant en même temps la conversation du lieutenant du Neptune, Walker devint soucieux; et la brise venant à tourner grand frais, il prit la résolution de se mettre à l'abri dans le havre de Gaspé. Un navire français de la Biscaye était là, en train de charger du poisson pour l'Europe. On s'en empara, et comme le lendemain il fallait faire d'inutiles efforts pour le touer au large, l'ordre fut donné de le saborder, de mettre le feu aux habitations du bassin, de détruire les provisions qu'on y trouverait, et de faire prisonniers tous ceux qu'on rencontrerait, pendant que le Sapphire et le Léopard iraient brûler Bonaventure, qui ne fut sauvé que par un calme plat.
Amère dérision des choses humaines! Qui aurait dit en ce moment au chevalier Sir Hovenden Walker, contre-amiral de l'escadre blanche, que ce méchant lougre coulé à fond, et cette dizaine de baraques réduites en cendres seraient les seuls souvenirs que sa formidable armada laisserait aux flots oublieux du Saint-Laurent, l'aurait-il crû?
Un vent frais poussa bientôt l'escadre hors du bassin de Gaspé. En le débouquant la brise fléchit, le calme se fit; et, une pluie fine se prit à tomber pendant qu'au large le brouillard se faisait. Bientôt il enveloppa la flotte, ne laissant voir que de fois à autres les voiles d'une frégate ou d'un transport, qui tâchaient de garder autant que possible leur ligne de bataille pour éviter le boulet que chaque commandant de division avait ordre de leur envoyer, dans le cas où ils s'en sépareraient. Ceci dura toute la journée du 22 août, mais le soir le vent se prit à souffler en foudre, le brouillard devint de plus en plus intense, la sonde ne mordit pas, et comme depuis le mardi les vigies n'avaient pas signalé la terre, ou calcula par estime qu'on serrait de près le Nord.
L'officier de loch venait de faire une erreur de quinze lieues!
Paradis consulté, fut alors d'avis de mettre en panne avec les amures à bâbord, tout en ayant soin de se tenir la tête au sud au moyen du perroquet d'artimon et du grand hunier.
Deux heures et demie se passèrent à faire cette manoeuvre, et l'amiral venait de se mettre au lit, quand tout à coup, le capitaine de l'Edgar crut entrevoir là terre. D'après de nouveaux calculs, il en était arrivé à la conclusion que c'était la côte sud, et courant avertir son supérieur, il reçut l'ordre de faire des signaux à la flotte pour qu'elle virât immédiatement vent arrière, et recommençât la même manoeuvre avec les amures à tribord.
Un jeune officier du régiment du général Seymour, le capitaine Goddard, se trouvait alors sur le gaillard d'arrière. Il aperçut la mer déferler et se briser sous le vent, au moment où l'Edgar faisait son abatée; et tout effrayé, il se précipita dans les appartements de l'amiral, en lui criant:
—Sir Hovenden! nous sommes entourés de récifs!
L'amiral se prit à plaisanter M. Goddard sur sa frayeur; lui assura que le capitaine de sa frégate, M. Paddon, était encore plus compétent pour les choses de la mer qu'un officier d'infanterie, et lui souhaita le bonsoir.
Le fantassin ne se tint pas pour battu. Pendant cette conversation avec son supérieur les brisants avaient grandi: un tumulte terrible se faisait sur le pont, et oublieux de l'étiquette pour ne plus songer qu'au salut de tous, le capitaine Goddard rentrant de nouveau dans le carré de Sir Hovenden, le supplia au nom de Dieu, de monter sur son banc de quart.
L'amiral s'y rendit gaiement—in gown and slippers—en robe de chambre et en pantoufles.
L'Edgar était à la veille de talonner. Tout le monde avait perdu la tête; personne ne savait où était allé Paradis. La frégate faisant chapelle s'était laissée coiffer, et avait rejeté les brisants sous sa hanche, pendant que pour comble de malheur, le capitaine Paddon hors de lui, faisait dégager une ancre qui dérapa de suite, et qu'il fallut couper immédiatement.
La lune sortit alors du brouillard, et montrant distinctement la côte Nord, permit à l'amiral de rassurer un peu ses hommes. Sur ces entrefaites, Paradis que l'on avait éveillé fit transmettre l'ordre de hisser toutes les voiles. Il fallait sortir de là couvert de toiles, ou chavirer.
L'Edgar, sous la main ferme du capitaine canadien-français se pencha sur les brisants, fit une seconde abatée, plongea fermement ses écubiers sous la lame, et sortit.
Pendant cette nuit là, séparé de son escadre, l'amiral courut dans le sud; puis, au matin, en reprenant sa bordée, il fit la rencontre du Swiftsure, qui lui apprit une partie de l'immense désastre que nous ne connaissons plus que sous le nom du "naufrage de l'Anglais."
A ce rapport vint bientôt se joindre celui du capitaine Alexander, du Chatam. Il était navrant.
Huit gros transports de 2,316 tonneaux et trois quarts,—ancienne jauge,—l'Isabella Anne-Catherine, le Samuel et Anne, le Nathaniel et Elisabeth, le Marlborough, le Chatam, le Colchester, le Content et le Marchand de Smyrne étaient venus s'éventrer sur l'Ile-aux-Oeufs, pendant cette nuit terrible. Les capitaines Richard Bayley, Thomas Walkhup et Henry Vernon s'étaient noyés. Jusqu'à présent 884 cadavres jonchaient les criques de l'Ile-aux-Oeufs et les sables de la côte du Labrador. Trois frégates le Windsor, l'Aigle et le Montagne n'avaient évité une perte totale, qu'en se réfugiant, sans le savoir, dans la passe où le Napoléon III est ancré en ce moment. Par ce désastre, les régiments des colonels Windress, Kaine et Clayton, ainsi que celui du général Seymour, entièrement composés de vétérans de l'armée de Marlborough, se trouvaient presqu'anéantis: et l'on reconnut sur la grève deux compagnies entières des gardes de la reine, qu'on distingua à leurs casaques rouges6.
Note 6: (retour)Vide Charlevoix, Histoire de la Nouvelle-France, Livre XV, page 357.
D'après les numéros des lundis 10 et 23 juillet 1711 du Boston News-Letter, published by authority, les régiments embarqués sur les transports de l'amiral Walker, étaient ceux des colonels Kirke, Seymour, Disney, Windresse, Clayton, Kaine, ainsi que celui du général Hill. Outre ces troupes, il y avait 600 hommes d'infanterie de marine commandés par le colonel Churchill, et un train d'artillerie de quarante chevaux sous les ordres du colonel King. Les troupes de milice consistaient en deux régiments levés dans la baie du Massahusetts, dans le New-Hampshire et dans la plantation du Rhode-Island, le premier commandé par le colonel Walton, le second par le colonel l'honorable M. Vetch.
Quel était le chiffre exact des pertes de l'amiral Walker? Nul ne le saura positivement, mais ce que l'historien peut rappeler, sans faire erreur, c'est que dès son arrivée à Boston, Sir Hovenden demandait au gouverneur Dudley quatre mois de rations pour les 9,885 hommes qu'il amenait d'Angleterre; puis que lors du conseil de guerre tenu sur l'opportunité d'attaquer Plaisance, après le naufrage de l'Ile-aux-Oeufs, il déclara ne plus avoir que 3,802 hommes à bord de ses frégates et 3,841 sur ses transports, soit un total de 7,643 matelots et soldats.
Or, d'après le rapport officiel de l'amiral Walker, 220 hommes embarquèrent à bord de l'Isabella Anne Catherine; 102 étaient sur le Chatam; 150 sur le Marlborough; 246 sur le Marchand de Smyrne; 354 sur le Colchester; 188 sur le Nathaniel et Elizabeth; et 150 sur le Samuel et Anne: soit un total de 1,410. Tous ses vaisseaux, plus le Content qui n'est pas mentionné dans cette pièce justificative, périrent sur l'Ile-aux-Oeufs. Et en faisant la part de la maladie et des désertions, nous pouvons donc sans exagérer mettre à 1,100 le nombre des noyés et des manquants à l'appel, le lendemain de la triste nuit du 22 août.7
Note 7: (retour)Il ne faut pas oublier, que dans l'introduction de son journal, page 25, Walker avoue avoir perdu, en s'en revenant, la frégate le Feversham de 36 canons, commandée par le capitaine Paston, ayant à son bord 196 hommes d'équipage, et trois nouveaux transports dont les morts n'entrent pas dans le dénombrement.
Au moment de livrer cette page à l'impression un curieux bouquin me tombe sous la main. Il est intitulé: The chronological historian, containing a regular account of all transactions relating to British affairs, by Mr. Johnson, London, MDCCXLIII.
On lit ce qui suit aux pages 313, 314:
22 August 1711.—Eight of the transports of Sir Hovenden Walker's fleet with eight hundred officers and soldiers were cast away in the river Canada, where upon the rest of the fleet returned to New-England.
9 October 1711.—Sir Hovenden Walker and Brigadier Hill with the fleet of men of war and transports returned to Portsmouth from their Expedition of Canada, and on the 15 instant the admiral's ship the Edgar was accidentally blown up with 400 seamen and several other people on board, all the officers being ashore.
Ce soir-là, la tempête s'était rappelé qu'elle avait jadis dompté l'orgueil d'un autre amiral anglais, Sir William Phipps, en lui arrachant plus de mille hommes, et en lui brisant 38 vaisseaux. Vingt minutes lui avaient suffi pour faire cette nouvelle oeuvre de destruction, et sauver la Nouvelle-France de l'étreinte de l'Anglais.
Atterré par son incroyable désastre, l'amiral Walker enjoignit au capitaine Cook du Léopard de croiser autour de l'île et de sauver ceux qu'il pourrait, pendant que lui-même courrait des bordées toute la nuit. Le lendemain, il dépêcha le Monmouth, avec ordre de chercher un mouillage sûr dans les environs, pour la flotte; mais l'officier de ce navire ayant fait un rapport négatif, et les pilotes se reconnaissant incapables de conduire l'escadre dans la baie des Sept-Iles, l'amiral donna l'ordre de répartir les survivants sur le reste de ses vaisseaux, et réunit son conseil de guerre.
On était alors à six lieues ouest-sud-ouest de la pointe des Monts Pelées.
Tous les capitaines et pilotes furent sommés de se rendre auprès du pavillon amiral, hissé temporairement à bord du Windsor. Les minutes de cette séance disent que Sir Hovenden Walker présida, et que les officiers présents furent, le capitaine Joseph Soans du Swiftsure, le capitaine John Mitchel du Monmouth, le capitaine Robert Arris du Windsor, le capitaine George Walton du Montague, le capitaine Henry Gore du Dunkirk, le capitaine George Paddon de l'Edgar, le capitaine John Cockburn du Sunderland, et le capitaine Augustin Rouse du Sapphire. La discussion débuta sur un ton d'aigreur. Quelques officiers allèrent jusqu'à reprocher à Sir Hovenden Walker de ne pas les avoir consultés, avant le départ de Boston. L'amiral fut hautain. Le capitaine Bonner pilote de l'Edgar, et M. Miller pilote du Swiftsure, insistèrent sur le danger qu'offrait le passage de l'île aux Coudres, près de Québec. Leurs camarades vinrent à la suite les uns des autres avouer leur incompétence, et il fut résolu à l'unanimité d'abandonner toute tentative sur Québec, et de s'en aller à la rivière Espagnole, au cap Breton, pendant que le Léopard, en compagnie d'un brick le Four Friends et d'un sloop le Blessing, continueraient à croiser le long du lieu du sinistre.
Au Cap Breton, les tâtonnements et les pertes de temps recommencèrent. Walker n'osait plus retourner en Angleterre sans tenter un coup de main sur Plaisance. D'ailleurs ses instructions étaient positives là-dessus. Beaucoup d'officiers furent de l'avis de l'amiral; mais le général Hill fit à ce projet une forte opposition. On eut recours encore une fois à un conseil de guerre, et il fut résolu à l'unanimité, vu que l'on n'avait plus que pour onze semaines de vivres—les hommes étant mis à la demi-ration—de faire voile vers les côtes anglaises. Mais avant de partir, l'amiral crut prudent de prendre possession de cette terre au nom de la reine Anne, en remplaçant les armes de France par une inscription latine taillée en forme de croix.
Tout était maintenant au complet, puisque cette croix qui se dressait sur le Cap Breton, faisait face à l'entrée de ce golfe et de ce fleuve Saint-Laurent, devenus le tombeau des Anglais, et remplaçait celle que Sir Hovenden Walker avait oublié de laisser sur la côte déserte du Labrador.
Ainsi se termina cette terrible expédition armée à grands frais, et sur laquelle la reine Anne et ses ministres reposèrent tant d'espérances. La désertion des équipages, l'indiscipline des officiers, l'incompétence des pilotes, l'incroyable jettatura de l'amiral, et surtout le manque de patriotisme des Bostonnais, toujours prêts à importuner le roi pour lui faire tenter un coup de main sur Québec, mais incapables de faire le moindre sacrifice pécuniaire pour aider Sa Majesté à mener à bonne fin pareille entreprise—furent les causes premières des désastres de cette campagne qui, loin de perdre la Nouvelle-France, comme on l'espérait, ne fut qu'une source de profits pour elle.
"—On crut envoyer à l'Ile-aux-Oeufs ramener leurs dépouilles, dit la soeur Jeanne-Françoise Juchereau de Saint-Ignace, dans son Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec. Monsieur Duplessis, receveur des droits de monsieur l'amiral, et monsieur de Montseignat, agent de la ferme, frétèrent une barque et gagèrent quarante hommes, à qui ils donnèrent un aumônier et des provisions de vivres pour aller passer l'hiver dans cet endroit, afin qu'au printemps ils tirassent tout ce qu'ils pourraient. Ils partirent en 1711 et revinrent en 1712, au mois de juin, avec cinq bâtiments chargés. Ils trouvèrent un spectacle dont le récit fait horreur: plus de 2,000 cadavres nus sur la grève qui avaient presque tous des postures de désespérés: les uns grinçaient des dents, les autres s'arrachaient les cheveux, quelques-uns étaient à demi-enterrés dans le sable, d'autres s'embrassaient. Il y avait jusqu'à sept femmes qui se tenaient par la main et qui apparemment avaient péri ensemble. Un sera étonné qu'il se soit trouvé des femmes dans ce naufrage. Les Anglais se tenaient si assurés de prendre ce pays qu'ils en avaient déjà distribué les gouvernements et les emplois: ceux qui devaient les remplir emmenaient leurs femmes et leurs enfants afin de s'établir en arrivant. Les Français prisonniers qui étaient dans la flotte, y en virent quantité qui suivaient leurs pères ou leurs maris, et grand nombre de familles entières qui venaient pour prendre habitation."
"La vue de tant de morts était affreuse, et l'odeur qui en sortait était insupportable; quoique la marée en emportât tous les jours quelques-uns, il en restait assez pour infecter l'air. On en vit qui s'étaient mis dans le creux des arbres; d'autres s'étaient fourrés dans les herbes. On vit les pistes d'hommes pendant deux ou trois lieues, ce qui fit croire que quelques-uns avaient été rejoindre plus bas leurs navires. Il devait y avoir de vieux officiers; car on trouva des commissions signées du Roy d'Angleterre, Jacques II, réfugié en France dès 1689. Il y avait aussi des catholiques, car parmi les hardes il se trouva des images de la Sainte-Vierge."
"On rapporta des ancres d'une grosseur surprenante, des canons, des boulets, des chaînes de fer, des habits fort étoffés, des couvertures, des selles de chevaux magnifiques, des épées d'argent, des tentes bien doublées, des fusils en abondance, de la vaisselle, des ferrures de toutes sortes, des cloches, des agrès de vaisseaux et une infinité d'autres choses."
On en vendit pour 5000 livres.
Tout le monde courait à cet encan: chacun voulait avoir quelque chose des Anglais.
On y laissa beaucoup plus qu'on en put enlever; cela était si avant dans l'eau qu'il fut impossible de tirer tout ce qu'on vit.
On en rapporta deux ans après pour 12,000 livres, sans compter tout ce qu'on avait été d'ailleurs; c'en fut assez, ajoute naïvement la soeur Saint-Ignace, pour nous faire espérer que nos ennemis ne nous attaqueraient plus et pour affermir notre confiance en Dieu."
A Québec, l'effet de ce désastre fut immense. La nouvelle y était parvenue dès le 19 octobre 1711. C'était M. de la Valtrie qui, de retour du Labrador, l'avait annoncée le premier; et nos pères voyant que la colonie venait d'être sauvée d'une perte certaine, ne purent contenir leur joie. Le vocable de la petite église de la basse-ville de Québec, Notre-Dame de la Victoire, fut changé par la ville reconnaissante, en celui de Notre-Dame des Victoires.
"On ne parlait plus que de la merveille opérée en notre faveur, dit une chronique du temps; les poètes épuisèrent leur verve pour rimer de toutes les façons sur ce naufrage. Les uns étaient historiques et faisaient agréablement le détail de la campagne des Anglais; les antres satiriques et raillaient sur la manière dont ils s'étaient perdus. Le Parnasse devint accessible à tout le monde: les dames mêmes prirent la liberté d'y monter, quelques-unes d'entre elles commencèrent et mirent les messieurs en train, et non seulement les séculiers, mais les prêtres et les religieux faisaient tous les jours des pièces nouvelles."
En Angleterre, le retour de l'expédition de l'amiral Walker sema la honte à la cour et le deuil dans les familles. La main de Dieu ne cessa pas de s'appesantir sur le malheureux Sir Hovenden. A peine arrivé à Londres pour se rapporter à l'Amirauté, une estafette l'y rejoignit et lui annonça la plus terrible des nouvelles. L'Edgar, belle frégate de 70 canons, montée par 470 marins d'équipe, et qui avait navigué sous pavillon-amiral pendant une partie de la campagne, venait de faire explosion en rade de Portsmouth! Pas un homme, pas un officier, pas un document, n'avait été sauvé; et il ne restait pas même une épave pour être déposée plus tard au Musée Britannique, et y indiquer qu'une frégate du nom de l'Edgar avait existé jadis dans la marine royale.8
Qu'ajouter à cette série de malheurs?
Note 8: (retour)Parmi ces documents se trouvait l'original du journal tenu par Sir William Phipps lors de son expédition de Québec.
—The French minister came to me this evening, brought with him Sir William Phipp's original journal of his Québec expedition, and gave it me. This was blown up amongst several other material papers and draughts in the Edgar—Walker's Journal p. 87.
Pendant quelques années, Sir Hovenden Walker honni et ridiculisé par tous, lorsque son collègue,—le général Hill,—se voyait honoré d'un commandement, reçut dans sa retraite à Somersham, près de Saint Ives Huntington. Ses vieux camarades de l'Amirauté, qui avaient servi avec lui ou sous lui, oublieux de sa captivité en France et de ses vingt-huit années de commandement, pour ne plus se souvenir que du naufrage de l'Ile-aux-Oeufs, refusèrent pendant deux ans de régler ses comptes, sous prétexte que les pièces justificatives s'étaient perdues sur l'Edgar: puis, l'année suivante, sans aucun avis préalable, ils le retranchèrent de la liste des amiraux, et lui ôtèrent sa demi-solde. Enfin, un jour que l'amiral était de passage à Londres, un journal, le Saint James Post, ayant annoncé qu'il avait été arrêté à sa résidence de Newington Stoak par ordre de la Reine, Walker, qui aurait pu voir ses services acceptés par la république de Venise ou par le czar de Moscou, mais qui était trop loyal pour se mettre dans la position de pouvoir porter un jour les armes contre l'Angleterre, se décida le coeur navré, à quitter son implacable patrie pour se rendre dans la Caroline du Sud, y cultiver une plantation.
Là encore, les sarcasmes et la haine de ses compatriotes poursuivirent le proscrit anglais.
A sa grande surprise, après son désastre, l'amiral Walker avait été assailli à Boston, par une avalanche de brochures plus violentes les unes que les autres. J'ai dit à sa grande surprise, car Sir Hovenden qui rêvait d'éclipser la gloire de Drake et de Cavendish en s'emparant de Québec, pensait sérieusement être récompensé pour avoir ramené les restes de l'expédition. Dans ces brochures, le gouverneur Dudley, le colonel Nicholson, tous les New-Englanders s'en donnèrent à coeur joie sur le compte du malheureux amiral, et bientôt ces dénonciations parvinrent jusqu'en Caroline, où elles attisèrent tellement les passions populaires contre lui, que Sir Hovenden Walker fut obligé d'aller chercher un refuge aux Barbades.
Néanmoins, petit à petit ces haines et ces rancunes de l'orgueil anglais blessé, se turent. Le calme se refit dans cette existence brisée. Dès 1720, Sir Hovenden Walker put faire imprimer une justification et un rapport complet sur sa triste expédition, et ce journal fut accueilli avec assez de faveur, si l'on en juge par la rareté de ce bouquin, devenu presqu'introuvable aujourd'hui. Bientôt, l'oubli se fit autour du vieil amiral; et, revenu dans la Caroline, il finit par s'éteindre tranquillement dans sa plantation, en l'année 1725, au milieu des muses qu'il cultivait avec un certain succès, et entouré des éditions de son poète favori, Horace, qui lui avait fourni l'épigraphe de sa défense:
Sois fort dans la détresse et si ta bonne étoile
Fait naître enfin pour toi des vents moins désastreux;
A ces protecteurs dangereux
Ne livre qu'à demi ta voile.
—Il y a du vrai dans tout cela, et depuis que je suis ici, je me suis toujours douté de quelque chose de semblable, dit une voix étrangère, en s'adressant à Agénor Gravel. Des goélettes prises par le calme, dans la passe du Nord, y ont déjà repêché des canons. Dame! ils n'étaient pas neufs la rouille les rongeait; les huîtres et les coquilles s'étaient attachées au fer et au cuivre, et ils n'étaient plus de grande utilité, si ce n'est pour servir de lest. A l'autre bout de l'île, à la pointe des Anglais, la cabane du père Ruel est pleine de bayonnettes, de haches, de boulets et autres vieilles ferrailles, qu'il s'amuse à ramasser lorsqu'il ne pêche pas. Et, puisque vous êtes si curieux de ces choses, venez, avec moi jusqu'au phare: je vous donnerai un bout de baguette de fusil qui vient de l'Anglais, et que l'autre jour en seinant, nous avons ramené au plein.
Cette voix sympathique était celle de M. Paul Côté, l'excellent gardien du phare de l'Ile-aux-Oeufs.
Agénor ne se fit pas prier pour accepter ce morceau de cuivre tout rongé par le temps et par la mer. Il l'examina longuement: puis, après l'avoir retourné en tous sens, il le glissa flegmatiquement dans la fameuse sacoche, en nous disant sous forme de péroraison:
—Les bibelots du père Ruel, et ce bout de baguette de fusil, voilà peut-être tout ce qui reste maintenant pour raconter au passant la fin terrible de l'expédition de Sir Hovenden Walker. Si d'un côté l'histoire fut indulgente pour le marin anglais, et si quelques-uns de ses compatriotes, Smith entre autres, allèrent jusqu'à passer sous silence cette catastrophe, la légende s'empara de la navrante ballade, et c'est ainsi que la soeur Juchereau de Saint-Ignace écrivit plus tard que Sir Hovenden "craignant d'être mal reçu de la Reine fit sauter en l'air son navire quand il fut sur la Tamise". Il est vrai que Charlevoix assurait à son tour "qu'il se brisa sur l'Ile-aux-Oeufs avec sept de ses plus gros transports."
Puis après une pause:
—La première de ces assertions était sans doute suffisante pour donner libre cours à l'imagination de mon voisin de gauche, reprit Gravel en me regardant malicieusement, car, si je ne me trompe pas, tu as jadis écrit dans tes "Contes à la Veillée" l'histoire de cet amiral du brouillard qui demandait à ses persécuteurs:
—Pouviez-vous vous attendre à ce que j'ordonnasse au vent et à la tempête de s'arrêter? Serait-il devenu possible que, par les subtilités de la magie, j'eusse eu le pouvoir de créer l'ouragan et de tisser des brouillards dans le seul but de noyer tant de malheureux et de chercher le danger, sans aucun autre profit ou avantage pour moi, que le plaisir toujours stérile de faire le mal pour le mal?
Situé à soixante-et-dix pieds an-dessus du niveau de la haute marée et à six cents pieds au bout sud du rocher, le phare de l'Ile-aux-Oeufs est une construction octogone de trente-cinq pieds de haut. Cette tourelle surplombe la maison du gardien Paul Côté, et déjà sur le pas de la porte on voyait les figures souriantes de ses deux filles, qui s'empressaient pour mieux nous recevoir pendant que, par la fenêtre entr'ouverte un bel enfant, à l'oeil intelligent, mais aux joues pâlies par la fièvre et par la douleur, nous regardait venir d'un air tout étonné. Quinze jours auparavant, en voulant tirer sur une outarde, il s'était déchargé un fusil dans le bras gauche, et sa blessure soignée tant bien que mal par des gens qui n'avaient pas la moindre notion de chirurgie, présentait déjà les symptômes de la gangrène.
Pourtant, notre présence sur l'île avait ramené un peu de gaieté et partout dans cette maison régnait le plaisir de l'hospitalité. A l'intérieur du phare, tout n'était que joie, bruit et questions. La vaisselle, les nappes, les friandises des jours de fête sortaient des coffres et des armoires. Pendant que madame Côté trottinait et donnait des ordres pour nous faire servir une collation froide, Agenor et sa bruyante compagnie s'étaient emparés de l'harmonium placé dans le petit salon qui fait face à la mer, et entonnaient l'In exitu Israël de leur plus belle voix de mélomanes. Quant au maître de céans il ne flânait guère, non plus; et sous son oeil vigilant, pots, verres bols et carafons s'alignaient ainsi, sans vergogne sur table et commodes, défiant à qui mieux mieux la proverbiale sobriété de notre capitaine.
Ce fut alors qu'un de nos officiers mis en belle humeur par toutes ces bonnes choses, se prit à nous raconter sur la famille Côté un trait d'héroïsme qui mérite d'être connu.
Chaque année, du premier avril au vingt décembre, le phare de l'Ile-aux-Oeufs doit être allumé. Du côté de la mer il offre une lumière blanche, tournante, visible à quinze milles, et qui donne un éclat chaque minute et demie. Tous les marins savent si la rotation d'un phare à feu changeant doit se faire avec une précision mathématique. Autrement, il peut y avoir erreur. Une lumière est prise pour une autre, et un sinistre devient alors la fatale conséquence du moindre retard apporté dans le fonctionnement de la machine. Or, une nuit vers la fin de l'automne de 1872, le pivot de la roue de communication de mouvement qui s'abaisse, de manière à ce que les roues d'angle engrènent convenablement, se cassa. La saison était trop avancée pour faire parvenir la nouvelle à Québec et demander du secours au ministère de la marine. Force fut donc de remplacer la mécanique par l'énergie humaine, et le gardien, aidé par sa famille, se dévoua. Pendant cinq semaines, cet automne-là, et cinq semaines au printemps suivant, homme, femme, filles et enfants tournèrent à bras cet appareil. Le givre, le froid, la lassitude engourdissaient les mains; le sommeil alourdissait les paupières. N'importe, il fallait tourner toujours, tourner sans cesse, sans se hâter, sans se reposer, tant que durerait ce terrible quart, où la consigne consistait à devenir automate et à faire marcher la lumière qui indiquait la route aux travailleurs de la mer. Pendant ces interminables nuits, où les engelures, les insomnies et l'énervement s'étaient donné rendez-vous dans cette tour, pas une plainte ne se fit entendre. Personne, depuis l'enfant de dix ans jusqu'à la femme de quarante, ne fut trouvé en défaut; et le phare de l'île-aux-Oeufs continua, chaque minute et demie, à jeter sa lumière protectrice sur les profondeurs orageuses du golfe.
Que de navires, sans le savoir, furent sauvés, ces années-là, par l'héroïsme obscur de Paul Côté, de sa femme et de ses filles, les demoiselles Pelletier.
Déjà, quelques heures avaient été consacrées à la douce hospitalité de ces braves gens, lorsqu'un matelot vint nous prévenir que la baleinière attendait; et bientôt nous quittions l'île au milieu d'un feu de mousqueterie bien conditionné. Agénor s'était élu à l'unanimité chef de la pétarade du bord, pendant que Paul Côté, debout sur un rocher et armé d'un vieux mousquet français, s'efforçait de remettre consciencieusement à Gravel l'horrible tintamarre que ce dernier s'était ingénié à tirer hors des flancs de son harmonium.
Mais hélas! cent fois hélas! le psalmiste avait peut-être en tête le bourdonnement de ces bruyantes salves, lorsqu'il écrivait: "periit gloria, eorum tum sonitu." Bientôt, nous ne vîmes plus que de petits flocons de fumée blanchâtre s'élever de la falaise, où toussait le mousquet obstiné du gardien du phare, pendant que, toutes voiles dehors et vapeur à trois quarts de vitesse, nous laissions dans notre sillage le flot où dormaient les matelots de Sir Hovenden Walker, et que nous cinglions rapidement vers la baie des Sept-Iles.
Il ventait grand frais, et comme le baromètre s'était pris à baisser et qu'il présageait du gros temps, le capitaine décida que nous chercherions, pour la nuit, un refuge dans ce havre spacieux. Vers cinq heures de l'après-midi, nous nous engagions donc dans la passe qui s'ouvre entre les îles aux Basques et celles du Carousel et de la Manowin.
Rien de féerique comme le spectacle qui nous attendait au moment où nous allions débouquer le chenal du milieu, qui a une largeur d'un mille et quart. Incliné sous ses huniers et faisant demi-vapeur, le Napoléon III passait comme une flèche, rasant à une encablure à peine des rochers qui avaient de quatre à cinq cents pieds de hauteur, et dont les têtes semblaient avoir été atteintes par la lame d'acier de Roland qui, apprenant la trahison d'Angélique, s'amusait pour tromper sa douleur à fendre des montagnes d'un seul coup d'épée. Large de deux milles et trois quarts à son entrée, la baie des Sept-Iles s'étend à peu près à six milles du nord à l'ouest. Après avoir fait notre dernière abatée, l'ancre mordit sur un fond d'argile; et doucement à l'abri, au milieu de cet immense cercle qui pourrait contenir à l'aise les plus belles flottes du monde, on se serait cru alors sur un lac tranquille, si le sifflement du vent dans nos hunes et dans nos mâts de perroquet ne fût venu nous avertir que la tempête sûre de nous rejoindre une autre fois, passait fièrement au-dessus de nos têtes, dédaignant pour le quart-d'heure de secouer le Napoléon III dans ses bras nerveux.
Si un climat rigoureux, une terre aride et le défaut de bois de construction n'étaient là pour entraver ses débuts, il y aurait moyen de fonder sur cette grève sablonneuse un des plus beaux entrepôts de pêche, et l'une des plus fortes villes maritimes du continent américain. Six forts construits avec toutes les innovations créées par le génie moderne et jetés à l'entrée des chenaux de l'est, de l'ouest et du milieu—trois goulets qui mènent au fond de la baie—seraient suffisants pour défendre les passes et saborder n'importe quel vaisseau qui voudrait les forcer. Mais la solitude et la désolation semblent faites pour le Labrador; et il vaut mieux respecter le secret de Dieu qui, si l'on en croit une légende racontée par les gens de mer, a voulu que le silence, les longs hivers et l'abandon pesassent à tout jamais sur cette terre, qui fut maudite avant d'être donnée en partage à Caïn.
A la place de cette splendide cité que nous nous sommes amusés à fonder ce soir-là, on apercevait du pont du navire un maigre entrepôt de la compagnie de la Baie d'Hudson, et une petite chapelle destinée au culte catholique. Six hommes d'équipe nous conduisirent à terre, où nous fûmes accueillis par un Irlandais, facteur de la puissante raison sociale qui jadis avait le monopole des fauves arctiques, et régnait en souveraine jusque dans les solitudes du pôle nord. Ce brave homme nous fit les honneurs de son magasin, où nous ne vîmes qu'une assez mince provision de fourrures.
C'était l'époque de la traite avec les Montagnais. Sur la grève gisaient dix on onze ouigouams, autour desquels pullulaient des chiens à la queue en trompette. La cloche venait de tinter le signal de la prière du soir, et chacun dans la tribu se hâtait, pour arriver un des premiers, à la petite chapelle construite en bois et peinte en bleu à l'intérieur. Les hommes entraient de ce pas furtif et léger qui caractérise les races qui s'en vont, et allaient s'agenouiller du côté qui leur était réservé; pendant que dans leur compartiment, la tête enveloppée dans un large foulard rouge, les femmes s'accroupissaient sur leurs talons, et ressemblaient ainsi à ces moresques qu'aimait tant à peindre ce pauvre Henri Regnault, tué par les Prussiens à Buzenval. Bientôt, une voix vieillotte et nasillarde attaqua bravement le chapelet. La langue montagnaise doit se prêter admirablement à la déclamation, si l'on en juge par notre expérience de ce soir-là; car, tout en ne manquant pas un seul gloria, ni un seul ave, la vieille chargée de réciter la prière battait intrépidement la mesure sur les antipodes sauvages d'un rejeton des anciens néophytes du P. Maximin Leclère9. Le moutard, comme il en avait le droit, hurlait à coeur fendre, pendant que l'implacable main montait et descendait sur la partie lésée, avec la précision d'une pendule. Le chapelet ne subissait pas une minute de retard pour tout cela et une madone tricotée en laine jaune et bleue regardait cette exécution d'un air abasourdi, pendant qu'un saint, sculpté dans le chêne d'un mât trouvé au plain, donnait gravement dans sa niche, en se rappelant sans doute les périls qu'il avait courus jadis, sur la terre et sur l'onde. Au milieu de ces choses, certains parfums hétéroclites s'étaient hypocritement glissés dans l'atmosphère; et toute la tribu toussait comme si elle se disposait à entrer à l'hôpital. Un mouvement très prononcé de tangage et de roulis entre le pouce et l'index, sans cesse plongés dans le scalp d'ébène de ces enfants de la forêt, indiquait clairement que chaque personne, portait sur elle des myriades d'autres créatures du bon Dieu. Il n'en fallut pas plus pour décourager notre talent d'observateur. Agénor, malgré nos protestations, commençait à trouver éternels ces hommages rendus à la patience suprême, et de guerre lasse nous retournâmes respirer sur la grève, admirant sans réserve le courage des saints missionnaires d'autrefois qui, pour arracher ces âmes à l'ignorance et à l'idolâtrie, n'avaient pas craint d'affronter la misère, le froid, les rigueurs de l'hiver, les tortures, la maladie, and last but not least, l'incomparable vermine qui suit partout le peau-rouge.
Note 9: (retour) Le P. Maximin Leclère, frère du P. Chrétien Leclère, était de Lille en Flandre, et avait déjà servi cinq ans aux Sept-Iles et à l'île d'Anticosti. Harrisse, Bibliographie de la N-France, p. 160.
Il était écrit que nous ririons ce jour-là; car Agénor à qui son caractère nerveux ne permettait pas de rester en place, venait de découvrir le chef de ces ex-anthropophages. Il était assis gravement sur un banc, appuyant sans façon son royal dos sur le revêtement de la petite chapelle. Une casquette d'ingénieur de la marine anglaise, rehaussée par l'éclat d'un large galon d'or, ornait la tête huileuse du roi de ces parages qui, pour nous faire honneur, s'était aussi pompeusement paré que la mère Jézabel. Après s'être respectueusement incliné devant ce collègue du roi de Prusse, qui a nom Barthélémy I, nous cherchions et nous allions trouver quelques-unes de ces paroles polies et flatteuses qui concilient de suite, aux humbles et aux petits, la faveur des grands de la terre, lorsque Gravel, sans plus de façon se mit à marchander les mocassins en peau de caribou qui protégeaient les pieds de Sa Majesté. Barthélémy, avec toute la dignité possible, leva en l'air trois de ses doigts de potentat, pendant que ses lèvres royales daignaient laisser passer le mot "shilling". Agénor se mit alors à compter six douze sous, et ce fut ainsi que maître Gravel trouva le moyen d'entrer dans les bottes de S. M. Barthélémy I. Le roi devait pourtant avoir une joie plus complète encore que celle que lui procurait la possession de cette menue monnaie. Un de nos camarades de voyage, M. Smith, ayant tiré de sa poche un galon d'argent de la longueur de huit pouces, plus ou moins, remarqua un éclair de convoitise dans la prunelle du chef indien. Il le lui offrit gracieusement, et, dans son enthousiasme, Sa Majesté oublieuse de tout décorum, se mit à danser une gavotte autour de nous. Je crois qu'en ce moment nous aurions pu obtenir n'importe quoi de sa haute protection; d'autant plus que, si la chose existait en ce royaume, une baronnie vaudrait un mètre de galon rouge, et un duché s'échangerait contre une casquette anglaise. O Jean Verrazzano, ô Roberval, ô Cook, ô Marion, ô Lapeyrouse, dire que vous êtes disparus dans les oesophages de gens semblables à ceux-ci, et qui n'auraient pas demandé mieux que de troquer le déjeuner de ce matin-là, contre un bout de cuivre ou un vieux couteau de pacotille!
Pendant que nous prenions nos ébats à la cour de Barthélémy I, le temps était devenu aussi maussade que la figure d'un ministre en train de remettre son portefeuille. Un rideau de brume courait sur la mer. Nous nous embarquâmes avant qu'il eût eu le temps de nous masquer le Napoléon III, et bientôt nous dormions tranquillement sur nos ancres, bercés au bruit des rafales qui s'engouffraient le long des îlots mornes et déserts qui bouchent l'entrée de la baie.
A quelques encablures était mouillée une goëlette américaine, arrivée de la veille. La tempête l'avait forcée à venir chercher un refuge aux Sept-Iles, et dans le courant de l'après-midi, une embarcation se détacha de son arrière et se dirigea vers notre steamer. Elle était montée par le capitaine Johnson et cinq matelots américains, au nez en poinçon, à la tête osseuse et énergique, aux épaules athlétiques et à la chique monstrueuse. Partis de Gloucester depuis deux mois, ils faisaient la pêche au flétan, et trente mille livres de cet excellent poisson étaient déjà entassées dans la cale de leur bâtiment. L'équipage de ces goëletons de pêche est payé à la part: en moyenne, chaque homme gagne ainsi de cinquante à soixante piastres par mois, et cela pendant toute l'année, car pour eux la morte-saison n'existe pas, puisque l'hiver ils s'en vont prendre la morne sur les bancs de Terreneuve. En quatre jours, l'année précédente, notre hôte avait eu la chance d'emmagasiner à son bord 32,000 livres de ce dernier poisson.
Ces pêches miraculeuses se renouvellent souvent, et cet américain nous raconta qu'un de ses amis, le capitaine O'Brien de la goëlette l'Ossipee avait pris, en un mois, 90,628 livres de flétan qui, vu l'encombrement du marché, ne lui avaient rapporté pour cette courte croisière, que deux mille cinq cent trente-trois piastres. Il y a deux espèces de flétan, ajoutait le capitaine Johnson: l'une est blanche et se vend habituellement seize cents la livre, l'autre est grise et se donne pour onze cents.
Malheureusement, comme cela arrive presque toujours en Amérique, lorsqu'un mineur cupide frappe un filon qui rapporte, il finit par le gâter avant de lui faire donner son rendement. Il en a été de même pour la pêche au flétan dans les eaux canadiennes. Les Américains l'épuisent chaque année, et la conséquence inévitable de cette destruction, sans relâche, a été la baisse toujours croissante du prix de ce poisson recherché qui, s'il n'est protégé par une sage législation, finira par disparaître. Ce qui se vendait en 1873 pour seize et onze cents, ne valait plus en 1876 que neuf cents et demi et cinq cents et demi, et dernièrement encore la goëlette l'Arequipa appartenant à la maison Rowe et Jordan, commandée par le capitaine Dowdell, rentrait à Gloucester, après une station de treize jours dans le golfe Saint-Laurent, avec un chargement de 32,000 livres valant $2,100. La part seule du cuisinier, pour ces treize jours d'ouvrage se montait à $155, et celle de chaque homme d'équipage à $119.
Depuis la signature du traité de Genève, les armateurs et les pêcheurs américains ont le droit de venir vivre et faire fortune, où nos pêcheurs canadiens ne trouvent que le moyen de végéter et de se traîner dans la misère et la routine. Deux goëlettes américaines, assure le commandant Lavoie, dans son rapport de 1875, entrèrent un matin à la pointe aux Esquimaux, et à l'étonnement de ceux qui étaient présents, prirent à une distance de 20 à 50 verges du rivage 75,000 livres de flétan. Il est vrai que nos rivaux, au lieu de se diviser sur de niaises questions locales, et de s'asservir insoucieusement au monopole jersiais, ne négligent rien pour obtenir le succès et surtout de gros profits. Ils ont à leur disposition les plus fins voiliers, les engins de pêche les plus perfectionnés, les appâts les plus dispendieux, et par-dessus tout,—chose, paraît-il, impossible à rencontrer chez nous,—ils allient l'esprit de concorde à celui d'entreprise.
Si la visite du capitaine Johnson était intéressante pour nous, elle était pour lui on ne peut plus intéressée. Il venait s'informer si nous allions saisir sa goëlette, car elle péchait en contrebande; et il ignorait complètement ce qui s'était conclu lors de la convention de Genève. Or, le traité devenait en force quelques jours après. Notre capitaine jugea prudent de ne pas trop faire de zèle. Nous avions assez alors des réclamations de l'Alabama; et sur sa réponse négative, la joie reparut sur toutes ces figures de loups de mer.
On organisa un concert à bord. Un de nos lieutenants avait découvert un violon à trois cordes. Encouragée par les sons d'une petite flûte sournoise, une lutte d'harmonie s'engagea entre ces terribles instruments, le vent et les cordages, pendant que le capitaine qui n'y pouvait rien, nous racontait, en guise de distraction, la fin de son premier ingénieur, M. Crockett. Lors de la croisière précédente, ce musicien distingué, à force de faire des fugues et des arpèges, avait fini un beau soir par fermer à tout jamais son cahier de musique. Dans un moment de folie incontrôlable, il se figura que les modestes chants de la terre ne lui allaient plus. D'une main fébrile il avait déposé sa casquette d'uniforme sur le capot d'échelle, et du haut des bastingages de tribord il s'était perdu dans le trémolo de l'océan.
Ce récit me rappela la mort de mon ami, le commandant Têtu, qui était venu s'éteindre dans ces parages, et comme ce brave garçon subit la loi commune, et qu'il semble oublié maintenant, je crus bon, pendant que flûte et violon allaient toujours crescendo, de me réfugier sur le banc de quart, et là, d'essayer à me rappeler les moindres détails de cette triste occurrence.
On aurait dit que ces choses s'étaient passées la veille, tant elles se présentaient fraîches à ma mémoire.
C'était cependant vers les premiers jours de mai 1868: la goélette armée la Canadienne se balançait sur ses ancres, prête à quitter la rade de Québec, pour s'acheminer vers la haute mer. Une véritable coquetterie de marin avait présidé à son armement. Les matelots avaient endossé la tenue de service; le pont bien ciré donnait des reflets de glace de Venise; les canons brillaient comme un anneau de fiançailles; les flammes et les banderolles couraient du beaupré à la corne d'artimon, et de temps à autre un joyeux vivat s'échappait du carré des officiers. On partait pour la campagne de l'année pour courir sus à la contrebande et à la fraude, protéger le gagne-pain des pêcheurs du golfe; et le commandant qui tenait toujours à bien faire les choses, donnait à ses amis, ce jour-là un repas d'adieu.
La Canadienne partit joyeuse, s'inclinant coquettement sous le baiser de la vague, et entraînant avec elle son bruyant équipage.
Six mois se passèrent, et avec eux une croisière comme chaque parole d'adieu l'avait souhaitée. Puis au mois d'octobre—mensonge, ou plutôt vérité de la poussière humaine,—l'élégant officier que tous avaient connu si jovial, si spirituel, si dévoué à ce que la religion nous dit d'aimer sur la terre, nous revenait seul, cloué dans une caisse que l'on déposa vers minuit, sur un quai, au milieu des colis de la cargaison.
L'agonie s'était passée ainsi.
Partie le 11 octobre au matin de la Longue-Pointe, près de Mingan, la Canadienne, après s'être mise en panne vis-à-vis la rivière au Tonnerre, armait un canot sur l'ordre du commandant qui avait manifesté le désir de se rendre à terre.
En route, M. Têtu se plaignit d'une violente douleur dans la région du coeur; mais de retour à son bord, le mal avait disparu assez pour lui permettre de réciter à son équipage la prière du soir.
Le mieux continua à se manifester. Après le souper il causa avec un garde-pêche de la côte nord, Beaulieu, et comme la mer devenait forte, il donna l'ordre à son capitaine de mettre sur les Sept-Iles.
Vers onze heures de la nuit le malaise regagna du terrain. Croyant à une indigestion, le commandant, avec cette nature énergique que tous lui connaissaient, sauta hors de son cadre pour prendre ce qu'il croyait être un vomitif. C'était de la poudre antimoniale, substance comparativement inoffensive, écrivait son prédécesseur, le commandant Fortin. Plus tard, ajoutait-il encore, comme la douleur augmentait, il prit de la magnésie, puis de la menthe, puis deux légères doses d'opium.
Le mieux se montra de nouveau, et croyant que tout était fini, M. Têtu donna l'ordre au maître d'hôtel d'aller se reposer.
—Je sonnerai, s'il y a lieu.
Quelque temps après, le garde-pêche qui était couché dans le carré, vit le commandant passer dans son cabinet de toilette: il revint d'un pas ferme vers son lit, s'y appuya; puis joignant les mains, murmura:
—Mon Dieu! que je suis faible! Mon Dieu! ayez pitié de moi!
Ce furent là ses dernières paroles.
Quelques secondes après, le râle l'empoignait: et quand son compagnon de carré courut à lui, suivi du capitaine qui essaya de soulever le commandant dans ses bras, ces deux hommes atterrés ne purent saisir au passage que trois longs soupirs entrecoupés.
Le commandant Têtu venait de descendre son dernier quart.
Jeune—trente-quatre ans—doué d'une intelligence supérieure, d'une âme profondément catholique, d'un coeur loyal—dans une acception que bien des gens de notre siècle auraient peine à comprendre, Théophile Têtu remplissait à la satisfaction de tous le poste d'honneur qu'on lui avait confié. Ses études, militaires et scientifiques, ses connaissances en droit maritime, ses travaux particuliers, contribuèrent à en faire un spécialiste qui, hélas! n'eut que le temps de se faire regretter.
Le matin de ce triste jour, la Canadienne, flamme en berne, cinglait vers le bassin de Gaspé, emportant la dépouille de son ancien commandant. Le lendemain elle s'arrêtait au milieu de la baie. Une foule énorme était allée au-devant du cercueil qui, couvert du drapeau anglais, était porté sur les épaules de six marins de choix. Les cordons du poêle étaient tenus par les consuls et les notables: le canon grondait de minute en minute, et le deuil qui assombrissait toutes ces figures de pécheurs, au teint hâlé par le vent de la mer, donnait bien la mesure de la perte qu'ils venaient de faire.
Puis, tout en arpentant le banc de quart, mon esprit me ramenait à Québec, où la modestie qui avait présidé à la vie de M. Têtu avait jeté un dernier reflet sur ses funérailles.
Ici, plus de garde d'honneur, plus de clairons, plus de fanfares de deuil: mais-un long cortège d'amis se déroulant en file, sous un ciel gris et sombre d'automne, derrière un modeste cercueil, sur lequel reposaient les insignes de lieutenant de vaisseau.
Au cimetière, un temps d'arrêt au bord d'une fosse que les croque-morts avaient oublié de faire assez large; et ce bruit mat et mystérieux de la terre qui s'égrène et croule de la pelle du fossoyeur sur une tombe, où gît une parcelle du coeur de ceux qui se groupent silencieux autour du trou béant.
La mer rapproche de Dieu. Ce soir-là—et je n'ai pas besoin de l'écrire ici—une fervente prière fut dite pour l'âme de celui qui dort maintenant, à quelques pas de la fosse des pauvres, au pied d'une humble croix du cimetière de Belmont; de cette croix qui sera toujours pour le croyant ce qu'était l'ancre de salut pour le commandant de la Canadienne, un gage de foi et d'espérance en la miséricorde de son Dieu.
Au milieu de ces retours vers le passé, nous avions quitté l'hospitalière baie des Sept-Iles.
Elle commençait à s'effacer derrière nous, et le cap tourné vers l'Anticosti, nous tanguions et nous nous laissions emporter sur le dos flexible de la houle du large. Chacun avait regagné son cadre, excepté les officiers de service et le gardien du phare de la Pointe-aux-Bruyères, mon fidèle conteur Gagnier, qui ne tarissait plus, une fois qu'il était mis à même de nous dire quelques uns des terribles drames de son île.
—Avez-vous entendu parler de la catastrophe de la baie du Renard? me dit-il, en allumant un cigare.
—Non, mon ami. Où se trouve cette baie?
—A quelque vingt milles de mon phare, endroit où j'ai bien hâte d'arriver.
—Et que s'est-il donc passé à la baie du Renard?
—Quelque chose qui se présente assez souvent sur notre île. Il y a de cela assez longtemps, au printemps de 1820, un trappeur, en visitant ses pièges, fit la trouvaille d'une corde qui pendait le long d'un rocher. Il la tira à lui. Une cloche de navire se mit aussitôt à tinter. Le premier mouvement du chasseur fut celui de la frayeur; mais après avoir réfléchi, il fit le tour du plateau, et se trouva en face de trente cadavres. C'était tout ce qui restait de l'équipage et des passagers du vapeur le Granicus. Jetés à la côte vers la fin du mois de Novembre 1818, non-seulement ces malheureux avaient eu à combattre contre le froid; mais la faim s'était mise à les harceler sans pitié. La lutte avait été longue, à en juger par les tristes reliefs qui entouraient ces morts. Dans un four, construit tant bien que mal, à quelques pas de là, gisait la moitié d'un cadavre qui avait servi à repaître ces pauvres affamés. A la branche d'une pruche était suspendu le corps déchiqueté d'une petite fille qui, elle aussi, avait dû faire partie du lugubre garde-manger. Mangeurs et mangés furent enterrés pêle-mêle dans une vaste fosse que les pêcheurs ont eu la précaution d'entourer d'une palissade. Je vous mènerai voir ce triste endroit, si vous passez quelques jours au phare.
—Merci de votre complaisance, et je ne dis pas non, si le capitaine veut nous accorder cette relâche; mais en attendant, savez-vous que votre naufrage du Granicus m'en rappelle un autre qui s'est passé en 1736? A cette époque un gouvernement prévoyant n'avait pas encore songé à venir en aide aux marins dévoyés, en jetant sur leurs routes des phares, des amers, et, en cas de malheur, des dépôts de provisions et des maisons de secours. Ce naufrage est celui du P. Crespel. Embarqué sur la Renommée, vaisseau de 300 tonneaux, armé de 14 canons et commandé par M. de Freneuse, il vint se jeter "à un quart de lieue de terre, sur la pointe d'une batture de roches plates, éloignée d'environ huit lieues de la pointe méridionale de l'Anticosti". C'est peut-être une des plus navrantes légendes de l'île. A coup sûr, c'est la moins connue; et comme causer aide à tuer le temps à bord, je veux vous conter de fil en aiguille ce terrible épisode de la mer10.
Note 10: (retour) Ce naufrage est raconté à son frère par le père Emmanuel Crespel qui le lui décrit d'une manière très-vive. Bibaud nous dit dans son "Magasin du Bas-Canada" que, "ce récollet arriva dans la Nouvelle-France au commencement d'octobre 1724". Après être resté quelque temps à Québec, le P. Crespel fut nommé par Mgr de la Croix de Saint-Vallier missionnaire de Sorel, où il demeura deux ans. M. de Lignerie l'emmena alors comme aumônier de l'expédition contre les Outagamis, et à son retour le P. Crespel desservit le fort de Niagara pendant les trois années d'usage, puis successivement le Détroit, le fort de Frontenac, et celui de la pointe à la Chevelure, sur le lac Champlain: mission pénible s'il en fut une, assure-t-il, en mentionnant cette dernière dans son livre. Sauvé du naufrage de la Renommée, le P. Crespel fut nommé à la cure de Soulanges, où il demeura deux ans. L'ordre de ses supérieurs le fit alors repasser en France, sur le vaisseau du roi le Rubis, commandant de Jonquières, pour prendre le vicariat du couvent d'Avesnes en Hainault. Il y demeura jusqu'à ce qu'il fut nommé aumônier des troupes françaises commandées par le maréchal de Maillebois, et finit son long et dur apostolat par venir mourir à Québec, le 28 avril 1775, après avoir été pendant quinze ans supérieur commissaire de son ordre, au Canada.
—C'était le 3 novembre 1736 que M. de Freneuse partait de Québec avec 54 hommes à son bord11. Tout s'était passé sans aucune avarie jusqu'au 14 au matin. Il y avait bien eu, de fois à autre, quelque saute de vent qui, jeté au nord-nord-est, avait passé au nord-est, puis à l'est, pour se fixer pendant deux jours au sud-sud-est. Jusque là, solide et neuve, la Renommée se comportait admirablement. Les ris pris dans les huniers, elle louvoyait au large de l'Anticosti, se gouvernant sur son compas au sud-est-quart-est, puis au sud-est. Tout-à-coup, le vent fraîchit et se met à souffler en tempête. La lame se creuse, devient fatigante; et en voulant virer à terre, le navire touche, talonne et embarque aussitôt d'énormes paquets de mer. Il n'en fallait pas plus pour faire perdre la tête à une partie de l'équipage. Seul, le maître canonnier eut en ce moment le sang-froid de sauter dans la soute aux provisions, d'y prendre ce qu'il put de biscuit, de monter quelques fusils, un baril de poudre et une trentaine de gargousses, et d'entasser le tout dans le petit canot. Une vague vint sur ces entrefaites ajouter encore aux plaintes et à la confusion, en emportant le gouvernail de la Renommée, et le mât d'artimon rompu à coups de hache, étant tombé sur la hanche de bâbord, fit prêter la bande au malheureux navire.
Note 11: (retour) La Renommée devait se rendre à la Rochelle: elle était consignée à M. Pacaud, trésorier de France.
Impassible au milieu de ce chaos, M. de Freneuse donne l'ordre de hisser la chaloupe sur ses porte-manteaux. Vingt personnes embarquent; mais au moment où la dernière prend place, un des palans manque: et la moitié de cette grappe humaine est précipitée dans l'abîme pendant que ceux qui restent, se cramponnent aux plats-bord de l'embarcation, suspendue en l'air. Pas un muscle n'a bronché sur la figure de M. de Freneuse, à la vue de cette nouvelle catastrophe. D'une voix forte il donne l'ordre de filer le palan d'arrière. Mais au moment où la chaloupe reprend son équilibre et touche au flot, une vague brise le gouvernail de l'embarcation, et celle-ci mal assise, est rasée coup sur coup par deux lames. On parvient pourtant à pousser au large. Un des sous-officiers gouverne le mieux possible avec un mauvais aviron, et matelots et passagers trempés par la pluie qui tombait par torrents et masquait l'atterrage, la figure fouettée par les embruns de la mer, rament au plus près, en récitant à haute voix le confiteor, et en s'unissant au P. Crespel qui psalmodiait les versets du miserere. Pendant ce temps, un ressac terrible bat à la côte. On l'entend clairement à bord. Le bruit va grandissant. Tout-à-coup la chaloupe entre dans le tourbillon mugissant. Une lame énorme l'empoigne, la soulève, la chavire, et roule chacun pêle-mêle et meurtris sur le sable et sur les galets de la grève.
Un nouvel acte de sang-froid venait de prolonger les jours de ces malheureux. Voyant la chaloupe grimper sur le dos de la dernière vague, et prévoyant qu'elle la reporterait au large, un matelot avait passé un grelin dans un organeau, l'avait enroulé autour de son poignet, et s'était laissé porter à terre avec lui.
La mer venait de lâcher sa proie; mais la position des naufragés n'en était guère devenue meilleure. Le hasard les avait jetés sur un îlot que la marée haute recouvrait, et en gagnant la terre ferme, ils faillirent périr une troisième fois. Il fallait traverser à gué la rivière du Pavillon.
Quelques heures après, le petit canot monté par six personnes vint les rejoindre. Elles rapportaient que dix-sept matelots n'avaient pas voulu abandonner M. de Freneuse. Ce dernier ne pouvait se décider à quitter son navire; et on peut se faire une triste idée de cette première nuit passée, par les uns sans abri et sans feu sur cette terre déserte de l'Anticosti, par les autres sur un navire battu en brèche par la mer, et certains d'être engouffrés par elle d'une minute à l'autre.
A minuit, la tempête était dans toute sa violence. Chacun avait perdu l'espoir de se sauver, lorsqu'au petit jour, on s'aperçut que le navire tenait bon. La violence du flot était tombée. Il n'y avait plus une minute à perdre pour le sauvetage, et chacun se mit à l'oeuvre. On embarqua des provisions avariées, les outils du charpentier, du goudron, une hache, quelques voiles. Puis, il fallut regagner terre; et le capitaine de Freneuse les larmes aux yeux et emportant son pavillon, quitta le dernier l'épave de la Renommée.
Cette seconde nuit passée sur l'île, fut encore plus triste que la première. Il tomba deux pieds de neige. Sans les voiles, tout le monde serait mort de froid. Ces rudes débuts ne découragèrent personne; de suite on se mit au travail. Le mât d'artimon de la Renommée était venu du plain; on tailla dedans une quille nouvelle pour la chaloupe. Elle fut calfatée avec soin, et son étambot et ses bordages furent refaits à neuf. Pendant que les uns coupaient du bois, les autres faisaient fondre la neige. Bref, on se créa le plus d'occupations possibles pour tâcher d'oublier: mais hélas! à ces heures de travail, succédèrent bientôt les heures d'épuisement. Les malheureux naufragés avaient, au moins, une perspective de six mois sur l'île d'Anticosti, puisqu'il leur fallait y attendre l'ouverture de la navigation. Or, en ces temps-là, les navires qui passaient de Québec en France n'emportaient que pour deux mois de vivres. Au moment où elle avait touché, la Renommée avait onze jours de mer; une partie des provisions étaient avariées par le naufrage, et en s'astreignant à la plus stricte économie, c'est-à-dire en ne distribuant à chacun qu'une maigre ration par vingt-quatre heures, chaque homme pouvait—tous calculs faits—prolonger sa vie de quarante jours! A cette incontestable certitude, était venu se joindre l'hiver, arrivé dans toute sa rigueur. La glace rendait le navire inaccessible; six pieds de neige couvraient le sol, et pour comble de désespoir, les fièvres venaient de faire leur apparition et exerçaient de faciles ravages sur ces natures émaciées.
Il fallut prendre une décision suprême.
Un poste français passait alors l'hiver à Mingan, où il s'occupait à faire la chasse au loup-marin. Pour se rendre là, il fallait d'abord faire quarante lieues de grève avant d'atteindre la pointe nord-ouest de l'île, puis comme le dit le P. Crespel, "descendre un peu et traverser douze lieues de haute mer". On agita l'idée de se diviser en deux groupes. L'un devait rester à la rivière au Pavillon: l'autre irait à Mingan chercher du secours. Lorsque cette proposition fut soumise au conseil, chacun la trouva inattaquable. La grande difficulté consistait à désigner ceux qui feraient du premier groupe, et ceux qui feraient partie du second. C'était à qui ne resterait pas en arrière.
Dans cette pénible alternative, le P. Crespel eut recours à Dieu. Le 26 novembre, il dit la messe du Saint-Esprit; et dès que le saint sacrifice eut été terminé, vingt-quatre hommes se levèrent, et prirent la résolution de se résigner à la volonté divine, assurant qu'ils hiverneraient coûte que coûte à la rivière au Pavillon.
Cet acte d'abnégation tranchait le noeud gordien. Toute cette nuit-là fut employée à entendre des confessions; et le lendemain, après avoir laissé des provisions à ces braves gens, et leur avoir juré sur les saints Évangiles qu'ils reviendraient les reprendre aussitôt que possible, le capitaine de Freneuse, le P. Crespel, M. de Senneville, suivis de trente-huit personnes, prirent le chemin de l'inconnu. La misère et le danger avaient nivelé la position de ces hommes. Avant de se quitter officiers et matelots s'embrassèrent en pleurant. Hélas! bien peu devaient se revoir.
En partant, M. de Freneuse subdivisa ses gens en deux sections. Treize d'entre eux manoeuvraient le petit canot; vingt-sept s'embarquèrent dans la chaloupe. Jusqu'au 2 décembre, cette navigation de conserve fut affreuse. A peine gagnait-on chaque jour deux ou trois lieues qu'il fallait faire à la rame, et par un froid intense. Le soir, on dormait sur la neige: et pour toute nourriture ces pauvres abandonnés n'avaient qu'un peu de morue sèche, et quelques gouttes de colle de farine détrempée dans de l'eau de neige.
Le 2 décembre, le temps se mit au beau. Une petite brise soufflait sans âpreté, et la joie renaissait sur ces figures hâves et décharnées, lorsqu'en voulant doubler la pointe sud-ouest, la chaloupe qui allait à la voile, fit la rencontre d'une houle affreuse. En manoeuvrant pour lui échapper, elle perdit le canot de vue. Plus tard on sut ce qu'était devenu ce dernier: il s'était laissé affaler. Mais comme pour le quart d'heure, il fallait faire terre au plus vite, on finit par y parvenir à deux lieues de là, au milieu de mille précautions. Un grand feu fut allumé sur la côte, pour indiquer aux retardataires où se trouvaient les gens de M. de Freneuse; puis, après avoir mangé un peu de colle, ils s'endormirent dans l'eau et dans la neige fondante, pour n'être réveillés que par une tempête terrible. Dès ses premières bourrasques, elle jeta la chaloupe à la côte. Il fallut alors s'occuper à la réparer de suite; mais ce contre-temps eut son bon côté. Deux renards qui étaient venus rôder dans les environs furent pris au piège, et cette viande fraîche devint par la suite d'un grand secours.
Dès le 7 décembre, M. de Freneuse put reprendre la mer, mais le coeur navré. Malgré de nombreuses reconnaissances, il n'avait pu découvrir aucune trace de son canot.
A peine la chaloupe eut-elle fait trois heures de marche qu'une nouvelle tempête l'assaillissait au large. Pas un havre, pas une crique ne s'offrait pour donner refuge à ces malheureux; et cette nuit-là fut peut-être une des plus terribles qu'ils eurent à endurer. Ils la passèrent à errer au milieu des vagues et des glaces, dans une baie où le grappin ne mordait pas. On ne réussit à débarquer qu'au petit jour, au milieu d'un froid brûlant, qui ne tarda guère à faire prendre la baie, et avec elle la chaloupe. Dès lors celle-ci devenait inutile.
Il fallut donc se décider à ne pas pousser plus loin. Les provisions furent débarquées; et de suite on se mit à l'oeuvre pour construire des cabanes en branches de sapin12, ainsi qu'un petit dépôt, où les vivres furent disposés de manière, à ce que personne ne pût y toucher sans être aussitôt vu par les autres. Puis, on adopta un règlement pour la distribution. Chacun avait droit à quatre onces de colle par jour; et on fit en sorte que deux livres de farine et deux livres de viande de renard pussent servir au repas quotidien de dix-sept hommes! Une fois la semaine, une cuillerée à bouche de pois venait rompre la monotonie de cette cuisine; et en vérité, dit le P. Crespel, c'était le meilleur de nos dîners.
Note 12: (retour) Le P. Crespel qui, dans ses missions chez les Outagamis s'était mis au fait de cette étude d'architecture primitive, avoue ingénument que sa cabane était la plus commode.
Les exercices du corps devinrent obligatoires. Léger, Basile et le P. Crespel allaient couper des fagots et faire du bois; d'autres transportaient l'approvisionnement aux cabanes; les troisièmes traçaient ou entretenaient la route qui menait à la forêt. Au milieu de ces occupations, les épreuves ne faisaient guère défaut. La vermine rongeait ces malheureux qui n'avaient qu'un change pour tous vêtements. La fumée des huttes et les éblouissantes blancheurs de la neige donnaient à la plupart de douloureuses ophtalmies; et la mauvaise nourriture, jointe à l'eau de neige, avaient engendré la constipation et le diabète, sans faire, pour cela, ployer d'un cran l'énergie de ces hommes de fer.
Le 24 décembre, le P. Crespel fit dégeler quelques gouttes de vin. La Noël approchait; et il se préparait à dire la messe de minuit. Elle fut célébrée sans pompe, ni ornements, dans la plus grande des cabanes. Ce dut être un spectacle sublime que de voir tous ces abandonnés, se recueillir au milieu des solitudes de l'Anticosti, et dans leur dénuement sans exemple, se rapprocher d'un enfant nu et couché dans une étable, pour mêler leurs larmes aux siennes, et pour l'y adorer.
L'année 1737 débuta pour ces pauvres gens d'une manière, terrible. Dès l'aube du jour de l'an, Foucault envoyé à la découverte, revint avec la poignante nouvelle que la chaloupe avait été enlevée par les glaces. Pendant cinq jours, ce ne furent que gémissements et lamentations. Tout le monde se sentait perdu. Chacun voulait mourir. L'esprit de suicide passait et repassait dans ces cerveaux troublés par tant de malheurs, et le P. Crespel ne cessa, pendant ce temps, de leur démontrer la grandeur de l'apostolat de la souffrance: cette seule voie que Dieu avait prise pour racheter le genre humain. Il les supplia de se confier en la miséricorde divine; célébra le jour des Rois une seconde messe du Saint-Esprit, pour le prier de donner sa force et ses lumières à ces âmes si éprouvées, et parla dans son sermon, de la grandeur de la mission qui incombe à ceux qui se dévouent pour sauver les autres. Touchés par ces bonnes paroles, Foucault et Vaillant s'offrirent pour aller à la recherche de la chaloupe.
—Tant il est vrai, ajoute finement le P. Crespel, que dans quelque situation que l'on soit, on aime toujours à s'entendre élever. L'amour-propre ne nous quitte qu'avec la vie.
Bien leur prit de cet excès de zèle. Deux heures après, ils accouraient tout joyeux, et annonçaient à leurs camarades qu'en fouillant la grève et le bois, ils étaient tombés sur un ouigouam indien, et sur deux canots d'écorce abrités sous des branches. Comme trophée de leur expédition, ils emportaient une hache et de la graisse de loup-marin.
L'île était habitée!
Il n'y avait plus à en douter, et les éclats de la joie la plus vive succédèrent au plus sombre des chagrins. Chacun sentait le courage lui revenir. Le lendemain fut tout aussi joyeux. En poussant plus loin leurs excursions, deux matelots découvrirent la chaloupe arrêtée au large, dans un champ de glace, et en revenant au camp avec cette heureuse nouvelle, ils firent l'inappréciable trouvaille d'un coffre plein d'habits, que le flot avait arraché à la Renommée, et que les hasards de la mer étaient venus apporter là.
Mais tous ces rires ne durèrent qu'un éclair. L'épreuve allait revenir plus amère que jamais.
Le 23 janvier, le maître-charpentier mourut presque subitement. Des symptômes alarmants s'accentuèrent de plus en plus. Fresque tous les hommes eurent les jambes enflées: et le 16 février, un coup terrible vint foudroyer le camp. Le capitaine de Freneuse s'en était retourné vers Dieu, au milieu des prières de l'Extrême-Onction. Puis, ce fut autour de Jérôme Bosseman; puis, à celui de Girard; puis, au maître-canonnier qui, avant de mourir, abjura le calvinisme. Chacun, avant l'heure suprême, se confessait au P. Crespel, et s'éteignait saintement dans la résignation. Quand tout était fini, les moins faibles se levaient, traînaient au dehors les cadavres de leurs camarades, et les amoncelaient dans la neige, à la porte de la cabane. Nul n'avait la force d'aller plus loin.
Les éléments conjurés luttèrent avec ces angoisses terribles. Le 6 mars, une tempête de neige se déchaîna sur l'île et écrasa sous une avalanche la cabane du P. Crespel, le forçant à venir se réfugier dans celle des matelots, qui était plus spacieuse. Là, pendant trois jours, ils furent retenus prisonniers par l'ouragan, sans pouvoir allumer du feu, n'ayant rien à manger, ne se désaltérant qu'avec de la neige fondue, et voyant périr de froid cinq de leurs camarades. A tout prix, il fallait sortir de ce tombeau. En unissant leurs efforts, ils réussissent à déblayer la neige et vont alors aux provisions. Hélas! le froid est piquant. Un quart d'heure suffit pour geler les pieds et les mains de Basile et de Foucault, qu'il faut rentrer à bras dans la cabane. Grâce cependant au dévouement de ces deux hommes, une ration de trois onces de colle vint rompre ce jeûne de trois jours; mais elle fut mangée avec tant d'avidité, que tous faillirent en mourir. Encouragés par l'exemple de Basile et de Foucault, Léger, Furst et le P. Crespel courent au bois pour en remporter quelques fagots. Dès huit heures du soir cette maigre provision est déjà consumée, et le froid devint si intense cette nuit-là, que le sieur Vaillant père fut trouvé mort sur son lit de branches de sapin. Il fallut songer à changer de cabane et à déblayer celle du P. Crespel. Elle était la plus petite, et pouvait être plus facilement chauffée. On ne peut imaginer rien de plus navrant que le sombre défilé qui se fit alors: les moins écloppés portant sur leurs épaules MM. de Senneville et Vaillant fils qui tombaient par morceaux, pendant que Le Vasseur, Basile et Foucault, ayant les extrémités gelées, se traînaient sur leurs coudes et sur leurs genoux.
Le 17 mars, la mort vint mettre un terme aux souffrances de Basile; et le 19, Foucault, qui était jeune et d'une grande force musculaire, s'éteignit après une agonie terrible. Les plaies de ces malheureux ne pouvaient être pansées qu'avec de l'urine, et des lambeaux de vêtements arrachés aux pauvres morts servaient de charpie aux vivants. Douze jours après ces deux départs, les pieds de MM. de Senneville et Vaillant se détachèrent en putréfaction; mais, au milieu de ces douleurs et de cette infection, ils ne cessaient de mettre leur confiance en Dieu et d'unir leurs souffrances à celles du Christ. Le P. Crespel était ému de cette foi inébranlable et de cette résignation sublime qui semblaient se refléter sur les autres; car, au milieu de toutes ces horreurs, pas un mot de découragement ne se fit entendre. Chacun essayait d'apporter à son voisin quelques distractions ou quelques douceurs; et ce fut ainsi que le 1er avril, en allant à la découverte du côté où les canots d'écorce étaient cachés, Léger ramena au camp un indien et sa femme.
C'étaient les premières figures humaines qu'on eût vues depuis le départ de la rivière au Pavillon. Le P. Crespel parlait à merveille plusieurs idiomes sauvages; il expliqua à ces nouveaux hôtes leur triste situation, et les supplia les larmes aux yeux d'aller à la chasse et de leur apporter des vivres.
L'indien promit solennellement.
Le lendemain arrive. Deux jours, trois jours se passent; le peau-rouge ne revient pas. Alors n'y pouvant plus tenir, Léger et le P. Crespel se traînent jusqu'au ouigouam, mais pour constater avec terreur qu'un des canots est disparu! Rendues prudentes par le malheur, ces deux ombres décharnées s'attellent sur celui qui restait, le transportent jusqu'à leur cabane et l'attachent à la porte, bien persuadées que l'un des indiens ne quittera pas l'île, sans venir réclamer sa propriété.
Hélas! nul ne vint, sinon la terrible visiteuse accoutumée, la mort. Elle enleva successivement MM. Le Vasseur, Vaillant fils, âgé de seize ans, et de Senneville qui en avait vingt, et était fils du lieutenant du Roy, à Montréal13. Dégagé du soin des malades et n'ayant plus de vivres, le P. Crespel réunit alors en conseil les survivants. Il fut décidé de quitter cet endroit funeste et de partir en canot. Pour rendre serviable l'embarcation de l'indien, on l'enduisit de graisse: des avirons furent dégrossis, et le 21 avril fut désigné comme le jour de l'embarquement.
Note 13: (retour)Le père du jeune de Senneville, avant d'exercer la charge de Lieutenant du Roy de Montréal, avait été page de madame la Dauphine, et avait servi dans les mousquetaires. Son fils était né au Canada.
—On dirait qu'une étrange fatalité s'attache à ce nom de Senneville. Lors du naufrage de l'Auguste, M. de Senneville, cadet à l'aiguillette, et mademoiselle de Senneville furent au nombre des noyés.
Ce terrible sinistre eut lieu sur les côtes du Cap-Breton en octobre 1761. L'Auguste, était un navire affrété par le général Murray pour rapatrier en France les officiers, les soldats et les Français qui en avaient manifesté le désir. Il portait à son bord les soldats du Béarn ainsi que ceux du Royal Roussillon. Parmi les victimes de ce désastre furent les capitaines, MM. le chevalier de la Corne de Bécancour de Portneuf: les lieutenants, MM. de Varennes, Godefroy, de la Vérenderie, de Saint-Paul, de Saint-Blin, de Marolles et Pécaudy de Contrecoeur; les enseignes en pied, MM Villebond de Sourdis, Groschaine-Rainbaut, de Laperière, de la Durantaye et d'Espervanche; et les cadets à l'aiguillette, MM. de la Corne de Saint-Luc, le chevalier de la Corne, de la Corne-Dobreuil, de Senneville, de Saint-Paul fils, et de Villebond fils.
A cette nombreuse liste, M. Saint-Luc de La Corne, qui fut un des cinq survivants de ce naufrage, ajoute les noms de Paul Héry, François Héry, Léchelle, Louis Hervieux, bourgeois, et de mesdames de Saint-Paul, de Mézière, Busquet, de Villebond, ainsi que ceux de mesdemoiselles de Sourdis, de Senneville et de Mézière.
M. de Lacorne retrouva aussi sur la grève, et enterra le corps d'un négociant anglais nommé Delivier, le second, trois officiers de l'Auguste, le maître d'hôtel, huit matelots, deux mousses, le cuisinier, douze femmes tant de bourgeois que de soldats, seize enfants, huit habitants et trente-deux soldats.
Une moitié de jambon de renard composait alors tout le garde-manger de cette troupe d'affamés. Il avait été entendu qu'on en boirait le bouillon, réservant la viande pour le lendemain: mais dès que les parfums de cet étrange pot-au-feu se firent sentir, chacun se jeta comme un loup sur le gigot, qui fut mangé en un tour de main. "Bien loin de nous rendre nos forces, cet excès nous en ôta", dit la relation laissée par le P. Crespel: de sorte que le lendemain ils se réveillèrent affaiblis, plus malades qu'auparavant, et qui plus est, sans ressources. Deux jours se passèrent alors dans la faim et le désespoir. Personne ne voulait lutter plus longtemps contre la mort; et déjà, la plupart s'étaient jetés à genoux sur la grève en disant les litanies des agonisants, lorsqu'un coup de fusil retentit sur le rivage.
C'était l'indien. Propriétaire prévoyant il venait savoir ce qu'était devenu son canot.
En l'apercevant, les malheureux se traînent vers lui, poussant les plus navrantes supplications; mais le sauvage n'entend pas de cette oreille, et prend la fuite. Le P. Crespel et Léger sont en bottes: qu'importe? Ce nouvel abandon rend l'haleine à ces moribonds. Ils se mettent à donner la chasse au fugitif; traversent tant bien que mal la rivière Becsie, et finissent par rejoindre le fuyard, qu'un enfant de sept ans embarrasse dans sa course. Pris comme un lièvre au collet, le peau-rouge, redevenu diplomate, leur indique un endroit du bois où il a caché un quartier d'ours à demi-cuit, et tous ensemble, Indien et Français passent la nuit blanche à s'observer mutuellement du coin de l'oeil.
Le lendemain, le P. Crespel intime au sauvage l'ordre de le conduire au camp de sa tribu. Le canot contenant l'enfant, devenu un otage, est placé sûr un traîneau: Léger, et le père Récollet s'attellent dessus, pendant que l'indien marche devant et sert de guide. Au bout d'une lieue de marche la petite caravane débouche sur la mer, et comme c'était la voie la plus courte, on se décide à la prendre. Mais ici s'élève une nouvelle difficulté. Le canot ne peut contenir que trois personnes. L'indien a désigné pour l'accompagner son enfant et le P. Crespel qui, s'embarque au milieu des lamentations de ses camarades, à qui, cependant, il réussit à arracher le serment de suivre le rivage dans la direction, prise par l'embarcation.
Le soir de ce jour-là, l'indien proposa au père de descendre à terre pour y faire du feu. Ce dernier y consentit, avec d'autant plus de plaisir que la bise était mordante. Mais étant monté sur un monticule de glace pour examiner les alentours, le sauvage profita de ce que le père avait le dos tourné, pour gagner le bois avec son enfant.
La mort seule pouvait maintenant mettre fin à cette série de catastrophes. Abandonné de tous, le P. Crespel s'appuya sur le canon de son fusil, remit ses peines entre les mains de Dieu, et récita les versets du livre de Job. Pendant qu'il priait ainsi, il fut rejoint par Léger. Avec des larmes dans la voix, ce dernier lui annonça que son camarade Furst était tombé d'épuisement à une distance considérable de là, et qu'il avait été obligé de le laisser sur la neige.
En ce moment, un coup de fusil retentit. La forêt s'ouvrait à quelques pas de là. Léger, que le courage n'avait pas encore laissé, décide le père Récollet à l'y accompagner, et au moment de s'y engager, un deuxième coup de feu se fait entendre. Rendus de plus en plus prudents par l'expérience, les deux abandonnés se gardent bien d'y répondre. Ils marchent, se guidant sur l'endroit d'où viennent ces détonations; et bientôt, ils débouchent dans une clairière où fumait la cabane d'un chef indien.
Ce brave homme leur fit le plus touchant accueil, tout en leur expliquant l'étrange conduite du guide du P. Crespel, qui ne les avait ainsi abandonnés, que par crainte du scorbut, de la variole, et du "mauvais air."
Enfin, ceux-ci étaient sauvés! mais tout n'était pas fini, Furst restait en arrière. Le Père Crespel, offrit en cadeau son fusil au chef pour le décider à l'aller chercher. Ce fut peine inutile. "M. Furst, dit la relation, passa la nuit sur la neige, où Dieu seul put le garantir de la mort, car dans la cabane même, nous endurâmes un froid inexprimable, et ce ne fut que le lendemain, comme nous nous disposions à aller au-devant de lui, que nous le vîmes arriver".
Deux jours furent alors consacrés au repos. Pendant ce court espace de temps, ces malheureux qui n'oubliaient pas le serment fait à ceux qui étaient restés à la rivière au Pavillon, recouvrirent assez de leurs forces pour s'embarquer le premier mai et mettre le cap sur Mingan. Le P. Crespel fut le premier à y arriver. Le vent étant tombé en route, ce vaillant homme, dans sa hâte de faire expédier aussitôt que possible des secours à ses camarades, s'était fait mettre sur un canot d'écorce et l'avait pagayé seul, pendant l'espace de six lieues de mer.
M. Volant commandait le poste de Mingan. Il reçut ses compatriotes à merveille. Pas un instant ne fut perdu pour aller au secours de l'équipage de la Renommée: et une grosse chaloupe armée, et bien approvisionnée fut dépêchée sous son commandement.
M. Volant emmenait avec lui le P. Crespel, Furst et Léger.
Dès qu'ils furent par le travers de la rivière au Pavillon, une salve de mousqueterie fut tirée. Alors on vit quatre hommes, qui ressemblaient à des fauves, sortir du bois, se jeter à genoux, et tendre des bras suppliants vers la chaloupe. Les soins les plus empressés furent donnés à ces gens qui n'étaient plus que de véritables squelettes. Pendant les pérégrinations du P. Crespel et de sa troupe, ces pauvres matelots avaient enduré d'incroyables souffrances. Tour à tour ils avaient vu leurs camarades tomber, décimés, les uns par le froid, les antres par les maladies gangreneuses; tous par l'inanition. Les vivres finirent par manquer complètement. Alors on eut recours aux expédients. Tout passa pour la nourriture jusqu'aux souliers des morts que l'on faisait bouillir dans de la neige, puis griller sur la braise, et quand cette dernière ressource manqua, on se rejeta sur les culottes de peau. Il n'en restait plus qu'une, lorsque M. Volant était arrivé en sauveur, et devant ces inénarrables misères, ce dernier comprit toutes les précautions dont il fallait user. Des ordres sévères furent donnés pour qu'on ne distribuât que peu de nourriture à la fois à ces estomacs qui en avaient perdu l'habitude; mais malgré cela, l'un des survivants, un breton nommé Tenguy, mourut subitement en avalant un verre d'eau-de-vie, et la joie fit perdre la raison à Tourillet, un autre de ses camarades d'infortune.14 Quant aux autres, Baudet et Boneau—tous deux originaires de l'île de Rhé—ils se mirent à enfler par tout le corps, et la chaloupe de M. Volant fut changée en infirmerie, pendant qu'à terre, on s'occupait à donner la sépulture aux vingt et un cadavres qui marquaient l'endroit, où la première escouade des matelots de la Renommée avait passé son dernier hiver.
Note 14: (retour) Tourillet était contre-maître, du département de Brest.
Une modeste croix indiqua le lieu où ils avaient souffert, où ils s'étaient résignés, et où le sacrifice avait été consommé; puis, on reprit la mer, en côtoyant le rivage à distance, rapprochée et en remontant à petites journées, afin de découvrir les traces des gens du canot.
A quelques lieues de l'endroit où s'élève aujourd'hui le phare gardé par M. Pope, les gens de M. Volant découvrirent les corps de deux hommes qui gisaient sur la grève, non loin des fragments d'une petite embarcation. C'était tout ce qui restait, pour indiquer le sort des treize hommes qui avaient vogué de conserve avec la chaloupe de M. de Freneuse, jusqu'au moment où ce dernier les avait perdus de vue, en doublant par une grosse mer la pointe sud-ouest, le soir du deux décembre 1736.
Pendant le cours de ce récit, la lune s'était levée: elle éclairait de sa lumière mélancolique les flots qui doucement bruissaient sous la proue du Napoléon III. Déjà le matelot de vigie avait piqué le quart de minuit. Nous regagnâmes alors nos cadres, afin d'être plus frais et dispos, lorsque le maître d'équipage viendrait nous éveiller le lendemain, pour descendre à cette pointe ouest de l'île d'Anticosti, qui avait vu s'embarquer le P. Crespel allant chercher à Mingan la bonne nouvelle, pour la rapporter aux trois survivants de la Renommée.
Dès sept heures du matin, le Napoléon III mouillait par le travers de la pointe ouest de l'Anticosti15 et le vent de terre nous apportait le bruit de la canonnade qui saluait notre arrivée. Les habitations du poste se pavoisaient de drapeaux et de banderolles en signe de réjouissance; et bientôt nous étions reçus à bras ouverts par le gardien du phare, M. Malouin, qui certes, ne s'attendait pas à la surprise que nous lui ménagions.
Note 15: (retour) Le mot Anticosti est indien et non espagnol (ante en face costa de la côte) comme l'ont prétendu certains étymologistes. Thévei appelle cette Ile Naticousti dans son Grand-Insulaire; Lescarbot Anticosti, et Haklûyt Natiscotee. "Ce dernier mot, remarque l'abbé Laverdière, se rapproche davantage de celui de Natas couel (où l'on prend l'ours) que lui donnent les Montagnais".
Un fort cheval normand attelé à une lourde charrette de roulage, aux roues peintes en rouge, était venu au devant de la chaloupe, et nous attendait avec de l'eau jusqu'au poitrail. La baleinière ne pouvait atterrir, et cet, ingénieux genre de locomotion exempta les pieds de nos seigneuries de venir en contact avec l'onde-amère qui, ce matin-là, était de ces plus, froides et de ces plus basses. Entassés pêle-mêle sur le véhicule amphibie, nous fûmes présentés en bloc à M. Malouin qui, tout en nous aidant à sauter sur la grève, nous dit du ton le plus cordial du monde:
—Soyez les bienvenus, messieurs!
Tout-à-coup, un passager s'avança vers lui, tête nue, et s'adressant au vieux gardien du phare lui dit d'un ton tremblant:
—Ne me reconnaissez-vous donc pas?
—Mais, oui, attendez. Cette voix.....? Oh! mon Dieu! c'est toi, mon fils!
Et enlacés dans les bras l'un de l'autre, ils se tinrent longtemps embrassés.
Depuis neuf ans le jeune Malouin était parti pour l'étranger, dans le but d'y tenter fortune. La Californie, qui a été le tombeau de tant d'autres, lui avait souri. Il revenait aujourd'hui partager ses épargnes avec son père, et dorer ses vieux jours de l'aurea mediocritas du poète. Dans le cours de ma vie aventureuse, bien des choses m'ont fait plaisir, jamais je n'ai éprouvé plus grand contentement du coeur, qu'au moment où ce vieillard et cet homme fait, oublieux des longues heures de la séparation, se jetèrent dans les bras l'un de l'autre pour pleurer de bonheur.
Il fallait se garder de venir rompre ce tête-à-tête, et bientôt nous nous éparpillâmes sur la grève, chacun se livrant à son plaisir favori: celui-ci faisant collection de coquillages, celui-là discutant géologie, cet autre se plaignant de ce que la sensation du roulis le suivait jusque sur le rivage. Quant à nous, guidés par un domestique, nous allâmes visiter le phare, belle lumière de second ordre, dont l'appareil a été construit en 1856 par la maison L. Sautter, de Paris.
Cent neuf pieds séparent le sol de la girouette. Le foyer de la lanterne, qui donne une lumière fixe et blanche, est à 112 pieds au-dessus du niveau des hautes eaux. De la galerie de la tour, l'oeil embrasse, par un temps calme, une des plus ravissantes marines du golfe Saint-Laurent. En temps de brume et pendant les tempêtes de neige, un coup de canon, tiré d'heure en heure indique aux gens du large l'approche de la pointe ouest. En cas d'accident, un dépôt de provisions où se trouvent six barils de farine, quatre barils de lard, huit barils de pois et six paires de raquettes, est mis à la disposition des naufragés qui ne sont pas les seuls à en profiter, si l'on en juge par ce qui est arrivé en 1874. Une bande de Terreneuviens avait hiverné dans l'île, et s'étant laissée surprendre par la famine, vint défoncer à coups de hache la petite maison qui contenait le précieux dépôt. Pendant quelques jours ces écumeurs firent bombance aux dépens du gouvernement de la Puissance, se contentant de se bourrer l'estomac autant que possible et de rire aux larmes des légitimes remontrances du gardien.
Comme tout n'est qu'antithèse ici-bas, à quelques arpents du dépôt qui contient tout ce qui peut rendre à la vie, le voyageur égaré trouve aussi le champ du dernier repos. Dans ce petit cimetière, dort, entourée de ses trois enfants, une pauvre mère dont l'épitaphe porte pour toute légende les mots:
ALICE WRIGHT.
September 22 years; 1865.
Rien de triste comme cette jeune femme abandonnée avec ses enfants dans cette solitude, et n'ayant pour tout regret que les gémissements du flot qui déferle à quelques pas.
Deux années plus tard, lors de ma troisième croisière dans le golfe Saint-Laurent, en faisant une nouvelle visite à cette tombe, en compagnie de plusieurs amis, nous vîmes que la mort, cette grande pourvoyeuse, avait envoyé une nouvelle compagne à la pauvre Alice Wright. C'était une petite fille de dix ans, du nom de Béliveau, qui, un matin de juin, s'en était allée jouer dans les bois d'alentour, pendant que ses parents défrichaient une terre nouvelle. Après les courses sur l'herbe, la cueillette des rares fleurs sauvages de l'île, et les chasses données aux petits oiseaux, la pauvrette se sentit fatiguée. Un nid de verdure s'offrait au milieu d'un taillis à quelques pas de là: elle s'y blottit pour ne plus se réveiller que parmi les anges; car son père, étant venu mettre le feu à ces broussailles, brûla vive sans le savoir son unique enfant!
Cette navrante histoire avait coupé la verve à mes compagnons de route, et maintenant que je songe à ces choses, je me rappelle que pour nous en distraire, nous acceptâmes la proposition du docteur de la Terrière, que nous avions trouvé sur l'île, en mission officielle. Le gouvernement l'y avait envoyé, avec l'ordre de vacciner tous ceux qui se présenteraient à lui; et comme il y avait chômage ce jour-là, armés chacun d'un long bâton ramassé sur la grève, nous étions allés pousser une reconnaissance à deux milles du phare, à la pointe des Anglais. C'est là qu'était, il n'y a pas longtemps, le siège principal de la compagnie Forsyth. Nous en avions déjà entendu dire monts et merveilles. Ces utopistes de la finance voulaient, ni plus ni moins, relier la baie d'Ellis à celle du Renard, par une route macadamisée longue de 120 milles. Des embranchements de chemin de fer sillonneraient l'île en tous sens. Le remuement de capitaux qu'entraînerait l'ouverture de cette voie, ferait de la pointe ouest à la pointe aux Bruyères un vaste champ en culture, et l'Anticosti réalisait la première, ce rêve de l'ami Dupont, qu'un poète a rendu avec tant de verve:
Là, de sa roue en feu le coche humanitaire
Usera jusqu'aux os les muscles de la terre;
Du haut de ce vaisseau les hommes stupéfaits
Ne verront qu'une mer de choux et de navets.
Le monde sera propre et net comme une écuelle;
L'humanitairerie en fera sa gamelle
Et le globe rasé, sans barbe ni cheveux,
Comme un grand potiron roulera dans les cieux.
Nous arrivâmes à cet Eldorado par un sentier couvert de pierre à chaux, une des seules richesses de l'île. De fois à autres, nous étions bien obligés de passer à gué quelques ruisseaux; où, appuyés sur nos gourdins, de renouveler le saut périlleux du vaillant compagnon de Cortès, de don Pedro de Alvarado qui, serré de près par les Mexicains, le soir de la nuit triste, et se trouvant en face d'un canal qu'il fallait traverser à la nage, ficha le fer de sa lance en terre, s'appuya fermement sur le manche, et franchit ainsi une distance qui ne fut égalée que plus tard, dans les contes de Perrault, par les fabuleuses, enjambées du petit Poucet.
En route, la causerie roula sur les extravagances de la compagnie Forsyth. En bon voyageur, j'ai contracté l'habitude de prendre un peu et de laisser beaucoup de ce qui se dit autour de moi. J'avoue qu'il me fallut ici abandonner cette habitude. Nous étions arrivés; et dans les vastes hangars qui s'élevaient devant nous, on avait entassé......
—Des pelles, des pioches, des charrues, des vivres, des habillements, enfin tout ce qui convient à de nouveaux colons, dira le lecteur prévoyant.
Nenni! homme prudent. A la place de ces, premières nécessités de la vie, on voyait pour des milliers de piastres de chevilles en fer pour les bottes, des masses, des enclumes, des perches de lignes superbes des marche-pieds de carrosses, des poignées de cercueils, une imprimerie; bric-à-brac impossible envoyé d'Angleterre par des gens qui avaient trompé la compagnie, et qu'il fallut revendre plus tard à des prix infimes. Notre lieutenant, LeBlanc, nous assura qu'en échange de cinq piastres il avait reçu des effets pour une valeur de quarante-cinq dollars parmi lesquels se trouvait un magnifique Ulster coat, qu'un loustic baptisa du nom de "sortie-d'hôpital". Au milieu de cette pacotille impossible, pendant que dans les vitrines s'étalaient des selles anglaises, des livrets d'hameçons et de mouches, des boucles de harnois, on avait oublié le nécessaire; et le lard se vendait une piastre la livre!
Autour de ces magasins, vides aujourd'hui, est venu se grouper un village assez propret, habité par des Acadiens et par quelques familles irlandaises. Nous y trouvâmes tout le monde en liesse. Chacun était endimanché. Ce petit Landerneau était en l'air, car ce jour-là un photographe avait fait son apparition dans ces endroits reculés. Ce noble représentant de l'art était une femme de l'Islet qui avait frété un goëleton, et se faisait accompagner par sa fille et par trois hommes d'équipage. Elle courait, pendant la belle saison, le Labrador et les îles du golfe, prenant le portrait de celui-ci pour trois gallons d'huile de loup-marin, échangeant la binette de celui-là contre de l'édredon, des oeufs d'oiseaux, confectionnant la caricature d'un troisième pour la valeur d'une peau de renard; bref, se tirant toujours d'affaire, et réussissant à faire louvoyer tant bien que mal sa goëlette sur les flots du Pactole. L'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi nous poussant, nous fîmes comme les autres. Nous eûmes la satisfaction de voir nos têtes, hâlées par le vent de mer, ressortir à côté du minois frais et éveillé d'une gentille Acadienne, mademoiselle Lelièvre qui, partie il y a quelques mois de la Grande Rivière, accomplissait ici une mission de dévouement et d'utilité publique. Enfermée pendant cinq heures, chaque jour, dans un cabanon en bois rond dont la porte était décorée d'une planche noire, d'où ressortait en lettres d'or le nom d'un navire naufragé, le Tanaro, elle faisait avec grand succès l'école á quarante-trois élèves; et rarement il est donné à des voyageurs de rencontrer des enfants plus propres, mieux élevés, répondant plus poliment, et saluant les passants avec plus de courtoisie.
C'est ici, à la pointe des Anglais, c'est-à-dire à une lieue de la pointe ouest, que M. Ferland place le principal établissement de Jolliet.
Jolliet! voilà un nom qui, avec celui du P. Marquette, éveille dans tous les coeurs français le souvenir des gloires du passé; de longues marches dans les solitudes de l'ouest; de nuits d'insomnie employées à se défendre contre les embûches de l'indien, les intempéries des saisons, les morsures des moustiques; d'interminables courses en canot d'écorce, entreprises dans le but de réaliser le grand rêve de la découverte du Mississipi.
Le voyez-vous, là-bas, debout comme un prophète,
Le regard rayonnant d'audace satisfaite,
La main tendue au loin vers l'Occident bronzé
Prendre possession de ce domaine immense,
Au nom du Dieu vivant, au nom du roi de France
Et du monde civilisé!
Jolliet! Jolliet! deux siècles de conquêtes,
Deux siècles sans rivaux ont passé sur nos têtes,
Depuis l'heure sublime où, de ta propre main,
Tu jetas, d'un seul trait sûr la carte du monde
Ces vastes régions, zone immense et féconde,
Futur grenier du genre humain.
Oui, deux siècles ont fui! La solitude vierge
N'est plus là. Du progrès le flot montant submerge
Les vestiges derniers d'un passé qui finit.
Où le désert dormait, grandit la métropole;
Et le fleuve asservi courbe sa large épaule
Sous l'arche aux piliers de granit. 16
Note 16: (retour) Ces beaux vers font partie d'une pièce, lue à l'Université Laval lors du deuxième centenaire de la découverte du Mississipi, par l'auteur, M. L. H. Fréchette, ancien député de Lévis aux Communes du Canada.
Cinq ans après son voyage au Mississipi, Jolliet était créé seigneur de l'île d'Anticosti. Cette île lui était donnée "en considération de la découverte que le dit sieur Jolliet avait faite du pays des Illinois, dont il avait envoyé la carte, depuis transmise à monseigneur Colbert, ainsi que d'un voyage qu'il venait de faire à la baie d'Hudson dans l'intérêt et l'avantage de la ferme du Roy".
Dès lors, le nouveau suzerain s'occupa du soin d'améliorer les ressources de son fief en faisant, la traite avec le nord, et en chassant le loup-marin.
Ses actes ne sont plus signés que Jolliet d'Anticosti; et plus tard, un de ses fils se faisait appeler Jean Jolliet de Mingan. Six ans après avoir pris possession de son île, en 1681, un recensement cité par M. Ferland donne de curieux détails sur la famille du découvreur du Mississipi.
D'abord apparaît Louis Jolliet âgé de 42 ans; puis vient sa femme Glaire Bissot, fille de Normands de Pont-Audemer, âgée de 23 ans; puis leurs enfants, Louis âgé de cinq ans, Jean âgé de trois ans, Anne de deux ans et Claire d'un an. La maison du sire de céans se composait de six domestiques armés de six fusils, et Jolliet était propriétaire de deux bêtes à cornes et de deux arpents de terre défrichée.
Si l'on en croit Charlevoix, en donnant cette seigneurie à Jolliet, le roi de France ne lui fit pas un grand présent. Elle n'est absolument bonne à rien, remarque cet historien. Elle est mal boisée, son territoire est stérile, et elle n'a pas un seul havre où un bâtiment puisse être en sûreté. Les côtes de cette île sont assez poissonneuses; toutefois je suis persuadé, conclut Charlevoix, que les héritiers du sieur Jolliet troqueraient volontiers leur vaste seigneurie pour le plus petit fief de France.
Jolliet mourut très pauvre, en 1700, dans son Anticosti prétendent les uns, sur une des îles Mingan,—celle située devant le gros Mécatina, au Labrador-assure M. Henry Harrisse. Celui qui avait donné la moitié d'un hémisphère à la France; cet hydrographe du roy qui avait eu la patience de faire quarante-neuf voyages pour prendre connaissance de la rivière et du golfe, avant de dresser sa carte du Saint-Laurent; celui que la Grèce aurait mis au rang des dieux et que Rome aurait porté au Capitole; cet homme fut enfoui modestement par une main inconnue, sous une grève quelconque, n'ayant pour épitaphe que la page émue que lui à consacrée l'histoire reconnaissante.
O mon pays! que fais-tu donc de tes gloires? Crois-tu qu'un peuple se déshonore en érigeant des statues à des gens comme Jacques-Cartier, Champlain, de Maisonneuve, Joliette, Dollard et Montcalm?
Mais ces réminiscences du passé semblent m'entraîner loin de cet humble récit de voyage, et me faire oublier le phare de la pointe de l'Ouest où, au milieu de la canonnade qui nous avait accueillis le matin, j'avais remarqué la voix vibrante d'une pièce assise sur un affût de gazon. Ce canon ne ressemblait nullement à celui que le ministre de la marine fait livrer aux gardiens de lumière. C'était un spécimen de l'artillerie anglaise du XVIIe siècle, pièce longue, en fer battu, pesant 2,800 livres. Elle avait été ramassée, il y a une vingtaine d'années, sur les brisants qui font face au phare. A cette époque, elle était entourée de plusieurs autres canons qui, à marée basse, servaient aux chasseurs d'outardes et de canards pour les aider à défiler le gibier. Mais petit à petit, ces témoins muets d'une autre époque disparurent. L'an dernier, il ne restait plus que deux de ces puissants engins de guerre: encore, n'asséchaient-ils que lors des grandes marées, et ils finirent à leur tour par être entraînés en eau profonde, lors de la débâcle du printemps. M. Malouin m'assura, qu'au jusant de la grande mer le voyageur qui se promènerait en chaloupe dans les environs, apercevrait encore une foule de ces pièces qui détachent sur le vert sombre des algues marines leurs longs cous rouilles et couverts de coquillages.
Quel terrible drame s'est donc passé sur cette pointe de brisants? et qui jamais viendra raconter les péripéties de ce désastre?
Je l'ai dit, ces pièces d'artillerie sont anglaises, et elles ressemblent à s'y méprendre aux canons du XVIIe siècle que l'on montre encore dans la Tour de Londres. Ne serait-ce pas sur les récifs de la pointe ouest que le capitaine Rainsford, commandant une des frégates de l'amiral Phipps, serait venu se heurter et se briser en fuyant à pleines voiles cette ville de Québec, dans la cathédrale de laquelle, le comte de Frontenac avait pieusement suspendu le pavillon du contre-amiral anglais humilié et vaincu?
L'histoire du temps rapporte qu'il fit naufrage sur l'île Anticosti, où il réussit à débarquer avec quelques-uns de ses compagnons. Plusieurs se noyèrent en voulant prendre terre trop précipitamment; et comme les survivants n'avaient que peu de provisions, il fut entendu que la ration de chaque homme serait de deux biscuits, une demi-livre de lard, une demi-livre de farine, une pinte et quart de pois et deux petits poissons. Quelques épaves du navire leur servirent à élever une hutte, où ils s'installèrent tant bien que mal, jusqu'à ce que le froid et le scorbut fussent venus éclaircir leurs rangs. Le premier qui mourut fut le chirurgien. On l'enterra le 20 décembre 1690; et quarante hommes le suivirent en quelques semaines. La faim de ces malheureux était extrême. Nuit et jour, les plus faibles étaient obliges de se cacher ou de veiller, crainte de se voir voler leur maigre ration ou d'être assommés et mangés par les plus forts. Un jour, un matelot irlandais enfonça, malgré les protestations de tous, le dépôt à provisions, et mangea à lui seul dix-huit biscuits, ce qui le fit tellement enfler que, deux heures après, il faillit crever comme une peau de bouc. Enfin, à bout de ressources et d'expédients, cinq des matelots de Rainsford se décidèrent, le 22 mars 1691, à mettre en mer une petite chaloupe échappée au naufrage et qu'ils avaient calfatée le mieux possible. Ils mirent le cap sur Boston, où ils arrivaient à demi-morts d'épuisement, après trente-cinq jours de navigation. Un navire de guerre fut expédié de suite au secours de Rainsford; et ces naufragés décimés par la misère, ne furent tirés de leur triste position que par un miracle,—c'est le capitaine qui l'assure lui-même,—plus heureux en cela que bien d'autres de leurs camarades qui périrent au nombre de plus de mille, soit dans le golfe Saint-Laurent, soit dans la mer des Antilles, où leurs vaisseaux avaient été pourchassés par l'ouragan.
Le secret du capitaine Rainsford n'est pas le seul que la tempête ait confié à la discrétion, des brisants de la pointe ouest de l'Anticosti. Mon interlocuteur, à qui je rappelais les déboires de l'amiral William Phipps, m'apprit à son tour, qu'un matin, en sortant du phare, il avait trouvé sur la grève un brigantin, la quille en l'air, et tout son monde noyé à bord.
Oh! combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont ensevelis!
Combien ont disparu, dure et triste fortune!
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle Océan à jamais enfouis.
Combien de patrons morts avec leurs équipages!
L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages
Et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots!
Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongée,
Chaque vague en passant, d'un butin s'est chargée;
L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots 17.
Note 17: (retour) Victor Hugo, Les rayons et les ombres.
Une journée charmante s'était écoulée en études, en récits et en pérégrinations. M. Malouin voulut nous offrir à souper. On avait tué le veau gras en l'honneur du retour inespéré de son fils, et cette excellente réception devait terminer notre relâche comme elle avait commencé. Pour cette fois, c'était à mon tour d'être agréablement surpris.
Nous étions au salon. D'une main distraite je feuilletais un album de photographie, pieux legs laissé à la famille du gardien par une de ses filles devenue religieuse. Tout-à-coup mes yeux tombèrent sur le portrait de ma soeur aînée Augusta qui avait été l'amie de mademoiselle Malouin. Aussitôt cette joyeuse trouvaille me ramena aux joies de la famille absente. Mon oeil se mouilla au souvenir de ceux qui m'aiment, et tout rêveur je restais là, en contemplation devant cette douce vision qui hélas! ne devait faire que passer sur terre. Quel est donc le poète qui a dit:
Les chemins d'ici-bas vont tous au cimetière?
A quelque temps de là, ma sainte soeur, ma douce Augusta nous quittait, le sourire de l'espérance et de la résignation sur les lèvres.
Ainsi doit s'engloutir notre frêle existence.
......... ........ ....... ....... ........ ......
Et de nos souvenirs rien ne sera resté
D'autres enfants chéris...........................
Fouleront sous leurs pieds nos tertres funéraires
Et ne penseront pas que nous avons été.
Car tout disparaîtra, les parures, les grâces,
Les danses et les jeux, les innocents plaisirs;
Et le temps de son aile emportera nos traces
Comme l'aile des vents emporte nos soupirs. 18
Note 18: (retour) Jules Prier. Les veilles d'un artisan.
La rude voix de LeBlanc vint faire diversion à mes pensées, en nous criant que la chaloupe était prête. Il fallait partir: le Napoléon III était déjà sous vapeur. Notre pavillon salua. Une salve lui répondit du rivage; et deux heures après nous passions devant Ellis Bay, mieux connue de nos navigateurs canadiens-français sous le nom de baie de Gamache.
Les souvenirs que Louis Olivier Gamache a laissés dans le golfe Saint-Laurent sont des plus vivaces. Les combats de Le Moyne d'Iberville et de ses rudes matelots; les aventures du baron de Saint-Castin; les désastres de Phipps et de Walker seront depuis longtemps oubliés de la foule, quand les caboteurs et les mariniers canadiens-français se raconteront encore le soir, au pied du grand mât, les merveilleux exploits de Gamache. Dans cent ans et plus, ils se diront la manière dont il s'y prenait pour faire la contrebande des fourrures, en évitant les croiseurs de la Baie d'Hudson; ses tours incroyables; et ses relations avec le malin esprit qui lui obéissait comme un mousse, et poussait la condescendance jusqu'à souffler dans ses bonnettes et ses perroquets, pendant que la proue du mystérieux navire du capitaine canadien glissait sur une mer polie comme l'acier.
Le héros de ces récits du gaillard d'avant, Louis Olivier Gamache est né à l'Islet en 1784, d'une famille originaire des environs de Chartres. Il débuta sa longue vie par l'école de la garcette. Matelot dans la marine anglaise, son enfance se passa à courir le monde; mais ces excursions lointaines finirent par le blaser. Après avoir essayé un petit commerce le long de la côte de Rimouski, Gamache vint se fixer dans l'île d'Anticosti, et le farouche aventurier ne tarda pas à se faire reconnaître comme le souverain absolu de cette solitude. Du fond de sa baie, où il cultivait quelques arpents de terre, élevait quelques animaux, et faisait la pêche en grand, l'ancien matelot dirigeait des excursions sur la côte nord, trafiquait avec les Montagnais, et se moquait surtout du monopole de la Compagnie de la baie d'Hudson. Si l'hospitalité de Gamache était proverbiale, ses excentricités ne l'étaient pas moins; et jointes à sa vie solitaire et à sa mort mystérieuse, elles donnèrent naissance aux légendes qui se racontent encore sur son compte. Pas n'est besoin d'ajouter qu'à bord longues-vues, jumelles avaient été mises en réquisition pour regarder un coin de cette terre illustrée par maître Gamache. Mais hélas! la maison qu'avait habitée le célèbre marin était brûlée. Nous ne vîmes qu'un pâté de maisonnettes groupées près de ses ruines, et des enfants jouer et folâtrer à deux pas de la tombe de celui qui fut si longtemps le croque-mitaine du golfe Saint-Laurent.
Poussés par la marée et par la vapeur, nous arrivâmes bientôt en face de la pointe sud-ouest de l'île. C'est là que se trouve situé le plus ancien phare de l'Anticosti. Bâtie en 1831, cette tour circulaire, recouverte de bois blanchi, mesure une hauteur de cent pieds, et une minute d'intervalle s'écoule entre chaque éclat de la lumière, qui est visible entre les points nord-nord-ouest-quart sud au sud-est et est.
Le temps était superbe. Tout près de nous la mer venait mourir au pied d'un quai naturel, taillé par la vague dans un immense banc de calcaire gris, où les fossiles pullulent; et pendant que chacun s'éparpillait sur la grève, j'eus à loisir le temps de collectionner des coraux et des coquillages.
Au point de vue géologique l'île d'Anticosti est un trésor inappréciable pour l'amateur. Un paléontologiste, mort depuis, M. Billings écrivait au regretté sir William Logan, que le groupe de cette île était composé de lits du passage silurien inférieur et superposé simultanément avec le conglomérat d'Onéida, le grès de Médina, le groupe Clinton des géologues de New-York et la formation Caradoc d'Angleterre.
A l'appui de cette théorie, un des employés du bureau des géologues canadiens, M. Richardson,19 assurait qu'après avoir fait une étude minutieuse de cette île, il était arrivé à la conclusion qu'elle se composait "de calcaires argileux ayant 2,300 pieds d'épaisseur, régulièrement stratifiés par couches conformes et presque horizontales. Tous ces faits tendent à prouver, ajoute-t-il, que ces strates ont été précipitées au fond d'une mer tranquille, en succession non-interrompue, pendant la période où les parties supérieures du groupe de la rivière Hudson, le conglomérat d'Onéida, le grès de Médina et le groupe Clinton étaient en train de se déposer dans cette partie de l'océan paléozoïque qui constitue maintenant l'État de New-York, et quelques-unes des contrées adjacentes. Si cette manière de voir est exacte, les roches d'Anticosti deviennent alors très-intéressantes, parce qu'elles nous procurent, avec une grande perfection, une faune jusqu'ici inconnue à la paléontologie de l'Amérique septentrionale. En songeant à la grande épaisseur des sédiments entre les groupes de la rivière Hudson et de Clinton, on se convainc que leur déposition a occupé un laps de temps considérable; et comme le conglomérat d'Onéida n'est pas fossilifère, et que le grès de Médina ne fournit que quelques espèces peu marquées, nous avons été jusqu'à présent presque sans moyens de connaître l'histoire des mers américaines de cette époque. Les fossiles de la partie moyenne des roches de l'Anticosti remplissent exactement cette lacune, et nous procurent les matériaux nécessaires pour relier le groupe de la rivière Hudson à celui de Clinton, par les lits de passage, contenant les fossiles caractéristiques des deux formations, associés à plusieurs espèces nouvelles qui ne se présentent ni dans l'un ni dans l'autre de ces groupes."
Note 19: (retour) Rapport de l'année 1856 par E. Billings, paléontologiste, adressé à Sir William E. Logan, géologue provincial-p.263.
Au nombre des découvertes faites par M. Richardson, se trouvent certains fossiles, désignés par M. Billings sous le nom de genre beatricea. Ils ont, dit-il, la forme d'arbre, et furent recueillis, par le premier, dans les terrains siluriens inférieurs et moyens de l'île. Ces plantes, d'après la description de ce savant voyageur, se composent de tiges presque droites, d'un pouce à quatorze pouces de diamètre, perforées sur toute l'étendue par un tube cylindrique et presque central; en dehors de ce tube se rencontrent de nombreuses couches concentriques, semblables à celles d'un arbre exogène.
A l'est de la rivière au Saumon, sir William Logan assure qu'il se présente un escarpement de soixante pieds de hauteur, dans lequel des troncs abattus de ce fossile avancent en dehors de la falaise. Leurs extrémités circulaires et l'orifice qu'ils ont au milieu, donnent à cette côte l'aspect d'une citadelle hérissée de gueules de canons, et les voyageurs frappés de cette ressemblance n'ont pas cru mieux faire, qu'en donnant à cet endroit le nom de Pointe-à-la-Batterie.
Que de raretés scientifiques doivent se trouver cachées ainsi sous ces bancs de calcaire, et attendent là, depuis des milliers d'années, les études et les recherches de la curiosité et de la patience humaines! Petit à petit, sans se hâter, elles révèlent leurs mystères chaque jour; et dernièrement encore un pêcheur, en voulant entrer dans une des criques qui bordent ce paradis de géologie, trouvait, à son grand étonnement, une énorme baleine entièrement pétrifiée et dans un parfait état de conservation.
Tout en collectionnant ainsi un peu partout et un peu de tout, notre promenade nous, conduisit jusqu'à la tour, et là nous fîmes connaissance avec son gardien, M. E. Pope, qui nous fit l'accueil des gens de sa race, et nous offrit cette hospitalité écossaise que les sceptiques prétendent reléguée à tout jamais, au fond du libretto de la Dame Blanche. Sa famille se trouvait réunie dans la vaste cuisine du phare, dont le parquet était en pierre. Une épave de bois flotté flambait dans l'âtre; et çà et là des trophées de chasse, des ailes d'aiglons, des têtes d'ours, des carabines et des engins de pêche relevaient la couleur sombre de la boiserie. Une fenêtre entr'ouverte laissait voir un coin de paysage qui ne manquait pas de charmes: tout autour de nous respirait la santé et le bien-être. Il nous paraissait évident que M. Pope possédait un secret qui manque à bien des gardiens de phare. Où plusieurs de nos compatriotes auraient senti les étreintes de la solitude et de la gêne, cet homme essentiellement pratique réussissait à se créer une aisance relative. Ses champs étaient défrichés et bien fumés; ses étables pleines; ses vignots couverts de morues, et ce qui surprenait surtout les gens de l'île, au bout d'un an ses vaches ne mouraient pas de ce mystérieux catarrhe qui emportait toutes les bêtes à cornes de l'Anticosti. Elles seules, avaient le privilège de vivre et d'attendre à point le pot-au-feu. Un joli yacht se balançait dans la baie au milieu d'une escadrille de berges destinées à faire la pêche sur les fonds: bref, M. Pope avait fait fi du dicton favori de grand nombre de ses collègues, qui se laissent aller à l'apathie et répondent à ceux qui essayent de les en tirer:
—Bah! à quoi sert de défricher la terre, d'exploiter la mer ou de se créer de nouvelles occupations? Nettoyons, allumons, éteignons notre phare aux heures réglementaires, et pendant que vogue ainsi la galère, croisons-nous les bras. Notre salaire n'est-il pas gagné? Gardons-nous bien surtout de faire valoir ce qui nous entoure et qui n'est à personne. Ce serait travailler pour son successeur; et la vie est trop courte pour s'amuser ainsi.
M. Pope a cru devoir prendre un autre genre d'égoïsme. Sa lumière est en ordre, ainsi que ses champs, ses étables, ses exploitations. Tout en faisant son devoir, il ne rougit pas d'employer le temps de manière à laisser à ses enfants une fortune assez rondelette, qu'il leur léguera un jour avec l'amour de l'économie et du travail.
A quelques arpents du phare de la pointe sud-ouest se trouve la cabane d'un pauvre colon du nom de Fortin. Il vint nous demander si nous avions un prêtre à bord.
—Depuis trois ans, nous disait-il, ma femme et moi nous n'avons pas entendu la messe. C'est une bien grande privation pour un catholique!
Il devait se passer encore trois longues années avant que le pieux désir de Fortin pût se réaliser.
Ce fut un des aumôniers de notre troisième croisière, M. l'abbé Marcoux, qui eut le bonheur de s'acquitter de cette mission, et d'offrir le saint sacrifice dans cet humble cabanon, pendant qu'un de ses confrères changeait la hutte voisine en confessionnal.
En me reportant ainsi vers le passé, je me rappelle la surprise qu'éprouva Agénor Gravel, en retrouvant parmi les plus fervents pénitents de l'île, une de ses vieilles connaissances, le père Luc Marolles.
Depuis trente six ans le père Luc habitait l'Anticosti. Il avait été l'ami de Gamache; avait trappé et couru en tous sens les bois et les rivières de l'île. Ce n'était pas à ce métier-là, paraît-il, que saint Augustin recueillit les notes qui servirent plus tard à rédiger sa Cité de Dieu. Ce qui venait à l'appui de cette hypothèse, c'est que des mauvaises langues prétendaient avoir vu le père Luc tituber, comme Noé dans ses plus belles vignes. D'autres avaient ouï-dire, qu'il ne se gênait pas de jurer comme un payen. Mais ces commérages n'avaient plus leur raison d'être. Celui que nous avions quitté épervier, plus tard nous devions le retrouver colombe: et le père Luc dépouillé du vieil homme, et fier d'avoir mis en liesse tous les justes du paradis, a continué depuis à être l'exemple de l'île.
La première fois que nous le rencontrâmes chez M. Pope, il vint nous donner sans façon une vigoureuse poignée de main, et causer des dernières nouvelles.
Comme d'habitude, elles ne roulaient que sur des histoires de naufrage:
—Tenez, messieurs, nous disait-il, en nous indiquant du doigt une pointe sombre qui se perdait sous l'horizon: voyez-vous, là-bas, cette langue de terre qui touche à la rivière Observation? Un brick est venu y faire côte, en décembre dernier. Il neigeait à ne pas voir le bout de son nez: l'équipage était à demi gelé; et ce ne fut qu'après des efforts inouïs qu'il parvint à descendre à la mer une de ses chaloupes. A peine cette embarcation eût-elle franchi trois encablures qu'elle se prit à talonner. Fous de peur, se croyant sur les brisants, ses matelots remirent le cap sur leur brick naufragé, et vinrent se faire écraser par la mer, le long des flancs du navire. Sept matelots et le capitaine périrent ainsi; pendant que le second, accompagné d'un de ses hommes, furent rejetés à la mer par le contre-coup. Ils nagèrent ferme: mais la vague les porta malgré leurs efforts, vers le récif où la baleinière avait touché. De rechef ils se croient perdus, lorsqu'une lame en se retirant ne leur laisse de l'eau qu'à la ceinture: puis venant les reprendre, elles les lance sans connaissance sur ces cayes qui les avaient tant effrayés un quart d'heure auparavant, et qui n'étaient autre chose que le rivage! Dès le petit jour, en se rendant à la rivière, le second trébucha sur le corps mutilé de son capitaine: il était venu atterrir pendant la nuit.
Quant aux autres, je les retrouvai tous le lendemain; et parmi eux un nègre qui s'était noyé la tête en bas, le pied droit pris entre un chaînon de l'ancre et l'écubier.
Tout en causant ainsi, le père Luc nous avait entraînés du côté du petit cimetière, situé près de la tour. Un enclos en bois peint y renferme le tombeau destiné aux Pope, et qu'occupent déjà deux membres de cette honorable famille.
Un peu plus loin, sont entassés pêle-mêle, sous des monticules de tourbe couverts de ronces, les corps des vingt et un naufragés, faisant partie de l'équipage du "George Channing," navire anglais qui vint à la côte en 1830. Neuf de ces malheureux sont couchés dans une même fosse. Une épitaphe se dresse sur ce morne charnier. Elle consiste en une planche, sur laquelle une main amie a gravé avec la pointe d'un couteau ces lignes, que je reproduis textuellement:
To
the memory
of
DAVID CORMACK GEORGE MILLER
who departed this life on the
22 December 23 December
aged 25 aged 51
having been shipwrecked in the OTTAWA, London
2d December 1835.
Erected by the remaining survivors of the crew.
Jamais de ma vie je n'ai vu quelque chose de plus triste et de plus navrant que ces tombes d'inconnus qui demeurent là sans prières; et pour oublier ces tristesses, nous prîmes le parti de nous rendre à la gracieuse invitation de madame Pope. Chez elle une charmante surprise nous attendait. Sur une table, au milieu du salon de la tour, étaient éparpillés une foule de croquis, d'études et de dessins signés par mademoiselle Grâce Pope. Ces ébauches indiquaient non-seulement les plus heureuses dispositions pour la peinture, mais elles prouvaient que cette enfant de treize ans avait un talent remarquable pour l'art statuaire. On nous fit voir un modèle en argile d'une matrone romaine agenouillée, qui certes, par l'élégance de la draperie, la pureté des lignes et la finesse du travail, n'aurait pas fait honte aux débuts de certains artistes à la mode. Les uns admiraient j'étais du nombre. D'autres hasardaient de timides conseils. Pendant ce temps-là, madame Pope faisait à ses hôtes une distribution de zoophytes, de coquilles, et ce ne fut que lorsque nous eûmes repris la haute mer, que nous pûmes compter nos trésors, et bien nous rappeler les attentions délicates de cette hospitalité.
Notre départ avait été précipité. Du haut du phare, le capitaine avait vu un banc de brume se former à l'horizon, et à peine avions-nous couru une bordée au large, qu'il fallut capéer. Déjà le brouillard nous enveloppait, pour ne plus nous quitter qu'après quatre-vingt-sept heures.
Rien de triste comme cette nuit en plein jour qui parfois, ne permet pas à un matelot de distinguer son voisin sur le pont. Autour de lui, tout est nuageux, opaque. La mer est là, qui confond ses teintes grisâtres avec le ciel fumeux: et sans le monotone clapotis de la vague qui se brise sur le flanc du navire, l'homme à la roue croirait que son capitaine le fait voguer vers le néant.
Au milieu de ce chaos, nous devions nous orienter et veiller au plus près: on se trouvait sur la route la plus fréquentée par les navires. La brise fraîchissant vers la tombée de la nuit, les vigies furent doublées. Une houle grosse et longue nous balançait au milieu du rideau de crêpe qui ne cessait de nous couvrir; et toujours facétieux, Agénor Gravel, qui se souciait fort peu des collisions, profita de l'occasion pour donner du courage à un passager, en lui assurant qu'avec un vapeur en fer, de la force du Napoléon III on était certain de couler n'importe quel voilier qui viendrait se mettre par notre travers.
Pendant quatre-vingts heures nous eûmes sur les yeux l'impénétrable tissu du brouillard. Quelquefois le soleil perçait en curieux ce dôme de brume, dont nous étions le centre. L'azur du ciel nous apparaissait alors dans toute sa splendeur sereine, mais ce n'était que pour nous renouveler le supplice de Tantale. Tout aussitôt, la voûte sombre se refermait sur notre grand mât. D'abord, ce n'étaient que de légers flocons de fumée qui tachetaient rapidement le fond de saphir. Puis des teintes laiteuses, se groupèrent petit à petit autour du disque solaire. D'éblouissante, la lumière devint pâle peu à peu: elle passa au jaune blafard, au roux; puis elle alla s'amoindrissant, jusqu'à ce que le brouillard plus dense et plus entêté que jamais, eût ramené la tristesse sur nos fronts, en étouffant le soleil dans sa chape de plomb.
Je ne le cache pas, ce fut avec un sentiment d'indéfinissable plaisir que nous débarquâmes à la pointe sud. Plongés dans cette demi-obscurité, ne respirant que moiteur et humidité, la vie du bord était devenue pour nous d'une monotonie désespérante. Invariablement, la conversation roulait sur le vent qu'il faisait, et sur celui qui soufflerait le lendemain. L'oeil se fatiguait à interroger l'horizon qui restait muet. Les uns avaient un faible pour le baromètre, et le consultaient constamment. D'autres n'avaient foi que dans les sondages, et se dressaient à chaque instant, comme des points d'interrogation, devant l'officier chargé de cette délicate opération. Le soir, chacun s'endormait du sommeil du juste, en faisant des rêves, dont les moins farouches leur montrait le Napoléon III passant à toute vapeur sur le corps des navires, assez imprudents pour se trouver sur son passage.
Dès le petit jour, une seule interrogation partait de tous les coins du carré:
—Raphaël, quel temps ce matin?
—De la brume, messieurs, encore de la brume, toujours de la brume! répondait le maître d'hôtel, tout en veillant à ce que la table fût préparée pour le déjeûner.
Et les heures, succédaient ainsi aux heures, sans que le jour pût voir le jour.
Nouveau Lazare, le soleil enfin quitta son linceul! Il était là, se mirant dans la mer; et nos yeux purent se reposer sur autre chose que sur l'insaisissable. Ils avaient devant eux le phare de la pointe sud, tour blanche, hexagone, qui atteint soixante-quinze pieds de hauteur, et dont la lumière blanche placée à cinquante-quatre pieds du sol donne un éclat toutes les vingt secondes. Près de là, se trouvaient groupées quelques maisonnettes, dont l'une, trop petite et mal construite, est destinée au gardien, et l'autre renferme un engin à vapeur qui, pendant les tempêtes de neige ou par les temps obscurs et brumeux, fait résonner un sifflet dix secondes par minutes.
La garde du phare de la pointe sud est confiée par le ministère de la marine à un homme aussi instruit qu'énergique, M. David Têtu. Grand, les épaules légèrement voûtées, l'oeil doux et serein, possédant un poignet de fer et une santé à toute épreuve, notre ami nous représentait à merveille le type du canadien-français de jadis; et cet esprit chevaleresque et aventureux qui, n'obéissant qu'à son impulsion, et ne se laissant guider que par son flair et par ses connaissances, parcourait en tous sens le continent américain, y faisant des découvertes merveilleuses, et ne revenait au pays, que pour léguer à d'antres son amour du voyage, de la liberté et de l'inconnu. Ce fut dans une de ses longues promenades sur la côte du Labrador que David Têtu découvrit ces fameux gisements de sable qui, bien exploités, donneraient les plus beaux minerais magnétiques du monde. Ce fut aussi grâce à son courage, que les maraudeurs de Saint-Alban purent échapper aux limiers qui les traquaient comme des fauves. Rendez-vous avait été pris au milieu de la nuit sur le pont de glace, en face de Québec. Là, un homme se faisait reconnaître de Têtu, au moyen d'un signe accepté, et ils devaient alors se remettre aveuglément à sa discrétion. Malheureusement, les confédérés s'égarèrent sur le fleuve. Ce ne fut qu'au point du jour, qu'ils purent rejoindre leur guide près de la pointe de l'île d'Orléans, Sons sa conduite, ils descendirent en voiture le long de la côte nord jusqu'au Saguenay; puis à pied jusqu'à Moisïe, ou, au printemps, ils s'embarquèrent sur une goélette que Têtu commanda pour l'occasion. Cet excellent marin, profitant alors d'une tempête qui rendait la mer intenable, put courir déposer ses passagers à bord d'un croiseur qui les attendait dans le golfe.
L'esprit d'aventure, le goût de la solitude faisaient de notre ami, un homme on ne peut plus apte à remplir les fonctions de gardien de lumière. Les longs quarts de nuit qu'il lui fallait faire, lui permettaient de se livrer à ses études favorites sur l'histoire naturelle. Il aimait son phare comme un chasseur d'Afrique aime son cheval arabe. Une partie de la journée se passait à, l'astiquer et à le mettre en ordre; puis, quand la besogne était terminée, quand l'hiver était venu et que sa lumière avait été éteinte—le vingt décembre—alors commençait la saison des chasses et des explorations. Vite, on, chaussait les raquettes. Les fusils étaient démontés et nettoyés, les pièges éprouvés, et bientôt, le jarret solide et alerte, enveloppé dans une chaude vareuse, on voyait Têtu, la carabine sur l'épaule, portant avec lui des provisions pour plusieurs jours, prendre la lisière du bois ou le long de la grève, et aller déclarer une guerre sans merci aux loutres, aux ours et aux renards gris, rouges, noirs, et argentés. Rarement ce nouvel Oeil-de-Faucon revenait bredouille; et plus sa chasse ou sa pêche avait été abondante, plus ses voisins et ses amis, les pauvres, s'en ressentaient. Alors fourrures précieuses, morceaux de venaison, grosses pièces, truites monstrueuses, tout passait entre les mains de cet homme, qui se souciait fort peu, en ce temps-là, de savoir ce que sa gauche ou sa droite faisaient.
Le soir au coin du feu, maints trappeurs racontent encore les histoires merveilleuses de ce pêcheur habile et de ce chasseur adroit; mais nulle à mon avis ne vaut celle de l'ours tué au vol.
Têtu avait ouï-dire qu'une baleine morte était venue atterrir à quelques lieues de son habitation. En homme qui sait profiter du vieux dicton—aide-toi, le ciel t'aidera—il part, accompagné de Crispin, son domestique, bien décidés tous deux à tirer du cétacé toute l'huile qu'il pourrait rendre. La nuit tombait lorsqu'ils arrivèrent au lieu de l'échouage; et comme avant de camper, Têtu tenait à être renseigné sur la valeur de l'épave, les chasseurs se dirigèrent du côté de la baleine. Ils avaient été devancés par des rôdeurs de grève encore plus alertes qu'eux: et deux ours noirs s'en donnaient à coeur joie, le museau plongé dans les flancs du monstre, mangeant comme deux clercs échappés de carême, et ne s'interrompant de fois à autre que pour respirer longuement, et pour lécher leurs babines toutes ruisselantes de lard.
Le domestique de Têtu était devenu pratique au contact de ce maître.
—M. David, lui dit-il doucement, en glissant une balle dans son fusil, permettez-moi de tirer le plus gros? J'ai besoin d'une robe de carriole, lorsque je retournerai chez moi, à l'automne. Et ma foi! plus d'un faraud m'enviera cette peau d'ours, lorsque le dimanche, mon cheval m'attendra à la porte de l'église de Berthier.
Sa vie de trappeur, autant qu'une certaine fable de Lafontaine, avaient mis Têtu au courant des habitudes rusées de maître Ursus. Aussi, fit-il signe à son compagnon de ne pas trop se presser de tirer. L'ours, dont la fourrure soyeuse devait orner l'arrière d'une des carrioles de Berthier, se présentait mal; et puisque Crispin tenait absolument à celui-là, il fallait attendre le moment favorable, pour le prendre à l'oeil ou au coeur.
Mais la chanson de Nadaud aura toujours raison:
L'ambition perd les hommes.
Crispin, rendu nerveux par l'appât du butin, venait d'épauler. V'lan! le coup part. La balle ricoche sur le museau de l'ours, et va, comme Jonas se perdre dans le ventre de la baleine. Le second ours, plus gourmet et sans doute de meilleure famille que son camarade, avait réussi, pendant le colloque des chasseurs, à se hisser sur le dos du cétacé. C'était sa manière à lui de mettre la main au plat. La détonation du fusil le surprit là; et tout effrayé, perdant la tête comme Balthazar au milieu de son festin, mais ayant moins de décorum que ce roi, il s'élança dans l'espace, où la balle de Têtu vint le rejoindre. Celle-ci l'envoya rouler roide mort sur le dos de son compagnon qui, hurlant de douleur, le museau haché par la balle de Crispin, et surpris par cette avalanche d'un nouveau genre, prit le bois au galop, laissant le propriétaire de la petite carriole de Berthier réfléchir à la philosophie de ces deux vers, que Têtu prenait le malin plaisir de lui répéter, en rechargeant sa carabine:
.....................il ne faut jamais
Vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.
David Têtu avait reçu de la nature certains talents de société qui, sur l'île d'Anticosti, ne sont pas à dédaigner. Tour à tour cordonnier, mécanicien, inventeur, zoologiste, géologue, lettré, homme du monde, cordon bleu et trappeur, il avait su donner à la maison qu'il habitait le cachet de ses occupations multiples. Aux murs étaient accrochés des canardières, des pistolets, une carabine, un fusil de rempart et des perches de ligne. Dans un coin, on voyait un coffre de pharmacie sauvé du naufrage du Shandon. Tout se coudoyait dans sa petite bibliothèque, depuis le Cornhill Magazine, l'almanach de Raspail, jusqu'à l'Imitation de Jésus-Christ et un traité d'entomologie. Une courte-pointe en fourrure couvrait un lit de sangle, auprès duquel se dressait une table de nuit surchargée de boîtes de fossiles et de paperasses, où le maître, au moment où nous entrions, venait d'insérer ses dernières observations météorologiques, et sur lesquelles il avait négligemment jeté, en guise de presse-papier, une énorme défense de morse.
Inutile de peindre la joie de Têtu en nous apercevant. Quoique beaucoup plus âgé que moi, il avait été mon compagnon d'enfance, et bien qu'un mois de causeries n'eût pas suffi pour nous dire tout ce que nous avions vu et appris depuis une séparation de douze ans, il fallait subir les exigences de la consigne, et le laisser libre de son temps. Nous n'avions que cinq heures devant nous pour ravitailler ce phare. Mais avant d'aller sur la grève prendre livraison de ce que lui expédiait le ministère de la marine, Têtu donna des ordres pour faire préparer en notre honneur, une chasse aux homards.
Cette chasse se fait au moyen de chiens de Terreneuve qui plongent et vont à marée basse, chercher ces délicieux crustacés dans ces herbes marines que Denys appelait des plantins, et que les pêcheurs du golfe ont baptisées du nom de prairies à homards. Enfoncés dans d'énormes bottes sauvages, que l'on avait eu la complaisance de nous prêter, et armés chacun d'un panier et d'un bâton, au bout duquel était fixé un crochet de fer, nous cheminions dans l'eau et suivions de point en point les instructions de notre guide. Il fallait marcher à pas comptés et avoir l'oeil vif, pour distinguer dans cette herbe verte qui suivait les ondulations de la mer, la carapace noire ou les longues serres de ceux que nous cherchions. En voyions-nous un: vite nous plongions notre engin de pêche pour tâcher de l'attraper. Mais prompt comme l'éclair, le crustacé nous avait dépassés d'un coup de queue, et la chasse était à recommencer, aux grands éclats de rire de notre guide. Celui-ci, plus expert, n'avait qu'à glisser hypocritement son croc sous le ventre de la pauvre bête, à la chatouiller quelques secondes, puis à l'envoyer rejoindre brusquement la douzaine et demie de camarades qui, tout abasourdis par leur changement de garnison, se livraient à la plus excentrique des manoeuvres pour sortir de leur prison d'osier. Quant aux terre neuves, ils n'y mettaient pas tant de façons. Dès qu'ils avaient flairé un de ces malheureux homards, ils le happaient hardiment et allaient le déposer sur la grève.
En mer, cinq heures peuvent apporter bien des changements. Le temps, qui s'était mis au beau, fut de nouveau gâté par l'impitoyable brume. A tire d'aile, elle accourait du large. La houle s'était refaite; elle devenait creuse, et bien qu'elle n'offrît aucun danger, comme la baleinière remorquait une longue échelle, et que le vent soufflait dans une direction opposée à la marée, nous arrivâmes couverts d'embruns au Napoléon III.
En accostant, les hommes se défendirent mal. Nous faillîmes emplir; et la vague poussa l'impudence jusqu'à s'approprier la casquette d'Agénor Gravel, qui s'en vengea, en parodiant le fameux vers de Racine:
Le flot qui l'emporta recule épouvanté.
L'alexandrin de Théramène fut la seule oraison funèbre que reçut cette vieille amie de vingt ans.
En voyant venir le brouillard, Têtu craignit que nous eussions quelques difficultés à retrouver la route du steamer; et, prenant sa boussole, il avait tenu à nous faire la conduite. Fermement assis sur le banc d'un esquif long de dix pieds, qu'il gouvernait comme une plume au moyen de deux légers avirons, il vint ainsi jusqu'au Napoléon III. Nous sachant alors en sûreté, il revira de bord, salua de la main; et ramant vers terre, la dernière fois que nous le vîmes, comme l'oiseau précurseur des tempêtes, il se laissait bercer ainsi qu'un pétrel sur le dos des vagues énormes.
Trente milles séparent à peine la pointe sud de la Pointe-aux-Bruyères. Avec une bonne brise pour un voilier, et du temps calme pour un vapeur, cette distance n'est qu'une promenade d'agrément; mais avec le brouillard tout doit compter en mer. Il fallut donc remettre à la cape, et nous mîmes trente-six heures à franchir douze lieues. De temps à antre, le son d'une conque ou d'un porte-voix nous arrivait à travers la brume, qui s'étendait plus grise et plus épaisse que jamais. C'était un gros navire qui arrivait sur nous. Comme un fantôme, il passait sous notre étrave, ou coupait notre sillage, puis une seconde après, sombrait dans le brouillard, où nous disparaissions à notre tour. Appuyés sur les bastingages, les matelots oisifs fumaient leurs pipes et se laissaient bercer par la mer, d'un air ahuri; pendant que Jim, vieille gaffe rouillée par de nombreuses campagnes faites à bord des marines anglaise et chilienne, leur disait d'un ton goguenard, en désignant Agénor Gravel, qui, se croyant protégé par la densité de la brume, se livrait à de douloureuses études sur le mal de mer:
—Well tars! I think that a man who travels at sea for his pleasure, might as well go to purgatory for his past time.
Ce ne fut qu'en sondant, et qu'en prenant mille précautions, que nous arrivâmes ainsi par le travers de la Pointe-aux-Bruyères. Bientôt, à la faveur d'une éclaircie nous pûmes apercevoir le phare. Il a été construit en 1855, et a la forme d'une tour blanche, circulaire, haute de cent-dix pieds. D'après le livre bleu de la marine, ce phare est toujours ouvert au sud de la pointe au Cormoran, et est visible entre les points sud-ouest-quart-nord et est. Il est bâti sur une pointe très basse qui vue d'une certaine distance en mer, s'efface complètement pour ne laisser apercevoir que la tour. Celle-ci, par un curieux effet d'optique, ressemble alors à une voile sur l'horizon.
Notre aimable camarade de route, M. Gagnier, devait nous quitter ici. Avant de nous dire adieu, il voulut nous faire les honneurs de son domaine, qui ressemble plutôt à une ferme modèle qu'à l'emplacement d'un phare. Nous sautâmes donc ensemble dans la baleinière; et bientôt nos vigoureux rameurs nous débarquèrent sur l'étroite lisière de grève qui sépare la mer d'un petit lac d'eau douce. Le voyageur, en parcourant cette partie de l'Anticosti, rencontre assez fréquemment ces lagunes, peuplées d'anguilles. Elles sont creusées dans une vaste tourbière qui, d'après M. James Richardson, s'étend le long des terres basses de la côte sud de l'île, depuis la Pointe-aux-Bruyères jusqu'à huit ou neuf milles de la pointe sud-ouest. Cette plaine continue de tourbe a plus de quatre-vingts milles d'étendue. Sa largeur moyenne est de deux milles; elle présente une superficie de plus de cent-soixante milles carrés, et les sondages lui ont donné, une épaisseur de trois à dix pieds. En y pratiquant des canaux, on pourrait aisément l'assécher et la rendre propre à l'exploitation. C'est, autant que je sache, ajoute M. Richardson, la plus vaste tourbière du Canada. On y a tracé une route qui conduit au phare. Elle n'est pas très longue, un mille tout au plus, mais ce jour-là, elle nous parut interminable. Nous étions accompagnés par un énorme terreneuve qui nous montrait des dents à rendre jaloux n'importe qui, par leur blancheur, et à faire trembler n'importe quel mollet, par leur longueur. Ce terrible échantillon de la race canine était appuyé par un petit taureau noir, à l'encolure puissante. L'oeil en feu, les naseaux frémissants de colère, ce dernier faisait de droite et de gauche des charges à fond de train sur les envahisseurs de son île. Heureusement que Gagnier était très bien avec le terre-neuve. Pendant qu'il le cajolait et l'amadouait de son mieux, nous nous débarrassions de notre second assaillant, en faisant pleuvoir un déluge de pierres et de bois flotté sur cet animal farouche et dégénéré, dont les paisibles ancêtres s'étaient jadis illustrés au service des rois fainéants.
Une réception cordiale nous attendait à la tour, et un excellent dîner y avait été servi par les soins de madame Gagnier. Pendant que nous lui faisions honneur, les questions et les réponses pleuvaient des quatre coins de la table. L'un, apprenait avec surprise la mort du fondateur de la confédération canadienne, de Sir George Cartier; l'autre, interpellé sur les affaires de France, annonçait la présidence du maréchal de MacMahon. Chacun vidait le dessus de son panier en échange des nouvelles locales, et ce fut ainsi que nous apprîmes la fin terrible d'un des enfants de la famille Bradley. En jouant, il s'était perdu dans les bois. De longues et de fréquentes battues furent organisées. Tout fut inutile: et les parents s'étaient déjà résignés, lorsqu'ils virent leur pauvre coeur soumis à une nouvelle épreuve. Quelques mois plus tard, un second enfant partit dans une embarcation, conduite par un domestique. Ils se rendaient à trois milles de là; mais un coup de vent du nord les surprit en vue de la côte, et ils furent entraînés vers la haute mer. Ont-ils été recueillis par un navire qui passait? Le golfe leur a-t-il donné une de ses vagues pour linceul? Nul n'a pu pénétrer encore un secret que l'abîme semble vouloir si bien garder.
Notre amphitryon était l'ami intime de David Têtu, et que de fois, ils avaient franchi à pied ou en berge les trente milles qui les séparaient l'un de l'autre, et ce, pour avoir le plaisir de causer et de fumer une pipe ensemble! Comme tous les inséparables, leurs caractères faisaient antithèse. Ils ne s'accordaient que sur deux choses, la pêche et la chasse. Autant Têtu adorait sa liberté et ses franches coudées, autant Gagnier aimait le confort, la vie domestique. Sur cette île déserte, livré aux seules ressources de son bon sens et de sa modeste bibliothèque, il avait réussi à former et à élever la plus charmante famille du monde. Il est vrai qu'une femme pieuse et dévouée l'avait aidé à mener à bonne fin cette tâche sublime, et que le Dieu qui aime tant les petits enfants avait béni leurs efforts chrétiens.
L'intérieur du phare de la Pointe-aux Bruyères ressemble plutôt à celui d'une de nos riches chaumières canadiennes-françaises, qu'à un poste jeté au milieu de la solitude pour guider ou secourir les naufragés. En homme prudent, Gagnier a su tirer parti de tout: pas un coin où l'oeil ne rencontrât une armoire. Un poêle toujours ronflant, des couvre-plats bien étamés, une longue file d'assiettes, de bols et de soucoupes rangés dans des buffets à jour, donnent à la cuisine un perpétuel air de fête. Le salon est joli, bien disposé et trouverait grâce devant le plus difficile. Des chambres à coucher sort ce parfum de linge net et blanc, qui fait l'orgueil des ménagères de notre pays, et depuis la lanterne jusqu'au rez-de-chaussée du phare, tout respire le calme, l'ordre et la propreté.
Hélas! cette tranquillité ne pouvait toujours durer. Bientôt l'impitoyable mort vint faire jaillir les larmes au milieu de cette douce joie.
En 1874 un brigantin, l'Alexina, faisait naufrage près de la Pointe-aux-Bruyères. Tout le monde put quitter l'épave et gagner terre sain et sauf: mais à la suite du froid et de la misère, un matelot de l'Islet, du nom de Deroy, fut atteint d'une fièvre cérébrale. Depuis quelque temps déjà le jeune Thomas Gagnier—il avait treize ans—souffrait de la consomption. On le voyait dépérir promptement sous ce rude climat; mais en apprenant la terrible position de Deroy, le père du poitrinaire oublia les fatigues que pourrait occasionner à sa famille un nouveau malade, et donna des ordres pour que le matelot fût transporté à la tour. Tous les soins furent prodigués à ce jeune homme de vingt-trois ans: mais sans résultat. Deroy mourut, emporté au milieu d'une attaque de délire, et celui qui ne l'avait pas abandonné un seul instant, son fidèle camarade Adélard Couillard-Desprès—troisième lieutenant à bord du Napoléon III—fut obligé de prendre le cadavre dans ses bras, de le descendre sans bruit, à onze heures du soir—crainte d'attirer l'attention du jeune Gagnier qui se mourait—et d'aller le déposer dans un hangar, où il passa le reste de la nuit à l'ensevelir, à lui faire un cercueil, et à ouvrir à grand'peine une fosse dans la terre gelée. Ceci se passait au commencement d'avril. Le sept du même mois, l'enfant du gardien de la Pointe-aux-Bruyères rendait à son tour le dernier soupir. Desprès et les autres naufragés venaient de trouver l'occasion de regagner la côte sud: et le malheureux père, laissé à sa propre initiative, fut forcé de faire l'ensevelissement, la tombe et la fosse: de porter lui-même son enfant jusqu'au petit enclos qui sert de cimetière, et de l'y enterrer au milieu de sa famille au désespoir qui sanglotait un de profundis.
—Je me sentis alors tellement fou de douleur, me disait le brave Gagnier, avec des larmes dans les yeux, que j'oubliai les vivants pour ce cher petit mort. A force de penser à cette catastrophe, je faillis un jour prendre mes jambes à mon cou et me sauver dans les bois.
Ce ne fut qu'en 1875, que j'eus l'occasion de visiter le dépôt de naufragés, où les gens de l'Alexina avaient passé l'hiver. Le lieutenant Couillard-Desprès nous conduisit à cet abri, qu'un gouvernement prévoyant a érigé là, pour les malheureux jetés à la côte. Cet officier en faisait les honneurs avec d'autant plus de plaisir, que lui-même y avait été sauvé d'une mort certaine. L'habitation se compose d'un seul appartement et d'un grenier. Une double rangée de couchettes en bois, superposées les unes sur les autres, fait le tour de cette unique chambre, et les hôtes que le hasard loge à pareille enseigne, n'ont pour matelas que de la paille qui parfois n'est point très-fraîche. Un grand poêle en fonte occupe le milieu de ce réduit: et seule sa lueur l'éclaire à la veillée, car le ministère de la marine ne fournit pas le luminaire.
La provision réglementaire d'un dépôt de naufragés consiste en quinze quarts de farine, sept quarts de pois, du sucre, du thé, et sept barils de lard20.
Note 20: (retour) En 1874, on a ajouté à ces provisions, deux boîtes de viandes en conserve, et douze couvertes.
Tant pis pour ceux qui arrivent les derniers à cette hôtellerie de la mer. D'autres y étaient passés auparavant: et la ration quotidienne donnée à l'équipage de l'Alexina ne se composa que d'une petite mesure de pois, d'une livre et demie de farine, et de trois-quarts de livre de lard. Desprès fut acclamé cuisinier en chef de cette bande d'affamés; et comme la batterie mise à sa disposition ne se composait que d'un poêlon, ainsi que d'un plat de fer-blanc, et que les couteaux étaient surtout remarquables par leur absence, il eut un trait de génie, en se promenant un jour sur la grève. Remarquant une large coquille, il la ramassa et y adapta une pince en bois. Ses camarades en firent autant; et on peut s'imaginer tous les services que cette cuillère improvisée rendit alternativement, à la purée aux pois et aux vareuses des naufragés de l'Alexina. Le frugal menu détaillé plus haut ne rappelle pas précisément celui des Frères Provençaux: et que de fois les gardiens du phare, se laissant attendrir par la vue des maladies et des privations qui fondent sur ces délaissés, ne leur fournissent-ils pas des provisions prises sur leur propre réserve.
Le ministère de la marine s'est montré d'une grande sollicitude pour tout ce qui touche à l'habillement des naufragés. Le maître du phare distribue à chaque homme, dès son arrivée, un excellent gilet de laine bleue, un pantalon en serge, une paire de caleçons, deux vestons de flanelle, des bas, des bottes, des mocassins, des raquettes, un bonnet de fourrure, des mitaines et une chaude vareuse. Pour peu qu'un homme ait de l'énergie, et ne se laisse pas abattre par l'oisiveté et par l'isolement, il peut ainsi passer un hiver assez confortable: et la chasse, la pêche et la coupe du bois de corde le tiennent toujours en haleine empêchant ses muscles de s'engourdir.
La vue de cette chambre désolée, où un interminable hiver s'était passé, avait rappelé au lieutenant Desprès ce qu'il y avait souffert. Devant ses yeux repassait le naufrage de l'Alexina, l'atterrage miraculeux de son unique embarcation, la maladie de Deroy, sa triste agonie, et la nuit terrible de l'ensevelissement. Tout en songeant à ces choses, ses pas distraits l'avaient mené jusqu'à l'endroit où dormait son camarade de danger: et j'aidai Després à planter une croix sur ce tertre solitaire, pour indiquer au passant qu'un chrétien s'était endormi là, sur les bords de la mer, en attendant paisiblement l'heure solennelle de la résurrection.
Mais ces réminiscences d'une troisième croisière, que je dois, pour ne pas me répéter, mêler sans cesse à ceux de mon premier voyage, me font oublier qu'il nous faut retourner à bord. Gagnier et son excellente famille ont reçu nos adieux. Les avirons frappent le flot en cadence; et pendant que nous tournons le dos à cette terre inhospitalière de l'Anticosti qui, pour nous a menti si gracieusement à sa réputation, je songe à ce que l'avenir peut réserver à cette île qui a une longueur de cent vingt-deux milles, une largeur de trente, et une circonférence de deux cent soixante-dix. Privée de ports et entourée d'une redoutable ceinture de récifs, j'ai bien peur que tous les efforts faits pour la coloniser ou la défricher restent infructueux.
Depuis l'instant où elle fut découverte et baptisée par Jacques-Cartier du nom de l'Assomption, l'Anticosti n'a guère changé d'aspect. C'est toujours cette terre que Champlain trouvait "blanchâtre comme les falaises de la côte de Dieppe," et que le routier de Jean Alphonse de Saintonge nous présente dans son langage poétique, comme étant "assise sur des rochers blancs et d'albâtre, couverte d'arbres jusques au bord de la mer." Seulement, ces représentants du règne végétal sont en certains endroits tellement rabougris et tellement enchevêtrés les uns dans les autres, qu'on peut marcher des arpents sur leurs cîmes métamorphosées en ressorts élastiques.
Quelques-uns ont prétendu que l'île renfermait des richesses minérales. Je ne crois pas qu'il se soit fait quelques travaux en ce sens, depuis le jour où Charlevoix livra à la postérité la désopilante histoire de la première tentative.
—"Il courut un bruit il y a quelques années, assure cet écrivain, qu'on avait découvert à Anticosti une mine d'argent, et faute de mineurs on fit partir de Québec, où j'étais alors, un orfèvre pour en faire l'épreuve; mais il n'alla pas bien loin. Il s'aperçut bientôt au discours de celui qui avait donné l'avis, que la mine n'existait que dans le cerveau blessé de cet homme, lequel lui recommandait sans cesse d'avoir confiance en Dieu. Il jugea que si la confiance en Dieu pouvait par miracle faire trouver une mine, il n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à l'Anticosti, et il revint sur ses pas."
Pendant l'été, l'île d'Anticosti est parcourue par des bandes nomades de pêcheurs qui exploitent le saumon, la morue, le maquereau, le homard et le hareng. Au printemps, les chasseurs de loups-marins arrivent à leur tour; et avec ces poissons et cet amphibie, la chaux, la tourbe, la pierre de taille et les collections de fossiles, demeurent, à tout prendre, les seules et véritables richesses de l'île.
L'hiver, la population sédentaire ne dépasse guère soixante-quinze personnes. Pareil nombre compte peu aux yeux de la statistique; mais n'oublions pas que l'île d'Anticosti réserve pour le jour du jugement dernier la terrible quote-part qu'elle doit au recensement des humains. Alors, de ses rives désertes se lèveront officiers, soldats et matelots, portion considérable de l'immense foule des fils de ces pauvres gens, qui
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève
Ceux qui ne sont pas revenus.
Pour ravitailler le Rocher-aux-Oiseaux, il faut que la mer soit parfaitement calme. Au moindre souffle qui court sur la surface du golfe, la vague agit comme un bélier contre la falaise escarpée de l'îlot, et réduit en atome tout ce qui commet l'imprudence de passer à portée de son étreinte. Il ne faut donc pas s'étonner si, dix heures après son départ de l'Anticosti, le Napoléon III luttant contre une petite brise, frisait l'île Brion, et allait jeter l'ancre dans une des criques de ce groupe. Il était alors cinq heures de l'après-midi. Devant nous se détachaient les flancs rougeâtres de l'île: ils tranchaient sur le bleu de la mer; et vu du tillac, le paysage qui nous entourait, semblait devenir l'avant-plan d'une marine superbe, dont le fond se serait composé des îles de la Madeleine et du Rocher-aux-Oiseaux.
Ce fut le 25 juin 1534, que Jacques-Cartier découvrit cette partie de l'archipel de la Madeleine. Il lui donna le nom de Brion, en l'honneur de l'amiral de France le vicomte de Chabot, seigneur de Brion; mais comme ici-bas tout se perd, cette île n'est plus connue par la plupart de nos marins canadiens-français que sous le nom de Brillante, pendant que les cartes anglaises la désignent sous le nom de Bryon Island, et que la géographie élémentaire à l'usage des élèves des frères de la doctrine chrétienne, au Canada, l'appelle poétiquement l'île de Byron. En y débarquant, Cartier et ses compagnons furent si émerveillés par sa prodigieuse fertilité, que le capitaine malouin crut devoir rappeler dans le "Discours de son voyage" le souvenir de ce qu'il y vit ce jour-là.
—"Ces îles sont de meilleure terre que nous eussions oncques vues, en sorte qu'un champ d'icelle vaut plus que toute la terre Neuve. Nous la trouvâmes pleine de grands arbres, de prairies, de campagnes pleines de froment sauvage et de pois qui étaient fleuris aussi épais et beaux comme l'on eût pu voir en Bretagne, et qui semblaient avoir été semés par des Laboureurs. L'on y voyait aussi grande quantité de raisins ayant la fleur blanche dessus, des fraises, roses incarnates, persil et autres herbes de bonne et forte odeur".
Hélas! depuis le jour où Cartier mit le pied dans ce lieu enchanteur, Brion a perdu ses airs de paradis terrestre. Ses grands arbres sont disparus les uns après les autres. Ses vignes se sont desséchées; et ses roses incarnates sont mortes, étouffées sous les âpres baisers de la bise du Nord. Seule, la terre de l'île a su conserver sa fécondité; ses prairies sont restées fameuses dans tout le golfe Saint-Laurent. Elles fournissent à l'élevage une nourriture saine, qui peut soutenir la comparaison avec les meilleurs gazons anglais. Aussi le bétail qu'on y fait paître est-il superbe, et les moutons de Brion ne dépareraient pas l'étal du plus difficile de nos bouchers canadiens, un jour de foire de Pâques.
Jadis, Brion jouissait d'une autre célébrité: c'était là que se réunissaient ces troupeaux de vaches marines qui faisaient naïvement consigner la remarque suivante, dans le livre de loch de Cartier:
—"A l'entour de cette île il y a plusieurs grandes bêtes comme grands boeufs, qui ont deux dents en la bouche comme l'éléphant, et vivent même en la mer. Nous en vîmes une qui dormait sur le rivage".
Champlain fait la même remarque quelque part; et longtemps après ces voyageurs, on venait à l'abri des falaises de cette île, se livrer à la chasse productive de l'ivoire. Depuis plus d'un siècle les morses sont disparus du golfe. Ils ont cherché un refuge dans les solitudes arctiques, et à peine d'années en années trouve-t-on sur les rivages du Labrador ou sur les côtes de l'Anticosti une défense ou un crâne de ces mammifères marins, entraînés là par les courants ou par les glaces, pour indiquer au voyageur que le golfe Saint-Laurent a perdu l'une de ses plus précieuses ressources. Pourchassés sans trêve ni merci, comme l'était autrefois la baleine, comme l'est aujourd'hui la morue, le flétan et le loup marin, les vaches marines ont fini par suivre la loi commune des animaux qui doivent s'éteindre, dans un avenir assez rapproché.
—"C'est ainsi, nous assure M. l'abbé Provancher, que le lion qu'on ne voit plus qu'en Afrique, se trouvait autrefois en Grèce. L'auroch qui paît encore dans les forêts de la Lithuanie, se rencontrait jadis en France. Le loup a disparu de la Grande-Bretagne; le cerf à bois gigantesque a déserté l'Europe; le castor n'y est plus qu'extrêmement rare, de même que la tortue, la loutre et le lynx. Le bouquetin ne se voit plus que dans les Pyrénées et les Alpes, et l'ours dans les montagnes de la Suisse. Enfin, il y a plus d'un siècle que l'oiseau appelé le doute a disparu de l'Ile-de-France. La même chose se voit en Amérique. Le cachalot, la vache marine n'ont pas été vus dans le golfe depuis plus de soixante ans. La morue qui se péchait autrefois jusqu'à Kamouraska, se rend à peine à présent à Rimouski21. Le cerf du Canada qu'on chassait jadis sur les bords du Saint-Laurent ne se trouve plus que dans l'ouest: le castor et l'orignal y sont devenus rares. Le lynx roux a quitté l'est du Saint-Laurent, et le dindon sauvage qui était si commun sur les bords du lac Huron, ne s'y rencontre plus que rarement".
Note 21: (retour) Elle ne dépasse guère Matane, maintenant.
Aux judicieuses observations de ce naturaliste, j'ajouterai l'expérience des enseignements de l'histoire. Pendant plus d'un siècle et demi, l'anguille fut une des principales ressources de nos habitants: ils en prenaient des quantités prodigieuses entre Trois-Rivières et Québec. En 1646 le Journal des Jésuites rapporte que la seule pêcherie de Sillery en donna quarante milliers! Que devient aujourd'hui cette branche importante d'un commerce jadis si lucratif? Faute d'avoir été protégée, l'anguille va diminuant de jour en jour. Du temps de Charlevoix, les marsouins et les pourcils venaient prendre leurs ébats jusque dans la rade de Québec; aucun de ces souffleurs ne se hasarderait maintenant au-delà de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En 1720, Tadoussac était encore remarquable par la pêche de la baleine. Qui, de nos jours, peut se vanter d'avoir harponné l'un de ces cétacés, dans les eaux de l'ancien moulin Baude? Enfin, l'île Bouge qui, au XVIIe siècle, était célèbre par ses pêcheries au loup-marin, ne l'est plus guère que par sa solitude et ses naufrages22.
Note 22: (retour) —Au mois de juin, M. Abraham avec deux de ses gendres, s'en alla pour la première fois à la pêche des loups marins; il en prit la veille de la Saint-Jean quarante à l'île Rouge, et il en fit six barriques d'huile. Journal des Jésuites.
Quand donc nos lacs, nos rivières, nos mers et nos forêts seront-ils contrôlés par de sages règlements? et quand donc nos parlements et nos conseils d'états se mettront-ils dans la tête cet incontestable axiome:
—Légiférer pour les bêtes, c'est protéger l'homme.
En attendant la solution de ce problème élémentaire d'économie politique, les habitants de Brion ont fait leur deuil de la vache marine, et ont essayé de se rattraper sur l'agriculture.
Quelques-uns d'entre eux étaient déjà à bord, et nous offraient leurs services. L'un surtout, M. William Didgewell, insistait pour nous mener à sa métairie qui se trouve à un mille et demi dans l'intérieur, nous invitant à venir y goûter du lait, des gâteaux de sarrasin, et à nous laisser aller aux douceurs de la vie pastorale. Cette proposition fut acceptée de grand coeur.
Parmi les notes et les informations que nous recueillîmes sur Brion, nous apprîmes que sa population se composait d'une cinquantaine de personnes, réparties dans les cinq maisons de l'île. Elle est écossaise, à l'exception d'un Français qui habite seul, à l'autre extrémité de Brion. La pêche, l'amour du travail et une grande connaissance de l'agriculture mettent ces insulaires à l'abri du besoin. Chacun jouit ici, d'une modeste aisance et de la plus complète liberté. Ces braves gens ont résolu le problème difficile de vivre sans l'entremise du code municipal; et ce n'est pas vers leur île que doivent se diriger les avocats, en quête d'un cours d'eau en litige ou d'un procès de bornage. Néanmoins, l'isolement les a rendus défiants envers les étrangers: et l'un d'eux me demandait, si un piége ne se cachait pas sous la série de questions imprimées, que lui avait officiellement adressées le comité chargé par l'Assemblée Législative de la province de Québec, de s'enquérir de la tenure des terres dans l'archipel de la Madeleine. J'eus beau lui donner les meilleures raisons du monde pour l'engager à y répondre, je ne pus le convaincre: et je ne crois pas qu'un seul habitant de Brion ait pris la peine de se déranger, pour venir en aide à la commission d'enquête.
Leur île a un peu plus de quatre milles de longueur, sur une largeur de un mille et quart: ses plus hautes falaises ne dépassent pas deux cent dix pieds de hauteur. Les flancs de Brion sont parsemés de cavernes et de trous ils indiquent l'action incessante de la mer sur cette terre poreuse, où l'eau fraîche est rare.
Les savants sont d'opinion que le groupe de la Madeleine a dû former jadis une masse compacte. Je n'ai pas de peine à les croire; car l'amiral Bayfield a constaté que Brion est relié à mi-chemin, d'un côté, aux îles de la Madeleine—distance de 10 1/2 milles—par une lisière de roche où la sonde donne quatre brasses; et que, de l'autre côté, un second banc, qui donne sept brasses la rattache au Rocher-aux-Oiseaux, sis à l0 3/4 milles. Par un temps bien calme, l'oeil distingue sous le flot ces dangereux récifs; et on peut déduire de là, qu'une tempête doit être terrible dans ces parages, surtout avec une mer qui crève ainsi du fond. Cela n'empêche pas les habitants d'être aussi hardis marins, qu'ils sont habiles agriculteurs. Leur principal débouché est Amherst, une des îles de la Madeleine, et il faut que la brise soit bien carabinée pour les empêcher d'aller échanger sur ce marché, leur poisson, leur foin, leurs bestiaux et leurs denrées.
De frais qu'il était, le vent tomba complètement vers deux heures du matin. Notre longue promenade sur le Brion nous avait donné un sommeil de plomb; et ce ne fut qu'après bien des efforts réitérés que notre maître d'hôtel parvint à nous faire hisser nos pantalons et carguer nos bonnets de nuit. Avec une mer calme, par un soleil radieux, nous venions d'arriver par le travers du Rocher-aux-Oiseaux. Cinq minutes après, nous grimpions sur le pont; et un cri d'admiration saluait ce récif étrange, jeté au milieu de la mer pour faire l'effroi des matelots et le bonheur de la gente ailée.
Nous étions rendus au 25 juin. Ce matin-là, il y avait 340 ans, que ces rochers avaient été découverts par Jacques-Cartier. Poussé par un vent du nord-Ouest, il avait été obligé de courir quinze lieues dans le sud-est, et s'était ainsi approché "de trois îles, desquelles y en avait deux petites droites comme un mur, en sorte qu'il était impossible d'y monter dessus, et entre icelles, y a un petit écueil. Ces îles, ajoute ce marin, étaient plus remplies d'oiseaux que ne serait un pré d'herbe, lesquels faisaient là leurs nids, et en la plus grande de ces îles y en avait un monde de ceux que nous appelions Margaux, qui sont blancs et plus grands qu'oysons, et étaient séparés en un canton, et en l'autre part y avaient des Godets.... Nous descendîmes au plus bas de la plus petite et tuâmes plus de mille Godets et Apponats23, et en mîmes tant que voulûmes en nos barques, et en eussions pu, en moins d'une heure, remplir trente semblables barques. Ces îles furent appelées du nom de Margaux24".
Note 23: (retour) On les nomme perroquets, aujourd'hui ce palmipède est le grand macareux du nord.
Note 24: (retour) Discours du voyage fait par le capitaine Jacques-Cartier, en la terre du Canada, dite Nouvelle France, en l'an 1534, p. 4. A Rouen—de l'imprimerie de Raphaël du Petit Val—MDXCVIII.
Ceci se passait en 1534. Quatre-vingt-douze ans plus tard, en 1626, Champlain croisait dans ces parages, et ne constatait plus que la présence de deux îlots, au lieu des trois relevés par Jacques-Cartier. L'un s'était effondré dans la mer, et ses habitants surpris par ce cataclysme, avaient tourbillonné un instant sur le gouffre qui venait d'engloutir leur domaine; puis, oublieux comme tout être créé, ils étaient partis à tire-d'aile pour aller demander l'hospitalité aux camarades, restés en possession des rochers qui sont encore debout aujourd'hui. De même que Cartier, Champlain trouve en passant par là, "telle quantité d'oyseaux appelés tangueux qui ne se peut dire de plus: les vaisseaux, quand il fait calme, avec leurs batteaux vont à ces îles, et tuent de ces oyseaux à coups de bâton en quantité qu'ils veulent".25
Note 25: (retour) Oeuvres de Champlain, p. 1084. Edition Laverdière.
Espèce de citadelle, accessible que par escalade, et continuellement rongée par la mer, le Rocher-aux-Oiseaux dépasse, comme aspect, comme étrangeté, toutes les descriptions que ces voyageurs célèbres en ont fait. Longue de 770 verges, large de 270, couvrant une superficie de sept acres et trois quarts, et présentant du côté du sud un précipice perpendiculaire de 80 pieds, qui atteint 114 pieds du côté du nord, l'île principale est couverte de pingouins, d'alques à bec en rasoir, de guillemots, de fous de Bazan et de grands macareux du nord. Ils y planent, y pèchent, y couvent et y vivent par millions. Partout, leurs nids couvrent la croupe du brisant, qu'à une lieue en mer, surtout par un clair de lune, on prendrait pour un rocher couvert de neige,—tant il est tapissé de blanc duvet. A trois arpents de cette république ailée, ces oiseaux abasourdissaient déjà notre équipage de leurs cris. Nous les voyions à tout instant, tournoyer autour de l'île, prendre terre après quelques minutes de valse fantastique, et s'accroupir sur leurs nids qu'ils retrouvent sans hésiter, au milieu de cet inextricable fouillis. A l'époque de la couvaison, ces derniers sont en si grand nombre, qu'ils font ressembler la cime à un champ de pomme de terre que la bêche du jardinier viendrait de rechausser.
Le Rocher-aux-Oiseaux est un des nombreux endroits du golfe Saint-Laurent, où il ne faut pas trop flâner. Il n'est permis aux navigateurs de s'en approcher, que lorsque les vents dorment; et sous pareille circonstance, pas n'est besoin de dire que nos chaloupes n'avaient pas mis grand temps à quitter leurs porte-manteaux. Bientôt, nous mettions le pied sur une étroite lisière de grève, composée d'une série de blocs erratiques, que la mer dans ses jours de fureur, a roulés aux pieds des falaises roussâtres de l'île. Malgré le calme plat qui nous entourait, un assez fort ressac se faisait sentir au rocher. L'épaule herculéenne du lieutenant LeBlanc nous prêta son appui; et nous sautâmes au bas des échelles que nous devions escalader.
—Bon voyage, messieurs, nous cria-t-il, en nous voyant nous engager sur le premier échelon. Ayez le pied ferme; et surtout prenez garde à ces maudits margaux. Un suffit, pour encharogner toute une marine!
Ce volatile était le seul ennemi que nous connaissions à LeBlanc. Un jour, en passant près d'un nid et craignant de faire mal à la mère, il l'avait doucement reculée de la main. En récompense de cette attention délicate, le lieutenant s'était fait saisir à la joue par une paire de tenailles aussi maternelle que terrible; et au mépris du décorum, cet officier, vigoureusement éperonné dans sa course insensée par l'implacable oiseau, qui restait suspendu à dix lignes de son oeil gauche, avait été forcé de galoper dans cet équipage, devant ses matelots ébahis, et de faire ainsi deux fois le tour de l'île.
Ce fut en riant aux éclats du récit de cet engagement corps à corps, que nous montâmes à l'escalade.
Agénor Gravel battait la marche. Nous grimpions à sa suite: j'étais le serre-file. Déjà une partie de l'ascension se terminait; nous avions derrière nous cinquante pieds d'abîme, et la première échelle était dépassée. Il fallait maintenant se rendre à la seconde, séparée de nous par une corniche longue de cinq pas, large de dix-huit pouces, et courant sur une pente inclinée26.
Note 26: (retour) Une petite plate-forme, entourée d'une balustrade en fer, sépare maintenant le point d'intersection des échelles, et rend l'ascension plus commode.
Agénor l'a bien passé,
Tire lire,
fredonnai-je gaiement, sur l'air des Canards; et fermement, je posai le pied sur l'étroite lisière. En ce moment, un caillou roule sous mon talon, ferré. La terre et le tuf s'égrènent sous moi. Je les sens qui cèdent, et les entends qui tombent à pic dans l'abîme. Mais avec un sabot de mule on passe partout, me disais-je; et m'aidant unguibus et rostro, les reins souples comme une lame d'acier, j'appuie légèrement sur le sol qui cherche à se dérober, et saute sur le dernier barreau de la seconde échelle. Celle-ci avait une longueur de quarante pieds. Tout en nage les yeux fixés sur le sommet qui surplombe, les mains fermement posées sur les barres, je gravissais lentement l'espace, pendant que je traînais sur mon dos cet étrange frisson que donne le vide. Dix échelons restaient encore; puis tout était fini. Mais, horreur! mes jambes se roidissent! Je viens de sentir distinctement l'échelle osciller dans ses crampons de fer, et se détacher du rocher! Une sueur froide couvre mon front: mes yeux se ferment involontairement. Le vertige bourdonne dans mes oreilles: il veut s'emparer de mon cerveau; et déjà je suis envahi par cette attraction mystérieuse qu'exerce toujours l'abîme, sur les proies qu'il veut se donner. Le vide m'attirait; j'allais lâcher prise pour tomber dans l'horrible spirale, lorsqu'un reste de volonté se prend à refluer vers mon coeur. Ma droite, et ma gauche se font tenailles, arrachent le corps à sa dangereuse immobilité; soulèvent mes jambes, qui sont devenues lourdes comme des masses de plomb, et par un dernier effort me déposent sur la crête dentelée du gouffre.
A quatre-vingts pieds en l'air, je venais d'éprouver ce mouvement de tangage, que ressentent quelquefois sur terre les personnes qui arrivent de la mer; je ne sais s'il me fallait passer en cette minute, par toutes les agonies du vertige pour eu être guéri, mais depuis, j'ai refait cinq ou six fois cette route aérienne, et j'ai grimpé dans les mâtures les plus hautes, sans jamais éprouver la moindre faiblesse, ni la moindre crainte.
Le spectacle qui nous attendait sur l'île, était encore plus extraordinaire que celui que nous avions contemplé du pont du vapeur. Pendant que nous nous reposions sur le maigre gazon du rocher, des myriades de godets, de margaux, de perroquets de mer et de marmettes étaient là, couvant et jacassant, à une longueur de bâton.27 Divisés en cantons, comme du temps de Cartier et de Champlain, leurs nids abondaient et surgissaient de partout. Ici, c'était celui du margaux, petit creux entouré de branchage et de terre, où reposait un oeuf blanc, de la grosseur de celui d'une oie. Là-bas, les macareux du nord dormaient dans les anfractuosités du rocher, ou entraient, puis ressortaient flegmatiquement des terriers qu'ils s'étaient creusés à même la falaise. Serrés en rang le long des corniches de l'île, ceux-ci, graves et hautains, faisaient l'effet d'une chambre de pairs qui se serait composée de pingouins, de guillemets et de macareux; pendant qu'à leurs pieds, se battaient ou discutaient à grands cris les fous de Bazan, qui personnifiaient à s'y méprendre les communes démocratiques. Je n'ai pas besoin d'ajouter, qu'une odeur fortement inconstitutionnelle s'élevait de ce champ de liberté. Mais, hélas! pendant que ces assemblées délibérantes s'occupaient de la gestion des affaires de leur république, la mort et l'émeute grondaient à leur porte. Déjà, les journées de juin s'étaient levées pour elles. Bientôt, des pierres pleuvent de toutes parts sur les malheureux habitants du rocher. Des coups de fusil se font entendre; et les bandes insurgées s'avancent, guidées par Agénor Gravel, qui sifflote entre ses dents:
Margot! Margot!
Lève ton sabot,
La danse commence.
Note 27: (retour)Les marins canadiens ont conservé à deux de ces espèces d'oiseaux les noms que leur donna Cartier: celui du margaux et du godet. Seulement, par abréviation, ils disent God en parlant de ce dernier. Champlain avait nommé le margaux le tangueux, et en fait une excellente description. Néanmoins il montre un peu trop de bonne volonté envers ce volatile, lorsqu'il écrit que "les petits marges sont aussi bon que pigeonneaux".
—"Ils sont gros comme des oies, dit-il, ont le bec fort dangereux, sont tout blancs, hormis le bout des ailes qui est noir, et sont de bons pêcheurs pour le poisson qu'ils prennent et portent sur leurs îles, pour manger".
Le margaux est le fou de Bazan; la marmette le guillemet; le perroquet de mer, le grand macareux du nord, et le pingouin du golfe l'alque à bec en rasoir.
Nos matelots, excités par ce chant bachique, que Massé ne se serait guère attendu à voir métamorphosé un jour en hymne révolutionnaire, roulaient dans l'espace des quartiers de roche à rendre Sysiphe poitrinaire, tout en chantant à tue-tête sur l'air que vous connaissez.
A chaque reprise de ce choeur des Noces de Jeannette, les pierres et les coups de fusil partaient drus comme grêle. Il fallait voir alors les malheureux volatiles dégringoler par grappes dans l'onde qui, ce jour-là, n'était pas aussi amère que leur existence. Franchement, pareille tuerie devenait dégoûtante. C'était avoir des dispositions au meurtre que de taper ainsi sur ces animaux stupides et comme nos gens y prenaient goût, ce ne fut qu'à force d'instances que nous parvînmes à faire cesser cet inutile massacre.
Les plumes du fou de Bazan sont soyeuses, très fourrées, très blanches, mais donnent une forte odeur de musc. Bien préparées, elles acquéreraient une certaine valeur dans le commerce; et je suis étonné que quelques-uns de nos industriels n'aient pas encore songé à exploiter cette source de facile revenu. En revanche, les Américains, qui sont à l'affût de tout, commencent à les connaître. Ils se sont aperçus de plus, que les oeufs du margaux étaient d'excellent débit. A l'époque de la couvaison, leurs équipages descendent dans les îles où se réfugient ces oiseaux, cassent les oeufs qu'ils trouvent dans les nids, pour en obtenir de plus frais; puis, quand ce truc a réussi, ils chargent leurs goélettes, mettent le cap sur Boston, et vendent leur cargaison 25 à 30 cents la douzaine.
C'est surtout au milieu des îles qui bordent la côte du Labrador, que cette désastreuse industrie s'exerce. L'abbé Perron, longtemps missionnaire à Nastashquouan, écrivait à ce sujet:
"De peur que leur larcin soit découvert, les Américains enfouissent dans le sable les quarts d'oeufs qu'ils ont ramassés, ou les descendent au fond de l'eau, jusqu'à ce qu'ils en aient assez pour former une cargaison. Lorsque ceux qui ont échappé à leurs perquisitions ont été couvés et sont éclos, ils viennent de nouveau parcourir nos îles, tuent le gibier, enlèvent sa plume, et abandonnent par monceaux sa chair à la corruption".
Trois jours après notre départ, le Rocher-aux-Oiseaux fut saccagé par ces écumeurs de nids! Ne serait-il pas temps de défendre sévèrement ces excursions périodiques qui tendent à exterminer notre gibier? Ces gens là, ne sont pas difficiles sur les oeufs: il empilent à fond de cale tous ceux qui leur tombent sous la main.
Ces palmipèdes ne sont pas les seuls êtres ailés qui aient élu domicile sur le Rocher-aux-Oiseaux. Deux grives y ont passé un été. Une autre année, un couple d'émérillons est venu semer la terreur et le deuil au milieu des plus paisibles ménages de l'île; et en 1875, je retrouvai la maison du gardien pleine de fauvettes et de moucherolles. Elles entraient par les fenêtres entr'ouvertes, et sautillaient en becquetant sur le buffet et les modestes meubles du seul abri que présente cette solitude28.
Note 28: (retour) M. F. X. Bélanger le savant conservateur du musée zoologique, de l'Université Laval, a eu la complaisance de déterminer la classification de quelques-uns des oiseaux que nous vîmes sur le rocher. Ils appartiennent au genre Miotilta varia de Veillot, ainsi qu'au genre Dendroica aestiva et Dendroica castenea, de Baird, et font partie de la nombreuse famille des Sylvicolidae, oiseaux qui vivent exclusivement d'insectes, et habitent ordinairement les forêts.
Le phare du Rocher-aux-Oiseaux est une tour blanche hexagone, qui fut allumée pour la première fois en 1870. Elle est à 140 pieds au-dessus de la hante marée, et donne un feu blanc, fixe, dioptrique, de second ordre, qui s'aperçoit à vingt et un milles en mer.
Chaque dimanche soir, pendant l'hiver, le phare du Rocher-aux-Oiseaux rallume ses feux depuis sept heures jusqu'à neuf heures. Si la lumière reste visible pendant ce temps, c'est, un signe que tout va bien sur le Rocher; mais si elle se masque trois fois en l'espace de ces deux heures, alerte sur la côte de Brion ou de la Madeleine! Un accident est arrivé aux habitants de l'île. Comme le phare est construit sur un point très-exposé, M. Mitchell quand il était ministre de la marine, donna l'ordre en 1873 d'ajouter des étais à la tour afin de mieux l'assujettir au roc.
L'habitation du gardien se trouve située à deux cents pieds de la lumière. C'est une maisonnette petite, puante et mal tenue: mais l'impression qu'elle m'avait laissée lors de mon premier voyage s'est effacée depuis. En 1875, elle avait changé de main: et sous la direction de M. Whelan, elle était devenue beaucoup plus confortable. En y entrant, on nous montre un puits creusé dans le roc: il contient 3,000 gallons d'eau de pluie, la seule qu'on puisse se procurer sur l'île. Cette fontaine improvisée, ne demande pas mieux que d'être remplacée par une bonne machine à distiller l'eau de mer. Une passerelle court de l'habitation à la lumière; elle sert de lien de communication avec la tour, et les jours de vent, ses solides garde-fous en fer empêchent le gardien et ses aides, d'être emportés par les terribles rafales qui balayent alors tout ce qui ne se trouve pas cloué à ce rocher, où pousse à peine une herbe languissante et étiolée. A quelques pas du corps de logis s'élève une croix, plantée entre de gros morceaux de tuf: elle est protégée par une balustrade en bois, déjà branlante et toute disjointe. En attendant que cet endroit devienne un cimetière, c'est le lieu où, quand le temps est propice, on vient s'agenouiller pour faire la prière du soir, et admirer les plus beaux couchers du soleil au monde. Un peu plus loin, se dresse là poudrière, et l'abri où se cache le canon chargé d'annoncer d'heure en heure l'approche du récif, aux navires surpris par la neige ou par la brume.
Un petit tramway en bois, court du dépôt de provisions à la maison de la tour; et du côté nord-ouest de l'île, trois ouvriers intelligents MM. Jobin, Blanchet et Roza, ont accompli un véritable tour de force, en taillant dans le roc une tranchée perpendiculaire, haute de 127 pieds et large de 28. Elle permet à une grue de faire mouvoir une boîte, suspendue à un câble en fil de fer: dans cet élévateur on dépose les effets destinés au phare, lorsque la mer ne brise pas trop de ce côté.
Lors de notre passage au Rocher, en 1873, la population de l'île se composait de quatre hommes et d'une petite fille.
Tout ce qui méritait d'être vu ou étudié sur le Rocher-aux-Oiseaux, l'avait été par nous. Il ne nous restait plus qu'à refaire le précipice, où nous nous engageâmes allègrement, escortés en route par quelques morceaux de coke anglais, provenant d'un quart, arrêté dans son ascension par une anfractuosité du rocher, et que maître LeBlanc, attaché au bout d'une forte corde, s'en était allé défoncer à grands coups de hache. Au milieu de ce bombardement d'un nouveau genre, nous descendions le plus vite possible, qui ayant des chapelets d'oeufs enroulés autour du cou, qui des peaux d'oiseaux suspendues derrière lui par des bouts de ficelles; chacun évitent les projectiles qui lui passaient le long des oreilles, et tous arrivant tant bien que mal au pied du rocher, où notre équipage nous attendait, en défendant les flancs de la baleinière contre la morsure de la falaise.
L'opération du ravitaillement était finie: mais pour y arriver, que de courage et de mépris de la fatigue n'avait-il pas fallu à nos braves matelots? Dans l'eau jusqu'au cou, les uns empêchent les chaloupes de frapper avec le ressac; les autres, aident à débarquer et à rouler sur deux madriers mal assujettis, les quarts de poudre, de pétrole et de provisions destinés à l'île; les troisièmes travaillent à la grue, ou dégagent les objets qui se mêlent, s'enchevêtrent et ne peuvent arriver à destination. C'est ainsi que chaque escouade se hâte de faire sa besogne, sous le commandement d'officiers qui montrent l'exemple et ne s'épargnent guère. Les lieutenants LeBlanc, Savard et Couillard-Després sont là, payant de leur personne; et je ne crois pas qu'on puisse rencontrer ailleurs des gens plus dévoués et de meilleure humeur. Puis, quand la rude besogne est terminée; quand après douze heures de travail, les baleinières reviennent à bord, ces hommes trempés, rompus et qui devraient être sur les dents, regagnent leur carré en chantant, et trouvent encore le moyen d'exploiter la vieille gaîté gauloise, en riant aux éclats, et en faisant des lazzis sur les aventures de la journée.
Par sa position exceptionnelle au milieu du golfe Saint-Laurent, le Rocher-aux-Oiseaux est placé sur la route du neuf-dixième des steamers, et de la moitié des navires à voile qui vont à Québec ou à Montréal. Aussi est-il appelé à rendre, comme observatoire télégraphique, les services les plus signalés. Bientôt, grâce aux efforts du commandant Fortin, député de Gaspé aux Communes du Canada, ce récif qui, jusqu'à présent, n'a été qu'un objet de terreur pour les marins, perdra son antique réputation. Il accomplira, lui aussi, sa mission dans le rouage universel. Relié par un câble sous-marin au Cap Breton, au groupe de la Madeleine, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Edouard, à la Gaspésie, à l'Anticosti—et plus tard à la côte nord, et à Belle-Isle—il annoncera au monde le passage des navires, donnera les nouvelles qui serviront de bases à d'importantes études météorologiques, et indiquera aux pêcheurs et aux habitants de la côte, les pérégrinations du hareng, du maquereau, de la morue et du loup-marin, ainsi que l'endroit où il viendra se porter pour leur faire une pêche ou une chasse fructueuses.
Il était cinq heures du soir, lorsque le premier tour de l'hélice nous arracha à la contemplation du Rocher-aux-Oiseaux. Le soleil était chaud: et pendant que nous courions sur Brion pour y passer la nuit, le second rocher se montrait à nous sous les apparences les plus fantastiques. Il était à un demi-mille sous le vent; et tandis que celui que nous quittions prenait dans l'éloignement la forme d'une tour Martello, celui-ci ressemblait à un bastion, à travers lequel on aurait percé une porte de guerre, arche profonde de trente pieds, large de cinquante, et haute de vingt. Puis, à mesure que le steamer avançait, il perdit cette forme, pour affecter celle d'une pyramide, n'ayant guère plus de vingt pieds de superficie. Fière et inaccessible, comme le bonnet phrygien de la liberté, elle allait se perdre dans les profondeurs du ciel bleu.
Après les rudes labeurs de la journée, nos hommes avaient mérité de prendre une nuit de repos, et le lendemain, quittant plus frais et plus dispos le petit havre de Brion, nous faisions route vers les îles de la Madeleine. Depuis assez longtemps, le Napoléon III filait à toute vapeur, sur le dos d'une mer calme qui l'entraînait dans ses vagues longues et presqu'insensibles. Tout à coup l'ordre fut donné de virer de bord. Notre capitaine venait d'avoir la première attaque de cette terrible maladie—un ramollissement cérébral—qui devait l'emporter deux ans après. Sous les premières étreintes de ce mal étrange, cette tête intelligente avait senti sa mémoire vaciller. Cet excellent marin, s'était trompé dans ses calculs, et au lieu du groupe de la Madeleine, nous avions devant nous les côtes montagneuses de Terreneuve pivelées de larges taches de neige. Mis en présence de cette barrière inattendue, le Napoléon III fit volte-face. Bientôt nous eûmes sous notre beaupré les falaises escarpées de l'île Saint-Paul, et nous aperçûmes l'un de ces phares fièrement campé sur un mamelon gris. Cette île, qui a trois milles, est jetée à l'entrée du golfe Saint-Laurent, entre les extrémités sud-ouest de Terreneuve et nord du Cap Breton. Elle se compose de deux îlots, séparés l'un de l'autre par un bras de mer si étroit, que vus du pont d'un navire, ces deux fragments semblent ne faire qu'un tout compact La plus grande hauteur de Saint-Paul, est de quatre cent cinquante pieds au-dessus du niveau de là mer. Le sol est composé de roches appartenant aux formations primaires; et comme l'île est coupée à pic, à peine présente-t-elle aux bateaux-pêcheurs deux abris passables, les anses de la-Trinité et de l'Atlantique. Encore, pour y tenir, faut-il que le vent se lève de terre. Bien, des naufrages terribles ont eu lieu sur cette île "escarpée et sans bord", où vivotent à peine quelques épinettes rabougries, sous lesquelles, se cachent une demi-douzaine de renards, arrivés sur l'île, "on n'a jamais su comment".
Néanmoins, depuis quelques années Saint-Paul a perdu de sa sauvage réputation. Le gouvernement y a fait construire deux tours blanches, octogones, dont l'une, bâtie sur le rocher vis-à-vis la pointe nord-est de Saint-Paul, donne une lumière blanche, fixe, masquée entre nord quart-est-quart-est et est-nord-est, tandis que l'autre, érigée sur la pointe sud-ouest de l'île, donne un éclat blanc toutes les minutes. Le ministère de la marine a complété cette oeuvre philanthropique, en faisant construire un sifflet d'alarme sur le coté sud-ouest de l'anse de l'Atlantique, à un demi-mille à peu près de l'établissement de secours. Pendant les temps couverts et les tempêtes, ce sifflet se fait entendre toutes les minutes.
Les trombes ne sont pas fréquentes dans le golfe Saint-Laurent; mais elles y sont d'une violence inouïe. Le 16 août 1816, Saint-Paul fut dévasté par un de ces cataclysmes atmosphériques, et je ne saurais mieux faire que de reproduire ici le récit officiel de cette catastrophe, tel que transmis par le gardien du phare au ministère de la marine, à Ottawa.
"Du 1er au 16 août, nous n'avions eu ni pluie ni nuages pour tempérer les brillants rayons du soleil. Finalement, l'atmosphère se remplit d'une fumée si épaisse, qu'on eût dit que la terre entière était en feu. Le 16, le temps changea; le vent passa au N. N. E. avec grain-de pluie. La fumée, qui depuis quelques jours était devenue insupportable, se dissipa, et nous espérâmes du beau temps. Dans la matinée du 17, le vent souffla de l'est; le soleil fut très chaud. Dans l'après-midi, le vent passa au S. S. O. avec grain de pluie. Le matin du 18, il était sud, avec risées et nuages menaçants. Dans l'après-midi, le firmament offrait un aspect terrible: les nuages paraissaient se heurter les uns contre les autres, et tourner dans toutes les directions. Vers quatre heures p. m., nous commençâmes à entendre des coups de tonnerre dans le lointain. Un quart d'heure après, la foudre et la pluie étaient dans leur plein déchaînement. Le vent se mit au N. O. Je sortis, et fis le tour des bâtiments, afin de voir si tout était en bon ordre. Tout à coup, il était alors 9 1/2 heures, j'entendis un bruit terrible. En tournant mes regards dans la direction d'où il partait, j'aperçus un spectacle qui me fit frissonner de la tête aux pieds: à moins d'un quart de mille de l'endroit où je me trouvais, je vis, vers l'ouest, des roches, de la terre, de l'eau et des arbres s'élever en tourbillonnant dans l'air, jusqu'à une hauteur de plus de 100 pieds. J'examinai attentivement la trombe, pour voir quelle direction elle prendrait, et constatai avec terreur qu'elle traversait l'anse en se dirigeant sur moi, et qu'elle allait probablement emporter le logement dans sa course furibonde. Ma mère, une soeur sourde-muette, les domestiques étaient dans la maison, et j'avais deux hommes occupés aux champs. Je courus les avertir. En route, une rafale se déchaîna autour de moi, emportant dans l'espace une pierre meulière, des roches et des arbrisseaux. Le corps principal de la trombe était près de moi; je courus avec toute la vitesse de mes jambes vers le logement, et criai aux deux hommes qui étaient dans le champ de me suivre. Ils me parurent terriblement effrayés; l'un d'eux n'eut que le temps d'entrer dans la maison. Comme nous franchissions le seuil de la porte, il se fit une obscurité aussi profonde que celle de la nuit, et la tempête qui éclata, fit trembler l'édifice de la base au sommet. Au milieu du plâtre qui tombait, des cheminées, des vitres réduites en atomes, des chaises, des tables renversées, nous crûmes que notre dernière heure était arrivée. Toutefois, la tourmente s'en alla aussi rapidement qu'elle était venue. Le calme se rétablit, et le soleil reparut dans tout son éclat: mais quel désastre! La fumée du plâtre qui tombait nous avait fait croire que la maison était en feu; voyant qu'il n'en était rien, je sortis le mieux que je pus. Au moment où la trombe avait fait son apparition, deux de mes hommes se trouvaient à un quart de mille de la maison. En voyant le tourbillon s'avancer, et comprenant qu'ils ne pourraient pas arriver à temps, ils se jetèrent à terre, se cramponnèrent aux buissons, et échappèrent à la destruction. Il n'en fut pas ainsi du pauvre homme qui n'avait pas semblé entendre mes cris d'avertissement: après une demi-heure de recherches, nous le trouvâmes mort sur le pas de la porte. Il a dû être tué dans le champ, et emporté par la trombe à l'endroit où nous le retrouvâmes, distance d'environ 300 pieds. Je constatai que cinq bâtiments avaient été détruits avec leur contenu; il n'en restait pas une parcelle. La cabane de la chaloupe, le dépôt aux provisions et le logement sont encore debout, mais terriblement endommagés. Le logement est une véritable ruine: le toit est défoncé en plusieurs endroits, les cheminées, renversées, les fondations écroulées, les fenêtres brisées, et à l'intérieur tout le plâtre est tombé. Ce qui a été détruit, consiste en une maison de refuge, la grange, l'étable, et deux antres bâtiments situés sur le sommet de la colline, à 600 pieds l'un de l'autre. Quatre de ces édifices couvraient on espace de 70 x 20 pieds. Les deux ponts sur lesquels je venais de passer un instant auparavant, furent emportés, à une distance d'environ 400 pieds, et mis en pièces. Une roche de 3 x 4 pieds de diamètre et 18 pouces d'épaisseur, fut brisée en trois ou quatre morceaux. Une charrue et une pierre qui se trouvaient dans la maison de refuge, ainsi que des ustensiles de ferme et de cuisine, des outils de charpentier, furent enlevés par dessus la maison, et trouvés à plus de 200 pieds de là. L'homme préposé à la garde du phare sud-ouest me dit que, vers 4 heures p. m., il vit six tourbillons d'eau s'élever dans la direction de l'ouest, à trois milles; deux passèrent au sud-est de l'île. De l'établissement de secours nous en aperçûmes un, après le désastre: deux gagnèrent au nord, et deux autres, dont l'eau s'abattit sur la station, passèrent pardessus l'île. Les deux qui atteignirent l'île vinrent près de la station sud-ouest, mais ne firent heureusement aucun, dommage."
Nous n'eûmes pas à passer par de pareilles péripéties. La journée était ravissante; une petite brise venait agiter mollement la tente que nous avions fait tendre sur le gaillard d'arrière, et enveloppé dans son panache de fumée, le Napoléon III insoucieux, rasait impunément la côte de fer de Saint-Paul. Petit à petit ces îlots déserts s'enfuirent derrière nous, pour se plonger dans un bain de lumière, et bientôt nous vîmes surgir en proue les flancs verts-sombres du Cap Nord,—une des extrémités de l'île du Cap-Breton 29—qui se détachaient vigoureusement sur les tons glauques de la mer. J'étais alors appuyé sur le bastingage de bâbord, et tout en m'occupant à fumer un cigare, mon oeil distrait se rivait à cette ligne de rocs sauvages, derrière lesquels l'imagination me montrait ce vieux Louisbourg qui avait une ceinture de cinquante acres de fortification, et "dont les tours, au dire de Garneau, s'élevaient au-dessus des mers du Nord comme des géants menaçants". Ce n'était plus cet endroit triste et oublié que heurte aujourd'hui, sans le savoir, le pied du marchand de poisson ou du spéculateur de charbon de terre. Non! Ce que le temps et la rage des hommes avaient démantelé et fini par niveler, reprenait une forme sous le coup de baguette de la pensée. La ville royale surgissait de nouveau hors des mornes qui la recouvrent, pour m'apparaître avec sa cathédrale, son théâtre, sa brasserie, ses chapelles, ses hôpitaux, ses-couvents, ses riches demeures. La brise du golfe m'apportait alors des bruits de clairons et des roulements de tambours. De fortes patrouilles parcouraient en cadence ces remparts disparus, qui miraient de nouveau leurs massives assises dans l'eau dormante de leurs fossés. Le lourd pont-levis chargé de protéger la ville du coté de la campagne, se levait au commandement d'un officier supérieur, et allait se boucler à de gigantesques supports. La batterie tournante qui en défendait l'entrée se mettait à tonner, comme aux jours de parade de jadis, et du côté de la mer, des corsaires taillés pour la course sortaient du port qui leur servait de nid, et se couvrant de toile, allaient courir sus à l'Anglais. Puis les mauvais jours arrivaient à tire-d'aile. Bigot qui devait débuter par la catastrophe de la flotte du duc d'Anville, pour finir par être si fatal à la Nouvelle-France tout entière, était là. Il enveloppait le malheureux Louisbourg dans les effluves de son mauvais-oeil. Commissaire-ordonnateur de la colonie du Cap-Breton, il apportait déjà un règlement de la solde des hommes, ce manque de régularité qui, plus tard, devait le faire embastiller. La garnison se révoltait. Les suisses qui ne meurent bien que lorsqu'ils sont payés, déposaient leurs officiers, s'emparaient des casernes, ainsi que des magasins du roi; pendant que l'ennemi profitant des divisions intestines, prêchait la guerre sainte, et faisant inscrire sur ses drapeaux les mots "Nil desperandum Christo duce" venait mettre le siège devant la redoutable forteresse. Une lutte terrible s'engageait alors; lutte étrange, où ces révoltés de la veille s'obstinaient à se battre et à mourir au nom de la France, tandis qu'à leur tour les officiers, ces chevaliers de Saint-Louis, dont pas un n'eût rougi d'orgueil à la pensée de tomber au champ d'honneur,—s'obstinaient par une fatale erreur, à se méfier de leurs soldats. Et, conséquence fatale! Louisbourg la vierge, Louisbourg l'imprenable, tombait entre les mains d'une armée de paysans, commandée par William Pepperell, petit marchand dont l'enseigne se trouvait à Kittery Point, un des Bourgs ignorés de la Nouvelle Angleterre. Puis, pendant que de braves diplomates s'occupaient à rendre le Cap-Breton à la France, en retour de Madras prise par de la Bourdonnaye, l'orgueil du vieux sang gaulois me montait à la figure, en songeant que nous n'avions pas toujours été les vaincus de ces parages, et que longtemps avant la chute de Louisbourg, longtemps avant le traité d'Aix-la-Chapelle, un capitaine du port de Dieppe avait, avec une poignée de matelots, forcé lord James Stuart de se rendre prisonnier, et de remettre entre les mains du capitaine Claude le fort du Port-aux-Baleines, où cet aventureux seigneur écossais était venu planter l'étendard du roi d'Angleterre30.
Note 29: (retour)Jacques-Cartier avait baptisé ce promontoire du nom de cap de Lorraine, et donna à l'Ile, que Verrazzani avait nommée île du Cape, celui d'île Saint-Laurent. Plus tard, elle prit le nom d'Ile Royale pour garder définitivement celui de cap Breton. Drake dans ses "Nooks and corners of New England coast" prétend, à la page 21, que le Cap Breton avait sa place sur la carte, longtemps avant la découverte de Cartier. Un vieux portulan du temps de Henri II, mentionne ce nom, assure-t-il.
Le cap Breton a 110 milles de long sur 90 de large, et comprend à peu près 200,000 acres de terre. Il est séparé de la Nouvelle-Écosse par le détroit de Canseau qui, dans-certains endroits n'a pas plus de 3/4 de mille de largeur, tandis que dans d'autres, il y en a le double.
Note 30: (retour) Stuart fut amené en France au mois de décembre 1629, et remis entre les mains de Richelieu.
A mesure que ces rêves de jadis passaient devant moi, pour aller se perdre au milieu des spirales bleuâtres de la fumée de mon cigare, ces fanfares de guerre, ces bruits devenaient de moins en moins distincts. Bientôt ils s'évanouirent. Seule, je n'entendis plus que la grande voix de la mer qui, à son tour, venait me raconter les mystérieux épisodes qui se sont déroulés au pied des falaises du Cap-Breton. Devant mes yeux épouvantés passa alors comme l'éclair, un navire démâté, pourchassé par un ouragan du sud-est. Sur son tillac, je distinguais les mâles figures des jésuites Lallemand, Noyrot et de Vieuxpont, et j'entendais l'équipage consterné chanter d'une voix tremblante le Salve Regina, pendant que le vaisseau affolé courait toujours sur l'aile de la tourmente. Tout-à-coup un craquement terrible se fait entendre; ces malheureux—à l'exception de dix—viennent de s'abîmer sur les îles Canso, et bientôt mon oreille navrée n'est plus frappée que par la voix forte du P. Noyrot qui, entraîné par un énorme paquet de mer, psalmodie fermement:
—In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Puis la vague suivante me montre à la hauteur de Louisbourg, le Chameau, "grande et belle flûte du roi, commandée par M. de Voutron." Naguère partie joyeuse des côtes de France, elle se trouvait maintenant en pleine perdition. Des ecclésiastiques, de brillants officiers, des dames, un gouverneur des Trois-Rivières, M. de Louvigny, un intendant habile, M. de Chazel, venu pour remplacer M. Bégon, des soldats, des marins, des paysans se trouvent à bord. Mais que sont le rang, la puissance, la jeunesse, la beauté, l'habileté, la science, la force et le courage, devant le moindre des sauvages caprices de l'océan? Un simple soulèvement de sa vaste poitrine, a suffi pour précipiter corps et biens la frégate du roi au fond de l'abîme.
Chaque flot qui passait ainsi devant moi, avait sa lugubre histoire. L'un, engloutissait, la frégate anglaise, le Nassau; démâtait et dispersait la flotte de l'amiral Holburn. L'autre, roulait des cadavres inconnus, des épaves oubliées, des navires sans noms. Un troisième plus aristocratique, ne voulait servir de suaire qu'aux naufragés de l'Auguste. Il courait porter sur la grève désolée les dépouilles de messeigneurs de Varennes, de Portneuf, de la Verendrye, d'Espervenche, de la Corne de Saint-Luc, de Marolles, de Pécaudy de Contrecoeur, de Saint-Blin, de Villebond de Sourdis, de la Durantaye; et celles des nobles et puissantes dames de Saint Paul de Mezières, de Sourdis et de Senneville. A côté de ces noyés de haute lignée, flottaient épars les corps des grenadiers des régiments du Béarn et du Royal Roussillon, glorieux débris échappés aux batailles des plaines d'Abraham et de Sainte-Foye, pour servir de pâture aux requins du golfe Saint-Laurent, et blanchir de leurs os les rives désertes du Cap Breton.
Franchement, le cigare que je fumais ne me tournait pas les idées à une folle gaieté. J'en secouai les cendres sur le plat-bord et, le lançant à la mer, j'allais essayer de jeter avec lui l'étrange vision qui m'obsédait, lorsque j'aperçus le ravissant groupe des îles de la Madeleine. Le soleil était à son couchant, et les collines rouges qui bordent la grève, se détachaient admirablement sur le vert des prairies qui prenaient une teinte mordorée, sous les rayons solaires. Le steamer entrait dans l'Anse-à-la-cabane. En face de nous était le phare: et un peu à gauche, le village acadien éparpillé le long du demi-cercle formé par la crique. Tout autour du Napoléon III, des berges aux voiles peintes en rouge couraient chargées de poissons, et laissaient arriver sur la grève. On ferlait la toile: puis on démâtait; et tout aussitôt de robustes pêcheurs au teint hâlé, aux bras nus, faisaient la chaîne et jetaient la morue, le hareng, le homard aux femmes qui les ramassaient et les empilaient sur le rivage. Dessinez à l'extrémité de ce paysage une petite grotte, sombre, mystérieuse, qui montre aux poissons sa gueule béante: jetez un peu plus loin un rocher percé à jour, en ayant soin de laisser entrevoir à travers son arche les franges bleues de la mer, et vous aurez une marine de ces plus originales.
Bien d'autres voyageurs que nous ont été frappés par l'aspect poétique des îles de la Madeleine. L'un d'eux, le savant amiral Bayfield chargé d'en faire le relevé hydrographique, ne pouvait s'empêcher de consigner en ces termes, dans son "Pilote du Saint-Laurent," les impressions que lui avait causées l'approche de ce groupe:
—Par une journée chaude et ensoleillée, l'oeil ne peut se rassasier de contempler ces falaises multicolores, où le rouge est la couleur dominante, et où le jaune blafard des lagunes de sable fait antithèse au vert tendre des pâturages, au vert sombre des bois, au bleu saphir du ciel et de la mer. Ces contrastes produisent alors un effet extraordinaire, et contribuent à donner à cet archipel un cachet artistique, qu'on ne saurait retrouver aux autres îles du golfe Saint-Laurent. Par les jours de gros temps, lorsque le vent d'est fouette et fait rage, le paysage change, il est vrai; mais il n'en reste pas moins aussi caractéristique. Alors les pics isolés des îles, leurs falaises échiffées, se glissent, apparaissent confusément à travers la pluie, le brouillard, et semblent reliés entre eux par une ceinture de brisants qui masquent presqu'entièrement les bancs de sable et les lagunes. Garde à vous, matelots! n'approchez pas alors impunément de la Madeleine. En voulant la serrer de trop près, vous talonneriez, et vous seriez naufragés avant d'avoir pu même éventer le danger.
C'est ce qui arriva au Napoléon III, lors de sa croisière de 1875. En voulant lui faire prendre la passe du chenal de Sandy Hook, le capitaine Desprès—un brave et excellent marin, dont le nom reviendra plus d'une fois sous ma plume, dans le cours de ces récits—rasa de trop près un banc de sable qui change avec les années. Pris au talon dans sa course, le Napoléon III se mit à battre l'obstacle en brèche; mais une secousse de la vague dégageant son arrière, porta son milieu sur un bourrelet de sable. Cette nouvelle situation pouvait avoir pour le navire les plus fâcheuses conséquences. Ses deux extrémités cessant d'être soutenues, le steamer devait inévitablement fléchir et se casser. Sur l'ordre du capitaine la machine est renversée. Deux canots commandés par le lieutenant Leblanc sont mis à la mer, et font le tour du Napoléon III. À un quart d'encablure de nous, on annonce partout trois brasses de fond. Il devenait évident que nous étions saisis par le bout du banc de Sandy Hook, et déjà le brouillard se dissipant, nous laissait apercevoir la lumière rouge du phare de l'île d'Entrée. Une petite ancre de touée est alors portée à l'arrière. La vapeur est renversée de nouveau, et la manoeuvre conduite de manière à ce que nous puissions égrener l'extrémité du banc, en pivotant sur notre axe. Peine inutile; le cable de touée, mal soutenu, se prend dans l'hélice, se rompt, et bien que tout le monde fasse son devoir, le découragement s'empare de quelques-uns. Un conseil rassemblé à la hâte décide d'attendre la marée du lendemain: ce qui était plus facile à dire qu'à faire. La houle travaillait lourdement une de nos hanches, et c'était vraiment pitié, que d'entendre et de sentir sous ses pieds craquer cette puissante membrure. Mais ici-bas, il ne faut douter de rien: si l'Océan a souvent de folles colères, souvent il présente aussi des ressources inattendues. Une pièce de mer vient frapper le steamer par le travers, lui fait violemment prêter la bande et le force à se relever.
Tout tremblant sous ce terrible coup de bélier, le Napoléon III frémit depuis la quille jusqu'au mât de hune. Bientôt on sent le pont glisser sous nous.
—Le Napoléon III remue! s'écrie notre camarade Brault d'une voix formidable. Et cette exclamation partie du gaillard d'arrière arrive jusqu'aux vigies de beaupré.
—Vapeur en arrière! commande aussitôt le capitaine. Qu'une escouade d'hommes descende à fond de cale reporter sur bâbord, les colis et les objets pesants.
Brault et Agénor Gravel prennent aussitôt le commandement de ces caliers improvisés; dix minutes leur suffisent pour opérer ce branle-bas.
Les mécaniciens déploient encore plus de zèle, et à force de chauffer la machine, ils faillirent mettre le feu aux hunes et aux perroquets qui avaient été orientés de manière à profiter du vent de proue. Mais pendant que ces divers commandements s'exécutent, le malheureux steamer talonne et frappe plus que jamais. Sa membrure et ses courbes gémissent sous l'action frémissante de la lutte. La bande s'accentue de plus en plus à tribord, et déjà on recommence à désespérer du résultat, lorsqu'une vague énorme soulève le Napoléon III du lit de sable où il s'est tordu pendant cinq heures et dix minutes, et, sans secousse, le remet en eau profonde.
—C'est un singulier assemblage de force et de faiblesse qu'un navire, s'écriait, dans un moment semblable, l'amiral Julien de la Gravière; il dompte un ouragan et trébuche sur un grain de sable.
Notre vaillant steamer était de ceux qui se fient à la mine avenante et toute pastorale du groupe de la Madeleine. Il avait failli en payer la façon; et notre capitaine qui en était à son premier échouage, dut ce jour-là faire comme l'amiral Bruat, qui avait la réputation d'être le plus rude échoueur du monde. Il apprit par coeur, pour s'en servir au besoin, l'antique proverbe breton:
—Qui veut vivre vieux marin doit saluer les grains et arrondir les pointes.31
Note 31: (retour)Cet incident de voyage donna rumeur à une dépêche, que publiait le 11 septembre 1875, le Star de Montréal.
—A dispatch from Quebec, states that there has been a rumor for some days past, which was revived again yesterday, that the government steamer "Napoléon III," which left five weeks ago, on a cruise to the lighthouses of the gulf Saint-Lawrence, has foundered and all hands perished.
C'était un peu l'opinion de Leblanc qui, lui aussi pendant cette nuit terrible, avait négligé d'arrondir sa pointe, et s'était fait broyer un doigt par le bout de la patte de l'ancre. L'application d'un caustique énergique fut jugée nécessaire. Pendant qu'elle se faisait, de grosses sueurs froides perlaient du front du lieutenant; mais ses lèvres semblaient, par le plus narquois des sourires, défier les crispations de la chair.
—Ce n'est rien, disait-il, en désignant son doigt pantelant, auprès de l'effort qu'a dû faire cette nuit la bonne Sainte-Anne-du-Nord, pour soulever sur une de ses mains le Napoléon III en danger.
Rira qui voudra de cette pieuse naïveté. Pour moi, un marin canadien-français n'est guère complet sans cette foi robuste, et le mot de mon vieux Le Blanc nous fit venir des larmes aux yeux.
Par leur position, les îles de la Madeleine sont exposées aux coups de vent, et deux tempêtes sont restées célèbres dans les annales de l'archipel.
La première est celle du 23 août 1873. Elle dura trois jours sans désemparer, et surprit quatre-vingt-quatre navires ancrés dans la baie de Plaisance. Dès les premières rafales, quarante-huit d'entre eux se mirent de suite à chasser sur leurs ancres: dix allèrent s'ensabler sur la rive de la baie, et trente-huit firent côte dans le havre d'Amherst, où ils trouvèrent vingt-six de leurs camarades revenus au mouillage, pendant que dix seulement résistaient encore sur leurs fonds. Au milieu des péripéties de cet épouvantable ouragan, qui le croirait? on n'eut à déplorer que la mort de trois personnes. "Quelques-uns de ces malheureux navires, rapporte le commandant Lavoie, après avoir été ballottés de tous côtés et avoir perdu leurs ancres, allèrent se jeter sur le rocher à fleur d'eau qui est au pied de la côte des Demoiselles. La lame brisait à cet endroit à une hauteur de cent pieds! Sans Aimé Nadeau et James Cassidy qui virent venir à terre, la Diploma, l'Ellen Woodward et l'Emma Rich, les équipages de ces navires auraient certainement péri. Ces deux hommes courageux descendirent le cap, à l'aide d'une corde, et aidés du chien de terreneuve de Cassidy qui saisissait un à un les naufragés dans le ressac, ils purent opérer leur sauvetage, et arracher à une mort certaine trente et une personnes." L'année suivante, le 18 juin, une seconde tempête vint fondre sur l'archipel. Ces ravages ne furent pas aussi considérables que la première, et pendant les quatre jours qu'elle dura, elle ne put mettre à la côte que deux goélettes, et balayer la plupart des filets et des engins de pêche qui étaient à la mer.
Ce fut le 28 juin 1534 que Jacques-Cartier reconnut les îles de la Madeleine, que deux jours auparavant il avait prises pour la terre ferme. "Nous allâmes, dit-il, le long des dites terres environ dix lieues, jusqu'à un Cap de terre rouge qui est roide et coupé comme un roc, dans lequel on voit un entre-deux qui est vers le Nord, et est un pays fort bas, et y a aussi comme une petite plaine entre la mer et un étang, et de ce Cap de terre et étang jusques à un autre Cap qui paraissait, y a environ quatorze lieues, et la terre se fait en façon d'un demi-cercle tout environné de sablon comme une fosse, sur laquelle l'on voit des marais et étangs aussi loin que se peut étendre l'oeil. Et avant que d'arriver au premier Cap, l'on trouve deux petites îles assez près de terre. A cinq lieues du second Cap il y a une île vers Surouest qui est très haute et pointue, laquelle fut nommée Alezay, et le premier Cap fut appelé de Saint-Pierre, parce que nous y arrivâmes au jour et fête du dit saint".
Plus tard, en mentionnant ce groupe, Champlain frappé sans doute par l'aspect singulier qu'offraient ces îles reliées entre elles par d'immenses lisières de sable, les désigne sous le nom de "Ramées-Brion." Au temps de Denys—en 1672—elles ne s'appelaient plus que les îles de la Madeleine; et alors comme à présent, le seul souvenir gardé par les marins oublieux au temps où Champlain croisait dans ces parages, était le nom de l'île Aubert, que de nos jours les Anglais appellent Amherst Island, nom que les habitants français du groupe se refusent à reconnaître.
Denys assure, dans sa description de l'Amérique septentrionale, qu'il chassa plusieurs fois les Anglais de la Madeleine, "les Français étant en possession de ces lieux-là de temps immémorial." Néanmoins, la plus ancienne concession de cet archipel remonte à la date du 16 janvier 1663; et eu feuilletant le deuxième volume de mémoires des commissaires du Roy, je vois que ce jour-là, un acte a été passé au bureau de la compagnie de la Nouvelle-France, donnant en pleine propriété au sieur Doublet, capitaine de navire, l'île Saint-Jean,—aujourd'hui l'île du Prince Edouard—les îles des Oiseaux et celles de Brion, toutes sises dans le golfe Saint-Laurent. Cette concession était faite au capitaine normand "à condition de n'exercer aucune traite ou négoce avec les sauvages". Doublet embarqua sur deux navires tout ce qui pouvait servir à la nouvelle colonie; mais en jetant l'ancre à l'île Percée, on lui apprit que la compagnie de la Nouvelle-France avait outre-passé ses droits, et que le sieur Denys, "gouverneur-lieutenant général pour le Roy et propriétaire de toutes les terres et isles qui sont depuis le cap de Campseaux jusqu'au cap des Roziers", était depuis dix ans en possession du groupe de la Madeleine. Le capitaine Doublet ne se découragea pas pour si peu. Faisant voile vers ces îles, il y débarqua ses pécheurs basques et normands, et pendant deux ans y dirigea, en compagnie de son intendant M. Brevedent, l'exploitation de la pêche; mais le succès ne répondant pas à ses efforts, la colonie se dispersa.
Que devinrent ces immenses possessions entre les mains de ses héritiers? L'histoire ne le dit pas. Ce que l'on sait, c'est que le 18 août 17l7, le sieur Duchesnay, tout en demandant au Roy le titre de grand-maître des eaux et forêts, priait Sa Majesté de lui accorder la concession de ces îles, et qu'en 1719, le comte de Saint-Pierre, premier écuyer de la duchesse d'Orléans, formait une compagnie pour exploiter les îles de Saint-Jean, de Miscou et de la Madeleine. "C'était, dit Garneau, à l'époque du fameux système de Law, et il était plus facile de trouver les fonds que de leur conserver la valeur factice que l'engouement des spéculateurs y avait momentanément attachée. Malheureusement, l'intérêt qui avait réuni les associés de la compagnie Saint-Pierre, les divisa; tous les intéressés voulurent avoir part à la régie, et peu d'entre eux avaient l'expérience de ces entreprises. On ne doit pas en conséquence être surpris si tout échoua. L'île tomba dans l'oubli, d'où on l'avait momentanément tirée, jusque vers 1749, époque où les Acadiens fuyant le joug anglais, commencèrent à s'y établir."
Pendant quelques années, ces malheureux proscrits y vécurent sans être molestés; mais un jour, le hasard voulut qu'une frégate anglaise vînt reconnaître l'archipel de la Madeleine. Elle portait à son bord le nouveau gouverneur du Canada, lord Dorchester, et était commandée par le capitaine Sir Isaac Coffin, qu'on n'avait pas encore jugé à propos de mettre à la porte de la marine royale32, pour le réhabiliter plus tard, en lui donnant le titre de baronnet et le grade d'amiral. Ce jour-là, le temps était clair, le ciel serein; un soleil chaud et bienfaisant enveloppait de ses effluves les côtes et les pics empourprés de ces îles. Toutes les lunettes de la frégate étaient braquées sur ce paradis terrestre; celle de Sir Isaac plus encore que les autres. Quand elle eut scruté l'horizon, et fouillé à l'aise l'archipel qu'on longeait en ce moment, l'officier anglais la déposa gravement sur son banc de quart, et se tournant vers lord Dorchester, le supplia de lui concéder les îles qui gisaient devant lui. Comment refuser quelque chose à un capitaine de frégate, qui n'a cessé de combler pendant toute une longue traversée, ses hôtes distingués de soins, de grogs et de confort? Le nouveau potentat promit de faire droit à la requête de Sir Isaac; et le 31 juillet 1787, il la lui adressait officiellement. Mais comme l'oubli est commensal de haut lieu, et hante fréquemment le cabinet des gouverneurs et des ministres, ce fut son successeur Robert Prescott qui fit droit à la demande du capitaine Coffin. Onze ans après, le 24 août 1798 "l'île à la Madeleine, l'île de l'Entrée, l'île du Corps Mort, Shag Island, l'île de Brion et l'île aux Oiseaux furent concédées à perpétuité, en franc et commun soccage, à titre de féauté à Sir Isaac Coffin et à ses hoirs et ayant causes". Ce royal cadeau leur était fait à la condition, que la partie de l'île de la Madeleine, comprenant la pointe nord-est et Old Harry's Point serait réservée pour le soutien et l'entretien d'un clergé protestant dans la province de Québec; et si d'un côté, le gouvernement britannique gardait le droit d'exploiter les mines, d'ouvrir des chemins et de construire des fortifications, d'un autre côté Sir Isaac Coffin s'obligeait, "sous peine de nullité, de permettre la libre entrée et sortie de ses îles aux sujets anglais qui désiraient venir y pêcher, et s'engageait à leur laisser abattre et emporter le bois nécessaire à leur chauffage et à l'exploitation avantageuse de leurs pêcheries."
Note 32: (retour)In 1773, Isaac Coffin was taken to sea by lieutenant Hunter of the Gaspé, at the recommendation of Admiral John Montague. His commander officer said he never knew any young men to acquire so much nautical knowledge in so short a time. After reaching the grade of post-captain, Coffin for a breach of the regulation of the service, was deprived of his vessel, and Earl Howe struck his name from the list of post-captains. This act being illegal, he was reinstated in 1790. In 1804, he was made a baronet, and in 1814 became a full admiral in the British navy.
Drake—Nooks and corners of New England coast p. 342.
Peu soucieux des droits des premiers colons, le gouvernement anglais venait de commettre un acte d'irréparable injustice. Il frappait à mort le développement et l'avenir de ce ravissant archipel, que le matelot appelle dans son langage pittoresque, le Royaume du Poisson. Aussi, depuis cette fatale date du 24 août 1798, les habitante de la Madeleine, sachant qu'ils ne peuvent posséder leurs terres, ne se livrent qu'au travail nécessaire pour les faire vivre, et ne connaissent que par oui-dire les jouissances de la propriété et l'amour du sol.
Un aussi triste état de choses devait finir par émouvoir le gouvernement de la province de Québec. Soixante-seize ans après la concession de ces îles, un bureau fut chargé par le parlement, de s'enquérir de la tenure des terres de l'archipel. Cinquante-deux habitants de la Madeleine s'empressèrent de répondre à la série de questions imprimées que l'on avait fait distribuer à la population. Les uns demeuraient dans l'archipel depuis vingt-cinq, trente-cinq et quarante-cinq ans; d'autres depuis cinquante, cinquante-trois et soixante ans. Un seul, M. Jean Nelson Arseneau, y était né; et le doyen des résidents se trouvait être M. Bruno Terriau, qui habitait ce groupe depuis soixante-seize ans. Tous déclaraient qu'ils occupaient des lots comme locataires, en vertu de baux emphytéotiques, et leurs réponses portaient à la connaissance du gouvernement de curieuses révélations.
Ainsi, quelques colons avaient des billets de simple location qui leur donnaient droit d'obtenir un bail du propriétaire, tandis que d'autres avaient un bail de quatre-vingt-dix neuf ans. Ceux qui étaient porteurs d'un bail de cinquante-deux ans, pouvaient le faire durer; et les détenteurs d'un bail de dix ans étaient en droit d'exiger un bail perpétuel du propriétaire. Ce dernier mode semble ne plaire que médiocrement aux agents de l'amiral Coffin. Chacun s'accorde à dire qu'il tend à disparaître peu à peu: car chaque fois que l'occasion s'en présente, ces employés échangent contre d'autres les baux de dix ans.
Généralement, ces contrats de louage renferment des clauses qui permettent au seigneur de l'archipel de reprendre ses terres, de jouir de leur amélioration, et de s'emparer sans remboursement, des bâtiments et de la maison du locataire, si par malheur ce dernier n'a pu exécuter les clauses de son bail. C'est ainsi que deux des descendants des plus anciens pionniers des îles de la Madeleine, Louis Boudraut et François Lapierre, furent obligés—après bien des années de travaux et de privations—d'abandonner à l'amiral Coffin la terre où avaient vécu leurs ancêtres, et que leurs enfants avaient améliorée de leur mieux. C'est ainsi que Fabien Lapierre faillit être dépouillé de tout son avoir. Cet homme s'étant décidé à partir, en 1863, pour explorer la côte nord du Labrador, avait laissé une terre qu'il occupait depuis vingt-cinq ans, aux soins de deux de ses compatriotes, Basile Cormier et Emile Morin. Ils devaient en jouir à la condition de l'entretenir, de payer la rente et de la lui remettre lors de son retour. Pendant la première année tout alla pour le mieux. L'agent avait consenti à recevoir la redevance des deux mandataires de Lapierre: mais dès le commencement de la deuxième année, il refusa leur argent, prit possession de la terre, en faucha le foin, ouvrit de force la maison de l'absent, y mit sa récolte, qu'il n'emporta qu'en hiver, puis vendit le tout, terre et dépendances à Désiré Giasson. L'année suivante, Lapierre revint et réclama. En réponse, l'agent de l'amiral Coffin le menaça de l'empêcher de couper du bois, et lui fit dire que s'il continuait à se plaindre, il le ferait chasser du pays. A force de supplications, ce pauvre homme aidé par les conseils de son curé, l'abbé Boudreault, finit par recouvrer la moitié de sa terre, à la condition toutefois de consentir à un nouveau bail qui l'obligeait à payer annuellement un schelling par arpent.
Quant à l'autre moitié de son bien, elle était restée, et est encore en la possession de l'acheteur Giasson qui s'en était légalement emparé moyennant la somme de cinq louis 33. On comprend le malaise que pareil régime doit faire peser sur l'archipel; et quelques-uns des habitants secouant leur torpeur, allèrent jusqu'à contester devant la cour de circuit de la Madeleine la validité des titres de l'amiral Coffin. Les uns plaidaient prescription. D'autres alléguaient l'illégalité des baux et leur tenure onéreuse, contraire à la colonisation et au progrès des îles. Les plus philosophes racontaient, que pendant près d'un siècle leurs aïeux avaient cultivé en pleine propriété ces mêmes terres, que leurs descendants et leurs héritiers légitimes n'occupaient plus que comme simples locataires; tandis que les plus normands assuraient, qu'on avait dû consulter les ancêtres, et que ces derniers n'avaient jamais consenti de titre à l'amiral Coffin. Toutes ces réclamations ne servirent à rien. La cour décida en faveur du propriétaire; et comme il arrive presque toujours, les plaideurs qui avaient peut-être une chance en appelant de ce jugement, ne purent faute de moyens pécuniaires, s'adresser à un tribunal plus élevé. Les choses reprirent donc leur Cours.
Note 33: (retour) L'imagination n'entre pour rien dans ces récits. Je ne fais qu'analyser, les réponses aux questions posées par le comité chargé de s'enquérir de la tenure des terres dans les îles de la Madeleine—1874—Vide p. 26 et 27.
L'apathie et le découragement régnèrent alors en suzerains sur ces îles, qui n'attendent que l'avènement d'un nouveau régime, pour devenir un grenier d'abondance, un entrepôt de richesse. Les locataires continuèrent à payer les contributions locales et scolaires, pendant que leur seigneur et maître percevait rigoureusement les rentes annuelles de ses terres; rentes exorbitantes, lorsqu'on les compare à celles des terres en ce pays. Néanmoins, au milieu de ce sourd mécontentement, quelques anciens colons trouvent le moyen d'être satisfaits de leur position. Plusieurs d'entre eux ont cent acres en état de culture, pour lesquels ils ne payent annuellement que quinze shillings, ou un quintal de morue. Ce sont les rois de l'archipel ceux-là, et ils font bien des envieux autour d'eux; car, un jeune colon qui désirerait louer la même étendue de terre inculte et déboisée, serait obligé de donner vingt piastres chaque année. En remplissant cette condition, ce dernier devient alors locataire. Pendant quelque temps la jeunesse, l'ambition, l'amour du travail décupleront ses forces. Sous le soc de sa charrue, ces landes désertes deviendront des champs fertiles. La pêche viendra combler son déficit. Il pourra vivre convenablement et sera heureux autant que peut l'être un locataire. Mais viennent les mauvais jours; que la rente soit en retard; alors arrivent les menaces de l'agent. Le démon de l'expropriation plane sur la petite propriété; et il ne reste plus au malheureux travailleur, que l'exil ou la servitude.
Il ne faut pas s'étonner, si presque toute cette population qui, ailleurs, serait entreprenante et riche, demeure ici dans le demi-sommeil et dans la pauvreté. Les étrangers fuient ce nid de féodalité, et un négociant américain venu il y a quelques années visiter l'archipel, dans le but d'y fonder un établissement de pêche, de la valeur de $80,000, s'en retourna dégoûté, disant à qui voulait l'écouter:
—Mon père a fui l'Irlande pour ne plus entendre parler du vieux régime emphytéotique. Ce ne sera pas son fils qui remettra un pareil gouffre sur le chemin de ses petits enfants.
Ces vexations ont eu pour résultat d'établir un fort courant migrateur entre le Labrador et l'archipel. Plus de trois cents chefs de famille ont quitté les îles et sont allés fonder à Kékaska, à Natashquouan, à la Pointe-aux-Esquimaux, d'importants groupes de la race française. Ces départs ont affaibli d'autant la population des îles de la Madeleine. Tous les ans, grand nombre de compatriotes viennent à leur tour rejoindre ceux qui sont partis; et déjà l'on prévoit dans un avenir assez rapproché la désertion complète de l'archipel. Pour remédier à ce triste état de choses, il n'y a qu'un moyen à prendre. Tous ceux qui ont été consultés par la commission parlementaire sont unanimes à le suggérer. Le gouvernement de Québec doit acheter les droits du propriétaire, et l'un des colons les plus respectés de l'archipel, M. Painchaud, n'hésite pas à affirmer que sous ce nouveau régime, un huitième des habitants paierait de suite, et affranchirait aussitôt les terres de toutes redevances seigneuriales.
Mais cette longue digression, nécessaire pour bien faire comprendre la position anormale de ces insulaires, me fait oublier les quelques heures charmantes que nous devions passer au petit village acadien de l'Anse-à-la-Cabane. Le premier compatriote qui nous y accueillit à bras ouverts, fut un brave charpentier du nom de Migneault. Dans sa joie, il voulut nous faire connaître de suite le patriarche de l'endroit, et nous conduisit à la maison de M. Vigneault. Ce dernier était un beau vieillard, âgé de quatre-vingt-dix ans. Il virait au milieu de sa famille. Ses deux fils étaient venus se bâtir de chaque côté du toit paternel; et pendant de longues années, tous ensemble, ils avaient savouré la douce vérité du commandement du Seigneur:
—Père et mère tu honoreras afin de vivre longuement.
Un voile de tristesse devait pourtant tomber, un jour, sur ce bonheur terrestre. Le soir où nous le vîmes pour la première fois, le père Vigneault avait perdu sa franche gaieté. Il était pensif. Ses yeux rougis par les larmes plutôt que par l'âge, erraient douloureusement sur le havre; et à travers la fenêtre, ils suivaient anxieusement les manoeuvres d'une petite goëlette qui venait d'appareiller, et qui finit par disparaître dans les demi-teintes du crépuscule. Hélas! son fils Désiré était à bord. En compagnie de douze familles acadiennes, il s'en allait demander au sol des Sept-Iles ces plaisirs inconnus de la propriété, qu'il troquait contre les douces joies de la maison paternelle.
M. Vigneault était né à Saint-Pierre de Miquelon, où son père était arrivé, Dieu sait comment, après avoir fait partie de cette malheureuse colonie acadienne qui, lors de sa cruelle dispersion par les Anglais, vit ses rejetons éparpillés aux quatre vents des cieux. Plus tard, il était venu aux îles de la Madeleine, où à force de travail et d'intelligence il s'était créé une aisance relative. Son âge, sa longue expérience, son esprit ferme et lucide, ses bonnes manières, lui conciliaient le respect et la confiance de tout le monde. Ici, les décisions du père Vigneault étaient respectées à l'égal de celles que donnent ailleurs le juge ou le curé.
Ce fut dans son hospitalière maison que mon oreille fut frappée pour la première fois par l'intonation que les Acadiens donnent à la langue française. Un étranger qui se mêlerait à leur conversation, se croirait transporté en Gascogne, et se figurerait entendre causer des Bordelais. Ainsi, ces braves gens diront une foâ pour une fois. Le mot année se prononcera chez eux ânée, tout comme sur les bords de la Garonne. Un cheval devient un gueval au pluriel, et un chevau au singulier; puis, ils font un assez grand abus des "j'étions," des "je pourrions," et des "je pensions".34 Leurs moeurs sont simples et douces. Ils vivent surtout de pêche, et s'occupent quelque peu d'agriculture. Comme caboteurs, ils n'ont pas leurs maîtres au monde, et ils peuvent donner des points aux plus habiles chasseurs et aux plus patients pêcheurs. L'un des habitants de l'île, M. Fox, interrogé sur les particularités distinctives du caractère acadien, répondait à la commission parlementaire:
—Le caractère particulier du peuple acadien est de vivre sur mer.
Note 34: (retour)Dans une notice sur le patois saintongais que vient de publier la "Revue des langues Romanes" de Montpellier, je trouve ce curieux passage:
"Les noms qui, en français, se terminent en al, font au en saintongais, pour ces deux nombres: le chevau, l'animau, in jôrnau. (Ancien français; li chevaus (sujet du verbe); le cheval (régime) pluriel li cheval (sujet), les chevaux (régime).)
"Quelques paysans de la Saintonge pour faire les muscadins disent aussi, dés cheval, dés journal.
"On connaît la leçon de beau langage donnée par un paysan à son fils qui revient de la ville—"Qu'as-tu vut de jolit, drole?—P'pa j'ai vui dés chevau superbes.—Dis donc cheval, animau.
Grand nombre de Canadiens et d'Acadiens tirent leur origine du pays d'Annis et de la Saintonge, cette terre aimée, qui a vu naître Samuel de Champlain.
Ces mots, sont à eux seuls une définition.
Dès le petit jour, quand la saison de pêche est venue, vous voyez l'Acadien faire sa prière, mettre gaiement sa berge en mer, gagner les fonds à morue qui se trouvent à trois, quatre et quelque fois à six milles au large. Là, il ne cesse d'agiter sa ligne à l'eau, de la retirer, de la bouetter, et de la reconfier aux profondeurs de la mer, jusqu'à ce que son embarcation soit pleine de poissons. Alors les voiles se hissent. On regagne la grève. Quelques quarts-d'heure suffisent pour trancher la morue que l'on vient de capturer; puis on remâte la berge, elle glisse de nouveau vers son poste de pêche, et on réussit ainsi à faire quelquefois trois ou quatre voyages par jour. Pendant tout ce temps, un morceau de galette, un biscuit ou une miche de pain—quand il y en a—suffit pour entretenir la vie de ce robuste pêcheur. L'Acadien est l'homme le plus frugal que je connaisse; il se contente, au milieu de tous ces pénibles travaux, d'une nourriture que dédaigneraient la plupart des mendiants de nos villes.
La pèche de la morue, avec celle du hareng et du maquereau, constituent les apports de la campagne d'été. Quant à celle d'hiver, elle se fait pendant les mois de mars, avril et mai. Alors commence la chasse au loup-marin. Divisés par groupes de six ou dix hommes, vous voyez les Acadiens armés de cordes et de bâtons, prendre le pas gymnastique, et franchir en courant des distances de dix à douze milles, avant d'arriver sur le terrain de chasse. Pour y parvenir, il a fallu sauter par-dessus les crevasses et les profondes fissures des champs de glace, ou prendre la banquise par escalade. Mais qu'est-ce que tous ces dangers, au prix des plaisirs que va leur donner la chasse qui les attend? Les loups marins ne sont-ils pas là, derrière cette muraille glacée, qui se prélassent en famille? Et comme une trombe, les Acadiens arrivent sur les malheureux phoques qui ne se doutent de rien. Le massacre commence, au milieu des cris et des gémissements. Quand chacun a sa part de butin, les chasseurs reprennent la route du village, traînant leur proie derrière eux; et ils sont prêts à recommencer leurs courses, tant que durent le jour et la bonne chance.
Né sur les bords de la mer, habitué à ses caprices, à ses caresses et à ses colères, le peuple acadien voit en elle son véritable domaine. Eté comme hiver, il ne cesse de se confier, à elle. La mer, fidèle à cette longue amitié, ne cesse à son tour, de les combler de ses inépuisables générosités.
Nous venions de ravitailler l'Anse-à-la-Cabane, et comme la nuit était survenue, il nous y fallut attendre le jour, pour débarquer plus commodément les provisions destinées au phare de l'Entrée. Au soleil levant, nous étions déjà embossés par le travers de cette île, dont les pics escarpés ont cette couleur rougeâtre particulière au groupe de la Madeleine; et bientôt, les uns étaient à même de fouler ces gazons plantureux, où ruminait une magnifique race de moutons, pendant que ceux qui étaient restés à bord, s'amusaient à contempler le paysage. Sur notre avant se dessinait le petit village d'Amherst, groupé autour de son église. A tribord, on apercevait le Havre-aux-Maisons; et tout autour de nous croisait une flotte de quatre cents goélettes, qui couraient le maquereau, toutes voiles dehors. Certes, Gudin n'aurait pu demander une marine plus pittoresque, pour la fixer sur une de ses toiles immortelles.
De l'île d'Entrée nous devions nous rendre à l'île de la Pierre Meulière35. Nous profitâmes de ce point d'arrêt pour nous faire débarquer au petit quai de la maison Leslie, qui tient là un magasin d'approvisionnement assez considérable. La foule encombrait ce comptoir, et rien d'amusant comme d'entendre ses colloques avec les commis de M. Leslie. C'était à qui se montrerait le plus normand en affaires. Les femmes braillaient surtout dans cette lutte pacifique. Tout en suivant de près leurs petites transactions, elles ne perdaient pas une maille du tricot qu'elles traînent ici, partout où elles vont. Modestes, intelligentes, pieuses, dévouées, les Acadiennes sont vraiment dignes du nom de femmes. Elles n'appartiennent guère à cette catégorie du sexe qui faisait dire à Buchamore—un type réussi de vieux grognard, inventé par Alfred Assollant:
—"Je n'aime pas ces demoiselles qui ne savent rien faire que se peigner tout le jour, se regarder dans une glace, essayer des robes, faire des grimaces, mettre des gants et parler du bout des lèvres comme si l'on n'était pas digne de les entendre, ou d'une voix tantôt plus flutée que celle des serins et tantôt plus aigre que celle des pie-grièches. Ça, c'est des bécasses, comme disait mon vieux curé. Ça ne sait pas travailler, ça ne sait pas s'occuper, ça ne sait pas penser, ça ne sait que faire de ses dix doigts. Quand c'est riche, ça ennuie son mari et ses enfants. Quand ça n'a pas d'argent, ça ne trouve pas de mari, où si ça en trouve, ça grogne, ça se fâche, ça ennuie tout le monde, et tout le monde s'en va."
Note 35: (retour) Les Anglais la nomment Grindstone Island.
Au milieu de la cohue qui encombrait la maison Leslie se trouvait, un vieillard, né à Saint Roch de Québec, et qui habitait l'île de la Pierre Meulière depuis soixante-sept ans. Il s'appelait M. Thorn, et avait laissé au pays un frère, dont il était sans nouvelles depuis fort longtemps. Pendant que nous causions ainsi des absents, notre ingénieur, M. Barbour, vint nous prévenir qu'il allait visiter le phare du Grand Etang du Nord. Je devais l'accompagner, mais nous ne pûmes trouver de voitures, et je regrette encore aujourd'hui la perte de la seule occasion qu'il m'ait été donné de pouvoir étudier, et observer les moeurs de ces campagnes, où vit, travaille, et meurt une des populations les plus honnêtes de la terre.
On m'apprit ici que l'archipel de la Madeleine se compose d'écueils, et qu'à part de Brion et du Rocher-aux-Oiseaux, il compte six îles qui se nomment le Corps-Mort, Amherst ou l'île Aubert, la Pierre-Meulière, l'île d'Entrée, Allright et la Grosse Ile. Ces groupes présentent ensemble une superficie d'à peu près 55,400 acres qui, suivant le recensement de 1871, est habitée par une population de 3,172, dont 2,883 Acadiens. Les récifs les plus à craindre sont—au dire des pêcheurs—ceux de la Pierre du gros Cap, de la Perle, d'Allright, du Cheval Blanc, les bancs de Colombine et l'écueil de Doyle. Ce dernier n'a que trois encablures de long sur une demie de largeur, et c'est là, m'assure-t-on, que des navires courant sous la brise ont soudainement disparu aux yeux de plusieurs de mes interlocuteurs. Quant aux courants, ils sont tellement irréguliers, qu'on me fit la même réponse donnée jadis à l'amiral Bayfield, et que personne ne put me dire précisément leur vitesse et leur direction.
A ces renseignements géographiques et hydrographiques venaient se mêler les plaintes et les confidences d'un chacun. Tous regrettaient le déboisement des îles. Privées de bois de construction, elles sont maintenant en train de voir disparaître leur maigre bois de chauffage. Chacun avouait que son voisin se tirait d'affaire comme il le pouvait, faisant feu de tout, et détruisant la forêt sans discernement. Quelques uns même finissaient leurs doléances, en prophétisant que dans vingt ans il n'y aurait plus une seule broussaille sur l'archipel, et qu'alors on serait obligé de faire venir à grands frais du charbon de terre de la Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton. Puis, la grande question du chauffage épuisée, arrivaient les observations générales. Celui-ci désirerait voir inaugurer une meilleure tenure de terre dans les îles; celui-là aurait aimé que le propriétaire protégeât plus efficacement son locataire; un troisième se plaignait amèrement d'être sans nouvelles depuis le mois de novembre jusqu'au quinze de mai, et plus longtemps encore.
—Si au moins, disait-il en secouant tristement sa pipe, nous avions des communications télégraphiques avec la terre ferme?
—Bah! des moulins à farine et des moulins à étoffes sont encore plus nécessaires que ton télégraphe, répliquait dans un coin, un pécheur, plus positif que ce rêveur. A ta place je m'en contenterais.
—La belle affaire que tes moulins! pour les construire il faudrait peut-être se faire taxer, et je m'en tiens à ce que me font payer les commissaires d'écoles; un par cent, et quelquefois un et demi.
—Encore si le propriétaire nous montrait l'exemple, et payait comme nous, répliquait le pêcheur positif.
—Pas si-bête, Evé. Il se tient au courant des nouvelles, et lit ses journaux dans son hôtel de Londres, pendant que pour rencontrer notre taxe municipale, nous donnons nos deux jours de travail sur les chemins publics, ou que nous payons quatre-vingts cents par jour pour chaque chef de famille.
Une fois sur la taxe, les conversations menaçaient d'aller loin, lorsque l'ingénieur, M. Barbour, fit son apparition au milieu du groupe. Il était temps de se rembarquer. Nous sortîmes du magasin Leslie, pendant que tout le monde se découvrait sur notre passage; et une chaude poignée de main nous sépara pour la vie de ces braves gens.
Le Napoléon III était déjà sous vapeur. Comme le temps était splendide et que la besogne avait été promptement expédiée, le capitaine, mis en belle humeur par ces bonnes choses, voulut nous permettre d'aller reconnaître le fameux rocher du Corps-Mort, qu'au mois de septembre 1804, Moore a chanté dans ses plus beaux vers. Nous prîmes donc par la passe de Sandy Hook, et en contournant l'île d'Amherst, nous ne pûmes nous empêcher d'admirer la beauté du paysage qui défilait sous nos yeux; et de nous demander pourquoi ces ravissants endroits n'étaient pas plus fréquentés par les touristes. Comme place d'eau, si les îles de la Madeleine n'avaient pas à lutter contre l'île du Prince-Edouard, elles seraient sans rivales dans le golfe Saint-Laurent. Les points de vues y sont superbes; le gibier y abonde, et elles réservent à l'amateur, en quête de poissons, d'inépuisables éditions de la pêche miraculeuse, qu'il peut renouveler à loisir dans les baies et des havres admirablement disposés pour les courses de yacht et le sport maritime.
Pendant que nous causions de toutes ces merveilles ignorées, le Corps-Mort se dessina par le travers de notre hanche de tribord. Vraiment, le langage populaire lui avait bien donné le seul nom qu'il pût porter; car, vu de cette distance, il ressemblait à s'y méprendre au cadavre d'un matelot flottant au gré des vagues. Involontairement je me rappelai alors l'Ile des Morts, ces belles strophes qu'un de nos bons poëtes canadiens, James Donelley, avait imitées de Thomas Moore: 36.
See you, beneath you cloud so dark,
Fast gliding along, a gloomy bark?
Her sails are full, though the wind is still,
And there blows not a breath her sails to fill!
Oh! what doth that vessel of darkness bear?
The silent calm of the grave is there,
Save now and again a death-knell rung,
And the flap of the sails with night-fog hung?
There lieth a wreck on the dismal shore
Of cold and pitiless Labrador;
Where, under the moon, upon mounts of frost,
Full many a mariner's bones are tost!
You shadowy bark hath been to that wreck,
And the dim blue fire, that lights her deck,
Doth play on as pale and livid a crew
As ever yet drank the church-yard dew!
To Dead-man's Isle, in the eye of the blast,
To Dead-man's Isle she speeds her fast,
By skeleton shapes her sails are furl'd,
And the hand that steers is not of this world!
Oh! hurry thee on—oh! hurry thee on,
Thou terrible bark! ere the night be gone;
Nor let morning look on so foul a sight
As would blanch for ever her rosy light!
Note 36: (retour) Voilà les vers de Moore. Ils sont intitulés: "Written on passing Dead-man's island, in the Gulf of Saint Lawrence, late in the evening, September, 1804".
Ami, vois-tu là-bas, sous ce nuage sombre,
Cet étrange vaisseau qui s'avance dans l'ombre,
Et qu'un souffle inconnu fait bondir sur tes eaux?
D'un vent mystérieux ses voiles semblent pleines!
Et pourtant les zéphirs retiennent leurs baleines:
Dans un calme profond au loin dorment les flots.
Qu'a-t-il donc à son bord ce vaisseau des ténèbres?
Il porte du tombeau tous les signes funèbres;
Un silence de mort sur les ondes le suit.
Seul un glas triste et lent parfois s'y fait entendre,
Avec un battement des voiles que fait pendre
L'humide pesanteur des brumes de la nuit.
Au milieu des rochers de la stérile plage
Gisent des os blanchis, jetés par le naufrage,
Sous les brouillards épais du sombre Labrador.
La lune, en éclairant ces lieux impitoyables,
Découvre avec horreur ces restes lamentables,
Que les flots irrités se disputent encore.
C'est là que cette barque en sa course nocturne
Va cueillir en passant la troupe taciturne
Qui semble maintenant à son bord se mouvoir.
Une flamme bleuâtre à demi les éclaire,
Et jamais la rosée, au morne cimetière,
Ne tomba sur des fronts plus livides à voir.
C'est à l'Ile-des-Morts qu'un vent fatal les guide!
C'est-à-l'Ile-des-Morts que s'avance rapide
Cette ombre de vaisseau par des ombres conduit
Des squelettes sont là, déroulant à la brise
La sinistre voilure; une forme indécise
Debout veille à la poupe, et la barque obéit!
Fuis, Ô barque terrible! ô barque de mystère!
Fuyez pendant que l'ombre enveloppe la terre.
Fantômes de la nuit, rentrez vite au cercueil,
De peur qu'à votre aspect la jeune et tendre aurore
Ne dépouille son front de l'éclat qui le dore,
Et se cache à jamais sous un voile de deuil.
Quel contraste entre le Napoléon III et ce vaisseau fantôme que venait de faire surgir, à la vue du Corps Mort, la puissante imagination du poète. Son taille-mer fermement posé sur la vague, ses tuyaux, ses vergues et son pont inondés par les feux du soleil couchant, notre steamer venait de jeter en poupe l'île des Morts, et la proue tournée vers la Nouvelle-Écosse, il courait rapide vers Pictou, où nous allions oublier pour quelques jours ces âcres parfums de la mer que nous venions de humer, les paysages et les bonnes gens que nous venions de voir, pour respirer la poussière des villes et goûter aux fades douceurs de la civilisation.
FIN
TABLE DES MATIÈRES
I.—En descendant le fleuve.
II.—L'Expédition de l'amiral Walker.
III.—Au milieu du golfe.
IV.—L'Ile d'Anticosti.
V.—L'Archipel de la Madeleine.
End of the Project Gutenberg EBook of Les îles
by Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES ÎLES ***
***** This file should be named 14828-h.htm or 14828-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
https://www.gutenberg.org/1/4/8/2/14828/
Produced by Wallace McLean, Renald Levesque and the Online Distributed
Proofreading Team. This file was produced from images generously
made available by the Canadian Institute for Historical
Microreproductions.
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
https://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.