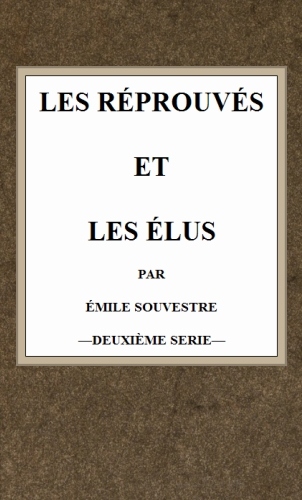
The Project Gutenberg EBook of Les réprouvés et les élus, by Émile Souvestre This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Les réprouvés et les élus (t.2) Author: Émile Souvestre Release Date: April 25, 2013 [EBook #42594] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES RÉPROUVÉS ET LES ÉLUS *** Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
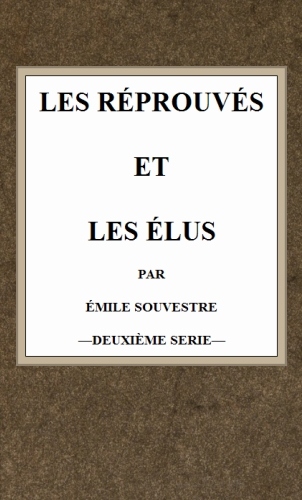
COLLECTION MICHEL LÉVY
ŒUVRES COMPLÈTES
D’ÉMILE SOUVESTRE
| Format grand in-18 | |
| ——— | |
| AU BORD DU LAC | 1 vol. |
| AU COIN DU FEU | 1 — |
| CHRONIQUES DE LA MER | 1 — |
| CONFESSIONS D’UN OUVRIER | 1 — |
| DANS LA PRAIRIE | 1 — |
| EN QUARANTAINE | 1 — |
| HISTOIRES D’AUTREFOIS | 1 — |
| LE FOYER BRETON | 2 — |
| LES CLAIRIÈRES | 1 — |
| LES DERNIERS BRETONS | 2 — |
| LES DERNIERS PAYSANS | 1 — |
| DEUX MISÈRES | 1 — |
| CONTES ET NOUVELLES | 1 — |
| PENDANT LA MOISSON | 1 — |
| SCÈNES DE LA CHOUANNERIE | 1 — |
| SCÈNES DE LA VIE INTIME | 1 — |
| SOUS LES FILETS | 1 — |
| SOUS LA TONNELLE | 1 — |
| UN PHILOSOPHE SOUS LES TOITS | 1 — |
| EN FAMILLE | 1 — |
| RÉCITS ET SOUVENIRS | 1 — |
| SUR LA PELOUSE | 1 — |
| LES SOIRÉES DE MEUDON | 1 — |
| SOUVENIRS D’UN VIEILLARD | 1 — |
| SCÈNES ET RÉCITS DES ALPES | 1 — |
| LA GOUTTE D’EAU | 1 — |
| LES RÉPROUVÉS-ET LES ÉLUS | 2 — |
| LES PÉCHÉS DE JEUNESSE | 1 — |
| LES ANGES DU FOYER | 1 — |
| RICHE ET PAUVRE | 1 — |
| L’ÉCHELLE DE FEMMES | 1 — |
| PIERRE ET JEAN | 1 — |
| LES DRAMES PARISIENS | 1 — |
| DEUX MISÈRES | 1 — |
| POISSY.—Typographie ARBIEU. |
PAR
ÉMILE SOUVESTRE
—DEUXIÈME SERIE—
PARIS
MICHEL LEVY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE VIVIENNE, 2 BIS
——
1859
Reproduction et traduction réservées.
En quittant Marc pour se rendre chez la baronne de Luxeuil, le duc avait promis de faire connaître au garçon de bureau, avant le soir, le résultat de sa démarche; mais le jour s’écoula sans qu’il reparût. L’attente et l’inquiétude redoublèrent la fièvre du blessé. Vers le soir ses idées commencèrent à se troubler; il prenait l’infirmier tantôt pour le duc, tantôt pour Arthur de Luxeuil, et lui adressait mille questions sans suite sur le mariage, sur les créanciers, sur Clotilde.
Françoise vint le soir; il ne la reconnut pas, et l’interne, qui veillait au service de la salle, déclara à la jeune fille que son état laissait peu d’espoir.
Celle-ci retourna à la rue des Morts le cœur serré.
Elle trouva Brousmiche étonné de l’absence de M. de Saint-Alofe. Il l’avait vu ressortir, après sa visite au garçon de bureau, dans le costume élégamment suranné dont nous avons parlé, mais sans savoir où il se rendait. La fleuriste l’ignorait également et passa la nuit dans une véritable inquiétude, le lendemain elle courut à l’hôpital, dans l’espoir d’obtenir quelques renseignements du blessé; son délire était toujours le même; après d’inutiles tentatives, elle revint à la hâte et apprit que le duc n’était point rentré.
Déjà troublé par les étranges incidents qui s’étaient succédé depuis trois jours, Françoise sentit ses inquiétudes grandir. Après l’assassinat de Marc tout lui paraissait possible; l’absence de M. de Saint-Alofe devait être l’annonce d’un nouveau malheur.
S’exaltant de plus en plus dans ces pressentiments funestes, elle ne tarda pas à les étendre davantage. Le billet écrit à Charles, il y avait quatre jours, sur la demande du voyageur de l’hôtel des Etrangers, était resté sans réponse, et ce silence semblait d’autant plus inexplicable que la lettre était plus pressante. Charles n’avait annoncé aucun projet d’absence: à défaut de temps pour venir il pouvait écrire; le prétendu conseiller se serait-il présenté à lui sans l’entremise de Françoise? l’aurait-il attiré dans quelque rendez-vous?... La pensée de la jeune fille n’osa aller plus loin; mais prise d’une terreur subite elle remit à la hâte son bonnet, son tartan et courut au numéro 12 de la rue d’Enghien.
C’était là que se trouvait le domicile avoué du prétendu commis. Fidèle à ses idées d’économie, Marquier y avait loué, au quatrième, un appartement de cent écus, qui lui tenait lieu de petite maison et où il recevait, outre ses correspondances galantes, celles de quelques entremetteurs d’affaires subalternes dont il se servait pour certaines opérations usuraires également bonnes à faire et à cacher.
Nous avons déjà vu comment la crainte de nuire à la bonne réputation du commis avait, jusqu’alors, empêché Françoise d’y venir; la violence de ses angoisses avait pu seule la décider à une démarche qu’elle eût elle-même condamnée en toute autre occasion; car dans son humble dévouement, la grisette avait accepté que son amour pût être pour Charles un embarras ou une honte et que la réputation à sauver ne fût pas la sienne mais celle de son amant.
Voulant prévenir tous les soupçons, elle se présenta un carton à la main, comme une fille de comptoir qui apporte une commande.
La portière était absente et la loge gardée par une petite fille de huit ans, occupée à feuilleter un journal illustré qu’elle avait adroitement dégagé de sa bande.
Françoise entr’ouvrit la porte et demanda M. Charles.
—Escalier B, quatrième au-dessus de l’entresol, porte à gauche, répondit la petite fille machinalement.
—Alors il est chez lui? dit la grisette joyeuse.
—Non, répliqua l’enfant, en continuant à regarder les gravures.
—Il est sorti?
—Oui, Mademoiselle.
—Et quand reviendra-t-il?
—Je ne sais pas.
Françoise, qui avait eu un moment d’espoir, laissa échapper un geste de désappointement.
—C’est peut-être quelque chose qu’on peut lui dire? demanda la petite fille, qui savait par cœur le vocabulaire obligé de la loge.
—Je voulais lui parler à lui-même, reprit Françoise; et vous êtes bien sûre qu’il n’est pas chez lui?
—Bien sûre, voilà sa clef et ses lettres.
La grisette tourna les yeux vers l’endroit indiqué par la petite fille et reconnut, sur une des adresses, sa propre écriture.
—Mon, billet! s’écria-t-elle; il ne l’a point encore reçu?... mais il n’est donc pas rentré depuis quatre jours?
—Depuis que la voiture l’a emmené, dit l’enfant.
—Une voiture?
—Oui, il a dit à maman d’aller lui chercher un fiacre, parce qu’il était pressé... que quelqu’un l’attendait.
—Et depuis?
—Depuis il n’est pas revenu.
Françoise se sentit frissonner: tout ce que lui apprenait l’enfant confirmait ses appréhensions. Charles avait pu être attiré dans un piége; il y avait succombé peut-être... Cette pensée lui fit froid jusqu’au cœur.
—Et voilà quatre jours que vous n’avez eu aucune nouvelle de lui? demanda-t-elle à la petite fille.
—Oui, répondit l’enfant, mais il est venu des lettres écrites à l’encre bleue.
—Comment?
—Oh! il en arrive souvent, et comme celles-là sont des lettres d’affaires, M. Charles veut qu’on les lui adresse en son absence à un autre endroit.
—Où cela?
—Je ne sais pas bien, mais il a mis l’adresse ici, dit l’enfant en ouvrant le registre de la loge.
Françoise se pencha, et reconnut ces mots écrits de la main de Charles:
«Aristide Marquier, rue du Mont-Blanc, 7.»
Sa résolution fut aussitôt prise; elle dit adieu à l’enfant, et courut à l’adresse indiquée.
Cette fois, l’émotion lui avait ôté toute prudence. Sans autre pensée que de connaître le sort de Charles, elle demanda à parler à M. Aristide Marquier.
Mais ce jour-là, le banquier s’était précisément mis en frais pour célébrer le mariage d’Arthur, et avait réuni à déjeuner Dovrinski, de Cillart et une partie des convives que nous avons déjà vus au souper de Clotilde. On quittait la table; le groom avait apporté les cigares avec le brasero, et les invités, échauffés par le champagne, venaient de passer sur le balcon, lorsque la jeune fille se présenta.
Éconduite d’abord, elle insista, pria, supplia, suivit le valet qui l’avait congédiée, arriva avec lui au premier salon et y renouvelait ses supplications, lorsque la voix du banquier se fit entendre dans la pièce voisine.
Françoise, saisie, s’arrêta court, et prêta l’oreille: la voix s’approchait, elle devenait plus distincte; elle finit par éclater, mêlée de rires et d’exclamations; enfin Marquier entra avec de Cillart, qu’il tenait par le bras.
Françoise ne pensa d’abord qu’au bonheur de le revoir, et se précipita vers lui, avec un cri de joie; le banquier y répondit par un cri d’épouvante. Les noms de Charles et de Françoise, répétés presque en même temps, avec une expression opposée, se confondirent, tandis que la grisette, hors d’elle, et profitant de la première stupeur de Marquier, se jetait dans ses bras.
Celui-ci se dégagea vivement.
—Eh bien! que fais-tu... que faites-vous... balbutia-t-il honteux et courroucé.
Dans ce moment, les convives qui avaient entendu les deux cris se montrèrent, et Françoise recula confuse.
—Qu’y a-t-il donc? demanda Arthur étonné de la présence d’une femme portant le costume d’ouvrière?
—Venez, venez! s’écria de Cillart en riant, nous avons spectacle après le café. Une scène de sentiment jouée à deux.
—Comment cela?
—Ne voyez-vous pas? Mademoiselle vous représente une des conquêtes du banquier.
—Du tout, interrompit Marquier; Messieurs... je vous assure... qu’il y a erreur!
—Laissez donc, reprit l’ancien garde-du-corps, vous l’avez tutoyée... regardez, d’ailleurs, comme elle a rougi.
—Ah! diable! elle rougit, fit observer de Rovoy, en lorgnant Françoise, c’est une spécialité précieuse.
—Et pas chère! acheva Arthur, qui jeta un regard ironique sur le costume de la fleuriste.
—L’apparence est, en effet, modeste, dit le vicomte de Rossac, mais c’est peut-être un déguisement.
—Au fait, le banquiers toujours affecté la discrétion.
—Il faut qu’il s’explique.
—C’est cela; fermez les portes, que personne ne puisse sortir.
—Allons, Marquier, mon cher, une confession générale.
—Messieurs! messieurs... bégaya le petit homme, qui, dans sa confusion, avait accueilli la supposition ironique du vicomte comme une chance de salut, je ne puis vous dire... l’honneur... la délicatesse... ne permettez point... de grâce, ne retenez pas madame... Ouvrez la porte, Dovrinski, ouvrez, je vous en prie.
Le Polonais, demeuré étranger à tout ce qui avait précédé, ouvrit et se rangea pour laisser passage à la jeune ouvrière; mais celle-ci n’en profita point. Au milieu du trouble qui, dans le premier instant, ne lui avait permis de rien voir ni de rien entendre, le nom de Marquier, donné à Charles, venait de la frapper. Elle releva la tête, croyant avoir mal entendu.
De Cillart profita de ce retard pour fermer la porte.
—Un moment! s’écria-t-il, nous vivons sous un gouvernement constitutionnel où le roi lui-même doit céder au vœu de la majorité. Or, ici, la majorité demande des éclaircissements. Je somme donc l’honorable amphitryon de répondre à mon interpellation.
—Et nous lui promettons d’être discret, ajouta Arthur.
—Oui, achevèrent toutes les voix, la parole est à Marquier.
—Marquier! répéta Françoise saisie, c’est le nom du maître... de la maison... et non celui de M. Charles.
—Qu’est-ce que M. Charles? demanda de Cillart étonné.
—Assez, Messieurs, interrompit le banquier d’un accent qu’il s’efforça de rendre impérieux; je ne souffrirai pas une plus longue explication!...
—Pardieu! c’est inutile! s’écria Arthur, tout est deviné maintenant, mon cher. De Rossac s’est seulement trompé pour le déguisement; il était de votre côté; c’est un moyen emprunté au Gamin de Paris.
—Je ne comprends pas.
—C’est pourtant clair; vous vous êtes présenté sous le nom modeste de M. Charles; vous vous serez donné pour artiste, étudiant en médecine ou clerc d’avoué, et c’est seulement aujourd’hui que l’innocente victime vient de reconnaître dans son séducteur le capitaliste Aristide Marquier.
Le banquier qui avait passé par toutes les expressions de l’embarras et de l’impatience demeura étourdi. Arthur lui mit la main sur l’épaule.
—Je comprends maintenant votre discrétion, mon cher, dit-il en riant, vous jouez le rôle de Jupiter auprès d’Alcmène... Seulement j’ai peine à m’expliquer la douleur de la princesse, en découvrant que son amant est un Dieu.
—Eh bien! vous oubliez donc le Gamin de Paris, que vous citiez tout à l’heure, reprit de Cillart. En cachant sa position, l’amant a pu donner des espérances... Il y a eu peut-être promesse de mariage.
—Du tout, s’écria Marquier, arraché à sa torpeur par ce dernier mot...
—Alors c’est une passion libre, fit observer M. de Rovoy.
—Et surtout désintéressée, ajouta Arthur, qui jeta de nouveau un regard sur le petit bonnet de tulle et sur le tartan de coton de la jeune ouvrière. Le banquier nous parlait toujours de son horreur pour les liaisons dispendieuses; il est aisé de voir qu’il met ses principes en pratique.
Un rire général s’éleva, et tous les yeux s’arrêtèrent sur Marquier. De toutes les accusations honteuses à subir, celle d’avarice était, en effet, la seule qui pût exciter le mépris de ces hommes qui avaient toujours mis leur générosité à ne point économiser sur les vices. Aussi le banquier voulut-il protester.
—Ne le croyez pas, s’écria-t-il, c’est une plaisanterie... Il ne s’agit point ici d’une liaison... mais d’une rencontre... d’un caprice.
Françoise fit un mouvement.
—Un caprice! balbutia-t-elle en joignant les mains avec désespoir; quand nous nous connaissons depuis près de trois années... quand l’autre jour encore vous me promettiez de songer à l’avenir de notre enfant!
—Un enfant! s’écria Arthur; il y a un petit Marquier! Ah! messieurs, ceci manquait! nous voilà tombés du Gamin de Paris dans Boquillon.
Les éclats de rire redoublèrent, tous les convives entourèrent le banquier avec un empressement grotesque, en lui demandant le nom de l’enfant, son âge, la couleur de ses cheveux et s’il ressemblait à son père. Marquier, pâle de colère, lança à Françoise un regard haineux. Cette dernière révélation mettait le comble aux humiliants embarras que lui avait attirés coup sur coup l’imprudente visite de la jeune ouvrière; elle venait de fournir à de Luxeuil et à ses amis un thème inépuisable de railleries; il était à jamais ridicule, c’est-à-dire presque déshonoré. Cette pensée alluma en lui une sorte de rage.
—Elle est folle, s’écria-t-il avec emportement, je ne sais ce qu’elle veut dire.
—La chose est pourtant facile à comprendre, objecta de Cillart; elle a un fils auquel il faut un père.
—Et elle vous a choisi pour cela, continua Arthur.
—Mais moi, je refuse, interrompit le banquier.
—Quoi! cet enfant?
—Ne m’est rien. Au diable la mère et le fils!
Françoise avait poussé une exclamation de surprise douloureuse à chacune des premières réponses de Marquier; mais, à cette dernière malédiction prononcée sur elle et sur son enfant, elle resta la tête dressée, les yeux ouverts, les bras pendants, muette et comme pétrifiée. On eût dit que le coup qui l’avait frappée venait de produire en elle une secousse intérieure qui avait arrêté le mouvement de la sensation et de la pensée. Quelques interjections étouffées s’échappaient de ses lèvres entr’ouvertes; mais sans signification et sans suite, ses regards fixes n’exprimaient qu’une sorte de stupéfaction égarée; un voile de marbre semblait envelopper tout son être et y tenir la vie enchaînée.
Malgré leur légèreté railleuse, les convives du banquier furent frappés de cette immobilité; les rires s’éteignirent, et le cercle qui entourait la jeune femme s’élargit.
Marquier en profita pour passer dans une pièce voisine.
Françoise le vit s’éloigner sans prononcer un mot, sans faire un geste; mais quand il eut disparu, elle reprit le carton qu’elle avait posé près d’elle, traversa le salon, l’antichambre, ouvrit la porte et gagna la rue.
Elle ne se sentait pas marcher, elle ne voyait rien; une douleur horrible mais confuse l’avertissait seule de son existence; raison, mémoire, volonté, tout dormait en elle. Conduite par une sorte d’instinct machinal, qui avait seul survécu, elle allait sans savoir où, sans y songer. Ce n’était plus un être vivant, mais un être qui se souvenait d’avoir vécu.
Cependant, cette inspiration née de l’habitude la conduisit à la rue des Morts; elle reconnut la maison, entra à la loge et demanda la clef.
M. Brousmiche saisi de la voir si pâle, lui demanda s’il lui était arrivé quelque chose, elle ne l’entendit pas, prit sa clef et monta à sa chambre.
Le petit bossu, inquiet, profita du premier moment de liberté qu’il put saisir pour la rejoindre; il la trouva prête à monter aux mansardes avec la tasse de lait, le petit pain et la cuiller d’argent.
—Que portez-vous là, madame Charles? demanda-t-il étonné.
—Ne voyez-vous pas? dit-elle d’un accent bref; c’est le déjeuner de M. Michel.
—Mais il n’est plus ici! s’écria le bossu stupéfait.
—Il n’est plus ici, répéta madame Charles, sans avoir l’air de comprendre.
—Avez-vous donc oublié que vous étiez sortie pour vous informer de lui?
La jeune femme demeura immobile, en murmurant:
—Ah! c’était... pour cela!...
Le portier la regarda avec inquiétude.
—Sûrement vous avez appris quelque mauvaise nouvelle, madame Charles, s’écria-t-il, vous êtes toute... je ne sais comment dire ça... mais on dirait que vous n’entendez pas.
Françoise posa la tasse qu’elle tenait, s’assit et porta la main à son front.
—Oui, dit-elle, j’ai mal...
—Où cela?
—Je ne sais pas... mais je voudrais dormir....
En prononçant ces derniers mots d’une voix alourdie, la jeune fille commençait à dégrafer sa robe, comme si elle eût été seule.
—Couchez-vous, dit le bossu qui gagna la porte; je reviendrai savoir comment vous vous trouvez. Vous n’auriez pas besoin de quelque chose?
—Non, murmura Françoise, dont les yeux se fermaient, je voudrais seulement... ne plus sentir... rien... Ce jour... fait mal!
Le bossu ferma avec soin les rideaux, et se retira.
Lorsqu’il revint une demi-heure après, Françoise était tombée dans une somnolence entrecoupée de plaintes sourdes; elle n’ouvrit point les yeux à son approche et répondit à peine à ses questions.
Cet état s’aggrava encore pendant les heures qui suivirent. Brousmiche avait fait avertir la femme de ménage du pharmacien qui avait été garde-malade, et dont l’expérience lui inspirait une grande confiance. Celle-ci examina Françoise, lui proposa tour à tour du café, de la pâte de guimauve, une rôtie au vin, et, sur le refus de la jeune femme, déclara que son état réclamait les soins du médecin.
Il fallut courir trois heures avant d’en trouver un; car Paris est la ville du monde où il y a, en même temps, le plus de médecins qui manquent de malades, et de malades qui manquent de médecins. Enfin, vers le soir, il en arriva un qui déclara que madame Charles était atteinte d’une congestion cérébrale, dont il décrivit en termes scientifiques les caractères et les dangers. A chaque mot incompréhensible, Brousmiche levait les yeux au ciel, comme si on lui eût enlevé une espérance, tandis que l’ex-garde-malade faisait un signe de tête pour saluer d’anciennes connaissances.
Après cette petite leçon de clinique, réclame obligée par laquelle le médecin constate sa science aux yeux des ignorants, vinrent les prescriptions données en langage plus humain, et que le portier promit de suivre scrupuleusement.
Mais, malgré ses soins et l’appropriation du traitement, le mal ne parut point céder. L’état de Françoise, sans devenir plus grave, resta aussi inquiétant. Le médecin s’efforça en vain de déterminer quelque crise décisive, il ne put arracher les puissances vitales à leur engourdissement. On eût dit que la mort et la vie se sachant de force égale campaient vis-à-vis l’une de l’autre, comme deux ennemies qui n’osent risquer une bataille.
Cette espèce d’attente se prolongea plusieurs jours; enfin, pourtant, les symptômes les plus fâcheux disparurent, mais sans que Françoise retrouvât l’activité de ses perceptions. A la torpeur de la maladie, succéda un anéantissement que rien ne put surmonter. Toute l’énergie de cette vigoureuse nature avait été sourdement usée par ce combat de quelques jours; elle demeura vaincue, épuisée et n’ayant plus que les apparences de la vie.
Les jours, les semaines s’écoulèrent sans rien changer à la situation de Françoise. Guérie en apparence, elle demeurait ensevelie dans sa langueur indifférente: n’entendant jamais qu’après plusieurs appels, répondant par monosyllabes, elle restait des heures entières dans la position qu’on lui avait donnée, les mains à plat sur ses genoux, les yeux fixes devant elle, la respiration courte, mais égale. Brousmiche montait vingt fois par jour à la chambre de la convalescente, et redescendait chaque fois, le cœur serré.
—Tout est fini, mam’Berton, disait-il à la femme de ménage du pharmacien; mieux vaudrait qu’elle fût enterrée que de vivre ainsi comme une morte.
—Faudrait essayer la jarlatine, répliquait madame Berton, qui répétait l’avis du pharmacien; ça se compose avec des os de morts, ça se prend en bain et ça fait l’effet d’un grand bouillon qui restaure tout l’individu.
Mais le bossu secouait la tête.
—J’ai bien peur que tous les remèdes n’y fassent rien, mam’Berton, reprenait-il tristement; on dirait, voyez-vous, que la pauvre femme vit encore sans s’en apercevoir, et que son âme est déjà partie.
A ces mots, l’ex-garde-malade, que ses relations avec les hommes de la science avaient rendue esprit fort, haussait les épaules en répliquant:
—Dites donc pas de ces bêtises-là, monsieur Brousmiche; l’âme, c’est un préjugé des gens sans éducation.
Et elle revenait à la gélatine indiquée par le pharmacien, qui en vendait.
Mais la crise dont on désespérait devait venir d’ailleurs, et par un moyen inattendu.
En ne voyant plus M. Charles reparaître, le bossu comprit sans peine qu’une rupture avait eu lieu entre les deux amants le jour où la jeune femme était rentrée dans cet état d’égarement qui l’avait si vivement alarmé: il avait donc évité avec soin tout ce qui eût pu la ramener à ces douloureux souvenirs et il s’était même étudié à ne plus l’appeler que mademoiselle Françoise. Aussi éprouva-t-il un véritable embarras en recevant une lettre timbrée du village où son petit se trouvait en nourrice. Rappeler son enfant à la malade, c’était lui rappeler en même temps l’abandon du père et la séparation qui l’avait déjà si cruellement éprouvée; il hésita longtemps et ne se décida enfin que sur l’observation de madame Berton qu’il fallait bien ouvrir une lettre dont on avait payé le port.
Il monta donc chez Françoise qu’il trouva assise dans un grand fauteuil de jonc, acheté autrefois pour Charles.
La chambre de la jeune femme avait complètement changé d’aspect depuis sa maladie. A la propreté amoureuse et arrangée qui en faisait la principale élégance, avait succédé le désordre. Des tasses, des potions, des bouilloires étaient parsemées sur les meubles tachés; les plis des rideaux fermés, étaient couverts de poussière, les araignées avaient tendu leurs toiles dans tous les coins du plafond, et deux petites caisses de fleurs posées dans l’embrasure de la fenêtre, étaient encore garnies de plants de bruyère blanche, desséchés faute d’air et de soins; on eût dit une de ces chambres abandonnées à la hâte par suite de départ ou de mort.
Françoise elle-même complétait, pour ainsi dire, cet aspect désolé. A la voir assise dans le coin le plus obscur, immobile, muette et pâle, on eût pu la prendre, au premier coup d’œil, pour un de ces cadavres auxquels la folle science des embaumeurs prétend conserver une mensongère apparence de vie en éternisant une réalité apparente de mort.
Brousmiche s’approcha d’elle et s’informa de sa santé.
Françoise tourna lentement les yeux de son côté, fit un mouvement de tête qui semblait dire: bien, et rentra dans son immobilité.
Il lui demanda si elle ne voulait point essayer ses forces en faisant le tour de sa chambre; elle fit un signe négatif.
—Laissez-moi vous pousser au moins près de la fenêtre, mam’selle Françoise, reprit le bossu, qui ne pouvait s’habituer à cette torpeur; il fait aujourd’hui un soleil à faire rire les morts; ça vous ranimera.
Françoise ne répondit pas, et Brousmiche, regardant son silence comme un consentement, alla tirer les rideaux, ouvrit la fenêtre et y traîna le fauteuil sur lequel la jeune femme était assise.
Éblouie par la lumière et étourdie par l’air libre, celle-ci poussa d’abord un léger cri; elle baissa les paupières, aspira avec effort, et porta les deux mains à son front comme si elle eût éprouvé une sensation trop forte; mais insensiblement ses yeux s’accoutumèrent au jour, son oppression se calma, une légère teinte rosée monta à ses joues amaigries; elle releva lentement la tête et se pencha vers la rue.
Un soleil d’avril, clair et joyeux, glissait sur les toits voisins, en faisant étinceler les vitrages. On entendait les gazouillements des oiseaux qui se poursuivaient le long des corniches. De petites colonnes de fumée blanche et ténue s’épanouissaient au-dessus des cheminées et allaient se perdre dans le bleu grisâtre du ciel. Un vent frais apportait les senteurs des giroflées exposées sur les fenêtres des mansardes et les bruits de la rue arrivaient jusqu’à la malade avec leurs mille nuances. Françoise parut en ressentir l’influence. L’invincible réseau de glace qui tenait ses membres captifs se fondit, une tiède moiteur détendit ses muscles roidis, ses bras s’avancèrent vers la fenêtre, ses pieds s’appuyèrent au plancher, un long frémissement entr’ouvrit ses lèvres; ses prunelles dilatées se resserrèrent et reprirent leur mobilité; elle regarda au dehors, puis se regardant elle-même, elle referma sa robe dégrafée, redressa le petit châle qui couvrait ses épaules, déroula ses cheveux, les tordit avec un geste de femme inimitable et charmant, et les releva en arrière sous son peigne de corne ouvrée.
Le bossu contemplait cette espèce de résurrection avec un étonnement ravi.
—J’en étais bien sûr que le soleil vous aurait fait du bien, s’écria-t-il; voilà que vous vous ranimez à vue d’œil.
—Oui, dit la jeune femme, dont la voix était aussi faible, mais plus assouplie; je sens l’air... qui me coule dans les veines... Je vois, j’entends mieux... Il me semble... que je me réveille.
—Et vous ne vous trompez pas, chère demoiselle Françoise, reprit Brousmiche; vous vous réveillez, ou plutôt vous ressuscitez; car ce n’est pas vivre que d’être comme la maladie vous avait laissée. Mais il n’y a plus de danger; vous voilà partie: avec du repos et des consommés, ça va rouler tout seul maintenant... Ah! Dieu!... Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai eu tant peur... que de vous voir... hors d’affaire... ça me laisse... ça me rend... c’est pourtant bien bête... à mon âge...
Et le petit bossu s’arrêta pour essuyer de grosses larmes qui roulaient sur ses joues, pendant que le rire était sur ses lèvres.
Françoise, encore trop faible pour comprendre toute la générosité de cette émotion, se contenta de répéter:
—Bon monsieur Brousmiche!
—C’est plus fort que moi, reprit le portier en se mouchant pour combattre son attendrissement; je m’attache à mes locataires comme s’ils étaient de ma famille. Après ça, vous me direz que c’est tout naturel. Quand on voit quelqu’un tous les jours, qu’on cause avec lui, qu’on lui rend de petits services... il finit par vous devenir nécessaire.. aussi, je n’aurais pu me consoler s’il vous était arrivé un malheur... surtout après la perte de ce cher monsieur Michel.
Ce nom parut réveiller la mémoire de Françoise.
—La perte! répéta-t-elle lentement..... Ah! oui, je me souviens... il avait disparu, et vous n’avez point eu de nouvelles?
—Aucune.
—Il y a longtemps, n’est-ce pas?
—Bientôt deux mois.
Françoise baissa la tête et redevint silencieuse; mais, à la contraction de ses sourcils et de ses lèvres fermées, il était aisé de voir qu’elle faisait effort pour ressaisir les fils rompus de ses souvenirs. Par instants un éclair illuminait ses traits, puis un nuage le faisait disparaître; c’était une lutte acharnée entre la volonté renaissante et la mémoire encore endormie. Celle-ci finit pourtant par se ranimer insensiblement. Des mots entrecoupés s’échappaient des lèvres de la jeune femme, comme si elle eût voulu aider par le son à ses souvenirs. Mais, tout à coup, un nom machinalement ramené par l’habitude, celui de Charles, la fit tressaillir. Ce nom était la clef magique devant laquelle devait se rouvrir le passé. Subitement assaillie par tous ses souvenirs, elle se redressa: ses mains se pressèrent sur sa poitrine, puis sur ses tempes, puis sur son front. On eût dit qu’elle voulait modérer les flots d’images douloureuses qui reprenaient à la fois possession de tout son être.
Cette crise terrible ne dura que quelques instants et se termina par un cri qui résumait, pour ainsi dire, tout le passé et tout l’avenir.
—Mon enfant! où est mon enfant? bégaya la malheureuse mère en tendant les mains.
Brousmiche qui était resté saisi d’épouvante, se rappela subitement le motif de sa venue.
—L’enfant est bien, mam’selle Françoise, s’écria-t-il, n’ayez pas d’inquiétude; voici de ses nouvelles:
Et il présentait la lettre.
Françoise la saisit précipitamment, l’ouvrit et voulut lire; mais les lignes flottaient sous ses yeux, les mots se confondaient; elle ne voyait plus! elle présenta le papier au bossu qui mit vivement ses lunettes, se rapprocha de la fenêtre pour mieux voir et lut avec un peu de difficulté ce qui suit:
MAIRIE DE GAILLON
«Madame,
»J’ai l’honneur de vous faire savoir que la nommée Désirée Leblanc, femme Moirier, qui s’était chargée de votre enfant, n’ayant point reçu le paiement des deux derniers mois dûs pour la nourriture de ce dernier et que vous aviez coutume de lui adresser par les voitures de Louviers, s’est présentée à moi, en déclarant qu’elle ne voulait plus continuer à garder votre fils.»
Françoise poussa une exclamation de saisissement...
«En conséquence,» continua le bossu, «j’ai dû reprendre de ses mains le nourrisson, qui a été déposé au tour des Enfants-Trouvés.»
La jeune femme se leva avec un cri si terrible que Brousmiche recula effrayé.
—Mon fils... balbutia-t-elle d’une voix étranglée, mon fils déposé au tour... des Enfants-Trouvés!... Il y a cela... vous êtes bien sûr...
—Bien sûr, dit le bossu en cherchant le passage... Voyez... «au tour des Enfants-Trouvés...»
Françoise s’appuya au dossier du fauteuil, mais resta debout.
—Il y a le nom de l’hospice, n’est-ce pas? demanda-t-elle d’un accent bref.
—Je pense, dit M. Brousmiche, en regardant à la fin de la lettre... Oui... voilà: «hospice de Louviers, département de l’Eure.»
—Bien, reprit Françoise, qui voulut regagner l’autre extrémité de la chambre en s’appuyant au mur... Je partirai ce soir... tout à l’heure.
—Vous! s’écria le portier.
—Vous connaissez la voiture de Louviers? continua la grisette, qui était arrivée à sa commode et s’efforçait d’ouvrir le tiroir où se trouvait l’argent, vous me direz où je dois la prendre...
—Mais vous n’y pensez pas! s’écria le bossu; partir aujourd’hui... Vous pouvez à peine vous soutenir...
—Aux Enfants-Trouvés, mon pauvre petit!... murmura la jeune femme avec une indicible expression de douleur contenue.
—Vous ne m’écoutez pas, mam’selle Françoise, reprit Brousmiche, qui s’approcha inquiet. Au nom de Dieu! songez à ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez partir ainsi.
—Pourquoi? demanda-t-elle en comptant machinalement son argent.
—D’abord parce que les forces vous manqueraient.
—Je n’ai pas besoin de forces, j’irai en voiture. Voici de l’argent.
—Mais vous le devez! s’écria le bossu, qui crut avoir trouvé un moyen souverain de retenir la convalescente; vous ne pouvez partir sans payer les frais de votre maladie.
—Ah! vous avez raison! dit Françoise en pâlissant... Grand Dieu! je n’avais point songé... il faut que je paie.
—Et une fois tout soldé, il ne vous restera plus de quoi faire le voyage, ajouta Brousmiche.
Elle le regarda d’un air éperdu.
—Est-ce vrai? reprit-elle... Quoi! je ne pourrais pas aller retirer mon fils!... Oh! c’est impossible. J’irai, j’irai à pied... Mais non, j’arriverais trop tard... Je ne le retrouverais plus, peut-être!
Et, se ravisant tout à coup:
—Mais je suis folle! s’écria-t-elle... Tout ce qui est ici m’appartient... je puis tout vendre. Je vendrai tout; je veux quitter Paris pour ne plus y revenir. Il n’y a plus rien ici pour moi... que des souvenirs... dont j’aime mieux être loin. Mon pays à présent, c’est où est mon fils; j’irai le chercher; je l’emporterai dans mes bras; je l’aurai à moi, du moins, et je pourrai l’embrasser tant que le cœur m’en dira. Ah! pauvre chérubin, je crois le voir, le tenir là...
Et dans son délire de mère elle baisait ses propres mains, pleurant comme si elle eût baisé les joues de son enfant.
M. Brousmiche, troublé, voulut en vain élever de nouvelles objections; Françoise s’habillait sans l’écouter pour aller chercher un revendeur. Il fallut enfin venir à une transaction. Le bossu obtint de la jeune femme qu’elle s’occuperait seulement ce jour-là de régler ce qu’elle devait, et de faire ses préparatifs, tandis qu’il se chargerait, lui, d’avertir les acheteurs pour la vente du lendemain.
Il espérait que ce retard pourrait modifier les résolutions de Françoise; mais il ne fit que la raffermir dans son projet. Ainsi qu’elle l’avait dit au bossu, rien ne la retenait plus à Paris; tout l’en repoussait au contraire. Son enfant était devenu l’unique pôle vers lequel se tournait ce cœur blessé. Elle vendit tout ce qu’elle possédait, comme elle en avait annoncé l’intention, et après avoir laissé à M. Brousmiche sa cuiller d’argent en souvenir d’amitié et pour qu’elle servît à M. Michel s’il revenait jamais, elle embrassa le bossu avec la tendresse d’une sœur, et monta dans le cabriolet qui devait la conduire aux diligences de Louviers.
Le portier resta sur le seuil de la porte cochère tant qu’il put voir le cabriolet, puis, rentrant dans sa loge, il s’assit tristement entre son chat et son oiseau.
Le départ de Françoise après la disparition de M. Michel et l’absence de Marc, toujours retenu à l’hôpital, avaient laissé le portier de la rue des Morts dans un complet isolement. Il restait encore, sans doute, dans la maison de l’entrepreneur beaucoup d’habitants, mais ce n’étaient point de ceux que le petit bossu appelait ses locataires. Il n’était associé ni à leurs afflictions, ni à leurs joies. Au milieu de cette réunion de travailleurs indigents, Marc, M. Michel et Françoise formaient un groupe de réprouvés près duquel le mépris qui frappait son infirmité lui avait naturellement assigné une place. Mais une sorte de fatalité avait subitement désuni et dispersé ce faisceau de misères fraternelles, de sorte que maintenant il restait seul livré au ridicule et au dédain.
L’absence de la jeune ouvrière lui fut surtout pénible, non-seulement parce qu’elle partit la dernière, mais parce que l’habitude de sa présence avait, pour le bossu, quelque chose de plus doux, de plus nécessaire; il trouvait, dans cette affection, le charme caressant que la femme communique à tous les liens. M. Brousmiche avait besoin de voir Françoise, d’entendre sa voix sans qu’il s’en fût jamais rendu compte; c’était, comme l’air, un élément de vie et de bien-être dont on ne comprend la nécessité que lorsqu’on l’a perdu.
En descendant plus au fond de lui-même, il eût peut-être trouvé la cause de ce besoin longtemps ignoré; mais sans pouvoir donner de nom au sentiment particulier qui l’attachait à la fleuriste. Ce n’était point de l’amitié, car l’amitié n’a point cette ardeur; c’était encore moins de l’amour, car l’amour a des désirs, des espérances, des jalousies; c’était plutôt un mélange de ces deux affections; un sentiment confus, incomplet et singulier comme celui qui l’éprouvait.
Malgré l’abattement dans lequel la tristesse avait jeté le petit bossu, il visitait Marc le plus souvent qu’il le pouvait. Craignant de nuire à la guérison du blessé, il lui cacha quelque temps le départ de Françoise et la disparition du duc; mais, pressé par ses questions, il finit par tout avouer. Dès ce moment le garçon de bureau ne songea qu’à quitter l’hôpital, et il sollicita son billet de sortie avec tant d’instances que le médecin finit par céder.
Son premier soin fut de courir à l’hôtel de la comtesse où il apprit le mariage d’Honorine. Bien que ce coup fût prévu, il en demeura d’abord terrassé. Ainsi tous ses avertissements avaient été sans résultat, tous ses efforts inutiles! Le duc de Saint-Alofe lui-même n’avait pu rien empêcher, et, selon toute apparence, son intervention lui avait été fatale.
Du reste, toutes les questions faites par Marc pour découvrir ce qu’il était devenu, furent vaines, et il se décida à des recherches suivies.
Mais avant de les commencer, il fallait savoir comment Honorine supportait sa nouvelle position. Plus que jamais peut-être, elle avait besoin de dévouement et de conseils. Marc résolut de la voir.
Il apprit à l’hôtel de madame de Luxeuil que le mariage d’Arthur avait été suivi de discussions violentes entre le fils et la mère. Cette dernière qui se vantait d’avoir tout conduit, s’était flattée que la fortune d’Honorine serait une proie commune; mais arrivé au but, Arthur oublia l’auxiliaire qui lui avait assuré la réussite et voulut profiter seul de la victoire. La comtesse indignée accusa son fils d’ingratitude, celui-ci répondit en demandant des comptes de tutelle qui ne lui avaient jamais été rendus; on s’aigrit des deux côtés, on se menaça et tout finit par une rupture. Le jeune homme quitta sa mère pour aller habiter avec Honorine, rue de Lille, l’ancien hôtel du général Louis.
Ce fut là que Marc se présenta déguisé en commis coureur pour les parfumeries. Ainsi qu’il l’avait prévu, il ne put arriver la première fois jusqu’à Honorine; mais il laissa au concierge une carte sur laquelle il écrivit son adresse et son nom avec prière de la remettre à madame Arthur de Luxeuil, et en avertissant qu’il reviendrait le lendemain. Il était sûr qu’ainsi prévenue, la jeune femme donnerait ordre de le recevoir.
Il allait partir, lorsque le tilbury d’Aristide Marquier s’arrêta devant le seuil de l’hôtel qu’il était près de franchir. Marc, tremblant d’être reconnu, se rejeta en arrière et enfonça son chapeau jusqu’à ses yeux; mais le banquier tout occupé de se débrouiller des rênes, pour les remettre au nouveau groom qu’il s’était donné depuis peu, ne prit point garde à ce mouvement. Il fit quelques recommandations à l’enfant, sauta du marche-pied à terre avec une affectation de légèreté, et passa en fredonnant, devant Marc, qui se hâta de franchir le seuil.
Depuis sa désagréable aventure avec Françoise, Marquier avait senti la nécessité de se réhabiliter aux yeux de la fashion par un redoublement de luxe. Il avait acheté un tilbury, pris un groom et loué un quart de loge aux Italiens. Il s’était même lancé dans les paris aux dernières courses, où il prétendait avoir perdu trois cents louis, c’est-à-dire, selon de Luxeuil, trois fois plus qu’il n’y avait engagé. Du reste, le banquier apportait à ces prodigalités l’espèce de rage des avares qui se mettent en dépense; il avait l’air d’essayer à s’étourdir lui-même, de repousser la réflexion et de vouloir se ruiner de parti pris.
Cette étourderie de bon ton ne l’empêchait pourtant ni de continuer les affaires, ni de profiter de tous les avantages que pouvait lui donner son habileté ou le hasard. Le loup cervier avait eu beau changer d’apparence, à la première occasion il reprenait sa nature et s’élançait à la curée. Ses gants paille, ses bottes vernies et son lorgnon n’étaient qu’un déguisement; comme l’habit de berger dont parle La Fontaine, ils lui servaient à s’approcher plus facilement du troupeau.
La modification apportée à ses habitudes s’était étendue jusqu’à ses sentiments. Instruit par son aventure avec Françoise, il avait renoncé aux amours de grisette, et s’était décidé à tenter quelque liaison qui pût le relever du passé et lui donner une position dans le monde galant de la fashion. Après avoir cherché quelque temps ses yeux s’arrêtèrent sur la femme d’Arthur.
Négligée par son mari dont l’éloignait évidemment une répulsion invincible, et de plus assez retirée du monde pour ne pas être en position de choisir son consolateur, Honorine semblait une conquête facile. Ce qui faisait sa défense se trouvait en elle et ne pouvait être deviné par Marquier; il ne vit que la position apparente et ne douta point du succès.
Arthur facilitait d’ailleurs toutes les tentatives. Trop insouciant pour garder Honorine et dédaignant trop Marquier pour le craindre, il n’opposait aucun obstacle à l’intimité de ce dernier.
Quant à la jeune femme, son indifférence même favorisait cette intimité. Elle acceptait les soins du banquier, avec cette distraction des âmes endolories, lui laissant prendre, sans s’en apercevoir, des habitudes chaque jour plus familières; elle l’employait pour tous ces riens dont on charge un commis dans les affaires, mais qui, dans le monde, sont le privilége du cavalier servant.
Incapable de deviner la véritable cause de cette confiance passive, Marquier y voyait les présages assurés de son prochain empire et affectait déjà, devant les tiers, des airs victorieux.
En passant près de la loge, il demanda d’un ton dégagé si madame de Luxeuil était à l’hôtel, moins pour s’en assurer que pour constater le privilége qui le faisait recevoir en visite du matin. Le concierge lui répondit d’une manière affirmative, et ajouta, comme preuve, que Madame n’avait point encore fait prendre ses lettres.
—Je les lui porterai, dit Marquier, dont le dévouement pour Honorine aimait surtout à s’exprimer par ces petites prévenances de mauvais goût.
Le concierge lui remit les lettres avec plusieurs cartes, parmi lesquelles se trouvait celle de Marc, et le banquier monta à l’appartement occupé par madame de Luxeuil.
Mais celle-ci n’était point encore visible et le fit prier d’attendre; Marquier profita de ce retard pour passer chez Arthur qui occupait l’autre côté du même étage.
Il le trouva avec de Cillart qui lui racontait une intrigue galante dans laquelle il se trouvait lancé depuis quelques jours et qu’il espérait conduire prochainement à bonne fin par l’entremise d’un certain Moreau, ancien employé au bureau de recensement de la ville de Paris et qui exerçait, sur une grande échelle, l’industrie équivoque à laquelle nous avons déjà vu l’Alsacien Moser se livrer sous le nom de monsieur Hartmann. Grâce à lui, l’ex-garde-du-corps avait appris, en vingt-quatre heures, le nom des parents de la jeune fille qu’il poursuivait, leurs antécédents et l’état de leur fortune. Vingt-quatre heures après il avait réussi à faire parvenir une lettre et quarante-huit heures plus tard il avait reçu une réponse. A la vérité, le prix des services était proportionné à la rapidité avec laquelle ils étaient rendus, et monsieur Moreau gagnait, disait-on, chaque année, à ce jeu, quelque chose comme dix mille écus.
—Dix mille écus! s’écria Marquier émerveillé; mais c’est une spéculation superbe.
—Il faut l’entreprendre, mon bon, dit Arthur sérieusement; ce serait un moyen d’exploiter vos relations.
—Fi donc! interrompit le petit homme, scandalisé par cela même que la supposition n’était pas assez invraisemblable pour lui paraître plaisante; vous me prenez certainement pour un autre...
—Songez donc, cher ami, insista de Luxeuil, gagner dix mille écus!
—Mon Dieu! reprit Marquier, on peut les gagner autrement, sans exercer une industrie que tout le monde méprise...
—Et dont tout le monde se sert à l’occasion, ajouta de Cillart, vous le premier.
—Lui! s’écria Arthur; ah! je vous garantis le contraire! avez-vous donc oublié son horreur pour les galanteries dispendieuses?
Le banquier se mordit les lèvres.
—Allons, toujours la même histoire! reprit-il en s’efforçant de rire, décidément vous vous répétez, mon cher.
—Non, non, ce n’est pas Aristide Marquier qui paiera des agents pour faciliter ses amours, continua de Luxeuil sans l’écouter; il est accoutumé à conduire ses affaires lui-même... par économie. D’ailleurs, il est occupé pour le moment.
—En vérité, dit de Cillart, est-ce encore une grisette?
—Du tout, du tout; il s’agit, cette fois, d’un amour du grand monde.
—Bah! et qui donc est l’objet...
Arthur regarda le garde-du-corps.
—Vous le savez aussi bien que moi, dit-il en haussant les épaules.
—Nullement, répondit de Cillart.
—Allons, vous voulez faire le discret.
—Je vous jure que j’ignore.
—Vrai?
—Parole d’honneur.
—Eh bien!... c’est madame Arthur de Luxeuil!
Ce dernier nom avait été prononcé avec une si singulière bonhomie que de Cillart et Marquier tressaillirent, le premier de surprise, le second de peur.
—Votre femme! répéta le garde-du-corps; pardieu! la confidence est charmante.
—Charmante! répéta Marquier, en s’efforçant de rire pour cacher son trouble; charmante... comme dit de Cillart... Seulement je dois à la vérité... de protester!
—Pourquoi cela, interrompit de Luxeuil avec une nonchalance impertinente; me croyez-vous jaloux par hasard, et jaloux de vous?
—Je ne me flatte pas d’un tel honneur... balbutia le banquier, qui cherchait à rire plus fort à mesure que son malaise devenait plus grand.
Arthur le mesura d’un regard ironiquement pacifique qui devait être le comble de la rancune ou le comble du dédain.
—Ne vous gênez donc pas, mon bon, reprit-il d’un ton léger; continuez à vous montrer assidu près de madame de Luxeuil. Il n’y a rien de fâcheux comme le vague pour les femmes. La mienne passe sa vie à s’ennuyer sans savoir pourquoi; quand vous êtes là, il y a du moins une cause...
—Comment, comment, mais c’est une épigramme! s’écria Marquier dont le rire tournait à la crispation.
—Sans compter que vous empêchez l’approche de poursuivants plus dangereux, continua de Luxeuil avec la même tranquillité.
—C’est-à-dire, reprit le banquier, en faisant beaucoup de gestes pour se donner l’air libre, que vous espérez faire de moi un plastron... mais je vous ferai observer, mon cher, que c’est vouloir me donner un ridicule.
—Qu’importe un de plus? D’ailleurs, vous avez aussi des dédommagements. Le rôle d’amant supposé donne une position; c’est comme une prélature in partibus infidelium; on est évêque sans évêché.
—Très-bien, très-bien, interrompit Marquier, qui ne pouvait soutenir plus longtemps son personnage d’homme battu et content; mais je vous déclare que je refuse de jouer ce rôle.
—Vous le jouez déjà.
—Moi?
—Qui sert d’écuyer cavalcadour à madame de Luxeuil quand elle va au bois; qui lui apporte la musique nouvelle...
—C’est-à-dire que deux ou trois fois...
—Qui s’occupe de lui procurer des billets de concert, de spectacle, de sermon?
—Permettez... je n’ai jamais...
—Et, tenez, interrompit de Luxeuil, en voyant les cartes et les lettres que le banquier tenait à la main, je parie que c’est encore une de ses commissions.
—Du tout, s’écria Marquier, du tout, mon cher; ceci m’a été remis en passant par le concierge... Voyez plutôt.
Et il éparpilla, sur le marbre de la cheminée, les papiers qu’il tenait. De Luxeuil jeta un regard indifférent; mais tout à coup son œil s’arrêta sur la carte de Marc, dont il crut reconnaître l’écriture; il se redressa, lut le nom, l’adresse et tressaillit.
—Qu’est-ce donc? dit le banquier étonné.
—Cette carte aussi se trouvait à la loge? demanda de Luxeuil.
—Probablement.
—Et, en vous la remettant, le concierge n’a rien dit?
—Rien.
Arthur la regarda encore un instant; puis, la réunissant aux lettres adressées à madame de Luxeuil, il sonna et remit le tout au valet qui entra.
Cette espèce d’épisode avait été si rapide, que de Cillart, qui feuilletait une Revue à quelques pas, n’y avait point pris garde. Le domestique venait de sortir lorsqu’il prit son chapeau.
—Vous nous quittez? demanda Arthur qui se leva.
—Dovrinski et d’Apolda m’attendent au manége de Cillart.
—Je vous prends alors dans mon coupé, j’ai précisément affaire au Luxembourg; Marquier nous accompagnera.
—Mille grâces, dit le banquier, mon tilbury est en bas.
—Ah! parbleu, il faut que je le voie; le mien me déplaît et je voudrais le changer..... passez donc, Messieurs.
Marquier n’osa point dire qu’il était venu pour madame de Luxeuil et descendit avec de Cillart et Arthur qui ne prirent la route du Luxembourg qu’après l’avoir vu partir.
Lorsqu’il déposa son compagnon à la porte du manége, de Luxeuil lui serra la main.
—N’oubliez pas de me tenir au courant de votre affaire Moreau, dit-il en riant.
—Vous aurez de mes nouvelles dans huit jours, répondit le garde-du-corps.
—Si tôt?
—Peut-être avant.
—Pardieu votre monsieur Moreau est un homme merveilleux, je vous demanderai son adresse.
—Auriez-vous quelque idée!...
—Il peut m’en venir.
—Alors, allez rue de Tournon, 8.
—Grand merci.
De Cillart fit un signe de la main et disparut.
Arthur se pencha vers le valet de pied qui se tenait debout près de la portière.
—Vous avez entendu l’adresse, Félix?
Le domestique s’inclina, referma la portière, et le coupé se dirigea vers la rue de Tournon.
Honorine était seule, près d’un feu mourant, la tête appuyée sur une main et tenant de l’autre la carte de Marc. Des ordres avaient été donnés par elle pour que le prétendu commis en parfumerie fût introduit aussitôt qu’il se présenterait à l’hôtel, et elle l’attendait avec une impatience inquiète.
En apprenant la fausseté de la lettre attribuée à sa mère, la première pensée de la jeune femme avait été, comme nous l’avons vu, de rompre un mariage auquel elle n’avait consenti que par surprise; mais l’arrestation de M. de Saint-Alofe lui avait enlevé, en même temps, et les moyens et la volonté de poursuivre cette rupture. La folie constatée du vieillard ôtait à l’accusation portée par lui son caractère de certitude et d’authenticité; la lettre, qui avait tout décidé, restait, sinon prouvée, du moins possible. Honorine voulut échapper à ce que sa position avait d’horrible en prenant un parti extrême. Elle demanda à suivre sa grand’mère aux Motteux; mais Arthur et la mère Louis repoussèrent également ce projet. La grosse paysanne, qui ne pouvait comprendre que l’on montrât si peu de goût pour un beau gars comme de Luxeuil, traita Honorine de mijaurée et prédit que dans quelques jours elle aurait renoncé à toutes ces frimes, tandis qu’Arthur objectait ironiquement son amour, et, plus sérieusement, le scandale d’une pareille séparation. La mère Louis repartit donc seule, laissant sa nièce sans défense et désespérée.
De Luxeuil ne fit rien pour la rassurer ni pour l’apaiser. Forcé à une longue dissimulation, humilié par un refus, ballotté longtemps entre les espérances et les craintes, il avait fini par s’irriter contre celle qui le soumettait à tant d’ennuis, et son indifférence s’était insensiblement transformée en rancune. Il en voulait à sa cousine de la peine qu’il avait eue à l’obtenir. Aussi ne répondit-il à sa douleur que par la dureté, à ses répulsions que par le dédain.
Les débats avec sa mère vinrent encore aigrir son humeur. Il en reporta la responsabilité sur Honorine, qui en était la cause indirecte; mais l’excès même de cette injustice devint, pour la jeune femme, un motif de soulagement. Accablée par tant de coups, elle tomba dans un abattement qui ôta à de Luxeuil jusqu’au désir de la tourmenter: l’insensibilité de la victime rendit son indifférence au bourreau. Il reprit sa vie dissipée, laissant à Honorine la liberté de sa tristesse.
La jeune femme en prit possession et s’y arrangea. Dans la jeunesse, les douleurs mêmes ont leur enivrement. Tel est alors le besoin d’agitation de notre âme que nous aimons mieux la sentir dans la lutte que dans l’immobilité; il semble que le malheur nous relève; nous nous trouvons honorés de souffrir comme ces enfants qui montrent orgueilleusement une blessure en disant:
—Maintenant, nous sommes des hommes!
Condamnée à l’abandon, Honorine accepta sa destinée avec une espèce de fierté valeureuse. Loin de chercher à éconduire sa douleur, elle lui donna place près d’elle et en fit comme l’ombre de son âme. Uniquement occupée de ce qui pouvait l’entretenir, elle promenait perpétuellement sa pensée au milieu des espérances mortes du passé ou des prévisions menaçantes de l’avenir. Elle espérait peut-être que cet acharnement implacable contre elle-même rendrait la lutte moins longue; car dans toute épreuve, la mort est le premier espoir de cet âge; mais, comme pour se jouer de cette illusion, la vie semblait s’épanouir en elle chaque jour plus invincible. Enveloppées de leur nuage de tristesse, sa force et sa beauté grandissaient comme ces plantes qui fleurissent sous l’orage. L’âme avait beau s’abreuver de désespoir, le corps échappait à ces influences mortelles et puisait la santé aux sources empoisonnées qui devaient lui donner la mort.
Nous avons déjà dit avec quelle impatience Honorine attendait la visite de Marc. Son œil consultait, à chaque instant, l’aiguille de la pendule, et son oreille quêtait le moindre bruit de pas; enfin, quelques minutes avant l’heure indiquée, on vint lui annoncer le commis en parfumerie.
Elle ordonna de le faire entrer et fit signe au valet de se retirer.
A peine avait-il disparu que la jeune femme se leva, courut fermer une seconde porte qui ouvrait sur le salon, puis se retournant:
—Enfin, je vous revois, dit-elle d’un accent rapide et contenu. Qu’êtes-vous devenu depuis trois mois, mon Dieu! Vous êtes pâle... Vous semblez avoir souffert? Que s’est-il donc passé, et pourquoi m’avoir abandonnée?
Pour toute réponse, Marc entr’ouvrit ses vêtements et montra sa poitrine que sillonnait une plaie à peine fermée.
Honorine étendit les deux mains en avant avec un cri d’horreur.
—Blessé! balbutia-t-elle.
—Voilà pourquoi vous ne m’avez point vu, dit Marc tristement; mais un protecteur plus puissant devait me remplacer; un ami qui pouvait avouer sa mission et faire valoir ses droits.
—M. de Saint-Alofe!
—Il est donc venu?
—Il est venu.
—Et son intervention n’a pu vous sauver?
—Elle n’a servi qu’à le perdre.
Elle raconta alors rapidement ce qui avait eu lieu et de quelle manière le marquis de Chanteaux avait fait exécuter le jugement qui déclarait M. de Saint-Alofe atteint de folie.
—Mais ce jugement est une erreur, et cette folie un mensonge, interrompit Marc.
—En êtes-vous sûr? s’écria Honorine.
—Depuis trois années, je connais M. le duc de Saint-Alofe; sa raison est aussi ferme, aussi saine que son cœur. On a profité de ridicules préventions, exploité des apparences pour le dépouiller de ses biens en lui ravissant sa liberté.
—Dieu! et c’est M. le marquis de Chanteaux?...
—Oui, un lâche dont j’ai eu l’honneur et la vie entre les mains. Ah! j’irai le trouver...
—Il est en Allemagne, interrompit vivement Honorine; mais ne peut-on profiter de son absence même pour délivrer le duc?
—Ouvertement, c’est impossible; il y a un arrêt.
—Eh bien! en secret, par la fuite, qui lui a déjà réussi une fois.
Marc parut réfléchir.
—Pour que la chose fût praticable, dit-il, il faudrait savoir où l’on a conduit M. de Saint-Alofe; le marquis l’a sans doute éloigné de Paris.
—Qu’importe! ne peut-on découvrir sa retraite à force de recherches?
—Peut-être; mais c’est un moyen long, dispendieux.
—Ah! n’épargnez rien, dit Honorine; j’ai été la cause involontaire de son arrestation. A tout prix il faut qu’il redevienne libre. Promettez une récompense à qui pourra découvrir sa prison, gagnez ses gardiens, aidez sa fuite; je fournirai à tout, je paierai tout.
Elle avait couru à un secrétaire qu’elle ouvrit, et où elle prit un rouleau d’or qu’elle présenta à Marc; celui-ci hésita à l’accepter.
—Ne pouvez-vous charger un autre de ces recherches, dit-il, tandis que j’agirai de mon côté?
—Pourquoi un autre? demanda la jeune femme; aurait-il la même activité, le même zèle? Qui pourrait d’ailleurs m’inspirer plus de confiance, que celui à qui j’ai été recommandée par ma mère?
—Vous avez raison, reprit Marc pensif; l’agent que vous choisiriez vous trahirait peut-être, car ici vous ne pouvez compter sur personne. Tous ceux qui vous entourent vendraient votre secret à M. de Luxeuil.
—A lui? Qu’en ferait-il? Que lui importe la captivité du duc ou sa délivrance, maintenant que notre union est irrévocable? Que peut-il craindre encore?
—Il peut craindre les conseils d’un attachement véritable et éclairé; tout ce qui vous protégerait lui fait peur, car il y trouverait un obstacle à ses projets.
—Que voulez-vous dire?
Avant que Marc eût pu répondre, deux coups furent frappés à la porte de la chambre, qui s’ouvrit presque en même temps, et Arthur parut sur le seuil.
Honorine ne put réprimer un geste de saisissement.
—Vous me pardonnerez si j’entre sans me faire annoncer, dit de Luxeuil, qui salua légèrement; mais je n’ai trouvé personne dans l’antichambre.
—J’avais pourtant ordonné à Baptiste d’y rester, répliqua Honorine.
—Pour défendre votre porte, peut-être, reprit de Luxeuil, qui examinait Marc d’un regard dédaigneux et scrutateur; vous étiez sans doute en affaire avec Monsieur?
—Je venais offrir à Madame différents articles dont le placement m’est confié, dit le garçon de bureau, qui affecta de reprendre le petit coffret à courroies qu’il avait déposé sur un fauteuil.
—Ah! vous faites la commission?
—Pour la parfumerie.
Arthur approcha de l’œil son lorgnon, examina de nouveau le prétendu commis-coureur, puis, se tournant vers Honorine, qui suivait ces mouvements avec inquiétude:
—Vous connaissez Monsieur? dit-il avec une intention marquée.
—Pourquoi cette question? demanda Honorine troublée.
—C’est que je jurerais l’avoir vu ailleurs, continua de Luxeuil en regardant Marc fixement.
Celui-ci releva la tête.
—Moi! dit-il; où cela, Monsieur?
—A la forge des Buttes: seulement, vous portiez alors un costume de paysan.
—Ah! je comprends alors, Monsieur aura vu mon frère qui habite Corbeil; c’est vrai qu’on l’a souvent pris pour moi.
—Et ce n’est pas le seul qui puisse donner lieu à cette erreur, ajouta Arthur, le regard toujours appuyé sur le commis-coureur, car votre ressemblance n’est pas moins frappante avec un garçon de bureau, demeurant rue des Morts.
Marc tressaillit.
—C’est en effet un hasard singulier, dit-il.
—D’autant plus singulier, continua de Luxeuil, que l’on vous retrouve encore, trait pour trait, dans un commissionnaire stationnant au coin du faubourg Saint-Honoré.
Cette fois Marc perdit contenance, et Honorine, qui avait suivi cette espèce d’examen avec une anxiété croissante, laissa échapper un geste effrayé.
—Vous ne soupçonniez point peut-être que monsieur eût tant de frères jumeaux, reprit ironiquement de Luxeuil. Mais en cherchant bien, je pourrais encore en trouver d’autres...
—Ce serait une recherche au moins inutile, interrompit Honorine, qui tremblait que l’explication ne se prolongeât.
—Beaucoup moins que vous ne le pensez, reprit Arthur. J’ai toujours eu l’infirmité de croire peu aux menechmes, mais je crois aux différents personnages joués par le même acteur, et si, à cet égard, le talent de monsieur mérite mon admiration, il excite en même temps ma défiance. Aussi voudrais-je savoir au juste le motif qui l’amène.
—Je croyais, répliqua Marc embarrassé, que M. de Luxeuil connaissait déjà...
—Le prétexte, interrompit Arthur; mais je demande la raison véritable... et puisque vous refusez de l’avouer, je vais vous la dire, moi!
Honorine pâlit.
—Vous venez ici, continua de Luxeuil d’une voix plus haute, pour vous emparer de secrets de famille dont vous espérez ensuite tirer profit; pour exploiter la crédulité d’une femme dont vos mensonges ont surpris la confiance; pour vous enrichir de la discorde que vous aurez préparée, et puiser à cette source dorée qui coule déjà pour vous.
—Qui vous a appris? s’écria Honorine stupéfaite.
—Voilà ce que vous venez faire, reprit Arthur sans prendre garde à l’interruption de la jeune femme; maintenant faut-il dire qui vous êtes?
Marc fit un geste de prière et de terreur.
—Cet homme, Madame, reprit Arthur en s’adressant à Honorine, porte aujourd’hui la chaîne de la police, après avoir porté celle du bagne!
Le garçon de bureau poussa un cri et voulut s’élancer vers de Luxeuil; Honorine se jeta entre eux, les mains en avant.
—Laissez, Madame, dit Arthur, qui avait avancé le bras vers la sonnette, nos gens sont là, et, grâce à leur intervention, nous pouvons avoir des preuves plus convaincantes de ce que j’avance.
—Des preuves, répéta la femme haletante, et lesquelles, Monsieur?
—La marque qui a brûlé l’épaule de cet homme, et la carte d’espion qu’il cache sur lui.
En prononçant ces mots il avait saisi le cordon de la sonnette; Honorine le retint.
—N’appelez pas, Monsieur, dit-elle; ne voyez-vous pas que toute intervention est désormais inutile!
L’élan de colère de Marc n’avait été, en effet, qu’un éclair; il venait de s’appuyer au mur, le visage caché dans ses mains. Il y eut une courte pause pendant laquelle les acteurs de cette scène étrange demeurèrent immobiles. La jeune femme contemplait le garçon de bureau écrasé sous la douleur et la honte, tandis qu’Arthur les enveloppait tous deux d’un regard ironiquement triomphant.
—Ainsi, c’est vrai! reprit Honorine; tout est bien vrai, mon Dieu!
—Non, dit Marc, en laissant retomber ses mains; non, tout n’est point vrai, Madame. Je ne suis venu ni pour surprendre des secrets ni pour en profiter. Ce qui est vrai, c’est la honte de mon passé, l’infamie du présent!... Tout le reste est un mensonge! Si je vous ai cherchée c’était pour accomplir un devoir. Celle qui me l’avait imposé SAVAIT CE QUE J’ÉTAIS, et cependant elle a eu confiance! Ah! si je pouvais dire!... Mais à quoi bon;... d’un mot on m’a flétri à vos yeux; maintenant vous ne pouvez avoir pour moi que du mépris!...
Il s’arrêta; une sueur glacée inondait son front, il pressa ses mains sur sa poitrine comme s’il eût voulu ralentir les battements de son cœur et un gémissement inarticulé lui échappa.
Honorine, partagée entre l’horreur et la pitié, s’était laissée tomber sur un fauteuil.
Marc reprit machinalement son chapeau et son coffret de cuir, lui jeta un dernier regard, puis disparut.
Cette scène laissa la jeune femme dans un état d’angoisse impossible à peindre. La révélation faite par Arthur bouleversait toutes ses résolutions et toutes ses espérances. Le protecteur qui se présentait à elle au nom de sa mère et avec le signe qui devait le faire reconnaître, était un misérable doublement déshonoré par sa révolte contre la société et par les services qu’il lui rendait! De Luxeuil avait-il donc deviné juste? Cette sollicitude mystérieuse n’était-elle que le calcul d’un escroc habile? Mais comment le croire, en se rappelant tant de services rendus, tant d’avertissements utiles? L’esprit de la jeune femme se perdait dans mille suppositions aussitôt détruites que formées. Elle ne pouvait ajouter foi aux coupables intentions prêtées à Marc et elle ne pouvait lui rendre sa confiance. Cet homme restait pour elle un inexplicable problème.
Ainsi, un nouvel élément de trouble était jeté dans cette vie déjà si tourmentée, et à toutes les souffrances de l’âme, venaient se joindre les anxiétés d’un esprit incertain.
De Luxeuil ne put ni les voir ni les deviner. Les renseignements obtenus par l’entremise de M. Moreau, lui avaient réellement donné sur Marc l’opinion qu’il avait exprimée, et il ne doutait pas que cette conviction ne fût désormais partagée par Honorine. Il ignorait les détails qui devaient maintenir celle-ci dans le doute et l’existence de ce fragment d’anneau qui constatait l’espèce d’autorité déléguée par la baronne. Aussi demeura-t-il complétement rassuré.
Trois mois s’écoulèrent ainsi. Marquier, un instant inquiet, n’avait point tardé à se rassurer et était devenu plus assidu que jamais. Quanta à de Luxeuil, le flot d’or que son mariage venait de lui apporter, avait exalté sa vanité jusqu’à la folie. Après avoir satisfait ses anciens créanciers au moyen des économies accumulées pendant la minorité d’Honorine, il s’en était créé de nouveaux. La facilité de l’emprunt lui était une sensation trop récente pour qu’il n’en abusât pas. Tout l’or qu’il se procura ainsi lui sembla, non pas retranché, mais ajouté à sa fortune; sa signature battait monnaie; il crut que ce don lui était acquis à jamais et voulut surpasser, en prodigalité, tous les princes de la fashion.
Il y eut une telle fougue dans ce premier élan d’extravagances que tout ce qu’il pouvait prendre des biens d’Honorine fut engagé au bout de quelques mois et qu’il se trouva ramené aux expédients.
Mais la royauté qu’il venait d’acquérir dans le monde élégant, chatouillait trop doucement sa vanité pour qu’il y renonçât si tôt et sans lutte. L’idée de déchoir d’ailleurs lui causait une sorte de rage. Il devinait d’avance les railleries de ceux qu’il avait écrasés par son luxe, l’insultante pitié des indifférents et le mépris de cette foule qui blâme ou approuve toujours selon l’événement. Aussi jura-t-il de prolonger autant qu’il lui serait possible et par tous les moyens, l’opulence apparente dans laquelle il avait placé son honneur.
Marquier était pour cela indispensable. Outre les avances qu’il lui avait déjà faites, il connaissait mille moyens de forcer les créanciers à des transactions, de procurer des signatures d’endosseurs fictifs, d’échapper à l’accomplissement de conventions gênantes. L’expérience lui avait appris à connaître tous ces guets-apens autorisés par la loi, qui font de ce que l’on appelle les affaires, une sorte de piraterie pacifique exercée par autorité des tribunaux de commerce et par ministère d’huissier.
Le banquier tenait ainsi de Luxeuil lié à lui par le plus indestructible de tous les liens, la nécessité! celui-ci continuait bien à se montrer railleur et dédaigneux, mais sous cette impertinence affectée se cachait la dépendance réelle; c’était l’orgueil du grand seigneur avec l’intendant qu’il peut maltraiter de paroles, mais auquel il obéit parce que de lui dépend sa ruine. Marquier comprit fort bien ses avantages et tâcha d’en profiter. Rassuré du côté d’Arthur, qui avait trop besoin de lui pour s’effaroucher de ses assiduités auprès d’Honorine, il avait fini par admettre, en riant, ses suppositions et par se proclamer le cavalier servant de madame de Luxeuil.
Ce titre, qui n’avait d’abord excité que la raillerie, prit insensiblement un caractère plus sérieux. On se dit, qu’après tout, l’isolement dans lequel vivait Honorine rendait le succès de Marquier possible; on cita des exemples de liaisons non moins bizarres. On apporta en preuve l’intimité persistante du banquier; enfin, ce qui n’avait été, dans le principe, qu’une moquerie contre ce dernier, devint, à la longue, une condamnation contre madame de Luxeuil.
Elle continua à l’ignorer et à recevoir, presque sans y prendre garde, les visites de Marquier. Sa froide réserve avait même, jusqu’alors, empêché celui-ci de s’expliquer. Enfin, enhardi par les félicitations de tous ses amis, qui le supposaient arrivé au but, il se persuada que sa modestie lui faisait illusion et qu’il était plus avancé dans les bonnes grâces d’Honorine qu’il ne l’avait pensé lui-même. Il s’accusa de lenteur, de timidité, et se décida à se déclarer sans plus de retards.
L’embarras d’un aveu fait de vive voix et la crainte de ne pouvoir trouver, avant longtemps, une occasion favorable, le décida à écrire. Il fit donc appel aux souvenirs qu’avaient pu lui laisser les romances de M. Bétourné ou les opéras de M. Planard, composa, après plusieurs essais, une lettre qui lui parut réunir toutes les qualités du genre, et résolut de la faire parvenir à la première occasion et sans intermédiaire.
Sur ces entrefaites, Honorine reçut la carte de Marcel de Gausson, qui venait d’arriver à Paris.
De Gausson se présenta à l’hôtel d’Honorine, dès le lendemain de son arrivée, à l’heure où elle recevait. Il trouva au salon madame de Biézi, de Cillart, le vicomte de Rossac et quelques autres.
Tant de témoins rendirent le premier abord contraint; mais quand la marquise fut partie, les visiteurs passèrent, l’un après l’autre, dans le salon voisin, et de Gausson resta seul avec la jeune femme.
La joie que tous deux éprouvaient à se revoir, était mêlée d’un sentiment d’amertume qui les empêcha d’abord de profiter de leur rapprochement. Le regard de Marcel, empreint d’une tristesse pensive, resta quelque temps comme oublié sur Honorine, tandis que celle-ci, muette et oppressée, agitait d’une main distraite le gland du coussin sur lequel elle était appuyée. Enfin, de Gausson chercha à excuser son silence par l’émotion d’une première entrevue, après cette séparation. Honorine répondit en se plaignant de n’avoir reçu aucune nouvelle pendant une si longue absence, et la conversation une fois engagée continua de plus en plus libre et expansive.
Cependant il était aisé de voir que Marcel s’était imposé une réserve sévère sur tout ce qui pourrait la ramener au passé. Chaque fois, que par une tendance naturelle, l’entretien menaçait d’y revenir, il s’en détournait avec effort, comme s’il eût craint de glisser trop loin sur cette pente des souvenirs.
Mais, tout en se défendant de ce qui eût pu paraître une allusion à des espérances mortes sans retour, il laissait, malgré lui, le secret de son âme s’échapper sous toutes les formes et par tous les côtés. Il parla longuement de la retraite où il avait passé ces mois d’absence, de ses occupations, de ses lectures, de ses rêveries, et, chaque détail dévoilait, à son insu, l’inguérissable tristesse dont il était atteint.
Honorine raconta également, non les faits survenus depuis leur séparation, mais ses regrets du passé, ses dégoûts du présent et de l’avenir.
Ainsi, sans y prendre garde, sans le vouloir, tous deux se révélaient le besoin qu’ils avaient l’un de l’autre: la plainte leur était douce par cela seul qu’elle leur était commune; à défaut de bonheur, ils échangeaient leur désespoir. En passant l’un près de l’autre, ils ne pouvaient se dire, comme les disciples de Rancé, que:—frère, il faut mourir; mais c’était du moins se parler!
Une heure entière se passa dans cet épanchement affligé qui a tant de charme pour les cœurs endoloris. En se plaignant ensemble, tous deux sentaient leur chagrin décroître, comme une eau dormante à laquelle on donne une issue; ils s’animaient insensiblement à la joie de se rencontrer dans les mêmes émotions, de se sentir les mêmes aspirations. En vain le sort les avait séparés, ils restaient unis de désirs, mariés par l’âme! déjà leur accent était plus rapide, leurs regards plus brillants, leurs gestes plus animés, le sourire épanouissait leurs visages éclairés l’un par l’autre; ils avaient oublié un instant tout le reste pour jouir du bonheur de se trouver ensemble, de se voir et de s’entendre.
L’entrée de Marquier les arracha à cet enivrement.
A la vue de Marcel le banquier s’avança d’un air empressé.
—Vous à Paris, monsieur de Gausson! s’écria-t-il; aviez-vous donc été averti du malheur qui menaçait Bouvard?
—Depuis deux jours seulement, répliqua Marcel.
—Et... vous vous trouvez intéressé à sa faillite? reprit le banquier avec précaution.
—J’avais chez lui à peu près tout ce que je possède, répliqua de Gausson simplement.
Honorine se retourna.
—Que dites-vous? s’écria-t-elle, votre fortune était entre les mains de M. Bouvard?
—Qui ne donnera que dix pour cent! ajouta Marquier.
—Mais c’est votre ruine alors, interrompit la jeune femme saisie.
—Je le crains, Madame, dit Marcel avec tranquillité.
Elle le regarda, puis joignit les mains.
—Et j’ignorais tout! reprit-elle; vous ne m’aviez rien dit?...
—A quoi bon vous attrister, répliqua de Gausson en souriant doucement; le malheur était irréparable; fallait-il donc perdre en explications financières le peu d’instants que j’avais à passer ici? Je dois l’avouer, d’ailleurs, en vous revoyant, Madame, j’ai oublié la cause de mon retour à Paris, et je n’ai songé qu’à la joie de me retrouver près de vous.
—Diable! c’est pousser la galanterie jusqu’au sublime! fit observer Marquier avec son sourire discordant; oublier que l’on perd cent mille écus!
—Et il n’y a rien à faire? demanda Honorine en s’adressant à Marcel.
—Je pars demain pour Lyon afin de savoir ce qui peut être sauvé, reprit de Gausson; mais j’ai peu d’espoir.
La jeune femme fit un geste d’admiration.
—Ah! je ne connaissais point encore tout votre désintéressement et tout votre courage, dit-elle attendrie.
—Mon Dieu, qui sait si je ne dois point bénir le hasard? répondit de Gausson. Ma vie n’avait plus de but, je languissais dans une oisiveté pleine d’angoisses, maintenant la nécessité va me rejeter dans l’action. Les forces que j’employais à me faire malheureux, il faudra les employer à me faire vivre. Le travail me sera une distraction, un soulagement; il me laissera moins de temps pour le souvenir. Ne croyez-vous point que ce soit une suffisante compensation, Madame, et qu’à tout prendre je puisse accepter ce malheur presque comme un bienfait?
Le sens voilé que renfermaient ces paroles n’échappa point à la jeune femme; c’était la première allusion faite par de Gausson à ce passé, dont les images s’agitaient toujours au fond de son cœur; elle en fut profondément émue et baissa la tête sans répondre.
Marcel qui se sentait lui-même gagné par un trouble auquel il craignait de céder, profita de la première interruption, pour passer dans la pièce voisine.
Après avoir serré la main à de Cillart, au vicomte et à quelques autres anciens compagnons, il prit un journal, afin d’éviter des conversations indifférentes, qu’il ne se sentait point en état de suivre, et alla s’asseoir au coin le plus obscur, vis-à-vis de la porte qui séparait les deux salons.
Là, le front penché, comme s’il eût été complètement absorbé dans sa lecture, il put repasser dans sa pensée tout ce qu’Honorine venait de lui dire; tous ses gestes, tous ses regards. Sans se demander le but de cette espèce d’examen, il comparait, dans sa mémoire, l’accueil présent de la jeune femme, à l’accueil passé de la jeune fille, et il y trouvait la même tendresse. A chaque instant son œil glissant sur la brochure qu’il tenait à la main, allait retrouver Honorine dans l’autre salon, où il la voyait pensive comme lui-même, et se détournant souvent pour le chercher du regard. Il n’osait encore rien conclure de ses remarques ni de ses comparaisons; mais son sang circulait plus vite; une sorte d’ivresse lui montait au cerveau; le nom d’Honorine flottait sur ses lèvres!...
Ce nom prononcé tout bas, à quelques pas, et avec un rire étouffé, l’arracha tout à coup à son extase. Il jeta un coup d’œil à la dérobée vers le groupe qui l’avait fait entendre, et reconnut d’Alpoda, de Rovoy et le vicomte.
—Moi, je vous déclare qu’elle se moque de lui, disait ce dernier; que diable, très-cher, il suffit de regarder. Physiquement, le petit homme ressemble à un hanneton en toilette.
—Et moralement il me fait l’effet d’un orang-outang élevé par la méthode de Lancastre, ajouta de Rovoy.
—Tout ce que vous voudrez, reprit d’Alpoda; je vous dis, moi, qu’il est parvenu à ses fins. Voyez plutôt comme il tourne autour de la dame... Malheureusement le docteur Darcy est près d’elle et lui intercepte les communications.
—Il est certain, objecta de Rovoy, qu’il a l’air de chercher quelque chose.
—Tenez, tenez, interrompit d’Alpoda, en saisissant de Rossac par le bras, il tient une lettre!
—C’est, ma foi, vrai!
—Reste à savoir ce qu’il en veut faire.
—Le voilà qui s’approche de la causeuse, reprit d’Alpoda; il avance la main, voyez, il prend le petit carnet que l’on a eu soin de mettre à sa portée; il y place la lettre... il le referme et il le rend à la dame!... Doutez-vous encore, maintenant?
—C’est-à-dire que c’est pour moi de la fantasmagorie; j’ai vu, mais je ne crois pas.
—Parbleu! nous allons interroger le banquier lui-même.
Celui-ci, enchanté d’avoir pu glisser son épître à Honorine, venait d’entrer dans le salon, où il s’approcha du groupe de jeunes gens.
—Eh bien! le tour est fait! dit d’Alpoda en riant.
—Quel tour? demanda Marquier.
—Celui de la lettre et du carnet.
Le banquier parut déconcerté.
—Allons, allons, mon bon, il est inutile de nier, reprit de Rovoy, nous avons tout vu de nos yeux, ce qui s’appelle vu.
—Et je vous en fais mon compliment, ajouta d’Alpoda.
—Le vicomte en a été confondu.
—Il n’est même pas encore bien sûr.
—Il est certain qu’elle ne laisse rien paraître.
—Avez-vous vu avec quel sang-froid elle a repris le carnet?
—Et puis, parlez de l’inexpérience de la jeunesse!
—Il ne faut pas oublier que madame Honorine a été élevée au couvent.
—Et qu’elle a reçu les instructions de la comtesse: Bon sang ne peut mentir.
—Plus bas, Messieurs, de grâce plus bas, interrompit Marquier, effrayé d’entendre les voix des trois interlocuteurs s’élever insensiblement. Songez que si l’on savait...
—Ainsi, vous êtes décidément le dieu du temple? demanda de Rossac qui ne pouvait cacher son étonnement.
Marquier sourit d’un air de fatuité.
—Permettez, cher ami, dit-il, en promenant autour de lui un regard précautionneux; vous comprenez que ce n’est pas à moi de déclarer... d’autant que j’ai toujours été cité pour ma discrétion. C’est à vous de juger s’il y a des preuves suffisantes...
Jusqu’à ce moment de Gausson avait tout vu et tout écouté dans une immobilité complète. La surprise d’abord, puis la douleur et l’indignation avaient pour ainsi dire suspendu en lui la faculté de l’action. Arraché à sa méditation exaltée par l’étrange révélation qui venait d’avoir lieu, il se trouva dans la position du fumeur d’opium qui s’éveille subitement d’un rêve enchanté pour se retrouver dans la fange du chemin. Cependant, au milieu même de ce vertige, aucun doute injurieux pour Honorine ne s’éleva en lui; il ne pouvait comprendre, mais il ne soupçonnait pas. Ce fut seulement en entendant les dernières paroles prononcées par Marquier que la présence d’esprit lui revint. A cet aveu détourné qui proclamait le déshonneur d’Honorine, il se leva comme réveillé en sursaut.
—Non, je n’accepte point la preuve, dit-il vivement.
—Tiens, Marcel nous écoutait! s’écria d’Alpoda.
—Je ne l’accepte point, continua de Gausson avec une gravité impérieuse, et si M. Marquier est un homme d’honneur, il rétractera ce qu’il vient de dire...
—Moi!... je n’ai rien dit, interrompit le banquier effarouché. J’ai au contraire protesté de ma discrétion...
—La discrétion suppose un secret à cacher, Monsieur, reprit impétueusement Marcel, et ce secret n’existe pas... Ne vous armez point d’une prétendue réserve qui en dit plus que la parole: le silence peut aussi calomnier.
—Permettez, balbutia Marquier d’un ton embarrassé qu’il eût voulu rendre conciliant, ce n’est point ma faute si ces messieurs ont vu...
—C’est juste! fit observer de Rovoy en s’adressant à Marcel; vous oubliez la lettre, mon cher.
—Toute la question est là, continua d’Alpoda.
—Sans la lettre je douterais comme vous, acheva le vicomte.
De Gausson regarda les trois jeunes gens. Il est des inspirations que rien ne peut expliquer, et auxquelles nous obéissons pourtant avec une irrésistible confiance, élans sublimes ou folles témérités, selon les chances et selon le succès, mais toujours également subites, également inattendues pour nous-mêmes. De Gausson se sentit emporté par un de ces mouvements pour ainsi dire involontaires. En entendant les doutes exprimés sur la lettre que Marquier venait de remettre, il fit un geste de résolution, quitta brusquement le groupe de jeunes gens, s’approcha d’Honorine, qui tenait toujours à la main le carnet d’ivoire, et le lui demanda à haute voix. La jeune femme le lui remit.
—Me permettez-vous de l’ouvrir, Madame? demanda de Gausson qui la regarda fixement.
—Pourquoi non? dit-elle en souriant.
—Êtes-vous sûre qu’il ne renferme rien de secret? insista Marcel.
—Vous n’y verrez que des titres de livres et des adresses, répliqua Honorine avec le même sourire.
De Gausson jeta un regard vers le groupe de jeunes gens, qui paraissaient stupéfaits.
—Alors, reprit-il, en ouvrant lentement les tablettes, si j’y trouve autre chose, ce ne peut être qu’à votre insu, et vous m’autorisez à tout lire.
—Bien volontiers.
—Même ce billet?
Il montrait la petite lettre du banquier. Celui-ci toussa convulsivement et fit des signes désespérés auxquels Marcel ne prit point garde.
—Un billet, répéta Honorine surprise, je ne sais ce que ce peut être.
—L’écriture même ne vous le fait point deviner? demanda de Gausson en montrant la lettre.
—Nullement, dit la jeune femme d’un ton si naturel et si calme que le doute même devenait impossible.
—Alors vous me permettrez de vous le faire connaître, reprit Marcel.
Et lançant un regard d’une froideur implacable sur Marquier, dont tous les traits exprimaient la colère, la honte et la peur, il commença lentement cette lecture.
Dès les premières lignes Honorine parut frappée d’étonnement, puis, comprenant tout à coup, elle arrêta de Gausson par un geste.
—Assez, s’écria-t-elle pâle et la voix tremblante, ce billet ne pouvait m’être adressé, Monsieur; ce serait une injure trop grossière, trop lâche, et dont je ne puis soupçonner aucun de ceux que je reçois ici; il y aura eu quelque erreur.
—Sans aucun doute, dit Marcel avec intention; mais il était important qu’elle fût éclaircie. Maintenant que les apparences ne peuvent tromper personne, vous disposerez de cette lettre...
—Soit, dit Honorine, en la prenant avec un ressentiment dédaigneux; mais ne voulant point chercher qui l’a écrite et ignorant à laquelle des servantes de l’hôtel elle était destinée, je ne puis que la faire disparaître.
Elle tordit le papier et le jeta au feu.
Le banquier sur le front duquel perlait une sueur glacée, poussa un soupir de soulagement. De Gausson rejoignit le groupe.
—Vous avez gagné la partie, dit de Rovoy émerveillé de ce qui venait de se passer.
—Je le disais bien, moi! continua le vicomte.
—Décidément Marquier est un fat, ajouta d’Alpoda désappointé.
De Gausson ne répondit rien, mais regardant le banquier, il dit gravement:
—Je ne pars demain qu’à midi; jusqu’à cette heure je serai chez moi.
—Irez-vous? demanda le vicomte à Marquier, lorsque Marcel fut parti.
Pour toute réponse le petit homme prit son chapeau et sortit par une porte opposée.
Il espérait encore qu’Honorine n’aurait reconnu ni son style, ni son écriture, et que le départ de Marcel le replacerait dans son ancienne position; mais lorsqu’il se présenta le lendemain à l’hôtel, on lui répondit que madame de Luxeuil ne pouvait le recevoir, et le même refus se renouvela les jours suivants.
Il comprit que tout était découvert et que la jeune femme avait rompu avec lui sans retour.
Ce renvoi honteux non-seulement trompait ses espérances, mais exposait sa vanité à la plus cruelle des humiliations. Toutes les félicitations qu’il avait précédemment acceptées, au sujet de sa réussite, se tournèrent forcément en condoléances et en moqueries. On savait maintenant qu’il n’avait été souffert si longtemps que grâce à son insignifiance même. Resté comme inaperçu, il avait été chassé le jour où il avait voulu avertir de sa présence!
Sa réputation amoureuse se trouvait ainsi compromise dès le début. Entré dans le royaume de la galanterie par la porte du ridicule, il ne pouvait plus y espérer de réussite, car les femmes du monde choisissent bien moins qu’elles n’imitent, et la plupart prennent un amant comme elles lisent un livre nouveau, non parce qu’il leur plaît, mais parce qu’il a plu à d’autres.
Cette conviction acquise par Marquier l’anima d’une violente rancune contre Honorine. Il s’arma de l’influence qu’il avait sur Arthur pour se venger par mille sourdes persécutions; il trouvait une sorte de joie à creuser plus profondément et plus vite le gouffre où ce dernier devait s’engloutir, dans l’espérance qu’il y entraînerait la jeune femme à sa suite.
De Luxeuil ne se prêtait que trop facilement à cette manœuvre. Saisi du vertige qui étourdit les glorieux, aux approches de la ruine, il se lançait chaque jour plus aveuglément dans la voie de perdition où il se trouvait engagé. Comme toutes les natures auxquelles, à défaut de sens moral, manque l’orgueil, il descendait insensiblement, et sans s’en apercevoir, de la corruption dans la bassesse.
Son mariage avait précipité cette chute. Aussi son indifférence pour Honorine se transformait-elle, peu à peu, en une sorte de haine. Honorine était tout à la fois un obstacle, un reproche et un contraste. Il trouvait d’ailleurs en elle, depuis quelque temps, une fermeté glacée qui aiguisait son irritation. Toutes ses sollicitations, tous ses ordres pour l’engager à recevoir de nouveau Marquier avaient été inutiles; il parut enfin y renoncer.
Cette trêve permit à Honorine de respirer. Le laborieux courage employé à se défendre l’avait tenue dans un état d’excitation qui l’avait épuisée. Incapable de rancune, elle déposa son hostilité dès qu’elle n’en eut plus besoin pour sa défense, et reprit, vis-à-vis d’Arthur, sa douceur inoffensive.
Soit que celui-ci fût réellement touché d’un oubli si prompt, soit qu’il éprouvât lui-même un besoin de repos, il se montra tout à coup plus bienveillant. Bientôt même, cette bienveillance commença à se traduire par des prévenances qui indiquaient une sorte de repentir; il évitait tout ce qui eût pu déplaire à Honorine, et montrait parfois, devant elle, des sentiments sympathiques dont l’expression semblait lui échapper. On eût dit qu’une révolution intérieure s’opérait en lui, à son insu et sous une influence invisible.
Honorine d’abord défiante, finit par croire à la possibilité d’un changement. Les nouvelles manières d’Arthur n’avaient effet aucun de ces caractères d’exagération qui peuvent faire douter de la sincérité; elles étaient modifiées plutôt que changées; on eût dit une crise dont le résultat restait encore incertain et qui pouvait également avorter ou réussir.
De Luxeuil entra un matin chez Honorine, un gros bouquet de violettes à la main.
—Je viens vous annoncer le printemps, dit-il en le lui présentant; l’offre n’est peut-être pas du meilleur goût, mais tout à l’heure, je traversais à pied les ponts, j’ai aperçu ces fleurs, et je me suis rappelé votre préférence.
Honorine prit le bouquet en remerciant, et s’étonna qu’Arthur fût sorti de si bonne heure.
—C’est vrai, je me dérange, dit-il; voilà plus d’une semaine que je me couche le soir et que je me lève le matin.
—Vous persistez donc dans votre réforme? demanda Honorine en souriant.
—Plus que jamais, répliqua de Luxeuil. Je ne sais comment il s’est fait que tout à coup la vie à laquelle je me laissais aller m’a paru insupportable; mais désormais je croirai aux conversions. Il faut que la mienne soit complète, car savez-vous à quoi je pensais tout à l’heure, en suivant les quais et en voyant bourgeonner les arbres des Tuileries?
—A quoi donc?
—A la campagne!
—Oui, Madame; je me disais qu’au lieu de passer sa vie dans cette prison de pierre qu’on nomme Paris, esclaves de mille plaisirs qui vous ennuient, il y aurait peut-être plus de sagesse et de bonheur à se faire une grande existence dans quelque beau domaine où l’on serait roi de soi-même.
—Quoi! vous pourriez accepter un pareil changement?
—Pourquoi non? il y a temps pour tout. On aime le tourbillon du monde pendant qu’il peut donner quelque émotion nouvelle; mais il vient un moment où l’on se lasse de tourner dans cette roue d’écureuil. Je sais bien que prendre un pareil parti serait se donner un ridicule éternel; il ne faudrait plus reparaître à Paris, mais, ma foi! on brûlerait ses vaisseaux.
—Parlez-vous sérieusement? s’écria la jeune femme.
—Très-sérieusement, reprit Arthur. Vous êtes sans doute surprise de me voir de pareilles idées? c’est la faute de Dovrinski.
—Comment cela?
—Vous savez que la princesse Goriska, sa tante, avait acheté un domaine près d’Orléans; Dovrinski en arrive et m’a raconté des merveilles. Il paraît qu’il y a des bois où l’on peut chasser le sanglier, un lac, des prairies immenses. La princesse fait exploiter par son intendant et a établi elle-même des écoles où sont instruits les enfants du voisinage, des hôpitaux où l’on guérit les malades. A force de faire le bien, elle oublie ses propres malheurs; elle n’a plus le temps d’y penser; c’est une sorte d’empire qu’elle a conquis là-bas; elle s’est proclamée la reine des pauvres et des cœurs affligés.
—Ah! combien je lui envie sa conquête! s’écria Honorine, dont ce récit venait d’éveiller le rêve favori.
De Luxeuil qui parcourait la chambre s’arrêta.
—Vous la lui enviez, répéta-t-il gaiement; eh bien, pardieu! il faut la lui acheter.
—Que voulez-vous dire?
—La princesse Goriska est obligée de repartir pour la Lithuanie, où sa mère la rappelle; elle cherche un acquéreur pour son domaine.
—Se peut-il!... Et vous consentiriez?... Oh! c’est une plaisanterie.
—Non, dit Arthur sérieusement; ce serait un moyen de rompre avec le passé, et je le saisirais avec joie. Cela vous paraît trop sage pour être vraisemblable, n’est-ce pas? mais les plus grands étourdis ont leurs moments de réflexion. Quoi qu’on fasse, il vient un jour, une heure où l’on s’aperçoit qu’en suivant la grande route avec la foule des masques, on perd son temps. Alors, qu’une trouée s’ouvre à droite ou à gauche, on en profite: c’est une occasion à saisir: si on la manque, tout est dit, et on continue avec le tourbillon; mais, dans le cas contraire, on recommence une vie nouvelle.
—Et comment ces idées vous sont-elles venues? demanda Honorine en regardant fixement de Luxeuil.
—Je vous l’ai dit, par suite de la rencontre de Dovrinski. Il m’a parlé avec un tel enthousiasme du bonheur de sa tante que j’y ai ensuite rêvé malgré moi: elle aussi avait épuisé les jouissances de Paris et allait périr d’ennui, lorsqu’elle est partie pour ce domaine où elle a retrouvé tout un monde de plaisirs inconnus. Pourquoi n’aurais-je point le même bonheur qu’elle? on peut vivre pour soi seul et se moquer du reste tant qu’on y trouve son plaisir; mais, en définitif, on ne peut pas être fanatique de son égoïsme, et, quand il ennuie, je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher d’essayer autre chose.
Tout cela était dit avec une sorte d’embarras, comme si le besoin d’épanchement eût arraché à de Luxeuil ces aveux, et que ses habitudes d’esprit le rendissent honteux de les faire. Il y avait évidemment chez lui une lutte et un effort. Honorine en fut frappée.
—Il faut acheter le domaine de la princesse Goriska, s’écria-t-elle vivement.
—Vrai? dit Arthur en dressant la tête; ce projet vous sourit?
—Il m’enchante.
—Ainsi vous accepteriez la continuation de l’œuvre commencée par la tante de Dovrinski?
—Ce serait pour moi un inexprimable bonheur. J’aurais enfin une occupation et un but.
Arthur la regarda.
—Oui, dit-il avec intention, ce sera un dédommagement; cela détournera votre pensée de votre propre situation... vous pourrez oublier...
Honorine voulut l’interrompre.
—Oh! vous avez raison, continua-t-il précipitamment, il vaut mieux ne point toucher à ce sujet, et cependant j’aurais tant à vous dire!... mais plus tard... quand nous aurons commencé ensemble une nouvelle existence et que la communauté de l’œuvre accomplie nous aura rapprochés... car je veux prendre part à vos efforts, Madame; je veux savoir s’il m’est encore possible de devenir bon à quelque chose... pourvu toutefois que vous ne refusiez point mon aide?
—Je vous le demande, dit Honorine d’un accent de douce cordialité.
—Alors tout est pour le mieux, reprit Arthur gaiement, je serai votre intendant, votre économe; on dit que les prodigues réformés sont excellents pour cela. Je tiendrai les comptes... Mais à propos de comptes, nous recommençons ici celui que faisait Perrette avec son pot au lait... Et l’argent nécessaire pour l’achat du domaine?
—Ah! mon Dieu! je n’y pensais pas! s’écria Honorine.
—J’y ai pensé, moi, reprit de Luxeuil; il suffirait de cent mille écus comptant, le reste se paierait plus tard.
—Mais comment trouver ces cent mille écus, objecta la jeune femme... Si je vendais quelques fermes?
—Ce serait un moyen, dit Arthur; mais lent, dispendieux et qui, de plus, tournerait à votre désavantage, car les fermes vendues n’appartiennent qu’à vous seule et le domaine acheté deviendrait une propriété commune; ce serait donc vous dépouiller à mon profit, ce que je ne puis permettre.
—Que faire alors?
—Offrir ces fermes pour gages sans vous en dessaisir, et emprunter les cent mille écus. Notre séjour à la campagne nous permettra de réaliser bien vite des économies, avec lesquelles on pourra rembourser la somme due; de cette manière vous aurez acquis un nouveau domaine sans avoir engagé ce que vous possédez déjà.
La jeune femme approuva l’expédient, et il fut convenu que de Luxeuil s’occuperait sur-le-champ de négocier l’emprunt nécessaire.
Le projet qu’il venait de suggérer à Honorine répondait trop bien à ses aspirations pour ne pas s’emparer de tout son être. Pendant le reste du jour, elle ne put songer à autre chose. Comme toutes les femmes qui n’ont pu trouver dans l’amour satisfait l’emploi de leurs facultés expansives, Honorine éprouvait un immense besoin de charité; ce cœur, malgré lui refermé, eût voulu répandre sur tous le trop plein de tendresse qu’il n’avait pu vouer à un seul.
Puis, le changement survenu chez Arthur lui inspirait je ne sais quelle reconnaissance attendrie. A cet espoir de rencontrer un frère, là où elle avait eu jusqu’alors presque un ennemi, elle remerciait Dieu tout bas, elle se sentait plus confiante. Aussi, lorsque de Luxeuil revint le soir, en lui annonçant qu’il avait trouvé les cent mille écus, et que tout pourrait se conclure dans quelques jours avec la princesse Goriska, qui arrivait à Paris, elle ne put retenir une exclamation de joie et elle lui tendit la main.
Celui-ci se montra touché de ce témoignage d’affection, le premier qu’il eût reçu de la jeune femme depuis son mariage, et lui proposa, pour bien achever la journée, de la conduire au Théâtre-Français.
C’était une condescendance dont Honorine devait se montrer d’autant plus reconnaissante que, comme tous les gens d’un certain monde, Arthur avait témoigné habituellement un dédain affecté pour notre première scène littéraire; car c’est un signe remarquable et singulièrement concluant que cette répugnance de toutes les aristocraties pour les spectacles capables d’éveiller la pensée. A Rome, les patriciens abandonnaient les représentations de Térence pour écouter des joueuses de flûte ou des mimes habiles à imiter le cri des animaux; à Paris, l’élite du monde élégant déserte Molière, le Sage, Beaumarchais, Corneille, pour assister à un ballet ou pour entendre un ut de poitrine; c’est qu’aussi les spectacles lyriques satisfont les deux goûts dominants des classes oisives: la vanité et la paresse. Plus dispendieux, ils prouvent la richesse du spectateur; plus bruyants et plus splendides, ils occupent ses sens et laissent en repos son intelligence. Avec eux, on est moins exposé à ces appels qui réveillent spontanément la pensée, à ces émotions qui nous arrachent, malgré nous, à notre égoïsme; à ces leçons ironiques ou saisissantes dont notre conscience est involontairement gênée. La musique de théâtre n’a point de prétentions dogmatiques; elle n’enseigne pas; aidée des prestiges de la mise en scène, elle amuse, elle anime, elle caresse, mais sans rien nous demander; c’est une belle esclave qui chante, seulement pour plaire.
Madame des Brotteaux arriva au moment où Honorine allait partir et la suivit au spectacle, avec sa nonchalance habituelle, sans savoir où elle allait. En se trouvant au Français elle jeta les hauts cris et déclara que c’était une trahison. Heureusement que son indolence prévenait les longues plaintes. Une fois assise elle retomba dans cette somnolence éveillée qui faisait sa vie, appuya son beau bras d’albâtre sur la balustrade et se mit à lorgner dans la salle avec distraction.
Quant à Arthur, il avait pris son parti et s’était placé au fond de la loge, bien décidé à ne rien voir ni à ne rien entendre.
Mais les vers de Molière et de Corneille, commentés par les applaudissements du parterre, l’associaient, malgré lui, à la représentation. Cherchant à y échapper, et, ramené sans cesse à une attention forcée, il éprouvait l’impatience que donnent les efforts infructueux.
De son côté, Honorine était tout entière au spectacle. Emportée d’abord par la tragédie vers cette atmosphère sublime où tout ce qui est petit dans l’humanité s’efface, et où les hautes passions apparaissent avec leur majestueuse simplicité, elle venait de redescendre, grâce à Molière, au milieu du monde réel dont les vices se montraient à elle en personnifications vivantes. Au serrement de cœur enivré que donne l’admiration, avait succédé l’épanouissement joyeux qui naît de la gaieté sincère, lorsque M. Darcy entra dans la loge.
A sa vue, madame des Brotteaux fit un geste de joie.
—Ah! enfin, voici quelqu’un! s’écria-t-elle.
—Je viens seulement de vous apercevoir, répondit le médecin en saluant, et j’ai cru d’abord que je me trompais. Par quel hasard vous trouvez-vous ici?
—Madame de Luxeuil a désiré venir, dit Arthur.
—Et je l’ai suivie sans savoir où j’allais, ajouta Hortense; c’est un vrai piège; croiriez-vous, docteur, que vous êtes notre premier visiteur?
—En vérité?
—Mais il est donc tout à fait abandonné, ce théâtre?
—Mon Dieu, oui, dit M. Darcy avec une fausse bonhomie; il ne vient absolument que du public. Vous voyez, tout est plein... Mais, comme vous dites, il n’y a personne.
—Et comment peut-on voir de vieilles pièces que tout le monde connaît?
—Ce sont les seules dont la critique ne dise point de mal.
—Nos auteurs ne font donc plus rien qui vaille?
—Rien, Madame. Nous avons une douzaine d’hommes d’esprit chargés de donner cette nouvelle une fois par semaine à la France entière. Grâce à eux, nous savons qu’il ne s’écrit rien qui ait le sens commun, sauf leurs articles. La république des lettres est frappée de stupidité depuis qu’ils s’occupent de la régenter. Dieu sait pourtant que ce n’est point leur faute si les écrivains s’égarent! chacun d’eux connaît au juste la route du beau, et l’indique à tout venant: seulement, l’un dit de tourner à droite, tandis que l’autre recommande de tourner à gauche; de sorte que les plus sages passent tout droit sans les écouter.
—A la bonne heure, dit madame des Brotteaux, qui s’intéressait médiocrement à cette tirade contre la critique; mais que la faute en soit à qui vous voudrez, on ne peut venir à ce théâtre. Voyez plutôt, pas une toilette! il semble que ces gens ne soient ici que pour écouter.
—En voilà au moins un qui est venu pour voir, fit observer M. Darcy, en désignant à Hortense un homme enveloppé dans un manteau, qui tenait les yeux fixés sur leur loge avec une persistance singulière.
Madame des Brotteaux tourna sa lorgnette du côté indiqué.
—Que regarde-t-il donc si fixement? demanda-t-elle.
Honorine qui, tout occupée des sentiments réveillés chez elle par la représentation, n’avait pris jusqu’alors aucune part à la conversation, fut pourtant frappée de ces derniers mots; elle tourna machinalement les yeux vers le point que lorgnait madame des Brotteaux, et reconnut Marc.
Celui-ci remarqua sans doute qu’il avait été aperçu, car il quitta presque aussitôt la galerie. Mais son apparition ramena Honorine à des souvenirs et à des doutes déjà connus du lecteur. C’était la première fois qu’elle le revoyait depuis le jour où Arthur lui avait appris ce qu’il était, et cette rencontre lui causa un battement de cœur involontaire. Cet homme, quel qu’il fût, était lié à sa destinée par quelque nœud mystérieux qui l’effrayait et la rassurait tour à tour.
Elle se pencha en avant, après son départ, pour savoir s’il ne reparaîtrait point dans une autre partie de la salle. Mais toutes ses recherches furent inutiles.
Elle allait se retourner vers le théâtre, lorsque ses yeux rencontrèrent une main appuyée sur le bord de la loge voisine. Au petit doigt brillait l’anneau incomplet, à chaton d’émeraude, qui lui avait été déjà présenté une fois.
Elle avança la tête et reconnut Marc, de l’autre côté de la cloison de velours qui séparait les deux loges. Il semblait lire à voix basse un journal qu’il tenait à la main; mais Honorine reconnut son nom confusément prononcé; elle tourna l’oreille de son côté, affectant de regarder à la galerie opposée, et entendit distinctement ces mots:
—Il faut que je vous parle!... Si vous m’entendez sans que vos voisins s’en aperçoivent, levez la main...
Honorine hésita une seconde, puis leva la main.
—Je ne vous demande pas de confiance, reprit la voix d’un ton oppressé... Je sais ce que vous devez penser de moi... Aussi je ne vous dirai pas de croire, mais seulement d’écouter... Dans le cas où vos voisins m’entendraient, avancez votre éventail pour m’avertir.
Honorine fit le signe affirmatif convenu; Marc reprit, les yeux toujours sur son journal:
—Il y a un complot formé contre vous.
Elle se retourna en tressaillant.
—Prenez garde! reprit la voix précipitamment; ne faites aucun mouvement qui puisse avertir que je suis là... il y va de notre salut à tous deux.
La jeune femme appuya le coude au bord de la loge et regarda vers le théâtre d’un air indifférent.
—Votre mari ne se montre-t-il pas plus empressé et plus affectueux depuis quelques jours? demanda Marc.
Elle souleva la main.
—Et vous n’avez point deviné la cause de ce retour?
Honorine demeura immobile.
—Eh bien! la voici, reprit Marc plus vivement; M. de Luxeuil espère...
—Qu’est-ce donc que ce marmottage que j’entends à côté? demanda tout à coup Arthur.
Honorine avança vivement son éventail.
M. Darcy, qui était debout, se pencha en avant pour regarder dans la loge voisine. Marc continua les yeux toujours fixés sur son journal:
—...Ce qui est une chose difficile, vu l’acharnement des partis dans la Péninsule. On vient encore de fusiller...
—C’est un honnête bourgeois qui prend une leçon de lecture dans la gazette, fit observer le docteur, en reculant au fond de la loge.
Marc continua:
—...De fusiller une douzaine de carlistes, et jusqu’à présent rien n’annonce la pacification...
Honorine retira son éventail; le lecteur retourna la feuille du journal, jeta un regard de côté et reprit rapidement:
—Il espère regagner votre confiance... obtenir de nouveaux sacrifices d’argent. Il l’a promis à la femme qui achève sa ruine. Je ne puis vous en dire davantage, la pièce va commencer; mais tenez-vous sur vos gardes, et surtout ne donnez aucune signature!...
L’entrée en scène des acteurs l’interrompit; il replia son journal, et, quelques instants après, Honorine entendit la porte de sa loge se refermer.
L’avertissement de Marc surprenant Honorine au milieu de son enchantement, l’avait rejetée dans toutes les anxiétés du doute. L’accusation portée contre Arthur était-elle véritable, ou n’était-ce qu’une vengeance de l’homme qu’il avait peu auparavant démasqué?
La jeune femme résolut de s’éclairer par tous les moyens. Elle avait appris aux dépens de sa vie entière la nécessité de la prudence; elle se promit de ne s’engager qu’après de plus amples renseignements.
Ainsi qu’il l’avait promis, de Luxeuil se présenta le lendemain avec l’acte d’emprunt qu’elle devait signer.
—Eh bien! dit-il en souriant, avez-vous bien pensé, depuis hier, à notre projet?
—Beaucoup, répondit Honorine.
—Et l’espérance de remplacer la princesse dans sa douce royauté vous paraît-elle toujours aussi charmante?
—Toujours, Monsieur, pourvu qu’elle puisse s’accomplir.
Arthur lui montra l’acte.
—Voici le talisman qui vous en donne l’assurance, et au moyen duquel vous deviendrez reine.
—Cet acte ne peut rien sans la volonté de la princesse Goriska, fit observer Honorine, et, avant tout, il faudrait au moins s’en assurer. Je viens de lui écrire à ce sujet.
De Luxeuil tressaillit.
—Vous avez fait partir la lettre? s’écria-t-il.
—Elle partira dans un instant, reprit la jeune femme; mais avant toute proposition, il reste à s’assurer de l’exactitude de nos calculs, et à savoir si nous pourrons faire face aux obligations que nous voulons contracter. Je veux consulter pour cela M. des Brotteaux.
De Luxeuil, sur les traits duquel s’étaient succédé les expressions de l’étonnement, de l’impatience, du dépit, s’avança tout à coup, et, regardant Honorine en face, il lui dit brusquement:
—Vous avez vu quelqu’un qui vous a prévenue contre le projet que vous aviez accepté hier? reprit-il plus vivement.
—Vous vous trompez, Monsieur, interrompit Honorine, qui saisit le moyen offert de déplacer la question: je ne désire pas moins qu’hier la réussite de ce projet. Je veux savoir seulement si son exécution est possible...
—Dites qu’on a éveillé vos soupçons, reprit impétueusement de Luxeuil; ne cherchez pas à le nier.
—Je ne nie rien, Monsieur... mais quoi que l’on ait pu m’apprendre, je vous le répète, mes désirs ne sont point changés. Je ne demande qu’un délai, indispensable pour m’éclairer.
—Et moi, je ne puis l’accepter, s’écria Arthur poussé à bout par cette résistance inattendue: ma parole est engagée; l’argent doit être remis aujourd’hui même, voici l’acte, vous allez le signer.
Il s’était fait dans le ton de M. de Luxeuil un changement dont la jeune femme fut saisie. C’était son accent d’autrefois, dur, méprisant, impérieux; il y avait de la menace dans son attitude, et son regard exprimait la haine.
Elle sentit revenir toutes ses répugnances.
—Vous ne persisterez pas dans une pareille exigence, dit-elle avec fermeté; là où je suis seule responsable, votre parole ne peut être engagée, et je ne comprends pas bien la nécessité que l’argent vous soit remis aujourd’hui même.
Elle appuya sur ces mots qui l’avaient frappée.
—Que voulez-vous dire, Madame? demanda Arthur d’une voix troublée.
—Je veux dire, reprit-elle, en le regardant pour étudier l’effet de ses paroles, qu’une telle précipitation à emprunter ne pourrait être justifiée que par un besoin immédiat de satisfaire à des obligations ou à des promesses secrètes.
Arthur pâlit.
—Qui vous a appris?... demanda-t-il.
—C’est donc vrai? acheva vivement Honorine.
Il fit un geste violent. La contrainte qu’il s’imposait depuis tant de jours avait épuisé sa patience. Mal à l’aise et honteux sous son masque hypocrite, il l’arracha lui-même dès qu’il se vit reconnu, et s’écria avec explosion:
—Marc vous a parlé, Madame! vous savez tout!
—Oui, dit Honorine.
—Alors les détours sont superflus, continua-t-il avec emportement; laissons là nos rôles et finissons sur-le-champ. Je ne sortirai point avant que vous ayez signé ce papier.
—Et moi, Monsieur, je refuse, dit Honorine troublée, mais résolue.
De Luxeuil posa l’acte sur le bureau, prit une plume et la présenta.
—Croyez-moi, signez, Madame, reprit-il d’un accent bref et strident: ne me poussez pas à bout; ne me forcez point à chercher quel droit peut avoir sur votre volonté le misérable dont vous écoutez les conseils. Signez sur-le-champ, je le veux; entendez-vous, Madame, je le veux!
Il avait forcé Honorine à prendre la plume qu’il lui présentait, et l’avait entraînée de force vers le bureau.
—Monsieur! s’écria la jeune femme en résistant, vous ne voudriez point employer la violence.
—Signez! répéta de Luxeuil, qui serrait avec rage sa main et qui la conduisait jusqu’au papier.
Honorine se dégagea par un effort violent et courut à la porte.
—Arrêtez, Madame, s’écria Arthur en lui barrant le passage; songez bien à ce que vous allez faire.
—Faut-il appeler à mon secours, Monsieur? interrompit la jeune femme indignée.
—Il faut que vous m’écoutiez! reprit de Luxeuil les bras croisés sur la poitrine; il faut que vous sachiez que cet argent m’est nécessaire; que lui seul peut me sauver; que je le dois enfin!... Oh! je sais ce que vous pouvez me répondre. Vous n’êtes pas responsable de mes prodigalités; ma ruine n’est point la vôtre! mais l’honneur du moins nous est commun. Ecoutez donc bien, Madame, et tâchez de comprendre! Vous êtes résolue à m’abandonner, n’est-ce pas, à me pousser du pied dans l’abîme au lieu de me tendre la main! Eh bien! moi, je suis résolu à vous y entraîner avec moi! Le nom que vous refusez de mettre au bas de cet acte, je l’écrirai!
—Mon nom? s’écria Honorine.
—Oui, reprit de Luxeuil qui avait posé l’acte sur la table; vous aurez à choisir entre l’argent et le scandale, car si vous protestez contre cette signature la honte rejaillira sur vous!
Il avait saisi la plume; Honorine s’élança vers lui en poussant un cri.
—Non, dit-elle, vous ne ferez point cela, Monsieur!... ce serait un crime!
De Luxeuil se pencha sur l’acte sans répondre.
—Au nom de votre honneur, Monsieur!...
Il approcha le papier.
—Eh bien! reprit Honorine, donnez!...
Elle tendait la main vers la plume... Arthur se redressa et la lui présenta. Mais ce mouvement fut si prompt, l’éclair de triomphe qui traversa ses yeux si subit, que la jeune femme fut comme illuminée. Elle s’arrêta en regardant de Luxeuil:
—Ah! c’était encore un piége, s’écria-t-elle, je ne signerai pas!
Arthur qui était déjà pâle devint livide. Les dents serrées, l’œil dilaté et les poings fermés, il demeura un instant comme paralysé par la violence même de sa colère. Cette subite intuition de la jeune femme avait plongé jusqu’au fond de sa bassesse; de nouveaux détours étaient désormais impossibles; il se trouvait deviné tout entier!
L’élan de rage dont il fut saisi à cette pensée lui donna le vertige; il fit un pas vers Honorine, qui s’était réfugiée près de la fenêtre avec une exclamation d’épouvante; mais il s’arrêta tout à coup, passa la main sur son front, revint vers la table, y prit l’acte qu’il froissa avec une sourde fureur, puis se tournant vers la jeune femme:
—Aussi longtemps que vous vivrez, dit-il d’un ton bas, vous vous rappellerez cette heure, Madame! Tout ce que je pourrai vous faire subir de tourments et d’humiliations, je le ferai! A partir de cet instant, je suis votre ennemi!...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le jour commençait à tomber, mais de Luxeuil, les deux pieds posés sur ses chenêts, les bras croisés et la tête penchée, ne s’en apercevait point. Plongé dans une rêverie sombre, il repassait confusément les souvenirs de ces dernières années, et toujours sa pensée, après quelques détours, revenait se heurter à son dernier échec. Alors une rougeur rapide lui montait au visage; il s’agitait avec une crispation de colère et cherchait comment il pourrait se venger.
Ce qui venait de se passer entre Honorine et lui avait brisé leurs derniers liens. Elle l’avait surpris dans son mensonge, dédaigné dans ses menaces; il s’était inutilement avili! La plus vivace de ses passions, la vanité, était désormais intéressée à sa haine. Décidé à rendre au centuple l’humiliation qu’il avait eu à subir, il cherchait avec une ardeur furieuse, le point par lequel il pourrait frapper ce cœur et le faire saigner...
Il fut interrompu dans sa recherche par le valet de chambre qui lui annonça qu’une dame voulait lui parler. De Luxeuil étonné allait demander son nom, lorsque la porte fut ouverte brusquement et lui laissa voir Clotilde, en grande toilette de ville.
Il se leva stupéfait.
—Ah! tu ne t’attendais pas à ça, mon petit, dit l’actrice, en éclatant de rire, en v’là une farce, hein? Avoir osé pénétrer dans le domicile conjugal!
—Toi ici, s’écria Arthur, qui ne pouvait comprendre une pareille démarche, que viens-tu faire?
—Je passais avec de la société, reprit Clotilde, j’ai reconnu ton domestique à la porte de l’hôtel, alors on a dit:—C’est là que ton monsieur demeure; tu devrais l’emmener dîner avec nous; j’ai tout de suite fait arrêter et je viens te chercher.
—Tu n’es donc pas seule?
—Non, il y a avec nous Léa; tu sais bien, la grosse qui est tant sur sa bouche, puis Phrosine, que je veux lancer, enfin le grand Derval.
—Qu’est-ce que c’est que le grand Derval?
—Ah! oui, tu ne l’as jamais vu! C’est un farceur, premier numéro. Il a joué toutes espèces de rôles en province; maintenant il va dans les soirées pour faire des scènes de ventriloque et de physionomies. Il imite à votre choix Napoléon, Odry, Lepeintre jeune et le gladiateur mourant. Du reste, tu le verras, mais dépêche-toi, car ils t’attendent.
—J’en suis fâché, dit Arthur, qui était encore sous l’influence de son irritation et peu disposé à s’amuser; mais je n’irai pas.
—Par exemple! tu as donc une affaire?
—Oui.
—Eh bien! tu la remettras; je veux que tu viennes. Voyons, Fifi, soyez gentil; vite vos gants, votre chapeau, et ne serrez pas les lèvres comme si vous jouiez de la clarinette.
Elle avait appuyé un de ses bras sur l’épaule d’Arthur, et penché sa figure pour qu’il l’embrassât; il voulut résister à cette avance.
—Non, reprit-il d’un ton bourru; je ne veux pas sortir.
—Alors, dit l’actrice, c’est que tu dînes en famille?
De Luxeuil fit un signe négatif.
—Ou que tu conduis ton épouse en soirée?
Il haussa les épaules.
—Non plus? répéta Clotilde; dans ce cas, mon cher, vous n’avez pas d’empêchement; c’est un caprice.
—Quand cela serait!
—Ah! tu l’avoues! s’écria-t-elle; tu n’as d’autre raison que:—Je ne veux pas! Une vraie raison de directeur. Eh bien! mon bon, moi je te répondrai que je le veux, et je te déclare que je ne m’en irai qu’avec toi!
—Alors tu ne t’en iras pas, dit Luxeuil qui étendit les pieds sur le garde-feu.
—Est-il aimable! reprit mademoiselle Beauclerc après une courte pause; moi qui avais promis qu’il nous ferait dîner au Rocher de Cancale. Il faut donc maintenant que j’aille les désinviter?
—Comme tu voudras.
—Eh bien! non, s’écria l’actrice avec une résolution subite; je vais les chercher pour les amener ici.
—Comment!
—Puisque tu ne veux pas nous conduire au restaurant, je fais invasion dans le domicile légitime et je demande à dîner; tant pis s’il y a de l’esclandre.
La menace de Clotilde était une plaisanterie, et n’avait d’autre but que de décider Arthur; mais, à son grand étonnement, celui-ci redressa la tête comme s’il eût pris la chose au sérieux.
—Dîner ici, répéta-t-il... pardieu! c’est une idée... et j’accepte!
L’actrice le regarda.
—Tu veux te moquer? dit-elle.
—Va chercher les autres, reprit de Luxeuil en se levant.
—Quoi, vrai? tu nous recevras?
—Je vous recevrai.
—Mais la bourgeoise est donc absente?
—Non.
—Et tu n’as pas peur que ça la vexe?
—Va les chercher! te dis-je.
—J’y vais, j’y vais, dit Clotilde. Ah bien! en voilà un apologue! venir manger à la table légale! c’est un peu fort de café, mais pas commun; aussi ça me sourit; je reviens tout de suite, mon petit.
De Luxeuil sonna pour donner les ordres nécessaires et mademoiselle Beauclerc reparut bientôt avec Léa, Euphrosine et le grand Derval.
La première seule était connue d’Arthur. Actrice comme Clotilde, et citée quelques années auparavant pour sa beauté, elle avait acquis depuis un développement de formes qui menaçait d’en faire quelque jour une reproduction de madame Beauclerc. Son embonpoint avait pourtant quelque chose de maladif et de factice. On l’eût dit victime d’un de ces engraissements artificiels, appliqués par les Anglais à leurs troupeaux. Au moral, Léa qui avait joué le drame de l’école moderne avait des tendances avouées à la mélancolie et affectionnait le style échevelé. Les détails gastronomiques pouvaient seuls l’arracher à son rôle d’ange exilé; à table ce n’était plus qu’un ange à l’engrais.
Euphrosine était une jolie brune de dix-huit ans, sortant du Conservatoire et attendant, comme Cendrillon, la fée bienfaisante qui devait lui donner des cachemires, des diamants et un équipage.
Quant au grand Derval, ce qu’en avait dit Clotilde suffisait pour le faire comprendre. Parasite doublé d’un bouffon, il appartenait à cette classe de Falstaffs contemporains, riant également des vices, de la vertu, d’eux-mêmes, et qui, à force d’indifférence, arrivent parfois à la profondeur. Son visage était maigre et pâle, sa voix cassée, son costume d’une propreté douteuse. Tout en lui révélait enfin je ne sais quelle effronterie flegmatique dont on demeurait frappé dès le premier abord.
—Nous voici, s’écria Clotilde en entrant, ils ne voulaient pas me croire quand je leur ai dit que nous restions à l’hôtel.
—Nous n’avions aucun droit pour être reçus au foyer domestique de M. de Luxeuil, fit observer Léa.
—Alors vous devez me payer mon hospitalité, ma belle, dit Arthur qui essaya de l’embrasser.
Léa voulut se défendre.
—Laisse, laisse, ma chère, dit Derval tranquillement, tu n’es pas ici chez les montagnards écossais où l’hospitalité ne se vend jamais, mais dans cette belle France qui a dit par la bouche de Cambronne: Les dîners se paient et ne se donnent pas.
—Alors réglez la carte tout de suite, ajouta Clotilde.
Et elle poussa Euphrosine vers de Luxeuil qui l’embrassa également.
—Après la grosse pièce le dessert, acheva Derval toujours flegmatique.
—Tu ne la connaissais pas, reprit l’actrice en désignant la jeune fille; c’est la sœur de Rose avec qui j’ai fait ma première communion; aussi je veux tâcher de la servir.
—Je vous aiderai, dit Derval; je connais justement un marquis.
—Vous!
—Oui, ma belle, un vieux.
—Quel âge a-t-il?
—Quarante mille livres de rentes.
—Est-il généreux?
—Il est affreusement laid.
—Tiens, ça pourrait convenir alors, dit Clotilde; faudra que tu nous reparles de ça, mon chéri; l’enfant a des dispositions; il suffit de la lancer; après, ça ira tout seul.
—Je crois plutôt que ça ira en compagnie.
—Allons, farceur! dites pas de bêtises, voyons; faut penser que nous sommes dans une maison décente. Vous aurez de la tenue à table, Floridor.
—Oui, monsieur Derval, ajouta Léa prétentieusement; veuillez ménager mes oreilles de femme: il y a des paroles qui sont une souillure, et puis, à table, ça détourne de manger.
—Vous m’excuserez si je vous traite sans façon, fit observer Arthur; j’ai été pris à l’improviste.
—Connu! interrompit Clotilde; nous aurons le pot-au-feu de l’amitié.
—Cuisine bourgeoise; on porte en ville! ajouta Derval dit Floridor, comme s’il lisait une enseigne.
—Mais il y a la cave pour nous dédommager, fit observer Clotilde; faudra nous servir du Tokai... un vin qui vaut cinquante francs la bouteille, ma petite.
—Cinquante francs la bouteille! répéta Euphrosine d’un ton d’admiration mêlé d’envie.
—Tu nous en feras boire aussi quelque jour.
—Ah! je ne demande pas mieux. Si seulement je pouvais faire la connaissance de ce marquis! mais j’ai peur que ce soit une charge de M. Floridor.
—Pardonnez-moi, ma chère, répliqua le grand homme maigre, c’est une charge de l’État, vu que ledit vieillard est pair.
—Un marquis, duc et pair! s’écria Euphrosine; voilà qui serait une chance! il nous aurait donné des billets pour Fieschi!
—Nous verrons, nous verrons, ma chatte, reprit Clotilde d’un ton capable. Je t’ai dit que je te servirais de sœur; ainsi, n’aie point d’inquiétude, tu seras bien placée.
—En attendant, occupons-nous de dîner, interrompit Léa, qui venait d’entendre annoncer que l’on était servi.
De Luxeuil lui prit le bras, et tous passèrent dans la pièce voisine.
Arthur s’attendait à voir paraître Honorine dans la salle à manger, et il s’était préparé à jouir de sa surprise; mais à son grand désappointement, il apprit qu’elle se trouvait souffrante et qu’elle ne descendrait pas.
—Ah! c’est pour ça que tu nous a invités, dit Clotilde; du reste, j’en suis bien aise; on ne sera pas obligé de garder son quant à soi: en route, mon petit Floridor, tu peux faire tes farces à ta discrétion.
Mais le bouffon ne songeait pour le moment qu’à satisfaire son appétit. Ce fut seulement vers le milieu du repas qu’il retrouva sa gaieté, si l’on peut donner ce nom à la hardiesse cynique dont il avait l’habitude. Toujours de mauvais goût, mais souvent incisive, sa raillerie se promenait indifféremment sur toutes choses; il semait à tout propos les calembours et les anecdotes, mimait les personnages connus et jouait mille scènes bouffonnes: c’était une verve intarissable, mais sans élan, qui avait quelque chose de mécanique; une sorte de danse macabre de l’esprit, dans laquelle les images les plus lugubres ou les plus honteuses étaient audacieusement présentées sous une forme grotesque. On eût dit la personnification de ce scepticisme ironique, lèpre morale qui va, à notre époque, gagnant tous les esprits et enveloppant à la fois, dans sa mortelle contagion, le beau et le laid, le bien et le mal.
De Luxeuil et ses convives applaudissaient à cette gaieté étrange en remplissant et vidant leurs verres. Pendant que les vins étourdissaient leurs sens, la voix du bouffon étourdissait leurs esprits; les mauvaises passions entraient en fermentation, les instincts grossiers se faisaient jour, le repas tournait rapidement à l’orgie.
—Le tokai! verse le tokai, s’écria enfin Clotilde en avançant son verre.
—C’est juste, dit Floridor, voilà une heure que la bouteille est là demandant à être bue et chantant comme M. le curé: introibo ad altare Dei.
—Qu’est-ce que ça veut dire Dei? demanda Euphrosine.
—Ça veut dire l’estomac, ma chère, répondit gravement Derval.
—Dans quel langage?
—Dans le langage parlementaire.
—Eh bien! comment trouvez-vous le piqueton? demanda Arthur qui avait pris le ton de ses hôtes.
—Fameux! répliqua la petite élève du Conservatoire.
—Du pur hypocras, Monseigneur! ajouta Léa qui buvait avec recueillement.
—Faudrait que la bouteille ne coûtât que trente sous, acheva l’actrice, tout le monde pourrait en goûter.
—Le souhait a déjà été formulé par feu Couteaudier, fit observer le bouffon.
—Qu’est-ce que Couteaudier? demanda de Luxeuil.
—Un homme complet, répondit Floridor, qui demandait un ordre de choses où l’on pût s’enrichir en satisfaisant son attraction pour ne rien faire, et qui voyant sa pétition rejetée par la Chambre des députés, s’est trouvé poussé à nier l’ordre social, ou, selon l’expression plus vulgaire de ceux qui parlent pour qu’on les comprenne, à paraître devant la Cour d’assises.
—Ah! c’est la charge qu’il nous avait promise, interrompit Clotilde; voyons, mon vieux, il faut que tu nous contes ça.
—Alors, ouvrez les écluses, le moulin ne marche pas sans eau, dit Floridor en tendant son verre.
—Et moi, je n’écoute bien qu’en fumant, ajouta l’actrice, qui prit une des cigarettes placées autour de la cassolette; en uses-tu, Phrosine?
—Tout de même.
—Dans ce cas, prends, allume et silence; voici les trois coups, la toile se lève: bas le chapeau. A toi, Floridor.
—Pour lors, Messieurs, reprit celui-ci avec l’accent aigu d’un aboyeur de saltimbanques, nous disons que le théâtre représente une cour d’assises. Il y a l’avocat, le procureur du roi, la cour et une douzaine d’honnêtes gens appelés à régler le sort du criminel, vu qu’il doit être jugé par ses pairs. Le prévenu est enroué du larynx et le président enrhumé de l’esprit. L’huissier crie: Silence.
LE PRÉSIDENT. Accusé, levez-vous. (L’accusé se lève.) Vos noms et prénoms?
L’ACCUSÉ (d’une voix enrouée). Rue de la Huchette.
LE PRÉSIDENT (insistant). Je vous demande vos noms et vos prénoms?
L’ACCUSÉ. Numéro 23.
LE PRÉSIDENT (avec indulgence). Vous semblez ne pas bien saisir ma question; je désirerais savoir comment vous vous appelez.
L’ACCUSÉ. Ah! bon, Ernest, le bel Ernest, dit Couteaudier.
LE PRÉSIDENT. Accusé, soyez attentif à ce que vous allez répondre.
Ici un petit homme en perruque se lève et marmotte pendant trois quarts d’heure. En justice, ça s’appelle un greffier lisant l’acte d’accusation.
Quand il a fini, on interroge les témoins. Puis le président recommence.
LE PRÉSIDENT. Accusé, qu’avez-vous à répondre à ces dépositions?
L’ACCUSÉ (avec énergie). C’est pas vrai! C’est des gens qui veulent me faire arriver de la peine. Je suis une victime politique. Dans les journées 17 et 19 Transnonain, 12 et 13 mai, j’ai bousculé des réverbères, tutoyé des municipaux et marché sur les corps des sergents de ville. Voilà pourquoi on m’ostine. Le préfet de police prend prétexte d’un vieux, que j’aurais soi-disant maltraité, pour me faire avoir des mots avec le procureur du roi (se tournant vers les témoins), vous êtes tous des galopins.
LE PRÉSIDENT (avec impartialité). Ces raisons, quoique bonnes, sont étrangères à la cause qui nous préoccupe.
L’ACCUSÉ. La défense n’est pas libre. (Il se lève, le gendarme le force à se rasseoir.)
LE PRÉSIDENT. Je vous ferai observer, accusé, que vous avez été vu par plusieurs personnes sur le lieu du crime. Que faisiez-vous, à trois heures du matin, sur le quai des Invalides?
L’ACCUSÉ. J’attendais un omnibus.
LE PRÉSIDENT. Le prétexte est plausible; mais malheureusement d’autres témoins vous ont vu frapper la victime.
L’ACCUSÉ. Voilà comment la chose est arrivée, mon président. Je venais d’arriver sur la place de la Révolution...
LE PRÉSIDENT (le reprenant). De la Concorde.
L’ACCUSÉ. Oui... J’étais donc sur la place Louis XV...
LE PRÉSIDENT. Vous affectez de ne pas savoir le véritable nom de cette place. Pourquoi l’appeler place Louis XV?
L’ACCUSÉ. C’te farce! mais parce qu’on y a guillotiné Louis XVI!
LE PRÉSIDENT (d’un air satisfait). Ah! je comprends.
L’ACCUSÉ. Pour lors donc, j’enquille le pont de la chambre des députés, autrement dit des grands hommes.
LE PRÉSIDENT (avec sévérité). Accusé, je vous défends de plaisanter les représentants de la nation..... Je ferai observer de plus que vous ne parlez pas très-distinctement, et je vous engage, au nom de la société, à ôter le tabac que vous avez dans la bouche.
L’ACCUSÉ. Ma chique! pourquoi donc que j’ôterais ma chique? Est-ce que les Français ne sont plus égales devant la loi. Depuis une heure, vous avez prisé au moins une demi-once de régie; ça vous fait parler du nez et cependant je ne vous ai rien dit.
LE PRÉSIDENT (se tournant vers les juges). C’est juste, pardon, accusé, continuez.
L’ACCUSÉ. J’arrivais donc sur le quai des Invalides, quand j’aperçois un vieux en redingote verte, pantalon blanc, gilet blanc, cravate blanche, cheveux blancs! Je me dis, c’est un ennemi du gouvernement, un carliste! Qu’est-ce que vous auriez fait à ma place, monsieur le président?
LE PRÉSIDENT. Je l’aurais salué.
L’ACCUSÉ. Moi je l’y ai demandé l’heure! Pour lors il s’est mis à courir; mais je le rattrape, je le couche et je le fouille, et je ne trouve sur lui que trente sous... Trente sous! et encore y se met à crier parce que je les prends! Tapage nocturne, septième chambre; je lui ai donné un coup de vivacité pour le faire taire... et voilà!
LE PRÉSIDENT. C’est là tout ce que vous avez à dire pour excuser votre crime?
L’ACCUSÉ. Encore un mot, mon président: quand j’ai voulu passer la pièce de trente sous, elle était rognée... c’est une circonstance atténuante.
LE PRÉSIDENT. Vous vous trompez, accusé, l’altération de la pièce ne vous justifie pas d’avoir attenté à la vie d’un de vos semblables.
L’ACCUSÉ. Un de mes semblables! un vieux qui avait deux cautères et qui portait de la flanelle: mais il appartenait déjà aux pompes funèbres, votre protégé. Qu’est-ce qu’il pouvait avoir à vivre? quinze jours?..... trois semaines?..... je les rembourse et nous serons quittes.
LE PRÉSIDENT. C’est encore une erreur, accusé.
L’ACCUSÉ (l’interrompant). Ah! donnez-nous la paix, vous; ça me scie le dos à la fin; vous êtes un vieux serin.
LE PRÉSIDENT. Accusé, je dois vous avertir que vous prenez là un funeste système de défense et que vous aggravez votre position.
L’ACCUSÉ. Ça m’est égal, condamnez-moi à seize francs d’amende; je ne crains pas la mort!
Après le réquisitoire du procureur du roi et le plaidoyer de l’avocat, Couteaudier entend prononcer la peine capitale et sort en demandant le cordon.
Cette cynique parodie, merveilleusement mimée par l’ancien comédien, avait fréquemment excité le rire d’Arthur et de ses compagnes. Tous se levèrent enfin de table dans un demi enivrement et passèrent au salon voisin en dansant une sauteuse de bal masqué.
La beauté sensuelle de Clotilde avait encore grandi dans l’orgie. L’œil allumé, les lèvres humides, le sein palpitant, elle tournait entre les bras d’Arthur qui finit par aller tomber, avec elle, sur un divan.
—En voilà une soirée dans le genre Chicard, dit l’actrice, qui relevait ses cheveux dénoués, tandis que de Luxeuil baisait son épaule; sais-tu que c’est joliment commode ici, on pourrait danser un galop infernal, comme chez Musard. Elle est mieux logée que moi, ta femme.
—Est-ce que tu es jalouse, par hasard? demanda de Luxeuil, en lui enveloppant la taille d’un de ses bras.
—Tiens, c’est peut-être pas agréable d’habiter un hôtel; elle a son appartement de ce côté.
—Oui.
—Et elle y est?
—Oui.
—Quel dommage!
—Pourquoi?
—J’aurais été si contente de le voir.
—L’appartement de ma femme?
—Certainement.
—Je vais t’y conduire! s’écria Arthur qui se redressa brusquement et prit l’actrice par la main.
—Quelle farce! dit celle-ci, en haussant les épaules, puisque tu dis qu’elle y est.
—Raison de plus!
—Quoi! pour de bon!
—Viens, te dis-je.
L’actrice lui sauta au cou.
—Ah! si tu fais cela, tu es le roi des bons enfants, s’écria-t-elle: avez-vous entendu, vous autres? il me conduit chez son épouse.
—Et vous pouvez venir tous, reprit de Luxeuil qui, exalté par l’ivresse et par la haine, avait saisi avec transport l’occasion d’insulter Honorine.
Floridor offrit le bras à Léa en chantant l’air de la Parisienne:
—Est-ce dans le quartier? Où faut-il prendre un omnibus? ajouta-t-il.
—Suivez-moi, dit Arthur, qui ouvrait la porte du salon.
Le bouffon tendit l’autre bras à Euphrosine, et reprit:
Boum! boum! boum!
—Allons, donne-nous la paix, Floridor, interrompit Clotilde en se détournant, et tâche d’être meilleur genre.
—Le genre masculin est le plus noble, répliqua Floridor: Exemple: bonus, bona, bonum.
—Silence!
—C’est ce qu’eût dit mon père s’il avait été huissier.
Ils étaient arrivés au petit salon qui précédait la chambre d’Honorine, une camériste parut.
—Madame de Luxeuil? demanda Arthur.
—Elle est chez elle, dit la femme de chambre stupéfaite.
—Annoncez-nous alors.
—Pardon, Monsieur, qui faut-il annoncer?
—Madame de Montespan et sa société.
—Tiens, c’est vrai! s’écria Clotilde en éclatant de rire, c’est mon dernier rôle; faut-il que j’entre sur la ritournelle:
De Luxeuil l’entraîna vers la porte que la femme de chambre venait d’ouvrir et entra au moment même où celle-ci répétait d’une voix mal assurée l’annonce de madame de Montespan et sa société.
Honorine, assise à l’autre extrémité de sa chambre, se retourna stupéfaite.
—Mille pardons de vous déranger, dit Arthur d’un ton léger; mais Madame désirait voir votre appartement, et je n’ai pu la refuser.
Honorine, qui s’était levée, regarda les visiteuses avec une surprise mêlée d’incertitude, et salua faiblement.
—Je ne devine point, dit-elle, l’intérêt que peut avoir un pareil examen pour ces dames auxquelles je suis inconnue...
—Cela leur procure l’avantage de faire votre connaissance, reprit de Luxeuil ironiquement. Du reste, comme vous me paraissez peu en train de faire les honneurs de votre logement, vous me permettrez de vous remplacer.
Et se tournant vers Clotilde:
—Comment madame la marquise trouve-t-elle l’appartement? demanda-t-il.
—Ça ne serait pas mal si c’était un peu plus gai, répliqua l’actrice.
—Cette gravité majestueuse convient à la mélancolie, fit observer Léa.
—Possible! reprit Clotilde, mais moi ça me tarabuste; on dirait une chambre de religieuse.
—Pourquoi de religieuse? demanda Euphrosine.
—Tu ne vois donc pas ce petit bénitier?
—Tiens! j’ai cru que c’était pour mettre des allumettes phosphoriques!
—Et dans la ruelle? Il n’y a pas seulement de glace.
—C’est trop froid à l’estomac; on préfère le lait de poule, fit observer Floridor.
—Y a que les rideaux du lit que j’aime, reprit l’actrice; ils ont un reflet qui doit être avantageux.
—A propos de rideaux, qu’est-ce que c’est que celui-là? interrompit l’élève du Conservatoire.
—Eh bien! tu ne vois pas qu’il cache un tableau?
—C’est donc quelque chose d’indécent?
—C’est le portrait d’Henri IV.
—Ah! bah!
—Ces dames demandent la toile! cria le bouffon.
—Oui! oui!
—Alors que l’honorable société ouvre l’œil; voici le moment, voici l’instant.
Tout ce dialogue avait été trop rapide pour qu’Honorine pût l’interrompre. D’abord incertaine, comme nous l’avons dit, puis frappée de stupeur, elle n’avait point compris sur-le-champ quelles étaient les femmes présentées par Arthur; mais les dernières paroles échangées ne pouvaient lui laisser de doute; aussi, lorsque Floridor s’avança pour écarter le rideau qui couvrait le portrait de la baronne, la jeune femme se jeta devant lui, pâle de honte et d’indignation.
—Emmenez ces gens, Monsieur, dit-elle en regardant de Luxeuil.
—Comment, ces gens! s’écria Clotilde; par exemple! Est-ce que Madame nous prend pour des servantes?
—Je suis chez moi, reprit la jeune femme palpitante; emmenez-les, Monsieur, je le veux.
—Vous voulez! répéta de Luxeuil qui appuya avec ironie sur chaque syllabe.
—La femme doit obéissance à son mari, article 213, murmura Floridor.
—Et elle ne doit point oublier que le domicile conjugal appartient à ce dernier, continua Arthur.
—C’est clair, nous sommes chez toi! dit effrontément Clotilde; puisque dans le mariage c’est l’homme qui est le maître... D’ailleurs Madame pouvait nous prier de la laisser sans nous appeler des gens.
—Surtout quand ce n’est le nom d’aucun de nous, ajouta Floridor.
—Et quand on se présentait en personnes bien nées! ajouta majestueusement Léa.
Honorine, appuyée au portrait de sa mère, écoutait et regardait avec stupéfaction; une pareille audace dépassait toutes ses craintes; elle pouvait à peine y croire! Elle porta les deux mains à son front, pour s’assurer qu’elle veillait, regarda les femmes qui se trouvaient devant elle, puis de Luxeuil et s’écria enfin:
—Je ne suis point folle pourtant; c’est vous, Monsieur, qui les avez conduites ici... mais si vous ne respectez rien autre chose, respectez au moins votre nom que je porte.
—Fi donc, interrompit Arthur, vous oubliez que votre honneur n’est plus le mien, madame; c’est vous qui avez établi le principe. Et désormais je veux le mettre en pratique. Puisque vous réclamez vos droits, je ferai valoir aussi les miens. A l’avenir vous voudrez bien vous soumettre à ce que j’aurai décidé, en faisant bon visage aux personnes qu’il me plaira de recevoir et cela parce que vous êtes chez moi, Madame, et parce que je le veux, entendez-vous. Je le veux!
Ce mot avait été prononcé d’un accent si absolu et accompagné d’un geste si violent qu’Honorine en eut froid jusqu’au cœur. Elle voulut répondre, mais elle ne put que bégayer quelques mots entrecoupés; de Luxeuil se tourna vers Clotilde et changea subitement de ton.
—Tu désires voir ce qu’il y a sous cette toile, ma belle, reprit-il; cela n’en vaut guère la peine; mais tu vas juger.
—Je vous en conjure, Monsieur, s’écria Honorine, en voulant l’arrêter.
Il haussa les épaules, tira brusquement le rideau, et montra à tous les yeux l’image de la baronne.
—Tiens, ce n’est qu’un vieux portrait de femme, dit Euphrosine étonnée.
—Ah! ciel! un costume de l’Empire! quelle horreur! interrompit Léa.
—Oui, mais voyez comme elle a des diamants! reprit l’élève du Conservatoire; ça vous relève joliment une figure.
—Ah bien! les goûts sont libres, interrompit Clotilde, j’aime mieux la mienne sans diamants.
—Et avec dix amants! ajouta Floridor.
Ce grossier quolibet fit rire les trois femmes; Honorine ne put se contenir plus longtemps. Elle avait supporté les humiliations, les railleries, les menaces, mais cette espèce de profanation du portrait de sa mère fut un coup trop fort pour son cœur navré; elle cacha son visage dans ses mains et fondit en larmes.
Cette explosion inattendue produisit sur les témoins un effet singulier. Les femmes se regardèrent avec un embarras ému, tandis que Floridor faisait une grimace d’étonnement grotesque, et que les traits d’Arthur s’assombrissaient.
—Une scène de larmes, dit-il durement; pardieu! Madame, vous ne pouviez mieux choisir votre moment; voici mademoiselle Léa qui a joué le drame et qui pourra apprécier votre talent.
—Taisez-vous donc! interrompit Clotilde à demi-voix; elle pleure tout de bon.
—Les pluies d’orage entretiennent la fraîcheur, marmotta Floridor.
—Et pourrait-on savoir d’où vient ce débordement subit de sensibilité? reprit de Luxeuil. Est-ce parce qu’on a vu ce portrait?
—Madame, assurément, aime trop la peinture, dit le bouffon.
—Mais parlez donc, reprit Arthur irrité; veuillez répondre...
—Et si elle ne le veut pas! s’écria Clotilde, touchée des pleurs de la jeune femme, et qui était passée, avec la mobilité habituelle à ces natures d’instinct, de la mauvaise humeur à l’intérêt. Faut pas non plus brusquer les gens comme ça! nous ferons mieux de nous en aller...
—Je reste! dit de Luxeuil avec une sorte d’acharnement.
—Et moi je ne veux pas, reprit l’actrice résolûment; vous êtes un vrai sans-cœur... Qu’est-ce qu’elle vous a fait après tout pour la tourmenter? C’est nous qui avons eu tort de venir comme ça la braver... Allons-nous-en tout de suite.
murmura Floridor entre ses dents.
Il avait repris le bras d’Euphrosine et de Léa; Clotilde prit celui d’Arthur et l’entraîna malgré lui.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il en est de certaines destinées comme de ces ballons captifs retenus à la terre par une seule corde: que le hasard ou la violence la brise, et le ballon s’élance exposé à tous les vents. Honorine l’éprouva pour elle-même. Arrêtée jusqu’alors dans la triste union qui lui avait été imposée par de fragiles liens qu’Arthur venait de rompre, elle se trouva tout à coup sans direction et sans but. Elle ne pouvait rester plus longtemps dans cette demeure où on lui refusait même un coin solitaire pour pleurer; mais à qui demander protection?
Elle s’était d’abord levée avec une seule pensée, fuir! et elle avait rassemblé à la hâte quelques vêtements, quelques objets précieux, quelques chers souvenir; puis la raison avait murmuré tout bas:—Où aller? Où aller, en effet, alors que sa tante l’avait vendue, que son tuteur était mort, que le duc avait disparu! Et cependant il le fallait! dût-elle partir exposée à toutes les chances de l’abandon, il le fallait; c’était le seul moyen de consentir à vivre.
Elle pria devant le portrait de sa mère, lui demandant conseil et appui, jusqu’à ce que la fatigue fermât ses yeux rougis de larmes.
Mais alors même, par un de ces phénomènes fréquents qui semblent constater l’indépendance de l’âme, celle-ci continua à rester éveillée et à chercher une voie de salut. Seulement, chaque pensée se traduisait en image, et tous ceux qui avaient laissé une trace au cœur d’Honorine, lui apparurent successivement dans son rêve. Elle vit ainsi la prieure, le jardinier Étienne, Marcel, le duc de Saint-Alofe; tous murmuraient des paroles d’affection, mais sans donner de conseil ni d’espérance.
Et à chaque vision, l’âme plus désolée invoquait un nouveau protecteur.
Enfin, il lui sembla qu’elle se trouvait dans la Maison-Verte à Château-la-Vallière. Les lieux dont elle ne gardait, éveillée, aucun souvenir, lui apparurent comme dans un miroir fidèle et avec tous leurs détails. Elle se voyait elle-même toute petite, debout sur le perron. Plus bas était un homme tenant à la main un bâton de voyage et près d’elle sa mère, qui tout en passant les doigts dans ses cheveux, disait:
—Mon enfant n’avait plus personne au monde, aussi je suis revenue, quoique morte, pour la sauver. Vous allez la prendre par la main et la conduire à sa grand’-mère qui aura peut-être pitié d’elle; et de peur que vous ne la perdiez ou qu’elle vous perde dans la foule, voici un anneau dont je vous donne à chacun la moitié.
Alors sa mère se pencha sur Honorine, posa les lèvres sur ses yeux, et comme l’enfant refusait de partir, elle la poussa doucement vers son guide, en lui disant:
—Va et crois en lui, car il a le signe!
A ces mots tout disparut et Honorine se réveilla.
Elle appuya son front sur ses deux mains, repassa dans sa mémoire tout le rêve et, redressant vivement la tête:
—Oui, ma mère, s’écria-t-elle en tendant la main vers la peinture adorée, oui, je croirai et j’irai.
Elle se leva aussitôt sans hésitation et écrivit un billet adressé à Arthur.
«Les derniers liens sont rompus entre nous; je pars pour les Motteux, où j’espère trouver asile et protection. Je vous laisse la libre jouissance de tout ce qui m’appartient. Tant que vous respecterez ma retraite, je m’interdirai toute réclamation de mes droits; si vous essayez de la troubler, j’en appellerai aux juges qui, en légitimant une séparation nécessaire entre les personnes, devront la prononcer également entre les intérêts...
»J’espère que vous comprendrez cette position et que vous éviterez un éclat qui ne pourrait tourner que contre vous-même.
»Adieu, soyez heureux si vous le pouvez; je pars sans rancune et sans haine.
»Honorine.»
Ce billet cacheté, elle chercha les objets qu’elle avait réunis la veille, prit une capote, un manteau de voyage et sortit de l’hôtel.
Le jour commençait seulement à paraître. Les premières rues qu’elle traversa étaient encore désertes; mais elle allait sans crainte et dans une sorte d’ivresse. Préparée par sa première éducation de couvent à croire possible l’intervention des êtres invisibles, elle avait accepté son rêve, non comme une symbolisation des pensées qui préoccupaient son âme, mais comme un avertissement surnaturel adressé par sa mère. Aussi n’avait-elle aucune des incertitudes que laissent les résolutions basées sur les raisonnements humains. Elle allait, conduite par une autorité irrésistible et sainte, ne sentant ni le poids de la responsabilité, ni la crainte du résultat. Les sages eussent peut-être regardé cette confiante audace comme une crise de folie; mais, aux yeux d’Honorine ce n’était que la foi dans l’ordre et les promesses de sa mère.
Sept heures sonnaient à l’horloge de Saint-Louis lorsqu’elle frappa à la porte de la maison de la rue des Morts.
Trois jours après les derniers événements connus du lecteur, Marc et Honorine gravissaient le coteau qui s’élève au nord de Trévières, entre la route d’Isigny et la petite rivière d’Esques. Tous deux venaient de quitter la voiture de Bayeux et se dirigeaient vers l’habitation de la mère Louis, dont ils aperçurent bientôt la toiture élevée.
Ancien domaine seigneurial transformé en exploitation agricole, les Motteux s’offraient sous un aspect équivoque dont le regard était désagréablement affecté. L’allée d’arbres qui menait directement au château avait été abattue et l’avenue elle-même livrée à la culture. Un chemin oblique conduisait maintenant aux bâtiments de service dans lesquels l’ancienne meunière avait établi sa ferme.
Quant au château, le rez-de-chaussée servait de magasin pour les récoltes, et l’étage supérieur de grenier à foin. Les combles avaient été abandonnés aux dégradations successives du temps, qui avaient fait fléchir le toit et brisé la plupart des fenêtres. A gauche de l’entrée s’élevait la chapelle dont la mère Louis avait fait une écurie, et la serre changée en grange. L’ancienne cour d’honneur était devenue une aire à battre le blé; enfin, les jardins dépouillés de leurs tonnelles, de leurs charmilles et de leurs fleurs, n’offraient plus à l’œil que de grands carrés de pommes de terre ou de choux qu’encadraient quelques restes de bordures de buis et au milieu desquels s’élevaient des socles de pierre surmontés de vases à demi détruits ou de statues mutilées.
Toutes ces transformations brutales donnaient aux Motteux un air trivial et dévasté. On n’y trouvait ni la triste majesté que l’abandon imprime aux grands édifices, ni la grâce champêtre de la ferme. C’était je ne sais quelle association de splendeur déguenillée et de simplicité prétentieuse. Le château n’avait pu devenir une ferme, et la ferme avait trop conservé du château. Ajoutez le désordre, inévitable dans toute grande exploitation dirigée par une femme, et l’économie inintelligente qui laissait les chemins impraticables et les clôtures en ruines.
Marc s’arrêta à quelques pas de la cour d’entrée, péniblement saisi. Son regard, après s’être promené un instant autour de lui, se reporta sur Honorine avec une sorte d’angoisse: mais une autre préoccupation troublait alors celle-ci: elle songeait à l’accueil qu’elle allait recevoir de sa grand’mère, et comme il arrive souvent dans les inquiétudes extrêmes, elle pressait le pas afin de savoir plus vite ce qu’elle avait à craindre ou à espérer. Marc franchit avec elle la porte d’entrée, et allait s’avancer vers la ferme pour demander la mère Louis, lorsqu’elle parut à la porte des écuries avec un paysan. Tous deux paraissaient vivement irrités.
—Moi, je te dis, Romain, que tu me paieras la bringée (vache tachetée), s’écriait la fermière, vu que c’est ton chien qui l’a égohinée (étouffée).
—Pourquoi que vous faites pâturer la bête dans un endroit qu’est pas enclos, répliquait le paysan; je réponds pas de mon chien.
—Non! eh bien! c’est ce que nous verrons; je te ferai venir devant le juge.
—Faut pas m’écarer (irriter), mam’ Louis, reprenait Romain, qui froissait son bonnet entre ses mains: vous m’avez fait de la peine assez souvent; mais y a pas de saint qui ne se fatigue à la fin.
Comme la mère Louis allait répondre, Honorine, qui venait de l’apercevoir, courut à sa rencontre.
—Dieu nous sauve! c’est la petite! s’écria-t-elle à sa vue.
—Ah! vous ne m’avez point oubliée! dit la jeune femme qui se jeta dans ses bras.
—Toi ici! reprit la mère Louis en se dégageant; c’est-y bien possible! et comment que t’es venue? où donc qu’est ton homme?
—A Paris! répliqua Honorine embarrassée.
—Pourquoi ça, reprit la fermière, est-ce qu’une femme doit voster (courir) sans son mâle? Qu’est-ce que c’est donc que celui-là, alors?
La mère Louis désignait Marc.
—Je vous expliquerai tout, dit Honorine qui ne pouvait répondre devant le paysan; mais je voudrais parler... à vous seule?
—Oh! je devine, interrompit la fermière, je parie que t’as planté là ton mari.
—De grâce!!...
—C’est-y vrai ou non, voyons? oh! y faut pas se catuner (baisser la tête avec humeur). Je te vois arriver sans savoir quoi ni qu’est-ce, et l’air tout douillant; qu’est-ce qui s’est passé, voyons; parle vite, je puis pas perdre de temps; j’ai là une bête au mouroir!
—Je tâcherai de ne vous prendre que peu d’instants, dit Honorine émue de cet accueil; seulement permettez-moi de vous parler en particulier.
La mère Louis céda en grommelant; mais avant de partir elle se retourna vers Romain et lui répéta sa menace; celui-ci y répondit par un regard haineux, remit son bonnet à deux mains, et tourna brusquement les talons.
Cependant la paysanne avait conduit Honorine dans une pièce basse de la ferme qui lui servait en même temps de salon, de bureau et d’office. Dès qu’elles se trouvèrent seules, la jeune femme commença le récit des faits que le lecteur connaît déjà. A mesure qu’elle avançait dans cette confession, ses souvenirs réveillés semblaient raviver sa douleur, et, arrivée au dernier outrage qui l’avait forcée de fuir, les larmes l’empêchèrent d’achever.
La fermière parut ne rien comprendre à cette désolation.
—Dieu me sauve! elle est affolée! s’écria-t-elle. Comment! c’est pour des lures (sornettes) pareilles que tu as quitté ton mari! un biau gars, qu’avait tout ce qui faut pour te rendre heureuse. Ah! Jésus! le proverbe a-t-il raison:
—Mais vous n’avez donc point entendu? s’écria Honorine avec désespoir.
—J’ai entendu, j’ai entendu que tu parlais de ton mari comme d’un gadolier (garnement), interrompit la mère Louis: mais qu’est-ce qu’il a fait après tout? T’a-t-il refusé de l’argent? T’a-t-il empêchée de sortir? T’a-t-il battue! non! eh bien! pourquoi donc que tu griches alors! Il fait la riotte avec des créatures, que tu dis! Est-ce que tu espères l’avoir pour toi toute seule, par hasard? Ah ben! un joli garçon qui n’aurait point de jeunesse; ça ferait hodiner la tête aux saints du Paradis. D’ailleurs, je peux-t-y y faire quéqu’chose, moi? Qu’est-ce que tu viens chercher aux Motteux?
—Je croyais vous l’avoir dit? reprit Honorine tremblante. Je venais vous demander... de me recevoir.
—Toi! s’écria la mère Louis; une grande dame dans la ferme! ah bien, il n’y aurait plus alors qu’à mettre le feu aux quatre coins. Non, non, je veux que tu retournes avec ton mari.
—Ah! jamais! s’écria Honorine exaltée, je partirai plutôt seule, en mendiant sur mon chemin. Vous pouvez me condamner, me repousser; mais aucune puissance humaine ne me forcera à rentrer dans cette chaîne honteuse.
—Eh bien! v’là une femme soumise! reprit l’ancienne meunière étonnée de l’air résolu d’Honorine; on la croirait jodane (bonasse), et c’est comme les agneaux de Caumont, il n’en faut que trois pour étrangler un loup. Mais tu me crois donc cousue d’écus, malheureuse, pour que je peuve entretenir ici une Parisienne à battre le Job (rien faire).
—Oh! je ne vous serai point à charge! dit vivement Honorine, je vous aiderai, je travaillerai.
—Toi, s’écria la fermière; si ça ne fait pas compassion! Qu’est-ce que tu sais faire? boire, manger, dormir et chanter? Ça n’est pas assez pour nous autres. Ici, vois-tu, il faut savoir aussi ben gagner que les grandes dames savent dépenser. C’est pas assez de dire:—j’aiderai! il faut voir à quoi tu pourras m’aider, car comme dit le proverbe: Il est difficile de peigner un diable qui n’a pas de cheveux.
—Eh bien! si je suis mal habile d’abord, vous me dirigerez, dit Honorine avec une humilité touchante; ce que les autres ont appris, je puis aussi l’apprendre. Essayez au moins, Madame, ne me traitez point plus mal qu’une étrangère qui viendrait vous demander du travail. Songez que j’arrive de bien loin vers vous, que j’ai compté sur votre pitié; que vous êtes ma seule espérance! ne me repoussez pas, mon Dieu! je vous en prie à mains jointes, Madame... et si j’osais... oui, tenez, je vous en prie à genoux.
Le mouvement de la jeune femme avait été si instantané que la paysanne en fut tout étourdie.
—Allons! qu’est-ce qu’elle fait donc, s’écria-t-elle un peu émue, veux-tu bien finir tes adoremus. Lève-toi, je te dis... tu resteras!
Honorine poussa un cri de joie et baisa les mains de la vieille femme que cette caresse acheva de gagner.
—Puisque tu le veux, nous essaierons, reprit-elle... Et pour commencer, laisse là ta roquelaure et ta bourguignote!
La jeune femme se débarrassa vivement de son manteau et de sa coiffure.
—Je vas te montrer ce qu’il y a à faire dans la maison, pendant que moi j’irai donner un roc (réprimande) aux garçons.
A ces mots elle passa devant Honorine et la conduisit dans la pièce voisine où Marc l’attendait. La jeune femme courut à lui.
—Elle a cédé, dit-elle rapidement et à voix basse.
—J’ai tout entendu, répondit Marc.
—Je reste.
—Mais à quelles conditions!
—Silence, au nom du ciel! c’est mon seul refuge.
—Eh bien! c’est comme ça que tu viens, s’écria la mère Louis de l’autre bout de la pièce.
—Adieu, revenez avant de partir, dit Honorine en tendant la main à son conducteur.
Et elle courut rejoindre la paysanne.
Marc la suivit des yeux, resta quelque temps immobile, dans une attitude de méditation douloureuse, puis, faisant un effort, il quitta la ferme et se dirigea vers le bourg de Trévières.
Le jour baissait: l’atmosphère était humide et froide. Le brouillard qui s’élevait de la vallée commençait à envelopper les coteaux de ses plis glacés. Bien qu’il ne fût point encore tard, on n’apercevait plus de travailleurs aux champs, et à peine entendait-on, de loin en loin, les sonnettes de quelques attelages attardés qui regagnaient les fermes.
Marc, qui avait d’abord marché lentement, hâta le pas, et il venait d’atteindre la route qui conduit au bourg, quand il aperçut à peu de distance, une jeune femme qui suivait la même direction, avec un enfant dans ses bras.
Les vêtements de ce dernier, frais, soignés et élégants, formaient un contraste singulier avec ceux de la voyageuse, misérables et souillés par une longue marche. Elle se traînait avec peine, mais semblait oublier sa fatigue pour égayer l’enfant par ces agaceries que les mères seules savent trouver.
Le nourrisson y répondait par mille gazouillements et mille gestes joyeux entremêlés d’embrassements.
Intéressé malgré lui, Marc s’approcha de la jeune femme pour lui adresser la parole; mais en entendant le son de sa voix, celle-ci se retourna brusquement et s’écria.
—Dieu! monsieur Marc!
—Mademoiselle Françoise! dit le garçon de bureau stupéfait.
—Ah! c’est une rencontre du bon Dieu, reprit la fleuriste, dont les traits pâlis et fatigués se ranimèrent; voilà la première figure d’ami que je trouve sur mon chemin.
—Mais que faites-vous ici? demanda Marc.
—D’où je viens? reprit Françoise; eh bien! vous ne voyez donc pas que je l’ai, mon fils, mon trésor!... ce n’a pas été sans peine; mais enfin, on me l’a rendu, et, maintenant, je défie bien qu’on me l’ôte! Cher sang de mon cœur, va!
Elle avait rapproché l’enfant de ses lèvres et le couvrait de baisers. Il la serra dans ses petits bras potelés, en répétant mam... man, mam... man, avec cette accentuation saccadée des enfants qui s’essaient à répéter les sons.
—Entendez-vous? il parle! s’écria Françoise triomphante. Est-il beau, n’est-ce pas? et fort, cher monsieur Marc, et bien portant, et gai!... Ah! Dieu m’a-t-il fait une grande grâce de me le rendre ainsi!
Et la grisette attendrie se remit à embrasser son fils avec une ivresse triomphante.
Marc la regardait silencieusement. Cette exaltation de mère semblait n’avoir rien qui l’étonnât; loin de là, on eût dit qu’il y trouvait ses propres sensations: il laissa la tendresse de la jeune femme s’épancher librement, et ne reprit qu’après une pause:
—J’avais su tout ce qui était arrivé: votre maladie, votre départ pour chercher l’enfant, mais le petit était près de Gaillon, comment vous trouvez-vous à Trévières?
—Ah! ce n’est pas volontairement, allez, reprit Françoise; j’ai eu bien du tourment depuis que j’ai quitté Paris et il y en aurait pour longtemps à vous conter.
—Donnez-moi d’abord le petit à porter, interrompit Marc; vous êtes morte de fatigue.
Il avança les bras pour prendre l’enfant; mais celui-ci se rejeta sur l’épaule de sa mère.
—Vous avez cru qu’il irait comme ça avec vous? dit Françoise en riant; ah! bien oui, il ne connaît que moi: voilà deux mois qu’il vit, pour ainsi dire, entre mes bras.
—Mais il vous tue, fit observer le garçon de bureau, qui avait été frappé du changement opéré chez Françoise.
—Oh! ne croyez pas ça, reprit-elle en couvant l’enfant d’un regard passionné, quand je ne l’ai plus je suis brisée; mais dès que je le reprends, il me revient des forces. De sentir comme ça sa petite main sur mon épaule et son haleine sur ma joue ça me soulage, ça m’empêche de penser à autre chose. On dirait qu’il le sait, car il ne se laisse prendre par personne; faut que ça soit toujours moi qui le porte! n’est-ce pas, cher ange du bon Dieu?
Et elle recommença à caresser l’enfant, toute reconnaissante de la fatigue qu’il lui imposait. Marc n’insista pas.
—Vous avez pu retrouver sans peine le petit? demanda-t-il.
—Parce que je suis arrivée avant les échanges, répliqua Françoise. Figurez-vous, monsieur Marc, que maintenant dans les hospices, ils ont pris la manière de faire des trocs d’enfants d’un endroit à l’autre. Ça s’échange, tête pour tête, entre les administrations. Il y a des parents qui, de peur de voir éloigner leurs enfants, les reprennent: comme ça on a des bouches de moins à nourrir, et il est clair que l’hospice y gagne.
—Et les orphelins qui n’ont point de famille?
—Oh! ceux-là, ils ont encore la chance d’être adoptés par leurs pères nourriciers; car vous savez qu’on donne les enfants trouvés en pension dans les campagnes; il y a des gens qui s’attachent à ces pauvres abandonnés comme si c’était leur sang, et, quand on leur demande de les échanger contre un autre, ils ne peuvent pas comme ça transporter leur affection à commandement, et abandonner l’ancien enfant qu’ils aiment pour un nouveau qu’ils ne connaissent pas. J’en ai vu qui faisaient mal à voir: ils priaient, ils suppliaient de leur laisser le petit, et le monsieur de l’hospice leur répondait:—Alors, adoptez-le.—Mais nous avons déjà notre famille que nous pouvons à peine nourrir, répondaient-ils.—Alors, rendez-le, reprenait le monsieur. Les braves gens se consultaient quelque temps, et ceux qui avaient trop de cœur, finissaient par dire:—Eh bien, nous partagerons avec lui; nous le garderons! C’était encore autant de gagné pour l’hospice.
—Oui, répliqua Marc, on exploite comme ça les bons cœurs, on espère qu’ils auront plus d’amitié que de prudence, et on s’arrange pour mettre à leur seule charge ce qui devrait être à la charge de tout le monde. Pour nourrir le nouvel adopté, il faut que toute la famille mange un peu moins que sa faim, et marche nu-pieds au lieu d’aller en sabots; mais l’hospice prospère, il fait des économies. Dans le public, on dit que c’est un établissement bien conduit! Je connais ça, moi qui ai été élevé aux enfants trouvés!
—Vous, monsieur Marc? dit Françoise surprise.
—Oui, oui, reprit le garçon de bureau, qui semblait sous le poids de souvenirs pénibles; mais il n’est pas question de moi, vous vouliez me parler de votre petit!
—Eh bien! je vous disais donc que j’étais justement venue le jour des échanges, reprit Françoise; il y avait de pauvres innocents à qui on avait ôté leurs anciennes mères-nourrices, et qui les appelaient sans pouvoir se consoler. La religieuse m’a dit qu’on en voyait de si attachés, qu’ils dépérissaient à vue d’œil après l’échange, et mouraient avant la fin du mois.
—Nouvelle économie pour l’hospice, murmura Marc.
—On était donc au moment de donner aussi mon fils à une nouvelle nourrice quand je suis arrivée, reprit la grisette; mais j’ai dit tout de suite que je venais pour le réclamer, et alors on m’a reçue bien poliment. J’ai payé les dépenses qui avaient été faites pour le petit, et je l’ai emporté comme une folle. Je n’aurais pas été plus heureuse si je l’avais sauvé d’un naufrage.
—Et vous n’avez pas voulu reprendre la route de Paris?
—Oh! non! répliqua vivement Françoise. Paris m’aurait rappelé trop de choses... Puis, j’aurais pu rencontrer... Non, je n’ai pas voulu retourner à Paris, mais je suis allée à Louviers, espérant que je trouverais à travailler de mon état; il n’y avait rien! à Évreux, on m’a proposé une place dans un magasin, mais il eût fallu me séparer encore du petit; je n’en ai pas eu la force. Alors on a dit que j’étais une paresseuse, que les femmes comme nous ne devaient pas tant s’occuper de leurs enfants, que c’était bon pour les bourgeoises qui n’avaient rien autre chose à faire. Ça m’a navrée, monsieur Marc, car c’est vrai, pourtant.
—Et vous avez continué à chercher du travail?
—Oui, n’importe lequel, pourvu qu’il me permît de rester avec mon chérubin; mais partout j’étais renvoyée à cause de lui. Une pauvre femme qui a un enfant dans les bras, c’est comme un homme infirme, on pense qu’elle ne sera bonne à rien. Puis, quand on me demandait le nom de son père, je balbutiais toujours et je devenais rouge, de sorte qu’on me renvoyait avec un air de mépris. Je trouvais bien, de loin en loin, à m’occuper; mais au bout de quelque temps, le travail manquait toujours; aussi j’arrivai à me trouver presque sans ressources.
—Pauvre femme! murmura Marc en jetant à la jeune mère un regard d’affectueuse compassion.
—Enfin, reprit Françoise, il y a huit jours, j’appris par hasard qu’une dame dont j’avais été autrefois la protégée à Paris, habitait Bayeux; je me décidai aussitôt et je partis à pied.
—Avec votre enfant?
—Oui. Oh! je crus d’abord que les forces me manqueraient; de lieue en lieue je m’arrêtais et je m’asseyais sur la route en pleurant; mais le petit riait et jouait avec les brins d’herbe, baisait mes larmes et alors je reprenais courage. Des fermiers qui revenaient du marché me prenaient aussi quelquefois en pitié, et me donnaient place dans leurs chariots; des saulniers me faisaient monter sur celles de leurs mules dont ils avaient vendu la charge; enfin, après huit jours de fatigues, je suis arrivée hier matin à Bayeux.
—Et vous y avez trouvé votre ancienne protectrice?
—J’ai appris que, depuis un mois, elle était repartie pour Paris!
—Ah! pauvre créature! s’écria Marc en s’arrêtant tout court.
—Oh! oui, dit la jeune femme, à qui les larmes vinrent aux yeux; vous avez raison de me plaindre, allez, car j’avais usé pour ce voyage toutes mes forces, dépensé jusqu’au dernier sou, et il ne me restait même pas de quoi donner à manger à ce pauvre innocent! Comprenez-vous, monsieur Marc, n’avoir rien pour mon enfant! Cette idée me fit tourner le sang. Je m’échappai, en courant devant moi, jusqu’à ce qu’on ne vît plus de maisons (car je ne sais pourquoi je n’ose pas pleurer devant tout le monde); et quand je me trouvai dans la campagne, je m’assis sur une pierre, où je me laissai aller. Jules, qui ne comprenait rien, continua d’abord à jouer et à me caresser comme d’habitude; mais, cette fois, le cœur était trop malade: ses caresses, au lieu de me consoler, me faisaient pleurer plus fort. J’étais comme folle, et je me répétais en l’embrassant:—Plus rien... rien pour lui!... il faudra mourir tous deux!... Personne pour avoir pitié de mon enfant!... Il faut croire que dans ma douleur je parlais tout haut, car, au milieu de mes sanglots, j’entendis tout à coup une voix qui me demandait:—Qu’avez-vous, pauvre femme? Et en relevant la tête, j’aperçus un jeune homme à cheval, qui s’était arrêté devant moi.
—Vous ne le connaissiez point?
—Non; mais le chagrin vous ouvre le cœur: je lui racontai, aussi bien que je le pouvais en pleurant, ce qui m’était arrivé et comment je me trouvais sans ressources. Alors il m’interrogea en détail sur ce que je pouvais faire, et, après m’avoir bien écoutée, il me dit:
—Je suis attendu à Caen pour une affaire importante qui ne me permet pas de m’arrêter; mais je vais vous remettre un billet avec lequel j’espère que vous trouverez à vous placer.
Il tira alors un carnet, écrivit sur une feuille qu’il détacha, y mit l’adresse et me la donna avec l’argent nécessaire pour continuer ma route.
—Et ce billet? demanda Marc.
—Le voici, dit Françoise en présentant un petit papier plié sur lequel le garçon de bureau lut:
A Madame Louis, propriétaire aux Motteux
(près Trévières).
Il fit un mouvement de surprise.
—Connaissez-vous la personne? demanda Françoise.
—Je viens de la quitter, répondit Marc.
—Elle est donc en affaires avec votre maison? car c’est à votre tour de me dire comment vous avez pu laisser votre bureau pour venir ici.
—Plus tard je vous le dirai, répondit Marc... pour le moment il faut tâcher de faire accepter vos services par madame Louis. Il y a maintenant aux Motteux sa petite-fille... une pauvre femme qui est aussi bien malheureuse et qui vous trouvera, j’espère, prête à la consoler et à lui rendre service.
—Ah! si je peux quelque chose, elle n’a qu’à parler, s’écria Françoise avec l’empressement dévoué qui lui était naturel; ça rend si heureux de faire plaisir aux autres, surtout quand ils souffrent. Mais qu’est-ce qu’une pauvre créature comme moi pourrait faire pour la petite-fille de madame Louis.
—Plus tard, si vous êtes reçue aux Motteux, vous le saurez, dit Marc; aujourd’hui vous ne devez songer qu’à vous reposer; voici précisément l’auberge qui m’avait été indiquée; entrons ensemble, il me reste encore beaucoup de choses à vous demander.
Après avoir donné à son fils tous les soins que réclamait son âge, et s’être assurée qu’il dormait paisiblement, Françoise descendit pour rejoindre Marc.
Celui-ci avait fait apprêter un repas propre à réparer les forces épuisées de la jeune femme, et tous deux se mirent à table.
Le garçon de bureau interrogea longuement la jeune fille sur son passé, sur ses projets; on eût dit qu’il voulait entrer plus avant dans cette âme et savoir jusqu’à quel point Honorine pourrait y trouver de la sympathie et de l’appui. La fleuriste, étrangère à tout détour, se laissa voir telle qu’elle était, déjà oublieuse d’un triste passé qu’elle pardonnait, et n’ayant pour l’avenir d’autre rêve que son fils. Aussi, après un long entretien, Marc demeura-t-il persuadé que la rencontre de Françoise était un coup du ciel. Il pensa que s’il réussissait à l’établir à la ferme près d’Honorine, celle-ci n’y serait plus seule, et qu’il pourrait la quitter plus tranquille, sûr de lui laisser quelqu’un qui saurait la servir et l’aimer.
Mais tandis qu’il songeait aux moyens d’assurer la réussite de ce projet, Honorine se trouvait déjà aux prises avec les difficultés de sa nouvelle position.
Restée seule avec sa petite fille, la mère Louis voulut mettre sur-le-champ sa bonne volonté à l’épreuve, en l’occupant aux soins domestiques dont elle-même avait l’habitude.
Bien qu’elle eût été jusqu’alors étrangère à ces travaux, la jeune femme s’y soumit avec une résignation empressée. Elle était à cet âge où les changements extrêmes découragent moins qu’ils n’excitent, et dans une de ces heures d’exaltation qui rendent toute tâche possible. Résolue de s’affranchir à tout prix, elle était prête à payer cet affranchissement par la fatigue, les veilles, la souffrance même.
La fermière, qui triomphait d’avance des maladresses et des répugnances de la dame de Paris, fut donc complétement trompée dans son attente. Honorine obéissait à tous ses ordres, ne reculant devant aucun détail et suppléait à l’habitude par l’intelligence.
Cette aptitude, loin de plaire à la vieille paysanne, l’irrita. Comme toutes les femmes exclusivement appliquées aux détails du ménage, elle tirait gloire de sa capacité reconnue et souffrait impatiemment tout ce qui pouvait en amoindrir la valeur. Elle avait espéré jouir de sa supériorité en constatant l’ignorance de la Parisienne, et jouer près d’elle ce rôle de protectrice bourrue qui satisfaisait en même temps sa vanité et sa mauvaise humeur; mais l’activité intelligente d’Honorine dérangeait toutes ses espérances. A peine trouvait-elle, de loin en loin, l’occasion d’une réprimande, reçue même trop doucement pour être renouvelée.
Ce désappointement aigrit la vieille femme. Irritée de ne pouvoir trouver sa petite-fille en faute, elle multiplia les ordres, demanda des choses plus difficiles, les exigea plus rapidement. On eût dit une de ces fées malfaisantes des vieux contes, soumettant quelque pauvre princesse, belle comme le jour, à des épreuves au-dessus des forces humaines.
Par malheur, Honorine n’avait pas de marraine toute-puissante qui pût lui prêter le secours de sa baguette. Aussi ses forces et sa présence d’esprit ne purent-elles longtemps suffire.
Elle avait, d’ailleurs, à surmonter, dans ses nouvelles fonctions, mille difficultés, mille frayeurs, dont la volonté ne triomphait qu’avec peine. Le vieux puits ruiné auquel la mère Louis l’envoyait lui donnait le vertige; chaque fois qu’elle devait franchir le seuil, les aboiements furieux du dogue enchaîné près de la porte la faisaient pâlir et trembler. Mais ce fut encore bien pis, quand il fallut visiter les étables avec la fermière, effleurer les taureaux qui lui jetaient, de côté, un regard farouche, sentir sur sa joue l’haleine brûlante des chevaux impatients de l’entrave, entendre toutes ces voix fauves hennir et beugler à son oreille. Cependant, elle s’efforçait de cacher son trouble, et la fermière, de plus en plus mécontente, redoublait d’exigence. Enfin, elle s’écria aigrement:
—En v’là assez, voyons; c’est pas des métiers de Parisienne que tu fais là. Je veux pas que tu t’estermines par gloriole.
Honorine voulut répondre; la vieille femme l’interrompit.
—C’est bon, c’est bon, dit-elle sèchement; on sait bien que tu ne voudras pas en venir à jubé (à repentance); les dames de Paris c’est toujours un tantinet jésuet (hypocrite); mais tu vas me suivre.
—Où cela? Madame.
—Chez le mière; faut ben qu’y sache que t’es ici; c’est ton oncle après tout. Prends le panier qui est là; c’est de la victuaille sur quoi il compte... Eh bien! est-ce que tu le trouves trop lourd?
—Non, dit Honorine, qui fit un effort violent pour enlever le panier.
—Est-elle glorieuse, grommela la mère Louis, avec un dépit concentré; elle n’avouera pas qu’elle en a trop; c’est pour m’erjuer (m’agacer), eh bien! tant pis, elle le portera pour lui apprendre!
Et elle prit le chemin du bourg avec la jeune femme qui, chargée de son fardeau, avait peine à la suivre.
M. Vorel n’habitait point à Trévières même. Sa maison, située sur la gauche, n’était que la plus petite partie d’un ancien manoir dont le docteur avait démoli le reste pour en vendre les pierres et la charpente. Ce fragment d’édifice, revu et corrigé par son propriétaire, ne conservait, d’ailleurs, plus rien de sa physionomie primitive. Le docteur en avait fait un pavillon, sans autre caractère apparent que la propreté. Tout y était entretenu avec un soin qui annonçait l’intelligence et l’économie. Les crépis de chaux ne présentaient ni lézardes ni soufflures; les volets, qui garnissaient toutes les croisées, étaient parfaitement d’équerre sur leurs gonds; la vigne, récemment taillée, courait régulièrement le long du cordon placé entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et les gouttières descendaient du toit, sans aucune déviation, jusqu’à des tonneaux soigneusement goudronnés.
Devant la maison se trouvait une petite cour défendue par une grille de fer, et dont les pavés cimentés ne laissaient paraître ni le plus léger brin d’herbe, ni la moindre mousse.
Cependant, cet air de bon entretien avait quelque chose de sec qui lui ôtait son charme. On voyait bien partout la surveillance attentive du propriétaire qui veut conserver sa chose, mais rien qui annonce qu’on l’aime ou qu’on en jouit. La plupart des volets étaient fermés, la cour restait déserte, et aucun bruit de voix ne se faisait entendre.
Ce que l’on apercevait du jardin confirmait, en quelque sorte, ce premier aspect. C’étaient des arbres fruitiers sévèrement taillés, des plates-bandes tirées au cordeau et en pleine culture, mais pas un arbuste, pas une fleur, rien de ce qui réjouit l’œil. Tout dans cette demeure semblait soumis à une règle d’arithmétique: évidemment le maître savait compter, mais il n’avait pas de goût!
Cette sévérité calculée donnait au pavillon du docteur, malgré son élégance relative, une apparence plus triste encore que celle des Motteux. A la ferme du moins, la création se montrait par instants au milieu des dégradations et du désordre; le lierre tapissait les murs en ruines, les gramens germaient autour de l’aire, et quelques fleurettes s’épanouissaient sur la toiture de chaume. Puis il y avait le bruit, le mouvement; c’était la vie en désordre, mais enfin la vie! Ici, c’était la mort régulièrement administrée, mais toujours la mort!
Honorine, que la fatigue avait forcée de s’arrêter à une centaine de pas du manoir, fut saisie, dès le premier coup d’œil de cet aspect morne, et demanda si c’était le logis du docteur.
—Ah! t’es pressée d’arriver? dit la mère Louis ironiquement. Oui, c’est la maison du mière; y la soigne plus que son âme; tu vas voir ça en dedans. Ah! dame, y a pas de varivara (désordre) chez lui; c’est l’autel avant la grand’messe. Voyons, encore un coup de jarret, Madame de Paris, nous voilà rendues.
Honorine fit un dernier effort et reprit le panier.
—Y a pas beaucoup de logement au manoir, reprit la fermière, mais aussi y sont que trois; M. Vorel, le grand’jodane et la Sureau. Une fière servante, la Sureau! Y en a pas une pareille dans le pays. Mais le mière a toujours eu, comme ça, de la chance.
—Sauf pour son fils, à ce qu’il me semble, fit observer Honorine.
—De quoi! son fils? reprit l’ancienne meunière, parce qu’il est de la famille de M. Matignon[A]? Voilà le mière bien à plaindre! Il restera toujours tuteur, donc, et c’est autant de gagné. Ah! y serait bien fâché si les sorciers du pays pouvaient redonner de l’esprit au grand’jodane. Ton oncle, vois-tu, c’est un grec (avare) dans le cœur; il a toujours faim de ce qui se garde.
Elles étaient arrivées à la porte du manoir: la mère Louis frappa.
Une servante déjà vieille, mais encore robuste, vint ouvrir.
C’était la Sureau, espèce de bête de somme qui servait le docteur depuis trente ans sans avoir jamais reçu de lui autre chose que le vêtement et la nourriture. Ses gages restaient aux mains de son maître, qui lui avait promis de ne point l’oublier dans son testament. Cette espérance était devenue l’unique pensée de la Sureau; elle vivait pour l’accomplissement de ce rêve, elle y rapportait toutes ses actions; c’était le règne de mille ans promis à son avenir. Fatigues, privations, gronderies, elle se consolait de tout avec ce mot:
—Je serai sur le testament de Monsieur.
Elle salua la mère Louis du ton familier ordinaire aux vieux serviteurs.
—Eh bien! oùs’ que vous êtes restée? demanda-t-elle un peu brusquement, j’attendais toujours après les œufs que vous aviez promis.
—Fallait-il pas tout laisser pour te les apporter, dobiche (vieille femme), répliqua la fermière, pourquoi que tu n’es pas venue les chercher.
—J’ai pas eu le temps dans la veprée (soirée).
—Eh bien! ni moi; chacun connaît midi à sa porte, vois-tu; j’avais une vache malade... puis il m’est arrivé une Parisienne à la ferme; tu ne vois pas?
—Ah! c’est une dame de Paris! dit la Sureau, qui jeta à Honorine un regard soupçonneux et presque malveillant; et quoi donc qu’elle vient faire au pays?
—C’est la fille du général, reprit la fermière avec une nuance d’orgueil; elle n’a pas pris avec son mari, et alors elle est venue me demander de la garder.
—Voyez-vous ça, dit la Sureau en continuant à regarder Honorine qui rougissait; on a ben raison de dire que dans la grande ville les ménages sont comme la caniviere au diable; le mâle et la femelle n’en valent rien. Mais dites-moi donc, mam’Louis, si c’est la fille au général, c’est la cousine à Zozo.
—Certainement.
—Ah bien! il va être joliment étonné; dis donc, Zozo, viens ici; il y a une belle dame de Paris qui est ta parente; viens l’embrasser.
Celui qu’on appelait parut à la porte du pavillon. Bien qu’il eût trois ans de plus qu’Honorine, sa taille ne dépassait pas celle d’un enfant. Il avait les cheveux rares et blonds, les yeux gros, la mâchoire pendante et le teint d’une blancheur blafarde. De longs poils follets, témoignages d’une virilité manquée, garnissaient son menton et ses joues.
Il s’avança d’abord, d’un air incertain et en se balançant, jusqu’à moitié de la cour; mais dès que sa myopie lui permit de reconnaître la fermière, il s’arrêta.
—Eh bien! approche donc, grand’jodane, s’écria celle-ci; est-il mal housté (habillé) au moins; toujours les bas sur les talons. Avec ça qu’il marche de travers comme un chien qui revient de vêpres; c’est ma vraie croix que ce failli gars de rien du tout.
L’idiot, qui était d’abord resté immobile, fit un mouvement pour rentrer au manoir; Honorine en eut pitié; elle courut à lui, prit sa main et dit doucement:
—C’est moi, monsieur Henri, qui suis votre cousine, ne voulez-vous point me souhaiter la bien-venue?
Zozo, rassuré par cette douce voix, regarda la jeune femme dont il n’avait pu, de loin, distinguer les traits, et parut frappé d’admiration.
—Ma cou.... cousine! répéta-t-il avec un bégaiement qui semblait moins chez lui un défaut d’organe que l’effet de la timidité.
Et ses yeux restèrent fixés sur le visage triste et charmant de la jeune femme.
—Eh bien! embrasse-la donc, jodane, s’écria la mère Louis avec un gros rire.
L’idiot fit un mouvement pour obéir, mais la crainte l’arrêta: Honorine pencha en souriant son front jusqu’à ses lèvres.
—Oh! ma....a cousine, vous n’êtes pas mé...méchante.... vous! bégaya-t-il.
—C’est-à-dire que nous autres nous le sommes? interrompit la fermière qui fit un geste de menace.
Par un mouvement instinctif, l’idiot se rangea contre Honorine, comme s’il eût déjà compté sur sa protection.
—Ce n’est point la pensée de M. Henri, reprit celle-ci d’un ton conciliant; il a seulement voulu me dire une chose aimable, et je l’en remercie! J’espère que nous serons bons amis.
—Oh! ou...i... oui, répliqua Zozo, avec une sorte de vivacité; je vous fe....ferai des corbeilles.
—C’est tout ce qu’y peut faire, le pauvre innocent! dit la Sureau avec commisération; y tresse des paniers de jonc pour ses amis..... ça n’peut servir à rien; mais y croit vous rendre service.
—V’là pourquoi il n’a jamais voulu m’en faire à moi, le souton (dissimulé), reprit la fermière; du reste, je m’en bats l’œil; amitié de crapaud ne fait pas de profit; mais, voyons, où est le mière, il faut que je lui mène la Parisienne.
—Le voici, dit la Sureau en montrant le médecin qui descendait le perron.
Il avait vu arriver la fermière avec sa petite-fille; mais, fidèle à son habitude de prudence, il s’était décidé à écouter la conversation des trois femmes avant de se montrer.
En apprenant qu’Honorine arrivait aux Motteux pour y rester, il n’avait pu réprimer un tressaillement d’inquiétude. Son front se plissa et ses sourcils grisonnants se rapprochèrent. Il était évident que cette arrivée imprévue dérangeait quelque projet longuement médité. Il pencha la tête en portant la main à ses lèvres, comme il avait coutume de faire lorsqu’une difficulté à résoudre l’absorbait, et demeura à la même place jusqu’à ce que la voix de la mère Louis se fît entendre de plus près. Il sortit alors brusquement de sa rêverie. L’expression soucieuse de ses traits s’effaça sous cette espèce de rire normal dont nous avons déjà parlé, et il s’avança sur le perron avec tous les signes de la surprise et de l’empressement.
—Suis-je bien éveillé! madame de Luxeuil ici! s’écria-t-il, en courant au-devant de la jeune femme les mains tendues; par quel heureux hasard..... comment se fait-il?.... mais vous n’êtes point seule?
—On va vous conter tout ça, dit la fermière qui montait le perron en soufflant. J’ai tant vosté (couru) aujourd’hui, que les jambes me rentrent dans l’estomac; voyons, arrivez donc, vous vous ferez des politesses plus tard.
Le docteur, qui se confondait en humilités près d’Honorine, lui offrit le bras et la conduisit au salon.
C’était une grande pièce boisée, sans autre ameublement que des chaises, une table et un casier formant pharmacie. Vorel s’excusa de recevoir madame de Luxeuil dans son pauvre logis de médecin de campagne.
—En v’là un gas mentoux (menteur), s’écria la mère Louis, y rabaisse sa turne (cabane) pour qu’on l’admire.
—Vous oubliez qui est madame et d’où elle arrive? fit observer Vorel avec respect.
—Eh ben, quoi? elle arrive de Paris; le pays de la noblesse à Martin-Firou, gilet de velours et ventre de son.
—Ce proverbe peut être vrai pour beaucoup de gens, reprit le médecin en souriant, mais pour madame de Luxeuil...
—Ah! non; elle, c’est pas ce soulier-là qui la blesse, interrompit l’ancienne meunière; mais elle n’en a pas moins sa croix à porter, et la preuve c’est qu’elle s’en est fui de Paris.
La mère Louis se mit alors à raconter au docteur l’arrivée de la jeune femme à la ferme et tout ce qui s’était passé entre elles.
—Je voulais la renvoyer, dit-elle en finissant, mais elle a tant pigné (pleuré) qu’a ben fallu la garder.
—Il me semble que vous ne pouviez avoir un seul instant d’hésitation, répliqua le médecin de sa voix caressante: recevoir madame doit être pour vous, pour nous tous, un devoir et un plaisir.
—Merci, j’aime pas ce qui me dérange, moi, répondit grossièrement la fermière, et j’aurais autant aimé qu’elle restât chez elle.
—Mon Dieu! Madame a suivi un premier mouvement de dépit bien naturel, reprit le docteur, et je dirais de plus que j’en espère un heureux résultat.
—A cause donc? demanda la paysanne.
—A cause de la hardiesse même de la démarche. Ce sera pour M. de Luxeuil une leçon qui le rendra plus circonspect.
—Vous croyez?
—Il devra tout faire pour qu’on oublie un pareil éclat.
—Eh bien, alors, reprit la mère Louis, rien n’empêche la petite de retourner avec lui.
—Moi! interrompit Honorine, oh! c’est impossible, Madame.
—Impossible! impossible, ma chère, c’est ce qu’on verra, reprit la fermière aigrement: on n’est pas mari et femme pour jouer aux quatre coins, peut-être! S’y a moyen de vous remettre ensemble, faut vous remettre. Le mière se chargera d’arranger la chose.
—Ah! ce n’est point là ce dont nous étions convenues! s’écria Honorine les larmes aux yeux; je m’étais engagée à ne point être pour vous une gêne, et à vous servir selon mes forces; j’ai tâché de tenir ma promesse, pourquoi revenir sur la vôtre?
L’allusion d’Honorine aux efforts qu’elle avait faits pour se rendre utile depuis son arrivée, loin de toucher la fermière, ralluma sa mauvaise humeur.
—Ah! tu me reproches déjà tes services! s’écria-t-elle; eh ben, je n’en veux plus.
—Mais, Madame...
—Non, je n’en veux plus. Aussi bien, ça n’aurait pas pu durer; c’était un feu de paille: tu ne feras plus rien, je te nourrirai comme les chapons, d’ici que le mière ait réglé l’affaire avec ton homme. Allons, c’est décidé, ainsi, il est inutile de vessiner (tourner) autour de moi; j’en veux plus entendre parler, que je te dis.
La paysanne écarta de la main Honorine, qui s’était approchée pour renouveler ses prières, et reprit, en grommelant, le panier que la Sureau venait de rapporter. Vorel parut affligé de sa brusquerie.
—Que madame de Luxeuil pardonne, dit-il, en souriant avec intention; on est un peu vif dans le Bessin, mais on n’est pas si diable qu’on le paraît. Nous mettrons toute la réserve désirable dans une pareille affaire, et j’ose espérer qu’elle se terminera heureusement. Ce soir même je vais écrire à Paris.
—A propos d’écriture, et mes mémoires? interrompit la fermière; voilà huit jours que vous devez les régler.
—Je n’ai pu trouver encore un instant, objecta Vorel; mais au premier jour...
—C’est ça! reprit madame Louis avec humeur; y n’a pas le temps d’écrire à Paris. C’est comme l’an dernier, qu’y m’a fait manquer la vente de mon grain par le retard d’une lettre; mais aussi ça lui a fait mieux vendre le sien.
—Allons, ma mère, encore cette histoire! dit le médecin qui ne put se défendre d’un geste d’impatience.
—Tiens! il y a peut-être pas de raison pour que j’m’en souvienne, reprit la vieille femme; j’ai perdu de l’affaire plus de soixante écus. Faut-il être malheureuse d’avoir pas été éduquée et de ne pouvoir chiffrer toute seule!
—Prenez un commis, dit Vorel ironiquement.
—Eh bien! pourquoi donc que j’en prendrai pas? s’écria la mère Louis, chez qui couvait depuis longtemps une colère que la plaisanterie du docteur fit éclater. Oui, j’en gagerai un. Ah! vous croyez me défier; vous vous dites:—La bonne femme peut pas s’passer de moi, et alors vous prenez votre air de petit bon Dieu sur une pelle; mais j’veux faire mes comptes chez moi; j’aurai quéqu’un.
Et se tournant tout à coup vers Honorine:
—Mais, à propos, tu es une savante, toi, dit-elle; tu dois savoir l’orthographe et compter en centimes, comme ils veulent à c’t’heure.
Honorine répondit affirmativement.
—Alors, reprit la mère Louis en jetant au médecin un regard de triomphe, je te garde! ça sera un commis tout trouvé.
—Parlez-vous sérieusement, Madame? s’écria la jeune femme avec un geste de joie.
—Puisque je te le dis, interrompit la fermière; à preuve que le mière va te donner les quittances qu’il avait pour établir les comptes. Voyons, dépêchez-vous, mon gendre.
La fermière ne se servait de cette dernière désignation avec Vorel que dans les moments d’irritation sérieuse. Le médecin parut inquiet.
—C’est une plaisanterie, dit-il en exagérant son sourire habituel; la chère maman Louis ne voudrait point m’enlever ainsi mon emploi.
—C’est vous qui l’avez proposé et maintenant c’est accepté, répliqua la paysanne avec résolution; la petite fera mon affaire.
—Mais vous ne l’aurez point toujours! fit observer Vorel qui continuait à sourire.
—Pourquoi ça, si elle veut rester aux Motteux? demanda la mère Louis.
—Rappelez-vous donc ce que vous me disiez tout à l’heure, qu’il fallait travailler à une réconciliation.
—Puisqu’elle a répondu qu’elle refusait! s’écria la fermière, dont les opinions avaient changé avec les intérêts; faudrait peut-être la renvoyer avec ce gadolier (mauvais sujet), qui la rend plus malheureuse que les pavés.
—Prenez garde, reprit Vorel gravement; ce gadolier, comme vous l’appelez, a le droit en sa faveur, et il viendra ici la reprendre de force.
—Lui!
—Et il faudra bien que vous la laissiez aller.
—C’est ce que nous verrons! s’écria la paysanne, qui, dans la disposition agressive de son humeur, fut pour ainsi dire encouragée par cette menace. Ah! on viendra pour m’arracher ma petite-fille; alors ça sera aux juges à décider! J’en appellerai jusqu’au Père éternel, d’abord, quand je devrais mander ma dernière chemise! Qu’il vienne un peu ce gas de Paris, je lui montrerai que Taupin vaut bien Marotte! N’aie pas peur, ma petite, s’il faut des procès nous lui en ferons, et en attendant tu chiffreras pour moi. Voyons, à la fin de tout, je vous dis que je veux les quittances, mon gendre!
Vorel comprit qu’un plus long débat ne ferait que raffermir la résolution de la fermière, et il lui remit les papiers qu’elle demandait.
L’espoir d’échapper à la dépendance du médecin par l’entremise de la jeune femme avait complétement changé les dispositions de la mère Louis, et la menace d’une lutte à soutenir contre de Luxeuil était plutôt propre à la confirmer dans sa nouvelle résolution qu’à l’en détourner. Il y avait chez elle trop de sang normand pour que la nécessité de défendre un bien devant le juge ne le lui rendît pas plus précieux.
En arrivant à la ferme, elle conduisit Honorine à la chambre qu’elle lui destinait, comme pour constater sa résolution de la garder, y fit porter le livre de compte, une table pour écrire, et aida la jeune femme à tout ranger.
Mais tant de fatigues et d’émotions avaient épuisé cette dernière: après quelques efforts, elle se laissa tomber au bord du lit qu’elle voulait préparer, et porta les deux mains à son front.
—Qu’est-ce qu’y lui prend donc? dit la mère Louis en courant à elle.
—Je ne sais, balbutia Honorine, je vois... tout flotter... devant mes yeux.
—Par exemple! va pas tomber en faiblesse! s’écria la fermière en la soutenant; j’étais bien sûre que tu en faisais trop pour tes forces!... Pourquoi donc que tu t’es pas reposée... Y a-t-il du bon sens de se mettre dans un pareil état... et puis..... V’là que j’y pense, je t’ai rien proposé quand t’es arrivée; t’as besoin peut-être.
—En effet, murmura Honorine, je n’ai rien pris depuis ce matin.
La fermière recula.
—Qu’est-ce que tu dis là? s’écria-t-elle, malheureuse! et t’as pas demandé?...
—Je ne voulais... rien déranger... aux habitudes, dit Honorine, qui continuait à lutter contre sa défaillance.
La mère Louis joignit les mains avec une exclamation de surprise dans laquelle perçait une sorte d’admiration. La réserve de la jeune femme était un mérite trop à portée de cette nature plutôt grossière que mauvaise, pour qu’elle n’en fût pas touchée. A la pensée que sa petite-fille avait eu faim chez elle sans rien dire, elle sentit une larme lui venir dans les yeux.
—C’est aussi passer la plaisanterie! s’écria-t-elle. A-t-on jamais vu! elle se serait laissée périr plutôt que de donner de l’embarras... et on dit encore la Parisienne!... Ici Marie-Jeanne, François! apportez tout ce qu’y a à manger dans la maison! Et dire que j’ai pas pensé plus tôt... non, y a des jours comme ça, où je suis une vraie Iroquoise... Attends, petite, attends mezette (mésange); je vais te chercher queuque chose qui te remettra.
La mère Louis sortit en trottant et revint bientôt avec une bouteille de cassis dont elle força sa petite-fille à boire quelques gouttes; de leur côté, les servantes apportèrent des fruits, des viandes, du laitage: en un instant la table fut couverte.
La fermière voulait forcer Honorine à manger de tout, prétendant que si elle refusait, ce serait preuve de rancune. La jeune femme eut beaucoup de peine à se défendre et à faire comprendre qu’un peu de lait et quelques heures de repos suffiraient pour la remettre. La mère Louis ne se rendit que sur la promesse qu’elle se dédommagerait le lendemain. Elle arrangea elle-même l’oreiller d’Honorine, tendit une nappe devant la fenêtre qui n’avait point de rideau, se retira sur la pointe du pied en lui recommandant de dormir la grasse matinée et descendit pour empêcher tout bruit qui eût troublé son sommeil.
La révolution opérée ne pouvait être plus complète; Honorine était maintenant sa petite-fille, ce n’était plus la dame de Paris.
Mais pendant que ce changement favorable s’opérait aux Motteux, Vorel parcourait le jardin du manoir les bras croisés, la tête basse et les lèvres serrées. Ce qui venait de se passer entre lui et la mère Louis avait trompé toutes ses espérances, et en assurant le séjour d’Honorine à la ferme, lui donnait une dangereuse rivale. Il n’ignorait point qu’en cédant à son influence, la mère Louis avait contre lui une haine tempérée de crainte qui ne demandait que l’occasion pour s’exprimer et grandir. S’il ne réussissait à éloigner la jeune femme, sa domination était donc compromise, et, par suite peut-être, toutes ses espérances de richesse anéanties!
Cette dernière pensée coula au cœur de Vorel comme un venin et y alluma une sourde haine contre sa nièce. Une fois déjà elle avait fait obstacle à ses projets, en lui échappant pour passer aux mains de la prieure de Tours. Depuis, près de vingt années avaient été consacrées à réparer cet échec, et l’enfant devenue femme menaçait de nouveau son édifice de ruses! Une telle persistance ressemblait à de la fatalité; évidemment Honorine était l’archange destiné à le perdre, s’il ne réussissait à s’en délivrer.
A la ville, le lever du soleil n’est qu’un changement de sensation pour le regard, tout au plus un réveil de la pensée et de l’action; mais, à la ferme, c’est l’apparition d’un nouveau monde: la différence de la nuit et du jour n’y est point seulement un contraste d’optique, c’est la manifestation de deux formes distinctes de la création. Le monde des ombres rentre au repos pour laisser paraître le monde de lumière. Les cris de l’oiseau de nuit s’éteignent; la bête fauve, dont l’ombre rôdait autour[Pg 120-----] des habitations, disparaît dans les bois; les lumières mystérieuses s’évanouissent, la brise plaintive tombe, les rumeurs des eaux s’apaisent, et tout à coup, aux lueurs rougissantes de l’aurore, les pinsons s’éveillent dans les feuilles, les grands bois sortent de l’obscurité étincelante de rosée; les aboiements des chiens retentissent, et les appels des travailleurs se font entendre. L’homme reprend possession de son domaine; la création entière semble célébrer la réapparition de son roi!
Honorine fut réveillée par ce concert de lumières et d’harmonie. L’aube illuminait sa chambre de joyeux rayons, et les parfums qu’exhale au matin la sève ravivée pénétraient jusqu’à son lit par les vitrages à demi brisés.
Elle se leva ranimée et courut à la fenêtre. Les brumes qui enveloppaient la vallée commençaient à se soulever, montrant au loin des percées lumineuses dans lesquelles scintillaient les toits du hameau.
Les servantes traversaient la cour en chantant; les vaches mugissaient dans leurs étables, les pigeons roucoulaient sur les toits de chaume; tout respirait enfin je ne sais quelle gaieté agreste et vivace! c’était comme un réveil de la vie, mais plus facile, plus calme et pour ainsi dire renouvelée!
Quelle que fût la préoccupation de la jeune femme, elle ne put échapper à cette influence bienfaisante du matin. Aussi la mère Louis poussa-t-elle une exclamation de joie en entrant.
—Ah! vertudieu! à la bonne heure, voilà ses couleurs revenues, s’écria-t-elle en l’embrassant; eh bien! comment que t’as dormi dans notre logane (cabane), petiote?
—Fort bien, Madame, répondit Honorine timidement.
—Et t’as pas fait de mauvais rêves? T’as pas vu de hans (fantômes)? Dame! c’est pas gentil comme dans vos palais de Paris; mais l’accoutumance fait la jouissance. Nous tâcherons, d’ailleurs, de l’arranger un peu ton nid.
—Tel qu’il est j’en suis satisfaite, dit Honorine, et je ne demande rien de plus, Madame.
—M’appelle donc pas comme ça, interrompit la fermière avec une grosse bonhomie. Voyons, ma mezette (mésange), parle-moi d’amitié, et dis-moi mère Louis... Tu me gardes peut-être rancune d’hier.
—Oh! ne le croyez pas, Madame.
—Encore!
—Non... ma mère, reprit Honorine en levant sur la paysanne un regard plus rassuré; ma mère, puisque vous me permettez de me dire votre fille.
—Si je te le permets! est-ce que c’est pas un droit? Allons, allons, mezette, tu verras que nous nous entendrons. Mais, pour le quart d’heure, il faut que tu descendes, vu qu’il y a en bas l’homme qui t’a conduite ici.
—Marc?
—Oui, il vient d’arriver avec une femme; je leur ai fait servir à déjeuner... car y faut pas croire, d’après ce qui t’est arrivé hier, que ta grand’mère soit avaricieuse, au moins! Vertudieu! j’suis jamais plus contente que quand j’peux faire manger mon bien par de braves gens... Aussi je leur ai fait servir du meilleur.
Honorine suivit la mère Louis, et trouva Marc et Françoise assis devant une table, sur laquelle la fermière avait fait entasser tout ce qui pouvait se manger à la ferme. Il était évident qu’elle tenait à rétablir sa réputation aux yeux de sa petite-fille, et à racheter, à ses propres yeux, son oubli de la veille. C’était de l’hospitalité, exaltée par le remords!
—Vois-tu, dit-elle en entrant, les voilà qui s’empaffent (se rassasient) à discrétion; vous dérangez point, braves gens; table servie doit être amie. Vous voyez que ce matin la petite est gaillarde comme le moisson d’arbanie (le moineau).
—Madame est-elle vraiment comme elle le souhaitait? demanda Marc, qui s’était levé et dont le regard interrogateur donnait un double sens à ses paroles.
—Oui, dit Honorine avec intention, ne vous inquiétez point pour moi, monsieur Marc, tout ira bien.
Le garçon de bureau parut respirer plus librement.
—J’en réponds que ça ira bien, reprit la mère Louis, qui n’avait vu, dans la question et dans la réponse échangées, qu’une allusion à l’indisposition de la veille; avant un mois je parie vous l’engraisser que vous ne la reconnaîtrez plus. Je me charge de sa santé, moi! Pas vrai, petite, que tu me laisseras être ton mière? Oh! c’est qu’elle n’a plus peur de moi; nous sommes toutes deux maintenant à pain et à pot; mais remettez-vous donc à table!
—Faites excuse, Madame, dit Marc, nous avons fini; mais puisque vous nous êtes si bonne, ça m’enhardit à vous adresser une demande.
—Qu’est-ce que c’est?
—Voici une jeune femme qui a besoin et bonne volonté de gagner sa vie. On lui a dit qu’elle trouverait du travail à la ferme, et alors elle est venue...
—Ah! c’est pour ça, dit la mère Louis, qui changea subitement de ton et jeta sur Françoise un regard inquisitorial, et qu’est-ce qu’elle fait, votre protégée?
—Tout ce qu’on m’ordonnera, Madame, dit Françoise avec soumission.
—Ce qui veut dire que vous ne savez rien, reprit la fermière rudement; ça ne peut pas nous aller, ma chère; d’ailleurs, vous avez les mains trop blanches pour nous autres gens de la campagne; vous vous êtes trompée de maison.
—Pardonnez-moi, dit Marc, elle était adressée à la ferme par une personne qui lui a remis une lettre.
—Qui ça?
—Un Monsieur bien bon, reprit Françoise en présentant le billet; il m’a dit qu’il était le voisin de Madame.
—Donnez à la mezette; j’ai pas d’assez bons yeux pour lire l’écriture de main... Un voisin des Motteux?... Qui donc que ça peut être?
Honorine ouvrit le billet, regarda la signature et tressaillit.
—M. de Gausson, s’écria-t-elle.
—Ah! c’est le beau brun, reprit l’ancienne meunière; c’est différent; je l’aime tout plein.
—Il est donc ici? demanda Honorine agitée.
—Mais certainement, reprit la mère Louis; il demeure à son vieux pigeonnier de Vert-Bec; est-ce que tu le connais aussi?
—Je l’ai vu à Paris.
—Tiens, c’est juste, il en est... eh ben, comme ça se trouve... y vient souvent aux Motteux, vous pourrez refaire connaissance; mais voyons donc ce qu’elle chante sa lettre.
Honorine lut:
«Chère madame Louis,
»Je vous adresse une pauvre femme que je recommande à votre bon cœur. Procurez-lui du travail; elle paraît douce, pleine de zèle et de bons sentiments. A mon retour, j’irai vous remercier de ce que vous aurez fait pour elle.
»Je vous avertis que le gros Lorry a vendu ses foins 37 francs le millier.
«De Gausson.»
—Voyez-vous, s’écria la mère Louis, frappée surtout de ce dernier renseignement qui formait comme la péroraison de la supplique de Marcel; 37 fr. le millier, quand mon gendre voulait me les faire livrer à 34; c’est comme ça qu’y prend mes intérêts! on ne peut compter sur personne.
—Sauf sur M. de Gausson, fit observer Honorine en souriant.
—C’est vrai qu’il est bien gentil d’avoir pensé à moi, reprit la mère Louis; du reste, je l’ai toujours dit, c’est un fel gars.
—Aussi vous ne refusez point sa protégée, ma mère, continua la jeune femme; il la recommande à votre bon cœur, et il doit venir vous remercier à son retour, il faut bien, pour cela, que vous fassiez quelque chose.
—Tu crois, dit la fermière adoucie; eh bien! nous verrons. Mais qu’est-ce qu’on peut faire de quéqu’un qu’a un enfant sur les bras!... encore si elle pouvait coudre... laver!
Françoise se hâta de répondre qu’elle le pouvait.
—Alors on vous prendra... mais rien qu’à l’essai! dit la fermière qui, au milieu même de ses entraînements, gardait quelque chose de la prudence normande; vous demeurez à Trévières, pas vrai?
—Elle est arrivée hier, fit observer Marc, et ne demeure encore nulle part.
—Ah! elle est sur le pavé, reprit la mère Louis avec brusquerie, mais en jetant à Françoise un regard plus attentif; il faut bien pourtant qu’elle trouve une niche pour elle et son petit.
—Je chercherai, Madame...
—Oui, mais y faut un ménage, et m’est avis que vous portez tout votre faix dans votre bonnet de nuit! Y a bien ici, au bout du petit bois, la turne de l’ancien garde qu’on pourrait vous prêter.
—Ah! Madame! s’écria Françoise attendrie, comment vous remercier...
—C’est qu’en attendant, je vous avertis, reprit la mère Louis toujours précautionneuse, si j’trouve à la louer plus tard, faudra déménager... mais pour le moment vous serez toujours à l’abri avec le petit... Quel âge qu’il a vot’gars?
—Trente mois, Madame.
—C’est éveillé comme un jacquet (écureuil), donnez-le moi donc un peu.
—Mon Dieu! je vous demande bien pardon, dit timidement Françoise, mais il est si accoutumé à moi qu’il ne veut point me quitter... Veux-tu aller à madame?
L’enfant regarda la fermière, et, trompé sans doute par son costume qui lui rappela son ancienne nourrice, il se jeta dans ses bras avec un cri joyeux.
—Vous le voyez qu’il veut bien venir, dit la mère Louis en le faisant sauter.
—C’est la première fois! répliqua Françoise étonnée, et madame est la seule personne qui ne lui ait point fait peur.
—Et pourquoi donc que je lui ferais peur à ce pauvre friquet, dit la paysanne visiblement flattée de l’exception faite en sa faveur par l’enfant; ces petits, ça sent le monde, voyez-vous; ça a l’instinct de connaître les bons des maxis (méchants); pas vrai, mon jacquet; allons, gazouille; grimpe sur ma falle (estomac); a-t-y l’air dégoté au moins; je veux que nous soyons bons amis. Dites donc, ma fille, comment qu’on vous appelle?
—Françoise, Madame.
—Eh bien, Françoise, faudra que vous preniez tous les soirs une guichonnée de lait à la ferme pour le petit.
—Ah! Madame, que de bontés!...
—Je vous dis pas que ça sera une rente à perpétuité, au moins; mais pour le quart d’heure l’enfant en profitera.
Honorine se joignit à Françoise et à Marc pour remercier la mère Louis, dont leur reconnaissance exalta la bonne volonté, et qui voulut établir sur-le-champ la grisette dans l’ancienne maison du garde.
Celle-ci, placée à la lisière du taillis, sur le penchant du coteau qui domine au nord la rivière d’Esque, avait quelque chose de sauvage, qui formait contraste avec les autres habitations du pays. Sa vue, bornée de tous côtés par les fourrés, ne s’étendait que sur une friche semée de rochers et de touffes de chênes, tandis qu’un peu plus bas, le coteau, soigneusement cultivé, présentait à l’œil des vergers, des champs de blé vert et des prairies entrecoupées de maisonnettes blanches.
Mais après tant d’épreuves, l’aspect d’un toit qui pût abriter son fils ne pouvait manquer, quel qu’il fût, de réjouir Françoise. Douée d’ailleurs de cette heureuse souplesse, qui fait que les désirs s’abaissent ou s’élèvent selon la situation, comme une eau docile qui prend d’elle-même son niveau, la grisette n’avait à combattre ni le regret des biens perdus, ni l’ajournement des biens espérés. Elle recevait de Dieu son bonheur au jour le jour, sans se tourmenter de ce qu’il avait été la veille, de ce qu’il serait le lendemain. Aussi lorsque, après avoir mis en ordre le pauvre ménage de la maison des taillis, elle se retrouva, le soir, devant un feu de broussailles, et son enfant endormi sur ses genoux, sa pensée ne se reporta point vers les angoisses qu’elle venait de traverser, mais sur le secours inespéré qui lui était offert. Satisfaite d’avoir trouvé, comme l’oiseau du ciel, un nid et le repos du soir, elle ne porta pas plus loin ses regards et attendit tranquillement le sommeil.
Quant à Honorine, de retour à la ferme, elle y avait trouvé une réponse d’Arthur à la lettre écrite avant son départ.
Sans entrer dans aucune explication, de Luxeuil déclarait consentir provisoirement à son séjour près de sa grand’mère, et lui demandait une procuration qui lui permît d’exercer les droits qu’elle avait déclaré lui abandonner.
La lettre était courte, sans allusions, et ne laissait aucun moyen de deviner les intentions d’Arthur pour l’avenir.
En tous cas, le présent semblait assuré et la jeune femme pouvait espérer qu’emporté par le tourbillon du monde, son mari finirait par l’oublier. Trop de prévoyance d’ailleurs eût entraîné trop d’inquiétudes; elle résolut de se laisser aller au courant des événements, sans ajouter au poids de chaque jour celui d’un avenir incertain.
Rien ne retenait plus Marc à la ferme; il prit congé d’Honorine qui, au moment de le quitter, se sentit saisie d’un attendrissement mêlé d’angoisses. Malgré l’évidence du service reçu, la révélation d’Arthur continuait à la troubler: elle eût voulu réhabiliter dans son propre jugement celui dont elle avait obtenu le secours, ennoblir sa reconnaissance par l’estime, glorifier enfin un dévouement dont elle profitait sans pouvoir l’avouer!
Au moment où Marc se découvrit en répétant d’un accent ému, un dernier adieu, elle lui saisit la main et s’écria:
—Vous ne partirez pas ainsi sans m’avoir ôté mes doutes! on vous a accusé devant moi!... mais ce qu’on a dit était un mensonge, avouez-le, je vous en conjure à mains jointes; avouez-le, à moi, à moi seule! je ne vous demande pas d’explication, dites seulement: non! et je vous croirai.
Au premier mot prononcé par la jeune femme, Marc était devenu très-pâle; il retira sa main et répondit à voix basse:
—Madame n’a-t-elle point vu que je n’avais rien à répondre, quand monsieur de Luxeuil m’a accusé?
—Oui, dit vivement Honorine, mais quelque motif... que j’ignore... vous a sans doute forcé à vous taire.
Il secoua la tête.
—Je me suis tu parce qu’il disait la vérité, répliqua-t-il sourdement.
Honorine le regarda.
—Mais alors, reprit-elle troublée, si vous avez été.... si vous êtes... ce qu’il a dit, que peut-il y avoir eu de commun entre vous et ma mère? Pourquoi ce dévouement dont je ne puis désormais soupçonner la sincérité? Quel intérêt trouvez-vous à me défendre?
—Vous m’avez déjà fait cette question, murmura Marc.
—Et vous m’avez répondu: plus tard!
—Oui, plus tard..... peut-être... peut-être aussi jamais! cela dépendra de vous.
—De moi? comment faut-il vous supplier alors?
—Ne suppliez pas, c’est inutile... pour me faire parler il faut autre chose que vos désirs d’aujourd’hui... car je comprends bien, allez, pourquoi ces questions! Vous êtes triste d’être protégée par un réprouvé comme moi; vous voudriez ne pas être obligée de me mépriser, le mépris gêne la reconnaissance! mais je n’en attends pas; vous ne m’en devez pas!
—Que dites-vous?
—Non; tout ce que je vous demande c’est d’avoir confiance! c’est quand vous aurez besoin de moi, de me faire signe, c’est de me regarder comme votre chien, de me dire: va là, viens ici! et j’irai, je viendrai! de vous servir de moi sans vous inquiéter de moi; de me regarder comme une chose qui est à vous et dont vous pouvez tout faire pour votre bonheur.
Honorine fut remuée jusqu’au fond du cœur. Le ton de Marc n’avait ni l’élévation ni l’élan que donne l’exaltation; il était bas, presque calme, mais profond. On sentait qu’il n’y avait là aucune surexcitation passagère; c’était l’expression d’un sentiment depuis longtemps maître de l’âme tout entière, et qui en était devenu pour ainsi dire l’état.
—Et vous pensez que je puis accepter un échange aussi inégal, s’écria-t-elle, les yeux fixés sur Marc! à vous tous les sacrifices; à moi la liberté de l’ingratitude! je repousse de pareilles conditions! si je ne dois être pour vous qu’une cause d’abnégation et de souffrance, je renonce à en profiter plus longtemps.
—Ah! ne dites pas cela! interrompit précipitamment Marc d’un accent douloureux: ce que je fais pour vous est désormais ma seule consolation; si je ne l’avais point, tout serait fini! Savez-vous, d’ailleurs, si ce n’est pas un moyen de me racheter... si je n’ai rien à expier!.... Ah! ne me faites pas de questions, mais laissez-moi continuer ce que j’ai commencé... Si ce n’est pas pour vous, que ce soit pour moi-même; j’en ai besoin et je..... je l’ai PROMIS!
Ce dernier mot fut accentué par Marc avec une sorte d’exaltation pieuse. Il semblait l’avoir prononcé sous l’obsession d’un souvenir toujours présent, et comme si quelque ombre invisible eût pu entendre ce renouvellement de serment. Honorine saisie garda le silence; il y eut une pause assez longue.
—Je retourne à Paris, reprit enfin Marc, c’est là surtout que vous avez besoin d’un serviteur dévoué. Je veillerai sur M. de Luxeuil; et, s’il est nécessaire, vous recevrez mes avertissements.
—Allez donc, dit la jeune femme, puisque vous voulez rester un bienfaiteur inconnu; allez, et quel qu’ait été votre passé, soyez béni pour ce que je vous dois.
Elle lui présenta les deux mains qu’il prit et qu’il baisa l’une après l’autre avec une humilité attendrie, puis il salua et partit.
Les premiers jours furent employés par Honorine à s’établir à la ferme. Marc lui avait recommandé Françoise avant son départ; mais cette recommandation était inutile. La protégée de Marcel était déjà celle d’Honorine.
Il y avait d’ailleurs, entre les deux jeunes femmes, des rapports de position qui devaient les rapprocher. Toutes deux meurtries par de douloureuses épreuves, toutes deux exilées dans un milieu nouveau et inconnu, elles sentirent le besoin de s’appuyer l’une sur l’autre. La similitude des souffrances avait fait disparaître l’inégalité des rangs, et à peine ces cœurs de même famille se furent-ils sentis, qu’ils s’adoptèrent avec ardeur.
Seulement, la différence des habitudes donna à chacune une position distincte. Honorine fut la maîtresse affectueuse et tendre, Françoise la servante reconnaissante et dévouée.
Toutes deux travaillèrent ensemble à conquérir les bonnes grâces de la mère Louis, non par calcul, mais par un besoin commun d’être aimées. La fermière, dont le grossier égoïsme s’était jusqu’alors agité au milieu des basses servilités ou des résistances brutales, se trouva comme enveloppée dans l’affectueuse complaisance de ces deux femmes. Leur zèle et leur patience désarmaient sa mauvaise humeur. Toujours dans son tort avec elles, sans qu’elles le fissent jamais sentir, la paysanne finit par reconnaître intérieurement son injustice. Ces coups, auxquels on ne répondait jamais que par le sourire ou les caresses, lui firent honte; elle mit les deux Parisiennes hors de la sphère où grondaient ses emportements, et n’eut plus pour elles que des paroles amicales. C’était comme un port où, après les tempêtes du ménage, elle venait respirer. Elle arrivait toujours près des deux femmes chargée de malédictions ou de menaces, et, tout en criant ses plaintes, elle se dégrisait de sa colère, se calmait insensiblement et finissait par redevenir tranquille et souriante. On eût dit une nuée d’orage entrant dans une atmosphère paisible où elle se déchargeait insensiblement de ses foudres.
Vorel s’était vite aperçu de l’influence acquise par Honorine et par Françoise; mais tous ses efforts pour y nuire furent inutiles: la fermière des Motteux étant une de ces natures pour lesquelles l’opposition est un stimulant, loin d’être un obstacle. En voyant le médecin combattre sa nouvelle préférence, elle y trouva, outre le charme de l’entraînement, celui de la contradiction, et elle s’y affermit.
C’était, d’ailleurs, pour elle, un moyen d’échapper à Vorel, que la nécessité lui avait longtemps imposé, et elle le lui déclara avec sa liberté habituelle. Le docteur ne témoigna nulle rancune apparente à sa nièce ni à Françoise, mais il ne négligea rien de ce qui pouvait leur nuire dans le pays.
L’humeur de la fermière amenait de fréquentes querelles de voisinage, des réclamations d’ouvriers, des débats d’intérêt dont le docteur était l’arbitre: qui avait à se plaindre de la mère Louis venait s’adresser à lui comme au seul intermédiaire qui pût faire entendre raison à la propriétaire des Motteux, et son intervention était toujours décisive. Mais, peu après l’arrivée d’Honorine, il affecta de refuser son entremise, en déclarant que la fermière avait renoncé à ses conseils, qu’elle était désormais sous de nouvelles influences, et qu’il n’y avait plus rien à espérer.
Les malheureux, ainsi éconduits, se retiraient le cœur gros de malédictions contre les deux Parisiennes, qui devenaient responsables, à leur insu, de toutes les injustices et de toutes les violences de la paysanne.
Celle-ci contribuait, de son côté, sans le vouloir, à grossir l’animadversion générale contre ses protégées. Justement préoccupée de tout ce qu’il y avait chez elle à louer, elle les citait sans cesse en exemple; elle s’en faisait une arme pour frapper, et un moyen de comparaison pour déprécier; les noms d’Honorine et de Françoise étaient devenus à Trévières ce qu’avait été celui d’Aristide à Athènes. Les plus vicieux les avaient prises en haine, et les meilleurs eux-mêmes se lassaient de les entendre appeler justes. Ajoutez l’hostilité instinctive des paysans pour tout ce qui vient de la ville, et surtout de la grande ville. Rien qu’en leur qualité de Parisiennes, les deux femmes étaient déjà des ennemies. Que venaient chercher ces étrangères? Pourquoi occupaient-elles à la ferme des places qu’auraient pu occuper des gens du pays? Ne suffisait-il pas de voir leur beauté, leur grâce, leurs manières polies pour deviner que toutes deux devaient être des intrigantes?...
Et avec cela elles se montraient fières. Elles évitaient de causer indifféremment avec tout le monde; elles ne faisaient point de visites aux voisins; elles ne prenaient part à aucun des commérages qui occupaient la paroisse: on ne les voyait qu’au travail pendant la semaine, et à l’église le dimanche! Pour se condamner à vivre ainsi isolées, il fallait avoir quelque chose de bien sérieux à se reprocher.
Ces calomnies et ces inductions passant de bouche en bouche, grossies par la sottise ou par la méchanceté, une sorte de ligue se forma contre les deux femmes: on les accusait sourdement de tout ce qui se faisait de mal à la ferme.
Mais, parmi les haines ainsi fomentées, il en était une plus dangereuse que toutes les autres: c’était celle de ce paysan entrevu par le lecteur lors de l’arrivée d’Honorine aux Motteux.
Romain, le fermier du Vrillet, passait depuis longtemps pour l’homme le plus redoutable du canton. L’opinion publique l’accusait même tout bas d’avoir occasionné la mort de sa sœur par ses violences; mais nul n’eût osé répéter hautement, et en sa présence, une pareille dénonciation. Capable de tous les excès quand il était poussé par la passion, il avait réussi à se faire une sauvegarde de ses emportements; la terreur qu’il inspirait lui tenait lieu d’innocence: personne ne l’avait pour ami, tout le monde évitait de se le rendre ennemi.
La propriétaire des Motteux partageait, sans l’avouer, la crainte générale. Elle se querellait bien, de temps en temps avec Romain, dont la ferme touchait à ses terres; elle le menaçait même par instants, mais tout s’arrêtait là, et le paysan, sûr d’obtenir ce qu’il voulait, pardonnait à sa voisine cette résistance plus bruyante que sérieuse.
L’arrivée d’Honorine changea cet état de choses. Affligée des débats qu’elle voyait, la jeune femme engagea la mère Louis à y couper court, en brisant tout rapport avec le fermier du Vrillet. En conséquence, les clôtures furent rétablies, un terrain qui se trouvait commun partagé, quelques comptes arriérés soumis à un arbitre et l’on cessa de se voir et de se parler.
Cette rupture, dans laquelle Romain eut tout à perdre, l’enflamma de haine contre la dame de Paris qui en avait été la conseillère innocente mais avouée. Seule, elle avait secoué ce joug de terreur qui, après avoir fait la sûreté du paysan, était insensiblement devenu son orgueil, et elle l’avait fait sans effort, sans bruit, avec une facilité indifférente qui augmentait son dépit. Aussi, lorsqu’assis à sa porte, il voyait passer cette jeune femme frêle et timide en apparence, qui avait réussi à débarrasser la mère Louis de ses exigences, son front ne manquait jamais de se plisser; ses lèvres se tordaient autour de la courte pipe serrée entre ses dents et il se demandait en lui-même comment il pourrait se venger.
Honorine ne soupçonnait ni cette rancune ni ce danger. Ne connaissant point Romain, elle n’avait pu prévoir l’effet que produiraient sur lui les mesures conseillées; son audace n’avait été que de l’ignorance et elle y persistait.
Cependant, parmi tant d’ennemis, la jeune femme avait un allié; c’était le fils même de Vorel.
Le grand Jodane, comme on l’appelait, avait trouvé chez sa cousine une bienveillance compatissante qui l’avait d’autant plus touché qu’elle était, pour lui, toute nouvelle. Chaque jour plus assidu près de la jeune femme, il retrouvait, à ses côtés, quelques lueurs de son intelligence avortée; il comprenait ce qu’elle disait, il avait pour elle des prévenances qui prouvaient un reste de mémoire et de raisonnement; il s’apercevait de sa gaieté et de sa tristesse; il la partageait! L’âme de l’idiot semblait prendre des forces au contact de celle d’Honorine, comme l’enfant au sein de sa mère; c’était une sorte d’allaitement spirituel qui, momentanément, renouvelait chez lui la vie et donnait à son intelligence une énergie passagère.
La jeune femme se plaisait à faire jaillir ainsi quelques étincelles de ce foyer presque éteint; elle y soufflait doucement, elle y entretenait le reste de flamme vacillante qui retenait encore son cousin dans l’humanité; elle le disputait à l’abrutissement avec une caressante sollicitude!
Contrairement à ce qu’on eût pu craindre, Vorel favorisa cette intimité de son fils avec Honorine.
Quant à celle-ci, ignorant l’orage qui la menaçait, elle s’était peu à peu accoutumée à sa nouvelle situation.
Trois mois s’écoulèrent sans y rien changer. Une lettre de Marc lui avait appris que de Luxeuil, lancé plus que jamais dans les hasards du turff, s’y soutenait grâce à des paris toujours heureux, et ne pensait point à elle; d’un autre côté, la mère Louis continuait à lui montrer une confiance croissante, et Françoise entrait chaque jour plus avant dans son affection.
Elle était donc aussi tranquille qu’elle pouvait l’être, lorsque, se trouvant un dimanche matin dans l’avenue des Motteux, avec la grisette, qui lui racontait son histoire, le petit Jules, occupé à cueillir des fleurettes, se redressa tout à coup au milieu de l’herbe et montra du doigt un cavalier qui venait de tourner l’avenue. Les deux femmes levèrent les yeux en même temps, et poussèrent deux cris, l’un de joie, l’autre de saisissement. Le cavalier était Marcel de Gausson.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Après la première surprise et les premières questions échangées, Françoise avait pris la bride du cheval de Marcel pour le conduire à la ferme et avertir madame Louis. Le jeune homme et Honorine restèrent seuls.
Celle-ci venait de prendre sur ses genoux le petit Jules, et passait les doigts dans ses cheveux bouclés; Marcel, debout devant elle, la regardait sans parler.
Il y eut une assez longue pause pendant laquelle on n’entendit que le gazouillement des oiseaux et de l’enfant. Enfin, de Gausson laissa échapper un geste douloureux.
—Et c’est ici que je vous retrouve, dit-il, comme s’il achevait tout haut une pensée commencée tout bas; vous ici, mon Dieu!...
—C’était mon seul asile, murmura Honorine.
—Ainsi, tout ce que j’avais craint s’est accompli! Ah! si j’avais pu vous parler avant mon départ, avant ce mariage....
—Ne rappelons point le passé, interrompit précipitamment Honorine; à quoi bon revenir sur ce qu’on ne peut changer? Parlez-moi de vous, de vos projets...
—Je n’en ai point, reprit de Gausson; ou plutôt, ceux de la veille sont détruits par les désirs du lendemain. Mon âme ressemble à ces malades qui cherchent une attitude moins douloureuse sans pouvoir la trouver. Il y a quelques jours encore, je songeais à partir, à quitter la France...
Honorine leva brusquement la tête.
—J’ignorais alors votre arrivée aux Motteux, continua Marcel; depuis.... j’ai réfléchi...
—Et vous avez renoncé à ce projet?
—Je veux le soumettre à votre décision.
—Comment?
—Rappelez-vous notre première entrevue, il y a trois ans, reprit-il en regardant la jeune femme; alors nous étions tous les deux libres, heureux, pleins d’espérances et je vous proposai d’associer nos joies... de devenir votre ami! Aujourd’hui tout est changé; nous voici enchaînés au passé, sombres, l’âme abattue; eh bien! je viens vous offrir de mettre en commun nos tristesses, de renouer cette amitié suspendue. Si vous acceptez, je reste, car ma vie aura retrouvé un but; je ne serai plus inutile et isolé; si vous refusez, au contraire, je pars, et cet entretien sera un adieu!
—Pourquoi une pareille alternative? dit Honorine émue; vous ne pouvez ignorer combien votre amitié m’est précieuse; mais cette amitié ne peut absorber votre vie tout entière. Vous avez d’autres joies à attendre. Qui vous oblige à devenir solidaire d’une destinée perdue, quand la vôtre est libre, riche d’avenir? Que pouvez-vous trouver dans cette association fraternelle où je n’apporterais que des afflictions sans remèdes?
—J’y trouverai... le bonheur de m’affliger avec vous, dit Marcel d’un ton plein de passion, celui de vous soutenir! Nous chercherons ensemble une distraction à vos chagrins; de bonnes actions à faire; quelque généreuse mission à remplir. Vous aurez la volonté, moi l’action. Je serai le serviteur dévoué de vos projets, et je vous rapporterai la joie de la réussite. Un jour, vous l’avez oublié peut-être, un jour vous m’avez dit:—Pourquoi ne suis-je pas votre sœur? Eh bien! ce que le hasard n’avait point voulu faire, le malheur l’aura fait; je deviendrai votre frère... Votre frère, comme les hommes sont les frères des anges.
—Hélas! c’est un beau rêve! dit la jeune femme, qui s’animait malgré elle à l’ardeur de Marcel; mais rien qu’un rêve!
—Pourquoi cela? demanda de Gausson étonné.
—Pourquoi? répéta Honorine avec une émotion embarrassée, parce qu’à la femme abandonnée le monde impose la solitude.
Le front de Marcel s’assombrit subitement, et il demeura muet. Depuis qu’il avait appris la présence d’Honorine aux Motteux, ce projet de rapprochement avait grandi en lui sans que son exaltation soupçonnât aucun obstacle. Les mots prononcés par madame de Luxeuil frappèrent ses espérances comme la flèche qui atteint l’oiseau dans les nuages. Il sentit une douleur aiguë lui traverser le cœur et demeura un instant paralysé; mais, trop loyal pour nier la vérité parce qu’elle renversait son édifice de bonheur, il reprit avec accablement:
—Vous avez raison, Madame; oui, le monde ne croit pas aux affections pures; la souffrance excite plutôt ses soupçons que sa pitié. Je ne pourrais venir à la ferme sans que mes visites fussent connues, calomniées. Ah! vous avez raison, il vaut mieux que je parte.
—Non, dit Honorine avec prière; si la malignité humaine nous défend l’intimité, elle ne nous impose point une séparation inutile. Demeurez près de nous. Je saurai du moins que vous êtes là; je vous verrai de loin en loin, j’entendrai prononcer votre nom, je penserai enfin qu’il y a, dans le voisinage, un ami qui ne m’oubliera pas, et que je puis appeler au besoin.
—Eh bien! soit, dit Marcel ranimé par cette espérance d’être encore, de loin, un protecteur pour Honorine; puisque vous le voulez, je resterai à portée de votre voix, sans me montrer; ne songeant qu’à vous, mais attendant votre appel. Seulement, laissez-moi la consolation des absents: celle de vous écrire...
Honorine voulut l’interrompre.
—Oh! ne me refusez pas! continua de Gausson avec impétuosité; songez que ce sera ma seule joie. Si le monde nous sépare, que nos esprits au moins puissent s’entendre à travers l’espace; que pouvez-vous craindre? Je ne vous écrirai que ce que vous m’auriez permis de vous dire, si j’avais pu vous voir. Je ne vous demande point de me répondre, mais de me lire, à vos heures perdues, comme vous liriez le journal d’un ami éloigné ou mort! Vous me le promettez, n’est-ce pas, Madame? Il le faut, il le faut, ou moi aussi je n’ai rien promis; si vous me refusez, je partirai. L’arrivée de la mère Louis empêcha Honorine de répondre.
L’ex-meunière venait au-devant de Marcel avec cet empressement souriant qu’elle avait toujours pour les beaux gars. Elle conduisit de Gausson à la ferme, où elle le força d’accepter une collation et de visiter avec elle ses étables, ses granges, son courtil. Comme elle se faisait toujours suivre par Honorine, le jeune homme multipliait les questions pour prolonger la visite et s’extasiait sur tout. Aussi, au moment de se séparer, la mère Louis déclara-t-elle que le monsieur de Paris était né pour vivre à la campagne et pour conduire une ferme.
—Qué dommage qu’y lui aient mangé, là-bas, son saint frusquin, ajouta-t-elle, en s’adressant à demi-voix à Honorine; maintenant faut qu’il aille chercher fortune dans les colonies.
—Dans les colonies! répéta la jeune femme étonnée.
—Ou ailleurs, reprit la fermière; toujours est-il qu’une fois parti, nous n’aurons guère chance de le revoir!
Honorine tressaillit.
—Pas vrai, voisin, reprit la fermière plus haut, et se retournant vers de Gausson; pas vrai que la dernière fois vous m’avez parlé de quitter le pays?
—En effet, dit Marcel.
—Et vous êtes décidé sur l’endroit?
—Pardon, reprit le jeune homme, en regardant Honorine avec intention; j’ai tout à l’heure expliqué à Madame mes projets.
—Ah! eh bien, qu’est-ce que c’est, mezette, y part?
—Non, ma mère, balbutia Honorine émue, il reste!
En acceptant l’espèce de compromis proposé par de Gausson, la jeune femme n’avait pas seulement obéi à la crainte de le voir s’éloigner; elle avait aussi cédé, sans le savoir, à sa propre inclination. Ces lettres qu’il demandait à lui écrire, et qu’elle avait d’abord refusées, elle les désirait de toute l’ardeur de son amour et de son isolement.
La première qu’elle reçut la jeta dans une agitation inexprimable. Marcel la remerciait avec effusion d’avoir consenti à cette correspondance; il lui racontait la joie qu’il trouvait à lui écrire de son donjon à demi ruiné; il réglait, pour l’avenir, l’emploi de ses journées solitaires, et cette solitude était pleine du souvenir d’Honorine.
Ainsi qu’il l’avait promis, sa lettre ne renfermait aucun aveu; mais l’amour brillait à travers, comme ces lumières qu’enveloppe un globe d’albâtre.
Pendant la journée, Honorine s’échappa dix fois pour relire cette lettre qu’elle savait par cœur le soir, et qu’elle passa une partie de la nuit à relire encore!
Celle du lendemain ne la trouva ni moins empressée ni moins ravie. Les jours se succédèrent ainsi, apportant toutes les pensées, toutes les aspirations de Marcel. Bientôt Honorine sentit le besoin de répondre; ce fut d’abord pour se plaindre d’une lettre désespérée, pour rappeler de Gausson à la résignation, au courage; son billet n’était qu’un acte d’humanité vulgaire; mais la réponse de Marcel fut si expansive, qu’il y eût eu de la cruauté à ne point poursuivre une cure si heureusement commencée. La jeune femme continua donc sans s’apercevoir du changement de rôle, et que c’était le consolateur qui maintenant devait être consolé!
La correspondance d’abord limitée aux encouragements, devint bientôt plus variée et plus intime. Au monologue avait succédé le dialogue rapide, ardent, entrecoupé! Un courant électrique s’établit du donjon à la ferme et de la ferme au donjon. On avait d’abord employé pour faire parvenir les lettres, mille expédients que créait l’adresse ou que fournissait le hasard; mais quand l’échange se fut régularisé, il fallut trouver un moyen sûr et constant. On convint donc que les lettres seraient déposées, tous les matins et tous les soirs, au creux d’un vieux pommier qui s’élevait sur le coteau, au point où finissait le fourré et où commençaient les cultures. Caché par les taillis, Marcel pouvait y arriver sans être aperçu, et Honorine trouvait l’arbre presque sur son passage, en revenant de la cabane habitée par Françoise. Rien ne devait donc éveiller les soupçons.
Un intérêt trop grave préoccupait d’ailleurs depuis quelque temps les habitants de la ferme et ceux de Trévières pour qu’ils pussent songer à surveiller les deux amants.
Parmi tous les fléaux qui parfois frappent la population des champs, il en est un plus redouté qu’aucun autre, si redouté qu’elle ne peut se résoudre à l’attribuer à Dieu et qu’elle en accuse hautement l’esprit du mal; nous voulons parler des épizooties.
C’est que, pour le paysan, le troupeau n’est point une partie de la richesse, mais toute la richesse! c’est l’instrument sans lequel la charrue demeure immobile. Les laboureurs, privés d’attelages, ressemblent à ces archers auxquels le prince Noir fit couper les trois doigts de la main droite; la vie leur devient inutile. En 1815, des chefs de bande parcouraient les fermes de l’ouest en criant aux paysans:
—Envoie tes fils aux chouans ou nous tuons tes bœufs.
Et les paysans obéissaient.
Quand l’inondation ou l’incendie ravagent les campagnes, on peut leur disputer une part des richesses; quand le choléra décime les familles, ceux qui échappent se consolent par le travail ou la prière; mais, après l’épizootie, nulle ressource! Il faut rendre au maître la ferme qu’on ne peut plus cultiver et quitter la paroisse où l’on était connu pour aller demander, à son tour, le pain journalier que l’on donnait autrefois!
Or, ce fléau terrible menaçait le Bessin depuis plus de deux mois. Il avait été jusqu’alors combattu par un certain Roc Jallu, espèce de sorcier, étranger au pays, dont on racontait des merveilles. Mais le mal, arrêté par lui sur un point du département, reparaissait aussitôt ailleurs et tenait la population entière dans l’inquiétude.
Bien que par un heureux et singulier privilége Trévières eût échappé jusqu’alors à la contagion, on s’en préoccupait vivement dans la paroisse, non pour s’y préparer (la prévoyance est une vertu inconnue du peuple), mais pour en parler.
Un soir, tous les gens de la ferme se trouvaient réunis dans une salle basse où l’on prenait en commun les repas. La journée avait été orageuse; un brouillard pluvieux couvrait le ciel, et bien que l’on fût au mois de juin, la nuit était sans étoiles.
Un vent tiède et lourd grondait à travers les hangars vides ou faisait crier la girouette rouillée de la chapelle. Le feu allumé pour préparer le repas s’éteignait au foyer, et la puette (chandelle de résine) elle-même ne jetait qu’une clarté trouble qui donnait aux objets des formes incertaines. Il y avait enfin dans l’air je ne sais quoi de triste et d’étouffant qui oppressait toute expansion de vie, une atmosphère de plomb par laquelle on se sentait douloureusement alourdi.
Malgré l’insensibilité nerveuse ordinaire aux paysans, les gens de la ferme éprouvaient eux-mêmes l’influence de cette sombre soirée. La conversation était plus languissante et les funestes prévisions avaient remplacé les plaisanteries de la veillée.
On parlait depuis quelques jours de bestiaux morts à Balleroy; le tour de Trévières ne pouvait tarder à venir.
Un des garçons de charrue fit observer que M. Vorel était parti depuis la veille pour Bayeux où il était appelé, avec les autres maires de l’arrondissement, afin de chercher les mesures à prendre contre la mortalité des troupeaux. Le vieux berger Micou tira sa pipe, regarda le foyer et secoua la tête. C’était sa manière habituelle, toutes les fois qu’il voulait dire quelque chose de grave.
Anselme Micou, qui se trouvait à la ferme avant qu’elle eût été acquise par la mère Louis, appartenait à cette race de bergers sentencieux et songeurs auxquels la crédulité de nos paysans attribue une seconde vue. Il avait passé quarante années à parcourir les friches, à la suite de son troupeau, à voir les étoiles se lever et mourir, à observer le vol des hirondelles de mer, à écouter les mille voix du crépuscule ou du soir, et ces contemplations solitaires avaient amené chez lui une sorte d’exaltation intérieure. Il parlait rarement, mais ses paroles avaient toujours quelque chose de solennel, de prophétique.
Au geste bien connu qu’il venait de faire, tous les regards s’étaient tournés vers lui; le vieux Micou demeura quelque temps muet, puis, retournant vers les gens de la ferme son visage tanné et plissé de rides:
—Les monsieurs de Bayeux auront beau faire, dit-il, y n’empêcheront pas les malheurs qui se préparent pour le pays.
—Y a donc eu des signes, vieu Anselme? demanda une jeune servante effrayée.
—Y a toujours des signes pour ceux qui voient, répliqua Micou.
—Et vous avez vu qué’q’chose? reprirent plusieurs voix.
—J’ai vu que le diable vellinait (rôdait) autour de la paroisse: la nuit dernière il était chez Romain.
Tous les assistants se regardèrent.
—Comment donc que vous savez ça? demanda le garçon de charrue.
Le berger secoua les cendres de sa pipe éteinte.
—Vous connaissez bien tous la viette (sentier) qui conduit de la route d’Isigny aux Motteux? demanda-t-il.
—Oui, répliqua la jeune servante; elle passe devant la maison de Romain.
—Pour lors donc, je revenais hier dans la serence (soirée) de conduire au boucher les moutons que mam’Louis avait vendus et j’allais passer le riolet (petit ruisseau), quand je vois tout à coup je ne sais quoi dans le sombre, ça allait sans pieds et sans rien, à travers l’herbe, jusqu’à la petite cour de Romain.
Plusieurs exclamations d’étonnement l’interrompirent.
—J’m’étais arrêté tout coi, reprit le berger avec son calme habituel, j’attendais d’voir la chose là où y avait d’la lune; ça glissa tout doucettement le long d’la grange et ça arriva en pleine clarté!.... C’était un buisson.
—Un buisson qui marchait? répéta tout le monde.
—Ça en avait la mine du moins, continua Micou, ça avait d’la branche et d’la feuille; mais j’ai ben compris su l’moment c’qu’en était et j’ai fait autour de moi, avec mon bâton, le cercle de conservation; alors le buisson s’est approché des étables et il est entré dedans.
—Dans l’étable?
—Où il est resté cunché (caché) un tantinet; après quoi j’l’ai vu ressortir, il a passé devant moi en halaisant (haletant) comme un être de chair et y s’est perdu dans les vignots (joncs marins).
Les paysans se regardèrent avec une expression dans laquelle l’étonnement se mêlait à l’inquiétude.
—Quoi donc qu’ça peut être? demanda le garçon de charrue; on n’a jamais entendu parler de rien d’pareil dans le pays; c’est ni un varou ni le rongeur d’os de Bayeux.
—Dans mon pays, fit observer une des servantes qui portait la coiffure des environs de Falaise, y a ben tarane et farloro; mais y paraissent avec des figures comme le monde vivant et tout brillants de flammes.
—Chez nous, ajouta un gars de Domfront, on s’défie surtout de la Mazarine qu’est la mère de tous les mauvais esprits, mais toutefois et quantes on la voit, c’est avec l’air d’une housta (femme-hommasse) et non pas d’un buisson.
—Quoi donc qu’ça peut être? reprirent en chœur les assistants, dont les regards s’arrêtèrent sur le berger pour lui demander l’explication de sa vision.
—On ne l’saura ben que trop tôt! répliqua Micou d’un air triste. Quand les choses vont pas à l’ordinaire, voyez-vous, c’est que l’bon Dieu s’est écaré (impatienté) contre ceux d’en bas et qu’y veut effriter (effrayer) par un exemple. Romain est dur avec les pauvres gens, il a donné un mauvais coup à sa sœur qui en est morte; le bon Dieu n’oublie pas ça, non; et il faudra ben que le fermier du Vrillet ravoue (répare) ses mauvaisetés.
Honorine, placée à quelques pas du cercle de paysans, près de la mère Louis, qui sommeillait dans son fauteuil de jonc, et de Françoise, occupée à bercer son fils sur ses genoux, n’avait jusqu’alors pris aucune part à la conversation. Mais à ces derniers mots, elle se tourna vers Micou et lui dit en souriant:
—Alors vous pensez que la punition s’arrêtera à Romain, vieil Anselme, et que les braves gens n’auront rien à craindre?
—Perjou! s’écria le garçon de charrue: ça ne serait pas juste si nous étions housqués (punis) pour l’homme du Vrillet; faudra que le malheur s’arrête à lui et à son fait.
—Oui, s’il n’y a qu’un pécheur dans le pays, reprit Micou; mais si on les trouve à grouée (en quantité) faudra ben que le bon Dieu frappe partout. Ah! il y a longtemps que je dis qu’y s’lassera; mais on est calard (paresseux) pour sortir du mal; et ben v’là le jour où faudra faire ses comptes; y aura des signes...
Un éclair, suivi d’un cri terrible, interrompit le berger. Les paysans effrayés se retournèrent. Françoise pâle, le corps rejeté en arrière et enveloppant son enfant d’un de ses bras, comme pour le défendre, montrait de l’autre main la fenêtre ouverte. Tous les yeux prirent cette direction; mais l’éclair avait passé et l’on n’apercevait plus au dehors qu’un abîme obscur.
—Qu’est-ce qui a ripé (crié)? dit la mère Louis éveillée en sursaut.
—Quoi donc est-ce que vous avez, ajoutèrent les voix des domestiques?
—Je l’ai vu, bégaya Françoise, là, j’en suis sûre.
—Qui ça?
—Il était grand comme lui... et tout blanc...
—Blanc? Ah! Jésus! c’est un raparat (fantôme)! s’écrièrent les servantes.
—Non, reprit Françoise qui serrait son enfant contre elle; non... c’était un des assassins... de M. Marc.
—Un assassin! répétèrent toutes les voix.
Il y eut une courte pause, puis deux des garçons se levèrent.
—Faut voir, dirent-ils en décrochant, l’un une vieille hallebarde suspendue au mur, l’autre un fusil.
La mère Louis se leva également et saisit une fourche neuve que l’on venait d’emmancher.
—J’vas avec vous, mes gars, dit-elle; dans ces cas-là une femme peut servir, il n’y a pas de mauvais coups pour tuer une vipère.
Malgré sa terreur, Honorine voulut suivre sa tante et Françoise voulut suivre Honorine.
La petite troupe, accompagnée d’une des servantes, qui avait eu la bravoure d’allumer la lanterne, fit le tour de l’aire à battre, visita les granges, les étables, la buanderie sans rien découvrir. Enfin il fut bien constaté qu’il n’y avait personne dans l’enclos.
Cependant le chien de garde, dont les aboiements avaient d’abord semblé appuyer la déclaration de Françoise, faisait entendre maintenant des hurlements plaintifs et demeurait devant sa loge rampant sur le ventre et allongeant convulsivement les pattes sous son museau dont il creusait la terre. A la vue de la troupe qui rentrait à la ferme, il redoubla ses gémissements, se laissa aller sur le flanc et raidit tout son corps qui frissonnait.
La mère Louis s’arrêta saisie malgré elle.
—Eh ben, qu’est-ce qu’il a donc Castor? demanda-t-elle, en regardant le chien qui râlait.
—Il a le mal de la mort, dit Anselme Micou qui venait de s’approcher.
—Comment, mon chien va mourir! s’écria la fermière; mais il est venu quelqu’un alors?
—Il est venu le mauvais esprit! continua le berger, le même qui a visité la ferme du Vrillet. Faut qu’chacun songe à ses torts.
—Allons, tu nous assouis (étourdis) toi, interrompit brusquement la paysanne; v’là-t’y pas qu’on devrait faire sa confession générale parce qu’un chien est malade. Faut que tu n’as pas plus d’assent (raison) que tes bêtes.
—Que ceux qui ne croient rien ne craignent rien! dit le berger d’un air sombre; mais il viendra des enseignements!
—Prenez garde à vous, voisine! interrompit tout à coup la voix d’un paysan à cheval qui suivait le chemin du Balleroy.
—C’est Richard! s’écria le garçon de charrue.
—Le mauvais air est sur Trévières, continua la voix; toutes les bêtes sont mortes au Vrillet!...
A ces mots l’homme et le cheval disparurent rapidement dans la nuit!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La nouvelle donnée par Richard se confirma, malheureusement, le lendemain; mais le fléau ne s’arrêta pas au Vrillet, il frappa successivement la plupart des fermes environnantes, et la contagion devint bientôt générale.
Tous les travaux furent suspendus, les hommes, réunis aux cabarets, rendez-vous ordinaire dans les afflictions comme dans les joies, se communiquaient les nouvelles arrivées des différents points du canton, tandis que les femmes se lamentaient devant les seuils ou allumaient des cierges bénits à l’église de la paroisse. La consternation croissait à chaque instant par l’annonce de quelque nouveau désastre et par la révélation des circonstances mystérieuses qui l’avaient précédé; car, soit vision, soit réalité, partout des apparitions étranges avaient effrayé les habitants des fermes isolées. Les uns avaient aperçu, comme Anselme Micou, le buisson marchant, d’autres, comme Françoise, un fantôme à figure sinistre, plusieurs parlaient d’un mendiant qui, après avoir rôdé autour de leur habitation, s’était échappé sans que l’on pût dire comment; quelques-uns enfin assuraient avoir aperçu un homme vêtu de noir et d’une grandeur démesurée, qui, en passant devant les étables, avait avancé la main par les étroites fenêtres, comme pour jeter un sort sur les animaux.
Mais quelle que fût la nature des visions aperçues, tous s’accordaient pour reconnaître une intervention mystérieuse et surhumaine; le pays était évidemment sous l’influence de quelque maudit, auquel l’esprit du mal avait dévolu sa puissance par un acte signé.
Les vieillards racontaient, à ce propos, une foule de faits transmis par la tradition et qui constataient les ravages exercés, à différentes reprises, dans le Bessin, par ces souffleurs de mauvais air. Certains auditeurs, échauffés par ces récits, communiquaient déjà leurs soupçons et hasardaient des noms! Les plus sages songeaient à demander ce Roc-Jallu dont le secours avait été si efficace dans les autres cantons, lorsqu’on apprit qu’il se trouvait précisément à Isigny. Romain partit aussitôt avec un autre paysan pour le chercher.
Le fermier du Vrillet était d’autant plus intéressé à l’arrivée du sorcier étranger qu’il avait été frappé le premier et le plus cruellement. Tous ceux de ses bestiaux qui n’avaient point succombé dès le premier jour, se trouvaient dans un état désespéré, et un miracle seul semblait pouvoir les sauver.
Par un inexplicable hasard, la ferme des Motteux avait été épargnée. L’apparition qui avait effrayé Françoise et la mort du chien n’avaient été suivies d’aucun nouvel incident; mais cette exception même, loin de rassurer madame Louis, la tenait dans une continuelle inquiétude: son bonheur l’effrayait. Elle se trouvait dans la situation d’un commandant de redoute qui, sachant tous les autres postes emportés par l’ennemi, attend que le sien subisse le même sort; bien qu’il ne s’agît point pour elle, comme pour ses voisins, d’une question de vie ou de mort, la pensée d’une perte qui pourrait amoindrir ses économies de l’année lui donnait le frisson.
L’enrichissement n’avait, en effet, rien changé à cette nature de paysan, âpre au gain, thésauriseuse et toujours en effroi devant la ruine. Menacée par l’épizootie qui désolait Trévières, elle se reprochait de ne l’avoir point prévue plus tôt; elle eût dû renoncer à l’élève des bestiaux, vendre ses foins, mettre ses terres labourables sous grains. Elle ne pouvait se consoler d’avoir placé son argent dans des choses vivantes, comme elle les appelait, au lieu de l’avoir employé en cultures, elle eût voulu s’en prendre à quelqu’un de cette faute commise par sa seule volonté. Aussi son inquiétude et ses regrets se traduisaient-ils en perpétuelles plaintes. A l’entendre, il y avait un complot général contre ses intérêts. Tous les gens de la ferme s’entendaient pour appeler sur elle la ruine. Elle n’était entourée que de paresseux, de voleurs, d’ennemis! Ses deux favorites, Honorine et Françoise, échappaient à peine à ce soupçon universel; la mère Louis ne formulait point encore contre elles d’accusations précises, mais elle avait déjà cessé de faire leur éloge.
Sur ces entrefaites, Vorel arriva de Bayeux, où le conseil d’arrondissement l’avait retenu.
La première visite du docteur fut à la ferme. La mère Louis se trouvait dans la chambre qu’elle occupait au rez-de-chaussée, et où elle venait de toucher le prix d’une vente de fourrages. En reconnaissant la voix du médecin, elle rejeta l’argent dans le sac de toile et le fourra au fond de son armoire, qu’elle referma; prudence de paysan fondée sur cette morale normande, que notre main gauche ne doit point savoir ce que notre main droite a compté d’écus.
Cependant, quelle qu’eût été sa promptitude, le docteur en vit assez, sans doute, pour deviner, car il dit en souriant:
—Maintenant, je sais où est le magot, mère Louis.
—Eh bien! de quoi? Est-ce que vous voulez le voler? demanda la fermière avec une maussaderie brutale. Y en a assez d’autres qui s’en occupent, allez.
—Vous avez donc découvert quelque nouveau gavaillage (gaspillage)? dit Vorel.
—Pardi! y a pas besoin de chercher, répliqua la paysanne, les voleries, c’est comme le gloria patri, on en trouve partout... sans parler du malheur qui est sur le pays à c’t’heure.
—Et dont vous avez été heureusement préservée? fit observer Vorel.
La mère Louis haussa les épaules.
—Belle avance! reprit-elle; faudra bien que notre tour arrive; et alors Dieu sait ce que nous deviendrons tous. Si ça continue, voyez-vous, nous n’aurons plus qu’à prendre le bissac et le bâton blanc.
—Ne croyez donc pas cela! dit Vorel en souriant; j’espère, d’abord, que cette prétendue contagion va s’arrêter; on a fait des découvertes qui ont donné certains soupçons... Enfin, j’attends demain deux de mes confrères et le vétérinaire du département. Nous examinerons les animaux morts...
—Et y resteront toujours morts! interrompit brusquement la paysanne; mières pour hommes, mières pour bêtes, c’est toujours de la même farine; ça vous égohine (assassine) en vous disant de grands mots. Non, non, le malheur, pour moi, c’est que j’aie pas vendu l’an dernier tout mon bétail.
—Vendu votre bétail, dit le médecin étonné; mais quand je suis parti, il y a huit jours, vous étiez décidée à l’augmenter!
—Moi?
—A telles enseignes que vous m’avez chargé de vous chercher trois paires de bœufs maigres.
—Et vous les avez trouvées?
—On doit vous les amener aujourd’hui.
La mère Louis, qui était assise, frappa sur ses genoux.
—Ah! ça me manquait, s’écria-t-elle; trois paires de bœufs maigres... Et vous croyez que je les recevrai?
—J’ai donné des arrhes, objecta Vorel.
—Ça vous regarde! s’écria la vieille femme; vous avez fait le marché, vous le déferez. Trois paires de bœufs! ici!... quand les bêtes meurent comme mouche! un mière qui va se mettre à faire le harivelier (marchand de bestiaux); mais c’est donc exprès pour me ruiner; vous voulez donc tous ma mort? pourquoi donner des arrhes? pourquoi acheter des bœufs? qui vous l’a demandé? Ce dernier mot, qui pour le geste et le ton, pouvait être regardé comme la parodie du fameux qui te la dit d’Hermione, produisit sur Vorel le même effet que sur Oreste. Il resta d’abord étourdi.
—Qui l’a demandé? s’écria-t-il; mais c’est vous, ici, il y a cinq jours; vous ne pouvez l’avoir oublié?
—C’est-à-dire que je mens? interrompit la mère Louis.
—Ah! je mens, répéta la fermière, qui se hâtait de prendre le rôle d’offensée, afin de n’avoir pas à donner de raisons, eh bien! alors vous garderez les trois paires de bœufs à votre compte; oui! je n’en veux plus entendre parler; je dirai que vous n’aviez pas d’ordre... que vous avez voulu faire votre esbrouffe (important). Y s’arrangeront avec vous à leur idée; je ne paierai rien.
Le sang monta au visage de Vorel. Quelle que fût chez lui la domination habituelle du calcul sur la sensation, il arrivait des instants où la violence de cette nature s’échappait malgré lui.
Depuis l’arrivée d’Honorine, il avait refoulé dans son âme tant de mouvements de dépit, que cette âme, refermée sur sa haine, ressemblait aux mines trop chargées; une étincelle suffisait pour qu’elle éclatât. Il tordit convulsivement la cravache qu’il tenait à la main, et ses lèvres se tendirent.
—Prenez garde à ce que vous ferez, dit-il en regardant fixement la mère Louis; voilà longtemps que je souffre, sans rien dire, ce qui se passe ici; mais il ne faut pas me pousser à bout. Je me suis engagé sur votre prière; vous ferez honneur à ma parole, ou sinon...
—Eh bien! quoi? demanda la fermière en l’interrogeant d’un regard de défi.
—Sinon je vous y forcerai! s’écria Vorel avec emportement; et la preuve, c’est que vous allez me compter tout de suite la somme que je dois payer pour vous: tout de suite, entendez-vous bien?
Les yeux du médecin lançaient des éclairs, et il avait saisi le bras de la mère Louis; mais la paysanne se dégagea brusquement.
—Laissez-moi! s’écria-t-elle pâle de colère; vous êtes bien hardi d’oser me toucher.
—Finissons! murmura Vorel les dents serrées et comme ayant peine à se maîtriser.
La fermière recula d’un pas, le regarda en face et son visage vulgaire s’éclaira de je ne sais quelle audace vaillante.
—Et si je n’veux pas finir, moi! cria-t-elle énergiquement; non, je n’veux pas. Ah! v’là donc q’vous montrez enfin vot’naturel... Eh bien! j’aime mieux ça que des lousses (tromperies); mais faut pas croire seulement q’vos menaces pourront m’effriter (effrayer); ah! mais non, mais non! vous vous croyez le bourgeois ici, parce qu’un temps je vous ai laissé tout faire; mais c’temps-là est passé et y n’reviendra pas.
—Peut-être, murmura Vorel sourdement.
La mère Louis tressaillit.
—Au fait y sera un jour le maître, reprit-elle comme frappée d’un souvenir subit.... avec cet acte qu’y m’ont fait signer...
—Mon Dieu, il ne s’agit point de cela, dit le médecin précipitamment; je voudrais seulement vous faire comprendre...
—Qu’l’autre n’a plus de droit, n’est-ce pas? interrompit la fermière, vous m’avez entortillée tezi-tezant (tout doucement), j’ai signé le papier; mais j’irai voir le notaire...
Et s’interrompant tout à coup.
—C’est-à-dire non, s’écria-t-elle; j’ai même pas besoin de lui.
Elle courut à son armoire, l’ouvrit vivement, fouilla sous une énorme pile de draps, jaunis faute d’usage, et retira un papier dont l’enveloppe soigneusement cachetée portait le mot TESTAMENT.
A sa vue Vorel fit un geste de saisissement.
—Vous n’saviez pas qu’on m’l’avait rendu, dit la fermière d’un air de triomphe; mais le v’là.
—Et que voulez-vous faire? s’écria le médecin.
—J’veux rendre justice à tout l’monde! répliqua la mère Louis; avec ça vous comptiez houquer (voler) sa part à la petite de Paris, et ben faut en faire vot’deuil.
L’action avait accompagné la parole et le testament était déchiré avant que le médecin eût pu s’y opposer. Au cri qu’il jeta, la paysanne tourna vers lui un regard de vengeance satisfaite et continua son œuvre de destruction.
—Ah! tu me menaces, méchant halabre, reprit-elle avec un acharnement haineux; tu oses mettre la main sur moi, eh bien, ça te coûtera gros. Tiens, tiens, en v’là une pluie de papier; autant de morceaux autant de lesches de terre perdues pour toi. Tu m’disais tout à l’heure de tout finir: v’là que j’finis: mais tu vois bien que c’est toi qui paies les trois paires de bœufs, et un bon prix encore; vingt mille écus de rente pour six bêtes maigres. Ah! ah! ah! ça t’apprendra qu’y faut pas faire le maxi (méchant) avec la mère Louis.
Le premier mouvement de Vorel avait été de surprise, le second fut de rage. Il demeura un instant devant la fermière les poings fermés, le corps rejeté en arrière, l’œil flamboyant comme la bête fauve prête à s’élancer: enfin, au moment où elle jeta à ses pieds les débris du testament, une exclamation furieuse monta de son cœur à ses lèvres, un nuage passa sur ses yeux; il fit un pas en avant, un reste de raison l’arrêta!... Effrayé de lui-même, il tourna la tête, chercha la porte et s’élança hors de la ferme dans un inexprimable transport de colère.
C’était en effet plus que n’en pouvait supporter cette âme déjà gonflée de venin et ulcérée d’avarice. Perdre en une seule fois tout le prix de tant de ruse, de tant de patience! Voir tomber l’épi d’or cultivé pendant quinze années, être dépouillé, non de vingt mille écus de revenus, comme l’avait dit la fermière qui connaissait mal ses propres ressources, mais de cinquante mille écus peut-être! Cette seule pensée soulevait en lui des flots de désespoir et de rage. Violentées de bonne heure par la loi sociale, toutes les énergies de cette nature absorbante s’étaient tournées vers la richesse. C’était le seul but permis à son ambition et il y tendait avec l’âpreté farouche de toutes les ardeurs qui grandissent à l’ombre de la dissimulation. Pour l’atteindre il eût tout brisé devant lui sans hésitations, sans regrets; c’était son goût, sa foi, son besoin.
Aussi, en quittant la ferme ne laissa-t-il point son esprit flotter dans de vains ressentiments; sa logique prit en bride sa colère. Sans s’occuper de la mère Louis, il retourna toute sa haine contre la rivale qui lui avait enlevé la domination et qui pouvait seule profiter de ses dépouilles.
Mais cette haine ne se borna point à des malédictions intérieures: sa pensée roulait mille projets sinistres.
Arrêtée sur l’image d’Honorine, elle cherchait le point pour frapper, comme ces magiciens qui tuent de loin leur ennemi, en perçant au cœur son simulacre.
Là, en effet, se trouvait le véritable obstacle. Délivré d’Honorine, Vorel était sûr de recouvrer son influence et de ressaisir cette fortune qu’elle seule pouvait lui disputer. Tout sans elle, rien avec elle, peut-être! L’alternative était trop pressante pour laisser aucun doute: le médecin voulait tout.
Mais le moyen, le moyen! il le cherchait en suivant la route du manoir. Qui eût pu lire, dans ce moment, au fond de ce cœur ténébreux, eût peut-être reculé d’épouvante; mais à l’extérieur, rien ne trahissait ses pensées. Protégé par son masque souriant, Vorel s’avançait d’un pas lent et la tête baissée, comme un homme livré à une méditation paisible.
Ce fut seulement en arrivant à sa porte qu’il sortit de sa rêverie. La Sureau vint lui ouvrir, et l’avertit que Richard l’attendait depuis longtemps avec le fameux sorcier Roc Jallu, qu’il avait demandé à voir aussitôt son arrivée. Cette annonce sembla donner un nouveau cours aux idées du médecin; il passa dans le salon que le lecteur connaît déjà, et dit à la servante de lui amener le sorcier sans son conducteur.
Un instant après, Roc parut.
C’était un homme déjà vieux et portant un costume qui pouvait également appartenir au paysan et à l’ouvrier. Il s’arrêta près de la porte, salua le médecin avec une certaine brusquerie, et lui demanda en quoi il pouvait le servir.
Vorel remarqua que son accent n’avait rien de normand.
—Je vous ai fait appeler comme maire, dit le médecin, dont le regard scrutateur restait attaché sur l’étranger.
—Alors, ce sont mes papiers que vous voulez? dit Jallu.
Et il tira de sa poche un portefeuille usé dans lequel il chercha un passe-port, qu’il présenta à Vorel.
Celui-ci le prit, mais ne l’ouvrit point et continua à observer le sorcier.
—Vous faites profession de guérir les animaux atteints par la contagion? reprit-il; vous vous présentez à Trévières dans ce but?
—Je ne me suis pas présenté, répliqua Roc sans répondre directement; on est venu me chercher à Isigny.
—Comment vous y trouviez-vous?
—Eh bien!... pour mes affaires, donc!
—Pour quelles affaires?
Roc parut embarrassé.
—Cela me regarde, dit-il; mes papiers sont en règle, et je peux aller où il me convient.
—Et il vous convient d’aller où la maladie se déclare? ajouta Vorel.
—Quand cela serait, répliqua le sorcier, qu’est-ce qu’il y a d’étonnant?
—Ce qu’il y a d’étonnant, reprit le médecin, dont le regard ne quittait point Jallu, je vais vous le dire: c’est que, d’après la remarque faite dans plusieurs autres cantons, partout où la maladie éclate, on vous voit arriver dès le lendemain, comme si vous connaissiez d’avance son invasion! C’est que vous employez, pour arrêter le mal, des moyens illusoires, et que cependant le mal s’arrête, dit-on, à votre commandement; c’est qu’enfin les vétérinaires de Ryes et de Creuilly ont cru reconnaître, dans plusieurs des animaux morts, la trace du poison.
—Et c’est moi qu’on accuse de le leur avoir donné? s’écria Roc; je prouverai que j’étais absent du pays; qu’ils étaient malades avant mon arrivée; que je ne les ai pas approchés! Ah! je comprends la chose maintenant; ce sont les médecins de bêtes qui m’en veulent, parce que je suis plus recherché qu’eux; mais je ne les crains pas: on ne peut pas dire que j’exerce leur métier, puisque je ne donne aucun remède; que je ne suis venu que pour le bien; et si on ne veut pas de moi à Trévières, je ne demande pas mieux que d’en partir.
Il fit un mouvement pour sortir; mais, tout en parlant, le médecin s’était placé, sans affectation, entre lui et la porte; il l’arrêta du geste.
—Il faut auparavant que tout s’explique, dit-il, et d’abord, je ne sais pourquoi, plus je vous regarde, et plus il me semble vous avoir vu ailleurs.
—C’est impossible! interrompit Roc visiblement troublé.
—Vous n’êtes point Normand?
—Non, Bourguignon, il n’y a qu’à voir mes papiers.
Vorel ouvrit lentement le passe-port, mais, pendant que ses yeux le parcouraient machinalement, sa pensée continuait à fouiller dans le passé et à y chercher quelque réminiscence qui pût aider sa mémoire. Enfin, en relevant la tête, son regard rencontra le portrait du général suspendu vis-à-vis de la fenêtre!
Ce fut pour lui comme un éclair dans la nuit! son souvenir alla, par un enchaînement rapide, du général à la mère d’Honorine, et de la mère d’Honorine à la Maison verte!... Il regarda de nouveau son interlocuteur, tressaillit et recula jusqu’à la porte.
Le sorcier, qui remarqua ce mouvement, parut inquiet.
—Est-ce que tout n’est pas en règle? demanda-t-il en désignant du doigt le passe-port.
—A peu près, dit Vorel, dont l’œil alla chercher l’un des casiers de sa pharmacie portative; il y a seulement une légère erreur.
—Dans le signalement?
—Dans les noms et qualités du signataire.
—Comment?
—On a écrit ici Roc Jallu, exerçant la profession de marchand de bestiaux.
—Eh bien! qu’est-ce qu’il fallait donc écrire?
—Il fallait écrire, dit Vorel qui le regarda en face, Jacques dit le Parisien condamné pour vol à Château-Lavallière.
Le sorcier changea de visage: il avait reconnu, dès son entrée, le médecin pour l’un des témoins appelés à déposer contre lui dans l’affaire de la Maison verte, mais l’espoir que le temps aurait fait oublier ses traits à ce dernier l’avait d’abord rassuré: en se voyant découvert, il demeura un instant saisi, puis regarda autour de lui. La pièce n’avait d’autre issue que la fenêtre garnie de barreaux de fer, et la porte contre laquelle le médecin se tenait appuyé! Les lèvres de Jacques se serrèrent; il enfonça sa main dans la poche de sa veste.
—Monsieur le maire se trompe, dit-il d’une voix brève: et, en tous cas, il ne peut me retenir; il n’a point de mandat d’arrêt: qu’il me rende mon passe-port, et je quitte le pays.
—Vous n’êtes point seul ici? demanda Vorel en le regardant.
—Peut-être, reprit le Parisien; c’est une raison pour ne pas chercher à m’ostiner... Rendez-moi mon passe-port, mille noms!
—Il ne vous appartient pas, dit le médecin en le repliant.
—Ainsi, vous le gardez! s’écria Jacques dont l’œil devenait plus farouche.
Vorel fit un signe affirmatif.
—Et vous ne voulez pas me laisser passer?
—Non.
—Vous êtes décidé?
—Décidé.
Le Parisien tira brusquement un couteau de la poche de sa veste et voulut s’élancer vers le médecin; mais celui-ci, qui avait étendu la main dans le casier, lui présenta le bout d’un pistolet armé.
—Ah! tu joues toujours à ce jeu là, vaurien, dit-il d’un ton qui n’exprimait ni crainte ni colère; ton nouveau métier ne t’a pas fait renoncer à l’ancien.
—Ne me poussez pas à bout! dit le Parisien, qui avait reculé d’un pas et qui se tenait à demi replié sur lui-même, le couteau en arrière et comme prêt à l’attaque; j’ai juré de ne pas retourner au pré (bagne), et, si vous ne me laissez pas passer, il y aura du sang versé.
—Tu passeras, dit Vorel, mais à une condition.
—Laquelle?
—C’est que tu me rendras un service.
Le Parisien le regarda.
—Vous avez quelque ennemi? demanda-t-il en baissant la voix et d’un air d’intelligence.
Vorel posa un doigt sur ses lèvres, désarma son pistolet, et, rouvrant la porte, il fit signe à Jacques de le suivre au jardin.
Quelques heures après l’entrevue de Vorel et du Parisien, celui-ci descendit seul, à la tombée du jour, un des petits sentiers qui traversaient le fourré placé au sommet de la colline. Il s’arrêtait de temps en temps avec hésitation pour regarder autour de lui, puis reprenait sa route, comme s’il eût aperçu des signes indiquant la direction qu’il devait suivre. Cependant, il eût été difficile de rien remarquer, dans le taillis, qui pût servir de reconnaissance ou d’avertissement. Sauf quelques petites branches brisées çà et là par le vent, quelques touffes d’herbes arrachées par les chèvres qui s’échappaient parfois dans le fourré, rien ne pouvait y frapper l’œil le plus attentif. Ceux que nos guerres de chouannerie avaient initiés à ces mystères de la vie des bois auraient seuls observé peut-être que ces branches n’étaient point brisées à rencontre du vent, et que les touffes d’herbe se trouvaient arrachées seulement de loin en loin, là où Jacques changeait de direction.
Il fit d’assez longs détours, et la nuit était complétement venue lorsqu’il s’arrêta à la lisière du taillis, dans un endroit singulièrement sauvage. Plusieurs rochers ombragés de buissons rabougris, nés dans les fentes de la pierre, y étaient groupés de manière à présenter, de loin, l’apparence d’une tour en ruine; mais les ronces et les orties ne permettaient point de reconnaître si le centre de ce groupe formait un espace libre comme l’extérieur pouvait le faire supposer. Le problème offrait, du reste, assez peu d’intérêt pour que personne, dans le pays, n’eût songé à le résoudre, et l’on n’y connaissait guère les Grandes Mercs que pour les digitales et les épines blanches que les enfants allaient quelquefois y cueillir.
Cet amas de pierres servait pourtant de limites à la propriété de la mère Louis, et c’était là ce qui lui avait valu le nom de Mercs, employé par les Normands pour désigner les bornes qui séparent les héritages. Au-dessous commençaient les terres du Vrillet, dont les vergers s’étendaient jusqu’au groupe de rochers.
Jacques en fit deux fois le tour, afin de s’assurer qu’il était bien seul, puis se baissant pour examiner de plus près les arbustes qui bordaient les Grandes Mercs, il s’arrêta devant un buisson de houx dont une branche pendait brisée, plaça ses deux mains, réunies en porte-voix, devant sa bouche et fit entendre le cri du hibou, si longtemps employé comme signal parmi les chouans.
Aucun cri ne répondit, et il y eut un assez long intervalle avant que Jacques fît entendre de nouveau son appel.
Cette fois une sorte de glapissement qui rappelait imparfaitement celui du renard, retentit au milieu des ronces qui couvraient les Grandes Mercs; bientôt les broussailles s’agitèrent, et un petit chien griffon parut sous les branches d’un houx.
—Ah! c’est toi, Sapajou, dit Jacques à voix basse; eh bien! bonne bête, le juif ne sort donc pas de son trou?
Pour toute réponse, le chien fit entendre un léger grognement et rentra sous les buissons. Le Parisien le suivit en rampant sur les mains et sur le ventre jusqu’à ce qu’il eût atteint une sorte d’enceinte, d’environ dix pieds carrés, où l’attendait Moser.
Celui-ci portait un déguisement dont la forme étrange rappelait à la fois le costume de Méphistophélès et celui de Crispin. Il donnait à la grande taille de l’Alsacien quelque chose de si bouffon, que Jacques ne put s’empêcher de rire.
—Ah! tu es donc déjà en habit de bataille, toi? dit-il à voix basse et en regardant son compagnon de la tête aux pieds; tonnerre! sais-tu que c’est une vraie bonne fortune d’avoir soulevé la malle de ce cabotin de Caen; ça te va comme un gant.
—Bas frai? dit Moser, qui se redressa et avança avec une certaine fatuité ses jambes maigres qui flottaient dans le maillot noir; bas frai que j’ai l’air gomme y faut?
—Tu as l’air d’un grand bâton de cire à cacheter, répliqua le Parisien.
—Eh pien! ça leur fait beur! reprit le Juif avec une expression d’orgueil souriant; y m’brennent pour le tiable!... Eh! eh! eh! frai, ça m’amuse! d’autres fois, je m’hapille en pierrot, et y m’brennent pour un revenant; d’autres fois je me change en fagot...
—C’est bon, interrompit Jacques, dont la gaieté avait duré peu de temps; en voilà assez pour le quart d’heure...
—J’sais pien, dit Moser; puisque te foilà, y faut plus tonner de boudre aux pêtes, bour que t’aies l’air de jasser la maladie.
—Il s’agit bien de maladie, reprit le Parisien; la boutique est enfoncée, monsieur Jérusalem, il y a un gredin qui connaît nos couleurs.
—Pach!
—Si bien qu’il nous faut trousser bagage.
—Ah! mein godd! alors ma beine y sera berdue?... et ma boudre aussi!
—Oui.
—Mein Godd, mein Godd!... mais on beut bas même attendre... pour faire un beu de gommerce?
—Je te dis qu’il faut partir! seulement avant de filer nous travaillerons... dans l’ancien genre.
—Ah! et y aura cras?
—Pas trop: mais il faut que l’affaire se fasse... à moins que nous ne voulions être raccourcis.
—Faut bas, faut bas, interrompit gaiement Moser; on n’est jamais trop crand.
—Excepté quand il faut mettre les pantalons des autres! fit observer Jacques, en regardant le maillot de l’Alsacien, qui ne pouvait rejoindre la veste; du reste l’affaire en question n’est pas commode; il y aura des précautions à prendre. Et d’abord, dis-moi, tu es allé à la ferme des Motteux?
—Rien qu’une fois; y a là une betite, tu sais pien, celle que nous affons vue à l’hôtel des Étranchers; elle m’a regonnu et j’ai bas osé retourner.
—Mais il y a aussi une jeune dame de Paris.
—Ah! foui, matame Honorine? J’ai là une lettre bour elle.
—Une lettre, d’où te vient-elle?
—C’est une varce, reprit Moser en riant; une cholie varce. Imachine-toi que c’matin en refenant de faire ma tournée, je bassais près du vercher qui est là, plus pas, quand je fois un pourcheois qui sort du pois, tout toucement, tout toucement; il recarte s’y a bersonne, y gourt au bommier qui est au port du gemin et pouff! y chette une lettre dans le fieux tronc.
—Tiens!
—C’est ce que j’ai dit: diens! mais guand il a été barti, je me suis abroché du bommier.
—Et tu a pris la lettre?
—Chuste!
—Donne-la.
—Bourquoi faire, tu beux bas lire la nuit?
—Ah! c’est vrai, mais tu l’as lue, toi?
—Foui, foui; faut pien faire quéq’chosse bendant le jour; on beut pas touchours tormir?
—Eh bien! qu’est-ce qu’elle chante?
—Elle jante la romance:
—Ah! diable!
—Et buis y s’blaint.... y temande à foire matame Honorine; y la brie d’aborter sa rébonse au bommier.
—Et sais-tu si elle l’a portée?
—Non, non, c’est blus tard, en refenant de gontuire la betite oufrière. Je la fois basset tous les chœurs à dix heures.
—Et elle est seule?
—Toute seule.
Le Parisien parut réfléchir.
—Ce serait une bonne occasion, murmura-t-il; mais ce soir, c’est impossible, il y aura par-là des gens qui nous empêcheraient de travailler.
—Quelles chens?
—Les hommes du Vrillet: ils m’ont demandé de chasser le mauvais air de leur ferme, je leur ai donné rendez-vous dans la cabane du verger pour la cérémonie.
—Ah! pon, s’écria Moser réjoui; ça fera un betit goup de gommerce afant de bartir; compien qu’ils ont bromis?
Jacques ne répondit pas. La tête baissée et les poings appuyés sur ses genoux, il concentrait évidemment toutes les forces de son intelligence sur une idée qui venait de surgir dans son esprit: le Juif qui le comprit respecta sa méditation, et il y eut un assez long silence.
Enfin il se leva résolûment et frappant la terre du pied:
—J’ai notre affaire, monsieur Jérusalem, dit-il avec un éclat de gaieté farouche.
—Un noufeau brochet? demanda Moser.
—Oui, mon vieux, reprit Jacques, à qui son idée souriait évidemment d’une façon toute particulière; quelque chose de neuf, d’étourdissant. Ca vaudra mademoiselle Georges dans Lucrèce Borgia. Tu te rappelles Lucrèce Borgia?
—Barfaitement; c’est une bièce où nous afons fait un pracelet.
—Oui.
—Un pien pel ouvrage, Barisien, le pracelet y fallait cent écus.
—Eh bien! mon ouvrage à moi nous en rapportera quatre cents, vieux squelette, sans nous exposer à aucun désagrément.
—Gomment que tu feras tonc?
—Je vas te dire ça, reprit le Parisien en regardant le ciel. Mais il doit être déjà neuf heures; nous allons filer jusqu’à la lisière du fourré pour que tu me montres le pommier qui sert de boîte aux lettres et là je t’expliquerai tout. Envoie Sapajou en avant; il nous servira d’éclaireur.
Moser appela le chien griffon qui, sur un signe, s’élança dans l’espèce de corridor par lequel Jacques était entré. Les deux compagnons prirent bientôt le même chemin et atteignirent l’enceinte extérieure des Grandes Mercs.
Bien que le ciel fût sombre pour la saison, on pouvait encore distinguer les objets d’assez loin. Une lueur morne qui filtrait à travers l’atmosphère grisâtre, jetait sur la campagne une teinte pâle mais uniforme, au milieu de laquelle les rochers, les arbres, les maisons, se dessinaient en masses vigoureusement sombres. On entendait encore à l’horizon quelques roulements de charrettes et quelques bêlements de troupeaux, mais ni chants, ni cris d’appel, car la contagion avait suspendu les réunions dans les fermes et les rondes dansées devant les seuils. Chacun demeurait renfermé chez soi, oppressé par la tristesse.
Moser et le Parisien purent donc atteindre les vergers du Vrillet sans faire aucune rencontre.
Arrivés là, ils s’abritèrent derrière un massif de noisetiers toujours gardés par Sapajou qui faisait sentinelle à quelques pas, l’oreille droite et le museau au vent.
Là, Moser désigna à son compagnon l’arbre choisi pour la correspondance établie entre Honorine et Marcel. C’était un de ces pommiers appelés Marin-Onfroy, du nom de leur introducteur en Normandie, et qui, à en juger par son apparence de vétusté, pouvait dater de l’époque même de cette introduction. Le tronc miné par les ans ne conservait de sève qu’à sa surface, et les branches desséchées pour la plupart, n’avait plus pour ornement que la verdure parasite du gui.
A environ trente pas du vieil arbre s’élevait une de ces huttes en torchis, recouvertes de paille, destinées à abriter un gardien pendant la récolte. C’était là que Jacques avait donné rendez-vous aux gens du Vrillet. Il les aperçut déjà rassemblés à la porte et attendant son arrivée.
Après avoir examiné avec soin la disposition des lieux qu’il trouva favorable à son projet, et donné à Moser toutes les instructions nécessaires, il quitta le massif de noisetiers, fit un long détour et rentra enfin dans le verger par un côté opposé.
Ceux qui l’attendaient l’aperçurent et vinrent à sa rencontre.
Il y avait là outre Romain, son oncle Pierre Fareu, vieil avare au cœur d’acier, son jeune frère Richard, chez qui les superstitions populaires étouffaient toute conscience, sa femme et sa fille âgée de douze ans.
Le Parisien les compta du regard, puis entra sans rien dire dans la hutte.
Le choix qu’il avait fait de cet abri écarté pour l’accomplissement de ses sortiléges, avait d’autant moins surpris les gens du Vrillet, qu’il était en tout conforme à la tradition. C’était toujours dans un lieu solitaire et inhabité, que de pareilles opérations devaient s’accomplir. Pierre Fareu se rappelait avoir assisté, dans sa jeunesse, à une de ces évocations magiques, entreprise pour démasquer un voisin soupçonné d’avoir le cordeau[B], et elle avait lieu dans une bergerie abandonnée. Instruit par les leçons d’un mendiant de Falaise, longtemps voué à la profession de sorcier, et qu’il avait eu pour compagnon de chaîne à Toulon, le Parisien connaissait toutes les formes usitées pour ces incantations, et ce qu’il y mettait de sa propre inspiration, selon les besoins du moment, ne faisait qu’ajouter à l’infaillible effet produit sur son auditoire. Cette fois surtout, l’importance du but à atteindre l’engagea à plus de soins et d’efforts.
La hutte dans laquelle il se trouvait n’avait d’autre ouverture que la porte et une fenêtre sans volet, trop étroite pour que l’on pût y passer la tête. Il la parcourut d’abord en tous sens afin de s’orienter, puis se plaça debout au milieu, se dépouilla jusqu’à la ceinture, et commença à prononcer quelques paroles incompréhensibles, d’une intonation de plus en plus accentuée. Enfin il se pencha et traça sur la terre une ligne qui brilla quelques instants autour de lui comme un cercle de flamme; il jeta alors trois cris d’appel, et presque au même instant, un murmure semblable à celui d’une voix qui parle bas se fit entendre vers la fenêtre. Tous les regards se tournèrent de ce côté, mais sans rien apercevoir.
Jacques répondit en mots mystérieux, et l’entretien continua ainsi quelques instants, jusqu’à ce que l’être invisible, qui semblait parler dehors, eût poussé un rugissement accompagné d’une secousse dont la cabane fut ébranlée.
La petite fille cacha sa tête sur les genoux de sa mère, qui n’avait pu retenir une exclamation de saisissement; les trois hommes eux-mêmes pâlirent.
Quant à Jacques, il s’était accroupi avec toute l’apparence de la terreur; mais au bout d’un instant, il se redressa lentement, traça de nouveau, autour de lui, plusieurs cercles de feu, murmura quelques phrases cabalistiques, puis, respirant avec effort, il s’écria:
—Le grand Varou m’a parlé; je sais d’où vient le mal qui frappe le pays.
—Et d’où vient-il? demanda Romain qui était le moins effrayé.
—Il vient d’une personne qui a un pacte rouge avec le noir-velu; le pacte rouge lui donne le droit sur tout ce qui vit, depuis le moindre animal jusqu’à l’homme fait.
—Alors, c’est elle qui a enfantômé nos bêtes? reprit Fareu.
—Et elle les prendra toutes, y compris la gerce (vieille brebis), et le poulain.
Le vieux paysan joignit les mains d’un air consterné.
—Et après les bêtes, continua le sorcier, viendra le tour des enfants!
—Ah! Jésus! cria la femme de Romain en serrant sa fille entre ses genoux.
—Et après les enfants, le reste! acheva Jacques.
Les trois hommes se regardèrent.
—Mais ne peut-on rien faire pour empêcher le mal? demanda Richard.
—Pour sauver les bêtes? continua Fareu.
—Et les enfants, ajouta la paysanne.
—Si on connaissait seulement la magicienne, murmura Romain d’un air sombre.
—Quand on la connaîtrait, dit Jacques, ça empêcherait-il quelque chose?
—Oui bien, oui bien, reprit le fermier du Vrillet, dont la nature violente commençait à se révéler, car, dans ce cas, je la matrasterais.
—C’est le seul moyen d’échapper à son pouvoir, fit observer Richard.
—Et ça nous empêcherait d’être ruinés! continua Fareu.
—Faites-nous savoir quelle est la sorcière de malheur qui m’a enlevé mes banons[C], reprit le fermier du Vrillet avec une exaltation croissante; aussi vrai que v’là deux mains, je l’étranglerai comme une mauve (mauviette).
—Faut prendre garde de faire des promesses, objecta Jacques; si vous n’alliez pas les tenir, le grand Varou se vengerait sur vous et sur moi! peut-être qu’en connaissant la personne qui a amené la malédiction sur le pays vous n’oserez plus...
—Moi! s’écria Romain avec rage, j’oserai pas me revenger de celle qui m’a fait mourir une paire de bœufs! Dites donc, père Fareu, est-ce que vous croyez que j’oserais pas?
—Je t’aiderai, répliqua le vieillard, pour sauver ce qui nous reste! Perjou! si tu l’étrangles j’tirerai la corde.
—Et moi les pieds, ajouta Richard.
—Le nom seulement, dites le nom, reprit Romain; faut en finir tout de suite.
Jacques parut céder, mais déclara que ce qui allait se passer demandait certaines précautions. Il ordonna aux trois hommes de tirer leurs habits et leurs chaussures, de se noircir le visage avec de la poudre de charbon qu’il avait apportée; puis il recommença ses évocations.
Bientôt la voix se fit entendre de nouveau, et, a chaque repos, Jacques traduisait tout haut ce qu’elle lui avait dit.
—La personne qui jette le mauvais air est une femme... Elle n’est pas du pays... La ferme où elle demeure est épargnée par la maladie... Ce sont ses ennemis qui ont été les premiers frappés.
Ces désignations étaient trop claires pour laisser le moindre doute; aussi le nom d’Honorine sortit presque en même temps de toutes les lèvres.
Romain ferma les poings et ses yeux s’injectèrent de sang: au milieu de sa rage, il éprouvait une sorte de joie féroce à trouver l’intérêt de sa vengeance si bien d’accord avec l’inspiration de sa haine.
—Où peut-on la trouver maintenant? demanda-t-il.
—Sur ta terre, répondit Jacques; elle vient tous les soirs pour y jeter ses maléfices.
—Tous les soirs! et je ne l’ai jamais aperçue!
—Parce qu’elle se rend invisible; mais veux-tu que le grand Varou te la montre?
—Oui.
Le Parisien fit quelques signes magiques, puis, sur un léger glapissement qui se fit entendre derrière la hutte, il ouvrit brusquement la porte et les trois hommes qui avaient avancé la tête avec une avidité palpitante, demeurèrent immobiles de surprise.
Plongés dans l’ombre, ils apercevaient devant eux la campagne doucement éclairée par la lune, comme un tableau lumineux qu’encadrait la porte de la cabane. Au premier plan apparaissaient les arbres du verger projetant leurs ombres gigantesques; un peu plus loin, le pommier séculaire, et, tout au fond, le sentier qui côtoyait le fourré.
Or, dans ce sentier, au penchant du coteau, glissait une forme blanche qui s’avançait vers la pommeraie. Elle dépassa les derniers buissons du fourré, atteignit la ligne de lumière et les trois paysans la reconnurent.
—C’est elle, dit Romain.
—Elle traverse la viette.
—La voilà qui entre dans notre champ.
—Faut qu’elle y reste! reprit le fermier en faisant un mouvement pour sortir.
Sa femme se jeta devant lui.
—Prends garde, Romain, elle peut te reconnaître! s’écria-t-elle.
—Il est trop bien peint, murmura le sorcier.
—Mais demain, quand on la retrouvera dans notre verger...
—La rivière n’est pas loin, continua Jacques.
—C’est ça, la rivière! répéta Romain; c’est le plus sûr... Vous avez promis de m’aider, vous autres?
—Nous sommes prêts.
—Alors, c’est dit.
Il sortit suivi de Richard et de Fareu. Dans ce moment, Honorine avait dépassé le massif de noisetiers et arrivait près du vieil arbre, au creux duquel sa main plongea: elle parut surprise de n’y rien trouver, fouilla de nouveau, et, y déposant enfin sa lettre, voulut regagner le sentier. Elle atteignait déjà le détour du verger lorsque Romain, qui avait suivi le sillon à travers les blés, se dressa tout à coup sur son passage.
A la vue de ce noir visage, elle poussa un cri et voulut reculer; mais, au même instant, deux bras vigoureux la saisirent par derrière, une main s’appuya sur sa bouche, tandis que son écharpe, violemment serrée, lui ôtait la respiration; elle ne se débattit que quelques instants et tomba suffoquée aux pieds de ses meurtriers.
Le Parisien, qui avait tout regardé sans dire un mot et sans faire un mouvement, s’approcha.
—A l’eau, maintenant! murmura-t-il d’un ton bas et précipité.
Les paysans s’efforcèrent de soulever le corps immobile.
—Nous ne pourrons jamais la chiboler (transporter) jusque-là, dit Fareu.
—J’ai vu plus bas un cheval au vert, fit observer Jacques.
—Oui, à la friche! répéta Romain.
Tous trois prirent à gauche, et, gagnant un champ voisin où des bestiaux se trouvaient parqués, s’approchèrent du cheval, sur lequel ils déposèrent leur fardeau.
Le fermier du Vrillet monta lui-même par derrière, tandis que Richard se plaçait à côté.
—Prenez la quaire, mon oncle, dit-il à Fareu; nous allons au petit tourbillon.
Le vieux paysan détacha la corde qui retenait le cheval au piquet et ils se mirent en marche.
Romain et ses deux compagnons traversèrent d’abord plusieurs champs, puis arrivèrent à la route qui longeait les prairies. On apercevait plus bas l’Esques, dont le cours, dessiné par une ligne d’aunes et de saules, serpentait au fond de la vallée. Le silence de la nuit n’était troublé que par le lourd clapotement de l’eau contre ses rives, ou, de temps en temps, par les hurlements sinistres d’un chien dans quelque ferme éloignée.
Les meurtriers marchaient palpitant d’une sourde terreur; mais tout à coup le fermier du Vrillet, qui soutenait la morte d’une main crispée, crut la sentir s’agiter.
—Qu’est-ce que c’est? demanda Richard.
—Elle a gandolé (remué), dit Romain.
—Faut aller plus vite, interrompit Fareu, qui excita le cheval à presser le pas.
Ce mouvement sembla ranimer Honorine, qui se raidit sous l’étreinte du fermier; Richard, qui la soutenait, recula.
—Eh ben! picot (dindon), c’est comme ça que t’es rufle (courageux), dit le fermier avec colère. Veux-tu nous faire sourguer (surprendre)?
Il ramena en même temps le corps vers lui et frappa sa monture du talon; mais, au même instant, le galop d’un cheval se fit entendre au fond du chemin creux qu’ils allaient prendre; il approchait rapidement et les trois paysans aperçurent bientôt, dans l’ombre, un cavalier qui venait droit à eux.
Il y eut un mouvement d’épouvante. Fareu s’était arrêté; Richard lâcha de nouveau le fardeau qu’il soutenait, et Romain lui-même fit un mouvement pour sauter à terre.
—Nous sommes pris! murmura le vieux paysan.
—Faites entrer le cheval dans le pré! répliqua le fermier.
Fareu tira la corde à lui; mais la brèche qu’il fallait franchir se trouva fermée par une claie, et le cavalier approchait toujours; il n’était plus qu’à quelques pas lorsque Honorine se redressa avec un soupir.
Romain serra convulsivement l’écharpe, se courba à moitié pour retenir le corps qui glissait à terre, et murmura à l’oreille de Richard:
—Si tu grouces (remues), tu es frit.
Le jeune paysan demeura glacé et muet.
Le cavalier n’était plus qu’à quelques pas; il avait ralenti l’allure de son cheval, et tenait les yeux fixés sur les trois hommes que l’ombre des arbres ne lui permettait point de bien distinguer. Il s’arrêta même un instant, comme s’il eût voulu se rendre compte de ce groupe étrange, puis remettant son cheval au trot, il passa en se retournant plusieurs fois.
Lorsqu’il eut disparu dans la nuit, Romain respira fortement.
—Au Petit-Tourbillon, maintenant, dit-il, d’un accent précipité, et vitement, car elle joufle (respire) toujours.
Fareu, qui avait réussi à ouvrir la barrière, reprit la corde du cheval, et ils descendirent rapidement vers la rivière. Ils la rejoignirent sur un point où le lit, subitement abaissé, donnait lieu à une chute assez forte. L’eau tombant du niveau supérieur, avait fini par creuser plus bas une sorte de gouffre au-dessus duquel on voyait tournoyer l’écume, et que l’on connaissait dans le pays sous le nom de Petit-Tourbillon. Romain, qui était descendu, fit signe à Richard. Tous deux saisirent Honorine, redevenue immobile, et s’approchèrent du petit cap qui surplombait la rivière. Mais les arbustes formaient, dans cet endroit, une barrière qui ne permettait point d’apercevoir le tourbillon; il fallut poser le corps au penchant de la berge et écarter les branches pour lui faire un passage. Il glissa doucement entre les feuilles... on entendit sa chute dans le gouffre... et tout redevint silencieux.
Les trois hommes se regardèrent glacés de terreur, puis, par un mouvement involontaire, tous trois se découvrirent, se signèrent et reprirent en silence la route du Vrillet.
Comme ils y arrivaient, Jacques sortit de derrière une haie, les regarda rentrer, puis, se tournant vers Moser:
—Le pain est cuit, dit-il; il faut maintenant, qu’on nous paye la façon.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pendant que ceci se passait, le cavalier qui avait croisé Romain et ses compagnons, continuait à suivre la route conduisant au Vrillet. Ce cavalier n’était autre que M. de Gausson, qui dans sa fièvre d’impatience, n’avait pu attendre le matin pour venir chercher la réponse déposée au creux du vieux pommier. Mais, quelles que fussent ses préoccupations, la rencontre qu’il venait de faire le frappa. Deux ou trois fois il s’arrêta pour chercher derrière lui l’étrange apparition et il crut voir des ombres traverser la prairie.
Il remit son cheval au pas, cherchant à s’expliquer quelles pouvaient être ces ombres et ce qu’elles faisaient.
Or, parmi les phénomènes psychologiques auxquels notre nature complexe donne naissance, il en est un que tout le monde connaît par sa propre expérience. Un objet a frappé notre regard au passage sans que nous ayons pu le distinguer assez nettement pour le juger, et cependant, à mesure que nous y pensons, l’impression obscure qu’il nous a laissée s’éclaircit; les détails prennent plus de précision, le raisonnement éclaircit les images vaguement imprimées dans notre mémoire; enfin, ce qui n’était qu’une vision confuse devient subitement une perception nette et arrêtée!
Ce fut là ce qui arriva à M. de Gausson; à mesure qu’il réfléchissait à son apparition; elle se dessinait plus distinctement à ses yeux. Les trois hommes qu’il venait de rencontrer avaient le visage peint ou masqué de noir, et le fardeau porté sur leur cheval rappelait la forme humaine. Selon toute apparence un crime avait été commis; Marcel venait de rencontrer la victime et les assassins.
Il en était là de ses inductions lorsque ses yeux, baissés vers la route, y virent briller quelque chose à la lueur des étoiles; il descendit de cheval et releva une petite croix de brillants qu’Honorine tenait de la prieure et qu’elle portait toujours au cou.
Ce fut pour lui un horrible trait de lumière! Saisi d’épouvante, il remonta vivement sur son cheval, et lui faisant franchir la clôture qu’il avait à sa droite, afin de couper au plus court, il gagna au galop le point vers lequel il avait vu les ombres se diriger.
Mais dans ce moment même les gens du Vrillet venaient de finir leur sinistre expédition et revenaient, comme nous l’avons vu, par la route ordinaire.
Ils étaient déjà rentrés depuis quelque temps et ils avaient fait disparaître tout ce qui pouvait les trahir, lorsqu’un grand bruit de voix et de pas précipités retentit au dehors.
La femme, qui était assise sur l’âtre, pâle et frissonnante, jeta un cri. Le fermier lui imposa silence par un geste terrible.
Le bruit approchait; on heurta à la porte et plusieurs voix appelèrent Romain.
Il fit signe de ne pas répondre.
L’appel se renouvela plus élevé.
—Dieu Sauveur! c’est sa grand’mère! balbutia la fermière du Vrillet, dont les dents claquaient, et qui, par un mouvement instinctif, attira sa fille près d’elle.
Romain s’était approché de la porte et demanda d’un accent altéré ce que l’on voulait.
—Ouvrez, c’est Madame Louis répliquèrent plusieurs voix.
Le fermier tira le verrou avec répugnance, et l’ancienne meunière entra précipitamment.
Elle était essoufflée, couverte de sueur et dans un désordre de costume prouvant qu’elle avait quitté les Motteux au moment de se mettre au lit.
—Ma petite-fille, dit-elle d’une voix haletante; avez-vous vu, par ici, ma petite-fille?
—Vous voulez dire la dame de Paris, balbutia Romain qui cherchait ses mots.
—Oui, oui, savez-vous où elle est?
—Comment est-ce que je pourrais le savoir? répliqua le paysan.
—Elle m’a quitté après neuf heures pour retourner aux Motteux, fit observer Françoise qui avait suivi la mère Louis avec la plupart des gens de la ferme, et elle a pris, comme d’habitude, par le petit sentier qui longe le verger de M. Romain.
—On ne peut pas voir d’ici dans la viette, objecta le bonhomme Fareu.
—Qui est-ce qui te dit le contraire, vieux grec (avare), reprit la grand’mère dont l’inquiétude ne pouvait changer le ton habituel; mais quelqu’un de vous a dû aller aux champs ce soir.
—Personne.
—Personne, répéta la mère Louis, dont le regard venait de s’arrêter sur une charge de luzerne déposée près de la porte; d’où vient alors la pagnolée fraîche que je vois là?
Les trois hommes demeurèrent interdits, mais la fermière du Vrillet vint à leur secours.
—C’est moi, mam’Louis, dit-elle doucement, qui suis allée au vert.
—Et tu n’as rien vu, rien entendu? demanda la grand’mère.
—Rien, mam’Louis, répliqua la fermière avec effort. Mais peut-être bien... qu’en cherchant ailleurs... vous trouverez...
—Nous avons cherché partout, dit la vieille paysanne en se laissant tomber sur un escabeau... Tu vois que je suis rouge comme un papi (coquelicot). C’est au moment d’aller dormir que je me suis étonnée de ne pas voir la mezette. D’ordinaire à cette heure elle n’est pas avaux les champs; j’ai voulu savoir ce qu’elle était devenue; mais on a eu beau parler, courir!... Faut qu’il lui soit arrivé un malheur.
—Ah! pauv’ chère dame! dit Fareu d’un air hypocrite; pourquoi donc que le bon Dieu lui aurait fait du chagrin? Vous verrez qu’elle reviendra dans un moment ou dans un autre.
—Et qu’elle vous expliquera tout, ajouta Romain.
—Peut-être bien qu’elle est déjà en route pour les Motteux.
—Ou même qu’elle est arrivée.
—Vous allez la revoir.
—La voici! cria une voix haletante.
Et de Gausson parut à l’entrée portant dans ses bras Honorine sans mouvement.
Au milieu des cris de surprise qui s’élevèrent, il y en eut trois d’une inexprimable terreur poussés par Richard, par la fermière et par sa fille: Romain et Fareu restèrent seuls muets; le saisissement les avait pétrifiés.
La mère Louis s’était levée, hors d’elle; à la vue d’Honorine ruisselante d’eau et immobile, elle s’écria:
—Ah! Dieu sauveur! elle est noyée.
—Non, dit Marcel, tout à l’heure elle a parlé.
—Mais qu’est-il donc arrivé? d’où vient-elle?
—Vous saurez tout... plus tard... Ce qu’il faut maintenant, c’est un médecin.
—Allez chercher le mière! cria la mère Louis.
Deux des domestiques qui l’avaient suivie y coururent pendant que de Gausson déposait Honorine sur un lit, dont la grand’mère s’approcha avec de bruyantes lamentations.
—Seigneur Jésus! dans quel état la voilà! s’écriait-elle, en prenant la main de la jeune femme; froide comme marbre et les yeux clos... Mezette, pauvre mezette, est-ce que tu ne m’entends pas, dis? Ah! elle a groucé (remué), monsieur Marcel; y a encore du remède. Ouvre les yeux, mezette, je t’en prie; c’est moi, c’est grand’mère.
Elle était penchée sur Honorine, qu’elle secouait et qu’elle embrassait avec une tendresse mêlée d’impatience. La jeune femme parut enfin se ranimer; elle ouvrit et referma les yeux plusieurs fois, comme si la lumière l’eût blessée, regarda la mère Louis et voulut murmurer quelques mots; la vieille paysanne fit un geste de joie.
—Bon! tu es revivante! s’écria-t-elle en frappant dans ses mains; garde les yeux ouverts, mezette; reviens à ton esto; c’est rien, va, c’est rien du tout; nous allons bien te migeoter et demain y n’y paraîtra plus. Mais comment donc qu’ça t’est arrivé? et par quel hasard que le voisin s’est trouvé là?...
—Par un hasard dont je devrais remercier Dieu à deux genoux, dit Marcel encore palpitant, car quelques instants plus tard le crime était accompli!
Il raconta alors en mots rapides et entrecoupés la rencontre que le lecteur connaît déjà, les soupçons qu’elle avait fait naître en lui, ses recherches au bord de l’Esques, où des gémissements l’avaient enfin conduit jusqu’à Honorine, emportée par le courant au milieu des roseaux.
On devine les exclamations de surprise et d’épouvante des auditeurs. Françoise qui s’était approchée, sanglotait en baisant les mains de sa jeune maîtresse; la mère Louis jurait qu’elle découvrirait les haingeux (méchants) qui avaient voulu lui égorger sa mezette, et les gens des Motteux se perdaient en conjectures.
Marcel venait de finir son récit lorsque Vorel arriva avec les domestiques qui avaient couru l’avertir. Il paraissait vivement ému, et s’informa, dès la porte, avec anxiété, de l’état d’Honorine.
—Venez, venez, mon mière, dit la mère Louis joyeusement, il n’y a pas trop de mal, grâce à ce fel gars qui me l’a retirée de la mort. La voilà qui se ravigote, regardez: elle va pouvoir nous raconter comment la chose s’est passée.
—Ne la fatiguez pas, de grâce, interrompit le médecin, ce qu’il lui faut par-dessus tout c’est du repos...
—Laissez-la nous dire seulement quelques mots, reprit la vieille paysanne.
Mais Vorel s’y opposa en déclarant qu’il fallait la laisser se remettre et changer ses vêtements.
Françoise se dépouilla d’une partie des siens, et la fermière du Vrillet fournit le reste. Le médecin, qui s’était écarté de quelques pas avec Marcel, pendant cette toilette, apprit de lui tout ce que le jeune homme avait déjà raconté avant son arrivée; il se rapprocha ensuite et engagea la mère Louis à se rendre aux Motteux pour revenir avec le char-à-banc; mais celle-ci, qui avait déjà commencé à questionner Honorine, résista à toutes ses instances et voulut d’abord l’entendre.
La jeune femme, dont l’affaissement commençait à se dissiper, apprit alors de quelle manière elle avait été enlevée à l’improviste par trois hommes rencontrés près du petit sentier. Pendant qu’elle parlait, les gens du Vrillet s’étaient groupés au coin le plus obscur, de peur de laisser voir leur trouble, et écoutaient dans une angoisse inexprimable.
Quant à Vorel, il se tenait debout près du lit, la tête penchée, une main sur le pouls d’Honorine. Aucune pâleur, aucune contraction ne se faisait remarquer sur son visage, seulement la veine qui traverse le front était gonflée!
—Et tu n’as pas reconnu les scélérats qui t’ont prise? demanda la mère Louis, quand sa petite-fille eut achevé.
—Ils étaient masqués, répondit-elle.
—Mais tu as au moins remarqué leurs habits?
—Je n’ai point eu le temps.
—Et leur voix?
—Ils n’ont point parlé.
—De sorte que quand on te les montrerait tu ne pourrais pas dire: les v’là!
—Non.
Un frisson de soulagement parcourut le groupe caché dans l’ombre; Vorel ne fit aucun mouvement, mais la veine de son front s’effaça.
—Que le diable m’épouse si j’y comprends rien! reprit la vieille fermière: les gens du pays ne peuvent pas avoir fait un pareil coup; faut que ce soient des horsains (étrangers).
—Mais dans quel intérêt auraient-ils commis ce crime? objecta de Gausson.
—Au fait, ils ne lui ont rien pris, continua la paysanne; c’est pas des voleurs; pourquoi donc alors qu’ils en voulaient à la mezette?
—Oh! je sais bien moi! dit tout à coup une voix grêle et traînante.
Les regards se tournèrent vers le foyer et l’on aperçut le fils de Vorel accroupi sur l’âtre.
L’idiot, qui avait entendu crier que la dame de Paris était assassinée, s’était levé sans rien dire; il avait suivi le médecin à son insu, et au milieu du trouble général, personne ne s’était aperçu de son arrivée. Assis à l’angle du foyer, il avait donc tout écouté et tout vu. Or, quel que fût l’affaiblissement intellectuel et moral de cette nature, quelques lueurs de la flamme divine y survivaient encore. L’idiotisme chez Henri était moins l’effet d’une organisation manquée que d’une organisation détruite; cette âme n’était que cendres et ruines; mais sous ces débris pétillaient encore, par instants, quelques étincelles. Depuis l’arrivée d’Honorine surtout, ces éclairs de lucidité étaient devenus plus fréquents; ainsi que nous l’avons déjà dit, sa douce influence avait fait germer quelques bourgeons dans cette terre stérile, et la mère Louis elle-même s’était émerveillée deux ou trois fois de ce que le grand’jodane eût l’air d’un humain. L’annonce que la dame de Paris avait été tuée et la vue d’Honorine, pâle, échevelée, mourante, avaient produit chez Henri une secousse qui sembla soulever, momentanément, le voile de plomb étendu sur son intelligence; à force de sentir, il put comprendre et se rappeler. Ce fut d’abord un travail lent et confus; mais insensiblement le jour se fit dans cette âme, et, au moment où il s’écria:—Je sais bien moi! il avait une complète conscience et de ce qu’il avait entendu et de ce qu’il venait de dire.
Son regard exprimait sans doute quelque chose de cette illumination intérieure, car la mère Louis, qui ne se donnait point habituellement la peine de lui répondre, se tourna de son côté et dit d’un ton dans lequel l’ironie n’était qu’une habitude.
—Tu sais quelque chose, toi, grand’jodane?
—J’étais réveillé, reprit l’idiot, qui tenait les yeux fixés devant lui, comme s’il eût vu ses souvenirs, j’ai entendu marcher dehors... puis causer... je me suis levé... la fenêtre était ouverte... il y avait deux hommes dans le jardin.
—Ne voyez-vous pas qu’il va nous raconter un rêve, interrompit Vorel; en voilà assez, Henri.
—Non, laissez-le parler, reprit la mère Louis que l’air de l’idiot frappait de plus en plus; voyons, grand’jodane, qu’est-ce que c’étaient que ces hommes?
—Le petit avait un habit comme tout le monde, et le grand ressemblait aux images des livres.
—Vous voyez bien qu’il divague! interrompit de nouveau le médecin.
—N’importe, reprit la paysanne; et qu’est-ce que disaient les deux hommes, mon gars?
—Ah! d’abord j’ai pas entendu! répliqua l’idiot... ils parlaient trop bas. Mais après le grand a dit: Elle est bien noyée!
—Il a dit cela! s’écria la mère Louis.
—Et alors, reprit Henri, l’autre a répondu: le bourgeois sera content.
Tout le monde fit un geste de stupéfaction; la veine se gonfla de nouveau au front de Vorel.
—Je suis véritablement désolé, dit-il en s’approchant sans affectation de son fils, que vous preniez garde aux folies de cet innocent; c’est l’encourager.
—Qu’est-ce que ça vous fait, interrompit la fermière des Motteux avec impudence, puisque nous voulons l’écouter!.... ont-ils encore dit autre chose, mon ami?
—Oui, murmura l’idiot d’une voix moins assurée.
—Eh bien! raconte tout...
—Ils ont dit, reprit Henri, ils ont dit...
Mais ses yeux avaient rencontré ceux du médecin qui semblaient le fasciner. Il balbutia quelques instants, puis l’éclair d’intelligence qui brillait dans son regard s’éteignit, il baissa la tête et se mit à se balancer avec un murmure monotone sans que les questions de la mère Louis et de Marcel pussent l’arracher à son hébétement.
Vorel fit alors observer doucement que la confusion de l’idée avec le fait, était une conséquence naturelle de l’état dans lequel se trouvait Henri. Il entra même à ce sujet dans quelques explications physiologiques, puis passant à l’événement dont Honorine avait failli être victime, il demanda si l’on ne pouvait pas l’attribuer à une méprise.
C’était ouvrir aux imaginations une nouvelle voie dans laquelle elles se précipitèrent. Chacun se mit à chercher d’où pouvait venir l’erreur; on épuisa toutes les suppositions. Enfin, l’arrivée du char-à-banc que l’on avait envoyé demander y mit momentanément un terme. On y porta Honorine qui prit le chemin de la ferme, accompagnée de la mère Louis et de Marcel, tandis que le médecin retournait au manoir avec Henri.
Celui-ci, qui avait repris son allure habituelle, marchait en chantonnant et en repoussant du pied, devant lui, les pierres de la route. Vorel suivait, le regard fixé sur l’idiot.
Quiconque eût pu lire l’expression de ce regard à travers les lunettes sombres qui le cachaient, se fût senti glacé. C’était à la fois de la terreur, de la colère, de la haine! Les bras croisés sur sa poitrine, comme pour comprimer son agitation intérieure, le médecin continuait, au fond de son esprit, une de ces méditations entrecoupées auxquelles le monologue dramatique a donné une voix. Les pensées se succédaient en lui comme autant de traits sombres et rugissants.
—Vivante!... tous mes efforts inutiles.... et si l’on allait découvrir.... Cet idiot sait... tout peut-être!... et sa vie m’est nécessaire... C’est par lui que je possède, que j’hérite!... Oui... mais son intelligence n’est point encore assez éteinte; il ne faut plus qu’il voie, qu’il entende, il ne faut plus qu’il parle surtout... je saurai l’empêcher...
Ici la pensée de Vorel cessait de se formuler; son esprit flottait entre mille projets confus à peine entrevus et aussitôt abandonnés; enfin un mot prononcé intérieurement sembla fixer ses irrésolutions. Il hâta le pas pour rejoindre Henri, qui venait d’arriver au manoir.
La Sureau les attendait curieuse de savoir ce qui s’était passé. Vorel répondit brièvement et lui reprocha d’avoir laissé l’idiot le suivre au Vrillet.
—Pardi! c’est pas ma faute, s’écria la servante. J’ai huché après lui, mais il s’en est fui comme un autenais (poulain) échappé.
—Je crains que cette sortie, au milieu de la nuit, ne vaille rien pour lui, reprit Vorel; chauffez son lit et faites-le coucher sur-le-champ.
—Soyez tranquille, je vas le mettre dans sa niche comme un petit Jésus.
—Il faudrait aussi lui faire prendre quelque chose de chaud.
—Oui.
—Et fermer ses volets.
—Je les fermerai.
La Sureau se hâta, en effet, d’exécuter les ordres de son maître, en reprochant à Zozo d’être sorti sans permission, et lui déclarant qu’il ne méritait pas d’avoir un père si occupé de sa santé.
L’idiot venait de se coucher, lorsque Vorel entra lui-même avec le lait chauffé par sa servante; il le présenta à son fils qui, après l’avoir goûté, déclara qu’il le trouvait amer; mais la Sureau se récria, et, sur l’ordre de son père, le grand’Jodane acheva de boire.
Il ne tarda pas à tomber dans un sommeil lourd qui parut rassurer également le médecin et la servante, et tous deux le quittèrent.
Cependant rentré chez lui, Vorel ne se recoucha point. Après s’être promené quelque temps, il ouvrit un portefeuille et en retira les deux lettres remises par Moser; c’étaient celles de Marcel et d’Honorine. Il les lut en entier; puis, s’asseyant devant son secrétaire, il traça quelques lignes en déguisant son écriture, joignit son billet aux lettres, et réunissant le tout sous une enveloppe cachetée, il y mit pour adresse:
A Monsieur
Arthur de Luxeuil,
Rue de Lille, 17. Paris.
C’est une étrange existence que celle de la femme qui choisit le théâtre, non pour y cultiver un art, mais pour y exposer sa beauté. Si elle réussit, vous la voyez subitement transportée de la loge ou de la mansarde au milieu de tous les raffinements de l’opulence. Hier, son cercle ne se composait que de commis marchands et de clercs d’avoué, aujourd’hui la voilà mêlée, par la galanterie, à ce que la naissance, la richesse ou la politique ont de plus renommé.
Comme tous les parvenus, du reste, elle apportera dans cette fortune inattendue, une exagération de luxe, d’égalité et de manières qui trahira son ancienne condition. Trop longtemps pauvre pour avoir appris à compter, elle sèmera l’or avec l’insouciance qu’elle mettait autrefois à semer les gros sous; trop longtemps confondue dans les derniers rangs pour savoir tenir sa place dans les premiers, elle outrera le ton de l’aristocratie. Quoi qu’elle fasse, la liberté et le naturel manqueront toujours à ses grands airs; on y sentira le rôle appris. Elle-même s’en lassera parfois. Ennuyée de ces plaisirs dispendieux qui ne lui rappellent rien, elle regrettera les joies faciles de ses pauvres années, cette vie de bohémien passée sous les toits, au milieu de la senteur des giroflées et du gazouillement des hirondelles, alors qu’on avait une seule robe, lavée le samedi soir pour la partie de campagne du dimanche, une seule collerette qu’on repassait dans un livre, et un chapeau de paille cousue dont on devait encore les rubans.
Ah! quelles belles promenades, quelles joyeuses parties! Que de danses, de rires, de chants, de plaisanteries! Si le cœur a tressailli une seule fois, c’est dans ces années de liberté et d’insouciance. Aussi, le souvenir en est-il toujours resté charmant. Aussi, vienne l’occasion, et la grande dame se refera grisette quelques heures pour retrouver ses folles gaietés, boire du cidre et faire des farces.
C’était à une fantaisie de ce genre qu’il fallait attribuer le singulier désordre dans lequel se trouvait le logement de Clotilde. L’actrice, fatiguée des soupers fins et des roués de la fashion, avait voulu revenir à un de ses plaisirs d’autrefois, alors qu’elle chantait l’opéra-comique à la classe de M. Ponchard, et donnait, dans la loge de sa mère, des thés composés d’eau sucrée et de marrons. Les invités avaient été choisis en conséquence. C’étaient, outre Floridor, la nièce du cocher, grande élève du Conservatoire, noire et laide, mais qui avait adopté la danse pour faire valoir des formes capables de compenser tout le reste; une modiste du troisième, moins occupée de coiffures que de bals masqués; deux musiciens de Valentino et un jeune étudiant dentiste, récemment arrivé de Normandie; tous trois locataires des combles.
Euphrosine, liée depuis peu avec le co-intéressé d’un agent de change, était arrivée par hasard au moment de la soirée et avait été retenue par Clotilde; enfin, la société particulière de madame Beauclerc complétait le cercle: c’étaient, outre le cocher, la portière qui l’avait remplacée au Marais et une garde-malade à qui elle donnait le titre de cousine.
Tout ce monde réuni dans l’élégant salon de l’actrice, formait trois groupes principaux et distincts. Au fond se trouvait d’abord l’ex-portière avec ses chiens et sa compagnie; les chiens dormaient dispersés sur deux divans et la compagnie jouait aux cartes en buvant du vin cacheté. La conversation était sur ce point peu active et se bornait à quelques réflexions philosophiques de madame Beauclerc, entrecoupées, de loin en loin, par les grognements du cocher ou par les dictons égrillards de la garde-malade.
Le second groupe était composé de la future danseuse, qui interrogeait Euphrosine sur son Monsieur, d’un des musiciens lutinant la modiste, et du jeune Normand uniquement occupé de rougir et de chercher ce qu’il pourrait faire de ses mains. Après les avoir successivement employées à brosser son chapeau, à battre le rappel sur ses genoux et à effiler les glands du canapé, il venait enfin de suspendre ses deux pouces dans les emmanchures de son gilet, attitude qui lui donnait, pensait-il, un air d’aisance tout à fait parisien.
Enfin, près du foyer, se trouvaient l’autre musicien, Floridor, et Clotilde qui avait fait apporter une poêle dans le salon, et qui confectionnait des beignets aux pommes, en canezou de dentelle et en robe de soie.
Il y avait entre ce dernier groupe et le second un échange continuel de remarques, de rires et de plaisanteries, au milieu desquels Floridor lançait, comme d’habitude, ses quolibets, tout en mangeant sournoisement les beignets les mieux réussis.
Clotilde s’en aperçut.
—Eh bien! qu’est-ce qu’il fait donc, s’écria-t-elle en retirant vivement l’assiette; il dévore tout, ce grand squelette-là? Tu ne peux pas attendre que j’aie fini mes beignets?
—Tu ne veux donc pas qu’ils finissent par la faim? objecta le comédien, en appuyant sur le mot pour faire sentir le calembour.
—Je veux que nous mangions tous ensemble, reprit l’actrice; dis donc, Phrosine, prépare le couvert, ma petite, voilà que j’ai bientôt plus de pâte.
—Faut alors que j’aille chercher une table? demanda la jeune fille.
—Non, non, reprit Clotilde; une table serait un genre trop vertueux; faut faire un repas de grisette; mets la nappe là, sur le divan.
—Je veux bien, s’il y avait une nappe.
—Est-elle princesse au moins, depuis qu’elle a son tiers d’agent de change; prends la première chose venue.
—Un tire-botte ou un faux-col? fit observer Floridor.
—Je ne vois que ton écharpe de velours.
—Eh bien! est-ce que c’est pas bon? reprit Clotilde, qui fit jaillir la friture autour d’elle; approche seulement le cidre qui est là-bas.
—Et des verres?
—Parbleu! ma chère, regarde, cherche ce qui pourra servir. S’il faut te dire tout, alors y a pas de plaisir.
—Attendez, reprit la modiste qu’une pratique journalière avait rendue habile dans cette science d’expédients; je vas vous aider. Quand on a un peu d’idée, on trouve toujours moyen de s’arranger. J’ai donné le mois dernier un déjeuner de six couverts avec deux assiettes. Dans le petit Dunkerque nous trouverons tout ce qu’il faut.
Les deux musiciens se joignirent à la modiste et trouvèrent en effet sur les étagères de curiosités, les éléments d’un service complet. Les coquilles d’huîtres perlières et les cocos sculptés tinrent lieu de verres; les assiettes furent remplacées par des fragments de mosaïque, et l’on servit à chacun, en guise de fourchettes, une belle flèche madécasse armée de son arête. L’étudiant dentiste seul fut favorisé d’un couvert chinois composé d’un cure-dents et de ses petits bâtons d’ivoire.
Un grand couteau en silex, destiné à découper, et deux urnes lacrymatoires métamorphosées en sucriers, complétèrent le service.
A sa vue Clotilde éclata de rire.
—A la bonne heure donc, s’écria-t-elle; voilà un couvert! Cristi! un carabin de septième année n’aurait pas mieux fait la chose. Y vous manque seulement des flambeaux, vu que le soleil se couche; eh bien! mes enfants, voici une manière de candélabre, qui servira en même temps de surtout. A ces mots elle apporta une mandoline indienne incrustée d’ivoire et percée de plusieurs ouvertures, dans lesquelles on plaça des bougies allumées. Floridor frappa trois coups sur un gong chinois pour avertir que tout était prêt, prononça le benedicite de Sardanapale, arrangé à l’usage du dix-neuvième siècle: et chacun s’assit par terre autour du divan. On avait déjà commencé à entamer le plat de beignets, lorsqu’on frappa à la porte du salon.
—Tiens, qu’est-ce qui vient là? demanda Clotilde sans se déranger.
—Passez votre chemin, bonhomme, on a donné à votre père, cria Floridor.
—Il n’y a personne, ajoutèrent les deux musiciens.
—Entrez, dit Euphrosine, qui grignotait le beignet piqué à sa flèche malgache.
La porte s’ouvrit et Marquier parut. Le petit homme qui avait la vue basse fit d’abord quelques pas sans rien distinguer; mais il s’arrêta tout à coup devant l’étrange couvert et les convives qui l’entouraient. Un hourrah général l’accueillit.
—Offre donc à Monsieur ses talons pour s’asseoir, dit Floridor en montrant le parquet.
—Monsieur est tambour de la garde nationale, ajouta un des musiciens.
—Donnez vos buffleteries, Mesdemoiselles.
—Et joignez-y ma bénédiction.
—Avec le moyen de s’en servir.
—Comment! s’écria Marquier étourdi et lorgnant autour de lui; vous avez un raout, ma belle, et vous ne nous aviez point avertis.
—Non, dit le comédien, qui commençait son quatrième beignet, elle n’a pas voulu d’hommes comme il faut... par décence et vu qu’il se trouvait des demoiselles.
—Eh bien! pardieu! je m’invite, reprit Marquier.
—Servez une flèche à Monsieur et faites-lui place, dit Clotilde; je vous avertis seulement, mon petit, que nous prenons tous au même plat, comme les amis de Saint-Antoine.
—Monsieur en est, fit observer Floridor qui donna place au banquier près de lui.
—Je vois que c’est une orgie de grisette, reprit celui-ci en s’asseyant sur le tapis.
—Juste, cria Clotilde, on a droit d’être mauvais genre et on danse le cancan; passez donc le plat au petit gros, vous autres.
—Ce sont des beignets? demanda Marquier qui cherchait à en piquer un avec sa flèche sans pointe.
—Beignets de potiron au racahout, reprit gravement Floridor, communément nommés beignets des sultanes, vu l’emploi que les lorettes du grand seigneur font de ce légume savoureux.
—C’est moi qui les ai faits, interrompit Clotilde.
—Et le fauteuil rouge a tenu la queue de la poêle, acheva Floridor.
Marquier, qui était enfin parvenu à s’emparer d’un beignet, le déclara excellent. L’actrice versa à boire, et la gaieté devint de plus en plus expansive. Le cidre fini, on passa au vin muscat et du vin muscat au vin de Champagne. Les musiciens, qui étaient gris, se livraient à des plaisanteries équivoques; le jeune Normand, rouge comme une pêche en espalier, se défendait à chaque instant plus mal contre les agaceries de la nièce du cocher. Floridor seul avait conservé sa même figure blafarde et son même flegme effronté. Il continuait à manger, à boire, à lancer ses quolibets avec une continuité mécanique, tandis que Clotilde, folle de gaieté, dansait une polonaise des plus hasardées avec Marquier. Mais après trois ou quatre tours de salon, elle se laissa tomber sur un divan en s’éventant avec un coussin.
—Ah! bah! vous n’avez pas le chic, s’écria-t-elle, on dirait que vous avez peur de vous échauffer.
—Près de vous, cela se comprend, dit le banquier avec une galanterie égrillarde.
Clotilde le regarda par-dessus son épaule nue.
—Ah! si vous retombez dans le genre pair de France, merci! dit-elle; j’en ai assez comme ça.
—En effet, reprit Marquier qui jeta un coup d’œil dédaigneux sur la réunion; je vois que vous vous ennuyez de la bonne compagnie.
—Tiens, c’est étonnant peut-être? vous ne parlez que de chevaux et de Bourse. Vous, surtout, vous êtes amusant comme un almanach de cabinet.
—Ah! ah! est-elle méchante, dit Marquier en s’efforçant de rire, vous voulez me taquiner, mais j’ai toujours été cité pour mon bon caractère, ma belle; je ne me fâche jamais... mal à propos, et, la preuve c’est que je veux vous rendre un service.
—Avec combien de commission? demanda l’actrice hardiment.
—De commission, répéta Marquier un peu déconcerté; pardieu! vous m’y faites penser; au fait, j’ai droit à une commission, je la réclame.
—Voyons d’abord le service.
—Eh bien! voici, ma belle, continua-t-il en se penchant vers elle et baissant la voix. J’ai cru m’apercevoir depuis quelque temps que vous étiez moins contente d’Arthur; madame Beauclerc m’a même fait entendre que vous ne seriez pas éloignée de rompre; ce qui ne m’étonne pas... vu que j’ai moi-même à me plaindre de lui.
—Après?
—Eh bien! vous vous rappelez sans doute un Belge que je vous ai présenté il y a quinze jours.
—Ce monsieur qui a l’air d’un bonhomme de pain d’épice?
—Il a deux cent mille écus de rente.
—C’est pas trop pour sa boule.
—Outre un million dans les fonds publics.
—Qu’est-ce que ça me fait?
—Cela peut vous faire beaucoup, si vous voulez.
—A cause?
—A cause de l’effet que vous avez produit sur M. Vankrof qui est prêt à vous offrir ses hommages.
—Pour de bon! interrompit madame Beauclerc, qui venait de quitter le jeu et de s’approcher.
—Pour tout de bon! répondit Marquier.
—Et y fera les choses... comme y faut?
—Il souscrira à tous les désirs de votre fille!
—Si tu manques encore celui-là, n’y a plus qu’à aller se jeter dans la Seine! dit la grosse femme avec énergie.
—Un bain de rivière, je n’en suis pas, répliqua l’actrice.
—Mais songe donc, malheureuse!... reprit la mère Beauclerc.
Clotilde interrompit.
—Ah! si vous allez recommencer vos monologues, je file, dit-elle avec humeur; ça m’ennuie à la fin d’entendre toujours répéter la même chose. C’est vous qui m’avez mise avec Arthur, après tout.
—Parce qu’alors il avait de quoi, reprit l’ancienne portière; mais maintenant c’est fini; tu le sais bien; si tu le gardes, c’est qui t’a ensorcelée.
—Lui!
—Tu en as besoin comme une nouvelle mariée de son mari.
—Ah! par exemple! s’écria Clotilde visiblement blessée; voilà qui est un peu foncé de couleur! moi je suis amoureuse! ah! ah! ah! mais vous me croyez donc bête à bâter?
—Pourquoi est-ce que tu tiens au Luxeuil alors?
—Qui vous a dit que j’y tenais?
—Puisque tu le gardes!
—Parbleu! on garde bien ses vieilles pantoufles... quand on les a.
—Alors tu consentirais à rompre?
—Je m’en moque pas mal.
—Eh bien, nous allons voir, reprit vivement madame Beauclerc, si tu n’as pas menti: tu vas écrire tout de suite au monsieur pour lui dire de chercher fortune ailleurs; aussi bien tu es dans ton droit, voilà deux mois qu’y ne t’a pas payé la pension.
—Et vous ne devez plus espérer qu’il la paie, fit observer Marquier, ses affaires sont dans un état désespéré; moi-même je me trouve compromis pour une somme énorme.
—Entends-tu ça? dit madame Beauclerc, en posant sur le guéridon tout ce qui était nécessaire pour écrire; voudrais-tu garder un homme ruiné..... pour qu’y te mange tout... et que tu deviennes la dernière des dernières?... faudrait avoir bien peu de cœur.
Clotilde prit la plume sans répondre. En voyant tarir le flot d’or dans lequel Arthur l’avait jusqu’alors laissée puiser, elle s’était dit à elle-même toutes ces choses, et l’ouverture faite par Marquier la trouvait beaucoup mieux disposée qu’elle ne voulait le paraître et que sa mère ne semblait le supposer. Sous son apparence légère, Clotilde cachait, comme toutes ses pareilles, une avidité native qui réglait tous ses goûts. Ce n’était pas de l’avarice, car l’avarice suppose l’esprit de conservation, mais cet instinct des courtisanes qui les tourne vers la richesse comme le fer se tourne vers l’aimant.
Elle trempa la plume dans l’écritoire et écrivit avec quelque lenteur les lignes suivantes:
«Mon pauvre Tutur,
»Y me dize tous, depuis si l’ontan, qu’y faut nous séparé, que sa m’en donn la migrainn; n’y a pas moien autrman d’avoir du repau; aussi je me résign; fée com’ moi, et cherche ailleur une bonne fille qui remplace ta fidèle amie,
»Clotilde.»
La mère Beauclerc, qui avait mis ses lunettes pour lire par-dessus l’épaule de sa fille, battit des mains.
—Bravo! ma biche! s’écria-t-elle; c’est tourné comme aurait pu le faire un rédacteur-écrivain public. S’il se fâche après ça, c’est qu’il a un bien mauvais caractère. Ah! mais, minute; avant de fermer, redemande-lui ton collier, qu’il avait pris pour le faire réparer: les bons comptes, comme on dit, font les bons amis.
L’actrice reprit la plume et écrivit:
P. S. «Renvoie-moi le collié de perle fine aveq le fermoire d’émail. Je tien à tout se qui me rapèle ton souvenire chérie.»
Elle écrivit ensuite l’adresse, et donna la lettre à la grosse femme, qui la baisa au front.
—Va, tu es une fille raisonnable, dit-elle avec attendrissement; aussi le bon Dieu t’en récompensera. Je vas descendre moi-même pour jeter ton billet dans la boîte; maintenant, tu peux t’amuser, ma biche; tout ira bien.
La mère Beauclerc sortit, et Clotilde rejoignit ses invités, qui jouaient à la main chaude à l’autre extrémité du salon. La gaieté était bruyante, et chaque incident amenait quelque quolibet de la part de Floridor, dont les gravelures devenaient de plus en plus transparentes. L’intervention de Clotilde et de Marquier donnèrent au jeu un nouvel essor.
Autant le banquier avait l’air gauche dans le monde aristocratique où le hasard l’avait implanté, autant il semblait à l’aise dans un autre milieu. Le mauvais ton lui était si naturel, que pour le prendre il n’avait qu’à se laisser aller; aussi, au bout de quelques instants, était-il devenu le héros de la réunion. Heureux de faire jouer à l’étudiant-dentiste le rôle qu’il avait l’habitude de jouer lui-même, il le prit pour but de ses plaisanteries, et lui retourna toutes les mystifications apprises ailleurs à ses propres dépens. Quand il fallut se séparer, il envoya le Normand complétement hébèté à l’omnibus de la barrière du Trône, en lui persuadant qu’il logeait à Vincennes. Pendant ce temps, un des musiciens reconduisait chez elle la nièce du cocher, et Floridor regagnait sa chambre garnie dans la calèche d’Euphrosine. Au moment de prendre congé de Clotilde, Marquier lui demanda quand il pourrait lui conduire M. Vankrof.
—Venez quand vous voudrez, répondit l’actrice; demain, si le cœur vous en dit: je n’ai pas de répétition.
—Alors vous serez ici?
—Tout le jour.
Le banquier promit de venir avec son protégé, et salua pour partir; mais, en ouvrant la porte, il parut se raviser.
—Pardon, dit-il, je fais une réflexion; demain, Arthur aura votre lettre; dès qu’il l’aura lue, il ne peut manquer d’accourir. Si, en conduisant ici mon ami Vankrof, j’allais le rencontrer?...
—Eh bien!...
—Je crains que cela n’amène quelque scène désagréable...
—C’est-à-dire que vous avez peur, mon petit homme.
—Moi! quelle plaisanterie! De quoi pourrais-je avoir peur, ma belle? Ce que j’en dis, c’est pour vous... et pour mon ami Vankrof. Si vous pouviez nous recevoir le soir dans votre loge... Arthur n’y vient jamais.
—Je le veux bien, mais alors il faut que je vous donne un billet de passe.
—Comment?
—Ce polisson de directeur ne veut plus nous laisser recevoir au théâtre que nos parents.
—Ah! bah!
—Je vais attester que vous êtes deux cousins... du côté de mon père... ce qui est possible, vu que je ne l’ai jamais connu. Si la portière vous dit quelque chose, vous lui fermerez la bouche avec une pièce de cent sous. Elle n’a jamais su résister à ça, la mère Lampou.
Le banquier promit de rappeler le moyen à son compagnon, et Clotilde lui écrivit l’autorisation nécessaire pour arriver le lendemain jusqu’à sa loge. Rentrée dans sa chambre, elle y trouva madame Beauclerc, qui, tout en la déshabillant, s’informa de ce que Marquier venait de lui dire, et de ce que l’on pouvait espérer de ce Melchior Vankrof. Clotilde ne l’avait vu que deux ou trois fois, mais elle en avait entendu parler à de Luxeuil et à ses amis comme d’un des plus riches étrangers de Paris. Son oncle, d’abord batelier sur l’Escaut, puis négociant-armateur, lui avait laissé en mourant une fortune de plusieurs millions que Melchior apprenait à manger noblement, c’est-à-dire à force de vices. Tous ces détails ravirent l’ancienne portière.
—C’est le bon Dieu qui t’envoie ce monsieur, ma biche, dit-elle avec une sorte d’onction; je savais bien qu’y t’arriverait comme ça quéq’bonne chance un jour ou l’autre... J’avais encore fait un cierge pour toi à Saint-Roch le mois dernier. On a beau dire, vois-tu, que c’est des superstitions de jésuites; moi j’ai toujours eu un fond de religion; aussi, tu vois que ça ne m’a pas trompée! Maintenant c’est à toi de profiter de l’occasion. Tu vas avoir une belle boule en main!...
—Une belle boule! répéta Clotilde; c’est pas celle de M. Vankrof, toujours, on dirait un potiron avarié.
—Y s’agit pas de plaisanteries, ma chère, interrompit la grosse femme choquée du peu d’effet produit par son discours; je parle sérieusement.
—Tiens, ça vous est égal à vous le physique de l’individu, reprit hardiment l’actrice; mais moi c’est autre chose. Après tout, Tutur était un beau garçon, tandis que ce M. Melchior est un vrai hérisson... Mon Dieu, ça ne m’empêchera pas de bien le recevoir, ajouta-t-elle en voyant le mouvement d’impatience de sa mère; on fera tout ce qu’il faudra, mais on a bien le droit de faire la différence peut-être!
Madame Beauclerc secoua la tête et poussa un gros soupir.
—Ah! les jeunesses, murmura-t-elle; ça a-t-il des idées petites! On voit bien, pauvres créatures, que vous ne connaissez encore rien de rien à la vie... ou plutôt, vois-tu, j’en reviens à mes moutons; tu as un faible pour ce monsieur de Luxeuil.
Clotilde haussa les épaules sans répondre, et acheva de se déshabiller en chantonnant. La vérité était qu’elle regrettait Arthur, non pour lui-même, mais par suite de la comparaison avec Melchior. Derrière le calcul de la courtisane il y avait le goût de la femme qui répugnait à l’échange, bien qu’en s’y soumettant. Puis, comme il arrive toujours, au moment de rompre cette liaison, elle y trouvait des charmes auparavant inaperçus: sa mémoire lui rappelait mille souvenirs endormis, réveillant mille riantes images!... La mère Beauclerc était déjà sortie depuis longtemps et l’actrice, demi-nue, continuait à rouler ses papillotes avec distraction, lorsque ses yeux, fixés sur le miroir, virent tout à coup la portière de velours se soulever doucement et la tête d’Arthur apparaître. Elle se retourna avec un cri...
—Chut! interrompit de Luxeuil en imposant silence de la main.
—Vous ici! reprit-elle stupéfaite.
—La femme de chambre causait dans l’escalier, reprit le jeune homme, la porte était ouverte, je suis entré comme un voleur.
—Alors personne ne t’a vu?
—Personne.
Une folle idée traversa l’esprit de l’actrice. Arthur n’avait point encore reçu sa lettre; il ignorait ses intentions: la rupture pouvait être remise au lendemain, et avant de tenter une nouvelle liaison, elle trouvait l’occasion de faire au passé un tendre et dernier adieu; le projet fut aussitôt accepté que conçu, et courant à la porte par laquelle de Luxeuil venait d’entrer, elle la referma vivement et poussa le verrou.
Le jour, depuis longtemps levé, pénétrait à travers les doubles rideaux et inondait la chambre de joyeuses clartés: assis sur un fauteuil près de la fenêtre, Arthur écrivait un billet tandis que Clotilde, encore couchée, luttait contre un reste de sommeil. Tout à coup on frappa à la porte.
—Ouvrez, balbutia l’actrice qui oubliait avoir fermé la veille.
—C’est le valet de monsieur de Luxeuil, dit la femme de chambre du dehors.
Arthur alla tirer le verrou.
A sa vue la femme de chambre fit deux pas en arrière.
—Monsieur est là! s’écria-t-elle.
—Sans que vous le sachiez, répliqua l’actrice, ce qui prouve qu’on entre ici comme sur le Pont-Neuf. Voyons, préparez-moi tout ce qu’il faut pour me lever.
Elle s’était mise sur son séant et avait ôté sa coiffure de nuit pour relever ses cheveux. Arthur reparut bientôt des lettres à la main et s’approcha de la fenêtre pour les lire, tandis que l’actrice se faisait chausser et passait une robe de chambre de cachemire blanc. Il parcourut d’abord l’adresse de plusieurs billets, à travers le papier desquels on apercevait des colonnes de chiffres annonçant clairement des mémoires de créanciers, puis une lettre plus volumineuse avec le timbre de Bayeux, et enfin une douzaine de circulaires portant l’inévitable estampille des frères Bidault. Il rejeta le tout sur la table, sans rien ouvrir, s’arrêta à une petite missive, dont l’enveloppe glacée exhalait une forte odeur d’ambre, et en examina la suscription.
—Dieu me pardonne! on croirait que c’est votre écriture, ma chère, dit-il en se tournant vers Clotilde, voyez donc?
L’actrice jeta un regard sur la lettre et ne put retenir une exclamation.
—Est-ce que vous m’auriez vraiment écrit? demanda de Luxeuil.
—Pourquoi pas? répliqua-t-elle en prenant son air résolu.
—Diable! c’est une faveur rare, reprit Arthur d’un ton légèrement ironique, et cela ne vous arrive d’habitude que dans les occasions solennelles; il y a donc quelque chose de nouveau?
—Ça se peut.
—Quelque négociation diplomatique trop délicate pour être traitée de vive voix?
—Justement.
—Vous piquez ma curiosité et j’ai hâte de connaître...
—Ça vous est facile, dit Clotilde, qui faisait évidemment provision d’assurance pour l’explication dont elle était menacée.
Malgré son prétendu empressement, de Luxeuil brisa le cachet et dégagea le billet de son enveloppe avec une visible lenteur: il savait que les autographes de Clotilde se payaient en général fort cher, et qu’elle n’écrivait que pour des réclamations sérieuses. Aussi, cherchait-il, tout en dépliant la lettre, le moyen d’éluder la demande qu’il prévoyait sans la connaître. L’actrice, de son côté, s’était placée devant son miroir en fredonnant et suivait de l’œil tous les mouvements du jeune homme. Lorsqu’il commença la lettre, celui-ci crut à une plaisanterie, et ce fut seulement arrivé au post-scriptum que la chose lui parut sérieuse. Encore eut-il besoin de lire une seconde fois pour s’en assurer. Bien que cette rupture ne pût le surprendre, il en demeura un instant étourdi, mais il se remit presque aussitôt. Dans la carrière galante qu’il avait parcourue, de pareils événements étaient trop ordinaires pour qu’il n’y eût point pensé d’avance: c’était un de ces échecs prévus pour lesquels la fashion avait établi certaines règles que l’on ne pouvait violer sans s’exposer au ridicule. Quel que fût le dépit, il fallait, comme le gladiateur, tomber selon les traditions du cirque et dans l’attitude voulue. De Luxeuil comprima donc son premier élan; il tourna la lettre en tous sens, comme s’il eût voulu s’assurer qu’elle ne renfermait rien de plus, la parcourut de nouveau pour gagner du temps et mieux se remettre, puis, se tournant vers Clotilde, qui continuait à défaire ses papillotes:
—Comment donc! ma chère, dit-il avec une colère contenue qui s’efforçait d’imiter l’ironie, mais vous avez un véritable talent épistolaire. Sauf l’orthographe, qui vise un peu trop au pittoresque, votre lettre me paraît un chef-d’œuvre.
—Oh! vous pouvez vous en moquer, dit Clotilde embarrassée de la tranquillité d’Arthur; je l’ai écrite comme j’ai pu, et bien malgré moi.
—Pourquoi cela? reprit de Luxeuil, vous étiez complétement dans votre droit; le terme peut être indifféremment déclaré par le propriétaire ou par le locataire.
—Eh bien! merci, s’écria Clotilde, vous me regardez alors comme un appartement à louer? Du reste, je vous permets tout, vu que vous devez m’en vouloir.
—Moi! interrompit de Luxeuil en riant avec effort; oh! charmant! elle me croit contrarié.
Clotilde le regarda d’un air de surprise mêlé de dépit.
—Ça vous est donc égal? s’écria-t-elle.
—Du tout, reprit Arthur, ne voyez-vous pas, au contraire, que je suis désespéré... Comment pourrait-on perdre sans regret des charmes... qui augmentent chaque jour.
Clotilde se mordit les lèvres. Depuis quelque temps en effet, elle luttait contre un embonpoint toujours croissant, et qui lui inspirait de sérieuses inquiétudes.
—Malheureusement, je devais m’attendre à cet abandon! continua de Luxeuil, qui comprit qu’il avait touché le point sensible; il y a maintenant à Paris trop d’Orientaux amoureux des beautés développées... Je parie, ma chère, que vous êtes en pourparlers avec l’ambassade ottomane.
L’actrice haussa les épaules.
—Dans ce cas, tenez bon, continua Arthur du même accent persiffleur; la beauté est pour ces messieurs une question de poids, et vous avez à cet égard un avenir incalculable!...
—Ah! vous m’ennuyez à la fin! s’écria Clotilde poussée à bout; si j’engraisse physiquement plus que de raison, vous, mon cher, vous maigrissez pécuniairement plus qu’il ne faudrait.
Ce fut au tour d’Arthur de se mordre les lèvres.
—C’est gentil de faire le millionnaire, continua-t-elle aigrement, mais il ne faut pas que ce soit avec l’argent du carrossier, du maquignon et du tapissier. Croyez-moi, mon petit, il est temps de mettre de l’ordre dans vos affaires et de vous corriger de vos vices.
—Vous remarquerez que j’en ai déjà un de moins, fit observer de Luxeuil, qui regarda l’actrice; mon plus gros vice. Quant aux autres, je m’en corrigerai avec l’aide de Dieu et de mes créanciers. Je n’en suis pas moins touché de votre sollicitude, ma belle, et, pour la reconnaître, je vous donnerai un bon conseil.
—Je n’en veux pas.
—Parce que vous ne pourrez jamais me le rendre, n’est-ce pas? mais je vous en fais cadeau. Vous avez, sans doute, déjà trouvé l’heureux infortuné qui doit me remplacer.
—Oui, je l’ai trouvé! interrompit Clotilde aigrement, et je peux choisir entre plusieurs, si je veux.
—Ne choisissez pas! reprit Arthur.
—Pourquoi cela?
—Parce qu’il vaut mieux les garder tous.
L’actrice lui lança un regard flamboyant.
—S’ils oubliaient les fins de mois comme certaines gens que je connais, c’est possible, dit-elle avec intention; mais il y a un millionnaire... oui, Monsieur, un millionnaire... seulement il n’est pas grand seigneur! ce qui fait qu’il ne se croit pas obligé d’être insolent, et qu’il paie ses dettes. Ça vous paraît bien mauvais genre, hein?
Arthur avait avidement recueilli le renseignement qui venait d’échapper à l’actrice, mais il ne laissa rien paraître.
—Mon Dieu, vous appuyez bien sur le mérite de payer ses créanciers, dit-il avec une hauteur railleuse; est-ce que par hasard, je resterais votre débiteur? Voyons, dans ce cas, réglons nos comptes: donnez votre chiffre.
Quelle que fût son impudence, mademoiselle Beauclerc recula devant une demande faite de cette manière et sur ce ton.
—Il ne s’agit point de cela, dit-elle, je ne vous ai point parlé de moi.
—Ah! j’y suis, s’écria de Luxeuil, en retournant la lettre de l’actrice qu’il tenait toujours à la main; ce billet a dû être écrit hier soir?
—Certainement, dit Clotilde.
—Avant mon arrivée.
—Eh bien?
—Eh bien! alors, ma chère, je n’avais aucun droit de me présenter ici; notre contrat de mariage était déchiré; vous ne m’avez reçu que par hospitalité, pour me rendre service, et tout service rendu mérite récompense.
Et parlant ainsi, il avait tiré de sa poche un portefeuille dans lequel il prit un billet de banque qu’il présenta à Clotilde. Celle-ci devint pourpre. En voyant de Luxeuil ouvrir sa lettre, elle s’était préparée à combattre ses reproches, et sa froideur moqueuse l’avait déjà déconcertée, mais ce dernier acte mit le comble à son désappointement. Habituée à recevoir le prix de ses complaisances sous des formes qui en déguisaient la honte, elle avait mis sa dignité à éviter tout ce qui révélait trop clairement le marché; là était, à ses propres yeux, l’étroite limite qui la séparait de la prostituée. Aussi cette offre de paiement immédiat et direct lui sembla-t-il le plus sanglant de tous les outrages. Elle recula avec un geste violent.
—Par exemple! s’écria-t-elle, il faut que vous soyez bien insolent!...
—D’offrir si peu, interrompit Arthur, qui feignit de se méprendre sur le motif de l’indignation; je puis augmenter la somme, ma chère.
—Sortez d’ici, cria Clotilde dont les yeux lançaient des flammes et qui lui montra la porte; sortez d’ici tout de suite ou j’appelle!
De Luxeuil éclata de rire.
—Il faut avouer que les rôles sont singulièrement intervertis, dit-il, ravi de la fureur de l’actrice; c’est moi que l’on congédie et c’est vous qui menacez!... décidément vous n’êtes point dans votre bon sens.
—Ah! quel gueux! s’écria Clotilde à qui le sang-froid d’Arthur donnait des transports de rage.
—Le mot est peu littéraire, fit observer celui-ci en ricanant, mais il avait cours sans doute dans la loge de la mère Beauclerc. Du reste, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, ma belle; vous attendez peut-être votre millionnaire et je craindrais que ma présence ne l’effarouchât. Je vais m’occuper sur-le-champ de vous faire renvoyer le bracelet que vous voulez bien garder en mémoire de moi... ce qui est une résolution pleine de sagesse! car toute liaison peut se rompre, mais les souvenirs restent!...
Il prit sa canne, son chapeau, et déposant sur la toilette le billet de banque:
—Si je dois davantage, vous enverrez votre quittance, dit-il, ceci est une dette d’honneur... comme toutes les dettes qu’on ne peut avouer.
Il venait de sortir lorsque la porte opposée s’ouvrit pour donner passage à la mère Beauclerc. Sa fille s’était laissée tomber sur le divan.
—Qu’est-ce que c’est? Comment, tu pleures! s’écria la grosse femme.
L’actrice pleurait en effet, mais de rage.
—Ah! le misérable, le sans-cœur, balbutiait-elle.
—C’est donc vrai que tu l’as reçu?
—Oh! je me vengerai! à tout prix je me vengerai!
Elle arrachait avec fureur les torsades du coussin placé près d’elle. La mère Beauclerc le retira.
—Faut pas dégraboliser les meubles pour ça, interrompit-elle. Qu’est-ce donc qu’il t’a encore fait, ce gredin-là?
—Ce qu’il m’a fait, répéta Clotilde en fermant les poings; je ne pourrai jamais vous dire tout. D’abord, il a ri de ma lettre... Il a en l’air content d’avoir son congé.
—Par exemple!
—Il m’a traitée comme la dernière des créatures.
—Toi?
—Parce que j’engraisse!
Madame Beauclerc bondit sur elle-même.
—Ah! le brigand, s’écria-t-elle, il veut te déprécier. Pourquoi que je ne me suis pas trouvée là!
—Et bien pis que tout ça, reprit Clotilde d’une voix entrecoupée.
—Encore pis? répéta la grosse femme hors d’elle.
—Il a osé...
—Quoi donc?
—M’offrir de l’argent...
L’exaspération de l’ex-portière au lieu de grandir, parut s’arrêter tout à coup.
—Ah! il t’a offert... de l’argent, reprit-elle en regardant instinctivement autour d’elle...
Son œil rencontra le billet de banque laissé par de Luxeuil.
—C’est sans doute ça, dit-elle en avançant la main.
—Donnez, s’écria Clotilde, je veux le lui renvoyer en morceaux.
Mais la mère Beauclerc avait reculé de trois pas avec le billet.
—Lui, c’est un polisson, dit-elle; mais son argent n’a aucun tort à ton égard.
—Je vous dis que je n’en veux pas.
—Alors, c’est moi qui le garderai.
—Non, rendez-moi ce billet, entendez-vous; rendez-le moi, il me le faut.
L’actrice, irritée, poursuivait madame Beauclerc, qui cherchait à lui échapper; enfin celle-ci fourra le précieux papier dans son châle, et, y appuyant les deux mains:
—Vous ne l’aurez pas, Clotilde, s’écria-t-elle, quand vous devriez m’arracher la vie.
Il y avait dans le mouvement de la portière et dans l’énergie de son accent quelque chose de si grotesquement majestueux, que Clotilde s’arrêta tout à coup: la pose de la grosse femme défendant son billet lui rappela celle du fameux écuyer de Franconi défendant son drapeau, et, prise d’une subite gaieté, elle éclata de rire. Madame Beauclerc, habituée à ces changements d’humeur, n’en parut ni surprise ni blessée.
—Riez, folle que vous êtes, dit-elle en haussant les épaules, mais, pendant ce temps, l’heure de la répétition arrive.
—Ah! fichtre! je n’y pensais plus! s’écria Clotilde, dont la pensée avait déjà pris un autre cours. C’est ce méchant gant-jaune qui m’a fait perdre mon temps. Je serai encore à l’amende. Voyons, il faut pourtant que je déjeune avant de partir.
—Tout est prêt, fit observer la vieille femme; vous n’avez qu’à passer au salon.
Mademoiselle Beauclerc essuya quelques traces de larmes qui restaient sur ses joues, s’arrêta un instant en passant devant sa psyché pour lisser ses cheveux, puis sortit en fredonnant. Sa mère fit de la tête et des yeux un mouvement qui voulait dire:
—Est-elle heureuse de m’avoir!
Puis tournant autour de la chambre, elle se mit à ranger machinalement et arriva près de la table sur laquelle de Luxeuil avait posé ses lettres.
—Tiens, grommela-t-elle, il a laissé sa correspondance... sans l’ouvrir... savoir ce que ça peut être!
Elle chercha ses lunettes, prit les lettres l’une après l’autre, et les entr’ouvrant, avec une adresse qui eût révélé à elle seule son ancienne profession, elle lut quelques mots constatant des réclamations de créanciers; mais arrivée à la lettre plus volumineuse de Vorel, tous ses efforts furent inutiles. L’enveloppe, en papier épais et soigneusement cachetée, ne laissait rien paraître: elle la retourna quelque temps entre ses doigts avec le sentiment d’inquiétude et de convoitise du chat qui aperçoit un mets friand dont il est séparé par une vitre; enfin son regard s’arrêta sur le timbre de Bayeux qui coupait en deux l’adresse.
—Bayeux, reprit-elle, c’est pas loin de là qu’est la jeune dame que Marc protége; je lui ai promis d’avoir l’œil ouvert... peut-être bien que ça pourra lui servir...
A ces mots elle glissa la lettre dans la poche de son tablier, et regagna sa chambre.
Pendant ce temps Arthur suivait le boulevard, livré à des réflexions singulièrement agitées. Son dépit avait d’abord été maintenu par la nécessité de faire bonne contenance devant Clotilde, puis par le plaisir de l’humilier; mais lorsqu’il se trouva seul, son apparente insouciance s’évanouit. Depuis longtemps sur cette pente glissante qui devait le conduire, un peu plus tôt ou un peu plus tard, au fond de l’abîme, il comprit que l’abandon de l’actrice était l’avant-coureur de tous les autres désastres. C’était la première pierre qui se détachait de cet édifice de luxe et de plaisirs désormais sans base et maintenu seulement par l’habitude.
Puis il faut bien le dire, Clotilde avait acquis sur lui l’inexplicable ascendant qu’acquièrent presque infailliblement les courtisanes et qu’elles savent conserver, sans esprit, sans amour, sans beauté. Cet homme qui n’avait connu aucune des affections de la famille, qui riait de toutes les nobles passions, et dont toute la vie prouvait l’insensibilité, cet homme avait besoin de Clotilde; il l’aimait à sa manière, par vanité, par habitude, par sensualité. L’idée de ne plus l’avoir pour maîtresse éveillait en lui des mouvements de regrets furieux; son unique pensée était de deviner celui qui la lui avait arrachée et de se venger. Mais pour cela il fallait se hâter, car une fois la nouvelle liaison de l’actrice déclarée, toute provocation devenait ridicule. L’usage qui permet de se battre pour sa femme ou pour une maîtresse du grand monde défendait une pareille vengeance à propos de Clotilde. Près d’elle le rival n’était qu’un remplaçant. Pour pouvoir se venger décemment de ce dernier, il fallait donc trouver un prétexte de querelle avant sa prise de possession. Mais l’important était de le découvrir. De Luxeuil chercha longtemps sans pouvoir arrêter ses soupçons; la qualité de millionnaire donnée par l’actrice à son successeur l’embarrassait. Fallait-il regarder ce titre comme un trope ou comme une réalité? Dans le premier cas, le cercle des suppositions devenait trop immense; dans le second, il se faisait trop restreint. Il en était donc toujours aux mêmes incertitudes, lorsqu’une main se posa sur son épaule; c’était de Cillart qui venait de descendre de voiture avec d’Alpoda et Dovrinski.
—Eh bien! c’est comme cela que vous vous trouvez à nos rendez-vous? dit le garde-du-corps en souriant.
—Quel rendez-vous? demanda de Luxeuil.
—Quoi! vous avez oublié que nous allons ce matin chez le Belge?
—M. Vankrof?
—Vous vouliez voir sa galerie, et nous avions pris jour.
—Arthur se frappa le front.
—C’est juste! s’écria-t-il, je me rappelle maintenant...
—Nous venons de votre hôtel.
—Je vous dois alors des excuses...
—Nullement; nous voilà, nous allons entrer.
De Cillart s’était arrêté devant la porte d’un vaste hôtel, dont le péristyle était soutenu par des colonnes de stuc. Il entra avec ses compagnons, et tous quatre arrivèrent à un vaste escalier couvert de tapis précieux et bordé de vases de marbre garnis de plantes rares. Ils traversèrent un large palier, au milieu duquel s’élevait une naïade de bronze versant l’eau dans une vasque marine, et se trouvèrent enfin dans une antichambre où attendaient plusieurs laquais en livrée. L’un d’eux leur ouvrit un salon somptueusement décoré, tandis qu’un second allait les annoncer à M. Vankrof. D’Alpoda plaça son lorgnon entre la joue et le sourcil et l’y retint au moyen de cette grimace qui nous a été transmise par le dandysme d’outre-mer; il promena autour de lui un regard rapide.
—Eh bien, ce n’est pas trop hollandais tout cela, dit-il avec un accent moqueur dans lequel perçait l’envie; il faut que ce M. Vankrof ait près de lui quelqu’un qui s’y entende.
—Personne, répliqua de Cillart, c’est lui-même qui s’occupe de tout.
—Ah! bah! Est-ce qu’on aurait du goût sur l’Escaut?
—On a de l’argent qui en tient lieu. Tout ce que vous voyez ici n’est qu’imitation; ces consoles sont copiées sur celles du Louvre, cet éclairage sur celui de la galerie Aguado, ces socles sur ceux de Munich, seulement on y a mis le prix, et l’imitation est parfaite.
—Ah! j’entends, reprit d’Alpoda, notre Belge se livre à la contrefaçon sous toutes les formes. Eh bien, à la bonne heure, j’aime que l’on soit de son pays. En définitive, son hôtel est magnifique et tout m’y semble parfaitement à sa place... excepté lui. Comprenez-vous un pareil type vivant familièrement au milieu des Antinoüs et des Apollons!
—Mon Dieu! n’en dites pas de mal, reprit de Cillart; quel qu’il soit, il n’a qu’à vouloir pour vous enlever vos amis et votre maîtresse.
—Parce que?...
—Parce qu’il est millionnaire.
Arthur qui était demeuré muet jusqu’alors tressaillit à ce mot. En cherchant l’homme qui le supplantait, sa pensée ne s’était pas reportée une seule fois sur le Belge, et maintenant un seul mot prononcé par hasard réveillait en lui mille souvenirs. Il se rappela tout à coup l’admiration que M. Vankrof avait exprimée devant lui pour la beauté de Clotilde, sa demande de lui être présenté, les avances indirectes faites à l’actrice, et qui ne lui avaient semblé alors que de banales galanteries, mais auxquelles il trouvait maintenant une signification évidente. Toutes ces réflexions, qui surgirent à la fois dans son esprit, furent pour lui comme une révélation. Cependant il doutait encore, lorsqu’un domestique vint les avertir que M. Vankrof les attendait. Ils traversèrent plusieurs salons garnis de tableaux, d’antiquités, de meubles précieux, et arrivèrent à une sorte d’atelier que le Beige appelait son cabinet d’étude.
C’était une vaste pièce que l’on eût pu prendre, au premier abord, pour la boutique d’un marchand de curiosités. Les différents fournisseurs de M. Vankrof y déposaient les objets qui lui étaient proposés, et, avant d’en faire l’acquisition, le Belge les soumettait à un examen minutieux. On y voyait des tableaux dépouillés de leurs cadres, des poteries péruviennes, des guipures de Flandre, des collections minéralogiques et des tissus indiens. M. Vankrof en robe de chambre, au milieu de ce capharnaüm, allait d’un objet à l’autre, le faisant placer et déplacer, donnant des ordres de cet accent rude et haut habituel à ses compatriotes. C’était un homme de quarante ans, à large encolure, à tournure épaisse, dont les traits justifiaient, vu la grossièreté du dessin et la couleur, cette dénomination de bonhomme de pain d’épice donnée par Clotilde. Il vint d’un pas lourd au-devant des visiteurs qu’il salua familièrement.
—Ah! vous voilà! dit-il d’un ton brusque; j’en suis bien aise! vous me trouvez au milieu de mes travaux. Voyez-vous ces caisses?
—Quelques nouveaux objets d’art? demanda d’Alpoda.
—Non, répliqua le Belge, c’est un herbier renfermant toutes les mousses connues.
—Des mousses? Vous vous occupez donc aussi de botanique?
—Du tout; mais une collection unique, c’est toujours curieux. Avec ça que j’ai eu du bonheur! le voyageur qui l’avait faite vient de mourir, ce qui augmente la valeur de la chose. Mais vous préférez peut-être les coquillages?
—Je n’en suis pas sûr, dit d’Alpoda, en fait de conchyologie, mes études se sont à peu près bornées à celles que l’on peut faire au Rocher de Cancale.
—N’importe, regardez-moi ça, reprit Vankrof, en montrant deux magnifiques armoires vitrées, c’est un véritable écrin et qui ne m’a coûté presque rien, vu que le propriétaire avait besoin d’argent.
Dans ce moment un domestique se présenta avec une riche cassette de laque. Le Belge l’emmena à l’écart, lui fit quelques recommandations à voix basse, puis fouilla dans la poche de sa robe de chambre dont il tira plusieurs papiers parmi lesquels il sembla chercher en grommelant: Détails d’un bahut... ce n’est pas cela... Liste des toiles de l’Ecole flamande... pas encore cela... Mémoire de frais... au diable! Le portier du théâtre laissera entrer la personne... ah! c’est cela!... De Luxeuil qui examinait un médailler à quelques pas, retourna vivement la tête et, jetant un regard de côté sur le papier que tenait M. Vankrof, crut reconnaître l’allure novice d’une écriture d’autant facile à distinguer qu’il venait de la voir un instant auparavant: il se rapprocha sans affectation du Belge qui continuait à chercher, mais qui s’arrêta enfin.
—Ah! voici l’adresse, dit-il en s’adressant au domestique, mademoiselle Clotilde, rue Vivienne. Vous remettrez la cassette à elle-même... ou à sa mère.
—Faudra-t-il dire de quelle part? demanda le laquais.
—C’est inutile, je la verrai ce soir.
Le domestique sortit et M. Vankrof rejoignit de Cillart qui s’extasiait devant une panoplie placée à l’autre extrémité de la pièce. Mais Arthur avait tout entendu et ses soupçons étaient désormais une certitude! les yeux toujours fixés sur le médailler qu’il ne voyait plus, il mordait avec rage la pomme d’or de sa badine et cherchait le moyen de se venger. La voix de Dovrinski l’arracha à ses réflexions. Le prince polonais venait l’avertir que d’Alpoda et de Cillart avaient suivi M. Vankrof dans sa galerie de tableaux. Lorsqu’ils les rejoignirent, ce dernier était occupé à leur montrer des panneaux de bois sculpté qu’il venait de faire achever.
—Vous voyez, disait-il de sa voix de marchand forain, c’est un chef-d’œuvre! eh bien, ça ne m’a coûté presque rien. L’ouvrier est un pauvre diable qui mourait de faim. Il est venu me demander de l’employer à ce que je voudrais, et je l’ai pris à la journée.
—Mais c’est un grand artiste! s’écria de Cillart, qui ne pouvait se lasser d’admirer l’entrelacement de feuilles, de fruits et de fleurs qui encadrait les panneaux.
—Certainement, répliqua Vankrof avec un gros rire: si on démontait les panneaux ça se vendrait un prix fou! Aussi quand lord Fawley est venu ici, il a voulu connaître le sculpteur; mais pas si simple! Une fois en vogue, le drôle refuserait de travailler au même prix! Je ne veux pas qu’on me le gâte... avant qu’il ait fini mes panneaux.
D’Alpoda et de Cillart trouvèrent la précaution prudente, et l’on continua la revue des richesses artistiques entassées dans l’hôtel de Vankrof. Celui-ci avait pour chaque tableau une anecdote relative non à la peinture ou à l’artiste, mais au marché qui l’en avait rendu propriétaire. Pour lui, sa collection n’était qu’un placement de fonds, sa manie artistique, une application détournée de l’instinct commercial. Ce qu’il aimait n’était point l’œuvre, mais l’acquisition: il se réjouissait moins de sa perfection que de la médiocrité de son prix: il se glorifiait d’avoir tout acheté pour rien, c’est-à-dire d’avoir volé l’art ou l’artiste; le goût de l’amateur servait de prétexte au calcul du marchand. Après avoir tout montré aux visiteurs, avec cet empressement qui sent moins la complaisance que la vanité, il arriva enfin à un petit salon exclusivement consacré à ces galants peintres de marquises et de bergères longtemps méprisés, mais dont la grâce chatoyante survivra à tous les ponsifs académiques de notre école pédantesque. Un Vatteau achevait cette collection coquette, minaudière et charmante. En l’apercevant, de Cillart se tourna vers Arthur.
—Pardieu! voilà le pendant que vous cherchiez pour votre jolie toile de votre bibliothèque d’été.
—Ça, Messieurs, reprit Vankrof d’un air triomphant, c’est mon chef-d’œuvre.
—C’est-à-dire celui de Vatteau, fit observer d’Alpoda.
—Non, le mien, reprit le Belge avec chaleur. Je ne l’ai payé presque rien; mais vous ne vous doutez pas de tout ce que je me suis donné de peines!... D’abord j’avais été averti trop tard, et il était passé aux mains d’un marchand de tableaux... vous savez rue Saint-Germain-l’Auxerrois.
—En effet, fit de Luxeuil, je me rappelle l’avoir vu et marchandé.
—Et l’on en voulait un prix fou, n’est-ce pas? mais j’ai là-dessus des principes; jamais je ne discute avec un marchand; ce serait lui prouver que je désire sa marchandise. J’ai laissé celui-ci vanter son tableau; seulement je lui envoyais tous les jours quelqu’un qui découvrait un défaut, qui mettait en doute l’authenticité. Au bout d’une semaine le malheureux n’était plus sûr d’avoir un original; au bout d’un mois il était convaincu qu’il n’avait qu’une copie.
—Et c’est alors que vous avez acheté?
—C’est-à-dire que j’ai fait proposer un prix, puis un second, puis un troisième; enfin j’allais avoir la toile quand un amateur arrive, surenchérit et conclut le marché.
—Ah! diable!
—A ma place vous auriez cru tout perdu, n’est-ce pas, dit Vankrof de sa plus grosse voix; mais nous autres Belges, nous ne nous laissons point décourager ainsi. L’amateur n’avait point donné d’arrhes, j’ai détaché au marchand quelqu’un d’adroit qui l’a averti que son acheteur était un homme ruiné, insolvable.
—Qui vous l’avait dit?...
—Personne. Mais cela a effrayé le brocanteur; là-dessus je suis arrivé avec de l’argent comptant et il m’a livré la toile... ah! ah! ah! comment trouvez-vous le moyen?
—Parfait pour vous, dit d’Alpoda, mais le mystifié eût pu se fâcher.
—Bah! nous ne nous sommes jamais vus, répliqua le Belge, et mon marchand a promis le secret.
Depuis quelques instants de Luxeuil était devenu singulièrement attentif, et à ces derniers mots un éclair traversa son regard.
—Ainsi, vous ne connaissez point le concurrent que vous avez si habilement écarté, Monsieur? demanda-t-il.
—Pas même de nom! répliqua Vankrof, et comme il y a déjà trois mois que le tour lui a été joué, je conclus qu’il ne viendra pas m’en demander raison.
—Vous vous trompez, s’écria Arthur, il est venu; car le mystifié, c’est moi!
Ce fut un véritable coup de théâtre. De Luxeuil tenait sous son regard hautain le Belge stupéfait, tandis que de Cillart, d’Alpoda et Dovrinski se jetaient un coup d’œil embarrassé.
—Comment! reprit Vankrof, après un moment de silence, c’est vous, monsieur de Luxeuil...
—Cet homme ruiné, insolvable, qui a manqué le Vatteau faille d’arrhes, oui, Monsieur. Je suis désolé de n’avoir point su plutôt ce que ma réputation vous devait; mais je tiens à vous prouver que je puis encore au moins payer certaines dettes.
Vankrof parut déconcerté.
—Monsieur, j’ai vraiment regret, dit-il avec quelque hésitation, si j’avais su, si j’avais pu prévoir...
—Mon Dieu! il me semble que tout ceci est un malentendu, fit observer de Cillart en s’entremettant. Il suffit que M. Vankrof rétracte sa plaisanterie.
—Très-volontiers, reprit le Belge, qui, sans être poltron, n’avait nulle envie de donner suite à cette affaire.
—Et cette rétractation changera-t-elle quelque chose au tort que Monsieur a pu me faire? reprit vivement de Luxeuil; m’ôtera-t-elle l’humiliation d’avoir été joué? me rendra-t-elle enfin le tableau que j’avais acheté le premier?
—M. Vankrof consentirait peut-être à vous le céder, hasarda de Cillart en regardant le Belge.
Mais le visage de celui-ci se rembrunit.
—Ça, c’est impossible, s’écria-t-il; il est indispensable à ma collection... puis ce serait une perte...
—N’en parlons plus, reprit rapidement de Luxeuil: toute explication nouvelle serait inutile... Aujourd’hui même M. Vankrof recevra la visite de deux de mes amis.
A ces mots il salua cavalièrement le Belge, qui rendit le salut avec une solennité gourmée et se retira.
Ainsi que nous l’avons dit, Vankrof n’était point un lâche, mais sa nature n’avait rien de militaire. Capable d’un acte de courage civil, il avait toujours eu une invincible répugnance pour les armes; puis c’était avant tout un homme de calcul, et le calcul lui annonçait dans cette occasion trop peu de chances favorables pour qu’il se résignât volontiers à les courir. Il avait entendu parler de l’adresse d’Arthur; il se voyait à sa merci, à peu près sûr de succomber, et cette persuasion assombrissait singulièrement ses réflexions. Il cherchait en lui-même le moyen d’arriver à une transaction sans avoir l’air de faiblir, lorsqu’on lui annonça Marquier. Le banquier, qui lui avait envoyé dès le matin un billet avec le laissez-passer de l’actrice, s’attendait à le trouver dans la joie de son prochain triomphe; il demeura tout saisi de son air soucieux. Mais ce fut bien autre chose lorsqu’après lui avoir raconté ce qui venait de se passer, le Belge déclara qu’il l’avait choisi pour témoin. Bien que l’état embarrassé des affaires d’Arthur eût singulièrement refroidi l’amitié du banquier, qui se prétendait compromis pour des sommes considérables, il avait toujours prudemment évité de rompre avec lui, et leur liaison était restée, en apparence, aussi intime. Or, en s’interposant dans le débat qui allait avoir lieu, il craignait que quelque explication n’amenât la découverte de ses dernières démarches près de Clotilde. Sa position, déjà fausse, pouvait devenir dangereuse si l’on en venait à des éclaircissements. Aussi son premier cri fut-il que ce duel ne pouvait avoir lieu: Vankrof objecta la provocation d’Arthur.
—C’est une folie, dit le banquier avec agitation; se couper la gorge pour une peinture!
—Il le faut, dit le Belge en pliant les épaules.
—Non, c’est impossible! reprit Marquier que la peur exaltait; le duel n’est plus dans nos mœurs, tous les hommes avancés le regardent comme un reste de barbarie auquel on doit avoir le courage de se soustraire.
Le millionnaire secoua la tête.
—Songez enfin à ma position, mon cher monsieur Vankrof, continua le petit homme; vous savez si je vous suis dévoué; j’ai chez moi une partie de vos fonds! mais d’un autre côté de Luxeuil est mon débiteur; s’il lui arrive malheur, ma créance est perdue, vous me tuez quatre-vingt mille francs! Je suis donc obligé, dans l’intérêt de mes affaires, de faire des vœux pour lui et contre vous!... C’est horrible, parole d’honneur, horrible, monsieur Vankrof; vous ne voudrez point me placer dans une pareille alternative!
—Mais comment y échapper? demanda le Belge pensif.
—Je n’en sais rien, reprit Marquier en parcourant la chambre; mais il faut tout employer, forcer de Luxeuil à partir... le faire enlever comme dans le Chevalier de Saint-Georges!... Ah! quel dommage que nous n’ayons plus la Bastille... c’était si commode pour...
Il s’arrêta brusquement.
—Mais nous l’avons toujours! s’écria-t-il avec un élan subit: seulement elle a changé de quartier.
—Comment?
—On l’a transportée rue de la Clef.
—Quoi! Sainte-Pélagie...
—Est maintenant notre Bastille, et il dépend de vous d’y envoyer votre adversaire.
—Mais il n’est point mon débiteur.
—Il est le mien.
—En vérité!
—Soixante mille francs de billets souscrits et que j’ai passés à l’ordre d’un certain Duroc pour pouvoir exercer les poursuites. Il y a eu protêt, jugement; tout est en règle; on peut faire arrêter de Luxeuil aujourd’hui même. Quelques jours de captivité le calmeront, et tout s’arrangera.
—Ce serait en effet un moyen, dit Vankrof; mais si l’on savait que la chose vient de moi?...
—Ne craignez donc rien: Duroc est sûr; il prendra tout sur lui; vous ne paraîtrez en rien.
—Vous êtes certain?
—Je vous y engage ma parole.
—Alors... je ne vois point d’obstacle... et l’on pourrait voir...
—Je me charge de tout! interrompit Marquier en reprenant son chapeau; je vais passer chez Duroc pour l’avertir que vous achetez les billets?
—Ah! c’est-à-dire que vous me les vendez! fit observer le Belge.
—Pour que vous traitiez de Luxeuil en débiteur, il faut bien que vous soyez créancier?... Du reste vous ne perdrez rien... il doit hériter de sa mère; puis sa femme est riche; c’est simplement une affaire de temps, et que vous importe à vous d’être payé un peu plus tôt, un peu plus tard? Songez, d’ailleurs, que c’est le seul moyen d’éviter un désastre; car vous savez sans doute que votre adversaire a la main singulièrement malheureuse...
Vankrof fit un geste affirmatif.
—Alors c’est convenu! vous m’autorisez à traiter. Avant deux heures je viendrai vous avertir du succès de notre expédition.
Cependant, malgré sa promesse, Marquier ne revint que le soir. Une partie de la journée avait été perdue en démarches inutiles; enfin, Arthur avait été arrêté au moment où il sortait de son hôtel. Vankrof, rassuré, fit atteler pour se rendre à la loge de Clotilde avec le banquier ravi d’avoir empêché le duel et d’être rentré dans les fonds prêtés à de Luxeuil. Presqu’au même instant Marc, à qui la mère Beauclerc avait remis la dénonciation de Vorel, montait dans la diligence de Bayeux pour avertir Honorine du danger qui la menaçait.
La diligence dans laquelle se trouvait Marc venait de s’arrêter à Tiberville pour un relais. Mais les chevaux ne se trouvèrent point prêts, et, au grand mécontentement du conducteur, il fallut se résigner à attendre. L’inexactitude du maître de poste se trouvait, du reste, suffisamment expliquée, sinon justifiée, par le tumulte joyeux qui régnait partout; on était au 30 juillet, et la population tibervillaise célébrait, à grand renfort de lampions et de fusées, le souvenir de notre dernière révolution.
A Paris, où tout s’use vite et où l’ironie marche à la suite des triomphes, comme l’ombre après le corps, on rit déjà de ces grandes journées ridiculisées dans le jargon d’atelier sous le nom des trois glorieuses. Paris a splendidement enterré ses morts; il leur a élevé une colonne de bronze, il les a chantés sur toutes les cordes de sa lyre d’or; que lui demander davantage? L’apothéose finie, il faut bien en revenir au pont-neuf. Le temple est debout, les dieux reconnus: continuer à les adorer serait monotone; on les plaisante par amour pour la variété. Les Juifs crucifiaient un homme et le ressuscitaient Dieu; mais Paris est trop spirituel pour ne point perfectionner le procédé; il commence par déifier, puis il crucifie!
La province, moins prompte dans ses enthousiasmes, y persévère plus longtemps. Quels que soient les mécomptes qui aient suivi notre dernier élan populaire, le titre de héros de Juillet n’est point encore devenu ridicule à ses yeux. Elle n’a point parodié le chant national répété le lendemain de la victoire par des bouches encore noires de poudre, et au milieu des barricades arrosées d’un sang généreux. Elle a gardé sérieusement tous les souvenirs de ces miraculeux efforts, et leur anniversaire est toujours une fête nationale. Tiberville se trouvait donc monté, ce jour-là, au plus haut ton de l’exaltation patriotique. La Parisienne et la Marseillaise retentissaient de toutes parts, mêlées aux chansons militaires de l’Empire; car le peuple ne peut célébrer aucune gloire nationale sans évoquer l’héroïque image de l’homme au petit chapeau et à la redingote grise!
Un feu de joie, préparé sur la place principale, était entouré d’une foule bruyante poussant des cris d’appel. Quelques gendarmes en grand uniforme et à mine officiellement impassible se montraient de loin en loin pour maintenir l’enthousiasme dans la limite de l’arrêté municipal, tandis que les officiers de la garde nationale causaient à la porte de la mairie avec les autorités en écharpe tricolore. Or, au moment où la joie générale se trouvait portée au plus haut point de turbulence, une chaise de poste parut à l’extrémité de la place, qu’elle traversa aussi rapidement que le lui permettait la foule, et vint s’arrêter à côté de la diligence. Les chevaux furent dételés sans pouvoir être remplacés, de sorte que les deux voitures demeurèrent, l’une à côté de l’autre, immobiles et sans attelages. Les voyageurs de la chaise de poste ne s’aperçurent probablement point sur-le-champ du contre-temps qui menaçait de les retenir à Tiberville, car les stores restèrent levés jusqu’au moment où le vieux domestique, qui occupait le siége et qui était entré à la maison de poste, se présenta à l’une des portières. Il avertit sans doute ses maîtres de l’impossibilité de continuer, car deux exclamations de désappointement se firent entendre.
—Mais c’est affreux! s’écria une voix de femme. Dites qu’on cherche des chevaux, Picard, qu’on s’en procure par quelque moyen que ce soit.
—Proposez de payer un supplément, ajouta une voix d’homme.
—J’y ai déjà pensé, répliqua Picard; mais les écuries sont vides, et la diligence est là qui attend comme nous.
—De grâce, voyez ce que l’on peut faire, reprit la comtesse de Luxeuil (car c’était elle); pour rien au monde je ne voudrais rester ici au milieu de ce peuple, dont les cris me font peur.
Celui auquel s’adressait cette prière se leva avec un peu de répugnance et se présenta à la portière pour descendre; mais, au moment où il avançait la tête afin de chercher du regard le marchepied, la lueur des lanternes éclaira ses traits, et Marc, qui se trouvait appuyé à l’une des glaces de la diligence, reconnut M. de Chanteaux! Il ouvrit vivement la portière et le rejoignit à l’hôtellerie. Le marquis se faisait confirmer par le maître de poste lui-même les renseignements que lui avait donnés Picard.
—Et faudra-t-il attendre longtemps? demandait-il.
—Il est impossible de rien promettre à Monsieur, répliquait l’hôtelier; nos premiers chevaux seront pour la diligence.
—C’est-à-dire que je puis être retenu toute la nuit? Mais c’est une chose horrible! Comment se fait-il que vous manquiez de chevaux?
—Par la raison que j’en ai perdu huit depuis un mois, répliqua le maître de poste.
—Il fallait les remplacer! s’écria M. de Chanteaux.
—Pour les perdre comme les autres, reprit l’aubergiste: ce serait travailler moi-même à ma ruine.
—Et qu’importe aux voyageurs votre ruine, mon cher, fit observer le marquis avec cette dureté familière qui est le privilége des gens bien nés; vous n’êtes point maître de poste pour devenir millionnaire, mais pour nous fournir des chevaux; et pour en fournir il faut en avoir.
—Mais pour en avoir il faut qu’ils vivent, ajouta le maître de poste, et la maladie est dans le pays.
Le marquis haussa les épaules.
—Allons, dit-il, nous voilà tombés même à la merci des loueurs d’attelage. J’arrive d’Angleterre, Monsieur, et nous avons toujours fait quatre lieues à l’heure, sans accidents, sans attentes.
—Il fallait y rester, dit brusquement le maître de poste, choqué du ton de M. de Chanteaux et surtout de sa prédilection anglaise; quand on se trouve mieux de l’autre côté de la mer que dans son pays, c’est qu’on a, sans doute, ses raisons.
L’expression donnée à ces derniers mots était si claire qu’elle renfermait, pour ainsi dire, tout un jugement sur la personne et les opinions politiques du marquis; le maître de poste avait évidemment deviné l’ancien émigré saisissant toutes les occasions de vanter l’étranger aux dépens de la France. Le costume, la tournure et le visage de M. de Chanteaux ne permettaient, du reste, à cet égard aucun doute. C’était le type complet du ci-devant sorti de ces quarante années d’épreuves sans avoir rien appris ni rien oublié. Quoi qu’il en fût, la remarque parut faire quelque impression sur le marquis; une légère nuance d’inquiétude assombrit ses traits, et son ton changea subitement.
—Ah! j’étais bien sûr de piquer votre amour-propre national, dit-il au maître de poste en souriant; maintenant vous tiendrez à me prouver, j’espère, que les relais de France valent ceux de la Grande-Bretagne. Je ne demande pas mieux que d’être persuadé; je ne voudrais point seulement que la dame qui m’accompagne attendît vos chevaux dans la chaise de poste; pouvez-vous lui faire préparer une chambre?
L’hôtelier, adouci par cette demande, répondit affirmativement et rentra afin de donner les ordres nécessaires. Le marquis se retourna pour rejoindre madame de Luxeuil, et se trouva en face de Marc, qui était demeuré debout derrière lui. Il fit un geste de surprise.
—Que voulez-vous? demanda-t-il avec hauteur.
—Monsieur Content ne me reconnaît pas? dit Marc.
A cet ancien nom de guerre, le marquis tressaillit.
—D’où savez-vous?... reprit-il vivement.
Puis il s’interrompit, regarda le garçon de bureau avec plus d’attention, et s’écria:
—C’est le Rageur!
—Voilà longtemps que je vous attendais, reprit celui-ci à demi-voix; mais on m’avait dit que vous étiez en Allemagne.
—J’y ai passé quelques mois...
—Et vous êtes revenu par l’Angleterre?
—Oui, mais pourquoi ces questions? Que me voulez-vous?
Marc regarda le marquis fixement.
—Il y a quinze ans, dit-il avec amertume, que j’eus l’honneur de me présenter à M. de Chanteaux pour le prier de me venir en aide. Je subissais alors les conséquences d’une condamnation qui m’avait ôté le droit de choisir le lieu de mon séjour; je suppliai mon ancien commandant d’intercéder pour moi, d’obtenir que ma présence à Paris, jusqu’alors ignorée de la police, fût tolérée...
—Eh bien? interrompit le marquis.
—Eh bien! au lieu de le faire, continua Marc, il abusa de ma confiance pour me dénoncer et provoquer mon arrestation.
M. de Chanteaux parut troublé.
—Je ne sais ce que vous voulez dire, mon cher, reprit-il d’un ton hautain; quel intérêt pouvais-je avoir à vous nuire?...
—L’intérêt qu’on a toujours à se débarrasser d’un complice, répliqua Marc à voix basse; M. le marquis n’avait point oublié l’argent pillé par son ordre pour le service de la cause royaliste, et dont il a seul profité; il se rappelait aussi sans doute ce maire misérablement assassiné...
—Tais-toi, malheureux! interrompit M. de Chanteaux effrayé; pourquoi viens-tu rappeler ces souvenirs?
—Pour prouver à M. le marquis qu’on pourrait les rappeler à d’autres, répliqua le garçon de bureau avec intention.
L’ancien chef de chouans regarda si personne n’avait pu les entendre, puis entraîna Marc à l’écart.
—C’est une menace que tu viens me faire, dit-il, un moyen d’appuyer quelque demande?
Marc fit un signe affirmatif.
—Et que veux-tu, reprit précipitamment le marquis, en portant la main à la poche de son paletot de voyage, de l’argent, sans doute?
—Non, répliqua Marc.
—Quoi donc, alors?
—La liberté du duc de Saint-Alofe.
M. de Chanteaux fit un pas en arrière.
—D’où le connais-tu, s’écria-t-il, et quel intérêt peux-tu prendre...
—Ce serait une explication inutile, monsieur le marquis, interrompit le garçon de bureau; accordez-moi seulement ce que je vous demande.
—Vous n’y pensez pas, mon cher: le duc est enfermé en vertu d’un jugement...
—Que vous avez provoqué dans le but d’extorquer sa fortune; oh! je connais la vérité, monsieur le marquis, et vous essayeriez vainement de me donner le change; mais j’ai promis de tout faire pour la délivrance du duc, et vous ne me la refuserez pas.
—Et si je vous la refuse? demanda M. de Chanteaux ironiquement.
—Alors, moi je parlerai, et ce que je vous répétais tout à l’heure tout bas, je le répèterai tout haut.
—On ne te croira pas.
—Peut-être.
—Si tu oses parler d’ailleurs, les tribunaux te condamneront comme calomniateur.
—Les tribunaux, c’est possible; mais la foule saura que j’ai dit la vérité.
—Que m’importe la foule?
—Ah! ne dites pas cela, monsieur le marquis, reprit Marc vivement, car elle est là qui peut m’entendre: qui sait ce qu’elle ferait si j’allais lui crier: Cet homme, qui passe en chaise de poste, est le chef des bandes qui ont désolé le Maine et la Normandie; il a pillé des villages, brûlé des femmes sous leurs toits, massacré les enfants qui ne criaient pas assez tôt: Vive le roi! Il y a peut-être là les fils de quelques patriotes autrefois égorgés par ceux qui portaient votre cocarde. Êtes-vous sûr que le désir de la vengeance ne se réveillera pas dans ces cœurs? Il ne faut pas tenter la patience de ceux qui ont souffert, quand ils sont devenus les plus forts. Le lieu et l’heure ne vous sont point favorables, écoutez plutôt!
Une longue clameur venait d’éclater dans la foule à l’aspect du feu de joie dont les flammes commençaient à s’élever, les cris de: Vive la Charte! se mêlaient au chant de la Marseillaise, interrompu par les coups de feu et les fusées. M. de Chanteaux fut, malgré lui, saisi. Il tourna un regard inquiet vers cette multitude dont les mille têtes flottaient dans la nuit comme des vagues sombres, puis sur sa chaise de poste immobile; il se sentit mal à l’aise. Cependant il affecta de sourire.
—Tu ne feras point cela, dit-il avec une tranquillité dédaigneuse.
—Pourquoi? demanda Marc.
—Parce qu’en excitant la violence contre un voyageur inoffensif, tu t’exposerais à une responsabilité trop dangereuse.
—Qui sait, dit Marc en regardant fixement le marquis, si ce voyageur n’est point aujourd’hui ce qu’il était autrefois, et si son séjour en Angleterre et en Allemagne n’avait point un but... qu’il désire cacher.
Cette insinuation avait été hasardée par l’ancien chouan, moins comme une probabilité que comme une épreuve, mais le coup porta juste et profondément, car M. de Chanteaux releva la tête en pâlissant. Ce fut pour Marc un trait de lumière. Il se rapprocha vivement.
—Ne niez point, monsieur le marquis, continua-t-il plus bas et d’un accent précipité; je suis au fait de tout; vous venez de remplir une mission près des princes déchus, et, si l’on cherchait bien, on pourrait en trouver la preuve.
—Ah! vous changez votre plan de bataille, dit M. de Chanteaux en s’efforçant de cacher son inquiétude sous un air d’ironie; vous espérez être plus heureux par ce nouveau moyen d’intimidation...
—Je n’ai qu’un mot à vous dire, reprit Marc, dont l’assurance croissait à mesure que le trouble du marquis devenait plus visible; je puis vous faire arrêter à l’instant même.
—Et de quel droit?
—Par un droit que vous m’avez forcé de prendre, continua l’ancien chouan amèrement; car ce que vous aviez refusé de solliciter en ma faveur, je l’ai obtenu aux dépens d’un reste d’honneur. La police me défendait d’habiter Paris; pour qu’elle me le permît, je me suis mis à ses gages.
—Vous!
—Et aujourd’hui je n’ai qu’à parler pour empêcher votre chaise de poste de continuer sa route. Voyez donc ce que vous devez faire dans l’intérêt de votre parti, de votre sûreté. Je vous demande peu de chose: la liberté d’un vieillard dont la fortune vous restera, puisqu’un arrêt des juges vous l’a livrée. Si vous me l’accordez, vous pourrez continuer jusqu’à Paris sans péril; si vous refusez, vous savez quelles peuvent être les suites de votre arrestation.
Tout en parlant, les deux interlocuteurs étaient arrivés près de la chaise de poste, et la comtesse, penchée à la portière, avait entendu la fin de leur conversation. La menace de Marc lui glaça le cœur. Une arrestation entraînait infailliblement leur perte, car elle devait fournir toutes les preuves du complot dont elle avait aidé le marquis à devenir le promoteur et l’agent. Epouvantée d’un tel péril, elle appela vivement son compagnon et il y eut entre eux, à voix basse, une explication précipitée. Il était évident que madame de Luxeuil pressait le marquis de céder et que celui-ci opposait quelque résistance; mais enfin il parut céder, se retourna vers Marc et lui fit signe d’approcher.
—Remerciez madame de Luxeuil de craindre un éclat que j’aurais bravé pour ma part, dit-il avec une contrariété mal déguisée; je cède à ses sollicitations et non à vos menaces.
—Soit, monsieur le marquis, répliqua Marc; peu importe la cause, pourvu que je sache où trouver le duc.
—Tout près d’ici, à Brionne, interrompit rapidement la comtesse, demandez la maison de santé de Bel-Air.
—Mais comment obtiendrai-je l’élargissement de M. de Saint-Alofe?
—Sur la remise d’un billet écrit par le marquis.
—Pardon, je craindrais des difficultés imprévues. Brionne est à quelques lieues et sur votre chemin, un léger détour permettrait à M. le marquis de lever lui-même tous les obstacles.
—C’est-à-dire que vous vous défiez?...
—Nullement, madame la comtesse, mais je prévois.
—Et comment pourrez-vous nous suivre?
—M. Picard ne me refusera point la moitié de son siége.
Pendant cet échange d’objections et de répliques, le marquis avait réfléchi.
—Nous passerons à Brionne, reprit-il brusquement; c’est le plus sûr moyen d’en finir. Voici heureusement les chevaux.
Marc courut chercher son manteau, revint prendre place près du valet, et quelques minutes après la diligence et la chaise de poste partirent en sens inverse, emportées au galop. Quelque pressé que fût l’ancien chouan d’arriver près d’Honorine, la rencontre du marquis avait été pour lui une bonne fortune qu’il n’avait pu laisser échapper. Il ignorait encore jusqu’à quel point la délivrance du duc de Saint-Alofe servirait ses projets; mais il se réjouissait de pouvoir annoncer à Honorine cette délivrance lorsqu’il arriverait aux Motteux. Il pensait au bonheur du vieillard en se retrouvant libre, aux chances de réhabilitation que pourrait lui présenter l’avenir. Il éprouvait enfin cette satisfaction vivifiante que donne le devoir courageusement accompli. Enveloppé dans son manteau et bercé par le mouvement de la chaise de poste, il passa insensiblement de la méditation à la rêverie et de la rêverie à ce demi-sommeil pendant lequel les objets extérieurs ne frappent nos sens que comme des images fugitives.
Au dedans de la chaise de poste tout paraissait également immobile et silencieux; mais sous cette apparence de calme se cachait l’agitation. La comtesse et M. de Chanteaux continuaient à causer vivement à voix basse, comme s’ils eussent mis en délibération quelque résolution importante; ce fut seulement près d’arriver que tous deux semblèrent tomber d’accord. La chaise de poste venait de prendre une avenue conduisant à la maison de santé de Bel-Air tenue par M. Lefort. Malgré l’heure avancée, plusieurs fenêtres étaient éclairées et l’on voyait passer des ombres sur les rideaux fermés. La voiture s’arrêta sous un mur de clôture très-élevé et devant une petite porte percée d’un guichet. Picard sonna. Un homme parut avec une lanterne à l’ouverture grillée, demanda le nom des visiteurs, puis, sur la réponse du marquis et de la comtesse qui venaient de descendre, il tira plusieurs verrous et les laissa entrer avec Marc. Tous trois traversèrent, à sa suite, une cour garnie de quelques massifs d’arbres verts, montèrent un perron de vingt marches et arrivèrent à un rez-de-chaussée dont la première pièce formait vestibule. On les introduisit enfin dans un salon assez mal meublé où leur introducteur les pria d’attendre, en annonçant que M. Lefort était occupé. Mais le marquis l’interrompit.
—Nous avons hâte de repartir, dit-il rapidement, et je viens seulement pour reprendre un de nos pensionnaires; veuillez me conduire à M. Lefort, je lui expliquerai tout en deux mots.
Le valet y consentit, et Marc resta seul avec la comtesse. Celle-ci, debout devant la glace, s’occupa d’abord, par habitude, à redresser une coiffure qui ne cachait plus ses rides, puis promena les yeux autour d’elle. L’immense salon était à peine éclairé par les deux bougies que le domestique y avait allumées, et son meuble de calicot rouge, bordé d’une grecque jaune, lui donnait je ne sais quel éclat dur et faux qui blessait le regard. Le carrelage de briques soigneusement encaustiquées avait fléchi dans certaines parties et formait des espèces d’ondulations rigides que le brillant de la cire rendait plus apparentes. Des gravures anglaises représentant la personnification des douze mois, tachaient de loin en loin la tapisserie d’un jaune sale, et la cheminée était décorée d’un groupe mythologique porté sur un char dont la roue servait de cadran à une pendule. Enfin, quelques fauteuils de merisier rouge, et une vieille bergère garnie de sa housse, meublaient, tant bien que mal, cette immense pièce qui n’avait qu’une seule porte. Madame de Luxeuil fut sans doute impressionnée de l’arrangement délabré qui donnait à ce salon l’air plus pauvre et plus triste qu’il ne l’était en réalité; car, au lieu de s’asseoir, elle se mit à le parcourir avec une visible impatience, et en tournant à chaque instant les yeux vers la porte, comme si elle eût accusé le marquis de lenteur. Enfin, un bruit de voix se fit entendre, et ce dernier parut avec le propriétaire de la maison de santé.
M. Lefort n’avait pas toujours exercé l’industrie à laquelle il se livrait alors. Nommé sous-préfet vers la fin de l’Empire, il avait successivement rempli, plus tard, les fonctions de rédacteur-responsable, de correspondant pour une agence de remplacement militaire, d’inspecteur des travaux dans une ferme modèle fondée par souscription. Enfin, un mariage l’avait rendu propriétaire de cette maison de Bel-Air, primitivement destinée aux traitements orthopédiques, et qu’il avait transformée en maison de santé. Un médecin de Brionne soignait les malades, tandis qu’il veillait à la direction générale. M. Lefort était un homme entreprenant, trouvant tout facile, par ignorance ou faute de scrupule, et qui, malgré vingt entreprises destinées à le rendre millionnaire, n’avait pu réussir encore à vivre sans créanciers. Il s’avança vivement vers madame de Luxeuil et se confondit en excuses de l’avoir fait attendre.
—Je commençais, en effet, à m’inquiéter du retard de monsieur le marquis, dit la comtesse; d’autant plus que nous sommes attendus à Paris.
—Ainsi, je ne puis espérer que madame la comtesse accepte pour quelques heures notre humble hospitalité? dit M. Lefort le corps incliné; je suis véritablement désespéré!... j’aurais été si heureux de prouver à Madame la comtesse mon respectueux dévouement.
—Mille grâces, c’est impossible, interrompit madame de Luxeuil rapidement; M. de Chanteaux vous a sans doute dit qu’il venait reprendre le duc?
—Oui, mais il ne m’a pas parlé...
—De Monsieur, interrompit le marquis en désignant Marc; c’est à sa prière que je suis venu.
M. Lefort toisa l’ancien chouan.
—Ah! fort bien, dit-il; monsieur est un serviteur dévoué du duc.
Marc fit un signe affirmatif.
—Et il ne craint pas que M. de Saint-Alofe n’abuse de la liberté qui lui sera rendue?
—Plût à Dieu que tous les hommes pussent en faire un aussi bon usage! dit Mare.
L’ancien sous-préfet le regarda plus fixement...
—C’est-à-dire que monsieur ne croit pas à la folie du duc, reprit-il; fort bien; je conçois; alors il persiste à vouloir l’emmener.
—Je suis venu ici dans ce but, reprit Marc un peu étonné du ton de M. Lefort, et je ne me retirerai qu’avec M. de Saint-Alofe.
Le propriétaire de la maison de santé remua la tête d’un air réfléchi.
—Dans ce cas, reprit-il lentement, monsieur va avoir la bonté de me suivre jusqu’au dortoir des hommes; Monsieur le marquis et Madame la comtesse voudront bien m’excuser.
—Nous vous attendons, répliqua M. de Chanteaux.
M. Lefort salua deux fols, fit un signe à Marc, et tous deux quittèrent le salon.
L’ancien chouan et son conducteur montèrent d’abord un escalier, prirent un long corridor et arrivèrent vis-à-vis d’une porte à guichet, comme toutes les autres. M. Lefort appuya sur un bouton caché dans l’une des moulures, et il invita par un geste Marc à entrer. Celui-ci passa en s’excusant, mais à peine eut-il fait un pas que la porte se referma sourdement derrière lui.
Il se retourna étonné, et aperçut M. Lefort au guichet.
—Que faites-vous, Monsieur? s’écria-t-il.
—Je prends mes précautions, répondit Lefort qui poussait un nouveau verrou.
—Cela signifie, mon cher ami, que M. le marquis m’a heureusement averti de ne pas me fier à la mine, vu que votre folie tournait subitement à la fureur.
Marc devint pâle.
—Ah! c’est un piége horrible! s’écria-t-il; le marquis est un infâme!...
—Nous y voilà! murmura M. Lefort toujours la main sur le verrou.
—Ouvrez, reprit Marc en se précipitant contre la porte; vous n’avez aucun droit de me retenir contre ma volonté, Monsieur; ouvrez, je le veux!
M. Lefort fit un mouvement pour se retirer; Marc comprit que s’il le laissait partir tout était perdu.
—Au nom de Dieu, écoutez-moi! reprit-il en cherchant à maîtriser son indignation; on vous a trompé, Monsieur; parlez-moi, interrogez-moi; je suis prêt à vous prouver que je jouis de toute ma raison.
—Pourquoi êtes-vous venu à Bel-Air?
—Je vous l’ai déjà dit, pour obtenir la liberté du duc.
—Que vous regardez comme un sage?
—Comme un martyr.
—Indignement persécuté par son cousin?...
—Qui aura un jour à rendre compte de ses odieuses manœuvres!
—C’est bien ce que m’avait annoncé M. de Chanteaux, murmura-t-il; ils se ressemblent tous! quand ils ne sont pas rois, ils sont poursuivis par des ennemis!... toujours la vanité ou la peur.
Il haussa encore les épaules et fit un pas pour se retirer.
—Ah! vous ne croyez point au mensonge du marquis, s’écria Marc; vous ne pouvez y croire; si vous le feignez, c’est que vous êtes son complice! mais prenez garde à ce que vous allez faire, Monsieur; tôt ou tard la vérité sera connue, et alors je demanderai justice...
M. Lefort avait quitté le corridor et ne pouvait plus l’entendre. Marc saisit les barreaux du guichet en s’efforçant d’ébranler la porte; elle resta immobile et comme scellée à sa place. Il poussa un cri en portant à son front ses deux poings fermés; toutes ses précautions avaient été inutiles, le marquis l’emportait, il était enfermé!
Au premier instant, un nuage de colère sembla obscurcir son esprit; mais ce ne fut qu’un court égarement. Ramené à la possession de sa volonté par la grandeur même du danger, il regarda autour de lui. Les deux fenêtres qui éclairaient la pièce où il se trouvait avaient été aux deux tiers murées, et le dernier tiers était garni d’une grille de fer qui ôtait jusqu’à la pensée de chercher par là une issue. Autant que lui permit de juger la lueur stellaire qui glissait à travers les grillages, la pièce n’avait point d’autre porte que celle par laquelle il venait d’entrer. Cependant, il se mit à marcher à tâtons, en suivant les murs matelassés, et finit par rencontrer une saillie ronde et mobile qui sembla fuir sous sa main: c’était un tour destiné à passer au prisonnier la nourriture. En le faisant rouler sur son axe, Marc aperçut, par une ouverture ménagée à dessein, un second corridor éclairé et conduisant à des cellules numérotées. Il cherchait le moyen d’utiliser sa découverte, lorsqu’un bruit de voix se fit entendre de l’autre côté.
C’était d’abord celle de M. Lefort parlant vivement, selon son habitude, puis la voix ferme et calme du duc qui paraissait demander une explication refusée. Bientôt l’ancien sous-préfet sortit d’une des cellules en répétant au vieillard que la voiture du marquis l’attendait. Il passa près du tour et descendit précipitamment l’escalier.
Marc n’en pouvait plus douter, non content de le retenir prisonnier, on enlevait le duc, afin d’éviter leur rapprochement. Alors même que sa prison lui serait ouverte le lendemain, la possibilité de délivrer ce dernier lui était enlevée, car il ignorerait sa nouvelle retraite et il ne lui resterait aucun moyen de la découvrir. L’avantage que le hasard avait pu lui donner sur M. de Chanteaux serait d’ailleurs perdu. C’était une occasion manquée..... à jamais peut-être! Livré tout entier à l’amertume de cette conviction, Marc était resté le front appuyé contre le mur, lorsqu’un bruit de pas retentit dans le corridor. Il se baissa de nouveau. Le duc sortait de sa cellule et s’avançait seul vers l’escalier. Marc eut une rapide inspiration. Enfonçant la tête dans le tour jusqu’à l’ouverture qui laissait voir de l’autre côté, il appela M. de Saint-Alofe à voix basse. Les deux premiers appels furent inutiles, mais au troisième, le vieillard s’arrêta et chercha autour de lui d’où pouvait venir la voix.
—Qui m’appelle? demanda-t-il.
—C’est moi, Marc, répondit l’ancien chouan.
—Vous! s’écria le duc qui l’aperçut à travers l’ouverture du tour: qui a pu vous conduire ici?
—Je venais dans l’espoir de vous délivrer. Mais le marquis de Chanteaux m’a tendu un piége... Je suis prisonnier.
—Ciel!
—Et il vous emmène?
—A l’instant.
—Où cela?
—Je l’ignore.
—Vous pouvez lui échapper.
—Que dites-vous?
—Le marquis n’a avec lui que madame de Luxeuil et un domestique. Il ne peut vous retenir de force; au premier relais, descendez de la chaise de poste et refusez de poursuivre.
—Et s’il en appelle à l’autorité pour me faire saisir?
—Alors vous déclarez hardiment que M. le marquis et madame la comtesse arrivent de Goritz avec tous les éléments d’un complot en faveur de la branche aînée.
—Sûr. La peur d’une enquête les forcera à vous laisser aller. Votre liberté est dans vos mains, monsieur le due, il suffit d’un peu de résolution...
—J’en aurai, répliqua vivement le vieillard; mais vous-même, comment échapper...
—Ne vous inquiétez point de moi, interrompit Marc; moi, je n’ai rien à craindre. Quoi que l’on puisse faire, je serai bientôt hors d’ici. Ne songez qu’à profiter de l’avertissement que je vous donne; on vient; adieu, bonne chance et bon courage.
Quelqu’un montait en effet l’escalier; Marc se retira promptement et reconnut la voix d’un gardien, qui après avoir reproché au duc sa lenteur, l’obligea à descendre avec lui.
Bientôt le bruit de leurs pas s’éteignit et tout rentra dans le silence. Marc courut à la fenêtre, atteignit le grillage et y demeura l’oreille collée jusqu’à ce qu’un roulement confus lui eût appris le départ de la chaise de poste. Descendant alors avec précaution, il recommença à tâtons l’inventaire de sa prison, rencontra un lit et s’y jeta tout habillé, pour attendre le lendemain.
Il y a dans l’aspect de la campagne, vers la fin de l’automne, alors que les moissons ont disparu, que l’herbe devient moins fleurie, que les arbres commencent à jaunir, je ne sais quoi de décourageant et de plaintif qui semble se communiquer à nous malgré nous-mêmes. La saison des espérances est passée, les jours d’activité finis, tout décline et pâlit sans que l’on puisse encore entrevoir de loin l’époque à laquelle tout doit renaître. Mélancolique passage où l’homme s’arrête un instant inoccupé devant la création languissante! Pénible attente des heures sans verdure, sans parfums et sans soleil. L’on se trouvait précisément arrivé à cette triste saison. Le domaine des Motteux n’offrait plus aux regards que des sillons hérissés de chaume et des vergers dépouillés de leurs fruits. Les prairies elles-mêmes étaient garnies d’une herbe plus rare qu’émaillaient seules, de loin en loin, quelques frêles marguerites ou quelques fleurs de trèfle pâle. Aux gazouillements des grives, des pinsons et des bouvreuils, avaient succédé les gloussements des perdrix ou les cris des vanneaux s’abattant dans les genêts. L’horizon, enveloppé de brumes, ne montrait plus que des lignes confuses et la brise faisait tourbillonner les feuilles mortes à la lisière des fourrés.
Le jour commençait à baisser. Tous les champs étagés sur la pente qui descend de la route d’Isigny vers l’Esques, étaient déserts; mais on apercevait au sommet de la colline le troupeau de moutons d’Anselme Micou, broutant les herbes menues qui poussent parmi le chaume. Le vieux berger se tenait lui-même à l’une des extrémités du plateau, appuyé sur le bâton ferré qui lui servait de houlette, et son chien favori couché à ses pieds. Son neveu Pierre, assis un peu plus loin, sur le rebord d’un sillon, tressait de la paille en chantant une vieille reverdie, léguée par les mères à leurs filles et conservée intacte depuis le temps de Basselin. Au milieu du silence mélancolique de la soirée, la voix de l’enfant s’élevait claire et joyeuse.
Anselme Micou, qui n’avait point paru prendre garde aux premiers vers de cette naïve pastorale, se retourna enfin vers son neveu.
—Le temps des violettes est passé, mon gars, dit-il, et aussi celui des chansons. Maintenant, il faut moins songer aux bouquets qu’aux migauts (provision de fruits pour l’hiver).
—Ah bah! ça regarde mam’Louis, reprit le jeune garçon en souriant, c’est elle qui boulange le pain que je mange.
Anselme remua la tête.
—Oui, oui, dit-il d’un ton pensif, les enfants, ça vit comme les oiselets du bon Dieu, qui chantent en attendant que les graines mûrissent sur le buisson. J’ai été comme ça aussi, mais depuis j’ai reçu bien des harées (averses) et conduit bien des brebis au boucher.
—Dame! c’est sûr que vous devez avoir de l’esquience (expérience), reprit l’enfant; y a pas un berger dans tout le pays à qui on ait tant de fiat (foi) qu’en vous, vieux Anselme, et si vous vouliez...
—Tais-toi, interrompit le berger sans lever les yeux, voici qué’qu’un qui nous arrive.
—Comment que vous savez ça? dit l’enfant étonné.
—Regarde Farraut.
Le chien qui paraissait endormi, venait en effet de dresser légèrement les oreilles, bientôt ses yeux s’entr’ouvrirent, son museau s’allongea et il fit entendre un léger grondement.
—Ah! il a senti qu’on venait dans les étos (chaumes), dit le jeune garçon.
—Oui, mais n’y a pas de danger, ajouta Micou sans faire un mouvement, ce sont des amis.
L’enfant se redressa et porta la main à son bonnet en prononçant le nom de M. de Gausson. Celui-ci suivait, en effet, un des sillons et n’était plus qu’à quelques pas. Il portait un costume de chasse et tenait son fusil sous le bras.
—Vous avez donc changé de pâturage, papa Micou? dit-il en saluant de la tête le vieux berger.
—Où il n’y a plus d’herbe, les moutons ne font plus de laine, répondit Anselme du ton sentencieux qui lui était ordinaire. Monsieur va sans doute à la ferme?
—Précisément; comment y est-on aujourd’hui?
Le berger plia les épaules.
—Toujours bien petitement, Monsieur.
—Ainsi madame Louis ne se trouve point mieux?
—Il n’y a pas d’apparence; on a hier battu dans les granges et elle n’a pas voulu descendre, parce qu’elle avait peur du henu (brouillard). Quand une femme comme mam’ Louis pense au temps qu’y fait, c’est mauvais signe.
—Il est vrai que ses forces semblent diminuer chaque jour, reprit Marcel: depuis cette affreuse nuit où madame Honorine a failli périr, elle n’a pu se relever.
—Monsieur Vorel dit qu’elle a pris un chaud et froid, fit observer le jeune garçon; sans compter que ça lui a fait une révolution de voir comme ça la dame de Paris quasi neyée.
—Et malheureusement on ne peut lui faire accepter aucun remède! ajouta de Gausson.
Anselme secoua la tête et fit un soupir.
—C’est pas tout ça qui aurait soumis une felle femme comme mam’ Louis, reprit-il: non, non; elle en a supporté bien d’autres!
—Et à quelle cause attribuez-vous donc sa maladie? demanda Marcel.
—A la cause qui a amené tous les autres malheurs, répliqua le berger. Il y a des temps, voyez-vous, où l’on dirait que tous les bons anges-gardiens abandonnent une maison. Voici la treizième récolte depuis que le feu a pris aux granges, où mam’ Louis a manqué brûler! treize ans avant, son fils le général est mort quasi subitement, et il y avait alors juste treize ans qu’elle était veuve!
—Et que concluez-vous de ces coïncidences?
—Ça prouve, Monsieur, que tous les treize ans l’esprit de malheur est maître du Motteux et que nous tombons tous à sa merci.
De Gausson sourit.
—Encore les mêmes idées, père Micou, dit-il; vous ne pouvez croire que le mal vienne naturellement.
—Non, Monsieur, dit le berger, ça ne peut pas être le bon Dieu qui frappe comme ça sans regarder; faut que l’autre soit queuq’ fois le maître pour tout bonessonner (troubler). Sans ça comment qu’y aurait tant d’injustice et de méchanceté sous la toiture du ciel? Voyez plutôt cette jeune dame de Paris pour qui vous avez de l’amitié, qui est-ce qui lui a fait faire un cumblet (saut) dans le Petit-Tourbillon?
—Toutes mes recherches pour le découvrir ont été inutiles, répliqua Marcel.
—Parce que les auteurs de la chose ne craignent pas les juges, reprit Micou avec conviction; vous n’avez ni vu leur figure, ni entendu leur voix, non! c’était noir et ça ne parlait pas; mais s’ils n’ont pas réussi à neyer la dame, y n’la perdent pas pour ça de vue.
—Que voulez-vous dire?
—Qu’y a comme un mauvais sort qui la poursuit. Tout ce qu’elle fait dans le pays amène des fouah (huées); on l’accuse de tout le mal et on ne veut pas croire au bien.
—Ah! je ne m’étais donc pas trompé, interrompit vivement Marcel, qui croyait avoir fait la même observation, et d’où peuvent venir ces préventions?
—Qu’est-ce qui sait d’où vient le vent qui brûle les prairies ou la pluie qui noie les blés? répondit Micou; voilà cinquante ans que je garde les moutons dans les friches et que je regarde dans le ciel sans pouvoir dire comment arrive le plus petit nuage. Les dires des vieux ne sont pas des lures (sornettes), allez, not’ maître; les hommes sont, sans comparaison, comme mes moutons; y z’ont des bergers et des chiens qui les conduisent; seulement y en a de bons et de maxis; et c’est ça qui fait le malheur ou la chance.
De Gausson savait qu’il eût été inutile de combattre les opinions du vieux berger; il prit congé de lui et continua sa route vers la ferme. Mais cet entretien, en confirmant ses propres remarques sur l’espèce de réprobation qui frappait Honorine, le jeta dans une sombre préoccupation. Quel hasard, ou plutôt quel ennemi secret pouvait avoir ainsi prévenu le plus grand nombre contre la jeune femme? Le vieil Anselme avait raison; un mauvais esprit pesait sur la vie d’Honorine, mais ce mauvais esprit avait un corps, un nom qu’il fallait découvrir. Les soupçons de Marcel allaient de l’un à l’autre sans oser ni sans pouvoir s’arrêter. Il arriva enfin à la ferme et trouva à l’entrée Françoise qui lui ouvrit la porte de l’espèce de salon où se tenait la malade.
C’était cette pièce du rez-de-chaussée, dont nous avons déjà parlé et qui servait à la fois de parloir, de bureau et de lingerie. Depuis sa maladie, la mère Louis avait encore ajouté à ces destinations. Ne pouvant quitter ce qu’elle appelait la chambre jaune, elle en avait fait le centre de son activité valétudinaire. C’était là que l’on portait les échantillons de récolte, les provisions de ménage, les instruments à réparer. Son inquiétude soupçonneuse avait grandi avec sa faiblesse. Ne pouvant promener sa surveillance, comme autrefois, sur toutes les parties de la ferme, elle eût voulu concentrer celle-ci tout entière dans l’étroit espace où la retenait son mal, rapprocher ce qu’il ne lui était plus permis d’aller trouver, tout amener enfin à portée de sa main et de son regard. Cette monomanie donnait à la pièce où elle se trouvait une apparence de désordre et d’encombrement impossible à rendre. On y voyait, pêle-mêle, des pains sortant du four, des livres de comptabilité, des tisanes et des tourtes de saindoux. A toutes les poutres étaient suspendues des touffes desséchées de plantes potagères conservées pour graines ou des paniers remplis de vieilles ferrailles. Dans les coins on voyait entassés les socs destinés à la forge, les pioches sans pointe, les faux ébréchées et les bêches qui attendaient un manche. Le plancher était enfin couvert de mannequins de fruits, de barres de savon et de poupées de lin peigné; une petite roue de charrue toute neuve avait été placée sous la fenêtre.
Assise au milieu de ce chaos, la mère Louis s’occupait à battre du lait, tout en donnant ses ordres à une servante qui arrangeait des œufs dans une corbeille. Sans avoir beaucoup maigri, la fermière avait perdu cette apparence de vigueur qui frappait autrefois dès le premier coup d’œil. Son teint coloré avait pris je ne sais quelle pâleur jaune et jaspée de petits filaments rougeâtres; ses chairs flasques flottaient à chaque mouvement et ses membres roidis semblaient avoir perdu leurs articulations. Ses yeux seuls, plus ronds et plus ouverts, avaient pris un éclat fiévreux qui, joint à la mobilité de la prunelle, leur donnait quelque chose de légèrement égaré. Une toux opiniâtre appelait par instant le sang au visage qui devenait ensuite subitement plus pâle. Son costume, dont la propreté soignée frisait autrefois l’élégance, avait éprouvé la même transformation. Composé de pièces disparates, il annonçait une sorte d’abandon de soi-même qui est, même chez la femme la moins recherchée, le symptôme le plus certain du triomphe de la souffrance. Un verre et un broc remplis de maître-cidre étaient placés à portée de sa main, car depuis que la maladie avait enlevé à la paysanne son activité, elle cherchait une consolation malheureusement trop fréquente dans la tisane de Marin-Onfroy, et tous les efforts d’Honorine pour combattre cette déplorable passion, devenaient chaque jour plus inutiles. Au moment où reprend notre récit, elle venait encore de recourir à ce dangereux remède, tandis que la jeune femme, assise devant un petit bureau, achevait tout haut quelques calculs.
—Alors tu ne trouves pas le compte! s’écria tout à coup la mère Louis, y manque encore un écu et sept sous?
—Je vais recommencer l’addition, balbutia la jeune femme troublée par la voix de Marcel qu’elle crut reconnaître.
—C’est la malédiction du bon Dieu qui est sur moi, reprenait la fermière d’un ton lamentable. Tous les goureurs du pays se sont donné le mot pour profiter de ma maladie. Y me feront mourir sur une botte de paille... et dire que personne ne prendrait les intérêts d’une pauvre malheureuse qui ne peut plus gandoler (remuer). Ah! Jésus-Sauveur, qu’est-ce que je vais donc devenir? Eh bien! pourquoi que tu laisses tes chiffres, toi?
—Voici M. de Gausson, ma mère, dit Honorine, en montrant le jeune homme qui venait d’ouvrir la porte.
—Ah! qu’est-ce qu’i veut? demanda la fermière en détournant à demi la tête.
—Je venais savoir comment vous vous trouviez aujourd’hui, chère madame Louis, dit Marcel qui s’avança vers la malade avec empressement.
—Aujourd’hui c’est comme hier et comme les jours d’avant, répliqua la mère Louis d’un air maussade; on gavaille (gaspille) tout, on me ruine, et j’ peux rien faire; quand on souffre on n’a plus d’ami, voisin.
—Vous me permettrez de croire le contraire, reprit le jeune homme; pour ma part, je suis désolé de cette persistance de la maladie, et si je pouvais quelque chose...
—Oui, oui, on dit toujours ça quand on est sûr qu’on ne peut rien, interrompit la mère Louis.
Honorine rougit, et de Gausson parut lui-même embarrassé; mais il s’efforça de se remettre en répondant gaiement:
—Allons, vous êtes une ingrate, voisine; vous niez l’amitié que l’on a pour vous, afin de ne pas être obligée d’en rendre; mais vous aurez beau faire, vous ne m’empêcherez pas de m’intéresser à votre santé et de déplorer que vous vous refusiez à tout traitement...
—Ah! voilà la chanson, reprit aigrement la paysanne; faudrait prendre des drogues. Comme si c’était pas assez de l’ennui du mal, sans avoir l’ennui des remèdes. La mezette aussi me fait des reproches tant que le jour dure. Faudrait appeler le médecin. Des médecins; on mourra bien sans ça, allez, et ça ne fera pas de chagrin à beaucoup; quand on n’est plus bonne à rien, le mieux est de se laisser crever dans un coin comme un chien qui a perdu son maître.
Honorine jeta un regard désolé à de Gausson, et une larme vint mouiller ses cils. Quelque égoïste que fût l’affection de la vieille femme, c’était la seule parente en qui elle eût trouvé quelque sympathie; ce cœur avait d’ailleurs donné ce qu’on pouvait en espérer; et Honorine aimait la mère Louis par comparaison et par disette de tendresse. Celle-ci s’aperçut de son émotion; mais loin d’en être touchée, elle s’en irrita, car, comme la plupart des malades, elle s’indignait également que l’on contrariât sa triste prévision, et qu’on parût y croire.
—Vas-tu geindre maintenant, s’écria-t-elle; Dieu me pardonne! ils ont tous juré de me faire damner! et quand je serais portée en terre, voyons, qu’est-ce que ça te fera? tu auras ta part de mon bien, et les écus d’un mort, ça vaut toujours mieux que les gronderies du vivant. Mais j’suis pas encore cousue dans le drap, ma chère! toi et le mière faut que vous attendiez vot’tour.
—Ah! pouvez-vous me parler ainsi! dit la jeune femme, dont les larmes, retenues jusqu’alors, coulèrent silencieusement.
—Allons v’là qu’elle pigne maintenant, reprit la fermière en repoussant la baratte à beurre; si c’est pas capable de vous tourner le sang! Emporte ça, voyons, emporte vite; j’aime mieux être toute seule que de voir des figures de mater dolorosa. M. Marcel t’ouvrira la porte.
L’invitation était trop claire pour que le jeune homme pût feindre de ne point comprendre; il prit congé de la mère Louis et suivit Honorine. Celle-ci arrivée dans la pièce voisine s’assit sur un banc et fondit en larmes. Depuis tant de jours que ses soins près de la fermière n’étaient payés que par des reproches ou des duretés, elle avait le cœur trop plein; ce dernier choc le fit déborder. Marcel qui était demeuré d’abord debout devant elle, sans pouvoir parler, fit un geste de désespoir.
—C’est trop aussi! murmura-t-il enfin à voix basse; c’est trop pour qui n’a mérité aucune de ces épreuves! Le berger dit vrai, il y a un mauvais esprit acharné à votre poursuite.
—Ah! quand je me suis décidée à venir ici.., bégaya Honorine au milieu de ses sanglots... pourquoi n’ai-je pas eu plutôt... le courage... de mourir...
De Gausson lui prit vivement la main.
—Ne dites pas cela, reprit-il avec angoisse, vous me brisez le cœur. Mon Dieu, ne puis-je donc rien faire pour vous! mais à quoi servent alors le dévouement, l’affection, le courage... Je vous suis inutile, moi qui rachèterais chacun de vos chagrins au prix de tout mon bonheur.
—Ah! je le sais! dit la jeune femme qui pleurait toujours, mais dont la douleur se transformait en attendrissement à la voix de Marcel; je sais que vous êtes mon meilleur, mon seul ami.
—Plus qu’un ami, répliqua de Gausson, qui avait saisi sa main et qui la pressait dans les siennes...
—Un frère! répéta la jeune femme.
—Plus qu’un frère, ajouta-t-il, en attirant contre son cœur la main qu’il tenait.
Honorine tressaillit et voulut se dégager. Marcel la retint avec force.
—Plus que vous n’avez cru, plus que je n’ai jamais osé vous dire! continua le jeune homme avec une exaltation croissante. Je vous aime, Honorine! oh! ne tremblez pas, ne cherchez point à m’échapper: je vous aime depuis le premier jour où je vous ai revue. Mariage, séparation, rien n’a pu me guérir de cet amour, rien ne m’en guérira.
—Pourquoi... me le dire... murmura la jeune femme, pleurant plus fort de trouble et peut-être de bonheur.
—Parce que je me suis tû trop longtemps! reprit Marcel avec passion. Ce secret me pesait là, comme une chaîne; il arrêtait tous mes épanchements; il étouffait ma voix quand je voulais vous consoler! Maintenant je vous ai dit que ma vie vous appartenait, que ma joie était en vous, ordonnez ce que je puis faire; sachant que vous êtes tout pour moi, vous oserez, j’espère, tout me demander.
Honorine voulut répondre, mais elle n’en trouva point la force. Cet aveu que de Gausson avait retenu jusqu’alors, elle le prévoyait, elle le désirait peut-être; aussi n’éveilla-t-il chez elle ni surprise ni révolte. Les objections qu’il pouvait faire naître s’étaient depuis longtemps présentées à son esprit, qui les avait discutées, combattues. Fascinée par la voix de celui qu’elle aimait, honteuse, éperdue, elle fit un dernier effort pour échapper à ses étreintes, puis, cédant à sa propre émotion, elle cacha son visage sur la poitrine du jeune homme. Celui-ci sentit ses yeux se mouiller, un flot de joie inonda son âme; il avait compris! Sa tête se pencha vers celle d’Honorine, et posant chastement les lèvres sur ses cheveux:
—Merci! balbutia-t-il à son oreille; mais, maintenant, vous ne direz plus que vous voulez mourir...
Quand Honorine reparut dans la chambre de sa grand’mère, une sorte de transfiguration s’était opérée en elle. Son visage, altéré par la fatigue et les veilles, rayonnait d’une auréole de joie; sa voix était plus harmonieuse, ses mouvements plus souples, un souffle de flamme semblait avoir pénétré tout son être embelli et allégé. Elle se mit à genoux sur le tabouret placé aux pieds de la malade et, à force de douces paroles et de caresses, elle arriva à trouver le chemin de cette âme aigrie. La mère Louis, qui avait longtemps résisté à toutes ses avances, finit par lui prendre la tête à deux mains et l’embrassant au front:
—Tiens, tu n’es pas une humaine, toi, s’écria-t-elle attendrie; faudrait être plus méchant qu’un lancret pour te faire du chagrin.
—Alors, vous qui êtes bonne, vous ne voudriez pas me rendre malheureuse, dit Honorine de ce ton plaintivement caressant qui a tant de charme chez les femmes et les enfants.
—Non que je ne le veux pas, chère câline.
—Alors vous consentez à vous soigner?
—Ah! tu vas encore me parler de médecin...
—Essayez seulement, grand’mère; je vous en conjure... pour moi... rien que pour moi.
Elle avait pris les mains de la mère Louis et y appliqua ses lèvres. La vieille femme finit par céder.
—Allons, on ne peut pas te résister, mezette, dit-elle plus gaiement, nous verrons le mière puisque tu le veux. S’y peuvent me relever, ça ne sera pas malheureux pour nous tous, car ça mettra peut-être fin aux voleries. Ah! pauvre mezette, le proverbe a bien raison:
—Allons, reprit Honorine, qui voulait profiter des bonnes dispositions de la fermière; je vais faire avertir tout de suite M. Vorel.
—Rien ne presse, fit observer la paysanne; je dormirai bien sans ses drogues; demain s’il y a du soleil, nous attellerons le char-à-bancs et nous irons ensemble au manoir. Mais en attendant je veux prendre quéqu’chose, un peu de tisane de Marin-Onfroy.
Honorine fit un geste de prière.
—Eh bien, non, reprit la mère Louis avec un visible effort; je ne veux pas t’erjuer (te contrarier), fais-moi une piquette et puis j’irai me coucher. C’est pas que je m’ennuie avec toi, au moins, mais, comme disait le roi Dagobert à ses chiens, il n’est si bonne compagnie qu’on ne se sépare.
Honorine prépara à la vieille femme le mélange de crème, de lait caillé et de sucre qu’elle lui avait demandé, l’aida à se mettre au lit, puis se retira elle-même dans sa chambre. Mais elle était peu disposée au sommeil; la nuit entière se passa pour elle dans un enivrement de cœur entrecoupé de larmes. La pensée qu’elle était aimée de Marcel lui causait tour à tour des élans de joie et des tressaillements d’épouvante. Cependant sa joie était plus forte. Elle repassait dans sa mémoire tous les souvenirs qui prouvaient cet amour; elle rêvait un avenir uniquement occupé par lui; son imagination aidait son cœur à créer tous les incidents de ce poëme ineffable qui comprend tout le reste et que résume un seul mot. Les premières lueurs du jour la trouvèrent encore bercée dans ces enivrantes images. Mais cette veille loin d’épuiser ses forces les avait ranimées et rafraîchies. Elle se leva comme l’alouette qui reprend possession des airs. En se réveillant, la mère Louis rencontra son doux visage penché sur son oreiller.
—Déjà debout, ma moissonnette, dit la vieille femme étonnée.
—Il fait beau, grand’mère, répliqua Honorine, en baisant les joues flétries de la vieille femme.
—Ah! parbleu! t’as pas besoin de le dire, reprit la mère Louis, on voit le soleil levant dans tes yeux. Eh bien! puisqu’il fait beau, mezette, nous irons au manoir.
—J’ai fait sortir le char-à-bancs.
—Bon.
—Et j’ai dit de préparer la Caillie; c’est la jument que vous préférez.
—Parce qu’elle ne vole pas sa branée (mesure de son); c’est une vieille dure-à-cuire comme moi, vois-tu, on n’en fait plus comme de not’ temps. A propos, donne-moi un coup de cassis; je me sens mal au cœur quand je me réveille.
Honorine n’osa refuser et versa la liqueur demandée dans une des petites mesures appelées demoiselles. La mère Louis l’obligea à la remplir.
—Est-elle grecque au moins, dit-elle d’un air mécontent; elle me regrette toujours mon petit coup du matin.
—Vous savez ce que monsieur Vorel vous a dit, grand’mère.
—Bah! bah! laisse-moi donc avec le Vorel.
—Ah! grand’mère, vous oubliez vos promesses d’hier.
—Du tout! mais nous n’avons pas encore eu la consultation. Ainsi je suis ma maîtresse et j’veux en profiter. Avant que nous partions, faut que tu me fasses manger queuq’chose qui me soutienne.
Honorine eut beaucoup de peine à obtenir que la vieille paysanne se contentât d’un peu de lait jusqu’à ce que M. Vorel eût indiqué le régime à suivre, et, pour couper court à sa réclamation, elle lui annonça que le char-à-bancs attendait.
—Allons! je vois qu’on veut me faire mourir de famine, reprit la mère Louis en se levant; les mières auront beau dire, vois-tu, je sens que j’ai besoin et que si je pouvais manger je me remettrais debout. Y suffirait de trouver ce qui convient à mon estomac... A propos, apporte donc queuq’chose pour boire en chemin... J’ai toujours soif..... Ah! Jésus! je suis-t’y faible sur mes pieds; y m’semble que j’marche sur du coton.
Honorine lui donna le bras et toutes deux rejoignirent le char-à-bancs où la mère Louis monta avec peine.
Le ciel était brillant et pur, et les dernières senteurs de la végétation mourante flottaient sur les brises du matin. C’était la première fois depuis plusieurs semaines que la mère Louis quittait la ferme, car, comme il arrive toujours aux gens d’action, le mal l’avait jetée dans une inertie subite et exagérée. Le jour où elle s’était trouvée trop faible pour continuer ce qu’elle faisait d’habitude, elle avait renoncé à tout et s’était alitée plus par dépit que par nécessité. Depuis, l’immobilité, l’irritation et une hygiène déplorable avaient assez aggravé le mal pour lui faire croire à l’impossibilité de remuer; aussi éprouva-t-elle une surprise joyeuse lorsqu’à la suite de l’effort qu’elle venait de tenter, elle se trouva plus ferme et plus vaillante qu’elle ne l’avait supposé. En passant près des étables, elle voulut voir son bétail, examina tout avec l’ardeur d’une convalescente, gronda un peu pour n’en point perdre l’habitude, mais remonta en char-à-bancs plus satisfaite qu’elle ne voulait le paraître. La route qu’elles suivaient pour se rendre au manoir était bordée de buissons dont les oiseaux venaient becqueter les baies mûres. On entendait les chants des pâtres, et les passants s’arrêtaient, pour saluer la mère Louis et la félicitaient sur sa sortie. Celle-ci ne manquait point de répondre qu’elle ne se trouvait pas mieux et que l’on sortait bien les morts pour les porter en terre; mais dans le fond, elle se trouvait raffermie et ranimée par ce qu’elle sentait, ce qu’elle voyait et ce qu’elle entendait. Aussi répondait-elle plus affectueusement aux prévenances d’Honorine qui avait été l’occasion, sinon la cause de cette résurrection; elle l’aimait par retour sur elle-même, comme on aime ce qui égaie et soulage.
—Allons, fouette la Caillie, petite, lui dit-elle; faut que nous arrivions avant que le mière soit parti pour ses visites; j’veux lui demander à déjeuner à ce grec-là.
Honorine obéit, et elles arrivèrent bientôt à la porte de M. Vorel. Celui-ci qui les avait aperçues vint à leur rencontre et fit de grandes démonstrations de joie.
—Oui, recevez-moi bien, dit la mère Louis en descendant avec peine; car je viens vous consulter.
—Enfin!
—C’est pas que j’aie plus de fiat (confiance) qu’autrefois, non; mais c’est la mezette qui l’a voulu, et donc je viens prendre queuq’chose avec vous.
—J’ai bien peur de n’avoir à vous offrir que des tisanes, dit le médecin en souriant; la première condition de rétablissement est une diète sévère.
—Oh! j’en étais sûre! s’écria la paysanne; c’est toujours le même oremus. Mais, après ça, faudra voir..... Ah! Dieu! j’ai-t-y les jambes emolentées (fatiguées); donnez-moi donc de quoi m’asseoir.
Vorel apporta un fauteuil et commença quelques questions sur ce qu’éprouvait la mère Louis.
—Pardi! vous savez bien ce que j’ai, interrompit celle-ci; je vous l’ai dit assez souvent depuis un mois; c’est toujours la même chose... Voyez si vous aurez dans vot’sac des remèdes pour me redonner du cœur aux jambes.
Vorel répondit qu’il ne doutait point qu’un traitement suivi ne ramenât la santé, mais qu’une plus longue négligence pouvait tout compromettre. Il examina ensuite la malade attentivement, indiqua à Honorine les précautions à prendre, en ajoutant qu’il apporterait lui-même, dans la journée, une potion dont l’effet ne pouvait manquer d’être favorable.
—Eh bien! à propos, reprit la mère Louis, qui avait écouté tous ces détails avec une répugnance évidente, puisque vous êtes si habile, pourquoi que vous ne guérissez pas le grand Jodane... car il est toujours malade, à ce qu’il paraît.
—Toujours, répliqua Vorel.
—Pauvre Henri!... ne pourrions-nous le voir? demanda Honorine.
—En vérité, je ne sais s’il serait prudent... objecta Vorel.
—Pourquoi donc ça? reprit la fermière, à laquelle le quasi refus du médecin inspira un désir subit de rendre visite à l’idiot; y me semble qu’on ne peut pas m’empêcher de voir mon petit-fils.
—Si vous y tenez... absolument...
—Certainement que j’y tiens; j’serais pas fâchée de savoir si y m’trouvera bien changée.
Vorel parut se raviser.
—Ce sera, en effet, un moyen d’éprouver son intelligence, murmura-t-il; je vais alors le prévenir.
—C’est inutile, nous montons avec vous.
Vorel voulut essayer quelques objections, qui, comme à l’ordinaire, ne firent que confirmer la mère Louis dans sa résolution. Appuyée sur le bras d’Honorine, elle se mit à monter l’escalier à la suite du médecin, qui parut enfin prendre son parti. Arrivé au premier étage, Vorel ouvrit une porte, et introduisit les deux visiteuses dans une première pièce couverte d’un tapis qui amortissait le bruit des pas. Il ouvrit ensuite une seconde pièce fermée à clef, et où les persiennes ne laissaient pénétrer qu’une lueur crépusculaire.
—Ah! Jésus! c’est noir comme un tombeau! s’écria la fermière qui, venant de quitter la pleine lumière, n’aperçut rien au premier instant.
Le médecin entra sans répondre, et s’avança vers un lit enveloppé de rideaux sombres qu’il entr’ouvrit.
—Voici votre grand’mère et votre cousine qui viennent vous voir, mon cher Henri, dit-il de sa voix mélodieuse.
Une sorte de gloussement, qui n’avait rien d’humain, lui répondit.
—C’est donc là qu’il est? demanda la mère Louis; voyons un peu ce qu’il va dire...
Elle s’était approchée du lit pour apercevoir le malade; mais lorsque son œil, déjà accoutumé à l’obscurité, rencontra ce qu’il cherchait, elle s’arrêta tout à coup frappée de stupeur. L’idiot se tenait accroupi au fond de la ruelle, entouré de draps roulés et de couvertures en lambeaux, et occupé à retirer les crins du matelas sur lequel il était assis. Son étiolement d’autrefois avait fait place à une maigreur effrayante; ses cheveux, plus pâles, se dressaient par touffes rudes et inégales; les muscles de son visage étaient agités d’un frémissement convulsif, et une écume visqueuse bordait ses lèvres bleuies. Honorine, qui était restée immobile comme la fermière, joignit les mains avec un cri étouffé.
—Vous le trouvez bien changé? demanda Vorel d’un air triste. Hélas! tous mes soins ont échoué contre l’abâtardissement de cette nature avortée.
—Comme il nous regarde! s’écria la mère Louis; on dirait qu’il ne sait pas qui nous sommes.
—C’est votre grand’mère, Henri, dit Vorel en montrant la paysanne à l’idiot.
Pour toute réponse, celui-ci porta avec avidité à sa bouche le crin qu’il avait arraché au matelas, en faisant entendre l’espèce de cri animal qu’il avait déjà poussé à l’arrivée du médecin.
—Est-ce que tu ne me reconnais pas, grand Jodane? reprit la fermière, troublée malgré elle à la vue d’une telle misère.
L’idiot tourna de son côté des yeux égarés, et fit claquer ses dents.
—Quoi! vous ne vous souvenez plus de moi, Henri? demanda à son tour Honorine.
—Vite, répondit le grand Jodane. C’est l’heure... du pain.
—Tu as oublié la dame de Paris que tu aimais tant? ajouta la mère Louis.
—Beaucoup... beaucoup! reprit l’idiot.
—Dieu nous sauve! il n’y a plus rien à faire de lui! dit la paysanne.
—Je le crains! soupira Vorel, sous les lunettes duquel brillait un regard de triomphe, il a perdu la mémoire, le jugement... mais les fonctions animales ne sont nullement troublées, et nous n’avons pas à craindre du moins pour sa vie.
—La vie! répéta la mère Louis; que je sois damnée s’il ne vaudrait pas mieux pour vous le voir entre quatre planches.
—Oh! vous ne savez pas ce que c’est qu’un fils unique, ma mère! dit Vorel avec une expression si ardente qu’Honorine en fut remuée jusqu’au cœur.
—Mon Dieu! mais ne peut-on rien faire? demanda-t-elle.
—J’ai eu recours à tous les moyens connus, répliqua le médecin d’un ton accablé.
—Et... si l’on en essayait d’autres? reprit la jeune femme; pardon d’oser donner un avis... Mais il me semble que ce silence, cette obscurité doivent à la longue énerver et anéantir. Puisque le traitement indiqué par la science n’a point réussi, ne pourrait-on en essayer un autre, rendre à Henri de l’air, de la lumière et de la liberté?
—Maintenant, je n’y vois point d’empêchement, répliqua Vorel, les regards fixés sur l’idiot; il se pourrait que cet isolement, nécessaire pour le but que je désirais atteindre, altérât à la longue la santé de ce malheureux enfant et... avant tout, je veux qu’il vive!
—Alors permettez qu’il sorte, reprit vivement Honorine; qu’il vienne à la ferme comme autrefois; je vous promets de veiller sur lui comme sur un frère.
—Pardi! pourquoi qu’y ne viendrait pas tout de suite? dit la mère Louis; y fait un temps pour les malades aujourd’hui. Voyons, grand Jodane, lève-loi et viens avec ta grand’mère; nous déjeunerons ensemble!
L’idiot comprit ce dernier mot, car il se mit à rire en étendant ses mains crochues et répétant:
—Déjeuner! hou! hou! toujours déjeuner...
—Y paraît qu’il a appétit, reprit la fermière... Je parie que vous l’aurez fait jeûner pour le guérir! la diète, c’est comme les licous, ça va à toutes bêtes. Envoyez la Sureau habiller ce pauvre innocent, nous allons l’attendre en bas.
Les deux femmes descendirent au salon et le médecin alla donner les ordres nécessaires à la vieille servante. Il les rejoignit bientôt et engagea Honorine à visiter plusieurs variétés de chrysanthèmes qui venaient de fleurir au jardin, tandis qu’il préparait la potion nécessaire pour la mère Louis. Celle-ci regarda la jeune femme descendre le perron et traverser le parterre.
—A-t-elle l’air coquet, dit-elle, avec cette complaisance des grands parents pour la beauté de leurs petites-filles; y en a pas une autre dans le pays qui l’égale, non!
—Madame de Luxeuil est, en effet, charmante, répliqua Vorel.
—Et courageuse! continua la fermière; y a pas de basse (servante) qui en approche pour le travail, sans compter que c’est attaché...
—Oui, reprit Vorel d’un air paterne; je la crois d’une nature fort affectueuse.
—Y faut ça! car vrai, y a des fois où je la tarabuste.
—Vous êtes vive, mais au fond si bonne...
—Eh ben, v’là où est la menterie! s’écria la fermière qui, par contradiction, se trouvait en veine de franchise; je suis pas bonne du tout; et vous le savez bien mieux que personne.
—Oui, oui; vous me l’avez dit.... D’abord, je suis pas bonne quand ça m’ennuie. Mais la mezette ne s’fâche jamais, j’ai beau l’agonir, elle garde toujours sa mine douce et sa voix de petit oiseau. Aussi, moi, ça me touche, et maintenant, voyez-vous, je sais pas ce que j’deviendrais si je l’avais plus.
—C’est un malheur que vous ne devez point craindre, objecta Vorel; madame Honorine est retenue ici par un intérêt trop puissant....
—Quel intérêt donc?
—Allons, vous le savez aussi bien que moi.
—Parole! je ne sais rien de rien.
—Alors, je dois me taire.
—Et moi je veux que vous parliez, s’écria la paysanne impatientée. Y a rien qui m’est maque comme d’entendre dire: v’là une chose; mais vous ne la verrez pas. Voyons, mon gendre, qui est-ce qui retient la mezette?
—Eh bien! puisque vous voulez que je vous dise.... ce que tout le monde sait: Madame Honorine reste ici parce que M. de Gausson s’y trouve.
—Ah bah! reprit la mère Louis intéressée; vous croyez qu’elle en tient pour le beau brun?
—Il suffit de regarder.
—Au fait, c’est juste, maintenant que j’y pense... quand le voisin se trouve là, mezette est toute... chose!... Ah! c’est pour ça qu’elle reste aux Motteux!
La mère Louis devint pensive, à la grande joie du médecin; il connaissait l’égoïsme exigeant de l’ancienne meunière et savait la malveillance des vieilles femmes contre tout amour qu’elles n’ont point permis et protégé. Aussi, ne doutait-il pas que la révélation qu’il venait de faire n’amenât tôt ou tard, entre la grand’mère et la petite-file, des débats qui pourraient finir par une séparation. En toute autre occasion, ses espérances se fussent réalisées; mais la maladie avait attaqué l’énergique personnalité de la fermière. Plus dépendante des autres, elle était devenue moins absolue dans ses prétentions, et l’idée d’une rupture à laquelle elle se fût arrêtée autrefois avant toute autre, lui causait maintenant un effroi qui la rendait plus indulgente. Elle étouffa son premier dépit, accepta une place secondaire dans les affections de la jeune femme et ne songea qu’aux moyens de l’exploiter le plus fructueusement qu’il serait possible. Or, il lui sembla, à la réflexion, que cet amour d’Honorine et de Marcel, loin d’être nuisible aux soins qu’elle attendait de sa petite-fille, pouvait les lui assurer plus attentifs et plus tendres. Il suffisait pour cela de le prendre sous sa protection, de se faire volontairement l’occasion du rapprochement entre les deux amants, comme elle l’avait été jusqu’alors à son insu; d’entrer enfin dans ce roman de manière à profiter d’une double reconnaissance. Tout ceci se présenta à l’esprit de la mère Louis, comme nous venons de le dire, mais sous des formes plus vagues, plus grossières. Sans bien s’expliquer les motifs, elle comprit que la révélation faite par Vorel pouvait tourner à son profit. Grâce au médecin, elle tenait désormais sa petite-fille par le cœur! aussi l’expression de mécontentement qui avait d’abord plissé son front, fit-elle presque immédiatement place à un épanouissement de bonne humeur.
—Ah! perjou! dit-elle, vous êtes un fameux dénicheur, mon mière; rien ne vous échappe! moi, qui vois ces jeunesses tous les jours, je ne savais rien de leur secret.
—La chose était pourtant assez claire! reprit Vorel surpris de la placidité de la mère Louis, et je ne suis point le seul à l’avoir devinée!
—Si c’est possible!
—Tout le monde en parle à Trévières.
—Voyez-vous ces jacasseurs (bavards).
—Je crois même qu’il serait prudent de faire quelques représentations à madame Honorine dans son intérêt.
—On les lui fera, dit la mère Louis, on les lui fera; mais Jésus Dieu! voyez donc le grand Jodane qui vient là. On dirait qu’il a oublié de marcher.
L’idiot s’avançait soutenu par la jeune femme et en chancelant à chaque pas. Son changement, plus visible au grand jour, sembla effrayer Vorel lui-même.
—Est-ce que vous croyez qu’il pourra vivre comme ça? demanda la mère Louis avec cette naïveté brutale des paysans.
—Je l’espère, je n’ai aucune raison d’en douter, répliqua le médecin, dont l’œil interrogeait les traits de l’idiot avec une attention qui ressemblait à de la sollicitude; seulement je crois que vous avez raison, et qu’il faut lui rendre un peu d’air et de mouvement.
—Laissez-le venir avec nous, Monsieur, dit Honorine, à qui la langueur de l’idiot inspirait une sérieuse pitié.
—Au fait, ça ne peut que lui être bon, reprit la fermière; pas vrai, grand Jodane que tu veux venir avec nous?
Pour toute réponse, le grand Jodane se pressa contre la jeune femme en poussant son cri habituel qui ressemblait à un gémissement.
—Nous allons le faire monter en char-à-bancs, reprit la fermière qui s’était levée, et ce soir on vous le ramènera.
Vorel parut balancer un instant, puis finit par consentir, et les deux femmes partirent avec leur nouveau compagnon. Il y eut d’abord un assez long silence, mais lorsque l’on eut perdu de vue le manoir, la mère Louis se tourna vers Honorine qui tenait les rênes.
—Est-ce que tu n’as pas envie de faire une plus longue promenade, mezette? demanda-t-elle d’un air malicieux.
—Moi, volontiers, ma mère, répliqua la jeune femme; mais où faut-il aller?
—Consulte-toi un petit, voyons; n’y a donc pas un côté vers où ton cœur se tourne, hein? Allons, ne fais pas la jesuette.
—Je vous assure... que je ne comprends point, répliqua Honorine qui rougit de manière à prouver qu’elle craignait de comprendre.
—Et ben petiote, faut tourner là, à gauche, et, en allant toujours devant, nous arriverons à un endroit qui s’appelle Vertbec!
Honorine tira brusquement les rênes.
—Quoi! vous voulez aller chez M. de Gausson? dit-elle vivement.
—Pourquoi donc pas? reprit la fermière d’un ton narquois; y nous a fait assez de visites pour qu’on lui en rende une: entre voisins, faut ben voisiner, pas vrai?
—Je crains qu’il ne soit absent, reprit Honorine, qui n’eût point voulu comprendre les allusions de sa grand’mère.
—Alors nous retournerons une autre fois, reprit la paysanne... y me semble que ça n’peut pas te faire de peine?... T’es pas ennemie du beau brun, je crois.
—Vous savez que j’ai toujours eu... beaucoup d’amitié... pour M. Marcel, répliqua Honorine embarrassée.
—Juste! répliqua la mère Louis ironiquement, t’as de l’amitié... et lui itou... et comme on dit que deux amitiés valent un amour...
—Ma mère...
—Eh ben! faut pas t’estomaquer pour ça; pardi! on est tous mortels, comme dit c’t’autre, et un beau gars est toujours un beau gars.
—Pouvez-vous penser?...
—Je pense pas; je pense rien, interrompit la vieille femme; ce que j’en dis, c’est pas pour te faire de la peine, au contraire, suis ta fantaisie, mezette, et n’aie pas peur que nous ayons d’halmèche pour ça...
La mère Louis accompagna ces mots d’un gros baiser sur la joue d’Honorine qui demeura étourdie. La découverte de sa grand’mère l’avait épouvantée, et sa grossièreté indulgente l’humiliait plus que des reproches. Aussi voulut-elle s’expliquer, se défendre, mais la fermière lui ferma la bouche.
—C’est bon, c’est bon, dit-elle, on ne te demande pas de dire s’y retourne du pique ou du cœur; t’es cachottière comme toutes les jeunesses. Je t’en aime pas moins pour ça. Plus tard t’auras plus de fiat en ta grand’mère; pour le moment, fouette la Caillie que nous arrivions à Vertbec le plus tôt possible; j’ai l’estomac dans les talons.
Honorine qui savait toute contestation inutile, obéit en silence, et ils aperçurent enfin l’habitation de Marcel. Ainsi que nous l’avons dit ailleurs, l’ancien château de Vertbec n’était plus qu’une ruine dont les débris couronnaient le sommet d’une verdoyante colline. Un antiquaire eût facilement retrouvé parmi ces pans de murailles à demi-abattus et ces tourelles rongées de lierre, le plan primitif de l’édifice. Mais, pour le passant, il n’y avait là qu’un amas de décombres dont il supputait la valeur marchande ou dont il admirait l’effet pittoresque, selon sa profession et ses instincts. Une seule partie de la construction primitive était restée intacte; c’était le donjon! Sa masse colossale s’élevait au centre comme un géant que rien n’a pu terrasser. Les violiers en fleurs, les pariétaires et les élégantes ciguës qui ondoyaient au sommet des créneaux, loin de leur donner un aspect de ruines, semblaient un ornement destiné à les égayer. Aucune réparation récente n’avait du reste altéré le caractère du vieux monument. Les pierres, que joignait l’une à l’autre le lierre ou la mousse, semblaient rongées par le temps; les étroites fenêtres étaient garnies de châssis plombés; la porte basse et déjetée était défendue par des lames de fer boulonnées. La mère Louis, qui n’était point venue au Vertbec depuis quelques années, parut stupéfaite.
—Comment! il n’y a pas de maison! s’écria-t-elle, où donc est-ce qu’il demeure alors?
—M. de Gausson s’est arrangé un logement dans le donjon, fit observer Honorine.
—Quoi! dans ce pigeonnier? demanda la fermière; ah! perjou! mais comment qu’on fait pour entrer là-dedans? Faut donc monter avec une échelle?
Avant qu’Honorine eût pu répondre, de Gausson parut lui-même à la porte de la tour; il accourait à la rencontre du char-à-bancs avec de grandes démonstrations de surprise et de joie.
—Ah! vous ne vous attendiez pas à ça, voisin, s’écria la mère Louis; c’est une surprise que j’ai voulu vous faire; je vous amène mezette... c’est bien malgré elle, par exemple.
—Se peut-il? dit Marcel.
—Oui, dit la paysanne; elle donnait des raisons pour ne pas venir... histoire de faire la sainte n’y touche, vous comprenez; mais moi j’ai pas donné dans les lures (sornettes), et nous voilà.
De Gausson exprima sa reconnaissance avec une vivacité qui fit cligner les yeux à la vieille femme.
—C’est bon, c’est bon, dit-elle; on sait que vous aimez mieux voir la mezette que le tonnerre!... Faut pas rougir pour ça, petiote.
C’est un proverbe aussi vieux que Mathieu-Salé.
Honorine était au supplice; Marcel s’en aperçut et se hâta de couper court, en conduisant ses hôtes au donjon.
—Je suis désolé de vous faire monter mes cent marches de pierre, dit-il à la mère Louis; mais le plus haut étage est le seul qui ait été remis en état; vous allez trouver que j’habite un nid de hiboux.
—Ça m’est égal, pourvu qu’on y déjeune, dit la fermière, car je vous ai pas encore dit que nous étions venus pour casser la croûte avec vous.
Marcel répondit qu’il les traiterait le moins mal qu’il lui serait possible, et aida la vieille paysanne à atteindre le sommet de l’escalier étroit et tournant. Honorine suivait avec l’idiot.
—Nous voilà arrivés, dit enfin de Gausson, en poussant une petite porte de chêne qui servait d’entrée à son logement.
—C’est pas malheureux, reprit la mère Louis essoufflée: faut que vous ayez du jarret pour vous loger, comme une cloche, auprès des nuages. Ouf! heureusement que voici de quoi s’asseoir.
Le jeune homme avança un grand fauteuil gothique garni de cuir, dans lequel la vieille femme se laissa tomber; puis des tabourets de même forme pour Honorine et pour l’idiot. Mais celui-ci s’était accroupi dans le coin le plus obscur, près d’une petite cheminée de fonte incrustée dans l’intérieur du mur, et la jeune femme regardait autour d’elle avec une curiosité et une émotion involontaires.
Le logement de Marcel avait, en effet, dès le premier aspect, quelque chose de singulièrement remarquable. Il ne se composait que de deux pièces séparées par une portière alors ouverte, et qui permettait ainsi de le voir tout entier. Les murs, sans tapisserie, n’avaient d’autres ornements que quelques armes de chasse; un filet de pêche et un caban de peau de chèvre suspendu près de la porte. Tout l’ameublement de la première pièce consistait en quelques siéges gothiques, une table à pieds tors et une grande armoire de chêne sur les battants de laquelle avait été sculpté l’H symbolique surmonté de la croix des chrétiens. Dans la seconde pièce, on apercevait une couchette de fer recouverte d’un tapis brun, quelques rayons chargés de livres, et un pupitre d’ébène incrusté; enfin, sur l’un des pans de la muraille, vis-à-vis du chevet du lit, Honorine reconnut la petite croix trouvée par de Gausson le jour où il l’avait arrachée à la mort. Il y avait dans cet intérieur quelque chose de pauvre, de noble et de sévère qui toucha la jeune femme jusqu’aux larmes. Le logis révélait complétement le maître. Au milieu de ces meubles de chêne, de ces armes, de cette couche de fer, la croix de brillants apparaissait comme un symbole; c’était la seule richesse et le seul ornement de cette demeure, comme l’amour qu’elle rappelait était le seul espoir et la seule joie de celui qui s’y abritait.
Honorine s’approcha de la fenêtre pour cacher son trouble. La vue embrassait un horizon immense entrecoupé de collines, de bois, de villages, au delà duquel une bande d’un bleu sombre allait se réunir aux nuages, c’était la mer. Plus près, le regard s’arrêtait sur les taillis et les vergers qui entouraient Vertbec, et plus près encore sur les ruines au milieu desquelles s’élevait le donjon. Le vent qui soupirait à peine aux pieds de la colline, grondait sourdement au haut de la tour, et les oiseaux nichés dans les créneaux passaient à chaque instant devant le vitrage qu’ils effleuraient de leurs ailes.
Honorine, un coude appuyé au rebord de la croisée, regardait et écoutait, le cœur gonflé d’attendrissement. La grandeur poétique du spectacle qu’elle avait sous les yeux, la pensée qu’elle se trouvait chez Marcel, mille souvenirs qui traversaient sa mémoire, mille espérances qui tourbillonnaient confusément devant son âme, tout en elle et hors d’elle semblait se réunir pour accroître son trouble! De Gausson s’était excusé près de ses hôtes et était ressorti afin de donner des ordres au jeune paysan qui le servait; la mère Louis, fatiguée de sa course, venait de s’asseoir sur son fauteuil; l’idiot ne faisait entendre, comme d’habitude, qu’un murmure monotone. Honorine resta longtemps à la même place, en proie à une émotion qui n’était ni le bonheur ni la tristesse, mais qui tenait, à la fois, de tous deux.
Le retour de Marcel arracha Honorine à sa rêverie. Il revenait avec le jeune paysan chargé de tout ce qu’il avait pu se procurer à la ferme de Vertbec. La mère Louis se réveilla à son entrée.
—A la bonne heure, dit-elle en apercevant les provisions, nous allons faire une sapée (festin), moi d’abord j’ai la frinvalie. Voyons, mezette, aide donc le jeune gars à nous mettre le couvert.
Honorine obéit. Elle éprouvait une sensation étrange à remplir chez Marcel ces soins domestiques; c’était en même temps comme de la honte et de la joie. Le jeune homme, de son côté, semblait fasciné. Il la regardait aller et venir dans ses deux chambres, dresser le couvert, préparer le repas comme si elle se fût trouvée à la ferme, et son cœur se gonflait d’ivresse; il eût désiré oublier tout le reste, croire un instant qu’elle était là chez elle, pour lui et avec lui! Il contemplait avec une sorte de respect ce pauvre ménage de solitaire, la veille encore sans valeur et aujourd’hui consacré par sa visite. Il eût voulu baiser chaque objet qu’elle avait touché, il se sentait enivré de cet air qu’elle remplissait de son haleine, des froissements de sa robe, du léger bruit de ses pas! La mère Louis l’arracha à son extase en criant de se mettre à table. L’exercice et le grand air avaient éveillé l’appétit de la fermière qui avait d’ailleurs le principe normand, que tout ce que l’on mange chez les autres est autant d’ajouté à notre bien. Honorine voulut la rappeler à la prudence, mais elle s’écria:
—La paix, voyons, mezette; je t’ai conduite à ton valentin (galant), faut être reconnaissante.
Et la jeune femme, toute honteuse, n’osa plus hasarder aucune objection. L’idiot montrait encore plus d’avidité. On eût dit qu’il satisfaisait une faim longtemps inassouvie. La mère Louis prenait plaisir à cette voracité que rien ne pouvait rassasier.
—Va, va, grand Jodane, disait-elle en chargeant l’assiette de l’idiot, le voisin ne regarde pas à son commentage (vivres), faut t’en donner à mort. Ce grec de mière l’aura fait jeûner par économie et il aura pris sa faim pour une maladie. Encore un coup, grand Jodane; justement la bouteille est débouchée; mais, comme on dit, à bon bère n’y a pas besoin de bouchon.
A tout cela de Gausson et Honorine répondaient peu de chose. Heureux de se trouver l’un vis-à-vis de l’autre à la même table, ils jouissaient silencieusement de leur joie. Mais enfin, le repas fini, Marcel proposa de visiter avant de repartir, ce qu’il appelait en souriant son domaine.
—J’ai fait labourer quelques pieds de terre près de la grande tour ruinée, dit-il, et j’y ai moi-même planté des fleurs. A défaut de dessert, je puis vous offrir un bouquet.
—Merci, dit la mère Louis, qui se sentait alourdie par le déjeuner; j’ai pas le cœur à marcher maintenant; montrez ça à la petite, qui aime les fleurs comme une avette (abeille).
Honorine voulut se défendre de quitter sa grand’mère; mais celle-ci l’y obligea.
—As-tu peur du voisin, dit-elle, fais donc pas la mijaurée comme ça, voyons! Y te mangera pas, M. Marcel. Va avec lui pendant que moi je ferai un somme.
La jeune femme ne pouvant refuser plus longtemps sans affectation, appela l’idiot, qui descendit avec elle.
De Gausson les conduisit à travers les ruines vers un petit plateau qui avait dû former autrefois une cour intérieure, et que ceignaient encore des restes de murailles. C’était là que se trouvait établi le parterre dont il venait de parler. Il y avait réuni une collection de plantes, si habilement choisies, que tout y semblait également fleuri; on y voyait des rhododendrons à feuilles lustrées, des chrysanthèmes de couleurs variées, des dalhias tardifs et des lauriers thyms à fleurs blanches ou lilas. Sur les vieux murs rampaient des chèvrefeuilles blancs mêlés aux roses du Bengale, et les plates-bandes étaient bordées de résédas et de violettes. A l’extrémité du plateau, sous l’arcade d’une porte en ruines, étaient posées deux ruches entourées de thym et de fenouil. Marcel y conduisit Honorine, qui s’arrêta à quelques pas, un peu effrayée par les bourdonnements des abeilles, suspendues en grappes à l’entrée de leurs cellules.
—Ne craignez rien, lui dit de Gausson en souriant, ce sont les amies de ma solitude, et nous nous connaissons. Vous voyez ce banc placé sous les ruches? C’est là que je viens tous les soirs attendre la nuit. Le bourdonnement des abeilles rentrant au logis me berce et me tient compagnie; c’est comme une musique champêtre qui donne plus de sérénité à mes rêveries. En fermant les yeux, j’arrive par instant adonner un corps à mes chimères. Je ne me crois plus seul ici; j’entends, de loin, une voix connue qui donne des ordres; il me semble que des pieds légers font crier le sable des allées; mon nom retentit prononcé à voix basse, je sens une main se poser sur mes cheveux!..... Alors, je rouvre vivement les yeux..... et je ne vois rien que mon donjon isolé, mon jardin désert et la nuit qui descend!... mais j’ai fait un doux rêve, et je le dois à mes abeilles. Honorine écoutait palpitante, n’osant répondre et cependant heureuse d’écouter. Marcel prit son silence pour un reproche.
—Mes confidences vous déplaisent, Honorine? dit-il en la prenant par la main.
—Non, répondit la jeune femme sans lever les yeux; mais... elles... me troublent... Je sens que j’ai tort de les écouter.
—Pourquoi cela? reprit doucement de Gausson; doutez-vous donc de la pureté de cet amour qui fait ma seule occupation depuis tant d’années? Ah! ne vous faites point de vains remords! La vie n’a-t-elle pas assez de ses réelles douleurs. Honorez-vous, honorez-moi par votre confiance. Tant que j’ai espéré pour vous le maintien d’une union désormais brisée, j’ai gardé le silence; mais aujourd’hui que nous nous restons seuls à nous-mêmes, ne repoussons pas les pures joies d’une affection consolante. Croyez en moi, Honorine, comme je crois en vous, avec simplicité et résolution. Nos existences peuvent rester séparées, mais regardez nos âmes comme fiancées et jouissez de leur union sans remords, puisqu’elle est sans honte.
L’accent de Marcel avait cette gravité pénétrante dont la jeune femme avait été si vivement émue la première fois qu’il lui parla à Bagatelle. Elle sentit ses tremblements s’apaiser et son bonheur raffermi prendre possession de lui-même. Levant un regard encore troublé, mais plein de tendresse vers Marcel:
—Ah! parlez ainsi, dit-elle doucement; vous me rassurez moi-même. Oui, vous avez raison, la règle qui guide les autres ne peut plus me conduire, hélas! Dieu doit avoir quelque indulgence pour les malheurs qu’on n’a point mérités, et il ne nous défend pas, sans doute, toute consolation. J’ai foi en vous, Marcel; soyez mon ami, mon conseiller; je mets notre amour à tous deux sous la garde de votre honneur.
Il ne répondit qu’en serrant contre sa poitrine le bras de la jeune femme qu’il avait posé sur le sien; il avait le cœur trop plein pour parler. Tous deux continuèrent quelque temps à parcourir les allées du parterre sans rien dire, tout entiers à l’enchantement de se voir, de se sentir, de s’entendre respirer. Mais sortant peu à peu de ce muet extase, la conversation reprit, entrecoupée d’abord, incertaine, sans suite, puis plus intime et plus suivie. Chacun laissa lire plus avant qu’il ne l’avait encore fait dans ses goûts, dans ses regrets, et cette confession mutuelle rapprochait insensiblement deux cœurs déjà l’un à l’autre. Chaque ressemblance constatée ajoutait un anneau à la chaîne sympathique qui les unissait. Les heures s’écoulèrent ainsi dans des ravissements toujours renouvelés, et ce fut seulement en voyant l’ombre de la tour s’allonger sur le parterre qu’Honorine se rappela qu’il fallait songer au retour.
—Vous reviendrez, demanda de Gausson, en retenant son bras contre sa poitrine palpitante; vous me le promettez?
—Je tâcherai, répondit la jeune femme, pour qui cette journée était la plus belle de sa vie entière.
Il prit ses deux mains qu’il tint longtemps pressées sur ses lèvres, puis remonta avec elle l’escalier du donjon. Mais, avant d’arriver à l’étage supérieur, tous deux furent frappés par des éclats de voix qui les firent tressaillir. On chantait une vieille bacchanale du Bessin:
—Dieu! c’est ma grand’mère, s’écria Honorine qui s’arrêta saisie. La voix continua.
Pendant que ce couplet s’achevait, la jeune femme et son conducteur avaient atteint la porte du dernier étage; ils la poussèrent vivement. La mère Louis, qui était assise devant la table et qui tenait un verre plein à la main, se retourna.
—Eh! arrivez donc, mes tourtereaux, s’écrie-t-elle, sans quoi y aura plus rien dans la bouteille.
—Grand Dieu! ma mère, que faites-vous? s’écria Honorine, en courant à la paysanne et voulant lui retirer son verre.
—Eh ben! veux-tu laisser! balbutia la vieille femme avec un hoquet d’ivresse... Mille millions! ne touche pas à ma vinée, je veux boire!
Houp! avalons..... Le v’là dedans comme frère Jean.
Honorine joignit les mains avec une exclamation de douleur; de Gausson paraissait sérieusement embarrassé.
—Il est impossible d’emmener madame Louis maintenant, dit-il enfin; vous pourriez rencontrer quelqu’un... puis, pour traverser Trévières...
—Mon Dieu! que faire! s’écria Honorine les larmes aux yeux.
—Attendre encore. Quand la nuit sera venue, vous partirez. D’ici là, madame Louis aura eu le temps de se remettre; et, dans tous les cas, vous ne serez point vues.
—C’est sa maladie qui a amené ces fatales habitudes! dit Honorine en enlevant rapidement tout ce qui se trouvait sur la table. Pourvu que son mal ne soit point aggravé!... Ah! j’aurais dû veiller... ne pas descendre!
Elle fut interrompue par la fermière, qui redemandait à grands cris la bouteille, et qui, sur le refus de sa petite-fille et de Marcel, se livra à un accès d’indignation furieuse.
—Ah! c’est comme ça que tu traites ceux qui viennent te voir! cria-t-elle à de Gausson; tu leur regrettes ta piscantine (piquetton)! Eh ben! tu ne verras plus la mezette; je te défends d’être son valentin, entends-tu? et je t’avertis que je ne l’amènerai plus dans ta cranière (masure), failli halabre (garnement)... Parisien ruiné... T’as beau faire ton air grichu (mécontent), tu seras jamais qu’un Iroquois... et je me moque de toi... comme de la police de Bayeux!...
Honorine avait en vain essayé d’arrêter ce torrent d’injures. Appuyée sur l’épaule de la vieille paysanne, elle avait en vain posé la main sur ses lèvres avec des supplications et des larmes; la mère Louis avait, selon l’expression normande, un vin de lansquenet; elle continua ses imprécations jusqu’à ce que la vue de l’idiot eût donné à ses idées une autre direction. Elle appela le grand Jodane, lui fit boire ce qui restait dans son verre et recommença à lui chanter des bacchanales et des branles villageois. Ces vieux couplets dont la naïveté ne rachète pas toujours les gravelures, causaient à Honorine un embarras que de Gausson voulut soulager en se retirant. Il ne revint qu’à la tombée du jour et pour annoncer à la jeune femme que le char-à-bancs était attelé. Il eût voulu les reconduire lui-même, mais la mère Louis déclara qu’elle ne partirait pas avec un grec qui lui avait ôté le verre des lèvres, et il fallut céder.
Honorine, humiliée de la triste fin d’une journée d’abord si charmante, serra la main de Marcel et reprit tristement la route des Motteux. Par malheur, l’ivresse de la mère Louis, loin de se dissiper, semblait prendre un caractère plus bruyant et plus fâcheux; exaltée par la fièvre, elle tournait au délire. La vieille femme continuait à chanter et à parler haut, en s’interrompant tout à coup pour pousser des plaintes sourdes ou recommencer des imprécations contre tous ceux dont elle avait eu à se plaindre récemment ou autrefois. C’était tantôt de Gausson, tantôt son gendre, tantôt Romain. Tous les efforts d’Honorine, pour calmer cette exaltation, avaient été inutiles, et maintenant elle ne songeait qu’à gagner la ferme le plus tôt possible. Elle aperçut enfin les toits crevassés du château, traversa Trévières et arriva à la porte de la grande cour. Françoise les y attendait et courut à leur rencontre.
—Ah! vous voilà enfin! s’écria-t-elle d’une voix altérée; je languissais d’inquiétude; il ne vous est rien arrivé au moins?
—A boire! la Parisienne, cria la mère Louis d’une voix rauque; j’ai la falle (estomac) pleine de charbons ardents.
—Grand Dieu! est-ce que vous êtes malade? demanda la grisette.
—Non, interrompit Honorine, en rejetant les rênes sur le cou de la Caillie; aidez-moi à la descendre et ne dites rien à personne.
Françoise comprit, et aida la jeune femme qui fit le tour pour ne point traverser la grande pièce du rez-de-chaussée où tout le monde se trouvait, conduisit la mère Louis à sa chambre et l’obligea à se mettre au lit. La grisette avait averti un des garçons de remiser le char-à-bancs en se contentant de répondre à ses questions que les dames étaient rentrées fatiguées de leur promenade et désiraient du repos. Elle rejoignit ensuite Honorine demeurée près du lit de sa grand’mère. Cette espèce de mystère éveilla nécessairement la curiosité de la ferme. On avait cru entendre la mère Louis parler à haute voix; on continuait à marcher dans sa chambre et Françoise ne redescendait pas: une des servantes voulut savoir ce qui se passait et monta sous prétexte d’offrir ses services, mais Honorine qui craignait de laisser voir sa grand’mère dans l’état honteux où elle se trouvait, la remercia sans lui ouvrir, et elle descendit sans avoir entendu autre chose que les plaintes de la fermière qui demandait à boire. Il était évident qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire que la dame de Paris voulait cacher. On essaya d’interroger l’idiot, mais il ne put donner aucun renseignement. Anselme Micou consulté à son tour ne répondit rien sinon que l’on était dans le treizième automne, l’année du malheur des Motteux. Il fallut donc se retirer sans en savoir davantage.
Mais le lendemain, en se levant, les valets apprirent que l’on avait envoyé chercher M. Vorel et que leur vieille maîtresse se trouvait dans un état alarmant. La nuit avait été terrible pour Honorine et Françoise. A l’ivresse de la mère Louis avait succédé une exaltation fébrile que rien n’avait pu apaiser: elle voulait se lever, visiter ses voisins, faire bandours et bobans (réjouissance et bonne chère); c’était enfin un délire d’épicuréisme dont les deux jeunes femmes avaient été d’autant plus effrayées qu’il semblait plus contraire à toutes les habitudes de la vieille paysanne. Elles ne savaient point encore que ce qui leur semblait du délire n’était que l’expansion de goûts longtemps contenus. Car, nous en avons déjà fait ailleurs la remarque, si la maladie dénature parfois les instincts, souvent aussi elle les affranchit et relève tout à coup un caractère ignoré des autres et de nous-mêmes. Une vie laborieuse avait pu comprimer les penchants sensuels de la mère Louis, mais sans les éteindre; cette nature, sobre par économie, avait conservé toute son avidité inassouvie. En sentant la vie lui échapper, elle se retournait avec une sorte de fureur vers ces plaisirs dont elle s’était sevrée et qu’elle ne pouvait plus ajourner. Chose étrange à dire et pourtant ordinaire, tous les désirs se réveillaient chez la fermière des Motteux au moment où la maladie la rendait impuissante à les satisfaire! Elle regrettait le temps perdu, les joies oubliées: comme ces affamés auxquels il ne reste plus que quelques instants pour assouvir leur faim, elle eût voulu ressaisir à la fois tout cet arriéré de jouissances.
Telle était même l’énergie de cette sensation qu’elle lui avait fait oublier ses inquiétudes avaricieuses; elle demandait que tout fût en fête aux Motteux, qu’on adressât des invitations, que l’on préparât ce qu’il fallait pour recevoir des convives; elle voulait s’amuser une fois en sa vie. Sa jeunesse lui revenait, et elle la recevait comme l’enfant prodigue en tuant le veau gras! Triste et tardif retour à des goûts toujours réprimés mais jamais vaincus! Vorel la trouva dans ce paroxysme de prodigalité. A la vue du médecin, elle voulut que l’on apportât une bouteille de poiré bouchée pour trinquer avec lui, et elle lui déclara qu’il fallait la guérir tout de suite, parce qu’elle était décidée à prendre du bon temps.
—Après tout, on ne vit qu’une fois, dit-elle; il n’y a pas besoin d’être milsondier (millionnaire) pour manger des fallues (gâteau). J’ai assez travaillé à c’ t’heure et je veux un peu rire avant d’être cousue dans le drap.
Vorel parut surpris du changement opéré chez la vieille femme, mais il lui répondit conformément à ses souhaits. Il demeura longtemps près de son lit, l’interrogeant, l’observant et semblant réfléchir. Enfin il prescrivit quelques soins à donner, accorda à la malade presque tout ce qu’elle demanda et promit de revenir. Il revint, en effet, le soir, puis les jours suivants, et se montra encore moins sévère. Les désirs de la mère Louis semblaient être sa seule règle; il trouvait toujours quelque motif pour y céder. Honorine qui voyait le funeste résultat de ces concessions, s’efforçait de les combattre; mais Vorel appuyait alors la malade qui, forte de cette approbation, s’emportait contre sa petite-fille et l’accusait de tyrannie. Il résulta, au bout de quelque temps, de cette conduite différente, un déplacement d’affection. La mère Louis reporta sur Vorel une partie de l’amitié qu’elle avait eue pour Honorine et sur Honorine l’aversion qu’elle avait eue contre Vorel. Celui-ci s’en aperçut et redoubla de complaisances. Loin de réprimer les dangereux caprices de la malade, il les excitait; il cherchait lui-même ce qui pouvait flatter ses goûts sans s’inquiéter des suites; on eût dit qu’il poursuivait le double but de lui plaire et de hâter, chez elle, les progrès du mal.
Honorine, au contraire, bien qu’elle s’aperçût du mauvais effet de ses oppositions, y persistait par conscience et par attachement. Il en résulta une aigreur toujours croissante de la part de la mère Louis qui se remit à l’appeler la dame de Paris. Elle lui retira les comptes pour les confier de nouveau au médecin. Une vente heureuse conclue par ce dernier acheva de le rétablir dans l’amitié de la vieille paysanne. Vorel venait chaque soir faire une partie de brisque près de son lit, en mangeant une rôtie arrosée de poiré. Il lui parlait des travaux de la ferme, lui racontait les commérages de Trévières, et trouvait moyen de flatter ses vanités et ses manies. Aussi la vieille femme proclamait-elle le médecin le roi des bons gars.
Cependant les progrès de la maladie étaient chaque jour plus visibles; la mère Louis ne sortait plus de sa douloureuse torpeur que pour prendre des repas, infailliblement suivis d’une surexcitation fiévreuse qu’exaltait encore la tisane de Marin-Onfroy. Son dépérissement frappait tous les gens de la ferme sans qu’ils en devinassent la cause. Anselme Micou seul secouait la tête quand on s’en étonnait.
—C’est la treizième année! répétait-il toujours; vous voyez que mam’ Louis a beau manger et boire du chenu; rien ne lui profite; il y a sur elle un mauvais sort.
Ce mauvais sort, c’était le médecin. Il avait hâte d’en finir avec une existence qui exposait l’héritage espéré; mais, en précipitant sa fin, il eût voulu reconquérir ses anciens avantages, et arracher à Honorine le droit de lui disputer une part dans les dépouilles de sa victime. Il eut en conséquence recours à toutes les ruses, à toutes les insinuations. Ses entretiens de chaque jour devinrent comme autant de fils pour tisser la trame dans laquelle il voulait prendre l’esprit de la malade. Celle-ci se débattait en vain et se dégageait avec efforts des nœuds qui l’enveloppaient. Vorel recommençait la chaîne brisée avec cette ténacité patiente des volontés qui se cachent. Il détachait insensiblement du cœur de la vieille les souvenirs qui lui recommandaient encore Honorine; il multipliait entre elle et cette dernière les occasions de lutte; puis il la plaignait doucement de ce ton de pitié réservée qui irrite les âmes emportées. Enfin, quand il crut avoir suffisamment préparé la vieille femme, il se décida à frapper un grand coup. Le hasard sembla pour cela venir à son aide.
Un soir que la malade était plus abattue que d’habitude, Honorine voulut essayer quelques nouvelles représentations; mais la souffrance avait mal préparé la mère Louis à la soumission; elle répondit aux conseils de sa petite-fille par des emportements, et enfin lui ordonna de sortir. Honorine, craignant d’augmenter son irritation en prolongeant le débat, se retira les larmes aux yeux. Son départ n’apaisa point la malade; elle continua à se plaindre amèrement des persécutions de la dame de Paris, qui prétendait la gouverner à sa guise.
—V’là comme c’est reconnaissant! ajouta-t-elle en frappant de son poing sur le lit; ça commence par vous demander un pauv’coin par charité, et quand vous l’y avez donné, ça veut toute la maison. Ah! mais non, mais non! j’suis pas encore tombée en enfance, j’suis trop cœurue pour qu’on me marche sur la tête... Faudra en finir, et plus vite que ça.
Vorel s’efforça de l’apaiser, mais en termes qui eurent pour résultat d’allumer plus vivement sa colère. Enfin, il lui fit observer, d’un ton peiné que, si un pareil état de chose se prolongeait, il était à craindre que l’incompatibilité des caractères ne nécessitât, quelque jour, une rupture fâcheuse. Tout cela était dit avec des circonlocutions et des pauses qui ne pouvaient qu’exalter l’impatience emportée de la mère Louis; aussi déclara-t-elle, en l’interrompant, que ce jour-là était venu, qu’elle voulait être la maîtresse à la ferme, et qu’elle était décidée à prier la dame de Paris de chercher un autre gîte. Le médecin objecta la difficulté d’une pareille séparation et l’espèce de droit acquis par Honorine de rester aux Motteux... qu’elle pouvait regarder comme sa propriété future! A ce dernier mot la mère Louis fit un bond.
—Sa propriété, répéta-t-elle; c’est-à-dire qu’elle me croit déjà morte! Ah! c’est pour ça qu’elle veut tout faire de son esto (mouvement) et que je suis comme un second manche à une cognée? Eh ben, j’connais le moyen de lui ôter son idée; pas plus tard que demain, mon mière, vous amènerez ici le notaire. J’veux lui chanter une chanson, et quand elle sera sur du timbré, on verra si la Parisienne est aussi glorieuse.
Vorel affecta de ne point prendre au sérieux la recommandation de sa belle-mère afin de la faire insister, et, après une résistance destinée à la raffermir dans son projet, il promit de remplir ses intentions. Anselme Micou entra dans ce moment en avertissant que le boucher d’Isigny venait d’arriver, et le médecin descendit afin de traiter avec lui pour la vente d’un certain nombre de moutons.
La fermière retint le vieux berger et lui adressa plusieurs questions sur le troupeau et sur la culture. Mais sa récente colère l’avait mise dans une agitation qui l’empêchait de bien suivre les réponses d’Anselme.
—Cette malheureuse m’a fait ensangmêler, dit-elle; je sais plus ce que je dis, ni ce que j’entends... Dis donc, grand Jodane, es-tu là?
L’idiot, qui se tenait assis près de la fenêtre, releva la tête.
—Viens ici, reprit la fermière, en tirant une clef de dessous son oreiller, ouvre la grande armoire... bon... Maintenant regarde derrière la pile de draps, y doit avoir une bouteille de cassis. C’est ça, apporte ici; mais prends bien garde... donne-moi ma clef... et les verres qui sont sur la cheminée. A vous, père Micou, c’est du doux!
Elle avait versé dans deux verres; elle en prit un, le vieux berger prit l’autre et but à la santé de sa maîtresse. L’idiot les regardait.
—Et moi... moi... bégaya-t-il d’un ton avide et pleureur.
—Toi, répéta la mère Louis, ah! liqueréi (friand)! Eh ben, approche.
L’idiot avança un verre, but une gorgée de la liqueur et fit entendre un grognement de joie.
—Dirait-on pas que c’est le lait de sa mère, reprit la paysanne, qui s’amusait de l’avidité du grand Jodane; après ça, y n’a pas d’autre plaisir! encore un coup, vieu’ Anselme.
Le berger tendit son verre et but à la santé de sa maîtresse.
—Ah! oui, la santé, reprit madame Louis en avalant par gorgées. Ce serait la plus grande fortune pour moi à c’t’heure! Si seulement j’pouvais sortir, faire quéq’ visites chez les voisins!
—Y en a un qu’est venu tout à l’heure à la ferme, fit observer le berger.
—Qui ça donc?
—Le monsieur de Vertbec.
—Ah! le grand brun!
—Y voulait savoir si Madame était toujours aussi malade.
—Moi! ah ben oui! y venait pour la Parisienne; y s’cherchent comme la paille et le vent.
—Faut pas s’étonner, après l’service que le Monsieur a rendu à notre jeune maîtresse, dit Micou; sans lui, elle aurait maintenant une robe de terre.
—Oui, oui, reprit la mère Louis, en posant son verre près d’elle; mais à c’t’heure, c’est moi qui ai eu le malheur! sans cette nuit-là, j’serais encore sur mes pieds.
Micou prononça quelques paroles d’encouragement, et prit congé de la fermière. Mais celle-ci, dont les idées venaient de prendre un nouveau cours, continua à parler seule et à demi-voix.
—C’est tout de même quéqu’chose de mirou (étonnant), murmura-t-elle, qu’on n’ait jamais pu deviner pourquoi qu’on avait voulu egohiner (égorger) la mezette, et qu’est-ce qui avait fait le coup... Ça m’a toujours tourné le sang, moi.
Elle demeura la tête baissée sur sa poitrine, roulant avec distraction le coin de son drap de toile à demi-rousse. La nuit était venue, et la faible lueur qui éclairait encore la chambre pénétrait à peine jusqu’à l’alcôve. L’idiot, dont l’avidité était éveillée, et qui n’avait point détourné les yeux de la liqueur placée près de la malade, se glissa, en rampant, jusqu’à la bouteille, qu’il saisit, et dont il porta le goulot à ses lèvres. La mère Louis, tout entière aux souvenirs que le vieux venait de réveiller en elle, n’y prit point garde. Ce succès encouragea le grand Jodane à recommencer, jusqu’à ce que l’effet de la liqueur se fît sentir: son sang commença à circuler plus rapidement; une rougeur inaccoutumée colora son visage blafard; ses yeux devinrent plus brillants, sa pensée plus active, et il se mit à chantonner à demi-voix. La paysanne retourna la tête et aperçut la bouteille qu’il tenait à deux mains avec une expression de gaieté tendre.
—Eh ben! qu’est-ce que tu fais là, failli gouras (gourmand), s’écria-t-elle en avançant la main pour reprendre la liqueur; veux-tu bien me rendre mon bère (boisson)!
L’idiot recula avec le grognement d’un dogue auquel on veut enlever sa proie.
—Encore... boire, bégaya-t-il, encore!
—Ah! méchant halabre, si je vais à toi... Laisseras-tu cette bouteille?
Le grand Jodane se réfugia à l’autre extrémité de la chambre et reporta le goulot à ses lèvres. La fermière, indignée, voulut se lever pour aller à lui; mais elle sentit les forces lui manquer. Henri, qui s’était arrêté, éclata de rire en voyant son impuissance.
—Elle peut pas, la hanne (vieille femme), dit-il, enhardi par une demi-ivresse... Ah! ah! ah! j’ai pas peur de ses griches.
La mère Louis lui montra les deux poings.
—Ah! si je te tenais! s’écria-t-elle.... et dire qu’on me laisse seule!... Eh! mezette... Madame Honorine! Attends, attends, va, méchant Gauplumé, la dame de Paris va venir!
—Ça m’est égal, dit l’idiot, la dame de Paris n’est pas gavaste (brutale) comme vous.
—Elle appellera ton père.
—Il est parti, dit l’idiot avec ce geste de bravade des esclaves qui savent que leur maître ne peut les entendre.
—Il reviendra avec une branche de fesselaron (houx).
—Il est parti, répéta Henri qui but une nouvelle gorgée.
Et il se mit à chanter.
—Ah! maudit gogaile (imbécile), reprit la paysanne, je te ferai mettre au pain et à l’eau.
Il chanta plus fort.
—Tu seras matrasé (assommé).
L’idiot but un nouveau coup et dansa. La mère Louis frappa la muraille et appela encore Honorine; mais se rappelant tout à coup les craintes superstitieuses de l’idiot elle se retourna vers lui et reprit:
—Tu ne veux pas laisser la bouteille?
—Non, murmura Henri.
—Eh bien! je vais appeler les huards (lutins).
L’idiot parut inquiet.
—Ils vont venir avec le grand Varou pour t’emporter!
Il se rapprocha de l’alcôve.
—Je n’ai qu’à faire un signe, continua la fermière, et ils te prendront comme ils ont pris ta cousine pour la jeter dans le petit tourbillon.
La première menace de la fermière avait évidemment effrayé l’idiot, mais l’exemple ajouté pour l’effrayer davantage produisit un effet contraire. Il laissa échapper un de ces éclats de rire vagues et saccadés qui lui étaient ordinaires.
—Ce n’est pas le Varou qui a emporté ma cousine, reprit-il d’un air de confiance.... Ils étaient deux hommes.
La fermière tressaillit et se rappela l’indication déjà donnée par l’idiot, le jour même du crime.
—Deux hommes! répéta-t-elle étonnée de cette persistance de souvenir... tu es sûr de les avoir vus?
—Dans le jardin... ils ont dit:—Tout est fini. Et alors le mière les a payés.
—Comment! Qu’est-ce que tu dis? Ton père?
—Oui.... alors il ont voulu avoir plus.... parce qu’il serait seul à hériter!
La mère Louis ne put retenir un geste de saisissement. Ces mots de Henri venaient de faire passer devant ses yeux une horrible lumière; elle se redressa sur son séant, se pencha vers l’idiot, et baissant la voix:
—Rappelle-toi bien, reprit-elle vivement, et je te laisserai boire tant que tu voudras. Ces hommes ont dit à ton père que maintenant il hériterait seul. Voyons, et après il faut ne rien oublier, mon Jodane.
—Après, répéta l’idiot, chez qui le souvenir était si vivement réveillé qu’il semblait voir et entendre ce qu’on lui rappelait; après il a dit:—Non... et ils ont repris:—Il n’y a plus qu’à en finir avec la grand’mère.
—Et lui, demanda la mère Louis palpitante, qu’est-ce qu’il a répondu?
—Il a répondu tout bas... On est venu sonner à la porte, et les deux hommes se sont sauvés.... Mais ce sont pas des huards.... aussi, j’ai pas peur.
Et pour le prouver il acheva la bouteille d’un seul trait. Au même instant le bruit d’un pas qui se dissimulait fit craquer le plancher. La mère Louis releva la tête et vit une ombre passer sur les rideaux à demi fermés de l’alcôve.
—Qui est-là? cria-t-elle.
On ne lui fit aucune réponse, et l’ombre et le bruit s’éloignèrent. Elle poussa un cri d’épouvante auquel accourut Honorine, qui venait d’entrer dans la chambre voisine.
—Il y a quelqu’un dans le corridor! dit précipitamment la mère Louis.
La jeune femme y regarda, et répondit qu’elle ne voyait personne.
—Demande de la lumière et cherche partout, reprit la fermière, je suis sûre d’avoir entendu marcher; je veux savoir qui est-ce qui nous écoutait.
Honorine appela Françoise, qui arriva avec une puette (chandelle de résine), mais toutes leurs recherches furent inutiles. La mère Louis demeura tremblante. La révélation de l’idiot l’avait bouleversée. Au milieu de toutes ses variations de conduite, il y avait en elle, contre Vorel, une répugnance instinctive qui se taisait par instants, mais que la première occasion faisait renaître. Circonvenue par le médecin, lorsqu’elle revenait à lui c’était le fait de la fascination bien plus que de la sympathie; elle se laissait prendre, elle ne se livrait pas, et, au milieu de ses abandons les plus entiers, elle conservait une sourde défiance. Aussi, la confidence de Henri éveilla-t-elle dans son esprit moins d’incrédulité que de soupçons: mise sur la voie, elle donna libre carrière à son imagination; elle rapprocha des circonstances, se rappela des détails, et plus l’examen avançait, plus les preuves devenaient évidentes et multipliées! Honorine, frappée du trouble dans lequel elle avait retrouvé la malade, essaya de l’interroger; mais la mère Louis ne répondit que par des phrases inintelligibles. Elle répétait que, pour l’honneur de la famille, il ne fallait rien dire, qu’elle voulait d’abord s’assurer de la vérité; que le lendemain, le notaire devait venir et qu’il connaîtrait son projet! Elle ne s’expliqua point davantage; encore tout cela était-il entrecoupé de plaintes, d’imprécations, de marques de pitié pour la jeune femme. Celle-ci regarda l’exaltation de sa grand’mère comme du délire, elle allait faire chercher Vorel lorsqu’il arriva. A sa vue, la mère Louis poussa une exclamation de terreur et se rejeta dans la ruelle du lit.
—N’approchez pas, s’écria-t-elle, je n’vous ai pas demandé; j’ai besoin de rien.
Le médecin parut surpris et s’arrêta devant l’alcôve.
—Vous souffrez davantage ce soir? demanda-t-il d’un air paterne.
—Je ne souffre pas! interrompit la fermière; demain je serai bien... et je m’informerai... je saurai... enfin, je m’entends... le moment d’hériter n’est pas encore venu... ni celui d’hériter seul, non!... Tenez... ne me faites pas causer... Allez-vous en, mon gendre, ça vaudra mieux, allez-vous-en.
—Je crois, en effet, qu’il serait dangereux pour vous de trop parler, dit Vorel sérieusement; tâchez de vous calmer; je reviendrai... plus tard.
—Mais n’y a-t-il rien à faire? demanda Honorine visiblement inquiète.
—Je ne ferai rien; je ne veux point de ses remèdes! interrompit précipitamment la mère Louis. Qu’y s’en aille, le malheureux! c’est le notaire que je veux voir.
Honorine voulut insister; Vorel lui imposa silence de la main; il regarda fixement la malade, dont le visage était enflammé, jeta un coup d’œil autour de la chambre pour chercher l’idiot, et, ne l’apercevant point, sortit en faisant signe à la jeune femme. Celle-ci se hâta de le suivre.
—Ma grand’mère a le délire, dit-elle avec agitation.
—Il est impossible de s’y tromper, répondit le médecin, dans l’accent duquel il y avait un peu de trouble; nous touchons au moment d’une crise qui peut être heureuse ou fatale.
—Et ne peut-on rien faire pour qu’elle soit favorable?
—On peut beaucoup; mais, vous l’avez entendue déclarer qu’elle ne voulait aucun remède venant de moi.
—Je parviendrai peut-être à lui persuader...
—Ne l’espérez pas: combattre sa manie ne servirait qu’à l’y raffermir.
—Mon Dieu! de quelle manière s’y prendre, alors?
—Je ne sais; peut-être, avec de l’adresse, réussirait-on à lui donner le change.
—Comment?
—En mêlant le remède aux boissons qu’elle préfère.
—Ah! vous avez raison; c’est le plus sûr moyen.
—Malheureusement, je me trouve pris au dépourvu, et il faudra envoyer à la pharmacie la plus voisine.
—Chez M. Duclerc. Voici ce qu’il faut pour écrire.
—Pardon; M. Duclerc me garde rancune, sous prétexte que je lui fais concurrence. Un billet de vous serait mieux reçu.
—Soit.
Elle prit la plume et écrivit sous la dictée de Vorel, qui lui donna toutes les instructions nécessaires sur l’emploi du remède demandé; il l’engagea seulement à l’envoyer chercher par quelqu’un de sûr, en lui faisant observer que la moindre indiscrétion mettrait la grand-mère sur ses gardes et les empêcherait d’employer une seconde fois le même subterfuge. Ayant ensuite cherché de nouveau le grand Jodane sans le trouver, il reprit la route du manoir, persuadé que l’idiot l’y avait précédé. La jeune femme courut jusque chez Françoise, lui remit le papier adressé à M. Duclerc en l’avertissant de ne rien dire à la ferme et revint à la hâte près de la malade.
L’exaltation de celle-ci ne faisait que grandir; son langage devenait de plus en plus incohérent et entrecoupé. Elle multipliait des questions dont Honorine ne pouvait comprendre le but, et réclamait le notaire avec tant de persistance que, malgré les recommandations de M. Vorel, la jeune femme se décida à envoyer chez lui, pour la tranquilliser. Sur ces entrefaites, Françoise revint avec le remède demandé. M. Duclerc avait d’abord fait quelques difficultés pour le lui livrer; mais ayant heureusement reconnu la main d’Honorine, qui avait eu occasion de lui écrire, au nom de sa grand’mère, il s’était décidé sur l’assurance que tout se faisait sous la surveillance du médecin. La jeune femme se hâta de suivre les prescriptions de ce dernier: elle mêla le médicament au vin que la malade venait de faire demander et le lui présenta. La mère Louis but une gorgée, posa le verre à portée de sa main et referma les yeux.
Depuis quelques instants, son agitation avait fait place à une torpeur fiévreuse. Honorine craignant de la fatiguer allait écarter la lumière et refermer les rideaux, lorsqu’elle aperçut l’idiot accroupi dans un coin de l’alcôve, et qui épiait ses mouvements. Elle lui fit signe de se lever pour la suivre, mais il répondit par un grognement de refus. Craignant d’engager un débat dont le bruit eût troublé le repos de la malade, elle se décida à le laisser où il se trouvait et à passer, avec la lumière, dans la chambre voisine. Dans ce moment arriva le notaire qui avait été demandé. Elle lui annonça que sa grand’mère venait de s’endormir, et l’engagea à revenir le lendemain.
Tous ces détails avaient pris plus de temps que nous n’avons pu leur donner d’espace dans notre récit. La nuit était déjà avancée et la fatigue commençait à se faire sentir à Honorine. Elle s’assit près de la fenêtre, les yeux fixés sur cet abîme sombre de la nuit, au fond duquel brillaient à peine quelques étoiles qui semblaient vaciller dans les nuages comme les feux de vaisseaux ballottés par la mer. Elle essaya d’abord de lutter contre la fascination endormeuse de cet aspect; elle pencha l’oreille vers l’alcôve pour guetter la moindre plainte ou le plus léger appel; mais tout était silencieux. Au dehors, on n’entendait que le frissonnement de la brise sur les vitres, au dedans que la respiration affaiblie de la mère Louis. Les paupières d’Honorine s’abaissèrent malgré tous ses efforts; elle flotta quelque temps entre la veille et le sommeil, puis sa tête s’affaissa sur sa poitrine et elle s’endormit. Mais son âme, en sortant de l’empire du réel pour entrer dans celui des songes, sembla déposer sur la limite toutes les tristes images du passé. Il lui sembla qu’elle recommençait à vivre, non plus orpheline, mais protégée par sa mère, qu’elle voyait jeune et souriante, comme dans le portrait qui lui avait conservé ses traits. Elle se tenait aux pieds de cette douce protectrice qui berçait sa tête sur ses genoux et passait la main dans ses cheveux, tandis qu’un peu plus loin Marcel, debout et souriant, les regardait! Elle entendait sa voix et celle de sa mère résonner à son oreille comme une musique, et toutes deux arrangeaient son avenir sans qu’elle eût besoin de rien dire, car leurs yeux lisaient dans son âme comme dans un livre ouvert. Puis, une nuit passait sur ce tableau et elle se retrouvait près du jeune homme un bras sur son épaule, une joue sur ses cheveux, écoutant la baronne qui lisait des vers à quelques pas, et ce qu’elle lisait était une traduction fidèle de ce qu’ils sentaient tous deux. Ici le songe redevenait confus. Ce n’était plus qu’une succession d’images tendres, charmantes et à peine saisies, une sorte de revue de tous ces rêves de jeunesse auxquels manque une forme, un nom, et que la pensée suit comme l’œil suit le nuage. Cependant, au milieu de ce chaos de douces visions, flottaient toujours deux fantômes, sa mère et de Gausson! Elle les tenait chacun d’une main, et marchait avec eux emportée dans un tourbillon d’ivresse sereine. Leurs noms erraient sur ses lèvres; elle écoutait le sien que leurs voix tendres semblaient se renvoyer.
Mais tout à coup ces voix changèrent; elle n’en entendit plus qu’une inquiète, haletante, et ce n’était pas la même, c’était la voix de Françoise! Elle se débattit contre cette espèce d’hallucination, jusqu’à ce que les efforts de la lutte l’eussent arrachée au sommeil. Elle ouvrit les yeux, il faisait grand jour, et la grisette penchée sur elle l’appelait.
—C’est bien, Françoise! répéta-t-elle en s’efforçant de se reconnaître.
—Réveillez-vous, réveillez-vous, reprit la jeune fille oppressée.
—Ma grand’mère souffre-t-elle davantage? demanda Honorine.
—Non, elle dort, répliqua la fleuriste, mais quelqu’un vient d’arriver et veut vous parler.
—Quelqu’un?
—M. Marc.
—Ciel! il est ici?
—Ce matin, au point du jour, il est venu frapper à ma porte avec M. de Gausson.
—Et il veut me parler?
—Sans retard; il s’agit d’un avertissement important.
—Où est-il?
—Chez moi; il vous attend; personne n’est encore levé et vous pouvez sortir sans être vue.
—Mais ma grand’mère?
—Elle est tranquille; je veillerai, d’ailleurs, jusqu’à votre retour.
Honorine courut à l’alcôve et se pencha sur la malade qu’elle trouva enveloppée dans ses couvertures. Elle entendit le bruit d’une respiration faible et lente, mais sans oppression. Rassurée, elle jeta sur ses épaules un burnous de voyage, descendit légèrement, ouvrit la porte qui donnait sur la lisière des taillis et gagna la maisonnette de Françoise. De Gausson attendait sur le seuil de la cabane et vint vivement à la rencontre d’Honorine.
—Ah! Dieu soit loué! vous voilà, s’écria-t-il, je craignais que la maladie de madame Louis ne vous arrêtât.
—Elle repose, répliqua Honorine; on m’a dit que M. Marc me demandait?
—Entrez, on vous attend.
Elle franchit le seuil et aperçut le chouan qui s’était levé en attendant sa voix. Il avait la barbe longue, le visage pâle, les vêtements en lambeaux, et paraissait se soutenir avec peine.
—Grand Dieu! qu’avez-vous? s’écria la jeune femme qui s’arrêta saisie.
—Ne vous effrayez point... Ce n’est que de la fatigue, dit vivement de Gausson. Il marche depuis trois jours, après avoir réussi à s’échapper d’une maison de fous dans laquelle on l’avait enfermé.
—Lui! comment?
—Il vous racontera tout; mais permettez d’abord qu’il vous dise en peu de mots ce qui l’amène; car vous n’avez pas de temps à perdre. Je vais veiller à ce que l’on ne puisse vous interrompre.
Il montra un siége à Honorine et ressortit.
—M. de Gausson a raison, dit Marc, le temps est précieux. Je vous avertis de vous mettre sur vos gardes, car vous avez ici un ennemi.
—Moi! répondit Honorine étonnée.
—Un ennemi mortel qui espionne vos actions, surprend vos secrets, intercepte vos correspondances.
—En voici la preuve.
Il présentait à la jeune femme les deux lettres qui lui avaient été remises par madame Beauclerc. En reconnaissant son écriture et celle de Marcel, elle ne put retenir un cri d’étonnement. Marc lui raconta alors par quel concours de circonstances son mari, à qui ces lettres étaient adressées, ne les avait point lues, et comment elles se trouvaient entre ses mains. Il lui apprit ensuite de quelle manière il avait quitté Paris pour la prévenir, et quelles avaient été les suites de sa rencontre avec M. le marquis de Chanteaux.
Ce récit, souvent interrompu par les exclamations et par les questions d’Honorine, s’était prolongé assez de temps pour que Marcel crût devoir rentrer, mais le trouble de la jeune femme lui avait fait oublier, pour un instant, tout le reste, et Marc, instruit par de Gausson du meurtre auquel elle avait failli succomber, n’était pas moins préoccupé de deviner l’ennemi caché qui s’acharnait à sa perte. Tous trois cherchèrent longtemps en vain. Enfin, accablée par la pensée de cette haine qui la poursuivait dans l’ombre sans qu’elle l’eût méritée et sans qu’elle pût rien faire pour s’en défendre, Honorine avait appuyé sa tête sur une de ses mains et laissait couler silencieusement ses larmes. Elle était arrivée à l’un de ces moments où la multiplicité des coups qui nous frappent brise les restes de notre courage, où, lassés de combattre, nous appelons nous-mêmes la défaite pour finir la lutte. Rappelant avec amertume les souvenirs de tant de pièges tendus à son repos ou à son bonheur, de tant d’inimitiés dont elle avait en vain cherché la cause; de tant de chocs humiliants ou douloureux, elle se sentit subitement découragée de la vie. A quoi bon, en effet, prolonger cette épreuve renaissante, marcher sous cette épée de l’inconnu, dont la pointe effleurait toujours son front, s’acharner dans cette existence chère à un seul homme qui ne pouvait en jouir? Ces pensées s’entassaient sur son cœur comme les nuées sur le ciel, et tout y devenait de plus en plus sombre. Elle n’écoutait plus ni les questions de Marc, qui continuait ses recherches, ni les encouragements de de Gausson, triste de sa tristesse. Immobile à la même place, elle demeurait ensevelie dans son accablement lorsqu’un bruit de pas et des cris d’appel l’arrachèrent à sa douloureuse torpeur. C’étaient les voix d’Anselme Micou et de plusieurs autres, parmi lesquelles on entendait la voix de Françoise troublée et suppliante. Tout à coup la porte fut brusquement poussée et plusieurs gens de la ferme parurent à l’entrée.
—Vous voyez bien que la dame de Paris y est, dit le berger à Françoise d’un ton de reproche.
—Seulement, elle s’trouve pas seule, ajouta à demi-voix un des garçons.
Honorine s’était levée en tressaillant.
—Que me voulez-vous? demanda-t-elle troublée.
—Faites excuse, dit Anselme d’un ton grave et triste, mais on a besoin de madame à la ferme.
—La malade me demande?
—Non.
—Qu’est-ce donc alors?
Micou se découvrit, et, faisant le signe de la croix, il dit avec une simplicité émue et pieuse:
—La grand’mère vient de mourir!
Après le premier saisissement de douleur, Honorine avait suivi à la ferme ceux qui étaient venus la chercher. Elle voulut se rendre près de la morte où elle resta en prière jusqu’à l’arrivée de Vorel; il lui annonça la visite du juge de paix appelé pour remplir les formalités exigées par la loi et l’engagea doucement à se retirer. La jeune femme ne fit point de résistance. La présence des gens de la ferme, qui venaient témoigner successivement une douleur plus bruyante que profonde, l’avait jusqu’alors tenue dans une pénible oppression; elle sentait le besoin de se livrer seule et en liberté à son affliction. Elle déposa donc un dernier baiser sur les mains immobiles de sa grand’mère et courut s’enfermer dans sa chambre, où ses larmes purent couler sans contrainte. Ces larmes n’étaient que trop justifiées par la perte qu’elle venait de faire. Quelle que fût l’égoïste rudesse de celle qui lui était enlevée, elle n’avait point de plus sûre protection. La mère Louis l’avait aimée à sa manière, elle s’était parfois émue de son isolement, elle l’appelait d’un de ces noms familiers que rien ne remplace; c’était un anneau de famille qui se brisait, et, de fer ou d’or, il restait sans prix, car c’était le dernier! Puis la mort est un si puissant appel à la miséricorde! les défauts de l’être qu’on vient de perdre s’effacent si aisément dans notre souvenir! Émus de sa disparition, nous ne voulons nous rappeler que ce qui le rendait digne de notre attachement; nous formons un faisceau de tous ses mérites, nous dressons à sa mémoire un autel, et tout ce qu’il a pu nous faire souffrir est oublié. Dans les cœurs généreux, la moindre séparation éteint les ressentiments; mais pour les transformer en tendresses, il faut la grande absence, celle que nous savons sans espérance et sans retour!
Honorine passa plusieurs heures abandonnée à son affliction. La sincérité de ses regrets lui avait fait oublier les avertissements de Marc et tout le reste; elle ne songeait qu’à cette mort rapide qu’elle n’avait pu prévoir ni adoucir; elle se reprochait amèrement son absence dans un pareil instant; elle fondait en larmes à la pensée que sa grand’mère l’avait peut-être appelée au moment de fermer les yeux et ne l’avait point trouvée là! Elle était au plus fort de ses crises de regrets, lorsqu’on frappa à sa porte. C’était Françoise qui entra pâle, agitée, et referma vivement derrière elle. Honorine lui demanda la cause de ce trouble.
—Mon Dieu! je ne puis vous dire au juste de quoi il s’agit, répondit Françoise dont le regard se tourna vers la porte avec une sorte d’effroi; mais ils sont tous là dans la chambre de madame Louis... C’était d’abord M. Vorel et le juge de paix; puis on a envoyé chercher un autre médecin, puis M. Duclerc, le pharmacien; et enfin la plupart des gens de la ferme auxquels on a fait des questions... Moi-même on vient de m’interroger sur ce qui s’est passé depuis quelques jours.
—Et dans quel but?
—Je l’ignore! mais ils ont tous des figures... qui m’ont donné froid, et je ne sais pourquoi j’ai peur pour vous.
—Pour moi; que puis-je craindre?
—C’est qu’ils m’ont fait de si singulières demandes! et puis, quand on prononçait votre nom, tout le monde se regardait d’une manière... Soyez sûre qu’il se prépare quelque chose!... et, tenez, écoutez... on vient ici!...
Des pas venaient en effet de retentir dans le corridor, on s’arrêta devant la porte de la chambre et on frappa. Honorine alla ouvrir, c’était une des servantes de la ferme, accompagnée du greffier, qui venait la chercher. La jeune femme déjà saisie par les avertissements de Françoise, les suivit sans savoir ce qu’on voulait d’elle ni où on la conduisait. Ils la firent entrer dans la chambre mortuaire où toutes les personnes précédemment indiquées par la grisette se trouvaient réunies. A leur vue Honorine s’arrêta; le juge de paix l’invita par un signe à s’avancer, puis parla bas à Vorel et au pharmacien. Il y eut une courte pause. Les garçons et les servantes des Motteux se tenaient groupés à l’une des extrémités de la chambre et dirigeaient sur la jeune femme des regards étranges; celle-ci embarrassée de sa position, inquiète sans savoir pourquoi, jeta autour d’elle un coup d’œil rapide et tressaillit en apercevant la morte immobile au fond de l’alcôve. Son mouvement n’échappa point au juge de paix qui venait de se retourner.
—Cette vue vous trouble, Madame, dit-il, en indiquant du doigt le lit funèbre.
Honorine ne put répondre, ses pleurs avaient recommencé à couler malgré elle et étouffaient sa voix.
—Ce serait, sans doute, dans votre position, une douleur naturelle, reprit le juge, si vous n’aviez précédemment prouvé votre indifférence pour la malade, en l’abandonnant au dernier instant.
—Ah! ne me le rappelez point, Monsieur! s’écria la jeune femme, au milieu de ses sanglots; je me suis déjà fait plus de reproches que vous ne pourriez m’en adresser... si j’avais prévu... mais rien ne pouvait me faire craindre un malheur si prompt. Quelqu’un... me demandait...
—Quelqu’un, que madame n’a point l’habitude de faire attendre? ajouta le juge de paix avec intention.
La jeune femme rougit et voulut balbutier une réponse, mais il l’arrêta du geste.
—Nous reviendrons sur ce sujet, dit-il; pour le moment il s’agit d’autre chose. Veuillez reprendre votre sang-froid, Madame, et répondre clairement aux questions que je vais avoir l’honneur de vous adresser: elles ont pour vous une importance capitale.
A ces mots, il se retourna vers le greffier qui s’était assis près d’une table sur laquelle il se préparait à écrire; il lui fit, à demi-voix, quelques recommandations, et s’adressant de nouveau à Honorine, il lui demanda ses noms, prénoms, et la date de son arrivée aux Motteux. Elle fit à toutes ses demandes des réponses que le greffier inscrivit. Enfin le juge de paix, qui laissait un intervalle après chaque question afin de donner le temps d’écrire, arriva à l’interroger sur ses rapports avec la mère Louis. Honorine ne répondit que par des expressions de reconnaissance. Elle rappela avec attendrissement les marques d’affection qu’elle avait reçues de sa grand’mère à différentes reprises. Le juge fit un signe affirmatif.
—Nous savons, en effet, dit-il, que madame Louis a longtemps montré une préférence qui rendait votre volonté toute puissante aux Motteux; mais cette amitié n’avait-elle point faibli depuis quelque temps?
—Il se peut que la maladie y eût apporté quelque altération, répliqua Honorine qui ne faisait cet aveu qu’avec effort.
—Ainsi, vous convenez que votre grand’mère se montrait mécontente, irritée?
—Par suite de ses souffrances, Monsieur.
—N’avait-elle point même fini par ne vous garder près d’elle qu’à regret, et ne venait-elle pas de déclarer l’intention de vous frustrer de son héritage?
—Je l’ignore.
—Vous en êtes sûre?
—Monsieur, une pareille supposition...
—Doit d’autant moins vous surprendre, Madame, que vous avez hier renvoyé le notaire qui se présentait pour recevoir les dernières volontés de la mourante.
—Parce que je ne soupçonnais point la gravité de son mal, Monsieur, et que je craignais de troubler son sommeil!
—C’est effectivement la raison que vous avez alors donnée... On aura plus tard à l’apprécier! Passons maintenant à un autre ordre de faits. Vous avez écrit ce billet à M. Duclerc, ici présent?
—Il est vrai.
—Il vous a envoyé le médicament demandé?
—Sans doute.
—Et qu’en avez-vous fait?
—Je l’ai donné à la malade, Monsieur.
Le juge de paix redressa la tête.
—Ainsi, vous l’avouez, s’écria-t-il.
—Pourquoi le nierais-je, répliqua la jeune femme; j’ai fidèlement suivi l’ordonnance de M. Vorel.
Il y eut un grand mouvement parmi les spectateurs. Tous les yeux se tournèrent vers le médecin, qui avait fait un geste d’étonnement dont le naturel valait la plus énergique protestation.
—Moi! répéta-t-il en regardant Honorine, j’ai donné une ordonnance... Dans ce cas, madame de Luxeuil l’a conservée?
—Mais sans doute, dit Honorine; la voici.
—Quoi! ce billet de votre main...
—Je l’ai écrit sous votre dictée.
—Et vous en avez envoyé une copie à M. Duclerc...
—Sur votre recommandation.
Vorel se retourna vers le pharmacien.
—Vous ne m’accuserez plus d’empiéter sur vos attributions, Monsieur, dit-il avec une ironie affligée, vous voyez que je vous adresse des acheteurs.
—Ce serait la première fois, objecta aigrement le pharmacien.
—Je regrette que madame de Luxeuil n’ait pas trouvé d’explication plus vraisemblable, reprit Vorel d’un accent d’indignation triste qui émut les auditeurs. Je comprends maintenant son aveu. Désespérant de cacher les faits, elle a pensé qu’il suffirait de m’en attribuer la responsabilité. La manœuvre est ingénieuse, mais heureusement facile à déjouer. Je vois pourquoi mademoiselle Françoise vient de sortir tout à l’heure: elle a voulu avertir sa maîtresse de ce qui se passait, et lui donner le temps de préparer sa défense.
Le greffier déclara qu’il avait, en effet, trouvé la grisette chez Honorine. Vorel jeta au juge de paix un regard expressif, plia les épaules et poussa un soupir. Il était évident qu’il regardait une plus longue défense comme inutile. Tous les spectateurs partagèrent sans doute son opinion, car les regards se tournèrent de nouveau vers la jeune femme, comme si on eût attendu d’elle quelque explication plus vraisemblable. Elle demeura d’abord étourdie devant le médecin.
—Vous niez! s’écria-t-elle enfin, et pourquoi? Quel était ce breuvage?... Qu’est-il donc arrivé? Au nom de Dieu, répondez: que me reproche-t-on enfin?...
—Ah! vous comprenez qu’il s’agit d’un reproche? dit le juge avec un regard scrutateur.
—A quoi bon sans cela cet interrogatoire! reprit vivement Honorine; on m’accuse, mais de quoi? Ah! parlez, je le veux, Monsieur... Je vous en conjure à mains jointes.
Le juge garda un instant le silence, puis la regardant en face il dit lentement:
—Madame Louis, votre grand’mère, est morte empoisonnée!
Le cri poussé par Honorine fut si horrible qu’il fit tressaillir tous les spectateurs. Ce n’était ni une exclamation de surprise ni un gémissement de douleur; mais une de ces protestations sans nom qui sortent quelquefois du fond des entrailles et semblent résumer, dans une syllabe, tout ce que les langues humaines ne peuvent exprimer. Aussi lui fut-il impossible de rien ajouter. Après l’avoir poussé elle demeura droite, muette, les deux mains pressées l’une contre l’autre et les yeux immobiles. On eût dit que, foudroyée par les paroles du juge, elle avait exhalé son âme entière dans ce cri suprême. Mais son anéantissement fut court. Elle en sortit par un second cri plus bas, plus douloureux, plus indigné. Ses regards cherchèrent autour d’elle, et courant à Vorel qui gardait son attitude affligée:
—Avez-vous entendu, Monsieur, bégaya-t-elle avec égarement... Morte... empoisonnée... est-ce vrai... est-ce vrai?
—Trop vrai, murmura le médecin en secouant la tête.
Honorine fit un pas en arrière.
—Mais alors c’est vous qui l’avez tuée! cria-t-elle éperdue.
—Encore! dit Vorel qui se redressa.
—Rappelez-vous vos recommandations, reprit vivement la jeune femme. C’était dans la chambre voisine. La malade venait de refuser vos soins. Vous m’avez prié de lui cacher que le remède était donné par vos ordres. Vous ne pouvez avoir oublié toutes ces circonstances. S’il y a eu erreur, imprudence, ayez le courage de l’avouer, Monsieur; ne me laissez point sous le coup de cette horrible accusation; vous ne le pouvez pas, vous ne le devez pas; j’en appelle à votre honneur!
Elle parlait avec une véhémence qui donnait à ses paroles une irrésistible autorité. Vorel s’en aperçut, et sa tristesse étudiée parut faire place tout à coup à un élan involontaire.
—C’est aussi trop d’audace! s’écria-t-il en se levant; j’aurais voulu garder le silence, mais puisque vous en appelez à mes souvenirs, puisque vous me forcez à parler, je vous dirai, à mon tour, ce qui se passe ici depuis trois mois. D’abord vos correspondances avec M. de Gausson, vos entrevues chaque soir...
—Que dites-vous?
—Une seule fois on s’est aperçu à la ferme de votre absence; l’alarme a été donnée; on a commencé les recherches de tous côtés; mais, avertie à temps vous avez pu inventer, pour justifier votre disparition, ce prétendu enlèvement par des inconnus...
—Quoi, vous doutez?...
—A partir de ce jour votre grand’mère conçut des doutes; son affection se refroidit, et... tomba subitement malade.
—Ah! c’est horrible! balbutia Honorine, écrasée par tant d’audace.
—Horrible, en effet, répéta Vorel avec une expression profonde: car, à partir de cet instant, les souffrances de madame Louis sont toujours allées croissant. Mes conseils eussent pu l’éclairer peut-être, j’ai été écarté! Une seule fois la malade demanda à me voir, elle vint au manoir; je lui prescrivis un régime, des remèdes qui pouvaient encore la sauver! Au sortir de chez moi, madame la conduit à Vertbec, d’où elle la ramène mourante, et, de peur que des soins pussent la rappeler à la vie, elle cache à tout le monde son état; elle ne permet à personne la vue de la malade; elle la veille seule pendant la nuit!... Le reste est connu de tout le monde! Le matin même, sûre d’avoir atteint son but, madame quittait la morte au point du jour, et vous savez où les gens envoyés à sa recherche l’ont trouvée!... J’aurais voulu ne rien révéler de tout cela, laisser à d’autres le soin de découvrir la vérité... mais on m’a forcé de tout dire... et madame ne doit s’en prendre qu’à elle-même!
Les accusations de Vorel étaient si précises, il y avait dans son accent une sincérité si pénétrante, et une si douloureuse conviction, que les derniers doutes parurent s’effacer dans l’esprit des auditeurs. Il s’éleva parmi les gens de la ferme un premier murmure qui confirmait toutes les assertions du médecin, puis un second plein de reproches et de colère. Quant à Honorine, elle semblait partager l’impression générale. Atterrée par la vraisemblance des accusations, elle ne songeait plus à nier ni à se défendre; toute sa présence d’esprit l’avait abandonnée, elle ne voyait plus autour d’elle que des nuages, au milieu desquels s’agitaient des visages ennemis et courroucés; il fallut que le juge lui adressât par deux fois la parole, pour l’arracher à cette espèce d’étourdissement.
—Vous avez entendu, Madame? dit-il d’un ton plus sévère qu’au début. Après les explications du docteur, vous ne pouvez persister dans un système de défense aussi dangereux qu’invraisemblable. Je vous adjure donc de vous résoudre enfin à la déclaration de la vérité.
Honorine essaya de répondre; mais elle ne put que balbutier quelques mots sans suite. Le juge attendit encore un moment, puis se retournant vers les deux médecins, il leur parla un instant tout bas et enfin se leva.
—Mes fonctions ne me permettent point de pousser cette affaire plus loin, Madame, dit-il; les magistrats supérieurs seront avertis et feront leur devoir. Attendez-vous à les voir demain et à subir un interrogatoire plus sérieux. D’ici là vous êtes libre.
Il avait appuyé sur ces mots avec une intention qui n’échappa point à la jeune femme. C’était une invitation détournée à la fuite, seule chance de salut qui parût désormais possible pour elle! Ce dernier témoignage d’intérêt fondit, pour ainsi dire, l’enveloppe glacée qui retenait la vie d’Honorine comme suspendue. Elle poussa un gémissement, porta les deux mains à son front, et s’écria:
—Ainsi... personne ne veut croire!... Ah! Monsieur... Monsieur, ne me quittez pas ainsi, ayez pitié de moi... dites ce qu’il faut faire pour vous persuader. Oh! ne pouvoir donner aucune preuve!... c’est impossible... quelqu’un doit savoir!... quelqu’un doit avoir entendu!... quoi, pas un mot, pas un fait qui puisse me justifier!... personne qui veuille venir à mon secours!
Elle s’était tournée vers les gens de la ferme, le regard suppliant et les mains tendues! tous baissèrent les yeux ou détournèrent la tête. Elle fit un geste de désespoir.
—Personne, répéta-t-elle; non, ils m’accusent tous.
Et se tournant vers la morte avec une douleur égarée:
—Avez-vous entendu, ma mère? continua-t-elle, en courant vers le lit funéraire et se laissant tomber à genoux près du chevet; c’est moi qu’ils accusent de vous avoir tuée... moi qui eusse donné ma vie pour vous faire vivre... moi qui n’avais plus que vous au monde pour me protéger... ils m’accusent... et je n’ai rien à leur répondre... Ma mère, ô ma mère, justifiez-moi, défendez-moi!
Elle s’était penchée sur le cadavre qu’elle couvrait de baisers et de larmes; mais tout à coup elle se rejeta en arrière avec un grand cri!... La morte venait de se soulever et de tourner vers elle ses yeux à demi entr’ouverts! Tous les spectateurs reculèrent glacés d’épouvante. La mère Louis se redressa avec effort sur son coude. Ses lèvres s’agitèrent sans pouvoir faire entendre aucun son; enfin, une de ses mains se détacha du lit, s’avança lentement et vint se poser sur le front d’Honorine.
—Ah! elle a témoigné pour la jeune dame, s’écria Micou, qui était tombé à genoux avec tous les autres gens de la ferme.
—Oui, murmura la ressuscitée d’un accent si faible qu’il parvenait à peine jusqu’aux auditeurs; pour elle... qui est injustement accusée... car... j’ai tout entendu.
—Vous! s’écria Vorel stupéfait.
—Tout! répéta la vieille femme avec plus de force, et pendant qu’on l’accablait, j’essayais en vain de donner un signe; je restais morte malgré moi! ce n’est qu’en sentant ses caresses que je me suis réveillée... ah! que Dieu soit béni, pour m’avoir permis de revivre encore une fois!
—Nous devons tous le remercier doublement de ce miracle! dit le juge d’une voix troublée, car il sauve deux existences...
—Peut-être! interrompit la mère Louis, qui se ranimait; faites retirer tout ce monde, monsieur Beaumont, je veux, parler à la mezette... et à mon gendre... plus tard, je vous appellerai.
Le juge de paix fit ce que lui demandait la malade, et celle-ci se trouva seule avec Honorine et le médecin. Vorel n’avait pu revenir encore de son saisissement. Ses traits décomposés laissaient deviner la rage et la frayeur qui se partageaient son âme. A la demande faite par la mère Louis il avait tourné les yeux vers la porte comme s’il eût voulu échapper par la fuite à cette explication; un reste d’audace le retint. Il demeura à la même place jusqu’au moment où le dernier des spectateurs eut disparu. La mère Louis fit alors un signe à Honorine.
—Vois s’ils ont bien fermé les portes, dit-elle avec une gravité sombre.
La jeune femme alla s’en assurer.
—Y a-t-il quelqu’un dans l’autre chambre? demanda encore la paysanne.
Honorine répondit négativement.
—Ainsi personne ne peut nous entendre?
—Personne!
La mère Louis se retourna alors vers Vorel; mais la vue du médecin sembla produire sur elle un effet électrique et ses yeux s’allumèrent.
—Approche, dit-elle avec un geste impérieux: approche que je puisse voir de plus près le visage d’un assassin.
Vorel voulut l’interrompre.
—Ne parle pas! continua la paysanne hors d’elle, ou j’appelle le juge pour lui montrer le scélérat qui a d’abord voulu noyer la petite-fille, puis empoisonner la grand’mère.
Honorine fit une exclamation.
—Oh! tu ne savais pas ça, toi, reprit-elle; moi aussi j’ai été dupe... J’ai pas cru à l’instinct qui me disait de me garer de la vipère, et elle a voulu me mordre! mais le bon Dieu s’est fait mon second. Grâce à lui j’en suis sortie; et maintenant c’est à mon tour de me revenger.
—Oh! ne l’essayez pas, ma mère, interrompit Honorine: s’il est vrai que de tels crimes aient été commis, ce n’est pas à nous de les punir.
—Et à qui donc? interrompit la mère Louis avec une indignation qui ennoblissait sa brutalité accoutumée. Si ceux qui tiennent les meurtriers par la gorge les laissent vivre, qu’est-ce qui défendra les honnêtes gens? Sais-tu seulement tout ce qu’il a à sa charge. Demande-lui pourquoi il est devenu veuf si vite!... pourquoi son fils est idiot... pourquoi tu es orpheline... car c’est lui qui soignait ta mère quand ta mère est morte!
La jeune femme joignit les mains avec un cri étouffé.
—Non, non, reprit la fermière dont la colère grandissait; y ne sera pas dit qu’on se sera nourri du sang et de la chair des miens, sans que j’aie demandé vengeance. Je mettrai la corde dans les mains de la justice... et ce sera à elle de la tirer.
Vorel redressa lentement la tête. Il avait eu le temps de se remettre insensiblement, et les menaces de la mère Louis, loin de l’abattre, l’avaient ranimé. Ainsi poussé aux dernières extrémités, il se retourna subitement comme un loup traqué par les chiens et qui n’a plus d’espoir que dans une lutte désespérée!
—Réfléchissez à ce que vous allez entreprendre, dit-il d’un ton bas et menaçant, avec vous je ne tenterai point une défense inutile; votre prévention vous empêcherait de la comprendre; mais devant les juges je parlerai... et ce n’est point contre moi que tourneront les preuves!
—Et contre qui donc?
—Contre celle qui vous a préparé et offert le poison.
—A moi?
—Dans un breuvage dont le reste a été recueilli.
—Le reste, répéta Honorine, mais qui donc a pu boire?
—Attendez, s’écria la mère Louis en portant une main à son front... Le verre était là... près de moi... oui... cette nuit... je me rappelle..... quand je me suis réveillée j’ai vu quelqu’un le prendre...
—Dieu! et c’était?
—C’était l’idiot.
Vorel recula épouvanté.
—Henri, répéta-t-il, mon fils... vous êtes sûre.....
—Sûre, reprit la mère Louis, je l’ai même menacé et il s’est échappé de ce côté. Elle désignait un cabinet ménagé à l’extrémité de l’alcôve. Vorel et Honorine y coururent, mais à peine curent-ils repoussé la porte que la jeune femme s’arrêta avec un cri; l’idiot était étendu à terre roide et sans mouvement.
Le médecin se pencha vivement sur lui, consulta son pouls, écouta son haleine. Il était mort! Il y eut un moment de douloureuse stupeur pour Honorine et pour la mère Louis. Frappées de cette péripétie inattendue, elles se regardèrent en joignant les mains. Quant à Vorel, il s’était jeté à genoux près du cadavre de l’idiot qu’il avait soulevé dans ses bras, et il s’efforçait de retrouver en lui quelques restes de vie. En vain ne rencontrait-il que le froid de la mort, il ne pouvait y croire; il appelait Henri, il secouait sa tête flottante avec une rage désespérée. Mais enfin, sûr de son malheur, il la laissa retomber sur le plancher et se redressa avec une sorte de rugissement. Une si pénible attente, de si longs efforts, tant de crimes, tout cela inutile! inutile par sa faute! Il avait empoisonné son fils, et son fils mort, il n’héritait plus! Cette affreuse pensée envahit si violemment tout son être, qu’elle le jeta dans le délire. Il se mit à parcourir la chambre les bras en avant, et en poussant des cris insensés. Dans son égarement, il mêlait d’hypocrites expressions de douleur paternelle aux sincères lamentations de la cupidité déçue! On voyait à la fois le masque et le visage. Il pleurait son fils unique, sa seule affection; il supputait tout haut l’héritage qui lui échappait; il s’emportait en malédictions contre la mère Louis, contre Honorine..... Il prenait à deux, mains son front et le heurtait contre la muraille!
Les deux femmes contemplaient ce hideux égarement avec une curiosité épouvantée; serrées l’une contre l’autre, elles suivaient d’un regard inquiet tous les mouvements du médecin, prêtes à appeler à leur secours. Mais elles n’en eurent point besoin. Après avoir parcouru cinq ou six fois la chambre en chancelant, Vorel se laissa tomber sur un fauteuil près de la fenêtre, cacha sa tête dans ses deux mains et pleura! C’étaient les premières larmes qu’il eût versées! La colère de la mère Louis fut ébranlée par cette expression de douleur inattendue. Elle ne se demanda point au juste ce que regrettait le médecin, elle ne vit que ses pleurs. L’idée de cet innocent mort pour elle et dont le cadavre était là avait d’ailleurs changé ses préoccupations; elle se sentit attendrie, passa la main sur ses yeux humides; puis se retournant du côté de Vorel qui se tenait toujours à la même place:
—Le bon Dieu a lui-même imposé le châtiment, dit-elle avec une gravité émue; les hommes n’ont rien à faire après lui. Cachez encore un peu la mort de votre fils; j’arrangerai tout avec les gens de justice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La mère Louis tint parole. La mort de l’idiot, déclarée seulement le surlendemain, n’éveilla aucun soupçon, et elle affecta de recevoir Vorel comme par le passé. Mais sortie de sa léthargie, elle avait retrouvé toutes ses souffrances; le médecin de Balleroi, consulté le lendemain par Honorine, déclara que ce retour à la vie était le dernier effort d’une organisation épuisée, et annonça l’agonie pour le soir même.
La malade devina cet arrêt et s’y résigna. Comme il arrive souvent, l’approche du moment suprême avait relevé cette nature. Dépouillée de ses grossières passions, et domptée par la douleur, elle se montrait plus compréhensive, plus tendre. Le prêtre et le notaire furent appelés. La mère Louis remplit ses devoirs avec un calme digne qu’Honorine ne lui connaissait point. Elle prit toutes les précautions pour assurer à sa petite-fille la totalité de son héritage, régla avec elle quelques comptes arriérés, lui donna de sages conseils, puis sentant diminuer ses forces, elle l’embrassa plusieurs fois et entra dans l’agonie! Celle-ci fut longue mais paisible. On eût dit un sommeil légèrement agité. De loin en loin, la mourante rouvrait les yeux avec un soupir, prononçait le nom d’Honorine, serrait sa main, puis retombait dans sa somnolence oppressée. Enfin, vers le soir, sa respiration devint plus sifflante, elle prononça des mots entrecoupés, poussa quelques cris étouffés et mourut. Honorine qui s’était jusqu’alors contenue éclata en sanglots. Les dernières heures de la vie de sa grand’mère avaient doublé sa tendresse; en croyant la perdre d’abord, elle avait pleuré par sensibilité et par devoir, mais en la perdant réellement cette fois, elle sentit son cœur se briser. Françoise essaya de la calmer.
—Laissez-moi, s’écria-t-elle en tombant à genoux près de la morte; je l’ai méconnue jusqu’au dernier instant, rien ne me consolera de cette douleur!
—Madame nous permettra au moins de la partager! dit une voix railleuse qui retentit tout à coup derrière elle.
Les deux femmes se retournèrent en même temps et demeurèrent frappées de stupeur devant Arthur de Luxeuil!
Quelque imprévue qu’elle pût paraître, l’arrivée du mari d’Honorine n’avait rien qui dût la surprendre. Sorti depuis peu de prison, grâce à l’intervention de quelques amis, il avait appris la maladie de la mère Louis, et prévoyant la possibilité d’un prochain héritage, il était parti sans retard pour les Motteux, où il arriva quelques instants après la mort de la vieille paysanne. Cette mort réalisait des espérances trop longtemps caressées pour ne pas être accueillie avec transport. Dès le lendemain, après la cérémonie funèbre, du Luxeuil se rendit chez le notaire afin de l’interroger sur la fortune laissée par la mère Louis et sur ses dispositions testamentaires. Pendant ce temps, Honorine restée seule dans la chambre mortuaire, priait et pleurait. Tout ce qui frappait ses regards entretenait son affliction. Après avoir remis en place chaque chose, par une habitude machinale, comme si celle qui n’était plus là devait y revenir, elle s’arrêta avec un tressaillement devant cette alcôve vide, dont le funèbre désordre entretenait ses souvenirs douloureux!... Dans ce moment de Gausson ouvrit doucement la porte. A sa vue, elle poussa une exclamation involontaire et lui tendit les mains avec cette expression plaintive et suppliante des enfants qui demandent secours. Le jeune homme courut à elle.
—Ah! je viens de savoir seulement ce que vous aviez souffert, dit-il, Françoise m’a tout appris, et je suis accouru!...
—Elle est morte! murmura Honorine qui ne pouvait penser à autre chose.
—Mais vos amis vous restent! reprit de Gausson qui baisait avec une passion attendrie les mains qu’il tenait, et si la mort vous a enlevé votre protectrice, un heureux hasard vient de vous rendre un protecteur; le duc de Saint-Alofe est libre.
—Se peut-il?
—Marc a reçu une lettre de lui, d’abord adressée à Paris, puis retournée à Trévières où il l’a trouvée. Le duc se cache dans le département voisin.
—Ah! je veux qu’il vienne ici, près de nous, dit vivement la jeune femme: vous irez le chercher, Marcel.
—Je le souhaite, mais songez que sa liberté tient au secret de sa retraite.
—Ne peut-il se cacher aux Motteux?
—Vous oubliez qu’il est connu de M. de Luxeuil.
Honorine tressaillit.
—Ah!... je n’y pensais plus, dit-elle en pâlissant... oui... Nous ne sommes pas seuls... mais M. de Luxeuil repartira bientôt, sans doute.
—Dieu le veuille.
Elle le regarda.
—Avez-vous donc quelque nouveau sujet de crainte? demanda-t-elle vivement; Marcel, au nom du ciel, répondez; vous savez quelque chose?
—Rien, répliqua le jeune homme, mais je tremble...
—Et pourquoi?
—Parce que tout à l’heure, en venant ici, j’ai aperçu M. de Luxeuil causant avec le médecin.
—M. Vorel?
—Je ne doute plus que ce misérable ne soit l’ennemi caché dont Marc venait vous dénoncer la présence; lui seul a pu surprendre notre correspondance, et s’il en parle à votre mari!...
—Ah! vous me faites trembler, interrompit Honorine épouvantée... Il parlera, n’en doutez point... et quand M. de Luxeuil saura... Vous ne pouvez rester ici, Marcel; je veux que vous partiez sur-le-champ...
—Que dites-vous! fuir au moment du danger...
—Il le faut! il le faut!
—C’est impossible, Honorine! Songez à ce que vous me demandez!
—Écoutez! interrompit la jeune femme en baissant subitement la voix et imposant silence des deux mains.
C’était Arthur que l’on entendait parler dans l’escalier, où il donnait quelques ordres.
—Il va vous trouver ici! continua-t-elle épouvantée.
—Par ce côté, vous le rencontrez...
—Mais là?
—Ah! oui... vite, le voici...
Elle fit entrer précipitamment de Gausson dans la chambre voisine, ferma la porte et retira la clef. Au même instant de Luxeuil parut à l’entrée.
—J’use des priviléges de la campagne, dit-il en s’inclinant légèrement; j’entre sans dire: gare! Madame excusera, j’espère, ma liberté.
—Vous avez sans doute... à me parler? demanda Honorine troublée.
—Je ne me serais point, sans cela, permis de me présenter, fit observer Arthur, qui semblait n’avoir d’autre but que de faire ressortir, par une politesse affectée, ses intentions impertinentes; mais Madame doit comprendre qu’après une aussi longue séparation ce n’est point trop d’une entrevue de quelques instants. Je tâcherai, du reste, de l’importuner peu de temps.
Honorine parut vouloir prendre acte de cette dernière promesse en restant debout, une main appuyée sur le dossier de la chaise qu’elle avait instinctivement avancée; mais il était évident qu’Arthur, malgré sa protestation de laconisme, désirait s’expliquer avec détail: car, prenant lui-même un siége, il invita du geste Honorine à s’asseoir. Elle parut hésiter.
—De grâce souffrez que nous nous expliquions à l’aise, reprit-il avec insistance; on ne cause guère debout qu’au théâtre; et nous sommes ici chez nous, jouant la comédie sans témoins et pour notre propre compte.
Honorine s’assit. Il y eut une courte pause, puis Arthur reprit:
—Mon intention n’est point de vous reparler des débats qui se sont autrefois élevés entre nous, Madame; nous avions entrepris tous deux une lutte folle, et que votre départ a heureusement interrompue; je reviens aujourd’hui complétement transformé, et comme on eût dit autrefois, l’olivier à la main. J’ose espérer que vos intentions ne sont pas moins pacifiques.
—Je n’ai jamais cherché ni souhaité la lutte, Monsieur, répliqua Honorine, qui ne comprenait point encore où il en voulait venir.
—Alors nous ne pouvons manquer de nous entendre, continua de Luxeuil. En définitive, nous nous sommes beaucoup tourmentés l’un l’autre, et pourquoi? Parce que nos goûts étaient différents, nos principes contraires! Comme si le monde n’était point assez grand pour deux volontés! Aussi ai-je fait depuis de sages réflexions, et suis-je arrivé à cette opinion, que le mariage était une auberge où l’on devait profiter des bénéfices de l’association sans s’imposer les gênes de l’intimité. Il me semble que ma définition doit obtenir votre approbation.
—J’attends... le but de ces explications, Monsieur, dit Honorine, qui se sentait malgré elle glacée du ton froidement persiffleur d’Arthur.
Celui-ci s’inclina.
—Ah! le but, reprit-il; en effet, je m’aperçois que je me suis laissé emporter aux développements philosophiques, et je vous remercie, Madame, de me rappeler au fait. Le but, le voici. La mort de madame Louis vous laisse un héritage suffisant pour réparer les brèches faites à votre fortune par les nécessités du passé. Grâce à lui, vous pouvez reprendre des habitudes auxquelles vous n’eussiez dû jamais renoncer; je viens, en conséquence, vous arracher à votre exil pour vous rendre, dans le monde, le rang qui vous est dû.
Honorine releva vivement la tête.
—A moi? s’écria-t-elle; ah! je n’ai d’autre ambition que la retraite, Monsieur, et rien ne pourra m’obliger à recommencer une vie à laquelle je dois mes plus cruels souvenirs. J’apprécie, du reste, comme je le dois, votre démarche!...
—Pardon! vous n’en devinez évidemment qu’une partie, fit observer de Luxeuil tranquillement. Vous avez compris que je voulais profiter de votre nouvelle opulence; c’est effectivement un privilége que je tiens du code, et j’ai toujours professé un respect aveugle pour les lois... quand elles sont faites à mon profit. Mais j’aurais pu jouir de ces avantages en vous laissant ici par un compromis amiable, et je l’aurais fait sans aucun doute si je n’avais besoin de votre retour à Paris.
—Que voulez-vous dire, Monsieur? demanda Honorine stupéfaite de cette étrange franchise.
—Mon Dieu! c’est chose humiliante à déclarer, reprit Arthur; cet aveu va vous donner sur moi d’immenses avantages: mais maintenant je suis franc, par paresse... Depuis votre départ, ma réputation est devenue détestable. Un mari peut mal vivre avec sa femme; c’est la chance commune, l’état normal; mais vivre séparés!... cela a quelque chose de choquant. Le monde, qui ne s’inquiète pas du mal, condamne tout ce qui a l’apparence du désordre! puis, le moyen, quand on est seul, de tenir une maison, de donner des fêtes, de garder enfin son rang avec quelque éclat? Depuis un an, je suis descendu, malgré moi, au rôle de célibataire; on m’a adressé des invitations que je ne puis rendre; mon hôtel est désert; je vis au foyer de l’Opéra et au café de Paris. Tout cela était parfait, il y a cinq à six ans; mais je me fais un peu vieux pour continuer ce personnage de garçon; il est temps de prendre une position plus grave, de devenir sérieusement chef de maison, et, comme pour cela il me faut une femme, j’ai dû penser naturellement à la mienne.
—Je ne puis regarder une pareille explication comme sérieuse, Monsieur, dit Honorine glacée par ce cynisme moqueur, et j’aime encore à croire que vous ne persisterez point dans une intention... qui ne peut être qu’une menace.
—Mon Dieu! pourquoi ne pas achever votre pensée, reprit de Luxeuil d’un ton souriant; vous regardez mes prétentions comme une ruse.
—Monsieur!...
—Vous croyez que je parle de vous conduire à Paris afin de vous forcer à racheter le droit de demeurer ici? Je suis étonné que vous ne m’ayez point encore demandé pour quelle somme je consentirais à vous laisser dans votre solitude.
—Eh bien! je vous le demande! s’écria la jeune femme poussée à bout.
—Décidément, Madame, vous me forcerez à me mettre au rang des maris incompris, dit Arthur ironiquement; je suis véritablement contrarié de ne pouvoir vous convaincre que je tiens non-seulement à votre fortune mais à vous-même.
Honorine fit un mouvement.
—Oh! ne donnez point trop d’étendue à mes prétentions, reprit de Luxeuil avec un accent incisif; ce que je demande, c’est seulement une apparence! Je n’ai point le téméraire espoir d’obtenir davantage. Toute liberté sera laissée à vos sentiments, à vos habitudes, à vos actes, et, pour n’avoir jamais à revenir sur un sujet pareil, je me permettrai un simple avis.
—Quel avis, Monsieur?
—Celui de mettre plus de prudence, Madame, dans des relations qui ont tout intérêt à se déguiser; de ne point confier aux arbres une correspondance qui pourrait être surprise; de choisir enfin pour vos rendez-vous du matin un lieu qui ne soit point ouvert à tout venant.
Au premier mot prononcé par Arthur, la jeune femme avait tressailli, puis elle devint très-pâle.
—Je m’attendais à ces accusations... balbutia-t-elle; mais quelles que puissent être vos préventions, Monsieur, je puis vous affirmer...
—De grâce! pas de serments! interrompit de Luxeuil; je ne vous ai adressé ni questions, ni reproches: j’ai seulement hasardé un conseil!
—Non, s’écria Honorine, bouleversée par ce calme sardonique, dont elle ne pouvait comprendre la cause; non, ce n’est point un conseil! Ah! votre froide raillerie cache quelque piége, Monsieur; montrez-le, quel qu’il soit; que voulez-vous enfin, parlez! Si c’est une part de cet héritage que Dieu m’a donné dans sa colère, prenez-la; mais si c’est mon repos, ma liberté, n’espérez point que je vous les livre; je ne reprendrai point une chaîne dont vous m’avez fait une flétrissure; je ne feindrai point un pardon que je n’ai point accordé; je ne veux point de la paix que vous me proposez, et si vous n’en avez point d’autre, c’est moi qui demande la guerre.
—A la bonne heure, dit de Luxeuil en frappant le plancher de sa badine. Je vous reconnais enfin, Madame; vous voilà telle que je vous aime; audacieuse par irrésolution et menaçante par peur! seulement je dois m’étonner de la lenteur de votre intelligence pour ce qui me concerne. Vous me demandez pourquoi je vous parle si tranquillement de votre amour pour M. de Gausson? moi je vous demande, Madame, comment j’en pourrais parler autrement? Faut-il donc m’indigner de ce qui me sert?
—Je ne vous comprends pas, Monsieur.
—Autrefois, Madame, j’étais l’offenseur, j’avais tout à craindre; aujourd’hui je suis l’offensé, et c’est à vous de trembler! vous êtes désormais à ma merci. Je sais où vous frapper. Ah! vous avez longtemps abusé de vos avantages, c’est à mon tour enfin. Maintenant, Madame, au moindre geste vous devrez obéir: quand je vous dirai de venir, vous viendrez, car, au premier refus, moi, votre mari, votre maître, je puis aller trouver celui que vous aimez... le tuer... et le monde dira que j’ai bien fait. Oh! tout est changé; vous avez perdu ce talisman qui vous défendait; aujourd’hui mon honneur est pour moi une épée avec laquelle je puis égorger votre bonheur. Faites-vous donc humble et patiente, si vous ne voulez savoir ce qu’il y a de tristesse dans un cœur de veuve!
A mesure que de Luxeuil parlait, Honorine devenait plus pâle. Elle comprenait enfin et elle demeurait égarée d’épouvante. Ce fut seulement au dernier mot prononcé qu’elle se leva avec un cri.
—Ah! c’est horrible, dit-elle éperdue...
—C’est simplement raisonnable, répliqua Arthur en se levant à son tour. Remarquez que le hasard pouvait vous donner un mari sans usage, qui eût pris tout de suite la chose au tragique et ne vous eût point laissé d’alternative. Moi, au contraire, je suis comme le Dieu de M. Tartuffe, j’admets les accommodements. Tant que vous resterez sur le pied de paix, M. de Gausson ne cessera point d’être de mes amis; comme Mécène, je dormirai pour Auguste; mais à la première révolte, je vous avertis que je me réveille, et alors malheur à qui aura compromis la femme de César!
—Ainsi, s’écria la jeune femme révoltée, vous croyez à ma honte et vous l’acceptez à l’amiable... par compromis! Ah! je ne vous croyais pas descendu si bas.
—J’ai dû vous suivre, Madame, répliqua ironiquement de Luxeuil.
—Et vous avez espéré que j’accepterais cette transaction inouïe, reprit Honorine, chez qui le dégoût faisait taire la peur. Vous avez pensé que j’achèterais de vous le droit du déshonneur. Non, Monsieur, non; quoi que vous ayez pu croire, je ne suis point arrivée à ce point d’abaissement; je puis me justifier de toutes les accusations portées contre moi; loin de craindre la vérité, je la veux, je la demande.
Arthur l’interrompit d’un geste.
—Alors, veuillez me remettre la clef de cette porte, dit-il, en montrant la chambre dans laquelle de Gausson se trouvait enfermé.
Honorine changea de visage. Dans son élan d’indignation, elle avait oublié un instant qu’il était là.
—Donnez, répéta de Luxeuil plus vivement, car je me lasse enfin de ce débat; puisque vous désirez la vérité, moi aussi je veux la connaître.
Il avait fait un pas vers la porte, Honorine s’y appuya suppliante et éperdue.
—Ah! vous étiez averti, dit-elle; vous saviez que M. de Gausson était ici.
—Ainsi, vous en convenez? interrompit Arthur qui la tenait palpitante sous son regard.
—N’en concluez rien contre lui ni contre moi, Monsieur; Dieu sait que le hasard a tout fait; que cette visite n’avait rien qui ne pût s’avouer; mais je vous savais prévenu par M. Vorel... J’ai craint une première explication, c’est le seul motif qui nous ait décidés... le seul, je vous le jure.
M. de Luxeuil tendit la main.
—La clef, Madame.
—Écoutez-moi, Monsieur, je vous en conjure, écoutez-moi, dit la jeune femme épouvantée et dont les idées se troublaient, si ce n’est par confiance que ce soit par pitié pour moi, par respect pour vous-même. N’en venez point à un éclat honteux et inutile.
—Je vous ai offert un moyen de l’éviter, fit observer de Luxeuil; consentez à ce que j’exige, et à cette condition je me retire.
La jeune femme fit un effort.
—Eh bien... bégaya-t-elle, je vous demande, Monsieur, quelques heures...
Arthur la regarda.
—Un autre refuserait de laisser échapper une occasion aussi favorable, dit-il; mais je veux vous prouver jusqu’au bout mon désir de conciliation... d’autant que je suis assez fort pour me montrer généreux. Je me retire; mais je reviendrai demain. D’ici là, tâchez d’accoutumer votre esprit aux conditions que je vous propose; elles n’ont rien de dur; vous le verrez à la pratique; ce plan qui vous effarouche ressemble au péché; on s’y décide difficilement, puis on y persévère avec délices. Pensez-y.
Il la salua avec une politesse railleuse et sortit. Dès que le bruit de ses pas eut cessé de se faire entendre, Honorine ouvrit vivement la chambre dans laquelle s’était caché de Gausson. Il ne s’y trouvait plus! Elle courut à la fenêtre ouverte et aperçut, au-dessous, la trace de ses pieds profondément empreinte dans le sol. La crainte d’être découvert et de la compromettre l’avait sans doute décidé à cette fuite périlleuse. Honorine descendit rapidement, espérant savoir de Françoise ce qui s’était passé; mais celle-ci n’était point à la ferme. Elle courut à la maison du garde que la grisette habitait, et la trouva fermée..... Il fallut revenir aux Motteux sans avoir rien appris. Ce fut seulement plusieurs heures après que Françoise reparut. Elle venait de Vertbec, où de Gausson était arrivé sain et sauf. Un long entretien avait eu lieu entre lui et Marc, et ce dernier devait attendre Honorine à la maison du garde-forestier vers le déclin du jour. Bien qu’elle ignorât le motif de cette entrevue, la jeune femme s’y rendit, à l’heure indiquée. Honorine avait espéré trouver Marcel chez Françoise, mais le chouan y était seul. Il avait changé ses haillons contre un costume bourgeois d’une propreté recherchée. La jeune femme voulut l’instruire de ce qui s’était passé entre elle et de Luxeuil; il l’interrompit.
—M. de Gausson m’a tout appris, dit-il; je viens pour vous secourir.
—Vous le pouvez donc? s’écria Honorine; ah! si vous avez un moyen, parlez.
—Lisez d’abord cette lettre.
La jeune femme prit la lettre qu’il lui présentait; c’était l’écriture de Marcel! Elle l’ouvrit et lut:
«J’étais là, Honorine, et jusqu’au moment où il vous a demandé la clef, j’ai tout entendu! C’est alors seulement que la crainte de confirmer ses soupçons par ma présence, et de lui donner un nouvel avantage contre vous, m’a décidé à partir!
»Oui, j’ai tout entendu! Maintenant je connais ses projets: je les comprends; je sais ce qu’il doit, ce qu’il peut oser! Ses menaces ne sont point de vaines suppositions; tout ce qu’il vous a dit, il le fera!
»Ainsi je deviendrais pour lui un moyen de persécution! Il vous forcerait à racheter ma vie par une odieuse soumission! Ah! mon premier mouvement à cette pensée a été de courir pour provoquer moi-même la rencontre dont il vous menace; votre souvenir m’a arrêté. Quel que soit le résultat d’une lutte entre M. de Luxeuil et moi, elle vous sera également fatale, car le monde ne voudra voir en nous qu’un mari et un amant... Vainqueur ou vaincu, je vous perdrais donc toujours, et je n’aurais réussi qu’à vous flétrir!
»Comprenez-vous, Honorine; moi qui ai le saint amour d’un frère, moi qui, pour conserver l’auréole de pureté qui vous couronne, donnerais dix fois ma vie, penser que je pourrais vous laisser avec un honneur soupçonné! Non, cela ne peut pas être, cela ne sera pas. J’aurais voulu n’avoir à donner que mon sang; c’est ma joie, mon espoir que l’on demande, je ne balance pas.
»Quand vous recevrez cette lettre, Honorine, je serai parti!»
—Parti! s’écria la jeune femme en s’interrompant et en regardant Marc. C’est impossible!
—Lisez, répéta doucement ce dernier.
Elle chercha l’endroit auquel elle s’était arrêtée, et reprit:
«Soyez donc désormais sans crainte; moi absent, les menaces de M. de Luxeuil deviennent vaines; il n’a plus d’armes contre vous. Toutes les recherches pour me trouver seraient inutiles; j’aurai fui trop loin et pour toujours!
»En écrivant ces mots, je sens mon cœur qui se brise... mais il le faut. Ainsi, du moins, vous redeviendrez libre; vous serez maîtresse de votre présent, de votre avenir. Vous resterez honorée autant que pure!... Mon but sera atteint. Dieu décidera du reste.
»Adieu, vous dont j’emporte le souvenir comme un talisman; vous à qui je dois tant d’innocentes joies et de consolations sans remords; adieu, mon amie, ma sœur! Quelque épreuve ou quelque bonheur que vous garde l’avenir, pensez à moi sans tristesse, mais ne m’oubliez pas.
»Marcel.»
Les larmes avaient gagné Honorine; elle put à peine lire les dernières lignes tracées par de Gausson, et quand elle les eut achevées, elle les pressa sur ses lèvres en sanglotant. Marc respecta cette douleur qu’il semblait partager, et laissa passer quelques instants avant de reprendre la parole. Enfin, il s’approcha de la jeune femme et lui dit d’un accent ému:
—M. de Gausson a pris le seul parti qui fût sage, Madame; mettez autant de courage à accepter son sacrifice qu’il en a mis à le faire. Sa seule récompense maintenant est de penser qu’il a assuré votre repos. Songez à ce qu’il souffrirait s’il voyait votre affliction.
—Parti! répéta Honorine, qui ne pouvait détacher son âme de cette pensée.
—Il vous a expliqué pourquoi il le faisait.
—Oui... oui; mon Dieu! Oh! j’ai compris... mais... parti!...
—Pourquoi vous acharner à cette pensée?... Songez plutôt à ce qu’il faut faire pour que ce départ ne soit point inutile. Vous le devez à vous-même... vous le devez à M. Marcel.
—Comment? que faut-il encore? demanda Honorine émue par ce dernier argument.
—Si vous restez ici, reprit Marc, vous ne pouvez empêcher M. de Luxeuil d’y demeurer également, la loi l’autorise, et il est à craindre qu’il n’use de ce droit pour essayer mille persécutions.
—Mais si je pars, reprit la jeune femme, ramenée au sentiment de sa position, ne peut-il courir à ma poursuite, me forcer de le suivre?
—C’est un privilége écrit dans le code, mais auquel on a dû renoncer dans la pratique, fit observer Marc; rien ne vous oblige d’ailleurs à faire connaître votre retraite; un homme d’affaires muni de votre procuration peut régler tout ce qui concerne l’héritage de madame Louis, et lui seul saura où vous trouver.
—Alors je partirai.
—Je venais vous l’offrir; toutes les précautions sont prises pour qu’il soit impossible de suivre nos traces, et nous pouvons quitter ce soir même les Motteux.
—A l’instant, je suis prête.
—Vous vous en allez! s’écria Françoise, et moi! vous ne me laisserez point ici sans vous!
Honorine l’embrassa.
—Non, non, dit-elle; tu nous suivras.
—Pardon, interrompit Marc; mademoiselle Françoise fait partie de notre plan; mais elle ne peut venir avec nous! Une femme qui conduit un enfant se remarque trop facilement; elle servirait à mettre sur nos traces, tandis qu’elle peut aider à les faire perdre.
—De quelle manière?
—Qu’elle prenne ce soir la diligence de Paris; on s’apercevra en même temps de sa disparition et de la vôtre, on ne doutera point que vous ne soyez parties ensemble; et les recherches se feront dans cette direction, tandis que nous en prendrons une autre.
—Laquelle?
—Celle de Coutances. Arrivée à Paris, mademoiselle Françoise retournera à son ancien logement, et j’irai l’y prendre dès que nous aurons trouvé une retraite.
La grisette et Honorine tombèrent d’accord que c’était le moyen le plus sûr. Après être convenue de tous les détails, Honorine regagna la ferme, assista au repas du soir et se mit au lit; mais, une fois tout le monde endormi, elle se releva, descendit avec précaution et trouva Marc à la porte de l’aire.
—Venez, dit celui-ci en enveloppant la jeune femme dans un manteau qu’il avait apporté; M. de Gausson m’a laissé son cabriolet qui nous attend au bout de l’avenue.
—Et Françoise? demanda-t-elle.
—Partie depuis deux heures; mais vite, vite! si par hasard quelqu’un nous rencontrait, tout serait perdu.
La jeune femme le suivit en pressant le pas. Seulement, arrivée au carrefour du chemin qui conduisait aux Motteux, elle se retourna; un rayon de lune glissait doucement sur le toit de chaume de la ferme, et le vieux château masquait l’horizon de sa masse délabrée. Honorine entendit de loin le mugissement des bœufs dans les étables, et la vieille girouette de la chapelle qui criait sur son axe de fer; son cœur se serra, elle sentit une larme gonfler sa paupière, et appuyant une main à ses lèvres elle envoya un baiser d’adieu à cette habitation où elle avait tant souffert et tant aimé! Le cabriolet avait été caché par Marc à l’entrée du taillis; tous deux y montèrent et prirent un chemin de traverse qui aboutissait à la route d’Isigny. Il les conduisit, au bout de quelques instants, sous les murs du jardin de M. Vorel. En apercevant, dans l’ombre, le pignon aigu et étroit du manoir, la jeune femme ne put se défendre d’un frémissement intérieur. Le regard de Marc s’arrêta également sur la demeure isolée.
—Voilà sa tanière, murmura-t-il.
—Heureusement qu’il ne peut nous voir! dit Honorine dont la voix tremblait; il dort maintenant.
—Ah! vous croyez donc qu’un pareil homme peut dormir? demanda Marc.
—Que ferait-il... à cette heure!...
—Je voudrais le savoir!
Un cri sourd venant du manoir sembla lui répondre. Il redressa la tête en retenant les rênes.
—Avez-vous entendu? demanda-t-il.
—Passons vite! passons vite!... s’écria Honorine glacée.
Il prêta encore l’oreille; mais tout était silencieux. Après un court moment d’hésitation, il fouetta le cheval qui tourna brusquement le mur de clôture, et quelques minutes après ils roulaient sur la route d’Isigny. Cependant, le cri qu’ils avaient entendu n’était point une illusion de leurs sens, et avant de continuer notre récit nous devons instruire le lecteur de ce qui se passait au manoir.
En revenant de la cérémonie funèbre, Vorel avait ordonné à la Sureau de se rendre à la ferme où l’on pouvait avoir besoin d’elle, et lui recommanda de ne revenir que le lendemain. Il avait saisi ce prétexte pour rester sans témoins. Après les coups terribles qui venaient de le frapper, il avait, en effet, besoin de silence et de solitude. Obligé de maintenir devant la foule le masque de douleur résignée qu’il avait adopté, il le sentait près de tomber malgré tous ses efforts; il avait épuisé le reste de sa patience et de son courage; il éprouvait, comme le tigre blessé, le besoin de rugir sa douleur.
On croit les hypocrites à l’abri des ferventes passions, parce qu’on ne voit que le dehors fardé qu’ils montrent; mais qui pourrait lire au fond de ces âmes sans issues demeurerait frappé de stupeur. Oh! si l’on savait ce qui s’agite de tempêtes sous ces surfaces paisibles, quelles flammes sous cette froideur, que de grincements de dents derrière ces sourires! Malheureux damnés qui brûlent et doivent conserver la face des anges! quelles que soient les passions, quand elles s’épanchent, elles peuvent donner une âcre et fiévreuse jouissance, une ivresse de quelques instants! mais renfermer en soi-même tous les venins corrosifs, couver ses désirs comme une nichée de serpents, et, à mesure qu’ils grandissent, laisser ronger un morceau de son cœur pour leur donner place, quel plus hideux et plus horrible supplice? Aussi qui peut dire l’emportement de l’hypocrite qui éclate enfin? qui pourrait résister à ses tempêtes grossies et renfermées; comment arrêter la colère tant de fois remise?
Vorel l’éprouva pour lui-même. Resté seul, il ferma les portes et les fenêtres par un reste de prudence, comme si l’habitude de son rôle appris ne pouvait l’abandonner entièrement au plus fort de sa passion; puis, laissant un libre cours à son désespoir furieux, il se mit à parcourir sa chambre en renversant les meubles et en poussant des cris mêlés de blasphèmes. Avoir tout perdu, sans compensation, sans espoir de retour à jamais, et ne pouvoir même se venger sur quelqu’un de ce désastre! Rester malgré lui dépouillé, inoffensif, muselé; cette idée le rendait fou! Aussi après avoir tout bouleversé, s’arrêta-t-il avec un rugissement de colère désappointée. Ces objets inanimés sur lesquels s’exerçait sa furie ne pouvaient l’assouvir; ils ne sentaient pas ses coups, il ne pouvait leur faire partager sa souffrance. Il demeura debout devant son bureau, les mains crispées, les lèvres convulsives et écumantes. Mais tout à coup son regard s’arrêta sur un papier plié en forme de lettre et qui y avait été sans doute déposé par la Sureau en son absence. Il le saisit, en regarda l’écriture qui lui était inconnue, et, brisant brusquement le cachet, lut ce qui suit:
«Monsieur Vorel,
»J’ai à converser avec vous pour plusieur choses qui vous intéresse; mais comme j’ai queq’raisons pour ne pas paraître dan le pays, je ne viendrais que le soire. Ayez donc la bonté de laissé la petite porte du bas du jardin ouverte; je sifflerais pour avertir que je suis là.
»Jacques.»
Le médecin relut deux fois ce billet sans pouvoir en pénétrer le sens. Pour oser revenir vers lui après ce qui s’était passé, il fallait que le Parisien eût un motif bien grave ou bien pressant. Quel qu’il fût, du reste, Vorel résolut de le connaître. La passion qui le dominait faisait taire sa prudence accoutumée. Il avait une vague espérance que ce Jacques lui apporterait quelque moyen inattendu de réparer son échec ou du moins de se venger. Or, il se trouvait dans un de ces moments où les âmes corrompues cèdent à je ne sais quel délire du mal et arrivent à aimer le crime pour lui-même. Vous avez vu après les pluies d’orage la terre subitement inondée de reptiles ou de larves immondes; leurs hideux essaims couvrent les herbes abattues, les arbustes brisés, les fleurs flétries; tout ce que le sol recélait dans son sein de vénéneux ou d’horrible apparaît et cache le reste! La tempête qui venait d’agiter le cœur du médecin y avait opéré le même prodige. Toutes les haines acharnées, tous les désirs infâmes, toutes les espérances criminelles avaient surgi et se tordaient à sa surface.
Après avoir regardé de nouveau la date du billet afin de s’assurer que le rendez-vous était bien pour cette nuit, Vorel descendit au jardin, ouvrit la petite porte désignée par Jacques, puis regagna la maison. Il se promena longtemps dans sa chambre, se penchant, de loin en loin, à la fenêtre ouverte pour entendre le signal annoncé. Mais tout à coup il lui sembla que l’on montait l’escalier. Il se rappela alors qu’il n’avait point fermé, en dedans, la porte de la maison, courut à celle du palier et heurta le Parisien.
—Vous deviez m’avertir de votre arrivée, dit-il brusquement; pourquoi ne l’avoir point fait?
—Je vous ai aperçu du dehors, répliqua Jacques. Alors j’ai pensé que je pouvais monter.
—C’est une imprudence, un domestique eût pu vous rencontrer.
—Y a pas de danger, reprit le Parisien d’un air singulier; personne ne m’a vu; nous pourrons causer sans être dérangés.
—Qu’avez-vous à me dire?
Avant de répondre, le Parisien, qui avait réussi à entrer dans la chambre, promena un regard rapide autour de lui.
—Ce que j’ai à vous dire, répéta-t-il, ça demande pas mal d’explications, vu qu’il s’agit d’une affaire conséquente.
—Venez-vous recevoir mes remerciements de ce que vous avez fait il y a trois mois? demanda le médecin.
—Eh bien quoi! répliqua Jacques insolemment, est-ce notre faute si cet animal de Romain ne sait pas travailler! Dire qu’à trois ils n’ont pas pu noyer une femme! Si j’avais supposé la chose, j’aurais donné un coup de main.
—Vous vous y étiez engagé et vous avez reçu le paiement de ce que vous n’aviez point fait.
—Qué’q’ chose de chenu! reprit Jacques; trois cents balles pour un extrait mortuaire qui devait faire de vous un milesoudier (millionnaire), comme ils disent dans le pays.
—C’était plus qu’il ne vous était dû, puisque vous avez eu la maladresse de tout manquer.
—La maladresse! répéta Jacques évidemment blessé; facile à dire, quand on n’a qu’à regarder les coups. Mais lorsqu’il faut mettre la main à la pâte!... C’est comme aux cartes, voyez-vous; on a beau bien jouer, faut la chance. Eh bien, c’était la petite qui l’avait; à preuve que vous n’avez pas mieux réussi que nous.
—Moi!
—Oui, dans votre second essai.
—Je ne sais ce que vous voulez dire.
Jacques jeta au médecin un regard effrontément narquois.
—Vrai! dit-il; eh bien, c’est que vous avez la mémoire courte, pour lors. Je veux dire, bourgeois, qu’en voyant l’affaire manquée avec la dame de Paris, vous avez voulu, comme on dit, tirer d’un autre tonneau. Vous vous êtes débarrassé de la mère Louis.
—Moi!
—Avec l’espérance qu’on soupçonnerait sa petite-fille.
Vorel affecta de sourire en haussant les épaules.
—Et c’est pour me faire ce conte ridicule que vous êtes venu? demanda-t-il sèchement.
—Ridicule, c’est possible, répliqua le Parisien; mais, en tout cas, je n’en suis pas l’inventeur: l’honneur en appartient à un particulier qui a été aux premières loges pour voir l’affaire; c’est le juge de paix du canton.
Cette fois le médecin ne put réprimer un tressaillement.
—Tu mens, misérable! s’écria-t-il vivement; M. Beaumont n’a pu dire... Comment le saurais-tu d’ailleurs?
—De fait, c’est un hasard, reprit Jacques; je me trouvais dans la voiture de Saint-Lô avec deux voyageurs, et comme j’avais entendu dire qu’un d’eux était juge, je dormais pour me donner une contenance, quand j’ai entendu ces messieurs, qui parlaient bas, prononcer le nom de madame Louis; alors j’ai ouvert les oreilles tout en continuant à ronfler, et M. Beaumont a raconté ce qui s’était passé à la ferme.
—Et il... il a exprimé des soupçons.
—Il disait qu’il y avait eu, sans aucun doute, du poison de donné.
—L’autopsie de la mère Louis a prouvé le contraire.
—C’est bien ce qui l’embarrassait, reprit le Parisien; mais tout en les écoutant parler, j’ai fait, moi, une réflexion.
—Laquelle?
—C’est qu’il y a eu deux morts, celle de la fermière et celle de votre fils.
—Eh bien?
—Eh bien, je me suis dit que si la première était naturelle, on pouvait bien avoir aidé à la seconde!
Vorel pâlit.
—En tout cas, il y aurait donc que’q’ chose qui ne serait pas conforme aux réglements, continua Jacques les yeux fixés sur son interlocuteur; que’qu’ manigance dans laquelle vous vous trouvez fourré.
—Après? dit le médecin.
—Après, j’ai pensé que ça vous serait nécessairement désagréable qu’on éclaircît la chose, et je suis, en conséquence, venu pour vous avertir.
Vorel qui tenait la tête baissée, la releva brusquement.
—C’est-à-dire que tu veux me proposer d’acheter ton silence? s’écria-t-il.
—On achète bien la parole des avocats! fit observer Jacques d’un ton cynique; chacun vit de son état.
—Et tu as pensé que je me laisserais effrayer par tes menaces?
—Du tout; je sais que vous n’êtes pas poltron, bourgeois, mais je sais aussi que vous êtes raisonnable! Vous comprendrez qu’il suffirait d’une petite lettre à la justice pour qu’on recherche de quoi votre fils est mort, et si on trouve qu’il a avalé une boulette, faudra bien savoir si c’est vous qui la lui avez jetée.
—Moi! s’écria Vorel; mais tu ne comprends donc pas, malheureux, que cette mort m’enlève tout droit à l’héritage de madame Louis; qu’elle me ruine, que je donnerais une partie des années qui me restent à vivre pour ressusciter mon fils!
—Bah! dit Jacques, persuadé par l’accent douloureux du médecin; mais si c’est pas vous qui avez fait le coup, pourquoi donc que vous n’avez rien dit, alors? La justice aurait bien trouvé ceux qui avaient intérêt à la chose.
—Intérêt! répéta le médecin frappé: il n’y avait que cette femme à en profiter.
—La petite Parisienne! Eh bien, puisqu’elle vous prend sur les nerfs, pourquoi ne pas lui avoir passé cette corde-là au cou?
Le front de Vorel s’éclaira subitement.
—La mère Louis morte, une explication devient impossible, murmurait-il; toutes les circonstances accusent Honorine... elle seule trouvait avantage à se débarrasser d’un cohéritier... Comment n’ai-je point pensé plus tôt!... Ah! la haine est aveugle! mais il est encore temps! Oui, quelles que soient les difficultés, j’entreprendrai cette tâche: je la poursuivrai jusqu’au bout; j’arracherai à cette femme l’héritage qu’elle m’a dérobé!
—Eh bien, c’est à moi que vous devrez ça, reprit le Parisien; je vous demandais de payer pour me taire; maintenant, j’y ai encore bien plus de droit, pour avoir parlé.
—Tu veux une récompense pour être venu me menacer, dit Vorel, à qui son espoir avait rendu une nouvelle énergie; vide la place, drôle, je fais déjà trop en te laissant ce que tu m’as volé.
—Prenez garde! dit le Parisien, dont le front s’était rembruni; faut pas être ingrat avec les amis. Je pourrais dire des choses...
—Qui te perdraient sans me nuire, car tu ne pourrais appuyer les déclarations d’aucune preuve. Cesse tes menaces qui sont ridicules, et va-t’en.
—Pas encore, cria Jacques en se précipitant sur le médecin, qui se sentit frappé au-dessous du bras.
Mais l’arme rencontra une côte qui la repoussa; le Parisien voulut redoubler; Vorel lui saisit la main et se jeta sur lui à corps perdu. La lutte se continua quelque temps entrecoupée de menaces et d’imprécations. Vorel qui ne pouvait espérer aucun secours, faisait des efforts désespérés; il poussa son adversaire jusqu’à la fenêtre. Celui-ci, qui se sentait faiblir, cria:
—A moi, Moser, à moi!...
Une grande ombre se leva tout à coup des plates-bandes. Le médecin l’entrevit. Comprenant que tout était perdu s’il donnait à un nouvel assaillant le temps d’intervenir, il se lança contre le Parisien par un élan suprême et le renversa sur le balcon; mais la balustrade céda avec un craquement sinistre et tous deux tombèrent sur le perron qui se dressait au-dessous. La tempe de Vorel alla frapper l’angle d’une des marches; il demeura où il était tombé, sans plainte et sans mouvement. Le Parisien se redressa avec un gémissement.
—L’Alsacien!... à mon secours!... bégaya-t-il.
—Me f’là! me f’là! dit Moser qui restait au bas du perron.
—Vite!
—J’ai beur que le pourgeois ne soit bas fini! reprit le Juif.
Et pour s’en assurer il ramassa l’arme que son compagnon avait laissé échapper, et en effleura le visage du médecin; mais le corps demeura immobile.
—Il a son gompte, dit-il plus résolûment; mais toi, bauvre Barisien, tu es pien malate, dis?
—Ah! brigand! interrompit Jacques, qui faisait des efforts inutiles pour se soulever sur les coudes; il a encore l’air de me plaindre... quand c’est lui qui est cause!...
—Foyons, foyons... nous fageons bas! dit Moser, qui voulut le prendre sous les bras; est-ce que tu beux bas te leffer?
—J’ai les jambes... brisées....
—Pah!... les teux?
Le Juif le laissa retomber sur la pierre.
—Eh pien! mais... gomment tonc que tu fas faire pour te sauffer! s’écria-t-il.
—Faut que tu m’emmènes, reprit Jacques qui se tordait dans d’atroces souffrances; Moser... je t’en prie... soulève-moi... porte-moi... ne me laisse pas ici... oh! oh! Moser... rien que jusqu’à la première maison... pourquoi ne réponds-tu pas?
Le Juif ne répondait point parce qu’il réfléchissait. Il avait compris l’impossibilité d’emmener son compagnon, et il se demandait s’il devait fuir sur-le-champ ou exécuter seul le projet de vol qui les avait amenés. Effrayé de son silence, le Parisien se redressa sur le ventre:
—Scélérat! balbutia-t-il, tu veux me laisser ici..... mais, prends garde... si tu m’abandonnes... je te dénoncerai...
—Qu’est-ce que tu tis? s’écria Moser en s’approchant.
—Oui... reprit Jacques d’un accent convulsif, sauve-moi ou je te perdrai... aussi... je dirai... tout.
—Tu tiras rien! interrompit le Juif.
Et il plongea à deux reprises dans la poitrine de son compagnon l’arme qu’il tenait. Celui-ci poussa un cri étouffé. Dans ce moment un bruit de voiture retentit dans le chemin; c’étaient Marc et Honorine qui regagnaient la route d’Isigny. Moser les laissa s’éloigner, puis entra au manoir dont la porte n’avait point été refermée. Il n’en sortit que deux heures après, chargé de tout ce qui pouvait être emporté, et se dirigea rapidement vers Carantan, d’où il gagna Saint-Lô, puis Coutance et Granville.
Cette direction n’avait point été prise par lui au hasard, il poursuivait un projet formé avec le Parisien, et que tous deux devaient accomplir après l’affaire Vorel. Maîtres d’une forte somme amassée par le vol et conservée par l’économie de l’Alsacien, ils avaient résolu de quitter la France dont le séjour leur devenait à chaque instant plus dangereux. Moser, qu’avait enrichi l’héritage de son compagnon, persista dans ce plan qui devait lui assurer la paisible jouissance de ce qu’il possédait. Descendu dans une des moindres auberges de Granville, il y rencontra le capitaine d’un petit navire portant le pavillon des États-Unis et lui communiqua son intention. L’Américain fit un tableau si séduisant de son pays, où l’on ne s’informait du passé de personne, et où chacun était classé d’après ce qu’il apportait de dollars, que le Juif se laissa persuader de le suivre. Tout ce qu’on lui disait réalisait, en effet, son idéal. Possesseur désormais d’un capital honnête, il pouvait rentrer dans la vie régulière, et appliquer au commerce permis les capacités jusqu’alors employées aux industries défendues. Il se voyait déjà citoyen estimé d’un grand État, et exploitant cette estime comme un escompte de son capital; défenseur de l’ordre établi, maintenant qu’il y avait trouvé sa place, et trouvant tout bien dès qu’il ne se trouvait plus mal. Il songeait même à reprendre une religion pour être plus respectable et à louer un commis qui sût l’orthographe à sa place. Bercé par ces rêves charmants, il s’embarqua dans la chaloupe américaine pour aller rejoindre le navire prêt à mettre à la voile. Comme il débordait, une petite barque glissa près de la sienne, et il aperçut à l’arrière un homme déjà vieux assis près d’une jeune femme à l’air accablé; c’étaient Marc et Madame Honorine de Luxeuil qui gagnaient le vieux manoir de la Brichaie.
On ne peut jeter les yeux sur une carte du département de la Manche, sans remarquer la vaste échancrure creusée par la mer au sud-ouest de ce département. Elle forme un arc régulier dont Granville et Cancale occupent les deux extrémités. Du côté de cette dernière ville, la baie n’a pour encadrement que les grèves basses et arides, à l’entrée desquelles s’élève le mont Saint-Michel; mais en remontant vers le nord, après avoir dépassé Tombelene, le rivage s’élève doucement et prend un aspect plus riant jusqu’à ce que l’on rencontre la vallée de Sartilly, verdoyante, ombreuse et encadrée de coteaux du sommet desquels apparaît un des plus magnifiques paysages que l’œil puisse embrasser. C’est dans cette vallée que se trouvent dispersées les maisons de campagne de la bourgeoisie de Granville, riantes demeures d’été, abritées par des bois et entourées de jardins, de vergers ou de prairies; mais la plupart avoisinent la route d’Avranches vers l’embouchure du vallon: aux bords de la mer elles deviennent plus rares et l’on ne trouve guère que de pauvres fermes ou quelques maisonnettes de pêcheurs. Cependant quiconque a côtoyé la baie doit avoir remarqué une vieille habitation bâtie au flanc de la falaise et à moitié masquée par un bouquet de pins rabougris. Bien que l’architecture ne permette guère d’assigner une époque fort reculée à cette construction bâtarde, le site et l’abandon lui ont imprimé un singulier caractère de vétusté. Le corps du bâtiment, peu élevé, ne présente que quatre fenêtres de façade; mais deux longues ailes qui s’étendent par derrière triplent en réalité le logement apparent. Entre ces deux ailes commence un jardin qui se prolonge dans une sorte de fente ouverte au milieu du coteau et qui, par une pente insensible, va en rejoindre le sommet. Malgré l’aridité de tout ce qui l’environne, ce jardin doit à sa position abritée du côté du nord une fertilité dont le contraste frappe et étonne le regard. Du reste triste, isolée, et n’ayant pour voie de communication avec la ville que les barques de pêcheurs, la Brichaie était depuis longtemps demeurée déserte. Depuis deux mois seulement un étranger l’habitait, sans autre serviteur qu’une vieille paysanne chargée de garder l’habitation; et cet étranger n’était autre que le duc de Saint-Alofe.
En quittant la maison de santé de Bel-Air, il avait mis à profit la confidence de Marc, forcé le marquis à le laisser libre, et gagné Granville, puis la Brichaie, dont l’isolement devait faire une sûre retraite. C’était de là qu’il avait écrit à Marc cette lettre renvoyée de Paris à Trévières, et dont nous avons précédemment parlé. L’arrivée d’Honorine lui causa autant de surprise que de joie; mais celle-ci fut bientôt tempérée par la révélation de tout ce que la jeune femme avait eu à souffrir, et de ce qu’elle avait à craindre. Il y eut entre lui et Marc une longue conférence, à la suite de laquelle ce dernier repartit avec une procuration en blanc signée par Honorine. Son absence, qui devait être courte, se prolongea plusieurs semaines. Le duc passait ses journées à méditer et à écrire; la vieille paysanne, qui était sourde, ne parlait que pour faire les questions indispensables, ou pour y répondre; Honorine, toujours seule et silencieuse, n’avait donc d’autre occupation, d’autre compagnie que ses souvenirs; circonstance fatale, qui devait enraciner plus profondément sa douleur. L’activité, succédant aux cruelles épreuves qu’elle venait de traverser, eût empêché son esprit de se les rappeler; distraite de sa souffrance, elle eût pu arriver à se résigner sinon à se guérir; mais l’oisiveté et la solitude la laissèrent livrée à toute l’amertume de ses regrets; elle porta de ce côté ce qu’il y avait en elle de force et d’ardeur; chaque semence douloureuse laissée dans son cœur put y germer, se développer, grandir, et quand Marc revint, il fut effrayé des progrès que le mal avait faits pendant son absence. Pour comble de malheur, il apportait de fâcheuses nouvelles. Irrité du départ d’Honorine, de Luxeuil avait attaqué le testament de la mère Louis, qui, selon lui, portait atteinte au droit d’administration que lui donnait son titre de mari, et un procès allait se trouver engagé. Honorine dut signer de nouveaux pouvoirs, et écrire pour se procurer les fonds nécessaires. Elle le fit avec une répugnance nonchalante qui affligea profondément l’ancien chouan. Elle semblait ne point comprendre la nécessité de disputer cet héritage qu’elle eût voulu abandonner; désintéressée de la vie, elle ne demandait qu’à ne plus entendre ses bruits et qu’à se plonger plus profondément dans la retraite. Marc espéra vaincre cette espèce de torpeur en peuplant et en égayant la Brichaie: il repartit donc pour Paris d’où il revint avec Françoise et avec M. Brousmiche qui relevait d’une maladie à la suite de laquelle on lui avait retiré sa place de portier. A la vue de la grisette, Honorine eut en effet un élan de joie qu’augmentèrent encore les larmes de la mère et les caresses du fils.
—Eh bien! la reconnais-tu, mon petit Jules? répétait Françoise, qui riait et pleurait en même temps; c’est la bonne dame, ainsi que tu l’appelais. Ah! si vous saviez comme il vous aime..... et comme il m’a parlé de vous! C’était si souvent que quéq’fois j’en ai pris de l’humeur... oui... j’en étais presque jalouse!
Honorine souriait attendrie et serrait l’enfant dans ses bras.
—Et pourtant j’aurais dû comprendre ça, reprenait la grisette; moi qui trouvais si triste de ne plus vous voir et qui avais tant besoin de ramener votre nom en causant.... Demandez à M. Brousmiche; pas vrai, monsieur Brousmiche, que j’en rabâchais?
—C’est un terme que mademoiselle Françoise peut seule se permettre à l’égard d’elle, répliqua le petit bossu avec sa politesse ordinaire; mais il est certain que nous avons pris bien souvent la liberté de nous entretenir de Madame... quoique n’ayant pas l’honneur de la connaître ni d’être connu d’elle.
—Vous vous trompez, monsieur Brousmiche, reprit Honorine; je vous connais depuis longtemps déjà.
Le petit bossu parut étonné.
—Croyez-vous donc que je ne sache pas ce que vous avez fait pour le duc, pour Marc, pour Françoise? continua la jeune femme d’un accent affectueux; nous sommes de vieux amis sans nous être jamais vus, et je vous demande pardon de ne pas m’être encore informée de Lolo et de Fanfan.
—Hélas! Madame, répondit le petit bossu, dont le visage s’altéra à ces derniers mots; vous êtes trop bonne.... mais tous mes soins ont été inutiles... cela a fini par un malheur...
—Ah! je suis désolée de vous l’avoir rappelé, interrompit gracieusement Honorine... je voulais vous prouver seulement qu’en disant vous connaître je ne me vantais pas! Mais, pardon, vous devez être fatigués, je vais vous montrer les chambres que l’on a fait préparer pour vous.
Elle les y conduisit en effet; mais Françoise ne voulut prendre aucun repos qu’elle n’eût visité le jardin, la maison et le petit bois de sapins. Tout lui parut charmant, et, chemin faisant, elle communiqua ses projets d’arrangements et d’améliorations. Elle déclara qu’elle aurait une basse-cour, trouva un vieux grenier d’appentis excellent pour des pigeons, énuméra tout ce qu’il faudrait semer dans le jardin, et finit par déclarer que l’on pourrait avoir une couple de chèvres qui brouteraient l’herbe rase de la dune. Brousmiche s’associait à tous ces plans en y ajoutant quelques menus détails, toujours proposés sous la forme du doute et toujours acceptés avec empressement par la grisette. Mais, arrivés au bout du jardin, tous deux s’arrêtèrent pour regarder la mer qui s’étendait à l’horizon. Le petit bossu qui l’avait aperçue, il y avait quelques heures, pour la première fois, ne pouvait se rassasier de la regarder et s’inquiétait de savoir d’où pouvait venir tant d’eau, tandis que Françoise, plus familiarisée avec ce spectacle, faisait observer que l’on trouvait sur les rochers des coquillages et des crabes et que ça pouvait être encore une ressource. Quant à Honorine, elle jouait avec l’enfant qu’elle élevait dans ses bras pour qu’il pût atteindre les pommes de pin, et qu’elle conduisait sur les grèves de sable brillant ou vers le banc de cailloux polis par la mer. C’était une occupation nouvelle et charmante fournie à son oisiveté. Le petit Jules qui n’avait jamais connu, pour ainsi dire, qu’elle et sa mère les confondait dans ses expansions enfantines; il avait pour toutes deux une part presque égale de mots tendres et de baisers. Il cessa de donner à Honorine le nom de la bonne dame pour l’appeler l’autre maman.
Mais là où le cœur est troublé les sources de la joie elles-mêmes s’aigrissent. Cette affection d’enfant qui, au premier moment, avait été pour Honorine une consolation, devint insensiblement un motif d’amertume. En écoutant le nom qu’il lui donnait, de nouvelles aspirations s’éveillèrent dans son âme; cette maternité adoptive lui rappela qu’elle n’en connaîtrait jamais de plus complète; que privée des bonheurs de l’épouse elle le serait encore de ceux de la mère; que le ciel lui avait refusé jusqu’à cette tardive consolation donnée aux femmes les plus éprouvées, de rajeunir et de revivre dans un être qui est encore une part d’elles-mêmes! Oh! si à bout de tout espoir elle avait pu du moins espérer pour son enfant! lui préparer une place dans la vie, le voir heureux par elle et réchauffer sa vieillesse au soleil de sa prospérité! Mais ne trouver que l’isolement dans le présent, l’isolement dans l’avenir; n’avoir aucune raison de vivre, aucun but à poursuivre! Cette pensée l’écrasait. Alors, au milieu de son découragement, le souvenir de Marcel lui revenait plus douloureux. La persuasion qu’il avait quitté la France et qu’elle ne devait plus le revoir, la jetait dans un désespoir sans mesure; elle s’indignait de vivre, elle appelait la mort comme une libératrice! Le duc, livré à ses préoccupations, ne s’apercevait de sa tristesse que par intervalles; Françoise et Brousmiche qui la voyaient tous les jours, avaient fini par s’y accoutumer, mais Marc, dont les absences étaient fréquentes, s’effrayait de la retrouver, à chaque retour, plus muette, plus indifférente à tout. Il s’attrista d’abord, puis l’inquiétude succéda, lorsqu’il vit la jeune femme pâlir et perdre ses forces. Tous les essais tentés pour combattre cette langueur furent inutiles. Les médecins appelés parlèrent d’affection nerveuse, mot vague et immense dans lequel la Faculté embrasse tout ce qui est inconnu. Quelques-uns émirent des doutes plus précis en prononçant le mot de phthisie! Marc, frappé d’épouvante, voulut conduire la jeune femme à Paris, où il espérait que la science se montrerait plus éclairée; mais il ne put l’y déterminer. Croyant sentir l’approche d’une mort qu’elle souhaitait, Honorine se déclara incapable de quitter la Brichaie et supplia de ne point exiger d’elle un effort inutile.
Marc, désespéré, employa en vain toutes les prières; ensevelie dans sa torpeur, la jeune femme se défendait par le silence. Enfin, ne pouvant rien obtenir, il prit un parti extrême, partit subitement pour Paris et se présenta chez le docteur Darcy. La réputation de celui-ci avait encore grandi dans ces derniers temps, et ses soins étaient une faveur que l’on se disputait à force d’argent et de patience. Marc trouva trois salons remplis de clients qui venaient le consulter. Tous les âges et toutes les classes étaient là momentanément confondus par l’égalité de la souffrance et attendant le moment de parler à M. Darcy comme ils eussent attendu la guérison. On voyait des malheureux se traînant à peine et sortis du lit pour obtenir un conseil; car, ce n’était plus lui qui se transportait près de la couche du malade, mais le malade qui quittait sa couche pour se transporter près de lui; le temps du savant était plus précieux que la vie de celui qui souffrait. Marc attendit plusieurs heures et fut renvoyé avant que son tour fût arrivé; le lendemain il fut plus heureux et put pénétrer dans le cabinet du docteur. Ce cabinet était une vaste pièce entourée de bibliothèques que décoraient les bustes des médecins matérialistes les plus célèbres. Trois bureaux y étaient disposés, et à chacun de ces bureaux se trouvait assis un secrétaire qui écrivait. M. Darcy se tenait au milieu devant une table couverte de livres et de lettres.
Au moment où Marc entra, il dictait à l’un des secrétaires:
«Le traitement proposé se composera: 1º de frictions opiacées...»
Marc salua; Darcy lui jeta un regard de côté en disant:
—Quelle est votre affection, Monsieur?
Et, se retournant vers le secrétaire, il continua:
«De frictions opiacées sur toutes les régions soumises à la douleur...»
Puis, adressant de nouveau la parole à Marc, il reprit:
—Parlez, Monsieur, je vous écoute.
Et tout en écoutant, il continuait:
«2º Des applications de sinapismes journaliers...»
Marc était demeuré immobile. La pensée que l’on dictait ainsi la vie ou la mort comme s’il se fût agi d’une facture réglée sauf erreur, lui causa un tel saisissement qu’il resta d’abord indécis. Il venait le cœur plein de trouble et de larmes consulter sur une vie plus précieuse pour lui que le monde entier, et il voyait ces consultations données au milieu d’une conversation, presque sans y prendre garde! Après un instant de stupeur, il fit un mouvement instinctif pour se retirer. Le docteur, qui avait achevé de dicter, et qui prenait le papier pour signer, leva la tête.
—Eh bien! où allez-vous donc? demanda-t-il étonné, j’attends que vous me parliez. Qu’éprouvez-vous? Quelle est votre affection?
—Je ne venais pas pour moi, Monsieur, répliqua Marc en hésitant; mais pour une personne qui habite loin de Paris... et dont j’aurais voulu vous parler sans témoins.
Le docteur se leva et fit passer Marc dans une pièce voisine.
—Ici, nul ne peut nous entendre, dit-il lorsque la porte fut refermée.
Le garçon de bureau le regarda en face.
—Vous souvenez-vous, Monsieur, dit-il d’une voix basse et légèrement émue, d’un voyage fait, il y a vingt ans, avec madame la comtesse de Luxeuil?
—En Touraine.
—A Château-la-Vallière.
—Pardieu! nous arrivâmes pour voir mourir sa sœur, la baronne Louis.
—Oui, reprit Marc, visiblement troublé par ces souvenirs; mais la baronne laissa une fille...
—Mademoiselle Honorine! qui a plus tard épousé son cousin... et qui a été forcée de le fuir... Je me rappelle parfaitement... une charmante brune... tempérament bilio-sanguin... magnifique constitution...
—Eh bien... elle est mourante, Monsieur!
Darcy releva brusquement la tête.
—Mademoiselle Honorine? répéta-t-il, qu’est-ce que vous me dites-là? Que lui est-il donc arrivé? Quel est son mal?
Marc raconta sommairement au médecin les derniers événements qui avaient obligé Honorine à quitter les Motteux (en lui taisant toutefois ce qui avait rapport à de Gausson), et dans quelle langueur la jeune femme était tombée depuis son arrivée à la Brichaie. Le docteur écoutait avec une attention qui devenait à chaque instant plus sérieuse. Il adressa plusieurs questions à Marc, lut deux consultations données par des médecins de Granville, puis se mit à parcourir la chambre d’un air soucieux.
—Prostration des forces... pâleur... dégoûts, murmura-t-il... diable! diable!
—Vous trouvez ces symptômes alarmants, n’est-il pas vrai, Monsieur? dit Marc palpitant.
—Je les trouve surtout incertains, reprit Darcy en continuant à se promener; s’il s’agissait d’un homme on pourrait avoir une opinion, mais avec une femme on ne peut rien décider. Les femmes sont les plaies de la médecine, Monsieur, elles échappent à toutes les observations, contrarient tout principe: la veille vous les croyez perdues et le lendemain on les trouve au bal. Vous les déclarez guéries et on vous adresse une invitation pour leur enterrement. Il semble qu’elles ne vivent et qu’elles ne meurent que par caprice et sans s’inquiéter des règles de la physiologie... Aussi empêchent-elles tous les progrès de la science... tant qu’il y aura des femmes, on ne pourra arriver à aucune certitude en médecine.
—Mais votre impression, Monsieur? demanda Marc, dont cette incertitude augmentait l’angoisse.
—Je veux être pendu si j’en ai une, reprit Darcy, tout ce que je vois là peut également indiquer un état désespéré ou une crise passagère... il faudrait s’assurer... examiner par soi-même. Peut-être suffirait-il d’un régime raisonnable pour la sauver.
—Ah! vous la sauverez alors! s’écria Marc en joignant les mains.
—Ce serait de tout mon cœur, reprit Darcy; mais le moyen de la voir: elle ne peut, dites-vous, venir à Paris?
—Il est trop vrai.
—Vous comprenez que de mon côté je ne puis partir pour la Normandie, reprit Darcy d’un ton qui ne permettait même point de discuter la possibilité de ce voyage.
Marc laissa retomber ses mains et baissa la tête.
—C’est juste, dit-il avec abattement; dans la position de M. le docteur, il ne peut se déranger... pour nous!... et cependant, mon Dieu! penser qu’il suffirait peut-être d’une visite pour la faire vivre; que si, au lieu d’être une pauvre femme, abandonnée de tout le monde, elle avait son rang, sa famille, monsieur eût pu céder à des prières plus puissantes! Mais moi, il ne me connaît pas, je n’ai le droit de lui rien demander; et ceux qui auraient dû protéger madame Honorine l’aiment mieux morte que vivante... vu qu’ils héritent! aussi bien, qui sait si elle ne sera pas plus heureuse de s’en aller! Une fois dans le cimetière elle pourra dormir tranquille du moins; on ne lui en voudra plus de ce que Dieu lui a donné. Après l’avoir tuée on prendra son deuil!... et s’il y a quelqu’un qui la regrette trop... il pourra la rejoindre!... Monsieur excusera mon importunité.
L’accent de Marc était devenu entrecoupé; des larmes tremblaient dans sa voix; il fit un pas vers la porte, Darcy le retint. L’émotion de l’ancien chouan l’avait gagné.
—Un moment! reprit-il, que diable, il ne faut pas se désespérer ainsi. J’espère qu’il y a encore de la ressource... et, dans tous les cas, j’en veux avoir le cœur net, je partirai avec vous.
Marc poussa un cri de joie.
—Vous consentiriez! dit-il. Ah! Monsieur, laissez-moi serrer vos mains. Oui, j’ai eu tort de perdre courage; je devais tout espérer de votre cœur.
—Il ne s’agit point de cœur, interrompit le docteur, qui tenait à maintenir sa réputation d’insensibilité; la position de madame Honorine peut donner lieu à de curieuses observations, et ce que j’en fais est dans l’intérêt de la science... Seulement il ne faudrait point de retard, et nous partirons... Voyons, il faut d’abord que je consulte mon carnet.
Il appela un des secrétaires qui lui apporta un petit registre dont il examina les dernières feuilles.
—Bien, murmura-t-il; je ne vois rien d’absolument indispensable. Le vieux duc de Clairvaut! il mourra parfaitement sans moi. M. d’Escar, il peut encore bouloter trois ou quatre jours sans danger, et il a son confesseur pour lui faire prendre patience. Madame de Chanteaux: depuis que de Cillart est parti avec cette danseuse, elle se dit malade pour faire quelque chose... Ah! le prince Dovrinski; il faudra envoyer lever son appareil. La marquise m’a écrit ce matin qu’il avait renoncé à se rebrûler la cervelle. Pour le reste, vous enverrez Mullin à ma place; il indiquera aux malades le traitement, et le hasard les guérira. Je vais achever de signer quelques consultations, faire mes préparatifs, et dans deux heures nous serons sur la route de Normandie.
Marc se retira en promettant d’être exact. Il employa le peu de temps qui lui restait à voir l’homme d’affaires chargé des intérêts d’Honorine, puis revint chez Darcy avec lequel il monta en chaise de poste pour Granville.
L’arrivée du médecin causa à la jeune femme un premier saisissement qui fut bientôt suivi d’une crise de larmes. Sa vue lui rappelait tout un passé vers lequel sa pensée ne pouvait retourner sans émotion. Darcy s’efforça de la calmer par d’affectueux encouragements. Il feignit de ne point la trouver changée et parut à peine s’occuper de sa santé. Mais sous cette tranquillité apparente se cachait une réelle inquiétude. L’examen le plus attentif ne put rien lui apprendre sur la cause de la souffrance qui minait Honorine: aucune lésion sérieuse ne semblait justifier son dépérissement. Le mal était évidemment une de ces influences intérieures qui tarissent la vie à sa source même. Après avoir passé une partie du jour à chercher la solution de ce problème, Darcy fit quelques recommandations, indiqua une hygiène, puis prit congé d’Honorine. Mais avant de le laisser repartir, Marc le prit à l’écart.
Le docteur plia les épaules et répliqua d’un ton désappointé qu’il ne pouvait rien dire.
—Ah! elle est perdue, s’écria Marc.
—Que je me fasse moine si j’en sais rien! reprit Darcy; il y a évidemment chez elle un mal profond et qui se cache; mais où est-il? quel est-il? Je l’ignore. On dirait qu’outre tous ses chagrins elle couve une affliction particulière; quelque chose comme une passion comprimée. Si c’est cela, il n’y a qu’un remède, et vous le connaissez aussi bien que moi; tâchez de lui redonner envie de vivre, tout le reste est inutile.
A ces mots le docteur remonta en chaise de poste et partit. Mais ses dernières paroles avaient fait une profonde impression sur Marc, et dès le lendemain il quitta de nouveau la Brichaie. Son absence ne dura que trois jours. Il reparut un matin au moment où Honorine, tentée par la beauté du jour, venait de sortir pour gagner la lisière du petit bosquet de sapins. Le soleil brillait doucement, la brise gazouillait dans les feuilles, et l’Océan immobile semblait une plaque d’azur frangée d’argent. La jeune femme était assise sur un pliant de bambous, et Françoise, accroupie à ses pieds, tenait le petit Jules debout devant ses genoux. L’enfant lui montrait des coquillages ramassés sur la grève, et la malade lui répondait par des signes caressants. Elle était vêtue de noir: ses cheveux, relevés sans soin par un peigne d’écaille, donnaient à sa physionomie quelque chose de plus naïf et de plus jeune encore. Mais cette jeunesse n’avait rien de fort ni de riant. Pâles et amaigris, les traits d’Honorine avaient pris cette délicatesse maladive des fleurs nées sans soleil; c’était quelque chose de plus tendre, de plus élégant, de plus suave peut-être, mais de profondément triste. Le regard flottait dans une vague expression, les lèvres à peine colorées restaient doucement entr’ouvertes, les contours moins arrêtés avaient je ne sais quoi d’incertain, et son teint, plus transparent, semblait éclairé d’un reflet bleuâtre. Elle regardait devant elle, écoutant les causeries de l’enfant et de Françoise, comme ces douces rumeurs de flots ou de vent qui vous charment sans qu’on les comprenne, lorsque Marc s’avança vers elle; à sa vue elle fit un mouvement.
—Ah! vous voilà! dit-elle avec un pâle sourire; je ne vous espérais pas si tôt.
Marc, qui paraissait éprouver quelque embarras, répondit que l’affaire pour laquelle il était parti s’était arrangée plus vite qu’il ne l’avait d’abord supposé, et avertit Françoise qu’on la demandait au logis. La grisette prit son fils dans ses bras et partit en chantant. Marc la regarda aller.
—Bonne et tendre fille, dit-il à demi-voix; Dieu ne lui a donné pour la dédommager de tout qu’une affection, et c’est assez pour la rendre heureuse.
—Ah! c’est que pouvoir jouir d’une affection, c’est vivre, dit Honorine doucement; il n’y a de véritablement à plaindre que ceux qui restent sans liens.
Marc la regarda.
—Ainsi c’est là ce qui vous fait mourir? dit-il brusquement.
La malade tressaillit; une rougeur subite traversa sa pâleur; c’était la première fois que le chouan faisait allusion à son amour pour de Gausson et à la séparation qui avait brisé leur joie. Elle porta une main à son cœur comme si elle y eût senti le contre-coup de ces brusques paroles.
—Je n’ai point... parlé... de moi!... balbutia-t-elle blessée.
—Ah! ne cherchez point à me donner le change, reprit Marc, dont l’embarras se traduisait par une rudesse inaccoutumée... Vous souffrez, parce que votre isolement vous tue. Aux Motteux vous supportiez tout; il y avait dans l’air quelque chose qui vous donnait de la force!
—Pourquoi me le rappeler? murmura Honorine, qui serra son mouchoir sur ses lèvres...
—C’est donc vrai, bien vrai, reprit Marc rapidement; tout votre mal vient de là! Répétez-le moi, je vous en prie.
—Ne m’interrogez pas, dit la jeune femme, dont les paupières se gonflèrent de larmes. A quoi bon me demander... ce que je ne veux point savoir moi-même? Jusqu’à ce moment vous aviez eu pitié de moi; vous m’aviez épargné des explications inutiles... Laissez les choses suivre leur cours... Je ne me suis pas plainte! Pourquoi vouloir me consoler? Ce qu’il y avait dans l’air des Motteux, comme vous le dites, aucune puissance humaine ne peut le mettre dans celui de la Brichaie...
—Qu’en savez-vous? dit Marc.
Elle releva vivement la tête, regarda fixement son interlocuteur, joignit les mains et s’écria:
—Vous avez vu Marcel?
—Je l’ai vu! répondit-il.
—Ainsi... il n’a point quitté la France?
—Non...
—Et... il est près d’ici... car votre absence a été courte... Où est-il? Que vous a-t-il dit? répétez-moi tout, ne me trompez pas; oh! parlez, parlez, je vous en conjure.
Elle avait saisi la main de Marc; son œil brillait, sa voix était palpitante; on eût dit qu’un flot de vie élancé de son cœur venait d’inonder tout son être; Marc serra sa main dans les siennes.
—Oui, reprit-il ému, je l’ai vu... et il ne m’a parlé que de vous... Il ne peut supporter plus longtemps cette séparation. Lui aussi il languit; et pour revivre il ne demande qu’à vous voir.
—Ah! qu’il vienne! cria Honorine en se levant.
Elle n’acheva pas! Son nom venait d’être prononcé dans un cri... et Marcel était à ses pieds. Incapable de supporter une pareille émotion, elle laissa tomber sa tête sur son épaule, à demi évanouie de bonheur. Quand elle revint à elle, Marc avait disparu, mais de Gausson se tenait à ses côtés, les regards sur les siens, pâle d’inquiétude et de douleur. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit afin de s’assurer qu’elle n’était point le jouet d’un rêve. La voix de Marcel dissipa ses doutes; il répétait son nom, il parlait du bonheur de la revoir en mots entrecoupés; il jurait de ne plus la quitter... et Honorine enivrée écoutait sans répondre; s’il s’arrêtait, elle murmurait tout bas:
—Parlez encore! parlez encore!
Et insensiblement, ses joues se coloraient, son œil devenait plus brillant, son sein se gonflait; elle sentait le réseau de plomb qui pesait sur elle se soulever et le sang circuler plus librement dans ses veines; elle retrouvait sa force, elle vivait! La journée entière passa comme un rêve; le lendemain et les jours qui suivirent ce fut le même enchantement. La guérison d’Honorine était désormais assurée; elle traversait toutes les joies de la convalescence. De Gausson était venu s’établir dans une petite maison de pêcheur réparée et meublée par les soins de Marc; elle se trouvait placée vis-à-vis de la chambre occupée par Honorine, et chaque matin les deux amants couraient à leurs fenêtres pour se saluer du regard et du geste. C’était à qui devancerait l’autre dans ce rendez-vous. Puis Marcel venait déjeuner à la Brichaie où le duc lui développait ses espérances de régénération sociale, ajoutant tous les jours quelque nouveau détail à ce poëme de l’avenir que poursuivait sa vieillesse. Le jeune homme écoulait ces nobles inspirations, les yeux fixés sur Honorine et le cœur épanoui de sa joie: il espérait avec le vieillard; il voyait comme lui poindre à l’horizon l’aurore d’un meilleur temps; son bonheur lui donnait la foi. Quant à la jeune femme elle avait repris son activité sereine; attentive près du duc, tendre pour Marcel, bonne envers les autres, elle était redevenue le soleil qui donnait à tous la lumière et la gaieté. Françoise avait recommencé à chanter comme une alouette; le petit Jules s’était remis à jouer avec la jeune dame, et Brousmiche, toujours au jardin, qu’il avait entrepris de cultiver, s’appuyait sur sa bêche lorsqu’il apercevait Honorine et de Gausson, et les regardait passer avec un sourire attendri.
Marc seul était demeuré grave, sinon triste: ange gardien de ce paradis, il tenait les yeux fixés vers l’entrée avec inquiétude, comme s’il eût craint quelque funeste apparition. Mais ses protégés n’y songeaient pas. Tout entiers à leur ravissement, ils laissaient passer les jours comme ces nuées qui voguent dans un ciel d’été. La lumière succédait à la lumière, l’azur à l’azur. Qui eût pu leur faire craindre la tempête? Ils parcouraient lentement les grèves, les promontoires, les vallées, appuyés l’un sur l’autre, regardant la mer et le ciel, écoutant le vent dans les sapins, foulant aux pieds les bruyères défleuries, le cœur si plein que leur enivrement débordait sur tout et ne leur faisait voir autour d’eux que charmes et délices. C’était la première fois qu’ils connaissaient cette plénitude d’existence, que l’avenir et le passé s’effaçaient du monde et qu’ils glissaient dans la vie, emportés sur leur bonheur comme sur une barque qui vous suit partout. Ah! quand lassé des épreuves qui traversent les plus belles destinées, on se plaint du mélange amer d’espérances et de désenchantements qui forme la trame de la vie, on a oublié ces rapides illusions de la jeunesse qui seules peuvent faire comprendre les joies immuables d’un autre monde; on ne se souvient plus du temps où l’on semait sa joie partout et où partout on la voyait germer et fleurir; de ces jours où les eaux, les bois, le ciel nous parlaient avec une seule voix, nous regardaient avec un seul regard, où toutes les divergences humaines venaient se confondre dans l’immense unité d’un amour partagé. Songe d’un jour qui ne laisse à sa suite que le regret et l’incrédulité. Honorine et de Gausson y étaient plongés! suffisamment heureux de s’aimer, ils ne désiraient rien, ils ne craignaient rien. Leur bonheur était trop complet pour qu’ils pussent le croire périssable! Et cependant l’orage était proche! Tandis que, comme le premier couple peint par Milton, ils traversaient leur Éden, enveloppés de leur amour, l’ennemi préparait ses embûches et cherchait l’entrée de la retraite où ils s’étaient abrités.
Il est rare que les retours, après de longues séparations, ne soient pas, pour ceux qui se retrouvent, une occasion de surprise et de désappointement. On s’est quitté se connaissant bien, avec des haines ou des sympathies justifiées, et pendant l’absence l’action invisible du temps, de l’âge, des événements, a amené de chaque côté des changements qui font qu’on se reconnaît à peine. On se parle de ses anciennes affections, de ses anciens goûts, de ses anciennes espérances, et à chaque demande l’interlocuteur s’embarrasse, comme si on lui parlait d’un mort; il faut refaire connaissance avec une nouvelle famille de sentiments inconnus qui vous accueillent avec défiance. Or, ce qui arrive à cet égard dans la vie, arrive également dans le récit du romancier. Tandis que les événements marchent et que le temps s’écoule, les personnages que vous aviez laissés en arrière ont suivi leur voie, et quand le drame vous les ramène ce ne sont plus les mêmes gens que vous aviez présentés à vos lecteurs. Non que tout soit changé en eux, car chaque âme humaine ne se renouvelle qu’avec ses propres éléments, mais les mêmes instincts ont revêtu d’autres formes; vous sentez le besoin d’une explication pour les faire reconnaître.
Cette explication nous est surtout devenue nécessaire au sujet de madame la comtesse de Luxeuil, abandonnée par nous après le mariage de son fils, et à peine entrevue depuis, lors de la rencontre de Marc et du marquis de Chanteaux. Pour elle comme pour tant d’autres, l’âge avait amené, non pas une conversion dans les sentiments, mais une réforme dans les habitudes. Sentant les vanités mondaines lui échapper, elle s’en était retirée comme ces hommes d’État qui envoient leur démission la veille de leur chute. Sa ruine se trouvait consommée par la rupture de son fils. Ne pouvant continuer le train de maison qu’elle avait jusqu’alors soutenu, elle se sentit subitement touchée par la grâce et se réfugia du monde, qui n’avait plus de place pour elle, dans l’Église qui ne demandait qu’à lui en faire une. On l’y reçut avec son égoïsme, sa malveillance, sa frivolité, comme une naufragée dont il faut accepter les infirmités et les haillons. Elle trouva place pour tout. La dévotion est une habitation à cloisons mobiles où chacun se loge selon ses habitudes. Grâce à elle, il en est de Dieu comme des rois de la terre qui sont faits pour leurs peuples; on peut l’accommoder aux désirs de chaque pécheur, et allonger ou raccourcir, selon les besoins, le glaive de la justice. Mais cette indulgence doit s’acheter. Dieu ne se montre accommodant qu’au profit de ses ministres; ce que l’on empiète sur ses priviléges, il faut le rendre à l’Église. La comtesse de Luxeuil le savait et accepta sincèrement l’obligation. Son nom et ses anciennes relations pouvaient la rendre utile à mille saintes négociations, entreprises pour la plus grande gloire du ciel; on le comprit, et elle s’y prêta avec la bonne grâce qu’elle mettait toujours à accorder les services qui la servaient elle-même. Rompue aux intrigues et ayant l’expérience du monde, elle devint bientôt un des instruments les plus indispensables de cette association catholique dont l’activité commençait à tout remuer. Grâce à ses nouveaux amis, ses affaires furent réglées, sa position assurée, et elle put jouir de toutes les aisances du luxe, en faisant tout doucement son salut.
Les choses continuèrent ainsi jusqu’à ce qu’Arthur revînt des Motteux. L’association méditait alors d’élever une tribune du haut de laquelle on pût attaquer les ennemis du catholicisme, et proclamer les saines doctrines qui devaient sauver le monde en le donnant aux associés. Mais en plaçant à la tête d’une pareille entreprise des noms appartenant au clergé, on lui ôtait d’avance toute influence de propagande mondaine; ce n’était plus que transporter le sermon dans un journal. Si l’on pouvait, au contraire, lui donner pour chef un homme du monde, on faisait sortir la croisade de l’Église; on y intéressait de nouveaux auxiliaires, on faisait croire enfin à la foule, toujours prise par les apparences, que la réaction avait gagné toutes les classes et que l’armée catholique comptait autant de fracs que de robes noires. On chercha longtemps parmi les gens dont le nom aristocratique pouvait donner un certain éclat à cette tentative, et celui d’Arthur de Luxeuil fut prononcé. On le savait réduit aux derniers expédients, par conséquent accessible à la tentation. Sa mère fut chargée de négocier cette affaire. En prétextant le désir d’une réconciliation, il lui était facile d’attirer Arthur, et de savoir au juste ce que l’on pouvait attendre de lui. Le marquis de Chanteaux servit d’intermédiaire: il alla trouver le jeune homme et l’amena à la comtesse. L’entrevue fut, en apparence, fort touchante. Madame de Luxeuil réussit à pleurer, et Arthur à faire des excuses, mais aucun ne fut dupe de l’autre. La mère comprit que le fils espérait quelque chose de ce rapprochement, et le fils devina que la mère avait sur lui quelque projet. Aussi abrégèrent-ils, par un accord tacite, les attendrissements préliminaires, afin d’en venir au fait. Madame de Luxeuil exposa à son fils l’impossibilité de suivre la voie dans laquelle il s’était engagé; elle lui parla de la nécessité de revenir à des idées plus sages, de se rattacher à l’Église, hors laquelle il n’y a point de salut, et finit par lui parler du journal projeté. Arthur accueillit favorablement ces ouvertures. Pour le moment, rien de plus convenable ne pouvait lui être offert. Il sortait ainsi de l’impasse dans laquelle il se trouvait engagé, et devenait l’instrument nécessaire d’un corps riche, nombreux, et puissant. L’hésitation était impossible; aussi déclara-t-il à la comtesse qu’il était prêt à discuter les conditions qui pouvaient lui être offertes. M. de Chanteaux, qui avait été en tiers dans l’entrevue, fit aussitôt part du succès aux intéressés, et le contrat par lequel Arthur de Luxeuil se trouvait acquis à la cause des catholiques fut convenu et signé. Cette conversion fit un certain éclat, ainsi que la congrégation l’avait espéré. De Luxeuil lui-même y mit une sorte d’ostentation. Il craignait les railleries, et voulait les prévenir par la publicité avouée de sa nouvelle position. Elle n’avait imposé, du reste, aucune contrainte à ses habitudes; car si l’on peut retrouver encore quelque part le type du Tartuffe de Molière, il faut reconnaître que c’est rarement à Paris, et seulement par exception. Les catholiques contemporains n’ont point été inaccessibles à la loi du progrès: ils ont su singulièrement perfectionner leurs moyens d’action. L’hypocrisie du héros de Molière était gênante, difficile, dangereuse; ils l’ont supprimée. Loin d’affecter des mœurs plus austères que le commun des impies, ils les dépassent en liberté d’allures. Vous les trouvez également aux sermons du révérend Père Lacordaire et aux bals masqués de l’Opéra, aux conférences de la Société de Saint-Paul et dans les coulisses de nos théâtres. Si vous vous étonnez de ce singulier mélange de sacré et de profane, ils vous traiteront de Pharisiens; ils déclareront que la communion des fidèles est partout où se trouvent des hommes de bonne volonté (et parmi les hommes ils comprennent nécessairement les femmes); ils vous répèteront que la foi sanctifie tout. A la vérité, ces apôtres à barbe et à lorgnon vous donneront, encore tout émus d’une danse échevelée, l’adresse de leur confesseur; ils vous apprendront au juste quels sont les prédicateurs de l’Avent, et où se disent les plus belles messes, car ils conduisent leurs vices à l’église, ils acceptent les mystères, et expliquent le cantique des cantiques.
De Luxeuil prit place dans cette phalange de fervents fashionables, en élaguant seulement la messe et le confesseur. Il se rangea parmi les forts, exemptés de pratiquer les doctrines en raison de leur ardeur à les soutenir. Sa mère le complétait à cet égard en assistant à tous les offices et en abandonnant sa conscience à deux directeurs. Cependant une circonstance imprévue vint bouleverser cet arrangement. Depuis sa conversion, madame de Luxeuil avait dû rompre avec le docteur Darcy, et prendre un des médecins recommandés par ses patrons. Tant qu’elle se porta bien, elle l’accepta sans réclamation; mais l’âge amena des infirmités, que le nouveau docteur ne put faire disparaître, et la comtesse l’accusa d’ignorance. Elle se rappela alors l’habileté de Darcy, dont les soins avaient toujours réussi et elle se persuada que lui seul pourrait la guérir. Craignant de le rappeler ostensiblement, elle lui écrivit un billet, dans lequel elle lui avouait sincèrement sa position, et faisait appel à son ancienne amitié. L’expérience lui avait appris que la franchise était la meilleure ruse vis-à-vis du docteur. Celui-ci vint en effet le soir même. Il trouva la malade avec Marquier et M. de Chanteaux. A sa vue, elle fit un geste de joie.
—J’étais bien sûre qu’il ne m’abandonnerait pas! s’écria-t-elle, en lui tendant la main; ah! merci d’être venu pour moi...
—Pour vous! répéta Darcy, qui, tout en se rendant à la prière de la comtesse, avait promis de se venger; pardieu! dites pour moi-même, madame la comtesse. Si je suis venu c’est par respect pour ma propre dignité, et afin démontrer à vos amis qu’il n’est pas besoin d’être dévot pour pardonner les injures.
—Ah! vous êtes le roi des hommes, reprit madame de Luxeuil, en faisant signe à Marquier d’avancer un fauteuil au docteur.
—Cela veut dire tout simplement que vous avez besoin de moi, répliqua Darcy qui ôtait ses gants; je ne suis le roi de rien... pas même celui des Juifs; mais je n’ai pas été fâché de voir comment travaillaient ceux de mes confrères, qui comptent sur l’inspiration du Saint-Esprit. Car c’est M. Delarue qui vous soigne, n’est-ce pas?
La comtesse fit un signe affirmatif.
—Un savant du premier ordre, continua Darcy ironiquement; l’inventeur de la médecine orthodoxe... qui consiste à faire prendre des infusions de psaumes et des élixirs de litanies à différentes doses! Comment diable ne vous a-t-il pas guérie?
—Vous êtes toujours implacable, docteur, dit la comtesse d’un ton contraint.
—Pour les hypocrites, reprit Darcy en tâtant le pouls de la malade; il vous a sans doute fait prendre de la thériaque ou quelque autre drogue du moyen âge?... Ce qui ne vous empêche pas d’avoir la fièvre.
—Vous croyez?
—Et de ne pouvoir supporter aucun aliment.
—Quoi, vous avez deviné!...
—Il n’y a pardieu pas besoin pour cela d’être prophète... vous avez le foie pris.
—Cette chère amie a eu tant de fatigues et d’émotions depuis quelque temps, fit observer M. de Chanteaux.
—Bah! répéta Darcy d’un air incrédule.
—Vous n’avez donc pas su, docteur, reprit Marquier; Madame la comtesse a fait un voyage en Angleterre.
—Puis, ajouta le marquis, il y a eu cette réconciliation avec son fils.
—Ah!... et vous croyez que cela engorge le foie! dit le médecin. C’est sans doute une observation récente de mon confrère Delarue.
—Allons! vous êtes un homme terrible, fit observer le banquier en riant; vous ne voulez jamais croire à l’influence du moral sur le physique...
Darcy jeta au gros petit homme un regard de côté.
—Et vous y croyez, vous? demanda-t-il.
—Par la raison qu’on ne peut nier ce qu’on sent, répliqua Marquier; que diable! mon cher docteur, il suffit de s’observer pour savoir que l’âme gouverne le corps...
—Ainsi, c’est votre âme qui vous rend pléthorique, reprit Darcy; c’est elle qui a arrêté le développement de vos extrémités au profit de vos organes abdominaux; c’est votre âme qui vous prédispose tout doucement à l’apoplexie...
—Comment, comment? interrompit le banquier effrayé.
—A l’asthme, à la goutte, à la gravelle, continua le docteur; par le ciel! délivrez-vous de cette ennemie intime, et redevenez tout simplement un vertébré à l’état normal.
—Vous déplacez la question, docteur, vous déplacez la question! s’écria Marquier.
—C’est-à-dire que c’est vous, répliqua Darcy; vous venez me parler d’âme à propos de maladie de foie... quand vous ne devriez en parler qu’à propos de finances. Savez-vous depuis quand vous sentez votre âme, comme vous dites? depuis que la congrégation vous a choisi pour son banquier.
—Moi!
—Vous allez le nier, peut-être! N’est-ce pas de votre caisse que sort l’argent employé à fonder ce nouveau journal que dirige de Luxeuil... A propos, j’avais oublié de vous faire compliment, madame la comtesse, sur la subite conversion de monsieur votre fils!
—Il est vrai que nous avons réussi à lui inspirer de meilleurs sentiments, dit la malade avec quelque embarras.
—C’est évident, reprit Darcy; il vient de publier une profession de foi qui ferait honneur au grand-maître des dominicains!... Je suis fâché seulement de le voir marquer de si bons sentiments aux trois personnes de la Trinité, qui, à la rigueur, pouvaient s’en passer, et si peu de pitié pour celle qui porte son nom.
La comtesse fit un mouvement.
—Honorine, répéta-t-elle, en auriez-vous entendu parler?
—J’ai fait mieux, Madame, je l’ai vue!
—Ici?
—Non, fort loin de Paris, au contraire, où je l’ai trouvée mourante.
Tous les auditeurs firent un mouvement.
—Se peut-il! s’écria la comtesse, et vous n’avez point averti Arthur?
—Par la raison que je me suis engagé à taire la retraite de votre nièce, répliqua Darcy; elle tient à demeurer cachée, à vivre tranquille!... Ce sont ses propres paroles.
—Ah! vous m’avez donné un coup terrible! dit madame de Luxeuil, en se renversant sur son fauteuil; Honorine mourante, grand Dieu! sans que nous en sachions rien!
—Il est difficile de s’occuper en même temps des affaires du ciel et de la terre, fit observer le médecin sèchement. Vous, qui accordez tout à l’âme, vous ne devez point vous étonner qu’une jeune femme n’ait pu supporter tant de chagrins et de luttes.
—Je sais que mon fils a eu des torts, reprit la comtesse, mais maintenant il serait facile de les lui faire reconnaître, et de travailler à un rapprochement. Au nom du ciel, docteur, dites-moi où est Honorine?
Darcy prit un air grave.
—Madame la comtesse oublie que j’ai promis de garder le silence, dit-il.
—Qu’importe! Vous ne pouvez vous regarder comme enchaîné par un caprice de malade; une promesse n’oblige qu’à la condition d’être raisonnable...
—Elle oblige toutes les fois qu’elle a été faite sérieusement et librement.
—Mais, songez!...
—Pardon, madame la comtesse; j’en ai déjà trop dit et mon indiscrétion est une faute; vous me permettrez d’écrire la consultation que vous m’avez fait l’honneur de me demander.
Il s’était approché d’une table sur laquelle se trouvait le pupitre, formula les prescriptions nécessaires, donna de vive voix quelques explications, puis salua froidement et se retira. Mais la comtesse demanda aussitôt son fils pour lui faire part de ce qu’elle venait d’apprendre. Cette confidence réveilla ses anciens projets. Honorine avait pu lui échapper par la fuite une première fois; mais, en la retrouvant, il était sûr de la forcer à le suivre, ou à racheter du moins sa liberté. Dans le cas même d’une mort prochaine, il pouvait tenter une réconciliation qui lui assurerait une partie des avantages sur lesquels il avait autrefois compté. Quoi qu’il arrivât enfin, il devait découvrir au plus tôt sa retraite dans l’intérêt de ses espérances. Il y tenait, en outre, dans l’intérêt de son orgueil, de sa haine. Ses échecs successifs l’avaient aigri contre la jeune femme; il en était venu à désirer ce qui pouvait la faire souffrir, même sans profit pour lui-même, il voulait se venger de tant de mécomptes et d’humiliations. Aussi commença-t-il, après l’avertissement de sa mère, des recherches actives et dont le succès ne pouvait être longtemps douteux. Il sut que le docteur s’était absenté un mois auparavant et qu’il avait pris la route de Granville! c’était assez pour le mettre sur la voie. Il régla tout pour une absence de quelques semaines et partit. La comtesse, prévoyant qu’il pourrait avoir besoin des conseils d’un homme versé dans les affaires, lui fit accepter Marquier pour son compagnon de voyage. Arrivés à Granville, leurs recherches commencèrent; mais toutes les précautions avaient été prises par Marc. Le duc, qui se faisait appeler comme autrefois M. Michel, passait pour le père d’Honorine, et de Gausson pour un cousin récemment arrivé en France. Du reste, nul ne les connaissait. Arthur entendit parler de cette famille étrangère retirée à la Brichaie sans que rien pût lui faire soupçonner la vérité. Toutes ses perquisitions du côté de Bréhal, de Gavray, de Villedieu, avaient été inutiles, et il commençait à désespérer lorsqu’il reçut de sa mère une lettre qui le força de suspendre ses recherches pour visiter, au nom d’amis communs, deux insurgés vendéens, récemment envoyés au Mont-Saint-Michel.
Bien que la baie de Cancale soit surtout estimée des gastronomes, elle ne mérite pas moins la visite des touristes et l’admiration de quiconque se laisse émouvoir par les grands aspects de la création. Vous ne trouvez point, comme sur les grèves du Finistère, ces promontoires de granit taillé par les vagues en colonnes, en cavernes, en portiques; ce ne sont point non plus les hautes falaises du Calvados avec leur verdure rase et serrée, se déroulant sur le sol comme un tapis velouté; ici, tout est plat et aride, c’est le désert avec ses sables mouvants et ses lignes d’horizons infinis. Mais d’un côté les flots grondent à la limite de ce Sahara maritime, de l’autre des villes apparaissent au loin dans les brumes; et vers le milieu s’élève ce rocher aux flancs duquel pend une prison et que couronne la vieille église de l’archange! A une certaine heure tout est désert, morne, immobile dans cette plaine aride: mais attendez seulement quelques instants: un murmure bruira dans l’espace, une ligne blanche frémira à l’horizon, et ce murmure, c’est la voix de la mer, cette ligne blanche, c’est le flux qui arrive; vous avez eu à peine le temps de le reconnaître, de le nommer, que la plage a disparu partout; le mont qui, tout à l’heure dominait les grèves, ne domine plus que les vagues; en quelques instants le continent est devenu une île.
Depuis son retour à la santé, Honorine avait entrepris plusieurs excursions avec Marc, Françoise et de Gausson. Une barque de pêcheur les transportait le matin sur quelque point de la baie, et après avoir marché tout le jour sans autre guide que leur fantaisie, et s’en remettant au hasard pour leur découverte, ils la rejoignaient le soir, fatigués mais joyeux, et regagnaient la Brichaie bercés par la lame et éclairés par les étoiles. Souvent Honorine élevait la voix au milieu du murmure des flots; elle répétait de vieux airs de son enfance, ou quelque chant plus nouveau, choisi parmi les plus simples et les plus doux: Marcel l’appuyait, à demi-voix, de son accent profond; et alors, le pêcheur ravi restait appuyé sur sa barre, l’oreille au vent et le sourire sur les lèvres. Françoise, touchée, sans savoir pourquoi, embrassait Jules qui s’était endormi dans ses bras, et Marc, la tête penchée sur sa poitrine, s’oubliait dans de longues rêveries. Les promeneurs s’étaient d’abord peu éloignés de la Brichaie; mais le succès de leurs excursions les enhardit. Voulant les étendre plus loin et dans une nouvelle direction, ils partirent un matin avant le jour, arrivèrent à l’embouchure du Couesnon, petite rivière qui séparait autrefois la Bretagne de la Normandie, et de là gagnèrent à pied Pontorson.
Une partie du jour fut employée à parcourir les campagnes voisines. Jamais Honorine ne s’était sentie l’esprit si libre, le cœur si léger. Le soleil commençait à tomber, lorsque Marc rappela qu’il était temps de rejoindre la barque, si l’on ne voulait point manquer la marée. On reprit donc la route de la grève. L’ancien chouan alla en avant, de ce pas égal et modéré que donne l’habitude de la marche. Honorine et de Gausson suivaient plus lentement. Animée par la course, l’œil souriant et les traits illuminés de joie, la jeune femme marchait un bras appuyé sur celui de Marcel, dont elle sentait battre le cœur. Son autre main tenait une branche de houx ornée de ses fruits, et de longues herbes cueillies par de Gausson ornaient sa capote de soie violette. Son écharpe, à demi-échappée de ses épaules, laissait voir sa taille cambrée: elle se tenait penchée un peu en avant et la tête tournée vers Marcel, dans cette attitude de confidence si gracieuse et si caressante! A chaque pas, quelque nouvelle remarque ralentissait leur marche. Elle montrait la mer, les nuages, une cabane de paysan, et tous deux s’arrêtaient jusqu’à ce que la voix de Marc les avertît de nouveau. Ces avertissements devinrent de plus en plus fréquents. Le ciel s’était assombri; l’ancien chouan paraissait inquiet.
—De grâce! hâtons-nous, dit-il enfin; le vent commence à s’élever, et je n’aime point ces nuages.
—Que craignez-vous? demanda Honorine.
—Je crains du gros temps.
—Qu’importe?
—Vous oubliez qu’il nous reste à regagner la Brichaie.
—Eh bien! nous aurons un orage; ce doit être si beau! J’ai toujours désiré savoir comment je me comporterais en pareille occasion: ce serait un moyen d’essayer mon courage.
Marc secoua la tête.
—Oh! vous croyez que c’est bravade, reprit Honorine en souriant; mais non, Marc, c’est confiance! Je me sens si forte... si heureuse...
—Que vous voudriez cesser de l’être?..... interrompit-il brusquement.
—Que je ne puis croire à un changement, reprit la jeune femme. Après tout, mon bon Marc, Dieu est juste! et c’est lui qui fait nos lots ici-bas. Quand on a été longtemps éprouvé, on doit avoir plus de confiance dans l’avenir; on a payé sa dette.
—Le malheur est toujours notre créancier, dit le chouan sourdement: il ne faut jamais lui rappeler que nous vivons.
—Oh! vous êtes triste, s’écria Honorine; je ne veux point vous croire: j’espère encore le beau temps...
Un éclair, suivi d’un sourd grondement de tonnerre, l’interrompit; elle fit un mouvement en arrière et pâlit.
—C’est une réponse, dit Marc, et qui vous persuadera mieux que moi, peut-être... Au nom du ciel, allons plus vite; j’ai peur qu’il soit déjà trop tard!
Ils pressèrent le pas et atteignirent enfin le pont du Couesnon, près duquel leur conducteur les attendait. Mais l’orage avait continué à grandir; le vent de mer chassait devant lui de lourds nuages chargés de pluie, et les éclats de tonnerre devenaient de plus en plus rapprochés. Après s’être concerté quelque temps avec le vieux marin, Marc déclara que l’on ne pouvait, sans imprudence, tenter la traversée.
—Mais que va-t-on penser à la Brichaie? s’écria Honorine.
—On devinera, j’espère, que le mauvais temps nous a empêchés de reprendre la mer, dit le chouan, et, en tout cas, mieux vaut l’inquiétude pour eux que le péril pour vous. Demain la bourrasque aura cessé, et nous pourrons nous rembarquer; mais, maintenant, nous n’avons qu’à gagner l’auberge la plus voisine, pour y passer la nuit.
Honorine n’accepta qu’à regret une pareille nécessité. Ce contre-temps avait fait envoler sa joie. Comme toutes les âmes ballottées par le flot de la passion, elle passa subitement de la confiance à l’inquiétude. Les nuages qui venaient d’envahir le ciel semblaient avoir un reflet dans son cœur. Contrariée et abattue, elle se laissa conduire à la petite hôtellerie que le pêcheur avait indiquée à Marc. Plusieurs touristes revenant du mont Saint-Michel les y avaient précédés et se trouvaient réunis dans une salle à manger séparée de la première pièce par une cloison vitrée à hauteur d’appui. On y entendait un bruit de couverts et de voix qui effraya la jeune femme. Désirant éviter la table d’hôte, elle envoya Marc pour lui faire préparer une chambre, et attendit son retour avec de Gausson dans l’espèce de parloir où on les avait fait entrer. L’orage, jusqu’alors suspendu, venait d’éclater dans toute sa violence; la nuit était subitement venue, et les deux amants ne tardèrent pas à se trouver plongés dans une obscurité presque complète. Honorine n’y prit point garde; le front appuyé contre les petites vitres de la fenêtre, elle regardait les gros nuages noirs qui accouraient traînant à leur suite un long voile de pluie qui semblait réunir le ciel à la terre. De Gausson se tenait à quelques pas, les yeux également fixés sur l’horizon. Attristés par cette bourrasque inattendue, tous deux gardaient le silence, et le bruit des voix leur arrivait directement du salon voisin entre chaque pause de l’ouragan.
Une de ces voix frappa plus particulièrement l’oreille de de Gausson, qui devint tout à coup attentif. Elle s’élevait au-dessus de toutes les autres, et son grasseyement criard la rendait facile à reconnaître. Marcel s’approcha vivement de la cloison vitrée, se baissa pour regarder dans la salle à manger, et aperçut debout près de la table Aristide Marquier, en costume de voyage. Devant lui se tenait Arthur de Luxeuil! Le jeune homme recula avec une exclamation involontaire.
—Qu’y a-t-il? demanda Honorine qui se retourna étonnée.
—Pas un mot, au nom du ciel! murmura de Gausson, en courant à elle et lui désignant du geste le salon voisin.
—Il y a là quelqu’un que nous connaissons?
—Votre mari!
Elle fit un geste d’épouvante.
—Etes-vous sûr? demanda-t-elle.
Marcel la conduisit doucement jusqu’au vitrage; elle écarta le rideau, jeta un regard dans la pièce voisine, et se redressant épouvantée, fit un mouvement pour fuir; de Gausson la retint; Arthur et Marquier venaient d’ouvrir la porte du salon! Honorine recula jusqu’au coin le plus sombre du parloir. Celui-ci était plongé dans une obscurité presque complète; le banquier et son compagnon le traversèrent sans prendre garde qu’il y eût quelqu’un; mais, au moment où ils sortaient, Marc parut sur le seuil une lumière à la main. Il y eut pour tous un premier mouvement de stupéfaction. De Luxeuil, qui s’était arrêté en apercevant l’ancien chouan, se retourna au cri jeté derrière lui, et aperçut Honorine, dont Marcel tenait encore la main. Il ne put retenir à son tour une exclamation répétée sur un autre ton par le banquier. Quant à Marc, il était resté à la même place, un bras en avant. Tous gardèrent un instant le silence, comme s’ils eussent voulu s’assurer qu’ils ne se trompaient pas. Enfin de Luxeuil fit un pas vers la jeune femme.
—Vous ici, Madame! s’écria-t-il; pardieu! je dois remercier le hasard, car il me sert mieux que toutes les recherches.
—C’est un vrai coup du ciel! ajouta Marquier; notre voyage eût été inutile sans cette heureuse rencontre...
—D’autant plus heureuse, reprit de Luxeuil, que le docteur Darcy nous avait, à ce que je vois, alarmé sans raison.
—Quoi! interrompit Honorine, le docteur vous a dit...
—Qu’il vous avait laissée mourante, acheva Arthur; mais il est évident que la science a été mise cette fois en défaut, et que Madame a trouvé un médecin plus habile que M. Darcy.
Ces mots, prononcés d’un accent ironique, furent accompagnés d’un regard provocateur lancé à de Gausson. Honorine ne permit point à ce dernier de répondre.
—Le docteur s’était effectivement effrayé outre mesure, dit-elle; le temps et le repos ont suffi pour ma guérison.
—Il est certain que Madame ne m’a jamais paru plus éblouissante de santé! fit observer Marquier avec une intention visiblement galante.
—Aussi est-ce pour moi une bonne fortune inattendue, reprit de Luxeuil; je venais offrir des soins, et, loin de là, je puis en demander.
—Des soins!
—Non pas pour moi, Madame, mais pour ma mère affaiblie, souffrante, et qui vous réclame.
—Quoi! madame de Luxeuil?... interrompit de Gausson.
Arthur lui jeta un regard hautain, et s’adressa de nouveau à Honorine, sans lui répondre:
—J’espère n’avoir pas besoin de recommencer ici les fâcheuses explications que j’ai dû donner aux Motteux, continua-t-il; j’engage seulement Madame à se rappeler et à réfléchir! notre chaise de poste sera demain à ses ordres.
L’arrivée de la servante qui venait annoncer que la chambre d’Honorine était prête, coupa court à la conversation; celle-ci parut un instant indécise, puis faisant signe à Marc, elle sortit avec lui. De Gausson attendit que la lumière qui les éclairait eût disparu dans l’escalier. La fatale rencontre qui replaçait Honorine dans l’horrible alternative dont on l’avait déjà menacée aux Motteux, venait de lui inspirer une résolution extrême. Resté seul avec Marquier et Arthur, il s’approcha de ce dernier.
—J’ai eu l’honneur d’adresser tout à l’heure la parole à M. de Luxeuil sans qu’il ait daigné me répondre, dit-il à demi-voix.
—En effet, Monsieur, répliqua Arthur froidement.
—Ainsi, le silence de M. de Luxeuil n’a été ni un oubli ni une distraction?
—Ni l’un, ni l’autre.
—Alors c’est une insulte dont j’ai droit de lui demander raison.
De Luxeuil regarda Marcel avec une sorte d’étonnement.
—Ah! c’est vous qui prenez l’initiative, dit-il d’un ton railleur; mais avez-vous bien réfléchi, monsieur de Gausson, à ce que vous allez faire? Avez-vous averti... la personne intéressée à cette affaire, et vous a-t-elle donné la permission de vous battre?
—Ceci, Monsieur, est une seconde insulte, dit Marcel d’une voix animée.
—Vous croyez, reprit Arthur; j’aurais pensé que c’était à moi de me fâcher; mais j’accepte que vous soyez l’offensé.
—Et à ce titre, reprit Marcel, j’ai le choix des armes?
—Ah! voilà le mot de l’énigme! s’écria de Luxeuil, parbleu! cher Monsieur, offenseur ou offensé, il eût suffi de me demander cet avantage, mais puisqu’il vous plaît d’intervertir les rôles, veuillez me dire comment vous désirez vous battre?
—A bout portant, Monsieur; l’un des pistolets chargé, et l’autre vide.
Arthur redressa la tête.
—Je comprends, dit-il en regardant de Gausson, vous voulez être sûr d’en finir, et que madame de Luxeuil soit définitivement délivrée de son mari ou de son amant... mais je puis refuser un pareil duel?
—Ici peut-être, reprit Marcel, ici où personne ne vous voit, mais je vous suivrai à Paris, Monsieur; là je dirai que vous n’avez point voulu égaliser les armes en vous remettant du succès au hasard, et l’on saura ce que l’on doit penser de votre réputation de courage...
—J’espère vous épargner cette fatigue, interrompit brusquement Arthur; votre heure, Monsieur?
—Demain, au point du jour.
—Je serai prêt.
Tous deux se saluèrent, et de Gausson gagna la chambre qui lui avait été préparée. Il ne voulut s’interroger ni sur ce qu’il venait de faire, ni sur le résultat qu’il pouvait craindre ou espérer. Arrivé à l’un de ces moments où tout regard jeté en arrière devient inutile, il ne songea qu’à faire ses dispositions pour le lendemain. Après avoir écrit ses dernières volontés, et un billet adressé à son homme d’affaires, il commença une longue lettre pour Honorine dans laquelle il épancha tout ce qu’il ne lui avait dit jusqu’alors qu’imparfaitement et par aveux entrecoupés. Suprêmes adieux qui contiennent notre cœur tout entier et que nous adressons à ceux qui nous aiment au moment de les quitter pour toujours! Il écrivait les dernières lignes, lorsque l’on frappa doucement à sa porte; il courut ouvrir; c’était Marc! L’ancien chouan paraissait plus sombre qu’à l’ordinaire. Il vit les lettres écrites par de Gausson, s’assit, demeura quelques instants les bras croisés, puis enfin regarda le jeune homme, et dit lentement:
—Ainsi vous vous battez demain?
—Qui vous l’a dit? demanda Marcel étonné.
—Ce banquier qui suit M. de Luxeuil, et qui est venu me trouver pour me prier d’empêcher le duel.
—C’est impossible, interrompit de Gausson; il faut qu’il ait lieu et toutes les représentations seraient inutiles.
Marc secoua la tête.
—Oui, dit-il; quand cet homme m’a raconté ce qui s’était passé, j’ai compris tout de suite que vous vouliez rendre la liberté à... ELLE..., et que, pour cela, vous aviez fait le sacrifice de votre vie. Mais, avez-vous bien vu le résultat? Si votre adversaire vous tue, ELLE reste à sa discrétion, avec la douleur de vous avoir perdu; si vous le tuez, cette mort même qui la délivre la sépare de vous à jamais.
—Je le sais, je le sais! s’écria Marcel; mais que pouvais-je faire? Fallait-il donc la laisser au pouvoir de cet homme, demeurer moi-même sous sa menace, et recevoir de lui le droit de vivre comme une aumône! Ah! je ne me suis point senti la force d’accepter, pour tous deux, cette honteuse servitude: mieux vaut un malheur connu, et dont on voit la limite; mieux vaut mille fois la mort!
—Aussi ne suis-je pas venu pour vous proposer de rester sous le joug de M. de Luxeuil, dit Marc; non, qu’il vous tue plutôt, et que madame Honorine meure!... Mais il y a peut-être un autre moyen.
—Lequel?
Le chouan ne répondit pas sur-le-champ; il était tombé dans une sorte de rêverie; enfin il reprit tout à coup en regardant de Gausson:
—Si elle était votre femme... êtes-vous sûr de la rendre heureuse? demanda-t-il.
—Pourquoi cette question? dit Marcel.
—Répondez-moi, reprit-il avec instance; mais en regardant bien dans votre cœur. Je ne vous demande pas si vous l’aimez comme on peut aimer beaucoup de femmes... mais assez pour n’avoir pas d’autre désir sur la terre que de la voir contente de vivre, assez pour vous consoler de tout quand elle sourit... même du mépris...; assez pour vous sacrifier à un autre qu’elle aimerait, et pour dire: C’est bien! Si ce n’est pas ainsi que vous l’aimez, c’est trop peu, et vous pouvez vivre sans elle.
—Vous-même avez pu vous assurer du contraire, fit observer de Gausson, étonné de l’exaltation du chouan.
—Oui, reprit celui-ci en se parlant à lui-même...; ils ne pouvaient vivre séparés...; ils ont besoin l’un de l’autre... ils s’aiment... Ah! si j’étais bien sûr...
Il appuya son front sur ses deux mains, et demeura longtemps ainsi. Marcel, ému, n’osait l’interroger. Enfin il releva la tête.
—Si c’est bien pour elle-même que vous l’aimez, reprit-il, fût-elle pauvre, méprisée, elle ne vous serait pas moins chère?
—Je n’ose dire qu’elle me le serait davantage, répliqua de Gausson, et cependant combien de fois je lui ai souhaité moins de dons, rêvé quelque disgrâce qui pût donner le charme du désintéressement ou du dévouement à ma tendresse.
Marc se leva brusquement.
—Eh bien!... écoutez-moi, s’écria-t-il avec une sorte de désordre; à vous... je dirai tout!... Il y a sur sa naissance un secret que je connais seul... qui devait mourir avec moi... vous le saurez!...
—Et quel est-il?
L’ancien chouan regarda fixement Marcel, et dit très-lentement:
—Honorine... n’est pas la fille... du général Louis!
De Gausson recula.
—Que dites-vous! s’écria-t-il. La baronne... vous osez l’accuser!...
—Non! interrompit précipitamment Marc. Oh! malheur à qui l’accuserait!
—Mais comment expliquer alors?... D’où avez-vous su?... Qui êtes-vous donc enfin?...
—Qui je suis? s’écria Marc... Oui, c’est là ce que je dois vous dire d’abord... C’est un cruel récit, Monsieur... mais je vous l’ai promis...; et d’ailleurs, il le faut pour ELLE.
Il y eut encore une pause, comme s’il eût voulu recueillir ses souvenirs; puis il commença d’une voix basse et souvent interrompue.
—Je n’ai jamais eu de famille, Monsieur. Tout ce que j’ai pu savoir, c’est que le jour de ma naissance, on me laissa devant la margelle d’un puits, au village de Noyant, en Maine-et-Loire, et que les premiers qui me trouvèrent là me ramassèrent pour m’apporter à l’hospice, d’où l’on m’envoya chez une nourrice de campagne. J’étais chétif, mal soigné; j’aurais dû mourir, et ma mort n’eût fait pleurer personne! Justement pour cela, je pris le dessus, je grandis et je devins fort. Ma force eût pu me servir à travailler; mais les garçons de mon âge me méprisaient à cause de ma naissance; on m’appelait bâtard! J’employai ma force à les faire taire. Alors on se mit à me haïr, et personne ne voulut me donner du travail. J’allai ailleurs, ce fut de même. Partout il y avait des gens qui me tourmentaient, et ceux qui étaient meilleurs laissaient faire; car les bons sont toujours plus timides que les méchants. Les choses continuèrent ainsi pendant quelque temps; je passais pour une mauvaise tête qui ne savait pas endurer la plaisanterie, et c’est pourquoi on me donna le sobriquet de Rageur. J’avais fini par tirer gloire de mon défaut, parce qu’il me faisait craindre; mais je vivais misérablement. Vers ce temps-là, des chefs royalistes arrivèrent dans l’Anjou pour soulever les campagnes. Je n’avais jamais pensé au roi ni à l’empereur; mais, dans ma position, je préférais nécessairement ce qui n’existait pas à ce qui était établi; je me mis dans une bande de braconniers et de vagabonds, dont je fus bientôt le capitaine. On nous adjoignit une dizaine de vauriens embauchés à Paris, parmi lesquels se trouvaient Jacques et Moser. Le marquis de Chanteaux, qui commandait plusieurs cantons, envoyait de préférence notre bande quand il y avait quelques mauvais coups à faire. Je me troublai un peu d’abord; mais, à défaut de goût vint l’habitude. Je voyais autour de moi les deux partis brûler et tuer sans pitié; je fis comme les autres. C’était d’ailleurs une guerre; il y avait du danger à faire le mal, ce qui le rendait moins répugnant: on égorgeait, on était égorgé, la cruauté avait l’air d’être du courage. Notre bande devint la terreur du pays. Je ne vous raconterai pas toutes ses expéditions, Monsieur, pendant ces trois mois du luttes; j’arrive sur-le-champ à la dernière, la seule qui puisse vous intéresser. C’était vers la fin des Cent-Jours; je me trouvais dans les taillis de Longué, avec une cinquantaine d’hommes, quand on vint nous avertir qu’une voiture, escortée par des cavaliers, paraissait sur la levée. Je courus avec mes gens, et j’aperçus, en effet, une chaise de poste et un peloton de chasseurs d’Angers commandés par un officier. Dès que celui-ci nous reconnut, il fit faire halte et eut l’air de se consulter avec quelques-uns de ses hommes; je m’étais approché en avant de ma bande, embusquée des deux côtés de la route. L’officier agita son mouchoir, comme s’il eût voulu parlementer, et nous cria:
—Ne tirez pas! royalistes. Vivent les Bourbons!
Nous pensâmes que c’étaient des gentilshommes du pays qui avaient revêtu l’uniforme de l’armée, comme cela leur arrivait quelquefois pour certaines expéditions. Mes hommes remontèrent sur la chaussée, et nous nous avançâmes tous sans défiance! mais, au moment même, l’officier reprit la tête du peloton, en criant de charger, et les vingt cavaliers se précipitèrent au galop, en sabrant tout devant eux. Le mouvement avait été si prompt et si inattendu qu’une dizaine de nos hommes tombèrent, tandis que le reste prit la fuite en se précipitant le long des berges. Mais la première surprise passée, les plus hardis profitèrent de leur position qui les mettait à l’abri des cavaliers et commencèrent un feu de tirailleurs. Une de leurs balles alla frapper le postillon qui avait voulu, pendant le tumulte, faire passer sa chaise de poste, et les chevaux privés de guide s’arrêtèrent. De leur côté les chasseurs assaillis à droite et à gauche avaient perdu leur avantage; ils battirent d’abord en retraite, puis, voyant leurs rangs s’éclaircir de plus en plus, ils mirent leurs chevaux au galop et disparurent. Je courus aussitôt à la voiture que quelques-uns de nos gens étaient déjà occupés à piller et dans laquelle se trouvait une femme évanouie. Nous regagnâmes avec elle l’auberge de Longué où je la confiai à l’hôtesse. Mais la trahison dont nous venions d’être victimes avait exaspéré mes compagnons. Des cris de mort s’élevèrent contre la prisonnière. Bien que partageant leur colère, il me répugnait de laisser égorger une femme; je demandai à boire dans l’espérance de la faire oublier. Le moyen ne réussit que peu de temps: avec l’ivresse revinrent les idées de vengeance et les menaces; une révélation d’un de nos compagnons blessé les rendirent plus furieuses. Il avait entendu un soldat crier au postillon:—Sauvez la femme du commandant! L’officier qui nous avait tendu un piége était donc le mari de notre prisonnière et nous pouvions nous venger sur cette dernière de sa perfidie! Cette découverte finit par justifier à mes propres yeux les représailles. Échauffé par le vin, je me sentais gagner à la rage de mes compagnons; je m’associai malgré moi à leurs désirs. Cependant, au moment où les plus furieux se levèrent pour courir à la chambre de la prisonnière, je les retins en déclarant que je me chargeais moi-même de venger les morts. Le Parisien me passa son pistolet et je montai l’escalier qui conduisait à la pièce occupée par l’étrangère. La nuit était venue; je suivis à tâtons le long corridor au bout duquel se trouvait une porte entr’ouverte et faiblement éclairée. Je la poussai du pied et j’aperçus la femme que je cherchais. Elle était couchée sur le lit le visage caché dans l’oreiller. Au bruit que je fis en entrant, elle se releva à demi, et dans ce mouvement, sa robe, délacée par l’hôtesse pendant son évanouissement, glissa de son épaule nue. J’étais entré étourdi par l’ivresse et chaud de colère, mais sans projet arrêté... Une fatale inspiration traversa mon esprit à cette vue. Je pensai que l’honneur de la femme était le bien le plus précieux du mari; que je pouvais le punir par la honte de celle qui portait son nom; mes sens s’éveillèrent. Je posai sur un fauteuil l’arme qui m’avait été donnée et je refermai la porte derrière moi.
Ici, Marc s’arrêta un instant comme s’il eût manqué de paroles pour continuer; il tenait les yeux baissés et la rougeur couvrait ses joues; enfin, faisant un effort visible:
—J’étais seul avec la prisonnière, reprit-il sans lever les yeux; elle se trouvait en mon pouvoir..... et quand mes compagnons arrivèrent, attirés par ses cris..... elle était déshonorée!.....
De Gausson fit un geste d’horreur.
—C’était une lâcheté infâme, reprit vivement le Chouan; je le compris à l’instant même! Le crime, à peine commis, me fit rougir. Dégrisé par la violence d’un désespoir dont j’étais la cause, je ne pus le supporter et j’allais m’échapper, lorsque j’entendis à la porte la voix du Parisien et des autres qui me criaient d’ouvrir. L’imminence du danger me rendit ma présence d’esprit: s’ils entraient, la prisonnière était perdue. J’avais déjà honte de ma violence; je voulus la racheter au moins en sauvant celle qui en avait été victime. L’enlevant dans mes bras, je courus à une seconde porte d’où je gagnai un escalier extérieur qui conduisait à la cour de l’auberge. La chaise de poste avait été dételée, mais les chevaux étaient restés à la porte des écuries. Je m’élançai sur le porteur, et, plaçant l’étrangère devant moi, je pris au galop la route de Beaugé. Tout cela avait été aussi rapide que la parole. Un seul mot, murmuré à l’oreille de la prisonnière, lui avait fait comprendre mon intention. Une fois à cheval, je continuai au galop jusqu’aux premières maisons du faubourg; arrivé là, je sautai à terre.
—Où suis-je? demanda celle que je conduisais.
—Dans un cantonnement de bleus, répliquai-je, à Beaugé.
Au même instant, un bruit de pas se fit entendre; je frappai le cheval qui partit, puis, franchissant le fossé qui bordait le chemin, je regagnai Longué à travers les champs et les prairies. Quand j’y arrivai, mes compagnons venaient d’être avertis de l’approche d’un détachement, et s’étaient dispersés. Quelques jours après, la capitulation de Paris fut connue, le retour des Bourbons proclamé et nos bandes licenciées.
Je me trouvais comme par le passé, sans état, sans ressources, et avec des habitudes de violence de plus! Plusieurs des hommes dont j’étais le capitaine avaient résolu de continuer, pour leur compte, la guerre faite jusqu’alors au profit d’un parti; je refusai d’abord de les suivre; l’impossibilité de vivre finit par vaincre mes répugnances, j’avais été chouan par occasion, je devins voleur par nécessité. Cependant, ce ne fut pas sans résistance. Plus d’une fois j’essayai de rentrer dans l’ordre, de retourner au travail; mais ceux qui ne me haïssaient pas me craignaient; nul ne voulait avoir pour serviteur un homme qui avait manié le fusil et tenu le pays sous sa volonté; on s’excusait de m’employer ou l’on me refusait, de sorte que la faim me repoussait toujours dans le mal. Ce fut ainsi que je me retrouvai associé malgré moi à Jacques et à l’Alsacien. Ils avaient préparé une affaire qui devait, disaient-ils, faire notre fortune. Il s’agissait d’entrer dans une maison isolée qu’habitait une femme malade avec une nourrice et un enfant; on prit toutes ces mesures, et, vers le milieu de la nuit, nous étions tous trois sous le balcon. Je devais monter le premier pour ouvrir, mais une fois entré, je me sentis troublé; en voulant me hâter, je pris une porte pour l’autre, et, au lieu d’arriver à l’escalier, je me trouvai dans une chambre éclairée. Au fond était un berceau sur lequel la mère s’était penchée et endormie. Je reculai précipitamment; la femme se redressa au bruit, et je demeurai immobile de saisissement. C’était l’étrangère de Longué!
Elle me reconnut également, car elle poussa un grand cri. Je tendis les mains pour lui imposer silence, mais elle redoubla ses appels. Presqu’au même instant j’entendis la voix de mes deux compagnons, et je les aperçus qui accouraient le couteau à la main, je n’eus que le temps de refermer la porte et de pousser le verrou. Elle aussi les avait aperçus; égarée, elle étendit les bras vers le berceau, saisit l’enfant endormi et me le présenta en s’écriant:
—Sauvez votre fille!
De Gausson, qui écoutait palpitant, se leva avec un cri.
—Votre fille! balbutia-t-il, achevez... et cette femme était...
—La mère de madame Honorine de Luxeuil.
Marcel demeura les mains appuyées sur ses genoux et les veux fixés sur le chouan; l’excès de son étonnement lui avait ôté la force de l’exprimer par aucune exclamation ni par aucun geste.
—Répétez, dit-il après un silence, répétez encore.
—Oui, reprit Marc, dont l’œil brillait d’une inexprimable tendresse, ma fille, c’était ma fille! Ah! je ne puis vous dire ce que ce cri de mère me fit éprouver; mon cœur fondit.... j’étendis les mains... et je tombai à genoux sans pouvoir répondre, sans pouvoir rire ni pleurer.... c’était une émotion trop forte.... je me sentais près d’étouffer....
—Et la baronne!
—La baronne... oh! ce souvenir me mouille les yeux!... le cœur des femmes est un abîme de miséricorde!... la baronne, quand elle vit mon attendrissement, pencha l’enfant vers moi, et je sentis ses cheveux sur mon front... ce fut comme une bénédiction, Monsieur: il me sembla que quelque chose de l’innocence de cette douce créature coulait en moi; je me relevai avec un cœur nouveau.
—Et pendant ce temps vos compagnons qui voulaient prendre la fuite avaient été arrêtés?
—Grâce à l’arrivée de M. le docteur Darcy et de la comtesse de Luxeuil. Près d’être surpris à mon tour, je n’eus que le temps de me réfugier dans un cabinet obscur placé contre l’alcôve de la baronne. Ces dernières émotions avaient achevé de la tuer; bientôt commença son agonie. La comtesse en profita pour détruire le testament qui assurait les dernières volontés de la mourante qu’elle abandonna ensuite...
—Et qui, par votre entremise, put tout réparer.
—Oui, dit Marc, dont l’émotion semblait croître à chaque parole; j’ai eu cette dernière joie! ah! quand je vivrais mille années je n’oublierai jamais cette entrevue. D’abord elle ne voulait point m’entendre; elle me maudissait; elle regrettait des espérances perdues... et que j’ai connues plus tard. Mais la vue de sa fille adoucit tout à coup son désespoir; elle la prit dans ses bras en pleurant sur elle, et moi... je n’osais parler... mais je pleurais aussi; jusqu’à ce qu’elle étendît la main de mon côté, en s’écriant:
—Aidez-moi à la sauver.
—Hélas! que faut-il faire? demandai-je; mon sang est à elle et à vous.
Elle eut l’air touché, et elle voulut écrire: c’était son testament: quand elle eut achevé, elle me regarda, et dit:
—Si j’osais vous le confier?...
—J’appuyai ma tête sur le bord du lit en pleurant, et je répondis:
—Pourquoi ne pouvez-vous me croire? Jusqu’à présent je n’ai su faire que le mal; vous ne pensez pas que je veuille faire le bien, et cependant je sens que je ne suis plus le même homme. Ah! demandez une preuve, Madame, demandez une preuve: que faut-il faire pour vous et pour elle? S’il suffisait de se battre... de travailler... de souffrir...! Ah! je voudrais vous donner ma vie, mon sang, pour vous faire croire...
—Je crois, me dit-elle; il le faut... Oui, vous veillerez sur elle; vous lui rendrez en dévouement ce que vous m’avez ôté en bonheur, oui, je vous crois... et je vous pardonne!
Alors elle me parla de sa fille; elle me dit quels projets d’avenir elle avait formés pour elle; de quels ennemis on devait la défendre; quels sentiments il fallait lui donner. Elle parla tant qu’elle eut de force, puis, quand elle sentit qu’elle ne pouvait en dire davantage, elle me montra une porte dérobée par laquelle je pouvais m’échapper. Il fallut avoir le courage de partir. Je lui demandai encore une fois son pardon; je baisai la main de l’enfant qui s’était endormie, et je m’enfuis éperdu. Mais quand je me présentai quelques jours après devant le conseil de famille pour remettre le testament de la baronne, la nourrice me reconnut, et je fus envoyé au bagne avec mes complices. J’aurais dû achever de m’y perdre comme tant d’autres; mais j’emportais avec moi un souvenir qui devait me servir de sauvegarde. Dans ce monde, dont j’avais été rejeté, restait une enfant au bonheur de laquelle j’avais promis de veiller. Cette idée me prit tout entier: c’était ma première affection; j’y reportai tout ce que mon cœur avait jusqu’alors économisé de tendresse. Peut-être aurez-vous peine à comprendre cette passion, Monsieur; moi-même je ne l’ai jamais essayé, et je ne saurais vous l’expliquer. Tout ce que je puis vous dire, c’est qu’à partir de ce jour je ne me trouvai plus étranger à la société des hommes; je ne m’estimai plus leur ennemi; j’avais parmi eux un intérêt. L’image de cette enfant flottait partout devant moi, comme on dit que l’image du Christ flottait autrefois devant les saints; j’y rapportais toutes mes actions. Acceptant ma captivité sans révolte, de peur de la prolonger, je m’étudiai à vaincre mes emportements, à obéir, à me soumettre. Ma bonne conduite m’avait fait placer au jardin botanique de l’hôpital maritime: le jardinier en chef me prit en amitié; il me donna des conseils, des leçons. Grâce à lui je pus acquérir l’instruction première qui m’avait fait défaut jusqu’alors; enfin, lors de l’incendie qui dévora l’arsenal, j’eus le bonheur d’être utile; une demande en grâce fut adressée en ma faveur, et l’on me rendit la liberté. Je savais la baronne au couvent de Tours; j’y courus, et, en déguisant mon âge, je réussis à m’y faire recevoir comme jardinier. Ce furent les deux plus douces années de ma vie entière. Je voyais l’enfant tous les jours, je lui parlais, elle m’appelait son ami! J’aurais voulu prolonger cette heureuse intimité au prix de tout mon sang!... Hélas! elle touchait à son terme. Un jour, attiré par les cris d’une des sœurs, j’arrivai assez à temps pour sauver Honorine qui se noyait, mais les efforts et le saisissement me firent perdre connaissance, et quand je revins à moi, le médecin appelé pour me donner des soins, avait aperçu la marque infâme qui dénonçait la honte de mon passé. Il fallut quitter le couvent. J’espérai en vain pouvoir rester dans le voisinage; lorsque j’avais quitté le bagne une résidence m’avait été imposée; arrêté en rupture de ban, je dus subir un nouveau jugement et une nouvelle détention. Ainsi ma captivité continuait sous une autre forme; on avait seulement élargi ma prison! Condamné à ne point franchir les limites qui m’avaient été prescrites, je ne pouvais espérer ni de voir la fille de la baronne, ni de veiller sur elle comme je l’avais promis! Un seul moyen me restait d’échapper à cette servitude; j’en avais horreur et pourtant je l’acceptai, c’était pour elle!... Muni d’un permis provisoire je partis pour Paris et j’entrai dans la police de sûreté. Le reste doit vous être connu. Vous savez comment mes efforts pour empêcher le mariage de Monsieur de Luxeuil avec sa cousine furent rendus inutiles, et quelles en ont été les suites. Hier encore j’espérais que notre retraite pourrait nous sauver... qu’elle prolongerait au moins ce temps de repos et de joie qui vous dédommageait du passé. Le hasard a déjoué tous mes plans, le moment suprême que j’espérais toujours reculer est venu. Notre existence à tous va se décider dans quelques heures! Voilà pourquoi j’ai parlé, Monsieur, et maintenant que j’ai tout dit, je vous répète ma demande et je vous conjure d’y répondre sans réticence, sans détour. Avez-vous dans votre cœur le même amour pour celle que j’ai osé nommer ma fille? Vous sentez-vous capable de lui tenir seul lieu de toute famille et de lui faire oublier à force de bonheur ce qu’elle a souffert jusqu’à ce jour?
De Gausson qui avait écouté la longue confidence du chouan avec un trouble mêlé d’horreur et de pitié, releva la tête. Il était très-pâle, mais il n’y avait dans son regard aucune hésitation. Il étendit la main comme s’il eût voulu prêter un serment et répondit d’une voix ferme:
—Sur ma vie et sur mon honneur, j’ai plus d’amour pour celle que vous avez nommé votre fille, sur ma vie et sur mon honneur je me sens capable de lui tenir lieu de tout et de la rendre heureuse.
—Alors rien n’est désespéré, reprit Marc avec effort... demain... je parlerai à monsieur de Luxeuil.
Et comme il vit que de Gausson voulait l’interrompre.
—Oh! ne craignez point d’essai de conciliation, continua-t-il plus vivement; je sais que ce serait une tentative inutile... non... il faut que toute incertitude finisse... que votre avenir se décide, et il se décidera...
—Et par quel moyen? demanda Marcel.
—Vous le saurez... plus tard, répliqua le chouan qui s’était levé... pour ce soir, c’est assez... Dormez, Monsieur, afin d’avoir demain toutes vos forces; dormez, et bon courage.
Il fit de la main un signe à de Gausson, qui salua, et il s’avança vers la porte; mais au moment de l’ouvrir, il se retourna les yeux baissés et dit d’une voix oppressée:
—Je ne vous ai rien caché, et après avoir écouté, vous vous êtes tu! Je comprends ce silence, c’était, sans doute, tout ce que je pouvais espérer de votre justice. A vos yeux, le repentir n’a pu expier le crime... et vous n’éprouvez pour moi que haine et mépris!...
—Non, dit Marcel avec quelque effort, si mon premier sentiment a été l’indignation... ensuite... il a cédé... à la pitié! et maintenant je vous plains.
Marc le regarda.
—Vous le pouvez, dit-il d’un accent sourd, plaignez-moi, plaignez-moi! Si mon plus cruel ennemi savait ce que j’ai souffert, il renoncerait à la vengeance. Ce secret que je viens de dire... voilà vingt années qu’il pèse là, sur ma poitrine, qu’il me déchire, qu’il m’étouffe! vingt fois, il a failli m’échapper; vingt fois, quand j’étais près d’elle, quand elle me remerciait; vingt fois, j’ai failli lui dire:—Je suis ton père!... mais elle eût répondu par un cri de douleur; elle eût rougi... Je me suis tu. Oh! Monsieur, n’avoir qu’une pensée et ne pouvoir l’avouer, n’avoir qu’un amour et le tenir caché comme un crime. Ne jamais espérer de retour... C’est ma fille, Monsieur... Eh bien! savez-vous... je mourrai sans l’avoir embrassée!
L’accent avec lequel ces mots avaient été prononcés émut de Gausson.
—Pourquoi vous arrêter sur ces tristes pensées? dit-il d’un ton radouci. Songez plutôt à cette expiation si courageusement entreprise et qui doit vous relever à vos propres yeux. Si vous n’avez pas les droits d’un père, vous en avez eu le dévouement, et, autant que vous l’avez pu, vous en avez mérité le nom.
—Le pensez-vous sincèrement? demanda Marc, les regards fixés sur le jeune homme. Ai-je vraiment reconquis ce titre usurpé par un crime? Ah! si vous le croyez, montrez-le moi par un signe. Prouvez-moi qu’à vos yeux j’ai réellement racheté ma faute, que je ne suis plus pour vous un objet de mépris.
De Gausson lui tendit la main. Marc poussa un cri de joie, et la saisit.
—C’est donc vrai, s’écria-t-il au milieu de ses larmes... Vous m’avez pardonné... vous... vous... être pur et loyal... J’ai donc conquis le droit de presser une main sans souillure! ah! laissez-la moi, laissez-la moi, monsieur Marcel... Songez... elle aussi, elle l’a pressée. Cette main lui appartient... comme le cœur... en la sentant... c’est à elle que je pense; c’est elle que je vois!
Il avait approché la main du jeune homme de ses lèvres et la baisait avec des sanglots et des larmes. De Gausson attendri s’efforça en vain de l’apaiser par de douces paroles; l’horloge qui sonnait minuit, put seule le rappeler à lui-même. Il laissa aller la main de Marcel, essuya ses yeux et se redressant:
—Assez, dit-il, comme s’il se parlait tout haut; assez maintenant... et merci à vous, monsieur Marcel; je m’en vais raffermi, heureux! Je ne crains plus rien désormais. Avant de venir j’avais vu M. de Luxeuil, tout est convenu. De peur qu’on ne soupçonne quelque chose, vous sortirez demain avec le conducteur de notre barque; il connaît les chemins et vous vous rendrez ensemble au carrefour des Pierres noires, tandis que votre adversaire vous rejoindra par un autre chemin; je le conduirai moi-même. Le banquier demeurera à l’auberge afin de veiller sur madame Honorine; c’est M. de Luxeuil qui l’a exigé. Adieu! ayez confiance.
Il serra encore une fois la main du jeune homme et sortit.
De Gausson était parti avec le vieux pêcheur à l’heure convenue; de Luxeuil et Marquier ne tardèrent pas à descendre; le banquier tout frissonnant et tout pâle se plaignait du froid du matin.
—J’ai bien peur, mon cher, que le froid ne soit point dans l’air, mais en vous-même, fit observer Arthur, dont l’accent était plus railleur et l’air plus hautain que de coutume; cependant, vous serez ici parfaitement en sûreté.
—Il s’agit bien de moi, reprit Marquier, quand vous allez vous exposer...
—De grâce ne vous occupez pas des dangers que je cours, interrompit de Luxeuil, et songez seulement à tenir votre promesse.
—Ne craignez rien; je vous réponds que madame Honorine ne quittera point l’auberge.
—J’espère que vous me tiendrez parole, vu qu’il s’agit seulement de tenir tête à une femme. J’emmène tous ceux dont la présence eût pu vous embarrasser... même ce monsieur Marc.
—Le voici.
L’ancien chouan venait en effet d’entrer. Il était enveloppé d’un caban de peau de chèvre et tenait une lanterne à la main.
—Monsieur de Luxeuil est-il prêt? demanda-t-il d’une voix brève.
—Vous voyez que je vous attends, dit Arthur qui boutonnait ses gants.
Marc ouvrit en grand la porte qui donnait sur la rue et fit un pas au dehors.
—Au revoir donc... ou adieu... dit de Luxeuil au banquier en allumant un cigare; dans une heure vous aurez de nos nouvelles.
Marquier voulut répondre; mais Arthur lui imposa silence du geste, affermit son chapeau sur sa tête, plaça le cigare entre ses lèvres et suivit son conducteur.
Les premières lueurs du jour blanchissaient seulement l’horizon; les brouillards de la mer couvraient le rivage, et l’on apercevait à peine le sentier qu’il fallait suivre. Marc allait en avant, éclairant de sa lanterne les pas de son compagnon. Ils descendirent d’abord jusqu’au pont du Couesnon, puis gagnèrent la grève. Le vent était froid et humide; de Luxeuil pressa le pas sans s’en apercevoir, de manière à marcher de front avec Marc. Le duel dont il allait courir les chances ressemblait trop peu à ceux dont il était précédemment sorti victorieux pour qu’il n’éprouvât pas, malgré lui, quelque chose de cette inquiète impatience qui s’éveille chez tout homme à l’approche du danger. Son sang circulait plus vivement, une agitation involontaire parcourait ses nerfs, il chantait sans s’en apercevoir; il eût voulu parler, et le silence de son compagnon l’oppressait; enfin, quelle que fût sa répugnance, il se décida à lui adresser la parole.
—Sommes-nous bientôt à l’endroit où M. de Gausson doit nous attendre? demanda-t-il.
—Non, répondit le chouan.
Il y eut un court silence.
—C’est, il me semble, une étrange idée d’avoir choisi un rendez-vous si éloigné, reprit Arthur; tout pouvait se décider à dix pas de l’auberge.
—En exposant madame Honorine à entendre le coup de pistolet et à voir le cadavre, répliqua Marc.
De Luxeuil fit des épaules un mouvement ironique.
—C’est juste, reprit-il, ce n’est pas tout de se faire tuer pour les dames, il faut encore le faire de manière à ménager leurs nerfs!... Mais en tout cas, les précautions ont été exagérées; l’on pouvait aller moins loin.
Marc ne répondit pas.
—Je crains, de plus, que nous ne suivions pas la bonne route, reprit de Luxeuil un instant après; voyez, le sable cède sous nos pas.
—Ne craignez rien, Monsieur, nous arriverons au but, reprit Marc dont le regard semblait chercher à l’horizon.
De Luxeuil, fatigué de ce laconisme, jeta son cigare avec humeur et pressa le pas. Les premières clartés du soleil levant commençaient à percer le brouillard qui enveloppait la grève; la brise devenait plus vive, le murmure des flots plus distinct, les sables plus mouvants. De Luxeuil, qui marchait avec peine, et dont le regard se promenait à l’horizon pour découvrir son adversaire, s’arrêta tout à coup.
—Sur mon âme! dit-il, si nous étions sur la bonne route, on voit maintenant assez loin pour apercevoir M. de Gausson!
—Vous ne voyez donc rien? demanda Marc d’une voix étrange.
—Rien qu’une ligne blanche qui tremble là-bas dans le brouillard.
—Et vous ne devinez pas ce que ce peut être?
—En aucune façon; à moins qu’il n’y ait là quelque banc de rocher ou de sable éclairé par le soleil levant.
Marc, qui s’était arrêté, secoua la tête.
—Ce ne sont ni des sables, ni des rochers, répondit-il, car la ligne grossit, elle avance!...
—Mais qu’est-ce donc alors? s’écria de Luxeuil.
—La mort!
Arthur recula.
—J’ai voulu délivrer la femme qui portait votre nom, reprit le chouan, la rendre libre pour qu’elle pût encore être heureuse.
—Ah! misérable, c’est un assassinat, interrompit de Luxeuil.
—Non, dit Marc tranquillement, c’est un duel, un duel à mort pour tous deux, car aucun de nous ne sortira désormais vivant de cette place.
—Tu mens, s’écria Arthur, en regardant autour de lui. Saint-Michel est là; je puis encore atteindre le chemin...
Il voulut s’élancer dans la direction du mont, dont la masse sombre commençait à se dessiner dans la brume; mais, dès les premiers pas, les sables mouvants cédèrent sous ses pieds... Il enfonça jusqu’aux genoux et étendit les bras en poussant un cri.
—Un pas de plus de ce côté, et vous êtes englouti dans les grèves, fit observer le chouan.
—Malheureux! tu ne me laisseras pas périr ainsi, reprit Arthur, qui faisait de vains efforts pour se dégager: aide-moi, il en est temps encore... Dis ce que tu veux et je te l’accorderai... Fais tes conditions, mais hâte-toi. Regarde, la mer vient!
La houle s’avançait en effet avec la rapidité d’un cheval de course: ligne imperceptible d’abord, puis flot grossissant: c’était une montagne écumeuse et mouvante qui roulait vers eux avec un immense rugissement; on distinguait déjà les vagues, on sentait la rafale fraîche et humide! Les cheveux d’Arthur se dressèrent sur son front; il fit un effort suprême et se dégagea à moitié; mais au même instant, l’écume salée lui jaillit au visage, et le flot le souleva; il poussa un cri si terrible qu’on l’entendit retentir au-dessus de tous les grondements de la mer. L’orgueil qui faisait son courage l’avait abandonné: il ne voyait plus qu’une mort inattendue, horrible, et il avait peur. Par un mouvement instinctif, Marc s’était rapproché et lui avait tendu la main; aidé par ce point d’appui, il acheva de se dégager des sables... et retenant le bras de son conducteur:
—Au nom de Dieu!... sauvez-moi! s’écria-t-il éperdu... Je renoncerai à mes droits sur Honorine... je renoncerai à me venger de M. de Gausson... sauvez-moi, et tout ce qui me reste vous appartient... Oh! vite... vite... regardez, le flot gagne, oh! je vous en conjure à mains jointes... mais ce que vous faites est infâme, c’est une trahison, une lâcheté... Vous voulez un duel, dites-vous?... eh bien, conduisez-moi hors d’ici et je me battrai... à telles conditions que vous voudrez... vous serez également satisfait... puisque vous voulez ma mort... mais que ce soit une autre mort... pas celle-ci... pas celle-ci... Dieu! le flot m’emporte.
Il s’était cramponné au chouan qui, appuyé à un tertre de sable, avait jusqu’alors résisté au roulis de la vague et ne fit aucun effort pour le repousser.
—Ne perdez point ces derniers instants en vaines supplications, dit-il gravement; aucune puissance humaine ne peut désormais nous sauver.
—Est-ce possible? bégaya de Luxeuil, les cheveux hérissés.
—Pensez à Dieu! reprit Marc d’une voix plus haute; demandez pardon dans votre cœur à celle dont vous avez si longtemps torturé la vie; il ne vous reste plus pour cela qu’un instant.
—Non, non, balbutia de Luxeuil, que la mer soulevait; je ne veux pas mourir... encore...
Il abandonna brusquement Marc et voulut s’élancer à la nage vers la rive; mais le chouan saisit une de ses mains et la retenant fortement dans les siennes:
—Priez! dit-il.
Et quittant le point d’appui qui l’avait jusqu’alors retenu, il se laissa emporter par le flot qui se précipitait avec plus de violence. Deux ou trois fois on vit sa tête et celle d’Arthur reparaître sur la crête des lames au milieu des écumes, puis tout disparut, et l’on n’aperçut que la grande mer roulant ses longs replis sur la grève envahie, tandis que le brouillard achevait de s’élever et que le soleil inondait la baie de ses splendides lueurs.
De Gausson qui attendait au rendez-vous, rentra à l’auberge pour s’informer des causes de ce retard. En apprenant de Marquier que son adversaire était parti peu après lui sous la conduite de Marc, un étonnement mêlé d’inquiétude le saisit. Il ressortit avec le vieux matelot pour faire des recherches, mais toutes furent inutiles. Enfin, comme ils regagnaient la Croix-Verte, ils rencontrèrent quelques paysans qui, en traversant la grève que la mer avait abandonnée, venaient d’y découvrir deux cadavres. De Gausson courut au lieu indiqué et reconnut Marc et de Luxeuil. Le premier tenait encore serrée dans ses deux mains la main de son compagnon; mais il avait le visage ferme et calme comme si la mort l’eût surpris au milieu d’un grand sacrifice librement accompli. Les autorités averties se rendirent sur les lieux et constatèrent officiellement les deux morts. L’événement était expliqué par trop d’exemples précédents pour qu’il pût surprendre. Il fut attribué à l’ignorance des localités et à l’imprudence des deux victimes. Marcel seul devina tout, mais garda le silence. Le corps d’Arthur fut transporté à Paris pour être déposé dans le tombeau de sa famille. Quant à celui de Marc, réclamé par de Gausson, il fut conduit à la Brichaie et enterré sous le bosquet de sapins qui regardait la mer. La barrière qui séparait les deux amants était désormais brisée, mais leur union ne pouvait avoir lieu que plus tard; le deuil d’Honorine devait durer une année. De Gausson comprit que sa présence à la Brichaie, pendant cette attente, donnerait trop d’avantage à leurs ennemis, et quelque cruel que fût pour lui le départ, il s’y résigna.
Tous les voyageurs ont parlé de ces hautes montagnes qui semblent étager par terrasses certaines portions de l’Asie. La caravane gravit avec mille fatigues des pentes dangereuses, elle traverse des précipices sur des arbres tremblants, elle franchit des cascades dans lesquelles restent toujours quelques compagnons plus faibles ou plus malheureux; elle souffre le froid et le chaud, la soif et la faim; et après une longue ascension, alors que les forces manquent à tous et que le désespoir s’empare des plus courageux, tout à coup le dernier pic s’aplanit et montre aux yeux ravis une immense contrée couverte de bosquets en fleurs, de moissons dorées et de villes opulentes.
Il en est de même de certaines existences. Vous gravissez longtemps les rocs inaccessibles, vous laissez à chaque caillou une goutte de votre sang, à chaque ronce un lambeau de votre espérance, et, quand tout semble perdu, quand vous cherchez une place pour vous cacher et mourir, ce qui faisait obstacle s’écroule subitement et vous vous trouvez assis dans l’Eden que vous aviez cru perdu sans retour. Hasard étrange ou loi mystérieuse qui semble partager la vie humaine en autant de drames distincts et contrastés, débutant tantôt par la tragédie, tantôt par l’idylle, mais échappant toujours brusquement au poëme commencé pour en entreprendre un nouveau.
La mort d’Arthur changea tout dans la destinée d’Honorine. Il sembla avoir emporté avec lui, dans sa tombe, la fatalité qui avait jusqu’alors pesé sur la jeune femme. Délivrée de ceux qui s’étaient, tour à tour, acharnés à sa perte, elle se retrouvait libre et sans inquiétude. On eût dit une colombe échappée aux filets de l’oiseleur et qui reprenait possession de la verdure et du ciel. De Gausson, retourné aux Motteux, y avait réglé toutes les affaires de la succession; ses lettres tenaient Honorine au courant, jour par jour, de ce qu’il avait fait, de ce qu’il avait pensé. Chaque mois il revenait passer quelques heures à la Brichaie. C’étaient alors toutes les enivrantes joies du retour, toutes les ravissantes tristesses du départ; et l’attente, ainsi entrecoupée d’émotions, avait elle-même je ne sais quel charme ardent! Oh! qui n’a regretté ces angoisses des années amoureuses, tout ce cortége poétique mêlé de chimères, de regrets, d’espoir! Olympe romanesque où nous plaçons nos rêves pour en faire des Dieux, fascination charmante qui nous enlève aux froissements de la réalité pour nous emporter comme Elisée dans les nuées. L’année d’épreuve s’écoula et le mariage eut lieu dans la petite église de Sartilly. Le duc, dont les forces allaient s’affaiblissant, s’y fit transporter. Françoise et Brousmiche pleuraient de joie derrière les mariés, et le petit Jules, qui tenait ses petites mains jointes, répéta tout haut la simple prière qui lui avait été apprise par sa mère:
«Mon Dieu, bénis tous ceux qui nous aiment et pardonne à ceux qui nous haïssent!»
Honorine et de Gausson revinrent à la Brichaie à pied, à travers les viettes ombragées, respirant les premières senteurs du printemps, écoutant les premiers chants des oiseaux, ayant leurs mains enlacées et le cœur gonflé d’un bonheur trop grand pour pouvoir l’exprimer par des paroles. Trois mois s’écoulèrent dans un inexprimable enchantement; les épreuves du passé rendaient encore plus enivrantes les délices du présent. Honorine ne pouvait s’accoutumer à tant de bonheur. Parfois, au milieu des extases silencieuses qui suivaient ces longs entretiens, elle laissait échapper tout à coup un léger cri; des larmes venaient mouiller ses longs cils, et elle serrait la main de Marcel en disant:
—Ah! je suis trop heureuse, j’ai peur!
Ces craintes ne tardèrent pas à être justifiées par un malheur prévu, mais qu’ils devaient sentir douloureusement. La santé du duc de Saint-Alofe déclinait de jour en jour; bientôt commença pour lui cette agonie sans souffrance et sans affaiblissement d’esprit, rare privilége accordé à certains vieillards. La vie le quittait lentement, comme une eau qui fuit; il la sentait lui échapper; il assistait par l’intelligence à cet anéantissement du corps, et, semblable à Socrate, il continuait à proclamer d’une voix ferme, quoique affaiblie, les grandes doctrines auxquelles il avait voué sa vie. Enfin, un matin du mois d’août, il se fit transporter à la lisière du bosquet de sapins, près de la tombe de Marc. Il aimait ce lieu élevé d’où l’on apercevait les bois et la mer. A demi couché sur un tapis étendu à terre, il regarda longtemps l’horizon. Son visage amaigri était plus pâle, ses cheveux plus rares, ses mains plus tremblantes, mais la même flamme brillait dans son regard plein de douceur. Honorine et de Gausson, debout près de lui, le surveillaient avec une tendresse inquiète. Il releva la tête vers eux, essaya de sourire, et dit d’une voix faible:
—La terre est toujours aussi verte, le ciel aussi bleu, et vos regards nagent dans la joie... Où pourrais-je m’éteindre plus doucement?
—Ah! pourquoi ces pensées? interrompit Honorine en se penchant vers le vieillard avec des larmes dans les yeux.
Le duc prit sa main, qu’il retint dans les siennes.
—Que peuvent-elles avoir de triste? dit-il doucement. La mort qui brise une vie dans sa fleur, ou des projets à peine commencés, peut affliger l’homme qui la subit; mais quand la tâche est remplie, on se repose sans regrets. J’ai élevé jusqu’au faîte l’édifice que je voulais bâtir; un homme ne pouvait en faire davantage.
—Mais cet édifice est encore invisible pour le plus grand nombre, fit observer de Gausson; il vous reste à le faire connaître.
—Je n’ai plus le temps, dit le vieillard; mais je vous remercie d’y avoir pensé... Vous me rendez ainsi plus facile la demande que je voulais vous faire.
—Ah! parlez! s’écrièrent à la fois les deux époux; nous accomplirons tous vos désirs; que voulez-vous?
—Ce que je veux, reprit le duc, dont la voix s’anima, c’est que le fruit de longues études ne soit point perdu pour le bonheur des hommes. S’il ne m’a point été donné de voir lever ce soleil dont j’aperçois les lueurs à l’horizon du monde, je n’ai point pour cela cessé d’y croire; non, j’en prends Dieu à témoin, je meurs avec la foi de l’avenir! Mais cette terre promise dans laquelle doivent s’établir nos fils, il faut en indiquer la route à la foule; je l’ai cherchée trente ans...
—Et vous l’avez découverte! interrompit vivement de Gausson.
—Alors, montrez-la à tous, reprit le vieillard; promettez-moi que ces longues études ne demeureront point ensevelies dans l’oubli, et que, grâce à vous, elles seront publiées.
—J’en prends l’engagement! s’écria Marcel.
Le vieillard lui tendit la main.
—J’étais sûr de votre réponse, dit-il; vous trouverez tous mes manuscrits en ordre dans la cassette d’ébène donnée par Honorine... Si je ne me suis point trompé, le jour de la justice viendra pour mon œuvre. Quelque longue que soit l’attente, le germe conservé ne périra pas. Quelqu’un l’apercevra un jour et lui donnera assez de terre, d’eau et de soleil pour qu’il s’élève et s’épanouisse.
—Ah! vous verrez ce jour! dit Honorine, en s’approchant du vieillard avec une émotion croissante; pourquoi ne point espérer dans la bonne foi et dans la bonne volonté des hommes?
—Parce que je les connais depuis soixante années! répliqua le duc avec une légère nuance d’amertume; ne sont-ce pas eux qui ont flétri mes espérances dans l’avenir du nom de folie? Avez-vous donc jamais oublié le gibet du Golgotha? Toutes les royautés spirituelles doivent passer par la couronne d’épines. Heureux seulement les martyrs qui tombent en laissant leur vie dans d’autres âmes. Cette joie ne m’a point été donnée! Je meurs sans avoir pu communiquer mon souffle à aucun apôtre; il ne restera de moi qu’un livre où ma pensée dormira immobile comme ces corps dérobés à la décomposition par l’art égyptien. Ah! cette douleur... j’aurais voulu me la cacher à moi-même... vous avez forcé mon cœur à s’ouvrir... Que m’eût importé de mourir si d’autres avaient continué ma vie!... Mais je meurs tout entier... Mon âme ne laisse point de fils sur la terre, et il n’y aura pour elle, comme pour mes os, qu’une épitaphe!
L’accent du vieillard était devenu tremblant, son œil s’était voilé; il se laissa retomber sur un de ses bras et referma les paupières. Honorine et de Gausson, profondément touchés, se regardèrent; tous deux avaient la même inspiration. Il leur suffit de ce regard pour se comprendre. Ils se penchèrent en même temps, et soutenant dans leurs mains réunies la tête du vieillard:
—Non, votre souffle ne s’éteindra point tant que nous vivrons, dit Honorine avec un attendrissement religieux, car vous nous avez pénétrés de votre foi et échauffés de votre amour.
—Oui, ajouta Marcel d’un ton de fermeté émue, dites ce que nous devons faire et nous le ferons.
Le duc rouvrit les yeux, se releva sur le coude, et son pâle visage parut s’éclairer.
—Vous! répéta-t-il; est-ce bien vrai.... vous vous feriez les apôtres d’une croyance pour la populariser et la défendre, vous renonceriez à votre bonheur?
—Non, dit Marcel, car ce bonheur vient de notre amour et rien ne peut nous l’enlever; mais nous voulons le mériter et le sanctifier par le dévouement. Ah! ne nous jugez pas trop sévèrement pour ces premiers mois d’oisiveté et de rêverie! tant de traverses nous avaient désaccoutumés de la joie! nous avions besoin de nous y reprendre, de nous assurer d’un bonheur si longtemps espéré! Mais maintenant cette convalescence d’un long malheur est achevée; nous nous sentons forts et nous voulons être utiles. Ne dédaignez donc point notre bonne volonté et acceptez pour vos apôtres ceux qui sont déjà vos enfants.
Il avait plié le genou et Honorine l’avait imité. Le mourant se redressa brusquement comme si la vie se fût tout à coup réveillée en lui; il étendit ses deux mains tremblantes, les posa sur la tête des époux et deux larmes coulèrent sur ses joues flétries.
—Allez donc, reprit-il lentement, et suivez vos bons désirs. Tu as dit vrai, Marcel... la lutte ne peut rien vous enlever de votre bonheur; vous vous appuierez l’un sur l’autre; vous vous serez réciproquement une Providence. C’est l’isolement qui fait la faiblesse et le désespoir.
Il les attira alors plus près de lui et commença d’une voix tantôt familière, tantôt exaltée, une de ces improvisations sublimes que la mort inspire quelquefois. Il résuma avec une lucidité rapide tous les éléments de la doctrine nouvelle qui devait régénérer la terre, et ses deux auditeurs fascinés écoutaient sans oser faire un mouvement. Enfin, sa voix s’éteignit, ses forces étaient épuisées. Il se recoucha doucement, et referma les yeux.
Honorine et Marcel troublés demeurèrent à la même place, les mains enlacées. Les paroles du vieillard venaient, pour ainsi dire, d’agrandir leur amour en l’arrachant à son égoïsme. Maintenant ils sentaient le besoin de le répandre sur tout, d’en faire un foyer de chaleur et de lumière pour les cœurs aveugles ou glacés, de lui donner une occupation, un but! quelque chose de grave s’était tout à coup mêlé à leur joie; c’était toujours le même enivrement, mais plus noble et plus serein. Pensifs, ils attendirent le réveil du duc, jusqu’au moment où les derniers rayons du soleil vinrent se jouer sur son front et dans ses cheveux. Surpris de son immobilité, ils se penchèrent alors sur lui... Le duc était mort sans plainte et avec un sourire sur les lèvres! De Gausson et Honorine furent fidèles à leur promesse. Tous deux reparurent dans le monde, non pour prendre part à ses vains plaisirs, mais pour féconder les idées dont le dépôt leur avait été confié, pour appuyer les faibles, éclairer les forts et appeler à l’œuvre les hommes de bonne volonté.
Les obstacles surgissent chaque jour devant leurs pas, les injures et les calomnies germent sur leur route comme l’herbe des chemins, mais leur amour est une cuirasse impénétrable contre laquelle viennent s’émousser tous les traits. Après dix mois de laborieuses épreuves, tous deux s’échappent de Paris, chaque année, pour venir puiser de la patience et du courage à la Brichaie. Là, près du tombeau de Marc et du duc de Saint-Alofe, ils retrempent leurs âmes dans la solitude et amassent des forces pour retourner dans la mêlée. Françoise, dont le fils grandit, chante alors du matin au soir, et le vieux Brousmiche croise les mains lorsqu’il les voit passer, en répétant que ce sont des saints. Mais après avoir puisé des forces dans la retraite, tous deux repartent à l’heure indiquée. Semblables à ces plongeurs qui, revenus sous le ciel pour respirer, s’enfoncent de nouveau dans l’abîme, tous deux rentrent dans la Babylone où les attendent les mêmes sarcasmes; généreux réprouvés d’un monde pour lequel ils sont près de mourir comme le Christ en disant: «Pardonnez-leur, mon père, car ils ne savent ce qu’ils font!» Quant à madame la comtesse de Luxeuil et à M. de Chanteaux, ce sont toujours des élus dont le noms se trouve inscrit en tête de toutes les œuvres pieuses; Marquier vient d’arriver à la députation, et l’on parle du mariage de mademoiselle Clotilde avec M. Vankrof, auquel un journal a dernièrement décerné le titre de Mécène de l’Escaut.
FIN DU DEUXIÈME ET DERNIER VOLUME.
| Pages. | ||
| I. | Une maîtresse | 1 |
| II. | Une mère | 11 |
| III. | Encore Marc | 20 |
| IV. | Une découverte | 29 |
| V. | Deux amants | 40 |
| VI. | Les deux loges | 51 |
| VII. | Femme et maîtresse | 61 |
| VIII. | Les Motteux | 86 |
| IX. | Un gendre | 99 |
| X. | Adieux | 113 |
| XI. | Amis et ennemis | 124 |
| XII. | Présages | 134 |
| XIII. | Projets de vengeance | 143 |
| XIV. | Le sorcier | 152 |
| XV. | Le Petit-Tourbillon | 164 |
| XVI. | Soirée de grisette | 177 |
| XVII. | Rupture | 190 |
| XVIII. | M. Vankrof | 201 |
| XIX. | Une rencontre | 211 |
| XX. | La maison de Bel-Air | 223 |
| XXI. | La déclaration | 227 |
| XXII. | Le château de Vertbec | 241 |
| XXIII. | Une journée chez Marcel | 255 |
| XXIV. | Le gendre et la belle-mère | 267 |
| XXV. | L’accusation | 281 |
| XXVI. | Les droits du mari | 296 |
| XXVII. | La punition | 311 |
| XXVIII. | Une retraite | 320 |
| XXIX. | Madame de Luxeuil | 337 |
| XXX. | Rencontre | 346 |
| XXXI. | La grève de Saint-Michel | 368 |
| XXXII. | Conclusion | 374 |
FIN DE LA TABLE DU DEUXIÈME ET DERNIER VOLUME.
NOTES:
[A] En Normandie, on attribue à M. Matignon ou à M. La Vaquerie tous les coq-à-l’âne et toutes les naïvetés qui sont attribuées ailleurs à MM. de Sottenville ou à Jean-l’Innocent. Le Matignon normand est l’Hercule de la bêtise; il résume en lui tous les idiots.
[B] On prétend en Normandie que certaines gens ont la faculté de s’approprier le lait de vos vaches et de vos chèvres, au moyen d’un cordeau magique qui fait passer les produits de vos étables dans leur laiterie.
[C] Nom qu’on donne en Normandie aux bestiaux qu’on laisse pâturer librement.
| On a effectué les corrections suivantes: |
|---|
| un constraste=> un contraste {pg 50} |
| le vériritable=> le véritable {pg 74} |
| celui-ci répétait=> celle-ci répétait {pg 78} |
| Ça m’a navré, monsieur Marc=> Ça m’a navrée, monsieur Marc {pg 95} |
| place dans leurs charriots=> place dans leurs chariots {pg 96} |
| nous étions convenu=> nous étions convenues {pg 108} |
| nulle resource=> nulle ressource {pg 134} |
| erme=> ferme {pg 134} |
| J’métais arrêté=> J’m’étais arrêté {pg 137} |
| j’lai vu=> j’l’ai vu {pg 137} |
| différents point du canton=> différents points du canton {pg 141} |
| endroit sigulièrement sauvage=> endroit singulièrement sauvage {pg 153} |
| et attegnirent l’enceinte=> et atteignirent l’enceinte {pg 158} |
| de plaisanteries.=> de plaisanteries! {pg 178} |
| que j’aie fini mes beignets.=> que j’aie fini mes beignets? {pg 180} |
| Non, répliqua la Belge=> Non, répliqua le Belge {pg 203} |
| Ah! qu’est-ce qui veut=> Ah! qu’est-ce qu’i veut {pg 234} |
| toujours les gravulures=> toujours les gravelures {pg 262} |
| les feux de vaisseaux ballotés=> les feux de vaisseaux ballottés {pg 277} |
| Mirou se découvrit=> Micou se découvrit {pg 281} |
| monsieur Baumont=> monsieur Beaumont {pg 291} |
| le dernier des spectateurs eût disparu=> le dernier des spectateurs eut disparu {pg 292} |
| Frappée de cette péripétie inattendue, elles=> Frappées de cette péripétie inattendue, elles {pg 294} |
| Faut-il donc m’indigner de ce qui me sert.=> Faut-il donc m’indigner de ce qui me sert? {pg 303} |
| quand elle les eût achevées=> quand elle les eut achevées {pg 308} |
| les âmes ballotées par le flot=> les âmes ballottées par le flot {pg 350} |
End of Project Gutenberg's Les réprouvés et les élus (t.2), by Émile Souvestre
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LES RÉPROUVÉS ET LES ÉLUS ***
***** This file should be named 42594-h.htm or 42594-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/4/2/5/9/42594/
Produced by Laurent Vogel, Chuck Greif and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive/Canadian Libraries)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.