
LE
CAPITAINE COUTANCEAU

EN VENTE A LA LIBRAIRIE DE E. DENTU
DU MÊME AUTEUR
| LA DÉGRINGOLADE, 5e édit. 2 vol. gr. in-18, | 7 fr. » |
| LA VIE INFERNALE, 5e édit. 2 vol. gr. in-18. | 7 fr. » |
| L’AFFAIRE BEROUGE, 13e édit. 1 vol gr. in-18. | 3 fr. 50 |
| LE DOSSIER Nº 113, 12e édit. 1 vol. gr. in-18. | 3 fr. 50 |
| LE CRIME D’ORCIVAL, 10e édit. 1 vol. gr. in-18 | 3 fr. 50 |
| LES ESCLAVES DE PARIS, 6e édit. 2 vol. gr. in-18. | 7 fr. » |
| LE 13e HUSSARDS, 22e édit. 1 vol. gr. in-18. | 3 fr. 50 |
| MONSIEUR LECOQ, 6e édit. 2 vol. gr. in-18. | 7 fr. » |
| LES COTILLONS CÉLÈBRES, 7e édit. ornée de portraits, 2 vol. gr, in-18. | 7 fr. » |
| LES COMÉDIENNES ADORÉES, 3e édit. 1 vol. | 3 fr. 50 |
| LES GENS DE BUREAU, 5e édit. 1 vol. gr. in-18 | 3 fr. 50 |
| LA CLIQUE DORÉE, 7e édit. 1 vol. gr. in-18. | 3 fr. 50 |
| MARIAGES D’AVENTURE, 3e édition, 1 vol | 3 fr. 50 |
| LA CORDE AU COU, 7e édit. 1 vol. gr. in-18. | 3 fr. 50 |
| L’ARGENT DES AUTRES, 6e édit. 2 vol. gr. in-18 | 7 fr. » |
| LE PETIT VIEUX DES BATIGNOLLES, 1 vol. gr. in-18 | 3 fr. 50 |
| SAINT-OMER.—IMP. H. D’HOMONT. | |
PAR
ÉMILE GABORIAU
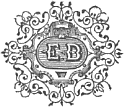
E. DENTU, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
PALAIS-ROYAL, 15-17-19, GALERIE D’ORLÉANS
___
1878
Tous droits réservés
C’était l’autre soir.
La journée finie, nous étions tous réunis, amis et voisins, chez les Coutanceau, et nous devisions—les fenêtres ouvertes, à cause de la grande chaleur.
De braves gens, ces Coutanceau, depuis l’aïeul, le capitaine, un homme de fer qui passera la centaine, jusqu’au dernier des mioches.
Des gens d’une probité antique, bien connus dans notre quartier, qu’ils habitent de père en fils depuis plus d’un siècle, si aimés et si respectés que c’est un honneur dont on est fier que d’être admis chez eux.
Mais l’autre soir, nous n’étions point gais comme de coutume.
Des nouvelles circulaient, depuis une semaine, qui faisaient les fronts soucieux.
D’aucuns affirmaient que le roi de Prusse, pendant qu’il passait à cheval devant le front de ses troupes, avait osé publiquement, en plein soleil, à la face de tous, écarter d’un geste dédaigneux notre ambassadeur, le représentant de la France, qui s’avançait vers lui.
—C’est à n’y pas croire, disait M. Dolin, le marchand de bois, c’est à se demander si l’orgueil n’a pas troublé la raison de ces gens-là.
Il commençait à s’animer, lorsqu’à ce moment de grandes clameurs qui montaient de la rue lui coupèrent la parole.
Nous nous précipitâmes aux fenêtres.
Une bande de jeunes gens passait, portant un drapeau et criant:
—A Berlin!... A Berlin!... A Berlin!...
Prompt comme l’éclair, un des fils Coutanceau s’élança dehors, et, lorsqu’il reparut l’instant d’après, il tenait un journal du soir.
Il était un peu pâle, et ses narines frissonnantes, comme il arrive quand on est secoué par quelque puissante commotion, mais ses yeux brillaient d’un éclat extraordinaire.
—Ils l’ont voulu! s’écria-t-il, la guerre est déclarée... tenez, lisez...
Il disait vrai.
Un grand silence se fit, solennel, comme si chacun de nous eût eu la soudaine vision de ce que représente de grandeurs et de sacrifices, d’héroïsmes et de souffrances ce mot terrible la guerre.
Mais ce fut l’affaire d’un instant.
Le vieux capitaine Coutanceau, qu’on eût cru assoupi dans son fauteuil, s’était dressé en pied.
Il s’avança jusqu’au milieu de nous, et d’une voix vibrante, de cette voix dont il électrisait l’âme de ses soldats:
—Ah! ils le veulent!... s’écria-t-il. Ah! ils nous provoquent et nous défient!... Eh bien! tant mieux!... A Berlin!
Mais il faudrait connaître le capitaine Coutanceau, pour se faire une juste idée des émotions qu’il remua en nous.
Celui-là est un des derniers, un des rares survivants de ces héroïques bataillons qui firent de leur poitrine un rempart à la France menacée.
Successivement il a vu tomber autour de lui tous ceux de sa génération, et il est resté debout, pareil à ces vieux chênes épargnés par la cognée qu’on aperçoit de loin en loin s’élevant au-dessus des taillis.
Il doit avoir quatre-vingt-seize ou dix-sept ans, mais c’est à peine si on lui en donnerait soixante-dix, lorsqu’il sort pour sa promenade quotidienne, le pied solide encore, la taille droite dans sa longue redingote de gros drap.
Le voir c’est être frappé de respect, tant éclate sur sa physionomie sereine toutes les vertus dont il a honoré sa vie, tant reflète sur son front et la fierté de son âme et la noblesse de son intelligence. Qui n’a pas la conscience nette, doit se troubler sous le regard perspicace de ce vieillard qui jamais, j’en jurerais, n’a eu seulement une pensée dont il eût à rougir.
Et indulgent avec cela, et bon, et faible! Ah! ses petits enfants ont terriblement abusé de lui quelquefois!
Tel est l’homme qui se dressait au milieu de nous, imposant et sublime comme si toutes les gloires de la patrie se fussent incarnées en lui.
—Oui, tant mieux! poursuivait-il. A cette heure, je bénis le ciel de m’avoir accordé une existence si longue... Je verrai donc notre revanche avant de mourir... la revanche de 1815... Ah! si seulement j’avais trente ans de moins!... Mais vous êtes là, mes petits-fils, vous êtes là, Louis et Henri...
D’un même mouvement enthousiaste, les deux jeunes gens serrèrent la main de leur aïeul.
—Nous comptions te demander la permission de nous engager demain, grand’père, dirent-ils...
Un sourire éclaira le visage du vieillard: il se reconnaissait.
—Bien, cela, fit-il, très-bien!... Pardieu! il eût fait beau voir qu’on se fût battu sur le Rhin et qu’il ne se fût pas trouvé un Coutanceau à la bataille...
Mais il s’interrompit. Il venait de surprendre une larme dans les yeux de sa fille.
—Pourquoi pleurer Marie-Louise, fit-il d’un ton de reproche... C’est ici une guerre juste, une guerre nationale, le devoir des enfants est de partir...
Et plus doucement:
—Réfléchis donc, chère fille, que plus il partira de volontaires, plus la victoire sera sûre, moins le danger sera grand... La raison et le devoir sont d’accord... Ah! s’ils se levaient en masse, tous ceux qui sont en état de porter les armes et de courir à l’ennemi, la guerre serait finie demain... la Prusse, épouvantée, se rendrait sans combat...
Il ne put s’empêcher de rire à cette idée, et gaiement:
—D’ailleurs, ajouta-t-il, Berlin n’est pas au bout du monde... On y va très-bien, et même on en revient...
Nous savions tous que le capitaine Coutanceau avait fait les guerres de la Révolution et de l’Empire, et même nous nous étions souvent étonnés qu’un homme de sa valeur fût resté dans les grades inférieurs, alors que tant de ses anciens camarades étaient morts généraux et même maréchaux de France.
Cela tenait, disait-on, à un drame terrible auquel le capitaine s’était trouvé mêlé, et qui avait brisé sa carrière—mais personne jamais n’avait osé le questionner à ce sujet.
Ce soir-là on fut plus hardi.
—Ah! capitaine, insinua son ami le docteur, si vous vouliez...
Il comprit et, clignant de l’œil:
—Je vois bien, fit-il, où vous voulez en venir... Eh bien! je ne dis pas non... Mais plus tard. Ce soir, je me dois à ces deux enfants qui, peut-être, avant un mois seront, en face des Prussiens... Je veux leur dire quels sont ces ennemis à qui ils vont avoir affaire...
On avança son fauteuil, il s’assit et commença:
—Pour vous donner, même par à peu près une idée de Paris dans les premiers jours du mois de juin 1792, il faudrait, mes amis, une éloquence que je n’ai pas.
Non, jamais je ne saurais vous rendre la terrible fermentation des esprits, l’exaltation des espérances, cette fièvre qui s’était emparée de nous tous et qui nous transportait hors de nous-mêmes.
Alors, on vivait sur la place publique, aux sections, aux clubs, aux sociétés organisées pour instruire le peuple de ses droits.
Le soir venu, des orateurs s’improvisaient à toutes les bornes des carrefours, ou des lecteurs de bonne volonté qui lisaient les papiers publics à la lueur d’une petite chandelle entourée de papier huilé.
Il y avait foule dans les endroits publics, au café de la Régence, rendez-vous des officiers de la garde nationale; au café de Choiseul, dont le propriétaire, Achille Chrétien, un patriote fougueux, mettait à la porte ceux qui n’étaient pas de son avis; au café Manouri, chez Procope et au Pavillon de Foi.
Le pain était bon marché, mais tout travail ayant cessé et tout commerce, beaucoup souffraient...
Mon père, Jean Coutanceau, qui était maître boulanger, avait sa boutique rue Saint-Honoré, non loin de la maison de Duplay, le menuisier, l’hôte et l’ami de Robespierre.
Mais il ne restait guère chez nous.
Toute la nuit il travaillait au pétrin, nu jusqu’à la ceinture, comme le dernier de ses garçons, mais dès que le pain était défourné, il remettait son habit et partait pour ne reparaître qu’à l’heure du dîner. Le soir, il allait régulièrement aux Jacobins et ne rentrait que pour reprendre sa besogne.
Souvent, je me suis demandé de quel ciment il était bâti, pour résister à de telles fatigues et à une privation presque constante de sommeil.
Eh bien! ils étaient des centaines et des milliers qui vivaient de cette vie là, des hommes de fer trempés pour leur œuvre, que la fièvre de la liberté soutenait.
En d’autres circonstances, ma mère se fût sans doute indignée et révoltée de cet abandon du foyer.
Mais les idées de mon père étaient les siennes, et si parfois elle était inquiète, elle mettait son honneur à cacher ses alarmes.
—Il faut que les hommes fassent leur devoir, disait-elle.
Et chaque soir, elle attendait mon père avec une impatience fébrile, et lorsqu’il arrivait, il fallait qu’il lui racontât toutes les nouvelles, ce qui se passait aux faubourgs et aux Tuileries, les motions des clubs, quels orateurs avaient parlé à l’assemblée et ce qu’ils avaient dit.
Le dimanche, cependant, mon père restait au logis.
Il faisait ses comptes et écrivait des réclamations qu’on portait aux pratiques qui ne nous payaient pas. Il y en avait beaucoup dans ce cas; il y en avait même tant et tant que, bien loin de gagner de l’argent, il nous fallait chaque mois prendre quelque chose de notre petit patrimoine. C’était alors un vilain métier que celui de boulanger.
Ce jour-là, presque toujours, M. Goguereau, le médecin, qui avait été élu député de Paris aux élections de 1791, venait partager notre modeste dîner.
C’était un très-vieil ami de notre famille, presque notre parent, car sa belle-sœur était mariée à un neveu de ma mère, un nommé Moisson, ébéniste au faubourg Saint-Antoine.
Au dessert, invariablement, mon père descendait à la cave chercher une bouteille de vieux vin, et tout en la buvant, c’étaient entre M. Goguereau et lui des discussions interminables. Je ne saisissais pas toujours parfaitement leurs théories, mais de tout ce qu’ils disaient ressortait pour moi éclatante comme le soleil cette vérité que la liberté est le plus précieux des biens et les plus sacrés des droits d’un homme.
J’avais alors dix-sept ans et j’étais si grand et si vigoureux qu’on m’en eût donné vingt, pour le moins.
Cependant, mon père n’avait pas voulu faire de moi un boulanger, comme l’avait été mon grand-père, et comme il l’était lui-même.
Il prétendait me faire donner une éducation supérieure à la sienne, et chaque matin je me rendais à une classe que tenait derrière Saint-Roch un père de l’Oratoire, un vieux brave homme qui ne s’occupait pas de politique, mais seulement de bien bourrer ses élèves de latin, d’histoire et de géographie.
Je mentirais si je disais que je ne souhaitais pas vivement accompagner mon père. Mais il n’entendait pas de cette oreille, et toute la journée il me fallait rester, en tête à tête avec mes livres.
C’est à la seule indulgence de ma mère que je devais de ci et de là quelques heures de liberté.
Parfois, lorsqu’il s’amassait du monde dans la rue, lorsqu’on entendait battre le tambour, voyant les angoisses de ma curiosité, la pauvre chère femme me disait:
—Allons, va voir! et surtout ne sois pas trop longtemps.
Et bien vite je filais.
C’est ainsi que le 20 juin 1792, je vis la grande manifestation qui se rendait à l’assemblée et qui ensuite envahit les Tuileries.
Ce fut la première émotion terrible et ineffaçable de ma vie, car je n’avais vu aucune des journées glorieuses et néfastes de la Révolution, ni la prise de la Bastille, ni les scènes de l’Hôtel-de-Ville, ni la catastrophe du Champ-de-Mars.
En tête de la première colonne, marchaient Santerre et un homme vêtu en fort de la halle qu’on me dit être le marquis de Saint-Huruge. En arrière, à quelques pas, venaient des invalides, traînant sur un char un haut peuplier tout chargé de feuilles.
Le peuple ne semblait ni irrité, ni menaçant, mais fort gai, au contraire et disposé à rire. Je remarquai beaucoup de femmes avec leurs enfants dans leurs bras.
A plusieurs de ces gens, je demandai où ils allaient et ce qu’ils comptaient faire, ils me répondirent qu’ils n’en savaient rien; mais qu’il fallait amener à la raison, M. et madame Véto,—on appelait ainsi le roi et la reine,—dont la mauvaise volonté perdait la nation.
Jusqu’à quatre heures, je demeurai parmi la foule, et je fus entraîné par le courant lorsqu’on brisa, faute d’issues, les grilles du Carrousel, mais je ne pénétrai pas dans les Tuileries. Quand je vis braquer les canons contre les portes du château, j’eus peur, je vous l’avoue, et je me sauvai.
Mon père était sombre, quand il rentra le soir.
—Tout va mal! nous dit-il. Que font nos armées? Rien. Et cependant l’ennemi est aux frontières!... Il est vrai qu’il y a sans doute des Français indignes de ce nom qui l’appellent de tous leurs vœux... Ah! malheur aux scélérats qui pactiseraient avec l’étranger!...
Mon père, qui était pourtant un homme humain et honnête, disait cela d’une telle voix et avec de si terribles regards, que je frémis.
C’est que je ne vous ai pas dit encore que depuis le mois d’avril précédent les hostilités étaient commencées entre la France et l’Autriche.
Et, certes, on ne saurait imaginer une guerre entreprise sous des auspices plus désastreux.
La campagne était à peine ouverte, que déjà l’indiscipline de notre armée était à son comble.
Luckner, La Fayette, Rochambeau, nos généraux n’avaient pas la confiance de leurs soldats, on refusait de leur obéir.
Travaillées de sinistres soupçons, nos troupes voyaient la trahison partout, devant et derrière eux. Deux régiments s’étaient repliés sans tirer un coup de feu, en criant: Nous sommes trahis.
De tels débuts devaient emplir l’ennemi de confiance. Le mal était immense, et cependant on ne semblait pas s’occuper d’y porter remède. Et dans Paris on disait que ce n’était pas le succès de nos armes que souhaitaient le roi et la reine, M. et madame Véto.
Voilà où en était l’opinion, quand le bruit se répandait que la Prusse, rompant sa neutralité, s’ébranlait pour marcher contre nous.
Ce fut mon père qui nous apporta cette nouvelle, en sortant d’un club où on avait lu une lettre apportée de Coblentz, quartier général de l’armée prussienne.
Ma mère parut consternée.
—Est-ce bien possible, s’écria-t-elle. Quelle raison auraient ces gens de nous faire la guerre?
—Aucune.
—Alors... pourquoi viendraient-ils?
—Pourquoi! parce qu’ils savent notre frontière dégarnie, parce qu’ils croient que le dur enfantement de notre liberté nous met à leur merci... Parce que la Prusse est une nation de proie et qu’elle espère tirer quelque chose de nous: une forteresse, une ville, une province peut-être!...
Durant quelques jours, on douta, on voulut douter de cette nouvelle. On avait tant besoin qu’elle ne fût pas vraie!
D’un autre côté, beaucoup de gens plus honnêtes que clairvoyants, pensaient que les Prussiens hésiteraient ou même seraient arrêtés par l’impossibilité de justifier leur agression.
L’anxiété n’en allait pas moins grandissant.
Il me semblait sentir Paris bouillonner et frémir comme une chaudière immense dont la vapeur cherche une issue.
C’est à peine, désormais, si je voyais mon père. Il prenait ses repas dehors, ou bien j’étais couché quand il rentrait. Puis c’étaient des patriotes qui venaient le voir. Ils s’enfermaient dans l’arrière boutique pour tenir conseil, et si je prêtais l’oreille, je les entendais répéter d’un ton de fureur concentrée:
—Il faut aviser au moyen de nous sauver nous-mêmes, car le roi et la reine s’entendent avec l’étranger pour nous livrer.
C’était là ce que j’entendais dire partout...
Or, j’en étais venu insensiblement à passer mes journées dehors. Mon vieux professeur avait suspendu ses leçons, ma mère ne me demandait plus compte de mes sorties, j’avais tout mon temps à moi, j’étais mon maître, j’en profitais insoucieusement comme un enfant que j’étais.
Je m’en allais au hasard par la ville, me mêlant aux groupes, suivant les manifestations qui se succédaient à propos de tout et à propos de rien, écoutant, interrogeant, glanant les on-dit.
Mais c’est au Palais-Royal que je finissais toujours par revenir.
Là, sous ces mêmes arbres dont les feuilles, arrachées par Camille Desmoulins, avaient été le premier signe de ralliement de la Révolution, là se pressait, autour des nouvellistes et des politiques en plein vent, une foule haletante de curiosité.
Alors, mes amis, nous n’avions ni les chemins de fer, ni le télégraphe. Alors les dépêches étaient apportées à franc étrier, et il fallait bien des jours et bien des relais à un courrier pour venir de la frontière.
C’est vous dire l’impatience dont on était dévoré, le travail des imaginations et par contre le déluge de nouvelles fausses dont on était inondé.
Fabriquer des nouvelles était une manie. Il y avait des gens qui s’en faisaient une renommée et presque un état. Les plus habiles exerçaient au Palais-Royal, on les connaissait, et dès qu’ils paraissaient, on les hissait sur un banc et on les écoutait.
Et suivant que c’était tel ou tel qui pérorait, on croyait tout perdu ou tout sauvé, et c’était des cris de joie absurdes ou des paniques plus ridicules encore.
Parmi ces beaux donneurs de renseignements, il en est un qu’il me semble voir encore.
C’était un certain Mouchet, haut comme ma botte, bancroche et bossu, noir de peau et le nez en vrille qu’on avait surnommé le Diable boîteux. Il avait une voix si aigre et si perçante qu’on l’entendait sous les galeries de bois et qu’il faisait taire tous les autres. Il ne manquait pas d’une certaine faconde, s’étant exercé longtemps au club des Minimes.
Ce Mouchet avait la spécialité des nouvelles désastreuses.
Il n’était guère d’après-midi qu’il ne nous annonçât que nos soldats venaient d’être mis en pleine déroute. Et si quelqu’un faisait seulement mine de douter, tout de suite il tirait de sa poche et lisait une lettre qu’il venait, jurait-il, de recevoir de l’armée, à l’instant même.
Il s’était, par surcroit, donné l’emploi de dénoncer quotidiennement le général La Fayette, lequel n’était guère en odeur de patriotisme, et qui était bien loin déjà du temps où on arrachait pour s’en faire des reliques les crins de son cheval blanc.
Le malheur est que cet intarissable parleur n’inventait pas toujours.
Il disait vrai, par exemple, en annonçant que le duc de Bade avait mis les Autrichiens dans Kehl, et qu’on craignait un complot pour livrer Strasbourg. Il disait vrai en affirmant que l’Alsace, debout et frémissante, demandait en vain des armes pour marcher à l’ennemi.
C’est de même par Mouchet que j’appris les trop réels malheurs des Flandres.
Là, le vieux Luckner, le général de la Révolution, n’était pas à la hauteur de son rôle. Poussé par Dumouriez, il s’était d’abord avancé et avait pris Courtrai et deux places fortes. Puis, tout à coup, comme s’il eût été effrayé de sa témérité et de son succès, il s’était replié en hâte jusque sous le canon de Lille, après en avoir fait juste assez pour compromettre les amis et les partisans de la France.
—Or, concluait Mouchet, de sa voix glapissante, or, je le demande aux braves sans-culottes qui m’écoutent, pourquoi cette retraite?... Parce que M. Véto l’a ordonnée. La trahison est visible, on veut donner aux Prussiens le temps d’arriver.
Ce qu’il ne disait pas, ce Mouchet, c’est que, pour tenir tête à tête à l’armée autrichienne, Luckner n’avait pas quarante mille hommes, brûlants d’enthousiasme, c’est vrai, mais sans aucune instruction militaire, à peine organisés, sans vivres, presque sans munitions.
C’est l’objection qui me vint, et le soir, je la soumis à mon père, mais lui, pourpre d’indignation, et les poings crispés.
—Et à qui donc s’en prendre, s’écria-t-il, si notre frontière est ouverte, si les cadres de nos armées sont vides, si nos soldats manquent de tout, si nos généraux sont des poltrons ou des incapables, à qui donc s’en prendre, sinon à celui qui a juré de défendre la France, qui en a les moyens, et qui ne le fait pas?...
C’est pourtant juste, pensais-je, mon père a raison.
Mais lui, s’animant poursuivait:
—On devait établir un camp entre la frontière et Paris. Où est-il ce camp? Ce ne sont cependant pas les soldats qui manquent.
Ah! ce n’était que trop évident; la France était en péril, les plus simples ne s’y trompaient pas. Mais ce péril, comment le prévenir?...
Hélas! comment eût-on été d’accord sur les moyens, quand on ne l’était pas sur les causes, chaque parti accusant l’autre de trahison.
Enfin, le 30 juin, le député Jean Debry lut à l’Assemblée un rapport sur les mesures à prendre en cas de danger de la patrie.
Accueilli par des applaudissements presque unanimes, le rapport fut mis en discussion et ne tarda pas à devenir l’objet d’une lutte passionnée et qui menaçait de durer longtemps.
Mon père, je l’ai compris depuis, ne se rendait pas bien compte de l’énorme gravité des débats; il s’indignait de ces lenteurs.
—A chaque jour qu’on perd, grondait-il, les Prussiens peuvent faire une étape.
Voilà où en étaient les choses, lorsque, le soir du 2 juillet, juste comme j’aidais nos garçons à mettre les volets de la boutique, je vis arriver le vieil ami de mes parents, M. Goguereau, le député.
—Mon cher Coutanceau, dit-il à mon père, je sais que depuis longtemps vous désirez entendre Vergniaud; il doit prendre la parole demain; si vous le voulez, je viendrai vous chercher, ainsi que le jeune citoyen qui est là,—et il me montrait,—et je vous ferai placer.
Si mon père fut content, et remercia, il ne faut pas le demander.
Dès huit heures, le lendemain, il avait fait faire sa barbe et avait passé son plus bel habit. J’avais mis pareillement mes plus beaux effets, avec une chemise à gros jabot selon la mode d’alors.
A l’heure dite M. Goguereau arriva, et nous partîmes.
Ah! bien nous en prit, d’être avec un député. Jamais je n’ai vu affluence de monde comme celle qui se pressait autour de l’Assemblée. Le bruit s’était répandu la veille que Vergniaud devait prononcer un discours, et c’était à qui pourrait entendre le grand orateur de la Gironde. Mais il y avait des gardes à toutes les portes, qui barraient le passage...
La consigne n’était pas pour nous. M. Goguereau se nommait, en disant: «Ces citoyens sont avec moi,» et on s’empressait de nous laisser passer.
Ainsi il nous guida le long des couloirs, puis il nous ouvrit la porte d’un petit escalier, et finalement il nous introduisit dans les tribunes.
Elles étaient pleines à crouler d’auditeurs—de femmes surtout—et ce n’est pas sans soulever une tempête de récriminations, que nous réussîmes, mon père et moi, à conquérir—c’est bien l’expression—deux pauvres petites places au bout d’une banquette.
J’étais horriblement mal à l’aise, et surtout martyrisé par un chapiteau de colonne qui me meurtrissait les reins dès que je me dressais. Mais je ne souffrais de rien, tant j’étais saisi de la majesté du spectacle que j’avais sous les yeux pour la première fois.
Quels hommes siégeaient dans cette assemblée, mes amis, il est inutile, n’est-ce pas, que je vous le dise. Leurs noms sont dans toutes les mémoires, et ils vivront autant que leur œuvre,—œuvre immense, qui nous a fait ce que nous sommes, et que presque tous, hélas! ont scellée de leur sang.
De ma place, je planais au-dessus d’eux tous.
Je voyais les députés de la gauche—de la Montagne—échanger des regards enflammés, des paroles irritées et des gestes menaçants, avec ceux de la droite. Je voyais ceux du centre—du Marais, comme on disait alors—essayer de s’interposer entre des rancunes implacables.
Je n’avais pas assez d’yeux pour regarder le président, immobile sur son fauteuil comme une statue, la main sur le manche d’ébène de sa sonnette.
Derrière lui, dans un réduit grillé d’une douzaine de pieds carrés il me semblait apercevoir des ombres qui s’agitaient. Là, se tenaient des journalistes qui venaient de trouver le secret d’écrire aussi vite que l’on parle et qu’on appelait, pour cette raison, des logotachygraphes.
C’est dans cette loge que quelques jours plus tard, le 10 août, Louis XVI, chassé des Tuileries, devait venir chercher un refuge.
A la tribune où on montait par un escalier assez roide, était alors un petit homme maigre, qui parlait avec des gestes de convulsionnaire du salut public, l’unique et la suprême loi, disait-il.
On ne l’écoutait guère.
A tout bout de phrases les autres députés l’interrompaient, et dans les tribunes les conversations continuaient tout haut, comme à la Halle... Même, non loin de mon père et de moi, il y avait des gens qui buvaient et mangeaient, sans façon, comme s’ils eussent été chez eux.
A la fin, cependant, cet orateur si peu écouté descendit de la tribune.
Et je vis s’avancer pour le remplacer, un homme tout jeune encore, au regard doux, à la physionomie pensive.
Autour de moi on chuchotait:
Vergniaud! Vergniaud!...
Ce qui me frappait en lui, c’était la grâce familière de sa démarche, une certaine nonchalance d’attitude et je ne sais quel inexprimable charme qui vous attirait vers lui et faisait qu’on l’aimait et qu’on souhaitait d’être son ami.
Mais quand son pied frappa le parquet de la tribune, comme pour en prendre possession, il fut transfiguré... L’orateur surgissait de l’homme... Il m’apparut tel qu’un dieu, sur le Sinaï de la liberté, le front éblouissant d’éclairs.
Le silence s’était fait, profond, intense.
Au-dehors, même, les grondements sourds de la foule se taisaient.
Lui, un peu pâle d’abord, et violemment ému d’une virile émotion, il promena son regard autour de la salle..., son bras se leva d’un geste impérieux, ses lèvres s’entr’ouvrirent... Il parla.
Le discours qu’il prononça ce jour-là, mes amis, marque une date dans les fastes de l’éloquence humaine—une date dans l’histoire de notre Révolution.
Vous le trouverez, ce discours, dans tous les livres.
Mais ce que les livres ne vous diront pas, c’est cette parole inspirée, cette voix puissante et grave, qui avait des caresses divines, quand il adjurait ses collègues de s’unir pour le salut de la patrie, et qui vibrait comme le métal des cloches quand montait son indignation.
Dédaigneux des ménagements de la prudence, il alla droit au fait.
Ce que la France pensait et disait tout bas, il le cria d’une voix si forte que le trône chancelant de Louis XVI en fut renversé...
Après avoir déroulé l’effrayant tableau des calamités de la France, il disait l’immensité et l’imminence du péril, et aussi l’incurie criminelle du pouvoir. Il montrait l’ennemi à nos portes, les émigrés en armes à la frontière, l’invasion menaçante, et le roi paralysant de son veto toutes les mesures de salut public, le roi n’osant défendre formellement à ses généraux de vaincre, mais leur enlevant hypocritement les moyens de vaincre.
«Appelez, ô mes collègues, disait-il, appelez, tous les Français à sauver la patrie... Montrez leur l’immensité du gouffre... Ce n’est que par un effort extraordinaire qu’ils pourront le franchir!...»
Un frisson électrique parcourait l’Assemblée, à ces accents inspirés du grand orateur... Chacun avait cru entendre sonner le glas de la patrie agonisante.
Alors il me fut donné de connaître l’empire de la parole humaine.
Dans cette assemblée, l’instant d’avant si divisée, et agitée de tant de passions contraires, on eût dit que tous les cœurs battaient à l’unisson pour un même désir, pour une seule pensée.
Sur les bancs de la gauche, à droite, au centre, dans les galeries, on applaudissait avec une sorte de frénésie.
Pâle, les dents serrées, les yeux brillants de larmes, mon père m’étreignit le bras à le briser.
—Ce n’est pas un homme qui parle, me disait-il, j’ai entendu la voix de la patrie elle-même... Maintenant, j’ai bon espoir.
Et cependant, à trois ou quatre places de moi, j’avais remarqué un auditeur dont la contenance contrastait singulièrement avec l’enthousiasme de tous.
C’était un très jeune homme, vêtu comme les ouvriers de la plus pauvre condition.
Il était assis au premier rang, et, chaque fois qu’on prononçait le nom du roi, je voyais parfaitement ses doigts se crisper de rage contre le bois de balustrade.
Par moments, il bondissait, se levait à demi et se penchait vers la salle comme pour jeter une insulte à la face de l’orateur.
D’autre fois, il portait la main droite sous ses habits, d’un geste si convulsif, qu’on eût dit qu’il y cherchait une arme.
Si extraordinaire était son manége que, malgré moi-même, je me pris à l’examiner avec toute l’attention dont j’étais capable.
Évidemment les habits misérables qu’il portait n’étaient pas ses habits ordinaires. La blancheur de ses mains, les soins que trahissaient ses cheveux blonds, la finesse du peu qu’on apercevait de son linge, tout en lui trahissait l’aristocrate.
Mais qu’était-il venu faire là? Pourquoi ce déguisement et ces gestes désordonnés?
A une époque où les plus noires défiances empoisonnaient toutes les relations, où il n’était question que de trahisons et de complots, où on ne parlait que d’ennemis du peuple, d’espions de l’étranger et d’émissaires des émigrés, il y avait là de quoi me faire travailler prodigieusement l’esprit.
J’allais peut-être faire part de mes soupçons à mon père, quand le jeune homme se retourna. Sa figure qui respirait l’audace et l’énergie, était de celles qu’on n’oublie pas. Nos yeux se rencontrèrent, et il me semble éprouver encore l’étrange sensation que je ressentis au choc de son regard. J’eus comme la certitude que cet individu se trouverait mêlé à ma vie, et serait pour quelque chose dans ma destinée.
Si forte fut la sensation que je me tus.
D’ailleurs les galeries se vidaient.
Vergniaud venait de descendre de la tribune et de quitter la salle, et tout le monde se précipitait dehors pour l’attendre et l’acclamer au passage. Mon père m’entraîna.
Mais c’est en vain qu’à l’exemple de plusieurs milliers de personnes, nous restâmes plantés sur nos jambes devant la grande porte, l’orateur de la Gironde avait dû s’échapper par quelque porte latérale.
Beaucoup pour se dédommager de ce contre-temps, se donnèrent rendez-vous à la comédie française, où on fit une ovation à mademoiselle Candeille, qui était la maîtresse de Vergniaud.
Le lendemain, 4 juillet, l’Assemblée décréta:
Que dès que le péril deviendrait extrême, le Corps législatif le déclarerait lui-même, par cette formule solennelle: La patrie est en danger.
Qu’à cette déclaration tous les citoyens seraient tenus de remettre aux autorités les armes par eux possédées, pour qu’il en fût fait une distribution convenable.
Que tous les hommes, jeunes ou vieux, en état de servir, seraient enrôlés...
Une immense acclamation de Paris entier salua le décret de l’Assemblée.
La nouvelle s’en était répandue avec la rapidité d’une traînée de poudre jusqu’à l’extrémité des faubourgs. Le soir, au coin des rues, les groupes étaient plus animés que de coutume, et les marchands de journaux chargés de leurs feuilles encore humides, partaient en criant:
«Achetez, pour lire le décret qui sauve la patrie!...»
Était-elle donc sauvée, en effet? Il y en avait qui le croyaient, attribuant ainsi à l’Assemblée le pouvoir de changer, par la seule manifestation de sa volonté, une situation terrible.
Comme il arrive dans toutes les crises violentes, je voyais, non sans un étonnement profond, les gens passer soudainement de l’abattement le plus extrême à une confiance presque sans bornes.
Mon père ne se possédait pas de contentement.
—Il faudra mettre un gigot au four, commanda-t-il à ma mère, j’amènerai souper quelques bons patriotes, et nous viderons une bouteille au bonheur de la nation...
Le soir, en effet, il arriva avec trois de ses amis, dont le grand Fortier, le marchand de toiles, qui fut tué un mois plus tard, à la prise des Tuileries, le 10 août.
Leur persuasion était que les Prussiens, quand ils sauraient la ferme attitude de l’Assemblée, et l’impossibilité où serait le roi de favoriser leur invasion, s’arrêteraient.
C’est ce dont ne semblait nullement convaincu M. Goguereau, le représentant, qui était de ce souper.
—Ne nous hâtons pas de chanter victoire, disait-il, de peur d’être obligés de déchanter.
Cependant tout ce qu’il nous apprit n’était pas fait pour diminuer notre assurance.
C’est de lui que nous sûmes positivement que, de tous les points de la province, des gardes nationaux fédérés se mettaient en marche, en armes et avec du canon, pour aller former un camp aux environs de Soissons.
On en attendait cinq cents de Marseille et trois cents de Brest, qui devaient déjà être en route.
Tous devaient passer par Paris et y assister à la grande fête patriotique qui se préparait pour le 14 juillet, anniversaire de la prise de la Bastille.
—Vous voyez donc bien, disait mon père, que tout s’arrangera... Allons, allons, le commerce va reprendre et l’argent va reparaître... et ma foi! je n’en serai pas fâché, car j’ai des pratiques dont la «taille» s’allonge à faire trembler.
A l’air dont M. Goguereau secouait la tête, je voyais bien qu’il ne disait pas tout ce qu’il pensait, lui qui connaissait le dessous des cartes.
Mais à quoi bon désoler les gens à l’avance!...
L’aveuglement de mon père était si obstiné, qu’il nous annonça la résolution où il était de partir en tournée pour acheter du blé, comme il faisait tous les ans à l’époque de la moisson.
Et, en effet, le lendemain, quoi que pût lui dire ma mère, il voulut se mettre en route, et je l’accompagnai jusqu’à la rue du Coq, où était le bureau de la voiture qui faisait le service entre Paris et Chartres, où il se rendait.
Je puis vous affirmer, mes amis, que vous ririez bien si j’avais le pouvoir de vous mettre tout à coup en présence de cette diligence, qui excitait alors mon admiration, et dont on disait qu’il ne se ferait rien de mieux, ni de plus commode, ni de plus rapide.
C’était un grand coffre carré, haut huché sur roues, peint en bleu clair et percé de petits guichets larges comme les deux mains.
Cela mettait quatorze heures à faire le trajet. On partait de la rue du Coq à trois heures de l’après-midi, et on arrivait à Chartres sur les cinq heures du matin. C’était un voyage.
Resté seul à Paris avec ma mère, et plus que jamais libre de ma personne, je m’étais bien promis de devenir un des auditeurs assidus de l’Assemblée nationale, ce qui devait m’être facile, avec la protection de M. Goguereau...
Hélas! le jour où j’y retournai, je pus reconnaître combien avaient été chimériques les espérances de mon père et de ses amis.
La question de savoir en quelles formes la déclaration du danger de la patrie serait faite avait été résolue, c’est vrai.
Mais il restait à décider s’il y avait ou non lieu de proclamer sur-le-champ la patrie en danger.
Et sur cette question qui ne me semblait pas à moi, naïf, présenter l’ombre d’un doute, la discussion avait repris avec une âpreté toute nouvelle. Deux députés, surtout, qu’on me dit être, l’un l’évêque du Cher, Torné, l’autre Pastoret, représentant de Paris, faisaient assaut de violence.
L’irritation grandissait, quand soudain arriva un message du roi annonçant à l’Assemblée que les hostilités de la Prusse étaient imminentes et qu’une armée de cinquante-deux mille Prussiens s’avançait vers notre frontière...
Je renonce, mes amis, à vous donner une idée de la tempête de ricanements et de huées qui accueillit cette notification.
—C’est encore un piége, criait un député, l’armée prussienne n’est pas de cinquante-deux mille, mais de cent mille hommes.
—Sans compter vingt mille émigrés disait un autre.
—Et c’est quand ils sont à Coblentz que le roi avertit les représentants de la nation!...
Il est de fait que, dans mon âme et conscience, je ne savais comment qualifier cette communication tardive, d’un fait connu de l’Europe entière, qui était l’unique sujet d’entretien de Paris, qui avait motivé le foudroyant discours de Vergniaud et le décret qui en avait été la suite...
L’Assemblée ne daigna pas s’en occuper, et les débats continuaient, quand un orateur nouveau parut à la tribune.
C’était un vieillard de la figure la plus noble, avec cet air de mansuétude que l’imagination prête aux Apôtres.
Je demandai son nom. On me répondit que ce député n’était autre que Lamourette, ancien grand vicaire de l’évêque d’Arras et alors évêque constitutionnel de Lyon.
Vénéré de ses collègues, il obtint le silence, et, d’une voix émue:
«On vous a proposé, commença-t-il, on vous proposera encore des mesures extraordinaires, pour parer aux dangers de la France... A quoi bon! si vous ne savez pas rétablir dans votre propre sein la paix et l’union... J’entends dire que ce rapprochement est impossible... Ces mots me font frémir; ils sont une injure à cette Assemblée... Les honnêtes gens ont beau être divisés d’opinion, il est un terrain de patriotisme et d’honneur où ils se rencontrent toujours... Ah! celui qui réussirait à vous réunir tous, serait le véritable vainqueur de la Prusse et de Coblentz!...»
Après bientôt un siècle, mes amis, je suis sûr de vous citer textuellement les paroles de cet homme de bien, tant elles se gravèrent profondément dans ma mémoire...
—Celui-ci a grandement raison, pensais-je, et il songe aux intérêts de la France et non à ceux de ses rancunes ou de son ambition.
Et l’émotion qui s’était emparée de moi, je voyais bien que tout le monde la partageait.
Lui, cependant, d’un accent irrésistible poursuivait:
«Jurons de n’avoir qu’un seul esprit, qu’un seul sentiment; jurons de nous confondre en une seule et même masse d’hommes libres. Le moment où l’étranger verra que ce que nous voulons nous le voulons tous, sera le moment où la liberté triomphera, et où la France sera sauvée!...»
Il n’avait pas achevé que tous les députés étaient debouts et, la main étendue, prêtaient le serment proposé.
Toutes les rancunes s’étaient fondues à la chaleur de ce patriotisme.
Puis, un cri de concorde et de fraternité se fait entendre, et d’un mouvement spontané, tous les partis se mêlent et se confondent. Les hommes des factions les plus opposées se jettent dans les bras de leurs ennemis. Condorcet, en ce moment, entrait dans la salle, Pastoret qui le haïssait, court à lui et l’embrasse. Il n’y a plus de côté gauche, ni de côté droit, ni de centre, il n’y a plus que l’Assemblée nationale...
Cependant, une députation, ayant à sa tête Lamourette, s’était hâtée d’aller porter au roi un extrait du procès-verbal.
Il se hâta d’accourir et je le vis entrer, précédé de ses ministres, pâle, attendri, ému, pouvant à peine croire à cette incroyable et soudaine réconciliation.
—Je ne fais qu’un avec vous, balbutia-t-il, notre union sauvera la France...
Et dans les tribunes publiques et au dehors, mille cris d’allégresse répondaient; tout le monde avait des larmes dans les yeux...
La séance levée, cependant, lorsque je traversai la terrasse des Feuillants pour regagner la maison paternelle, je fus croisé par deux hommes dont l’un disait à l’autre:
—On s’embrassait aussi la veille de la Saint-Barthélemy.
L’exclamation de ces deux hommes me révolta si fort que, pour un peu, je leur aurais cherché querelle.
—Ceux-là, pensais-je, sont de ces êtres haineux qui jugent les autres d’après eux.
Et, en effet, comment ne pas se sentir véritablement réjoui après ce que je venais de voir et en présence du spectacle que j’avais sous les yeux.
Le roi, de retour aux Tuileries, s’est empressé de faire ouvrir le jardin qu’il tenait fermé depuis les scènes du 20 juin, et un peuple immense s’y était précipité et se pressait sous les fenêtres du château en criant à pleins poumons: Vive le roi!...
Je vous le demande, mes amis, n’était-ce pas à s’y méprendre!
Et la preuve, c’est que ma mère, à qui je racontai en rentrant ce qui se passait, me dit, la pauvre femme:
—Il faut écrire à ton père, il verra que la tranquillité va revenir, et il fera des achats plus considérables.
J’écrivis, en effet, à l’adresse que mon père nous avait assignée, à l’hôtel de la Nation, tenu par un nommé Servan, qui descendait toujours chez nous, quand il venait à Paris faire ses provisions.
Niais que j’étais!... Mon père n’avait pas reçu ma lettre que déjà tout était changé et redevenu pire qu’avant.
Ce beau rêve de concorde avait duré ce que durent les rêves, une nuit.
Paris, à son réveil, bafoua d’un éclat de rire immense un projet qu’il jugea beaucoup trop beau pour être réalisable.
Dès le matin, des crieurs s’étaient répandus dans les rues, offrant pour deux sous la Grande Pantalonnade sentimentale de ces Messieurs de l’Assemblée, pamphlet plus injurieux que spirituel, composé par les rédacteurs du Journal du Diable.
Les chansons ne tardèrent pas à s’en mêler, car en aucun temps on ne rima davantage.
Il me semble voir encore un grand vieux tout dépenaillé, qui se tenait devant Saint-Roch, abrité sous un large parapluie, et qui chantait une longue complainte dont le refrain était:
Enfin, des députés que j’avais vu de mes yeux, dans les bras l’un de l’autre, s’embrassant comme du pain, écrivirent aux journaux pour démentir le fait.
Cette scène de réconciliation n’avait-elle donc été qu’une hypocrisie préméditée des partis, désireux d’endormir leurs mutuelles défiances?...
N’était-elle, comme d’aucuns l’insinuaient, qu’une comédie convenue entre le roi et l’évêque de Lyon pour détourner les esprits de la discussion de la loi du danger de la patrie, et laisser ainsi aux Prussiens le temps d’arriver?
M. Goguereau, que je me permis d’interroger, m’affirma que ce n’était ni l’un ni l’autre.
—Pourquoi donc, me dit-il, n’aurions-nous pas été sincères!... La haine n’est pas si douce!... Nous avons été émus et entraînés... Toutes les assemblées sont exposées à des surprises sentimentales de ce genre...
Je vous donne l’explication telle qu’elle m’a été donnée. Ce qui n’empêche qu’une célébrité de ridicule est demeurée attachée à cette scène, qui m’avait tiré des larmes... Encore aujourd’hui, un «baiser Lamourette» est le synonyme de comédie et de trahison.
Mais précisément parce qu’ils étaient furieux d’avoir été dupes d’un mouvement de leur cœur, les partis n’en étaient devenus que plus acharnés.
Une mesure qu’on ne manqua pas de dire provoquée par la cour devait d’ailleurs attiser encore les colères.
Je l’appris, au matin, d’un ouvrier, qui était entré dans notre boutique acheter un pain. Comme il me semblait exaspéré, je lui demandai ce qu’il avait:
—J’ai, me répondit-il, que le directoire de Paris vient de suspendre Pétion de ses fonctions, et veut le poursuivre comme organisateur de la manifestation du 20 juin.
C’était si grave que, tout d’abord, je crus à une de ces fausses nouvelles comme on en lançait dix par jour dans la circulation.
Frapper Pétion, le maire de Paris, l’homme le plus populaire du moment... était-ce possible.
C’était vrai. Le premier passant m’apprit que le roi, au lieu d’annuler, comme il le pouvait, cette décision, venait de la notifier à l’Assemblée, en lui laissant «le soin de statuer sur l’événement.»
—C’est encore une trahison! criaient les sans-culottes, furibonds.
—Quelle épouvantable maladresse! gémissaient les patriotes paisibles.
Mais le sentiment général était que la cour n’eût point hasardé ce coup de partie, si elle n’eût été sûre de l’approche des Prussiens.
Quoi qu’il en soit, c’est au milieu de ce déchaînement de l’opinion, que fut enfin présentée à l’Assemblée par Hérault de Séchelles, la déclaration du danger de la patrie.
C’était le 11 juillet 1792.
Le rapport entendu, les conclusions furent adoptées, et, aussitôt après, le président se levant, prononce d’une voix émue et au milieu d’un silence effrayant, la formule solennelle:
«Citoyens, la patrie est en danger.»
L’effet, je me le rappelle, fut terrible.
Il n’y eut pas un cri dans les tribunes publiques, pas un mot, pas un geste.
Et quand la séance fut levée, la foule, turbulente d’ordinaire, et qui emplissait les escaliers du tumulte de ses discussions, la foule s’écoula muette et consternée.
Cependant, les patriotes étaient satisfaits.
—Voilà enfin un acte, disaient-ils, et qui vaut un peu mieux que les embrassades de l’autre jour... Ça ira, maintenant; il faudra bien que M. Véto marche droit.
Mais c’est en vain que le lendemain on attendit les grandes mesures du salut public.
La déclaration demandée le 30 juin, formulée le 4 juillet et votée le 11, ne devait être proclamée que le 22 juillet. Il fallut tout ce temps pour obtenir du pouvoir exécutif l’autorisation nécessaire.
Je vous laisse à penser si pendant ces onze jours les esprits se montèrent. Je voyais, pour ainsi dire, l’exaltation augmenter d’heure en heure...
La veille, les ministres en masse avaient donné leur démission et avaient été remplacés par d’autres. Bast! on n’y avait pas pris garde. Ce n’est assurément pas sur eux qu’on comptait.
J’avais acheté une carte des frontières, et tous nos voisins venaient la consulter. Et il fallait que je leur montre Coblentz, où était, disait-on, l’armée prussienne, et nous calculions les journées de marche qu’il y a pour une grande troupe de la frontière à Paris.
Les gens, d’ailleurs, répétaient comme un verset d’Evangile, une phrase du dernier discours de Robespierre aux Jacobins.
«Dans des circonstances aussi critiques, avait-il dit, les moyens ordinaires sont dérisoires: Français, sauvez-vous vous-mêmes.»
—Voilà, pensais-je, qui est parler!
Mais la préoccupation de l’étranger ne faisait pas oublier Pétion.
M. Goguereau, qui avait promis à mon père de venir nous voir tous les jours, en son absence, était obligé de se cacher pour tenir sa promesse, tant les gens des environs qui le connaissaient l’assaillaient de questions indiscrètes.
De tous côtés Paris signait des pétitions en faveur de son maire. Il y en eut une, celle des ouvriers du bâtiment, qui réunit quarante mille signatures. On en faisait circuler une dans notre quartier: j’y mis mon nom, et nos trois garçons, ne sachant pas écrire, y apposèrent leur croix.
Pour un empire je n’aurais pas manqué la séance où Pétion parut à la barre de l’Assemblée.
Il s’avança la tête haute. Jamais homme ne ressembla moins à un accusé qui vient se disculper.
«Mon crime, commença-t-il, est d’avoir empêché le sang de couler...»
On ne le laissa pas poursuivre...
Il avait été disgracié par la cour, l’Assemblé l’admit aux honneurs de la séance, et décréta «que le maire de Paris serait rétabli dans ses fonctions, et que le pouvoir exécutif serait tenu d’exécuter le décret dans la journée même.»
C’était le 13 juillet 1792.
Le lendemain allait avoir lieu la fête de la Fédération.
Instituée pour perpétuer le souvenir de la prise de la Bastille, cette fête du 14 juillet inspirait aux meilleurs patriotes les plus vives appréhensions.
Paris était alors comme un baril de poudre, et chacun sentait bien qu’il suffirait de la moindre étincelle pour déterminer une formidable explosion.
Or, quel serait le résultat d’une explosion?... C’est ce que nul n’était capable de dire avec quelque certitude.
Qui pouvait garantir que l’ivresse ne tournerait pas à la fureur et qu’on ne compromettrait pas en un jour le patrimoine précieux des libertés conquises!
Ce qui augmentait l’anxiété, c’était la présence à Paris d’un certain nombre de Fédérés de la province.
Les cinq cents Marseillais qu’on attendait n’étaient pas arrivés encore, mais il était venu des Bretons et des Lyonnais.
Presque tous étaient jeunes et brûlants d’un enthousiasme chauffé à blanc par les démonstrations patriotiques dont ils avaient été l’objet tout le long de leur route.
Ils étaient logés, quelques-uns chez des patriotes, le plus grand nombre rue de la Pépinière, à l’ancienne caserne des gardes françaises.
Déjà, depuis quelques jours, on les rencontrait par bandes dans les rues. Ils se promenaient, hantaient les clubs et se multipliaient si bien qu’on les eût cru dix mille.
Déjà, même, ils avaient occasionné quelques rires.
Le soir du 13 juillet précisément, huit ou dix d’entre eux voulurent tout casser chez le restaurateur Cerni, dont l’établissement faisait le coin de la rue des Moulins. Il est juste d’ajouter qu’ils avaient été imprudemment provoqués.
Trouvant mauvais le vin qu’on leur servait, ils en avaient demandé de meilleur, et Cerni leur avait répondu qu’il en avait, mais qu’il le gardait pour les Prussiens.
C’est notre voisin l’épicier qui, ayant été témoin de l’algarade, accourut nous la raconter.
Il trouva chez nous cinq ou six commerçants de la rue, qui agitaient la question de savoir s’ils ouvriraient leur boutique le lendemain.
En digne femme de Jean Coutanceau ma mère dit:
—Je ne fermerai pas, quoi qu’il arrive, un boulanger ne doit jamais fermer.
Mais son courage n’alla pas jusqu’à me donner, tout d’abord, la permission d’aller voir la fête.
Elle ne pouvait oublier que l’année précédente, le 27 juillet, le Champ-de-Mars avait été le théâtre d’une collision sanglante.
—Que veux-tu aller faire là, me répétait-elle; tu es encore trop jeune, ce n’est pas ta place...
Cependant, j’insistai tant qu’elle finit par céder, mais à la condition que je me ferais accompagner de notre premier geindre, et que je ne le quitterais pas...
Ce geindre, nommé Fougeroux, âgé d’une quarantaine d’années, était chez nous depuis vingt ans, et faisait en quelque sorte partie de la famille. Il mangeait à notre table, logeait dans notre maison, et c’était ma mère qui raccommodait ses hardes.
C’était un hercule, avec des épaules larges comme un dressoir, et des bras qui, à battre la pâte, avaient pris des proportions véritablement colossales.
Son intelligence n’était pas très développée et il était têtu comme une mule, mais il était honnête et bon.
Dire qu’il nous était dévoué serait dire trop peu. Son affection pour mon père, pour ma mère et pour moi surtout, qu’il avait vu naître, tenait du fanatisme. Quand il avait parlé de son jeune bourgeois, il n’y avait plus qu’à tirer l’échelle. Et malheur à qui se fût avisé de ne me point trouver parfait.
Avec cela, Fougeroux était un déterminé sans-culotte. Les affaires publiques le préoccupaient à un degré d’autant plus étonnant qu’il n’avait pas la plus vague idée de la révolution qui s’opérait. Son incessant désespoir était de n’avoir jamais pu apprendre à épeler ses lettres. Aussi n’était-il sortes de cajoleries qu’il ne me fît pour me déterminer à lui lire le journal.
Je lui lisais souvent, amplement payé de ma peine par le plaisir que j’avais à le voir écouter bouche béante et les yeux écarquillés, tout ces mots qui se suivaient, auxquels il ne comprenait absolument rien mais qui l’enchantaient.
Son autre passion, dès qu’il avait une heure de libre, était de courir à une guinguette du quartier, où on serinait, à raison de deux sous la séance, des chansons patriotiques, la Carmagnole ou Ça ira...
L’idée de m’accompagner ne pouvait manquer de ravir Fougeroux.
—Je réponds de lui, bourgeoise, dit-il à ma mère, en retroussant ses manches, pour montrer ses bras d’athlète, geste qui lui était familier.
Et en effet, le lendemain, 14 juillet, sur les six heures du matin, nous nous mîmes en route après avoir mangé une bouchée.
Nous nous attendions à trouver les rues pleines de monde; point. Jamais je n’avais vu Paris si morne.
Nul bruit; pas de marchands comme d’habitude, ni laitières, ni maraîchers, pas un garçon de boutique lavant le seuil de sa maison.
A peine, de loin, en loin, apercevions-nous un petit groupe de bourgeois suivant le même chemin que nous...
Lorsque nous arrivâmes au Champ-de-Mars, ou au Champ de la Fédération, comme on disait alors, il était absolument vide.
Fougeroux n’en revenait pas.
—Et dire, répétait-il, qu’il y a deux ans à pareille date, dès quatre heures du matin, la foule était si drue, que si on eût jeté une épingle en l’air, elle ne serait pas tombée par terre.
Pour la première fois de ma vie, mes amis, j’allais assister à une grande solennité populaire. J’étais ému. Tout, dans cette journée, devait me frapper extraordinairement. Soixante-dix-huit ans se sont écoulés depuis, eh bien! il n’est pas un détail de cette fête de la Fédération qui ne soit présent à ma mémoire, comme si elle datait hier.
Sur des monticules de sable disposés en cercle, on avait monté quatre-vingt-trois petites tentes, ombragées chacune d’un peuplier.
C’était le symbole des quatre-vingt-trois départements, c’était la France entière, campant en présence de l’ennemi.
Deux bourgeois, qui examinaient comme nous, ne comprirent pas cette idée, ou ne l’approuvèrent pas, car il y en eut un qui dit tout haut:
—On aurait dû, pendant qu’on y était, planter quarante-quatre mille peupliers, pour figurer les quarante-quatre mille municipalités...
Il ricanait, et l’intention était si visiblement insultante, que Fougeroux commençait à relever ses manches, et que je jugeai prudent de l’entraîner plus loin.
Au centre du Champ-de-Mars, on avait dressé quatre catafalques, figurant les tombeaux des volontaires qui étaient morts ou qui allaient mourir à la frontière, pour la défense de la patrie.
Sur un des côtés on lisait: Nous les vengerons!
L’autel de la patrie, formé d’une colonne tronquée, était dressé tout en haut des gradins construits en 1790. Sur quatre autels plus petits, on avait placé des urnes funéraires et des brûle-parfums.
A cent toises de l’autel, en allant vers la rivière, s’élevait un grand arbre, l’arbre de la féodalité, dont toutes les branches étaient chargées de couronnes, de tiares, de chapeaux de cardinaux, d’écussons, de mitres d’évêques, de manteaux d’hermine, de casques, d’armoiries et de parchemins... On devait y mettre le feu.
Une statue de la loi et une statue de la liberté, de grandeur colossale, et montées sur des roulettes, étaient près de l’arbre.
A droite et à gauche ou avait établi deux tentes très-vastes, destinées, celle de droite au roi et à l’Assemblée nationale, celle de gauche aux corps administratifs de Paris.
Enfin, cinquante-quatre pièces de canon bordaient le Champ-de-Mars du côté de la Seine, et tous les arbres étaient surmontés du bonnet rouge...
Nous avions tout vu, et cependant l’espace immense où s’élevait le décor que je vous décris continuait à rester désert...
Ce n’est guère que vers neuf heures que les curieux commencèrent à arriver. Parmi eux se trouvait un sans-culotte, ami de Fougeroux, lequel nous apprit que tout le peuple était à la Bastille, où soixante députés posaient la première pierre d’un monument qu’on devait élever sur les ruines de la forteresse maudite.
Mon premier mouvement fut de m’écrier:
—Courons à la Bastille!... Courons voir!...
Mais Fougeroux m’arrêta.
—Il est trop tard maintenant, me dit-il, visiblement dépité d’avoir manqué cette cérémonie. Et, puisque nous sommes ici les premiers profitons-en pour nous choisir une bonne place d’où nous verrons tout.
Tout à côté des bâtiments de l’École militaire se trouvaient accumulés des matériaux de construction, destinés à des écuries dont on apercevait les fondations à fleur de terre.
C’est là que Fougeroux et moi prîmes position, au grand détriment de nos mains et de nos habits, sur un énorme tas de briques, qui s’élevait bien à la hauteur d’un premier étage.
Nous finissions de consolider notre installation, quand un petit homme à figure chafouine, tout de noir habillé, et que je pris pour un clerc de procureur, vint poliment nous demander une petite place à nos côtés. Pour toute réponse, je lui tendis la main et il grimpa.
De ce poste, nous dominions si entièrement le Champ-de-Mars, que je distinguais jusqu’aux canonniers, qui, tout à l’extrémité, sur le bord de la Seine, s’empressaient autour de leurs pièces.
On avait annoncé que le serment serait prêté sur l’autel de la patrie, à midi précis.
Onze heures sonnaient, lorsque des salves d’artillerie et des roulements de tambours annoncèrent l’arrivée du roi.
Il ne tarda pas à paraître... Il était dans un immense carrosse tout doré, avec la reine, ses enfants et la princesse de Lamballe.
Aux portières, de chaque côté, marchaient les ministres, et ce détail parut révolter notre compagnon, le petit homme maigre.
—N’est-ce pas une honte, me dit-il, de voir les ministres de la nation à pied, dans la crotte, confondus parmi les palefreniers et les laquais!... Il est vrai que c’est l’étiquette!
Je ne répondis pas, car nous étions à une époque où on ne s’ouvrait pas volontiers à des inconnus, mais j’avoue que j’étais choqué. Et je compris comment les plus misérables questions de cérémonial peuvent engendrer des haines atroces.
Du reste, notre inconnu, à nous, semblait connaître la cour sur le bout du doigt. Il nous nomma toutes les personnes qui suivaient la famille royale dans deux voitures superbes. Il nous montra le prince de Poix et M. de Brézé, madame de La Roche-Aymon, madame de Maillé et madame de Tarente. Les hommes portaient des costumes brodés sur toutes les coutures, et les femmes étaient en grand habit de gala avec les coiffures très hautes.
Le cortége, fort imposant, était composé de cavalerie et de troupes de ligne.
Des grenadiers, volontaires nationaux, escortaient les voitures, et la marche était fermée par quatre compagnies des grenadiers suisses.
Le roi me parut accablé de lassitude. Il était affaissé plutôt qu’assis dans le fond de la voiture, ses traits étaient extraordinairement boursoufflés, on eût dit qu’il dormait... La reine, au contraire, qui avait une toilette très brillante, redressait la tête d’un air fier, et ses yeux erraient dans la foule comme pour y compter ses amis et ses ennemis. On voyait qu’elle avait pleuré.
Une partie des troupes traversa l’Ecole-Militaire, sous le portique du milieu, pour aller se former dans le Champ-de-Mars.
Le roi et la reine mirent pied à terre, et un moment après nous les vîmes paraître au balcon, qui était tendu d’un riche tapis de velours cramoisi brodé d’or.
C’est de là qu’ils devaient assister au défilé du cortége national.
—Nous serons aussi bien qu’eux, me disait Fougeroux ravi.
Mais déjà les canons recommençaient à tonner, les tambours s’étaient remis à battre, le cortége national approchait.
Presque au même moment, de tous les côtés à la fois et par toutes les issues, des flots de peuple se ruèrent dans le champ de la Fédération. Il n’y a que la mer rompant ses digues qui puisse donner idée d’un pareil spectacle. En un clin d’œil, l’immense espace, presque vide jusqu’alors, se trouva plein d’une foule compacte, se poussant, se pressant, se tassant...
Et de toutes les poitrines un même cri sortait, incessant, obstiné, furieux:
—Vive Pétion!...
Fougeroux se frottait les mains; notre compagnon dit:
—C’est la revanche du maire de Paris.
Je n’écoutais pas, je n’avais pas assez d’yeux pour voir.
Le cortége entrait par la grille de la rue de Grenelle, défilait devant le balcon de l’Ecole et allait se ranger autour de l’autel de la patrie.
Des gendarmes nationaux ouvraient la marche, immédiatement suivis de deux ou trois cents musiciens jouant avec une sorte de frénésie l’air de: Ça ira!... Puis, venait un bataillon de volontaires nationaux, puis deux compagnies de fédérés des départements traînant un canon, puis un régiment d’hommes armés de piques, puis... plus rien qu’une foule en délire, où les rangs, les âges, les sexes se confondaient et se mêlaient en une inexprimable cohue...
—Jamais tous ces gens ne trouveront de place, répétait Fougeroux, inquiet pour notre fragile édifice de briques...
Et cependant, il en arrivait toujours... C’étaient des bataillons de sans-culottes, coiffés de bonnets rouges, brandissant des miches au bout de leurs piques... des groupes de petites filles en blanc, couronnées de fleurs... des troupes de femmes portant des bannières où on lisait: Honneur aux braves morts à la prise de la Bastille, ou encore Aux armes! Vengeons ceux qui meurent à la frontière!...
Et les tambours battaient toujours, les cuivres mugissaient, les canons tiraient à coups si précipités que leur fumée fermait l’horizon... Et au-dessus de tout, s’élevait de plus en plus formidable le même cri:
—Vive Pétion!...
C’était comme le mot d’ordre de la journée...
On le voyait sur tous les drapeaux. Des milliers d’hommes avaient écrit à la craie sur leur bonnet ou sur leur chapeau: Pétion ou la mort!...
D’où j’étais, en me penchant, je pouvais apercevoir le roi.
Il était immobile comme une statue, regardant d’un œil morne cette marée humaine qui montait toujours...
C’étaient les sections qui défilaient... Le 104e régiment passa, précédant des fédérés qui portaient les tables de la loi et un modèle en plâtre de la Bastille... Puis vint la section Saint-Marceau, dont la musique jouait: Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille...
Enfin, le triomphateur de la journée, Pétion lui-même, parut à la tête de la municipalité.
Ses habits étaient en désordre, sa coiffure dérangée, il était pâle comme la mort et semblait près de défaillir, écrasé sous le poids de son triomphe...
Il s’appuyait au bras d’un ami, et par moments faisait un geste de la main, comme pour dire: «Grâce!... assez!...» Mais ce geste, loin de calmer les acclamations, redoublait leur violence.
Quand il passa devant notre tas de briques, Fougeroux se dressa, et agitant son chapeau, clama d’une voix de tonnerre! «Pétion ou la mort!...» Puis, se retournant vers moi:
—Ah! on se ferait tuer pour cet homme-là, me dit-il.
J’étais bouleversé; cependant je ne pus m’empêcher de sourire et je lui demandai:
—Pourquoi?...
Il parut embarrassé, puis haussant les épaules:
—Je ne sais pas, me répondit-il, mais n’importe: Vive Pétion!...
Le tour était venu de l’Assemblée nationale. Elle s’avançait, formant un bataillon compacte de huit cents hommes, ayant à sa tête son président, qui était, ce jour-là, Aubert-Dubayer.
L’Assemblée s’arrêta, devant le portique de l’Ecole-Militaire, et le roi descendit, pour se rendre, au milieu d’elle, jusqu’à l’autel de la patrie...
Lorsque les députés se remirent en marche, la reine quitta le balcon, et quand elle reparut l’instant d’après, elle tenait une longue vue, dont elle se servit pour suivre le roi...
De notre tas de briques, nous le distinguions à son habit brodé... Il avançait péniblement, ballotté par la foule comme une coquille de noix par les vagues... Deux fois je le perdis de vue... puis enfin il apparut au sommet de l’autel de la patrie.
Je le vis lever la main pour prêter serment...
Tous les canons éclatèrent à la fois, les tambours roulèrent et une acclamation s’éleva, formidable, à faire crouler le ciel.
L’instant d’après, le roi avait disparu, et je crus apercevoir comme une mêlée au bas des gradins...
Je sus, le soir, ce que c’était: Le président de l’Assemblée avait proposé au roi de mettre le feu à l’arbre de la Féodalité, et le roi avait refusé en disant:
—C’est inutile... Il n’y a plus de féodalité en France.
N’importe! le programme était rempli... ou à peu près.
Un escadron de cavalerie se mit en mouvement au pas, et cette manœuvre permit au roi de regagner sans encombre l’Ecole-Militaire.
Il se montra au balcon, et quelques timides: Vive le roi! le saluèrent, aussitôt étouffés sous des: Vive Pétion! plus furieux que jamais.
L’instant d’après, nous le vîmes remonter en carrosse et s’éloigner...
Il s’agissait de nous retirer nous-mêmes, et en vérité ce n’était pas chose aisée, que de traverser diagonalement le Champ de Mars, pour gagner une des grilles.
Le départ du roi n’avait en rien diminué la cohue, et l’exaltation, s’il est possible, augmentait.
A défaut du roi, quatre députés, Jean Debry, Gensonné, Antonelle et Garreau, étaient allés mettre le feu aux matières inflammables dont on avait entouré l’arbre de la Féodalité, et le peuple s’étouffait pour le voir brûler, battant des mains chaque fois que la flamme atteignait un des emblèmes dont il était chargé.
De notre place, nous ne distinguions qu’un tourbillon de fumée noire et d’étincelles; mais cela suffisait pour transporter Fougeroux.
—Très-bien! criait-il. Ça ira, ça ira..
Mais notre compagnon, le petit bonhomme au nez pointu, était plus difficile à contenter.
—Imbéciles! grommelait-il, qui croient, en brûlant le simulacre, anéantir la réalité!...
Moi qui savait combien le salpêtre était rare, et qu’on organisait des explorations dans les caves de Paris pour s’en procurer, je pensais:
—Toute cette poudre qu’on brûle, on ferait bien mieux de la réserver pour les Prussiens!...
C’est que Dieu sait ce que l’on en perdait... Aux sourdes détonations des canons du bord de l’eau, se joignaient de tous côtés les pétillements de la mousqueterie. Tous les hommes armés de fusils, volontaires nationaux ou fédérés des départements, déchargeaient leurs armes en l’air. On ne s’entendait plus; on se serait cru au fort d’une bataille. L’odeur de la poudre vous saisissait à la gorge, et au-dessus du Champ de la Fédération, planait un nuage immense de poussière et de fumée, dans lequel tourbillonnaient comme des papillons blancs les enveloppes des cartouches.
A vingt-cinq toises de nous était arrêtée une charrette, sur laquelle on avait établi une presse, et des ouvriers en manche de chemise, coiffés du bonnet rouge, imprimaient et distribuaient à profusion des chansons patriotiques.
En face de l’Ecole Militaire, des volontaires avaient, je ne sais comment, déblayé un assez large espace, et on y dansait des rondes, au son de musiques véritablement enragées...
Jamais je n’avais vu, jamais je n’ai vu depuis chose pareille... Paris entier était là, Paris saisi de vertige, délirant, fou.
Alors je compris la contagion des grandes passions qui bouleversent les masses... Je sentais la fièvre me gagner, mes idées se brouillaient; j’éprouvais comme un vague besoin d’imiter tous ces gens que je voyais là, de crier, de me démener...
Malheureusement, je me sentais aussi défaillir... Il était quatre heures, et je n’avais rien pris de la journée qu’une croûte de pain et un doigt de vin blanc.
Fougeroux me vit si blême qu’il s’en inquiéta.
—Il faut rentrer coûte que coûte, me déclara-t-il résolument, la bourgeoise doit être inquiète.
C’était bien mon avis, mais mesurant de l’œil la distance à parcourir et l’effroyable épaisseur de la foule, je me sentais découragé.
—Si nous nous engageons dans cette cohue, répondis-je, nous serons peut-être des heures pour nous en tirer.
—Essayons toujours, gronda Fougeroux, en retournant ses manches et en faisant mine de descendre de notre tas de briques.
Mais notre compagnon à mine chafouine l’arrêta en nous disant:
—Permettez, citoyens... un service en vaut un autre. Grâce à vous, j’ai très-bien vu, je vais, en échange, vous tirer d’ici... Le peuple, voyez-vous, ça me connaît... Laissez-moi seulement passer devant.
Il se laissa glisser à terre, et nous l’imitâmes, mais sans avoir grande confiance en ses promesses...
Même Fougeroux me dit:
—C’est un farceur, ce citoyen, vous verrez qu’il compte tout simplement sur mes coudes.
Il se trompait.
A peine nous étions-nous jetés dans la foule, qui se referma sur nous, que se manifesta le singulier pouvoir de ce petit homme, que j’avais pris pour un clerc de procureur.
Il glissait dans la mêlée, comme une anguille dans la vase, sans effort, pour ainsi dire, échangeant à tout moment des signes de reconnaissance avec des gens qu’il trouvait sur son passage.
Apercevait-il un groupe où l’exaltation paraissait plus grande, vite il s’y faufilait, et là, on lui faisait place, on s’écartait autant que s’écarter était possible, et même, on le saluait...
Fougeroux, sur les talons de qui je marchais, en était confondu, et il se retournait en grommelant:
—Ah ça! bourgeois, qu’est-ce que ce citoyen?
Nous ne tardâmes pas à l’apprendre.
Au moment où nous traversions un bataillon de sectionnaires, huit ou dix se mirent à crier, et tous les autres répétèrent:
Tout nous était expliqué. Je le connaissais ce Goudril, maintes fois j’avais vu son nom dans les journaux, et j’avais entendu cent fois mon père en parler comme d’un scélérat fort dangereux.
C’était un ancien clerc de Danton, chassé par Danton, qui avait été un moment au service de Marat et qui, pour le moment, rédigeait une espèce de journal dépassant de beaucoup en ignominie le Père Duchêne, l’immonde feuille d’Hébert.
Il s’était en outre improvisé tribun, et s’était fait une sorte de renom, par la violence ordurière de son langage et l’excentricité de ses motions.
En ce moment, il me parut jouir délicieusement de ce renom, et je m’ébahissais à voir de quel air superbe il distribuait des poignées de main.
Puis, comme on le priait de parler, il avisa les épaules d’un énorme sectionnaire, s’y hissa et commença un discours...
Et positivement, on en entendait quelque chose, malgré l’effroyable vacarme, tant il forçait sa voix aigre et perçante comme un fifre.
Il n’était pas d’ailleurs le seul à se livrer à cet exercice étrange, et, en me haussant sur la pointe des pieds, je pouvais apercevoir à quelque distance cinq ou six orateurs qui péroraient pareillement du haut de ce qu’on appelait alors une «tribune patriotique...»
Mais nous ne restâmes pas longtemps à l’écouter.
Voyant que bien décidément il nous oubliait:
—Mettez-vous derrière moi, bourgeois, me dit Fougeroux, tenez-moi solidement, et en route.
Durant un moment, grâce aux puissantes épaules de mon compagnon, tout alla bien. Mais quand nous arrivâmes aux grilles, comme beaucoup de gens voulaient sortir, et se précipitaient, je crus qu’il nous faudrait battre en retraite. Littéralement on s’y étouffait, et par moments nous entendions des cris déchirants.
Enfin, une vigoureuse poussée nous dégagea, et nous nous trouvâmes sains et saufs rue de Grenelle, Fougeroux avec ses vêtements tout déchirés, moi ayant perdu mon chapeau dans la bagarre.
Nous avançâmes assez loin dans la rue, pour nous mettre à l’abri de la foule, et n’en pouvant plus, nous nous assîmes sur les marches d’une maison pour reprendre haleine.
Nous y étions bien depuis cinq minutes, quand tout à coup, d’une rue qui nous faisait presque face, nous vîmes sortir en courant de toutes ses forces, une femme toute jeune—une jeune fille, plutôt, vêtue comme l’étaient alors les cuisinières.
Dix ou douze hommes déguenillés, armés de piques pour la plupart, et dont quelques-uns avaient des figures atroces, la poursuivaient...
La malheureuse avait bien une quinzaine de pas d’avance, mais la frayeur troublait sa raison et l’aveuglait, car au lieu de tourner d’un côté ou de l’autre de la rue de Grenelle, elle poursuivit sa course tout droit, et vînt donner et s’abattre contre la maison devant laquelle nous étions assis...
Les hommes aussitôt l’entourèrent, en l’accablant d’injures et en proférant les plus terribles menaces.
Je dois en convenir, mes amis, à cette époque héroïque, mais étrangement troublée que j’essaie de vous faire connaître, il ne se passait guère de jour que la rue ne fût le théâtre de quelque scène de désordre ou de violences.
Et on y était si bien accoutumé, que les gens qui revenaient du Champ de la Fédération ne daignaient seulement pas s’arrêter pour voir ce dont il s’agissait.
Plus curieux et moins blasé, je m’étais vivement approché.
Déjà la jeune fille s’était redressée et appuyée fortement au mur, comme si elle eût espéré qu’il s’ouvrirait miraculeusement pour lui livrer passage, elle faisait face à ses ennemis. Bien qu’elle fût d’une pâleur mortelle et que ses cheveux s’échappassent en désordre de son bonnet de linge, elle me parut d’une beauté merveilleuse, et ses grands yeux noirs rencontrant les miens, je me sentis bouleversé.
Aux injures dont l’accablaient les misérables qui l’entouraient elle ne répondait rien.
Et l’un d’eux lui ayant mis le poing sous le nez pendant qu’un autre brandissait une pique au dessus de sa tête, pas un des muscles de son visage ne bougea.
Mais je n’en pus pas supporter davantage, et m’adressant à ces malheureux:
—N’avez-vous pas honte, m’écriai-je, vibrant d’indignation, de vous mettre à dix pour outrager une femme!...
Tous se retournèrent, surpris, et l’un d’eux, qui semblait le chef de la bande, peut-être parce qu’il avait une plus mauvaise figure que les autres, me toisa d’un air furieux, en disant:
—Toi, citoyen joli-cœur, j’ai un conseil à te donner... Passe ton chemin!...
Je n’ai jamais été très-endurant, et à ce moment-là, après toutes les émotions qui me secouaient depuis le matin, j’étais dans une exaltation qui me transportait hors de moi-même.
Saisissant donc à la poitrine le grossier sans-culotte, je le secouai rudement en criant de ma plus grosse voix:
—Et moi je vous préviens que le premier qui manquera de respect à mademoiselle, aura affaire à moi!...
Toute la colère de ces gens aussitôt se tourna contre moi.
—Qu’est-ce que c’est, clamaient-ils, qu’est-ce que c’est que cet aristocrate, qui vient insulter d’honnêtes patriotes?...
—Ne voyez-vous pas, hurlait le chef, que je tenais toujours, ne voyez-vous pas qu’il arrive de Coblentz! C’est un émissaire des Prussiens...
De pareilles accusations, en ce temps-là, suffisaient pour vous conduire droit au fond de la Seine avec une pierre au cou.
Je n’y songeai même pas.
Écartant d’un vigoureux effort les enragés qui m’entouraient, je me jetai devant la jeune fille, en appelant:
—A moi! Fougeroux...
Il n’avait pas attendu mon appel, le brave garçon, pour retrousser ses manches, et il guettait le moment d’intervenir.
Me voyant menacé, il se rua sur le groupe, qu’il rompit d’un seul coup d’épaules, pendant que ses formidables poings s’abattant sur les deux plus hargneux de la bande les envoyaient prendre la mesure du pavé.
—Ah! on veut toucher à mon jeune bourgeois!... ricanait-il.
Il y eut parmi les assaillants dix secondes de stupeur... C’est d’un œil hésitant qu’ils considéraient le torse du formidable champion qui semblait me tomber du ciel.
Lui, calme autant que s’il eût été devant son pétrin, en profita pour passer sous mon bras le bras de la jeune fille, et nous poussant:
—Allez, nous dit-il, m’attendre au coin de la rue du Bac... j’en ai pour une minute à régler le compte de ces braves sans-culottes.
Mais ils étaient déjà revenus de leur surprise, et les trois plus vigoureux se précipitèrent sur Fougeroux, s’accrochant à ses vêtements... Il s’en débarrassa d’un tour de reins, aussi aisément qu’un lion qui secouerait des roquets acharnés à sa peau. Et comme je revenais à son aide:
—Mais, allez-vous en donc, jarniguié! jura-t-il, vous voyez bien que vous nous empêchez de nous entendre, les citoyens et moi.
A l’attitude de nos adversaires, je compris que Fougeroux les avait dégoûtés de la bataille, et que toute leur fureur se passait en criailleries.
Reprenant donc le bras de la jeune fille, je l’entraînai rapidement le long de la rue de Grenelle.
Ce qui ne laissait pas que de me surprendre, c’est que durant toute cette scène, elle était demeurée muette et impassible.
Était-ce sang-froid, était-ce au contraire stupeur? Je ne savais.
Tout en marchant, je l’observais du coin de l’œil. Les couleurs étaient revenues à ses joues, elle allait d’un pas aisé; jamais, à voir son calme, on n’eût soupçonné le danger qu’elle venait de courir...
Comme de raison, mille questions se pressaient dans mon esprit.
Qu’était cette jeune fille, et quels étaient ces hommes?... Qu’avait-elle fait? comment s’était-elle attiré leur colère, et que voulaient-ils d’elle?
Mais je n’osais interroger... De nous deux, maintenant celui qui tremblait, c’était moi.
De ma vie, je n’avais approché une femme si belle!... Qu’était près d’elle la fille de M. Despois, l’armurier, notre voisin, qui avait dans tout le quartier Saint-Honoré un immense renom de beauté!... J’aurais passé des siècles près de mademoiselle Despois, sans que mon cœur battît plus vite à un moment qu’à l’autre, tandis que près de celle-ci!... Puis, celle-ci me semblait extraordinairement imposante, en dépit de ses vêtements plus que simples. Il y avait en elle tant de noblesse et tant de grâce en ses moindres mouvements, que près d’elle, mademoiselle Despois, dont on disait qu’elle avait «un port de reine,» aurait eu l’air d’une laveuse de vaisselle.
Si je puis aujourd’hui vous dire si exactement mes sensations, jugez de ce que je dus éprouver alors!...
Je mourais d’envie de lui parler, et je n’osais pas... Je sentais très bien que je devais dire quelque chose, et ma langue était comme collée à mon palais... Et plus j’avais conscience du ridicule de ma situation, plus mon embarras redoublait.
Bien certainement, nous serions allés jusqu’à la rue du Bac sans échanger une parole, si elle n’eût rompu le silence.
Elle appuya légèrement la main sur mon bras, pour me faire ralentir le pas, et d’une voix qui me parut douce comme une musique céleste:
—Je vous dois la vie, monsieur, me dit-elle... plus encore, peut-être: l’honneur. Comment pourrai-je jamais m’acquitter envers vous!...
Je me sentais plus rouge que le feu, et c’est d’une voix étranglée que je balbutiai quelque chose comme ceci:
—Je suis trop payé, déjà, mademoiselle, par le bonheur d’avoir pu vous être utile en quelque chose... Ce que j’ai fait n’est rien...
—Comment, rien!... Vous avez risqué votre vie, monsieur.
—Ne le croyez pas, mademoiselle...
—Pardonnez-moi. Ces misérables vous auraient bel et bien massacré, sans ce robuste... citoyen qui nous est venu en aide.
—Non, mademoiselle, non... Ces gens étaient fort exaltés, c’est vrai, mais croyez bien qu’au fond ils ne sont pas méchants.
Elle s’arrêta court, et m’examinant attentivement:
—Croyez-vous vraiment ce que vous dites? me demanda-t-elle.
—Assurément.
Pour parler vrai, je ne le croyais qu’à demi et mon accent devait manquer d’assurance. Elle eût cependant l’air de me croire, et se remettant à marcher.
—Du moins, poursuivit-elle d’un ton moitié plaisant et moitié attendri, du moins vous me direz, je l’espère, le nom de mon sauveur pour que je puisse le joindre à mes prières... Comment vous nommez-vous, monsieur?
—Justin Coutanceau, mademoiselle...
Et poussé par un mouvement de vanité:
—Le prénom de Justin, ajoutai-je, est celui de mon parrain, M. Goguereau, le député de Paris.
Je sentis que son bras tressaillait sous le mien, et avec une vivacité singulière:
—Quoi! s’écria-t-elle, vous êtes le filleul de Goguereau!... C’est bien l’ami de Vergniaud, n’est-ce pas? de Gensonné, de l’ancien ministre Roland, et de tous les Girondins!...
—Oui, mademoiselle, répondis-je, confondu d’entendre une jeune fille, une ouvrière, parler de tels hommes comme si elle les eût connus.
Pour la première fois, ma protégée daigna prendre attention à mon humble personne, et elle m’examina d’un rapide et subtil coup-d’œil.
Mais elle devait être, et fut déroutée, par ma mise, plus recherchée que celle des jeunes gens de ma condition, et aussi par ma taille et ma figure, qui me faisaient paraître quatre ou cinq bonnes années de plus que mon âge.
—Et vous..., citoyen, reprit-elle, vous étudiez sans doute pour devenir un avocat célèbre, comme ces messieurs de l’Assemblée?
Elle ne disait plus: «monsieur,» elle disait: «citoyen.»
L’ironie était palpable, elle se moquait de l’Assemblée nationale, et de Justin Coutanceau, par la même occasion.
—Je n’ai pas une ambition si haute, mademoiselle, répondis-je d’un ton vexé.
Elle avança dédaigneusement les lèvres et murmura:
—Oh! si haute!... si haute!...
—Je vis chez mon père, ajoutai-je, et je n’ai pas encore de profession.
—Et que fait votre père!
—Il est boulanger, mademoiselle.
—Et... patriote, n’est-ce pas?... C’est-à-dire grand partisan des idées nouvelles; hantant les clubs et les sections.
C’était, à ce qu’il me parut, une superbe occasion de prendre ma revanche de ses sarcasmes.
Me drapant donc de toute la dignité dont j’étais capable:
—Vous l’avez dit, mademoiselle, répondis-je, mon père est patriote... Mon père est de ceux qui pensent que «tous les citoyens sont égaux, et que s’ils doivent être distingués entre eux, c’est par la vertu et non par la naissance... Mon père croit que chaque citoyen a des droits et doit mourir plutôt que de les abandonner...»
Je puis bien vous dire, mes amis, que cette belle phrase, qui était du citoyen Robespierre, et non de moi, parut égayer singulièrement ma compagne.
Elle m’interrompit d’un éclat de rire, en disant:
—A merveille!... Je vois que j’ai eu ce rare bonheur d’être secourue par un philosophe... Je doute seulement, citoyen, que vos beaux principes eussent suffi à me tirer des mains des patriotes qui voulaient m’écharper... Les poings du robuste sans-culotte qui est venu à notre secours m’inspireraient plus de confiance... Vous le connaissez beaucoup, ce sans-culotte?
—C’est un des geindres... je veux dire un des garçons de mon père.
—Et il vous est dévoué.
—Aveuglément.
—De sorte que, si vous lui commandiez quelque chose, n’importe quoi, il ne réfléchirait ni ne discuterait..., il obéirait.
—Je le crois, mademoiselle...
Elle parut réfléchir, et moi j’essayai de mettre un peu d’ordre dans mes idées en déroute.
Si naïf que je fusse, je comprenais bien, désormais, que ce n’était pas une ouvrière que j’avais au bras, et je n’en admirais que plus son sang-froid, son courage, et jusqu’à son aisance superbe à se moquer de moi.
Cependant, nous étions arrivés au coin de la rue du Bac, et je cherchais des yeux quelque établissement où ma protégée pût réparer le désordre de sa toilette, désordre dont elle ne s’apercevait pas, mais qui provoquait les quolibets des passants.
J’allais me décider à la conduire chez un petit traiteur de la rue de Grenelle, quand j’aperçus de loin Fougeroux, qui arrivait en se dandinant lourdement selon sa coutume.
J’en eus un mouvement de joie, car, malgré ma confiance en sa force prodigieuse, songeant au nombre de ses adversaires, et qu’ils pouvaient se raviser, j’étais inquiet.
J’entraînai donc vivement ma protégée à sa rencontre, et dès qu’il fut à portée de la voix:
—Eh bien!... lui criai-je.
Il haussa dédaigneusement les épaules, et riant de son large rire, qui lui fendait la bouche jusqu’aux oreilles:
—Les citoyens ont compris que j’avais raison, répondit-il, et ils m’ont payé une bouteille.
Puis, s’adressant à notre inconnue:
—Maintenant, toi, citoyenne, lui dit-il, voudrais-tu nous faire le plaisir de nous dire pourquoi ces braves patriotes t’en voulaient si fort?
Elle rougit un peu, mais c’est du ton le plus dégagé qu’elle répondit:
—C’est ce qu’ils ont oublié de m’apprendre.
A l’air capable dont Fougeroux hocha la tête, je vis bien que ses adversaires avaient dû parler, et qu’il était travaillé de défiances.
—A d’autres!... grogna-t-il. Des patriotes sont incapables de malmener, sans raison, une jeune fille comme toi... Je les ai interrogés, ils prétendent que tu n’es qu’une aristocrate déguisée, une émissaire de Coblentz et des Prussiens...
—Ah! ils prétendent cela.
—Mais, oui... Au moment où la reine quittait le champ de la Fédération, ils t’ont vue te faufiler jusqu’à son carrosse et lui jeter un billet...
Je pensais qu’elle allait essayer de nier: point.
—Et après!... fit-elle audacieusement. Existe-t-il donc une loi qui défende de remettre un placet à la reine de France!...
Je voyais que la colère la gagnait et je sentais son bras se dégager peu à peu du mien.
Je frémis à l’idée qu’elle pouvait nous planter là, que je ne saurais rien d’elle, que je ne la reverrais plus...
Imposant donc silence à Fougeroux, dont la grossièreté me révoltait, je me retournai vers la jeune fille, et du ton le plus humble:
—Croyez, mademoiselle, dis-je, que ce citoyen n’a nullement eu l’intention de vous offenser... Et la preuve c’est qu’il sera, de même que moi, trop heureux de vous escorter jusqu’à votre domicile...
Visiblement elle hésita.
—En vérité, citoyen, me dit-elle, je ne sais si je dois accepter votre offre... je ne vous ai déjà causé que trop d’embarras.
—Je vous en prie, insistai-je.
—Vous le voulez, fit-elle, soit, venez.
Et reprenant mon bras, elle m’entraîna du côté du Pont-Royal, si rapidement qu’on eût dit qu’elle essayait de distancer Fougeroux, lequel, les mains dans les poches et sifflant la Carmagnole, marchait obstinément sur nos talons.
Mais, comme bien vous le pensez, je ne remarquais pas ce détail. Je ne pouvais détacher mon esprit de cette idée que j’allais être séparé de cette étrange jeune fille. Et la douleur que j’en ressentais me donnait du courage.
—Ne saurai-je donc pas, mademoiselle, demandai-je, à qui j’ai eu le bonheur de rendre service.
—On vous l’a dit, répondit-elle en souriant, à une aristocrate déguisée.
—Ainsi, vous ne me laisserez même pas l’espérance de vous revoir.
—A quoi bon!...
—Qui sait... je pourrais peut-être vous être utile encore.
Elle s’arrêta, et arrêtant sur moi un regard si intense que tout mon sang afflua à mon visage:
—Bien vrai, monsieur Justin, murmura-t-elle d’une voix d’une douceur infinie, bien vrai; si je vous demandais quelque chose, vous me l’accorderiez...
Ah! elle ne m’appelait plus citoyen, maintenant.
—Je donnerais mon sang pour vous, mademoiselle, m’écriai-je.
Elle réfléchit un moment, puis vivement:
—Eh bien! où demeurez-vous? me demanda-t-elle.
—Rue Saint-Honoré, juste en face de Doniol, le gantier de la reine...
—Doniol... oui, en effet, je vois cela d’ici... Et maintenant, si je voulais vous faire tenir un billet, comment devrais-je m’y prendre?...
—Adressez-le à Fougeroux, il m’est dévoué, je le préviendrai, il me le remettra. Fougeroux... vous rappellerez-vous de ce nom?
—Très bien... Alors, c’est entendu. Si vous recevez un billet signé Marie-Thérèse, vous viendrez au rendez-vous qu’il vous assignera...
—Je vous le jure...
Nous avions alors traversé la Seine, et nous nous trouvions en face du guichet des Tuileries.
Brusquement la jeune fille abandonna mon bras, et s’adressant à Fougeroux et à moi:
—Il ne me reste plus, citoyens, nous dit-elle, qu’à vous remercier... Me voici arrivée... Selon les circonstances, adieu, ou... au revoir.
Et légère comme l’oiseau, elle s’élança sous le guichet du palais et disparut.
Je ne sais, en vérité, combien de temps je serais demeuré planté sur mes pieds devant les Tuileries, si Fougeroux ne m’eût arraché à l’extase où j’étais plongé.
—Allons, allons, fit-il en me tirant par la manche, il est l’heure de rentrer, monsieur Justin, j’ai ma fournée qui m’attend.
Machinalement, je répondis:
—Oui, va, je te suis.
Mais je ne pouvais m’éloigner de cette place d’où j’avais vu disparaître cette jeune fille dont la rencontre devait bouleverser ma vie.
Qu’attendais-je?... Qu’elle reparût?... Je savais bien qu’elle ne reparaîtrait pas. Et je restais, cherchant à m’imaginer l’intérieur de ce palais, d’après les récits de ceux qui y avaient pénétré le 20 juin. Qu’y faisait-elle en ce moment? Sans doute elle racontait le danger qu’elle avait couru, forcée ainsi de s’occuper de moi.
Ah! que c’est beau la jeunesse, mes amis, que c’est beau, et que je plains ceux qui n’ont pas eu leurs années de généreuses folies et de radieuses illusions!
Par bonheur, si je divaguais, Fougeroux avait le parfait sang-froid d’un homme à jeun depuis le matin.
Aussi, tout en me ramenant à la maison par la rue Saint-Nicaise, qui allait de la Seine à la rue Saint-Honoré.
—Eh bien! commença-t-il, avais-je raison, quand je vous disais que c’était une aristocrate déguisée, que nous venions de tirer des mains des patriotes!...
—Rien ne le prouve.
L’allégation était si audacieuse que Fougeroux en fut d’abord interdit.
—Comment, rien ne le prouve! s’écria-t-il ensuite. Une coquine qui se déguise pour jeter des billets dans la voiture de la reine, qui se moque de l’Assemblée nationale et qui loge aux Tuileries! Et encore je ne vous ai pas tout dit. Dès que madame Véto a eu lu le billet, elle l’a déchiré menu comme balle d’avoine, et après elle a donné un ordre à un officier à cheval, qui est parti au grand galop... Qu’était-ce que ce billet? Encore quelque conspiration contre les patriotes?
—Que m’importe! interrompis-je. Des lâches menaçaient une femme, il était de notre devoir de la défendre.
Si peu clairvoyant que fût Fougeroux, mon emportement l’éclaira.
—Oh!... fit-il du ton d’un homme surpris d’une soudaine découverte. Oh!... c’est vrai qu’elle est diantrement jolie, la ci-devant...
Jamais l’honnête garçon ne m’avait paru si absolument stupide, je l’aurais battu.
—Je te prie, lui dis-je, de me faire grâce de tes réflexions.
C’était la première fois de ma vie que je lui parlais brutalement, il dut être navré.
—Comme cela, insista-t-il, c’est bien vrai: si elle vous écrit, vous irez à son rendez-vous.
Ce fut mon tour d’être stupéfait.
—Comment sais-tu qu’elle doit m’écrire? dis-je.
—La belle malice!... Je marchais sur vos talons, quoiqu’elle cherchât à vous éloigner de mes oreilles, la fine mouche, et j’ai tout entendu.
A quoi bon nier, puisque pour dérober à mes parents le secret de cette correspondance je devais avoir besoin de la complaisance de Fougeroux.
—Si j’avais ce bonheur, répondis-je, qu’elle me donnât un rendez-vous, je passerais au travers du feu pour y courir.
C’est d’un air consterné que le brave garçon leva les bras au ciel.
—Y pensez-vous, monsieur Justin! s’écria-t-il. Revoir une ennemie de la nation, une émissaire de Coblentz, une amie de madame Véto.
Il n’était guère, alors, de patriote qui n’eût partagé la répulsion de Fougeroux, tant était abominable la réputation de Marie Antoinette et des femmes de son intimité.
Même, beaucoup ont prétendu que c’était la Révolution, que c’était le peuple, qui avait inventé les calomnies atroces qui se débitaient en 92. C’est faux.
C’est à Versailles, c’est à la cour que se fabriquaient les pamphlets immondes qui couraient Paris, et où on racontait les orgies supposées de la reine, ses prétendues parties fines, ses soi-disant aventures au bal de l’Opéra.
Comment le peuple n’eût-il pas cru ce que répandaient des gens de la noblesse. Je le croyais si ferme, pour ma part, que je ne trouvais rien à répondre à Fougeroux.
Et lui poursuivait:
—D’ailleurs, cher M. Justin, qu’avez-vous à espérer!... Que cette aristocrate vous aime, vous, le fils à Jean Coutanceau le boulanger? Vous savez bien que ce n’est pas possible... Donc, si jamais elle vous assigne un rendez-vous, ce sera pour se moquer ou pour tirer de vous quelque avantage... C’est que je la connais, moi, cette race!... On me dirait qu’elle veut vous corrompre, vous enrôler contre la nation, faire de vous un agent des émigrés et des Prussiens, que je n’en serais pas surpris.
Et s’exaltant à cette pensée, comme on s’exaltait à cette époque de fièvre.
—Vous, un agent de l’étranger, s’écriait-il, vous!... Ah! je vous tuerais avant de ma propre main...
Si les craintes de Fougeroux étaient exagérées, ses soupçons n’étaient pas non plus sans quelque vraisemblance, je le reconnaissais. Mais la passion a toujours des sophismes à son service.
Non-seulement je rassurai le digne garçon, mais j’obtins de lui—non sans peine par exemple—le serment qu’il me garderait le secret.
Il était temps; nous approchions de la maison, et déjà j’apercevais ma mère, causant devant la porte de la boulangerie avec deux de ses voisins, M. Doniol, le marchand de gants, et l’épicier Laloi, qui avait sa boutique au coin de la rue.
A la façon dont elle vint à moi, la pauvre chère femme, et dont elle me jeta les bras autour du cou pour m’embrasser, je compris qu’elle avait été terriblement alarmée de ma longue absence.
Comment ne l’eùt-elle pas été, avec tous les bruits sinistres qui avaient agité Paris. N’était-on pas allé jusqu’à dire que les Suisses avaient tiré sur le peuple, et qu’il était resté un millier de morts sur le carreau.
—Or, je vous le demande, répétait tristement M. Doniol, comment voulez-vous qu’on vende gants avec des affaires pareilles!
C’était M. Laloi qui s’était empressé de conter ces sottises à ma mère, et je le lui reprochai, sans en être étonné. C’était un de ces êtres malfaisants qui ne sont jamais si heureux que quand ils ont une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Poltron, avec cela, comme un lièvre, et dissimulant mal sa lâcheté sous des airs de fier-à-bras.
Jusqu’en janvier 1792, il s’était appelé Leroi, comme défunt son père, mais une émeute ayant eu lieu ce mois-là, le 25, je crois, à cause de la cherté extraordinaire du sucre, et une bande de femmes ayant bouleversé sa boutique, il s’était imaginé que son nom y était pour quelque chose, et s’était empressé de changer Leroi en Laloi.
Cet imbécile n’était pas venu à la fête du Champ-de-Mars, mais il était allé le matin, avec sa section, assister à la pose de la première pierre du monument qu’on devait élever sur l’emplacement de la Bastille.
Et même, il avait rapporté de cette cérémonie une tabatière qu’il montrait fièrement, et qui était tournée dans du bois provenant des démolitions.
C’était un certain Palloy, lequel s’intitulait Palloy le Patriote, qui faisait ce commerce. Chargé de démolir la terrible forteresse, il s’était imaginé de la débiter en menus souvenirs patriotiques, et l’idée lui rapportait gros.
Dans les pierres, il faisait sculpter des Bastilles en miniature; avec les bois de charpente, il fabriquait des cannes, des tabatières ou des éventails; il transformait les ferrures en boucles de souliers ou de chapeau.
C’est donc par notre voisin l’épicier que nous sûmes ce qu’avait été la cérémonie.
Il nous expliqua comment, sous la première pierre, on avait placé une boîte de cèdre contenant la déclaration des droits gravée sur une table d’airain, une copie de la constitution, des monnaies et des assignats...
Mais ce qui l’émerveillait le plus, c’est que le mastic employé pour sceller la pierre, avait été composé avec des cendres d’anciens titres de noblesse...
—Tout cela, soupirait M. Doniol, ne fera pas vendre une paire de gants!...
J’étais jeune, je ne pouvais m’empêcher de rire des gémissements de notre voisin, et cependant, il était bien naturel qu’il s’affligeât. Ce n’est pas quand une nation se sent menacée dans son existence même, qu’elle songe à s’acheter des gants.
Et on peut dire que l’immense péril de la France grandissait d’heure en heure.
Alors, les journaux commençaient à donner sur les Prussiens des renseignements précis. On savait que leur armée était de quatre-vingt-dix mille hommes, tous vieux soldats, commandés par le duc de Brunswick, qui passait alors pour le meilleur général de l’Europe, ayant fait ses preuves sous le grand Frédéric, pendant la guerre de Sept-Ans.
On savait aussi que le roi de Prusse s’avançait avec son armée.
Mais ce qui portait à son comble l’exaspération, c’était la certitude où on était que mêlés à ces étrangers, marchaient pour combattre la patrie, vingt-deux mille gentilshommes émigrés, parmi lesquels les frères et les amis du roi.
Comment, après cela, eût-on cru à la sincérité du roi, en admettant qu’il eût été sincère!...
—Il est avec nous par force, disaient les patriotes; il est clair que son cœur est avec les Prussiens, avec ces nobles qui composaient autrefois sa cour, et c’est pour leur triomphe que sont tous ses vœux...
Et il faut bien le reconnaître, le roi et la reine semblaient prendre à tâche de ne négliger aucune imprudence pour accréditer ce bruit qu’ils pactisaient avec l’étranger.
Pendant que les principaux de leur noblesse les avaient abandonnés pour courir à Coblentz, le quartier général de l’émigration, qu’ils emplissaient du tapage de leurs forfanteries et du scandale de leurs amusements, la roi et la reine, aux Tuileries, se trouvaient assaillis de quantité d’ambitieux subalternes, et d’intrigants avides et remuants, qui, sous prétexte de servir la cause royale, achevaient de la ruiner.
Ces ineptes conspirateurs avaient installé, rue Saint-Nicaise, une espèce de bureau de recrutement, où ils enrôlaient pour l’armée de l’invasion, qu’ils appelaient l’armée du roi, tout ce qu’ils rencontraient sur le pavé de vauriens prêts à tout, et de pauvres diables mourant de faim.
Le prix de l’enrôlement était de sept cents livres, payables en assignats hors de France, au quartier général des émigrés. Et en attendant qu’on pût diriger ces malheureux sur la frontière, on les logeait dans un mauvais cabaret, à l’enseigne de l’Ecuelle de bois, près des Tuileries.
C’est à la porte de cette auberge que je les ai vus quelquefois, fumant leur pipe à l’ombre, se moquant sans doute entre eux des niais qui croyaient avoir acheté leur dévouement.
En parvint-il seulement un seul à Coblentz? Ce n’est rien moins que sûr. Il y avait à les faire passer à l’étranger de grandes difficultés, et ceux qu’on expédiait désertaient avant d’arriver à destination et revenaient à Paris.
C’est par les rumeurs du quartier que je connus ce bureau de recrutement, mais c’est par moi-même que je constatai l’existence de ce fameux Club national établi dans une maison du Carrousel, qui fit tant de bruit à l’époque.
J’avoue, par exemple, que le hasard seul me mit sur sa trace, et d’une façon bien simple:
Depuis ce fameux soir où ma mystérieuse inconnue m’avait si vivement planté là, son souvenir obsédait mon esprit à ce point que j’en perdais le sommeil. Avec quelle amertume je me reprochais ma timidité, et de n’avoir pas insisté pour qu’elle se fit connaître. Ne me devait-elle pas cela, après le service que je lui avais rendu. Tandis que je n’étais même pas sûr de savoir son nom, car rien ne me prouvait que ce nom de Marie-Thérèse qu’elle m’avait jeté fût le sien... Et cependant, je le trouvais bien doux à prononcer!... Jamais réunion de syllabes n’avait eu, pour mon oreille, une telle harmonie.
Comme de raison, je n’aurais pas, pour un empire, bougé de la boutique, le lendemain de la fête de la Fédération: j’espérais, j’attendais un billet. Il n’en arriva pas. Il n’en vint pas davantage les deux jours qui suivirent...
J’étais désolé et furieux, tout ensemble, et la satisfaction de mon confident Fougeroux m’exaspérait.
—Décidément, répondait-il à mes doléances, décidément elle vaut mieux que je ne croyais, cette jolie aristocrate. Elle s’est simplement moquée de vous, M. Justin, et ce rendez-vous n’était qu’un prétexte pour nous fausser poliment compagnie... Croyez-moi, c’est une fière chance que vous avez là.
C’était si peu mon opinion, que je me jurai que je retrouverais l’ingrate, me fallut-il, pour y arriver, fouiller une à une toutes les maisons de Paris...
On se fait pourtant de ces serments-là, à l’âge que j’avais!...
Mais il n’était pas besoin de telles extrémités, puisque je savais ou que je croyais savoir plutôt, qu’elle demeurait aux Tuileries.
De ce moment, je passai mes journées à rôder autour du palais, faisant faction des heures entières devant les guichets, dévisageant toutes les femmes qui allaient et venaient, me donnant le torticolis à épier les ombres qui glissaient le long des fenêtres.
Je me disais qu’à force de temps et de patience, je finirais bien par l’apercevoir, cette jeune fille, dont le souvenir était devenu mon tourment.
Cependant, je perdais mes peines, quand un matin, en traversant le Carrousel, je fus heurté assez rudement par un gentilhomme en uniforme de fantaisie, qui, marchant dans le même sens que moi venait de me dépasser.
J’ouvrais la bouche pour lui reprocher sa maladresse, mais il se retourna au même moment, et, en apercevant sa figure, je demeurai béant.
Cette figure, je l’avais déjà vue quelque part, j’en étais sûr. Mais où?
Un effort de mémoire me mit sur la voie.
Ce gentilhomme n’était autre que ce faux ouvrier dont l’exaltation m’avait tant frappé dans les tribunes de l’Assemblée législative le jour du discours de Vergniaud.
Cloué littéralement sur place par la stupeur, je le suivis des yeux et je le vis entrer dans une maison à vingt pas de moi.
Machinalement, je me rapprochai de cette maison pour l’examiner, et en moins de cinq minutes, je comptai plus de soixante personnes qui y entraient, après avoir dit quelques mots à un vieil homme debout sur la porte.
En un temps où dix journaux, tous les matins, dénonçaient chacun son complot, je devais être et je fus assailli des plus sinistres soupçons.
Au lieu donc de m’éloigner, j’attendis, et, au bout d’une demi-heure je vis ressortir tous les gens que j’avais vus arriver. Seulement, ils avaient échangé leur costume contre des haillons et s’étaient coiffés du bonnet rouge...
Une fois dehors, ils ne semblaient pas se connaître et s’éloignaient par groupes de trois ou quatre.
Mais leur point de réunion était arrêté d’avance, je ne tardai pas à en acquérir la certitude.
M’étant attaché au pas de deux de ces singuliers sans-culottes, je les vis gagner la terrasse des Feuillants, où tous les autres ne tardèrent pas à les rejoindre... Puis, quand ils furent en nombre, ils se présentèrent aux portes de l’Assemblée nationale, où ils furent admis.
J’en avais trop fait pour ne pas poursuivre jusqu’au bout l’aventure, et d’ailleurs la curiosité m’aiguillonnait jusqu’à me faire oublier Marie-Thérèse.
Je pénétrai donc, à mon tour, dans la salle de l’Assemblée, et je reconnus tous ces hommes disséminés dans les galeries publiques, avec tant d’art, pour paraître très nombreux, qu’on eût dit que des places leur avaient été réservées.
Bientôt un orateur parut à la tribune... C’était un député Girondin. Les sans-culottes de la place du Carrousel ne lui laissèrent pas articuler dix paroles... Il essaya de lutter, de tenir tête à l’orage, inutiles efforts. Le président agitait sa sonnette à la briser... en vain.
Des députés se levèrent pour imposer silence aux perturbateurs, ils furent couverts de huées... le complot était évident.
Épouvanté, je descendis quatre à quatre, et j’envoyai un huissier chercher mon parrain M. Goguereau.
Dès qu’il parut, et avant qu’il pût me demander ce que j’avais et pourquoi j’étais si pâle, je l’entraînai dans un coin, et d’une voix émue, je lui racontai ce que je venais de découvrir.
Il m’écouta, les sourcils froncés, et même une larme roula dans ses yeux.
Puis, lorsque j’eus achevé:
—Ce que tu me dis là, Justin, fit-il, je le savais et tous mes collègues le savent... Oui, il est des hommes qui ont formé le dessein de tuer la liberté par les excès qu’ils commettent en son nom... S’ils triomphaient, à l’heure où l’ennemi se presse à la frontière, c’en serait fait de la révolution et peut-être de la France... Mais nous veillons, et le moment est proche où seront déjouées leurs criminelles espérances... Et toi, mon enfant, n’ébruite pas ce que tu as surpris, il n’y a déjà que trop de causes de défiances et de désordres...
J’avais trop le respect de mon parrain pour ne pas me taire, puisqu’il me le recommandait.
Mais Fougeroux n’était pas quelqu’un pour moi, ma confiance en lui était entière et absolue, je ne vis nul inconvénient à lui raconter ce que j’avais surpris.
J’en eus quasi regret, tant fut terrible l’émotion qu’il en ressentit.
Il est vrai que cela me mettait à même de juger de l’effet que pouvaient produire sur les rudes patriotes du faubourg ces histoires de complots incessamment colportées, et qui allaient grossissant de bouche en bouche.
Ce garçon si honnête, qui était la bonté même, qui n’eût pas, comme on dit, fait de mal à une mouche, devint livide; ses yeux étincelèrent, et remuant les bras terriblement:
—Il faudrait pourtant en finir, s’écria-t-il avec tous ces conspirateurs, avec M. Véto et ces aristocrates de malheur!... Nous prennent-ils donc décidément pour un bétail qui est leur propriété! Quoi! plutôt que de reconnaître nos droits, ils sont allés chercher l’étranger comme un particulier irait chercher la garde pour mettre à la raison ses domestiques révoltés!... Rappelez-vous ce que je vous dis aujourd’hui, M. Justin, c’est une trahison qui leur coûtera cher!...
Je le calmai, parce que mon influence sur lui était toute puissante, mais en moi-même, je me disais:
—Les autres, ceux des faubourgs, qui les calmera?... Qui peut se flatter, après les avoir mis en branle, de les arrêter à son gré; de leur dire: Vous n’irez pas plus loin, et d’être écouté!
Fougeroux m’avait bien promis d’être discret, mais je ne tardai pas à reconnaître que mon secret était celui du drame, tout le monde le connaissait.
Les journaux ne cessaient de dénoncer le Club national de la rue du Carrousel, et l’Ami de la Vérité,—une feuille relativement modérée,—publia une liste de ses principaux membres et de longs détails sur sa constitution et son but.
Il s’y rencontre, écrivait-il, des militaires, des journalistes, un ancien ministre, des chanteurs publics, enfin des affidés de toutes conditions, prêts à revêtir tous les travestissements pour se faufiler partout, dans les comités de l’Assemblée nationale, dans toutes les sociétés patriotiques, et jusqu’aux Jacobins.
On y trouve des applaudisseurs gagés, des orateurs forts en gueule qui débitent les discours qu’on leur apprend par cœur, des motionneurs chargés d’inspirer les groupes, des lecteurs de place publique, des distributeurs d’écrits, des observateurs et enfin toute une armée de faux sans-culottes...
L’Ami de la Vérité ajoutait que ce club national coûtait à la cour cent soixante-quatre mille livres par mois...
Le jour même où furent imprimées ces révélations, il y eût dans les tribunes publiques de l’Assemblée une rixe où deux hommes furent laissés pour morts, entre les sans-culottes à gourdins et les fédérés des départements.
Car les fédérés étaient toujours à Paris, et il en arrivait chaque matin...
Il avait été décidé qu’ils ne feraient qu’assister à la fête de la Fédération et qu’ils partiraient ensuite, mais on les laissait sans ordres.
Et les gens, selon leurs opinions, affirmaient qu’ils étaient retenus par la cour dans la crainte qu’ils n’arrêtassent l’invasion prussienne, ou encore que chacun des partis qui déchiraient l’Assemblée prétendait les garder pour les enrôler au service de ses ambitions et de ses rancunes...
En attendant, on leur donnait trente sous par jour, et ils passaient leurs journées à l’Assemblée nationale, leurs soirées dans les clubs, leurs nuits n’importe où, pourvu qu’ils y eussent la licence de faire tapage.
Il m’arriva de causer avec plusieurs d’entre eux, et je constatai qu’ils étaient extraordinairement montés.
Avaient-ils tort?... Non, tel n’est pas mon avis.
Quoi! brûlants du plus pur enthousiasme patriotique, ils avaient tout quitté, pays, famille, amis, intérêts, pour marcher à l’ennemi, et on les laissait à Paris... Quoi! on avait déclaré la patrie en danger, et on n’utilisait pas les forces vives de la nation!...
De même que Fougeroux, ils répétaient: Il faut en finir!...
Et la province n’était guère moins agitée.
Mon père nous écrivait que les achats de grains devenaient de plus en plus difficiles. Encore que la récolte eût été bonne, on n’en voyait presque pas paraître sur les marchés. Ceux qui en avaient, le cachaient, les uns, par peur, les autres, par spéculation. Ceux qui se décidaient à en montrer quelques sacs, exigeaient de l’or en échange. De l’or!... on eût dit qu’il avait émigré, il n’y avait plus que les agioteurs qui en avaient plein leurs poches. Tout se payait avec des assignats, d’autant plus dépréciés qu’il en circulait beaucoup de faux.
De là un renchérissement extraordinaire du blé qui faisait souffrir les populations et les exaspérait.
Dans une bourgade des environs de Chartres, mon père avait vu une bande de gens armés envahir le marché, taxer arbitrairement le grain, et l’enlever à ce prix.
Déjà cette scène déplorable avait eu lieu à Etampes, l’année précédente, et le maire de la ville, Simoneau, avait été tué en essayant de s’opposer à cette taxe forcée, violation inique de la liberté de commerce.
Même l’Assemblée nationale avait décrété qu’en souvenir de son dévouement à la loi, un monument lui serait élevé sur une des places d’Etampes, et que son écharpe serait suspendue aux voûtes du Panthéon français.
Mais près de Chartres, il ne se trouvait pas de Simoneau, et mon père s’était vu arracher des mains le blé qu’il venait d’acheter pour les deux tiers du prix qu’il l’avait payé.
Sa lettre trahissait une tristesse profonde et de sinistres appréhensions.
«Je ne suis pas sensible, nous disait-il à la fin de sa lettre, à une perte d’argent, et je plains plus que je ne maudis les malheureux qui me l’ont fait subir, mais si nous en sommes-là, au mois de juillet, que sera-ce cet hiver...»
Cet effroi d’un avenir qui s’assombrissait de plus en plus, était celui de tous les hommes de bon sens, et arrêtait toutes les affaires. Plus d’industrie, plus de commerce, plus de travail, rien...
Courir aux nouvelles, lire les journaux, suivre les séances de l’Assemblée et des clubs, pérorer, discuter, s’inquiéter des projets de la cour encore plus que de ceux de l’ennemi, piquer sur des cartes la marche de l’armée prussienne, voilà toute l’occupation de Paris.
A voir la population oisive qui circulait dans les rues, qui emplissait les promenades et les places publiques, on eût dit une ville de rentiers et que chacun avait sa fortune faite.
Jamais la misère n’avait été si affreuse.
Que de fois, pendant que je restais à la boutique, assis dans le comptoir, que de fois j’ai vu se coller contre les vitres le hâve et maigre visage de quelque pauvre patriote exténué de besoin.
L’instant après, un homme entrait timidement, à qui la honte ramenait un peu de sang aux joues, et qui d’une voix à peine intelligible balbutiait:
—Citoyen, je n’ai pas mangé depuis avant-hier.
Jamais, ni ma mère ni moi, nous n’avons eu l’affreux courage de refuser une livre de pain à qui nous la demandait. Mon père d’ailleurs, ne l’eût pas souffert.
Et Dieu sait, cependant, s’il était grand le nombre de ceux qui venaient nous tendre la main. C’était comme une procession, à certains jours, et j’ai vu des fournées entières s’en aller ainsi morceau à morceau.
Fougeroux, parfois s’en fâchait.
—Vous êtes trop bonne, madame Coutanceau, disait-il, on abuse...
Ma mère ne répondait pas, elle pleurait.
—Quel métier, Seigneur! gémissait-elle, que le métier de boulanger, par cette grande misère... Nous ne pouvons pourtant pas nourrir tous ceux qui ont faim!
Non, nous ne le pouvions pas, et le peu que nous faisions était encore énorme pour nous, et insensiblement diminuait le petit avoir péniblement gagné par mes parents.
Mais mon père ne songeait pas à se plaindre. Il n’était pas de ceux qui n’avaient vu dans la Révolution qu’une occasion de se pousser et d’assouvir leurs convoitises. Patriote ardent et sincère, il avait fait, je lui ai entendu dire souvent, le sacrifice de sa fortune, et il était prêt à faire celui de sa vie, pour le maintien des droits de l’homme...
Croyez que les généreuses idées de mon père étaient alors celles d’un grand nombre de citoyens. Si les agioteurs et les intrigants continuaient à étaler un luxe impudent au Palais-Royal, les honnêtes gens supportaient fièrement les privations. On ne rougissait pas d’être pauvre.
Je me rappelle avoir entendu mon parrain, M. Goguereau, nous décrire un dîner où il avait été invité, chez un restaurateur des Champs-Élysées et qui avait été, nous disait-il, extraordinairement servi.
Il s’y trouvait trois députés, dont un ancien ministre, et leurs femmes, en tout six convives: la carte ne s’était pas élevée à quinze francs...
Cependant, les grands événements approchaient; nous étions au 22 juillet.
S’il est dans notre histoire une date héroïque, mes amis, c’est cette date du 22 juillet 1792, et il n’est pas d’âme vraiment française qui la puisse oublier.
La France, ce jour-là pour la première fois, fit l’épreuve de son énergie, et sûre de ses forces, reprit pour ainsi dire possession d’elle-même.
Il n’était pas six heures du matin, lorsque je fus éveillé en sursaut par un grand bruit, dont il me fut tout d’abord impossible de me rendre compte.
J’écoutai... Le bruit se renouvela et les vitres de ma chambre tremblèrent... Il n’y avait pas à s’y méprendre, c’était une salve d’artillerie.
Palpitant, la sueur au front, je me jetai à bas de mon lit, je me vêtis en un tour de main et d’un bond je fus dans la boutique.
Elle était pleine de voisins, qui causaient avec une animation extraordinaire, mêlés à nos ouvriers dont le travail venait de finir.
—Qu’est-ce, m’écriai-je, qu’y a-t-il?
Fougeroux s’avança vers moi, et, d’un accent où vibrait son patriotisme:
—Il y a, répondit-il, que M. Véto a été obligé de céder... On promulgue aujourd’hui le décret qui proclame la patrie en danger.
Fou que j’étais!... Tout entier à l’obsédant souvenir de Marie-Thérèse, j’avais oublié!...
Furieux contre moi-même, j’allais m’élancer dehors, quand l’honnête Fougeroux me barra le passage.
—Attendez-moi, M. Justin, dit-il, je vous accompagne.
L’instant d’après, en effet, dès qu’il eut tout ordonné pour que la boulangerie ne souffrit pas de son absence, nous sortions ensemble.
Déjà, la rue Saint-Honoré était pleine de monde et des crieurs publics vendaient aux passants l’ordre et la marche de la cérémonie.
La Commune avait voulu que la promulgation fût faite avec une solennité austère, qui répondit à l’effrayante gravité des circonstances, et elle avait chargé Sergent du programme.
Artiste médiocre, Sergent était allé demander des inspirations à Danton, et il s’est surpassé.
On sentait un puissant souffle révolutionnaire dans l’ordonnance de cette solennité, et il n’était pas un détail qui ne fut admirablement choisi pour frapper les imaginations et exalter le patriotisme.
David, qui depuis a été l’ordonnateur de Robespierre, a fait plus grandiose, il n’a jamais fait mieux ni surtout plus juste.
Les canons du Pont-Neuf avaient annoncé la solennité par cette salve de trois coups qui m’avait éveillé.
Ils continuèrent à tirer d’heure en heure, toute la journée, jusqu’à sept heures du soir.
Des détonations profondes leur répondaient... C’était l’artillerie de l’Arsenal qui faisait écho.
Les six légions de la garde nationale de Paris avaient été convoquées à la place de Grève, et c’est là que nous les trouvâmes, Fougeroux et moi, attendant des ordres, l’arme au pied.
A huit heures précises, on les divisa en deux colonnes qui prirent chacune en même temps, une direction différente, pour porter dans tout Paris la proclamation.
Chaque cortége avait en tête un escadron de cavalerie, avec tambours, trompettes, et six pièces de canon.
Quatre huissiers à cheval, en grand costume, portaient des drapeaux où on lisait: Liberté-Egalité-Constitution-Paris.
Douze officiers municipaux ceints de leur écharpe, suivaient, groupés autour d’un garde national à cheval qui soutenait une immense bannière tricolore, où on avait écrit, en grosses lettres, ces mots effrayants et sauveurs:
Puis venaient encore six pièces de canon, roulant sur le pavé avec un bruit sinistre, et les légions de la garde nationale.
Un escadron de cavalerie fermait la marche.
A tous les carrefours, sur les ponts et sur les places, le cortége s’arrêtait.
Les huissiers agitaient leurs drapeaux et un long roulement de tambours commandait le silence...
Alors un officier municipal se détachait du groupe, et se haussant sur son cheval pour être entendu de plus loin, lisait l’acte de l’Assemblée législative.
Puis, par deux fois il répétait:
La patrie est en danger!... La patrie est en danger!...
Pour nous tous, c’était la voix même de la France menacée, faisant au dévouement de ses enfants un suprême appel.
Aussi, à chaque proclamation, un frisson terrible courait dans la foule, pareil à la rafale qui couche les épis de blé.
A cette pensée de la patrie en danger, chacun se sentait menacé en son existence même, en son honneur, en sa famille, en sa liberté...
Et aux salves de l’artillerie, aux appels lugubres des trompettes, un cri immense, le cri de tout un peuple répondait:
—Aux frontières!... Aux frontières!...
Ah! on n’oublie jamais ces émotions poignantes, quand on les a ressenties!...
Je n’avais pas un fil de sec sur moi, mes dents claquaient, les oreilles me tintaient, et il me montait au cerveau comme des bouffées de flamme.
Ce jour-là je compris l’exaltation des martyrs, l’ivresse sainte du sacrifice, je compris tout ce qu’on peut éprouver de joie à verser pour la défense du sol sacré de la patrie la dernière goutte de son sang.
Ému d’une émotion non moins profonde que la mienne, Fougeroux me serrait le poignet à le briser.
Il était blême, de grosses larmes roulaient le long de ses joues, et c’est d’une voix à peine articulée qu’il balbutiait:
—Maintenant les Prussiens peuvent venir, la France les recevra!...
Mais ce n’était pas tout que d’exalter jusqu’au délire le sentiment national.
De tous côtés des amphithéâtres avaient été dressés pour recevoir les enrôlements.
Il y en avait à la Place Royale, au Parvis Notre-Dame, à l’Estrapade, place Maubert et au Carré Saint-Martin.
Chacun d’eux se composait d’une estrade grossièrement charpentée, recouverte d’une tente pavoisée de banderolles et de drapeaux tricolores, ornée de couronnes et de branches de chêne. On y arrivait par un escalier de quatre à six marches.
Une large planche, posée sur des tambours servait de table.
Trois officiers municipaux et six notables recevaient les engagements, les enregistraient et délivraient à chaque volontaire un certificat d’inscription.
Une triple rangée de gardes nationaux isolaient l’amphithéâtre et en défendaient l’accès.
Et, certes, c’était une sage mesure que d’entourer ainsi les estrades.
La foule s’y ruait avec un si furieux enthousiasme que les factionnaires avaient mille peines à la modérer et à la contenir.
Près de moi, j’entendis une vieille femme me dire:
—Ils ne se presseraient pas plus quand il s’agirait d’entrer en paradis.
Elle avait raison. C’était à qui franchirait le premier le roide escalier, à qui tiendrait son certificat d’inscription et l’agiterait en l’air en criant: Vive la Nation!...
A tout instant, il fallait qu’un officier municipal se levât pour calmer le tumulte.
—Patientez, répétait-il. Que diable! nous ne pouvons cependant pas vous inscrire tous à la fois!...
Ce qui n’empêche que las de s’étouffer au bas de l’escalier, des impatients cherchaient à escalader l’estrade.
De tous côtés, on entendait des gens crier: «Inscrivez-moi, je suis un tel, âgé de tel âge, demeurant telle rue, tel numéro... D’autres écrivaient leur déclaration au crayon, sur des morceaux de papier qu’ils jetaient aux officiers municipaux.
Tout se confondait en un même délire, en un pareil élan, les conditions et les âges. C’était bien l’égalité absolue devant le danger de la patrie. Il n’y avait plus là des inférieurs et des supérieurs, des riches et des pauvres, il n’y avait que des citoyens réclamant un même droit, celui de défendre leur pays...
Il en venait de tout jeunes, des enfants, qui s’efforçaient de prouver qu’ils avaient seize ans, l’extrême limite d’âge fixée par l’Assemblée, et qui se retiraient désespérés de n’être pas admis...
Il se présentait des vieillards, qui brandissaient des armes entre leurs mains débiles, jurant que la vue de l’ennemi leur rendrait toute leur énergie, qu’ils étaient encore assez robustes pour combattre et qu’en tout cas ils sauraient mourir.
Les partants, eux, chantaient, quand le soir, les officiers municipaux les conduisaient à l’Hôtel-de-Ville. Ils criaient à la foule émue:
—Chantez donc avec nous!
Il y eut le premier jour près de cinq mille enrôlements... Il avait été impossible d’en inscrire davantage.
Et ce qui s’était fait à Paris, le même jour et à la même heure, se répéta dans toutes les communes de France.
Et partout où se fit entendre le cri de détresse de la patrie, un dévouement pareil répondit.
La Gironde déclara qu’elle n’enverrait pas, qu’elle marcherait tout entière sur le Rhin. A Arcis, sur une population de dix mille mâles, quatre mille s’enrôlèrent. A Argenteuil, tous les hommes partirent...
Voilà quelles nouvelles nous apportaient chaque matin les journaux, et ils ajoutaient qu’on n’avait plus qu’un embarras, celui du nombre...
Une lettre de mon père, que ses affaires avaient conduit à Vendôme, vint nous donner une idée exacte de l’enthousiasme des départements.
«Tout se soulève, nous écrivait-il, tout marche!...
»Les citoyens de chaque canton choisissent entre eux ceux qui doivent partir. Ceux qui ont obtenu cet honneur se rendent au chef-lieu du district, où on leur donne de la poudre, des balles et une feuille de route...
»D’uniforme, il n’en est pas question. La France n’en a pas à en donner, on s’en passera... Il n’est pas besoin d’un uniforme, pour marcher au combat, pour vaincre ou pour mourir!...»
Mon père ajoutait encore:
«Une grande joie pour moi, c’est que tous les partis abjurent leurs rancunes... J’ai vu les hommes des opinions les plus opposées se réconcilier devant l’autel de la Patrie, s’embrasser et partir bras dessus bras dessous pour le district... Ils ne se souviennent plus que d’une chose, c’est qu’ils sont Français et que la France est menacée...»
L’émotion de mon parrain M. Goguereau était visible, lorsque je lui lus cette lettre où éclatait le plus pur patriotisme.
—Dieu veuille, me dit-il, que ton père ne se trompe pas... L’union seule, en un si grand péril, peut nous sauver... User notre énergie à des querelles intestines, ce serait ouvrir notre frontière à l’ennemi, et avant un mois les Prussiens feraient boire leurs chevaux à la Seine...
Il eût fallu être dépourvu de bon sens pour ne pas reconnaître qu’il avait mille et mille fois raison, et tous les voisins réunis chez nous, ce soir-là, et qui l’écoutaient religieusement applaudissaient.
—Rien de si juste! disait Fougeroux. Si nous ne sommes pas d’accord, eh bien! nous nous arrangerons plus tard, entre nous... Mais écrasons d’abord l’ennemi.
M. Goguereau, cependant, d’un accent prophétique, poursuivait:
—Ne nous abusons pas, mes amis, ce n’est pas une guerre politique que nous fait la Prusse... C’est une guerre de races. Les hommes du Nord s’avancent fatalement vers le Midi, c’est l’immuable loi des invasions... Ce qu’ils veulent, ces Prussiens, ce qui enflamme leurs convoitises, c’est notre climat plus doux, notre sol fertile, nos coteaux où mûrit le raisin... Ce n’est pas une armée, qu’il faut envoyer contre eux, ni deux, ni trois, c’est la nation tout entière... Les vaincre ne suffit pas, ils reviendraient plus nombreux, il faut les écraser... Donc, debout tous, et à la frontière!...
Et tout le monde se levait, et si prodigieux était l’élan, qu’il y avait des imbéciles pour dire et pour croire que ceux-là même qui l’avaient provoqué s’en épouvantaient.
Il me semble voir encore le semeur de nouvelles sinistres, M. Laloi, l’épicier, entrer tout pâle dans notre boutique, nous tirer à part, Fougeroux et moi, et nous dire en grand mystère:
—Vous savez ce qui arrive?... Tous les députés se sauvent. Vergniaud, Guadé, Gensonné et Brissot ont déjà pris leur passe-port pour l’Angleterre.
Fougeroux ne le laissa pas continuer.
—Ce n’était vraiment pas la peine de quitter vos pains de sucre, lui dit-il, pour venir nous débiter des sottises pareilles!
Et dans le fait, Fougeroux avait raison d’écouter son gros bon sens plutôt que les cancans dont M. Laloi se faisait l’écho.
Le lendemain même, Brissot publiait dans son journal, le Patriote français, cette noble et fière réponse:
«Les agents de l’étranger—et il n’en est que trop à Paris de ces misérables—ont seuls pu répandre le bruit de notre fuite... Nous méprisons trop les lâches qui abandonnent leur poste à l’heure du danger pour partager leur ignominie.»
Mais les plus stupéfaits de l’enthousiasme inouï des volontaires, et de ces enrôlements innombrables, étaient assurément les recruteurs du quai de la Ferraille, dont le métier désormais était perdu.
Ces recruteurs était de vieux soudards, presque tous sous-officiers, portant pour la plupart, les plus étranges surnoms.
Ils s’appelaient Belle-Rose ou La Tulipe, La Ramée ou la Clé-des-Cœurs.
Chargés de racoler pour le roi, ils rôdaient par la ville ou traînaient de mauvais lieu en mauvais lieu, faisant sonner dans leur poche les écus de la prime.
Avaient-ils un homme à leur convenance, ils l’abordaient sous un prétexte quelconque, lui offraient à boire, l’entraînaient au cabaret et lui versaient du vin, jusqu’à ce qu’il fut assez ivre pour trinquer à la santé du roi, et apposer sa signature, ou sa croix s’il ne savait pas écrire au bas d’un acte d’engagement.
Et le lendemain, l’ivrogne se réveillait soldat, trop heureux s’il ne se trouvait pas dépouillé de la prime dont on l’avait alléché.
Mais, en dépit de ces manœuvres honteuses, malgré les piéges grossiers et les ignobles séductions, les hommes manquaient aux recruteurs, et c’est à grand peine si chaque année ils réunissaient quelques milliers de simples d’esprit, de pauvres diables mourants de faim, ou de gredins à bout d’expédients.
Et voilà que tout à coup, à un roulement de tambour, ils voyaient surgir des armées.
—Voilà un peuple bien changé, disaient-ils... Rien autrefois ne l’effrayait autant que le service militaire, tandis que maintenant...
Il se trompait.
Ce n’était pas le peuple qui avait changé, mais bien les conditions du service.
Qu’était le soldat de l’ancienne monarchie? Un paria.
Soldat du roi, ou plutôt de son colonel, que lui importaient les causes confiées à son courage, en quoi le touchaient-elles?
Il n’avait même pas de drapeau à défendre, car le drapeau, le clocher de la patrie armée, est une idée de la Révolution, et c’est autour d’une bannière portant les armes du propriétaire du régiment que se battait le soldat.
En échange de sa liberté et de son sang, qu’avait-il à attendre? Rien.
L’armée de la monarchie, c’était la noblesse, à qui étaient exclusivement réservés tous les grades, et qui dévorait, à elle seule, plus de la moitié du budget de la guerre.
Le reste ne comptait pas.
Qui était soldat, restait soldat ou sous-officier, sans espoir d’avancement... Et il n’était pas d’application, de courage, de génie même, capables de combler l’abîme qui séparait le sergent de l’officier...
Aussi est-ce dans ces rangs sacrifiés que la Révolution trouva et prit tous les grands généraux qui ont illustré nos armes.
Jourdan, Joubert et Kléber, qui d’abord avaient servi, avaient quitté l’armée comme une impasse, comme une carrière désespérée.
Augereau était sous-officier d’infanterie.
Hoche était sergent aux gardes.
Marceau était simple soldat.
Et ces héroïques jeunes gens étaient cloués là pour toujours...
Hoche, qui avait vingt et un ans, n’en faisait pas moins son éducation, comme s’il eût eu le pressentiment de sa destinée. Et comme sa faible solde ne lui suffisait pas à acheter les livres indispensables, ce grand homme brodait des gilets d’officier, qu’il allait vendre dans un café...
Le peuple savait cela, et voilà pourquoi il avait en horreur le service militaire...
Tout changea, le jour où il cessa d’être le soldat du roi et devint le soldat de la nation.
Ayant reconquis la patrie, fier de ses droits nouveaux, sentant que la cause qui se débattait était sienne, il sauta sur ses armes...
Et ce n’est pas tout:
Une généreuse émulation, l’ambition la plus avouable enflammait encore le courage de l’armée de 92.
Elle savait bien qu’il allait falloir choisir dans ses rangs les officiers qui la commanderaient... Elle comprenait que les grades allaient être, non le privilége du plus noble, mais la récompense du plus digne...
Comment donc n’eut-elle pas été invincible...
Mais en 1792, mes amis, l’épreuve n’était pas faite, et la France ignorait ce que seraient les phalanges héroïques à qui elle allait confier ses destinées.
Elle se demandait, anxieuse, ce qu’ils feraient au feu, ces volontaires qui abandonnaient, pour la défendre, l’atelier, la boutique, la charrue, le foyer de la famille.
Résisteraient-ils au choc qu’on disait irrésistible des vieilles bandes prussiennes?...
Certes, leur résolution était puissante, leur courage grand comme le danger, leur enthousiasme communicatif vibrait dans toutes les âmes, mais il est un abîme entre la volonté et le fait. Autre chose est de dire: Je pars, et je saurai, héros obscur, mourir pour la patrie... et de le faire.
Quand on les voyait défiler le long des rues, ces enrôlés de la veille, marchant au pas et chantant:
on les applaudissait, mais on leur eût souhaité peut-être plus de gravité et de recueillement qui sied aux grands sacrifices.
Donc, je dois vous le dire, parce que c’est la vérité, la France était fiévreuse et inquiète.
Il n’était pas un patriote qui, en passant devant l’Hôtel-de-Ville, ne se sentit le cœur serré, lorsqu’il y voyait arborée en permanence la grande bannière tricolore où on lisait: La patrie est en danger.
Il n’était pas un citoyen vraiment digne de ce nom qui n’eût payé de la dernière goutte de son sang la joie de voir le péril conjuré et cet étendard fatal enlevé.
C’est que c’était comme un immense crêpe de deuil étendu au-dessus de Paris, au-dessus de la France!... C’était l’angoisse perpétuelle du lendemain paralysant tout...
Vous ne rencontriez que des visages mornes ou des yeux étincelants, selon que les gens s’abandonnaient au découragement ou frémissaient de colère...
Sans se connaître, on s’abordait, chacun espérant qu’un autre saurait peut-être quelque chose, qu’il ignorait, de ce qui se passait là-bas, vers Sierck, vers Longwy, là où nos soldats défendaient le sol sacré de la patrie.
—Eh bien!... se demandait-on, la grande colonne des Prussiens, où est-elle?...
Selon les uns, elle demeurait immobile dans ses cantonnements, ou même reculait... A entendre les autres, elle avançait à grandes journées...
Et comme chacun affirmait tenir ses renseignements de source certaine, on ne savait que croire, que craindre ni qu’espérer.
Il avait été décrété que des relais seraient établis de la frontière à Paris, et que matin et soir un courrier apporterait à l’Assemblée nationale un bulletin de l’armée, lequel serait aussitôt publié.
Mais il arrivait un accident au courrier, ou bien les chevaux manquaient, ou bien encore un général écrasé de fatigues et de soucis n’avait pas eu le temps de rédiger son rapport.
Souvent les dépêches ne contenaient que ces trois mots: Rien de nouveau! Et la fièvre de Paris redoublait. Est-ce possible, se disait-on, qu’il n’y ait rien de nouveau. Puis, on trouvait toujours les bulletins trop laconiques. On eut voulu des détails infinis...
Seuls, les effrontés spéculateurs du Palais-Royal, les agioteurs du Perron, comme on disait alors, ne partageaient pas ces poignantes émotions... S’ils se préoccupaient des douloureuses anxiétés de Paris, c’était uniquement pour les exploiter... Pourvu que le cours du louis et des assignats variât incessamment, ils se tenaient pour satisfaits... Et ils ne reculaient devant aucune manœuvre pour provoquer ce résultat, lorsqu’il ne se produisait pas naturellement.
A ce point que «nouvelle du perron» était devenu le synonyme de mensonge impudent...
Avec tout cela, le nombre des volontaires grossissait toujours.
Et s’il s’en trouvait qui n’avaient pas conscience des devoirs qui leur étaient imposés, beaucoup, je vous l’affirme, se préparaient froidement à la terrible partie qu’ils allaient jouer pour la France.
Ils savaient, ceux-là, que présenter intrépidement sa poitrine aux balles n’est pas tout, et ils s’exerçaient au maniement des armes qui allaient leur être confiées.
Résolus à mourir, s’il le fallait, ils voulaient que leur mort fut au moins profitable, et vendre chèrement leur vie.
Parmi ces volontaires, il s’en trouvait une certaine quantité de notre quartier, mes camarades d’enfance, et je suivais leurs exercices.
Chaque jour nous nous rendions rue des Bons-Enfants, chez un vieux maître d’armes nommé Sylvain, qui avait été longtemps sergent aux gardes-françaises, et il nous enseignait ce qu’on enseigne aux conscrits, lorsqu’ils arrivent au régiment.
C’est lui qui, le premier, m’a fait tenir debout, les talons sur la même ligne, les épaules effacées, qui m’a commandé tête droite et tête gauche, et qui m’a fait marcher au pas: une!... deux!... une!... deux!...
Il n’avait pas de fusils pour nous tous, mais les gardes nationaux des environs se faisaient un plaisir de nous prêter les leurs, que nous reportions religieusement après chaque leçon...
Et durant des heures, le père Sylvain nous montrait comment on s’aligne et comment on se tourne, comment on se serre sans se gêner.
Il nous apprenait encore à connaître notre fusil, à démonter et remonter la batterie, à changer la pierre, à renouveler les amorces, à le charger vite et bien, à l’épauler, à ajuster, à tirer...
Il nous démontrait la puissance de la baïonnette, l’arme par excellence des volontaires de 1792, et nous exerçait à la croiser, à la lancer en avant et à s’en servir pour parer les coups de sabre de la cavalerie.
C’est à ce vieux brave homme que j’ai entendu dire un mot singulier et profond, qui m’est toujours resté dans la mémoire, et que plus d’une fois j’ai répété depuis.
Un de nos camarades, que les longueurs parfois fastidieuses de l’exercice ennuyaient beaucoup, jeta un jour son fusil dans un coin, en disant:
—C’est assez comme cela de porter arme et de présenter arme... J’en sais plus qu’il n’en faut pour mourir pour la patrie.
Le père Sylvain rougit jusqu’à la racine des cheveux, et d’une voix tonnante:
—Mourir, s’écria-t-il, mourir, c’est bientôt dit, citoyen!... Ce n’est pas de mourir qu’il s’agit, mais de vaincre...
Pour mon compte, je commençais à exécuter fort proprement la charge par temps et mouvements, quand, un samedi soir, au moment où nous nous mettions à table, ma mère et moi, mon père entra...
Sa dernière lettre, datée de Blois, ne nous annonçait pas son retour, et nous l’attendions si peu, que nous ne pûmes retenir un cri.
—C’est pourtant moi! fit-il.
Et comme ma mère, tout émue, s’était dressée, il l’embrassa avec une effusion de tendresse qui me parut présager quelque malheur.
Cette impression dut être celle de ma mère, car vivement elle demanda:
—Que se passe-t-il, Jean?...
—Rien, répondit-il, rien que je n’aie prévu depuis longtemps... Si je reviens, c’est que c’est perdre son temps que de courir après du blé qui se cache...
Déjà son couvert était mis, il s’assit, et tout en mangeant, et de la façon la plus simple et la plus naturelle du monde:
—Ah! nos affaires ne sont pas brillantes, poursuivit-il... Pauvre femme aimée, pauvre cher fils, de cent trente mille francs que nous possédions l’an passé, bien liquides et ne devant rien à personne, c’est à peine si les deux tiers nous restent. C’est la ruine, dans un temps donné...
Et comme ma mère soupirait:
—Je vous dis cela, ajouta-t-il, pour vous prévenir et non pour me plaindre... Il ne serait pas digne d’être Français, celui qui songerait à ses intérêts, quand l’étranger va peut-être fouler le sol de la France... Nous devons notre sang à la patrie, nous lui devons tout ce que nous possédons...
Je n’avais jamais douté de l’ardent patriotisme de mon père, et cependant ses derniers mots me firent tressaillir de joie.
Ils étaient pour moi plus qu’une promesse, la certitude qu’il ne s’opposerait pas à une résolution que j’avais arrêtée dans mon esprit.
Aussi, notre modeste repas terminé, ma mère étant sortie pour quelques ordres à donner:
—Père, lui dis-je, tant que tu étais absent, mon devoir était de rester ici... Mais maintenant que te voici de retour, que dois-je faire?...
Ce que je voulais dire, quelle était ma résolution, mon père le comprit à l’instant même, car il devint extraordinairement pâle.
Ah! mes amis, ce qu’il ressentait alors, je l’ai ressenti depuis... J’ai eu le cœur brisé par cette douleur horrible que ne sauraient soupçonner seulement ceux qui n’ont pas un fils.
Une larme brilla dans ses yeux, mais elle fut aussitôt séchée, et c’est d’une voix ferme qu’il me dit.
—Tu veux t’enrôler, Justin?
—Oui mon père.
—Tu vas nous abandonner, ta mère et moi, pour courir à la frontière?
—Oui.
Je craignais une objection, elle ne vint pas.
—C’est ton devoir, en effet, mon fils, me dit simplement mon père. La patrie est en danger, tu lui offre ta vie, c’est bien... Moi, je lui ai donné ma fortune, je lui donne aujourd’hui mon enfant... Dieu tout-puissant, en échange de tant de sacrifices à une sainte et juste cause, tu nous dois bien la victoire!...
C’est ainsi que parla mon père. Mais ce que je ne puis vous traduire, c’est son accent qui me remua jusqu’au plus profond de moi-même, c’est le regard brûlant d’une tendresse infinie dont il m’enveloppa.
Je voulais lui répondre, parler, lui dire ce que je ne sentais que trop; que mon sacrifice près du sien n’était rien, absolument rien... impossible; ma langue était comme collée à mon palais.
Lui, cependant, craignant sans doute de me montrer la profondeur de son émotion, se mit à marcher comme au hasard par la chambre.
Il se versa ensuite un grand verre d’eau, qu’il but, et, revenant à moi:
—Je ne t’aurais jamais conseillé de t’enrôler, Justin, reprit-il, mais, tiens, je le sens là—et il se frappait la poitrine—si tu ne l’avais pas fait, je t’aurais peut-être moins aimé... Tu es jeune, tu es robuste, tu seras bon soldat... Ah! si tu savais seulement manier un fusil!...
—Je le sais, mon père, non très bien encore, mais assez pour vendre chèrement ma vie... Je m’exerce tous les jours; j’ai pris des leçons.
Le visage de mon père rayonna, et me serrant la main:
Bien! approuva-t-il, c’est très bien d’avoir fait cela... Ah! que n’en ont-ils fait autant, tous nos jeunes hommes... Toutes les heures perdues dans les cafés à discuter les nouvelles, que ne les ont-ils employées à s’exercer au maniement des armes! La France, à cette heure, rirait bien des menaces de ces barbares qui prétendent l’envahir.
Il réfléchit, et à demi-voix, comme s’il eût répondu aux objections de son esprit.
—N’importe! poursuivit-il, la masse aussi est une force, et une force irrésistible! Ceux qui ne sauraient pas se battre sauraient toujours se faire tuer, user les munitions de l’ennemi, et faire de leur cadavre un rempart...
Oui, c’est devant moi, son fils, à la veille de partir, qu’il disait cela, et aussitôt après:
—Demain, Justin, dit-il, je t’accompagnerai au bureau d’enrôlement.
Mais il se tut, mon parrain, M. Goguereau entrait, qui venait nous rendre sa visite quotidienne.
Il dut être fort surpris du retour inopiné de mon père, il nous le dit, mais sa physionomie n’en conserva pas moins l’expression d’une profonde tristesse.
A ce point que saisi d’inquiétude:
—Serions-nous donc menacé de quelque désastre! m’écriai-je.
Il hocha la tête et s’étant assis:
—Peut-être!... répondit-il. J’arrive du Palais-Royal, et l’effervescence y est à son comble... Si grande y est la foule qu’on n’y circule plus... A tout instant, sans raison, sans prétexte, il s’y engage des rixes et des mêlées... On a renversé les étalages des marchands des galeries de bois... On se dispute dans les cafés, et il passe par moments des bandes de gens qui crient on ne sait quoi, et qui semblent prendre à tâche d’augmenter le désordre...
Il soupira, et d’une voix plus grave:
—On dirait, continua-t-il, que nous ne sommes pas d’accord... Pas d’accord, quand les Prussiens sont aux portes de Sierk... est-ce possible! Ah! nous avons été trop généreux, nous avons gardé parmi nous des amis et des agents de nos ennemis... En Prusse, on n’ignore rien de ce qui arrive à Paris, nous ne savons rien, nous, de ce qui se passe chez eux. Ce soir même, j’ai entendu des gens qui ont osé dire que nous n’étions pas de force à soutenir la lutte et qu’il fallait s’en remettre à leur générosité... Étaient-ils Français, les gens qui disaient cela?... Non, n’est-ce pas...
Il ébranla la table d’un formidable coup de poing, et s’animant de plus en plus.
—La générosité des Prussiens!... poursuivit-il, quelle dérision... Généreux, ces barbares qui ne cherchaient qu’un prétexte pour fondre sur nous pour nous écraser des forces qu’ils accumulaient en silence depuis des années... Allez, allez, c’est toujours le sang germain qui demande compte au sang gaulois de siècles de domination et de suprématie... On parle d’hypocrites protestations de désintéressement qu’ils répandent en Europe... Fiez-vous-y... Je vous l’ai déjà dit, ce qu’ils veulent de nous, c’est deux ou trois provinces... Justes dieux! demander à la France une de ses provinces autant vaudrait demander à chacun de nous de se laisser couper la main... Entrer vainqueurs à Paris... voilà leur rêve, mais croyez que la gloire ne leur suffirait pas... Le jour où on les a soulevés, on leur a montré Paris, comme une proie magnifique à dépecer... Là-bas, leur a-t-on dit, vous trouverez l’assouvissement de toutes vos convoitises, une chère exquise, des vins comme vous n’en avez bu, et les femmes tremblantes seront à vos genoux... Et ils avancent avec l’espoir de rentrer chez eux pliant sous le butin...
Mes cheveux se dressaient, en l’écoutant, et je frémissais d’une colère comme jamais je n’en avais ressenti... Alors, je comprenais la haine, la vengeance, cette fureur aveugle qui fait qu’on se jette sur son ennemi sans souci de la vie, pourvu qu’on prenne la sienne.
—Non, ils ne viendront pas à Paris, m’écriai-je, non, jamais, car nous serions un million d’hommes pour le défendre, un million qui, à défaut de fusils, nous battrons avec des bâtons, avec des faulx et avec des fourches, avec les pierres du chemin...
—Bien, approuvait mon parrain, très bien!... C’est ainsi que tout homme de cœur doit parler, et, en France, Dieu merci, ce ne sont pas les hommes de cœur qui manquent...
Quant à cela, il avait bien raison, il n’y avait aucun mérite alors à faire le sacrifice de sa vie; quiconque eût paru seulement hésiter eût été montré au doigt.
Une vingtaine de jeunes gens de je ne sais quel petit village, ayant refusé de s’enrôler, les jeunes filles envoyèrent à chacun une quenouille.
A Paris, c’était une autre histoire:
Souvent, quand il passait des bandes de jeunes gens, chantant à tue-tête des chants patriotiques les boutiquiers sortaient de chez eux, et, leur barrant le passage, demandaient:
—Êtes-vous enrôlés?
—Oui.
—Montrez-nous, en ce cas, votre certificat d’inscription.
S’ils le montraient, tout était dit, on leur donnait des poignées de main et on les laissait passer.
Si, au contraire, ils répondaient qu’ils n’étaient pas enrôlés, ou s’ils n’avaient pas de certificat à montrer:
—Alors nous vous défendons de chanter, disaient les boutiquiers... Ceux-là seuls ont le droit de chanter des hymnes patriotiques qui sont résolus à courir à la frontière mourir pour la patrie.
Résistaient-ils, les bourgeois se fâchaient, certains que tous les passants prendraient parti pour eux.
Mais neuf fois sur dix les chanteurs répondaient:
—Ah! il faut nous enrôler pour avoir le droit de crier à notre aise... Eh bien, nous y allons...
Et ils y allaient.
Mais quoi qu’on fît, quoi qu’on pût faire, rien ne paraissait étrange, tant les âmes s’exaltaient jusqu’au délire, en songeant à tout ce que représentaient peut-être de misère, de douleurs et d’humiliations ces cinq mots terribles: La patrie est en danger!
Tout ce qu’ils enfantaient de chimériques projets ou de conceptions ridicules, il me faudrait des journées pour vous le dire...
Et cependant, puisque je m’efforce de vous donner une idée de ces temps d’impérissable gloire, il est certains traits que je ne saurais vous passer sous silence.
Un soir que j’étais allé avec mon père et Fougeroux aux Cordeliers, voilà que tout à coup, au milieu de la séance, le président se lève.
—Citoyens, dit-il, je demande à vous donner communication de la lettre d’un patriote de Landrecies, qu’on me remet à l’instant.
—Lisez, lui cria-t-on de toutes parts, lisez.
Il prit la lettre sur son pupitre et commença:
«Citoyen président,
»C’est avec une très grande surprise que j’apprends par les feuilles publiques, par l’Ami de la Liberté, notamment que vous admettez, vous autres Parisiens, la possibilité d’une armée prussienne s’avançant jusque sous les murs de la capitale...
»C’est que vous n’avez pas réfléchi, citoyen président, et je le prouve. Combien, entre la frontière de l’Est et Paris, pensez-vous qu’il y ait d’arbres, de fondrières, de fossés, de rochers, capables de cacher un homme à l’affût? Mettons quatre millions...
»Eh bien! il faut que chaque fossé, chaque fondrière, chaque arbre abrite son patriote armé d’un fusil, prêt à tirer, à tuer ou être tué.
»Pour cette guerre d’embuscades et de buissons, nul besoin d’uniforme, d’artillerie, de charrois... Un fusil, de la poudre, des balles, et quelques livres de pain dans un bissac suffisent...
»C’est dans cet équipage que j’entre en campagne ce soir avec mon aîné, et notre cousin Fichet... Et si les Prussiens s’avancent, tant pis pour eux... Nous sommes chez nous, n’est ce pas!...
»Que deux millions, qu’un million seulement de patriotes, de ceux qui sont trop jeunes ou trop vieux pour l’armée nous imitent, et si un seul Prussien rentre chez lui raconter à son épouse ce qu’il a vu chez nous, je veux perdre le nom dont je signe:
»Salut et fraternité.
»SATURNIN VAROT.
»Patriote de Landrecies.»
D’unanimes applaudissements accueillirent cette lettre.
—Il a raison, criait-on de toutes parts, il a parfaitement raison.
Et même il fut voté que le citoyen Varot recevrait une lettre de félicitations et serait mis à l’ordre du jour.
Mais nul, assurément n’était aussi enthousiasmé que Fougeroux. De tous les moyens de défense proposés, aucun ne l’avait autant frappé et séduit.
—C’est qu’il est plein de bon sens, ce patriote de Landrecies, disait-il à mon père, pendant que nous rentrions chez nous. Oui, je comprends très bien son idée. On empoigne son fusil et son bissac, c’est simple comme bonjour... Et les canons des Prussiens ne leur serviraient pas de grand chose...
Il ne fut pas besoin, Dieu merci, de recourir à ce moyen suprême d’un peuple menacé dans son indépendance et à bout de ressources, mais je me suis demandé parfois si la lettre du citoyen Varot n’avait pas inspiré ces francs-tireurs, ces enfants perdus, ces compagnies infernales, qui plus tard, contre ces mêmes Prussiens, défendirent avec une admirable intrépidité les passages des Vosges.
Et chaque jour, mes amis, voyait éclore quelque plan de ce genre, tandis que d’autre part, des exemples d’héroïque dévouement à la patrie étaient donnés, tels que l’antiquité n’en offre pas de plus magnifiques.
Jamais je n’oublierai une lettre du citoyen Lanthoine qui arracha à Paris et à la France entière, un cri d’admiration.
Ce citoyen, fort riche, et qui menait une de ces heureuses existences où trop souvent se détrempent les caractères, écrivait à un journal:
«Citoyen rédacteur,
»Trois de mes amis et moi avons recruté, équipé, armé et monté à nos frais un escadron de cinq cents cavaliers qui nous ont élu leurs chefs.
»Nous partons aujourd’hui pour la frontière où nous nous mettrons aux ordres du général en chef; et tant que durera la campagne, nous vivrons à nos frais.
»Comme évidemment dès la première rencontre notre nombre sera diminué, nous faisons appel aux citoyens de bonne volonté pour combler les vides.
»Pour être admis à remplacer les morts, il suffit d’être robuste, bon cavalier, et de savoir manier un sabre... Il faut aussi prêter un serment ainsi conçu: Je jure de ne rentrer dans mes foyers qu’après que la patrie aura purgé son territoire des ennemis qui le souillent... Si la fortune trahissait nos armes, plutôt que de survivre à l’asservissement de la France, je me donnerais la mort de ma propre main!...»
Voilà, mes amis, ce qu’était notre enthousiasme quand, le 20 juillet 1792, le bruit se répandit que les Prussiens, décidément, avançaient en une seule colonne interminable, marchant droit devant eux comme ces terribles fourmis rouges qui détruisent tout sur leur passage...
On ajoutait que leur général en chef, le duc de Brunswick venait d’adresser un manifeste aux Français.
Comme c’était notre voisin Laloi qui, d’une mine consternée et mystérieusement était venu conter cela à mon père, nous crûmes à une de ces fausses nouvelles qu’il avait tant de plaisir à propager.
Nous y crûmes d’autant mieux, que les détails qu’il nous donnait passaient si bien toute croyance, que mon père lui tourna le dos en lui disant:
—Tenez, Laloi, une fois pour toutes, fichez-moi la paix... Vous mériteriez vous et les gens qui débitent des sornettes pareilles, qu’on vous fessât au coin des rues.
Et cependant, pour cette fois, notre voisin avait raison.
Etant sorti, je ne tardai pas à me procurer un de ces manifestes, que des gens sortis on ne sait d’où, et payés par on ne sait qui, distribuaient à profusion...
Il y était dit que Sa Majesté le roi de Prusse, «bien loin de convoiter nos provinces et de prétendre s’enrichir par des conquêtes, n’avait en vue, en faisant la guerre à la France, que le bonheur des Français...»
Il y était dit que si l’armée prussienne envahissait la France, c’était pour y rétablir l’ordre et un gouvernement à sa guise...
»Que jusqu’à l’arrivée de S. M. le roi de Prusse à Paris, les gardes nationales et les autorités étaient rendues responsables de tout désordre...
»Que les habitants qui OSERAIENT SE DÉFENDRE, seraient punis sur-le-champ comme rebelles, et que leurs maisons seraient démolies ou brûlées...»
Ah! tenez, après tantôt un siècle, au souvenir seul de ce manifeste d’une insolence stupide, je sens mon cœur se gonfler de colère...
Qu’il se soit trouvé un roi pour rédiger ce manifeste monstrueux et un général pour le signer, c’est ce qu’on a peine à comprendre.
N’importe! elle fut, cette proclamation, comme l’étincelle tombant sur un baril de poudre...
La France entière fut debout, brandissant ses armes, frémissant d’une rage désormais inapaisable... Quels hommes dégénérés, nous croyaient-ils donc ces barbares!... Ce fut, comme si chaque citoyen eut reçu un soufflet sur la joue...
Quoi! une nation oserait proposer à la France de rendre sa capitale sans combat!...
Des millions de voix répondirent:
—Notre capitale... Viens la prendre...
Et Vergniaud traduisit en un fier et magnifique langage notre pensée à tous, le jour où il s’écria:
«Faites retentir dans toutes les parties de l’Empire ces mots sublimes: Vivre libre ou mourir! que ces cris se fassent entendre jusqu’auprès des trônes coalisés contre vous; qu’on leur apprenne qu’on a compté en vain sur nos divisions intérieures; qu’alors que la patrie est en danger, nous ne sommes plus animés que d’une seule passion, celle de la sauver ou de mourir pour elle; qu’enfin, si la fortune trahissait dans les combats une cause aussi juste que la nôtre, nos ennemis pourraient bien insulter à nos cadavres, mais jamais ils n’auraient un seul Français dans leurs fers.»
Voilà, mes amis, sous l’empire de quelles excitations brûlantes je me rendis au district pour signer mon enrôlement.
Il est de ces dates qu’on n’oublie pas: c’était le 29 juillet 1792.
Fidèle à sa promesse, mon père m’accompagnait, et rien ne paraissait plus sur son mâle visage de sa première émotion.
Il avait été décidé, entre nous, que nous ne dirions rien à ma mère qu’au dernier moment, au moment où le sac au dos et le fusil sur l’épaule, je quitterais la maison paternelle.
Non qu’elle fût femme à essayer de me retenir... Trop noble était son âme pour ne pas s’élever à la hauteur des plus pénibles devoirs; mais nous voulions lui épargner les angoisses de l’attente et le douloureux effort de dissimuler ses larmes...
Il était neuf heures du matin lorsque nous arrivâmes à la maison commune.
Tout autour des groupes de patriotes s’entretenaient avec une grande animation, pendant que d’autres se crevaient les yeux à lire quantité de ces affiches qu’on placardait matin et soir, et où il était donné des nouvelles de l’armée, des départements et de l’Assemblée nationale.
Devant la porte, une douzaine de gardes nationaux entouraient deux de leurs camarades, qui, à cheval sur un banc jouaient aux cartes en fumant leur pipe.
Sur un grand écriteau accroché au mur, on lisait: Le bureau des enrôlements est à gauche, au fond de la cour.
Ayant suivi cette indication, nous arrivâmes à une salle immense, très haute de plafond, froide et nue comme une église pillée, où une trentaine d’hommes de tout âge attendaient leur tour d’inscription.
Tout au milieu, devant une table si petite que les registres des enrôlements la couvrait entièrement, un employé était assis.
Ah! ce n’était plus l’appareil imposant et théâtral du premier jour.
Rien de moins belliqueux que cet employé, petit homme à figure joufflue, le nez surmonté de lunettes, très soigné en sa mise mesquine, portant par dessus son habit vert clair des manches de serge noire.
Il me semble le voir encore, et je ris en pensant à l’air d’importance dont il inscrivait les volontaires qui se succédaient devant sa petite table. On eût dit qu’à chaque coup de plume il sauvait la patrie.
Nous étions beaucoup à l’attendre... il n’en allait pas plus vite, procédant posément et méthodiquement, selon la tradition bureaucratique.
Enfin, mon tour étant arrivé, il me toisa de la tête aux pieds, et d’un ton rogue:
—Votre nom, me demanda-t-il, votre domicile...
—Justin Coutanceau, demeurant rue Saint-Honoré.
—Quel âge avez-vous?
—Dix-sept ans et demi.
—Peste!... vous avez bien poussé, on vous en donnerait au moins vingt-deux...
Il m’adressa plusieurs autres questions, écrivant les réponses à mesure, et finalement il me tendit une plume en me disant de signer:
J’obéis, il me remit mon certificat d’inscription, et nous allions nous éloigner, quand une grosse voix joyeuse et de nous bien connue, dit derrière nous:
C’était Fougeroux.
Je ne lui avais rien dit, mais il me connaissait, le brave garçon, il avait surpris certains regards échangés entre mon père et moi, en présence de ma mère, et ayant deviné mes intentions, il nous avait épiés et suivis en cachette, se proposant de nous surprendre.
—Comment, tu veux t’enrôler, lui dit mon père.
—Tout juste, bourgeois. D’abord, moi, voyez-vous, l’idée qu’il y a des Prussiens chez nous, en France, qui veulent nous faire la loi, cela me rongeait... Quand j’ai compris que M. Justin allait partir, je n’y ai plus tenu, et me voilà... Nous partirons ensemble... C’est qu’il est bien jeune, voyez-vous, pour que nous le laissions aller là-bas tout seul, faire le coup de fusil, marcher des journées entières sous le soleil ou sous la pluie, dormir sur la terre mouillée sans rien dans le ventre, souvent... Mais je serai là.
Et s’adressant à l’employé:
—Allons, lui dit-il, inscrivez Pierre Fougeroux, âgé de trente-six ans, garçon boulanger...
Puis, quand il tint son certificat:
—Et maintenant, interrogea-t-il, quand filons nous..., quand nous équipe-t-on... où faut-il se présenter?
—Quand?
—Prochainement.
Je voyais bien que le vague de ces réponses ne convenait point à Fougeroux; sa grosse face devenait cramoisie, et il commençait à parler très haut et à s’en prendre à ce pauvre diable de scribe, lequel évidemment n’en pouvait mais, quand une porte au fond de la salle s’ouvrit et un homme entra à grands pas.
Il n’était guère que de taille moyenne; mais sa stature était herculéenne, ses épaules rondes étaient aussi larges que celles de Fougeroux, et le col de sa chemise déboutonné et sa cravate dénouée laissaient voir un cou énorme et la puissante musculature de sa poitrine velue.
Il était laid, mais d’une laideur étrange et saisissante... La petite vérole avait ravagé son visage et brouillé son teint, son nez était écrasé comme par un coup de poing... mais sa bouche avait une incroyable expression de mépris et d’audace, ses lèvres charnues semblaient faites pour laisser couler des flots de lave et ses yeux lançaient des éclairs.
Il nous avait entendu, car, s’adressant à Fougeroux:
—Qu’est-ce tu veux? lui dit-il d’un ton brusque, des habits de soldat? La patrie n’en a pas à donner à ses volontaires... Elle n’a même pas de souliers à leur mettre aux pieds, pas de pain pour les nourrir... Elle aura tout cela, le jour où les citoyens comprendront toute la signification de ce mot, notre unique salut: patriotisme.
J’ai gardé dans ma mémoire les paroles textuelles de cet homme... Elles n’avaient rien, me direz-vous, d’extraordinaire... Soit, mais il les prononçait d’un tel accent que j’en fus bouleversé...
Et je ne fus pas le seul, car Fougeroux demeura béant, et mon père s’approchant:
—Je t’ai compris, citoyen, dit-il à l’homme... Je ne suis pas riche, mais n’importe!... Je prends l’engagement d’équiper et d’armer mon fils, mon garçon que voici, et deux volontaires pauvres... Avant quinze jours ils seront en route.
L’homme enveloppa mon père d’un regard étonnant de douceur et de bienveillance, et lui serrant la main:
—Ah! tu es un patriote, toi, fit-il, et si jamais tu as besoin de moi...
Des clameurs confuses qui s’élevaient de la rue l’interrompirent, et l’employé se penchant vers lui vivement, lui dit:
—C’est encore de ces maudits volontaires... tous les jours il en vient crier devant la porte, et même quelques-uns entrent qui me traitent très mal... Ils prétendent que, puisqu’ils sont enrôlés, on leur doit les moyens de partir...
—Je vais leur parler... dit l’homme.
Il sortit, en effet, de son pas massif, et nous le suivîmes.
Quatre ou cinq cents volontaires au moins étaient massés devant la maison commune, chantant avec une sorte de frénésie le: Ça ira!...
A la vue de l’homme, ils se turent.
Lui, aussitôt, monta sur un des bancs de pierre placés à droite et à gauche de la porte, et d’une voix qui tonnait comme un bourdon de cathédrale:
—«Ce n’est pas vos chants, commença-t-il, qui chasseront les Prussiens... Que demandez-vous?»
Un seul et même cri lui répondit:
—Des armes!...
Il eut un geste si terrible qu’un frisson courut dans la foule, et avec une violence qui vous électrisait:
—«Et si j’en pouvais faire avec ma chair vous en auriez sur l’heure... La patrie n’en a pas... Que ceux qui en veulent, volent à la frontière... Là, chaque soldat qui meurt laisse échapper son arme... Qu’ils la ramassent et s’en servent pour venger sa mort.»
Ces paroles, vous les trouverez dans toutes les histoires, et c’est à cette occasion qu’il les prononça.
—Vive Danton!... cria la foule.
C’était lui, que je ne connaissais pas... Vivement je me détournai pour le voir encore, il était descendu de son banc et avait disparu.
Du moment où mon père avait promis, rien au monde n’était capable de l’empêcher de tenir sa promesse, sinon l’impossibilité flagrante, le cas de force majeure.
Il avait dit qu’il équiperait et armerait quatre volontaires, ce fut désormais son unique préoccupation.
Le malheur est qu’il n’y avait à Paris ni équipements ni armes.
Et ici, mes amis, je ne vous parle pas d’équipements d’une certaine façon plutôt que de telle autre, je ne vous parle pas d’armes particulières.
A la lettre, il était impossible de se rien procurer de ce qui est indispensable à un soldat.
Les boutiques des armuriers étaient vides; vides, les magasins de fabricants d’uniformes.
Quant à trouver un ouvrier qui consentit à travailler de son métier, il n’y fallait pas songer.
L’atelier avait été déserté pour la place publique, pour les cafés et les cabarets, pour les abords de l’Assemblée nationale.
La terrasse des Feuillants était trop étroite pour les groupes qui s’y tassaient et qu’eut vainement essayé de disperser la garde nationale.
Que faisait dehors, me demanderez-vous, tout ce peuple de la capitale?...
Rien!...
Remué jusqu’en ses profondeurs, jusqu’en ses boues, haletant d’angoisses, dévoré de soupçons, il se débattait dans le vide, triomphant ou consterné, selon qu’un imbécile criait: victoire! ou: sauve qui peut!...
On attendait surtout des nouvelles.
Nouvelles de qui, de quoi, d’où?...
Est-ce qu’on savait!...
Il ne s’était rien passé... n’importe! On voulait le bulletin du néant...
Et de toutes les bornes un orateur surgissait, demandait ce qu’on avait fait, disant ce qu’on eût dû faire, déclarant absurdes toutes les mesures et s’offrant carrément de sauver la patrie, si on voulait avoir confiance en lui...
Voilà comment vers la fin d’août nous étions encore à Paris, Fougeroux et moi et les deux volontaires dont s’était chargé mon père, et qui étaient un serrurier et un clerc de procureur de notre quartier.
Mais que de choses, que d’événements pendant ce mois, qui nous parut, à nous impatients, aussi long qu’un siècle.
Les Marseillais étaient arrivés à Paris, le dix août avait eu lieu, et Danton, selon son expression, avait été porté au ministère par un boulet de canon; Danton, l’homme qui proposait aux enrôlés enragés de combattre, de courir au champ de bataille pour s’y armer des fusils des morts...
Les Marseillais dont je vous parle étaient cinq cents volontaires, qui, pour répondre à l’appel de Barbaroux et de Rebecqui, députés des Bouches-du-Rhône, venaient de traverser la France.
Ils étaient arrivés à Paris le 30 juillet, et il me semble les voir encore à la barrière de Charenton, reçus par deux bataillons de fédérés des départements, et par une députation de Jacobins, ayant en tête Héron, de la Bretagne, et Fournier l’Américain...
Quel fut leur rôle, à Paris, j’étais trop jeune pour le bien comprendre.
Ce que je vis, c’est que ces méridionaux, exaltés par les ovations qui les avaient accueillis tout le long d’une route de plus de deux cents lieues, se laissèrent aller à de certains excès regrettables.
Il y en eut qui, dans les rues, arrachaient aux passants les cocardes de soie tricolore qu’ils portaient au chapeau, les obligeant à y substituer des cocardes de laine.
Puis, un soir, à la suite d’un banquet qui leur avait été offert aux Champs-Elysées, ils dégainèrent et se jetèrent sur des grenadiers de la section des Filles-Saint-Thomas et des Petits-Pères.
Mais il faut tout dire...
Pendant que les Marseillais buvaient au salut de la patrie, et à la victoire de nos soldats, à un restaurant qu’on appelait: Le grand Salon du couronnement de la Constitution, ils avaient entendu partir d’une guinguette voisine, nommée le Jardin royal, des éclats de rire moqueurs et des cris de: Vive le roi!
Cruellement offensés en leur patriotisme, se croyant insultés et bravés, ils avaient brisé les treillages qui séparaient les deux établissements, et une lutte s’était engagée, lutte fratricide, à laquelle applaudissait une héroïne alors aussi célèbre que Théroigne de Méricourt, la fameuse reine Audu.
J’étais aux Champs-Elysées, ce soir-là, avec mon père et mon parrain, et ce n’est pas sans un frisson que je vis ce dernier se jeter au plus fort de la mêlée pour séparer les combattants.
Ils ignoraient qui il était, et des deux côtés on appuyait des canons de pistolet sur ses tempes et on le menaçait d’épées nues.
Mais que lui importait la mort, à ce député de Paris... Qui sait même si son souhait le plus ardent n’était pas de mourir ainsi sur le champ d’honneur du devoir.
Ah! c’était un spectacle terrible que de voir cet homme à cheveux blancs, la tête nue, les habits en désordre, ballotté entre ces furieux en armes, rempart vivant entre ces haines furibondes, impassible quand sa chair eût dû frémir au contact glacé du fer.
Pour lui, offrir sa poitrine n’était pas une figure de rhétorique.
Il voulait parler, il parla... Il sut contraindre à l’écouter ces hommes qui semblaient incapables de rien entendre...
«Insensés, leur criait-il, ne comprenez-vous donc pas que nos discordes sont la joie de nos ennemis et font toute leur audace!... Quoi! pendant que nos volontaires pleurent de rage de n’avoir pas d’armes, vous, assez heureux pour en posséder, vous les tournez les uns contre les autres!... Le flot de l’invasion monte, et pour un vivat vous en venez aux mains!... Faut-il donc que je vous relise l’insultant manifeste de Brunswick!... La France ne doit plus avoir qu’une pensée, qu’une haine, qu’un cri: dehors les barbares!... Il serait voué à l’exécration des races futures, le malheureux qui verserait une goutte de sang Français, pendant que les Prussiens souillent notre sol.»
Mais ce n’est que bien imparfaitement que je vous traduis les paroles de mon parrain... Tous les journaux d’alors les rapportèrent, et on pourrait les y retrouver...
Ce que je puis vous dire, c’est que je vis les sabres rentrer au fourreau, honteux d’en être sortis... C’est que les Marseillais voulurent rendre hommage à l’homme courageux qui les avait rappelés au devoir, c’est qu’ils l’escortèrent jusqu’à sa maison en chantant l’hymne sublime dont ils firent, les premiers, retentir les échos de Paris...
Cet hymne, mes amis, c’était la Marseillaise.
Comment il fut trouvé, ce chant sacré de la patrie armée, à Strasbourg, à deux pas de l’ennemi, dans l’atmosphère brûlante des bataillons volontaires... nul ne l’ignore.
Les volontaires partaient le lendemain au jour, pour marcher à l’ennemi... Le maire de Strasbourg, Diétrich, les réunit à un banquet où vinrent leur serrer la main les officiers de la garnison... Les demoiselles Diétrich et nombre de jeunes filles de l’Alsace, assistaient à ce repas d’adieu, quelques-unes le cœur bien gros et dissimulant mal leurs larmes.
Vers la fin, pendant que se choquaient les verres, on voulut chanter des chants patriotiques... mais lesquels?... Ce n’était pas la sauvage Carmagnole ni le colérique Ça ira! qui pouvaient traduire les émotions de ces convives unis en une communion fraternelle avant d’affronter, au nom sacré de la liberté, les balles de l’ennemi...
On chercha un refrain, et un des volontaires s’écria: «Aux armes!...»
«Aux armes!...» Ces deux mots disaient tout. Un officier de vingt ans, Rouget de l’Isle, s’en empara... Il se précipite dehors et l’instant d’après le visage inspiré par le génie de la révolution, il rentrait en chantant:
Ce fut comme un éclair du ciel... Ce chant qu’ils entendaient pour la première fois, ils le reconnurent, ils le savaient en quittant la table, ils le répandirent par toute la France, par le monde entier...
Et certes, il était temps qu’il fût trouvé l’hymne de la patrie en danger, le chant qui électrise les bataillons et gagne les batailles...
Les Prussiens avaient marché, pendant le mois d’août...
Le 27, on apprit à Paris qu’ils avaient passé la frontière, qu’ils avaient impitoyablement pendu à Sierck quelques pauvres paysans coupables d’avoir défendu leur pays, et enfin qu’ils s’étaient emparés de Longwy.
Paris eut un instant de stupeur.
Longwy pris!... Longwy au pouvoir des Prussiens!...
Allons donc!... Personne n’y voulait croire... Les prophètes de malheur de la veille étaient devenus les plus obstinés sceptiques du lendemain.
Longwy, disait-on, était défendu par des soldats français, donc les Prussiens n’y sont pas...
Ceux-là même qui avaient proclamé le danger de la patrie doutaient... Car en le proclamant, c’est à peine s’ils y croyaient, ou du moins ils le supposaient bien éloigné encore. Ils avaient voulu surtout prendre leurs précautions contre l’improbable. Et pas du tout, ce qui de leur part n’avait été qu’un acte de prévoyance devenait une mesure de salut.
Car à la fin, il fallut bien se rendre à l’évidence.
La nouvelle apportée par un courrier ne tarda pas à être confirmée de dix côtés à la fois.
Les Prussiens étaient bien réellement à Longwy.
Oh! mes amis, j’assistai ce jour-là à un mouvement sublime. Foulé le long du Rhin par le sabot des chevaux barbares, le sol de la patrie tressaillit jusqu’à la Méditerranée.
De même que s’il eût ressenti la secousse d’un tremblement de terre, chaque citoyen s’élança hors de sa maison, ses armes à la main, éperdu de colère et criant:
—Où sont-ils?
Puis, les esprits se mirent à rechercher les causes de cette défaite inouïe, et un mot effrayant vola de bouche en bouche, murmure d’abord, bientôt clameur immense...
—Trahison!... trahison!...
On se compta, chacun d’un œil défiant interrogea les yeux de son voisin...
On se dit que parmi nous, généreux et faciles, beaucoup vivaient pour qui notre premier échec était un premier triomphe, et qui, secrètement, se frottaient les mains pendant que nous avions peine à retenir des larmes de douleur et de rage.
Et après avoir crié: trahison, on cria:
—Justice! justice!...
Mais où chercher la vérité, où prendre des renseignements, comment se procurer des détails... des détails minutieux, infinis?...
Pour calmer l’angoisse publique, il n’y avait rien que la dépêche affichée aux districts, dont l’effrayant laconisme ouvrait le champ aux plus lamentables suppositions...
Les Prussiens occupent Longwy...
Par l’éducation que m’avait donnée mon bon et honnête père, j’étais de notre maison et de celle des voisins, le plus apte à donner des indications sur cette ville de Longwy, sur sa situation, sur son importance...
J’étais donc occupé à chercher dans mes livres de quoi satisfaire, de quoi tromper, plutôt, la curiosité de tous, lorsque M. Goguereau arriva chez nous, suivi d’un tout jeune homme, je suis sûr qu’il n’avait pas vingt ans, revêtu de l’uniforme de l’artillerie, chaussé de fortes bottes et crotté jusqu’à l’échine...
C’était un des courriers expédiés à l’Assemblée nationale, qui avait assisté à l’affaire de Longwy, et que mon parrain sachant nous être agréables, avait invité à dîner chez nous.
Par ce jeune officier, nous sûmes tout ce qui s’était passé...
C’était le 19 août 1792, que l’armée prussienne avait franchi la frontière, s’avançant du côté de Longwy.
Le roi de Prusse et le duc de Brunswick conduisaient l’avant-garde, l’armée suivait par lignes.
La première ligne s’arrêta vers les bois de Chenière, ayant Longwy à dos, couvrant ainsi la place comme un corps d’observation.
La seconde ligne campa sur les hauteurs en face de la ville.
Puis, entre ces deux corps, et aux extrémités, se massèrent les dragons de Bareith, de Lothum et de Normann; les cuirassiers de Weymar et d’Ilow...
La forteresse de Longwy était alors un hexagone, avec cinq demi lunes et un ouvrage à corne du côté de Saint-Marc. Les casemates y étaient dans le meilleur état, soixante-douze pièces de canon étaient en batterie sur les remparts et les magasins étaient abondamment pourvus de vivres et de munitions.
Avec de tels moyens de défense, il n’était pas un seul des dix-huit cents soldats composant la garnison qui ne fût persuadé que le commandant Lavergne allait faire une longue et glorieuse résistance.
Le jour même, cependant, de l’investissement de la place, le roi de Prusse fit sommer le gouverneur Lavergne de se rendre... Il répondit, en présence de la garnison, qu’il tiendrait tant qu’il aurait un biscuit, un boulet et un homme valide.
Seconde sommation, le lendemain... même fière réponse.
Les Prussiens annoncèrent donc qu’ils allaient bombarder la ville.
C’était le colonel du génie Tempelhof, qui avait été chargé de conduire les opérations du siége.
Le 21, dans la journée, il fit établir deux batteries de quatre obusiers, et le soir, sur les sept heures, à la tombée de la nuit, il ouvrit le feu.
Il n’endommagea que fort peu la place...
L’obscurité profonde de la nuit l’empêchait de calculer ses distances et une pluie torrentielle empêchait absolument l’effet de ses obus...
De son côté, la garnison de Longwy riposta par un feu très vif, mais si mal dirigé, par suite de la jeunesse et de l’inexpérience des canonniers, que les Prussiens en souffrirent très peu...
Suspendu vers les trois heures du matin, le bombardement recommença dès qu’il fit jour...
A huit heures, il était dans toute sa violence...
Mais les défenseurs de la place ne s’en étonnaient pas. En quelques heures, ils avaient acquis une certaine habileté; les officiers pointaient les pièces et les boulets commençaient à n’être plus perdus...
Voilà où en était le siége quand, un peu avant neuf heures, huit ou dix bombes, tombant presque simultanément dans la place, tuèrent une douzaine d’habitants, hommes et femmes, et mirent le feu à deux maisons et à un magasin à fourrages.
Épouvantés de ces premiers désastres, les habitants s’assemblent tumultueusement, et demandent à grands cris qu’on ouvre les portes aux Prussiens plutôt que de laisser incendier la ville.
Menacés de mort par ces lâches, indignes du nom de Français, les magistrats qui font partie du conseil de défense, prennent peur à leur tour, se réunissent en hâte et se rendent chez le gouverneur pour le sommer de capituler.
Lavergne leur résista d’abord, essayant de prouver qu’ils se trouvaient sous le coup des menaces de la proclamation du duc de Brunswick, puisque en somme, peu ou prou, ils se sont défendus.
Deux d’entre eux ripostent en ricanant qu’ils sauront bien s’arranger avec les Prussiens.
Lavergne, alors, demande à consulter les officiers placés sous ses ordres. Il les envoie quérir aux remparts où ils faisaient leur devoir, et leur expose la situation.
Tous, d’une même voix répondent que se rendre serait une abominable lâcheté.
Persuadés que leur commandant est de leur avis, ils se retirent... Mais lui, revenu près des magistrats, se laisse convaincre, envoie secrètement un parlementaire aux avant-postes ennemis, et signe la capitulation qui livre Longwy au roi de Prusse.
Tout ce qu’on lui avait accordé, c’était que la garnison sortirait avec les honneurs de la guerre le lendemain 23.
Un seul des magistrats avait refusé d’apposer sa signature au bas de cet acte infâme...
Les habitants mirent le feu à sa maison et le commandant prussien le condamna à être pendu séance tenante...
Déjà, il avait autour du cou la corde fatale, quand soudain le clou se détache... Il tombe de la hauteur du second étage, se relève sans blessures, prend sa course et disparaît avant que ses bourreaux soient revenus de leur étonnement.
Le lendemain, cet homme courageux réussissait à gagner sain et sauf l’armée française où on le nommait capitaine en récompense de sa belle conduite...
Telle est, mes amis, la douloureuse histoire de la capitulation de Longwy, telle que nous la racontait l’hôte de mon père, un de ces intrépides volontaires qu’elle avait réduit à mettre bas les armes sans combat...
Je crois le voir encore, cet officier de vingt ans, tel qu’il m’apparut ce soir-là.
Les larmes de rage que lui avait arrachées l’humiliation n’étaient pas sèches encore, et on comprenait à son accent qu’il n’avait plus au monde qu’une ambition, qu’un espoir: prendre une revanche éclatante, terrible.
—Demain, nous disait-il, je repars pour l’armée rejoindre mes camarades, et ce que nous avons souffert, ah! il faudra bien que les Prussiens nous le payent!...
Puis, revenant sur les circonstances de la capitulation:
—Et cependant, poursuivait-il, les Prussiens ne nous ont pas vaincus... La forteresse qu’ils nous ont prise, ils l’avaient achetée... Car, voyez-vous, rien ne m’ôtera de l’idée que tout était, d’avance, arrêté, convenu et payé... Ce bombardement de six heures qui n’a aucunement endommagé la ville... comédie! Cette émeute de bourgeois, cette réunion du conseil de défense, le semblant de résistance du commandant de place Lavergne... comédie. Il fallait bien tromper la garnison, puisqu’il n’y avait aucune chance de la corrompre... Et pendant que nous autres, pauvres soldats naïfs, nous ne songions qu’à faire notre devoir, résolus à mourir sur la brèche, les traîtres ouvraient une poterne à l’ennemi et nous livraient...
Tous, peu à peu, nous avions été gagnés par la douleur et l’indignation de notre hôte...
Ma mère pleurait. Fougeroux, dans un coin, étouffait des blasphèmes en crispant ses redoutables poings. Quant à mon parrain, dont j’épiais non sans anxiété les impressions, je voyais son visage s’assombrir de plus en plus.
—Peut-être avez-vous raison, jeune homme, dit-il à l’officier, peut-être, en effet, y a-t-il eu trahison...
Mais mon père l’interrompant:
—Quoi!... s’écria-t-il, vous doutez, mon vieil ami!... moi, non! Résolus à violer notre territoire avec l’espoir de nous en arracher un lambeau, les Prussiens ont prodigué l’or avant d’oser employer le fer... Une ténébreuse invasion de traîtres a précédé et préparé l’invasion armée... Trop loyaux pour soupçonner une telle perfidie, nous avons accueilli leurs espions en amis, nous leur avons accordé notre confiance et ils vivent au milieu de nous, écoutant nos délibérations, guettant nos mouvements, cherchant à deviner nos projets les plus secrets, pour les dévoiler... Ils nous entourent, n’attendent que l’heure de tendre la main à qui paye leur infâmie, prêts à voler pour les vendre les clés de nos poternes, prêts à enclouer nos canons... Ah! pas de merci pour de tels misérables... Auriez-vous donc pitié de l’infâme à qui vous auriez donné un abri sous votre toit, une place à votre table, et qui, pour prix de votre hospitalité, la nuit, pendant votre sommeil, irait à pas de loup ouvrir la porte de votre maison à une bande d’assassins!...
La colère emportait mon père au delà, peut-être, de l’exacte réalité, mais il ne se trompait pas...
Trois jours plus tard, Paris eut une preuve irrécusable de la trahison qui avait ouvert Longwy aux Prussiens.
Le 31 août 1792, Guadet, le député Girondin, chargé du rapport de cette affaire honteuse, monta à la tribune, et dit:
«On a découvert dans les papiers de M. Lavergne une lettre qu’on lui adressait du camp ennemi, datée de l’avant-veille de l’investissement de la place, et qui contient ces dégradantes exhortations.
»Vous ne balancerez pas, sans doute, entre le parti de servir notre cause ou d’être le stipendié de Pétion... Vous savez que votre femme est désolée, qu’elle vous a écrit plusieurs fois... Je suis chargé de la part de S. M. le roi de Prusse et du duc de Brunswick de vous assurer que votre zèle pour nos intérêts ne restera pas sans récompense...
Mais l’indignation de l’Assemblée nationale n’avait pas attendu pour éclater la découverte de ce document accusateur.
»Pour un soldat, pour un Français, n’était-ce pas déjà trahir que de s’avouer vaincu sans combat!...»
L’Assemblée publia cette brève proclamation:
«Citoyens, la place de Longwy vient d’être rendue ou livrée... Les Prussiens s’avancent... Peut-être se flattent-ils de trouver partout des incapables, des lâches ou bien des traîtres, ils se trompent... La patrie vous appelle, partez...»
Et voici le décret qu’elle rendait le même jour:
«Tout citoyen qui, dans une ville assiégée, parlera de se rendre, sera puni de mort...»
La France entière applaudit à ce décret, qui nous paraissait, à tous, inspiré par le génie même de la liberté.
De plus, l’Assemblée avait décidé:
Que la ville de Longwy serait rasée.
Que ses habitants seraient, pendant dix ans, privés de leurs droits civils...
Que les citoyens qui ne marcheraient pas à l’ennemi seraient obligés de remettre leur fusil aux citoyens prêts à partir pour la frontière...
Cependant, il était des gens que rien ne semblait rassurer, ni l’énergie de l’Assemblée, ni le nombre des volontaires, ni l’admirable spectacle de la France debout en armes...
M. Laloi, comme de raison, était de ce nombre.
A toutes les mesures de salut, on le voyait hocher la tête et répéter:
—Je n’ai pas confiance... Non, je n’ai pas confiance du tout.
Jusqu’à ce qu’un soir je le vis arriver dans notre boutique, brandissant une douzaine de feuilles de papier.
—Lisez-moi cela, me dit-il, et nous verrons si vous m’appellerez encore alarmiste...
C’était une douzaine de pages d’une méchante histoire de Frédéric-le-Grand, que M. Laloi avait trouvées parmi les vieilles paperasses qu’il achetait à la livre pour envelopper ses épiceries.
Lorsqu’il vit que je les avais parcourues:
—Eh bien!... me demanda-t-il.
—Quoi?...
—Comment, quoi!... vous ne comprenez donc pas ce qui est imprimé là?... La Prusse est comme qui dirait un immense camp retranché, dont chaque ville est une caserne et chaque maison un poste. Tous les Prussiens sont militaires dès la mamelle et passent leur vie à faire l’exercice. C’est un de leurs rois, Frédéric-le-Grand, qui les a organisés comme cela, pour qu’ils pussent un jour conquérir le monde entier... Vous n’avez donc pas vu que ce roi dépensait des sommes immenses pour attirer de tous les coins de l’Europe les hommes les plus grands et les plus forts dont il faisait des grenadiers. Il les forçait ensuite à épouser des espèces de géantes, et obtenait de ces unions des soldats d’une taille et d’une force exceptionnelles. Eh bien! cher monsieur Justin, voilà les troupes qui nous attaquent. Là, de bonne foi, comment voulez-vous que nous leur résistions!
Je ne pouvais m’empêcher de sourire encore que je n’en eusse guère envie.
—Que faudrait-il donc faire, selon vous, cher M. Laloi, demandai-je...
Il rougit légèrement, et avec un embarras visible:
—Dame!... bégaya-t-il, je ne sais pas, moi... Il me semble que si les Prussiens n’étaient pas trop exigeants...
—Halte-là!... interrompit une voix terrible... Vous proposez de capituler?... Rappelez-vous le décret: peine de mort!...
Déjà M. Laloi, épouvanté, s’était précipité dehors, sans avoir eu le temps de reconnaître que c’était mon père qui se moquait de lui.
Malheureusement, tous les alarmistes n’étaient pas de si facile composition.
Et Dieu sait s’il y en avait, de ces gens qui, soit pusillanimité, soit affectation de sagesse, soit enfin on ne sait quel inqualifiable sentiment, prenaient à tâche de semer autour d’eux le découragement...
Qui s’en allaient évoquant de ces terreurs qui enfantent la panique des armées et les grands crimes politiques des peuples au désespoir...
C’était à croire que les Prussiens étaient des ogres, et nous des enfants dont ils n’allaient faire qu’une bouchée.
D’après eux, songer, non pas à vaincre, mais à résister seulement, était folie... Nos armées, ils les diminuaient jusqu’à zéro, multipliant au contraire jusqu’à l’absurde, les bataillions ennemis... Selon leurs calculs, les Prussiens n’étaient plus quatre-vingt-dix mille, mais cinq cent mille, un million, plusieurs millions...
Et ils vous les montraient partout à la fois, sur tous les points du territoire... ici, là, ailleurs encore... Ce n’était plus seulement Longwy qu’ils tenaient, mais deux autres places fortes... toutes nos places fortes...
Hélas!... L’événement sembla donner raison à leurs sinistres prévisions.
Un matin, Paris, à son réveil, apprit que Verdun venait de capituler...
C’est par la relation d’un officier du Maine-et-Loire, qui faisait partie de la garnison de Verdun, que Paris apprit, en même temps que la reddition de la place, les détails de ce nouveau malheur.
Apportée par un courrier qui avait franchi en trente-deux heures les soixante-cinq lieues qui séparent Verdun de Paris, cette relation avait été imprimée dans la nuit, et, dès sept heures du matin, on l’avait distribuée à des vendeurs qui se répandirent par la ville, criant tout le long des rues:
—Achetez ce qui vient de paraître: la capitulation de la ville et de la citadelle de Verdun, contenant l’exposé des faits de guerre et le récit du patriotisme du commandant de place...
Ainsi, du moins, on n’eut pas comme pour Longwy le tourment de l’incertitude.
La France entière connut le désastre dans toute son étendue, avec les circonstances capables de l’alléger ou de le rendre plus douloureux.
Ecrite par un homme du métier, cette relation avait de plus cet avantage de nous donner une idée exacte des opérations, des intentions et des espérances de nos ennemis.
Maître de la place de Longwy, au lieu de profiter de ce premier avantage pour se porter en avant, le duc de Brunswick avait perdu plusieurs jours dans le camp retranché qu’il avait établi autour de la place.
Pressé par son maître, le roi de Prusse et par les émigrés qui encombraient son quartier général, de poursuivre son mouvement offensif, de marcher immédiatement sur Mouzon ou sur Sedan, le duc de Brunswick avait résisté avec une invincible opiniâtreté.
Il lui fallait, disait-il, avant toutes choses, assurer ses communications entre Longwy et Luxembourg, rallier différents corps chargés de protéger sa marche, établir des magasins de vivres et de fourrages, et organiser des boulangeries et des équipages de ponts.
Quatre jours furent ainsi perdus pour le salut de la France.
Ce n’est que le 28 août que l’armée prussienne commença à s’ébranler. Elle coucha le soir à Longuyon et le lendemain à Etain et à Pillon.
Enfin, le 30, elle campa sur les hauteurs de Saint-Michel, situées à deux mille pas de Verdun et dominant entièrement la ville.
Les deux lignes prirent position entre Fleury et Grand Bras, pendant que les avant-postes s’étendaient jusqu’à Marville, Montmédy et Juvigny.
Le duc de Brunswick établit son quartier général à Regret et le roi de Prusse à Glorieux.
Circonstance singulière, et qui donna lieu, vous le pensez, à plus d’un jeu de mots, car le nom de ces deux villages traduisait parfaitement la disposition morale du roi et de son généralissime.
Les émigrés qui escortaient les Prussiens s’étaient, eux, installés à Hettange avec les troupes hessoises.
La place de Verdun avait, pour résister à toute cette armée, dix bastions liés entre eux par des courtines, des fossés profonds et quelques ouvrages légers sur les deux rives de la Meuse.
La citadelle, affectant la forme d’un pentagone irrégulier, était entourée d’une fausse braie.
Tous ces ouvrages avaient été laissés en assez mauvais état, mais le commandant de la place, Beaurepaire, était un homme.
Officier de carabiniers sous l’ancienne monarchie, Beaurepaire avait organisé et commandait depuis 1789 le bataillon de Maine-et-Loire.
A la première nouvelle de l’invasion, ces intrépides patriotes n’avaient pas perdu une heure en stériles discussions... Ils avaient traversé la France au pas de course et s’étaient jetés dans Verdun.
Ils avaient si bien le pressentiment que les trahisons dont la Révolution était entourée les vouaient à une mort certaine, qu’ils avaient chargé un député de porter à leur famille leur testament et leurs adieux.
Marié depuis peu de jours, les mains encore mouillées des larmes de sa jeune femme, Beaurepaire n’en était pas moins résolu à une de ces résistances enragées qui illustrent une ville et ses défenseurs.
Ses trois mille cinq cents soldats brûlaient de combattre, et le nom seul des officiers placés sous ses ordres en dit plus que tout les commentaires; ils s’appelaient Lemoine, Dufour, Marceau...
Malheureusement, les habitants de Verdun n’étaient rien moins que disposé à seconder l’héroïsme de la garnison.
Beaucoup appelaient de tous leurs vœux l’armée prussienne... Plusieurs avaient franchi les remparts sans courir au-devant d’elle... Et dès le premier jour la populace avait essayé de piller les magasins et de noyer les poudres aux cris de:
—Pas de siége!... Pas de siége!... Vivent les Prussiens!...
Le duc de Brunswick n’ignorait rien de ces dispositions.
Le 31 août, au moyen d’un pont jeté sur la Meuse, il compléta l’investissement de la place, et le roi de Prusse la fit sommer de se rendre.
—Se rendre est un mot qui n’est pas français, répondit Beaurepaire en congédiant les parlementaires.
Peu de moments après, sur les six heures du soir, le bombardement commençait.
Il dura jusqu’à une heure du matin et reprit le lendemain de trois heures jusqu’à sept.
Était-ce un bombardement véritable ou un simulacre? On pouvait douter, tant les coups étaient mal dirigés... C’est à peine si le feu prit à cinq ou six maisons.
Et cependant, les bourgeois s’assemblèrent, comme à Longwy, réclamant la capitulation, disant qu’ils ne souffriraient pas qu’on les ensevelit, eux et leurs familles, sous les ruines de leur cité.
De même qu’à Longwy, le conseil de défense se réunit, délibère et déclare qu’une plus longue résistance n’amènerait qu’une inutile effusion de sang.
En vain Beaurepaire et ses officiers s’opposent de toutes leurs forces à cette détermination...
Vainement Marceau insiste sur la nécessité de se défendre, en indique les moyens et répond du succès...
Une seconde sommation menaçant d’un assaut immédiat redouble les terreurs des lâches et exalte l’audace des traîtres, le conseil décide qu’il va capituler.
Frémissant d’indignation, Beaurepaire, une fois encore, essaie de ramener à la voix de l’honneur ces Français indignes, c’est à peine s’ils daignent l’écouter.
Alors, lui, les écrasant du regard:
—«Messieurs, dit-il, j’ai juré de mourir plutôt que de me rendre... survivez à votre ignominie, puisque vous en avez le courage... Moi je meurs...»
Et il se brûle la cervelle...
Eh bien! mes amis, ce trait d’héroïsme qui valut à Beaurepaire les honneurs du Panthéon, un nom immortel et l’admiration passionnée de la France, n’émut pas les bourgeois du conseil de défense...
Ils osèrent enjamber ce cadavre pour porter au roi de Prusse les clés de Verdun.
Le chef de bataillon Lemoine avait bien eu le temps de se jeter dans la citadelle avec quelques soldats de Maine-et-Loire, mais ils manquaient de pain, d’eau et de poudre... Force leur fut de capituler...
Et le lendemain, quand le roi de Prusse entra dans Verdun, vingt jeunes filles vêtues de blanc s’avancèrent au-devant de lui, jonchant le sol de fleurs effeuillées, sous le sabot de son cheval...
Cependant le lieutenant-colonel de Noyon, à qui revenait après la mort de Beaurepaire le commandement en chef, sut obtenir pour ses soldats des conditions honorables.
La garnison sortit avec tous les honneurs de la guerre, tambours battants, enseignes déployées, emportant ses armes et ses bagages, traînant deux pièces de quatre avec leurs caissons, et un fourgon qui renfermait le corps de l’héroïque Beaurepaire.
Debout devant une des portes, à l’avancée, entouré de son état-major, le roi de Prusse regardait défiler ces fiers soldats, lorsqu’il remarqua un chef de bataillon qui marchait à pied, vêtu d’un uniforme déchiré, sans manteau, sans armes...
Il s’informe, et apprenant que cet officier a perdu ses bagages, qu’on lui a tout pillé, il s’approche et lui demande:
—Que voulez-vous qu’on vous rende?
Mais l’autre, le regardant avec des yeux enflammés, dit simplement:
—Mon sabre.
Cet officier c’était Marceau.
Vous le voyez, mes amis, la France déchirée et saignante avait encore le droit d’être fière de ses enfants.
Mais le coup était si terrible qu’on n’apercevait que le résultat.
La trahison de Longwy avait été un malheur, un accident, en quelque sorte, dont on avait pris son parti.
La capitulation de Verdun parut un désastre irréparable.
—Combien y a-t-il de lieues de Verdun à Paris? voilà ce que de tous côtés vous demandaient des gens effarés.
Et quand vous leur répondiez:
—Soixante-cinq.
C’était comme si vous leur eussiez coupé bras et jambes, et consternés ils s’éloignaient en trébuchant.
Pourquoi ne vous le dirais-je pas, mes amis?...
Ce temps que j’évoque eut trop de grandeurs pour qu’il soit utile de dissimuler ou d’atténuer ses faiblesses...
Paris fut terrifié... Paris fut saisi du vertige honteux de la peur... Paris vit les Prussiens à ses portes...
Alors, toutes les sinistres prophéties semées par les alarmistes levèrent et portèrent leurs fruits.
Sept ou huit cents personnes s’enfuirent de la capitale dans la journée, emportant ce qu’elles avaient de plus précieux.
Le prix des voitures haussa pour ainsi dire d’heure en heure...
A midi, un de nos voisins paya mille livres en assignats une méchante carriole attelée de deux rosses, qui devait le conduire avec sa famille jusqu’à Orléans.
Le récit de ce qui se passait au conseil des ministres et dans certaines réunions de députés, ne contribuait pas peu à augmenter l’épouvante.
On affirmait que les Girondins—et ce n’était cependant pas des lâches—s’étaient écriés à la nouvelle du désastre:
—Abandonnons Paris aux Prussiens... Portons dans le Midi la statue de la liberté!...
Roland, le ministre de l’intérieur, avait dit, prétendait-on:
—Les nouvelles sont alarmantes, il faut que les ministres et l’Assemblée quittent Paris!...
—Pour aller où?... demanda Danton.
—A Blois, et nous emmènerons le trésor et le roi...
Clavières et Servan avaient appuyé la proposition de Roland, et aussi et surtout le député Kersaint, admis à cette conférence parce qu’il arrivait de Sedan, où il avait été envoyé en mission.
—Oui, il faut partir, s’était écrié Kersaint, car il est aussi impossible que dans quinze jours Brunswick ne soit pas à Paris, qu’il l’est que le coin n’entre pas dans la bûche quand on frappe dessus...
Ces bruits étaient exacts, de même qu’il était parfaitement vrai que Danton, à force de passion et d’éloquence, avait obtenu qu’on ne prit aucune détermination...
Aussi dans tous les groupes entendait-on dire:
—Avant huit jours... avant trois jours... demain, les Prussiens seront à Paris, et Dieu sait ce qu’ils feront de nous!...
Les menaces du manifeste du duc de Brunswick troublaient toutes les cervelles.
Ne déclarait-il pas qu’il traiterait comme rebelle, qu’il jugerait et exécuterait sommairement tous les Français qui OSERAIENT se défendre, tous les Français qui avaient embrassé la cause de la Révolution!...
Autant dire qu’il exterminerait Paris, qu’il l’anéantirait...
—Et c’est ce qu’il fera, disaient les trembleurs blêmes, «toute la population, de même que les troupeaux qu’on mène à l’abattoir, sera conduite dans la plaine Saint-Denis, et mitraillée sans triage, sans distinction d’âge, de sexe et de rang...»
Vous le voyez, mes amis, quels que soient les temps, les mêmes calamités rappellent les mêmes effarements...
Nous étions à la fin du dix-huitième siècle, nous nous étions armé du scepticisme de Voltaire, et cependant nous reculions soudainement jusqu’aux époques de Charles VI, alors que l’Anglais envahissait la France... Que dis-je!... Nous reculions jusqu’aux invasions barbares, en ces temps où les foules saisies de panique s’enfuyaient en criant:
—Voilà les barbares!... C’est le fléau de Dieu qui approche, c’est le jugement dernier!...
Danton était inaccessible à ces terreurs.
Au sortir du conseil des ministres, il s’était rendu à l’hôtel de ville.
Là, il rassemble la Commune, et Manuel, le procureur-syndic, inspiré par lui, se lève et propose que, «tous les citoyens en état de porter les armes se réunissent au Champ-de-Mars, y campent, et le lendemain marchent sur Verdun pour purger le sol français des barbares qui le souillent, ou mourir...»
La commune décrète ensuite.
Que tous les chevaux de luxe pouvant servir aux volontaires qui partent pour la frontière seront requis...
Qu’un état sera dressé des hommes prêts à partir...
Que le canon d’alarme sera tiré sans discontinuer, le tocsin sonné, la générale battue...
Informée des mesures que vient de prendre la commune pour la levée en masse, l’Assemblée bat des mains...
Et Vergniaud, le grand orateur de la Gironde, dont le génie croît avec le danger de la patrie, s’élance à la tribune et dit:
«Il paraît que le plan des Prussiens est de marcher droit sur Paris en laissant les places fortes derrière eux... Eh bien! ce projet fera notre salut et leur perte... Nos armées, trop faibles pour leur résister, seront assez fortes pour les harceler sur leurs derrières; et tandis qu’ils arriveront poursuivis par nos bataillons, ils trouveront en leur présence l’armée parisienne, rangée en bataille sous les murs de la capitale, et, enveloppés là de toutes parts, ils seront dévorés par cette terre qu’ils avaient profanée...
»Mais au milieu de ces espérances flatteuses, il est un danger qu’il ne faut pas dissimuler, c’est celui des terreurs paniques...
»Nos ennemis y comptent et sèment l’or pour le produire...
»Et vous le savez, il est des hommes pétris d’un limon si fangeux qu’ils se décomposent à l’idée du moindre danger...
»Je voudrais qu’on put signaler cette espèce sans âme et à la figure humaine, et réunir tous les individus dans une même ville, à Longwy, par exemple, qu’on appellerait la ville des lâches, et là, devenus l’opprobre du genre humain, ils ne sèmeraient plus l’épouvante chez leurs concitoyens...
»... Ils ne nous feraient plus prendre des nains pour des géants, et la poussière qui vole devant un escadron de uhlans pour une innombrable armée...
»Parisiens, l’heure est venue de montrer votre énergie...
»Pourquoi vos retranchements ne sont-ils pas avancés?...
»Où sont les bêches et les pioches qui ont pour notre grande solennité d’il y a deux ans, bouleversé le Champ-de-Mars?
»Vous avez montré pour les fêtes une grande ardeur... En auriez-vous donc moins pour les combats?...
»Vous avez célébré, acclamé, chanté la liberté... Il faut maintenant la défendre...
»Ce n’est plus des statues qu’il s’agit de renverser, mais un monarque de chair et d’os, le roi de Prusse, armé de toute sa puissance...
»Je demande donc que l’Assemblée nationale donne le premier exemple et envoie douze commissaires, non pour faire des exhortations, mais pour travailler eux-mêmes, et piocher de leurs mains à la face de tous les citoyens...»
Des applaudissements frénétiques saluent les dernières paroles de Vergniaud.
Sa proposition est votée d’enthousiasme, et un autre orateur lui succède à la tribune: Danton.
D’une voix brève et saccadée il rend compte des mesures de salut prises par la Commune, puis, avec ce geste impérieux qui imposait aux foules ses terribles volontés:
»Une partie du peuple, poursuit-il, va se porter aux frontières, une autre va creuser des retranchements et la troisième, avec des piques, défendra l’intérieur de nos villes.
»Mais ce n’est pas assez: il faut envoyer partout des commissaires et des courriers pour engager la France entière à imiter Paris; il faut rendre un décret par lequel tout citoyen soit obligé, sous peine de mort, de servir de sa personne ou de remettre ses armes...»
Il était deux heures, à ce moment.
Le canon venait de commencer à tonner aux quatre coins de Paris; toutes les cloches jetaient au vent les lamentations du tocsin, la générale battait dans les rues...
Danton s’interrompit, levant la main comme pour dire:
—Écoutez...
Et durant plus de deux minutes, il y eut dans l’Assemblée et dans les tribunes publiques un silence solennel, comme celui qui se fait autour du lit d’un agonisant.
Alors, lui, de l’accent d’une indomptable énergie:
«Le canon que vous entendez, s’écria-t-il, n’est pas le canon d’alarme... c’est le pas de charge sur les ennemis de la patrie... Pour les vaincre, pour les atterrer, que faut-il? De l’audace, et la France sera sauvée!...»
Ah! mes amis, ce cri sublime du tragique orateur de la Révolution, pour Paris, pour la France entière, ce fut le cri de la patrie...
Consternée la veille, la grande ville se redressa, saisie d’un désespoir furieux, plus que jamais menaçante et terrible, honteuse de sa panique et résolue à la faire payer cher aux Prussiens...
C’est que chacun de nous ne sentait que trop qu’il s’agissait de bien plus que la vie...
C’était le patrimoine de nos droits et de nos libertés qui allait être l’enjeu de cette suprême partie, ce patrimoine si chèrement acquis, payé de tant et de si immenses sacrifices.
Songer qu’on tomberait sous le fer du vainqueur après avoir subi son insolence, après avoir eu peut-être sa maison en flammes et sa famille outragée, c’était déjà horrible, n’est-ce pas?...
Ce n’était rien, comparé à cette pensée qui nous poignait le cœur, qu’il allait s’éteindre sous le pied des chevaux Prussiens, ce foyer d’une civilisation nouvelle, qui de Paris rayonnait sur le monde.
C’est ainsi que, dans la douleur de ces deux désastres successifs, Longwy et Verdun, la France puisa l’énergie qui devait assurer sa victoire...
Justement, le grand élan qui avait suivi la proclamation du danger de la patrie, s’était insensiblement ralenti...
Beaucoup, qui s’étaient enrôlés, hésitaient à partir... Quelques-uns discutaient la valeur de leur engagement... D’autres, qui ne cessaient de réclamer des armes aux refrains furieux du Ça ira! ne les demandaient certes pas pour voler à la frontière...
La capitulation de Verdun tomba comme de l’huile sur un feu près de s’éteindre... La flamme du patriotisme se ranima plus vive.
Et, de ce jour, je puis le dire, date le grand, le gigantesque effort.
Du matin au soir, Paris prit l’aspect d’une place forte en état de siége.
Partout du canon, des munitions, des armes, des soldats... Au Champ-de-Mars, des bataillons de volontaires s’exerçaient à la manœuvre et au maniement du fusil. Dans la plaine des Sablons, on organisait un régiment de cavalerie avec les chevaux de luxe mis en réquisition...
Le travail était prodigieux, l’activité dévorante...
La nuit, de tous côtés, on apercevait des comme des lueurs d’incendie... C’était le reflet des forges où nuit et jour on forgeait des armes.
Les églises avaient été transformées en ateliers, où des milliers de femmes travaillaient incessamment à préparer des tentes, des habits, des sacs, des effets d’équipement.
Puis, chacun, pour ainsi dire, s’était fait recruteur, prêchant la guerre sainte. Et de porte en porte, des vieillards s’en allaient, offrant aux jeunes quelque vieil uniforme, un sabre, un fusil, des cartouches...
C’est qu’ils voulaient, dans la mesure de leurs forces, parfois au delà, servir la patrie menacée, ceux qui ne pouvaient lui donner leur sang.
Les dons patriotiques affluèrent dans des proportions qui vous paraîtraient à peine croyables.
Deux hommes, à eux seuls, montèrent, armèrent et équipèrent trois escadrons de cavalerie.
Un fabricant de tissus, Lemoine, donna toute sa fortune, huit cent mille livres environ, ne réservant qu’une rente de deux cents louis, non pour lui, mais, «pour sa femme âgée et infirme.»
Gerson, un propriétaire de la Bourgogne, mit ses vignes aux enchères, pour «le prix en être versé dans les caisses de la nation,» et il se trouva un financier pour les acheter le double de leur valeur.
Des villages se cotisèrent, qui envoyèrent à l’Assemblée des sommes fabuleuses—pour le temps—des trente, des quarante, des cent vingt mille livres—et en or, pas en assignats.
Et cela mieux que tout le reste, vous dit l’universalité du mouvement et sa profondeur, et de quelle fièvre brûlait le cœur de la France.
Un paysan déterrer ses vieux louis lentement et péniblement économisés et les donner? L’héroïsme du sacrifice ne saurait aller plus loin. Quand le paysan a donné son argent, que lui importe son sang, il le prodigue...
Et sur ces listes infinies de dons patriotiques, que d’offrandes touchantes!
Ce sont de pauvres femmes de la Halle, qui apportent un jour quatre mille livres, «produit de la vente de leurs bijoux,» de leurs boucles d’oreilles, sans doute, et de leurs anneaux de mariage.
C’est une mercière de la rue Saint-Denis, qui offre sa croix d’or...
C’est une pauvre veuve qui donne une timbale et un couvert d’argent, reliques précieuses d’un enfant qu’elle a perdu.
C’est encore une jeune fille, une ouvrière, qui vend, pour en verser le prix, dix-huit livres seize sols, un dé d’or dont son fiancé lui avait fait présent...
Pendant ce temps, chaque jour partaient de Paris cinq cents, mille et jusqu’à quinze cents volontaires...
Vingt mille partirent ainsi successivement, et il y en eût eu bien d’autres si on ne les eût retenus...
L’Assemblée nationale fut obligée de renfermer et de faire garder à vue les typographes qui imprimaient le compte-rendu de ses séances.
Il fallut décréter que tels ouvriers, les serruriers, par exemple, resteraient à Paris, où ils servaient mieux la nation en forgeant des armes qu’en courant à la frontière.
Alors, véritablement, du sol de la patrie souillé par les pas de l’ennemi, surgissent des armées.
La France s’ébranla pour marcher tout entière au-devant des Prussiens, résolue à les vaincre, ne fût-ce que par le nombre, sûre de les écraser sous sa masse, fût-ce au prix de torrents de sang et de milliers de cadavres...
Mais l’immense sacrifice accepté froidement d’avance, devait être inutile.
Dans les rangs de cette armée, qui était le peuple même, marchaient encore inconnus les héros dont l’occasion allait révéler le génie.
Pour conduire à la victoire de la liberté ces légions de volontaires, partis au chant de la Marseillaise, Dieu leur devait et leur donna de ces capitaines dont un seul, en d’autres temps eût suffi pour illustrer un pays...
Il leur donna Kellerman, Macdonald, Masséna, Desaix, Hoche, Marceau, Davoust, Ney, Bernadotte, Jourdan, Augereau, Moncey, Joubert, Victor, Lefebvre, Kléber, Oudinot, Mortier, toute cette foule enfin de glorieux soldats qui enseignaient d’exemple à vaincre ou à mourir.
Je vois votre surprise, mes amis...
Vous vous demandez comment nous pouvions craindre avec de si prodigieuses ressources, comment nous doutions de la victoire, nous sentant appuyés sur tout un peuple debout...
Croyez-moi, nous étions excusables en 1792.
La France d’alors ne se peut mieux comparer qu’à ce géant qui n’ayant jamais essayé ses forces s’effrayait des menaces d’un enfant.
Nous n’avions expérimenté, nous autres, ni l’ascendant des idées, ni la puissance d’une nation qui combat pour son indépendance et ses libertés.
Nul, d’ailleurs, n’ignorait qu’une force ne vaut qu’autant qu’elle est organisée, réglée, répartie, dirigée...
Et le désordre était partout, nous nous débattions au milieu des ruines.
De l’ancienne monarchie, que nous restait-il? Rien. Ou plutôt elle ne nous avait légué que des embarras et des obstacles. Tous les ressorts étaient disloqués et rompus, de cette machine compliquée qui s’appelle un gouvernement régulier.
Et lorsque tout était à improviser, vous m’entendez, tout absolument, le temps manquait... Ce n’était pas par mois, qu’il nous fallait compter, ce n’était pas par semaines ni par jours... c’était par minutes.
Si encore l’ivresse de la liberté nouvellement conquise n’eût pas égaré les meilleurs esprits!...
Tous ces fédérés, qui arrivaient par centaines et par milliers, avaient fait le sacrifice de leurs intérêts, de leurs affections et de leur vie... nullement celui de leur volonté.
Ils prétendaient n’obéir qu’à eux seuls, c’est-à-dire aux officiers choisis et élus par eux.
Et ces officiers, si remarquables d’ailleurs que fussent leurs qualités personnelles, leur patriotisme et leur bravoure, ignoraient presque tous les premiers et les plus vulgaires éléments de l’art militaire.
Être assimilés aux troupes de ligne révoltait les volontaires... Ils se fâchaient dès qu’on leur disait que sans discipline il n’est pas d’armée, partant pas de victoire. L’idée de subordination, dans leur imagination défiante, était inséparable de l’idée de despotisme.
Je me rappelle qu’un de mes parents, un homme superbe, de vingt ans, maître corroyeur, nommé Lefort, qui avait été élu commandant d’un bataillon, disait gravement à mon père:
—Jamais les sans-culottes que je commande ne subiront les ordres d’un général, je ne les subirais pas moi-même...
—Cependant, objectait mon père, pour tenir campagne, pour livrer bataille...
—Eh bien!... qu’est-il besoin d’un général!... Je conduis mes hommes à l’ennemi... ce n’est pas difficile, n’est-ce pas?... Je commande en avant... nous nous précipitons et nous sommes vainqueurs, et nous ne sommes pas tués...
En vain, pendant tout une soirée, nous nous tuâmes, mon père et moi, à expliquer à cet entêté qu’il n’est d’efforts efficaces que ceux qui sont concertés... Vainement nous nous épuisâmes à lui démontrer qu’une bataille est une action immense dont chaque épisode doit être réglé par un chef suprême utilisant à propos toutes les ressources...
Il nous écoutait attentivement, hochant même la tête d’un air d’approbation; puis, quand nous pensions l’avoir convaincu:
—Tout cela est bel et bon, nous disait-il, mais notre idée à nous autres est de marcher comme je vous l’ai dit...
Ce n’est que deux ans plus tard, après le déblocus de Landau, si je ne m’abuse, que je revis mon parent Lefort.
Il était capitaine de grenadiers. Nous passâmes une journée ensemble, et comme je le voyais mener ses hommes un peu... militairement, je lui rappelai ses opinions et ses discours d’autrefois.
De ma vie, je n’ai vu un homme rire de meilleur cœur.
—C’est pourtant vrai, me répondit-il, je vous ai dit toutes ces bêtises-là... et le pis est que je les pensais... Ce que c’est pourtant que de vouloir raisonner sur des choses qu’on ignore!... Mais les plus courtes folies sont les meilleures, et la mienne n’a guère duré... Nous n’avions pas rejoint l’armée depuis trois fois vingt-quatre heures, que je m’étais jugé... Je rassemblai donc mes volontaires, et après leur avoir fait former le cercle: «Mes enfants, leur dis-je, pourquoi m’avez-vous nommé votre commandant? Parce que je suis un honnête homme, n’est-ce pas, un bon vivant et un gaillard que ne fera jamais bouder une balle prussienne... Je vous remercie de l’honneur... Malheureusement, comme je ne suis pas seulement capable de commander un à gauche par quatre, comme le premier caporal venu m’en remontrerait, si je vous mène au feu, je suis dans le cas de vous faire tous massacrer sans profit pour la patrie. C’est pourquoi je m’en vais de ce pas aller trouver le général en chef et le prier de nous nommer un commandant qui sache son métier et nous apprenne le nôtre, qui est de tuer le plus possible et d’être tué le moins qu’on peut... Si ça vous va, tant mieux! sinon, tant pis! Et là-dessus: Vive la nation! et rompez le cercle...» Et aussitôt dit, aussitôt fait. Kellermann nous envoya un solide lapin qui savait sa théorie comme une dévote son pater, et je devins simple grenadier comme les camarades... Un mois après j’étais sergent, me voici capitaine, avant cinq ans, si un boulet ne m’emporte pas, je serai général, et je saurai mon métier...
Mais tous les volontaires n’avaient pas ce bon sens et cette bonne foi.
Il n’y en eut que trop qui ne surent pas reconnaître ou ne voulurent pas avouer que le courage sans discipline ne sert de rien. Et Kellermann, Beurnouville et Custine n’eurent que trop à se plaindre de l’insubordination des fédérés qui arrivaient au camp de Châlons.
Il y en eut d’autres qui ne s’étaient pas parfaitement rendu compte du sacrifice qu’ils faisaient à la patrie, qui partirent pour la frontière comme pour une partie de plaisir et que les premières privations étonnèrent et irritèrent jusqu’à la révolte.
Si j’avais sous la main les journaux du mois de septembre 1792, je vous lirais une pétition qu’adressait à l’Assemblée nationale le bataillon d’une petite ville de l’ouest...
Mais je suis assez sûr de ma mémoire pour vous la citer textuellement:
«Citoyens législateurs, écrivaient ces soldats, un peu plus que naïfs, nous venons vous dénoncer notre général, qui ne peut être qu’un traître vendu aux Prussiens, ou un aristocrate...
»Voici quatre nuits qu’il nous fait coucher en plein champ, sur la terre nue, sans couverture, et cela, par une bruine épaisse qui nous mouille et nous refroidit jusqu’aux os... Aussi, sommes-nous presque tous atteints de maux de gorge...
»Ce traître, la nuit dernière, a poussé la perfidie jusqu’à nous empêcher d’allumer des feux, sous prétexte que leurs lueurs révéleraient notre position aux Prussiens... comme si se cacher de l’ennemi n’était pas indigne d’un patriote.
»Nous n’avons depuis deux jours d’autres vivres que la farine dont nous faisons une sorte de bouillie d’autant plus détestable que nous manquons totalement de sel... Pas de vin, pas de viande, pas d’eau-de-vie, rien enfin!...
»Il est clair, citoyens législateurs, que l’aristocrate qui nous commande a formé le projet exécrable de nous affaiblir, de nous exténuer, pour nous livrer plus aisément à l’ennemi...
»Nous vous demandons sa mise en jugement...»
Eh bien! mes amis, il se trouva un membre de l’Assemblée nationale, pour appuyer cette étrange pétition... Il demanda une enquête, et qui peut savoir ce qu’il eût demandé, si sa voix n’eût pas été couverte par un immense éclat de rire...
Je dois ajouter que moins de deux mois plus tard, ceux qui avaient signé la pétition ne s’en vantaient pas...
C’est vers cette époque qu’un matin des conscrits du bataillon de Saint-Laurent se présentent tumultueusement à Kellermann.
—Citoyen général, lui dit l’orateur de la troupe, on nous a donné des souliers si mal ajustés et d’un cuir si grossier que nous souffrons des pieds.
Lui les regarde, avec ce flegme étonnant qui ne le quittait jamais, et les montrant à quelques grenadiers de la Moselle debout près de lui:
—Avez-vous jamais vu, leur dit-il, des mâtins d’aristocrates pareils... La patrie leur donne des souliers et ils ne sont pas encore contents!...
...Mais c’est le côté le moins grave et même comique, en quelque sorte, de notre situation, que je vous expose ici...
Ces conscrits qu’effrayait un rhume, qui s’indignaient parce que leurs chaussures les blessaitent, baptisés au feu de Valmy et de Jemmapes, allaient devenir ces grenadiers indomptables qui, vingt années durant, promenèrent à travers l’Europe, dans les plis de notre drapeau tricolore, nos idées d’affranchissement et de liberté.
Nous avions, en 1792, d’autres sujets d’inquiétude.
Si prodigieux avait été le mouvement d’hommes provoqué par les appels de l’Assemblée nationale, que le nombre constituait presque un danger...
L’armée risquait de devenir cohue.
Dans leur empressement d’accueillir quiconque se présentait pour défendre la patrie, les municipalités avaient trop oublié qu’un soldat doit être en état de porter l’arme qui lui est confiée, et de s’en servir avec succès.
Des feuilles de route avaient été délivrées sans discernement ni mesure à un nombre incroyable d’enfants, de vieillards et d’infirmes, qui, bien loin d’être utiles, paralysaient tous les efforts des organisateurs de la défense.
Le 20 août 1792, un mois jour pour jour avant Valmy, Kellermann écrivait aux commissaires de l’Assemblée:
«Si le patriotisme suffisait pour faire mordre la poussière à l’ennemi, je vous dirais que nous pouvons braver l’Europe. Malheureusement, il n’est pas d’enthousiasme, si brûlant qu’on le suppose, qui ne s’éteigne après deux jours de jeûne, et nous jeûnons ici. Les vivres manquent, les bouches inutiles nous ruinent.»
Deux jours plus tard, le même général dépêchait au ministre Servan un courrier extraordinaire avec cette lettre:
«Arrêtez, sans retard, le mouvement des volontaires sur le camp.
»La plupart de ces soldats, sans armes, sans gibernes et déguenillés de la façon la plus pitoyable, ne peuvent ni ne sauraient être de la moindre utilité... Qu’on les lance contre l’ennemi quand tout sera désespéré, j’y consens... Mais en ce moment, il y aurait une barbarie dont je suis incapable, à exposer ces pauvres gens à des coups de fusil qu’ils ne sont pas dans le cas de rendre... Livrés à eux seuls, surtout avec des chefs élus par eux, les volontaires ne peuvent en rien concourir au bien de la chose... J’ai pris le parti de les renvoyer sur les derrières avec des instructeurs qui, en un mois, m’en feront des soldats... En attendant, j’incorpore les meilleurs et les plus solides dans les troupes de ligne, où ils seront incomparables...»
Biron de son côté, écrivait au même Servan:
«Les gardes nationales non soldées forment des troupes admirables, calmes et solides...
»Les volontaires nationaux sont appelés à rendre d’immenses services, et ils sauveront peut-être la patrie, si on parvient à leur persuader qu’ils sont soldats et que tous les devoirs de l’état militaire sont renfermés dans l’obéissance passive... Nous n’en sommes pas là, malheureusement... Leurs officiers, qu’on leur laisse la liberté de nommer, jusqu’au grade de lieutenant-colonel, inclusivement, n’ont sur eux aucune influence...
»Au camp, tout va encore; c’est dans les marches que les inconvénients sautent aux yeux... Les colonnes s’allongent à l’infini, les queues restent dans les cabarets, et j’ai des quantités de trainards en arrière de deux ou trois marches...
»Recruter nos troupes de ligne, par les volontaires, braves et plein d’élan malgré leur insubordination, est le seul moyen que j’imagine de reconstituer très vivement une armée solide...»
Et ce n’est pas tout encore:
Ce flot d’hommes qui se précipitait vers nos frontières envahies, roulait son écume, la lie des populations des grandes villes.
Il se rencontra des volontaires, indignes de ce nom qui s’écartaient de leur bataillon, désertaient leur drapeau, et s’en allaient à l’aventure à travers la France, maraudant le long des chemins, frappant des réquisitions les habitants effrayés des petits villages qu’ils rencontraient.
«Ces malheureux, dit l’emphatique Beurnouville, dans un rapport à Pache, ne sont plus les enfants de l’honneur, mais les compagnons du crime et de la débauche... J’en tiens un certain nombre en prison, et j’ai eu beaucoup de peine à empêcher l’armée indignée d’en faire bonne et prompte justice.»
Si j’entre dans ces détails, mes amis, c’est qu’il faut que la vérité soit connue...
C’est qu’il est irritant aussi de voir la légende se substituer à l’histoire, et d’entendre obstinément déprécier toutes les générations au profit d’une seule.
On ne cesse de répéter:
—Ah! les hommes de 92!...
Les hommes de 92 n’étaient que des hommes, et partout, en tous les lieux et en tous temps, l’homme est semblable à lui-même, incompréhensible amalgame de ce qu’il y a de meilleur et de ce qu’il y a de pire.
Nous avons eu en 92 une page sublime!... S’en suit-il qu’elle doive être la dernière du livre d’or de la France?...
Hélas! si nous eûmes nos splendeurs, nous eûmes aussi nos misères cruellement ressenties... On ne voit plus que les splendeurs, aujourd’hui; à la distance d’un siècle les misères s’effacent... C’est ainsi que dans la nuit on n’aperçoit pas la fumée du feu qui brille dans le lointain...
Mais moi je puis vous affirmer que vers le commencement de septembre 1792, la France désespérait presque d’elle-même...
Après ce grand effort de la levée en masse, après cette explosion terrible de colère. Il y eut une heure d’affaissement et de torpeur...
Les pulsations du cœur de Paris s’arrêtèrent pour ainsi dire.
Chacun se sentait oppressé comme le joueur qui, sur une seule carte, risquerait tout ce qu’il possède, tout ce qu’il a de plus cher au monde: honneur, famille, fortune...
Tout ce qu’elle pouvait faire, la France l’avait fait, ses destinées, désormais, étaient aux mains de la Providence, son sort dépendait d’une bataille...
Les Prussiens étaient à six marches de Paris, la faible armée de la Révolution les arrêterait-elle?...
Aussi, mes amis, quelles inexprimables angoisses!... Quelles tortures quand on songeait combien faibles étaient nos chances et grandes celles de nos ennemis... Ils étaient tant nous et étions si peu!...
Toute existence sociale était suspendue. On ne vivait plus, on ne mangeait plus, on ne dormait plus... On attendait la grande nouvelle, la nouvelle de vie ou de mort. Tout homme qui paraissait à cheval aux barrières était pris pour un courrier, arrêté et questionné... Il y avait des gens qui prêtaient l’oreille, croyant, ô folie de l’anxiété, entendre dans le lointain le grondement sourd du canon.
Il ne fallait rien moins que la grande voix de Vergniaud pour arracher la France à cette stupeur.
Il parut à la tribune:
«Tous les jours, commença-t-il, j’entends dire: nous pouvons éprouver une défaite. Que feront alors les Prussiens? Viendront-ils à Paris? Non, si Paris est dans un état de défense respectable, si vous préparez des postes où vous puissiez opposer une forte résistance; car alors l’ennemi craindrait d’être poursuivi et enveloppé par les débris même de l’armée qu’il aurait vaincue, et d’en être écrasé comme Samson sous les ruines du temple qu’il renversa... Au camp donc, citoyens, au camp!...
»Eh quoi! tandis que vos frères, vos concitoyens, par un dévouement héroïque abandonnent ce que la nature doit leur faire chérir le plus, leurs femmes, leurs enfants, leurs foyers, demeurerez-vous plongés dans une molle oisiveté!
»N’avez-vous d’autre manière de prouver votre patriotisme que de demander comme les Athéniens: Qu’y a-t-il de nouveau aujourd’hui? Au camp, citoyens, au camp!...
»Tandis que vos frères arrosent peut-être de leur sang les plaines de la Champagne, ne craignons pas d’arroser de quelques sueurs les plaines Saint-Denis, pour assurer leur retraite!...»
Il n’était pas de citoyen en état de raisonner un peu, qui n’applaudit aux éloquentes et énergiques exhortations de Vergniaud.
Les plus simples comprenaient fort bien que les Prussiens seraient fatalement anéantis jusqu’au dernier, si éblouis de leur facile victoire, ils osaient se hasarder entre Paris devenu un camp retranché et la France entière soulevée et armée autour d’eux, coupant leurs communications, les tuant un à un, et les réduisant à mourir de faim.
«Ils seraient là, écrivait Camille Desmoulins, comme une bande de loups qui se serait aventurée entre les vagues de la marée montante et des falaises inaccessibles.»
Oui, mais il eût fallu faire de ce Paris ce camp retranché imprenable, et c’est ce dont on ne s’occupait pas assez.
On discourait beaucoup, les ingénieurs traçaient des plans et enfonçaient leurs jalons sur le terrain, chacun avait son projet ou son idée, qu’il exposait et discutait avec passion... Seulement rien n’avançait.
Des philosophes expliquaient ces lenteurs et tant d’incurie, en disant que le génie de notre nation est de se précipiter en avant et non de s’immobiliser pour la résistance, que la France est le glaive alerte qui frappe, et non le pesant bouclier qui pare les coups.
Chansons, que tout cela...
Il s’agit bien, vraiment, d’instincts particuliers, quand l’étranger souille le sol de la patrie de son exécrable présence!... L’expulser par tous moyens, l’écraser, l’anéantir n’importe comment, voilà le génie d’un grand peuple et le plus sacré de ses devoirs.
La timidité de plusieurs des administrateurs, chargés des travaux de défense, ne contribuait pas peu à les ralentir.
—D’abord, vous disaient les uns, rien ne prouve que nous serons vaincus dans la grande bataille; il faut espérer que nous ne le serons pas...
Et les autres, d’un ton discret de diplomate, ajoutaient:
—Prendre des mesures énergiques pour la défense de la capitale en cas de malheur est bien difficile... Ne serait-ce pas effrayer la population et lui donner à penser que nous doutons de la vaillance de nos soldats et de la victoire?
A quoi de véritables patriotes répondaient:
—Épouvantez la population, s’il le faut, mais, morbleu! sauvez la patrie. Que craignez-vous? Que les lâches ne s’enfuient? Tant mieux!... Débarrassés des bouches inutiles, nous tiendrons plus longtemps, nous qui resterons, résolus à nous ensevelir sous les ruines de notre ville, plutôt que d’y laisser entrer l’ennemi... Ce n’est pas désespérer de la victoire que de prévoir un revers... Creusez donc nos fossés profonds comme des abîmes, élevez nos remparts plus haut que nos clochers; faites, s’il le faut, dix lieues de désert autour de Paris.
Tout cela ne remuait pas une charretée de terre.
Chose étrange, à une époque où, par suite de la suspension de toute industrie, tant de gens mouraient de faim, ce n’est qu’à grand peine qu’on trouvait des ouvriers pour le camp retranché.
C’est alors que Vergniaud, voyant le peu de résultat de son discours, résolut de prêcher d’exemple.
Un matin, les flâneurs qui venaient quotidiennement inspecter l’état des travaux, furent tout surpris de voir arriver le grand orateur de la Gironde, accompagné de deux de ses collègues de l’Assemblée nationale.
Ils mirent habit bas, et s’armant chacun d’une pioche, ils commencèrent à creuser un fossé, tracé depuis longtemps par les ingénieurs... Et toute la journée ils travaillèrent aussi rudement que le dernier des manœuvres.
Si bien que le bruit de cet événement s’étant répandu dans Paris, il vint, entre midi et six heures, plus de trente mille personnes pour voir de leurs yeux.
Mon père, Fougeroux et moi, fûmes, je dois l’avouer, de ces curieux...
Mais quand nous reconnûmes Vergniaud et les deux députés ses amis, remuant la terre, le visage tout en sueur, la honte nous saisit, et sautant sur une bêche, nous allâmes travailler à côté d’eux...
Des milliers de patriotes nous imitèrent, l’élan était donné.
Singulier peuple que nous sommes!... Donner un coup de main aux fortifications devint une fureur, une rage... une mode, enfin!
On allait en partie de plaisir piocher à la tranchée, rouler la brouette ou planter des palissades... C’était le ton, comme autrefois de se montrer à Longchamps dans un carrosse...
Tout Paris voulut être ouvrier volontaire au camp retranché. On y put voir ce qui restait de muscadins et de femmes à la mode; car les femmes s’en mêlèrent. Un jour, toute la Comédie Française y vint, Fleury et Louise Contat en tête.
Ce qui manquait, c’était les outils, ils ne manquèrent pas bien longtemps...
Des industriels élevèrent quantité de petites baraques, où ils vendaient des pelles et des pioches patriotiques.
Des guinguettes aussi s’établirent, où on venait se rafraîchir et même déjeuner et dîner après avoir joué au terrassier.
Tout cela n’empêchait pas l’angoisse publique de devenir plus poignante, à mesure qu’on sentait approcher le moment où serait livrée la bataille décisive...
Ah! si nous n’avions eu que les Prussiens à craindre!...
Mais en 1792, mes amis, la France avait contre elle l’Europe entière, car les rois qui ne lui faisaient pas ouvertement la guerre conspiraient sourdement sa ruine.
Le choc terrible qui venait de renverser Louis XVI, avait si terriblement ébranlé tous les trônes, que tous les monarques de l’Europe s’étaient coalisés pour étouffer en son berceau, la France, cette révolution qui émancipait les peuples...
Nos frontières du Nord étaient forcées, nos frontières du Midi étaient menacées, l’ennemi était partout, de tous côtés...
Les Prussiens, enivrés de leurs succès de Longwy et de Verdun, s’avançaient en Champagne... Mais les Autrichiens étaient, eux aussi, entrés en France, et Luckner, un de nos généraux, avait été forcé d’abandonner les positions qu’il occupait à Longeville, près de Metz, pour essayer de les arrêter...
Jamais aucun peuple, en aucun temps, ne fut si près de sa perte que nous l’étions... S’ils eussent triomphé, les coalisés nous destinaient le sort qu’ils firent peu après subir à la malheureuse Pologne... Avant d’entrer en campagne, ils avaient tiré au sort entre eux nos dépouilles futures, l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. C’était la peau du lion endormi qu’ils se partageaient... et le lion allait se réveiller.
A l’époque dont je vous parle, cependant, les Prussiens seuls causaient nos angoisses.
Ils étaient, nous le savions, nos ennemis les plus acharnés et les plus avides. Leur armée était la plus nombreuse... Enfin ils étaient en Champagne, aux portes de Paris...
Chaque jour, des lettres arrivaient des officiers de notre armée, que les journaux reproduisaient, et qui nous apprenaient à connaître ces insolents envahisseurs...
Frédéric-Guillaume II, leur roi, qui avait recueilli la succession du grand Frédéric, était alors âgé de quarante-huit ans...
Implacable adversaire de la Révolution française, il était d’autant plus dangereux que la faiblesse de son caractère, son goût immodéré pour le plaisir, ses superstitions grossières et ses velléités de gloire le livraient aux intrigues d’indignes favoris ou de courtisanes effrontées.
Son confident le plus influent n’était autre que Rietz, son valet de chambre, et le mari complaisant d’une de ses maîtresses, Wilhelmine Encke, celle qui reçut plus tard le titre de comtesse de Lichteneau...
Son autre conseiller intime était Rodolphe de Bischofswerder... Celui-là était son rose-croix, un chef d’illuminés, qui devait son influence à des scènes de sorcellerie. Quand Frédéric-Guillaume avait soupe, Bischofswerder lui faisait apparaître des fantômes, l’ombre de César, par exemple, qui prédisait au roi de Prusse l’empire de Charlemagne.
Sans répudier la reine sa femme, sans éloigner Wilhelmine Encke, Frédéric-Guillaume II avait épousé en plein soleil la comtesse d’Enhof. Il est vrai qu’en même temps qu’il leur donnait ce scandale inouï, il imposait à ses sujets l’édit de conscience, qui avait la prétention de réformer l’enseignement religieux.
Tel était Frédéric-Guillaume II, tel était ce souverain qui, tout enflammé de l’espoir d’une proie magnifique, s’avançait au cœur de la France...
Et certes, il ne doutait pas du succès, d’un succès prompt et glorieux.
Comment en eût-il douté, après tous les témoignages de servile admiration dont il s’était vu l’objet.
Son voyage, de Berlin jusqu’à notre frontière, n’avait été qu’une longue marche triomphale.
Partout, des acclamations requises le saluaient victorieux avant le combat; les maisons se tapissaient de drapeaux, on jonchait la route de bouquets et de lauriers.
A Erfurth, où il avait couché une nuit, des illuminations et des feux d’artifice avaient célébré son arrivée... Aux portes de la ville, on lui avait élevé un arc de triomphe et il y avait pu lire cette inscription due à l’ingénieuse courtisanerie d’un de ses favoris:
A FRÉDÉRIC-GUILLAUME II
Qu’il vive, pour sa gloire
Il anéantira les Français
Anéantir les Français, s’emparer de leurs provinces!... Quel rêve pour un roi de Prusse, pour le chef de la nation de proie, pour l’héritier des traditions de conquête à tout prix, par la force ou par la ruse, per fas et ne fas du grand Frédéric!...
Et ce rêve splendide, l’entourage de Frédéric-Guillaume prenait à tâche de l’entretenir.
Circonvenues par l’or de la coalition, ses maîtresses le poussaient vers la France.
Rietz, son valet de chambre et son confident, lui garantissait la victoire.
N’avait-il pas entendu l’illuminé Bischofswerder, au moment de l’entrée en campagne, dire, après une revue, aux généraux réunis:
«N’achetez pas trop de chevaux, messieurs... La comédie ne durera pas longtemps... Déjà les fumées de la liberté se dissipent à Paris... L’armée des avocats sera bientôt anéantie, et nous serons de retour dans nos foyers pour l’automne...»
Et ces belles espérances, le généralissime de S. M. le roi de Prusse, le duc de Brunswick les partageait...
Et cependant il avait la réputation d’un sage, celui-là, d’un politique avisé et d’un philosophe, il avait gagné des batailles et s’était garanti des désordres de la cour dissolue où il avait été élevé.
Il connaissait le monde autrement que par ses flatteurs... Souverain, il avait voyagé en simple particulier, il avait visité la France et s’était arrêté plusieurs mois à Paris...
Mirabeau, qui avait été à même d’étudier le duc de Brunswick dans sa capitale même, nous a laissé de lui ce portrait:
«... Sa figure annonce profondeur et finesse... Il parle avec précision et élégance, il est prodigieusement laborieux, instruit, perspicace... Religieusement soumis à son métier de souverain, il a compris que l’économie était son premier devoir... Sa maîtresse, mademoiselle de Hartfeld, est la femme la plus raisonnable de la cour... Véritable Alcibiade, il aime les grâces et les voluptés, mais elles ne prennent jamais sur son travail et sur ses devoirs, même de convenance. Est-il à son rôle de général Prussien, personne n’est aussi matinal, aussi actif, aussi minutieusement exact... Ce prince n’a que cinquante ans. Son imagination brillante et sa verve ambitieuse se prennent facilement de premier mouvement, mais sa méfiance des hommes et le soin de sa réputation le ramènent bientôt aux hésitations de l’expérience et à une circonspection peut-être excessive...»
Dans un autre passage de sa correspondance secrète, Mirabeau nous montre le duc de Brunswick comme «dominé, surtout, et avant tout, par une frayeur extraordinaire de perdre ou seulement de compromettre l’énorme réputation militaire qu’il s’était acquise pendant la guerre de sept ans...»
Si donc le roi de Prusse eût conservé quelques doutes, ils se fussent dissipés devant l’assurance de son généralissime, lequel, non moins présomptueux que Bischofswerder, le rose-croix, disait à ses officiers:
«Surtout, messieurs, pas d’embarras, pas de dépense... Ce n’est pas une campagne que nous entreprenons, mais une simple promenade militaire...»
Il est vrai que Brunswick, lui aussi, avait été rassasié jusqu’au dégoût,—ce sont les propres expressions de sa lettre—de basses adulations et de louanges anticipées...
Il n’avait pas encore quitté Coblentz, que déjà on ne l’appelait plus que le bras droit des rois et le héros du Rhin...
Il faut ajouter encore qu’autour du roi de Prusse se pressaient les émigrés, si remuants, si exigeants et si pleins de jactance que l’empereur d’Autriche les avait éloignés de son quartier général.
Quel rôle jouaient-ils, ces nobles qui avaient abandonné aux Tuileries le roi et la reine, pour courir implorer contre la Révolution l’aide et l’assistance de l’étranger? Ils ne le comprenaient pas.
Ce que l’étranger exigerait de la France après une invasion victorieuse, quand ils lui tiendraient l’épée sous la gorge, les émigrés ne se le demandaient pas. Peut être avaient-ils pris pour argent comptant ces hypocrites protestations de désintéressement dont les envahisseurs masquent toujours leur avidité.
Ou plutôt, non: les émigrés ne songeaient qu’à la restauration de leurs priviléges, à leurs intérêts compromis, à la satisfaction de leurs convoitises, de leurs rancunes et de leurs mesquines ambitions.
Ils promettaient monts et merveilles à Frédéric-Guillaume... Ils lui promettaient à Paris une guerre civile qui tendrait la main à l’invasion.
A les entendre, la France les appelait de tous ses vœux, ils y avaient laissé un parti puissant obéissant à un mot d’ordre, un parti qui, dès le premier signal, se lèverait, troublant la paix des villes et la discipline des armées, prêt à trahir la patrie au profit de l’étranger, de l’ennemi...
Fiers de leur nombre, car ils étaient plus de vingt mille... Fiers de leurs régiments de cavalerie, qui portaient l’habit bleu des gardes du corps, le gilet rouge, la culotte de nankin et la cocarde blanche et noire, les émigrés disaient qu’à eux seuls ils réduiraient la Révolution.
L’armée française ne les troublait guère. Ils n’avaient pas assez de quolibets pour ce «ramassis de tailleurs et de savetiers,» comme ils disaient.
Et ils sollicitaient l’honneur de marcher à l’avant-garde de l’armée prussienne, l’honneur de la guider à travers la France pour lui ouvrir la route et provoquer les trahisons...
Frédéric-Guillaume n’avait pas besoin de leurs tristes services pour être exactement informé de tout ce qui se faisait chez nous.
S’il acceptait la complicité des émigrés, s’il se réjouissait d’en profiter, il comptait plus encore sur les émissaires à sa solde.
Suivant en cela des traditions nationales, que la Prusse a bien perfectionnées depuis, il avait fait précéder son invasion d’une avant-garde plus dangereuse pour nous que des batteries d’obusiers.
De la frontière à Paris, les espions prussiens s’étaient abattus en nuées, comme des sauterelles.
On en trouvait partout, aux sections, dans les clubs et jusque dans les tribunes de l’Assemblée nationale.
Avec une audace et une obstination incroyables, ils se faufilaient à travers tous les obstacles. Nos arsenaux, nos magasins d’équipements n’avaient pas de secrets pour eux. Tous les travestissements leur étaient bons, dès qu’il s’agissait de lever le plan de nos forteresses ou de vérifier l’état de nos armements.
On en arrêta sur les routes, en train de compter les volontaires qui passaient pour rejoindre l’armée.
Mêlés au rebut de la population, ils organisaient le tumulte de la rue. Répandus dans tous les quartiers, ils promenaient partout, à la même heure, les mêmes fausses nouvelles. Alarmistes par excellence, ils épouvantaient les lâches en énumérant les forces irrésistibles, assuraient-ils, de l’armée prussienne, prêchant l’inutilité de la résistance et les avantages d’une prompte soumission à un vainqueur généreux.
Et on n’élevait pas un épaulement au camp de Paris, on n’y creusait pas un fossé que Frédéric-Guillaume n’en reçut le dessin...
C’est à ce point que Lanverdale affirme dans ses mémoires, qu’entre Paris et le quartier général du roi de Prusse, un service de courriers était organisé, plus rapide que celui qui mettait en communication notre armée et l’Assemblée nationale...
Et cependant, vous pouvez m’en croire, à ce métier d’espion pour le compte de S. M. le roi de Prusse, en 92, on jouait gros jeu...
Toutes ces circonstances, vous devez le comprendre, mes amis, exaltaient jusqu’au délire la confiance de ces Prussiens, qui, au mépris de toute justice, envahissaient notre territoire.
Depuis Frédéric-Guillaume, jusqu’au dernier goujat des cantines, il n’était pas un homme de toute cette armée qui ne se tint pour assuré de coucher à Paris avant quinze jours.
Tous les mémoires du temps—et ils sont nombreux—qui rapportent les projets et les conversations des états-majors, sont unanimes sur ce point.
A Coblentz, au Café des trois couronnes, le passe-temps favori des émigrés était de jouer des dîners et des parties de plaisir payables à Paris.
Les officiers prussiens, gens remplis de prudence, quêtaient de tous côtés des renseignements sur la façon de vivre en France, et particulièrement à Paris. Ils s’informaient du prix de toutes choses, des modes et des bons endroits.
Beaucoup étaient munis d’une sorte de guide, où étaient indiqués, étape par étape, les meilleurs gîtes, les bons hôtels des villes que l’armée devait traverser, les vins qu’il fallait boire selon le pays.
J’ai eu entre les mains un de ces itinéraires, trouvé dans la poche d’un officier tué à Valmy. Le pauvre diable y avait noté les adresses d’une table d’hôte à trois livres, rue Saint-Honoré, et d’une maison meublée rue du Bouloi... A la suite, était une longue liste d’objets de toilette et de fantaisie que sa maîtresse et ses sœurs l’avaient chargé de leur rapporter.
Enfin, beaucoup des chefs de l’armée avaient écrit à Paris pour qu’on leur retint des logements, et si forte était leur persuasion qu’ils les occuperaient, qu’ils avaient fait verser des arrhes par leurs agents...
Gœthe, que le roi de Prusse traînait à sa suite, pour qu’il fût l’historiographe de ses conquêtes, Gœthe a raconté dans sa correspondance les transports d’orgueil de son souverain.
C’était la veille de l’invasion, et l’armée prussienne tout entière était campée sur notre frontière...
Tant loin qu’il put s’étendre, on ne distinguait que baïonnettes, casques et armures, reluisant au soleil.
Au centre, était massée une artillerie formidable que devait alimenter un parc immense de caissons et de fourgons.
Au premier plan, s’alignaient droits et raides comme un mur, les régiments de la garde, les vieux grenadiers de Frédéric-le-Grand, tous hommes de six pieds, restes des vieilles bandes qui avaient conquis la Silésie, que le soleil et la glace, les journées de marcher sans pain, les nuits sur la terre mouillée, avaient endurci et bronzé.
Ceux-là passaient pour des soldats invincibles, les premiers de l’Europe pour la discipline, qui en faisait autant d’automates, et par leur mépris de la mort qu’ils avaient tant de fois bravée.
A midi, Frédéric-Guillaume parut à cheval, suivi du duc de Brunswick, escorté de tout un escadron d’officiers emplumés et dorés.
Il se posta sur un tertre élevé, et contemplant autour de lui ce fourmillement terrible d’hommes et de chevaux qui emplissait l’horizon, le vertige de l’orgueil lui monta au cerveau et il s’écria:
—La France est à moi!... Je serai généreux!...
C’est le lendemain de cette revue que l’armée prussienne entra en France.
Malheureusement cette générosité, dont Frédéric-Guillaume avait plein la bouche, ses soldats ne l’avaient pas au cœur.
Ils avaient pris à la lettre cette phrase abominable du manifeste du duc de Brunswick, cette phrase qui semble la déclaration de guerre, non d’un prince civilisé, mais d’un chef de sauvages:
«Les habitants des bourgs, villes et villages, qui oseraient se défendre contre les troupes de S. M. le roi de Prusse, et tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par les fenêtres ou les portes de leurs maisons, seront punis sur le champ suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies et brûlées.»
Sierck le premier village français où parurent les uhlans, fut le premier théâtre de leurs sanglants exploits, et apprit à mesurer la distance qui sépare l’hypocrisie des chefs de la cruauté de ses soldats.
A Sierck, un bataillon de volontaires de Seine-et-Oise avait été placé en observation, avec ordre de se replier sur Thionville dès que paraîtrait l’ennemi.
Les malheureux se gardaient mal, jugeant peut-être la prudence au-dessous de leur courage, ou plutôt ignorant cet art merveilleux qu’ont les cavaliers prussiens d’apparaître là où ils savent qu’ils ne trouveront pas de résistance...
Les volontaires étaient en train de préparer leur soupe, quand tout à coup ils se virent assaillis, entourés, cernés...
Se défendre... impossible. Ils n’avaient même pas leurs armes à la portée de la main. Ils se rendirent...
Mais qu’importaient aux uhlans les lois sacrées des peuples civilisés, qui déclarent inviolable l’ennemi désarmé?...
Parmi ces prisonniers qu’ils viennent de faire, ils choisissent les deux principaux, le capitaine et un lieutenant du bataillon de Seine-et-Oise, et à trente qu’ils sont, ils s’acharnent sur ces deux hommes, et à coups de sabre et de crosse de pistolets, il les tuent...
Ce fut le signal du massacre... Puis, le meurtre ne suffisant plus à leur férocité, ils y joignent l’insulte. Ils dépouillent le cadavre de deux volontaires et, après les avoir coiffés d’un bonnet rouge, il les accrochent à un arbre à l’entrée du village.
Le râle d’agonie de ces malheureux arriva-t-il jusqu’aux oreilles de sa magnanime majesté Frédéric-Guillaume II?...
Non, assurément... Et d’ailleurs que lui eût importé!...
La fortune souriait à ses glorieuses armes, ses traîtres et ses espions venaient de lui livrer Longwy...
Il y triompha, mais il se plaignit d’une victoire trop facile... Il ne voulait pas trop de résistance, mais il en voulait un peu, sinon pour lui du moins pour l’Europe qui avait les yeux sur son armée.
De là, cette résolution, qui fut prise et exécutée, de jeter quelques bombes dans Verdun. On en jeta trois cents... Bombes perdues, en vérité, puisque là encore, la trahison attendait, le doigt sur le loquet de la porte...
Nouveau triomphe du roi de Prusse, orné cette fois de jeunes filles effeuillant des roses sous ses pas.
Pauvres jeunes filles, hélas! Pauvres vierges de Verdun!... Elles devaient bien peu après payer de leur vie ce crime qui était celui de leurs parents.
Verdun pris, le roi de Prusse l’occupa quelques jours... Il y régna, il y administra comme dans une de ses villes, comme à Berlin. Il nomma un gouverneur, un maire, des juges... tous prussiens.
Même, cela fit ouvrir aux émigrés de grands yeux surpris... Peut-être comprirent-ils que si jamais ce monarque si désintéressé venait à conquérir la France, il serait bien difficile de lui arracher ce qu’il aurait conquis.
Ils réclamèrent... Le roi leur fit dire qu’il n’avait pas le temps d’entendre leurs remontrances, qu’il les écouterait à Paris.
Si quelque chose troublait sa joie, ce n’était assurément pas cela. C’était la mort héroïque de Beaurepaire, se brûlant la cervelle plutôt que de capituler, c’était le regard brûlant de Marceau, répondant à ses prévenances royales: «rendez-moi mon sabre.»
On dit qu’il fit venir le chef de son armée d’espions et de traîtres, et qu’il lui demanda:
—Y a-t-il, en France, beaucoup d’hommes comme ces deux-là?...
L’espion dut répondre: «Non, sire.»
L’événement prouva que si.
Fort des intelligences qu’ils avaient dans Thionville, le roi et le duc de Brunswick se flattaient que cette place, qui leur avait fermé ses portes, ne résisterait pas longtemps.
Ce fut leur première déception.
Longwy et Verdun avaient capitulé. Thionville tenait toujours. Bien plus, à une sommation nouvelle, les assiégés répondirent en plantant sur leurs remparts un cheval de bois qui avait une botte de foin liée autour du cou.
Au-dessous, ils avaient écrit: «Quand ce cheval mangera ce foin, Thionville se rendra.»
Cependant cette déconvenue ne dérangeait nullement le plan du duc de Brunswick, qui avait résolu de négliger les places fortes, de les tourner et de marcher droit sur Paris, comme un boulet de canon.
Une division de troupes Autrichiennes fut chargée de bloquer Thionville...
Et le roi de Prusse s’avança en France, n’ayant qu’une crainte, c’est que notre armée, cette armée de tailleurs et de savetiers, ne l’attendît pas et se dispersât à son approche, comme les feuilles sèches au souffle de l’ouragan...
Et nous, pour contenir ce torrent de barbares faméliques et pillards, pour résister à ces escadrons d’émigrés frémissants de haine, qu’avions-nous?...
Ah! mes amis, vous le dire, c’est vous expliquer le désarroi des ministres, la stupeur de l’Assemblée, le découragement de Kersaint, les terreurs désordonnées de Paris.
Vous le dire, c’est vous rappeler tout ce que nous devons de reconnaissance à ces hommes qui ne désespérèrent pas du salut de la patrie, quand tout était désespéré...
L’armée que nous avions à opposer à l’invasion, l’armée nationale, jaillie du grand effort de la patrie en danger, n’existait encore que sur le papier, sur les registres d’enrôlement... Les ateliers patriotiques n’avaient pas achevé ses uniformes, ses armes n’étaient pas sorties des mains de l’ouvrier.
Ce qu’on en avait pu mettre sur pied, commençait en hâte dans les camps et sur nos places publiques son éducation militaire, ou dispersé par petits pelotons sur toutes les routes de France, doublait les étapes pour joindre plus tôt l’ennemi.
Notre seule force disponible se composait donc de troupes de ligne, comme on disait alors grossies de quelques centaines de bataillons de fédérés de 91, et de gardes nationales non soldées.
Si encore elle eût été solidement unie, cette armée si faible, soumise à une forte discipline, maniable et enflammée du même patriotisme!...
Hélas! telle n’était pas la situation.
L’émigration, en lui enlevant les deux tiers de ses officiers, l’avait disloquée. Elle était déchirée par les factions, livrée à une incroyable licence, dévorée de soupçons et de défiances et travaillée sans relâche par les ignobles tentatives d’embauchage des espions du roi de Prusse.
«J’ai parmi mes troupes, écrivait Kellermann désespéré, un millier de scélérats qui n’attendent qu’un coup de fusil pour se débander et répandre partout la panique, au cri de: sauve qui peut, nous sommes trahis!...»
Si seulement cette chétive armée, notre suprême ressource et notre unique espoir eût été réunie en une seule masse!...
On eût pu la lancer à la rencontre de la formidable colonne des Prussiens ou la rappeler en arrière pour couvrir Paris.
Mais non!...
L’impéritie, la faveur, le désir de fournir à beaucoup l’occasion de se distinguer, l’espoir de s’assurer des créatures en distribuant des commandements, et plus que tout cela encore, peut-être, la crainte de donner trop de prépondérance à un général, avait fait étendre, sans raison, ni mesure, disséminer, émietter nos forces.
A Lille, à Maubeuge et au camp de Maulde, nous avions trente mille hommes dont la mission impossible à remplir, assurément, était de couvrir nos frontières du Nord et des Pays-Bas...
Vingt-trois mille campaient à Sedan.
Vingt mille formaient un corps d’observation à Longeville, appuyés sur Metz.
Nous en avions enfin de trente à trente-cinq mille, tant à Landeau que disséminés par toute l’Alsace.
C’était en tout cent mille soldats, étendus sur un territoire immense, sans communications entre eux, sans direction, sans plan, et dont la présence à la frontière était bien inutile, puisque Brunswick avait forcé leurs lignes, qu’il était déjà hors des atteintes de la plupart d’entre eux et qu’il s’avançait en plein cœur de la France.
Et de tout les généraux, nul n’avait assez d’autorité, une supériorité assez unanimement reconnue, assez de dévouement ou d’audace pour s’emparer sous sa responsabilité d’une situation si périlleuse.
Je dois ajouter que les troupes campées à Sedan n’avaient même pas de chef du tout.
Leur général, l’homme au cheval blanc, celui que Mirabeau appelait Cromwel-Grandisson, et d’Antraigues, «le nageur entre deux eaux,» Lafayette enfin, venait de passer à l’ennemi.
Du jour où il vit que jamais il ne parviendrait à se tailler un fauteuil de dictateur dans les débris du trône qu’il avait tant contribué à renverser, la Révolution lui fit horreur.
Et le 21 août, abandonnant ses soldats, il monta à cheval, et suivi de presque tous ses officiers-généraux, il franchit les avants-postes et se rendit aux Autrichiens.
Mais il est des hommes que leur chance heureuse protége contre eux-mêmes...
Les Autrichiens qui eussent dû faire grand accueil à Lafayette, le mirent en prison et le gardèrent plusieurs années dans les cachots de Magdebourg et d’Olmutz...
Si bien que l’intérêt de la persécution s’attachant à sa personne, fit oublier l’odieux de son action...
Quoiqu’il en soit, Lafayette venant de passer aux Autrichiens, il n’y avait pas à songer à l’opposer à Brunswick.
Beurnonville, Moreton et Duval, qui commandaient à Maulde, à Maubeuge et à Lille, n’offraient pas, quelque fût d’ailleurs leur talent militaire, les garanties qu’en exige d’un général en chef.
Kellermann ne s’était pas encore révélé.
Custine, alors en Alsace, était déjà suspect.
Restait le maréchal Luckner, commandant le corps d’armée de Metz, qui offrait cet avantage d’être étranger,—il était Hanovrien,—et de n’appartenir à aucun des partis qui se disputaient le pouvoir.
Luckner ne manquait pas d’esprit, mais son âme était petite. Il était d’une avarice sordide et sans éducation. Parvenu au sommet de la hiérarchie militaire, son penchant et ses habitudes le ramenaient toujours à un rôle subalterne. Par exemple, le grand air de Lafayette lui avait toujours imposé prodigieusement.
Il avait encore l’activité corporelle d’un hussard, mais ses idées étaient des plus confuses.
De tout le plan de la campagne des Pays-Bas, qui lui avait été confiée, il n’avait jamais pu se loger dans la tête que l’avant-garde, et à toutes les explications du ministre de la guerre, il n’avait su que répéter de son accent tudesque:
—«Oui, oui, moi tourne par la droite, moi tourne par la gauche et marcher vite.»
Et dans le fait de cette expédition des Pays-Bas, qui, bien conduite, eût peut-être détourné le torrent de l’invasion prussienne, Luckner n’avait fait qu’une «housardaille.»
Ce qui l’effrayait, c’était le train de son armée et des équipages. C’était son objection à tous les mouvements qu’on lui proposait.
Général d’armée, il aurait volontiers passé toute la campagne dans son camp de Metz, et serait allé de sa personne faire la petite guerre.
Chef d’avant-garde, il aurait mené une armée au bout du monde.
Le matin, il était tout dévoué à la nation, et le soir tout attaché au roi. Il ne concevait rien à la Révolution. Il confondait tous les objets et tous les partis, et ne cessait de se plaindre d’être entouré de factieux.
Il se levait avant le jour, montait à cheval sans autre but que de se montrer aux soldats, rentrait fort tard, dînait mal, bourrait tout le monde, signait des lettres qu’il ne lisait pas et se couchait à neuf heures.
Enfin, pour achever de le peindre, il se croyait le plus grand capitaine de son temps, depuis la mort de Frédéric-le-Grand, soigneusement entretenu dans cette persuasion, par son chef d’état-major Berthier, le futur major-général de l’empire, le futur prince de Neufchâtel.
Allait-il donc falloir confier à ce soudard étranger les destinées de la patrie menacée?...
Ah! c’eût été une impiété!... Jamais aux heures du péril suprême, n’a fait défaut à la France un de ses fils pour la sauver...
Dumouriez fut nommé général en chef.
Gardez dans votre mémoire, mes amis, le nom de Dumouriez...
D’aucuns vous diront que l’homme qui l’a fait illustre ne fut pas exempt de reproches.
S’ils ont tort ou raison, nous n’avons pas le droit de le rechercher...
Ce qui est sûr, positif, indiscutable, c’est que tel jour Dumouriez a sauvé la patrie.
Des hommes de son temps, qui vivaient dans son intimité et qui ont eu sa confiance, racontent qu’il portait en lui le pressentiment de quelque grande tâche à remplir.
Et eux étaient persuadés qu’il saurait hausser son génie au niveau des plus grandes et des plus difficiles circonstances.
Doué des aptitudes les plus diverses, brave comme son épée, prodigieusement instruit, entreprenant, spirituel, habile, dévoré d’ambition et assoiffé de renommée, Dumouriez semblait fait pour arriver à tout, et pour y arriver très vite et d’un seul bond.
Il n’en fut pourtant pas ainsi.
Jusqu’à la Révolution, il languit dans les grades subalternes ou dans les emplois diplomatiques à peine avoués et qui ont une teinte d’espionnage.
Allez, ce serait une histoire curieuse et étrangement mouvementée que celle de cet homme si éminemment supérieur, dont la vie jusqu’à cinquante-six ans, s’usa à se débattre contre une fortune qu’il sentait bien n’être pas à sa taille, déployant à écarter de son chemin des toiles d’araignée une énergie à déplacer des montagnes.
C’est qu’entre ses rêves et leur réalisation, un obstacle se dressait, qui était presque infranchissable alors: sa naissance.
Dumouriez était noble, mais de très petite noblesse de robe, et, avant 1789, grades, cordons, faveurs étaient le patrimoine exclusif de la noblesse de cour.
Né à Cambrai, en janvier 1739, d’une vieille famille parlementaire de Provence, Charles-François Dumouriez dut à son père, commissaire des guerres, le plus honnête des hommes, mais un parfait original, une éducation supérieure.
Tristes et pénibles furent ses premières années. Jusqu’à sept ans, il demeura comme noué, traîné sur une chaise roulante et emmaillottée de fer.
Il fût mort, dans cette armure barbare où l’emprisonnaient l’ignorance des médecins, sans un digne chantre de la cathédrale de Cambrai, qui, en ayant pitié, l’emporta chez lui, le délivra, le soigna, et fit de l’être chétif et à peine viable, un robuste garçon capable de supporter les plus grandes fatigues.
A dix-sept ans, après trois ans passés au collége Louis-le-Grand, il avait si bien oublié les infirmités de sa première enfance, qu’il voulait à toute force entrer chez les jésuites pour devenir missionnaire et avoir ainsi l’occasion de voyager, de dépenser son besoin d’activité, de braver des périls inconnus.
Cette «vocation» ne persista pas...
La guerre de sept ans ayant été déclarée, il suivit son père qui venait d’être nommé intendant de l’armée, qui sous les ordres du maréchal d’Estrée, devait opérer en Hanovre.
Apprenti commissaire des guerres, Dumouriez trouvait là l’occasion de s’initier à tous les détails de l’administration militaire, administration modeste, assurément, mais dont dépendent les armées... et la victoire;
A ses heures de liberté, il recevait les leçons d’un chef d’état major de grand talent, M. de Montazet, qui l’avait pris en amitié et s’en faisait aider dans ses importantes et délicates fonctions.
Mais on ne tarda pas à se battre près de Brême, où se trouvait alors Dumouriez... L’odeur de la poudre lui monta à la tête.
Il quitta un moment la plume pour le mousquet, et se mêlant à une compagnie de grenadiers de la légion royale, il chargea l’ennemi et reçut sa première blessure avec une demi-douzaine de balles dans ses habits.
La bataille venait de lui révéler sa véritable vocation.
C’est pourquoi, sans rien dire à son père de son projet, un beau matin il s’engagea dans le régiment d’Escars, celui qui portait cette devise sur son étendard: fais ce que dois, advienne que pourra.
Après ce beau coup, il rentra l’oreille un peu basse, redoutant une semonce paternelle. Point.
—Tu as bien fait de suivre tes goûts, dit simplement son père.
Alors, lui, radieux:
—J’entre tard au service, s’écria-t-il, mais je ne perdrai pas de temps. Je vous jure qu’avant quatre ans je serai chevalier de Saint-Louis ou mort...
Et il partit pour rejoindre, en Basse-Normandie, le régiment d’Escars, où il entrait comme simple cavalier...
Il n’avait pas oublié la parole donnée à son père, et bientôt, à sa conduite, il fut aisé de voir qu’il la tiendrait.
Envoyé en Allemagne, on le vit à la suite d’un combat perdu par l’infatuation du chevalier de Müy, rallier autour de l’étendard de son régiment les escadrons décimés et débandés, sauver une batterie de cinq pièces, et couvrir la retraite et le passage difficile d’une rivière de toute une brigade.
Il avait eu un cheval tué sous lui et avait reçu deux blessures...
Savez-vous, mes amis, quelle fut sa récompense, pour cette action d’éclat où il avait à vingt ans fait preuve du plus admirable sang-froid?... Écoutez, car ceci, mieux que tout, vous dira les difficultés de cette étonnante carrière.
Il reçut une gratification de cent écus, qu’il distribua dans son escadron.
Mais sa destinée, en un moment de caprice, allait lui ménager pour l’avenir une revanche bizarre. Elle allait le rapprocher du duc de Brunswick.
C’était la veille du combat de Closterkamp, la veille de ce combat immortalisé par le dévouement sublime de d’Assas, jetant à ses soldats cet avertissement suprême qui devait lui coûter la vie: «A moi, Auvergne!... Voilà les ennemis.»
Dumouriez, qui était d’ordonnance auprès du comte de Thiars, fut envoyé par ce général porter un ordre à l’aile gauche de l’armée...
Il venait à peine de dépasser nos colonnes, quand il est assailli par une vingtaine de hussards ennemis.
Il se défend, il met deux hussards hors de combat, mais son cheval tombe mort sous lui, et cela si malheureusement, que son pied se trouve pris dans l’étrier.
Il dégage sa jambe, mais il se trouve retenu par le pied et soutient, dans cette position, un combat de quatre à cinq minutes contre des furieux.
Cependant, il parvient à se blottir entre une haie et le cadavre de son cheval, et blesse encore trois hommes.
Les hussards, alors, s’éloignent de la portée de son sabre, l’entourent et lui tirent presque à bout portant des coups de carabine et de pistolet, dont un lui emporte le doigt du milieu de la main droite et le désarme; un autre l’atteint au bras, un autre à la cuisse, et tous les autres enfin lui brûlent les sourcils, les paupières et les cheveux, et lui criblent le visage de grains de poudre...
Il allait succomber, évidemment, lorsqu’un officier supérieur ennemi, qui survint, le baron Behr, lui sauva la vie, commanda qu’on le porta à son propre bivouac et lui fit faire un premier pansement.
Dumouriez avait treize blessures, sans compter quantité de coups et de meurtrissures, sans compter ses grains de poudre au visage qui le faisaient beaucoup souffrir.
Ce qui l’affectait le plus était de ne pouvoir faire usage de ses bras, et d’être ainsi à la merci de ceux qui l’entouraient, encore qu’on eût pour lui les plus grandes attentions.
Le lendemain, il fut présenté au duc de Brunswick, qui l’accueillit en lui prodiguant les plus grands éloges, mais qui le retint prisonnier...
Il fut retenu ainsi plusieurs semaines, et comme compensation, sans doute, le duc en lui rendant la liberté, écrivit au marquis de Castries une lettre où le courage de Dumouriez était porté aux nues.
Certes, le duc de Brunswick ne prévoyait pas que cette lettre serait le point de départ de la fortune militaire de son jeune prisonnier, ni qu’il le retrouverait encore, mais général en chef de l’armée française, alors, et lui barrant le chemin de Paris.
Les quatre années que Dumouriez s’était accordées n’étaient pas écoulées, quand il reçut la croix de Saint-Louis. On lui donna de plus une compagnie à ce régiment d’Escars qui l’avait vu simple cavalier... Il n’avait pas vingt-trois ans...
Mais je m’aperçois, mes amis, que j’en aurais pour plus d’une journée, si j’entreprenais de vous conter en détail l’existence aventureuse de cet homme, un des plus extraordinaires, à coup sûr, de notre histoire.
Oui, certes, il me faudrait plus d’un jour pour vous dire ses luttes, ses voyages, ses duels, ses multiples intrigues, ses amours en Espagne et l’étrange et touchant roman de son mariage.
Je ne m’attacherai donc qu’à l’essentiel.
Commandant d’une compagnie du régiment d’Escars et chevalier de Saint-Louis à un âge où tant d’autres viennent à peine d’être mis au port d’armes, Dumouriez devait croire au plus brillant avenir...
Croyance illusoire, au moins pendant bien des années.
Survint la paix de 1763, et il se trouva mis en non activité, ou plutôt brusquement mis à la réforme, en même temps qu’un millier de braves officiers qui venaient de faire la guerre de sept ans.
Quel prix retirait-il de tant d’intelligence déployée, de ses campagnes, de ses actions d’éclat, de ses vingt-deux blessures?
Un brevet de pension de six cents livres.
Un autre eût désespéré, lui non.
«A travers les nuages de l’adversité, écrit-il à un de ses amis, je voyais toujours briller mon étoile.»
Le malheur est qu’il fallait vivre.
Et c’est alors que les inéluctables nécessités de chaque jour, plus encore que la dévorante activité de son imagination, le lancèrent dans les voies ténébreuses de la diplomatie occulte.
«On m’a reproché, dit-il dans une autre lettre à son ami Fabvier, d’avoir été peu scrupuleux sur les moyens de m’élever.
«J’aurais bien voulu voir mes censeurs à ma place.
«Comme si j’avais eu le choix des moyens!...»
Toujours est-il qu’au retour d’un voyage en Italie, qu’il avait entrepris et accompli à pied et presque sans argent, il adressa au ministère Choiseul un mémoire sur les «voies et moyens pour unir étroitement l’île de Corse à la France.»
Mal reçu par le ministre, le trouvant opposé à ses vues et rien moins qu’au courant de la question, Dumouriez s’emporta si fort et s’oublia si bien, qu’il n’eut rien de mieux à faire en sortant de l’audience que de mettre vite la frontière entre lui et une lettre de cachet plus que probable.
Mais M. de Choiseul se ravisa.
Il manda Dumouriez, et après lui avoir donné la satisfaction d’une réparation publique, il le nomma aide-maréchal-général-des-logis du corps d’armée que la France envoyait en Corse, et lui fit payer une forte gratification d’entrée en campagne.
Lui, du moment où son amour-propre était satisfait, ne marchanda pas plus son zèle qu’il n’épargna sa personne.
Et l’intelligence, la bravoure et l’activité qu’il déploya dans cette pénible guerre de Corse, eussent suffi à assurer la réputation d’un homme moins enguignonné que lui.
C’est qu’il était,—l’aveu est un de ses plus cruels ennemis,—il était un de ces instruments trop précieux pour que ceux qui les emploient tirent jamais volontairement de l’obscurité.
Les prodiges qu’il avait accomplis en Corse ne firent que mettre de nouveaux bâtons dans les roues de sa fortune.
Revenu à Paris avec le duc de Lauzun, pour donner au roi les détails de la conquête de l’île de la Corse, il se vit reçu en serviteur dont on se débarrasserait de grand cœur, si on avait seulement l’ombre d’un prétexte.
Il était trop délié pour ne pas comprendre tout ce qu’il peut tenir de menaces dans un sourire de cour.
Aussi se tint-il coi, vivant de trois mille livres de revenu qui venaient de lui échoir par la mort de son père, et d’une pension que lui avait fait octroyer le duc de Choiseul.
Sa société se composait alors presque exclusivement d’artistes et de gens de lettres; il passait gaiement la soirée avec eux, et comme il fallait bien que son activité trouvât une issue, il employait ses nuits à rédiger des projets de campagne.
Il se croyait oublié, et il faut bien le dire, il s’en désolait, quand M. de Choiseul l’envoya chercher.
Il s’agissait de se rendre en Pologne, et d’y organiser le parti patriote polonais assez fortement pour le mettre à même de résister aux entreprises de la Russie, qui déjà préludait à l’effacement de la carte d’Europe, de ce malheureux pays.
Pour cette mission, un homme d’expédients et de décision était nécessaire, un homme dévoué, en même temps, et prêt à tout, même à être désavoué et puni au besoin, car l’expédition devait être tenue absolument secrète même aux ambassadeurs et agents officiels du gouvernement français...
Dumouriez accepta toutes les chances et partit.
Son œuvre de six mois est à peine croyable. De rien, du néant, il tira quelque chose. De quelques soldats épars, il constitua le noyau d’une armée de l’indépendance. Il improvisa une artillerie avec de vieux canons de tous les titres, qu’il déterra de droite et de gauche. Il créa même deux places fortes, dont l’une résista à une sérieuse attaque des Russes...
Il fit plus. Aidé puissamment par une intriguante, spirituelle au possible et d’une rare beauté, la comtesse de Mniszeck, il fut sur le point de mettre un terme aux divisions séculaires des Polonais; divisions funestes, qui avaient commencé la décadence de la patrie, et allaient consommer sa ruine.
Si Dumouriez eût réussi, la Pologne serait peut-être aujourd’hui la puissance prépondérante du nord.
Et il allait réussir, quand le ministre Choiseul fut disgracié.
La politique fut changée... Dumouriez reçut l’ordre de rentrer en France et revint à Paris, Gros-Jean comme devant, pleurant ses desseins avortés, mais point découragé...
C’était le temps où s’étendait au-dessus de l’Europe le filet d’intrigues le plus inextricable qui fut jamais...
Comment aurait-on laissé inactif un homme tel que Dumouriez.
Il n’avait pas débouclé ses malles qu’il fut envoyé en Suède, toujours en qualité d’agent secret, pour on ne sait trop quelle louche négociation.
L’aventure, cette fois, tourna mal pour lui... Forcés de le renier, ceux qui l’employaient le firent arrêter à Hambourg où il levait des troupes, et jeter à la Bastille.
Il y resta six mois, bien traité, mais fort fracassé par des juges qui eussent été ravis de lui arracher son secret. Il se défendit si vertement que l’un d’eux disait: «Ma foi! si c’est un poulet qu’on a cru nous donner-là, il est diantrement coriace!...»
Sa fermeté lui porta bonheur.
Relâché, il obtint enfin un poste plus digne de lui et au grand jour. Il fut nommé commandant de Cherbourg, chargé de présider à la fondation de ce grand port militaire dont il avait le premier conçu la pensée.
Promu au grade de maréchal de camp au tour d’ancienneté, en 1788, il fut, en 1791, attaché à la 12e division militaire, qui englobait la Vendée, dont il prévit dès lors, ses lettres en font foi, le soulèvement.
Rappelé à Paris, en 1792, par le ministre de la guerre, il s’y trouva un moment réduit à une telle détresse, qu’après avoir vendu son argenterie, il eût été réduit à vendre ses livres, sans l’aide d’une amie dévouée et fidèle, qui était la sœur de Rivarol.
Mais ni les soucis de la gêne ni les incertitudes de l’avenir n’abattaient son courage, et plus que jamais il rédigeait des notes, des rapports, des mémoires, qu’il faisait parvenir au roi par l’entremise de son ami Laporte.
Tous ces travaux ne l’empêchaient pas de paraître au club des Jacobins, de suivre les séances de l’Assemblée, et de se lier avec les députés Girondins les plus influents, principalement avec Gensonné.
Et voilà comment, le 15 mars 1792, Dumouriez fut nommé ministre des affaires étrangères...
S’il était encore en France un homme capable de sauver la cause presque perdue de la vieille monarchie, cet homme assurément c’était Dumouriez.
Mais si le débonnaire et faible Louis XVI en avait eu le vague pressentiment, ses amis, les ambitieux et les intrigants qui l’entouraient, furent moins clairvoyants que lui.
Il n’y eut qu’un cri de stupeur et de colère, dans les antichambres des Tuileries, quand on connut le nom des membres du nouveau cabinet.
Les rares courtisans demeurés près du roi s’en allaient le long des corridors, le visage long d’une aune, hochant la tête et répétant:
—C’en est fait, nous avons un ministère sans-culottes.
Cela se disait si haut que Dumouriez l’entendit.
—Sans-culottes, oui, certainement, répondit-il: on en verra que mieux que nous sommes des hommes.
On ne l’appelait lui-même, que le ministre «bonnet rouge,» parce qu’un soir, à une séance des Jacobins, on l’avait vu dans une tribune ayant sur la tête le fameux emblème phrygien.
Peut-être ne s’en était-il pas coiffé beaucoup plus volontiers que Louis XVI le 20 juin—il l’affirme, du moins, dans ses mémoires,—mais il n’en était pas à une concession près, lorsqu’il la jugeait opportune.
Ne disait-il pas à ce sujet:
—Si j’étais le roi, je me ferais Jacobin, et Jacobin si furieux que les plus furieux Jacobins ne seraient plus près de moi que des scélérats d’aristocrates.
Ce n’est pas avec de tels propos, commentés et envenimés qu’il pouvait imposer silence aux clabauderies.
Aussi, quand il venait aux Tuileries pour le conseil, tout le monde s’écartait-il de lui comme d’un pestiféré.
On chuchotait sur son passage, et certains gardes du corps, de ces «habiles de la main» recrutés dans les académies d’escrime, par Bertrand de Molleville, lui adressaient des regards provoquants.
A l’occasion, on réveillait pour l’embarrasser et le gêner, des questions d’étiquette...
Car il y avait une étiquette encore, aux Tuileries, le cérémonial du pouvoir survivait au pouvoir lui-même, l’apparence à la réalité.
La première fois que Dumouriez parut à la cour, avec Roland, son collègue du ministère de l’intérieur, la simplicité du costume de ce dernier, qui avait l’air d’un pédant endimanché, son chapeau rond, et les rubans qui nouaient ses souliers firent l’étonnement et le scandale des valets.
Le maître des cérémonies s’approcha de Dumouriez, d’un air inquiet; le sourcil froncé, la voix basse et contrainte montrant Roland, du coin de l’œil:
—Eh! monsieur, point de boucles à ses souliers, point de boucles...
Sur quoi Dumouriez avec un grand sang-froid:
—C’est vrai, monsieur, répondit-il, tout est perdu...
Dumouriez était alors au mieux avec Roland, et ce bon accord persista jusqu’au jour où il déplut à madame Roland, et par contre à tous les députés Girondins...
La cause de la brouille qui amena la dislocation du ministère, vaut la peine d’être contée:
En arrivant au pouvoir, les six ministres étaient convenus de dîner entre eux seuls, les trois jours de conseil de chaque semaine, tour à tour chez l’un d’entre eux.
Là, chacun apportait son portefeuille, on convenait des affaires qu’on présenterait au roi, on les discutait à fond et on se formait une opinion commune.
Cela dura environ un mois, au bout duquel Roland prétendit que chez lui sa femme fût admise.
Cette prétention fit bondir Dumouriez, et, avec une brusquerie toute militaire, il répondit que la place de madame Roland était dans son salon dont «elle faisait les honneurs comme personne.»
Rien ne pouvait blesser plus profondément une femme qui était l’incarnation même de la vanité, la virilité de son mari et l’Egérie pieusement écoutée d’un grand parti politique.
Elle se vengea en répétant à qui voulait l’entendre que Dumouriez avait l’esprit délié mais le regard faux, et qu’il serait prudent de s’en défier... Qu’il avait de l’esprit et de la bravoure, qu’il était bon général et capable de grandes entreprises, mais qu’il manquait absolument de caractère et de moralité.
Elle le déclarait «plaisant avec ses amis, mais prêt à les tromper tous, galant auprès des femmes, mais peu propre à réussir près de celles qu’un commerce tendre séduit.»
Enfin elle lui reprochait d’avoir trop d’aptitudes pour les intrigues ministérielles d’une cour corrompue, et de s’être fait le courtisan du roi jusqu’au point de descendre à le recréer en lui contant des gaillardises.
Madame Roland, vous le voyez, quand elle entreprenait un ennemi, elle n’y allait pas de main morte.
Seulement, elle se trompait: ce n’était pas par des gaillardises que Dumouriez avait séduit Louis XVI—jamais monarque ne fut moins gaillard—mais par une sorte de franchise brutale, bien affectée à coup sûr, car il était la politesse même.
Dès la première entrevue, il prit vis-à-vis du roi l’attitude d’un homme qui ne mâche pas la vérité, comme on dit, et il la mâcha si peu, qu’après son départ, le roi stupéfait s’écriait:
—Jamais je n’avais rien entendu de pareil.
Reçu par la reine, il continua si bien ce même rôle, que l’altière Marie-Antoinette rougissant de colère, s’écria:
—Prenez garde, monsieur!... vous êtes tout puissant en ce moment, mais cela ne durera pas.
Cette explosion qu’il avait provoquée, ne fit rien perdre à Dumouriez de son sang-froid, et il mena si habilement le reste de l’audience, qu’il se flattait, en se retirant, de posséder l’entière confiance de la reine...
Cependant Dumouriez, l’infatigable rédacteur de mémoires, arrivait au ministère avec tout un plan de réformes en tête.
Lui, qui, depuis trente ans, avec l’ardeur de l’ambition souffrante, avait tout étudié, la diplomatie, l’administration, l’armée, l’intérieur et l’extérieur, il voyait partout des améliorations à introduire, jugeant que pour que la machine politique continuât à fonctionner, il était indispensable de modifier les institutions dans le sens de la Révolution...
Enfin, lui qui avait tant enfanté de projets, il allait quitter le domaine des théories pour celui de la réalité.
C’est vous dire qu’il se mit à l’œuvre avec cette dévorante activité, qui était un des traits essentiels de son génie, travaillant jusqu’à effrayer ses employés obligés, bon gré malgré de l’imiter quelque peu.
Debout à quatre heures, à cinq il était dans son cabinet; à six, son secrétaire général, Bonne-Carrière, venait travailler avec lui. A onze heures, commençaient les rendez-vous et les audiences qui étaient son désespoir, à cause du temps qu’il y perdait... A quatre heures, il se mettait à table. A quatre heures et demie, il rentrait dans son cabinet, et n’en sortait qu’à minuit ou une heure, pour souper ou se coucher...
Les jours de conseil ou de séance nécessaire à l’Assemblée ou au comité diplomatique lui apportaient un surcroît de besogne...
Il est vrai qu’un fardeau déjà si lourd à ce moment, du ministère des affaires intérieures il joignait celui du ministère de la guerre, dont le titulaire, Degrave, n’avait aucune expérience des armées.
C’était donc Dumouriez qui, au vu et au su de tout le monde, réglait le mouvement des troupes et l’avance des officiers supérieurs, qui surveillait le service des places fortes et dressait les plans de campagne...
Mais la tâche qu’il s’était imposée était au-dessus de la puissance humaine...
Il avait espéré concilier les intérêts de la Révolution et ce que Louis XVI appelait ses droits: folies!... Il échoua.
Le 14 juin 1792, le ministère dont il faisait partie fut disloqué, trois ministres durent se retirer.
Dumouriez prit alors le ministère de la guerre mais juste un mois plus tard, le 14 juillet, il se vit lui-même obligé de donner sa démission.
On a essayé de flétrir Dumouriez de bien des accusations diverses; on n’a jamais du moins suspecté sa probité.
Cet officier de fortune, comme on disait alors, cet agent à peine reconnu des plus troubles intrigues politiques, cet homme qui mena la vie d’un chevalier d’aventures était désintéressé et méprisait l’argent.
Ses ennemis, lorsqu’il abandonna le pouvoir, essayèrent bien de l’attaquer de ce côté, mais il leur répondit si victorieusement, que l’attaque tourna à leur confusion et à sa gloire.
Il résumait exactement sa situation, lorsque d’un ton moitié plaisant et moitié attristé il disait à son ami Berneron:
—Je me suis enrichi, au ministère, d’un fonds inépuisable d’ennemis.
Comment en eût-il été autrement.
Il garda son sang-froid lorsque tout le monde perdait la tête, il prétendit demeurer modéré quand toutes les passions étaient déchaînées.
Arrivé au ministère par l’influence des Girondins, le ministère le brouilla mortellement avec les Girondins.
Simple lieutenant-général, il était au mieux avec les Jacobins... Devenu ministre, il amassa sur sa tête toutes les colères, toutes les rancunes des Jacobins...
Si encore l’armée lui fût restée!... mais pendant qu’il avait eu le portefeuille de la guerre, il avait poursuivi cette chimère de rendre à chacun la justice qui lui était due, et n’avait réussi qu’à se faire autant d’ennemis qu’il y avait d’officiers généraux et de maréchaux...
Il fallait vivre, cependant... force lui fut de reprendre son grade de lieutenant-général dont les appointements lui donnaient du pain.
Après mûres réflexions, il se décida à reprendre du service sous les ordres du maréchal Luckner qui venait d’évacuer Courtrai et Menin et se repliait sur Valenciennes.
C’est donc à Valenciennes que Dumouriez rejoignit l’armée.
Il fut très mal reçu par le vieux maréchal, et plus mal encore, s’il est possible, par les officiers d’état-major.
Il y avait eu des paris qu’il n’oserait pas joindre cette armée; d’aucuns même avaient gagé qu’il n’y serait pas reçu.
Berthier, chef d’état-major, ne mit pas à l’ordre son arrivée, quoique par droit d’ancienneté, il dut prendre aussitôt le commandement de la gauche.
On ne lui envoya ni le mot d’ordre, ni ordonnances, ni garde d’honneur, et il resta quelques jours à Valenciennes comme un simple particulier.
Comme il n’y avait ni ennemis en présence, ni plan de campagne, ni même un ordre de bataille dans cette armée, encore moins de discipline et d’esprit militaire, il patienta quelques jours sans faire ni plaintes ni représentations, examinant le désordre de cette armée et l’incapacité de son chef...
Puis, au bout d’une semaine, il força le maréchal à lui accorder une audience, pensant le déterminer à abandonner le camp où il avait concentré son armée, et qui était détestable...
Mais Luckner s’emportant, lui répondit en jurant qu’il n’avait de conseils à recevoir de personne et qu’il était résolu à envoyer dans une citadelle le premier officier qui raisonnerait, cet officier eût-il été ministre des affaires étrangères ou de la guerre.
Ce fameux camp de Famars, enlevé plus tard par les Autrichiens, était cependant aussi mauvais que possible.
Le voisinage de Valenciennes tenait les troupes dans un état intolérable d’indiscipline et de débauche.
Officiers, soldats, généraux étaient nuit et jour à la ville.
Ce camp avait en arrière l’Escaut, qu’on n’aurait pu, en cas de malheur, passer que sur trois points, dont deux, à la moindre affaire, devaient infailliblement tomber aux mains de l’ennemi.
En avant coulait, il est vrai une petite rivière, la Rouelle, mais elle était guéable presque partout, et le terrain s’élevant sur les deux rives en amphithéâtre, donnait un feu égal à l’artillerie.
Tous ces inconvénients préoccupaient tellement Dumouriez, qu’à tous risques, il força une seconde fois la porte du maréchal, résolu à le contraindre de se rendre à l’évidence.
Luckner convint de tout, jura après les officiers dont il subissait les inspirations, les traita d’intrigants et de factieux, pleura et jura que tout allait prendre désormais une face nouvelle.
Et en effet, pendant le dîner où il avait prié Dumouriez de rester, il tança vertement ses aides de camp Lameth et Montmorency.
Le résultat de cet acte d’autorité fut que le lendemain, pour la première fois après huit ou dix jours, Berthier vint rendre sa visite au général Dumouriez, auquel il devait son avancement, et qui lui dit sérieusement, mais avec bonté, qu’il était temps de finir cette comédie et de penser à faire la guerre...
Malheureusement Luckner n’était pas homme à vouloir la même chose huit jours de suite.
Ses aides de camp reprirent leur empire sur lui et Dumouriez, après une seconde explication très orageuse, reçut l’ordre de partir sous les vingt-quatre heures pour aller prendre le commandement du camp de Maulde.
Ce camp, devenu fameux depuis, était destiné à couvrir les plaines si riches et les prairies qui s’étendent entre Lille, Douai, Valenciennes et Condé.
Seulement, il répondait mal à son importante destination.
Excellent pour dix ou douze mille hommes, il était des plus dangereux pour les dix ou douze bataillons qui s’y trouvaient et qui risquaient incessamment d’être tournés ou coupés.
Le général que venait remplacer Dumouriez avait bien couronné les hauteurs voisines de sept redoutes et élevé, en avant de Maulde, quelques mauvais ouvrages en terre, mais il n’y avait pas au camp assez de troupes pour défendre des fortifications si faibles qu’elles pouvaient être enlevées à la baïonnette.
Du premier coup d’œil Dumouriez vit bien qu’on l’avait envoyé là non-seulement pour se débarrasser d’un censeur incommode, mais aussi avec l’espoir qu’il y recevrait quelque échec. Il le manda même à quelques personnes à Paris, afin que, si un événement malheureux arrivait le blâme ne tombât pas sur lui seul.
Pour commencer, il s’établit à Saint-Amand et envoya quelques observations au maréchal Luckner. Mais, bien loin de lui accorder les renforts qu’il demandait, le maréchal ne daigna pas lui répondre.
Voyant que bien décidément on l’abandonnait à lui-même, Dumouriez quitta Saint-Amand et vint s’établir au camp, gagnant ainsi l’amitié des soldats, qui le voyaient partager leurs privations et leurs fatigues.
Il établit des communications réglées avec les généraux qui commandaient Douai et Lille, et il alla même les trouver pour concerter des mouvements combinés en cas de besoin.
Il figura par des petits postes la chaîne des grands postes qui auraient été nécessaires pour couvrir cette frontière. Il fit élever des batteries à la tête de la ville de Saint-Amand, et il rendit plus vive la petite guerre contre Tournay, Bury et Leuze, pour faire croire qu’il était en forces. Enfin, il fortifia Orchies, et y plaça un bataillon emprunté à la garnison de Douai.
Comme de raison, il rendait compte de toutes ces dispositions à Luckner, qui les approuvait.
Cependant, il poursuivait toujours sa petite guerre, et il y obtenait des succès dont on parlait d’autant plus que c’était le seul point par où l’ennemi ne pénétrait pas encore sur notre territoire et où nous soutenions encore l’offensive.
Partout ailleurs, et jusqu’aux alentours de nos armées, des hordes faméliques et pillardes de uhlans ravageaient le pays, mettant à sac les villages, incendiant les fermes isolées, massacrant les habitants sans défense; se conduisant enfin en bandits de grande route plutôt qu’en soldats d’une nation qui se piquait de civilisation.
C’est ainsi que, par des alertes continuelles et par des combats de chaque jour, Dumouriez habituait les troupes du camp de Maulde à une exacte discipline.
C’est ainsi qu’il leur donnait cet entrain à l’attaque et cette solidité sous le feu qui les distinguèrent tant que dura la campagne.
On avait cru lui nuire; on lui fournit simplement l’occasion de montrer des qualités de patience qu’on ne soupçonnait guère chez un homme qui était tout de premier mouvement.
Il est vrai que, tout en faisant fonction «d’officier instructeur»—car c’est ainsi qu’il se qualifiait,—Il travaillait à un projet d’invasion dans les Pays-Bas. Porter la guerre chez l’ennemi qui l’avait apportée chez nous, et le forcer ainsi à évacuer notre territoire était chez lui une idée fixe.
«Plus j’étudie la question sur le terrain même, écrivait-il à un de ses amis de Paris, plus je me persuade que le plan de campagne dicté par moi au commencement de la guerre était le bon.
»Impéritie ou mauvaise volonté, les généraux ne l’ont pas suivi, le déclarant impraticable...
»Il y faudra bien revenir, et j’envoie à ce sujet des notes au ministre de la guerre...»
Lui-même devait le reprendre plus tard, ce plan de campagne, et en démontrer l’excellence par le succès... Mais alors, disgracié et sans influence, il ne pouvait que s’indigner de voir des incapables, laisser échapper l’occasion qu’il eût été si prompt à saisir... Et, comme toujours, son indignation se répandait en projets et en notes.
—Toi, lui disait en plaisantant son ami Beurnonville, plutôt que de ne pas rédiger des mémoires, tu en rédigerais pour Dieu le père, sur l’art de gouverner le Paradis.
Il est vrai que, de ses jours de mauvaise fortune, Dumouriez avait conservé le secret de tout faire concourir à la réussite de ses plans.
On en peut voir l’exemple passablement romanesque au camp de Maulde même.
Dans le village de Mortagne, vivait un greffier nommé Fernig, qui avait été maréchal-des-logis de hussards.
Ce greffier avait cinq enfants: un fils, qui était officier dans un des régiments de Dumouriez, et quatre filles.
Deux de ces filles, âgées l’une de vingt-deux ans, l’autre de dix-sept, petites, délicates, bien élevées et modestes, avaient suivi plusieurs fois les détachements du camp de Maulde qui allaient en reconnaissance et avaient fait bravement le coup de feu.
L’une d’elles, la plus jeune, était-elle, comme on l’a dit, la maîtresse de Dumouriez?... Le bruit en courait si bien au camp, que les soldats ne l’appelaient jamais que la générale. Lui l’a toujours nié.
Ce qui est sûr, c’est que la bravoure de ces deux héroïnes lui servit à exalter le courage de nos de ses troupes. Comment un grenadier eût-il pu concevoir la pensée de reculer, quand il voyait deux jeunes filles s’élancer en avant sans souci de la fusillade!...
Les demoiselles Fernig devinrent même si célèbres que la Convention leur accorda une pension, et qu’un représentant en mission à l’armée écrivait dans un de ses rapports:
«Elles se sont distinguées dans toutes les actions, et se sont montrées plus extraordinaires encore par leur pudeur et leur vertu que par leur courage... Les soldats ont pour elles autant de respect que d’amitié, et on ne saurait trop proposer ces belles patriotes pour exemple à nos jeunes volontaires...»
Malheureusement nos autres généraux étaient loin d’avoir le génie de Dumouriez et de comprendre comme lui leur devoir.
C’est en ce moment où chacun aurait dû rester à son poste pour défendre la partie des frontières qu’il avait reconnues avec des troupes pareillement accoutumées au pays, que le ministre de la guerre et le maréchal Luckner arrangèrent le mouvement le plus extraordinaire et le plus dangereux: c’était de transporter le maréchal Luckner à Metz, et de faire venir à Valenciennes l’armée de Metz.
Ce mouvement dégarnissait pendant plusieurs jours les frontières et affaiblissait les deux armées par une marche de quatre-vingt lieues en plein mois de juillet.
Une combinaison politique qui n’aboutit pas, pouvait seule l’expliquer.
Quoiqu’il en soit, le 10 juillet, pendant que Dumouriez était occupé à faire tracer différents petits ouvrages pour les fortifications d’Orchies, il reçut un courrier de Luckner qui lui ordonnait de se rendre sur-le-champ à Valenciennes.
Il partit en toute hâte.
Le maréchal lui fit le meilleur accueil, et non sans un certain embarras lui apprit le mouvement qui devait commencer, dès le lendemain à la pointe du jour.
Puis, sans laisser à Dumouriez le temps d’ouvrir la bouche:
—Je laisse ici, ajouta-t-il, en manière de correctif, toute mon arrière-garde, composée de six bataillons et de cinq escadrons... Je ne touche ni au camp de Maulde ni aux garnisons de Maubeuge et de Dunkerque... Le tout forme un effectif assez considérable pour parer à toutes les éventualités pendant les huit ou dix jours que dureront les marches... Vous garderez le commandement de toutes ces troupes et du département du Nord, jusqu’à l’arrivée du général Dillon à qui vous aurez à le remettre.
Dumouriez avait toutes sortes de raisons pour être blessé de servir sous les ordres de Dillon, officier de mérite, d’ailleurs très brave et très loyal, mais dévoré d’ambition et trop fougueux pour rien ménager.
Cependant il ne laissa rien paraître de son mécontentement, disant simplement au maréchal Luckner qu’il obéirait, mais qu’il jugeait le mouvement horriblement dangereux et fort capable d’amener quelque désastre...
Peu s’en fallut que l’événement ne lui donnât raison.
Les Autrichiens, alors à Tournai, n’eurent pas plutôt appris par leurs espions le départ de Luckner, qu’ils formèrent un petit corps d’armée de cinq mille hommes, lequel alla tomber sur Orchies, où se trouvait un bataillon de volontaires de la Somme avec ses deux pièces de campagne et trente dragons...
C’est avec un élan terrible que les Autrichiens attaquèrent par deux portes, du côté de Douai et du côté de Lille.
On n’avait pas encore eu le temps d’élever les différents ouvrages de défense ordonnés par Dumouriez.
Le bataillon se défendit avec le plus grand courage, mais accablé par le nombre, il fut à la fin forcé de se replier sur Saint-Amand, laissant un de ses canons aux mains de l’ennemi.
Un capitaine, nommé Thory, se couvrit de gloire en cette affaire, et c’est à sa bravoure et à son sang-froid que les débris du bataillon durent leur salut.
C’est le soir, au camp de Famars, que Dumouriez apprit cette attaque.
Il se mit en route sur-le-champ, avec tout ce que Luckner lui avait laissé de troupes, et le lendemain, à la pointe du jour, il arrivait à Saint-Amand.
Déjà, d’après ses ordres, Beurnonville avait ramassé toutes les troupes du camp de Maulde et s’avançait à marches forcées pour couper la retraite à l’ennemi...
D’un autre côte, le commandant de Douai, le général Marassé, arrivait avec huit cents hommes de sa garnison...
Les Autrichiens se seraient trouvés cernés, s’ils ne s’étaient hâtés de se replier pendant la nuit, et de regagner leurs cantonnements...
Mais cette attaque devait être une leçon pour Dumouriez.
Il comprit que laisser éparpillées les faibles forces qui lui avaient été laissées par Luckner, c’était les exposer à être écrasées en détail et sans nul profit pour la défense des frontières.
Il prit donc le parti,—sous sa responsabilité,—de les masser en un seul corps, capable d’une forte résistance, et pouvant même, en cas de revers, infliger des pertes sérieuses à l’ennemi.
Son camp de Maulde lui parut encore la meilleure position.
Il y installa tout son monde, fit élever de nouveaux ouvrages de terre, et se remit de plus belle à inquiéter l’ennemi, en attendant l’arrivée de Dillon qu’il appelait de tous ses vœux.
Dumouriez l’a avoué depuis: jamais à aucun moment de sa vie tant agitée, il ne s’était senti si près du découragement.
Tout avenir lui semblait irrévocablement fermé. Ses ennemis venaient d’arriver au ministère, et il se savait également haï des deux partis qui se disputaient le pouvoir.
Lui qui avait la conscience de sa valeur, il se voyait condamné pour la vie à servir en sous-ordre et à obéir à des généraux sans capacité et sans vues d’ensemble, bien plus préoccupés de politique que de guerre.
«Je n’ai plus qu’un parti à prendre, écrivait-il à un ami fidèle, me faire oublier. Je vais m’appliquer à mon métier à la façon des bœufs qui tracent un sillon sans souci de savoir à quoi il servira. Et si avantageuses que puissent être mes idées, eh bien! je les garderai pour moi. C’est un fâcheux métier que celui de conseiller et qui ne rapporte que des ennemis, qu’on ait tort ou raison...»
C’était une sage résolution; mais, avec son caractère, plus facile à prendre qu’à exécuter.
Et dès que le général Dillon fut arrivé, après lui avoir remis son commandement, son premier soin fut de lui communiquer ses vues et d’essayer de le déterminer à la guerre offensive.
Le malheur est que le général Dillon avait toutes sortes de mauvaises raisons pour ne pas écouter Dumouriez.
D’abord, il avait toujours déclaré hautement, lui, Dillon, qu’à un fou seul pouvait venir la pensée d’attaquer, quand on avait déjà bien du mal à se défendre.
De plus, il n’avait pu voir sans une jalousie secrète l’influence de Dumouriez sur les troupes, et à quel point il était chéri de ses soldats.
Enfin, les flagorneurs de son état-major ne cessaient de lui répéter à la journée que Dumouriez, parce qu’il avait été ministre, affectait de grands airs de supériorité, frondait les autres généraux et faisait obstacle à leur autorité.
Mais Dillon, avec toutes sortes de travers, était un trop honnête homme et trop loyal pour abuser de son pouvoir et molester un officier dont il ne pouvait s’empêcher de reconnaître le mérite.
Il se contenta donc de remercier froidement Dumouriez de ses avis, disant qu’il aviserait...
Et il le relégua derechef au camp de Maulde, augmenté toutefois de quelques troupes qui portaient l’effectif à vingt-trois bataillons, tant de volontaires que de ligne, et à cinq escadrons de dragons.
Avec douze ou treize mille hommes sous ses ordres, Dumouriez redevint lui-même, il ne désespéra plus de l’avenir.
Voyant autour de lui ses armées se fondre, tous les liens de la discipline se relâcher, des régiments entier se débander, il comprit que le jour était proche où la France se trouverait sans défense contre les âpres convoitises de ses ennemis...
Et il conçut le projet de former une troupe d’élite qui, à l’heure du danger de la patrie, deviendrait le cadre d’une armée de salut.
Dès lors, il n’y eut plus une minute de son temps qui ne fut consacrée à la réalisation de ses desseins.
Du matin au soir, sous le soleil ou sous la pluie, on ne voyait que lui, à cheval, insoucieux de son vieil uniforme tout délabré.
Il n’était pas un détail d’administration qui échappât à son incessante vigilance. Les vivres, les munitions, les équipements, il examinait tout. Ah! ce n’est pas à lui qu’on eût livré pour ses soldats ces fameux souliers de carton qui furent un des scandales de 93.
Avec une patience infatigable, il formait les instructeurs qui devaient ensuite former ses troupes.
Et la nuit venue, il réunissait les officiers dans sa tente, et les leçons continuaient encore.
De même que les soldats il couchait sur la dure, roulé dans son manteau. Et, le plus souvent, c’est à la marmite de quelque bataillon qu’il envoyait chercher son dîner.
Le voisinage de l’ennemi, le péril continuel écartaient l’ennui de cette existence... Et pour lui donner une teinte romanesque, il y avait là les deux demoiselles Fernig, en costume de hussards, qui faisaient les fonctions d’aides de camp du général.
Dumouriez avait commencé par former deux corps de flanqueurs de quatre à cinq cents hommes chacun, qui allaient tous les jours en reconnaissance.
Ils étaient renouvelés tous les huit jours, officiers et soldats, excepté l’état-major, et pris à tour de rôle dans tous les bataillons, pour que chacun y passât à son tour, et s’accoutumât à l’ennemi et à la fatigue.
Chaque commandant de détachement recevait de la main du général une instruction au dos de laquelle était tracée une carte du pays qu’il avait à parcourir, où étaient marqués les chemins, les ponts, les villages, les censes, les moulins, les bois par où il devait passer en allant et revenant, ainsi que les points d’attaque et les endroits où il devait laisser des postes.
Ces reconnaissances étaient presque toujours heureuses, et ramenaient au camp des chevaux, du bétail et des prisonniers.
Il n’y avait au camp ni oisiveté ni cabales.
On n’y était ni Jacobin, ni Girondin, ni Feuillant, on y était soldat. Le général Dillon qui voyait les troupes placées sous ses ordres toujours à la veille de se révolter, n’en revenait pas...
Voilà quels prodigieux résultats avait obtenu Dumouriez, et tout à ses occupations purement militaires, il devait se croire profondément oublié, quand arriva à Paris la nouvelle terrible de l’invasion prussienne...
Je vous ai dit, mes amis, la colère de la France, et le puissant effort qui fit jaillir de notre sol profané des centaines de mille de volontaires...
Mais à ces soldats de la cause la plus sainte, il fallait un général...
Il fallait un chef dont le génie sût tirer parti de tout ce noble sang qui ne demandait qu’à se répandre pour le salut de la patrie...
C’est alors que l’Assemblée nationale, c’est alors que les ministres donnèrent au monde un grand, un sublime exemple de patriotisme.
Leur choix se fixa sur Dumouriez.
Dieu sait s’ils l’aimaient, cependant...
Les ministres revenus au pouvoir étaient précisément les hommes qui en avait été écartés lorsqu’il avait le portefeuille des affaires étrangères.
A l’Assemblée nationale, la droite et la gauche, les Girondins et les Jacobins le haïssaient presque également.
Les uns l’accusaient de duplicité et d’ingratitude, les autres le soupçonnaient d’être tout prêt à trahir la cause de la Révolution.
N’importe!...
Du moment où le salut de la France envahie fut en question, il n’y eut plus de partis.
Ou plutôt il y eut entre tous les partis une admirable émulation d’abnégation et de sacrifice.
Chacun mit sa gloire à renoncer à ses opinions les plus fortement enracinées, chacun répéta le mot de Gensonné:
«—Il n’est pas de rancune que n’efface dans le cœur d’un patriote la haine de l’étranger.»
Une voix timide s’éleva bien pour dire:
—«Dumouriez est un ambitieux, Dumouriez est un intriguant de l’ancien régime, qui a gardé des relations suspectes...»
Vingt députés se levèrent pour s’écrier:
—«Qu’importe! s’il est le seul qui puisse arrêter Brunswick.»
Et Danton, alors ministre de la justice prenant la parole:
«—Dumouriez, ajouta-t-il, aime trop la gloire pour ne pas vouloir vaincre à tout prix.»
Et c’est à l’unanimité qu’on alla chercher Dumouriez au camp de Maulde, dans la petite position où il était tombé, pour lui confier la défense nationale.
On écarta ou on lui subordonna tous les maréchaux, tous les officiers généraux qui pouvaient prétendre à un commandement.
Luckner fut envoyé à Châlons former des recrues.
Dillon et Kellermann reçurent l’ordre d’obéir...
Forces, pouvoir, tout fut concentré dans la main de l’homme dont on attendait tout...
Promptement informé d’ordinaire de toutes les décisions de l’Assemblée nationale, Dumouriez ne sut rien cette fois.
Debout à l’une des extrémités du camp, ayant à ses côtés la plus jeune des demoiselles Fernig, Dumouriez surveillait le travail d’une centaine de soldats occupés à enfoncer des palissades, lorsqu’une voiture vint s’arrêter à dix pas de lui.
C’était un vieux carrosse sonnant la ferraille, traîné par deux rosses efflanquées garnies de harnais d’artillerie.
Trois hommes, revêtus du costume de députés de l’Assemblée nationale, en descendaient, pendant qu’un quatrième, tout jeune encore, en «pékin,» celui-là, les jambes enveloppées de peaux de mouton, restait assis ou plutôt couché sur la banquette du fond.
Ces trois députés étaient Delmas, Dubois-Dubays et Bellegarde.
Le jeune homme qui demeurait dans le carrosse, et à qui la Révolution allait faire un nom tragique, n’était autre que Couthon, lequel se soignait alors aux boues de Saint-Arnaud, non loin du camp de Maulde, d’une paralysie gagnée dans une escapade amoureuse.
Dumouriez les connaissait les uns et les autres, et cependant il ne bougea pas de sa place...
Telle était alors sa situation qu’il dut croire qu’ils étaient envoyés pour le faire arrêter...
Eux, cependant, s’avancèrent, et le plus âgé, Bellegarde, tirant un portefeuille de sa poche, se mit à lire à Dumouriez le décret qui le nommait général en chef...
Bien des années plus tard, la plus jeune des demoiselles Fernig, sollicitant un bureau de tabac, a raconté dans la pétition qu’elle présentait au gouvernement cette scène tout entière.
Dumouriez devint extraordinairement pâle, et, d’une voix étranglée et de l’air égaré d’un homme qui doute du témoignage de ses sens, il répéta par deux fois:
—Général en chef!... général en chef!
—C’est l’armée tout entière qu’on vous confie... De ce moment vous avez pleins pouvoirs...
Lui dut avoir un éblouissement.
Les sommets entrevus dans ses rêves d’ambition les plus audacieux, il les atteignait tout à coup, et cela au moment où il s’était cru sur le point de rouler dans l’abîme.
Mais il se remit vite, grâce au prodigieux empire qu’il avait sur lui-même, et c’est d’un ton glacé qu’il dit:
—Du moins, citoyens représentants, vous m’accorderez bien vingt-quatre heures pour me consulter...
Ils l’interrompirent.
—Il n’y a pas à réfléchir, dirent-ils.
Jamais Dumouriez n’avait été soumis à une si terrible épreuve. Elle le surprenait lui que rien encore n’avait surpris.
D’un geste brusque, il enfonça son chapeau sur ses yeux et se mit à marcher comme au hasard, en proie aux plus terribles perplexités.
Puis, tout à coup, revenant sur les représentants, il arrêta sur eux ses petits yeux qui vous fouillaient jusqu’au fond de l’âme, et d’un accent qui trahissait toutes ses défiances:
—Qui me donnera des garanties? interrogea-t-il.
—Quelles garanties? demandèrent les autres, comme s’ils n’eussent pas compris.
—Je puis être... malheureux.
—Eh bien?...
—Ne m’accusera-t-on pas de trahison?
Aucun des députés ne répondit.
Mais du fond du carrosse, s’éleva la voix du paralytique Couthon, qui avait tout entendu, et qui criait:
—Quoi!... la nation t’appelle et tu hésites!... La patrie est en danger, et tu songes à toi!...
Dumouriez demeura un moment pensif... Puis, lui dont la parole avait d’ordinaire l’abondance et la verve méridionale, il dit lentement et en pesant sur chaque mot pour en souligner la valeur:
—C’est plus que la vie que vous me demandez, citoyens représentants, c’est peut-être l’honneur. Allez, je ne m’aveugle pas et je mesure bien le poids de l’effrayante responsabilité dont on me charge... Que je sois vaincu,—et je dois l’être,—et mon nom passera à la postérité accolé à l’ignoble épithète de traître.
—Qu’importe!... interrompit Couthon.
—Et bien! oui, en effet, qu’importe!... Vergniaud m’a tracé ma conduite le jour où il s’écriait à la tribune: «Périsse notre mémoire, mais que la France soit sauvée!...» Citoyens représentants, je ferai mon devoir... j’accepte.
Cependant, le bruit s’était répandu par tout le camp de l’arrivée de trois représentants du peuple en mission.
Les soldats avaient vu avec étonnement d’abord, puis avec inquiétude, cette voiture qui traversait la ligne.
Et à tous, la même idée était venue:
On vient enlever notre général!...
—Ah! c’est ce que nous ne souffrirons pas! s’étaient-ils dit.
Et sautant sur leurs armes, ils s’étaient précipités vers le théâtre de l’entrevue, et au nombre de plusieurs milliers, haletants d’attention, ils entouraient Dumouriez et les envoyés de l’Assemblée nationale.
Mais lorsqu’ils eurent compris ce dont il s’agissait, quand ils furent certains qu’on élevait à la dignité de général en chef leur général à eux, lorsqu’ils entendirent Dumouriez répondre: J’accepte!...
Oh! alors leur joie déborda en une immense clameur.
—Vive la nation! Vive Dumouriez!... Aux Prussiens! aux Prussiens!...
Dans le fait, il n’était pas un de ces soldats qui ne se sentît flatté au fond de son cœur du choix de l’Assemblée, pas un qui ne fût persuadé qu’il rejaillirait sur lui de la gloire de ce général à qui tous étaient dévoués jusqu’au fanatisme.
Il est vrai que la réflexion ne tarda pas à abattre cette grande joie.
—Maintenant qu’il va commander toutes les armées, pensèrent-ils, notre général va nous quitter!...
C’est pourquoi, dès que les représentants se furent éloignés, toutes les troupes se rassemblèrent autour de la tente de Dumouriez, le conjurant de rester quand même à leur tête...
Comment n’eût-il pas été ému de ces témoignages d’attachement de ces volontaires qu’il avait cependant soumis à la plus rude discipline.
Il leur promit qu’il ne les quitterait pas.
C’était effectivement son premier projet.
Maître absolu, désormais, sans discussion ni contrôle, il ne pouvait pas ne pas reprendre ses plans jusqu’ici contrariés d’une guerre offensive.
Battre Brunswick en France et le rejeter hors de notre territoire, Dumouriez ne le croyait pas possible, mais il était persuadé qu’un grand coup frappé dans les Pays-Bas y appellerait fatalement les Prussiens...
Et, dans ce cas, c’est surtout sur ses soldats du camp de Maulde qu’il comptait pour une de ces entrées en campagne dont la hardiesse et la rapidité déconcertent l’ennemi.
La nuit même qui suivit la communication des députés, le plan de campagne de Dumouriez fut arrêté dans son esprit, rédigé et envoyé sous forme de mémoire à l’Assemblée nationale.
Et dès le lendemain, il s’employait avec sa foudroyante activité à organiser son armée d’invasion et à lui donner des chefs...
Malheureusement, ce dernier point présentait d’énormes difficultés... Les généraux lui obéiraient-ils?... Et s’ils n’osaient pas se révolter ouvertement ne mettraient-ils pas à suivre ses instructions cette maladresse habile qui fait avorter les combinaisons les mieux calculées...
Mais chez Dumouriez, le général de génie était doublé d’un diplomate de premier ordre.
Intéresser au succès une douzaine de généraux, ménager les amours-propres et caresser les prétentions, utiliser les rivalités, éveiller et tenir en haleine toutes les ambitions, devait n’être qu’un jeu pour l’ancien agent secret de M. de Choiseul, pour l’homme qui avait été un moment sur le point de reconstituer la Pologne...
Sa première tentative fut un coup de maître.
Il décida Dillon, son ancien, Dillon qui, bien évidemment, se croyait plus de droits que lui à la direction suprême de la guerre, Dillon avec qui constamment il s’était trouvé en opposition, et dont la veille encore il n’était que le lieutenant, il le décida à entrer dans ses vues et à concourir à l’exécution d’un plan dont la veille encore il se moquait au milieu des rires de son état-major...
Mais il était écrit que toujours des événements imprévus traverseraient le projet favori de Dumouriez.
Il avait tout disposé pour se jeter sur les Pays-Bas; ses lieutenants avaient reçu leur ordre de marche; on avait distribué aux troupes les vivres de campagne. La confiance était absolue, l’enthousiasme immense, et le mouvement devait commencer le surlendemain...
Quand arriva au camp de Maulde un nouvel émissaire de l’Assemblée, sans caractère officiel, il est vrai, mais qui n’en apportait pas moins le dernier mot du ministère...
Cet émissaire était Westermann.
Alsacien de naissance, dissimulant sous les apparences d’une bonhomie de paysan l’esprit délié d’un diplomate consommé, Westermann était l’ami de Danton, ministre de la justice alors, et tout puissant, ami dévoué et fidèle jusqu’à la mort.
Nommé lieutenant-colonel après le 10 août, où il avait été le bras de la Révolution armée, Westermann gardait la tête froide à une époque où le délire emplissait tous les cerveaux.
Il comprenait la situation, et osait dire, à un moment où c’était une audace, que la discipline seule, et une discipline de fer, pouvait reconstituer notre armée, qui seule pouvait nous sauver.
Il voulait qu’on exigeât des moindres officiers certaines connaissances, et qu’on ne distribuât pas les grades aux plus bruyants parleurs... Il prétendait que le soldat qui reçoit un ordre doit l’exécuter et n’est pas un esclave parce qu’il obéit... Il soutenait que chasser un général uniquement parce qu’il était noble, était stupide... Il s’indignait d’entendre qualifier de traître tout officier malheureux...
Un tel homme devait ressentir pour Dumouriez une vive sympathie.
Aussi, les vit-on se promener bras dessus bras dessous pendant plus d’une heure devant la tente du général en chef.
Que se disaient-ils?... Voilà ce que tout le camp se demandait. Impossible de rien entendre, de saisir même un mot de l’entretien. Les factionnaires tenaient les curieux à distance.
Même, les demoiselles Fernig essayèrent vainement de forcer la consigne.
Envoyé par Danton, Westermann venait apprendre à Dumouriez les premiers succès du duc de Brunswick et les trahisons de Longwy et de Verdun...
Il venait lui dire que l’heure était passée de la guerre offensive, que les Prussiens arrivaient au cœur de la France, qu’ils menaçaient Paris, qu’il fallait essayer de les anéantir à tout prix.
Balancer n’était pas possible.
Dumouriez répondit qu’il allait quitter le camp de Maulde et courir à Sedan prendre le commandement de l’armée que venait d’abandonner Lafayette.
Il passa donc la nuit à contremander les mouvements ordonnés et à dicter de nouvelles instructions, promettant,—ce que personne ne crut,—qu’il serait de retour dans six semaines, et qu’il ferait encore cette année l’expédition de la Belgique...
Il y eut comme une émeute au camp dès qu’on apprit qu’il allait s’éloigner.
Mais il sut calmer ses soldats, qui demandaient à grands cris à le suivre. Il leur expliqua l’utilité de leur présence à Maulde, et comment ils retarderaient et embarrasseraient sa marche.
Et enfin, au jour, il partit à franc étrier, avec Westermann, suivi d’un seul aide de camp, de la plus jeune des demoiselles Fernig et de Baptiste, son fidèle valet de Chambre.
En arrivant à Sedan, il trouva le mal beaucoup plus grand qu’on ne lui avait dépeint.
L’armée était partagée en deux corps:
L’avant-garde, de six mille hommes, occupait sur la rive droite de la Meuse, sur les hauteurs de Vau, une sorte de camp dont la défense eût exigé pour le moins quarante mille hommes.
Le corps d’armée, qui ne comptait pas dix-huit mille soldats était campé à trois lieues en arrière, sur les hauteurs qui dominent Sedan.
Jamais position ne fut plus mal choisie.
Tout le monde le comprenait si bien que la consternation était générale.
Les soldats regardaient tous les officiers comme des traîtres et prenaient ce prétexte pour ne conserver ni discipline ni obéissance.
Les officiers, de leur côté, craignaient tant leurs soldats qu’ils n’osaient rien commander.
Personne ne donnait d’ordres, les vivres n’arrivaient plus, les munitions manquaient, des régiments entiers s’éparpillaient jusqu’à deux lieues à la ronde pour marauder.
Et certainement, si le duc de Brunswick eût poussé sur Sedan seulement dix mille hommes, l’armée française se débandait, se réfugiait dans les places fortes ou s’enfuyait jusque sous Paris.
Arrivé sans équipages, Dumouriez commença par se procurer un cheval frais, et tout aussitôt passa ses nouvelles troupes en revue.
On les avait de longue main prévenues contre lui.
Aussi leur trouva-t-il à toutes l’air singulièrement découragé. L’attitude de la cavalerie surtout était déplorable.
Passant devant une compagnie de grenadiers d’un régiment de ligne, Dumouriez en entendit un qui disait en le montrant:
—C’est pourtant ce chien-là qui a fait déclarer la guerre!...
C’était, en effet, un bruit qu’on avait fait courir pour le rendre odieux. Il le savait. Aussi s’arrêta-t-il et, toisant les grenadiers.
—Y a-t-il quelqu’un, demanda-t-il, assez lâche pour être fâché de la guerre?...
Croyez-vous gagner la liberté sans vous battre?...
Ce mot fit un très bon effet et ranima tout le monde.
Mais n’importe! la situation n’en était pas moins désespérée.
L’armée était sans généraux, sans officiers supérieurs, divisée par les factions et près de se révolter.
Les soldats, ne connaissant pas leur nouveau général, se défiaient d’autant plus de lui qu’il n’avait jamais eu de grand commandement et passait pour être un homme de plume bien plus qu’un homme d’épée.
Lui-même ne connaissait ni un des régiments ni un des officiers de cette armée.
Il n’avait pour le seconder ni officiers généraux ni état-major.
Jamais il n’avait étudié le pays qu’il était chargé de défendre.
De quelque côté qu’il se tournât, il n’apercevait que terreur, défiances ou mauvaise volonté.
Le sort de Longwy et de Verdun lui disait combien peu il devait compter sur la résistance des places fortes.
Sedan, d’ailleurs, n’était pas dans le cas de tenir huit jours, et Mézières n’était pas en meilleur état.
Enfin, il n’avait en tout et pour tout que vingt-trois mille hommes démoralisés, à opposer à cent mille soldats, les meilleurs de l’Europe, conduits par un général illustre.
Et cependant, il se voyait contraint d’abandonner les montagnes, où il eût pu tenir et rendre inutile l’immense cavalerie de l’ennemi, pour courir les vastes plaines de la Champagne d’abord, et ensuite tout le pays ouvert qui s’étend entre la Marne et la Seine.
Et quel secours avait-il à attendre?... Aucun.
L’armée qu’il venait de quitter était trop éloignée pour lui tendre la main... L’armée réunie sous Metz avait assez à faire de protéger cette place, que par une inconcevable incurie on avait négligé de mettre en état de soutenir un siége.
Restait Paris... Mais que pouvait lui envoyer Paris?...
Des bataillons de volontaires, levés à la hâte, brûlant de patriotisme sans doute, mais indisciplinés, sans officiers, sans cohésion, brûlant de combattre mais ne sachant pas tirer un coup de fusil...
A cette situation véritablement sinistre de nos armées et de la France, Dumouriez sut opposer la plus indomptable fermeté.
S’il désespéra, à un moment où tout le monde était si près de désespérer du salut de la patrie, il n’en laissa rien voir.
Officiers et soldats reprirent confiance en voyant l’assurance imperturbable et même la gaieté de leur général, de l’homme qui avait accepté l’effrayante responsabilité de la défense nationale.
Les seuls confidents de ses patriotiques angoisses furent les membres de l’Assemblée nationale envoyés en mission près de lui.
A eux il laissa voir combien chétives étaient nos ressources, immenses celles des Prussiens, combien faibles par conséquent étaient nos chances de succès.
Battre Brunswick et ses cent mille soldats ivres de leurs faciles victoires, il ne l’espérait pas, il l’avoua... Il ne songeait qu’à retarder leur marche, qu’à les arrêter...
Mais les arrêter un mois, quinze jours seulement, c’était vaincre.
Les immobiliser, c’était laisser à la France le temps d’organiser une seconde armée qui couvrirait Paris, et sur laquelle, en cas de défaite, la première se rallierait.
—Mais, pour atteindre ce but, citoyens représentants, ajoutait Dumouriez, il faut que l’Assemblée nationale et l’armée n’aient qu’une seule et même pensée: chasser l’ennemi. Nous ici, nous saurons verser jusqu’à la dernière goutte de notre sang; vous à Paris, sachez oublier vos rivalités... Pour qui aime sa patrie, il ne peut plus y avoir qu’un cri: «Dehors les Prussiens et vive la France.»
Le soir même du départ des représentants, Dumouriez rassembla un grand conseil de guerre, dans la misérable auberge où il avait établi son quartier-général.
Il y avait réuni le lieutenant-général Dillon, quatre maréchaux de camp, Vouillers, Chazot, Dangest, Dietman, l’adjudant-général Thouvenot et enfin son commissaire ordonnateur Petiet, homme d’un vrai mérite...
«Leur ayant présenté une carte de la Champagne, il leur exposa que les Prussiens ayant pris Longwy et Verdun, menaçant Metz, il ne fallait pas songer à une jonction avec le maréchal Luckner.
»Que, de quelque côté que ce fût, il n’y avait à espérer aucun renfort avant quinze ou vingt jours...
»Que force était donc de ne compter que sur la petite armée réunie autour de Sedan, que seule elle était chargée du salut de la Patrie...
—Notre armée, continuait-il, est des trois-quarts inférieure à celle de l’ennemi c’est vrai; mais notre cavalerie est la meilleure qu’il y ait actuellement en France, et notre infanterie, composée de régiments de ligne et de bataillons de gardes nationales non soldées, a été aguerrie par plus d’une année de campement, de marches et d’escarmouches continuelles... Enfin, notre artillerie est excellente et compte plus de soixante pièces de parc, outre les canons des bataillons...
«Passant de cet exposé de notre position à l’examen de la situation de l’ennemi, il ajoutait que les Prussiens seraient naturellement retardés et affaiblis par la nécessité de faire des siéges et d’assurer leurs communications, par la difficulté de trouver des vivres, par la longueur de leurs convois, par leur nombre même et surtout par l’énorme quantité de leur artillerie tant de siége que de campagne.
»Enfin, la présence du roi et de quantité de princes traînant après eux des équipages brillants et des nuées de domestiques, ne devait pas peu contribuer à appesantir et à embarrasser la marche en avant de l’armée prussienne.»
La conclusion de Dumouriez était que rester à Sedan serait une faute irréparable, et qu’il fallait prendre un parti.
C’était la première fois que Dumouriez rassemblait un conseil de guerre, et jamais, dans la suite, tant qu’il commanda des armées il n’en rassembla.
Son avis était que la décision doit venir de celui qui a la responsabilité, et que communiquer ses plans à ses subordonnés ne convient qu’à des généraux faibles et incertains, et qui cherchent à se ménager des excuses en cas de revers.
Mais en cette circonstance, Dumouriez voulait tâter le caractère et l’esprit de ses généraux, et essayer de découvrir sur qui il pourrait le plus sûrement s’appuyer.
Le lieutenant-général Dillon ouvrit l’avis «de mettre la Marne devant soi, et de gagner Châlons avant que l’ennemi s’y portât.
»Il montra sur la carte que les Prussiens en étaient plus près à Verdun que les Français à Sedan.
»Il dit avec beaucoup de justesse que si l’ennemi nous y prévenait il serait entre Paris et nous, et que le salut de la capitale importait plus que la conservation d’une province que nous n’étions pas sûr de défendre efficacement...»
Dillon concluait donc «à laisser le général Chazot avec quelques bataillons seulement à Sedan, et à marcher rapidement avec le reste de l’armée derrière la forêt de l’Argonne, par Sainte-Menehould, pour gagner Châlons et même Reims, si Châlons était déjà occupé.
»On se porterait ainsi derrière la Marne, on en défendrait le passage et on y attendrait les renforts qui viendraient de partout et permettraient de reprendre l’offensive...»
Cet avis était appuyé de raisons si fortes, qu’il fut adopté par tout le conseil.
Dumouriez alors se leva, dit qu’il réfléchirait, et ordonna à Dillon de replier l’avant-garde, dont il lui donnait le commandement, de la ramener à la gauche de la Marne, et de la camper autour de Mouzon.
Le conseil se sépara et Dumouriez ne retint près de lui que l’adjudant-général Thouvenot.
Il l’avait attentivement étudié tant qu’avait duré la conférence et avait cru deviner en lui une intelligence supérieure et des rapports singuliers avec son caractère à lui, Dumouriez.
Il ne s’était pas trompé, et c’est de ce jour que Thouvenot devint son ami et son bras droit.
Très instruit, versé dans les détails des campements, des reconnaissances et des marches, doué d’un grand courage, d’une infatigable activité et d’une extraordinaire fécondité d’expédients dans les moments difficiles, Thouvenot était le meilleur lieutenant que pût souhaiter un général en chef.
Dès qu’ils furent seuls, Dumouriez lui dit qu’il n’approuvait pas la retraite sur Châlons.
C’était abandonner la Lorraine, les Evêchés et les Ardennes, les reprendrait-on ensuite, quand l’ennemi s’y serait fortifié?
C’était de plus risquer d’avoir bientôt les Prussiens sur ses talons, auquel cas la retraite ne tarderait pas à dégénérer en déroute.
En se retirant derrière la Marne, on ne pourrait faire autrement que de sacrifier Châlons, Soissons et Reims...
On ferait couper forcément d’un côté l’armée laissée au camp de Maulde, et de l’autre l’armée de Luckner.
Puis, après avoir traversé la Champagne pouilleuse, les Prussiens ne trouveraient-ils pas abondamment des vivres dans les riches campagnes de Reims et d’Epernay?...
Prendre position à Châlons, c’était ouvrir au roi de Prusse et à son généralissime Brunswick, la route de Paris, soit par Reims ou Epernay, soit par Vitry et Troyes...
Et encore, qui garantirait qu’une fois maître des Ardennes et de la Lorraine, ils ne s’y cantonneraient pas pour y passer l’hiver en attendant des renforts.
Enfin, était-on sûr de pouvoir défendre à Châlons le passage de la Marne? Assurément non.
Ce qui était certain, malheureusement, c’est que le passage forcé, les Prussiens ramèneraient la faible armée française jusqu’à Paris ou la détruiraient en route, grâce à leur nombreuse et magnifique cavalerie...
Convaincu par cet exposé si précis, Thouvenot se tut...
Et alors Dumouriez montrant du doigt sur la carte la forêt de l’Argonne.
—Voilà, s’écria-t-il, d’un accent inspiré, voilà les Thermopyles de la France. Si j’ai le bonheur d’y arriver avant les Prussiens tout est sauvé!...
Le danger de la patrie venait de hausser jusqu’au génie les talents militaires de Dumouriez.
Thouvenot le comprit si bien, que, tout vibrant d’enthousiasme, il lui sauta au cou en s’écriant:
—Maintenant la France est sauvée!...
Et tous deux se mirent à détailler cet admirable plan.
Les avantages en étaient immenses.
D’abord, nous ne reculions pas, nous ne nous réduisions pas à la Marne pour unique et suprême ligne de défense; puis nous faisions perdre aux Prussiens un temps précieux et nous les obligions à séjourner dans la Champagne-Pouilleuse, dont le sol désolé ne pouvait suffire à l’entretien d’une armée de cent mille hommes.
Arrêtés à la forêt de l’Argonne, les Prussiens n’essayeraient-ils pas de la tourner?
C’était possible, c’était même probable.
Oui, mais s’ils remontaient vers Sedan, les forteresses des Pays-Bas devaient leur barrer le passage; et si, au contraire, ils se portaient sur Metz, l’armée du centre, commandée par Kellermann, serait là pour leur tenir tête et permettre à Dumouriez d’accourir et de les prendre entre deux feux.
Mais il faut, mes amis, que je vous donne une idée exacte du terrain que Dumouriez avait choisi pour y jouer les destinées de la France.
La forêt de l’Argonne est une lisière de bois qui se prolonge de Sedan jusqu’à Passavant, à une forte lieue au delà de Sainte-Menehould.
D’autres parties de bois, entremêlées de plaines, courent vers Bar-le-Duc, dans la direction de Révigny-aux-Vaches...
Mais l’Argonne, proprement dite, ne s’étend que jusqu’à Passavant, c’est-à-dire sur une longueur de treize lieues.
Sa largeur est très inégale.
Dans certaines parties, elle est de trois et quatre lieues, elle n’est que d’une demi-lieue dans certaines autres.
Elle sépare la riche et fertile province des Trois-Evêchés de la Champagne-Pouilleuse, le plus affreux pays qui soit en France, dont le terrain est une glaise tenace, où on ne trouve ni eaux, ni arbres, ni pâturages...
A peine, de loin en loin y rencontre-t-on quelque pauvre village, dont les habitants ont bien du mal à arracher à leur sol ingrat leur chétive subsistance.
Coupée par des montagnes, des rivières, des marais, la forêt de l’Argonne ne présente d’accessibles à la marche d’une armée que cinq passages: le Chêne-Populeux, la Croix-au-Bois, le Grand-Pré, la Chalade et les Islettes.
Le premier de ces défilés va de Sedan à Rethel; le second de Briquenay à Vouziers; le troisième de Stenay à Reims; le quatrième de Varennes à Sainte-Menehould...; le dernier, enfin, est la grand’route de Verdun à Paris...
Voilà les cinq passades qu’il s’agissait d’occuper et de disputer aux Prussiens.
Dumouriez décida que le général Dillon occuperait avec cinq mille hommes la position des Islettes et enverrait un fort détachement pour garder la Chalade.
Il confia la garde de la Croix-aux-Bois à un corps détaché sous les ordres du général Chazot.
Lui-même se réservait le poste de Grand-Pré.
Quant au défilé du Chêne-Populeux, force était à Dumouriez de le laisser momentanément ouvert, faute de troupes suffisantes.
Mais il attendait des renforts.
Le général Duval devait lui amener quatre mille hommes.
Beurnouville avait ordre de faire avancer à marches forcées les troupes excellentes du camp de Maulde.
Enfin, la ville de Reims se tenait prête à envoyer au premier signal quatre pièces de canon et dix-huit cents hommes parfaitement équipés et armés...
Le plan était hardi, mais d’une exécution extraordinairement difficile.
Que fallait-il pour donner l’éveil aux Prussiens? Une indiscrétion, le rapport d’un de ces espions dont ils avaient inondé le pays, un faux mouvement de l’armée française.
Prévenus, ils se seraient empressés de s’emparer des passages où on comptait les arrêter, et c’en eût été fait de nous.
Mais c’est ici que Dumouriez se surpassa lui-même et qu’il fut admirable de coup-d’œil, de précision, de promptitude et d’audace.
De Sedan, où il se trouvait, à Grand-Pré qu’il voulait occuper, on compte douze ou vingt lieues selon qu’on prend en avant ou en arrière de la forêt de l’Argonne.
S’il prenait la première route, il indiquait clairement ses projets aux Prussiens.
Il risquait, en choisissant la seconde, d’être attaqué dans sa marche et de perdre ses équipages et son artillerie.
Après mûres réflexions, il s’arrêta à un troisième parti plus audacieux et qui lui réussit.
Il pensa que si l’ennemi restait immobile sur la rive gauche de la Meuse, c’est qu’il n’avait là qu’un faible corps d’observation, lequel, à la moindre démonstration de l’armée française, s’empresserait, pour un combat, de repasser la rivière.
Sur cette conviction, il arrêta tous ses mouvements.
Il existe au delà de la Meuse, et derrière Stenay, une position excellente, nommée le camp de Brouenne.
Dumouriez ne douta pas que l’ennemi ne s’emparât de ce camp dès que lui-même s’avancerait.
C’est pourquoi il partagea son armée en trois corps.
Son avant-garde eut l’ordre d’aller attaquer Stenay et de le masquer.
Il conduisit lui-même son corps de bataille, composé de douze mille hommes, sans bagages, soutenant son avant-garde.
Et pendant ce temps, le général Chazot, avec cinq mille hommes, escortait les équipages de l’armée et le gros de l’artillerie, par Tannay et les Armoises...
Vous dire que les lieutenants de Dumouriez étaient satisfaits, ce serait, par exemple, vous mentir grossièrement.
Plusieurs, moins intelligents que Thouvenot, ne comprenaient rien au plan qu’on exécutait: les autres étaient indignés qu’on l’eût arrêté sans les consulter.
Dillon obéissait, fidèle à la parole qu’il avait donnée; mais n’ayant point juré de ne pas se plaindre, il se plaignait, et si haut que très souvent les officiers inférieurs et même les soldats l’entendaient.
—Ce b... là, disait-il, nous conduit droit dans la gueule du loup... Nous serons jolis garçons, quand il nous aura enfournés dans les défilés de l’Argonne...
Le langage des autres généraux n’était guère plus convenable.
Même, ils finirent par se montrer si bien entre eux, qu’un beau matin, en plein mouvement, ils s’en allèrent à cinq ou six demander une audience à Dumouriez.
Lui donna ordre de les introduire sur le champ et le plus éloquent d’entre eux se mit à exposer ses griefs et ceux des autres.
Ce fut long, et cependant Dumouriez les laissa aller jusqu’au bout. Mais lorsqu’ils eurent achevé:
—«Mes camarades, leur dit-il, ceci, a l’air d’un conseil de guerre et on ne doit point en en assembler sans que j’en donne l’ordre. Quand je vous demanderai vos avis, à chacun en particulier, votre devoir est de me dire ce que vous croirez le plus utile. Je suis seul responsable, et je sais ce que j’ai à faire... Retournez donc chacun à votre poste, et ne vous occupez que de me bien seconder.»
Cette ferme attitude de Dumouriez lui valut presque une victoire, en ce sens qu’elle lui fit un parti parmi tous les gens de bon sens qui n’avaient pas contre lui de griefs personnels.
—«Ce cadet-là ne serait pas si pimpant s’il n’était pas bien sûr du résultat de ses combinaisons. Taisons-nous donc et aidons-le de notre mieux.»
Les autres, réduits à dissimuler leur mécontentement, prirent le parti d’écrire à Paris, pour se plaindre du général en chef, peignant la situation sous des couleurs plus sombres encore que la réalité, s’efforçant de démontrer à leurs amis de l’Assemblée nationale, que cette forêt de l’Argonne où on s’engageait allait devenir le tombeau de l’armée française.
Informé de leurs manœuvres, Dumouriez ne leur en faisait pas plus mauvaise mine.
—«Ce sont des entêtés, disait-il à Thouvenot, et je n’ai qu’un moyen de les convaincre... c’est de vaincre.»
Tout autre général eût été peut-être forcé de céder aux murmures et de modifier son plan, mais Dumouriez, par grand bonheur, avait près de lui et pour lui, toujours prêt à le soutenir et à répondre de lui, Westermann, qui représentait la pensée et la volonté de Danton, alors ministre de la justice et tout puissant aussi bien au conseil des ministres qu’à l’Assemblée.
Or, Westermann ayant adopté d’enthousiasme les plans du général en chef, ne permettait pas qu’on les discutât.
Tâté par Dillon, qui essayait, à mots couverts, de prédire un échec prochain, il le regarda fixement et lui dit ces mots, dont la signification à cette époque était terrible au point de faire pâlir les plus braves:
—Le souhaiteriez-vous?... Il faut le dire.
C’est qu’il ne badinait pas, le héros du 10 août, dès que la discipline était en question.
Beaucoup de volontaires, lorsqu’il était arrivé, s’étaient imaginé qu’il accueillerait toutes leurs réclamations... Ils furent vite détrompés.
Il fallait voir de quel air il écoutait la réclamation, et de quel ton il criait aux réclameurs:
—Allons, c’est bon, la patrie ne vous demande pas tout ça... Demi-tour et à vos rangs!...
Ce fut lui, plus encore peut-être que Dumouriez qui refusa de recevoir Laveneur dans son ancien grade.
Celui-là n’était cependant qu’un étourdi que les amitiés avaient égaré.
Admis dans l’intimité de La Fayette, dont il avait été l’aide de camp, il crut devoir le suivre, quand, à la suite du 10 août, il abandonna son armée et s’enfuit à l’étranger.
Mais de la part de Laveneur ce n’était là qu’un coup de tête.
Il ne sentit pas plus tôt sous ses pieds le sol ennemi, que le désespoir le prit, et il rentra en France plus vite qu’il n’en était parti.
Lieutenant-général au moment de son départ, il pensait qu’on serait trop heureux de lui rendre ses épaulettes dans une armée où les officiers supérieurs faisaient encore défaut.
Mais ni Dumouriez, ni Westermann n’entendirent de cette oreille.
—Vous avez perdu votre grade, lui déclarèrent-ils, le jour où vous avez franchi la frontière.
Des larmes, dit-on, vinrent aux yeux de Laveneur.
—Quoi! vous me refusez, fit-il, quand la patrie en danger a besoin de tous ses enfants!...
Et les autres ne répondant pas:
—Je veux me battre, cependant, insista-t-il.
Alors Dumouriez:
—Il nous est mort un hussard cette nuit, prononça-t-il froidement, je vous autorise à prendre son cheval, ses armes et son rang dans l’escadron.
Laveneur n’en demanda pas plus.
—Merci, dit-il, je ne resterai pas longtemps simple hussard.
Il devait tenir parole, et son nom est resté attaché à un des plus audacieux exploits de la campagne de 92.
C’était après la bataille de Jemmapes.
Le général Valence, à la suite d’une capitulation, était entré dans Namur; mais six mille soldats ennemis s’étaient retranchés dans le château, et de là prétendaient dicter des conditions à l’armée française.
Le siége du château fut aussitôt ordonné.
Mais il fallait commencer par se rendre maître du fort Vilatte qui en défendait l’accès, et dont l’attaque de vive force était entièrement dangereuse et incertaine, en raison des nombreux fourneaux de mines que les assiégés avaient pratiqué sous les glacis.
C’est alors que Laveneur conçoit le projet de s’en emparer en surprenant la garnison.
A gauche du château se trouvait un chemin de communication d’un accès très difficile, et défendu par des palissades et des parapets. Ce chemin conduisait au fort.
—J’y passerai, dit Laveneur.
A minuit, en effet, guidé par un déserteur, il sort à la tête de douze cents hommes.
On marche en silence, et servi par une obscurité profonde, on arrive aux premiers parapets. Ils ne sont pas gardés ou les sentinelles se sont endormies, on les franchit.
Mais les sentinelles des palissades crient et font feu...
Si dangereuse était la situation que les hommes de Laveneur hésitent. Lui s’élance en avant, mais se trouvant de trop petite taille pour franchir les palissades.
—Jette-moi par-dessus! commande-t-il à un officier très grand et très robuste, qui se trouvait près de lui.
L’officier obéit, puis se précipita après son chef, et quelques grenadiers, entraînés par l’exemple, l’imitent malgré la fusillade la plus meurtrière.
Laveneur, cependant, s’est relevé sans blessures. Il s’élance vers le poste, et apercevant le commandant qui s’efforce de rassembler la garnison, il le saisit au collet d’une main, et de l’autre lui appuie son épée sur la poitrine en lui disant:
—Conduis-moi à tes mines!...
Le commandant, étourdi, hésite.
—Conduis-moi à tes mines, répète Laveneur d’une voix terrible, à l’instant, ou tu es mort!
Et en même temps, il appuie plus fort la pointe de son épée.
Epouvanté, perdant la tête, le commandant se décide à marcher, et Laveneur, sur ses indications, arrache les mèches de sa propre main.
Une heure après, la garnison du fort était prisonnière, et le lendemain le château avec ses six mille défenseurs était au pouvoir de Laveneur...
Eh bien! c’est à cet homme que Dumouriez fit rendre la veste de simple hussard...
Grande, il faut bien le dire, fut la surprise des soldats, mais l’effet fut admirable, et peut-être décisif, tant il est vrai que souvent des circonstances infimes produisent d’immenses résultats. Ce fait décida de la discipline de l’armée. Les plus mutins des volontaires se disaient entre eux.
—Il ne plaisante pas, le général.
Et voyant obéir sans récriminations un homme de la trempe de Laveneur, avec énormes moustaches, son air terrible et son bonnet de police sur le côté, ils ajoutaient:
—Nous ferons bien d’obéir, nous aussi...
Tout réussissait, d’ailleurs, à Dumouriez, en ces commencements d’une campagne qui allait décider du sort de la France... Les événements le récompensaient de la rapidité de ses décisions et de sa prévoyance.
A chaque pas, pour ainsi dire, du difficile mouvement qu’il exécutait pour prévenir les Prussiens aux défilés de l’Argonne, une nouvelle favorable lui arrivait.
L’avant-garde prussienne, tombant en plein dans le piége qu’il avait tendu, s’était retirée devant la démonstration de Dillon... On lui annonçait de Châlons quelques pièces d’artillerie... Les troupes du camp de Maulde, à la seule idée de rejoindre leur général adoré, faisaient deux étapes par jour... Kellermann venait de lui envoyer un de ses aides de camp pour lui promettre le concours le plus dévoué...
Enfin le 4 septembre 1792, Dumouriez put respirer... Il tenait une partie des défilés de l’Argonne, et il était de sa personne campé à Grand-Pré.
C’est alors qu’il écrivit à l’Assemblée nationale la lettre demeurée célèbre:
—Maintenant j’attends les Prussiens... Je suis aux Thermopyles et, plus heureux que Léonidas, je n’y périrai pas!...
Alors, mes amis, de même que leur chef, les soldats espéraient.
La foi, de son radieux flambeau, illuminait leurs routes.
Ils avaient la foi.
Qui eût désespéré de la patrie, eût paru lâche, eût paru traître.
De tous ces volontaires, arrachés la veille à leur charrue ou à leur comptoir, il n’en était pas un qui n’eût fait le sacrifice de sa vie.
Et quand on ne craint plus la mort, on est invincible.
Le soir, réunis autour des feux du bivouac, sans souci de la pluie qui tombait, du jeûne de la journée, des privations du lendemain, ils se disaient entre eux.
«—Qu’ils viennent, les Prussiens, ils verront combien en France nous sommes durs à mourir!»
Et les lettrés d’entre eux—car il était des génies littéraires, dans ces armées du dévouement et de la liberté—les philosophes ajoutaient:
—Qu’ils nous tuent, ces Prussiens, l’idée qui est en nous, l’idée de liberté s’échappera de nos blessures béantes et nous vengera!...
J’étais là, mes amis, mon âme s’exaltait à ces saints enthousiasmes, et en moi-même je me disais:
«O France, mère adorée et sacrée, mère pour qui nous sommes prêts à verser notre sang jusqu’à la dernière goutte, France, si jamais dans l’avenir un tel péril revenait pour toi, veuille Dieu que tes enfants, les nôtres, soient dignes de nous et qu’ils sachent mourir avant que tu ne sois frappée, ô Patrie!...
Cependant, nous étions déjà au 13 septembre...
La saison pluvieuse rendait les chemins détestables.
Les Prussiens, après avoir consommé les vivres qu’ils avaient trouvé dans Longwy et Verdun, achevaient de dévorer le pays déjà épuisé par l’armée française, et en étaient réduits à tirer difficilement leur subsistance de Trêves et de Luxembourg.
Les garnisons de Sedan, Montmédy, Thionville, Metz, même, allaient leur faire une guerre implacable, inquiéter leur ligne de retraite, menacer leurs communications et couper leurs convois.
Beurnonville allait arriver le 14 à Rhétel, à dix lieues de Grand-Pré, avec des renforts.
Kellermann allait être le 18 à Bar, d’où sa jonction ne serait plus qu’une question d’adresse et de manœuvres.
Toutes les attaques des Prussiens ne faisaient qu’irriter le courage de l’armée française, dont la position semblait inexpugnable.
Le roi de Prusse et son généralissime Brunswick commençaient à s’inquiéter.
Les mouvements populaires sur lesquels ils avaient compté ne venaient pas. Les paysans, terrifiés d’abord de leurs proclamations, commençaient à redresser la tête, et sortaient les vieux fusils de leurs cachettes.
Les soldats prussiens commençaient à sentir la faim, et quand ils n’ont pas à manger «plein leur ventre,» ces robustes gens du Nord, ils sont bien malades. On commençait à les rencontrer le long des routes, blêmes, les joues creuses, l’œil brillant, tremblant la fièvre, en quête de quelques mauvais fruits verts, qui étaient comme un poison pour leur estomac délabré, et qui les prédisposaient aux atteintes de la dysenterie.
Alors, ceux qui avaient tant calomnié Dumouriez, devenus ses flatteurs, ne savaient par quels éloges hyperboliques faire oublier leurs blâmes, et le pressaient de livrer bataille.
—Avec une armée telle que la vôtre, lui disaient-ils, la victoire ne saurait être douteuse.
Mais lui, dont la tête restait froide, au milieu des plus brûlantes émotions, répondait tranquillement:
—Laissez faire le temps, laissez faire les pluies!... Livrer une bataille, moi! pas si fou, je pourrai la perdre!... Renfermons-nous dans nos places fortes, hors de la portée des Prussiens; faisons le vide autour d’eux, coupons-leur les vivres, harcelons-les, fatiguons-les, tâchons que la France devienne pour eux un désert où ils erreront comme des loups affamés, et nous en viendrons à bout sans combat.
La fortune nous souriait enfin, quand une faute de Dumouriez mit la France à deux doigts de sa perte, et changea la belle situation dans laquelle il se trouvait en une position plus critique et plus dangereuse que jamais.
Il avait placé à la Croix-aux-Bois un colonel de dragons avec son régiment, deux bataillons de grenadiers et quatre pièces de campagne.
Cette force lui avait paru suffisante pour garder ce passage très difficile, d’autant plus que ce colonel lui avait mandé qu’il avait exécuté ponctuellement ses ordres, et que ses retranchements et ses abatis étaient inattaquables, qu’il les avait prolongés jusqu’à la tête du bois, qu’il avait rendu la route impraticable par des tranchées et par des puits.
Le colonel mandait qu’outre ses bataillons il y avait à Vouziers un excellent bataillon de volontaires des Ardennes, et un de ceux de l’ancienne garnison de Longwy, qu’en leur donnant des armes, ils suffiraient amplement à la défense de ce passage...
Il demandait en conséquence à rejoindre Dumouriez en ramenant avec lui un de ses bataillons et trois escadrons de son régiment.
Dumouriez, sans autre examen, et avec une légèreté impardonnable, en un chef d’armée, ajouta foi au rapport de ce colonel qui avait fait la guerre en Amérique, qui était d’un âge mûr et qui ne paraissait pas devoir en imposer.
La lettre du colonel était du 11 septembre.
Le 12, Dumouriez lui envoya l’ordre de laisser 200 hommes dans les retranchements, et de rentrer avec le reste de sa division.
En même temps, il donnait au commandant de son artillerie, l’ordre le plus positif d’envoyer sur le champ 600 fusils au bataillon des Ardennes avec cent cartouches par arme.
Bien plus, il ordonna au commandant de ce bataillon des Ardennes d’aller occuper les retranchements de la Croix-au-Bois avec sa troupe et trois cents cavaliers de la gendarmerie nationale qui se trouvaient en garnison à Vouziers.
Quoique la Croix-au-Bois fût très près de Grand-Pré, Dumouriez n’avait jamais trouvé le temps d’aller visiter ce poste si important.
Il s’en était rapporté à la fidélité des cartes, comme s’il n’eût pas su que les cartes, en France, ne semblent faites que pour induire en erreur ceux qui les consultent.
C’était une première faute.
Il n’y avait pas même envoyé Thouvenot, qui l’eût admirablement suppléé.
Il n’y avait point établi de batterie de canons de huit et de douze, encore qu’il en eût en quantité.
En tout et pour tout, il s’en était rapporté à l’expérience d’un subalterne dont il ne savait rien, sinon qu’il passait pour un habile homme de guerre... Comme s’il n’eût pas su ce qu’il faut croire de ces réputations banales que rien jamais n’a justifiées et qui s’emparent, par leur impudence, des places qui devraient être réservées au mérite seul.
Seconde faute, qui faillit faire échouer l’admirable plan qu’il avait conçu et que jusqu’alors il avait si bien conduit.
Donc, le 13 au matin, la Croix-au-Bois fut abandonnée par le colonel et la plus grande partie de ses troupes.
Et par surcroît de malheur, l’officier commandant le parc d’artillerie négligea l’ordre si précis qu’il avait reçu, et n’envoya au bataillon des Ardennes, ni armes, ni munitions...
Avertis par leurs espions, les Prussiens ne tardèrent pas à essayer de profiter des fautes commises, et dès le lendemain, avant midi, ils se présentèrent en forces au défilé de la Croix-au-Bois.
Les abatis avaient été si mal faits qu’ils furent à peine un obstacle... La route avait été si superficiellement coupée qu’en moins de rien elle fut assez réparée pour donner passage à l’artillerie.
Les cent hommes laissés en position essayèrent d’abord de se défendre, puis, reconnaissant l’inutilité de leurs efforts, ils se débandèrent, s’enfuirent à travers bois, et ne tardèrent pas à arriver au camp de Dumouriez.
Lui frémit...
Il vit l’Argonne, le boulevard de la France, au pouvoir des Prussiens.
Sans perdre une seconde, il donna au général Chazot deux brigades, six escadrons et douze pièces de huit, lui commandant de courir reprendre à tout prix le défilé.
—Et pas d’hésitation, commanda-t-il... Ne laissez pas l’ennemi se retrancher, abordez-le à la baïonnette...
Chazot, malheureusement, hésita et tâtonna...
Il perdit un jour entier, et le lendemain il lui fallut des efforts inouïs et un combat affreusement meurtrier pour reconquérir la Croix-au-Bois...
Si du moins il eût su la garder!
Mais non.
A peine maître de la position, au lieu de la fortifier il laissa ses troupes se reposer...
Si bien que les Prussiens revinrent plus nombreux, l’attaquèrent avec une irrésistible fureur, et le forcèrent à se replier sur Vouziers, après avoir perdu ses canons.
A la même heure, une autre colonne prussienne s’emparait du passage du Chêne-Populeux.
Ces deux nouvelles arrivant coup sur coup à Dumouriez n’ébranlèrent pas son courage.
Il vit sa position si belle la veille, désespérée... Il se vit cerné, tourné, pris au piége qu’il avait tendu à l’ennemi... N’importe.
Sa résolution était si bien prise de mourir plutôt que de mettre bas les armes, qu’il garda toute sa présence d’esprit et ces apparences de sécurité parfaite indispensables à un général en chef.
Il rassemble ses aides de camp, et, avec cette promptitude de décision qui est le propre des grands capitaines, il leur dicte ses ordres.
Beurnonville quittera Rhétel à l’instant et se hâtera d’accourir à Sainte-Menehould, et où lui-même Dumouriez va se rendre, et où Kellermann opérera sa jonction.
Kellermann doublera les étapes pour arriver plus vite.
Dillon, sans s’inquiéter de sa droite ni de sa gauche, devra tenir comme un roc aux débouchés des Islettes et de la Chalade.
Ces précautions prises, ce nouveau plan arrêté, Dumouriez ne songea plus qu’à tirer le gros de son armée, qu’il commandait en personne, de cette impasse de Grandpré, où d’un moment à l’autre il pouvait être accablé par toutes les forces prussiennes.
Maître encore de tout le cours de l’Aisne, il entrevoyait la possibilité d’y prendre une position formidable pour en défendre le passage.
Un temps affreux l’aida à se sauver.
Il se garda bien de faire aucun préparatif apparent de départ, aucun mouvement, aucun déplacement, surtout à l’avant-garde, tant qu’il fit jour...
Au milieu de tous ses embarras, le général prussien prince de Hohenlohe lui ayant fait demander une entrevue, il comprit que l’ennemi se défiait et voulait pénétrer dans ses lignes...
Cependant ne pouvant se rendre au rendez-vous et sentant quels soupçons eût excités un refus, il y envoya le général Duval.
Le prince de Hohenlohe fut exact, tout se passa en politesse réciproques, et le prince ne cacha pas sa surprise à Duval de voir tant d’ordre dans ses postes, et tant d’officiers parfaitement polis...
Les émigrés avaient dit aux Prussiens que l’armée française n’était commandée que par des bijoutiers, des cordonniers et des tailleurs ignorant même comment se charge un canon.
Duval, officier d’une haute intelligence désabusa l’émissaire prussien, lui expliquant que tous les généraux français avaient fait plusieurs campagnes, et que le général en chef, Dumouriez avait gagné tous ses grades sous l’ancienne monarchie.
Le prince de Hohenlohe ne put rien surprendre d’une retraite que tout le monde ignorait encore, et Duval—mentant d’autant mieux qu’il croyait dire la vérité,—annonça que le lendemain Beurnonville et Kellerman devaient arriver à Grandpré.
Cependant la nuit venue, l’avant-garde se replia en trois colonnes, sans bruit, n’ayant ni augmenté ni diminué ses feux, la droite par Marque, le centre par Chevières et la gauche par Grandpré.
Elle rompit les ponts après elle. Duval et Stengel la commandaient. Ils firent halte, pour donner à l’armée le temps de se mettre en marche étant chargés de faire son arrière-garde.
A minuit, Dumouriez partit du château de Grandpré, où il avait établi son quartier-général et monta au camp, qu’il trouva encore tendu.
Les chemins entre le château et le camp étaient si mauvais, la nuit était si noire, que les ordonnances envoyées en avant s’étaient perdues.
Dumouriez se gardant bien de faire battre le tambour, fit passer de bouche en bouche l’ordre de lever les tentes et de plier bagages, et moins d’une heure plus tard, sur les deux heures de la nuit, l’armée se mettait en marche en silence.
Dumouriez gagna d’abord les hauteurs d’Autry et donna ses ordres pour qu’on s’y rangeât en bataille.
A huit heures, les dernières troupes passèrent les ponts de Senucque et de Grandcham et prirent position.
Grâce à une manœuvre d’une audace et d’une adressé inouïe, Dumouriez venait de sauver son armée, et de la replacer dans une position à attendre la bataille.
Rassuré, il écrivit à Danton:
«J’ai été forcé d’abandonner le camp de Grand-Pré... La retraite s’est faite avec un bonheur que je n’osais pas espérer... Je réponds de tout...»
Il avait raison d’en répondre:
Le 20 septembre, date à jamais mémorable de notre histoire, sur les trois heures du matin, l’armée prussienne s’ébranla pour attaquer la petite armée française, qu’elle apercevait audacieusement postée sur la hauteur du moulin de Valmy.
Un ravin séparait les deux armées, dont la position avait ceci d’extraordinaire que les Français faisaient face à la France, tandis que les Prussiens avaient à dos le pays qu’ils venaient d’envahir.
Brunswick avait fait avancer cinquante-huit bouches à feu, pensant, il l’a avoué depuis, «qu’une douzaine de volées de canon, le ronflement des boulets, le bruit et la fumée» suffiraient pour épouvanter et disperser ces bataillons de volontaires qu’on avait la folie d’opposer à ses vieilles troupes...
Mais il se trompait... La jeune armée de la Révolution sut garder sous le feu une si héroïque attitude que Brunswick, saisi de stupeur, se retournant vers ses officiers, leur dit:
—Voyez, messieurs, voyez à quelles troupes nous avons affaire!... Qui diable eût jamais cru cela!
Oui, en effet, qui diable eût jamais cru que les vieux grenadiers de Frédéric, exaltés par la présence et les exhortations de leur roi, ne réussiraient pas à enlever les positions choisies par Dumouriez...
C’est ce qui arriva, cependant...
Après une canonnade de plus de douze heures, après avoir vu par cinq fois ses profondes colonnes d’attaque repoussées, Brunswick se décida à donner l’ordre de la retraite.
Par deux fois le roi de Prusse, frémissant de colère, ordonna à son généralissime de tenter un dernier effort.
—Nous ne vaincrons pas ici, répondit Brunswick découragé...
L’armée de la Révolution venait de recevoir le baptême du feu et de gagner sa première bataille... A moins d’un mois de là les Prussiens battaient en retraite...
Dumouriez avait tenu parole: il avait sauvé la France.
FIN
Saint-Omer Typ H D’Homont.
| On a effectué les corrections suivantes: |
|---|
| Lukner=> Luckner {pg 12, 17, 195} |
| parmi les palfreniers=> parmi les palefreniers {pg 49} |
| ses cheveux s’échapassent en désordre=> ses cheveux s’échappassent en désordre {pg 62} |
| Qu’était le soldait de l’ancienne monarchie=> Qu’était le soldat de l’ancienne monarchie {pg 108} |
| je me suis demandé porfois=> je me suis demandé parfois {pg 126} |
| sceptiques du lendedemain=> sceptiques du lendemain {pg 144} |
| n’avait plus au au monde=> n’avait plus au monde {pg 150} |
| Sédan=> Sedan {pg 158, 166} |
| Où sont les bèches et les pioches=> Où sont les bêches et les pioches {pg 169} |
| que leurs chaussures les blessait=> que leurs chaussures les blessaitent {pg 183} |
| se composait donc de troupes ne ligne=> se composait donc de troupes de ligne {pg 212} |
| quant il est assailli=> quand il est assailli {pg 222} |
| l’ardeur de l’ambition sonffrante=> l’ardeur de l’ambition souffrante {pg 235} |
| et dressait les plans ce campagne=> et dressait les plans de campagne {pg 236} |
| d’une infatiguable activité=> d’une infatigable activité {pg 274} |
| la dyssenterie=> la dysenterie {pg 291} |
| Bruswick se décida=> Brunswick se décida {pg 300} |