

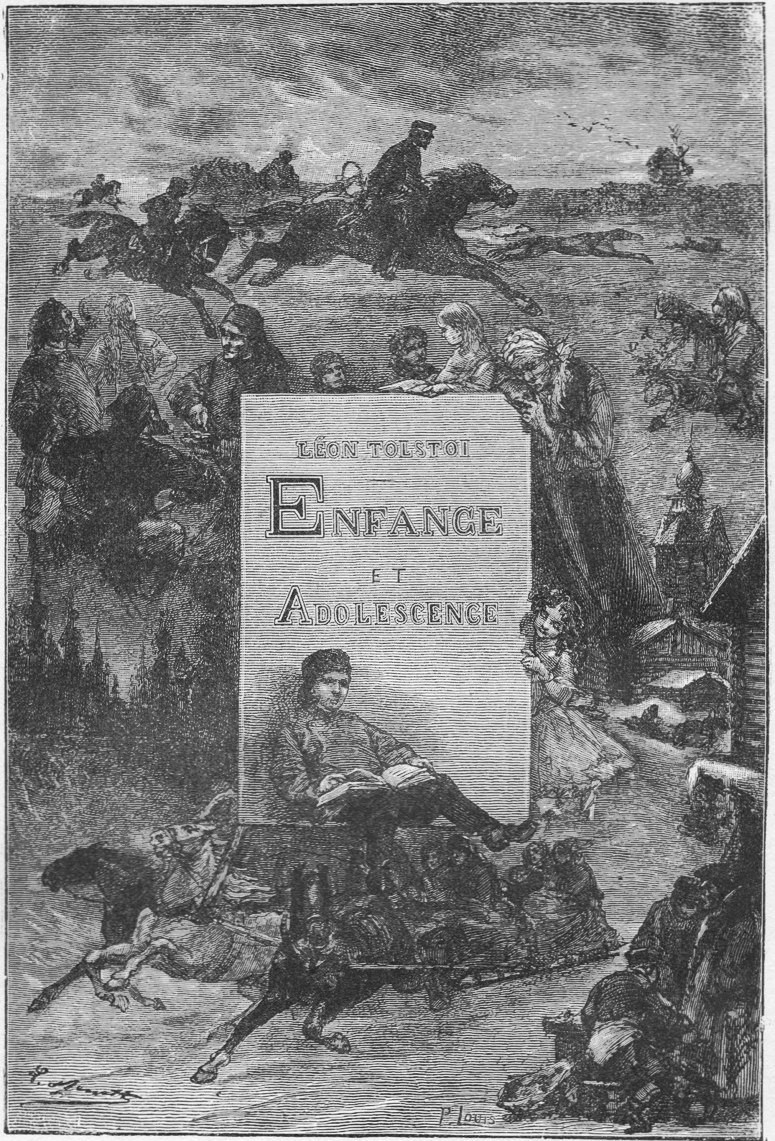

Le 12 août 18.., trois jours après le dixième anniversaire de ma naissance, où j'avais été comblé de tant de merveilleux cadeaux, Karl Ivanovitch me réveilla à sept heures du matin en abattant une mouche au-dessus de mon oreiller, au moyen d'une feuille de papier collée à un bâton. Il s'y prit si maladroitement que sa main heurta la petite image de mon ange gardien accrochée au haut dossier de mon lit en bois de chêne, et que l'insecte tomba droit sur ma tête.
Je sortis le nez de sous la couverture, j'arrêtai de la main la petite image qui se balançait toujours, et jetai la mouche écrasée sur le plancher. Bien qu'à moitié endormi, je dardai des regards furieux à Karl Ivanovitch.
Notre précepteur, à mon frère et à moi, vêtu d'une robe de chambre d'indienne, retenue à la taille par une ceinture de même étoffe, et coiffé d'une calotte rouge tricotée, ornée d'un gland, les jambes enfouies dans des bottes molles en peau de bouc, continuait à longer les murs pour viser les mouches, et tapait à vide avec un bruit retentissant.
«Soit, pensais-je en moi-même, c'est vrai, je ne suis qu'un petit garçon, mais est-ce une raison pour troubler mon sommeil? Pourquoi ne va-t-il pas chasser les mouches près du lit de Volodia? La tapisserie en est toute noire dans ce coin! Mais non, Volodia est plus âgé, et c'est parce que je suis petit qu'il me tourmente ainsi. Il passe sa vie à me faire des choses désagréables.... Il sait très bien qu'il m'a réveillé et qu'il m'a effrayé, mais il fait mine de ne pas le remarquer. Oh! quel homme dégoûtant! Et sa robe de chambre, sa calotte, et le mouchet de sa calotte, tout en lui est dégoûtant.»
Pendant que j'exhalais ainsi in petto ma colère contre Karl Ivanovitch, il revint vers mon lit, regarda sa montre qui était posée contre le mur, dans un petit soulier brodé de perles de verre, suspendit le chasse-mouche à un clou, et, se retournant de notre côté, de la plus belle humeur du monde, il s'écria, de sa bonne grosse voix:
«Debout, enfants, debout, il est temps de se lever, maman est déjà au salon.» Puis il revint vers moi, s'assit au pied de mon lit et tira une tabatière de sa poche.
Je feignis de dormir; Karl Ivanovitch s'administra d'abord une prise, se moucha, fit claquer ses doigts, et, se tournant vers moi en souriant, se mit à me chatouiller la plante des pieds.
«Lève-toi, lève-toi, petit paresseux!» répétait-il.
Malgré ma crainte d'être chatouillé, au lieu de sauter à bas du lit, je m'enfouis plus profondément sous les oreillers, et, sans répondre, je me mis à donner des coups de pied vigoureux, en prenant toutes les peines du monde pour me retenir de rire.
«Comme il est bon, pourtant! pensais-je, et comme il nous aime! et j'ai pu avoir de si mauvais sentiments pour lui!»
J'étais mécontent de moi-même et de Karl Ivanovitch, j'étais partagé entre le désir de rire et de pleurer, mes nerfs étaient agacés.
«Laissez-moi, Karl Ivanovitch!» m'écriai-je en sortant ma tête des coussins.
Mon maître surpris lâcha mes pieds et se mit à me questionner avec anxiété:
«Qu'as-tu? Est-ce l'effet d'un mauvais rêve?»
Son bon visage et la sollicitude avec laquelle il s'efforçait de pénétrer le motif de mes larmes les faisaient couler avec plus d'abondance. J'avais honte de moi-même, je ne pouvais plus comprendre comment, quelques minutes auparavant, j'avais pu ne pas aimer Karl Ivanovitch et trouver sa robe de chambre, sa calotte et son mouchet dégoûtants; maintenant, au contraire, je les trouvais très jolis, et le mouchet me semblait le signe incontestable de sa bonté.
Je lui répondis que je pleurais parce que j'avais fait un mauvais rêve: maman était morte, et on l'emportait pour l'enterrer. C'était une fiction, je ne me rappelais point mes songes de cette nuit-là; mais, lorsque Karl Ivanovitch, touché de mon récit, se mit à me consoler et à me tranquilliser, il me sembla que j'avais dit vrai et que j'avais eu réellement ces terribles visions; mes larmes reprirent de plus belle pour une autre cause.
Notre menin Nicolas entra; c'était un petit homme très propret, toujours grave, ponctuel, respectueux et grand ami de Karl Ivanovitch. Il nous apportait nos habits et nos chaussures: pour Volodia, des bottes, et pour moi, les exécrables souliers attachés par des nœuds de ruban. J'aurais eu honte de pleurer en sa présence; puis le soleil du matin brillait si gaiement aux fenêtres, et Volodia contrefaisait si bien Maria Ivanovna, l'institutrice de notre sœur! Il riait aux éclats, devant son lavabo, avec une telle exubérance de gaieté, que le grave Nicolas, la serviette sur l'épaule, le savon dans une main, le pot à l'eau dans l'autre, souriait, en disant:
«C'est assez s'amuser, Vladimir Pétrovitch, ayez la bonté de vous laver....»
Cette petite scène me fit oublier tous mes chagrins.
«N'êtes-vous pas encore prêts?» cria Karl Ivanovitch, de la salle d'étude.
Sa voix était sévère et n'avait plus cet accent de bonté qui m'avait touché jusqu'aux larmes. En classe, Karl Ivanovitch n'était plus le même homme, il ne restait que le maître.
Je m'habillai à la hâte, je plongeai mon visage dans l'eau et je courus à l'appel en tenant à la main la brosse dont je lissais mes cheveux humides.
Tous les matins, après le déjeûner, à l'heure des leçons nous trouvions Karl Ivanovitch dans la salle d'étude, assis à sa place, entre la porte et la fenêtre, ses lunettes sur le nez.
A gauche de cette porte, deux petits rayons étaient appliqués contre le mur; l'un nous était destiné, l'autre appartenait en propre à notre précepteur. Sur notre tablette se confondaient toutes sortes de livres de classe et d'autres, les uns debout, les autres couchés. Il n'y avait que deux grands volumes reliés en rouge, l'Histoire des Voyages, qui fussent bien alignés contre le mur; à côté gisaient, au hasard, des spécimens de tous les formats, gros ou longs, grands et petits, des reliures sans volume, des volumes sans reliure. Au moment de la récréation, lorsque Karl Ivanovitch nous criait de mettre en ordre la bibliothèque,—c'est ainsi qu'il désignait pompeusement ces deux maigres rayons,—nous prenions à pleines mains tout ce qui couvrait la table et le jetions pêle-mêle sur notre tablette.
Celle de notre maître présentait une collection d'ouvrages moins nombreuse, mais encore plus variée que la nôtre. Trois de ces volumes sont restés dans mon souvenir: une brochure en allemand sur l'Engrais des potagers et la Culture des choux, un exemplaire de l'Histoire de la guerre de sept ans, brûlé à un coin, et un cours complet d'Hydrostatique. Karl Ivanovitch passait la plus grande partie de son temps à lire, au point d'altérer sa vue. Les livres de sa bibliothèque et un journal, l'Abeille du Nord, alimentaient exclusivement ses lectures.
Il y avait, sur le rayon de Karl Ivanovitch, un objet en particulier dont je me souviendrai toujours, et qui, plus que toute autre chose, me rappelle notre précepteur. C'était un écran en carton assujetti au moyen d'un ardillon à un petit pied de bois. Une caricature représentant une dame et son coiffeur était collée sur ce meuble. Karl Ivanovitch était très ingénieux; il avait inventé et fabriqué lui-même cet écran pour garantir de la lumière ses yeux malades.
Je crois revoir aujourd'hui comme alors sa longue silhouette dans sa robe de chambre d'indienne, et sa calotte rouge sous laquelle passent de rares cheveux gris. Il est assis devant sa petite table, l'écran projette une ombre sur son visage; il tient un livre dans une main, l'autre repose sur le bras du fauteuil; près de lui est posée sa montre avec un chasseur dessiné sur le cadran; à côté, un mouchoir à carreaux, une tabatière noire toute ronde, un étui pour ses lunettes, des mouchettes sur un petit plateau. Tout cela est si bien rangé, chaque objet se trouve si exactement à sa place, qu'à la vue de cet ordre symétrique, on sent que Karl Ivanovitch a la conscience pure et l'âme tranquille.
Souvent aux heures de récréation, après m'être amusé en bas au salon, je montais en cachette, je me glissais sur la pointe des pieds dans la salle d'étude, et je surprenais Karl Ivanovitch. Il était seul, assis dans son fauteuil, penché sur un de ses bouquins chéris avec une physionomie sereine et noble en même temps; quelquefois il ne lisait plus, les lunettes glissaient sur le bout de son nez aquilin, ses yeux bleus à demi ouverts prenaient une expression singulière, ses lèvres souriaient mélancoliquement. Dans la chambre régnait un silence absolu, on n'entendait que le souffle égal de notre maître et le tic tac de la montre au chasseur.
Il ne me remarquait pas, et moi je m'arrêtais à la porte et je pensais:—«Pauvre cher vieillard! Nous sommes nombreux, nous jouons, nous nous amusons, et lui il est seul, tout seul, personne ne le caresse, il a raison de dire qu'il est orphelin. L'histoire de sa vie est si triste! Je me rappelle comment il l'a racontée à Nicolaï; c'est affreux de se trouver dans sa situation.» Et, pris de pitié, je m'approchais de lui, je lui prenais les mains et je lui disais:
«Cher, cher Karl Ivanovitch!»
Il aimait à s'entendre appeler ainsi, et me répondait par des caresses, sans dissimuler son émotion.
Sur l'autre mur de la salle pendaient des cartes géographiques, toutes déchirées, mais artistement raccommodées par Karl Ivanovitch. Sur la troisième paroi, au milieu de laquelle se trouvait la porte qui donnait sur le couloir, à droite, deux règles étaient attachées: l'une couverte de profondes entailles, c'était la nôtre, l'autre toute neuve, c'était celle de notre maître; il s'en servait plus souvent pour nous stimuler au travail que pour régler des pages.
De l'autre côté de la porte était suspendu un tableau noir sur lequel Karl Ivanovitch marquait nos grands délits, au moyen d'une grande croix et nos petits délits par une petite croix.
A gauche du tableau noir se trouvait le coin où Karl Ivanovitch nous mettait en pénitence.
Ah! ce coin, je me le rappelle bien! Je me souviens des moindres détails: de la petite porte du poèle, de la bouche de chaleur qui faisait tant de bruit quand on l'ouvrait. Souvent je suis resté dans ce coin, à genoux si longtemps, que les rotules et le dos me cuisaient, et je murmurais en moi-même:—«Karl Ivanovitch m'a oublié, il se trouve bien dans son fauteuil avec son Traité d'Hydrostatique, mais moi je souffre.» Et je me mettais, pour attirer son attention, à ouvrir et à fermer lentement la porte du poèle ou à gratter le crépi de la muraille; mais, si par hasard un trop gros morceau de plâtre se détachait et tombait à terre avec fracas, la crainte que je ressentais était sans doute plus terrible que le châtiment. Je regardais Karl Ivanovitch, et lui ne bronchait pas; il restait toujours renversé dans son fauteuil, le livre à la main, comme s'il ne voyait et n'entendait rien.
Le milieu de la chambre était occupé par une table carrée, couverte d'une toile cirée, noircie et déchirée, et qui laissait saillir les angles de bois taillés et découpés en tous sens par nos canifs. Des tabourets étaient rangés autour; ils étaient en bois, et un long usage les avait enduits d'une couche noire qui leur servait de vernis.
La quatrième muraille était percée de trois fenêtres qui s'ouvraient sur une route dont chaque flaque, chaque ornière, le moindre caillou m'étaient depuis longtemps connus et chers par cela même. De l'autre côté de la route, une allée de tilleuls taillés, entre lesquels on apercevait ici et là un échalier en treillis; au delà de l'avenue on distinguait la prairie, entre un enclos réservé aux meules de blé et la forêt; dans le lointain on discernait la maisonnette du garde.
D'une fenêtre, à droite, on découvrait la partie de la terrasse où les grandes personnes se tenaient avant le dîner.
Souvent, pendant que Karl Ivanovitch corrigeait ma dictée, je regardais dans cette direction; je voyais poindre la chère tête brune de maman ou le dos de quelque autre personne, et j'entendais un bruit vague de conversation et de rire; j'étais tout chagriné de ne pouvoir être auprès d'eux, et je me disais: «Quand donc serai-je grand? quand est-ce que j'aurai fini mes études, et, au lieu de me morfondre sur mes devoirs, pourrai-je rester dans la compagnie de ceux que j'aime?» Mon dépit se changeait en tristesse, et je me perdais dans des rêveries, sans entendre les observations de Karl Ivanovitch sur mes bévues.
Tous les matins, après la toilette, avant les leçons, notre maître posait sa robe de chambre, revêtait son habit bleu, froncé aux épaules, rajustait sa cravate devant le miroir et nous conduisait en bas pour souhaiter le bonjour à maman.
Maman était assise au salon et préparait le thé; d'une main elle refermait le robinet du samovar, et de l'autre elle maintenait en équilibre au-dessus la théière d'où l'eau débordait sur le plateau, sans que ma mère y prit garde, bien que ses yeux fussent fixés sur l'urne à thé. Elle ne remarqua pas non plus notre entrée au salon.
Lorsque la pensée évoque les traits d'un être aimé, les souvenirs du passé l'assaillent, en foule si pressée, que son visage nous apparaît confusément, comme au travers de larmes. Ce sont les larmes de l'imagination.
Quand je cherche à me représenter ma mère telle qu'elle était à cette époque, je ne vois plus que ses yeux bruns qui exprimaient toujours la même bonté et le même amour, le grain de beauté un peu au-dessous des quelques boucles folies qui frisotaient sur sa nuque, et son petit col blanc brodé.
Je sens encore le toucher de sa main douce et fluette qui me caressait si souvent, et que j'aimais tant à baiser; mais l'expression générale de son visage et de sa personne m'échappe tout à fait.
Je revois encore dans tous ses détails cette petite scène matinale: le long divan, à gauche le vieux piano anglais à queue où ma petite sœur prenait sa leçon de musique. Lioubotchka était une petite brunette; ses doigts, encore rosés sous l'impression de l'eau froide, se tendaient avec un effort visible pour jouer les études de Clémenti. Elle avait onze ans et portait une robe courte que dépassait la dentelle blanche de son pantalon; sa main ne pouvait donner l'octave qu'en l'arpégeant.
Assise de profil auprès d'elle se tenait Maria Ivanovna, Mimi, comme nous l'appelions, avec son bonnet à rubans roses et son caraco bleu. Son visage était rouge de mécontentement et prit une expression encore plus sévère lorsque Karl Ivanovitch entra. Elle le toisa du regard, et, sans répondre à son salut, continua de marquer la mesure en frappant du pied sur le plancher: un, deux, trois,... un, deux, trois,... d'un ton plus retentissant et plus péremptoire qu'auparavant.
Karl Ivanovitch n'eut pas l'air de s'en apercevoir; comme d'habitude, il s'inclina devant maman pour lui souhaiter le bonjour et lui baiser la main.
Elle revint à elle, comme quelqu'un qui sort d'un rêve, et, secouant sa chère petite tête, sans doute pour en chasser les pensées désagréables, elle tendit ses doigts à notre précepteur, et, pendant qu'il les baisait avec respect, effleura du bout de ses lèvres la tempe ridée du vieillard.
«Merci, cher Karl Ivanovitch ... est-ce que les enfants ont bien dormi?»
Il était sourd d'une oreille, et le bruit du piano l'empêcha d'entendre la question de ma mère. Il s'inclina plus bas devant elle, appuya une main sur la table, et, debout sur un pied, avec un sourire qui me semblait alors l'expression de la politesse la plus raffinée, il souleva son bonnet et dit:
«Vous m'excusez, Nathalia Nicolaevna?»
Karl Ivanovitch n'enlevait jamais son bonnet rouge, de crainte de s'enrhumer, et, chaque fois qu'il entrait au salon, il s'en excusait.
«Couvrez-vous, Karl Ivanovitch ... je vous demande si les enfants ont bien dormi,» répéta maman en s'approchant de lui et en haussant la voix.
Il n'entendit pas davantage, et, abritant sa calvitie sous sa calotte écarlate, il sourit encore plus gracieusement.
«Cessez le piano, pour un moment, Mimi, dit ma mère en souriant, on ne s'entend plus.»
Quand maman souriait, son visage, toujours beau, rayonnait, et tout semblait en fête autour d'elle! Si, dans les moments difficiles de la vie, je pouvais parfois revoir ce sourire, je ne saurais pas ce que c'est que la tristesse. Il me semble que toute la beauté de la physionomie tient au sourire; si le sourire donne plus de charme au visage, il est beau; si le sourire ne le transfigure pas, c'est un visage ordinaire; s'il l'enlaidit, c'est que ce visage ne peut être beau.
Lorsque ma mère m'eut embrassé, elle prit ma tête entre ses mains, la renversa et, me regardant en face, me dit:
«Tu as pleuré aujourd'hui?»
Je ne répondis pas, elle me baisa sur les yeux et répéta:
«Pourquoi as-tu pleuré?
—J'ai pleuré à cause d'un rêve,» dis-je en me rappelant tous les détails de ce songe imaginaire, et en tremblant à ce souvenir.
Karl Ivanovitch appuya ce que je venais de dire, mais ne raconta pas mon rêve. Après avoir parlé du temps, ma mère mit sur le plateau six morceaux de sucre pour les domestiques les plus favorisés, puis elle se leva, et, s'approchant de son métier à broder, près de la fenêtre, elle dit:
«Maintenant, mes enfants, courez vers votre père et dites-lui qu'il passe chez moi, sans faute, avant d'aller voir rentrer les blés.»
La musique scandée par les coups de pied rythmiques, accompagnés de regards féroces, recommença de plus belle, et nous nous échappâmes du salon pour nous rendre auprès de notre père. Karl Ivanovitch nous suivit.
Papa était debout devant son bureau; il parlait avec vivacité, désignant à son intendant, Iakov, des enveloppes, des papiers et des liasses de billets, et lui donnant des explications très animées. Iakov se tenait à sa place accoutumée entre la porte et le baromètre, et, les bras croisés derrière le dos, agitait ses doigts en tous sens.
Plus papa se fâchait, plus les doigts se démenaient; au contraire, dès que papa se taisait, les doigts s'arrêtaient aussi. Mais, quand Iakov prenait la parole, ses doigts se livraient à une gymnastique désespérée. Il me semble que, d'après leurs mouvements, on aurait pu deviner les pensées secrètes de Iakov. Son visage toujours calme exprimait à un degré égal le sentiment de sa propre dignité et la soumission.
En nous apercevant, papa nous dit, sans se déranger:
«Attendez ... je suis à vous tout de suite.»
Je me trouvais près de la table, et je me mis à déchiffrer les adresses inscrites sur les enveloppes. Il y en avait une qui portait «à Karl Ivanovitch Mauer».
Ayant remarqué que je venais de commettre une indiscrétion, mon père posa sa main sur mon épaule et, du geste, m'invita à m'éloigner de la table. Je ne compris pas si c'était une caresse ou une observation; mais, à tout hasard, je baisai la grande main nerveuse qui reposait sur mon épaule.
Quand il eut fini ce qu'il avait à dire à son intendant, mon père se tourna vers nous, et, sans préambule, nous déclara que nous avions assez longtemps regardé voler les mouches à la campagne, que nous n'étions plus de petits garçons, et qu'il était temps de commencer des études sérieuses.
«Vous savez déjà, n'est-ce pas, que je pars ce soir pour Moscou. Eh bien! je vous prends avec moi, dit-il. Vous vivrez chez votre grand'mère, et maman restera ici avec les petites. Surtout n'oubliez pas que la seule chose qui puisse la consoler de votre absence, ce sera d'apprendre que vous êtes appliqués à vos leçons, et qu'on est content de vous.»
Bien que les préparatifs qui se faisaient depuis quelque temps dans la maison nous eussent déjà fait pressentir un événement extraordinaire, cette nouvelle nous surprit pourtant; Volodia devint tout rouge d'émotion et fit d'une voix mal assurée le message de notre mère.
«Voilà, pensais-je, le malheur que mon mauvais rêve me prédisait, pourvu qu'il n'arrive rien de pis!»
Je songeai aussitôt au chagrin qu'éprouverait maman; mais le sentiment que nous étions de grands garçons me remplissait de satisfaction.
«Si nous partons aujourd'hui, nous n'aurons point de leçons.... Voilà une bonne chose!» me disais-je.
Pourtant, je regrettais beaucoup Karl Ivanovitch: «Il partira aussi ... cette lettre à son adresse le lui annonce sans doute....» Et je me dis que j'aimerais mieux étudier sans relâche et ne pas me séparer de maman, ni faire de la peine à ce pauvre Karl Ivanovitch; il est déjà assez malheureux sans cela!
Toutes ces idées se croisaient dans ma tête; je ne bougeais pas de ma place, et je regardais fixement les rubans noirs de mes souliers.
Après avoir discuté avec Karl Ivanovitch la baisse du baromètre, mon père intima l'ordre à Iakov de ne pas donner aux chiens leur pâtée et de les tenir prêts pour une dernière partie de chasse. Contrairement à mon attente, il nous envoya en classe, mais nous promit de nous emmener à la chasse.
Avant d'entrer dans la salle d'étude, je courus sur la terrasse; Milka, la chienne favorite de papa, était couchée au soleil, les yeux fermés.
«Chère Milka, lui dis-je, en caressant et en baisant son museau luisant, nous devons partir aujourd'hui, nous ne nous reverrons plus.»
Et je fondis en larmes.

Karl Ivanovitch était de fort mauvaise humeur; on pouvait le deviner au froncement de ses sourcils, au geste brusque dont il jeta son surtout dans la commode, à la précipitation avec laquelle il noua sa ceinture, à l'incision profonde qu'il fit avec son ongle dans le livre des Dialogues, pour marquer le morceau que nous devions apprendre par cœur.
Mon frère était appliqué; mais moi j'étais si ému, que je ne pouvais rien faire. J'avais beau regarder mon livre, je ne parvenais pas à fixer mon attention, et les larmes qui me montaient aux yeux, chaque fois que je pensais à la prochaine séparation, m'empêchaient de distinguer les lettres.
Quand vint l'heure de réciter, Karl Ivanovitch ferma les yeux, c'était un mauvais signe, et se mit à me questionner. Je ne pouvais réprimer les sanglots qui m'empêchaient de répondre.
La leçon de calligraphie suivit; mes larmes, en tombant sur le papier, firent de si grosses taches, qu'on eût dit que j'avais écrit avec de l'eau sur du papier de soie.
Karl Ivanovitch se fâcha, me fit mettre à genoux et me reprocha mon entêtement; il déclara que je faisais semblant d'être affligé, et me menaça de sa règle si je ne demandais pas pardon. Mais je ne pouvais rien dire, tant les larmes m'étouffaient.
Enfin, sentant qu'il s'était emporté à tort, il sortit de la salle d'étude, entra dans la chambre de notre menin en tapant la porte derrière lui, et la laissa entre-bâillée.
Je sortis doucement de mon coin et me mis aux aguets. Je surpris ainsi la conversation suivante:
«Sais-tu, Nicolas, que les enfants vont à Moscou?
—Ah! oui, je le sais.
—Faites du bien aux autres, attachez-vous à eux, mais n'attendez pas de la reconnaissance,» reprit Karl Ivanovitch d'une voix vibrante.
Notre menin, Nicolas, assis à la fenêtre où il réparait de la chaussure, hocha la tête en signe d'assentiment.
«Je suis resté douze ans dans cette maison, continua Karl Ivanovitch, en levant les yeux et sa tabatière vers le ciel, et je peux dire que je les ai aimés, et que j'ai pris plus de peine pour eux que s'ils eussent été mes propres enfants. Tu te rappelles, Nicolas, quand Volodia a eu le typhus? j'ai passé neuf jours à son chevet, sans fermer les yeux. Ah! oui, alors j'étais «le bon», «le cher» Karl Ivanovitch; alors on avait besoin de moi, et j'étais utile à quelque chose! Et maintenant, ajouta-t-il avec un sourire amer, maintenant: «Les enfants sont devenus grands; ils doivent commencer des études sérieuses.» Comme s'ils n'apprenaient rien avec moi, Nicolas!
—Que peuvent-ils apprendre de plus? je me le demande, dit Nicolas, en posant son alène et en tirant des deux mains les ligneuls.
—Oui, maintenant on n'a plus besoin de moi, et l'on me met à la porte,... c'est ainsi qu'on tient ses promesses! cela s'appelle de la reconnaissance! Je respecte et j'aime beaucoup Nathalia Nicolaevna, dit-il en pressant ses mains sur sa poitrine,... mais elle n'a aucune influence ici; sa volonté dans cette maison est aussi impuissante que cela.... Il jeta sur le plancher, d'un geste expressif, une rognure de cuir. Je sais bien qui a fait tout le mal, et pourquoi l'on n'a plus besoin de moi; parce que je ne veux pas flatter, et que je ne dis pas oui et amen à tout, comme font certaines personnes. J'ai pris l'habitude de dire à tout le monde la vérité, reprit-il avec orgueil.... Mais, que Dieu leur pardonne, ils n'en seront pas plus riches pour m'avoir congédié, et moi, je pourrai toujours me procurer un morceau de pain ... n'est-ce pas, Nicolas?»
Notre menin leva la tête; il examina Karl Ivanovitch, comme pour se demander si vraiment cet homme pourrait se procurer un morceau de pain, et ne répondit pas.
Karl Ivanovitch continua longtemps à se plaindre sur le même ton. Je compatissais à ses peines, et je souffrais de voir que papa et mon précepteur, que j'aimais également, ne s'entendissent point.
Quand il se tut, je me remis au coin où il m'avait laissé en pénitence, je m'assis sur mes talons et me pris à songer au moyen de faire la paix entre mon père et Karl Ivanovitch.
Mon maître revint peu après, il m'ordonna de préparer mon cahier pour la dictée. Quand tout fut prêt, il se laissa choir majestueusement dans son fauteuil, et, d'une voix qui semblait sortir de profondeurs incommensurables, dicta solennellement: «De tous les vices le plus cruel est l'ingratitude.»
«Avez-vous écrit?»
Il se tut, huma lentement une prise de tabac et répéta avec plus d'emphase: «Le plus cruel est l'ingratitude.»
Ayant inscrit le dernier mot, je regardai mon précepteur.
«Punctum!» cria-t-il avec un sourire involontaire, et il fit signe de lui passer les cahiers.
Il relut cette maxime, qui exprimait sa pensée secrète, plusieurs fois, avec des intonations diverses et l'air de la plus profonde satisfaction.
Puis il commença la leçon d'histoire et vint s'asseoir près de la fenêtre. Son visage n'était plus aussi sombre qu'auparavant; il reflétait le sentiment d'un homme qui s'est vengé avec dignité de l'outrage qu'on lui a fait.
Il était déjà une heure moins un quart, mais Karl Ivanovitch n'avait point l'air disposé à nous rendre notre liberté; au contraire, il inventait à tout instant quelque nouveau sujet de leçon.
L'ennui et l'appétit augmentaient pour nous dans la même proportion. Je suivais avec impatience tous les signes précurseurs du dîner, la fille de chambre qui passait avec le torchon pour essuyer les assiettes, le bruit de la vaisselle qu'on sortait du buffet. Je me disais: «Voilà qu'on allonge la table,... on place les chaises, Mimi entre avec sa fille Katienka et ma sœur Lioubotchka; elles reviennent du jardin ... mais je ne vois pas Foka!...»
Le valet de chambre Foka venait toujours nous annoncer que la table était servie; c'était le signal que nous attendions pour jeter les livres de côté et, sans prêter plus d'attention à Karl Ivanovitch, courir à la salle à manger.
Voici des pas qui crient sur l'escalier, mais ce n'est pas Foka; je connais le craquement de ses bottes et sa démarche....
La porte s'ouvrit, et un homme entra.
Le nouveau venu était âgé d'une cinquantaine d'années, le visage blême, allongé, et grêlé de la petite vérole. Il avait de longs cheveux blancs et une petite barbiche roussâtre aux poils rares.
Sa taille était si haute, qu'il dut se courber en deux pour pouvoir passer sous la porte de la salle d'étude. Il portait des lambeaux de vêtements, les restes d'un cafetan ou d'une soutanelle; il tenait à la main un gros gourdin noué.
Dès qu'il eut pénétré dans la salle, il se mit, avec son bâton, à frapper de grands coups sur le plancher, de toutes ses forces, et, relevant en arc ses sourcils, il ouvrit la bouche démesurément et ricana d'un air terrible qui n'était pas naturel.
Cet homme était borgne, et la pupille blanche de son œil dansait toujours et rendait son visage disgracié encore plus repoussant.
«Ah! vous voilà pris!...» cria-t-il en courant à petits pas vers Volodia; il lui saisit la tête et se mit à examiner attentivement son crâne. Puis, avec le même sérieux il s'éloigna de lui, s'approcha de la table, se mit à souffler sous la toile cirée et à la couvrir de grands signes de croix ... «O! O! O! ils vont s'envoler ces chers ... je les regrette ... O! O! O!» dit-il d'une voix que ses larmes faisaient trembler; il regarda mon frère avec attendrissement, puis essuya les grosses gouttes qui tombaient de ses yeux....
Sa voix était rude et enrouée, ses mouvements précipités et saccadés, ses paroles incohérentes; il ne faisait pas usage des pronoms, mais ses intonations étaient touchantes, et son visage, jaune et défiguré, prenait par instant une expression si douloureuse et si sincère, qu'on se sentait pénétré d'un sentiment mêlé de compassion, de crainte et de tristesse.
Tel était Gricha l'insensé, le pèlerin bien connu dans la contrée.
D'où était-il sorti? Qui étaient ses parents? Qu'est-ce qui l'avait contraint de choisir cette vie errante? Tout le monde l'ignorait. Je sais seulement que, dès sa quinzième année, il passait déjà pour un fou, un vagabond allant nu-pieds, l'hiver comme l'été, heurtant à la porte des couvents, et donnant à ceux qui lui plaisaient de petites images, en proférant des paroles sans suite que plusieurs prenaient pour des prophéties. Personne ne l'a vu dans son bon sens; les uns croient qu'il est le fils déshérité de parents aisés; d'autres assurent, au contraire, qu'il n'est qu'un paysan qui ne veut pas travailler.
Enfin le ponctuel Foka, si ardemment souhaité, vint nous appeler, et nous nous élançâmes hors de la salle d'étude. Gricha nous suivit en sanglotant; il prononçait des paroles inintelligibles et frappait les marches de son bâton.
Dans le salon, papa et maman se promenaient bras dessus, bras dessous, en s'entretenant à voix basse.
L'institutrice de ma sœur, Mimi, était assise dans un fauteuil posé de façon à former un angle droit avec le divan. D'une voix sévère mais contenue elle donnait des instructions, aux deux fillettes debout près d'elle. Lorsque Karl Ivanovitch entra, elle le toisa de nouveau, se détourna, et l'expression de son visage disait: «Je ne veux pas prendre garde à vous, Karl Ivanovitch.»
Je vis dans les yeux des petites filles qu'elles avaient quelque chose de très important à nous communiquer; mais nous aborder en ce moment eût été contraire à l'étiquette imposée par Mimi. Nous devions nous approcher d'elle premièrement, dire: «Bonjour, Mimi,» faire une révérence, et, après cette cérémonie, il nous était permis de causer entre nous.
Quelle personne insupportable que cette Mimi! On ne pouvait parler en sa présence de quoi que ce fût, elle trouvait tout ce qu'on disait inconvenant. Elle ne pouvait jamais nous laisser en paix; si je trouvais un plat de mon goût, elle me criait aussitôt: «Mais mangez donc du pain!»—ou: «Est-ce ainsi qu'on tient sa fourchette?»
Et qui lui permettait de s'occuper de nous? Ce n'était pas son affaire, elle n'avait qu'à surveiller ses fillettes, nous avions notre maître. Ah! comme je partageais les sentiments de Karl Ivanovitch à l'égard de certaines personnes!
«Demande à ta maman qu'on nous prenne à la chasse, me dit Katienka en cachette, en m'arrêtant par mon veston lorsque les grandes personnes passèrent dans la salle à manger.
—Bien, nous essaierons.»
Gricha dina ce jour-là dans la même pièce que nous, mais à une table à part; il ne levait pas les yeux de sur son assiette; parfois il soupirait en faisant des grimaces affreuses et se parlant à lui-même: «Cela fait pitié,... envolée!... Oh! une pierre sur sa tombe....»
Maman était agitée ce matin-là; il était facile de voir que la présence, les gestes et les sentences du fou ajoutaient à son malaise.
«J'ai oublié de te demander quelque chose, dit-elle à papa, qui lui tendait une assiette de potage.
—Qu'est-ce que c'est?
—Dis, je t'en prie, qu'on enferme tes terribles chiens, ils ont failli dévorer ce malheureux Gricha, quand il a traversé la cour.... Un jour ils sauteront sur les enfants....»
Gricha, ayant entendu prononcer son nom, se tourna vers nous, montra les pans déchirés de son habit, et, tout en faisant jouer ses mâchoires, il dit:
«Voulait ... me dévorer.... Dieu n'a pas permis ... un grand péché ... pas punir homme ... Dieu pardonnera....
—Qu'est-ce qu'il marmotte? demanda mon père avec un regard sévère; je n'y comprends rien.
—Moi, je comprends, reprit maman; il m'a raconté qu'un de tes chasseurs a lancé les chiens sur lui, et il te prie de ne pas le punir.
—Ah! c'est ce qu'il veut dire!... Mais qui lui fait croire que j'aurais envie de le punir? Tu sais que je ne suis pas grand amateur de cette engeance, ajouta-t-il en français; celui-ci surtout ne me revient pas, il doit être....
—Ah! ne dis pas cela, mon ami, dit ma mère en l'interrompant comme pour l'avertir d'un danger, qu'en sais-tu?
—Il me semble que j'ai eu assez souvent l'occasion d'observer cette espèce de gens; tu en reçois un si grand nombre, et ils sont tous taillés sur le même modèle ... ils chantent tous la même histoire....»
Il était facile de voir que maman pensait tout autrement sur ce sujet, mais elle s'abstint de toute remarque.
«... Non, cela me fâche,... continua papa en prenant le plat de petits pâtés, et le tenant, par distraction, hors de l'atteinte de ma mère,... cela me fâche quand je vois des personnes instruites, intelligentes, se laisser prendre pour dupes....»
Il donna un coup sur la table avec le manche de sa fourchette.
«Je t'en prie, passe-moi un pâté, reprit-elle, en tendant la main.
—Ceux qui mettent ces hommes en prison font bien, continua mon père; ils ne servent qu'à donner sur les nerfs de personnes qui sont déjà malades sans cela....»
Puis, voyant que ces réflexions étaient désagréables à maman, il lui tendit le petit pâté en souriant.
«Je ne te répondrai qu'une chose, dit-elle, c'est que j'ai de la peine à croire qu'un homme de soixante ans aille nu-pieds, l'hiver comme l'été, qu'il porte des chaînes pesant 5 kilos sous ses habits, et repousse toutes les offres qui lui ont été faites pour l'établir convenablement, par pur amour de la fainéantise.... Enfin, quant à ses prophéties, reprit-elle après une pause et un long soupir, je suis payée pour y croire...; ne t'ai-je pas raconté comment un fou a prédit à feu mon père, heure pour heure, le moment de sa mort...?»
Le dîner tirait à sa fin. Lioubotchka et Katienka nous adressaient des coups d'œil significatifs et s'agitaient sur leurs chaises, en laissant percer une vive inquiétude. Leurs regards disaient:
«Pourquoi ne demandez-vous pas si nous pouvons aller à la chasse?»
Je poussai mon frère du coude, il répondit par le même signe; puis il se décida enfin à parler. Il commença d'une voix timide, mais qui s'affermissait en s'accentuant, et il dit:
«Puisque nous partons aujourd'hui pour Moscou, nous aimerions que les petites vinssent avec nous à la chasse.»
Les grandes personnes tinrent un petit conciliabule; notre demande fut accordée, et, ce qui nous fut encore plus agréable, maman déclara qu'elle serait de la partie.
Quand le plat doux fut servi, papa fit appeler Iakov et commanda d'atteler la ligneïka[1], de seller les chevaux, d'amener les chiens; il entra dans les moindres détails, désignant chaque animal par son nom.
La monture de Volodia boîtait, et papa donna l'ordre de lui substituer un cheval de chasse.... Cheval de chasse, ces mots sonnaient désagréablement aux oreilles de maman; un cheval de chasse lui semblait devoir être un animal enragé qui ne pouvait manquer de s'emporter et de casser le cou de son fils. Malgré les protestations de papa et les bravades de mon frère, qui déclarait aimer par-dessus tout une bête qui s'emporte, la pauvre chère maman ne cessait de déclarer qu'elle serait inquiète pendant toute la promenade.
Le dîner fini, les grandes personnes prirent le café dans le cabinet de papa. Nous, les enfants, nous courûmes au jardin pour jaser et brasser dans les petites allées les feuilles sèches tombées des arbres. Nous bavardions: «Volodia monterait le cheval de chasse;—Lioubotchka devrait avoir honte de courir moins vite que Katienka;—comme ce serait intéressant de voir les chaînes que Gricha porte!» Mais pas un mot ne fut prononcé au sujet de notre prochaine séparation.
Notre babillage fut interrompu par l'arrivée de la ligneïka; au-dessus de chaque ressort était assis un petit serf. Les chasseurs et les chiens suivaient la voiture, puis venait le cocher Ignat monté sur le cheval destiné à Volodia et menant par la bride mon vieux poney. Après nous être pressés contre la haie pour regarder ces préparatifs intéressants, nous courûmes en toute hâte à nos chambres pour nous habiller, au bruit des aboiements des chiens et du piétinement des chevaux. Il s'agissait de s'accoutrer de façon à ressembler le plus possible à des chasseurs; le meilleur moyen était de fourrer le pantalon dans les bottes. Notre parti fut vite pris, nous nous mîmes à l'œuvre en nous dépêchant le plus possible, pour courir sur le perron jouir du spectacle des chiens et des chevaux et faire un bout de causette avec les chasseurs.
La journée était chaude. De petits nuages blancs aux formes fantastiques s'étaient glissés dès le matin au bord de l'horizon; un vent léger les chassa ensuite au-dessus de nos têtes et, par moments, ils interceptaient le soleil. Mais ils avaient beau courir, s'enfler et prendre des teintes noires, ils ne réussirent pas à s'entendre pour former un orage et gâter ainsi notre dernière partie de plaisir. Vers le soir ils commencèrent à se disperser; les uns pâlirent, s'allongèrent et s'enfuirent à l'horizon, les autres au-dessus de nous se condensèrent pour dessiner une vaste écaille blanche, nacrée et transparente; un seul nuage noir resta suspendu à l'est. Karl Ivanovitch, qui savait toujours où allaient les nuages, nous dit que celui-ci se dirigeait vers Maslovka, et il nous promit le beau temps.
Notre vieux domestique Foka, malgré son grand âge, descendit en courant l'escalier avec une agilité juvénile et cria:—«Faites avancer!»—puis, écartant les genoux, il se campa fermement sur les marches du perron, entre le seuil et la place où la ligneïka devait s'arrêter, dans l'attitude d'un homme à qui il est superflu de rappeler ses devoirs. Les dames firent leur apparition et, après s'être consultées pour savoir comment elles se placeraient et de quelle manière elles se tiendraient en équilibre (souci que je trouvais superflu), elles s'assirent, ouvrirent leurs ombrelles, et la ligneïka partit. Maman désigna le cheval de chasse et, d'une voix tremblante, demanda au cocher:
«N'est-ce pas le cheval de Vladimir Pétrovitch?»
Sur la réponse affirmative, elle fit un geste de la main et détourna le visage.
J'étais très impatient de montrer mes talents équestres; je sautai sur mon petit cheval, je le regardai fixement entre les oreilles, et j'exécutai dans la cour différentes évolutions.
«Ayez la bonté de ne pas écraser les chiens, me dit un des chasseurs.
—Sois tranquille; ce n'est pas la première fois,» lui répondis-je avec importance.
Volodia se mit en selle; en dépit de la fermeté de son caractère le cœur lui battait, et, tout en caressant le cheval de chasse, il demanda plusieurs fois:
«Est-il doux?»
Mon frère faisait un beau cavalier, on aurait dit un homme; ses cuisses arrondies étreignaient les arçons d'une pression si vigoureuse, que je ne pus me défendre d'un mouvement d'envie, d'autant plus, qu'à en juger par mon ombre, j'étais loin d'avoir si bonne tournure.
Enfin le pas de mon père retentit sur l'escalier; le valet de chiens rassembla la meute qui s'était dispersée; les chasseurs sifflèrent leurs lévriers et commencèrent à se mettre en selle.
Le palfrenier amena le cheval de papa devant le perron; ses chiens hardés, qui jusque-là étaient restés couchés autour de leur laisse dans des poses sculpturales, s'élancèrent au-devant de leur maître. Sur ses pas courait sa petite chienne, Milka, en secouant son collier de grains qui résonnaient contre le fermoir de cuivre. Chaque fois qu'elle sortait de la maison, Milka disait bonjour aux chiens de la meute, elle jouait avec les uns, flairait les autres en grognant ou leur cherchait leurs puces.
Papa monta à cheval et donna le signal du départ.
Devant nous, monté sur un cheval camus d'un gris bleuâtre, courait le piqueur Tourka; il portait un bonnet à poil, un grand cor en bandoulière sur le dos, un couteau dans la ceinture. En voyant sa figure sombre et féroce, on aurait pu croire qu'il marchait à une guerre à mort plutôt qu'à une chasse. Derrière les sabots du cheval roulait le peloton bizarre et onduleux des chiens hardés.
Malheur à qui voulait rester en arrière! il devait tirer à lui de toutes ses forces son compagnon de laisse, et, s'il réussissait à le retenir, un veneur le sanglait aussitôt d'un coup de son long fouet en criant:
«En place!»
Quand nous eûmes franchi le portail de notre cour, papa ordonna aux chasseurs de suivre la grande route, et lui-même s'engagea dans le champ de seigle.
Nous étions au plus fort de la moisson; le champ d'un jaune brillant s'étendait immense, à l'infini, borné seulement d'un côté, dans le lointain, par une haute forêt qui paraissait bleue, et qui me semblait le lieu éloigné et mystérieux où finissait le monde connu et commençaient les pays inhabitables.
Tout le champ était couvert de meules et de moissonneurs. Derrière le seigle haut et touffu, on voyait par-ci par-là, dans un sillon moissonné, le dos courbé d'une glaneuse ramassant les épis pour les serrer dans sa main gauche; plus loin, à l'ombre, une femme inclinée sur un berceau, et des gerbes éparses sur le champ parsemé de bluets.
De l'autre côté, les moissonneurs en manches de chemise, debout sur les chars, chargeaient les gerbes et répandaient un nuage de poussière sur le champ sec et incandescent.
Le starosta (chef des serfs du village), debout dans ses hautes bottes, les manches de sa souquenille flottant sur ses épaules, et le bâton de la taille à la main, aperçut de loin mon père; il ôta son chapeau mou, en peau d'agneau, essuya sa barbe rouge et sa tête ruisselante de sueur avec un essuie-mains et se mit à gourmander les moissonneurs.
Le petit cheval roux que montait papa marchait d'un pas léger et joyeux; il baissait de temps en temps la tête sur son poitrail et chassait de sa queue touffue les taons et les mouches qui se pressaient avec avidité sur ses flancs. Deux lévriers, la queue recourbée en forme de serpette, bondissaient en relevant les pattes avec grâce dans le chaume, derrière les pieds du cheval; Milka courait en avant, la tête penchée, attendant sa pâtée.
Les voix des moissonneurs qui parlaient entre eux, le piétinement des chevaux, le roulement des chars, le cri joyeux des cailles, le bourdonnement des insectes qui planaient dans l'air en essaims immobiles, l'odeur de l'absinthe, de la paille et de la sueur des chevaux; le jeu des ombres et des teintes que le soleil brûlant répandait sur le chaume jaune-clair, sur le bleu vaporeux de la forêt, sur les nuages d'un lilas-pâle; les fils blancs de la vierge qui flottaient dans l'air ou pendaient aux tiges des épis ... tout cela je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai senti.
A notre arrivée dans la forêt de Kalinova, nous trouvâmes la ligneïka et, ce qui nous réjouit par-dessus tout, un char attelé d'un cheval; au milieu était assis le domestique préposé à la garde du buffet. On apercevait, sous la paille, le samovar, un petit tonneau avec les moules pour les glaces et plusieurs autres boîtes et des paquets d'un aspect non moins appétissant. Il n'y avait plus de doute possible, nous allions prendre en plein air du thé, des glaces et des fruits. Aussi nous tous, enfants, nous saluâmes le char par des cris de joie; car, faire une collation sur la mousse, à une place où personne avant nous n'avait pris du thé ou des glaces, était un plaisir exquis.
Le piqueur Tourka, avant de se diriger vers la clairière, s'arrêta, écouta attentivement les instructions détaillées que lui donnait mon père: où il devait s'embusquer, et quand il devait faire une sortie. Au reste, il n'agissait jamais qu'à sa tête. Il lâcha les chiens et, sans se hâter, se remit en selle, siffla, puis disparut sous les jeunes bouleaux. Ses chiens courants laissés libres exprimèrent d'abord leur joie par des frétillements de queue; puis ils se secouèrent, s'étirèrent et, après s'être flairés mutuellement, partirent au petit trot dans toutes les directions.
«As-tu un mouchoir?» me demanda papa.
Je tirai mon mouchoir de ma poche et le lui montrai.
«Bien, passe-le au cou de ce chien gris.
—Au cou de Giran? dis-je d'un air entendu.
—Oui, et cours sur la route. Quand tu arriveras à la clairière, arrête-toi et ouvre bien les yeux ... gare à toi si tu reviens sans lièvre!»
Je roulai mon mouchoir autour du col velu de Giran et me mis à courir à toutes jambes vers l'endroit désigné.
«Vite, vite, criait mon père en riant, sinon le lièvre ne t'attendra pas.»
Giran s'arrêtait sans cesse, dressait les oreilles et écoutait la voix des chasseurs excitant les chiens. Je n'étais pas assez fort pour l'entraîner, je me mis à crier: «Hare, hare!» Alors mon compagnon partit avec une telle ardeur, que je ne pouvais plus le retenir et que je tombai plusieurs fois à terre avant d'arriver à l'endroit indiqué.
Après avoir choisi entre les racines d'un haut chêne une place ombragée et commode, je m'étendis sur le sol et je fis coucher Giran à mes côtés, puis j'attendis le lièvre. Mon imagination, comme toujours en pareille occurrence, s'envola bien au delà de la réalité; je me figurais déjà que je chassais mon troisième lièvre lorsqu'un des chiens courants donna l'éveil.
La voix de Tourka, de plus en plus forte et animée, retentissait dans la forêt, les chiens courants poussaient des cris plaintifs de plus en plus fréquents ... une autre voix de basse vint se joindre à la première, puis une troisième, une quatrième ... puis des silences, les voix s'interrompaient l'une l'autre ... puis elles devinrent plus bruyantes et continues, et enfin se confondirent dans un bruit sonore, un roulement sans fin. L'île était remplie d'échos, et les chiens y allaient de bon cœur.
A l'ouïe de tous ces cris je restai cloué à ma place, les yeux fixés éperdument sur la lisière du bois; je souriais comme un insensé, la sueur ruisselait de mon front, de grosses gouttes coulaient sur mon menton, me chatouillaient, et pourtant je ne les essuyais pas. Il me semblait que le moment décisif était arrivé; cette tension de nerfs était trop peu naturelle pour durer longtemps. Tantôt les chiens courants poussaient des hurlements dans la clairière, tantôt ils s'éloignaient de moi; mais j'avais beau regarder de tous côtés, je ne voyais point de lièvre. Giran n'était pas moins surexcité que moi; d'abord il s'efforça de s'échapper de mes mains, puis il poussa des cris plaintifs, ensuite il se coucha près de moi, posa son museau sur mes genoux et se tranquillisa.
Près des racines dénudées de mon chêne, sur la terre aride et grise, entre les feuilles sèches, les glands, les branches mortes et verdissantes, la mousse d'un vert jaunâtre et de rares brins d'herbe, grouillait tout un peuple de fourmis; l'une après l'autre elles se pressaient sur les chemins battus qu'elles s'étaient frayés; les unes portaient des fardeaux, les autres passaient librement. Je pris une petite branche, et je leur coupai le passage. Il fallait voir comment les unes méprisant le danger rampaient sous l'obstacle, comment d'autres le franchissaient en passant par-dessus; celles qui étaient chargées ne savaient que faire; elles s'arrêtèrent, cherchèrent un détour, rebroussèrent chemin ou gravirent bravement le brin de bois jusqu'à ma main, avec l'intention évidente d'entrer dans la manche de mon veston.
Je fus distrait de ces observations intéressantes par un papillon aux ailes jaunes qui voltigeait devant moi, avec une grâce séductrice à laquelle je ne sus pas résister. Je venais à peine de le remarquer, lorsqu'il s'envola à deux pas de moi et se mit à décrire des courbes autour d'une fleur blanche et à demi fermée de trèfle sauvage, puis il s'y posa. Je ne sais si c'était parce qu'un rayon de soleil le réchauffait ou parce qu'il butinait sur cette plante,—mais je vis qu'il était parfaitement heureux. Il agita de temps en temps ses ailes, étreignit la fleur de plus près et finit par s'endormir tout à fait.
Je pris ma tête dans les deux mains, et je le contemplai avec ravissement.
Tout à coup Giran hurla et me tira avec tant de violence, que je faillis rouler à terre. Je regardai autour de moi; à la lisière du bois, tout près de nous, une oreille levée et l'autre couchée, un lièvre sautillait. Tout mon sang reflua au cerveau, je perdis la tête et je me mis à crier quelque chose d'une voix surnaturelle, je lâchai le chien et commençai à courir après lui. Mais aussitôt je compris mon étourderie, et je m'en repentis; quant au lièvre, il s'était déjà ramassé sur lui-même et d'un bond il disparut.
Quelle ne fut pas ma honte, lorsque, après les chiens courants, qui criaient tous comme une seule voix dans la clairière, je vis passer Tourka! Il s'est aperçu de ma sottise! me dis-je. Il s'éloigna en me jetant un regard de mépris et cette seule interjection:
«Hé, monsieur!»
Mais il faut savoir de quel ton ces deux mots furent prononcés! J'aurais mieux aimé être pendu comme un lièvre aux arçons de sa selle.
Je restai longtemps, plongé dans mon désespoir, immobile à la même place; je ne rappelai pas mon chien, je ne fis que répéter en me tapant les cuisses:
«Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait?»
J'entendis les chiens courants s'éloigner, parcourir avec bruit l'autre partie de la forêt; je sus que le lièvre était retrouvé; puis Tourka souffla dans son grand cor pour rappeler la meute.—Mais je ne bougeai pas de ma place.
[1] Char à ressorts traversé dans sa longueur par un banc double, sans dossier, où les gens sont assis dos à dos. (Note du traducteur.)
La chasse est terminée. Un tapis est étendu sur le gazon à l'ombre des jeunes bouleaux, et toute la compagnie s'y est assise en cercle. A côté, le sommelier, Gavrilo, à genoux sur l'herbe verte et moelleuse, essuie les plats; puis il sort délicatement, d'une boîte, des prunes et des pêches, enveloppées de feuilles.
A travers les branchages des bouleaux filtrent des rayons qui mettent de grosses taches rondes et vacillantes sur les dessins du tapis, sur mes souliers et même sur le crâne glabre et ruisselant de sueur de Gavrilo. Une brise qui court dans le feuillage vient caresser mon visage moite et mes cheveux et m'apporte une sensation de fraîcheur et de bien-être.
Après avoir fait amplement honneur aux glaces et aux fruits, nous, les enfants, n'ayant plus rien qui nous retienne sur le tapis, et en dépit des rayons obliques et brûlants qui échauffent l'air en dehors de notre abri, nous nous élançons à la recherche d'un coin favorable pour jouer.
«A quoi allons-nous nous amuser? demande Lioubotchka en fermant les yeux à cause du soleil, et en sautillant sur l'herbe. Voulez-vous jouer au Robinson?
—Non ... c'est trop ennuyeux, dit Volodia en se laissant choir paresseusement sur le gazon et en mordillant des brins d'herbe;... toujours jouer au Robinson! si vous voulez vous amuser, allons construire un pavillon.»
Volodia faisait le grand garçon, il prétexta de la fatigue. Évidemment il avait la tête tournée pour avoir monté un cheval de chasse. Peut-être aussi était-il trop raisonnable et doué de trop peu d'imagination pour prendre plaisir au Robinson.
Ce jeu consistait dans la représentation des scènes du Robinson Suisse que nous venions de lire.
«Allons, je t'en prie..., pourquoi ne veux-tu pas nous faire ce plaisir? répétaient les petites, en insistant auprès de Volodia. Tu seras Charles, ou Ernest, ou tu feras le père, comme tu voudras, disait Katienka en le tirant par la manche de son veston pour le faire lever.
—Je vous assure que je n'en ai pas envie.... C'est trop ennuyeux, répondait Volodia en s'étirant et avec un sourire de suffisance.
—Alors tu aurais mieux fait de nous laisser à la maison puisque tu ne veux pas t'amuser,» recommença Lioubotchka, avec des larmes dans la voix.
Ma sœur était une pleurnicheuse accomplie.
«C'est bon, c'est bon, reprit-il, je jouerai, seulement ne pleure pas, tu sais que je déteste les larmes.»
La condescendance de Volodia ne contribua pas à notre amusement. Au contraire, sa mine indolente et maussade détruisait tout le charme du jeu. Nous nous étions assis par terre et nous faisions semblant de ramer à tour de bras pour figurer des pêcheurs dans leurs canots; mais Volodia restait immobile, les mains croisées, dans une attitude qui n'était point celle d'un pêcheur sur l'eau. Je lui en fis la remarque, il me demanda si, à force de nous balancer, nous avancerions d'un pouce? Je fus obligé de convenir qu'il avait raison.
De même, lorsque j'appuyai un bâton sur mon épaule et me mis fièrement en route en m'imaginant que j'allais à la chasse, Volodia se coucha sur le dos, replia ses bras sous sa tête et dit que, lui aussi, il partait pour la chasse. Son impassibilité et son mauvais vouloir jetèrent du froid dans nos jeux, d'autant plus que nous ne pouvions nier que le bon sens était de son côté.
Je savais du reste qu'avec un bâton on ne peut pas tuer un oiseau, ni même tirer un seul coup. Mais en raisonnant de la sorte on ne pourra plus faire de voyages sur des chaises; et Volodia, lui-même a-t-il déjà oublié les grandes excursions que nous avons faites pendant les longues soirées d'hiver? Un fauteuil couvert d'un tapis représentait notre équipage; un de nous grimpait dessus, c'était le cocher; un autre, derrière, figurait le laquais; les petites, au milieu, étaient les voyageuses; et les trois chaises étaient de vigoureux chevaux, et il fallait voir comme ils galopaient, et quelles distances nous parcourions ainsi! Les aventures ne manquaient pas non plus, et que les soirées d'hiver semblaient courtes à ce passe-temps, qu'elles s'envolaient gaiement!
Si l'on prend toutes choses au pied de la lettre, les jeux ne sont plus possibles, et, s'il n'y a plus de jeux, qu'est-ce qui nous reste?
Notre départ, pour plaire à maman, avait été remis au lendemain. Nous repartîmes tous ensemble. Mon frère et moi nous suivions la ligneïka, désireux de nous surpasser dans l'art de l'équitation, et, par esprit de bravade, nous nous mîmes à faire caracoler nos montures autour de la ligneïka.
Mon ombre s'était allongée, et, en la contemplant, je me figurais que je faisais un beau cavalier. Mon illusion fut de courte durée. Pour enlever les suffrages de la compagnie, je retins mon cheval un peu en arrière, puis, à l'aide de la cravache et des coups de talon, je lançai mon poney au galop.
Je me campai dans une attitude gracieuse et aisée; je voulais passer comme un coup de vent devant les petites. Je me demandais si je devais les dépasser en silence ou attirer leur attention par un cri. Pendant que je faisais ces réflexions, mon petit cheval, arrivé près de la ligneïka, s'arrêta d'un mouvement si brusque, que je bondis de la selle sur le cou de l'animal, et je faillis tomber à terre.

Il faisait déjà nuit quand nous arrivâmes à la maison. Maman s'assit au piano, et nous, les enfants, après être allés chercher du papier, des crayons et des couleurs, nous nous mîmes à dessiner autour de la table ronde.
Je ne possédais qu'une couleur, du bleu; je me mis quand même à peindre le tableau de la chasse. J'eus bientôt fait un garçon bleu avec des chiens bleus, lorsque je fus pris d'un doute: je ne savais pas si un lièvre pouvait être peint en bleu. Je courus dans le cabinet de papa pour lui demander son avis. Il lisait une brochure, et, à ma question: «Y a-t-il des lièvres bleus?» il répondit sans lever la tête:
«Oui, il y en a, mon ami, il y en a.»
Revenu à la table ronde, je peignis un lièvre, puis je jugeai à propos de transformer le lièvre en buisson. Le buisson ne me plut pas davantage, j'en fis un arbre. Je changeai l'arbre en meule de foin, et la meule en nuage; puis je barbouillai tout le papier de bleu, et, après l'avoir déchiré de dépit, je me mis à dormir dans un fauteuil voltaire.
Maman jouait le second concerto de Field; elle avait eu ce compositeur pour maître. Je sommeillais, et des visions légères, nettes et limpides, surgirent dans mon imagination. Maman exécuta ensuite la sonate pathétique de Beethoven, et des souvenirs tristes, sombres et oppressifs m'assaillirent. Maman jouait souvent ces deux morceaux; c'est pourquoi je me rappelle si bien les impressions qu'ils faisaient naître en moi.
J'avais le sentiment que je me souvenais de quelque chose; mais le souvenir de quoi? Il me semblait que je me rappelais ce qui n'était jamais arrivé.
En face de moi était la porte du cabinet de mon père. Je voyais entrer Iakov et d'autres paysans en cafetans et avec de longues barbes. La porte se refermait immédiatement sur eux: «Voilà, papa se remet à ses affaires», pensais-je.
Je croyais qu'il n'y avait rien au monde de plus sérieux que les affaires de papa. Ce qui me confirmait dans cette idéé, c'est que tout le monde s'approchait de la porte du cabinet sur la pointe des pieds et en parlant tout bas, tandis que la voix de papa arrivait distinctement. Je sentais aussi l'odeur de son cigare, laquelle, je ne sais pourquoi, m'attirait toujours.
A travers mon sommeil, je distinguai le craquement familier des bottes de Karl Ivanovitch, bien qu'il marchât sur le bout des pieds. Son visage était sombre et décidé; il tenait à la main des papiers qui semblaient être des comptes. Il frappa; on lui dit d'entrer, et la porte se referma sur lui.
«Pourvu qu'il n'arrive pas un malheur! me disais-je, Karl Ivanovitch est en colère, et il est capable de tout....»
Je m'assoupis de nouveau.
Il ne survint pas de malheur. Une heure plus tard le même craquement de bottes me réveilla. Karl Ivanovitch sortit du cabinet de papa; je vis qu'il passait un mouchoir sur ses joues et s'essuyait les yeux; il marmotta quelques paroles dans sa barbe et remonta dans sa chambre.
Tout de suite après son départ, papa entra dans le salon.
«Sais-tu ce que je viens de décider, dit-il d'un ton joyeux, en posant sa main sur l'épaule de maman....
—Qu'est-ce que c'est, mon ami?
—Je prends Karl Ivanovitch avec les enfants. Il y a une place pour lui dans la britchka. Les enfants sont habitués à lui, et il me semble qu'il leur est véritablement attaché. Après tout 700 roubles ne sont pas une affaire ... et puis, au fond, c'est un très bon diable.»
Je ne compris pas du tout pourquoi papa appelait Karl Ivanovitch «un diable».
«J'en suis très contente! s'écria maman, pour les enfants et pour lui, car c'est un excellent vieillard.
—Si tu avais vu comme il a été touché quand je lui ai dit de considérer les cinq cents roubles comme un cadeau! Mais le plus amusant, c'est le compte qu'il m'a présenté. Il mérite d'être examiné, ajouta-t-il avec un sourire, en donnant à maman la note écrite de la main de Karl Ivanovitch; ça vaut son pesant d'or.»
Voici la teneur de ce compte:
«Acheté pour les enfants deux lignes pour la pêche, du papier de couleur, une bordure d'or, de la colle d'amidon, pour faire une boîte donnée en cadeau aux enfants,—six roubles, cinquante-cinq copecks.
«Un pantalon donné à Nicolas,—quatre roubles.
«Monsieur m'a promis, à Moscou, une montre en or de cent quarante roubles.
«Karl Mauer a donc à recevoir, outre ses gages, cent cinquante-neuf roubles et soixante-dix-neuf copecks.»
En lisant ce compte où Karl Ivanovitch réclame l'argent qu'il a déboursé en cadeaux, et même de l'argent en échange d'un présent qu'il n'a pas encore reçu, on pourrait le prendre pour un froid égoïste, rapace et cupide; mais on se tromperait.
Il était entré dans le cabinet de papa avec son compte à la main, et un discours, préparé à loisir, où il se proposait d'exposer avec éloquence tous ses griefs, et d'énumérer toutes les injustices dont il avait souffert dans notre maison. Mais, quand il commença son plaidoyer sur le même ton sentimental qu'il avait pris pour notre dictée, il fut victime de sa propre éloquence, et, arrêté au passage où il disait: «Bien que je souffre beaucoup à la pensée de me séparer des enfants...,» il perdit le fil de son allocution, sa voix faiblit, et il se vit contraint de sortir son mouchoir à carreaux.
«Oui, Piotre Alexandrovitch, reprit-il à travers ses larmes (cette fois il improvisait), je suis tellement habitué aux enfants que je ne sais ce que je deviendrais sans eux.... J'aimerais mieux vous servir sans gages,» ajouta-t-il, en essuyant ses larmes d'une main, et en présentant la note de l'autre.
Je peux affirmer que Karl Ivanovitch parlait sincèrement, car je connais son bon cœur; mais comment ses paroles peuvent-elles se concilier avec son compte, c'est, à l'heure qu'il est, un mystère pour moi.
«Si vous avez de la peine à nous quitter, j'en aurai encore plus à me séparer de vous, répondit mon père, en lui donnant une tape amicale sur l'épaule; j'ai changé d'idée, vous resterez auprès des enfants....»
Un peu avant le souper Gricha, l'insensé, vint de nouveau près de nous. Depuis qu'il était entré dans la maison, il n'avait pas cessé de soupirer et de pleurer, ce qui était un très mauvais signe, au dire de ceux qui croyaient à ses prophéties; cela présageait un malheur à notre maison. Il fit ses adieux ce soir-là, en disant que dès le lendemain il continuerait son pélerinage. Je fis signe à mon frère de me suivre, et je sortis.
«Qu'est-ce que c'est? demanda-t-il.
—Veux-tu voir les chaînes de Gricha? Montons; Gricha couche dans la chambre à côté de la décharge. Nous nous tiendrons dans la décharge et nous pourrons tout voir.
—Très bien ... mais attends, je veux appeler Lioubotchka et Katienka.»
Les petites filles accoururent, et nous montâmes. Après nous être disputés pour savoir qui entrerait le premier dans la décharge, nous nous tapîmes dans un coin, pour attendre ce qui allait arriver.
Nous étions dans l'obscurité, et nous éprouvions un sentiment de malaise; serrés les uns contre les autres, nous restions sans mot dire. Tout de suite après nous, Gricha entra à pas lents. Il tenait d'une main son bâton et de l'autre une chandelle dans un bougeoir de cuivre. Nous retenions notre haleine.
«Seigneur Jésus-Christ!... Sainte Mère!...» répétait le fou avec de fortes aspirations, et sur différents tons; il se servait d'abréviations qui ne sont familières qu'à ceux qui emploient fréquemment ces mots.
Après avoir, sans cesser de prier, posé son bâton dans un coin et examiné le lit, il se mit en devoir de se déshabiller. Il détacha sa vieille ceinture noire, puis se mit à enlever lentement son sarrau de nankin en lambeaux, le plia avec soin et le posa sur le dossier de la chaise. Son visage n'exprimait pas en ce moment, comme de coutume, l'agitation et l'hébétement; au contraire; il était calme, recueilli, et même majestueux. Ses mouvements étaient lents et réfléchis.
Quand il eut quitté tous ses habits, et qu'il ne lui resta sur le corps que son linge, il se laissa tomber sur le lit, fit le signe de la croix dans toutes les directions et rajusta sous sa chemise ses lourdes chaînes; l'expression assombrie de son visage trahit un effort pénible.
Après être resté un moment sur son séant et avoir examiné avec soin sa chemise déchirée en plusieurs places, il se leva et dit une prière, en soulevant le bougeoir à la hauteur d'une armoire vitrée renfermant les icônes. Il se signa devant les saints, puis il renversa la chandelle; elle s'éteignit avec un pétillement sonore.
Un rayon de la lune, presque à son plein, frappa sur les fenêtres qui regardaient la forêt. La longue silhouette blanche de l'insensé était éclairée d'un côté par les pâles rayons d'argent de la lune, et mise en relief, de l'autre côté, par son ombre noire qui s'allongeait et, se confondant avec l'ombre des châssis, couvrait le plancher, les murs et montait jusqu'au plafond. Dans la cour, le veilleur frappa sur la feuille de cuivre.
Gricha resta prosterné devant les images saintes, ses mains énormes croisées sur sa poitrine; il ne proférait pas une parole et poussait par intervalles de gros soupirs; puis il se laissa tomber à genoux avec difficulté, à cause des chaînes, et dit ses prières.
D'abord il répéta doucement des prières connues, accentuant seulement quelques paroles; ensuite il les dit plus fort et avec une grande véhémence. Puis les mots sortirent avec effort parce qu'il cherchait à s'exprimer en slave. Ses paroles étaient incohérentes, mais elles étaient touchantes. Il pria pour tous ses bienfaiteurs, il désignait ainsi tous ceux qui l'accueillaient bien; nous étions de ce nombre ainsi que maman. Il pria pour lui-même, demandant à Dieu de lui pardonner ses péchés et de pardonner à ses ennemis. Il gémissait, se levait en répétant les mêmes invocations, retombait à terre, se relevait, malgré le contact froid des chaînes sur ses membres nus, s'agenouillait de nouveau et les faisait résonner sur le plancher avec un son sec et aigu.
Volodia me pinça la jambe et me fit très mal, mais je n'y pris pas garde. Je frottai de la main la place endolorie, et je continuai à contempler Gricha, sans vouloir perdre un seul de ses gestes, saisi d'un mouvement de pitié et de vénération enfantines.
Au lieu du spectacle burlesque et amusant auquel je m'attendais, j'avais le frisson, et mon cœur était plein d'effroi.
Le fou se berça longtemps dans cette religieuse extase et improvisa des prières en sanglotant amèrement. Puis il se jeta de nouveau à genoux, et, les mains jointes sur sa poitrine, il se tut.
Je passai la tête hors de la porte en retenant mon souffle. L'insensé ne bougea pas; de lourds soupirs déchiraient sa poitrine; dans la pupille trouble de son œil aveugle, la lune faisait reluire une larme.
«Que ta volonté soit faite!» cria-t-il tout à coup avec une expression qu'on ne peut rendre; puis, il battit le plancher de son front et se mit à pleurer comme un enfant....
Depuis ce temps beaucoup d'eau a coulé, beaucoup de souvenirs du passé ont perdu pour moi leur signification et se sont confondus dans mes rêveries. Le pèlerin Gricha, lui-même, a depuis longtemps accompli son dernier pèlerinage; mais l'impression qu'il a produite sur moi et les sentiments qu'il a éveillés ne s'éteindront jamais dans ma mémoire.
L'attendrissement avec lequel j'écoutais le pauvre insensé ne pouvait durer longtemps; ma curiosité était satisfaite, et je m'aperçus que mes jambes étaient engourdies d'être restées si longtemps à la même place. Je voulus me rapprocher des autres enfants qui chuchotaient derrière moi et s'agitaient dans l'obscurité. Dans les mouvements que je fis, au hasard, je renversai une chaise cassée qui se trouvait dans la décharge. L'insensé releva la tête, regarda de tous côtés, en récitant des prières, et se mit à faire des signes de croix à tous les coins de la chambre. Nous nous échappâmes avec fracas de notre cachette.

Vers le milieu du siècle dernier, on pouvait voir courir, dans le village que possédaient les parents de ma mère, une petite fille en robe de coutil, aux joues rouges, toujours pieds nus et toujours robuste et gaie. C'était Natachka. Son père était le joueur de clarinette de mon aïeul; à sa prière, et pour honorer ses mérites, mon grand-père fit entrer sa fille au nombre des servantes de ma grand'mère. Dans cette nouvelle position, Natachka fit preuve d'un bon caractère et montra beaucoup de zèle dans l'accomplissement de ses devoirs. Quand maman vint au monde, on lui donna Natachka pour niania, c'est-à-dire pour bonne. Elle mérita tous les éloges, en retour de la diligence et de la fidélité qu'elle apporta dans son service, et de l'attachement qu'elle témoigna à sa jeune maîtresse.
Mais, un beau jour, la perruque poudrée et les souliers à boucles du jeune et agile valet de chambre, Foka, captivèrent le cœur faible mais aimant de Natachka. Elle prit le parti de venir implorer elle-même auprès de mon grand-père la permission de se marier avec son domestique.
Grand-père vit dans cette demande une marque d'ingratitude; il se fâcha et, pour punir la pauvre Natachka, l'exila dans la basse cour d'un village éloigné, perdu dans la steppe.
Cependant, comme personne n'était capable de remplacer Natachka, six mois après elle fut réintégrée dans ses premières fonctions.
A son retour d'exil, elle vint dans sa robe de coutil se jeter aux pieds de mon grand-père et le conjura de lui rendre sa faveur, en lui promettant de renoncer à la folle idée qui s'était emparée d'elle, pour n'y jamais revenir.
La fille du joueur de clarinette tint parole. A partir de ce jour Natachka fut appelée Nathalia Savichna, et elle porta un bonnet. Elle voua à sa jeune maîtresse tout l'amour dont son cœur était susceptible.
Lorsque maman eut une institutrice, Nathalia Savichna reçut les clés de l'office et la surintendance du linge et des provisions. Elle remplit cette nouvelle charge avec le même zèle et le même dévouement. Elle se voua tout entière au service de ses maîtres, ne souffrant pas le moindre gaspillage, habile à surprendre le plus petit larcin, et veillant sans cesse aux intérêts de la maison.
Lorsque maman se maria, elle voulut récompenser dignement Nathalia Savichna pour ses vingt années de service. Elle l'appela auprès d'elle, exprima dans les termes les plus flatteurs sa reconnaissance et son affection pour la niania, et en même temps lui glissa dans la main un papier timbré; c'était l'acte d'affranchissement. Maman ajouta que Nathalia recevrait une pension de 300 roubles par an, et qu'elle était libre de vivre avec nous ou de nous quitter, à son choix. La niania écouta ma mère sans mot dire, prit le papier et le regarda d'un air courroucé, grommela entre ses dents quelques paroles inintelligibles, puis sortit de la pièce en tapant la porte derrière elle. Maman ne comprit rien à cette boutade; tout étonnée, elle suivit Nathalia dans sa chambre. Elle trouva la niania assise sur un coffre, les yeux rouges de larmes, tordant son mouchoir entre ses mains, et contemplant d'un regard fixe le document déchiré, dont les morceaux étaient éparpillés sur le plancher.
«Mais qu'avez-vous, chère Nathalia Savichna? demanda maman en lui prenant la main.
—Rien, petite mère, répondit celle-ci.... Il paraît que vous êtes bien dégoûtée de moi, puisque vous me chassez.... C'est bon! Je m'en irai.» Elle dégagea vivement ses mains et, refoulant avec difficulté ses larmes, voulut sortir de la chambre. Maman s'élança pour la retenir, l'embrassa, et toutes les deux fondirent en larmes.
Aussi loin que ma mémoire peut remonter, je me souviens de Nathalia Savichna, de sa sollicitude et de ses caresses; mais ce n'est que maintenant que je sais apprécier ses soins et sa tendresse. Alors il ne me venait jamais à l'idée que cette vieille femme était un être rare, admirable. Jamais elle ne parlait d'elle-même, elle s'oubliait toujours; toute sa vie n'était qu'un acte d'amour et un sacrifice de soi-même.
J'étais si bien habitué à cette affection désintéressée, que je croyais que c'était une chose toute naturelle, qui allait de soi, et je n'en étais même pas reconnaissant. Jamais je ne me demandais: «Est-elle heureuse? est-elle contente?»
Combien de fois, sous un prétexte, je m'échappais de la salle d'étude, aux heures des leçons, et je courais chez Nathalia Savichna! Je m'asseyais et je bavardais; je rêvais tout haut, sans être le moins du monde gêné par sa présence. Nathalia Savichna n'était jamais inoccupée; je la trouvais toujours tricotant des bas ou fouillant dans les bahuts dont sa chambre était garnie, ou encore inscrivant le linge. Elle prêtait une oreille complaisante à mon babillage; je lui contais comment, «lorsque je serais général, j'épouserais une femme d'une beauté admirable,... j'aurais un cheval roux,... je bâtirais une maison tout en verre,... je ferais venir de la Saxe les parents de Karl Ivanovitch....» A tous ces enfantillages, elle répondait:
«Oui, mon petit père, oui.»
Ordinairement, quand je me levais pour sortir, elle ouvrait un bahut bleu; je vois encore maintenant, collées dans l'intérieur du couvercle, une image coloriée représentant un hussard, une vignette enlevée à un pot de pommade et un dessin de Volodia; elle sortait du coffre un aromate, y mettait le feu et, tout en l'agitant en l'air, disait: «C'est un parfum turc, mon petit père. Lorsque feu votre grand-père—qu'il repose en paix dans le ciel—est allé à la guerre contre les Turcs, il me l'a rapporté de là-bas. Il ne me reste plus que ce petit morceau,» ajoutait-elle avec un soupir.
On trouvait de tout dans les bahuts de la niania; dès qu'il manquait quelque chose dans la maison on disait: Il faut le demander à Nathalia Savichna. Après quelques recherches dans ses coffres, elle apportait l'objet réclamé, en disant: «Voyez comme j'ai bien fait de le serrer.» Les bahuts renfermaient par milliers toutes les choses oubliées dont personne ne prenait soin, et dont tout le monde ignorait encore l'existence.
Je me rappelle pourtant avoir été une fois dans ma vie très mécontent de Nathalia Savichna. Voici ce qui s'était passé: au dîner, en voulant verser du kwass[1], je répandis sur la nappe le contenu du carafon.
«Faites venir Nathalia Savichna, dit maman, elle aura le plaisir de réparer les maladresses de son favori.»
La niania accourut aussitôt, et, en voyant la mare que je venais de faire, elle branla la tête; maman lui dit quelques mots à l'oreille, et elle sortit en me menaçant du doigt.
Après le dîner, je m'élançai dans le salon en sautant. J'étais de la plus belle humeur, lorsque, tout à coup, Nathalia sortit de la porte de la salle à manger, la nappe tachée à la main, et, me courant dessus, me saisit, et, malgré ma résistance désespérée, me frotta le visage avec le linge humide en répétant: «C'est pour t'apprendre à salir la nappe.» Ma dignité fut à tel point blessée par ce procédé, que je me mis à pousser des cris de rage.
«Comment! me disais-je à part moi en m'engouant de larmes, Nathalia Savichna, cette Nathalia me tutoie, et se permet de me frapper au visage avec une nappe mouillée, comme un garçon de service!... C'est horrible!...»
En m'entendant brailler de la sorte, Nathalia s'enfuit aussitôt, et moi, je continuai à me promener dans le salon en pensant à la meilleure manière de la punir de cette offense.
Quelques minutes après, Nathalia Savichna revint; elle s'approcha de moi timidement et se mit à s'excuser:
«Assez, petit père, ne pleurez pas ... pardonnez à la vieille folle ... c'est ma faute ... mais vous me pardonnerez, mon petit chéri?... Prenez ceci!...»
Elle sortit de sous son châle un sac en papier rouge contenant deux caramels et une figue sèche, et me l'offrit d'une main tremblante.
Je n'avais pas le courage de regarder la bonne vieille en face; je pris le cadeau en détournant la tête, et mes larmes coulèrent plus abondantes; ce n'étaient plus des larmes de colère, mais des larmes d'amour et de honte.
Le lendemain de la partie de chasse, vers midi, la calèche et la britchka (sorte de calèche à demi-couverte) furent amenées devant le perron. Notre menin, Nicolas, était en costume de voyage: le pantalon rentré dans les bottes, et son vieux surtout étroitement serré autour de sa taille par une ceinture. Debout dans la britchka, il arrangeait les coussins et les manteaux sur les sièges et s'asseyait dessus en rebondissant pour les aplatir et les égaliser.
Les valets de chambre, vêtus de surtouts, de cafetans ou de blouses, et sans chapeau; les femmes, en jupes de coutil, coiffées de mouchoirs rayés, avec des marmots dans leurs bras, et des enfants aux pieds nus réunis devant le perron, tout ce monde regardait les deux voitures et s'entretenait à voix basse.
Un des postillons,—un vieillard tout courbé, en cafetan, et un bonnet d'hiver sur le chef, tenait à la main le timon de la calèche et examinait d'un air absorbé la roue de la voiture. L'autre, un jeune homme bien découplé, en chemise blanche aux goussets de coton rouge, les cheveux très blonds et frisés, se grattait la tête sous un chapeau de laine d'agneau à forme conique, qu'il tirait tantôt sur une oreille, tantôt sur l'autre.
Il étendit son cafetan sur le siège, y jeta les guides et fit claquer son fouet tressé, en regardant tour à tour ses bottes et les cochers qui enduisaient la britchka de goudron.
Un d'eux, tous les muscles tendus par l'effort, soutenait le fond de la voiture, et un autre, penché sur la roue, graissait avec soin l'essieu et le moyeu, et, pour que le goudron qui restait sur la brosse ne fût pas perdu, il en frotta la jante.
Les chevaux de poste de différentes couleurs, pauvres bêtes courbaturées, étaient rangés devant la grille et chassaient les mouches du bout de leurs queues. Les uns allongeaient leurs pieds velus et fermaient leurs yeux pour sommeiller. Les autres, pour passer le temps, se mordillaient entre eux ou broutaient les feuilles et les tiges d'une fougère qui étalait près du perron ses feuilles d'un vert dur et sombre.
La poussière obscurcissait l'air, l'horizon était d'un gris liliacé; pas l'ombre d'un nuage dans le ciel. Un vent d'ouest impétueux soulevait des colonnes de poussière, sur les routes, en inondait les champs, courbait les cimes élevées des tilleuls et des bouleaux dans le jardin, et emportait au loin les feuilles sèches qui tombaient des branches.
Je suivais de la fenêtre les préparatifs du départ, et j'en attendais la fin avec impatience.
Quand nous fûmes tous réunis dans le salon, autour de la table ronde, pour passer ensemble les dernières minutes qui nous restaient, je ne m'imaginais point que nous eussions à traverser des moments si pénibles. Ma tête était remplie de choses futiles; je me demandais quel postillon conduirait la britchka, et qui mènerait la calèche? lequel de mon frère ou de moi voyagerait avec papa, et qui serait avec Karl Ivanovitch? Et pourquoi s'obstinait-on à m'emmitoufler dans un cache-nez et un veston ouaté?—«Suis-je si délicat? est-ce que je risque de mourir de froid?... Ah! que tout cela finisse le plus vite possible et que nous nous mettions en route!...»
Nathalia Savichna entra, un carnet à la main et les yeux, tout rouges.
«A qui dois-je remettre la liste du linge des enfants? demanda-t-elle à ma mère.
—Remettez-la à Nicolas, et venez prendre congé des enfants.»
La vieille femme voulut parler, mais elle resta court, cacha son visage dans son châle, fit un geste de la main et sortit du salon.
Mon cœur se serra à la vue de son chagrin; mais l'impatience de partir domina cette impression, et je continuai d'écouter, impassible, l'entretien de papa et de maman. Ils parlaient de choses qui évidemment ne les intéressaient ni l'un ni l'autre: «Que dois-je acheter pour la maison?... Que dirai-je de ta part à la princesse Sophie et à madame Julie?... La route est-elle bonne?»
Foka entra, et du même ton dont il disait tous les jours: «le dîner est servi,» il dit en s'adossant contre la porte: «les chevaux sont prêts.»
Je vis pâlir maman, et elle eut un léger frisson, comme si cette nouvelle la prenait à l'improviste.
Foka reçut l'ordre de fermer toutes les portes de la maison, à mon grand divertissement; il me sembla que tout le monde jouait à cachecache.
Toutes les personnes présentes s'assirent; Foka lui-même se posa sur l'angle d'une chaise. Il venait à peine de prendre place lorsque la porte du salon grinça; tous nous nous retournâmes, Nathalia Savichna entrait à pas précipités, et, sans lever les yeux, elle s'assit près de la porte sur le même siège que Foka.
Je vois encore aujourd'hui la tête chauve, le visage ridé et impassible du valet de chambre, et au-dessus, la bonne figure encadrée dans un bonnet blanc, sous lequel passaient les bandeaux gris de la niania. Nathalia et Foka serrés l'un contre l'autre sur la même chaise avaient l'air mal à l'aise tous les deux.
Je ne perdis rien de mon insouciance, ni de mon envie de partir au plus vite. Les dix minutes passées ensemble, avec les portes fermées, m'ont semblé une heure entière. Enfin tout le monde se leva, et les adieux commencèrent. Papa prit maman dans ses bras et l'embrassa à plusieurs reprises.
«Assez, chère amie, dit-il enfin, nous ne nous quittons pas pour toujours.
—Cependant c'est bien triste,» répondit maman avec un trémolo de larmes dans la voix.
Quand j'entendis sa voix émue, que je vis le tremblement de ses lèvres et ses yeux pleins de larmes, j'oubliai tout le reste et je fus saisi d'une telle tristesse, je ressentis une telle douleur, mêlée de crainte, que j'aurais mieux aimé m'enfuir n'importe où plutôt que d'aller dire adieu à maman. Je compris qu'en cet instant, en embrassant papa, elle prenait déjà congé de nous.
Ce fut le tour de Volodia; elle l'embrassa et le bénit, le reprit dans ses bras et le bénit de nouveau; je m'avançai, mais elle le serra encore une fois sur son cœur en le bénissant. Enfin elle me prit contre sa poitrine, je me collai à elle, et je pleurai, je pleurai, ne pensant plus qu'à ma douleur.
Au sortir du salon, et au moment de monter en voiture, nous trouvâmes l'antichambre remplie de valets et de filles de chambre qui voulaient aussi nous dire adieu. Leur présence m'importuna ainsi que leur requête: «Tendez-nous la petite main.»
Leurs baisers bruyants sur l'épaule, l'odeur de graisse qui s'exhalait de leurs têtes, éveillèrent en moi un sentiment de malaise, qui, chez des personnes très impressionnables, n'est pas fort éloigné de la répugnance. Sous cette impression je baisai très froidement le bonnet de Nathalia Savichna, tandis qu'elle m'embrassait tout en larmes.
Chose étrange, je me rappelle distinctement le visage des domestiques, et je pourrais décrire cette scène dans ses détails les plus minutieux; mais le visage de ma mère et son attitude m'ont complètement échappé.
C'est peut-être parce que, pendant tout ce temps, je n'ai pas eu le courage de lever les yeux sur elle. Il me semblait que, si je rencontrais son regard, sa douleur et la mienne dépasseraient les bornes de ce que l'on peut supporter de souffrance.
Je m'élançai le premier vers la calèche, et je m'assis dans le fond. La capote de la calèche était relevée et m'empêchait de voir derrière moi; mais je sentais instinctivement que maman était encore près de moi.
«Faut-il que je la regarde encore une fois ou non? pour la dernière fois?» me dis-je en moi-même, et aussitôt j'avançai la tête et me penchai en dehors de la voiture du côté du perron. Au même instant, maman qui avait eu la même idée m'appela par mon nom de l'autre côté de la calèche. En entendant sa voix derrière moi, je me retournai si vivement, que nos têtes s'entrechoquèrent. Elle sourit avec tristesse et m'embrassa fort, pour la dernière fois.
La voiture s'ébranla. Quand nous eûmes parcouru l'espace de quelques mètres, alors seulement j'eus le courage de chercher maman du regard. Je la vis sur le perron; elle montait lentement, soutenue par Foka, la tête baissée, le vent soulevant le fichu bleu attaché sur ses cheveux.
Papa était près de moi et se taisait. Mes larmes m'étranglaient, ma gorge était si serrée qu'il me semblait que j'allais étouffer.
Une fois sur la grande route, nous aperçûmes encore un mouchoir blanc qui flottait sur le balcon; je me mis à agiter le mien, et ce mouvement me calma un peu. Je pleurais toujours, et l'idée que mes larmes prouvaient ma sensibilité me faisait plaisir et me consolait.
Après avoir parcouru un kilomètre à peu près, je commençai à me tranquilliser. J'observais avec une attention obstinée l'objet le plus proche; c'était l'arrière-train du bricolier placé de mon côté. Je regardais comment ce cheval pie agitait sa queue, comment il frottait les pieds l'un contre l'autre, comment le fouet tressé du postillon le faisait sauter sur les deux pieds à la fois; je m'amusais à voir comment l'avaloir montait et descendait sur lui; puis je regardais les anneaux de l'avaloir, enfin je le vis s'humecter d'écume près de la queue de l'animal.
Alors j'en eus assez, et je laissai errer mes regards autour de moi; je vis des champs de seigle mûr ondoyer au soleil, puis les terrains sombres des jachères et, de loin en loin, un paysan avec sa charrue ou une jument auprès de son poulain; puis je remarquai les poteaux de verstes, et enfin je cherchai à voir quel postillon nous conduisait. Mes larmes n'étaient pas encore séchées sur mes joues, et déjà mes pensées vagabondaient bien loin de maman que je venais de quitter peut-être pour toujours. Pourtant tous mes souvenirs me ramenaient à elle. Je songeais au champignon que j'avais découvert la veille dans l'allée des bouleaux, je me rappelais comment Lioubotchka et Katienka s'étaient disputées pour savoir qui le prendrait, puis je me souvins comme elles pleuraient en nous disant adieu.
Je les regrettais; je regrettais aussi Nathalia Savichna et l'allée de bouleaux, et Foka, et même la méchante Mimi ... je les regrettais tous ... et la pauvre maman ... à cette pensée les larmes me montaient de nouveau aux yeux. Mais ce n'était pas pour longtemps.
[1] Boisson usitée en Russie.
Enfance! heureux, heureux temps qui ne reviendra plus! Comment ne pas chérir, comment ne pas caresser les souvenirs de cet âge? Ils élèvent mon âme, la rafraîchissent et sont pour moi la source des plus douces joies.
Je me souviens: je suis tout petit, j'ai couru jusqu'à en être las, je viens m'asseoir dans mon étroit fauteuil au siège élevé, devant la table où bout le thé; il est déjà tard, j'ai depuis longtemps fini ma tasse de lait sucré; le sommeil alourdit mes paupières, mais je ne bouge pas, je reste tranquille et j'écoute.
Et comment ne pas écouter? Maman parle avec quelqu'un, et le son de sa voix est si doux et si affable! Le simple son de sa voix dit tant de choses à mon cœur!
Les yeux troublés par le sommeil, je regarde fixement son visage, et tout d'un coup elle est devenue petite, toute petite; sa figure n'est pas plus grande qu'un bouton, mais je la vois distinctement, je vois qu'elle me regarde et qu'elle sourit.
J'aime à la voir si petite, je ferme encore plus les yeux, et elle n'est pas plus grande que ces petits garçons qu'on voit dans les prunelles quand elles reflètent l'image de quelqu'un. Mais je bouge, l'enchantement est détruit; en vain je cherche à rétrécir mes pupilles pour reformer l'image; c'est fini.
Alors je me lève, je grimpe sur un fauteuil; je rentre mes pieds sous moi, et je me pelotonne confortablement.
«Nicolinka, tu vas de nouveau t'endormir, tu ferais mieux de monter dans ta chambre et de te coucher.
—Je n'ai pas envie de dormir, maman,» et, pendant que je parle, des rêves vagues et doux s'emparent de mon imagination, un bon sommeil d'enfant clôt mes paupières, et, une minute après, j'oublie tout ce qui m'entoure, et je m'endors jusqu'à ce qu'on vienne me réveiller.
Tandis que je sommeille encore, je sens une main tendre; je la reconnais au toucher, et, tout endormi, je m'en empare et je la presse bien fort contre ma bouche.
Tout le monde s'est retiré, une seule bougie brûle dans le salon. Maman a dit qu'elle veut me réveiller elle-même, elle s'est assise sur le rebord du fauteuil dans lequel je dors; de sa main effilée et douce elle caresse mes cheveux, et sa voix chère et familière résonne à mon oreille:
«Lève-toi, ma petite âme, il est temps de te coucher.»
Il n'y a plus de regards indifférents pour la gêner, elle peut répandre sur moi, sans contrainte, toute sa tendresse, tout son amour. Je ne bouge pas, mais je baise sa main toujours plus fort.
«Lève-toi, mon ange!»
Elle passe son autre bras autour de mon cou, et ses petits doigts effleurent mon visage et me chatouillent.
Dans la chambre demi sombre, tout est silencieux; mes nerfs sont excités par ce chatouillement, et je me réveille.
Maman est tout près de moi, elle me touche, je sens le parfum qui flotte autour d'elle, et j'entends sa voix; je me soulève, j'entoure son cou de mes mains, je presse ma tête sur son sein, et je dis, tout oppressé:
«Ah! chère, chère maman, ah! que je t'aime!»
Elle sourit de son sourire triste et charmant; elle prend ma tête dans ses deux mains, me donne un baiser au front et m'attire sur ses genoux.
«Tu m'aimes beaucoup?» dit-elle; et, après une courte pause, elle ajoute: «Aime-moi toujours, ne m'oublie jamais. Quand ta mère ne sera plus là, tu ne l'oublieras pas! tu ne l'oublieras pas, Nicolinka?»
Elle m'embrasse encore plus tendrement.
Je m'écrie:
«Ne parle pas comme cela, ma chère petite mère!» Je sanglote, je baise ses genoux, et des larmes coulent à flots de mes yeux, des larmes d'amour et d'extase.
Puis je monte pour me coucher, et, une fois dans ma petite robe de chambre ouatée, je prie pour papa et pour maman. Quel sentiment ineffable remplit mon cœur! Je répète après maman les prières que mes lèvres d'enfant balbutient pour la première fois, et mon amour pour elle et pour Dieu s'unissent dans un même élan.
Après la prière, je me blottis sous la couverture, et mon âme est légère, pure et consolée. Un rêve efface l'autre, et quels rêves! Ils sont insaisissables, mais remplis d'amour pur et du sentiment d'un bonheur rayonnant.
Tout à coup je pense à Karl Ivanovitch et à son malheureux sort; c'est le seul homme que je sache malheureux, et je suis rempli de compassion pour lui. Mes larmes coulent, et je prie Dieu de lui donner le bonheur, et de permettre que j'allège son affliction; je sens que je suis prêt à tout sacrifier pour lui.
Alors je blottis sous un coin de mon oreiller de plumes mon jouet favori, le lièvre et le chien de porcelaine, et je pense comme ils se trouveront bien là, et comme ils auront chaud cette nuit. Puis je prie encore une fois pour tout le monde, je demande à Dieu qu'il fasse beau temps pour la partie de plaisir du lendemain; puis je me retourne de l'autre côté. Les pensées et les rêves s'embrouillent; je m'endors tranquillement, paisiblement, mais avec un visage encore humide de larmes.
Reviendra-t-elle cette insouciance du premier âge? retrouverons-nous ce besoin d'aimer et cette foi ardente que nous possédions dans l'enfance?
Quel temps pourrions-nous préférer à celui-là, où les deux plus douces vertus—la gaieté innocente et le besoin d'une affection sans bornes—sont les seuls mobiles de notre vie?
Où sont ces prières brûlantes? où est ce don plus précieux, les larmes si pures de l'attendrissement? L'ange gardien descend, il sèche avec un sourire ces larmes et envoie de doux rêves à l'imagination enfantine dont rien n'a encore altéré la pureté.
La vie a-t-elle laissé dans mon cœur des traces si profondes, que ces larmes et ces extases se soient retirées de moi pour toujours? N'en aurais-je gardé que le souvenir?
Environ un mois après notre arrivée à Moscou, un matin, j'étais assis devant une table, et j'écrivais dans la salle d'étude, au haut de la maison de grand'mère; en face de moi, notre maître de dessin mettait les dernières touches à une tête de Turc en turban, dessinée au crayon noir.
Mon frère, debout derrière lui, le cou tendu, regardait par-dessus l'épaule de son professeur. C'était le premier dessin à la mine de plomb de Volodia, et il devait le présenter le soir même à grand'mère pour célébrer sa fête.
«N'ajouterez-vous pas quelques ombres ici? demanda Volodia en se dressant sur la pointe des pieds et en indiquant le cou du Turc.
—Non, il n'en faut pas, répondit notre maître de dessin, en posant les crayons et le tire-ligne dans la boîte. Maintenant cela va bien, n'y touchez plus. Et vous, Nicolas, ajouta-t-il en se levant et sans détacher les yeux de la tête de Turc, dites-nous enfin votre secret, que voulez-vous offrir ce soir à votre grand'mère? Je suis certain que vous auriez mieux fait de dessiner aussi une tête. Au revoir, Messieurs.»
Il prit son cachet et son chapeau, puis il sortit. En cet instant, je m'avouai également qu'une petite tête au crayon aurait bien mieux valu que le travail auquel je m'acharnais depuis quelque temps.
Lorsqu'on nous avait annoncé que la fête de grand'mère approchait, et que nous devions lui préparer un cadeau, il m'était venu à l'idée de composer des vers pour cette occasion. Je trouvai sur-le-champ les deux premiers et je ne mis pas en doute que les autres viendraient tout seuls.
Je ne me rappelle plus comment cette idée, si étrange pour un enfant, m'était venue; mais je me souviens qu'elle me plut beaucoup, et qu'à toutes les questions qui me furent adressées à ce sujet, je répondis que mon présent serait prêt, cela sans dévoiler à âme qui vive en quoi il consistait.
Contrairement à mon attente, il advint qu'après avoir trouvé si facilement les deux premiers vers, dans le feu de l'inspiration, je ne trouvai plus rien, malgré tous mes efforts Je me mis à lire toutes les poésies de ma chrestomathie; mais, loin de m'aider, cette lecture ne fit que me décourager en me donnant une plus petite idée de mes dons poétiques.
Je savais que Karl Ivanovitch aimait à copier les vers; je fouillai dans ses papiers, et, parmi des poésies allemandes, je trouvai une pièce en russe, qu'il avait composée lui-même.
«A Madame L***.
Pétrovskoë, 3 juin 18...
Souvenez-vous de près,
Souvenez-vous de loin,
Souvenez-vous de moi
Aujourd'hui et toujours,
Souvenez-vous jusqu'à la tombe,
Comme je sais aimer fidèlement....»
Karl MAUER.
Cette poésie, copiée en belle écriture ronde sur une feuille de papier mince, me plut beaucoup à cause des sentiments touchants qu'elle exprimait. Je l'appris par cœur, et je résolus de la prendre pour modèle. A partir de ce moment, mon travail devint moins pénible.
Lorsque le jour de la fête de grand'mère arriva, j'étais venu à bout d'une félicitation en douze vers. Il me restait à la copier sur beau papier vélin. Je m'assis à la grande table de la salle d'étude, dans cette intention.
J'avais déjà gâché deux feuilles de papier, non en corrigeant mes vers, je les trouvais bien tournés, mais parce que, dès le troisième vers, les lignes montaient au grenier de plus en plus, et tant et si bien, qu'on voyait de loin que c'était écrit obliquement et que cela ne valait rien.
La troisième feuille ne fut pas tracée plus droit, mais cette fois j'étais bien décidé à ne pas recommencer.
Dans ces vers je félicitais grand'mère, je lui souhaitais une longue vie, et je concluais ainsi:
«Nous tâcherons de vous consoler,
Et nous vous aimons comme une réelle mère.»
Je répétai à voix basse:
«Et nous vous aimons comme une réelle mère....»
Le vers me déplut, et je cherchai en vain une autre rime.
Bah! me dis-je, ça passera toujours ... en tous cas mes vers sont meilleurs que ceux de Karl Ivanovitch. Je copiai le dernier vers sans y rien changer.
Un peu plus tard, je relus mon compliment à haute voix en y mettant l'expression et les gestes. Il s'y trouvait bien quelques vers sans rime; je ne m'y arrêtai pas, mais le dernier vers me frappa encore plus désagréablement qu'auparavant.
Je m'assis sur mon lit, et je devins pensif.
«Pourquoi ai-je mis: Comme une réelle mère?» Maman n'étant pas avec nous, je n'aurais pas dû faire cette allusion. Sans doute j'aime beaucoup grand'mère, je la respecte surtout, mais ce n'est pas comme ma mère; pourquoi ai-je écrit cela? Pourquoi ce mensonge? Il est vrai, je le dis en vers, et ce n'est pas la même chose qu'en prose; pourtant ce n'est pas bien!
En ce moment le tailleur entra et apporta des demi-fracs neufs.
«Advienne que pourra!» me dis-je en moi-même, impatienté, et je serrai avec dépit mes vers sous mon oreiller. Puis je m'empressai d'essayer le nouvel habit de Moscou.
Il était admirable, couleur de cannelle avec des boutons de bronze, et bien ajusté à la taille, à l'inverse de nos vêtements de campagne, toujours trop amples pour nous; le pantalon noir très collant dessinait à merveille les formes et retombait sur les bottes.
«Enfin, moi aussi j'ai un pantalon à sous-pieds, un vrai pantalon!» me disais-je, dans un transport de joie, et je regardais mes jambes en tous sens.
Bien que je me sentisse fort à l'étroit et très gêné de mes mouvements dans mon nouvel habit, je me gardai bien de l'avouer et j'assurai même à tout le monde que je me sentais tout à fait à mon aise, et que, si mon frac avait un défaut, ce serait d'être un peu trop large. Ensuite je me plaçai devant le miroir et me mis à peigner mes cheveux surabondamment pommadés; mais, en dépit de mes efforts pour les coucher, j'avais au sommet de la tête des mèches rebelles qui, aussitôt délivrées de la pression de la brosse, se hérissaient dans toutes les directions et se tenaient toutes droites; ce qui donnait à mon visage une expression tout à fait grotesque.
Karl Ivanovitch s'habillait dans l'autre chambre; je vis porter chez lui un habit bleu et du linge.
Quand j'entrai chez lui, je le trouvai penché devant un petit miroir posé sur la table; il tenait de ses deux mains le nœud de sa cravate flamboyante et tâchait de s'assurer que son menton rigoureusement rasé pouvait entrer dedans et en sortir librement.
Après avoir tiré nos habits sur nous dans tous les sens, il pria notre menin de lui rendre le même service, puis il nous conduisit vers notre grand'mère. Je ne peux m'empêcher de rire en me rappelant quel parfum de pommade nous exhalions tout le long de l'escalier.
Karl Ivanovitch tenait entre ses mains une petite boîte de sa fabrication; Volodia, son dessin, et moi, mes vers. Et tous les trois nous avions au bout de la langue le compliment que nous débiterions en présentant notre cadeau. A l'instant même où Karl Ivanovitch entr'ouvrit la porte du salon, nous aperçûmes le pope qui revêtait la chasuble, et les premières notes du Te Deum retentirent.
Grand'mère était déjà au salon; elle se tenait debout, le visage tourné vers la muraille, la taille recourbée; elle s'appuyait au dossier d'une chaise et priait avec ferveur. Mon père était auprès d'elle; il se retourna à notre entrée et sourit en nous voyant cacher furtivement nos présents et nous arrêter près de la porte, pour ne pas être remarqués. L'effet de surprise sur lequel nous avions compté était déjà perdu.
Comme la cérémonie touchait à sa fin, je me sentis envahi par un sentiment de timidité invincible et hébêtante; il me sembla que je n'aurais jamais le courage d'offrir ma pièce de vers, et je m'effaçai derrière le dos de Karl Ivanovitch. Celui-ci, après avoir exprimé ses félicitations dans les termes les plus choisis, fit passer la boîte de sa main droite dans sa main gauche et la présenta à grand'mère; puis il recula de quelques pas pour céder la place à mon frère.
Grand'mère parut enchantée de cette boîte garnie d'une bordure d'or, elle témoigna sa reconnaissance par un sourire des plus affectueux. Mais on voyait qu'elle ne savait où poser cette nouvelle acquisition, et évidemment dans le but de s'en débarrasser, elle attira l'attention de mon père sur la boîte et lui fit admirer avec quel art elle avait été fabriquée.
Mon père la passa à l'archi-prêtre qui parut non moins enchanté; il secoua l'objet, le retourna, regardant tantôt la boîte, tantôt l'artiste qui avait su exécuter ce chef-d'œuvre.
Volodia s'avança pour offrir son dessin et obtint également des louanges unanimes.
Mon tour était venu; grand'mère se tourna vers moi avec un sourire engageant.
Tous ceux qui ont souffert de la timidité savent que l'attente augmente ce malaise en proportion directe de sa durée, et que la résolution faiblit en proportion inverse du temps; autrement dit, plus l'attente est longue, plus la timidité devient insurmontable et plus la volonté fléchit.
Tout mon courage, tout ce qui me restait encore de volonté, m'abandonna lorsque Karl Ivanovitch et Volodia présentèrent leurs cadeaux. Ma timidité redoubla, il me sembla que tout mon sang refluait sans cesse de mon cœur vers mon cerveau et que je changeais à tout instant de couleur. De grosses gouttes de transpiration coulaient sur mon front et sur mon nez; les oreilles me brûlaient, une moiteur froide envahissait mon corps, frissonnant, et je piétinais sur place sans pouvoir avancer.
«Eh bien! Nicolas, montre nous ce que tu nous apportes: une boîte ou un dessin?»
Il n'y avait plus moyen de reculer; d'une main tremblante j'offris le fatal rouleau de papier tout chiffonné, mais la voix me fit défaut, et je restai devant grand'mère, immobile et muet.
Je ne pouvais me calmer à la pensée qu'au lieu du dessin qu'on attendait de moi, on allait lire devant tout le monde mes vers détestables, et par-dessus tout cette phrase: «comme une réelle mère» qui prouvait que je n'avais jamais aimé maman, et que je l'avais déjà oubliée.
Jamais je ne pourrai rendre toutes les souffrances que j'ai endurées pendant que grand'mère lisait à haute voix ma poésie; ne pouvant la déchiffrer, elle s'arrêta au milieu d'un vers pour regarder papa avec un sourire qui me parut moqueur, puis elle ne mettait pas le ton que j'aurais voulu, et, enfin, sans achever sa lecture à cause de sa faible vue, elle tendit à mon père la feuille de papier et le pria de relire mes vers du commencement à la fin.
Il me semblait qu'elle faisait tout cela parce qu'elle trouvait mes vers trop mauvais et parce que les lignes étaient penchées, et aussi pour que mon père lût lui-même le dernier vers qui prouvait que je n'avais point de cœur.
Je m'attendais à ce qu'il me souffletât avec le rouleau en me disant: «Vilain garçon, n'oublie pas ta mère ... et reçois le châtiment de ton insensibilité.» Mes prévisions ne furent pas réalisées; au contraire, quand mon père eut fini sa lecture, grand'mère s'écria: «C'est charmant!» et elle me baisa au front.
La boîte, le dessin et les vers furent déposés, avec deux mouchoirs de batiste et une tabatière ornée du portrait de ma mère, sur un guéridon placé à côté du fauteuil voltaire où grand'mère se tenait de préférence.
Tandis qu'elle contemplait, d'un air songeur, la miniature de maman, un des deux laquais, grands comme des géants et qui se tenaient toujours derrière sa voiture, entra pour annoncer:
«La princesse Varvara Ilinichna.»
Grand'mère toujours préoccupée ne répondit pas.
«Ordonnez-vous de les prier d'entrer. Votre Excellence?» répéta le domestique.
«Prie-la d'entrer,» dit grand'mère en se renversant dans son fauteuil.
La princesse était une femme de quarante-cinq ans, de taille au-dessous de la moyenne, grêle, sèche et bilieuse; l'expression de ses petits yeux gris-verts et désagréables contredisait évidemment le sourire de ses lèvres minces, qui affectait une douceur exagérée. De son petit chapeau de velours orné de plumes d'autruche, s'échappaient des cheveux d'un roux pâle; les sourcils et les cils semblaient encore plus clairs et plus fades auprès de son teint maladif. Mais, grâce à l'aisance de ses mouvements, à la sévérité exceptionnelle de ses traits, à ses mains toutes mignonnes, l'ensemble de sa personne avait quelque chose d'énergique et de distingué.
La princesse parlait trop; elle appartenait à cette classe de gens qui ont toujours l'air de croire qu'on les contredit, bien que pas un des assistants n'ait prononcé un mot. Tantôt elle élevait la voix, puis la baissait graduellement pour recommencer avec une volubilité nouvelle en regardant toutes les personnes présentes comme pour recueillir l'approbation.
Bien que la princesse eût baisé la main de grand'mère, et qu'elle l'appelât sans cesse: «Ma bonne tante,» je remarquai que grand'maman n'était pas contente d'elle, aux mouvements de ses sourcils qu'elle soulevait en écoutant son interlocutrice. La princesse expliquait en français comment le prince Kornakof, malgré son vif désir de venir apporter à grand'mère ses félicitations, en avait été empêché par des affaires. Grand'mère répondit en russe, ce qui indiquait son mécontentement.
«Je vous remercie beaucoup, ma chère, pour votre attention.... Si le prince n'est pas venu, c'est sans doute qu'il est très occupé ... et ensuite quel plaisir pourrait-il trouver dans la société d'une vieille femme!» Et, sans donner à la princesse le temps de répliquer, elle continua:
«Comment vont vos enfants, ma chère?
—Dieu merci, ma tante, ils grandissent, étudient et font les polissons. Étienne surtout, l'aîné, est un tel espiègle qu'il n'y a pas moyen d'avoir la paix dans la maison; mais il est intelligent, c'est un garçon qui promet. Imaginez-vous, mon cousin,» continua-t-elle en s'adressant exclusivement à mon père, car grand'mère ne paraissait pas s'intéresser aux enfants de la princesse et voulait se prévaloir de ses petits enfants; elle retira soigneusement les vers placés sous la boîte et se mit à déplier le rouleau, tandis que la princesse continuait:
«Imaginez-vous, mon cousin, ce qu'il a inventé ces jours-ci?»
Et, se penchant vers l'oreille de mon père, elle se mit à lui raconter quelque chose d'un ton très animé. Quand elle eut terminé son récit, que je n'ai point entendu, elle se mit à rire, et, regardant mon père d'un air interrogateur, elle dit:
«Quel garçon, mon cousin! Il aurait mérité d'être fouetté; mais cette malice était si spirituelle et si amusante, que je lui ai pardonné.» Et, tout en portant ses regards sur grand'mère, la princesse se mit à rire sans mot dire.
«Est-ce que vous battez vos enfants, ma chère? demanda grand'mère en soulevant les sourcils d'une manière expressive et en insistant sur le mot battez.
—Ah! ma bonne tante, répondit la princesse d'une voix doucereuse, en lançant un regard furtif sur mon père, je connais votre opinion sur ce sujet. Permettez-moi, sur ce seul point, de ne pas être de votre avis. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, beaucoup lu, beaucoup consulté; mais l'expérience m'a convaincue de la nécessité d'agir sur les enfants par la crainte.... Pour venir à bout d'un enfant il n'y a que la crainte ... n'est-ce pas, mon cousin? Et je vous demande un peu qu'est-ce que les enfants craignent plus que la verge?»
En prononçant ces mots, elle nous regarda interrogativement, et, je l'avoue, je me sentis mal à l'aise en ce moment.
«Vous avez beau dire, continua-t-elle, mais un garçon de douze et même de quatorze ans est encore un enfant ... pour une fille c'est autre chose....»
Je pensai en moi-même:
«Quel bonheur que je ne sois pas son fils!
—Oui, c'est fort bien, ma chère, dit grand'mère en repliant mes vers, et en les mettant sous la boîte, comme si, après cette déclaration, elle ne trouvait plus que la princesse fût digne de les entendre, c'est bien; mais dites-moi, je vous prie, quels sentiments délicats pouvez-vous attendre de vos enfants après cela?»
Et, comme elle tenait cet argument pour irréfutable, grand'mère ajouta comme conclusion:
«D'ailleurs chacun est libre d'avoir ses idées à ce sujet.»
La princesse ne répondit pas, mais sourit avec condescendance; elle témoignait ainsi qu'elle excusait ces étranges préjugés chez une personne qu'elle respectait profondément.
«Mais laissez-moi faire la connaissance de vos jeunes gens,» ajouta-t-elle, en nous regardant avec un sourire affable.
Mon frère et moi, nous nous levâmes sans savoir comment nous pouvions montrer que nous avions fait connaissance.
«Baisez la main de la princesse, nous dit mon père.
—Aimez votre vieille tante, reprit-elle en baisant Volodia sur les cheveux:—Quoique je sois pour vous une cousine éloignée, je compte d'après les liens du cœur et non d'après ceux de la parenté....» continua-t-elle en s'adressant particulièrement à grand'mère. Mais grand'mère était toujours mécontente, et elle répondit:
«Ah! ma chère, qui de nos jours tient compte d'une telle parenté?
«Celui-ci sera un homme du monde, dit mon père en indiquant Volodia; et celui-ci, un poète, continua-t-il en me désignant, tandis que, tout en baisant la petite main sèche de la princesse, je voyais distinctement dans cette main une verge, sous la verge un banc et sur le banc ... ainsi de suite.
—Lequel sera poète? demanda-t-elle en me retenant par la main.
—Celui-ci, le petit avec le toupet,» insista mon père en souriant gaiement.
«Que lui ont fait mes cheveux! me disais-je en me retirant dans un coin, ne pourrait-il pas trouver un autre sujet de conversation?»
J'avais les idées les plus insolites sur la beauté. Karl Ivanovitch était encore à mes yeux le plus bel homme du monde; mais je savais très bien que moi, je n'étais pas beau, et en cela je ne me trompais pas. Pour cette raison toute remarque sur ma figure me blessait douloureusement.
Il me souvient qu'un jour, au dîner,—j'avais alors dix ans—on parla de ma figure. Ma mère, voulant à tout prix trouver quelque chose de beau dans mon visage, disait que j'avais des yeux intelligents et un doux sourire; mais elle dut se rendre aux arguments de mon père et à l'évidence, et reconnaître ma laideur. Le repas fini, lorsque je m'approchai d'elle pour la remercier, elle me donna une petite tape sur la joue et me dit:
«Sache-le bien, Nicolinka, personne ne t'aimera pour ton visage, et c'est pourquoi tu dois tâcher d'être un bon et un sage garçon.»
Malgré cette assurance, j'avais des accès de désespoir; je m'imaginais qu'il n'y avait pas de bonheur sur cette terre pour un homme affligé d'un nez aussi large, de lèvres aussi épaisses, et de petits yeux gris comme les miens. J'implorais Dieu pour qu'il fit un miracle, pour qu'il me métamorphosât en un bel homme; j'aurais donné tout ce que je possédais, tout ce qui devait m'appartenir un jour en échange d'un beau visage.
La princesse, après avoir entendu mes vers, me combla d'éloges. Grand'mère s'adoucit aussitôt; elle adressa la parole en français à sa visiteuse, cessa de lui dire vous et ma chère, et l'invita même à venir dans la soirée avec ses enfants.
La princesse accepta cette proposition et se retira peu après.
Tant de personnes accoururent ce jour-là pour féliciter grand'mère, que, pendant toute la journée, plusieurs voitures stationnèrent dans la cour, devant le perron.
«Bonjour, chère cousine,» s'écria en entrant un des visiteurs.
C'était un homme d'environ soixante-dix ans et de haute stature. Il portait un uniforme militaire, orné de larges épaulettes et d'une grande croix blanche. Son visage était ouvert et paisible. Je fus frappé de la simplicité et de l'aisance de ses mouvements.
Bien que son crâne dénudé fût encadré seulement d'une couronne de cheveux clair-semés qui retombaient sur la nuque, et malgré le pli de sa lèvre supérieure qui accusait l'absence de dents, son visage était encore d'une beauté remarquable.
Le prince Ivan Ivanitch devait à son noble caractère, à sa belle figure, à sa bravoure exceptionnelle, à sa parenté haute et puissante, et peut-être avant tout à sa bonne étoile, d'avoir fourni dès sa jeunesse une brillante carrière, dans les dernières années du siècle passé.
Il resta au service de l'armée, où son ambition fut si largement satisfaite, qu'il ne trouva bientôt plus rien à souhaiter.
Tout jeune encore, il semblait déjà se préparer pour la place élevée dans le monde à laquelle sa destinée le conduisait. Aussi, bien que, dans cette vie glorieuse et un peu vaine, il ait éprouvé, comme tous les hommes, quelques échecs, quelques désenchantements, quelques déceptions, il conserva constamment son humeur paisible et ses idées élevées, et resta éternellement fidèle aux principes fondamentaux de la religion et de la morale. C'est pourquoi il dut l'estime générale, moins à sa position brillante qu'à la fermeté de son caractère et à sa conduite toujours conséquente avec ses principes.
Ce n'était pas un esprit supérieur; mais, grâce à sa situation qui lui permettait d'envisager de haut les vicissitudes puériles de la vie, sa manière de penser était toujours élevée. Il était bon et sensible, bien que froid et un peu arrogant dans ses manières. Sa position le mettait à même d'être utile à beaucoup de gens, et il avait choisi cette attitude pour opposer une digue aux sollicitations sans fin des hommes qui cherchaient à se frayer un chemin sous ses auspices.
Cette froideur était pourtant tempérée par la politesse condescendante d'un homme du tout grand monde. Il était cultivé et il avait beaucoup lu; mais son instruction se bornait à ce qu'il avait appris dans sa jeunesse, à la fin du siècle dernier. Il avait lu tout ce qui avait paru de remarquable en France en fait de philosophie et d'éloquence dans le XVIIIe siècle; il connaissait à fond les chefs-d'œuvre de la littérature française et citait volontiers des passages de Racine, Corneille, Boileau, Molière, Fénelon et même Montaigne. Il connaissait parfaitement la mythologie et lisait avec profit les monuments anciens de la poésie épique dans la traduction française; il avait puisé dans les ouvrages de Ségur des notions approfondies de l'histoire; mais il s'en tenait à l'arithmétique et n'avait aucune idée des mathématiques ou de la physique, et la littérature contemporaine lui était étrangère. Dans la conversation, il savait se taire à propos, ou glisser quelques remarques générales sur Gœthe, Schiller et Byron. Mais il ne les avait jamais lus.
Malgré cette éducation classico-française, le prince Ivan Ivanitch avait gardé beaucoup de naturel dans la conversation; cette simplicité lui aidait à cacher son ignorance sur certains sujets et donnait de l'agrément à ses manières en le rendant tolérant pour les opinions d'autrui.
Il était l'ennemi déclaré de toute originalité, et disait que l'originalité était un masque derrière lequel se retranchaient les gens de mauvais ton.
Il ne pouvait se passer de société; où qu'il se trouvât, à Moscou ou à l'étranger, il vivait sur un grand pied et recevait, à jours fixes, toute la ville. Il était entouré de tant de considération, qu'un billet d'invitation de sa main était un passe-port qui donnait l'entrée de tous les salons. Plusieurs jeunes et jolies femmes du meilleur monde lui tendaient avec empressement leurs joues roses, qu'il semblait baiser avec un sentiment paternel, et des personnages haut placés ne se possédaient plus de joie lorsqu'ils avaient le privilège de faire sa partie au jeu.
Le prince avait peu d'amis appartenant, comme ma grandmère, au même monde que lui; elle avait le même âge et partageait les mêmes idées, ayant reçu la même éducation; c'est pourquoi il tenait beaucoup à leur vieille amitié et témoignait une profonde estime à mon aïeule.
Pour moi, je ne me lassais pas de contempler le prince Ivan Ivanitch; la déférence dont tout le monde l'entourait, la joie que grand'mère exprimait en l'apercevant, un peu aussi ses grandes épaulettes, et beaucoup la familiarité de son attitude avec mon aïeule, que tous les autres gens semblaient craindre et avec laquelle il s'entretenait librement, poussant l'audace jusqu'à l'appeler «ma cousine,» toute sa manière d'être m'inspirait un respect peut-être encore plus grand que celui que j'avais pour grand'mère.
Lorsqu'on lui eut montré mes vers, il m'appela auprès de lui et s'écria:
«Qui peut savoir, ma cousine, ce sera peut-être un second Derjavine!» (célèbre poète russe du siècle dernier).
En prononçant ces paroles, il me pinça la joue si fort, que j'eus de la peine à retenir un cri de douleur, tout en comprenant que c'était une caresse.
Peu à peu les visites cessèrent; mon père et Volodia sortirent du salon et il ne resta plus que grand'mère, le prince Ivan Ivanitch et moi.
«Pourquoi notre chère Nathalia Nicolaevna n'est-elle pas avec nous? demanda tout à coup le prince, après un court silence.
—Ah! mon cher, répondit grand'mère en baissant la voix et en portant sa main sur la manche de l'uniforme de son vieil ami; sans doute elle serait venue si elle était libre de faire ce qu'elle veut. Elle m'a écrit que Pierre lui avait offert de venir, mais qu'elle avait refusé parce qu'ils n'ont pas touché leurs revenus cette année. Elle ajoutait encore: «Je ne sais pas pourquoi je me transporterais avec toute la maison à Moscou. Lioubotchka est encore trop petite; quant aux garçons, puisqu'ils sont chez vous, je suis plus tranquille que s'ils étaient avec moi.»
«Tout cela est bel et bon, poursuivit grand'mère, d'un ton qui indiquait clairement qu'elle le trouvait fort mauvais.
—Certainement, il était temps d'envoyer ces garçons pour qu'ils apprissent quelque chose et reçussent l'habitude du monde, car quelle éducation pouvait-on leur donner à la campagne?... L'aîné a déjà treize ans, le second onze..., et avez-vous remarqué, mon cousin, qu'ils semblent de petits sauvages, ils ne savent pas entrer dans un salon!
—Cependant je ne comprends toujours pas, répondit le prince, d'où viennent ces plaintes continuelles sur les mauvaises affaires.... Lui, il possède une grande fortune, et je connais très bien aussi les terres de Natacha; c'est là que nous avons joué la comédie dans le temps, je les connais comme mes dix doigts.—C'est une propriété admirable et qui doit rapporter de bons revenus....
—Je vous confie comme à un ami dévoué, interrompit grand'mère d'un air attristé, qu'il me semble que ces raisons ne sont que des prétextes qu'il met en avant pour venir seul ici et vivre à sa guise. Elle ne soupçonne rien, vous savez qu'elle est bonne comme un ange! Dans sa bonté, elle croit tout ce qu'il lui dit. Il lui a déclaré qu'il fallait emmener les garçons à Moscou, et qu'elle devait rester seule à la campagne avec une sotte institutrice, et elle l'a cru; s'il lui avait dit qu'elle doit battre ses enfants comme le fait la princesse Varvara Ilinichna, je crois qu'elle se laisserait persuader, continua grand'mère pour conclure, en se tournant dans son fauteuil d'un air de profond dégoût.
«Oui, mon ami, reprit-elle, après un silence d'une minute, et, prenant un des mouchoirs posés sur le guéridon, elle le porta à ses yeux pour essuyer une larme; je me dis souvent qu'il ne peut ni l'apprécier, ni la comprendre, et qu'en dépit de la beauté de ma fille, de son amour pour lui et de ses efforts pour me cacher sa douleur, je le sais très bien, elle ne peut pas être heureuse avec lui.... Rappelez-vous mes paroles. Et grand'mère enfouit son visage dans son mouchoir.
—Eh! ma bonne amie, dit le prince, d'un ton de reproche, je vois que vous n'êtes pas devenue plus raisonnable; vous pleurez et vous vous tourmentez toujours pour un malheur imaginaire! Comment n'avez-vous pas honte! Je le connais depuis longtemps et je sais qu'il est un bon, un excellent mari, plein d'attentions, et, ce qui est plus important, un homme très noble, un parfait honnête homme.»
Ayant involontairement écouté une conversation que je n'aurais pas dû entendre, je me glissai hors du salon sur la pointe des pieds, et profondément troublé.
«Volodia! Volodia! les Ivine!» criai-je en apercevant par la fenêtre trois garçons vêtus de redingotes d'hiver bleues, ornées d'un col de castor; ils suivaient leur jeune précepteur, un dandy, qui traversait la rue pour entrer chez nous.
Les jeunes Ivine étaient nos cousins, et presque de notre âge; aussitôt arrivés à Moscou, nous avions fait leur connaissance, et nous étions devenus bons amis.
Le second de ces jeunes gens, Serge Ivine, était un brun aux cheveux frisés, au petit nez ferme et retroussé, aux yeux bleu-foncé, aux lèvres très fraîches et rouges, qui laissaient d'habitude entrevoir une rangée de dents blanches avançant un peu; son visage exprimait une vivacité peu commune.
Jamais il ne souriait, il était très sérieux ou riait de tout son cœur, d'un rire franc, sonore et très communicatif. Sa beauté originale frappait à première vue. Je me sentais attiré vers lui par un entraînement irrésistible. Il me suffisait de le voir pour être tout à fait heureux; toutes les fibres de mon âme se concentraient dans ce seul désir: le voir.
Lorsqu'il m'arrivait de passer trois ou quatre jours sans le rencontrer, je commençais à m'ennuyer, et j'étais triste jusqu'aux larmes.
Éveillé ou endormi, je ne rêvais qu'à lui; le soir, en me couchant, je souhaitais de le voir dans mes songes; dès que je fermais les yeux, je le voyais devant moi et j'entretenais avec délices cette vision comme ma plus exquise jouissance. Je n'aurais avoué ce sentiment à personne au monde, tant il m'était précieux.
Est-ce à cause de l'obsession de mes yeux ardents qui le dévoraient ou parce qu'il ne ressentait aucune sympathie pour moi? mais il ne me cachait point qu'il préférait jouer et babiller avec Volodia plutôt qu'avec moi; cette indifférence ne troublait pas mon bonheur; je n'espérais rien, je ne demandais rien, j'étais prêt pour lui à tous les sacrifices.
Sa présence excitait en moi, à côté de mon inclination passionnée et au même degré, un autre sentiment, la crainte de lui faire de la peine, de le blesser, de lui déplaire.
Est-ce un effet de l'expression arrogante de son visage, ou parce que, conscient de ma laideur, je prisais trop haut cette qualité chez les autres, ou simplement, parce que c'est un signe caractéristique de l'affection? Mais je ressentais pour lui autant de crainte que de tendresse.
Lorsqu'il m'adressa la parole pour la première fois, ce bonheur imprévu me troubla si fort que je rougis, je pâlis, et je ne pus rien répondre.
Mon idole avait une mauvaise habitude; quand il se mettait à réfléchir il fixait un point quelconque en clignant des yeux et en relevant les narines et les sourcils. Tout le monde trouvait que ce tic le déparait; moi, je le trouvais charmant, et, sans y penser, je l'imitai si bien que, quelques jours après que j'eus fait sa connaissance, grand'mère me demanda si c'était parce que j'avais mal aux yeux que je les faisais clignoter, comme un hibou.
Je n'ai jamais soufflé à mon idole un mot des sentiments qu'il m'inspirait, mais il sentait son pouvoir sur moi, et, sans en avoir conscience, despotiquement, il en usait dans nos relations. Malgré toute mon envie de lui ouvrir mon cœur, je le craignais trop pour pouvoir me décider à lui faire des aveux; je m'efforçais, au contraire, de me montrer indifférent, et je me soumettais à lui sans murmurer. Parfois son joug me semblait lourd, insupportable; mais je n'avais pas la force de le secouer.
Je ne peux me rappeler sans tristesse ce pur et frais sentiment d'affection désintéressée et sans bornes, qui est mort sans avoir pu se répandre au dehors et sans trouver un sympathique écho.
Étrange anomalie! quand j'étais enfant, je faisais tout mon possible pour ressembler à une grande personne, et, depuis que j'ai cessé d'être un enfant, j'ai souvent souhaité de le redevenir.
Que de fois la crainte de paraître trop petit garçon m'a retenu dans mes rapports avec Serge Ivine. Cette crainte figeait le sentiment prêt à déborder et m'obligeait à le dissimuler! Non seulement je ne me permettais pas de l'embrasser, de prendre sa main, de lui dire combien j'étais heureux de le voir, mais je n'osais même pas lui donner son petit nom d'amitié; je l'appelais toujours Serge, tout court.... Telle était la règle entre nous.
Il nous semblait que toute expression du sentiment prouvait de l'enfantillage, et que celui qui se la permettait n'était qu'un gamin. C'est ainsi que, sans avoir passé par les épreuves amères qui rendent les hommes prudents et froids dans leurs relations, nous nous sommes privés des pures jouissances d'un tendre attachement enfantin, rien que pour imiter les grandes personnes.
Je courus recevoir les Ivine dans l'antichambre, et, après les avoir salués, je m'élançai auprès de grand'mère pour lui annoncer cette visite, comme si c'était un événement qui devait la combler de joie. Puis, mon regard obstinément fixé sur Serge, j'entrai avec lui au salon, et je me mis à épier ses moindres mouvements.
Grand'mère le considéra de ses yeux perçants et prononça qu'il avait grandi. J'éprouvais pendant cet examen la même alternative de crainte et d'espérance qu'éprouve un artiste en attendant le jugement d'un arbitre respecté sur son œuvre.
Le jeune précepteur des Ivine, Herr Frost, descendit avec nous au jardin, après avoir demandé à grand'mère sa permission. Il s'assit sur un banc vert, croisa pittoresquement les jambes, glissa entre elles sa canne à pomme de bronze, et alluma un cigare, de l'air d'un homme qui est très satisfait de sa pose.
Herr Frost était un allemand, mais un allemand d'une toute autre allure que notre bon Karl Ivanovitch. D'abord il parlait correctement le russe, et le français avec un mauvais accent; il avait la réputation, surtout auprès des dames, d'être ... «très savant homme»; secondement, il portait des moustaches rousses et une grosse épingle de rubis dans sa cravate de satin noir dont les bouts étaient passés sous les bretelles; son pantalon était d'un bleu clair à reflets chatoyants et pourvu de sous-pieds; troisièmement, il était jeune, sa tête était belle quoique suffisante, et ses pieds musculeux. C'était le type du jeune allemand russifié qui veut jouer un rôle et faire le vert-galant.
Nous nous amusions beaucoup au jardin; le jeu du brigand marchait on ne peut mieux, lorsqu'un accident vint tout bouleverser.
Serge était le brigand lancé à la poursuite des voyageurs; il fit un faux pas et, dans l'élan de la course, heurta du genou contre un arbre avec tant de violence que je crus qu'il s'était cassé en mille morceaux. Oubliant que je représentais le gendarme, et que ma consigne me prescrivait de m'emparer du brigand, je m'approchai de Serge pour lui demander s'il s'était fait mal. Pour toute réponse il se fâcha, serra les poings, tapa du pied et me cria d'une voix qui prouvait clairement qu'il s'était fait beaucoup de mal:
«Mais qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas du jeu! Pourquoi ne m'arrêtes-tu pas?» répéta-t-il plusieurs fois en guettant du coin de l'œil nos deux frères, qui, en leur qualité de voyageurs, couraient sur le sentier, et, tout à coup, il fondit sur eux avec un éclat de rire bruyant.
Je ne peux pas rendre l'impression que me fit cet acte héroïque; j'en fus frappé et charmé. Comment! malgré une souffrance aiguë, me disais-je, il ne pleure pas, ne laisse même pas voir qu'il a mal et n'abandonne pas le jeu, pas même pour un instant! J'eus bientôt une nouvelle occasion d'admirer son courage et la fermeté de son caractère.
Un nouveau compagnon de jeu se joignit à nous peu après cet incident; il s'appelait Ilinka Grap. C'était le fils d'un étranger pauvre qui avait vécu chez mon grand-père, et qui lui avait des obligations. Il croyait s'acquitter d'un devoir en envoyant son fils s'amuser avec nous. Il se trompait beaucoup en pensant que notre commerce pouvait lui donner du plaisir ou lui faire honneur; nous ne le regardions pas comme un ami, et nous ne prenions garde à lui que pour nous en moquer.
Ilinka Grap était un grand garçon de treize ans, maigre et pâle, ayant une mine d'oiseau et une expression débonnairement soumise. Il était très pauvrement vêtu; mais, en revanche, toujours pommadé avec une telle profusion, que nous avions l'habitude de dire que, les jours de soleil, la pommade devait fondre sur sa tête et couler sur ses habits. Maintenant, quand je pense à lui, je m'en souviens comme d'un bon, d'un très bon garçon, tranquille et serviable; mais, dans ce temps là, il me faisait l'effet d'un être insignifiant, qui ne méritait pas qu'on s'occupât de lui ou qu'on le prit en commisération.
Le jeu du brigand terminé, nous rentrâmes dans la maison. Pour passer le temps jusqu'au dîner nous nous livrâmes à des prouesses de gymnastique, voulant faire parade de notre habileté. Grap nous regardait avec un timide sourire d'étonnement. Lorsque nous l'engagions à en faire autant, il refusait en disant qu'il n'était pas assez fort.
Mon Serge était admirable dans ces exercices. Il avait ôté son veston, son visage rayonnait, ses yeux lançaient des flammes, il riait sans cesse et inventait de nouveaux tours de force; il sautait par-dessus trois chaises placées de front, parcourait la chambre en faisant la roue et se perchait sur les volumes du lexique la tête en bas et les pieds en l'air, exécutant avec ses jambes de si drôles de mouvements, qu'il était impossible de tenir son sérieux en le voyant.
Après cet exercice, il devint pensif, cligna des yeux, prit un air très grave et, s'approchant de Grap, lui dit:
«Tâchez de faire comme moi, je vous assure que ce n'est pas difficile.»
Ilinka Grap, voyant que l'attention générale se portait sur lui, rougit et, d'une voix si mal assurée qu'on pouvait à peine l'entendre, protesta qu'il était incapable d'essayer cette prouesse.
«Mais qu'est-ce que cela signifie, s'écria Serge, pourquoi ne veut-il rien faire? Pourquoi fait-il sa demoiselle? Il faut absolument qu'il se tienne sur la tête.»
Et mon ami prit Grap par la main.
«Sans merci, sans merci, sur la tête! criai-je avec mes camarades en faisant cercle autour du pauvre enfant et en l'entraînant vers le dictionnaire.
—Lâchez-moi, j'irai tout seul!» criait notre victime.
Mais ses cris de désespoir ne servaient qu'à nous exciter; nous nous tenions les côtes de rire, et, entre nos mains, le veston vert craquait sur toutes les coutures.
Volodia et Ivine l'aîné inclinèrent la tête de Grap et la posèrent sur les lexiques; Serge et moi, nous nous emparâmes de ses jambes grêles qui se débattaient en tous sens; nous retroussâmes son pantalon jusqu'aux genoux, puis, avec un rire bruyant, nous jetâmes ses pieds en l'air; pendant ce temps le plus jeune des Ivine maintenait le corps de Grap en équilibre.
A nos éclats de rires succéda un moment de silence, et l'on n'entendit plus dans la chambre que la respiration embarrassée de notre victime.
En ce moment je n'étais pas tout à fait sûr que cet amusement fût drôle et gai.
«Maintenant tu es un brave!» prononça Serge en donnant une claque au patient.
Ilinka Grap ne disait rien et s'efforçait de se délivrer en donnant des coups de pied dans toutes les directions. Dans un de ces mouvements désespérés, son talon atteignit Serge à l'œil, et si fortement, que des larmes involontaires jaillirent, et que mon ami lâcha sa victime et porta la main à ses yeux, tout en poussant Grap de l'autre main de toutes ses forces. Celui-ci, n'étant plus soutenu que par nous, tomba lourdement par terre comme inanimé et dit d'une voix étouffée par les larmes:
«Pourquoi me tourmentez-vous de la sorte?»
Le pauvre Ilinka, le visage en larmes, les cheveux ébouriffés, le pantalon retroussé sous lequel passaient les tiges de bottes non cirées, avait une mine si piteuse, que nous en fûmes frappés; nous restâmes silencieux et nous nous efforçâmes de sourire.
Serge fut le premier à se remettre.
«Voilà un pleurnicheur, une vraie demoiselle, dit-il en le touchant légèrement du bout du pied; il ne sait pas jouer.... Assez, levez-vous!
—Oui, tu es un vilain gamin, répéta Ilinka d'un ton fâché, et, se détournant, il se mit à sangloter à haute voix.
—Ah! ah! il donne des coups de talon et c'est encore lui qui dit des injures!» cria Serge en saisissant un dictionnaire qu'il brandit sur la tête du malheureux; celui-ci ne songeait pas à se défendre et se bornait à cacher sa tête entre ses mains.
«Eh bien! voilà ce que tu gagnes à dire des injures!... laissons-le là puisqu'il ne comprend pas la plaisanterie ... descendons,» dit Serge avec un rire forcé.
Je regardai le pauvre Grap, il me fit pitié. Il était étendu sur le plancher, le visage dans les dictionnaires; il semblait que, si les convulsions qui agitaient tout son corps duraient encore quelques minutes, il rendrait l'âme.
«Oh! Serge, dis-je à mon favori, pourquoi as-tu fait cela?
—Voilà encore!... J'espère que je n'ai pas pleuré aujourd'hui quand je me suis presque cassé la jambe?
—Oui, il a raison, pensai-je; Grap n'est qu'un pleurnicheur, tandis que mon Serge est un brave! Oh! comme il est brave!»
Je ne me disais pas que le malheureux Grap pleurait beaucoup moins de sa souffrance physique, que de la pensée que des garçons, qu'il aimait peut-être, avaient pu se liguer contre lui pour le détester et le chasser, sans qu'il leur eût fait aucun mal.
A l'heure qu'il est, je ne peux pas m'expliquer ma cruauté dans cette occasion. Comment se fait-il que je ne me sois pas approché de lui pour le défendre et pour le consoler? Qu'était devenu ce sentiment de compassion qui me faisait pleurer tout haut à la vue d'un choucas jeté hors du nid, d'un petit chien qu'on allait noyer ou d'un poulet qu'un marmiton emportait pour la cuisine!
Est-il possible que ces beaux sentiments fussent amortis chez moi par mon affection pour Serge, et par mon désir de paraître à ses yeux aussi brave que lui? Quand je songe à ces faiblesses de mon orgueil, il me semble qu'elles laissent sur les pages de mes souvenirs d'enfance les seules taches qui les ternissent.
Le remue-ménage inusité qui se fit dans la salle à manger transformée en buffet, le brillant éclairage qui donnait aux objets familiers un aspect nouveau, un air de fête, et, surtout, le fait que le prince Ivan Ivanitch nous avait envoyé son orchestre, tout me fit présumer que nous aurions beaucoup de monde le soir.
Au bruit de chaque voiture qui passait, je courais à la fenêtre, j'appuyais les paumes de mes mains contre la vitre en me prenant les tempes, et je regardais avec curiosité dans la rue. D'abord je ne distinguais rien, puis peu à peu la boutique d'en face avec sa lanterne bien connue saillait; ensuite je discernais de côté la grande maison dont deux fenêtres étaient éclairées au premier étage,—un fiacre transportait deux voyageurs, ou une calèche vide revenait au pas.
Mais tout à coup un équipage roula devant notre perron. Les Ivine avaient promis de venir de bonne heure, et je m'élançai pour les recevoir dans l'antichambre.
A leur place j'aperçus, derrière le domestique en livrée qui ouvrait la porte, deux personnes du sexe féminin: l'une était de grande taille, enveloppée dans un manteau bleu orné d'un col de martre, et l'autre, toute petite, emmitouflée dans un châle vert, sous lequel on n'apercevait que de très petits pieds chaussés de bottines fourrées.
Sans faire aucune attention à moi et sans se soucier de mes saluts réitérés, la petite personne s'approcha de sa compagne, sans mot dire, et resta immobile pendant que celle-ci déroulait le châle vert qui l'enveloppait de la tête aux pieds. La grande déboutonna le long manteau de la petite, le laquais lui enleva ses bottines, et, lorsqu'il eut dans les bras les vêtements que venaient de quitter les deux visiteuses, j'eus devant les yeux une charmante petite fille de douze ans, décolletée, en robe de mousseline courte qui découvrait un pantalon blanc et de mignons souliers noirs. Un ruban de velours noir entourait son fin cou blanc; sa petite tête était couverte de boucles d'un blond foncé, qui encadraient merveilleusement le joli minois de l'enfant, et retombaient avec tant de grâce sur ses épaules nues, que quelqu'un, Karl Ivanovitch lui-même, ne m'eût-il assuré que ces boucles frisaient si bien que parce que, dès le matin, elles avaient été enroulées dans des morceaux du Journal de Moscou et pressées entre des fers chauds, je ne l'aurais pas cru; il me semblait que la nouvelle venue avait dû naître avec cette tête bouclée.
Ce qui me frappait le plus dans ce visage, c'était la grandeur extraordinaire des yeux, convexes de forme, et toujours à demi-fermés, qui formaient le plus singulier, mais en même temps le plus agréable contraste avec la petite bouche mignonne.
Les lèvres étaient closes, le regard si sérieux, que l'expression générale des traits n'annonçait pas le sourire; mais, quand ce sourire éclatait, il était d'autant plus enchanteur.
Je m'efforçai de glisser inaperçu hors de l'antichambre, pour courir dans la première salle où je me promenai de long en large, en feignant d'être trop absorbé dans mes pensées, pour m'apercevoir de l'entrée de nos invités. Lorsque la mère et la fille furent au milieu de la pièce, je fis semblant de revenir à la réalité, et, après avoir fait ma révérence, je les prévins que grand'mère les attendait au salon.
Madame Valakine, qui me plut beaucoup à cause de sa ressemblance avec sa fille, répondit en inclinant la tête avec un air de bienveillance.
Grand'mère parut très contente de voir Sonitchka; elle la fit venir près d'elle, rajusta une boucle qui retombait sur le front de la jeune fille, et, la considérant avec attention, s'écria: «Quelle charmante enfant!» Sonitchka sourit, et son visage se couvrit d'une teinte rosée qui la rendit si jolie, que je rougis par sympathie en la regardant.
«J'espère que tu ne t'ennuieras pas chez moi, ma petite amie, dit grand'mère en lui soulevant le menton; donne-t'en à cœur joie, amuse-toi et danse le plus possible.... Nous avons déjà une dame et deux cavaliers,» dit-elle en s'adressant à la mère de la petite fille et en me touchant du doigt.
Ces paroles qui me rapprochaient de Sonitchka me furent si agréables que je rougis de nouveau.
Mais, me sentant encore plus intimidé, je profitai du roulement d'un nouvel équipage dans la cour pour opérer ma retraite.
Dans l'antichambre je trouvai la princesse Kornakova suivie de son fils et de ses filles qui formaient une troupe qui n'en finissait pas; elles étaient toutes laides, taillées sur le même patron, et ressemblaient à leur mère; aucune n'attirait les regards. Tout en posant leurs manteaux et leurs boas, elles parlaient toutes ensemble d'une voix flûtée, s'agitaient et riaient de quelque chose,—était-ce de se voir si nombreuses?
Leur frère Étienne était un garçon de quinze ans, très grand et gros de corps, avec un visage maigre et fatigué; ses yeux enfoncés étaient cernés d'une ligne bleuâtre, et ses pieds et ses mains étaient trop grands pour son âge. Il était gauche dans ses mouvements, et sa voix était d'un timbre désagréable et inégal; malgré ces défectuosités il semblait très content de lui-même, et représentait exactement à mes yeux le type d'un garçon élevé avec la verge.
Nous restâmes assez longtemps en face l'un de l'autre à nous examiner réciproquement, puis nous fimes un pas en avant pour nous embrasser; mais, après avoir échangé encore un coup d'œil, nous y renonçâmes. Quand les robes de toutes les sœurs eurent défilé devant nous avec un froufrou sonore, la conversation s'engagea entre nous. Je demandai à mon compagnon s'il ne s'était pas trouvé à l'étroit dans la voiture.
«Je ne sais pas, répondit-il négligemment;—je ne vais jamais dans la voiture, cela me fait mal au cœur, et maman le sait. Quand nous sortons, le soir, je me mets sur le siège; c'est beaucoup plus amusant, de là on voit tout. Philippe, notre cocher, me laisse conduire; quelquefois il me cède aussi le fouet, et alors, comme vous pensez, j'en gratifie les passants,—il compléta sa phrase par un geste expressif—c'est bon ça!...
—Votre Excellence, dit un laquais en entrant dans le vestibule, Philippe demande où vous avez mis le fouet.
—Comment où je l'ai mis? Je le lui ai rendu!
—Il dit que vous ne le lui avez pas rendu.
—Alors je l'ai accroché à la lanterne.
—Philippe dit qu'il ne l'a pas trouvé non plus sur la lanterne. Vous feriez mieux, continua le laquais dont la colère montait, d'avouer tout de suite que vous l'avez perdu, sans quoi Philippe répondra de sa bourse pour vos espiègleries.»
Le laquais était un homme âgé, à l'air respectable; il semblait prendre avec feu le parti du cocher et vouloir, coûte que coûte, éclaircir l'affaire.
Par un sentiment de délicatesse involontaire, je m'éloignai en faisant celui qui n'entend pas; mais tous les laquais qui assistaient à cette scène se rapprochaient et semblaient par leurs regards encourager le vieux serviteur.
«Eh bien! si je l'ai perdu, c'est perdu! dit Étienne pour mettre fin aux explications ... je lui payerai la valeur de son fouet. Est-ce assez drôle? ajouta-t-il en se rapprochant de moi et en m'entraînant vers le salon.
—Non, permettez, barine, avec quoi payerez-vous? Je connais votre manière de payer! Voilà déjà huit mois que vous devez vingt copecks à Maria Vassilievna, et à moi, voici deux ans, et à Pierre....
—Veux-tu te taire! cria le jeune homme, pâle de rage:—Je dirai tout!...
—Je dirai tout! je dirai tout! répéta le laquais en singeant son maître. Non, ce n'est pas bien, votre Excellence! ajouta-t-il avec une emphase remarquable, comme nous entrions dans la salle, et il se retira en emportant les manteaux.
—C'est bien répondu, très bien répondu!» crièrent plusieurs voix dans l'antichambre.
Grand'mère avait le don de faire comprendre l'opinion qu'elle avait des gens rien qu'aux inflexions de sa voix, et à l'usage qu'elle faisait des pronoms de la seconde personne. Elle employait le vous et le tu contrairement à l'habitude, et ces nuances prenaient dans sa bouche une signification exceptionnelle.
Lorsque le jeune prince vint lui présenter ses devoirs, elle répondit par quelques mots brefs, et lui dit vous, accompagnant ces paroles d'un regard exprimant tant de dédain, qu'à la place d'Étienne, je serais rentré sous terre. Évidemment, il était d'un tout autre tempérament que moi; il n'eut pas l'air de remarquer la froideur de cet accueil et fit à peine attention à grand'mère. Il salua toute la société, sinon avec grâce, tout au moins d'un air très dégagé.
Pour moi, je ne voyais plus que Sonitchka, lorsque je causais avec Volodia ou Étienne, à une place d'où je l'aperçevais et d'où elle pouvait me voir et m'entendre. J'étais content de parler, et, quand il m'arrivait de trouver un mot que je jugeais spirituel ou comique, je regardais aussitôt par la porte du salon pour voir quel effet j'avais produit; mais, si nous allions à un endroit d'où elle ne pouvait ni nous voir, ni nous entendre, je devenais silencieux et ne prenais plus aucun plaisir à la conversation.
Le salon et la grande salle se remplissaient peu à peu d'invités, et, dans le nombre, comme dans tous les bals d'enfants, se trouvaient plus d'un grand enfant, qui ne voulait pas laisser échapper cette occasion de danser et qui prétendait, tout le temps, ne s'amuser que pour être agréable à la maîtresse de la maison.
Quand les Ivine arrivèrent, au lieu du plaisir que j'éprouvais toujours à la vue de Serge, je ressentis un étrange sentiment de dépit à la pensée qu'il verrait Sonitchka et qu'il s'en ferait remarquer.
«Ah! nous allons danser, s'écria Serge en sortant du salon et en tirant de sa poche une paire de gants de peau de chien.—Il faut mettre des gants!»
«Qu'allons-nous faire? pensai-je, nous n'avons pas de gants!» et je montai en toute hâte dans notre chambre pour en chercher.
Mais j'eus beau fouiller dans tous les tiroirs des commodes, je découvris, dans l'une, nos mitaines de voyage, vertes, et dans l'autre un gant unique, très vieux, fort sale, beaucoup trop grand, et qui, enfin, ne pouvait m'aller, parce qu'il lui manquait le doigt du milieu, que Karl Ivanovitch avait coupé lorsqu'il avait eu mal au médius. Malgré cette lacune je mis ce lambeau de gant, et je regardai d'un œil désolé la place vide d'où sortait mon doigt du milieu, toujours taché d'encre.
«Ah! m'écriai-je, si Nathalia Savichna était ici, elle me donnerait des gants, bien sûr! Je ne peux pas descendre ainsi, et, si l'on me demande pourquoi je ne danse pas, que répondrai-je? Je ne peux pas non plus rester ici, car on viendra me chercher! Que dois-je faire? me demandais-je les bras ballants.
—Que fais-tu-là? cria au même instant Volodia qui venait m'appeler; viens vite engager une dame ... le bal va commencer....
—Mais, Volodia, répondis-je d'une voix piteuse, en lui montrant ma main dont deux doigts disparaissaient dans le gant sale, Volodia, toi, tu n'as pas pensé à cela?
—A quoi? dit-il, impatienté. Ah! à des gants! ajouta-t-il d'un air impassible en regardant ma main.—Non, c'est vrai, je n'y ai pas songé; il faut demander à grand'mère ce qu'elle en pense....»
Et, sans se mettre en souci, il courut en bas des escaliers.
Le sang-froid avec lequel il parlait d'une chose qui me paraissait d'une si grande importance, me tranquillisa un peu; je me rendis à la hâte au salon, oubliant tout à fait que j'avais ce gant mutilé sur la main gauche.
Je m'approchai à la dérobée du fauteuil de grand'mère, et, la tirant doucement par sa mantille, je lui dis à voix basse:
«Grand'mère, que faut-il faire, nous n'avons pas de gants?
—Quoi, mon ami?
—Nous n'avons pas de gants, répétai-je en me serrant contre elle et en posant les mains sur les bras du fauteuil.
—Et ça qu'est-ce que c'est? reprit grand'mère en saisissant ma main gauche.
—Voyez, ma chère, dit-elle en s'adressant à Mme Valakhine, voyez comme ce jeune homme s'est fait beau pour danser avec votre fille?»
Grand'mère tenait ferme ma main en l'air et regarda d'un air interrogatif toutes les personnes présentes, jusqu'à ce que la curiosité générale fût satisfaite, et que tout le monde partît d'un éclat de rire.
J'aurais été très contrarié si Serge m'avait vu dans cette situation, tout honteux. Je m'efforçai en vain de retirer ma malencontreuse main; mais Sonitchka se mit à rire si gaiement que les larmes lui montèrent aux yeux, et que toutes ses boucles voltigèrent autour de son visage devenu encore plus rose. Je ne ressentais plus de honte, j'avais compris que son rire était trop franc et trop naturel pour être moqueur; au contraire, nous avions ri ensemble et en nous regardant, c'était assez pour nous rapprocher l'un de l'autre.
L'épisode du gant, qui aurait pu se terminer mal, servit à me mettre à mon aise dans la compagnie que je redoutais entre toutes, celle du salon; le sentiment de ma timidité avait disparu.
Les timides souffrent parce qu'ils sont dans le doute sur l'opinion que les autres ont d'eux; aussitôt que cette opinion s'est manifestée, même à leur désavantage, leur malaise cesse.
Que Sonitchka était jolie en dansant le quadrille, avec le jeune prince si gauche! Elle était mon vis-à-vis. Comme elle souriait gentiment en me tendant sa petite main dans la «chaîne», avec quelle grâce ses boucles blondes se soulevaient et retombaient en mesure à chaque pas, et comme elle faisait naïvement les jetés de ses mignons pieds! A la cinquième figure, lorsque ma partenaire, sans tenir compte de la mesure, s'élança en avant sans moi, et que je me disposais à danser tout seul, Sonitchka serra les lèvres d'un air grave et regarda d'un autre côté. Mais elle s'inquiétait à tort; j'exécutai bravement mon «chassé en avant», «chassé en arrière», «balancé», et, au moment où je passai devant elle, je lui montrai, pour l'amuser, mon gant. Elle poussa un éclat de rire prolongé et fit ses pas avec encore plus de grâce. Il me souvient encore que, lorsque nous fîmes la grande ronde, elle inclina la tête et, sans lâcher ma main, gratta du bout de son gant son fin petit nez. Toutes ces scènes sont encore devant mes yeux maintenant, et j'entends encore le quadrille de la Fille du Danube, aux sons duquel nous avons dansé.
Sonitchka m'accorda le second quadrille. Dès que je me trouvai assis à côté d'elle, je ressentis un cruel embarras, et je ne savais plus de quoi lui parler. Quand mon silence se fut prolongé plus qu'il n'est permis, je craignis que Sonitchka me prît pour un imbécile, et je résolus de lui prouver le contraire, coûte que coûte.
«Vous habitez toujours Moscou? lui demandai-je enfin; et sur sa réponse affirmative, je continuai:
«Moi, je n'ai pas encore fréquenté la capitale.»
Je comptais surtout sur l'effet de ce mot fréquenté; je sentais cependant que, malgré ce commencement brillant qui révélait une connaissance approfondie de la langue française, il ne m'était pas possible de soutenir la conversation sur ce ton. Ce n'était pas encore notre tour de danser, et nous étions déjà retombés dans le silence. Je regardai ma partenaire avec inquiétude, pour voir quelle impression j'avais produite sur elle, et j'attendis qu'elle me vînt en aide.
«Où avez-vous trouvé ce drôle de gant?» me demanda-t-elle tout à coup.
Cette question me combla de joie, et je me sentis plus léger.
Je lui expliquai que ce gant appartenait à Karl Ivanovitch, et je fis avec une pointe d'ironie le portrait de mon maître; je dis combien il était drôle quelquefois, par exemple, quand il ôtait son bonnet rouge, et de quelle manière, un jour, en montant à cheval, il tomba et plongea dans un étang, etc.
Le quadrille passa si vite que c'est à peine si nous nous en aperçûmes. Tout cela était fort beau; mais qu'est-ce qui avait pu me pousser à parler ironiquement de ce bon Karl Ivanovitch? Sonitchka aurait-elle eu moins bonne opinion de moi si j'avais parlé de mon maître avec toute l'affection et le respect qui remplissaient mon cœur?
Le quadrille terminé, Sonitchka me dit «merci» avec tant d'expression, qu'elle avait l'air de penser que je méritais véritablement ses remercîments. J'étais enchanté, hors de moi de bonheur, et je ne me reconnaissais plus.
«Non, me disais-je, il n'y a plus rien qui puisse m'embarrasser, et je me promenais allègrement dans la salle; maintenant, je suis prêt à tout!»
Serge vint me demander de lui servir de vis-à-vis.
«Bon, lui répondis-je, bien que je n'aie pas de dame, mais j'en trouverai une.»
Je jetai sur toute la salle un coup d'œil décidé, et je remarquai que toutes les dames étaient engagées, à l'exception d'une grande demoiselle, debout près de la porte du salon. Un grand jeune homme se dirigeait vers elle pour l'inviter, à ce que je supposai, et il n'était plus qu'à deux pas d'elle, tandis que je me trouvais à l'autre bout de la salle!
En un clin d'œil je glissai légèrement sur le parquet, je franchis la distance qui me séparait de la jeune fille, et, tout en faisant ma révérence, je la priai d'une voix ferme de m'accorder cette contre danse.
La grande demoiselle me sourit d'un air protecteur et me tendit la main; le grand jeune homme resta sans danseuse.
J'avais si bien conscience de ma supériorité, que je ne fis pas même attention au dépit que manifesta le jeune homme; j'appris plus tard qu'il avait demandé qui était ce gamin ébouriffé qui lui avait soufflé sa dame sous son nez?
Le jeune homme à qui j'avais enlevé sa dame pour la contredanse, ouvrit la polka-masourka. Il bondit de sa place, en tenant sa danseuse par la main, et, au lieu de faire le «pas de basque» que nous avait appris Mimi, il courut tout bonnement en avant; arrivé à l'angle de la salle, il s'arrêta, écarta les jambes, frappa du talon sur le parquet, fit une pirouette en sautant et courut plus loin.
Comme je n'avais pas trouvé de dame pour cette danse, je m'étais assis derrière le haut fauteuil de grand'mère, d'où je regardais.
«Qu'est-ce qu'il fait donc? me demandai-je, ce n'est pas ce que Mimi nous a enseigné; elle assurait que la masourka doit se danser sur la pointe des pieds en glissant et avec des ronds de jambe, mais je vois qu'ici on la danse tout autrement!... Voilà les Ivine et Étienne qui ne font, ni les uns ni les autres, le pas de basque. Volodia sait déjà faire comme eux.... Et Sonitchka ... qu'elle est jolie quand elle danse!»
J'étais tout joyeux.
La masourka touchait à sa fin; déjà des messieurs et des dames âgés prenaient congé de grand'mère et partaient; les laquais se faufilaient entre les danseurs, portant des brassées de vêtements dans les arrière-chambres. Grand'mère était lasse, elle parlait avec effort et en traînant; les musiciens recommencèrent mollement, pour la trentième fois, le même air. La grande demoiselle, avec laquelle j'avais dansé, exécutait une figure; elle m'aperçut, et, quand elle eut fini, elle s'avança vers moi, avec un sourire perfide, tenant par la main Sonitchka et une des nombreuses sœurs d'Étienne; évidemment elle voulait se rendre agréable à grand'mère.
«Rose ou ortie? me demanda-t-elle.
—Ah! tu es là? dit grand'mère en se retournant, va danser, mon petit ami, va.»
A ce moment, j'avais plus envie de me tapir sous le fauteuil de grand'mère que d'accepter l'invitation de mon ancienne partenaire, mais comment motiver mon refus?
Je me levai, je choisis la rose en regardant timidement Sonitchka.
Avant que j'eusse le temps de revenir à moi, une main gantée de blanc glissa dans la mienne, et la princesse, avec son plus gracieux sourire, se mit en route et m'entraîna vers les danseurs, sans se douter que je ne savais au monde que faire de mes pieds.
Je savais que le pas de basque serait déplacé, inconvenant et pouvait me rendre même ridicule; mais les sons familiers de la masourka, en frappant mon tympan, communiquèrent aux nerfs acoustiques une impulsion déterminée, et ceux-ci la transmirent à mes pieds, qui, contrairement à ma volonté et à la surprise générale, se mirent à faire des ronds de jambe en se tenant sur la pointe.
Pour mettre fin à cette situation pénible, je m'arrêtai avec l'intention d'exécuter les mêmes mouvements que j'avais trouvés si gracieux, lorsque le jeune homme de la première paire avait dansé. Mais au moment où j'écartais les pieds pour bondir en avant, la princesse se mit à courir autour de moi, en regardant mes pieds, avec une expression de curiosité et d'étonnement stupides.
Ce regard me paralysa. Je me troublai tant et si bien, qu'au lieu de danser, je me mis à piétiner sur place d'une manière grotesque et qui ne s'harmonisait ni avec la mesure, ni avec quoi que ce soit; puis je restai court.
Tous les yeux se dirigeaient sur moi, remplis les uns de surprise, les autres de curiosité; quelques personnes souriaient d'un air moqueur, d'autres semblaient compatir à mon embarras, grand'mère restait seule impassible.
«Il ne faut pas danser quand vous ne savez pas,» dit tout à coup mon père, d'une voix courroucée, à mon oreille, et, me poussant doucement de côté, il prit la main de ma danseuse et fit avec elle la figure à l'ancienne mode, et à l'approbation unanime des spectateurs, puis il la ramena à sa place.
Ah! qu'il me tardait de voir la fin de cette masourka! Dans mon angoisse, je criai à part moi:
«Mon Dieu! Pourquoi me mets-tu à une si rude épreuve?... Je le vois, tout le monde me méprise et me méprisera toujours.... Le chemin de l'amitié, des honneurs m'est fermé maintenant.... Tout est perdu!
«Pourquoi, pendant que je dansais, Volodia m'a-t-il fait des signes que tout le monde a pu voir, et qui ne me servaient à rien? Pourquoi cette vilaine princesse s'est-elle mise à examiner mes pieds?
«Pourquoi Sonitchka.... Oh! non, elle est toujours gentille, mais pourquoi a-t-elle souri aussi? Pourquoi papa a-t-il rougi et m'a-t-il saisi par la main? Est-ce que lui aussi, il a eu honte de moi? Oh! c'est terrible! Si maman avait été ici, elle n'aurait pas rougi de son Nicolinka....»
Et mon imagination s'envola au loin, vers cette chère image; je revis le pré devant la maison, les grands tilleuls dans le jardin, l'eau pure du petit lac au-dessus duquel planent les hirondelles, le ciel bleu sur lequel flottent des nuages blancs, transparents, les meules de foin odorant; les souvenirs irisés de ces joies paisibles se pressaient dans mon cerveau troublé....
Au souper, le jeune homme qui avait dansé le premier la masourka vint prendre place à notre table d'enfants; il m'honora d'une attention toute spéciale, ce qui aurait grandement flatté mon amour-propre, si, après ma déconfiture, j'avais pu être sensible à quoi que ce soit.
Mais ce jeune homme voulait à tout prix ramener ma gaieté; il me provoquait à folâtrer avec lui, m'appelait «un brave», et, quand les grandes personnes ne nous voyaient pas, il remplissait mon verre de vin et m'obligeait à le vider. Vers la fin du souper, lorsque le maître d'hôtel me versa seulement un quart de verre à champagne d'une bouteille enveloppée dans une serviette, il protesta en insistant pour qu'il m'en donnât davantage, puis il me força de le boire d'un trait; aussitôt une douce chaleur se répandit dans tout mon corps, je ressentis une vive sympathie pour mon jovial protecteur, et je me mis à rire sans raison.
Tout à coup l'orchestre joua de nouveau dans la salle de danse, et tout le monde se leva de table. Mon amitié pour le grand jeune homme en resta là; il retourna auprès des grandes personnes, et, comme je ne pouvais pas le suivre, je me rapprochai de Mme Valakine, très curieux d'entendre ce qu'elle disait à sa fille.
Sonitchka implorait d'une voix suppliante:
«Encore une demi-heure!
—Impossible, je t'assure, mon ange.
—Pour me faire plaisir, je t'en prie, continuait la jeune fille en caressant sa mère.
—Mais seras-tu contente demain si j'ai mal à la tête? demanda Mme Valakine sans pouvoir réprimer un sourire imprudent.
—Tu permets! tu permets, nous resterons! s'écria Sonitchka en sautant de joie.
—Que faire avec toi? Eh bien! va, dansez ... voici un cavalier tout trouvé,» ajouta-t-elle en me désignant.
Sonitchka me donna la main, et nous courûmes dans la salle.
La présence de Sonitchka et sa gaieté, jointes à l'influence du verre de champagne, m'avaient fait oublier tout à fait ma récente mésaventure. Je me livrai à toutes sortes de gambades plus drôles l'une que l'autre; tantôt j'imitais le cheval, courant au petit trot et relevant fièrement les pieds, ou le mouton qui s'emporte contre le chien, et je trépignais sur place, je riais de tout mon cœur, sans m'inquiéter de l'impression que je faisais sur les spectateurs.
Sonitchka riait aussi sans interruption, et, entre autres, d'un vieux monsieur qui, après avoir étendu son mouchoir à terre, levait lentement les pieds et faisait semblant d'avoir beaucoup de peine à sauter par-dessus, et elle se tint presque les côtes, lorsque je fis de grands bonds jusqu'au plafond, pour lui montrer mon adresse.
En traversant le cabinet de grand'mère, je me regardai dans le miroir; je vis un petit garçon dont le visage était en sueur, les cheveux hérissés, et dont le toupet se tenait tout droit, mais l'expression générale de cette physionomie était si bonne, si gaie, si débordante de santé et de vie, que je me plus à moi-même.
«Si j'étais toujours comme je suis maintenant, pensai-je, je pourrais encore plaire....»
Mais, lorsque je portai de nouveau les yeux sur le joli visage de ma partenaire, je remarquai qu'il avait le même air de gaieté, de santé et d'insouciance qui m'avait tant charmé chez moi, et, en outre, une gracieuse et douce beauté, dont l'absence me remplit de dépit contre ma propre image. Je compris qu'il était absurde de ma part de vouloir captiver un être aussi charmant.
Je ne pouvais attendre la réciprocité, et je n'y songeai même pas; mon âme débordait de joie sans cela. Je ne comprenais pas qu'on pût demander un bonheur plus grand que celui dont ce sentiment remplissait mon cœur, et qu'on pût souhaiter autre chose que de le voir durer éternellement.
J'étais heureux! mon cœur palpitait comme un pigeon qui bat des ailes; je sentais mon sang affluer sans cesse vers lui, et je me sentais pris d'une douce envie de pleurer.
Dans le corridor, quand nous sortîmes du salon, je me dis: Comme je serais heureux si je pouvais passer toute ma vie avec elle, dans un recoin obscur, ignorés de tout le monde!
«N'est-ce pas, Sonitchka, c'était très gai aujourd'hui? lui murmurai-je d'une voix basse et tremblante, puis je hâtai le pas, effrayé, moins de ce que j'avais exprimé, que de ce que j'aurais voulu dire.
—Oui ... très gai! répondit-elle en tournant vers moi sa tête, avec une expression si sincère et si bonne, que je me rassurai aussitôt.
—Mais si vous saviez comme je suis ... j'aurais voulu dire: malheureux, mais je dis par timidité: comme je regrette de penser que vous allez partir bientôt, et que je ne vous reverrai pas.
—Pourquoi ne nous reverrons-nous pas? dit-elle en regardant le bout de ses petits souliers, et en promenant ses doigts le long du paravent près duquel nous passions; tous les mardis et tous les vendredis, je me promène avec maman sur le boulevard Tversky.... Est-ce que vous ne vous promenez jamais?
—Sans doute, je demanderai qu'on nous y conduise mardi prochain; et, si on ne veut pas, j'irai tout seul, sans chapeau ... je connais le chemin.
—Savez-vous, dit tout d'un coup Sonitchka, il y a des jeunes garçons qui viennent à la maison et à qui je dis tu; disons-nous tu. Veux-tu?» ajouta-t-elle en secouant sa petite tête et en me regardant dans les yeux.
Malgré cette invitation, je ne réussis pas de toute la soirée à placer le tu dans une seule phrase, bien que je composasse mentalement sans cesse de longues phrases où le tu revenait plusieurs fois. Je n'avais pas le courage de les dire. «Veux-tu» résonnait à mes oreilles tout le temps et m'enivrait; je ne voyais que Sonitchka.
Je remarquai par quel mouvement gracieux elle releva ses boucles, les jeta derrière les oreilles et découvrit la partie du front et des tempes que je n'avais pas encore vue; je regardai comment on l'emmitouflait dans le châle vert, si haut, que je ne voyais plus que le bout de son petit nez, et que, si elle n'avait pas pratiqué avec ses doigts rosés une petite ouverture pour la bouche, elle courait le risque d'être étouffée; je me rappelle comment elle descendit l'escalier avec sa mère et, arrivée au bas, se retourna vivement vers nous, inclina la tête et disparut derrière la porte.
Volodia, les Ivine, le jeune prince Étienne, moi, nous étions tous épris de Sonitchka; nous nous tenions sur l'escalier pour la suivre des yeux jusqu'au dernier moment. A qui son dernier salut était-il destiné? Je l'ignore; mais, en cet instant, je ne doutais pas qu'il fût pour moi.
Ce soir-là, en prenant congé de mes amis, je parlai à Serge sans aucun trouble, même je lui serrai la main un peu froidement. Je ne sais s'il a compris qu'il venait de perdre ma préférence, car il se montra très indifférent, mais il a dû regretter le pouvoir qu'il exerçait sur moi.
Je devenais pour la première fois infidèle dans mes affections, et, pour la première fois, je goûtai la douceur d'aimer. J'étais heureux de pouvoir échanger un sentiment d'amitié qui m'était devenu une habitude, contre un nouveau sentiment plein de mystère et de charme.
Et enfin, cesser d'aimer pour aimer encore, n'est-ce pas aimer deux fois plus qu'avant?
Une fois dans mon lit, je me pris à songer: «Comment ai-je pu aimer Serge si longtemps et si passionnément?... Non, il n'a jamais compris ni su apprécier mon affection, il ne l'a jamais méritée.... Tandis que Sonitchka!... quelle douceur!... «Veux-tu?» Je me soulevai et me représentai vivement son gracieux visage, puis je ramenai les couvertures sur ma tête, m'enveloppant de tous côtés. Enfin, lorsqu'il n'y eut plus une seule ouverture, je me blottis dans le nid que je venais de faire, et je me berçai dans mes rêves et dans mes souvenirs.
Les yeux immobiles et fixés sur la doublure de ma courte-pointe, je voyais Sonitchka aussi nettement qu'une heure auparavant, quand nous étions ensemble; je lui parlais, et cet entretien me procurait un plaisir indicible, car ces mots: tu, toi, avec toi revenaient sans cesse.
Ces rêves étaient si vivants, que je ne pouvais m'endormir, tenu en éveil par une douce émotion. J'éprouvai le besoin d'épancher auprès de quelqu'un les effusions de mon bonheur.
«Chérie! m'écriai-je presque à haute voix en me retournant brusquement de l'autre côté.—Volodia, est-ce que tu dors?
—Non, me répondit-il d'une voix somnolente.... Pourquoi?
—J'aime, Volodia, oh! j'aime Sonitchka de tout mon cœur.
—Qu'est-ce que cela peut me faire? répondit-il en s'étirant.
—Ah! Volodia, tu ne peux pas t'imaginer tout ce que je ressens ... pas plus tard qu'il y a un instant, j'étais tout emmitouflé dans mes couvertures, et je l'ai vue comme si elle était là, je lui ai parlé,... c'est surprenant. Et sais-tu encore quoi? lorsque je pense à elle je deviens si triste, si triste, que je voudrais pleurer.»
Volodia se retourna dans son lit.
«Je ne souhaite qu'une seule chose! continuai-je, c'est d'être toujours avec elle et rien de plus. Et toi, tu l'aimes aussi? Avoue-le?...»
C'est singulier, j'éprouvais le besoin de la voir aimée de tous et d'arracher à chacun cet aveu.
«Est-ce que cela te regarde? répondit Volodia en tournant la tête de mon côté: peut-être que je l'aime?
—Tu n'as pas envie de dormir, tu fais semblant d'avoir sommeil! m'écriai-je en remarquant qu'il avait les yeux brillants, qu'il se découvrait et ne semblait point disposé à dormir. Laisse-moi causer d'elle avec toi ... n'est-ce pas qu'elle est charmante?... Elle est un amour! Si elle me disait: «Nicolas, saute par la fenêtre, ou jette-toi dans le feu!» eh bien! je te jure que j'obéirais immédiatement avec joie.... Ah! qu'elle est ravissante! ajoutai-je, en évoquant son image avec tant de vivacité, que, pour mieux la savourer, je me retournai avec impétuosité et j'enfouis mon visage dans l'oreiller:—Oh! Volodia, comme j'ai envie de pleurer!
—Quel imbécile! dit-il en souriant, puis, après un moment de silence, il reprit:—moi, je ne suis pas comme toi; je pense que j'aurais voulu pouvoir me tenir près d'elle et lui parler....
—Ah! tu l'aimes donc, toi aussi! interrompis-je vivement.
—Tu ne comprends rien, prononça Volodia d'un ton dédaigneux.
—Mais si, je comprends, c'est toi qui ne comprends rien et qui dis des bêtises, répétai-je au milieu de mes larmes.
—Tu pleures? tu pourrais bien t'en dispenser. Tu n'es qu'une fille!»
Le 16 avril, presque six mois après la fête de grand'mère, mon père entra dans la salle d'étude, pendant les leçons, et nous annonça que nous devions partir le soir même pour la campagne.
A cette nouvelle, mon cœur se serra douloureusement, et je pensai aussitôt à ma mère.
Ce départ précipité était occasionné par la lettre suivante:
Petrovskoë, le 12 avril.
«Je reçois à l'instant, à dix heures du soir, ta bonne lettre du 3 avril, et, selon mon habitude, je te réponds tout de suite.
«Féodore a rapporté ta lettre de la ville déjà hier; mais, comme il était tard, il l'a remise à Mimi. Celle-ci, sous le prétexte que j'étais malade, ne me l'a pas donnée de toute la journée.
«Il est vrai que je me sentais un peu fiévreuse; il faut que je t'avoue toute la vérité, voici le quatrième jour que je ne suis pas très bien, et que je garde le lit.
«Cher ami, je t'en supplie, ne t'effraie pas; je me sens assez bien, et, si le médecin le permet, je pense me lever demain.
«Vendredi de la semaine passée, j'ai fait une promenade en voiture avec les enfants; mais, au moment de rejoindre la grande route, près du petit pont que j'ai toujours redouté, les chevaux se sont embourbés. Le temps était beau, et j'eus l'idée d'aller à pied jusqu'à la grande route, pendant qu'on dégageait la calèche.
«En arrivant à la chapelle, j'étais très fatiguée, et je m'assis pour me reposer; comme une demi-heure passa avant que l'on parvint à retirer la voiture de l'ornière, je pris froid, surtout aux pieds; je portais des bottines à semelles minces, et elles étaient mouillées.
«Après le dîner, j'eus tour à tour chaud et froid; mais, pour ne pas manquer au programme de la journée, je ne voulus pas me mettre au lit. Néanmoins après le thé j'essayai de jouer à quatre mains avec Lioubotchka (tu ne reconnaîtrais pas son jeu, elle a fait tant de progrès). Figure-toi ma stupéfaction en découvrant que je ne pouvais plus compter la mesure. J'ai recommencé plusieurs fois; mais tout s'embrouillait dans ma tête, j'avais un bourdonnement étrange dans les oreilles; je comptais: un, deux, trois, et tout de suite après: huit et quinze, et, ce qui est encore le plus étrange, je voyais très bien que je me trompais, et je ne pouvais pas me reprendre.
«Enfin Mimi vint à mon secours et me mit au lit. Voilà, mon ami, en détail, comment je suis tombée malade; tu vois que c'est par ma propre faute. Le lendemain, j'étais toute brûlante de fièvre, et notre bon vieux médecin Ivan Vassilitch est arrivé. Il est encore à la maison et il promet de me laisser bientôt sortir.
«Quel bon vieillard que cet Ivan Vassilitch! Tant que j'ai eu le délire, il n'a pas fermé l'œil de la nuit, il a passé tout ce temps au chevet de mon lit. Maintenant, pour me laisser écrire librement, il est dans la chambre des enfants; je l'entends d'ici qui leur raconte des contes allemands, et elles rient aux éclats.
«La belle Flamande, comme tu l'appelles, est en visite chez moi depuis deux semaines; sa mère est aussi en visite je ne sais où. Cette jeune fille me prouve par ses attentions la sincérité de son attachement. Elle me confie tous ses secrets de cœur. Avec sa belle tête, son bon naturel et sa jeunesse on pourrait en faire une femme excellente à tous égards, si elle se trouvait entre de bonnes mains; malheureusement, dans le monde qu'elle fréquente, à en juger par ce qu'elle en raconte, elle sera perdue.
«Lioubotchka voulait t'écrire elle-même; mais elle a déchiré sa troisième feuille de papier en disant: «Je sais que papa est fort moqueur, si je fais la moindre faute, il la signalera à tout le monde.»
«Katienka est toujours gentille, Mimi est toujours bonne et mélancolique.
«Maintenant, parlons de choses sérieuses. Tu m'écris que tes affaires ne vont pas bien cet hiver et que tu auras besoin de l'argent qui me revient de mes propriétés. Il me semble étrange que tu aies besoin de demander mon consentement. Est-ce que ce qui m'appartient n'est pas à toi?
«Tu es si bon, cher ami, que, de crainte de me chagriner, tu me caches la véritable situation de tes affaires; mais je devine que tu as beaucoup perdu au jeu, et, je te le jure, je ne m'en afflige pas. Si tu peux arranger cette affaire, ne t'en mets plus en peine, je t'en prie, et ne te tourmente pas pour rien.
«Je me suis habituée à ne point faire fond, pour les enfants, non seulement sur ce que tu peux gagner au jeu, mais encore, ne m'en veuille pas, sur ta propre fortune.
«Tes gains me font aussi peu de plaisir, que tes pertes, de chagrin; la seule chose qui me désole, c'est ta malheureuse passion pour le jeu, qui me ravit une partie de ta tendresse et m'oblige à te dire des vérités amères.... Dieu sait combien j'en souffre.... Je ne cesse de l'implorer pour qu'il nous sauve ... non pas de la misère (qu'est-ce que c'est que la misère?) mais de cette horrible éventualité qu'un jour les intérêts de nos enfants seront en conflit avec les nôtres, et que je serai forcée de les défendre....
«Jusqu'à ce jour le Seigneur a exaucé ma prière, tu n'as pas dépassé cette limite au delà de laquelle nous serions contraints de sacrifier une fortune qui n'est plus à nous, mais à nos enfants ... ou ... je n'ose pas y arrêter ma pensée ... mais ce malheur affreux nous menace toujours.... Oui, c'est une terrible croix que Dieu nous fait porter à l'un et à l'autre.
«Tu m'écris encore au sujet des enfants, et tu reviens à notre ancien sujet de division; tu me pries de consentir à ce que mes enfants entrent dans un pensionnat. Tu connais mes préventions contre ce mode d'éducation....
«Je ne sais pas, cher ami, si tu seras de mon avis; mais je te prie en tout cas, et pour l'amour de moi, de me donner la promesse que, tant que je vivrai et même après ma mort, si Dieu juge bon de nous séparer, tu ne mettras pas tes enfants en pension.
«Tu m'écris que tu seras obligé de te rendre à Saint-Pétersbourg pour affaires. Que Dieu soit avec toi, cher ami! va et reviens vite. Nous nous ennuyons tous sans toi. Le printemps est d'une beauté admirable; on a déjà enlevé la double porte du balcon; l'allée qui conduit à la serre est sèche depuis quatre jours, les pêchers sont en fleurs, il n' y a plus de neige que par places, les hirondelles sont de retour, et Lioubotchka vient de m'apporter les premières fleurs de la saison.
«Le médecin déclare que, dans trois jours, je serai tout à fait rétablie, et que je pourrai aller prendre l'air au jardin et me chauffer au soleil d'avril....
«Au revoir, cher ami, ne te fais pas de souci, je t'en prie, à cause de ma santé, ni au sujet de tes pertes au jeu; boucle vite tes affaires et viens passer tout l'été ici avec les enfants.
«J'ai des projets ravissants pour cet été, il ne manque que toi pour les réaliser....»
La suite de la lettre était écrite en français sur un bout de papier, d'une écriture lisible mais inégale.
«Ne crois pas un mot de ce que je t'ai dit au sujet de ma santé; nul ne soupçonne la gravité de mon mal. Je sais que je ne me lèverai pas de ce lit. Ne perds pas un instant, viens immédiatement et amène les enfants.
«Peut-être me sera-t-il donné de les revoir et de les bénir encore une fois; c'est mon unique et suprême désir....
«Je comprends quel coup je te donne, mais comment te l'épargner? Tôt ou tard, de ma main ou d'une autre, tu l'aurais également reçu; tâchons de supporter ce malheur avec fermeté et avec confiance en la miséricorde de Dieu.... Soumettons-nous à sa volonté.
«Ne vois pas dans ce que je t'écris les rêveries d'une imagination malade; au contraire, mes idées sont très nettes en ce moment, et je suis tout à fait calme. Ne cherche pas à te rassurer par le vain espoir qu'il n'y a là que les pressentiments trompeurs d'une âme faible. Non, je sens, je sais, et je le sais, parce que Dieu a voulu me le révéler,—je sais qu'il ne me reste que très peu de temps à vivre.
«Mon amour pour toi et mes enfants finirait-il avec ma vie? Non, je sens que c'est impossible; j'en suis trop pénétrée en ce moment pour penser que ce sentiment, sans lequel je ne peux pas comprendre l'existence, pourra jamais cesser. Mon âme ne peut pas exister sans son amour pour vous, et je sens qu'elle vivra toujours; le fait qu'un sentiment comme mon amour ne pourrait pas exister s'il devait un jour finir, me donne cette douce persuasion.
«Je ne serai plus avec vous; mais je suis fermement persuadée que mon amour ne vous abandonnera jamais, et cette pensée est si consolante pour mon cœur, que j'attends sans crainte et avec tranquillité la mort qui s'approche.
«Je suis calme; Dieu sait que j'ai toujours regardé et que je regarde la mort comme un passage à une vie meilleure; mais pourquoi les larmes me serrent-elles la gorge? Pourquoi priver les enfants de leur mère chérie? Pourquoi te porter un coup si rude et si inattendu? Pourquoi dois-je mourir, quand votre amour remplissait ma vie d'une félicité sans bornes?
«Que sa sainte volonté soit faite!
«Les larmes m'empêchent d'écrire. Peut-être ne te verrai-je plus. Je te remercie, mon ami adoré, pour tout le bonheur que tu m'as donné dans cette vie; je prierai Dieu pour qu'il te récompense.
«Adieu, cher ami, rappelle-toi, quand je ne serai plus là, que mon amour ne t'abandonnera jamais....
«Adieu, Volodia, adieu, mon ange, adieu Benjamin, mon Nicolinka....
«Est-il possible qu'un jour ils puissent m'oublier!...»
Cette lettre renfermait un petit billet de Mimi, dont voici le contenu:
«Les tristes pressentiments qu'exprime notre chère malade ne sont que trop confirmés par les paroles du médecin. Hier, dans la nuit, elle m'a priée d'envoyer cette lettre. Comme je croyais qu'elle parlait dans le délire, j'ai attendu jusqu'au matin, puis je l'ai décachetée pour y joindre ces lignes; pendant que je l'ouvrais, Nathalia Nicolaevna me fit demander ce que j'avais fait de cette lettre et m'ordonna de la brûler si je ne l'avais pas encore expédiée. Elle ne cesse de m'entretenir de cette lettre et déclare qu'elle vous fera mourir de chagrin.... Ne remettez pas votre départ, si vous voulez revoir cet ange avant qu'il nous ait quittés. Excusez ce griffonnage, je n'ai pas dormi de trois nuits. Vous savez combien j'aime Nathalia Nicolaevna.»
Nathalia Savichna m'a raconté depuis, qu'après avoir écrit la première partie de sa lettre, maman la posa près d'elle sur sa petite table et s'endormit.
«Moi-même, ajoutait Nathalia Savichna, je me suis endormie dans mon fauteuil, et le bas que je tricotais a glissé de mes doigts. Une heure plus tard j'entendis vaguement, dans mon sommeil, qu'elle se parlait à elle-même. J'ouvris les yeux, et je vis ma chère colombe assise dans son lit, les mains croisées et les larmes coulant à flots de ses yeux: «Tout est fini,» dit-elle, en cachant son visage dans ses mains.
«Je m'élançai pour lui demander: «Qu'avez-vous?»
«Ah! Nathalia Savichna, me dit-elle, si vous saviez qui je viens de voir!
«J'eus beau la questionner, elle ne dit plus rien, me priant seulement d'avancer la petite table, et elle écrivit de nouveau; puis elle m'a ordonné de cacheter la lettre devant elle et de l'expédier. Depuis, son état n'a fait qu'empirer.»
Le 25 avril, la berline s'arrêtait devant le perron de notre maison, à Pétrovskoë.
A notre départ de Moscou, mon père semblait préoccupé, et, lorsque Volodia lui demanda si maman était malade, il le regarda tristement et fit un signe de tête affirmatif. Dans le cours du voyage, mon père se tranquillisa beaucoup. Mais, à mesure que nous approchions, son visage prenait une expression de plus en plus anxieuse; il appela, de la voiture, Foka, qui accourut tout essoufflé.
«Où est Nathalia Nicolaevna?» demanda mon père d'une voix mal assurée et les larmes aux yeux.
Le bon vieux serviteur nous jeta un regard à la dérobée et, baissant les yeux, ouvrit la porte de l'antichambre, se détourna et répondit: «Voici le sixième jour que Madame n'est pas sortie de sa chambre.»
Milka accourut joyeusement vers mon père et bondit en jappant, pour lui lécher les mains. Le pauvre animal, comme je l'ai appris depuis, ne cessait de gémir depuis que maman était tombée malade. Mon père le repoussa et entra dans le salon, et ensuite dans la chambre des divans qui donnait sur la chambre à coucher et qu'il traversa sur la pointe des pieds et en retenant son souffle. Son inquiétude se manifestait de plus en plus, il se signa avant de poser la main sur la poignée de la porte qui était fermée à clé.
Au même instant, Mimi accourut du corridor; elle n'était pas coiffée, et on la voyait tout en larmes.
«Ah! Pierre Alexandrovitch, dit-elle à voix basse, avec l'expression d'un désespoir sincère, et, en voyant mon père tourner le loquet, elle ajouta: «On ne peut pas passer par là ... l'entrée est ici.»
Elle nous introduisit dans la lingerie; dans le corridor se trouvait Akime, l'idiot, dont les grimaces nous faisaient toujours rire; mais, en ce moment-là, bien loin de nous divertir, la vue de son visage d'une impassibilité stupide nous frappa plus douloureusement que tout le reste.
Dans la lingerie, deux jeunes servantes, occupées à un ouvrage à l'aiguille, se levèrent à notre entrée et nous saluèrent avec une expression empreinte d'une si profonde tristesse, que j'en fus atterré.
Après avoir traversé la chambre de Mimi, mon père ouvrit la porte de la pièce où était la malade, et nous fit entrer.
A droite de la porte étaient deux fenêtres recouvertes de châles. Devant une de ces croisées était assise Nathalia Savichna, les lunettes sur le nez et tricotant. Au lieu de nous embrasser selon son habitude, elle se contenta de se soulever à moitié, nous regarda un peu à travers ses lunettes, et les larmes coulèrent à flots de ses yeux. Je fus vivement impressionné, en voyant que toutes les personnes que nous approchions se mettaient à pleurer en nous apercevant, bien qu'elles fussent très calmes avant notre entrée.
A gauche de la porte était un paravent, et derrière ce paravent, le lit de la malade, une petite table, une armoire vitrée remplie de médicaments et un grand fauteuil où sommeillait le médecin.
Auprès du lit se tenait une jeune fille blonde d'une beauté remarquable, vêtue d'une matinée blanche, les manches un peu relevées; elle posait de la glace sur la tête de ma mère, ce qui m'empêchait de voir le visage de maman.
Cette jeune fille était la belle Flamande mentionnée dans la lettre de ma mère et qui devait plus tard jouer un grand rôle dans notre famille.
Aussitôt qu'elle nous aperçut, elle retira une main du front de la malade et se mit à rajuster les plis de sa robe de chambre sur sa poitrine, tout en disant: «Elle est assoupie!»
J'étais profondément affligé en cet instant, et néanmoins je remarquai, malgré moi, les moindres détails de cette scène. La chambre était plus qu'à moitié obscure et sentait la menthe, l'eau de cologne, la camomille et les gouttes de Hofmann.
Cette odeur me frappa tellement, qu'à l'heure qu'il est, il me suffit d'y penser, sans même que mon odorat en soit frappé, pour que mon imagination me reporte dans cette pièce sombre et étouffée et évoque les plus petits détails de cette heure terrible.
Les yeux de ma mère étaient ouverts, mais elle ne voyait rien.
Oh! je n'oublierai jamais ce regard, dans son effrayante fixité, exprimant une indicible souffrance.
On nous emmena aussitôt, mon frère et moi.
Voici comment Nathalia Savichna m'a décrit plus tard les derniers moments de ma mère:
«Après qu'on vous eût fait sortir de la chambre, elle se débattit encore longtemps, ma chère belle colombe! On aurait dit que quelque chose l'étouffait. Ensuite elle enfouit la tête dans ses oreillers et s'assoupit lentement, tranquillement, comme un ange du ciel. Je me suis éloignée un instant pour voir pourquoi l'on n'apportait pas la potion, et, quand je suis revenue vers ma chérie, elle avait tout renversé autour d'elle, et appelait sans cesse votre père; il se pencha sur elle, mais elle n'avait plus la force de parler, à peine ouvrait-elle les lèvres, qu'il s'en échappait des gémissements: «Mon Dieu! Seigneur! les enfants! je veux voir les enfants!» J'ai voulu aller vous chercher; mais le médecin ne l'a pas permis, disant que cela augmenterait son angoisse. Alors elle se contenta de lever sa petite main et de la baisser aussitôt.... Que voulait-elle dire par ce signe? Dieu le sait!... Moi, je crois qu'elle a voulu vous bénir bien qu'absents, puisque Dieu n'a pas voulu permettre qu'elle eût la joie de revoir ses enfants avant de mourir.... Enfin, ma chère colombe se souleva un peu, et, d'une voix dont le souvenir me fait mal, s'écria: «Sainte Mère! ne les abandonnez pas....» En ce moment son mal remonta vers le cœur ... on lisait dans ses yeux une souffrance horrible, la pauvre petite! Elle retomba sur les coussins, saisit le drap entre ses dents, et les larmes, les larmes, mon petit père, coulaient, coulaient....
—Et après?» demandai-je.
Nathalia Savichna ne pouvait plus parler; elle se détourna et pleura amèrement.
Ma mère est morte dans d'affreuses souffrances.
Le lendemain, tard dans la soirée, je voulus jeter un dernier regard sur elle; après avoir vaincu un sentiment d'effroi, involontaire, j'ouvris doucement la porte et me glissai, sur la pointe des pieds, dans la salle.
Au milieu, sur la table, était posée la bière; il ne restait des cierges que des lumignons qui fondaient dans les candélabres d'argent. Dans un coin écarté de la pièce était assis le sacristain; il lisait, d'une voix monotone et basse, la prière des morts.
Je restai interdit sur le seuil et je regardais; mais j'étais troublé, et mes larmes obscurcissaient ma vue au point que je ne pus rien distinguer. Tout se confondait étrangement: la lumière, le brocart, le velours, les grands candélabres d'argent, l'oreiller rose orné de dentelles, le bonnet de rubans, et au milieu, dans ce fouillis, quelque chose de transparent, couleur de cire. Je montai sur une chaise pour mieux voir le visage; mais de ma place je ne pus rien distinguer que ce même objet d'une pâleur d'ivoire. Était-ce là le visage de ma mère? Je ne pouvais le croire.
Je me mis à le contempler fixement, et peu à peu je commençai à reconnaître les traits familiers et si chers. J'eus un tressaillement d'horreur en acquérant la certitude que c'était bien elle. Pourquoi ses yeux clos sont-ils si enfoncés? Pourquoi cette pâleur livide? Et sur la joue cette tache noirâtre sous la peau transparente? Pourquoi l'expression du visage est-elle si rigide et si froide? Pourquoi les lèvres sont-elles décolorées, et pourquoi leur pli noble et majestueux exprime-t-il une paix tellement surnaturelle, qu'en les regardant, je sens un frisson glacé courir le long de mon dos et dans mes cheveux?...
Et plus je regardais, plus je sentais qu'une force mystérieuse et invincible rivait mes yeux à ce visage sans vie Je ne pouvais les détacher, et cependant mon imagination évoquait des tableaux resplendissants de vie et de bonheur. J'oubliais que ce corps inanimé qui gisait devant moi, et sur lequel je fixais un regard stupide, comme sur un objet qui n'avait rien de commun avec mes souvenirs, ce cadavre, c'était elle!
Je me la représentais dans des situations variées, mais toujours vivante, joyeuse, souriante; puis, tout à coup, un trait quelconque de ce pâle visage frappait mes yeux, le sentiment de l'horrible réalité me revenait, je frissonnais, sans pouvoir arracher mes yeux de ce spectacle.
Et, de nouveau, les rêves se substituaient à la réalité, jusqu'à ce que la conscience de cette réalité revînt encore une fois détruire mes rêves. Puis la lassitude s'empara de mon imagination, elle cessa de me bercer d'illusions, et le sentiment de ce qui m'entourait disparut aussi; je tombai dans l'assoupissement et l'oubli.
Je ne sais combien de temps je suis resté dans cet état; je ne saurais dire en quoi il consistait; je sais seulement que, pendant quelques instants, j'ai perdu le sentiment de mon existence, et que j'ai éprouvé une félicité céleste d'une suavité qu'on ne peut rendre, et pourtant triste.
Peut-être qu'en prenant son vol vers un monde meilleur, sa belle âme a jeté un regard de compassion sur cette terre où elle nous laissait; elle a vu ma douleur et, se laissant retomber jusqu'à moi sur les ailes de l'amour, elle est venue avec un sourire céleste me consoler et me bénir.
Le bruit de la porte qui grinçait sur ses gonds me ramena à la réalité; c'était un sacristain qui entrait pour relever le veilleur. Ma première pensée, en le voyant, fut toute personnelle; il va me prendre pour un enfant sans cœur qui est monté sur une chaise par espiéglerie ou par curiosité, car je ne suis pas en larmes, et ma pose n'a rien de touchant! Sur ces réflexions je me signai, je saluai le corps et je me mis à pleurer.
Quand j'évoque maintenant mes impressions, je découvre que cet instant d'oubli complet de moi-même et de tout ce qui m'entourait fut un moment de véritable douleur. Avant et après l'enterrement, je n'ai pas cessé de pleurer et d'être triste, mais je me rappelle cette douleur à ma honte, parce qu'elle était toujours entachée d'un sentiment égoïste. Tantôt je tenais à montrer que j'étais plus affligé que les autres, tantôt je me préoccupais de l'effet que je pouvais produire; je m'abandonnais à une curiosité sans objet, qui me portait à observer minutieusement le bonnet de Mimi et le visage des personnes présentes.
Je me méprisais de n'être pas exclusivement absorbé par mon chagrin, et je m'efforçais de dissimuler tous mes autres sentiments; c'est pourquoi ma tristesse n'était pas sincère et manquait de naturel. En outre, j'avais de la satisfaction à sentir combien j'étais malheureux; je cherchais à aviver en moi la conscience de mon malheur, et cette préoccupation égoïste tuait en moi, plus que toute autre chose, la véritable douleur.
Après avoir passé la nuit dans un sommeil lourd et tranquille, comme c'est ordinairement le cas après une forte secousse, je me réveillai avec des yeux secs et des nerfs plus calmes.
A dix heures, on nous fit appeler pour le service funèbre qu'on célébrait avant l'enlèvement du corps. Toute la chambre mortuaire était remplie par les gens de la maison et les paysans qui étaient venus rendre leurs derniers devoirs à leur maîtresse. Pendant l'office je pleurai beaucoup, je me signai et me prosternai jusqu'à terre, mais au fond je restai assez froid; je pensais involontairement à mon demi-frac neuf qui me serrait sous les aisselles, je songeais à ne point salir mon pantalon aux genoux, et je faisais des réflexions sur tous les assistants.
Mon père était debout au chevet de la bière; son visage était blanc comme son mouchoir, et il faisait un effort évident pour retenir ses larmes.
Sa taille élevée, serrée dans un habit noir, sa figure pâle et expressive, ses mouvements gracieux et aisés comme toujours, soit qu'il se signât, qu'il saluât, qu'il prît de la terre en sa main, qu'il reçût la cire de la main du prêtre, ou qu'il s'approchât du cercueil, toute son attitude faisait beaucoup d'effet, et je ne sais pourquoi tout ce qui attirait l'attention sur lui me causait du déplaisir.
Mimi était appuyée contre le mur et semblait pouvoir à peine se tenir sur ses pieds; sa robe était froissée et couverte de plumes, son bonnet, de côté; ses yeux gonflés étaient rouges, sa tête oscillait, sans cesse ébranlée par des sanglots déchirants, et elle cachait son visage dans son mouchoir ou dans ses mains.
J'eus l'impression qu'elle dérobait ainsi sa figure, pour se reposer un instant de ses larmes simulées. Je me souvins que, la veille, elle avait dit que la mort de notre mère était pour elle un coup dont elle ne se relèverait pas, qu'elle perdait tout en la perdant, mais que cet ange (c'est ainsi qu'elle désignait maman) ne l'avait pas oubliée, et qu'avant sa mort elle avait exprimé le désir d'assurer pour toujours l'avenir de Mimi et celui de sa fille. Elle versait des larmes amères en parlant ainsi, et peut-être ses regrets étaient-ils sincères, mais ils n'étaient pas sans mélange.
Lioubotchka, dans une petite robe noire, couverte de crêpe, la tête baissée et inondée de larmes, regardait de temps en temps la bière, et son visage n'exprimait qu'une terreur enfantine.
Katienka se tenait à côté de sa mère, et, bien que son jeune visage eût les traits allongés, il était rose et frais comme de coutume.
La nature ouverte de Volodia était franche jusque dans la douleur; il était tour à tour pensif, les regards fixés sur un objet quelconque, ou ses lèvres s'allongeaient dans une courbe, et il se mettait à se signer et se prosternait à la hâte.
Toutes les personnes étrangères qui assistaient au service funèbre m'étaient insupportables. Les phrases de condoléance qu'elles débitaient à mon père: «elle sera plus heureuse dans le ciel que sur cette terre....» m'étaient non moins désagréables.
De quel droit parlaient-elles de ma mère? de quel droit la pleuraient-elles? Quelques-unes, en parlant de nous, disaient «les orphelins», comme si nous ne savions pas qu'on appelle ainsi les enfants privés de leur mère! Mais il y a des gens qui aiment à être les premiers à vous donner un nom nouveau, comme on s'empresse de dire: «Madame» à une nouvelle mariée.
Dans un coin, à l'extrémité de la salle, et à demi cachée par la porte entr'ouverte du buffet, une vieille femme à cheveux blancs se tenait à genoux et courbée. Les mains jointes et les yeux levés, elle ne pleurait point, elle priait. Son âme s'élevait à Dieu, elle l'implorait de la joindre à celle qu'elle avait aimée par-dessus toutes choses ici-bas; et elle croyait fermement que sa prière serait bientôt exaucée.
«Voilà celle qui l'a sincèrement aimée!» me dis-je à part moi, et j'eus honte de moi-même.
Le service funèbre était terminé; le visage de la morte était découvert, et tous les assistants, l'un après l'autre, la famille exceptée, défilaient devant le cercueil et baisaient la main de la défunte.
L'une des dernières personnes était une paysanne qui tenait par la main une très jolie petite fille de cinq ans qu'elle avait amenée là, Dieu sait pourquoi! Au moment où elle s'approchait à son tour de la bière, je laissai tomber par mégarde mon mouchoir tout mouillé, et je me baissai pour le ramasser; au même instant mes oreilles furent frappées par un cri si terrible et si perçant, qui exprimait une telle épouvante, que de ma vie je ne l'oublierai, même si je devais vivre cent ans; à l'heure qu'il est, quand je me le rappelle, un frisson glacé court dans tout mon être.
Je levai précipitamment la tête; sur un tabouret, devant le cercueil, se tenait la même paysanne, retenant de force entre ses bras la fillette qui se débattait, en agitant ses menottes, rejetant en arrière son visage effaré, et fixant ses yeux écarquillés sur le visage de la défunte, en criant d'une voix effrayante et surnaturelle. Je poussai un cri d'une voix, je crois encore plus terrible, et je courus hors de la chambre.
Ce ne fut qu'en ce moment que je compris d'où provenait l'odeur âcre qui se mêlait au parfum de l'encens et remplissait la pièce. Alors la pensée que ce visage, qui quelques jours auparavant rayonnait de beauté et de tendresse, ce visage de la personne que j'aimais par-dessus tout au monde, était devenu un sujet d'épouvante, cette pensée me découvrit pour la première fois la vérité dans toute son horreur brutale et remplit mon âme d'un amer désespoir.
Ma mère n'était plus là, et cependant notre vie suivait toujours le même train. Nous nous levions, nous nous couchions aux mêmes heures que par le passé et dans les mêmes chambres; comme autrefois, nous prenions le thé le matin et le soir; le dîner, le souper revenaient aux mêmes intervalles; les tables et les chaises étaient à la même place, rien dans la maison ni dans notre manière de vivre n'avait changé; mais elle n'était pas là.
Il me semblait qu'après un tel malheur tout dans l'existence devait être bouleversé; reprendre ainsi notre manière de vie accoutumée me semblait une insulte à sa mémoire et me rappelait trop cruellement son absence.
Je me souviens encore que, la veille de l'enterrement, après dîner, j'ai eu sommeil, et je suis entré dans la chambre de Nathalia Savichna avec l'idée de me coucher sur son lit, de me blottir dans le duvet moelleux, sous sa courte-pointe ouatée.
Lorsque j'entrai, Nathalia Savichna était étendue sur sa couche et, à ce que je crois, dormait; au bruit de mes pas elle se redressa, jeta en arrière le fichu de laine qui enveloppait sa tête pour la préserver des mouches, et, rajustant son bonnet, elle s'assit sur le bord du lit.
J'avais souvent l'habitude de venir, après le dîner, faire un somme sur son lit; elle devina mon intention et se leva pour me céder la place.
«C'est vous, mon cher enfant? Vous êtes sans doute venu pour vous reposer, couchez-vous.
—Non, Nathalia Savichna, répondis-je en arrêtant son bras: je ne suis pas venu pour cela ... vous-même vous êtes fatiguée, et c'est vous qui devez vous reposer.
—Non, petit père, j'ai assez dormi, dit-elle, quoique je susse très bien qu'elle avait passé trois nuits blanches.... Et, ajouta-t-elle, qui peut penser au sommeil dans un pareil moment? et elle soupira profondément.
—Nathalia Savichna, lui dis-je en me penchant vers elle et en m'asseyant sur le lit, est-ce que vous vous attendiez à ce malheur?»
Je connaissais la sincérité de son attachement, et c'était une consolation pour moi de pleurer avec elle.
La vieille femme me regarda d'un air perplexe et intrigué. Évidemment elle n'avait pas compris pour quel motif je lui posais cette question.
«Qui pouvait s'y attendre? répétai-je.
—Ah! mon petit père, reprit-elle avec un regard empreint de la plus tendre compassion ... non seulement je ne m'y suis pas attendue, mais à l'heure qu'il est je ne peux pas le croire.... C'était à moi de partir et de laisser reposer mes vieux os. Eh bien! vois par où j'ai passé. J'ai vu partir votre grand'père, d'heureuse mémoire, le prince Nicolas Mikhaïlovitch; puis j'ai dû enterrer deux frères et ma sœur Annouchka, et ils étaient tous plus jeunes que moi, et maintenant, mon petit père, c'est évidemment pour me punir de mes péchés que je dois lui survivre aussi!
C'est sa sainte volonté! Il l'a prise parce qu'elle est digne de Lui, et Lui, il recueille les bons.»
Cette idée si simple me frappa et me sembla douce; je me rapprochai encore de Nathalia Savichna. Elle avait croisé les mains sur sa poitrine et regardait le ciel; ses yeux humides et enfoncés exprimaient une douleur intense, mais tranquille. Elle avait la ferme confiance que Dieu ne l'avait pas séparée pour longtemps de celle sur qui elle avait concentré, pendant un si grand nombre d'années, tout son amour.
«Oui, mon petit père, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que je l'emmaillotais et qu'elle m'appelait Nacha. Je me rappelle comme elle courait au devant de moi et, me passant ses menottes autour du cou, m'embrassait en disant:
«Chère Nacha ..., ma belle, mon cher petit dindon....»
Et moi je badinais et je lui disais:
«Non, petite mère, vous ne m'aimez pas; bientôt vous serez grande et vous vous marierez, et vous oublierez tout de suite votre Nacha.... Elle resta pensive et dit: «Non, j'aimerais mieux ne pas me marier si je ne peux pas garder Nacha avec moi, je n'abandonnerai jamais Nacha.... Eh bien, voilà qu'elle m'a abandonnée; elle n'a pas voulu m'attendre.... Et comme elle m'aimait, cette pauvre défunte! Mais qui n'aimait-elle pas? En vérité! petit père, vous ne pourrez jamais oublier votre mère.... Ce n'était pas une femme, mais un ange du ciel. Quand son âme sera entrée dans sa gloire, elle vous aimera encore de là haut, et elle aura de la joie à vous contempler ici-bas....
—Pourquoi dites-vous, Nathalia Savichna, quand son âme sera entrée dans sa gloire ... n'y est-elle pas déjà?
—Non, petit père, dit la vieille servante en baissant la voix et en s'asseyant plus près de moi,—pour le moment son âme est encore là....» Elle montrait le ciel et parlait dans un murmure, avec tant de sentiment et de conviction, que je levai involontairement les yeux vers le ciel, et, regardant les corniches du plafond, je me mis à chercher je ne savais quoi, quelque chose. Nathalia Savichna reprit:
—Lorsque l'âme du juste monte au paradis, elle doit passer par quarante épreuves, petit père; elle doit passer encore quarante jours chez elle, dans sa maison.»
Elle me parla encore longtemps dans ce sens, avec autant de simplicité et d'assurance que si elle m'avait raconté les choses les plus ordinaires du monde, des choses qu'elle aurait vues, et sur le compte desquelles il n'eût pu s'élever aucun doute. Je l'écoutais en retenant mon souffle, et, sans comprendre tout à fait ce qu'elle me disait, j'avais une confiance absolue en ses paroles.
«Oui, petit père, maintenant elle est ici, elle nous regarde; elle écoute peut-être ce que nous disons.»
Et Nathalia Savichna inclina la tête et se tut. Elle saisit son châle pour essuyer les larmes qui coulaient de ses yeux; puis, elle se leva, et, me regardant droit dans les yeux, elle me dit d'une voix tremblante d'émotion:
«Le Seigneur, par cette mort, m'a rapprochée de lui de bien des degrés.... Que me reste-t-il à faire ici-bas? Pour qui vivrais-je? Qui aimerais-je?
—Et nous? est-ce que vous ne nous aimez pas? lui demandai-je d'un ton de reproche, en retenant difficilement mes larmes.
—Dieu sait combien je vous aime, mes chéris; mais je n'ai jamais aimé personne comme je l'ai aimée, et je ne peux plus aimer ainsi....»
La voix lui manqua, et elle se détourna de moi pour sangloter tout haut.
Je ne songeais plus à dormir; nous pleurions sans parler et serrés l'un contre l'autre.
Tout à coup Foka entra dans la chambre; en nous voyant ensemble il s'arrêta sur le seuil de la porte, de crainte de nous déranger, et nous regarda en silence et d'un air timide.
«Qu'est-ce que tu viens demander, cher Foka? demanda Nathalia Savichna en essuyant ses larmes dans son châle.
—Une livre et demie de raisins, répondit le vieux serviteur, quatre livres de sucre et trois livres de riz pour faire le koutia (une sorte de gâteau qu'on mange après l'office des morts).
—Tout de suite, tout de suite, petit père!» dit Nathalia Savichna.
Elle aspira d'abord une prise de tabac, puis se dirigea à pas précipités vers le bahut. Les derniers vestiges de douleur, toutes traces de notre conversation disparurent pendant qu'elle accomplissait ses devoirs de femme de charge, bien qu'elle eût toujours l'air très grave.
«A quoi bon quatre livres? dit-elle en rechignant, tout en pesant le sucre, c'est assez de trois livres et demie.»
Et elle retira plusieurs morceaux de la balance.
«Et qu'est-ce que cela signifie?... Hier encore j'ai donné huit livres de riz, et ils en redemandent!... Non, je n'en donnerai pas! Ce voleur de cuisinier profite de ce que la maison est sens dessus dessous; et il croit que je ne m'en apercevrai pas!... Non je ne laisserai pas gaspiller le bien des seigneurs.... Je vous demande un peu!... huit livres!
—Mais que faut-il faire? insista Foka, il déclare que tout a été employé....
—Eh bien! prends alors!, prends! qu'il vole à son aise!...»
Je fus frappé de voir Nathalia Savichna passer sans transition d'un sentiment touchant à une humeur querelleuse, et de la voir entrer, dans des détails si minutieux.... Mais, à force d'y songer, j'ai compris ce qui s'était passé dans son âme; elle avait assez de force de caractère pour pouvoir remplir ses devoirs malgré son chagrin, et, en outre, la force de l'habitude la ramenait à ses occupations quotidiennes. La douleur l'avait si fortement saisie, qu'elle ne songeait même pas à la manifester, et ne croyait nullement nécessaire, pour prouver combien elle souffrait, de négliger les choses étrangères à sa peine; une pareille idée ne lui serait même jamais venue.
L'amour-propre est un des sentiments les moins compatibles avec une véritable douleur, et cependant il est si profondément ancré dans la nature humaine, que la douleur la plus vive est rarement assez puissante pour le bannir. L'amour-propre dans la douleur se manifeste par le désir de faire voir qu'on est triste ou malheureux, ou de faire preuve de fermeté, et ce vil désir, que nous ne nous avouons pas, ne nous abandonne jamais, pas même dans la plus grande douleur, et lui enlève sa puissance, sa dignité et sa sincérité.
Nathalia Savichna avait été si profondément frappée par son malheur qu'il n'était plus resté dans son âme un seul désir personnel, et elle continuait à vivre comme elle avait vécu jusque là, par la force de l'habitude.
Après avoir remis à Foka les provisions, en lui rappelant de ne pas oublier de faire préparer un gâteau pour le clergé de la paroisse, elle le congédia, prit son bas à tricoter et s'assit près de moi.
Nous recommencâmes l'entretien interrompu, et de nouveau nous avons pleuré ensemble pour essuyer encore une fois nos larmes.
C'était toujours la même conversation, les mêmes larmes tranquilles, et les mêmes paroles résignées et pieuses, qui m'ont apporté tant de consolation et d'allégement à ma souffrance.
Malheureusement nous fûmes bientôt séparés; trois jours après l'enterrement, nous reprenions la route de Moscou, et je n'ai pas revu Nathalia Savichna.
Grand'mère n'apprit la terrible nouvelle qu'à notre retour.
Sa douleur fut immense. On ne nous permit pas de voir grand'mère; pendant toute la semaine, elle fut dans un état de prostration complète. Les médecins craignirent pour sa vie, d'autant plus qu'elle refusait tous les remèdes et repoussait toute nourriture.
Parfois, assise toute seule dans sa chambre, elle était prise tout à coup d'un accès de rire nerveux auquel succédaient des sanglots sans larmes; elle se tordait dans des convulsions et proférait des paroles horribles et insensées. C'était la première grande épreuve qui la frappait, et sa douleur était désespérée. Elle éprouvait le besoin d'accuser quelqu'un de son malheur; et elle prononçait des imprécations terribles, menaçant quelqu'un avec une véhémence extraordinaire. Dans ces moments de paroxysme, elle sortait de son fauteuil, parcourait sa chambre à grands pas, pour tomber ensuite évanouie.
Une fois j'ai pénétré dans son appartement; je la trouvai assise comme d'ordinaire dans son fauteuil. Elle semblait calme, mais son regard me frappa; ses yeux étaient légèrement ouverts, éteints, avec une expression vague; elle me regardait fixement sans me voir. Ses lèvres ébauchèrent lentement un sourire, et elle dit d'une voix tendre et touchante: «Viens ici, mon ami, viens, mon ange!»
Je crus qu'elle s'adressait à moi, et je m'approchai d'elle; mais évidemment ce n'était pas moi qu'elle voyait; elle disait:
«Ah! si tu savais, mon âme, comme j'ai souffert, et que je suis contente que tu sois arrivée.»
Je compris qu'elle croyait voir maman, et je m'arrêtai; elle continua en se fâchant:
«On m'a dit que tu es morte ... quelle bêtise! est-ce que tu peux mourir avant moi?»
Et elle fut saisie d'un affreux rire nerveux.
Les êtres capables d'aimer fortement sont seuls capables de ressentir de si fortes douleurs; mais ce besoin d'aimer est pour eux un antidote contre la douleur et finit par les guérir. C'est pourquoi la nature morale de l'homme est plus vivace que sa nature physique; la douleur ne tue pas.
Au bout d'une semaine, grand'mère put pleurer, et les larmes la soulagèrent. Sa première pensée, en revenant à elle, fut pour nous, et l'amour qu'elle nous portait grandit encore. Nous ne quittions plus son fauteuil; elle pleurait doucement en nous parlant de maman et en nous comblant de caresses.
Personne, en voyant l'affliction de grand'mère, n'aurait pu supposer qu'elle exagérait sa douleur. Sa manière de l'exprimer était énergique et touchante; et pourtant la tristesse de Nathalia Savichna m'a fait une beaucoup plus vive impression, et je suis, jusqu'à ce jour, persuadé que personne n'a aimé si sincèrement et si purement ma mère, et que personne ne l'a autant regrettée, que cet être aimant et naïf.
L'heureux temps de mon enfance finit avec la mort de ma mère, et une nouvelle phase de ma vie commence, celle de l'adolescence.
Bien que je n'aie pas revu Nathalia Savichna, comme les souvenirs qu'elle m'a laissés se rapportent au premier âge, et qu'ils ont eu une grande et une bienfaisante influence sur le développement de ma sensibilité, je veux dire encore quelques mots sur elle et raconter sa mort avant de finir.
Après notre départ, à ce que m'ont raconté les gens qui sont restés dans notre maison de campagne, elle souffrit beaucoup de n'avoir plus rien à faire.
Sans doute tous les bahuts étaient restés sous sa garde, et elle ne cessait de fouiller dedans, de remuer les choses qui s'y trouvaient pour les suspendre, les déplacer; mais l'activité, qui avait toujours rempli la maison seigneuriale et à laquelle Nathalia Savichna était habituée, lui manquait beaucoup. Le chagrin que lui avait causé la mort de notre mère, le changement qui survint dans son existence et l'absence de soins développèrent en elle une maladie à laquelle la pauvre femme était prédisposée. Juste une année après la mort de notre mère, elle devint hydropique et fut contrainte de prendre le lit.
Elle n'avait pu supporter de vivre toute seule dans notre grande maison de campagne déserte, sans amis, sans parents, et surtout elle souffrit cruellement de se voir ainsi délaissée à ses derniers moments.
Les autres domestiques l'aimaient et la respectaient; mais elle n'avait aucune relation d'amitié avec eux et s'en faisait gloire.
Elle pensait que, dans sa position de femme de charge, honorée de la confiance de ses maîtres, et à qui incombe la surveillance non seulement des bahuts, mais de toutes sortes de biens, toute familiarité avec un des serviteurs de la maison l'entraînerait à des actes de condescendance criminelle, en la rendant moins impartiale. Pour cette raison, et peut-être aussi parce qu'il n'y avait en réalité rien de commun entre elle et les autres domestiques, elle s'éloignait de tous, en disant qu'il ne lui restait dans la maison ni parrains, ni parents, et qu'elle ne permettrait à personne de gaspiller le bien de ses maîtres.
Elle confiait à Dieu ses peines dans des prières brûlantes, et elle trouvait là une consolation; mais parfois, dans ces moments de faiblesse auxquels nous sommes tous sujets, et où nous avons besoin de trouver la sympathie d'un être vivant, elle prenait sur son lit un petit chien carlin qui lui léchait les mains, en fixant sur elle ses yeux jaunes; elle lui parlait et pleurait en le caressant.
Quand le carlin commençait à gémir plaintivement, elle s'efforçait de le consoler en disant: «Ne pleure pas, je sais, sans que tu me le dises, que je vais mourir bientôt.»
Un mois avant sa mort, elle sortit de son bahut du calicot blanc, de la mousseline blanche et des rubans roses; avec l'aide de la jeune fille placée sous sa direction, elle confectionna une robe et un bonnet et prit toutes les dispositions nécessaires pour son enterrement.
Elle passa soigneusement en revue tous les bahuts, l'inventaire en main, et remit le tout à la garde de la femme de charge qui devait prendre sa place. Elle sortit deux robes de soie et un vieux châle dont grand'mère lui avait fait présent autrefois, ainsi que l'uniforme militaire de grand'père qu'on lui avait également donné.
Les broderies et les galons de l'uniforme reluisaient comme s'ils étaient neufs, et le drap n'avait pas été touché par les mites, tant ils avaient été bien soignés.
Avant sa mort elle exprima le désir que la robe rose fût remise à Volodia, pour qu'on lui en fit une robe de chambre, et que l'autre, couleur ponceau et à carreaux, me fût donnée pour le même usage, tandis que le châle devait appartenir à Lioubotchka. Elle léguait l'uniforme au premier d'entre nous qui serait officier.
Tout le reste de son petit avoir et tout son argent, à l'exception de quarante roubles, qu'elle réservait pour couvrir les frais d'enterrement et payer les prières pour le repos de son âme, devait revenir à son frère.
Ce frère, qui avait reçu sa liberté longtemps auparavant était un fort mauvais sujet, et vivait loin de chez nous. Nathalia Savichna n'avait conservé aucune relation avec lui.
Lorsqu'il reçut son héritage, qui ne se composait que de 25 roubles, il refusa de croire que c'était là le produit des économies de sa sœur. «Il est impossible, disait-il, qu'une vieille femme qui a passé soixante ans dans une riche maison, ayant toutes choses entre les mains, et qui a vécu avec parcimonie, gardant précieusement le moindre chiffon, ne laisse après elle qu'une si maigre somme.»
Telle était cependant l'exacte vérité.
Nathalia Savichna souffrit cruellement de sa maladie. Pendant les deux mois qui précédèrent sa mort, elle supporta ses maux avec une résignation vraiment chrétienne, sans murmures et sans plaintes, se contentant, selon son habitude, d'implorer Dieu dans ses souffrances. Une heure avant sa fin, elle se confessa, avec une joie sereine, et reçut l'extrême-onction.
Elle demanda à tous ceux qui l'entouraient de lui pardonner ses offenses, et elle pria le père Vassili de nous dire à tous qu'elle ne savait pas comment nous remercier pour nos bienfaits, et qu'elle nous suppliait de lui pardonner si, par ignorance, il lui était arrivé de nous faire de la peine.
La seule qualité dont elle se glorifia c'était sa fidélité à ses maîtres.
«Pour voleuse, je ne l'ai jamais été, et je peux certifier que je n'ai jamais touché à un fil appartenant à mes maîtres.»
Après avoir revêtu la robe qu'elle s'était préparée et le bonnet, elle s'appuya du coude sur les oreillers et ne cessa jusqu'à son dernier soupir de parler au prêtre. S'étant souvenue qu'elle n'avait rien laissé pour les pauvres, elle sortit dix roubles de sa bourse et les remit au pope pour les distribuer dans la paroisse; puis, elle se signa, se renversa sur sa couche, en exhalant son dernier souffle avec un sourire joyeux, et le nom de Dieu sur les lèvres.
Elle renonçait à la vie sans regret; la mort ne lui causait nul effroi, elle la recevait comme un bienfait.
On dit cela souvent; mais il est bien rare que ce soit absolument vrai. C'était le cas de Nathalia Savichna. Elle n'avait pas à redouter la mort; elle mourait dans une foi inébranlable et après avoir accompli la loi de l'Évangile.
Toute sa vie n'avait été qu'amour pur, désintéressé, et abnégation de soi-même.
Sans doute ses croyances auraient pu être d'un ordre plus élevé, et sa vie dirigée vers un but plus grand; mais, parce qu'elle s'est mue dans une sphère plus étroite, cette âme pure est-elle moins digne d'amour et d'admiration?
Elle a remporté dans son humble vie la plus grande des victoires: elle est morte sans regret et sans crainte.
D'après son désir, on l'a enterrée tout près de la chapelle élevée sur le tombeau de ma mère.
Le petit tertre couvert d'orties et de chardons sous lequel elle dort est entouré d'une grille noire, et, en sortant de la chapelle, je n'oublie jamais de m'incliner respectueusement devant cette tombe. Parfois, je m'arrête silencieux entre la chapelle et la grille, et de sombres pensées montent dans mon âme ... alors je me demande: «Est-ce que la Providence ne m'aurait réuni dans cette vie à ces deux êtres que pour me les faire éternellement regretter?»
De nouveau, deux voitures attendent devant le perron de notre maison à Pétrovskoë: l'une est un carrosse dans lequel Mimi, Katienka, Lioubotchka et une femme de chambre prennent place, et Iakov, notre intendant, lui-même, s'installe sur le siège; l'autre véhicule est une britchka où je m'assieds à côté de Volodia. Le valet, Vassili, nous accompagne; c'est un serf récemment enlevé aux travaux des champs, pour être employé au service de la maison.
Mon père, qui doit nous rejoindre à Moscou quelques jours plus tard, est debout sur le perron, tête-nue, et fait des signes de croix sur le carrosse et la britchka.
«Eh bien! que le Seigneur soit avec vous! crie-t-il, en route!»
Iakov et les cochers ôtent leurs chapeaux et se signent, (cette fois nous voyageons avec nos propres chevaux).
«Hue, hue, allez, avec l'aide de Dieu!» crient-ils pour exciter leurs bêtes.
Le carrosse et la britchka commencent à sursauter sur la route inégale, et les bouleaux de la grande avenue courent devant nous l'un après l'autre.
Je ne ressens aucune tristesse; je suis tout entier, non à ce que je quitte, mais à ce qui m'attend. A mesure que je m'éloigne des objets auxquels se rattachent les douloureux souvenirs qui ont hanté mon imagination jusqu'à ce jour, ces réminiscences perdent de leur vivacité et font place à une joyeuse conscience de vie toute débordante de force, de fraîcheur et d'espérance.
Il m'est rarement arrivé de passer plusieurs jours—je ne dirai pas aussi gaiement, j'aurais eu honte de me livrer à la joie—mais d'une manière aussi agréable, et avec un tel sentiment de bien-être, que les quatre journées qu'a duré notre voyage. Je n'avais plus devant les yeux ni la porte close de la chambre de maman, dont je ne pouvais m'approcher sans tressaillir, ni le piano, muet maintenant, que personne n'osait plus toucher et que nous regardions avec une sorte de crainte, ni les tristes vêtements de deuil, qu'avaient remplacés nos simples costumes de voyage; plus aucun de ces objets qui me rappelaient trop vivement ma perte irréparable et réprimaient en moi toute manifestation de vie, comme un outrage à la mémoire de celle qui nous manquait. En route, au contraire, les points de vue changent continuellement et des scènes variées attirent mon attention et la distraient; puis, le spectacle de la nature printanière remplit mon âme de sentiments joyeux, de satisfaction du présent et d'espérances lumineuses pour l'avenir.
Le lendemain matin, à l'auberge, l'impitoyable et trop zélé Vassili—c'est toujours le défaut des hommes qui entrent dans de nouvelles fonctions—retira la couverture de mon lit et m'annonça qu'il était temps de partir, que tout était prêt. J'eus beau parlementer, avoir recours à la ruse, me fâcher, pour prolonger d'un quart d'heure au moins mon doux sommeil du matin, rien n'y fit, et je devinai, au visage décidé de Vassili, qu'il serait inexorable et tout prêt à retirer vingt fois mon couvre-pied. Je sautai à bas du lit et je courus dehors pour faire ma toilette dans la cour.
Dans l'antichambre, le samovar bout déjà, et Mitka, le postillon, est devenu rouge comme une écrevisse à force de souffler sur les braises.
Le temps est humide et brumeux; on dirait qu'une vapeur monte des fumiers gras. A l'orient, le soleil éclaire le ciel d'une lumière éclatante et joyeuse, qui ruisselle sur les larges auvents des toits de chaume, tout autour de la cour, et fait reluire la rosée.
J'aperçois nos chevaux attachés sous le rebord des toits, devant les auges, et j'entends le bruit régulier de leur mastication. Un petit chien noir, à la fourrure épaisse, roulé en boule depuis l'aube sur un tas de fumier sec, s'étire paresseusement; puis, agitant la queue, part en trottinant pour chercher une meilleure place dans un autre coin de la cour.
L'hôtesse, affairée, ouvre le portail qui grince, et elle fait un bout de causette avec sa voisine endormie, pendant que les vaches, l'air sérieux et pensif, vont rejoindre le troupeau qu'on entend piétiner dans la cour, où les bêlements des agneaux et les voix graves des ruminants se confondent.
Notre cocher, Philippe, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, tourne la roue du puits et en retire le seau, en faisant rejaillir l'eau claire autour de lui, avant de le vider dans l'abreuvoir de chêne; tout auprès les canards déjà éveillés barbottent dans une flaque. J'ai du plaisir à regarder Philippe, avec sa large barbe touffue, ses grosses veines qui se gonflent et les muscles qui se dessinent nettement sur ses vigoureux bras nus, à chaque effort qu'il fait.
Derrière la cloison où Mimi a dormi avec Katienka et Lioubotchka, et à travers laquelle nous avons causé ensemble le soir, on entend un bruit de va-et-vient. La femme de chambre entre et sort sans cesse; enfin la porte s'ouvre, et on nous appelle pour prendre le thé.
Vassili, toujours en proie à un excès de zèle, entre continuellement dans la chambre et porte dans la voiture tantôt une chose, tantôt une autre, et tout le temps il fait des signes désespérés pour supplier Mimi de donner le signal du départ.
Les chevaux sont attelés et manifestent leur impatience en secouant souvent leurs grelots; les malles, les caisses, les petites boîtes ont été portées de nouveau dans les voitures, et nous cherchons à reprendre nos places. C'est en vain; nous trouvons sur les sièges de la britchka des monceaux de bibelots, et nous nous creusons la tête pour comprendre où tous ces objets étaient casés la veille et où nous pourrons bien nous asseoir. Une boîte à thé, en noyer, avec un couvercle en forme de triangle, a été fourrée sous moi et fait mon désespoir; mais Vassili me promet que la boîte se rangera en route, et je suis forcé de me contenter de cette assurance.
Le soleil, voilé un moment par un épais nuage blanc qui couvre le ciel du côté de l'est, se dégage tout à coup et inonde la campagne d'une clarté paisible et joyeuse. Autour de moi tout est beau, et mon âme est légère et sereine.
La route se déroule devant nous en une large bande irrégulière, qui court entre les champs couverts de chaume sec et les prairies brillantes de rosée; ici et là apparaît au bord du chemin un morne cytise ou un jeune bouleau, avec de tendres feuilles gommeuses, jetant une ombre immobile sur les ornières desséchées du sol argileux et sur la petite herbe verte qui borde la voie.
Le bruit monotone des roues et des grelots ne domine pas le chant des alouettes qui tournoient au-dessus de nos têtes. L'odeur de poussière, d'acide et de drap rongé par les mites, qui s'exhale toujours de notre britchka, est remplacée par un parfum de printemps; je sens en mon âme un trouble joyeux, un vague besoin d'activité, le désir de produire quelque chose, signe infaillible d'un vrai contentement.
Tout à coup, sur le sentier des piétons, qui côtoie notre route, je distingue des formes qui se meuvent lentement, et, je reconnais des pèlerines. Leurs têtes sont emmitouflées de mouchoirs malpropres; elles portent sur le dos des besaces faites d'écorce de bouleau; leurs jambes sont entourées de bandes de toile d'un blanc douteux, et leurs pieds chaussés de lourds souliers de tille. Relevant en mesure leurs bâtons, elles avancent presque sans prendre garde à nous et marchent lentement à la queue leu-leu, d'un pas pesant. A leur vue, ces questions se pressent dans ma tête: Où vont-elles? Que vont-elles faire? Leur voyage doit-il durer longtemps? Est-ce que leurs longues ombres rejoindront l'ombre du cytise devant lequel elles doivent passer?
Mais mon attention est bientôt détournée.
Une voiture attelée de quatre chevaux de poste vient à notre rencontre; encore deux secondes, et les visages qui apparaissent à la portière pour nous regarder d'un air aimable et curieux seront déjà loin, et il me semble étrange que ces personnes n'aient aucune communication avec nous, et que je ne les reverrai peut-être jamais.
Ensuite arrivent de côté deux chevaux poilus tout en sueur; ils courent en agitant leurs colliers, les traits serrés dans les avaloires. Derrière eux, sur un troisième cheval, dont le garrot est surmonté d'un arc avec une cloche suspendue, est perché un jeune postillon qui laisse pendre des deux côtés de l'animal ses longs pieds dans d'énormes bottes. Il retourne au relais, le chapeau de laine d'agneau rabattu sur une oreille, et chante en traînant un refrain plaintif, accompagné par le son de la cloche que le cheval fait tinter. Son visage et toute son attitude expriment tant de satisfaction nonchalante et d'insouciance, qu'il me semble que le comble du bonheur est d'être postillon, de ramener ses chevaux au relais et de chanter des airs tristes.
Voilà, maintenant, que dans le lointain, se découpe sur le ciel d'un azur lumineux l'église d'un village, avec son toit vert; puis j'aperçois le village lui-même, le toit rouge de la maison seigneuriale et le jardin verdoyant. Qui habite cette maison? Y a-t-il là des enfants, un père, une mère, un précepteur? Pourquoi n'entrons-nous pas dans ce château, et ne faisons-nous pas la connaissance de ses maîtres?
A présent, une longue file de grands chariots viennent à notre rencontre; ils sont attelés de trois chevaux frais, bien nourris et aux jarrets solides. Nous sommes obligés de nous tirer de côté pour les laisser passer.
«Qu'est-ce que vous transportez sur vos chars?» demande Vassili au premier charretier.
Mais celui-ci, ses gros pieds pendant en dehors du véhicule, et tout en brandissant son fouet court, nous regarde d'un œil stupide et ne se décide à répondre que lorsque nous ne pouvons plus l'entendre.
«Quelle marchandise avez-vous là?» s'écrie encore Vassili, en s'adressant au second charretier couché sur le devant du chariot, sous une tente formée par une natte neuve. Une tête blonde aux joues rouges, terminée par une petite barbe roussâtre, sort un moment de sous cet abri, jette un regard d'indifférence méprisante sur notre britchka et se cache de nouveau sous la natte.
Je me dis alors que ces charretiers ne savent évidemment pas qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons....
Absorbé tout entier pendant une heure et demie dans des observations diverses, je ne remarque pas les chiffres posés en travers des poteaux pour marquer la distance.
Déjà le soleil commence à me brûler la tête et le dos, et la route devient plus poussiéreuse. Le couvercle en triangle de la boîte à thé me gêne horriblement et me fait mal; je change plusieurs fois de position; j'ai trop chaud et je ne me sens pas à l'aise. Toute mon attention se porte alors sur les poteaux indicateurs et leurs chiffres; je me livre à différents calculs mathématiques pour déterminer dans combien de temps nous arriverons au prochain relais.
«Douze verstes, (la verste est un peu plus d'un kilomètre) font le tiers de trente-six, il y a quarante et une verstes d'un relais à l'autre; or, nous avons parcouru un tiers de la route, plus ... mais je ne finis pas cette opération mentale et je crie:
«Vassili, cher Vassili, laisse moi monter sur le siège.»
Vassili, qui était en train de faire un bon somme, s'empressa de donner son consentement. Il changea de place avec moi et se mit aussitôt à ronfler, s'étendant de façon à prendre toute la place.
De la hauteur où je me trouve maintenant, je peux suivre un spectacle intéressant, celui de nos quatre chevaux: La Nouvelle, Sacristain, le Gauche timonier, et Pharmacien, ayant chacun ses qualités individuelles que je connais à fond.
«Pourquoi Sacristain est-il attelé aujourd'hui du côté droit et non pas à gauche, Philippe? demandai-je un peu timidement au cocher.»
—Sacristain?
—Et Pharmacien ne tire pas ... ajoutai-je.
—Sacristain? On ne peut pas atteler Sacristain à gauche, me répondit Philippe sans prendre garde à ma dernière remarque.—Sacristain n'est pas un cheval qu'on puisse atteler à gauche ... à gauche il faut un cheval, en un mot, qui soit un cheval, et non pas comme celui-ci....»
En prononçant ces mots, Philippe se pencha à droite, et, tirant la bride de toutes ses forces, il se mit à donner des coups de fouet au pauvre Sacristain, quoique l'animal fît tous ses efforts et tirât à lui seul la britchka. Philippe ne cessa cet exercice que lorsqu'il jugea nécessaire de se reposer et de remettre, Dieu sait pourquoi! son chapeau de côté, bien qu'il fût en place et tînt ferme sur sa tête.
Je profitai de ce moment de répit pour prier Philippe de me laisser conduire un instant. Il me remit d'abord une guide, puis la seconde, et enfin toutes les six et le fouet. Alors je fus au comble du bonheur. Je m'efforçai d'imiter le cocher, et je lui demandai si je conduisais bien; mais il se montra plutôt mécontent, disant que Pharmacien tirait trop et que La Nouvelle ne tirait rien du tout, et il finit par placer son coude devant ma poitrine et me reprit les rênes.
La chaleur devenait toujours plus intense; de petits nuages blancs se gonflaient comme des bulles de savon, s'élevaient, envahissaient le firmament, et, pressés les uns contre les autres, semblaient un troupeau de moutons, puis, se condensant, formaient une masse compacte d'un gris sombre.
Tout à coup, je vis une main tenant une bouteille et un paquet sortir de la portière du carrosse. Vassili, avec une agilité surprenante, sauta de la britchka sans faire arrêter et, courant après l'autre voiture, revint aussitôt chargé de talmouses et de kvass (boisson au goût aigrelet préparée avec du pain).
Aux descentes, quand la pente est raide, nous mettons tous pied à terre, et souvent nous courons pour voir qui arrivera le premier au pont ou à un autre but, tandis que Vassili et Iakov, après avoir enrayé les deux voitures, soutiennent le carrosse chacun d'un côté, comme s'il leur était possible de le retenir s'il venait à verser. Enfin, avec la permission de Mimi, Volodia ou moi, nous montons auprès d'elle et changeons de place avec Katienka ou Lioubotchka. Elles sont ravies et trouvent, non sans raison, qu'il est beaucoup plus gai de voyager dans la britchka découverte que dans le carrosse fermé.
Quelquefois, en, traversant un bosquet, nous nous arrêtons, nous faisons une cueillette de branches vertes dont nous formons une tente au-dessus de la britchka. Bientôt ce pavillon ambulant court à toute haleine après le carrosse, et Lioubotchka glapit d'une voix perçante, ce qui est, chez elle, le signe d'un contentement parfait.
Cette fois, nous apercevons le village où nous ferons halte. Je flaire déjà l'odeur du village: la fumée, le goudron, les talmouses; j'entends des voix, des pas, des bruits de roues; les grelots ne résonnent plus comme lorsque nous étions en plein champ. De chaque côté de la route se dressent des isbas (cabanes) aux toits de chaume, avec des perrons en bois sculpté et de toutes petites fenêtres ornées de volets rouges ou verts; parfois, à une de ces croisées apparaît la tête d'une paysanne curieuse.
Puis voici les enfants du village, garçons et fillettes, ayant pour tout vêtement une chemise; les yeux écarquillés et les bras ouverts d'étonnement, ils restent comme figés à leur place à notre aspect, ou trottinent, leurs pieds nus enfoncés dans la poussière, et courent après les voitures en s'efforçant de se jucher sur les malles attachées derrière, malgré Philippe qui les menace de son long fouet.
Maintenant, plusieurs aubergistes à la tête roussâtre se cramponnent aux deux portières de nos voitures et tâchent, par leurs belles promesses et leurs paroles alléchantes, de se faire donner la préférence.
Halte! les chevaux s'arrêtent. Les portails grincent, les palonniers frottent contre les murs, et nous faisons notre entrée dans la cour de l'auberge.
Nous avons devant nous quatre heures de répit et de liberté.
Le soleil descendait vers l'occident, et ses rayons obliques me brûlaient la nuque et les joues d'une façon insupportable; il n'y avait pas moyen de poser la main sur le rebord de la voiture, tant il était chaud. Une poussière épaisse tourbillonnait sur la route et remplissait l'air; pas le moindre souffle de vent ne s'élevait pour l'emporter. Devant nous, à une distance toujours égale, se balançait le carrosse poudreux, surmonté de malles, derrière lesquelles j'apercevais par moments le fouet que balançait Philippe, ou son chapeau et la casquette de Iakov.
Je ne savais que faire de moi-même; ni la vue de Volodia qui dormait près de moi, le visage noir de poussière, ni les mouvements d'épaules de Philippe, ni l'ombre allongée de notre britchka qui nous suivait en dessinant un angle aigu, rien ne parvenait à me distraire. Toute mon attention était concentrée sur les poteaux qui indiquaient les verstes parcourues et que j'apercevais de loin, ainsi que sur les nuages, qui n'étaient plus disséminés, mais s'avançaient dans le ciel, réunis en une vaste et sinistre nuée ombrée de noir, de fort mauvais augure. De temps en temps le tonnerre grondait, ce qui avivait de plus en plus mon impatience d'arriver à une auberge. L'approche de l'orage me causait un inexprimable sentiment d'angoisse et de frayeur, très pénible à supporter.
Nous avions encore dix verstes à parcourir pour gagner le village le plus proche, et l'énorme nuée d'un lilas sombre, venue je ne sais d'où, s'avançait rapidement vers nous, bien qu'il n'y eût pas de vent. Le soleil, encore à découvert, faisait ressortir la masse imposante du nuage, d'où émanaient en tous sens, jusqu'aux bords de l'horizon, de larges rayons grisâtres. De temps en temps, au loin, un éclair s'allumait, et j'entendais un bruit sourd qui allait grossissant, se rapprochait de nous et éclatait dans un long roulement saccadé parcourant la voûte céleste.
Tout à coup Vassili se lève sur le siège et relève la capote de la britchka, les cochers mettent leurs armïaki (manteaux), et, à chaque coup de tonnerre, ils ôtent leurs casquettes et se signent. Les chevaux dressent l'oreille, leurs naseaux se gonflent comme pour aspirer l'air frais, qui descend de la nuée poussée toujours plus près de nous, et la britchka, vole avec une célérité croissante sur la route poussiéreuse.
J'éprouve un sentiment désagréable; il me semble que mon sang coule plus vite dans mes veines.
Déjà les nuages épars commencent à intercepter le soleil; le voilà qui nous regarde pour la dernière fois, il éclaire d'une lumière fugitive l'horizon sombre et menaçant, et il disparaît. En un clin d'œil tout ce qui nous entoure a changé d'aspect et pris un caractère lugubre. Le bosquet de trembles est secoué de frissons; les feuilles sont devenues d'un blanc terne et se détachent durement sur le fond violacé du grand nuage; elles bruissent et palpitent. Les cimes des hauts bouleaux commencent à se balancer, et des tas d'herbe sèche s'éparpillent sur le chemin. Les martinets, les hirondelles, avec leurs guimpes blanches, planent autour de la britchka, passent sous le poitrail des chevaux, comme si elles voulaient nous arrêter dans notre course. Les choucas, les ailes déployées, volent en biais dans l'air. Nous avons ramené sur nous le tablier de cuir; les quatre bouts se soulèvent et laissent pénétrer des bouffées d'air humide; les coins se tordent dans toutes les directions et battent contre la voiture.
Un éclair éclate presque dans la britchka et nous aveugle, illuminant pour une seconde le drap gris, les galons de nos coussins et la figure de Volodia, qui s'est blotti dans un coin. En même temps, droit au-dessus de ma tête, résonne un bruit sourd, majestueux; il semble monter plus haut, toujours plus haut et s'étendre plus ample, toujours plus ample, dans une gigantesque spirale; il enfle d'instant en instant et s'abîme dans un écroulement formidable, écrasant, qui nous fait involontairement trembler et retenir notre souffle.
«La colère de Dieu!» Que de poésie dans cette expression populaire!
Les roues tournent de plus en plus vite; Philippe agite impatiemment les rênes; je devine aux mouvements de son dos et de celui de Vassili qu'ils ont aussi peur que moi.
La britchka glisse en bas de la descente et fait crier le pont de bois; je n'ose pas remuer et j'attends de minute en minute notre fin à tous.
Crac!...
Un des palonniers de la britchka, vient de se briser, et nous voilà contraints de nous arrêter au milieu du pont, malgré les coups de tonnerre qui se succèdent sans interruption et qui nous assourdissent!
J'appuie ma tête sur un des côtés de la britchka, et le cœur me manque, mon souffle s'arrête pendant que je suis tous les mouvements des gros doigts noirs de Philippe, qui serrent lentement un nœud et égalisent les traits. De l'autre main, et en s'aidant du manche de son fouet, le cocher pousse le bricolier à sa place.
Mon inquiétude, mes tourments et ma frayeur augmentent en proportion de l'orage qui grandit, et, quand survient le moment imposant d'accalmie qui précède d'habitude une nouvelle décharge d'électricité, mes impressions deviennent si intenses, que je serais certainement mort d'émotion si cet état avait duré un quart d'heure encore.
A cet instant même, il surgit tout à coup de dessous le pont un homme vêtu seulement d'une chemise sale et trouée, le visage enflé et stupide, la tête branlante et les cheveux coupés ras; il avait les jambes tordues et grêles et tendait, sans se gêner, au milieu de la britchka, son bras privé de main et terminé par un moignon rouge et luisant.
«Do-o-nnez au pauvre, pour l'amour de Dieu! do-o-nnez au pauvre!» gémit sa voix lamentable; et, à chaque mot, le mendiant se signait et nous saluait profondément jusqu'à terre.
Il m'est impossible de rendre l'expression d'effroi qui me glaça le cœur en ce moment. Un frisson courut dans mes cheveux, et mes yeux étaient rivés sur le pauvre avec la fixité stupide de l'épouvante.
Vassili, qui est chargé de distribuer les aumônes en route, est occupé à donner des instructions à Philippe pour consolider le palonnier, et ce n'est que lorsque tout est prêt, et que le cocher a déjà rassemblé les rênes, que Vassili sort quelque chose de sa poche de côté. La britchka s'ébranle de nouveau; mais à peine a-t-elle donné un tour de roues, qu'un éclair éblouissant embrase tout le ravin sous nos pieds et arrête brusquement les chevaux dans leur course. La lumière électrique est accompagnée, sans même une seconde d'intervalle, par un coup de tonnerre si formidable, qu'il semble que toute la voûte des cieux s'écroule sur nos têtes. Le vent fait rage; la crinière et la queue des chevaux, le manteau de Vassili, les coins du tablier flottent désespérément dans la même direction, emportés par la rafale. Sur la capote de la britchka une grosse goutte de pluie tombe en retentissant ... puis une seconde,... une troisième, une quatrième, et aussitôt on dirait que quelqu'un bat du tambour sur nos têtes; puis, tout autour de la voiture, résonne un bruit égal de pluie.
Je reconnais aux mouvements des coudes de Vassili qu'il délie sa bourse, et, pendant tout ce temps, le mendiant ne cesse pas de se signer et de nous saluer en répétant:
«Donnez, pour l'amour du Christ!»
Et il court si près des roues, que je crains à tout instant de voir la britchka lui passer sur le corps.
Enfin une monnaie de cuivre glisse devant nos yeux, et le pitoyable individu en haillons, mouillé jusqu'à la moelle des os, fouetté par le vent, s'arrête un moment au milieu de la route, perplexe et irrésolu, et nous le perdons de vue.
La pluie, chassée obliquement par un vent impétueux, coule comme si elle tombait d'un seau; des torrents ruissellent du manteau de frise de Vassili dans la flaque d'eau trouble qui s'est formée sur le tablier de cuir. La poussière, d'abord ramassée en pâtés, se transforme bientôt en une boue liquide que pétrissent les roues; les cahots sont moins fréquents, et, dans les ornières d'argile, s'étalent des ruisseaux fangeux. Peu à peu les éclairs sont plus amples et moins vifs, et les roulements du tonnerre n'éclatent plus aussi sonores au milieu du bruit cadencé de la pluie.
Et bientôt la pluie même devient plus fine, les nuées commencent à se partager en petits nuages moirés et s'éclaircissent par place; il se fait une trouée à l'endroit où le soleil s'est caché, et, à travers la traîne gris-perle de la plus grosse nuée, on distingue un petit pan bleu pâle. Une minute après, un timide rayon de soleil brille déjà sur les mares qui couvrent la route, à travers les lignes droites de fine pluie qui tombent comme d'un crible, et sur l'herbe lustrée, lavée de toute sa poussière.
La grosse nuée noire continue à courir aussi menaçante qu'avant, du côté opposé de l'horizon; mais je ne la redoute plus. J'éprouve un sentiment ineffable d'espérance et j'oublie ma terreur douloureuse. Mon âme s'épanouit avec la nature rafraîchie et devenue souriante.
Vassili rejette en arrière le col de son manteau, ôte sa casquette et la secoue; Volodia déboutonne le tablier de cuir; moi, j'avance la tête hors de la britchka et je bois avec avidité l'air frais et embaumé.
D'un côté de la route se trouve un vaste champ de blé d'automne, coupé ici et là de fossés peu profonds; la terre humectée et la verdure brillent et s'étendent en un tapis ombragé jusqu'au bord de l'horizon. De l'autre côté du chemin, un petit bois de trembles, entremêlés de noyers et de merisiers, reste immobile, plongé dans une extase de bonheur; les branches, sans un frisson, laissent lentement retomber les gouttes de pluie limpides sur les feuilles sèches d'antan.
De tous côtés, des alouettes huppées s'élancent dans les airs et frétillent avec des chants joyeux, puis, aussitôt, se laissent choir dans les champs.
Le suave parfum du bois, après cet orage de printemps, l'odeur du bouleau, de la violette, de la morille, du merisier, des fanes, m'enchantent au point, que je ne peux plus tenir dans la britchka; je saute à bas, je bondis dans les buissons, et, bien que je sois aspergé de gouttelettes, je cueille des branches humides de merisier en fleurs, je m'en donne de petits coups dans le visage, et je m'enivre de leur exquise senteur.
Je ne prends pas garde aux énormes plaques de boue qui se collent à mes bottes, je ne m'aperçois pas que mes bas sont depuis longtemps mouillés, je cours auprès de la portière du carrosse en criant:
«Lioubotchka! Katienka! Regardez comme c'est beau!»
Et je leur tends mon bouquet de merisier. Les jeunes filles poussent des cris de joie; Mimi m'ordonne de me retirer pour ne pas me faire écraser par la voiture; mais je répète à tue-tête:
«Sentez-le donc!... comme il sent bon!»

Katienka était assise auprès de moi et suivait, pensive, sa belle tête inclinée, la route poussiéreuse qui fuyait sous les roues.
Je la regardais en silence, surpris de voir pour la première fois sur son visage rose une expression qui n'était pas celle d'un enfant.
«Nous arriverons bientôt à Moscou, lui dis-je, qu'est-ce que tu en penses? Crois-tu que ce soit une grande ville?...
—Je ne sais pas, répondit-elle, par manière d'acquit.
—Cependant, quelle idée t'en fais-tu?... Crois-tu que Moscou est plus grande que la ville que nous venons de traverser?
—Comment?
—Non, je ne dis rien.»
Ce sentiment d'intuition, qui fait qu'un homme devine la pensée d'un autre et qui sert de lien à la conversation, fit comprendre à Katienka que son indifférence me faisait de la peine; elle releva la tête et me dit:
«Votre père ne vous a-t-il pas dit que nous devons demeurer chez votre grand'mère?
—Oui, il m'a dit que grand'mère désire vivre avec nous, tout à fait.
—Et nous devons tous demeurer chez elle?
—Sans doute, tous. Nous aurons un appartement au second étage; papa occupera l'aile de la maison, et nous dînerons tous ensemble au premier avec grand'mère.
—Maman m'a dit que votre grand'mère est si grande dame et si irascible.
—No-o-on! Elle fait cette impression au premier abord. Elle est grande dame, mais pas irascible; au contraire, elle est très bonne et très gaie.... Si tu avais vu le bal qu'elle a donné, le jour de sa fête....
—Cependant, j'ai peur d'elle.... Et puis ... Dieu sait encore, si....»
Katienka se tut subitement et devint grave.
«Qu'est-ce que tu allais dire? demandai-je avec inquiétude.
—Rien ... je n'ai rien voulu dire....
—Mais si ... tu as commencé à dire ... Dieu sait encore si....
—Tu dis qu'on a donné un grand bal, le jour de sa fête?....
—J'ai beaucoup regretté que vous n'y fussiez pas; il y avait une foule d'invités, peut-être un millier de personnes, et de la musique ... et des généraux.... J'ai dansé....—Katienka! ajoutai-je interrompant brusquement mon récit, tu ne m'écoutes pas.
—Si, j'écoute.... Tu as dit que tu avais dansé.
—Pourquoi es-tu si triste?
—On ne peut pas être toujours gaie!
—Non, ce n'est pas cela.... Tu as beaucoup changé depuis notre retour de Moscou. Dis-moi la vérité, continuai-je d'un ton décidé en me tournant vers elle ... pourquoi es-tu devenue si étrange?
—Est-ce que je suis étrange? répondit Katienka d'un ton animé qui prouvait que ma question l'avait piquée; je ne suis pas étrange.
—Pardon, tu n'es plus la même qu'auparavant, continuai-je; autrefois tu étais tout à fait comme une de nous, on voyait que tu nous prenais pour tes parents, et que tu nous aimais autant que nous t'aimions; maintenant tu es devenue si sérieuse!... et tu nous évites.
—Point du tout....
—Non, non, laisse-moi finir, dis-je, en l'interrompant.»
Je sentais déjà ce léger picotement dans le nez, qui précède les larmes; je le ressentais chaque fois que j'avouais une secrète pensée qui pesait depuis longtemps sur mon cœur.
«Tu nous évites, répétai-je, tu ne parles qu'à Mimi, comme si tu ne voulais plus nous connaître.
—On ne peut pas être toujours la même; il vient un jour où il faut changer!» répondit Katienka, qui avait l'habitude, quand elle était embarrassée, d'expliquer toutes choses par une nécessité impérieuse.
Je me souviens qu'un jour, ma sœur, se querellant avec elle, lui dit: «sotte!»
Katienka répliqua: «Tout le monde ne peut pas être sage; il faut aussi qu'il y ait des sots!»
Cette fois je ne fus pas content de sa réponse: «Il vient un jour où il faut changer,» et je continuai mon interrogatoire.
«Pourquoi est-il nécessaire de changer!
—Parce que nous ne pouvons pas vivre toujours ensemble, répondit-elle en rougissant et en fixant les yeux sur le dos de Philippe. Maman pouvait demeurer toujours avec votre mère qui était son amie; mais, on dit la comtesse, votre grand'mère, très irascible. Qui sait si elles s'accorderont?... Et même, si elles se conviennent, il faudra nous séparer un jour; vous êtes riches, vous avez des terres, Pétrovskoë; et nous, nous sommes pauvres; maman n'a rien.»
«Vous êtes riches, nous sommes pauvres,» ces paroles et les idées qui s'y rattachaient me parurent très singulières. En ce temps-là je ne considérais comme pauvres que les mendiants et les paysans, et mon imagination ne pouvait rattacher l'idée de pauvreté à la personne de Katienka, si jolie et si gracieuse. Il me semblait que Mimi et sa fille passeraient leur vie avec nous sur un pied d'égalité complète et qu'il ne pouvait en être autrement. A la révélation de la jeune fille, des milliers de pensées encore confuses surgirent dans mon esprit. Je fus pris d'une telle honte à l'idée que nous étions riches et qu'elle était pauvre, que je devins tout rouge et que je n'osai plus lever les yeux sur elle.
«Eh! qu'importe que nous soyons riches, et Mimi et Katienka pauvres!» me disais-je, pourquoi en résulterait-il une séparation?. Pourquoi ne partagerions-nous pas notre bien avec elles? Mais instinctivement je compris que je ne devais pas faire part à Katienka de mes réflexions, et mon bon sens me suggérait déjà, contrairement à mes déductions logiques, que Katienka avait raison et qu'il serait déplacé de lui exprimer ma pensée là-dessus.
«Est-ce possible que tu nous quittes? lui dis-je. Comment ferons-nous pour vivre séparés?
—Mais que faire!... J'en souffre moi-même.... Cependant je sais ce que je ferai si cela arrive....
—Tu deviendras actrice?. Quelle bêtise! lui dis-je, sachant que toute son ambition était de monter sur la scène.
—Non, je disais cela quand j'étais petite....
—Que comptes-tu faire?
—J'entrerai au couvent, et je serai cloîtrée, je porterai une simple robe noire et un bonnet de velours....»
Et elle se mit à pleurer....
Cette conversation avec Katienka me toucha profondément et, en m'obligeant à réfléchir à la position et à l'avenir de la jeune fille, me fit découvrir pour la première fois que nous, c'est-à-dire ma famille, nous n'étions pas seuls dans ce monde, qu'il y avait sur cette terre beaucoup de personnes qui ne pensaient pas à nous et qui ne soupçonnaient même pas notre existence.
Sans doute je le savais déjà; mais je ne m'en étais jamais rendu compte si nettement. Auparavant, je m'en doutais; mais je ne ne voulais pas le croire.
Maintenant, tout en laissant mes yeux errer sur les campagnes et les villes que nous traversions, je me disais, en passant devant chaque maison, que là vivait une famille comme la nôtre. A la vue des femmes et des enfants qui examinaient avec curiosité nos voitures, un instant, puis disparaissaient pour toujours, et devant les marchands et les paysans, qui non seulement ne nous saluaient pas avec la déférence qu'on nous témoignait à Pétrovskoë, mais ne daignaient pas nous regarder, pour la première fois, je me demandais: Qui sont ces hommes? Qu'est-ce qui les intéresse, puisqu'ils ne pensent point à nous? Ont-ils des enfants? Comment les élèvent-ils? Les laissent-ils jouer? Leur apprennent-ils à lire. Et ainsi de suite, sans fin.
Dès mon arrivée à Moscou, le changement survenu dans ma manière de voir les personnes et les choses, et de juger mes relations avec elles, devint encore plus sensible.
A ma première entrevue avec grand'mère, en apercevant son visage maigre et ridé, et ses yeux éteints, au lieu du sentiment de crainte et de respect que j'avais eu pour elle, j'éprouvai de la compassion. Quand je la vis appuyer son visage sur la tête de Lioubotchka et pleurer comme si elle avait eu devant elle le cadavre de sa fille, la compassion que je ressentais pour elle se transforma en amour.
Sa douleur me troubla. Je comprenais que les personnes n'étaient rien à ses yeux, qu'elle ne chérissait en nous que ses souvenirs; je sentais que, dans tous les baisers dont elle couvrait mes joues, se cachait une pensée unique: «Elle n'est plus, elle est morte, je ne la reverrai jamais!»
Mon père, qui ne s'occupait point de nous à Moscou et qui n'apparaissait qu'au dîner, en redingote ou en frac, et le visage toujours préoccupé, avait aussi beaucoup changé dans mon opinion. Quant à Karl Ivanovitch, grand'mère ne l'appelait jamais que le menin; il avait eu la singulière fantaisie de recouvrir sa vénérable calvitie, qui m'était si familière, d'une perruque rousse dont la raie était simulée par un fil qui partageait la tête presque au milieu. Sous cet accoutrement il me parut si comique, que je m'étonnais de n'avoir pas remarqué plus tôt combien il était drôle.
Une barrière invisible s'était élevée entre nous et les jeunes filles; elles avaient leurs secrets, et nous, les nôtres. On aurait dit qu'elles nous dédaignaient depuis qu'elles portaient leurs robes plus longues, et nous, de notre côté, nous étions très fiers de nos pantalons à sous-pieds.
Le premier dimanche après notre arrivée, Mimi se présenta au dîner dans une robe d'une telle magnificence, et avec une si grande profusion de rubans sur la tête, que je compris, sans en pouvoir douter dorénavant, que nous n'étions plus à la campagne, et qu'ici la vie serait toute différente.
Je n'avais qu'une année et quelques mois de moins que mon frère; nous avions grandi, étudié et joué ensemble. Jusqu'ici on n'avait fait aucune différence entre nous; mais, à l'époque dont je viens de parler, je commençai à comprendre que Volodia n'était plus un camarade pour moi, ni par l'âge, ni par les goûts, ni par le talent. Il me sembla même que Volodia se rappelait qu'il était l'aîné et qu'il en était fier.
Cette persuasion, peut-être erronée, éveillait mon amour-propre, qui souffrait chaque fois que mon frère et moi nous avions un conflit. Volodia m'était supérieur en tout: aux jeux, à l'étude, dans nos querelles, dans sa tenue. Le sentiment de mon infériorité m'éloignait de lui et me causait des souffrances morales, qui restaient incompréhensibles pour moi.
Ainsi, le jour où Volodia porta pour la première fois une chemise de toile de Hollande, si j'avais dit tout franchement que je regrettais de ne pas en avoir une pareille, il ne m'aurait pas semblé, chaque fois qu'il rajustait son col, que c'était pour m'humilier....
Ce qui me tourmentait le plus, c'est que Volodia avait quelquefois l'air de deviner ce qui se passait en moi, mais il le dissimulait.
Qui n'a pas observé ces rapports secrets qui s'établissent, sans qu'une parole soit prononcée, par un sourire, un mouvement, un coup d'œil furtif, entre des personnes vivant sous le même toit, entre frère et sœur, mari et femme, maîtres et domestiques, quand la franchise n'existe pas dans leurs relations? Que de désirs inavoués, de pensées non exprimées, et que de crainte d'être compris se révèlent dans un de ces regards imprévus qui se croisent timidement et sans le vouloir!...
Peut-être aussi ma susceptibilité excessive et mon besoin de tout analyser m'induit-il en erreur; il est possible que Volodia n'ait pas ressenti les mêmes impressions que moi. Il était fougueux, franc et inconstant dans ses passions. Il aimait toutes sortes de choses et s'y livrait de toute son âme.
Tantôt c'était la passion des gravures; il se mettait lui-même à dessiner, dépensait tout son argent en tableaux et en mendiait chez son maître de dessin, chez mon père et chez grand'mère. D'autres fois, il avait la toquade des brimborions; il les recueillait partout où il en trouvait, et en couvrait sa table de travail; puis, il s'éprenait de la lecture et y passait ses jours et ses nuits.
Sa passion dominante m'entraînait malgré moi; cependant, j'étais trop fier pour vouloir marcher sur ses brisées, et trop jeune et pas assez indépendant de caractère pour me tracer une voie nouvelle.
Je me rappelle qu'au plus fort de sa passion pour les bric-à-brac, je m'approchai un jour de sa table et brisai par inadvertance un petit flacon multicolore; par bonheur il était vide.
«Qui t'a prié de toucher à mes affaires?» s'écria Volodia, qui entrait dans la chambre juste à ce moment néfaste; du premier coup d'œil il s'aperçut que j'avais dérangé la symétrie de ses bibelots.... «Et où est le petit flacon de couleur? demanda-t-il; et de quoi te mêles-tu?
—Je l'ai renversé sans le vouloir, et il s'est cassé, répliquai-je. En voilà un malheur!
—Je te prie de ne jamais te permettre de toucher à mes affaires, dit Volodia en rassemblant les morceaux du flacon brisé et en les regardant d'un air désolé.
—Voyez! répondis-je; le grand malheur! j'ai cassé un flacon.... Eh bien, que veux-tu que j'y fasse?»
Et je souris, quoique je n'eusse nullement envie de sourire en cet instant.
«Oui, à toi, cela ne te fait rien, mais à moi cela me fait beaucoup ... continua Volodia en remontant une épaule, geste qu'il avait hérité de mon père et signe de son mécontentement.... Tu l'as cassé ... et tu en ris par-dessus le marché. Quel vilain gamin!
—Moi, je suis un gamin, et toi tu es grand, mais sot!
—Je n'ai nulle envie de dire des injures, répliqua Volodia en me repoussant avec douceur: va-t'en!
—Ne me pousse pas!...
—Va-t'en!...
—Je te dis de ne pas me pousser!»
Volodia me prit par la main et voulut m'éloigner de force de la table; mais j'étais déjà irrité au plus haut degré; je m'emparai du pied de la table, et je la renversai.
«Voilà ce que tu auras gagné à me pousser.»
Tous les brimborions de porcelaine et les ornements en cristal roulèrent à terre en se brisant en éclats.
«Abominable gamin!» s'écria Volodia en s'efforçant de retenir les objets qui glissaient.
«Maintenant, me dis-je en moi-même en sortant de la chambre, tout est fini entre nous, nous sommes brouillés pour la vie.»
De toute la journée pas une parole ne fut échangée entre nous. Je me sentais coupable; je n'osais pas regarder mon frère, et j'étais incapable de m'appliquer à quoi que ce fût. Volodia, au contraire, prit très bien ses leçons, et, après le dîner, selon son habitude, babilla et rit avec les jeunes filles comme si de rien n'était.
Après les classes, quand notre professeur fut parti, je redoutai de rester en tête à tête avec mon frère ... j'avais honte! Dès que la leçon d'histoire fut terminée, je pris mes cahiers et me dirigeai vers la porte. En passant devant Volodia, bien que j'eusse le désir de faire la paix, je boudai, et je fis la moue. Au même instant mon frère leva la tête et me regarda résolument dans les yeux avec un sourire imperceptible et débonnairement moqueur. Nos yeux se rencontrèrent, et je devinai aussitôt que non seulement il m'avait compris, mais qu'il pressentait que je savais qu'il m'avait compris; un sentiment invincible me força de me détourner.
«Cher Nicolas! me dit-il d'une voix naturelle, exempte de tout emphase, c'est assez se quereller: si je t'ai offensé, pardonne-moi.»
Et il me tendit la main.
Une sorte d'étau me serrait la poitrine, me coupait la respiration et, montant toujours, m'étreignait la gorge; cette sensation ne dura qu'une seconde; les larmes me montèrent aux yeux, et je me sentis soulagé.
«Pardonne-moi, Volodia!» dis-je en lui serrant la main.
Mon frère me regarda comme s'il ne pouvait absolument pas comprendre que j'eusse les larmes aux yeux pour si peu de chose.
«Mon Dieu! de la poudre!... s'écria Mimi d'une voix étranglée par l'émotion.—A quoi pensez-vous? vous voulez mettre le feu à la maison? nous faire tous périr?...»
Et, avec un courage d'une fermeté héroïque, Mimi ordonna à tout le monde de s'écarter, tandis qu'elle-même s'avançait d'un pas résolu vers la grenaille répandue à terre et, bravant le danger d'une explosion subite, se mit à la fouler sous ses pieds.
Lorsque, à son idée, le danger fut conjuré, elle appela un homme et lui dit de jeter toute cette poudre le plus loin possible et de préférence dans l'eau. Puis, balançant fièrement son bonnet, elle se dirigea vers le salon en marmottant:
«Ah! oui, ils sont bien gardés ici!»
Quand mon père sortit de son appartement et nous conduisit auprès de ma grand'mère, nous trouvâmes Mimi déjà assise près de la fenêtre; elle regardait devant elle d'un air grave et avec une expression mystérieusement officielle. Elle tenait à la main quelque chose enveloppé dans plusieurs morceaux de papier. Je devinai que c'était le menu plomb, et que grand'mère savait déjà tout.
Il y avait encore dans la chambre la servante Gacha, qui était très agitée et toute rouge de colère, et le médecin Blumenthal, un petit homme au visage un peu grêlé de la petite vérole. Le docteur s'efforçait d'apaiser la femme de chambre en lui faisant à la dérobée, de la tête et des yeux, des signes pacificateurs.
Grand'mère était assise un peu de côté; elle faisait une patience, dite le Voyageur, occupation qui était toujours chez elle un signe de mauvaise humeur.
«Comment vous portez-vous ce matin, maman? demanda mon père en lui baisant respectueusement la main.
—Très bien, mon cher; il me semble que vous savez déjà que je me porte toujours tout à fait bien, répondit grand'mère sur un ton qui semblait indiquer que la question de mon père était aussi déplacée qu'outrageante.... Eh bien! voulez-vous me donner un mouchoir propre? continua-t-elle en s'adressant à Gacha.
—Je vous l'ai déjà donné, répondit la camériste en montrant un mouchoir de batiste blanc comme neige, posé sur le bras du fauteuil où était grand'mère.
—Ma chère, enlevez-moi ce chiffon sale et donnez m'en un propre.»
Gacha s'approcha de la chiffonnière, ouvrit un tiroir et le referma si brusquement que les vitres tremblèrent.
Grand'mère nous jeta à tous un regard sévère et continua de suivre tous les mouvements de la femme de chambre. Lorsque Gacha lui donna le même mouchoir, à ce que je crois, elle reprit:
«Ma chère, quand est-ce que vous me râperez du tabac?
—Dès que j'en aurai le temps, je le râperai.
—Que dites-vous?
—Je le râperai aujourd'hui.
—Ma chère, si vous ne vouliez pas me servir, il fallait le dire plus tôt, je vous aurais depuis longtemps donné votre congé.
—Eh! donnez-le, on n'en pleurera pas,» grommela Gacha entre ses dents.
A ce moment, le médecin lui fit les gros yeux pour la faire taire; mais elle le toisa avec tant de colère et d'un air si décidé, qu'il baissa la tête et se mit à jouer avec sa clé de montre.
«Vous voyez, mon cher, dit grand'mère à mon père, lorsque Gacha sortit de la chambre en marmottant toujours, vous voyez comme on ose me parler dans ma maison?
—Mais permettez-moi, maman, de vous râper moi-même votre tabac, dit papa, que cet appel inattendu semblait jeter dans un grand embarras.
—Je vous remercie, non, cela ne se peut pas. Si elle est aussi insolente, c'est qu'elle sait bien qu'elle seule peut me râper mon tabac à mon goût. Savez-vous, mon cher, continua grand'mère après un silence d'une minute, que vos enfants ont failli mettre le feu à la maison?»
Mon père regarda grand'mère avec une curiosité respectueuse.
«Oui, voyez un peu en quoi consistent leurs joujoux.... Montrez à monsieur ce que vous tenez ... dit-elle en s'adressant à Mimi.
—Mais c'est de la grenaille, maman! dit papa, ce n'est pas du tout dangereux.
—Je vous suis très obligée, mon cher, de me l'apprendre,... je suis déjà si vieille, qu'on peut tout me faire croire!
—Les nerfs, les nerfs!» murmura le médecin.
Mon père se tourna immédiatement vers moi:
«Où avez vous pris cette grenaille? Et comment vous permettez-vous de jouer avec cela?
—Ce n'est pas à eux qu'il faut le demander, mais à leur menin, dit grand'mère en prononçant avec un mépris accentué ce mot menin.—A quoi lui servent ses yeux? je voudrais bien le savoir.
—Volodia m'a dit que Karl Ivanovitch lui a donné lui-même cette poudre, ajouta Mimi.
—Voilà, vous voyez quel excellent gardien vous avez là! continua grand'mère ... et où est-il ce menin ... ce ... comment l'appelle-t-on? Faites-le venir ici.
—Je lui ai permis d'aller voir des amis, repartit mon père.
—Ce n'est pas une raison, il doit toujours être ici.... Ces enfants ne sont pas à moi, mais à vous, et je n'ai pas le droit de vous donner des conseils, parce que vous êtes plus sage que moi;—mais il me semble qu'il est temps qu'ils aient un précepteur, et non plus un menin, un paysan allemand.... Oui, un paysan ignorant qui ne saura leur enseigner que de mauvaises manières et des chants tyroliens. Je vous demande un peu, vos enfants ont-ils besoin de savoir répéter des chants tyroliens?... Mais à quoi bon parler de ces choses?... A présent, il n'y a plus personne pour penser à tout cela, et vous pouvez faire comme bon vous semble.»
A présent voulait dire: maintenant que notre mère était morte; ces paroles évoquèrent de douloureux souvenirs dans le cœur de grand'mère; elle baissa les yeux sur la tabatière ornée du portrait de maman et devint rêveuse.
«Il y a longtemps que je pense moi-même à cela, se hâta de dire mon père, et je voulais vous demander ce que vous en pensiez, maman; si je leur donnais pour gouverneur Saint-Jérôme qui leur donne des leçons au cachet?...
—Tu ferais très bien, mon ami, dit grand'mère, d'une voix toute changée. Saint-Jérôme est au moins un gouverneur qui comprend comment on doit élever des enfants de bonne maison, et non pas un simple menin, qui n'est bon qu'à les accompagner à la promenade.
—Dès demain j'arrangerai tout cela,» répondit mon père.
Deux jours après cette conversation, Karl Ivanovitch céda sa place à un jeune petit-maître français.
Tard dans la soirée, la veille du jour où Karl Ivanovitch devait nous quitter pour toujours, il se tenait debout, près du lit, dans sa robe de chambre ouatée et son bonnet rouge, et, penché sur sa malle, il emballait avec soin ses hardes.
Pendant ces derniers temps, Karl Ivanovitch nous traitait sèchement; il avait l'air de vouloir nous éviter. Ce soir-là, de même, lorsque j'entrai dans la chambre, il se contenta de me regarder du coin de l'œil et continua d'empaqueter ses effets.
Je m'étendis sur mon lit; Karl Ivanovitch, qui me le défendait sévèrement autrefois, ne me dit rien. La pensée qu'il ne nous gronderait plus, qu'il ne serait plus là pour nous empêcher de faire ce que nous voulions, qu'il n'avait désormais plus rien à nous dire, me fit sentir plus vivement l'approche de la séparation. Je ne pouvais croire qu'il eût cessé de nous aimer, et j'eus envie de le lui faire entendre.
«Permettez-moi, Karl Ivanovitch, de vous aider,» dis-je en m'approchant de lui.
Notre «menin» jeta un regard sur moi et se détourna aussitôt; mais, dans ce coup d'œil furtif, je pus lire, au lieu de l'indifférence à laquelle j'attribuais sa froideur, une tristesse vraie et concentrée.
«Dieu sait tout, il voit tout, et tout se fait par sa sainte volonté! dit-il en se redressant de toute sa taille et avec un profond soupir.
«Oui, Nicolinka (cher Nicolas), reprit-il en remarquant que je le regardais les yeux pleins d'une sincère compassion, être malheureux du berceau à la tombe, tel est mon sort. On m'a toujours rendu le mal pour le bien que j'ai fait, et ma récompense me viendra de là! ajouta-t-il en indiquant le ciel.—Si vous connaissiez l'histoire de ma vie, si vous saviez tout ce que j'ai souffert.... J'ai été cordonnier, j'ai été soldat, j'ai été déserteur, fabricant, instituteur, et maintenant je suis zéro! Je n'ai pas un lieu pour abriter ma vieille tête.» Et, fermant les yeux, Karl Ivanovitch se laissa tomber dans un fauteuil.
Je remarquai que Karl Ivanovitch était dans cette humeur sentimentale, qui le rendait expansif et le portait à se raconter à lui-même ses pensées les plus intimes, sans se demander si on l'écoutait ou non. Les yeux toujours fixés sur son bon visage, je m'assis sur le lit.
«Vous n'êtes plus un enfant, vous pouvez me comprendre; je veux vous raconter mon histoire, l'histoire de tout ce que j'ai souffert.... Un jour vous vous rappellerez votre vieil ami, qui vous a beaucoup aimés, mes enfants!»
Karl Ivanovitch appuya son coude sur la petite table qui se trouvait près de lui; il aspira une prise de tabac, et, levant les yeux au ciel, il commença son récit de cette voix toute particulière et gutturale, qu'il prenait d'habitude pour nous faire la dictée:
«Cheai été malheureux tècha dans le sein de mon mère. Das Unglück verfolgte mich schon im schoosse meiner Mutter,» répéta-t-il avec encore plus d'emphase.
Karl Ivanovitch m'a tant de fois depuis raconté son histoire, dans le même ordre, en employant les mêmes expressions, avec les mêmes intonations, que j'espère pouvoir la rendre ici mot à mot; il va sans dire que j'omettrai les incorrections de langage dont j'ai donné un échantillon dans la première phrase de son récit.
Était-ce son histoire véritable ou l'œuvre de son imagination, enfantée dans la solitude de son existence, quand il vivait avec nous à la campagne, et à laquelle il avait fini par croire lui-même à force de la répéter? Ou bien, s'est-il contenté de broder les faits réels de sa vie et d'y ajouter des épisodes fantastiques? Je ne sais pas encore maintenant à quoi m'en tenir là-dessus. D'un côté, il racontait son histoire avec une émotion vraie et un ordre méthodique, deux signes qui semblent attester son authenticité et ne permettent pas de la mettre en doute; mais, d'un autre côté, il y avait beaucoup de traits poétiques dans ce récit, et ces fleurs de rhétorique éveillent en moi quelque doute.
Quoi qu'il en soit à cet égard, voici ce qu'il m'a raconté:
«Dans mes veines coule le sang noble des Sommerblatt! J'avais un frère cadet qui s'appelait Johann; mais j'ai vécu comme un étranger dans ma famille. Quand mon frère Johann faisait des sottises, mon père disait: «Ce Karl ne laisse jamais personne en repos.» Et c'est moi qu'on grondait, et c'est moi qui recevais les coups.
«Quand mes sœurs se querellaient, papa disait: «Ce Karl ne sera jamais obéissant,» et de nouveau j'étais grondé et battu.
«Ma bonne mère était la seule personne qui m'aimât et dont je reçusse des caresses. Elle m'embrassait en cachette. Un jour elle me dit:
«Pauvre, pauvre Karl! personne ne t'aime; mais moi, je ne te changerais contre personne. Ta mère ne te demande qu'une chose: travaille bien, sois toujours un honnête homme, et Dieu ne t'abandonnera pas!»
«Et je travaillai! Quand j'eus quatorze ans révolus et que le moment fut venu de faire ma première communion, ma mère dit à mon père:
«Karl est maintenant un grand garçon; Gustave, que ferons-nous de lui?
«Et mon père répondit: «Je n'en sais rien.» Alors ma mère lui dit:
«Envoyons-le à la ville, et plaçons-le chez M. Schultz pour qu'il apprenne le métier de cordonnier!»
«Et mon père dit: «Bien,» Und mein vater sagte: «Gut,» répéta Karl Ivanovitch, dans sa langue, pour donner plus de poids à ses paroles.
«J'ai passé six ans et sept mois chez le maître cordonnier; il m'aimait beaucoup.
«Un jour il me dit: «Karl, tu es un excellent ouvrier, et un de ces jours tu deviendras contre-maître.» Mais ... l'homme propose et Dieu dispose.... En 1796, on fit la conscription, et tous les jeunes gens de dix-huit à vingt ans qui n'étaient pas exemptés du service militaire devaient aller se présenter à la ville.
«Mon père et mon frère Johann arrivèrent à la ville, et nous allâmes ensemble tirer au sort pour savoir qui serait soldat et qui ne le serait pas. Johann tira un mauvais numéro, il devait être soldat; moi je tirai un bon numéro, je ne devais pas être soldat.
«Et mon père dit:
«J'avais un fils, et je dois m'en séparer.»
«Je pris mon père par la main et je lui dis:
«Pourquoi parlez-vous comme ça, mon père? Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire.»
«Et mon père vint avec moi. Nous entrâmes chez un traiteur et nous nous mîmes à une petite table. Je demandai deux cruches de bière; quand on les eut apportées, nous bûmes chacun un verre; mon frère Johann prit aussi un verre.
«Cher papa, dis-je alors, ne dites plus que vous n'avez qu'un fils et que vous devez vous en séparer; il me semble que mon cœur va éclater quand vous parlez ainsi.... Mon frère Johann ne fera pas le service militaire, moi je serai soldat. Karl n'est nécessaire à personne ici, et Karl sera soldat.
«Vous êtes un honnête homme, Karl,» me dit mon père, et il m'embrassa.
«Et je suis devenu soldat.»
«Nous étions alors dans des temps terribles, cher Nicolas, continua Karl Ivanovitch dans son récit. C'était l'époque de Napoléon.
«Il voulait conquérir l'Allemagne, et nous avions à défendre notre Vaterland jusqu'à la dernière goutte de notre sang.
«J'ai été à Ulm! j'ai été à Austerlitz! j'ai été à Wagram! Ich war bei Wagram!
—Comment, vous aussi vous vous êtes battu? demandai-je avec stupéfaction, en le regardant. Est-ce que vous avez tué des hommes?»
Karl Ivanovitch me rassura immédiatement à ce sujet.
«Un jour un grenadir français était resté en arrière, et il tomba au bord de la route. Je courus sur lui avec mon fusil et je voulus le percer de ma baïonnette; mais le Français rejeta son fusil en arrière et me demanda grâce, et je lui ai laissé la vie.
«A Wagram, Napoléon nous chassa sur une île et nous cerna de telle manière qu'il n'y avait moyen de s'échapper d'aucun côté. Pendant trois jours, nous sommes restés sans vivres et dans l'eau jusqu'aux genoux. Ce scélérat de Napoléon ne se décidait pas à nous faire captifs, et pourtant il nous retenait de force.
«Le quatrième jour, grâce à Dieu, il nous fit prisonniers, et l'on nous mena dans une forteresse. J'étais vêtu d'un pantalon bleu, d'un uniforme de bon drap, et je possédais quinze thalers et une montre en argent, cadeau de mon père. Un soldat français me dépouilla de tout cela. Heureusement pour moi, j'avais conservé sous mon gilet trois ducats que ma mère m'avait donnés. Personne ne m'a ravi cet argent.
«Je ne me souciais pas de rester longtemps dans cette forteresse, et je pris la résolution de m'enfuir. Un jour de grande fête, je dis au sergent qui nous gardait:
«Monsieur le sergent, c'est grande fête aujourd'hui ... je veux la célébrer.... Apportez, je vous prie, deux bouteilles de madère et nous les viderons ensemble.
«Le sergent répondit: «Bien!»
«Quand il eut apporté le madère, après avoir vidé chacun notre verre, je lui pris la main et je lui dis:
«Monsieur le sergent, avez-vous un père et une mère?
«Il me répondit: «Oui, monsieur Mauer, j'ai un père et une mère.»
«Mon père et ma mère,—dis-je alors,—ne m'ont pas vu depuis huit ans, et ils ne savent pas si je vis encore ou si mes os ne reposent pas depuis longtemps dans la froide terre. Oh! monsieur le sergent! j'ai deux ducats que j'ai cachés dans mon gilet, prenez-les et rendez-moi la liberté. Soyez mon bienfaiteur, et ma mère priera tous les jours Dieu pour vous.
«Le sergent prit un second petit verre de madère, et me dit:
«Monsieur Mauer, je vous aime beaucoup et je vous plains; mais vous êtes prisonnier, et moi je suis soldat.
«Je lui serrai la main et je lui dis: «Monsieur le sergent!»
«Et le sergent me dit: «Vous n'êtes pas riche, et je ne prendrai pas votre argent, mais je viendrai à votre aide. Lorsque j'irai me coucher, achetez un barillet d'eau-de-vie, donnez-le aux soldats, et ils s'endormiront. Moi, je fermerai les yeux.»
«Le sergent était un brave homme. J'achetai un barillet d'eau-de-vie, et, quand les soldats furent ivres, je mis mes bottes, un vieux manteau, et je sortis tranquillement dans la cour. Je me dirigeai vers le rempart, et je me disposais à le franchir, lorsque je m'aperçus qu'il était tout entouré d'eau; je ne voulais pas salir les seuls habits qui me restaient. Je me décidai à sortir par la porte.
«La sentinelle avec son fusil montait la garde en se promenant. Elle me regarda et me cria tout à coup: «Qui vive?»
«Je me tus.
«Qui vive?» dit encore une fois la sentinelle.
«Je gardai toujours le silence.
«Qui vive?» répéta la sentinelle pour la troisième fois.
«Alors je courus, je sautai dans l'eau, et je sortis de l'autre côté, puis je repris ma course.
«Je ne m'arrêtai pas de toute la nuit, et, quand il fit jour, dans la crainte d'être reconnu, je me cachai dans les seigles hauts. Alors je me mis à genoux, je rendis grâce à Dieu qui m'avait sauvé, et je m'endormis paisiblement.
«Je me réveillai le soir, et je continuai ma route. Tout à coup un grand fourgon allemand, attelé de deux chevaux noirs, me rejoignit. Dans le fourgon était assis un homme bien mis; il fumait une pipe et me regardait. Je me mis à marcher très lentement pour laisser la voiture prendre les devants; mais plus je marchais lentement, plus la voiture ralentissait sa marche, et l'homme me regardait toujours. Je m'assis sur le bord de la route, l'homme fit arrêter ses chevaux sans cesser de me regarder.
«Jeune homme, me dit-il, où allez-vous si tard?
«J'ai répondu que j'allais à Francfort.
«—Venez dans mon fourgon, il y a de la place, je vous y conduirai. Mais pourquoi n'avez-vous pas d'effets avec vous, et votre barbe n'est-elle point rasée, et vos vêtements sont-ils couverts de boue? ajouta-t-il quand je pris place à ses côtés.
«—Je suis un pauvre ouvrier, répondis-je, je voudrais trouver du travail dans une usine: mes habits sont crottés parce que je suis tombé sur la route.
«—Vous ne dites pas la vérité, jeune homme, dit l'inconnu: il n'y a pas de boue sur la route.
«Je ne répondis pas.
«—Avouez-moi toute la vérité, me dit ce brave homme. Qui êtes-vous? d'où venez-vous? Votre figure me plaît, et, si vous êtes un honnête garçon, je vous viendrai en aide.
«Je lui avouai tout.
«Il dit: «C'est bien, jeune homme, venez à ma fabrique de cordes: je vous donnerai du travail, des vêtements, de l'argent, et vous vivrez chez moi.»
«Et je dis: «Bien!»
«Arrivés à la fabrique de cordes, ce brave homme dit à son épouse: «Voici un jeune homme qui s'est battu pour sa patrie et qui s'est sauvé de prison; il n'a ni abri, ni vêtements, ni pain. Il vivra chez moi. Donne-lui du linge propre et sers-lui à manger.»
«Je suis resté un an et demi dans cette fabrique, et mon maître avait tant d'affection pour moi, qu'il ne voulait plus que nous nous séparions. Mais ce n'était pas pour finir mes jours chez des étrangers, loin de mon pays, que je m'étais évadé des mains des Français. Je m'arrachai à ce bien-être, et, un soir, quand tout le monde fut couché, j'écrivis une lettre à mon patron, où je lui avouais les angoisses de mon esprit et le remerciais de ses bontés. Je posai cette lettre sur la table de ma chambre; je rassemblai mes vêtements, je pris trois thalers en argent, et je sortis sans bruit dans la rue.
«Personne ne me vit, et je pus suivre tranquillement la grande route.»
«Je n'avais pas vu ma mère depuis neuf ans, et je ne savais pas si elle était encore vivante. Je retournai dans mon pays. Quand je me trouvai de nouveau dans ma terre natale, je demandai où demeurait Gustave Mauer, fermier chez le comte de Sommerblatt.
«Et l'on me répondit: «Le comte de Sommerblatt est mort, et Gustave Mauer habite la grand'rue, où il tient une échoppe de liqueurs.»
«Je revêtis mon gilet neuf, ma belle redingote,—un cadeau du fabricant de cordes,—je lissai soigneusement mes cheveux et je me rendis à l'échoppe de mon père. Ma sœur Mariechen était dans la boutique et me demanda ce que je désirais.
«Puis-je boire un petit verre de liqueur? répondis-je.
«—Père! cria-t-elle, voici un jeune homme qui demande un petit verre de liqueur.
«Mon père dit alors:
«Donne au jeune homme un petit verre de liqueur.
«Je m'assis à une table, je bus mon petit verre, je fumai ma pipe et j'observai mon père, Mariechen et mon frère Johann, qui entra aussi dans la boutique.
«Dans le cours de la conversation, mon père me dit:
«—Jeune homme, ne savez-vous pas où se trouve actuellement notre armée?
«—Je reviens moi-même de l'armée, répondis-je; dans ce moment elle est près de Vienne.
«—Notre fils, dit alors mon père, était soldat, et voici déjà neuf ans qu'il ne nous a écrit, et nous ne savons pas s'il est mort ou s'il vit encore. Ma femme ne cesse de le pleurer.
«Je continuai de fumer ma pipe et je dis:
«—Comment s'appelait votre fils et dans quel régiment a-t-il servi? je le connais peut-être.
«—On l'appelait Karl Mauer et il servait dans les chasseurs autrichiens, répondit mon père.
«—Il est de grande taille, un bel homme comme vous! ajouta ma petite Mariechen.
«—Je connais votre Karl, leur dis-je alors.
«—Amalia! s'écria soudain mon père, venez, il y a ici un jeune homme qui connaît notre Karl.
«Et ma mère accourut de l'autre chambre. Je la reconnus au premier coup d'œil.
«—Vous connaissez notre Karl? demanda-t-elle en me regardant toute pâle et tremblante....
«—Oui, je l'ai vu, répondis-je, sans oser lever les yeux sur elle. Mon cœur semblait vouloir bondir hors de ma poitrine.
«—Mon Karl vit? Où est-il, mon cher Karl? répétait-elle. Je mourrais tranquille si je pouvais voir encore une fois mon fils chéri». Et ma mère se mit à pleurer.
«Je n'y pouvais plus tenir:
«Ma mère, m'écriai-je, je suis votre Karl!»
«Et ma mère tomba dans mes bras.»
Karl Ivanovitch ferma les yeux, et ses lèvres tremblèrent.
Revenu à lui, il répéta encore une fois sa dernière phrase et essuya de grosses larmes qui roulaient sur ses joues.
Puis il termina son récit dans ces termes:
«Mais Dieu n'a pas permis que je finisse mes jours dans ma patrie. Je suis né pour être malheureux. Je n'ai passé que trois mois avec mes parents.
«Un dimanche, je me trouvais dans un café, devant une cruche de bière et je fumais tranquillement ma pipe en causant politique avec des amis; nous parlions de l'empereur Frantz, de Napoléon, de la guerre, et chacun disait son opinion.
«Près de nous se trouvait un inconnu en paletot gris; il prenait une tasse de café, fumait une pipe et ne disait mot.
«Lorsque le veilleur cria: «Dix heures!» je pris mon chapeau, je payai ma consommation et je rentrai à la maison. A minuit on frappa à notre porte. Je me réveillai et je demandai: «Qui est là?»
«—Ouvrez!
«-Je répétai: «Dites qui vous êtes, j'ouvrirai ensuite.»
«—Ouvrez au nom de la loi!»
«J'ouvris. Deux soldats armés de fusils restèrent à ma porte, et dans ma chambre entra l'inconnu au paletot gris, qui se trouvait près de moi au café.
«C'était un espion! Es war ein Spion!
«Suivez-moi, dit l'espion.
«—Bon,» répondis-je.
«Je passai mes bottes, und pantalon, je mis mes bretelles. J'arpentai là chambre, mon cœur bouillonnait; je me disais: «C'est un lâche!» Quand je me trouvai devant le mur où mon épée était suspendue, je la saisis tout à coup et je criai:
«Tu es un espion, défends-toi.»
«Je lui donnai un coup à droite, un coup à gauche et un sur la tête. Der Spion tomba!
«Je saisis ma malle et mon argent, et je sautai par la fenêtre.
«J'arrivai à Ems, où je fis la connaissance d'un général russe, M. Sasine. Il me prit en affection, me fit donner un passe-port et m'emmena en Russie comme précepteur de ses enfants.
«Quand le général Sasine fut mort, votre mère me fit venir et me dit:
«Karl Ivanovitch! Je vous confie mes enfants, aimez-les, et je ne vous abandonnerai jamais. J'assurerai votre vieillesse.»
«Elle n'est plus, et tout est oublié. Pour reconnaître mes vingt années de service, on me chasse aujourd'hui, un vieillard, dans la rue, m'envoyant chercher un morceau de pain sec....
«Dieu voit tout et sait tout, et telle est sa volonté; seulement je vous regretterai beaucoup, vous, mes enfants!» dit Karl Ivanovitch en terminant son récit. Il me prit par la main, m'attira vers lui et me baisa la tête.
Au bout de la première année de deuil, grand'mère commença à se remettre un peu de la douleur qui l'avait accablée et donna de temps en temps de petites réceptions, invitant de préférence des enfants de notre âge.
Elle invita à dîner, pour fêter le jour de naissance de ma sœur, la princesse Kornakova avec ses filles, Madame Valakine avec Sonitchka, Ilinka Grapp et nos deux jeunes amis Ivine.
Toute la société était déjà réunie au salon, et le murmure des voix, des éclats de rires, le bruit des allées et venues montaient jusqu'à notre salle d'étude au premier. Nous ne pouvions descendre avant la fin de nos leçons.
Sur le tableau suspendu dans notre chambre de classe nous pouvions lire: Lundi, de deux à trois heures, maître d'Histoire et de Géographie.
Et nous devions rester là jusqu'à l'arrivée de notre professeur, prendre la leçon, le reconduire, avant d'être libres.
Il était déjà deux heures et vingt minutes, et le maître d'histoire ne faisait pas son apparition dans la rue. Je le guettais de la fenêtre avec un secret et vif désir de ne pas l'apercevoir.
«On dirait que M. Lebedeff (le professeur d'histoire) ne viendra pas aujourd'hui? dit Volodia en posant pour une minute le livre où il apprenait sa leçon.
—Je le souhaite de tout mon cœur, répondis-je ..., car je ne sais rien. Mais il me semble que je l'entends....» ajoutai-je sur un ton de déception.
Volodia se leva et s'approcha de la fenêtre.
«Non, ce n'est pas lui, c'est un monsieur, dit-il. Attendons-le jusqu'à deux heures et demie, ajouta-t-il en s'étirant.» Et il se gratta le sommet de la tête, comme il le faisait toujours quand il se reposait durant le travail.
«S'il n'est pas ici à la demie, nous demanderons à Saint-Jérôme la permission de serrer nos cahiers.
—Et quel plaisir peut-il trouver à venir?» dis-je en m'étirant de même, et je balançai au-dessus de ma tête mon livre d'histoire que je tenais des deux mains.
Bientôt, par désœuvrement, j'ouvris le livre à l'endroit désigné pour la leçon, et je me mis à lire. Il y avait beaucoup à apprendre, et c'était difficile. Je n'en savais pas le premier mot, et je voyais qu'il me serait impossible d'en retenir quoi que ce fût, d'autant plus que je me trouvais dans cet état d'agitation qui empêche l'esprit de se fixer sur une chose quelconque.
La leçon d'histoire me semblait toujours la plus ennuyeuse et la plus ardue de toutes nos leçons. La dernière fois, mon professeur s'était plaint à Saint-Jérôme et m'avait marqué dans le carnet de notes un 2, ce qui voulait dire: très mal! Saint-Jérôme m'avait déclaré que, si j'avais moins de trois à la prochaine leçon, je serais sévèrement puni. Aussi j'avoue que, ce jour-là, j'avais peur.
Cependant, je m'absorbai si bien dans ma lecture, que le bruit des galoches déposées dans l'antichambre me prit à l'improviste. J'eus à peine le temps de me retourner pour voir apparaître sur le seuil le visage grêlé du professeur. Il était revêtu de son habit bleu, orné de boutons de métal surmontés de l'aigle impérial, qui est l'uniforme de l'université russe.
Il posa lentement sa toque sur la fenêtre, ses cahiers sur la table, écarta de ses deux mains les pans de son habit (comme s'il était besoin de tant de façons) et, après avoir repris haleine, il s'assit à sa place.
«Eh bien! messieurs, dit-il, en frottant l'une contre l'autre ses mains moites; répétons d'abord ce qui a été dit à notre dernière leçon, et ensuite je tâcherai de vous décrire les événements du moyen âge qui ont suivi.»
Tout cela voulait dire: récitez votre leçon.
Pendant que Volodia répondait avec la liberté d'esprit et l'assurance que donne le sentiment qu'on possède bien sa leçon, je me glissai comme une ombre sur l'escalier. Tout à coup, je me trouvai en face de Mimi, qui était toujours la cause de tous mes chagrins. Elle s'avança vers moi en disant:
«Vous ici?» et elle me regarda d'un air sévère.
Je me sentais coupable au plus haut degré; je baissai la tête et gardai le silence, tout en témoignant dans toute mon attitude une contrition touchante.
«Mais à quoi pensez-vous? dit Mimi. Que faites-vous ici?.»
Je me taisais toujours.
«Non, cela ne se passera pas ainsi, répéta-t-elle en frappant du revers de son doigt la balustrade de l'escalier; je le dirai à la comtesse....»
Quand je revins en classe, il était déjà trois heures moins cinq minutes. Le professeur, comme s'il n'avait remarqué ni mon absence ni mon retour, continua sa leçon pour Volodia. Quant il eut fini ses commentaires, il commença à plier ses cahiers. Mon frère passa dans la pièce voisine pour prendre le cachet. J'eus la satisfaction de me dire que mon maître m'avait oublié et que j'avais échappé à ses questions.
Mais tout à coup il me dit avec un demi-sourire perfide:
«J'espère que vous avez bien préparé votre leçon? Et il se frotta les mains.
—Oui, je l'ai préparée, répondis-je.
—Dans ce cas, veuillez me parler un peu de la croisade de Saint-Louis, continua-t-il en se balançant sur sa chaise et en regardant ses bottes d'un air absorbé. Vous me direz d'abord quelles causes ont obligé le roi de France à prendre la croix? reprit-il en relevant les sourcils et en montrant du doigt l'encrier; ensuite vous m'indiquerez les traits généraux et caractéristiques de cette croisade, ajouta-t-il en faisant un geste de toute la main, comme s'il voulait saisir quelque chose; enfin, il frappa la table à gauche avec son cahier. Vous me direz quelle a été d'une manière générale l'influence de cette croisade sur les différents états en Europe; puis, quelle a été l'influence de cette croisade sur la France,» dit-il pour finir, en frappant à droite sur la table avec son cahier et en inclinant la tête du même côté.
J'avalai plusieurs fois ma salive, je me raclai le gosier, je penchai la tête sur l'épaule et je me tus. Puis je pris une plume d'oie qui se trouvait sur la table, et je me mis à la déchiqueter, toujours sans rien dire.
«Passez-moi cette plume! me dit le professeur en tendant la main. Elle peut encore servir. Eh bien?»
Je commençai:
—Lou ... roi ... Saint-Louis était un ... était ... était un bon et sage tzar.
—Comment?
—Un tzar.... Il conçut l'idée d'aller à Jérusalem, et laissa les rênes du gouvernement à sa mère....
—Comment s'appelait-elle....
—Bou ... B ... lanche....
—Comment? Boulanche?»
Je souris de travers et gauchement.
«Eh bien! qu'est-ce que vous savez encore?» dit mon maître ironiquement.
Je ne pouvais pas empirer l'état des choses, je me mis à tousser de nouveau et à dire tout ce qui me passait par la tête.
Le professeur restait silencieux, époussetait la table avec la barbe de la plume, me regardait fixement de côté et répétait:
«Bien! très bien!...»
Je sentais que je ne savais rien, que je parlais Dieu sait comment! et je souffrais horriblement de ce que le professeur ne m'interrompait ni ne me reprenait.
«Pourquoi Saint-Louis a-t-il conçu l'idée d'aller à Jérusalem? demanda-t-il en répétant mes paroles.
—Parce que ... car ... pour....»
Je m'embrouillais de plus en plus; cette fois je restai court, et je sentais que, lors même que le professeur continuerait à se taire pendant une année, je n'aurais pas le pouvoir d'articuler un son.
Mon maître me considéra ainsi pendant trois minutes environ; puis, tout à coup, son visage exprima une profonde tristesse, et il dit d'une voix pénétrée à Volodia qui venait d'entrer dans la salle:
«Passez-moi le carnet; je veux marquer les notes.»
Volodia lui passa le carnet et posa délicatement le cachet à côté.
Le professeur ouvrit le carnet, trempa soigneusement sa plume; puis, de sa plus belle main, il mit à Volodia 5 pour la conduite et 5 pour l'étude; c'était le maximum.
Ensuite, posant sa plume sur ma colonne de notes, il me regarda, secoua la plume pour jeter le trop plein d'encre et resta pensif.
Tout à coup sa main fit un mouvement imperceptible ... et j'aperçus dans ma colonne le joli chiffre 1, puis un point; ensuite il répéta le même mouvement sur la colonne de la conduite, qui présenta comme l'autre le chiffre 1, suivi d'un point.
Le professeur referma le carnet avec soin, se leva, se dirigea vers la porte, sans avoir l'air de remarquer le regard plein de désespoir, de supplication et de reproche que je lui lançai.
«Monsieur le professeur! balbutiai-je....
—Non, répondit-il, devinant ce que j'allais dire:—Non, ce n'est pas ainsi qu'on étudie. Je ne veux pas recevoir de l'argent que je n'ai pas gagné.»
Il mit ses galoches, son manteau de camelot, et s'emmitoufla dans son cache-nez de manière à défier le vent.
Et je me demandais comment, après ce qui venait de m'arriver, on pouvait encore penser à s'emmitoufler. Pour lui ce n'était donc qu'un trait de plume, et pour moi ce trait de plume était un grand malheur.
«Est-ce que la leçon est finie? demanda Saint-Jérôme qui entrait dans la salle.
—Oui, monsieur.
—Le professeur a-t-il été content?
—Oui, répondit Volodia.
—Combien avez-vous reçu?
—Cinq.
—Et Nicolas?»
Je gardai le silence.
«Il me semble, quatre,» dit Volodia.
Mon frère avait compris qu'il fallait à tout prix me sauver du châtiment le jour où nous avions du monde.
«Voyons, messieurs, (Saint-Jérôme avait l'habitude de dire: voyons, à chaque mot) faites votre toilette et descendons.»
Aussitôt après notre entrée au salon, à peine les saluts d'usage échangés, nous passâmes dans la salle à manger.
Mon père était très en train. Il avait fait cadeau à Lioubotchka d'un riche service en argent. Au dessert, il se souvint tout à coup qu'il avait oublié chez lui une bonbonnière préparée pour l'héroïne de la fête.
«Va me la chercher, Colas, me dit-il, pour ne pas envoyer un domestique. Tu trouveras les clés sur la grande table, dans la coquille; tu sais ce que je veux dire?... Prends les clés, choisis la plus grande et ouvre le second tiroir à droite. Dans ce tiroir tu trouveras une boîte et les bonbons dans un sac. Apporte-moi tout cela.
—Et des cigares? veux-tu que je t'en apporte aussi? demandai-je, sachant qu'il avait l'habitude de les envoyer chercher après le dîner.
—Apporte-les si tu veux; mais prends garde de rien toucher dans mon cabinet,» cria-t-il comme je sortais de la salle.
Je trouvai les clés à la place indiquée; j'allais déjà ouvrir le tiroir, lorsque je fus saisi d'une envie folle d'essayer une toute petite clé qui faisait partie du trousseau.
Contre la galerie de la table, au milieu d'une foule d'objets de toutes sortes, était appuyé un portefeuille muni d'un cadenas; c'est là que je résolus d'essayer la petite clé. Ma tentative réussit à souhait, et tout un tas de papiers divers m'apparut.
La curiosité me poussait à lire ces papiers. Ce sentiment lutta en moi contre celui du respect que je portais à mon père. A mes yeux, mon père vivait dans une sphère à part, qui lui appartenait en propre et qui était trop haute pour être accessible à un enfant comme moi. Pris tout à coup de terreurs à l'idée de l'indiscrétion que j'allais commettre, et qui me semblait maintenant un sacrilège, je refermai le portefeuille le plus vite possible; mais il paraît que j'étais destiné à subir en ce jour néfaste tous les malheurs imaginables.
Après avoir introduit la petite clé dans la serrure, je la tournai dans le mauvais sens; croyant le cadenas fermé, je retirai la clé.... Oh! horreur! je n'avais plus dans la main que la tête de la petite clé. C'est en vain que je m'efforçai de la faire tenir sur la moitié qui était restée dans la serrure, espérant sans doute qu'elle en sortirait par un enchantement. Mais non, il fallait m'habituer à l'horrible idée que j'allais passer pour avoir commis un nouveau crime, qui serait découvert le jour même, lorsque mon père rentrerait dans son cabinet.
Ainsi, dans cette terrible journée, Mimi aurait porté plainte contre moi à grand'mère! J'avais reçu une mauvaise note, et cassé cette petite clé! Que pouvait-il m'arriver de plus?
Pas plus tard que ce même soir, j'aurais à répondre à grand'mère à cause du rapport de Mimi, à Saint-Jérôme, à cause de la mauvaise note, et à mon père pour l'affaire de la clé.
Et tout cela en un seul jour!
«Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Oh! oh, oh, oh!.... qu'ai-je fait? qu'ai-je fait? me répétais-je tout haut en marchant à grands pas sur le tapis moelleux qui recouvrait la pièce. Hélas! m'écriai-je, en prenant les bonbons et les cigares: «On n'échappe pas à sa destinée!» Et je courus à la salle à manger.
Cette sentence fataliste, que j'ai entendu prononcer dans mon enfance à notre menin Nicolas, m'a toujours fait du bien et n'a jamais manqué de me calmer au moment décisif, dans les circonstances les plus pénibles de ma vie.
Quand je me retrouvai au salon, j'étais très excité, et d'une gaieté qui n'était pas naturelle.
Après le dîner, les jeux commencèrent, et j'y pris une part active.
Pendant que nous jouions «au chat et à la souris», je courus par maladresse contre l'institutrice des Kornakoff, qui s'amusait avec nous, et, sans le vouloir, je déchirai sa robe. Je remarquai que les jeunes filles, et Sonitchka en particulier, furent enchantées de voir l'institutrice sortir du salon d'un air contrarié pour aller faire recoudre sa jupe dans la chambre des couturières. Je résolus aussitôt de procurer une seconde fois ce plaisir à mes jeunes amies.
Pour exécuter cet aimable dessein, dès que l'institutrice fut rentrée au salon, je me mis à gambader autour d'elle et me livrai à ces évolutions, jusqu'à ce que j'eusse réussi à mettre le pied sur sa robe et à la déchirer de nouveau. Sonitchka et les princesses eurent toutes les peines du monde à s'empêcher de rire, ce qui flatta énormément mon amour-propre. Mais Saint-Jérôme, qui avait, à ce qu'il paraît, deviné mon espièglerie, s'approcha de moi en fronçant les sourcils, menace que je ne pouvais pas souffrir, me déclara que ma gaieté bruyante n'annonçait rien de bon, et que, si je ne parvenais pas à la modérer, il saurait m'en faire repentir, bien que ce fût un jour de fête.
Je me trouvais dans cet état d'exaspération dans lequel tombe un joueur qui a mis sur le tapis plus qu'il n'avait dans sa poche et qui, de crainte de compter ses pertes, continue à mettre des cartes sans avoir la moindre espérance de regagner ce qu'il a perdu, mais jouant simplement pour ne pas se donner le temps de réfléchir.
C'est pourquoi je répondis à mon gouverneur par un sourire insolent, et je m'éloignai de lui.
Après «le chat et la souris,» ce fut le tour d'un autre jeu que nous avions surnommé «le pied de nez». Nous placions deux rangs de chaises en face l'un de l'autre, et les dames et les cavaliers se partageaient en deux camps, chaque dame choisissant le cavalier qui lui plaisait.
La plus jeune des princesses prenait toujours le plus jeune des frères Ivine; Katienka donnait alternativement la préférence à Volodia ou à Ilinka Grapp; quant à Sonitchka, elle choisissait à tous les tours Serge Ivine, et, à ma vive surprise, ne témoignait aucune confusion lorsque Serge venait d'emblée s'asseoir vis-à-vis d'elle, avant qu'elle l'en eût prié.
Elle riait, de sa voix sonore et harmonieuse, et l'approuvait d'un signe de tête pour montrer qu'il avait deviné son intention. Moi, personne ne me choisissait; je comprenais que j'étais de trop, celui qui restait, dont personne ne voulait et dont on devait dire chaque fois: «Quel est celui qui reste? Ah! Nicolinka.... Eh bien! prends-le, toi!» Et mon amour-propre était cruellement mortifié.
Aussi, quand c'était à moi de me présenter devant une dame, j'allais tout droit à ma sœur ou à la plus laide des petites princesses, et, pour mon malheur, je ne me trompais jamais.
Sonitchka avait l'air de s'occuper de Serge au point d'en oublier jusqu'à mon existence.
Je ne sais de quel droit je l'appelais dans ma pensée «une traîtresse,» car elle ne m'avait jamais promis de me choisir de préférence à Serge; mais j'étais tout à fait convaincu qu'elle se conduisait envers moi de la façon la plus coupable.
Le jeu terminé, je remarquai que cette traîtresse, que je vouais au mépris sans pouvoir détacher mes yeux de sur elle, s'était mise à l'écart avec Katienka et Serge, dans un coin, et qu'ils discutaient quelque chose d'un air de mystère.
Je me glissai derrière le piano à queue pour surprendre leur secret; et voici le tableau qui frappa mes yeux:
Katienka tenait un mouchoir de batiste par les deux bouts au-dessus de la tête de Serge et de Sonitchka:
«Non, vous avez perdu, il faut s'exécuter,» disait Serge.
Sonitchka, les bras retombants, restait debout devant lui comme une coupable, et rougissait en disant:
«Non, je n'ai pas perdu, n'est-ce pas, Katienka?
—Par amour de la vérité, je dois te dire, ma chère, que tu as perdu ton pari.»
Katienka avait à peine prononcé ces paroles, que Serge se pencha vers Sonitchka et l'embrassa!...
Et Sonitchka se mit à rire, comme si ce n'était rien, comme si c'était une plaisanterie!
N'est-ce pas horrible!!! Oh! l'astucieuse traîtresse!
Alors je ressentis un mépris profond pour toutes les jeunes filles en général et pour Sonitchka en particulier; je découvris tout à coup qu'il n'y avait rien de divertissant dans ces jeux, et qu'ils étaient bons pour amuser de vilaines gamines. Je fus pris aussitôt d'un désir irrésistible de me conduire mal et de commettre une espièglerie si forte qu'elle ébahirait tout le monde.
L'occasion de me signaler ne se fit pas attendre.
Je vis Saint-Jérôme tenir un conciliabule avec Mimi, puis sortir du salon; j'entendis ses pas d'abord sur l'escalier, puis au-dessus de nos têtes, s'acheminer dans la direction de la salle d'étude.
Je supposai que Mimi avait raconté à mon gouverneur qu'elle m'avait rencontré dans le corridor pendant ma leçon, et qu'il était allé regarder le carnet de notes.
Dans ce moment, je me figurais que l'unique but de Saint-Jérôme dans cette vie était de trouver un prétexte pour me punir.
Sous l'influence de ces mauvaises pensées, je perdis la faculté de réfléchir, et, lorsque Saint-Jérôme revint et, s'approchant de moi, me dit que je n'avais pas le droit de me trouver au salon, que je devais monter immédiatement, à cause de ma conduite pendant la leçon d'histoire et de la mauvaise note que j'avais reçue, je lui tirai la langue en déclarant que je ne sortirais pas du salon.
Au premier moment, mon gouverneur ne trouva pas un mot, saisi de stupéfaction et de colère.
«C'est bien!» dit-il enfin, et il me prit le bras.
«Je vous ai déjà menacé plus d'une fois du châtiment dont votre grand'mère a voulu vous sauver; mais je vois qu'il n'y a que la verge qui puisse vous faire obéir; aujourd'hui vous l'avez richement méritée....»
Il prononça cette sentence si haut que tout le monde l'entendit.
Le sang afflua vers mon cœur avec une force extraordinaire; je sentais ses battements, je sentais que mes joues pâlissaient et qu'un tremblement convulsif agitait mes lèvres.
Je devais être terrible à voir; Saint-Jérôme, évitant mon regard, s'approcha vivement de moi et s'empara de ma main; mais, à peine eus-je senti le contact de ses doigts, que je fus pris d'une telle irritation que ma fureur ne connut plus de bornes; j'arrachai ma main de son étreinte et je lui appliquai un coup, de toute ma force d'enfant.
«Mais qu'est-ce qui te prend? me dit à l'oreille Volodia, saisi d'effroi et de stupeur devant cet acte de rébellion.
—Laisse-moi, lui criai-je à travers mes larmes; personne de vous ne m'aime ... vous ne comprenez pas combien je suis malheureux! Vous êtes tous vilains!» ajoutai-je, dans une sorte de délire, en m'adressant à toute la compagnie.
A ce moment, mon gouverneur, pâle, mais résolu, s'approcha de nouveau de moi. Avant que j'eusse le temps de me mettre sur la défensive, mes deux mains furent prises comme dans un étau, et il m'entraîna hors du salon.
La tête me tournait d'émotion; je me souviens seulement de m'être débattu en désespéré de la tête et des genoux, tant que j'en eus la force. Je me rappelle que plus d'une fois mon nez frotta contre son pantalon; je mordis sa redingote; il me semblait que de tous côtés je rencontrais ses pieds, tandis qu'à l'odeur de la poussière se mêlait celle de la violette dont Saint-Jérôme se parfumait.
Cinq minutes plus tard, les portes de la chambre de débarras se refermèrent sur moi.
«Vassili! cria Saint-Jérôme, d'une voix de triomphe. Apporte-moi-la verge.»
Aurais-je jamais pu croire, à cet instant, que je survivrais à tous ces malheurs, et qu'un jour je pourrais les évoquer tranquillement?
En me rappelant tous mes méfaits je ne pouvais m'imaginer ce que je deviendrais; cependant j'avais un vague pressentiment que j'étais perdu sans retour.
Au premier abord, un silence absolu régna autour de moi et dans toute la maison; ou, tout au moins, la violence de mes émotions m'empêchait d'entendre quoi que ce fût; peu à peu je commençai à distinguer des bruits divers.
Vassili monta, jeta sur le rebord de la fenêtre de ma prison un objet qui ressemblait à un balai, puis il s'étendit en bâillant sur un coffre.
Ensuite j'entendis en bas un murmure de voix (évidemment on parlait de moi) et ensuite des cris d'enfants, des rires, des courses ici et là; et, quelques minutes plus tard, tout rentrait dans le silence, la maison reprenait son train ordinaire, comme si personne ne savait que j'étais enfermé dans ce réduit obscur, et personne ne se souciait de moi.
Je ne pleurais pas, mais je sentais quelque chose de lourd sur mon cœur, comme une pierre.
Une foule de pensées et d'images passaient plus rapides que l'éclair dans mon imagination troublée; le souvenir de mes malheurs interrompait sans cesse leur chaîne capricieuse, et de nouveau, dans l'ignorance du sort qui m'attendait, en proie au désespoir et à la crainte, je m'égarais dans un labyrinthe sans issue.
Tantôt je me disais que l'antipathie générale, la haine que tout le monde me témoignait, devaient avoir une cause quelconque. (En ce moment j'étais persuadé que tous dans la maison, à commencer par grand'mère et à finir par le cocher Philippe, me détestaient et se délectaient de mes souffrances.) Non, me disais-je, sans doute je ne suis pas le frère de Volodia, je suis un malheureux orphelin qu'on a recueilli par pitié, et cette idée saugrenue, non seulement me procura une triste consolation, mais elle me parut tout à fait vraisemblable.
Il m'était agréable de penser que j'étais malheureux, non par ma propre faute, mais parce que c'était mon sort depuis le jour de ma naissance, comme pour le pauvre Karl Ivanovitch.
«Mais à quoi bon m'en faire un mystère, pensais-je, puisque je suis arrivé à le pénétrer moi-même?... Eh bien! demain j'irai trouver papa, et je lui dirai:
«Papa, il est inutile de vouloir me cacher le secret de ma naissance, je l'ai deviné.»
Et papa répondra:
«Que puis-je faire, mon ami? oui, tôt ou tard tu devais le découvrir,—tu n'es pas mon fils, je t'ai adopté, mais, si tu te montres digne de mon affection, je ne t'abandonnerai jamais.»
Alors je lui dirai:
«Papa, bien que je n'aie pas le droit de t'appeler de ce nom, mais je le prononce pour la dernière fois, je t'ai aimé, et je t'aimerai toujours! Je n'oublierai jamais que tu es mon bienfaiteur! mais je ne puis plus rester chez toi. Ici personne ne m'aime, et Saint-Jérôme a juré de m'exterminer. Un de nous, lui ou moi, nous quitterons ta maison parce que je ne peux plus répondre de moi; je hais cet homme profondément; je me sens capable de tout! Je l'exterminerai. (Oui, je dirai cela): papa, je l'exterminerai!»
Papa me suppliera de n'en rien faire; mais moi, je ferai un grand geste, et je répondrai:
«Non, mon ami, mon bienfaiteur, nous ne pouvons plus vivre ensemble, laissez-moi partir.»
Puis je l'embrasserai, et je lui dirai:
«Oh! mon père! mon bienfaiteur! donne-moi pour la dernière fois ta bénédiction, et que la volonté de Dieu soit faite!»
Et, à cette pensée, je sanglote assis sur un coffre dans l'obscur réduit.
Puis, tout à coup, je me rappelle le honteux châtiment qui m'attend; la réalité apparaît à mes yeux sous son jour véritable, et tous mes rêves s'effacent en un clin d'œil.
Bientôt, pourtant, mes songes recommencent; je me vois déjà en liberté et hors de ma famille. Je me fais hussard et je pars pour la guerre. De tous côtés les ennemis fondent sur moi, je brandis mon sabre, et j'en tue un; encore un coup de sabre, et un second ennemi tombe raide, puis un troisième de même. Enfin, exténué de fatigue, couvert de blessures, je glisse sur la terre et je crie: «Victoire!» Un général à cheval se dirige vers moi et dit: «Où est notre libérateur?» On me désigne, alors il se jette à mon cou en versant des larmes et crie: «Victoire!»....
Me voilà remis de mes blessures, et je me promène sur le boulevard de Tver, à Moscou, le bras en écharpe soutenu par un mouchoir de couleur noire. Je suis général! Le Tzar vient au-devant de moi et demande qui est ce jeune homme couvert de blessures? On lui répond que c'est le célèbre héros Nicolas!—Le Tzar s'approche de moi et me dit: «Je te remercie, et je t'accorde tout ce que tu me demanderas!»
Je salue respectueusement le Tzar, et, m'appuyant sur mon sabre, je lui dis:
«Je suis heureux, grand Tzar, d'avoir pu verser mon sang pour ma patrie, et j'aurais voulu mourir pour elle; mais, puisque tu me fais la grâce de souffrir que je t'adresse une prière, je te supplie de permettre que j'extermine mon ennemi, l'étranger, Saint-Jérôme. Je veux exterminer mon ennemi Saint-Jérôme.»
Alors je me tourne vers Saint-Jérôme, et je lui dis d'un ton sévère: «Tu as fait mon malheur, à genoux!»
Mais, hélas! juste à cet heureux moment, je me rappelle qu'à chaque instant le véritable Saint-Jérôme peut entrer avec la verge, et je ne suis plus un général qui sauve son pays, mais l'être le plus misérable et le plus piteux de toute la terre.
Ou bien encore je me figurais que j'étais mort de chagrin, et je me représentais sous de vives couleurs le saisissement de Saint-Jérôme en trouvant à ma place un corps privé de vie.
Puis je me rappelais ce que Nathalia Savichna m'avait dit, que l'âme d'un mort hante la maison pendant quarante jours. Et je me voyais, invisible à tous, errant après ma mort dans les différentes pièces de la maison; j'entendais les larmes sincères de Lioubotchka, les regrets de grand'mère et les reproches que mon père adressait à Saint-Jérôme.
Papa disait, les larmes aux yeux:
«C'était un brave garçon!
—Oui, répondait Saint-Jérôme, mais un très grand polisson....
—Vous devriez avoir plus de respect pour les morts, interrompait papa, c'est vous qui l'avez fait mourir de peur; il n'a pas eu la force de supporter l'humiliation que vous lui réserviez.... Je vous chasse, scélérat!...»
Et Saint-Jérôme courbe le front et implore le pardon de mon père.
Après quarante jours, mon âme s'envole au ciel, et là je distingue une forme blanche, transparente et longue, et j'ai le sentiment que c'est ma mère. Cette forme blanche m'enveloppe, me caresse; cependant j'éprouve une inquiétude, je ne la reconnais pas entièrement.
«Si c'est toi, lui dis-je, découvre-moi ton visage que je puisse t'embrasser.
Et sa voix me répond: «Ici nous sommes tous ainsi, et il n'est pas en mon pouvoir de t'embrasser plus fort. Est-ce que tu ne te trouves pas bien ici?
—Oui, je suis très bien ... mais tu ne peux plus me caresser, et je ne peux pas baiser tes mains.
—Ce n'est pas nécessaire,» répond maman.
Et je sens qu'elle a raison et qu'on est très bien comme cela; puis, il me semble que nous nous envolons ensemble dans les airs, plus haut, toujours plus haut.
A ce moment, je me réveille, et je me retrouve sur le coffre, dans le cabinet noir, avec des joues humides de larmes, sans une idée quelconque, et me répétant: «Et nous nous envolons ensemble dans les airs, plus haut, toujours plus haut.»
Je me donne beaucoup de peine pour m'expliquer ma situation; mais je ne vois autour de moi que des ténèbres et un avenir encore plus noir. Je m'efforce d'évoquer de nouveau mes beaux rêves joyeux que la conscience de la réalité a mis en fuite; mais, à ma grande surprise, à mesure que j'essaie de rentrer dans la voie des songes envolés, je découvre qu'il m'est impossible de les continuer, et, ce qui m'étonne encore davantage, ils ne me procurent plus aucun plaisir.
J'ai passé la nuit dans mon cachot, et personne n'est venu me voir; ce n'est que le lendemain, qui était un dimanche, qu'on me transporta dans une petite chambre à côté de la salle d'étude, où l'on m'enferma de nouveau.
J'eus une lueur d'espoir: mon châtiment se bornerait peut-être à la prison.... Un brillant soleil dansait sur les vitres, la rue avait repris son mouvement accoutumé, et bientôt un doux sommeil vint me réconforter. Sous ces diverses influences, mon esprit s'apaisa quelque peu. Mais la solitude est toujours dure à supporter; j'avais envie de bouger, d'épancher dans une âme compatissante tout ce que j'avais sur le cœur; hélas! pas un être vivant ne m'approchait. Ce qui rendait ma situation plus intolérable, c'est que j'entendais dans la salle voisine le pas régulier de Saint-Jérôme. Il sifflait des refrains joyeux. J'étais certain qu'il n'avait nulle envie de chanter, et qu'il ne le faisait que pour me tourmenter.
A deux heures, Saint-Jérôme et Volodia descendirent chez grand'mère, et Nicolas apporta mon dîner. Je le retins pour lui avouer tous mes méfaits et l'entretenir de mes appréhensions.
«Eh! monsieur, me dit-il, «à force d'aller mal tout ira bien»....
Cet adage m'a souvent soutenu dans la suite, et, dans cette circonstance, il m'aurait un peu consolé si je n'avais eu un autre sujet d'inquiétude: on m'avait envoyé un dîner complet, rien n'y manquait, pas même du gâteau, et je me dis que, si j'étais en punition, on ne m'aurait envoyé que du pain et de l'eau; je devais comprendre par là que mon châtiment n'avait pas encore commencé, et qu'on se contentait de me séquestrer comme un être nuisible.
Pendant que j'étais plongé dans la solution de ce problème, la clé tourna dans la serrure de ma chambre, et Saint-Jérôme, le visage sévère et officiel, entra chez moi: «Venez chez votre grand'mère,» dit-il sans me regarder.
Avant de sortir, je voulus brosser ma manche que j'avais frottée contre de la craie; mais mon gouverneur me dit que c'était tout à fait superflu. Il me considérait donc comme un être si dégradé, qu'il ne valait plus la peine de s'inquiéter de son apparence.
Quand je traversai la salle d'étude, Katienka, Lioubotchka et Volodia me regardèrent exactement comme nous regardions les prisonniers qu'on menait tous les lundis sous nos fenêtres; l'expression était tout à fait la même.
Grand'mère était assise dans son fauteuil; quand je m'approchai d'elle pour lui baiser la main, elle la retira sous sa mantille en détournant la tête.
Il y eut un assez long silence, durant lequel grand'mère m'examina de la tête aux pieds, en fixant sur moi un regard si scrutateur, que je ne savais où mettre mes yeux, ni que faire de mes bras. Enfin elle prit la parole:
«Oui, mon cher, je peux dire que vous vous montrez sensible à mon amour et que vous êtes pour moi une véritable consolation; monsieur Saint-Jérôme, qui, à ma demande—continua-t-elle en traînant sur chaque mot,—a bien voulu se charger de votre éducation, ne veut plus rester dans ma maison. Pourquoi? A cause de vous, mon cher.»
Il y eut une pause très courte, et elle reprit d'un ton qui ne permettait pas de douter que ce speech n'eût été préparé d'avance:
«J'avais espéré que vous lui seriez reconnaissant pour ses soins et ses peines, et que vous sauriez apprécier ses services, mais vous! un gamin! vous avez osé lever la main sur lui.... Très bien! Fort beau! Je commence à croire aussi que vous n'êtes pas capable d'apprécier les bonnes manières et que, pour vous, il faut avoir recours à d'autres procédés plus humiliants.... Demande pardon, tout de suite, dit-elle d'une voix sévère et impérieuse, en indiquant Saint-Jérôme:—Tu entends ce que je te dis?»
Je suivis des yeux la direction que prenait la main de grand'mère, et, ayant aperçu la redingote de Saint-Jérôme, je me détournai sans bouger de ma place. Je sentais mon cœur défaillir.
«Eh bien! vous n'entendez pas ce que je dis?»
Je tremblais de tout mon corps, mais je ne fis pas un mouvement.
«Colas! dit grand'mère, qui avait évidemment deviné mes souffrances intérieures,—Colas! répétà-t-elle d'une voix plutôt tendre qu'impérative. Est-ce bien toi?
—Grand'mère! Je ne demanderai pas pardon, pour rien au monde!» m'écriai-je; et je demeurai interdit.
Je sentais que, si je prononçais encore un mot, je ne pourrais plus retenir les larmes qui m'étoufffaient.
«Je te l'ordonne ... je t'en prie.... Eh bien!
—Je ... je ... ne ... veux ... je ne peux ... dis-je avec effort, et les sanglots refoulés brisèrent leurs digues et débordèrent de ma poitrine dans un flot désespéré.
—C'est ainsi que vous obéissez à votre seconde mère?... C'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés? dit Saint-Jérôme d'un ton tragique; à genoux!
—Mon Dieu! si elle le voyait en ce moment! s'écria grand'mère, et elle se détourna pour essuyer ses larmes.—Si elle le voyait?... Non, elle n'aurait pas eu la force de supporter cette épreuve!»
Et grand'mère pleurait toujours avec violence.
Je pleurais aussi fort, mais j'étais bien décidé à ne pas demander pardon.
«Tranquillisez vous, au nom du ciel! Madame la Comtesse,» disait Saint-Jérôme.
Mais grand'mère ne l'entendait plus; elle enfouit son visage dans ses deux mains, et ses sanglots se transformèrent bientôt en une crise de nerfs.
Gacha et Mimi accoururent dans la chambre, l'air terrifié, et bientôt toute la maison fut'sens dessus dessous.
«Admirez votre ouvrage, me dit Saint-Jérôme en me reconduisant en haut.
—Mon Dieu! qu'ai-je fait! Quel criminel je suis!» me disais-je avec horreur.
Saint-Jérôme m'ordonna de rentrer dans ma chambre, et il retourna auprès de grand'mère. A peine m'eut-il quitté que je m'élançai, sans réfléchir à ce que je faisais, sur le grand escalier qui conduisait à la rue.
Avais-je vraiment l'intention de me sauver, de me noyer?... je ne me le rappelle pas, je sais seulement que je courais en bas de l'escalier en me cachant le visage pour ne voir personne.
«Où vas-tu? cria tout à coup une voix familière,... justement, c'est toi que je cherche.»
Une main s'avançait vers moi, je voulus lui échapper; mais mon père me saisit le bras en disant sévèrement:
«Viens avec moi, mon cher!—Comment as-tu osé toucher le portefeuille dans mon cabinet? dit-il en me traînant dans la petite chambre aux divans.
«Ah! tu ne réponds pas! Eh? ajouta-t-il en me pinçant l'oreille.
—Pardonne-moi, répondis-je: je ne sais pas moi-même ce qui m'a pris....
—Ah! tu ne sais pas ce qui t'a pris? Tu ne sais pas?... tu ne sais pas ... tu ne sais pas!... répétait-il en me tirant l'oreille à chaque mot: Tu apprendras à l'avenir à fourrer ton nez où il n'a rien à faire? Tu apprendras ... tu apprendras....»
Bien que je ressentisse une vive cuisson à l'oreille, je ne pleurais pas, j'éprouvais même un sentiment de bien-être moral. A peine eut-il lâché mon oreille, que je saisis sa main et je la couvris de baisers en fondant en larmes.
«Frappe-moi encore, dis-je à travers mes sanglots, encore plus fort, que cela me fasse encore plus mal, je suis un vaurien, un vilain, un malheureux....
—Qu'as-tu? me dit-il en me repoussant avec douceur.
—Non, je ne m'en irai pas, pour rien au monde, dis-je en m'accrochant à sa redingote; tout le monde me hait, je le sais; mais, pour l'amour de Dieu! écoute-moi, défends-moi ou chasse-le! Je ne peux pas vivre avec lui, il s'ingénie de toutes manières pour m'humilier; il m'ordonne de me mettre à genoux devant lui, il veut me fustiger. Je ne peux pas supporter cela; je ne suis plus un tout petit garçon, je ne le supporterai pas, je mourrai.... Il a dit à grand'mère que je suis un vaurien, et maintenant elle est malade ... elle mourra à cause de moi ... je t'en prie ... fais-moi donner le fouet ... mais,—qu'on ne me ... tourmente ... plus....»
Les larmes m'étouffaient. Je me laissai tomber sur le divan, n'ayant plus la force de parler, et ma tête se renversa sur les genoux de mon père; il me semblait que j'allais mourir.
«Mais d'où vient tout ce désespoir, mon gros joufflu? dit mon père d'un ton compatissant et en se penchant sur moi.
—Il est mon tyran,... il me tourmente ... j'en mourrai ... personne ne m'aime!» eus-je à peine la force de dire. Les derniers mots se perdirent dans des convulsions.
Papa me prit dans ses bras et me porta dans ma chambre à coucher.
Je tombai dans un profond sommeil.
Quand je me réveillai, la soirée était déjà très avancée; une bougie était placée près de mon lit, et dans l'autre chambre j'entrevis notre médecin, Mimi et Lioubotchka. On pouvait lire sur leur visage qu'ils étaient très inquiets de ma santé. Moi, au contraire, je m'éveillais, après un sommeil de douze heures, si frais et si dispos, que j'aurais volontiers sauté hors du lit, si je n'avais pas eu du plaisir à laisser croire aux autres que j'étais réellement malade.
Je ne veux pas suivre heure par heure mes souvenirs d'adolescence; je me contenterai de jeter un coup d'œil sur les principaux événements de ma vie, depuis les scènes que je viens de raconter jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de l'homme extraordinaire qui a exercé une influence définitive et bienfaisante sur mon caractère et mes idées.
Volodia doit entrer bientôt à l'Université. Les professeurs lui donnent des leçons particulières, et j'écoute avec envie, saisi d'un respect involontaire, pendant que mon frère frappe allègrement le tableau noir avec la craie et parle avec aisance de fonctions, de sinus, de racines etc., etc. qui me semblent être l'expression d'une science inaccessible à mon intelligence.
Enfin, un dimanche, il y eut une grande réunion, après le dîner, dans la chambre de grand'mère. Tous nos maîtres et deux professeurs de l'Université firent subir à Volodia une répétition de son examen d'admission; Volodia, à la grande joie de grand'mère, fit preuve de connaissances peu ordinaires.
On me posa aussi quelques questions sur différentes branches; mais je fus très faible dans mes réponses, et les professeurs firent tout leur possible pour dissimuler à grand'mère mon ignorance, ce qui n'aboutit qu'à augmenter ma confusion.
D'ailleurs on m'accorda fort peu d'attention, je n'avais que quinze ans, et il me restait encore une année pour me préparer à l'examen de l'Université.
A dater de cette première épreuve, Volodia change de manière de vivre; il ne descend que pour le dîner. Il passe la journée et la soirée entières à étudier en haut, non par nécessité, mais parce que c'est son plaisir. Il a beaucoup d'ambition et ne veut pas se contenter de faire un examen passable; il veut s'en tirer avec éclat.
Enfin, le jour de son premier examen est arrivé. Volodia revêt un habit bleu orné de boutons de bronze; il a sa montre d'or et des bottes vernies; le phaéton de mon père l'attend devant le perron. Nicolas jette en arrière le tablier de cuir, et Volodia et Saint-Jérôme montent en voiture.
Les jeunes filles, Katienka surtout, suivent de la fenêtre, d'un air ravi, la svelte personne de Volodia qui prend place dans l'équipage. Papa dit: «Que Dieu l'accompagne!» Grand'mère, qui s'est traînée jusqu'à la croisée, fait des signes de croix sur le phaéton, jusqu'à ce qu'il ait disparu dans la ruelle, et murmure quelque chose.
Volodia revient. Tout le monde le questionne à la fois avec impatience:
«Comment?... Bien?... Quelle note as-tu?»
Mais on peut lire déjà sur son joyeux visage que tout s'est bien passé. Volodia a obtenu cinq (le maximum).
Le lendemain il retourne à l'Université accompagné des mêmes craintes, des mêmes vœux, et on attend son retour avec la même impatience.
Neuf jours passent ainsi; le dixième, Volodia doit traverser l'épreuve la plus difficile, le catéchisme. Tout le monde est à la fenêtre, et on l'attend avec un redoublement d'impatience.
Il est déjà deux heures, et le phaéton n'apparaît pas.
«Les voilà! les voilà!» crie enfin Lioubotchka qui ne bougeait pas de son poste d'observation.
En effet Volodia était assis dans le phaéton, à côté de Saint-Jérôme; mais son habit bleu et sa casquette grise sont remplacés déjà par l'uniforme d'étudiant au col bleu brodé de galons; sa tête est coiffée d'un tricorne, et il a une épée au côté.
En l'apercevant, grand'mère s'écria:
«Ah! si au moins elle avait vécu pour le voir ainsi.»
Et elle s'évanouit.
Volodia accourut le visage rayonnant, il m'embrassa plusieurs fois, puis il embrassa Lioubotchka, Mimi et Katienka qui rougit jusqu'aux oreilles.
Volodia est hors de lui de bonheur. Comme il est beau dans cet uniforme! Comme ce col bleu fait ressortir le duvet naissant qui souligne ses lèvres! Quelle taille fine et haute! et quelle noblesse dans la démarche!
Pour fêter ce jour mémorable, le dîner eut lieu dans la chambre de grand'mère. La joie brillait sur tous les visages; au dessert, le maître d'hôtel apporta majestueusement, avec une gaieté respectueuse, une bouteille de champagne enveloppée dans une serviette. C'était la première fois qu'on débouchait une bouteille de champagne chez grand'mère depuis la mort de maman; grand'mère vida son verre, félicita encore une fois Volodia et pleura de joie en le regardant.
A partir de ce jour mon frère eut son équipage à lui, reçut ses amis dans son appartement particulier, se mit à fumer et alla au bal.
Cependant il dînait toujours à la maison, et, après le repas, comme autrefois, venait s'asseoir dans la chambre des divans et avait de longs et mystérieux entretiens avec Katienka; je ne prenais aucune part à ces conversations qui avaient pour sujet,—à ce que j'ai pu comprendre—les livres qu'ils lisaient; ils discutaient les mérites des héros et des héroïnes, leurs goûts, leurs préférences, le penchant de leur caractère. Je ne voyais nullement ce qu'ils pouvaient trouver d'intéressant dans ces longues causeries, ni pourquoi ils souriaient si finement dans l'ardeur de la discussion.
Katienka a seize ans; elle a grandi; les formes anguleuses, la timidité et la gaucherie, qui caractérisent les jeunes filles pendant qu'elles traversent l'âge ingrat, ont fait place à une grâce harmonieuse; c'est la fleur à peine entr'ouverte, dans toute sa fraîcheur. Et, cependant, Katienka n'a pas changé; elle a toujours les mêmes yeux bleu clair et le même regard souriant, le même petit nez sans inflexion qui forme presque une ligne droite avec le front, avec de fortes narines, une bouche mignonne au sourire lumineux, les mêmes petites fossettes dans les joues roses au teint transparent, les mêmes menottes blanches ... et, comme auparavant, le surnom de proprette lui sied à merveille.
Il n'y a de nouveau chez elle que l'épaisse tresse rousse qu'elle porte maintenant comme les grandes filles.
Bien que Lioubotchka ait été élevée avec Katienka et qu'elles aient grandi ensemble, ma sœur est une jeune fille toute différente de son amie.
Lioubotchka est petite de taille; à la suite d'une maladie d'enfant, elle est restée avec les jambes courbes, les pieds en dedans et un buste disgracieux. Il n'y a dans toute sa personne que les yeux qui soient beaux; mais les yeux sont admirables—grands, noirs, avec quelque chose de sérieux, de naïf, d'innocent, de plein de charme dans le regard. Il est impossible de ne pas les remarquer.
Lioubotchka est toujours simple et naturelle. Katienka veut toujours faire de l'effet.
Lioubotchka regarde toujours en face, et quelquefois il lui arrive, lorsqu'elle arrête ses immenses yeux noirs sur quelqu'un, de les tenir attachés si longtemps, qu'on la gronde en lui disant qu'elle n'est pas polie. Katienka, au contraire, baisse tout de suite les paupières et cligne des yeux. Elle assure qu'elle est myope; mais je suis sûr qu'elle y voit on ne peut mieux.
Lioubotchka n'aime pas à faire des manières devant les étrangers, et, lorsque quelqu'un lui fait des amitiés devant le monde, elle se fâche et répond qu'elle n'aime pas les effusions. Katienka, au contraire, lorsqu'il y a des visites, devient très affectueuse pour Mimi, et elle aime à se promener dans le salon en tenant une amie par la taille.
Lioubotchka est une grande rieuse, et, dans ses accès de rire, elle agite les mains et court dans toute la chambre; Katienka, au contraire, porte son mouchoir ou sa main sur sa bouche quand elle commence à rire.
Lioubotchka se tient toujours droite lorsqu'elle est assise et marche les bras pendants; Katienka tient la tête un peu de côté et marche les mains jointes.
Lioubotchka est toujours mécontente lorsque Mimi la serre trop dans son corset et se plaint en disant: «Mais je ne peux pas respirer!» et elle aime à manger. Katienka, au contraire, glisse souvent son doigt sous le col de sa robe pour montrer qu'elle est au large dans son corsage, et elle mange très peu.
Lioubotchka dessine volontiers la tête; Katienka préfère les fleurs et les papillons.
Lioubotchka joue avec beaucoup de netteté les concertos de Field et quelques sonates de Beethoven. Katienka exécute des variations et des valses en ralentissant la mesure, plaque des accords, met sans cesse la pédale et prélude toujours par trois arpèges qu'elle donne avec sentiment.
Malgré tout, Katienka me semblait plus grande demoiselle et m'agréait mieux que Lioubotchka.
Papa est très content depuis que Volodia est entré à l'Université; il vient beaucoup plus souvent dîner chez grand' mère.
Il lui arrive même de venir passer un moment avec nous avant d'aller au cercle; souvent il s'assied au piano, nous réunit autour de lui, et, tout en frappant la mesure avec le bout de ses bottes molles (il détestait les talons et n'en portait jamais), il nous chante des airs bohémiens.
Il fallait voir les transports de rire de Lioubotchka. Elle est la favorite de papa, et elle l'adore.
Parfois il vient dans la salle d'étude et, d'un air sévère, écoute comment je débite mes leçons.
Quelquefois, lorsque grand'mère commence à gronder et à se fâcher contre tout le monde, sans raison, papa nous fait des signes à la dérobée et nous dit plus tard: «On nous a bien arrangés aujourd'hui, mes enfants!»
Une fois, il entra au salon où nous étions, très tard dans la soirée. Il était en habit noir et en gilet blanc; il attendait Volodia, qui s'habillait en ce moment, pour le conduire au bal. Grand'mère s'était retirée dans sa chambre. Volodia devait se rendre chez elle. Chaque fois qu'il allait dans le monde, elle le faisait venir pour passer en revue sa toilette, le bénir et lui faire des recommandations.
Ce soir-là, une seule lampe éclairait le salon. Mimi et Katienka se promenaient de long en large, et Lioubotchka était au piano en train d'étudier le second concerto de Field, le morceau favori de maman.
Je n'ai jamais vu une ressemblance de famille plus accentuée que celle qui existait entre ma sœur et ma mère.
Cette ressemblance n'était pas dans le visage, ni dans le teint, ni dans les traits, mais résidait en quelque chose d'insaisissable; on la trouvait dans les mains, dans la démarche et surtout dans la voix et dans quelques façons de s'exprimer.
Quand Lioubotchka se fâchait, elle disait: «Voilà tout un siècle qu'on me dérange!» «Tout un siècle!» était le mot de maman. Lioubotchka le prononçait exactement comme elle; en l'entendant il nous semblait ouïr notre mère. Cette ressemblance s'accusait lorsque Lioubotchka se mettait au piano, dans la manière dont elle arrangeait les plis de sa robe, dont elle tournait les feuillets avec sa main gauche et en les prenant d'en haut. Enfin, quand elle s'embrouillait dans un passage difficile, comme maman, elle donnait un petit coup de poing sur le clavier en s'écriant: «Ah! mon Dieu!» Elle avait le même jeu que ma mère, net, et d'une douceur inexprimable, ce beau toucher de Field appelé si justement «le jeu perlé» et que tous les tours de force de nos virtuoses modernes ne feront pas oublier.
Mon père était entré au salon à petits pas pressés; il s'approcha de Lioubotchka, qui se leva du piano en l'apercevant.
«Non, continue Liouba, continue, dit-il en la faisant asseoir sur le tabouret: tu sais que j'aime à t'entendre.»
Lioubotchka se remit à jouer, et papa resta assis en face d'elle, la tête appuyée sur sa main; au bout d'un moment il remonta une épaule, selon son geste familier, se leva et se mit à marcher en long et en large. Chaque fois qu'il se rapprochait du piano, il s'arrêtait et regardait longuement et fixement Lioubotchka. Je reconnus, à sa démarche et à son attitude, qu'il était ému.
Après avoir plusieurs fois arpenté le salon, il s'arrêta derrière la chaise de ma sœur, posa un baiser sur sa tête brune; puis, tournant avec vivacité sur ses talons, il continua sa promenade.
Lorsque Lioubotchka, après avoir terminé son morceau, s'approcha de lui pour lui demander si elle avait bien joué, il prit doucement la tête de ma sœur entre ses mains et la baisa au front et sur les yeux avec une effusion de tendresse dont je ne l'aurais pas cru capable.
«Ah mon Dieu! tu pleures? s'écria tout à coup la jeune fille en lâchant la chaîne de montre de mon père et en fixant sur son visage de grands yeux étonnés:—Pardonne-moi, cher papa, j'avais tout à fait oublié que c'était le morceau de maman.
—Non, mon amie, joue-le aussi souvent que possible, dit-il d'une voix tremblante d'émotion; tu ne peux pas savoir comme cela me fait du bien de pleurer près de toi.»
Il l'embrassa encore une fois en faisant des efforts pour dominer son émotion, et, relevant l'épaule encore plus haut, il sortit du salon pour se rendre à la chambre de Volodia.
Grand'mère devient de jour en jour plus faible; sa sonnette, la voix revêche de Gacha et le bruit des portes qui tapent ne cessent pas dans sa chambre; elle ne nous reçoit plus dans son boudoir, assise en son fauteuil voltaire, mais autour de son lit élevé, soutenue par des oreillers garnis de dentelles.
Quand je m'approche d'elle pour lui souhaiter le bonjour, j'aperçois sur sa main une tache jaune, pàle et luisante, et il règne dans la chambre la même odeur lourde que j'ai sentie, il y a cinq ans, dans la chambre de ma mère.
Le médecin vient trois fois par jour, et il y a eu déjà plusieurs consultations. La malade n'a pas changé de caractère; elle gronde toujours son entourage et surtout papa; elle traîne sur certains mots et dit: «Mon cher.»
Mais voici déjà quelques jours qu'on ne nous laisse plus entrer chez elle.
Un matin, au milieu d'une leçon, Saint-Jérôme vint me proposer de faire une promenade en traîneau avec ma sœur et Katienka.
En montant en traîneau, je vois que la rue est couverte de paille sous les fenêtres de grand'mère et que des inconnus en manteaux bleus se tiennent devant la maison. Malgré cet indice, je ne devine pas pourquoi on nous fait sortir à une heure aussi indue.
Ce jour-là, pendant toute la promenade, nous nous trouvons, ma sœur et moi, dans cet état de folle gaieté où tout devient un prétexte pour rire. Un marchand ambulant saisit son plateau et traverse la rue en courant, et nous partons d'un éclat de rire. Un cocher, conduisant une haridelle, secoue les guides et veut nous devancer,—et de rire. Le fouet de Philippe s'accroche sous le traîneau et il se retourne en disant: «Eh ma!» et nous nous tenons les côtes à force de rire.
Mimi déclare d'un ton mécontent qu'il n'y a que les sots qui rient sans cause, et Lioubotchka, toute rouge de rire contenu, me regarde à la dérobée; nos yeux se rencontrent, et nous éclatons d'un rire fou qui nous met des larmes dans les yeux; impossible de retenir les accès d'hilarité qui nous étouffent.
A peine sommes-nous un peu calmés, que je répète la phrase sacramentelle qui est à la mode chez nous depuis quelque temps, et qui ne manque jamais de produire une explosion de gaieté.
En revenant, lorsque nous nous trouvons devant la maison, comme j'ouvre la bouche pour faire à Lioubotchka une belle grimace, mes yeux tombent sur le couvercle noir d'une bière appuyée contre un des battants de la porte cochère. Et, tout saisi, je reste la bouche ouverte.
Saint-Jérôme vient à notre rencontre, le visage pâle:
«Votre grand'mère est morte,» nous dit-il.
Peu de personnes pleurent sincèrement grand'mère. Il y en a une dont la douleur violente m'a frappé au plus haut degré; il s'agit de Gacha, la femme de chambre de grand'mère.
Elle s'est enfermée au grenier et ne cesse pas de sangloter, de s'arracher les cheveux; elle refuse toute consolation et déclare que la mort seule pourra adoucir la perte de sa maîtresse chérie.
Mais j'ai souvent remarqué que les sentiments sont d'autant plus sincères qu'ils paraissent plus invraisemblables.
Grand'mère n'est plus; mais sa mémoire est toujours vivante au milieu de nous, et son nom revient toujours dans nos entretiens. On parle surtout beaucoup de son testament, dont personne n'a eu connaissance, à l'exception de l'exécuteur testamentaire, le prince Ivan Ivanitch.
Une certaine effervescence s'est produite parmi les gens de grand'mère; on se demande à qui reviendront tous ses biens, et j'avoue que j'éprouve un mouvement de plaisir involontaire en pensant que nous allons recueillir un héritage.
Six semaines plus tard, Nicolas, qui colporte toujours toutes les nouvelles de la maison, m'apprend que grand'mère a laissé toute sa propriété à ma sœur Lioubotchka, qui aura pour tuteur, jusqu'à l'époque de son mariage, le prince Ivan Ivanitch, et non pas mon père.
Il ne me reste plus que quelques mois avant d'entrer à l'Université. J'étudie avec zèle. Maintenant j'attends mes professeurs sans appréhension, et même je prends un certain plaisir à mes leçons.
J'aime à répéter clairement et distinctement une leçon que j'ai apprise avec soin. Je me prépare pour la faculté des mathématiques, et, à vrai dire, ce choix a été déterminé par le prestige des termes: sinus, tangente, calcul différentiel, calcul intégral, etc., etc., qui exercent sur moi une attraction toute particulière.
Je suis beaucoup plus petit que Volodia, j'ai les épaules larges, beaucoup de muscles, mais je suis aussi laid que par le passé, ce qui me chagrine toujours autant.
Je pose pour l'original. Une seule chose me console, c'est que papa a dit un jour de moi: «Il a un museau intelligent!» Et je n'en doute pas.
Saint-Jérôme est content de moi; il me donne des éloges, et je ne le déteste plus; même lorsqu'il me dit: «qu'avec mon talent, mon esprit, il est honteux de ne pas faire ceci ou cela». Il me semble que je l'aime maintenant.
D'une manière générale, je commence à me corriger de mes défauts d'adolescent, à l'exception d'un seul, le plus grand, celui qui doit me procurer encore bien des ennuis dans cette vie, l'amour de raisonner.
Dans la société des amis de Volodia, je jouais un rôle insignifiant, qui froissait beaucoup mon amour-propre; cependant j'aimais à me tenir dans sa chambre lorsqu'il avait du monde, et à observer, sans mot dire, tout ce qui se passait.
Il recevait souvent l'adjudant Doubkof et un étudiant, le prince Neklioudof.
Doubkof n'était plus de la première jeunesse; c'était un petit homme brun, musculeux, les jambes un peu courtes, mais en somme pas trop mal bâti et toujours très gai.
C'était un de ces hommes un peu bornés, qui sont agréables en société pour cette raison; ils ne sont pas capables d'embrasser une question sous toutes ses faces, ils ne voient qu'un côté et s'enflamment facilement.
Leurs jugements sont toujours exclusifs et faux, mais toujours sincères et enthousiastes.
Même, je ne sais pourquoi, on est porté à leur pardonner leur égoïsme étroit et à le trouver agréable.
Doubkof avait en outre à nos yeux, à mon frère et à moi, le prestige de son port martial et de son âge. Les très jeunes gens prennent volontiers l'allure posée, que donnent quelques années de plus, pour l'air comme il faut dont on fait grand cas à cet âge.
D'ailleurs Doubkof était, en réalité, ce qu'on peut appeler un homme comme il faut.
Une seule chose m'était pénible: Volodia avait toujours l'air de rougir devant Doubkof de mes bévues les plus innocentes, et surtout de ma trop grande jeunesse.
Neklioudof n'était pas beau; il avait de petits yeux gris, un front bas et droit; la longueur démesurée de ses bras et de ses jambes n'ajoutait pas à l'élégance de ses proportions. Il n'avait de bien que sa taille élevée, la délicatesse de son teint et ses dents éblouissantes. Mais, grâce à ses yeux bridés et luisants et à l'expression changeante du sourire, ce visage était tour à tour sévère, ou enfantin et indécis, ce qui lui donnait un caractère énergique et original qui attirait tout de suite l'attention.
Je remarquai qu'il était très réservé, parce que la moindre plaisanterie le faisait rougir jusqu'aux oreilles; mais sa timidité ne ressemblait pas à la mienne. Plus il rougissait, plus sa physionomie exprimait de résolution et de hardiesse, comme s'il était fâché contre lui-même à cause de sa faiblesse.
Bien qu'il parût très lié avec Volodia et Doubkof, il était facile de voir que le hasard seul les avait réunis. Leurs idées étaient tout à fait opposées.
Volodia et Doubkof redoutaient par-dessus tout la sentimentalité et toute conversation sérieuse; Neklioudof, au contraire, était enthousiaste au plus haut degré, et souvent, malgré les railleries de ses amis, il se mettait à philosopher sur toutes sortes de questions et de sentiments.
Volodia et Doubkof parlaient volontiers de leurs préférences et aimaient en même temps les mêmes personnes et jusqu'à deux à la fois; Neklioudof, au contraire, s'emportait tout de bon lorsqu'on se permettait une allusion à ses inclinations.
Volodia et Doubkof s'amusaient souvent à tourner en ridicule leurs proches. Neklioudof était hors de lui si l'on s'avisait de faire la plus légère plaisanterie sur sa tante, pour laquelle il avait une affection passionnée.
Le prince Neklioudof m'avait frappé à première vue par son extérieur et par sa conversation. C'est peut-être parce que ses idées ressemblaient trop aux miennes, que le sentiment que j'ai ressenti, en le voyant pour la première fois, n'était rien moins qu'amical.
Je lui en voulais pour son regard prompt, sa voix ferme, son air altier, par-dessus tout pour l'indifférence absolue qu'il manifestait pour ma personne.
Souvent, j'avais une envie folle de le contredire au milieu d'une conversation. J'aurais voulu, pour le punir de son dédain, l'emporter sur lui dans la discussion et lui prouver que je ne manquais pas d'esprit, bien qu'il ne consentît pas à s'occuper de moi; mais la timidité me retenait.
Le soir, lorsque ma dernière leçon fut finie, je montai, selon mon habitude, auprès de mon frère. Je le trouvai étendu, les pieds sur le divan, accoudé et la tête appuyée sur sa main; il lisait un roman français. Il leva la tête pour une seconde, me jeta un coup d'œil et se replongea dans sa lecture. Rien de plus simple, ni de plus naturel que ce mouvement, et cependant j'en fus froissé.
Il me semblait que ce regard voulait dire: Pourquoi Nicolas est-il venu? Et, puisqu'il avait aussitôt baissé la tête, c'est qu'il ne voulait pas me laisser voir que ma visite l'ennuyait.
Ce besoin de donner de l'importance aux choses les plus insignifiantes était un des traits caractéristiques de mon adolescence.
Je m'approchai de la table, et je pris un livre; mais, avant de l'ouvrir, il me vint à l'idée que c'était très comique de rester ainsi sans échanger une parole, lorsque mon frère et moi, nous ne nous étions pas vus de toute la journée.
«Est-ce que tu sors ce soir? demandai-je.
—Je ne sais pas; pourquoi?
—Je l'ai demandé comme ça,» répondis-je. Et voyant que la causerie ne prenait pas, je me mis à lire.
Chose étrange, lorsque nous étions seuls, nous pouvions rester des heures entières sans échanger un mot; mais il suffisait de la présence d'un tiers, même silencieux, pour que la conversation la plus intéressante et la plus variée s'établît entre nous.
C'est que, livrés à nous-mêmes, nous sentions que nous nous connaissions trop bien; se connaître trop ou pas assez est également nuisible à l'intimité.
Je lisais depuis un moment, lorsque la voix de Doubkof retentit dans l'antichambre:
«Volodia est-il chez lui?
—Il est chez lui!» répondit Volodia en retirant ses pieds du divan et en posant son livre.
Doubkof et le prince Neklioudof entrèrent dans la chambre avec leurs manteaux et leurs chapeaux.
«Eh bien! est-ce que nous allons au théâtre, Volodia?
—Non, je n'ai pas le temps, répondit mon frère en rougissant.
—Quel prétexte! allons, viens, je t'en prie!
—Mais je n'ai pas de billet.
—Il y en a tant que tu en veux à la caisse.
—Attends, je reviens à l'instant,» répondit Volodia évasivement, et il sortit de la chambre en remontant une épaule.
Je savais que Volodia avait grande envie de répondre à l'appel de Doubkof et qu'il refusait uniquement parce qu'il n'avait pas d'argent.
Je savais qu'il était sorti pour se faire donner un acompte sur sa pension du mois prochain.
«Bonjour, diplomate,» me dit Doubkof en me tendant la main.
Les amis de Volodia m'appelaient ainsi parce qu'un jour, après le dîner, feu ma grand'mère avait dit en parlant de l'avenir de ses petits-fils, que Volodia serait un officier et moi un diplomate avec l'habit noir et la coiffure à la coq, inséparables de la dignité diplomatique, à ce que croyait mon aïeule.
«Où Volodia est-il allé? me demanda Neklioudof.
—Je ne sais pas, répondis-je en rougissant à l'idée qu'ils devineraient pourquoi Volodia avait disparu.
—Il n'a pas d'argent, n'est-ce pas? Eh!... diplomate? ajouta-t-il avec assurance en pénétrant mon sourire.... Mais, moi non plus, je n'ai pas d'argent ... et toi, en as-tu, Doubkof?
—Nous allons voir, dit Doubkof en sortant sa bourse avec un air malin et en faisant mine de promener dedans ses doigts courts et remuants de la menue monnaie; voici cinq kopeks; en voici vingt ... et puis ... plus rien!» dit-il en faisant un geste comique de la main.
En ce moment Volodia rentra.
«Eh bien! dit Neklioudof, est-ce que nous partons?
—Non.
—Que tu es drôle! dit Neklioudof, pourquoi ne pas avouer que tu n'as pas d'argent? Prends mon billet....
—Et toi?
—Il ira dans la loge de sa cousine, dit Doubkof.
—Non, je n'irai pas.
—Pourquoi?
—Je n'aime pas y être ... je me sens mal à l'aise.
—Toujours ta vieille chanson! Je ne peux pas comprendre pourquoi tu te trouverais mal à l'aise où tout le monde est aise de te voir.... C'est très drôle, mon cher.
—Que faire, si je suis timide? Je suis sûr qu'il ne t'est pas encore arrivé de rougir depuis que tu es au monde, et moi je rougis à tout instant et pour rien....» Et Neklioudof rougit déjà à la pensée qu'il rougissait facilement.
«Savez-vous d'où vient votre timidité, mon cher? dit Doubkof d'un ton protecteur; d'un excès d'amour-propre!
—Où prends-tu cet excès d'amour-propre? répondit Neklioudof, piqué au vif.—Au contraire, si je suis réservé, c'est parce que j'ai peu d'amour-propre; il me semble toujours qu'avec moi on doit s'ennuyer ... voilà pourquoi souvent je parais....
—Habille-toi donc, Volodia,» s'écria Doubkof; et, le prenant par les épaules, il lui enleva son veston.... «Ignat!... les habits de monsieur....
—Voilà pourquoi, souvent, je parais....»
Mais Doubkof ne l'écoutait plus. «Tra la, la,... tra ... la,... la,... la,... répétait-il en chantant.
—Non, tu ne te débarrasseras pas si facilement de moi, poursuivit Neklioudof: je te prouverai que ma timidité ne vient pas de l'amour-propre.
—Tu me le prouveras en venant avec nous au théâtre.
—J'ai déjà dit que je n'irai pas!...
—Alors, reste ici et fais ta démonstration au diplomate.... Quand nous rentrerons, il nous donnera tes conclusions....
—Eh! bien, oui, je lui prouverai que j'ai raison, répliqua Neklioudof avec une opiniâtreté enfantine;... seulement, revenez vite.
—Qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis pétri d'amour-propre?» dit-il en s'asseyant près de moi.
Quoique j'eusse mon idée très arrêtée sur ce point, je sentis mon courage m'abandonner à cette question inopinée, et je fus un instant avant de pouvoir répondre.
«Je crois que oui, dis-je, en sentant que ma voix tremblait et que le sang me montait au visage, maintenant que je tenais l'occasion si ardemment souhaitée de lui prouver que je n'étais pas bête.—Je pense que tout homme a de l'amour-propre et que toutes les actions de l'homme ne viennent que de l'amour-propre.
—Alors qu'entendez-vous par amour-propre? dit Neklioudof en souriant avec un peu de dédain, à ce qu'il m'a semblé.
—L'amour-propre, répliquai-je, est la conviction que je suis meilleur et plus intelligent que les autres.
—Mais comment tout le monde peut-il se croire meilleur?
—Je ne le sais pas, peut-être que je me trompe, il n'y a que moi qui l'avoue; mais je sais que je me crois plus intelligent que tous les autres, et je suis persuadé que vous pensez de même.
—Non, je dirai de moi, tout le premier, que j'ai rencontré des personnes que j'ai reconnues être plus intelligentes que moi.
—C'est impossible, insistai-je d'un ton convaincu.
—Mais est-ce que c'est vraiment votre idée? demanda Neklioudof en me regardant fixement.
—Très sérieusement,» répondis-je. Au même instant, un nouvel argument s'offrit à ma pensée et je me hâtai de le développer en disant! «Je vais vous prouver que j'ai raison. Pourquoi nous aimons-nous nous-mêmes plus que tous les autres? Parce que nous nous croyons meilleurs, plus dignes d'amour. Si nous trouvions les autres plus parfaits, nous les aimerions mieux que notre propre personne ... et ce cas ne s'est pas encore présenté; et, s'il en est ainsi, c'est que j'ai raison,» dis-je pour conclure, sans pouvoir réprimer un sourire satisfait.
Neklioudof resta silencieux un moment.
«Je n'aurais jamais cru que vous fussiez aussi intelligent,» dit-il enfin, avec un sourire si bienveillant et si charmant que tout à coup je me sentis très, très heureux.
La louange exerce une action si puissante sur le sentiment et sur l'esprit de l'homme, que, sous sa douce influence, il me sembla que je devenais plus intelligent qu'auparavant, et les pensées se pressaient dans ma tête avec une force extraordinaire.
Nous nous mîmes alors à aborder une foule de questions philosophiques, sur les meilleurs moyens de conduire notre vie, sur les avantages de la sagesse et de l'examen méthodique de toutes choses: un étranger aurait sans doute traité de fatras tous nos raisonnements, tant ils étaient obscurs et étroits;—mais, pour nous, ils étaient d'une haute valeur.
Nos âmes étaient accordées à l'unisson, et le moindre attouchement sur la corde de l'une retentissait sympathiquement dans l'autre.
Le plaisir que nous trouvions dans notre entretien naissait justement de cet accord. Il nous semblait que les paroles et le temps nous manquaient pour nous communiquer toutes les pensées qui demandaient à naître.
A partir de ce jour, il s'établit entre Dimitri Neklioudof et moi des relations assez originales, mais agréables au plus haut degré.
En présence d'autres personnes il ne faisait aucune attention à moi; mais, à peine nous retrouvions-nous en tête-à-tête, que nous nous installions confortablement dans un coin, et nous commencions à discuter sans fin, sans nous apercevoir de la fuite du temps.
Nous parlions de notre avenir, de l'art, des services à rendre à la patrie et à l'humanité, de notre mariage, de l'éducation de nos enfants! Et jamais il ne nous venait à l'idée que tout ce que nous disions n'était que du fatras.
C'est que ce fatras était un fatras spirituel et plein de charme.
Ce que j'aimais par-dessus tout, dans ces discussions métaphysiques qui remplissaient nos entretiens, c'était le moment où les pensées, se pressant dans une succession toujours plus rapide, devenaient de plus en plus abstraites et arrivaient à cet état nébuleux où je ne pouvais plus les exprimer, et où je disais tout autre chose que ce que j'avais l'intention de dire. J'étais heureux lorsque, planant plus haut, toujours plus haut dans la sphère de la pensée, j'embrassais soudain dans mon vol l'étendue infinie de la spéculation, et que je constatais l'impossibilité de pénétrer au delà.
A l'époque du carnaval, Neklioudof se laissa absorber par les plaisirs au point de me négliger complètement. Bien qu'il vint plusieurs fois par jour à la maison, il n'eut pas une seule conversation avec moi. J'en fus piqué au vif, et je me mis de nouveau à le considérer comme un homme orgueilleux et désagréable. Je guettais l'occasion de lui montrer que je ne tenais pas à sa société, et que je ne lui étais nullement attaché.
Lorsque, après le Carnaval, il voulut entamer une discussion, comme par le passé, je lui répondis que j'avais des leçons à préparer, et je montai. Un quart d'heure plus tard la porte de la salle d'étude s'ouvrit, et Neklioudof entra.
«Est-ce que je vous dérange? me demanda-t-il.
—Non, répondis-je malgré moi; j'aurais voulu lui dire que j'étais occupé.
—Alors pourquoi avez-vous quitté la chambre de Volodia? Il y a bien longtemps que nous n'avons pas discuté, et j'ai si bien pris l'habitude de ces entretiens, qu'il me semble qu'il me manque quelque chose.»
Mon dépit s'évanouissait peu à peu, et Dimitri redevenait à mes yeux l'homme aimable et bon que j'avais choisi pour ami.
«Vous avez sans doute deviné pourquoi je suis sorti de la chambre?
—Peut-être, répondit-il, en s'asseyant près de moi; mais, si j'ai deviné juste, je ne peux pas vous dire pourquoi.... Vous seul, vous pouvez l'avouer.
—Eh! bien, je vous le dirai: j'ai quitté la chambre parce que j'étais fâché contre vous.... Non, pas précisément fâché, mais j'étais mécontent.... Voyez-vous, je crains toujours que vous ne me méprisiez parce que je suis trop jeune pour vous.
—Savez-vous pourquoi nous nous sommes liés ainsi? répondit Neklioudof avec un regard bienveillant et plein d'intelligence, savez-vous pourquoi je vous préfère à tous ceux que je connais mieux que vous et avec qui j'ai plus de choses en commun? Je viens à l'instant de m'en rendre compte moi-même; c'est parce que vous possédez une qualité admirable et rare: la sincérité!
—C'est vrai, je dis toujours les choses que j'ai le plus honte d'avouer; mais je ne les dis qu'aux personnes dont je suis sûr.
—Mais, pour avoir toute confiance en quelqu'un, il faut être très intimement lié avec lui, et nous ne sommes pas encore assez étroitement unis. Nicolas, rappelez-vous ce que vous venez de me dire de l'amitié: pour être de véritables amis, il faut être sûrs l'un de l'autre.
—Il faut être certain que nos aveux ne seront jamais divulgués à personne, lui dis-je; car les pensées les plus graves, les plus intéressantes sont celles que nous ne confierions pour rien au monde à qui que ce soit. Et le plus souvent ces pensées sont vilaines!... si laides, que si nous savions que nous serons contraints de les confesser, elles n'oseraient jamais pénétrer dans notre tête!
—Nicolas! j'ai une idée!» s'écria Neklioudof en se levant de sa chaise; il se frotta les mains et sourit.
«Faisons un pacte, et vous verrez comme il nous sera utile à tous les deux: promettons-nous de tout nous avouer l'un à l'autre. Ainsi nous nous connaîtrons mutuellement, et nous n'aurons pas honte; mais, pour ne pas avoir à redouter les étrangers, échangeons mutuellement la promesse de ne jamais rien répéter à une tierce personne: vous de ce que je vous aurai dit, moi de ce que vous me direz. Voulez-vous?
—Je vous le promets,» répondis-je.
Et nous avons tenu parole.
Alphonse Karr a dit que dans toute affection il y a deux parts inégales: l'un qui aime, et l'autre qui se laisse aimer; l'un qui donne le baiser, et l'autre qui tend la joue. Cette remarque est tout à fait juste.
Dans l'amitié qui me liait à Dimitri, c'est moi qui l'embrassais et lui qui tendait la joue; il est vrai qu'il était aussi tout prêt à m'embrasser de lui-même. Nous nous aimions d'une égale affection, car nous nous connaissions et nous nous appréciions mutuellement; ce qui ne l'a pas empêché d'exercer une grande influence sur moi, et moi de me soumettre à son influence.
On comprend que j'aie pris sans m'en douter les idées de mon ami; elles consistaient dans un culte enthousiaste d'un idéal de vertu et dans la conviction que l'homme est appelé à se perfectionner toujours.
Il nous semblait alors que redresser tous les torts de l'humanité, détruire tous les vices, supprimer tous les malheurs, était une chose très facile à accomplir.
Mais surtout, dans la contemplation de cet idéal, nous ne mettions pas en doute que rien ne serait plus simple que de nous corriger nous-mêmes de tous nos défauts, de pratiquer toutes les vertus et d'atteindre le bonheur!

| I. | Notre précepteur Karl Ivanovitch | |
| II. | Maman et papa | |
| III. | La leçon—Gricha l'insensé | |
| IV. | La chasse | |
| V. | Les jeux | |
| VI. | Le salon—Les chaînes de Gricha | |
| VII. | Nathalia Savichna | |
| VIII. | L'enfance—La fête de grand'mère | |
| IX. | La princesse Kornakova Le prince Ivanitch | |
| X. | Les invités | |
| XI. | La masourka | |
| XII. | Après la masourka | |
| XIII. | Départ précipité | |
| XIV. | La douleur |
Liste des illustrations:
KARL IVANOVITCH ASSIS A SA PLACE.
NICOLAS EXAMINAIT KARL IVANOVITCH.
PAPA S'ENGAGEA DANS LE CHAMP DE SEIGLE.
MAMAN M'EMBRASSA.
IL TENAIT DE SES DEUX MAINS LE NŒUD DE SA CRAVATE.
«CE SERA PEUT-ÊTRE UN SECOND DERJAVINE.»
ILS SUIVAIENT LEUR JEUNE PRÉCEPTEUR.
LORSQUE NOUS FIMES LA GRANDE RONDE.
NOUS NOUS TENIONS SUR L'ESCALIER.
PRÈS DU PETIT PONT, LES CHEVAUX SE SONT EMBOURBÉS.
«A L'HEURE QU'IL EST JE NE PEUX PAS LE CROIRE.»
UN ÉCLAIR ÉCLATA PRESQUE DANS LA «BRITCHKA».
«VOILA CE QUE TU AURAS GAGNÉ A ME POUSSER!»
«QUI VIVE?» RÉPÉTA LA SENTINELLE.
APRÈS AVOIR INTRODUIT LA PETITE CLÉ DANS LA SERRURE.
QUAND JE TRAVERSAI LA SALLE D'ÉTUDE.
NOUS PARTIONS D'UN ÉCLAT DE RIRE.
L'ADJUDANT DOUBKOF AVAIT LE PRESTIGE DE SON PORT MARTIAL.