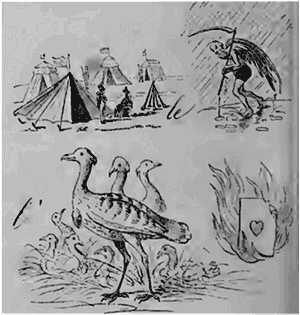L'ILLUSTRATION,
JOURNAL UNIVERSEL.

|
Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |
N°72. Vol. III. |
Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |
SOMMAIRE.
Histoire de la Semaine. Le Conseil de l'Ordre des Avocats devant la cour royale.--Courrier de Paris. Mademoiselle Rachel dans Phèdre et le Dépit Amoureux; les Ménestrels de la Virginie; la plus belle moitié du genre humain à la Cour d'Assises.--Un voyage au long cours à travers la France et la Navarre, par A. Aubert. Chap. VI et VII. Neuf gravures, par Bertall.--Romanciers contemporains. Eugène Sue.--Revue comique de l'exposition de l'Industrie. Dix-huit gravures, par Cham.--Une soirée à Saint-Pétersbourg. Statue de la Néva.--Colonie de Saint Thomas de Guatemala.--Les Forçats. (Deuxième article.) Sept gravures, d'après les dessins de M. Letuaire, de Toulon.--Bulletin bibliographique.--Incendie de la Djeninah à Alger. Une gravure.--Caricature par Seigneurgens.--Correspondances. Rébus.
Histoire de la Semaine.

Le Conseil de L'Ordre des Avocats devant la Cour royale
de Paris, Chambres réunies, audience du 6 juillet 1844
Nous nous garderons bien d'aller contre le vœu de la loi en rendant compte de la séance secrète dans laquelle la cour royale, toutes chambres réunies, a fait comparaître devant elle, lundi dernier, le bâtonnier et les vingt membres composant le conseil de l'ordre des avocats. Nous ne nous aviserons pas d'imiter tous les journaux, qui ont l'indiscrétion d'apprendre à leurs lecteurs que la cour, présidée par M. Séguier, était au grand complet; que M. le procureur général, entouré de tous les membres de son parquet, occupait le siège du ministère public; qu'on est entré en séance à une heure; que M. Hébert a donné ses conclusions contre le conseil à l'occasion de la lettre écrite par celui-ci à M. le premier président et de sa résolution à l'égard de la première chambre, et que le bâtonnier de l'ordre, M. Chaix-d'Est-Ange, a répondu par une défense rédigée en commun; que la cour est entée à deux heures moins un quart en délibération, et que ce n'est qu'à six heures qu'elle a donné lecture d'un arrêt qui ordonne la suppression de la lettre du conseil et prononce contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement. Mais la loi n'interdisant pas de reproduire la physionomie d'une audience secrète, les artistes de l'Illustration peuvent donc user d'un privilège que le législateur, par oubli sans doute, a constitué au crayon. Nos abonnés profiteront de cette distraction, et seront peut-être portés à penser que le silence de nos lois sur la presse est plus libéral que leurs prescriptions. Ce qu'il nous est permis de dire, parce que ces résolutions sont postérieures au huis clos, c'est que les membres du conseil ont été unanimes à penser et à décider que, malgré les termes favorables d'un des considérants, où le loyal concours que le barreau prête à la justice est reconnu, leur situation, contre laquelle ils avaient protesté, était aggravée encore par la peine disciplinaire qui venait de leur être infligée; que ce qui n'était auparavant qu'un conflit avec M. le premier président semblait en devenir un avec la cour tout entière, alors que, par le prononcé d'une peine, elle sanctionnait les procédés contre lesquels le conseil avait cru avoir le droit de réclamer; que la conséquence logique devrait être pour les membres de l'ordre, de s'abstenir de plaider devant toutes les chambres de la cour; mais qu'il était plus convenable de maintenir la détermination première, c'est-à-dire l'abstention de paraître devant la chambre présidée par M. Séguier, et de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour. Ces résolutions ont été prises à l'unanimité, et le conseil, pour les faire sanctionner par l'ordre tout entier, vient de donner sa démission et de se soumettre à une réélection à laquelle il sera procédé samedi 13. On se demandait, il y a huit jours, comment cela finira t-il? Aujourd'hui, on se demande si cela finira.
C'est aussi la question que les députés impatients s'adressent en voyant la session se prolonger indéfiniment. Les ministres ne seraient pas moins désireux de venir lire l'ordonnance de clôture; néanmoins ils paraissent appelés à monter plus d'une fois encore à la tribune avant d'y faire entendre cet ite missa est parlementaire. Les succès leur deviennent rares, et la fin de la tâche est pour eux laborieuse. M. le ministre de la guerre a, cette semaine, éprouvé le premier échec. La chambre des pairs, cédant à son désir, avait rétabli à huit années la durée un service militaire, ainsi fixée par le projet primitif de la nouvelle loi sur le recrutement mais réduite à sept ans par la chambre des députés lors de la précédente discussion qui a eu lieu cette année au palais Bourbon. Le projet y étant rapporté de nouveau, un nouvel amendement a été présenté pour que la Chambre maintînt son premier chiffre, et ne rendît pas obligatoire pendant un plus long temps, et sans profit pour la constitution d'une réserve sérieuse à laquelle on ne veut pas songer, ce service qu'on a appelé l'impôt du sang. A ces mots M. Dupin l'aîné a paru pris d'une animation très-grande. Il a combattu vivement cette expression d'un défenseur de l'amendement; en revanche il a soutenu vivement l'amendement lui-même; enfin il a fait une pointe jusqu'il Versailles, et a trouvé moyen d'exalter la liste civile pour l'emploi national et bien entendu de ses revenus, comme, quelques jours auparavant, il l'avait malmenée pour l'insistance et l'âpreté de ses réclamations pécuniaires. On n'est jamais sûr, sans doute, avant le départ, de se rencontrer avec M. Dupin; mais quand on sait qu'il est allé par la rive gauche, on peut être certain qu'il reviendra par la rive droite. L'amendement et le terme de sept ans ont été adoptés malgré les efforts du ministre, dont l'autorité sur la Chambre avait faibli dans cette question, par suite des opinions contraires qu'il a émises à différentes fois, en invoquant toujours une expérience que personne ne conteste, mais devant laquelle on s'incline plus volontiers quand elle se montre conséquente avec elle-même.
M. le ministre des finances, dont le but était de faire prendre patience à la Chambre sur la question de la conversion de la rente, sans engager le cabinet, n'a pas su conjurer un vote qui, en bonne logique financière, peut être regardé comme les prémisses dont la réduction du 5 pour cent est la conséquence. L'intérêt payé par l'État aux dépositaires de cautionnements était jusqu'ici de 4 pour cent. Sur la proposition de M. Havin, et malgré tous les efforts de M. Lacave-Laplagne, il sera réduit, à partir du 1er janvier prochain, à 3 pour 100. Puisque c'est là la valeur véritable que la Chambre assigne à la location de l'argent, elle ne peut longtemps encore allouer 3 pour 100 aux rentiers. C'est, du reste, une impatience que ne partage pas le ministre, car, avant l'adoption de la mesure proposée par M. Havin, il avait répondu à une interpellation de M. de Saint-Priest sur la conversion, qu'il en reconnaissait le droit et les avantages, mais qu'il ne pouvait prendre aucun engagement pour l'exécuter, ni préciser l'époque à laquelle elle serait opportune. C'est, depuis 1836, le langage qui se tient, la déclaration qui se renouvelle chaque année; mais on comprendra bientôt que cela ne fait pas avancer la question d'un pas, et que celle-ci veut être enfin résolue.
M. le ministre de la justice et des cultes a eu aussi ses luttes à soutenir. Une réintégration, au moins prématurée, d'un chef de parquet, que l'on s'était vu forcé de destituer par suite de la part scandaleuse qu'il avait prise à des menées électorales mises en lumière par la commission de la chambre des députés, a, dès l'ouverture de la discussion sur le budget de ce double département ministériel, amené un débat très-vif. Il n'y avait pas là de vote possible, et comme les propositions financières du ministre étaient la reproduction de celles de l'an dernier, la mauvaise humeur de la Chambre n'avait pas matière à s'exercer. Cependant, dans un tout petit coin du budget des cultes, M. Martin (du Nord) proposait de modifier une disposition de la loi organique de l'an X, et d'accorder à M. l'archevêque de Paris quatre vicaires généraux au lieu de trois. Cette création était motivée en partie sur l'accroissement d'occupation que nécessite l'examen des livres nouveaux. MM. Dufaure, Dupin aîné et Isambert ont combattu successivement la proposition. On a dit que c'était tout simplement la censure ecclésiastique que l'on arrivait à sanctionner ainsi, et que pour modifier la loi qui a donné force et vigueur au concordat, ce n'est point un article inaperçu de budget qu'il faut, mais, si la nécessité en est reconnue, une loi ostensiblement présentée, examinée, rapportée et discutée. La proposition ministérielle a été repoussée.
M. le ministre des affaires étrangères a eu son tour. Le ton de discussion de la presse et même des tribunes anglaises, à l'occasion de notre affaire du Maroc; les espèces de menaces qu'on à lait entendre contre la sécurité de nos possessions d'Afrique; les interpellations annoncées à la chambre des communes, par M. Sheil, sur la question de savoir si le consul d'Angleterre en Algérie exerce ses fondions en vertu d'un exequatur du gouvernement français, ou en vertu d'une autorisation du gouvernement précédent, et sur la situation des relations de l'Angleterre avec la France en ce qui concerne l'Algérie; tout donnait un à-propos nouveau à une question qui n'est cependant pas nouvelle, celle précisément que M. Sheil posait de son côté, M. Crémieux a reproduit à M. Guizot l'interrogation des précédentes années. Pourquoi, alors que tous les consuls et vice-consuls des puissances étrangères en Algérie ont demandé depuis 1830, l'exequatur de la France, l'Angleterre seule s'en est-elle cru dispensée? M. Guizot a pensé sortir de la difficulté en reproduisant la réponse qu'il avait faite les années précédentes, à savoir, que l'exequatur une fois donné à un agent lui sert pendant tout son exercice et malgré tous les changements de gouvernement qui peuvent survenir; que le consul anglais à Alger s'y trouvant depuis plus de quatorze ans, il n'avait pas eu d'exequatur nouveau à solliciter après la chute du dey. Mais M. Crémieux, qui s'attendait à cette réponse stéréotypée, et qui avait échelonné ses moyens d'attaque, a fait observer à M. Guizot qu'en admettant qu'on dût se contenter de cette explication pour le consul général d'Alger, il resterait à expliquer comment les vice-consuls anglais de Bone, d'Oran, de Bougie se trouvent également tous sans exequatur, et comment notamment il se fait que dans cette dernière ville, où un même personnage est tout à la fois vice-consul de Sardaigne, de Toscane et d'Angleterre, cet agent ait demandé et obtenu l'exequatur du gouvernement comme représentant de la Sardaigne et de la Toscane seulement? M. Guizot laissait voir l'embarras le plus mal dissimulé et la crainte de se mettre en contradiction trop ouverte avec ce qu'il se disait, sur le même sujet, peut-être au même moment, de l'autre côté de la Manche, quand M. Fulchiron s'est montré à la tribune, et un mouvement d'hilarité a distrait la chambre et laissé respirer le ministre.
Les projets de lois à discuter entre les deux budgets s'amoncellent. M. le ministre des travaux publics avait présenté un projet pour l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Sceaux, partant de la barrière d'Enfer, suivant le système de M. Arnoux, lequel, on le sait, a déjà été expérimenté, sur une très-petite échelle, à Saint-Mandé, et admet les courbes d'un rayon très-réduit, sans crainte de déraillement. M. Dumon vient d'apporter une proposition nouvelle à la Chambre pour essayer également le système atmosphérique. On ne lui fera pas attendre le vote de ces deux lois et l'ouverture de ces deux crédits; ce sera ensuite à lui à mettre son activité à faire procéder le plus tôt possible à cette double expérience qui peut opérer une révolution dans le système des chemins à établir et apporter une économie énorme dans leur confection.
On se rappelle la proposition relative à l'abolition du timbre des journaux déposée il y a plusieurs mois par M. Chapuys-Montlaville. La commission qui avait été chargée, de son examen vient de terminer ses travaux et de nommer son rapporteur. La majorité a repoussé tout à la fois deux mesures présentées comme connexes; l'abolition du droit du timbre réclamée par M. Chapuys-Montlaville, et la fixation d'un droit à percevoir sur les annonces. Elle s'est bornée à proposer d'uniformiser le timbre des journaux qui est aujourd'hui, selon le format, de quatre centimes pour la plupart des feuilles de département et pour le Charivari, par exemple, de cinq centimes pour le Siècle, le Constitutionnel, la Presse et autres, et enfin de six centimes pour le Journal des Débats et la Gazette des Tribunaux. Le timbre serait, désormais uniformément fixé à quatre centimes, et il serait loisible aux feuilles périodiques, selon les besoins de leur publicité, de s'en tenir à un format réduit ou de recourir au plus étendu. La différence de recettes causée par cette réduction est estimée devoir être insignifiante pour le trésor.
La chambre des pairs, de son côté, poursuit activement ses travaux.
Elle a entendu le rapport fait par M Mérillion sur le projet de loi relatif à l'état de l'esclavage dans les colonies. La lecture de ce travail n'a pas duré moins de deux heures.--Elle a voté le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, en retranchant toutefois, sûr les observations de M. le comte Molé, assez dures pour le ministère, le fameux article 7 que M. Crémieux y avait fait inscrire. Quel parti va prendre la chambre des députés, à laquelle le projet ainsi amendé vient d'être rapporté?--Enfin, la chambre des pairs, s'émouvant comme celle des députés et comme le pays, du ton et du langage des organes de la Grande-Bretagne à l'occasion du Maroc, avait résolu d'adresser, lundi dernier, des interpellations au ministre des affaires étrangères. La discussion du budget de son département dans l'autre enceinte législative a forcé M. Guizot de prier la Chambre d'ajourner au mercredi cette conversation, qui se tient au moment même où nous écrivons.
Nous disions, il y a quinze jours, qu'on semblait vouloir nous imposer, si nous faisions une pointe dans les États de l'empereur de Maroc, l'obligation de nous borner à toucher barre et à nous retirer aussitôt. La réalisation de cette prédiction ne s'est pas fait attendre. Des dépêches télégraphiques, de M. le maréchal Bugeaud, ont informé M. le ministre de la guerre que, le 19 nos troupes étaient entrées sans coup férir dans les murs d'Oneida, et que le 21 elles en étaient ressorties pour prendre la route quelles avaient suivie en sens contraire quarante-huit heures auparavant, 100 hommes seulement avaient été distraits de la colonne pour aller à Djeninah, point sur la côte distant d'Oran de trente-cinq lieues, situé à quatre lieues de Nedroma et à douze de Tlemcen, dont il serait devenu le port, si, à la suite de cette pointe, on n'eût reconnu qu'il n'offrait aucune sûreté pour les navires. Pendant ces toutes petites promenades exécutées l'arme au bras, Abd-el-Kader et les siens, bien armés de fusils anglais, passent entre nos colonnes, font des razzias sur le territoire de la régence d'Alger, et y lèvent des contributions forcées; dans le même temps, le général marocain qui nous a si inopinément et si brutalement attaqués nous écrit qu'il n'a pas la permission de faire la guerre, mais il se montre encore moins autorisé à faire sa paix avec nous; pendant ce temps, enfin, M. le prince de Joinville a paru en vue de la côte d'Oran, et sa présence a électrisé nos marins et nos soldats. A coup sûr, ils ne seraient pas moins animés si l'on mettait à l'ordre du jour de notre brave année les insolents discours qui se prononcent à cette occasion dans le parlement anglais. Les questions de lord Palmerston, la déclaration à la chambre des lords du comte de Minto qu'il a vu avec inquiétude, le commandement des forces navales françaises donné au prince de Joinville; l'énumération des forces considérables envoyées, dit le Morning Post, «pour stationner sur la côte d'Afrique et surveiller la flotte française sous le commandement de M. le prince de Joinville;» tout cela est triste et irritant, et il est fâcheux que M. le ministre des affaires étrangères ait cru devoir faire à la tribune de notre chambre des députés un éloge de la prudence du jeune amiral d'un ton qui ressemblait à une leçon à l'adresse de celui-ci et une satisfaction à ses censeurs de l'autre côté de la Manche.--Lord Minto, que nous nommions tout à l'heure, en posant quelques questions assez pressantes à lord Aberdeen, s'est attiré de lord Londonderry une réponse que nous devons rapporter: «En bonne justice, a dit Sa Seigneurie, la Chambre reconnaîtra que le pays doit beaucoup à la sage politique du comte Aberdeen, qui a su diriger habilement nos affaires dans un moment de crise très difficile pour nos relations avec la France, et l'on ne saurait avoir oublié comment il a réglé la question du droit de visite.» La question du droit de visite est donc à la fin réglée? Eh! que ne nous le disait-on? Et comment l'est-elle, s'il n'est pas trop indiscret de le demander?
On se préoccupe fort, on le comprend, à Alger, de ce qui se passe; ou, pour être plus exact, de ce qui ne se passe pas sur la frontière du Maroc. Toutefois, le mois dernier, une prédiction rapportée tout récemment de la Mecque avait donné à la population indigène une assez forte distraction, en lui persuadant qu'une ville musulmane allait être engloutie par les eaux. Ce ne pouvait être qu'Alger; mais on pouvait se préserver en priant pendant trois jours et en égorgeant un mouton dans chaque famille. En général, les Maures, qui se laissent un peu gagner par l'esprit d'examen depuis la conquête, se sont dispensés du préservatif; mais les nègres n'ont pas imité cette indifférence, et le mercredi, 19 juin, ils se sont rendus à la qoubbah de Ciddi-Bellal (leur marabout spécial), auprès du quartier d'Hussein-Dey. Là chaque dar-el-djemaa (maison d'assemblée) ou réunion de chacune des six nations du Soudan, avait ses représentants. Un bœuf a été immolé et mangé sur place, «car il ne fallait pas, disaient les convives, qu'une seule parcelle de la victime entrât à Alger, sans quoi les prières et les sacrifices eussent été perdus.» Ils nous paraissent n'avoir réussi qu'à faite changer l'inondation en incendie, car le 26 au soir, le feu a pris dans la baraque d'un rôtisseur juif, près de la place Royale d'Alger et s'est bientôt communiqué à des constructions en bois et à un bâtiment servant de magasin de campement. (Voir la dernière page de ce numéro.)
Le Moniteur vient de publier le tableau du mouvement commercial de 1843 comparé à celui des années 1842 et 1841. Les importations ont suivi une marche constamment ascendante. Elles ont été:
En 1841, de 1,121 millions. En 1842, de 1,142 id. En 1843, de 1,187 id.
Ces chiffres embrassent les importations par terre et par mer. Sur un mouvement de 16,411 navires, les nôtres figurent au nombre de 6,106; les navires étrangers y entrent pour 10,305, c'est-à-dire pour près du double. On voit que la condition faite à notre marine par de déplorables traités de commerce ne s'améliore que bien difficilement. Sous le rapport du tonnage, les étrangers ont sur nous un avantage plus marqué encore. Ainsi, les 6,106 navires français n'ont transporté que 659,637 tonneaux, soit un peu plus de 1104 tonneaux par navire, tandis que charnu des 10,305 navires étrangers qui sont venus dans nos ports portait en moyenne plus de 133 tonneaux. Les exportations se sont un peu relevées en 1843, sans pourtant atteindre encore le niveau de 1841. Voici les chiffres:
1841, 1 milliard 65 millions. 1842, 940 id. 1833, 992 id.
Ici, la proportion est meilleure pour le pavillon national. Sur 11,585 navires qui se sont partagé les transports par mer, l'étranger ne compte que pour 6,260. Mais il n'en demeure pas moins vrai que, sur l,230,756 tonneaux de produits exportés en 1843, nous n'en transportons pas même la moitié (565,282).
Le 24 avril un combat a eu lieu près de Montevidéo. Dans cette affaire, Oribe a perdu 800 hommes et les Montevidéens ont en 200 des leurs tués ou blessés. Parmi les morts malheureusement se trouvent 40 braves de la légion française, qui sont tombés dans une embuscade et ont été impitoyablement massacrés. Le général commandait les Montevidéens dans cette affaire très-sérieuse, à laquelle une légion formée d'italiens a pris une glorieuse part. Mais un fait non moins digne d'attention, c'est le déchirement qui vient de s'opérer entre M. l'amiral Lainé et M. le consul Bichon, dont la conduite dans toute cette affaire a été si peu digne de la nation qu'il représentait. Après que la légion française, pour obtempérer aux injonctions de l'amiral, eut quitté notre cocarde et se fut placée sous les couleurs montevidéennes, M. l'amiral Lainé se déclara officiellement satisfait. Mais le lendemain 14, il transmit la demande faite par M. Pichon d'être réintégré dans ses fonctions; le gouvernement montevidéen s'y refusa, et de dépit M. Bichon s'est retiré avec sa famille à Buenos-Ayres, auprès de Rosas, d'où il s'amuse à lancer des pamphlets contre les Français, les Montevidéens et les amiraux qui se sont succédé à la Plata et desquels il avait toujours et vainement sollicité le bombardement de Montevidéo. C'était l'idée fixe de ce diplomate.
Il nous faudrait beaucoup plus de place qu'il ne nous en reste à remplir pour donner avec quelques détails les faits intérieurs ou extérieurs qui ont mérité d'occuper l'attention publique cette semaine. Mentionnons les donc rapidement, sans développement, sans préambule, sans transition.
M. Charles Laffitte a été réélu pour la quatrième fois au collège de Louviers. Il avait eu le bon esprit, cette fois, de retirer préalablement sa soumission. Le conseil lui en avait été donné beaucoup plus tôt, mais il avait écouté M. Liavières; aujourd'hui il a été mieux inspiré. Jamais sa position n'avait été meilleure, car il sera reçu député, et, si l'amendement de M. Crémieux est réintroduit dans la loi du chemin de Bordeaux, il sera débarrassé de la condition que Louviers y avait mise.
Cinq voyageurs dépendant de notre établissement du Sénégal ont remonté le fleuve de ce nom, remorqués par bateau à vapeur jusqu'à Bakel, capitale du royaume de Galam, situé sur le fleuve, à cent myriamètres de Saint-Louis. Ce trajet leur avait demandé dix-sept jours. Au-dessus de Bakel, une rivière qui vient du sud se jette dans le Sénégal; elle s'appelle Falémé. Sur la rive droite de la Falémé mais en la remontant, est le royaume de Bambouck; sur la rive gauche, le royaume de Bondou. Il ont visité l'un et l'autre. Le Bambouck est fameux par ses mines d'or, qu'ils étudièrent et où ils firent des expériences, qui étaient le principal but de leurs voyages. Les obstacles que nos courageux compatriotes ont eu à surmonter sont innombrables. Cette expédition aura d'utiles résultats. Le Bambouck compte soixante mille habitants. Le lavage de l'or, dont est semé ce pays, est l'objet d'un commerce actif de la part de ces peuplades et de leurs chefs. Indépendamment des avantages que réserve l'avenir il ne pouvait pas être indifférent de diriger vers nous le commerce du Bambouck, en présence surtout de la concurrence que nous font les Anglais dans ces contrées.
Parmi les nouvelles apportées par la dernière malle de l'Inde, il s'en trouvait une dont la gravité n'a pas été suffisamment appréciée. C'est l'état de rébellion ouverte dans lequel se sont placés plusieurs régiments natifs au service de compagnie des Indes. Les 1er, 34e, 64e et 69e régiments d'infanterie indigène et le 7e de cavalerie légère sont ceux qui ont le plus vivement manifesté cet esprit d'insubordination. Le 64e notamment, qui en a donné le premier exemple, est montré tout disposé à recommencer en arrivant à Sakkir sur l'Indus. La Gazette de Delhi nie le fait, il est vrai; mais d'autres journaux de l'Inde discutent la probabilité d'une seconde rébellion. Le Friend of India, journal dévoué au gouverneur général, lord Ellenborough, remarque qu'une seconde révolte à cause du Scinde ferait autant de tort au gouverneur actuel que le drame de Caboul en avait fait à lord Strickland. Mais il soutient qu'un second éclat pareil n'aura pas lieu, et la raison qu'il en donne est curieuse à noter: C'est, dit-il, parce que toute disposition à la révolte qui pourrait se manifester de nouveau sur les bords de l'Indus, sera calmée à l'amiable par des concessions qui dépasseront celles que la notifications du gouvernement avait fait connaître; si les troupes demandent l'argent de leurs rations, en vertu des promesses qui leur ont été faites à Ferozepote, elles l'obtiendront; en effet, le résultat d'une seconde révolte serait plus funeste à la stabilité de l'empire que ne serait grand le dommage causé au trésor par des allocations extraordinaires qui, pour une armée de 15,000 hommes, s'élèveront peu au delà de 7 lacs de roupies par an (un million 550,000 fr.).
Après le Maroc, l'enquête à faire sur la violation du secret de lettres, et le droit à cet égard du ministre de l'intérieur a beaucoup occupé les deux Chambres anglaises. Le cabinet été obligé, chez les lords comme aux communes, de laisser nommer une commission pour rechercher les abus commis dans le Post-Office. Lord Radmor, qui a joué dans la chambre haute le rôle qu'a rempli dans l'autre M. Duncombe, a fait une déclaration que nous devons consigner ici: «M. Guizot, a-t-il dit, a été interpellé ces jours derniers à la chambre des députés sur la question du secret des lettres. La réponse qu'il a faite m'a causé le plus grand plaisir. Le ministre a déclaré que le secret des lettres était respecté en France, tant à l'égard des étrangers que des nationaux. Cette déclaration fait honneur à la France. Chez nous, au contraire, on viole le secret des lettres. N'est-ce pas une honte pour le pays, n'est-ce pas là une ignoble pratique?»
La chambre des lords est constituée en cour de justice pour examiner le pourvoi d'O'Connell et de ses codétenus. Pendant ce même temps, un meeting monstre de douze mille spectateurs avait lieu à Covent-Garden, et, ce même jour, la cité de Westminster se réunissait pour voter une proclamation en faveur d'O'Connell. Une double pétition a été discutée et arrêtée pour inviter le parlement à intervenir auprès de la reine à l'effet de faire élargir O'Connell et ses frères martyrs.--L'illustre prisonnier s'est refusé à se laisser porter candidat pour le poste de lord-maire de Dublin, et un protestant modéré, M. Arabin, a été nommé à son refus.
Une lettre d'Akanra (Nouvelle-Zélande), en date du 28 janvier dernier, rapporte que la tribu des Mahouris a tué trente Anglais appartenant à la colonie et a mangé ces malheureux.
--Nous avions été faire, dit une lettre, une partie de chasse dans l'intérieur; nous y étions depuis huit jours, ignorant le conflit élevé entre les Anglais et les Mahouris, lorsqu'un soir nous sommes arrivés chez nne tribu amie des Terauparan ou Mahouris. Nous les avons trouvés mangeant des débris humains; nous crûmes tous qu'ils mangeaient des prisonniers ou esclaves de leur nation. Comme j'entends la langue des Mahouris, je ne pus m'empêcher de leur témoigner mon indignation, en les menaçant de les faire châtier par les hommes de la corvette. Ces sauvages, effrayés, me dirent: «Ce ne sont point les hommes de Mahouri que nous mangeons, ce sont des yes, yes.» (C'est ainsi qu'ils appellent les Anglais.) Ils me montrèrent alors les têtes des Anglais, parmi lesquelles je reconnus le capitaine Wakefield, un des notables habitants du port Nicholson, qui nous avait reçus chez lui lorsque nous avions été faire des vivres dans cette ville. Je fus saisi d'horreur à cet aspect. Mes compagnons me firent des reproches d'avoir risqué d'irriter ces cannibales, car nous n'étions que cinq contre deux cents. Mais ils nous rassurèrent en nous disant; «Oh! les oui, oui (c'est ainsi qu'ils nous appellent), sont bons, mais les yes, yes sont méchants.» Alors ils nous racontèrent pourquoi ils avaient tué les Anglais; que c'était parce qu'ils avaient voulu s'établir dans une baie qu'ils n'avaient pas achetée, et que d'ailleurs ils ne voulaient plus vendre de terre aux Anglais. Nous nous retirâmes alors le cœur soulevé d'horreur et de dégoût.»
--Nous attendrons, pour enregistrer les démissions ministérielles en Espagne, qu'elles aient été officiellement acceptées et que la lutte où le générai Narvaez se distingue, dit-on, par un esprit tout nouveau de constitutionalisme, compte enfin des vainqueurs et des vaincus. Alors sans doute nous cil connaîtrons mieux les bulletins.
--Les feuilles italiennes présentent toujours comme ayant échoué la tentative des fils de l'amiral Bandiera.--Cependant leur nom n'a pas figuré parmi ceux des rebelles arrêtés.
--En Grèce, le général Grivas, chef de partisans, s'est réfugié à bord du bâtiment français le Papin, dont le capitaine lui a donné asile. On l'a fait passer à bord de la Diligente, autre bâtiment français qui doit le déposer en lieu sûr. Les ministres se sont adressés à M. Piscatory, notre ambassadeur, qui a hautement approuvé la conduite du commandant du Papin. «Nous voulons, a-t-il répondu, aider la Grèce de tout notre pouvoir, mais jamais aux dépens de la dignité de notre pavillon.»
--Le Moniteur vient de publier une circulaire par laquelle M. le garde des sceaux se propose d'empêcher le retour du scandale qu'ont donné les avides et élégantes spectatrices des débats de l'assassinat de Pontoise. Les émotions de la cour d'assises ou du moins ses places réservées seront désormais interdites à la plus belle moitié du genre humain. (Voir la page 308 de ce numéro.) Il peut leur rester encore l'espoir de la police correctionnelle, car la circulaire ne parle que des inconvénients qu'un encombrement semblable peut avoir pour l'attention du jury.
COURRIER DE PARIS
Bien que le drame soit terminé, Paris s'est encore occupé pendant quelques jours de Rousselet et d'Édouard Donon-Cadot. Que voulez-vous? Après toute une semaine d'attention donnée aux débats de la sanglant affaire, il était difficile de l'oublier tout à coup, dès le premier instant qui a suivi le dénouement; et d'ailleurs, quand ces terribles procès sont achevés, la curiosité publique ne trouve-t-elle pas à s'exercer encore hors de l'enceinte du tribunal dont les accusés viennent de sortir condamnés ou absous?--ne cherche-t-elle pas à pénétrer dans le secret de la prison où le coupable que la justice a frappé commence à subir sa peine? Ne s'attache-t-elle pas à suivre, dans les premiers moments de sa liberté, l'homme que la voix du juge vient d'amnistier? Que se passe-t-il dans cette prison? Comment le condamné supporte-t-il l'arrêt? Dites-nous son air et son attitude. Rapportez-nous chacun de ses gestes, chacune de ses parole. A-t-il pâli? S'est-il trouvé mal? Montre-t-il de la résolution ou de l'insouciance? Il faut que tous ces curieux insatiables soient satisfaits; car ils ne laisseront leur proie qu'à la dernière extrémité, quand les jours qui passent auront remplacé ce drame qui les occupe par un autre non moins terrible et fatal. La cour d'assises ne chôme jamais!
Aussi les journaux judiciaires, qui connaissent et flattent la passion de leurs lecteurs, ont ils prolongé les émotions du cette lugubre affaire de Pontoise, bien au delà de l'arrêt. Les uns ont montré Rousselet ému pour la première fois, et parlant avec tristesse de sa femme et de ses enfants; les autres l'ont dépeint au contraire farouche et impassible; ceux-ci lui laissent la teinte sombre que son crime a jeté sur lui; ceux-là le transforment tout à coup en idylle, et le font voir cultivant les fleurs dans un coin solitaire de son cachot; de sorte qu'il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment les criminels repentants, et pour ceux qui préfèrent les endurcis. On ne saurait mieux traiter son monde, et les journaux judiciaires sont de complaisants compères et d'habiles conteurs.
Quant à Édouard Donon-Cadot, son acquittement ne l'a pas mis à l'abri des descriptions, des narrations, des indiscrétions et de tout ce qui s'ensuit. On a dit, raconté, imprimé que le lendemain de sa mise en liberté, il était retourné à Pontoise, où il avait fait son apparition en tilbury; on ajoutait qu'Édouard Donon se dispose à entrer comme clerc dans l'étude d'un des notaires de la ville: qu'Édouard retourne à Pontoise; qu'il cherche à effacer par le travail et par une conduite honorable le souvenir des tristes soupçons qui ont pesé sur lui; que son avenir rachète ce passé fatal, et fortifie de toute l'autorité d'une vie sérieuse et irréprochable le jugement qui a déclaré son innocence, rien de mieux; c'est ce qu'il faut croire, c'est ce qu'il faut espérer; cependant il y a quelque chose de trop dans cette affaire: c'est le tilbury. Nous aimerions à savoir que ce tilbury-là a été fabrique par l'imagination peu scrupuleuse des feuilletonistes de cours d'assises et des marchands de faits Paris.--Mais il est temps d'abandonner ce drame Donon-Cadot au silence du greffe et à l'éditeur des Causes célèbres: c'est la dernière fois que nous en parlerons pour notre compte: ces images sanglantes nous répugnent, et nous n'aimons guère à nous arrêter longtemps sur ces déplorables spectacles. En fait de drames, la fiction nous convient mieux que la réalité. Avec la fiction du moins on a l'âme en repos, et si par hasard il vous arrive de vous laisser aller et de croire un moment que vous assistez à un drame réel, la toile qui tombe et les quinquets qui s'éteignent vous rendent bien vite votre tranquillité, en vous montrant qu'après tout il ne s'agissait que d'un drame pour rire.
Malheureusement, à l'heure où nous parlons, il s'est joué plus de drames véritables que de drames d'imagination, les vols, les guets-apens, les assassinats se multiplient avec une abondance effrayante. Pour ne parler que des huit derniers jours qui viennent de s'écouler: ici, on a surpris des fabricants de fausse monnaie; là, un saint homme en apparence, pratiquant la piété avec ostentation s'est enfui, emportant la cassette, comme ce bon M. Tartufe; et quelle cassette! la cassette des révérends pères de la congrégation, une cassette contenant 250,000 fr. Notre larron est une espèce de Janus, un congrégationiste à double face: les jours de sa pieuse comédie, il se faisait un visage candide, revêtait la robe d'innocence baissait les yeux, se signait à tous moments, et assistait aux offices avec componction; mais ce n'était là qu'une moitié de son visage: de l'autre côté, notre homme n'était plus le même; au lieu de ce regard contrit, vous trouviez un œil animé par le plaisir; et tandis que la main droite tenait un chapelet et un rosaire, la main gauche recouverte d'un gant paille, maniait impertinemment une cane de dandy ou offrait un bouquet de fleurs mondaines à quelque bayadère. Que vous dirai-je? le héros de cette comédie à double visage prenait, d'un air de canonisé, dans la caisse de la congrégation l'or qu'il semait à pleines mains pour ses passe-temps païen et de damné. Il a été arrêté à la sortie de l'Opéra, muni d'or et de billets de banque. On ne dit pas encore son nom; mais le réquisitoire du procureur du roi et la cour d'assises ne tarderont pas à nous le faire connaître.
A côté de cette grande comédie, qu'est-ce que la petite pièce dont le théâtre du Vaudeville nous a gratifiés cette semaine? Bien peu de chose, en vérité. Nous en dirons quelques mots cependant, ne fut-ce que pour la rareté du fait. Et n'est-ce pas vraiment une rareté, par ce temps de disette dramatique, qu'un drame nouveau en deux actes? Les théâtres vivent en effet les bras croisés depuis longtemps, et ne produisent rien de neuf. Jetons-nous donc avidement sur ce morceau de vaudeville qu'ils offrent, par hasard, à notre appétit.
Le titre dissimule; le litre est; un Mystère. Qu'y a-t-il dans ce mystère? Il y a une veuve et un colonel: la veuve est duchesse, rien que cela; vous voyez que je ne vous mets pas en compagnie de petites gens. Quant au colonel, il est le brave des braves, et se bat avec acharnement pour son pays, jusqu'à la dernière extrémité.
Le hasard de la guerre l'emmène loin de duchesse; puis, la guerre finie, la duchesse et lui se retrouvent. A la vue du colonel, la duchesse pâlit et frissonne, à la vue de la duchesse, le colonel se trouble; pourquoi? C'est là le mystère; mais comme je suis, de ma nature, un homme fort peu mystérieux, je vais vous dire le mot de l'énigme.
Il y a deux ou trois ans de cela le colonel avait sauvé la duchesse d'un grand danger; la reconnaissance fit naître l'amour dans le cœur de la tendre femme; le colonel profita de la circonstance; mais le lendemain du jour où il avait tout obtenu d'elle, il écrivit à cette pauvre duchesse une lettre insolente où il lui déclarait qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne l'avait jamais aimée, et que fini était fini entre eux; c'était là un terrible outrage. Comment un si brave colonel a-t-il pu commettre une si grande lâcheté? Que voulez-vous, mon colonel avait une vengeance à exercer contre les femmes et particulièrement contre les duchesses, et celle-là lui était tombée la première sous la main; remarquez que j'explique mon colonel et que je ne l'excuse pas.
Mais voici que la duchesse prend sa revanche: le remords est entré dans l'âme du coupable, et en revoyant sa victime, il se met à l'adorer; d'abord la duchesse, se rappelant l'outrage, le repousse avec dédain, avec colère, avec mépris; mais les colonels sont bien habiles, et les duchesses bien faibles! Celui-ci fait tant qu'à force de repentir, de désespoir et d'amour, il apaise le ressentiment de la comtesse; que dis-je? il fait de nouveau la conquête de son amour, et cette fois la conclusion de l'aventure est un bon et légitime mariage qui absout le passé et assure le présent. Mon colonel, tu dois être content! De son côté, le public n'a pas troublé, par aucun signe équivoque, cette satisfaction du colonel et de la duchesse. L'auteur est M. Alexis de Comberousse.
 Mademoiselle Rachel, rôle de Phèdre. |
 Mademoiselle Rachel, rôle de Marinette dans le Dépit amoureux. |
Nous avons déjà parlé de la double apparition que Mademoiselle Rachel a faite, avant de partir pour Bruxelles, dans Phèdre et dans le Dépit amoureux; Molière et Racine tout à la fois, ce n'est pas peu d'ambition. Dans Phèdre, mademoiselle Rachel a été admirable; il est difficile d'allier un art plus exquis à une vérité plus poétique; quant à la Marinette du Dépit amoureux, les éloges lui sont plus disputées. Nous ne reviendrons pas sur ceux que nous lui avons donnés la semaine dernière; peut-être, dans notre enthousiasme pour Phèdre, avons-nous un peu flatté Marinette; nous aussi, d'autres ne l'ont ils pas trop maltraitée? Sans doute Rachel-Marinette n'a pas interprété Molière avec la vérité de Phèdre-Rachel récitant les beaux vers de Racine; mais a-t-elle joué aussi maladroitement dans cette comédie que de rudes critiques l'ont prétendu? ce n'est pas notre avis. Je crois qu'il est plus juste de dire que dans ce rôle de Marinette, mademoiselle Rachel a été plutôt singulière que mauvaise. Quoi qu'il en soit, nous offrons à nos lecteurs cette Phèdre et cette Marinette en personne. Voici la pâle et malheureuse fille de Pasiphaé et de Minos; voici l'amante joviale de Gros-René. Là, les soupirs, le remords, la fatalité; ici, le gros rire et le propos gaillard; toute la poésie du malheur, toute la folle insouciance de la gaieté; ce qu'il y a de sûr, c'est que Phèdre convient naturellement à mademoiselle Rachel, et que l'une semble avoir été créée pour l'autre; tandis que le bavolet, le jupon court et la gaieté de Marinette lui vont comme va un costume d'emprunt qu'on a pris par hasard et pour une fantaisie. Il est probable que mademoiselle Rachel ne le reprendra pas de sitôt: on ne se déguise pas tous les jours.
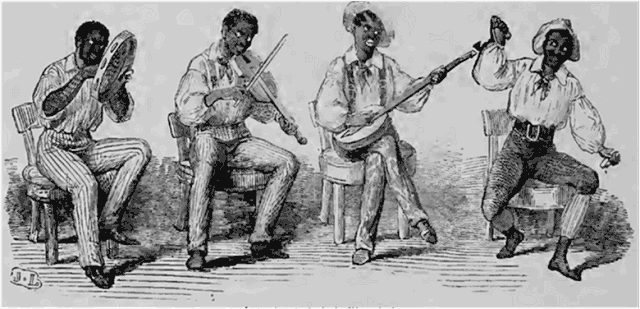
Les ménestrels de la Virginie.
Il s'est passé au théâtre du Palais-Royal quelque chose d'assez bizarre; nous voulons parler de l'apparition des ménestrels de la Virginie. Ces ménestrels sont au nombre de quatre; on les avait annoncés avec grand fracas, et pendant huit jours, de solennelles affiches placardées sur tous les murs sollicitaient d'avance l'admiration publique; les curieux sont donc accourus; mais ces affiches, comme tant d'autres, avaient battu la grosse caisse avec beaucoup trop de bruit; vérification faite de ces merveilleux phénomènes, on a reconnu qu'ils n'étaient en réalité que des bipèdes fort ordinaires.
D'abord ils ont l'air de nègres; mais méfiez-vous-en, ce sont des nègres qui déteignent; un homme digne de foi m'a certifié qu'il les avait vus, de ses propres yeux vus, se barbouiller de noir dans la coulisse.
Cependant les voici tous quatre qui entrent en scène; les frais de cette entrée ne sont pas considérables; avec quatre chaises, on fait l'affaire; or, les chaises étant généralement faites pour s'asseoir, nos ménestrels y sont bientôt assis; l'un racle du violon, l'autre d'une espèce de guitare, le troisième agite des petits bâtons en forme de castagnettes, et je ne sais plus ce que fait le quatrième, pas grand'chose, j'imagine, à l'exemple de ses trois confrères. Pour rehausser l'agrément de cet orchestre baroque, nos nègres faux teint baragouinent des chansonnettes dont la plus courte et la plus agréable semble lutter de monotonie et de longueur avec la complainte du Juif errant; ces chansons se donnent pour écrites en pure langue de l'Ohio, mais la vérité est que c'est du picard tout franc; cela chanté, un des quatre ménestrels se met à remuer la tête, puis à danser une danse qui rappelle à s'y méprendre le sautillement d'un frotteur qui donnerait un coup de brosse à un parquet.--On a rarement vu une mystification plus complète; c'est comme souvenir de ce puff sans pareil, même dans ce siècle du puff par excellence, que nous avons cru devoir recueillir l'image de ces étonnants ménestrels et les mettre sous vos yeux, chers abonnés.--Ne touchez pas à ces nègres, vous vous noirciriez les doigts.
On se rappelle les sœurs Romanini, fameuses danseuses de corde, ou plutôt danseuses de fil d'archal; tout Paris avait admiré, il y a quelques années, leur adresse et leur intrépidité. On annonce leur prochain retour et leur rentrée au Cirque-Olympique; nul doute que leur vogue ne s'accroisse encore de la singularité d'une aventure dont une des «Jeux sœurs Romanini vient d'être l'héroïne en Afrique, Mademoiselle Romanini l'aînée en sa qualité de femme intrépide, s'était tout récemment aventurée un peu avant dans le désert; une bande de quatre ou cinq Zeybecks l'aperçut, vinrent à elle et voulut s'en emparer. Mademoiselle Romanini est jolie, et les Zeybecks sont fort galants un peu rudes, mais fins connaisseurs; une autre que mademoiselle Romanini se serait évanouie, et Dieu sait que MM. les Zeybecks en auraient fait; mais rien ne donne plus de courage à l'innocence que la danse de corde et l'usage du fil d'archal; donc, notre demoiselle Romanini, au lieu d'avoir une crise de nerfs, s'élance hardiment à la rencontre des Zeybecks, se précipite sur le premier qui se présente lui enlève son yatagan, v'lan! lui en donne un coup dans le flanc et le tue; les quatre autres Zeybecks menacent mais la Romanini leur tient tête; elle en blesse un profondément, elle en égratigne autre, et les deux qui reste sans blessures s'enfuient épouvantés. Voilà ce qu'a fait mademoiselle Romanini, et la danse qu'elle a fait danser aux Zeybecks... sans balancier.
Mademoiselle Romanini sera à Paris dans quinze jours; elle débutera par une représentation au bénéfice de la veuve et des enfants du Zeybeck qu'elle a tué, et des deux Zeybecks qu'elle a mis hors de combat.
Mademoiselle Romanini est une ennemie généreuse; comme tous les grands vainqueurs elle panse les blessures qu'elle a faites, et tend la main au vaincus. Mais, tudieu! quelle rude vertu! nous ne conseillons pas aux Zeybecks du Jockey's-club de s'y frotter sans la permission de mademoiselle Romanini; on voit ce qu'il en coûte.

La plus belle moitié du genre humain à la Cour
d'Assises.
Un Voyage au long cours à travers la France et la Navarre.
Récit philosophique, sentimental et pittoresque.
(Voir t. III, p. 249 et
263.)
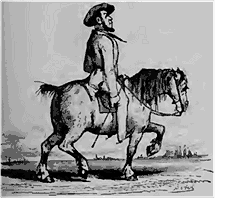
Vingt fois on avait vu Othon
seller sa grande jument
poulinière.
CHAPITRE VI.
LA GRAINE DE LUZERNE.
Pourquoi donc M. Robinard avait-il serré le bras de madame Verdelet avec cette grossière familiarité? Et pourquoi la jeune dame avait-elle baissé les yeux en rougissant?--Je connais, parmi les lecteurs, de si mauvaises langues, que je dois me hâter de prévenir les inductions malignes que plus d'un tirerait sans doute de l'impertinence et de la rougeur de nos deux personnages.
Le présent chapitre sera donc uniquement consacré à démentir les malhonnêtes apparences des précédents; car, comme l'a dit M. Ponsard:
La maison d'une épouse est un temple sacré,
Où même le soupçon ne soit jamais entré.
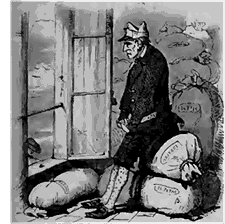
Othon revenait tristement chargé
de sa fameuse graine, dont
regorgea bientôt la maison
paternelle.
M. Othon Robinard de la Villejoyeuse cachait pourtant, sous cette mine superbe que vous lui connaissez, un souci rongeur comparable au ver qui mord le cœur d'une belle pomme. M. Othon voulait se marier, et quoiqu'il fût doué d'un physique plus que convenable, qu'il portât un beau nom et qu'il eût une bourse ronde, aucune demoiselle de l'Orléanais ne s'était encore souciée de s'appeler madame de la Villejoyeuse. Inde iræa. Vingt fois, on avait vu Othon seller sa grosse jument poulinière et embrasser son affectionné père, en lui disant de faire préparer la chambre verte, destinée, depuis un temps immémorial, aux nouveaux mariés de la famille Villejoyeuse, et vingt fois aussi on avait vu le même Othon revenir l'oreille basse, le chapeau enfoncé sur les yeux, et garçon comme devant. Les bonnes gens s'imaginaient qu'un malin sorcier avait jeté un sort sur le beau blond.

Louise, qui tricotait au coin du
feu, entendant le récit de ces
prouesses, levait ses yeux timides
vers les deux hercules.
Ici Othon était supplanté par un misérable maigre qu'il aurait tué de son petit doigt; là, les trois sœurs déclaraient qu'elles voulaient se faire religieuses plutôt que d'épouser le magnifique baronnet; naguère enfin, pour comble de honte, une riche héritière des environs d'Étampes, courtisée en même temps par un vieil employé de la douane et par le bel Othon, avait fait choix de celui-là à la barbe rousse de celui-ci.
Décidément Othon mettait sa gloire à vaincre la rigueur du destin, et, jour et nuit, il n'avait plus qu'une idée: «Il faut que je me marie, il faut que je trouve une femme plus belle et plus riche que toutes celles qui m'ont rebuté; il faut, pour vexer tout le pays, que je fasse une noce dont on se souviendra comme de la plus fameuse de toutes les noces.» Et là-dessus, il sellait derechef sa jument, embrassait encore son père, lui disant désormais, par prudence:
«Je m'en vais à Étampes chercher de la graine de luzerne.
--Bon, répliquait le vieux baronnet; moi, je m'en vais faire préparer la chambre verte.»
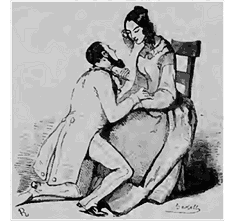
Trois jours après, Othon s'était
glissé dans la chambre de
l'héritière, et lui demandait sa
main à genoux.
Ce qui donnait aux plus madrés le mot du rébus. Et, dans la province, on commençait à nommer graines de luzerne toutes les demoiselles à marier.
Mais Othon, toujours poursuivi par un sort contraire, s'en revenait tristement, chargé de sa fameuse graine, dont regorgea bientôt la maison paternelle, de telle sorte que le vieux baronnet eût fort désiré que son bien-aimé fils variât un peu son prétexte, quand il allait aux champs pour chercher femme.
Sur ces entrefaites, Othon crut un instant toucher au terme de ses vœux, et se vit au moment de déjouer la malice de la fortune ennemie.--Il parvint à se faire aimer.--Voici comment.
Mademoiselle Louise était la nièce d'un sieur Bouchard, qui se disait descendant direct des Bouchard de Montmorency, et avait un gros moulin à blé sur la rivière du Loir. Louise passait, dans le pays, pour un très-bon parti, mais les prétendants à sa main étaient fort rares parce que, de bonne heure, Antoine Bouchard, son cousin, fils du meunier, avait bonnement annoncé qu'il casserait les reins au malappris qui marcherait sur ses traces conjugales. Cet Antoine était haut de près de six pieds, il avait des épaules carrées comme la porte de son moulin, et des poings énormes toujours au service, de son humeur revêche, et de son caractère batailleur. Mais Antoine joignait à ces solides qualités une laideur au moins égale à sa stature. La roue de son moulin loi avait un beau jour attrapé la joue gauche, dont un morceau fut enlevé, que les plus habiles médecins ne purent jamais remplacer.

Ce fut ainsi que Louise devint
madame Verdelet.
Mademoiselle Louise, élevée au moulin, grandit dans le respect absolu et dans l'admiration des géants: tout le jour elle entendait son oncle et son cousin, ces deux colosses, mépriser le reste des hommes et apprécier chacun de leurs voisins au degré de sa vigueur ou de sa taille. Le soir, après souper, il n'était question, entre le père et le fils, que des fameux coups de poing que l'un et l'autre se vantaient d'avoir donnés, et des tours de force incomparables que tous deux avaient exécutés. Le père avait un jour, disait-il, arrêté d'une main sa voiture lancée au grand galop; le fils avait soulevé un tonneau tout rempli de vin; le père s'était, en son jeune temps, battu contre cinq goujats ensemble; le fils avait, d'un coup d'épaule, jeté bas un gros mur, etc., etc.
Louise, qui tricotait au coin du feu, entendant le récit de ces prouesses, levait ses yeux timides vers les deux Hercules, qui lui semblaient alors les premiers du monde, et dont un geste, un regard même, la faisait trembler de tous ses membres. Mais son cousin était si laid!... Louise avait bien soin de toujours placer sa chaise du côté droit d'Antoine, c'est-à-dire du côté de la joue qui n'était point balafrée; et pourtant, malgré cette précaution, la pauvre demoiselle ne pouvait s'empêcher de penser souvent à cette horrible, joue gauche qu'elle serait bien, un jour, obligée de voir: car, quand on se marie, c'est pour longtemps, comme disait Oscar, et votre mari, madame, ne sera pas toujours tourné du côté, droit.
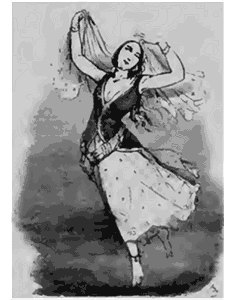
Une Bibiaderi dansant.
Othon avait épuisé déjà la plus grande partie de l'Orléanais, et, en désespoir de cause, il résolut d'aller chercher de la graine de luzerne au moulin du sieur Bouchard. Il n'ignorait point les charitables avertissements que le terrible Antoine avait semés dans le pays, mais il savait aussi que les Bouchard avaient entendu parler de lui d'une façon qui devait leur donner de la jalousie; et comme jusqu'alors Othon avait toujours rossé, il ne s'imaginait pas qu'il pût trouver à son tour qui le rossât.
Donc, il s'en allait fort tranquille et donnant des coups de poing dans l'air pour se faire le bras. A deux portées de fusil du moulin, il entendit une voix lamentable qui implorait son assistance; c'était le vieux Bouchard qui s'était démis la jambe en tombant de cheval et gisait sur la route, sans pouvoir même se traîner. L'occasion était belle. Othon chargea vigoureusement, sur ses épaules le gros homme blessé, et, leste sous ce faix énorme, il fit une entrée triomphale au moulin.
Louise et Antoine poussèrent un cri d'admiration à sa vue; le fils Bouchard pâlit d'étonnement et de jalousie, car, s'il prétendait avoir soulevé un tonneau de vin, assurément il ne s'était jamais vanté d'avoir soulevé l'auteur de ses jours. Louise, qui, par habitude, regardait d'abord le nouvel arrivé du côté droit, sembla surprise agréablement lorsque la joue gauche de M. Othon lui parut tout à fait semblable à la droite, et désormais elle levait sans précaution ses yeux sur le bel étranger.

Je me rappelle, dit l'abbé, avoir
lu les aventures extraordinaire
d'un coche parti de Nantes, en
Bretagne, et qui demeura plus de
deux ans en route avant d'arriver
à Paris, lieu de sa destination.
Antoine considérait le baronnet d'un œil sournois, et plusieurs fois il grogna en voyant les regards d'Othon dirigés fixement sur mademoiselle Louise. Le soir venu, Bouchard le père, la jambe enveloppée, était étendu sur une bergère, et la conversation se tourna naturellement vers son objet habituel, je veux dire la force des poignets. Antoine se vanta magnifiquement: à l'en croire, chacun de ses coups de poing aurait tué un bœuf. Othon avec modestie rappelait quelques succès obtenus par lui dans les foires du département; sur quoi, le jeune meunier lui prit la main, et, tout en feignant de rire, il lui serrait le poignet de façon à le briser. Othon ne sourcilla pas; de la main qui lui restait libre il saisit à son tour l'autre poignet d'Antoine, et celui-ci ne put s'empêcher de jeter un cri.--Dès ce moment, Antoine fut déchu du premier rang aux yeux de Louise.
Trois jours après, Othon, qui ne perdait point de temps, s'était glissé dans la chambre de l'héritière, et, à genoux, lui demandait sa main en les termes les plus fleuris que lui pouvait fournir sa littérature fablière. Louise rougissait, baissait les yeux, ne répondait rien, mais son silence était beaucoup plus clair que les plus longs discours du monde. Tout à coup un bruit de pas se fit entendre dans le corridor.

Première banquette du coche.
«Fuyez, disait Louise toute tremblante.
--Fuir? jamais! répliquait le superbe Othon.
--C'est Antoine, il vous tuera!
--Me tuer?»
Othon retroussait déjà ses manches. Louise joignit les mains, et si vivement elle le supplia, que, maugréant et jurant, il consentit enfin à se blottir au fond d'un placard, que la demoiselle referma sur lui. Antoine frappait à la porte d'entrée, il frappait à coups redoublés;
«Ouvre-moi, mille tonnerres! ouvre-moi!»
Louise alla ouvrir à son cousin. Quand il la vit pâle et chancelante, il ne conserva plus aucun doute: la colère lui monta au visage, et sa balafre, devenue pourpre, était horrible à voir.
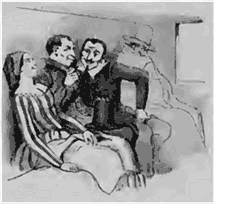
Deuxième banquette du coche.
«Où est-il? que je le tue!» s'écriait-il, heurtant violemment son bâton sur le carreau; «sacredieu! où est-il? sacrebleu!» Louise était près de se trouver mal; Othon, blotti au fond du placard, se contenait encore, quoique ses oreilles commençaient à s'allumer. «Mille dieux!» s'écriait le terrible cousin, frappant du pied; «il a bien fait de se sauver, ce craquelin, ou je l'aurais exterminé!»
Craquelin! exterminé! Othon, bouillonnant dans son trou, donna violemment du poing dans la porte du placard, et s'écria de toute sa force:
«Ici! maître sot, ici, ouvre-moi!»
Et il frappait coups sur coups dans la porte. Mais Antoine, renversant des chaises de droite et de gauche:
«Mille, dieux, si je le trouve! s'il a le malheur de vous regarder encore, je l'aplatis comme un œuf sur le mur!
--Ouvre-moi donc, gredin! lâche! bélitre! ouvre-moi donc, grand gladiateur!»
Othon faisait rage dans son placard et y piétinait sur la faïence avec un vacarme effroyable. Louise avait pris le parti de s'évanouir.--Antoine lâcha encore une vingtaine de jurons épouvantables, frappa du pied et du bâton sur tous les meubles, et sacra de toutes ses forces en s'écriant qu'il tuerait Othon, partout où il le rencontrerait.--Là-dessus il sortit.
Othon, écumant, parvint à forcer la porte de sa prison, et s'élança, le poing levé, à la poursuite de son exterminateur; mais la première personne qu'il rencontra dans le corridor, ce fut le vieux Bouchard, qui le prit par le milieu du corps et, avec l'aide de deux valets de charrue, le jeta enfin à la porte, dans un fossé plein d'eau.
Louise déclara à son oncle qu'elle n'épouserait jamais Antoine, et celui-ci, par vengeance, conseilla à son père d'accepter la demande de M. Verdelet, pharmacien retiré et adjoint au maire d'Orléans.--Ce fut ainsi que Louise devint madame Verdelet, à son grand deuil. Othon, dans sa première exaspération, avait bien songé à massacrer le vieil apothicaire, mais il se ravisa, et sachant que Louise avait conservé de lui un tendre souvenir, il préféra la ruse à la force vis-à-vis du mari. Electeur influent, la maison de l'adjoint lui fut ouverte d'abord, et quoique M. Verdelet le jugeât par derrière t'animal le plus insupportable, par-devant il le traitait flatteusement, et l'invitait toujours à dîner lorsqu'il venait en ville. Louise, très-réservée avec son ancien prétendant, lui marquait néanmoins un reste d'intérêt ou d'admiration; et M. Othon, triomphant de quelques regards qu'on lui adressait tous les huit jours, s'apitoyait déjà publiquement, comme nous avons vu, et très-prématurément, ce semble, sur le sort futur réservé à ce pauvre mari Verdelet.
D'où il suit que le jeune Oscar avait eu grand tort de prendre un avenir douteux pour un passé bien accompli; et désormais, nous le promettons à nos lecteurs, notre héros se gardera, dans ses jugements, d'une semblable témérité.
CHAPITRE VII.
AVANT D'ARRIVER A ORLÉANS.
Le jeune Oscar, placé, on s'en souvient, vis-à-vis de madame Verdelet dans le wagon, se perdait en toutes sortes de réflexions analytiques; car c'était là le faible ou le fort, comme vous voudrez, de notre personnage, de vouloir toujours analyser ses moindres impressions, et d'employer un tiers de sa vie à chercher intérieurement le pourquoi des deux autres; encore souvent cette recherche n'aboutissait-elle à rien de satisfaisant.--Or, à ce moment, Oscar se demandait compte à lui-même du plaisir manifeste que lui causaient les jolis yeux de madame Verdelet, et à bon droit il s'étonnait de se trouver si jeune en voyage, lui à qui les dames de Paris reprochaient de valser comme aurait pu faire Caton le censeur dans ses jours de liesse.
«Le cœur de l'homme, se disait notre héros, a beau se fortifier et même se durcir, il sera toujours faible et mou dans le changement, et le moyen de demeurer sage, c'est de rester immobile; pourtant je ne veux point monter sur la colonne du Stylite, ni regarder éternellement mon nombril, comme font les fakirs de l'Inde.--Et parbleu! j'y pense maintenant, ces pieux missionnaires qui ont appris à coups de discipline à se mortifier la chair dans la poudre de saint Sulpice... je m'imagine que le diable doit trouver son compte lorsque nos saints hommes, abordant sur le rivage indien, aperçoivent d'abord une bibiadéri portant à sa cheville blanche et rose de jolis petites clochettes qui sonnent en mesure à chacun des pas harmonieux de la danseuse!--Bref, j'estime que les grands voyageurs doivent être d'insignes amoureux, et, quand je serai marié, j'entends bien que ma femme ne monte jamais en voiture sans moi; voyager avec son mari, cela diminue beaucoup l'influence perfide du changement, la figure d'un époux étant toujours le contraire et l'antidote de cette haïssable nouveauté...»
Tandis que le jeune Oscar méditait ainsi dans son for, le vieil abbé, ami de la conversation, et passionné, en sa qualité de géographe, pour les beaux discours, avait recommencé à deviser avec le gros Verdelet sur les chemins de fer, les diligences et autres modes de transport; et, de fil en aiguille, il en vint à trouver pour sa fameuse histoire l'à-propos qu'il guettait, ou plutôt qu'il s'efforçait d'amener depuis dix minutes. Il s'écria donc... modestement toutefois;
«C'était en l'an de grâce 1567... à la tombée de la nuit, le coche de Paris partit de Nantes... Huit personnes se trouvaient entassées dans la pesante voiture, huit personnes de sexe, d'âge et d'état différents... d'abord un soldat breton qui s'en allait en guerre, et portait sur le visage un coup de sabre très-bien affilé du coin de l'œil droit jusqu'au bout de la moustache gauche, en passant par ou sur le nez; ensuite une comédienne, femme d'une vie hasardeuse, qui depuis longtemps, adorait les faux dieux, et avait contracté, sur le théâtre, l'habitude de porter du rouge sur les deux joues, ce qui la faisait ressembler à une peinture; troisièmement et quatrièmement, une grosse dame de petite noblesse, avec sa fille grande demoiselle que l'on avait élevée les yeux baissés, ce qui annonçait sur sa figure une vive dévotion; cinquièmement un moine de l'ordre des Carmes, gras et frais, comme il convient à un serviteur de Dieu, exempt des soucis qui font pâtir le commun des hommes; sixièmement, un cavalier encapuchonné dans son manteau, et dont on ne voyait encore que le bout du nez, mais qui grommelait à part lui, ce qui n'annonçait rien de bon; septièmement et huitièmement, deux Gascon qui hâblaient en leur coin et parlaient tout haut de la Dordogne en des termes libidineux pour faire sourire la comédienne assise à côté d'eux.
«Ainsi était composée notre carrossée, et déjà l'on était à la bailleur d'un village nommé Oudon, qui a une grosse tour lorsque tout à coup l'essieu crie et se rompt...»
Le convoi arrivait à Orléans. Madame Verdelet donna deux ou trois coups du coude à son mari, qui enfin, d'un ton froid se résigna à offrir l'hospitalité à nos deux voyageurs. La politesse du gros monsieur était si forcée et si impolie, que notre héros, par malice, accepta ses offres avec une cordialité apparente qui dut faire enrager l'amphitryon.
«Et moi, s'écria Robinard, où me logerez-vous, mon cher adjoint, car je vous préviens que j'ai compté sur votre domicile?--M. Verdelet ouvrait une grande bouche, mais il ne répondait point...--Mon Dieu! point de façons, s'écria le baronnet, un lit de sangle au salon... deux nuits, c'est bientôt passé; et parbleu! je ne caserai point vos deux Chinois de faïence verte!»
Madame Verdelet avait un air mécontent qui réconcilia un peu le jeune Oscar avec elle.
(La suite à un prochain numéro.)
Albert Aubert.
Les Romanciers contemporains.
M. EUGÈNE SUE.
Si le mérite d'un écrivain se devait mesurer au bruit que ses livres font dans le monde, l'auteur des Mystères de Paris serait justement mis à la première place parmi les romanciers contemporains. Les succès les plus fameux oui pâlit près des siens, et l'immense popularité des deux grands auteurs anglais, Walter Scott et Charles Dickens, ne surpasse point celle que M. Eugène Sue a conquise rapidement depuis quelques années. Quatre-vingt mille exemplaires des Mystères de Paris se sont vendus dans les seuls États-Unis et j'imagine que les meilleurs romans de Cooper n'ont jamais reçu un semblable accueil des Américains eux-mêmes. Chez nous, depuis les romans infinis du dix-septième siècle, on n'avait point vu de livres obtenir une faveur aussi universelle que ceux de M. Eugène Sue; et, s'il nous était permis de toucher à la biographie d'un écrivain encore vivant, nous trouverions sans doute, de la part des lecteurs et des lectrices d'aujourd'hui, des marques de sympathie et d'admiration plus flatteuses encore que l'offre de mariage faite autrefois à Calprenède par une très-riche veuve, sous cette condition que le marié achèverait son interminable roman de la Cléopâtre.
Le succès, quand il dépasse ainsi toutes les limites, doit être tenu d'abord, et avant examen, pour parfaitement légitime; désormais le rôle de la critique se borne à chercher, à discerner, à expliquer le mérite de l'œuvre, mérite nécessaire, mérite que ne peut laisser en doute l'extraordinaire applaudissement du public. Pourtant je ne sache point de livre qui ait été critiqué, je dirai même invectivé avec autant d'amertume que le furent les Mystères de Paris, et nous avons vu des Aristarques s'attarder encore à nier le succès, alors même qu'il devemait de jour en jour plus éclatant et plus incontestable. Que la mode s'en soit un peu mêlée, je le veux bien; de quoi la mode un se mêle-t-elle point depuis que le monde est monde? Mais à coup sûr la sottise serait étrange d'attribuer tout le succès des Mystères à cette insaisissable frivole faveur qui a introduit dans tous nos salons la gigue hongroise que vous savez.
D'ailleurs, je veux le dire tout de suite, le roman de M. Eugène Sue a obtenu son plus grand succès peut-être parmi une classe de lecteur» sur laquelle la mode n'a que bien peu d'empire; j'entends la classe des pauvres et des malheureux, elle est allée, cette fois, chercher dans ces feuilletons, lecture ordinaire des gens dont les heures ne sont pas comptées, les paroles généreuses, les libérales pensées de l'écrivain, sa touchante sympathie, sa noble pitié pour ceux qui souffrent et qui gémissent dans ce meilleur des mondes. Que de belles histoires de cœur, que d'extraordinaires aventures, que d'admirables élégies, que de drames effrayants nous ont été contés bien contés depuis tantôt vingt ans! Que d'esprit et style, que de sentiment et d'imagination ont été jetés, comme à pleines mains, dans tous ces romans psychologiques, intimes, historiques ou goguenards dont notre époque s'est montrée merveilleusement abondante. Mais le peuple ne les a point lus, mais le peuple les a laissés de côté, ne les jugea point faits pour lui, ne les considérant guère que comme chimère agréable d'un monde qu'il ne connaît point, d'une société qui lui est étrangère. Seul il a été véritablement populaire et dans toute l'acception de ce mot, l'écrivain généreux qui entreprit de Révéler les réelles et douloureuses misères du pauvre, qui mit pour ainsi dire sa grande imagination au service de cette cause charitable, qui sût bâtir avec les souffrances et les vices d'en bas une histoire plus émouvante, un roman plus pathétique que les autres n'avaient su faire avec tous les pleurs d'amour, toutes les peines du cœur, toutes les maladies de l'esprit, toutes les infirmités de la grandeur humaine. Celui-ci avait touché la plaie vive, celui-là avait fait vibrer la corde affreuse, et, terreur et pitié, ces deux grands ressorts de tout drame possible, emplissaient tellement le cœur de l'écrivain, qu'il lui fallait modérer toujours l'expression de son sentiment, plutôt que de l'exalter et de l'exagérer, selon l'usage des romanciers d'amour. On sent bien que l'auteur a souffert lui même en écrivant ces pages douloureuses; on voit bien que, comme autre fois Diderot, composant sa Religieuse, M. Sue, composant les Mystères de Paris, il s'est désolé du conte qu'il faisait!»
Ce serait une étude intéressante que de suivre dans les romans de M. Eugène Sue le progrès et la transformation du système perpétuel de l'auteur, qui repose tout entier sur ce vieil antagonisme, deux principes, le bien et le mal. A son début, le romancier, frappé déjà de la double domination qui se partage le monde, imagine toujours, à côté du ses héros excellents par le cœur et par l'esprit, un personnage effroyable dans lequel semblent se réunir les vices et les méchancetés, une sorte de traître un peu mélodramatique, disons-le sans compter l'imitation de Méphistophélès. Ainsi nous allons du Szaffie de la Salamandre au Lugarto de Mathilde, à travers plusieurs héros du mal coulés dans le même monde. Mais aujourd'hui le romancier a fait ce grand progrès de ne plus imaginer de semblables parangons de vertu ou de vice, et de chercher plutôt le bien et le mal dans la réalité même. Alors, au lieu de Lugarto, ce monstre impossible, chargé de rétablir l'équilibre quand Mathilde et Rochegune font par trop pencher la balance du côté de la vertu; au lieu, dis-je, de Lugarto, nous avons eu les misères du peuple et les vices affreux engendrés par ces mêmes misères; un lieu des noirceurs d'une âme diabolique, l'auteur nous a montré ce gouffre sans fond plein d'infamies, de crimes et de douleurs qui se creuse nuit et jour au plus bas de la société. Alors aussi s'est subitement élevé le talent du conteur. Soutenu, pour ainsi dire, par la force de la réalité, l'écrivain ne s'est plus épuisé en ces paginations excessives qui péchaient toujours par leur excès même; désormais il n'avait besoin que de refléchir dans son œuvre ces vérités effrayantes qu'on n'invente point, et qui laissent bien loin, pour la terreur et la pitié, pour la curiosité même, toutes les inventions humaines; désormais le roman devenait presque de l'histoire.--Après cela, on a crié de toutes parts à l'immoralité. A quoi non parler aux pauvres de leur pauvreté, aux misérables de leur misère, aux désespérés de leur désespoir? S'ils allaient s'irriter enfin à la vue de ce tableau trop vrai de l'atroce destinée que le monde leur a faite?... Rognez ce chapitre, la morale le réprouve; cachez cette plaie, l'humanité n'en supporte point la vue; étouffez ce cri, l'ordre public en serait troublé; taisez ce scandale, la religion s'en indignerait, etc. Ainsi les scrupuleux effarouchaient de la nudité de ces tableaux; les délicats ne pouvaient tolérer la crudité de ces tons, et les uns et les autres condamnaient chaque chapitre en particulier, oubliant en vue de quel enseignement général l'auteur les avait tracés, ne voyant pas quelle haute moralité il avait eu le généreux dessin de tirer de ces pages immorales et scandaleuses!
Dieu merci! tout cela est devenu bien clair aujourd'hui; la faveur publique, qui ne peut, quoi qu'on dise, s'attacher jamais à une œuvre foncièrement immorale, a fait justice déjà de toutes ces fausses accusations dirigées contre l'auteur des Mystères de Paris, et il nous est permis maintenant de louer, le louer hardiment et sans restrictions ce merveilleux talent de conteur qui a gagné à M. Eugène Sue tous les lecteurs du monde.
Il ne faut point se dissimuler que le roman français a toujours été quelque peu bavard. Souvenez-vous des volumineuses histoires du Cyros et de la Clétie. Que de conversations mêlées au récit! que de portrait-tracés au milieu des événements! que de réflexions au travers de l'aventure! Mademoiselle de Scudéry est bien la patronne de tous nos romanciers passés, présents et futurs. Toujours nous avons vu nos conteurs les plus excellents songer à faire ainsi, tout en contant, les affaires de pur esprit. Nos historiens même écrivaient des chapitres entiers, où ils se délassaient du récit en discutant les traits, en raisonnant sur la politique, en déployant toutes les richesses de leur style. Aucun d'eux, avant M. de Barante, n'avait eu assez de résignation pour accepter la fameuse devise: Scribitur ad narrandum, non ad probandum. Parmi nos romanciers, prenez tel que vous voudrez, prenez, comme j'ai dit, ceux qui content par excellence, prenez Lesage lui-même; ne sentez-vous pas à chaque page l'esprit satirique de l'auteur percer sous les discours qu'il met dans la bouche de ses personnages. Souvent ne voyez-vous pas l'histoire interrompue par des réflexions que les faits suggèrent à l'auteur, plutôt qu'aux personnages du roman? De la Glèbe on pourrait extraire un volume entier de conversations, de digressions morales et de portraits inutiles à l'action. De Gil Blas on tirerait de même un Lesagana, c'est-à-dire un recueil d'aphorismes critiques, de hors-d'œuvre littéraires ou moraux appartenant en propre à l'auteur, et à peu près étranger à son récit. Enfin, il n'y aurait pas jusqu'au roman burlesque et goguenard de Pagault-Lebrun qui ne nous offrît un pareil exemple de digression personnelle, et je n'en veux pour preuve que le fameux chapitre de la lanterne magique dans Monsieur Halle.
Aujourd'hui le spectacle est beaucoup moins philosophique, et se tourne de préférence vers la description.
Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales.
Nos meilleurs romans, les plus tendres, les plus passionnés, les plus émouvants, décrivent encore plus qu'ils ne content; pas une scène ne se peut passer sans que le lieu ne soit peint avec une exactitude rigoureuse, pas une parole d'amour ne sera dite sans que nous sachions sous quels arbres et auprès de quelles fleurs elle doit être prononcée. M. de Balzac, cet esprit si fécond, si fin et si vigoureux, a plus que tout autre sacrifié à la description, et, pour citer ici l'un de ses meilleurs livres, le Lys dans la vallée est plutôt un paysage qu'un roman. Jusqu'à Mathilde, nous avons vu M. Sue payer aussi son tribut à la mode descriptive qui gouverne toute notre époque, depuis les poètes jusqu'aux avocats; mais les Mystères de Paris semblent purs de cet élément si funeste au récit, et nous montrent un conteur véritable, un conteur uniquement jaloux de conter, se sacrifiant lui-même à son conte, élève et rival des conteurs modèles, Walter Scott et Dickens.
On a souvent répété, comme éloge insigne, que Walter Scott avait fondé le roman historique; à mon sens, il eût mieux valu dire, pour l'honneur de l'écrivain, qu'il avait fondé le roman conteur; et personne ne pourra douter du mérite singulier de ce nouveau genre, si l'on réfléchit aux difficultés presque insurmontables de la narration. Les plus grands écrivains de notre langue, Bossuet, Fénelon, Voltaire, n'ont jamais donné de marque plus visible et plus belle de leur talent d'écrire que lorsqu'ils abordèrent le narratif. L'action d'abord, l'action ensuite, et encore l'action, voilà la triple et unique qualité essentielle au véritable récit, et sans laquelle il ne saurait exister. Volontiers j'adopterais comme emblème allégorique du roman conteur cette caricature, où nous voyons une locomotive qui tire derrière elle une immense page de papier noir scié à la vapeur, et la déroule incessamment sur le railway. Vous ne conterez point, si vous n'avez dans l'esprit comme un mouvement perpétuel, comme une agitation, comme un souffle d'air qui enfle la voile de votre invention et vous pousse toujours en avant; nous l'avons dit, le vrai conteur conte pour conter, ne se préoccupant guère du pays déjà parcouru, moins encore de l'espace qui lui reste à franchir; tout entier à l'action du présent, il se meut, il avance, entendant résonner à son oreille la voix impérieuse dont parle Bossuet, et qui lui crie sans trêve; Marche! marche!--Aussi semble-t-il que M. Eugène Sue vient de rencontrer le sujet unique, le sujet par excellence, le vrai sujet du roman conteur, je veux dire le Juif errant, cet éternel voyageur sur les pas duquel l'écrivain doit marcher d'un pas infatigable, réglant l'action de son livre sur l'action perpétuelle du héros, et obéissant nuit et jour au mouvement d'en haut, qui pousse sans fin et sans relâche Ahasvérus!
Remarquez, en effet, que les romans anglais, et surtout ceux de Cooper, ne sont autre chose, à bien prendre, que des marches et des contre-marches perpétuelles. Le dernier roman de Dickens, le Marchand d'antiquités, qu'était-ce, s'il vous plaît? simplement un voyage de Londres en Écosse, un voyage à pied, celui d'un pauvre vieillard et de sa petite fille. Et le fameux conte de Cooper, le Dernier des Mohicans? une marche encore, une marche presque militaire, au travers des savanes et des forêts, ou plutôt une course tellement longue et tellement rapide que les héros, arrivés au bout de leur route, doivent mourir d'épuisement.--Mais le Juif errant est un personnage admirable, parce qu'il ne se lasse point, et, cependant, ne sait point ce que c'est que de s'arrêter.
Les Mystères de Paris sont déjà un premier chef-d'œuvre de récit, et tout ce peuple de lecteurs entraîné pendant dix volumes, captivé durant une année entière, et comme garrotté par l'intérêt croissant du récit, fait assez foi de cette perfection dont nous parlons; le roman de M. Eugène Sue est du petit nombre de ceux qui ne souffrent pas qu'on les laisse avant d'être arrivé à leur dernière page, et dont la lecture est tellement attachante qu'elle vous fait tout oublier. Une fois que le livre vous tient, bon gré, mal gré, il faut bien aller jusqu'au bout, et si vous résistez, soyez sûr que le livre vous fera violence.
Mais ce serait dire trop peu que d'appeler seulement M. Eugène Sue un conteur; il est aussi un homme d'imagination, et, en cela, il dépasse de beaucoup les romanciers anglais, ses modèles en l'art du récit. A coup sûr, je ne veux point dire le plus petit mal du talent de Walter Scott et de celui de ses successeurs; mais je m'étonne souvent du peu d'invention que ces romanciers ont fait voir dans leurs livres, si attachants d'ailleurs et si merveilleusement contés. Une histoire toute simple, une histoire unique qui se déroule tout droit devant elle, coupée de temps en temps par ces accidents faciles à prévoir, et pour ainsi dire tirés du sujet même. Prenez Ivanhoe ou les Puritains, ces chefs-d'œuvre, et comparez-les, pour l'invention, aux romans espagnols ou italiens, comparez-les aussi à la Crète ou à la Cléopâtre, ce ne sera plus qu'un fil auprès d'une trame, qu'une rue auprès d'un carrefour. L'Arioste fut le grand maître en l'art de ces aventures croisées, toutes marchant de front, enjambant les unes sur les autres, suspendant l'intérêt sans le ralentir, irritant la curiosité du lecteur sans jamais la lasser, et menant le livre par vingt routes à la fois aux vingt dénouements réunis enfin dans un seul et même chapitre. A l'exemple du grand poète italien, nos premiers romanciers excellèrent aussi dans ce genre croisé, qui demande une fertilité singulière d'invention et une industrie de talent plus merveilleuse encore. La dernière partie de la Crète offre un dénouement modèle; trente-deux mariages, célébrés du même coup après des traverses infinies et des infortunes inextricables! M. Eugène Sue a retrouvé, dans les Mystères de Paris, cet art si difficile des vieux conteurs, cet art si important aux romans de longue haleine, et sans lequel on ne saurait remplir des volumes, à moins de tomber dans l'insipide monotonie de Richardson. Les Mystères, qui avaient eu, dans ce genre, pour précurseurs les Mémoire du Diable de M. Frédéric Soulié, se montrent à nous comme un monde tout entier, où les personnages de toutes sortes se mêlent sans se confondre, où la comédie vient interrompre le drame, et réciproquement, où l'aimable scène d'amour est continuée par le spectacle hideux du crime ou de la misère, où le rire succède aux larmes et l'attendrissement à la terreur; fleuve profond, qui suit sa pente sans relâche et sans repos! mais cent affluents y viennent jeter leurs eaux à droite et à gauche, accélérant son cours au lieu de le ralentir; tout y roule pêle-mêle, à pleins bords, tout s'y précipite à la fois vers l'embouchure lointaine et mystérieuse. Que de types variés! que de physionomies diverses! sombres ou gracieuses, douces ou terribles! quelle multitude vivante et remuante! Et par combien de situations l'auteur sait-il encore en varier les aspects! Pas un théâtre qu'il n'explore, pas une scène où il ne fasse jouer tous les personnages, à la fois fantastiques et réels, que son imagination a créés, depuis le boudoir aux parfums exquis jusqu'aux bouges noirs et fangeux, depuis la mansarde au bord des toits, fleurie et toute brillante de soleil, jusqu'aux sombres greniers de la misère et de la souffrance! A côté de l'assassin ivre et furieux, Fleur-de-Marie portant entre ses bras son rosier malade et qui va périr faute d'air et de rayons; auprès de la belle et pure madame d'Harville, Sarah intrigante et criminelle; auprès de Fernand, cet avare taché de sang, Rodolphe, le soutien du malheureux, la providence du pauvre, la consolation des affligés! L'auteur semble avoir tout vu, tout connu, tout éprouvé; il nous fait parcourir la société entière; à tous les échelons, sous tous les costumes, nous voyons s'agiter cette multitude bruyante, qui pleure et qui rit, née d'un souffle du poète et de sa fantaisie; anges et démons s'y coudoient, allant et venant, montant et descendant; on dirait une autre échelle de Jacob!
Pour une imagination abondante et exubérante comme celle de M. Eugène Sue, le plan du livre n'est proprement qu'un cadre; rien ne la gène, tout peut entrer dans le livre, livre divers, fourmillant et touffu, si je puis dire ainsi. Ne demandez pas trop à l'auteur la méthode, ce qu'on appelait autrefois le dessin de l'ouvrage; il ne se pique pas de construire son volume sévèrement et correctement: tenui deducta poemata filo; son talent n'est pas là, son talent plein de verve et de hasards, talent d'improvisation et de mouvement; il n'est pas de ceux qui distillent leur œuvre, lentement, filtrée goutte à goutte par un alambic; le travail de la lime ne lui convient pas, il laisse à son livre les imperfections du premier jet et les lignes du moule, mais aussi la physionomie vive et les arêtes saillantes. On sent bien que s'il pouvait s'arrêter, il corrigerait, il retoucherait; mais évidemment il est entraîné lui-même et poussé en avant par la force irrésistible de son récit.
Je ne crains point, d'ailleurs, d'aller trop loin dans mes éloges, quand je songe que l'imagination de M. Eugène Sue, brillante dès son début, a acquis chaque jour un nouvel éclat, et deviendra sans doute plus éblouissante encore. La plupart de nos romanciers réinventent aujourd'hui leurs premières inventions, à peu près comme les ours sauvages qui, s'étant engraissés pendant l'hiver, se sustentent, quand la bise est venue, en se léchant les pattes avec assiduité. L'auteur de la Salamandre, au contraire, a toujours renchéri sur lui-même, sa veine est féconde, inépuisable; après Mathilde, les Mystères de Paris, et maintenant le Juif Errant, admirable sujet, comme nous l'avons dit, et qui saurait donner de l'imagination à l'esprit le moins inventif du monde, et au-dessous duquel M. Eugène Sue ne restera point, j'en suis sûr.
Encore un mot,--sur ce qu'on appelle la curiosité en termes littéraires.--Vous pouvez, n'est-ce pas? inventer de fort belles choses, sans en trouver une seule de curieuse. Or, par le temps qui court, et la fatigue générale qui alanguit les esprits, il faut du nouveau, c'est-à-dire du curieux; il faut que vous saisissiez d'abord votre lecteur par un tableau étrange, que tout de suite sa langueur s'évanouisse et son attention se réveille. Les Mystères de Paris, chef-d'œuvre de récit et d'imagination, sont encore un chef-d'œuvre de curiosité, curiosité non point éclose dans les rêves bizarres, dans les fantaisies excentriques de l'auteur, non point artificiellement composée à l'aide de spirituels paradoxes ou d'axiomes pris au rebours, mais puisée tout entière,--et c'est là ce qui en fait le mérite,--dans la réalité même, plus curieuse, quand on la sait observer, que toutes les lanternes magiques du monde, plus bizarre cent fois que tous les cerveaux connus des poètes et des chimériques. La Cité et ses mystères étaient à deux pas de nous; il suffisait d'y regarder pour en tirer des scènes saisissantes, d'affreux tableaux, d'étonnants spectacles. C'est ce qu'a fait M. Eugène Sue; et, de même, nous le verrons encore demander à la vie, à la société, aux secrets du riche et du pauvre, sa curiosité, bien supérieure à celle des romanciers allemands, qui ont poussé jusqu'à la folie la recherche du bizarre et de l'original. Pour moi, le rosier de Fleur de Marie est plus curieux certainement que le docteur Sphex de Jean-Paul, pleurant dans une soucoupe parce qu'il veut faire sur ses larmes une expérience chimique!
Que si, maintenant, quelques-uns, plus sévères, me trouvent excessif dans l'éloge, je ne nierai point que ces louanges me sont dictées aussi par une sorte de reconnaissance envers M. Eugène Sue. N'est-ce donc rien d'avoir amusé, pour prendre le terme le plus mince, d'avoir amusé, dis-je, les lecteurs des deux mondes durant une année entière, d'avoir donné une pâture au commun des esprits (et j'en sais des plus fiers qui s'en sont nourris comme les autres), d'avoir enfin, parmi toutes le pauvretés courantes, trouvé une mine riche et féconde? Un bon roman, je l'avoue, m'a toujours semblé un véritable bienfait rendu à la pauvre espèce humaine, qui s'ennuie si fort; et j'estime qu'on doit de la reconnaissance à celui qui nous a tiré, ne fût-ce qu'une demi-heure par jour, de notre assiette ordinaire, plate et nauséabonde, qui nous a menés avec lui dans les espaces de l'imagination, qui nous a fait goûter un peu l'oubli de nous-mêmes et des autres. A ce compte, jamais romancier n'a mieux mérité de la race des lecteurs que M. Eugène Sue, et il y aurait plus que de l'ingratitude à oublier ces dix volumes de feuilletons, notre lecture quotidienne et presque nécessaire pendant plus d'une année.
--«Le paradis, disait un Anglais, c'est le coin du feu et un roman pour l'éternité.»--Un roman comme Mathilde, s'entend, ou comme les Mystères de Paris.
Revue comique de l'Exposition, par Cham.
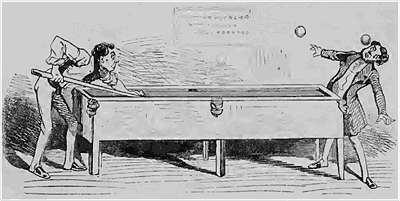
Billard à bandes en caoutchouc.

Eau africaine pour teindre les cheveux.

Lit en fer assuré contre l'incendie.

Avantages d'un chapeau qui
prend la forme de la tête.
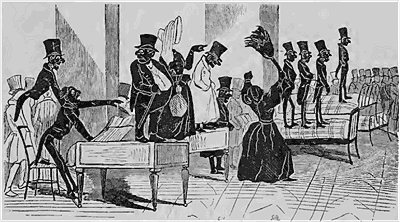
Le lundi, à l'Exposition.--les exposants
curieux de voir la famille royale.
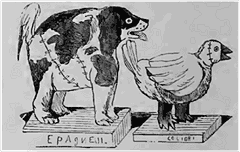
Animaux empaillés.
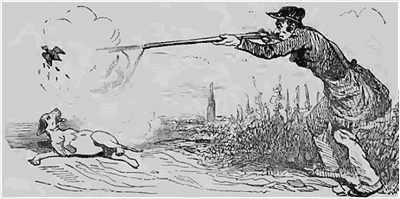
Un fusil à deux coup perfectionné.
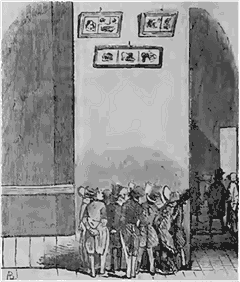
La gravure sur bois est trop haut placée
cette année pour qu'on puisse en faire un
éloge suffisant.
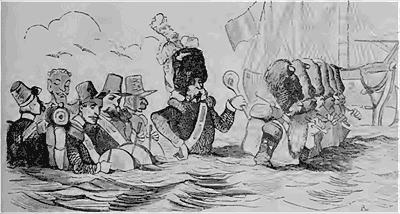
Application de la ceinture de sauvetage
au transport des troupes.
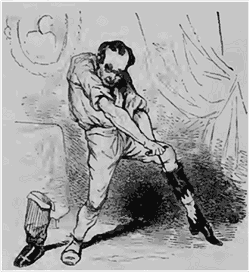
Bottes à 15 fr.

Faux toupets à l'usage des vieillards qui,
n'ayant plus le droit d'avoir des cheveux,
veulent avoir un front chauve.
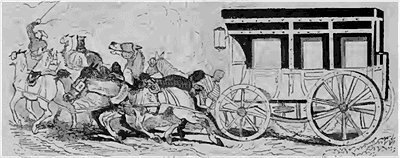
Une voiture inversable: elle ne peut pas marcher.

Parapluie imperméable.
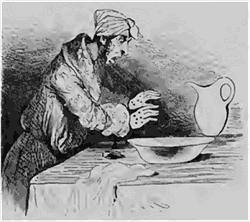
Savon de toilette à tacher les mains.
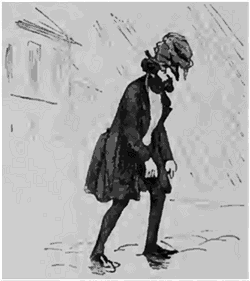
Un chapeau imperméable.
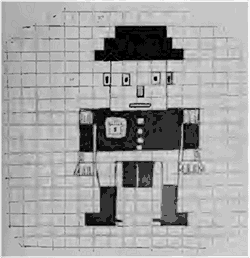
Napoléon en tapisserie, d'après M. Gros.
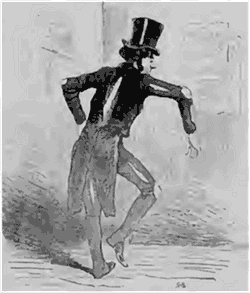
Drap Sedan... cédant au moindre effort.
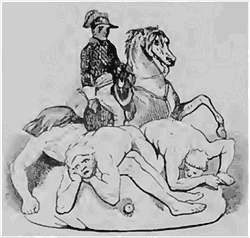
Nouveau modèle de pendule.--On
demande où est le cadran.
Une Soirée à Saint-Pétersbourg.
STATUE DE LA NÉVA, PAR JACQUES.
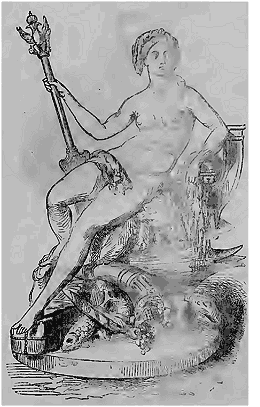
Un jeune sculpteur français, nommé Jacques, qui avait obtenu jadis le premier prix de Rome, était venu s'établir à Saint-Pétersbourg, où il exerçait son art avec un succès égal à son talent. Non-seulement il suffisait à tous ses besoins, mais il avait déjà amassé une petite fortune, lorsqu'en 1842 il renonça à tous les travaux qui le faisaient vivre et qui l'enrichissaient pour s'adonner exclusivement à une œuvre colossale qui, si ses espérances se réalisaient, devait rendre son nom immortel. La gloire était désormais l'unique pensée de son ambition; à cet avenir incertain il sacrifiait avec joie le présent. Enfermé dans son atelier, il passa une année entière et il composa le modèle en plâtre, de la statue dont l'Illustration offre aujourd'hui un dessin à ses abonnés.
C'était la Néva. Depuis longtemps, les architectes russes ou étrangers établis à Saint Pétersbourg cherchaient, sans pouvoir les trouver, les moyens de construire sur la Néva un pont qui liât ensemble, à l'époque de la débâcle, les deux parties de la capitale de la Russie. Personne n'ignore qu'au moment de la fonte des glaces toutes les communications sont interrompues souvent pendant plusieurs jours entre la rive droite et la rive gauche du fleuve. Plus d'un habitant de Saint-Pétersbourg reste ainsi parfois une semaine entière forcément absent de son domicile. Une multitude de projets avaient été successivement présentés au comité spécial chargé de les examiner: tous furent rejetés.
Enfin, en 1841, un nouveau plan obtint, l'assentiment universel. Pour l'exécuter il fallait, il est vrai, abattre un nombre considérable de maisons, combler des canaux, percer des rues, etc. Une vaste place devait, en outre, aboutir au pont, du côté du quai Anglais. A peine M. Jacques eut-il connaissance de ce projet, il conçut l'idée de sculpter une statue colossale destinée à l'ornement de cette place, et il fit, en conséquence, un modèle en plâtre qui excita des transports unanimes d'admiration.
Heureux et fier de ce premier succès l'artiste croyait toucher au terme de ses vœux; déjà il s'apprêtait à transformer ce modèle fragile en un bloc de pierre ici impérissable, lorsqu'un matin,--ô douleur!--on vint lui apprendre que pendant la nuit un incendie avait tout dévoré; son atelier, son modèle, sa petite fortune, son avenir, sa gloire, ses espérances et ses rêves... Il supporta ce coup affreux avec une noble fermeté; mais, s'il se montra résigné, s'il cacha ses douleurs à tous les yeux, son désespoir n'en fut pas moins violent.
A cette nouvelle, tous les étrangers établis à Saint-Pétersbourg ouvrirent une souscription en faveur de notre malheureux compatriote. Pour en augmenter le chiffre, qui s'élevait cependant avec rapidité, quelques Français formèrent le projet de donner une représentation publique de Tartufe. S. E. le général de Guidennoff directeur en chef de tous les théâtres de l'empire, s'empressa d'accorder l'autorisation qu'on lui avait demandée; et, le 6 mai dernier, le chef d'œuvre de Molière a été joué par des amateurs, dans la grande et belle salle de la maison Paguellard, en présence d'une assemblée nombreuse et réjouie. Toute l'aristocratie de la capitale était à cette représentation, qui a rappelé à tous les assistants les plus belles soirées du théâtre impérial italien, où Pauline Viardo-Garcia, Rubini et Tamburini obtenaient tant d'applaudissements, de rappris, de bouquets et de couronnes. La recette s'est élevée à 4,500 roubles, sans compter les dons particuliers.
M. Jacques a donc été remboursé de ses frais; il a pu faire honneur à sa signature; mais, de son chef-d'œuvre, il ne reste plus maintenant qu'un souvenir... et notre dessin.
Le Sacrifice d'Alceste.
(2e partie.--Voir page 237.)
Le mariage projeté entre Nathaniel de Keraudran et Mathilde de Larcy, reprit mon oncle Antoine commençant une seconde histoire, avait surtout pour but de terminer des démêlés d'intérêts qui avaient divisé leurs familles. Mathilde, par ses idées romanesques, en exigeant un homme qui eût sacrifié sa vie pour elle, rompit tous ces projets. Aussitôt que Keraudran eut refusé la fiole de poison, elle refusa son alliance. Les procès recommencèrent; et au lieu du notaire on vit paraître les avocats.
Nathaniel de Keraudran en était désolé.
«Faut-il donc devenir ennemis?» disait-il.
Dans son désir de la paix, il eût souscrit à toutes les conditions pour obtenir un arrangement amiable. Il me pressa d'être son négociateur, et je partis pour le château de Larcy chargé de cette délicate mission. J'avoue aussi que, de mon autorité privée, j'en avais pris une plus délicate encore. Je connaissais l'amour de Keraudran pour Mathilde; il n'avait fait que s'enflammer depuis leur rupture. D'un autre côté, j'étais persuadé que Mathilde aimait Nathaniel, et que sa tendresse avait survécu au bizarre caprice qui avait provoqué leur séparation. Je ne désespérais donc pas de les réunir, et je partis dans ce but, tout autant que dans celui de terminer leur procès.
Je fus parfaitement accueilli au château de Larcy. J'avais été l'ami de la famille avant même d'être celui de Keraudran. De plus, je ne dissimulai pas le moins du monde mon caractère officiel d'ambassadeur. Je m'annonçai comme messager de paix, chargé de pleins pouvoirs, et je m'aperçus bien vite qu'on désirait terminer les hostilités aussi bien au château de Larcy qu'à celui de Keraudran.
Mais je vis aussi que ma seconde entreprise serait plus difficile: ce n'était pas seulement un caprice de jeune fille, mais une volonté sérieuse, un calcul bien arrêté d'avance, qui avaient amené la bizarre épreuve dans laquelle Nathaniel avait échoué. Prendre un époux, c'était dans la pensée de Mathilde, lui donner sa vie; elle ne voulait la donner qu'à un homme qui l'eût, payée d'un semblable retour. Aussi, lorsque je lui parlai de l'amour de Keraudran, lorsque je peignis son désespoir, elle haussa les épaules.
«J'en ai fait l'expérience, répondit-elle avec un sourire ironique; je suis maintenant que cette passion si vive, que cet amour si dévoué ne peut aller jusqu'à boire deux cuillerées de potion! Que voulez-vous? continua-t-elle d'un ton agaçant, je m'étais mis dans la tête que je valais la peine d'être aimée pour tout de bon. J'attendrai de l'être pour me décider.
--Personne ne vous aimera plus que Nathaniel, répliquai-je.
--Eh bien! alors... j'attendrai toujours! et je ne ma déciderai pour personne!»
Je revins souvent sur le même sujet, et toujours avec aussi peu de succès. Je commençai donc à désespérer de renouer une alliance qui paraissait définitivement rompue, et si j'en parlais encore à Mathilde, ce n'était plus que pour trouver un sujet d'amusantes querelles et d'innocentes coquetteries. De son côté, Mathilde semblait se plaire beaucoup à ces taquineries galantes qui occupaient nos tête-à-tête sans les rendre dangereux, et qui lui rappelaient un nom et des souvenirs beaucoup plus chers peut-être qu'elle n'eût voulu le laisser croire.
Je dois avouer aussi que j'avais à cette époque une assez mauvaise habitude: c'était, de faire la cour à toutes les jolies femmes que je rencontrais; et cela presque sans but, par simple passe-temps, comme un jeu d'esprit, et de même qu'on dit en termes d'escrime, pour m'entretenir la main. J'avais conservé cette habitude dans mes nouvelles relations avec Mathilde, et elle répondait à mes galanteries avec une présence d'esprit et une gaieté qui m'encourageaient à continuer en me permettant de croire qu'elle ne s'abusa pas sur leur véritable valeur. Que pouvious-nous, d'ailleurs, faire de mieux pour tromper les loisirs de cette vie de château monotone et solitaire?
C'étaient donc des agaceries, des taquineries, des coquetteries sans fin. Jamais le père de Larcy n'avait assisté à de semblables remue-ménage.
«La paix, la paix, que diable! enfants! disait-il par intervalles; vous ne pouvez donc pas être deux minutes ensemble sans vous chamailler? Quelle langue, bon Dieu! parbleu, marquis, on voit bien que vous êtes Gascon!
--Gascon? repartis-je; merci! Il y a des Bretons et même des Bretonnes qui ne leur cèdent en rien.
--Ou s'en flatte! répliqua vivement Mathilde; mais on sait ce que vaut la Garonne... et nous sommes francs, au moins!
--J'en suis d'avis. Il n'y a que les Bretonnes pour tenir ce qu'elles promettent...
--Et les Bretons, donc! répondit Mathilde avec un sourire un peu forcé; nous en savons quelque chose. Je doute cependant que les Gascons valussent beaucoup mieux, et ce sont des répondants auxquels je me fierais peu.
--Je vous dirai comme la première fois: Essayez!
--Un défi!... nous verrons. Mais savez-vous bien que j'ai été sur le point de vous envoyer aussi la fameuse bouteille? J'aurais été curieuse de savoir ce que vous auriez fait, monsieur le Gascon.
--Ce que j'aurais fait? je vais vous le dire, parbleu! J'aurais jeté la fiole par les fenêtres et rossé le sorcier pour lui apprendre à rendre les gens malades... et dites que ce n'eut pas été une preuve frappante de ma tendresse!»
Mathilde se mit à lire aux éclats, et nous continuâmes sur ce ton de folle gaieté. Au reste, loin d'entraver notre intimité croissante, le vieux papa semblait au contraire la favoriser de tout son pouvoir. Je ne doute pas qu'il n'eût pensé que je pouvais remplacer avantageusement Keraudran, et il eût reçu avec, plaisir la proposition d'écarteler mon blason avec celui de sa fille; mais j'étais loin d'une semblable idée. Engagé ailleurs dans les liens d'une véritable tendresse, je ne pouvais dépasser avec Mathilde les limites de la simple et pure amitié, malgré les amusements de nos causeries et de nos agaceries réciproques.
Avec tout cela, mon séjour se prolongeait au château de Larcy; je m'y plaisais trop pour chercher à le quitter bien vite. Toutefois, je songeais déjà sérieusement à préparer mon départ, lorsque Mathilde m'apprit un soir qu'elle s'était engagée à honorer de sa présence, suivant le style d'usage, une fête qui devait avoir lieu dans une ferme située quelques lieues plus loin.
«Nous partirons demain matin, ajouta-t-elle; soyez prêt de bonne heure.
--Nous? répondis-je en riant; c'est à merveille. Vous disposez de moi en véritable despote. Il n'y a pas même d'observations à faire, à ce que je vois: allons, je me résigne.
--Pauvre jeune homme! répliqua Mathilde; voyez-vous, il se sacrifie! Soyez sûr de toute ma reconnaissance, monsieur le marquis, pour cette complaisance inespérée.»
Et elle fit ironiquement une profonde révérence.
«J'y compte, dis-je, et je la réclamerais au besoin.»
Nous partîmes, en effet, le lendemain de bonne heure. Le temps était superbe, mais la route détestable; elle traversait les bois, en tournant, montant, descendant et remontant sans cesse, creusée de ravins, encombrée de pierres et de branches d'arbres. La voiture ne pouvait marcher qu'au pas.
J'étais sur le devant de la calèche, dont Mathilde et son père occupaient le fond. Mathilde était en toilette de bal, et franchement je ne l'avais jamais vue si jolie. Je me trouvais, d'ailleurs, en disposition taciturne et rêveuse, en sorte que le voyage était silencieux. Je me contentais de regarder mon gracieux vis-à-vis, et sans doute mes yeux expliquaient trop clairement mes impressions, car souvent, lorsque nos regards se rencontraient, elle rougissait et tournait légèrement la tête. Peu à peu elle devint pensive, elle-même, la chaleur du jour qui s'élevait avec le soleil, le silence du bois, à peine troublé par le bruit monotone et cadencé des roues et des chevaux, le bercement lent et uniforme de la voiture, l'air embaumé de la forêt, ces alternatives d'ombre et de lumière qui passaient et repassaient sur nous à travers les branchages qui se courbaient au-dessus de nos têtes, enfin une sorte d'influence magnétique nous disposaient tous deux à la rêverie; et mes yeux, qui rencontraient maintenant plus souvent et plus longtemps ses grands yeux bleus, y lisaient cette langueur veloutée, ce feu pénétrant et voilé... qui vous entraîne plus loin qu'on ne voudrait souvent.
L'influence avait également agi sur le vieux baron.--Il dormait profondément sur son coussin.
Je ne suis comment cela se fit, mais, après un long regard échange presqu'à notre insu, Mathilde tressaillit, et se tourna brusquement pour regarder dans le bois.
«Il fait une chaleur étouffante, murmura-t-elle en entrouvrant ses dentelles, et nous sommes exposés au soleil sur cette maudite route... tandis qu'il y a là-bas dans les taillis des pelouses si vertes, si fraîches, si bien ombragées!
--Nous pourrions peut-être suivre le voiture à pied, le long du bois... Voulez-vous mon bras?»
Il y eut comme un moment d'indécision.
«Non, je vous remercie, dit-elle sans lever les yeux.
--On pourrait peut-être remédier au soleil.» repris-je.
Et pendant que la voilure longeait un taillis d'églantiers et d'aubépines en fleurs, j'en cueillis de longs rameaux; puis, les tenant réunis en forme, d'éventail, je me penchai vers Mathilde pour l'abriter sous leur berceau embaumé. Elle sourit et me remercia d'un signe de tête.--Mais la position que j'avais prise était fatigante et peu commode; je fus bientôt obligé de me courber tout à fait pour appuyer mon bras du côté de Mathilde: ma main touchait presque son épaule, et mes genoux frôlaient sa robe de satin. Elle avait été obligée elle-même de se renverser en arrière, dans une pose coquette et gracieuse. Elle était si jolie, si séduisante ainsi, que peu à peu je me sentis enivré d'une vive émotion. De son côté, Mathilde semblait palpiter sous le feu de mes regards; ses yeux, qu'elle tenait baissés, se relevèrent languissamment et se fixèrent sur les miens...--Mais elle tressaillit de nouveau, et, poussant un cri léger, se rejeta vers son père dont elle saisit le bras.
«Quoi? quoi?--s'écria le vieux baron, se relevant et se réveillant en sursaut;--qu'y-a-t-il? qu'y-a-t-il? sommes-nous versés?
--Non, dit Mathilde d'une voix émue... mais c'est un cahot... J'ai eu peur!
--Cette route est détestable, reprit le baron. J'en suis terriblement fatigué. Arrivons-nous bientôt?»
On prit des informations auprès du cocher, qui répondit qu'il n'y avait plus qu'une petite demi-heure de marche. D'ailleurs la route s'améliorait en sortant du bois, et nous arrivâmes assez rapidement.
Pendant la fête, Mathilde fut excessivement réservée. Du mon côté, en réfléchissant aux circonstances de notre voyage, je compris cette réserve, et j'avoue même que j'en fus bien aise. J'aurais été embarrassé pour recommencer avec elle nos enfantillages des premiers jours; je craignais même d'avoir été trop loin, et je résolus de partir le plus promptement possible.
La fête champêtre était, au reste, fort gaie. Il y eut une espèce de feu d'artifice, et le bal finit fort tard, il avait été décidé que nous passerions la nuit chez nos hôtes, et on nous conduisit à nos appartements respectifs. Mathilde et son père furent logés dans le bâtiment principal, à un étage au-dessus l'un de l'autre Pour moi, l'on m'avait assigné un petit pavillon sur le jardin. Je m'y endormis profondément.
Un grand bruit et des cris me réveillèrent au point du jour. Lorsque j'ouvris les yeux, je vis ma chambre entièrement éclairée d'une rouge et sinistre lueur. Je me jetai précipitamment en bas du lit; j'ouvris ma porte... Le feu était à la ferme. A peine vêtu, je me précipitai vers les bâtiments embrasés; j'eus en un instant traversé le jardin, et j'arrivai dans la cour.
C'était affreux: le logis principal, assez solidement construit en maçonnerie, était entouré des bâtiments d'exploitation élevés en charpente, couverts en chaume pour la plupart et adossés aux murs de la maison: tous ces bâtiments étaient en feu. Quelques flammèches d'artifice avaient sans doute causé cet incendie. Les habitants de la maison, réveillés par les flammes, s'étaient sauvés à demi nus dans la cour; on criait, on courait, on s'appelait, on se heurtait, et, dans ce désordre, il n'y avait aucun moyen de combattre et d'arrêter les progrès du feu, qu'attisait encore la brise du matin. Au reste, il n'y avait plus guère d'espoir: les bâtiments légers construits en avant étaient déjà presque entièrement consumés, et les flammes enveloppaient le corps de logis principal, qu'elles commençaient à dévorer. Quelques seaux d'eau, jetés çà et là au hasard, sans ensemble et sans direction, par des mains éperdues, ne faisaient qu'irriter la fureur de l'incendie.
Mon premier soin fut de chercher Mathilde et son père dans la foule.--Je rencontrai le vieux baron qui appelait sa fille à grands cris.--Mathilde n'y était pas! Ce fut un coup terrible; personne ne l'avait vue!
«Cherchez-la! ramenez-la moi! criait ce père éploré.
--Pas moyen de rentrer dans la maison, répondit un valet de ferme, revenant, ses habits à demi bridés. L'escalier s'est écroulé; il a failli me tomber sur la tête.»
A ce moment, ce fut comme une ineffable et terrible vision; tout en haut, sur le sommet de la maison, on vit apparaître Mathilde: fuyant devant les flammes qui s'élançaient d'étage en étage, elle était montée jusqu'au faîte. La pauvre enfant avait, pour fuir, revêtu ses habits de la veille; elle était là, accroupie sur le bord du toit, en parure de bal, blanche et brillante comme une fée. Au-dessous d'elle, les flammes tourbillonnaient avec des bruissements de fureur, et une large nappe de fumée brillante et rouge se déroulait derrière en ondoyant sous le vent. Perdue au milieu de l'incendie qui l'entourait de toutes parts, prêt à la dévorer, elle restait immobile, les mains croisées sur sa poitrine, et si elle appelait du secours, sa voix, étouffée dans les mugissements du feu, ne parvenait pas jusqu'à nous.
«Vingt mille livres, trente mille livres, cent mille livres à qui me ramènera ma fille! s'écriait le vieux baron en se tordant les mains de désespoir.
--Ce n'est pas possible!» répétait-on autour de lui.--Et tous les yeux se fixaient mit elle.--Comment arriver là-haut? Tout brûle dessous.»
Un jeune homme, plus hardi, courut vers la maison et voulut franchir le premier bâtiment embrasé; un chevron du toit se détacha et l'étendit presque sans vie sur les charbons ardents. On le retira privé de connaissance.
J'avais déjà pris mon parti: je m'étais emparé de deux couvertures de laine que je plongeai dans un des tonneaux de la cour; je saisis un paquet de cordes, une longue échelle, et je me précipitai à travers le feu et la fumée, au milieu des cris des spectateurs. Arrivé au pied du mur principal, déjà crevassé et fumant, je plantai l'échelle et je gravis rapidement jusqu'au toit, disputant chaque échelon aux flammes qui commençaient à s'y attacher. Lorsque je parvins sur la corniche, le pied de l'échelle était en feu, et, un instant après, elle tomba. J'étais auprès de Mathilde.
«Venez, lui dis-je, hâtons nous.»
Et en même temps je l'enveloppais des convertures mouillées.
«Serrez-les bien autour de vous, et ne craignez rien.
--Non, me répondit-elle, il est trop tard.--Comment descendrons-nous? Voyez, l'échelle est brûlée.
--Laissez-moi faire.»
Et t'attachais fortement aux barreaux de la lucarne la corde que j'avais apportée.
«Maintenant, Mathilde, couvrez bien votre visage et vos beaux cheveux. Tenez-vous fortement à moi.--Puis, écoutez-moi bien: si, quand je serai arrivé en bas, je tombais... ne vous arrêtez, pas, et courez toujours devant vous.»
En achevant ces mots, je lui fis passer ses bras autour de moi, et, cramponné à la corde, je commençai à descendre.
Ce fui un cri d'effroi et d'anxiété qui parvint jusqu'à mes oreilles, lorsqu'on nous vit abandonner le mur et disparaître au milieu des flammes et de la fumée. J'ignore, à partir de ce moment, comment j'accomplis ce périlleux trajet. Étourdi, aveuglé, je me laissai glisser jusqu'en bas, puis je tombai sur les poutres embrasées, je fus couvert de feu, je roulai sur les charbons et je ne sais trop ce que devint Mathilde. Enfin j'arrivai, chancelant, suffoqué, les cheveux et les mains brûlés, les habits en lambeaux, presque inanimé, au milieu de la cour; alors je revis Mathilde et son père, qui me reçurent dans leurs bras.--Je m'évanouis.
Heureusement, je n'avais pas de blessures graves. Quelques jours de repos suffirent pour me rétablir. Mathilde, protégée par les couvertures dont je l'avais enveloppée, n'avait reçu aucune atteinte; et jusqu'à mon rétablissement, elle ne quitta pas mon chevet.
Aussitôt que mes blessures furent cicatrisées, j'annonçai mon départ. A cette nouvelle inattendue, Mathilde tressaillit.
«Quoi! dit-elle d'une voix évidemment altérée par la surprise, vous voulez partir... si tôt?
--Il y a longtemps que j'abuse de la permission qui m'a été donnée de résider au château. Ma mission, qui pouvait seule justifier mon séjour, est terminée; la transaction a été signée il y a huit jours, et...
--Il s'agit bien de cela! interrompit-elle assez vivement. Me suis-je jamais occupée de ce procès? Et vous...»
Elle s'arrêta.
«J'espère bien aussi que notre séparation ne sera pas de longue durée, repris-je en souriant. Le plaisir que j'éprouve ici et la peine que j'éprouve en vous quittant, me font désirer le moment où je pourrai vous revoir.
--Plaisantez-vous? demanda-t-elle avec une certaine agitation. Vous me quittez ainsi!... vous qui avez donné votre vie pour la mienne?
--Moi, répondis-je en riant et en lui prenant la main; Vous ne vous souvenez, donc plus?... J'ai acquitté la lettre de change que vous avez tirée sur Keraudran.
--Eh bien!... ensuite?»
Et elle tenait ses yeux baissés, tandis que son sein palpitait violemment.
«Eh bien! répliquai-je d'un ton plus sérieux; Nathaniel vous aime, Mathilde, comme vous ne serez jamais mieux aimée; vous l'aimez aussi, je le sais, j'en suis sûr... et moi...
--Vous m'avez donné votre vie! interrompit-elle.
--C'est possible..., mais je ne puis aussi vous donner que mon amitié; je compte sur la vôtre, c'est la seule reconnaissance que j'exigerai... Et je vous le répète, Mathilde, c'est la seule, je le sais, que votre cœur pourrait me donner. Aussi, j'y compte, n'est-ce pas?»
Elle me serra la main sans répondre, je portai la sienne à mes lèvres... et trois jours après, je quittai le château de Lurcy...
Alors mon oncle Antoine se tut et se renversa sur son fauteuil en croisant les jambes.
«Eh bien! m'écriai-je, qu'est-ce que cela prouve? vous avez sauvé la vie à Mathilde sans l'aimer! Vous avez eu raison; mais cela n'empêche pas que Keraudran n'ait eu tort.
--Ta, la, la, dit mon oncle Antoine; en toute chose, avant de juger, il faut attendre la fin.--C'est un précepte de Solon qui, après tout, n'était pas un sot, bien qu'il ait été un des sept sages de la Grèce.»
D. Fabre d'Olivet.
Colonie de Santo-Thomas de Guatemala.
Il n'est pas d'œuvre importante dans le monde sur laquelle l'Illustration n'ait le droit d'appeler l'attention de ses lecteurs. Pendant que nos hommes d'État, nos publicistes s'évertuent à trouver un système de colonisation applicable à l'Algérie, il se passe à nos portes un fait capital à l'égard duquel la presse française est d'une inexplicable indifférence. Coloniser l'Algérie, c'est pour le gouvernement français une rude tâche, à laquelle il voudrait bien se soustraire; mais les événements qui se passent en Afrique, et l'opinion publique aidant, ne lui permettent pas de se débarrasser de ce lourd fardeau.
La Belgique, au contraire, à qui la conquête n'avait pas donné, comme à la France, un vaste territoire à coloniser, un empire à fonder, n'a pas eu de repos qu'elle n'eût trouvé un coin de terre où elle pût faire de gaieté de cœur ce que la France ne fait pas même à contre-cœur. La Belgique a déniché, dans un coin de l'Amérique, un territoire où elle fait de la colonisation.
Nous allons donner en peu de mots à nos lecteurs une idée de la situation actuelle de l'établissement belge de Santo-Thomas. Les résultats obtenus dans l'intervalle d'une année sont consignés dans un rapport adressé par l'agent général de la compagnie belge de colonisation au conseil général et au consul de commerce et d'industrie de cette compagnie.
Un arrêté royal, en date du 31 mars dernier, a autorisé toutes les communes du la Belgique à ouvrir dans leur sein une souscription pour le placement des lots de la communauté. Cette souscription est confiée à MM. les bourgmestres; le produit en sera perçu par les receveurs des contributions de l'État et versé au trésor.
Cette souscription, fermée le 1er juillet courant, offre aux communes des avantages positifs. La moitié des souscriptions prises dans les communes, soit par l'administration communale, soit par des particuliers ou des étrangers, devrait être employée en achats des produits industriels de cette commune; la seconde moitié sera employée à conduire à Santo-Thomas des colons choisis dans les communes par le bourgmestre et le curé.
Ce sont là deux avantages incontestables.
Le territoire du district de Santo-Thomas comprend une étendue de 100,000 hectares; il possède un port vaste et sûr dans la mer des Antilles. Ce gouvernement de l'État de Guatemala concéda en 1841, ce territoire à la compagnie; la chambre législative de Belgique ratifia cette concession. La compagnie est donc propriétaire en vertu d'un titre égal et authentique; une loi de l'État l'a mise en possession, et a conféré en même temps à tous les colons la jouissance des droits civils et publiques des nationaux.
Ce territoire est couvert de forêts, et les diverses voies navigables, qui présentent un développement de près de deux cents lieues, offrent des moyens de transport convenables à l'exploitation de ces bois. La latitude du district est égale à celle de la Havane, qui est la plus riche colonie des Antilles.
L'administration a divisé la propriété du district en deux portions égales: 200,000 hectares sont réservés pour la communauté; 200,000 hectares ont été divisés en 8,000 lots de 25 hectares chacun. Le prix de chaque lot a été fixé à 500 fr., soit 20 fr. par hectare.
Les acquéreurs de bois sont intéressés dans la communauté pour une partie de leur acquisition; le prix des lots est versé dans la caisse de la communauté, et forme son capital d'exploitation. Les lots de la communauté de l'Union se composent de deux titres distincts: l'un représentant 20 hectares de terre dont le propriétaire dispose à son gré; l'autre représentant 5 hectares dont l'exploitation est réservée à la compagnie, et en échange desquels elle donne une action de la communauté. Cette action donne droit au partage dans le tiers des bénéfices de toute nature réalisés dans les opérations industrielles, agricoles ou commerciales, et au partage en liquidation dans la moitié de tous les biens meubles et immeubles de la communauté.
La valeur des lots a monté aujourd'hui de 500 à 1,000 francs, et cette valeur grandit de jour en jour. Une décision récente du conseil général (3 mai 1844) a garanti un dividende annuel du 40 francs à chaque action de communauté, de sorte que l'acquéreur actuel d'un lot au taux du 1,000 fr. a la certitude de recevoir au moins le 4 pour cent de la somme déboursée, et il lui reste comme prime les 20 hectares de terre qu'il peut vendre, louer, exploiter ou faire exploiter.
On peut se faire une idée du développement inouï que l'esprit d'association a imprimé à la colonie belge, si je songe, que l'installation des soixante-neuf premiers colons date à peine d'une année, et que leur nombre s'élève aujourd'hui à huit cents. Les fondations d'une ville ont été jetées, des routes sont ouvertes, les terres se défrichent, les travaux du port s'exécutent, des fermes sont construites, et l'administration est assez forte pour maintenir l'ordre, faire respecter la loi, et même expulser de la colonie les perturbateurs et les membres inutiles. Le crédit de la communauté est fondé, et les traites qu'elle tire sur la compagnie en Europe sont prises par toutes les maisons de banque et de commerce.
L'administration approvisionne elle-même ses magasins, et elle fourni aux colons, au prix coûtant augmenté seulement de 5 pour cent, tous les objets nécessaires à leur consommation, en leur garantissant une part dans les bénéfices généraux et du travail pour toute l'année de telle sorte que dans ces pays, où toutes les provenances d'Europe sont à des prix excessifs, où les conditions de l'existence sont si pénibles, les colons du Santo-Thomas y peuvent vivre, en gagnant peu, mieux qu'ils ne vivraient à la Havane ou à la Nouvelle-Orléans, quand même ils y recevraient un triple salaire.
Nous avons cru devoir offrir à nos lecteurs une situation sommaire de la colonie belge, qui est sans contredit une des œuvres les plus importantes qu'ait produites de nos jours l'expansion du génie européen. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si les mesures adoptées par la compagnie belge sont ou ne sont pas susceptibles d'amélioration. Nous constatons seulement le progrès immense qu'elle a accompli, et nous appelons l'attention des hommes qui se préoccupent à bon droit des difficultés que soulève la question bien plus vaste de la colonisation de l'Algérie, sur les résultats obtenus à Guatemala par l'esprit d'association, par l'énergie que donne aux travailleurs l'assurance d'une part dans les bénéfices que leur travail procure.
Les Forçats.
(2e Article.--Voir t. III, p. 299.)
Les travaux sont suspendus ou terminés; les forçats rentrent dans leurs salles, soit pour y faire le repas, dont nous parlerons tout à l'heure, soit pour s'y reposer des fatigues du jour, à onze heures du matin, ou à quatre et cinq heures du soir. Avant qu'ils repassent le seuil de la porte du bagne, un garde-chiourme les fouille de la tête aux pieds. Durant la matinée ou la journée, ils ont tous eu, en effet, de fréquents rapports avec les ouvriers libres et les visiteurs du bagne; peut-être ont-ils obtenu de leur pitié un peu d'argent ou quelques douceurs prohibées; peut-être se sont-ils rendus coupables d'un vol au préjudice de l'administration pendant les travaux; leurs fers ne sont-ils pas limés? qui sait même si un parent, un ami, un complice, ne leur a pas remis des scies, des limes ou des objets d'habillement pour faciliter leur évasion et leur fuite? D'importantes saisies justifient tous les jours cette utile précaution. Chaque forçat passe à son tour à la visite. Il tient son bonnet à la main, parce qu'elle a lieu en présence d'un adjudant supérieur. A mesure qu'un garde-chiourme les fouille, un autre les compte, pour s'assurer que tous les hommes sortis et marqués sur la planche de sûreté rentrent au bagne.
Tous les matins, avant la sortie, on distribue à chaque homme, dans l'intérieur du bague, un morceau de pain noir. A onze heures, après leur rentée, a lieu le dîner. Outre le pain, la ration quotidienne d'un forçat se compose d'un litre de bouillon très-faible, de quatre onces de fèves et de quarante-huit centilitres de vin.
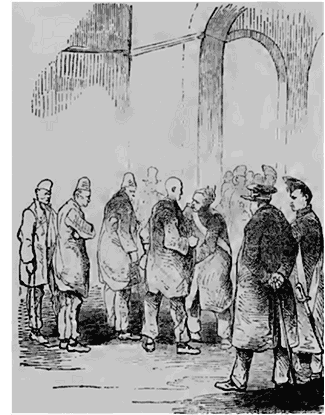
Visite au retour des travaux.
La cuisine et la cantine des forçats sont très-simples, ainsi qu'on peut s'en convaincre en jetant les yeux sur les dessins ci-joints. La cuisine est une petite salle carrée attenante à la salle du bagne et communiquant avec cette salle par une fenêtre. Au fond, près de la fenêtre, on aperçoit un petit cabinet servant de bûcher, un fourneau, une énorme marmite, des seaux, une poêle, tels sont les seuls ustensiles de la cuisine. Contre le mur pendent un faubert, une pincette et une barre de fer. Ce sont les forçats qui remplissent les fonctions de cuisiniers c'est-à-dire qui font cuire des fèves dans de l'eau salée, avec du beurre ou de la graisse. Un seau contient la ration de cinq hommes.
A la cantine le service est fait par un commis aux vivres et un sous-adjudant; la barrique de vin se trouve en face de la porte d'entrée, et les forçats viennent par escouades prendre leur ration, consistant, comme nous l'avons dit, en quarante-huit centilitres de vin par jour. Cette ration, qui s'appelle une carte, se distribue en deux fois. Un demi signifie la moitié ou vingt-quatre centilitres. La mesure est placée sur une planche percée de petits trous, à travers lesquels le trop-plein tombe dans un baquet inférieur. Diverses mesures et une sonde sont suspendues au mur.

La barbe.
Tous les forçats devraient être soumis au même régime, mais ce principe d'égalité absolue est souvent violé: au bagne, nous l'avouons avec peine, le pauvre expie plus cruellement ses crimes que le riche. A leur arrivée, on enlève aux condamnés, en même temps que leurs habits, tout l'argent qu'ils ont apporté avec eux, et on le dépose sous leur nom dans une caisse instituée à cet effet dans les bureaux du commissaire. D'après les règlements du bagne, un forçat ne doit pas avoir sur lui plus de 5 francs, mais à mesure que cette somme diminue, il peut la compléter en donnant une note de ses dépenses. Ainsi, ceux qui sont riches, ceux qui reçoivent des secours de leur famille ou de leurs complices, se procurent certaines petites jouissances dont les pauvres sont privés; ils achètent surtout du pain blanc et du ragoût à un marchand fricottier, établi dans l'intérieur du bagne avec une permission de l'autorité supérieure. On en voit souvent qui se régalent le matin de ratatouille, tel est le nom de ce ragoût, sans en offrir à leur camarade de chaîne, que la misère contraint à manger son pain noir sec. La peine du pauvre s'augmente donc de la diminution de celle du riche.
Les fonctions de barbier (au bagne on nomme les barbiers barberots) sont, comme celles de cuisinier, exercées par les forçats qui ont mérité des récompenses. Cette opération se fait dans un coin de la salle commune; un grand fauteuil en bois grossièrement travaillé est destiné aux forçats, qui vont, se laver à une fontaine voisine dès qu'ils sont rasés.
Lorsque les forçats sont valides et bien portants, il faut qu'ils paient à l'État ce qu'il fait pour eux, c'est-à-dire qu'ils exécutent avec soumission et résignation les travaux qui leur sont imposés; il faut que toujours et partout leur conduite soit bonne, régulière, paisible; sinon des châtiments proportionnés aux fautes, aux délits dont ils se rendent coupables ou complices, leur sont infligés avec sévérité.
On pense bien que, parmi un aussi grand nombre de détenus, la colère, la haine, l'irritation, la vengeance, souvent même le désir de la mort, qu'ils n'usent pas se donner eux-mêmes, font commettre des crimes qu'on n'a pas eu le temps ni la possibilité d'empêcher.
Ces crimes sont jugés le plus tôt possible et sans appel par un tribunal maritime spécial. Les condamnations qui sont prononcées reçoivent leur exécution dans les vingt-quatre heures; il faut en excepter toutefois les arrêts de mort, qui maintenant sont soumis préalablement à la décision royale.

La Cuisine.
Le chef de service du bagne a à sa disposition les moyens nécessaires pour y faire régner le plus grand ordre et une parfaite sécurité. Ces moyens consistent dans la dispensation qu'il fait seul des punitions et des récompenses.
Autrefois, quand les forçats servaient sur les galères de l'État, ils étaient soumis à un code d'autant plus rigoureux qu'il fallait prévenir ou punir sur l'heure les attentats de tout genre et les délits d'insubordination ou de désobéissance dont ces criminels se rendaient coupables.
Ce code, qui se ressentait de la barbarie des lois pénales de cette époque, était effrayant; il infligeait des châtiments terribles, tels que la mutilation, la perte du nez, des oreilles, de la langue, etc., même pour des fautes peu graves.
Mais à mesure que les moeurs s'adoucirent, on renonça à toutes ces punitions, et il n'y a plus aujourd'hui contre les individus qui contreviennent aux lois et aux règlements intérieurs que des peines que l'humanité avoue et qui sont suffisantes.
Jadis la bastonnade était une des moindres punitions; elle est aujourd'hui la plus forte, et encore n'est-elle appliquée que dans le cas d'évasion, de tentative d'évasion non consommée, ou pour excitation, dans les salles et sur les travaux, à des résistances ou mutineries qu'il est essentiel de réprimer promptement et avec vigueur.
La bastonnade est aussi donnée aux condamnés qui volent à leurs camarades, soit des vivres, soit de l'argent ou de menus effets.

Cantine.
Le forçat condamné à la bastonnade subit sa peine étendu, la figure vers la terre, sur un banc, dit banc de justice, et recouvert d'un petit matelas; ses mains sont liées ensemble avec une corde, un forçat lui tient les pieds, l'exécuteur du bague met à nu son épaule droite et frappe le nombre de coups fixé par l'arrêt de condamnation. L'instrument du supplice est un rotin en corde qui, après avoir trempé plusieurs jours dans l'eau, est devenu, en séchant, aussi dur mais plus flexible que du bois. En général, la bastonnade rend malades les forçats qui la reçoivent, quelques-uns cependant bravent la douleur ou ne la ressentent pas.
Les autres punitions disciplinaires sont:
Le retranchement du vin;
La perte de la chaîne brisée, ou, ce qui est la même chose, la remise en couple pour un temps plus ou moins long;
L'exposition, pour les forçats qui se sont évadés;
Le cachot, que nous ferons voir à nos lecteurs dans un troisième et dernier article.
Ces punitions sont tout à fait suffisantes. En général, elles sont peu nombreuses, et rarement appliquées, grâce à la surveillance attentive que l'on exerce envers les condamnés, qui sentent la nécessité de la soumission.

Exposition d'un forçat évadé.
A peine l'évasion d'un forçat est-elle connue, on hisse au bagne un pavillon jaune, et le bâtiment amiral tire un coup de canon, pour avertir tous les habitants de la ville et des campagnes environnantes. L'arrestation d'un forçat évadé se paie 50 fr., si elle a lieu dans l'arsenal ou dans la ville; 100 fr. dans la banlieue. Aux signaux d'alarmes, citadins et paysans se mettent à la recherche et à la poursuite des malheureux qui sont parvenus à tromper l'active surveillance des chiourmes. La crainte d'être volés ou assassinés, plus encore que l'espoir, de cette récompense, stimule leur zèle.
Aussi les forçats évadés parviennent-ils rarement à se procurer des vêtements et une perruque, ou à gagner un asile sûr. Tant qu'ils ne sont pas découverts, le pavillon jaune reste hissé. Quelquefois ils demeurent, pendant plusieurs jours, cachés dans le bagne même, entre des pièces de bois, et leurs camarades leur remettent des provisions. Quand ils sont repris, ils sont condamnés à la bastonnade et au cachot, on augmente d'une ou de deux années la durée de leur peine, et on les expose, assis sur une barrique, à la porte du bagne.
--Leur tête est rasée, et on ne leur laisse qu'une petite touffe de cheveux; leurs mains sont garrottées, et sur leur poitrine est un écriteau qui porte ces mots:
ÉVADÉ RAMENÉ.
«La distribution des récompenses à la bonne conduite, à l'obéissance et aux bons services, est encore plus efficace, dit M. Vénuiste-Gleizes, dans son mémoire sur l'état actuel des bagnes en France (1840), que les punitions infligées aux mauvais sujets et aux hommes turbulents. Ces récompenses encouragent les bons, elles les maintiennent dans la voie du bien, et elles y ramènent souvent les détenus qui en sont détournés par la violence de leur caractère.»
Voici de quelle nature sont ces récompenses:
D'après les dispositions de la loi, les forçats détenus au bagne sont, ainsi que nous l'avons montré dans notre premier article, accouplés, c'est-à-dire attachés deux à deux par une chaîne en fer, dont chacun traîne la moitié.
Cet accouplement dure plusieurs années; il dure même toujours pour les hommes suspects et dangereux; et il ne cesse, après quatre ou cinq ans d'expiation, que lorsqu'un condamné s'est fait remarquer par une conduite régulière, par son repentir, par sa résignation, et par son mérite comme ouvrier ou comme infirmier. Alors le chef du service ordonne par écrit le désaccouplement, ce qui s'exprime au bagne par ces mots; mis en chaîne brisée. L'homme dans cet état porte la demi-chaîne, dont un bout est scellé dans la manille placée autour du bas de la jambe, et l'autre bout, replié autour du corps, reste attaché à la ceinture.
C'est la plus douce récompense, la plus grande faveur qu'un forçat puisse recevoir.
Cette différence de position est en effet immense, et l'on comprend aisément combien elle est précieuse pour lui! Quelle satisfaction il éprouve de pouvoir marcher seul, sans être obligé d'attendre que son compagnon veuille, ou puisse se mouvoir en même temps que lui; et souvent celui-ci lui est inconnu, antipathique, a un caractère difficile, violent, etc.
--Contraste horrible, qui rend encore mille fois plus amère et plus cruelle la condition des condamnés.
Aussi, dans tous les temps, depuis que les bagnes existent, le chef du service a trouvé dans la mise en chaîne brisée un des moyens les plus puissants pour maintenir la paix et le repos parmi le personnel de la chiourme et dans les travaux qui lui sont imposés.
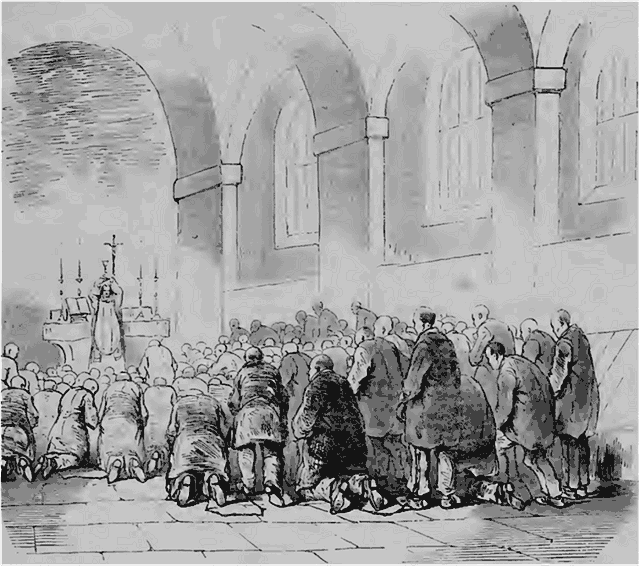
La messe.
On accorde cette faveur insigne, qui se retire impitoyablement pour les moindres fautes, aux vieillards, aux infirmes, aux forçats employés comme infirmiers et servants dans les hôpitaux, et aux ouvriers recommandés par les ingénieurs.
Les autres récompenses accordées aux forçats, outre la chaîne brisée, sont leur place dans une salle d'épreuve, les fonctions de servants et d'infirmiers dans les hôpitaux, et des postes de confiance dans l'intérieur des bagnes.--On choisit parmi les forçats les infirmiers et servants pour les malades de toutes armes en traitement dans les hôpitaux de la marine. En général ces hommes sont actifs, soigneux, fidèles, subordonnés, parce qu'ils craignent d'être renvoyés au bagne, où ils seraient bien plus mal.--Les postes de confiance dans l'intérieur du bagne occupent un certain nombre de forçats comme écrivains de salles, balayeurs, donneurs de pain, sbires, barberots, etc. Ces divers employés, pris ordinairement parmi les anciens de la maison, ne vont point aux travaux du port, et sont par conséquent moins misérables que les autres.--Les forçats placés dans une salle d'épreuves ont un petit matelas pour la nuit, et de la viande deux fois par semaine.
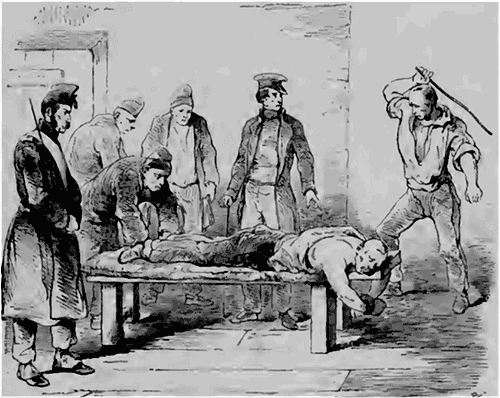
La Bastonnade.
Enfin, le maximum des récompenses que puissent obtenir les forçats, le but de tous leurs voux, le remède le plus efficace contre leurs souffrances, c'est la perspective éloignée ou prochaine du terme de leur captivité, et cette perspective leur paraît se rapprocher à mesure qu'ils se mettent en position d'être portés sur le tableau des grâces, qui est soumis annuellement à la clémence du roi.
Tous les ans, une commission spéciale, composée de plusieurs officiers de la marine, attachés aux diverses directions du port, d'ingénieurs des constructions navales et des travaux maritimes, ainsi que des officiers supérieurs d'artillerie, du commissaire des hôpitaux et du chef du service des chiourmes, se réunit sous la présidence du commissaire général de la marine, et examine successivement tous les noms dont le chef du bagne a préparé la liste après avoir compulsé tous les dossiers des condamnes. Cet examen achevé, elle arrête le tableau des malheureux qu'elle croit devoir recommander à la miséricorde royale.
Bien que le nombre des graciés ou des commués soit peu considérable puisqu'il n'est réglementairement que le trentième du personnel de la chiourme, on ne peut imaginer, dit M. le directeur du bagne de Brest, les transports de joie, les ravissements, les cris de bonheur qui retentissent dans toutes les salles à la proclamation des noms de ceux qui ont obtenu une commutation de peine ou leur grâce entière.
A part un certain nombre d'individus inaccessibles au remords et à la pitié, il est un grand nombre de condamnés qui sont en droit d'obtenir leur liberté à des époques plus ou moins rapprochées.
Frustrés dans leur attente à diverses reprises, parce qu'ils ne peuvent pas bien juger de leur position comparativement avec celle des autres, ils se flattent d'être plus heureux l'année suivante. Souvent trompés, ils ne renoncent pas à revoir leur famille et leur pays, à mourir libres. En attendant, ils augmentent la grande masse des condamnes soumis, résignés, dignes de miséricorde et de pardon.
Il n'est pas dans le monde entier un établissement où la religion puisse porter ses espérances et ses consolations avec plus de fruit qu'au bagne. Des prêtres chrétiens sont toujours prêts, à prodiguer avec un admirable dévouement les secours de leur ministère aux forçats qui les réclament ou qui en ont besoin, à essuyer leurs larmes, à les exhorter à la patience et à la résignation, à leur promettre, au nom d'un Dieu tout-puissant et miséricordieux, le pardon entier des fautes qu'ils expient... Tous les dimanches, ils leur disent la messe et leur adressent des instructions religieuses. L'immense majorité des forçats assiste au service divin et écoute les sermons avec un pieux recueillement...
(La fin à un prochain numéro.)
Bulletin bibliographique.
De la loi du Contraste simultané des Couleurs, et de ses applications; par M. Chevreul, membre de l'institut, de le Société royale de Londres, etc.--Chez Langlois et Leclercq.
Le livre que nous allons essayer d'analyser est à la fois un livre de science et un livre d'application. Livre de science, en ce qu'il nous révèle les lois qui président aux modifications que les couleurs éprouvent dans leurs apparences par leur juxtaposition ou leur succession: livre d'application, en ce qu'il fait voir le parti qu'on peut tirer de ces influences réciproques dans la peinture, la fabrication des tapis, l'emploi des couleurs dans l'architecture, l'assortiment des étoffés pour les meubles, l'habillement et la coiffure des femmes, et la disposition des fleurs des parterres. Le sujet du livre étant ainsi suffisamment indiqué, traçons d'abord l'historique de son origine. Lorsque M. Chevreul fut appelé, par ses beaux travaux de chimie organique, à diriger les ateliers de teinture de la manufacture des Gobelins, on appela son attention sur les couleurs noires employées dans l'établissement. Les artistes qui peignent avec des fils colorés ces admirables tapisseries se plaignaient que le noir était trop pâle, et que leurs ombres manquaient de vigueur dans les draperies bleues et violettes. M. Chevreul se procura des laines teintes en noir, provenant des ateliers les plus renommes de la France et de l'étranger, et reconnut qu'elles n'avaient aucune supériorité sur celles des Gobelins, et que le défaut du vigueur reproché au noir tenait à sa juxtaposition avec d'autres couleurs. Physicien aussi bien que chimiste, M. Chevreul reconnut qu'il avait à étudier à la fois le contraste des couleurs juxtaposées, et les moyens chimiques de leur donner toute la vivacité et la fixité désirables. Le premier problème rentrait dans le domaine de l'optique, le second appartenait à la chimie.
Si l'on regarde à la fois deux zones peu étendues, inégalement foncées et d'une même couleur, ou deux zones également foncées de couleurs différentes, qui soient contiguës par un de leurs bords, ces couleurs paraîtront plus différentes qu'elles ne le sont réellement; c'est ce phénomène que M. Chevreul appelle le contraste simultané des couleurs. Ce contraste est de deux espèces: ou bien il porte sur l'intensité de la couleur, c'est le contraste de ton; ou bien sur la nuance, c'est le contraste de couleur.
L'expérience suivante est propre à faire voir le contraste de ton. Prenez deux morceaux de papier non satiné, A et a, de la grandeur d'une carte, colorés avec le même gris, et deux autres, B et b, de même grandeur, colorées en gris plus foncé; puis placez sur une feuille de papier blanc A et B de manière a ce que leurs bords se touchent, tandis que a et b sont éloignés l'un de l'autre et du groupe AB. En considérant attentivement ces quatre cartes, vous verrez que A vous paraîtra plus clair que a et B, plus fonce que b; ce qui tient uniquement au contraste des deux gris dont les tons sont différents. On réussira également avec toute autre couleur que le gris, et l'on verra que c'est le long de la ligne de contact des deux cartes juxtaposées que le contraste est le plus frappant; il va en s'affaiblissant à mesure qu'on s'éloigne de cette ligne.
Les contrastes de couleurs s'obtiennent en juxtaposant des papiers et des étoffes colorés: ainsi, le rouge juxtapose à l'orange, tire sur le violet; tandis que l'orange tire sur le jaune. Si l'on juxtapose du rouge et du bleu, le premier lire sur le jaune, le second sur le vert, etc.
Voici l'explication de ces apparences. On lit dans les traités de physique que les couleurs complémentaires sont celles qui, ajoutées à une autre couleur, donnent du blanc. Le rouge est complémentaire du vert, l'orange du bleu, le jaune-verdâtre du violet, l'indigo du jaune-orange. Si donc vous juxtaposez deux Couleurs, A et B, l'effet de cette juxtaposition est de faire paraître les deux couleurs aussi dissemblables que possible. Le phénomène provient de ce que la couleur C, complémentaire de A, s'ajoutera à la couleur B; tandis que D, complémentaire de B, s'ajoutera à la couleur A.
Exemple: Juxtaposez de l'orangé et du vert. Le bleu, étant complémentaire de l'orange, s'ajoutera au vert et le rendra moins jaune. D'un autre côte le rouge, complémentaire du vert, s'ajoutant à l'orange, le vert tirer sur le rouge. Tel est le principe très-simple au moyen duquel on peut prévoir l'effet de la juxtaposition des couleurs, ou de leur contraste; simultané. M. Chevreul examine ensuite avec détail le résultat de la juxtaposition des corps colorés et des corps blancs, des corps colorés et des corps noirs, des corps colorés et des corps gris.
Le contraste successif se distingue du contraste simultané en ce qu'il a lieu quand on considère plusieurs couleurs l'une après l'autre. Regardez pendant quelque temps un papier rouge, puis portez les yeux sur une surface blanche, vous y verrez du vert, qui est la couleur complémentaire du rouge. Depuis longtemps les marchands d'étoffes ou de papiers peints avaient remarqué le fait suivant. Si l'on présente à un acheteur successivement douze ou quinze pièces du même rouge, il trouvera que les dernières ont une teinte verdâtre; mais si, après avoir fait passer sous les veux de l'acheteur cinq ou six pièces rouges, on lui en présente plusieurs qui soient vertes, et qu'il revienne ensuite au rouge, celui-ci lui semblera très-vif et très-pur. Cela tient à ce que l'œil, fatigué de rouge, est très-bien préparé à recevoir l'impression du vert, et vice versa. En un mot, une couleur tend à faire naître la sensation de sa couleur complémentaire. Ainsi, lorsqu'on fixe les yeux sur un carré de papier ronge placé sur un fond blanc, il paraît bordé d'un vert faible; jaune, il paraît entouré de bleu; vert, de blanc-pourpre, etc.
Après avoir exposé ces principes, que nous n'avons pu qu'énoncer brièvement, M. Chevreul passe à l'application. Il examine d'abord le coloris en peinture, et met l'artiste en garde contre les effets de contraste qui tendent a altérer les couleurs du modèle; il prouve que souvent, dans ses retouches continuelles, il ne fait que s'éloigner de plus en plus de la vérité, s'il ne connaît pas la loi du contraste simultané et successif des couleurs: ainsi il saura qu'une étoffe blanche, bordée de rouge, paraîtra nécessairement un peu verdâtre dans le voisinage de la bordure rouge, et il ne mêlera pas du vert au blanc contigu à cette bordure rouge.
Les lois s'appliquent avec plus de bonheur encore à la fabrication des tapis, où l'on produit les couleurs en juxtaposant des fils de nuances différentes, et conduisent l'auteur à donner des conseils aux fabricants de tapis sur le choix des dessins et l'assortiment des couleurs, de manière à produire le meilleur effet possible, sans élever démesurément le prix des tapisseries.
Passant à une industrie moins relevée, celle des toiles peintes, M. Chevreul fait voir que l'ignorance de ces lois a même donné lieu à des procès qu'il a été assez heureux pour terminer à l'amiable. Ainsi un marchand de nouveautés ayant donné des étoffes de couleur unie, rouge, violette et bleue à des imprimeurs pour qu'ils y appliquassent des dessins noirs, se plaignit que les noirs étaient verts, jaunâtres ou cuivrés. Il a suffi au savant professeur de circonscrire ces dessins noirs avec des papiers blancs découpés pour convaincre ce marchand que les dessins étaient du plus beau noir, et qu'il était abusé par un effet de contraste.
Nous ne saurions suivre l'auteur dans ses savantes et poétiques considérations sur l'architecture polychrome des Égyptiens, des Grecs, et les vitraux des églises gothiques. De ces hautes régions de l'art, nous descendrons avec lui dans des considérations plus prosaïques, mais qui nous touchent de plus près. Il s'agit des étoffes pour meubles. Ici le contraste est tout-puissant, car il s'agit à la fois de faire ressortir la couleur du bois et celle de l'étoffe; c'est ainsi que vous emploierez des étoffes violettes ou bleues avec des bois jaunes, telles que ceux de citron ou de racine de frêne; les étoffes vertes avec l'acajou; si votre meuble est en velours cramoisi, alors séparez, le velours du bois par des clous dorés, ou un galon jaune ou noir. Le palissandre s'harmonisera avec le brun, le rouge, le bleu, le vert et le violet.
Le choix des couleurs pour la décoration d'une salle de spectacle est un des problèmes les plus compliqués que puisse se proposer l'architecte décorateur. Créer un ensemble harmonieux à la vue, éclairé par une lumière artificielle, tantôt vive, tantôt ménagée; éviter les contrastes désagréables avec les décors du théâtre et les costumes des acteurs; faire ressortir la toilette des femmes et les peintures du plafond ou du rideau, telles sont les conditions à remplir. Le fond des loges ne devra jamais être rose ou lie de vin, car il donnerait à la peau un aspect verdâtre; le vert pâle, au contraire, fera valoir les carnations rosées, un fond rouge blanchira la peau; le rebord pourra être vert pour s'harmoniser avec le rouge du fond.
Les uniformes militaires fournissent de nombreuses occasions de vérifier les vues de M. Chevreul. L'on ne doit jamais oublier, dans l'assortiment de leurs couleurs, les effets de contraste: le bleu et le jaune, le rouge et le vert, le jaune et le vert, convenablement assortis, sont des combinaisons heureuses et qui ont été adoptées instinctivement dans les différentes armées de l'Europe.
Parmi les uniformes français, M. Chevreul critique celui des cuirassiers, où le retroussis écarlate du 1er régiment, cramoisi du 2e aurore du 3e et rose du 4e, vont mal avec le rouge garance du pantalon.
Ceux des hussards lui paraissent pécher tous en ce que le rouge du pantalon ne s'harmonise pas par sa nuance avec la couleur du dolman. Celui de l'artillerie est irréprochable.
Je ne sais si beaucoup de lectrices auront eu la patience de me suivre dans cette analyse, mais celles qui auraient persévéré jusqu'à ce paragraphe, l'achèveront certainement: il s'agit du l'assortiment des couleurs pour leurs chapeaux, leurs robes et leurs bonnets. Oui, mesdames, une femme qui s'habille mal viole non-seulement les règles du goût, mais encore celles de la physique. Le goût exquis des Parisiennes est une divination instinctive des phénomènes du contraste; toutes font de la chromatologie (terrible mot!) sans le savoir. Avant que M. Chevreul vint dévoiler ces lois, elles les mettaient en pratique, et en étudiant la toilette d'une femme du monde, le savant professeur a pu souvent jouir de la continuation de ses principes. Pourquoi entrerai-je dans ces détails superflus? qu'apprendrai-je à ces savantes analystes qu'elles ne sachent mieux que moi? Si nous étions dans la saison des bals, je quitterais ma plume, j'irais dans un salon, et j'achèverais mon article en rentrant. Mais j'ai promis une analyse, je la ferai en tremblant, car je parle à des juges trop compétents pour n'être pas sévères.
La couleur des cheveux blonds étant le résultat d'un mélange de rouge, de jaune et de brun, il faut la considérer comme de l'orange très-pâle; les yeux bleus forment avec ces cheveux une harmonie de contraste, et la couleur de la peau une harmonie d'analogue; le bleu de ciel, complémentaire de l'orange, sied, comme chacun sait, très-bien aux blondes.
Chez les brunes, les harmonies du contraste remportent sur les harmonies d'analogue. La couleur des cheveux, des sourcils et des yeux contrastent avec la blancheur de la peau, et leurs lèvres, plus vermeilles que celles des blondes, font paraître les cheveux et les sourcils encore plus foncés. Le jaune et l'orange, en mêlant aux cheveux des teintes de violet et de bleuâtre, produisent le meilleur effet.
Les tissus en contact avec la carnation devront varier suivant que la peau est blanche ou rose. Dans le premier cas, on emploiera le vert tendre; dans le second, le rose séparé de la peau par une ruche de tulle. Quand la peau a une teinte orangée, le jaune lui prêtera une teinte rose en neutralisant le jaune, et c'est encore une raison pourquoi le jaune sied bien aux brunes. Le violet est une des couleurs les moins favorables à la peau; il donne du jaune verdâtre aux peaux blanches, augmente la teinte jaune des peaux orangées, et s'il y a du bleu dans la carnation, il le verdit. L'orange bleuit les peaux blanches, blanchit les peaux orangées et verdit celles qui ont une couleur jaunâtre. Le blanc élève le ton de toutes les couleurs, va bien aux peaux rosées, mal à toutes les autres; le tulle, la mousseline font plutôt l'effet du gris, parce qu'elles laissent passer la lumière outre leurs mailles. Le noir blanchit la peau qui lui est contiguë, mais par cela même, il fait paraître celles qui sont plus éloignées rouges ou jaunes, pour peu qu'elles aient quelques nuances de ces couleurs.
Quand on discute la couleur d'un chapeau, il faut non-seulement avoir égard aux couleurs juxtaposées, mais encore aux couleurs reflétées par le chapeau. Ainsi un chapeau rose reflète du rose sur la figure, ce rose engendre des teintes verdâtres; heureusement les couleurs reflétées ont moins d'influence que les femmes ne le croient généralement, car leur effet n'est guère sensible que sur les tempes, et fort inférieur à celui du contraste avec les cheveux ou les carnations auxquelles le chapeau est juxtaposé. M. Chevreul s'en est assuré par des expériences directes. Aux blondes conviennent des chapeaux noirs avec des plumes blanches ou de fleurs roses; bleus clairs avec des fleurs jaunes ou orangées; verts avec des fleurs roses. Les brunes préféreront un chapeau noir avec des accessoires blancs, roses, oranges ou jaunes; rose, rouge ou cerise, avec des fleurs blanches entourées de feuilles; jaune avec du violet ou du bleu.
Qu'ajouterai-je après avoir analysé cet important chapitre si propre à réhabiliter la physique dans l'esprit des dames, où elle se liait ordinairement avec des idées de tubes de cuivre, de ballons de verre, de fioles pleines de mercure ou de machines à vapeur toujours prêtes à éclater.
J'engagerai les horticulteurs à méditer les préceptes de M. Chevreul sur l'art d'assortir les fleurs des parterres, les massifs de verdure de même nuance ou de nuances variées. Les artistes liront avec fruit les considérations sur le jugement des divers objets dont la perception nous arrive par le sens de la vue, et le philosophe méditera le dernier chapitre, où l'auteur examine si les autres sens sont soumis au contraste, et où il jette en quelques pages une vive lumière sur quelques phénomènes de l'entendement qui ont de l'analogie avec ceux qui font le sujet de son ouvrage.
CH. M.
Les Heures, poésies par M. Louis de Ronchaud. 1 vol. in-8. --1844. Amyot.
Les Heures sont sœurs cadettes des Méditations et des Harmonies. M Louis de Ronchaud, comme tant d'autres jeunes poètes, est un écho de
Ce poète sublime
Dont le nom, cher à tous, sur ses lèvres ranime
Tant de divins concerts.
Mais, jusqu'à ce jour, l'école de M. de Lamartine n'avait peut-être pas vu se produire devant le public un disciple qui se fût plus rapproché du maître. Facile et élégant, le vers de M. Louis de Ronchaud a une franchise et une vigueur naturelles bien rares chez les débutants. A part quelques négligences échappées sans doute à l'improvisation:
Et s'approchant alors près de la jeune fille,
et certaines phrases peu poétiques:
Mes rêves,--doux troupeau dont je suis le berger!--
Comme cela va, fuit, monte, tournoie et plane
Dans la chaude lumière.
Le style est toujours correct et harmonieux, surtout lorsque M. Louis de Ronchaud ne se sert pas de mots nouveaux semblables à celui-ci:
Un poète a bâti Néphélocorygie...
M. Louis de Ronchaud a assez de talent pour que nous nous permettions de lui adresser un reproche plus sérieux. La pensée, dans ses poésies, reste souvent au-dessous de l'expression; nous aimerions mieux que le contraire fût vrai. En général, il y a dans la plupart des Heures beaucoup trop de mots vagues et sonores. Que M. Louis de Ronchaud se méfie de sa facilite; qu'il médite avant de chanter, ou que les caprices de son imagination soient moins vulgaires et plus nets. Des pensées nouvelles, fortes et profondes ou des fantaisies vraiment saisissantes et originales, tels sont les deux buts où doit tendra avant tout le poète qui aspire, non pas à un succès éphémère, mais à une renommée solide et durable.
Parmi les meilleures pièces de ce remarquable recueil, nous choisissons à l'appui de nos éloges les deux fragments suivants empruntes à l'Hymne du Printemps et à Mon Jardin.
Oui, je te reconnais, c'est bien ton doux sourire,
O Printemps! Cette voix qui mollement soupire,
C'est bien la douce voix dont tout être est charmé.
Quand tu viens délivrer la nature enchaînée.
Quand tu fais du tombeau sortir la jeune année.
Qui ne t'aime, ô Printemps, dans ton lit parfumé!
Souvenir de l'Eden qui traverse notre âge.
Sur ton berceau pourtant flotte plus d'un nuage;
Plus d'une fleur succombe à tes matins frileux;
Plus d'un souffle, fatal aux bourgeons dans leur sève,
Brusquement interrompt le poète qui rêve
Une rive inconnue aux printemps fabuleux!
O fils aîné du ciel, dont l'haleine féconde
Couvrit de tant d'attrait la jeunesse du monde.
Que ton souffle était doux sur le globe naissant.
Quand tout avait sa grâce et sa beauté première
Sur terre et dans le ciel, où la jeune lumière
Achevait de tomber des doigts du Tout-Puissant!
Quelle était, ô Printemps, ta pureté sonore
Sur cette terre neuve, où toute chose encore
De la virginité gardait le don charmant;
Où le vent, vierge encor de toute haleine immonde,
Parcourait, libre et pur, la mer vierge dont l'onde
Sur une rive vierge expirait doucement!
Mais la chute de l'homme entraîne la nature.
Un seul crime commis par une créature
A suffi pour changer l'universelle loi.
Avant l'homme déchu par un arrêt suprême,
La terre en même temps fut déchue elle-même,
Et l'univers suivit le destin de son roi.
Le règne de l'hiver commença sur la terre
Avec celui du Mal, son triste et sombre frère;
Et l'on vit remonter au ciel en même temps,
De peur de se souiller à nos ombres funestes,
Ces deux enfants de Dieu, ces deux jumeaux célestes,
L'Innocence divine et le divin Printemps.
.............................................
Le poète est sans doute une double personne:
La moitié de lui-même est roi dans un palais,
Magnifique, entouré d'un peuple de valets,
La pourpre sur l'épaule et la couronne en tête,
Habitant au milieu d'une éternelle fête!
L'autre est un malheureux, marchant les yeux baissés,
Les habits en lambeaux, les pieds demi-chaussés.
Un bâton à la main, sur son dos la besace
Que les enfants au doigt se montrent quand il passe
Sur l'or de son balcon, un matin s'appuyant,
Le prince voit en bas passer le mendiant,
Et dans ce vagabond, pauvre, souffrant et blême,
Reconnaît aussitôt la moitié de lui-même.
Il l'appelle, il l'embrasse. Il le prend par la main;
Il l'invite chez lui jusques au lendemain;
Il le fait souverain de sa riche demeure,
Il lui met dans la main le sceptre... pour une heure;
Il ordonne aux valets d'obéir à sa voix.
Pendant un jour entier le mendiant est roi.
Le lendemain, quand l'aube a ouvert sa paupière,
Il se retrouve assis sur la borne de pierre;
Il reprend son chemin, pieds nus, sur le pavé,
Et, pour soulagement, se dit... qu'il a rêvé.
Incendie de la Djeninah, à Alger.
On nous écrit d'Alger, 28 juin 1844;
Le mercredi 26 juin, à neuf heures du soir, deux coups de canon tirés de la rade jetèrent l'alarme dans la population de la ville d'Alger. Tous les habitants, Européens ou Maures, se précipitaient hors de leurs maisons et demandaient avec anxiété ce que signifiait cet effrayant signal. Les conjectures les plus étranges circulaient déjà parmi la foule; mais la vérité ne tarda pas à être connue. Un violent incendie venait d'éclater près de la place Royale. Le feu avait pris dans la baraque d'un juif marchand de beignets, et s'était communiqué rapidement aux autres constructions en bois situées entre la rue Bab-Azoun et la Djeninah. Quand les premiers secours arrivèrent sur le lieu du sinistre, les flammes avaient fait de tels progrès qu'on ne dut plus songer qu'à sauver les bâtiments voisins, qu'elles menaçaient d'envahir, la Djeninah et l'évêché. Mais tous les efforts furent inutiles; malgré le dévouement de la population civile, des troupes de toutes armes, malgré le généreux empressement des marins de la frégate sarde Beroldo, mouillée dans la rade, on ne parvint à se rendre maître du feu que le lendemain matin, et l'incendie avait dévoré l'aile droite de la Djeninah et une partie des objets de campement qui y étaient emmagasinés.
La perte est, dit-on, considérable.--Personne n'a péri; mais le nombre des blessés s'élève à trente. A Alger, comme partout ailleurs, des voleurs ont profilé du désordre pour piller. On a arrêté en flagrant délit une cinquantaine de ces misérables.--Les malheureuses victimes de ce sinistre ont ainsi perdu, pour la plupart, le peu d'objets précieux qu'elles avaient arrachés aux flammes. Dès le lendemain de l'incendie, la chambre du commerce ouvrit en leur faveur une souscription qui, dans la journée, se monta à 8,000 francs.
De mémoire d'homme Alger n'avait vu un incendie pareil à celui du 20 juin.

Voici, d'après une chronique arabe, la liste de ceux qui ont été le plus violents.
1025 de l'hégire (1616 de J.-C.), sous Mustapha, explosion des poudres; incendie du quartier des Kilchawas.
1041 (1632), sous Schikh Hussein, incendie de la Casbah.
1044 (1635), sous Youssef, la Casbah est incendiée de nouveau.
1091 (1670), sous Baba-Hassan, incendie de la grande poudrière.
1155 (1742), sous Ibrahim, incendie du fort l'Empereur.
La Djeninah, qui vient d'être en partie détruite par les flammes, et que représente notre dessin, fut fondée en 939 de l'hégire (1553 de J.-C.), sous le pachalik de Saleh. Dapper en donne la description suivante, d'après Haédo et Marmol, historiens espagnols:
«Le plus beau bâtiment d'Alger est le palais du bacha, qui est au milieu de la ville, entouré de deux belles galeries l'une au-dessus de l'autre, soutenues par deux rangs de colonnes de marbre.--Il va aussi deux cours, dont la plus grande a trente pieds en carré, où le divan s'assemble tous les samedis, les dimanches, les lundis et les mardis. --C'est là que le bacha traite les conseillers du divan au temps de la fête du Beyram. L'autre cour est devant le palais du vice-roi.»
La Djeninah se composait encore, pour le service intérieur, d'un côté d'une suite de maisons démolies après la conquête, pour faire place aux baraques provisoires devenues la proie des flammes, et, de l'autre, de deux bâtiments, dont l'un sert pour la manutention, et l'autre pour le corps de garde de la milice.
Une inscription placée au-dessus de la porte du corps de garde relate que près de là, et adossé contre le mur, il existait jadis un mortier de marbre dans lequel on pilait les condamnés à mort.--De pauvres soldat; ivres, coupables seulement de désertion, ont subi cet horrible supplice; c'est du moins ce qu'ajoute l'inscription.
Quoi qu'il en soit, la Djeninah a servi de palais aux dey d'Alger jusqu'en 1232 de l'hégire (1817 de J.-C.). A cette époque, Ali, l'avant dernier dey, transporta le siège du gouvernement à la Casbah pour échapper au despotisme sanglant de la milice turque. Hussein, son successeur, imita son exemple. Depuis la conquête française en 1830, la Djeninah servait de magasin pour les objets de campement.
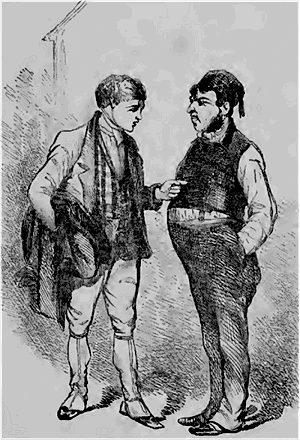
Il vit de ses rentes, tu vis de tes
gages, et je vide ses poches.
On lit dans le Journal de la Librairie:
A monsieur le Rédacteur.
Monsieur, la librairie allemande est fort étonnée, en ce moment, de la publication des premières livraisons de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, de M. Thiers. Cette publication, faite par un éditeur de Leipzig, M. Schæfer, est une audacieuse mystification contre laquelle je dois prévenir ses compatriotes. Il paraît que, dans la prétendue traduction de l'ouvrage de M. Thiers, l'Histoire du Consulat et de l'Empire commence à la naissance de Napoléon. L'histoire véritable commence après le 18 brumaire, et fait suite, sans lacune ni interruption, à l'Histoire de la Révolution française, de l'auteur. Il n'est pas encore sorti des mains de M. Thiers un seul feuillet de copie, et il n'en sortira pas un seul avant le mois d'août prochain, époque à laquelle commencera réellement l'impression en France et en Allemagne. L'édition allemande est cédée par M Thiers à M. J.-P. Metine, éditeur à Leipzig.
Agréez, etc.
Paulin.
Paris, le 5 Juillet 1844.
Rébus.
EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS
Toi que l'oiseau ne suivrait pas,
Toi qui n'es pas de nos climats.