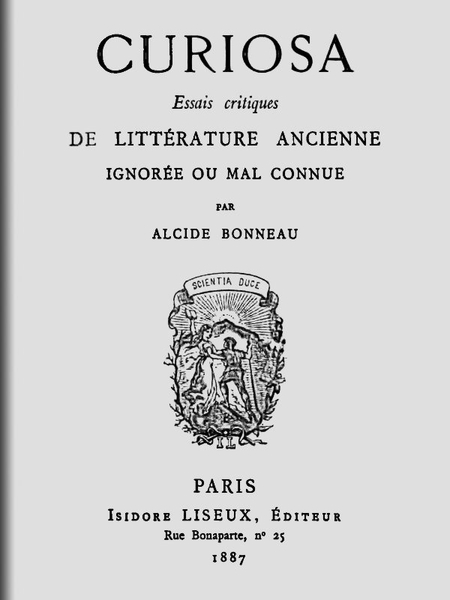
CURIOSA
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE
deux cents exemplaires
sur
PAPIER DE HOLLANDE
CURIOSA
Essais critiques
DE LITTÉRATURE ANCIENNE
IGNORÉE OU MAL CONNUE
PAR
ALCIDE BONNEAU

PARIS
Isidore LISEUX, Éditeur
Rue Bonaparte, no 25
1887

AVERTISSEMENT

Ce recueil est formé d’Études et de Notices placées en tête de réimpressions ou de traductions d’ouvrages curieux à quelque titre, qui ont été publiées depuis une dizaine d’années environ par M. Isidore Liseux. Voltaire disait, non sans une apparence de raison, qu’un livre qui n’a pas eu de nombreuses éditions mérite l’oubli dans lequel on l’a laissé tomber, et il aurait volontiers établi la valeur intrinsèque d’un ouvrage d’après le plus ou moins de facilité avec laquelle on se le procure. A ce compte nous aurions donc fait, M. Isidore Liseux et moi, une besogne bien inutile, car, à peu d’exceptions près, nous ne nous sommes guère occupés que de ce qui était rare, en quelque sorte inédit, et parfois introuvable. On ne peut cependant pas s’absorber éternellement, comme un prêtre de Bouddha regardant son nombril, dans la contemplation d’Homère, de Virgile, d’Horace, de Shakespeare, de Dante, VI de Bossuet, et rééditer sans cesse, pour y découvrir de nouvelles sources d’intérêt et d’admiration, le Télémaque, les Oraisons funèbres, l’Esprit des Lois, ou le Siècle de Louis XIV! Qu’il soit bon de faire de ces chefs-d’œuvre incontestés sa nourriture habituelle, nous ne le nions pas; mais combien de livres pleins d’attraits et de mérites ont été submergés depuis trois ou quatre cents ans par la marée montante des publications nouvelles, et valent cependant la peine d’être tirés de la demi-obscurité où ils sommeillent! Le goût des choses anciennes nous portait tous les deux vers ces curiosités littéraires, qui sont, comme le disait très bien Paul de Saint-Victor, le dessert de l’esprit, après le repas substantiel des maîtres; et de notre collaboration journalière, l’un s’appliquant à les rechercher, l’autre à les traduire ou à les présenter, par une étude préliminaire, à un public restreint d’amateurs, est né ce volume. Les humanistes et les érudits de la Renaissance: Pogge, Laurent Valla, Érasme, Henri Estienne; les conteurs Italiens, de Boccace à Batacchi et à l’abbé Casti: Sacchetti, Firenzuola dont il n’existait aucune traduction Française, Pietro Aretino, si décrié et si inconnu; les poètes humoristiques, comme Pacifico Massimi, Lorenzo Veniero, Baffo, nous ont attirés tour à tour et insensiblement amenés à Nicolas Chorier, à VII l’auteur anonyme des Heures perdues d’un cavalier Français et aux conteurs du XVIIIe siècle: Crébillon fils et Voisenon.
Dans son ensemble, notre recueil forme une sorte de Supplément à l’histoire de la littérature Italienne et de la littérature Française, ses meilleures pages étant consacrées à des auteurs ou à des ouvrages sur lesquels les traités ex-professo ne fournissent que des notions inexactes ou confuses, quand ils ne sont pas absolument muets. Nous avons dû cependant, pour ne pas grossir le volume au-delà de toutes proportions, ne présenter qu’en abrégé quelques-uns de nos travaux, comme l’Essai sur les livres de Civilité, l’Étude historique qui précède la Donation de Constantin, de Laurent Valla, la Notice où nous avons définitivement résolu l’attribution à Nicolas Chorier des Dialogues de Luisa Sigea, l’Essai sur la langue érotique, préliminaire au Dictionnaire de Blondeau; d’autres, sur Robert Gaguin et son poème de l’Immaculée Conception, sur les Sonetti lussuriosi de Pietro Aretino, sur les Confessions de Jean-Jacques Bouchard (réimprimé dans la Curiosité littéraire et bibliographique, 2e série), n’ont pu y prendre place. Il nous suffira de les mentionner.
Paris, Mars 1887.

CURIOSA

CURIOSA
I
ADVIS
POUR DRESSER UNE BIBLIOTHÈQUE
PAR GABRIEL NAUDÉ[1]

L’advis pour dresser une bibliothèque est un de ces livres d’érudition aimable qui se lisent toujours avec plaisir. Nul n’était plus apte à traiter ce sujet que Gabriel Naudé, le passionné bibliophile, l’organisateur des bibliothèques du président de Mesmes, des cardinaux Bagni et Barberini (deux des grands amateurs du 4 temps), de Mazarin et de la reine Christine. Il semble même qu’il n’aurait pu écrire ce livre qu’à la fin de sa carrière, comme résumé de ses observations et de ses travaux, alors que les plus belles collections lui avaient passé entre les mains et avaient été mises en ordre par lui, tant en Italie qu’en France et en Suède. C’est au contraire au début de sa vie, à l’âge de vingt-cinq ou vingt-six ans, simple étudiant en Médecine, recueilli par le président de Mesmes pour mettre un peu d’ordre dans ses livres, qu’il fit preuve, en rédigeant cet opuscule, d’un savoir véritablement étonnant, de connaissances déjà si étendues et si variées, et surtout de ce remarquable esprit de classification dont il était doué. Depuis, il suivit toujours la même voie, sans s’en laisser détourner même par ses vastes travaux d’érudition et par les vives polémiques auxquelles il fut contraint de se livrer pour les soutenir. Il passa sa vie dans les livres, classant ceux qu’il avait, guettant ceux qu’il n’avait pas juste au moment où les collections auxquelles ils appartenaient pouvaient tomber en son pouvoir, achetant sans cesse, en France, en Hollande, en Italie, en Angleterre, presque toujours pour le compte des autres, parfois aussi pour son propre compte quand les malheurs du temps faisaient chanceler la fortune de ses protecteurs. On le vit bien pendant la Fronde, lorsqu’un arrêt inepte du Parlement ordonna la vente de la bibliothèque du cardinal Mazarin dans laquelle Naudé, au prix de tant de peines et de fatigues, avait réuni près de 40,000 volumes. Ce fut un véritable pillage dont Naudé sauva ce qu’il put, en y consacrant tout l’argent qu’il avait, une maigre somme, un peu plus de 3,000 livres.
5 Ce dont il faut surtout le louer, c’est qu’il ne fut pas, comme tant d’autres, un bibliophile égoïste, désireux de thésauriser d’immenses richesses littéraires pour lui seul, ou tout au plus un petit cercle d’amis. S’il proposait comme premier résultat de la fondation d’une grande bibliothèque l’avantage de sauver de la destruction une foule d’ouvrages exposés à périr en restant disséminés, il entrevoyait pour but principal de faire jouir tout le monde de ces trésors si difficilement amassés. On lui doit la première bibliothèque ouverte au public en France, la Mazarine. A peine eut-il réuni, sur l’ordre du cardinal, douze ou quinze mille volumes, qu’il lui persuada de ne pas les garder pour lui, d’en faire part généreusement à quiconque voudrait les consulter. La chose sembla bien téméraire, comme toutes les innovations. Il n’y avait alors, en Europe, que trois bibliothèques ouvertes au public: l’Ambroisienne, fondée à Milan par le cardinal Borromée, en 1608; la Bodléienne, ouverte à Oxford en 1612 et la Bibliothèque Angélique, du nom de son fondateur Angelo Rocca, établie à Rome, en 1620. On doutait que pareille tentative pût réussir en France; mais Naudé aurait volontiers répondu, comme d’Alembert, à ces infatigables adversaires de toute idée un peu neuve: «Qu’on leur donne à manger du gland, car le pain fut aussi, dans son temps, une grande innovation.» A la fin de 1643, il eut le bonheur de voir le public pénétrer dans la bibliothèque du cardinal, bonheur bientôt suivi de rudes épreuves lorsqu’il lui fallut assister à la dispersion de ses chers livres. Le cœur navré, il partit pour Stockholm, où la reine Christine lui offrait la direction de sa bibliothèque, puis revint 6 à Paris reconstituer celle du cardinal. Au milieu de toutes ces traverses, des voyages qu’il lui fallut entreprendre tant pour visiter les principales collections de l’Europe que pour en acquérir quelques-unes, il trouva encore le temps d’écrire cinq ou six grands ouvrages d’érudition et une trentaine de dissertations, la plupart fort curieuses et qui le placèrent à la tête des plus savants hommes de son temps.
Savant, il l’était déjà au début de sa carrière et lorsqu’il publia l’Advis que nous réimprimons. On s’en apercevra dès les premières pages de cet opuscule, qu’il écrivit comme en se jouant et sans vouloir, sans doute, faire parade de sa science. Le lecteur d’aujourd’hui, habitué à une érudition plus sobre, sourira peut-être en voyant l’auteur, à peine entré en matière, citer Pline, Cardan, Sénèque, faire défiler Alexandre, Démétrius, Tibère, les rois d’Égypte, évoquer les Pyramides et le temple de Salomon; il y a là un étalage un peu enfantin, mais on tombe sous le charme en voyant combien Naudé est plein de son sujet, comme il connaît son antiquité et les modernes; on se convainc qu’il ne songe qu’à vous faire jouir du fruit de ses lectures, et l’on partage l’enthousiasme du bibliomane qui ne voit rien de plus beau que ceux qui collectionnent les livres, si ce n’est peut-être ceux qui les font. Presque rien n’a vieilli dans cet opuscule qui a deux siècles et demi de date; tout au plus le bibliophile contemporain donnerait-il plus d’extension à quelques parties et diminuerait-il d’autant quelques autres. Certaines branches du savoir n’ont pas, dans la classification de Naudé, tout le développement qu’on leur donnerait de nos jours, et l’on trouverait aisément 7 que la théologie, la scolastique, la controverse religieuse, la vieille jurisprudence et l’alchimie occupent au contraire une trop grande place. C’est la conséquence de la marche du temps et de l’esprit humain: comme la mer, il se retire d’un côté pour se reporter de l’autre. Encore y aurait-il bien à redire à ces restrictions, car nombre de ces livres sont d’une haute curiosité. Mais, comme idées générales, l’Advis pour dresser une bibliothèque reste un modèle de classification méthodique et raisonnée. L’impression dernière qui en résulte est saine; l’auteur l’a si bien pénétrée de son amour des livres, qu’on se laisse insensiblement aller à sa passion. On gagne à sa lecture, sinon le désir de posséder une de ces belles collections qu’il imagine, désir chimérique pour la plupart, du moins le respect de ces majestueux «réservoirs» du génie de l’homme, et surtout la soif de connaître.
Paris, Septembre 1876.

II
SOCRATE ET L’AMOUR GREC
PAR J.-M. GESNER[2]

Jean-Matthias Gesner, l’auteur de cette curieuse dissertation, est un érudit Allemand du XVIIIe siècle, dont les travaux ne sont pas très connus en France. On lui doit d’excellentes études sur les Scriptores rei rusticæ, une Chrestomathie de Cicéron, une Chrestomathie Grecque, des Lexiques, une traduction Latine des œuvres de Lucien, des éditions de Pline le jeune, de Claudien, de Quintilien, de Rutilius Lupus et autres anciens rhéteurs, toutes enrichies de notes savantes et de longs prolégomènes; plus, un nombre formidable de dissertations sur toutes sortes de sujets, Opuscula diversi argumenti (Breslau, 1743-45, 8 vol. 9 in-8o), parmi lesquelles son Socrates sanctus pæderasta tire forcément l’œil par la bizarrerie de son titre.
Cette bizarrerie a valu au livre sa notoriété, et en même temps lui a fait grand tort. Beaucoup de gens, entre autres Voltaire, malheureusement pour l’érudit Tudesque, n’ont pas été au delà, et ils ont construit sur cette mince donnée un ouvrage tout entier de leur fantaisie, à l’extrême désavantage du pauvre Gesner. D’autres ont cru Voltaire sur parole et sont arrivés au même résultat.
C’est Larcher, l’Helléniste, qui le premier chez nous mit en lumière cet opuscule, dans son Supplément à l’Histoire universelle de l’abbé Bazin (1767, in-8o), en le citant parmi les ouvrages à consulter sur le procès de Socrate; il se contenta d’en faire mention, sans même traduire ni expliquer le titre, ne s’imaginant pas qu’on pût s’y méprendre, et qu’un homme tel que Gesner fût supposé capable d’une indécente apologie. Voltaire, dont le vif et alerte esprit se plaisait à effleurer les surfaces, sans presque jamais approfondir, ne connaissait sans doute pas Gesner et certainement n’avait pas lu son Socrates. Le Supplément à l’Histoire universelle n’était d’ailleurs qu’une réfutation très savante, quoiqu’un peu lourde, de son Introduction à l’Essai sur les mœurs, publiée d’abord à part et sous le pseudonyme de l’abbé Bazin; quelques critiques justes qu’on y rencontre le mirent de mauvaise humeur, et, battu sur divers points d’érudition, il chercha une occasion de dauber Larcher, à côté du sujet, selon son habitude. Il crut la trouver dans le livre étrange qu’il supposa, d’après le titre cité qu’il interprétait mal, s’indigna de ce qu’on osait donner comme faisant autorité de si 10 monstrueuses élucubrations (le monstrueux n’était que dans ce qu’il imaginait), et tantôt sous le pseudonyme d’Orbilius, tantôt sous celui de Mlle Bazin (Défense de mon oncle, un de ses pamphlets), il ne cessa de poursuivre là-dessus de ses brocards son inoffensif adversaire. Très content d’avoir levé ce lièvre, il a même reproduit son assertion plus que hasardée dans le plus populaire de ses ouvrages; on la trouve en note de l’article Amour socratique, du Dictionnaire philosophique: «Un écrivain moderne, nommé Larcher, répétiteur de collège, dans un libelle rempli d’erreurs en tout genre et de la critique la plus grossière, ose citer je ne sais quel bouquin dans lequel on appelle Socrate Sanctus pederastes; Socrate saint b....! Il n’a pas été suivi dans ces horreurs par l’abbé Foucher.»
Larcher avait trop beau jeu pour ne pas répliquer. Il le fit dans sa Réponse: la Défense de mon oncle (1767, in-8o), opuscule rare, réimprimé à la suite du Supplément à l’Histoire universelle: «Vous m’attribuez,» dit-il à Voltaire, «votre infâme et infidèle traduction du titre de cette dissertation de feu M. Gesner. Je n’ai point traduit le titre de cette dissertation; il ne pouvait se prendre que dans un sens très honnête, mais il était réservé à Mlle Bazin et à Orbilius de lui en donner un infâme. Cela ne vous suffisait-il pas? Fallait-il encore me l’imputer?»
Pour qui avait suivi toutes les phases de la discussion, Larcher et Gesner étaient innocentés; Voltaire restait convaincu d’avoir noté d’infamie un livre sans le connaître. Mais ces temps sont loin; personne aujourd’hui ne lit Larcher pour son plaisir, et le Dictionnaire philosophique est dans toutes les mains. Voilà 11 pourquoi on croit généralement que Gesner a développé le plus scabreux des paradoxes et fait une apologie en règle d’un vice honteux. Nous pourrions citer au moins un de ceux qui, se fiant à Voltaire, ont propagé l’erreur mise par lui en circulation, et affirmé que cette dissertation n’est qu’un tissu d’invectives; mais nous ne voulons faire de la peine à personne.
Gesner, écrivain des plus doctes et plus estimé encore pour son caractère que pour son savoir, professeur de Belles-Lettres à l’Université de Gœttingue, puis bibliothécaire de cette université, ne pouvait écrire qu’une défense de Socrate, une réfutation des calomnies dont on a obscurci sa mémoire, et que la langue a attachées à son nom d’une manière en quelque sorte indélébile par les mots de socratisme et d’amour socratique. Inquiet et tourmenté, comme il l’assure, de voir peser sur le père de la Philosophie de si indignes soupçons, il a voulu remonter aux sources, compulser tout le dossier et reviser le procès sur les pièces mêmes. Il l’a fait d’une façon non moins ingénieuse que savante dans cette dissertation lue à l’Académie de Gœttingue en Février 1752, recueillie dans les Mémoires de cette Académie (t. II, p. 1), dans les Opuscula diversi argumenti de l’auteur et tirée à part en 1769 (Utrecht, in-8o). C’est cette dernière édition que nous avons suivie pour la réimprimer et la traduire, ce qui n’avait jamais été fait en Français, ni probablement dans aucune autre langue. Gesner a-t-il réussi à disculper entièrement Socrate? Nous l’espérons; mais nous étions de son avis avant d’avoir lu son livre, et, comme personne ne l’ignore, c’est surtout chez ceux 12 qui pensent comme lui qu’un auteur, si bon dialecticien qu’il soit, porte la conviction. Les esprits mal faits qui inclinent à l’opinion contraire, et ceux-là seront toujours difficiles à persuader, persisteront peut-être à trouver singulier que Platon, interprète de Socrate, ait si souvent parlé de l’amour; qu’il ait consacré trois de ses plus beaux dialogues, le Lysis, le Phèdre et le Banquet, à cette brûlante passion; qu’il l’ait tant de fois soumise aux analyses les plus délicates, expliquée par les conceptions les plus poétiques, et que jamais, sauf un moment, dans l’admirable épisode de Diotime du Banquet, il ne soit question de la femme.
Janvier 1877.


III
UN VIEILLARD
DOIT-IL SE MARIER?
DIALOGUE DE POGGE[3]

C’est au savant éditeur Anglais William Shepherd que l’on doit la connaissance de ce Dialogue. Auteur d’une excellente étude sur Pogge (Life of Poggio, Londres, 1802, in-8o), Shepherd regrettait vivement la perte de ce morceau littéraire, non inséré dans les Œuvres complètes ni imprimé à part, et qu’il restait peu de chances de retrouver. On savait que Pogge l’avait composé quelque temps après son mariage, comme pour se disculper vis-à-vis de ses amis de ses noces tardives; qu’il était primitivement dédié à Cosme de 14 Médicis; que, des deux interlocuteurs, l’un y blâmait, l’autre approuvait le mariage d’un vieillard avec une jeune fille; qu’enfin Apostolo Zeno en avait eu en sa possession une copie; mais là se bornaient les renseignements. W. Shepherd en découvrit par hasard un manuscrit, en 1805, à Paris, dans le dépôt de la Bibliothèque Nationale, et se hâta de le publier sous ce titre: Poggii Bracciolini Florentini Dialogus, An seni sit uxor ducenda, circa an. 1435 conscriptus, nunc primum typis mandatus et publici juris factus, edente Gulielmo Shepherd (Liverpooliæ, typis Geo. F. Harris, 1807, in-8o). C’est cette édition, la seule qui ait été faite[4], que nous avons suivie; comme elle est assez rare, et que d’ailleurs ce dialogue n’a jamais été traduit en Français, c’est pour ainsi dire un ouvrage inédit que nous offrons aux lecteurs.
Ce morceau valait la peine d’être tiré de l’oubli, tant en faveur de la nouveauté de la thèse, un paradoxe finement traité, que pour sa valeur littéraire; il est écrit avec cette bonne humeur, cet enjouement dont Pogge a marqué tous ses ouvrages, sans préjudice de ces qualités pittoresques qu’il recherchait parfois aux dépens de la pure Latinité. Son ordonnance rappelle, avec plus de laisser-aller (ce qui en double le charme), celle de ces beaux dialogues antiques qu’il arrachait aux catacombes des monastères, et dont il se nourrissait l’esprit en les recopiant avec amour. Il y a mis 15 toute son ingéniosité, car c’était sa propre cause qu’il plaidait. Il s’agissait pour lui, non-seulement d’excuser le mariage d’un homme de cinquante-cinq ans, ce qui après tout n’est pas un crime, mais surtout de démontrer par vives raisons que c’est avec une jeune fille, non avec toute autre, qu’on doit se marier à cet âge. C’était là pour Pogge le point capital, car en épousant, dans son arrière-saison, une jeune fille d’une grande beauté, dans toute la fleur de ses dix-huit ans, il abandonnait une vieille maîtresse qui, quatorze fois de suite, l’avait rendu père de famille.
Le mariage de Pogge est un curieux épisode de sa vie. Ses amis l’adjuraient depuis longtemps de faire cesser l’irrégularité de sa conduite. Successivement secrétaire de sept ou huit papes, chargé de missions presque ecclésiastiques, sans être cependant engagé dans les ordres, il ne semblait pas se douter du discrédit que ses mœurs jetaient sur lui; il s’amusait même à rire aux dépens des autres. Mais, à mesure qu’il vieillissait, les reproches devenaient plus vifs, et il arriva même à l’un de ses protecteurs, le cardinal de Saint-Ange, de le tancer un jour vertement. Ce prélat avait été envoyé en Allemagne, le cierge d’une main, l’épée de l’autre, pour y détruire l’hérésie et convaincre spécialement les disciples de Jean Huss, qu’on venait de brûler à Constance. Sans s’amuser à prêcher longtemps ces rebelles, il leva une armée composée en grande partie de reîtres et de lansquenets Allemands, et envahit la Bohême, au grand effroi des populations paisibles; mais à peine ses soudards aperçurent-ils l’ennemi qu’ils s’enfuirent dans le plus grand désordre: le cardinal perdit sa bulle, sa crosse, et jusqu’à son chapeau 16 rouge, dans la bagarre. Pogge se mit à railler sans pitié son ami: «Le triste et ridicule résultat de ton expédition en Bohême, d’une expédition préparée si longuement et si laborieusement, m’a consterné,» lui écrivit-il; «il est étonnant que tes soldats se soient sauvés, avant même d’avoir vu l’ennemi, comme des lièvres effrayés par un coup de vent. Ce qui me console, c’est que j’avais prévu la chose et que je ne t’ai pas caché mes craintes sur l’issue de cette funeste guerre; tu te mis à rire de mes alarmes, tu répondis que les prophéties de malheur étant plus souvent justifiées par l’événement, j’agissais avec prudence en formant de sinistres présages. Mes conjectures, cependant, n’étaient pas téméraires... Les Allemands étaient fameux jadis par leur bravoure; ils le sont maintenant par leur gloutonnerie à boire et à manger: ils sont braves en proportion du vin qu’ils ont avalé, et quand leurs tonneaux sont vides, leur courage est épuisé. Aussi suis-je tenté de croire que ce n’est pas la crainte d’un ennemi, qu’ils n’ont pas vu, qui les a fait fuir, mais bien le manque de vin. Jusqu’ici, tu croyais que la sobriété était nécessaire au soldat, mais si tu recommences ton expédition, il faudra changer de maxime et regarder le vin comme le nerf de la guerre.»
Le cardinal n’aimait pas la plaisanterie. Il répondit à Pogge qu’il en prenait bien à son aise pour un homme perdu de réputation, qui avait une maîtresse et des bâtards. C’était, du reste, le refrain que Pogge entendait continuellement autour de lui depuis quelque temps. Il essaya d’abord de s’en tirer par de nouveaux sarcasmes. «Tu me reproches» écrivit-il à l’irascible prélat, «d’avoir des enfants, ce qui ne 17 convient pas à un ecclésiastique, et de les avoir eus d’une concubine, ce qui est un déshonneur même pour un laïque. Je pourrais te répondre que j’ai des enfants, ce qui n’est pas défendu à un laïque, et que je les ai eus d’une concubine, ce qui est la coutume des ecclésiastiques depuis le commencement du monde. Ne rencontre-t-on pas tous les jours, dans tous les pays, des prêtres, des moines, des abbés, des évêques et de plus hauts dignitaires encore qui ont eu des enfants de femmes mariées, de veuves et même de religieuses? Ces moines, qui font profession, à ce qu’ils disent, de fuir le monde et qui, couverts de bure, vont de ville en ville, les yeux baissés, montrent-ils plus de réserve et de retenue? Ils font semblant d’être pauvres, ils ont toujours à la bouche le nom de Jésus et ne songent qu’à s’emparer du bien d’autrui, pour en user comme d’un bien propre. De peur qu’on leur reproche, comme à un serviteur négligent, de tenir caché le seul talent qu’ils possèdent, ils s’efforcent de le rendre productif dans le terrain des autres. Souvent j’ai ri de la réponse hardie ou plutôt téméraire d’un certain abbé Italien qui se présenta un jour à la cour de Martin V avec son fils, grand gaillard sur lequel on le questionna: Je n’ai pas que celui-là, répondit-il, j’en ai quatre autres, tous en état de porter les armes, et que je mets au service de Sa Sainteté. Ce propos fit beaucoup rire le pape et toute sa cour... Quant à tes conseils sur le genre de vie que je dois suivre, je te déclare que je ne dévierai pas du chemin que j’ai suivi jusqu’à présent. Je ne veux pas être prêtre; je ne veux pas de bénéfices. J’ai vu une foule de gens, d’abord très estimables, et qui, après leur ordination, sont devenus avares, 18 paresseux et débauchés. Dans la crainte de subir la même métamorphose, je finirai mon pèlerinage sur la terre avec l’habit laïque. Trop souvent j’ai remarqué que votre grande tonsure ne rase pas seulement les cheveux: le même coup de rasoir vous enlève la conscience et la vertu.» (Poggii Epistolæ, ep. 27.)
Pogge avait beau dire: il n’en était pas moins touché à l’endroit sensible. S’il était bien décidé à ne pas se faire prêtre, il n’avait pas la même horreur pour la vie de famille, et, peu de temps après l’échange de ces lettres, il épousa une jeune et noble Florentine, Vaggia de’ Buondelmonti. Il s’était arrangé, à Florence, une délicieuse retraite, encombrée de manuscrits précieux, de statues antiques et d’objets d’art, où c’eût été agir en égoïste que de vivre seul. Presque toutes ses lettres, à partir de cette époque, témoignent des satisfactions de tous genres qu’il rencontra dans son mariage; on dirait qu’il y fait déborder le trop plein de sa félicité conjugale. Voici, par exemple, ce qu’il écrit à un savant ecclésiastique de ses amis en lui apprenant son union récente: «Trop longtemps, mon cher père, j’ai interrompu par négligence nos entretiens épistolaires: veuillez cependant ne pas croire que le tort provienne d’un coupable oubli de mes nombreuses obligations envers vous; je conserverai éternellement la mémoire de vos bienfaits. Seulement, depuis ma dernière lettre, rien ne m’a paru assez important pour mériter que je vous en fisse part. Aujourd’hui qu’un grand changement s’est opéré dans ma situation, je m’empresse de vous l’apprendre pour vous faire participer à ma joie et à mon bonheur. J’ai 19 mené jusqu’à présent, comme vous le savez, une existence intermédiaire, ni tout à fait laïque, ni tout à fait ecclésiastique. J’ai pour le sacerdoce une répugnance invincible et, parvenu maintenant à cette période de la vie où la régularité des habitudes devient indispensable, j’ai résolu de ne pas finir mes jours dans la solitude, à un foyer désert. Quoique au déclin des ans, j’ai pris pour femme une jeune fille d’une rare beauté et douée, en outre, de toutes les vertus et de toutes les qualités qui sont l’honneur de son sexe. Vous me direz peut-être que j’ai mis bien du temps à me décider. Je suis de votre avis; mais il y a là-dessus un vieux proverbe: Mieux vaut tard que jamais; et vous n’avez sans doute pas oublié cette maxime des Philosophes: Sera nunquam est ad bonos mores via. Certainement j’aurais dû me marier il y a longtemps, mais alors je ne posséderais pas la femme que j’ai choisie, un caractère si heureux qu’il se plie à mes goûts et à toutes mes habitudes, une compagne qui fait évanouir tous les tourments et tous les chagrins de ma vie. Je n’ai que faire de lui rien souhaiter, car la nature lui a prodigué tous ses dons. Aussi, du fond du cœur, ne cessé-je de remercier Dieu qui, après m’avoir toujours favorisé, m’a enfin comblé de sa grâce en m’accordant plus que je ne pouvais raisonnablement désirer. La sincère amitié que vous m’accordez et l’estime que j’ai pour vous m’ont engagé à vous écrire dans cette circonstance, et à vous faire part de mon bonheur. Adieu.»
Pogge manifeste les mêmes sentiments dans son dialogue: An seni sit uxor ducenda; mais il les reproduit cette fois sous la forme démonstrative. On voit qu’il veut se rendre compte de son bonheur, l’expliquer 20 théoriquement, démontrer que ce ne fut pas un effet du hasard, mais que cela devait être, et du même coup pallier sa conduite et convier tous les célibataires endurcis à suivre son exemple. Les interlocuteurs sont au nombre de trois: Pogge, qui du reste joue un rôle assez effacé, son ami le savant Niccolo Niccoli, celui précisément auquel est adressée la charmante relation des Bains de Bade[5], et Carlo Aretino, chancelier de Florence, beaucoup plus jeune alors que les deux autres. Niccolo, avec sa verve railleuse, expose que Pogge, en se mariant si tard avec une jeune fille de dix-huit ans, a peut-être fait par hasard une bonne affaire, mais qu’il en pourra cuire à ceux qui seraient tentés de l’imiter, et il énumère spirituellement toutes les tribulations d’un pareil ménage. C’est un tableau très réussi, et il offre cette particularité qu’il n’est pas chargé le moins du monde. Avec un art consommé, l’auteur se garde bien des exagérations que le sujet comportait naturellement, mais qui auraient rendu la réfutation trop facile. Niccolo paraît avoir tout à fait raison, jusqu’à ce qu’il cède la parole à Carlo Aretino, dont la réplique en faveur des mariages tardifs n’en est que plus piquante. Par une autre délicatesse, Pogge n’a pas voulu plaider pour lui-même, il a préféré placer ce qu’il avait à dire dans la bouche de son jeune ami. Carlo, après avoir démoli pièce à pièce toute l’argumentation de son adversaire, en fait une contrepartie si exacte qu’il semble qu’on voie clair pour la 21 première fois dans une question embrouillée à plaisir; évidemment le vrai bonheur est de se marier aux environs de la soixantaine et de prendre sa femme la plus jeune possible. Le porte-parole de Pogge accumule avec tant d’esprit tant de bonnes raisons, qu’on arrive à se faire la réflexion formulée ironiquement à la fin par Niccolo: Hâtons-nous de vieillir, mettons les années doubles, pour arriver au plus tôt à cet état de parfaite béatitude.
Voilà qui est bien; mais l’ancienne maîtresse, la femme aux quatorze enfants? Le souvenir de son abandon et de celui des quatre enfants qui avaient survécu, dans le nombre, ne fait-il pas quelque ombre au tableau? Pogge ne semble pas s’être laissé importuner outre mesure par les remords; à partir de son mariage, son ancienne femme et ses enfants semblent avoir été pour lui comme s’ils n’existaient pas. Que devinrent cependant ces malheureux? Laurent Valla prétend que Pogge les laissa tranquillement mourir de faim, qu’il alla même jusqu’à déchirer une donation par laquelle il leur avait antérieurement assuré une petite aisance. Valla était un ennemi acharné de Pogge, et il a inventé contre lui de si odieuses et si absurdes calomnies, qu’il ne devait pas lui en coûter beaucoup de mentir une fois de plus; Tommaso Tonelli, le traducteur Italien de la Vie de Pogge, par Shepherd, met à découvert toute sa mauvaise foi. Il paraît que les enfants naturels de Pogge avaient acquis la légitimation par deux actes authentiques, dont le premier est une bulle pontificale, et le second un décret de la Seigneurie de Florence qui, en considération du retour de Pogge dans son pays natal, de 22 son savoir et de ses occupations littéraires, l’exempta, lui et ses fils, de tout impôt. Ce décret fut rendu en 1532, trois ans avant son mariage. Ces fils légitimés conservaient donc tous leurs droits, même dans le cas où leur père aurait d’autres enfants. Quant à la donation soustraite et déchirée, c’est bien probablement une fable puisque Pogge, sans se donner tant de peine, pouvait la révoquer d’un trait de plume, en faisant d’autres dispositions testamentaires. Rien n’empêche donc de croire que Pogge assura, de façon ou d’autre, l’avenir de la femme qu’il quittait et des enfants qu’il avait eus d’elle; que s’il n’en a plus jamais parlé, cette absence de toute préoccupation et la sérénité de son esprit à leur égard témoignent précisément en faveur des dispositions qu’il avait dû prendre. Un homme tel que lui ne s’avilit pas de gaîté de cœur.
Quoi qu’il en soit, Pogge fut parfaitement heureux avec Vaggia de’ Buondelmonti; sa félicité conjugale résista au temps et dépassa de beaucoup les limites de la lune de miel, au cours de laquelle il écrivait ce dialogue. Pogge y prétend qu’il n’y a rien de tel que le fruit vert pour ragaillardir un vieillard et réveiller en lui le jeune homme: il le prouva bien[6]. Lui qui 23 nous a conté tant de bons tours joués aux vieux maris, et qui peut-être leur en avait joué plus d’un, il eut la chance de démentir le mot de Plutarque: Qu’un barbon se marie autant pour ses voisins que pour soi. On prétend même qu’il mourut un peu prématurément, à soixante-dix-neuf ans sonnés, pour avoir été trop aimé par sa femme[7]. Son mariage, en somme, est 24 d’un bon exemple pour les célibataires arrivés à la cinquantaine: à eux d’en faire leur profit.
Juin 1877.


IV
LA CIVILITÉ PUÉRILE[8]

La Civilité puérile évoque de lointains souvenirs d’école. Il y a peu d’hommes de trente à quarante ans qui n’aient eu pour premier livre, comme syllabaire et comme rudiment, cette petite plaquette cartonnée, de quinze ou vingt pages, commençant par un alphabet, continuant par un tableau des voyelles et des consonnes (on lisait consonnantes dans les exemplaires un peu anciens), et terminée par des préceptes de savoir-vivre. Dès qu’on pouvait épeler, on y apprenait à ne pas se moucher sur sa manche. Le tout était imprimé en gros caractères, qui passaient insensiblement de la lettre capitale au Romain et dont l’œil diminuait en proportion des progrès présumés de l’élève. Les générations 26 précédentes avaient eu entre les mains à peu près le même livre, imprimé en caractères bizarres, qui étaient censés représenter l’écriture cursive: peut-être était-ce l’écriture du temps d’Alain Chartier ou de Jeanne d’Arc; il faut aujourd’hui, pour la déchiffrer, de forts paléographes, et elle devait constituer pour les enfants un supplice des plus raffinés.
«Je crois qu’il faut attribuer l’usage persistant de ce caractère,» dit M. Jérôme Pichon (Du caractère dit de Civilité, dans les Mélanges de littérature et d’histoire de la Société des Bibliophiles François, 1850), «à l’utilité qu’il présente pour familiariser les jeunes enfants avec les anciennes écritures, et les mettre ensuite à même de lire dans ce que les maîtres d’école appellent les contrats.» C’est possible; mais la mauvaise impression d’un livre laisse toujours dans l’esprit un préjugé fâcheux qui a beaucoup de peine à se dissiper, et cela dut aider considérablement au discrédit dans lequel finit par tomber la Civilité puérile. Il a fallu longtemps, près de deux siècles. Telle était l’autorité de ces petits manuels, qu’ils se perpétuaient d’âge en âge, sous leur atroce forme Gothique, sans qu’on osât y rien changer. On disait d’un homme qui commettait quelque balourdise: Il n’a pas lu la Civilité puérile! La seule innovation que l’on tenta, vers 1820, et encore pas dans toutes les villes, ce fut de substituer aux caractères de Civilité, reconnus enfin illisibles, des caractères ordinaires; le fond resta le même. Enfin on s’aperçut que les préceptes de savoir-vivre qu’ils contenaient étaient ou surannés ou absurdes, et on les proscrivit de l’enseignement scolaire. A peine aujourd’hui trouverait-on une Civilité puérile dans quelque 27 école de village, tenue par les Frères des Écoles Chrétiennes, qui la conservent encore par une sorte de fétichisme pour leur fondateur, J.-B. de La Salle, l’auteur le plus répandu des manuels de ce genre.
Le véritable auteur de la Civilité puérile, c’est Érasme. Cet esprit si caustique et si fin a été la mère Gigogne de ces ineptes petits livres qui, durant deux siècles ont pullulé dans les écoles. Ils procèdent tous de lui, malgré leurs innombrables variétés, mais comme alfana venait d’equus dans l’épigramme du chevalier de Cailly, après avoir subi tant de métamorphoses en route, qu’il n’en restait pas une seule lettre.
Une chose assez surprenante, c’est que personne, à notre connaissance du moins, ne se soit préoccupé de cette filiation, qui est cependant facile à établir. Cela tient à ce que J.-B. de La Salle, qui emprunta beaucoup à Érasme, sans doute par l’intermédiaire d’un autre prêtre, Mathurin Cordier, et de vieilles traductions ou imitations Françaises, n’indiqua jamais le nom de l’auteur primitif, quoiqu’il ne l’ignorât pas; d’autre part, la Civilitas morum puerilium ne tient pas la première place dans l’œuvre du grand écrivain, et elle a toujours été un peu négligée. Ceux mêmes qui se sont le plus scrupuleusement occupés de la vie et des travaux d’Érasme, comme Désiré Nisard dans ses Études sur la Renaissance, l’ont tout à fait passée sous silence; d’autres se sont bornés à la citer, sans songer à la rapprocher des livres similaires infiniment plus connus et à déterminer les emprunts qui pouvaient lui avoir été faits. C’est un manque de curiosité dont 28 il y a lieu d’être surpris; essayons d’y suppléer de notre mieux.
Érasme composa ce traité vers la fin de sa carrière, en 1530, pour un jeune enfant qu’il affectionnait[9]. Son ton est paternel, avec une pointe de bonne humeur et d’enjouement que ses plagiaires ont lourdement émoussée. Ce qui dut séduire le clergé, qui de bonne heure adopta son livre, sans en nommer ni en remercier l’auteur, c’est qu’il s’y montre dévot, un peu bigot même; aux génuflexions qu’il exige quand passe un Religieux, on a peine à reconnaître le satirique hardi du Repas maigre et de tant de bonnes plaisanteries sur les Franciscains. Mais ses deux principaux imitateurs, Mathurin Cordier et J.-B. de La Salle, ont tellement abusé de ces menus suffrages de dévotion, que, par comparaison, Érasme en semble sobre. Telle 29 qu’elle est, sauf quelques prescriptions que les changements d’usages ont fait tomber en désuétude, sa Civilité puérile pourrait encore servir aujourd’hui; c’est l’œuvre d’un esprit délicat, et son seul tort est d’avoir été le point de départ des autres.
En revanche, Érasme avait-il eu des modèles? Évidemment, il n’inventait pas le savoir-vivre et bien avant lui on en avait posé les règles générales. Cette sorte de littérature pédagogique était cultivée depuis l’antiquité Grecque; mais le premier il a traité la matière d’une façon spéciale et complète: personne avant lui n’avait envisagé la civilité ou, si l’on veut, la bienséance, comme pouvant faire l’objet d’une étude distincte. Aussi croit-il devoir s’excuser, s’il traite à fond cette partie infime et négligée de la philosophie, en disant que les bonnes mœurs se reflètent dans la politesse des manières, que la rectitude appliquée aux gestes, aux actes usuels, aux façons d’être avec ses égaux ou ses supérieurs, manifeste aussi l’équilibre des facultés, la netteté du jugement et que, par conséquent, il n’est pas indigne d’un philosophe de s’occuper de ces détails en apparence indifférents. Il ne s’appuie sur aucune autorité antérieure et ne prend guère conseil que de son propre goût et du bon sens.
On pourrait même aller plus loin et dire que, non content de ne presque rien devoir à ses devanciers, il a moins mis en maxime les règles du savoir-vivre de son temps, que spirituellement critiqué ses contemporains, en prescrivant tout le contraire de ce qu’il voyait faire autour de lui. Il suffirait, pour s’en convaincre, de comparer l’un de ses colloques, celui qui 30 est intitulé Diversoria (Auberges), avec les règles qu’il donne dans sa Civilité. On y voit que sa délicatesse était fort en avance sur les mœurs de son époque, grâce à une sensibilité toute particulière qu’on devait alors trouver excessive. Lui qui était souffreteux de sa nature, qui ne pouvait supporter une mauvaise odeur, la saleté d’un voisin mal vêtu, une haleine un peu forte, que la vue d’un crachat étalé par terre indisposait sérieusement, il consigne avec désespoir, dans ses notes de voyage, tous les déboires qu’il éprouve dès qu’il est obligé de vivre en dehors de chez lui. On lui parle dans la figure en lui envoyant au nez des bouffées d’ail, on crache partout, on fait sécher au poêle des vêtements mouillés et toute la salle en est empuantie; il y en a qui nettoient leurs bottes à table, tout le monde trempe son pain dans le plat, mord à belles dents et recommence le manége jusqu’à épuisement de la sauce; si un plat circule, chacun se jette sur le meilleur morceau, sans se soucier de son voisin; les uns se grattent la tête, d’autres épongent leur front ruisselant de sueur; la nappe est si sale, qu’on dirait une voile de navire fatiguée de longs voyages. Érasme en a mal au cœur et l’appétit coupé pour huit jours.
Sans doute, ce qu’il retrace là ce sont des mœurs d’auberge, des mœurs de table d’hôte, comme on dirait maintenant; raison de plus pour y chercher le niveau moyen de la politesse à son époque, et ce niveau ne paraît pas élevé. La Civilité puérile, quoique écrite beaucoup plus tard que ce dialogue, semble une critique calculée de ces grossiers usages dont Érasme avait eu à se plaindre toute sa vie; il y formule ses 31 desiderata[10], bien modestes après tout, et nombre de gens pensaient probablement comme lui, sans en rien dire, car à peine son petit livre eut-il paru qu’il se répandit rapidement dans toute l’Europe et jouit d’une vogue prodigieuse.
Deux ans ne s’étaient pas écoulés depuis l’apparition de l’ouvrage à Bâle en 1530, qu’il était déjà réimprimé à Londres avec une traduction Anglaise en regard (W. de Worde, 1532, in-16); la traduction est de Robert Whytington. Mais c’est en France que la Civilitas morum puerilium fut surtout goûtée; elle y devint rapidement, dans son texte Latin, un livre familier aux élèves des colléges et, dans ses traductions ou imitations Françaises, un manuel d’écolier destiné aux tout petits enfants. A partir de 1537, les traductions se succédèrent pour ainsi dire sans interruption: le Petit traité de la Civilité puérile et honneste, de P. Saliat (Paris, Simon de Colines, 1537); La Civilité puérile, distribuée par petitz chapitres et sommaires, de Jehan Louveau (Anvers, 1559); la Civile honnesteté pour les enfans, de Mathurin Cordier (Paris, 1559), si souvent réimprimée, et quelques autres encore.
Mathurin Cordier s’est évidemment inspiré d’Érasme; la division en sept chapitres est la même, les préceptes sont identiques, et cependant c’est plutôt un travestissement qu’une traduction d’Érasme. A peine y 32 retrouve-t-on de temps en temps une phrase qui ait conservé l’empreinte du texte Latin, de ce style savoureux et pittoresque à l’aide duquel Érasme donne de l’intérêt à des détails infimes.
Au commencement du XVIIIe siècle parut la Civilité de J.-B. de La Salle. Elle était intitulée: Les Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne; divisé en deux parties; à l’usage des Écoles Chrestiennes. L’auteur, selon toute vraisemblance, ne s’est aucunement préoccupé du texte d’Érasme; il a fait un ouvrage nouveau, qui est bien de lui. Entre ses mains, l’opuscule de Mathurin Cordier est devenu un gros volume de trois cents pages, farci de toutes sortes de choses. L’esprit d’Érasme se trouve à peu près évaporé dans ce fatras; toutefois le mordant écrivain avait donné à ses préceptes un tour si ingénieux, si rapide, qu’il était difficile de mieux dire, et quelques-unes de ses idées transparaissent encore, sous ces épaisses couches d’alluvions.
D’autres Civilités couraient encore les écoles; celle de J.-B. de La Salle s’éditait surtout à Paris; les autres sortirent principalement de Toul, Troyes, Châtellerault et Orléans. Les Civilités de Châtellerault étaient renommées entre toutes pour leur mauvaise exécution typographique: le papier est plus rance et plus grenu que du papier à chandelle; les caractères, empâtés et effacés par des tirages séculaires, ne produisent que des maculatures illisibles. Celles d’Orléans, imprimées chez Rouzeau-Montaut, sont au contraire irréprochables; elles procèdent, pour la pureté et la finesse des caractères, des belles éditions de Granjon et de Danfrie. Pour le fond, ces Civilités provinciales sont tirées 33 d’Érasme, soit d’après le texte Latin, qui était toujours en usage dans les collèges, soit par l’intermédiaire d’anciennes traductions ou de l’imitation libre de Mathurin Cordier. On croit généralement qu’elles sont toutes copiées les unes sur les autres; c’est une erreur. Chacune d’elles était réimprimée à foison, le plus souvent dans la même ville; mais chaque ville, outre Paris qui approvisionnait une grande partie de la France, avait pour ainsi dire la sienne: de là une foule de variétés qui n’ont entre elles que peu de rapports. Les auteurs de ces manuels étaient des éclectiques; ils prenaient de côté et d’autre et arrangeaient à leur guise ce qui leur convenait, ajoutant ou retranchant, selon leurs tendances particulières, et masquant habilement ce qu’ils empruntaient[11].
34 Avec le XVIIIe siècle disparurent ces diverses Civilités; elles firent place à l’abrégé de J.-B. de La Salle, réimprimé partout à profusion, d’abord sous le titre primitif de Règles de la Bienséance et de la Civilité Chrétienne, puis sous celui de Civilité puérile et honnête. Cet abrégé, composé un siècle après la mort de l’auteur, ne possède guère de J.-B. de La Salle que le nom.
Après toute cette série d’imitations et de travestissements, le traité d’Érasme, rétabli dans son intégrité par une traduction littérale, peut presque passer pour une nouveauté. Le texte Latin n’avait cependant pas cessé, durant deux siècles, de rester en honneur; avant la Révolution, on le faisait encore apprendre par cœur 35 dans les collèges. On le réimprimait, à l’usage des classes d’humanités, avec le De officiis scholarum, de Nicolas Mercier, dont le troisième livre: De Civilitate morum, sive de ratione proficiendi in moribus, n’est, du reste, qu’une élégante versification des principaux préceptes d’Érasme. Un autre poète Latin du XVIIe siècle, François Hœm, de Lille (Franciscus Hœmus Insulanus), a même accompli, avec beaucoup d’adresse, le tour de force de mettre en vers, chapitre par chapitre, toute la Civilitas morum puerilium, et ce petit poème était aussi, sous Louis XV, un livre classique. La tradition n’en a pas moins fini par se perdre, et de tant d’enfants qui ont appris à lire dans une Civilité puérile, pas un peut-être, devenu homme, ne s’est douté qu’il avait eu Érasme pour premier maître.
Octobre 1877.


V
LES FACÉTIES DE POGGE[12]

Les Facéties restent l’œuvre la plus populaire de Pogge, et, si bizarre que ce rapprochement paraisse, la moins connue. Il n’en existe pas en Français de traduction complète; celle-ci est la première qui présente Pogge tel qu’il est, sans le mutiler ou le travestir. L’ancienne imitation attribuée à Guillaume Tardif, Lecteur du Roi Charles VIII, et imprimée vers la fin du XVe siècle, n’est qu’une paraphrase. Elle ne contient d’ailleurs que cent douze contes sur deux cent soixante-treize, et le choix n’est pas très judicieux, car l’auteur a éloigné, non ce qui pouvait paraître un peu 37 gaillard (les gens du XVe et du XVIe siècle n’étaient pas si pudibonds), mais ce qui regardait les vices du Clergé, matière inépuisable aux railleries, dans ce temps-là; pour ce qu’il a conservé, il change le lieu de la scène, invente des noms aux personnages et fait tout un roman[13]. Il goûtait Pogge, cependant, ce 38 bon Guillaume Tardif; il l’appelle, dans son Épitre au Roi, «le bien litéré et facétieus homme, Pogge Florentin», et il le loue d’avoir usé, «selon la matière subjecte, de termes Latins fort élégamment exquis et rhétoricques;» mais, en ne voulant donner que «la substance et l’intention de ses joyeux devis», il les a étrangement défigurés. Les éditions 39 qui suivirent, celles de Jehan Bonnefons (1549)[14], de Nicolas Bonnefons (vers 1575), de Cousturier (1606), et de Jean-Frédéric Bernard (Amsterdam, 1712), ne sont que des reproductions ou des rajeunissements de la première. Celle d’Amsterdam, où les contes sont réduits à soixante-treize, est la plus commune, et, quoiqu’elle se vende cher, la moins estimable; chaque anecdote y est accompagnée de remarques insipides. L’anonyme qui s’est avisé de faire ce petit travail (David Durand, ou, selon Barbier, l’éditeur Jean-Frédéric Bernard), a voulu tirer, de contes pour rire ou de libres reparties, des sentences morales, des déductions philosophiques! Lenfant, 40 dans son Poggiana, s’est préoccupé de leur côté historique, et n’a pas été beaucoup plus heureux; il a extrait du recueil une centaine d’anecdotes, pour les accommoder à sa guise, les abréger, leur donner du trait, et les mêler à d’autres, de provenances étrangères. Ils auraient tous entrepris de prouver que Pogge n’était ni un homme d’esprit, ni une fine plume, qu’ils n’eussent pas fait autrement. Mais la renommée du vieux conteur était bien assise: ceux qui autrefois, du temps que le Latin était la langue courante des érudits, lisaient les Facéties dans l’original, leur avaient fait une réputation qui a résisté aux efforts inconscients des traducteurs pour la ruiner.
Tout récemment, deux estimables érudits, M. P. Ristelhuber, de Strasbourg, et M. Gustave Brunet, de Bordeaux, ont pris à cœur de faire juger les Facéties plus équitablement que sur ces pauvres échantillons. L’ouvrage de M. Ristelhuber, intitulé les Contes de Pogge[15], n’est en réalité qu’un Choix des Contes de Pogge, car il n’en contient que cent douze, juste le même nombre que l’imitation du Lecteur de Charles VIII; presque tous sont écourtés, quelques-uns outre mesure. Par exemple, le LXXVIe, D’un pauvre Batelier (c’est le CLXXVe de notre édition), est coupé à la moitié; M. Ristelhuber s’arrête à la première partie de la réponse du mauvais plaisant au batelier: «Ne passe jamais personne sans te faire payer 41 d’avance», comme si le conte était fini: ce n’est pas là traduire; il est vrai que le reste est un peu léger, mais le plus souvent les suppressions portent, sans qu’on sache pourquoi, sur des détails qui n’offrent rien de scabreux. Ce petit livre rachète heureusement ce qu’il a de défectueux, comme traduction, par des notes historiques et des commentaires d’une certaine valeur. M. Gustave Brunet[16] a voulu compléter le travail de M. Ristelhuber, et il a encore trouvé cent trois contes dignes d’être mis en Français; c’était un joli regain, mais tous ne sont pas de Pogge, il s’en faut d’un bon tiers au moins.
Les Facéties méritent cependant d’être considérées mieux que comme un ensemble de matériaux bruts à rogner, tailler et polir. Pogge a donné lui-même à ces Menus Propos ou Joyeux Devis, comme il les appelait, une forme excellente, à laquelle il est parfaitement inutile d’en substituer une autre; aussi avons-nous fait une version littérale. Le soin qu’ont pris constamment ses prétendus traducteurs de l’élaguer, de le raccourcir ou de le paraphraser, ferait croire qu’il abonde en détails oiseux ou d’une licence exorbitante: il n’en est rien. Son récit, quoi qu’on dise, est bref, bien conduit, d’un tour ingénieux et piquant, et ce qui domine, c’est la bonne humeur, la bonne grosse gaieté, beaucoup plus que la licence. Pogge est de son temps; il ne recule pas devant les mots, mais c’est pour 42 assaisonner la plaisanterie; il est sans gêne à la manière de Rabelais, mais il ne recherche pas les équivoques comme Béroalde de Verville; et Brantôme, par exemple, a bien plus de raffinements. D’ailleurs, au lieu d’employer, suivant l’ancienne coutume, des périphrases souvent pires que le mot propre, nous avons laissé en Latin les passages et les expressions qui pouvaient «scandalizer les foibles», comme disait le bon Abbé de Marolles en traduisant Martial, et nous prendrions volontiers pour épigraphe la vieille devise: Si non caste, saltem caute.
Le texte que nous avons principalement suivi est celui de l’édition de Bâle[17], in-fol., 1538, donné, dit-on, par Henri Bebel, érudit Allemand, auteur lui-même de Facéties. Celui de François Noël (Trajecti ad Rhenum, 1797, ou Londini, 1798, 2 vol. in-18), est aussi défectueux que le livre est mal imprimé. Noël a voulu faire parler Pogge en Cicéronien, comme un auteur du XVIe siècle, et il a omis, sans aucune raison, bon nombre de mots ou même de phrases qui lui paraissaient inutiles. Sa manie réformatrice a été jusqu’à remplacer les titres des contes, tels qu’ils sont libellés dans les anciennes éditions, par d’autres de son invention, plus courts sans doute et plus piquants, mais qui ont le tort d’enlever au vieux conteur son cachet de bonhomie. Non que les titres anciens soient 43 sûrement de Pogge: il est possible qu’ils aient été rédigés par ses premiers éditeurs, mais, en tous cas, ils sont tels qu’on les comprenait à son époque.
Nous avons fait suivre les Facéties d’un Index des noms propres, qui pourra, jusqu’à un certain point, tenir lieu de commentaire. Les Saumaises futurs s’exerceront, s’ils le veulent, sur Pogge; le plus pressé était de donner un texte qui manquait. On pourra rechercher l’origine de quelques-uns de ses contes ou les innombrables imitations qui en ont été faites: Noël s’est déjà, en grande partie, acquitté de cette besogne. Les personnages qui y sont mis en scène peuvent être aussi l’objet de notes historiques: Lenfant et, après lui, M. Ristelhuber, s’y sont essayés. Au fond, la filiation de tel ou tel conte et l’identité des personnages n’ont qu’un intérêt fort accessoire. Les Facéties présentent bien un certain caractère de Mémoires anecdotiques de la Cour des Papes, qui semble appeler des notes biographiques, et que les anciens traducteurs ont peut-être trop dédaigné en francisant, de manière à les rendre complètement méconnaissables, des noms déjà latinisés par Pogge: ainsi, dans l’imitation de Guillaume Tardif, Antoine le Louche, au lieu d’Antonio Lusco, et le vicomte Jannotot, au lieu de Giannozzo Visconti, sont ridicules. Mais, comme il ne s’agit, en somme, que de bagatelles, il est plus que suffisant de rétablir les noms altérés, et d’accompagner quelques-uns d’entre eux d’une brève indication, sans rattacher nécessairement à tous un commentaire. Faire de longues recherches à travers la chronologie et l’histoire, compulser l’Art de vérifier les dates et tout Muratori pour savoir au juste qui 44 était cet ambassadeur à qui un Pape se plaignait d’avoir mal aux dents, ce serait se donner beaucoup de peine pour un très mince résultat. Sauf quelques personnages historiques et un petit nombre de lettrés ou d’amis de Pogge, les magnifiques Seigneurs et les Cardinaux très illustres dont il parle ou qu’il fait parler ont souvent aujourd’hui, en fait de notoriété, celle que leur donne, dans ce recueil, un mot pour rire; ils ressemblent à ces Académiciens du XVIIe siècle, inconnus quoique immortels, dont on dit pour tout souvenir: «Tallemant leur a consacré une historiette.»
Mars 1878.


VI
LA PAPESSE
NOUVELLE DE CASTI[18]

Vraie ou fausse, la Papesse Jeanne a donné à l’abbé Casti l’occasion de composer un badinage agréable et digne d’être réimprimé et traduit; c’est tout ce que nous voulons en dire. Comme problème historique, ce singulier personnage est fort loin d’avoir l’importance que lui prêtent ceux qui nient ou qui affirment son existence, soit pour défendre, soit pour dénigrer l’Église. Les Sept Péchés Capitaux, un par un ou parfois tous ensemble, ont été si souvent assis (dans les temps anciens) sur la chaire de Pierre, qu’un scandale de plus ou de moins, sans embarrasser les apologistes, sert à peine aux adversaires. Auprès des 46 désordres de Sergius III, de Jean XI et de Jean XII, amants, fils ou créatures de courtisanes; des scélératesses d’Alexandre VI; des turpitudes d’Innocent X, sigisbé de Madame Olympia, qu’est-ce que le sexe douteux de Jean VIII? D’austères écrivains de la Réforme ont même raison de le prétendre: c’est faire beaucoup d’honneur à l’Église que de l’avoir crue capable de choisir, au IXe siècle, un Pape instruit, lettré, prudent, tel qu’on représente Jeanne enfin, sauf qu’elle était femme et que son Pontificat se termina par une catastrophe.
Au point de vue chronologique, c’est une autre affaire: la suppression de Jean VIII cause dans la liste des Papes un remue-ménage incommode, et, rien que pour cela, on devrait le laisser à son rang. L’Église a pris si longtemps au sérieux la fiction de la Papesse, que tous les Jean, et il y en a beaucoup, se trouvent aujourd’hui mal étiquetés jusqu’à Jean XXIII, forcé de devenir Jean XXII. Qu’on s’imagine le trouble porté dans notre chronologie Royale, si l’on découvrait que Charles-le-Bel, par exemple, est un mythe, une personnification d’Apollon ou de Bélus, comme son surnom l’indiquerait du reste, et que les historiens ont eu tort de l’accueillir: tous les Charles descendraient d’un numéro, et il faudrait s’habituer à voir Charles IX chassé de France par la Révolution de Juillet, Charles VIII ordonner la Saint-Barthélemy, Charles VII faire son entrée aux flambeaux à Naples, et Charles VI donner le jour à Louis XI. Quel casse-tête! et comme on demanderait d’être ramené bien vite au vieux errements de Mezeray et d’Anquetil!
L’abbé Casti, tout prêtre qu’il était, en jugeait sans 47 doute ainsi, car, pour lui, l’authenticité de la Papesse ne paraît pas faire question. Non content de s’inspirer de la légende, telle qu’elle avait cours, il a voulu aller au fond des choses, et il a recueilli, sous forme d’extraits de vieilles Chroniques, dans des notes que l’on trouvera en Appendice, la substance de toutes les controverses. Le poème, assaisonné de sel Gaulois et de finesse Italienne, n’a d’érudition que juste ce qu’il faut; l’auteur est un homme d’Église, mais qui se croit permis d’être homme d’esprit, et qui montre la bonne humeur de l’Épicurien. L’abbé Casti est à peine connu et mal apprécié aujourd’hui en France, après y avoir joui, vers la fin du dernier siècle, d’une vogue non imméritée. On le réimprimait encore à Paris en 1838, mais peut-être pour l’exportation; car ses compatriotes le goûtent toujours, et, chez nous, le Toscan n’est plus une langue courante, comme autrefois. Ses Animaux parlants, bien inférieurs à ses Novelle galanti dont la Papessa est une des plus importantes, ont seuls eu l’avantage d’être traduits en Français; on le juge donc presque uniquement sur ce long poème allégorique, composé sur un plan trop vaste, où l’enjouement prolongé lasse à la fin sans que la profusion amusante des épisodes, des allusions, et le tour gracieux des détails masquent suffisamment l’uniformité de l’ensemble. Des critiques, inspirés sans doute par l’esprit de parti, semblent lui refuser tout ce qui constitue l’écrivain: l’imagination, l’esprit, le style; c’est se montrer bien dédaigneux. Ce disciple de Voltaire, qui fut notre hôte (car c’est à Paris, sous le Directoire et sous le Consulat, qu’il a écrit et fait imprimer la plupart de ses œuvres), a son originalité. Il invente 48 peu, il puise d’ordinaire dans le riche fonds des vieux Conteurs, des Légendes ou des Chroniques; mais il excelle à rajeunir ces sujets qui ont passé par tant de mains, il y introduit de nouveaux éléments d’intérêt, et les rehausse souvent par l’abondance et la variété des peintures. S’il n’a pas toute la malice de Voltaire, il en a bien un peu, comme on le pourra voir dans la Papesse, et sa qualité d’ecclésiastique y ajoute certain ragoût piquant. Pour son style, il est loin d’être négligé comme on le prétend, et, sous une apparence de laisser-aller, il a des arrangements pleins de coquetterie.
Nous l’avons rendu fidèlement, par une traduction absolument littérale ou, pour mieux dire, linéaire; autant qu’il a été possible, la forme du vers, la construction de la période, les tournures, les inversions, les rejets ont été respectés, de façon à offrir le dessin exact du modèle. Ce procédé, employé par un trop petit nombre de traducteurs, est certainement le plus apte à donner une idée juste des ouvrages en vers écrits dans une autre langue, et à leur conserver au moins quelque chose de leur saveur exotique.
Mars 1878.


VII
LE DÉCAMÉRON
DE BOCCACE[19]

Des innombrables Conteurs qui sont la gloire de l’Italie, deux ont déjà pris place dans la Petite Collection Elzevirienne: Pogge par ses Facéties, traduites complètement pour la première fois en Français; l’abbé Casti, par la plus curieuse de ses Nouvelles galantes, la Papesse, une épopée badine et satirique, un petit poème où l’érudition se cache sous une malice toute Voltairienne.
D’autres choix pourraient encore être faits dans cette copieuse littérature: Franco Sacchetti et ses Trecento Novelle, sources d’informations précieuses pour l’histoire anecdotique et dans lesquelles on trouverait aisément un si riche butin; Giovanni Fiorentino, Luigi 50 da Porto et Giraldi Cintio, qui tous les trois ont eu l’honneur d’inspirer Shakespeare et de lui fournir, l’un le Marchand de Venise, l’autre Othello, le troisième Roméo et Juliette; Morlini, qui se servit du Latin, comme Pogge, avec moins d’esprit et de concision; Niccolo Franco, ce pauvre diable qui périt au bout d’une corde en expiation d’un mauvais distique sur les Vespasiennes d’un Pape peu endurant, cet original moitié philosophe et moitié satyre: secrétaire de l’Arétin, et amant de l’idéal au point de se créer une Béatrix, comme Dante: auteur des Priapées, et capable d’écrire une sorte d’autobiographie amoureuse, où il n’y a rien que d’imaginaire[20]; le Bandello, qui fut assez goûté chez nous pour que notre Henri II en fît un évêque Français et dont Belleforêt, dans ses Histoires tragiques, n’a donné qu’une idée incomplète; Parabosco et ses Passe-temps si agréables (I Diporti); le Lasca, dont les Cene sont d’une observation si piquante, d’un style si vif; Strapparola et ses Piaccevoli Notti, suffisamment traduites du reste sous le titre de Facétieuses nuits du seigneur Strapparole, par J. Louveau 51 et Pierre Larivey (c’est une des perles de la Bibliothèque Jannet); Luigi Alamanni, Pietro Fortini, Firenzuola, les deux Gozzi, etc. Il y a dans ces maîtres tant d’invention et d’originalité, tant de traits de mœurs intéressants, tant de scènes d’un haut comique et de peintures séduisantes, qu’on regrette de les voir pour la plupart peu connus en France, mal jugés parce qu’ils ont été mal traduits, quelques-uns tout à fait ignorés.
Mais il faut savoir se borner. Les Facéties et les Nouvelles Galantes sont comme les deux pôles du conte Italien: condensé en quelques pages, ou même en quelques mots par Pogge, avec la netteté et la vigueur que donne la langue Latine, la crudité d’expression qu’elle permet: développé par l’abbé Casti avec une agréable profusion de détails, orné des élégances du vers, dans un idiome abondant et poétique. Boccace vient naturellement se ranger à côté ou plutôt au-dessus de ses deux émules, si dissemblables entre eux, quoiqu’ils l’aient eu tous deux pour modèle.
Le Décaméron est une de ces œuvres impérissables qui rajeunissent avec les siècles, au lieu de vieillir, et celle qui porte le plus profondément peut-être l’empreinte de l’époque où elle parut. La joie de revivre y éclate, la grande joie de la Renaissance, quelque chose d’analogue à cette effusion que peint Goethe au commencement de son Faust, quand tout le monde sort en habits de fête des maisons closes par le deuil de la Semaine sainte en s’écriant: Christ est ressuscité! Seulement alors c’était l’homme qui, longtemps emmailloté dans le linceul, levait enfin la pierre du 52 tombeau et fêtait lui-même son retour à la vie. Comme pour donner plus de saveur et de raffinement aux voluptés, Boccace a mis pour frontispice à son livre la peste de Florence, tableaux lugubres de la Mort, sinistre emblème du Moyen Age en personne, décharné par les macérations, abêti par la scolastique. Le voile de tristesse que la religion répandait sur ce monde, pour faire désirer d’en sortir, Boccace le déchire en se jouant; ce poison glacial qu’elle faisait circuler dans les veines pour abolir toute énergie, toute vitalité, Boccace en trouve dans le rire l’antidote tout-puissant. Les hiboux du cloître et de l’école pourront continuer à discuter, dans leurs épaisses ténèbres, l’être, la substance, l’accident, la réalité des universaux, les hypostases et autres quintessences de chimères: Boccace a fait reluire ce clair rayon de soleil qui dissipe les ombres et chasse les cauchemars.
La Renaissance, dès son aurore, s’annonce comme un retour plus ou moins franc, mais très réel et très spontané au Paganisme, une revanche de longs siècles d’oppression et d’abrutissement. Tel ne prétend que retrouver les titres perdus de l’humanité, restaurer les lettres Grecques et Latines, qui, sans le vouloir, se refait païen. Remettre en honneur les langues d’Homère et de Platon, de Cicéron et de Virgile, c’était en effet renouer une chaîne que le Moyen Age croyait avoir brisée pour jamais, rendre l’essor à la pensée et faire rentrer dans le néant les sciences fausses et stériles. Dérouler le tableau des civilisations et des arts de l’Antiquité, c’était poser les termes d’une comparaison bien périlleuse et montrer au grand jour l’effroyable abaissement, l’ennui mortel où le catholicisme 53 avait plongé le monde. Les Vertus théologales faisaient maigre figure à côté des trois Grâces, et il suffisait de songer aux Dieux de l’Olympe, à ces Dieux toujours jeunes, souriants et robustes, ardentes personnifications des phénomènes naturels, des forces génératrices et des joies de la vie, immuablement assis dans leur sérénité lumineuse, pour faire prendre en dégoût ce culte de l’agonie et de la souffrance, qui étale partout l’image lamentable d’un Dieu supplicié. Qu’est-ce en effet que le catholicisme du Moyen Age, sinon l’abolition de la vie, la religion du sépulcre? L’homme est fait pour être mangé des vers; il n’a pas été créé pour agir, mais pour prier. Arrière donc la science, l’étude; arrière la famille, la patrie, toutes les grandes et nobles affections humaines: ce sont autant de faces du Diable, qui en peut prendre des milliers. L’homme ne doit penser qu’à une seule chose, à son salut; se demander perpétuellement, jour et nuit, serai-je damné? s’absorber dans l’espoir des joies paradisiaques réservées aux élus ou dans la crainte de l’enfer qui l’attend, s’il trébuche. Agir, inventer, chercher le progrès, le bien-être, développer sa volonté et son énergie, se laisser prendre au piège de l’ambition, de l’amour, de la poésie, de l’art, c’est folie; il n’y a de vrai que le tombeau et, par derrière, la vie éternelle. Quelle violente envie de rompre ce réseau de momeries lugubres et de pratiques asservissantes devait tourmenter ceux qui se sentaient faits pour vivre, pour penser et pour agir! Comme ils devaient aspirer à se voir délivrés d’une religion qui, sous prétexte de mater la chair, privait l’homme de tout ce qui peut le charmer, l’épouvantait, le terrifiait pour le rendre plus docile et le forçait 54 d’user son intelligence à résoudre des questions ineptes ou insolubles! Combien durent être de cœur avec ce Grec enthousiaste qui s’écriait: «Cela ne peut pas durer; revenons-en aux Dieux d’Homère!»
Boccace est un païen par l’ardeur sensuelle, par le culte de la grâce, de la beauté, surtout par le mépris de la mort et de ses terreurs, si chères à l’Église dont elles remplissent l’escarcelle. Pendant que la peste ravage Florence, que le glas sonne, conviant à la prière, invitant à se couvrir du sac de cendre, il rassemble ses jeunes femmes et ses galants cavaliers dans une délicieuse villa qui rappelle les frais ombrages de Tibur, et il leur fait mettre en pratique le carpe diem des poètes Épicuriens. Si la Mort arrive, elle les surprendra le sourire aux lèvres et se passant la couronne de fleurs qui chaque jour désigne le Roi ou la Reine du festin. Ce qui, pour un autre conteur, n’aurait été qu’un cadre ingénieux, devient ici l’œuvre même et lui donne un sens. Dans ce cadre, Boccace a déroulé en cent histoires puisées un peu partout, mais rajeunies avec un art suprême, la vaste épopée héroïque, galante, libertine, tragique ou railleuse que chantent les passions dans le cœur de l’homme: la haine, la jalousie, la vengeance et surtout l’amour, qui les inspire toutes. Paladins des anciens âges que l’on croirait détachés du Cycle d’Artus et de la Table-Ronde, tyrans farouches taillés sur le patron des Ugolin et des Ezzelino, maris débonnaires ou féroces, amants audacieux et entreprenants, gros marchands pleins d’astuce ou de bêtise, prêtres hypocrites, moines enragés de hâblerie et de luxure, Boccace nous présente l’homme sous toutes ses faces; comme peintre de femmes, il est sans rival. 55 Quelle gracieuse galerie de filles d’Ève, avant ou après la pomme! La Laure de Pétrarque, la Béatrix de Dante sont des êtres vaporeux, insaisissables; les autres idéales figures qui traversent l’épopée du sombre Florentin, la tragique Francesca de Rimini, avec sa plaie au flanc, parcourant l’espace enlacée à son Paolo, la languissante Pia de’ Tolomei, fleur fanée dans l’air étouffant des Maremmes, sont des ombres plutôt que des femmes. Celles de Boccace ont plus de corps: elles ont même un corps assez épais, ces grosses et grasses matrones sur lesquelles s’assouvit sans vergogne l’appétit monacal; ces rusées commères si adroites à passer d’un lit dans un autre, à duper leurs maris, à leur boucher le bon œil, à les occuper dans le cuvier pendant que le galant les cajole; ces fringantes courtisanes toutes roides dans leurs robes de brocart et d’une impudence intrépide. L’artiste épris de la beauté des formes comme un païen, un Grec du temps de Praxitèle et de Parrhasius, se révèle en caressant d’un libre pinceau des nudités chatoyantes: la douce et charmante Grisélidis, si jolie en costume d’Ève; la veuve innocente qui, dupée par un facétieux étudiant, s’en va au clair de lune, déshabillée comme une nymphe du Giorgione, guetter sous la feuillée les célestes Demoiselles qui doivent lui ramener son amant; Geneviève et Isola, blondes comme fil d’or, aux cheveux bouclés, entremêlés d’une légère guirlande de pervenche, viennent pêcher dans le vivier, sous les yeux du Roi de Sicile, et montrent ingénument sous la chemise de lin leurs charmes naissants; dans la forêt de Ravenne, une femme court toute nue et rose à travers bois, talonnée par la meute, poursuivie par le 56 féroce veneur qui sonne du cor à pleins poumons. Dante, le fervent et mystique Chrétien, eût fait de ce supplice l’expiation de quelque crime; il eût cinglé de ses tercets, comme d’un fouet à triple lanière, les épaules de l’épouse adultère ou de la maîtresse infidèle; mais Boccace est un Épicurien: la suppliciée n’est coupable que de vertu, elle a osé résister à l’amour! Peut-être Boccace a-t-il dit son dernier mot sur la femme dans l’histoire de cette séduisante Alaciel, qu’on ne peut voir sans la désirer, qu’on se dispute à coups de couteau, qui passe des bras de celui-ci dans ceux d’un autre, de la cabine des matelots dans le harem d’un pacha, goûte l’amour des vieux et des jeunes, des princes et des voleurs, au milieu de toutes sortes d’enlèvements et d’aventures, puis revient fraîche et souriante à son fiancé, le roi de Garbe, comme si de rien n’était: Bouche baisée ne perd pas de son charme, mais se renouvelle, comme fait la lune.
Ces contes, qui ne sont pas tous aussi voluptueux et où la licence ne tient d’ailleurs pas plus de place qu’elle n’en occupait alors dans les mœurs, nous sont précieux encore à un autre titre: ils ont servi de passeport à la libre-pensée. Il fallait constamment se tenir en garde contre une théologie ombrageuse, pour qui la pensée était suspecte et qui surveillait d’un œil jaloux tout ce qui pouvait faire échec à ses enseignements. Quand Boccace prit la plume, Cecco d’Ascoli venait d’être brûlé. Les temps n’étaient pas encore mûrs pour la discussion philosophique; mais s’il est défendu de raisonner, on peut toujours rire, peindre les travers, les ridicules, les mœurs bonnes ou mauvaises, et le conte, avec ses apparences anodines, son 57 franc parler, ses insouciantes allures, fut la petite fissure, bientôt large brèche ouverte, par où la libre pensée s’échappa d’abord. Depuis longtemps nos fabliaux, si plaisants, si naïfs, malheureusement écrits dans un idiome informe, destiné à périr, étaient une mine inépuisable de traits satiriques contre le clergé. Boccace leur a emprunté ce bon curé qui, voulant faire l’amour à une commère, laisse en gage sa soutane, et cet autre qui, se flattant de changer en jument la femme d’un de ses paroissiens, n’est arrêté par le bélitre qu’au moment où il veut appicar la coda. A ces histoires édifiantes, il en ajoute bien d’autres: celle du moine qui couche avec une dévote en se faisant passer pour l’ange Gabriel (on croirait lire l’aventure de la Cadière et du Père Girard); celle de l’abbé qui enferme dans une tombe un mari gênant et lui fait accroire qu’il est en purgatoire, pour l’expiation de ses péchés; celle du Juif qui se convertit au catholicisme après avoir vu de près, à Rome, la vie des cardinaux et des moines, persuadé qu’une religion qui dure depuis des siècles, avec de tels scélérats pour ministres, doit nécessairement être d’institution divine, etc. Nos vieux Gaulois, tout en vilipendant les mœurs des prêtres, n’osaient guère s’en prendre à leurs fourberies et respectaient les dogmes. Boccace va plus loin: il démontre la parfaite égalité des trois religions issues de la Bible, le Judaïsme, le Mahométisme, le Christianisme, dans sa fable ingénieuse des Trois Anneaux; il se moque des superstitions dans l’histoire de Messire Chappelet, ce voleur émérite qui trompe un prêtre par une fausse confession, est canonisé après sa mort, et dont les reliques font tout autant de miracles, dit le conteur, 58 que celles d’un autre saint; il bafoue les imbéciles à qui un prédicateur exhibe une plume de perroquet comme tombée de l’aile de l’archange dans la chambre de la Vierge, et qui se laissent marquer d’un signe de croix au front avec les charbons retirés sous le gril de Saint Laurent; son impiété va jusqu’à nous montrer la petite Alibech, agenouillée devant l’ermite et assistant à la resurrezion della carne, bien avant qu’aient sonné aux quatre coins du ciel les trompettes du Jugement dernier. Se moquer ainsi des choses saintes et des mystères! «La liberté philosophique toute seule eût fait brûler l’auteur», dit Villemain: «elle prit pour manteau la licence des mœurs; elle a passé sous cette sauvegarde.»
Le charme des récits avait rendu le Décaméron si populaire en Italie, que l’Église n’osa se fâcher: elle ne le prohiba qu’au concile de Trente; leur hardiesse irrévérente fit sa faveur auprès des Protestants. On s’en amusait depuis longtemps en France, à cette cour brillante du héros de Marignan, où tout le monde lisait et parlait l’Italien, et surtout dans ce petit cénacle d’esprits indépendants, groupés autour de Lefèvre d’Étaples et de Marguerite de Valois, sincèrement religieux au fond, mais qui détestaient les vices et les désordres du clergé catholique, regardaient le monachisme comme un fléau et préludaient à la Réforme en se moquant des superstitions ridicules, des saints équivoques et du culte des reliques. Pour eux, Boccace faisait plaisamment écho à Calvin, l’adversaire impitoyable des prépuces de Jésus-Christ, du vin des Noces de Cana, des patins et des peignes de la Vierge 59 Marie, du bouclier de S. Michel archange, «toutes inventions de néant, forgées pour attraper deniers aux peuples,» et les attirait autant par cette conformité avec leurs propres aspirations que par l’art exquis avec lequel il avait transfiguré les naïfs produits de la vieille veine Gauloise. Marguerite, dans sa retraite de Nérac, en commanda une traduction Française à son secrétaire, Antoine Le Maçon, pour remplacer une ancienne imitation, démodée et hors d’usage, qu’avait publiée Laurens de Premierfaict dès la fin du XIVe siècle. Antoine Le Maçon s’acquitta de sa tâche avec tant de goût et d’exactitude, que son travail est devenu en quelque sorte définitif: Sabastier de Castres s’est borné à le retoucher prétentieusement, tout en donnant sa traduction comme nouvelle. Mieux vaut laisser dans son intégrité, avec ses tournures naïves, ses périodes quelquefois embarrassées et ses expressions archaïques mais pleines de saveur, cette langue du XVIe siècle en comparaison de laquelle la nôtre, plus châtiée et plus régulière, semble fade.
Boccace a dédié son œuvre «aux pauvres Dames qui, retirées de leurs vouluntez et plaisirs, par le vouloir des pères, des mères, des frères et des marys, le plus du temps demeurent enfermées dans le petit circuit de leurs chambres»; il pensait surtout à celles qui aiment, car il ne faut aux autres, ajoute-t-il, que l’aiguille, le fuseau et le rouet. Quoique aujourd’hui les femmes soient moins strictement recluses qu’au temps où la reine Berthe filait, elles se délectent encore aux romans d’amour, à l’exception de celles qui font «les desdaigneuses et les succrées», et c’est à elles que 60 l’on songe tout naturellement en réimprimant le Décaméron. Aussi a-t-il semblé superflu de l’accompagner de notes historiques ou philologiques: l’érudition alourdirait ces pages légères. Rappelons-nous que Léonard de Vinci en faisait écouter la lecture à Monna Lisa, pour amener sur ses lèvres ce sourire ambigu qu’il a pour jamais fixé dans sa Joconde.
On a reproduit exactement, dans la présente édition, les ornements typographiques et les vignettes de l’édition Lyonnaise de Guillaume Roville, 1551, in-16. Les vignettes passent pour être de Salomon Bernard, surnommé le Petit Bernard, le graveur de la Bible dite de Lyon, et sont tout au moins dans sa manière. Ces vieux bois, d’une exécution savante, s’encadrent bien dans le texte et s’harmonisent avec le style du XVIe siècle, mieux que ne pourraient le faire des dessins d’une touche et d’un sentiment modernes, si parfaits qu’ils fussent comme œuvre d’art[21].
Juillet 1878.


VIII
LA DONATION
DE CONSTANTIN[22]

L’Église catholique est d’une extrême opulence en documents apocryphes; nulle n’a falsifié l’histoire avec plus d’audace et d’ingéniosité. Cela s’explique. Création artificielle, reposant sur un ensemble de fictions qui sont en contradiction flagrante avec les faits avérés, elle s’est trouvée dans l’obligation d’adresser un appel constant à l’esprit inventif de ses adeptes pour forger de toutes pièces les titres nécessaires à son existence, à ses vues de domination, ainsi que les preuves de la mission qu’elle s’attribuait; se créer des annales 62 imaginaires qui vinssent à l’appui de ses affirmations et leur faire subir, de temps en temps, d’habiles retouches, car la science augmente et la crédulité décroît. La vérité subsiste par elle-même, solide, inébranlable; mais le mensonge, de quels étançons, de quels arcs-boutants faut-il le soutenir pour le forcer à rester un instant en équilibre! Aussi voyons-nous depuis tant de siècles les gens d’Église occupés sans relâche à préserver de ruine le vieil et branlant édifice; labeur de jour et de nuit dans des choses croulantes, travail incessant, toujours à refaire: c’est avec du papier, des textes fabriqués, des titres chimériques, des contrats suspects qu’ils espèrent en boucher les lézardes et les crevasses! Quand une de leurs fictions est usée, que la critique en a démontré le néant, ils l’abandonnent, la désavouent, l’attribuent aux Ariens, aux Grecs, aux Albigeois, aux Vaudois, aux Luthériens, à n’importe qui, sauf à ses véritables machinateurs, et vite en exhibent une autre, toute neuve, qui durera ce qu’elle pourra, et dont la destinée est d’être aussi, à son déclin, mise sur le compte des hérétiques. De là chez eux tant de supercheries contradictoires, nées des besoins du jour, puis alternativement délaissées ou reprises, selon le souffle du vent.
Entre tous ces vieux parchemins, insignes monuments de l’imposture sacerdotale, se placent au premier rang la Donation de Constantin et les Fausses Décrétales, dans le recueil desquelles on la rencontra d’abord. Elles ont bouleversé tout le droit public et privé au Moyen Age, mis la civilisation à deux doigts de sa perte, et failli faire de l’Europe la proie d’une théocratie envahissante et impitoyable.
63 On croit généralement que la Donation de Constantin n’a servi qu’à constituer le pouvoir temporel des Papes dans le sens le plus restreint du mot, c’est-à-dire à les rendre maîtres de ce petit royaume Italien dont les limites ont varié suivant les temps et que le Saint-Siège vient enfin de perdre, après tant de vicissitudes. Le but et la portée de cet acte célèbre furent autres et bien plus considérables: il posa les premières assises de la monarchie universelle, un rêve que beaucoup de Papes firent tout éveillés. Étienne II le songea, ce rêve; Grégoire VII, Innocent III, Grégoire IX, Adrien IV, Boniface VIII s’épuisèrent en vains efforts pour le réaliser.
Elle fut fabriquée, probablement par Étienne II, certainement sous son pontificat[23], pour donner un point d’appui à ces ambitions. Si Constantin fut choisi comme donateur de préférence à tout autre, c’est que ce Prince, en transférant de Rome à Byzance la capitale de l’Empire, pouvait plus aisément passer pour avoir voulu laisser l’Occident au chef de la religion. Toute l’histoire, les monuments, les monnaies, les médailles, les partages successifs de l’Empire démentaient cette supercherie; mais quand les documents écrits sont rares, qu’on a une armée de scribes pour les falsifier, qu’on revendiquera bientôt le droit d’enseigner seul et d’imposer de force ce que l’on affirme être la vérité, on ne s’arrête pas devant un si mince obstacle.
Une première fable, celle du baptême de 64 Constantin par le Pape Miltiade ou Melchiade, en 313, fut inventée. Après la fameuse bataille du pont Milvius et l’apparition du Labarum, Constantin, rentré à Rome en triomphateur, se décide à embrasser la religion Chrétienne et donne à son chef le palais de Latran transformé en église, de magnifiques ustensiles d’or et d’argent, patènes, ciboires, calices, burettes, pour le service des autels, lui assigne des revenus sur les deniers publics et lui concède des domaines dans la banlieue de Rome[24]. Un édit de tolérance envers les Chrétiens et la permission accordée au Pape d’ouvrir un Concile, pour apaiser la querelle de Cécilien et des Donatistes, complétaient cette légende assez bien tissue, sauf que dans l’épître où elle est narrée, le Saint Pape Melchiade parle du Concile de Nicée, tenu onze ans après sa mort: une misère! L’Église aurait pu se contenter de cette fiction honorable et profitable pour elle; mais quoi! un pauvre petit palais, quelques calices, quelques ostensoirs, de maigres revenus, c’était bien peu. Pas un mot là-dedans de la primauté de l’Évêque de Rome, ni de l’abandon des insignes impériaux et de la pourpre sénatoriale en faveur des prêtres, ni du partage de l’Empire, ni d’aucune clause qui permît au Pape de se dire le suzerain de tous les monarques, le distributeur de toutes les couronnes. Il fallait changer cela. On décida que Melchiade devait avoir subi le martyre, soit sous Maximin, soit sous Constantin lui-même; que ses Lettres, 65 fabriquées par les Ariens, étaient autant d’impostures[25]; et une nouvelle histoire, celle du baptême par Saint Sylvestre, en 323 ou 324, fut mise en circulation. La supercherie réussit à merveille: interpolée au VIIIe siècle, dans les Actes de S. Sylvestre et le Liber 66 Pontificalis du Pape Damase, qui peut-être est en entier apocryphe, elle fut prise au sérieux même par les adversaires de l’Église, Laurent Valla tout le premier. De quels arguments plus pressants il aurait fortifié sa réfutation s’il avait su que ce baptême, cause première de la Donation, était simulé comme elle!
Dans cette seconde fable, répétition de la première, mais revue, corrigée et augmentée, Constantin se montre d’abord le plus grand constructeur d’églises qui ait jamais vécu. Lui qui ne séjourna jamais à Rome, qui n’y fit que de courtes apparitions, il y bâtit en un rien de temps, in eodem tempore (Vie de Saint Sylvestre, Pape, dans la collection des Conciles, de Labbe), sept immenses basiliques; il en bâtit encore quatre autres à Ostie, dans la ville d’Albe, à Capoue, à Naples. L’énumération complaisante des richesses qu’il accumule dans ces églises a quelque chose de prodigieux; il y emploie l’or et l’argent en guise de plomb ou de fer, et sème les pierreries comme des cailloux. Ce ne sont partout qu’autels d’argent massif (une église à elle seule en a sept, pesant chacun deux cents livres); chancels ou grilles de chœur, aussi en argent, pesant mille livres; baldaquins, encore d’argent et pesant deux mille livres; patènes d’or, calices d’or enchâssés de pierreries, amphores, buires, burettes, brûle-parfums, encensoirs d’or, tabernacles d’or, chandeliers d’or, lanternes d’or. Suit une énumération considérable de domaines affectés à l’entretien de toutes les églises, ainsi déclarées propriétaires, par un acte longtemps regardé comme authentique, d’une foule de fermes, châteaux et villas, de milliers d’arpents de terre et de 67 bois dans toutes les régions de l’Italie, de maisons à Rome, à Antioche, à Tarse, à Tyr, à Alexandrie, à Nicée en Numidie, sans compter des redevances en encens et en parfums, en nard, baume, storax, cannelle, safran, dues par la plupart des villes d’Orient. Ici la fraude atteint des proportions colossales, car nous pouvons nous fier à la rapacité des gens d’Église pour croire qu’ils ont dû réclamer, et durement, sinon le safran et la cannelle des rives de l’Euphrate, du moins les rentes des domaines, qui se trouvaient à portée de leur main, et que le pseudo-Constantin, en excellent économe, désigne très clairement, sur les territoires de Rome, de la Sabine, de Tibur, d’Albe, d’Ostie, de Capoue, de Naples.
La charte de Donation, qui vient à la suite de la Vie de Saint Sylvestre, se trouve ainsi amenée et préparée. Dans ce document d’une naïveté grossière, proportionnée à la crédulité d’alors, Constantin, attaqué de la lèpre, ayant épuisé tous les secours de l’art, s’adresse aux prêtres du Capitole, qui, après mûre réflexion, lui conseillent de prendre un bain de sang d’innocents. Plusieurs centaines d’enfants, enlevés aux premières familles de Rome, sont amenés au Capitole; on va les égorger pour remplir de leur sang une grande cuve, quand l’Empereur, pris de pitié, leur fournit des carrosses pour s’en retourner chez eux. En récompense, Saint Pierre et Saint Paul lui apparaissent la nuit suivante et lui enjoignent d’aller trouver Saint Sylvestre, Pape, quoiqu’il n’y en eût pas encore, qui le guérira en lui conférant le baptême. Constantin se rend à l’église, reconnaît dans les figures d’un tableau que lui montre Sylvestre les 68 personnages de son apparition nocturne, et, frappé de stupeur, se fait baptiser: il sort de la piscine entièrement guéri, le corps blanc comme neige. Pour marquer sa vénération envers Saint Pierre et Saint Paul, ses charitables avertisseurs, il ordonne que l’on exhume pieusement leurs restes, les place de ses mains dans des caisses d’ambre, «que la force de tous les éléments ne pourrait rompre,» ferme ces caisses avec des clefs d’or, et bâtit pour les recevoir une église dans les fondations de laquelle il jette douze sacs de terre qu’il a portés sur ses épaules, en l’honneur des douze apôtres. Ces inventions sont tellement en dehors de tout bon sens, que Gratien a pris soin de les passer sous silence en insérant la Donation dans son Décret. Il est amusant d’y voir Constantin, néophyte et déjà docteur en théologie, discourir ex professo sur la Création, le péché originel, la fameuse pomme, le serpent tentateur, le Verbe, la Trinité, qu’il explique en fort bons termes, le Diable, l’enfer, la résurrection, le jugement dernier et tous les mystères; il se pique d’orthodoxie, lui qui doit protéger le premier schisme, et, ce qui était encore plus précieux pour les Papes, il y donne vingt-cinq ou trente fois à Sylvestre le titre de Summus Pontifex, qu’il garda précisément pour lui-même.
Le reste, tout aussi ridicule dans la forme, est plus sérieux au fond. Constantin y concède à l’Évêque de Rome la primauté sur tous les Évêques et Patriarches du monde, même sur le Patriarche de Constantinople, qui n’était pas encore fondée, puis il y reconnaît, en abandonnant Rome et l’Italie au Pape, «qu’aucun souverain terrestre ne doit avoir de pouvoir là où le 69 souverain céleste a établi le chef de son empire;» ce sont les deux clauses capitales: le Saint-Siège a réussi à faire consacrer la première par le Concile de Trente et il a défendu la seconde jusqu’aux dernières extrémités; par la cession, fort vague d’ailleurs, que l’Empereur est censé faire, en outre, des Gaules, de l’Espagne, de la Germanie, de la Judée, de la Thrace et des Iles, il opère au profit des Papes, pour peu qu’ils sachent s’en servir, la constitution d’une des plus vastes monarchies du monde; par une autre clause, celle qui attribue aux Pontifes le droit exclusif de porter les ornements impériaux et aux simples prêtres les vêtements des sénateurs (la pourpre des Cardinaux n’a pas d’autre origine), il satisfait cette soif de distinctions honorifiques qui a toujours dévoré le clergé, et il le relève de son abjection originaire en le déclarant apte à remplir toutes les charges publiques, les plus hautes magistratures; enfin il place de ses propres mains sa couronne sur la tête de Sylvestre, qui refuse d’abord, avec une humilité comique dans un acte faux, puis, comme Pepin, il tient la bride de son cheval. Qu’un tel document ait jamais pu être produit et pris au sérieux, c’est ce qui donne une triste idée de l’impudence et de la sottise humaines; mais il avait un droit incontestable à figurer dans ce fameux recueil de Gratien, code du droit canon, où les Fausses Décrétales d’Isidore Mercator tiennent un si bon rang, où la monstrueuse falsification connue sous le nom de Constitutions Apostoliques est donnée comme d’une authenticité incontestable, avec le Liber Pontificalis du Pape Damase, et tant de Lettres de Papes, fabriquées ad majorem Dei gloriam. La Donation occupe, 70 dans le Décret, la majeure partie de la Distinction XCVI, Canon XII, et vient à l’appui de propositions qui toutes sont destinées à établir sur des bases solides la suprématie Pontificale, et à défendre l’Église de l’ingérence séculière. Le Décret de Gratien est, pour le clergé, une œuvre tellement capitale, l’infirmation de la moindre de ses parties, à plus forte raison d’une pièce importante, est pour lui d’une telle conséquence, que dès que l’inauthenticité de la Donation de Constantin fut seulement soupçonnée, on s’efforça d’exonérer de cette supercherie l’auteur du Décret. Antoine de Florence, Nicolas Cusan, Volaterranus, par exemple, affirmèrent qu’elle ne se trouvait pas dans quelques anciens manuscrits, ce qui s’explique, puisque postérieurement à l’imprimerie, elle n’a souvent été éditée, en pays libres, en France et en Allemagne, qu’avec la glose infamante: Cette Donation est une supercherie; Hæc dona sunt mendacia. Ceux qui la désapprouvaient si catégoriquement ont bien pu la retrancher de leurs exemplaires, sans pour cela douter que Gratien l’eût recueillie. Gratien n’était pas si scrupuleux et Valla lui-même, dans un autre de ses ouvrages[26], le prend en flagrant délit d’imposture, mutilant un passage d’Isidore Mercator pour en tirer un sens exagéré, à propos du Symbole des Apôtres, récité au Concile de Nicée: falsifier ce qui est déjà faux, c’est un assez joli tour de force. Toutefois, subissant malgré lui l’ascendant d’un livre que l’on commentait dans toutes les 71 écoles de droit, d’un auteur qui jouissait d’une si grande autorité, Valla refuse de croire Gratien capable d’avoir inséré la charte apocryphe parmi les Canons, et, sans doute pour ne pas avoir affaire à trop forte partie, préfère charger du délit un interpolateur imaginaire du nom de Paléa.
La Donation figure, en effet, dans le Décret, sous la rubrique Palea, qui lui est commune avec quelques autres documents du même genre, et qui a donné lieu aux plus bizarres interprétations. «Environ cinquante Canons, dispersés dans le Décret de Gratien, portent ce titre que l’on ne peut plus, et depuis longtemps, positivement expliquer. D’après les uns, Palea est une abréviation du nom propre de Paucapaléa, auquel on attribue l’interpolation de ces Canons dans le Décret de Gratien; mais si, en effet, Paucapaléa ou Protopaléa, un des premiers et des plus remarquables disciples de Gratien, compila plusieurs de ces Canons, tous ne sont pas incontestablement de lui. D’autres savants, comme Walter, pensent que ces passages ne s’étant trouvés dans l’origine qu’à la marge et ne provenant pas de Gratien lui-même, ne furent guère tenus en estime par les glossateurs qui les désignèrent comme de la paille, palea, en comparaison du pur froment de Gratien.» (L’abbé Goschler, Dictionnaire encyclopédique de la Théologie catholique, art. Paléa.) Valla tantôt adopte la première et tantôt la seconde de ces hypothèses, pour avoir devant lui un adversaire qu’il puisse prendre à partie, n’osant pas s’attaquer aux Papes, qu’il pensait bien, au fond, être les auteurs de la fraude, et pour s’amuser à jouer sur le nom de ce Paléa, homme de paille de la Papauté. Vraisemblablement, 72 palea est la transcription du Grec παλαιά, sous-entendu γράμματα; les copistes qui ont mis cette indication en tête de quelques parties des Canons ont sans doute voulu marquer que ces documents étaient vieux et qu’ils en ignoraient l’origine[27]. De leur παλαιά, comme du Pirée, on a fait un homme: Paucapaléa, Protopaléa, aussi appelé Pocopaléa, Quotapaléa ou tout simplement Paléa, disciple de Gratien, d’une érudition consommée, d’un goût exquis, etc.! Par suite d’une méprise, peut-être intentionnelle, une rubrique est devenue un savant; un peu plus elle devenait un saint: que de personnages de l’histoire ecclésiastique n’ont pas d’autre droit à l’existence!
Laurent Valla ne fut pas le premier à soupçonner de fausseté la Donation; une telle supercherie, si grossière, ne pouvait pas être examinée de près sans qu’on en vît la trame. Dès 998, l’Empereur Othon III la dénonçait publiquement, dans une de ses Constitutions. Frédéric Barberousse sembla néanmoins l’admettre comme vraie, en principe[28], et Gervais de 73 Tilbury, secrétaire de Othon IV, en reconnut, au nom de son maître, la validité; mais ces aquiescements, extorqués d’une façon plus ou moins adroite, ne signifient rien. Ils sont le fruit de la fameuse alliance du trône et de l’autel, deux despotismes faits pour s’entendre et, après maintes querelles, se réconcilier toujours aux dépens des peuples. En dehors des juristes papalins, bien peu d’esprits élevés, familiers avec les textes, faisaient le moindre cas d’une charte dont la rédaction est si ridicule, dont chaque clause dénonce la fraude, chaque phrase la sottise d’un scribe ignorant. En 1152, lorsque Eugène III argua de la Donation, que Gratien venait de produire au grand jour, pour disputer Rome au peuple, soulevé par Arnaud de Brescia, un des disciples de l’apôtre démocratique, Wetzel, écrivait à Frédéric Barberousse: «Ce mensonge ou plutôt cette fable hérétique, par laquelle Constantin passe pour avoir simoniaquement cédé à Sylvestre les droits de l’Empire sur la ville de Rome, est aujourd’hui dévoilé; les journaliers et les bonnes femmes en savent assez là-dessus pour fermer la bouche aux docteurs, si bien que le Pape et les Cardinaux n’osent plus se montrer en public, tant ils en sont honteux[29].» Il traite de même le baptême 74 de Constantin par Melchiade, cette première fable dont nous avons parlé et qu’on essayait sans doute de remettre à flot, en voyant contester le baptême par Sylvestre. Dante paraît avoir cru à l’authenticité de la Donation; il en déplore les effets et la signale comme la principale cause de la corruption de l’Église, de l’avilissement du trône pontifical:
C’est le poète qui parle, et vraie ou fausse, la Donation avait eu les effets qu’il déplore. Jacques Almain, théologien de Paris, déniait à cette ancienne supercherie toute autorité (1310); Marsile de Padoue enseignait que la primauté de Pierre, fondée non sur les Évangiles, mais sur la Donation de Constantin, est un leurre, une imposture, et que ni Pape, ni Évêques, ni prêtres, n’ont de juridiction sur personne[31]: opinions bien hardies au XIVe siècle, en face des bûchers toujours allumés. Jean XXII 75 commença par excommunier Marsile, le réfuta et soutint la parfaite authenticité de la Donation.
Les Papes persistant toujours à s’appuyer sur une Charte fabriquée par eux et refusant de se rendre aux arguments tirés avec modération de la raison et de la logique, il était urgent de faire descendre la discussion des hauteurs où Dante et le grand juriste de Padoue l’avaient portée, pour s’en tenir à l’analyse de l’acte en lui-même, en dénoncer impitoyablement les absurdités, et montrer, non pas seulement que la Donation était illégale ou excessive et révocable, ce qui lui supposait une ombre d’existence, mais l’œuvre d’un faussaire: la fraude une fois divulguée, indéniable, peut-être que les Papes n’oseraient plus brûler ni excommunier personne. C’est ce que Laurent Valla entreprit, avec d’autant plus d’assurance qu’il pouvait compter sur l’appui d’un Prince toujours menacé de retomber sous la sujétion du Vatican. La date à laquelle il composa son Traité contre la Donation se trouve fixée par diverses circonstances qu’il rappelle: la révolte de Bologne, le siège soutenu par Eugène IV dans le château Saint-Ange (1434) et qu’il dit avoir eu lieu six ans auparavant, la déposition toute récente de ce Pape par le Concile de Bâle et l’élection d’Amédée de Savoie (Félix V); c’est donc aux environs de 1440 qu’il mit la main à la plume. Valla vivait alors à la cour du roi de Naples, Alphonse d’Aragon, non pas en exil, comme l’insinue charitablement Steuchus[32], mais de 76 son propre gré, ayant quitté Rome à la suite de premiers démêlés avec Pogge, qui l’avait empêché d’obtenir de Martin V une place de Secrétaire Apostolique[33]. Il accompagnait dans ses expéditions Alphonse, en train de conquérir son royaume; il se vante même de s’être battu sous ses ordres et d’avoir repoussé un furieux assaut, du haut des murs d’un couvent. S’il avait l’étoffe d’un homme de guerre, sa plume était encore plus affilée que son épée, et il le prouva bien.
Le Concile de Bâle venait de ramener l’attention sur les prétentions temporelles des Papes, et entre tous les États de l’Europe le royaume de Naples, tenu si longtemps dans l’étroite dépendance du Saint-Siège, avait le plus d’intérêt à secouer ce joug. Sur l’invitation du Roi, Valla fut amené à interroger le principal titre des Pontifes, n’eut pas de peine à le trouver faux et conçut le projet de le dire. Mais ici faisons justice d’une appréciation qui n’a pas le moindre fondement. «Dédaignant», dit M. Ch. Nisard, «de pénétrer dans l’histoire avec le flambeau de la critique, uniquement pourvu de cette espèce d’arguments que l’imagination suggère aux purs déclamateurs, Valla entreprit de prouver que la Donation de Constantin aux Papes était chimérique et insoutenable. Combattre les faits par cela seul qu’ils manquent de vraisemblance n’est pas précisément une méthode conforme à la plus exacte manière de raisonner. Combien d’événements vrais ne laissent pas de paraître invraisemblables! Mais cette 77 fois, Valla rencontra juste: les travaux des érudits ont démontré, il y a longtemps, que cette Donation était une fable; Valla eut le mérite de le deviner[34].» Ceux qui liront l’argumentation pressante de Valla décideront s’il est tombé juste par hasard, s’il a fait œuvre de devin ou de critique, et si la patiente analyse à laquelle il se livre, les remarques ingénieuses et mordantes qu’elle lui suggère, sont bien les fruits de son imagination. Quant aux érudits qui, depuis Valla, ont battu en brèche la Donation, le Cardinal Baronius (à son grand regret), Hotman et Bank, ils n’ont, et pour cause, rien ajouté de décisif à sa thèse; les deux derniers se sont bornés, l’un à la résumer, en lui rapportant tout l’honneur de la discussion, l’autre à la reproduire.
Laissons donc à Valla ce qui lui appartient bien, le mérite d’avoir le premier dévoilé la fraude, et par des arguments propres à la rendre désormais insoutenable. Cela aurait pu lui coûter assez cher. Ayant eu l’imprudence de revenir à Rome, en 1452, il faillit être assassiné, sur le simple soupçon d’avoir écrit ce livre abominable, qu’il s’était contenté de lire à ses amis de Naples, et qu’il gardait prudemment par devers lui, sans le publier; il dut s’enfuir sous un déguisement, s’embarquer et gagner l’Espagne, pendant qu’on instruisait son procès.
Le De falso credita et ementita Donatione Constantini ne fut réellement connu, divulgué, qu’après sa mort 78 et surtout lorsque Ulrich de Hutten l’eut édité pour la première fois, en 1517, à l’aide de presses clandestines établies dans son château délabré de Steckelberg, pour le dédier à Léon X. Luther apparaissait alors sur la scène du monde, et cette virulente négation de droits jusqu’alors réputés inébranlables servit de machine de guerre à la Réforme contre la Papauté. «J’ai entre les mains,» écrivait Luther, «la Donation de Constantin réfutée par Valla, éditée par Hutten. Bon Dieu! que de ténèbres ou de perversités accumulées par Rome! Vous serez stupéfait que Dieu ait permis, non seulement que cela durât pendant des siècles, mais que cela prévalût, que des mensonges aussi infâmes, aussi grossiers, aussi impudents fussent insérés dans les Décrétales et imposés comme des articles de foi[35].» Cette première édition, fort rare, est précédée d’une ironique dédicace à Léon X. «Ceux-là ne te connaissent pas, Saint-Père,» lui disait plaisamment Hutten, «qui croient que tu ne sauras pas apprécier le travail de Laurent Valla. Tu affirmes que tu veux rendre la paix au monde: il n’y a pas de paix possible tant que les ravisseurs n’auront pas restitué aux possesseurs légitimes ce 79 qu’ils leur ont injustement pris.» Léon X lui répondit à sa manière, en ami des arts sinon en ami des lettres, et d’une façon qui, pour être détournée, n’en affirmait pas moins une fois de plus l’attachement obstiné de la Papauté à ses titres chimériques. Il commandait à Raphaël, outre la Bataille du pont Milvius, dont le sujet véritable, au point de vue catholique, est l’apparition miraculeuse du Labarum, deux immenses fresques: le Baptême de Constantin par Saint Sylvestre, et Constantin donnant Rome au Pape, qui ornent encore une des salles les plus splendides du Vatican.
Résumé brillamment et complété par Hotman, au XVIe siècle, réédité par Schardius, puis encore au XVIIe siècle par Banck, qui le donne comme une pièce capitale pour l’histoire des démêlés du Saint-Siège avec les puissances, le traité de Laurent Valla mérite assurément de ne pas tomber dans l’oubli. C’est une œuvre. L’auteur a extrêmement soigné, au point de vue de la composition et du style, ce pamphlet ou plutôt ce plaidoyer qui était pour lui un morceau de prédilection et qu’il retoucha jusque dans sa vieillesse. La forme en est légèrement artificielle, comme tout ce qui tient au genre oratoire et demande de la symétrie; mais la langue est pure, puisée aux bonnes sources, digne de celui qui avait recueilli et commenté les Élégances de la langue Latine. Les premières pages sont toutes Cicéroniennes. Laurent Valla y prête successivement la parole, avec une grande ampleur, aux fils et aux amis de Constantin, au Sénat, au Peuple, qui tous le supplient de ne pas donner l’Empire; enfin à Sylvestre, 80 qui refuse de le recevoir, et il a placé dans la bouche de ces différents personnages les raisons les plus propres à faire toucher du doigt les impossibilités matérielles et morales soit de la Donation, soit de son acceptation. Ce ne sont pas là de vaines tirades déclamatoires, des morceaux de rhétorique plus ou moins achevés; la forme oratoire ne nuit en rien à la vigueur des arguments, et, sous l’abondance du style, la cadence des périodes, l’éclat et la hardiesse des figures, des apostrophes, on sent une robuste dialectique, comme des muscles solides sous une draperie. Le discours de Sylvestre surtout est remarquable. Tous les motifs du refus qu’il le suppose faire, avec une malicieuse bonhomie, tirés de la prédication et de l’enseignement de Jésus, des Épîtres de Saint Paul, des écrits des Pères, appliqués avec une rare justesse, s’appuient sur des textes qu’on ne peut guère écarter; mais c’est une ironie bien cruelle que de placer dans la bouche d’un Pape cette audacieuse contre-partie des prétentions de Grégoire VII, fondées sur des allégories de la Lune et du Soleil. Ces polémistes du XVe siècle étaient de rudes jouteurs, et, en pareilles matières, leur connaissance profonde des lettres sacrées les rendait bien redoutables. L’Église, maîtresse de l’instruction publique, lui donnant pour base l’étude des livres saints, pour couronnement celle de la théologie et du droit canonique, formait sans doute des prêtres instruits et se préparait des apologistes; mais elle se créait aussi de dangereux adversaires en ceux qu’elle nourrissait ainsi de sa moelle et que venait à éclairer un rayon de libre pensée. Ce sont des théologiens qui lui ont fait le plus de mal.
81 La discussion proprement dite de l’acte incriminé se trouve dans la seconde moitié du livre; elle est mordante, acharnée, spirituelle; le polémiste, auquel M. Nisard lui-même reconnaît pour habitude «d’alléguer des raisons avant de dire des injures,» y redouble d’invectives, mais le «grammairien» surtout, éplucheur de mots et de syllabes, y triomphe. Valla, et ce n’est point son moindre mérite, a ouvert la voie à la critique diplomatique, un art encore en enfance à son époque, et que l’Église n’était guère tentée de protéger. Toute brillante et passionnée qu’elle est, sa discussion repose sur un examen approfondi du texte, au point de vue historique comme au point de vue grammatical; il passe tout au crible avec un soin minutieux, et si l’on analyse les moyens de vérification qu’il emploie pour saisir les traces de fraude, on se convaincra que les Mabillon et les d’Achéry n’en ont point eu d’autres: ils ont précisé et formulé les règles que Valla appliquait d’intuition.
Février 1879.

IX
LES CONTES
DE VOISENON[36]

L’Abbé de Voisenon est une originale figure du XVIIIe siècle. Presque aussi laid qu’un singe, d’une taille petite et rabougrie, la mine chétive, envahie d’une jaunisse perpétuelle, bâti par la nature dans un moment de distraction, d’une santé délabrée, avec cela, et de temps en temps, étouffé par un asthme qu’il prétendait tenir de sa nourrice, il ne laissa pas d’être un homme à bonnes fortunes; c’était un abbé galant, un coureur d’alcôves. Ne rappelons pas qu’à vingt-cinq ou vingt-six ans il avait été grand-vicaire, ce qui nous est au moins aussi indifférent qu’à lui-même, et que sur son refus d’accepter l’épiscopat, il reçut l’abbaye royale du Jars, près de son château de 83 Voisenon, avec trente mille livres de rente: entré dans les lettres sous les auspices de Voltaire, il nous est rien que pour cela sympathique, et s’il conserva de fructueux bénéfices en restant fidèle à cette amitié de sa jeunesse, il en aurait obtenu bien d’autres en passant dans le camp des cafards, sans avoir besoin de changer de mœurs. Voltaire, que l’on nous peint aujourd’hui comme un mangeur de prêtres, comme l’ogre du clergé, Voltaire eut toute sa vie autour de lui une véritable cour de gens d’Église; à voir, dans sa Correspondance, la peine infinie qu’il se donne pour procurer du pain à celui-ci, un emploi de secrétaire à celui-là, un canonicat à cet autre, on pourrait croire qu’il tenait le bureau de placement de tous les abbés de France.
Voisenon fut un des premiers à tirer parti de cette bienveillance; patronné par Voltaire, il se lança dans les cercles des beaux esprits et les salons des jolies femmes. Il eut sa place marquée dans la Société du bout du banc et le Recueil de ces Messieurs; ses petits vers plurent, quoiqu’ils n’eussent pas toujours le sens commun; ses reparties piquantes et sa malice empêchèrent de trop voir les disgrâces de sa personne, et il eut des succès, il fit des conquêtes! Les femmes ne se l’arrachaient pas, cela se conçoit; elles le prenaient par curiosité, pour amuser le tapis, et se le repassaient de l’une à l’autre comme un magot sans conséquence. Elles l’appelaient leur ami Greluchon, leur petite poignée de puces. Voisenon dit que Crébillon fils passait pour être insolent envers les femmes, sans avoir de quoi justifier son insolence; mais lui-même aurait peut-être été bien embarrassé, avec son asthme, d’en 84 montrer davantage, et cela ne l’empêchait pas d’être insolent. Stendhal conte de lui une bonne histoire. Le duc de Sône le surprend, une nuit, au lit avec sa femme. L’abbé ordonne à la duchesse de faire semblant de dormir, et se met à lire tranquillement. Quand le duc paraît sur la porte, l’abbé, le doigt sur la bouche, lui fait signe de se taire, et lui dit tout bas qu’il a gagé de s’introduire dans le lit de la duchesse à une heure du matin, sans qu’elle s’en aperçût. «Mais est-il déjà une heure?» dit le mari; et pendant qu’il consulte la pendule, Voisenon se lève, s’habille et s’en va. L’anecdote est jolie; elle serait plus certaine s’il avait existé un duc et une duchesse de Sône au XVIIIe siècle. Du reste, la lecture semble avoir été, au lit, l’occupation favorite du maladif abbé; plus tard, quand il rencontra de tendres consolations près de la jolie Madame Favart, devenue une grosse et réjouie commère, le duc de Lauraguais prétend qu’on le trouvait le matin lisant son bréviaire entre les draps; Madame Favart, en cornette de nuit, répondait: Amen[37].
Ses Contes, ce qu’il a fait de plus agréable, en somme, et l’œuvre qui le reflète le mieux, ne sont, comme sa vie et ses amours, qu’une parodie et une gageure. La note tendre, émue ou passionnée n’est pas dans ses cordes; sa tête seule travaille, les sens absolument calmes, et il résout à chaque instant le problème en apparence insoluble d’écrire des contes libertins qui ne soient pas le moins du monde 85 érotiques: ceux qui y chercheraient des impressions voluptueuses seraient bien déçus. Aussi ne faut-il pas placer ses légères esquisses, simples débauches d’esprit, à côté des toiles chaudement colorées de Crébillon fils ou de Diderot. Voisenon n’a pour lui que l’esprit, le style et l’imagination bouffonne; il conte vite et bien, plutôt en causeur qui veut éblouir, qu’en romancier qui voudrait intéresser; il s’enchevêtre dès les premières pages dans des inventions impossibles, et ne se tire d’affaire qu’en renchérissant sur ses propres extravagances.
La mode était de son temps aux Contes de fées et, à la fin du siècle, le libraire Panckoucke, qui en raffolait encore, ainsi que des Voyages imaginaires, a pu en réunir, dans les 37 volumes in-8o de son Cabinet des Fées, la plus étonnante collection. Ce genre aimable, auquel nous devons quelques gracieux chefs-d’œuvre de notre littérature, avait pris naissance aussitôt après la Révocation de l’Édit de Nantes: dans l’étouffant silence qui pesait sur toutes les plumes, alors qu’il était dangereux de penser, le mieux que l’on pouvait faire était de se passionner pour le Rameau d’or ou de courir après l’Oiseau bleu. La Maintenon encourageait cette littérature inoffensive, elle s’y intéressait au delà de tout, et le fuseau lui échappait des mains en écoutant Peau d’Ane ou Riquet à la houppe. Des gens sérieux disaient que les Contes de fées étaient l’histoire du cœur et l’école des rois. Ce goût enfantin survécut à ses causes, mais ceux qui s’y livraient, d’une imagination moins inépuisable que les Persans et les Arabes, ne tardèrent pas à tomber dans le galimatias et l’insipidité. On est vite à bout d’expédients, dans ce genre 86 qui demande tant de ressources, tant de délicatesse, pour ne pas être ennuyeux, et Hamilton lui-même regrettait d’avoir donné une suite à ses Quatre Facardins:
Du temps de l’abbé de Voisenon, ce n’était plus un second ni même un troisième étage qu’on élevait: on surchargeait outre mesure de constructions parasites le frêle édifice. Voisenon résolut de le faire crouler en lui apportant sa pierre, le Sultan Misapouf; il se trompait: cette parodie des Contes de fées eut autant ou plus de succès que les vrais Contes, et l’abbé continua de s’exercer dans ce genre facétieux. Naturellement, ces bluettes n’étaient pas destinées à voir le jour; mais on sait l’histoire: dès qu’elles sont écrites, il se trouve toujours un secrétaire infidèle pour en prendre copie, et un coquin de libraire pour profiter de l’indiscrétion. Ainsi coururent sous le manteau le Sultan Misapouf, Tant mieux pour elle et la plupart des autres Contes de Voisenon, à la grande désolation de l’honnête Favart, qui se lamentait de voir affiché de la sorte «un homme respectable autant par ses mœurs que par son état.»
Aujourd’hui, la mode semble revenir à ces bagatelles du temps passé: on réédite avec luxe Boufflers, Caylus, Crébillon fils, Voisenon; Montcrif, Godard 87 d’Aucourt, La Morlière et Fromaget auront leur tour. Mais il y a plus à laisser qu’à prendre dans ces jolis habilleurs de riens. Voisenon, en particulier, est très inégal; son Histoire de la Félicité, quoique courte, a des longueurs; Zulmis et Zelmaïde, Il eut raison, Il eut tort, Ni trop ni trop peu, sont insignifiants. Quand une bonne âme, Madame de Turpin de Crissé, crut devoir réunir ses Œuvres complètes (1781, 5 vol. in-8o), tout le monde s’aperçut que le sémillant abbé perdait plus qu’il ne gagnait, à être ainsi délayé en cinq tomes, et faisait la mine d’un papillon écrasé sous un in-folio. Tout récemment, M. Octave Uzanne a extrait de ce gros recueil tous les Contes de Voisenon[38]. Nous nous en tiendrons, pour notre compte, à ses deux ouvrages les plus célèbres, ceux où il se piquait d’avoir mis tout son art et reculé l’extravagance au delà des limites ordinaires: le Sultan Misapouf et Tant mieux pour elle, en complétant le recueil par la Navette d’amour, bluette sentimentale qui donne une idée suffisante de son savoir-faire dans le genre gracieux. Voisenon a l’haleine courte, c’est un auteur de petit format; il a fait fortune sous le manteau: qu’on puisse le fourrer dans la poche.
Mai 1879.


X
LA NUIT ET LE MOMENT
PAR CRÉBILLON FILS[39]

Les romans légers du XVIIIe siècle, non réimprimés depuis longtemps, si ce n’est peut-être en Belgique, et dont quelques-uns sont mis à l’index en France, par une pruderie exagérée, deviennent peu à peu assez rares pour n’être plus qu’entre les mains exclusives des bibliophiles. Leurs éditions anciennes, classées soit dans les cabinets des amateurs, qui les gardent avec un soin jaloux, soit dans les bibliothèques publiques, où l’on refuse généralement de les donner en lecture, se trouvent par le fait retirées de la circulation, et si tout le monde connaît, au moins de titre, les plus fameux, la connaissance se borne là. Un spirituel écrivain, qui met de la grâce dans l’érudition, et qui 89 sait bien le prix du petit volume où il a consigné ses recherches sur cette partie de notre littérature, car il l’a maintes fois réimprimé sous toutes sortes de titres (Bibliothèque galante, 1855; Galanteries du XVIIIe siècle, 1862; Amours du temps passé, 1877), M. Charles Monselet, commence par déclarer qu’il ne parlera ni d’Angola, ni d’Aline et Valmont, ni du Sultan Misapouf, ni du Hasard du coin du feu, par la raison qu’ils sont connus de tout le monde, ou peuvent l’être. Est-ce si sûr que cela? Il nous semble, au contraire, qu’on en parle un peu par ouï-dire et qu’on les juge sur commune renommée. Des phrases toutes faites sur l’effronterie, l’immoralité, la corruption d’un siècle pervers, voilà ce qui se répète, sans conviction d’ailleurs, et rien que pour ne pas rompre en visière aux préjugés. Sommes-nous devenus si collets-montés depuis Rabelais et Brantôme?
Entre toutes les productions de Crébillon fils, la Nuit et le Moment, ce petit chef-d’œuvre d’une perfection achevée, a généralement trouvé grâce devant ces censeurs moroses ou prévenus, mais il n’en a pas été pour cela apprécié avec plus d’exactitude. «Dans un très-joli roman intitulé la Nuit et le Moment, Crébillon fils a raconté les joyeux passe-temps de la campagne.» Libre à l’imagination de bâtir sur ces trois lignes de Jules Janin tout ce qu’elle pourra rêver d’agréable dans le genre champêtre et bucolique: promenades sous les grands arbres du parc, tendres entretiens à l’ombre des cabinets de verdure, danses et dîners sur l’herbe, jeux d’escarpolette, feux d’artifice au bord de l’eau, etc.: elle en sera pour ses frais. Et cependant la courte et sèche indication du 90 défunt prince des critiques, qui ne dit pas un mot de plus de ce livre charmant, n’est pas entièrement fantaisiste; la scène se passe dans un château des environs de Paris ou de Versailles: c’est là tout ce qu’il y a d’un peu champêtre dans l’action, qui montre pour décor, non les grands bois, mais les tentures d’une chambre à coucher; le bocage, avec ou sans mystère, est remplacé par les rideaux de l’alcôve.
Les grandes maisons du XVIIIe siècle avaient pris un instant la mode de donner ce qu’on appelait des journées de campagne, où elles offraient à leurs invités des divertissements exquis et de toutes sortes. Crébillon, aussi bien et mieux qu’un autre, aurait pu nous retracer une de ces journées; mais avec sa finesse ordinaire, il s’est contenté d’en raconter l’épilogue. La dernière fusée éteinte, la dernière coupe de Champagne vidée, quand chacun s’est mis en quête de son appartement, il semble que tout soit fini; au contraire, tout commence. Ces sortes de réunions servaient de prétexte à des rencontres, à des arrangements fortuits; l’imprévu était de la fête. Cidalise s’est enfermée chez elle, mais elle a oublié de pousser le verrou; l’a-t-elle vraiment oublié? Clitandre, en simple robe de chambre de taffetas, erre par les couloirs, trouve une porte qui s’ouvre toute seule et pénètre chez Madame sans se faire autrement annoncer. Est-ce bien là qu’il croyait entrer, et Madame l’attendait-elle, si toutefois elle attendait quelqu’un? Autant de points qui restent dans l’ombre; Crébillon fils est le peintre des demi-teintes et l’homme des sous-entendus: il laisse plus à deviner qu’il ne donne à voir. La conversation s’engage, légère et spirituelle d’abord, puis de 91 plus en plus intime; on se rapproche, on se fait des confidences. On se croyait invinciblement attaché de part et d’autre, et bientôt, à la manière dont Cidalise tout comme Clitandre parlent de leurs amours de la veille, ils s’aperçoivent que ce sont des amours déjà bien lointains, bien effacés, ils entrevoient qu’ils ne sont peut-être pas aussi indifférents l’un à l’autre qu’ils le supposaient. Crébillon fils est un maître en ce genre d’escrime amoureuse; les stratagèmes insidieux de l’attaque, les coquetteries de la défense, le trouble de la défaite, il nous a peint tout cela vingt fois, et toujours avec un art parfait, de nouvelles délicatesses de sentiment et de style. Ce sont des variations sur une seule corde, toujours la même, mais quelle corde! la fibre la plus déliée et la plus sensible du cœur humain.
Ce n’est pas d’ailleurs chose facile que de donner un intérêt croissant à un dialogue de ce genre, qui aurait au théâtre une durée de deux ou trois heures. En cela, Crébillon a plus d’une ressemblance avec Marivaux et semble souvent avoir voulu reprendre sous une autre forme, plus vive et d’une couleur plus chaude, le Jeu de l’amour et du hasard de son devancier. Tous deux sont du même monde et, à quelques années de distance, s’inspirent des mêmes modèles, raffinent les préciosités des mêmes salons. Mais l’auteur dramatique a, pour se soutenir, une intrigue qu’il emmêle et file jusqu’au dénouement, les allées et venues de la scène, les incidents qu’il lui plaît de créer: le romancier se sauve par la peinture des caractères et les descriptions. Crébillon fils, à la fois auteur dramatique et romancier dans ce petit livre, 92 s’est volontairement privé des ressources de l’un et de l’autre. Une causerie qui parcourt tous les tons, qui commence par le badinage et finit par l’attendrissement, les progrès d’un sentiment, d’un caprice, d’une fantaisie que l’on voit naître et se développer, cela lui suffit pour éveiller la curiosité. Et que de jolies digressions, d’anecdotes lestement troussées, pour remplir les vides et amuser les entractes! Quoi, il fallait tant d’esprit, de ténacité, de persuasion et d’éloquence, des phrases si bien tournées, des compliments si adroits pour décider à l’indulgence une de ces femmes que l’on nous peint comme de fieffées impures! Le XVIIIe siècle est une époque calomniée.
«La vérité ne saurait être plus exacte,» dit Palissot, «que dans les romans de Crébillon fils, les caractères mieux tracés, les situations filées et graduées avec plus d’art. Ne l’accusons pas de la licence des mœurs qu’il a peintes, il pourrait dire à tout son siècle:
»Le comte Hamilton est le seul écrivain à qui Crébillon ait été comparé. Si Hamilton a donné dans ses Mémoires de Grammont un modèle de plaisanterie exquise que personne n’est tenté d’imiter, ses contes, quoiqu’il en ait fait de très agréables, n’ont pas à ce qu’il nous semble la gaîté piquante, ni l’originalité des romans de Crébillon, ni surtout cette vérité de mœurs qui les fera vivre tant qu’on sera curieux de connaître les Français du XVIIIe siècle. La réputation de ces romans peut, à la vérité, décroître par le changement qui s’est déjà fait dans nos habitudes, mais il sera 93 toujours vrai que Crébillon a été l’historien le plus fidèle des mœurs de son temps.» Ce jugement doit rester; Crébillon n’est pas seulement un écrivain délicat, c’est un observateur pénétrant et un peintre fidèle. Par la nature du cadre qu’il s’impose généralement, il ne peut s’appesantir sur aucun caractère, sur aucune situation; il faut qu’il aille vite, que les tableaux se succèdent, et chaque personnage n’a que le temps de dessiner en passant sa silhouette. Toutes sont justes et précises, elles ne paraissent qu’effleurées et sont étudiées à fond. Ses portraits ont cette vérité et cette variété infinie que rencontrent seulement ceux qui peignent sur le vif; aucune de ses femmes ne ressemble à l’autre, n’a le même ton, le même visage, la même langue, et toutes cependant sont des rouées et des coquettes; elles ne diffèrent que par des nuances pour ainsi dire insaisissables: ces nuances, il les a saisies et fixées. Bien peu d’écrivains du même genre ont si finement arrêté les contours de physionomies fugitives et donné ce cachet de réalité aux filles de leur imagination.
Juillet 1879.

XI
LES NOUVELLES
DE SACCHETTI[40]

Les Trecento Novelle de Franco Sacchetti sont un des monuments de la littérature Italienne: comme style, de pur Toscan, elles font autorité et se classent parmi les testi di lingua; comme fond, elles ont l’inappréciable avantage d’être des tableaux de mœurs d’une vérité, d’une précision et d’une couleur on ne peut plus rares. Il y a lieu de s’étonner qu’elles soient restées manuscrites près de cinq siècles; presque contemporaines de Boccace, elles n’ont vu le jour que du temps de Voltaire. Les Italiens de la Renaissance les connaissaient pourtant à merveille; Strapparola, Bandello, le Lasca, Pogge surtout, en ont largement profité, mais l’idée de s’en faire l’éditeur n’est venue à 95 personne de ceux qui les mettaient si bien à contribution. Peut-être était-ce par remords et pour ne pas dévoiler leurs larcins: croyons plutôt qu’ils les trouvaient d’un style trop rude, trop archaïque, et qu’ils préféraient de bonne foi à ces vieilleries leurs amplifications ou rajeunissements. Bottari les imprima le premier en 1724; Poggiali en donna une édition plus correcte et plus exacte (Livourne, sous la rubrique de Londres, 1795, 3 vol. in-8); à cette époque, le temps avait déjà produit dans l’œuvre de Sacchetti des ravages irréparables. Les copies en étaient encore nombreuses; il y en avait à Florence, à Rome, dans les bibliothèques publiques et dans les collections particulières; mais la plupart étaient de date récente, du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe, et leurs auteurs ne semblaient avoir eu qu’une préoccupation: rajeunir le texte et lui enlever toute saveur, raccourcir ou délayer les Nouvelles, substituer leurs propres réflexions à celles de Sacchetti; ces copies ne pouvaient être d’aucune utilité. Un manuscrit ancien de la Bibliothèque Laurentienne, à Florence (on le croit du XVe siècle), servit de base aux travaux de Bottari, de Poggiali et de tous ceux qui vinrent après eux; malheureusement, il était mangé des vers, perdu d’humidité, des feuillets avaient été arrachés, le commencement et la fin manquaient. Le commencement fut retrouvé, cousu à une copie plus récente, dans la Bibliothèque Magliabecchi; la fin n’a jamais été découverte, et, même en rejoignant les deux parties, séparées l’une de l’autre, nous ne savons à quelle occasion, on ne réussit pas à combler toutes les lacunes. Dans l’état où elles sont actuellement, après cinq ou six éditions dont la meilleure est celle de 96 M. Ottavio Gigli (Firenze, Le Monnier, 1868, 2 vol. grand in-18), les Trois cents Nouvelles se trouvent réduites à deux cent vingt-trois[41].
Placé entre Boccace, qui le précède d’une vingtaine d’années, et Pogge, qui le suit à un demi-siècle de distance, Sacchetti tient à la fois de l’un et de l’autre; il refait à sa manière certains contes du Décaméron, par exemple le Diable en enfer, comme pour montrer ce que l’on peut tenter, même après un chef-d’œuvre; et par courtoises représailles, Pogge traite à son tour en Latin, avec l’originalité qui lui est propre, un grand nombre de sujets tirés des Trecento Novelle. Mais Pogge a une préférence marquée pour les brèves anecdotes, les reparties spirituelles, surtout pour les contes gras; il vise au trait et va droit au mot de la fin en une page ou deux. Boccace, conteur éloquent et fleuri, Cicéronien d’éducation et de style, affectionne les récits longuement accidentés, les aventures épiques. Peu lui importent le lieu de la scène et le temps de l’action; il choisit dans l’histoire ancienne, aussi bien que parmi les événements contemporains, le fait qu’il juge propre à captiver l’intérêt, il l’idéalise et le 97 transforme en une peinture générale des travers, des vices et des passions: chacune de ses Nouvelles est un poème, une tragédie, une comédie. Sacchetti a de moins hautes visées; tandis que son prestigieux rival rehausse de tout l’éclat de son imagination les aventures déjà empreintes d’un caractère exceptionnel, lui se borne à nous raconter la vie au jour le jour, le fait divers de la semaine, l’aventure bourgeoise qui a défrayé les commérages du quartier. Les personnages de Boccace, même les plus vulgaires, deviennent des types, comme ceux de Molière et de Shakespeare: ils représentent l’humanité; ceux de Sacchetti restent des individus. Mais si l’auteur des Trecento Novelle n’a pas les hautes facultés d’idéalisation de son rival, il possède d’autres qualités à peine inférieures, et, en concentrant sur un seul foyer la peinture des mœurs Italiennes à son époque, toute l’intensité de son observation, il a réussi à nous laisser des tableaux pleins de l’animation de tout ce qui est vrai et sincère; on y sent la vie. L’un de ses mérites, très sensible même aux étrangers (combien doit-il l’être plus aux Italiens!), consiste dans le naturel et la justesse de l’expression, empruntée toute vive à la langue populaire, dans un style fourmillant d’idiotismes Florentins. Il a quelque chose de notre Villon, qui, lui aussi, nous a conservé tant de vieux proverbes et de locutions Parisiennes: l’absence de toute recherche littéraire et, sous cette négligence apparente, la précision du trait, du détail caractéristique, l’art d’esquisser une physionomie, de donner le croquis d’une scène, d’une manière ineffaçable, en deux ou trois coups de crayon; il ne compose pas un récit, il vous met la chose même sous les yeux.
98 Mieux que personne, Sacchetti était en position de bien connaître tous ces menus faits de la vie journalière, qu’il a recueillis pour son amusement et pour le nôtre; il remplit dans la dernière moitié de sa vie la charge de Podestat, magistrature qui, outre ses attributions administratives et politiques, conférait un pouvoir presque arbitraire, et dont la juridiction singulièrement étendue allait des cas de simple police aux causes emportant la peine capitale: dans la même séance, le Podestat décidait d’une contestation à propos d’un panier d’œufs et envoyait un mauvais drôle à la potence. Sacchetti ne dut assurément pas être pour les petites villes de Bibbiena et de San-Miniato, où l’envoya successivement la République de Florence, ce qu’est Angelo, tyran de Padoue, dans le sombre drame de Victor Hugo: la griffe du tigre sur la brebis, l’homme devant qui les fenêtres se ferment, les passants s’esquivent, le dedans des maisons tremble; mais s’il n’entendait point, la nuit, des pas dans son mur, il est bien permis de croire que son esprit observateur et curieux pénétrait assez facilement les murs et les secrets des autres. De là, dans ses Nouvelles, tant de renseignements puisés aux meilleures sources sur les principales familles Italiennes et les personnages en vue de son temps; il aimait ses délicates fonctions, tout en se dépitant de ne pas les exercer sur un plus vaste théâtre, il se plaît à les rehausser, à rapporter de beaux procès, jugés soit par lui-même, soit par divers de ses collègues, et, au milieu de ses récits généralement plus plaisants que tragiques, il tient souvent en réserve quelque terrible histoire, propre à effrayer 99 quiconque voudrait se moquer des Podestats, Prévôts, Capitaines-grands et autres gens de justice.
Par sa naissance autant que par ses aptitudes, Franco Sacchetti était destiné aux charges publiques. La famille des Sacchetti est citée avec celle des Pulci, par Machiavel, comme une des plus anciennes et des plus importantes du parti Guelfe, chassées de Florence lors d’un triomphe éphémère des Gibelins à l’approche de l’Empereur Frédéric II, réduites à se réfugier dans les forteresses du Val-d’Arno et dont l’exil faisait la sécurité des vainqueurs. Elles furent rappelées peu de temps après et depuis lors conservèrent presque toujours le pouvoir. Dante aussi en parle comme d’une des premières familles de Florence:
(Les Sacchetti appartenaient sans doute à la corporation des pelletiers); Dante les cite parmi les vieux Florentins dont le nom se perd dans la nuit des temps:
100 Pourtant une vieille haine existait entre les Sacchetti et les Alighieri. Dans l’Enfer, Dante rencontre un de ses parents, Geri del Bello, tué par un Sacchetti, et l’Ombre, lui rappelant que sa mort est restée jusqu’à présent sans vengeance, le menace fortement du doigt (Inferno, XIX, 25-27). Ces inimitiés, que le temps finit par éteindre, n’altérèrent en rien le culte que voua plus tard Franco Sacchetti au grand poète Florentin; maints endroits de ses écrits témoignent de sa profonde admiration pour le chantre de la Divine Comédie, et l’une de ses Nouvelles (CXXI—Le Tombeau du Dante), renferme l’éloge le plus original, le plus audacieux qu’on puisse faire de son génie.
Il grandit et atteignit l’âge viril à l’une des périodes les plus troublées de l’histoire de Florence, celle où de terribles calamités vinrent se joindre aux luttes des partis qui divisaient continuellement cette turbulente République. Nobles et Plébéiens étaient arrivés à se faire la guerre, non plus pour obtenir, comme le remarque Machiavel, partage égal du pouvoir, mais pour s’annuler et se proscrire, dès que l’une des deux factions l’emportait. Le Duc d’Athènes, amené et soutenu par la faction des Nobles, venait d’être chassé, les Nobles tous tués ou proscrits. Le parti populaire, auquel appartenaient les Sacchetti, dominait; la ville n’en était pas plus calme, déchirée entre diverses familles qui se disputaient les armes à la main les principales magistratures. Des bandes de condottieri, appelées les unes par le Pape, les autres par l’Empereur, erraient à travers l’Italie, pillant les campagnes, prenant d’assaut les petites villes, prêtes à se mettre au service de n’importe quelle cité ou de quel prince, et 101 forçant tout le monde à se renfermer chez soi, à s’armer pour se défendre d’attaques imprévues. La peste vint apporter un surcroît de désolation et de terreur. Né en 1335, Sacchetti avait treize ans lorsque éclata cette terrible peste noire, décrite par Boccace sous de si sombres couleurs dans le prologue du Décaméron, et qui lui laissa, à lui aussi, des souvenirs ineffaçables, car il en a également parlé dans la préface de ses Nouvelles[43]. On a peu de détails sur la première partie de son existence; on sait seulement qu’il voyagea, pour apprendre le négoce; qu’il était en 1350 en Slavonie, en 1353 à Gênes. Il s’adonnait en même temps à la poésie et dut à un certain nombre de Canzones, de Sonnets, de Madrigaux et de Ballades, qui le firent placer par ses contemporains immédiatement au-dessous de Pétrarque, son premier renom littéraire; très peu de ses vers ont été conservés et, quoiqu’ils soient fort estimables, ils ne légitiment pas tout à fait une si favorable appréciation.
Une de ses meilleures pièces est celle qu’il composa en 1375, à propos de la mort de Boccace; d’autres Canzones lui furent inspirés à diverses époques de sa vie par les événements auxquels il se trouva mêlé, et suivant l’usage du temps, par ses amours. Il dit avoir poursuivi de ses instances, pendant vingt-six ans, une dame dont le nom est resté ignoré, et qu’il accabla sans résultat de ses bouquets à Chloris. Sur la fin de sa vie, il s’en désolait encore et, contant dans l’une de 102 ses Nouvelles (CXI—Le paquet d’orties), l’histoire d’un Religieux qui avait, en amour, des procédés un peu plus expéditifs, «un autre, et je suis de ceux-là,» dit-il avec quelque tristesse, «un autre aura beau adresser aux femmes mille madrigaux ou ballades, il n’en recevra pas un salut!» Il a en outre composé des Sermons dont nous dirons un mot; enfin on a quelques lettres Latines qui indiquent un esprit très-cultivé[44].
Le point culminant de sa carrière politique fut la part qu’il prit, en 1376, à la ligue des États du nord et du centre de l’Italie contre l’Église, sous le Pontificat de Grégoire XI. L’Italie échappait au Pape qui, de son palais d’Avignon, prétendait la gouverner plus étroitement que jamais. Toutes les villes qu’il tenait sous sa domination se soulevaient; Bologne chassait ignominieusement son Légat, Rome même n’était pas sûre. Pour se consolider dans Faënza, l’Évêque d’Ostie, un des plus grands scélérats de l’époque, au dire de Muratori, prit à sa solde l’Anglais John Hawkwood (le Giovanni Acuto ou Gian Acut de Sacchetti et des chroniques Italiennes), qui guerroyait depuis longues années dans la Péninsule, à la tête de bandes indomptables. L’Anglais pénétra dans Faënza, puis réclama au Légat la solde de ses hommes; c’était une comédie convenue d’avance. «Payez-vous sur les habitants,» 103 répondit le Cardinal. Hawkwood commença par bannir onze mille citoyens, toute la population valide, puis, sûr de ne plus rencontrer de résistance, mit la ville à sac; toutes les femmes furent livrées aux soldats, trois cents massacrées. «Voilà quels chiens,» dit Muratori, »prenaient à leur service en Italie les ministres de l’Église!» Le cardinal de Genève, depuis Anti-Pape sous le nom de Clément VII, émerveillé des hauts faits d’Hawkwood, l’envoya contre Cesena, qu’il traita aussi cruellement, puis contre Florence, qui ferma ses portes. L’Anglais ne put que ravager les territoires environnants, détruire les moissons et menacer la ville d’une épouvantable famine. En gens avisés, les Florentins achetèrent Hawkwood, qui, recevant de grosses sommes pour les réduire et le double pour ne rien faire, resta tranquillement dans ses quartiers; plus tard, ils le prirent à leur solde et l’employèrent avec succès contre le Pape, circonstance à laquelle cet illustre bandit doit d’avoir à Florence un magnifique mausolée, surmonté de sa statue équestre, dans l’église de Santa-Croce.
s’écrie Sacchetti dans une furieuse invective adressée à Grégoire XI; il y rappelle les massacres ordonnés par le Cardinal de Genève:
Mais il ne se contenta pas de faire des vers. Délégué comme ambassadeur de Florence près des seigneurs de la Romagne par le Conseil des Huit, magistrature dictatoriale créée en vue de la guerre, il se rendit à Bologne avec Matteo Velluti pour collègue, tandis que son frère, Giannozo Sacchetti, était envoyé au même titre à Sienne et à Chiusi; il acquit à la ligue Bologne et quelques autres villes, puis fut dépêché à Milan, y conclut l’alliance entre Barnabò Visconti et la République Florentine, et pendant cinq années ne cessa de réchauffer le zèle des adhérents, de susciter à l’Église de nouveaux ennemis. C’est à cette date que se rapportent ses relations avec les principaux chefs ou capitaines de la ligue: Malatesta de Rimini, Gambacorta de Pise, les Manfredi de Faënza, les Visconti, et surtout avec Ridolfo Varano de Camerino, qui eut le commandement en chef des forces alliées, et dont il rapporte tant de traits dans ses Nouvelles. Au retour de ses missions, en 1372, il fut surpris en mer par les Pisans et fait prisonnier; l’un de ses fils, qui l’accompagnait, 105 Filippo, reçut une blessure grave pendant le combat. La République lui alloua soixante-dix florins d’or en dédommagement de ses pertes. Quelques années auparavant, il avait reçu de son pays une autre marque de faveur singulière. Son frère, Giannozo, se trouva compromis dans une obscure intrigue et convaincu de trahison: il affectait de grands principes religieux, couchait sur la dure, ne portait que des haillons, et n’avait pas laissé cependant d’accepter, en même temps que Franco, les fonctions d’ambassadeur; mais secrètement il travaillait pour le Pape et s’était abouché, à Padoue, avec les chefs des réfugiés Guelfes, que leur attachement au parti de l’Église avait fait bannir de Florence. De concert avec eux, il essaya de décider Carlo de Durazzo à s’emparer de Florence en se rendant à Naples, où il allait, sur la prière du Pape, chasser la reine Jeanne. Surpris avec quelques-uns des conjurés à Marignolle et mis à la torture, Giannozo avoua tout et fut condamné à mort; il eut la tête tranchée le 3 Octobre 1379. D’après une loi de Florence, nul des parents d’un condamné ne pouvait exercer de fonctions publiques: un décret de la Seigneurie, en date de 1380, releva expressément Franco Sacchetti de cette déchéance, manifestant ainsi la haute estime où le tenaient ses concitoyens. En 1383, Sacchetti fut élevé au Priorat; la date mérite d’être signalée: c’était au plus fort de la lutte entre Louis d’Anjou et Carlo de Durazzo, et la peste noire ayant fait de nouveau son apparition à Florence, les principaux habitants abandonnaient la ville, les magistrats désertaient leurs postes; il donna l’exemple du devoir. La même année, au sortir de sa charge, il entra au Conseil des Huit. 106 Le reste de sa vie s’écoula dans des magistratures plus paisibles; on l’envoya successivement en qualité de Podestat à Bibbiena, à San-Miniato, puis à Portico (1398), avec le titre de Gouverneur de la province de Florence. Ses deux fils, Niccolo et Filippo Sacchetti, marchèrent sur ses traces; tous deux furent élevés au Priorat, comme leur père, et le second eut la charge de Gonfalonier de Justice en 1419.
Dans les loisirs que lui laissaient ses fonctions de Podestat, Franco Sacchetti continua de s’adonner à ses goûts littéraires; il ajouta un certain nombre de pièces à son recueil de Canzones et de Sonnets, rédigea ses Trecento Novelle et composa ses Sermons évangéliques. L’étrange discordance qui semble se manifester entre les Sermons, œuvre d’un homme profondément religieux, et les Nouvelles, pour la plupart hostiles aux prêtres, a fait incliner Bottari à croire que Sacchetti, après avoir mené une vie licencieuse, était devenu bigot dans sa vieillesse, par imbécillité. Le cas est fréquent; mais ce n’est pas celui de notre conteur. Cette hypothèse facile dispensait Bottari, prêtre lui-même, d’aller au fond des choses et d’expliquer comment on peut détester le clergé pour son esprit de domination, ses désordres et ses vices, tout en restant un parfait Chrétien, un croyant convaincu. Or, c’est bien là le cas de Sacchetti. En même temps qu’il se plaisait à recueillir ses Nouvelles, de la même plume il écrivait ses Sermons, au nombre de quarante-neuf, un par jour de Carême, et proposait à ses méditations les points les plus ardus de la doctrine catholique; il les écrivait, non pour les autres, mais pour lui-même, 107 et sans doute afin de se raffermir dans sa foi, ébranlée par les spectacles qu’il avait eus sous les yeux. Adversaire acharné de l’Église, en tant que pouvoir temporel; détestant les cuistres, les cafards et les hypocrites, qu’il accable de ses traits satiriques; se moquant, comme Boccace, des reliques miraculeuses, des Saintes qui ont trois bras, des fioles de lait de la Vierge, des ridicules superstitions et surtout de ceux qui en vivent, il essaye pourtant de se persuader que le dogme reste sauf et que la religion n’est pas atteinte par la sottise ou l’impureté de ses ministres; il propose de châtrer tous les prêtres, seul moyen, à son avis, de leur donner de bonnes mœurs (le moyen est peut-être excessif), et en même temps il veut qu’on croie à ce qu’ils enseignent. C’est une inconséquence qui nous paraît aujourd’hui singulière: ce n’en était pas une à cette époque de foi sincère et naïve.
Pour offrir une idée complète de l’homme, de ses pensées intimes et de son talent dans des genres divers, nous avons traduit deux de ces Sermons. Le premier est tout dogmatique; l’auteur y expose le mystère de la présence réelle, d’après les arguments de l’école, ceux qui avaient cours alors: la pierre héliotrope, qui rend invisible; le poussin qui sort de l’œuf sans que personne l’y ait vu entrer, etc.; c’est un travail curieux et qui porte bien sa date. Le second, d’une forme plus littéraire, est une sorte d’oraison funèbre de Jésus-Christ, traitée avec une ampleur et une originalité magistrales; peu de prédicateurs du temps de Sacchetti auraient été capables d’écrire ce morceau d’éloquence sacrée. Parmi ses Nouvelles, nous avons choisi, sans autre parti pris que d’en tirer un livre 108 agréable, celles que recommandent les mérites de la narration, l’intérêt du sujet, la franchise et le naturel du style. Nous aurions pu prendre un plus grand nombre de celles qui daubent sur les prêtres et les moines: elles sont toutes piquantes; mais c’eût été fausser l’esprit du recueil et présenter Sacchetti comme un auteur exclusivement irréligieux, ce qu’il est fort loin d’être. Prélats, hommes de guerre, grands seigneurs, paysans, bourgeois, moines, magistrats, bouffons de Cour à la langue affilée, nonnes confites en dévotion, maris trompés, femmes volages, il met tout le monde en scène, il sait sur tous une foule d’anecdotes et de bons mots; en choisissant les meilleurs, dans chaque sorte, nous avons conservé à l’ensemble sa physionomie générale.
Août 1879.


XII
LES NOUVELLES
DE BANDELLO[46]

Matteo Bandello n’est pas tout à fait aussi ignoré en France que bien d’autres Novellieri Italiens d’une valeur égale ou supérieure à la sienne; il occupe même chez nous un assez bon rang, grâce à trois circonstances particulières. Henri II, pour le récompenser de son attachement à notre cause durant les guerres d’Italie, en fit un prélat Français, un Évêque d’Agen; Shakespeare lui emprunta le sujet le plus populaire de ses tragédies, Roméo et Juliette, et la critique littéraire, toujours curieuse des sources d’où ont jailli les chefs-d’œuvre, s’est trouvée ainsi amenée à remettre en lumière celui qui passait pour le premier metteur en 110 scène de ce dramatique sujet; deux écrivains Français du XVIe siècle, Boaistuau et son continuateur Belleforest, popularisèrent Bandello, et c’est par eux que Shakespeare le connut; leurs Histoires tragiques, extraites de l’Italien de Bandel, eurent plusieurs éditions consécutives. Voilà ses titres à la notoriété; ils sont pourtant de nature à le faire juger assez inexactement. Évêque, Bandello le fut le moins possible; à peine s’il exerça les fonctions épiscopales, s’étant empressé de déléguer ses pouvoirs à un collègue, afin de rester homme du monde, de vaquer à ses études favorites et de recueillir ses Nouvelles, dont il comptait se prévaloir auprès de la postérité bien plus que de la qualité de prélat; le sujet de Roméo et Juliette ne lui appartient pas absolument: il l’avait trouvé chez un autre conteur, Luigi da Porto, et se l’était approprié en lui donnant des formes nouvelles, une plus grande délicatesse dans la mise en scène, en en faisant un récit mieux lié, mérites qui sont grands assurément, mais qui ne peuvent faire oublier le premier inventeur; enfin, les Histoires tragiques de Boaistuau et de Belleforest sont leur œuvre personnelle à peu près autant que celle de Bandello, et le Privilège qui leur conférait le droit de publier ces Histoires était parfaitement dans le vrai en constatant qu’elles sont «traduites et enrichies outre l’invention de l’auteur». Il y a en effet, dans leur recueil, beaucoup trop de richesses qui leur sont propres. Non contents de bouleverser tout l’ordre des Nouvelles, afin de justifier leur titre en accordant la préférence aux plus tragiques, de retrancher les Dédicaces, qui donnent à chacune d’elles son cadre particulier, de ne respecter ni le style ni la manière de l’auteur, c’est-à-dire ce qui 111 constitue sa personnalité littéraire, ils ont fréquemment modifié ses récits, altéré les circonstances, imaginé d’autres dénouements et intercalé partout des réflexions, des souvenirs de l’histoire Grecque et Romaine, des harangues, des lettres, des sonnets, des romances dont le texte n’offre pas la moindre trace.
Une chose frappe pourtant dans ce fatras et lui valut, il y a trois cents ans, une foule de lecteurs: c’est l’étonnante diversité et l’intérêt de ces Nouvelles, qui offrent pour la plupart les péripéties, les développements de caractère et de passion des romans modernes. En les accommodant au goût du jour, par de désastreuses amplifications, la prétendue traduction Française n’a pu entièrement leur enlever ce qui en constitue le nerf et l’attrait principal. Depuis Boccace, personne n’avait rassemblé un tel nombre de récits, de genres si variés, d’un accent si vrai, et tous de nature à piquer la curiosité, à exciter l’émotion. A ces mérites, qui sont ceux du fond, il faut joindre ceux de la forme, entièrement annulés par Belleforest, mais très réels dans le texte original, bien que Bandello se défende d’être un styliste et allègue qu’en qualité de Lombard il peut lui arriver d’écorcher la pure langue Florentine. Quoi qu’il en dise, c’est un écrivain du genre fleuri, habile à tout exprimer, et fort élégamment, à l’aide de métaphores ingénieuses, ne dédaignant pas le mot pour rire, et enjolivant jusqu’aux situations les plus brutales. S’il est parfois incorrect (il en demande l’absolution, croyons-le sur parole), ce n’est pas impuissance de mieux faire, c’est plutôt crainte que sa prose ne sente l’huile; il écrit comme il aurait conté dans un cercle de galants seigneurs et de 112 jolies femmes, sachant très bien qu’on lui pardonnera une tournure familière, une répétition, s’il relève ces négligences par un trait délicat, une finesse de causeur, un mot piquant.
Pour restituer à ces Nouvelles leur véritable caractère, il ne suffisait pas de les traduire plus exactement qu’au XVIe siècle, il fallait encore leur rendre le cadre dans lequel l’auteur les avait placées. Bayle, en excusant Boaistuan et Belleforest de leur mauvais style, déclarait ne pouvoir leur pardonner d’avoir ajouté, retranché, modifié mille choses, et surtout d’avoir supprimé les Dédicaces; elles font partie intégrante du récit et n’en peuvent être distraites sans amoindrir l’intérêt. «Les Épîtres qui précèdent les Nouvelles, et qui leur servent d’introduction ou de commentaire, nous font connaître», dit Ginguené, «l’origine, l’occasion, les circonstances, les témoins de l’événement, et même le but, toujours moral, que l’auteur se propose; quelquefois on y trouve un tableau des opinions, des mœurs du temps auquel se rapporte le sujet de la Nouvelle, ce qui la rend encore plus vraisemblable et plus intéressante. C’est ainsi qu’il trace à Lancino Curzio et à Bartolomeo Ferraro, philosophe et poète, le tableau le plus vrai et le plus affligeant des vices dominants des femmes et des hommes de son temps. Il nous parle des erreurs des Protestants, mais sans taire les vices des Catholiques, et surtout des ecclésiastiques, qui les ont occasionnées. Il cherche encore à rétablir le véritable caractère politique ou littéraire de certains personnages que l’histoire ou la tradition vulgaire avaient altéré.» (Histoire littéraire d’Italie, tome VIII.)
113 Depuis Boccace, les Conteurs se mettaient presque tous l’esprit à la torture pour relier entre eux leurs récits, les encadrer dans une fiction agréable qui leur donnât en outre quelque vraisemblance. Mais il était difficile de surpasser, ou même d’égaler cette poétique mise en scène du Décaméron, dont les contrastes produisent un effet si puissant; le mieux qu’on imagina, ce fut de l’imiter. Ser Giovanni Fiorentino, Mariconda, Parabosco se contentèrent de diviser leurs histoires par séries, qu’ils appelèrent des Journées, comme Boccace; en une seule Journée, bien remplie, Firenzuola fit tenir toutes sortes de dissertations amoureuses et une dizaine d’agréables Nouvelles; Grazzini, plus connu sous le nom de Lasca, imagina une suite de Soupers (Cene) où chaque convive tient le dé à son tour; chez Strapparola, ce sont des Nuits, ou plus exactement des Veillées; le prétexte des Cent Nouvelles de Giraldi Cinthio, c’est la retraite à Marseille d’un certain nombre de réfugiés du sac de Rome, qui trompent les ennuis de l’exil par d’amusantes causeries; Erizzo, dans ses Six Journées, nous présente une petite société d’étudiants de Padoue s’exerçant, sur des sujets d’histoire ancienne et moderne, à l’art de la parole. Aucune de ces fictions n’a d’intérêt, et Sacchetti avait été peut-être mieux avisé en s’en passant. Bandello ne voulut pas suivre la route commune; en faisant précéder chacune de ses Nouvelles d’une dédicace, il leur donnait à toutes un cadre particulier, ce qui est assez ingénieux, et, par la même occasion, se disculpait à l’avance du reproche qu’on pourrait lui faire de traiter des sujets déjà mis en œuvre par d’autres. Ce n’est jamais lui qui raconte; il n’a l’air que de servir de secrétaire 114 aux personnages qu’il désigne dans les Épîtres dédicatoires et de la bouche desquels il tient les détails, qu’il s’est borné, nous dit-il, à coucher sur le papier. Sa première Nouvelle, les Noces sanglantes (nous lui conservons ce titre, qui lui a été donné dans la présente traduction), se trouve presque mot pour mot dans Machiavel (Istorie Florentine, lib. II, 2 et 3); mais Bandello déclare l’avoir entendu raconter à l’Alamanni, qui peut-être la tenait de Machiavel; Luigi da Porto a le premier traité le sujet de Roméo et Juliette, mais Bandello nous le donne comme un récit que fit da Porto lui-même, en sa présence, aux bains de Caldiero; et ainsi des autres. Ces questions de priorité entre Conteurs n’ont, d’ailleurs, pas grand intérêt; un sujet maintes fois traité appartient, en définitive, à celui qui en a tiré le meilleur parti, et il convient de réserver l’accusation de plagiat aux véritables faits de piraterie, comme lorsque Brevio, un autre évêque, s’appropriait, sans y changer un mot, le Belphégor de Machiavel et l’insérait dans ses œuvres. Bandello, qui emprunte beaucoup aux uns et autres, y met toujours du sien, et quelquefois d’une façon assez amusante; ainsi, en reprenant un vieux fabliau Français, les Deux Changeurs (Legrand d’Aussy, tome IV), pour en tirer sa IIIe Nouvelle, il intervertit très judicieusement l’ordre des deux historiettes qui la composent, de façon à présenter le mauvais tour joué par Pompeio à Eleonora comme une revanche, tandis que le Changeur du fabliau, bafouant sa maîtresse sans provocation aucune, est assez odieux. Il ne se contente pas de cela, il nous fait sourire avec les précautions qu’il prend de ne pas désigner la ville où la scène se passe, de cacher les 115 noms des personnages, parce que, dit-il, s’expliquer plus au clair ce serait vouloir mettre l’épée à la main à nombre de ses amis. Les héros de l’aventure, si toutefois elle n’est pas tout à fait imaginaire, étaient morts depuis deux ou trois cents ans; mais le moyen de ne pas ajouter une foi entière à un homme si prudent et si scrupuleux!
Un autre reproche, qui lui a été adressé avec tout autant de raison que celui de plagiat, c’est d’avoir une sorte de préférence pour les contes licencieux; ses deux anciens imitateurs Français, qui ne voyaient chez lui qu’aventures tragiques, se seraient donc bien trompés! Apostolo Zeno va jusqu’à dire que «la liberté des tableaux, et même des expressions, dans ses Nouvelles, ne fait honneur ni au Religieux qui les a écrites, ni à l’Évêque qui les a publiées;» Corniani le vilipende en qualité d’apologiste des passions: Bandello se contente d’en être le peintre, un peintre d’un coloris souvent vigoureux, et c’est abuser de la plaisanterie que de lui reprocher de chercher l’émotion et l’intérêt là précisément où il a chance de les rencontrer, dans les passions. Les trois Vertus théologales sont de charmantes personnes, capables d’inspirer d’excellentes homélies, mais on n’en a que faire à moins qu’on ne rédige les Vies des Saints; tant qu’il y aura au monde des poètes, des conteurs et des romanciers, ils s’adresseront de préférence aux sept Péchés capitaux: voilà les Saints de leur calendrier.
Septembre 1879.

XIII
LES RAGIONAMENTI
OU DIALOGUES DE P. ARETINO[47]

Le Pornodidascalus du grave professeur Allemand Gaspard Barth, est comme on le sait, ou comme on ne le sait pas, la traduction Latine de l’un des célèbres Ragionamenti de Pietro Aretino: le troisième Dialogue de la première Partie. C’est un livre bien intéressant, quoique le Latin, composé, non sur le texte original, mais sur une version ou imitation Espagnole, ne puisse naturellement laisser apercevoir que par à peu 117 près, à travers un double voile, les mérites de l’ouvrage primitif. Ce Dialogue, qui traite de la Vie des Courtisanes, a toujours passé pour le plus curieux, sans que l’on sache au juste pourquoi, car les qualités qu’on lui trouve, les cinq autres Journées des Ragionamenti les ont absolument au même degré: c’est dans toutes la même verve endiablée, la même malignité d’observation et cette abondance de piquants détails, d’expressions pittoresques, de comparaisons singulières, cette extraordinaire variété de types pris sur le vif, de scènes caractéristiques, cette profusion de mots spirituels et de saillies d’une gaieté irrésistible, qui mettraient l’Arétin au rang des premiers écrivains et des meilleurs auteurs comiques, n’était sa mauvaise renommée.
Un jour que nous achevions la lecture du Pornodidascalus, l’envie nous prit de marcher sur les traces de Barth, de compléter son œuvre dans la même langue que lui, et de faire pour la Vie des Religieuses, la Vie des femmes mariées, l’Éducation de la Pippa, les Roueries des hommes et la Ruffianerie ce que le savant philologue avait fait pour la seule Vie des Courtisanes. Mais à mesure que nous avancions dans ce travail de Bénédictin, nous acquérions la certitude que le Diable n’est pas aussi noir qu’on veut bien le peindre; que ce qui nuit à l’Arétin, c’est moins ce qu’il est réellement, que ce qu’on le suppose être, d’après une multitude d’ordures éditées sous son nom; et nous remîmes l’ouvrage sur le métier, bien décidé à donner purement et simplement une traduction Française des six Journées. Cependant, pour ne pas tout perdre de cette version Latine qui nous avait donné beaucoup de mal, nous 118 en avons laissé subsister çà et là quelques bribes, un mot, un lambeau de phrase, parfois une phrase entière, selon l’occurrence, selon que la langue de Pétrone nous semblait plus apte que celle de Bossuet à rendre avec précision la pensée de l’auteur, à mieux exprimer certaines délicatesses, certaines particularités.
De quelque façon que l’on s’y prenne, et tout en usant avec lui des ressources de deux idiomes, l’Arétin n’est pas des plus aisés à traduire: il a, comme Rabelais, son émule, trop d’originalité pour n’être pas souvent obscur; mais l’Elzevier de Leyde ou d’Amsterdam qui le réimprima en 1660 donne aux Lecteurs deux excellents conseils, dont nous avons fait notre profit comme traducteur. Le premier, c’est d’user de patience, à l’égard des endroits difficiles, et de bien réfléchir dessus, jusqu’à ce qu’on les ait compris; le second, c’est de posséder un bon Dictionnaire et de s’en servir. L’Arétin, pas plus que nul autre auteur, ne résiste à l’emploi de ces deux judicieuses recettes. Nous ne nous flattons point cependant de n’avoir pas laissé échapper quelque finesse trop déliée, quelque allusion trop lointaine. «Ces dialogues sont d’une telle difficulté,» dit leur éditeur, «que bien peu de gens, même parmi les Italiens de nation, en saisissent le sens, ce qui m’a décidé de placer en marge quelques notes, afin d’élucider les passages les plus obscurs et de donner la vraie signification des vocables les moins usités.» Ces notes marginales sont malheureusement de peu de valeur et n’éclaircissent pas grand’chose; elles manquent, comme la plupart de celles des commentateurs, aux endroits où on les désirerait le plus. Ce que nous retiendrons encore de la 119 préface de cette édition, c’est l’appréciation suivante: «L’Arétin avait un tel talent pour traiter avec la plus exquise élégance n’importe quel sujet, qu’il en reçut le surnom de Divin; et, entre tous ses écrits, les plus dignes d’admiration et d’estime sont ses Capricieux et plaisants Ragionamenti. Capricieux[48], ils le sont, en vérité, et de façon que l’on s’étonne qu’un esprit de cette trempe se soit amusé à traiter de semblables sujets; mais ils sont encore plus plaisants, et si comiques, qu’il n’est pas possible de les lire sans se retenir d’éclater de rire et d’admirer.»
Ces éloges paraîtront sans doute bien hyperboliques à ceux qui ne connaissent l’Arétin que par ces opuscules sans goût, sans esprit et sans style, publiés sous son nom depuis deux ou trois cents ans. Mais quoi! si l’Arétin était le cynique et mauvais écrivain que l’on suppose d’après ces œuvres apocryphes, sans prendre la peine de le juger sur les siennes propres, Gaspard Barth, en le traduisant «pour l’édification de la jeunesse Allemande,» ne l’appellerait pas «l’éminemment 120 ingénieux et presque incomparable démonstrateur des vertus et des vices: ingeniosissimus et fere incomparabilis virtutum et vitiorum demonstrator;» tous ses contemporains ne l’eussent pas choyé, adulé à l’envi; des Rois, des Doges, des Cardinaux, des Princes, des grands seigneurs ne se seraient pas évertués à le combler de cadeaux; l’austère Michel-Ange n’aurait pas été son correspondant assidu; le Titien ne se serait pas laissé appeler par lui «mon compère», ni traiter si longtemps en hôte et commensal dans son splendide palais de Venise; il n’aurait pas fait dix fois son portrait ni chanté de si bon cœur Magnificat à sa table, en mangeant ses perdrix; un Pape ne se serait pas occupé de marier l’une de ses sœurs, un Médicis d’élever ses neveux; un autre Médicis, le chevaleresque Jean des Bandes noires, n’aurait pas tenu à l’avoir à son lit de mort, pour expirer entre ses bras; enfin l’Arioste, arrivé au bout de son long poème et feignant de voir, du haut du navire qui le ramène au port, tous ses amis rassemblés, pour lui faire fête, sur le rivage, n’aurait pas placé l’Arétin au milieu d’eux parmi les plus hautes illustrations de l’époque, et il ne s’écrierait pas avec joie en l’apercevant:
Octobre 1879.


XIV
ROLAND FURIEUX
POÈME DE L’ARIOSTE[49]

Traduire l’Arioste, suivre dans ses méandres cette infatigable et prestigieuse imagination, c’est un travail de plus d’attrait que de fatigue. Après le plaisir de créer et de douer de vie ses propres conceptions, plaisir qui doit être intense, mais qui n’est pas pour tout le monde à portée de la main, il n’en est peut-être pas de plus grand que de s’attacher à l’œuvre d’un tel maître, de la revivre, pour ainsi dire, avec lui, et d’essayer d’en donner une copie fidèle.
Cette tâche a séduit bien des gens de talent et de mérite, depuis le vieux Jehan des Gouttes qui, dès 122 1543, a montré à tous le chemin, jusqu’à MM. Du Pays, C. Hippeau et Marc Monnier, qui nous précèdent immédiatement. Dans l’intervalle, Mirabaud, Creuzé de Lesser, Duvau de Chavagne, le comte de Tressan, Delatour, Philippon de la Madelaine, Panckoucke et Framery, M. Desserteaux s’y sont exercés tour à tour, soit en vers, soit en prose, et y ont usé quelque chose de leur existence: car ce n’est pas une mince affaire que reprendre vers par vers un poème qui en compte cinquante mille, et il faut que le traducteur, en se mettant à une telle besogne, se sente soutenu d’un peu de cette foi qui, dit-on, transporte les montagnes. Chacun d’eux a cru faire mieux que ses devanciers: ce sera notre excuse d’être venu à leur suite, et si nous n’avons mieux fait, au moins aurons-nous fait autrement.
Des essais de traductions poétiques, le dernier, celui de M. Marc Monnier (le Roland de l’Arioste raconté en vers, 1878), est le plus agréable. En choisissant dans l’œuvre entière les épisodes qui lui convenaient, ceux où Roland est en scène, non pour les faire passer littéralement dans notre langue, mais pour en extraire le suc, en prendre la fleur, l’auteur, un homme d’esprit, qui parfois en prête même à l’Arioste, a mieux que tout autre réussi à rendre le génie du poète, sa libre allure, sa légèreté de touche et ce mélange d’enjouement et de sérieux qui est sa caractéristique. Le vers de dix pieds, substitué au monotone Alexandrin, la forme de la strophe, qui rappelle l’octave Italienne, font presque illusion. Mais c’est là un aimable et savant badinage inspiré par l’Arioste, plutôt que l’Arioste en personne; il y est trop vu en raccourci. Dans 123 le Roland furieux, Roland n’est, malgré le titre, qu’au second plan, et comme épopée, ce qui distingue celle-ci entre toutes, c’est qu’elle n’a ni action principale, ni héros qui prime ses voisins (si elle en avait un, ce serait Roger), ni but autre que d’enchanter et de divertir. Son intérêt est dans cette succession d’épisodes à peine reliés entre eux, dans ce chassé-croisé d’aventures et de personnages qui se cherchent, se rencontrent, se perdent, se retrouvent, au grand amusement du poète, qui n’a jamais assez de fils pour ourdir sa vaste toile, et du lecteur, qui ne se lasse pas de le suivre dans le libre champ de sa fantaisie.
Les traductions en prose, quoique généralement bien pâles et bien effacées, donneraient donc encore l’idée la plus vraie du poème, si elles n’avaient le grave défaut d’accréditer cet ancien préjugé, que traduction et ennui sont une seule et même chose sous deux noms différents. On a oublié celles de Mirabaud et du comte de Tressan; elles appartiennent à ce genre faux qui sacrifie au prétendu bon goût les comparaisons luxuriantes, les métaphores hardies, tout ce qui constitue le nerf, l’originalité du style, et les remplacent par de pauvres fleurs fanées de collège. Les plus récentes, d’un exact et consciencieux travail, restent encore bien loin de l’original, dont la poésie s’est comme évaporée dans le passage d’une langue à l’autre; aussi a-t-on été amené à les aider du secours de l’illustration, à faire disparaître le texte sous les images.
Nous n’avons pas voulu nous priver entièrement de ce précieux auxiliaire, mais sans lui donner une part prépondérante. En tête de chaque chant, de vieux 124 bois d’une ancienne édition de Venise[50], finement et savamment gravés à nouveau par M. A. Prunaire, ornent le texte sans l’absorber, sans faire passer la curiosité des yeux avant celle de l’esprit.
Au vers, qui impose toujours une gêne, qui force à des compromis et ne se pénètre plus intimement de la poésie du modèle qu’aux dépens de la littéralité; à la simple prose, muse pédestre, bien traînante et bien terre à terre pour suivre dans son vol le plus capricieux des poètes, nous avons préféré le système de traduction linéaire dont M. Léon de Wailly a donné dans son Robert Burns un excellent modèle, et qui se plie, comme le vers, aux inversions, aux tournures poétiques, aux hardiesses de langue, sans l’embarras du rythme, de la rime et de la césure. Une traduction n’est toujours qu’un reflet; Rollin disait: l’envers d’une tapisserie. Comparons celles qui sont obtenues par cette méthode à une image projetée dans l’eau et dont certains détails peuvent être affaiblis, mais qui conserve ses lignes et ses contours: le texte placé en regard aidera à la similitude. Arriver à ce que l’œuvre primitive se dessine aussi exactement dans la traduction qu’un objet placé devant un miroir, ce serait la perfection, et elle n’est pas de ce monde. Mais le lecteur a l’un à côté de l’autre le texte et sa reproduction; d’un seul coup d’œil il pourra rectifier celle-ci et lui 125 rendre ce qui lui manque, si le miroir est un peu terne, si l’image y a perdu quelqu’une de ses vives couleurs.
Septembre 1879.


XV
DES HERMAPHRODITS
PAR JACQUES DUVAL[51]

Le traité des Hermaphrodits, du vieux médecin Rouennais Jacques Duval, est depuis longtemps classé parmi ces livres curieux et rares que les bibliophiles aiment à posséder et peut-être à lire. La singularité du sujet, que personne encore n’avait étudié si à fond et que l’auteur sut étendre bien au-delà de ses limites naturelles, lui valut au XVIIe siècle une renommée assez grande; la bizarrerie et la naïveté du style, les étonnants développements donnés à certains détails 127 physiologiques, la lui ont conservée jusqu’à nos jours. Un médecin qui aujourd’hui reprendrait ce thème le traiterait sans doute autrement, sur des bases plus certaines et à l’aide d’observations mieux contrôlées; il ferait un livre plus scientifique, mais à coup sûr moins divertissant.
Jacques Duval n’est guère connu que par cet ouvrage. Il est en outre l’auteur d’une Hydrothérapeutique des fontaines médicinales nouvellement découvertes aux environs de Rouen, Rouen, 1603, in-8o; d’une Méthode nouvelle de guérir les catarrhes et toutes les maladies qui en dépendent, Rouen, 1611, in-8o; et d’une Réponse au discours fait par le sieur Riolan contre l’histoire de l’hermaphrodit de Rouen, Rouen, 1615, in-8o. On lui reproche généralement de s’être montré trop crédule, d’avoir accueilli sans examen quantité de fictions et de fables puériles, de faits controuvés et d’opinions ridicules. C’est la science incomplète et pédante de son temps qui en est cause; un des chapitres du livre, celui où il explique à l’un des Conseillers de la Cour les motifs de son rapport, dans la cause de ce fameux hermaphrodite de Rouen, rappelle étonnamment la phraséologie des médecins de Molière. En le lisant attentivement, on s’aperçoit d’ailleurs qu’il rejette au moins autant d’erreurs qu’il en admet et que, de celles qu’il adopte, la plupart ne lui appartiennent pas en propre: Cardan, Paracelse y avaient fait croire avant lui. Au point de vue historique, les extravagantes données sur lesquelles reposait l’ancienne médecine ont leur intérêt; elles font apprécier le chemin parcouru depuis et le génie persévérant de ceux qui osèrent rompre avec une routine 128 consacrée par tant de vieux textes, tant d’autorités en apparence si inébranlables.
La singulière occasion qui lui mit la plume à la main, montre précisément qu’il n’était pas l’esclave des sots préjugés de son époque. Un pauvre diable, victime d’un vice de conformation assez rare, après s’être cru longtemps femme et avoir passé la moitié de sa vie comme chambrière dans diverses maisons, s’aperçoit un beau jour qu’il a tout ce qu’il faut pour être homme; une jeune veuve qu’il courtise est de son avis et ne trouve aucune différence appréciable entre l’ex-chambrière et son défunt époux. Sa décision aurait dû suffire; mais l’Église, pas plus que les Parlements, n’était bien tendre pour les disgraciés de la nature, et les individus d’un sexe indécis se trouvaient spécialement voués à l’anathème comme fils ou suppôts de Satan. Riolan, médecin de Marie de Médicis, celui-là même à qui J. Duval adressa la Réponse citée plus haut, Riolan croyait être bien hardi en établissant que l’on peut se dispenser de faire périr les géants, les nains, les sexdigitaires, les individus à tête disproportionnée, et qu’il suffit de les reléguer loin de tous les regards: cela semblait une nouveauté bien paradoxale. Quand l’homme en question s’adressa, pour avoir dispense de se marier, au Pénitencier de Rouen, il fut déféré à Justice et le procureur du roi conclut bel et bien à ce qu’on le brûlât vif, sans autre information; tout ce que les juges purent faire, ce fut de commuer le bûcher en la potence. Cependant, le misérable en appela, la Cour ordonna qu’il serait examiné, chose que l’on avait négligée comme superflue, et, par bonheur pour lui, Jacques Duval fut un des dix 129 médecins, chirurgiens et sages-femmes jurées commis à cet effet. Tandis que tous ses confrères et les vieilles matrones elles-mêmes, arrêtés par une pudeur bien surprenante, se contentaient de regarder de loin le monstre et, ne voyant rien, déclaraient que le prétendu hermaphrodite était une ribaude bonne à pendre, Duval, plus entreprenant, mit les doigts où il fallait pour s’assurer de la vérité du fait, et se convainquit d’avoir affaire à un androgyne ou gunanthrope intermittent. Il ne put triompher de la répugnance de ses confrères, qui s’obstinèrent, malgré ses supplications, à garder leurs mains dans leurs poches; mais son rapport décida la Cour, qui renvoya l’hermaphrodite absous et lui permit plus tard d’épouser la veuve.
Fier, et à bon droit, d’un résultat pareil, Jacques Duval ne voulut pas en laisser périr la mémoire. Il composa donc tout exprès ce livre, pour lequel il colligea diligemment tous les exemples d’hermaphroditisme qu’il put rencontrer, tant dans la Fable que dans les auteurs, depuis Adam, qu’un verset de la Genèse dit avoir été créé homme et femme, jusqu’à Marin le Marcis, l’intéressant gunanthrope soumis à son examen. Cela le conduisit à parler d’autres monstruosités non moins curieuses: du noble Polonais à qui survint une dent d’or, de l’homme qui, à force de vivre dans les bois, se vit pousser des cornes de cerf sur la tête, de la jeune fille qui avait, au lieu d’ongles, des tuyaux de plumes de cygne, et d’une foule d’autres belles histoires. Pour se rendre compte de toutes ces anomalies, encore faut-il avoir quelques notions du corps humain à l’état normal et spécialement, pour le cas ambigu de Marin le Marcis, des parties destinées à 130 la génération chez l’homme et chez la femme; Duval exposa donc doctoralement tout ce que de son temps on savait là-dessus, et, comme la matière est intéressante, il y ajouta par surcroît quelques bons chapitres sur les signes de pucelage et les signes de défloration, la membrane hymen, le déduit vénérien, les grossesses, les accouchements, avec force recommandations à l’adresse des sages-femmes ignares et négligentes; il fit de son livre un traité presque complet d’anatomie et un manuel d’obstétrique. Enfin, ne voulant rien oublier, il chercha dans l’astrologie la cause efficiente des malheurs du pauvre gunanthrope et ne manqua pas de la trouver: le malin Mercure, la bénigne Vénus, le triste Saturne avaient coopéré à sa génération, ce qui explique tout, et les médecins, chirurgiens, sages-femmes, devaient fatalement balancer longtemps à reconnaître son sexe, puisqu’il était né sous le signe de la Balance!
Ces rêveries n’enlèvent rien à l’utilité que put avoir au XVIIe siècle le traité des Hermaphrodits et à l’intérêt qu’il a maintenant encore pour nous; au contraire, elles nous amusent. Le livre nous plairait toutefois davantage, si l’abondance et la confusion d’idées du savant ne faisaient quelque tort à la limpidité de l’écrivain. Jacques Duval commence une phrase avec la meilleure intention du monde, mais il a tant de choses à dire qu’il la perd tout de suite de vue et s’égare, sans l’achever souvent, dans un dédale d’incises et de parenthèses; rarement avons-nous rencontré style plus bizarre et plus embrouillé. N’importe; ce mauvais grammairien fut un brave homme. Sa physionomie, telle que la gravure nous l’a transmise, indique un 131 esprit réfléchi en même temps qu’un grand fonds de bonté; ce sont deux qualités louables, chez un médecin. Il a sauvé la vie d’un pauvre diable et écrit un livre curieux: en voilà assez pour que sa mémoire ne périsse pas complètement.
Juillet 1880.

XVI
LES NOUVELLES
DE BATACCHI[52]

Les renseignements biographiques font absolument défaut sur Batacchi. Quand nous aurons dit qu’il s’appelait Domenico, qu’il était né à Livourne en 1749 et qu’il mourut, on ne sait où, en 1802, nous aurons épuisé toute notre science et celle des Dictionnaires. Était-il évêque comme Bandello, moine comme Firenzuola, abbé comme Casti, ou simple séculier comme tout le monde? On l’ignore. Ses premiers Contes (Raccolta di Novelle, Londra, anno VI della Republica Francese, 4 vol. in-12) furent publiés, soit en France, soit en Italie, sous le nom du Père Atanasio de Verrocchio et traduits un peu plus tard en Français par Louet, de Chaumont: Nouvelles galantes et critiques, Paris, 1803, 4 vol. in-18. Cette traduction est si mauvaise que la 133 nôtre peut passer pour la première. Dans le préambule d’une de ces Nouvelles, Elvira, il est dit cependant que celle-ci doit être attribuée, non au P. Atanasio da Verrocchio, mais au P. Agapito da Ficheto: ce nous est tout un. Batacchi est, en outre, l’auteur de deux compositions poétiques de plus longue haleine: La Rete di Vulcano, poemo eroi-comico, Sienne, 1779 (1797) 2 vol. in-12, et Il Zibaldone, poemetto burlesco in dodici canti (Londres, 1798, in-8o).
Quel qu’il soit, Batacchi est tout entier dans ses Nouvelles, et notre traduction le fera suffisamment connaître aux lecteurs Français: il mérite de l’être. C’est un conteur jovial, plein de drôleries; le sans façon et la bonne humeur ne peuvent guère être poussés plus loin. Il ne recherche pas les effets de style et les complications d’événements, mais il a de l’invention, de l’originalité, une grande vivacité de dialogue, de mise en scène et, surtout, à un très haut point le sens du grotesque. On s’en aperçoit à la façon dont il comprend des sujets qui ont été traités par d’autres[53]. Son Prêtre Ulivo n’est que la légende, populaire chez nous, du Bonhomme Misère, que MM. Lemercier de Neuville et Champfleury ont reprise, après maints auteurs de contes et de fabliaux: la palme reste encore à Batacchi pour les détails plaisants. Elvira est l’antique 134 aventure de Combabus mise en vers; la Gageure a été traitée par Grécourt; le Faux Séraphin est une imitation burlesque de l’Ange Gabriel, de Boccace, et l’abbé Casti, qui a voulu aussi reprendre en vers ce joli conte du Décaméron, a été certainement moins heureux, moins original. A l’exemple des auteurs de poèmes chevaleresques, Pulci, l’Arioste, qui aiment à s’appuyer sur des chroniques imaginaires, principalement sur celle du fabuleux Turpin, Batacchi indique aussi les sources où il prétend avoir puisé; c’est tantôt le Turcellino, tantôt un vieux livre imprimé par Alde Manuce, tantôt Bellarmin, Turnèbe, Freinshemius, et ces graves autorités interviennent toujours, chez lui, d’une façon comique. Une autre bizarrerie de ces contes gais: les cocus ont une tendance fatale à se pendre; le malheureux tailleur du Roi Barbadicane et Grâce, le fermier Meo, de la Gageure, mettent fin par la corde à leurs infortunes conjugales; mais, chez Batacchi, la mort elle-même est ridicule.
Si l’on en croyait la Biographie Didot, les Italiens n’apprécieraient guère ce conteur, dont ils considéreraient les productions comme diffamatoires. Cependant, les Poèmes et les Nouvelles ont été plusieurs fois réimprimés et il en a été fait récemment plusieurs éditions populaires; ils ne sont donc pas si oubliés. Pour ce qui est de la diffamation, nous n’y avons rencontré que deux traits piquants à l’adresse d’un certain Cardinal Merciai: Batacchi lui fait rédiger et contresigner la facétieuse bulle Latine du Roi Barbadicane, et dans le Roi Grattafico, ayant à produire sur la scène un saucisson, il lui donne pour enveloppe un sonnet du même Merciai; ces mentions malicieuses n’ont rien de 135 bien méchant. Tout ce que nous conclurons de ces attaques persistantes dirigées contre un haut dignitaire de la Cour Romaine, c’est que Batacchi pourrait bien avoir été lui-même homme d’Église.
Août 1880.

XVII
LES NOUVELLES
DE L’ABBÉ CASTI[54]

Nous avons eu déjà l’occasion de dire un mot de l’abbé Casti et de son genre de talent poétique en présentant aux lecteurs de la Petite Collection Elzévirienne la traduction de la Papesse[55]. On trouvera, tant dans notre Avant-Propos que dans la Notice de Ginguené, dont nous l’avons fait suivre, des détails biographiques et des appréciations générales qui feraient ici double emploi. Bornons-nous donc à rappeler ce que sont les Nouvelles galantes et à caractériser brièvement leur mérite littéraire.
137 La plupart des Conteurs Italiens, Sacchetti, Bandello, Firenzuola, le Lasca, ont écrit en prose, à l’imitation de Boccace, dont le Décaméron semble leur avoir servi de règle et de modèle. Chez nous, au contraire, le conte est presque toujours rimé; nous avons suivi la voie ouverte par nos vieux auteurs de fabliaux. L’abbé Casti, qui vécut longtemps en France et à qui notre langue était plus ou moins familière, s’est approprié le goût Français. Le Conte en vers était, à la fin du XVIIIe siècle, une nouveauté pour les Italiens et, en essayant d’être le premier dans ce genre, où Batacchi seul, son contemporain, lui dispute la palme, Casti voulut aussi s’inspirer, au moins pour la forme, des poèmes chevaleresques; il choisit le mètre héroïque, la stance de huit vers à rimes croisées adoptée par le chantre de la Gerusalemme liberata et qui, par sa structure, par son ampleur, ne peut guère servir de moule qu’à une action suffisamment développée. C’est assez indiquer par quels côtés il s’éloigne de La Fontaine et de Grécourt, dont les récits ont une tournure bien plus brève et bien plus vive; les Nouvelles galantes sont toutes des compositions d’une certaine étendue se rapprochant beaucoup plus de l’épopée badine que du conte, tel que nous l’entendons.
Par leur cadre, par les sujets qui y sont traités, on peut les diviser en trois ou quatre catégories, parmi lesquelles nous n’avons pas fait porter indifféremment le choix que nous nous proposions de faire. Il y a d’abord les poèmes mythologiques; nous les avons écartés tous, si gracieux et si plaisants qu’ils soient le plus souvent; le goût n’est plus aujourd’hui à ce genre de compositions galantes que chez nous Parny 138 et Lemercier, dans ses Quatre Métamorphoses, ont pour ainsi dire épuisé. Viennent ensuite d’assez nombreux morceaux où l’auteur s’est proposé de reprendre à sa façon des sujets déjà mis en œuvre par Boccace ou par La Fontaine; le Rossignol, le Purgatoire, l’Ange Gabriel, la Jument du Compère Pierre, les Culottes de Saint François, etc.; mais ces deux maîtres ont imprimé à tout ce qu’ils ont touché une forme trop définitive pour que l’infériorité de l’abbé Casti ne soit pas manifeste, surtout à travers le voile d’une traduction.
Quant aux sujets historiques, il les a généralement traités d’une manière intéressante; l’Origine de Rome, l’Apothéose, où il retrace les infortunes conjugales de Marc-Aurèle, les Mystères surtout, qui ont pour objet la fameuse aventure de Claudius surpris avec la femme de Jules César, sont des poèmes fort remarquables; mais la Papesse peut donner une idée suffisante de l’art avec lequel il sait mêler l’enjouement aux choses sérieuses.
Nous avons choisi, entre toutes, celles de ses Nouvelles qui, par l’action comme par les détails, sont de sa propre invention, celles qui révèlent l’originalité du conteur et les mérites de l’écrivain. Casti est un abbé Voltairien; sceptique à l’endroit des choses de la foi, il manque rarement l’occasion de s’en moquer d’une façon légère et spirituelle; c’est aussi un poète dont l’imagination a de la fraîcheur et le style du coloris; un vieillard resté jeune, amoureux de la femme, dont il excelle à rendre le charme et les séductions; un satirique sans amertume, joignant à une grande finesse d’observation la bonhomie railleuse de l’Épicurien. 139 Les Nouvelles dont nous avons fait choix permettront d’apprécier quelques-unes des qualités de cet esprit aimable et enjoué.
Août 1880.


XVIII
LES NOUVELLES
DE FIRENZUOLA[56]

Firenzuola est plus qu’un conteur agréable: c’est un maître écrivain, qui met un style plein de nerf au service d’une imagination naturellement voluptueuse, et dont les peintures sont d’un coloris plein de vivacité. On l’a loué de ne pas s’en être tenu à la langue telle que l’avaient faite Dante, Boccace, Pétrarque, et d’avoir enrichi la sienne d’une foule de locutions pittoresques puisées aux sources vives, c’est-à-dire empruntées au parler populaire: à Florence comme à Paris, on entend plus de tropes un jour de marché qu’en plusieurs centaines de séances Académiques. Son œuvre, peu considérable, se compose 141 d’un recueil d’Apologues orientaux intitulé: Discorsi degli Animali; des Ragionamenti d’Amore; de deux Discours sur les beautés des Femmes; de deux comédies, La Trinuzia et I Lucidi; d’une traduction de l’Ane d’or, d’Apulée; de Poésies, parmi lesquelles figurent des Capitoli d’une touche légère, et de quelques opuscules. L’un d’eux, Expulsion des lettres nouvelles inutilement introduites dans la langue Toscane, est dirigé contre le Trissino, qui voulait augmenter l’alphabet de certaines lettres parasites, entre autres de l’oméga. Deux au moins de ces ouvrages ont été anciennement traduits en notre langue et paraissent avoir joui de quelque notoriété; les Discorsi degli Animali l’ont été une première fois par Gabriel Cottier, sous ce titre: Plaisant et facétieux Discours des Animaux, avec une histoire non moins véritable que plaisante advenue puis n’a guières en la ville de Florence, Lyon, 1556, in-16, et une seconde fois par Pierre de Larivey; ils font partie d’un traité intitulé: Deux livres de Philosophie fabuleuse, Lyon, 1579, in-16. Brantôme[57] connaissait les Discorsi delle bellezze delle Donne, au moins dans la traduction suivante: Discours de la Beauté des Dames, prins de l’Italien du seigneur Ange Firenzuole, par J. Pallet, Saintongeois, Paris, 1578, in-8o. L’Ane d’or offre cette particularité singulière que Firenzuola, se substituant au Lucius d’Apulée, s’est approprié non seulement 142 les inventions de l’auteur, mais les mésaventures du héros, qu’il prend pour son compte personnel, ce qui lui donne l’occasion de nous retracer, au début, un peu de sa biographie et la généalogie en règle de toute sa famille. Paul-Louis Courier, un fin connaisseur en ces matières, estimait fort cette traduction pour sa saveur légèrement archaïque. «Sans reproduire,» dit-il, «les phrases obscures, les termes oubliés de Fra Jacopone ou du Cavalcanti, Firenzuola emprunte du vieux Toscan une foule d’expressions naïves et charmantes, et sa version, où l’on peut dire que sont amassées toutes les fleurs de cet admirable langage, est, au sentiment de bien des gens, ce qu’il y a de plus achevé en prose Italienne.»
Les Ragionamenti d’Amore se recommandent par les mêmes agréments du style et, de plus, les Nouvelles auxquelles ils servent de cadre sont autant de petits chefs-d’œuvre de narration badine et de finesse spirituelle. C’est évidemment sa création la plus vivante, celle qui lui assure le plus de chance d’être connu et goûté hors de l’Italie. Cependant, ils n’ont jamais été traduits en Français, peut-être à cause de leur titre, qui ne promet pas grand intérêt, peut-être à cause des fadeurs alambiquées du préambule, qui laisse assez peu soupçonner combien l’auteur va déployer ensuite de hardiesse et de fantaisie. A l’imitation de Boccace, mais avec bien moins de charme, Firenzuola suppose qu’une société de jeunes dames et de galants cavaliers se trouve réunie dans une agréable villa; ils passent le temps en longues causeries qui rappellent, par leur objet, les abstractions quintessenciées des cours d’Amour, et, sur la fin de la journée, ayant choisi 143 une Reine, comme dans le Décaméron, ils se font à tour de rôle de joyeux récits où, par un piquant contraste, la Vénus céleste, si mystiquement exaltée durant les préliminaires, est sacrifiée sans la moindre hésitation à la Vénus terrestre. Peut-être est-ce une tournure symbolique adoptée par l’auteur pour nous faire comprendre que l’amour pur et idéal, excellent en paroles, dans la conversation, n’a plus aucun cours dans la vie réelle.
Si ingénieux que soit ce cadre, il n’a pas assez d’originalité pour que nous soyons forcé d’en tenir grand compte; nous avons donc négligé les discussions métaphysiques du commencement des Ragionamenti et traduit seulement les Nouvelles qui en forment la conclusion. Nous donnerons une idée suffisante de l’ensemble en disant que la scène est à Pozzolatico, près de Florence, dans le décor obligé de ces sortes de compositions semi-allégoriques: jardins en terrasse, fontaines jaillissantes, bocages ombreux, ruisseaux murmurants, prairies émaillées de fleurs, et que les interlocuteurs sont au nombre de six, trois gentilshommes: Celso, Folchetto, Selvaggio, et trois dames: Costanza Amaretta, Fioretta, Bianca. Celso, c’est Firenzuola lui-même; il a pris ce pseudonyme en maints autres de ses ouvrages; sous les noms de Fioretta et de Bianca, il paraît avoir désigné sa sœur et sa belle-sœur; sous celui de Folchetto, mari de Bianca, son propre frère, Girolamo Firenzuola. Quant à Costanza Amaretta, qui est prise pour Reine, c’était une Florentine de haute naissance, de grand esprit, que Firenzuola aimait d’amour tendre et qui mourut jeune, dans tout l’éclat de sa beauté. Il conserva pour 144 elle une sorte de culte et, dans son Epistola in lode delle Donne, adressée au savant Siennois Claudio Tolomei, après l’avoir mise pour les talents et la grâce sur le même rang que les plus illustres dont fasse mention l’histoire ancienne ou l’histoire moderne, Sapho, Aspasie, Cornélie, Calpurnia, Sempronia, la marquise de Pescaire, etc., il la compare, pour les vertus, à la Diotime de Platon, à Sainte Monique, mère de Saint Augustin. Mais, malgré l’auréole de chasteté dont il entoure pieusement sa figure, il ne laisse pas de lui faire écouter de la bonne oreille une suite de récits dont les principaux traits ne dépareraient ni le Moyen de parvenir, ni les Dames galantes de notre Brantôme.
On s’est demandé s’il était bien vrai, comme d’anciens titres le portent, que l’auteur de ces contes libres et de Capitoli qui ne le sont guère moins, eût jamais porté l’habit de Bénédictin. Tiraboschi en a douté sérieusement, par la raison convaincante que si Firenzuola eût été Moine, il aurait su imposer à son imagination une plus grande retenue. L’argument est plaisant; c’est comme si l’on disait que Rabelais n’a pas dû être curé de Meudon, puisqu’il a écrit Gargantua et Pantagruel. Firenzuola vécut et mourut Bénédictin. A la vérité, le chanoine Moreni a découvert dans le Bullarium Archiepiscopale de Florence un bref de Clément VII, à la date de 1526, annulant ses vœux monastiques, sous le prétexte que sa vêture et sa profession n’avaient pas été selon les règles; mais un autre acte bien postérieur, passé à Prato en 1539, nous montre «le Rév. Dom Angelus Florentiola, usufruitier et administrateur perpétuel de l’Abbaye San-Salvator 145 de Vaiano, de l’ordre de Vallombreuse,» constituer pour procureur du Couvent Girolamo Firenzuola, son frère. Il était donc toujours resté attaché à l’ordre, en dépit de ce bref d’annulation, qu’on ne sait comment expliquer. D’ailleurs, les Ragionamenti lui sont antérieurs; Firenzuola, qui n’a rien imprimé de son vivant, les dédiait en 1525 à la marquise de Camerino, et, bien mieux, il en avait lu la première Journée, la seule qu’il ait achevée, à Clément VII, qui s’en était montré fort satisfait. On possède à cet égard le propre témoignage de l’auteur: «Je veux,» dit-il dans une seconde Dédicace aux vertueuses dames de Prato, «je veux et je puis me vanter de ce que la judicieuse oreille de Clément septième, dont aucune plume, si bonne fût-elle, ne pourrait assez dire les louanges, en présence des plus grands esprits de l’Italie, resta grande ouverte nombre d’heures à écouter le son de ma propre voix, pendant que je lui faisais lecture du Discacciamento[58] et de la première Journée de ces Ragionamenti, que je venais de dédier à l’illustrissime signora Caterina Cibo, très honorable duchesse de Camerino.»
Ce souvenir lui rappelait le moment de sa plus haute faveur à la Cour pontificale. Touchons quelques mots de sa biographie. Il était né à Florence, en 1493, d’une famille originaire de Firenzuola, petit bourg situé au pied des Alpes, entre Florence et Bologne, dont ses ascendants avaient pris le nom. Son bisaïeul et son 146 grand-père occupaient des charges importantes dans la maison des Médicis; son père, Sebastiano Firenzuola, successivement juge et notaire public, remplit les fonctions de chancelier préposé à l’élection des magistrats de la ville. Sa mère était fille d’Alessandro Braccesi, estimable érudit, auteur d’une bonne traduction d’Appien, qui fut de plus premier secrétaire de la République sous les grands-ducs Laurent et Pierre de Médicis, et qui mourut à Rome, ambassadeur de Florence près d’Alexandre VI; Firenzuola lui fit élever un mausolée dans la basilique du couvent de Sainte-Praxède, dont il fut un moment Abbé. Destiné par sa famille aux charges ecclésiastiques, il alla étudier le droit canon à Sienne, puis à Pérouse, où il connut le fameux Pierre Arétin et noua avec lui des relations durables. Ces études lui répugnaient; il se plaint quelque part d’y avoir consumé à grand’peine et sans aucun plaisir la plus grande partie de sa jeunesse. Il parvint néanmoins au grade de docteur et se rendit aussitôt, vers 1516, à Rome, où il fut attaché à la Curie. Sous le pontificat de Clément VII, divers documents retrouvés par ses biographes le montrent chargé de défendre un certain nombre de causes, en qualité de procurateur, et revêtu en même temps des titres d’abbé de Sainte-Praxède et de Sainte-Marie-l’Hermite, de Spolète. Quoiqu’il n’eût rien fait imprimer, ses ouvrages manuscrits étaient assez répandus pour lui procurer une légitime notoriété; c’était en outre un homme d’humeur joviale, estimé pour l’aménité de son caractère. «Vous qui répandez l’allégresse dans les âmes de ceux qui vous pratiquent familièrement,» lui écrivait l’Arétin, «souvenez-vous que je vous ai connu 147 écolier à Pérouse, citoyen à Florence, prélat à Rome»[59]. Dans une autre lettre, il lui rappelle ses bons offices auprès du Pape. «J’ai encore mémoire», dit-il, «du grand plaisir qu’éprouva le Pape Clément, le soir que je le déterminai à lire ce que vous veniez de composer sur les Omégas du Trissino. Ce fut ce qui décida Sa Sainteté, en même temps que monseigneur Bembo, à vouloir vous connaître personnellement»[60]. On a vu plus haut Firenzuola lire au Pape non seulement sa spirituelle diatribe contre le Trissino, mais la première Journée des Ragionamenti; les Papes d’alors écoutaient des contes badins, assistaient aux représentations de la Mandragore, de Machiavel, ou de la Calandra, du Cardinal de Bibiena, et riaient comme de simples mortels.
La mort de Clément VII, en 1534, le dégoût que causaient à Firenzuola ses fonctions juridiques et surtout une fièvre pernicieuse, la fameuse fièvre des Marais Pontins, qui rend parfois le séjour de Rome très dangereux, lui firent abandonner la Curie. Il obtint l’abbaye de Vaiano, près de Crémone, mais séjourna surtout soit à Florence, soit à Prato, et essaya de rétablir, dans un air plus salubre, sa santé ruinée. La fièvre 148 fut longtemps à déguerpir; sept années entières elle le travailla, après l’avoir réduit à l’état de squelette:
Bref, il ne s’en débarrassa que grâce à la décoction de gaïac, le «saint bois» si célèbre au XVIe siècle pour ses vertus curatives; Firenzuola reconnaissant en a célébré les louanges dans un de ses meilleurs Capitoli, In lode del legno santo, auquel appartiennent les stances qui précèdent. Toutefois, sa mort, arrivée en 1544 ou 1545, suivit de près le rétablissement de sa santé; du moins eut-il, comme ce malade dont parlait un médecin facétieux, la consolation de mourir guéri. Il avait commis l’imprudence de retourner à Rome, et il fut enterré près de son père, dans l’église de son ancienne Abbaye de Sainte-Praxède.
Cette longue maladie est cause sans doute que les 149 Ragionamenti d’Amore, son œuvre capitale, restèrent inachevés. Ils furent publiés tels quels, avec quelques autres de ses ouvrages, par les soins de son frère Girolamo, sous le titre suivant: Prose di M. Agnolo Firenzuola, Florentino; in Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino, impressor ducale, 1552, in-8o. A la première Journée, composée des Entretiens préliminaires et de six Nouvelles, Firenzuola comptait en ajouter cinq, ordonnées sur le même plan. On retrouva plus tard dans ses papiers quatre autres Nouvelles, matériaux préparés d’avance pour une des Journées subséquentes; elles portent dans notre traduction les nos V, VI, VII et VIII. Nous les donnons toutes les dix, dans l’ordre adopté par les anciens éditeurs[61], qui modifièrent l’arrangement de Firenzuola pour faire entrer les dix récits dans le cadre d’une seule Journée. Tels qu’ils sont, ces contes plaisent par leur libre allure, leur ton enjoué, la perfection achevée de leur style, beaucoup plus que par les dissertations oiseuses et les conversations qui leur servent de transition ou d’entrée en matière; ils font vivement regretter que l’auteur n’ait pu en écrire davantage.
Janvier 1881.


XIX
LES HEURES PERDUES
D’UN CAVALIER FRANÇOIS[62]

Brantôme, entreprenant son long et mirifique Discours des Dames qui font l’amour et leurs maris cocus, craint de n’avoir jamais fini, s’il veut épuiser la matière, «car,» dit-il, «tout le papier de la Chambre des Comptes de Paris n’en sçauroit comprendre par escrit la moitié de leurs histoires, tant des hommes que des femmes.» Il déclare donc qu’il en écrira ce qu’il pourra et que, quand il n’en pourra plus, il quittera sa plume au Diable, ou à quelque bon compagnon qui la reprendra. Nous croirions volontiers que la plume du seigneur de Bourdeilles fut ramassée, non par le Diable, mais par le «Cavalier François», auteur 151 anonyme de ces Heures perdues. Ce recueil de vingt-sept Nouvelles, toutes très piquantes et lestement troussées (la XXVIIIe et la XXIXe sont absolument apocryphes), est une suite naturelle des Dames galantes, et l’auteur mérite on ne peut mieux cette qualification de bon compagnon que Brantôme donnait à son continuateur futur. Certainement aussi il dut connaître Brantôme et vivre dans le même milieu. Avait-il eu entre les mains quelque copie manuscrite du Second Livre des Dames qui, à la rigueur, pouvait circuler dès 1605 ou 1610? C’est plus douteux, quoiqu’une de ses Nouvelles (III, l’Heure du Berger) reproduise la seconde anecdote du 1er Discours des Dames galantes.
On ne sait pas qui était ce «Cavalier François»; il n’a livré aux curieux que ses initiales: R. D. M. Quérard et Barbier, qui ont usé leur vie à déjouer les supercheries littéraires, à deviner les anonymes et les pseudonymes, sont muets sur son chapitre; Brunet a cité l’ouvrage et ses diverses éditions, sans plus amples commentaires. Charles Nodier possédait les Heures perdues dans sa célèbre bibliothèque, où il n’admettait guère que des livres précieux à quelque titre; mais la notice qu’il leur a consacrée est assez insignifiante:
«Heures perdues..., etc.; 1662. Joli exemplaire d’un recueil de Nouvelles, dont quelques-unes sont écrites et contées d’une manière fort agréable. Je m’étonne que ce volume, qui n’est pas très rare, ait échappé aux recherches de nos faiseurs de feuilletons, qui ne seraient ni fâchés, je pense, ni embarrassés d’y trouver la matière de quelque bon roman qu’ils parviendraient sans peine, je m’en rapporte à eux, à délayer en une trentaine, peut-être même en une quarantaine 152 de chapitres. Je prends en conséquence la liberté de leur recommander ce joli recueil.»
Au lieu de se demander quel parti les romanciers pourraient bien tirer des Heures perdues, Nodier aurait mieux fait d’appliquer les ressources de son érudition à découvrir quel en est l’auteur. Un autre chercheur, Viollet-le-Duc, n’a pas été plus heureux. «Ce petit livre», dit-il, «est attribué par quelques biographes à Gayot de Pitaval, infatigable compilateur auquel on doit la Bibliothèque des gens de Cour, l’Esprit des conversations agréables et autres ouvrages de même sorte. Ce qui a causé cette erreur, c’est qu’en effet beaucoup des contes des Heures perdues ont été répétés par Gayot de Pitaval, qui en a volé bien d’autres; mais les Heures perdues sont imprimées en 1616 et Gayot de Pitaval n’est né qu’en 1673. La préface des Heures perdues, adressée: A la belle que j’aime mieux, ni que mon cœur ni que mes yeux, est signée R. D. M. Les contes sont nouveaux et assez piquants.» (Bibliographie des chansons, etc., p. 150). Viollet-le-Duc s’est mépris: ce que l’on attribue à Gayot de Pitaval, ce ne sont pas les Heures perdues d’un Cavalier François, ce sont les Heures perdues et divertissantes du Chevalier de R*** (Rior), Amsterdam, 1716, petit in-12, dont il paraît être réellement l’auteur, et s’il en a répété les contes autre part, il n’a fait que reprendre son bien. Ce recueil d’anas est postérieur d’un siècle entier au recueil de Nouvelles qui nous occupe. Charles Nodier et Viollet-le-Duc ne connaissaient de celui-ci que la réimpression de 1662, mais la première édition, 153 dont nous donnons le titre en fac-simile, est de 1616; Brunet en cite même une de 1615, qui est douteuse, du moins n’avons-nous pu nous la procurer. Les Heures perdues d’un Cavalier François ont été réimprimées à Lyon, Cl. Larjot, 1620, in-12; à Rouen, Jean Berthelin, 1629, petit in-12. L’édition de Paris, 1662, in-12, Jean Dehoury ou Estienne Maucroy, offre cette particularité qu’elle a deux Nouvelles de plus que les précédentes, ce qui la fait considérer comme seule complète; c’est une supercherie de libraire. L’auteur, mort et enterré depuis longtemps à cette date, selon toute apparence, ne songeait guère à augmenter son recueil. Nous les avons mises en appendice, comme manquant d’authenticité; elles ne sont, du reste, nullement dans le ton des autres.
Rien de tout cela ne nous dit quel pouvait être ce «Cavalier François». Les bibliographes ont trouvé la clef des anagrammes et des pseudonymes les plus rébarbatifs; ainsi nous lisions dernièrement dans un catalogue: L’Anti-Hermaphrodite, etc., par J. P. D. B. C. D. P. G. P. D. M. L. M. D. F. E. X.; eh bien, cet alphabet plus que complet a été déchiffré sans la moindre difficulté. Cette kyrielle de majuscules signifie: par Jonas Petit de Bertigny, ci-devant prévôt général provincial de Messieurs les Maréchaux de France en Xaintonge; et les trois petites initiales R. D. M., qui désignent un Raoul de Montdragon, ou un René de Maltravers quelconque, n’ont pas trouvé leur Œdipe! La plupart des conteurs anonymes se trahissent par quelque endroit; les personnages qu’ils mettent en scène sous de faux noms finissent par être devinés; le retour fréquent de certaines particularités 154 de temps et de lieux, les faits historiques, les circonstances connues auxquelles ils font allusion, permettent souvent de percer le voile. Mais le «Cavalier François» n’a aucune de ces échappées. On dirait que c’est chez lui parti pris, qu’il l’a fait exprès. Jamais il ne conte une aventure qui lui soit personnelle, jamais il ne précise assez la physionomie des personnages pour qu’on les reconnaisse avec certitude. Cependant, on peut rapprocher quelques indices qui mettront sur une bonne voie les Quérards de l’avenir.
L’époque à laquelle il prit la plume et rédigea ses Nouvelles peut être approximativement fixée aux dernières années du XVIe siècle. Dans la Xe, il parle des «travaux de ceste dernière guerre finie par la valeur extrême de ce généreux monarque Henry le Grand»; les débris de la Ligue, sous Mayenne et sous Joyeuse, firent leur soumission en 1596. Dans la XIXe, il fait mention du siège d’Amiens, puis rapporte à Philippe II une vieille anecdote Espagnole, qui se trouve racontée autrement dans le Moyen de parvenir; les termes dont il se sert: «le feu Roy Dom Philippes, dernier mort», font voir que ce monarque était récemment trépassé, et sa mort eut lieu en 1598. Cependant la XVIIIe qui commence ainsi: «Du règne du Roy Henry le Grand», autorise à croire qu’il a pu en écrire quelques-unes postérieurement à 1610, au moment de livrer le recueil à l’impression.
Les connaissances anatomiques dont il fait parade en un sujet très délicat (IV, Le Pucelage recousu), lorsqu’il énumère la série des ravages commis en certaine région, «la dame du milieu retirée, les barres froissées, la barbole abattue, le ponnant débiffé, le guillocquel 155 fendu, le guillemard eslargi, le halleron desmis», feraient de prime abord soupçonner un Médecin, caché sous ce masque de Cavalier, mais tout le reste sent trop son capitaine pour que cette supposition soit plausible[63]. La plupart de ses métaphores sont empruntées à l’art militaire, et chez lui ce langage coule de source. Ici, c’est un cavalier qui fait tant de rondes par nuit; là, un autre qui se dépite de n’avoir pas son pistolet chargé. L’amour est toute une stratégie: engager l’escarmouche, mettre l’épée à la main, reconnaître la forteresse, faire les approches, dresser les machines, pointer les pièces, envoyer des volées de canon, franchir la contrescarpe, combler le fossé, passer le retranchement, allumer la mèche, bouter le feu à la mine, se loger dans la place. Il emprunte aussi d’assez jolies figures à la marine: tendre les voiles, les cordages et le grand mât, entrer dans le havre, mouiller l’ancre. Mais ce qui dénote surtout le gentilhomme, c’est le mépris qu’il a pour les petites gens et les mésalliances. Il fait honte à ces nobles «qui apparient leurs filles en des familles plus basses, voire des plus viles, estant certain qu’il y aye du bien: n’important pas mesme que les races soient tarées, pourveu que la tare soit couverte avec force pistoles»; 156 ailleurs, il considère le sort malheureux de ceux qui se rendent, par mariage, serfs de personnes indignes de les approcher, et les prévient que le meilleur marché qu’ils auront de ces sortes d’unions, c’est de «porter le panache».
Ce «Cavalier François» était donc un bon gentilhomme, nourri dans le métier des armes et très fier de sa noblesse. Il devait avoir quelque charge à la Cour; la plupart des Contes qu’il rapporte se passent «en ceste ville de Paris», en une des rues ou bien en un des principaux logis «de ceste ville de Paris», et il parle continuellement de telle ou telle dame de «ceste Cour», de tel ou tel Prince dont il sait les aventures galantes. Peut-être était-il attaché, comme Brantôme, à Marguerite de Navarre, première femme de Henri IV. «Je cognois», dit-il, «une Princesse qui a tousjours esté tenue pour le plus bel esprit de son temps, la plus libérale qui aye régné devant elle; car tout son soing a esté et est encore d’employer tous ses biens à donner à ceux qui simpatisent le plus à son humeur... L’amour, le plus souvent, se plaisoit fort à sa compagnie.» Cela convient très bien à Marguerite. Dans cette hypothèse, le souvenir qu’un peu plus loin un de ses gentilshommes rappelle à la Princesse: «Ce que la fortune et le malheur vous avoit fait perdre par la mort d’une personne que vous aimiez...», se rapporterait à la Môle; enfin, la suite du conte (la Princesse fait coucher avec sa dame d’honneur ce gentilhomme, qui n’y pensoit pas précisément) est tout à fait dans l’humeur de la Reine Margot. Les fureteurs, qui ont exploré tous les coins et recoins des Mémoires du temps, nous diront peut-être aussi le nom de cette 157 dame de la Cour, dont les galanteries étaient célèbres sous Charles IX, qui avait quatre filles, aussi faciles que jolies, et dont la maison était une Académie amoureuse où allaient le Roi, les Princes et les plus grands seigneurs. Cette dame possédait un château en Touraine et en faisait, dans la belle saison, le rendez-vous «des plus galants et des mieux frisés de la Cour»; notre Cavalier en était assurément, et connaissait la maison par le menu, car il a consacré deux de ses Nouvelles (la IVe, Le Pucelage recousu, et la VIe, La Bonne Mère) à cette dame et à ses filles, «trois desquelles», dit-il, «furent mariées en des meilleures maisons du royaume, dans lesquelles elles n’entrèrent pas si neufves, qu’elles ne fussent capables d’enseigner leurs marys en ce qui despendoit de l’art qu’elles avoient appris sous l’aisle de leur mère». C’est peut-être encore la même dont la fille aînée, «en un canton de la Touraine», se fait donner l’Enseignement complet (Nouvelle X).
En dehors de ces personnalités, trop vaguement accusées pour qu’on en tire des déductions précises, et d’une certaine antipathie à l’encontre des gens de robe, auxquels il consacre huit ou dix contes, toujours pour en faire des maris ridicules, nous ne trouvons plus rien à signaler dans ces Heures perdues, sauf un rapprochement que tout le monde fera entre un passage de la XIe Nouvelle (L’Artifice amoureux) et quelques vers des Femmes savantes. «Anciennement», dit notre auteur, «les filles estoient nourries si grossièrement, que la pluspart ne sçavoient ny lire ny escrire, et ne vouloient leurs parens que leur jugement fust capable d’autre chose, que de sçavoir discerner le pourpoint 158 d’avec les chausses de leurs maris.» C’est ce que dit, dans les mêmes termes, le bonhomme Chrysale:
Molière avait-il lu ces Nouvelles? Cela ne nous étonnerait aucunement. Leurs quatre éditions, peut-être cinq, de 1615 à 1662, montrent qu’elles eurent une certaine vogue, dont profitèrent d’Ouville, qui intitula son recueil: Contes aux heures perdues du sr D’Ouville, et plus tard encore les Heures perdues du chevalier de Rior. D’Ouville est plus connu que le «Cavalier François». Cela tient à ce qu’il a beaucoup imité et que les annotateurs, toujours heureux d’étaler leur érudition, le citent cent fois à propos de tous les larcins qu’il a faits à Pogge, à Quevedo, à Solorzano, à ser Giovanni, à Strapparola, à Bandello, à Des Periers, aux conteurs de tous les temps et de tous les pays. Le Cavalier François n’a copié personne; il a tiré ses contes de son propre fonds, car si en deux ou trois endroits il se rencontre avec Brantôme et l’auteur du Moyen de parvenir, son récit même montre qu’il ne les a pas lus, mais qu’il recueille l’anecdote aux mêmes sources qu’eux, pour l’arranger à sa manière. Ses contes ont de l’originalité, de la nouveauté; tant pis pour lui: les annotateurs ne pourront le citer à l’occasion d’Ésope, de l’Hitopadesa, d’Abstemius, et il restera ignoré. Du moins le dernier éditeur de d’Ouville, M. P. Ristelhuber, aurait-il pu le mentionner au bas de la XLIIe Nouvelle de son Élite des Contes, pour laquelle 159 il n’indique aucune source et que d’Ouville a copiée honteusement, mot pour mot, dans les Heures perdues (VII, De la raison pertinente qu’une belle Dame donna de la cause du cocuage); le plagiaire en a tout pris, jusqu’au titre, sans rien déguiser. L’excuse de M. P. Ristelhuber, c’est qu’il ignorait, comme tout le monde, ce Cavalier François, dont nul n’a parlé, et que nous tirons de l’oubli injuste où il dort depuis plus de deux siècles.
Février 1881.


XX
LE HASARD
DU COIN DU FEU
PAR CRÉBILLON FILS[64]

On n’édite guère la Nuit et le Moment sans l’accompagner du Hasard du Coin du feu; ce sont deux compositions du même genre, qu’on ne sépare pas l’une de l’autre: elles sont destinées à se faire pendant, quoique écrites par l’auteur à près de dix ans de distance (1755-1763). Avec ces deux petits romans dialogués, on a, comme le dit très bien Ch. Monselet, le Théâtre complet de Crébillon fils. «Ne souriez pas,» ajoute-t-il, «ce théâtre-là en vaut bien d’autres. Dans la Nuit et le moment, il n’y a que deux personnages: Clitandre et Cidalise; la scène se passe au petit coucher de cette dernière. On assiste à un siège en règle: 161 quel tacticien que Crébillon! Ainsi qu’on le devine, la place est forcée de se rendre, et, au lendemain matin, Cidalise et Clitandre refont ensemble le lit. Tenez ce dialogue pour un chef-d’œuvre. Les personnages, dans le Hasard du coin du feu, sont au nombre de quatre: le Duc, la Marquise, Célie et La Tour, valet de chambre de Célie. Cette fois il s’agit d’une femme qui se laisse ravir insensiblement les dernières faveurs, sans avoir pu amener son vainqueur à lui dire ces trois mots indispensables: Je vous aime. Comme esprit, comme sous-entendus, comme peinture de mœurs, l’auteur tant vanté du Caprice n’a jamais fait aussi bien. Je dois avouer pourtant que la mise en scène des Proverbes de Crébillon offrirait plusieurs difficultés.» C’est aussi bien notre opinion; l’action, arrivée à une certaine phase, atteint un tel degré d’animation, que le public s’effaroucherait d’une mimique aussi expressive; mais à la lecture on est sous le charme, et le dénouement est si bien préparé, si finement gazé, que personne n’est tenté de jeter le holà.
Un petit point négligé par Ch. Monselet dans la rapidité de son appréciation: la Nuit et le Moment, c’est le siège d’une femme par un homme, avec toutes les roueries, toutes les feintes, toutes les hardiesses de la stratégie amoureuse; le Hasard du coin du feu développe les incidents de la situation contraire: le siège d’un homme par une femme. La stratégie opère en sens inverse et d’une façon peut-être plus délicate encore; car si l’homme ne craint guère de montrer à une femme qu’il la désire, la femme est naturellement plus réservée; son 162 rôle est d’amener tout doucement à ce qu’on s’aperçoive de ce qu’elle ne peut dire et, après être arrivée à son but, d’avoir encore l’air de se faire prier, ou de pousser les cris d’une pauvre victime prise de force. Crébillon a nuancé tout cela avec un art parfait. Célie est laissée seule, au coin du feu, en tête-à-tête avec le Duc, l’amant déclaré de son amie, la Marquise. Le Duc, un causeur étincelant d’esprit, effleure toutes sortes de sujets galants; Célie manœuvre pour faire prendre un tour plus intime à la conversation, qui tantôt s’éloigne, tantôt se rapproche du terrain sur lequel elle voudrait la fixer: une déclaration en bonne forme. Mais le Duc est trop attaché à la Marquise. Toutefois, il n’a pas la sottise de laisser échapper une occasion pareille, et l’originalité de la scène, c’est l’entêtement qu’il met à ne pas donner à Célie une satisfaction très mince, tout en l’accablant de protestations bien plus directes. Avec elle, il entend réduire l’amour à la formule de Chamfort: l’échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. C’était à peu près la formule de tout le monde, au XVIIIe siècle.
Avril 1881.

XXI
LES DIALOGUES
DE LUISA SIGEA[65]

La supercherie littéraire dont Chorier s’était avisé, pour se mettre à couvert, en attribuant ces Dialogues à Luisa Sigea de Tolède, dont le manuscrit perdu aurait été traduit en Latin par le savant Hollandais Meursius, n’a pas eu un succès de bien longue durée. L’opinion, un moment égarée, n’a pas tardé à faire 164 justice de l’assertion facétieuse qui prêtait à la vertueuse fille d’honneur de Dona Maria de Portugal une si vaste érudition en matière érotique[66]. On fut un peu plus longtemps à revenir sur le compte de Meursius et, en plein XVIIIe siècle, quelques critiques étrangers attribuaient encore l’Aloysia au laborieux érudit Hollandais. On songea aussi à Isaac Vossius et à Jean Westrène, jurisconsulte de La Haye; mais en France le jour était fait depuis longtemps sur cette question, et de son vivant même Chorier put voir que le masque derrière lequel il s’abritait ne tarderait pas à être arraché. Un passage de ses Mémoires, écrits en Latin, restés longtemps inédits et que la Société de Statistique de l’Isère s’est enfin décidée à publier dans son Bulletin (tome IV, 1846), le montre aux prises à ce sujet d’une manière assez violente avec l’Intendant de justice du Dauphiné, sur la dénonciation d’Étienne Le Camus, évêque de Grenoble.
«Je m’attirai la haine de Le Camus,» dit-il. «Vingt ans auparavant[67] la Satire d’Aloysia Sigea, écrite en Latin, d’un style élégant et fleuri, avait vu le jour. Lorsque tout d’abord elle tomba entre les mains des hommes, comme nul n’ignorait que je fusse savant en Latin, je ne sais quels lettrés me soupçonnèrent perfidement et injurieusement d’être l’auteur de cette 165 Satire. Aux yeux de Le Camus, qui veut du mal à tout le monde, sans aucun égard pour les mérites, un soupçon qui n’a pas la moindre importance tient d’ordinaire lieu de preuve complète. Il s’étonnait, disait-il, qu’un pareil livre eût pu être publié impunément; il me désignait tout haut, afin d’exciter contre moi la malveillance. Pour persuader à d’Herbigny[68] cette imposture, aussi éloignée de la vérité que les ténèbres le sont de la lumière, il remuait ciel et terre. Je fus trouver d’Herbigny, non pour m’excuser, mais pour repousser l’accusation. Tandis que je lui parle avec la liberté d’un honnête homme et d’un innocent, il m’échappe de lui dire que ceux qui m’accusaient avec tant de fausseté en avaient menti impudemment; je ne croyais pas le choquer en m’exprimant de la sorte. Mais indigné de ce que je ne tiens pas compte de son rang, il s’emporte et ne se contente pas de vociférer, il se met en rage contre moi avec d’autant plus de fureur que je m’efforçais plus soigneusement d’expliquer le mot. Que faire? je me retirai de sa présence. Georges Matelon, de Vienne, supérieur des Capucins de Grenoble, me rapporta du caractère de ces deux personnages beaucoup de traits qui adoucirent mon chagrin. Je me consolai par le témoignage de ma conscience; 166 ne me sentant coupable d’aucune faute, je n’avais à pâlir d’aucune»[69].
La conscience de Chorier était beaucoup moins nette qu’il ne se plaît à le dire, et si l’évêque ne put fournir contre lui, à cette époque, des preuves absolument convaincantes, Chorier nous en a laissé assez, dans ses Mémoires, dans la Préface d’une édition nouvelle de l’Aloysia (1678 ou 1679), dans son recueil de Poésies Latines publié à Grenoble en 1680, pour que nous soyons tout à fait édifiés. Les Mémoires, à côté de la dénégation intéressée qu’on vient de lire, contiennent cet aveu précieux, que Chorier, dans sa jeunesse, avait composé deux satires, l’une Ménippée, l’autre Sotadique. La satire Ménippée est perdue, mais la Sotadique est évidemment celle qu’il a publiée sous le nom de Luisa Sigea. Tout en niant comme un beau diable en être l’auteur, il n’était pas fâché de laisser à la postérité des indices auxquels elle pourrait reconnaître la véritable paternité de l’œuvre. Il en a encore fourni d’autres, avec une imprudence dans laquelle on peut très bien voir un calcul. L’édition de 1678 (ou 1679) renferme, outre un septième Dialogue resté vingt ans inédit, deux pièces de vers, De laudibus Aloysiæ et 167 Tuberonis Genethliacon, que Chorier a reconnues siennes en les insérant dans son recueil de Poésies de 1680. Cet indice a été relevé comme suffisamment probant par l’abbé d’Artigny, La Monnoye, Lancelot, etc.; il l’est bien davantage si l’on rapproche le Tuberonis Genethliacon de certain passage de la Préface où les mêmes invectives sont reproduites contre le personnage voilé sous le pseudonyme de Tubero, qui paraît avoir été un ennemi personnel de Chorier. L’importance de cette Préface (Summo viro Aloysia, ex Elysiis hortis) a échappé à tous les critiques; son examen aurait pourtant donné plus de certitude à leurs conjectures.
Si l’on pèse, en effet, avec quelque attention les raisons alléguées jusqu’ici pour faire de Chorier l’auteur incontestable de l’Aloysia, on s’aperçoit que tout ce dont il est atteint et convaincu, c’est d’avoir corrigé les épreuves des Dialogues, veillé à leur exécution typographique, reçu gratuitement un certain nombre d’exemplaires: les choses se seraient passées de même s’il n’eût été que l’éditeur de l’œuvre d’un autre; et, quant aux deux pièces de vers qui sont de lui, elles auraient pu être insérées sans son aveu. En même temps qu’ils ne trouvent contre Chorier que des présomptions si faibles, tous semblent s’être donné le mot pour prétendre que, dans ses autres ouvrages, l’avocat Dauphinois est entièrement dépourvu d’imagination et de style, que son Latin est lourd et pédantesque, sans aucune grâce. «Personne ne soupçonnait Chorier d’écrire si bien en Latin,» dit l’abbé d’Artigny. Les continuateurs de Moréri ont été plus loin encore, en raillant Guy Allard, qui trouvait aux vers de Chorier 168 de la saveur et de la pureté: «Cela fait bien peu d’honneur à son goût,» disaient-ils. Charles Nodier[70] s’est sans doute appuyé là-dessus pour émettre fort légèrement l’assertion suivante: «Je suis loin de défendre les mœurs de Chorier, qui lui ont probablement attiré cette méchante imputation» (d’avoir composé l’Aloysia), «mais je connais son style Français et Latin, qui met son innocence à l’abri de tout soupçon de ce genre. Chorier ne manquait pas d’instruction, mais ce serait se moquer que de chercher dans ses écrits de la verve et de l’éloquence, et ce sont les caractères distinctifs de la Latinité néologique et maniérée du faux Meursius.» Qui ne serait trompé, à une affirmation aussi nette? Une chose est cependant certaine pour nous, c’est que Nodier n’avait pas lu deux pages du Latin de Chorier; il s’est imaginé en avoir lu. Sans se livrer à de profondes études comparatives, on reconnaît à première vue dans les écrits Latins de Chorier, y compris l’Aloysia, les mêmes procédés de style, les mêmes tournures, les mêmes périodes Cicéroniennes, le même choix de mots. Si l’Aloysia se trouve avoir plus d’attraits que la Vie de Boissat, les Carmina ou les Mémoires, cela tient uniquement au sujet; l’écrivain, avec ses qualités et ses défauts, reste parfaitement identique à lui-même.
La première édition, parue, comme nous l’avons dit plus haut, vers 1658, ne contenait que six Dialogues: Velitatio, Tribadicon, Fabrica, Duellum, Libidines, Veneres; telle se présenta tout d’abord l’œuvre originale, 169 telle nous la reproduisons, au moins provisoirement. Ce n’est pas que nous contestions l’authenticité du Septième, intitulé Fescennini, que Chorier crut devoir ajouter à l’édition de 1678. Ce supplément, sans faire corps avec l’ouvrage et restant en dehors du plan primitif, est bien de la même main, et l’on pénètre sans difficulté le motif qui en a dicté la composition: il fut imaginé pour que l’on pût attribuer l’ouvrage avec une ombre de vraisemblance à Luisa Sigea, attribution à laquelle Chorier n’avait pas songé d’abord, et dont l’idée ne lui vint qu’après coup. La scène des six premiers Dialogues se place en Italie; les interlocuteurs sont tous des Italiens, des Italiennes; parmi les quelques comparses qui apparaissent çà et là se rencontrent un Français et un Allemand: d’Espagne et d’Espagnols, pas un mot. Il était bien peu naturel à Luisa Sigea de ne jamais parler ni de son pays, ni de ses amis et connaissances, dans une pareille étude de mœurs, où ce que l’on a sous les yeux est ce que l’on peint avec plus de précision. Le Septième Dialogue eut pour but de réparer cette inadvertance; quoique les interlocutrices, Tullia et Ottavia, restent les mêmes, la scène se trouve transportée en Espagne, sans que rien n’explique ce changement à vue, et les maris des deux héroïnes sont métamorphosés en Espagnols pur sang; s’ils ont un voyage à faire, ce n’est plus à Rome ou à Naples, comme dans les premiers Dialogues, c’est à Tarragone. Les anecdotes qui y sont contées fournissent au fameux Louis Vivès, contemporain de Luisa Sigea, l’occasion de jouer un certain rôle; Gonzalve de Cordoue figure à plusieurs reprises dans le récit; les noms des Ponce, des Guzman, des Albuquerque, des 170 Gomez, des Padilla, y reviennent continuellement. Sans doute Chorier avait l’intention de faire subir à tout le reste de l’ouvrage la même transposition de lieux et de personnages, puis il y aura renoncé. Tel qu’il est, ce Supplément se présente avec de nombreuses lacunes; des récits commencés, puis coupés par une interruption, ne sont pas repris: des pages entières manquent. On remarque aussi, entre cette partie et les premières, des contradictions bizarres. Chorier, qui avait peur d’être compromis, a dû laisser exprès imparfait cet appendice: il se réservait ainsi la possibilité de donner au manuscrit un air de vétusté qui le mettait personnellement à l’abri du soupçon. C’était un malin bien capable de prendre une précaution de ce genre, pour le cas où on l’inquiéterait. Ce septième Dialogue a d’ailleurs de l’intérêt, de la variété; les morceaux que l’auteur n’a pas négligé d’achever offrent des peintures d’un charme égal à celui qui est répandu à profusion dans tout le reste; peut-être le donnerons-nous plus tard sous le titre de Supplément.
Il nous faut dire un mot, en terminant, des traductions qui ont précédé celle-ci. La plus ancienne, Aloysia ou Entretiens académiques des dames, 1680, pet. in-12, réimprimée sous les deux titres suivants: Les Sept entretiens satyriques d’Aloysia, Cologne, 1681, et Aloisia ou l’Académie des dames en sept entretiens satyriques, augmentée de nouveau, Cologne, 1693 et 1700, in-12, passe pour être de l’avocat Nicolas, fils du libraire de Grenoble qui aurait édité l’ouvrage Latin[71]; 171 elle est très mauvaise. Celle que l’on réimprime encore en Belgique, le Meursius Français ou l’Académie des Dames, Amsterdam, 1788, 3 vol. in-18, est réputée meilleure; ce n’est cependant pas une traduction, c’est un travail à côté, fait sur le même sujet, avec des développements autres. Presque partout, le Traducteur a défiguré le dialogue au point de le rendre méconnaissable, intercalé des dissertations et réflexions ineptes, qui n’appartiennent qu’à lui, et des couplets ridicules où nage rime avec large, pour remplacer des citations d’Ovide ou de Lucrèce. Même lorsqu’il a la prétention de suivre le texte, il le paraphrase si lourdement que toute la grâce, toute la saveur de cette Latinité si élégante, si fleurie, se trouve noyée dans un verbiage insipide. Le début du Premier Entretien est, somme toute, la partie qu’il a traitée avec le plus de soin, celle où il s’écarte le moins du texte. La voici, pour qu’elle serve de point de comparaison:
Tullie. Bonjour, Octavie.
Octavie. Votre servante, ma cousine, je suis ravie de vous voir; je pensais présentement à vous.
Tullie. Je viens, ma très chère, me réjouir avec toi de la nouvelle que j’ai apprise de ton mariage avec Pamphile; je te jure, en amie, que j’y prends autant de part que si j’en devais partager le plaisir la première nuit de tes noces. Ah! mon enfant, que tu seras heureuse! Car ta beauté te rend digne des plus tendres caresses d’un mari.
Octavie. Je vous suis fort obligée, ma cousine, de la part 172 que vous prenez à mes intérêts; je n’attendais rien moins de votre amitié et je suis ravie que votre visite nous donne lieu de nous entretenir pleinement sur ce sujet. J’ai appris hier de ma mère que je n’avais plus que deux jours de terme; elle a déjà fait dresser un lit et préparé dans le plus bel appartement de notre maison une chambre et toutes les choses les plus nécessaires pour cette fête. Mais pour vous dire vrai, ma chère Tullie, tout cet appareil me donne plus de crainte qu’il ne me cause de joie, et je ne puis pas même concevoir le plaisir que vous dites que j’en dois recevoir.
Tullie. Ce n’est pas une chose fort surprenante qu’étant tendre et jeune comme tu es, car à peine as-tu atteint ta quinzième année, tu ignores des choses qui m’étaient entièrement inconnues quand je fus mariée, quoique je fusse un peu plus âgée que toi. Angélique me disait assez souvent que je goûterais les plaisirs du monde les plus délicieux; mais, hélas! mon ignorance me rendit insensible à toutes ses paroles.
Octavie. Vous me surprenez, Tullie, et j’ai de la peine à croire ce que vous voulez me persuader de votre ignorance; pensez-vous que je ne sache pas que vous avez toujours passé pour une des filles les plus éclairées de notre sexe? que vous vous êtes rendue savante dans l’histoire et dans les langues étrangères? et que j’ignore que la connaissance des choses les plus cachées de la nature n’a pu échapper à la vivacité de votre esprit?
Tullie. Il est vrai, Octavie, que j’ai une obligation bien particulière à mes parents de ce qu’ils m’ont élevée dans l’étude de tout ce qu’il y a de plus beau et de plus curieux à savoir. J’ai tâché aussi de répondre parfaitement à leur intention; car, bien loin de faire gloire de ma science et de ma beauté, selon la coutume de celles de notre sexe, j’ai évité le faste et la galanterie comme un écueil dangereux, et j’ai fait tous mes efforts pour acquérir seulement la réputation d’une fille sage et honnête.
173 Octavie. Ceux qui ne veulent point nous flatter disent qu’il n’y a rien de plus rare qu’une femme savante et éclairée qui se conserve dans les bornes de l’honnêteté. Il semble que plus nous recevons de lumière, moins nous avons de vertus, et je me souviens, Tullie, de vous avoir ouï faire des discours sur ce sujet qui ne se ressentaient point de l’affectation que vous venez de faire paraître en décrivant votre conduite. Car, parlons franchement, serait-il bien possible que votre beauté, qui est capable toute seule d’enflammer les cœurs, ne vous eût point fait naître d’occasions de divertissements auxquels vous n’avez pu résister? non, je ne puis me le persuader, puisque votre esprit même suffirait pour engager ceux qui seraient assez aveugles pour être insensibles aux traits de votre visage.
Tullie. Comment! Octavie, où est donc la simplicité de tantôt? Le nom de mariage te faisait peur, et tu parles à présent d’amour, de beauté et de divertissements. Tu sais ce que c’est que d’engager un cœur, et tu as l’esprit assez vif pour découvrir ce que je voulais te dissimuler. Je t’avouerai tout, puisque tu as été assez adroite pour pénétrer les sentiments de mon cœur, je ne veux plus faire de mystères avec toi, je te demande seulement une ingénuité pareille à la mienne et que la confidence que tu me donneras dans tes amitiés soit sincère.
Octavie. Ah! Tullie, qu’une fille amoureuse a de peine à cacher au dehors ce qui se passe au dedans d’elle-même! Vous avez beau déguiser vos paroles, je vois dans vos yeux les mouvements de votre âme, et la sympathie qui est entre ces deux parties m’en a fait connaître la vérité. Soyez donc une autre fois plus sincère et plus véritable, et n’abusez pas de la crédulité d’une jeune fille comme moi. Si vous le demandez, je vous ouvrirai mon cœur comme à ma plus intime; et afin que vous n’en doutiez pas, je vais vous en donner des preuves par le récit de ce qui s’est passé entre Pamphile et moi... etc., etc.
174 Si de temps à autre on ne rencontrait, comme point de repère, une phrase à peu près rendue, on croirait à peine que le Traducteur avait sous les yeux le même texte que nous. En poursuivant la lecture, on fait les découvertes les plus imprévues. A certain moment, Octavie interrompt le récit que lui fait Tullie en s’écriant: «C’est assurément qu’il avait le feu au derrière et qu’il ne pouvait l’éteindre que par son secours;» on cherche dans le Latin, et on s’aperçoit que cette gentillesse est toute de l’invention du Traducteur; Tullia poursuit son récit, sans qu’Ottavia l’interrompe. Dans le Colloquium IV, Ottavia suggère à Tullia cette objection: «Sed dixisti tunc non alte tibi infixum fuisse Calliæ mucronem?» Traduction: «Ah! le pauvre enfant, qu’il avait de peine!» On relèverait un millier de traits aussi réjouissants. Cependant ces inepties s’achètent, et ceux qui se les procurent à prix d’or s’imaginent savourer enfin le Meursius, ce livre si célèbre, le chef-d’œuvre du genre. C’est le cas de le répéter: il n’y a que la foi qui sauve.
Mai 1881.

XXII
MANUEL
D’ÉROTOLOGIE CLASSIQUE
PAR FRÉD.-CH. FORBERG[72]

L’éminent auteur de ce livre n’a pas beaucoup fait parler de lui; son nom est quelquefois cité, dans les Manuels et les Catalogues, à propos de l’Hermaphroditus d’Antonio Beccadelli, surnommé le Panormitain, qu’il a édité: Brunet, Charles Nodier, la Bibliographie des ouvrages relatifs aux femmes, à l’amour et au mariage, le mentionnent à cette occasion; la liste de ses ouvrages se trouve d’autre part dans l’Index locupletissimus librorum ou Bücher-Lexicon de Christian-Gottlob Kayser (Leipzig, 1834). Mais, sauf l’Allgemeine Deutsche 176 Biographie, que la Commission historique de l’Académie de Munich a commencé à publier en 1878 et qui lui a consacré une courte Notice, tous les Dictionnaires ou Recueils de Biographie ancienne et moderne sont muets à son égard; le Conversations-Lexicon et l’immense Encyclopédie de Ersch et Gruber n’ont pas une ligne pour lui: chez nous, Michaud, Didot, Bachelet et Dezobry, Bouillet, Vapereau, ignorent complètement son existence. Il vaut pourtant bien la peine qu’on en dise un mot ou deux.
Friedrich-Karl Forberg, né en 1770 à Meuselwitz (Duché de Saxe-Altenbourg), mort en 1848 à Hildburghausen, était un adepte et un collaborateur de Fichte; il s’occupa aussi d’exégèse religieuse, et fut surtout un philologue, un humaniste érudit et curieux. Il suivit d’abord la carrière universitaire; privat-docent en 1792, professeur-adjoint de Philosophie à la Faculté d’Iéna (1793), il fut nommé, en 1796, co-recteur à Saalfeld. Sa thèse inaugurale: Dissertatio inauguralis de æsthetica transcendentali, porte la date de 1792 (Iéna, in-8o); il la fit suivre d’un Traité des bases et des règles du libre-arbitre, en Allemand (Iéna, 1795, in-8o) et d’un Fragment tiré de mes papiers, en Allemand (1795). De 1796 à 1800, il contribua pour une large part à la défense des doctrines de Fichte dans les Journaux, les Revues, notamment le Magasin philosophique de Schmid, et dans diverses feuilles fondées par Fichte lui-même. Il publia en outre: Animadversiones in loca selecta Novi Testamenti (Saalfeld, 1798, in-4o); Apologie pour son prétendu athéisme, en Allemand (Gotha, 1799, 177 in-8o); Des devoirs des Savants, en Allemand (Gotha, 1801, in-8o), etc.
La seconde partie de sa carrière semble avoir été uniquement consacrée aux lettres. En 1807, il fut nommé conservateur de la Bibliothèque aulique, à Cobourg, et, philosophe désabusé, se voua décidément au culte de l’antiquité Latine et Grecque. Antérieurement déjà ses goûts s’étaient manifestés par de jolies éditions qu’il avait données de petits poètes érotiques Latins; elles forment une collection de six ou huit volumes tous imprimés en format in-16, avec des encadrements rouges, qu’il est fort difficile de se procurer. La découverte qu’il fit, dans la Bibliothèque de Cobourg, d’un manuscrit de l’Hermaphroditus du Panormitain, offrant des leçons et variantes précieuses, lui suggéra l’idée d’en donner une édition définitive, avec de copieux commentaires. Cet Hermaphroditus, ainsi intitulé «parce que», dit La Monnoye, «toutes les ordures touchant l’un et l’autre sexe font la matière du volume,» est un recueil d’épigrammes Latines farcies de centons de Virgile, d’Ovide, de Martial, où la mémoire a beaucoup plus de part que l’imagination et qui ne nous a jamais semblé avoir une grande valeur littéraire; mais les mésaventures du livre, autrefois brûlé, en manuscrit, sur les places publiques de Bologne, de Ferrare et de Milan, les anathèmes dont l’ont poursuivi quelques savants, la faveur que lui ont au contraire accordée certains autres, heureux sans doute du plaisir que peuvent causer de vieilles réminiscences, lui a valu une sorte de réputation. L’abbé Mercier de Saint-Léger l’édita le premier, à Paris, en compagnie de quatre autres 178 poètes du même genre: Ramusius de Rimini, Pacificus Maximus, Jovianus Pontanus et Jean Second[73]. Mais Forberg, tout en appréciant le travail et surtout l’audace de l’érudit Français, y trouvait beaucoup à reprendre: les Épigrammes du Panormitain ne portaient pas de numéros, ce qui rendait les citations difficiles; un grand nombre de leçons étaient fautives, et, grâce à son manuscrit, il pouvait les corriger; enfin, Mercier de Saint-Léger avait négligé de faire de son auteur un commentaire perpétuel, de l’éclairer au moyen de notes et de rapprochements, alors que, de l’avis de Forberg, un tel livre exigeait des notes par dizaines et par centaines, que chaque vers, chaque hémistiche, chaque mot offrait matière à des réflexions philosophiques, à des rapprochements d’un grand intérêt. Il reprit donc l’œuvre et se mit à colliger curieusement tout ce que les Anciens avaient pu écrire sur les matières scabreuses dont traite l’Hermaphroditus; mais, arrivé au bout de sa tâche, il s’aperçut que son Commentaire submergerait le livre, qu’à peine pourrait-il en donner un vers toutes les deux ou trois pages, le reste étant pris par ses Notes, et que ce serait un chaos à ne plus s’y reconnaître. Faisant de son travail deux parts, il laissa la moindre au bas de l’Hermaphroditus, réduit à n’être accompagné que des éclaircissements 179 les plus indispensables, et de la seconde, de sa plus copieuse moisson de recherches érudites, il composa un traité spécial qu’il fit imprimer à la suite, sous le titre d’Apophoreta, ou Second service, ce traité ne devant être, dans son intention, qu’une sorte de dessert après le repas substantiel fourni par le poète Latin du XVe siècle. Le tout forme un volume très recherché des amateurs: Antonii Panormitæ Hermaphroditus; primus in Germania edidit et Apophoreta adjecit Frid. Carol. Forbergius. Coburgi, sumtibus Meuseliorum, 1824, in-8o[74].
Le bon Forberg se trompait, par trop de modestie: le vrai repas substantiel, nourrissant, savoureux, c’est le sien, celui qu’il a tiré de son propre fonds, de son inépuisable mémoire et de la connaissance étonnante qu’il avait, jusque dans leurs infiniment petits détails, des auteurs Grecs et Latins. En réimprimant cet excellent travail, qui méritait assurément d’être traduit, nous lui avons donné un autre titre qui lui convient beaucoup mieux, celui de Manuel d’Érotologie classique. Par le charme, l’abondance, la variété des citations, c’est une précieuse Anthologie érotique; par la classification méthodique des matières, Forberg en a fait un ouvrage didactique, un véritable Manuel. Sa préoccupation première avait été de rassembler, chez les 180 Grecs et les Latins, le plus grand nombre des traits épars qui pouvaient servir de point de comparaison avec les Épigrammes de Beccadelli; en possession de tant de richesses, il a été amené à y introduire de l’ordre, à ranger les uns près des autres les textes similaires, et il s’est arrêté à une division en huit chapitres, répondant à autant de manifestations spéciales de la fantaisie amoureuse ou de ses dépravations. Dans chaque classe, il a encore trouvé à faire des subdivisions, comme le sujet le requérait, à noter des particularités, des individualités, et le contraste entre cet appareil scientifique et les facétieuses matières soumises aux lois rigoureuses de la déduction, de la démonstration, n’est pas ce qu’il y a de moins plaisant. Un grave savant d’outre-Rhin était peut-être seul capable d’avoir l’idée de classer ainsi par catégories, groupes, espèces, variétés, genres et sous-genres toutes les sortes connues de voluptés naturelles et extra-naturelles, d’après les auteurs les plus dignes de foi. Mais Forberg a poursuivi encore un autre but. Au cours de ses recherches, il avait remarqué combien les annotateurs et les interprètes sont en général sobres d’éclaircissements aux endroits qui en demanderaient davantage, les uns par une fausse retenue et de peur de se montrer trop savants, les autres par ignorance; combien aussi se sont trompés et ont commis d’insignes bévues, faute d’entendre la langue érotique et d’en saisir les nuances infinies. Le savant humaniste a précisément fait porter ses plus décisives observations sur ces endroits difficiles et obscurs des anciens poètes, sur ces locutions d’une ambiguité voulue, qui ont mis à la torture les critiques et fait se 181 fourvoyer les plus doctes. Ce qu’il a compulsé d’auteurs, tant Grecs que Latins, Français, Allemands, Anglais, Hollandais, pour établir son exacte et judicieuse classification, monte à un chiffre formidable; on trouve dans le Manuel d’Érotologie quelque chose comme cinq cents passages, empruntés à plus de cent cinquante ouvrages différents, tous contrôlés, expliqués, commentés, et, le plus souvent, de ténébreux qu’ils étaient, rendus la lucidité même par leur simple rapprochement. Avec Forberg pour guide, nul ne risque plus désormais de s’égarer, de croire, comme M. Leconte de Lisle, que cette femme dont Horace dit qu’elle ne change ni de costume ni de lieu, peccatve superne, «n’a pas failli outre mesure»; il s’agit bien de cela! ou de traduire, comme M. Nisard dans Suétone: illudere capiti alicujus, par: «attenter à la vie de quelqu’un».
Philosophe, Forberg a traité ces délicates matières en philosophe, c’est-à-dire d’une façon toute spéculative, en homme bien détaché des choses d’ici-bas et particulièrement des lubricités qu’il s’était donné la tâche de soumettre à un examen si attentif. Il déclare n’en rien savoir par lui-même, n’avoir jamais songé à s’en rendre compte expérimentalement, et n’en connaître que ce qu’en disent les livres. Sa candeur est à l’abri de tout soupçon. Elle ne lui a toutefois pas épargné les censures; mais, comme il a réplique à tout et des autorités pour tout, il y avait répondu d’avance par ce mot de Juste-Lipse, à qui l’on reprochait de se délecter aux turpitudes de Pétrone: «Les vins, quand on les pose sur la table, surexcitent l’ivrogne et laissent fort calme l’homme sobre; de 182 même, ces sortes de lectures échauffent peut-être une imagination déjà dépravée, mais elles ne font aucune impression sur un esprit chaste et tempérant.»
Octobre 1882.


XXIII
LA CAZZARIA
D’ANTONIO VIGNALE[75]

Tous les curieux connaissent, tome IV du Ménagiana, une longue lettre de La Monnoye dans laquelle cet intrépide érudit, ce fin connaisseur en tant de doctes matières, s’adressant plus spécialement «aux amateurs de la gaie littérature», recommande à un sien correspondant anonyme, alors en Italie, la recherche d’une notable quantité de manuscrits uniques, de livres introuvables ou rarissimes: les Centons de Lælius Capilupus; le Philelphe in-folio de l’an 1502; les Trecento Novelle de Franco Sacchetti, non encore imprimées, ce dont il s’émerveille; les Novellæ 184 Hieronymi Morlini, 1520, in-4o, avec privilège du Pape! le Petrus Delphinus de 1524, in-folio, etc. Arrivé aux Ragionamenti de P. Aretino, il pense qu’on doit en trouver assez facilement à Venise les plus anciennes éditions «prétendues faites à Turin, quoiqu’elles soient sûrement de Venise», dit-il, ce qui est vrai, et il ajoute:
«On trouve à la suite de la Première Partie un Dialogue merveilleux de l’Arsiccio Intronato. Vous en jugerez par le titre qui est la Καζζαρία. Un académicien Siénois, dont le vrai nom est Antonio Vignali de’ Buonagiunti, en est l’auteur. J’ai ce Dialogue manuscrit, et je voudrois bien avoir de même les sèze Sonnets que fit l’Arétin pour mettre au bas des figures gravées par Marc-Antoine, de Boulogne d’après les dessins de Jules Romain.»
En attendant les Sonnets, qu’il ne devait jamais réussir à se procurer, La Monnoye fut si charmé de la Cazzaria, ce «Dialogue merveilleux», qu’il le recopia diligemment et soigneusement, de sa minuscule écriture de savant habitué à ponctuer de pattes de mouche les marges des livres. Sa copie passa entre les mains de Charles Nodier, qui mit au-devant cette petite Note:
«S’il y a quelque chose de plus rare que la Cazzaria d’Antonio Vignale, c’est la copie de la Cazzaria faite de la main de La Monnoye. Je n’ai pas eu le choix entre le livre et le manuscrit, mais il me semble que j’aurais été fort embarrassé de choisir.»
Un simple regard jeté sur la Table des Matières justifiera aux yeux du lecteur intelligent l’estime toute 185 particulière que La Monnoye et Nodier faisaient de ce livre singulier, d’un esprit si fin, d’une érudition si peu commune. Nous n’avons chez nous que le Moyen de parvenir où des problèmes de même nature aient été abordés avec cet aplomb magistral. L’auteur connaissait-il la Cazzaria et s’en est-il inspiré? Quelques ressemblances ont pu le faire croire. Ainsi le conte des Trois Filles se trouve dans tous les deux (Cazzaria, voy. pag. 33 et 35, et Moyen de parvenir, chap. LXIII), avec quelques modifications toutefois, car, dans ce dernier, les trois filles sont trois Nonnes, et l’Abbesse vient les mettre d’accord en leur faisant part de sa propre expérience: au lieu d’un morceau à trois mains nous avons un morceau à quatre mains. Les motifs de la prééminence dont jouit ce que nos pères appelaient Messire Luc sont exposés dans le Moyen de parvenir, ch. XLI, à peu près comme dans la Cazzaria. Une autre question bien intéressante: Perche pisciando si tirin le coreggie, est aussi posée dans le Moyen de parvenir, chap. XL, mais il est donné du fait une tout autre raison; enfin, Béroalde de Verville revient à deux reprises, chap. LV et XCIV, sur le problème capital qui est le sujet même ou tout au moins le prétexte de la Cazzaria, savoir: Perche i coglioni non entrino...; il pose la question par deux fois et n’en indique aucune solution, quand il aurait pu satisfaire la curiosité du lecteur sans se mettre en frais d’invention, s’il avait lu la Cazzaria. Tout compte fait, les points de contact que présentent les deux ouvrages sont peut-être plutôt de simples rencontres que des emprunts, et pour l’ensemble, la forme, le style, on ne peut noter entre eux que des 186 dissemblances très accusées: autant le Moyen de parvenir, avec ses conversations à bâtons rompus, ses coq-à-l’âne perpétuels, est embrouillé, confus, d’une lecture pénible, malgré tous les bons mots, tous les jolis contes dont il est semé, et qui aident à digérer ce galimatias, autant la Cazzaria est claire, limpide, méthodique, écrite tout du long d’un style agréable et soigné, qui n’est pas sans avoir quelque prétention au style académique.
Ce fut peut-être le morceau de réception de son auteur, lorsque entre 1525 et 1530 il fonda dans sa ville natale, à Sienne, l’Académie des Intronati, c’est-à-dire des Stupides, des Hébétés, et y gagna haut la main le titre d’Archi-Intronato. Il y converse avec un autre académicien, le Sodo (Marcantonio Piccolomini), et mentionne un certain nombre de ses confrères, qu’il désigne seulement par leurs surnoms: le Musco, le Discreto, l’Importuno, le Folletico, l’Impassionato, l’Affumicato, le Svegliato, l’Ombroso, l’Accorto, le Circoloso, le Duro, le Caperchia, le Soppiatone, le Sosperone, etc.; comme il invoque leur témoignage sur quelques points controversés et rapporte leurs opinions, on peut conjecturer qu’ils s’occupaient assez ordinairement des matières traitées dans la Cazzaria, mais sauf l’Affumicato, le Svegliato et l’Ombroso, que l’on sait être le comte Achille d’Elci, Diomede Borghesi et Figliuccio Figliucci, ils sont tous parfaitement inconnus. Il en est de même du Bizarro et du Moscone, dont le premier est supposé écrire au second la jolie lettre qui sert d’introduction au volume.
Sans la Cazzaria, Vignale (ou Vignali) de’ Buonagiunti ne jouirait pas lui non plus d’une bien grande 187 notoriété. On ignore la date de sa naissance; et tout ce qu’on sait de lui, c’est qu’il mourut en 1559, banni de Sienne, et secrétaire du Cardinal Cristoforo Madrucci, gouverneur de Milan. Il n’a composé de plus qu’une comédie en prose, la Floria, imprimée après sa mort, en 1560, et très rare (Fontanini et Apostolo Zeno la disent extrêmement licencieuse), et une Lettre sur les proverbes à double sens (Alcune Lettere piacevoli, una dell’Arsiccio Intronato [Antonio Vignale] in proverbj, e l’altre di Alessandro Marzj, Sienne, 1587, in-4o). Cette faible contribution à l’éclat littéraire de l’Italie n’aurait guère attiré sur lui les regards de la postérité: il doit uniquement de se survivre au Dialogue fescennin, comme l’appelle Apostolo Zeno, que nous réimprimons et dont nous avons essayé de faire passer dans notre langue les spirituelles excentricités.
Les bibliographes mentionnent quatre anciennes éditions, toutes sans date, de la Cazzaria, et aujourd’hui introuvables[76]. Le libraire Molini prétendait en avoir vu une imprimée à Venise, en caractères Italiques, et portant la date de 1531. C’est en effet vers cette époque qu’elle dut paraître. Dans sa Priapea, imprimée en 1541, Niccolo Franco prête ces paroles à l’auteur, dédiant son livre au Dieu des jardins:
Ce scélérat de Franco, bien digne de la potence au bout de laquelle un pape l’envoya faire sa dernière grimace, calomnie là gratuitement son ancien bienfaiteur, mais son témoignage ne nous en sert pas moins à savoir qu’antérieurement à 1541 le chef-d’œuvre d’Antonio Vignale jouissait déjà d’une grande réputation.
Il existe deux imitations en vers de la Cazzaria; l’une est un petit poème en octaves, de dix-huit stances, portant le même titre et que nous ne citons que d’après les bibliographes, n’ayant pas pu nous le procurer; l’autre est le Libro del perchè, dont les éditions sont très nombreuses. Des trois Chants ou Novelle qui forment l’ensemble de ce second poème, le dernier n’a rien à voir avec la Cazzaria, mais le premier, Perchè non si trovino cazzi molti grossi nè potte molto strette, con molti altri perchè, Istoria poetica, fisica e 189 morale, cavata dal Libro del perchè del grand’Aristotele, n’est qu’une versification élégante d’un des principaux épisodes du Dialogue, l’horrible guerre cazzicide dont l’Arsiccio entame le récit page 147 de la présente traduction, et qui est fort probablement une plaisante allégorie des dissensions intestines de Sienne, dissensions qui, pour Antonio Vignale, aboutirent à l’exil; sous les noms de Cazzone, d’Abbagio, de Cazzocchio et de Cazzetto, il raille sans doute les principaux personnages politiques de son temps, et, dans la grande conspiration des piccioli cazzi contre les cazzi grossi, il n’est pas difficile de voir clairement symbolisée une lutte du parti populaire contre le parti aristocratique. La deuxième Nouvelle, Perchè gli uomini e le donne si sforzino di chiavare anco di là dal loro potere, e perchè vi si ajutino e vi si eccitino gli uni gli altri; Novella cavata dal Libro del perchè del grand’ Aristotele, est également empruntée à la Cazzaria; c’est le récit de l’ambassade envoyée par les femmes à Jupiter (voy. p. 91 et suiv.) pour qu’il améliore leur condition. Il y a beaucoup d’esprit, d’ingéniosité dans ce Libro del perchè dont les vers rappellent la facture aisée de nos meilleurs petits poètes du XVIIIe siècle, mais toute l’invention et les traits les plus heureux appartiennent à Antonio Vignale.
Décembre 1882.


XXIV
LE SONGE
DE POLIPHILE[77]

L’Hypnerotomachia Poliphili, ou Songe de Poliphile, est un livre célèbre entre tous, fort recherché des amateurs, au moins dans sa première édition, donnée par Alde Manuce en 1499, et qui est plus rare qu’un corbeau blanc, albo corvo rarior, dit Charles Nodier. Les cent soixante-cinq figures sur bois dont un maître inconnu, G. Bellini peut-être, à moins que ce ne soit Mantegna, Carpaccio ou Sperandio, un habile graveur en médailles, l’a illustrée, en font une des merveilles de la Renaissance; mais ces figures lui donnent seules le prix élevé de deux ou trois mille francs qu’elle a 191 quelquefois atteint dans les ventes, car depuis longtemps le texte est réputé tout à fait illisible. Une traduction Française en parut en 1545, chez Jacques Kerver, in-folio; elle est très défectueuse; le traducteur a retranché, sous prétexte de longueurs et de fatras pédantesque, tout ce qu’il n’entendait pas, et il n’entendait presque rien. Son travail, tout informe qu’il est, a cependant eu trois éditions, grâce encore à la beauté des gravures, supérieures à celles de l’édition Aldine, qu’elles reproduisent avec une certaine liberté d’interprétation et une conformité plus grande aux indications du texte. Une seconde traduction Française porte le nom de Béroalde de Verville; c’est la même, avec les mêmes bois, mais frustes et usés, sous ce titre: Tableau des riches inventions, couvert du voile des feintes amoureuses qui sont dans le Songe de Poliphile; Béroalde s’est imaginé que l’auteur avait caché là le secret de la pierre philosophale, ce qu’il explique dans une longue et confuse préface, et il a fait composer tout exprès un frontispice extravagant, formé de tous les emblèmes de l’alchimie, de la magie et de l’astronomie. Nous ne mentionnerons que pour mémoire une troisième traduction, celle de M. J.-G. Legrand, architecte (Le Songe de Poliphile, Paris, Didot aîné, 1804, 2 vol. gr. in-18); elle est encore plus écourtée que les précédentes, quoique l’auteur ait fait de son mieux. «J’ai beaucoup retranché du texte,» dit-il, «et quelquefois même je me suis permis d’ajouter et d’étendre ce qu’une idée originale m’inspirait.» A ce compte, ce n’est plus le Songe de Poliphile, c’est le songe de M. Legrand.
Une traduction véritable, d’une littéralité absolue et permettant de juger dans son entier l’œuvre du P. 192 Colonna, restait à faire; l’entreprise a tenté M. Claudius Popelin, et il ne s’est pas laissé décourager par le renom d’impénétrabilité dont jouissait le style de ce moine près de tous ceux qui disaient avoir essayé de l’aborder. La bizarrerie du livre, l’énigme que l’auteur semble avoir voulu proposer à ses lecteurs en les emmenant à la poursuite de sa mystérieuse Polia[78], en déroulant sous leurs yeux une série de visions fantasmagoriques où il a renfermé tout ce qu’il avait pu s’assimiler de savoir humain, pour l’appliquer aux arts plastiques, spécialement à l’architecture et à la statuaire, ont en effet exercé la sagacité de beaucoup d’érudits. Mais quoique Vossius, Casaubon, Baillet, Bayle, Félibien, Ginguené, Fontanini, Apostolo Zeno et bien d’autres aient parlé plus ou moins longuement du Poliphile, que La Monnoye lui ait consacré une notice de quinze ou seize pages, qu’enfin Charles Nodier l’ait pris pour thème d’une de ces fantaisies bibliographiques auxquelles il excellait, nous soupçonnons fort M. Claudius Popelin d’être le premier qui ait eu la conscience de le lire d’un bout à l’autre, avec l’intention bien arrêtée de le comprendre. Tous ces savants, les traducteurs eux-mêmes, se sont arrêtés à la surface de l’œuvre sans jamais la pénétrer, chose qu’ils déclaraient d’ailleurs impossible, et ils ont borné leur ambition à en signaler les principales singularités. La première édition est-elle de Trévise, 1467, ou de Venise, 1499? Quel est celui qui a découvert le nom de l’auteur, 193 caché dans l’acrostiche que forment les lettres initiales des trente-huit chapitres: POLIAM FRATER FRANCISCVS COLVMNA PERAMAVIT? Polia était-elle une religieuse, une patricienne, ou bien est-ce une simple allégorie? Francisco Colonna se fit-il moine de désespoir? Telles sont les menues questions de détail qu’ils traitent et résolvent en sens divers, d’accord seulement sur un point: à savoir, qu’on ne peut tenter la lecture du Poliphile à moins d’être un polyglotte émérite. «Il est besoin, pour bien l’entendre, du Grec, du Latin, du Toscan et du langage vulgaire», s’était contenté de dire Leonardo Crasso, protonotaire apostolique à Venise, qui fit les frais de l’édition d’Alde et la dédia au duc d’Urbin. Fontanini ajoute qu’il faudrait de plus connaître le Chaldéen, l’Hébreu, l’Arabe, et tout le monde a répété cette effrayante assertion. D’une phrase de l’épître liminaire adressée par Poliphile à Polia: «Je soumets l’œuvre suivante à ton intelligent et ingénieux jugement, renonçant au style primitif (lasciando il principiato stilo), pour le traduire à ton instance en celui-ci,» on a tiré avec la même unanimité les conclusions les plus singulières et tout aussi fausses. «Cette épître,» dit Bernard de La Monnoye, «sert à nous instruire d’une circonstance assez curieuse, qui est que François Colonne, dont la diction en cet ouvrage est si extraordinaire, l’avoit d’abord commencé dans un langage clair et usité, mais qu’à la prière de sa maîtresse il avoit changé de style, traduisant ses expressions de claires et simples en obscures et affectées, jusqu’à se rendre presque inintelligible. D’où je présume que cette Polia étoit une fausse savante qui donnoit dans le pédantisme, ou qu’ayant honte d’avoir un moine pour 194 galant, elle l’avoit engagé à dérober sous le voile du galimatias l’histoire de leurs amours à la connoissance du vulgaire. Quoi qu’il en soit, il répondit parfaitement bien à ce qu’elle souhaitoit de lui. Son jargon fut monstrueux et son livre un tissu de chimères à perte de vue.» Le lambeau de phrase visé par La Monnoye, et dont il déduit tant de choses plaisantes, doit être interprété tout autrement: La Monnoye fait dire à ce pauvre Colonna ce qu’il n’a jamais eu envie de dire, et l’erreur s’est d’autant mieux accréditée que l’on croyait tenir un aveu de l’auteur lui-même.
La langue dans laquelle Colonna avait commencé à écrire son livre, c’était le Latin, seul usité alors des savants. Pour mettre ses idées et ses conceptions plus à portée, il y renonça en faveur de l’idiome Lombard, parlé dans le nord de l’Italie; mais il se réserva d’emprunter au Latin, qui lui était encore plus familier, un certain nombre de formes, et dériva du Grec les termes composés dont il avait besoin: voilà à quoi se réduit son jargon monstrueux, si on l’examine d’un peu près. L’Arabe, l’Hébreu, le Chaldéen, ne figurent que dans des inscriptions, et toujours doublement expliqués, en Latin et en Grec; ils n’entravent donc pas la lecture du texte, que rendent surtout difficile à déchiffrer les abréviations, une ponctuation défectueuse et d’innombrables fautes typographiques. C’est déjà bien assez. La diction extraordinaire du P. Colonna, clarifiée dans l’exacte traduction de M. Cl. Popelin, est, en somme, une prose élégante et rythmée, fleurie outre mesure, surchargée d’une profusion de richesses et d’ornements; elle devait déplaire, comme tout ce qui est complexe et recherché, aux sobres écrivains du XVIIe siècle; elle 195 ne nous semble pas, à nous, si méprisable. Quant au poème, il n’est ni plus ennuyeux ni plus extravagant que bien d’autres de la même époque: un rêve avec ses incohérences et ses changements à vue était, au contraire, un cadre parfaitement approprié aux étonnantes conceptions du P. Colonna. Essayons d’en donner une idée, ce qui nous permettra de faire passer sous les yeux de nos lecteurs quelques-unes des gravures tirées des deux luxueux volumes, véritables objets d’art, que M. Isidore Liseux achève en ce moment de publier[79]. Ces gravures ont ceci de particulier, qu’elles sont comme le produit d’une double collaboration, à quarante-cinq ans d’intervalle. Le maître Italien de la fin du XVe siècle, l’illustrateur de l’édition Aldine, n’a guère eu que le mérite de l’invention; il n’a fourni que l’ébauche, l’indication de la ligne et du mouvement, et il a même commis une sorte de contresens dans ces formes courtes et ramassées, ces tournures épaisses et hommasses dont il a gratifié tous ses personnages. Le graveur français qui travaillait un demi-siècle après pour Jacques Kerver a non seulement terminé l’esquisse, mais il a modifié l’ensemble de la façon la plus heureuse, en donnant aux figures, par un allongement gracieux, une sveltesse, une légèreté qui sied à ces créatures aériennes, à ces filles du rêve et de l’imagination.
Après une nuit d’insomnie, hantée de la vision de 196 Polia, «objet non mortel, mais tout divin», Poliphile s’endort au lever du soleil et se voit aussitôt transporté dans une prairie où règne un silence absolu. A la lisière est une forêt ténébreuse; il y pénètre et s’y égare, en proie tantôt à une soif brûlante, qu’il désaltère au courant des ruisseaux, tantôt obsédé de la terreur des bêtes fauves qui ne vont pas manquer de l’assaillir. Puis il lui semble s’endormir, et, nouveau songe intercalé dans un songe, il est transporté bien loin de la forêt dans un pays inconnu. Entre deux collines, une immense construction à demi ruinée, en marbre de Paros, attire ses regards; il s’approche, examine ces débris qui couvriraient l’emplacement d’une grande ville, et décrit les principaux: une colonnade aux fûts gigantesques, encore debout, une porte monumentale bâtie sous une pyramide, un cheval ailé autour duquel grimpent et tombent des enfants; un éléphant surmonté d’un obélisque, un colosse de bronze couché, dans l’intérieur duquel il voit avec stupéfaction, en y pénétrant par la bouche et en suivant un escalier taillé dans la gorge, qu’on a reproduit tout l’organisme interne du corps humain. L’étrangeté de ces ruines, c’est qu’elles ont les dimensions énormes des édifices Égyptiens et les heureuses proportions de l’art Grec. Aussi Poliphile, qui les mesure comme s’il avait le compas en main, en fait-il admirer l’eurythmie, la symétrie parfaite: c’est un rêve de Pharaon exécuté en imagination par des Phidias. Il y a encore une multitude de stèles, de socles, de mosaïques, de bas-reliefs, de sarcophages surmontés de statues qu’il examine curieusement et dont il relève avec soin les inscriptions, les hiéroglyphes. Plus il s’avance, plus il 197 découvre de merveilles. Cette longue description, hérissée de détails techniques et nécessairement arides, est coupée par l’apparition d’un dragon monstrueux, seul habitant de ces ruines, qui le force à s’enfoncer par des escaliers et des corridors obscurs dans ce qu’il croit être les entrailles de la terre.
Sorti des ténèbres et rendu à la clarté du jour, il est accueilli par une troupe de nymphes couronnées de myrtes sur leurs cheveux bouclés, vêtues de tuniques légères qui laissent voir leurs jambes rondes et ivoirines, chaussées de sandales à semelles d’or ou de brodequins aux couleurs voyantes: on pourrait les croire des incarnations de la grâce et de la beauté, mais leurs noms, Aphéa, Osphrasia, Orasia, Achoé, Geusia, indiquent qu’elles personnifient les cinq sens, et elles lui déclarent qu’elles vont le mener devant la reine Éleuthérilide (Libre Arbitre). Elles allaient toutes au bain, aussi portent-elles des urnes d’albâtre remplies d’essences, des bassins d’or garnis de pierreries, des miroirs, etc. Description des thermes, de forme octogonale, et de tous les détails tant extérieurs qu’intérieurs de leur architecture. Les nymphes forcent Poliphile à se baigner avec elles, s’amusent de son pudique embarras et lui jouent en riant toutes sortes de mauvais tours, comme de le faire arroser d’un jet d’eau froide par un Amour de marbre dont un mécanisme caché relève tout à coup le petit appareil, ou de l’inviter à se frotter d’un onguent qui l’enflamme aussitôt d’un priapisme aigu. En vain les poursuit-il, dans l’intention de faire payer cher la plaisanterie à celle qui lui tombera sous la main. Elles lui échappent.
Le palais où elles l’introduisent, précédé d’un enclos 198 de feuillage qu’orne une fontaine monumentale, est nécessairement une merveille d’architecture, et le narrateur ne nous fait grâce ni de l’ordonnance générale, ni du portique à voûte dorée, ni des frises qui se déroulent autour des salles, ni des lames d’or et des peintures sur émail des parois, ni des pavages en mosaïque, ni des ciselures des portes, que recouvrent de riches tapisseries. La reine, toute raide dans ses habits de brocart, et plus constellée de pierreries qu’une madone Espagnole, reçoit Poliphile au milieu d’une salle dont le plafond est un treillis de poutrelles où s’enroulent des sarments de vigne à feuilles d’émeraude mêlés à des brins de convolvulus d’or. A la suite de l’audience royale, un repas est servi par une véritable armée de nymphes superbement vêtues; les tables, à trépied de jaspe et à disque d’or pour la reine, à trépied d’ébène et à disque d’ivoire pour les convives, sont couvertes de nappes brodées de perles, sur lesquelles une belle enfant répand des fleurs. La vaisselle est d’une richesse proportionnée à celle de la salle à manger: c’est un ruissellement de béryls, de rubis, de topazes, de chrysolithes, de jacinthes, de perles d’Orient, rehaussant les formes gracieuses des coupes, des aiguières, des bassins, des lampadaires, des corbeilles, d’une fontaine mobile qu’une servante roule entre les tables et qui distille des parfums. Au festin succède un ballet: trente-deux nymphes, seize habillées de drap d’or, seize de drap d’argent, figurent en dansant les combinaisons d’une partie d’échecs, les pavés de la salle offrant la disposition d’un damier. La reine congédie Poliphile, ébloui de toutes ces splendeurs, et le remet aux mains de Logistique (Raisonnement) et de 199 Thélémia (Volonté), qui doivent le mener chez Télosia (Accomplissement); là, il trouvera celle qu’il cherche et la fin de ses peines. Pour s’y rendre, il traverse les dépendances du palais, non moins curieuses que le palais lui-même, et remarquables surtout par un goût singulier de l’artificiel qu’elles révèlent chez l’auteur. C’est d’abord un jardin dont toute la végétation, arbres et plantes, feuilles et fruits, est en verre filé et colorié; puis un canal en labyrinthe qui est une image de la vie humaine: le courant porte la barque entre des rives verdoyantes, comme dans la célèbre page de Bossuet, qui, selon toute apparence, n’avait pourtant pas lu le Poliphile; des filles séduisantes vous convient à faire le chemin avec elles, et quoiqu’on en choisisse une, on est bien libre encore d’en aimer d’autres; arrivé au milieu du trajet, le courant vous entraîne vers le centre fatal, l’air s’épaissit, on ne rencontre plus que des femmes mûres, et impossible de retourner la barque! Après le labyrinthe, second bosquet artificiel, celui-ci tout en soie: feuilles et fleurs de soie sont fixées sur des tiges d’or, dans des caisses en point de tapisserie; le sol est en velours de soie, les murs sont tendus d’un réseau de perles. Un troisième bosquet est formé de cent arcades entre chacune desquelles se dresse une statue; au milieu, une pyramide triangulaire.
Après avoir passé par diverses épreuves allégoriques dont ses guides lui donnent l’explication, Poliphile pénètre dans le domaine de Télosia. D’un chœur de jeunes filles se détache une nymphe éblouissante de beauté, qui vient au-devant de lui, une torche allumée à la main, et qui va être désormais sa compagne. C’est Polia, mais si transfigurée en immortelle qu’il hésite à 200 la reconnaître, quoiqu’il l’examine bien en détail, car la description de ses charmes, de ses vêtements et de ses parures n’occupe pas moins de sept ou huit pages. Polia devient dès lors sa conductrice, son initiatrice aux mystères, dont il lui reste encore à parcourir bien des cycles, et elle le fait d’abord assister à un spectacle d’une pompe extraordinaire. Autour de quatre chars de triomphe (le char d’Europe, traîné par des centaures; le char de Léda, traîné par des éléphants; le char de Danaé, traîné par des licornes; le char de Bacchus, auxquels sont attelés des tigres) défile tout ce que la mythologie et l’histoire ancienne comptent de filles et de femmes célèbres par leurs aventures amoureuses et les passions qu’elles ont inspirées.
Ces processions païennes, qui se déroulent en longues théories, comme les Panathénées sur les frises du Parthénon, sont une imitation évidente des Triomphes de Pétrarque; mais le P. Colonna s’est plus que le poète préoccupé du côté plastique, et les gravures, comme ses descriptions, nous représentent non seulement les groupes du cortège, mais la structure des chars aux roues de diamant, d’agate, de chrysolithe, d’asbeste, les panneaux dont ils sont décorés et les principaux motifs de leur ornementation. Aux pompes triomphales succèdent les fêtes champêtres de Pomone et de Vertumne, que termine une offrande à l’autel de Priape, reproduite dans une planche que des amateurs par trop pudibonds ont quelquefois lacérée dans les anciens exemplaires. Polia, qui se révèle à son fervent adorateur, le conduit ensuite au temple de la Vénus physique, un temple circulaire de la plus harmonieuse architecture, où ils sont fiancés après l’accomplissement de 201 purifications, d’immolations et de cérémonies propitiatoires dont il a puisé une partie dans ce que l’on peut connaître des rituels Égyptiens, Grecs et Romains, et une autre dans sa féconde imagination. Ce n’est pas fini toutefois: cette même imagination inventive n’est pas en peine de trouver de nouveaux épisodes qui reculent le dénouement et prolongent encore la féerie des descriptions.
A peine fiancé, Poliphile veut entrer en possession. Arrivé dans un endroit solitaire où ils s’étendent l’un près de l’autre, après avoir longuement repu ses yeux de toutes les beautés de Polia, contemplé amoureusement ses cheveux d’or, son torse de statue, ses seins «ronds comme des pommes» et le délicieux petit vallon, «sépulture de son âme», qui les sépare, il se demande s’il ne va pas «violenter sans retenue et avec une audace Herculéenne la nymphe divine et pure». Polia le calme en le prenant par son faible, en l’envoyant visiter dans les ruines d’un polyandrion, ou cimetière, qui se trouve là fort à propos, une foule de tombeaux intéressants. Une revue des monuments funéraires manquait en effet à cette exhumation complète de l’antiquité. Poliphile en voit et en décrit de toutes sortes: simples pierres sépulcrales, tables votives, autels, sarcophages, mausolées, chapelles, colonnes brisées, obélisques, urnes cinéraires, et, parmi les inscriptions qu’il relève, il en est d’assez bien imitées pour avoir trompé quelques savants. Il s’arrache à sa funèbre promenade, retrouve Polia, et Éros en personne survient, qui les emmène. Dans une nacelle de bois de santal chevillée de clous d’or, avec six jolies filles peu vêtues pour rameurs et l’Amour pour pilote, 202 ils voguent vers Cythère, accompagnés d’une foule de néréides, de tritons, de cygnes blancs et de monstres marins. Une procession de nymphes, portant des trophées, des vases, des corbeilles de fleurs, se présente au-devant d’eux: elle précède un char traîné par de chimériques sauriens, dans lequel prend place Cupidon, et le cortège se met en marche. Encore des temples, des palais, des portiques, des colonnades, dont l’auteur varie les dispositions et le style avec une étonnante fécondité, des jardins, des parterres, des allées sablées de nacre, de cinabre et de lapis ou pavées de pierres précieuses, des berceaux de fleurs, des clôtures concentriques de myrtes, de châtaigniers, de citronniers, de buis, de grenadiers, dont les fûts et les arcades répètent dans toutes les nuances du vert les fantaisies de marbre blanc des architectures. Au centre d’un amphithéâtre dans lequel vient évoluer le cortège, entre Bacchus et Cérès (sine Cerere et Libero friget Venus), Cithérée se baigne nue dans la vasque d’une fontaine, en jouant avec des colombes. La déesse accueille et bénit les deux amants, non sans de tendres exhortations qui pourraient durer longtemps si Mars, survenant tout à coup, ne quittait son armure pour prendre son bain avec Vénus, spectacle qui fait baisser les yeux aux chastes nymphes du cortège; et toute l’assistance s’éloigne pour aller en pèlerinage au tombeau d’Adonis, un merveilleux sépulcre enfoui sous les fleurs et couvert de sculptures. Là, les nymphes, avant de laisser à eux-mêmes les nouveaux époux, veulent apprendre de Polia l’histoire de sa vie et de leurs amours.
Polia raconte donc qu’elle est issue d’une ancienne 203 famille patricienne de Rome, la gens Lelia, dont tous les membres, sauf un, victimes du courroux des dieux, avaient péri à une époque indéterminée dans une catastrophe mythologique, métamorphosés en fleuves, en ruisseaux, en fontaines, en oiseaux. Le survivant, Lelius Maurus, fondateur de Trévise, en transmit la seigneurie à ses descendants, dont elle est la dernière héritière, sous le nom de Lucrezia Lelia. Un jour que sa servante lui peignait ses beaux cheveux d’or sur la terrasse de son palais, Poliphile l’aperçoit et se sent aussitôt pris au filet; mais la peste ayant éclaté à Trévise, la jeune fille promet de se vouer à Diane si elle échappe au fléau. Poliphile ne la revoit que plus d’un an après, le lendemain même de sa consécration, et, la trouvant seule en prière dans le temple, lui fait l’aveu de son amour; la vierge le repousse si durement que le pauvret en tombe inanimé; et, sans plus s’émouvoir, elle tire le cadavre par les pieds, le cache dans un coin. La nuit venue, elle a une vision qui lui donne à réfléchir. Emportée par un tourbillon dans une obscure forêt, elle assiste au supplice terrible de deux jeunes femmes: l’Amour les a attelées nues à son char, il les fustige d’une poignée de verges enflammées, les pousse à travers les ronces, les sentiers fangeux, et les fait dévorer au bout de leur course, après les avoir coupées en morceaux, par des chiens, des loups et des lions. La nourrice de Polia lui explique que c’est le supplice des cruelles, de celles qui se sont montrées insensibles aux prières de leurs amoureux, et la jeune fille retourne éperdue dans le temple où elle a laissé le sien. Poliphile était bien mort, car son âme avait eu le temps de faire un petit voyage dans l’Empirée, de 204 comparaître devant la souveraine Vénus et d’y accuser l’Amour; Polia lui rend la vie en le couvrant de baisers. Mais les prêtresses la surprennent et voient le temple profané; elles chassent les deux sacrilèges, qui s’enfuient et se retrouvent un peu plus tard dans un autre sanctuaire, celui de la secourable Vénus, dont la grande prêtresse les unit. Cela fait au moins trois fois qu’ils reçoivent la bénédiction nuptiale, et Poliphile n’en est pas plus avancé. Le récit de Polia achevé, les nymphes se retirent en souhaitant aux époux le parfait bonheur; l’amoureux, mis enfin en possession de la femme aimée, va l’étreindre dans ses bras: Polia s’évanouit comme une ombre légère, ne laissant après elle qu’une trace de parfums, et Poliphile se réveille. Tout en ce monde est un songe,—omnia humana somnium,—comme dit le titre du livre; l’auteur clôt la série de ses visions par cette mention mélancolique: A Trévise, le jour des calendes de Mai, alors que le malheureux Poliphile était détenu dans les adorables liens de Polia.
Comme roman, mais c’est là son moindre intérêt, le Songe de Poliphile se rattache à cette nombreuse classe d’ouvrages dus aux «fidèles d’Amour», dont la Divine Comédie, la Vie nouvelle et le Banquet, de Dante, les Sonnets et les Triomphes, de Pétrarque, la Fiammetta, de Boccace, sont les chefs-d’œuvre incontestés, et dans lesquels la femme, idéalisée, transfigurée, apparaît comme le guide céleste de l’homme, la régulatrice de sa vie, l’inspiratrice de toutes les vertus et des plus hautes ambitions.
Ce culte seulement n’est pas aussi éthéré chez le 205 P. Colonna, qui, plus artiste, y mêle une dose assez forte de sensualité païenne. Polia, personnification de l’Antiquité, dont il relève et complète en songe les ruines éparses, est moins le type de la perfection morale absolue que le type de la beauté plastique, la créature aux belles formes, aux charmes séduisants, qui éveille chez l’homme les facultés génératrices, qui l’invite à produire et à se perpétuer. L’élément féminin peuple et anime seul les magnifiques décors de ses architectures et la profondeur de ses paysages: point d’hommes; partout des déesses allégoriques ou mythologiques, des groupes chantants et dansants de nymphes, de dryades et de prêtresses, ondoyantes évocations de tout ce que la fable, la poésie et la statuaire antiques ont créé ou rêvé de plus parfait, et, en amoureux fervent, il ne trouve jamais de tons assez chatoyants et nacrés pour rendre le grain et la finesse de leur peau, de tissus assez délicats, de pierreries assez éclatantes, de bijoux assez ciselés pour les parer dignement, de baumes assez suaves pour les envelopper d’une atmosphère de parfums. L’expression de la beauté féminine, sous ses aspects multiples, le préoccupe toujours, et tel bassin d’or incrusté de joyaux et constellé de figures, telle aiguière dont le ciseleur pourrait essayer de reproduire le précieux travail, ne sert pourtant, dans le dessin général du passage, qu’à faire valoir la gracieuse attitude d’une nymphe à demi vêtue, arrondissant son bras potelé pour verser de haut et donner à laver aux convives. Çà et là, quelques pages où se manifeste sans vergogne le prurit charnel: un satyre, comme dans le beau Titien du Louvre, soulève lascivement les draperies qui cachent une 206 femme couchée; de provocantes nudités plongent dans l’eau des fontaines ou se détachent sur la verdure des bois; des nymphes agacent Poliphile, Galathées fuyant sous les saules, et Polia elle-même, l’immortelle et aérienne beauté, n’est pas à l’abri de ses tentatives indiscrètes. Au reste, le but du pèlerinage est Cythère: on fait une station dans le temple de la Vénus physique et, en chemin, nous assistons à des représentations phalliques, à des offrandes au symbole de la virilité.
Un amour malheureux, réfugié dans la cellule d’un monastère, cherchant l’oubli dans l’étude de l’antiquité et y trouvant encore des images troublantes, plus propres à réveiller ses convoitises inassouvies qu’à les engourdir, explique assez naturellement, au point de vue des idées modernes, l’ensemble de l’œuvre du P. Colonna, pour qu’on ait cru qu’il avait allégoriquement raconté ses peines de cœur et le chapitre douloureux de sa vie dans les derniers épisodes du Songe de Poliphile. Ces épisodes, tout à fait conformes à la poétique des fidèles d’Amour, peuvent n’être qu’une fiction, comme tout le reste. Toutefois, on a découvert que l’évêque de Trévise, vers le milieu du XVe siècle, s’appelait Teodoro Lelio; il a pu avoir une nièce qui, en prenant le voile de religieuse, laissa d’éternels regrets à Francesco Colonna. Lucrezia Lelia aurait alors un peu plus de réalité que Béatrice Portinari, cette enfant de neuf ans dont un seul regard enchaîne à tout jamais la vie de Dante, qu’il prend pour sa règle souveraine et son impératrice, et qui, par une série d’idéalisations, devient successivement la Beauté parfaite et la Vertu, puis la Théologie, la Philosophie, et, en dernière analyse, la suprématie impériale, le triomphe 207 des Gibelins sur les Guelfes. Mais il n’est pas vrai que Francesco Colonna soit mort en 1467, comme on le lit dans l’ingénieuse Nouvelle de Charles Nodier, le jour anniversaire des vœux qu’il aurait prononcés lui-même, de désespoir, après avoir tracé la dernière ligne du livre où il s’était forcé d’exprimer en symboles plus ou moins transparents sa double adoration d’amoureux et d’artiste. L’obituaire des Dominicains de Venise, ordre auquel il appartenait, relate qu’il mourut en 1527, âgé de quatre-vingt-quatorze ans révolus; en 1467, il avait donc seulement trente-quatre ans, et il n’était même pas à la moitié de sa longue carrière. Il professait alors la grammaire et les belles-lettres à Trévise, dans une maison de l’ordre, sous l’habit de Dominicain. La mention inscrite à la fin du Songe de Poliphile n’indique pas, comme on le croit généralement en pensant que l’auteur s’est conformé à l’usage habituel, la date de l’achèvement du manuscrit, mais seulement celle du jour où il fit ce rêve prodigieux et compliqué, qu’il mit peut-être ensuite vingt-cinq ou trente ans à écrire. Le Songe de Poliphile ne peut pas, en effet, être une œuvre de jeunesse. La masse de connaissances qui y est accumulée est telle qu’un homme laborieux aurait peine à la rassembler dans toute une longue vie d’étude, et elle justifie pleinement cette qualification de docte en quantité de sciences—multiscius Franciscus Columna—que donnait à l’auteur un de ses contemporains, commentateur des Arrêts d’Amour, de Martial d’Auvergne. Ce moine savait à peu près tout ce que l’on pouvait apprendre de son temps.
Outre les lettres Grecques et Latines qu’il enseignait 208 et qui lui ont servi à se fabriquer une langue pour son propre usage, outre Dante, Pétrarque et Boccace, qu’il avait étudiés à fond et qu’il imite fort souvent, outre la théologie et la métaphysique de l’école, qu’un esprit aussi curieux que le sien n’a pu négliger, mais qu’il dédaigna sans doute, car on en trouve à peine quelques traces dans son ouvrage, tout païen d’inspiration, il avait des connaissances très étendues en histoire naturelle, en minéralogie, en mécanique, en géométrie, savait de l’alchimie et de l’astrologie, pour les rêveries desquelles il semble avoir de la prédilection, tout ce qu’en professaient les adeptes, et possédait sinon la pratique, du moins la théorie de l’architecture, de la peinture et de la gravure; l’histoire ancienne et la mythologie, auxquelles il emprunte ses plus gracieuses conceptions, lui étaient familières dans leurs plus petits détails, et c’est presque à ceux-là seuls qu’il fait allusion, ce qui le rend parfois si difficile à entendre. Enfermer tant de connaissances dans un cadre romanesque n’était pas chose facile, et cette haute ambition peut lui faire pardonner ses bizarreries, ses mots mal forgés, les artifices souvent puérils de sa composition. Si effrayé, si haletant qu’il soit, au milieu de toutes sortes de péripéties, Poliphile a toujours l’esprit assez présent pour inventorier d’un coup d’œil rapide les merveilles que le songe déroule devant ses regards et pour lesquelles il met à contribution les ruines, les palais, les fresques et jusqu’aux fleurons et aux arabesques des manuscrits, ses propres études et ses lectures. Traverse-t-il une forêt, il en compte toutes les essences; une prairie, il en énumère toutes les herbes. Il entend sans doute nous montrer qu’il en 209 sait très long, mais il a aussi le but fort louable de ne rien laisser en dehors de l’enseignement artistique, qu’il veut complet et qu’il pousse jusqu’à ses plus extrêmes recherches. Pour tout le monde, une plante n’est qu’une plante; pour l’artiste, c’est une merveille de structure et de couleur, et elle peut fournir un joli motif d’ornementation. De même, en ce qui touche la mécanique, il décrit ou invente des lampes vaporisant des parfums, des jets d’eau ingénieusement combinés d’après les lois de la réfraction pour produire de nouveaux effets de lumière, des appareils où se réunissent la science hydraulique, la statuaire et la ciselure. Mécanique, astrologie, alchimie, histoire, mythologie, il ramène tout à l’art, il en fait des sources d’inspiration et de production. Quelques peintres, sculpteurs et architectes se sont inspirés directement du Poliphile: Mantegna et Annibal Carrache dans leurs allégories; Jules Romain dans les fresques du palais du T, à Mantoue; Poussin dans ses Bacchanales; Temanza dans la construction d’une des églises de Venise; le Bernin pour l’obélisque de la place de la Minerve, à Rome; Lesueur a peint Poliphile se prosternant devant la reine, dans la salle à vigne d’émeraude, et peut-être encore quelques autres épisodes; Bouchardon a dessiné Poliphile au milieu des Nymphes (Dessins du Louvre); les orfèvres et les joailliers sont ceux qui y ont trouvé et qui y trouveraient encore le plus de gracieux modèles. Mais nous ne nous attachons qu’à l’analyse purement littéraire; l’esthétique du P. Colonna, la valeur de ses idées et de ses conceptions, l’influence qu’il a exercée sur les développements de la Renaissance et le retour aux principes de l’art Grec, 210 sont autant de points que M. Claudius Popelin a traités dans son Introduction d’une façon magistrale et avec une compétence à laquelle nous ne saurions prétendre.
L’amoureux de Polia, ce maître en toutes sciences, cet érudit plein de curiosité, cet écrivain recherché et fleuri, ne pouvait guère être compris que par un autre Poliphile, un lettré, un savant et un artiste; il a eu la bonne fortune de rencontrer M. Claudius Popelin. Par ses travaux antérieurs, ses études sur la Renaissance Italienne, ses recherches sur l’émail des peintres, le traducteur d’Alberti, l’auteur des Vieux Arts du feu, était tout préparé à cette tâche laborieuse; familiarisé avec la technologie et les procédés du XVIe siècle, il avait la clef de bien des difficultés qui eussent entravé tout autre. Le goût des choses d’art, des ciselures du style, des fantaisies d’imagination, l’a fait sympathiser profondément avec son modèle et l’a aussi préservé d’une tentation à laquelle ne manquent pas de succomber les gens prétendus raisonnables, celle d’émonder ce qui leur semble trop luxuriant et touffu. Il a voulu non seulement tout traduire, mais tout expliquer.
L’obscurité du livre tient surtout à ce que l’auteur fait sans cesse allusion à des faits de l’histoire ancienne dont la trace est effacée, à des monuments entièrement oubliés, à des accidents mythologiques de si mince importance qu’on n’en a plus aucun souvenir, si toutefois on les a jamais sus: M. Claudius Popelin a cependant pris à tâche de ne rien laisser sans éclaircissement, et l’abondance des notes dont il a illustré le 211 texte montre assez les recherches patientes qu’il a été obligé de faire pour lever tous les voiles sous lesquels le Poliphile était resté impénétrable.
Février 1883.


XXV
DEUX DIALOGUES
du
LANGAGE FRANÇOIS ITALIANIZÉ
PAR HENRI ESTIENNE[80]

Au temps de Henri II et de Catherine de Médicis, les courtisans avaient la manie de tout accommoder à l’Italienne, même la langue Française. Le mal datait de loin. Les expéditions de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, la possession intermittente du Milanais, prétexte incessant de guerres et de voyages, le retentissement en France des chefs-d’œuvre littéraires d’outre-mont, écrits dans une langue plus tôt formée que la nôtre, plus fleurie et plus sonore, avaient depuis 213 longtemps entretenu entre les deux peuples, de même race Latine, un continuel échange d’idées, tantôt sympathiques, tantôt hostiles: les Florentins venus chez nous en foule, à la suite de la nièce de Clément VII, firent décidément pencher la balance du côté de la sympathie. Ils tenaient le haut du pavé, jouissaient bruyamment de la faveur royale, et, pour ne leur point céder en élégance, il fut dès lors de bon air de les imiter dans la somptuosité des équipages et des vêtements, les velours, les soies, les brocarts, les dentelles, d’user de leurs fards et de leurs onguents, de singer leurs mœurs, de parler comme eux. De là, partout où résidait la cour, des nouveautés vues d’un mauvais œil par les Français de vieille roche, attachés aux anciennes coutumes, des modes extravagantes et un langage italianizé des plus choquants pour leurs oreilles. Avoir sa stanse en la cour, capiter ou s’imbatter quelque part, être tout sbigottit, spaceger par la strade, faire scorne, stenter, indugier à quelque chose, se montrer de bonne voglie, étaient des locutions journellement employées dans la conversation, et dire la même chose en Français n’eût pas été de bon garbe, aurait montré de la salvatichesse et même de la gofferie dans la façon de s’exprimer. Le parler de l’escholier Limosin de l’alme, inclyte et célèbre Académie que l’on vocite Lutèce, déambulant par les compites et quadrivies de l’urbe, et transfretant la Séquane pour capter la bénévolence de l’omnijuge, omniforme et omnigène sexe féminin, n’est pas plus ridicule.
C’est de ce travers que se moque Henri Estienne. Il l’avait attaqué déjà dans la préface du Traité de la Conformité du langage François avec le Grec; il y revient 214 dans sa Précellence du langage François, deux ouvrages qui, avec les Dialogues du langage François italianizé et autrement desguizé, forment une sorte de trilogie écrite pour la défense et la glorification de notre idiome national. «Pourquoi,» disait-il, «ne pas feuilleter nos romans, et desrouiller force beaux mots, tant simples que composez, qui ont pris la rouille pour avoir esté si long temps hors d’usage? Non pas pour se servir de tous sans discrétion, mais de ceux pour le moins qui seroient le plus conformes à l’usage d’aujourd’huy. Mais il nous en prend comme aux mauvais mesnagers, qui, pour avoir plus tost faict, empruntent de leurs voisins ce qu’ils trouveroient chez eux, s’ils vouloient prendre la peine de le cercher. Et encore faisons-nous souvent bien pis, quand nous laissons (sans savoir pourquoy) les mots qui sont de notre creu, et que nous avons en main, pour nous servir de ceux que nous avons ramassez d’ailleurs. Je m’en rapporte à manquer et à son fils manquement, à baster et à sa fille bastance, et à ces autres beaux mots: à l’improviste, la première volte, grosse intrade, grand escorne... Car qui nous meut à dire manquer, manquement, plus tost que défaillir, défaut? baster et bastance, plus tost que suffire et suffisance? Pourquoy trouvons-nous plus beau à l’improviste, que au despourvu? la première volte, que la première fois? grosse intrade, que gros revenu? il a receu un grand escorne, plus tost que, il a receu une grande honte, ou ignominie, ou vitupère, ou opprobre? J’alléguerois bien la raison, si je pensois qu’il n’y eust que ceux de mon pays qui la deussent lire estant ici escripte, mais je la tairay, de 215 peur d’escorner ou escornizer ma nation envers les estrangers[81].»
Le scrupule qui l’arrêtait alors, il ne l’avait sans doute plus quand il composa les Dialogues; il y a mis tant de raillerie désobligeante pour les Italiens, qu’on l’accusera volontiers d’avoir exagéré, et qu’on se demandera si le jargon composite de son gentilhomme Courtisanopolitois, Jan Franchet, dit Philausone, s’adressant aux lecteurs tutti quanti, n’est pas tout à fait de son invention. Nous avons heureusement, dans les écrivains de l’époque, des témoignages positifs en faveur de la véracité d’Estienne. M. de Blignières[82] a relevé, après Paul-Louis Courier, un assez grand nombre de tournures Italiennes dans Amyot: Trop plus, trop mieux (troppo più, troppo meglio), le plus du temps (il più del tempo); à tant (a tanto), pour à ce point; pour tant (per tanto), au lieu de pour cela; non pour tant (non per tanto), au lieu de néanmoins; comme ainsi soit que (conciosiachè); au moyen de quoi (per mezzo di che); à l’occasion de quoi (a cagion di che); là où (là dove); fors que et hors que (fuorchè); premier que, combien que, comment que (prima che, quantunque, come che); impropère (improperio), pour reproche; issir (uscire), pour sortir; rober et roberie (robare, roberia), pour voler et larcin; se partir (partirsi), pour s’en aller; être entre deux (star infra due), pour hésiter entre deux partis à prendre; un qui 216 (uno che), etc. Feugère[83] en conclut que, de la conversation, les Italianismes avaient passé dans les livres, et que les auteurs les plus purs leur payaient leur tribut. Mais on remarquera que beaucoup de ces locutions, aujourd’hui tombées en désuétude, étaient employées chez nous bien avant le XVIe siècle; elles se trouvent dans les deux idiomes, d’origine commune, sans qu’on puisse distinguer bien nettement qui les a empruntées à l’autre. L’examen de Rabelais est, à notre avis, beaucoup plus probant, car l’auteur du Gargantua et du Pantagruel italianise avec autant d’aplomb que latinisait l’escholier Limosin dont il se moque: Ainsi font mes compaignons, dont, par adventure, sommes dicts parabolains...—Nous, à ceste heure, n’avons autre faciende que rendre coignées perdues?...—Pour dix mille francs d’intrade ne quitteriez vos soubhaits...—Ils pourront tirer denares...—Voire les escuz de guadaigne...—Un entonnoir d’ébène tout requamé d’or...—Elle l’appelait son estivallet...—Corpe de galline! respondit Frère Jean...—Le portier joyeusement sonne la campanelle...—Révérend père, si m’avez trouvé bonne robbe...—Un gros et large anneau dans la palle duquel estoit enchâssée...—Considérans le minois et les gestes de ces poiltrons magnigoules...—Iceulx, après avoir à belles dents tiré la figue, la monstroient au boie..., etc. etc. Parabolain (parabolano, jaseur, hâbleur); faciende (facienda, besogne); intrade (intrata, rente); denares (danari, deniers, argent); 217 guadaigne (guadagno, gain); requamé (ricamato, enrichi, orné); estivallet (stivale, botte); galline (gallina, poule); campanelle (campanella, clochette); de bonne robbe (di buona roba, de bonne composition); palle (palla, boule, chaton); magnigoule (manigoldo, bélître); boie (boia, bourreau) ne peuvent plus guère être compris aujourd’hui que des Italianisants. Or, Rabelais a précisément ajouté au IVe livre du Pantagruel, auquel nous empruntons tous ces lambeaux de phrases, une «Briefve déclaration des dictions plus obscures»; il y donne le sens de mythologie, prosopopée, catastrophe, misanthrope, thème, sarcasme, catégorique, solécisme, période et autres mots sans doute alors étranges, quoique devenus depuis si Français, et pas un de ceux que nous venons de citer ne figure dans cet Index: c’est qu’ils étaient assez dans le langage courant pour ne devoir arrêter aucun lecteur, et que l’usage les avait dès longtemps naturalisés. On regretterait peut-être de ne pas les trouver dans Rabelais; ils contribuent, avec tant d’autres vocables qu’il tirait du Grec, du Latin, de l’Hébreu, ou qu’il forgeait de toutes pièces, à donner à son style cette exubérance qui nous émerveillera toujours. Mais, en somme, ils font double emploi avec autant de mots de notre vieille langue, de tout aussi bon aloi, et c’étaient des richesses superflues.
Avant Catherine de Médicis et ce débordement d’Italianismes qui menaça de submerger notre idiome, on se montrait volontiers assez tolérant; on admettait que les deux nations n’avaient qu’à gagner à se prêter mutuellement ce qui leur manquait, et que la douceur, la mollesse, la fluidité du Toscan corrigeait heureusement 218 la rudesse un peu sauvage de nos vieux dialectes. Une quarantaine d’années avant les Dialogues du François Italianizé, Lemaire de Belges écrivait sa Concorde des deux langages (1540, in-8o); il supposait, comme Estienne, deux personnes devisant entre elles de la comparaison du Français et du Florentin, «lesquels», dit-il, «sont dérivés et descendus d’un même tronc et racine, c’est à savoir de la langue Latine, mère de toute éloquence, tout ainsi comme les ruisseaux procèdent de la fontaine», et concluait qu’ils doivent «vivre et persévérer ensemble en amoureuse concordance, pour ce que», ajoutait-il, «aux temps modernes, plusieurs nobles hommes de France fréquentant les Itales se délectent et excercitent audit langage Toscan à cause de sa magnificente élégance et douceur: et, d’autre part, les bons esprits Italiques prisent et honorent la langue Françoise et s’y déduisent mieux qu’en la leur propre, à cause de la résonnance de sa gentillesse et courtoisie humaine.»
Henri Estienne est loin de ces idées de conciliation; pour lui, ce sont des gaste-françois, ceux qui empoisonnent notre langue de termes étrangers, et, dans les quelques néologismes qu’il admet, perce son antipathie pour nos voisins d’au-delà les Alpes. Il trouve, par exemple, excellent qu’on tire de l’Italien poltronnerie et forfanterie, car ces qualités n’étant pas Françaises, force a bien été d’en demander les noms au pays dont elles sont, dit-il, une production naturelle; intrigant, charlatan, baladin, bouffon, sont aussi de bonne prise, «car nous ne pourrions trouver de mots Français signifiant telles gens, veu que le mestier duquel ils se 219 mêlent est tel, qu’à grand’peine le pourroit-on descrire à un François, si non en les contrefaisant;» quant à spadassin, assassin, sicaire, il est de toute justice qu’ils soient de provenance Italienne, puisque le métier d’assassiner était exercé en Italie longtemps avant qu’on sût en France ce que c’était. En garder l’usage, c’est faire à la langue Italienne l’honneur qui lui appartient, c’est reconnaître que ces beaux mots sont de son fief. Pour le reste, nous n’avons que faire de lui rien emprunter, notre fonds étant suffisamment riche. Henri Estienne met là quelque méchanceté; mais, en qualité de protestant, il détestait les Italiens comme dévots au Pape et à la messe; il abhorrait surtout ceux de la cour de France, comme complices des persécutions qu’il avait lui-même subies, avec ses coreligionaires. Il gardait contre eux la rancune d’un expatrié, et peu s’en faut qu’il ne les accuse de profiter de ce qu’il n’était pas là, pour opérer des dégâts dans son propre domaine, cette vieille bonne langue que son père et lui se sont tant évertués à nourrir de Grec et de Latin. Il ne reproche pas seulement aux courtisans l’abus des mots nouveaux: il leur en veut encore d’énerver et d’affadir la langue par la substitution de l’è ouvert ou de l’é fermé au plein et bon son de l’oi; de dire mé, fé, ré, lé, pour moi, foi, roi, loi; puis, par une affectation contraire, de changer aussi oi en oa, dans certains cas, et de faire échec à toute bonne prononciation, à toute syntaxe, quand ils disent chouse pour chose, j’avions, j’étions, etc.:
Ces querelles ne nous intéressent plus beaucoup; l’usage a depuis longtemps fixé la prononciation et décidé, non sans inconséquence, que de deux mots qui s’écrivaient au XVIe siècle avec la diphtongue oi, l’un se prononcerait comme il s’écrit et l’autre comme s’il y avait ai. Étret, dret, fret, comme on disait, à l’Italienne, à la cour de Henri II, n’ont pas prévalu contre étroit, droit et froid; tandis que François, j’irois, j’étois, je venois sont devenus Français, j’irais, j’étais et je venais; on a continué de dire loi, moi, foi, roi, mais en exagérant le son ouvert de la diphtongue oi, qu’Estienne prononçait oè (Françoès, loè, moè, foè, roè), comme le font encore nos paysans, et que nous sommes bien près de prononcer oa. Remarquons d’ailleurs que la prononciation dret, endret, pour droit, endroit, qui subsiste encore dans les campagnes, était bien antérieure au XVIe siècle; on la rencontre dans les trouvères. Sans remonter plus haut que Villon, qui fait rimer Chollet avec souloit, exploits avec laiz, Robert et haubert avec plus part et poupart, La Barre avec terre, et appert avec despart, on voit qu’Estienne semble mettre sur le dos des courtisans des fautes de langage dont ils n’étaient pas responsables. «Bien qu’il possédât son idiome Roman mieux que ses contemporains», dit à ce propos M. Francis Wey[84], 221 «on s’aperçoit que les manuscrits lui étaient étrangers, qu’il lisait nos vieux auteurs dans des textes rajeunis.» C’est une grosse erreur: Estienne reproche aux courtisans, non pas d’inventer une mauvaise prononciation, mais de la remettre à la mode, après un ou deux siècles de désuétude; il savait très bien que du temps de Villon on disait la tarre pour la terre, comme le disent encore les paysans, et un haubart pour un haubert[85]. Où il se trompe un peu, c’est lorsqu’il fait affirmer à son Celtophile que si le roi Henri II se délecte à entendre dire chouse pour chose, cousté pour costé, et j’avions, j’étions, etc., François Ier, «de tres celebre et perpetuelle mémoire», n’eût pas été de si bonne composition. «Car luy qui avoit faict si heureusement fleurir en son royaume l’estude des trois langages, l’Hebrieu, le Grec, le Latin, estoit si jaloux de l’honneur du sien maternel, qu’il est vraysemblable que le meilleur marché qu’eussent eu les inventeurs de cest écorchement de langage, c’eust été d’avoir le dos écorché à coups de fouet[86].» François Ier aurait donc été forcé de se faire donner d’abord les étrivières, car il s’amusait aussi parfois, lui aussi, à parler et à écrire de la sorte: «Le cerf nous a menés jusqu’au tartre de Dumigny... 222 J’avons espérance qu’y fera beau temps, veu ce que disent les estoiles que j’avons eu le loisir de voir... Perot s’en est fouy, qui ne s’est ousé trouver devant moy[87].»
Dans ce procès qu’il faisait aux Italianismes, Henri Estienne a eu le plus souvent cause gagnée: Aconche, amorevolesse, capiter, favoregger, disturbe, goffe et gofferie, s’imbatter, indugier, s’inganner, mercadant, leggiadre, mariol, menestre, poignelade, ringracier, salvatichesse, sbigottit, scorne, spaceger, spurquesse, straque, usance, voglie, s’en sont allés où sont les neiges d’antan; bon voyage! A peine regretterons-nous usance et amorevolesse, qui ne manquent pas de garbe. A plus forte raison, l’usage n’a-t-il pas consacré, dans le sens qu’ils ont en Italien, amasser, attaquer, fermer, forestier, piller, poste, triste, volte, etc.; ces mots avaient déjà, chez nous, pris une acception autre, dont il aurait fallu les déposséder; de même bugie (bugia, mensonge), cattif (cattivo, méchant), stanse (stanza, chambre), auraient fait équivoque. Salade (celata) s’est dit longtemps pour casque: on a fini par l’abandonner, peut-être seulement avec les casques. Mais un grand nombre de mots dont Estienne se moquait et qu’il voulait arrêter à la frontière: caprice, citadin, courtoisie, disgrâce, estaffier, estafilade, gentillesse, s’estomaquer, manquer, réussir, riposte, risque, vocable, etc., sont néanmoins entrés et font même assez bonne 223 figure dans notre langue. Nous avions au dépourvu; cela ne nous a pas empêchés de prendre à l’improviste, et de les garder tous deux: un ami nous arrive à l’improviste, et un billet à payer peut nous prendre au dépourvu; il y a une nuance, et c’est la variété des nuances qui fait la richesse d’un idiome. Fastide n’est pas resté: nous en avons dérivé fastidieux, qui est excellent; pérégriner ne s’emploie guère: nous en avons tiré pérégrination, très bon mot qui nous permet de conserver à pèlerinage, lequel est exactement le même, une acception spéciale. Quelques Italianismes ne se sont naturalisés chez nous qu’en subissant des métamorphoses bizarres; comme l’Alfana du chevalier de Cailly, ils ont beaucoup changé en route, supercherie, par exemple. L’Italien soverchiare veut dire surpasser et être de superflu; comment supercherie, que l’on en a dérivé, a-t-il le sens d’imposture? Ceux qui l’ont introduit, ne se doutant pas de ce qu’il voulait réellement dire, lui ont attribué une signification de fantaisie, qui a prévalu tout de même.
Ces Dialogues ont un grand mérite; ils sont d’une lecture attrayante, tout en roulant sur des sujets qui ne semblent pas précisément appeler le mot pour rire. En les achevant, on s’aperçoit qu’on vient de passer quelques longues heures en compagnie de Mesdames Grammaire, Linguistique et Syntaxe, personnes maussades entre toutes, non seulement sans ennui, mais avec plaisir. Henri Estienne, ce laborieux érudit, tout bourré de Grec et de Latin, est le moins pédant des savants. Il écrit sans plan bien arrêté d’avance, au 224 courant de la plume; son Celtophile et son Philausone engagent, plutôt qu’une discussion dogmatique, une conversation à bâtons rompus qu’un rien fait dévier. Des anecdotes, des reparties, des souvenirs, des citations, rompent continuellement la trame de l’entretien et l’empêchent d’être jamais monotone; la satire des mots amène la satire des mœurs et donne prétexte à d’amusantes digressions. «Les imperfections mêmes de cet ouvrage, très patriotique au fond», dit avec beaucoup de justesse M. Francis Wey, «contribuent à en rehausser l’intérêt historique, car, délaissant parfois le sujet principal, l’auteur, emporté par l’instinct comique, affuble son courtisan de tous les ridicules du jour et profite de l’occasion pour généraliser la satire, en l’étendant à quantité de préjugés, d’usages et de prétentions des gens du bel air. La physionomie des Raffinés d’une époque où la chose que ce mot a désignée depuis n’avait pas encore reçu de sobriquet, se trouve là tout entière; ce livre équivaut à des Mémoires intimes.»
Qui croirait que ces inoffensifs Dialogues furent vus d’aussi mauvais œil à Genève que l’Apologie pour Hérodote, cette grosse machine de guerre dirigée insidieusement contre la superstition religieuse? Ils attirèrent à Henri Estienne tant de tracasseries, qu’il prit le parti de rentrer en France. Depuis que l’Apologie avait tant bien que mal réussi à passer par les mailles de la censure, on le surveillait étroitement; il était obligé de montrer en épreuves chaque feuille qui sortait de ses presses: on l’accusa, pour les Dialogues, d’avoir fait des additions sur ses épreuves, introduit en fraude des récits d’un tour trop libre, des anecdotes 225 inconvenantes. L’édition fut saisie. Au fond, ce qui déplaisait chez Henri Estienne, c’était son franc parler sur toutes matières et sa force satirique. Les sectaires ne détestent pas la raillerie quand ils s’en servent eux-mêmes, et Théodore de Bèze, l’un de ses rigides censeurs, ne s’en faisait pas faute à l’occasion; mais c’est une arme dangereuse, qu’ils n’aiment pas voir aux mains des autres.
Mai 1883.


XXVI
LES CADENAS
ET CEINTURES DE CHASTETÉ[88]

On verra si l’on veut l’origine des Cadenas de chasteté dans ce nœud spécial, appelé Herculéen, qui attachait la ceinture de laine des vierges Grecques, et que le mari seul devait dénouer, le soir de ses noces. Solidifiez ce nœud, appliquez-le à une armature de métal, et vous avez à peu près le Cadenas; mais les Grecs ne paraissent pas avoir connu cet appareil de sûreté. Ce n’est que dans le conte de Voltaire que l’on voit Proserpine défendue par une armure de ce genre; Vulcain, l’habile ouvrier, ne réussit jamais qu’à forger le fameux filet qui lui permit de surprendre le flagrant 227 délit, non de l’empêcher; et quand Ulysse fermait la porte de son royal logis au moyen d’une cheville passée dans des courroies, il eût sans doute été bien en peine de mettre une serrure à Pénélope.
La ceinture de virginité des jeunes Grecques se revêtait à la nubilité et se quittait dès le mariage; tout au contraire, la Ceinture de chasteté était présentée par le mari à la femme le matin de la nuit de noces, comme excellemment propre à maintenir entre eux l’union et le bon accord en dissipant toutes ses défiantes appréhensions. Dans l’Aloysia du pseudo-Meursius, cette élégante peinture des mœurs du XVIe siècle, voici par quels arguments un mari, qui a bien ses raisons pour se tenir sur ses gardes, décide sa femme à en revêtir une. C’est elle-même, Tullia, qui raconte l’incident à son amie Ottavia: «Certes,» me dit-il, «je suis bien persuadé que tu es on ne peut plus honnête et chaste; néanmoins j’ai peur pour ta vertu, si toi et moi ne lui venons en aide.—Qu’ai-je donc fait pour qu’il te vienne à l’idée un soupçon pareil, mon cœur?» demandai-je; «quelle opinion as-tu de moi? Je n’entends pourtant pas m’opposer à ce que tu as pu résoudre.—Je veux,» reprit-il, «te mettre une Ceinture de chasteté; si tu es vertueuse, tu ne t’en fâcheras pas; dans le cas contraire, tu conviendras que c’est avec raison que je suis porté à agir de la sorte.—Je mettrai tout ce que tu voudras,» répliquai-je; «je n’existe que pour toi, je ne serai femme que pour toi, bien volontiers, isolée de tout le reste du monde, que je méprise ou que je déteste. Je ne parlerai pas même à Lampridio, je ne 228 le regarderai même pas.—Ne fais pas cela,» s’écria-t-il; «au contraire, je veux que tu en uses avec lui familièrement, quoique honnêtement, et que ni lui ni moi nous n’ayons sujet de nous plaindre de toi: lui, si tu le traitais trop rudement, moi, si tu lui faisais trop bonne mine. La Ceinture de chasteté te permettra de vivre en pleine liberté avec lui, et me donnera vis-à-vis de Lampridio sécurité entière.» A l’aide d’un ruban de soie dont il m’entoura le corps au-dessus des reins, il prit alors la mesure, à la grosseur de mon corps, des dimensions que devait avoir la ceinture, puis, d’un autre ruban de soie, mesura l’intervalle de mes aines à mes reins. Cela fait: «J’aurai soin,» ajouta-t-il, «de te montrer ostensiblement combien je t’estime. Les chaînettes, qui doivent être recouvertes de velours de soie, seront en or; l’ouverture sera en or, et le grillage, en or aussi, sera extérieurement constellé de pierres précieuses. Un orfèvre, le plus renommé de notre ville, à qui j’ai souvent rendu des services, va s’appliquer à en faire le chef-d’œuvre de son art. Je te ferai donc honneur, tout en semblant te faire injure[89].»
Quel honneur! M. de Laborde[90] semble croire que les spécimens qui nous restent de ces engins sont dépourvus d’authenticité. «Des interprétations forcées,» 229 dit-il, «ont donné une sorte d’existence légale à un conte et servi de passeport à des pièces curieuses de musées d’amateurs. Comme usage établi, ces Ceintures n’ont point existé, surtout chez une nation aussi spirituelle que la nôtre: comme lubie de quelque maniaque, elles peuvent avoir été forgées exceptionnellement. Je les rejette donc, et conseille aux amateurs d’en faire autant.» Qu’une telle pratique ait existé chez un peuple Européen à l’état de coutume générale, d’usage établi, nul ne le prétend; mais en Espagne, en Italie et même en France, les maris ou les amants jaloux qui ont jugé à propos d’y contraindre leurs femmes étaient peut-être plus nombreux qu’on ne pense. Quoi qu’en ait dit Molière, les verroux et les grilles sont des obstacles d’une efficacité réelle; l’efficacité sera bien plus grande encore si cette serrurerie est appliquée non seulement aux portes et aux fenêtres, mais à la personne même de la femme, rendue ainsi artificiellement invulnérable. A un point de vue très égoïste, le corps de la femme est comme le garde-manger des plaisirs de l’homme; quoi de plus simple que de mettre au garde-manger un cadenas, de peur que quelque intrus ne vienne faire main basse sur les meilleurs morceaux et dévorer les friandises?
En Europe, le plus ancien personnage dont l’histoire ou plutôt la légende fasse mention comme ayant appliqué à ses femmes ou à ses maîtresses un appareil de ce genre est Francesco da Carrara, le dernier seigneur souverain de Padoue au XIVe siècle. Freydier l’en considère comme l’inventeur. Il avait puisé ses renseignements dans l’abbé Misson (Voyage d’Italie, 230 tome Ier, p. 112), qui dit avoir vu au Palais Ducal de Venise le buste de ce tyran «fameux par ses cruautés,» étranglé avec ses quatre enfants et son frère, par ordre du Sénat de Venise. «On y montre de plus,» ajoute-t-il, «un coffret de toilette dans lequel il y a six petits canons qui y sont disposés avec des ressorts ajustés d’une telle manière, qu’en ouvrant le coffret les canons tirèrent et tuèrent une dame, la comtesse Sacrati, à laquelle Carrara avait envoyé la cassette en présent. On montre avec cela de petites arbalètes de poche et des flèches d’acier dont il prenait plaisir à tuer ceux qu’il rencontrait sans qu’on s’aperçût presque du coup, non plus que de celui qui le donnait. Ibi etiam sunt seræ et varia repagula quibus turpe illud monstrum pellices suas occludebat[91].» Dulaure, après Freydier, a quelque peu brodé sur ce passage. Il prétend, ce que ne dit pas Misson, quoiqu’il le laisse entendre, que ses actes de cruauté traînèrent sur l’échafaud Francesco da Carrara; qu’un des chefs d’accusation relevés contre lui fut l’emploi des Ceintures de chasteté dont il avait cadenassé toutes les femmes de son sérail, et que l’on conserva longtemps un coffre rempli de ces Ceintures et Cadenas comme pièces de conviction dans le procès fait à ce monstre. Le désir tout naturel d’avoir quelques détails sur un procès si extraordinaire et sur un tyran Moyen-âge si bien réussi, nous a conduit à faire quelques recherches, et notre désappointement a 231 été grand de ne rien trouver, ou de ne trouver que des faits en contradiction complète avec les assertions de Misson, de Freydier et de Dulaure. Francesco II da Carrara, dont les Chroniques Italiennes recueillies par Muratori parlent presque toutes et très longuement, car il joua un rôle considérable à la fin du XIVe siècle, fut bien étranglé dans sa prison à Venise, mais comme ennemi politique, pour s’être emparé de Vérone et de quelques villes Lombardes à la mort de Galéaz Visconti. Bloqué dans Padoue et forcé de capituler, il reprit les armes, après avoir feint d’accepter les conditions du vainqueur qui, s’étant emparé de lui, résolut de s’en défaire. Son procès et son exécution sont racontés dans leurs plus menus détails par Andrea Navagero (Storia della republica Veneziana), par Sanuto (Vite dei Duchi di Venezia), par l’auteur du Chronicon Tarvisianum, et surtout dans l’Istoria Padovana d’Andrea Gattaro; de son sérail, de ses femmes cadenassées, de la boîte à surprise qui tua la comtesse Sacrati, des arbalètes de poche, il n’est pas dit un traître mot. L’abbé Misson aura prêté une oreille trop confiante aux contes d’un cicerone fallacieux. Restent donc seulement ces Cadenas et ferrements qu’il a dû voir et dont l’existence paraît certaine, qu’ils provinssent de Francesco da Carrara ou de tout autre. Moins d’un siècle après ce voyageur, quand le président de Brosses visita le petit Arsenal du Palais des Doges, ces engins se trouvaient réduits à un seul, et le sérail du tyran, diminué dans la même proportion, ne se composait plus que d’une femme, son épouse légitime. «C’est aussi là,» dit le spirituel président, «qu’est un Cadenas célèbre dont jadis un certain tyran de 232 Padoue se servoit pour mettre en sûreté l’honneur de sa femme. Il falloit que cette femme eût bien de l’honneur, car la serrure est diablement large!» (Lettres familières, XVIe). Voilà comment s’évanouissent les légendes quand on les examine d’un peu près.
Le président de Brosses n’ayant pas jugé à propos de nous décrire ce Cadenas, et la pudeur de l’abbé Misson l’ayant empêché de dire autre chose que quelques mots, en Latin, de ceux qu’il avait vus, nous ne pouvons que conjecturer ce qu’ils étaient. Les divers systèmes employés dans la construction de ces appareils ingénieux nous sont heureusement connus, soit par des descriptions précises, soit par des spécimens encore existant dans les collections publiques. Le plus simple est celui d’une des Ceintures de chasteté conservées au Musée de Cluny. L’occlusion est formée par un bec d’ivoire rattaché par une serrure à un cerceau d’acier muni d’une crémaillère. Le bec d’ivoire, dont la courbe suit celle du pubis et s’y adapte exactement, est creusé d’une fente longitudinale pour le passage des sécrétions naturelles; la crémaillère permet d’ajuster à la taille le cerceau, qui est recouvert de velours, pour ne pas blesser les hanches, et on la maintient au cran voulu en donnant un tour de clef. Une tradition que rien ne justifie prétend que cette Ceinture est celle dont Henri II revêtait Catherine de Médicis; son exiguïté n’aurait pas permis de l’ajuster à une femme d’un aussi riche embonpoint que l’était la reine, à qui un soldat fit la réponse rapportée par Brantôme. Elle demandait pourquoi les Huguenots 233 avaient donné son nom à une énorme couleuvrine:—«C’est, Madame,» lui dit l’homme, «parce qu’elle a le calibre plus grand et plus gros que toutes les autres.»
La Ceinture de chasteté décrite par N. Chorier dans l’ouvrage cité plus haut reposait sur une combinaison différente: un grillage d’or était maintenu fixe sur le pubis par quatre chaînettes dont deux, soudées au haut de la grille, s’attachaient par devant à la ceinture; deux autres s’attachaient par derrière en passant sous les cuisses.
Mais tout n’était pas en sûreté avec ce système, pas plus qu’avec le précédent. La grille d’or, comme le bec d’ivoire, ne protégeait que la chasteté du devant, en laissant l’autre absolument sans défense. Un Français pouvait s’en contenter, aussi croirions-nous volontiers ces engins de fabrication Française; mais un Italien du XVIe siècle (ménageons nos contemporains), n’aurait jamais cru sa femme entièrement sauvegardée par un appareil si incomplet. Les maris jaloux de ce temps-là étaient trop soupçonneux, trop bien au fait des habitudes de leurs compatriotes, pour ne prendre leurs précautions que d’un seul côté.
La seconde ceinture conservée au Musée de Cluny répond au double objet que les Italiens devaient se proposer, et elle est de plus fort remarquable: excellente comme engin préservatif, elle est en même temps un objet d’art. Elle se compose de deux plaques de fer forgé, gravé, damasquiné et repiqué d’or, réunies dans le bas par une charnière et dans le haut par une ceinture en fer ouvragé et à brisures. Tout autour des plaques et de la ceinture sont ménagés des trous 234 destinés à la piqûre des doublures. La plaque de devant porte à l’extrémité inférieure une ouverture dentelée de forme allongée; l’ouverture de celle de derrière est en forme de trèfle. Toutes deux sont décorées de mascarons et d’arabesques; sur la partie antérieure sont de plus gravées les figures d’Adam et Ève. C’est une cuirasse à l’épreuve des armes les mieux trempées et défiant d’un côté comme de l’autre les tentatives les plus audacieuses. Voilà un véritable ouvrage Italien; aussi bien est-ce d’Italie que Mérimée l’a rapporté, pour en faire don au Musée de Cluny.
L’auteur de l’article Ceinture de chasteté, dans l’Encyclopédie, en décrit une autre d’une fermeture aussi exacte, mais d’une construction tout à fait primitive. «Cette Ceinture,» dit-il, «est composée de deux lames de fer très flexibles assemblées en croix; ces lames sont couvertes de velours. L’une fait le tour du corps, au-dessus des reins, l’autre passe entre les cuisses, et son extrémité vient rencontrer les deux extrémités de la première lame; elles sont toutes trois réunies par un Cadenas dont le mari seul a le secret. La lame qui passe entre les cuisses est percée de manière à assurer un mari de la sagesse de sa femme, sans gêner les autres fonctions naturelles.»
Faut-il placer parmi les spécimens du genre la Ceinture dont parle Freydier, dans son plaidoyer pour la demoiselle Lajon? Ce n’était pas, en tout cas, un objet d’orfèvrerie comparable à celui que nous avons décrit plus haut. Freydier la définit «un caleçon bordé et maillé de plusieurs fils d’archal réunis par des coutures,» au maintien desquelles veillaient de nombreux cachets de cire d’Espagne. Elle ne devait pas être d’une 235 solidité exemplaire, malgré la serrure qui commandait tout le système; le sieur Berlhe, le tyran de Padoue de la dlle Lajon, avait dû la fabriquer lui-même des débris de quelque vieille cotte de mailles. Elle n’en serait que plus curieuse, si on l’avait conservée au Musée de Nîmes, comme produit d’un art naïf et spontané, ne devant rien à l’imitation des maîtres.
Tout le monde est d’accord, au moins chez nous, pour rejeter en Italie l’invention et l’usage plus ou moins commun de la Ceinture de chasteté. Diderot l’appelle l’engin Florentin; Voltaire croit ou feint de croire qu’à Rome et à Venise l’emploi en est général; Saint-Amand dit aussi que la plupart des Romaines portaient de son temps des caleçons ou brayers de fer:
Rabelais (Pantagruel, III, XXVI) fait dire à Panurge: «Le Diantre, celluy qui n’a point de blanc en l’œil, m’emporte doncques ensemble, si je ne boucle ma femme à la Bergamasque, quand je partiray hors de mon serrail!» locution qui ferait croire que les Bergamasques usaient encore plus communément que tous les autres Italiens de ces sortes de clôture mécanique, ou que les serruriers de Bergame avaient acquis en ce genre de fabrication la supériorité des armuriers 236 de Tolède pour la trempe des fines lames d’épées. Dans les Mémoires du comte de Bonneval sont racontés les amours de cet aventurier célèbre avec une dame de Côme qui se trouvait porter une de ces Ceintures. Il n’était pas possible de la couper ou de la découdre sans qu’on s’en aperçût, et sa vie en dépendait. Bonneval tue en duel le mari et est obligé de s’enfuir à Vienne où, l’histoire ayant transpiré, les dames de la haute aristocratie et l’empereur François-Joseph lui font mille questions sur ce curieux instrument, inconnu en Autriche. Mais ces Mémoires sont apocryphes. Particularité assez étrange, autant on trouve de renseignements sur les Ceintures de chasteté Italiennes dans les auteurs Français, autant les Italiens sont muets là-dessus. On n’y relève, à notre connaissance, aucune allusion dans leurs conteurs du XVe et du XVIe siècle, si féconds pourtant en histoires d’amours, en mésaventures conjugales, en vengeances de maris jaloux. Explique qui voudra cette anomalie.
Quoi qu’il en soit, la mode faillit s’en introduire chez nous, sous Henri II. Brantôme (Dames galantes, Discours 1er) parle d’un quincaillier «qui apporta une douzaine de certains engins à la foire de Sainct-Germain pour brider le cas des femmes; ils estoient faits de fer et ceinturoient comme une ceinture, et venoient à prendre par le bas et se fermer à clef; si subtilement faits, qu’il n’estoit pas possible que la femme, en estant bridée une fois, s’en peust jamais prévaloir pour ce doux plaisir, n’ayant que quelques trous menus pour servir à pisser.
»On dit qu’il y eut quelque cinq ou six marys jaloux fascheux, qui en acheptèrent et en bridèrent leurs 237 femmes de telle façon qu’elles purent bien dire: Adieu bon temps! Si y en eut-il une qui s’advisa de s’accoster d’un serrurier fort subtil en son art, à qui ayant montré le dit engin, et le sien et tout, son mary estant allé dehors aux champs, il y appliqua si bien son esprit qu’il lui forgea une fausse clef, que la dame le fermoit et ouvroit à toute heure, quand elle vouloit. Le mary n’y trouva jamais rien à dire; elle se donna son saoul de ce bon plaisir, en dépit du fat jaloux cocu de mary, pensant vivre toujours en franchise de cocuage. Mais ce méchant serrurier, qui fit la fausse clef, gasta tout, et si fit mieux, à ce qu’on dit, car ce fut le premier qui en tasta et le fit cornard. On dit bien plus qu’il y eut beaucoup de gallants honnestes gentilshommes de la Cour, qui menacèrent de telle façon le quincaillier, que, s’il se mesloit jamais de porter de telles ravauderies, qu’on le tueroit, et qu’il n’y retournast plus, et jettast tous les autres qui estoient restez dans le retrait, ce qu’il fit. Et depuis onc n’en fut parlé, dont il fut bien sage, car c’estoit assez pour faire perdre la moitié du monde, à faute de ne le peupler, par tels bridements, serrures et fermoirs de nature, abominables et détestables ennemis de la multiplication humaine.»
L’introduction et l’emploi de ces engins en France remonterait beaucoup plus haut que le règne de Henri II, si l’on prenait au pied de la lettre certaines paroles assez obscures des écrivains du XVe siècle. Guillaume de Machault disait, par exemple, en parlant d’une de ses maîtresses:
Agnès de Navarre écrivait à ce même Guillaume de Machault: «Ne veuilliez mie perdre la clef du coffre que j’ai, car si elle estoit perdue, je ne croi mie que j’eusse jamais parfaite joie. Car, par Dieux! il ne sera jamais deffermé d’autre clef que celle que vous avez, et il le sera quand il vous plaira.» Guillaume répondait à Agnès: «... Quant à la clef que je porte du très riche et gracieux trésor qui est en coffre où toute joie, toute grace, toute douceur sont, n’ayez doubte qu’elle sera très-bien gardée, se à Dieu plaist et je puis. Et la vous porterai le plus briément que je porrai, pour veoir les graces, les gloires et les richesses de cest amoureux trésor.» Des commentateurs ont pensé que, pour assurer son amant de sa constance, Agnès de Navarre portait de son plein gré une Ceinture de chasteté dont elle avait donné la clef à Guillaume de Machault; mais on peut interpréter ces passages dans un sens tout allégorique et immatériel, assez conforme au symbolisme raffiné des fidèles d’Amour.
De la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIIe, les indications relatives à l’emploi des Ceintures de chasteté, 239 sans être bien nombreuses, laissent pourtant croire que le quincaillier de Brantôme avait eu des successeurs. M. Niel, dans ses Portraits du XVIe siècle, cite une gravure satirique dont on pourrait conclure que Henri IV était soupçonné de prendre ce genre de sûreté avec une de ses maîtresses. Elle est intitulée: Du coqu qui porte la clef et sa femme la serrure, et représente assise sur un lit une femme nue, dans laquelle on reconnaît les traits de la marquise de Verneuil. Celle-ci a autour du corps une Ceinture à cadenas dont elle remet la clef au Béarnais; mais derrière les rideaux du lit la chambrière présente une seconde clef à un galant gentilhomme, qui tire sa bourse pour la payer.
Voltaire eut l’occasion, dans sa jeunesse, d’en voir et d’en palper une, bien authentique, celle-là, et solidement verrouillée autour du corps d’une de ses premières maîtresses, qu’il désigne sous le nom resté mystérieux de Mme de B...; c’est ce qui nous a valu le joli conte du Cadenas. L’auteur, dit une note de l’édition de Kehl, avait environ vingt ans quand il fit cette pièce, adressée en 1716 à une dame contre laquelle son mari avait pris cette étrange précaution; elle fut imprimée pour la première fois en 1724.
Les Ceintures de chasteté n’étaient donc pas d’un emploi aussi rare qu’on serait tenté de le croire à première vue, et nous en trouvons encore une preuve dans le plaidoyer de Freydier, avocat de Nimes, en faveur de la malheureuse que son amant forçait à s’embarrasser de cette prison portative, quand il allait en voyage. Ce plaidoyer est antérieur à 1750, année où il a été imprimé pour la première fois. Pour bien connaître l’affaire, il nous faudrait avoir le reste du 240 dossier, la défense de la partie adverse et surtout le jugement, dont les considérants ne pouvaient manquer d’être curieux; mais la harangue de l’avocat Nimois a été seule sauvée de l’oubli. Un Nicolas Chorier aurait peut-être tiré de cette cause grasse un meilleur parti; cependant, tel qu’il est, ce morceau mérite d’être apprécié des connaisseurs. C’est, en tout cas, le dernier document positif que nous ayons sur la matière; il termine la série des renseignements que l’on peut réunir sur un usage très probablement tombé aujourd’hui en pleine désuétude.
Août 1883.


XXVII
LA
TARIFFA DELLE PUTTANE
DI VENEGIA[92]

La présente réimpression de la Tariffa delle Puttane di Venegia[93] a été faite d’après une copie que Tricotel, l’érudit bien connu, mort il y a quelques années, avait obtenu de prendre sur nous ne savons quel exemplaire, et, sans cette copie, il nous aurait été probablement impossible de faire figurer dans notre Collection un ouvrage de si haute curiosité. Nous ne connaissons de la Tariffa delle Puttane que les deux 242 exemplaires signalés par Brunet, l’un comme ayant été acquis 3 liv., 13 shel., 6 den. à la vente Heber, prix exceptionnellement bas, et le second qui parut successivement aux ventes Nodier (395 fr.) et Libri (355 fr.). L’espoir d’en jamais rencontrer un troisième était donc à peu près nul, et force nous eût été d’en faire notre deuil, si le manuscrit de Tricotel n’avait passé entre les mains de l’Éditeur.
M. Deschamps a consacré quelques lignes à la Tariffa delle Puttane dans le Supplément au Manuel du Libraire. «Ce livret rarissime,» dit-il, «est exécuté incontestablement avec les types de Zoppino de Venise; ce sont les mêmes caractères ronds qui ont servi à l’exécution des Satire d’Ariosto publiées la même année (1535) par cet imprimeur. Passano (I Novellieri Italiani in verso, p. 144-148) parle en détail de cet opuscule que l’on a sans raison plausible porté à l’actif d’Aretino, mais qu’on peut attribuer sans hésitation à Lorenzo Veniero, l’auteur de la Zaffetta.» Cependant, la Tariffa delle Puttane n’est probablement pas de 1535, et certainement pas de Lorenzo Veniero. Elle est postérieure à la Zaffetta, à laquelle il est fait allusion en deux ou trois passages, et on peut lire dans l’Avertissement placé en tête de la traduction récemment parue de ce petit poème[94], les raisons qui portent à croire que la Zaffetta n’a été écrite qu’après la Seconde Partie des Ragionamenti, c’est-à-dire après 1536. L’auteur n’est pas non plus Lorenzo Veniero, 243 puisqu’il l’invoque, avec l’Aretino, comme étant le poète qui avant lui a le plus disertement parlé des Courtisanes; il s’écrie:
et un peu plus loin, à propos de la Zaffetta:
Veniero aurait pu, à la vérité, s’invoquer ainsi lui-même pour donner le change et faire supposer un autre auteur; mais l’âpreté avec laquelle il revendique, au début de la Zaffetta, la paternité de la Puttana errante, traitant de grosses bêtes et de maroufles ceux qui croyaient ce poème d’un autre que de lui, montre assez qu’il n’était pas d’humeur à se déguiser si bien et à renier ses œuvres.
Une seule chose pourrait faire croire à l’antériorité de la Tariffa: l’Aretino semble la citer dans la Première Journée de la Seconde Partie des Ragionamenti. La Nanna, catéchisant sa fille, lui dit: «Mets-toi à causer du Turc, qui doit venir, du Pape, qui n’est pas encore crevé, de l’Empereur, qui fait des choses miraculeuses, du Roland furieux et du Tarif des Courtisanes de Venise, que j’aurais dû mettre en tête.» Ce doit être une allusion à une autre composition plus ancienne, en prose ou en vers, portant à peu près le même titre 244 que le poème, et qui ne nous est point parvenue; on a, du reste, beaucoup d’exemples de semblables rajeunissements.
Septembre 1883.

XXVIII
LES
CONTES DE VASSELIER[95]

Joseph Vasselier n’est connu que de quelques amateurs: c’est à peine si les historiens de la Littérature Française consentiraient à lui donner une toute petite place, dans le voisinage de Desmahis, parmi les poetæ minores du XVIIIe siècle, et, s’il n’était l’auteur que de ses poésies académiques, l’oubli, l’inéluctable oubli, le couvrirait entièrement; mais il a fait ses Contes, et tous ceux entre les mains de qui a pu tomber d’aventure ce petit volume devenu rare, auront été sans doute surpris, comme nous-même, de ce qu’un homme peut dépenser d’esprit, de gaîté et d’invention sans devenir pour cela célèbre; la même surprise attend ceux qui feront connaissance avec lui dans la présente réimpression.
246 Les Contes de Vasselier parurent en 1800; l’auteur était mort deux ans auparavant (1798), survivant, à travers la tourmente révolutionnaire, au régime sous lequel il avait vécu, écrit, et sans avoir un seul instant songé à rassembler ses œuvres, productions légères restées pour la plupart manuscrites, quelques-unes seulement ayant été insérées dans les journaux. Ses amis lui rendirent le pieux service de les recueillir en deux volumes, dont le premier (à Paris, de l’imprimerie d’Égron) est intitulé Poésies, et composé d’Épîtres, de Couplets de table et d’Impromptus; le second (Paris, sous la rubrique de Londres) renferme les Contes, bien supérieurs à ces pièces de circonstance que nul aujourd’hui ne songerait à réimprimer. Ils assignent à Vasselier un rang très honorable au-dessous de La Fontaine, sans doute, mais peut-être au-dessus de Grécourt. Ce ne sont, pour le plus grand nombre, que de brefs récits en douze ou quinze vers, courant au trait final avec la rapidité de l’épigramme; un bon mot, quelquefois déjà connu (l’Horloge, le Quiproquo, la Bagarre, l’Apostolat, l’Appétit vient en mangeant), suffit souvent au poète, mais il réussit aussi bien une composition plus détaillée, exigeant plus de soin et d’art chez le conteur, par exemple le Cas réservé, la Fileuse, le Nœud conjugal, où il essaye de lutter avec La Fontaine; il n’est faible que lorsqu’il veut trop s’étendre et s’ingénie à remplir avec des riens une vaste toile, comme dans le Mage consulté, le Pouvoir de la vanité et même la fameuse Origine des truffes, qui passe pour son chef-d’œuvre et qui lui valut d’être remarqué par Voltaire. La pièce est d’une mythologie un peu prétentieuse, et Vasselier, encouragé par 247 les suffrages du grand philosophe, lui a donné dans la Sauce Robert un pendant culinaire de plus haut goût. Il est tout à fait bon dans les petites pièces comme le Sifflet, le Cul de poule, etc., presque toutes celles, au reste, qui composent le recueil; et le rigide Vauvenargues, qui trouvait des longueurs aux Contes du Bonhomme, serait ici forcé de rester bouche close.
L’amitié de Voltaire fut le seul événement un peu considérable de la vie de Vasselier. Né à Rocroi en 1735, après avoir passé presque toute sa jeunesse dans la profession des armes, il quitta l’uniforme en 1762 pour entrer dans l’administration des Postes, où il acquit rapidement le grade de premier commis, à Lyon. Il s’attira la bienveillance de Voltaire, établi à Ferney, en facilitant la circulation de ses écrits, plus sans doute encore que par ses talents poétiques, et d’amicales relations s’établirent entre eux. Tous les ans il se rendait à Ferney et y faisait un assez long séjour; Voltaire lui offrit plusieurs fois de lui donner une retraite assurée, dans une maison qui lui appartiendrait en toute propriété, indépendante du château; Vasselier préféra garder son poste et continuer de s’y rendre utile à son illustre ami. C’était un homme de mœurs simples et paisibles, aimant la bonne chère et payant son écot à table par quelques spirituels couplets. Ses vers, un peu sérieux, quoique toujours enjoués, ainsi qu’il sied à un bon vivant, ont été composés pour l’Académie de Lyon, dont il était membre. Les plus travaillés sont le Remercîment, qu’il lut à sa séance d’admission, en 1782, les Vers sur la Paix (1783) et une Épître sur les ennuis de la vie (1784); malgré le mérite littéraire de ces pièces, le poète est beaucoup 248 plus lui-même dans ces légères épîtres, moitié vers et moitié prose, qu’il adressait à Voltaire, dans ses Couplets de table et surtout dans ses Contes.
Novembre 1883.


XXIX
LA PUTTANA ERRANTE
poème
DE LORENZO VENIERO[96]

Deux ouvrages que l’on confond le plus souvent, un Poème et un Dialogue en prose, portent le titre de Puttana errante; tous les deux étaient attribués autrefois à Pietro Aretino, qui n’a fait ni l’un ni l’autre.
Le Poème, parodie bouffonne des romans de chevalerie et œuvre de Lorenzo Veniero, le meilleur disciple de l’Arétin, est plus ancien que le Dialogue. Son auteur, jeune patricien qui occupa de hautes charges dans la République et fut le père d’un prélat, Maffeo Veniero, évêque de Corfou, l’avait composé dans sa 250 jeunesse. Ce Lorenzo Veniero fut peut-être un homme d’État distingué, mais ce fut certainement un amoureux vindicatif. Les deux petits poèmes qui nous donnent une idée très suffisante de sa verve satirique et qui ont transmis son nom à une postérité déjà reculée, la Puttana errante et la Zaffetta, sont des diatribes d’une violence extrême, d’une exagération monstrueuse, dirigées contre deux belles et bonnes filles qui avaient eu le grand tort de coucher avec lui. L’une, la Zaffetta, lui ferme un soir sa porte en lui faisant dire par sa chambrière qu’elle ne peut le recevoir: c’en est assez à l’irascible gentilhomme-poète pour qu’il la livre, par métaphore seulement, espérons-le, aux brutalités des garçons d’auberge et des pêcheurs de Chioggia. L’autre, il la soupçonne de lui avoir escamoté sa bourse pendant qu’il la caressait, ce dont elle était coutumière, nous dit-il: pour s’en venger, il lui compose une effroyable généalogie de coupe-jarrets, de sbires et de filous, la promène en errante Paladine, en Marphise d’un nouveau genre, à travers toutes les villes de l’Italie, qu’elle régale du spectacle de ses lubriques prouesses, et, dans le triomphe que finalement on lui décerne à Rome, il fait figurer à la queue du cortège un énorme char rempli des larcins que ses mains rapaces ont opérés partout. Tel est le sujet des quatre Chants de la Puttana errante.
L’ouvrage en prose qui porte le même titre, par supercherie, est très inférieur au poème en mérite littéraire, mais il est beaucoup plus connu; c’est de lui qu’entendent parler Libri, Ch. Nodier, et bien d’autres, lorsqu’ils appellent l’Arétin l’auteur de la Puttana errante. On ne sait pas au juste l’époque où ce titre a 251 été appliqué, sans que rien le justifiât, au premier des Dialoghi doi di Ginevra e Rosana, parus dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous le couvert du nom illustre de Pietro Aretino, dont ils ne rappellent en rien le style ni la manière. La plus ancienne édition datée que l’on ait de ces deux Dialogues est de 1584. Sont-ce les Elzévirs qui, en donnant en 1660 leur édition des Ragionamenti, ont eu l’idée de détacher le premier du second, d’en rajeunir le style, de changer les noms des interlocutrices, et d’intituler l’ouvrage: La Puttana errante, ovvero Dialogo di Maddalena e Giulia, pour satisfaire la curiosité des lecteurs, qui demandaient la fameuse Putain errante de l’Arétin? ou bien la supercherie leur est-elle antérieure, comme on peut le conjecturer d’une édition de Venezia, senz’anno, citée dans le Catalogue de Floncel, où déjà le premier Dialogue, séparé de l’autre, porte le titre de Puttana errante? La question n’a qu’une importance secondaire. Nous savons par une lettre de Francesco Coccio à Lionardo Parpaglioni, réimprimée par les anciens éditeurs des Ragionamenti, que de semblables fraudes avaient lieu du vivant même de l’Arétin, et que les mauvais plaisants n’attendirent pas sa mort pour lui attribuer leurs propres élucubrations. «C’est un péché,» dit-il, «que Sa Seigneurie n’ait pas recueilli la multitude de gentilles œuvres qu’elle a composées; il est bien vrai qu’elles ne sont pas perdues et que le duc de Mantoue en a un grand nombre, mais le mal, c’est que beaucoup de gens qui veulent se donner du crédit mettent son nom à leurs sottises. Laissons faire: un Michel-Ange, un Sansovino, un Sebastiano del Piombo resplendiraient jusque dans les ténèbres!» Ce bon Coccio, 252 admirateur fervent de celui qu’il appelle «l’homme divin», s’exagérait évidemment la perspicacité des connaisseurs; de même qu’une quantité innombrable de vieilles croûtes enfumées sont pieusement reçues dans nos Musées comme de Sebastiano del Piombo, qui était un grand paresseux et n’aurait jamais pu tant produire, quand bien même il eût été le plus infatigable peintre de son temps: de même les Dialoghi doi di Ginevra e Rosana, la Puttana errante qu’on en a tirée postérieurement, le Zoppino, les Dubbii amorosi, une quinzaine de sonnets apocryphes ajoutés aux Sonetti lussuriosi, etc., sont encore attribués sans hésitation à Pietro Aretino par bon nombre de lettrés.
La similitude du titre lui a fait également attribuer la Puttana errante en vers, avec d’autant plus de facilité que ses contemporains l’en avaient cru l’auteur, et il s’est établi de bonne heure, entre deux ouvrages si différents, une confusion dont les bibliographes les plus experts ne se sont pas toujours tirés à leur honneur. Ceux qui, en les distinguant l’un de l’autre, comme La Monnoye, les ont cru tous deux de l’Aretino, ne se sont trompés que légèrement en comparaison de ceux qui affirment, comme Severio Quadrio, que le Poème est le Dialogue mis en vers: il n’y a pas la moindre conformité entre les deux; Osmont commet une méprise du même genre lorsqu’il considère le Dialogue de Magdelaine et de Julie comme la traduction Française du Poème. Bayle restitue bien le Poème à Lorenzo Veniero, l’Arétin l’ayant désavoué, dit-il, ce qui est vrai, mais il ajoute que l’auteur y traite au long de i diversi congiungimenti jusqu’au nombre de 253 trente-cinq, et Forberg[97], croyant Bayle sur parole, nous conte que Lorenzo Veniero, noble Vénitien, «a pris sur lui d’énumérer, dans la Puttana errante, jusqu’à trente-cinq manières de faire l’amour;» ils parlent du poème, c’est évident, et les trente-cinq postures, abusivement dites de «l’Arétin», ne se trouvent que dans le Dialogue en prose, dont ni l’Arétin ni le Veniero n’est l’auteur. Ces erreurs seraient singulières s’il s’agissait de tous autres livres, mais la grande rareté de ceux-ci les rend excusables. La Puttana errante en prose, ou Dialogo di Maddalena e Giulia, c’est-à-dire la première partie des Dialoghi doi di Ginevra e Rosana rajeunie de style et pourvue d’un titre qui ne lui convient aucunement, se trouve encore avec assez de facilité, grâce à sa réimpression dans l’édition des Ragionamenti due aux Elzévirs (Cosmopoli, 1660, in-8o); mais le Poème de Veniero, quoiqu’il ait eu au moins deux éditions, l’une sans nom d’auteur, l’autre portant, par plaisanterie, le nom de Maffeo Veniero, l’évêque de Corfou, est d’une grande rareté. Pour le réimprimer et le traduire[98], on n’a pu s’en procurer aucun exemplaire, et on a eu recours, comme pour la Tariffa delle Putane, à une copie manuscrite de Tricotel, probablement prise sur les nos Y2 1445 et Y2 1455 de la Bibliothèque Nationale.
Une autre méprise, capitale également, a été 254 commise par des bibliographes mieux informés, Brunet et Hubaud. Elle consiste à croire que, dans ses deux poèmes, Lorenzo Veniero met en scène la même héroïne. Brunet semble n’en faire qu’un seul: «La Puttana errante, La Zaffetta (Venezia, 1531); petit ouvrage très rare, bien digne de l’Arétin par les obscénités dont il est rempli, mais qui lui a été faussement attribué. Lorenzo Veniero, noble Vénitien, en est le véritable auteur. Il le publia pour se venger d’une courtisane de Venise appelée Angela, qu’il désigne sous le nom injurieux de Zaffetta, c’est-à-dire, en langue Vénitienne, fille d’un sbire. Dans le premier poème, il décrit la vie de cette femme; dans le second, la vengeance aussi brutale que cruelle qu’il prit des torts qu’elle avait eus à son égard.» C’est une conjecture très mal fondée. Hubaud, qui a redressé les erreurs de tous les autres bibliographes, a repris celle-ci pour son propre compte et lui a donné une vie nouvelle en en faisant la base même de son travail: Dissertation littéraire et bibliographique sur deux petits poèmes Italiens composés dans le XVIe siècle (1854, in-8o); par exemple, pour déterminer l’âge de la Zaffetta, il met à son actif les courses vagabondes de la Putain errante à travers les principales villes de l’Italie.
La Zaffetta et l’héroïne de la Puttana errante sont deux femmes tout à fait distinctes: la dernière s’appelait Elena Ballarina. Une remarque que Hubaud aurait pu faire, c’est que la Putain errante assiste au sac de Rome, en 1527, qu’elle a déjà accompli la plupart de ses voyages (il ne lui reste plus qu’à se rendre à Naples), et que l’auteur la représente comme une vieille vache effondrée, hors de service; or la Zaffetta, lors de 255 son horrible aventure à Chioggia, en 1531, est une fillette, ayant encore le lait à la bouche:
quatre ans de plus n’avaient pourtant pas pu la rajeunir!
Et puis, comment s’imaginer qu’un trente et un était pour faire peur à une si valeureuse Paladine, qu’elle pleure à chaudes larmes d’avoir à ses trousses une douzaine ou deux de pêcheurs, elle qui vient de courir toute l’Italie précisément à la recherche d’aventures de ce genre? Partout, à Venise, à Padoue, à Ferrare, à Florence, elle a invité les plus redoutables champions à venir par bandes jouter avec elle, et finalement, à Rome, elle a convié l’armée entière du connétable de Bourbon à lui passer sur le corps; le petit trente et un de Chioggia, bien loin de lui être un châtiment, aurait été pour elle un régal.
En second lieu, si Veniero ne donne nulle part le nom de son héroïne dans la Puttana errante, «pour ne pas déshonorer le monde,» dit-il, il le donne dans la Zaffetta, en y comparant l’une à l’autre ses deux ennemies:
Enfin, tous les doutes sont levés par la Tariffa delle Puttane, où la Zaffetta et la Ballarina ont chacune leur 256 petit paragraphe et où cette dernière est dite expressément l’héroïne de la Puttana errante. Voici d’abord ce qui concerne la victime du fameux trente et un:
Au tour de l’autre, maintenant:
Les contemporains savaient bien que l’Errante et la Zaffetta n’avaient rien de commun entre elles; Hubaud gourmande donc à tort Apostolo Zono qui, seul de tous les bibliographes, avait conservé ce souvenir et distingué l’héroïne du Trente et un de celle de la Puttana. On trouverait encore quelques renseignements sur cette dernière dans le Lamento d’Elena Ballarina detta l’Errante, de Niccolò Ponte, l’une des pièces du recueil intitulé Poesie da fuoco. Voilà un point parfaitement éclairci.
Une autre difficulté est un peu plus malaisée à se résoudre: elle est relative à la date de la Puttana errante. La plupart des bibliographes croient que le Poème parut en 1531, mais ils en donnent des raisons si mauvaises, que Hubaud n’a pas eu de peine à croire qu’il les prenait en faute. Ainsi La Monnoye se fonde sur ce passage d’une lettre de Bernardo Arelio de l’Armellino, du 17 Octobre 1531, adressée à l’Aretino: Ho veduto di nuovo una Puttana errante, condutta in fino qua a Turino, et la bella festa che li fanno queste madonne intorno; «J’ai vu dernièrement une Putain errante, qui a poussé jusqu’à Turin, et la belle réception que ces dames lui ont faite.» Bien évidemment, il s’agit là d’une courtisane en tournée, non du poème de Veniero, et ceux qui ont accepté l’interprétation fautive donnée par La Monnoye à ce passage se sont payés de mots. Mais Hubaud erre à son tour en disant qu’une forte raison, à laquelle il est étonné que nul 258 n’ait songé et qui lui fait rejeter une édition de la Puttana errante en 1531, c’est qu’à cette époque Angela Zaffetta n’avait pas plus de treize ans, qu’elle était par conséquent incapable d’avoir accompli tant d’exploits, fait tant de voyages; puisque la Zaffetta n’est point l’héroïne de la Puttana, son âge ne peut nous fournir là-dessus aucun éclaircissement. Appuyé sur cette forte raison, qui ne vaut rien du tout, il reporte à sept ou huit ans plus tard la première édition du Poème. Cependant il avait lu le Capitolo de l’Aretino au duc de Mantoue, et on peut y trouver une indication importante.
Pietro Aretino était fier d’avoir dans le Veniero un si brillant disciple, un poète d’une langue si acérée, d’un vocabulaire si riche en invectives; il ne s’est pas contenté d’écrire le mirifique Sonnet qui se lit en tête du poème et dans lequel il propose de donner un clystère d’encre, ni plus ni moins, à Homère et à Virgile, en l’honneur du chantre de la Puttana: il a redoublé d’éloges en envoyant l’œuvre, dans sa nouveauté, à son grand ami et protecteur le duc de Mantoue. Voici la fin de ce Capitolo qui, comme tous les autres et beaucoup des Lettres de «l’homme divin», avait pour but de hâter l’arrivée d’une gratification en retard:
Ce Capitolo, si on le lit attentivement, semble déceler la date à laquelle l’écrivait l’Aretino. Vers le milieu, toujours à propos de la gratification qui n’arrivait pas, il se demande à quoi tient l’oubli du prince:
Le changement de marquis en duc, dont il est question, ne pouvait être bien ancien lors de l’envoi du Capitolo, sans quoi on ne comprendrait guère qu’il y fût fait allusion. L’Aretino adressait donc la Puttana errante, soit imprimée, soit manuscrite, à Frédéric II de Gonzague, peu de temps après l’érection du marquisat de Mantoue en duché par Charles-Quint, fait 260 qui se place en 1530. Cette particularité, en fixant l’apparition du poème à une date assez rapprochée de ce petit événement historique, rendrait plausible une première édition de 1531 à laquelle ont ajouté foi la plupart des bibliographes.
On peut encore tirer un indice assez probant des mentions que l’Aretino a faites, dans la Première Journée des Ragionamenti (1534) et dans sa comédie du Philosophe (1537), d’un livre intitulé la Puttana errante, et qui semble bien être le poème de Veniero:
«Antonia. Qui donnait les baisers les plus savoureux?
Nanna. Les Moines, sans conteste.
Antonia. Et pour quelle raison?
Nanna. Pour les raisons qu’allègue la Légende de la Putain errante de Venise[99].»
Une opinion toute semblable est soutenue dans le Chant III de la Puttana errante. Dans le Philosophe, Lisa, chambrière d’une courtisane, parle en ces termes de sa maîtresse: «Elle lit la Pippa et l’Antonia» (c’est-à-dire les deux parties des Ragionamenti), «et prétend que leurs roueries sont des sottises, bonnes seulement à duper des nigauds. Le Livre de l’Errante dit qu’au bout de sept années d’études un écolier sur mille s’instruit jusqu’à savoir deux H, mais que, dans le putanisme, en sept jours rien n’y manque (Acte II, scène VII).» Il serait difficile de 261 ne pas voir là un souvenir des débuts du Chant IV; toutefois, les citations sont bien peu textuelles, et les formules vagues dont se sert l’Aretino: la Légende de la Putain errante de Venise, le Livre de l’Errante, ne conviennent pas parfaitement à un poème qui devait être dans sa nouveauté soit en 1534, date de la première Partie des Ragionamenti, soit encore en 1537, date de la comédie du Philosophe. Existait-il, sous le titre de Puttana errante, une vieille légende, antérieure au poème de Veniero, et que celui-ci aurait suivie de très près, en la brodant comme un canevas? Cette supposition avait d’abord été adoptée par nous, et nous avons donné le fait comme certain dans une note au passage des Ragionamenti cité plus haut (Tome I, page 15). Nous ne sommes plus aussi affirmatif aujourd’hui: une pareille hypothèse nous semble, réflexion faite, s’accorder assez mal avec le génie tout primesautier du Veniero, qui ne devait guère se plier à suivre péniblement le sillon tracé par un autre; elle tombe d’elle-même si l’allusion à l’érection du marquisat de Mantoue en duché, relevée dans le Capitolo, paraît suffisante pour qu’on place aux environs de 1531 l’envoi de cette pièce, et par conséquent du poème. Dans ce cas, ce serait bien à l’œuvre de son disciple, parue quelques années avant les Ragionamenti, qu’aurait fait allusion l’Aretino.
Décembre 1883.

XXX
DOUTES AMOUREUX[100]

Les manuels de Cas de conscience sont des livres fort curieux, à ce point que l’autorité ecclésiastique en réserve quelques-uns ad usum confessorum, et les interdit aux profanes, de peur que ceux-ci ne deviennent trop doctes en certaines matières. Ces excellents casuistes sont, en effet, instructifs à la façon de ce prédicateur dont parle Pogge[101], qui tonnait en chaire contre un mari assez avisé pour «natibus uxoris pulvinum subjicere», afin d’augmenter l’attrait du déduit: dans le conte, un paroissien quitte le sermon et rentre bien vite chez lui essayer de la recette. Les Sanchez, 263 les Benedicti, les Diana, les Billuart, les Liguori, les Sinistrari et, de nos jours, les Settler, les Gury, les Rousselot, les Craisson, les Bouvier, les Debreyne, nous en apprendraient bien d’autres que ce naïf prédicateur. Voulez-vous savoir ce que c’est que de connaître sa femme more canino? Benedicti vous le dira, et s’il n’ajoute pas:
la raison en est qu’il vivait bien avant Marie-Antoinette et Louis XVI; mais il ne vous laissera pas ignorer que l’Église n’y est point contraire, quando mulier est ita pinguis ut non possit aliter coire, pourvu que toutefois vir ejaculetur semen in vas naturale. L’homme qui, pour s’exciter, ou pour éprouver une plus grande jouissance (quo se excitet, vel majoris voluptatis captandi gratia) Sodomitice copulam inchoat, avec l’intention bien arrêtée non consummandi, nisi intra vas naturale, commet-il une usurpation de juridiction? Sanchez, l’auteur du fameux De matrimonii sacramento, a élucidé ce point extrêmement important, et un autre qui ne l’est guère moins, à savoir si, in actu copulæ, immittere digitum in vas præposterum uxoris, est chose licite en droit canon. Il va plus loin encore: Quid, si vir intromittat membrum in os fœminæ, toujours, bien entendu, non animo consummandi, vel tangat membro superficiem illius vasis?» Saint Liguori déclare franchement désapprouver cette pratique, quand même on aurait les meilleures intentions du monde, et il en donne une 264 raison judicieuse: «Ob calorem oris,» dit-il, «adest proximum periculum pollutionis.» Oui, en effet, le péril est imminent!
Les Dubbii amorosi appartiennent à ce genre de casuistique raffinée; ils exposent des difficultés qui avaient échappé aux plus profonds théologiens et leur donnent des solutions pour le moins aussi ingénieuses que celles de Sanchez et de Liguori. Le savantissime docteur in utroque jure qui les a compilés et mis en vers, incline généralement pour l’indulgence, sauf dans quelques cas exceptionnellement graves, et tient surtout compte de la direction d’intention; il se met ainsi de plain pied avec les adeptes déterminés du probabilisme. C’est assez dire que ce docteur ne peut pas être Pietro Aretino, sous le nom duquel ils ont toujours été publiés jusqu’à présent. Du temps de l’auteur des Ragionamenti le probabilisme ne faisait que de naître, et la casuistique, laissée aux docteurs de Sorbonne, n’était pas encore un sujet public de controverse, comme elle le devint au siècle suivant. On n’en connaît d’ailleurs aucune édition du XVIe siècle et ils se composent de deux séries, l’une en huitains, l’autre en quatrains, dont la seconde est encore plus moderne que la première. Ils couraient manuscrits dès le commencement du XVIIe siècle et ne furent, selon toute apparence, imprimés pour la première fois que longtemps plus tard, dans le Recueil du Cosmopolite (1735, in-8o), avec les Sonetti lussuriosi; disons toutefois que Mazzuchelli affirme en avoir vu une édition sans date qui lui a semblé être de 1600 ou environ. La question n’a pas grande importance; la seule chose qui en ait, c’est que les Dubbii ne sont ni ne peuvent 265 être de Pietro Aretino, et là-dessus tous les bibliographes sont d’accord.
Ces facétieux Cas de conscience en matière érotique ont été évidemment inspirés à un homme d’esprit par les lubriques subtilités de Sanchez et du P. Benedicti, dont la Somme des péchés et le remède d’iceux (Lyon, 1584) fut, le premier des ouvrages de ce genre, publié en Français, afin que tout le monde pût y puiser des sujets d’édification. Brantôme nous dit que de son temps les dames en préféraient la lecture à celle des contes les plus licencieux, et le vieux Barbagrigia, qui, en cette même année 1584, réimprimait les Ragionamenti, déclare que le livre de Confession du savant Cordelier est tout uniment une contre-façon du chef-d’œuvre de l’Arétin. «Ce théologien,» dit-il, «n’a pas osé publier les Journées telles qu’elles sont, mais il les a reproduites sous une autre forme.» Sans avoir jamais fait les Dubbii amorosi, notre divin messer Pietro est donc néanmoins pour quelque chose dans cette plaisante parodie des casuistes qui lui avaient dérobé le meilleur de sa substance.
Décembre 1883.

XXXI
LE ZOPPINO[102]

Nous avons déjà rencontré l’occasion, dans l’Avertissement préliminaire à notre traduction des Ragionamenti, de dire un mot du Zoppino, et de combattre l’attribution erronée qui a été faite de ce Dialogue, par tous les bibliographes, à Pietro Aretino. «Le Ragionamento del Zoppino,» y disions-nous, «quoique ayant quelques ressemblances, quelques points d’attache avec les Six Journées, n’est certainement pas de l’Arétin. On n’y retrouve ni son style ni sa manière; les mots forgés, les comparaisons bizarres, les mille facettes dont le maître aime à faire chatoyer sa prose et qui la rendent si reconnaissable, manquent complètement. Nous n’y voyons non plus aucun de ces traits de haut-comique, de ces bons contes, pleins de gaieté, qui font le charme des Ragionamenti. Le Zoppino est 267 triste, presque lugubre, et surtout nauséabond. Au lieu de ces franches vauriennes, mais si jolies, si drôles, dont les roueries, contées par la Nanna ou la Commère, nous font éclater de rire, il nous montre dans toutes les courtisanes de malpropres guenipes qu’on ne toucherait pas avec des pincettes, des souillons couvertes de vermine et portant sur elles de si épaisses couches de crasse qu’on y planterait des laitues! Ce point de vue est entièrement opposé à celui de l’Arétin.» Celui qui a composé ce Dialogue, curieux d’ailleurs, plein d’informations, n’aurait jamais écrit non seulement les Ragionamenti, mais les délicieuses lettres de l’Arétin à la Zaffetta et à la Zuffolina.
Nulle part pourtant, chez les bibliographes, nous n’avons vu douter que le Zoppino ne fût vraiment de messer Pietro. Il parut de son vivant, mais anonyme, sous ce titre: Ragionamento del Zoppino fatto frate, e Lodovico puttaniere, dove contiensi la vita et genealogia di tutte le cortigiane di Roma (Venezia, Francesco Marcolini, 1539, in-8). C’est l’éditeur de 1584, qui, en le réimprimant à la suite des Ragionamenti, a de sa propre autorité modifié ce titre, pour y introduire le nom de l’Arétin: Piacevol Ragionamento de l’Aretino, nel quale Zoppino fatto frate, etc.; il a été suivi par les Elzeviers, et depuis ce temps, personne n’a réclamé. Libri, qui possédait l’édition de Marcolini, avec tant d’autres raretés Italiennes, a consacré au Zoppino une petite notice dans son Catalogue de 1847: «Cette édition originale d’un des ouvrages les plus licencieux de l’Arétin, est restée, à ce que nous croyons, toujours inconnue. Elle n’est pas citée dans le Manuel du libraire, et nous pensons que c’est là un des livres les 268 plus rares de cette classe. Offrir aux amateurs une édition originale et inconnue d’un ouvrage sorti de la plume d’un auteur si célèbre et qui a tant exercé les bibliographes, c’est leur procurer une jouissance inespérée.» Mazzuchelli (Vita di Pietro Aretino, p. 206) ne doute pas non plus que le Zoppino ne soit de l’Arétin, et il considère comme plus complètes les éditions des Ragionamenti qui renferment ce Dialogue (Barbagrigia, 1584; Elzeviers, 1660) que l’édition originale. Ginguené s’est trompé bien plus ridiculement encore; il a fait du Zoppino le principal ouvrage de P. Arétin, celui autour duquel rayonnent tous les autres. Voici comment il simplifie, ou plutôt embrouille la bibliographie Arétine: «Ouvrages en prose: Ses Dialogues licencieux, en Italien: Ragionamenti (sic) del Zoppino fatto frate e Lodovico puttaniere, dove si contiene la vita e la genealogia di tutte le cortigiane di Roma, divisés en trois Parties, dont la première a été imprimée à Venise en 1534, la seconde à Turin en 1536 et la troisième à Novarre en 1538.» Les deux premières dates sont celles de l’impression des deux Parties des Ragionamenti; la troisième est celle d’un ouvrage tout différent de P. Arétin, le Dialogue moral des Cours et du Jeu: Ginguené croit donc que le Zoppino, un opuscule tout à fait à part, d’une quarantaine de pages, est le titre général de cet ensemble hétérogène! C’était pourtant un estimable érudit, qui avait fait de la littérature Italienne sa spécialité. Il ajoute qu’il craint qu’on ne trouve son article trop long; «mais,» dit-il, «on parle souvent de l’Arétin, on le méprise beaucoup et on le connaît peu. J’ai voulu, non qu’on le méprisât moins, mais qu’on le 269 connût davantage.» Avant d’essayer de le faire connaître aux autres, Ginguené aurait bien dû en prendre connaissance lui-même.
Le Zoppino n’est pas de P. Arétin; édité de son vivant, il ne porte pas son nom, et c’est là une preuve très forte de sa non authenticité, quand même on ne tiendrait aucun compte du style, qui n’est pas le sien, ni des idées, qui sont tout à l’opposé des siennes. On ne peut, en effet, citer un seul ouvrage de l’Arétin, un seul, qui soit bien de lui, dont on n’ait un témoignage certain dans ses Lettres, ses Comédies, ses Préfaces, et qui, imprimé de son vivant, ne porte pas son nom.
Quoiqu’on dépouille le Ragionamento del Zoppino, en lui enlevant cette fausse attribution, d’une bonne partie de ce qui lui a donné sa notoriété, il n’en garde pas moins une certaine valeur. C’est un document; il fait pendant à la Tariffa delle puttane di Venegia, et nous renseigne sur les courtisanes de Rome comme ce petit poème sur celles de Venise. L’auteur se complaît sans doute un peu trop à remuer le linge sale des filles, à étaler leurs dessous malpropres, qu’il exagère; il nous affecte fortement l’odorat de toutes sortes de senteurs qui n’ont rien d’agréable, et entre dans des détails dégoûtants: mais il est bien informé, il sait une foule de particularités curieuses sur les vendeuses d’amour qu’entretenait la Cour pontificale au temps de sa plus grande splendeur, et ce qu’il nous dit de la généalogie et des aventures de quelques-unes, la Matrema, par exemple, la Lorenzina, Angela Greca, d’autres encore, est particulièrement intéressant en ce 270 qu’elles sont aussi nommées dans les Ragionamenti, qu’elles y jouent parfois un rôle épisodique. Il habitait Venise, ce qui se voit à bon nombre de locutions et d’idiotismes empruntés au dialecte Vénitien, mais il avait dû vivre longtemps à Rome, dans le même milieu que l’Arétin, dont pourtant il ne prononce pas une seule fois le nom. L’un de ses interlocuteurs dit avoir connu la belle Imperia, dont les beaux jours dataient du temps d’Alexandre VI; les souvenirs de l’auteur anonyme remontaient donc bien haut, lorsqu’il les recueillait sous le pontificat de Paul III: cette date de la composition du Dialogue ressort de ce qu’il dit avoir vu débarquer à Rome, sous Alexandre VI, une famille Napolitaine, la mère et ses trois filles, qui, faisant souche de courtisanes, en a fourni la Cour sous sept Papes, et l’en fournira peut-être encore, ajoute-t-il, sous sept autres. En comptant du fameux Borgia, on a: Alexandre VI, Pie III, Jules II, Léon X, Adrien VI, Clément VII, et Paul III est le septième.
Un autre passage laisse voir qu’il avait quelque peu l’intention de lutter avec Ovide. Après avoir attribué aux femmes dont il parle les laideurs physiques les plus repoussantes: tetons pendants, ventres à gros plis tombant en cascades, genoux crasseux, haleines fétides, visages emplâtrés d’onguents et de vermillon, «je te prie donc,» ajoute Zoppino, «de vouloir bien t’informer de tout cela, car c’est là le vrai remède d’amour.» Serait-ce un souvenir du De Remedio amoris, dans lequel se rencontrent de semblables descriptions, mais d’un naturalisme moins violent, adouci par l’élégance des vers? Au poète appartient l’idée de 271 surprendre la femme à sa toilette, de la voir, au milieu de ses fioles de toutes couleurs, s’enduire le visage de poisons et de graisses onctueuses; il recommande aussi de faire marcher nues par la chambre, pour s’en dégoûter, celles dont les énormes appas envahissent toute la poitrine:
Entre autres indiscrétions, Ovide en mentionne une bien singulière:
Mais en fait de détails écœurants et malpropres, c’est encore à notre Italien que revient la palme.
Décembre 1883.

XXXII
LES
POÉSIES DE BAFFO[103]

Les historiens littéraires de l’Italie, tout entiers à l’exécration qu’ils font semblant d’avoir pour les œuvres de Baffo, se sont contentés d’écrire sur elles quelques pages déclamatoires, et ne nous ont transmis sur l’homme que des détails insignifiants. Peut-être, après tout, Baffo n’eut-il pas de biographie, comme les peuples heureux qui n’ont pas d’histoire.
Il était né à Venise. Les Dictionnaires biographiques ne nous ont fourni aucune date certaine, et ils le font naître vaguement dans les premières années du XVIIIe siècle; mais le portrait gravé qui se trouve en tête de la meilleure édition de ses Œuvres[104] porte 273 cette inscription: Obiit anno 1768, ætatis suæ a. 74, qui nous donne pour sa naissance la date de 1694. Dans un Sonnet intitulé Vieillesse et qui commence ainsi:
il se souhaite de mourir d’apoplexie à quatre-vingt-dix ans: les Destins n’ont pas tout à fait exaucé son vœu, mais il atteignit néanmoins un âge assez avancé. Il fut le dernier rejeton d’une vieille famille patricienne, inscrite dès la plus haute antiquité sur le Livre d’or, qui avait fourni un grand nombre de magistrats à la Sérénissime République et possédé, dit-on, dans des temps très reculés, la souveraineté de l’île de Paphos (Baffo, en dialecte Vénitien), d’où elle aurait tiré son nom. C’est peut-être un conte; nous empruntons cette assertion à Philarète Chasles, qui, parlant de la vie facile, ou plutôt dissolue, que tout le monde menait à Venise au temps de notre poète, en fait mention incidemment. «Ceux-ci,» dit-il, «jouent beaucoup; ceux-là vivent d’emprunts; d’autres de quelque chose de pis: il y en a dont les sœurs sont jolies et les femmes avenantes; l’argent est rare, le commerce ordinaire ne produit rien. Certains enseignent l’art d’aimer à la jeunesse des deux sexes, comme fit le seigneur Paphos, transformé en Baffo, lequel tirait de cette île Cyprine son nom et sa généalogie, s’en vantait, honorait Vénus comme sa déesse unique, et imprimait à soixante-cinq ans, sénateur, patricien, et des plus considérables, le glorieux monument de ses 274 quatre monstrueux volumes d’impudicités, devenus le Manuel de leur genre, et qu’il signa.» Nous avons vainement cherché, dans les nombreux hymnes à Vénus du recueil, l’endroit où Baffo aurait tiré gloire de cette généalogie Cyprine; le Canzone qui commence par
lui offrait cependant une occasion bien favorable de rappeler ce souvenir de famille[105]. En revanche, nous savons par lui-même et par son épitaphe[106] que les Baffo eurent l’honneur de fournir une sultane à l’Empire Ottoman. Un de ses ancêtres, nous raconte-t-il, allait fonder un comptoir à Corfou, accompagné de sa femme et de sa fille; ils furent capturés par des corsaires, et la fille, qui était d’une grande beauté, enfermée dans le harem du Grand Seigneur, ne tarda pas à devenir sultane favorite. Elle eut un fils qui régna après que le père se fut fait crever à force de faire l’amour, dit Baffo, et sur lequel elle exerça aussi un grand ascendant. Il ne nous donne malheureusement pas le nom de ces deux Princes, qui le touchèrent de si près, et se contente de tirer du fait une réflexion très judicieuse: c’est que, si les Sultans ont quelques gouttes de son propre sang dans les veines, rien d’étonnant à ce qu’ils soient si paillards:
275
Le fameux Casanova de Seingalt, dans sa jeunesse, connut beaucoup Baffo, qui remplit près de lui durant quelques années le rôle officieux de tuteur. Baffo était grand ami de son père et, bien probablement, plus grand ami encore de sa mère, qui jouait la comédie à Venise et s’y faisait fort applaudir. Quelques-uns de ces Sonnets où Baffo parle, sans les nommer expressément, d’actrices alors en vogue, ont peut-être été composés pour elle. Casanova raconte qu’à l’âge de huit ou neuf ans, il fit avec sa mère et lui un petit voyage de Venise à Padoue, par le canal de la Brenta, et donna au poète une preuve de la précocité de son intelligence. Voyant que le bateau semblait immobile, tandis que les arbres s’enfuyaient avec rapidité le long des rives: «Il se peut donc,» se serait écrié Casanova, «que le soleil ne marche pas non plus, et que ce soit nous au contraire qui marchions d’Occident en Orient!» Là-dessus sa mère de le gronder de sa bêtise, et un de leurs compagnons de voyage, un Grimani, de déplorer son imbécillité; «mais M. Baffo,» poursuit le narrateur, «vint me rendre l’âme. Il se jeta sur moi, m’embrassa tendrement, et me dit: «Tu as raison, mon enfant; le soleil ne bouge pas; prends courage, raisonne toujours comme cela et laisse rire.» Ma mère, surprise, lui demanda s’il était fou de me donner des leçons pareilles; mais le philosophe, sans même lui répondre, se mit à m’ébaucher une théorie faite pour ma raison enfantine. Ce 276 fut le premier vrai plaisir que je goûtai dans ma vie.» C’était Baffo qui avait décidé sa mère à le mettre en pension à Padoue, l’air de Venise lui étant tout à fait malsain, et Casanova dit à ce propos qu’il lui fut vraisemblablement redevable de l’existence. Il aurait bien dû, ne fût-ce que par reconnaissance, nous transmettre sur l’homme privé quelque appréciation personnelle, qui, venant de lui, si fin observateur, nous serait bien utile. Il se borne à l’appeler «sublime génie, poète dans le plus lubrique de tous les genres, mais grand et unique... Il est mort vingt ans après,» ajoute-t-il, «le dernier de son ancienne famille patricienne; mais ses poèmes, quoique licencieux, ne laisseront jamais mourir son nom. Les inquisiteurs d’État de Venise auront par esprit de piété contribué à sa célébrité, car en persécutant ses ouvrages manuscrits, il les firent devenir précieux; ils auraient dû savoir que spreta exolescunt.»
Baffo, comme le dit très bien Casanova, fut un grand poète et surtout un poète unique. Il n’a chanté que le plaisir sensuel, mais avec quelle originalité d’esprit, quelle incroyable fécondité d’imagination! Horace[107] blâme celui qui entreprend d’être merveilleusement varié dans un sujet toujours le même: s’il revenait au monde pour lire Baffo, et la chose en vaudrait la peine, il changerait évidemment d’avis. A ne parcourir que sommairement les titres des six cents petits 277 poèmes, Sonnets, Madrigaux et Canzones, dont se compose l’œuvre du jovial Vénitien, à ne jeter sur ses vers qu’un coup d’œil distrait et en voyant qu’une demi-douzaine de mots, toujours les mêmes, reviennent continuellement, on le croirait volontiers d’une insupportable monotonie: on se tromperait de beaucoup. Le poète ne s’est pas répété une seule fois dans ces étonnantes variations sur un seul thème. Une imagination aussi Priapique ne s’est jamais manifestée avec autant d’ingéniosité, et aussi avec autant de franchise. Baffo chante la Vénus prodigieuse, chère aux Italiens, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde; il raconte ses exploits, ses bonnes fortunes, ses jouissances solitaires ou partagées, et décrit des débauches imaginaires ou réelles avec un cynisme dont rien n’approche. Des rêves lubriques ne cessent de hanter son cerveau: tantôt il se représente, en les amplifiant, les grandes orgies Romaines; tantôt il construit un temple immense où tournoient des rondes d’une lasciveté poussée jusqu’à la frénésie; tantôt il fonde un couvent dont il se fait l’abbé: le nouvel Ordre a ses règles, ses austérités, ses psaumes et ses cérémonies; on devine les ouvrages sacrés qu’il met dans les mains des Nonnes; tantôt il prend à partie un peintre et lui commande une galerie qui exigerait le pinceau d’un Jules Romain.
Toutes ces folies se pardonnent à la faveur de l’esprit, de la bonne humeur, de la drôlerie vraiment comique, et parfois même de la grâce que l’auteur répand à pleines mains. Baffo manie le joli dialecte Vénitien avec une aisance merveilleuse et il a une variété de mètres, une richesse d’images que pourraient 278 envier bien des poètes plus sérieux. Malgré tant de documents que nous possédons sur la vie à Venise au XVIIIe siècle, les Mémoires de Casanova, d’Alfieri, de Lorenzo da Ponte, de Gozzi, les comédies de Goldoni, il nous manquerait quelque chose si nous n’avions pas Baffo et le récit de ses promenades nocturnes sur la Piazza, de ses rencontres avec les courtisanes et les filles de théâtre, de ses parties fines à l’Osteria et au Ridotto, ses tableaux si animés des fameuses fêtes de l’Ascension et tant d’autres pages exquises. Comme écrivain, par la brutalité voulue de ses expressions, il réagit contre la langue guindée et solennelle des Académies, contre les fadeurs des Dorats Italiens dont il parodie burlesquement les hyperboles, les périphrases et les subtilités. Pendant que les poètes de son temps mettaient à la Muse du rouge et des mouches, Baffo la troussait, comme il le dit, et la faisait parler en sgualdrina, en gourgandine Vénitienne. Disons d’ailleurs que les obscénités énormes dont il se vante, les goûts d’empereur Romain qu’il affiche, tout cela n’était que jeu d’esprit. Il avoue spirituellement qu’il se les donnait par pur caprice, rien que pour montrer la bonne veine en poésie et pour ne pas faire de tort à sa nation:
Ailleurs encore et en maints endroits, il va jusqu’à laisser percer une répugnance profonde pour des pratiques auxquelles on le croirait adonné avec ferveur, 279 sans prendre souci de la singulière contradiction qu’offrent ces passages avec tout le reste de ses œuvres. Baffo travaille dans l’impudicité sans être personnellement impudique, de même que Corneille, par exemple, travaillait dans l’héroïsme, sans être lui-même un Auguste, un Polyeucte ou un Nicomède. Mais son idée à lui est beaucoup plus bizarre et il ne risque pas de rencontrer un grand nombre d’imitateurs.
Ses sonnets politiques et philosophiques, où il trouve néanmoins moyen d’introduire les objets de ses méditations habituelles, tout en étant aussi plaisants que les autres, montrent dans Baffo un esprit indépendant, un libre penseur déterminé, en même temps qu’un patriote digne des jours héroïques de Venise. Ce Diogène était un moraliste à sa façon. Ceux qu’il lance contre les moines, le clergé et Clément XIII lui auraient attiré, par leur virulence, bien des désagréments avec l’Inquisition, s’il n’avait eu la précaution de ne rien laisser imprimer de son vivant. Cette impiété a semblé plus coupable encore que tout le reste à un critique de la Revue des Deux Mondes[108], M. Ferrari. «Baffo,» dit-il, «provoque le fou rire sur tout ce qu’il y a de plus grave et de plus respecté. Ici c’est le Couvent avec ses règles, ses austérités, ses dévotions, qui devient un temple de Priape; là c’est l’ombre de Bonfadio, l’historien cynique de Gênes, qui revient de l’autre monde pour dire à Baffo qu’il a cherché Dieu partout, mais qu’il ne l’a trouvé nulle part; ailleurs c’est Baffo lui-même qui fait des sonnets 280 d’outre-tombe pour débiter toutes sortes d’obscénités. Puis on rencontre une foule d’observations, de réflexions, de railleries sur Dieu, sur l’Enfer, sur l’honneur, sur la vertu, ou bien l’apologie du vice, la religion du Soleil et une foule d’autres choses destinées à achever l’éducation des dilettanti. Cinquante ans auparavant le poète aurait été étranglé; mais les temps étaient changés, et il put se moquer des nonnes, des papes, des religieux, sans que l’attention du Conseil des Dix fût éveillée par ces débauches poétiques.» Nous savons au contraire, par Casanova, que les Inquisiteurs d’État firent rechercher ses manuscrits en les pourchassant de leur mieux, et Baffo nous dit quelque part que, pour ne pas être inquiété, il dut promettre au farouche tribunal de se montrer plus circonspect à l’avenir.
Ami de son repos et de ses aises, Baffo ne voulut briguer ni les honneurs ni les charges publiques. Il fut cependant élu membre de la Quarantia, Cour suprême de Justice à Venise, après une lutte où il eut pour compétiteur un certain Pagnecca, et dont il a retracé avec bouffonnerie les péripéties diverses dans quelques-uns de ses sonnets: rien ne dit qu’il ne fut pas un magistrat sérieux, quoiqu’il nous ait donné çà et là de plaisantes parodies d’arrêts. Possesseur d’un magnifique palais construit par le Sansovino, il semble n’y avoir eu pour vivre que des débris fort modestes de l’ancienne opulence de sa famille; il y vivait dans un coin de la cuisine, faute d’argent:
Cette gêne, si elle fut réelle, ne lui vint sans doute que dans sa vieillesse, après que le jeu et les femmes eurent fait de larges brèches à sa fortune; elle ne l’empêcha pas, malgré quelques boutades misanthropiques, de rester fidèle jusqu’à la fin de ses jours à son aimable philosophie Épicurienne. Il ne se maria pas, afin de ne pas aliéner sa liberté et «de peur de produire des enfants qui peut-être se feraient pendre»; vécut entouré d’amis qui le recherchaient pour sa gaîté, son urbanité, la finesse de son esprit, et parvint à un âge avancé sans que sa bonne humeur l’abandonnât jamais: nullo tædio afficiebatur, dit son épitaphe. La siora Mona lui causa seule quelques regrets, lorsque le sior Cazzo prit définitivement congé de son propriétaire: dix Sonnets, consacrés aux funérailles burlesques de ce cher ami, attestent l’intensité de sa douleur.
282 C’est à l’admiration enthousiaste d’un riche Anglais, lord Pembroke, que Baffo doit sa célébrité Européenne. Les amis du poète, trois ans après sa mort, s’étaient bornés à faire dans ses œuvres un choix de deux cents pièces environ: Le poesie di Giorgio Baffo, Patrizio Veneto, 1771, in-8o, petit volume d’une rareté insigne, dont on ne connaît à l’heure qu’il est qu’un ou deux exemplaires. Il en figure un, sous le no 2971, dans le Catalogue Libri (1847) avec cette mention: «Recueil trop célèbre, en patois Vénitien; cette édition contient des pièces qui n’ont pas été reproduites dans les éditions successives.» Nous avions la bonne fortune d’en posséder un autre, celui-là même qui appartint à lord Pembroke, dont il porte sur le titre la signature; il nous a donc été facile de vérifier l’exactitude de cette assertion et de donner en Appendice, parmi les pièces non reproduites, celles qui avaient de l’intérêt et n’étaient pas de simples variantes. Nous avions également en notre possession un recueil manuscrit, beaucoup plus copieux que l’imprimé de 1771, qui nous en a fourni quelques-unes. Mais lord Pembroke n’avait rien négligé d’important dans la belle édition qu’il a fait faire à ses frais (Raccolta universale delle opere di Giorgio Baffo, Veneto; Cosmopoli, 1789, 4 vol. in-8o), sur les manuscrits du poète. C’est elle que nous avons suivie ponctuellement, sans tenir plus de compte des rajeunissements d’orthographe et de style des réimpressions récentes que des variantes de l’édition de 1771. Celle-ci, quoique donnée par les amis de l’auteur, renferme maintes pièces qui ne sont évidemment que des ébauches dont lord Pembroke a trouvé la rédaction définitive dans les papiers de Baffo: 283 les corrections sont la plupart du temps trop heureuses pour avoir été faites par d’autres que par le poète lui-même.
Février 1884.


XXXIII
LIBER SADICUS[109]

L’Édition originale de la fameuse Justine ou les malheurs de la Vertu, du marquis de Sade, est en quelque sorte un livre inconnu des lecteurs de la génération actuelle. L’auteur l’a désavouée, prétendant, selon l’usage, qu’un ami infidèle lui avait dérobé son manuscrit et n’en avait publié qu’un extrait tout à fait misérable, indigne de celui dont l’énergique crayon avait dessiné la vraie Justine. Il s’abusait étrangement. Ce prétendu extrait est au contraire l’œuvre capitale du trop célèbre monomane, et les remaniements qu’il lui a fait subir par la suite l’ont complètement gâtée. Il faut une intrépidité à toute épreuve pour affronter la 285 lecture de la Justine en quatre volumes, suivie de la Juliette en six autres, que réimpriment à foison les officines de la Belgique, et, si l’on s’y essaye, l’ennui et l’écœurement ont bien vite raison de la volonté la plus tenace. Le cas, ici, est tout différent. Dans les deux tomes, de médiocre grosseur, dont se compose l’édition originale, nous tenons la première conception de l’écrivain, telle qu’il l’avait formulée avant que, le succès venant à l’enhardir, il n’entreprît de surenchérir encore sur ses excentricités; nous tenons le livre dont le retentissement fut si grand, de 1791 à 1795, celui que les Révolutionnaires ne dédaignèrent pas de feuilleter, et qui, devenu très rare, est absolument oublié aujourd’hui.
L’analyse qui en a été donnée dans la Curiosité littéraire et bibliographique (1re Série, 1880) nous dispense d’en faire ici une appréciation détaillée; nous y renvoyons le Lecteur.
Il nous suffira de dire que cette Justine primitive, au rebours de la longue divagation qui en a été postérieurement tirée, non seulement est lisible, mais se laisse lire avec intérêt. C’est un document. Le système que l’auteur y présente comme une intuition d’homme de génie, une vérité fondamentale restée inaperçue jusqu’alors et qu’il lui a été donné de révéler au monde, à savoir que la vraie volupté, la volupté complète, doit avoir pour condiment les cris de souffrance des victimes livrées à d’épouvantables tortures, est un système monstrueux; sa démonstration d’ailleurs est illogique, car les peintures de Justine sont plus propres à donner le cauchemar qu’à provoquer des ardeurs érotiques: mais il y a dans ce bizarre amalgame, dans ce chaos de 286 ténébreuses imaginations et de criminelles folies, un curieux sujet d’étude pour le lettré, le philosophe. Les dissertations morales, politiques, religieuses, sociales et autres, qui servent d’intermèdes aux scènes de débauche et aux supplices, montrent que le marquis de Sade n’était pas qu’un monomane enragé de luxure: il avait beaucoup lu, et, ce qui surprendra, quelque peu médité. Il n’est pas que l’écho des D’Holbach et des La Mettrie, dont il s’inspire évidemment: il a des idées à lui, et quelquefois des idées neuves. Qui s’attendrait, par exemple, à trouver en germe, dans un livre tel que Justine, les doctrines de Darwin sur l’évolution des espèces et la sélection par la lutte pour la vie? Telle était l’extraordinaire fermentation des esprits, à l’aurore de la Révolution, qu’on en rencontre des témoignages jusque dans les documents où on ne songerait certes pas à les chercher.
Mai 1884.


XXXIV
LA MESSE DE GNIDE
par
GRIFFET DE LA BAUME[110]

L’Opuscule que nous réimprimons pour les gens de goût, les délicats, ne porte pas un titre de fantaisie, c’est bien un livre de messe: on peut l’emporter à l’église, et suivre d’un bout à l’autre, de l’Introibo à l’Ite, missa est, toutes les phases et péripéties de l’office.
La Messe de Gnide a eu deux éditions: la première à Paris, l’an deuxième de la République une et indivisible (1793), la seconde à Genève, en 1797. Dans les deux, elle est donnée comme l’ouvrage posthume d’un certain Nobody[111], jeune poète du plus grand avenir, 288 à qui l’abus de l’opium aurait rendu la vie intolérable et qui se serait tué d’un coup de pistolet en 1787. Le véritable auteur a vainement essayé de donner le change au moyen de cette fable ingénieuse, on a fini par le soupçonner: «Griffet de la Baume, né à Moulins en 1750, mort en 1805,» lisons-nous dans le Catalogue de Viollet Le Duc, «est accusé d’avoir composé ce petit poème impie, où le saint sacrifice est parodié d’une manière érotique, avec grâce et élégance. C’est une curiosité littéraire de la plus grande rareté.»
Mais Griffet de la Baume a-t-il entendu faire une parodie, dans le sens qu’on donne ordinairement à ce mot? On reconnaîtra le contraire. Il règne dans ce petit poème un souffle lyrique, un accent religieux, fort éloignés de la moquerie et de la dérision. Les vers, dont les différents mètres sont habilement combinés, ont de l’ampleur, de l’harmonie et un peu de la grâce antique d’André Chénier. C’est l’œuvre d’un croyant, d’un homme pieux, dont la piété s’adresse à d’autres autels, et qui remplace le Dieu des Chrétiens, le supplicié du Calvaire, par l’Alma Venus, inspiratrice de Lucrèce. Les Chrétiens ont emprunté presque toute la liturgie de la messe aux mystères du paganisme; elle fait retour à ceux-ci, dans ce poème d’un païen du XVIIIe siècle: c’est donc moins une parodie qu’une restitution. D’ailleurs, le culte de la femme est le seul qui soit réellement catholique, c’est-à-dire universel.
Septembre 1884.


XXXV
LES
PROVERBES EN FACÉTIES
D’ANTONIO CORNAZANO[112]

Les Proverbii in facetie sont un des plus agréables recueils de Nouvelles que nous ait légués l’Italie, si riche en ce genre de littérature; c’était, au XVIe siècle, un petit livre populaire, qui se vendait orné de vignettes sur bois d’un travail aussi primitif que celles du Bon Berger, de Jean de Brie. Les bibliographes en ont relevé une vingtaine d’éditions, de 1518 à 1560, ce qui ne l’a pas empêché de devenir extrêmement rare. Renouard en a fait chez Didot l’aîné, en 1812, une réimpression qui, sans être commune, se trouve plus aisément que les éditions anciennes et dont le texte, beaucoup moins 290 incorrect, nous a servi pour la présente traduction.
L’auteur d’un ouvrage qui a joui d’une si grande vogue, Antonio Cornazano, n’est plus guère connu que par lui, quoiqu’il en ait écrit bien d’autres. Comme tant de laborieux érudits de la Renaissance, il avait fondé sa renommée sur de volumineux travaux, où il croyait mettre tout son génie, et la postérité en lit seulement quelques pages légères, tombées de sa plume dans un jour de bonne humeur. Son fameux poème De fide et vita Christi, en terza rima, qui combla d’admiration ses contemporains et le fit égaler à Dante, est absolument négligé aujourd’hui, et les Allemands, qui savent tout, ignorent probablement qu’avant Klopstock il avait composé une Messiade. Ses terze rime en l’honneur de la Vierge Marie ont eu le même sort, ainsi que son poème didactique en neuf chants sur l’art de la guerre; les six livres de Commentaires qu’il a soigneusement rédigés en Latin sur un des grands capitaines de son temps, Bartolommeo Coleoni, sont perdus dans la vaste compilation de Grævius et Burmann. Ce n’est ni comme émule de Dante et de Pétrarque, ni comme continuateur de Végèce et de Frontin qu’il s’est sauvé de l’oubli.
Il était né à Plaisance en 1431. Quelques biographes le font naître à Ferrare, où il résida les vingt dernières années de sa vie, mais il a lui-même parlé de Plaisance comme de sa ville natale en maints endroits de ses ouvrages, et pris le titre de poeta Placentinus en tête de l’un d’eux. Passano, dans la petite notice qu’il lui a consacrée (Novellieri Italiani in prosa, 1878, tome Ier), rapporte que, comme il faisait ses premières études, il tomba vers l’âge de douze ans passionnément 291 amoureux d’une jeune fille, et que son père, pour le guérir, l’envoya à l’Université de Sienne. Nous avons trouvé la confirmation de ce fait, d’ailleurs peu important, où nous n’aurions pas songé à la chercher, dans son poème à la Vierge: De la sanctissima vita di Nostra Donna, a la illustrissima Madonna Hippolyta Visconti, duchessa di Calabria, in-4o sans date ni lieu d’impression, de la plus grande rareté[113]. Le poète s’y dit alors âgé de vingt-huit ans:
et il ajoute:
Douze et seize font bien vingt-huit, ce qui montre que malgré l’exil à Sienne il était resté fidèle, et ce pin aux fruits d’or nous désignerait la famille de son adorée si 292 nous étions suffisamment initiés aux mystères du blason.
Depuis 1455 il vivait à Milan, à la cour du duc Francesco Sforza, près duquel il avait été chercher fortune, qui l’avait accueilli avec faveur et qui le garda près de lui jusqu’à sa mort, arrivée en 1466. Ce fut là qu’il composa une bonne partie de ses œuvres. Le poème à la Vierge dont il vient d’être question, n’était pas son premier essai littéraire, et il avait débuté par des compositions d’un tout autre genre, plus conformes à son tempérament amoureux, car dans son Invocation du début il dit à la Madone:
Ces rimes lascives et ces vers folâtres sont peut-être parmi les manuscrits de Cornazano que possèdent en assez grand nombre les Bibliothèques de Modène et de Florence, et que les biographes du poète, dont des extraits figurent dans le Thesaurus de Grævius et Burmann, appellent Elogia quædam, Poemata varia, Carmina in oculorum laudem, titres Latins qui désignent fort probablement des ouvrages écrits en Italien. Un autre grand poème, en terza rima, comme le précédent: Opera bellissima de l’arte militar, del excellentissimo poeta miser Antonio Cornazano, imprimé seulement en 1493 (Venise, in-folio), doit être encore 293 rapporté à cette époque, l’auteur en parlant ailleurs comme d’une œuvre de sa jeunesse, ainsi que le De fide et vita Christi, dont l’impression est de 1472. Cornazano tenait en outre, près du duc Francesco Sforza l’emploi qu’ont généralement les poètes de cour admis dans la familiarité des princes: il rédigeait ses missives amoureuses. «Les paroles,» dit-il, «peuvent aussi causer du plaisir aux belles jeunes femmes; j’en puis rendre quelque témoignage, moi qui fus une dizaine d’années à la cour de ce duc, souvent requis par Sa Seigneurie de composer pour elle des lettres d’amour et des sonnets[114].»
Du service de Fr. Sforza, Cornazano passa en 1466 à celui du célèbre condottiere Bartolommeo Coleoni, alors général de la République de Venise, dont il écrivit les hauts faits dans les plus minutieux détails et sous sa dictée, car le récit n’est pas poursuivi jusqu’à la mort du capitaine. Cet intéressant travail, qui est comme un abrégé de l’histoire de l’Italie dans la seconde moitié du XVe siècle, Coleoni ayant été activement mêlé à toutes les guerres de son temps, est en Latin; Cornazano ne l’avait pas fait imprimer de son vivant, et Grævius et Burmann en ayant rencontré le manuscrit l’ont inséré au tome IX, VIIe partie, de leur Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiæ. Coleoni mort, en 1475, Cornazano revint à Plaisance et fut, en 1479, envoyé comme ambassadeur à Milan; il alla aussi en France, ainsi qu’il le rapporte dans son 294 poème De fide et vita Christi, mais on ne sait à quelle date et à quelle occasion. En 1480 ou 1481 il passa à la cour d’Hercule d’Este, à Ferrare, qui l’accueillit et l’entretint avec bienveillance; il épousa, sur le tard, Taddea de Varro, appartenant à une ancienne et noble famille, et mourut une vingtaine d’années après, en 1500. Il fut enseveli dans l’église des Servites. Zilioli, dans ses Vite de’ Poeti Italiani, se contente de dire qu’il était aussi savant en Grec qu’en Latin, et qu’en Italien il écrivit divers ouvrages aussi utiles qu’amusants, honorable occupation, dans laquelle il passa gaîment sa vie et parvint à une sainte et joviale vieillesse. «Il avait en vers,» ajoute-t-il, «un style facile, agréable, et qui ne manquait pas de grâce, mais il était si licencieux en paroles que rien de plus, et usait de vocables que les gens de goût ne peuvent lire sans rougir.»
Cette critique, fort exagérée, ne peut s’appliquer à aucun des ouvrages de Cornazano dont nous venons de parler, et pas davantage à d’autres du même genre, tels que le traité Del modo di reggere e di regnare et le Triumphus Caroli Magni dont il y avait dans la Bibliothèque de Renouard un magnifique manuscrit sur parchemin en lettres d’argent, avec initiales en or et en couleur; elle vise uniquement les Proverbes en facéties, qui existent sous deux formes, en vers élégiaques Latins et en prose Italienne, sans qu’on puisse bien déterminer celle des deux langues à laquelle Cornazano avait d’abord donné la préférence.
Le recueil Latin, imprimé trois ans après la mort de l’auteur, porte ce titre: Antonii Cornazani Placentini novi poetæ facetissimi quod de Proverbiorum inscribitur 295 opus nunquam alias impressum, adeo delectabile et jocosum variisque facetiis refertum, ut unicuique etiam penitus mœsto hilaritatem maximam afferat. Impressum Mediolani per Petrum Martyrem de Mantegatiis, anno salutis MCCCCCIII, die ultima Septembris. Une autre édition sans date, exactement sous le même titre, y compris le nunquam alias impressum, et ne différant que par le nom de l’éditeur: impresso in Milano per Gotardo da Ponte, est considérée par tous les bibliographes, Brunet, Passano, etc., comme une réimpression ou contrefaçon de la précédente. Toutes deux sont de la plus grande rareté. Le volume se compose d’un Prologue et de dix poèmes d’inégale longueur, mais tous un peu plus étendus que les contes du recueil Italien, et traitant des proverbes suivants:
- I. Quare dicatur: Pur fieno che gli è paglia d’orzo.
- II. Quare dicatur: Futuro caret.
- III. Quare dicatur: Non me curo de pompe pur che sia ben vestita.
- IV. Quare dicatur: La va de Fiorentino a Bergamasco.
- V. Quare dicatur: Dove il Diavolo non pò mettere il capo gli mette la coda.
- VI. Quare dicatur: Chi fa li fatti suoi non s’imbratta le mani.
- VII. Quare dicatur: Si crede Biasio.
- VIII. Quare dicatur: Se ne accorgerebero gli orbi.
- IX. Quare dicatur: El non è quello, vel: Tu non sei quello.
- X. Quare dicatur: Tu hai le noce et io ho le voce.
296 Le Prologue est adressé Ad magnificum et potentem Ciccum Simonetam, ducalem consiliarium dignissimum, c’est-à-dire à Cicco ou, moins familièrement, Francesco Simonetta, homme d’État Milanais, qui fut le premier ministre de Francesco Sforza, puis de Galéas-Marie et enfin de Bonne de Savoie, régente du duché durant la minorité de Jean-Galéas. Ludovic le More le fit décapiter en 1480, lorsqu’il s’empara des États de son neveu. Cornazano y parle, comme d’un temps déjà éloigné, de sa jeunesse, de ses œuvres guerrières, du peu de profit qu’il en retirait alors, mais il ajoute qu’à présent Plaisance l’honore à l’égal des plus grands poètes:
C’est donc lorsque sa ville natale, dont il était devenu un des premiers citoyens, l’envoya comme ambassadeur à Milan, qu’il dédiait son œuvre à Simonetta, alors à l’apogée de sa faveur, mais bien près de sa mort tragique.
297 Le recueil Italien n’est pas une traduction, comme l’ont avancé Libri et quelques autres bibliographes, ni même un abrégé du précédent. Des seize petites Nouvelles, expliquant autant de proverbes, qu’il renferme, quatre seulement, la Ire, la VIe, la VIIe et la XVe ont leur équivalent dans le Latin. Les deux plus anciennes éditions que l’on en connaisse: Venise, 1518, per Francesco Bindoni e Maffeo Pasini compagni (signalée par Passano), et Venise, 1523, ne contiennent que quatorze Nouvelles. Nous pouvons décrire avec exactitude la seconde, qui se trouve à la Bibliothèque de l’Arsenal. Elle est intitulée: Proverbii di messer Antonio Cornazano in facecia, et Luciano de Asino aureo, et historiati novamente stampati. Sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, come nel breve appare. Stampata nella inclyta Città di Venetia, per Nicolò Zoppino et Vincentio compagno, nel MCCCCCXXIII, a di XXII de Agosto. Regnante lo inclito Principe messer Andrea Gritti. La traduction de l’Ane d’or, de Lucien, est du comte Boiardo, l’auteur de l’Orlando innamorato, et les historiati se composent uniquement de la Novella ducale, de Cornazano, dont le héros est le duc Francesco Sforza, et à laquelle nous avons fait plus haut un emprunt; comme elle ne tient pas à l’œuvre des Proverbii in facetie, nous n’avons pas jugé à propos de la reproduire. Quant au Privilège pontifical, ce n’est qu’une plaisanterie; au revers du titre, on lit bien un Bref menaçant d’amende les contrefacteurs, mais ce Bref se rapporte à un autre ouvrage que les Proverbes, une Historia rerum in Italia ab anno Domini MCCCCVC usque in hodiernum ferme gestarum, publiée par les mêmes libraires, N. Zoppino d’Aristotile et Vincentio, 298 son associé; il n’a été mis là que pour effrayer ceux qui pouvaient ne pas savoir le Latin. Dans toutes les éditions qui suivirent, à partir de 1525 (et on n’en compte pas moins de seize jusqu’à celle de Didot en 1812), on lit en sous-titre: con tre proverbii aggiunti e due Dialoghi, quoiqu’il n’y ait en réalité que deux proverbes ajoutés; ce sont les deux doubles versions d’un même adage: Anzi corna che croce et Tutta è fava; on peut légitimement douter qu’elles soient de Cornazano, d’autant plus que l’une d’elles, la première, se trouve dans le Convito de Gio-Battista Modio, imprimé en 1558.
Passano s’est fondé là-dessus pour estimer que l’ouvrage Latin, De origine Proverbiorum, est seul attribué avec certitude à Cornazano; d’après lui, le recueil Italien des Proverbii in facetie ne serait qu’une compilation placée par un anonyme sous le couvert d’un écrivain renommé. Sebastiano Poli, Modi di dire Toscani (1761, in-8o), à l’adage Adio fave, croit au contraire que Cornazano est l’auteur de l’un comme de l’autre et qu’il avait écrit la version Italienne avant la version Latine, ce dont on trouverait l’indication dans un distique du Prologue à Fr. Simonetta:
et il affirme de plus que l’œuvre était en vers blancs (in verso sciolto), imprimés depuis, par l’ignorance des typographes, comme s’ils étaient de la prose. Nous ne déciderons pas du bien fondé de cette seconde allégation, mais, quant à la première, elle est entièrement 299 fausse; le distique en question ne se prête à ce qu’on veut lui faire dire que si on l’isole de celui qui le précède:
Nous ne voyons là qu’une allusion à un ouvrage dont toute trace, sauf celle-ci, semble perdue, et qui devait être une sorte de Secrétaire des Amants, à moins que ce ne fût une traduction ou imitation des Héroïdes d’Ovide. Cornazano devait, en effet, avoir publié quelque petit livre de ce genre, car voici ce qu’on lit au début de sa terza rima en l’honneur du Christ:
Quoi qu’il en soit, ce manuel de correspondance amoureuse que les jeunes filles lisaient sur le pas de leurs portes et dont elles s’inspiraient pour répondre aux galants, n’a aucun rapport avec les Proverbii in facetie; le bibliographe s’est fourvoyé en donnant aux deux vers du Prologue un sens qu’ils ne peuvent pas avoir.
Nous croyons néanmoins comme lui que le recueil Italien est bien de Cornazano, à qui il a été de tout temps attribué et qui d’ailleurs ne saurait être du premier compilateur venu. C’est l’œuvre d’un maître écrivain, plein d’art et de finesse, égal par le style aux meilleurs conteurs et en surpassant quelques-uns par l’originalité de l’invention. L’idée de prendre des proverbes usuels et de leur assigner, au moyen d’une histoire plaisante, une origine tout à fait imprévue est des plus ingénieuses. Cinthio degli Fabrizii, dans son Origine delli volgari Proverbi (1527, in-folio), autre livre bien curieux, s’en est emparé après lui, et, en traitant quelquefois les mêmes sujets, leur a donné une ampleur quelque peu démesurée; il dit en plusieurs milliers de vers ce que Cornazano esquisse légèrement en deux ou 301 trois pages. On lira avec plaisir ces petits contes libres, qui ont la grâce de ceux de Boccace et le piquant des facéties de Pogge.
Septembre 1884.


XXXVI
LA VIE DE MON PÈRE
par
RESTIF DE LA BRETONNE[115]

De tous les ouvrages de Restif de la Bretonne, Monsieur Nicolas, les Nuits de Paris et les Contemporaines, seront toujours ceux qu’on lira le plus, ceux où l’on ira puiser le plus de renseignements sur la condition des classes moyennes à la fin du XVIIIe siècle. Dans cette suite de tableaux, aussi variés que la vie elle-même, où il fait passer devant nos yeux, avec la rapidité et la netteté des ombres d’une lanterne magique, tant de types divers ayant chacun leur existence propre, leur manière d’être, leur physionomie, Restif manifeste tout entier son génie, composé à 303 doses presque égales d’observation et d’imagination. La Vie de mon père, qui se rattache comme document biographique à Monsieur Nicolas, dont elle est, pour ainsi dire, la préface, appartient à un genre plus austère: c’est toujours un tableau de mœurs, comme tout ce qu’a fait Restif, incapable d’invention proprement dite et qui n’écrivait que ce qu’il voyait ou croyait voir; mais ici son observation, au lieu de s’éparpiller, se concentre sur un seul point, la vie rurale, sur un seul homme, Edme Restif, son père, et deux ou trois autres figures dessinées au second plan. Avec ces simples éléments, celui qu’on a surnommé le Rousseau du ruisseau et le Voltaire des femmes de chambre, celui dont M. de Jouy disait que la platitude ordinaire de son style, la vileté des acteurs qu’il faisait mouvoir et l’extravagance de son amour-propre l’avaient plongé à tout jamais dans le ridicule, a réussi à faire un chef-d’œuvre. Oui, certes, la Vie de mon père est un chef-d’œuvre, ne l’envisagerait-on qu’au point de vue de la composition littéraire, de l’intérêt du récit, de ses parfaites proportions, et de la convenance du style avec le sujet. Ce tableau de la vie rurale au XVIIIe siècle, présenté avec sincérité et naturel, a un grand charme, qui se double encore de l’utilité du livre, de l’enseignement moral qui en découle. Si le prix Montyon pour l’ouvrage le plus utile aux bonnes mœurs avait existé à l’époque où parut la Vie de mon père, elle l’aurait sans aucun doute obtenu des juges les plus difficiles.
Restif semble cependant avoir écrit ces belles pages sans effort, du premier jet, comme tout ce qui est tombé de sa plume: à cela seul on jugera s’il était 304 bien doué comme écrivain. «En me rappelant,» nous dit-il, «ce que mon père avait souvent raconté devant moi, pendant mon enfance, de son séjour à Paris et de Mlle Pombelins, il me vint une idée, vive, lumineuse, digne du Paysan-Paysanne pervertis! Je réfléchis sur tous les traits sortis de la bouche d’Edme Restif, et je composai sa Vie. Je ne revis pas ce petit ouvrage, je le livrai à l’impression en achevant de l’écrire. Aussi tout y est-il sans art, sans apprêt; la mémoire y a tenu lieu d’imagination. A la seconde et à la troisième édition, je n’ai fait que corriger quelques fautes de style ou replacer quelques traits oubliés. Cette production eut un succès rapide, ce qui doit étonner; elle n’était faite ni pour les petits-maîtres, ni contre les femmes, ni pour dénigrer la philosophie: les bonnes gens seuls la pouvaient acheter. Apparemment ils donnèrent le ton pour la première fois[116].»
La Vie de mon père est, non le roman, mais la vie d’un honnête homme; l’élément romanesque s’y réduit à peu de chose, très probablement à la fantastique apparition, dans l’église Saint-Roch, d’un bienfaiteur mort, le «vertueux Pombelins», sous les traits d’un vieux prêtre, et à la lugubre célébration du mariage d’Edme Restif devant le cadavre de son père. Un type digne des anciens âges, ce Pierre Restif, père du héros du livre et grand-père de Nicolas, ce paysan Bourguignon, bon vivant et rieur avec les autres, mais dont le sourcil se fronce dès qu’il rentre chez lui, qui a mangé presque tout son bien à ne rien faire et qui 305 gouverne sa famille comme les anciens Romains, en maître absolu. Tout tremble devant lui, femme, filles, valets, et le fils lui-même, grand garçon de vingt ans, sur le simple soupçon qu’il voudrait peut-être s’émanciper, est vigoureusement cinglé de coups de fouet. Envoyé à Paris, il va y contracter un mariage avantageux: son père aussitôt le rappelle, lui déclare qu’il veut être obéi, le marie de force à une épaisse et disgracieuse fille de ferme, et meurt, ce beau coup fait, avec la conscience d’être resté jusqu’au bout en possession de l’autorité paternelle. Edme renonce à ses espérances, aime la laborieuse ménagère qui lui a été imposée comme il aurait aimé la femme de son choix, et, à l’imitation des patriarches de la Bible, travaille sept ans chez son beau-père, un autre type anguleux et dur de paysan. Ce stage accompli, et sa première femme étant morte, il se met à faire valoir ses biens, et enfin vient s’établir sur ce domaine de la Bretonne dont son fils a illustré le nom. Comme c’est un homme d’un sens droit, d’un esprit avisé et réfléchi, il essaye de meilleurs modes de culture, il épierre ses champs et les préserve d’inondations périodiques, il transforme en vignoble un coteau abrupt où de temps immémorial on n’avait rien pu faire pousser; ses voisins l’imitent et de proche en proche on voit régner l’aisance dans un village réputé jusqu’alors le plus misérable de la contrée. Il avait acquis un peu de pratique dans sa jeunesse chez un cousin, avocat à Noyers, et chez un procureur au Parlement, à Paris: il est de bonne heure notaire; puis le seigneur du lieu, un chevalier de Malte, le nomme juge et enfin lieutenant. Dans ces fonctions publiques, sa droiture, son équité, 306 lui valent le surnom d’honnête homme, sous lequel on le désigne non seulement à Sacy, mais dans tous les bourgs voisins. Plus de querelles, plus de procès; une comparution devant l’honnête homme met fin à tous les différends. Et quelle bonne existence patriarcale, les jours de la semaine consacrés aux travaux des champs, l’après-midi du dimanche aux affaires de la commune! Le soir, quatorze enfants, sept d’un premier lit, sept autres d’un second mariage, prennent place par rang d’âge autour de la table où viennent s’asseoir à leur côté d’abord les garçons de charrue, puis les vignerons, enfin le bouvier, le berger et deux servantes. Le repas fait, un bon repas où tout le monde mange le même pain blanc de froment et boit la même piquette qui râpe un peu le gosier, le patriarche lit quelques passages de la Bible, et le lendemain, en poussant la charrue, les garçons n’ont pas de plus grand plaisir qu’à commenter la lecture de la veille.
L’heureux coin de terre, que ce petit canton de Bourgogne! Et le bon Edme Restif n’est pas le seul honnête homme qui essaye d’y ramener l’âge d’or. Lisez les allocutions familières du vénérable Berthier à la jeunesse des deux sexes, et demandez-vous si beaucoup de nos instituteurs de campagne pourraient parler avec tant d’onction, avec une éloquence si pénétrante et si persuasive. Le curé de Sacy, messire Antoine Foudriat, est un homme des temps apostoliques; les gens de justice font remise de leurs honoraires aux plaideurs; les collecteurs des tailles eux-mêmes sont animés des meilleurs sentiments envers le 307 pauvre monde, et un paysan profite du clair de lune pour labourer en cachette les champs de son beau-père! A Nitry, le bon curé Pandevant, un dimanche, dit à ses paroissiens: «Mes amis, on va sonner les vêpres, mais allez plutôt relever vos foins; profitez du beau temps; qui travaille prie.» Il n’est pas jusqu’aux frères aînés du narrateur de cette idylle, le curé de Courgis et l’abbé Thomas, qui ne donnent l’exemple de la bonté, de la serviabilité, du désintéressement. Seul le pauvre Nicolas ferait tache dans un milieu si vertueux: aussi s’en exile-t-il de bonne heure pour aller mener au loin une vie agitée de passions et d’inquiétudes.
Tel est le tableau que nous présente Restif de son pays natal, quelque trente ou quarante ans avant la Révolution. Si nous ne possédions pas d’autre document sur l’ancien régime, nous serions persuadés que c’est bien à tort qu’il est si décrié, et que le paysan est injustifiable quand il fait mine de prendre sa fourche dès qu’on parle de l’y ramener. Mais d’autres documents subsistent, et en grand nombre, qui justifient assez son hostilité contre le vieil ordre de choses, et son attachement à la Révolution, qui l’a renversé. C’est d’abord la terrible page de La Bruyère: «L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine; et, en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans les tanières où ils vivent de pain 308 noir, d’eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé.» Notons que La Bruyère écrivait cela vers l’époque, à peu près, où naissait l’honnête Edmé Restif, et que, des Caractères aux doléances contenues dans les cahiers des États-Généraux, la situation du paysan semble avoir encore empiré.
La Bruyère croit qu’au moins le paysan peut manger du pain; les rapports des intendants de province constatent que ce pain noir souvent lui manque, et qu’en maintes contrées il est réduit à manger de l’herbe, comme ses bestiaux. Saint-Simon dit qu’en dehors de la cour, où s’engouffre toute la fortune du pays, le roi de France n’est que le roi d’un peuple de gueux, que son royaume est un hôpital de mourants. Massillon, en parcourant son diocèse de Clermont-Ferrand, se sent le cœur saigner; partout il a vu ses ouailles sans lit, sans meubles, manquant du pain d’avoine, leur seule nourriture. «Les nègres sont plus heureux!» s’écrie-t-il; leur maître du moins les nourrit, les habille et les abrite. Le Journal de d’Argenson, les procès-verbaux des Assemblées provinciales et, à l’approche de la Révolution, le Voyage en France de l’Anglais Arthur Young, nous éclairent encore mieux, s’il est possible, sur la misérable situation de l’agriculteur durant les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Young définit l’habitation des paysans, «des taudis de boue amoncelée entre quatre pieux, où un Anglais regarderait à mettre ses pourceaux,» et le beau sexe de la campagne, «des êtres appelés femmes par la 309 courtoisie des habitants, en réalité des tas de fumier ambulants.» Puis viennent les économistes qui, avec leurs statistiques, nous font toucher du doigt le pourquoi de cette horrible misère: sur un revenu de cent francs tiré à grand’peine et grand labeur du sol, le cultivateur se voit enlever par l’impôt plus des quatre cinquièmes, 81 fr. 70 c.; quand il a payé au roi la taille, la capitation, les deux vingtièmes; au curé la dîme; qu’il a racheté ses corvées, acquitté l’impôt obligatoire du sel, la taxe des aides, s’il récolte du vin, et les redevances seigneuriales, il ne doit plus rien à personne, mais il a les mains vides, et c’est à peine s’il lui reste tout juste de quoi ne pas mourir de faim.
Restif, en écrivant la Vie de mon père, s’est-il donc plu à nous conter une agréable fiction? ce n’est pas présumable. Il a pu orner la vérité de quelques enjolivements, et lui-même, relatant dans Monsieur Nicolas ses Mémoires intimes, a ramené quelques-uns des personnages accessoires à des proportions plus réelles. De ses deux frères aînés, par exemple, le curé de Courgis et l’abbé Thomas, qui dans la Vie ont toutes les vertus des saints canonisés, le premier est un Janséniste fanatique qui ne peut venir à la Bretonne et y rencontrer le jeune Nicolas sans lui donner le fouet «pour effacer le péché originel par la douleur»; le second, dont il nous avait vanté la candeur, la modestie, l’humilité, est bien près de ne plus être qu’un simple cafard. Quant au vénérable magister, Maître Berthier, son fils, sous la férule duquel se trouva placé Nicolas, il avait déjà bien dégénéré, car avec ses écoliers et écolières il se servait moins de la persuasion que du martinet, «arme qu’il 310 portait toujours, comme les nobles leur épée, et les Italiens leur poignard». Mais ce ne sont là que des détails insignifiants, l’ensemble reste vrai et sincère. S’il y a un si profond désaccord entre ce que Restif a vu de ses yeux, chez son père, et ce que d’autres ont non moins bien vu ailleurs, cela tient à ce que, dans l’ancienne France, autant de provinces, autant d’États; autant de paroisses, autant de pays fort dissemblables de mœurs, d’aisance ou de misère. Ceux qui nous ont tracé de la condition sociale du paysan de si désolantes peintures n’ont point passé par les bourgs de Nitry et de Sacy à l’époque où Maître Berthier y tenait sa classe, où Edme Restif, l’honnête homme, y rendait la justice. Et puis il y a encore autre chose. Sous un régime où l’impôt était à peu près arbitraire, où le fisc prenait tout ce qu’il trouvait à portée de sa main crochue, le paysan devait se faire encore plus misérable qu’il n’était réellement, et le voyageur, l’intendant, le grand seigneur, l’évêque même, en tournée pastorale, n’ont vu que ce qu’il voulait bien laisser voir. Qu’on se rappelle un des plus frappants épisodes des Confessions. «Un jour,» nous dit Jean-Jacques, «m’étant à dessein détourné pour voir de près un lieu qui me parut admirable, je m’y plus si fort et j’y fis tant de tours que je me perdis enfin tout à fait. Après plusieurs heures de course inutile, las et mourant de soif et de faim, j’entrai chez un paysan dont la maison n’avait pas belle apparence, mais c’était la seule que je visse aux environs. Je croyais que c’était comme à Genève ou en Suisse, où les habitants à leur aise sont en état d’exercer l’hospitalité. Je priai celui-ci de me donner à dîner en payant. Il m’offrit du lait écrémé et de gros pain 311 d’orge, en me disant que c’était tout ce qu’il avait. Je buvais ce lait avec délices et je mangeais ce pain, paille et tout; mais cela n’était pas fort restaurant pour un homme épuisé de fatigue. Ce paysan qui m’examinait, jugea de la vérité de mon histoire par celle de mon appétit. Tout de suite, après avoir dit que j’étais un bon honnête jeune homme qui n’était pas là pour le vendre, il ouvrit une petite trappe, à côté de sa cuisine, descendit, et revint un moment après avec un bon pain bis de pur froment, un jambon très appétissant, quoique entamé, et une bouteille de vin dont l’aspect me réjouit le cœur plus que tout le reste; on joignit à tout cela une omelette assez épaisse, et je fis un dîner tel qu’autre qu’un piéton ne connut jamais. Quand ce vint à payer, voilà ses inquiétudes et ses craintes qui le reprennent; il ne voulait point de mon argent, il le repoussait avec un trouble extraordinaire, et ce qu’il y avait de plaisant était que je ne pouvais imaginer de quoi il avait peur. Enfin il prononça en frémissant ces mots terribles de commis et de rats-de-cave. Il me fit entendre qu’il cachait son vin à cause des aides, son pain à cause de la taille, et qu’il serait un homme perdu si l’on pouvait se douter qu’il ne mourût pas de faim. Tout ce qu’il me dit à ce sujet et dont je n’avais pas la moindre idée, me fit une impression qui ne s’effacera jamais. Ce fut là le germe de cette haine inextinguible qui se développa dans mon cœur contre les vexations qu’éprouve le malheureux peuple et contre ses oppresseurs. Cet homme, quoique aisé, n’osait manger le pain qu’il avait gagné à la sueur de son front, et ne pouvait éviter sa ruine qu’en montrant la même misère qui régnait autour de lui. Je 312 sortis de sa maison aussi indigné qu’attendri, et déplorant le sort de ces belles contrées, à qui la nature n’a prodigué ses dons que pour en faire la proie des barbares publicains.» Même dans ce petit domaine de la Bretonne, si bien régi et si prospère, il n’est pas sûr que devant les collecteurs des tailles, survenant inopinément au moment du repas du soir, on aurait servi sur la table aux vingt-deux couverts les bonnes assiettes de soupe fumante et le râpé à pleins pichets.
Dans la vie rurale telle que la dépeint Restif, tout est trop beau pour n’avoir pas été légèrement idéalisé, mais les parties principales, ce qui en fait le fond, restent vraies. Le dernier et le plus complet historien de l’Ancien régime, H. Taine, a négligé ou dédaigné la Vie de mon père; il aurait pu y trouver un heureux correctif à l’impression probablement trop sombre que laisse la lecture des documents. Sous un régime odieux, une administration exécrable, malgré ce qui survivait encore de la féodalité, les privilèges des nobles, les exactions du fisc, un homme d’énergie et de bon vouloir, probe et laborieux, pouvait vivre content de son sort, acquérir de l’aisance, élever une nombreuse famille et faire du bien autour de lui. Aujourd’hui la condition du peuple est moins précaire, mais la leçon est toujours aussi profitable. Restif nous dit qu’après avoir lu la Vie de mon père, un «homme en place» aurait voulu que le Ministère en fît tirer cent mille exemplaires, pour les distribuer gratis à tous les chefs de bourgs et de villages: on pourrait faire le même vœu aujourd’hui et souhaiter que cet ouvrage fût placé dans toutes les bibliothèques 313 scolaires; hommes et enfants y puiseraient autant de notions du bien et du juste que dans le meilleur des manuels civiques.
Octobre 1884.

XXXVII
LA RAFFAELLA
D’ALESSANDRO PICCOLOMINI[117]

Alessandro Piccolomini, lorsqu’il composait ce Dialogue de la Bella creanza delle donne, sorte de manuel théorique et pratique des élégances féminines, n’était pas encore professeur de morale à l’Université de Padoue, et pas davantage archevêque. Il faisait partie, avec quelques autres jeunes gens, d’un petit cénacle littéraire fondé vers 1525, l’Académie Siennoise des Intronati, la première par rang d’ancienneté de toutes les Académies Italiennes, et qui eut ses jours d’éclat. Quoique ses membres se fussent intitulés en bloc les Hébétés, et eussent pris chacun un surnom à l’avenant 315 du titre général, ils avaient l’intelligence fort éveillée. Alessandro Piccolomini s’y appelait le Stordito, l’Étourdi, peut-être parce qu’il s’estimait le plus sérieux de tous. Dans ce cénacle, on ne s’occupait point, comme à la Crusca, de vanner la langue et d’en séparer le son du pur froment; on y dissertait sur des sujets agréables ou facétieux, on écrivait des comédies, des farces de carnaval, des Dialogues plaisants, et même plus que plaisants, témoin cette inénarrable Cazzaria, due à l’un des fondateurs, Antonio Vignale, surnommé l’Arsiccio, et dont la forte saveur Rabelaisienne faisait se pâmer d’aise le bon La Monnoye.
Si l’on en croyait les bibliographes, la Bella creanza delle donne appartiendrait exactement au même genre que la Cazzaria; ils la rangent tous, sans exception, dans la classe des ouvrages licencieux, et les Conservateurs de notre Bibliothèque Nationale ont suivi les mêmes errements: au mépris des décisions des Conciles, des Bulles pontificales qui défendent aux laïques de censurer les oints du Seigneur, ils n’ont pas hésité un seul instant à mettre un archevêque dans l’Enfer; notre prélat pourrait en appeler comme d’abus. Son œuvre n’est licencieuse tout au plus que par omission, en ce qu’elle aurait pu l’être, étant donné le sujet; l’auteur n’avait pour cela qu’à emprunter la plume de son bon ami et confrère Antonio Vignale. Mais on ne peut, en bonne justice, le condamner pour ce qu’il aurait pu faire, puisqu’il a eu la réserve de se l’interdire.
Tout en n’étant pas licencieux, ce Dialogue entre une jeune femme et une vieille rouée d’entremetteuse qui la décide à prendre un amant, n’est assurément 316 pas moral; l’adultère, un vilain mot et une plus vilaine chose, y est prêché ouvertement, enguirlandé de roses et montré aux femmes comme la sanction suprême de leur beauté, le but et le couronnement d’une éducation vraiment élégante. C’est une thèse assez peu canonique, pour un évêque, et le haut dignitaire de l’Église aurait bien dû être obligé d’en demander publiquement pardon à Dieu et aux hommes, aux hommes mariés surtout, tête nue et à genoux, dans sa cathédrale. Mais condamnation une fois passée là-dessus, on reconnaîtra qu’il n’a manqué ni d’esprit, ni d’ingéniosité, ni de finesse, pour soutenir cette thèse abominable. Sa Raffaella fait bonne figure entre tant de types d’entremetteuses si amoureusement étudiés par les auteurs comiques et satiriques de son temps; il n’en est pas de plus rusée, de plus adroite, de plus experte dans le grand Pietro Aretino lui-même, un fin connaisseur pourtant en ces matières, et celui qui semblait avoir dit sur elles le dernier mot. Notre vieux Mathurin Regnier, profitant des travaux de ses devanciers et y ajoutant ce qu’il devait à son observation personnelle, grâce aux lieux où il fréquentait, comme dit Boileau, n’a pas fait mieux en créant cette Macette
et qui n’est pas sans quelques points de ressemblance avec la principale interlocutrice du Dialogue.
Le Piccolomini, ou plutôt le Stordito Intronato, semble avoir eu surtout en vue de nous apprendre comment les femmes s’habillaient, se coiffaient et se fardaient au temps où il leur faisait sans doute une 317 cour assidue et s’initiait à tous leurs petits mystères; il entre à ce sujet dans des détails abondants, précis, pleins d’intérêt et dont on pourrait relever curieusement les singularités. Ovide avait bien daigné composer un poème des Medicamina faciei qui nous serait d’une grande utilité, s’il nous était parvenu en entier, pour comparer les deux époques, et faire voir dans quelle profonde décadence était tombée la parfumerie au XVIe siècle. Il en était alors de la toilette comme de l’édilité: dans la ville, des monuments tels qu’on n’en construit plus, merveilles d’architecture et de sculpture, mais bâtis le long de rues et de ruelles qui sont des cloaques infects; de même, les femmes portent de riches étoffes, de la soie, des brocarts d’or et d’argent, des bijoux, des colliers de perles, mais elles se lavent tout au plus la figure: pour le reste, dit la Raffaella, faites-vous le signe de la croix. Et de quels cosmétiques elles usent! du vert-de-gris délayé dans des blancs d’œufs! de la limaille d’argent et de la poudre de perles amalgamées avec du mercure, de l’huile et de l’alun! elles se mettent sur la figure des emplâtres de céruse et de craie, des couches de sublimé qu’elles colorent de vermillon, pour se faire ressembler à des masques, et s’adoucissent les mains avec un composé de miel, d’amandes amères et de farine de moutarde qui devait tenir plus du cataplasme que toute autre chose. Notons qu’en outre elles ont la déplorable habitude de mâcher du mastic, comme encore à présent les Orientales et les Algériennes, pour se blanchir les dents, se purifier l’haleine, et qu’elles confectionnent elles-mêmes leurs fards en les humectant de crachat! En fait d’odeurs, elles ne connaissent que les plus 318 pénétrantes: le musc, le benjoin, le camphre, la térébenthine; passe encore pour le camphre, mais la térébenthine! il ne leur aurait plus manqué que de se mettre quelques gouttes d’alcali volatil sur le mouchoir. On les aimait tout de même pourtant, en dépit de ce que le nez pouvait y trouver à redire, et on faisait pour elles les mêmes folies qu’à présent.
La Bella creanza delle donne parut en 1539 (Venise, Curzio Navo e fratelli, in-8o); elle ne portait pas de nom d’auteur, mais l’Épître dédicatoire aux Dames, datée de Lucignano, le 22 Octobre 1538, était signée du sobriquet Académique d’Alessandro Piccolomini: Lo Stordito Intronato. Des savants en us, Placcius, De Anonymis, Rhodius, De Suppositis, n’en ont pas moins attribué l’ouvrage au pape Paul V, et Scavenius, apud eumdem Placcium, au pape Pie V; le bibliographe Italien Zeno a vu dans ces fausses attributions émanant d’hérétiques l’intention méchante, qu’ils n’avaient peut-être pas, de discréditer le Saint-siège Apostolique. Plût aux Dieux immortels que ces deux intolérants et cruels pontifes n’eussent pas commis d’autre méfait que ce Dialogue! Ses mérites littéraires l’ont fait réimprimer deux ou trois fois au XVIe siècle, une fois au XVIIIe, et il en a été donné une réédition à Florence en 1862. On en connaît sous le titre d’Instructions pour les jeunes Dames, par M. D. R. (Lyon, 1573, in-12), une ancienne traduction ou imitation Française souvent réimprimée avec quelques changements.
Décembre 1884.

XXXVIII
DES
DIVINITÉS GÉNÉRATRICES
PAR DULAURE[118]

Jacques-Antoine Dulaure fut un de ces modestes et laborieux savants à l’esprit ouvert et chercheur, d’une variété remarquable d’aptitudes, d’une facilité de travail, d’une fécondité qui étonnent, tels qu’il s’en était formé un grand nombre à l’école de la philosophie du XVIIIe siècle, des Encyclopédistes, et qui pour la plupart se sont perdus dans le gouffre de la Révolution. «Que faisiez-vous pendant la Terreur?» demandait-on à Sieyès.—«J’ai vécu,» répondait-il. 320 C’était déjà beaucoup, en effet, que d’arriver seulement à vivre; mais Sieyès y réussit tout en restant jusqu’au bout au milieu des partis qui s’entretuaient, Dulaure n’échappa à la guillotine qu’en s’exilant.
Suppléant à l’Assemblée Nationale, puis député à la Convention, Dulaure était de ces esprits sages, pondérés, qui auraient voulu fonder pacifiquement un nouveau régime de liberté, d’égalité et de justice, et acheminer la Révolution dans une voie régulière. Il fut décrété d’accusation le 15 Octobre 1793, cinq mois après les Girondins, et n’échappa qu’à grand’peine au sort de ses amis, en se dérobant aux recherches de la police. Arrivé en Suisse, par les montagnes du Jura, il se présenta à une manufacture d’indiennes où, embauché d’abord comme ouvrier, il trouva par la suite à utiliser ses talents de dessinateur. «Pourquoi,» disait-il, «suis-je banni du sol de la liberté, moi qui depuis plusieurs années n’ai agi, écrit, pensé que pour elle? Avant et après la Révolution, j’ai constamment combattu la triple tyrannie des prêtres, des nobles et des rois!» Il vécut là entièrement inconnu, ne laissant soupçonner à personne ni son nom, ni qui il était, jusqu’à la chute de Robespierre. Après le 9 Thermidor, il rentra en France et reprit paisiblement possession de son siège à la Convention. Trois départements, le Puy-de-Dôme, la Corrèze et la Dordogne où, envoyé en mission, il avait su gagner tous les suffrages par son honnêteté, sa modération et son patriotisme, l’élurent député aux Cinq-Cents; il y siégea jusqu’au 18 Brumaire, qui mit fin à sa carrière politique.
Rendu à la vie privée, pourvu d’un modeste emploi 321 dans les finances qui lui assurait le vivre et le couvert, il revint à ses études favorites et fit paraître le remarquable ouvrage intitulé: Des cultes qui ont précédé et amené l’idolâtrie ou l’adoration des figures humaines (Paris, Fournier, 1805, in-8o), suivi la même année du volume qui le complète: Des Divinités génératrices, ou du culte du Phallus chez les Anciens et les Modernes, des cultes du dieu de Lampsaque, de Pan, de Vénus, etc.; c’était le Voltairien qui protestait contre la réaction catholique dont la réouverture des églises avait donné le signal, et contre l’engouement qui portait aux nues le Génie du Christianisme. Aux poétiques fictions de Châteaubriand, Dulaure opposait des faits réels, précis et, remontant à l’origine des religions, les montrait toutes issues d’un grossier ou monstrueux fétichisme. Le vieux républicain, le conventionnel se réveilla à la Restauration; il publia une Défense des propriétaires des biens nationaux (1814, in-8o), et un virulent pamphlet qui est en même temps un document historique: Causes secrètes des excès de la Révolution (1815, in-8o), où il faisait des émigrés et des prêtres les instigateurs de la mort de Louis XVI, les rendait responsables du règne même de la Terreur. Ce pamphlet parut dans le Censeur, dont il motiva la saisie, et souleva contre son auteur des haines qui trouvèrent l’occasion de se satisfaire lorsque, dix ans plus tard, Dulaure réimprima, sous le titre général d’Histoire abrégée des différents cultes, les deux volumes de mythologie dont il est question plus haut. Celui qui traite des Divinités génératrices n’avait été l’objet à son apparition, en 1805, que de critiques et de contradictions plus ou moins vives: en 1825, on le jugea attentatoire à la morale 322 publique et religieuse, l’édition fut saisie, condamnée et en partie détruite[119].
Dulaure était à cette époque en train de publier son grand ouvrage: Histoire physique, civile et morale de Paris (1821-22, 7 vol. in-8o), que dans les éditions suivantes il porta à dix volumes, et qui fut, avec l’Esquisse historique des principaux événements de la Révolution (1825, 4 vol. in-8o), le travail de toute la dernière partie de sa vie. L’Histoire de Paris est restée justement estimée, et l’on peut dire populaire. Moins prolixe que Sauval pour tout ce qui regarde la topographie Parisienne, les accroissements successifs de la ville, ses édifices civils, ses églises, ses fondations pieuses, moins copieux que D. Félibien et Lobineau en chartes, ordonnances, règlements, etc., Dulaure est très supérieur à ses devanciers par la façon dont il a mis en œuvre ses savants matériaux. Paris ayant été naturellement le théâtre des principaux événements de notre histoire, c’est une histoire de France vue dans son ensemble qu’il nous présente en retraçant celle de la capitale. Dulaure n’a pas la flamme d’un Michelet, mais il est exact et véridique, n’avançant guère un 323 fait, une assertion, qu’il ne l’appuie d’un document. Il est surtout curieux des particularités, des anecdotes; c’est l’homme qui a colligé avec le plus de soin dans les chroniques, les mémoires, les registres du Parlement et de la Chambre des Comptes, les sermons des prédicateurs, tout ce qui pouvait ruiner les superstitions religieuses, décrier les mœurs et les institutions de la Monarchie.
Il nous reste à dire un mot du mythologue. Dulaure a porté dans ce genre de recherches, où il excellait, la netteté de vues, la conscience, l’exactitude, qui lui étaient particulières; il a rassemblé autour des questions qu’il se proposait d’élucider une telle quantité de textes, de citations empruntées aux auteurs anciens et modernes, qu’on s’émerveille de la variété et de l’étendue de ses lectures. Ses travaux sont d’autant plus dignes d’éloge, qu’il marchait dans une voie à peine frayée et ne trouvait que de faibles soutiens soit dans l’Origine des cultes de Dupuis, du système duquel il s’écarte considérablement, soit dans les monographies de l’abbé Mignot, de Court de Gébelin et du président De Brosses, qui n’avaient traité que des points tout à fait spéciaux. Une comparaison du système de Dulaure avec ceux de ses devanciers et des mythologues plus récents, Creuzer, Guigniaut, Alfred Maury, nous entraînerait trop loin; disons seulement qu’il a sur tous l’avantage d’être très simple et d’offrir, par conséquent, les plus grandes chances de vraisemblance, car l’homme des anciens âges n’a pas dû être le métaphysicien subtil que suppose la Symbolique de Creuzer.
324 Contrairement à Dupuis, qui voit dans le Sabéisme, c’est-à-dire dans l’adoration des astres, l’origine de tous les cultes, Dulaure montre jusqu’à l’évidence qu’il y eut des cultes bien antérieurs aux connaissances astronomiques dont le Sabéisme montre l’homme en pleine possession; que les premiers objets de son adoration superstitieuse furent des objets naturels: les montagnes qui bornaient son horizon, les forêts impénétrables qui servaient de barrières aux tribus, les fleuves, les sources bienfaisantes où il buvait, la mer infranchissable pour lui et qui le frappait d’étonnement, puis les pierres extraites des montagnes sacrées, les bornes posées solennellement comme frontières entre les nations, comme limites entre les patrimoines.
Pour ce qui est du culte du Phallus, par dérogation à son système, Dulaure lui donne une origine planétaire; il est, en effet, associé au signe zodiacal du Taureau dans les plus anciens documents que l’on ait sur lui. Ce point de vue est peut-être contestable; mais on rendra du moins cette justice à Dulaure, qu’il n’a rien négligé pour nous donner de ce culte singulier l’exposé le plus ample et le plus lumineux. Il en a suivi les développements et les ramifications dans tous les temps et dans tous les pays, jusqu’à nos jours où sous des noms divers il s’est clandestinement perpétué. Lui seul est complet; qu’on lise après lui les quelques pages éparses sur ce sujet dans la Symbolique, les quelques lignes que lui consacre Alfred Maury dans son Histoire des religions de la Grèce antique! Il sait de plus intéresser par la variété, l’abondance des renseignements 325 et des citations, la clarté du récit. Dulaure n’occupe point parmi les mythologues le rang qui lui est légitimement dû.
Janvier 1885.


XXXIX
LE DICTIONNAIRE ÉROTIQUE
LATIN-FRANÇAIS
DE NICOLAS BLONDEAU[120]

Si l’on examine d’un peu près la langue érotique, les termes et locutions dont elle se compose, tant chez les Anciens que chez les Modernes, on s’aperçoit que les écrivains puisent les éléments de leur vocabulaire à trois sources principales.
Il y a d’abord le mot cru, le terme propre, qui peut maintenant nous paraître assez malsonnant, mais qui certainement à l’origine ne devait pas être obscène. 327 L’homme donna un nom à ses parties génitales, à celles de la femme, à l’acte amoureux, aux sécrétions qui en résultent, comme à toutes les autres parties du corps, à toutes les autres actions et sécrétions, sans choquer en rien la pudeur. Les Grecs et les Romains employaient le mot cru, non seulement entre hommes et dans la conversation familière, mais publiquement, dans les poèmes, dans les livres, sur la scène. Aristophane disait le mot et exhibait la chose en plein théâtre. Horace dit ingénument: dum futuo; il parle sans périphrase des résultats d’un songe provoqué chez lui par l’attente d’une servante d’auberge, dans son voyage à Brindes[121]; ses invectives à Canidie sont intraduisibles en langage décent. Martial a encore moins de sans-gêne qu’Horace: il se plaît à étaler en ce genre des énormités et appelle cela parler Latin, user de la simplicité Romaine[122].
Un second élément est puisé dans la langue médicale. Le médecin ne peut se contenter du mot populaire assigné à tel ou tel organe; le sérieux de son art ne s’accommoderait pas d’un terme banal ou plaisant et qui fait rire; de plus, l’anatomie lui a révélé la complexité de cet organe, qui est un pour le vulgaire, mais qui pour lui se compose d’un certain nombre de parties distinctes, jouant chacune leur rôle, et auxquelles il assigne un nom particulier. Il se servira donc, soit de termes vagues, par décence, comme inguen, abdomen, uterus, pudenda, muliebria, habitare, 328 inire, coire, etc.; soit, s’il a besoin d’être précis, des termes techniques dont il enrichit la langue, et que l’écrivain ou tout le monde peut employer à son tour, s’ils n’ont pas un aspect scientifique par trop rébarbatif.
Réduit à ces deux éléments premiers, le vocabulaire érotique serait encore bien restreint, et la nécessité d’un glossaire spécial se ferait à peine sentir. Mais ils n’ont, à vrai dire, que la moindre importance, et le troisième élément, l’élément métaphorique, est de beaucoup la source la plus abondante. Le peuple crée naturellement et continuellement des métaphores, en matière érotique comme en toute autre matière; les écrivains utilisent les locutions passées en usage, en forgent d’autres, à l’infini, suivant leur tournure d’esprit ou leur caprice, détournent le sens ordinaire des mots, parlent d’une chose pour en faire entendre une autre, se servent d’équivoques s’ils ont peur d’être trop bien compris, et créent ainsi, parallèlement à la langue générale, une langue particulière, figurée, d’autant plus savoureuse et d’autant plus riche qu’ils ont plus d’ingéniosité. Quelques-uns en ont tant, que les seuls initiés comprennent la moitié de ce qu’ils ont voulu dire et, pour l’autre moitié, en sont réduits aux conjectures. Sans les anciens scoliastes qui nous avertissent que tel passage d’Aristophane renferme une allusion obscène, on poursuivrait sans la voir; et les savants disputent encore sur le sens qu’il faut donner à tel vers de Perse, de Juvénal, d’Ausone, à telle phrase de Pétrone et d’Apulée. C’est ici qu’un bon lexique n’est pas de trop, et, malgré quelques essais estimables, il est encore à faire.
329 Mais avant de pénétrer plus intimement dans l’étude de la langue érotique, pourquoi les écrivains, le peuple lui-même, ont-ils recours à tant de métaphores, périphrases, ambages et circonlocutions, dès qu’il est question des organes et des rapports sexuels? Si nous n’avons pas honte d’être hommes, pourquoi n’oser parler qu’à mots couverts de ce qui rend chez nous manifeste la virilité? La Nature a fait de l’union des sexes la condition de notre existence et de la perpétuité de la race; elle y a attaché, en vue de cette perpétuité, l’attrait le plus puissant, la volupté la plus intense: pourquoi nous en cacher comme d’un délit ou d’un crime? Pourquoi appeler honteuses ces parties sexuelles où la Nature a concentré toute son industrie, et rougir de montrer ce dont nous devrions être fiers? Même à ne considérer que l’acte brutal, il est encore dans le vœu de la Nature, puisqu’elle nous en fait un besoin, et la satisfaction d’un besoin ne peut avoir en elle-même rien de honteux. Des moralistes ont vu, dans cette singulière pudeur, une hypocrisie injustifiable. Écoutez Montaigne: «Qu’a fait l’action génitale aux hommes, si naturelle, si nécessaire et si juste, pour n’en oser parler sans vergongne, et pour l’exclure des propos sérieux et réglés? Nous prononçons hardiment tuer, dérober, trahir, et «cela», nous n’oserions qu’entre les dents. Est-ce à dire que moins nous en exhalons en paroles, d’autant nous avons loy d’en grossir la pensée? Car il est bon que les mots qui sont le moins en usage, moins escripts et mieux teus, soient les mieux sçeus et plus généralement cogneus.» Un autre grand écrivain, moraliste à sa manière, maître Pietro Aretino, va bien plus loin: «Les bêtes 330 doivent-elles donc être plus libres que nous? Il me semble, à moi, que l’instrument à nous donné par la Nature pour sa propre conservation devrait se porter au col en guise de pendant, et à la toque en guise de médaillon, puisque c’est la veine d’où jaillissent les fleuves des générations, et l’ambroisie que boit le monde, aux jours solennels. Il vous a fait, vous qui êtes des premiers chirurgiens vivants[123]; il m’a créé, moi qui suis meilleur que le pain; il a produit les Bembo, les Molza, les Varchi, les Dolce, les Fra Sebastiano, les Sansovino, les Titien, les Michel-Ange et, après eux, les Papes, les Empereurs, les Rois; il a engendré les beaux enfants et les très belles dames, cum Santo Santorum: on devrait donc lui prescrire des jours fériés, lui consacrer des Vigiles et des Fêtes, et non le renfermer dans un morceau de drap ou de soie. Les mains seraient bien mieux cachées, elles qui jouent de l’argent, jurent à faux, prêtent à usure, vous font la figue, déchirent, empoignent, flanquent des coups de poing, blessent et tuent. Que vous semble de la bouche qui blasphème, crache à la figure, dévore, enivre et vomit? Bref, les Légistes se feraient honneur s’ils ajoutaient pour lui une glose à leur grimoire, et je crois qu’ils y viendront.»
Ce sont des jeux d’esprit, des paradoxes. Diderot, qui reproduit à peu près dans les mêmes termes la remarque de Montaigne, a du moins le mérite de la 331 franchise: il écrit en toutes lettres le dérivé Français du Latin futuo[124]; mais Montaigne se sert pudiquement du mot «cela», obéissant ainsi au préjugé qu’il blâme; et quant à maître Pietro Aretino, il s’est donné pour tâche, dans ses étonnants Ragionamenti, de traiter les sujets les plus lubriques sans employer une seule fois le mot propre: le Diable n’y a rien perdu. Ce préjugé est si fort, si anciennement enraciné, qu’on ne le détruira pas. On aura beau nous dire que le membre viril a beaucoup plus de noblesse que le nez, la bouche ou les mains, nous continuerons à ne pas l’exhiber; et quoique le rapprochement sexuel soit dans le vœu de la Nature, nous ferons toujours difficulté de nous y livrer en public. Les premiers couples humains se cachaient dans les bois pour l’opérer:
dit Lucrèce, parlant de ces temps anciens où l’homme ne se nourrissait encore que de glands. Cet instinct appartient à l’animal même. Un naturaliste Anglais, le révérend Philips, attribue la disparition presque complète aujourd’hui des éléphants, si communs autrefois qu’on les recrutait par milliers pour les armées, à la pullulation des singes qui viennent, au moment solennel, les troubler dans leurs solitudes; ils cherchent en vain un fourré assez impénétrable pour se livrer aux douceurs de l’hymen hors de la présence de ces 332 importunes bêtes, et, faute de le trouver, se résignent au célibat. En captivité, il refusent de s’accoupler, ainsi du reste que la plupart des animaux non domestiques, ou ne s’y décident que si on les y amène par supercherie, à force de ruse et de patience, ne voulant pas qu’un si profond mystère ait des témoins profanes: à moins qu’on les croie convertis aux idées de Malthus, et bien résolus à ne pas procréer de pauvres petits destinés à devenir des malheureux.
L’homme, d’ailleurs, ne tient pas tant que cela à ressembler aux bêtes. C’est bien assez qu’on lui dise à présent qu’il descend directement du gorille, ou qu’il est son proche parent au moyen d’un ancêtre commun. Précisément peut-être parce qu’il a une obscure conscience de cette infime origine, il s’efforce d’étouffer ou d’atténuer chez lui le gorille. Ses besoins naturels le rapprochent le plus de l’animal: il se cachera donc pour les satisfaire, et il sera logique en cela, quoi qu’on dise. Il ne se cache pas pour boire et pour manger, étant parvenu à s’en acquitter proprement, avec décence, de façon à ne pas trop montrer l’animal qui prend sa pâture; mais il va déposer à l’écart le résultat de sa digestion. Voilà pourtant un besoin naturel, dont la satisfaction est légitime; pourquoi le considérer comme immonde?
Ce n’est pas la pruderie ou l’hypocrisie moderne qui a imaginé d’appeler honteuses les parties sexuelles. Les Latins les appelaient pudenda, les Grecs αἰδοῖα, mot qui a le même sens. «Faire des choses malhonnêtes» semble appartenir exclusivement à la langue de M. Prudhomme: c’est une locution Grecque, ἀρρητα 333 ou αἰσχρα ποιεῖν. Les termes vagues, les périphrases: être, aller, dormir avec une femme, cohabiter, avoir commerce, remplir le devoir, etc., sont toutes des locutions Latines: esse, dormire cum muliere, coire, cognoscere mulierem, habitare, habere rem, officium fungi, et elles ont leurs similaires en Grec; connaître, dormir, dans le sens érotique, remontent à une civilisation encore plus ancienne, puisqu’on les trouve dans la Bible: Adam connut Ève, sa femme, et Ruth dormit avec Booz.
Les Latins, qui reculaient si peu devant la crudité des mots, avaient en même temps des termes atténués d’une bien plus grande délicatesse que nous-mêmes. Les traducteurs Français des grands satiriques Latins auraient donc pu tenter d’enrichir notre langue érotique en y faisant passer les hardiesses de Juvénal, de Perse, de Pétrone, de Martial surtout, dont le vocabulaire est si opulent. Leurs essais n’ont été jusqu’à présent qu’insuffisants ou ridicules. Trois traductions assez estimées de Martial: celle de l’abbé de Marolles, une seconde attribuée sur le titre à des «militaires», et qu’on croit être de Volland, la troisième de Simon de Troyes et publiée par Auguis, ont été examinées à ce point de vue par Éloi Johanneau[125]. On se ferait difficilement une idée de leur niaiserie. L’abbé de Marolles traduit Priapus par visage!
334 «Il n’y a rien de plus vilain que le visage d’un prêtre de Cybèle.» Il rend futuere, par «cajoler, se divertir, passer le temps, aimer, entretenir, avoir une entrevue»; fututor par «galant, effronté»; sa manie de décence quand même le conduit tout droit à faire des contre-sens d’écolier, comme lorsqu’il traduit pædicare par «faire l’amour»; ailleurs il dit que c’est «faire d’étranges choses», ce qui, sans être meilleur, montre pourtant qu’il comprenait. Il a le privilège des périphrases souvent plus lestes que le mot propre de l’original; il traduit mentula par «je ne sçay quoy qui fait aimer les hommes», et ajoute en note: «Quelque lasciveté, sans doute»; ailleurs, c’est «quelque chose que l’on porte». Inguina, c’est: «ce que je ne puis nommer»; canus cunnus, «une vieille passion»; vellere cunnum, «farder sa vieillesse»; percidi, équivalent de pædicari, «se faire gratter». Il abuse de «quelque chose»; ce «quelque chose» rend les mots les plus divers: mentula, c’est «quelque chose», inguina «quelque chose», qu’il s’agisse de l’homme (VII, 57) ou de la femme (III, 72), et culus est «quelque autre chose» (III, 71).
Les «militaires» ou Volland se sont dressé à l’avance une espèce de Barême; ils traduisent constamment les mêmes mots Latins par les mêmes mots Français auxquels ils donnent un sens conventionnel: futuere par «aimer, forniquer»; entre femmes (VII, 69) c’est aussi «forniquer»; fututor, par «amant, amateur»; vulva, barathrum, cunnus, par «anneau»; mentula, penis, columna, veretrum, par «béquille», s’inspirant sans doute de la chanson de Collé: La béquille du Père Barnaba; fellare et lingere par 335 «breloquer», d’où fellator, «breloqueur», et fellatrix, «breloqueuse»; irrumare, qui signifie une chose, et percidere, irrumpere, qui en signifient une autre, par «se faire breloquer»: contre-sens énorme du moment qu’ils prennent «breloquer» pour l’équivalent de lingere et de fellare. Ce mélange de breloques, de béquilles et d’anneaux, nous donne des «breloqueurs et breloqueuses d’anneaux», une «béquille énervée», une «béquille en fureur», une béquille qui «apprend une route inconnue»; ailleurs, des «testicules de cerf remplacés par une jeune béquille»; un «anneau qui parle», des anneaux «qui se réjouissent». De temps à autre, ils veulent cependant varier un peu: ils traduisent alors pædicare, tantôt par «faire des polissonneries», et tantôt par «jouer le second rôle», ce qui montre combien peu ils savent ce qu’ils disent; fellator par «fripon», pædico par «badin», et continuellement confondent le rôle actif avec le rôle passif.
Simon de Troyes, et son reviseur Auguis, n’entendaient pas beaucoup mieux le Latin, car pour eux le pædico est un Ganymède (VI, 33); ils affectionnent les périphrases les plus pompeuses: mentula, organe des plaisirs, frêle instrument des amours, intention directe; cunnus, ceinture de Vénus; colei, les recoins les plus secrets du corps; pædicare, se livrer à une débauche irrégulière, avoir des habitudes vicieuses. Encore ces périphrases, toutes niaises qu’elles sont, feraient-elles croire qu’ils comprennent; mais non: ils traduisent periclitari capite, par «perdre la tête»!
La seule bonne méthode de traduction que l’on doive, suivant nous, appliquer aux érotiques Grecs et 336 Latins, est celle qui s’impose comme règle de dire à mots couverts seulement ce que l’auteur a dit à mots couverts, de ne pas mettre de périphrases où il n’en a pas mis, de rendre le mot propre par le mot propre, et les métaphores par des métaphores semblables, tirées des mêmes termes de comparaison. Traduire autrement sera toujours donner une idée fausse du goût personnel de l’auteur, de ce qui constitue son style ou sa manière. Mais le mot propre serait souvent bien plus obscène en Français qu’il n’était en Latin; les dérivés populaires de cunnus, colei, futuere, les équivalents de pædico, de cinædus, sont absolument ignobles, et les termes Latins ne l’étaient pas, du moins au même degré[126]. Pour obvier à cette difficulté, rien 337 n’empêche qu’on ne francise tous ceux qu’on pourra, conformément au génie de la langue. Mentule, gluber, vérètre, quelques autres encore, se trouvent dans Rabelais; irrumation, fellation, dans La Mothe Le Vayer; l’abbé de Marolles a osé fellatrice; pourquoi ne dirait-on pas fellateur, pédicon et pédiquer, fututeur, drauque, cinède, cunnilinge, liguriteur, exolète, irrumer, etc.? Ces mots, nous objectera-t-on, ne seront compris que de ceux qui savent le Latin, et le traducteur doit se faire entendre de tout le monde. Mais n’en est-il pas de même de sesterce, modius, laticlave, pallium, atrium, impluvium, vomitoire, vélite, belluaire, et de tant d’autres termes francisés depuis longtemps par les archéologues? Les définitions vagues qu’en fournissent les Dictionnaires: monnaie, mesure Romaine, partie du vêtement, de l’édifice Romain, soldat, gladiateur, donnent-elles la valeur précise du mot à celui qui ignore le Latin et les mœurs de l’ancienne Rome?
Le Dictionnaire érotique de Nicolas Blondeau ne fera pas faire de grands progrès dans cette voie aux chercheurs de traduction exacte et littérale. L’auteur, et François Noël qui l’a complété, sont tous les deux des partisans à outrance de la périphrase, qui enveloppe le mot comme une orange dans du papier, et de l’équivalent, qui n’équivaut jamais, qui est toujours au-dessous, au-dessus ou à côté de l’expression dont il s’agit de rendre l’énergie, la grâce ou la finesse. Il n’en est pas moins curieux par le nombre, l’abondance de ces équivalents, de ces périphrases patiemment colligées dans les auteurs ou plaisamment imaginées, et dont 338 quelques-unes sont de véritables trouvailles[127]. Publié en son temps, il eût été le premier, ce qui est la meilleure excuse de ses imperfections et de ses lacunes: la série des mots et surtout des locutions érotiques est loin d’être complète dans les volumineux Glossaires d’Henri Estienne, de Forcellini et de Du Cange, et la difficulté de trouver l’acception spéciale au milieu d’une foule d’autres, fait qu’on songe rarement à y avoir recours. Resté si longtemps manuscrit, il a été devancé par un autre, bien connu des amateurs, le Glossarium eroticum linguæ Latinæ, sive theogoniæ, legum et morum nuptialium apud Romanos explanatio nova, auctore P. P. (Parisiis, 1826, in-8o), auquel on croit qu’Éloi Johanneau a collaboré, mais dont l’auteur est resté incertain[128]. Ce recueil est d’une utilité incontestable pour tous ceux qui veulent lire et comprendre les érotiques ou satiriques Latins; il abonde en citations qui éclaircissent les passages obscurs ou douteux, mais les explications sont en Latin, ce qui laisse à celui de Blondeau et Noël une certaine supériorité. 339 La comparaison des deux ouvrages est instructive et montre les difficultés d’un pareil genre de travail. Rien que dans la lettre A, nous relevons chez Noël et Blondeau soixante-quinze mots ou locutions qui ne se trouvent pas, au moins à cette place, dans le Glossarium dit de Pierrugues; en revanche, celui-ci en a deux cent vingt-huit négligés par ses devanciers, et vingt-deux articles seulement sont communs aux deux recueils. De plus, si on les collationne avec l’Index du Manuel d’Érotologie, on se convainc que près de la moitié des mots commentés par Forberg ne se trouvent ni dans l’un ni dans l’autre. Une refonte générale de ces trois ouvrages, sur un bon plan, donnerait un résultat sinon parfait, du moins très satisfaisant.
Il nous resterait, en terminant, à dire un mot de la langue érotique contemporaine; mais quoique nous ayons des «naturalistes», qui ne reculent pas devant les mots, et même des «pornographes», on serait embarrassé de relever chez eux les éléments d’un vocabulaire original, qui leur soit propre. Les plus timides ou les moins maladroits s’essayent dans les réticences, les sous-entendus de Laclos et de Crébillon fils; mais comme ils n’ont pas l’art exquis et la finesse de ces maîtres, on devine l’intention qu’ils avaient de dire quelque chose, plus qu’on ne voit clairement la scène qu’ils ont voulu décrire. D’autres se sont fait avec des crudités du vieux Français, mélangées à des trivialités du faubourg, à ce que Richepin appelle la gueulée populacière, une langue hybride, bâtarde, assez écœurante, et il en est une pire encore, celle dont Alfred Delvau s’est constitué hardiment le lexicographe dans 340 son Dictionnaire de la langue verte, puis dans son Dictionnaire érotique moderne. Nos pères avaient déjà, pour désigner ces bonnes filles dont le métier est de faire plaisir aux hommes, un nombre plus que suffisant d’appellations désobligeantes: carogne, catau, catin, coureuse, créature, donzelle, drôlesse, gueuse, gourgandine, poupée, putain; comme nous sommes plus riches! nous avons: allumeuse, baladeuse, blanchisseuse de tuyaux de pipes, bouchère en chambre, chahuteuse, chameau, chausson, crevette, éponge, gadoue, gaupe, gibier de Saint-Lazare, gonzesse, gouge, gouine, grenouille, loupeuse, marmite, menesse, morue, omnibus, paillasse, peau, pierreuse, punaise, rouchie, rouleuse, rutière, sangsue, taupe, tireuse de vinaigre, tocandine, toupie, traînée, vache, vadrouille ou vadrouilleuse, et vessie! Ce que peuvent être les locutions imagées où ces termes choisis entrent en combinaison avec d’autres de plus basse catégorie encore, on le conçoit sans peine. Ni l’énergie ni le pittoresque ne leur manquent; mais à part quelques bonnes et vertes Gauloiseries, ce vocabulaire est par trop ordurier. Malgré toutes les raisons qu’on peut donner en faveur du parler à la bonne franquette et contre la pruderie bégueule, nous penchons à partager l’aversion de beaucoup de gens pour ces mots que l’on nous dit être la langue de l’amour, et qui sentent mauvais, qui font sur le papier comme des taches malpropres. Nous sommes volontiers de l’avis de La Fontaine:
Avril 1885.


XL
LE COUVENT HOSPITALIER
CONTE
D’ALOYSE CYNTHIO DEGLI FABRITII[129]

A diverses reprises nous avons été sollicité de réimprimer et de traduire, comme l’une des plus notables curiosités Italiennes du XVIe siècle, l’Origine delli volgari Proverbii, d’Aloyse Cynthio degli Fabritii. La rareté de ce recueil de Nouvelles en vers (Vinegia, Bern. et Matth. Vitali, 1527, in-folio), est, en effet, bien connue des amateurs; les dix ou douze exemplaires qui en existent actuellement sont si recherchés, qu’on les suit un à un dans les ventes, où ils n’apparaissent qu’à de longs intervalles, et toujours cotés à 342 de très hauts prix: on en trouvera le détail dans le Manuel du Libraire et dans le Catalogue de Libri (1847, nos 1498-99). Nous ne voulons pas nier que cet écrivain fantaisiste ne soit plein de bonnes qualités, qu’il n’ait des inventions d’une originalité plaisante et que, malgré un penchant déplorable à la prolixité, aux digressions historiques et surtout mythologiques, il ne soit souvent fort amusant. Malheureusement, son recueil se compose de quarante-cinq Nouvelles, toutes divisées méthodiquement en trois Chants, et d’une étendue chacune de sept cents à mille ou douze cents vers: au total quarante mille vers environ, à peu de chose près ce que renferme l’Orlando Furioso, sauf que son style n’a pas toujours le charme et n’a jamais la limpidité de celui de l’Arioste. Degli Fabritii se moque sans façon de la syntaxe comme de la grammaire, et le Florentin ne lui suffisant pas pour dire tout ce qu’il veut dire, il y mêle du Vénitien, du Lombard, tous les patois de la Péninsule; il se sert de locutions tombées depuis longtemps en désuétude, ou qui n’ont peut-être jamais été usitées, et ne dédaigne même pas l’argot: un Italien aurait déjà quelque peine à démêler un écheveau si embrouillé. Ajoutez à ces difficultés d’interprétation celles de la simple lecture: le texte unique de 1527 fourmille de fautes typographiques qui, jointes au manque de ponctuation et de capitales où il en faudrait, car il en offre partout où il n’en faudrait pas, le rendent souvent tout à fait inintelligible. Nous attendrons pour le traduire, si tant est que nous le traduisions jamais, que les Italiens en aient donné une édition correcte, enrichie de quelques Notes qui en faciliteraient l’intelligence aux pauvres étrangers.
343 Pour satisfaire la curiosité des amateurs, nous nous contenterons donc aujourd’hui de leur présenter l’une des Nouvelles de l’Origine delli volgari Proverbi, la seconde: Ogni scusa e buona, pur che la vaglia, à laquelle nous avons donné un autre titre: Le Couvent hospitalier, qui en exprime mieux le sujet. Ce n’est pas la plus mauvaise, ce n’est peut-être pas non plus la meilleure: nous l’avons prise à peu près au hasard. Pour le texte, nous l’avons reproduit tel quel, avec ses bizarreries d’orthographe et de ponctuation, comme un fac-similé: il n’en donnera que mieux au Lecteur l’idée du livre; pour la traduction, nous avons fait de notre mieux, sans nous flatter d’avoir toujours compris.
Cynthio degli Fabritii, comme beaucoup de conteurs, n’a guère d’imagination que dans les détails, et il traite le plus souvent des sujets vingt fois rebattus. Il a surtout beaucoup emprunté à Antonio Cornazano qui, dans ses deux recueils, l’un Italien, l’autre Latin: Proverbii in facetie, et Proverbiorum opus, avait eu bien avant lui l’idée d’assigner à un certain nombre d’adages populaires une origine plaisante. Au reste, voici les titres des quarante-cinq proverbes mis en œuvre par degli Fabritii; nous y joignons pour quelques-uns l’indication sommaire du sujet et des sources.
- I. La Invidia non morite mai: c’est un de nos vieux fabliaux, rajeuni tout récemment encore par Lemercier de Neuville et Champfleury, sous le titre de Bonhomme Misère. Batacchi avait aussi traité ce thème dans la Vita e morte del prete Ulivo.
- II. Ogni scusa e buona, pur che la vaglia: Le Couvent hospitalier.
- 344 III. Lettere non danno Senno: Apologue où les rôles sont joués par des animaux, le lion, le renard, le singe.
- IV. Chi non si puo distender si ritragga: Débat entre le sexe masculin et le sexe féminin.
- V. Alli Cani magri van le Mosche: Même sujet que dans le Faiseur de Papes (XIVe des Cent Nouvelles nouvelles); traité par Masuccio, Malespini et La Fontaine.
- VI. Futuro caret; imité de Cornazano (Proverbiorum opus, II).
- VII. Chi di Gatta nasce Sorge piglia: «Qui naît de chatte prend la souris»; la moralité du conte est que les mauvais penchants sont innés.
- VIII. La va da Tristo a Cattivo; imitée de Cornazano (Proverbiorum opus, IV), où le Proverbe est intitulé: La va da Fiorentino a Bergamasco.
- IX. Ogni cosa ee por lo Meglio: Bizarres aventures d’un pêcheur dont la barque sombre et qui visite l’empire de Neptune.
- X. Altri han le Noci, et io ho la voce: imité en partie de Cornazano (Proverbiorum opus, X), et de Boccace (Journée VII, Nouv. IX).
- XI. Tu guardi l’altrui Busca, et non vedi il tuo Travo: imité de Pogge (Facéties, CLXXV: De paupere qui navicula victum quærebat).
- XII. Dove chel Diavolo non puo metter lo capo gli mette la coda: vieux fabliau qui est dans le recueil de Méon (tome II): D’un moyne qui contrefist l’ymage du Diable; degli Fabritii l’a connu par Cornazano (Proverbiorum opus, V).
- XIII. Le fatto il becco all’Occha. On trouve le même conte dans le Pecorone de Ser Giovanni; mais au lieu 345 d’une oie mécanique, dans laquelle se cache l’amoureux, c’est un aigle.
- XIV. Per fina li Orbi sene accorgerieno: Imité de Cornazano (Proverbiorum opus, VIII).
- XV. Chi Pecora si fa, lo Lupo la mangia.
- XVI. Chi non ha Ventura non vada a pescar; ce conte a quelque ressemblance avec la Pêche de l’anneau, dans les Cent Nouvelles nouvelles, III.
- XVII. Si crede Biasio: imité de Cornazano (Proverbiorum opus, VII).
- XVIII. Non mi curo de Pompe, pur che sia ben vestita; imité de Cornazano (Proverbii in facetie, VI).
- XIX. Chi fa le fatti suoi non s’imbrata le Man; encore imité de Cornazano (ibid., VII).
- XX. Passato el tempo che Berta filava.
- XXI. Meglio ee tardi che non mai; emprunté en partie à Boccace (Décaméron, II, V); les aventures d’Andreuccio de Pérouse remplissent les deux premiers Chants. On trouve le même Proverbe dans Cornazano (Proverbii in facetie, IX), mais expliqué par une tout autre histoire.
- XXII. A chi ha Ventura poco Senno basta; imité de Masuccio, Ire Journée, II.
- XXIII. Non ee piu tempo di dar fen ad Ocche; imité en partie du Décaméron, II, X.
- XXIV. Alli signali si conoscono le balle.
- XXV. Tu vai cercando Maria per Ravenna; les deux premiers Chants, empruntés à Boccace (Décaméron, IX, VI), paraphrasent longuement le conte du Berceau; le troisième a quelque ressemblance avec la IIe Nouvelle de Firenzuola.
- XXVI. Chi vuol Amici assai ne provi pochi.
- 346 XXVII. La offerto le arme al Tempio; c’est le vieux fabliau des Culottes du Cordelier, sujet aussi traité par Pogge (Facéties, CXXXII) et par l’abbé Casti: Le brache di San Griffone.
- XXVIII. Chi cosi vuole cosi si habbia; imité de Cornazano (Proverbii in facetie, II), mais degli Fabritii a fait du héros un Moine, à la place d’un gentilhomme.
- XXIX. Prima si muta il pelo che si cambia il Vezzo; Pogge (Facéties, CXCV, l’Abcès au doigt) a fourni la plus grande partie de ce conte.
- XXX. Chi troppo vuole da rabbia more; histoire d’une reine très exigeante, d’un évêque, d’un barbier et d’une bague enchantée qui, mise au doigt de l’évêque, le rend bien malade, et, reprise par le barbier, fait crier grâce à la reine.
- XXXI. La le va dietro qual la Matta al fuso; le même sujet est traité dans un ancien conte Italien: Novella della figliuola del mercatante, che si fuggi la primera sera del marito per non essere impregnata.
- XXXII. Chi troppo si assotiglia si scavezza; paraphrase d’une anecdote de Pogge (Facéties, CLXX: De Monacho qui misit per foramen tabulæ Priapum).
- XXXIII. In fra la Carne e l’Ungia alcun non punza; les deux premiers Chants ont quelque ressemblance avec le Proverbe de Cornazano intitulé: A buon entenditore poche parole (Proverbii in facetie, III).
- XXXIV. Il non ee oro tutto quel che luce.
- XXXV. Guastando s’impara; imité de Boccace (Décaméron, VII, II), conte dont La Fontaine a fait le Cuvier.
- XXXVI. Ogni Cuffia scusa di notte; encore imité de 347 Boccace (Décaméron, IX, II) et traité aussi par La Fontaine (Le Psautier).
- XXXVII. Rebindemini.
- XXXVIII. Dove chel Dente duol la lingua tragge.
- XXXIX. Ciascun si aiuta co gli suo Ferrizzuoli.
- XL. Per via si concia Soma.
- XLI. L’occhio vuol la sua parte; imité de Pogge (Facéties, V.: De homine insulso qui existimavit duos cunnos in uxore).
- XLII. Ciascun tira l’Acqua al suo Molino.
- XLIII. La Necessità non ha legge.
- XLIV. Fuge Rumores.
- XLV. Pissa chiaro et encaca al Medico; imité de Cornazano (Proverbii in facetie, XIV).
Un des exemplaires de l’ouvrage, ayant appartenu à quelque ami intime de l’auteur, a une XLVIe Nouvelle manuscrite, intitulée: Chi va al molino primo macina. L’ancien possesseur y a joint cette note marginale: Nota questa Satyra essere di propria mano di l’Autore, et non vi essere altra copia, e pochi giorni drieto morse, in qual modo non lo dico[130]. On a inféré de ces derniers mots que Cynthio de gli Fabritii avait terminé ses jours sur la potence: les termes vagues dont s’est servi l’annotateur prêtent à toutes sortes de conjectures, mais n’indiquent pas forcément une mort infamante. On a du reste très peu de renseignements sur degli Fabritii; 348 on ne sait ni la date de sa naissance ni celle de sa mort. Dans la Préface de son livre, adressée au Pape Clément VII, auquel il le dédie, il prend le titre de docteur ès lettres et en médecine: delle arti et di medicina dottore, en même temps qu’il se dit citoyen de la puissante et illustre ville de Venise: della poderosa inclyta citta di Vinegia cittadino. Il semble cependant s’être livré au commerce, car dans cette XLVIe Nouvelle restée manuscrite il raconte que, voyageant par eau et la barque, trop chargée, menaçant de sombrer, il fallut l’alléger en sacrifiant partie des bagages; aussitôt des Moines qui se trouvaient là, sachant combien il les détestait, se mirent en besogne de jeter les siens, consistant en balles de coton, de draps et de cire. Sa haine contre les Moines avait encore une autre cause plus personnelle; d’après une des notes marginales de l’exemplaire en question, son beau-frère qui était Récollet, lui aurait nié une quittance ou règlement de compte «gli negoe uno scritto,» et par cette fraude l’aurait frustré d’une partie de sa fortune. Aussi pour lui tous les Moines, et spécialement les Récollets, qu’il appelle Frères gris, Frati bigi, bigozi, Zoccolanti, sont-ils des gredins et des paillards.
Malgré ces invectives contre les Moines et tant de passages des plus libres, l’Origine degli volgari Proverbii vit le jour avec privilège du Pape et de la Seigneurie de Venise: Con la gratia del sommo Pontefice et della Illustrissima Signoria di Vinegia. Dans sa Dédicace, comme dans des Stances et un Sonnet, qui sont également adressés à Clément VII, Cynthio degli Fabritii élève très haut les vertus de son protecteur et se vante de 349 vivre «à l’ombre de ses ailes»; il l’appelle la boussole de son petit bateau:
et termine ainsi le sonnet:
Les Récollets n’en obtinrent pas moins le retrait du privilège, et le Conseil des Dix paraît avoir ordonné la destruction du livre ou arrêté sa publication. Mais si les Moines de Venise ont tout fait pour que l’Origine degli volgari Proverbii ne parvînt pas à la postérité, les Moines Français se sont attachés, dans les limites de leurs forces, à nous le conserver; l’un des deux exemplaires de la Bibliothèque Nationale provient d’un couvent d’Augustins à Paris, et porte cette mention: Ex Catalogo ffr. discalciatorum Sti Augustini Conventus Parisiensis.
Août 1885.

XLI
LE JARDIN PARFUMÉ
DU
CHEIKH NEFZAOUI[131]

Il existe, en langue Arabe, un ouvrage qui n’est pas sans offrir quelque similitude avec les Kama Sutra de Vatsyayana: c’est le Jardin parfumé du cheikh Sidi Mohammed el Nefzaoui, composé au commencement du XVIe siècle, environ l’an 925 de l’Hégire. L’auteur, dont le surnom, el Nefzaoui, indique qu’il était de Nefzaoua, petite ville située au sud du royaume de 351 Tunis, n’est du reste connu que par cet ouvrage, mais il s’y montre un homme d’assez vaste érudition, ayant plus de connaissances en littérature et en médecine que n’en ont communément les Arabes. Il paraît avoir rédigé ce traité d’Érotologie d’après les ordres du grand vizir du bey de Tunis alors régnant, curieux sans doute de posséder un manuel où tout ce qui regarde l’amour et les rapports sexuels serait exposé dans un ordre méthodique: classification des plaisirs, diverses manières de les goûter, préceptes d’hygiène, composition des baumes et parfums, recettes aphrodisiaques, dont les Orientaux, épuisés de bonne heure, sont particulièrement friands, etc. Le cheikh Sidi Mohammed s’est acquitté de sa tâche avec un remarquable talent; excellent conteur et bon poète, il a de plus assaisonné le tout de quantité d’historiettes divertissantes et de fragments de pièces de vers, qui donnent encore plus de saveur à un sujet déjà fort attrayant par lui-même. Nous en citerons quelques-uns, d’après la traduction faite il y a trente-cinq ans par un officier de notre armée Algérienne, qui ne l’a signée que de ses initiales, traduction restée longtemps manuscrite, et autographiée, en 1876, à trente-cinq exemplaires, par les soins d’une réunion de militaires[132].
352 Le Jardin parfumé jouit d’une grande réputation chez les Arabes; cependant, contrairement à l’habitude des Orientaux, qui est d’écrire de longs commentaires sur les ouvrages renommés, ils n’en ont rédigé aucun sur celui-ci. «Ne serait-ce pas,» se demande le traducteur, «à cause de la nature des sujets qui y sont traités, et qui aurait effrayé des esprits sérieux? Mais quoi de plus important que l’étude des principes sur lesquels repose le bonheur de l’homme et de la femme, en raison de leurs relations mutuelles, relations qui toutes sont assujetties à des causes de caractère, de santé, de tempérament, de constitution, qu’il appartient au philosophe d’approfondir? Ne craignons pas, dit excellemment Maupertuis, de comparer les plaisirs des sens avec les plaisirs les plus intellectuels; ne nous faisons pas l’illusion de croire qu’il y ait des 353 plaisirs d’une nature moins noble les uns que les autres: les plaisirs les plus nobles sont ceux qui sont les plus grands[133].»
Le cheikh Sidi Mohammed n’a divisé son livre sur les choses de l’amour ni en cent mille chapitres, comme Dieu, à l’origine du monde, d’après ce que nous rapporte Vatsyayana, ni en mille ou en cinq cents, comme Shvetaketou et Nandi; il s’est contenté de vingt et un, dont voici les titres:
- I.—Relatif aux hommes dignes d’éloges.
- II.—Relatif aux femmes dignes d’éloges.
- III.—Relatif aux hommes méprisables.
- IV.—Relatif aux femmes méprisables.
- V.—Relatif à l’acte de la génération.
- VI.—Concernant ce qui est favorable à l’acte de la génération.
- VII.—Relatif à ce qui est nuisible à l’acte de la génération.
- VIII.—Relatif aux divers noms des parties sexuelles de l’homme.
- IX.—Relatif aux divers noms des parties sexuelles de la femme.
- X.—Concernant l’acte de la génération chez les divers animaux.
- XI.—Relatif aux ruses et trahisons des femmes.
- XII.—Relatif à diverses questions d’utilité pour les hommes et pour les femmes.
- XIII.—Relatif aux causes de la jouissance dans l’acte de la génération.
- 354 XIV.—Description de l’utérus des femmes stériles, et de leur traitement.
- XV.—Relatif aux remèdes qui provoquent l’avortement.
- XVI.—Relatif aux causes d’impuissance de l’homme.
- XVII.—Déliement des aiguillettes.
- XVIII.—De ce qui augmente les dimensions des petits membres et les rend superbes.
- XIX.—Relatif à ce qui enlève la mauvaise odeur des aisselles et des parties sexuelles de la femme, et rétrécit ces parties.
- XX.—Instructions sur la grossesse des femmes et sur ce que la femme engendre, c’est-à-dire connaissance du sexe du fœtus.
- XXI.—Renfermant la Conclusion de cet ouvrage et signalant l’utilité de la déglutition des œufs comme favorable à l’acte vénérien.
Le livre débute par une sorte d’hymne où éclate l’amour passionné de la femme et de ses perfections; c’est de la poésie d’une sensualité brutale et qui cependant reste profondément religieuse, par un mélange auquel nous ne sommes pas accoutumés:
«Louange à Dieu qui a mis le plus grand plaisir des hommes dans les parties naturelles des femmes, et qui a fait consister celui des femmes dans les parties naturelles des hommes!
»Il n’a donné de bien-être aux parties des femmes, il ne leur a accordé de satisfaction et de bonheur, qu’elles n’aient été pénétrées par les organes du mâle; de même les parties sexuelles du mâle n’ont ni repos ni tranquillité, qu’elles ne soient entrées dans celles de la femme.
»Le Tout-Puissant a plongé les femmes dans une mer de splendeur, de volupté et de délices, couvertes de 355 vêtements précieux, avec des ceintures éclatantes et des sourires excitants.
»Il leur a donné des yeux inspirant l’amour et des cils tranchants comme des glaives étincelants.
»Qu’il soit donc exalté et élevé, celui qui a créé les femmes et leurs beautés, avec des chairs appétissantes; qui les a dotées de cheveux, de taille, de gorge, de seins qui se gonflent et de gestes amoureux, appelant le désir!»
D’après cette profession de foi, on juge assez à quels mérites se reconnaissent l’homme digne d’éloges et l’homme méprisable: cela se mesure à l’aune; au-dessous de certaines dimensions, l’homme n’a aucun moyen de plaire. Alfred de Musset donne d’ailleurs là-dessus les mêmes sentiments aux Françaises que le Cheikh aux femmes Arabes:
La description que le Cheikh fait de la femme digne d’éloges, c’est-à-dire par la même raison, apte à provoquer les désirs, mérite d’être citée; elle nous initie aux grâces qui charment les Orientaux:
«Pour qu’une femme soit goûtée par les hommes, il faut qu’elle ait la taille parfaite, qu’elle soit riche en embonpoint. Ses cheveux seront noirs, son front large, ses sourcils auront la noirceur des Éthiopiens, ses yeux seront grands et d’un 356 noir pur, le blanc en sera limpide; les joues seront d’un ovale parfait; elle aura un nez élégant et la bouche gracieuse: ses lèvres seront vermeilles, ainsi que sa langue; une odeur agréable s’exhalera de son nez et de sa bouche; son cou sera long et sa nuque robuste; son buste large, ainsi que son ventre; ses seins devront être fermes et remplir sa poitrine; son ventre devra être dans de justes proportions, son nombril développé et enfoncé; la partie inférieure du ventre sera large, saillante et riche en chair; ses cuisses seront dures ainsi que ses fesses; elle possédera une chute des reins large et replète; sa taille sera bien prise; ses mains et ses pieds se feront remarquer par leur élégance; ses bras seront potelés, ainsi que ses avant-bras, et encadreront des épaules robustes. Si une femme qui a ces qualités est vue par-devant, on est fasciné; si elle est vue par-derrière, on en meurt. Vue assise, c’est un dôme arrondi; couchée, c’est un lit moelleux; debout, c’est la hampe d’un drapeau.»
Qu’avec cela elle parle peu, ne rie jamais aux éclats, ne fasse d’agaceries à personne, n’aime que son mari, ait pour lui toutes les complaisances, ne s’abandonne qu’à lui, dût-elle en dessécher d’abstinence; qu’elle soit vêtue élégamment, de la plus soigneuse propreté, se parfume d’essences, se serve d’antimoine pour sa toilette et se nettoie les dents avec du souak, et ce sera le Paradis sur la terre. Cette page, malgré la crudité de certains détails, n’est-elle pas poétique et gracieuse? Quelle jolie comparaison que celle de la hampe du drapeau, pour peindre une taille svelte et élancée!
Presque dans chaque chapitre, des historiettes très bien contées, et dont quelques-unes sont de petits chefs-d’œuvre, viennent à l’appui des définitions de 357 l’auteur, et leur donnent de l’agrément. C’est d’abord l’Histoire de Moçaïlama et de la Prophétesse, rapportée à l’occasion des parfums, ces puissants adjuvants en amour, et auxquels les Orientaux attachent une extrême importance. L’imposteur Moçaïlama, le faux Mahomet, celui qui dénatura nombre de passages du Koran, pour nuire à son rival, mais qui ne put jamais faire un miracle[134], veut avoir Chedja-el-Temimia, la Prophétesse, qui lui dit qu’il ne pourra la posséder que s’il la met en pâmoison. Il la fait entrer sous sa tente, où de l’ambre, du musc, des roses, des fleurs d’oranger, de la jonquille, du jasmin, des jacinthes, des œillets, chargent l’air de leurs effluves, et où de plus du neddé (mélange de benjoin et d’ambre), brûlant dans des cassolettes, fait une fumée assez intense pour se mêler à de l’eau et la pénétrer. La Prophétesse est suffoquée, nous n’avons pas de peine à le croire, et Moçaïlama vient à bout de ses désirs.
Il s’agit d’un autre genre de pâmoison dans l’Histoire de Bahloul et Hamdouna, si joli conte que nous en donnerons une analyse détaillée. Bahloul était le poète, c’est-à-dire le bouffon, d’Abdallah-ben-Mahmoud, un des fils d’Haroun-er-Reschid, calife en l’an 178 de l’hégire. Bahloul avait épousé deux femmes, qui lui faisaient subir le martyre, et Mahmoud lui demande, pour s’amuser, des nouvelles de son ménage.—«Je ne suis bien ni avec l’une ni avec l’autre,» répond le 358 malheureux.» Le Calife veut qu’il lui récite des vers sur ses infortunes conjugales. Bahloul chante:
Le Calife rit de cette poésie à se renverser en arrière, et, pour le plaisir qu’il a eu, fait cadeau à Bahloul d’une robe lamée d’or. Hamdouna, fille de Mahmoud et épouse du Grand Vizir, aperçoit le bouffon, du haut des terrasses du palais, et dit à sa négresse: «Par le Dieu de la Mecque! voilà Bahloul revêtu d’une belle robe dorée; de quel stratagème pourrai-je me servir pour la lui prendre?» La négresse a beau lui dire que Bahloul est bien plus rusé qu’elle: «Il faut que cela soit,» dit Hamdouna, et elle lui envoie sa négresse. «Oh! Bahloul,» dit-elle en l’apercevant, je crois que tu es venu ici pour m’entendre chanter,» car elle avait pour le chant un talent merveilleux; puis elle lui fait servir des gâteaux et des sorbets. «Je ne sais pourquoi je me figure,» ajoute-t-elle, «que tu te dépouilleras volontiers de ta robe pour 359 m’en faire don.—Oh! maîtresse,» répond Bahloul, «j’ai fait serment de ne la donner qu’à celle à laquelle j’aurai fait ce que l’homme fait à la femme.—Tu sais donc ce que c’est, ô Bahloul?—Celui-ci prend, celui-là donne,» dit le bouffon; «celui-ci vend, celui-là achète; pour moi, toutes ces choses sont sans attrait: ma seule pensée est l’amour et la possession des belles femmes.» Or Hamdouna était éblouissante, par sa taille et par l’harmonie de ses formes. Elle veut que Bahloul lui dise des vers; il lui en récite qu’il improvise, passionnés, lubriques; elle commence à s’émouvoir.
«Lorsque Hamdouna eut entendu ces paroles, elle se pâma. Tantôt elle se disait: «Je me donnerai à lui;» et tantôt: «Je ne lui céderai pas.» Pendant cette incertitude, la jouissance se fit pressentir... Elle ne résista plus alors et se rassura en se disant intérieurement: «Si ce Bahloul, après avoir joui de moi, vient à le divulguer, personne n’ajoutera foi à ses paroles.» Elle dénoua sa ceinture et se jeta, en tremblant de toutes ses forces, sur un lit de soie dont le dessus était comme une voûte élevée, puis elle leva ses robes, et tout ce qu’elle avait de beauté se trouva entre les bras de Bahloul.»
La suite fait songer à l’un des Contes de Pogge[135].—«O maîtresse!» dit Bahloul, «mes reins me font souffrir et ne me permettent pas de monter sur ta poitrine; mais toi, place-toi sur moi, agis comme 360 l’homme, puis prends la robe et laisse-moi partir.» Hamdouna y consent volontiers, mais lorsque après elle réclame la robe, Bahloul se plaint de ne l’avoir pas possédée, ayant été plutôt possédé par elle. Après la seconde fois:—«Et la robe?» demande Hamdouna.—«La première a été pour toi, la seconde pour moi,» dit Bahloul; «la troisième sera pour la robe.» Hamdouna, bonne fille, se laisse faire encore, et définitivement Bahloul lui donne la robe; mais il trouve moyen de la lui reprendre. Conduit à la porte par la négresse, il y revient frapper, et demande à boire. La négresse lui apporte de l’eau dans une tasse de porcelaine; après avoir bu, il laisse tomber la tasse, qui se brise. Survient le Grand Vizir, mari de Hamdouna, qui lui dit: «Que fais-tu donc là, Bahloul?—La négresse m’a apporté à boire,» répond-il; «j’ai par malheur brisé la tasse, et, pour m’en punir, elle m’a pris la belle robe d’or que le Calife m’avait donnée.» Le Grand Vizir gronde Hamdouna et la négresse, et leur ordonne de rendre la robe à Bahloul. «Hamdouna s’écria alors, en frappant ses mains l’une contre l’autre:—«Qu’as-tu donc fait, ô Bahloul?» Celui-ci répondit:—«J’ai parlé à ton mari le langage de ma folie; parle-lui, toi, celui de la raison.» Et elle s’extasia de la ruse qu’il avait employée, puis elle lui rendit sa robe, et il partit.»
Une troisième histoire, celle du Nègre Dorérame, semble tirée des Mille et une Nuits.—«Le sommeil ne m’arrive pas; je désire parcourir la ville,» dit à ses grands officiers le roi Ali-ben-Dirème. On se met en marche, bien armés, et le chaouch en tête: il est 361 possible qu’on en ait besoin. La petite troupe fait la rencontre d’un homme qui se lamente; le roi le questionne. Sa maîtresse lui a été enlevée, et il est sûr que c’est pour le compte de Dorérame, un grand vilain nègre qui est l’amant de la femme du premier vizir, à qui elle donne beaucoup d’argent et qui, non content de cela, veut encore toutes les femmes des autres. Une vieille entremetteuse lui en fournit tant qu’il veut, et les entraîne dans sa maison de réprobation, de malheur et de débauche. Pas moyen de les ravoir avant que le Nègre en soit rassasié, et il en a là des quantités, toutes belles comme la lune. Le roi veut connaître cette maison dont il entend parler pour la première fois, et le premier vizir, qui est présent, fait triste mine. L’homme affligé les y mène; mais les portes sont solides et les murailles d’une hauteur formidable. En faisant monter le vizir sur les épaules du chaouch, et l’homme affligé sur celles du vizir, Ali-ben-Dirème pénètre seul dans l’enceinte, le sabre au poing, et, circulant par les chambres, finit par trouver le Nègre et ses amis de même couleur, tous parfaitement ivres, au milieu d’un vrai sérail. Le Nègre est près de la plus belle, sans doute celle que pleure son amant; mais elle lui résiste et, pour gagner du temps, lui chante des vers. Pendant ce temps-là, les autres se divertissent à tour de rôle avec leurs préférées, et Ben-Dirème assiste à leurs ébats, caché derrière une porte. Deux jeunes femmes s’éloignent, ayant quelque tendre confidence à se faire, et, comme elles se mettent toutes nues pour s’entretenir plus à l’aise, il se revêt des robes de l’une d’elles, puis, en se cachant la figure, demande où le Nègre met les clefs de la maison; il finit par le savoir; 362 revient dans la grande salle et, s’étant emparé des clefs, court ouvrir à ses compagnons. Ils le suivent en silence, et l’homme affligé reconnaît en effet sa femme dans celle qui résistait au Nègre. Elle lui chantait toujours des vers:
Elle allait peut-être elle-même montrer sa propre fragilité, car le Nègre devenait pressant, quand la petite troupe fait irruption dans la salle. Aussitôt les compagnons de Dorérame, tout épuisés qu’ils sont de leurs nombreuses fatigues et alourdis par le vin, veulent se défendre; le chaouch en coupe un en deux, d’un revers de sabre.—«Ton bras n’est pas desséché,» dit 363 Ben-Dirème. Il en assomme un autre: «Ton bras n’est pas desséché,» répète le roi. En peu de temps les nègres sont mis hors de combat; le roi leur fait à tous couper la tête, sauf à Dorérame, réservé à un plus cruel supplice: il est pendu, après qu’on lui a coupé le nez, les oreilles et les parties génitales que, par un raffinement habituel aux Arabes, on lui met dans la bouche. Ben-Dirème veut savoir ce que le Nègre mangeait, pour être si ardent, si insatiable de femmes, et on lui apprend qu’il faisait sa nourriture habituelle de jaunes d’œufs frits dans la graisse et nageant dans le miel, de pain blanc, de vin vieux et musqué. Tel était le régime succulent par lequel il s’entretenait toujours en état de plaire.
Le chapitre V est relatif à ces caresses longuement détaillées auxquelles se complaisent les Orientaux et dont il y a tant d’exemples dans les Kama Sutra; les Arabes, ainsi que les Hindous, analysent tout avec une rare subtilité, et, comme ils distinguent quatorze couleurs dans l’arc-en-ciel, où nous n’en voyons que sept, de même, ce qui pour nous est un, est pour eux multiple, composé d’une infinité de phases et de gradations. «La femme,» dit le Cheikh, «est comme un fruit qui ne laisse échapper sa suavité que si tu le frottes entre tes mains. Vois le basilic: si tu ne l’échauffes entre tes doigts, il ne laisse pas exhaler ses parfums. Ne sais-tu donc pas que l’ambre, à moins d’être manipulé, garde dans ses pores l’arome qui y est contenu? Il en est de même de la femme: si tu ne l’animes par des badineries entremêlées de baisers, d’accolements de poitrines, tu n’obtiendras pas d’elle ce 364 que tu désires. Il faut promener la bouche sur les seins, sur les joues, humer la salive, explorer partout avec activité, jusqu’à ce que tu la voies haletante, les yeux humides et la bouche entr’ouverte.»
Dans le chapitre suivant, sont décrites les postures amoureuses, au nombre de vingt-neuf; elles n’ont de particulier que leurs appellations, et encore un certain nombre de celles-ci sont-elles à peu près les nôtres. Le Cheikh avait lu les livres de l’Inde concernant cette partie de la science érotique, car il dit: «Les Hindous ont décrit dans leurs ouvrages un grand nombre de manières, mais la plupart ne donnent pas de jouissance dans leur application; elles exigent plus de peine qu’elles ne procurent de plaisir.» Notons un curieux appendice (n’est-ce pas le cas d’employer le mot?) consacré au bossu. Le Cheikh plaisante agréablement ce disgracié de la Nature:
Néanmoins il examine les diverses sortes de congrès possibles entre un bossu et une femme droite, un homme droit et une bossue, et aussi entre bossue et bossu, ce qui doit être tout à fait drôle.
Le chapitre VII, De ce qui est nuisible à l’acte de la 365 génération, contient des prescriptions qui ne seraient pas toutes acceptées par la science médicale actuelle. Le congrès debout provoque la sciatique et des douleurs dans les articulations des genoux; le congrès la femme dessus, procure des maladies de l’épine dorsale et une orchite, si quelques gouttes du liquide vaginal coulent dans l’urèthre. Rester près d’une femme après le coït rend chauve. Se laver à l’eau froide donne des chancres. Regarder l’intérieur du vagin amène infailliblement la cécité: à ce compte, nos médecins de dispensaires seraient tous depuis longtemps aux Quinze-Vingts. Les vêtements de soie empêchent l’érection, qu’ils soient portés par l’homme ou par la femme. Besogner une vieille, c’est absorber une nourriture empoisonnée; une jeune, c’est au contraire se redonner de la vigueur. Du reste, mangez des œufs, des confitures, des plantes aromatiques, du miel, de la viande, et vous serez toujours bien disposé pour l’amour. Néanmoins, le Cheikh recommande la modération: deux fois par mois, trois au plus, c’est tout ce que l’homme le mieux portant doit se permettre. «Ne recherchez pas trop,» dit-il, «les caresses des filles aux seins gonflés.»
Ceux qui connaissent la richesse du lexique Arabe, qui a plus de cinq cents mots pour désigner le lion, et plus de mille pour désigner l’épée, s’étonneront qu’il n’en ait que trente-neuf, pas davantage, pour les parties sexuelles de l’homme, et quarante-trois pour celles de la femme. Encore cette richesse est-elle plus apparente que réelle, tous ces mots n’étant, en somme, que des épithètes auxquelles on donne la valeur d’un substantif. C’est dans le corps de l’ouvrage qu’il faut 366 chercher les appellations un peu originales; ainsi le Cheikh dit quelque part que la vulve ressemble à la tête du lion, et, ailleurs, à l’empreinte du pied de la gazelle sur le sable du désert; il compare des lèvres rouges à une lame de sabre ensanglanté, et les seins au calice de la jacinthe: cela vaut toujours bien les «gamelles à tentation» de M. Alex. Dumas fils. Il a fait suivre ces deux chapitres (VIII et IX) d’une sorte de Clef des Songes: Voir en rêve son membre coupé, c’est très mauvais signe! voir des dents, signifie longues années; un ongle retourné: défaite; un lys: malheur imminent; une autruche: la mort; une rose fraîche: de la joie; une rose flétrie: des nouvelles mensongères; des jasmins: une déception; une marmite: la conclusion d’un marché; de la sciure de bois: une bonne nouvelle; un encrier: guérison; un turban: menace de cécité prochaine; un fusil: succès; une orange amère: calomnie; une carotte: de la tristesse; un navet: une affaire irrévocable; un verre brisé: retour à Dieu. Celui qui rêve d’une amande verra la fin de ses tourments; d’un soulier: il aura la femme qu’il désire; d’une savate: il fera la conquête d’une vieille. S’il perd son soulier, c’est signe qu’il perdra sa femme. «Je sais bien,» dit le Cheikh, «que ce n’était pas le lieu de traiter de tout cela; mais les paroles s’enchaînent les unes aux autres;» et il renvoie au Traité complet d’un certain Ben-Sirine ceux qui voudraient en savoir plus long; nous y renvoyons à notre tour les auteurs modernes de Clefs des Songes: ils y trouveront peut-être des indications précieuses.
A la suite, sans plus d’ordre méthodique, viennent 367 de très jolies historiettes. C’est d’abord un apologue digne de la Cazzaria: les testicules se plaignent d’avoir perdu leur frère, égaré dans une profonde caverne, et le redemandent à grands cris.—«Vous ne l’aurez que mort!» répond la caverne; il revient, en effet, si pâle, si maigre, si défait, un vrai cadavre, qu’il n’est plus reconnaissable. Mais, d’une voix éteinte, il raconte qu’il a été si heureux dans cette caverne, que les testicules veulent à toute force subir le même traitement. Puis vient l’Histoire de Djoaïdi et de Fadehat el Djemal. El Djemal est une femme qui a toutes les perfections: une chair moelleuse comme le beurre frais, des lèvres comme du corail, une bouche en chaton de bague, des seins comme des grenades et des joues comme des roses. Oui, mais elle rebute Djoaïdi, et lui chante ces vers, en ricanant:
Djoaïdi, ne pouvant deviner ce qu’elle veut dire, va consulter le savant Abou-Nouass, et lui récite cette cantilène, qu’il a retenue. Abou-Nouass y lit à livre ouvert que la femme est d’une haute taille, qu’elle est veuve et qu’elle craint de ne pas rencontrer, pour dresser sa tente, un pieu aussi solide que le premier. Reste à Djoaïdi de montrer qu’il a compris l’énigme et de faire ses preuves: il épouse Fadehat el Djemal.
368 Le chapitre XI aurait fait les délices de Pietro Aretino, qui, s’il l’avait connu, aurait peut-être ajouté quelques épisodes à sa Ruffiannerie. La Femme changée en chien pourrait être un de nos vieux fabliaux. Une entremetteuse est en train d’enjôler une jeune femme; passe un chien enragé, hérissé, la gueule saignante.—«Vous ne la reconnaissez pas? je la connais bien moi; c’est une telle; elle a été changée en chien pour avoir refusé de se donner à un homme qui l’aimait.» La petite ne veut pas du tout être changée en chien; elle consent à suivre l’entremetteuse, qui l’enferme chez elle, et se met en quête de celui pour le compte duquel elle opérait. Malheureusement l’amoureux n’est pas chez lui. «Bast! le premier venu profitera de l’occasion,» se dit-elle, et elle arrête un passant, qu’elle émoustille par la description des beautés d’une jeune femme qu’elle a à sa disposition. Il la suit, et elle les met aux prises; mais c’est justement le mari qui, reconnaissant sa femme, s’en va tout penaud, persuadé, par les hauts cris qu’elle jette, qu’elle a voulu éprouver sa fidélité, et qu’il est tombé dans un piège. «Appréciez d’après cela les ruses des femmes, et ce dont elles sont capables!» dit sentencieusement le Cheikh; c’est le refrain qui revient périodiquement après chaque histoire. Celle de Bahia est plaisante. Bahia (la Beauté éblouissante) a un mari, et un amant qu’elle ne peut voir, tant le mari la tient serrée. Pour passer quelques heures avec lui, elle imagine un stratagème auquel finit par se prêter un ami de son amant: il se couchera dans le lit conjugal à sa place. Rien à craindre, car le mari reste toute la nuit dehors avec son troupeau d’ânesses; 369 seulement il rentre vers minuit et apporte une tasse de lait à sa femme. Le jeune homme n’aura qu’à la prendre et à boire, sans souffler mot; le mari n’y verra rien, vu qu’il n’allume jamais la chandelle. Les choses ainsi convenues, Bahia s’évade avec son amant, et l’ami se couche. Au milieu de la nuit, le mari vient apporter la jatte de lait; le jeune homme la prend et se met à boire, mais comme il n’est pas très rassuré, malgré l’obscurité, la jatte lui échappe des mains et se brise.—«Ah! tu as cassé le pot!» s’écrie le mari; il empoigne un gourdin et se met à rouer de coups, à tâtons, celui qu’il croit sa femme, et qui n’ose souffler, de peur de se faire reconnaître; puis il s’en va. La sœur de Bahia, aussi jolie qu’elle, qui ne sait rien de l’échange opéré, et qui a seulement entendu les coups de bâton, vient consoler la pauvrette ainsi maltraitée; le jeune homme l’attire sur sa poitrine, et elle s’étend près de lui, croyant coucher avec Bahia; détrompée bien vite, elle y reste, «et tous deux passent la nuit dans le bonheur des baisers, des étreintes et des plaisirs réciproques.»
Un autre encore de ces contes est plein d’esprit et d’originalité. Quelqu’un prétendait savoir à fond tous les stratagèmes des femmes et ne s’y laisser jamais prendre. Il commet néanmoins l’imprudence d’entrer chez une rusée commère, à l’œil plein de promesses amoureuses, qui lui fait signe, sur le pas de sa porte: le mari est absent, une savoureuse collation est préparée, qui diable y résisterait? Mais à peine s’est-il assis à table, que le mari revient. Quel fâcheux contretemps! la jolie commère fait cacher le galant dans une armoire. Le mari se met à table à sa place, non sans 370 montrer quelque surprise de cette profusion de mets et de fruits; il en demande la raison.—«C’est que j’avais fait venir mon amant,» répond la femme.—«Ton amant? et où est-il?—A ton arrivée, je l’ai fourré dans l’armoire.» Le mari se lève.—«Il n’y a pas la clef; où est la clef?—La voici;» et il introduit la clef dans la serrure: la femme éclate de rire.—«De quoi ris-tu?—Je ris de la faiblesse de ton jugement et de ton peu de raison. O homme sans discernement! peux-tu croire que si j’avais un amant caché dans cette armoire, je te le dirais? La collation était pour toi.» Le mari, sans ouvrir, vient se rasseoir et mange.—«C’est vrai!» dit-il; vois ce qu’un homme de bon sens peut faire sans réflexion! Moi qui n’ai jamais douté de toi, je me suis levé et je suis allé à l’armoire!» Le repas achevé, il sort, et la bonne commère va délivrer le prisonnier.—«Eh bien, le connaisseur en ruses de femmes, vous doutiez-vous de celle-là?» Le pauvret avait eu une telle frayeur en entendant mettre la clef dans la serrure, qu’il en avait sali ses chausses; il n’en demande pas davantage, et déguerpit lestement. «Appréciez d’après cela les ruses des femmes,» répète le Cheikh; «elles réussiraient à faire monter un éléphant sur le dos d’une fourmi.»
Un Manuel de ce genre ne serait pas complet s’il ne contenait des recettes aphrodisiaques; contentons-nous d’en relever quelques-unes. Pour être toujours en état de satisfaire la femme la plus exigeante, il faut manger des oignons saupoudrés de gingembre, de cardamome et de cannelle; des onguents de fiel de 371 chacal, de graisse de bosse de chameau, de cubèbe mâché avec de la graine de cardamome, de baume de Judée, de pyrèthre, gingembre, lilas et écorce de cannelier, produisent aussi des effets souverains; un composé de miel, de pyrèthre et de graines d’orties remédie à l’impuissance. Le déliement des aiguillettes est une opération très compliquée: il faut prendre du galanga, de la cannelle, de la girofle, du cachou, de la muscade, du cubèbe, une langue de passereau, du poivre Persan, du chardon de l’Inde, du cardamome, du pyrèthre, de la graine de laurier, de la fleur de giroflée, et faire cuire le tout dans du bouillon de pigeon ou de poulet. Mais restons en là de cette pharmacopée amusante; nous en avons dit assez pour donner une idée de ce curieux Livre du Cheikh, et suppléer, par une analyse, à sa rareté.
Octobre 1885.

XLII
L’HECATELEGIUM
DE
PACIFICO MASSIMI[136]

Pacificus Maximus n’est pas un inconnu pour ceux qui ont lu le Manuel d’Érotologie classique de Forberg: l’érudit Allemand en a cité quelques morceaux de choix, très propres à donner une haute idée du poète d’Ascoli. Forberg, toutefois, ne semble pas avoir eu entre les mains l’Hecatelegium complet; il a emprunté ses extraits au recueil des Quinque illustrium poetarum de Mercier de Saint-Léger[137] et il s’y réfère continuellement. 373 Le chef-d’œuvre de Pacificus Maximus est, en effet, très rare, si rare que ce serait peine perdue de le demander en librairie; pour le réimprimer et le traduire, nous avons dû en prendre copie sur l’unique exemplaire qu’en possède la Bibliothèque Nationale, et qu’elle a acquis au prix de douze cents francs.
Dans l’Hecatelegium, tout n’est pas de la force de ces quelques pièces qui font l’ornement du Manuel d’Érotologie; on peut en dire ce que Martial disait trop modestement de ses Épigrammes:
Sunt bona, sunt quædam mediocria, sunt mala plura;
avec cette différence toutefois que le médiocre l’emporte sur le bon et le mauvais. Le mérite du recueil consiste un peu dans son insigne rareté, un peu dans sa Latinité, qui est élégante, beaucoup dans l’étrangeté des sujets que l’auteur aime à prendre pour thèmes de ses développements poétiques. Les humanistes donneront volontiers une place dans leur bibliothèque à ce curieux produit de la verve désordonnée de la Renaissance.
La vie de Pacificus Maximus ou, pour lui restituer son nom véritable, Pacifico Massimi, est assez peu 374 connue. Quoique issu d’une opulente famille d’Ascoli, il semble avoir mené une vie errante et misérable, celle d’un bohème de lettres, ayant tâté de tous les métiers sans trouver dans aucun la fortune. Son père, Giovanni de’Massimi, était à Ascoli, vers 1390, le chef de la faction Guelfe. Chassé une première fois de la ville, avec ses principaux adhérents, il y était rentré de vive force et, après avoir fait exiler ou tuer tous les Gibelins, avait reconquis sa situation première. Pacifico nous a conté lui-même comment, dans une autre sédition, Giovanni avait été forcé de s’enfuir une seconde fois, heureux de s’échapper par une fenêtre à l’aide d’une corde, pendant que les Gibelins défonçaient les portes à coups de hache et mettaient le feu à la maison (Hecatelegium, II, VIII). C’est en parlant de sa naissance que le poète nous fait part de ces détails, sa mère, qui était enceinte, ayant accouché de lui en pleins champs durant cette nuit tragique. Quelques pas plus loin, son grand-père, Marino, qui s’était assez inconsidérément enfui sur un âne poussif, avait été dévoré par les loups. Giovanni de’Massimi recouvra pourtant encore une fois toute sa puissance, car il fut, postérieurement à ces événements, créé gouverneur d’Ascoli par le Souverain Pontife, reconnaissant de son attachement à la cause du Saint-Siège.
Ce fut à Campli, petite ville des Abruzzes peu distante d’Ascoli, que Pacifico passa, dans l’exil de ses parents, ses premières années; aussi, au lieu du titre de poeta Asculanus qu’il se donne en tête de chaque livre de l’Hecatelegium, a-t-il pris quelquefois, ou lui a-t-on donné celui de poeta Camplensis, qui figure sur le titre de ses deux livres de Triomphes dédiés à Braccio 375 Baglioni[138], poèmes Latins publiés pour la première fois par Gio-Battista Vermiglioli (Poesie inedite di Pacifico Massimi Ascolano in lode di Braccio II Baglioni, capitano de’ Fiorentini e generale di S. Chiesa; Pérouse, 1818, in-4o). Il aimait du reste Campli, cet asile de sa jeunesse, et il a chanté dans ses vers l’agglomération des trois bourgades dont s’est formée la ville érigée plus tard en évêché par Clément VII:
Dans la biographie Latine (Vita Pacifici Maximi ex Atheneo Asculano deprompta) qui précède une édition expurgée de quelques-unes des œuvres de notre poète[139], on rapporte qu’aussitôt qu’il fut en âge d’apprendre, son père, remis en possession de ses biens et revenu à Ascoli, lui donna d’excellents précepteurs et que, doué de l’intelligence la plus vive, le jeune homme en profita pour parcourir rapidement tout le cycle des études: Grammaire, Rhétorique, Philosophie, Mathématiques et même Astronomie ou Astrologie (scientia sideralis). Plus tard, il acquit une 376 grande réputation dans la science du Droit et fut compté parmi les jurisconsultes les plus habiles de son temps; c’est surtout comme poète qu’il mérite d’être considéré, et, dit le biographe, «on le réputerait le meilleur de tous, dans l’élégie, s’il n’eût souillé ses vers de honteuses amours: non qu’il fût aucunement lascif, mais pour que ses poésies fussent du goût de la plupart des hommes, qui sont loin d’être bons, et pour qu’ils daignassent les lire. Aussi, à la fin de son ouvrage, a-t-il demandé pardon de ces impuretés à la Sainte Vierge, mère de Dieu.» On en croira ce qu’on voudra, Pacifico ayant, en effet, maintes fois déclaré dans l’Hecatelegium que si ses vers sonnaient mal aux chastes oreilles, ses mœurs étaient irréprochables, et aussi souvent affirmé qu’il pratiquait cyniquement les vices les plus infâmes, et qu’il avait depuis longtemps rejeté toute pudeur.
Né en 1400, il mourut centenaire à Fano en 1500, et on est assez embarrassé de savoir comment il remplit une si longue existence. Du riche patrimoine de ses aïeux, il ne lui était rien resté; son père, d’après la biographie Latine que nous citions plus haut, avait fini par périr d’une façon tragique, assassiné par Francesco de Carrara, qui s’était emparé d’Ascoli pour les Gibelins: le fait est douteux, au moins pour ce qui regarde Francesco de Carrara, étranglé à Venise par l’ordre du Sénat, en 1404, le père de Pacifico ayant assez vécu, ainsi que cela résulte de cette même biographie et de divers passages de l’Hecatelegium, pour que son fils fût en âge d’avoir des précepteurs. Quoi qu’il en soit, la ruine de la famille des Massimi, vers le milieu du XVe siècle, est indubitable. Le poète ne cesse de se 377 lamenter sur sa misère; lui, dont autrefois les immenses domaines étaient labourés par un millier de bœufs, il avoue n’avoir plus un pouce de terre où la grêle puisse tomber. Une requête adressée par lui au roi de Naples, Ferdinand d’Aragon (Hecat., V, IX), nous montre que, dans les premières années du règne de ce monarque, car il l’appelle nova gloria regum, c’est-à-dire vers 1458, Pacifico était de nouveau exilé d’Ascoli par la faction rivale et dépouillé de ses biens; il demande à Ferdinand de le réintégrer dans les domaines qu’il lui a confisqués pour en faire don à un intrus. A cette époque, Pacifico avait perdu non seulement son père et sa mère, mais sa femme, avec laquelle il faisait assez mauvais ménage, si l’on en juge par les furieuses invectives dont il l’a accablée (Hecat., I, V), et les trois enfants issus de son mariage, un fils, Ippolito, dont il a déploré la perte en termes touchants, et deux filles:
C’est ce dernier point surtout qui lui tient à cœur. Il était orphelin, veuf et sans enfants, mais du moins il était riche, et il se plaît à rappeler que partout l’or reluisait sous ses lambris. La requête n’opéra nul effet, car il n’a cessé de se plaindre et de parler de ses vêtements en loques dont riaient les gamins: Pueri mea pallia rident! dit-il (III, VIII).
A cette époque, c’est-à-dire en 1459, il vivait à Pérouse au Collège Grégorien de la Sapienza Vecchia, 378 probablement en qualité de professeur de Droit ou de Belles-Lettres; Gio-Battista Vermiglioli lui donne le titre d’étudiant, mais il avait barbe grise et approchait de la soixantaine. Ce qui est certain, c’est qu’il prit part à une sédition armée des étudiants de l’Université, ainsi qu’il l’a raconté dans deux épîtres en vers, adressées à Cosme de Médicis, que Vermiglioli a publiées pages 281 et 282 des Memorie di Jacopo Antiquari. Le tumulte fut apaisé par Braccio Baglioni, lieutenant du Saint-Siège à Pérouse, avec lequel Pacifico contracta une étroite amitié. Il a chanté ce vaillant condottiere, qui lui offrit une princière hospitalité, dans ses Triomphes, publiés également par Vermiglioli (Poesie inedite di P. Massimi, 1818), composition poétique en deux livres dont le premier est consacré aux vertus civiles, le second aux vertus guerrières de Braccio Baglioni, et dans la Draconide, en trois chants, où il retrace les origines fabuleuses des armoiries de cette famille.
Il fut aussi l’hôte de Sixte IV, qui l’hébergea dans la Villa Farnèse, dont il a décrit les splendeurs (Hecat., IV, III), et il n’a pas ménagé les louanges au pontife, dans la cinquième élégie du même livre, pour les embellissements dont il avait doté Rome: le Ponte-Sisto, la Via-Lata, les rues boueuses changées en larges avenues, etc. C’est toutefois bien à tort qu’il le félicite d’avoir dignement restauré les monuments antiques, car on accuse avec raison Sixte IV de s’être servi d’eux comme de simples carrières de marbre pour en tirer ses constructions nouvelles. M. Müntz (Les Arts à la cour des Papes pendant le XVe et le XVIe siècles) a reproduit un poème d’Aurelio Prandolini, De laudibus 379 Sixti Quarti, pour montrer quel avait été l’enthousiasme des contemporains en voyant s’édifier cette Rome nouvelle sur les ruines de l’ancienne; il aurait pu citer aussi les pièces V et VI du quatrième livre de l’Hecatelegium.
Au milieu de ces splendeurs et malgré une hospitalité dont il finissait par se dégoûter sans doute, Pacifico n’en restait pas moins misérable. Il écrit à son ami Bictinicus (IV, IV), qu’à moins d’être un empoisonneur[140], un maquereau ou un filou, il est impossible de vivre à son aise à Rome. Et cependant 380 Dieu sait s’il était homme de ressources! Il lui énumère tous les métiers dont il était capable:
il se vante encore d’être bon cuisinier, de savoir tricher au jeu comme pas un, d’avoir, en un mot, autant de tours de gibecière que Panurge, et il ne parvient pas à gagner sa pauvre vie! Qu’il fût quelque peu médecin, nous en avons la preuve dans diverses pièces de l’Hecatelegium, notamment III, VIII, où il demande à Alphonse d’Aragon, roi de Naples, à suivre ses camps pour guérir les blessés, et V, X, où il prétend avoir en sa possession une eau merveilleuse pour rappeler à la vie les soldats les plus mortellement atteints: c’était peut-être l’eau d’arquebuse, dont la recette est arrivée jusqu’à nous. Mais son métier le plus lucratif fut encore celui de précepteur, sans doute dans quelques-unes de ces familles princières, les Baglioni et les Salviati, où il était si bienvenu. On ne saurait trop admirer, étant donné l’homme, les excellents préceptes de morale et de vertu qu’il inculquait à ses élèves. Nous en avons au moins deux exemples, la huitième élégie du livre VII, Ad Antonium, et la troisième du livre X, Ad Franciscam, où il rappelle à cette jeune femme le temps où il l’éduquait, sous l’égide de sa sainte mère,
Nous qui connaissons l’Hecatelegium, publié par lui vers la fin de sa longue existence, en 1489, nous le 381 voyons mal dans ce rôle de magister. D’autant plus qu’avant même qu’il ne les imprimât, ses vers licencieux n’étaient pas ignorés; aussi répondait-il à l’un de ses protecteurs, Braccio Baglioni, qui les lui reprochait, par cette distinction subtile de l’homme et de l’œuvre, dont il est question plus haut. A celui-là, qui peut-être lui donnait son fils ou sa fille à instruire, il ne disait pas qu’il avait depuis longtemps rejeté toute pudeur; il réclamait pour le poète le privilège de rester complètement étranger, comme homme, aux thèmes qu’il a choisis comme écrivain; ainsi Virgile a écrit les Géorgiques sans jamais avoir fait paître de troupeaux ni tenu en main un manche de charrue, et chanté les guerres de l’Énéide sans jamais avoir renversé de murailles:
Ceux qui se contentaient de ces raisons oratoires étaient des gens faciles à satisfaire.
Sixte IV et Braccio Baglioni ne furent pas ses seuls protecteurs: il jouit aussi de la faveur de Nicolas V et de Pie II, de Laurent de Médicis, du roi de Hongrie Mathias Corvin, d’Alphonse et de Ferdinand d’Aragon, rois de Naples. Ces derniers le comblèrent, sinon de biens, du moins d’honneurs, lui décernèrent en grande 382 pompe la couronne poétique, et Alphonse le créa chevalier, ce qui ne s’accordait, dit le biographe, qu’aux gens de haute naissance et d’un mérite insigne. On ignore quelles circonstances ou quel emploi l’avaient fait venir à Fano, où il mourut. Quelques années auparavant, sa détresse était telle, qu’il songeait, comme l’Arétin, à aller demander asile au Grand-Turc, à Constantinople: cette pensée commune à deux hommes dont l’existence et les œuvres offrent plus d’un point de ressemblance n’est-elle pas singulière?
Au cours de cette longue vie si accidentée et de ces alternatives d’opulence et de misère, Pacifico Massimi a trouvé moyen d’écrire un grand nombre d’ouvrages, qui d’ailleurs sont à peu près oubliés aujourd’hui. Il s’est exercé dans les genres les plus divers, avec un faible prononcé, en dehors de la poésie, pour les récréations mathématiques. On a de lui un calendrier perpétuel qu’il avait dressé pour Jacopo Salviati, et il résolvait à l’aide de cercles concentriques pourvus de numéros, ou de chiffres marqués sur les phalanges des doigts, toutes les difficultés de construction du pentamètre et de l’hexamètre. Ces figures, reproduites dans l’édition expurgée de ses Carmina (Parme, 1691) ornaient un opuscule qu’il avait fait imprimer à Florence en 1485, contenant un Poème Latin en l’honneur de Giovanni Fatale Salvaglio, un Discours en prose prononcé par le poète dans le Sénat de Lucques à l’occasion d’une distribution de bannières, un Traité intitulé De componendo hexametro et pentametro, adressé à Jacopo Salviati, ainsi que l’explication donnée au même du calendrier de son invention. La première édition de l’Hecatelegium est de 1489; l’auteur de la 383 biographie Latine dont nous avons parlé (Vita Pacifici Maximi ex Atheneo Asculano deprompta) dit en avoir vu une seconde, dont il ne précise pas la date, imprimée à Bologne et en tête de laquelle se trouvait le portrait de Pacifico, très vieux, la tête ceinte du laurier poétique. Il en fut fait une troisième à Fano (1506, per Hieronymum Soncinum); elle contient à la suite, outre les diverses pièces mentionnées plus haut, deux grands poèmes où Pacifico, délaissant ses anciens errements, se fait le champion de la chasteté, de la pudicité: In laudem Lucretiæ libri duo; In laudem Virginiæ libri duo. L’édition de Parme, 1691, contient également tous ces divers ouvrages, mais l’Hecatelegium y est, comme nous l’avons dit, expurgé des pièces licencieuses. On doit encore au fécond écrivain: De bello Spartasio libri sex; De bello Cyri regis libri septem; De bello Syllæ et Marii libri duo; Grammatica de regimine verborum Græcorum, soluta et vincta oratione conscripta, ad Hippolytum filium, qui furent imprimés à Fano, per Hieronymum Soncinum, partie en 1500 et partie en 1506. Quelques-unes de ses œuvres ont dû rester manuscrites et ignorées. Gio-Battista Vermiglioli a remis de lui en lumière les deux livres des Triomphes et la Draconide, parce que ces poèmes intéressaient la mémoire de Braccio Baglioni, à qui cet érudit a consacré une savante étude, plus quarante-deux épigrammes, adressées également à Braccio, et qui faisaient partie d’un recueil manuscrit plus copieux, mais dont il n’a pas voulu reproduire les pièces libres. On porte encore à son avoir divers traités philosophiques: De Sapientia libri septem; De Castitate libri octo; De Moderatione animi; De Bono; De Fato; De Anima libri novem; De 384 Divina Providentia libri decem, parce que, dans l’hendécasyllabe qui précède le VIIe livre de l’Hecatelegium, il dit en être l’auteur; mais c’est prendre trop au sérieux une plaisanterie du poète.
De tous ces ouvrages, c’est, en somme, l’Hecatelegium qui survivra; Pacifico Massimi se place, grâce à ce recueil, à la tête des poètes érotiques les plus audacieux. Le cynisme de certaines pièces n’a été dépassé par personne, pas même par Baffo; d’autres, parmi les élégies amoureuses, sont gracieuses ou spirituelles. Nul, à notre connaissance, n’a encore fait la remarque qu’une centaine d’années avant Francesco Berni, qui a donné son nom au genre Bernesque, Pacifico avait inventé ce genre, et même l’avait du premier coup porté à sa perfection: De Palmera (III, III), Expiscatio (III, IX), Venatio (X, VIII) sont de petits chefs-d’œuvre, comparables à ce que Berni, Molza et Giovanni della Casa ont fait de mieux, le Pesche, la Ficheide, le Forno, etc.; l’équivoque badine y est si finement déduite, à l’aide de sous-entendus si adroits, que les reviseurs de l’édition expurgée n’y ont rien aperçu, à moins qu’ils aient fait semblant de ne rien voir, ce qui est encore possible. Une autre pièce, In hypocritam (V, I), est encore bien remarquable par la quantité de mots à double sens dont elle est pleine: l’édition expurgée ne l’a pas rejetée davantage. Les poètes du XVIe siècle ont excellé dans ce genre plaisant: à Pacifico revient le mérite de leur avoir montré l’exemple, et dans une langue qui se prête moins facilement que l’Italien à l’équivoque.
Décembre 1885.


XLIII
LA CHANSON DE LA FIGUE
PAR
ANNIBAL CARO[142]

Le Commento delle Fiche, d’Annibal Caro, parut pour la première fois en 1539, à Rome, imprimé sans l’aveu de l’auteur par Barbagrigia, pseudonyme sous lequel la plupart des bibliographes croient que se cachait le fameux Blado d’Asola, directeur de l’imprimerie du Vatican. Si Barbagrigia portait déjà barbe grise en 1538, il devait être bien vieux en 1584 lorsqu’il rééditait les Ragionamenti de Pietro Aretino, dans la préface desquels il promettait aux amis du gai savoir de leur donner, entre autres belles choses, la plaisante 386 dissertation d’Annibal Caro. Elle se trouve à la fin des quatre éditions des Ragionamenti publiées sous la date de 1584, mais précédée d’un Avertissement signé de l’Herede di Barbagrigia, et depuis elle a été reproduite dans l’édition si connue des Elzévirs (Cosmopoli, 1660). On vient tout récemment de la réimprimer à part en Italie.
Malgré la gaillardise du sujet et les équivoques badines dont elle est remplie, c’est un morceau académique, de même que la Ficheide de Molza, dont elle est le commentaire ingénieux. Molza, qui appartenait à l’Académie Romaine des Vignerons (i Vignaruoli), où il s’appelait le Figuier (il Fico), y avait lu un Capitolo burlesque dans le genre du Berni sur la Figue. Annibal Caro, qui était de l’Académie des Vertueux (i Virtuosi), où il avait pris le nom de Ser Agresto (Verjus), y lut son Commentaire sur le Capitolo de Molza, qu’il appelle savamment il Padre Siceo (du Grec σὺκον, figue). On sait, ou l’on devine aisément ce que les Italiens entendent par la figue, comme ils appellent autre chose le melon ou la pêche, par analogie de configuration. Horace désigne l’objet par son nom propre, ajoutant que bien avant Hélène il avait été la cause la plus active des guerres:
Tout l’esprit du Capitolo de Molza, comme celui des pièces du même genre: le Four, l’Anguille, la Flûte, la Pêche, la Bague, le Mortier, etc., consiste à entendre 387 le mot donné tantôt selon la lettre, tantôt selon le «mystère», et à faire là-dessus une équivoque perpétuelle. Annibal Caro, dans son Commentaire, a renchéri encore sur les imaginations excentriques du poète, qui semblait cependant avoir épuisé le sujet. Sous prétexte d’éclaircir les endroits difficiles, il a fait une excellente parodie de ces annotateurs dont les gloses étouffent le texte et qui devinent sous le moindre mot des profondeurs infinies. Seulement, au rebours de ces ennuyeux pédants, il amuse toujours et sa prose est encore plus spirituelle que les vers du Molza. Qui croirait qu’on peut déployer tant d’érudition à propos d’une figue? Arrivé au bout de sa tâche, l’auteur prend soin pourtant d’énumérer en une page ou deux ce qu’il n’a pas dit, et on s’aperçoit qu’il aurait pu, en marchant du même train, poursuivre bien longtemps sa route. C’est que, suivant la vieille plaisanterie en honneur chez les Italiens, la figue est une matière ample et large, un Nouveau-Monde où chaque navigateur qui s’aventure ne manque pas de faire des découvertes, une mer sans rivages, dont jamais ancre n’a touché le fond. Aussi annonce-t-il qu’il médite deux autres Figuades, pour faire suite à la première, et il était bien capable de les écrire; mais il s’en est tenu là, et peut-être a-t-il bien fait.
A la suite du Commento delle Fiche nous avons traduit la Diceria de’ Nasi, autre opuscule d’Annibal Caro qui s’y trouve joint dans toutes les réimpressions. C’est encore une harangue académique, pleine d’originalité, faite en l’honneur d’un président ou roi des Virtuosi, 388 un nommé Leoni, doué d’un nez véritablement prodigieux, que les Académiciens s’étaient engagés à célébrer à tour de rôle aux séances solennelles. L’auteur y a mis moins d’équivoques badines que dans la première Dissertation, mais tout autant de finesse et d’esprit.
Octobre 1886.

APPENDICE
LES RAGIONAMENTI
ou Dialogues
DE PIETRO ARETINO
AVANT-PROPOS DE L’ÉDITION DE 1882[143]

Notre divin Pietro Aretino, l’incomparable auteur de ces célèbres Ragionamenti dont nous donnons présentement un bon texte, correct, d’une lecture facile, et une traduction complète, littérale, n’a presque rien de commun avec cet Arétin dont la mémoire est plus chargée de méfaits que le bouc émissaire des Juifs. L’Arétin n’est guère connu que pour avoir édité ou tout au moins inspiré certains recueils de postures obscènes auxquels son nom est resté attaché, et pour avoir écrit la Puttana errante, petit Dialogue des plus médiocres, fameux seulement parce qu’on 392 y trouve, suivant l’expression de Bayle, une description raisonnée de i diversi congiungimenti jusqu’au nombre de trente-cinq. Lisez tous nos historiens ou chroniqueurs, de Brantôme à Michelet; lisez tous nos bibliographes, tous nos critiques littéraires et artistiques, de Bayle, La Monnoye et Félibien à Libri et à Brunet, l’excellent auteur du Manuel du Libraire; lisez tous les Italiens, Crescimbeni, Mazzuchelli, Tiraboschi ou Fontanini, partout vous trouverez que l’Arétin doit le plus clair de sa mauvaise renommée à ces deux ouvrages: si l’on a besoin d’une périphrase pour le désigner, on l’appelle indifféremment l’homme aux postures ou l’auteur de la Puttana errante. Lorsqu’une précédente tentative de traduction des Dialogues, que nous avions essayée sur d’autres bases que celle-ci, en prenant la peine de transposer en Latin les passages scabreux, encourut les sévérités de la Justice, est-il bien sûr que ce ne soit pas cet Arétin-là, un Arétin tout de fantaisie, qu’on ait cru condamner? Pietro Aretino n’est absolument pour rien dans aucun des recueils connus de figures libres, les Arétins d’Annibal et d’Augustin Carrache, l’Arétin Français, etc., et il n’est que pour fort peu de chose dans un plus ancien recueil du même genre bien difficile à juger avec compétence, puisque personne ne l’a vu, depuis plus de deux cents ans; il a seulement griffonné, au bas des seize estampes qui le composaient, et qu’il n’avait ni commandées ni inspirées, seize Sonnets presque si complètement disparus, eux aussi, que si l’on veut les retrouver, il faut, pour ainsi dire, avoir recours à la nécromancie. Quant à la Puttana errante, que l’on entende par là soit le poème en quatre chants qui porte ce titre, et qui est d’un de ses amis, Lorenzo Veniero, soit le Dialogue de Maddalena e Giulia, qui n’a le titre de Puttana errante que depuis deux siècles environ, il n’en a jamais écrit un traître mot. On le condamne donc 393 pour des crimes qui ne sont pas les siens; on l’excommunie sans savoir au juste ce qu’il a fait.
Il a fait les Ragionamenti, ouvrage qui à lui seul est plus que suffisant pour lui maintenir sa réputation, mais dans lequel du moins la vivacité de quelques peintures, justifiée déjà par l’extrême licence des temps, l’est encore bien plus par les mérites de tous genres qui font de ce livre un vrai chef-d’œuvre. Nous les donnons tels que l’auteur les a conçus et écrits, tels qu’il les a édités de son vivant. Toutes les pièces qu’on a postérieurement ajoutées aux Six Journées: le Ragionamento del Zoppino, le Commento di ser Agresto, la Diceria de’ Nasi, la Puttana errante, bien loin d’en faire partie intégrante, ne sont pas même de P. Aretino, et constituent autant de supercheries de libraires dont sont encore dupes, à l’heure qu’il est, bibliophiles et bibliographes, même les bibliographes Italiens qui, les premiers, auraient dû facilement découvrir la fraude et la signaler.
A deux années d’intervalle parurent: 1o le Ragionamento de la Nanna et de la Antonia, fatto a Roma sotto una ficaia; composto dal divino Aretino per suo capricio, a correttione de i tre stati delle donne. Parigi, 1534, in-8; c’est la 1re partie des Ragionamenti, divisée en trois journées (Vie des Religieuses, Vie des Femmes mariées, Vie des Courtisanes) et dédiée par l’auteur à son Sapajou; 2o le Dialogo di Messer Pietro Aretino, nel quale la Nanna, il primo giorno, insegna a la Pippa, sua figliola, a esser puttana; nel secondo gli conta i tradimenti che fanno gli huomini a le meschine chi gli credano; nel terzo la Nanna et la Pippa, sedendo nel orto, ascoltano la Comare et la Balia che ragionano de la ruffianaria, Torino, 1536, in-8; c’est la 2e partie, divisée également en trois journées (l’Éducation de la Pippa, les Roueries des Hommes, la Ruffianerie), et dédiée à Bernardo Valdaura. Ce Ragionamento et ce Dialogo, 394 imprimés probablement tous les deux à Venise avec les fausses indications de Paris et de Turin, constituent l’œuvre entière et complète des Ragionamenti; l’Aretino n’y ajouta ni une page ni une ligne. Dans ses Lettres, il en parle assez souvent et les désigne tantôt sous le titre général de Capricci, tantôt sous ceux de la Nanna ou de la Pippa, suivant qu’il entend mentionner la première ou la seconde partie; nulle part il ne souffle mot du Zoppino, de Ginevra e Rosana (ancienne version de la Puttana errante en prose), ni d’aucune des autres pièces qui ont été plus tard jointes aux Ragionamenti.
Deux ans après la publication de la seconde partie, en 1538, l’Aretino fit imprimer un Ragionamento de le Corti, où il maltraite surtout la cour de Rome et se venge des déboires qu’il y avait éprouvés. Cet ouvrage n’a aucun rapport avec les Six Journées et il n’en a pas davantage avec le Dialogo di Pietro Aretino nel quale si parla del gioco con moralità piacevole, qui parut en 1542 et qui a pour sujet les jeux de cartes. Néanmoins, un éditeur caché sous le nom de Giovan Andrea Melagrano, en 1589, crut devoir faire un tout de cet ensemble si peu homogène et présenter ce nouveau Ragionamento et ce Dialogo comme formant la troisième partie des Ragionamenti. M. Libri, dans son catalogue de 1847, a parlé de cette édition de 1589 d’une façon propre à induire en erreur: «Cette Troisième Partie, dans laquelle l’Arétin parle avec une grande liberté des Cours et du Jeu, n’a pas été reproduite par les Elzeviers. Elle est peu connue et mérite cependant d’attirer l’attention des amateurs.» Les Elzeviers ont eu mille fois raison de ne pas la reproduire, puisqu’elle ne se rattache en aucune façon aux Six Journées; il faut plutôt leur reprocher de s’être montrés trop faciles en 395 introduisant dans leur édition des pièces qui ne sont pas même de P. Arétin.
De bonne heure les Libraires, pour grossir le volume, avaient pris l’habitude de joindre aux Six Journées quelque opuscule qu’ils jugeaient être du même genre et de le faire passer sous le couvert d’un livre renommé. Ainsi, à l’exemplaire de la première édition, fort rare, que possède la Bibliothèque Nationale (Y2 1445) se trouvent joints: la Puttana errante, in rime (c’est le poème de Lorenzo Veniero; les rédacteurs du Catalogue disent qu’il est soit de Maffeo, soit de Lorenzo Veniero, soit de Pietro Aretino) et la Cazzaria del Arsiccio Intronato, que les mêmes rédacteurs disent devoir être de P. Aretino, ou d’Antonio Vignali de’ Bonagiunti: elle est certainement de ce dernier, et de nul autre. Bandello eut peut-être entre les mains un recueil factice du même genre, où l’on avait réuni à la Nanna et à la Pippa un ouvrage assez différent. Il dit dans une de ses Nouvelles (XXXIVe, Première Partie) que la Zanina, son héroïne, lisait soit Pétrarque, soit l’Arioste «tout récemment sorti des mains de l’imprimeur», soit la Nanna, soit la Raffaella de l’Arétino. Le Dialogue de Madonna Raffaella et de Margharita, dont le véritable titre est: Dialogo nel quale si ragiona della bella creanza delle Donne, del Stordito Intronato (Alessandro Piccolomini), se trouve en effet quelquefois annexé aux Ragionamenti, notamment dans un exemplaire de la Bibliothèque Nationale (Y2 1452). Si un contemporain, un lettré, comme Bandello, croyait la Raffaella de l’Arétin, par la raison qu’elle était reliée avec la Nanna, on peut juger si les éditeurs et contrefacteurs de la fin du siècle ou du siècle suivant se tinrent en garde contre de pareilles méprises: ils réimprimèrent tout ce qu’ils rencontrèrent rassemblé de la sorte, le nom de l’Arétin leur semblant 396 un excellent pavillon pour couvrir toute espèce de marchandise.
On ne connaît d’édition faite du vivant de P. Aretino que celle de 1534-36. Brunet en cite une, qu’il croit être du milieu du XVIe siècle, ainsi intitulée: Dialogo del divino Aretino che scopre le falsità, rubarie, tradimenti et fatuchiari ch’usano le cortegiane per ingannare li simpli huomini che de loro s’innamorano, intitolato la Nanna e Antonia (Parigi, senz’anno). L’ouvrage contient quatre Journées seulement, la 3e de la Première Partie et les trois de la Seconde; la Vie des Religieuses et la Vie des Femmes mariées sont retranchées. Brunet ne fait mention d’aucune pièce ajoutée à l’exemplaire qu’il décrit.
En 1584 parut la première réimpression complète des Six Journées; ce long intervalle s’explique par les censures et prohibitions dont la cour de Rome avait frappé toutes les œuvres de l’Arétin, même ses œuvres dévotes, les Psaumes, l’Humanità di Cristo, la Genèse, etc. Elle sortait des presses d’un homme de beaucoup d’esprit et de goût, nourri de la moelle des bons auteurs et qui s’est masqué sous le nom de Barbagrigia. Quatre éditions au moins des Ragionamenti portent cette date de 1584 et le nom de Barbagrigia; Brunet conjecture avec raison que la première, la bonne, les autres étant des contrefaçons, dut être faite à Lyon[144]. Celles qui nous sont passées par les mains sont toutes uniformément composées des Six Journées, du Ragionamento del Zoppino, 397 qui est donné comme de P. Arétin, du Commento delle Fiche et de la Diceria de’ Nasi. Les Elzeviers, dans leur édition de Cosmopoli, 1660, ont suivi exactement Barbagrigia, sauf qu’un de leurs tirages a de plus la fameuse Puttana errante en prose.
Le Commento di ser Agresto et la Diceria de’ Nasi, deux agréables badinages d’Annibal Caro, n’ont aucun titre à figurer avec les Six Journées, et le Ragionamento del Zoppino, quoique ayant quelque ressemblance, quelques points d’attache avec ces dernières, n’est certainement pas de l’Arétin. On n’y retrouve ni son style ni sa manière: la lecture en est facile; les mots forgés, les comparaisons bizarres, les mille facettes dont le maître aime à faire chatoyer sa prose et qui la rendent si reconnaissable, manquent complètement. Nous n’y voyons non plus aucun de ces traits de haut comique, de ces bons contes, pleins de gaieté, qui font le charme des Ragionamenti. Le Zoppino est triste, presque lugubre, et surtout nauséabond. Au lieu de ces franches vauriennes, mais si jolies, si drôles, dont les roueries, contées par la Nanna ou la Commère, nous font éclater de rire, il nous montre dans toutes les courtisanes de malpropres guenipes qu’on ne toucherait pas avec des pincettes, des souillons couvertes de vermine et portant sur elles de si épaisses couches de crasse qu’on y planterait des laitues! Ce point de vue est entièrement opposé à celui de l’Arétin.
Nous en dirons autant et même davantage de la Puttana errante, overo Dialogo di Maddalena e di Giulia, qui cependant est supposée donner du prix à l’édition des Elzeviers, quand elle s’y rencontre (Manuel du Libraire, art. Arétin). Le Zoppino du moins est ancien et contemporain des Ragionamenti. Mais le Dialogue de Madeleine et de Julie! on y chercherait en vain le moindre reflet des qualités propres au divin Pietro. 398 C’est un ouvrage de pacotille pour la confection duquel on a rajeuni le style et l’orthographe du premier des deux Dialoghi di Rosana e Ginevra, vieille rhapsodie mise en circulation sous le nom de Pietro Aretino à la date vraie ou fausse de 1584. On lui a donné le titre de Puttana errante, qui ne lui convient nullement, pour le faire confondre avec le célèbre poème de Lorenzo Veniero, longtemps attribué à l’Arétin; de là sa réputation usurpée. Comment les bibliographes Italiens ne se sont-ils jamais aperçus d’une supercherie aussi manifeste?
Au lieu de ces morceaux apocryphes, nous préférons donner une pièce, véritablement authentique, celle-là, dont on nous saura gré sans doute. C’est la reproduction à l’eau-forte de la belle gravure de Marc-Antoine Raimondi, d’après le Titien, dont voici la description telle que nous la trouvons dans Bartsch (Le Peintre graveur, XIVe vol., éd. de Vienne, 1814).—«Pierre Arétin, célèbre poète. Il est à mi-corps et vu de face. Sa tête est couverte d’un bonnet, et, par-dessus, d’un chapeau qui, mis de biais, passe sur son oreille droite. Le chiffre est gravé à droite, à mi-hauteur et tout près du bord de l’estampe.»
Au-dessous de l’inscription, dans la marge du bas, se lisent deux distiques dont nous reproduisons ici le texte, avec la ponctuation convenable:
«Cette estampe,» ajoute Bartsch, «est une des plus rares de Marc-Antoine; c’est la mieux gravée, la plus terminée et en même temps la plus artiste de tout son œuvre.»
FIN

[1] Advis pour dresser une Bibliothèque, présenté à Monseigneur le Président de Mesme, par Gabriel Naudé, Parisien. Réimprimé sur la deuxième édition (Paris, 1644). Paris, Liseux, 1876, petit in-18.
[2] Socrate et l’Amour Grec (Socrates sanctus παιδερασθής): dissertation de Jean-Matthias Gesner, traduite en Français pour la première fois, texte Latin en regard, par Alcide Bonneau. Paris, Liseux, 1877, pet. in-18.
[3] Un Vieillard doit-il se marier? Dialogue de Pogge, traduit pour la première fois par Alcide Bonneau, texte Latin en regard. Paris, Liseux, 1877, pet. in-18.
[4] Vincenzio Pecchioli l’a reproduite dans l’Appendice de sa traduction Italienne de la Vie de Laurent le Magnifique, de Roscoe.
[5] Paris, Liseux, 1876, pet. in-18.
[6] Pogge eut de Vaggia de’ Buondelmonti cinq fils: Pietro-Paolo, Giovan-Batista, Jacopo, Giovan-Francesco et Filippo. Pietro-Paolo naquit en 1438, prit l’habit de Dominicain et fut promu prieur de Santa-Maria-della-Minerva, à Rome, fonctions qu’il exerça jusqu’à sa mort arrivée en 1464.
Giovan-Batista naquit en 1439; il obtint le grade de docteur en droit civil et en droit canon, fut ensuite chanoine de Florence et d’Arezzo, recteur de l’église Saint-Jean-de-Latran, acolyte du souverain Pontife et clerc assistant de la Chambre. Il a composé en Latin les vies de Niccolo-Piccinnino, fameux condottière du temps, et de Domenico Capranica, cardinal de Fermo. Il mourut en 1470.
Jacopo fut le seul des fils de Pogge qui n’embrassa pas l’état ecclésiastique. Ce fut un littérateur distingué. Entré au service du cardinal Riario, ennemi acharné des Médicis, il était son secrétaire en 1478 et fut engagé par lui dans la conspiration des Pazzi. Le cardinal Riario parvint à s’échapper, mais le malheureux Jacopo subit le sort de la plupart des autres conjurés, qui furent pendus aux fenêtres du Palais de Justice de Florence.
Giovan-Francesco, né en 1447, fut, comme Giovan-Batista, chanoine de Florence et recteur de Saint-Jean-de-Latran. Appelé à Rome, il y devint camérier du pape et abréviateur des lettres apostoliques. Léon X, qui l’avait en grande estime, le prit pour secrétaire. Il mourut à Rome en 1522 et fut enseveli dans l’église de San-Gregorio.
Filippo naquit en 1450; c’est de sa naissance que Pogge se félicite dans une lettre à Carlo Aretino en lui annonçant que, quoique septuagénaire, il vient d’avoir un fils plus fort et plus beau que tous ses aînés. Filippo obtint à l’âge de vingt ans un canonicat à Florence, puis il abandonna l’état ecclésiastique pour épouser une jeune fille appartenant à une famille illustre, dont il eut trois filles.
Outre ses cinq fils, Pogge eut encore une fille, Lucrezia, qu’il maria de bonne heure à un Buondelmonti. On ne sait si cette fille provenait de son mariage, ou si c’était un des enfants qu’il avait eus de sa maîtresse.
[7] En ce cas, il aurait ressemblé à l’un des plus célèbres médecins de son siècle, le Ferrarais Jean Manard, mort en 1537, à l’âge de 74 ans. Ce Manard, «s’étant marié fort vieux avec une jeune fille, fit des excès qui le tuèrent. Les poètes ne manquèrent pas de plaisanter là-dessus, et principalement ceux qui sçurent qu’un astrologue lui avoit prédit qu’il périroit dans un fossé. Ce fut le sujet de ce distique de Latomus:
«On a tant brodé la pensée de ce distique, que l’on est venu jusques à dire que Manard, pour éviter la prédiction, s’éloignoit de tous les fossez. Il ne songeoit qu’au sens litéral, et ne se défioit point de l’allégorique; mais il reconnut par expérience que ce n’est pas toujours la lettre qui tue, et que l’allégorie est quelquefois le coup mortel.» (Bayle, art. Manard.)
[8] La Civilité puérile, par Érasme de Rotterdam; traduction nouvelle, texte Latin en regard, précédée d’une Notice sur les Livres de Civilité depuis le XVIe siècle, par Alcide Bonneau. Paris, Liseux, 1877, pet. in-18.
[9] Henri de Bourgogne, fils d’Adolphe, prince de Veere, et petit-fils d’Anne de Borsselen, marquise de Nassau. Cette dame avait été l’affectueuse protectrice d’Érasme, dans sa jeunesse: elle lui avait fait une pension de cent florins pour qu’il pût étudier la théologie à Paris et elle lui continua longtemps ses libéralités. Érasme écrivit pour son fils, Adolphe, prince de Veere, le traité intitulé: Oratio de virtute amplectenda, une de ses premières œuvres; il dédia plus tard à l’un de ses petits-fils, Maximilien de Bourgogne, le dialogue: De recta Latini Græcique sermonis pronuntiatione, auquel il fait allusion dans sa préface, et à l’autre le De Civilitate morum puerilium. Parmi ses lettres, on en rencontre un grand nombre adressées à Anne de Borsselen.—Veere, dans l’île de Walcheren, était au XVIe siècle un des ports fortifiés les plus importants de la Zélande. Cette ville fut apportée en dot, avec la principauté qui en dépendait, par Anne de Borsselen à son mari, Philippe de Bourgogne, fils de l’un des nombreux bâtards du duc Philippe le Bon.
[10] Il les avait déjà formulés, en passant, dans divers autres de ses ouvrages. Un de ses colloques, Pietas puerilis, renferme quelques-unes des maximes qu’il a exposées plus complètement dans la Civilité puérile; il y revient encore dans ses Monita pædagogica.
[11] Notons ici la particularité curieuse d’une des Civilités que possède la Bibliothèque de l’Arsenal (no 2544). Au lieu des quatrains de Pibrac, annoncés sur le titre, on trouve une poésie intitulée: La Manière civile de se comporter pour entrer en mariage avec une demoiselle:
Cette poésie badine est de Moncrif. L’historiogriffe des chats se trouvait un jour, paraît-il, à Châtellerault, chez un imprimeur de ses amis. Pour s’amuser aux dépens des Civilités, de ceux qui les éditent et de ceux qui les lisent, il improvisa cette pièce de vers et la fit composer avec ces caractères particulièrement illisibles dont Châtellerault avait le monopole. On plaça sans doute le feuillet, par mégarde, à la suite de l’ouvrage qui se débitait le plus en ce moment-là; mais la plaisanterie est un peu roide.
[12] Les Facéties de Pogge Florentin, traduites en Français, avec le texte en regard. Première édition complète. Paris, Liseux, 1878, 2 vol pet. in-18.—Les Facéties, traduites en Français, avec le texte Latin. Seconde édition complète. Paris, Liseux, 1878, 2 vol. in-18.—Poggio. The Facetiæ, or Jocose Tales of Poggio, now first translated into English; with the Latin text. Paris, Liseux, 1879, 2 vol. in-18.
[13] Comme exemple, voici le début de sa traduction, tel que nous le trouvons dans l’édition de Jehan Bonnefons, Paris, 1549, et, avec des rajeunissements d’orthographe, mais sans modifications essentielles, dans celle de Jean-Frédéric Bernard, Amsterdam, 1712:
Conte premier.—D’un pauvre pescheur qui loua et despita Dieu tout en une heure.
Ès parties de Lombardie auprès de la mer est une petite ville nommée Cajette, en laquelle ne demeuroient que tous povres gens, et dont la plus part n’avoient que boire ne que manger, fors de ce qu’ilz povoient gaigner et assembler en pescherie. Or est ainsi que entre eux Cajettans, fut ung nommé Navelet, jeune homme, lequel se maria à une moult belle jeune fille, qui se mist à tenir son petit mesnage, et est assez vray semblable, veu la grandeur luccative dont il estoit, qu’il n’avoit pas de toutes monnoies pour change tenir; dont il n’estoit pas fort joyeux, et non pas de merveilles: car gens sans argent sont à demy mors. Or est vray que pour la petite provision que ce povre jeune homme faisoit en la maison, sa femme souvent le tourmentoit et tempestoit, et si luy donnoit grandes reprouches: tellement que le povre compaignon, comme tout désespéré, proposa de s’en aller dessus la mer, et de laisser sa femme, en espérance de gaigner, et de ne retourner jamais en sa maison, ne au pays, tant qu’il eust aucune chose conquesté. Et a doncques mist à poinct toutes ses besongnes, et fist toutes ses réparations aux navires avecques aucuns certains complices et compaignons que il avoit. Partit d’avecques sa femme, laquelle il laissa en une povre maisonnette toute descouverte: ayant seulement ung petit lict, dont la couverture ne valloit comme riens. Et s’en alla dessus mer, là où il y fut près de cinq ans ou plus, sans revenir. Or advint que tantost après que ce dict gallant fut party, un Quidam, qui estoit tout de loisir, voyant la beaulté de ceste povre jeune femme (que son mary par povreté avoit abandonnée), vint à elle, et l’exhorta par belles parolles, dons et promesses qu’il luy feist, tant qu’elle se consentit à faire sa voulenté, et mist en oubly la foy de mariage qu’elle avoit promise à son mary. Ainsi recouvrit la povre femme pour son mary ung amy, lequel la vestit plaisamment, et luy donna un très-beau lict et belle couverture, luy feist refaire sa maison toute neufve, la nourrit et gouverna très-bien: et qui plus est, à l’aide de Dieu, et de ses voysins, en succession de temps luy feist trois beaulx enfans, lesquelz furent honnestement eslevez et nourris, tant qu’ilz estoient jà tous grans, quant le mary de la mère (qui estoit desjà oublié) retourna, lequel au bout de cinq ans ou environ arriva au port de la cité, non pas tant chargé de biens qu’il avoit espoir quand il partit. Après que ce povre homme fut descendu sur terre, il s’en alla en sa maison, laquelle il veit toute réparée, sa femme bien vestue, son lict couvert d’une belle couverture, et son mesnage très-bien empoint. Quant cest homme veit cest estoit, ainsi que dict est, il fut moult esbahy, et demanda à sa femme dont ce procédoit. Premier, qui avoit esté cause de refaire la maison, de la revestir si bien, qui luy avoit donné son beau lict, sa belle couverture, et générallement dont estoient procedez et venus tant de biens à la maison, qu’il n’y avoit au devant qu’il partist. A toutes les demandes que ce mary feist à cette femme, elle ne respondit aultre chose: sinon que la grace de Dieu les luy avoit envoyez, et luy avoit aidé. Adonc commença le povre homme à louer Dieu, et luy rendre grace de tant de biens qu’il luy avoit envoyez. Tantost après arriva dedans la maison ung beau petit enfant environ de l’aage de trois ans, qui se vint frotter encontre la mère, ainsi que la mère l’admonnestoit. Lors le mary se voyant tout esbahy commença à demander qui estoit celluy enfant. Elle respondit qu’il estoit à eulx. Et le povre homme tout estonné demanda dont il luy estoit venu, que luy estant dehors, et en son absence elle eust conceu et enfanté ung enfant. A ceste demande répondit la jeune femme, que ce avoit esté la grace de Dieu qui luy avoit envoyé. Adonc le povre homme, comme tout hors du sens et enragé, commença à maugréer et despiter Dieu, que tant sollicitement s’estoit meslé de ses besougnes et affaires; qu’il ne luy suffisoit pas de se mesler des affaires de la maison, sans qu’il touchast à sa femme, et lui envoyer des enfans. Ainsi en peu d’heure le povre homme loua, maugréa et despita Dieu de son fait. En ceste facecie est donné à entendre que il n’est rien si subtil et malicieux que une mauvaise femme, rien plus promt ne moins honteux pour controuver mensonges et excusations. Et à ceste cause qu’il n’est homme si ygnorant que aucunesfois ne congnoisse ou apperçoive une partie de sa malice et mensonge.
[14] Paris, Jehan Bonnefons, 1549, in-4o Gothique; c’est la seule édition Française que possède la Bibliothèque Nationale (Y2, 1542, Réserve). Cette édition paraît donner, dans toute son intégrité, le texte de Guillaume Tardif.
[15] Les Contes de Pogge, Florentin, avec introduction et notes, par P. Ristelhuber. Paris, Alphonse Lemerre, 1867, in-16 de XXXII-160 pages, tiré à 212 exemplaires.
[16] Quelques Contes de Pogge, traduits pour la première fois en Français, par Philomneste Junior. Genève, J. Gay et Fils, 1868, in-12 de XI-68 pages, tiré à 104 exemplaires.
[17] Poggii Florentini oratoris et philosophi Opera, collatione emendatorum exemplarium recognita... Basileæ, apud Henricum Petrum, MDXXXVIII, petit in-fol. de 6 ff. et 491 pp.
[18] La Papesse. Nouvelle en trois parties et en vers, de l’abbé Casti, traduite pour la première fois, texte Italien en regard; avec les notes et pièces justificatives. Paris, Liseux, 1878, pet. in-18.
[19] Le Décaméron, de Boccace; traduction complète par Antoine Le Maçon, secrétaire de la Reine de Navarre (1545). Paris, Liseux, 1879, 6 vol. pet. in-18. Figures sur bois.
[20] La Filena, singulier ouvrage qui serait un chef-d’œuvre s’il n’était d’une prolixité fatigante (Mantoue, 1547, 3 vol. in-12). L’auteur y raconte les enivrements, les jalousies, les déceptions, les désespoirs, les tortures que lui fait éprouver une femme—qui n’existe pas. Il est assez curieux de voir à plus de deux siècles de distance, Franco, un cynique, devinant et présageant le système de Kant, affirmer comme lui que nous ne voyons que nos propres idées, que la réalité nous échappe, que nous créons nous-mêmes ces êtres, ces femmes à qui nous donnons notre amour, notre confiance, à qui nous sacrifions notre vie et qui ne sont que des fantômes de notre imagination.
[21] Tous les ornements et vignettes en question ont été gravés à nouveau par un artiste habile et consciencieux, M. Alfred Prunaire.
[22] La Donation de Constantin, premier titre du pouvoir temporel des Papes: où il est prouvé que cette Donation n’a jamais existé, et que l’Acte attribué à Constantin est l’œuvre d’un faussaire, par Laurent Valla (XVe siècle). Traduit en Français et précédé d’une Étude historique, par Alcide Bonneau. Avec le texte Latin. Paris, Liseux, 1879, pet. in-18.
[23] Rohrbacher, Histoire universelle de l’Église, tome IV.
[24] Epistola Papæ Melchiadis, dans la Collection des Conciles de Labbe, tome I; Vita S. Sylvestris, Papæ.
[25] C’est ce que dit Steuchus réfutant Laurent Valla, qui s’appuie sur la donation faite à Melchiade pour nier celle que Constantin aurait faite à Sylvestre. «Melchiade n’a jamais vu ni connu Constantin; il n’a pu parler ni de lui ni de la Donation, qui s’est effectuée longtemps après sa mort. Ce sont les Grecs, les Ariens qui ont inventé la concession par Constantin à Melchiade de je ne sais quelles constitutions. Cela est faux, l’histoire le prouve surabondamment; Melchiade ne vécut pas jusqu’au temps de Constantin: il avait reçu la couronne du martyre sous ses prédécesseurs. Lisez Damase et bien d’autres. Les paroles que Valla prête à Melchiade ont donc été imaginées par les Ariens, ainsi que les prétendues constitutions. Voilà ce qui a trompé notre homme; voilà quelle a été son incroyable cécité; il n’a pas su lire dans les histoires que Melchiade n’avait jamais pu parler ni de la foi, ni de la religion, ni des dons de Constantin.» (Contra Laurentium Vallam, p. 147.)—Singulier retour des choses d’ici-bas! Depuis que la Donation a été reconnue fausse et qu’il ne s’est plus agi de la soutenir, mais de ne pas tout perdre, la fable de Melchiade, très mauvaise du temps de Steuchus, excellente depuis, a été ressuscitée (moins ce qui concerne le baptême, décidément abandonné), et l’on peut lire dans tous les historiens de cette période de l’Église, Chateaubriand, l’abbé Rohrbacher, l’abbé Darras, M. de Broglie, comment ce saint Pape, quoique mis à mort en 312 par Maximin, d’après Steuchus, fut au mieux l’année suivante avec Constantin, en reçut la permission d’ouvrir le Concile de Rome, des présents considérables, et mourut paisiblement, chargé de gloire et d’années. De son martyre, il n’est pas autrement question, et ses Lettres n’ont plus été fabriquées par les Ariens. Ce Pape qui a deux biographies, deux genres de vie et deux genres de mort, suivant les besoins de la polémique religieuse, est une des nombreuses curiosités de l’histoire ecclésiastique.
[26] Pro se et contra calumniatores Apologia. Laurentii Vallæ opera, Basileæ, 1543, in-fol., p. 800.
[27] V. Banck, De tyrannide Papæ in Reges et Principes Christianos, Franequeræ, 1649, in-12. Ce jurisconsulte Suédois, qui a dédié son livre à la reine Christine, s’amuse aussi à jouer sur le nom de Paléa: «... Et cum palea sit, ac pro palea in Decretis inseratur, nulla veritatis grana unde colligere licet, Piscator Romanus granaria sua auro replevit.»
[28] Il prétendait seulement que toute donation pouvant être révoquée pour cause d’ingratitude, il se réservait d’user de ce droit. «Au temps de Constantin, S. Sylvestre possédait-il quoi que ce soit de la dignité royale? Ce fut ce Prince qui rendit à l’Église la liberté et la paix, et tout ce que vous possédez, comme Pape, provient de la libéralité des Empereurs. Lisez les histoires et vous y trouverez ce que je dis.» (Lettre à Adrien IV.)
[29] «Mendacium vero illud et fabula hæretica, in qua refertur Constantinus Sylvestro imperialia simoniace concessisse in Urbe, ita detecta est, ut etiam mercenarii et mulierculæ quoslibet etiam doctissimos concludant, et dictus Apostolicus cum suis Cardinalibus in civitate præ pudore apparere non audeant.» Martène et Durand, Amplissima Collectio veterum scriptorum, 1724; Epist. 384.
[31] Defensorium pacis, paru en 1324. Réimprimé dans Goldast.
[32] «Regi Neapolitano, apud quem exulabat, gratificaturus.» Contra Laurent. Vallam, p. 80.
[33] Laurentii Vallæ opera, p. 352.
[34] Les Gladiateurs de la République des lettres (t. Ier, p. 201).
[35] «Habeo in manibus Donationem Constantini a Laurentio Valleno confutatam, per Huttenum editam. Deus bone, quantæ seu tenebræ, seu nequitiæ Romanorum! et quod in judicio Dei mireris, per tot sæcula non modo durasse, sed etiam prævaluisse, ac inter Decretales relata esse tam impura, tam crassa, tam impudentia mendacia, inque fidei articulorum vicem suscepisse.» Cette lettre porte la date de 1520.
[36] Contes de Voisenon: Tant mieux pour elle; Le Sultan Misapouf; La Navette d’Amour. Paris, Liseux, 1879, pet. in-18.
[37] G. Desnoiresterres, Épicuriens et Lettrés, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Charpentier, 1879.
[38] Contes de l’abbé de Voisenon, avec une notice bio-bibliographique, par Octave Uzanne. Paris, Quantin, 1878, pet. in-4o.
[39] La Nuit et le Moment, par Crébillon fils. Paris, Liseux, 1879, pet. in-18.
[40] Nouvelles choisies de Franco Sacchetti, bourgeois de Florence (XIVe siècle), traduites en Français pour la première fois par Alcide Bonneau. Paris, Liseux, 1879, pet. in-18.
[41] Ginguené en compte par erreur deux cent cinquante-huit (Histoire littéraire d’Italie, tome III); il a été trompé par le chiffre de la dernière Nouvelle, qui est bien en effet CCLVIII, mais les éditeurs Italiens ont avec raison conservé à chacune d’elles, comme nous l’avons fait nous-même pour notre Choix, le numéro qu’elle porterait dans le recueil complet. En réalité, outre les quarante-deux dernières, dont il ne subsiste pas trace, il en manque trente-cinq dans le corps de l’ouvrage, et une trentaine des deux cent vingt-trois qui restent ne sont que des fragments réduits parfois à quelques lignes.
[43] Ce n’est qu’un fragment assez informe, ce qui nous a empêché de la traduire.
[44] Quelques-unes de ses poésies, entre autres douze Sonnets, des lettres, tant Italiennes que Latines, et les Sermons évangéliques, ont été recueillis par M. Ottavio Gigli et forment le premier volume des Opere di Franco Sacchetti (Florence, Le Monnier, 1857-1860, 3 vol. grand in-18).
[45] Canzone cité par M. Ottavio Gigli.
[46] Nouvelles de Bandello, Dominicain, évêque d’Agen (XVIe siècle), traduites en Français pour la première fois. Paris, Liseux, 1879 et 1880, tomes I et II (seuls parus), pet. in-18.
[47] Les Dialogues du divin Pietro Aretino, entièrement et littéralement traduits pour la première fois. Première partie, Paris, Liseux, 1879, 3 vol. pet. in-18; Seconde partie, Londres, 1880, 3 vol. pet. in-18. Ensemble 6 volumes.—Autre édition: Les Ragionamenti ou Dialogues du divin Pietro Aretino. Texte Italien et traduction complète par le Traducteur des Dialogues de Luisa Sigea. Avec une réduction du portrait de l’Arétin, peint par le Titien et gravé par Marc-Antoine. Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1882, 6 vol. in-8o.
[48] Capricciosi e piacevoli Ragionamenti di Messer Pietro Aretino: tel est en effet le titre sous lequel les Dialogues ont été constamment réimprimés, soit en Italie, soit en Hollande. L’édition originale, faite du vivant de l’auteur, porte aussi expressément qu’ils ont été composés par caprice: Ragionamento della Nanna e dell’Antonia, fatto in Roma sotto una ficaia, composto dal Divino Aretino per suo capriccio, a correzione dei tre stati delle Donne. Parigi, 1534.—Le P. Joachim Périon, adversaire acharné de l’Arétin, qu’il proposait de faire brûler vif, a joué agréablement là-dessus: «Scripsit atque edidit,» dit-il, «nefarium librum quemdam quem Capricium a caprorum lascivia et libidine inscripsit.» Par la même occasion, il propose de changer le nom d’Aretinus en Arietinus.
[49] Roland furieux, poème de l’Arioste. Chants I à XV. Traduction nouvelle, littérale et juxtalinéaire, par Alcide Bonneau. Paris, Liseux, 1879-1883, 3 vol. pet. in-18 (seuls parus).
[50] Orlando furioso di M. Ludovico Ariosto, novissimamente alla sua integrità ridotto et ornato di varie figure. In Venetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrari. M.D.XLII.
[51] Traité des Hermaphrodits, parties génitales, accouchemens des femmes, etc., où sont expliquez la figure des laboureurs et verger du genre humain, signes de pucelage, défloration, conception, et la belle industrie dont use Nature en la promotion du concept et plante prolifique, par Jacques Duval, Docteur et professeur en Médecine, natif d’Évreux, demeurant à Rouen. Réimprimé sur l’édition unique (Rouen, 1612). Paris, Liseux, 1880, in-8.
[52] Nouvelles de Batacchi, littéralement traduites pour la première fois. Paris, Liseux, 1880-1882, 2 vol. in-12.
[53] D’après la Bibliographie des Ouvrages relatifs à l’amour, etc., la plupart des Nouvelles de Batacchi sont tirées de Masuccio (ou Masuzo), conteur Napolitain du XVe siècle (Il Novellino, Napoli, 1746, in-fol., souvent réimprimé depuis et traduit du dialecte Napolitain en langue Toscane, mais presque toujours avec de graves altérations de texte).
[54] Nouvelles de l’abbé Casti, traduites pour la première fois. Paris, Liseux, 1880, in-12.
[55] La Papesse, nouvelle en trois parties et en vers, de l’abbé Casti, traduite en Français pour la première fois, texte Italien en regard, avec les Notes et pièces justificatives. Paris, Isidore Liseux, 1878, 1 vol. de la Petite Collection Elzévirienne.
[56] Nouvelles d’Agnolo Firenzuola, moine Bénédictin de Vallombreuse (XVIe siècle), traduites en Français pour la première fois, par Alcide Bonneau. Paris, Liseux, 1881, pet. in-18.
[57] «M. du Gua et moy lisions une fois un petit livre Italien qui s’intitule De la Beauté, fait en dialogue par le seigneur Angello Fiorenzolle, Florentin.» Dames galantes, Disc. I.
[58] L’Expulsion des lettres, etc., dont nous avons parlé plus haut.
[59] «Voi, che spargete la giocondità del piacere negli animi di coloro che vi praticano colla domestichezza, che a Perugia scolare, a Firenze cittadino, e a Roma prelato vi ho praticato io.»
[60] «... Dello spasso che ebbe le stesso Papa Clemente, la sera ch’io lo spinsi a legger cio, che già componeste sopra gli Omeghi del Trissino. Per la qual cosa la Santidade Sua volle, insieme con monsignor Bembo, personalmente conoscervi.»
[61] Opere di messer Agnolo Firenzuola, Milano, 1802, 5 vol. in-8o. Elles ont été rééditées par Bianchi, Naples, 1864, 2 vol. in-18. Dans cette réimpression, dont le texte est meilleur, la première Journée a été rétablie telle que l’avait écrite Firenzuola; les quatre autres Nouvelles sont données en appendice.
[62] Les Heures perdues d’un Cavalier François. Réimprimé sur les éditions de 1616 et 1662. Paris, Liseux, 1881, pet. in-18.
[63] Tous ces termes, au témoignage de Furetière, faisaient partie des formules adoptées par les Matrones jurées dans les rapports qu’elles déposaient en Justice, au sujet des filles déflorées. «Ils sont fort anciens, et sont en usage en plusieurs lieux, parce qu’on n’étoit pas autrefois si modeste en paroles qu’on est à présent.» Furetière, Dictionnaire universel, art. Pucelage.
[64] Le Hasard du coin du feu, par Crébillon fils. Paris, Liseux, 1881, pet. in-12.
[65] Les Dialogues de Luisa Sigea, ou Satire Sotadique de Nicolas Chorier, prétendue écrite en Espagnol par Luisa Sigea et traduite en Latin par Jean Meursius. Édition mixte Franco-Latine. Paris, Liseux, 1881, 4 vol. pet. in-18.—Autre édition: Les Dialogues de Luisa Sigea sur les arcanes de l’Amour et de Vénus; ou Satire Sotadique de Nicolas Chorier, prétendue écrite en Espagnol par Luisa Sigea et traduite en Latin par Jean Meursius. Texte Latin revu sur les premières éditions et traduction littérale, la seule complète, par le traducteur des Dialogues de Pietro Aretino. Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1882, 4 vol. in-8.
[66] Luisa Sigea, d’une famille d’origine Française, était née à Tolède vers 1530; elle mourut en 1560. Elle a composé quelques poésies Latines.
[67] Cette partie des Mémoires se rapporte à l’année 1679; elle nous donne la date de la première édition de l’Aloysia, qui doit être, au plus tard, de 1658 ou 1659.
[68] Henri Lambert d’Herbigny, marquis de Thibouville, intendant de justice, police et finances de la ville de Lyon, provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dauphiné. Il venait d’entrer en charge (1679) et succédait à François Dugué de Bagnols, ami et protecteur de Chorier. Ce changement d’intendant donnait à la dénonciation de l’évêque Le Camus quelque chance d’aboutir.
[69] Nicolai Chorerii Viennensis Adversarorium de vita et rebus sui libri tres. Nous avons donné une traduction complète de ces Mémoires dans la Curiosité, IIIe et IVe séries; on trouvera en outre dans la IIIe série, sous le titre d’Éclaircissements sur le «Meursius», des renseignements plus détaillés sur toute cette période de la vie de Nicolas Chorier et ses relations avec l’intendant Du Gué de Bagnols. Ce travail avait déjà paru en tête de l’édition in-8o des Dialogues de Luisa Sigea.
[70] Note du catalogue Pixerécourt.
[71] Nous avons sous les yeux la première édition, que personne n’avait encore déterminée: elle a, selon toute apparence, été imprimée non à Grenoble, mais à Lyon.
[72] Manuel d’Érotologie classique (De Figuris Veneris), par Fréd.-Ch. Forberg. Texte Latin et traduction littérale par le Traducteur des Dialogues de Luisa Sigea. Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1882, 2 vol. in-8.
[73] Quinque illustrium poetarum, Antonii Panormitæ; Ramusii Ariminensis; Pacifici Maximi Asculani; Jo. Joviani Pontani; Jo. Secundi Hagiensis, Lusus in Venerem, partim ex codicibus manuscriptis, nunc primum editi. Parisiis, prostat ad Pistrinum, in Vico Suavi (à Paris, chez Molini, rue Mignon), 1791, in-8o.
[74] A quelques exemplaires se trouvent jointes vingt et une gravures au trait, empruntées aux Monuments de la vie privée des douze Césars et aux Monuments du culte secret des Dames Romaines, deux ouvrages qui ne sont pas rares.
[75] La Cazzaria, dialogue Priapique de l’Arsiccio Intronato (Antonio Vignale); littéralement traduit pour la première fois, texte Italien en regard, par le Traducteur des Ragionamenti de P. Aretino. Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1882, in-8.
[76] La réimpression faite à 100 exemplaires en 1863, Cosmopoli (Bruxelles), petit in-8o, est elle-même devenue fort rare.
[77] Le Songe de Poliphile, ou Hypnérotomachie de Frère Francesco Colonna, littéralement traduit pour la première fois, avec une introduction et des notes, par Claudius Popelin; figures sur bois gravées à nouveau par A. Prunaire. Paris, Liseux, 1883, 2 vol. in-8.
[78] Poliphile, dans l’intention de l’auteur, signifie amant de Polia.
[79] Cet article a paru, illustré de gravures empruntées à l’ouvrage, dans la Revue «Le Livre», no du 10 Mars 1883.
[80] Deux Dialogues du nouveau Langage François italianizé et autrement desguizé, principalement entre les courtisans de ce temps, par Henri Estienne. Réimprimé sur l’édition originale et unique de l’Auteur (1578). Paris, Liseux, 1883, 2 vol. in-8.
[81] Traité de la conformité du langage François avec le Grec.
[82] Essai sur Amyot et les traducteurs de Plutarque.
[83] Essai sur la vie et les ouvrages de Henri Estienne.
[84] Histoire des révolutions du langage en France.
[85] «Et du language de nos prédécesseurs, qu’en dirons-nous? quelles pensons-nous qu’estoyent les oreilles d’alors qui portoyent patiemment Mon frère Piarre? Mon frère Robart? La place Maubart? Et toutes fois nostre Villon, un des plus éloquents de ce temps-là, parle ainsi.» Apologie pour Hérodote, tome II, p. 135, édit. Liseux, 1879.
[86] V. tome I, p. 53.
[87] Lettre de François Ier à M. de Montmorency, dans les Lettres de la Reine de Navarre, tome I, p. 467. Citée par Génin, Variations du langage Français.
[88] Les Cadenas et Ceintures de chasteté; notice historique, suivie du Plaidoyer de Freydier, avocat à Nîmes. Avec Figures. Paris, Liseux, 1883, in-16.
[89] Nicolas Chorier, Dialogues de Luisa Sigea, tome II, pages 202 et suiv. de l’édition in-8o. (Paris, Liseux, 1882.)
[90] Notice des émaux du Louvre, tome II, Glossaire; art. Ceinture de chasteté.
[91] Là encore sont des cadenas et divers ferrements dont cet horrible monstre bouclait ses concubines.
[92] La Tariffa delle Puttane di Venegia (XVIe siècle). Texte Italien et traduction littérale. Paris, Liseux, 1883, in-16.
[93] Tarif des Putains, ou Dialogue de l’Étranger et du Gentilhomme, dans lequel se marquent le prix et la qualité de toutes les Courtisanes de Venise, avec les noms des Ruffianes, et quelques bons tours pour rire joués par plusieurs de ces fameuses Signoras à leurs amoureux.
[94] Le Trente et un de la Zaffetta, texte et traduction littérale; Paris, Liseux, 1883.
[95] Contes de Vasselier (XVIIIe siècle); réimprimés sur l’édition originale (Londres, 1880). Paris, Liseux, 1883, in-16.
[96] La Puttana errante, poème en quatre chants, de Lorenzo Veniero, gentilhomme Vénitien (XVIe siècle); littéralement traduit, texte Italien en regard. Paris, Liseux, 1883, in-16.
[97] Manuel d’Érotologie classique, Paris, Liseux, 1882, 2 vol. in-8o.
[98] Cette traduction est l’œuvre de l’amateur anonyme à qui l’on doit les deux séries des Nouvelles de Batacchi (Paris, Liseux, 1888-82) et les deux premiers volumes de Bandello.
[99] Ragionamenti. Tome I, p. 15 de l’édition in-8o (Liseux, 1882).
[100] Doutes amoureux, ou Cas de conscience et Points de droit, avec leurs solutions: à l’usage des Confesseurs et des Magistrats. Texte Italien et traduction en regard. Paris, Liseux, 1883, in-16.
[101] Facéties. Paris, Liseux, 1879, 2 vol. in-18.—Tome Ier, conte XLV.
[102] Le Zoppino, dialogue de la vie et généalogie de toutes les Courtisanes de Rome (XVIe siècle). Littéralement traduit, texte Italien en regard. Paris, Liseux, 1883, in-16.
[103] Poésies complètes de Giorgio Baffo, en dialecte Vénitien, littéralement traduites pour la première fois avec le texte en regard. Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1884, 4 vol. in-8.
[104] Cosmopoli (Venise), 1789, 4 vol. in-8o.
[105] Philarète Chasles se trompe très certainement en disant que Baffo imprima ses œuvres à soixante-cinq ans; de son vivant, pas une de ses pièces de vers ne fut imprimée.
[106] «Baffum, affinem..., ut par est, stipiti Orientalis Imperii...»
[108] 1er Juin 1839: De la Littérature populaire en Italie.
[109] Ce titre factice n’existe que sur la couverture; le véritable titre est donné à l’intérieur du volume, et suivi de ces mots: «Reproduction textuelle de l’édition originale (en Hollande, 1791).» Imprimé à cent cinquante exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1884, in-8o.
[110] La Messe de Gnide, poème, par Griffet de la Baume. Paris, Liseux, 1884, in-32.
[111] Mot Anglais qui signifie personne.
[112] Les Proverbes en facéties d’Antonio Cornazano (XVe siècle). Traduit pour la première fois, texte Italien en regard. Paris, Liseux, 1884, in-16.
[113] Il se trouve à la Bibliothèque de l’Arsenal.
[114] Novella ducale, insérée à la suite des Proverbii in facetie, dans les anciennes éditions.
[115] La Vie de mon Père, par Restif de la Bretonne. Réimprimé sur la troisième édition (1788), Paris, Liseux, 1884, in-8o.
[116] Monsieur Nicolas, édition Liseux, tome X, p. 234.
[117] La Raffaella, dialogue de la gentille éducation des femmes, par Alessandro Piccolomini, archevêque de Patras et coadjuteur de Sienne (XVIe siècle). Traduction nouvelle, texte Italien en regard, par Alcide Bonneau. Paris, Liseux, 1884, in-16.
[118] Des Divinités génératrices, ou du culte du Phallus chez les Anciens et les Modernes, par J.-A. Dulaure, auteur de l’Histoire de Paris. Réimprimé sur l’édition de 1825, revue et augmentée par l’Auteur. Paris, Liseux, 1885, in-8.
[119] Il est inexact de dire, comme on le lit dans le Catalogue des ouvrages condamnés, de M. Drujon, et ailleurs, que cette seconde édition fut supprimée quoique l’auteur y eût fait des retranchements. Dulaure n’a rien retranché, il a, au contraire, ajouté. Ce que l’on peut dire, c’est qu’aucune de ces additions, simples développements d’idées ou de faits déjà exposés, n’était de nature à justifier une condamnation, si l’ouvrage, tel qu’il avait paru primitivement, n’outrageait en rien la morale. On a suivi dans cette impression le texte de 1825, plus complet, plus correct, et que l’auteur s’était efforcé de rendre définitif.
[120] Dictionnaire érotique Latin-Français, par Nicolas Blondeau, avocat en Parlement, censeur des livres et inspecteur de l’Imprimerie de Trévoux (XVIIe siècle). Édité pour la première fois sur le Manuscrit original, avec des notes et additions de François Noël, inspecteur général de l’Université; précédé d’un Essai sur la langue érotique, par le Traducteur du Manuel d’Érotologie de Forberg. Paris, Liseux, 1885, in-8.
[121] Sat., I, 5, v. 85.
[122] Qui scis Romana simplicitate loqui (XI, 21.)
[123] Ce passage est extrait d’une lettre adressée à l’un des plus célèbres médecins de l’époque, messer Battista Zatti, de Brescia.
[124] «F..tez comme des ânes débâtés, mais permettez-moi de dire f..tre.»
[125] Épigrammes contre Martial, ou les mille et une drôleries, sottises et platitudes de ses traducteurs, par un ami de Martial (Paris, 1835, in-8o).
[126] «Il y a tout lieu de croire que beaucoup d’expressions dont la malhonnêteté nous choque n’avaient pas la même portée chez les Romains et n’étaient pas si brutales. Martial dit quelque part que les jeunes filles peuvent le lire sans danger. Admettons que ce propos soit une fanfaronnade Bilbilitaine, et réduisons l’innocence de son recueil à ce qu’elle est en réalité: encore est-il vrai qu’on ne se cachait pas pour le lire, que les gens de bon ton, comme on dirait chez nous, gens qui ont d’autant plus de pruderie en paroles qu’ils sont plus libres dans la conduite, avouaient publiquement leur admiration pour Martial. J’ai sans doute bien mauvaise idée de la Rome impériale, et je crois peu à la chasteté d’une ville où des statues nues de Priape souillaient les palais, les temples, les places publiques, les carrefours; où, dans les fêtes de Flore, on voyait courir sur le soir, à travers les rues, non pas des prostituées, mais des dames Romaines échevelées et nues; où les femmes se baignaient pêle-mêle avec les hommes; où les comédiennes se déshabillaient quand on leur avait crié du parterre: Déshabillez-vous. Mais j’ai peine à croire qu’on pût s’y vanter ouvertement de faire ses délices de Martial, si Martial eût été aussi impur qu’il nous paraît aujourd’hui.» (Désiré Nisard, les Poètes Latins de la décadence.)
[127] Le suppositoire vivant, le gobet amoureux, le calendrier naturel, le combat de cinq contre un, le manuel des solitaires, etc.
[128] Quérard dit que les initiales P. P. cachent le chevalier P. Pierrugues, ingénieur à Bordeaux, qui publia en la même année 1826 un bon plan de cette ville. On lui attribue également, mais peut-être à tort, les Notes de l’Errotica Biblion (édition de 1833). C. de Katrix, auteur d’un Avant-Propos placé en tête de ce dernier ouvrage, dit avoir eu entre les mains un exemplaire du Glossarium portant cette mention: «Ab Eligio Johanneau constructum, auspicio et cura (forsitan) baronis Schonen. S. E.»
[129] Le Couvent hospitalier, conte tiré du Livre de l’Origine des Proverbes populaires, d’Aloyse Cynthio degli Fabritii (XVIe siècle). Littéralement traduit pour la première fois, texte Italien en regard. Paris, Liseux, 1885, in-16.
[130] «Sachez que cette Satyre est écrite de la propre main de l’Auteur et qu’il n’en existe pas d’autre copie; il est mort il y a quelques jours, de quelle façon, je ne le dis point.»
[131] Le Jardin parfumé du cheikh Nefzaoui, manuel d’Érotologie Arabe (XVIe siècle). Traduction revue et corrigée. Paris, Liseux, 1886, in-8o.
La Notice qu’on va lire a été imprimée en Appendice aux Kama Sutra de Vatsyayana, parus précédemment: Les Kama Sutra de Vatsyayana, manuel d’Érotologie Hindoue, rédigé en Sanscrit vers le cinquième siècle de l’ère Chrétienne; traduit sur la première version Anglaise (Bénarès, 1883) par Isidore Liseux. Paris, Liseux, 1885, in-8o.
[132] En voici le titre, suivant la disposition de cette édition autographiée:
OUVRAGE
du Cheikh, l’imam, le savant, le
très érudit, le très intelligent, le très
véridique
SIDI MOHAMMED EL NEFZAOUI
que Dieu très élevé lui fasse miséricorde par sa puissance!
Amen!
Traduit de l’Arabe
par Monsieur le baron R***.
Capitaine d’État-Major
1850
Autographié, en 1876, à 35 exemplaires, avec 15 figures hors texte et de nombreuses vignettes dans le texte. C’est un in-8o ainsi composé:
Faux-titre, titre et épigraphe: 5 ff. non chiffrés;
Notice sur le Cheikh Nefzaoui: 6 ff. chiffrés I à VI;
Texte: 283 pp. de 33 lignes à la page.
Postface de l’Éditeur: pp. I à XI.
Errata: 1 f. non chiffré.
Table des matières: 3 pp. non chiffrées.
Ce volume se paye (quand on le trouve) de 5 à 600 francs.
[133] Essai de philosophie morale, Berlin, 1749.
[134] D’après les historiens Arabes, quand Mahomet crachait dans l’œil d’un borgne, il rendait la vue au malade; si Moçaïlama tentait la même expérience, l’homme devenait aveugle.
[135] D’un paysan qui portait une oie à vendre; facétie LXIX, tome Ier, éd. Liseux, 1878, 2 vol. in-18.
[136] Hecatelegium, ou les Cent Élégies satiriques et gaillardes de Pacifico Massimi, poète d’Ascoli (XVe siècle). Littéralement traduit pour la première fois, texte Latin en regard. Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis. Paris, 1885, in-8o.
[137] Quinque illustrium poetarum, Ant. Panormitæ, Ramusii Ariminensis, Pacifici Maximi Asculani, Jo. Joviani Pontani, Jo. Secundi Hagiensis, lusus in Venerem, partim ex codicibus manu scriptis nunc primum editi. Parisiis, prostat ad Pistrinum, in Vico Suavi (chez Molini, rue Mignon), MDCCXCI. Noël a également inséré quelques élégies de Pacificus, d’après cette même source, dans son Erotopægnion (1798).
[138] Christi nomme invocato, Pacifici Camplensis de Maximis de Asculo liber primus Triumphorum incipit feliciter.
[139] Carmina Pacifici Maximi, poetæ Asculani (Parmæ, apud Galeatium Rosatum, Superiorum consensu, 1691, in-4o).
[140] Notons à ce propos ce qu’il dit des pratiques de sorcellerie, des envoûtements, des conjurations et surtout de ces fameux poisons alors très employés en Italie, qui tuaient un homme, pour ainsi dire, à jour fixe, et dont on fait ordinairement honneur à la scélératesse des Borgia:
On voit que, lorsque Alexandre VI et César Borgia usèrent un peu plus tard de ces toxiques surprenants, ils n’avaient rien inventé et suivaient tout bonnement d’anciennes traditions. Si personnelles que soient la plupart des Élégies, elles ne laissent pas d’être de temps à autre d’intéressants tableaux de mœurs. Quelques auteurs ont cité la deuxième du IIIe livre, A Priape, comme une preuve décisive de l’existence de la vérole, avant la découverte de l’Amérique; cette conjecture n’est pas fondée. La maladie Vénérienne, dont le poète se plaint, et dont il obtient la guérison à l’aide d’une simple prière, n’a aucun des caractères distinctifs de la syphilis.
[141] G.-B. Vermiglioli, Poesie inedite di Pacifico Massimi.
[142] La Chanson de la Figue, ou la Figuéide de Molza, commentée par Annibal Caro (XVIe siècle). Traduit en Français pour la première fois, texte Italien en regard. Paris, Liseux, 1886, in-8o.
[143] Paris, Liseux, six volumes in-8o.—On a lu plus haut, page 116, l’Avant-propos de l’édition Elzévirienne de 1880; celui-ci fera mieux connaître l’écrivain et l’œuvre.
[144] Quelques passages de la Préface de Barbagrigia, notamment une allusion aux édits sur les duels, montrent qu’elle est Française; Lyon se trouve indiqué, ce semble, par la mention qui y est faite du P. Benedicti, dont le livre de Cas de conscience (la Somme des Péchez) venait d’être imprimé en cette ville, cette même année 1584.

TABLE DES MATIÈRES
| Pages | ||
| Avertissement | V | |
| I. | Advis pour dresser une Bibliothèque, par Gabriel Naudé | 3 |
| II. | Socrate et l’amour Grec, par J.-M. Gesner | 8 |
| III. | Un vieillard doit-il se marier? dialogue de Pogge | 13 |
| IV. | La Civilité puérile | 25 |
| V. | Les Facéties de Pogge | 36 |
| VI. | La Papesse, nouvelle de Casti | 45 |
| VII. | Le Décaméron de Boccace | 49 |
| VIII. | La Donation de Constantin | 61 |
| IX. | Les Contes de Voisenon | 82 |
| X. | La Nuit et le Moment, par Crébillon fils | 88 |
| XI. | Les Nouvelles de Sacchetti | 94 |
| XII. | Les Nouvelles de Bandello | 109 |
| XIII. | Les Ragionamenti ou Dialogues de P. Aretino | 116 |
| XIV. | Roland furieux, poème de l’Arioste | 121 |
| XV. | Des Hermaphrodits, par Jacques Duval | 126 |
| XVI. | Les Nouvelles de Batacchi | 132 |
| XVII. | Les Nouvelles de l’abbé Casti | 136 |
| XVIII. | Les Nouvelles de Firenzuola | 140 |
| XIX. | Les Heures perdues d’un Cavalier François | 150 |
| XX. | Le Hasard du coin du feu, par Crébillon fils | 160 |
| XXI. | Les Dialogues de Luisa Sigea | 163 |
| 402 XXII. | Manuel d’Érotologie classique, par Fr.-Ch. Forberg | 175 |
| XXIII. | La Cazzaria d’Antonio Vignale | 183 |
| XXIV. | Le Songe de Poliphile | 190 |
| XXV. | Deux Dialogues du langage François italianizé, par H. Estienne | 212 |
| XXVI. | Les Cadenas et Ceintures de chasteté | 226 |
| XXVII. | La Tariffa delle Puttane di Venegia | 241 |
| XXVIII. | Les Contes de Vasselier | 245 |
| XXIX. | La Puttana errante, poème de Lorenzo Veniero | 249 |
| XXX. | Doutes amoureux | 262 |
| XXXI. | Le Zoppino | 266 |
| XXXII. | Les Poésies de Baffo | 272 |
| XXXIII. | Liber Sadicus | 284 |
| XXXIV. | La Messe de Gnide | 287 |
| XXXV. | Les Proverbes en facéties, de Cornazano | 289 |
| XXXVI. | La Vie de mon Père, par Restif de la Bretonne | 302 |
| XXXVII. | La Raffaella d’Alessandro Piccolomini | 314 |
| XXXVIII. | Des Divinités génératrices, par Dulaure | 319 |
| XXXIX. | Le Dictionnaire érotique Latin-Français de Nicolas Blondeau, et la Langue érotique | 326 |
| XL. | Le Couvent hospitalier | 341 |
| XLI. | Le Jardin parfumé du cheikh Nefzaoui | 350 |
| XLII. | L’Hecatelegium de Pacifico Massimi | 372 |
| XLIII. | La Chanson de la Figue | 385 |
| Appendice.—Les Ragionamenti ou Dialogues de P. Aretino: avant-propos de l’édition de 1882 | 389 | |

IMPRIMÉ
PAR
CHARLES UNSINGER
TYPOGRAPHE A PARIS
Rue du Bac, no 83.

Isidore LISEUX, Libraire-Éditeur,
25, Rue Bonaparte, Paris.
LA
CURIOSITÉ LITTÉRAIRE
ET BIBLIOGRAPHIQUE
Recueil complet en 4 volumes grand in-18.
LE SONGE DE POLIPHILE
OU HYPNÉROTOMACHIE
DE FRÈRE FRANCESCO COLONNA
Littéralement traduit pour la première fois
Avec une Introduction et des Notes, par CLAUDIUS POPELIN
Figures sur bois gravées à nouveau par A. Prunaire
Deux forts volumes in-8, imprimés sur papier de Hollande
à 400 exemplaires numérotés.
APOLOGIE POUR HÉRODOTE
[Satire de la Société au XVIe siècle]
Par HENRI ESTIENNE
Nouvelle Édition, faite sur la première, et augmentée de remarques
Par P. RISTELHUBER
Deux forts volumes petit in-8.
DEUX DIALOGUES
DU
LANGAGE FRANÇOIS ITALIANIZÉ
Par HENRI ESTIENNE
Réimprimé sur l’édition originale
Deux volumes petit in-8.
MONSIEUR NICOLAS
ou le cœur humain dévoilé
Mémoires intimes
De RESTIF DE LA BRETONNE
Quatorze volumes petit in-8.
Pour les prix, on est prié de se référer
aux plus récents Catalogues.
Paris.—Charles Unsinger, imprimeur, 83, rue du Bac.
Au lecteur:
Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original, et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules quelques erreurs clairement introduites par le typographe ont été tacitement corrigées. La ponctuation a été corrigée par endroits, mais n'a pas été harmonisée. Les notes ont été renumérotées et placées à la fin de l'ouvrage.