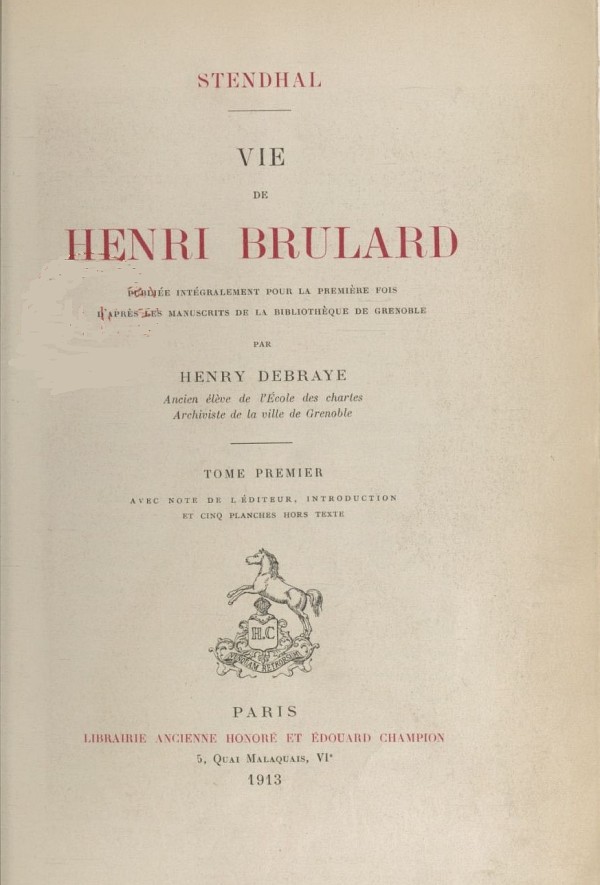
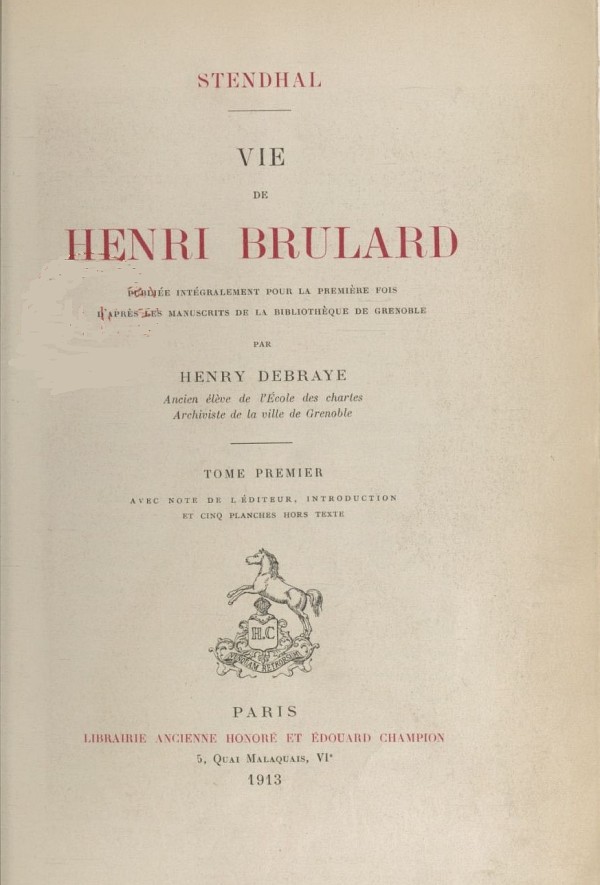
Nous tentons pour la première fois de donner au public lettré les œuvres complètes de Stendhal. L'édition publiée par MM. Calmann-Lévy, en volumes d'aspects et de mérites divers, n'est pas complète et ne répond pas aux exigences de la critique moderne, encore qu'elle ait rendu de grands services, que la notice de Mérimée, notamment, placée à la tête de la Correspondance ait été longtemps le seul guide des Stendhaliens, et que la publication récente du Journal d'Italie par M. Arbelet soit un modèle de sagace érudition. Les ouvrages posthumes sont dispersés chez différents libraires ou dans des revues quelquefois peu accessibles; plusieurs sont épuisés ou demeurent introuvables. Rien de plus difficile à constituer qu'une collection des œuvres de Stendhal comme celle qu'a réunie,[p. viii] au siège du Stendhal-Club, l'archiviste zélé et obligeant, M. Paupe.
Si l'on songe à l'influence de Stendhal sur les esprits les plus notoires de notre génération, si l'on réfléchit à la substance de son œuvre, on reste surpris que le dessein d'en donner une édition complète n'ait tenté aucun de nos grands libraires si audacieux et si avisés. Sans doute ils ont jugé l'entreprise trop malaisée. Stendhal semble avoir pris plaisir à dérouter ses futurs éditeurs par l'énigme de son écriture, de ses signes particuliers, de son langage conventionnel. Il s'enveloppe d'ombre et de mystère. Il faut d'abord l'avoir bien prié, ou bien maltraité, pour qu'il se dévoile. Et c'est ainsi que m'a été laissé le soin de l'éditeur.
Stendhal avait légué son manuscrit de Brulard au plus âgé des libraires de Londres et dont le nom commençait par un C.; ce sera le plus jeune des libraires de Paris dont le nom commence par un C. qui recueillera pieusement son legs.
Un érudit plus qualifié avait accepté de diriger notre entreprise et de mener à bien cette lourde tâche. Il savait tout de Stendhal et n'ignorait rien de Beyle. J'ai nommé Casimir Stryienski, trop tôt enlevé aux lettres et aux études historiques. J'avais jugé naturel et nécessaire de lui offrir la direction de cette œuvre, il l'avait acceptée dans des termes dont je reste encore confus, mais je ne fus pas moins surpris de sa retraite quand je lui[p. ix] demandai de revoir les textes sur les manuscrits de Stendhal qui sont parvenus jusqu'à nous. «Toute réflexion faite, je ne puis me charger de ce grand labeur. Cette édition complète de Stendhal représente un travail considérable: recherches, corrections d'épreuves, contrôles divers. Tout cela est au-dessus de mes forces. Il y a dix ans j'aurais accepté. J'ai, du reste, des travaux nombreux en vue qui me suffisent, et je considère ma tâche stendhalienne comme finie. Que les autres profitent de tout ce que j'ai publié... Il va sans dire que je reste à la disposition de vos collaborateurs et que je serai très heureux de leur donner des conseils...» (19 février 1912).—«Je comprends votre insistance très aimable. Je vois bien, au point où j'en suis, quel profit vous retireriez de mon nom, mais permettez-moi de vous confesser que j'ai mieux à faire à mon âge...» (20 février 1912). Il s'était cependant «ravisé pour un unique volume (Brulard)», «le premier des œuvres complètes», mais ce projet fut définitivement abandonné quand j'exprimais ma volonté absolue de corriger les épreuves sur le manuscrit conservé à la Bibliothèque de Grenoble et d'y relever les variantes et les inédits. N'est-ce pas là un détail à noter au chapitre Brulard de l'excellente Histoire des œuvres?
Je devais ces explications aux nombreux amis connus ou inconnus qui, au courant de mes projets, se sont étonnés de la publication en juin dernier[p. x] d'une nouvelle édition de la Vie de Henri Brulard à la librairie de mon excellent confrère, M. Émile Paul. Si C. Stryienski l'a rééditée, quelques jours seulement avant le tragique accident où il devait trouver la mort, alors qu'il n'ignorait rien de mon projet, n'était-ce pas pour affirmer sa méthode d'éditeur? Il l'avait indiquée dès la première édition: «Fort de la permission de Beyle, j'ai reproduit presque entièrement le texte, me permettant toutefois de supprimer les redites et de couper quelques longueurs». «Toutefois», ajoutait-il, «j'ai fort peu profité de cette permission, je suppose que les lecteurs ne s'en plaindront pas». La réédition Émile Paul (1912), presque textuelle, sauf quelques corrections (dont l'une, proposée par M. J. Bédier, acceptée sans vérification, n'est pas confirmée par l'examen du manuscrit), affirme donc un dessein déterminé: elle soulève un problème de méthode, qui a ici son importance.
M. Paul Arbelet, l'un des plus savants et des plus compétents beylistes, a défendu par avance la mémoire de celui qu'il désigne à juste titre comme l'inventeur de Stendhal[1]: «Il fallait glaner et extraire: œuvre personnelle que chacun entend à sa façon, œuvre difficile où l'on ne saurait contenter tout le monde, mais qui est ici inévitable. Et il faut admirer Stryienski si, du premier coup,[p. xi] il sut aller à l'essentiel...» Par l'effet de mon éducation peut-être, par scrupule de vérité historique certainement, je ne puis accepter cette manière de voir. Dès qu'il s'agit d'une autobiographie, on doit tout publier. Le lecteur fera lui-même son choix. Autrement l'on risque de trahir l'auteur; et même lorsqu'il vous invite à les faire, les coupures ne sont pas légitimes, puisqu'il ne les a pas opérées lui-même. «Souviens-toi de te méfier», disait cet ami de Stendhal, Prosper Mérimée, le malicieux auteur de H. B. Appliquons ici cet axiome. Qui jurerait qu'après la publication de ce nouveau Brulard que voici, avec cent et quelques pages inédites, qu'après la nouvelle édition du Journal et la publication des tomes dédaignés par les précédents éditeurs, un jugement comme celui de M. Paul Bourget, par exemple, ne serait pas à réviser? Et certainement les biographies, celle de E. Rod, celle de M. Arthur Chuquet, pourtant si studieuse et si bien documentée, les études de Stryienski lui-même, sont toutes à revoir, comme les Pages choisies de M. Léautaud à compléter. Nous ne croyons donc pas prudent de faire une œuvre personnelle en choisissant là où l'auteur n'a pas voulu le faire. Si nous ne publions pas tout des 72 in-folios manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble, ce sera—absolument d'accord avec M. P. Arbelet—pour éliminer les versions latines de l'élève Beyle ou les copies d'ouvrages exécutés[p. xii] dans l'ennui d'un consulat. Je ne publierai pas comme de Stendhal des fragments du Dictionnaire philosophique de Bayle, et j'éviterai de rééditer le Code civil, quand Henri Beyle s'est calmé à en copier les articles les plus concis.
Voici le plan de notre édition.
En ce qui concerne les ouvrages de Stendhal dont nous avons pu retrouver des manuscrits authentiques dans les bibliothèques publiques ou privées, nous avons reproduit scrupuleusement la leçon de ces manuscrits. Quand les originaux ont disparu, nous suivons la dernière édition imprimée du vivant de l'auteur. Les variantes des éditions précédentes seront notées exactement, et, comme nous l'avons fait pour Brulard, rejetées à la fin, avec les notes. Celles-ci ne contiendront que l'essentiel. Chaque volume sera accompagné d'illustrations documentaires propres à situer l'œuvre et à l'éclairer.
Les époques de publication seront variables: il paraîtra par an environ quatre volumes suivant, autant que possible, un ordre logique et rationnel. Après Brulard, où Stendhal raconte sa jeunesse, suivront le Journal et les Souvenirs d'égotisme, pour en finir avec l'autobiographie. Sans doute ne résisterons-nous pas au plaisir, avant de continuer l'édition des œuvres connues, de publier certains inédits. Il en est ainsi d'une série d'articles écrits par Stendhal sur la littérature, les beaux-arts et la société.[p. xiii] Imprimés, après traduction, dans diverses revues anglaises, le Monthly Review, le London Magazine, la Revue Britannique, entre 1820 et 1830, ils ont été retrouvés et traduits en français par Miss Doris Gunnell, maître de conférences à l'université de Leeds, et sont comme les preuves de son très utile ouvrage Stendhal et l'Angleterre.
Ils forment la matière de quatre volumes de manuscrits in-folios, et feront l'objet d'une publication à laquelle Miss Doris Gunnell et M. Émile Henriot ont accepté de donner leurs soins, en se chargeant de mettre en ordre et de présenter au public ces documents inédits.
Les volumes publiés du vivant de Stendhal paraîtront dans l'ordre de leur première date de publication: Vies de Haydn, Mozart et Métastase; Histoire de la peinture en Italie; Rome, Naples, Florence, etc., etc.
La correspondance sera réservée pour les derniers volumes: chaque jour elle s'augmente, et notre édition aidant, nos appels étant entendus, il ne restera plus bientôt, nous l'espérons, aucun trésor caché et nous pourrons enfin donner une édition complète des Lettres de Beyle.
Je souhaite aussi que, certaines riches archives privées m'étant ouvertes, j'y puisse relever des annotations mises par l'auteur de la Chartreuse en marge de ses lectures. A en juger par celles qui ont été publiées déjà, la moindre de ses remarques a de[p. xiv] l'intérêt—et elles en présentent toutes pour l'histoire de la formation intellectuelle de Stendhal.
Le tout dernier volume sera consacré à une table générale des noms propres de personnes et de lieux, réels ou fictifs, figurant dans l'œuvre entière.
Entre temps aura paru une bibliographie de Stendhal, due à M. Cordier, le savant membre de l'Institut. C'est le complément indispensable de toute édition. M. Cordier a fait ses preuves d'érudition stendhalienne. En nous apportant tout de suite le résultat de son expérience et de ses recherches, en éclairant l'œuvre parfois cachée et mystérieuse de Stendhal, en mettant de l'ordre et de la clarté dans les travaux des Stendhaliens, depuis qu'il y en a et qui écrivent, il aura rendu un inappréciable service tant à nous-mêmes qu'à nos lecteurs. Une notice iconographique par M. Octave Uzanne, avec l'indication des gravures, dessins, tableaux, est également dans notre programme.
Chacun de nos volumes sera présenté à l'aide de substantielles préfaces par l'élite des écrivains contemporains que notre œuvre intéresse et qui l'encouragent: Charles Maurras (Rome, Naples, Florence); Rémy de Gourmont (De l'Amour); G. d'Annunzio (Promenades dans Rome); Henry Roujon (Mélanges d'Art), etc., pour n'en citer que quelques-uns et suivant l'ordre de publication.[p. xv] MM. Anatole France et Maurice Barrès nous ont promis leur précieux concours pour l'Abbesse de Castro et la Chartreuse de Parme. Notons ici que cette édition de la Chartreuse sera rendue nouvelle par les appendices où seront relevés, d'après l'exemplaire si précieux de l'érudit grenoblois M. Chaper, les corrections et additions qu'y fit Stendhal après le fameux article de Balzac, quand il cherchait «le caractère de perfection, le cachet d'irréprochable beauté» que lui conseillait le directeur de la Revue Parisienne.
Le soin de mettre au point l'édition de Brulard, du Journal, de Lucien Leuwen, de Napoléon et en général de toutes les œuvres, inédites ou non, complètes ou ébauchées, que renferment les manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble, est échu à M. Henry Debraye. Ancien élève de l'École des chartes, archiviste de la ville de Grenoble, M. Debraye s'est voué entièrement à l'édification de ce monument des Œuvres complètes. L'écriture hiéroglyphique de Stendhal n'a plus guère de secret pour lui: telle page de Brulard ou du Journal demeurée jusqu'à présent mystérieuse, il l'a déchiffrée avec une patience et une sagacité admirables, se défiant des interprétations de bon sens dont il faut souvent se garder en paléographie. Que l'on compare plutôt son édition et les précédentes! D'une page de Brulard, écrite en hâte et sans chandelle, deux mots ont pourtant échappé au[p. xvi] déchiffrement de M. Debraye—la page entière échappait d'ailleurs le lendemain à Stendhal lui-même—nous avons décidé de la reproduire en fac-simile: bien que l'image soit légèrement réduite par les exigences de notre format, on pourra s'amuser à en tenter la lecture. Et on applaudira vite à la science du parfait paléographe qu'est Henry Debraye.
Il m'est impossible de nommer à cette place toutes les personnes qui m'ont encouragé dans mon entreprise. Je tiens pourtant à remercier M. Élie-Joseph Bois, rédacteur au Temps, qui, le premier, a annoncé l'édition des Œuvres complètes; M. Henri Welschinger, qui a réalisé ce miracle de réconcilier Stendhal et l'Institut en lisant à l'Académie des Sciences morales des inédits ensuite insérés dans les Procès-verbaux officiels: M. Georges Cain, dont les Souvenirs stendhaliens (Figaro du 29 septembre 1912) me sont particulièrement chers; M. A. Paupe, dont le concours incessant m'est toujours précieux et dont l'ouvrage sous presse, Vie littéraire de Stendhal, Documents inédits, appendice aux Œuvres complètes, sera bien souvent cité dans nos études préliminaires. M. Georges Grappe s'est employé amicalement pour Brulard comme si cette œuvre était sienne. J'ai profité des conseils de M. Mario Roques que mon projet a toujours intéressé. Je dois aussi une reconnaissance toute particulière à M. Maignien, conservateur de la Bibliothèque[p. xvii] de Grenoble, à ses bibliothécaires et à ses commis. M. Paillart, l'obligeant maître-imprimeur, a surveillé personnellement, dans ses ateliers d'Abbeville, la confection de cette édition, à qui M. Longuet, par d'admirables phototypies et M. Lafuma, par un impérissable papier pur chiffon, assurent, je puis le dire, l'immortalité.
Edouard Champion.
16 Février 1913.
Une lettre de Henri Beyle annonçait, le 11 novembre 1832, au libraire parisien Levavasseur: «J'écris maintenant un livre qui peut-être est une grande sottise; c'est Mes Confessions, au style près, comme Jean-Jacques Rousseau, avec plus de franchise.» Suivait un plan sommaire du nouvel ouvrage: «J'ai commencé par la campagne de Russie en 1812... A côté de la campagne de Russie et de la cour de l'Empereur, il y a les amours de l'auteur; c'est un beau contraste.»
Stendhal faisait-il allusion à une première rédaction de son autobiographie, qu'il intitula plus tard[p. xx] la Vie de Henri Brulard?—C'est possible, mais peu probable, nous le verrons tout à l'heure; en tout cas, rien n'est resté de ce premier essai. Aurait-il été détruit par son auteur? Ce serait bien extraordinaire, car Beyle fut toujours très soucieux de conserver la moindre page de ses écrits.
Dès 1832, cependant, Stendhal se préoccupait de raconter les différentes péripéties de son existence. Il écrivait, de Cività-Vecchia, le 12 juin, à son ami Di Fiore: «Quand je suis exilé ici, j'écris l'histoire de mon dernier voyage à Paris, de juin 1821 à novembre 1830. Je m'amuse à décrire toutes les faiblesses de l'animal; je ne l'épargne nullement...» Mais cette histoire porte le titre de Souvenirs d'Egotisme, elle n'a rien de commun avec la Vie de Henri Brulard.
En 1833, nouvelle tentative: le 15 février, Beyle commence les Mémoires de Henri B., mais écrit à peine les quelques pages du premier chapitre du livre I, que nous donnons en annexe de la présente édition.
Enfin, il se décida en 1835: le 23 novembre, il commençait son autobiographie, qu'il appela Vie de Henri Brulard, et dont il écrivit sans désemparer près de neuf cents pages.
Son idée de 1832 le hantait encore: Stendhal débute ainsi: «Je me trouvais ce matin, 16 octobre 1832...,» et affirme, quelques pages plus loin: «Je ne continue que le 23 novembre 1835.» Fantaisie[p. xxi] d'écrivain, car le premier feuillet porte bien la date du 23 novembre 1835, et celle du 16 octobre 1831 (sic), mise en surcharge, a été ajoutée postérieurement, lorsque Beyle a revu sa première rédaction: les mots: 16 octobre 1831, et les corrections, sont de la même encre.
Le manuscrit, tel que le possède la Bibliothèque municipale de Grenoble, est formé de trois gros volumes, cotés R 299, du format 300 sur 210 millimètres, que Beyle lui-même fit relier, et, en outre, de deux cahiers, l'un compris dans le carton côté R 300, l'autre relié avec le tome XII de la collection en vingt-huit volumes, cotée R 5.896. Les trois volumes reliés contiennent respectivement les feuillets 2[1] à 248, 249 à 500, et 501 à 796; la fin de l'ouvrage (fol. 797 à 808) est dans le tome XII de la collection R 5.896; enfin, le cahier R 300 comprend (dans cet ordre) les chapitres XV, XIII et V de la présente édition. Le papier est rugueux, de couleur verdâtre, sauf à partir du feuillet 708, dans un angle duquel Stendhal a noté: «Nouveau papier, acheté à Cività-Vecchia.»
Stendhal n'a pas économisé son papier: il a couvert seulement le recto des feuillets, son écriture est large, les lignes sont très espacées. Mais il corrigeait souvent, ajoutait à son texte, l'accompagnait de réflexions; aussi, en beaucoup d'endroits, les[p. xxii] marges, les interlignes, le verso des pages ont été abondamment surchargés.
Enfin, le texte lui-même ou bien le verso des feuillets est illustré de nombreux plans, dessinés à la diable, sans recherche des proportions ni de l'échelle, et cependant, en général, exacts dans l'ensemble. On se rappelle, en voyant ces croquis de mathématicien, que Beyle a préparé l'École polytechnique; ils dénotent un très grand souci de précision et permettent au lecteur de comprendre sans peine le texte[2]. Ils localisent, bien souvent, la situation exacte d'un évènement, et surtout d'une maison, d'un magasin. En plusieurs endroits, la légende qui accompagne le plan de Grenoble en 1793, annexé à la présente édition, a été précisée, après vérification, au moyen des dessins du manuscrit.
La Vie de Henri Brulard se présente comme très homogène de pensée et de composition; elle a été écrite, presque sans interruption, entre le 23 novembre 1835 et le 17 mars 1836, tantôt à Rome, tantôt à Cività-Vecchia. Stendhal occupait tous ses moments de loisir à sa nouvelle œuvre, et en rédigeait en moyenne dix pages par jour, ou plutôt, comme il le dit lui-même dans l'une des[p. xxiii] notes marginales de son manuscrit, «ordinairement dix-huit ou vingt pages par jour et, les jours de courrier, quatre ou cinq, ou pas du tout». Au reste, «aucun travail les jours de voyage et le soir d'arrivée».
Le résultat de ce travail est du plus haut intérêt pour le biographe et le critique, non seulement à cause du texte lui-même, mais aussi à cause des notes et des observations que Stendhal a semées dans les marges et au verso des feuillets. Manuscrit vivant entre tous, où l'auteur se raconte avec toute la sincérité dont il est susceptible, où parfois il se juge lui-même, où très souvent il met le lecteur au courant des plus petits faits de sa vie journalière; aussi, l'ouvrage est à la fois la synthèse de l'enfance et de la jeunesse de Beyle, et le tableau de son existence en Italie, ou plus exactement à Rome, à la fin de 1835 et au commencement de 1836.
Cette autobiographie est certainement, de tous ses livres, celui que Stendhal a composé avec le plus de plaisir. Il dit, le premier jour: « J'ai fait allumer du feu et j'écris ceci, sans mentir, j'espère, sans me faire illusion, avec plaisir, comme une lettre à un ami.» Et il ajoute encore, le 6 avril 1836, après avoir rédigé la dernière page[3]: «Écrire ce qui suit était une consolation.»
C'est même plus que du plaisir, c'est de la passion: à mesure que les souvenirs reviennent en foule, l'écriture se précipite, de mauvaise devient parfois énigmatique, surtout lorsque Beyle, emporté par son sujet, laisse tomber le jour et trace dans l'obscurité des signes presque indéchiffrables.
Il est facile de constater, d'ailleurs, que la passion l'entraîne. Au début, Stendhal est résolu à produire une œuvre bien écrite et bien composée. Puis, le chaos de ses souvenirs l'embarrasse, le flot des pensées fait bouillonner tumultueusement le style, qui se charge d'incidentes, de parenthèses, de réflexions qui n'ont rien de commun avec le sujet, si bien que cet aveu échappe à l'auteur: «En relisant, il faudra effacer, ou mettre à une autre place, la moitié de ce manuscrit.»
La Vie de Henri Brulard, en effet, telle que nous la possédons, n'est qu'une ébauche, et une ébauche inachevée. On dirait d'un livre écrit en voyage; et, de fait, c'est un peu cela: Beyle résidait le moins possible au siège de son consulat, et passait le plus clair de son temps à Rome; son manuscrit fit donc plusieurs fois le trajet de Rome à Cività-Vecchia. Et puis, le nerveux écrivain accuse d'autres causes: les devoirs de sa charge de consul, qu'il appelle dédaigneusement le «métier», ensuite le froid de l'hiver, et surtout l'ennui qui l'accable au milieu des «sauvages» d'Italie. Lui-même explique[p. xxv] cet état d'esprit dans une longue note ajoutée à l'un des cahiers du manuscrit[4]:
«Pourquoi Rome m'est pesante.
«C'est que je n'ai pas une société, le soir, pour me distraire de mes idées du matin. Quand je faisais un ouvrage à Paris, je travaillais jusqu'à étourdissement et impossibilité de marcher. Six heures sonnant, il fallait pourtant aller dîner... J'allais dans un salon; là, à moins qu'il ne fût bien piètre, j'étais absolument distrait de mon travail du matin, au point d'en avoir oublié même le sujet en rentrant chez moi, à une heure.
«Voilà ce qui me manque à Rome: la société est si languissante!...
«Tout cela ne peut me distraire de mes idées du matin, de façon que, quand je reprends mon travail, le lendemain, au lieu d'être frais et délassé, je suis abîmé, éreinté, et, après quatre ou cinq jours de cette vie, je me dégoûte de mon travail, j'en ai réellement usé les idées en y pensant trop continuement. Je fais un voyage de quinze jours à Cività-Vecchia ou à Ravenne (1835, octobre); cet intervalle est trop long, j'ai oublié mon travail. Voilà pourquoi le Chasseur vert[5] languit, voilà ce qui, avec le manque total de bonne musique, me déplaît dans Rome.»
Stendhal réduisit cet inconvénient au minimum en ne se séparant de son manuscrit dans aucun de ses déplacements. Commencée à Rome le 23 novembre 1835, la Vie de Henri Brulard est continuée à Cività-Vecchia du 5 au 10 décembre; à Rome de nouveau du 13 décembre 1835 au 7 février 1836; à Cività-Vecchia du 24 février au 17 mars, avec quelques corrections, faites à Rome les 22 et 23 mars. Enfin Stendhal en reste là: le 26 mars 1836, dit-il, «annonce du congé pour Lutèce; l'imagination vole ailleurs, ce travail en est interrompu». Et il ajoute avec mélancolie: «L'ennui engourdit l'esprit, trop éprouvé de 1832 à 1836, Rome. Ce travail, interrompu sans cesse par le métier, se ressent sans doute de cet engourdissement[6].»
Stendhal cependant comptait faire de ses confessions un véritable livre, il écrivait pour la postérité. Les nombreux testaments, ou fragments de testaments, qu'il sème au hasard des feuillets, en sont la preuve. Je ne veux citer que les plus caractéristiques.
L'un est du 24 novembre 1835:
«Testament.
«Je lègue et donne ce manuscrit: Vie de Henri Brulard, etc., et tous ceux relatifs à l'histoire de ma vie, à M. Abraham Constantin, chevalier de la[p. xxvii] Légion d'honneur, et, s'il ne l'imprime pas, à M. Alphonse Levavasseur, libraire, place Vendôme, et, s'il meurt avant moi, je le lègue successivement à MM. Ladvocat, Fournier, Amyot, Treutel et Wurtz, Didot, sous la condition: 1° qu'avant d'imprimer ce manuscrit, ils changeront tous les noms de femme: là où j'ai mis Pauline Sirot, ils mettront Adèle Bonnet, et il suffit de prendre les noms de la prochaine liste[7], de changer absolument tous les noms de femmes et de ne changer aucun nom d'homme.—Seconde condition: envoyer des exemplaires aux bibliothèques d'Édimbourg, Philadelphie, New-York, Mexico, Madrid et Brunswick. Changer tous les noms de femme, condition sine qua non.
H. Beyle[8].»
Le deuxième testament a été écrit moins d'un mois après:
«Je lègue et donne le présent volume à M. le chevalier Abraham Constantin (de Genève), peintre sur porcelaine. Si M. Constantin ne l'a pas fait[p. xxviii] imprimer dans les mille jours qui suivront celui de mon décès, je lègue et donne ce volume successivement à MM. Alphonse Levavasseur, libraire, n° 7, place Vendôme. Philarète Chasles, homme de lettres, Henri Fournier, libraire, rue de Seine, Paulin, libraire, Delaunay, libraire, et si aucun de ces Messieurs ne trouve son intérêt à faire imprimer dans les cinq ans qui suivront mon décès, je laisse ce volume au plus âgé des libraires habitant dans Londres et dont le nom commencera par un C.
H. Beyle.[9]»
Désireux de laisser un livre digne de lui, Stendhal avait eu souci de la composition. Il eut certainement l'intention de reprendre sa première rédaction pour donner à l'ouvrage plus de cohésion, plus d'harmonie, pour rétablir enfin la chronologie un peu confuse des chapitres consacrés à son enfance et à sa première jeunesse.
Il voulait consacrer au moins deux volumes à son autobiographie; la page 249 porte cette note: «Laisser le n° 249 à cette page et aller ainsi jusqu'à 1.000.» Et je trouve sur la feuille contenant la table du troisième tome cette mention: «Chapitre 42[p. xxix] [XLVII de la présente édition] commencera le quatrième volume.» Or, de ce quatrième volume, Stendhal a écrit à peine un chapitre.
Il s'était également proposé d'établir un texte définitif, puisqu'il note à la page 783 de son manuscrit: «A placer ailleurs en recopiant[10].»
Malheureusement, le ministre des Affaires étrangères accorda un congé au consul de France à Cività-Vecchia; et, laissant là souvenirs et réflexions, Beyle partit pour Paris. Son congé se prolongea pendant trois ans. Au retour, la Vie de Henri Brulard était oubliée, elle ne fut jamais achevée, ni corrigée.
Stendhal avait, avant d'écrire, dressé un plan général de son autobiographie. Le voici, tel qu'il nous est parvenu:
«Division.
Pour la clarté, diviser cet ouvrage ainsi:
Livre premier.
«De sa naissance à la mort de madame Henriette Gagnon.
Livre second.
«Tyrannie Raillane (ainsi nommée non pour sa forme, mais pour ses effets pernicieux).
Livre 3.
«Le maître Durand.
Livre 4.
«L'École centrale, les mathématiques jusqu'au départ pour Paris, en novembre 1799.
«Diviser en chapitres de vingt pages.
«Plan: établir les époques, couvrir la toile, puis, en relisant, ajouter les souvenirs, par exemple: 1° l'abbé Chélan;—2° je me révolte (l'ouvrier chapelier, journée des Tuiles[11]).»
De ce plan si soigneusement établi, ne prévoyant cependant que la première partie de l'ouvrage, Stendhal n'a pu respecter le cadre. Ses souvenirs étaient, chronologiquement, trop confus, et le nombre des épisodes trop inégal pour chacun des quatre livres projetés: les faits du temps de la «tyrannie Raillane» et ceux du «maître Durand», par exemple, ont une importance bien différente. Aussi, en cours de rédaction, Stendhal ébauche-t-il un nouveau plan, le livre II devant commencer à son premier séjour à Paris. Division sans doute aussi précaire que la première, puisque l'auteur ne prévoit pas un livre III lorsqu'il raconte son départ de Paris et son voyage jusqu'à Milan, à la suite de l'armée de réserve.
Cette difficulté de proportionner à peu près également plusieurs livres, Stendhal la retrouve lorsqu'il s'agit de partager l'ouvrage en chapitres. Nous l'avons vu tout à l'heure indiquer une division « en chapitres de vingt pages». Dans le fait, cette méthode est à peu près respectée, mais elle a été appliquée a posteriori. La Vie de Henri Brulard a été écrite sans souci de chapitres divers, à part quelques périodes bien déterminées, qui exigeaient une coupure nette ou racontaient une anecdote spéciale: le chapitre III, où commencent les souvenirs de Beyle, le chapitre X, qui narre le début du préceptorat Durand, le chapitre XI, Amar et Merlinot, le chapitre XII, épisode du billet Gardon, le chapitre XIII, premier voyage aux Échelles, le chapitre XIV, mort du pauvre Lambert, le chapitre XXXI, commencement de la passion pour les mathématiques, le chapitre XXXVI, Paris. Plus on va, moins la division est précise. Stendhal, emporté par la passion, jette ses souvenirs, pêle-mêle, sur le papier, au fur et à mesure qu'ils lui viennent à l'esprit; puis, en revoyant une première fois son ébauche, il intercale, de vingt en vingt pages environ, un feuillet bis; ce feuillet indique la séparation du chapitre, dont il reproduit généralement la première page, ou seulement les premières lignes; enfin, ce premier travail une fois terminé, les chapitres sont numérotés.
Travail factice, on le voit, et que Stendhal considérait[p. xxxii] lui-même comme provisoire, puisqu'il écrit à la fin de la table qui termine le premier volume: «Je laisse les chapitres XIII et XIV pour les augmentations à faire à ces premiers temps. J'ai quarante pages écrites à insérer[12].»
Stendhal doit cette incertitude dans la division et dans la mise en place de certains de ses chapitres à l'inexactitude de sa chronologie. Il connaît mal les dates auxquelles tels ou tels événements se sont passés. Il en convient à plusieurs reprises dans son texte: «Il faudrait, dit-il par exemple dans une note, acheter un plan de Grenoble et le coller ici. Faire prendre les extraits mortuaires de mes parents, ce qui me donnerait des dates, et l'extrait de naissance de my dearest mother et de mon bon grand-père[13].»
Nous retrouvons pareille incertitude dans la division matérielle des chapitres. J'en veux seulement pour preuve les chapitres XV et XVIII de la présente édition.
Stendhal avait d'abord songé à incorporer le chapitre XV au chapitre XVII: il a d'abord occupé les feuillets 256 à 268, et le feuillet 255 fait précisément partie du chapitre XVII[14]. Ce feuillet, au[p. xxxiii] reste, se termine par ces mots, qui ont été rayés: «Ma pauvre mère dessinait fort...», et d'autre part l'ancien feuillet 256 continuait ainsi: « ... bien, disait-on dans la famille.» Puis, Stendhal s'est ravisé, il a songé à placer le chapitre XV après le chapitre XVI: la dernière page de celui-ci est la deux cent quarante-huitième du manuscrit, et notre chapitre XV porte une nouvelle numérotation 249 à 260. Enfin, l'auteur s'est rendu compte que ce passage ne pouvait convenir ni à l'une, ni à l'autre place, et il a pris le parti de le placer ailleurs, «after the death of poor Lambert», après le récit de la mort du domestique Lambert, et d'en faire un chapitre spécial.
Même difficulté pour le chapitre de «la première communion», le dix-huitième de la présente édition. Stendhal l'avait d'abord incorporé au chapitre X, «le maître Durand»: les deux passages, en effet, portent la même date, 10 décembre 1835, et l'un devait suivre l'autre, puisque les deux premiers feuillets du chapitre XVIII ont été chiffrés 168 et 169; puis un regret est venu, Beyle a continué son chapitre sans numéroter les pages et, incertain de la place définitive, il a inscrit dans son manuscrit deux mentions contradictoires; en tête du chapitre, on lit: «A placer après Amar et Merlinot», et d'autre part, à la fin du chapitre XVII, après le feuillet 259, une note indique: « First communion, à 260.» C'est la place que j'ai choisie, et c'est bien[p. xxxiv] celle que lui attribuait Stendhal, puisqu'il a laissé sans les numéroter les feuillets 260 à 273, entre lesquels il a fait relier et le récit de sa première communion et ce hors-d'œuvre intitulé: « Encyclopédie du XIXe siècle», que j'ai rejeté parmi les annexes[15].
La Vie de Henri Brulard, telle qu'elle nous est parvenue, est donc une ébauche, un amoncellement de matériaux ramassés en vue de la construction d'une œuvre plus parfaite. Stendhal n'a exécuté qu'une partie du plan qu'il s'était tracé: il a «établi les époques», il a « couvert la toile», niais il n'a pu «en relisant ajouter les souvenirs », ou, plus exactement, tous les souvenirs. La valeur littéraire de l'ouvrage y perd peut-être, mais de quels avantages cette perte légère est-elle compensée! Nous y trouvons d'abord un Stendhal sincère, ou, plus exactement, aussi sincère qu'il peut l'être, car il dit lui-même: «Je n'ai pas grande confiance, au fond, dans tous les jugements dont j'ai rempli les 536 pages précédentes. Il n'y a de sûrement vrai que les sensations; seulement, pour parvenir à la vérité, il faut mettre quatre dièses à mes impressions. Je les rends avec la froideur et les sens[p. xxxv] amortis par l'expérience d'un homme de quarante ans[16].»
C'est Beyle jugé par Beyle, seulement à trente-cinq ou quarante-cinq ans de distance! Mais on y trouve aussi le Beyle de cinquante-deux ans, et celui-là tout entier. Le texte foisonne de jugements contemporains; de plus, de précieuses notes illustrent le manuscrit, soit dans les marges, soit en haut des feuillets, soit au verso. Au fur et à mesure qu'il écrit, Stendhal explique sa pensée, la justifie, et raconte ses impressions ou ses actions du jour.
C'est ainsi qu'il s'excuse d'écrire ses Mémoires: «Droit que j'ai d'écrire ces Mémoires: quel être n'aime pas qu'on se souvienne de lui[17]?» Il s'excuse en même temps d'avoir dit souvent du mal de ses parents: «Qui pense à eux aujourd'hui que moi, et avec quelle tendresse, à ma mère, morte depuis quarante-six ans? Je puis donc parler librement de leurs défauts. La même justification pour Mme la baronne de Barckoff, Mme Alexandrine Petit, Mme la baronne Dembowski[18] (que de temps que je n'ai pas écrit ce nom!), Virginie, deux Victorines, Angela, Mélanie, Alexandrine, Métilde, Clémentine, Julia, Alberthe de Rubempré, adorée pendant un mois seulement.»
Il découvre un peu sa méthode d'investigation psychologique: «Je rumine sans cesse sur ce qui m'intéresse, à force de le regarder dans des positions d'âmes différentes, je finis par y voir du nouveau, et je le fais changer d'aspect[19].» Plus loin, c'est un peu de sa méthode de composition qui transparaît: «Style, ordre des idées. Préparer l'attention par quelques mots en passant: 1° sur Lambert;—2° sur mon oncle, dans les premiers chapitres[20]». Et ailleurs: « Idée: aller passer trois jours à Grenoble, et ne voir Crozet que le troisième jour. Aller seul, incognito, à Claix, à la Bastille, à La Tronche[21].»
Son style aussi le préoccupe; il écrit, au hasard d'une marge: « Style: pas de style soutenu[22].» Cependant, il châtie sa langue, de nombreuses ratures en témoignent. Et, une fois, il écrit deux phrases de même sens, et note en face: «Style: choisir des deux rédactions[23].» Il va jusqu'à juger ses effets: «Style. Ces mots, pour un instant, sont un repos pour l'esprit; je les eusse effacés en 1830. mais, en 1835, je regrette de ne pas en trouver de semblables dans le Rouge[24].» Son ironie s'exerce même à ses propres dépens: racontant la journée[p. xxxvii] des Tuiles, qui marque le prélude de la Révolution à Grenoble, la mort de l'ouvrier chapelier et l'agitation de cette ridicule bonne femme qui se «révolte», il ajoute après coup cette phrase: «Le soir même, mon grand-père me conta la mort de Pyrrhus; «et il remarque en note: «Cette queue savante fait-elle bien[25]?» Il connaît si bien son caractère qu'il écrit en marge du chapitre VII: «Idée. Peut-être, en ne corrigeant pas ce premier jet, parviendrai-je à ne pas mentir par vanité[26].»
Le sort de son livre le préoccupe. Il pense à intéresser le public: « Non laisser cela tel quel. Dorer l'histoire Kably, peut-être ennuyeuse pour les Pasquier de cinquante ans. Ces gens sont cependant l'élite des lecteurs[27].» Mais il se décourage parfois, il doute du succès, et s'écrie mélancoliquement: «Qui diable pourrait s'intéresser aux simples mouvements d'un cœur, décrits sans rhétorique[28]?» Ou encore: «J'ai été fort ennemi du mensonge en écrivant, mais n'ai-je point communiqué au lecteur bénévole l'ennui qui me faisait m'endormir au milieu du travail, au lieu des battements de cœur du n° 71, Richelieu[29]?»
Stendhal serait bien rassuré, s'il revenait parmi[p. xxxviii] nous, en voyant avec quelle passion son récit autobiographique a été étudié et commenté, et quel cas ses fidèles font de ses confessions!
Le manuscrit de la Vie de Henri Brulard a un autre intérêt encore: il contient de minutieux détails sur la vie au jour le jour d'Henri Beyle. Un petit nombre de privilégiés ont eu le bonheur de voir de leurs yeux le précieux manuscrit, c'est pourquoi nous avons tenu à reproduire aussi minutieusement que possible, dans les notes placées à la fin de l'ouvrage, la plupart des observations, réflexions et «idées» de Stendhal.
L'auteur nous raconte les plus petits détails de son existence, tant à Rome qu'à Cività-Vecchia. Nous savons qu'il quitta la ville des papes le 3 ou le 4 décembre 1835 pour rejoindre son poste, qu'il fit un nouveau séjour à Rome entre le 11 ou le 12 décembre 1835 et le 24 février 1836, et qu'il y revint encore, après un court séjour à Cività-Vecchia, le 19 mars suivant.
Nous savons aussi que le mois de décembre fut froid, à Rome, en 1835. Le 17, le pauvre Stendhal avoue: «Je souffre du froid, collé contre ma cheminée. La jambe gauche est gelée.» Le lendemain, encore, «froid de chien, avec nuages et soleil», et trois jours après, le 21, «pluie infâme» et «continue». Le 27, la chaleur n'est pas revenue, Stendhal a «froid aux jambes, surtout aux mollets, un peu[p. xxxix] de colique, envie de dormir. Le froid et le café du 24 décembre m'a donné sur les nerfs. Il faudrait un bain, mais comment, avec ce froid?» Le 4 janvier 1836, il est auprès de son feu, «se brûlant les jambes et mourant de froid au dos». La santé, au reste, n'est pas très bonne: «A trois heures, idée de goutte à la main droite, dessus; douleur dans un muscle de l'épaule droite.» Puis, c'est de nouveau la pluie au commencement de février; le 4, Beyle va voir le Tibre qui «monte au tiers de l'inscription sous le pont Saint-Ange».
La température de Cività-Vecchia est plus clémente, car, le 6 décembre 1835, on peut s'habiller «la fenêtre ouverte, à neuf heures et demie; impossible à Rome, plus froide l'hiver».
Mais qu'on s'ennuie dans ce triste port de mer! Tout excède Stendhal: les habitants de Cività-Vecchia, qui ne peuvent soutenir la moindre conversation spirituelle, le chancelier du consulat, Lysimaque Tavernier, sa charge elle-même, qu'il appelle avec dédain le «métier », le «gagne-pain». Aussi, notre consul passe-t-il le plus clair de son temps à Rome; là, du moins, les distractions ne manquent pas. Beyle assiste, le 2 décembre, à une messe de Bellini chantée à San Lorenzo-in-Damaso, admire le pape officiant à Saint-Pierre le jour de Noël, entend une messe grecque le 6 janvier et écoute, le 31 mars, les «vieux couplets barbares en latin rimé» du Stabat Mater, qui, du[p. xl] moins, ne sont pas infestés d'«esprit à la Marmontel».
Le «métier» l'occupe toujours, mais peu, et il se console en lisant les œuvres du président de Brosses, le Chatterton d'Alfred de Vigny, le Scarabée d'Or d'Edgar Poë, en écrivant à ses amis Di Fiore, de Mareste, Romain Colomb. Il visite musées et expositions de peinture, et se promène dans les jardins de la villa Aldobrandini ou à San Pietro-in-Montorio, où l'idée de raconter sa vie lui vint, en 1832. Il dîne en ville, va au bal et y ébauche même une intrigue avec la comtesse Sandre, du 8 au 17 février. Quoique la musique romaine soit mauvaise, le concert l'attire, et le 19 décembre il écoute jouer la Filarmonia.
Il se garderait de négliger le spectacle, qui l'a toujours passionné, et fréquente assidûment le théâtre della Valle. Il y entend, notamment, une «comédie de Scribe, par Bettini»; il y passe la soirée du 31 décembre 1835 et termine l'année, de onze heures trois quarts à minuit, chez M. Linpra, en devisant devant le feu avec son jeune ami Don Philippe Caetani.
Cependant, nous l'avons déjà vu, Rome l'ennuie, il aspire à quitter l'Italie, et reçoit avec joie la lettre ministérielle qui lui accorde un congé. Des projets de voyage l'occupent: il ira en bateau à vapeur jusqu'à Marseille et y prendra la malle-poste, fût-ce celle de Toulouse ou de Bordeaux, afin d'éviter[p. xli] la route de Paris par Valence, Lyon, Semur et Auxerre, villes trop connues, dont le souvenir le remplit de dégoût.
Le manuscrit de la Vie de Henri Brulard nous raconte tout cela, et beaucoup d'autres menus détails encore. Il vit, et de la vie la plus intense, il nous dit fidèlement les petites joies, les petits soucis du grand écrivain, il est le témoin le plus sûr d'une tranche de sa vie pendant quatre mois. Le lecteur ne me reprochera pas, je l'espère, d'avoir présenté les à-côtés du livre avant de lui en donner le texte enfin complet et, je veux croire, définitif.
Je dois cependant dire encore quelques mots de ce manuscrit, si précieux dans l'histoire de la pensée et de la méthode stendhaliennes. Tout y est particulier, personnel, original: l'écriture, la ponctuation, l'orthographe, la forme même des noms.
L'écriture, d'abord. Tout le monde connaît cette graphie fantaisiste, inquiète, élégante parfois mais plus souvent presque illisible, «en pieds de mouche», comme l'avoue Stendhal lui-même. On en trouvera des spécimens caractéristiques au cours de ces deux volumes. Il faut un œil exercé pour lire intégralement le manuscrit de la Vie de Henri Brulard, encore certains mois échappent-ils même à ceux qui fréquentent le plus assidûment les papiers stendhaliens.
Beyle mettait d'ailleurs, à écrire mal, une sorte de coquetterie. Il considérait ses grimoires comme une bastille difficilement vulnérable, accessible aux seuls initiés. Il dit quelque part à ce sujet: «La vergogne de voir un indiscret lire dans mon âme en lisant mes papiers m'empêche, depuis l'âge de raison, ou plutôt pour moi de passion, d'écrire ce que je sens[30].» Il faut croire qu'il jugea son écriture suffisamment indéchiffrable en rédigeant la Vie de Henri Brulard, car une des notes marginales porte: «Ma mauvaise écriture arrête les indiscrets.» Paroles qu'on jugerait naïves chez un autre que lui—car, après tout, le meilleur moyen de n'être jamais lu est de ne pas écrire!—mais qui n'étonnent pas de la part de cet esprit souvent mystificateur et toujours en contradiction avec lui-même.
La vérité est plus simple, et Beyle n'est pas poussé à mal écrire par le désir de n'être pas lu. Son écriture a toujours été déplorable; celle de la jeunesse est déjà très défectueuse, et Stendhal va même jusqu'à dire que son griffonnage de 1800, du temps qu'il était commis auxiliaire au ministère de la Guerre, était «bien pire» que celui de 1836[31]. Affirmation d'ailleurs inexacte: l'écriture de 1800 est, du moins en général, assez lisible.
En fait, Beyle a toujours écrit fort vite[32]. Son esprit vif et mobile obligeait sa main à suivre le cours rapide de ses idées. Et, constatant le résultat de cette méthode: «Voilà, s'écrie-t-il, comment j'écris quand la pensée me talonne. Si j'écris bien, je la perds[33].» Il répond en ces termes aux reproches de Romain Colomb: «Comment veut-on que j'écrive bien, forcé d'écrire aussi vite pour ne pas perdre mes idées[34]?»
Et puis, Stendhal écrit sa Vie de Henri Brulard en hiver: il fait froid, et le soir tombe vite. Il confesse, le 1er janvier 1836, en écrivant la vingt-sixième page de la journée: «Toutes les plumes vont mal, il fait un froid de chien; au lieu de chercher à bien former mes lettres et de m'impatienter, io tiro avanti.» La passion d'écrire domine son impatience. Emporté par son sujet, il est parfois étreint par l'émotion, il laisse tomber le jour sans s'en apercevoir, et note alors en marge: «Écrit à la nuit tombante», ou: «Écrit de nuit», ou encore: «Écrit absolument de nuit.» Il est à remarquer que les passages les plus particulièrement difficiles à déchiffrer sont précisément ceux qu'il a écrits[p. xliv] avec le plus de passion: le récit de la mort de sa mère, le premier séjour aux Échelles, le souvenir de l'arrivée à Milan, et certains passages où il cherche à s'analyser plus profondément.
Une autre particularité complique les difficultés de lecture: c'est ce que j'appellerai le jargon de Stendhal. Certains mots paraissent illisibles d'abord, incompréhensibles ensuite; or, ce sont tout simplement des anagrammes; l'auteur s'est contenté d'en intervertir les syllabes ou les lettres.
Le plus connu de ces anagrammes est le mot jésuite, que Stendhal écrit le plus souvent tejé, ou encore tejésui, tejessui. Cette méthode est, la plupart du temps, appliquée à des mots d'ordre religieux ou politique; Beyle, avec sa prudence habituelle et sa crainte maladive de la police, jargonne alors à plaisir: le jésuitisme devient tistmejésui, la religion s'écrit gionreli, ou gionré, ou abréviativement, gion; le prêtre est un reprêt, les prêtres, des trespré, le vicaire, un cairevi; un dévot est un votdé, une absurde dévotion, surdeab tiondévo; les pairs sont sairp ou sraip; des opinions républicaines deviennent kainesrépubli, et le congé qu'a demandé le consul de France s'appelle un gékon. Les noms propres sont aussi déformés, puisque Rome est mué en Omar ou Mero, M. Daru en M. Ruda, et le ministre Molé en Lémo. D'autres fois, Stendhal se contente d'écrire la première lettre du mot: au lecteur de deviner le reste. Enfin,[p. xlv] la langue anglaise vient à son secours: Dieu est traduit God, et un roi s'appelle un king.
Ces continuelles transpositions rendent souvent la lecture du texte assez pénible, aussi ai-je rétabli les formes régulières, et indiqué en note la forme originale. Mais j'ai conservé les mots en anglais et en italien, dont Stendhal aimait à charger son style.
Mon respect du texte n'est pas allé non plus jusqu'à reproduire l'orthographe parfois fantaisiste de l'auteur; outre qu'il emploie des formes orthographiques maintenant désuètes, il tombe parfois dans l'irrégularité absolue. Il s'en excuse à plusieurs reprises, et remarque, par exemple: «Voilà l'orthographe de la passion: orreur! » Ou bien: «Voilà déjà que j'oublie l'orthographe, comme il m'arrive dans les grands transports de passion!»
Ce tempérament passionné rend aussi la ponctuation des plus irrégulières. Stendhal eut rarement le souci de la virgule, du point et virgule, voire même du point. Il laissait à ses éditeurs le soin de mettre au net sa rédaction. Je n'ai cru devoir respecter scrupuleusement que ses coupures d'alinéas. J'estime que l'alinéa est plus qu'une élégance typographique, il marque les étapes de la pensée d'un écrivain.
J'aurai donné une idée complète du manuscrit de la Vie de Henri Brulard en décrivant encore deux de ses particularités.
Il forme, je l'ai déjà dit, trois gros volumes in-quarto, plus deux cahiers. C'est beaucoup pour 878 pages, même écrites au recto seulement, et pourvues parfois de bis, de ter et même de quater. Mais Beyle a laissé de nombreuses pages blanches à la fin, souvent même au milieu des chapitres. Dans quel but? Cela est difficile à démêler. Mieux vaut ne rien dire que d'échafauder de hasardeuses hypothèses.
Enfin, le manuscrit est accompagné d'une vingtaine de gravures au trait; la plupart ont été insérées dans le premier volume, quelques-unes ornent le second, et le troisième en est complètement dépourvu. Ces gravures reproduisent des tableaux de vieux maîtres italiens aimés de Beyle: Pérugin, Mantegna, Titien, et surtout Raphaël et le Dominiquin. Certaines proviennent d'une revue d'art alors en faveur: L'Ape Italiana. Deux d'entre elles portent des notes au crayon, hâtivement griffonnées par Stendhal. Au bas de la Vocation des saints Pierre et André, l'auteur a écrit: «A Saint-André della Valle, admirable Dominiquin»; et, sous la Sainte Famille d'Annibal Carrache, il note: «Physionomie commune: les grands peintres ne vivaient qu'avec des ouvriers, Annibal Carrache par exemple (la Reine de Saba, aux Loges de Raphaël, canaille).»
Outre ces gravures, Stendhal a joint au premier volume un petit portrait à l'aquarelle, peu poussé,[p. xlvii] mais de facture large et agréable. Il note de sa main que ce portrait est celui de Don Philippe Caetani. Deux ébauches au crayon accompagnent le portrait; des légendes de Stendhal annoncent le «baron Aulajani» et la «main de la comtesse Sandre». Une note de Casimir Stryienski attribue le portrait de Don Philippe—dubitativement d'ailleurs et sans aucune preuve—à Abraham Constantin, peintre sur porcelaine et miniaturiste, fort lié avec Beyle, et qui effectivement séjournait à Rome en 1835.
Telle est cette masse touffue et cependant si vivante qui constitue le manuscrit de la Vie de Henri Brulard.
Avec une piété fidèle, j'ai reproduit ce manuscrit dans son intégralité. En supprimant certaines parties, en en abrégeant d'autres, on risque de diminuer l'œuvre et d'égarer soit les biographes, soit les critiques. Sur la foi de l'édition de Casimir Stryienski M. Arthur Chuquet, l'auteur de Stendhal-Beyle, s'étonne (page 5) que Stendhal ait à peine mentionné ses camarades d'enfance, et n'ait pas dit un mot de Crozet. Étonnement injustifié, surtout en ce qui concerne Crozet.
A dire vrai, les éditions de Casimir Stryienski, aussi bien celle de 1890 que celle de 1912, ont laissé beaucoup d'inédit dans le texte de la Vie de Henri Brulard, surtout dans la période de la formation[p. xlviii] intellectuelle du jeune Beyle. Elles sont souvent inexactes dans la lecture et ont même, une fois, ajouté au texte de Stendhal une réflexion de Romain Colomb.
Loin de moi la pensée d'en faire un grief à Casimir Stryienski. Son mérite est assez grand, et il a rendu trop de services aux fidèles de Stendhal, pour qu'on ne puisse lui pardonner des péchés, en somme, véniels.
Et, grâce à lui, cette Vie de Henri Brulard est bien autre chose qu'une banale réédition[35].
Henry Debraye.
[1] Par une erreur inconcevable, le premier feuillet a été relié avec le manuscrit R 5.886. tome XII, fol. 3.
[2] Nous ne pouvons, malheureusement, reproduire tous ces dessins. Mais on les trouvera décrits aussi minutieusement que possible dans les notes et, d'autre part, résumés en grand nombre, dans deux planches de la présente édition: Grenoble en 1793 et Plan de l'appartement du docteur Gagnon.
[3] Feuillet de garde, en tête du tome III du manuscrit.
[4] R .900, fol. 09 v° vl 70 v°.
[5] Le Chasseur vert devint Lucien Leuwen, publié pour la première fois, en 1894, par M. Jean de Mitty.
[6] Tome III du manuscrit, dernier feuillet.
[7] La clef annoncée par Stendhal n'existe pas. Il n'y a plus lieu, d'ailleurs, de respecter exactement celte volonté du testateur: les noms cités par lui sont devenus historiques pour la plupart.
[8] Manuscrit R 5.896, vol. XII, fol. 3 v°.—Stendhal ajoute à côté: «Vie de Henri Brulard. Conditions: 1° N'imprimer qu'après mon décès; 2° Changer absolument tous les noms de femmes; 3° Ne changer aucun nom d'homme. Cività-Vecchia, le 30 novembre 1835. H. Beyle.»
[9] Tome 1er du manuscrit, feuillet de garde.—Les autres testaments ou fragments de testaments se trouvent aux feuillets 7 bis, 59 v°, 511 v°, 554 v° et 572 v°. Le lecteur les trouvera dans les notes de la présente édition correspondant à ces passages du manuscrit.
[10] Voir chapitre XLII.
[11] Ce plan se trouve dans R 5.896, tome XII, fol. 2.
[12] Ces quarante pages se trouvent clans le cahier R 300. Elles constituent les chapitres XIII et XV de la présente édition.
[13] Cette note est placée à la fin du cahier R 300, fol. 68 v°.
[14] Le fol. 255 se termine par cette phrase: «Pendant plus d'un mois, je fus fier de cette vengeance; j'aime cela dans un enfant. » (Tome I, p. 200 de la présente édition.)
[15] Cf. la note placée en tête du chapitre XVIII, tome II, p. 249.—L'«Encyclopédie du XIXe siècle» est la deuxième des annexes, tome II, p. 311.
[16] Chapitre XXXIV, tome II, p. 57-58.
[17] Cette note est placée à la fin du cahier R 300, fol. 08 v°.—La note citée un peu plus loin est écrite sur ce même feuillet.
[18] La seconde est Alexandrine, la troisième Métilde, que Stendhal cite plus loin dans la même phrase.
[19] Chapitre XXXI.
[20] Chapitre V.
[21] Chapitre XIV.
[22] Chapitre XXV.
[23] Chapitre XXX. La rédaction écartée a été rayée au crayon par Stendhal.
[24] Chapitre XV. Stendhal vient d'écrire: «J'emprunterai pour un instant la langue de Cabanis.»
[25] Chapitre V.
[26] Chapitre VII.
[27] Chapitre XXV.
[28] Chapitre XXXIV.
[29] Écrit le 6 avril 1830, avant de partir en congé, sur un feuillet de garde du volume III.
[30] Lettre à Romain Colomb, du 4 novembre 1834.
[31] Chapitre XLI.
[32] J'ai écrit horriblement vite douze ou quinze volumes in-octavo, que M. de Stendhal a imprimés. (Lettre à Romain Colomb citée ci-dessus.)
[33] Chapitre XXX.
[34] Chapitre XX.—Stendhal écrit encore, un peu plus loin: « Justification de ma mauvaise écriture: les idées me salopent et s'en vont si je ne les saisis pas. Souvent, mouvement nerveux de la main.»
[35] J'ai l'agréable devoir de remercier, à cette place, tous ceux qui ont bien voulu m'assister de leur expérience. J'adresse en particulier l'expression de ma gratitude à M. Georges Cain, Stendhalien passionné et Parisien érudit, ainsi qu'à mes aimables concitoyens Grenoblois, M. Edmond Maignien, bibliothécaire municipal, le dévoué et compétent gardien des manuscrits de Stendhal; M. Samuel Chabert, professeur à la Faculté des Lettres, dont la notice sur la Maison natale d'Henri Beyle complète le présent ouvrage, et M. Émile Robert, architecte municipal, un de ceux qui connaissent le mieux l'ancien Grenoble.
Je me trouvais ce matin, 16 octobre 1832, à San Pietro in Montorio, sur le mont Janicule, à Rome. Il faisait un soleil magnifique; un léger vent de sirocco à peine sensible faisait flotter quelques petits nuages blancs au-dessus du mont Albano; une chaleur délicieuse régnait dans l'air, j'étais heureux de vivre. Je distinguais parfaitement Frascati et Castel-Gandolfo, qui sont à quatre lieues d'ici, la villa Aldobrandini où est cette sublime fresque de Judith du Dominiquin. Je vois parfaitement le mur blanc qui marque les réparations faites en dernier lieu par le prince F. Borghèse, celui-là même que je vis à Wagram colonel du régiment de cuirassiers, le jour où M. de M..., mon ami,[p. 2] eut la jambe emportée. Bien plus loin, j'aperçois la roche de Palestrina et la maison blanche de Castel San Pietro, qui fut autrefois sa forteresse. Au-dessous du mur contre lequel je m'appuie, sont les grands orangers du verger des Capucins, puis le Tibre et le prieuré de Malte, et un peu après, sur la droite, le tombeau de Cecilia Metella, Saint-Paul et la pyramide de Cestius. En face de moi, je vois[2] Sainte-Marie-Majeure et les longues lignes du palais de Monte-Cavallo. Toute la Rome ancienne et moderne, depuis l'ancienne voie Appienne avec les ruines de ses tombeaux et de ses aqueducs jusqu'au magnifique jardin du Pincio, bâtis par les Français, se déploie à la vue.
Ce lieu est unique au monde, me disais-je en rêvant; et la Rome ancienne, malgré moi, l'emportait sur la moderne, tous les souvenirs de Tite-Live me revenaient en foule. Sur le mont Albano, à gauche du couvent, j'apercevais les Prés d'Annibal.
Quelle vue magnifique! C'est donc ici que la Transfiguration de Raphaël a été admirée pendant deux siècles et demi. Quelle différence avec la triste galerie de marbre gris où elle est enterrée aujourd'hui au fond du Vatican! Ainsi, pendant deux cent cinquante ans ce chef-d'œuvre a été ici, deux cent cinquante ans!... Ah! dans trois mois j'aurai cinquante ans, est-il bien possible! 1783, 93, 1803,[p. 3] je suis tout le compte sur mes doigts... et 1833, cinquante. Est-il bien possible! Cinquante! Je vais avoir la cinquantaine: et je chantais l'air de Grétry:
Quand on a la cinquantaine.
Cette découverte imprévue ne m'irrita point, je venais de songer à Annibal et aux Romains. De plus grands que moi sont bien morts!... Après tout, me dis-je, je n'ai pas mal occupé ma vie, occupé! Ah! c'est-à-dire que le hasard ne m'a pas donné trop de malheurs, car en vérité ai-je dirigé le moins du monde ma vie?
Aller devenir amoureux de Mlle de Grisheim! Que pouvais-je espérer d'une demoiselle noble, fille d'un général en faveur deux mois auparavant, avant la bataille de Iéna! Brichaud avait bien raison quand il me disait, avec sa méchanceté habituelle: «Quand on aime une femme, on se dit: Qu'en veux-je faire?»
Je me suis assis sur les marches de San Pietro et là j'ai rêvé une heure ou deux à cette idée: je vais avoir cinquante ans, il serait bien temps de me connaître. Qu'ai-je été, que suis-je, en vérité je serais bien embarrassé de le dire.
Je passe pour un homme de beaucoup d'esprit et fort insensible, roué même, et je vois que j'ai été[p. 4] constamment occupé par des amours malheureuses. J'ai aimé éperdument Mlle Kably, Mlle de Grisheim, Mme de Diphortz, Métilde, et je ne les ai point eues, et plusieurs de ces amours ont duré trois ou quatre ans. Métilde a occupé absolument ma vie de 1818 à 1824. Et je ne suis pas encore guéri, ai-je ajouté, après avoir rêvé à elle seule pendant un gros quart d'heure peut-être. M'aimait-elle[3]?
J'étais attendri, en prière, en extase. Et Menti[4], dans quel chagrin ne m'a-t-elle pas plongé quand elle m'a quitté? Là, j'ai eu un frisson en pensant au 15 septembre 1826, à San Remo, à mon retour d'Angleterre. Quelle année ai-je passée du 15 septembre 1826 au 15 septembre 1827! Le jour de ce redoutable anniversaire, j'étais à l'île d'Ischia. Et je remarquai un mieux sensible; au lieu de songer à mon malheur directement, comme quelques mois auparavant, je ne songeais plus qu'au souvenir de l'état malheureux où j'étais plongé en octobre 1826 par exemple. Cette observation me consola beaucoup.
Qu'ai-je donc été? Je ne le saurai. A quel ami, quelque éclairé qu'il soit, puis-je le demander? M. di Fiore lui-même ne pourrait me donner d'avis. A quel ami ai-je jamais dit un mot de mes chagrins d'amour?
Et ce qu'il y a de singulier et de bien malheureux, me disais-je ce matin, c'est que mes victoires[p. 5] (comme je les appelais alors, la tête remplie de choses militaires) ne m'ont pas fait un plaisir qui fût la moitié seulement du profond malheur que me causaient mes défaites.
La victoire étonnante de Menti ne m'a pas fait un plaisir comparable à la centième partie de la peine qu'elle m'a faite en me quittant pour M. de Bospier.
Avais-je donc un caractère triste?
... Et là, comme je ne savais que dire, je me suis mis sans y songer à admirer de nouveau l'aspect sublime des ruines de Rome et de sa grandeur moderne: le Colysée vis-à-vis de moi et sous mes pieds, le Palais Farnèse, avec sa belle galerie de choses modernes ouverte en arceaux, le palais Corsini sous mes pieds.
Ai-je été un homme d'esprit? Ai-je eu du talent pour quelque chose? M. Daru[5] disait que j'étais ignorant comme une carpe; oui, mais c'est Besançon qui m'a rapporté cela et la gaieté de mon caractère rendait fort jalouse la morosité de cet ancien secrétaire-général de Besançon [6]. Mais ai-je eu le caractère gai?
Enfin, je ne suis descendu du Janicule que lorsque la légère brume du soir est venue m'avertir que bientôt je serais saisi par le froid subit et fort désagréable et malsain qui en ce pays suit immédiatement le[p. 6] coucher du soleil. Je me suis hâté de rentrer au Palazzo Conti (Piazza Minerva), j'étais harassé. J'étais en pantalon de...[7] blanc anglais, j'ai écrit sur la ceinture, en dedans: 16 octobre 1832, je vais avoir la cinquantaine, ainsi abrégé pour n'être pas compris: J. vaisa voir la 5[8].
Le soir, en rentrant assez ennuyé de la soirée de l'ambassadeur, je me suis dit: Je devrais écrire ma vie, je saurais peut-être enfin, quand cela sera fini, dans deux ou trois ans, ce que j'ai été, gai ou triste, homme d'esprit ou sot, homme de courage ou peureux, et enfin au total heureux ou malheureux, je pourrai faire lire ce manuscrit à di Fiore.
Cette idée me sourit.—Oui, mais cette effroyable quantité de Je et de Moi! Il y a de quoi donner de l'humeur au lecteur le plus bénévole. Je et moi, ce serait, au talent près[9], comme M. de Chateaubriand, ce roi des égotistes.
De je mis avec moi tu fais la récidive...
Je me dis ce vers à chaque fois que je lis une de ses pages. On pourrait écrire, il est vrai, en se servant de la troisième personne, il fit, il dit; oui, mais comment rendre compte des mouvements intérieurs de l'âme? C'est là-dessus surtout que j'aimerais à consulter di Fiore.
Je ne continue que le 23 novembre 1835. La[p. 7] même idée d'écrire my life m'est venue dernièrement pendant mon voyage de Ravenne; à vrai dire, je l'ai eue bien des fois depuis 1832, mais toujours j'ai été découragé par cette effroyable difficulté des Je et des Moi, qui fera prendre l'auteur en grippe; je ne me sens pas le talent pour la tourner. A vrai dire, je ne suis rien moins que sûr d'avoir quelque talent pour me faire lire. Je trouve quelquefois beaucoup de plaisir à écrire, voilà tout[10].
S'il y a un autre monde, je ne manquerai pas d'aller voir Montesquieu; s'il me dit: «Mon pauvre ami, vous n'avez pas eu de talent du tout,» j'en serai fâché, mais nullement surpris. Je sens cela souvent, quel œil peut se voir soi-même? Il n'y a pas trois ans que j'ai trouvé ce pourquoi.
Je vois clairement que beaucoup d'écrivains qui jouissent d'une grande renommée sont détestables. Ce qui serait un blasphème à dire aujourd'hui de M. de Chateaubriand (sorte de Balzac) sera un truism en 1880. Je n'ai jamais varié sur ce Balzac: en paraissant, vers 1803, le Génie de Chateaubriand m'a semblé ridicule[11]. Mais sentir les défauts d'un autre, est-ce avoir du talent? Je vois les plus mauvais peintres voir très bien les défauts les uns des autres: M. Ingres a toute raison contre M. Gros, et M. Gros contre M. Ingres (je choisis ceux dont on parlera peut-être encore en 1835).
Voici le raisonnement qui m'a rassuré à l'égard de ces Mémoires. Supposons que je continue ce[p. 8] manuscrit et qu'une fois écrit je ne le brûle pas; je le léguerai non à un ami qui pourrait devenir dévot [12] ou vendu à un parti, comme ce jeune serin de Thomas Moore, je le léguerai à un libraire, par exemple à M. Levavasseur (place Vendôme, Paris).
Voilà donc un libraire qui, après moi, reçoit un gros volume relié de cette détestable écriture. Il en fera copier quelque peu, et lira; si la chose lui semble ennuyeuse, si personne ne parle plus de M. de Stendhal, il laissera là le fatras, qui sera peut-être retrouvé deux cents ans plus tard, comme les mémoires de Benvenuto Cellini.
S'il imprime, et que la chose semble ennuyeuse, on en parlera au bout de trente ans comme aujourd'hui l'on parle du poème de la Navigation de cet espion d'Esménard, dont il était si souvent question aux déjeuners de M. Daru en 1802. Et encore cet espion était, ce me semble, censeur ou directeur de tous les journaux qui le poffaient (de to puff) à outrance toutes les semaines. C'était le Salvandy de ce temps-là, encore plus impudent, s'il se peut, mais avec bien plus d'idées.
Mes Confessions n'existeront donc plus trente ans après avoir été imprimées, si les Je et les Moi assomment trop les lecteurs; et toutefois j'aurai eu le plaisir de les écrire, et de faire à fond mon examen de conscience. De plus, s'il y a succès, je cours la[p. 9] chance d'être lu en 1900 par les âmes que j'aime, les madame Roland, les Mélanie Guilbert, les...[13]
Par exemple, aujourd'hui 24 novembre 1835, j'arrive de la chapelle Sixtine, où je n'ai eu aucun plaisir, quoique muni d'une bonne lunette pour voir la voûte et le Jugement dernier de Michel-Ange; mais un excès de café commis avant-hier chez les Caetani par la faute d'une machine que Michel-Ange[14] a rapportée de Londres, m'avait jeté dans la névralgie. Une machine trop parfaite. Ce café trop excellent, lettre de change tirée sur le bonheur à venir au profit du moment présent, m'a rendu mon ancienne névralgie, et j'ai été à la chapelle Sixtine comme un mouton, id est sans plaisir, jamais l'imagination n'a pu prendre son vol. J'ai admiré la draperie de brocart d'or, peinte à fresque à côté du trône, c'est-à-dire du grand fauteuil de bois de noyer du Pape. Cette, draperie, qui porte le nom de Sixte IV, Pape (Sixtus IIII, Papa), on peut la toucher de la main, elle est à deux pieds de l'œil où elle fait illusion après trois cent cinquante quatre ans.
N'étant bon à rien, pas même à écrire des lettres officielles pour mon métier, j'ai fait allumer du feu, et j'écris ceci, sans mentir j'espère, sans me faire illusion, avec plaisir, comme une lettre à un ami. Quelles seront les idées de cet ami en 1880? Combien différentes des nôtres! Aujourd'hui c'est une énorme imprudence, une énormité pour les trois[p. 10] quarts de mes connaissances, que ces deux idées: le plus fripon des Kings et Tartare hypocrite[15] appliquées à deux noms que je n'ose écrire; en 1880, ces jugements seront des truisms que même les Kératry de l'époque n'oseront plus répéter. Ceci est du nouveau pour moi; parler à des gens dont on ignore absolument la tournure d'esprit, le genre d'éducation, les préjugés, la religion [16]! Quel encouragement à être vrai, et simplement vrai, il n'y a que cela qui tienne. Benvenuto a été vrai, et on le suit avec plaisir, comme s'il était écrit d'hier, tandis qu'on saute les feuillets de ce jésuite[17] de Marmontel qui pourtant prend toutes les précautions possibles pour ne pas déplaire, en véritable Académicien. J'ai refusé d'acheter ses mémoires à Livourne, à vingt sous le volume, moi qui adore ce genre d'écrits.
Mais combien ne faut-il pas de précautions pour ne pas mentir!
Par exemple, au commencement du premier chapitre, il y a une chose qui peut sembler une hâblerie: non, mon lecteur, je n'étais point soldat à Wagram en 1809.
Il faut que vous sachiez que, quarante-cinq ans avant vous, il était de mode d'avoir été soldat sous Napoléon. C'est, doue aujourd'hui, 1835, un mensonge tout à fait digne d'être écrit que de faire entendre indirectement, et sans mensonge absolu (jesuitico[18] more), qu'on a été soldat à Wagram.
Le fait est que j'ai été maréchal des logis et sous-lieutenant au sixième dragons à l'arrivée de ce régiment en Italie, mai 1800, je crois, et que je donnai ma démission à l'époque de la petite paix de 1803. J'étais ennuyé à l'excès de mes camarades, et ne trouvais rien de si doux que de vivre à Paris, en philosophe, c'était le mot dont je me servais alors avec moi-même, au moyen de cent cinquante francs par mois que mon père me donnait. Je supposais qu'après lui j'aurais le double ou deux fois le double; avec l'ardeur de savoir qui me brûlait alors, c'était beaucoup trop.
Je ne suis pas devenu colonel, comme je l'aurais été avec la puissante protection de M. le comte Daru, mon cousin, mais j'ai été, je crois, bien plus heureux. Je ne songeai bientôt plus à étudier M. de Turenne et à l'imiter, cette idée avait été mon but fixe pendant les trois ans que je fus dragon. Quelquefois elle était combattue par cette autre: faire des comédies comme Molière et vivre avec une actrice. J'avais déjà alors un dégoût mortel pour les femmes honnêtes et l'hypocrisie qui leur est indispensable. Ma paresse énorme l'emporta; une fois à Paris, je passais des six mois entiers sans faire de visites à ma famille (MM. Daru, Mme Le Brun, M. et Mme de Baure), je me disais toujours demain; je passai deux ans ainsi, dans un cinquième étage de la rue d'Angiviller, avec une belle vue sur la colonnade du Louvre, et lisant La Bruyère,[p. 12] Montaigne et J.-J. Rousseau, dont bientôt l'emphase m'offensa. Là se forma mon caractère. Je lisais beaucoup aussi les tragédies d'Alfieri, m'efforçant d'y trouver du plaisir, je vénérais Cabanis, Tracy et J.-B. Say, je lisais souvent Cabanis, dont le style vague me désolait. Je vivais solitaire et fou comme un Espagnol, à mille lieues de la vie réelle. Le bon père Jeki, Irlandais, me donnait des leçons d'anglais, mais je ne faisais aucun progrès, j'étais fou d'Hamlet.
Mais je me laisse emporter, je m'égare, je serai inintelligible si je ne suis pas l'ordre des temps, et d'ailleurs les circonstances ne me reviendront pas si bien.
Donc, à Wagram, en 1809, je n'étais pas militaire, mais au contraire adjoint aux commissaires des Guerres, place où mon cousin, M. Daru, m'avait mis pour me retirer du vice, suivant le style de ma famille. Car ma solitude de la rue d'Angiviller avait fini par vivre une année à Marseille avec une actrice charmante[19] qui avait les sentiments les plus élevés et à laquelle je n'ai jamais donné un sou.
D'abord, par la grandissime raison que mon père me donnait toujours cent cinquante francs par mois sur lesquels il fallait vivre, et cette pension était fort mal payée à Marseille, en 1805.
Mais je m'égare encore. En octobre 1806, après Iéna, je fus adjoint aux commissaires des Guerres, place honnie par les soldats; en 1810, le 3 août,[p. 13] auditeur au Conseil d'Etat, inspecteur général du mobilier de la Couronne quelques jours après. Je fus en faveur, non auprès du maître, Napoléon ne parlait pas à des fous de mon espèce, mais fort bien vu du meilleur des hommes, M. le duc de Frioul (Duroc). Mais je m'égare.
[1] Le chapitre I comprend les feuillets 1 à 20.—Écrit les 23 et 24 novembre 1835.—Le fol. 1 ne fait pas partie du ms. R 299 de la Bibl. mun. de Grenoble. Il a été relié avec le vol. R 5896. Le fol. 1 du ms. R 299 porte: «Moi, Henri Brulard, j'écrivais ce qui suit, à Rome, de 1832 à 1836.»
[2] En face de moi, je vois ...—Variante: «J'aperçois.»
[3] M'aimait-elle?—Nous n'adoptons pas la leçon proposée par M. Bédier à M. Paul Arbelet et adoptée par Stryienski dans sa 2e édition de la Vie de Henri Brulard. Le manuscrit porte en effet nettement un point entre les mots: peut-être et m'aimait-elle. (Cf. Casimir Stryienski et Paul Arbelet, Soirées du Stendhal-Club, 2e série, p. 81 note.)
[4] Et Menti ...—Clémentine, que Stendhal appelle plus souvent Menta (Sur Mme Clémentine C...), voir A. Chuquet, Stendhal-Beyle, p. 180-183.
[5] M. Daru....—Ms.: «Ruda.»—Sur les habitudes anagrammatiques de Stendhal, voir l'Introduction.
[6] ...cet ancien secrétaire-général de Besançon.—Stendhal surnomme souvent Besançon son ami de Mareste, qui fut secrétaire-général de la préfecture du Doubs.
[7] J'étais en pantalon de ...—Le nom est laissé en blanc dans le manuscrit.
[8] J. vaisa voir la 5.—Entre cet alinéa et le suivant, Stendhal a laissé un assez grand espace dans lequel il a écrit le mot: «Chap.»
[9] ... au talent près ...—Variante: «Moins le talent.»
[10] Je trouve quelquefois beaucoup de plaisir à écrire, voilà tout.—Un feuillet intercalaire est ainsi conçu: «Au lieu de tant de bavardages, peut-être que ceci suffit:
Brulard (Marie-Henry), né à Grenoble en 1786 (sic), d'une famille de bonne bourgeoisie qui prétendait à la noblesse, il n'y eut pas de plus fiers aristocrates qu'on pût voir dès 1752. Il fut témoin de bonne heure de la méchanceté et de l'hypocrisie de certaines gens, de là sa haine d'instinct pour la gion. Son enfance fut heureuse jusqu'à la mort de sa mère, qu'il perdit à sept ans, ensuite les prêtres en firent un enfer. Pour en sortir, il étudia les mathématiques avec passion et en 1797 ou 98 remporta le premier prix, tandis que cinq élèves reçus le mois après à l'École polytechnique n'avaient que le second. Il arriva à Paris le lendemain du 18 brumaire (9 novembre 1799), mais se garda bien de se présenter à l'examen pour l'École polytechnique. Il partit avec l'armée de réserve en amateur et passa le Saint-Bernard deux jours après le Premier Consul. A son arrivée à Milan, M. Daru, son cousin, alors inspecteur aux revues de l'armée, le fit entrer comme maréchal des logis, et bientôt sous-lieutenant, dans le 6e de Dragons, dont M. Le Baron, son ami, était colonel. Dans son régiment B., qui avait 150 francs de pension par mois et qui se disait riche, il avait 17 ans, fut envié et pas trop bien reçu; il eut cependant un beau certificat du Conseil d'administration. Un an après, il fut aide-de-camp du brave lieutenant-général Michaud, fit la campagne du Mincio contre le général Bellegarde, jugea la sottise du général Brune et fit des garnisons charmantes à Brescia et Bergame. Obligé de quitter le général Michaud, car il fallait être au moins lieutenant pour remplir les fonctions d'aide-de-camp, il rejoignit le 6e de Dragons à Alba et Savigliano, fièrement, fit une maladie mortelle à Saluces ...
Ennuyé de ses camarades, culottes de peau, B. vint à Grenoble, devint amoureux de Mlle Victorine M.; et, profitant de la petite paix, donna sa démission et alla à Paris, où il passa dix ans dans la solitude, croyant ne faire que s'amuser en lisant les Lettres Persanes, Montaigne, Cabanis, Tracy, et dans le fait finissant son éducation.»
[11] ... le Génie de Cha[teaubriand]: m'a semblé ridicule.—Le Génie du Christianisme parut en 1802.
[12] ... qui pourrait devenir dévot ...—Ms.: «Votdé.»
[13] ... les madame Roland, les Mélanie Guilbert, les ...—La phrase est inachevée.
[14] ... une machine que Michel-Ange ...—Le prince Michel-Ange Caetani, frère de Don Philippe, ami de Stendhal.
[15] ... le plus fripon des Kings et Tartare hypocrite ...—Le premier est Louis-Philippe, le second le tsar de Russie, Alexandre Ier.
[16] ... les préjugés, la religion!—Ms.: «Gionreli.»
[17] ... tandis qu'on saute les feuillets de ce jésuite ...—Ms.: «Tejessui.»
[18] ... (jesuitico more) ...—Ms.: «Ticojesui.»
[19] ... vivre une année à Marseille avec une actrice charmante ...—Mélanie Guilbert, que Stendhal appelle ailleurs Louason.
Je tombai avec Napoléon en avril 1814. Je vins en Italie vivre comme clans la rue d'Angiviller[2]. En 1821, je quittai Milan, le désespoir dans l'âme à cause de Métilde, et songeant beaucoup à me brûler la cervelle. D'abord tout m'ennuya à Paris; plus tard, j'écrivis pour me distraire; Métilde mourut, donc inutile de retourner à Milan. J'étais devenu parfaitement heureux; c'est trop dire, mais enfin fort passablement heureux, en 1830, quand j'écrivais le Rouge et le Noir.
Je fus ravi par les journées de juillet, je vis les balles sous les colonnes du Théâtre-Français, fort peu de danger de ma part; je n'oublierai jamais ce beau soleil, et la première vue du drapeau tricolore,[p. 16] le 29 ou le 30[3], vers huit heures, après avoir couché chez le commandeur Pinto, dont la nièce avait peur. Le 25 septembre, je fus nommé consul à Trieste par M. Molé[4], que je n'avais jamais vu. De Trieste, je suis venu en 1831 à Cività-Vecchia et Rome[5], où je suis encore et où je m'ennuie, faute de pouvoir faire échange d'idées. J'ai besoin de temps en temps de converser le soir avec des gens d'esprit, faute de quoi je me sens comme asphyxié.
Ainsi, voici les grandes divisions de mon conte: né en 1783, dragon en 1800, étudiant de 1803 à 1806[6]. En 1806, adjoint aux commissaires des Guerres, intendant à Brunswick. En 1809, relevant les blessés à Essling ou à Wagram, remplissant des missions le long du Danube, sur ses rives couvertes de neige, à Linz et Passau, amoureux de madame la comtesse Petit, pour la revoir demandant à aller en Espagne. Le 3 août 1810 nommé par elle, à peu près, auditeur au Conseil d'Etat. Cette vie de haute faveur et de dépenses me conduit à Moscou, me fait intendant à Sagan, en Silésie, et enfin tomber en avril 1814[7]. Qui le croirait! quant à moi personnellement, la chute me fit plaisir.
Après la chute, étudiant, écrivain, fou d'amour, faisant imprimer[8] l'Histoire de la Peinture en Italie en 1817; mon père, devenu ultra, se ruine et meurt en 1819, je crois; je reviens à Paris en juin 1821. Je suis au désespoir à cause de Métilde, elle meurt, je l'aimais mieux morte qu'infidèle,[p. 17] j'écris, je me console, je suis heureux. En 1830, au mois de septembre, je rentre dans la carrière administrative où je suis encore, regrettant la vie d'écrivain au troisième étage de l'hôtel de Valois, rue de Richelieu, n° 71.
J'ai été homme d'esprit depuis l'hiver 1826, auparavant je me taisais par paresse. Je passe, je crois, pour l'homme le plus gai et le plus insensible, il est vrai que je n'ai jamais dit un seul mot des femmes que j'aimais. J'ai éprouvé absolument à cet égard tous les symptômes du tempérament mélancolique décrit par Cabanis. J'ai eu très peu de succès.
Mais, l'autre jour, rêvant à la vie dans le chemin solitaire au-dessus du lac d'Albano, je trouvai que ma vie pouvait se résumer par les noms que voici, et dont j'écrivais les initiales sur la poussière, comme Zadig, avec ma canne, assis sur le petit banc derrière les stations du Calvaire des Minori Menzati bâti par le frère d'Urbain VIII, Barberini, auprès de ces deux beaux arbres enfermés par un petit mur rond[9]:
Virginie (Kably), Angela (Pietragrua), Adèle (Rebuffel), Mélanie (Guilbert), Mina (de Grisheim), Alexandrine (Petit), Angelina que je n'ai jamais aimée (Bereyter), Angela (Pietragrua), Métilde (Dembowski), Clémentine, Giulia. Et enfin, pendant un mois au plus, Mme Azur dont j'ai oublié le nom de baptême[10], et, imprudemment, hier, Amalia (B.).
La plupart de ces êtres charmants ne m'ont point honoré de leurs bontés; mais elles ont à la lettre occupé toute ma vie. A elles ont succédé mes ouvrages. Réellement je n'ai jamais été ambitieux, mais en 1811 je me croyais ambitieux.
L'état habituel de ma vie a été celui d'amant malheureux, aimant la musique et la peinture, c'est-à-dire jouir des produits de ces arts et non les pratiquer gauchement. J'ai recherché avec une sensibilité exquise la vue des beaux paysages; c'est pour cela uniquement que j'ai voyagé. Les paysages étaient comme un archet qui jouait sur mon âme, et des aspects que personne ne citait, la ligne de rochers en approchant d'Arbois, je crois, en venant de Dole par la grande route, sont pour moi une image sensible et évidente de l'âme de Métilde. Je vois que la Rêverie a été ce que j'ai préféré à tout, même à passer pour homme d'esprit. Je ne me suis donné cette peine, je n'ai pris cet état d'improviser en dialogue, au profit de la société où je me trouvais, qu'en 1826, à cause du désespoir où je passai les premiers mois de cette année fatale.
Dernièrement, j'ai appris, en le lisant dans un livre (les lettres de Victor Jacquemont, l'Indien) que quelqu'un avait pu me trouver brillant. Il y a quelques années, j'avais vu la même chose à peu près dans un livre, alors à la mode, de lady Morgan. J'avais oublié cette belle qualité qui m'a fait tant d'ennemis. (Ce n'était peut-être que l'apparence de[p. 19] la qualité, et les ennemis sont des êtres trop communs pour juger du brillant; par exemple, comment un comte d'Argout peut-il juger du brillant? Un homme dont le bonheur est de lire deux ou trois volumes de romans in-12, pour femme de chambre, par jour! Comment M. de Lamartine jugerait-il de l'esprit? D'abord il n'en a pas et, en second lieu, il dévore aussi deux volumes par jour des plus plats ouvrages. Vu à Florence en 1824 ou 1826.)
Le grand drawback (inconvénient) d'avoir de l'esprit, c'est qu'il faut avoir l'œil fixé sur les demi-sots qui vous entourent, et se pénétrer de leurs plates sensations. J'ai le défaut de m'attacher au moins impuissant d'imagination et de devenir inintelligible pour les autres qui, peut-être, n'en sont que plus contents.
Depuis que je suis à Rome, je n'ai pas d'esprit une fois la semaine et encore pendant cinq minutes, j'aime mieux rêver. Ces gens-ci ne comprennent pas assez les finesses de la langue française pour sentir les finesses de mes observations: il leur faut du gros esprit de commis-voyageur, comme Mélodrame qui les enchante (exemple: Michel-Ange Caetani) et est leur véritable pain quotidien. La vue d'un pareil succès me glace, je ne daigne plus parler aux gens qui ont applaudi Mélodrame. Je vois tout le néant de la vanité.
Il y a deux mois donc, en septembre 1835, rêvant à écrire ces mémoires, sur la rive du lac d'Albano[p. 20] (à deux cents pieds du niveau du lac), j'écrivais sur la poussière, comme Zadig, ces initiales:
V. Aa. Ad. M. Mi. Al. Aine. Apg. Mde. C. G. Ar.
1 2 3 4 5 6
(Mme Azur, dont j'ai oublié le nom de baptême).
Je rêvais profondément à ces noms et aux étonnantes bêtises et sottises qu'ils m'ont fait faire (je dis étonnantes pour moi, non pour le lecteur, et d'ailleurs je ne m'en repens pas).
Dans le fait je n ai eu que six femmes que j'ai aimées.
La plus grande passion est à débattre entre
Mélanie, Alexandrine, Métilde et Clémentine.
2 4
Clémentine est celle qui m'a causé la plus grande douleur en me quittant. Mais cette douleur est-elle comparable à celle occasionnée par Métilde, qui ne voulait pas me dire qu'elle m'aimait?
Avec toutes celles-là et avec plusieurs autres, j'ai toujours été un enfant; aussi ai-je eu très peu de succès. Mais, en revanche, elles m'ont occupé beaucoup et passionnément, et laissé des souvenirs qui me charment, quelques-uns après vingt-quatre ans, comme le souvenir de la Madone del Monte, à Varèse, en 1811. Je n'ai point été galant, pas assez, je n'étais occupé que de la femme que j'aimais, et quand je n'aimais pas, je rêvais au spectacle des choses humaines, ou je lisais avec délices Montesquieu ou Walter Scott. Par ainsi, comme disent les enfants,[p. 21] je suis si loin d'être blasé sur leurs ruses et petites grâces qu'à mon âge, cinquante-deux[ans][11], et en écrivant ceci, je suis encore tout charmé d'une longue chiacchierata qu'Amalia a eue hier avec moi au Th[éâtre] Valle.
Pour les considérer le plus philosophiquement possible et tâcher ainsi de les dépouiller de l'auréole qui me fait aller les yeux, qui m'éblouit et m'ôte la faculté de voir distinctement, j'ordonnerai ces dames (langage mathématique) selon leurs diverses qualités. Je dirai donc, pour commencer par leur passion habituelle: la vanité, que deux d'entre elles étaient comtesses et une, baronne.
La plus riche fut Alexandrine Petit, son mari et elle surtout dépensaient bien 80.000 francs par an. La plus pauvre fut Mina de Grisheim, fille cadette d'un général sans nulle fortune et favori d'un prince tombé, dont les app[ointement]s faisaient vivre la famille, ou Mlle Bereyter, actrice de l'Opera-Buffa.
Je cherche à distraire le charme, le dazzling des événements, en les considérant ainsi militairement. C'est ma seule ressource pour arriver au vrai dans un sujet sur lequel je ne puis converser avec personne. Par pudeur de tempérament mélancolique (Cabanis), j'ai toujours été, à cet égard, d'une discrétion incroyable, folle. Quant à l'esprit, Clémentine l'a emporté sur toutes les autres. Métilde l'a emporté par les sentiments nobles, espagnols;[p. 22] Giulia, ce me semble, par la force du caractère, tandis que, au premier moment, elle semblait la plus faible: Angela P. a été catin sublime à italienne, à la Lucrèce Borgia, et Mme Azur, catin non sublime, à la Du Barry.
L'argent ne m'a jamais fait la guerre que deux fois, à la fin de 1805 et en 1806 jusqu'en août, que mon père ne m'envoyait plus d'argent, et sans m'en prévenir, là était le mal; [il] fut une fois cinq mois sans payer ma pension de cent cinquante francs. Alors nos grandes misères avec le vicomte[12], lui recevait exactement sa pension, mais la jouait régulièrement toute, le jour qu'il la recevait.
En 1829 et 30, j'ai été embarrassé plutôt par manque de soin et insouciance que par l'absence véritablement de moyen, puisque de 1821 à 1830 j'ai fait trois ou quatre voyages en Italie, en Angleterre, à Barcelone, et qu'à la fin de cette période je ne devais que quatre cents francs.
Mon plus grand manque d'argent m'a conduit à la démarche désagréable d'emprunter cent francs ou, quelquefois, deux cents à M. Beau. Je rendais après un mois ou deux; et enfin, en septembre 1830, je devais quatre cents francs à mon tailleur Michel. Ceux qui connaissent la vie des jeunes gens de mon époque trouveront cela bien modéré. De 1800 à 1830, je n'avais jamais dû un sou à mon tailleur Léger, ni à son successeur Michel (22, rue Vivienne).
Mes amis d'alors, 1830, MM. de Mareste, Colomb,[p. 23] étaient des amis d'une singulière espèce, ils auraient fait sans doute des démarches actives pour me tirer d'un grand danger, mais lorsque je sortais avec un habit neuf ils auraient donné vingt francs, le premier surtout, pour qu'on me jetât un verre d'eau sale, (Excepté le vicomte de Barral et Bigillion (de Saint-Ismier), je n'ai guère eu, en toute ma vie, que des amis de cette espèce.)
C'étaient de braves gens fort prudents qui avaient réuni 12 ou 15.000 [francs] d'appointements ou de rente par un travail ou une adresse assidue, et qui ne pouvaient souffrir de me voir allègre, insouciant, heureux avec un cahier de papier blanc et une plume, et vivant avec non plus de 4 ou 5.000 francs. Ils m'auraient aimé cent fois mieux s'ils m'eussent vu attristé et malheureux de n'avoir que la moitié ou le tiers de leur revenu, moi qui jadis les avais peut-être un peu choqués quand j'avais un cocher, deux chevaux, une calèche et un cabriolet, car jusqu'à cette hauteur s'était élevé mon luxe, du temps de l'Empereur. Alors j'étais ou me croyais ambitieux; ce qui me gênait dans cette supposition[13], c'est que je ne savais quoi désirer. J'avais honte d'être amoureux de la comtesse Al. Petit, j'avais comme maîtresse entretenue Mlle A. Bereyter, actrice de l'Opera-Buffa, je déjeunais au café Hardy, j'étais d'une activité incroyable. Je revenais de Saint-Cloud à Paris exprès pour assister à un acte du Matrimonio segreto à l'Odéon (Madame Barilli,[p. 24] Barilli, Tachinardi. Mme Festa, Mlle Bereyter). Mon cabriolet attendait à la porte du café Hardy, voilà ce que mon beau-frère[14] ne m'a jamais pardonné.
Tout cela pouvait passer pour de la fatuité et pourtant n'en était pas. Je cherchais à jouir et à agir, mais je ne cherchais nullement à faire paraître plus de jouissances ou d'action qu'il n'y en avait réellement. M. Prunelle, médecin, homme d'esprit, dont la raison me plaisait fort, horriblement laid et depuis célèbre comme député vendu et maire de Lyon vers 1833, qui était de ma connaissance en ce temps-là, dit de moi: C'était un fier fat. Ce jugement retentit parmi mes connaissances. Peut-être au reste avaient-ils raison.
Mon excellent et vrai bourgeois de beau-frère, M. Périer-Lagrange (ancien négociant qui se ruinait, sans le savoir, en faisant de l'agriculture près de La Tour-du-Pin), déjeunant avec moi au café Hardy et me voyant commander ferme aux garçons, car avec tous mes devoirs à remplir j'étais souvent pressé, fut ravi parce que ces garçons firent entre eux quelque plaisanterie qui impliquait que j'étais un fat, ce qui ne me fâcha nullement. J'ai toujours et comme par instinct (si bien vérifié depuis par les Chambres), profondément méprisé les bourgeois.
Toutefois, j'entrevoyais aussi que parmi les bourgeois seulement se trouvaient les hommes énergiques tels que mon cousin Rebuffel[15] (négociant rue[p. 25] Saint-Denis), le Père Ducros, bibliothécaire de la ville de Grenoble, l'incomparable Gros (de la rue Saint-Laurent), géomètre de la haute volée et mon maître, à l'insu de mes parents mâles, car il était jacobin et toute ma famille bigotement ultra. Ces trois hommes ont possédé toute mon estime et tout mon cœur, autant que le respect et la différence d'âge pouvaient admettre ces communications qui font qu'on aime. Même, je fus avec eux comme je fus plus tard avec les êtres que j'ai trop aimés, muet, immobile, stupide, peu aimable et quelquefois offensant à force de dévouement et d'absence du moi. Mon amour-propre, mon intérêt, mon moi avaient disparu en présence de la personne aimée, j'étais transformé en elle. Qu'était-ce quand cette personne était une coquine comme madame Piétragrua? Mais j'anticipe toujours. Aurai-je le courage d'écrire ces Confessions d'une façon intelligible? Il faut narrer, et j'écris des considérations sur des événements bien petits mais qui, précisément à cause de leur taille microscopique, ont besoin d'être contés très distinctement. Quelle patience il vous faudra, ô mon lecteur!
Donc, suivant moi, l'énergie ne se trouvait, même à mes yeux (en 1811), que dans la classe qui est en lutte avec les vrais besoins.
Mes amis nobles. MM. Raymond de Bérenger (tué à Lutzen), de Saint-Ferréol, de Sinard (dévot mort jeune), Gabriel Du B.......... (sorte de filou[p. 26] ou d'emprunteur peu délicat, aujourd'hui pair de France et ultra par l'âme), MM. de Monval, m'avaient paru comme ayant toujours quelque chose de singulier, un respect effroyable pour les convenances (par exemple, Sinard). Ils cherchaient toujours à être de bon ton ou comme il faut, ainsi qu'on disait à Grenoble en 1793. Mais cette idée-là, j'étais loin de l'avoir clairement. Il n'y a pas un an que mon idée sur la noblesse est enfin arrivée à être complète. Par instinct, ma vie morale s'est passée à considérer attentivement cinq ou six idées principales, et à tâcher de voir la vérité sur elles.
Raymond de Bérenger était excellent et un véritable exemple de la maxime: noblesse oblige, tandis que Monval (mort colonel et généralement méprisé vers 1829, à Grenoble) était l'idéal d'un député du centre. Tout cela se voyait déjà fort bien quand ces Messieurs avaient quinze ans, vers 1798.
Je ne vois la vérité nettement sur la plupart de ces choses qu'en les écrivant, en 1835, tant elles ont été enveloppées jusqu'ici de l'auréole de la jeunesse, provenant de l'extrême vivacité des sensations.
A force d'employer des méthodes philosophiques, par exemple à force de classer mes amis de jeunesse par genres, comme M. Adrien de Jussieu fait pour ses plantes (en botanique), je cherche à atteindre cette vérité qui me fuit. Je m'aperçois que ce que je prenais pour de hautes montagnes, en 1800,[p. 27] n'étaient la plupart que des taupinières; mais c'est une découverte que je n'ai faite que bien tard.
Je vois que j'étais comme un cheval ombrageux, et c'est à un mot que me dit M. de Tracy (l'illustre comte Destutt de Tracy, pair de France, membre de l'Académie française et, bien mieux, auteur de la loi du 3 prairial[16] sur les Écoles centrales), c'est à un mot que me dit M. de Tracy que je dois cette découverte.
Il me faut un exemple. Pour un rien, par exemple une porte à demi ouverte, la nuit, je me figurais deux hommes armés m'attendant pour m'empêcher d'arriver à une fenêtre donnant sur une galerie où je voyais ma maîtresse. C'était une illusion, qu'un homme sage comme Abraham Constantin[17], mon ami, n'aurait point eue. Mais au bout de peu de secondes (quatre ou cinq tout au plus) le sacrifice de ma vie était fait et parfait, et je me précipitais comme un héros au devant des deux ennemis, qui se changeaient en une porte à demi fermée.
Il n'y a pas deux mois qu'une chose de ce genre, au moral toutefois, m'est encore arrivée. Le sacrifice était fait et tout le courage nécessaire était présent, quand après vingt heures je me suis aperçu, en relisant une lettre mal lue (de M. Herrard), que c'était une illusion. Je lis toujours fort vite ce qui me fait de la peine.
Donc, en classant ma vie comme une collection de plantes, je trouvai:
Enfance, première éducation, de 1786 à 1800 15 ans.
Service militaire, de 1800 à 1803 3 —
Seconde éducation, amours ridicules avec Mlle Adèle Clozel et avec sa mère, qui se donna l'amoureux de sa fille. Vie rue d'Angiviller. Enfin beau séjour à Marseille avec Mélanie, de 1803 à 1805 2 —
Retour à Paris, fin de l'éducation 1 —
Service sous Napoléon, de 1806 à la fin de 1815 (d'octobre 1806 à l'abdication en 1814) 7 1/2
Mon adhésion, dans le même numéro du Moniteur on se trouva l'abdication de Napoléon. Voyages, grandes et terribles amours, consolations en écrivant des livres, de 1814 à 1830 15 1/2
Second service, allant du 15 septembre 1830 au présent quart d'heure 5 —
J'ai débuté dans le monde par le salon de Mme de Vaulserre, dévote à la figure singulière, sans menton, fille de M. le baron des Adrets et amie de ma mère. C'était probablement vers 1794. J'avais un tempérament de feu et la timidité décrite par Cabanis. Je fus excessivement touché de la beauté du bras de Mlle Bonne de Saint-Vallier, je pense, je vois la figure et les beaux bras, mais le nom est incertain, peut-être était-ce Mlle de Lavalette.[p. 29] M. de Saint-Ferréol, dont depuis je n'ai jamais ouï parler, était mon ennemi et mon rival, M. de Sinard, ami commun, nous calmait. Tout cela se passait dans un magnifique rez-de-chaussée donnant sur le jardin de l'hôtel des Adrets, maintenant détruit et changé en maison bourgeoise, rue Neuve, à Grenoble. A la même époque commença mon admiration passionnée pour le Père Ducros (moine cordelier sécularisé, homme du premier mérite, du moins il me semble). J'avais pour ami intime mon grand-père, M. Henri Gagnon, docteur en médecine.
Après tant de considérations générales, je vais naître.
[1] Le chapitre II comprend les feuillets 20 à 42. Non daté.
[2] Je vins en Italie vivre comme dans la rue d'Angiviller.—L'auteur était en 1819 à Grenoble, lors de l'élection de l'abbé Grégoire à la Chambre des Députés. (Note au crayon de H. Colomb.)
[3] ... le 29 ou le 30 ...—C'est le 28. (Note au crayon de R. Colomb.)
[4] ... M. Molé ...—Ms.: «Lémo.»—Molé fut ministre des Affaires étrangères entre le 11 août et le 2 novembre 1830.
[5] ... Cività-Vecchia et Rome ...—Ms.: «Omar.»
[6] ... étudiant de 1803 à 1806.—Négociant à Marseille, 1805. (Note au crayon de R. Colomb.)
[7] ... tomber en avril 1814.—En avril 1814. (Note au crayon de R. Colomb.)—Le manuscrit porte: 1815.
[8] ... faisant imprimer ...—Les lettres sur Mozart, Haydn, etc. (Note au crayon de R. Colomb.)
[9] ... enfermés par un petit mur rond.—En face, au verso du fol. 22, est une esquisse de cette scène: le «couvent», près duquel passe la «route tendant à Albano»; à droite, un arbre entouré d'un mur bas; à droite encore, au bord du «lac d'Albano», Stendhal assis. Devant lui, en capitales, les mots suivants: «ZADIG. ASTARTÉ.»
[10] ... dont j'ai oublié le nom de baptême.—Mme Azur est Mme Alberthe de Rubempré.
[11] ... à mon âge, cinquante-deux ans ...—Les chiffres ont été intervertis par Stendhal. Il explique le 52 en mettant en surcharge: (72 + 3).
[12] Alors nos grandes misères avec le vicomte ...—Le vicomte de Barral.
[13] ... ce qui me gênait dans cette supposition ...—Variante: «Idée.»
[14] ... mon beau-frère ...—Pauline, sœur de Beyle, avait épousé François-Daniel Périer-Lagrange.
[15] ... mon cousin Rebuffel ...—Jean-Baptiste Rebuffet. Stendhal orthographie continuellement Rebuffel. Nous avons respecté cette orthographe.
[16] ... loi du 3 prairial ...—La loi instituant les Écoles centrales est du 3 brumaire an IV.
[17] ... Abraham Constantin ...—Peintre sur porcelaine, originaire de Genève.
Mon premier souvenir est d'avoir mordu à la joue ou au front madame Pison-Dugalland, ma cousine, femme de l'homme d'esprit député à l'Assemblée constituante. Je la vois encore, une femme de vingt-cinq ans qui avait de l'embonpoint et beaucoup de rouge. Ce fut apparemment ce rouge qui me piqua. Assise au milieu du pré qu'on appelait le glacis de la porte de Bonne, sa joue se trouvait précisément à ma hauteur.
«Embrasse-moi, Henri», me disait-elle. Je ne voulus pas, elle se fâcha, je mordis ferme. Je vois la scène, mais sans doute parce que sur-le-champ on m'en fit un crime et que sans cesse on m'en parlait.
Ce glacis de la porte de Bonne était couvert de[p. 32] marguerites. C'est une jolie petite fleur dont je faisais un bouquet. Ce pré de 1786 se trouve sans doute aujourd'hui au milieu de la ville, au sud de l'église du collège[2].
Ma tante Séraphie[3] déclara que j'étais un monstre et que j'avais un caractère atroce. Cette tante Séraphie avait toute l'aigreur d'une fille dévote qui n'a pas pu se marier. Que lui était-il arrivé? Je ne l'ai jamais su, nous ne savons jamais la chronique scandaleuse de nos parents, et j'ai quitté la ville pour toujours à seize ans, après trois ans de la passion la plus vive, qui m'avait relégué dans une solitude complète.
Le second trait de caractère fut bien autrement noir.
J'avais fait une collection de joncs, toujours sur le glacis de la porte de Bonne (Bonne de Lesdiguières. Demander le nom botanique du jonc, herbe de forme cylindrique comme une plume de poulet et d'un pied de long).
On m'avait ramené à la maison, dont une fenêtre au premier étage donnait sur la Grande-rue, à l'angle de la place Grenette. Je faisais un jardin en coupant ces joncs en morceaux[4] de deux pouces de long que je plaçais dans l'intervalle entre le balcon et le jet d'eau de la croisée. Le couteau de cuisine dont je me servais m'échappa et tomba dans la rue, c'est-à-dire d'une douzaine de pieds, près d'une madame Chenavaz. C'était la plus méchante femme[p. 33] de toute la ville (mère de Candide Chenavaz qui, dans sa jeunesse, adorait la Clarisse Harlowe de Richardson, depuis l'un des trois cents de M. de Villèle et récompensé par la place de premier président de la cour royale de Grenoble; mort à Lyon non reçu).
Ma tante Séraphie dit que j'avais voulu tuer madame Chenavaz; je fus déclaré pourvu d'un caractère atroce, grondé par mon excellent grand-père, M. Gagnon, qui avait peur de sa fille Séraphie, la dévote la plus en crédit dans la ville, grondé même par ce caractère élevé et espagnol, mon excellente grand'tante, Mlle Elisabeth Gagnon[5].
Je me révoltai, je pouvais avoir quatre ans[6]. De cette époque date mon horreur pour la religion[7], horreur que ma raison a pu à grand'peine réduire à de justes dimensions, et cela tout nouvellement, il n'y a pas six ans. Presque en même temps prit sa première naissance mon amour filial instinctif, forcené dans ces temps-là, pour la... [8].
Je n'avais pas plus de cinq ans[9].
Cette tante Séraphie a été mon mauvais génie pendant toute mon enfance; elle était abhorrée, mais avait beaucoup de crédit dans la famille. Je suppose que dans la suite mon père fut amoureux d'elle, du moins il y avait de longues promenades aux Granges, dans un marais sous les murs de la ville, où j'étais le seul tiers incommode, et où je m'ennuyais fort. Je me cachais au moment de partir[p. 34] pour ces promenades. Là fit naufrage la très petite amitié que j'avais pour mon père.
Dans le fait, j'ai été exclusivement élevé par mon excellent grand-père, M. Henri Gagnon. Cet homme rare avait fait un pèlerinage à Ferney pour voir Voltaire et en avait été reçu avec distinction. Il avait un petit buste de Voltaire, gros comme le poing, monté sur un pied de bois d'ébène de six pouces de haut. (C'était un singulier goût, mais les beaux-arts n'étaient le fort ni de Voltaire, ni de mon excellent grand-père.)
Ce buste était placé devant le bureau où il écrivait; son cabinet était au fond d'un très vaste appartement donnant sur une terrasse élégante ornée de fleurs[10]. C'était pour moi une rare faveur d'y être admis, et une plus rare de voir et de toucher le buste de Voltaire.
Et avec tout cela, du plus loin que je me souvienne, les écrits de Voltaire m'ont toujours souverainement déplu, ils me semblaient un enfantillage. Je puis dire que rien de ce grand homme ne m'a jamais plu. Je ne pouvais voir alors qu'il était le législateur et l'apôtre de la France, son Martin Luther.
M. Henri Gagnon portait une perruque poudrée, ronde, à trois rangs de boucles, parce qu'il était docteur en médecine, et docteur à la mode parmi les dames, accusé même d'avoir été l'amant de plusieurs, entre autres madame Teisseire, l'une des[p. 35] plus jolies de la ville, que je ne me souviens pas d'avoir jamais vue, car alors on était brouillé, mais on me l'a fait comprendre plus tard d'une singulière façon. Mon excellent grand-père, à cause de sa perruque, m'a toujours semblé avoir quatre-vingts ans. Il avait des vapeurs (comme moi misérable), des rhumatismes, marchait avec peine, mais par principe ne montait jamais en voiture et ne mettait jamais son chapeau: un petit chapeau triangulaire à mettre sous le bras[11] et qui faisait ma joie quand je pouvais l'accrocher pour le mettre sur ma tête, ce qui était considéré par toute la famille comme un manque de respect; et enfin, par respect, je cessai de m'occuper du chapeau triangulaire et de la petite canne à pomme en racine de buis bordée d'écaille. Mon grand-père adorait la correspondance apocryphe d'Hippocrate, qu'il lisait en latin (quoiqu'il sût un peu de grec), et l'Horace de l'édition de Johannes Bond, imprimée en caractères horriblement menus. Il me communiqua ces deux passions et en réalité presque tous ses goûts, mais pas comme il l'aurait voulu, ainsi que je l'expliquerai plus tard.
Si jamais je retourne à Grenoble, il faut que je fasse rechercher les extraits de naissance et de décès de cet excellent homme, qui m'adorait et n'aimait point son fils, M. Romain Gagnon, père de M. Oronce Gagnon, chef d'escadrons de dragons qui a tué son homme en duel il y a trois ans, ce dont[p. 36] je lui sais gré, probablement il n'est pas un niais. Il y a trente-trois ans que je ne l'ai vu, il peut en avoir trente-cinq.
J'ai perdu mon grand-père pendant que j'étais en Allemagne, est-ce en 1807 ou en 1813, je n'ai pas de souvenir net. Je me souviens que je fis un voyage à Grenoble pour le revoir encore; je le trouvai fort attristé. Cet homme si aimable, qui était le centre des veillées où il allait, ne parlait presque plus. Il me dit: «C'est une visite d'adieu», et puis parla d'autres choses; il avait en horreur l'attendrissement de famille niais.
Un souvenir me revient, vers 1807 je me fis peindre, pour engager Mme Alex. Petit à se faire peindre aussi, et comme le nombre des séances était une objection, je la conduisis chez un peintre vis-à-vis la Fontaine du Diorama qui peignait à l'huile, en une séance, pour cent-vingt francs[12]. Mon bon grand-père vit ce portrait, que j'avais envoyé à ma sœur, je crois, pour m'en défaire, il avait déjà perdu beaucoup de ses idées; il dit en voyant ce portrait: « Celui-là est le véritable», et puis retomba dans l'affaissement et la tristesse. Il mourut bientôt après, ce me semble, à l'âge de 82 ans, je crois.
Si cette date est exacte, il devait avoir 61 ans en 1789 et être né vers 1728. Il racontait quelquefois la bataille de l'Assiette, assaut dans les Alpes, tenté en vain par le chevalier de Belle-Isle en 1742, je crois[13]. Son père, homme ferme, plein d'énergie et[p. 37] d'honneur, l'avait envoyé là comme chirurgien d'armée, pour lui former le caractère. Mon grand-père commençait ses études en médecine et pouvait avoir dix-huit ou vingt ans, ce qui indique encore 1724 comme époque de sa naissance.
Il possédait une vieille maison située dans la plus belle position de la ville, sur la place Grenette, au coin de la Grande-rue, en plein midi et ayant devant elle la plus belle place de la ville, les deux cafés rivaux et le centre de la bonne compagnie. Là, dans un premier étage fort bas, mais d'une gaieté admirable, habita mon grand-père jusqu'en 1789.
Il faut qu'il fût riche alors, car il acheta une superbe maison située derrière la sienne et qui appartenait aux dames de Marnais. Il occupa le second étage de sa maison, place Grenette, et tout l'étage correspondant de la maison de Marnais, et se fit le plus beau logement de la ville. Il y avait un escalier magnifique pour le temps et un salon qui pouvait avoir trente-cinq pieds sur vingt-huit.
On fit des réparations aux deux chambres de cet appartement qui donnaient sur la place Grenette, et entre autres une gippe[14] (cloison formée par du plâtre et des briques placées de champ l'une sur l'autre) pour séparer la chambre de la terrible tante Séraphie, fille de M. Gagnon, de celle de ma grand'-tante Elisabeth, sa sœur. On posa des happes en fer dans cette gippe et sur le plâtre de chacune de ces happes j'écrivis: Henri Beyle, 1789. Je vois[p. 38] encore ces belles inscriptions qui émerveillaient mon grand-père.
«Puisque tu écris si bien, me dit-il, tu es digne de commencer le latin.»
Ce mot m'inspirait une sorte de terreur, et un pédant affreux par la forme, M. Joubert, grand, pâle, maigre, en couteau, s'appuyant sur une épine, vint me montrer, m'enseigner mura, la mûre. Nous allâmes acheter un rudiment chez M. Giroud, libraire, au fond d'une cour donnant sur la place aux Herbes. Je ne soupçonnais[15] guère alors quel instrument de dommage on m'achetait là.
Ici commencent mes malheurs.
Mais je diffère depuis longtemps un récit nécessaire, un des deux ou trois peut-être[16] qui me feront jeter ces mémoires au feu.
Ma mère, madame Henriette Gagnon, était une femme charmante et j'étais amoureux de ma mère.
Je me hâte d'ajouter que je la perdis quand j'avais sept ans.
En l'aimant à six ans peut-être (1789), j'avais absolument le même caractère que, en 1828, en aimant à la fureur Alberthe de Rubempré. Ma manière d'aller à la chasse du bonheur n'avait au fond nullement changé, il n'y a que cette seule exception: j'étais, pour ce qui constitue le physique de l'amour, comme César serait, s'il revenait au monde, pour l'usage du canon et des petites armes.[p. 39] Je l'eusse bien vite appris et cela n'eût rien changé au fond de ma tactique.
Je voulais couvrir ma mère de baisers et qu'il n'y eût pas de vêtements. Elle m'aimait à la passion et m'embrassait souvent, je lui rendais ses baisers avec un tel feu qu'elle était souvent obligée de s'en aller. J'abhorrais mon père quand il venait interrompre nos baisers. Je voulais toujours les lui donner à la gorge. Qu'on daigne se rappeler que je la perdis, par une couche, quand à peine j'avais sept ans.
Elle avait de l'embonpoint, une fraîcheur parfaite, elle était fort jolie, et je crois que seulement elle n'était pas assez grande. Elle avait une noblesse et une sérénité parfaite dans les traits; brune, vive, avec une vraie cour et souvent elle manqua de commander à ses trois servantes et enfin[17] lisait souvent dans l'original la Divine Comédie de Dante, dont j'ai trouvé bien plus tard cinq à six livres d'éditions différentes dans son appartement resté fermé depuis sa mort.
Elle périt à la fleur de la jeunesse et de la beauté, en 1790, elle pouvait avoir vingt-huit ou trente ans.
Là commence ma vie morale.
Ma tante Séraphie osa me reprocher de ne pas pleurer assez. Qu'on juge de ma douleur et de ce que je sentis! Mais il me semblait que je la reverrais le lendemain: je ne comprenais pas la mort.
Ainsi, il y a quarante-cinq ans que j'ai perdu ce que j'aimais le plus au monde[18].
Elle ne peut pas s'offenser de la liberté que je prends avec elle en révélant que je l'aimais; si je la retrouve jamais, je le lui dirais encore. D'ailleurs, elle n'a participé en rien à cet amour. Elle n'en agit pas à la Vénitienne, comme madame Benzoni avec l'auteur de Nella. Quant à moi, j'étais aussi criminel que possible, j'aimais ses charmes avec fureur.
Un soir, comme par quelque hasard on m'avait mis coucher dans sa chambre par terre, sur un matelas, cette femme vive et légère comme une biche sauta par-dessus mon matelas pour atteindre plus vite à son lit [19].
Sa chambre est restée fermée dix ans après sa mort[20]. Mon père me permit avec difficulté d'y placer un tableau de toile cirée et d'y étudier les mathématiques en 1798, mais aucun domestique n'y entrait, il eût été sévèrement grondé, moi seul j'en avais la clef. Ce sentiment de mon père lui fait beaucoup d'honneur à mes yeux, maintenant que j'y réfléchis.
Elle mourut donc dans sa chambre, rue des Vieux-Jésuites, la cinquième ou sixième maison à gauche en venant de la Grande-rue[21], vis-à-vis la maison de M. Teisseire. Là j'étais né, cette maison appartenait à mon père qui la vendit lorsqu'il se mit à bâtir sa rue nouvelle et à faire des folies. Cette rue, qui l'a ruiné, fut nommée rue Dauphin (mon père[p. 41] était extrêmement ultra, partisan des pr[êtres] et des nobles) et s'appelle, je crois, maintenant rue Lafayette.
Je passais ma vie chez mon grand-père, dont la maison était à peine à cent pas de la nôtre[22].
[1] Le chapitre III comprend les feuillets 43 à 59.—Écrit à Rome, les 27 et 30 novembre 1835.
[2] ... au sud de l'église du collège.—La porte de Bonne, en effet, a été démolie en 1832, lors de l'agrandissement de la partie sud-est de l'enceinte de Grenoble par le général Haxo, de 1832 à 1836.
[3] Ma tante Séraphie ...—Sœur cadette de la mère de Beyle. Sur les membres de la famille Gagnon, voir plus loin, chapitre VII, et l'Annexe IV.
[4] ... coupant ces joncs en morceaux ...—Variante: «Bouts.»
[5] ... Mlle Elisabeth Gagnon.—Elisabeth Gagnon, sœur d'Henri Gagnon, grand-père maternel de Beyle.
[6] ... je pouvais avoir quatre ans.—On lit, à ce sujet, sur un feuillet intercalé en face du fol. 8: «M. Gagnon achète la maison voisine de madame de Marnais, on change d'appartement, j'écris partout sur le plâtre des happes: «Henri Beyle, 1789.» Je vois encore cette belle inscription qui émerveillait mon bon grand-père.
«Donc, mon attentat à la vie de madame Chenavaz est antérieur à 1789.»]
[7] ... mon horreur pour la religion ...—Ms.: «Gion.»
[8] ... forcené dans ces temps-là, pour la ...—Mot illisible.
[9] Je n'avais pas plus de cinq ans.—Variante: «Je pouvais avoir quatre ou cinq ans.»
[10] ... une terrasse élégante ornée de fleurs.—Il s'agit du cabinet d'été d'Henri Gagnon. Voir notre plan de l'appartement Gagnon.
[11] ... un petit chapeau triangulaire à mettre sous le bras ...—Dans la marge, Stendhal a fait un dessin grossier représentant le chapeau de son grand-père.
[12] ... pour cent-vingt francs ...—Ce portrait est de Boilly. Il fait partie actuellement de la collection Lesbros.
[13] ... la bataille de l'Assiettex ...en 1742, je crois.—Cette bataille eut lieu pendant la guerre de la Succession d'Autriche. Le 19 juillet 1747, le chevalier de Belle-Isle, frère du maréchal, voulant envahir le Piémont, fut repoussé au col de l'Assiette, entre Exiles et Fénestrelles.
[14] ... entre autres une gippe ...—Terme local, encore en usage à Grenoble.
[15] Je ne soupçonnais ...—Variante: «Savais.»
[16] ... un des deux ou trois peut-être ...—Stendhal a d'abord écrit: «un de ceux p», puis il continue: «des deux ou trois peut-être». Il semble que, dans ces conditions, la leçon «un de ceux p» doive être supprimée, quoique n'ayant pas été rayée par l'auteur.
[17] ... et enfin lisait ...—La lecture de cette ligne et de la précédente est très incertaine. Cette partie du texte est fort mal écrite. Stendhal s'en excuse dans la marge en disant: «Écrit de nuit à la hâte.»
[18] ... ce que j'aimais le plus au monde.—Entre cet alinéa et le suivant, Stendhal a laissé un large espace où il a écrit le mot: «Chapitre.»
[19] ... pour atteindre plus vite à son lit.—Entre cet alinéa et le suivant, nouvel espace assez large, marqué d'une +.
[20] Sa chambre est restée fermée dix ans après sa mort.—En marge de cet alinéa, Stendhal a fait un croquis représentant la chambre de sa mère, avec une notice explicative.
[21] ... en venant de la Grands-rue ...—Aujourd'hui rue Jean-Jacques-Rousseau, n° 14.—Voir l'Appendice II, la Maison natale de Stendhal, par M. Samuel Chabert.
[22] ... à peine à cent pas de la nôtre.—Dans la marge, Stendhal a dessiné un croquis donnant la situation respective de la maison de son père, de celle de son grand-père, et de la maison de Marnais. Un autre dessin plus grand est ajouté au manuscrit. Il représente la «partie de la ville de Grenoble en 1793» comprise entre la rue Lafayette, la rue Saint-Jacques, la place Grenette (où sont figurés l'«arbre de la Liberté», l' «arbre de la Fraternité» et la «pompe ancienne»), la Grande-rue et la rue des Vieux-Jésuites (aujourd'hui rue Jean-Jacques-Rousseau).—La maison occupée par Henri Gagnon porte actuellement le n° 20 de la Grande-rue et le n° 2 de la place Grenette.
Au verso, nouveau testament, ainsi conçu:
«Testament.
Je lègue et donne la Vie de Henri Brulard, écrite par lui-même, à M. Alphonse Levavasseur, place Vendôme, et après lui à MM. Philarète Chasles, Henri Foumier, Amyot, sous la condition de changer tous les noms de femme et aucun nom d'homme.
Cività-Vecchia, le 1er décembre 1835.
H. BEYLE.»
J'écrirais un volume sur les circonstances de la mort d'une personne si chère[2].
C'est-à-dire: j'ignore absolument les détails, elle était morte en couches, apparemment par la maladresse d'un chirurgien nommé Hérault, sot choisi apparemment par pique contre un autre accoucheur, homme d'esprit et de talent, c'est ainsi à peu près que mourut Mme Petit en 1814. Je ne puis décrire au long que mes sentiments, qui probablement sembleraient exagérés ou incroyables au spectateur accoutumé à la nature fausse des romans (je ne parle pas de Fielding) ou à la nature étiolée des romans construits avec des cœurs de Paris.
J'apprends au lecteur que le Dauphiné a une manière de sentir à soi, vive, opiniâtre, raisonneuse, que je n'ai rencontrée en aucun pays. Pour des yeux clairvoyants, à tous les trois degrés de latitude la musique, les paysages et les romans devraient changer. Par exemple, à Valence, sur le Rhône, la nature provençale finit, la nature bourguignonne commence à Valence et fait place, entre Dijon et Troyes, à la nature parisienne, polie, spirituelle, sans profondeur, en un mot songeant beaucoup aux autres.
La nature dauphinoise a une ténacité, une profondeur, un esprit, une finesse que l'on chercherait en vain dans la civilisation provençale ou dans la bourguignonne, ses voisines. Là où le Provençal s'exhale en injures atroces, le Dauphinois réfléchit et s'entretient avec son cœur.
Tout le monde sait que le Dauphiné a été un Etat séparé de la France et à-demi italien par sa politique jusqu'à l'an 1349[3]. Ensuite Louis XI, dauphin, brouillé avec son père, administra le pays pendant seize[4] ans, et je croirais assez que c'est ce génie profond et profondément timide et ennemi des premiers mouvements qui a donné son empreinte au caractère dauphinois. De mon temps encore, dans la croyance de mon grand-père et de ma tante Elisabeth, véritable type des sentiments énergiques et généreux de la famille, Paris n'était point un modèle, c'était une ville éloignée et ennemie dont il fallait redouter l'influence.
Maintenant que j'ai fait la cour aux lecteurs peu sensibles par cette digression, je raconterai que, la veille de la mort de ma mère, on nous mena promener, ma sœur Pauline et moi, rue Montorge: nous revînmes le long des maisons à gauche de cette rue (au Nord). On nous avait établis chez mon grand-père, dans la maison sur la place Grenette. Je couchais sur le plancher, sur un matelas, entre le fenêtre et la cheminée, lorsque sur les deux heures du matin toute la famille rentra en poussant des sanglots.
«Mais comment les médecins n'ont pas trouvé de remèdes?» disais-je à la vieille Marion (vraie servante de Molière, amie de ses maîtres mais leur disant bien son mot, qui avait vu ma mère fort jeune, qui l'avait vu marier dix ans auparavant, en 1780) et qui m'aimait beaucoup.
Marie Thomasset, de Vinay, vrai type de caractère dauphinois, appelée du diminutif Marion, passa la nuit assise à côté de mon matelas, pleurant à chaudes larmes et chargée apparemment de me contenir. J'étais beaucoup plus étonné que désespéré, je ne comprenais pas la mort, j'y croyais peu.
«Quoi, disais-je à Marion, je ne la reverrai jamais?
—Comment veux-tu la revoir, si on l'emportera (sic) au cimetière?
—Et où est-il, le cimetière?
—Rue des Mûriers, c'est celui de la paroisse Notre-Dame.»
Tout le dialogue de cette nuit m'est encore présent, et il ne tiendrait qu'à moi de le transcrire ici. Là véritablement a commencé ma vie morale, je devais avoir six ans et demi. Au reste, ces dates sont faciles à vérifier par les actes de l'état-civil.
Je m'endormis; le lendemain, à mon réveil, Marion me dit:
«Il faut aller embrasser ton père.
—Comment, ma petite maman est morte! mais comment est-ce que je ne la reverrai plus?
—Veux-tu bien te taire, ton père t'entend, il est là, dans le lit de la grand'tante.»
J'allai avec répugnance dans la ruelle de ce lit qui était obscure parce que les rideaux étaient fermés. J'avais de l'éloignement pour mon père et de la répugnance à l'embrasser.
Un instant après arriva l'abbé Rey, un homme fort grand, très froid, marqué[5] de petite vérole, l'air sans esprit et bon, parlant du nez, qui bientôt après fut grand vicaire. C'était un ami de la famille.
Le croira-t-on? à cause de son état de prêtre j'avais de l'antipathie pour lui.
M. l'abbé Rey se plaça près de la fenêtre, mon père se leva, passa sa robe de chambre, sortit de l'alcôve fermée par des rideaux de serge verte (il y avait d'autres beaux rideaux de taffetas rose, brodés de blanc, qui le jour cachaient les autres).
L'abbé Rey embrassa mon père en silence, je trouvai mon père bien laid, il avait les yeux gonflés, et les larmes le gagnaient à tous moments. J'étais resté dans l'alcôve obscure et je voyais fort bien.
«Mon ami, ceci vient de Dieu», dit enfin l'abbé; et ce mot, dit par un homme que je haïssais à un autre que je n'aimais guère, me fit réfléchir profondément.
On me croira insensible, je n'étais encore qu'étonné de la mort de ma mère. Je ne comprenais pas ce mot. Oserai-je écrire ce que Marion m'a souvent répété depuis en forme de reproche? Je me mis à dire du mal de God.
Au reste, supposons que je mente sur ces pointes d'esprit qui percent le sol, certainement je ne mens pas sur tout le reste. Si je suis tenté de mentir, ce sera plus tard, quand il s'agira de très grandes fautes, bien postérieures. Je n'ai aucune foi dans l'esprit des enfants annonçant un homme supérieur. Dans un genre moins sujet à illusions, car enfin les monuments restent, tous les mauvais peintres que j'ai connus ont fait des choses étonnantes vers huit ou dix ans et annonçant le génie.[6]
Hélas! rien n'annonce le génie, peut-être l'opiniâtreté serait un signe [7].
Le lendemain, il fut question de l'enterrement; mon père, dont la figure était réellement absolument changée, me revêtit d'une sorte de manteau[p. 48] en laine noire[8] qu'il me lia an cou. La scène se passa dans le cabinet de mon père, rue des Vieux-Jésuites: mon père était noir et tout le cabinet tapissé d'in-folio funèbres, horribles à voir. La seule Encyclopédie de d'Alembert et Diderot, brochée en bleu, faisait exception à la laideur générale.
Ce .... de droit avait[9] appartenu à M. de Brenier, mari de Mlle de Vaulserre et comte de...[10] Mlle de Vaulserre donna ce titre à son mari; dès lors on avait changé de nom. Vaulserre étant plus noble et plus beau que de Brenier. Depuis, elle s'était faite chanoinesse[11].
Tous les parents et amis se réunirent dans le cabinet de mon père[12].
Revêtu de ma mante noire, j'étais entre les genoux de mon père[en] 1 [13]. M. Picot, le père, notre cousin, homme sérieux, mais du sérieux d'un homme de cour, et fort respecté dans la famille comme esprit de conduite (il était maigre, cinquante-cinq ans et la tournure la plus distinguée), entra et se plaça en 3.
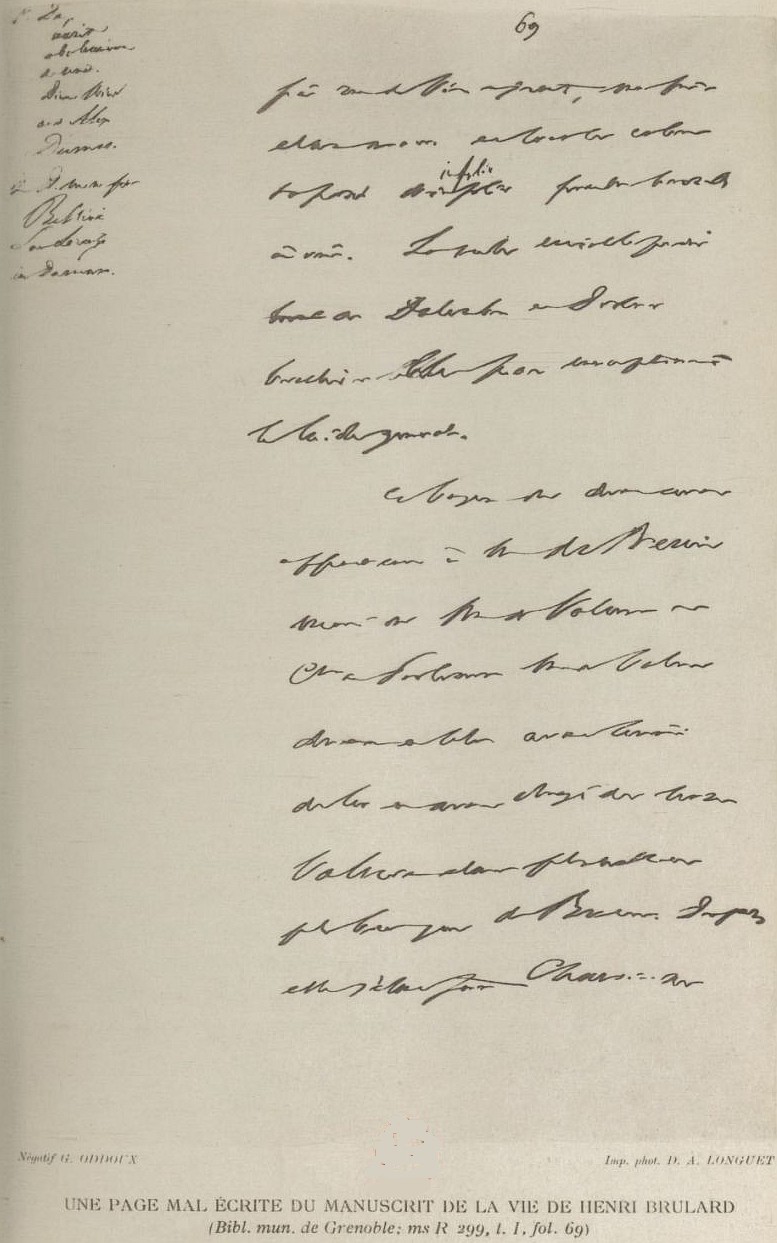
UNE PAGE MAL ÉCRITE DU MANUSCRIT DE LA VIE DE HENRI BRULARD (Bibl. mun. de Grenoble: ms R 299, t. 1, fol. 69)
Au lieu de pleurer et d'être triste, il se mit à faire la conversation comme à l'ordinaire et à parler de la Cour. (Peut-être était-ce la Cour du Parlement, c'est fort probable.) Je crus qu'il parlait des Cours étrangères et je fus profondément choqué de son insensibilité.
Un instant après entra mon oncle, le frère de ma mère, jeune homme on ne peut pas mieux fait et on[p. 49] ne peut pas plus agréable et vêtu avec la dernière élégance. C'était l'homme à bonnes fortunes de la ville, lui aussi se mit à faire la conversation comme à l'ordinaire avec M. Picot; il se plaça en 4. Je fus violemment indigné et je me souvins que mon père l'appelait un homme léger. Cependant je remarquai qu'il avait les yeux fort rouges, et il avait la plus jolie figure, cela me calma un peu.
Il était coiffé avec la dernière élégance et une poudre qui embaumait; cette coiffure consistait en une bourse carrée de taffetas noir et deux grandes oreilles de chien (tel fut leur nom six ans plus tard), comme en porte encore aujourd'hui M. le prince de Talleyrand.
Il se fit un grand bruit, c'était la bière de ma pauvre mère que l'on prenait au salon pour l'emporter.
«Ah! çà, je ne sais pas l'ordre de ces cérémonies», dit d'un air indifférent[14] M. Picot en se levant, ce qui me choqua fort; ce fut là ma dernière sensation sociale. En entrant au salon et voyant la bière couverte du drap noir où était ma mère, je fus saisi du plus violent désespoir, je comprenais enfin ce que c'était que la mort.
Ma tante Séraphie m'avait déjà accusé d'être insensible.
J'épargnerai au lecteur le récit de toutes les phases de mon désespoir à l'église paroissiale de Saint-Hugues. J'étouffais, on fut obligé, je crois, de[p. 50] m'emmener parce que ma douleur faisait trop de bruit. Je n'ai jamais pu regarder de sang-froid cette église de Saint-Hugues et la cathédrale qui est attenante[15]. Le son seul des cloches de la cathédrale, même en 1828, quand je suis allé revoir Grenoble, m'a donné une tristesse morne, sèche, sans attendrissement, de cette tristesse voisine de la colère.
En arrivant au cimetière, qui était dans un bastion près de la rue des Mûriers[16] (aujourd'hui, du moins en 1828, occupé par un grand bâtiment, magasin du génie), je fis des folies que Marion m'a racontées depuis. Il paraît que je ne voulais pas qu'on jetât de la terre sur la bière de ma mère, prétendant qu'on lui ferait mal. Mais
Sur les noires couleurs d'un si triste tableau
Il faut passer l'éponge ou tirer le rideau.
Par suite du jeu compliqué des caractères de ma famille, il se trouva qu'avec ma mère finit toute la joie de mon enfance.
[1] Le chapitre IV comprend les feuillets 60 à 74.—Écrit les 1er et 2 décembre 1835.
[2] ... les circonstances de la mort d'une personne si chère.—En surcharge: «Je remplirais des volumes si j'entreprenais de décrire tous les souvenirs enchanteurs des choses que j'ai vues ou avec ma mère, ou de son temps.» Ni le premier texte, ni celui-ci, ne conviennent absolument. Nous conservons la première leçon de Stendhal, qui n'a pas été rayée par lui, et qui correspond mieux au contexte.—Henriette Gagnon, mère de Stendhal, mourut le 23 novembre 1790.
[3] ... jusqu'à l'an 1349.—Une partie de la date est en blanc.—Le Dauphiné fut cédé au roi de France Philippe VI par le dauphin Humbert II.
[4] ...pendant seize ans ...—Egalement en blanc.—Louis XI gouverna le Dauphiné depuis 1440 jusqu'à sa retraite auprès de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en août 1456.
[5] ... marqué de petite vérole ...—Variante: «Creusé.»
[6] ... et annonçant le génie.—Dans la marge du fol. 68, on lit: «Écrit de nuit, le 1er déc. 35.» De fait, l'écriture de ce passage est particulièrement mauvaise.
[7] ... peut-être l'opiniâtreté serait un signe.—Variante: «Peut-être l'opiniâtreté est-elle un signe.»
[8] ... en laine noire ...—Variante: «Noir.»
[9]—Ce ... de droit avait ...—Un mot illisible. La lecture des autres mots est incertaine.
[10] ... Mlle de Vaulserre et comte de ...—Mot illisible. Ce titre de comte nous est totalement inconnu dans l'une comme dans l'autre des familles de Brenier et de Vaulserre.
[11] Depuis elle s'était faite chanoinesse.—Angélique-Françoise-Marie-Louise-Elisabeth-Gabrielle de Vaulserre, née le 4 mars 1754, épousa, le 10 juillet 1780, Jean-Antoine de Brenier. Elle mourut le 11 février 1812.
[12] Tous les parents et amis se réunirent dans le cabinet de mon père.—En haut du fol. 70 on lit la date: «2 décembre 1835.»
Presque toute la page est occupée par un plan intitulé: «Corps de logis où je fus placé avec mon précepteur, M. l'abbé Raillane.» Stendhal y indique, dans le cabinet de son père, la place de celui-ci, «dans un fauteuil» (1), et celles de M. Picot (3) et de Romain Gagnon (4).]
[13] ... j'étais entre les genoux de mon père en 1.—Les numéros correspondent au plan ci-dessus: M. Beyle et Henri sont placés près de la cheminée, MM. Picot et Romain Gagnon contre le mur opposé.
[14] ... dit d'un air indifférent M. Picot ...—Les mots: «d'un air indifférent» sont en interligne, entre les mots «cérémonies, dit M.» et: a choqua fort; ce fut.»
[15] ... la cathédrale qui est attenante.—En marge est un plan grossier de l'église Saint-Hugues et de la cathédrale. Le même plan, plus précis, se trouve reproduit en face du fol. 73 (verso du fol. 72).
[16] ... cimetière, qui était dans un bastion près de la rue des Mûriers ...—Voir l'emplacement du cimetière sur notre plan de Grenoble en 1793.—Le cimetière de la rue des Mûriers a été désaffecté en l'an VIII.
A l'époque où nous[2] occupions le premier étage sur la place Grenette, avant 1790 ou plus exactement jusqu'au milieu de 1789, mon oncle, jeune avocat, avait un joli petit appartement au second, au coin de la place Grenette et de la Grande-rue[3]. Il riait avec moi, et me permettait de le voir dépouiller ses beaux habits et prendre sa robe de chambre, le soir, à neuf heures, avant souper. C'était un moment délicieux pour moi, et je redescendais tout joyeux au premier étage en portant devant lui le flambeau d'argent. Mon aristocrate famille se serait crue déshonorée si le flambeau n'avait pas été d'argent. Il est vrai qu'il ne portait pas la noble bougie, l'usage était alors de se servir de chandelle.[p. 52] Mais cette chandelle, on la faisait venir avec grand soin et en caisse des environs de Briançon; on voulait qu'elle fût faite avec du suif de chèvre, on écrivait pour cela en temps utile à un ami qu'on avait dans ces montagnes. Je me vois encore assistant au déballement de la chandelle et mangeant du lait avec du pain dans l'écuelle d'argent; le frottement de la cuiller contre le fond de l'écuelle mouillé de lait me frappait comme singulier. C'étaient presque des relations d'hôte à hôte, comme on les voit dans Homère, que celles qu'on avait avec cet ami de Briançon, suite naturelle de la défiance et de la barbarie générales[4].
Mon oncle, jeune, brillant, léger, passait pour l'homme le plus aimable de la ville, au point que, bien des années après, madame Delaunay, voulant justifier sa vertu, laquelle pourtant avait fait tant de faux-pas: «Pourtant, disait-elle, je n'ai jamais cédé à M. Gagnon fils.»
Mon oncle, dis-je, se moquait fort de la gravité de son père, lequel, le rencontrant dans le monde avec de riches habits qu'il n'avait pas payés, était fort étonné. «Je m'éclipsais au plus vite», ajoutait mon oncle qui me racontait ce cas.
Un soir, malgré tout le monde (mais quels étaient donc les opposants avant 1790?), il me mena au spectacle. On jouait Le Cid.
«Mais cet enfant est fou», dit mon excellent grand-père à mon retour, son amour pour les lettres[p. 53] l'avait empêché de s'opposer bien sérieusement à ma course[5] au spectacle. Je vis donc jouer Le Cid, mais, ce me semble, en habits de satin bleu de ciel avec des souliers de satin blanc.
En disant les Stances, ou ailleurs, en maniant une épée avec trop de feu, le Cid se blessa à l'œil droit.
«Un peu plus, dit-on autour de moi, il se crevait l'œil.» J'étais aux premières loges, la seconde à droite[6].
Une autre fois, mon oncle eut la complaisance de me mener à la Caravane du Caire. (Je le gênais dans ses évolutions autour, auprès des dames. Je m'en apercevais fort bien[7].) Les chameaux me firent absolument perdre la tête, L'Infante de Zamora, où un poltron, ou bien un cuisinier, chantait une ariette, portant un casque avec un rat pour cimier, me charma jusqu'au délire. C'était pour moi le vrai comique.
Je me disais, fort obscurément sans doute, et pas aussi nettement que je l'écris ici: «Tous les moments de la vie de mon oncle sont aussi délicieux que ceux dont je partage le plaisir au spectacle. La plus belle chose du monde est donc d'être un homme aimable, comme mon oncle. » Il n'entrait pas dans ma tête de cinq ans que mon oncle ne fût pas aussi heureux que moi en voyant défiler les chameaux de la Caravane.
Mais j'allai trop loin: au lieu d'être galant, je[p. 54] devins passionné auprès des femmes que j'aimais, presque indifférent et surtout sans vanité pour les autres, de là le manque de succès et le fiasco. Peut-être aucun homme de la Cour de l'Empereur n'a eu moins de femmes que moi, que l'on croyait l'amant de la femme du premier ministre.
Le spectacle, le son d'une belle cloche grave (comme à l'église de...[8], au-dessus de Rolle, en mai 1800, allant au Saint-Bernard) sont et furent toujours d'un effet profond sur mon cœur. La messe même, à laquelle je croyais si peu, m'inspirait de la gravité. Bien jeune encore, et certainement avant dix ans et le billet de l'abbé Gardon, je croyais que God méprisait ces jongleurs. (Après quarante-deux ans de réflexions, j'en suis encore la mystification, trop utile à ceux qui la pratiquent pour ne pas trouver toujours des continuateurs. Histoire de la médaille, que raconta avant-hier Umbert Guitri, décembre 1835.)
J'ai le souvenir le plus net et le plus clair de la perruque ronde et poudrée de mon grand-père, elle avait trois rangs de boucles. Il ne portait jamais de chapeau.
Ce costume avait contribué, ce me semble, à le faire connaître et respecter du peuple, duquel il ne prenait jamais d'argent pour ses soins comme médecin.
Il était le médecin et l'ami de la plupart des maisons nobles. M. de Chaléon, dont je me rappelle[p. 55] encore le son des clercs[9] sonnés à Saint-Louis lors de sa mort; M. de Lacoste, qui eut une apoplexie dans les Terres-Froides, à La Frette; M. de Langon, d'une haute noblesse, disaient les sots; M. de Ravix, qui avait la gale et jetait son manteau à terre sur le plancher, dans la chambre de mon grand-père, qui me gronda avec une mesure parfaite parce que, après avoir parlé de cette circonstance, j'articulai le nom de[10] M. de Ravix; M. et Mme des Adrets, Mme de Vaulserre, leur fille, dans le salon de laquelle je vis le monde pour la première fois. Sa sœur, Mme de M......., me semblait bien jolie et passait pour fort galante[11].
Il était et avait été depuis vingt-cinq ans, à l'époque où je l'ai connu, le promoteur de toutes les entreprises utiles et que, vu l'époque d'enfance politique de ces temps reculés (1760), on pourrait appeler libérales. On lui doit la Bibliothèque[12]. Ce ne fut pas une petite affaire. Il fallut d'abord l'acheter, puis la placer, puis doter le bibliothécaire.
Il protégeait, d'abord contre leurs parents, puis plus efficacement, tous les jeunes gens qui montraient l'amour de l'étude. Il citait aux parents récalcitrants l'exemple de Vaucanson.
Quand mon grand-père revint de Montpellier à Grenoble (docteur en médecine), il avait une fort belle chevelure, mais l'opinion publique de 1760 lui déclara impérieusement que s'il ne prenait pas[p. 56] perruque personne n'aurait confiance en lui. Une vieille cousine Didier, qui le fit héritier avec ma tante Elisabeth et mourut vers 1788, avait été de cet avis. Cette bonne cousine me faisait manger du pain jaune (avec du safran) quand j'allais la voir le jour de Saint-Laurent. Elle demeurait dans la rue auprès de l'église de Saint-Laurent. Dans la même rue mon ancienne bonne Françoise, que toujours j'adorai, avait une boutique d'épicerie, elle avait quitté ma mère pour se marier. Elle fut remplacée par la belle Geneviève, sa sœur, auprès de laquelle mon père, dit-on, était galant.
La chambre de mon grand-père, au premier étage sur la Grenette, était peinte en gros vert et mon père me disait dès ce temps-là:
«Le grand-papa, qui a tant d'esprit, n'a pas de bon goût pour les arts.»
Le caractère timide des Français fait qu'ils emploient rarement les couleurs franches: vert, rouge, bleu, jaune vif; ils préfèrent les nuances indécises. A cela près, je ne vois pas ce qu'il y avait à blâmer dans le choix de mon grand-père. Sa chambre était en plein midi, il lisait énormément, il voulait ménager ses yeux, desquels il se plaignait quelquefois.
Mais le lecteur, s'il s'en trouve jamais pour ces fadaises[13], verra sans peine que tous mes pourquoi, toutes mes explications, peuvent être très fautives. Je n'ai que des images fort nettes, toutes mes explications[p. 57] me viennent en écrivant ceci, quarante-cinq ans après les événements[14].
Mon excellent grand-père, qui dans le fait fut mon véritable père et mon ami intime jusqu'à mon parti pris, vers 1796, de me tirer de Grenoble par les mathématiques, racontait souvent une chose merveilleuse.
Ma mère m'ayant fait porter dans sa chambre (verte), le jour où j'avais un an, 23 janvier 1784[15], me tenait debout près de la fenêtre; mon grand-père, placé vers le lit, m'appelait, je me déterminai à marcher et arrivai jusqu'à lui.
Alors je parlais un peu et pour saluer je disais hateus. Mon oncle plaisantait sa sœur Henriette (ma mère) sur ma laideur. Il paraît que j'avais une tête énorme, sans cheveux, et que je ressemblais au Père Brulard[16], un moine adroit, bon vivant et à grande influence sur son couvent, mon oncle ou grand-oncle, mort avant moi.
J'étais fort entreprenant, de là deux accidents racontés avec terreur et regret par mon grand-père: vers le rocher de la Porte-de-France je piquai avec un morceau de fagot appointé, taillé en pointe avec un couteau, un mulet qui eut l'impudence de me camper ses deux fers dans la poitrine, il me renversa. «Un peu plus, il était mort», disait mon grand-père[17].
Je me figure l'événement, mais probablement ce[p. 58] n'est pas un souvenir direct, ce n'est que le souvenir de l'image que je me formai de la chose, fort anciennement et à l'époque des premiers récits qu'on m'en fit.
Le second événement tragique fut qu'entre ma mère et mon grand-père je me cassai deux dents de devant en tombant sur le coin d'une chaise. Mon bon grand-père ne revenait pas de son étonnement: «Entre sa mère et moi!» répétait-il, comme pour déplorer la force de la fatalité.
Le grand trait, à mes yeux, de l'appartement au premier étage, c'est que j'entendais le bruissement de la barre de fer à l'aide de laquelle on pompait, ce gémissement prolongé et point aigre me plaisait fort.
Le bon sens dauphinois se révolta à peu près contre la Cour. Je me souviens fort bien du départ de mon grand-père pour les Etats de Romans, il était alors patriote fort considéré, mais des plus modérés; on peut se figurer Fontenelle tribun du peuple.
Le jour du départ, il faisait un froid à pierre fendre (ce fut (à vérifier) le grand hiver de 1789 à 1790[18], il y avait un pied de neige sur la place Grenette).
Dans la cheminée de la chambre de mon grand-père, il y avait un feu énorme. La chambre était remplie d'amis qui venaient voir monter en voiture.[p. 59] Le plus célèbre avocat consultant de la ville, l'oracle en matière de droit, belle place dans une ville de Parlement, M. Barthélemy d'Orbane, ami intime de la famille, était en O et moi en H [19], devant le feu pétillant. J'étais le héros du moment, car je suis convaincu que mon grand-père ne regrettait que moi à Grenoble et n'aimait que moi.
Dans cette position, M. Barthélemy d'Orbane m'apprit à faire des grimaces. Je le vois encore et moi aussi. C'est un art dans lequel je fis les plus rapides progrès, je riais moi-même des mines que je faisais pour faire rire les autres. Ce fut en vain qu'on s'opposa bientôt au goût croissant des grimaces, il dure encore, je ris souvent des mines que je fais quand je suis seul.
Dans la rue un fat passe avec une mine affectée (M. Lysimaque[20], par exemple, ou M. le comte ..., amant de Mme Del Monte), j'imite sa mine et je ris. Mon instinct est plutôt d'imiter les mouvements ou plutôt les positions affectées de la figure (face) que ceux du corps. Au Conseil d'Etat, j'imitais sans le vouloir et d'une façon fort dangereuse l'air d'importance du fameux comte Regnault de Saint-Jean-d'Angely, placé à trois pas de moi, particulièrement quand, pour mieux écouter le colérique abbé Louis, placé de l'autre côté de la salle vis-à-vis de lui, il abaissait les cols démesurément longs de sa chemise[21]. Cet instinct ou cet art que je dois à M. d'Orbane m'a fait beaucoup d'ennemis. Actuellement,[p. 60] le sage di Fiore me reproche l'ironie cachée, ou plutôt mal cachée, et apparente malgré moi dans le coin droit de la bouche.
A Romans, il ne manqua que cinq voix à mon grand-père pour être député. «J'y serais mort», répétait-il souvent en se félicitant d'avoir refusé les voix de plusieurs bourgeois de campagne qui avaient confiance en lui et venaient le consulter le matin chez lui. Sa prudence à la Fontenelle l'empêchait d'avoir une ambition sérieuse, il aimait beaucoup cependant à faire un discours devant une assemblée choisie, par exemple à la Bibliothèque[22]. Je m'y vois encore, l'écoutant dans la première salle remplie de monde, et immense à mes yeux. Mais pourquoi ce monde? à quelle occasion? C'est ce que l'image ne me dit pas. Elle n'est qu'image.
Mon grand-père nous racontait souvent qu'à Romans son encre, placée sur la cheminée bien chauffée, gelait au bout de sa plume. Il ne fut pas nommé, mais fit nommer un député ou deux dont j'ai oublié les noms, mais lui n'oubliait pas le service qu'il leur avait rendu et les suivait des yeux dans l'assemblée, où il blâmait leur énergie.
J'aimais beaucoup M. d'Orbane ainsi que le gros chanoine son frère, j'allais les voir place des Tilleuls ou sous la voûte qui de la place Notre-Dame conduisait à celle des Tilleuls, à deux pas de Notre-Dame, où le chanoine chantait. Mon père ou mon[p. 61] grand-père envoyait à l'avocat célèbre des dindons gras à l'occasion de Noël[23].
J'aimais aussi beaucoup le Père Ducros, cordelier défroqué (du couvent situé entre le Jardin-de-Ville et l'hôtel de Franquières lequel, à mon souvenir, me semble style de la Renaissance).
J'aimais encore l'aimable abbé Chélan, curé de Risset près Claix, petit homme maigre, tout nerfs, tout feu, pétillant d'esprit, déjà d'un certain âge, qui me paraissait vieux, mais n'avait peut-être que quarante ou quarante-cinq ans et dont les discussions à table m'amusaient infiniment. Il ne manquait pas de venir dîner chez mon grand-père quand il venait à Grenoble, et le dîner était bien plus gai qu'à l'ordinaire.
Un jour, à souper, il parlait depuis trois-quarts d'heure en tenant à la main une cuillerée de fraises[24]. Enfin il porta la cuiller à la bouche.
«L'abbé, vous ne direz pas votre messe demain, dit mon grand-père.
—Pardonnez-moi, je la dirai demain, mais non pas aujourd'hui, car il est minuit passé.» Ce dialogue fit ma joie pendant un mois, cela me paraissait pétillant d'esprit. Tel est l'esprit pour un peuple ou pour un homme jeune, l'émotion est en eux;—voir les réponses d'esprit admirées par Boccace ou Vasari.
Mon grand-père, en ces temps heureux, prenait la religion fort gaiement, et ces Messieurs étaient[p. 62] de son avis; il ne devint triste et un peu religieux qu'après la mort de ma mère (en 1790), et encore, je pense, par l'espoir incertain de la retrouver—revoir—dans l'autre monde, comme M. de Broglie[25] qui dit en parlant de son aimable fille, morte à treize ans:
«Il me semble que ma fille est en Amérique.»
Je crois que M. l'abbé Chélan dînait à la maison[26] lors de la journée des tuiles. Ce jour-là, je vis couler le premier sang répandu par la Révolution française. C'était un malheureux ouvrier chapelier (S), blessé à mort par un coup de baïonnette (S') au bas du dos.
On quitta [la] table au milieu du dîner (T). J'étais en H et le curé Chélan en C.
Je chercherai la date dans quelque chronologie. L'image est on ne peut plus nette chez moi, il y a peut-être de cela quarante-trois ans[27].
Un M. de Clermont-Tonnerre, commandant en Dauphiné et qui occupait l'hôtel du Gouvernement, maison isolée donnant sur le rempart (avec une vue superbe sur les coteaux d'Eybens, une vue tranquille et belle, digne de Claude Lorrain) et une entrée par une belle cour rue Neuve, près de la rue des Mûriers, voulut, ce me semble, dissiper un rassemblement; il avait deux régiments, contre lesquels le peuple se défendit avec les tuiles qu'il[p. 63] jetait du liant des maisons, de là le nom: Journée des tuiles[28].
Un des sous-officiers de ces régiments était Bernadotte, actuel roi de Suède, une âme aussi noble que celle de Murat, roi de Naples, mais bien autrement adroit. Lefèvre, perruquier et ami de mon père, nous a souvent raconté qu'il avait sauvé la vie au général Bernadotte (comme il disait en 1804), vivement pressé au fond d'une allée. Lefèvre était un bel homme fort brave, et le maréchal Bernadotte lui avait envoyé un cadeau.
Mais tout ceci est de l'histoire, à la vérité racontée par des témoins oculaires, mais que je n'ai pas vue. Je ne veux dire à l'avenir, en Russie et ailleurs, que ce que j'ai vu.
Mes parents ayant quitté le dîner avant la fin et moi étant seul à la fenêtre de la salle-à-manger, ou plutôt à la fenêtre d'une chambre donnant sur la Grande-rue, je vis une vieille femme qui, tenant à la main ses vieux souliers, criait de toutes ses forces: «Je me révorte! Je me révorte!»
Elle allait de la place Grenette à la Grande-rue. Je la vis en R [29]. Le ridicule de cette révolte me frappa beaucoup. Une vieille femme contre un régiment me frappa beaucoup. Le soir même, mon grand-père me raconta la mort de Pyrrhus.
Je pensais encore à la vieille femme quand je fus distrait[30] par un spectacle tragique en O. Un ouvrier chapelier, blessé dans le dos d'un coup de[p. 64] baïonnette, à ce qu'on dit, marchait avec beaucoup de peine, soutenu par deux hommes sur les épaules desquels il avait les bras passés. Il était sans habit, sa chemise et son pantalon de nankin ou blanc étaient remplis de sang, je le vois encore, la blessure d'où le sang sortait abondamment était au bas du dos, à peu près vis-à-vis le nombril.
On le faisait marcher avec peine pour gagner sa chambre, située au sixième étage de la maison Périer[31], et en y arrivant il mourut.
Mes parents me grondaient et m'éloignaient de la fenêtre de la chambre de mon grand-père pour que je ne visse pas ce spectacle d'horreur, mais j'y revenais toujours. Cette fenêtre appartenait à un premier étage fort bas.
Je revis ce malheureux à tous les étages de l'escalier de la maison Périer, escalier éclairé par de grandes fenêtres donnant sur la place.
Ce souvenir, comme il est naturel, est le plus net qui me soit resté de ces temps-là.
Au contraire, je retrouve à grand'peine quelques vestiges du souvenir d'un feu de joie au Fontanil (route de Grenoble à Voreppe) où l'on venait de brûler Lamoignon. Je regrettai beaucoup la vue d'une grande figure de paille habillée, le fait est que mes parents, pensant bien et fort contrariés de tout ce qui s'écartait de l'ordre (l'ordre règne dans Varsovie, dit M. le général Sébastiani vers 1632), ne voulaient pas que je fusse frappé de ces preuves[p. 65] de la colère ou de la force du peuple. Moi, déjà à cet âge, j'étais de l'opinion contraire; on peut-être mon opinion à l'âge de huit ans est-elle cachée par celle, bien décidée, que j'eus à dix ans.
Une fois, MM. Barthélemy d'Orbane, le chanoine Barthélemy, M. l'abbé Rey, M. Bouvier, tout le monde, parlait chez mon grand-père de la prochaine arrivée de M. le maréchal de Vaux.
«Il vient faire ici une entrée de ballet», dit mon grand-père; ce mot que je ne compris pas me donna beaucoup à penser. Que pouvait-il y avoir de commun, me disais-je, entre un vieux maréchal et un balai?
Il mourut[32], le son majestueux des cloches m'émut profondément. On me mena voir la chapelle ardente (ce me semble, dans l'hôtel du Commandement, vers la rue des Mûriers, souvenir presque effacé); le spectacle de cette tombe noire et éclairée en plein jour par une quantité de cierges, les fenêtres étant fermées, me frappa. C'était l'idée de la mort paraissant pour la première fois. J'étais mené par Lambert, domestique (valet de chambre) de mon grand-père et mon intime ami. C'était un jeune et bel homme très dégourdi.
Un de ses amis à lui vint lui dire: «La fille du Maréchal n'est qu'une avare, ce qu'elle donne de drap noir aux tambours pour couvrir leur caisse ne suffit pas pour faire une culotte. Les tambours se plaignent beaucoup, l'usage est de donner ce qu'il[p. 66] faut pour faire une culotte. » De retour à la maison, je trouvai que mes parents parlaient aussi de l'avarice de cette fille du maréchal.
Le lendemain fut un jour de bataille pour moi. J'obtins avec grande difficulté, ce me semble, que Lambert me mènerait voir passer le convoi. Il y avait une foule énorme. Je me vois au point H[33], entre la grande route et l'eau, près le four à chaux, à deux cents pas en-deçà et à l'orient de la Porte-de-France.
Le son des tambours voilés par le petit coupon de drap noir non suffisant pour faire une culotte m'émut beaucoup. Mais voici bien une autre affaire: je me trouvais au point H, à l'extrême gauche d'un bataillon du régiment d'Austrasie, je crois, habit blanc et parements noirs, L est Lambert me donnant la main à moi, H. J'étais à six pouces du dernier soldat du régiment, S.
Il me dit tout-à-coup:
«Eloignez-vous un peu, afin qu'en tirant je ne vous fasse pas mal.»
On allait donc tirer! et tant de soldats! ils portaient l'arme renversée.
Je mourais de peur; je lorgnais de loin la voiture noire qui s'avançait lentement par le pont de pierre[34], tirée par six ou huit chevaux. J'attendais en frémissant la décharge. Enfin, l'officier fit un cri, immédiatement suivi de la décharge de feu. Je fus soulagé d'un grand poids. A ce moment, la foule se[p. 67] précipitait vers la voiture drapée que je vis avec beaucoup de plaisir, il me semble qu'il y avait des cierges.
On fit une seconde, peut-être une troisième décharge, hors de la Porte-de-France, mais j'étais aguerri[35].
Il me semble que je me souviens aussi un peu du départ pour Vizille (Etats de la province, tenus au château de Vizille, bâti par le connétable de Lesdiguières). Mon grand-père adorait les antiquités et me fit concevoir une idée sublime de ce château par la façon dont il en parlait. J'étais sur le point de concevoir de la vénération pour la noblesse, mais bientôt MM. de Saint-Ferréol et de Sinard, mes camarades, me guérirent.
On portait des matelas attachés derrière les chaises de poste (à deux roues).
Le jeune Mounier, comme disait mon grand-père, vint à la maison. C'est par l'effet d'une séparation violente que sa fille et moi n'avons pas conçu par la suite une passion violente l'un pour l'autre, dernière heure que je passai sous une porte cochère, rue Montmartre, vers le boulevard, pendant une averse, en 1803 ou 1804, lorsque M. Mounier alla remplir les fonctions de préfet à Rennes[36]. (Mes lettres à son fils Edouard, lettre de Victorine, à moi adressée. Le bon est qu'Edouard croit, ce me semble, que je suis allé à Rennes.)
Le petit portrait raide et mal peint que l'on voit dans une chambre attenant à la bibliothèque publique de Grenoble, et qui représente M. Mounier en habit de préfet, si je ne me trompe, est ressemblant[37]. Figure de fermeté, mais tête étroite. Son fils, que j'ai beaucoup connu en 1803 et en Russie en 1812 (Viasma sur Tripes)[38], est un plat, adroit et fin matois, vrai type de Dauphinois ainsi que le ministre Casimir Périer, mais ce dernier a trouvé plus Dauphinois que lui. Edouard Mounier en a l'accent traînant, quoique élevé à Weimar, il est pair de France et baron, et juge bravement à la Cour de Paris (1835, décembre). Le lecteur me croira-t-il si j'ose ajouter que je ne voudrais pas être à la place de MM. Félix Faure et Mounier, pairs de France et jadis de mes amis?
Mon grand-père, ami tendre et zélé de tous les jeunes gens qui aimaient à travailler, prêtait des livres à M. Mounier, et le soutenait contre le blâme de son père. Quelquefois, en passant dans la Grande-rue, il entrait dans la boutique de celui-ci et lui parlait de son fils. Le vieux marchand de drap, qui avait beaucoup d'enfants et ne songeait qu'à l'utile, voyait avec un chagrin mortel ce fils perdre son temps à lire.
Le fort de M. Mounier fils était le caractère, mais les lumières ne répondaient pas à la fermeté. Mon grand-père nous racontait en riant, quelques années[p. 69] après, que madame Borel, qui devait être la belle-mère de M. Mounier, étant venue acheter du drap, M. Mounier, commis de son père, déploya la pièce, fit manier le drap, et ajouta:
«Ce drap se vend vingt-sept livres l'aune.
—Hé bien! monsieur, je vous en donnerai vingt-cinq», dit madame Borel.
Sur quoi M. Mounier replia la pièce de drap, et la reporta[39] froidement dans sa case.
«Mais, monsieur! monsieur! dit Mme Borel étonnée, j'irai bien jusqu'à vingt-cinq livres dix sous.
—Madame, un honnête homme n'a que son mot.»
La bourgeoise fut fort scandalisée.
Ce même amour du travail chez les jeunes gens, qui rendrait mon grand-père si coupable aujourd'hui, lui faisait protéger le jeune Barnave[40].
Barnave était notre voisin de campagne, lui à Saint-Robert, nous à Saint-Vincent (route de Grenoble à Voreppe et Lyon). Séraphie le détestait et bientôt après applaudit à sa mort et au peu de bien qui restait à ses sœurs, dont l'une s'appelait, ce me semble, madame Saint-Germain. A chaque fois que nous passions à Saint-Robert: «Ah! voilà la maison de Barnave», disait Séraphie, et elle le traitait en dévote piquée. Mon grand-père, très bien venu des nobles, était l'oracle de la bourgeoisie, et je pense que la mère de l'immortel Barnave, qui le voyait[p. 70] avec peine négliger les procès pour Mably et Montesquieu, était calmée par mon grand-père. Dans ces temps-là, notre compatriote Mably passait pour quelque chose, et deux ans après on donna son nom à la rue des Clercs[41].
[1] Le chapitre V ne fait pas partie des trois volumes de la bibliothèque municipale de Grenoble cotés R 299. Il forme les feuillets 39 à 68 (numérotés en outre par Stendhal de 1 à 29) d'un cahier côté R 300, n° 1. Stendhal a écrit dans la marge du fol. 39: «A dicter et mettre à sa place page 75. Relier ce manuscrit à la fin du second.» Il indique encore, en marge du fol. 40: «Petits souvenirs. A placer à son rang vers 1791. Copier à gauche à son rang.» Enfin, un feuillet intercalaire porte: «Petits souvenirs, à placer after the recit of my mother death: Barthélémy d'Orbane. Départ pour Romans, grande neige. Départ pour Vizille. Haine de Séraphie pour les demoiselles Barnave. Décrire la campagne (maison de campagne) ... (un mot illisible) nous passons à Saint-Robert.»
D'autre part, Stendhal a écrit au verso du fol. 74 (ms. R 299, t. I): «A mon égard la plus noire méchanceté succède à la bonté et à la gaieté.
CHAPITRE 4 bis: SOMMAIRE
Voici les souvenirs qui après 23 X 2 ans me restent des jours heureux passés du temps de ma mère: Salons. Soupers. Le Père Chérubin Beyle. L'abbé Chélan. Je me révorte! Départ pour Romans. Barthélémy d'Orbane. M. Barthélemy m'apprend les grimaces.»
—En haut du fol. 39 (ms. R 300), on lit la date suivante: «17-22 décembre 1835, Omar.» On lit également au verso du fol. 38: «18 déc. 1835, de 2 à 4 h. 1/2, 14 pages. Je suis si absorbé par les souvenirs qui se dévoilent à mes yeux que je puis à peine former mes lettres.»
[2] A l'époque où nous occupions le premier étage ...—Variante: «Quand nous occupions ...»
[3] ... au coin de la place Grenette et de la Grande-rue.—17 déc. 1835. Je souffre du froid, collé contre la cheminée. La cuisse gauche est gelée. (Note de Stendhal.)
[4] ... suite naturelle de la défiance et de la barbarie générales.—Style. Ordre des idées. Préparer l'attention par quelques mots en parlant: 1° de Lambert;—2° sur mon oncle, dans les premiers chapitres. 17 déc. 35. (Note de Stendhal.)—Autre note de Stendhal: «Style. Rapport des mots aux idées: directeur à l'Académie, artiste, Saint-Marc-Girardin, chevalier of Konig von Janfoutre, Débats.»
[5] ... de s'opposer bien sérieusement à ma course au spectacle.—Il y a un blanc dans le manuscrit entre «course» et «au spectacle».
[6] J'étais aux premières loges, la seconde à droite.—Ici Stendhal a dessiné un plan de la salle du Théâtre, avec cette légende: «Infâme salle de spectacle de Grenoble, laquelle m'inspirait la vénération la plus tendre. J'en aimais même la mauvaise odeur. Vers 1794, 95 et 96, cet amour alla jusqu'à la fureur, du temps de Mlle Kably.»—En face, plan de la partie de la ville où est situé le théâtre, jusqu'à «la Bastille, fortifiée de 1826 à 1836 par le général Haxo (infatigable hâbleur)».
[7] Je m'en apercevais fort bien.—Variante: «De quoi je m'apercevais.»
[8] ... comme à l'église de ...—Le nom a été laissé en blanc.
[9] ... je me rappelle encore le son des clercs ...—Ce mot est surmonté d'une croix. Ce signe revient plusieurs fois dans le manuscrit, à des passages incomplets ou obscurs. Il indique sans doute les endroits que Stendhal se proposait de corriger ultérieurement.
[10] ... j'articulai le nom de M. de Ravix ...—Variante: «Je nommai.»
[11] ... Mme de M......, me semblait bien jolie et passait pour fort galante.—Tout cet alinéa est une addition, qui paraît avoir été écrite le lendemain, d'après la comparaison des écritures.
[12] On lui doit la Bibliothèque.—Le nom de M. Henri Gagnon figure en effet parmi ceux des fondateurs de la bibliothèque municipale.
[13] ... s'il s'en trouve jamais pour ces fadaises ...—Variantes: «Fariboles, puérilités.»
[14] ... en écrivant ceci quarante-cinq ans après les événements.—Suit un plan de l'appartement de M. Gagnon ayant vue sur la Grande-rue et la place Grenette. Stendhal n'y indique pas les chambres d'Elisabeth et de Séraphie Gagnon. Il dit à ce sujet: «Je ne vois pas où logeaient ma tante Séraphie et ma grand'tante Elisabeth. J'ai un souvenir vague d'une chambre entre la salle-à-manger et la Grande-rue.»—En face, plan du quartier Saint-Laurent entre le pont de pierre (aujourd'hui pont de l'Hôpital) et les premières maisons de La Tronche. La Tronche était l'«église de M. Dumolard, mon confesseur, curé de La Tronche et grand tejé». Dans l'enceinte de Grenoble, non loin de la Citadelle, Stendhal indique l'emplacement de la a maison d'éducation de Mlle de La Sagne, ma sœur, son amie Mlle Sophie Gauthier». C'est l'ancien couvent des Ursulines, rue Sainte-Ursule, aujourd'hui occupé par les bureaux de la direction du Génie.
[15] ... le jour où j'avais un an, 23 janvier1784 ...—Stendhal indique 1783 (1786—3). Cette erreur est volontaire, car elle est reproduite dans un plan de l'appartement de M. Gagnon, dessina au verso du fol. 8, et portant: «Détail, 23 janvier 1788—5.»
[16] ... je ressemblais au Père Brulard ...—Chérubin Beyle, né le 17 septembre 1709, religieux du couvent de Saint-François de Grenoble, fils de Joseph Beyle et oncle de Joseph-Chérubin Beyle, père de Stendhal. (Sur la famille paternelle de Stendhal, voir Ed. Maignien, La famille de Beyle-Stendhal, Grenoble, 1889, broch. in-8.)
[17] «Un peu plus il était mort», disait mon grand-père.—En face, se trouve un croquis représentant une «coupe de la Porte-de-France», avec le «lieu de la ruade du mulet».
[18] ... le grand hiver de 1789 à 1790 ...—En surcharge, au crayon, de la main de R. Colomb: «1788 à 1789». La session des Etats de Romans à laquelle Stendhal fait allusion a duré du 2 novembre 1788 au 16 janvier 1789.
[19] ... M. Barthélémy d'Orbane, ami intime de la famille, était en O et moi en H ...—En face, est un plan d'une partie de l'appartement de M. Gagnon. Au coin à droite de la cheminée est Barthélémy d'Orbane et près de lui, devant le feu, le jeune Henri.
[20] ... M. Lysimaque ...—Lysimaque Tavernier, chancelier du consulat de France à Cività-Vecchia.—Sur ce personnage, voir C. Stryienski, Soirées du Stendhal-Club (1899), p. 236-242, et A. Chuquet, Stendhal-Beyle (1904), p. 532-533.
[21] ... il abaissait les cols démesurément longs de sa chemise.—Dans la marge est un croquis donnant les places respectives de «l'Empereur», du «colérique abbé Louis (alors non voleur et fort estimé)», du «terrible comte Regnault», et des auditeurs au Conseil d'Etat, parmi lesquels Henri Beyle.
[22] ... devant une assemblée choisie, par exemple à la Bibliothèque.—La bibliothèque municipale était alors située dans le passage dit aujourd'hui du Lycée, près de l'École centrale, plus tard lycée de garçons (voir notre plan de Grenoble en 1793).
[23] ... A l'occasion de Noël.—Variante: «Pour Noël.»
[24] ... tenant à la main une cuillerée de fraises.—Dans l'interligne est cette addition, marquée de deux croix: «Comme il allait manger des fraises.»
[25] ... M. de Broglie.—Ms.: «Gliebro.» Sur les habitudes anagrammatiques de Stendhal, voir notre Introduction.
[26] ... M. l'abbé Chélan dînait à la maison ...—Suit un plan d'une partie de l'appartement «au 1er étage», avec la table dans la salle-à-manger, la cuisine et une chambre à coucher. On y voit également, sur la place Grenette, l'emplacement où fut tué l'ouvrier chapelier (au pied des degrés qui conduisent aujourd'hui au n° 4 de la place Grenette).
[27] ... il y a peut-être de cela quarante-trois ans.—La journée des Tuiles eut lieu le 7 juin 1788. (Voir à ce sujet A. Prudhomme, Histoire de Grenoble, p. 587-590.)
[28] Journée des tuiles.—J'ai laissé à Grenoble une vue de cette révolte-émeute à l'aquarelle, par M. Le Roy. (Note de Stendhal.)
[29] Je la vis en R.—Plan indiquant la place de la vieille femme en R (Grande-rue) et «venant en R'» (place Grenette), et la situation en O (angle Nord de la place Grenette) de l'ouvrier blessé.
[30] ... quand je fus distrait ...—Variante: «Mais bientôt après je fus distrait ...»—En face, au verso du fol. 19, on lit: «Cette queue savante fait-elle bien? 22 décembre.»
[31] ... la maison Périer.—Maison Périer-Lagrange, aujourd'hui place Grenette, n° 4. (Voir notre plan de Grenoble en 1793.)
[32] Il mourut ...—Noël de Jourda, comte de Vaux, maréchal de France et lieutenant général du roi en Dauphiné, mourut à Grenoble le 14 septembre 1788.
[33] Je me vois au point H ...—Deux croquis expliquent la position des personnages; l'un est en coupe, l'autre en plan. Un autre dessin (en coupe) se trouve également au verso du fol. 10. Sur le bord de la route, du côté de l'Isère, est en H le «point d'où j'ai vu passer la voiture noire portant les restes du maréchal de Vaux, et, ce qui est bien pis, point d'où j'ai entendu la décharge à deux pieds de moi».
[34] ... le pont de pierre ...—Aujourd'hui, pont de l'Hôpital.
[35] ... mais j'étais aguerri.—Ici, nouveau plan indiquant la place de Stendhal, en H, à la première et aux seconde et troisième décharges.
[36] ... M. Mounier alla remplir les fonctions de préfet à Rennes.—Mounier fut nommé préfet de l'Ille-et-Vilaine le 13 avril 1802 par Bonaparte, premier consul.
[37] ... M. Mounier en habit de préfet ... est ressemblant.—Un portrait de Mounier existe en effet dans la galerie dauphinoise de la Bibliothèque municipale.
[38] (Viazma sur Tripes ...)—Viazma, chef-lieu de district du gouvernement de Smolensk, est situé sur deux rivières: la Viazma et la Bebréïa.
[39] ... et la reporta froidement dans sa case.—Variante: «Remit.»
[40] ... lui faisait protéger le jeune Barnave.—23 déc. 35. Fatigué du travail after 3 heures. (Note de Stendhal.)
[41] ... la rue des Clercs.—Le feuillet se termine par un plan indiquant la «grand'route» de Grenoble à Lyon, avec Saint-Robert et la maison de Barnave, le Fontanil et Saint-Vincent, avec la «chaumière pittoresque de mon grand-père», dit Stendhal.
Au verso de ce feuillet, on lit: «A placer: Secret de la fortune de MM. Rothschild, vu par Dominique le 23 décembre 1835. Ils vendent ce dont tout le monde a envie, des rentes, et de plus s'en sont faits fabricants (id est en prenant les emprunts).»
Au-dessous: «Il faudrait acheter un plan de Grenoble et le coller ici. Faire prendre les extraits mortuaires de mes parents, ce qui me donnerait des dates, et l'extrait de naissance de my dearest mother et de mon bon grand-père. Décembre 1835.—Qui pense à eux aujourd'hui que moi, et avec quelle tendresse, à ma mère, morte depuis quarante-six ans? Je puis donc parler librement de leurs défauts. La même justification pour madame la baronne de Barckoff, Mme Alex. Petit, Mme la baronne Dembowski (que de temps que je n'ai pas écrit ce nom!), Virginie, 2 Victorines, Angela, Mélanie, Alexandrine, Méthilde, Clémentine, Julia, Alberthe de Rubempré (adorée pendant un mois seulement).
V. 2 V. A. M. A. M. C. I. A.
Un homme plus positif dirait:
A. M. C. I. A.»
On lit encore: «Droit que j'ai d'écrire ces mémoires: quel être n'aime pas qu'on se souvienne de lui?»
—Deux feuillets supplémentaires, numérotés 69 et 70 du cahier, portent: (Fol. 69 recto) «20 décembre 1835. Faits à placer en leur lieu, mis ci-derrière pour ne pas les oublier: nomination d'inspecteur du mobilier, derrière la page 254 de la présente numération.—A sept ans commencé le latin, donc en 1790.»
(Fol. 69 verso): «Faits placés ici pour ne pas les oublier, à mettre en leur lieu: Pourquoi Omar m'est pesante.
C'est que je n'ai pas une société le soir pour me distraire de mes idées du matin. Quand je faisais un ouvrage à Paris, je travaillais jusqu'à étourdissements et impossibilité de marcher. Six heures sonnant, il fallait pourtant aller dîner, sous peine de déranger les garçons du restaurateur, pour un dîner de 3 fr. 50, ce qui m'arrivait souvent, et j'en rougissais. J'allais dans un salon; là, à moins qu'il ne fût bien piètre, j'étais absolument distrait de mon travail du matin, au point d'en avoir oublié même le sujet en rentrant chez moi à une heure.»
(Fol 70 verso): «20 décembre 1835. Fatigue du matin.
Voilà ce qui me manque à Omar: la société est si languissante (Mme Sandre, the mother of Marieta), la comtesse Rave ..., la princesse de Da ... ne valent pas la peine de monter en voiture.
Tout cela ne peut me distraire des idées du matin, de façon que quand je reprends mon travail le lendemain, au lieu d'être frais et soulagé je suis absolument éreinté.
Et après quatre ou cinq jours de cette vie, je me dégoûte de mon travail, j'en ai réellement tué les idées en y pensant trop continuement. Je fais un voyage de quinze jours à Cività-Vecchia et à Ravenne (1835, octobre). Cet intervalle est trop long, j'ai oublié mon travail. Voilà pourquoi le Chasseur vert languit, voilà ce qui, avec le manque total de bonne musique, me déplaît dans Omar.»
Après la mort de ma mère, mon grand-père fut au désespoir. Je vois, mais aujourd'hui seulement, que c'était un homme qui devait avoir un caractère dans le genre de celui de Fontenelle, modeste, prudent, discret, extrêmement aimable et amusant avant la mort de sa fille chérie. Depuis, il se renfermait souvent dans un silence discret. Il n'aimait au monde que cette fille et moi[2].
Son autre fille, Séraphie, l'ennuyait et le vexait; il aimait la paix par-dessus tout, et elle ne vivait que de scènes. Mon bon grand-père, pensant à son autorité de père, se faisait de vifs reproches de ne pas montrer les dents (c'est une expression du pays; je les conserve, sauf à les traduire plus tard en[p. 72] français de Paris, je les conserve en ce moment pour mieux me rappeler les détails qui m'arrivent en foule). M. Gagnon estimait et craignait sa sœur, qui lui avait préféré dans la jeunesse un frère mort à Paris, chose que le frère survivant ne lui avait jamais pardonné, mais avec son caractère à la Fontenelle, aimable et pacifique, il n'y paraissait nullement; j'ai deviné cela plus tard.
M. Gagnon avait une sorte d'aversion pour son fils, Romain Gagnon, mon oncle, jeune homme brillant et parfaitement aimable.
C'est la possession de cette qualité qui brouillait, ce me semble, le père et le fils; ils étaient tous deux, mais dans des genres différents, les hommes les plus aimables de la ville. Mon grand-père était plein de mesure dans les plaisanteries et son esprit fin et froid pouvait passer inaperçu. Il était d'ailleurs un prodige de science pour ce temps-là (où florissait la plus drôle d'ignorance). Les sots ou les envieux (MM. Champel, Tournus (le cocu), Tourte) lui faisaient sans cesse, pour se venger, des compliments sur sa mémoire. Il savait, croyait et citait les auteurs approuvés sur toutes sortes de sujets.
«Mou fils n'a rien lu», disait-il quelquefois avec humeur. Rien n'était plus vrai, mais il était impossible de s'ennuyer dans une société où était M. Gagnon le fils. Son père lui avait donné un charmant appartement dans sa maison et l'avait fait avocat. Dans une ville de parlement, tout le monde aimait[p. 73] la chicane, et vivait de la chicane, et faisait de l'esprit sur la chicane. Je sais encore un nombre de plaisanteries sur le pétitoire et le possessoire.
Mon grand-père donnait le logement et la table à son fils, plus une pension de cent francs par mois, somme énorme à Grenoble en 1789, pour ses menus plaisirs, et mon oncle achetait des habits brodés de mille écus et entretenait des actrices.
Je n'ai fait qu'entrevoir ces choses, que je pénétrais par les demi-mots de mon grand-père. Je suppose que mon oncle recevait des cadeaux de ses maîtresses riches, et avec cet argent s'habillait magnifiquement et entretenait les maîtresses pauvres. Il faut savoir que, dans notre pays et alors, il n'y avait rien de mal à recevoir de l'argent de Mme Dulauron, ou de Mme de Marcieu, ou de Mme de Sassenage, pourvu qu'on le dépensât hic et nunc et qu'on ne thésaurisât pas. Hic et nunc est une façon de parler que Grenoble devait à son parlement.
Il est arrivé plusieurs fois que mon grand-père, arrivant chez M. de Quinsonnas ou dans un autre cercle, apercevait un jeune homme richement vêtu et que tout le inonde écoutait, c'était son fils.
«Mon père ne me connaissait pas ces habits, me disait mon oncle, je m'éclipsais au plus vite et rentrais pour reprendre le modeste frac. Quand mon père me disait: Mais faites-moi un peu le plaisir de me dire où vous prenez les frais de cette toilette.[p. 74]—Je joue et j'ai du bonheur, répondais-je.—Mais alors, pourquoi ne pas payer vos dettes?—Et madame Une telle qui voulait me voir avec le bel habit qu'elle m'avait acheté! continuait mon oncle. Je m'en tirais par quelque calembredaine.»
Je ne sais si mon lecteur de 1880 connaît un roman fort célèbre encore aujourd'hui: les Liaisons dangereuses avaient été composées à Grenoble par M. Choderlos de Laclos, officier d'artillerie, et peignaient les mœurs de Grenoble.
J'ai encore connu Mme de Merteuil, c'était Mme de Montmort, qui me donnait des noix confites, boiteuse qui avait la maison Drevon au Chevallon, près l'église de Saint-Vincent, entre le Fontanil et Voreppe, mais plus près du Fontanil. La largeur du chemin séparait le domaine de Mme de Montmort (ou loué par Mme de Montmort) et celui de M. Henri Gagnon. La jeune personne riche qui est obligée de se mettre au couvent a dû être une demoiselle de Blacons, de Voreppe.
Cette famille est exemplaire par la tristesse, la dévotion, la régularité et l'ultracisme, ou du moins était exemplaire vers 1814, quand l'Empereur m'envoya commissaire dans la 7me division militaire avec le vieux sénateur comte de Saint-Vallier, un des roués de l'époque de mon oncle et qui me parla beaucoup de lui comme ayant fait faire d'insignes folies à mesdames N. et N., j'ai oublié les noms. Alors j'étais brûlé du feu sacré et ne songeais[p. 75] qu'aux moyens de repousser les Autrichiens, ou du moins de les empêcher d'entrer aussi vite.
J'ai donc vu cette fin des mœurs de Mme de Merteuil, comme un enfant de neuf ou dix ans dévoré par un tempérament de feu peut voir ces choses, dont tout le monde évite de lui dire le fin mot.
[1] Le chapitre VI est le chapitre IV bis du manuscrit (R 299, fol. 75 à 81).—Écrit à Rome, le 2 décembre 1835.
[2] Il n'aimait au monde que cette fille et moi.—Et moi a été ajouté au crayon par Stendhal.
La famille était clone composée, à l'époque de la mort de ma mère, vers 1790, de MM. Gagnon père, 60 ans; Romain Gagnon, son fils, 25; Séraphie, sa fille, 24; Elisabeth, sa sœur, 64; Chérubin Beyle, son gendre, 43; Henri, son fils, 7; Pauline, sa fille, 4; Zénaïde, sa fille, 2.
Voilà les personnages du triste drame de ma jeunesse, qui ne me rappelle presque que souffrances et profondes contrariétés morales. Mais voyons un peu le caractère de ces personnages.
Mon grand-père, Henri Gagnon (60 ans); sa fille Séraphie, ce diable femelle dont je n'ai jamais su l'âge, elle pouvait avoir 22 ou 24 ans; sa sœur Elisabeth Gagnon (64 ans), grande femme maigre,[p. 78] sèche, avec une belle figure italienne, caractère parfaitement noble, mais noble avec les raffinements et les scrupules de conscience espagnols. Elle a à cet égard formé mon cœur et c'est à ma tante Elisabeth que je dois les abominables duperies de noblesse à l'espagnole dans lesquelles je suis tombé pendant les premiers trente ans de ma vie. Je suppose que ma tante Elisabeth, riche (pour Grenoble), était restée fille à la suite d'une passion malheureuse. J'ai appris[2] quelque chose comme cela de la bouche de ma tante Séraphie dans ma première jeunesse.
La famille était enfin composée de mon père.
Joseph-Chérubin Beyle, avocat au Parlement du pays, ultra et chevalier de la Légion d'honneur, adjoint au maire de Grenoble, mort en 1819, à 72 ans, dit-on, ce qui le suppose né en 1747. Il avait donc, en 1790, quarante-trois ans[3].
C'était un homme extrêmement peu aimable, réfléchissant toujours à des acquisitions et à des ventes de domaines, excessivement fin, accoutumé à vendre aux paysans et à acheter d'eux, archi-Dauphinois. Il n'y avait rien de moins espagnol et de moins follement noble que cette âme-là, aussi était-il antipathique à ma tante Elisabeth. Il était de plus excessivement ridé et laid, et déconcerté et silencieux avec les femmes, qui pourtant lui étaient nécessaires.
Cette dernière qualité lui avait donné l'intelligence de la Nouvelle-Héloïse et des autres ouvrages[p. 79] de Rousseau, dont il ne parlait qu'avec adoration, tout en le maudissant comme impie, car la mort de ma mère le jeta dans la plus haute et la plus absurde dévotion[4]. Il s'imposa l'obligation de dire tous les offices d'un prêtre, il fut même question pendant trois ou quatre ans de son entrée dans les ordres, et probablement il fut retenu par le désir de me laisser sa place d'avocat; il allait être consistorial: c'était une distinction noble parmi les avocats, dont il parlait comme un jeune lieutenant de grenadiers parle de la croix. Il ne m'aimait pas comme individu, mais comme fils devant continuer sa famille.
Il aurait été bien difficile qu'il m'aimât: 1° il voyait clairement que je ne l'aimais point, jamais je ne lui parlais sans nécessité, car il était étranger à toutes ces belles idées littéraires et philosophiques qui faisaient la base de mes questions à mon grand-père et des excellentes réponses de ce vieillard aimable. Je le voyais fort peu. Ma passion pour quitter Grenoble, c'est-à-dire lui, et ma passion pour les mathématiques,—seul moyen que j'avais de quitter cette ville que j'abhorrais et que je hais encore, car c'est là que j'ai appris à connaître les hommes,—ma passion mathématique me jeta dans une profonde solitude de 1797 à 1799. Je puis dire avoir travaillé pendant ces deux années et même pendant une partie de 1790 comme Michel-Ange travailla à la Sixtine.
Depuis mon départ, à la fin d'octobre 1799,—je me souviens de la date parce que le 18 brumaire, 9 novembre, je me trouvais à Nemours,—je n'ai été pour mon père qu'un demandeur d'argent, la froideur a sans cesse augmenté, il ne pouvait pas dire un mot qui ne me déplût. Mon horreur était de vendre un champ à un paysan en finassant pendant huit jours, à l'effet de gagner 300 francs; c'était là sa passion.
Rien de plus naturel. Son père, qui portait, je crois, le grand nom de Pierre Beyle, mourut de la goutte, à Claix, à l'improviste, à 63 ans. Mon père à 18 ans (c'était donc vers 1765) se trouva avec un domaine à Claix rendant 800 ou 1.800 francs, c'est l'un des deux, une charge de procureur et dix sœurs à établir, une mère, riche héritière, c'est-à-dire ayant peut-être 60.000 francs et en sa qualité d'héritière ayant le diable au corps. Elle m'a encore longtemps souffleté dans mon enfance quand je tirais la queue à son chien Azor (chien de Bologne à longues soies blanches). L'argent fut donc, et avec raison, la grande pensée de mon père, et moi je n'y ai jamais songé qu'avec dégoût. Cette idée me représente des peines cruelles, car en avoir ne me fait aucun plaisir, en manquer est un vilain malheur.
Jamais peut-être le hasard n'a rassemblé deux êtres plus foncièrement antipathiques que mon père et moi.
De là l'absence de tout plaisir dans mon enfance, de 1790 à 1799. Cette saison, que tout le monde[5][p. 81] dit être celle des vrais plaisirs de la vie, grâce à mon père n'a été pour moi qu'une suite de douleurs amères et de dégoûts. Deux diables étaient déchaînés contre ma pauvre enfance, ma tante Séraphie et mon père, qui dès 1791 devint son esclave.
Le lecteur peut se rassurer sur le récit de mes malheurs, d'abord il peut sauter quelques pages, parti que je le supplie de prendre, car j'écris à l'aveugle, peut-être des choses fort ennuyeuses même pour 1835, que sera-ce en 1880?
En second lieu, je n'ai presque aucun souvenir de la triste époque 1790-1795, pendant laquelle j'ai été un pauvre petit bambin persécuté, toujours grondé à tout propos, et protégé seulement par un sage à la Fontenelle qui ne voulait pas livrer bataille pour moi, et d'autant qu'en ces batailles son autorité supérieure à tout lui commandait d'élever davantage la voix, or c'est ce qu'il avait le plus en horreur; et ma tante Séraphie qui, je ne sais pourquoi, m'avait pris en guignon, le savait bien aussi.
Quinze ou vingt jours après la mort de ma mère, mon père et moi nous retournâmes coucher dans la triste maison, moi dans un petit lit vernissé fait en cage, placé dans l'alcôve de mon père. Il renvoya ses domestiques et mangea chez mon grand-père, qui jamais ne voulut entendre parler de pension. Je crois que c'est par intérêt[6] pour moi que mon grand-père se donna ainsi la société habituelle d'un homme qui lui était antipathique.
Ils n'étaient réunis que par le sentiment d'une profonde douleur. A l'occasion de la mort de ma mère, ma famille rompit toutes ses relations de société, et, pour comble d'ennui pour moi, elle a depuis constamment vécu isolée.
M. Joubert, mon pédant montagnard (on appelle cela à Grenoble Bet, ce qui veut dire un homme grossier né dans les montagnes de Gap), M. Joubert qui me montrait le latin, Dieu sait avec quelle sottise, en me faisant réciter les règles du rudiment, chose qui rebutait mon intelligence, et l'on m'en accordait beaucoup, mourut. J'allais prendre ses leçons sur la petite place Notre-Dame[7], je puis dire n'y avoir jamais passé sans me rappeler ma mère et la parfaite gaieté de la vie que j'avais menée de son temps. Actuellement, même mon bon grand-père en m'embrassant me causait du dégoût.
Le pédant Joubert à figure terrible me laissa en legs le second volume d'une traduction française de Quinte-Curce, ce plat Romain qui a écrit la vie d'Alexandre.
Cet affreux pédant, homme de cinq pieds six pouces, horriblement maigre et portant une redingote noire, sale et déchirée, n'était cependant pas mauvais au fond.
Mais son successeur, M. l'abbé Raillane, fut dans toute l'étendue du mot un noir coquin. Je ne prétends pas qu'il ait commis des crimes, mais il est difficile d'avoir une âme plus sèche, plus ennemie[p. 83] de tout ce qui est honnête, plus parfaitement dégagée de tout sentiment d'humanité. Il était prêtre, natif d'un village de Provence; il était petit, maigre, très pincé, le teint vert, l'œil faux avec les sourcils abominables.
Il venait de finir l'éducation de Casimir et Augustin Périer et de leurs quatre ou six frères[8].
Casimir a été un ministre très célèbre et selon moi dupe de Louis-Philippe[9]. Augustin, le plus emphatique des hommes, est mort pair de France[10]. Scipion était mort un peu fou vers 1806[11]. Camille a été un plat préfet[12] et vient d'épouser en secondes noces une femme fort riche[13], il est un peu fou comme tous ses frères. Joseph, mari d'une jolie femme extrêmement affectueuse et qui a eu des amours célèbres, a peut-être été le plus sage de tous[14]. Un autre, Amédée[15], je crois, a peut-être volé au jeu vers 1815, aima mieux passer cinq ans à Sainte-Pélagie que payer.
Tous ces frères étaient fous au mois de mai, eh bien! je crois qu'ils devaient départir cet avantage à notre commun précepteur, M. l'abbé Raillane.
Cet homme, par adresse, ou par instinct de prêtre[16], était ennemi juré de la logique et de tout raisonnement droit.
Mon père le prit apparemment par vanité. M. Périer milord[17], le père du ministre Casimir, passait pour l'homme le plus riche du pays. Dans le fait, il avait dix ou onze enfants et a laissé trois[p. 84] cent cinquante mille francs à chacun[18]. Quel honneur pour un avocat au parlement de prendre pour son fils le précepteur sortant de chez M. Périer!
Peut-être M. Raillane fut-il renvoyé pour quelque méfait; ce qui me donne ce soupçon aujourd'hui, c'est qu'il y avait encore dans la maison Périer trois enfants fort jeunes, Camille de mon âge, Joseph et Amédée, je crois, beaucoup plus jeunes.
J'ignore absolument les arrangements financiers que mon père fit avec l'abbé Raillane. Toute attention donnée aux choses d'argent était réputée vile et basse au suprême degré dans ma famille. Il y était en quelque sorte contre la pudeur de parler d'argent, l'argent était comme une triste nécessité de la vie et indispensable malheureusement, comme les lieux d'aisance, mais dont il ne fallait jamais parler. On parlait toutefois et par exception des sommes rondes que coûtait un immeuble, le mot immeuble était prononcé avec respect.
M. Bellier a payé son domaine de Voreppe 20.000 écus. Pariset coûte plus de 12.000 écus (de trois livres) à notre cousin Colomb.
Cette répugnance, si contraire aux usages de Paris, de parler d'argent venait, de je ne sais où et s est complètement impatronisée dans mon caractère. La vue d'une grosse somme d'or ne réveille d'autre idée en moi que l'ennui de la garantir des voleurs, ce sentiment a souvent été pris pour de l'affectation, et je n'en parle plus.
Tout l'honneur, tous les sentiments élevée et fiers de la famille nous venaient de ma tante Elisabeth; ces sentiments régnaient en despotes dans la maison, et toutefois elle en parlait fort rarement, peut-être une fois en deux ans; en général, ils étaient amenés par un éloge de son père. Cette femme, d'une rare élévation de caractère, était adorée, par moi, et pouvait avoir alors soixante-cinq ans, toujours mise avec beaucoup de propreté et employant à sa toilette fort modeste des étoiles chères. On conçoit bien que ce n'est qu'aujourd'hui et en y pensant que je découvre ces choses. Par exemple, je ne sais la physionomie d'aucun de mes parents et cependant, j'ai présents leurs traits jusque dans le plus petit détail. Si je me figure un lieu la physionomie de mon excellent grand-père, c'est à cause de la visite que je lui fis quand j'étais déjà auditeur ou adjoint aux commissaires des guerres; j'ai perdu absolument l'époque de cette visite. J'ai été homme fort tard pour le caractère, c'est ainsi que j'explique aujourd'hui ce manque de mémoire pour les physionomies. Jusqu'à vingt-cinq ans, que dis-je, souvent encore il faut que je me tienne à deux mains pour n'être pas tout à la sensation produite par les objets et pouvoir les juger raisonnablement, avec mon expérience. Mais que diable est-ce que cela fait au lecteur? Que lui fait tout cet ouvrage? Et cependant, si je n'approfondis pas ce caractère de Henri, si difficile à connaître pour moi, je ne me conduis pas[p. 86] en honnête auteur cherchant à dire sur son sujet tout ce qu'il peut savoir. Je prie mon éditeur, si jamais j'en ai un, de couper ferme ces longueurs.
Un jour, ma tante Elisabeth Gagnon s'attendrit sur le souvenir de son frère, mort jeune à Paris; nous étions seuls, une après-dînée, dans sa chambre sur la Grenette. Evidemment cette âme élevée répondait à ses pensées, et comme elle m'aimait m'adressait la parole pour la forme.
«... Quel caractère! (Ce qui voulait dire: quelle force de volonté.) Quelle activité! Ah! quelle différence!» (Cela voulait dire: quelle différence avec celui-ci, mon grand-père, Henri Gagnon.) Et aussitôt, se reprenant et songeant devant qui elle parlait, elle ajouta: « Jamais je n en ai tant dit.»
Moi: «Et à quel âge est-il mort?»
Mlle Elisabeth: «A vingt-trois ans.»
Le dialogue dura longtemps; elle vint à parler de son père. Parmi cent détails, de moi oubliés, elle dit:
«A telle époque, il pleurait de rage en apprenant que l'ennemi s approchait de Toulon.»
(Mais quand l'ennemi s'est-il approché de Toulon? Vers 1736, peut-être, dans la guerre marquée par la bataille de l'Assiette, dont je viens de voir en 34 une gravure intéressante par la vérité.)
11 aurait voulu que la milice marchât. Or, rien au monde n'était plus opposé aux sentiments de mon grand-père Gagnon, véritable Fontenelle, l'homme[p. 87] le plus spirituel et le moins patriote que j'aie jamais connu. Le patriotisme aurait distrait bassement mon grand-père de ses idées élégantes et littéraires. Mon père aurait calculé sur-le-champ ce qu'il pouvait lui rapporter. Mon oncle Romain aurait dit d'un air alarmé: «Diable! cela peut me faire courir quelque danger.» Le cœur de ma vieille tante et le mien auraient palpité[19] d'intérêt.
Peut-être j'avance un peu les choses à mon égard et j'attribue à sept ou huit ans les sentiments que j'eus à neuf ou dix. Il est impossible pour moi de distinguer sur les même choses les sentiments de deux époques antiques.
Ce dont je suis sûr, c'est que le portrait sérieux et rébarbatif de mon arrière-grand-père[20] dans son cadre doré à grandes rosaces d'un demi-pied de large, qui me faisait presque peur, me devint cher et sacré dès que j'eus appris les sentiments courageux et généreux que lui avaient inspiré les ennemis s'approchant de Toulon.
[1] Le chapitre VII est le chapitre V du manuscrit (fol. 81 à 99).—Écrit à Rome, le 2 décembre, et à Cività-Vecchia, le 5 décembre 1835.—On lit au verso du fol. 92: «Idée: Peut-être en ne corrigeant pas ce premier jet parviendrai-je à ne pas mentir par vanité. Omar, 3 décembre 1835.»
[2] J'ai appris ...—Variante: «Su.»
[3] Il avait donc, en 1790, quarante-trois ans.—Chérubin-Joseph Beyle était né le 29 mars 1747. Il épousa le 20 février 1781 Caroline-Adélaïde-Henriette Gagnon et mourut le 20 juin 1819.
[4] ... la plus absurde dévotion.—Ms.: «Surdeab tiondévo.»
[5] Cette saison, que tout le monde ...—Variante: «Cet âge, que l'avis de tout le monde ...»
[6] Je crois que c'est par intérêt pour moi ...—Variante: «Amitié.»
[7] J'allais prendre ses leçons sur la petite place Notre-Dame ...—A cette époque, la «voie centrale» (rue Président-Carnot) et l'avenue Maréchal-Randon n'étaient pas encore ouvertes. Voir notre plan de Grenoble en 1793.
[8] ... Casimir et Augustin Périer et de leurs quatre ou six frères.—Casimir et Augustin Périer étaient fils de Claude Périer. Claude Périer eut neuf fils et trois filles: Jacques-Prosper (mort enfant), Elisabeth-Joséphine, Euphrosine-Marine (morte enfant), Augustin-Charles, Alexandre-Jacques, Antoine-Scipion, Casimir-Pierre, Adélaïde-Hélène, surnommée Marine, Camille-Joseph, Alphonse, Amédée-Auguste et André-Jean-Joseph.
[9] Casimir a été un ministre très célèbre ...—Casimir-Pierre Périer, le ministre, était né à Grenoble le 11 octobre 1777; il mourut à Paris le 16 mai 1832.
[10] Augustin ... est mort pair de France.—Augustin-Charles Périer était né à Grenoble le 22 mai 1773. Pair de France à la mort de son frère Casimir (16 mai 1832), il mourut à Frémigny (Seine-et-Oise), le 2 décembre 1833.
[11] Scipion était mort ... vers 1806.—Scipion Périer est mort à Paris en 1821. (Note au crayon de R. Colomb.)—Il était né le 14 juin 1776.
[12] Camille a été un plat préfet ...—Camille-Joseph Périer, né a Grenoble le 15 août 1781. Préfet de la Corrèze depuis le 12 février 1810 jusqu'en 1815, et de la Meuse depuis le 10 février 1819 jusqu'en 1822. Plus tard député et pair de France, il est mort le 14 septembre 1844.
[13] ... et vient d'épouser en secondes noces une femme fort riche ...—Erreur, Mlle de Sahune n'a pas eu un sou de dot. (Note au crayon de R. Colomb.)—Camille Périer épousa en premières noces Adèle Lecoulteux de Canteleux, et en secondes noces Amélie Pourcet de Sahune, cousine de Louise-Henriette de Berckeim, femme d'Augustin Périer.
[14] Joseph, mari dune jolie femme ...—André-Joseph-Jean Périer, né à Grenoble le 27 novembre 1786, dirigea la banque Périer frères, à Paris. A l'époque où Stendhal écrivait la Vie de Henri Brulard, il était député de la Marne (Epernay) depuis le 15 novembre 1832. Il épousa Mlle Marie-Aglaé du Clavel de Kergonan et mourut à Paris le 18 décembre 1868.
[15] ... Amédée ... a peut-être volé au jeu vers 1815 ...—Amédée-Auguste Périer, né à Grenoble le 14 mars 1785, est mort à Paris en 1851.—L'histoire racontée par Stendhal nous est absolument inconnue et nous semble un produit de l'esprit caustique de notre auteur.
[16] ... par instinct de prêtre ...—Ms.: «Reprêt.»
[17] M. Périer milord ...—Sur ce surnom de milord donné à Claude Périer, voir t. II, p. 149.
[18] ... a laissé trois cent cinquante mille francs à chacun.—-M. Périer a laissé dix enfants et 500.000 francs à chacun. (Note au crayon de R. Colomb.)—En réalité, Claude Périer eut douze enfants, dont deux moururent jeunes.
[19] ... auraient palpité ...—Variante: «Palpitaient.»
[20] ... le portrait sérieux et rébarbatif de mon arrière-grand-père ...—Le manuscrit porte: «Mon grand-père.»
A cette occasion, ma tante Elisabeth me raconta que mon arrière-grand-père était né à Avignon, ville de Provence, pays où venaient les oranges, me dit-elle avec l'accent du regret, et beaucoup plus rapprochée de Toulon que Grenoble. Il faut savoir que la grande magnificence de la ville c'étaient soixante ou quatre-vingts orangers en caisse, provenant peut-être du connétable de Lesdiguières, le dernier grand personnage produit par le Dauphiné, lesquels, à l'approche de l'été, étaient places en grande pompe dans les environs de la magnifique allée des Marronniers, plantée aussi, je crois, par Lesdiguières[2]. «Il y a donc un pays où les orangers viennent en pleine terre?» dis-je à ma tante. Je comprends aujourd'hui[p. 90] que, sans le savoir, je lui rappelais l'objet éternel de ses regrets.
Elle me raconta que nous étions originaires d'un pays encore plus beau que la Provence (nous, c'est-à-dire les Gagnon), que le grand-père de son grand-père, à la suite d'une circonstance bien funeste, était venu se cacher à Avignon à la suite[3] d'un pape; que là il avait été obligé de changer un peu son nom et de se cacher, qu'alors il avait vécu du métier de chirurgien.
Avec ce que je sais de l'Italie d'aujourd'hui, je traduirais ainsi: qu'un M. Guadagni ou Guadanianno, ayant commis quelque petit assassinat en Italie, était venu à Avignon vers 1650, à la suite de quelque légat. Ce qui me frappa beaucoup alors, c'est que nous étions venus (car je me regardais comme Gagnon et je ne pensais jamais aux Beyle qu'avec une répugnance qui dure encore en 1835), que nous étions venus d'un pays où les orangers croissent en pleine terre. Quel pays de délices, pensais-je!
Ce qui me confirmerait dans cette idée d'origine italienne, c'est que la langue de ce pays était en grand honneur dans la famille, chose bien singulière dans une famille bourgeoise de 1780. Mon grand-père savait et honorait l'italien, ma pauvre mère lisait le Dante, chose fort difficile, même de nos jours; M. Artaud, qui a passé vingt ans en Italie et qui vient d'imprimer une traduction de[p. 91] Dante, ne met pas moins de deux contre-sens et d'une absurdité par page. De tous les Français de ma connaissance, deux seuls: M. Fauriel, qui m'a donné les histoires d'amour arabes, et M. Delécluze, des Débats, comprennent Dante, et cependant tous les écrivailleurs de Paris gâtent sans cesse ce grand nom en le citant et prétendant l'expliquer. Rien ne m'indigne davantage.
Mon respect pour le Dante est ancien, il date des exemplaires que je trouvai dans le rayon de la bibliothèque paternelle occupé par les livres de ma pauvre mère et qui faisaient ma seule consolation pendant la tyrannie Raillane.
Mon horreur pour le métier de cet homme et pour ce qu'il enseignait par métier arriva à un point qui frise la manie.
Croirait-on que, hier encore, 4 décembre 1835, venant de R[ome] à C[ivit]à-V[ecchia], j'ai eu l'occasion de rendre, sans me gêner, un fort grand service à une jeune femme que je ne soupçonne pas fort cruelle. En route, elle a découvert mon nom malgré moi, elle était porteur d'une lettre de recommandation pour mon secrétaire. Elle a des yeux fort beaux et ces yeux m'ont regardé sans cruauté pendant les huit dernières lieues du voyage. Elle m'a prié de lui chercher un logement peu cher; enfin il ne tenait probablement qu'à moi d'en être bien traité; mais, comme j'écris ceci depuis huit jours, le fatal souvenir de M. l'abbé Raillane était réveillé. Le nez[p. 92] aquilin, mais un peu trop petit, de celte jolie Lyonnaise, Mme ...[4], m'a rappelé celui de l'abbé, dès lors il m'a été impossible même de la regarder, et j'ai fait semblant de dormir en voiture. Même, après l'avoir fait embarquer par grâce et moyennant huit écus au lieu de vingt-cinq, j'hésitais à aller voir le nouveau lazaret pour n'être pas obligé de la voir et de recevoir ses remerciements.
Comme il n'y a aucune consolation, rien que de laid et de sale, dans les souvenirs de l'abbé Raillane, depuis vingt ans au moins je détourne les yeux avec horreur du souvenir de cette terrible époque. Cet homme aurait dû faire de moi un coquin, c'était, je le vois maintenant, un parfait jésuite[5], il me prenait à part dans nos promenades le long de l'Isère, de la porte de la Graille[6] à l'embouchure du Drac, ou simplement à un petit bois au-delà du travers de l'île A[7] pour m'expliquer que j'étais imprudent en paroles: «Mais, Monsieur, lui disais-je en d'autres termes, c'est vrai, c'est ce que je sens.
—N'importe, mon petit ami, il ne faut pas le dire, cela ne convient pas.» Si ces maximes eussent pris, je serais riche aujourd'hui, car trois ou quatre fois la fortune a frappé à ma porte. (J'ai refusé en mai 1814 la direction générale des subsistances (blé) de Paris, sous les ordres de M. le comte Beugnot, dont la femme avait pour moi la plus vive amitié; après son amant, M. Pépin de Bellile, mon ami intime, j'étais peut-être ce qu'elle aimait le[p. 93] mieux.) Je serais donc riche, mais je serais un coquin, je n'aurais pas les charmantes visions du beau, qui souvent remplissent ma tête à mon âge de fifty two.
Le lecteur croit peut-être que je cherche à éloigner cette coupe fatale d'avoir à parler de l'abbé Raillane.
Il avait un frère, tailleur au bout de la Grande-rue, près la place Claveyson, qui était l'ignoble en personne. Une seule disgrâce manquait à ce jésuite[8], il n'était pas sale, mais au contraire fort soigné et fort propre. Il avait le goût des serins des Canaries, il les faisait nicher et les tenait fort proprement, mais à côté de mon lit. Je ne conçois pas comment mon père souillait une chose aussi peu saine.
Mon grand-père n'était jamais remonté dans la maison[9] après la mort de sa fille, il ne l'eût pas souffert, lui: mon père, Chérubin Beyle, comme je l'ai dit, m'aimait comme le soutien de son nom, mais nullement comme fils.
La cage des serins, en fils de fer attachés à des montants en bois, eux-mêmes attachés au mur par des happes à plâtre, pouvait avoir neuf pieds de long, six de haut et quatre de profondeur. Dans cet espace voltigeaient tristement, loin du soleil, une trentaine de pauvres serins de toute couleur. Quand ils nichaient, l'abbé les nourrissait avec des jaunes d'œuf, et de tout ce qu'il faisait cela seul m'intéressait. Mais ces diables d'oiseaux me réveillaient[p. 94] au point du jour, bientôt après j'entendais la pelle de l'abbé qui arrangeait son feu avec un soin que j'ai reconnu plus tard appartenir aux jésuites [10]. Mais cette volière produisait beaucoup d'odeur, et à deux pieds de mon lit et dans une chambre humide, obscure, où le soleil ne donnait jamais. Nous n'avions pas de fenêtre sur le jardin Lamouroux, seulement un jour de souffrance (les villes de parlement sont remplies de mots de droit) qui donnait une brillante lumière à l'escalier L[11], ombragé par un beau tilleul, quoique l'escalier fût au moins à quarante pieds de terre. Ce tilleul devait être fort grand.
L'abbé se mettait en colère calme, sombre et méchante d'un diplomate flegmatique, quand je mangeais le pain sec de mon goûter près de ses orangers. Ces orangers étaient une véritable manie, bien plus incommode encore que celle des oiseaux. Ils avaient les uns trois pouces et les autres un pied de haut, ils étaient placés sur la fenêtre O, à laquelle le soleil atteignait un peu pendant deux mois d'été. Le fatal abbé prétendait que les miettes qui tombaient de notre pain bis attiraient les mouches, lesquelles mangeaient ses orangers. Cet abbé aurait donné des leçons de petitesse aux bourgeois les plus bourgeois, les plus patets de la ville. (Patet, prononcez: Patais, extrême attention donnée aux plus petits intérêts.)
Mes compagnons, MM. Chazel et Reytiers[12], étaient bien moins malheureux que moi. Chazel[p. 95] était un bon garçon déjà grand, dont le père, méridional je crois, Ce qui veut dire homme franc, brusque, grossier, et commis-commissionnaire de MM. Périer, ne tenait pas beaucoup au latin. Il venait seul (sans domestique) vers les dix heures, faisait mal son devoir latin et filait à midi et demi, souvent il ne venait pas le soir.
Reytiers, extrêmement joli garçon, blond et timide comme une demoiselle, n'osait pas regarder en face le terrible abbé Raillane. Il était fils unique d'un père le plus timide des hommes et le plus religieux. Il arrivait dès huit heures, sous la garde sévère d'un domestique qui venait le reprendre comme midi sonnait à Saint-André (église à la mode de la ville, dont nous entendions fort bien les cloches). Dès deux heures, le domestique ramenait Reytiers avec son goûter dans un panier. En été, vers cinq heures M. Raillane nous menait promener, en hiver rarement, et alors c'était vers les trois heures. Chazel, qui était un grand, s'ennuyait de la promenade et nous quittait bien vite.
Nous ambitionnions beaucoup aller du côté de l'île de l'Isère: d'abord la montagne, vue de là, a un aspect délicieux, et l'un des défauts littéraires de mon père et de M. Raillane était d'exagérer sans cesse les beautés de la nature (que ces belles âmes devaient bien peu sentir; ils ne pensaient qu'à gagner de l'argent). A force de nous parler de la beauté du rocher de la Buisserate[13], M. l'abbé Raillane[p. 96] nous avait fait lever la tête. Mais c'était un bien autre objet qui nous faisait aimer le rivage près l'île. Là nous voyions, nous autres pauvres prisonniers, des jeunes gens qui jouissaient de la liberté, allaient et venaient seuls et après se baignaient dans l'Isère et un ruisseau affluent nommé la Biole[14]. Excès de bonheur dont nous n'apercevions pas même la possibilité dans le lointain le plus éloigné.
M. Raillane, comme un vrai journal ministériel de nos jours, ne savait nous parler que des dangers de la liberté. Il ne voyait jamais un enfant se baignant sans nous prédire qu'il finirait par se noyer, nous rendant ainsi le service de faire de nous des lâches, et il a parfaitement réussi à mon égard. Jamais je n'ai pu apprendre à nager. Quand je fus libre, deux ans après, vers 1795, je pense, et encore en trompant mes parents et faisant chaque jour un nouveau mensonge, je songeais déjà à quitter Grenoble, à quelque prix que ce fût, j'étais amoureux de Mlle Kably, et la nage n'était plus un objet assez intéressant pour moi pour l'apprendre. Toutes les fois que je me mettais à l'eau, Roland (Alphonse) ou quelque autre fort me faisait boire.
Je n'ai point de dates pendant l'affreuse tyrannie Raillane; je devins sombre et haïssant tout le monde. Mon grand malheur était de ne pouvoir jouer avec d'autres enfants; mon père, probablement[p. 97] très fier d'avoir un précepteur pour son fils, ne craignait rien à l'égal de me voir aller avec des enfants du commun, telle était la locution des aristocrates de ce temps-là. Une seule chose pourrait me fournir une date: Mlle Marine Périer[15] (sœur du ministre Casimir Périer) vint voir M. Raillane, qui peut-être était son confesseur, peu de temps avant son mariage avec ce fou de Camille Teisseire, patriote enragé qui plus tard a brûlé ses exemplaires de Voltaire et de Rousseau, qui, en 1811, lui étant sous-préfet par la grâce de M. Crétet, son cousin, fut si stupéfait de la faveur dont il me vit jouir dans le salon[16] de madame la comtesse Daru (au rez-de-chaussée sur le jardin de l'hôtel de Biron, je crois, hôtel de la Liste civile, dernière maison à gauche de la rue Saint-Dominique, au coin du boulevard des Invalides). Je vois encore sa mine envieuse et la gaucherie de sa politesse à mon égard. Camille Teisseire s'était enrichi, ou plutôt son père s'était enrichi en fabriquant du ratafia de cerises, ce dont il avait une grande honte.
En faisant rechercher dans les actes de l'état-civil de Grenoble (que Louis XVIII appelait Grelibre) l'acte de mariage de M. Camille Teisseire (rue des Vieux-Jésuites ou place Grenette, car sa vaste maison avait deux entrées) avec Mlle Marine Périer, j'aurais la date de la tyrannie Raillane.
J'étais sombre, sournois, mécontent, je traduisais Virgile, l'abbé m'exagérait les beautés de ce poète[p. 98] et j'accueillais ses louanges comme les pauvres Polonais d'aujourd'hui doivent accueillir les louanges de la bonhomie russe dans leurs gazettes vendues; je haïssais l'abbé, je haïssais mon père, source des pouvoirs de l'abbé, je haïssais encore plus la religion[17] au nom de laquelle il me tyrannisait. Je prouvais à mon compagnon de chaîne, le timide Reytiers, que toutes les choses qu'on nous apprenait étaient des contes. Où avais-je pris ces idées? Je l'ignore. Nous avions une grande bible à estampes reliée en vert, avec des estampes gravées sur bois et insérées dans le texte, rien n'est mieux pour les enfants. Je me souviens que je cherchais sans cesse des ridicules à cette pauvre bible. Reytiers, plus timide, plus croyant, adoré par son père et par sa mère, qui mettait un pied de rouge et avait été une beauté, admettait mes doutes par complaisance pour moi.
Nous traduisions donc Virgile à grand'peine, lorsque je découvris dans la bibliothèque de mon père une traduction de Virgile en quatre volumes in-8° fort bien reliés, par ce coquin d'abbé Desfontaines, je crois. Je trouvai le volume correspondant aux Géorgiques et au second livre que nous écorchions (réellement nous ne savions pas du tout le latin). Je cachai ce bienheureux volume aux lieux d'aisance, dans une armoire où l'on déposait les plumes des chapons consommés à la maison; et là, deux ou trois fois pendant notre pénible version,[p. 99] nous allions consulter celle de Desfontaines. Il me semble que l'abbé s'en aperçut par la débonnaireté de Reytiers, ce fut une scène abominable. Je devenais de plus en plus sombre, méchant, malheureux. J'exécrais tout le monde, et ma tante Séraphie superlativement.
Un an après la mort de ma mère, vers 1791 ou 92, il me semble aujourd'hui que mon père en devint amoureux, de là d'interminables promenades aux Granges[18], où l'on méprenait en tiers en prenant la précaution de me faire marcher à quarante pas en avant dès que nous avions passé la porte de Bonne. Cette tante Séraphie m'avait pris en grippe, je ne sais pourquoi, et me faisait sans cesse gronder par mon père. Je les exécrais et il devait y paraître puisque, même aujourd'hui, quand j'ai de l'éloignement pour quelqu'un, les personnes présentes s'en aperçoivent sur-le-champ. Je détestais ma sœur cadette, Zénaïde (aujourd'hui Mme Alexandre Mallein[19]), parce qu'elle était chérie par mon père, qui chaque soir l'endormait sur ses genoux, et hautement protégée par Mlle Séraphie. Je couvrais les plâtres de la maison (et particulièrement des gippes) de caricatures[20] contre Zénaïde rapporteuse. Ma sœur Pauline (aujourd'hui Mme veuve Périer-Lagrange) et moi accusions Zénaïde de jouer auprès de nous le rôle d'espion, et je crois bien qu'il en était quelque chose. Je dînais toujours chez mon grand-père, mais nous avions fini de dîner[p. 100] comme une heure et quart sonnait à Saint-André, et à deux heures il fallait quitter le beau soleil de la place Grenette pour les chambres humides et froides que l'abbé Raillane occupait sur la cour de la maison paternelle, rue des Vieux-Jésuites. Rien n'était plus pénible pour moi; comme j'étais sombre et sournois, je faisais des projets de m'enfuir, mais où prendre de l'argent?
Un jour, mon grand-père dit à l'abbé Raillane:
«Mais, monsieur, pourquoi enseigner à cet enfant le système céleste de Ptolémée, que vous savez être faux?
—Mais il explique tout, et d'ailleurs est approuvé par l'Eglise.»
Mon grand-père ne put digérer cette réponse et souvent la répétait, mais en riant; il ne s'indignait jamais contre ce qui dépendait des autres, or mon éducation dépendait de mon père, et moins M. Gagnon avait d'estime pour son savoir, plus il respectait ses droits de père.
Mais cette réponse de l'abbé, souvent répétée par mon grand-père, que j'adorais, acheva de faire de moi un impie forcené et d'ailleurs l'être le plus sombre. Mon grand-père savait l'astronomie, quoiqu'il ne comprit rien au calcul; nous passions les soirées d'été sur la magnifique terrasse de son appartement, là il me montrait la grande et la petite Ourse et me parlait poétiquement des bergers de la Chaldée et d'Abraham. Je pris ainsi de la considération[p. 101] pour Abraham, et je dis à Reytiers: Ce n'est pas un coquin comme ces autres personnages de la Bible.
Mon grand-père avait à lui, ou emprunté à la bibliothèque publique, dont il avait été le promoteur, un exemplaire in-4° du voyage de Bruce en Nubie et Abyssinie. Ce voyage avait des gravures, de là son influence immense sur mon éducation.
J'exécrais tout ce que m'enseignaient mon père et l'abbé Raillane. Or, mon père me faisait réciter par cœur la géographie de Lacroix, l'abbé avait continué; je la savais bien, par force, mais je l'exécrais.
Bruce, descendant des rois d'Ecosse, me disait mon excellent grand-père, me donna un goût vif pour toutes les sciences dont il parlait. De là mon amour pour les mathématiques et enfin cette idée, j'ose dire de génie: Les mathématiques peuvent me faire sortir de Grenoble.
[1] Le chapitre VIII est le chapitre VI du manuscrit (fol. 99 à 121).—Écrit à Cività-Vecchia, les 5 et 6 décembre 1835.
[2] ... la magnifique allée des Marronniers, plantée ... par Lesdiguières.—Il s'agit de la promenade de la Terrasse du Jardin-de-Ville. Les orangers de la Ville de Grenoble proviennent en effet de Lesdiguières. Lors de la vente de l'hôtel de Lesdiguières aux Consuls de Grenoble pour en faire un Hôtel-de-Ville, il y eut une longue discussion au sujet de la cession de l'orangerie et des orangers. Ceux-ci furent définitivement compris dans le contrat de vente du 5 août 1719 (Arch. mun. de Grenoble, DD 101).—Il importe toutefois de noter que la terrasse et l'orangerie ne furent pas l'œuvre de Lesdiguières lui-même. Elles datent en effet de 1675 environ.—Les orangers sont encore aujourd'hui,—mais non plus «en grande pompe»,—placés dans le Jardin-de-Ville et sur la place Grenette.
[3] ... était venu se cacher à Avignon à la suite ...—Après ces mots il y a dans le manuscrit un blanc d'une demi-ligne.
[4]—cette jolie Lyonnaise, Mme ...—Le nom a été laissé en blanc par Stendhal.
[5] ... un parfait jésuite ...—Ms.: «Tejé.»
[6] ... la porte de la Graille ...—Cette porte se trouvait sur l'actuel quai Créqui. Elle a été démolie en 1884, lors de l'agrandissement de l'enceinte. (Voir notre plan de Grenoble en 1793.)
[7] ... au-delà du travers de l'île A ...—Ici un plan explicatif.—L'île a disparu aujourd'hui; elle s'appelait l'île Sirand.
[8] Une seule disgrâce manquait à ce jésuite ...—Ms.: «Tejé.»
[9] Mon grand-père n'était jamais remonté dans la maison ...—Suit un plan d'une partie de la «maison paternelle», rue des Vieux-Jésuites.
[10] ... que j'ai reconnu plus tard appartenir aux jésuites.—Ms.: «Tejés.»
[11] ... qui donnait une brillante lumière à l'escalier L ...—Ainsi désigné par Stendhal dans son plan de la maison paternelle: «Escalier rejoignant celui de la maison.»
[12] ... Reytiers ...—Teisseire. (Note de Stendhal.)
[13] ... la beauté du rocher de la Buisserate ...—La montagne du Néron, appelée aussi, improprement, le Casque de Néron, qui se termine au-dessus de la Buisserate (hameau de Saint-Martin-le-Vinoux) par un rocher à pic de 300 mètres environ.
[14] ... un ruisseau affluent nommé la Biole.—Mot patois signifiant petit ruisseau. Il s'agit sans doute d'un petit cours d'eau, dénommé aujourd'hui canal de la Scierie, et qui du temps de Stendhal servait au colmatage des terrains voisins.
[15] MlleMarine Périer ...—Adélaïde-Hélène, dite Marine Périer, a épousé Camille-Hyacinthe Teisseire le 13 thermidor an II (31 juillet 1794).
[16] ... la faveur dont il me vit jouir dans le salon ... —Variante: «Où il me vit établi dans ...»
[17] ... je haïssais encore plus la religion ...—Ms.: «Gion.»
[18] ... d'interminables promenades aux Granges ...—Ce quartier suburbain, alors peuplé en grande partie de peigneurs de chanvre, est aujourd'hui à l'intérieur de la ville. Il est situé aux alentours de l'église Saint-Joseph. (Voir notre plan de Grenoble en 1793.)
[19] ... Mme Alexandre Mallein ...—Marie-Zénaïde-Caroline Beyle, née le 10 octobre 1788, épousa le 30 mai 1815 Alexandre-Charles Mallein, contrôleur des Contributions directes.
[20] Je couvrais les plâtres de la maison de caricatures ...—Je me rappelle d'une fort plaisante. Zénaïde était représentée dévidant du fil placé sur un tour; elle y était dessinée en pied, assez grotesquement, avec cette devise au bas: «Zénaïde, jalousie rapportante, Caroline Beyle.» (Note au crayon de R. Colomb.)
Malgré toute sa finesse dauphinoise, mon père, Chérubin Beyle, était un homme passionné. A sa passion pour Bourdaloue et Massillon avait succédé la passion de l'agriculture, qui, dans la suite, fut renversée par l'amour de la truelle (ou de la bâtisse), qu'il avait toujours eu, et enfin par l'ultracisme et la passion d'administrer la Ville de Grenoble au profit des Bourbons[2]. Mon père rêvait nuit et jour à ce qui était l'objet de sa passion, il avait beaucoup de finesse, une grande expérience des finasseries des autres Dauphinois, et je concilierais assez volontiers de tout cela qu'il avait du talent. Mais je n'ai pas plus d'idée de cela que de sa physionomie.
Mon père se mit à aller deux fois la semaine à[p. 104] Claix; c'est un domaine (terme du pays qui veut dire une petite terre) de cent cinquante arpents, je crois, situé au midi de la ville, sur le penchant de la montagne, au-delà du Drac[3]. Tout le terrain de Claix et de Furonières est sec, calcaire, rempli de pierres. Un curé libertin inventa, vers 1750, de cultiver le marais au couchant du pont de Claix; ce marais a fait la fortune du pays.
La maison de mon père était à deux lieues de Grenoble, j'ai fait ce trajet, à pied, mille fois peut-être. C'est sans doute à cet exercice que mon père a dû une santé parfaite qui l'a conduit jusqu'à soixante-douze ans, je pense. Un bourgeois, à Grenoble, n'est considéré qu'autant qu'il a un domaine. Lefèvre, le perruquier de mon père, avait un domaine à Corenc et manquait souvent sa pratique parce qu'il était allé à Corenc, excuse toujours bien reçue. Quelquefois nous abrégions en passant le Drac au bac de Seyssins, au point A.
Mon père était si rempli de sa passion nouvelle qu'il m'en parlait sans cesse. Il fit venir (terme du pays, apparemment), il fit venir de Paris, ou de Lyon, la Bibliothèque agronomique ou économique, laquelle avait des estampes; je feuilletais beaucoup ce livre, ce qui me valut d'aller souvent à Claix (c'est-à-dire à notre maison de Furonières) les jeudis, jours de congé. Je promenais avec mon père dans les champs et j'écoutais de mauvaise grâce l'exposé[p. 105] de ses projets, toutefois le plaisir d'avoir quelqu'un pour écouter ces romans qu'il appelait des calculs fit que plusieurs fois je ne revenais à la ville que le vendredi; quelquefois nous partions dès le mercredi soir.
Claix me déplaisait parce que j'y étais toujours assiégé de projets d'agriculture; mais bientôt je découvris[4] une grande compensation. Je trouvai moyen de voler des volumes de Voltaire[5] dans l'édition des quarante volumes encadrés que mon père avait à Claix (son domaine) et qui était parfaitement reliée, en veau imitant le marbre. Il y avait quarante volumes, je pense, fort serrés, j'en prenais deux et écartais un peu tous les autres, il n'y paraissait pas. D'ailleurs, ce livre dangereux avait été placé au rayon le plus élevé de la bibliothèque, en bois de cerisier et glaces, laquelle était souvent fermée à clef.
Par la grâce de Dieu, même à cet âge les gravures me semblaient ridicules, et quelles gravures! Celles de la Pucelle.
Ce miracle me faisait presque croire que Dieu m'avait destiné à avoir bon goût et à écrire un jour l'Histoire de la Peinture en Italie.
Vous passions toujours les féries[6] à Claix, c'est-à-dire les mois de septembre et d'août. Mes maîtres se plaignaient que j'oubliais tout mon latin pendant ce temps de plaisir. Rien ne m'était si odieux[7] que quand mon père appelait nos courses à Claix nos[p. 106] plaisirs. J'étais comme un galérien que l'on forcerait à appeler ses plaisirs un système de chaînes un peu moins pesantes que les autres.
J'étais outré et, je pense, fort méchant et fort injuste envers mon père et l'abbé Raillane. J'avoue, mais c'est avec un grand effort de raison, même en 1835, que je ne puis juger ces deux hommes. Ils ont empoisonné mon enfance dans toute l'énergie du mot empoisonnement. Ils avaient des visages sévères et m'ont constamment empêché d'échanger un mot avec un enfant de mon âge. Ce n'est qu'à l'époque des Écoles centrales (admirable ouvrage de M. de Tracy) que j'ai débuté dans la société des enfants de mon âge, mais non pas avec la gaieté et l'insouciance de l'enfance; j'y suis arrivé sournois, méchant, rempli d'idées de vengeance pour le moindre coup de poing, qui me faisait l'effet d'un soufflet entre hommes, en un mot tout, excepté traître.
Le grand mal de la tyrannie Raillane, c'est que je sentais mes maux. Je voyais sans cesse passer sur la Grenette des enfants de mon âge qui allaient ensemble se promener et courir, or c'est ce qu'on ne m'a pas permis une seule fois. Quand je laissais entrevoir le chagrin qui me dévorait, on me disait: «Tu monteras en voiture», et madame Périer-Lagrange (mère de mon beau-frère), figure des plus tristes, me prenait dans sa voiture quand elle allait faire une promenade de santé; elle me grondait[p. 107] au moins autant que l'abbé Raillane, elle était sèche et dévote et avait, comme l'abbé, une de ces figures inflexibles qui ne rient jamais. Quel équivalent pour une promenade avec de petits polissons de mon âge! Qui le croirait, je n'ai jamais joué aux gobilles (billes) et je n'ai eu de toupie qu'à l'intercession de mon grand-père, auquel, pour ce sujet, sa fille Séraphie fit une scène.
J'étais donc fort sournois, fort méchant, lorsque dans la belle bibliothèque de Claix je fis la découverte d'un Don Quichotte français. Ce livre avait des estampes, mais il avait l'air vieux, et j'abhorrais tout ce qui était vieux, car mes parents m'empêchaient de voir les jeunes et ils me semblaient extrêmement vieux. Mais enfin, je sus comprendre les estampes, qui me semblaient plaisantes: Sancho Pança monté sur son bon biquet est soutenu par quatre piquets, Ginès de Panamone a enlevé l'âne[8].
Don Quichotte me fit mourir de rire. Qu'on daigne réfléchir que depuis la mort de ma pauvre mère je n'avais pas ri, j'étais victime de l'éducation aristocratique et religieuse la plus suivie. Mes tyrans ne s'étaient pas démentis un moment. On refusait toute invitation. Je surprenais souvent des discussions dans lesquelles mon grand-père était d'avis qu'on me permît d'accepter. Ma tante Séraphie faisait opposition en termes injurieux pour moi, mon père, qui lui était soumis, faisait à mon grand-père[p. 108] des réponses jésuitiques, que je savais bien n'engager à rien. Ma tante Elisabeth haussait les épaules. Quand un projet de promenade avait résisté à une telle discussion, mon père faisait intervenir l'abbé Raillane pour un devoir dont je ne m'étais pas acquitté la veille et qu'il fallait faire précisément au moment de la promenade.
Qu'on juge de l'effet de Don Quichotte au milieu d'une si horrible tristesse! La découverte de ce livre, lu sous le second tilleul de l'allée du côté du parterre, dont le terrain s'enfonçait d'un pied, et là je m'asseyais, est peut-être la plus grande époque de ma vie.
Qui le croira? Mon père, me voyant pouffer de rire, venait me gronder, me menaçait de me retirer le livre, ce qu'il fit plusieurs fois, et m'emmenait dans ses champs pour m'expliquer ses projets de réparations (bonifications, amendements).
Troublé, même dans la lecture de Don Quichotte, je me cachai dans les charmilles, petite salle de verdure à l'extrémité orientale du clos (petit parc), enceinte de murs[9].
Je trouvai un Molière avec estampes, les estampes me semblaient ridicules et je ne compris que l'Avare. Je trouvai les comédies de Destouches, et l une des plus ridicules m'attendrit jusqu'aux larmes. Il y avait une histoire d'amour mêlé de générosité, c'était là mon faible. C'est en vain que je cherche[p. 109] dans ma mémoire le titre de cette comédie, inconnue même parmi les comédies inconnues de ce plat diplomate. Le Tambour nocturne, où se trouve une idée copiée de l'anglais, m'amusa beaucoup.
Je trouve comme fait établi dans ma tête que, dès l'âge de sept ans, j'avais résolu de faire des comédies, comme Molière. Il n'y a pas dix ans que je me souvenais encore du comment de cette résolution.
Mon grand-père fut charmé de mon enthousiasme pour Don Quichotte que je lui racontai, car je lui disais tout à peu près, cet excellent homme de 65 ans était, dans le fait, mon seul camarade.
Il me prêta, mais à l'insu de sa fille Séraphie, le Roland furieux, traduit ou plutôt, je crois, imité de l'Arioste par M. de Tressan (dont le fils, aujourd'hui maréchal de camp, et en 1820, ultra assez plat, mais, en 1788, jeune homme charmant, avait tant contribué à me faire apprendre à lire en me promettant un petit livre plein d'images qu'il ne m'a jamais donné, manque de parole qui me choqua beaucoup).
L'Arioste forma mon caractère, je devins amoureux fou de Bradamante, que je me figurais une grosse fille de vingt-quatre ans avec des appas de la plus éclatante blancheur.
J'avais en horreur tous les détails bourgeois et bas qui ont servi à Molière pour faire connaître sa pensée. Ces détails me rappelaient trop ma malheureuse vie. Il n'y a pas trois jours (décembre 1835)[p. 110] que deux bourgeois de ma connaissance, allant donner entre eux une scène comique de petite dissimulation et de demi-dispute, j'ai fait dix pas pour ne pas entendre. J'ai horreur de ces choses-là, ce qui m'a empêché de prendre de l'expérience. Ce n'est pas un petit malheur.
Tout ce qui est bas et plat dans le genre bourgeois me rappelle Grenoble, tout ce qui me rappelle Grenoble me fait horreur: non, horreur est trop noble, mal au cœur.
Grenoble est pour moi comme le souvenir d'une abominable indigestion; il n'y a pas de danger, mais un effroyable dégoût. Tout ce qui est bas et plat sans compensation, tout ce qui est ennemi du moindre mouvement généreux, tout ce qui se réjouit du malheur de qui aime la patrie ou est généreux, voilà Grenoble pour moi.
Rien ne m'a étonné dans mes voyages comme d'entendre dire par des officiers de ma connaissance que Grenoble était une ville charmante, pétillante d'esprit et où les jolies femmes ne s'oubliaient pas. La première fois que j'entendis ce propos, ce fut à table, chez le général Moncey (aujourd'hui maréchal, duc de Conegliano), en 1802, à Milan ou à Crémone; je fus si étonné que je demandai des détails d'un côté de la table à l'autre: alors sous-lieutenant riche, 150 francs par mois, je ne doutais de rien. Mon exécration pour l'état de mal au cœur et d'indigestion continue, auquel je venais seulement[p. 111] d'échapper, était au comble. L'officier d'état-major soutint fort bien son dire, il avait passé quinze ou dix-huit mois à Grenoble, il soutenait que c'était la ville la plus agréable de la province, il me cita mesdames Menand-Dulauron, Piat-Desvials, Tournus, Duchamps de Montmort, les demoiselles Rivière (filles de l'aubergiste, rue Montorge), les demoiselles Bailly, marchandes de modes, amies de mon oncle, messieurs Drevon, Drevon l'aîné et Drevon la Pareille, M. Dolle de la Porte-de-France[10], et, pour la société aristocrate (mot de 1800, remplacé par ultra, puis par légitimiste), M. le chevalier de Marcieu, M. de Bailly.
Hélas! à peine avais-je entendu prononcer ces noms aimables! Mes parents ne les rappelaient que pour déplorer leur folie, car ils blâmaient tout, ils avaient la jaunisse, il faut le répéter pour expliquer mon malheur d'une façon raisonnable. A la mort de ma mère, mes parents désespérés avaient rompu toute relation avec le monde; ma mère était l'âme et la gaieté de la famille, mon père, sombre, timide, rancunier, peu aimable, avait le caractère de Genève (on y calcule et jamais on n'y rit) et n'avait, ce me semble, jamais eu de relations qu'à cause de ma mère. Mon grand-père, homme aimable, homme du monde, l'homme de la ville dont la conversation était le plus recherchée par tous, depuis l'artisan jusqu'au grand seigneur, depuis Mme Barthélemy, cordonnière, femme d'esprit, jusqu'à M. le baron des Adrets,[p. 112] chez qui il continua à dîner une fois par mois, percé jusqu'au fond du cœur par la mort du seul être qu'il aimât et se voyant arrivé à soixante ans, avait rompu avec le monde par dégoût de la vie. Ma seule tante Elisabeth, indépendante et même riche (de la richesse de Grenoble en 1789), avait conservé des maisons où elle allait faire sa partie le soir (l'avant-souper, de 7 heures à 9). Elle sortait ainsi deux ou trois fois la semaine et quelquefois, quoique remplie de respect pour les droits paternels, par pitié pour moi, quand mon père était à Claix, elle prétendait avoir besoin de moi et m'emmenait, comme son chevalier, chez Mlle Simon, dans la maison neuve des Jacobins, laquelle mettait un pied de rouge. Ma bonne tante me fit même assister à un grand souper donné par Mlle Simon. Je me souviens encore de l'éclat des lumières et de la magnificence du service; il y eut au milieu de la table un surtout avec des statues d'argent. Le lendemain, ma tante Séraphie me dénonça à mon père et il y eut une scène. Ces disputes, fort polies dans la forme mais où l'on se disait de ces mots piquants qu'on n'oublie pas, faisaient le seul amusement de cette famille morose où mon mauvais sort m'avait jeté. Combien j'enviais le neveu de madame Barthélemy, notre cordonnière!
Je souffrais, mais je ne voyais point les causes de tout cela, j'attribuais tout à la méchanceté de mon père et de Séraphie. Il fallait, pour être juste, voir[p. 113] des bourgeois bouffis d'orgueil et qui veulent donner à leur unique fils, comme ils m'appelaient, une éducation aristocratique. Ces idées étaient bien au-dessus de mon âge, et d'ailleurs qui me les aurait données? Je n'avais pour amis que Marion, la cuisinière, et Lambert, le valet de chambre de mon grand-père, et sans cesse, m'entendant rire à la cuisine avec eux, Séraphie me rappelait. Dans leur humeur noire, j'étais leur unique occupation, ils décoraient cette vexation du nom d'éducation et probablement étaient de bonne foi. Par ce contact continuel, mon grand-père me communiqua sa vénération pour les lettres. Horace et Hippocrate étaient bien d'autres hommes, à mes yeux, que Romulus, Alexandre et Numa. M. de Voltaire était bien un autre homme que cet imbécile de Louis XVI, dont il se moquait, ou ce roué de Louis XV, dont il réprouvait les mœurs sales; il nommait avec dégoût la du Barry, et l'absence du mot madame, au milieu de nos habitudes polies, me frappa beaucoup, j'avais horreur de ces êtres. On disait toujours: M. de Voltaire, et mon grand-père ne prononçait ce nom qu'avec un sourire mélangé de respect et d'affection.
Bientôt arriva la politique. Ma famille était des plus aristocrates de la ville, ce qui fit que sur-le-champ je me sentis républicain enragé. Je voyais passer les beaux régiments de dragons allant en Italie, toujours quelqu'un était logé à la maison, je les dévorais des yeux; or, mes parents les exécraient.[p. 114] Bientôt, les prêtres se cachèrent, il y eut toujours à la maison un prêtre ou deux de caché. La gloutonnerie d'un des premiers qui vinrent, un gros homme avec des yeux hors de la tête lorsqu'il mangeait du petit salé, me frappa[11] de dégoût. (Nous avions d'excellent petit salé que j'allais chercher à la cave avec le domestique Lambert, il était conservé dans une pierre creusée en bassin.) On mangeait, à la maison, avec une rare propreté et des soins recherchés. On me recommandait, par exemple, de ne faire aucun bruit avec la bouche. La plupart de ces prêtres, gens du commun, produisaient ce bruit de la langue contre le palais, ils rompaient le pain d'une manière sale, il n'en fallait pas tant pour que ces gens-là, dont la place était à ma gauche, me fissent horreur[12].
On guillotina un de nos cousins à Lyon (M. Senterre), et le sombre de la famille et son état de haine et de mécontentement de toutes choses redoubla.
Autrefois, quand j'entendais parler des joies naïves de l'enfance, des étourderies de cet âge, du bonheur de la première jeunesse, le seul véritable de la vie, mon cœur se serrait. Je n'ai rien connu de tout cela; et bien plus, cet âge a été pour moi une époque continue de malheur, et de haine, et de désirs de vengeance toujours impuissants. Tout mon malheur peut se résumer en deux mots: jamais on ne m'a permis de parler à un enfant de mon âge. Et[p. 115] mes parents, s'ennuyant beaucoup par suite de leur séparation de toute société, m'honoraient d'une attention continue. Pour ces deux causes, à cette époque de la vie, si gaie pour les autres enfants, j'étais méchant, sombre, déraisonnable, esclave en un mot, dans le pire sens du mot, et peu à peu je pris les sentiments de cet état. Le peu de bonheur que je pouvais arracher était préservé par le mensonge. Sous un autre rapport, j'étais absolument comme les peuples actuels de l'Europe, mes tyrans me parlaient toujours avec les douces paroles de la plus tendre sollicitude, et leur plus ferme alliée ôtait la religion[13]. J'avais à subir des homélies continuelles sur l'amour paternel et les devoirs des enfants. Un jour, ennuyé des paroles de mon père, je lui dis: «Si tu m'aimes tant, donne-moi cinq sous par jour et laisse-moi vivre comme je voudrai. D'ailleurs, sois bien sûr d'une chose, c'est que dès que j'aurai l'âge je m'engagerai.»
Mon père marcha sur moi comme pour m'anéantir, il était hors de lui. « Tu n'es qu'un vilain impie», me dit-il. Ne dirait-on pas l'empereur Nicolas et la municipalité de Varsovie, dont on parle tant le jour où j'écris (7 décembre 1835, Cività-Vecchia), tant il est vrai que toutes les tyrannies se ressemblent.
Par un grand hasard, il me semble que je ne suis pas resté méchant, mais seulement dégoûté pour le reste de ma vie des bourgeois, des jésuites[14] et des hypocrites de toutes les espèces. Je fus peut-être[p. 116] guéri de la méchanceté par mes succès de 1797, 98 et 99 et la conscience de mes forces. Outre mes autres belles qualités, j'avais un orgueil insupportable[15].
A vrai dire, en y pensant bien, je ne me suis pas guéri de mon horreur peu raisonnable pour Grenoble; dans le vrai sens du mot, je l'ai oubliée. Les magnifiques souvenirs de l'Italie, de Milan, ont tout effacé.
Il ne m'est resté qu'un notable manque dans ma connaissance des hommes et des choses. Tous les détails qui forment la vie de Chrysale dans l'École des Femmes:
Et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats[16],
me font horreur... Si l'on veut me permettre une image aussi dégoûtante que ma sensation, c'est comme l'odeur des huîtres pour un homme qui a eu une effroyable indigestion d'huîtres.
Tous les faits qui forment la vie de Chrysale sont remplacés chez moi par du romanesque. Je crois que celle tache dans mon télescope a été utile pour mes personnages de roman, il y a une sorte de bassesse bourgeoise qu'ils ne peuvent avoir, et pour l'auteur ce serait parler le chinois, qu'il ne sait pas. Ce mot: bassesse bourgeoise, n'exprime qu'une nuance, cela sera peut-être bien obscur en 1880. Grâce aux journaux, le bourgeois provincial devient rare, il n'y a plus de mœurs d'état: un jeune homme élégant[p. 117] de Paris, avec lequel je me rencontrais en compagnie fort gaie, était fort bien mis, sans affectation, et dépensait 8 ou 10.000 francs. In jour je demandai:
«Que fait-il?
—C'est un avoué (procureur) fort occupé», me dit-on.
Je citerai donc, comme exemple de la bassesse bourgeoise, le style de mon excellent ami M. Fauriel (de l'Institut), dans son excellente Vie de Dante, imprimée en 1834 dans la Revue de Paris. Mais, hélas! où seront ces choses en 1880? Quelque homme d'esprit écrivant bien se sera emparé des profondes recherches de l'excellent Fauriel, et les travaux de ce bon bourgeois si consciencieux seront complètement oubliés. Il a été le plus bel homme de Paris. Madame Condorcet (Sophie Grouchy), grande connaisseuse, se l'adjugea, le bourgeois Fauriel eut la niaiserie de l'aimer, et en mourant, vers 1820, je crois, elle lui a laissé 1.200 francs de rente, comme à un laquais. Il a été profondément humilié. Je lui dis, quand il me donna dix pages pour l'Amour, aventures arabes: «Quand on a affaire à une princesse ou à une femme trop riche, il faut la battre, ou l'amour s'éteint.» Ce propos lui fit horreur, et il le dit sans doute à la petite mademoiselle Clarke, qui est faite comme un point d'interrogation, comme Pope. Ce qui fit que, peu après, elle me fit faire une réprimande par un nigaud de ses amis (M. Augustin Thierry, membre de l'Institut), et je la plantai là. Il y avait[p. 118] une jolie femme dans cette société, madame Belloc, mais elle faisait l'amour avec un autre point d'interrogation, noir et crochu, mademoiselle de M....; et, en vérité, j'approuve ces pauvres femmes.
[1] Le chapitre IX est le chapitre VII du manuscrit (fol. 122 à 144).—Écrit à Cività-Vecchia, les 6 et 7 décembre 1835.
[2] ... la passion d'administrer la Ville de Grenoble au profit des Bourbons ...—Chérubin Beyle, le père de Stendhal, nommé adjoint au maire de Grenoble le 29 septembre 1803, était encore en fonctions lors de l'avènement de Louis XVIII. Il fut remplacé en 1816 par le marquis de Pina, qui devint la même année maire de la ville.
[3] ... sur le penchant de la montagne, au-delà du Drac.—Suit un plan des environs au midi de Grenoble. En «A, pont en fil de fer établi vers 1826;—B, pont de Claix, fort remarquable, à plein cintre;—C, citadelle;—G, place Grenette;—D, rocher de Comboire, à pic sur le Drac, lequel est fort rapide, rocher et bois remplis de renards;—R, maison de campagne qui joua le plus grand rôle dans mon enfance, que j'ai revue en 1828, vendue à un général».—Le pont suspendu sur le Drac, dit pont de Sussenage, remplaça en 1826 le bac de Seyasins, dont Stendhal parle un peu plus loin.
[4] ... mais bientôt je découvris ...—Variante; «Trouvai.»
[5] Je trouvai moyen de voler des volumes de Voltaire ...—En surcharge: «Bientôt après, je volai des volumes.»
[6] Nous passions toujours les fériés à Claix ...—C'est-à-dire vacances. Nom latin francisé.
[7] Rien ne m'était si odieux ...—Le reste de la ligne a été laissé en blanc et marqué d'une +.
[8] ... Ginès de Panamone a enlevé l'âne.—Suit un grossier croquis de Sancho Pança sur son âne.
[9] ... petite salle de verdure ... enceinte de murs.—Suit un plan de la propriété de Claix, avec la mention: «Ce clos a six journaux de 600 toises.»
[10] ... M. Dolle de la Porte-de-France ...—Jean-Baptiste Dolle le jeune, qui avait construit à grands frais, au-dessus du rocher de la Porte-de-France, un beau jardin d'agrément. (Voir J. Vellein, L'habitation de plaisance d'un grenoblois au XVIIIe siècle. Les Jardins Dolle. Grenoble, 1896, br. in-8°.) Ces jardins sont aujourd'hui la propriété de la Ville de Grenoble; ils sont loués au Syndicat d'initiative de Grenoble, qui en a fait à nouveau une belle promenade publique.
[11] ... me frappa ...—Ce mot est marqué d'une croix. Il était certainement destiné à être corrigé.
[12] ... me fissent horreur.—Ms.: «Fît».—Le bas du fol. 138 est occupé par deux plans: 1° «Voici le plan de la table chez mon grand-père, où j'ai mangé de 7 ans à 16 et demi»;—2° «Voici la salle-à-manger.» Celle-ci possède de nombreux dégagements: «D, porte sur le petit escalier tournant»; «R, porte de la cuisine»; «E, grand passage conduisant dans l'autre maison sur la place Grenette»; «N, entrée de la chambre de Lambert»; «T, grande porte sur le grand escalier», «très beau»; «K, porte de la chambre de mon grand-père.» (Voir notre plan de l'appartement Gagnon.)
[13] ... leur plus ferme alliée était la religion.—Ms.: «Gion.»
[14] ... des jésuites...—Ms.: «Tejé.»
[15] ... j'avais un orgueil insupportable.—Le fol. 141 commence de la manière suivante: «Quand j'arrivai à l'École centrale (en l'an V, je crois), dès l'année suivante je remportai des premiers prix, peut-être y a-t-il mémoire de cela dans les papiers du Département (depuis, préfecture). Quand j'arrivai à l'École centrale, j'y apportai tous ces vices abominables, dont je fus guéri à coups de poing.» Stendhal a ajouté dans la marge: «Renvoyé à l'article: École centrale.»
[16] Et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats.—Stendhal a voulu dire: «les Femmes Savantes» (Acte II, scène VII).
Je ne trouve aucune mémoire de la manière dont je fus délivré de la tyrannie Raillane. Ce coquin-là aurait dû faire de moi un excellent jésuite[2], digne de succéder à mon père, ou un soldat crapuleux, coureur de filles et de cabarets. Le tempérament eût, comme chez Fielding, absolument voilé l'ignoble. Je serais donc l'une ou l'autre de ces deux aimables choses, sans mon excellent grand-père qui, à son insu, me communiqua son culte pour Horace, Sophocle, Euripide et la littérature élégante. Par bonheur, il méprisait tous les galants écrivains ses contemporains, je ne fus point empoisonné par les Marmontel, Dorat et autres canailles. Je ne sais pourquoi il faisait à tous moments des protestations de[p. 120] respect en faveur des prêtres, qui dans le fait lui faisaient horreur comme quelque chose de sale. Les voyant impatronisés dans son salon par sa fille Séraphie et mon père, son gendre, il était parfaitement poli à leur égard comme avec tout le monde. Pour parler de quelque chose, il parlait littérature et, par exemple, des auteurs sacrés, quoiqu'il ne les aimât guère. Mais cet homme si poli avait toutes les peines du monde à dissimuler[3] le profond dégoût que lui donnait leur ignorance. «Quoi, même l'abbé Fleury, leur historien, ils l'ignorent!» Je surpris un jour ce propos, qui redoubla ma confiance en lui.
Je découvris bientôt après qu'il se confessait fort rarement. Il était extrêmement poli envers la religion[4] plutôt que croyant. Il eut été dévot s'il avait pu croire de retrouver dans le ciel sa fille Henriette (M. le duc de Bro[glie] dit: «Il me semble que ma fille est en Amérique»), mais il n'était que triste et silencieux. Dès qu'il arrivait quelqu'un, par politesse il parlait et racontait des anecdotes.
Peut-être M. Raillane fut-il obligé de se cacher pour refus de serment à la Constitution civile du clergé. Quoi qu'il en soit, son éloignement fut pour moi le plus grand événement possible, et je n'en ai pas de souvenir.
Ceci constitue un défaut de ma tête, dont je découvre plusieurs exemples, depuis trois ans que m'est venue, sur l'esplanade de San Pietro in Montorio[p. 121] (Janicule), l'idée lumineuse que j'allais avoir cinquante[5] ans et qu'il était temps de songer au départ, et auparavant de se donner le plaisir de regarder un instant en arrière. Je n'ai aucune mémoire des époques ou des moments où j'ai senti trop vivement. Une de mes raisons pour me croire brave, c'est que je me souviens avec une clarté parfaite des moindres circonstances des duels où je me suis trouvé engagé. A l'armée, quand il pleuvait, et que je marchais dans la boue, cette bravoure était suffisante tout juste; mais quand je n'avais pas été mouillé durant la nuit précédente, et que mon cheval ne glissait pas sous moi, la témérité la plus périlleuse était pour moi, à la lettre, un vrai plaisir. Mes camarades raisonnables devenaient sérieux et pâles, ou bien tout rouges, Mathis devenait plus gai, et Forisse plus raisonnable. C'est comme actuellement, je ne pense jamais à la possibilité of wanting of a thousand francs, ce qui me semble pourtant l'idée dominante, la grande pensée de mes amis de mon âge, qui ont une aisance dont je suis bien loin (par exemple, MM. Besan[6], Kolon[7], etc.); mais je m'égare. La grande difficulté d'écrire ces mémoires, c'est de n'avoir et de n'écrire juste que les souvenirs relatifs à l'époque que je tiens par les cheveux; par exemple, il s'agit maintenant des temps, évidemment moins malheureux, que j'ai passés sous le maître Durand.
C'était un bonhomme de quarante-cinq ans peut-être,[p. 122] gros et rond de toutes les manières, qui avait un grand fils de dix-huit ans fort aimable, que j'admirais de loin et qui plus tard fut, je pense, amoureux de ma sœur. Il n'y avait rien de moins jésuite[8] et de moins sournois que ce pauvre M. Durand; de plus il était poli, vêtu avec une stricte économie, mais jamais salement. A la vérité, il ne savait pas un mot de latin, mais ni moi non plus, et cela n'était pas fait pour nous brouiller.
Je savais par cœur le Selectæ e profanis, et surtout l'histoire d'Androclès et de son lion, je savais de même l'Ancien Testament et peut-être un peu de Virgile et de Cornélius Nepos. Mais si l'on m'eût donné, écrite en latin, la permission d'un congé de huit jours, je n'y eusse rien compris. Le malheureux latin fait par des modernes, le De Viris illustribus, où l'on parlait de Romulus, que j'aimais fort, était inintelligible pour moi. Hé bien! M. Durand était de même, il savait par cœur les auteurs qu'il expliquait depuis vingt ans, mais mon grand-père ayant essayé une ou deux fois de le consulter sur quelque difficulté de son Horace non expliqué par Jean Bond (ce mot faisait mon bonheur; au milieu de tant d'ennuis, quel plaisir de pouvoir rire de Jambon!), M. Durand ne comprenait pas même ce qui faisait l'objet de la discussion.
Ainsi la méthode était pitoyable et, si je le voulais, j'enseignerais le latin en dix-huit mois à un enfant d'une intelligence ordinaire. Mais n'était-ce[p. 123] rien que d'être accoutumé à manger de la vache enragée, deux heures le matin et trois heures le soir? C'est une grande question. (Vers 1819, j'ai enseigné l'anglais en vingt-six jours à M. Antonio Clerichetti, de Milan, qui souffrait sous un père avare. Le trentième jour, il vendit à un libraire sa traduction des interrogatoires de la princesse de Galles (Caroline de Brunswick), insigne catin que son mari, roi et prodiguant les millions, n'a pas pu convaincre de l'avoir fait ce que sont 95 maris sur 100.)
Donc, je n'ai aucune souvenance de l'événement qui me sépara de M. Raillane.
Après la douleur de tous les moments, fruit de la tyrannie de ce jésuite[9] méchant, je me vois tout-à-coup établi chez mon excellent grand-père, couché dans un petit cabinet en trapèze à côté de sa chambre, et recevant des leçons de latin du bonhomme Durand qui venait, ce me semble, deux fois par jour, de dix à onze heures et de deux à trois. Mes parents tenaient toujours fermement au principe de ne pas me laisser avoir communication avec des enfants du commun. Mais les leçons de M. Durand avaient lieu en présence de mon excellent grand-père, en hiver dans sa chambre, au point M, en été dans le grand salon du côté de la terrasse, en M', quelquefois en M" dans une antichambre où l'on ne passait presque jamais[10].
Les souvenirs de la tyrannie Raillane m'ont fait[p. 124] horreur jusqu'en 1814; vers cette époque je les ai oubliés, les événements de la Restauration absorbaient mon horreur et mon dégoût. C'est ce dernier sentiment tout seul que m'inspirent les souvenirs du maître Durand à la maison, car j'ai aussi suivi son cours à l'École centrale, mais alors j'étais heureux, du moins comparativement, je commençais à être sensible au beau paysage formé par la vue des collines d'Eybens et d'Echirolles et par le beau pré anglais de la porte de Bonne, sur lesquels dominait la fenêtre de l'École, heureusement située au troisième étage du collège[11]; on réparait le reste[12].
Il paraît qu'en hiver M. Durand venait me donner leçon de sept heures du soir à huit. Du moins, je me vois sur une petite table éclairée par une chandelle, M. Durand presque en rang d'oignons[13] avec la famille, devant le feu de mon grand-père, et par un demi à droite faisant face à la petite table où moi, H, étais placé[14].
C'est là que M. Durand commença à m'expliquer les Métamorphoses d'Ovide. Je le vois encore, ainsi que la couleur jaune ou racine de buis de la couverture du livre. Il me semble qu'à cause du sujet trop gai il y eut une discussion entre Séraphie, qui avait le diable au corps plus que jamais, et son père. Par amour de la belle littérature, il tint ferme et au lieu des horreurs sombres de l'Ancien Testament [15], j'eus les amours de Pyrame et de Thisbé, et surtout Daphné changée en laurier. Rien ne m'amusa autant[p. 125] que ce conte. Pour la première fois de ma vie, je compris qu'il pouvait être agréable de savoir le latin, qui faisait mon supplice depuis tant d'années.
Mais ici la chronologie de cette importante histoire demande: «Depuis combien d'années?»
En vérité, je n'en sais rien, j'avais commencé le latin à sept[16] ans, en 1790. Je suppose que l'an VII de la République correspond à 1799 à cause du rébus:
Lancette
Laitue
Rat[17]
affiché au Luxembourg à propos du Directoire.
Il me semble qu'en l'an V j'étais à l'École centrale.
J'y étais depuis un an, car nous occupions la grande salle des mathématiques, au premier, quand arriva l'assassinat de Roberjot à Rastadt[18]. C'était peut-être en 1794 que j'expliquais les Métamorphoses d'Ovide. Mon grand-père me permettait quelquefois de lire la traduction de M. Dubois-Fontanelle, je crois, qui plus tard fut mon professeur.
Il me semble que la mort de Louis XVI, 21 janvier 1795, eut lieu pendant la tyrannie Raillane. Chose plaisante et que la postérité aura peine à croire, ma famille bourgeoise mais qui se croyait sur le bord de la noblesse, mon père surtout qui se[p. 126] croyait noble ruiné, lisait tous les journaux, suivait le procès du roi comme elle eut pu suivre celui d'un ami intime ou d'un parent.
Arriva la nouvelle de la condamnation; ma famille fut au désespoir absolument. «Mais jamais ils n'oseront faire exécuter cet arrêt infâme », disait-elle. «Pourquoi pas, pensais-je, s'il a trahi?»
J'étais dans le cabinet de mon père, rue des Veux-Jésuites, vers les sept heures du soir, nuit serrée, lisant à la lueur de ma lampe et séparé de mon père par une fort grande table[19]. Je faisais semblant de travailler, mais je lisais les Mémoires d'un homme de qualité de l'abbé Prévost, dont j'avais découvert un exemplaire tout gâté par le temps. La maison fut ébranlée par la voiture du courrier qui arrivait de Lyon et de Paris.
«Il faut que j'aille voir ce que ces monstres auront fait», dit mon père en se levant.
«J'espère que le traître aura été exécuté», pensai-je. Puis je réfléchis à l'extrême différence de mes sentiments et de ceux de mon père. J'aimais tendrement nos régiments, que je voyais passer sur la place Grenette de la fenêtre de mon grand-père, je me figurais que le roi cherchait à les faire battre par les Autrichiens. (On voit que, quoique à peine Agé de dix[20] ans, je n'étais pas fort loin du vrai.) Mais j'avouerai qu'il m'eût suffi de l'intérêt que prenaient au sort de Louis XVI M. le grand vicaire Rey et les autres prêtres, amis de la famille, pour me[p. 127] faire désirer sa mort. Je regardais alors, en vertu d'un couplet de chanson que je chantais quand je ne craignais pas d'être entendu par mon père ou ma tante Séraphie, qu'il était de devoir étroit de mourir pour la patrie quand il le fallait. Qu'était-ce que la vie d'un traître qui par une lettre secrète pouvait faire égorger un de ces beaux régiments que je voyais passer sur la place Grenette? Je jugeais la cause entre ma famille et moi, lorsque mon père rentra. Je le vois encore, en redingote de molleton blanc qu'il n'avait pas ôtée pour aller à deux pas de la porte.
«C'en est fait, dit-il avec un gros soupir, ils l'ont assassiné.»
Je fus saisi d'un des plus vifs mouvements de joie que j'aie éprouvés en ma vie. Le lecteur pensera peut-être que je suis cruel, mais tel j'étais à dix ans, tel je suis à cinquante-deux[21].
Lorsqu'en décembre 1830 l'on n'a pas puni de mort cet insolent maraud de Peyronnet et les autres signataires des Ordonnances, j'ai dit des bourgeois de Paris: ils prennent l'étiolement de leur âme pour de la civilisation et de la générosité. Comment, après une telle faiblesse, oser condamner à mort un simple assassin?
Il me semble que ce qui se passe en 1835 a justifié ma prévision de 1830.
Je fus si transporté de ce grand acte de justice nationale que je ne pus pas continuer la lecture de[p. 128] mon roman, certainement l'un des plus touchants qui existent. Je le cachai, je mis devant moi le livre sérieux, probablement Rollin, que mon père me faisait lire, et je fermai les yeux pour pouvoir goûter en paix ce grand événement. C'est exactement ce que je ferais encore aujourd'hui, en ajoutant qu'à moins d'un devoir impérieux rien ne pourrait me déterminer à voir le traître que l'intérêt de la patrie envoie au supplice. Je pourrais remplir dix pages des détails de cette soirée, mais si les lecteurs de 1880 sont aussi étiolés que la bonne compagnie de 1835, la scène comme le héros leur inspireront un sentiment d'éloignement profond et allant presque jusqu'à ce que les âmes de papier mâché appellent de l'horreur. Quant à moi, j'aurais beaucoup plus de pitié d'un assassin condamné à mort sans preuves tout-à-fait suffisantes que d'un King qui se trouverait dans le même cas. La death of a King coupable est toujours utile in terrorem pour empêcher les étranges abus dans lesquels la dernière folie produite par le pouvoir absolu jette ces gens-là. (Voyez l'amour de Louis XV pour les fosses récemment recouvertes dans les cimetières de campagne qu'il apercevait de sa voiture en promenant dans les environs de Versailles. Voyez la folie actuelle de la petite reine Dona Maria de Poctugal.)
La page que je viens d'écrire scandaliserait fort même mes amis de 1835. Je fus honni par le cœur chez Mme Bernonde, en 1829, pour avoir wished the[p. 129] death of the Duke of Bordeaux. M. Mignet même (aujourd'hui conseiller d'Etat) eut horreur de moi, et la maîtresse de la maison, que j'aimais (did like) parce qu'elle ressemblait à Cervantès, ne me l'a jamais pardonné, elle disait que j'étais souverainement immoral et fut scandalisée, en 1833, aux bains d'Aix, parce que madame la comtesse C...al[22] prenait ma défense. Je puis dire que l'approbation des êtres que je regarde comme faibles m'est absolument indifférente. Ils me semblent fous, je vois clairement qu'ils ne comprennent pas le problème.
Enfin, supposons que je sois cruel, hé bien, oui, je le suis, on en verra bien d'autres de moi si je continue à écrire.
Je conclus de ce souvenir, si présent à mes yeux, qu'en 1793, il y a quarante-deux ans, j'allais à la chasse du bonheur précisément comme aujourd'hui, en d'autres termes plus communs, mon caractère était absolument le même qu'aujourd'hui. Tous les ménagements, quand il s'agit de la patrie, me semblent encore puérils.
Je dirais criminels, sans mon mépris sans bornes pour les êtres faibles. (Exemple: M. Félix Faure, pair de France, Premier Président, parlant à son fils, à Saint-Ismier, été 1828, de la mort de Louis XVI: «Il a été mis à mort par des méchants.» C'est le même homme qui condamne aujourd'hui, à la Chambre des Pairs, les jeunes et respectables fous qu'on appelle les conspirateurs d'avril. Moi, je les[p. 130] condamnerais à un an de séjour à Cincinnati (Amérique), pendant laquelle année je leur donnerais deux cents francs par mois.) Je n'ai un souvenir aussi distinct que de ma première communion, que mon père me fit faire à Claix, en présence du dévot charpentier Charbonot, de Cossey[23], vers 1795.
Comme, en 1793, le courrier mettait cinq grandes journées et peut-être six, de Paris à Grenoble, la scène du cabinet de mon père est peut-être du 28 ou 29 janvier, à sept heures du soir. A souper, ma tante Séraphie me fit une scène sur mon âme atroce, etc. Je regardais mon père, il n'ouvrait pas la bouche, apparemment de peur de se porter et de me porter aux dernières extrémités. Quelque cruel et atroce que je sois, du moins je ne passais pas pour lâche dans la famille. Mon père était trop Dauphinois et trop fin pour ne pas avoir pénétré, même dans son cabinet (à sept heures), la sensation d'un enfant de dix[24] ans.
A douze ans, un prodige de science pour mon âge, je questionnais sans cesse mon excellent grand-père, dont le bonheur était de me répondre. J'étais le seul être à qui il voulût parler de ma mère. Personne dans la famille n'osait lui parler de cet être chéri. A douze ans donc, j'étais un prodige de science et, à vingt, un prodige d'ignorance.
De 1796 à 1799, je n'ai fait attention qu'à ce qui pouvait me donner les moyens de quitter Grenoble,[p. 131] c'est-à-dire aux mathématiques. Je calculais avec anxiété les moyens de pouvoir consacrer au travail une demi-heure de plus par jour. De plus j'aimais, et j'aime encore, les mathématiques pour elles-mêmes, comme n'admettant pas l'hypocrisie et le vague, mes deux bêtes d'aversion.
Dans cet état de l'âme, que me faisait une réponse sensée et développée de mon excellent grand-père renfermant une notice sur Sanchonioton, une appréciation des travaux de Court de Gebelin[25], dont mon père, je ne sais comment, avait une belle édition in-4° (peut-être qu'il n'y en a pas d'in-12), avec une belle gravure représentant les organes de la voix chez l'homme?
A dix ans, je fis en grande cachette une comédie en prose, ou plutôt un premier acte. Je travaillais peu parce que j'attendais le moment du génie, c'est-à-dire cet état d'exaltation qui alors me prenait peut-être deux fois par mois. Ce travail était un grand secret, mes compositions m'ont toujours inspiré la même pudeur que mes amours. Rien ne m'eût été plus pénible que d'en entendre parler. J'ai encore éprouvé vivement ce sentiment en 1830, quand M. Victor de Tracy m'a parlé de Le Rouge et le Noir (roman en deux volumes).
[1] Le chapitre X est le chapitre VIII du manuscrit (fol. 146 ter à 169; les feuillets 145, 146, 146 bis et 153 sont numérotés, mais laissés en blanc).—Écrit les 9 et 10 décembre 1835.
[2] ... faire de moi un excellent jésuite ...—Ms.: «Tejé.»
[3] ... toutes les peines du monde à dissimuler ...—Variante: «Cacher.»
[4] ... extrêmement poli envers la religion ...—Ms.: «Gionré.»
[5] ... j'allais avoir cinquante ans ...—Ms.: «25 x 2.»
[6] ... Besan ...—Besançon, c'est-à-dire le baron de Mareste.
[7] ... Kolon ...—Romain Colomb.
[8] ... rien de moins jésuite ...—Ms.: «Tejé.»
[9] ... la tyrannie de ce jésuite ...—Ms.: «Tejé.»
[10] ... dans une antichambre où l'on ne passait presque jamais.—En face, plan explicatif. Le point M est en face de la cheminée de la chambre de Henri Gagnon, laquelle était meublée du «magnifique lit de damas rouge de mon grand-père», de «son armoire,» d'une «magnifique commode en marqueterie, surmontée d'une pendule: Mars offrant son bras à la France; la France avait un manteau garni de fleurs de lis, ce qui plus tard donna de grandes inquiétudes». Cette chambre était éclairée, sur la grande cour, par une «unique fenêtre en magnifiques verres de Bohême. L'un d'eux, en haut, à gauche, étant fendu, resta ainsi dix ans». Le point M' est près d'une des fenêtres du «grand salon à l'italienne»; le point M" est devant la fenêtre de l'antichambre du salon. (Voir notre plan de l'appartement Gagnon.)
[11] ... située au troisième étage du collège ...—La fortification passait alors derrière le collège, ou École centrale (aujourd'hui lycée de filles), lequel se trouvait non loin de la porte de Bonne. (Voir notre plan de Grenoble en 1793.)
[12] ... on réparait le reste.—Le fol. 153, numéroté par Stendhal, est resté en blanc.
[13] ... presque en rang d'oignons ...—Le seigneur d'Oignon. (Note de Stendhal.)
[14] ... la petite table où moi, H, étais placé.—Suit un plan de la position des personnages dans la chambre de Henri Gagnon, voisine de la salle-à-manger. Ils sont en demi-cercle autour de la cheminée, la table d'Henri est juste en face de cette cheminée, et placée obliquement.
[15]. ... l'Ancien Testament ...—Ms.: «Ment-testa», selon la méthode anagrammatique chère à Stendhal.
[16] ... j'avais commencé le latin à sept ans ...—Ms.: «17—10.»
[17] Lancette Laitue Rat.—«L'an VII les tuera». Après le mot «rat», Stendhal a fait un croquis très grossier représentant cet animal.
[18] ... l'assassinat de Roberjot à Rastadt.—28 avril 1799.
[19] ... séparé de mon père par une fort grande table.—Suit un plan indiquant les places respectives de Beyle et de son père. Celui-ci tournait le dos à son fils et était assis à son bureau, dans un angle de la pièce: «Mon père, placé à son bureau C et écrivant.»
[20] ... quoique à peine âgé de dix ans ...—Ms.: «2 x 5.»
[21] ... tel j'tais à dix ans, tel je suis à cinquante-deux.—Ms.: «5 X 2» et «10 X 5 + 2».
[22] ... madame la comtesse C...al....—Le reste du nom est en blanc.
[23] ... Cossey ...—Hameau de Claix.
[24] ... la sensation d'un enfant de dix ans.—Ms.: «2 X 5.»
[25] ... une appréciation des travaux de Court de Gebelin ...—L'Histoire naturelle de la parole, de Court de Gebelin, parut en 1776, en un volume in-8°, accompagné de deux gravures.
Ce sont deux représentants du peuple qui un beau jour arrivèrent à Grenoble[2] et quelque temps après publièrent une liste de 152 notoirement suspects (de ne pas aimer la République, c'est-à-dire le gouvernement de la patrie) et de 350 simplement suspects. Les notoirement devaient être placés en état d'arrestation; quant aux simplement, ils ne devaient être que simplement surveillés.
J'ai vu tout cela d'en bas, comme un enfant, peut-être qu'en faisant des recherches dans le journal du Département, s'il en existait un à cette époque, ou dans les archives, on trouverait tout le contraire quant aux époques, mais pour l'effet sur moi et la famille il est certain. Quoiqu'il en soit,[p. 134] mon père était notoirement suspect et M. Henri Gagnon simplement suspect[3].
La publication de ces deux listes fut un coup de foudre pour la famille. Je me hâte de dire que mon père n'a été délivré que le 6 thermidor (ah! voici une date. Délivré le 6 thermidor, trois jours avant la mort de Robespierre) et placé sur la liste pendant vingt-deux mois.
Ce grand événement remonterait donc au 26 avril 1793[4]. Enfin je trouve dans ma mémoire que mon père fut vingt-deux mois sur la liste et n'a passé en prison que trente-deux jours ou quarante-deux jours[5].
Ma tante Séraphie montra dans cette occasion beaucoup de courage et d'activité. Elle allait voir les membres du Département, c'est-à-dire de l'administration départementale, elle allait voir les représentants du peuple, et obtenait toujours des sursis de quinze jours ou vingt-deux jours, de cinquante jours quelquefois.
Mon père attribue l'apparition de son nom sur la fatale liste à une ancienne rivalité d'Amar avec lui, lequel était aussi avocat, ce me semble[6].
Deux ou trois mois après cette vexation, de laquelle on parlait sans cesse le soir en famille, il m'échappa une naïveté qui confirma mon caractère atroce[7]. On exprimait en termes polis toute l'horreur qu'inspirait le nom d'Amar.
«Mais, dis-je, à mon père, Amar t'a placé sur la[p. 135] liste comme notoirement suspect de ne pas aimer la République, il me semble qu'il est certain que tu ne l'aimes pas.»
A ce mot, toute la famille rougit de colère, on fut sur le point de m'envoyer en prison dans ma chambre; et pendant le souper, pour lequel bientôt on vint avertir, personne ne m'adressa la parole. Je réfléchissais profondément. «Rien n'est plus vrai que ce que j'ai dit, mon père se fait gloire d'exécrer le nouvel ordre des choses (terme à la mode alors parmi les aristocrates); quel droit ont-ils de se fâcher?»
Cette forme de raisonnement: Quel droit a-t-il? fut habituelle chez moi depuis les premiers actes arbitraires qui suivirent la mort de ma mère, aigrirent mon caractère et m'ont fait ce que je suis.
Le lecteur remarquera sans doute que cette forme conduisait rapidement à la plus haute indignation.
Mon père, Chérubin Beyle, vint s'établir dans la chambre O, appelée chambre de mon oncle[8]. (Mon aimable oncle Romain Gagnon s'était marié aux Échelles, en Savoie, et quand il venait à Grenoble, tous les deux ou trois mois, à l'effet de revoir ses anciennes amies, il habitait cette chambre meublée avec magnificence en damas rouge—magnificence de Grenoble vers 1793.)
On remarquera encore la sagesse de l'esprit dauphinois. Mon père appelait se cacher traverser la rue et venir coucher chez son beau-père, où l'on savait qu'il dînait et soupait depuis deux ou trois ans. La Terreur fut donc très douce et j'ajouterai hardiment fort raisonnable, à Grenoble. Malgré vingt-deux ans de progrès, la Terreur de 1815, ou réaction du parti de mon père, me semble avoir été plus cruelle. Mais l'extrême dégoût que 1815 m'a inspiré m'a fait oublier les faits, et peut-être un historien impartial serait-il d'un autre avis. Je supplie le lecteur, si jamais j'en trouve, de se souvenir que je n'ai de prétention à la véracité qu'en ce qui touche mes sentiments; quant aux faits, j'ai toujours eu peu de mémoire. Ce qui fait, par parenthèse, que le célèbre Georges Cuvier me battait toujours dans les discussions qu'il daignait quelquefois avoir avec moi dans son salon, les samedis, de 1827 à 1830.
Mon père, pour se soustraire à la persécution horrible, vint s'établir dans la chambre de mon oncle, O. C'était l'hiver, car il me disait: « Ceci est une glacière.»
Je couchais à côté de son lit dans un joli lit fait en cage d'oiseau et duquel il était impossible de tomber. Mais cela ne dura pas. Bientôt je me vis dans le trapèze à côté de la chambre, de mon grand-père[9].
Il me semble maintenant que ce fut seulement à[p. 137] l'époque Amar et Merlinot que je vins habiter le trapèze, j'y étais fort gêné par l'odeur de la cuisine de M. Reyboz ou Reybaud, épicier, provençal, dont l'accent me faisait rire. Je l'entendis souvent grommeler contre sa fille, horriblement laide, sans quoi je n'eusse pas manqué d'en faire la dame de mes pensées. C'était là ma folie et elle a duré longtemps, mais j'eus toujours l'habitude d'une discrétion parfaite que j'ai retrouvée dans le tempérament mélancolique de Cabanis.
Je fus bien étonné, en voyant mon père de plus près dans la chambre de mon oncle, de trouver qu'il ne lisait plus Bourdaloue, Massillon ou sa Bible de Sacy en vingt-deux volumes. La mort de Louis XVI l'avait jeté, ainsi que beaucoup d'autres, dans l'Histoire de Charles Ier de Hume; comme il ne ne savait pas l'anglais, il lisait la traduction, unique alors, d'un M. Belot, ou président Belot. Bientôt mon père, variable et absolu dans ses goûts, fut tout politique. Je ne voyais dans mon enfance que le ridicule du changement, aujourd'hui je vois le pourquoi. Peut-être que l'abandon de toute autre idée avec lequel mon père suivait ses passions (ou ses goûts) en faisait un homme un peu au-dessus du vulgaire.
Le voilà donc tout Hume et Smolett et voulant me faire goûter ces livres comme, deux ans plus tôt, il avait voulu me faire adorer Bourdaloue. On juge[p. 138] de la façon dont fut accueillie celte proposition de l'ami intime de mon ennemie Séraphie.
La haine de cette aigre dévote redoubla quand elle me vit établi chez son père sur le pied de favori. Nous avions des scènes horribles ensemble, car je lui tenais tête fort bien, je raisonnais et c'est ce qui la mettait en fureur.
Mesdames Romagnier et Colomb, de moi tendrement aimées, mes cousines, femmes alors de trente-six ou quarante ans, et la seconde mère de M. Romain Colomb, mon meilleur ami (qui par sa lettre du . . décembre 1835, reçue hier, me fait une scène à l'occasion de la Préface de de Brosses, mais n'importe), venaient faire la partie de ma tante Elisabeth. Ces dames étaient étonnées des scènes que j'avais avec Séraphie, lesquelles allaient souvent jusqu'à interrompre le boston, et je croyais voir évidemment qu'elles me donnaient raison contre cette folle.
En pensant sérieusement à ces scènes depuis leur époque, 1793, ce me semble, je les expliquerais ainsi: Séraphie, assez jolie, faisait l'amour[10] avec mon père et haïssait passionnément en moi l'être qui mettait un obstacle moral ou légal à leur mariage. Reste à savoir si en 1793 l'autorité ecclésiastique eût permis un mariage entre beau-frère et belle-sœur. Je pense que oui, Séraphie était du premier sanhédrin dévot de la ville avec une Mme Vignon, son amie intime.
Pendant ces scènes violentes, qui se renouvelaient une ou deux fois par semaine, mon grand-père ne disait rien, j'ai déjà averti qu'il avait un caractère à la Fontenelle, mais au fond je devinais qu'il était pour moi. Raisonnablement, que pouvait-il y avoir de commun entre une demoiselle de vingt-six ou trente ans et un enfant de dix ou douze ans?
Les domestiques, savoir: Marion, Lambert d'abord et puis l'homme qui lui succéda, étaient de mon parti. Ma sœur Pauline, jolie jeune fille qui avait trois ou quatre ans de moins que moi, était de mon parti. Ma seconde sœur, Zénaïde (aujourd'hui madame Alexandre Mallein), était du parti de Séraphie et était accusée par Pauline et moi d'être son espion auprès de nous.
Je fis une caricature dessinée à la mine de plomb sur le plâtre du grand passage de la salle à manger aux chambres de la Grenette, dans l'ancienne maison de mon grand-père. Zénaïde était représentée dans un prétendu portrait qui avait deux pieds de haut, au-dessous j'écrivis:
Caroline-Zénaïde B..., rapporteuse.
Cette bagatelle fut l'occasion d'une scène abominable et dont je vois encore les détails. Séraphie était furieuse, la partie fut interrompue. Il me semble que Séraphie prit à partie mesdames Romagnier et Colomb. Il était déjà huit heures. Ces dames, justement offensées des incartades de cette folle et voyant[p. 140] que ni son père (M. Henri Gagnon) ni sa tante (ma grand'tante Elisabeth) ne pouvaient ou n'osaient lui imposer silence, prirent le parti de s'en aller. Ce départ fut le signal d'un redoublement dans la tempête. Il y eut quelque mot sévère de mon grand-père ou de ma tante; pour repousser Séraphie voulant s'élancer sur moi, je pris une chaise de paille que je tins entre nous, et je m'en fus à la cuisine, où j'étais bien sûr que la bonne Marion, qui m'adorait et détestait Séraphie, me protégerait.
A côté des images les plus claires, je trouve des manques dans ce souvenir, c'est comme une fresque dont de grands morceaux seraient tombés. Je vois Séraphie se retirant de la cuisine et moi faisant la conduite à l'ennemi le long du passage. La scène avait eu lieu dans la chambre de ma tante Elisabeth.
Je me vois et je vois Séraphie au point S[11]. Comme j'aimais beaucoup la cuisine, occupée par mes amis Lambert et Marion et la servante de mon père, qui avaient le grand avantage de n'être pas mes supérieurs, là seulement je trouvais la douce égalité et la liberté. Je profitai de la scène pour ne pas paraître jusqu'au souper. Il me semble que je pleurai de rage pour les injures atroces (impie, scélérat, etc.) que Séraphie m'avait lancées, mais j'avais une honte amère de mes larmes.
Je m'interroge depuis une heure pour savoir si[p. 141] cette scène est bien vraie, réelle, ainsi que vingt autres qui, évoquées des ombres, reparaissent un peu, après des années d'oubli; mais oui, cela est bien réel, quoique jamais dans une autre famille je n'aie rien observé de semblable. Il est vrai que j'ai vu peu d'intérieurs bourgeois, le dégoût m'en éloignait et la peur que je faisais par mon rang ou mon esprit (je demande pardon de cette vanité) empêchaient peut-être que de telles scènes eussent lieu en ma présence. Enfin, je ne puis douter de la réalité de celle de la caricature de Zénaïde et de plusieurs autres. Je triomphais surtout quand mon père était à Claix, c'était un ennemi de moins, et le seul réellement puissant.
«Indigne enfant, je te mangerais!» me dit un jour mon père en s'avançant sur moi furieux; mais il ne m'a jamais frappé, ou tout au plus deux ou trois fois. Ces mots: indigne enfant, etc., me furent adressés un jour que j'avais battu Pauline qui pleurait et faisait retentir la maison.
Aux yeux de mon père j'avais un caractère atroce, c'était une vérité établie par Séraphie et sur des faits: l'assassinat de Mme Chenavaz, mon coup de dent au front de Mme Pison-Dugalland, mon mot sur Amar. Bientôt arriva la fameuse lettre anonyme signée Gardon. Mais il faut des explications pour comprendre ce grand crime. Réellement ce fut un méchant tour, j'en ai eu honte pendant quelques années, quand je songeais encore à mon[p. 142] enfance avant ma passion pour Mélanie, passion qui finit en 1805, quand j'eus vingt-deux[12] ans. Aujourd'hui que l'action d'écrire ma vie m'en fait apparaître de grands lambeaux, je trouve fort bien la tentative Gardon.
[1] Le chapitre XI est le chapitre IX du ms. de Stendhal (fol. 172 à 187).—Les fol. 170 et 171 ont été numérotés par Stendhal, mais laissés en blanc.—En haut du fol. 172, on lit: «10 déc. 1835.» Et plus bas: «Chronologie: peut-être M. Durand ne vint-il dans la maison Gagnon qu'après Amar et Merlinot.» En face: «Voir la date dans les Fastes de Marrast.»—Ce chapitre a été écrit en partie à Cività-Vecchia, le 10 décembre 1835 (fol. 172 et 173), et en partie à Rome, le 13 décembre.
[2] ... deux représentants ... arrivèrent à Grenoble ...—Amar et Merlinot arrivèrent à Grenoble le 21 avril 1793.
[3] ... mon père était notoirement suspect et M. Henri Gagnon simplement suspect.—Cependant ni l'un ni l'autre n'ont été ni obligés de se cacher, ni emprisonnés. (Note au crayon de R. Colomb.)—Les listes ont été publiées le 26 avril 1793 avec un arrêté d'Amar et de Merlinot. Parmi les «personnes notoirement suspectes» figurait «Beyle, homme de loi, rue des Vieux-Jésuites»; mais le nom du docteur Gagnon n'est pas inscrit sur la liste des personnes «simplement suspectes». Le 6 thermidor correspondant au 24 juillet 1794, c'est donc pendant quinze mois seulement que Chérubin Beyle fut considéré comme notoirement suspect.
[4] Ce grand événement remonterait donc au 26 avril1793.—La date est en blanc dans le manuscrit.
[5]. ... n'a passé en prison que trente-deux jours ou quarante-deux jours.—Comme le dit plus haut R. Colomb, Chérubin Beyle ne fut jamais emprisonné.
[6] ... Amar ... avocat, ce me semble.—Amar (né à Grenoble le 11 mai 1755) était au moment de la Révolution trésorier de France au bureau des Finances de Grenoble et avocat au Parlement de cette ville.
[7] ... qui confirma mon caractère atroce.—On lit en tête du fol. 175: «13 décembre 1835. Omar. Repris le travail of Life.» Et au verso du fol. 174: «Écrit de la page 93 à celle-ci à Cività-Vecchia du 3 au 13 décembre 1835.»
[8] Mon père ... vint s'établir dans la chambre O ...—Au bas du fol. 176 est un plan de la partie de l'appartement Gagnon voisine de la maison Périer-Lagrange. On y voit, en O, la «chambre de mon oncle» occupée par «mon père, Chérubin Beyle, lisant Hume». Cette chambre s'ouvrait sur la «terrasse avec vue admirable» donnant sur le «jardin Périer» et, par delà celui-ci, sur le «jardin public nommé Jardin-de-Ville». Elle était voisine d'une «grande salle» où était un autel. (Voir notre plan de l'appartement Gagnon.)
[9] Bientôt je me vis dans le trapèze à côté de la chambre de mon grand-père.—Suit un plan de la chambre de M. Gagnon et de la chambre en trapèze. Cette forme était nécessitée par l'escalier voisin. Le «trapèze» donnait sur une «petite cour. Odeur de cuisine de M. Rayboz».
[10] Séraphie, assez jolie, faisait l'amour ...—Italianisme à ôter. (Note de Stendhal.)
[11] Je me vois et je vois Séraphie au point S.—Suit un plan des lieux de la scène: «La ligne pointillé marque la ligne de bataille», à travers la chambre d'Elisabeth Gagnon, le passage, la salle-à-manger et la cuisine. Le point S est situé dans le passage.
[12] ... quand j'eus vingt-deux ans.—Ms.: «11 x 2.»
On avait formé les bataillons d'Espérance, ou l'armée d'Espérance (chose singulière, que je ne me rappelle pas même avec certitude le nom d'une chose qui a tant agité mon enfance). Je brûlais d'être de ces bataillons que je voyais défiler. Je vois aujourd'hui que c'était une excellente institution, la seule qui puisse déraciner le jésuitisme [2] en France. Au lieu de jouer à la chapelle, l'imagination des enfants pense à la guerre et s'accoutume au danger. D'ailleurs, quand la patrie les appelle à vingt ans, ils savent l'exercice, et au lieu de frémir devant l'inconnu, ils se rappellent les jeux de leur enfance.
La Terreur était si peu la Terreur à Grenoble que les aristocrates n'envoyaient pas leurs enfants.
Un certain abbé Gardon, qui avait jeté le froc aux orties, dirigeait l'armée de l'Espérance. Je fis un faux, je pris un morceau de papier plus large que haut, de la forme d'une lettre de change (je le vois encore) et, en contrefaisant mon écriture, j'invitai le citoyen Gagnon à envoyer son petit-fils, Henri Beyle, à Saint-André, pour qu'il pût être incorporé dans le bataillon de l'Espérance. Cela finissait par:
«Salut et fraternité,
Gardon.»
La seule idée d'aller à Saint-André était pour moi le bonheur suprême. Mes parents firent preuve de bien peu de lumières, ils se laissèrent prendre à cette lettre d'un enfant, qui devait contenir cent fautes contre la vraisemblance. Ils eurent besoin des conseils d'un petit bossu nommé Tourte, véritable toad-eater[3], mangeur de crapauds, qui s'était faufilé à la maison par cet infâme métier. Mais comprendra-t-on cela en 1880?
M. Tourte[4], horriblement bossu et commis expéditionnaire à l'administration du Département, s'était faufilé à la maison comme être subalterne, ne s'offensant de rien, bon flatteur de tous. J'avais déposé mon papier dans l'entredeux des portes formant antichambre sur l'escalier tournant, au point A[5].
Mes parents, fort alarmés, appelèrent au conseil le petit Tourte qui, en sa capacité de scribe officiel,[p. 145] connaissait apparemment la signature de M. Gardon. Il demanda de mon écriture, compara avec sa sagacité de commis expéditionnaire, et mon pauvre petit artifice pour sortir de cage fut découvert. Pendant qu'on délibérait sur mon sort, on m'avait relégué dans le cabinet d'histoire naturelle de mon grand-père, formant vestibule sur notre magnifique terrasse[6]. Là je m'amusais à faire sauter en l'air (locution du pays) une boule de terre glaise rouge que je venais de pétrir. J'étais dans la position morale d'un jeune déserteur qu'on va fusiller. L'action de faire un faux me chicanait un peu.
Il y avait dans ce vestibule de la terrasse une magnifique carte du Dauphiné[7] de quatre pieds de large, accrochée au mur. Ma boule de terre glaise, en descendant du plafond fort élevé, toucha la précieuse carte, fort admirée par mon grand-père, et, comme elle était fort humide, y traça une longue raie rouge.
«Ah! pour le coup, je suis flambé, pensai-je. Ceci est bien une autre affaire; j'offense mon seul protecteur.» J'étais en même temps fort affligé d'avoir fait une chose désagréable à mon grand-père.
En ce moment on m'appela pour comparaître devant mes juges, Séraphie en tête, et à côté d'elle le hideux bossu Tourte. Je m'étais proposé de répondre en Romain, c'est-à-dire que je désirais servir la patrie, que c'était mon devoir aussi bien que mon plaisir, etc. Mais la conscience de ma faute envers[p. 146] mon excellent grand-père (la tache à la carte), que je voyais pâle à cause de la peur que lui avait fait le billet signé Gardon, m'attendrit, et je crois que je fus pitoyable. J'ai toujours eu le défaut de me laisser attendrir comme un niais par la moindre parole de soumission des gens contre lesquels j'étais le plus en colère, et tentatum contemni. En vain plus tard écrivis-je partout cette réflexion de Tite-Live, je n'ai jamais été sûr de garder ma colère.
Je perdis malheureusement par ma faiblesse de cœur (non de caractère) ma position superbe. J'avais le projet de menacer d'aller moi-même déclarer à l'abbé Gardon ma résolution de servir la patrie. Je fis cette déclaration, mais d'une voix faible et timide. Mon idée fit peur et on vit que je manquais d'énergie. Mon grand-père même me condamna, la sentence fut que pendant trois jours je ne dînerais pas à table. A peine condamné, ma tendresse se dissipa et je redevins un héros.
«J'aime bien mieux, leur dis-je, dîner seul qu'avec des tyrans qui me grondent sans cesse.»
Le petit Tourte voulut faire son métier:
«Mais, monsieur Henri, il me semble...
—Vous devriez avoir honte et vous taire, lui dis-je en l'interrompant. Est-ce que vous êtes mon parent pour parler ainsi?» etc.
—Mais, monsieur, dit-il, devenu tout rouge derrière les lunettes dont son nez était armé, comme ami de la famille...
—Je ne me laisserai jamais gronder par un homme tel que vous.»
Cette allusion à sa bosse énorme supprima son éloquence.
En sortant de la chambre de mon grand-père, où la scène s'était passée, pour aller faire du latin tout seul dans le grand salon, j'étais d'une humeur noire. Je sentais confusément que j'étais un être faible; plus je réfléchissais, plus je m'en voulais.
Le fils d'un notoirement suspect, toujours hors de prison au moyen de sursis successifs, venant demander à l'abbé Gardon de servir la patrie, que pouvaient répondre mes parents, avec leur messe de quatre-vingts personnes tous les dimanches?
Aussi, dès le lendemain on me fit la cour. Mais cette affaire, que Séraphie ne manqua pas de me reprocher dès la première scène qu'elle me fit, éleva comme un mur entre mes parents et moi. Je le dis avec peine, je commençai à moins aimer mon grand-père, et aussitôt je vis clairement son défaut: Il a peur de sa fille, il a peur de Séraphie! Ma seule tante Elisabeth m'était restée fidèle. Aussi mon affection pour elle redoubla-t-elle[8].
Elle combattait, je m'en souviens, ma haine pour mon père, et me gronda vertement parce qu'une fois, en lui parlant de lui, je l'appelai cet homme.
Sur quoi je ferai deux observations[9]:
1° Cette haine de mon père pour moi et de moi[p. 148] pour lui était chose tellement convenue dans ma tête, que ma mémoire n'a pas daigné garder [10] souvenir du rôle qu'il a dû jouer dans la terrible affaire du billet Gardon.
2° Ma tante Elisabeth avait l'âme espagnole. Son caractère était la quintessence de l'honneur. Elle me communiqua pleinement cette façon de sentir et de là ma suite ridicule de sottises par délicatesse et grandeur d'âme. Cette sottise n'a un peu cessé en moi qu'en 1810, à Paris, quand j'étais amoureux de Mme Petit. Mais encore aujourd'hui l'excellent Fiore (condamné à mort à Naples en 1800) me dit:
«Vous tendez vos filets trop haut.» (Thucydide.)
Ma tante Elisabeth disait encore communément, quand elle admirait excessivement quelque chose:
«Cela est beau comme le Cid.»
Elle sentait, éprouvait[11], mais n'exprimait jamais, un assez grand mépris pour le Fontenellisme de son frère (Henri Gagnon, mon grand-père). Elle adorait ma mère, mais elle ne s'attendrissait pas en en parlant, comme mon grand-père. Je n'ai jamais vu pleurer, je crois, ma tante Elisabeth. Elle m'eût pardonné tout au monde plutôt que d'appeler mon père cet homme.
«Mais comment veux-tu que je puisse l'aimer? lui disais-je. Excepté me peigner quand j'avais la rache[12], qu'a-t-il jamais fait pour moi?
—Il a la bonté de te mener promener.
—J'aime bien mieux rester à la maison, je déteste la promenade aux Granges.»
(Vers l'église de Saint-Joseph et au sud-est de cette église, que l'on comprend maintenant dans la place de Grenoble que le général Haxo fortifie[13], mais, en 1794, les environs de Saint-Joseph étaient occupés par des tasses à chanvre et d'infâmes routoirs (trous à demi pleins d'eau pour faire rouir le chanvre), où je distinguais les œufs gluants de grenouilles qui me faisaient horreur: horreur est le mot propre, je frisonne en y pensant.)
En me parlant de ma mère, un jour, il échappa à ma tante de dire qu'elle n'avait point eu d'inclination pour mon père. Ce mot fut pour moi d'une portée immense. J'étais encore, au fond de l'âme, jaloux de mon père.
J'allai raconter ce mot à Marion, qui me combla d'aise en me disant qu'à l'époque du mariage de ma mère, vers 1780, elle avait dit un jour à mon père qui lui faisait la cour: «Laissez-moi, vilain laid.»
Je ne vis point alors l'ignoble et l'improbabilité d'un tel mot, je n'en vis que le sens, qui me charmait. Les tyrans sont souvent maladroits, c'est peut-être la chose qui m'a fait rire le plus en ma vie.
Nous avions un cousin Senterre[14], homme trop galant, trop gai et, comme tel, assez haï de mon grand-père, beaucoup plus prudent et peut-être[p. 150] pas tout-à-fait exempt d'envie pour ce pauvre Senterre, maintenant sur l'âge et assez pauvre. Mon grand-père prétendait ne faire que le mépriser à cause de ses mauvaises mœurs passées. Ce pauvre Senterre était fort grand, creusé (marqué) de petite vérole, les yeux bordés de rouge et assez faibles, il portait des lunettes et un chapeau rabattu à grands bords.
Tous les deux jours, ce me semble, enfin quand le courrier arrivait de Paris, il venait apporter à mon grand-père cinq ou six journaux adressés à d'autres personnes et que nous lisions avant ces autres personnes.
M. Senterre venait le matin, vers les onze heures, on lui donnait à déjeuner un demi-verre de vin et du pain, et la haine de mon grand-père alla plusieurs fois jusqu'à rappeler en ma présence la fable de la Cigale et de la Fourmi, ce qui voulait dire que le pauvre Senterre venait à la maison attiré par le doigt de vin et le crochon de pain [15].
La bassesse de ce reproche révoltait ma tante Elisabeth, et moi peut-être encore plus. Mais l'essentiel de la sottise des tyrans, c'est que mon grand-père mettait ses lunettes et lisait haut à la famille tous les journaux. Je n'en perdais pas une syllabe.
Et dans mon cœur je faisais des commentaires absolument contraires à ceux que j'entendais faire.
Séraphie était une bigote enragée, mon père,[p. 151] souvent absent de ces lectures, aristocrate excessif, mon grand-père, aristocrate, mais beaucoup plus modéré; il haïssait les Jacobins surtout comme gens mal vêtus et de mauvais ton.
«Quel nom: Pichegru!» disait-il. C'était là sa grande objection contre ce fameux traître qui alors conquérait la Hollande. Ma tante Elisabeth n'avait horreur que des condamnations à mort.
Les titres de ces journaux, que je buvais, étaient: Le Journal des hommes libres, Perlet, dont je vois encore le titre, dont le dernier mot était formé par une griffe imitant la signature de ce Perlet [16]; le Journal des Débats; le Journal des défenseurs de la Patrie. Plus tard, ce me semble, ce journal, qui partait par courrier extraordinaire, rejoignait la malle, partie vingt-quatre heures avant lui.
Je fonde mon idée que M. Senterre ne venait pas tous les jours sur le nombre de journaux qu'il y avait à lire. Mais peut-être, au lieu de plusieurs numéros du même journal, y avait-il seulement un grand nombre de journaux.
Quelquefois, quand mon grand-père était enrhumé, j'étais chargé de la lecture. Quelle maladresse chez mes tyrans! C'est comme the Papes fondant une bibliothèque au lieu de brûler tous les livres comme Omar (dont on conteste cette belle action).
Pendant toutes ces lectures qui duraient, ce me[p. 152] semble, encore un an après la mort de Robespierre et qui prenaient bien deux heures chaque matin, je ne me souviens pas d'avoir été une seule fois de l'avis que j'entendais exprimer par mes parents. Par prudence, je me gardais bien de parler, et si quelquefois je voulais parler, au lieu de me réfuter on m'imposait silence. Je vois maintenant que cette lecture était un remède à l'effroyable ennui dans lequel ma famille s'était plongée trois ans auparavant, à la mort de ma mère, en rompant absolument avec le monde.
Le petit Tourte prenait mon excellent grand-père pour confident de ses amours avec une de nos parentes que nous méprisions comme pauvre et faisant tort à notre noblesse. Il était jaune, hideux, l'air malade. Il se mit à montrer à écrire à ma sœur Pauline, et il me semble que l'animal en devint amoureux. Il amena à la maison l'abbé Tourte, son frère, qui avait la figure abîmée d'humeurs froides. Mon grand-père ayant dit qu'il était dégoûté quand il invitait cet abbé à dîner, ce sentiment devint excessif chez moi.
M. Durand continuait à venir une ou deux fois le jour à la maison, mais il me semble que c'était deux fois, voici pourquoi: j'étais arrivé à cette époque incroyable de sottise où l'on fait faire des vers à l'écolier latin (on veut essayer s'il a le génie poétique), et de cette époque date mon horreur pour les[p. 153] vers. Même dans Racine, qui me semble fort éloquent, je trouve force chevilles.
Pour développer chez moi le génie poétique, M. Durand apporta un grand in-12 dont la reliure noire était horriblement grasse et sale.
La saleté m'eût fait prendre en horreur l'Arioste de M. de Tressan, que j'adorais, qu'on juge du volume noir de M. Durand, assez mal mis lui-même. Ce volume contenait le poème d'un jésuite sur une mouche qui se noie dans une jatte de lait. Tout l'esprit était fondé sur l'antithèse produite par la blancheur du lait et la noirceur du corps de la mouche, la douceur qu'elle cherchait dans le lait et l'amertume de la mort.
On me dictait ces vers en supprimant les épithètes, par exemple:
Musca (épit.) duxerit annos (ép.) multos (synonime).
J'ouvrais le Gradus ad Parnassum; je lisais toutes les épithètes de la mouche: volucris, avis, nigra, et je choisissais, pour faire la mesure de mes hexamètres et de mes pentamètres, nigra, par exemple, pour musca, felices pour annos.[17]
La saleté du livre et la platitude des idées me donnèrent un tel dégoût que régulièrement tous les jours, vers les deux heures, c'était mon grand-père qui faisait mes vers en ayant l'air de m'aider.
M. Durand revenait à sept heures du soir et me[p. 154] faisait remarquer et admirer la différence qu'il y avait entre mes vers et ceux du Père jésuite.
Il faut absolument l'émulation pour faire avaler de telles inepties. Mon grand-père me racontait ses exploits au collège, et je soupirais après le collège, là du moins j'aurais pu échanger des paroles avec des enfants de mon âge.
Bientôt je devais avoir cette joie: on forma une École centrale, mon grand-père fut du jury organisateur, il fit nommer professeur M. Durand.
[1] Le chapitre XII est le chapitre X du manuscrit de Stendhal (fol. 188 à 210).—Écrit à Rome, le 14 décembre 1835.
[2] ... qui puisse déraciner le jésuitisme ...-Ms.: «Tisjésui.»
[3] ... toad-eater ...—Expression anglaise signifiant littéralement: mangeur de crapauds, et, au figuré: flagorneur, flatteur, parasite.
[4] M. Tourte ...—Donnait des leçons d'écriture à Pauline; je le vois encore, taillant des plumes, d'un air important, avec des lunettes dont les verres avaient l'épaisseur d'un fond de gobelet. (Note au crayon de R. Colomb.)
[5] ... l'entredeux des portes formant antichambre ... au point A.—Suit un plan de cette partie de l'appartement; dans l'antichambre, en A, entre les deux fenêtres donnant sur la première cour, est la place où le jeune Beyle avait placé le billet Gardon.
[6] ... formant vestibule sur notre magnifique terrasse.—En face, est un plan de cette partie de l'appartement Gagnon. Au fond du grand salon à l'Italienne, en «A, autel où je servais la messe tous les dimanches»; dans la pièce voisine, donnant accès sur la terrasse, était pendue la «carte du Dauphiné dressée par M. de Bourcet, père du Tartufe et grand-père de mon ami à Brunswick, le général Bourcet, aide-de-camp du maréchal Oudinot, maintenant cocu et, je crois, fou». Dans le cabinet de M. Gagnon, également voisin du grand salon, se trouvait, dans un angle, un «tas de romans et autres mauvais livres ayant appartenu à mon oncle et sentant l'ambre ou le musc d'une lieue». Enfin, depuis «la terrasse, mur sarrazin large de quinze pieds et haut de quarante», Stendhal indique une vue «magnifique vers les montagnes en S (montagne de Seyssins et Sassenage), B (Bastille, que le général Haxo fortifie en 1835) et R (tour de Rabot)».
[7] ... une magnifique carte du Dauphiné ...—La carte du Dauphiné par Bourcet est en effet très belle. Elle est composée de dix feuilles in-folio, portant ce titre: Carte géométrique du haut Dauphiné et de la frontière ultérieure, levée par ordre du Roi, sous la direction de M. de Bourcet, maréchal de camp, par MM. les ingénieurs géographes de Sa Majesté, pendant les années 1749 jusqu'en 1754. Dressé par le sieur Villaret, capitaine ingénieur géographe du Roi.—Sur la famille de Bourcet, voir: Edmond Maignien, L'ingénieur militaire Bourcet et sa famille. Grenoble, 1890, in-8°.
[8] Aussi mon affection pour elle redoubla-t-elle.—On lit au verso du fol. 197: «Écrit de 188 à 197 en une heure, grand froid et beau soleil, le 14 décembre 1835.»
[9] Sur quoi je ferai deux observations.—«Je sens bien que tout ceci est trop long, mais je m'amuse à voir reparaître ces temps primitifs, quoique malheureux, et je prie M. Levavasseur d'abréger ferme, s'il imprime. H. BEYLE.»
[10] ... ma mémoire n'a pas daigné garder ...-Variante: «N'a pas gardé.»
[11] Elle sentait, éprouvait ...—Une partie de la ligne a été laissée en blanc.
[12] ... quand j'avais la roche ...—Affection du cuir chevelu chez les enfants, que le patois dauphinois étend, mais à tort, à la croûte de lait.
[13] ... la place de Grenoble que le général Haxo fortifie ...—L'agrandissement de l'enceinte par le général Haxo fut effectué entre 1832 et 1836.
[14] ... cousin Senterre ...—Il était contrôleur de la poste à Grenoble; en sa qualité de mon grand-oncle, il m'administrait force taloches; et lorsque je pleurais trop haut, il me faisait avaler des verres de kirsch, pour obtenir du silence et son pardon. (Note au crayon de R. Colomb.)
[15] ... le crochon de pain.—Terme dauphinois signifiant un morceau de pain, avec de la croûte.
[16] ... la signature de ce Perlet ...—A la suite du nom, Stendhal a tracé une imitation de la signature de Perlet.
[17] ... felices pour annos.—On lit au verso du fol. 209: «Le 14 décembre 1835, écrit 24 pages et fini la Vie de Costard, fou intéressant ...»
Il faut parler de mon oncle, cet homme aimable qui portait la joie dans la famille quand des Échelles (Savoie), où il était marié, il venait à Grenoble.
En écrivant ma vie en 1835, j'y fais bien des découvertes; ces découvertes sont de deux espèces: d'abord, 1° ce sont de grands morceaux de fresques sur un mur, qui depuis longtemps oubliés apparaissent tout-à-coup, et à côté de ces morceaux bien conservés sont, comme je l'ai dit plusieurs fois, de grands espaces où l'on ne voit que les briques du mur. L'éparvérage, le crépi sur lequel la fresque était peinte est tombé[2], et la fresque est à jamais perdue. A côté des morceaux de fresque conservés il n'y a pas de date, il faut que j'aille à la chasse des[p. 156] dates actuellement, en 1835. Heureusement, peu importe un anachronisme, une confusion d'une ou de deux années. A partir de mon arrivée à Paris en 1799, comme ma vie est mêlée avec les événements de la gazette, toutes les dates sont sûres.
2° en 1835, je découvre la physionomie et le pourquoi des événements. Mon oncle (Romain Gagnon) ne venait probablement à Grenoble, vers 1795 ou 96, que pour voir ses anciennes maîtresses et pour se délasser des Échelles où il régnait, car les Échelles sont un bourg, composé alors de manants enrichis par la contrebande et l'agriculture, et dont le seul plaisir était la chasse. Les élégances de la vie, les jolies femmes gaies, frivoles et bien parées, mon oncle ne pouvait les trouver qu'à Grenoble.
Je fis un voyage aux Échelles, ce fut comme un séjour dans le ciel, tout y fut ravissant pour moi. Le bruit du Guiers, torrent qui passait à deux cents pas devant les fenêtres de mon oncle, devint un son sacré pour moi, et qui sur-le-champ me transportait dans le ciel.
Ici déjà les phrases me manquent, il faudra que je travaille et transcrive les morceaux, comme il m'arrivera plus tard pour mon séjour à Milan; où trouver des mots pour peindre le bonheur parfait goûté avec délices et sans satiété par une aine sensible jusqu'à l'anéantissement et la folie?
Je ne sais si je ne renoncerai pas à ce travail. Je[p. 157] ne pourrais, ce me semble, peindre ce bonheur ravissant, pur, frais, divin, que par l'énumération des maux et de l'ennui dont il était l'absence complète. Or, ce doit être une triste façon de peindre[3] le bonheur.
Une course de sept heures dans un cabriolet léger par Voreppe, la Placette et Saint-Laurent-du-Pont me conduisit au Guiers, qui alors séparait la France de la Savoie[4]. Donc, alors la Savoie n'était point conquise par le général Montesquiou, dont je vois encore le plumet; elle fut occupée vers 1792, je crois. Mon divin séjour aux Échelles est donc de 1790 ou 91. J'avais sept ou huit ans.
Ce fut un bonheur subit, complet, parfait, amené et maintenu par un changement de décoration. Un voyage amusant de sept heures fait disparaître à jamais Séraphie, mon père, le rudiment, le maître de latin, la triste maison Gagnon de Grenoble, la bien autrement triste maison de la rue des Vieux-Jésuites.
Séraphie, le cher père[5], tout ce qui était si terrible et si puissant à Grenoble me manque aux Échelles. Ma tante Camille Poucet, mariée à mon oncle Gagnon, grande et belle personne, était la bonté et la gaieté même. Un an ou deux avant ce voyage, près du pont de Claix, du côté de Claix, au point A[6], j'avais entrevu un instant sa peau blanche à deux doigts au-dessus des genoux, connue elle descendait de notre charrette couverte. Elle était pour moi,[p. 158] quand je pensais à elle, un objet du plus ardent désir. Elle vit encore, je ne l'ai pas vue depuis trente ou trente-trois ans, elle a toujours été parfaitement bonne. Etant jeune, elle avait une sensibilité vraie. Elle ressemble beaucoup à ces charmantes femmes de Chambéry (où elle allait souvent, à cinq lieues de chez elle) si bien peintes par J.-J. Rousseau (Confessions)[7]; elle avait une sœur de la beauté la plus fine, du teint le plus pur, avec laquelle il me semble que mon oncle faisait un peu l'amour. Je ne voudrais pas jurer qu'il n'honorât aussi de ses attentions la Fanchon, la femme de chambre factotum, la meilleure et la plus gaie des filles, quoique point jolie.
Tout fut sensations exquises et poignantes de bonheur dans ce voyage, sur lequel je pourrais écrire, vingt pages de superlatifs.
La difficulté, le regret profond de mal peindre et de gâter ainsi un souvenir céleste, où le sujet surpasse trop le disant, me donne une véritable peine au lieu du plaisir d'écrire. Je pourrai bien ne pas décrire du tout par la suite le passage du Mont-Saint-Bernard avec l'armée de réserve (16 au 18 mai 1800) et le séjour à Milan dans la Casa Castelbarco ou dans la Casa Bovara.
Enfin, pour ne pas laisser en blanc le voyage des Échelles, je noterai quelques souvenirs qui doivent donner une idée aussi inexacte que possible des objets qui les causèrent. J'avais huit ans lorsque j'eus cette vision du ciel.
Une idée me vient, peut-être que tout le malheur de mon affreuse vie de Grenoble, de 1790 à 1799, a été un bonheur, puisqu'il a amené le bonheur, que pour moi rien ne peut surpasser, du séjour aux Échelles et du séjour à Milan du temps de Marengo.
Arrivé aux Échelles, je fus l'ami de tout le monde, tout le monde me souriait comme à un enfant rempli d'esprit. Mon grand-père, homme du monde, m'avait dit: «Tu es laid, mais personne ne te reprochera jamais ta laideur.»
J'ai appris, il y a une dizaine d'années, qu'une des femmes qui m'a le mieux ou du moins le plus longtemps aimé, Victorine Bigillion, parlait de moi dans les mêmes termes après vingt-cinq ans d'absence.
Aux Échelles, je fis mon amie intime de la Fauchon, comme on l'appelait. J'étais en respect devant la beauté de ma tatan Camille et n'osais guère lui parler, je la dévorais des yeux. On me conduisit chez MM. Bonne ou de Bonne, car ils prétendaient fort à la noblesse, je ne sais même s'ils ne se disaient pas parents de Lesdiguières.
J'ai, quelques années après, retrouvé trait pour trait le portrait de ces bonnes gens dans les Confessions de Rousseau, à l'article Chambéry.
Bonne l'aîné, qui cultivait le domaine de Berlandet, à dix minutes des Échelles, où il donna une fête charmante avec des gâteaux et du lait, où je[p. 160] fus monté sur un âne mené par Grubillon fils, était le meilleur des hommes; son frère M. Biaise, le notaire, en était le plus nigaud. On se moquait toute la journée de M. Blaise, qui riait avec les autres. Leur frère, Bonne-Savardin, négociant à Marseille, était fort élégant: mais le courtisan de la famille, le roué que tous regardaient avec respect, était au service du roi à Turin, et je ne fis que l'entrevoir.
Je ne me souviens de lui que par un portrait que Mme Camille Gagnon a maintenant dans sa chambre à Grenoble (la chambre de feu mon grand-père; le portrait, garni d'une croix rouge, dont toute la famille est fière, est placé entre la cheminée et le petit cabinet[8]).
Il y avait aux Échelles une grande et belle fille, Lyonnaise réfugiée. (Donc la Terreur avait[9] commencé à Lyon, ceci pourrait me donner une date certaine. Ce délicieux voyage eut lieu avant la conquête de la Savoie par le général Montesquiou, comme on disait alors, et après que les royalistes se sauvaient de Lyon.)
Mlle Cochet était sous la tutelle de sa mère, mais accompagnée par son amant, un beau jeune homme, M...[10], brun et qui avait l'air assez triste. Il me semble qu'ils venaient seulement d'arriver de Lyon. Depuis, Mlle Cochet a épousé un bel imbécile de mes cousins (M. Doyat, de La Terrasse, et a eu un fils à l'École polytechnique. Il me semble qu'elle a été un peu la maîtresse de mon père). Elle était[p. 161] grande, bonne, assez jolie et, quand je la connus aux Échelles, fort gaie. Elle fut charmante à la partie de Berlandet. Mais Mlle Poncet, sœur de Camille (aujourd'hui madame veuve Blanchet), avait une beauté plus fine; elle parlait fort peu.
La mère de ma tante Camille et de MMlle ...[11], madame Poncet, sœur des Bonne et de madame Giraud, et belle-mère de mon oncle, était la meilleure des femmes. Sa maison, où je logeais, était le quartier général de la gaieté[12].
Cette maison délicieuse avait une galerie de bois, et un jardin du côté du torrent le Guiers. Le jardin était traversé obliquement par la digue du Guiers[13].
À une seconde partie à Berlandet je me révoltai par jalousie, une demoiselle que j'aimais avait bien traité un rival de vingt ou vingt-cinq ans. Mais quel était l'objet de mes amours? Peut-être cela me reviendra-t-il comme beaucoup de choses me reviennent en écrivant. Voici le lieu de la scène[14], que je vois aussi nettement que si je l'eusse quitté il y a huit jours, mais sans physionomie.
Après ma révolte par jalousie, du point A je jetai des pierres à ces dames. Le grand Corbeau (officier en semestre) me prit et me mit sur un pommier ou mûrier en M, au point O, entre deux branches dont je n'osais pas descendre. Je sautai, je me lis mal, je m'enfuis vers Z.
Je m'étais un peu foulé le pied et je fuyais en[p. 162] boitant; l'excellent Corbeau me poursuivit, me prit et me porta sur ses épaules jusqu'aux Échelles.
Il jouait un peu le rôle de patito, me disant qu'il avait été amoureux de Mlle Camille Poncet, ma tante, qui lui avait préféré le brillant Romain Gagnon, jeune avocat de Grenoble revenant d'émigration à Turin[15].
J'entrevis à ce voyage Mlle Thérésine Maistre, sœur de M. le comte de Maistre, surnommé Bance, et c'est Bance, auteur du Voyage autour de ma Chambre, dont j'ai vu la montée à Rome vers 1832; il n'est plus qu'un ultra fort poli, dominé par une femme russe, et s'occupant encore de peinture. Le génie et la gaieté ont disparu, il n'est resté que la bonté.
Que dirai-je d'un voyage à la Grotte[16]? J'entends encore les gouttes silencieuses tomber du haut des grands rochers sur la route. On fit quelques pas dans la grotte avec ces dames: Mlle Poncet eut peur, Mlle Cochet montra plus de courage. Au retour, nous passâmes par le pont Jean-Lioud (Dieu sait quel est son vrai nom).
Que dirai-je d'une chasse dans le bois de Berland, rive gauche du Guiers, près le pont Jean-Lioud? Je glissais souvent sous les immenses hêtres. M..., l'amant de Mlle Cochet, chassait avec ... (les noms et les images sont échappés). Mon oncle donna à mon père un chien énorme, nommé Berland, de couleur noirâtre. Au bout d'un an ou deux, ce souvenir[p. 163] d'un pays délicieux pour moi mourut de maladie, je le vois encore.
Sous les bois de Berland je plaçai les scènes de l'Arioste.
Les forets de Berland et les précipices en forme de falaises qui les bornent du côté de la route de Saint-Laurent-du-Pont devinrent pour moi un type cher et sacré. C'est là que j'ai placé tous les enchantements d'Ismène de la Jérusalem délivrée. A mon retour à Grenoble, mon grand-père me laissa lire la traduction de la Jérusalem par Mirabaud, malgré toutes les observations et réclamations de Séraphie.
Mon père, le moins élégant, le plus finasseur, le plus politique, disons tout en un mot, le plus Dauphinois des hommes, ne pouvait pas n'être pas jaloux de l'amabilité, de la gaieté, de l'élégance physique et morale de mon oncle.
Il l'accusait de broder (mentir); voulant être aimable comme mon oncle à ce voyage aux Échelles, je voulus broder pour l'imiter.
J'inventai je ne sais quelle histoire de mon rudiment. (C'est un volume caché par moi sous mon lit pour que le maître de latin (était-ce M. Joubert ou M. Durand?) ne me marquât pas (avec l'ongle) les leçons à apprendre aux Échelles.)
Mon oncle découvrit sans peine le mensonge d'un enfant de huit ou neuf ans; je n'eus pas la prudence d'esprit de lui dire: «Je cherchais à être aimable comme toi!» Comme je l'aimais, je m'attendris,[p. 164] et la leçon me fit une impression profonde.
En me grondant (reprenant) avec cette raison et cette justice, on eût tout fait de moi. Je frémis en y pensant: si Séraphie eût eu la politesse et l'esprit de son frère, elle eût fait de moi un jésuite [17].
(Je suis tout confit de mépris aujourd'hui. Que de bassesse et de lâcheté il y a dans les généraux de l'Empire! Voilà le vrai défaut du genre de génie de Napoléon: porter aux premières dignités un homme parce qu'il est brave et a le talent de conduire une attaque. Quel abîme de bassesse et de lâcheté morales que les Pairs[18] qui viennent de condamner le sous-officier Samto à une prison perpétuelle, sous le soleil de Pondichéry, pour une faute méritant à peine six mois de prison! Et six pauvres jeunes gens ont déjà subi vingt mois (18 décembre 1835)!
Dès que j'aurai reçu mon Histoire de la Révolution de M. Thiers, il faut que j'écrive dans le blanc du volume de 1793 les noms de tous les généraux Pairs[19] qui viennent de condamner M. Thomas, afin de les mépriser suffisamment tout en lisant les belles actions qui les firent connaître vers 1793. La plupart de ces infâmes ont maintenant soixante-cinq à soixante-dix ans. Mon plat ami Félix Faure a la bassesse infâme sans les belles actions. Et M. d'Houdetot[20]! Et Dijon! Je dirai comme Julien: Canaille! Canaille! Canaille!)
Excusez cette longue parenthèse, ô lecteur[p. 165] de 1880! Tout ce dont je parle sera oublié à cette époque. La généreuse indignation qui fait palpiter mon cœur m'empêche d'écrire davantage sans ridicule. Si en 1880 on a un gouvernement passable, les cascades, les rapides, les anxiétés par lesquelles la Fr[ance] aura passé pour y arriver seront oubliées, l'histoire n'écrira qu'un seul mot à celui du nom de Louis-Philippe: le plus fripon des Kings.
M. de Corbeau, devenu mon ami depuis qu'il m'avait rapporté sur son dos de Berlandet aux Échelles, me menait à la pêche de la truite à la ligne dans le Guiers. Il pêchait entre les portes de Chailles, au bas des précipices du défilé de Chailles, et le pont des Échelles, quelquefois vers le pont Jean-Lioud. Sa ligne avait quinze ou vingt pieds. Vers Chailles, en relevant vivement l'hameçon, sa ligne de crin blanc passa sur un arbre, et la truite de trois-quarts de livre[21] nous apparut pendant à vingt pieds de terre au haut de l'arbre, qui était sans feuilles. Quelle joie pour moi[22]!
[1] Le chapitre XIII se trouve dans un cahier séparé, côté B 300 (Bibl. mun. de Grenoble), en même temps que les chapitres V et XV. Il va du feuillet 15 au feuillet 38, et porte une foliotation spéciale, de 1 à 24. En tête, Stendhal indique: «Dicter ceci et le faire écrire sur le papier blanc à la fin du 1er volume. Relier ce chapitre à la fin du second volume. 18 décembre.» Il ajoute: «Placer ce morceau vers 1792 à son rang, vers 1791.» Un feuillet intercalaire porte encore: «A placer à son époque, avant la conquête de la Savoie par le général Montesquiou, avant 1792. A faire copier sur le papier blanc. Placer a la fin du 1er volume.»—Le chapitre XIII a été écrit n Rome le 18 décembre 1835, par un «froid de chien».
[2] ... le crépi sur lequel la fresque était peinte est tombé ...—On lit en tête du fol. 2: «18 décembre 1835. Omar. Froid de chien, avec nuages au ciel.»
[3] ... triste façon de peindre le bonheur.—Variante: «Rendre.»
[4] ... qui alors séparait la France de la Savoie.—On lit en tête du fol. 5: «18 déc. Froid de loup près du feu.»
[5] ... le cher père ...—Lecture incertaine.
[6] ...du côté de Claix, au point A ...—En face, dans la marge, est un dessin représentant une coupe du pont de Claix. Le point A est sur la route, au sud du pont, sur la rive gauche du Drac.
[7] ... J.-J. Rousseau (Confessions) ...—On lit en tête du fol. 7: «18 décembre 1835. Froid à deux pieds de mon feu. Omar.»
[8] ... entre la cheminée et le petit cabinet.—En face, est un plan de la chambre, avec la place du portrait, près de la cheminée.
[9] Donc la Terreur avait commencé ...—Variante: «Etait commencée.»
[10] ... un beau jeune homme, M ...—Le nom est en blanc.
[11] La mère de ma tante Camille et de Mlle ...—Le nom est en blanc. Il s'agit sans doute de Marie Poncet, sœur de madame Romain Gagnon.
[12] Sa maison, où je logeais ...—Plan des Échelles et de ses environs, avec la maison Poncet (M). «Aux points AA étaient les poteaux avec les armes de Savoie du cité de la rive droite.»
[13] ... par la digue du Guiers.—Ici, un plan de la maison Poncet, avec le jardin traversé par la digue du Guiers.
[14] Voici le lieu de la scène ...—Suit un plan grossier de la scène: derrière une haie se trouve Beyle jetant des pierres aux dames, assises sur une «pente rapide en gazon». C'est une «pente de huit ou dix pieds où toutes ces dames étaient assises, On riait, on buvait du ratafia de Teisseire (Grenoble), les verres manquant, dans des dessus de tabatière d'écaillé». Plus haut est l'arbre M dans la fourche duquel fut placé Beyle, en O; tout près est un ruisseau, le long duquel il s'enfuit.
[15] ... revenant d'émigration à Turin.—En tête du fol. 17 on lit: «18 décembre 1835. Froid; jambe gauche gelée.»
[16] Que dirai-je d'un voyage à la Grotte?—Au verso du fol. 17 est un plan des environs des Échelles. La grotte y est figurée, avec son entrée sur la «route de Chambéry», non loin des «roches énormes coupées par Philibert-Emmanuel» et de la «coupure dans le roc par Napoléon». Y sont figurés l' «ancienne route» des Échelles, la «nouvelle route que je n'ai jamais vue, faite vers 1810», et le sentier conduisant, au «pont Jean-Lioud, à 100 pieds ou 80 au-dessus du torrent».—Au verso du fol. 18 est encore un plan du défilé de Chailles; Stendhal y a indiqué la situation de «Corbaron, domaine de M. de Corbeau». Dessous est un «détail des Portes de Chailles»: «là sont quatre diocèses».
Le pont Jean-Lioud, que Stendhal orthographie Janliou, est jeté sur le Guiers-Mort, lequel avait son cours entièrement en France. C'est le Guiers-Vif qui servait de frontière entre la France et la Savoie.—Actuellement, le pont Jean-Lioud est une passerelle en bois, utilisée par le charmant chemin qui va d'Entre-deux-Guiers à Villette, près Saint-Laurent-du-Pont.]
[17] ... elle eût fait de moi un jésuite.—Ms.: «Tejé.»
[18] ...les Pairs ...—Ms.: «Sraip.»
[19] ... tous les généraux Pairs ...—Ms.: «Sairp.»
[20] ... M. d'Houdetot ...—Ms.: «Detothou.»
[21] ... la truite de trois-quarts de livre ...—Suit une parenthèse comprenant trois ou quatre mots illisibles.
[22] Quelle joie pour moi!—Le chapitre est inachevé. On lit à la fin: «A 4 h. 50 m., manque de jour; je m'arrête.»
Je place ici, pour ne pas le perdre, un dessin[2] dont j'ai orné ce matin une lettre que j'écris à mon ami R. Colomb, qui à son âge, en homme prudent, a été mordu du chien de la Métromanie, ce qui l'a porté à me faire des reproches parce que j'ai écrit une préface pour la nouvelle édition de de Brosses; or, lui aussi avait fait une préface. Cette carte est faite pour répondre à Colomb, qui dit que je vais le mépriser.
J'ajoute: s'il y a un autre monde, j'irai vénérer Montesquieu, il me dira peut-être: «Mon pauvre ami, vous n'avez eu aucun talent dans l'autre inonde.» J'en serai fâché, mais point surpris: l'œil ne se voit pas lui-même.
Mais ma lettre à Colomb ne fera que blanchir tous les gens à argent; quand ils sont arrivés au bien-être, ils se mettent à haïr les gens qui ont été lus du public. Les commis des Affaires étrangères seraient bien aises de me donner quelque petit déboire dans mon métier. Cette maladie est plus maligne quand l'homme à argent, arrivé à cinquante ans, prend la manie de se faire écrivain. C'est comme les généraux de l'Empire qui, voyant, vers 1820, que la Restauration ne voulait pas d'eux, se mirent à aimer passionnément, c'est-à-dire comme un pis aller, la musique.
Revenons à 1794 ou 95. Je proteste de nouveau que je ne prétends pas peindre les choses en elles-mêmes, mais seulement leur effet sur moi. Comment ne serais-je pas persuadé de cette vérité par cette simple observation: je ne me souviens pas de la physionomie de mes parents, par exemple de mon excellent grand-père, que j'ai regardé si souvent et avec toute l'affection dont un enfant ambitieux est capable.
Comme, d'après le système barbare adopté par mon père et Séraphie, je n'avais point d'ami ou de camarade de mon âge, ma sociabilité (inclination à parler librement de tout) s'était divisée en deux branches.
Mon grand-père était mon camarade sérieux et respectable.
Mon ami, auquel je disais tout, était un garçon fort intelligent, nommé Lambert, valet de chambre de mon grand-père. Mes confidences ennuyaient souvent Lambert et, quand je le serrais de trop près, il me donnait une petite calotte bien sèche et proportionnée à mon âge. Je ne l'en aimais que mieux. Son principal emploi, qui lui déplaisait fort, était d'aller chercher des pêches à Saint-Vincent (près le Fontanil), domaine de mon grand-père. Il y avait près de cette chaumière, que j'adorais, des espaliers fort bien exposés qui produisaient des pêches magnifiques. Il y avait des treilles qui produisaient d'excellent lardan (sorte de chasselas, celui de Fontainebleau n'en est que la copie). Tout cela arrivait à Grenoble dans deux paniers placés à l'extrémité d'un bâton plat, et ce bâton se balançait sur l'épaule de Lambert, qui devait faire ainsi[3] les quatre milles qui séparent Saint-Vincent de Grenoble.
Lambert avait de l'ambition, il était mécontent de son sort; pour l'améliorer, il entreprit d'élever des vers à soie, à l'exemple de ma tante Séraphie, qui s'abîmait la poitrine en faisant des vers à soie à Saint-Vincent. (Pendant ce temps je respirais, la maison de Grenoble, dirigée par mon grand-père et la sage Elisabeth, devenait agréable pour moi. Je me hasardais quelquefois à sortir sans l'indispensable compagnie de Lambert.)
Ce meilleur ami que j'eusse avait acheté un mûrier[p. 170] (près de Saint-Joseph), il élevait ses vers à soie dans la chambre de quelque maîtresse.
En ramassant (cueillant) lui-même les feuilles de ce mûrier, il tomba, on nous le rapporta sur une échelle. Mon grand-père le soigna comme un fils. Mais il y avait commotion au cerveau, la lumière ne faisait plus d'impression sur ses pupilles, il mourut au bout de trois jours. Il poussait dans le délire, qui ne le quitta jamais, des cris lamentables qui me perçaient le cœur.
Je connus la douleur pour la première fois de ma vie. Je pensai à la mort.
L'arrachement produit par la perte de ma mère avait été de la folie où il entrait, à ce qui me semble, beaucoup d'amour. La douleur de la mort de Lambert fut de la douleur comme je l'ai éprouvée tout le reste de ma vie, une douleur réfléchie, sèche, sans larmes, sans consolation. J'étais navré et sur le point de tomber (ce qui fut vertement blâmé par Séraphie) en entrant dix fois le jour dans la chambre de mon ami dont je regardais la belle figure, il était mourant et expirant.
Je n'oublierai jamais ses beaux sourcils noirs et cet air de force et de santé que son délire ne faisait qu'augmenter. Je le voyais saigner, après chaque saignée je voyais tenter l'expérience de la lumière devant les yeux (sensation qui me fut rappelée le soir de la bataille de Landshut, je crois, 1809).
J'ai vu une fois, en Italie, une figure de saint Jean[p. 171] regardant crucifier son ami et son Dieu qui, tout-à-coup, me saisit par le souvenir de ce que j'avais éprouvé, vingt-cinq ans auparavant, à la mort du pauvre Lambert, c'est le nom qu'il prit dans la famille après sa mort. Je pourrais remplir encore cinq ou six pages de souvenirs clairs qui me restent de cette grande douleur. On le cloua dans sa bière, on l'emporta...
Sunt lacrimae rerum.
Le même côté de mon cœur est ému par certains accompagnements de Mozart dans Don Juan.
La chambre du pauvre Lambert était située sur le grand escalier, à côté de l'armoire aux liqueurs[4].
Huit jours après sa mort, Séraphie se mit fort justement en colère parce qu'on lui servit je ne sais quel potage (à Grenoble: soupe) dans une petite écuelle de faïence ébréchée, que je vois encore (quarante ans après l'événement), et qui avait servi à recevoir le sang de Lambert pendant une des saignées. Je fondis en larmes tout-à-coup, au point d'avoir des sanglots qui m'étouffaient. Je n'avais jamais pu pleurer à la mort de ma mère. Je ne commençai à pouvoir pleurer que plus d'un an après, seul, pendant la nuit, dans mon lit. Séraphie, en me voyant pleurer Lambert, me fit une scène. Je m'en allai à la cuisine en répétant à demi-voix et comme pour me venger: infâme! infâme!
Mes plus doux épanchements avec mon ami avaient lieu pendant qu'il travaillait à scier le bois au bûcher[5], séparé de la cour, en C, par une cloison à jours, formée de montants de noyer façonnés au tour, comme une balustrade de jardin[6].
Après sa mort, je me plaçais dans la galerie, au second étage de laquelle j'apercevais parfaitement les montants de la balustrade, qui me semblaient superbes pour faire des toupies. Quel âge pouvais-je avoir alors? Cette idée de toupie indique du moins l'âge de ma raison. Je pense à une chose, je puis faire rechercher l'extrait mortuaire du pauvre Lambert, mais Lambert était-il un nom de baptême ou de maison? Il me semble que son frère, qui tenait un petit café de mauvais ton, rue de Bonne, près de la caserne, s'appelait aussi Lambert. Mais quelle différence, grand Dieu! Je trouvais alors qu'il n'y avait rien de si commun que ce frère, chez lequel Lambert me conduisait quelquefois. Car, il faut l'avouer, malgré mes opinions parfaitement et foncièrement républicaines[7] mes parents m'avaient parfaitement communiqué leurs goûts aristocratiques et réservés. Ce défaut m'est resté et par exemple m'a empêché, il n'y a pas dix jours, de cueillir une bonne fortune. J'abhorre la canaille (pour avoir des communications avec), en même temps que sous le nom de peuple je désire passionnément son bonheur, et que je crois qu'on ne peut le procurer qu'en lui faisant des questions sur un objet important, c'est-à-dire[p. 173] en l'appelant à se nommer des députés.
Mes amis, ou plutôt prétendus amis, partent de là pour mettre en doute mon sincère libéralisme. J'ai horreur de ce qui est sale, or le peuple est toujours sale à mes yeux. Il n'y a qu'une exception pour Rome, mais là la saleté est cachée par la férocité. (Par exemple, l'unique saleté du petit abbé sarde Crobras; mais mon respect sans bornes pour son énergie. Son procès de cinq ans avec ses chefs. Ubi missa, ibi menia. Peu d'hommes sont de cette force. Les princes Caetani savent parfaitement ces histoires de M. Crobras, de Sartène, je crois, en Sardaigne[8].)
Les .....[9] que je me donnais au point H sont incroyables. C'était au point de me faire éclater une veine. Je viens de me faire mal en les mimiquant au moins quarante ans après. Qui se souvient de Lambert aujourd'hui, autre que le cœur de son ami!
J'irai plus loin, qui se souvient d'Alexandrine, morte en janvier 1815, il y a vingt ans?
Qui se souvient de Métilde, morte eu 1825? Ne sont-elles pas à moi, moi qui les aime mieux que tout le reste du monde? Moi qui pense passionnément à elles dix fois la semaine, et souvent deux heures de suite[10]?
[1] Le chapitre XIV est le chapitre XI du manuscrit (Bibl. de Grenoble, R 299, fol. 211 à 225).—Écrit à Rome, le 15 décembre 1835.
[2] Je place ici ... un dessin ...—Ce dessin représente un carrefour où aboutissent quatre voies. Au centre, au point A, est le moment de la naissance; à droite, horizontalement, la route de la fortune par le commerce ou les places; au milieu et perpendiculairement, la route de la considération: Félix Faure est fait pair de France; à gauche et obliquement, la route de l'art de se faire lire; à gauche, horizontalement, la route de la folie.
[3] ... Lambert, qui devait faire ainsi ...—Variante: «Qui faisait ainsi.»
[4] La chambre du pauvre Lambert était située ...—En face, est un plan d'une partie de l'appartement. On y voit la chambre de Lambert, voisine de la salle-à-manger, où se trouvait, dans un angle, l'armoire aux liqueurs. Cette chambre avait une «fenêtre éclairant mal, donnant sur l'escalier, mais fort grande et fort belle»; elle contenait une «grande armoire de noyer pour le linge de la famille. Le linge était regardé avec une sorte de respect». (Voir notre plan de l'appartement Gagnon.)
[5] ... scier le bois au bûchier ...—Plan du bûcher indiquant sa position au sud de la grande cour, près du grand escalier.
[6] ... séparé de la cour ...—Plan de la cour, avec le bûcher et la galerie. Stendhal y a joint des dessins représentant un chevalet avec une bûche, la scie de Lambert et les balustres du bûcher.
[7] ... mes opinions parfaitement et foncièrement républicaines ...—Ms.: «Kainesrépubli.»
[8] ... M. Crobras, de Sartène, je crois, en Sardaigne.—Erreur: Sartène est en Corse.
[9] Les ... que je me donnais ...—Deux mots illisibles. Stendhal doit faire allusion ici à quelque grimace d'enfant. Dans un croquis du fol. 221 il indique le point H dans la galerie du second étage, qui longeait la grande cour de la maison Gagnon: «H, moi. De là, je contemplais les barreaux de bois du bûcher et je me donnais des (les mêmes mots, toujours illisibles) en portant le sang à la tête et ouvrant la bouche.»
[10] ... souvent deux heures de suite?—On lit au verso du fol. 225: «Idée: Aller passer trois jours à Grenoble, et ne voir Crozet que le troisième jour. Aller seul incognito à Claix, à la Bastille, à La Tronche.»
Ma mère avait eu un rare talent pour le dessin, disait-on souvent dans la famille. «Hélas! que ne faisait-elle pas bien?» ajoutait-on avec un profond soupir. Après quoi, silence triste et long. Le fait est qu'avant la Révolution, qui changea tout dans ces provinces reculées, on enseignait le dessin à Grenoble aussi ridiculement que le latin. Dessiner, c'était faire avec de la sanguine des hachures bien parallèles et imitant la gravure; on donnait peu d'attention au contour.
Je trouvais souvent de grandes têtes à la sanguine dessinées par ma mère.
Mon grand-père allégua cet exemple, ce précédent tout-puissant, et malgré Séraphie j'allai apprendre à dessiner chez M. Le Roy. Ce fut un grand point[p. 176] de gagné; comme M. Le Roy demeurait dans la maison Teisseire, avant le grand portail des Jacobins[2], peu à peu on me laissa aller seul chez lui et surtout revenir.
Cela était immense pour moi. Mes tyrans, je les appelais ainsi en voyant courir les autres enfants, souffraient que j'allasse seul de P en R[3]. Je compris qu'en allant fort vite, car on comptait les minutes, et la fenêtre de Séraphie donnait précisément sur la place Grenette, je pourrais faire un tour sur la place de la Halle, à laquelle on arrivait par le portail L. Je n'étais exposé que pendant le trajet de R en L. L'horloge de Saint-André, qui réglait la ville, sonnait les quarts, je devais sortir à trois heures et demie ou quatre heures (je ne me souviens pas bien lequel) de chez M. Le Roy et cinq minutes après être rentré. M. Le Roy, ou plutôt madame Le Roy, une diablesse de trente-cinq ans, fort piquante et avec des yeux charmants, était spécialement chargée sous menace, je pense, de perdre un élève payant bien, de ne me laisser sortir[4] qu'à trois heures et quart. Quelquefois, en montant, je m'arrêtais des quarts d'heure entiers, regardant par la fenêtre de l'escalier, en F, sans autre plaisir que de me sentir libre; dans ces rares moments, au lieu d'être employée à calculer les démarches de mes tyrans, mon imagination se mettait à jouir de tout.
Ma grande affaire fut bientôt de deviner si Séraphie serait à la maison à trois heures et demie, heure[p. 177] de ma rentrée. Ma bonne amie Marion (Marie Thomasset, de Vinay), servante de Molière et qui détestait Séraphie, m'aidait beaucoup. Un jour que Marion m'avait dit que Séraphie sortait après le café, vers trois heures, pour aller chez sa bonne amie madame Vignon, la boime[5], je me hasardai à aller au Jardin-de-Ville (rempli de petits polissons gamins). Pour cela, je traversai la place Grenette en passant derrière la baraque des châtaignes et la pompe, et en me glissant par la voûte du jardin.
Je fus aperçu, quelque ami ou protégé de Séraphie me trahit, scène le soir devant les grands-parents. Je mentis, comme de juste, sur la demande de Séraphie:
«As-tu été au Jardin-de-Ville?»
Là-dessus, mon grand-père me gronda doucement et poliment, mais ferme, pour le mensonge. Je sentais vivement ce que je ne savais exprimer. Mentir n'est-il pas la seule ressource des esclaves? Un vieux domestique, successeur du pauvre Lambert, sorte de La Rancune, fidèle exécuteur des ordres des parents et qui disait avec morosité en parlant de soi: «Je suis assassineur (sic) de pots-de-chambre», fut chargé de me conduire chez M. Le Roy. J'étais libre les jours où il allait à Saint-Vincent chercher des fruits.
Cette lueur de liberté me rendit furieux. «Que me feront-ils après tout, me dis-je, où est l'enfant de mon âge qui ne va pas seul?»
Plusieurs fois j'allai au Jardin-de-Ville; si l'on s'en apercevait on me grondait, mais je ne répondais pas. On menaça de supprimer le maître de dessin, mais je continuai mes courses. Alléché par un peu de liberté, j'étais devenu féroce. Mon père commençait à prendre sa grande passion pour l'agriculture et il allait souvent à Claix[6]. Je crus m'apercevoir qu'en son absence je commençais à faire peur à Séraphie. Ma tante Elisabeth, par fierté espagnole, n'ayant pas d'autorité légitime, restait neutre; mon grand-père, d'après son caractère à la Fontenelle, abhorrait les cris; Marion et ma sœur Pauline étaient hautement pour moi. Séraphie passait pour folle aux yeux de bien des gens, et par exemple aux yeux de nos cousines, mesdames Colomb et Romagnier, femmes excellentes. (J'ai pu les apprécier après que j'ai eu l'âge de raison et quelque expérience de la vie.) Dans ces temps-là un mot de Mme Colomb me faisait rentrer en moi-même, ce qui me fait supposer qu'avec de la douceur on eût tout fait de moi, probablement un plat Dauphinois bien retors. Je me mis à résister à Séraphie, j'avais à mon tour des accès de colère abominables.
«Tu n'iras plus chez M. Le Roy», disait-elle.
Il me semble, en y pensant bien, qu'il y eut une victoire de Séraphie, et par conséquent, interruption dans les leçons de dessin.
La Terreur était si douce à Grenoble que mon père, de temps à autre, allait habiter sa maison, rue des[p. 179] Vieux-Jésuites. Là, je vois M. Le Roy me donnant leçon sur le grand bureau[7] noir du cabinet de mon père[8], et me disant à la fin de la leçon:
«Monsieur, dites à votre cher père que je ne puis plus venir pour trente-cinq (ou quarante-cinq) francs par mois.»
Il s'agissait d'assignats qui dégringolaient ferme (terme du pays). Mais quelle date donner à cette image fort nette qui m'est revenue tout-à-coup? Peut-être était-ce beaucoup plus tard, à l'époque où je peignais à la gouache.
Les dessins de M. Le Roy étaient ce qui m'importait le moins. Ce maître me faisait faire[9] des yeux de profil et de face, et des oreilles à la sanguine d'après d'autres dessins gravés à la manière du crayon.
M. Le Roy était un Parisien fort poli, sec et faible, vieilli par le libertinage le plus excessif (telle est mon impression, mais comment pouvais-je justifier ces mots: le plus excessif?), du reste poli, civilisé comme on l'est à Paris, ce qui me faisait l'effet de: excessivement poli, à moi accoutumé à l'air froid, mécontent, nullement civilisé qui fait la physionomie ordinaire de ces Dauphinois si fins. (Voir le caractère de Sorel père, dans le Rouge, mais où diable sera le Rouge en 1880?—Il aura passé les sombres bords.)
Un soir, à la nuit tombante, il faisait froid, j'eus l'audace de m'échapper, apparemment en allant[p. 180] rejoindre ma tante Elisabeth chez madame Colomb; j'osai entrer à la Société des Jacobins, qui tenait ses séances dans l'église de Saint-André. J'étais rempli des héros de l'histoire romaine, je me voyais un jour un Camille ou un Cincinnatus, ou tous les deux à la fois[10]. Dieu sait à quelle peine je m'expose, me disais-je, si quelque espion de Séraphie (c'est mon idée d'alors) m'aperçoit ici? Le président était en P, des femmes mal mises en F, moi en H[11].
On demandait la parole et on parlait avec assez de désordre. Mon grand-père se moquait habituellement, et gaiement, de leurs façons de parler. Il me sembla sur-le-champ que mon grand-père avait raison, l'impression fut peu favorable, je trouvai horriblement vulgaires ces gens que j'aurais voulu aimer[12]. Cette église étroite et haute était fort mal éclairée, j'y trouvai beaucoup de femmes de la dernière classe. En un mot, je fus alors comme aujourd'hui, j'aime le peuple, je déteste les oppresseurs, mais ce serait pour moi un supplice de tous les instants de vivre avec le peuple.
J'emprunterai pour un instant[13] la langue de Cabanis. J'ai la peau beaucoup trop fine, une peau de femme (plus tard j'avais toujours des ampoules après avoir tenu mon sabre pendant une heure), je m'écorche les doigts, que j'ai fort bien, pour un rien, en un mot la superficie de mon corps est de femme. De là peut-être une horreur incommensurable pour ce qui a l'air sale, ou humide, ou noirâtre.[p. 181] Beaucoup de ces choses se trouvaient aux Jacobins de Saint-André.
En rentrant, une heure après, chez madame Colomb, ma tante au caractère espagnol me regarda d'un air fort sérieux. Nous sortîmes: quand nous fûmes seuls dans la rue, elle me dit:
«Si tu t'échappes ainsi, ton père s'en apercevra...
—Jamais de la vie, si Séraphie ne me dénonce pas.
—Laisse-moi parler... Et je ne me soucie pas d'avoir à parler de toi avec ton père. Je ne te mènerai plus chez Mme Colomb.»
Ces paroles, dites avec beaucoup de simplicité, me touchèrent; la laideur des Jacobins m'avait frappé, je fus pensif le lendemain et les jours suivants: mon idole était ébranlée. Si mon grand-père avait deviné ma sensation, et je lui aurais tout dit s'il m'en eût parlé au moment où nous arrosions les fleurs sur la terrasse, il pouvait ridiculiser à jamais les Jacobins et me ramener au giron de l'Aristocratie (ainsi nommée alors, aujourd'hui parti légitimiste ou conservateur). Au lieu de diviniser les Jacobins, mon imagination eut été employée à se figurer et à exagérer la saleté de leur salle de Saint-André.
Cette saleté laissée à elle-même fut bientôt effacée par quelque récit de bataille gagnée qui faisait gémir ma famille.
Vers cette époque, les arts s'emparaient de mon[p. 182] imagination, par la voie des sens, dirait un prédicateur. Il y avait dans l'atelier de M. Le Roy un grand et beau paysage: une montagne rapide très voisine de l'œil, garnie de grands arbres; au pied de cette montagne un ruisseau peu profond, mais large, limpide, coulait de gauche à droite au pied des derniers arbres. Là, trois femmes presque nues (ou sans presque) se baignaient gaiement. C'était presque le seul point clair dans cette toile de trois pieds et demi sur deux et demi.
Ce paysage, d'une verdure charmante, trouvant une imagination préparée par Félicia, devint pour moi l'idéal du bonheur. C'était un mélange de sentiments tendres et de douce volupté. Se baigner ainsi avec des femmes si aimables[14]!
L'eau était d'une limpidité qui faisait un beau contraste avec les puants ruisseaux des Granges, remplis de grenouilles et recouverts d'une pourriture verte. Je prenais la plante verte qui croît sur ces sales ruisseaux pour une corruption. Si mon grand-père m'eût dit: « C'est une plante, le moisi même qui gâte le pain est une plante», mon horreur eût rapidement cessé. Je ne l'ai surmontée tout-à-fait qu'après que M. Adrien de Jussieu, dans notre voyage à Naples (1832), (cet homme si naturel, si sage, si raisonnable, si digne d'être aimé), m'eut parlé au long de ces petites plantes, toujours un peu signes de pourriture à mes yeux, quoique je susse vaguement que c'étaient des plantes.
Je n'ai qu'un moyen d'empêcher mon imagination de me jouer des tours, c'est de marcher droit à l'objet. Je vis bien cela en marchant sur les deux pièces de canon (dont il est parlé dans le certificat du général Michaud)[15].
Plus tard, je veux dire vers 1805, à Marseille, j'eus le plaisir délicieux de voir ma maîtresse, supérieurement bien faite, se baigner dans l'Huveaune couronnée de grands arbres (dans la bastide de madame Roy).
Je me rappelai vivement le paysage de M. Le Roy, qui pendant quatre ou cinq ans avait été pour moi l'idéal du bonheur voluptueux. J'aurais pu m'écrier, comme je ne sais quel niais d'un des romans de 1832: Voilà mon idéal!
Tout cela, comme on sent, est fort indépendant du mérite du paysage, qui était probablement un plat d'épinards, sans perspective aérienne.
Plus tard, le Traité nul, opéra de Gaveau, fut pour moi le commencement de la passion qui s'est arrêtée au Matrimonio segreto, rencontré à Ivrée (fin de mai 1800), et à Don Juan.
[1] Chapitre XV.—Comme les chapitres V et XIII, le présent chapitre se trouve dans un cahier séparé côté R 300 à la bibliothèque municipale de Grenoble, fol. I à 14. Stendhal a indiqué en tête de ce chapitre, qu'il intitule «chapitre 13»: «A placer after the death of poor Lambert.»—Écrit à Rome, le 17 décembre 1835; corrigé, à partir du fol. 11, le 25 décembre.—On lit en tête du fol. I: «17 déc. 35. Grand froid à la jambe gauche gelée.»
[2] ... M. Le Roy demeurait dans la maison Teisseire, avant le grand portail des Jacobins ...—Aujourd'hui, place Grenette, no 5, à l'angle de la rue de la République (autrefois rue de la Halle). La voûte qui séparait la rue de la Halle de la place Grenette a été démolie en 1908.
[3] Mes tyrans ... souffraient que j'allasse seul de P en R ...—Au verso du fol. 2 est un plan des environs de la place Grenette. On y voit les «portes de la maison de M. Gagnon (il me semble jurer quand je dis: M. Gagnon).»
[4] ... de ne me laisser sortir ...—Variante: «De ne me lâcher.»
[5] ... la boime ...—Terme dauphinois, que Stendhal définit ainsi: «Boime à Grenoble veut dire hypocrite, doucereuse, jésuite-femelle.» (Voir plus loin, chapitre XVII.)
[6] ... il allait souvent à Claix.—En face, au verso du fol. 5, est une carte grossière de la campagne située au midi de Grenoble, avec les chemins suivis pour aller à Claix et au hameau de Furonières, où se trouvait la propriété des Beyle. Stendhal ajoute en note: «Pour aller à Claix, c'est-à-dire à Furonières, nous prenions le chemin Meney par O F, le Cours (appelé le Course)[cours de Saint-André], le pont de Claix et les chemins R et R', quelquefois le chemin E du Moulin-de-Canel et le bac de Seyssins. Mon ami Crozet y a fait un pont en fil de fer vers 1826.»—Louis Crozet fut inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées; il exerça les fonctions de maire de Grenoble entre 1853 et 1858.
[7] ... sur le grand bureau ...—Variante: «Table.»
[8] ... cabinet de mon père ...—Un plan des situations respectives des personnages accompagne le récit.
[9] Ce maître me faisait faire ...—Variante: «M. Le Roy me faisait faire ...»
[10] ... tous les deux à la fois.—Variante: «En même temps.»
[11] ... des femmes mal mises en F, moi en H.—En face du fol. 8 (verso du fol. 7) est un plan de l'église Saint-André et de ses abords, et notamment, dans la Grande-rue, la «maison où habitaient Mmes Colomb et Romagnier.»
[12] ... ces gens que j'aurais voulu aimer.—On lit en haut du fol. 9: «17 décembre 1835.—Je souffre du froid devant mon feu, à deux pieds et demi du foyer, grand froid for Omar.»
[13] J'emprunterai pour un instant la langue de Cabanis.—On lit fol. 8 V°: «Style. Ces mots: pour un instant, je les eusse effacés en 1830, mais en 35 je regrette de ne pas en trouver de semblables dans le Rouge. 25 décembre 1835.»
[14] Se baigner ainsi avec des femmes si aimables!—On trouve en tête du fol. 13 un dessin schématique du «Paysage de M. Le Roy», et au verso du fol. 12 un plan de l'atelier.
[15] ...(dont il est parle dans le certificat du général Michaud).—«M. Colomb doit avoir ce certificat,» (Note de Stendhal.) «Oui,» a ajouté au crayon R. Colomb.
Je travaillais sur une petite table au point P[2], près de la seconde fenêtre du grand salon à l'italienne, je traduisais avec plaisir Virgile ou les Métamorphoses d'Ovide, quand un sombre murmure d'un peuple immense, rassemblé sur la place Grenette, m'apprit qu'on venait de guillotiner deux prêtres[3].
C'est le seul sang que la Terreur de 93 ait fait couler à Grenoble.
Voici un de mes grands torts: mon lecteur de 1880, éloigné de la fureur et du sérieux des partis, me prendra en grippe quand je lui avouerai que cette mort, qui glaçait d'horreur mon grand-père, qui rendait Séraphie furibonde, qui redoublait le[p. 186] silence hautain et espagnol de ma tante Elisabeth, me fit pleasure. Voilà le grand mot écrit.
Il y a plus, il y a bien pis, j'aime encore in 1835 the man of 1794.
(Voici encore un moyen d'accrocher une date véritable. Le registre du tribunal criminel, actuellement Cour royale, place Saint-André, doit donner la date de la mort de MM. Revenas et Guillabert[4].)
Mon confesseur, M. Dumolard, du Bourg-d'Oisans[5], (prêtre borgne et assez bonhomme en apparence, depuis 1815 jésuite furieux[6]), me montra, avec des gestes qui me semblèrent ridicules, des prières ou des vers latins écrits par MM. Revenas et Guillabert, qu'il voulait à toute force me faire considérer comme généraux de brigade.
Je lui répondis fièrement:
«Mon bon papa (grand-père) m'a dit qu'il y a vingt ans on pendit à la même place deux ministres protestants.
—Ah! c'est bien différent!
—Le Parlement condamna les deux premiers pour leur religion, le tribunal civil criminel vient de condamner ceux-ci pour avoir trahi la patrie.»
Si ce ne sont les mots, c'est du moins le sens.
Mais je ne savais pas encore que discuter avec les tyrans est dangereux, on devait lire dans mes yeux mon peu de sympathie pour deux traîtres à la patrie. (Il n'y avait pas en 1795 et il n'y a pas à mes[p. 187] yeux, en 1835, de crime seulement comparable.)
On me fit une querelle abominable, mon père se mit contre moi dans une des plus grandes colères dont j'aie souvenance. Séraphie triomphait. Ma tante Elisabeth me fit la morale en particulier. Mais je crois, Dieu me pardonne, que je la convainquis que c'était la peine du talion.
Heureusement pour moi, mon grand-père ne se joignit pas à mes ennemis, en particulier il fut tout-à-fait d'avis que la mort des deux ministres protestants était aussi condamnable.
«C'est petit: sous le tyran Louis XV la patrie n'était pas en danger.»
Je ne dis pas tyran, mais ma physionomie devait le dire.
Si mon grand-père, qui déjà avait été contre moi dans la bataille abbé Gardon, se fût montré de même dans cette affaire, c'en était fait [7], je ne l'aimais plus. Nos conversations sur la belle littérature, Horace, M. de Voltaire, le chapitre XV de Bélisaire, les beaux endroits de Télémaque, Séthos, qui ont formé mon esprit, eussent cessé et j'eusse été bien plus malheureux dans tout le temps qui s'écoula de la mort des deux malheureux prêtres à ma passion exclusive pour les mathématiques: printemps ou été 1797.
Tous les après-midi d'hiver se passaient, les jambes au soleil, dans la chambre de ma tante Elisabeth, qui donnait sur la Grenette au point A[8]. Par-dessus[p. 188] l'église de Saint-Louis ou à côté, pour mieux dire, on voyait le trapèze T de la montagne du Villard-de-Lans[9]. Là était mon imagination, dirigée[10] par l'Arioste de M. de Tressan, elle ne voyait, rêvait qu'un pré au milieu de hautes montagnes. Mon griffonnage d'alors ressemblait beaucoup à l'écriture ci-jointe de mon illustre compatriote[11].
Mon grand-père avait coutume de dire en prenant son excellent café, sur les deux heures après-midi, les jambes au soleil: «Dès le 15 février, dans ce climat, il fait bon au soleil.»
Il aimait beaucoup les idées géologiques et aurait été un partisan ou un adversaire des soulèvements de M. Elie de Beaumont, qui m'enchantent. Mon grand-père me parlait avec passion, c'est là l'essentiel, des idées géologiques d'un M. Guettard[12], qu'il avait connu, ce me semble.
Je remarquai avec ma sœur Pauline, qui était de mon parti, que la conversation dans le plus beau moment de la journée, en prenant le café, consistait toujours en gémissements. On gémissait de tout.
Je ne puis pas donner la réalité des faits, je n'en puis présenter que l'ombre.
Nous passions les soirées d'été, de sept à neuf et demie (à neuf heures, le sein ou saint[13] sonnait à Saint-André, les beaux sons de cette cloche me donnaient une vive émotion). Mon père, peu sensible à la beauté des étoiles (je parlais sans cesse constellations avec mon grand-père), disait qu'il[p. 189] s'enrhumait et allait faire la conversation dans la chambre attenante avec Séraphie.
Cette terrasse, formée par l'épaisseur d'un mur nommé Sarrasin[14], mur qui avait quinze ou dix-huit pieds, avait une vue magnifique sur la montagne de Sassenage; là, le soleil se couchait en hiver; sur le rocher[15] de Voreppe, coucher d'été, et au nord-ouest de la Bastille, donc la montagne (maintenant transformée par le général Haxo) s'élevait au-dessus de toutes les maisons et sur la tour de Rabot, qui fut, ce me semble, l'ancienne entrée de la ville avant qu'on eût coupé le rocher de la Porte-de-France[16].
Mon grand-père fit beaucoup de dépenses pour cette terrasse. Le menuisier Poncet vint s'établir pendant un an dans le cabinet d'histoire naturelle, dont il fit les armoires en bois blanc; il fit ensuite des caisses de dix-huit pouces de large et deux pieds de haut, en châtaignier, remplies de bonne terre, de vigne et de fleurs. Deux ceps montaient du jardin de M. Périer-Lagrange, bon imbécile, notre voisin.
Mon grand-père avait fait établir des portiques en liteaux de châtaignier. Ce fut un grand travail dont fut chargé un menuisier nommé Poncet, bon ivrogne de trente ans assez gai. Il devint mon ami, car enfin avec lui je trouvais la douce égalité.
Mon grand-père arrosait ses fleurs tous les jours,[p. 190] plutôt deux fois qu'une; Séraphie ne venait jamais sur cette terrasse, c'était un moment de répit. J'aidais toujours mon grand-père à arroser les fleurs, et il me parlait de Linné et de Pline, non pas par devoir, mais avec plaisir.
Voilà la grande et extrême obligation que j'ai à cet excellent homme. Par surcroît de bonheur, il se moquait fort des pédants (les Lerminier, les Salvandy, les...[17] d'aujourd'hui), il avait un esprit dans le genre de M. Letronne, qui vient de détrôner Memnon[18] (ni plus ni moins que la statue de Memnon). Mon grand-père me parlait avec le même intérêt de l'Egypte, il me fit voir la momie achetée, par son influence, pour la bibliothèque publique; là, l'excellent Père Ducros (le premier homme supérieur auquel j'ai parlé dans ma vie) eut mille complaisances pour moi. Mon grand-père, fort blâmé par Séraphie appuyée du silence de mon père, me fit lire Séthos (lourd roman de l'abbé Terrasson), alors divin pour moi. Un roman est comme un archet, la caisse du violon qui rend les sons, c'est l'âme du lecteur. Mon âme alors était folle, et je vais dire pourquoi. Pendant que mon grand-père lisait, assis dans un fauteuil en D[19], vis-à-vis le petit buste de Voltaire en V, je regardais sa bibliothèque placée en B, j'ouvrais les volumes in-4° de Pline, traduction avec texte en regard. Là je cherchais surtout l'histoire naturelle de la femme.
L'odeur excellente, c'était de l'ambre ou du musc[p. 191] (qui me font malade depuis seize ans, c'est peut-être la même odeur ambre et musc), enfin je fus attiré vers un tas de livres brochés jetés confusément en L. C'étaient de mauvais romans non reliés que mon oncle avait laissés à Grenoble lors de son départ pour s'établir aux Échelles (Savoie, près le Pont-de-Beauvoisin). Cette découverte fut décisive pour mon caractère. J'ouvris quelques-uns de ces livres, c'étaient de plats romans de 1780, mais pour moi c'était l'essence de la volupté.
Mon grand-père me défendit d'y toucher, mais j'épiais le moment où il était le plus occupé dans son fauteuil à lire les livres nouveaux dont, je ne sais comment, il avait toujours grande abondance, et je volais un volume des romans de mon oncle. Mon grand-père s'aperçut sans doute de mes larcins, car je me vois établi dans le cabinet d'histoire naturelle, épiant que quelque malade vînt le demander. Dans ces circonstances, mon grand-père gémissait de se voir enlevé à ses chères études et allait recevoir le malade dans sa chambre ou dans l'antichambre du grand appartement. Crac! je passais dans le cabinet d'études, en L, et je volais un volume.
Je ne saurais exprimer la passion avec laquelle je lisais ces livres. Au bout d'un mois ou deux, je trouvai Félicia ou mes fredaines. Je devins fou absolument, la possession d'une maîtresse réelle, alors l'objet de tous mes vœux, ne m'eût pas plongé dans un tel torrent de volupté.
Dès ce moment, ma vocation fut décidée: vivre à Paris en faisant des comédies, comme Molière.
Ce fut là mon idée fixe, que je cachai sous une dissimulation profonde, la tyrannie de Séraphie m'avait donné les habitudes d'un esclave.
Je n'ai jamais pu parler de ce que j'adorais, un tel discours m'eût semblé un blasphème.
Je sens cela aussi vivement en 1835 que je le sentais en 1794.
Ces livres de mon oncle portaient l'adresse de M. Falcon[20], qui tenait alors l'unique cabinet littéraire; c'était un chaud patriote, profondément méprisé par mon grand-père et parfaitement haï par Séraphie et mon père.
Je me mis par conséquent à l'aimer, c'est peut-être le Grenoblois que j'ai le plus estimé. Il y avait dans cet ancien laquais de madame de Brizon (ou d'une autre dame de la rue Neuve, chez laquelle[21] mon grand-père avait été servi à table par lui), il y avait dans ce laquais une âme vingt fois plus noble que celle de mon grand-père, de mon oncle, je ne parlerai pas de mon père et du jésuite Séraphie. Peut-être ma seule tante Elisabeth lui était-elle comparable. Pauvre, gagnant peu et dédaignant de gagner de l'argent, Falcon plaçait un drapeau tricolore en dehors de sa boutique à chaque victoire des armées et les jours de fête de la République.
Il a adoré cette République du temps de Napoléon comme sous les Bourbons, et est mort à quatre-vingt-deux[p. 193] ans, vers 1820, toujours pauvre, mais honnête jusqu'à la plus extrême délicatesse.
En passant, je lorgnais la boutique de Falcon, qui avait un grand toupet à l'œil au royal, parfaitement poudré, et arborait un bel habit rouge à grands boutons d'acier, la mode d'alors, les jours heureux pour sa chère République. C'est le plus bel échantillon[22] du caractère dauphinois. Sa boutique était vers la place Saint-André, je me rappelle son déménagement. Falcon vint occuper la boutique A[23], dans l'ancien Palais des Dauphins, où siégeait le Parlement et ensuite la Cour royale. Je passais exprès sous le passage B pour le voir. Il avait une fille fort laide, le sujet ordinaire des plaisanteries de ma tante Séraphie, qui l'accusait de faire l'amour avec les patriotes qui venaient lire les journaux dans le cabinet littéraire de son père.
Plus tard, Falcon s'établit en A'. Alors j'avais la hardiesse d'aller lire chez lui. Je ne sais pas si, dans le temps où je volais les livres de mon oncle, j'eus la hardiesse de m'abonner chez lui; il me semble que, d'une façon quelconque, j'avais de ses livres.
Mes rêveries furent dirigées puissamment par la Vie et les aventures de Mme de * * *[24], roman extrêmement touchant, peut-être fort ridicule, car l'héroïne était prise par les sauvages. Je prêtai, ce me semble, ce roman à mon ami Romain Colomb, qui encore aujourd'hui en a gardé le souvenir.
Bientôt je me procurai la Nouvelle-Héloïse, je crois que je la pris au rayon le plus élevé de la bibliothèque de mon père, à Claix.
Je la lus couché sur mon lit dans mon trapèze[25] à Grenoble, après avoir eu soin de m'enfermer à clef, et dans des transports de bonheur et de volupté impossibles à décrire. Aujourd'hui, cet ouvrage me semble pédantesque et, même en 1819, dans les transports de l'amour le plus fou, je ne pus pas en lire vingt pages de suite. Dès lors, voler des livres devint ma grande affaire.
J'avais un coin à côté du bureau de mon père; rue des Vieux-Jésuites, où je déposais, à demi cachés par leur humble position, les livres qui me plaisaient; c'étaient des exemplaires du Dante avec des gravures sur bois bizarres, des traductions de Lucien par Perrot d'Ablancourt (les belles infidèles), la correspondance de milord All-eye avec milord All-ear, du marquis d'Argens, et enfin les Mémoires d'un homme de qualité retiré du monde.
Je trouvai moyen de me faire ouvrir le cabinet de mon père, qui était désert depuis la fatale tyrannie Amar et Merlinot, et je passai une revue exacte de tous les livres. Il avait une superbe collection d'Elzévirs, mais malheureusement je ne comprenais rien au latin, quoique sachant par cœur le Selectae e profanis. Je trouvai quelques livres in-12 au-dessus de la petite porte communiquant au salon, et j'essayai de lire quelques articles de l'Encyclopédie.[p. 195] Mais qu'était-ce que tout cela à côté de Félicia et de la Nouvelle-Héloïse?
Ma confiance littéraire en mon grand-père était extrême, je comptais bien qu'il ne me trahirait pas envers Séraphie et mon père. Sans avouer que j'avais lu la Nouvelle-Héloïse, j'osai lui en parler avec éloge. Sa conversion au jésuitisme[26] ne devait pas être ancienne, au lieu de m'interroger avec sévérité il me raconta que M. le baron des Adrets (le seul des amis chez qui il eût continué à dîner deux ou trois fois par mois, depuis la mort de ma mère), dans le temps que parut la Nouvelle-Héloïse (n'est-ce pas 1770[27]?), se fît attendre un jour à dîner chez lui; Mme des Adrets le fit avertir une seconde fois, enfin cet homme si froid arriva tout en larmes.
«Qu'avez-vous donc, mon ami? lui dit Mme des Adrets, tout alarmée.
—Ah! Madame, Julie est morte! » Et il ne mangea presque pas.
Je dévorais les annonces de livres à vendre qui arrivaient avec les journaux. Mes parents recevaient alors, ce me semble, un journal en société avec quelqu'un.
J'allai m'imaginer que Florian devait être un livre sublime, apparemment d'après les titres: Gonsalve de Cordoue, Estelle, etc.
Je mis un petit écu (3 francs) dans une lettre et j'écrivis à un libraire de Paris de m'envoyer un[p. 196] certain ouvrage de Florian. C'était hardi, qu'eût dit Séraphie à l'arrivée du paquet?
Mais enfin il n'arriva jamais, et avec un louis que mon grand-père m'avait donné le jour de l'an j'achetai un Florian. Ce fut des œuvres de ce grand homme que je tirai ma première comédie[28].
[1] Le chapitre XVI est le chapitre XII du manuscrit (R 299, fol. 226 à 248).—Écrit à Rome, les 15 et 16 décembre 1835.
[2] Je travaillais sur uns petite table au point P ...—Un fol. 226 bis est rempli par un plan d'une partie de l'appartement Gagnon, avec le «grand salon à l'Italienne». (Voir notre plan de l'appartement Gagnon.)
[3] ... m'apprit qu'on venait de guillotiner deux prêtres.—Variante: «Deux généraux de brigade.» Voir l'explication de ce terme donnée plus loin par l'abbé Dumolard au jeune Henri.
[4] ... date de la mort de MM. Revenus et Guillabert—Les abbés Revenas et Guillabert furent guillotinés le 26 juin 1794. (Voir A. Prudhomme, Histoire de Grenoble, p. 645.)
[5] ... M. Dumolard, du Bourg-d'Oisans ...—L'abbé Dumolard était curé de La Tronche, près Grenoble.
[6] ... depuis 1815, jésuite furieux ...—Ms:«Tejé.»
[7] ... c'en était fait ...—Ici une croix et un blanc d'une demi-ligne.
[8] ... qui donnait sur la Grenette au point A.—Plan de la place Grenette, avec en A la chambre d'Elisabeth Gagnon, à l'extrémité Nord de l'appartement (voir notre plan). En B, à l'angle de la place et de la Grande-rue, «salle-à-manger du premier étage, occupé par mon grand-père avant notre passage à la maison de Marnais».
[9] ... le trapèze T de la montagne du Villard-de-Lans.—Croquis indiquant le trapèze formé, en haut par la crête de la montagne, et sur les trois autres cités par l'église Saint-Louis et les toits des maisons. La crête de la montagne, ainsi limitée, correspond à l'arête des montagnes de Lans, entre le Moucherotte et le col de l'Arc.
[10] ... mon imagination, dirigée ...—Variante: «Formée.»
[11] ... l'écriture ci-jointe de mon illustre compatriote.—Avec le manuscrit est relié (après les fol. 99 et 231) un fac-similé lithographique de l'écriture de Barnave. Ce fac-similé porte les légendes suivantes: «Extrait d'un album de Barnave ... L'original de cet écrit, tracé par Barnave en 1792, nous a été communiqué par MMmes ses sœurs.»
[12] ... M. Guettard.—Guettard (1715-1786), minéralogiste grenoblois, a laissé un ouvrage intitulé: Mémoires sur la minéralogie du Dauphiné (Paris, 1779, deux vol. in-4°).
[13] ... le sein ou saint ...—Le sing (de signum, signal) annonçait aux habitants de Grenoble la fermeture des portes de la ville; cette coutume fut conservée jusqu'en 1877, quoique depuis 1864 on ne fermât plus les portes de l'enceinte.
[14] Cette terrasse, formée par l'épaisseur d'un mur nommé Sarrasin ...—Ce mur, qui porte encore aujourd'hui le nom de mur sarrasin, est en réalité le mur de l'ancienne enceinte romaine de Grenoble. Il n'en reste plus qu'un vestige: la terrasse dont parle Stendhal, et qui se prolonge à travers toute la maison presque jusqu'à la Grande-rue. (Voir notre plan de l'appartement Gagnon.)
[15] ... sur le rocher de Voreppe ...—Stendhal a oublié un mot; nous le rétablissons d'après le sens du contexte.
[16] ... l'ancienne entrée de la ville avant qu'on eût coupé le rocher de la Porte-de-France.—La route qui passe au pied du rocher de Rabot date de la construction de la Porte-de-France par Lesdiguières en 1620. Avant cette date, on arrivait en effet à Grenoble par la tour de Rabot et la rue ou «montée» de Chalemont, et la «montée» du Rabot.
En face du fol. 234, Stendhal a figuré la terrasse, avec l'emplacement du «cabinet en losanges de châtaignier avec forme d'architecture de mauvais goût, à la Bernin». Y est également figuré le cabinet d'été de M. Gagnon; dans le cabinet voisin, «où s'établit Poncet», est indiqué le «banc de menuisier à côté duquel je passais ma vie». Dans le lointain est figurée la silhouette de la «montagne de Sassenage», avec la position du soleil à son coucher en juin et en décembre.
[17] ...(les Lerminier, les Salvandy, les ...—Le nom est en blanc dans le manuscrit.
[18] ... dans le genre de M. Letronne, qui vient de détrôner Memnon ...—Jean-Antoine Letronne, célèbre archéologue français (1787-1848), était en 1835 directeur de la Bibliothèque royale. Il avait publié en 1833 un mémoire sur la Statue vocale de Memnon.
[19] Pendant que mon grand-père lisait, assis dans un fauteuil en D ...—Plan du cabinet de M. Gagnon. Le fauteuil du grand-père de Beyle était placé devant la cheminée, où se trouvait le buste de Voltaire; derrière lui était la bibliothèque et dans un coin, en L, le tas des livres brochés laissés par Romain Gagnon.
[20] Ces livres de mon oncle portaient l'adresse de M. Falcon ...—Le libraire Falcon (1753-1830) prit une part très active au mouvement révolutionnaire. Il fut secrétaire, puis président (22 juillet-18 août 1794) de la Société populaire, qui se réunissait dans l'église Saint-André. La boutique de Falcon servait de lieu de réunion aux patriotes exaltés, si bien que le 24 thermidor an III (11 août 1795) le Conseil général de la commune de Grenoble prit une délibération pour interdire à «ceux qui ont participé aux horreurs commises sous la tyrannie de se rendre dans la boutique de Falcon et le café Dumas et dans tout autre lieu public, à peine de huit jours de détention et même de plus grande peine, s'il y échoit ...» Il était en outre enjoint à Falcon «de tenir sa boutique fermée à six heures du soir ..., sous les mêmes peines». (Archives municipales de Grenoble, LL 8, page 227.)
[21] ... une autre dame de la rue Neuve, chez laquelle ...—Ms.: «Lequel.»
[22] C'est le plus bel échantillon ...—Variante: «Exemple.»
[23] Falcon vint occuper la boutique A ...—Plan de la place Saint-André, avec la situation, en A, de la première boutique de Falcon, à l'angle du passage du Palais, B, «avec têtes en relief, comme à Florence» (ces têtes sont actuellement au Musée de Grenoble, mais des copies ornent encore, à leur ancienne place, l'entrée du Palais de Justice). En A', près de la «salle de spectacle», est l'emplacement de la seconde boutique de Falcon.
[24] ... la Vie et les aventures de Mme de*** ...—Voici le titre: Vie, faiblesses et repentir d'une femme. J'en ai un exemplaire, mis en très mauvais état par l'humidité. (Note au crayon de Romain Colomb.)
[25] Je la lus couché sur mon lit dans mon trapèze ...—Voir notre plan de l'appartement de Henri Gagnon.
[26] Sa conversion au jésuitisme ...—Ms.: «Tismejésui.»
[27] ... dans le temps que parut la Nouvelle Héloïse (n'est-ce pas 1770?) ...—La Nouvelle-Héloïse parut en 1761.
[28] —On lit sur l'avant-dernier feuillet du premier volume: «27 décembre 1835. Lacenaire aussi écrit ses Mémoires. On en dit brûlé un volume dans l'incendie de la rue du Pont-de-Fer.» Le dernier feuillet contient une table. Elle se termine ainsi: «Je laisse les chapitre XIII et XIV pour les augmentations à faire à ces premiers temps. J'ai 40 pages écrites à insérer. Le volume 2 commence par le chapitre XV.—Book commencé the twenty third of november 35, il y a 31 days.»
Séraphie avait fait son amie intime d'une certaine madame Vignon, la première boime de la ville[2]. (Boime, à Grenoble, veut dire hypocrite doucereuse, jésuite femelle.) Mme Vignon demeurait au troisième étage, place Saint-André, et était femme d'un procureur, je crois, mais respectée comme une mère de l'Eglise, plaçant les prêtres et en ayant toujours chez elle de passage. Ce qui me touchait, c'est qu'elle avait une fille de quinze ans qui ressemblait assez à un lapin blanc, dont elle avait les yeux gros et rouges. J'essayai, mais en vain, d'en devenir amoureux pendant un voyage d'une semaine ou deux que nous finies à Claix. Là, mon père ne se[p. 198] cachait nullement et a toujours habité sa maison, la plus belle du canton.
A ce voyage il y avait Séraphie, Mme et Mlle Vignon, ma sœur Pauline, moi, et peut-être un M. Blanc, de Seyssins, personnage ridicule qui admirait beaucoup les jambes nues de Séraphie. Elle sortait jambes nues, sans bas, le malin, dans le clos.
J'étais tellement emporté par le diable[3] que les jambes de ma plus cruelle ennemie me firent impression. Volontiers j'eusse été amoureux de Séraphie. Je me figurais un plaisir délicieux à serrer[4] dans mes bras cette ennemie acharnée.
Malgré sa qualité de demoiselle à marier, elle fit ouvrir une grande porte condamnée qui, de sa chambre, donnait sur l'escalier de la place Grenette, et à la suite d'une scène abominable, dans laquelle je vois encore sa figure, fit faire une clef. Apparemment, son père lui refusait celle de cette porte[5].
Elle introduisait ses amies par cette porte, en entre autres cette Mme Vignon, Tartufe femelle, qui avait des oraisons particulières pour les saints, et que mon bon grand-père eut eu en horreur si son caractère à la Fontenelle lui eût permis: 1° de sentir l'horreur;—2° de l'exprimer.
Mon grand-père employait son grand juron contre cette madame Vignon: Le Diable te crache au cul!
Mon père se cachait toujours à Grenoble, c'est-à-dire qu'il habitait [6] chez mon grand-père et ne sortait pas de jour. La passion politique ne dura que dix-huit mois. Je me vois allant de sa part chez Allier, libraire, place Saint-André, avec cinquante francs en assignats, pour acheter la Chimie de Fourcroy, qui le conduisit à la passion pour l'agriculture. Je conçois bien la naissance de ce goût: il ne pouvait promener qu'à Claix.
Mais tout cela ne fut-il pas causé par ses amours avec Séraphie, si amour y a? Je ne puis voir la physionomie des choses, je n'ai que ma mémoire d'enfant. Je vois des images, je me souviens des effets sur mon cœur, mais pour les causes et la physionomie, néant. C'est toujours comme les fresques du [Campo-Santo][7] de Pise, où l'on aperçoit fort bien un bras, et le morceau d'à côté, qui représentait la tête, est tombé. Je vois une suite d'images fort nettes, mais sans physionomie autre que celle qu'elles eurent à mon égard. Bien plus, je ne vois cette physionomie que par le souvenir de l'effet qu'elle produisit sur moi[8].
Mon père éprouva bientôt une sensation digne du cœur d'un tyran. J'avais une grive privée qui se tenait ordinairement sous les chaises de la salle-à-manger. Elle avait perdu un pied à la bataille et marchait en sautant. Elle se défendait contre les chats, chiens, et tout le monde la protégeait, ce qui[p. 200] était fort obligeant pour moi, car elle remplissait le plancher de taches blanches peu propres. Je nourrissais cette grive d'une façon peu propre, avec les chaplepans [9] noyés dans la benne de la cuisine (cafards noyés dans le seau de l'eau sale de la cuisine).
Sévèrement séparé de tout être de mon âge, ne vivant qu'avec des vieux, cet enfantillage avait du charme pour moi.
Tout-à-coup, la grive disparut, personne ne voulut me dire comment: quelqu'un, par inadvertance, l'avait écrasée en ouvrant une porte. Je crus que mon père l'avait tuée par méchanceté; il le sut, cette idée lui fit peine, un jour il m'en parla en termes fort indirects et fort délicats.
Je fus sublime, je rougis jusqu'au blanc des yeux, mais je n'ouvris pas la bouche. Il me pressa de répondre, même silence; mais les yeux, que j'avais fort expressifs à cet âge, devaient parler.
Me voilà vengé, tyran, de l'air doux et paternel avec lequel tu m'as forcé tant de fois d'aller à cette détestable promenade des Granges, au milieu des champs arrosés avec les voitures de minuit (poudrette de la ville).
Pendant plus d'un mois je fus fier de cette vengeance; j'aime cela dans un enfant[10].
La passion de mon père pour son domaine de Claix et pour l'agriculture devenait extrême. Il[p. 201] faisait faire de grandes réparations, amendements, par exemple miner le terrain, le défoncer à deux pieds et demi de profondeur et emporter dans un coin du champ toutes les pierres plus grosses qu'un œuf. Jean Vial, notre ancien jardinier, Charrière, Mayousse, le vieux ...[11], ancien soldat, exécutaient ces travaux par prix faits, par exemple vingt écus (soixante francs) pour miner une tière, espace de terre compris entre deux rangées de hautaies ou bien d'érables porteurs de vignes.
Mon père planta les grandes Barres, ensuite la Jomate, où il arracha la vigne basse. Il obtint par échange de l'hôpital (qui l'avait eue, ce me semble, par le testament d'un M. Gutin, marchand de draps) la vigne du Molard (entre le verger et notre Molard à nous), il l'arracha, la mina en enterrant le Murger (tas de pierres de sept à dix pieds de haut), et enfin la planta.
Il m'entretenait longuement de tous ces projets, il était devenu un vrai propriétaire du Midi.
C'est un genre de folie qui se rencontre souvent au midi de Lyon et de Tours; cette manie consiste à acheter des champs qui rendent un ou deux pour cent, à retirer, pour cela faire, de l'argent prêté au cinq ou six, et quelquefois à emprunter au cinq pour s'arrondir, c'est le mot, en achetant des champs qui rapportent le deux. Un ministre de l'Intérieur qui se douterait de son métier entreprendrait une mission contre cette manie qui détruit l'aisance et[p. 202] toute la partie du bonheur qui tient à l'argent, dans les vingt départements au midi de Tours et de Lyon.
Mon père fut un exemple mémorable de cette manie, qui a sa source à la fois dans l'avarice, l'orgueil et la manie nobiliaire[12].

DEUX CHAPITRES SUR LA MÊME PAGE-DÉBUT DES CHAP. XVIII ET XIX (Bibl. mun. de Grenoble: ms R 299. t. II, fol. 260bis)
[1] Le chapitre XVII est le chapitre XV de Stendhal (fol. 249 à 258).—Écrit à Rome, les 16, 17 et 25 décembre 1835.—Avec ce chapitre commence le second volume du manuscrit.
[2] ... la première boime de la ville.—On lit en tête du fol. 249 bis: «16 déc. 1835.—Envoyé la fin du chapitre XII.—Laisser le n° 249 à cette page et aller jusqu'à 1.000.—Faire suivre aussi les numéros des chapitres.»
[3] J'étais tellement emporté par le diable ...—Variante: «Par l'âge.»
[4] Je me figurais un plaisir délicieux à serrer ...—Variante: «Tenir.»
[5] ... son père lui refusait celle de cette porte.—En face, au verso du fol. 250, plan d'une partie de l'appartement Gagnon, avec la «chambre de Séraphie» et la porte sur l'escalier de la place Grenette. A côté, dans la «chambre de ma tante Elisabeth», «la famille au soleil». A l'angle de la Grande-rue et de la place Grenette, en «O, logement de mon oncle, au second étage, avant son mariage». Sur ce plan sont également indiquées les rues voisines: rue des Clercs, «ici logeaient Mably et Condillac»; rue du Département (aujourd'hui rue Diodore-Rahoult), au point «G', là je m'élevai à 7 avec Mr Galice»; place Saint-André, où sont indiquées les maisons de Mme Vignon et de Falcon. (Voir nos plans de l'appartement Gagnon et de Grenoble en 1793.)
[6] ... il habitait ...—Variante: «Logeait.»
[7] ... les fresques du Campo-Santo ...—Le nom a été laissé en blanc dans le manuscrit.
[8] ... l'effet quelle produisit sur moi.—On lit dans la marge: «Mettre un mot des promenades forcées aux Granges.»
[9] ... avec les chaplepans ...—Ce mot signifie, en patois du Dauphiné, gâcheur de pain (de chapla, briser en petits morceaux, et pan, pain).
[10] ... j'aime cela dans un enfant.—On lit au verso du fol. 254: «20 décembre 1835, faits à placer en leur temps, mis ici pour ne pas l'oublier: inspecteur du mobilier de la Couronne, comment, 1811.—Après l'objection de l'Empereur, je devins inspecteur du mobilier au moyen de mon acte de naissance, 2° du certificat Michaud, 3° de l'addition de nom. La faute est de ne pas avoir mis: Brulard de la Jomate (la Jomate étant à nous.) M. de Bor (Baure) était un magistrat parfaitement sage et poli de la fin du XVIIIe siècle; il aimait ce qui était honnête et droit, et n'aurait commis une mauvaise action qu'à la dernière nécessité et à son corps défendant. Du reste, de l'esprit, disert, bien disant, possédant une grande connaissance des auteurs, ami particulier de M. le colonel de Beaussac et de M. de Villaret, évêque (de l' (un mot illisible)), grand, maigre, digne, avec de petits yeux malins et un nez infini; il me fut un excellent et très digne archer. Il souffrait pour de l'argent ce que je n'aurais souffert pour rien, d'être vilipendé par M. le comte Daru, dont il était le secrétaire général. Ce fut lui qui, pour obliger M. Petit (car moi, avec mon étourderie et mes idées de haute et franche vertu, je devais le choquer vingt fois par jour), moyenne toute ma nomination après l'objection de l'Empereur. Mourut à Amsterdam le ... septembre ou novembre 1811.»
[11] ... Charrière, Mayousse, le vieux ...—Le nom est en blanc dans le manuscrit.
[12] ... cette manie, qui a sa source à la fois dans l'avarice, l'orgueil et la manie nobiliaire.—Variante: «Cette manie, qui tient à la fois à l'avarice, à l'argent et à la manie nobiliaire.»
Cette manie, qui a fini par ruiner radicalement mon père et par me réduire, pour tout potage, à mon tiers de la dot de ma mère, me procura beaucoup de bien-être vers 1794[2].
Mais avant d'aller plus loin, il faut dépêcher l'histoire de ma première communion antérieure, ce me semble, au 21 juillet 1794[3].
Ce fut un pr[être][4] infiniment moins coquin que l'abbé Raillane, il faut l'avouer, qui fut chargé de cette grande opération de ma première communion, à laquelle mon père, fort dévot dans ce temps-là, attachait la plus grande importance. Le jésuitisme de l'abbé Raillane faisait peur même à mon[p. 204] père; c'est ainsi que M. Coissi a fait peur, ici même, au jésuite[5].
Ce bon prêtre, si bonhomme en apparence, s'appelait Dumolard et était un paysan rempli de simplesse et né dans les environs de la Matheysine ou de La Mure, près le Bourg d'Oisans. Depuis, il est devenu un grand jésuite[6] et a obtenu la charmante cure de La Tronche, à dix minutes de Grenoble. (C'est comme la sous-préfecture de Sceaux pour un sous-préfet, âme damnée des ministres ou qui épouse une de leurs bâtardes.)
Dans ce temps-là, M. Dumolard était tellement bonhomme que je pus lui prêter une petite édition italienne de l'Arioste en quatre volumes in-18. Peut-être pourtant ne la lui ai-je prêtée qu'en 1803.
La figure de M. Dumolard n'était pas mal, à cela près d'un œil qui était toujours fermé; il était borgne, puisqu'il faut le dire, mais ses traits étaient bien et exprimaient non seulement la bonhomie, mais, ce qui est bien plus ridicule, une franchise gaie et parfaite. Réellement il n'était pas coquin en ce temps-là, et pour ainsi dire, en y réfléchissant, ma pénétration de douze ans, exercée par une solitude complète, fut complètement trompée, car depuis il a été un des plus profonds jésuites[7] de la ville, et d'ailleurs son excellentissime cure, à portée des dévotes de la ville, jure pour lui et contre ma niaiserie de douze ans.
M. le Premier Président de Barrai, l'homme le plus[p. 205] indulgent et le mieux élevé, me dit vers 1816, je crois, en me promenant dans son magnifique jardin de La Tronche, qui touchait la cure:
«Ce Dumolard est un des plus fieffés co[quins] de la troupe.
—Et M. Raillane? lui dis-je.
—Oh! le Raillane les passe tous. Comment M. votre père avait-il pu choisir un tel homme?
—Ma foi, je l'ignore, je fus victime et non pas complice.»
Depuis deux ou trois ans, M. Dumolard disait la messe souvent chez nous, dans le salon à l'italienne de mon grand-père. La Terreur, qui jamais ne fut Terreur en Dauphiné, ne s'aperçut jamais que quatre-vingts ou cent dévotes sortaient de chez mon grand-père tous les dimanches, à midi. J'ai oublié de dire que tout petit on me faisait servir ces messes[8], et je ne m'en acquittais que trop bien. J'avais un air très décent et très sérieux. Toute ma vie les cérémonies religieuses m'ont extrêmement ému. J'avais longtemps servi la messe de ce coquin d'abbé Raillane, qui allait la dire à la Propagation, au bout de la rue Saint-Jacques, à gauche; c'était un couvent et nous disions notre messe dans la tribune.
Nous étions tellement enfants, Reytiers et moi, qu'un grand événement, un jour, fut que Reytiers, apparemment par timidité, fit pipi pendant la messe, que je servais, sur un prie-Dieu de sapin. Le[p. 206] pauvre diable cherchait à absorber[9] l'humidité produite à sa grande honte en frottant son genou contre la planche horizontale du prie-Dieu. Ce fut une grande scène. Nous entrions souvent chez les nonnes; l'une d'elles, grande et bien faite, me plaisait beaucoup, on s'en aperçut sans doute, car en ce genre j'ai toujours été un grand maladroit, et je ne la vis plus. Une de mes remarques fut que madame l'abbesse avait une quantité de points noirs au bout du nez; je trouvais cela horrible.
Le Gouvernement était tombé dans l'abominable sottise de persécuter les prêtres. Le bon sens de Grenoble et sa méfiance de Paris nous sauvèrent de ce que cette sottise avait de trop âpre.
Les prêtres se disaient bien persécutés, mais soixante dévotes venaient, à onze heures du matin, entendre leur messe dans le salon de mon grand-père. La police ne pouvait même faire semblant de l'ignorer. La sortie de notre messe faisait foule dans la Grande-rue[10].
[1] Le chapitre XVIII est le chapitre XVI de Stendhal (fol. 260 à 266; le fol. 259 est blanc).—La leçon que je donne de ce chapitre ne suit pas d'une manière absolue l'ordre du manuscrit. Le premier alinéa est suivi de cette observation de Stendhal: «Ici, ma première communion.» Conformément à cette indication, j'ai inséré à cette place le récit de la première communion, lequel, dans le manuscrit, se trouve relié immédiatement avant, sans pagination. Le folio 260 bis a été écrit le 25 décembre 1835, alors que «la première communion» est du 10 décembre. Ce dernier texte commence ainsi: «Ce qui me console un peu de l'impertinence d'écrire tant de je et de moi, c'est que je suppose que beaucoup de gens fort ordinaires de ce XIXe siècle font comme moi. On sera donc inondé de Mémoires vers 1880 et avec mes je et mes moi, je ne serai que comme tout le monde. M. de Talleyrand, M. Molé, écrivent leurs Mémoires, M. Delécluze aussi.» J'ai cru devoir alléger le récit de cet alinéa.
En tête du récit de sa première communion, Stendhal avait écrit: «A placer après Amar et Merlinot. 10 décembre 1835, corrigé le 3 janvier 1836.» Je n'ai pas suivi cette indication, qui déjà n'a pu être respectée exactement dans l'édition Stryienski, et je me suis conformé à la note de Stendhal indiquée ci-dessus, opinion justifiée encore par ce fait que le fragment: «La première communion», est relié immédiatement avant le fol. 260, c'est-à-dire à peu près à sa place logique.
[2] ... me procura beaucoup de bien-être vers 1794.—Le fol. 260 bis est daté: «25 décembre 1835.» Il comprend le début du chapitre XVIII et celui du chapitre suivant, que Stendhal a marqué dans la marge par cette note: «Chapitre commençant à: «Mon père fut rayé.» Le lecteur pourra se rendre compte de la méthode que j'ai adoptée dans rétablissement du texte du commencement des chapitres XVIII et XIX, en se reportant à la planche reproduisant le fol. 260 bis.
[3] Mais avant d'aller plus loin ...—Ainsi que le lecteur peut s'en rendre compte sur l'illustration, cet alinéa ne fait pas immédiatement suite au précédent sur le manuscrit. Je l'ai cependant placé ici, à cause du contexte, et parce qu'il fait une transition voulue par Stendhal lui-même.
[4] Ce fut un prêtre ...—Le feuillet 261 et tous ceux qui constituent désormais notre chapitre XVIII n'ont pas été numérotés par Stendhal. Notre foliotation (261 à 266) est factice. Cette numérotation ne nuit pas à la foliotation indiquée par Stendhal lui-même, car l'auteur a laissé en blanc les feuillets compris entre les chiffres 261 et 273. C'est ainsi que nous verrons le chapitre XIX commencer au fol. 260 bis pour continuer au fol. 274.
[5] ... a fait peur, ici même, au jésuite.—Ms.: «Tejê.»
[6] ... devenu un grand jésuite ...—Ms.: «Tejê.»
[7] ... un des plus profonds jésuites ...—Ms.: «Tejê.»
[8] ... on me faisait servir ces messes ...—A cette époque, je servais une et quelquefois deux messes par jour, ce qui probablement m'a empêché de me rappeler que l'auteur faisait la même besogne. (Note au crayon de R. Colomb.)
[9] Le pauvre diable cherchait à absorber ...—Variantes: «Consommer, essuyer.»
[10] La sortie de notre messe faisait foule dans la Grande-rue.—Suit un plan du quartier où était située la maison Gagnon. On voit, sur la Grande-rue, en «A', porte par laquelle sortaient les soixante ou quatre-vingts dévotes, vers les onze heures et demie».
A la suite de ce chapitre est un fragment intitulé: «Encyclopédie du XIXe siècle.» Stendhal l'a accompagné de cette note: «A placer après ma first communion.» Ce fragment n'ayant rien de commun avec le récit, nous l'avons rejeté en annexe.
Mon père fut rayé de la liste des suspects (ce qui, pendant vingt-et-un mois, avait été l'objet unique de notre ambition) le 21 juillet 1794, à l'aide des beaux yeux de ma jolie cousine Joséphine Martin.
Il fit alors de longs séjours à Claix (c'est-à-dire à Furonières [2]). Mon indépendance prit naissance comme la liberté dans les villes d'Italie vers le VIIIe siècle[3], par la faiblesse de mes tyrans.
Pendant les absences de mon père, j'inventai d'aller travailler rue des Vieux-Jésuites dans le salon de notre appartement, où, depuis quatre ans, personne n'avait mis les pieds[4].
Cette idée, fille du besoin du moment, comme toutes les inventions de la mécanique, avait d'immenses avantages. D'abord, j'allais seul rue des Vieux-Jésuites, à deux cents pas de la maison Gagnon; secondo, j'y étais à l'abri des incursions de Séraphie qui, chez mon grand-père, venait, quand elle avait le diable au corps plus qu'à l'ordinaire, visiter mes livres et fourrager mes papiers.
Tranquille dans le salon silencieux où était le beau meuble brodé par ma pauvre mère, je commençai à travailler avec plaisir. J'écrivis ma comédie appelée, je crois, M. Piklar.
Pour écrire, j'attendais toujours le moment du génie.
Je n'ai été corrigé de cette manie que bien tard. Si je l'eusse chassée plus tôt, j'aurais fini ma comédie de Letellier et Saint-Bernard, que j'ai portée à Moscou et, qui plus est, rapportée (et qui est dans mes papiers, à Paris). Cette sottise a nui beaucoup à la quantité de mes travaux. Encore en 1806, j'attendais le moment du génie pour écrire. Pendant tout le cours de ma vie, je n'ai jamais parlé de la chose pour laquelle j'étais passionné, la moindre objection m'eût percé le cœur. Mais je n'ai jamais parlé littérature. Mon ami, alors intime, M. Adolphe de Mareste (né à Grenoble vers 1782), m'écrivit à Milan pour me donner son avis sur la Vie de Haydn, Mozart et Métastase. Il ne se doutait nullement que j'eu fusse the author.
Si j'eusse parlé, vers 1795, de mon projet d'écrire, quelque homme sensé m'eût dit: «Ecrivez tous les jours pendant deux heures, génie ou non.» Ce mot m'eût fait employer dix ans de ma vie dépensés niaisement à attendre le génie.
Mon imagination avait été employée à prévoir le mal que me faisaient mes tyrans et à les maudire; dès que je fus libre, en H[5], dans le salon de ma mère, j'eus le loisir d'avoir du goût pour quelque chose. Ma passion fut: les médailles moulées en plâtre sur des moules ou creux de soufre. J'avais eu auparavant une petite passion: l'amour des épinaux[6], bâtons noueux pris dans les haies d'aubépine, je crois; la chasse.
Mon père et Séraphie avaient comprimé les deux. Celle pour les épinaux disparut sous les plaisanteries de mon oncle; celle pour la chasse, appuyée sur les rêveries de volupté nourries par le paysage de M. Le Roy et sur les images vives que mon imagination avait fabriquées en lisant l'Arioste, devint une fureur, me fit adorer la Maison rustique, Buffon, me fit écrire sur les animaux, et enfin n'a péri que par la satiété. A Brunswick, en 1808, je fus un des chefs de chasses où l'on tuait cinquante ou soixante lièvres avec des battues faites par des paysans. J'eus horreur de tuer une biche, cette horreur a augmenté. Rien ne me semble plus plat aujourd'hui que de changer un oiseau charmant en quatre onces de chair morte.
Si mon père, par peur bourgeoise, m'eût permis d'aller à la chasse, j'eusse été plus leste, ce qui m'eût servi pour la guerre. Je n'y ai été leste qu'à force de force.
Je reparlerai de la chasse, revenons aux médailles[7].
[1] Le chapitre XIX est le chapitre XVI du manuscrit (fol. 260 bis et 274 à 279; les fol. 261 à 273 sont blancs).—Écrit à Rome, les 25 et 26 décembre 1835.—Au sujet de l'établissement du texte du début de ce chapitre, voir les notes du début du chapitre XVIII, et la reproduction du fol. 260 bis.
[2] ... Furonières ...—Hameau de la commune de Claix.
[3] ... les villes d'Italie vers le VIIIe siècle ...—A vérifier sur la dissertation 55 de Muratori, lue il y a quinze jours et déjà oubliée quant à la date. (Note de Stendhal.)
[4] ... où, depuis quatre ans, personne n'avait mis les pieds—En face, au verso du fol. 273, plan du quartier des maisons Gagnon et Beyle. On y voit, à l'angle de la Grande-rue et de la rue du Département, l'emplacement du «café tenu par M. Genou, père de M. de Genoude, de la Gazette de France». (Voir notre plan de Grenoble en 1793.) A ce sujet, on lit cette note au crayon de R. Colomb: «Le café Genou était sur la place Saint-André, dans la maison qu'habitait Mme Vignon, je crois; celui de la Grande-rue était tenu par Charréa.»
[5] ... dès que je fus libre, en H ...—En face, au verso du fol. 274, plan de l'appartement Beyle, rue des Vieux-Jésuites. On voit dans le salon, près de la fenêtre, en «H, table de travail» de Beyle.
[6] ... l'amour des épinaux ...—La lecture du dernier mot est incertaine.
[7] Je reparlerai de la chasse, revenons aux médailles.—On lit au verso du fol. 279, avec la date du 26 décembre: «A placer: «Caractère of my father Chérubin Beyle.—Il n'était point avare, mais bien passionné. Rien ne lui coûtait pour satisfaire la passion dominante: ainsi pour faire miner une tière, il ne m'envoyait pas à Paris les 150 francs par mois, sans lesquels je ne pouvais vivre.
Il eut la passion pour l'agriculture et pour Claix, puis un an ou deux de passion pour bâtir (la maison de la rue de Bonne, dont j'eus la sottise de faire le plan avec Mante). Il empruntait à huit ou dix pour cent à l'effet de terminer une maison qui un jour lui rendrait le six. Ennuyé de la maison, il se livra à la passion d'administrer pour les Bourbons, au point incroyable de passer dix-sept mois sans aller à Claix, à deux lieues de la ville. Il s'est ruiné de 1814 à 1819, je crois, époque de sa mort. Il aimait les femmes avec excès, mais timide comme un enfant de douze ans; Mme Abraham Mallein, née Pascal, se moquait ferme de lui à cet égard.»]
Après quatre ou cinq ans du plus profond et du plus plat malheur, je respirai seulement alors, quand je me vis seul et fermé à clef dans l'appartement de la rue des Vieux-Jésuites, jusque-là abhorré par moi. Pendant ces quatre ou cinq ans, mon cœur fut rempli du sentiment de la haine impuissante. Sans mon goût pour la volupté, je serais peut-être devenu, par une telle éducation, dont ceux qui la donnaient ne se doutaient pas, un scélérat noir ou un coquin gracieux et insinuant, un vrai jésuite[2], et je serais sans doute fort riche. La lecture de la Nouvelle-Héloïse et les scrupules de Saint-Preux me formèrent profondément honnête homme; je pouvais encore, après cette lecture faite avec larmes et[p. 212] dans des transports d'amour pour la vertu, faire des coquineries, mais je me serais senti coquin. Ainsi, c'est un livre lu en grande cachette et malgré mes parents qui m'a fait honnête homme.
L'histoire romaine du cotonneux Rollin, malgré ses plates réflexions, m'avait meublé la tête de faits d'une solide vertu (basée sur l'utilité et non sur le vaniteux honneur des monarchies; Saint-Simon est une belle pièce justificative pour la manière de Montesquieu, l'honneur bas des monarchies; il n'est pas mal d'avoir vu cela en 1734 dans l'état d'enfance où, à cette époque, était encore la raison des Français).
Avec les faits appris dans Rollin, confirmés, expliqués, illustrés par la conversation continue de mon excellent grand-père et les théories de Saint-Preux, rien n'était égal à la répugnance et au mépris profond que j'avais pour les...[3] expliqués par des prêtres que je voyais chaque jour s'affliger des victoires de la patrie et désirer que les troupes françaises fussent battues.
La conversation de mon excellent grand-père, auquel je dois tout, sa vénération pour les bienfaiteurs de l'humanité, si contraire aux idées du ch[ristian]isme, m'empêcha sans doute d'être pris comme une mouche dans les toiles d'araignée par mon respect pour les cérémonies. (Je vois aujourd'hui que c'était la première forme de mon amour[p. 213] pour la musique, 1, la peinture, 2, et l'art de Vigano, 3.) Je croirais volontiers que mon grand-père était un nouveau converti vers 1793. Peut-être s'était-il fait dévot[4] à la mort de ma mère (1790), peut-être la nécessité d'avoir l'appui du clergé dans son métier de médecin lui avait-elle imposé un léger vernis d'hypocrisie en même temps que la perruque à trois rangs de boucles. Je croirais plutôt ce dernier, car je le trouvai ami, et de longue date, de M. l'abbé Sadin, curé de Saint-Louis (sa paroisse), de M. le chanoine Rey et de Mlle Rey, sa sœur, chez lequel nous allions souvent (ma tante Elisabeth y faisait sa partie), petite rue derrière Saint-André, plus tard rue du Département[5], même l'aimable et trop aimable abbé Hélie, curé de Saint-Hugues, qui m'avait baptisé et me l'a rappelé depuis au café de la Régence, à Paris, où je déjeûnais vers 1803 pendant mon éducation véritable, rue d'Angiviller.
Il faut remarquer qu'en 1790 les prêtres ne prenaient pas les conséquences de la théorie et étaient bien loin d'être intolérants et absurdes[6] comme nous les voyons en 1835. On souffrait fort bien que mon grand-père travaillât en présence de[7] son petit buste de Voltaire et que sa conversation, excepté sur un seul sujet, fût ce qu'elle eût été dans le salon de Voltaire, et les trois jours qu'il avait passés dans ce salon étaient cités[8] par lui comme les plus beaux de sa vie, quand l'occasion s'en présentait.[p. 214] Il ne s'interdisait nullement l'anecdote critique ou scandaleuse sur les prêtres, et pendant sa longue carrière d'observations cet esprit sage et froid en avait recueilli des centaines. Jamais il n'exagérait, jamais il ne mentait, ce qui me permet, ce me semble, d'avancer aujourd'hui que quant à l'esprit ce n'était pas un bourgeois; mais il était apte[9] à concevoir des haines éternelles à l'occasion de torts très minimes [10], et je ne crois pas laver son âme du reproche de bourgeoisie.
Je retrouve le type bourgeois, même à Rome, chez M. ... et sa famille, ... M. Bois, le beau-frère, enrichi ...[11].
Mon grand-père avait une vénération et un amour pour les grands hommes qui choquèrent bien M. le curé actuel de Saint-Louis et M. le grand vicaire[12] actuel de l'évêque de Grenoble, lequel se fait un point d'honneur de ne pas rendre sa visite au préfet, en sa qualité de prince de Grenoble[13], je crois (raconté par M. Rubichon et avec approbation, Cività-Vecchia, juin 1835).
Le Père Ducros, ce cordelier que je suppose homme de génie, avait perdu sa santé en empaillant des oiseaux avec des poisons. Il souffrait beaucoup des entrailles et mon oncle m'apprit par ses plaisanteries qu'il avait un ...[14]. Je ne compris guère cette maladie, qui me semblait toute naturelle. Le Père Ducros aimait beaucoup mon grand-père, son médecin, et auquel il devait en partie sa[p. 215] place de bibliothécaire; mais il ne pouvait s'empêcher de méprisoter un peu la faiblesse de son caractère, il ne pouvait tolérer les incartades de Séraphie, qui allaient souvent jusqu'à interrompre la conversation, troubler la société, et forcer les amis à se retirer[15].
Les caractères à la Fontenelle sont fort sensibles à cette nuance de mépris non exprimé, mon grand-père combattait donc souvent mon enthousiasme pour le Père Ducros. Quelquefois, quand le Père Ducros arrivait à la maison avec quelque chose d'intéressant à dire, on m'envoyait à la cuisine; je n'étais nullement piqué, mais fâché de ne pas savoir la chose curieuse. Ce philosophe fut sensible à mes empressements et au goût vif que je montrais pour lui, et qui faisait que je ne quittais jamais la chambre quand il y était.
Il faisait cadeau à ses amis et amies de cadres dorés de deux pieds et demi sur trois, garnis d'une grande vitre, derrière laquelle il disposait six ou huit douzaines de médailles en plâtre de dix-huit lignes de diamètre. C'étaient tous les empereurs romains et les impératrices, un autre cadre présentait tous les grands hommes de France, de Clément Marot à Voltaire, Diderot et d'Alembert. Que dirait le M. Rey d'aujourd'hui à une telle vue?
Ces médailles étaient environnées, avec beaucoup de grâce, de petits cartons dorés sur tranche,[p. 216] et des volutes exécutées en même matière remplissaient les intervalles entre les médailles. Les ornements de ce genre étaient fort rares alors et je puis avouer que l'opposition de la couleur blanc mat des médailles et des ombres légères, fines, bien dessinées, qui marquaient les traits des personnages, avec la tranche dorée des cartons et leur couleur jaune d'or, faisaient un effet très élégant.
Les bourgeois de Vienne, Romans, La Tour du Pin, Voiron, etc., qui venaient dîner chez mon grand-père ne se lassaient pas d'admirer ces cadres. Moi, de mon côté, monté sur une chaise, je ne me lassais pas d'étudier les traits de ces hommes illustres dont j'aurais voulu imiter la vie et lire les œuvres.
Le Père Ducros écrivait dans le haut de la partie la plus élevée de ces cartons[16]:
HOMMES ILLUSTRES DE FRANCE
ou
EMPEREURS ET IMPÉRATRICES.
À Voiron, par exemple, chez mon cousin Allard du Plantier[17] (descendant de l'historien et antiquaire Allard), ces cadres étaient admirés comme des médailles antiques; je ne sais pas même si le cousin, qui n'était pas fort, ne les prenait pas pour des médailles antiques. (C'était un fils étiolé par un père homme d'esprit, comme Monseigneur par Louis XIV.)
Un jour, le Père Ducros me dit:
«Veux-tu que je t'apprenne à faire des médailles?»
Ce fut pour moi les cieux ouverts.
J'allai dans son appartement, vraiment délicieux pour un homme qui aime à penser, tel que je voudrais bien en avoir un pareil pour y finir mes jours.
Quatre petites chambres de dix pieds de haut, exposées au midi et au couchant, avec très jolie vue sur Saint-Joseph, les coteaux d'Eybens, le pont de Claix et les montagnes à l'infini vers Gap.
Ces chambres étaient remplies de bas-reliefs et de médailles moulées sur l'antique ou sur du moderne passable.
Les médailles étaient, la plupart, en soufre rouge (rougi par un mélange de cinabre), ce qui est beau et sérieux; enfin, il n'y avait pas un pied carré de la surface de cet appartement qui ne donnât une idée. Il y avait aussi des tableaux. «Mais je ne suis pas assez riche, disait le Père Ducros, pour acheter ceux qui me plairaient.» Le principal tableau représentait une neige, ce n'était pas absolument mal.
Mon grand-père m'avait mené plusieurs fois dans cet appartement charmant. Dès que j'étais seul avec mon grand-père, hors de la maison, loin de la portée de mon père et de Séraphie, j'étais d'une gaieté parfaite. Je marchais fort lentement, car mon bon grand-père avait des rhumatismes, que je suppose goutteux (car moi, son véritable petit-fils[p. 218] et qui ai le même corps, j'ai eu la goutte en mai 1835 à Cività-Vecchia).
Le Père Ducros, qui avait de l'aisance, car il a fait son héritier M. Navizet, de Saint-Laurent, ancien entrepreneur de chamoiserie, était fort bien servi par un grand et gros valet, bonhomme qui était garçon de bibliothèque, et une excellente servante. Je donnais l'étrenne à tout cela, par avis de ma tante Elisabeth.
J'étais neuf autant que possible par le miracle de cette abominable éducation solitaire et de toute une famille s'acharnant sur un pauvre enfant pour l'endoctriner, dont le système avait été fort bien suivi parce que la douleur de la famille mettait ce système dans ses goûts.
Cette inexpérience des choses les plus simples me fit faire bien des gaucheries chez M. Daru le père, de novembre 1799 à mai 1800.
Revenons aux médailles. Le Père Ducros s'était procuré, je ne sais comment, une quantité de médailles en plâtre. Il les imbibait d'huile et sur cette huile coulait du soufre mêlé avec de l'ardoise bien sèche et pulvérisée.
Quand ce moule ôtait bien froid[18], il y mettait un peu d'huile, l'entourait d'un papier huilé, haut, de A en B, de trois lignes, le moule au fond.
Sur le moule il versait du plâtre liquide fait à l'instant, et sur-le-champ du plâtre moins fin et plus fort, de façon à donner quatre lignes d'épaisseur[p. 219] à la médaille en plâtre. Voilà ce que je ne parvins jamais à bien faire. Je ne gâchais pas mon plâtre assez vite, ou plutôt je le laissais s'éventer. C'est en vain que Saint-...[19], le vieux domestique, m'apportait du plâtre en poudre. Je retrouvais mon plâtre en gelée, cinq ou six heures après l'avoir placé sur le moule en soufre.
Mais ces moules-là étant les plus difficiles, je les fis sur-le-champ, et fort bien, seulement trop épais. Je n'épargnais pas la matière.
J'établis mon atelier de plâtrerie dans le cabinet de toilette de ma pauvre mère, pénétrais dans cette chambre où personne n'entrait depuis cinq ans qu'avec un sentiment religieux; j'évitais de regarder vers le lit. Je n'aurais jamais ri dans cette chambre, tapissée de papier de Lyon imitant bien le damas rouge.
Quoique je ne parvinsse jamais à faire un cadre de médailler comme le Père Ducros, je me préparais éternellement à ce grand renom en faisant une quantité de moules en soufre (en B, dans la cuisine)[20].
J'achetai une grande armoire renfermant douze ou quinze tiroirs de trois pouces de haut, où j'emmagasinais mes richesses.
Je laissai tout cela à Grenoble en 1799. Dès 1796 je n'en faisais plus de cas; on aura fait des allumettes de ces précieux moules (ou creux) en soufre de couleur d'ardoise.
Je lus le dictionnaire des médailles de l'Encyclopédie méthodique [21].
Un maître adroit qui eût su profiter de ce goût m'eût fait étudier avec passion toute l'histoire ancienne; il fallait me faire lire Suétone, puis Denis d'Halicarnasse, à mesure que ma jeune tête eût pu recevoir les idées sérieuses.
Mais le goût régnant alors à Grenoble portait à lire et à citer les épîtres d'un M. de Bonnard, c'est, je pense, du petit Dorât (comme on dit: du petit Mâcon). Mon grand-père nommait avec respect la Grandeur des Romains de Montesquieu, mais je n'y comprenais rien; chose peu difficile à croire, j'ignorais les événements sur lesquels Montesquieu a dressé ses magnifiques considérations.
Il fallait au moins me faire lire Tite-Live. Au lieu de cela, on me faisait lire et admirer les hymnes de Santeuil: «Ecce sede louantes... » On peut se figurer la façon dont j'accueillais cette religion[22] de mes tyrans.
Les prêtres qui dînaient à la maison cherchaient à reconnaître l'hospitalité de mes parents en me faisant du pathos sur la Bible de Royaumont, dont le ton patelin et mielleux m'inspirait le plus profond dégoût. J'aimais cent fois mieux le Nouveau Testament eu latin, que j'avais appris par cœur tout entier dans un exemplaire in-18. Mes parents, comme les rois d'aujourd'hui, voulaient que la religion me maintint en soumission[23], et moi je ne respirais que révolte.
Je voyais défiler la légion Allobroge (celle, je crois, qui fut commandée par M. Caffe, mort aux Invalides, à 85 ans, en novembre ou décembre 1835), ma grande pensée était à l'armée. Ne ferais-je pas bien de m'engager?
Je sortais souvent seul, j'allais au Jardin[24], mais je trouvais les autres enfants trop familiers, de loin je brûlais de jouer avec eux, de près je les trouvais grossiers.
Je commençais même, je crois, à aller au spectacle, que je quittais [25] au moment le plus intéressant, à neuf heures en été, quand j'entendais sonner le sing (ou saint)[26].
Tout ce qui était tyrannie me révoltait, et je n'aimais pas le pouvoir. Je faisais mes devoirs (thèmes, traductions, vers sur la mouche noyée dans une jatte de lait[27]) sur une jolie petite table de noyer, dans l'antichambre du grand salon à l'italienne, excepté le dimanche pour notre messe; la porte sur le grand escalier était toujours fermée. Je m'avisai d écrire sur le bois de cette table les noms de tous les assassins de princes, par exemple: Poltrot, duc de Guise, en 1562. Mon grand-père, en m'aidant à faire mes vers, ou plutôt en les faisant lui-même, vit cette liste; son âme assez tranquille, ennemie de toute violence, en fut navrée, d en conclut presque que Séraphie avait raison quand elle me représentait comme pourvu d'une âme atroce. Peut-être avais-je été conduit à faire ma[p. 222] liste d'assassins par l'action de Charlotte Corday—11 ou 12 juillet 1793—dont j'étais fou. J'étais dans ce temps-là grand enthousiaste de Caton d'Utique, les réflexions doucereuses et chrétiennes du bon Rollin, comme l'appelait mon grand-père, me semblaient le comble de la niaiserie.
Et en même temps j'étais si enfant qu'ayant trouvé dans l'Histoire ancienne de Rollin, je crois, un personnage qui s'appelait Aristocrate, je fus émerveillé de cette circonstance et fis partager mon enthousiasme à ma sœur Pauline, qui était libérale et de mon parti contre Zénaïde-Caroline, attachée au parti de Séraphie et appelée espionne par nous.
Avant ou après, j'avais eu un goût violent pour l'optique, qui me porta à lire l'Optique de Smith à la bibliothèque publique. Je faisais des lunettes pour voir le voisin en ayant l'air de regarder devant moi[28]. On pouvait encore, avec un peu d'adresse, par ce moyen-là, facilement me lancer dans la science de l'optique et me faire emporter un bon morceau de mathématiques. De là à l'astronomie, il n y avait qu'un pas.
[1] Le chapitre XX est le chapitre XVII du manuscrit (fol. 280 à 298).—Écrit à Rome, les 26, 27 et 29 décembre 1835.
[2] ... un vrai jésuite ...—Ms.: «Tejê.»
[3] ... j'avaie pour les ...—Suivent quelques mots anglais illisibles.
[4] Peut-être s'était-il fait dévot ...—Ms.: «Votdé.»
[5] ... plue tard rue du Département ...—Plus tard encore, rue Saint-André, aujourd'hui rue Diodore-Rahoult.
[6] ... intolérants et absurdes ...—Ms.: «Surdesab.»
[7] ... que mon grand-père travaillât en présence de ...—Variante: «Devant.»
[8] ... dans ce salon étaient cités par lui ...—Variante: «Rappelés.»
[9] ... mais il était apte ...—Variante: «Facile.»
[10] ... à l'occasion de torts très minimes ...—Variante: «Pour des torts très petits.»
[11] ... chez M ... et sa famille, ... M. Bois, le beau-frère, enrichi ...—Trois mots illisibles.
[12] ... M. le grand vicaire ...—Ms.: «Cairevi.»
[13] ... en sa qualité de prince de Grenoble ...—L'évêque de Grenoble avait le titre d'évêque-prince.
[14] ... mon oncle m'apprit par ses plaisanteries qu'il avait un ...—Un mot illisible.
[15] ... forcer les amis à se retirer.—En face, au verso du fol. 285, on lit: «Réponse à un reproche: comment veut-on que j'écrive bien, forcé d'écrire aussi vite pour ne pas perdre mes idées? 27 décembre 1835. Réponse à MM. Colomb, etc.»
[16] Le Père Ducros écrivait dans le haut de la partie la plue élevée de ces cartons.—Au verso du fol. 287, Stendhal a dessiné le modèle de l'un de ces cadres, avec la légende suivante: «Cadre de médailles en plâtre blanc par le Père Ducros, bibliothécaire de la Ville de Grenoble (vers 1790), mort vers 1806 ou 1818.»
[17] ... mon cousin Allard du Plantier ...—Allard du Plantier (1721-1801), avocat au Parlement de Grenoble, fut élu en 1788 député du Tiers-Etat du Dauphiné aux États-Généraux. Il se retira à Voiron en 1790.
[18] Quand ce moule était bien froid ...—Dessin du moule. Le papier huilé est plus haut (de A en B) que l'épaisseur du moule, de manière à pouvoir recevoir le plâtre coulé.
[19] C'est en vain que Saint-...—Le reste du nom est en blanc.
[20] ( ...en B, dans la cuisine).—Au verso du fol. 291 est un plan d'une partie de l'appartement Beyle. Dans la «chambre de ma mère», en «A, atelier de mon plâtre»; dans la cuisine, en «B, fourneau où je faisais mes soufres». On lit au-dessous: «Maison paternelle, vendue en 1804. En 1816, nous logions au coin de la rue de Bonne et de la place Grenette, où je fis l'amour à Sophie Vernier et à Mlle Elise, en 1814 et 1816, mais pas assez, je me serais moins ennuyé. De là j'entendis guillotiner David, qui fait la gloire de M. le duc Decazes.»
[21] ...l'Encyclopédie méthodique.—On lit au verso du fol. 293: «27 décembre 1835. Fatigué après 13 pages. Froid aux jambes, surtout au mollet; un peu de colique; envie de dormir. Le froid et le café du 24 décembre m'ont donné sur les nerfs. Il faudrait un bain, mais comment, avec ce froid? Comment supporterai-je le froid de Paris?»
[22] ... j'accueillais cette religion ...—Ms.: «Gionreli.»
[23] ... me maintînt en soumission ...—Variante: «Abjection.»
[24] ... j'allais au Jardin ...—Il s'agit du Jardin-de-Ville.
[25] ... à aller au spectacle que je quittais ...—Variante: «Dont je sortais.»
[26] ... quand j'entendais sonner le sing (ou saint).—Sur le sing. voyez plus haut, notes du chapitre XVI, p. 244.
[27] ... vers sur la mouche noyée dans une jatte de lait ...—Allusion à la pièce de vers latin déjà citée plus haut, chapitre XII.
[28] Je faisais des lunettes pour voir le voisin en ayant l'air de regarder devant moi.—Suit un grossier croquis représentant une lunette munie d'un miroir incliné.
Quand je demandais de l'argent à mon père par justice, par exemple parce qu'il me l'avait promis, il murmurait, se fâchait, et au lieu de six francs promis m'en donnait trois. Cela m'outrait; comment? n'être pas fidèle à sa promesse?
Les sentiments espagnols communiqués par ma tante Elisabeth me mettaient dans les nues, je ne songeais qu'à l'honneur, qu'à l'héroïsme. Je n'avais pas la moindre adresse, pas le plus petit art de me retourner, pas la moindre hypocrisie doucereuse (ou jésuite[2]).
Ce défaut a résisté à l'expérience, au raisonnement, au remords d'une infinité de duperies où, par espagnolisme, j'étais tombé.
J'ai encore ce manque d'adresse: tous les jours, par espagnolisme, je suis trompé d'un paul ou deux en achetant la moindre chose. Le remords que j'en ai, une heure après, a fini par me donner l'habitude de peu acheter. Je me laisse manquer une année de suite d'un petit meuble qui me coûtera douze francs par la certitude d'être trompé, ce qui me donnera de l'humeur, et cette humeur est supérieure au plaisir d'avoir le petit meuble.
J'écris ceci debout, sur un bureau à la Tronchin fait par un menuisier qui n'avait jamais vu telle chose, il y a un an que je m'en prive par l'ennui d'être trompé. Enfin, j'ai pris la précaution de n'aller pas parler au menuisier en revenant du café, à onze heures du matin, alors mon caractère est dans sa fougue (exactement comme en 1803 quand je prenais du café enflammé rue Saint-Honoré, au coin de la rue de Grenelle ou d'Orléans), mais dans les moments de fatigue, et mon bureau à la Tronchin ne m'a coûté que quatre écus et demi (ou 4 X 5,45 = 24 fr. 52[3]).
Ce caractère faisait que mes conférences d'argent, chose si épineuse entre un père de cinquante-et-un[4] ans et un fils de quinze, finissaient ordinairement de ma part par un accès de mépris profond et d'indignation concentrée.
Quelquefois, non par adresse mais par pur hasard, je parlais avec éloquence à mon père de la chose que je voulais acheter, sans m'en douter je l'enfiévrais[p. 225] (je lui donnais un peu de ma passion), et alors sans difficulté, même avec plaisir, il me donnait tout ce qu'il me fallait. Un jour de foire place Grenette, pendant qu'il se cachait, je lui parlai de mon désir d'avoir de ces caractères mobiles percés dans une feuille de laiton grande comme une carte à jouer[5]; il me donna six ou sept assignats de quinze sous, au retour j'avais tout dépensé.
«Tu dépenses toujours tout l'argent que je te donne.»
Comme il avait mis à me donner ces assignats de quinze sous ce que dans un caractère aussi disgracieux on pouvait appeler de la grâce, je trouvai son reproche fort juste. Si mes parents avaient su me mener, ils auraient fait de moi un niais comme j'en vois tant en province. L'indignation que j'ai ressentie dès mon enfance et au plus haut point, à cause de mes sentiments espagnols, m'a créé, en dépit d'eux, le caractère que j'ai. Mais quel est ce caractère? Je serais bien en peine de le dire. Peut-être verrai-je la vérité à soixante-cinq ans, si j'y arrive[6].
Un pauvre qui m'adresse la parole en style tragique, comme à Rome, ou en style de comédie, comme en France, m'indigne: 1° je déteste être troublé dans ma rêverie;—2° je ne crois pas un mot de ce qu'il me dit.
Hier, en passant dans la rue, une femme du peuple de quarante ans, mais assez bien, disait à un homme[p. 226] qui marchait avec elle: Bisogna camprar (il faut vivre toutefois). Ce mot, exempt de comédie, m'a touché jusqu'aux larmes. Je ne donne jamais aux pauvres qui me demandent, je pense que ce n'est pas par avarice. Le gros garde de santé (le 11 décembre) à Cività-Vecchia, me parlant d'un pauvre Portugais au lazaret qui ne demande que six ...[7] par jour, sur-le-champ je lui ai donné six ou huit pauls en monnaie. Comme il les refusait, de peur de se compromettre avec son chef (un paysan grossier, venant de Finevista, nommé Manelli), j'ai pensé qu'il serait plus digne d'un consul de donner un écu, ce que j'ai fait; ainsi, six pauls par véritable humanité, et quatre à cause de la broderie de l'habit.
A propos de colloque financier d'un père avec son fils: le marquis Torrigiani, de Florence (gros joueur dans sa jeunesse et fort accusé de gagner comme il ne faut pas), voyant que ses trois fils perdaient quelquefois dix ou quinze louis au jeu, pour leur éviter l'ennui de lui en demander, a remis trois mille francs à un vieux portier fidèle, avec, ordre de remettre cet argent à ses fils quand ils auraient perdu, et de lui en demander d'autre quand les trois mille francs seraient dépensés.
Cela est fort bien en soi, et d'ailleurs le procédé a touché les fils, qui se sont modérés. Ce marquis, officier de la Légion d'honneur, est père de madame Pozzi, dont les beaux yeux m'avaient inspiré une si vive admiration en 1817. L'anecdote sur le jeu[p. 227] de son père m'aurait fait une peine horrible en 1817 à cause de ce maudit espagnolisme de mon caractère, dont je me plaignais naguère. Cet espagnolisme m'empêche d'avoir le génie comique:
1° je détourne mes regards et ma mémoire de tout ce qui est bas;
2° je sympathise, comme à dix ans lorsque je lisais l'Arioste, avec tout ce qui est contes d'amour, de forêts (les bois et leur vaste silence), de générosité.
Le conte espagnol le plus commun, s'il y a de la générosité, me fait venir les larmes aux yeux, tandis que je détourne les yeux du caractère de Chrysale de Molière, et encore plus du fond méchant de Zadig, Candide, le pauvre Diable et autres ouvrages de Voltaire, dont je n'adore vraiment que:
Vous êtes, lui dit-il, l'existence et l'essence,
Simple avec attribut et de pure substance.
Barral (le comte Paul de Barral, né à Grenoble vers 1785) m'a communiqué bien jeune son goût pour ces vers, que son père, le Premier Président, lui avait appris.
Cet espagnolisme, communiqué par ma tante Elisabeth, me fait passer, même à mon âge, pour un enfant privé d'expérience, pour un fou de plus en plus incapable d'aucune affaire sérieuse, ainsi que dit mon cousin Colomb (dont ce sont les propres termes), vrai bourgeois.
La conversation du vrai bourgeois sur les hommes et la vie, qui n'est qu'une collection de ces détails laids, me jette dans un spleen profond quand je suis forcé par quelque convenance de l'entendre un peu longtemps.
Voilà le secret de mon horreur pour Grenoble vers 1816, qu'alors je ne pouvais m'expliquer.
Je ne puis pas encore m'expliquer aujourd'hui, à cinquante-deux[8] ans, la disposition au malheur que me donne le dimanche. Cela est au point que je suis gai et content—au bout de deux cents pas dans la rue, je m'aperçois que les boutiques sont fermées: Ah! c'est dimanche, me dis-je.
A l'instant, toute disposition intérieure au bonheur s'envole.
Est-ce envie pour l'air content des ouvriers et bourgeois endimanchés?
J'ai beau me dire: Mais je perds ainsi cinquante-deux dimanches par an et peut-être dix fêtes; la chose est plus forte que moi, je n'ai de ressource qu'un travail obstiné.
Ce défaut—mon horreur pour Chrysale—m'a peut-être maintenu jeune. Ce serait donc un heureux malheur, comme celui d'avoir eu peu de femmes (des femmes comme Bianca Milai, que je manquai à Paris, un malin, vers 1829, uniquement, pour ne m'être aperçu de l'heure du berger—elle avait une robe de velours noir ce jour-là, vers la rue du Helder ou du Mont-Blanc).
Comme je n'ai presque pas eu de ces femmes-là (vraies bourgeoises), je ne suis pas blasé le moins du monde à cinquante ans[9]. Je veux dire blasé au moral, car le physique, comme de raison, est émoussé considérablement, au point de passer très bien quinze jours ou trois semaines sans femme; ce carême-là ne me gêne que la première semaine.
La plupart de mes folies apparentes, surtout la bêtise de ne pas avoir saisi au passage l'occasion. qui est chauve, comme dit Don Japhet d'Arménie, toutes mes duperies en achetant, etc., etc., viennent de l'espagnolisme communiqué par ma tante Elisabeth, pour laquelle j'eus toujours le plus profond respect, un respect si profond qu'il empêchait mon amitié d'être tendre, et, ce me semble, de la lecture de l'Arioste faite si jeune et avec tant de plaisir. (Aujourd'hui, les héros de l'Arioste me semblent des palefreniers dont la force fait l'unique mérite, ce qui me met en dispute avec les gens d'esprit qui préfèrent hautement l'Arioste au Tasse, tandis qu'à mes yeux, quand par bonheur le Tasse oublie d'imiter Virgile ou Homère, il est le plus touchant des poètes.)
En moins d'une heure, je viens d'écrire ces douze pages, et en m'arrêtant de temps en temps pour tâcher de ne pas écrire des choses peu nettes, que je serais obligé d'effacer.
Comment aurais-je pu écrire bien physiquement,[p. 230] M. Colomb?—Mon ami Colomb, qui m'accable de ce reproche dans sa lettre d'hier et dans les précédentes, braverait les supplices pour sa parole, et pour moi. (Il est né à Lyon vers 1785, son père, ancien négociant fort loyal, se retira à Grenoble vers 1788. M. Romain Colomb a 20 ou 25.000 francs de revenu et trois filles, rue Godot-de-Mauroy, Paris[10].)
[1] Le chapitre XXI est le chapitre XVIII du manuscrit (fol. 299 à 311).—Écrit à Rome, le 30 décembre 1835.
[2] ... hypocrisie doucereuse (ou jésuite).—Ms.: «Tejé.»
[3] ... mon bureau à la Tronchin ne m'a coûté que quatre écus et demi (ou 4 X 5.45 = 24 fr. 52).—Nous reproduisons sans le modifier, le calcul de Stendhal.
[4] ... un père de cinquante-et-un ans ...—Cinquante-et-un est en blanc dans le manuscrit.
[5] ... ces caractères mobiles percés dans une feuille de laiton grande comme une carte à jouer ...—Suit une figure représentant un B en laiton.
[6] ... verrai-je la vérité à soixante-cinq ans, si j'y arrive.—On lit en face, au verso du fol. 302: «A placer. Touchant mon caractère. On me dira: Mais êtes-vous un prince ou un Émile pour que quelque Jean-Jacques Rousseau se donne la peine d'étudier et de guider votre caractère? Je répondrai: Toute ma famille se mêlait de mon éducation. Après la haute imprudence d'avoir tout quitté à la mort de ma mère, j'étais pour eux le seul remède à l'ennui, et ils me donnaient tout l'ennui que je leur ôtais. Ne jamais parler à aucun autre enfant de mon âge!
—Écriture: les idées me galopent, si je ne les note pas vite, je les perds. Comment écrirais-je vite (sic)? Voila, M. Colomb, comment je prends l'habitude de mal écrire. Omar, thirthent december 1835, revenant de San Gregorio et du Foro boario.»]
[7] ... qui ne demande que six ...—Un mot illisible.
[8] ... à cinquante-deux ans ...—Ms.: «26 X 2.»
[9] ... à cinquante ans.—Ms.: «25 X 2.»
[10] ... rue Godot-de-Mauroy, Paris.—Justification de ma mauvaise écriture: les idées me galopent et s'en vont si je ne les saisis pas. Souvent, mouvement nerveux de la main. (Note de Stendhal.)
Au verso du fol. 311 est ce testament de Stendhal: «J'exige (sine qua non conditio) que tous les noms de femme soient changés avant l'impression. Je compte que cette précaution et la distance des temps empêcheront tout scandale. Cività-Vecchia, le 31 décembre 1835. H. BEYLE.»
Le siège de Lyon agitait[2] tout le Midi: j'étais pour Kellermann et les républicains, mes parents pour les émigrés et Précy (sans Monsieur, comme ils disaient).
Le cousin Senterre, de la poste, dont le cousin ou neveu[3] se battait dans Lyon[4], venait à la maison deux fois par jour; comme c'était l'été, nous prenions le café au lait du matin dans le cabinet d'histoire naturelle sur la terrasse.
C'est au point H[5] que j'ai peut-être éprouvé les plus vifs transports d'amour de la patrie et de haine pour les aristocrates (légitimistes de 1835) et les prêtres[6], ses ennemis.
M. Senterre, employé à la poste aux lettres[7], nous[p. 232] apportait constamment six ou sept journaux dérobés aux abonnés, qui ne les recevaient que deux heures plus tard à cause de notre curiosité. Il avait son doigt de vin et son pain et écoutait les journaux. Souvent, il avait des nouvelles de Lyon.
Je venais le soir, seul, sur la terrasse, pour tâcher d'entendre le canon de Lyon. Je vois dans la Table chronologique, le seul livre que j'aie à Rome[8], que Lyon fut pris le 9 octobre 1793. Ce fut donc pendant l'été de 1793, à dix[9] ans, que je venais écouter le canon de Lyon; je ne l'entendis jamais. Je regardais avec envie la montagne de Méaudre (prononcez Mioudre)[10], de laquelle on l'entendait. Notre brave cousin Romagnier (cousin pour avoir épousé une demoiselle Blanchet, parente de la femme de mon grand-père), je crois, était de Méaudre[11], où il allait tous les deux mois voir son père. Au retour, il faisait palpiter mon cœur en me disant: «Nous entendons fort bien le canon de Lyon, surtout le soir, au coucher du soleil, et quand le vent est au nord-ouest (nordoua).»
Je contemplais avec le plus vif désir d'y aller le point B, mais c'était un désir qu'il fallait bien se garder d'énoncer.
J'aurais peut-être dû placer ce détail bien plus haut, mais je répète que pour mon enfance je n'ai que des images fort nettes, sans date comme sans physionomie.
Je les écris un peu comme cela me vient.
Je n'ai aucun livre et je ne veux lire aucun livre, je m'aide à peine de la stupide Chronologie qui porte le nom de cet homme fin et sec, M. Loïs Weymar. Je ferai de même pour la campagne de Marengo (1800), pour celle de 1809, pour la campagne de Moscou, pour celle de 1813, où je fus intendant à Sagan (Silésie, sur la Bober); je ne prétends nullement écrire une histoire, mais tout simplement noter mes souvenirs afin de deviner quel homme j'ai été: bête ou spirituel, peureux ou courageux, etc., etc. C'est la réponse au grand mot:
Γνωτι σεαυτον
Durant cet été de 1793, le siège de Toulon m'agitait beaucoup; il va sans dire que mes parents approuvaient les traîtres qui le rendirent, cependant ma tante Elisabeth, avec sa fierté castillane, me dit ... [12].
Je vis partir le général Carteau ou Cartaud, qui parada sur la place Grenette. Je vois encore son nom sur les fourgons[13] défilant lentement et à grand bruit par la rue Montorge pour aller à Toulon.
Un grand événement se préparait pour moi, j'y fus fort sensible dans le moment, mais il était trop tard, tout lien d'amitié était à jamais rompu entre mon père et moi, et mon horreur pour les détails[p. 234] bourgeois et pour Grenoble était désormais invincible.
Ma tante Séraphie était malade depuis longtemps. Enfin, on parla de danger; ce fut la bonne Marion (Marie Thomasset), mon amie, qui prononça ce grand mot. Le danger devint pressant, les prêtres affluèrent.
Un soir d'hiver, ce me semble, j'étais dans la cuisine, vers les sept heures du soir[14], au point H, vis-à-vis l'armoire de Marion. Quelqu'un vint dire: «Elle est passée.» Je me jetai à genoux au point H pour remercier Dieu de cette grande délivrance.
Si les Parisiens sont aussi niais en 1880 qu'en 1835, cette façon de prendre la mort de la sœur de ma mère me fera passer pour barbare, cruel, atroce.
Quoi qu'il en soit, telle est la vérité. Après la première semaine de messes des morts et de prières, tout le monde se trouva grandement soulagé[15] dans la maison. Je crois que mon père même fut bien aise d'être délivré de cette maîtresse diabolique, si toutefois elle a été sa maîtresse, ou de cette amie intime diabolique.
Une de ses dernières actions avait été, un soir que je lisais sur la commode de ma tante Elisabeth[16], au point H, la Henriade ou Bélisaire, que mon grand-père venait de me prêter, de s'écrier: « Comment peut-on donner de tels livres à cet enfant! Qui lui a donné ce livre?»
Mon excellent grand-père, sur ma demande[p. 235] importune, venait d'avoir la complaisance, malgré le froid, d'aller avec moi jusque dans son cabinet de travail, touchant la terrasse, à l'autre bout de la maison, pour me donner ce livre dont j'avais soif ce soir-là.
Toute la famille était en rang d'oignons devant le feu, au point D [17]. On répétait souvent, à Grenoble, ce mot: rang d'oignons[18]. Mon grand-père, au reproche insolent de sa fille, ne répondit, en haussant les épaules, que: «Elle est malade.»
J'ignore absolument la date de cette mort; je pourrai la faire prendre sur les registres de l'état-civil à Grenoble[19].
Il me semble que bientôt après j'allai à l'École centrale, chose que Séraphie n'eût jamais souffert. Je crois que ce fut vers 1797 et que je ne fus que trois ans à l'École centrale.
[1] Chapitre XXII.—Ce chapitre, non numéroté par Stendhal, va du fol. 311 ter au fol. 315 bis.—Le chapitre commence ainsi: «Le fameux siège de Lyon (dont plus tard j'ai tant connu le chef, M. de Précy, à Brunswick, 1806-1809, mon premier modèle d'homme de bonne compagnie, après M. de Tressan, dans ma première enfance).»
—Le fol. 311 bis porte simplement ces deux mentions: «Tome second», et: «Siège de Lyon, été de 1793.»
[2] Le siège de Lyon agitait ...—Variante: «Agita.»
[3] ... dont le cousin ou neveu ...—Les deux mots: cousin ou, ont été rayés au crayon par R. Colomb.
[4] ... se battait dans Lyon ...—Il ne se battait pas; sa condamnation à mort fut motivée sur une lettre écrite à une dame de ses amies et interceptée par Dubois de Crancé. (Note au crayon de R. Colomb.)
[5] C'est au point H que j'ai peut-être éprouvé ...—En face, au verso du fol. 311 ter, se trouve un plan de la scène: dans le «cabinet d'histoire naturelle», garni sur ses deux plus grands murs d' «armoires fermées contenant minéraux, coquillages», est la «table de déjeuner avec café au lait excellent et fort bons petits pains très cuits, griches perfectionnées»; autour de la table, en «S, M. Senterre avec son chapeau à larges bords, à cause de ses yeux faibles et bordés de rouge»; en «H, moi, dévorant ses nouvelles». La terrasse est voisine; au bout se trouve en «J, mon jardin particulier, à côté de la pierre à eau».
[6] ... et les prêtres ...—Ms.: «Tresp.»
[7] M. Senterre, employé à la poste aux lettres ...—Stendhal a déjà parlé de son cousin Senterre et de la scène des journaux. Voir plus haut, chapitre XII.
[8] ... le seul livre que j'ai à Rome ...—Ms.: «Mero.»
[9] ... à dix ans ...—Ms.: «Ten.»
[10] ... la montagne de Méandre (prononcez Mioudre)...—En face, au verso du fol 312, est un dessin représentant la silhouette des plateaux de Saint-Nizier (A) et de Sornin (B) jusqu'à la vallée de l'Isère (V). «Méaudre ou Mioudre en M, dans la vallée entre les deux montagnes A et B»; «V, vallée de Voreppe, adorée par moi comme étant le chemin de Paris».
[11] ... Méaudre ...—Ms.: «Mioudre.»—Méaudre est un village de 784 habitants situé à 1.012 m. d'altitude, dans la vallée de la Bourne.
[12] ... ma tante Elisabeth, avec sa fierté castillane, me dit ...—Le reste de la page a été laissé en blanc par Stendhal. Cet alinéa et le suivant, accompagnés d'un grand blanc, étaient certainement destinés à être développés.
[13] ... sur les fourgons ...—Variante: «Ses fourgons.»
[14] ... j'étais dans la cuisine vers les sept heures du soir ...—Suit un plan de la cuisine. Sur la «grande table» de milieu, en «O, boîte à poudre qui éclata». En H, le jeune Henri devant l'armoire. (Voir notre plan de l'appartement Gagnon.)
[15] ... se trouva grandement soulagé ...—Variante: «Délivré.»
[16] ... un soir que je lisais sur la commode de ma tante Elisabeth ...—En face, au verso du fol. 313 quater, est un plan de la partie de l'appartement Gagnon occupé par les chambres d'Elisabeth et Séraphie Gagnon. Dans la chambre d'Elisabeth, en «H, moi lisant la Henriade ou Bélisaire, dont mon grand-père admirait beaucoup le quinzième chapitre ou le commencement: Justinien vieillissait ... Quel tableau de la vieillesse de Louis XV, disait-il!»—Dans un angle de la place Grenette est figuré l'«escalier et perron de la maison Périer-Lagrange. François, le fils aîné, bon et bête, grand homme de cheval, épousa ma sœur Pauline pendant les campagnes d'Allemagne».
[17] Toute la famille était en rang d'oignons devant le jeu au point D.—Plan de la chambre d'Elisabeth Gagnon en haut du fol. 314; autour de la cheminée, en D, la famille en rang d'oignons; en face de la cheminée, le jeune Beyle lisant sur la commode.
[18] ... rang d'oignons.—On lit en haut du fol. 315 bis: «30 décembre 1835. Omar.»—Le fol. 315 porte simplement: «Chapitre XIX.» Ce chapitre commence au milieu de la page 315 bis, suivant une indication de Stendhal lui-même.
[19] ... sur les registres de l'état civil à Grenoble.—Séraphie Gagnon est morte le 9 janvier 1797, à dix heures du soir.
Bien des années après, vers 1817, j'appris de M. de Tracy que c'était lui, en grande partie, qui avait fait la loi excellente des Écoles centrales[2].
Mon grand-père fut le très digne chef du jury chargé de présenter à l'administration départementale les noms des professeurs et d'organiser l'école. Mon grand-père adorait les lettres et l'instruction, et, depuis quarante ans, était à la tête de tout ce qui s'était fait de littéraire et de libéral à Grenoble.
Séraphie l'avait vertement blâmé d'avoir accepté ces fonctions de membre du jury d'organisation, mais le fondateur de la bibliothèque publique devait à sa considération dans le monde d'être le chef de l'École centrale[3].
Mon maître Durand, qui venait à la maison me donner des leçons, fut professeur de latin; comment ne pas aller à son cours à l'École centrale? Si Séraphie eût vécu, elle eût trouvé une raison, mais, dans l'état des choses, mon père se borna à dire des mots profonds et sérieux sur le danger des mauvaises connaissances pour les mœurs. Je ne me sentais pas de joie; il y eut une séance d'ouverture de l'École dans les salles de la bibliothèque, où mon grand-père fit un discours.
C'est peut-être là cette assemblée si nombreuse dans la première salle SS[4], dont je trouve l'image dans ma tête.
Les professeurs étaient MM. Durand, pour la langue latine; Gattel, grammaire générale et même logique, ce me semble; Dubois-Fontanelle, auteur de la tragédie d'Ericie[5] ou la Vestale et rédacteur pendant vingt-deux ans de la Gazette des Deux-Ponts[6], belles-lettres; Trousset, jeune médecin, la chimie; Jay, grand hâbleur de cinq pieds dix pouces, sans l'ombre de talent, mais bon pour enfiévrer (monter la tête des enfants), le dessin,—il eut bientôt trois cents élèves; Chalvet (Pierre, Vincent), jeune pauvre libertin, véritable auteur sans aucun talent, l'histoire—et chargé de recevoir l'argent des inscriptions qu'il mangea en partie avec trois sœurs, fort catins de leur métier, qui lui donnèrent une nouvelle v..., de laquelle il mourut bientôt après; enfin Dupuy, le bourgeois le plus[p. 239] emphatique et le plus paternel que j'aie jamais vu, professeur de mathématiques—sans l'ombre de talent. C'était à peine un arpenteur, on le nomma dans une ville qui avait un Gros! Mais mon grand-père ne savait pas un mot de mathématiques et les haïssait, et d'ailleurs l'emphase du père Dupuy (comme nous l'appelions; lui nous disait: mes enfants) était bien faite pour lui conquérir l'estime générale à Grenoble. Cet homme si vide disait cependant une grande parole: «Mon enfant, étudie la Logique de Condillac, c'est la base de tout.»
On ne dirait pas mieux aujourd'hui, en remplaçant toutefois le nom de Condillac par celui de Tracy.
Le bon, c'est que je crois que M. Dupuy ne comprenait pas le premier mot de cette logique de Condillac, qu'il nous conseillait; c'était un fort mince volume petit in-12. Mais j'anticipe, c'est mon défaut, il faudra peut-être en relisant effacer toutes ces phrases qui offensent l'ordre chronologique.
Le seul homme parfaitement à sa place était M. l'abbé Gattel, abbé coquet, propret, toujours dans la société des femmes, véritable abbé du XVIIe siècle; mais il était fort sérieux en faisant son cours et savait, je crois, tout ce qu'on savait alors des habitudes principales des mouvements d'instinct et en second lieu de facilité et d'analogie que les peuples ont suivie en formant les langues.
M. Gattel avait fait un fort bon dictionnaire où[p. 240] il avait osé noter la prononciation, et dont je me suis toujours servi. Enfin, c'était un homme qui savait travailler cinq à six heures tous les jours, ce qui est rare en province, où l'on ne sait que baguenauder toute la journée.
Les niais de Paris blâment cette peinture de la prononciation saine, naturelle. C'est par lâcheté et par ignorance. Ils ont peur d'être ridicules en notant la prononciation d'Anvers (ville), de cours, de vers. Ils ne savent pas qu'à Grenoble, par exemple, on dit: J'ai été au Cour-ce, ou: j'ai lu des ver-ce sur Anver-se et Calai-se. Si l'on parle ainsi à Grenoble, ville d'esprit et tenant encore un peu aux pays du Nord, qui pour la langue ont évincé le Midi, que sera-ce à Toulouse, Béziers, Pézenas, Digne? Pays où l'on devrait afficher la prononciation française à la porte des églises.
Un ministre de l'Intérieur qui voudrait faire son métier, au lieu d'intriguer auprès du roi et dans les Chambres, comme M. Guizot[7], devrait demander un crédit de deux millions par an pour amener[8] au niveau d'instruction des autres Français les peuples qui habitent dans le fatal triangle qui s'étend entre Bordeaux, Bayonne et Valence. On croit aux sorciers, on ne sait pas lire et on ne parle pas français en ces pays. Ils peuvent produire par hasard un homme supérieur comme Lannes, Soult, mais le général ...[9] y est d'une ignorance incroyable. Je pense qu'à cause du climat et de l'amour et de[p. 241] l'énergie qu'il donne à la machine, ce triangle devrait produire les premiers hommes de France. La Corse me conduit à cette idée.
Avec ses 180.000 habitants, cette île a donné huit ou dix hommes de mérite à la Révolution et le département du Nord, avec ses 900.000 habitants, à peine un. Encore j'ignore le nom de cet un. Il va sans dire que les prêtres[10] sont tout-puissants dans ce fatal triangle. La civilisation est de Lille à Rennes et cesse vers Orléans et Tours. Au sud de Grenoble est sa brillante limite[11].
Nommer les professeurs à l'École centrale[12] coûtait peu et était bientôt fait, mais il y avait de grandes réparations à faire aux bâtiments. Malgré la guerre, tout se faisait dans ces temps d'énergie. Mon grand-père demandait sans cesse des fonds à l'administration départementale.
Les cours s'ouvrirent au printemps, je crois, dans des salles provisoires.
Celle de M. Durand avait une vue délicieuse et enfin, après un mois, j'y fus sensible. C'était un beau jour d'été et une brise douce agitait les foins des glacis de la porte de Bonne, sous nos yeux[13], à soixante ou quatre-vingts pieds plus bas.
Mes parents me vantaient sans cesse, et à leur manière, la beauté des champs, de la verdure, des fleurs, etc., des renoncules, etc.
Ces plates phrases m'ont donné, pour les fleurs et les plates-bandes, un dégoût qui dure encore.
Par bonheur, la vue magnifique que je trouvai tout seul à une fenêtre du collège, voisine de la salle du latin, où j'allais rêver tout seul, surmonta le profond dégoût causé par les phrases de mon père et des prêtres, ses amis.
C'est ainsi que, tant d'années après, les phrases nombreuses et prétentieuses de MM. Chateaubriand et de Salvandy m'ont fait écrire le Rouge et le Noir d'un style trop haché. Grande sottise, car dans vingt ans, qui songera aux fatras hypocrites de ces Messieurs? Et moi, je mets un billet à une loterie, dont le gros lot se réduit à ceci: être lu en 1935.
C'est la même disposition d'âme qui me faisait fermer les yeux aux paysages des extases de ma tante Séraphie. J'étais en 1794 comme le peuple de Milan[14] est en 1835: les autorités allemandes et abhorrées veulent lui faire goûter Schiller, dont la belle âme, si différente de celle du plat Goethe, serait bien choquée de voir de tels apôtres à sa gloire.
Ce fut une chose bien étrange pour moi que de débuter, au printemps de 1791 ou 95, à onze ou douze ans, dans une école où j'avais dix ou douze camarades.
Je trouvai la réalité bien au-dessous des folles images de mon imagination. Ces camarades n'étaient[p. 243] pas assez gais, pas assez fous, et ils avaient des façons bien ignobles.
Il me semble que M. Durand, tout enflé de se voir professeur d'une École centrale, mais toujours bonhomme, me mit à traduire Salluste, De Bello Jugurtino. La liberté produisit ses premiers fruits, je revins au bon sens en perdant ma colère et goûtai fort Salluste.
Tout le collège était rempli d'ouvriers, beaucoup de chambres de notre troisième étage étaient ouvertes, j'allais y rêver seul.
Tout m'étonnait dans cette liberté tant souhaitée, et à laquelle j'arrivais enfin. Les charmes que j'y trouvais n'étaient pas ceux que j'avais rêvés, ces compagnons si gais, si aimables, si nobles, que je m'étais figurés, je ne les trouvais pas, mais à leur place, des polissons très égoïstes.
Ce désappointement, je l'ai eu à peu près dans tout le courant de ma vie. Les seuls bonheurs d'ambition en ont été exempts, lorsque, en 1810[15], je fus auditeur et, quinze jours après, inspecteur du mobilier. Je fus ivre de contentement, pendant trois mois, de n'être plus commissaire des Guerres et exposé à l'envie et aux mauvais traitements de ces héros si grossiers qui étaient les manœuvres de l'Empereur à Iéna et à Wagram. La postérité ne saura jamais la grossièreté et la bêtise de ces gens-là, hors de leur champ de bataille. Et même sur ce champ de bataille, quelle prudence! C'étaient des[p. 244] gens comme l'amiral Nelson, le héros de Naples (voir Caletta et ce que m'a conté M. Di Fiore), comme Nelson, songeant toujours à ce que chaque blessure leur rapporterait en dotations et en croix. Quels animaux ignobles, comparés à la haute vertu du général Michaud, du colonel Mathis! Non, la postérité ne saura jamais quels plats jésuites ont été ces héros des bulletins de Napoléon, et comme je riais en recevant le Moniteur, à Vienne, Dresde, Berlin, Moscou, que personne presque ne recevait à l'armée afin qu'on ne pût pas se moquer des messages. Les Bulletins étaient des machines de guerre, des travaux de campagne, et non des pièces historiques.
Heureusement pour la pauvre vérité, l'extrême lâcheté de ces héros, devenus pairs de France et juges en 1835, mettra la postérité au fait de leur héroïsme en 1809. Je ne fais exception que pour l'aimable Lasalle et pour Exelmans, qui depuis... Mais alors il n'était pas allé rendre visite au maréchal Bournon, ministre de la Guerre. Moncey aussi n'aurait pas fait certaines bassesses, mais Suchet...[16] J'oubliais le grand Gouvion-Saint-Cyr avant que l'âge l'eût rendu à-demi imbécile, et celte imbécillité remonte à 1814. Il n'eut plus, après cette époque, que le talent d'écrire. Et dans l'ordre civil, sous Napoléon, quels plats bougres[17] que M. de B...., venant persécuter M. Daru à Saint-Cloud, au mois de novembre, dès sept heures du matin, que le[p. 245] comte d'Argout, bas flatteur du général Sébastiani[18]!
Mais, bon Dieu, où en suis-je? A l'école de latin, dans les bâtiments du collège.
[1] Le chapitre XXIII est le chapitre XIX du manuscrit (fol. 315 bis à 331 bis).—Écrit à Rome, les 30 et 31 décembre 1835, et 1er janvier 1836.
[2] ... la loi excellente des Écoles centrales.—Stendhal avait d'abord écrit: «La loi excellente des Écoles centrales avait été faite, ce me semble, par un comité dont M. de Tracy était le chef avec 6.000 francs d'appointements, lui qui avait commencé avec 200.000 livres de rente; mais ceci arrivera plus tard.»—Sur l'enseignement donné dans les Écoles centrales en général et dans celle de Grenoble, en particulier, ainsi que sur les camarades et amis d'Henri Beyle, voir l'ouvrage de M. A. Chuquet, Stendhal-Beyle (1904).
[3] ... d'être le chef de l'École centrale.—Peut-être aussi la crainte des patriotes entra-t-elle pour quelque chose dans l'acceptation de cette fonction. (Note au crayon de R. Colomb.)
[4] ... dans la première salle SS ...—Plan de cette salle, à l'entrée de laquelle se trouvait le «bureau du bibliothécaire, le R. P. Ducros».—Au verso du fol. 314, Stendhal a figuré un plan du collège (aujourd'hui le Lycée de filles), alors situé entre la «rue Neuve, le faubourg Saint-Germain de Grenoble», et les «remparts de la ville en 1795». On y voit au rez-de-chaussée la «première salle des mathématiques» et la «salle de la chimie, professée par M. le Dr Trousset»; au premier étage, la «seconde salle où j'ai remporté le premier prix, sur sept ou huit élèves admis un mois après à l'École polytechnique»; enfin la «salle de latin, au second ou troisième, vue délicieuse» sur les «montagnes d'Echirolles» et sur des sommets recouverts par des «neiges éternelles ou de huit mois de l'année au moins».
[5] ... la tragédie d'Ericie ...—Ms.: «Aricie.»
[6] ... la Gazette des Deux-Ponts ...—La Gazette universelle de politique et de littérature des Deux-Ponts, fondée en 1770. Dubois-Fontanelle n'y collabora que jusqu'au 1er juin 1776.
[7] ... M. Guizot ...—Ms.: «Zotgui.»
[8] ... pour amener ...—Variante: «Porter.»
[9] ... mais le général ...—Le mot est en blanc dans le manuscrit.
[10] Il va sans dire que les prêtres ...—Ms.: «Tresp.»
[11] Au sud de Grenoble est sa brillante limite.—On lit en tête du fol. 324: «31 décembre 1835. Omar.»—Ce feuillet n'a qu'une seule ligne écrite; le reste est blanc.
[12] Nommer les professeurs à l'École centrale ...—On lit en haut du fol. 325: «31 décembre 1835. Omar. Commencé ce livre, dont voici la trois cent vingt-cinquième page, et cent, me ferait quatre cents le ... 1835.»—Le verso du même feuillet porte: «Rapidité: le 3 décembre 1835, j'en étais à 93, le 31 décembre à 325. 232 en 28 jours. Sur quoi il y a eu voyage à Cività-Vecchia. Aucun travail les jours de voyage et le soir d'arrivée ici, soit un ou deux sans écrire. Donc, en 23 jours, 232, ou dix pages par jour, ordinairement dix-huit ou vingt pages par jour, et les jours de courrier quatre ou cinq ou pas du tout. Comment pourrais-je écrire bien physiquement? D'ailleurs, ma mauvaise écriture arrête les indiscrets. 1er janvier 1836.»
—En interligne (aux mots: les professeurs de l'École centrale), Stendhal a écrit: «MM. Gattel, Dubois-Fontanelle, Trousset, Villars (paysan des Hautes-Alpes), Jay, Durand, Dupuy, Chabert, les voilà à peu près par ordre d'utilité pour les enfants; les trois premiers avaient du mérite.»—En face (fol. 324 verso) est encore un plan du «Collège ou École centrale».]
[13] ... sous nos yeux ...—Variante: «Vis-à-vis de nous.»
[14] ... le peuple de Milan ...—Ms.: «Lanmi.»
[15] ... lorsque, en 1810 ...—Ms.: «1811.»
[16] ... mais Suchet ...—Suit un blanc d'un quart de ligne.
[17] ... quels plats bougres ...—Ms.: «Ougresb.»
[18] ... général Sébastiani!—Ms.: «Bastiani-sebas.»
Je ne réussissais guère avec mes camarades; je vois aujourd'hui que j'avais alors un mélange fort ridicule de hauteur et de besoin de m'amuser. Je répondis à leur égoïsme le plus âpre par mes idées de noblesse espagnole. J'étais navré quand, dans leurs jeux, ils me laissaient de côté; pour comble de misère, je ne savais point ces jeux, j'y portais une noblesse d'âme, une délicatesse qui devaient leur sembler de la folie absolue. La finesse et la promptitude de l'égoïsme, un égoïsme, je crois, hors de mesure, sont les seules choses qui aient du succès parmi les enfants.
Pour achever mon peu de succès, j'étais timide envers le professeur, un mot de reproche contenu et[p. 248] dit par hasard par ce petit bourgeois pédant avec un accent juste, me faisait venir les larmes aux yeux. Ces larmes étaient de la lâcheté aux yeux de MM. Gauthier frères, Saint-Ferréol, je crois, Robert (directeur actuel du théâtre Italien, à Paris), et surtout Odru. Ce dernier était un paysan très fort et encore plus grossier, qui avait un pied de plus qu'aucun de nous et que nous appelions Goliath; il en avait la grâce, mais nous donnait de fières taloches quand sa grosse intelligence s'apercevait enfin que nous nous moquions de lui.
Son père, riche paysan de Lumbin ou d'un autre village dans la vallée[2]. (On appelle ainsi par excellence l'admirable vallée de l'Isère, de Grenoble à Montmélian. Réellement, la vallée s'étend jusqu'à la dent de Moirans, de cette sorte[3].)
Mon grand-père avait profité du départ de Séraphie pour me faire suivre les cours de mathématiques, de chimie et de dessin.
M. Dupuy, ce bourgeois si emphatique et si plaisant, était, en importance citoyenne, une sorte de rival subalterne de M. le docteur Gagnon. Il était à plat ventre devant la noblesse, mais cet avantage qu'il avait sur M. Gagnon était compensé par l'absence totale d'amabilité et d'idées littéraires, qui alors formaient comme le pain quotidien de la conversation. M. Dupuy, jaloux de voir M. Gagnon membre du jury d'organisation et son supérieur,[p. 249] n'accueillit point la recommandation de ce rival heureux en ma faveur, et je n'ai gagné ma place dans la salle de mathématiques qu'à force de mérite, et en voyant ce mérite, pendant trois ans de suite, mis continuellement en question. M. Dupuy, qui parlait sans cesse et (jamais trop) de Condillac et de sa Logique, n'avait pas l'ombre de logique dans la tête. Il parlait noblement et avec grâce, et il avait une figure imposante et des manières fort polies.
Il eut une idée bien belle en 1794, ce fut de diviser les cent élèves qui remplissaient la salle au rez-de-chaussée, à la première leçon de mathématiques, en brigades de six ou de sept ayant chacune un chef.
Le mien était un grand, c'est-à-dire un jeune homme au-delà de la puberté et ayant un pied de plus que nous. Il nous crachait dessus, en plaçant adroitement un doigt devant sa bouche. Au régiment, un tel caractère s'appelle arsouille. Nous nous plaignions de cet arsouille, nommé, je crois, Raimonet, à M. Dupuy, qui fut admirable de noblesse en le cassant. M. Dupuy avait l'habitude de donner leçon aux jeunes officiers d'artillerie de Valence et était fort sensible à l'honneur (au coup d'épée).
Nous suivions le plat cours de Bezout, mais M. Dupuy eut le bon esprit de nous parler de Clairaut et de la nouvelle édition que M. Biot (ce charlatan travailleur) venait d'en donner.
Clairaut était fait pour ouvrir l'esprit, que[p. 250] Bezout tendait à laisser à jamais bouché. Chaque proposition, dans Bezout, a l'air d'un grand secret appris d'une bonne femme voisine.
Dans la salle de dessin, je trouvai que M. Jay et M. Couturier (au nez cassé), son adjoint, me faisaient une terrible injustice. Mais M. Jay, à défaut de tout autre mérite, avait celui de l'emphase, laquelle emphase, au lieu de nous faire rire, nous enflammait. M. Jay obtenait un beau succès, fort important pour l'École centrale, calomniée par les prêtres. Il avait deux ou trois cents élèves.
Tout cela était distribué par bancs de sept ou huit[4], et chaque jour il fallait faire construire de nouveaux bancs. Et quels modèles! de mauvaises académies dessinées par MM. Pajou et Jay lui-même; les jambes, les bras, tout était en à peu près, bien patauds, bien lourds, bien laids. C'était le dessin de M. Moreau jeune, ou de ce M. Cachoud qui parle si drôlement de Michel-Ange et du Dominiquin dans ses trois petits volumes sur l'Italie.
Les grandes têtes étaient dessinées à la sanguine ou gravées à la manière du crayon. Il faut avouer que la totale ignorance du dessin y paraissait moins que dans les académies (figures nues). Le grand mérite de ces têtes, qui avaient dix-huit pouces de haut, était que les hachures fussent bien parallèles; quant à imiter la nature, il n'en était pas question.
Un nommé Moulezin, bête et important à manger du foin et aujourd'hui riche et important bourgeois de Grenoble, et sans doute l'un des plus rudes ennemis du sens commun, s'immortalisa bientôt par le parallélisme parfait de ses hachures à la sanguine. Il faisait des académies et avait été élève de M. Villonne (de Lyon); moi, élève de M. Le Roy, que la maladie et le bon goût parisien avaient empêché de son vivant d'être aussi charlatan que M. Villonne à Lyon, dessinateur pour étoffes, je ne pus obtenir que les grandes têtes, ce qui me choqua fort, mais eut le grand avantage d'être une leçon de modestie.
J'en avais grand besoin, puisqu'il faut parler net. Mes parents, dont j'étais l'ouvrage, s'applaudissaient de mes talents devant moi, et je me croyais le jeune homme le plus distingué de Grenoble.
Mon infériorité dans les jeux avec mes camarades de latin commença à m'ouvrir les yeux. Le banc des grandes têtes, vers H[5], où l'on me plaça, tout près des deux fils d'un cordonnier, à figures ridicules (quelle inconvenance pour le petit-fils de M. Gagnon!), m'inspira la volonté de crever ou d'avancer[6].
Voici l'histoire de mon talent pour le dessin: ma famille, toujours judicieuse, avait décidé, après un an ou dix-huit mois de leçons chez cet homme si poli, M. Le Roy, que je dessinais fort bien.
Le fait est que je ne me doutais pas seulement que le dessin est une invention de la nature. Je dessinais avec un crayon noir et blanc une tête en demi-relief. (J'ai vu à Rome, au Braccio nuovo, que c'est la tête de Musa, médecin d'Auguste.) Mon dessin était propre, froid, sans aucun mérite, comme le dessin d'un jeune pensionnaire.
Mes parents, qui avec toutes leurs phrases sur les beautés de la campagne et les beaux paysages, n'avaient aucun sentiment des arts, pas une gravure passable à la maison, me déclarèrent très fort en dessin. M. Le Roy vivait encore et peignait[7] des paysages à la gouache (couleur épaisse), moins mal que le reste.
J'obtins de laisser là le crayon et de peindre à la gouache.
M. Le Roy avait fait une vue du pont de la Vence, entre la Buisserate et Saint-Robert, prise du point A[8].
Je passais ce pont plusieurs fois l'an pour aller à Saint-Vincent, je trouvais que le dessin, surtout la montagne en M, ressemblait fort, je fus illusionné. Donc, d'abord, et avant tout, il faut qu'un dessin ressemble à la nature!
Il n'était plus question de hachures bien parallèles. Après cette belle découverte, je fis de rapides progrès.
Le pauvre M. Le Roy vint à mourir, je le regrettai. Cependant, j'étais encore esclave alors, et[p. 253] tous les jeunes gens allaient chez M. Villonne, dessinateur pour étoffes chassé de Commune-Affranchie par la guerre et les échafauds. Commune-Affranchie était le nouveau nom donné à Lyon depuis sa prise.
Je communiquai à mon père (mais par hasard et sans avoir l'esprit d'y songer) mon goût pour la gouache, et j'achetai de Mme Le Roy, au triple de leur valeur, beaucoup de gouaches de son mari.
Je convoitais fort deux volumes des Contes de La Fontaine, avec gravures fort délicatement faites, mais fort claires.
«Ce sont des horreurs, me dit Mme Le Roy avec ses beaux yeux de soubrette bien hypocrites; mais ce sont des chefs-d'œuvre.»
Je vis que je ne pouvais escamoter le prix des Contes de La Fontaine sur celui des gouaches. L'École centrale s'ouvrit, je ne songeai plus à la gouache, mais ma découverte me resta[9]: il fallait imiter la nature, et cela empêcha peut-être que mes grandes têtes, copiées d'après ces plats dessins, fussent aussi exécrables qu'elles auraient dû l'être. Je me souviens du Soldat indigné, dans Héliodore chassé, de Raphaël; je ne vois jamais l'original (au Vatican) sans me souvenir de ma copie; le mécanisme du crayon, tout-à-fait arbitraire, même faux, brillait surtout dans le dragon qui surmonte le casque.
Quand nous avions fait un ouvrage passable,[p. 254] M. Jay s'asseyait à la place de l'élève, corrigeait un peu la tête et raisonnait avec emphase, mais enfin en raisonnant, et enfin signait la tête par derrière, apparemment ne varietur, pour qu'elle pût, au milieu ou à la fin de l'année, être présentée au concours. Il nous enflammait, mais n'avait pas la plus petite notion du beau. Il n'avait fait en sa vie qu'un tableau indigne, une Liberté copiée d'après sa femme, courte, ramassée, sans forme. Pour l'alléger, il avait occupé le premier plan par un tombeau derrière lequel la Liberté paraissait cachée jusqu'aux genoux[10].
La fin de l'année arriva, il y eut des examens en présence du jury, et, je crois, d'un membre du Département.
Je n'obtins qu'un misérable accessit, et encore pour faire plaisir, je pense, à M. Gagnon, chef du jury, et à M. Dausse, autre membre du jury, fort ami de M. Gagnon.
Mon grand-père en fut humilié, et il me le dit avec une politesse et une mesure parfaites. Son mot si simple fit sur moi tout l'effet possible. Il ajouta en riant: «Tu ne savais que nous montrer ton gros derrière!»
Cette position peu aimable avait été remarquée au tableau de la salle de mathématiques.
C'était une ardoise de six pieds sur quatre, soutenue,[p. 255] à cinq pieds de haut, par un châssis fort solide; on y montait par trois degrés.
M. Dupuy faisait démontrer une proposition, par exemple le carré de l'hypoténuse ou ce problème: un ouvrage coûte sept livres, quatre sous, trois deniers la toise; l'ouvrier en a fait deux toises, cinq pieds, trois pouces. Combien lui revient-il?
Dans le courant de l'année, M. Dupuy avait toujours appelé au tableau M. de Monval, qui était noble, M. de Pina, noble et ultra. M. Anglès, M. de Renneville, noble, et jamais moi, ou une seule fois[11].
Le cadet Monval, buse à figure de buse, mais bon mathématicien (terme de l'école), a été massacré par les brigands en Calabre, vers 1806, je crois. L'aîné, étant avec Paul-Louis Courier dans sa prise...[12], devint un sale vieux ultra. Il fut colonel, ruina d'une vilaine façon une grande dame de Naples; à Grenoble, voulut souffler le froid et le chaud vers 1830, fut découvert et généralement méprisé. Il est mort de ce mépris général, et richement mérité, fort loué par les dévots (voir la Gazette de 1832 ou 1833). C'était un joli homme, coquin à tout faire.
M. de P..., maire à Grenoble de 1825 à 1830. Ultra à tout faire et oubliant la probité en faveur de ses neuf ou dix enfants, il a réuni 60 ou 70.000 francs de rente. Fanatique sombre et, je pense, coquin à tout faire, vrai jésuite[13].
Anglès, depuis préfet de police, travailleur infatigable,[p. 256] aimant l'ordre, mais en politique coquin à tout faire, mais, selon moi, infiniment moins coquin que les deux précédents, lesquels, dans le genre coquin, tiennent la première place dans mon esprit.
La jolie Mme la comtesse Anglès était amie de Mme la comtesse Daru[14], dans le salon de laquelle je la vis. Le joli comte de Meffrey (de Grenoble, comme M. Anglès) était son amant. La pauvre femme s'ennuyait beaucoup, ce me semble, malgré les grandes places du mari.
Ce mari, fils d'un avare célèbre, et avare lui-même, était l'animal le plus triste et avait l'esprit le plus pauvre, le plus anti-mathématique. D'ailleurs, lâche jusqu'au scandale; je conterai plus tard l'histoire de son soufflet et de sa queue. Vers 1826 ou 29, il perdit la préfecture de police et alla bâtir un beau château dans les montagnes, près de Roanne, et y mourut fort brusquement bientôt après, jeune encore. C'était un triste animal, il avait tout le mauvais du caractère dauphinois, bas, fin, cauteleux, attentif aux moindres détails.
M. de Renneville, cousin des Monval, était beau et bête à manger du foin. Son père était l'homme le plus sale et le plus fier de Grenoble. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis l'école.
M. de Sinard, bon écolier, réduit à la mendicité par l'émigration, protégé et soutenu par M. de Vaulserre, fut mon ami.
Monté au tableau, on écrivait en O[15]. La tête du démontrant était bien à huit pieds de haut. Moi, placé en évidence une fois par mois, nullement soutenu par M. Dupuy, qui parlait à Monval ou à M. de Pina pendant que je démontrais, j'étais pénétré de timidité et je bredouillais. Quand je montai au tableau à mon tour, devant le jury, ma timidité redoubla, je m'embrouillai en regardant ces Messieurs, et surtout le terrible M. Dausse, assis à côté et à droite du tableau. J'eus la présence d'esprit de ne plus les regarder, de ne plus faire attention qu'à mon opération, et je m'en tirai correctement, mais en les ennuyant. Quelle différence avec ce qui se passa en août 1799! Je puis dire que c'est à force de mérite que j'ai percé aux mathématiques et au dessin, comme nous disions à l'École centrale[16].
J'étais gros et peu grand, j'avais une redingote gris clair, de là le reproche.
«Pourquoi donc n'as-tu pas eu de prix? me disait mon grand-père.
—Je n'ai pas eu le temps.»
Les cours n'avaient, je crois, duré, cette première année, que quatre ou cinq mois.
J'allai à Claix, toujours fou de la chasse; mais en courant les champs, malgré mon père, je réfléchissais profondément à ce mot: «Pourquoi n'as-tu pas eu de prix?»
Je ne puis me rappeler si je suis allé pendant
quatre ans ou seulement pendant trois à l'École centrale. Je suis sûr de la date de sortie, examen de la fin de 1799, les Russes attendus à Grenoble.
Les aristocrates et mes parents, je crois, disaient:
O Rus, quando ego le adspiciam!
Pour moi, je tremblais pour l'examen qui devait me faire sortir de Grenoble! Si j'y reviens jamais, quelques recherches dans les archives de l'Administration départementale, à la Préfecture, m'apprendront si l'École centrale a été ouverte en 1796 ou seulement en 1797[17].
On comptait alors par les années de la République, c'était l'an V ou l'an VI. Ce n'est que longtemps après, quand l'Empereur l'a bêtement voulu, que j'ai appris à connaître 1796, 1797. Je voyais les choses de près, alors[18].
L'Empereur commença alors à élever le trône des Bourbons, et fut secondé par la lâcheté sans bornes de M. de Laplace. Chose singulière, les poètes ont du cœur, les savants proprement dits sont serviles et lâches. Quelle n'a pas été la servilité et la bassesse vers le pouvoir de M. Cuvier! Elle faisait horreur même au sage Sutton Sharpe. Au Conseil d'Etat, M. le baron Cuvier était toujours de l'avis le plus lâche.
Lors de la création de l'ordre de la Réunion, j'étais dans le plus intime de la Cour; il vint pleurer, c'est le mot, pour l'avoir. Je rapporterai en son temps[p. 259] la réponse de l'Empereur. Arrivés par la lâcheté: Bacon, Laplace, Cuvier. M. Lagrange fut moins plat, ce me semble.
Sûrs de leur gloire par leurs écrits, ces Messieurs espèrent que le savant couvrira l'homme d'Etat: en affaires d'argent, comme on le sait, ils courent à l'utile. Le célèbre Legendre, géomètre de premier ordre, recevant la croix de la Légion d'honneur, l'attacha à son habit, se regarda à son miroir, et sauta de joie.
L'appartement était bas, sa tête heurta le plafond, il tomba, à moitié assommé. Digne mort c'eût été pour ce successeur d'Archimède!
Que de bassesses n'ont-ils pas faites à l'Académie des Sciences, de 1825 à 1830 et depuis, pour s'escamoter des croix! Cela est incroyable, j'en ai su le détail par MM. de Jussieu, Edwards, Milne-Edwards, et par le salon de M. le baron Gérard. J'ai oublié tant de saletés.
Un Maupeou[19] est moins bas en ce qu'il dit ouvertement: «Je ferai tout ce qu'il faut pour avancer[20].»
[1] Le chapitre XXIV est le chapitre XX du manuscrit (fol. 331 bis à 355).—Écrit à Rome, le 1er janvier 1836. Stendhal note au fol. 335: «Froid en écrivant.»
[2] ... un autre village dans la vallée.—Du Versoud. (Note au crayon de R. Colomb.)
[3] ... la vallée s'étend jusqu'à la dent de Moirans, de cette sorte.—Suit une carte-esquisse, d'ailleurs inexacte. Stendhal appelle Dent de Moirans le Bec de l'Echaillon, situé sur la rive droite de l'Isère, au-dessus de Veurey. Entre Moirans et Voreppe, il signale des «campagnes comparables à celle de Lombardie et de Marmande, les plus belles du monde».
[4] Tout cela était distribuée par bancs de sept ou huit ...—Suit un plan de la classe de dessin; entre les deux rangées, «le grand Jay arpentant sa salle avec l'air de gémir et en tenant la tête renversée». La place du jeune Beyle était en H, dans les bancs placés du côté de la rue Neuve.
[5] Le banc des grandes têtes, vers H ...—Cette référence se rapporte au plan décrit ci-dessus.
[6] ... la volonté de crever ou d'avancer.—Rapidité, raison de la mauvaise écriture. 1er janvier 1836. Il n'est que deux heures, j'ai déjà écrit seize pages, il fait froid, la plume va mal; au lieu de me mettre en colère, je vais en avant, écrivant comme je puis. (Note de Stendhal.)
[7] M. Le Roy vivait encore et peignait ...—Variante: «Faisait.»
[8] M. Le Roy avait fait une vue du pont de la Vence, ... prise du point A ...—Suit un croquis schématique du point de vue. Le point A est au bas du pont, sur le bord du torrent, et l'arche du pont encadre la montagne M.
[9] ... mais ma découverte me resta ...—Stendhal a, par inadvertance, oublié un mot en passant d'un feuillet à un autre.
[10] ... la Liberté paraissait cachée jusqu'aux genoux.—-Le fol. 345 est aux trois-quarts blanc.
[11] ... et jamais moi, ou une seule fois.—En face, au verso du fol. 346, est un plan de la partie du collège contenant la «salle de dessin» et la «salle des mathématiques». Dans celle-ci, près du tableau, en «D, M. Dupuy, homme de cinq pieds huit pouces, avec sa grande canne, dans son immense fauteuil». Parmi les élèves, en «H, moi, mourant d'envie d'être appelé pour monter au tableau, et me cachant pour n'être pas appelé, mourant de peur et de timidité».
[12] ... avec Paul-Louis Courier dans sa prise ...—Un mot illisible. La lecture du mot prise n'est pas certaine.
[13] ... vrai jésuite.—Ms.: «Tejé.»
[14] ... Mme la comtesse Daru ...—Ms.: «Ruda.»
[15] Monté au tableau, on écrivait en O.—Croquis représentant un élève au tableau.
[16] ... comme nous disions à l'École centrale.—Suit une phrase que Stendhal n'a pas effacée, mais que nous supprimons cependant, car il l'a accompagnée de cette mention: répétition. «Pour ne pas m'embrouiller dans une longue opération d'arithmétique, je me mis à ne regarder que le tableau.»
[17] ... si l'École centrale a été ouverte en 1796 ou seulement en 1797.—L'École centrale de Grenoble, créée par le décret de la Convention du 7 ventôse an III, fut inaugurée le 11 frimaire an V (1er décembre 1796). Des prix furent décernés aux élèves le 30 fructidor an V (16 septembre 1797), le 10 germinal an VI (30 mars 1798), jour de la fête de la Jeunesse, le 30 fructidor an VI (16 septembre 1798) et le 17 brumaire an VII (7 novembre 1798).
[18] Je voyais les choses de près, alors.—Écriture. Le 1er janvier 1836, 26 pages. Toutes les plumes vont mal, il fait un froid de chien; au lieu de chercher à bien former mes lettres et de m'impatienter, io tiro avanti. M. Colomb me reproche dans chaque lettre d'écrire mal. (Note de Stendhal.)
[19] Un Maupeou ...—Ms.: «Maudpw.»
[20]—On lit à la fin du chapitre: «Le 1er janvier 1836, 29 pages. Je cesse, faute de lumière au ciel, à quatre heures trois quarts.»
Mon âme délivrée de la tyrannie commençait à prendre quelque ressort. Peu à peu je n'étais plus continuellement obsédé de ce sentiment si énervant: la haine impuissante.
Ma bonne tante Elisabeth était ma providence. Elle allait presque tous les soirs faire sa partie chez mesdames Colomb ou Romagnier. Ces excellentes sœurs n'avaient de bourgeois que quelques manies de prudence et quelques habitudes. Elles avaient de belles âmes, chose si rare en province, et étaient tendrement attachées à ma tante Elisabeth.
Je ne dis pas assez de bien de ces bonnes cousines; elles avaient l'âme grande, généreuse; elles en avaient donné des preuves singulières dans les grandes occasions de leur vie.
Mon père, de plus en plus absorbé par sa passion pour l'agriculture et pour Claix, y passait trois ou quatre jours par semaine. La maison de M. Gagnon, où il dînait et soupait tous les jours depuis la mort de ma mère, ne lui était plus aussi agréable à beaucoup près. Il ne parlait à cœur ouvert qu'à Séraphie. Les sentiments espagnols de ma tante Elisabeth le tenaient en respect, il y avait toujours très peu de conversation entre eux. La petite finesse dauphinoise de tous les instants et la timidité désagréable de l'un s'alliait mal à la sincérité noble et à la simplicité de l'autre. Mademoiselle Gagnon n'avait aucun goût[2] pour mon père qui, d'un autre côté, n'était pas de force à soutenir la conversation avec M. le docteur Gagnon; il était respectueux et poli, M. Gagnon était très poli, et voilà tout. Mon père ne sacrifiait donc rien en allant passer trois ou quatre jours par semaine à Claix. Il me dit deux ou trois fois, quand il me forçait à l'accompagner à Claix, qu'il était triste, à son âge, de ne pas avoir un chez-soi.
Rentrant le soir pour souper avec ma tante Elisabeth, mon grand-père et mes deux sœurs, je n'avais pas à craindre un interrogatoire bien sévère. En général, je disais en riant que j'étais allé chercher ma tante chez mesdames Romagnier et Colomb; souvent, en effet, de chez ces dames je l'accompagnais jusqu'à la porte de l'appartement et je redescendais en courant pour aller passer une demi-heure[p. 263] à la promenade du Jardin-de-Ville qui, le soir, en été, au clair de lune, sous de superbes marronniers de quatre-vingts pieds de haut, servait de rendez-vous à tout ce qui était jeune et brillant dans la ville.
Peu à peu je m'enhardis, j'allai plus souvent au spectacle, toujours au parterre debout.
Je sentais un tendre intérêt à regarder une jeune actrice, nommée Mlle Kably. Bientôt j'en fus éperdument amoureux; je ne lui ai jamais parlé.
C'était une jeune femme mince, assez grande, avec un nez aquilin, jolie, svelte, bien faite. Elle avait encore la maigreur de la première jeunesse, mais un visage sérieux et souvent mélancolique.
Tout fut nouveau pour moi dans l'étrange folie qui, tout-à-coup, se trouva maîtresse de toutes mes pensées. Tout autre intérêt s'évanouit pour moi. A peine je reconnus le sentiment dont la peinture m'avait charmé dans la Nouvelle Héloïse, encore moins était-ce la volupté de Félicia. Je devins tout-à-coup indifférent et juste pour tout ce qui m'environnait, ce fut[3] l'époque de la mort de ma haine pour feu ma tante Séraphie.
Mlle Kably jouait dans la comédie les rôles de jeunes premières, elle chantait aussi dans l'opéra-comique.
On sent bien que la vraie comédie n'était pas à mon usage. Mon grand-père m'étourdissait sans cesse du grand mot: la connaissance du cœur[p. 264] humain. Mais que pouvais-je savoir sur ce cœur humain? Quelques prédictions tout au plus, accrochées dans les livres, dans Don Quichotte particulièrement, le seul presque qui ne m'inspirât pas de la méfiance; tous les autres avaient été conseillés par mes tyrans, car mon grand-père (nouveau converti, je pense) s'abstenait de plaisanter sur les livres que mon père et Séraphie me faisaient lire [4].
Il me fallait donc la comédie romanesque, c'est-à-dire le drame peu noir, présentant des malheurs d'amour et non d'argent (le drame noir et triste s'appuyant sur le manque d'argent m'a toujours fait horreur comme bourgeois et trop vrai).
Mlle Kably brillait dans Claudine, de Florian.
Une jeune Savoyarde, qui a eu un petit enfant, au Montanvert, d'un jeune voyageur élégant, s'habille en homme et, suivie de son petit marmot, fait le métier de décrotteur sur une place de Turin. Elle retrouve son amant qu'elle aime toujours, elle devient son domestique, mais cet amant va se marier.
L'auteur qui jouait l'amant, nommé Poussi, ce me semble,—ce nom me revient huit à coup après tant d'années,—disait avec un naturel parfait: «Claude! Claude!» dans un certain moment où il grondait son domestique qui lui disait du mal de sa future. Ce ton de voix retentit encore dans mon âme, je vois l'acteur.
Pendant plusieurs mois, cet ouvrage, souvent redemandé par le public, me donna les plaisirs les plus vifs, et je dirais les plus vifs que m'aient donnés les ouvrages d'art, si, depuis longtemps, mon plaisir n'avait été l'admiration tendre, la plus dévouée et la plus folle.
Je n'osais pas prononcer le nom de Mlle Kably; si quelqu'un la nommait devant moi, je sentais un mouvement singulier près du cœur, j'étais sur le point de tomber. Il y avait comme une tempête dans mon sang.
Si quelqu'un disait la Kably, au lieu de: Mademoiselle Kably, j'éprouvais un sentiment de haine et d'horreur[5], que j'étais à peine maître de contenir.
Elle chantait de sa pauvre petite voix faible dans Le Traité nul, opéra de Gaveau (pauvre d'esprit, mort fou quelques années plus tard).
Là commença mon amour pour la musique, qui a peut-être été ma passion la plus forte et la plus coûteuse; elle dure encore à cinquante-deux[6] ans, et plus vive que jamais. Je ne sais combien de lieues je ne ferais pas à pied, ou à combien de jours de prison je ne me soumettrais pas pour entendre Don Juan ou le Matrimonio Segreto, et je ne sais pour quelle autre chose je ferais cet effort. Mais, pour mon malheur, j'exècre la musique médiocre (à mes yeux elle est un pamphlet satyrique contre la bonne, par exemple le Furioso de Donizetti, hier soir, Rome, Valle[7]. Les Italiens, bien différents de moi, ne peuvent[p. 266] souffrir une musique dès qu'elle a plus de cinq ou six ans. L'un d'eux disait devant moi, chez madame ...[8]: «Une musique qui a plus d'un an peut-elle être belle?»)
Quelle parenthèse, grand Dieu[9]! En relisant, il faudra effacer, ou mettre à une autre place, la moitié de ce manuscrit[10].
J'appris par cœur, et avec quels transports! ce filet de vinaigre continu et saccadé qu'on appelait Le Traité nul.
Un acteur passable, qui jouait gaiement le rôle du valet (je vois aujourd'hui qu'il avait la véritable insouciance d'un pauvre diable qui n'a que de tristes pensées à la maison, et qui se livre à son rôle avec bonheur), me donna les premières idées du comique, surtout au moment où il arrange la contre-danse qui finit par: Mathurine nous écoutait...
Un paysage de la forme et de la grandeur d'une lettre de change, où il y avait beaucoup de gomme-gutte fortifiée par du bistre, surtout sur le premier plan à gauche, que j'avais acheté chez M. Le Roy, et que je copiais alors avec délices, me semblait absolument la même chose que le jeu de cet acteur comique, qui me faisait rire de bon cœur quand Melle Kably n'était pas en scène; s'il lui adressait la parole, j'étais attendri, enchanté. De là vient, peut-être qu'encore aujourd'hui la même sensation m'est souvent donnée par un tableau ou par un[p. 267] morceau de musique. Que de fois j'ai trouvé cette identité dans le musée Brera, à Milan (1814-1812)!
Cela est d'un vrai et d'une force que j'ai peine à exprimer, et que d'ailleurs on croirait difficilement.
Le mariage, l'union intime de ces deux beaux-arts, a été à jamais cimenté, quand j'avais douze ou treize ans, par quatre ou cinq mois du bonheur le plus vif et de la sensation de volupté la plus forte, et allant presque jusqu'à la douleur, que j'aie jamais éprouvée.
Actuellement, je vois (mais je vois de Rome, à cinquante-deux[11] ans) que j'avais le goût de la musique avant ce Traité nul si sautillant, si filet de vinaigre, si français, mais que je sais encore par cœur. Voici mes souvenirs: 1° le son des cloches de Saint-André, surtout sonnées pour les élections, une année que mon cousin Abraham Mallein (père de mon beau-frère Alexandre) était président ou simplement électeur;—2° le bruit de la pompe de la place Grenette, quand les servantes, le soir, pompaient avec la grande barre de fer;—3° enfin, mais le moins de tous, le bruit d'une flûte que quelque commis marchand jouait, au quatrième étage, sur la place Grenette.
Ces choses m'avaient déjà donné des plaisirs qui, à mon insu, étaient des plaisirs musicaux.
Mademoiselle Kably jouait aussi dans l'Epreuve villageoise de Grétry, infiniment moins mauvaise[p. 268] que le Traité nul. Une situation tragique me fit frémir dans Raoul, sire de Créqui; en un mot, tous les mauvais petits opéras de 1794 furent portés au sublime pour moi, par la présence de Melle Kably; rien ne pouvait être commun ou plat dès qu'elle paraissait.
J'eus, un jour, l'extrême courage de demander à quelqu'un où logeait Melle Kably. C'est probablement l'action la plus brave de ma vie.
«Rue des Clercs», me répondit-on.
J'avais eu le courage, bien auparavant, de demander si elle avait un amant. A quoi l'interrogé me répondit par quelque dicton[12] grossier; il ne savait rien sur son genre de vie.
Je passais par la rue des Clercs à mes jours de grand courage: le cœur me battait, je serais peut-être tombé si je l'eusse rencontrée; j'étais bien délivré quand, arrivé au bas de la rue des Clercs, j'étais sûr de ne pas la rencontrer.
Un matin, me promenant seul au bout de l'allée des grands marronniers, au Jardin-de-Ville, et pensant à elle, comme toujours, je l'aperçus à l'autre bout du jardin, contre le mur de l'Intendance, qui venait vers la terrasse. Je faillis me trouver mal[13] et enfin je pris la fuite, comme si le diable m'emportait, le long de la grille, par la ligne F; elle était, je crois, en K'[14]. J'eus le bonheur de n'en être pas aperçu. Notez qu'elle ne me connaissait d'aucune façon. Voilà un des traits les plus marqués de mon[p. 269] caractère, tel j'ai toujours été (même avant-hier). Le bonheur de la voir de près, à cinq ou six pas de distance, était trop grand, il me brûlait, et je fuyais cette brûlure, peine fort réelle.
Cette singularité me porterait assez à croire que, pour l'amour, j'ai le tempérament mélancolique de Cabanis.
En effet, l'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule. Jamais je n'ai eu peur de rien que de voir la femme que j'aime regarder un rival avec intimité. J'ai très peu de colère contre le rival: il fait son affaire, pensé-je, mais ma douleur est sans bornes et poignante; c'est au point que j'ai besoin de m'abandonner sur un banc de pierre, à la porte de la maison. J'admire tout dans le rival préféré (le chef d'escadrons Gibory et Mme Martin, palazzo Aguissola, Milan).
Aucun autre chagrin ne produit chez moi la millième partie de cet effet.
Auprès de l'Empereur, j'étais attentif, zélé, ne pensant nullement à ma cravate, à la grande différence des autres. (Exemple: un soir, à 7 heures, à ...[15], en Lusace, campagne de 1813, le lendemain de la mort du duc de Frioul.)
Je ne suis ni timide, ni mélancolique en écrivant et m'exposant au risque d'être sifflé; je me sens plein de courage et de fierté quand j'écris une phrase qui serait repoussée par l'un de ces deux géants (de 1835): MM. de Chateaubriand ou Villemain.
Sans cloute, en 1880, il y aura quelque charlatan adroit, mesuré, à la mode, comme ces Messieurs aujourd'hui. Mais si on lit ceci on me croira envieux, ceci me désole; ce plat vice bourgeois est, ce me semble, le plus étranger à mon caractère.
Réellement, je ne suis que mortellement jaloux des gens qui font la cour à une femme que j'aime; bien plus, je le suis même de ceux qui lui ont fait la cour, dix ans avant moi. (Par exemple, le premier amant de Babet, à Vienne, en 1809.
«Tu le recevais dans ta chambre!
—Tout était chambre pour nous, nous étions seuls dans le château, et il avait les clefs.»
Je sens encore le mal que me firent ces paroles, c'était pourtant en 1809, il y a vingt-sept ans; je vois cette naïveté parfaite de la jolie Babet; elle me regardait.)
Je trouve[16] sans doute beaucoup de plaisir à écrire depuis une heure, et à chercher à peindre bien juste mes sensations du temps de Melle Kably[17], mais qui diable aura le courage de lire cet amas excessif de je et de moi? Cela me paraît puant à moi-même. C'est là le défaut de ce genre d'écrit et, d'ailleurs, je ne puis relever la fadeur par aucune sauce de charlatanisme. Oserais-je ajouter: comme les confessions de Rousseau? Non, malgré l'énorme absurdité de l'objection, l'on va encore me croire envieux ou plutôt cherchant à établir une comparaison.[p. 271] effroyable par l'absurde, avec le chef-d'œuvre de ce grand écrivain.
Je proteste de nouveau et une fois pour toutes que je méprise souverainement et sincèrement M. Pariset, M. de Salvandy, M. Saint-Marc Girardin et les autres hâbleurs, pédants gagés et jésuites[18] du Journal des Débats, mais pour cela je ne m'en crois pas plus près des grands écrivains. Je ne me crois d'autre garant de mérite que de peindre ressemblante la nature, qui m'apparaît si clairement en de certains moments.
Secondement, je suis sûr de ma parfaite bonne foi, de mon adoration pour le vrai: troisièmement, et du plaisir que j'ai à écrire, plaisir qui allait jusqu'à la folie en 1817, à Milan, chez M. Peroult, corsia del Giardino[19].
[1] Le chapitre XXV est le chapitre XXI du manuscrit (fol. 356 à 370; le bas du fol. 370 et le fol. 371, d'abord écrits par Stendhal, ont été barrés avec cette mention: «Longueur»).—Écrit à Rome, les 2 et 3 janvier 1836.
[2] Mademoiselle Gagnon n'avait aucun goût ...—Variante: «Pas de goût.»
[3] ... ce fut l'époque ...—Mot oublié inconsciemment par Stendhal, en passant d'un feuillet à un autre.
[4] ... que mon père et Séraphie me faisaient lire.—Style. Pas de style soutenu. (Note de Stendhal.)
[5] ... un sentiment de haine et d'horreur ...—Stendhal orthographie: «Orreur.» Et il ajoute en note: «Voilà l'orthographe de la passion: orreur».
[6] ... elle dure encore à cinquante-deux ans ...—Ms.: «26 X 2.»
[7] ...hier soir, Rome, Valle.—Au théâtre della Valle, à Rome. (Note au crayon de R. Colomb.)
[8] ... chez madame ...—Nom en blanc.
[9] Quelle parenthèse, grand Dieu !—On lit en tête du fol. 363: «1836, corrigé 4 janvier 1836, auprès de mon feu, me brûlant les jambes et mourant de froid au dos.»
[10] ... la moitié de ce manuscrit.—Stendhal a écrit à ce sujet, au verso du fol. 362, la note suivante: «Non laisser cela tel quel. Dorer l'histoire Kably, peut-être ennuyeuse pour les Pasquier de 51 ans. Ces gens sont cependant l'élite des lecteurs.»
[11] ... (mais je vois de Rome, à cinquante-deux ans) ...—Ms.: «26 X 2.»
[12] ... par quelque dicton ...—Variante: «Lieu commun.»
[13] Je faillis me trouver mal ...—Variante: «Tomber.»
[14] ...elle était, je croie, en K'—Suit un plan de la scène. En outre, au verso du fol. 366, plan du Jardin-de-Ville et de ses abords. Stendhal se trouvait sur la terrasse. Il note à ce sujet: «J'ai laissé à Grenoble un petit tableau à l'huile de M. Le Roy, qui rend fort bien cette promenade-ci.» Mlle Kably se trouvait dans l'allée qui longeait la rue du Quai (aujourd'hui rue Hector-Berlioz). A cette époque, un mur séparait le jardin de la rue: «Mur en 1794, bêtement remplacé par une belle grille vers 1814.»
—Ce mur est appelé par Stendhal «mur de l'Intendance», parce que le rez-de-chaussée de l'Hôtel-de-Ville fut occupé, jusqu'à la Révolution, par les bureaux de l'intendant de la province.]
[15] ... un soir, à 7 heures, à ... en Lusace ...—Le nom est en blanc.
[16] Je trouve ...—Variante: «J'ai.»
[17] ... mes sensations du temps de Mlle Kably ...—Variante: «Mes sensations d'alors.»
[18] ... pédants gagés et jésuites ...—Ms.: «Tejê.»
[19] ... chez M. Peroult, corsia del Giardino.-Peut-être tout le feuillet 370 est-il mal placé, mais la fadeur de l'amour Kably doit être relevée par une pensée plus substantielle. (Note de Stendhal.)
Mais revenons à Mlle Kably. Que j'étais loin de l'envie, et de songer à craindre l'imputation d'envie, et de songer aux autres de quelque façon que ce fût dans ce temps-là! La vie commençait pour moi.
Il n'y avait qu'un être au monde: Mlle Kably; qu'un événement: devait-elle jouer ce soir-là, ou le lendemain?
Quel désappointement quand elle ne jouait pas, et qu'on donnait quelque tragédie!
Quel transport de joie pure, tendre, triomphante, quand je lisais son nom sur l'affiche! Je la vois encore, cette affiche, sa forme, son papier, ses caractères.
J'allais successivement lire ce nom chéri à trois ou[p. 274] quatre des endroits auxquels on affichait: à la porte des Jacobins[2], à la voûte du Jardin[3], à l'angle[4] de la maison de mon grand-père. Je ne lisais pas seulement son nom, je me donnais le plaisir de relire toute l'affiche. Les caractères un peu usés du mauvais imprimeur qui fabriquait cette affiche devinrent chers et sacrés pour moi, et, durant de longues années, je les ai aimés, mieux que de plus beaux[5].
Même, je me rappelle ceci: en arrivant à Paris, en novembre 1799, la beauté des caractères me choqua; ce n'étaient plus ceux qui avaient imprimé le nom de Kably[6].
Elle partit, je ne puis dire l'époque. Pendant longtemps je ne pus plus aller au spectacle. J'obtins d'apprendre la musique, ce ne fut pas sans peine: la religion de mon père était choquée d'un art si profane, et mon grand-père n'avait pas le plus petit goût pour cet art.
Je pris un maître de violon, nommé Mention, l'homme le plus plaisant: c'était là l'ancienne gaieté française mêlée de bravoure et d'amour. Il était fort pauvre, mais il avait le cœur d'artiste; un jour que je jouais plus mal qu'à l'ordinaire, il ferma le cahier, disant: «Je ne donne plus leçon.»
J'allai chez un maître de clarinette, nommé Hoffmann (rue de Bonne), bon allemand; je jouais un peu moins mal. Je ne sais comment je quittai ce maître pour passer chez M. Holleville, rue Saint-Louis,[p. 275] vis-à-vis Mme Barthélemy, notre cordonnière. Violon fort passable, il était sourd, mais distinguait la moindre fausse note. Je me rencontrais là avec M. Félix Faure (aujourd'hui pair de France, Premier Président, jugeur d'août 1835). Je ne sais comment je quittai Holleville.
Enfin, j'allai prendre leçon de musique vocale, à l'insu de mes parents, à six heures du matin, place Saint-Louis, chez un fort bon chanteur.
Mais rien n'y faisait: j'avais horreur tout le premier des sons que je produisais. J'achetais des airs italiens, un, entre autres, où je lisais Amore, ou je ne sais quoi, nello cimento: je comprenais: dans le ciment, dans le mortier. J'adorais ces airs italiens auxquels je ne comprenais rien. J'avais commencé trop tard. Si quelque chose eût été capable de me dégoûter de la musique, c'eût été les sons exécrables qu'il faut produire pour l'apprendre. Le seul piano eût pu me faire tourner la difficulté, mais j'étais né dans une famille essentiellement inharmonique.
Quand, dans la suite, j'ai écrit sur la musique, mes amis m'ont fait une objection principale de cette ignorance. Mais je dois dire sans affectation aucune qu'au même moment je sentais dans le morceau qu'on exécutait des nuances qu'ils n'apercevaient pas. Il en est de même pour les nuances des physionomies dans les copies du même tableau. Je vois ces choses aussi clairement qu'à travers un[p. 276] cristal. Mais, grand Dieu! on va me croire un sot!
Quand je revins à la vie après quelques mois de l'absence de Mlle Kably, je me trouvai un autre homme.[7]
Je ne haïssais plus Séraphie, je l'oubliais; quant à mon père, je ne désirais qu'une chose: ne pas me trouver auprès de lui. J'observai, avec remords, que je n'avais pas pour lui une goutte de tendresse ni d'affection.
Je suis donc un monstre, me disais-je. Et pendant de longues années je n'ai pas trouvé de réponse à cette objection. On parlait sans cesse et à la nausée de tendresse dans ma famille. Ces braves gens appelaient tendresse la vexation continue dont ils m'honoraient depuis cinq ou six ans. Je commençai à entrevoir qu'ils s'ennuyaient mortellement et qu'ayant trop de vanité pour reprendre avec le monde, qu'ils avaient imprudemment quitté à l'époque d'une perte cruelle, j'étais leur[8] ressource contre l'ennui.
Mais rien ne pouvait plus m'émouvoir après ce que je venais de sentir. J'étudiai ferme le latin et le dessin, et j'eus un premier prix, je ne sais dans lequel de ces deux cours, et un second. Je traduisis avec plaisir la Vie d'Agricola de Tacite, ce fut presque la première fois que le latin me causa quelque plaisir. Ce plaisir était gâté amèrement par les taloches que me donnait le grand Odru, gros[p. 277] et ignare paysan de Lumbin, qui étudiait avec nous et ne comprenait rien à rien. Je me battais ferme avec Giroud, qui avait un habit rouge. J'étais encore un enfant pour une grande moitié de mon existence.
Et toutefois, la tempête morale à laquelle j'avais été en proie durant plusieurs mois m'avait mûri, je commençai à me dire sérieusement:
«Il faut prendre un parti et me tirer de ce bourbier.»
Je n'avais qu'un moyen au monde: les mathématiques. Mais on me les expliquait si bêtement que je ne faisais aucun progrès; il est vrai que mes camarades en faisaient encore moins, s'il est possible. Ce grand M. Dupuy nous expliquait les propositions comme une suite de recettes pour faire du vinaigre[8].
Cependant, Bezout était ma seule ressource pour sortir de Grenoble. Mais Bezout était si bête! C'était une tête comme celle de M. Dupuy, notre emphatique professeur.
Mon grand-père connaissait un bourgeois à tête étroite, nommé Chabert, lequel montrait les mathématiques en chambre. Voilà le mot du pays et qui va parfaitement à l'homme. J'obtins avec assez de peine d'aller dans cette chambre de M. Chabert; on avait peur d'offenser M. Dupuy, et d'ailleurs il fallait payer douze francs par mois, ce me semble.
Je répondis que la plupart des élèves du cours de mathématiques, à l'École centrale, allaient chez[p. 278] M. Chabert, et que si je n'y allais pas je resterais le dernier à l'École centrale. J'allai donc chez M. Chabert. M. Chabert était un bourgeois assez bien mis, mais qui avait toujours l'air endimanché et dans les transes de gâter son habit et son gilet et sa jolie culotte de Casimir merde d'oie; il avait aussi une assez jolie figure bourgeoise. Il logeait rue Neuve[9], près la rue Saint-Jacques et presque en face de Bourbon, marchand de fer, dont le nom me frappait, car ce n'était qu'avec les signes du plus profond respect et du plus véritable dévouement que mes bourgeois de parents prononçaient ce nom. On eût dit que la vie de la France y eût été attachée.
Mais je retrouvai chez M. Chabert ce manque de faveur qui m'assommait à l'École centrale et ne me faisait jamais appeler au tableau. Dans une petite pièce et au milieu de sept à huit élèves réunis autour d'un tableau de toile cirée, rien n'était plus disgracieux que de demander à monter au tableau, c'est-à-dire à aller expliquer pour la cinquième ou sixième fois une proposition que quatre ou cinq élèves avaient déjà expliquée. C'est cependant ce que j'étais obligé de faire quelquefois chez M. Chabert, sans quoi je n'eusse jamais démontré. M. Chabert me croyait un minus habens et est resté dans cette abominable opinion. Rien n'était drôle, dans la suite, comme de l'entendre parler de mes succès en mathématiques.
Mais dans ces commencements ce fut un étrange manque de soin et, pour mieux dire, d'esprit, de la part de mes parents, de ne pas demander si j'étais en état de démontrer, et combien de fois par semaine je montais au tableau; ils ne descendaient pas dans ces détails. M. Chabert, qui faisait profession d'un grand respect pour M. Dupuy, n'appelait guère au tableau que ceux qui y parvenaient[10] à l'École centrale. Il y avait un certain M. de Renneville, que M. Dupuy appelait au tableau comme noble et comme cousin des Monval; c'était une sorte d'imbécile presque muet et les yeux très ouverts; j'étais choqué à déborder quand je voyais M. Dupuy et M. Chabert le préférer à moi.
J'excuse M. Chabert, je devais être le petit garçon le plus présomptueux et le plus méprisant. Mon grand-père et ma famille me proclamaient une merveille: n'y avait-il pas cinq ans qu'ils me donnaient tous leurs soins?
M. Chabert était, dans le fait, moins ignare que M. Dupuy. Je trouvai chez lui Euler et ses problèmes sur le nombre d'œufs qu'une paysanne apportait au marché, lorsqu'un méchant lui en vole un cinquième, puis elle laisse toute la moitié du reste, etc., etc.
Cela m'ouvrit l'esprit, j'entrevis ce que c'était que se servir de l'instrument nommé algèbre. Du diable si personne me l'avait jamais dit, sans cesse M. Dupuy faisait des phrases emphatiques sur ce[p. 280] sujet, mais jamais ce mot simple: c'est une division du travail qui produit des prodiges, comme toutes les divisions du travail, et permet à l'esprit de réunir toutes ses forces sur un seul côté des objets, sur une seule de leurs qualités.
Quelle différence pour nous si M. Dupuy nous eût dit: Ce fromage est mou, ou il est dur; il est blanc, il est bleu; il est vieux, il est jeune; il est à moi, il est à toi; il est léger, ou il est lourd. De tant de qualités ne considérons absolument que le poids. Quel que soit ce poids, appelons-le A. Maintenant, sans plus penser absolument au fromage, appliquons à A tout ce que nous savons des quantités.
Cette chose si simple, personne ne nous la disait dans cette province reculée; depuis cette époque, l'École polytechnique et les idées de Lagrange auront reflété vers la province.
Le chef-d'œuvre de l'éducation de ce temps-là était un petit coquin vêtu de vert, doux, hypocrite, gentil, qui n'avait pas trois pieds de haut et apprenait par cœur les propositions que l'on démontrait, mais sans s'inquiéter s'il les comprenait le moins du monde[11]. Ce favori de M. Chabert non moins que de M. Dupuy s'appelait, si je ne me trompe, Paul-Émile Teisseire. L'examinateur pour l'École polytechnique, frère du grand géomètre, qui a écrit cette fameuse sottise (au commencement de la Statique), ne s'aperçut pas que tout le mérite de Paul-Émile était une mémoire étonnante.
Il arriva à l'École; son hypocrisie complète, sa mémoire et sa jolie figure de fille n'y eurent pas le même succès qu'à Grenoble; il en sortit bien officier, mais bientôt fut touché de la grâce et se fit prêtre. Malheureusement, il mourut de la poitrine: j'aurais suivi de l'œil sa fortune avec plaisir. J'avais quitté Grenoble avec une envie démesurée de pouvoir un jour, à mon aise, lui donner une énorme volée de calottes.
Il me semble que je lui avais déjà donné un à-compte chez M. Chabert, où il me primait avec raison par sa mémoire imperturbable.
Pour lui, il ne se fâchait jamais de rien et passait avec un sang-froid parfait sous les volées de: petit hypocrite, qui lui arrivaient de toutes parts, et qui redoublèrent un jour que nous le vîmes couronné de roses et faisant le rôle d'ange dans une procession.
C'est à peu près le seul caractère que j'aie remarqué à l'École centrale. Il faisait un beau contraste avec le sombre Benoît, que je rencontrai au cours de belles-lettres de M. Dubois-Fontanelle et qui faisait consister la sublime science dans l'amour socratique, que le docteur Clapier, le fou, lui avait enseigné.
Il y a peut-être dix ans que je n'ai pensé à M. Chabert; peu à peu je me rappelle qu'il était effectivement beaucoup moins borné que M. Dupuy, quoiqu'il eût un parler plus traînard encore et une apparence bien plus piètre et bourgeoise.
Il estimait Clairaut et c'était une chose immense que de nous mettre en contact avec cet homme de génie, et nous sortions un peu du plat Bezout. Il avait Bruce, l'abbé Marie, et de temps à autre nous faisait étudier un théorème dans ces auteurs. Il avait même en manuscrit quelques petites choses de Lagrange, de ces choses bonnes pour notre petite portée.
Il me semble que nous travaillions avec une plume sur un cahier de papier et à un tableau de toile cirée[12].
Ma disgrâce s'étendait à tout, peut-être venait-elle de quelque gaucherie de mes parents, qui avaient oublié d'envoyer un dindon, à Noël, à M. Chabert ou à ses sœurs, car il en avait et de fort jolies, et sans ma timidité je leur eusse bien fait la cour. Elles avaient beaucoup de considération pour le petit-fils de M. Gagnon, et d'ailleurs venaient à la messe à la maison, le dimanche.
Nous allions lever des plans au graphomètre et à la planchette; un jour nous levâmes un champ à côté du chemin des Boiteuses[13]. Il s'agit du champ B C D E. M. Chabert fit tirer les lignes à tous les autres sur la planchette, enfin mon tour vint, mais le dernier ou l'avant-dernier, avant un enfant. J'étais humilié et fâché; j'appuyai trop la plume.
«Mais c'était une ligne que je vous avais dit de tirer, dit M. Chabert avec son accent traînard, et c'est une barre que vous avez faite là.»
Il avait raison. Je pense que cet état de défaveur marquée chez MM. Dupuy et Chabert, et d'indifférence marquée chez M. Jay, à l'école de dessin, m'empêcha d'être un sot. J'y avais de merveilleuses dispositions, mes parents, dont la morosité bigote déclamait sans cesse contre l'éducation publique, s'étaient convaincus sans beaucoup de peine qu'avec cinq ans de soins, hélas! trop assidus, ils avaient produit un chef-d'œuvre, et ce chef-d'œuvre, c'était moi.
Un jour, je me disais, mais, à la vérité, c'était avant l'École centrale: Ne serais-je point le fils d'un grand prince, et tout ce que j'entends dire de la Révolution, et le peu que j'en vois, une fable destinée à faire mon éducation, comme dans Émile?
Car mon grand-père, homme d'aimable conversation, en dépit de ses résolutions pieuses, avait nommé Émile devant moi, parlé de la Profession[14] de foi du vicaire savoyard, etc., etc. J'avais volé ce livre à Claix, mais je n'y avais rien compris, pas même les absurdités de la première page, et après un quart d'heure l'avais laissé. Il faut rendre justice au goût de mon père, il était enthousiaste de Rousseau et il en parlait quelquefois, pour laquelle chose et pour son imprudence devant un enfant il était bien grondé de ma tante Séraphie.
[1] Le chapitre XXVI est le chapitre XXII du manuscrit (fol. 372 à 386).—Écrit a Rome, les 3, 4 et 6 janvier 1836.—En face du feuillet commençant le chapitre, on lit: «Treize pages en une heure et demie. Froid du diable. 3 janvier 1836.»
[2] ... à la porte des Jacobins ...—La porte des Jacobins était située place Grenette, à remplacement de l'actuelle rue de la République.
[3] ... à la voûte du Jardin ...—Le Jardin-de-Ville.
[4] ... à l'angle de la maison ...—Stendhal orthographie: «Engle.» Et il ajoute: «Engle, orthographe de la passion, peinture des sons, et rien autre.»
—Au verso du fol. 372 est un plan de la place Grenette et de ses environs, avec les emplacements où étaient collées les affiches théâtrales.]
[5] ... mieux que de plus beaux.—-On lit en haut du fol. 373: «4 janvier 1836. A trois heures, idée de goutte à la main droite, dessus, douleur dans un muscle de l'épaule droite.» Aussi Stendhal n'a-t-il écrit ce jour-là qu'une page et un tiers environ.
[6] ... le nom de Kably.—Les deux tiers du fol. 373 ont été laissés en blanc.
[7] ... j'étais leur ressource ...—Un blanc d'un tiers de ligne.
[8] ... recettes pour faire du vinaigre.—Le fol. 379, qui se termine ici, est aux trois-quarts blanc. On lit en tête du fol. 380, qui suit: «6 janvier 1836. Les Rois. Le froid est revenu et me donne sur les nerfs. Envie de dormir.»
[9] Il logeait rue Neuve ...—Aujourd'hui rue du Lycée. Un plan du carrefour des rues Neuve, Saint-Jacques et de Bonne est dessiné au verso du fol. 380. On y voit l'appartement de M. Chabert, figuré au troisième étage de l'immeuble portant actuellement le n° 15 de la rue du Lycée. A l'angle de la rue de Bonne et de la place Grenette, «ici fut dix ans plus tard la maison bâtie sur mes plans et qui a ruiné mon père».
[10] ... ceux qui y parvenaient ...—Variante: «Montaient.»
[11] ... s'il les comprenait le moins du monde.—La première moitié du fol. 383 a été laissée en blanc.
[12] ... sur un cahier de papier et à un tableau de toile cirée.—Suit un plan de la salle d'études.
[13] ... un jour noue levâmes un champ à côté du chemin des Boiteuses.—Suit un plan explicatif.—Le chemin des Boiteuses allait depuis la porte de Bonne jusqu'au cours de Saint-André. Il est remplacé aujourd'hui par les rues Lakanal et de Turenne. Stendhal y figure, non loin de la porte de Bonne, en «T, maison de ce fou de Camille Teisseire, jacobin qui, en 1811, veut brûler Rousseau et Voltaire»; plus loin, en «A, hôtel de la Bonne Femme; elle est représentée sans tête, cela me frappait beaucoup». Cet établissement, dit de la Femme sans Tête, a subsiste longtemps rue Lakanal; il a disparu il y a une huitaine d'années, en 1905.
[14] ... parlé de la Profession de foi du vicaire savoyard ...—Ms.: «Confession.»
J'avais, et j'ai encore, les goûts les plus aristocrates; je ferais tout pour le bonheur du peuple, mais j'aimerais mieux, je crois, passer quinze jours de chaque mois en prison que de vivre avec les habitants des boutiques.
Vers ce temps-là, je me liai, je ne sais comment, avec François Bigillion[2] (qui depuis s'est tué, je crois, par ennui de sa femme).
C'était un homme simple, naturel, de bonne foi, qui ne cherchait jamais à faire entendre par une réponse ambitieuse qu'il connaissait le monde, les femmes, etc. C'était là notre grande ambition et notre principale fatuité au collège. Chacun de ces marmots voulait persuader à l'autre qu'il avait eu[p. 286] des femmes et connaissait le monde; rien de pareil chez le bon Bigillion. Nous faisions de longues promenades ensemble, surtout vers la tour de Rabot et la Bastille. La vue magnifique dont on jouit de là, surtout vers Eybens, derrière lequel apparaissent les plus hautes Alpes, élevait notre âme. Rabot et la Bastille sont le premier une vieille tour, la seconde une maisonnette, situées à deux hauteurs bien différentes[3], sur la montagne qui enferme l'enceinte de la ville, fort ridicule en 1795, mais que l'on rend bonne en 1836[4].
Dans ces promenades nous nous faisions part, avec toute franchise, de ce qui nous semblait de cette foret terrible, sombre et délicieuse, dans laquelle nous étions sur le point d'entrer. On voit qu'il s'agit de la société et du monde.
Bigillion avait de grands avantages sur moi:
1° Il avait vécu libre depuis son enfance, fils d'un père qui ne l'aimait point trop, et savait s'amuser autrement qu'en faisant de son fils sa poupée.
2° Ce père, bourgeois de campagne fort aisé, habitait Saint-Ismier, village situé à une porte de Grenoble, vers l'Est, dans une position fort agréable dans la vallée de l'Isère. Ce bon campagnard, amateur du vin, de la bonne chère et des Fauchons paysannes, avait loué un petit appartement à Grenoble pour ses deux fils qui y faisaient leur éducation. L'aîné se nommait Bigillion, suivant l'usage de notre province, le cadet Rémy, humoriste,[p. 287] homme singulier, vrai Dauphinois, mais généreux, un peu jaloux, même alors, de l'amitié que Bigillion et moi avions l'un pour l'autre.
Fondée sur la plus parfaite bonne foi, cette amitié fut intime au bout de quinze jours. Il avait pour oncle un moine savant et, ce me semble, très peu moine, le bon Père Morlon, bénédictin peut-être, qui, dans mon enfance, avait bien voulu, par amitié pour mon grand-père, me confesser une ou deux fois. J'avais été bien surpris de son ton de douceur et de politesse, bien différent de l'âpre pédantisme des cuistres morfondus, auxquels mon père me livrait le plus souvent, tels que M. l'abbé Rambault.
Ce bon Père Morlon a eu une grande influence sur mon esprit; il avait Shakespeare traduit par Letourneur, et son neveu Bigillion emprunta pour moi, successivement, tous les volumes de cet ouvrage considérable[5] pour un enfant, dix-huit ou vingt volumes.
Je crus renaître en le lisant. D'abord, il avait l'immense avantage de n'avoir pas été loué et prêché par mes parents, comme Racine. Il suffisait qu'ils louassent une chose de plaisir pour me la faire prendre en horreur.
Pour que rien ne manquât au pouvoir de Shakespeare sur mon cœur, je crois même que mon père m'en dit du mal.
Je me méfiais de ma famille sur toutes choses[6];[p. 288] mais en fait de beaux-arts ses louanges suffisaient pour me donner un dégoût mortel pour les plus belles choses. Mon cœur, bien plus avancé que l'esprit [7], sentait vivement qu'elle les louait comme les kings louent aujourd'hui la religion[8], c'est-à-dire avec une seconde foi. Je sentais bien confusément, mais bien vivement et avec un feu que je n'ai plus, que tout beau moral, c'est-à-dire d'intérêt dans l'artiste, tue tout ouvrage d'art. J'ai lu continuellement Shakespeare de 1796 à 1799. Racine, sans cesse loué par mes parents, me faisait l'effet d'un plat hypocrite. Mon grand-père m'avait conté l'anecdote de sa mort pour n'avoir plus été regardé par Louis XIV. D'ailleurs, les vers m'ennuyaient comme allongeant la phrase et lui faisant perdre de sa netteté. J'abhorrais coursier au lieu de cheval. J'appelais cela de l'hypocrisie.
Comment, vivant solitaire dans le sein d'une famille parlant fort bien, aurais-je pu sentir le langage plus ou moins noble? Où aurais-je pris le langage non élégant?
Corneille me déplaisait moins. Les auteurs qui me plaisaient alors à la folie furent Cervantès, Don Quichotte, et l'Arioste (tous les trois traduits), dans des traductions. Immédiatement après venait Rousseau, qui avait le double défaut (drawback) de louer les prêtres et d'être loué par mon père. Je lisais avec délices les Contes de La Fontaine et Félicia. Mais ce n'étaient pas des plaisirs littéraires. Ce[p. 289] sont de ces livres qu'on ne lit que d'une main, comme disait Mme * * *[9].
Quand, en 1824, au moment de tomber amoureux de Clémentine, je m'efforçais de ne pas laisser absorber mon âme par la contemplation de ses grâces (je me souviens d'un grand combat, un soir, au concert de M. du Bignon, où j'étais à côté du célèbre général Foy; Clémentine, ultra, n'allait pas dans cette maison), quand, dis-je, j'écrivis Racine et Shakespeare, on m'accusa de jouer la comédie et de renier mes premières sensations d'enfance, on voit combien était vrai, ce que je me gardai de dire (comme incroyable), que mon premier amour avait été pour Shakespeare, et entre autres pour Hamlet et Roméo et Juliette.
Les Bigillion habitaient rue Chenoise (je ne suis pas sûr du nom [10]), cette rue qui débouchait entre la voûte de Notre-Dame et une petite rivière sur laquelle était bâti le couvent des Augustins. Là était un fameux bouquiniste que je visitais souvent. Au-delà était l'oratoire où mon père avait été en prison[11] quelques jours avec M. Colomb[12], père de Romain Colomb, le plus ancien de mes amis (en 1836)[13].
Dans cet appartement, situé au troisième étage, vivait avec les Bigillion leur sœur, Mlle Victorine Bigillion, fort simple, fort jolie, mais nullement d'une beauté grecque; au contraire, c'était une[p. 290] figure profondément allobroge[14]. Il me semble qu'on appelle cela aujourd'hui la race Galle. (Voir le Dr Edwards et M. Antoine de Jussieu; c'est du moins ce dernier qui m'a fait croire à cette classification.)
Mademoiselle Victorine avait de l'esprit et réfléchissait beaucoup; elle était la fraîcheur même. Sa figure était parfaitement d'accord avec les fenêtres à croisillons de l'appartement qu'elle occupait avec ses deux frères, sombre quoique au midi et au troisième étage; mais la maison vis-à-vis était énorme. Cet accord parfait me frappait, ou plutôt j'en sentais l'effet, mais je n'y comprenais rien.
Là, souvent j'assistais au souper des deux frères et de la sœur. Une servante de leur pays, simple comme eux, le leur préparait, ils mangeaient du pain bis, ce qui me semblait incompréhensible, à moi qui n'avais jamais mangé que du pain blanc.
Là était tout mon avantage à leur égard; à leurs yeux, j'étais d'une classe supérieure: le petit-fils[15] de M. Gagnon, membre du jury de l'École centrale, était noble et eux, bourgeois tendant au paysan. Ce n'est pas qu'il y eut chez eux regret ni sotte admiration; par exemple, ils aimaient mieux le pain bis que le pain blanc, et il ne dépendait que d'eux de faire bluter leur farine pour avoir du pain blanc[16].
Nous vivions là en toute innocence, autour de cette table de noyer couverte d'une nappe de toile écrue, Bigillion, le frère aîné, 14 ou 15 ans, Rémy 12, Mlle Victorine 13, moi 13, la servante 17.
Nous formions une société bien jeune[17], comme on voit, et aucun grand parent pour nous gêner. Quand M. Bigillion, le père, venait à la ville pour un jour ou deux, nous n'osions pas désirer son absence, mais il nous gênait.
Peut-être bien avions-nous tous un an de plus, mais c'est tout au plus, mes deux dernières années 1799 et 1798 furent entièrement absorbées par les mathématiques et Paris au bout; c'était donc 1797 ou plutôt 1796, or en 1796 j'avais treize ans[18].
Nous vivions alors comme de jeunes lapins jouant dans un bois tout en broutant le serpolet. Mlle Victorine était la ménagère; elle avait des grappes de raisin séché dans une feuille de vigne serrée par un fil, qu'elle me donnait et que j'aimais presque autant que sa charmante figure. Quelquefois, je lui demandais une seconde grappe, et souvent elle me refusait, disant: «Nous n'en avons plus que huit, et il faut finir la semaine.»
Chaque semaine, une ou deux fois, les provisions venaient de Saint-Ismier. C'est l'usage à Grenoble. La passion de chaque bourgeois est son domaine, et il préfère une salade qui vient de son domaine à Montbonnot, Saint-Ismier, Corenc, Voreppe, Saint-Vincent ou Claix, Echirolles, Eybens, Domène, etc.,[p. 292] et qui lui revient[19] à quatre sous, à la même salade achetée deux sous à la place aux Herbes. Ce bourgeois avait 10.000 francs placés au 5% chez les Périer (père et cousin de Casimir, ministre en 1832), il les place en un domaine qui lui rend le 2 ou le 2 1/2, et il est ravi. Je pense qu'il est payé en vanité et par le plaisir de dire d'un air important: Il faut que j'aille à Montbonnot, ou: Je viens de Montbonnot.
Je n'avais pas d'amour pour Victorine, mon cœur était encore tout meurtri du départ de Mlle Kably et mon amitié pour Bigillion était si intime qu'il me semble que, d'une façon abrégée, de peur du rire, j'avais osé lui confier ma folie.
Il ne s'en était point effarouché, c'était l'être le meilleur et le plus simple, qualités précieuses qui allaient[20] réunies avec le bon sens le plus fin, bon sens caractéristique de cette famille et qui était fortifié chez lui par la conversation de Rémy, son frère et son ami intime, peu sensible, mais d'un bon sens bien autrement inexorable. Rémy passait souvent des après-midi entières sans desserrer les dents.
Dans ce troisième étage passèrent les moments les plus heureux de ma vie. Peu après, les Bigillion quittèrent cette maison pour aller habiter à la Montée du Pont-de-Bois; ou plutôt c'est tout le contraire, du Pont-de-Bois ils vinrent dans la rue Chenoise, ce me semble, certainement celle à laquelle[p. 293] aboutit la rue du Pont-Saint-Jaime. Je suis sûr de ces trois fenêtres à croisillons, en B[21], et de leur position à l'égard de la rue du Pont-Saint-Jaime. Plus que jamais je fais des découvertes en écrivant ceci (à Rome, en janvier 1836). J'ai oublié aux trois-quarts ces choses, auxquelles je n'ai pas pensé six fois par an depuis vingt ans.
J'étais fort timide envers Victorine, dont j'admirais la gorge naissante, mais je lui faisais confidence de tout, par exemple les persécutions de Séraphie, dont j'échappais à peine, et je me souviens qu'elle refusait de me croire, ce qui me faisait une peine mortelle. Elle me faisait entendre que j'avais un mauvais caractère.
[1] Le chapitre XXVII est le chapitre XXIII du manuscrit (fol. 387 à 398).—Écrit à Rome, les 6 et 10 janvier 1836.
[2] Vers ce temps-là, je me liai ... avec François Bigillion ...—C'est par l'intermédiaire de Romain Colomb, qui s'était lié avec les deux frères, pour les avoir rencontrés dans la maison Faure, lors de leur arrivée à Grenoble. (Note au crayon de R. Colomb.)
[3] Rabot et la Bastille sont ... situes à des hauteurs bien différentes ...—Le fort Rabot est à l'altitude de 270 mètres environ, et la plateforme de la Bastille à 470 mètres.
[4] ... mais que l'on rend bonne en 1836.—On lit en tête du fol. 389: «10 janvier 1836. Le métier m'a occupé depuis huit jours. Froid du diable, 6 degrés le lundi.»
[5] ... cet ouvrage considérable ...—Variante: «Grand.»
[6] ... sur toutes choses ...—Variante: «Sur tous les objets.»
[7] ... bien plus avancé que l'esprit ...—Variante: «Ma tête.»
[8] ... louent aujourd'hui la religion ...—Ms.: «Gionreli.»
[9] ... comme disait Mme ***.—Duclos.
[10] Les Bigillion habitaient rue Chenoise (je ne suis pas sûr du nom) ...—Il s'agit, en effet, de la rue Chenoise.
[11] ... l'oratoire où mon père avait été en prison ...—Erreur; son père a pu se cacher, mais n'a jamais été en prison, surtout à l'Oratoire, où il n'y avait que des femmes et trois enfants: les deux Monval et moi. Le guichetier, dur et renfrogné, s'appelait Pilon. (Note au crayon de R. Colomb.)
[12] ... avec M. Colomb ...—M. Colomb père a fait toute sa prison à la Conciergerie, place Saint-André; j'ai couché quelquefois avec lui, dans cette prison. (Note au crayon de R. Colomb.)
[13] ... Romain Colomb, le plus ancien de mes amis.—Stendhal écrit ensuite: «Voici cette rue, dont le nom est à peu près effacé, mais non l'aspect.» Et il dessine au-dessous un plan de la partie de la ville où se trouvait la rue Chenoise.—-La maison où logeaient les Bigillion se trouvait entre la Montée du Pont de Bois (aujourd'hui rue de Lionne) et la rue du Pont-Saint-Jaime.
[14] ... c'était une figure profondément allobroge.—Elle était plutôt laide que jolie, mais piquante et bonne fille; Victorine jouait avec nous, sans se douter que nous appartenions à des sexes différents. (Note au crayon de R. Colomb.)
[15] ... le petit-fils de M. Gagnon ...—Ms.: «Le fils.»
[16] ... faire bluter leur farine pour avoir du pain blanc.—En face, au verso du fol. 393, est un plan des environs de la maison où logeaient les Bigillion, ainsi qu'un croquis représentant le Pont-de-Bois, situé au bout de la Montée du Pont-de-Bois. Stendhal note à ce sujet: «J'ai laissé à Grenoble une vue du pont de Bois, achetée par moi à la veuve de M. Le Roy. Elle est à l'huile et sbiadita, doucereuse, à la Dorat, à la Florian, mais enfin c'est ressemblant quant aux lignes; les couleurs seules sont adoucies et florianisées».
[17] Nous formions une société bien jeune ...—Variante: «C'était un ménage bien jeune.»
[18] ... en 1796 j'avais treize ans.—Ms.: «10 + 3.»
[19] ... qui lui revient à quatre sous ...—Variante: «Qui lui coûte.»
[20] ... qualités précieuses qui allaient ...—Un blanc d'une demi-ligne.
[21] Je suis sûr de ces trois fenêtres à croisillons, en B ...—Cette référence se rapporte au plan cité plus haut.
Le sévère Rémy aurait vu de fort mauvais œil que je fisse la cour à sa sœur, Bigillion me le fit entendre et ce fut le seul point sur lequel il n'y eut pas franchise parfaite entre nous. Souvent, vers la tombée de la nuit, après la promenade, comme je faisais mine de monter chez Victorine, je recevais un adieu hâtif qui me contrariait fort. J'avais besoin d'amitié et de parler avec franchise, le cœur ulcéré par tant de méchancetés, dont, à tort ou à raison, je croyais fermement avoir été l'objet.
J'avouerai pourtant que cette conversation toute simple, je préférais de beaucoup l'avoir avec Victorine qu'avec ses frères. Je vois aujourd'hui mon sentiment d'alors, il me semblait incroyable de voir[p. 296] de si près cet animal terrible, une femme, et encore avec des cheveux superbes, un bras divinement fait quoique un peu maigre, et enfin une gorge charmante, souvent un peu découverte à cause de l'extrême chaleur. Il est vrai qu'assis contre la table de noyer, à deux pieds de Mlle Bigillion, l'angle de la table entre nous, je ne parlais aux frères que pour être bien sage. Mais pour cela je n'avais aucune envie d'être amoureux, j'étais scolato (brûlé, échaudé), comme on dit en italien, je venais d'éprouver que l'amour était une chose sérieuse et terrible. Je ne me disais pas, mais je sentais fort bien qu'au total mon amour pour Mlle Kably m'avait probablement causé plus de peines que de plaisirs.
Pendant ce sentiment pour Victorine, tellement innocent en paroles et même en idées, j'oubliais de haïr et surtout de croire qu'on me haïssait.
Il me semble qu'après un certain temps la jalousie fraternelle de Rémy se calma; ou bien il alla passer quelques mois à Saint-Ismier. Il vit peut-être que réellement je n'aimais pas, ou eut quelque affaire à lui; nous étions tous des politiques de treize ou quatorze ans. Mais dès cet âge on est très fin en Dauphiné, nous n'avons ni l'insouciance ni le... [2] du gamin de Paris, et de bonne heure les passions s'emparent de nous. Passions pour des bagatelles, mais enfin le fait est que nous désirons passionnément.
Enfin, j'allais bien cinq fois la semaine, à partir[p. 297] de la tombée de la nuit ou sing[3] (cloche de neuf heures, sonnée à Saint-André), passer la soirée chez Mlle Bigillion.
Sans parler nullement de l'amitié qui régnait entre nous, j'eus l'imprudence de nommer cette famille, un jour, en soupant avec mes parents. Je fus sévèrement puni de ma légèreté. Je vis mépriser, avec la pantomime la plus expressive, la famille et le père de Victorine.
«N'y a-t-il pas une fille? Ce sera quelque demoiselle de campagne.»
Je ne me rappelle que faiblement les termes d'affreux mépris et la mine de froid dédain qui les accompagnait. Je n'ai mémoire que pour l'impression brûlante que fit sur moi ce mépris.
Ce devait être absolument l'air de mépris froid et moqueur que M. le baron des Adrets employait sans doute en parlant de ma mère ou de ma tante.
Ma famille, malgré l'état de médecin et d'avocat, se croyait être sur le bord de la noblesse, les prétentions de mon père n'allaient même à rien moins que celles de gentilhomme déchu. Tout le mépris qu'on exprima, ce soir-là, pendant tout le souper, était fondé sur l'état de bourgeois de campagne de M. Bigillion, père de mes amis, et sur ce que son frère cadet, homme très fin, était directeur de la prison départementale, place Saint-André, une sorte de geôlier bourgeois.
Cette famille avait reçu saint Bruno à la Grande-Chartreuse[p. 298] en....[4]. Rien n'était mieux prouvé, cela était autrement respectable que la famille B[ey]le, juge du village de Sassenage sous les seigneurs du moyen-âge. Mais le bon Bigillion père, homme de plaisir, fort aisé dans son village, ne dînait point chez M. de Marcieu ou chez Mme de Sassenage et saluait le premier mon grand-père du plus loin qu'il l'apercevait, et, de plus, parlait de M. Gagnon avec la plus haute considération.
Cette sortie de hauteur amusait une famille qui, par habitude, mourait d'ennui, et dans tout le souper j'avais perdu l'appétit en entendant traiter ainsi mes amis. On me demanda ce que j'avais. Je répondis que j'avais goûté fort tard. Le mensonge est la seule ressource de la faiblesse. Je mourais de colère contre moi-même: quoi! j'avais été assez sot pour parler à mes parents de ce qui m'intéressait?
Ce mépris me jeta dans un trouble profond; j'en vois le pourquoi en ce moment, c'était Victorine. Ce n'était donc pas avec cet animal terrible, si redouté, mais si exclusivement adoré, une femme comme il faut et jolie, que j'avais le bonheur de faire, chaque soir, la conversation presque intime?
Au bout de quatre ou cinq jours de peine cruelle, Victorine l'emporta, je la déclarai plus aimable et plus du monde que ma famille triste, ratatinée (ce fut mon mot), sauvage, ne donnant jamais à souper, n'allant jamais dans un salon où il y eût dix personnes,[p. 299] tandis que Mlle Bigillion assistait souvent chez M. Faure, à Saint-Ismier, et chez les parents de sa mère, à Chapareillan, à des dîners de vingt-cinq personnes. Elle était même plus noble, à cause de la réception de saint Bruno, en 1080[5].
Bien des années après, j'ai vu le mécanisme de ce qui se passa alors dans mon cœur et, faute d'un meilleur mot, je l'ai appelé cristallisation (mot qui a si fort choqué ce grand littérateur, ministre de l'Intérieur en 1833, M. le comte d'Argout, scène plaisante racontée par Clara Gazul[6]).
Cette absolution du mépris dura bien cinq ou six jours, pendant lesquels je ne songeais à autre chose. Cette insulte si glorieusement mince mit un fait nouveau entre Mlle Kably et mon état actuel. Sans que mon innocence s'en doutât, c'était un grand point: entre le chagrin et nous il faut mettre des faits nouveaux, fût-ce de se casser le bras.
Je venais d'acheter un Bezout d'une bonne édition, et de le faire relier avec soin (peut-être existe-t-il encore à Grenoble, chez M. Alexandre Mallein, directeur des Contributions); j'y traçai une couronne de feuillage, et au milieu un V majuscule[7]. Tous les jours je regardais ce monument.
Après la mort de Séraphie j'aurais pu, par besoin d'aimer, me réconcilier avec ma famille; ce trait de hauteur mit Victorine[8] entre eux et moi; j'aurais pardonné l'imputation d'un crime à la famille Bigillion, mais le mépris! Et mon grand-père était[p. 300] celui qui l'avait exprimé avec le plus de grâce, et par conséquent d'effet!
Je me gardai bien de parler à mes parents d'autres amis que je fis à cette époque: MM. Galle, La Bayette...[9]
Galle était fils d'une veuve qui l'aimait uniquement et le respectait, par probité, comme le maître de la fortune; le père devait être quelque vieil officier. Ce spectacle, si singulier pour moi, m'attachait et m'attendrissait. Ah! si ma pauvre mère eût vécu, me disais-je. Si, du moins, j'avais eu des parents dans le genre de madame Galle, comme je les eusse aimés! Mme Galle me respectait beaucoup, comme le petit-fils de M. Gagnon, le bienfaiteur des pauvres, auxquels il donnait des soins gratuits, et même deux livres de bœuf pour faire du bouillon. Mon père était inconnu.
Galle était pâle, maigre, crinche, marqué de petite vérole, d'ailleurs d'un caractère très froid, très modéré, très prudent. Il sentait qu'il était maître absolu de la petite fortune et qu'il ne fallait pas la perdre. Il était simple, honnête, et nullement hâbleur ni menteur. Il me semble qu'il quitta Grenoble et l'École centrale avant moi pour aller à Toulon et entrer dans la marine.
C'était aussi à la marine que se destinait l'aimable La Bavette, neveu ou parent de l'amiral[p. 301] (c'est-à-dire contre-amiral ou vice-amiral) Morard de Galles.
Il était aussi aimable et aussi noble que Galle était estimable. Je me souviens encore des charmantes après-midi que nous passions, devisant ensemble à la fenêtre de sa petite chambre. Elle était au troisième étage d'une maison donnant sur la nouvelle place du Département[10]. Là, je partageais son goûter: des pommes et du pain bis. J'étais affamé de toute conversation sincère et sans hypocrisie. A ces deux mérites, communs à tous mes amis, La Bavette joignait une grande noblesse de sentiments et de manières[11] et une tendresse d'âme non susceptible de passion profonde, comme Bigillion, mais plus élégante dans l'expression.
Il me semble qu'il me donna de bons conseils dans le temps de mon amour pour Mlle Kably, dont j'osai lui parler, tant il était sincère et bon. Nous mettions ensemble toute notre petite expérience des femmes, ou plutôt toute notre petite science puisée dans les romans lus par nous. Nous devions être drôles à entendre.
Bientôt après le départ de ma tante Séraphie, j'avais lu et adoré les Mémoires secrets de Duclos[12], que lisait mon grand-père.
Ce fut, ce me semble, à la salle de mathématiques que je fis la connaissance de Galle et de La Bayette; ce fut certainement là que je pris de l'amitié pour[p. 302] Louis de Barral (maintenant le plus ancien et le meilleur de mes amis; c'est l'être au monde qui m'aime le plus, il n'est aussi, ce me semble, aucun sacrifice que je ne fisse pour lui).
Il était alors fort petit, fort maigre, fort crinche, il passait pour porter à l'excès une mauvaise habitude que nous avions tous, et le fait est qu'il en avait la mine. Mais la sienne était singulièrement relevée par un superbe uniforme de lieutenant du génie, on appelait cela être adjoint du génie; c'eût été un bon moyen d'attacher à la Révolution les familles riches, ou du moins de mitiger leur haine.
Anglès aussi, depuis comte Anglès et préfet de police, enrichi par les Bourbons, était adjoint du génie, ainsi qu'un être subalterne par essence, orné de cheveux rouges et qui s'appelait Giroud, différent du Giroud à l'habit rouge avec lequel je me battais assez souvent. Je plaisantais ferme le Giroud garni d'une épaulette d'or et qui était beaucoup plus grand que moi, c'est-à-dire qui était un homme de dix-huit ans tandis que j'étais encore un bambin de treize ou quatorze. Cette différence de deux ou trois ans est immense au collège, c'est à peu près celle du noble au roturier en Piémont.
Ce qui fit ma conquête net dans Barral, la première fois que nous parlâmes ensemble (il avait alors, ce me semble, pour surveillant Pierre-Vincent Chalvet, professeur d'histoire et fort malade de la[p. 303] sœur aînée de la petite vérole), ce qui donc fit ma conquête dans Barral, ce fut: 1° la beauté de son habit, dont le bleu me parut enchanteur;—2° sa façon de dire ces vers de Voltaire, dont je me souviens encore:
Vous êtes, lui dit-il, l'existence et l'essence,
Simple...[13]
Sa mère, fort grande dame, c'était une Grolée[14], disait mon grand-père avec respect, fut la dernière de son ordre à en porter le costume; je la vois encore près de la statue d'Hercule, au Jardin [15], avec une robe à ramages, c'est-à-dire de satin blanc ornée de fleurs, ladite robe retroussée dans les poches comme ma grand-mère (Jeanne Dupéron, veuve Beyle[16]), avec un énorme chignon poudré et peut-être un petit chien sur le bras. Les petits polissons la suivaient à distance avec admiration, et quant à moi j'étais mené, ou porté, par le fidèle Lambert: je pouvais avoir trois ou quatre ans lors de cette vision. Cette grande dame avait les mœurs de la Chine, M. le marquis de Barrai, sou mari et Président, ou même Premier Président au Parlement, ne voulut point émigrer, ce pourquoi il était honni de ma famille comme s'il eût reçu vingt soufflets.
Le sage M. Destutt de Tracy eût la même idée à Paris et fut obligé de prendre des plans, comme M. de Barral, qui, avant la Révolution, s'appelait M. de Montferrat, c'est-à-dire M. le marquis de[p. 304] Montferrat (prononcez: Monferâ, a très long); M. de Tracy fut réduit à vivre avec les appointements de la place de commis de l'Instruction publique, je crois; M. de Barral avait conservé 20 ou 25.000 francs de rente, dont en 1793 il donnait la moitié ou les deux-tiers non à la patrie, mais à la peur de la guillotine. Peut-être avait-il été retenu en France par son amour pour Mme Brémont, que depuis il épousa. J'ai rencontré M. Brémont fils à l'armée, où il était chef de bataillon, je crois, puis sous-inspecteur des Revues, et toujours homme de plaisir.
Je ne dis pas que son beau-père, M. le Premier Président de Barral (car Napoléon le fit Premier Président en créant les Cours impériales[17]) fût un génie, mais à mes yeux il était tellement le contraire de mon père et avait tant d'horreur de la pédanterie et de froisser l'amour-propre de son fils qu'en sortant de la maison pour aller à la promenade dans les délaissés du Drac,
si le père disait: Bonjour,
le fils répondait Toujours,
le père Oie,
fils Lamproie,
et la promenade se passait ainsi à dire des rimes, et à tâcher de s'embarrasser.
Ce père apprenait à son fils les Satires de Voltaire (la seule chose parfaite, selon moi, qu'ait faite ce grand réformateur).
Ce fut alors que j'entrevis le vrai bon ton, et il fit sur-le-champ ma conquête.
Je comparais sans cesse ce père faisant des rimes et plein d'attentions délicates pour l'amour-propre de ses enfants avec le noir pédantisme du mien. J'avais le respect le plus profond pour la science de M. Gagnon, je l'aimais sincèrement, je n'allais pas jusqu'à me dire:
«Ne pourrait-on pas réunir[18] la science sans bornes de mon grand-père et l'amabilité si gaie et si gentille de M. de Barral?»
Mais mon cœur, pour ainsi dire, pressentait cette idée, qui devait par la suite devenir fondamentale pour moi.
J'avais déjà vu le bon ton, mais à demi défiguré, masqué par la dévotion dans les soirées pieuses où Mme de Vaulserre réunissait, au rez-de-chaussée de l'hôtel des Adrets, M. du Bouchage (pair de France, ruiné), M. de Saint-Vallier (le grand Saint-Vallier), Scipion, son frère. M. de Pina (ex-maire de Grenoble, jésuite[19] profond, 80.000 francs de rente et dix-sept enfants), MM. de Sinard, de Saint-Ferréol, moi, Mlle Bonne de Saint-Vallier (dont les beaux bras blancs et charmants, à la Vénitienne, me touchaient si fort).
Le curé Chélan, M. Barthélemy d'Orbane étaient aussi des modèles. Le Père Ducros avait le ton du génie. (Le mot génie était alors, pour moi, comme le mot Dieu pour les bigots.)
[1] Le chapitre XXVIII est le chapitre XXIII du manuscrit. Stendhal a mis par erreur le chiffre XXIII, au lieu de XXIV, et cette erreur se perpétue jusqu'à la fin de l'ouvrage.—Comprend les fol. 399 à 416.—Écrit à Rome, les 10, 11 et 12 janvier 1836.
[2] ... ni l'insouciance ni le ... du gamin de Paris ...—Le mot est en blanc dans le manuscrit.
[3] ... à partir de la tombée de la nuit ou sing ...—Ms.: «Saint.»
[4] Cette famille avait reçu saint Bruno à la Grande-Chartreuse en ...—La date est en blanc.
[5] ... à cause de la réception de Saint-Bruno, en 1080.—Date: Saint Bruno, mort en 1101 en Calabre. (Note de Stendhal.)—Cette date est exacte, mais c'est en 1084 seulement que saint Bruno vint à Grenoble et fonda la Grande-Chartreuse, dont l'église fut consacrée en 1085.
[6] ... scène plaisante racontée par Clara Gazul.—Le Théâtre de Clara Gazul, de Mérimée, a paru en 1825.—Mérimée est appelé, la plupart du temps, Clara par Stendhal.
[7] ... j'y traçai une couronne de feuillage, et au milieu un V majuscule.—Suit un croquis de cette lettre ornée.—En face, au verso du fol. 403, Stendhal écrit: «Mettre ceci ici, coupé trop net, le placer en son temps, à 1806 ou 10. A l'un de mes voyages (retours) à Grenoble, vers 1806, une personne bien informée me dit que Mlle Victorine était amoureuse. J'enviai fort la personne. Je supposais que c'était Félix Faure. Plus tard, une autre personne me dit: «Mlle Victorine, me parlant de la personne qu'elle a aimé si longtemps, m'a dit: Il n'est peut-être pas beau, mais jamais on ne lui reproche sa laideur ... C'est l'homme qui a eu le plus d'esprit et d'amabilité parmi les jeunes gens de mon temps. En un mot, ajouta cette personne, c'est vous.»—10 janvier 1836.—Lu de Brosses.»
[8] ... ce trait de hauteur mit Victorine ...—Ms.: «Virginie.»—Ce mot est surmonté d'une croix.
[9] MM. Galle, La Bayette ...—Une ligne est restée en blanc après ces deux noms.
[10] ... la nouvelle place du Département.—Près du Jardin-de-Ville. Aujourd'hui place de Gordes. Cette place a été créée en 1791.—Au verso du fol. 406 est un plan de la place et de ses alentours.
[11] ... La Bayette joignait une grande noblesse de sentiments et de manières ...—Nous faisions dans sa chambre des pique-niques, à cinq ou six sous par tête, pour manger ensemble du Mont-d'Or, avec des griches, le tout arrosé d'un petit vin blanc qui nous semblait délicieux. La Bayette avait un charmant caractère: il était aimant et avait beaucoup d'expansion. (Note au crayon de R. Colomb.)
[12] ... les Mémoires secrets de Duclos ...—Les Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV furent publiés en 1791, dix-neuf ans après la mort de Duclos.
[13] Vous êtes, lui dit-il, l'existence et l'essence, Simple ...—On lit en tête du fol. 411: «12 janvier 1836. Omar. Sirocco après trente ou quarante jours de froid infâme ...»
[14] Sa mère, fort grande dame, c'était une Grolée ...—La famille de Grolée était l'une des familles les plus anciennes et les plus estimées du Dauphiné.
[15] ... près de la statue d'Hercule, au Jardin ...—Au Jardin-de-Ville. Au milieu du jardin se trouve une statue du connétable de Lesdiguières sous les traits d'Hercule, attribuée à Jacob Richier. Cette statue, primitivement érigée dans l'île de l'étang du château de Lesdiguières, à Vizille, a été acquise par la Ville de Grenoble en 1740.
[16] ... Jeanne Dupéron, veuve Beyle ...—Jeanne Dupéron, fille de Pierre, banquier à Grenoble, et de Dominique Bérard, épousa le 14 septembre 1734 Pierre Beyle, procureur au Parlement. (Voir Ed. Maignien, La famille de Beyle-Stendhal, notes généalogiques. Grenoble, 1889.)
[17] ... les Cours impériales ...—Ms.: «Royales.»—M. de Barral fut Premier Président depuis 1804 jusqu'en décembre 1815.
[18] Ne pourrait-on pas réunir ...—Variante: «Avoir.»
[19] ... ex-maire de Grenoble, jésuite ...—Ms.: «Tejé.»—Jean-François-Calixte, marquis de Pina, remplaça comme adjoint au maire de Grenoble, en 1816, Joseph-Chérubin Beyle. Il fut nommé maire la même année, resta en fonctions jusqu'au 13 octobre 1818. Puis il fut encore maire de Grenoble entre le 26 août 1824 et la révolution de 1830.
Je ne voyais pas M. de Barral aussi en beau alors, il était la bête noire de mes parents pour avoir émigré.
La nécessité me rendant hypocrite (défaut dont je me suis trop corrigé et dont l'absence m'a tant nui, à Rome[2], par exemple), je citais à ma famille les noms de MM. de La Bayette et de Barrai, mes nouveaux amis.
«La Bayette! bonne famille, dit mon grand-père; son père était capitaine de vaisseau, son oncle, M. de ...[3], Président au Parlement. Pour Montferrat, c'est un plat.»
Il faut avouer qu'un matin, à deux heures du matin, des municipaux, et M. de Barral avec eux,[p. 308] étaient venus pour arrêter M. d'Anthon[4], ancien conseiller au Parlement, qui habitait le premier étage, et dont l'occupation constante était de se promener dans sa grande salle en se rongeant les ongles. Le pauvre diable perdait la vue et de plus était notoirement suspect, comme mon père. Il était dévot jusqu'au fanatisme, mais à cela près point méchant. On trouvait indigne dans M. de Barral d'être venu arrêter un des conseillers jadis ses camarades quand il était Président au Parlement[5].
Il faut convenir[6] que c'était un plaisant animal qu'un bourgeois de France vers 1794, quand j'ai pu commencer à le comprendre, se plaignant amèrement de la hauteur des nobles et entre eux n'estimant un homme absolument qu'à cause de sa naissance. La vertu, la bonté, la générosité n'y faisaient rien; même, plus un homme était distingué, plus fortement ils lui reprochaient le manque de naissance, et quelle naissance!
Vers 1803, quand mon oncle Romain Gagnon vint à Paris et logea chez moi, rue de Nemours, je ne le présentai pas chez Mme de Neuilly; il y avait une raison pour cela: cette dame n'existait pas. Choquée de cette absence de présentation, ma bonne tante Elisabeth dit:
«Il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, autrement Henri aurait mené son oncle chez[p. 309] cette dame; on est bien aise de montrer qu'on n'est pas né sous un chou.»
C'est moi, s'il vous plaît, qui ne suis pas né sous un chou.
Et quand notre cousin Clet, horriblement laid, figure d'apothicaire et, de plus, apothicaire effectif, pharmacien militaire, fut sur le point de se marier en Italie, ma tante Elisabeth répondait au reproche de tournure abominable:
«Il faut convenir que c'est un vrai Margageat, disait quelqu'un.
—A la bonne heure, mais il y a la naissance! Cousin du premier médecin de Grenoble, n'est-ce rien?»
Le caractère de cette excellente[7] fille était un exemple bien frappant de la maxime: Noblesse oblige. Je ne connais rien de généreux, de noble, de difficile qui fût au-dessus d'elle et de son désintéressement[8]. C'est à elle en partie que je dois de bien parler; s'il m'échappait un mot bas, elle disait: «Ah! Henri!» Et sa figure exprimait un froid dédain dont le souvenir me hantait (me poursuivait longtemps).
J'ai connu des familles où l'on parlait aussi bien, mais pas une où l'on parlât mieux que dans la mienne. Ce n'est point à dire qu'on n'y fît pas communément les huit ou dix fautes dauphinoises.
Mais, si je me servais d'un mot peu précis ou prétentieux, à l'instant[9] une plaisanterie m'arrivait,[p. 310] et avec d'autant plus de bonheur, de la part de mon grand-père, que c'étaient à peu près les seules que la piété morose de ma tante Séraphie permît au pauvre homme. Il fallait, pour éviter le regard railleur de cet homme d'esprit, employer la tournure la plus simple et le mot propre, et toutefois il ne fallait pas s'aviser de se servir d'un mot bas.
J'ai vu les enfants, dans les familles riches de Paris, employer toujours la tournure la plus ambitieuse pour arriver au style noble, et les parents applaudir à cet essai d'emphase. Les jeunes Parisiens diraient volontiers coursier au lieu de cheval; de là, leur admiration pour MM. de Salvandy, Chateaubriand, etc.
Il y avait d'ailleurs, en ce temps-là, une profondeur et une vérité de sentiment dans le jeune Dauphinois de quatorze ans que je n'ai jamais aperçues chez le jeune Parisien. En revanche, nous disions: J'étais au Cour-se, où M. Passe-kin (Pasquin) m'a lu une pièce de ver-se, sur le voyage d'Anver-se à Calai-ce.
Ce n'est qu'en arrivant à Paris, en 1799, que je me suis douté qu'il y avait une autre prononciation. Dans la suite, j'ai pris des leçons du célèbre La Rive et de Dugazon pour chasser les derniers restes du parler traînard de mon pays. Il ne me reste plus que deux ou trois mots (côte, kote, au lieu de kaute, petite élévation; le bon abbé Gattel a donc eu toute raison de noter la prononciation dans son bon dictionnaire, chose blâmée dernièrement par un[p. 311] nigaud d'homme de lettres de Paris), et l'accent ferme et passionné du Midi qui, décelant la force du sentiment, la vigueur avec laquelle on aime ou on hait, est, sur-le-champ, singulier et partant voisin du ridicule, à Paris.
C'est donc en disant chose au lieu de chause, cote au lieu de caute, Calai-ce au lieu de Kalai (Calais), que je faisais la conversation avec mes amis Bigillion, La Bavette, Galle, Barral.
Ce dernier venait, ce me semble, de La Tronche chaque matin passer la journée chez Pierre-Vincent Chalvet, professeur d'histoire, logé au collège sous la voûte[10]; vers B, il y avait une assez jolie allée de tilleuls, allée fort étroite, mais les tilleuls étaient vieux et touffus, quoique taillés, la vue était délicieuse; là je me promenais avec Barral, qui venait du point C, très voisin; M. Chalvet, occupé de ses catins, de sa v... et des livres qu'il fabriquait, et de plus le plus insouciant des hommes, le laissait volontiers s'échapper.
Je crois que c'est en nous promenant au point P[11] que nous rencontrâmes Michoud, figure de bœuf, mais homme excellent (qui n'a eu que le tort de mourir ministériel pourri, et conseiller à la Cour royale, vers 1827). Je croirais assez que cet excellent homme croyait que la probité n'est d'obligation qu'entre particuliers et qu'il est toujours permis de trahir ses devoirs de citoyen pour arracher quelque argent au Gouvernement. Je fais une énorme différence[p. 312] entre lui et son camarade Félix Faure; celui-ci est né avec l'âme basse, aussi est-il pair de France et Premier Président de la Cour royale de Grenoble.
Mais quels qu'aient été les motifs du pauvre Michoud pour vendre la patrie aux désirs du Procureur général, vers 1795, c'était le meilleur, le plus naturel, le plus fin, mais le plus simple de cœur des camarades.
Je crois qu'il avait appris à lire avec Barral chez Mlle Chavand, ils parlaient souvent de leurs aventures dans cette petite classe. (Déjà les rivalités, les amitiés, les haines du monde!) Comme je les enviais! Je crois même que je mentis une fois ou deux en laissant entendre à d'autres de mes compagnons que moi aussi j'avais appris à lire chez Mlle Chavand.
Michoud m'a aimé jusqu'à sa mort, et il n'aimait pas un ingrat; j'avais la plus haute estime pour son bon sens et sa bonté. Une autre fois, nous nous donnâmes des coups de poing, et comme il était deux fois plus gros que moi, il me rossa.
Je me reprochai mon incartade, non pas à cause des coups reçus, mais comme ayant méconnu son extrême bonté. J'étais malin et je disais des bons mots qui m'ont valu force coups de poing, et ce même caractère m'a valu, en Italie et en Allemagne, à l'armée, quelque chose de mieux et, à Paris, des critiques acharnées dans la petite littérature.
Quand un mot me vient, je vois sa gentillesse et non sa méchanceté. Je suis toujours surpris de sa portée comme méchanceté, par exemple: C'est Ampère ou A. de Jussieu qui m'ont fait voir la portée du mot à ce faquin de vicomte de La Passe (Cività-Vecchia, septembre 1831 ou 1832): «Oserais-je vous demander votre nom?» que le La Passe ne pardonnera jamais.
Maintenant, par prudence, je ne dis plus ces mots, et, l'un de ces jours, Don Philippe Caetani me rendait cette justice que j'étais l'un des hommes les moins méchants qu'il eût jamais vus, quoique ma réputation fût homme d'infiniment d'esprit, mais bien méchant et encore plus immoral (immoral, parce que j'ai écrit sur les femmes dans l'Amour et parce que, malgré moi, je me moque des hypocrites, corps respectable à Paris, qui le croirait? plus encore qu'à Rome[12]).
Dernièrement, Mme Toldi, de Valle, dit, comme je sortais de chez elle, au prince Caetani:
«Mais c'est M. de S[tendhal], cet homme de tant d'esprit, si immoral.»
Une actrice qui a un bambin[13] du prince Léopold de Syracuse de Naples! Le bon Don Filippo me justifia fort sérieusement du reproche d'immoralité.
Même en racontant qu'un cabriolet jaune vient de passer dans la rue, j'ai le malheur d'offenser mortellement les hypocrites, et même les niais.
Mais au fond, cher lecteur, je ne sais pas ce que je suis: bon, méchant, spirituel, sot. Ce que je sais parfaitement, ce sont les choses qui me font peine ou plaisir, que je désire ou que je hais.
Un salon de provinciaux enrichis, et qui étalent du luxe, est ma bête noire, par exemple. Ensuite, vient un salon de marquis et de grands-cordons de la Légion d'honneur, qui étalent de la morale.
Un salon de huit ou dix personnes dont toutes les femmes ont eu des amants, où la conversation est gaie, anecdotique, et où l'on prend du punch léger à minuit et demi, est l'endroit du monde où je me trouve le mieux; là, dans mon centre, j'aime infiniment mieux entendre parler un autre que de parler moi-même. Volontiers je tombe dans le silence du bonheur et, si je parle, ce n'est que pour payer mon billet d'entrée, mot employé dans ce sens, que j'ai introduit dans la société de Paris; il est comme fioriture (importé par moi) et que je rencontre sans cesse; je rencontre plus rarement, il faut en convenir, cristallisation[14] (voir l'Amour). Mais je n'y tiens pas le moins du monde: si l'on trouve un meilleur mot, plus apparenté, dans la langue, pour la même idée, je serai le premier à y applaudir et à m'en servir.
[1] Le chapitre XXIX est le chapitre XXIV du manuscrit (fol. 416 à 431).—Écrit à Rome, les 12 et 13 janvier 1836.
[2] ... dont l'absence m'a tant nui, à Rome ...—Ms.: «Omar.»
[3] ... son oncle, M. de ...—Le nom a été laissé en blanc.
[4] ... M. d'Anthon ...—Jean-Jacques-Gabriel de Vidaud d'Anthon de La Tour, né le 28 mars 1745, avait été nommé conseiller au Parlement par lettres patentes du 2 juillet 1766.
[5] ... quand il était Président au Parlement.—Le reste du feuillet est blanc, ainsi que tout le fol. 419.
[6] Il faut convenir ...—On lit en tête du fol. 419 bis: «12 janvier 36. Omar.—13 janvier, sans feu après ce froid si long de 3 à 7 degrés.»
[7] ... cette excellente fille...—Variante: «Noble.»
[8] Je ne connais rien de généreux, de noble, de difficile, qui fût au-dessus d'elle et de son désintéressement.—Variante: «Aucun sacrifice n'eût été au-dessus de sa générosité et de son désintéressement.»
[9] ... un mot peu précis ou prétentieux, à l'instant ...—Variante: «Un mot peu précis ou prétendant à l'effet, sur-le-champ.»
[10] ... au collège sous la voûte ...—Aujourd'hui passage du Lycée, allant de la rue du Lycée à la place Jean-Achard, celle-ci occupée à la fin du XVIIIe siècle par les remparts de la ville. Stendhal donne un croquis des lieux. B est l'allée de tilleuls, sur les remparts. (Voir notre plan de Grenoble en 1793.)
[11] Je crois que c'est en nous promenant au point P ...—En face, au verso du fol. 425, est un plan des lieux. A l'extrémité de la rue des Mûriers, qui longeait le rempart et le derrière de l'École centrale est, en «P, commencement de la promenade de vieux tilleuls écourtés (maimed) par la taille;» entre la rue des Mûriers et la promenade, en «L, jardin en contrebas de M. de Plainville, commandant ou adjudant de la place, père de Plainville, l'ami de Barral». (Voir notre plan de Grenoble en 1793.)
[12] ... plus encore qu'à Borne.—Ms.: «Omar.»
[13] Une actrice qui a un bambin ...—Variante: «Bâtard.»
[14] ... il faut en convenir, cristallisation ...—Sorte de folie qui fait voir toutes les perfections et tout tourner à perfection dans l'objet qui fait effet sur la matrice. Il est pauvre, ah! que je l'en aime mieux! Il est riche, ah! que je l'en aime mieux! (Note de Stendhal.)
Le premier volume du manuscrit (côté R 299) de la Vie de Henri Brulard commence par un testament:
«Je lègue et donne le présent volume à M. le chevalier Abraham Constantin (de Genève), peintre sur porcelaine. Si M. Constantin ne l'a pas fait imprimer dans les mille jours qui suivront celui de mon décès, je lègue et donne ce volume, successivement, à MM. Alphonse Levavasseur, libraire, n° 16, place Vendôme, Philarète Chasles, homme de lettres, Henry Fournier, libraire, rue de Seine, Paulin, libraire, Delaunay, libraire; et si aucun de ces Messieurs ne trouve son intérêt à faire imprimer dans les cinq ans qui suivront mon décès, je laisse ce volume au plus âgé des libraires habitant dans Londres et dont le nom commence par un C.
Cività-Vecchia, le 24 décembre 1835.»
On lit encore, sur un feuillet intercalé en face du fol. 8, le fragment suivant: «... de n'imprimer, si cela en vaut la peine, que quinze mois après mon décès. Rome, le 29 novembre 1835. H. Beyle.»
—Sur un autre feuillet, on lit:
«PETITS FAITS A PLACER
1. Mauvaise odeur de gens qui assistaient aux vêpres, à la Charité (M. Beyle, supérieur).
2. L'abbé Rey me fait entrer dans le chœur, à Saint-André. D'ordinaire, je me tenais tout près de la grande grille du chœur. Sermons.
Tout cela, avant la clôture des églises; mais à quelle époque furent-elles fermées à Grenoble?
3. Enterrement, ou plutôt obsèques, à Notre-Dame, de l'évêque intrus, appelé l'abbé Pouchot avec dédain par ma famille.»
Stendhal a pris soin de répéter le titre de son auto-biographie en tête de chacun des volumes de son manuscrit. Il y ajoute diverses indications destinées à dérouter les investigations possibles de la police, dont il avait une crainte maladive. Voici les diverses mentions placées sur les feuillets de garde des trois volumes:
TOME Ier
Vie de Henri Brulard.
A Messieurs de la Police. Ceci est un roman imité du Vicaire de Wakefield. Le héros, Henri Brulard, écrit sa vie, à cinquante-deux ans, après la mort de sa femme, la célèbre Charlotte Corday.
TOME II
Vie de Henri Brulard, écrite par lui-même. Roman imité du Vicaire de Wakefield, surtout pour la pureté des sentiments.
A Messieurs de la Police. Rien de politique. Le héros de ce roman finit par se faire prêtre, comme Jocelyn.
TOME III
Vie de Henri Brulard, écrite par lui-même. Roman à détails, imité du Vicaire de Wakefield.
A Messieurs de la Police. Rien de politique dans ce roman. Le plan est un exalté dans tous les genres qui, dégoûté et éclairé peu à peu, finit par se consacrer au culte des hôtels (sic).
TABLE DES GRAVURES DU TOME PREMIER
Portrait de Stendhal
Reproduction du f° 69 du manuscrit
Portrait d'Henri Gagnon
La maison natale de Stendhal
Reproduction du f° 260 bis du manuscrit
TABLE DU TOME PREMIER
NOTE DE L'ÉDITEUR
INTRODUCTION.—Le manuscrit de la Vie de Henri Brulard, par Henry Debraye
CHAPITRE Ier
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V.—Petits souvenirs de ma première enfance
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X.—Le maître Durant
CHAPITRE XI.—Amar et JHerlinot
CHAPITRE XII.—Billet Cardon
CHAPITRE XIII.—Premier voyage aux Échelles
CHAPITRE XIV.—Mort du pauvre Lambert
CHAPITRE XV
CHAPITRE XVI
CHAPITRE XVII
CHAPITRE XVIII.—La première communion
CHAPITRE XIX
CHAPITRE XX
CHAPITRE XXI
TABLE ALPHABÉTIQUE
La table alphabétique que nous donnons ici est très succincte et indique simplement les noms de personnes, sans aucun détail biographique. Une table alphabétique plus détaillée formera le dernier volume des Œuvres complètes de Stendhal.
A
Adrets (le baron des), I, 28, 55, 111, 195, 297; II, 45.
Adrets (Mme des), femme du précédent, I, 55.
Alembert (d'), I, 48, 215; II, 60, 61.
Alexandre, I, 113.
Alexandrine. Voyez: Petit (la comtesse Alexandrine).
Alfieri, I, 12; II, 65.
Allard (Guy), généalogiste grenoblois, I, 216.
Allard du Plantier, cousin de Stendhal, I, 216.
Allier, libraire à Grenoble, I, 199.
Amalia, I, 17, 21.
Amar, représentant du peuple, I, 133, 134, 137, 141.
Ampère, I, 313.
Ancelot (Mme), II, 152.
Angela. Voyez: Pietragrua (Angela).
Anglès (le comte), camarade de Stendhal, plus
tard préfet de police, I, 255, 256, 302; II, 64.
Anglès (Mme), femme du précédent, I, 256.
Anthon (d'), conseiller au parlement de Grenoble, I, 308.
Arago, II, 152.
Argens (le marquis d'), I, 194.
Argout (le comte d'), I, 19, 245, 299; II, 147.
Aribert, camarade de Stendhal, II, 35.
Arioste (l'), I, 109, 153, 163, 188, 209, 229, 288;
II, 19, 122, 133, 134, 135, 158, 177.
Aristote, II, 136.
Arlincourt (d'), II, 4.
Artaud, traducteur de Dante, I, 90.
Aubernon, II, 161.
Aubernon (Mme), femme du précédent, II, 161.
Augué des Portes (Mme et Mlles), sœur et nièces de
Mme Cardon, II
Azur (Mme). Voyez: Rubempré (Alberthe de).
B
Babet, maîtresse de Stendhal, I, 270; II, 31.
Bacon, I, 259; II, 95.
Bailly (Mlles), marchandes de modes à Grenoble, I, 111.
Bailly (Mme de), I, 111; II, 150.
Balzac (Guez de), I, 7.
Barberen (Mlle), associée et maîtresse de Rebuffet, II, 79.
Barberini, I, 17.
Barbier, fermier des Beyle à Claix, II, 41, 44.
Barilli, acteur de l'Odéon de Paris, I, 24.
Barilli (Mme), actrice de l'Odéon de Paris, femme
du précédent, I, 23; II, 104.
Barnave, I, 69.
Barral-Montferrat (le marquis de), président au parlement
de Grenoble, puis Premier Président de la cour d'appel de
Grenoble, I, 303, 304, 305, 307, 308.
Barral (le comte Paul de), fils du précédent, I, 227; II, 4.
Barral (le vicomte Louis de), fils et frère des précédents,
ami de Stendhal, I, 22, 23, 302, 303, 307, 311, 312; II, 11, 45.
Bartelon, II, 126.
Barthélemy (Mme), cordonnière à Grenoble, I, 111, 112, 275.
Barthélemy d'Orbane, avocat consistorial au parlement
de Grenoble, I, 59, 60, 65, 305.
Barthélemy (le chanoine), frère du précédent, I, 65.
Barthomeuf, commis au ministère de la Guerre,
II, 142, 143, 158, 159, 164.
Bassano (le duc de), II, 8.
Basset (Jean-Louis), baron de Richebourg, camarade
de Stendhal, II, 10, 11.
Basville, intendant du Languedoc, II, 78.
Baure (M. de), gendre de Noël Daru, I, 11; II, 142, 143.
Baure (Mme de), femme du précédent. Voyez: Daru (Sophie).
Bayle (Pierre), II, 17.
Beau, I, 22.
Beauharnais (Hortense de), II, 160.
Beaumont (Elie de), I, 188.
Beauvilliers (le duc de), II, 151.
Beethoven, II, 15.
Bellier, I, 84.
Bellile (Pépin de). Voyez: Pépin de Bellile.
Belloc (Mme), I, 118.
Belot (le président), traducteur de Hume, I, 137.
Benoît, camarade de Stendhal à l'École centrale, I, 281; II, 17.
Benvenuto Cellini, I, 8, 10.
Benzoni (Mme), I, 40.
Béranger, II, 125, 152, 161.
Bérenger (Raymond de), camarade de Stendhal, I, 25, 26.
Bereyter (Angelina), actrice, maîtresse de Stendhal, I, 17, 21, 24.
Bernadotte, roi de Suède, I, 63.
Bernard, II, 33.
Bernonde (Mme), I, 128.
Berry (la duchesse de), II, 33, 151.
Berthier, prince de Neuchâtel, II, 154.
Bertrand (Mme la comtesse), II, 161.
Berwick, graveur, II, 123.
Besançon. Voyez: Mareste (le baron de).
Beugnot (le comte), I, 92.
Beugnot (la comtesse), femme du précédent, II, 123.
Beyle (Pierre), grand-père de Stendhal, I, 80.
Beyle (le capitaine), grand-oncle de Stendhal, II, 177.
Beyle (Joseph-Chérubin), père de Stendhal, I, 16, 77,
78-81, 93, 103, 134, 135, 147, 163, 168, 178, 187,
198-202, 209, 223, 234, 262; II, 16, 41, 56, 73, 85,
108, 176.
Beyle (Pauline), sœur de Stendhal, depuis Mme Périer-Lagrange,
I, 45, 77, 99, 139, 141, 178, 198, 222; II, 50.
Beyle (Zénaïde-Caroline), sœur de Stendhal, depuis Mallein,
I, 77, 99, 139, 141, 222.
Bezout, auteur d'un manuel de mathématiques, I, 249,
250, 277, 282, 299; II, 55, 66.
Bigillion, I, 297, 298.
Bigillion (François), fils du précédent, ami de Stendhal,
I, 23, 285-287, 291, 295; II, 34, 45, 71, 72, 92, 147.
Bigillion (Rémy), frère du précédent, I, 286, 291, 292,
295, 296, 301, 311; II, 92.
Bigillion (Victorine), fille et sœur des précédents,
I, 159, 289-293, 295-299; II, 34, 45, 53, 74, 91, 92, 93.
Bignon (du). Voyez: Du Bignon.
Biot, I, 249.
Blacons (Mlle de), I, 74.
Blanc, I, 198.
Blanchet (Mlle), puis Mme Romagnier.
Voyez: Romagnier (Mme), cousine de Stendhal.
Blancmesnil (de), II, 105.
Boccace, I, 61.
Bois, I, 214.
Boissat (Jules-César), II, 7.
Bonaparte. Voyez: Napoléon.
Bond (Jean), traducteur d'Horace, I, 35, 122.
Bonnard (de), I, 220.
Bonne (MM.), oncles de Mme Romain Gagnon, I, 159-160, 161.
Bonne (Mlle), depuis Mme Poncet, mère de Mme Romain Gagnon, I, 161.
Bonoldi, chanteur italien, II, 103.
Borel (Mme), belle-mère de Mounier, I, 69.
Borel (Mlle), fille de la précédente,
depuis Mme Létourneau, II, 34.
Borghèse (prince F.), I, 1.
Bossuet, II, 121, 152.
Bouchage (du). Voyez: Du Bouchage.
Boufflers (le maréchal de), II, 137.
Bourdaloue, I, 103, 137.
Bourgogne (la duchesse de), II, 81.
Bourmont (le maréchal de), II, 191.
Bournon (le maréchal), I, 244.
Bouvier, I, 65.
Brémont (Mme), depuis Mme de Barral-Montferrat, I, 304.
Brémont, fils de la précédente, I, 304.
Brenier (de), I, 48.
Brenier (Mme de), femme du précédent. Voyez: Vaulserre (Mlle de).
Brichaud, I, 3.
Brizon (Mme de), I, 192.
Broglie (le duc de), I, 62, 120.
Brossard (le général de), II, 81.
Brossard (Mme de), femme du précédent. Voyez: Le Brun (Mlle Pulchérie).
Brosses (le président de), I, 138, 167; II, 21, 135.
Bruce, I, 101, 282.
Brun (Joseph), paysan de Claix, II, 41.
Bruno (saint), fondateur de la Grande-Chartreuse, I, 297, 299.
Buffon, I, 209; II, 45.
Burelviller (le capitaine), II, 169, 171, 172, 173, 174,
176, 182, 183, 184, 193, 198.
C
Cabanis, I, 12, 17, 28, 137, 180, 269.
Cachoud, peintre et graveur, I, 250.
Caetani (les princes), amis de Stendhal, I, 9.
Caetani (Michel-Ange), I, 9, 19.
Caetani (don Philippe), frère du précédent, I, 313.
Caetani (don Rugiero), II, 65.
Caffe, I, 221.
Cailhava, II, 94, 95.
Calderon, II, 175.
Caletta, I, 244.
Cambon (Mme), fille aînée de Noël Daru, II, 80, 108,
115, 116, 120, 121, 126.
Cambon (Mlle), fille de la précédente, II, 166.
Campan (Mme), II, 160, 163.
Cardan, mathématicien italien, II, 67.
Cardon (Mme), II, 119, 121, 122, 141, 158, 160, 162, 163.
Cardon (Edmond), fils de la précédente, ami de Stendhal,
II, 32, 119, 122, 141, 147, 158, 159, 164.
Cardon de Montigny, fils du précédent, II, 119.
Carnot, II, 119, 166.
Cartaud (le général), I, 233.
Castellane (Mme Boni de), II, 152.
Caton d'Utique, I, 222.
Cauchain (le comte de), II, 188.
Cauchain (le général de), oncle du précédent, II, 188.
Caudey (Mlles), marchandes de modes à Grenoble, II, 48, 49.
Caudey, leur frère, II, 49.
Cavé, II, 25.
Caylus (Mme de), II, 151.
Cervantes, I, 107, 129, 288; II, 19, 90, 133.
Chaalons, II, 19.
Chabert, professeur de Stendhal, I, 277, 278-280, 281,
282, 283; II, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 67.
Chaléon (M. de), I, 54.
Chalvet, professeur à l'École centrale de Grenoble, I, 238, 302, 311.
Champel, I, 72.
Charbonot, charpentier à Claix, I, 130.
Charost (le duc de), II, 151.
Charrière (Sébastien), I, 201; II, 41.
Chateaubriand, I, 6, 7, 242, 269, 310.
Chatel, II, 33.
Chavand (Mlle), maîtresse d'écriture à Grenoble, I, 312.
Chazel, camarade de Stendhal, I, 94, 95.
Chélan (l'abbé), curé de Risset, I, 61, 62, 305.
Cheminade, camarade de Stendhal, II, 65, 68, 88.
Chenavaz (Mme), I, 32, 33, 141.
Chenavaz (Candide), fils de la précédente, I, 33.
Chevreuse (le duc de), II, 151.
Chieze, II, 127.
Choderlos de Laclos. Voyez: Laclos (Choderlos de).
Cimarosa, II, 99, 101, 192, 193.
Clairaut, auteur d'un manuel de mathématiques, I, 249, 282.
Clapier (le docteur), I, 281; II, 17.
Clara, Clara Gazul. Voyez: Mérimée (Prosper).
Clarke (Mlle), I, 117.
Clémentine. Voyez: Menti.
Clermont-Tonnerre (de), gouverneur du Dauphiné, I, 62.
Clerichetti (Antonio), I, 123.
Clet, cousin de Stendhal, I, 309.
Cochet (Mlle), I, 160, 162.
Coissi, I, 204.
Collé, II, 152.
Colomb, cousin de Stendhal, I, 289.
Colomb (Mme) femme du précédent, I, 138, 139, 178,
181, 261, 262.
Colomb (Romain), fils des précédents, ami de Stendhal,
I, 22, 84, 121, 167, 168, 193, 227, 230, 289;
II, 21, 45, 46, 48, 50, 135.
Condillac, I, 239, 249.
Condorcet, II, 114.
Condorcet (Mme), femme du précédent. Voyez: Grouchy (Sophie).
Constantin (Abraham), peintre, I, 27; II, 102.
Corbeau (de), I, 161, 162, 165.
Corday (Charlotte), I, 222.
Corneille, II, 8, 19, 26, 133, 136, 152.
Cornélius Nepos, I, 122.
Corner (André), II, 32.
Corrège, II, 25.
Courchamp, II, 4.
Courier (Paul-Louis), I, 255.
Court ds Gebelin, I, 131.
Couturier, I, 250.
Crobras (l'abbé), I, 173.
Crozet (Louis), ami de Stendhal, II, 5-11, 29, 147, 148.
Cuvier (Georges, baron), I, 136, 258, 259.
D
Damoreau (Mme), II, 105.
Dante, I, 39, 90, 91, 194; II, 86, 167.
Daru (Noël), I, 5, 8, 11, 218; II, 19, 78, 79, 81,
91, 93, 94, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 122,
123, 124, 127, 128, 134, 135, 139, 160, 161.
Daru (Mme), femme du précédent, II, 80, 108, 162.
Daru (le comte Pierre), fils des précédents, I, 11, 12, 244;
II, 14, 80, 108, 121, 122, 124, 125, 128, 132,
133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 182.
Daru (Mme la comtesse), femme du précédent, I, 97, 256.
Daru (Martial), frère du comte Pierre Daru, II, 19,
80, 108, 118, 121, 140, 141, 163, 164, 166, 197, 198, 199.
Daru (Mlle Sophie), depuis Mme de Baure, I, 11; II, 80, 108.
[p. 409]Daru (Mlles). Voyez: Cambon (Mme); Le Brun (Mme).
Dausse, I, 254, 257; II, 70, 71.
Debelleyme, préfet de police, II, 7.
Delavigne (Casimir), II, 153.
Delécluze, I, 91; II, 120.
Delille, II, 20, 88, 133.
Del Monte (Mme), I, 59.
Dembowski (Mathilde), appelée Métilde par Stendhal,
I, 4, 15, 17, 18, 20, 173; II, 138.
Denis d'Halicarnasse, I, 220.
Des Adrets (le baron). Voyez: Adrets (le baron des).
Desfontaines (l'abbé), traducteur de Virgile, I, 98.
Destouches, I, 108.
Destutt de Tracy. Voyez: Tracy (Destutt de).
Diane (Mlle), II, 189.
Diday (Maurice), camarade de Stendhal, II, 29, 30, 31, 34, 35.
Diderot, I, 48, 215; II, 60.
Didier (Mme), cousine de Stendhal, I, 56.
Di Fiore, ami de Stendhal, I, 4, 6, 60, 148, 244; II, 33, 89.
Dijon, I, 164.
Diphortz (Mme de), I, 4.
Dittmer, II, 25.
Dolle le Jeune, I, 111.
Domeniconi, acteur italien, II, 70.
Dominiquin (le), I, 1, 250.
Donizetti, I, 265.
Dorat, I, 119, 220.
Doyat, I, 160.
Drevon, I, 111; II, 110.
Drier, cousin de Stendhal, II, 17.
Du Barry (Mme), I, 113; II, 2.
Du Bignon, I, 289.
Dubois-Fontanelle, professeur à l'École centrale
de Grenoble, I, 125, 238; II, 13-17, 19, 23, 24, 25.
Dubos (l'abbé), II, 28.
Du Bouchage, I, 305.
Duchesne, II, 154.
Duchesnois (Mlle), actrice de la Comédie française, II, 10.
Duclos, I, 301; II, 5, 63, 74, 109, 152.
Ducros (le Père), bibliothécaire de la ville de Grenoble,
I, 25, 29, 61, 190, 214-219, 305; II, 17.
Dufay. Voyez: Grand-Dufay.
Dufour (le colonel), II, 185.
Dugazon, actrice, I, 310.
Dulauron (Mme). Voyez: Menand-Dulauron (Mme).
Dumolard (l'abbé), curé de La Tronche, I, 204-205.
Dupéron (Jeanne), grand'mère paternelle de Stendhal, I, 303.
Dupin aîné, II, 152.
Dupuy, professeur à l'École centrale de Grenoble,
I, 238-239, 248-250, 255, 257, 277, 279, 280, 281, 283;
II, 35, 36, 37, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 70, 71, 72, 73.
Durand, précepteur de Stendhal, professeur à l'École centrale
de Grenoble, I, 119, 121-125, 152-154, 163, 238, 241, 243;
II, 5, 67.
Duroc, duc de Frioul, I, 13; II, 34.
Duvergier de Hauranne, II, 25.
E
Edwards (le docteur), I, 259, 290; II, 7.
Esménard, I, 8.
Euler, I, 279; II, 57.
Euripide, I, 119.
Exelmans (le maréchal), I, 244.
F
Fabien, maître d'armes à , II, 148, 153, 164.
Falcon, libraire à Grenoble, I, 192-193.
Fanchon, servante de Romain Gagnon aux Échelles, I, 158.
Faure (Félix), pair de France, ami de Stendhal,
I, 68, 129, 164, 275, 312; II, 7, 68, 91, 92, 93, 146,
147, 148, 154, 164.
Faure (Frédéric), frère du précédent, II, 91, 92.
Faure (Michel), frère des précédents, II, 91, 92.
Faure, père des précédents, I, 299.
Fauriel, I, 91, 117; II, 114.
Fauriel (Mme), femme du précédent. Voyez: Grouchy (Sophie).
Festa (Mme), actrice italienne, I, 24; II, 104.
Feydeau, II, 104.
Fielding, I, 119.
Fieschi, II, 125, 153.
Fiore (di). Voyez: Di Fiore.
Fioravanti, II, 101.
Fitz-James (le duc de), II, 152.
Fleury (l'abbé), I, 120.
Florian, I, 195-196, 264; II, 20.
Foix (le duc de), II, 151.
Fontanelle. Voyez: Dubois-Fontanelle.
Fontenelle, I, 58, 60, 71, 86.
Forisse, I, 120.
Fourcroy, I, 199.
Foy (le général), I, 289; II, 6.
Français de Nantes, II, 14.
Françoise, servante des Beyle, I, 56.
Frioul (duc de). Voyez: Duroc, duc de Frioul.
G
Gagnon (Elisabeth), grand'tante de Stendhal, I, 33,
37, 44, 77, 78, 85-87, 89, 108, 112, 138, 140, 147,
[p. 411] 148, 150, 151, 169, 178, 180, 181, 186, 187, 192,
213, 218, 223, 227, 233, 234, 261, 262, 308, 309;
II, 30, 41, 50, 64, 65, 73, 100.
Gagnon (le docteur Henri), grand-père de Stendhal,
I, 29, 33, 34-38, 54-62, 72, 74, 77, 86, 100, 134,
140, 144, 148, 168, 177, 187, 191, 198, 213, 217,
237, 241, 248, 254, 262, 298, 305; II, 13, 49, 54,
90, 100, 131, 137, 150.
Gagnon (Henriette), mère de Stendhal, I, 38-40, 57,
120; II, 99.
Gagnon (Séraphie), tante de Stendhal, I, 32, 33, 37,
39, 49, 71, 77, 78, 81, 99, 107, 112, 120, 124, 127,
130, 134, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 150,
157, 164, 168, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 180,
185, 187, 190, 192, 195, 197, 198, 208, 209, 215,
222, 234, 235, 237, 238, 242, 248, 262, 264, 276,
299, 301, 310; II, 1, 56, 64, 65, 73, 85, 90, 109, 168,
176.
Gagnon (Romain), oncle de Stendhal, I, 35, 48-49, 51-52,
72-73, 77, 87, 135, 155-156, 162, 163, 191,
308; II, 100, 110, 126.
Gagnon (Oronce), fils du précédent, I, 35.
Galle, camarade de Stendhal, I, 300, 301, 311; II, 45.
Galle (Mme), mère du précédent, I, 300.
Gardon (l'abbé), I, 54, 141, 143-147.
Gattel (l'abbé), professeur à l'École centrale de Grenoble,
I, 238, 239, 310.
Gauthier (les frères), camarades de Stendhal, I, 248; II, 18, 29.
Gaveau, I, 183, 265.
Geneviève, servante des Beyle, I, 56.
Genoude, ou de Genoude, II, 86.
Geoffrin (Mme), II, 150.
Gérard (le baron), I, 259.
Gibbon, II, 15.
Gibory, chef d'escadron, I, 269.
Giraud (Mme), tante de Mme Romain Gagnon, I, 161.
Giroud, libraire à Grenoble, I, 38.
Giroud, camarades de Stendhal, I, 277, 302.
Giulia, Giul, I, 17, 22; II, 191.
Goethe, I, 242.
Gorse ou Gosse, II, 116.
Gouvion-Saint-Cyr (le maréchal), I, 244.
Gozlan, II, 152.
Grand-Dufay, camarade de Stendhal, II, 1-3, 25, 28, 164.
Graves (la marquise de). Voyez: Le Brun (Mme).
Grétry, I, 3, 267 ; II, 97.
[p. 412]Grisheim (Mlle Mina de), I, 3, 4, 17, 21.
Gros, géomètre grenoblois, professeur de Stendhal,
I, 25; II, 65-68, 71.
Gros, peintre, I, 7.
Grouchy (Sophie), depuis Mme de Condorcet, puis Mme Fauriel,
I, 117; II, 114.
Grubillon fils, I, 160.
Guettard, minéralogiste grenoblois, I, 188.
Guilbert (Mélanie), actrice, maîtresse de Stendhal, I, 9, 17, 20, 28, 142.
Guillabert (l'abbé), I, 186.
Guise (le duc de), I, 221.
Guitri (Umbert), I, 54.
Guizot, I, 240.
Gutin, marchand de draps dauphinois, I, 201.
Guyardet, II, 194.
H
Hampden, II, 6.
Harcourt (le duc d'), II, 151.
Haxo (le général), I, 149, 189.
Hélie (l'abbé), curé de Saint-Hugues de Grenoble, I, 213.
Hélie (Ennemond), camarade de Stendhal, II, 27, 28.
Helvétius, II, 8, 9, 86, 89, 159, 190.
Herrard, I, 27.
Hippocrate, I, 113.
Hoffmann, professeur de clarinette à Grenoble, I, 274.
Holleville, professeur de violon à Grenoble, I, 274, 275.
Homère, I, 229.
Horace, I, 113, 119, 122, 187; II, 125.
Houdetot (d'), I, 164.
Hugo (Victor), II, 4.
Hume, I, 137.
Humières (le duc d'), II, 151.
I
Ingres, I, 7.
J
Jacquemont (Victor), I, 18.
Jay, peintre, professeur à l'École centrale de Grenoble,
I, 238, 250, 254, 283; II, 26-29, 35, 46.
Jeki (le Père), I, 12.
Joinville (le baron), II, 143, 194.
JOMARD, II, 52.
Joubert, précepteur de Stendhal, I, 38, 82, 163.
Jussieu (Adrien de), I, 26, 182, 259, 313.
Jussieu (Antoine de), I, 290.
K
Kably (Virginie), actrice, I, 4, 17, 95, 263-271, 273-274,
[p. 413]
276, 292, 296, 299, 301; II, 53, 74, 194.
Kellermann, I, 231.
Kératry (de), I, 10.
Kersanné, II, 147.
Koreff, II, 5, 152.
L
La Bayette (de), camarad de Stendhal, I, 300, 301, 307, 311; II, 45.
La Bruyère, I, 11; II, 150, 151, 152.
Laclos (Choderlos de), I, 74.
Lacoste (de), I, 55.
Lacroix, géographe, I, 101.
La Feuillade (le duc de), II, 151.
La Fontaine, I, 288; II, 8, 99, 253.
Lagarde, II, 5.
Lagrange, II, 9, 57, 259.
Laharpe, II, 13,14.
Laisné (le vicomte), II, 8.
Lamartine, I, 19; II, 90.
Lambert, valet de chambre d'Henri Gagnon,
I, 66, 113, 114, 139, 140, 167-173,
177, 303; II, 32.
Lamoignon, I, 64.
Lannes (le maréchal), I, 240.
La Passe (le vicomte de), I,313.
La Peyrouse (de), II, 43.
Laplace (de), I, 258, 259; II, 9.
La Rive, acteur, I, 310.
La Rochefoucauld (le duc de), II, 151.
La Rocheguyon (le duc de), II, 151.
Lasalle (le général), I, 244.
La Valette (de), II, 42.
La Valette (Mme), II, 165.
La Valette (Mlle de), I, 28.
La Vallière (Mlle de), II, 136.
Le Brun (Mme), fille de Noël Daru, depuis marquise de Graves,
I, 11; II, 80, 81, 108, 111, 117.
Le Brun (Mlle Pulchérie), fille de la précédente, depuis
marquise de Brossard, II, 81, 108.
Lefèvre, perruquier à Grenoble, I, 62, 104.
Legendre, I, 259.
Léger, tailleur à Paris, I, 22.
Léopold de Syracuse, prince de Naples, I, 313.
Lerminier, I, 190.
Le Roy, professeur de peinture de Stendhal à Grenoble,
I, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 209,
250, 251, 266; II, 45.
Le Roy (Mme), femme du précédent, I, 176, 253.
Lesdiguières (le connétable de), I, 67, 89.
Lesdiguières (le duc de), II, 151.
Létourneau, II, 34.
Létourneau (Mme), femme du précédent. Voyez: Borel (Mlle).
[p. 414]Létourneau (Mlle), depuis Mme Maurice Diday, II, 34, 35.
Letourneur, traducteur de Shakespeare, I, 287; II, 9, 133.
Letronne, I, 190.
Linné, I, 190.
Lorrain (Claude), I, 62.
Louis le Gros, II, 81.
Louis XI, I, 44.
Louis XIV, I, 216, 288; II, 74, 81, 125, 136.
Louis XV, I, 113, 128, 187; II, 74.
Louis XVI, 1, 113, 125, 126, 129; II, 163.
Louis XVIII, II, 64.
Louis-Philippe Ier, I, 165.
Luther (Martin), I, 34.
M
Mably, I, 70.
Machiavel, II, 8.
Mâcon, II, 194.
Maintenon (Mme de), II, 151.
Maistre (Mlle Thérésine de), I, 162.
Maistre (le comte Xavier de), frère de la précédente, I, 162.
Mallein (Abraham), beau-père de Zénaïde Beyle, I, 267.
Mallein (Alexandre), fils du précédent, beau-frère de Stendhal, I, 299.
Manelli, paysan italien, I, 226.
Mante, ami de Stendhal, II, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 164.
Marcieu (de), I, 298.
Marcieu (le chevalier de), I, 111.
Marcieu (Mme de), I, 73.
Mareste (le baron Adolphe de), surnommé par Stendhal Besançon,
I, 5, 22, 121, 208; II, 33, 147.
Maria (dona), reine de Portugal, I, 128.
Marie (l'abbé), mathématicien, I, 282; II, 55.
Marie-Antoinette, II, 119, 121, 163.
Marion, servante des Gagnon. Voyez: Thomasset (Marie).
Marmont (le maréchal), duc de Raguse, II, 175.
Marmontel, I, 10, 119; II, 14, 152.
Marnais (Mmes de), I, 37.
Marot (Clément), I, 215.
Marquis, camarade de Stendhal, II, 17.
Martin, II, 52.
Martin (Joséphine), cousine de Stendhal, I, 207.
Martin (Mme), I, 269.
Masséna (le maréchal), II, 134.
Massillon, I, 103, 137.
Mathis (le colonel), I, 121, 244.
Maupeou (de), I, 259.
Maximilien-Joseph, roi de Bavière, II, 14.
Mayousse, paysan de Claix, I, 201.
[p. 415]Mazoyer, commis au ministère de la Guerre, II, 129, 132, 133, 138.
Meffrey (le comte de), I, 256; II, 33.
Menand-Dulauron (Mme), I, 73, 111.
Mengs, II, 181.
Menti, Menta (Clémentine), I, 4, 5, 17, 20, 21, 289.
Mention, professeur de violon à Grenoble, I, 274; II, 97.
Mérimée (Prosper), appelé par Stendhal Clara ou Clara Gazul,
I, 299; II, 152.
Mérimée (Mme), femme du précédent, II, 162.
Merlinot, représentant du peuple, I, 133, 137.
Merteuil (Mme de). Voyez: Montmort (Mme de).
Métilde. Voyez: Dembowski (Mathilde).
Meyerbeer, II, 102.
Michaud (le général), I, 183, 244.
Michel-Ange, I, 9, 79, 250.
Michel, tailleur à Paris, I, 22.
Michoud, camarade de Stendhal, I, 311, 312; II, 45.
Mignet, I, 129; II, 161.
Milai (Bianca), I, 228.
Mirabaud, traducteur de l'Arioste, I, 163.
Milne-Edwards, I, 259.
Ming, II, 52.
Mirepoix (Mme de), II, 150.
Molé, ministre des Affaires étrangères en 1830, I, 16; II, 152.
Molière, I, 11, 108, 109, 192, 227; II, 19, 112, 148, 175, 178.
Moncey (le maréchal), duc de Conegliano, I, 110, 244.
Moncrif, II, 105.
Monge, II, 9.
Monge (Louis), frère du précédent, II, 61, 69.
Montaigne, I, 12.
Montesquieu, I, 7, 20, 70, 167, 212, 220; II, 9, 150.
Montesquiou (le général), I, 157, 160.
Montfort (le duc de), II, 151.
Montmort (Mme Duchamps de), I, 74, 75, 111: II, 110.
Monval (les frères de), camarades de Stendhal,
I, 26, 255, 257, 279; II, 28, 35, 50, 86, 87.
Moore (Thomas), I, 8.
Morard de Galles (l'amiral), I, 301.
Moreau le Jeune, I, 250.
Morey, II, 147.
Morgan (lady), I, 18.
Morlon (le Père), I, 287.
Moulezin, camarade de Stendhal, I, 251; II. 28.
Mounier, marchand de drap à Grenoble, I, 68, 69.
Mounier, fils du précédent, conventionnel, préfet de Rennes, I, 67, 68.
Mounier (Edouard), fils du précédent, I, 67, 68; II, 62.
[p. 416]Mounier (Victorine), sœur du précédent, I, 67; II, 34.
Mozart, 1, 171; II, 100, 101, 102.
Muller, graveur, II, 181,
Munichhausen (le grand chambellan de), II, 154.
Murat, roi de Naples, I, 63.
N
Napoléon Ier, I, 10, 13, 15, 28, 164, 243, 244, 258, 269,
304; II, 61, 69, 74, 125, 139, 144, 145, 153, 161,
166, 190, 191.
Navizet, entrepreneur de chamoiserie à Grenoble, I, 218.
Naytall (le chevalier), II, 1.
Nelson (l'amiral), I, 244.
Ney (le maréchal), II, 160.
Nicolas (l'empereur), I, 115.
Nivernais (le duc de), II, 152.
Nodier (Charles), II, 99, 152.
Numa Pompilius, I, 113.
O
Odru, camarade de Stendhal, I, 248, 276; II, 28-32.
Olivier (le général), II, 140.
Orbane (Barthélemy d'). Voyez: Barthélemy d'Orbane.
Ornisse (? la comtesse), II, 111.
Ossian, II, 25.
Ovide, I, 124, 185; II, 15.
P
Paisiello, II, 97, 101.
Pajou, I, 250.
Panseron, II, 105.
Pariset, I, 271; II, 5.
Parny, II, 14.
Pascal (César), II, 153, 154.
Passe (le vicomte de la). Voyez: La Passe (le vicomte de).
Pasta (Mme), actrice, II, 24, 67.
Pastoret (de), II, 153.
Penet, camarade de Stendhal, II, 18.
Pépin de Bellile, I, 92.
Périer (Claude), dit milord, I, 83, 292; II, 150, 154.
Périer (Amédée), fils du précédent, I, 83.
Périer (Augustin), frère du précédent, I, 83.
Périer (Camille), frère des précédents, I, 83.
Périer (Joseph), frère des précédents, I, 83.
Périer (Casimir), ministre, frère des précédents, I, 68,
83, 292; II, 149, 153, 154, 155.
Périer (Scipion), frère des précédents, I, 83; II, 155.
Périer (Elisabeth-Joséphine), depuis Mme Savoye de
Rollin, sœur des précédents, II, 149.
Périer (Mlle Marine), depuis Mme Teisseire, sœur des
[p. 417]précédents, I, 97.
Périer-Lagrange, voisin des Gagnon, I, 189.
Périer-Lagrange (Mme) femme du précédent, I, 106.
Périer-Lagrange, fils des précédents, beau-frère de Stendhal, I, 24.
Perlet, publiciste à Paris, I, 151.
Perrot d'Ablancourt, I, 194.
Peroult, I, 271.
Petiet (Mme), II, 165.
Petiet (le baron Auguste), fils de la précédente, II, 126.
Petiet (Mme), femme du précédent. Voyez: Rebuffet (Adèle).
Petit (la comtesse Alexandrine), I, 16, 17, 20, 21,
23, 36, 43, 148, 173; II, 138.
Philippe-Auguste, II, 74.
Piat-Desvials (Mme), I, 111.
Picard, II, 145.
Pichegru (le général), I, 151.
Pichot (Amédée), II, 4.
Picot le père, I, 48.
Pietragrua (Angela), maîtresse de Stendhal, I, 17, 22; II, 200.
Pina (de), camarade de Stendhal, maire de Grenoble, I, 255, 257, 305.
Pinto (le commandeur), I, 16.
Pipelet (Constance), depuis princesse de Salm-Dyck, II, 122-123, 157.
Pison-Dugalland (Mme), cousine de Stendhal, I, 31, 141.
Plana, ami de Stendhal, II, 11.
Plana, pharmacien à Grenoble, II, 52.
Pline, I, 190.
Poitou (le baron), II, 135.
Poltrot de Méré, I, 221.
Poncet (Mme), mère de Mme Romain Gagnon. Voyez: Bonne (Mlle).
Poncet (Camille), femme de Romain Gagnon, I, 157, 160, 162.
Poncet (Mlle), sœur de Mme Romain Gagnon, I, 161, 162.
Poncet, menuisier à Grenoble, I, 189.
Pope, I, 117.
Portal (le docteur), II, 93, 118.
Poulet, gargotier à Grenoble, II, 49.
Poussi, I, 264.
Pozzi (Mme), I, 226.
Précy, I, 231.
Prévost (l'abbé), I, 126.
Prié, camarade de Stendhal, II, 48.
Prunelle, médecin, maire de Lyon, I, 24; II, 7.
Ptolémée, I, 100.
Pyrrhus, I, 63.
Q
Quinsonnas (de), I, 73.
Quinsonnas (Mme de), femme du précédent, II, 150.
[p. 418]
Quinte-Curce, I, 82.
R
Racine, I, 153, 287, 288; II, 20, 129, 133, 136, 137, 138, 152.
Raillane (l'abbé), précepteur de Stendhal, I, 82-84,
91, 92, 93-101, 108, 120, 123, 203, 205; II, 149.
Raimonet, I, 249.
Raindre, II, 31, 154.
Rambault (l'abbé), I, 287.
Raphaël, I, 2, 253.
Raymond, II, 4.
Ravix (M. de), I, 55.
Rebuffet ou Rebuffel (Jean-Baptiste), neveu de Noël Daru,
I, 24; II, 79, 126, 127, 155, 163.
Rebuffet (Mme), femme du précédent, II, 126, 127, 162, 166.
Rebuffet (Mlle Adèle), fille des précédents, depuis
Mme Auguste Petiet, I, 17; II, 79, 126, 166.
Regnault de Saint-Jean-d'Angély (le comte), I, 59.
Renauldon, maire de Grenoble, gendre de Dubois-Fontanelle, II, 14.
Renauldon (Ch.), fils du précédent, II, 25.
Renault, peintre, directeur d'une académie à Paris, II, 123.
Renneville (de), I, 256.
Renneville (de), fils du précédent, camarade de Stendhal, I, 255, 256, 279.
Renouvier, prévôt d'armes à Paris, II, 153.
Revenas (l'abbé), I, 186.
Rey, I, 215.
Rey (l'abbé), grand-vicaire de Grenoble, I, 46, 47, 60.
Rey (le chanoine), I, 213.
Rey (Mlle), sœur du précédent, I, 213.
Rey, notaire, oncle de Stendhal, II, 37.
Rey (Mme), femme du précédent, II, 37.
Rey (Edouard), fils des précédents, II, 37-38.
Reybaud ou Reyboz, épicier à Grenoble, I, 137.
Reytiers, camarade de Stendhal, I, 94, 95, 98, 101, 205-206.
Richardson, I, 33.
Richebourg (le baron de). Voyez: Basset (Jean-Louis).
Richelieu (le duc de), II, 151.
Rietti (Mlle), II, 189.
Rivaut (le général), II, 154.
Rivière (Mlles), I, 111.
Roberjot, I, 125.
Robert, I, 248.
Robespierre, I, 152.
Roederer, II, 8, 14.
Roland (Alphonse), I, 96.
Roland (Mme), I, 9; II, 40.
Rollin, I, 212, 222; II, 31.
Romagnier (M.), cousin de Stendhal, I, 232.
[p. 419]Romagnier (Mme), femme du précédent, I, 138, 139, 178, 261, 262.
Romulus, I, 113.
Rosset, appelé aussi Sorel par Stendhal, II, 73, 74, 77, 91.
Rosset (Mme), femme du précédent, II, 163.
Rossini, II, 4, 98, 102, 203.
Rouget de Lisle, II, 100.
Rousseau (Jean-Jacques), I, 12, 79, 97, 158, 159,
283, 288; II, 16, 18, 19, 39, 127, 167, 171, 176,
179, 183, 193.
Roy (Mme), I, 183.
Royaumont, I, 220.
Royer (Louis), II, 30.
Royer gros-bec, II, 33.
Rubempré (Alberthe de), maîtresse de Stendhal, I, 17, 20, 22, 38.
Rubichon, I, 214.
S
Sacy (Silvestre de), I, 137.
Sadin (l'abbé), curé de Saint-Louis de Grenoble, I, 213.
Saint-Ferréol (de), camarade de Stendhal, I, 25,
29, 67, 248, 305; II, 35.
Saint-Germain (Mme), sœur de Barnave, I, 69.
Saint-Marc Girardin, I, 271.
Saint-Priest (de), intendant du Languedoc, II, 78.
Saint-Simon, I, 212; II, 53, 63, 110, 125, 151, 164.
Saint-Vallier (de), I, 305.
Saint-Vallier (le sénateur, comte de), I, 74.
Saint-Vallier (Mlle Bonne de), I, 28, 305.
Sainte-Aulaire, II, 152.
Salluste, I, 243.
Salm-Dyck (prince de), II, 123.
Salm-Dyck (princesse de), femme du précédent.
Voyez: Pipelet (Constance).
Salvandy (de), I, 8, 190, 242, 310.
Sandre (la comtesse), II, 1.
Santeuil, I, 220.
Sassenage (Mme de), I, 73, 298; II, 150.
Savoye de Rollin (le baron), II, 149.
Savoye de Rollin (Mme), femme du précédent.
Voyez: Périer (Elisabeth-Joséphine).
Say (Jean-Baptiste), I, 12; II, 9.
Schiller, I, 242.
Scott (Walter), I, 20; II, 39, 134.
Sébastiani (le général), I, 64, 245.
Senterre, cousin de Stendhal, I, 114, 149-152, 231.
Shakespeare, I, 287, 288, 289; II, 8, 9, 19, 23, 24,
53, 111, 133, 134, 138, 190.
Sharpe (Sutton). Voyez: Sutton Sharpe.
Sieyès (l'abbé), II, 21.
Simon (Mlle), I, 112.
[p. 420]
Sinard (de), camarade de
Stendhal, I, 25, 26, 29, 67, 256, 305; II, 35, 36. 87.
Sixte IV, pape, I, 9.
Smith (Adam), II, 9.
Smith, physicien, I, 222.
Smolett, I, 137.
Sophocle, I, 119; II, 25.
Sorel (M. et Mme). Voyez: Rosset.
Soulié, II, 4.
Soult (le maréchal), I, 240.
Suchet (le maréchal), I, 244.
Suétone, I, 220.
Sutton Sharpe, ami de Stendhal, I, 258.
T
Tachinardi, I, 24.
Tacite, I, 276.
Talaru (Mme de), II, 152.
Talleyrand (le prince de), I, 49.
Tasse (le), I, 229; II, 88, 89, 90.
Tavernier (Lysimaque), chancelier du consulat de
France à Cività-Vecchia, I, 59.
Teisseire, I, 40.
Teisseire (Camille), I, 97.
Teisseire (Mme Camille), femme du précédent.
Voyez: Périer (Marine).
Teisseire (Mme), I, 34.
Teisseire (Paul-Emile), camarade de Stendhal,
I, 280-281; II, 17, 18, 58.
Ternaux, II, 21.
Terrasson (l'abbé), I, 190.
Thénard, II, 9.
Thierry (Augustin), I, 117.
Thiers, I, 164; II, 152,161.
Thomas, I, 164.
Thomasset (Marie), dite Marion, servante des Gagnon,
I, 45, 46, 50, 113, 139, 140, 149, 177, 178, 234; II, 63, 65.
Thucydide, I, 148; II, 33.
Tiarini, II, 35.
Tite-Live, I, 2, 146, 220.
Toldi (Mme), actrice, I, 313.
Torrigiani (le marquis), I, 226.
Tortelebeau, II, 18, 57.
Tournus, I, 72, 111.
Tourte, maître d'écriture de Pauline Beyle, I, 72, 144-145, 146-147, 152.
Tourte (l'abbé), frère du précédent, I, 152.
Tracy (Destutt de), I, 12, 27, 106, 131, 237, 239, 303, 304;
II, 2, 8, 18, 24, 60, 67, 170.
Treillard, camarade de Stendhal, II, 46, 47, 50, 51.
Tressan (de), traducteur de l'Arioste, I, 109, 153, 188; II, 133.
Trousset, professeur à l'École centrale de Grenoble, I, 238.
Turenne (de), I, 11.
Turquin, II, 153.
U
Urbain VIII, pape, I, 17.
[p. 421]
V
Vasari, I, 61.
Vaucanson, I, 55.
Vaudreuil (de), II, 152.
Vaulserre (de), I, 256.
Vaulserre (Mme de), femme du précédent, I, 28, 55, 305.
Vaulserre (Mlle de), depuis Mme de Brenier, I, 48.
Vaux (le maréchal de), I, 65-67.
Vial (Jean), jardinier des Beyle à Claix, I, 201.
Vigano, I, 213.
Vignon (Mme), amie de Séraphie Gagnon, I, 138,
177, 197, 198; II, 56.
Vignon (Mlle), fille de la précédente, I, 198.
Villars (le duc de), II, 151.
Villèle (de), I, 33.
Villemain, I, 269; II, 20, 152, 153, 203.
Villonne, professeur de dessin à Grenoble, I, 250, 253.
Virgile, I, 97, 98, 122, 229; II, 132.
Voltaire, I, 34, 97, 105, 113, 187, 190, 213, 215,
227, 304; II, 15, 16, 19, 23, 26, 33, 122, 133, 134,
137, 151, 152.
W
Weymar (Loïs), I, 233; II, 20.