

AMORI ET DOLORI
SACRUM
ŒUVRES DE MAURICE BARRÈS
| LE CULTE DU MOI, trois romans idéologiques: | ||
| * | Sous l’Œil des Barbares. Nouvelle édition augmentée d’un examen des trois idéologies | 1 vol. |
| * * | Un Homme libre | 1 vol. |
| * * * | Le Jardin de Bérénice | 1 vol. |
| L’Ennemi des Lois | 1 vol. | |
| Du Sang, de la Volupté et de la Mort. Nouvelle éditionde 1903, revue et augmentée | 1 vol. | |
| Un Amateur d’Ames. Illustrations de L. Dunki, gravées sur bois | 1 vol. | |
| Amori et Dolori sacrum | 1 vol. | |
| LE ROMAN DE L’ÉNERGIE NATIONALE: | ||
| Livre premier: Les Déracinés | 1 vol. | |
| Livre deuxième: L’Appel au Soldat | 1 vol. | |
| Livre troisième: Leurs Figures | 1 vol. | |
| Scènes et Doctrines du Nationalisme | 1 vol. | |
| BROCHURES | ||
| Huit Jours chez M. Renan. Une brochure in-32 (Épuisé). | ||
| Trois Stations de Psychothérapie. Une brochure in-32. | 1 fr. | |
| Toute Licence sauf contre l’Amour. Une brochure in-32. | 1 fr. | |
| Le Culte du Moi. Tirage spécial de la préface de Sous l’Œil des Barbares. Une brochure in-18 jésus | 1 fr. | |
| Stanislas de Guaita. Une brochure in-8 (Épuisé). | ||
| Contre les Ouvriers étrangers (1893. Épuisé). | ||
| Assainissement et Fédéralisme. Discours prononcé à Bordeaux le 29 juin 1895 (Épuisé). | ||
| La Terre et les Morts: Sur quelles réalités fonder la Conscience française (1899. Épuisé). | ||
| L’Alsace et la Lorraine (1899. Épuisé). | ||
| UNE JOURNÉE PARLEMENTAIRE, comédie de mœurs en trois actes | 2 fr. | |
| POUR PARAITRE PROCHAINEMENT: | ||
| Greco ou le Secret de Tolède. | ||
| Le Voyage à Sparte. | ||
| LES BASTIONS DE L’EST: | ||
| * | La Discipline lorraine. | |
Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays,
y compris la Suède, la Norvège, la Hollande et le Danemark.
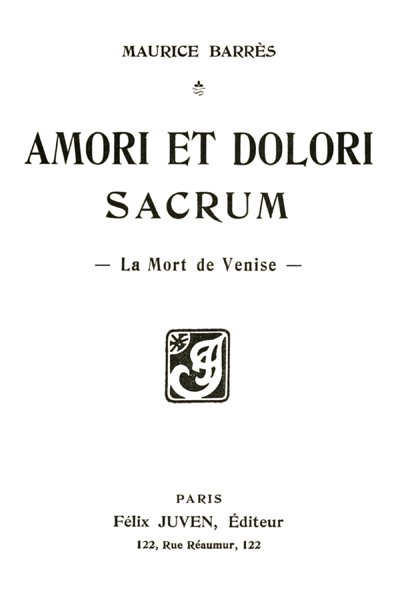
MAURICE BARRÈS
— La Mort de Venise —
PARIS
Félix JUVEN, Éditeur
122, Rue Réaumur, 122
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE:
20 exemplaires, sur papier de la manufacture impériale
du Japon, numérotés à la presse de 1 à 20.
30 exemplaires, sur papier de Hollande à la forme de
Van Gelder Zonen, numérotés à la presse de 21 à 50.
AMORI ET DOLORI SACRUM
J’ai pris le titre de ce livre à Milan, sur la façade rococo de Santa Maria della Passione. Quel magnifique jeu ce serait de meubler, en esprit, cette église pour qu’elle devînt digne de sa double consécration! Amori et Dolori sacrum... Consacré à l’Amour et à la Douleur... Peut-être que, d’abord, on voudrait y grouper les toiles de Luini, car ce peintre est grave, voluptueux et attendrissant. Mais ses modèles ont été mêlés à si peu de choses! Ce sont des petites gens, d’une pensée trop pauvre. Amours et douleurs de cloîtrés.
Dieu me garde de mépriser aucune sincérité; mais, puisque la conscience la plus [p. II] ouverte ne saurait tout accueillir et tout comprendre et puisqu’il faut faire un choix, je donne ma prédilection aux images qui sont chargées de riches expériences. Nul charme de jeune fille n’égale certaines figures de femmes âgées. On trouvera dans ce recueil un chapitre sur la vieillesse d’Élisabeth de Bavière, impératrice d’Autriche.
«Fille chérie, dit Antistius à Carmenta, l’Amour est la déesse myrionyme; on l’adore sous mille noms. Honte à qui tient pour impur l’acte suprême où l’homme le plus vulgaire et le plus coupable arrive à être jugé digne de continuer l’esprit de l’humanité. A tous les degrés de l’échelle infinie, l’amour se transfigure et lubrifie les joints de cet univers. Tout ce qui se fait de bien et de beau dans le monde se fait par le principe qui attire l’un vers l’autre deux enfants.» Je n’y contredis point, mais souvent les approches de la mort et l’usure affinent des hommes qui semblaient incapables de recueillement. A [p. III] bout d’excitation, ils s’arrêtent; leur désir décidément mort leur permet enfin d’écouter. Ils entendent le bâillement universel, l’aveu d’impuissance, l’«à quoi bon» qui fait le dernier mot de toutes les activités. Cette connaissance ne décolore pas l’univers; il est plus richement diapré sous les yeux avertis d’un Faust que sous le regard impatient d’un jeune brutal. Quel beau livre, celui qui mériterait qu’on lui donnât pour titre les trois mots inscrits sur un monument de Pise Somno et Quieti sacrum!
Les pages que nous publions aujourd’hui appartiennent à la même veine que Du Sang, de la Volupté et de la Mort. La mort et la volupté, la douleur et l’amour s’appellent les unes les autres dans notre imagination. En Italie, les entremetteuses, dit-on, pour faire voir les jeunes filles dont elles disposent les assoient sur les tombes dans les églises. En Orient, les femmes prennent pour jardins les cimetières. A Paris, on n’est [p. IV] jamais mieux étourdi par l’odeur des roses que si l’on accompagne en juin les corbillards chargés de fleurs. Sainte Rose de Lima (j’ignore sa biographie, mais un nom si délicieux lui prête une grande autorité) pensait que les larmes sont la plus belle richesse de la création. Il n’y a pas de volupté profonde sans brisement du cœur. Et les physiologistes s’accordent avec les poètes et les philosophes pour reconnaître que, si l’amour continue l’espèce, la douleur la purifie.
Je ne souhaite pas qu’Amori et Dolori Sacrum élargisse beaucoup le cercle des sympathies que me valut Du Sang. Une société silencieuse et choisie convient à ces deux livres. Celui-ci toutefois me paraît plus lourd dans la main et plus savant pour l’oreille que mon recueil de 1895. J’ai mis de l’ordre dans toutes mes libertés; j’ai vu l’unité des émotions que je recueillais sur de longs espaces de temps et de pays.
Dans une chambre d’hôtel, auprès de deux [p. V] bougies, si l’angoisse étreint un passant, il a peur d’être seul et cependant redoute qu’un importun l’oblige à sourire. La distance l’effraye qui le sépare de son chez soi. Ses tempes brûlent, le froid l’enveloppe. O nuit, puisses-tu bientôt passer! Mais elle est un pas vers la mort, dont je me fais, ce soir, une idée nette!... Cependant, le matin arrive, et voici que, sur le rempart de cette ville inconnue, le même voyageur goûte la lumière des champs, le son des cloches, l’insouciance des enfants. Il savoure la vie, il rirait de cet homme chagrin s’il se le rappelait.... Monotones balancements que nous portons sur tous les paysages!
Mais pourquoi cacher le pire? Pas plus que de livres, il n’est d’horizon qui demeure indéfiniment satisfaisant, car toute beauté que je m’assimile provoque en moi de plus grandes exigences. A l’user, je m’écrie d’une Venise, comme d’un Leconte de Lisle: «Encore un citron de pressé!»
[p. VI] Ce poète et cette ville ont beaucoup agi sur la première formation de mon goût. De voyage en voyage, j’ai vu Venise s’engraisser, elle si sèche, si pauvre autrefois. Des brasseries, d’innombrables boutiques, du confort; enfin une graisse germanique. Cependant j’y gardai toujours ma jeune puissance de sentir seulement ce qui pouvait exciter ma fièvre imaginative. On trouvera ici la cristallisation de quinze années. L’impératrice Joséphine, me dit le poète Robert de Montesquiou, possédait une opale fluide et fulgurante qu’elle nommait «l’Incendie de Troie». L’opale n’est point une pierre si rare qu’il me soit interdit de penser que j’offre à quelques amis un «Incendie de Venise». Je leur signale un certain embrasement sur l’eau.
Bien que ce soit ici très expressément un livre de solitude—et je rappelle que les Espagnols donnent le nom de soledad à certain petit poème elliptique,—on y rencontrera des [p. VII] idées et des images qui nourrissent notre action politique. C’est que l’auteur a vu peu à peu se former en lui-même une intime union de l’art et de la vie: toutes les réalités où s’appuient nos regrets, nos désirs, nos espérances, nos volontés, se transforment à notre insu en matière poétique. Il en va ainsi chez tout homme qui a trouvé, préservé, dégagé sa source, la source vive que chacun porte en soi-même.
Ces pages sont, à vrai dire, un hymne. Je n’ignore pas ce que suppose de romantisme une telle émotivité. Mais précisément nous voulons la régler. Engagés dans la voie que nous fit le dix-neuvième siècle, nous prétendons pourtant redresser notre sens de la vie. J’ai trouvé une discipline dans les cimetières où nos prédécesseurs divaguaient, et c’est grâce peut-être à l’hyperesthésie que nous transmirent ces grands poètes de la rêverie que nous dégagerons des vérités positives situées dans notre profond sous-conscient.
[p. VIII] Ce qui fait les dessous de ma pensée, ma nappe inépuisable, c’est ma Lorraine. Encore devrai-je dire comment je la conçois. Pour l’instant, j’inscris son nom dans un chapitre de ce recueil.
La beauté des jeunes femmes est distribuée sur les diverses parties de leur corps; aussi, pour la goûter, faut-il beaucoup de soins et leur grande complaisance, mais cette beauté, quand elles vieillissent, se fixe toute sur leur visage. C’est ainsi que, dans ma jeunesse, j’ai cru la beauté dispersée à travers le monde et principalement sur les régions les plus mystérieuses, mais aujourd’hui j’en trouve l’essentiel sur le visage sans éclat de ma terre natale.
Janvier 1903.
LA MORT DE VENISE
Vous rappelez-vous l’Exposition des «Graveurs du Siècle» qu’il y eut à Paris, voici quelques années? Je parcourais ses salles désertes, quand soudain une lithographie d’Aimé de Lemud m’arrêta, me vivifia, fit jaillir en moi un flot de poésie.
L’Enfance de Callot! Cela plut vers 1839. Une belle fille bohémienne tient le petit Callot par la main. A grand pas ils marchent vers l’Italie. De toute mon âme je les accompagne. Ah! que ne puis je leur être utile!
Pourtant, ne cherchez pas aux cartons des étalagistes cette vieille image mi-romantique, mi-bourgeoise. Elle serait dans votre main déçue l’humble petite bête noiraude qui, la veille au soir, luisait mystérieusement sous [p. 12] l’herbe du fossé: car vous n’avez point vécu les destinées de la Lorraine, et cette lithographie ne vaut qu’à les réveiller dans nos âmes. C’est ainsi que tels pauvres vers d’un méchant livret italien emplissent de volupté et de mélancolie celui qui possède le souvenir éternellement fécond d’un air de Bellini, dont ils servent à désigner la passion ou les nuances de sentiment.
Lemud, enfant de Thionville, quand il fit à Metz son apprentissage d’art, dut méditer avec nostalgie l’aventure de Callot qui, gamin de douze ans, pour voir de la belle peinture, se sauva de Lorraine jusqu’à Rome, avec des bohémiens. De là ce dessin, qui exprime notre esprit de l’Est, bien que pour le styliser il se soit souvenu du délicieux mythe méditerranéen, du petit Tobie guidé par l’ange. Le jeune, l’heureux Callot! Les belles histoires dont le nourrit son guide! Qu’ils sont excités! C’est l’image aimable d’une forte vocation; mais voyez-y davantage: reconnaissez le rêve d’une race qui, depuis des siècles, se bat aux extrêmes avant-postes contre les puissances [p. 13] de la Germanie pour l’idéal latin. Une prédisposition transmise avec notre sang nous oriente vers le classicisme, nous détourne d’Allemagne.
Cette médiocre lithographie déclenche (je ne sais pas de mot plus direct) la chanson qu’a mise en moi ma race, et qui m’entraînait, belle comme un ange, romanesque comme une fille tzigane, quand, à vingt-trois ans, pour la première fois, j’allais de Nancy à Venise.
C’est à travers des cultures déjà méridionales, mais grasses, miroitant de rosée le matin et frissonnant sans trêve aux caresses fécondes du ciel, que du Gothard ou du Brenner on s’achemine vers Venise, éclatante et sèche sur un marécage. Dans ces plaines, on peut suivre, jour par jour, la mobilité des saisons, et je songe au visage de Virgile qui rougissait aisément. Au printemps, ces arbres me tendent leurs branches fleuries avec l’innocence infiniment civilisée des Luini, et, quand l’automne les charge de fruits, tout ce Veneto agricole se fait sociable et voluptueux comme [p. 14] un Concert du Giorgione. Je ne puis décider dans lequel de ses styles cette nature multiforme m’enchante davantage. Mais, au terme du voyage, on trouve une ville toujours pareille sur une eau prisonnière.
Étincelante fête figée de Saint-Marc et du Grand Canal! Venise a des caprices, mais n’a point de saisons, elle connaît seulement ce que lui en racontent les nuages quand ils montent sur le ciel pour épouser sa lagune.
Cette ville ma toujours donné la fièvre. En vain, le matin, avec son bleu si tendre et quand elle sonne ses clairs angélus, en vain l’après-midi sur la Piazza, quand une musique et des jolies filles en châles ajoutent au meilleur des cafés, faisait-elle l’anodine. «Menteuse, lui disais-je avec amour, je sais bien tes poisons.»
Où n’imaginais-je point d’en trouver? Pour les fiévreux tout est fièvre. Vers 1889, je distinguais une mélancolie déchirante dans la peinture en S de ce Tiepolo où je ne vois plus qu’un adorable maître de ballet et le peintre aux teintes claires qui nous révéla les plus [p. 15] délicieuses jambes. Combien d’heures je passai à la Bibliothèque de Saint-Marc ou bien à la Querini, cherchant des interprétations romanesques à ses recueils de «caprices!» Ils sont luxe, facilité, invention intarissable, faiblesse, volupté, désespoir. Tiepolo dessine de l’insaisissable: la tristesse physiologique, l’épuisement de Venise. Partout un air de fête, mais rien ne nourrit plus les puissances de la République. Splendide bouquet, dont les racines sont coupées à Candie, en Morée, sur la terre ferme même. Sa lagune où elle plonge la protège; elle s’y fane pourtant. L’opéra fait ses dernières, ses plus hautes roulades; on va baisser, éteindre la rampe. L’État meurt. Et Venise dont les forces tarissent ne dure que pour justifier nos regrets de ses prestiges. Ainsi quand la délicieuse Chypre vénitienne disparut sous le flot des Turcs, rien n’y survécut de la métropole qu’Henri Martinengo. Les vainqueurs le mutilèrent au lieu de le tuer; il demeura dans le sérail du grand vizir...
Voilà quelles sensations, quand j’avais vingt-quatre [p. 16] ans, je tirais des albums que Tiepolo a dessinés aux temps d’extrême carnaval où Venise adorait le brillant et léger Cimarosa. L’air fiévreux des lagunes se mêle à mes jugements. Et puis dans cette ville flotte un romantisme créé par nos pères, qui se précipite sur un visiteur prédisposé.
Nul lieu qui se prête davantage à l’analyse des nuances du sentiment, aux rêveries sur le Moi. Cette eau plate frissonne à peine sous la barque qui m’emprisonne; de fastueux palais m’isolent de l’immense nature et de l’océan mouvant des phénomènes; ici tout est d’humanité et d’une humanité figée, semble-t-il, fixée. «Les forêts futures se balancent imperceptiblement aux forêts vivantes,» dit avec une délicatesse puissante le malade Maurice de Guérin. Il faut tout le malaise où Venise nous met, et qui nous affine, pour que nous puissions sentir ce quelle dégage de ses extrêmes maturités?
Sur le vaste miroir que la lune pâlissait, Jean-Jacques, puis Gœthe, entendirent de l’une à l’autre rive deux chanteurs alternés se [p. 17] jeter les vers du Tasse ou bien de l’Arioste. Plainte sans tristesse. Ces voix lointaines ont quelque chose d’indéfinissable qui émeut jusqu’aux larmes. Une personne solitaire chante pour qu’une autre animée des mêmes sentiments l’entende et lui réponde. Le Tasse et l’Arioste se taisent aujourd’hui. Mais si je m’écarte des hôtels où des barques en feu débitent des couplets napolitains, l’eau balancée, qui dans la nuit s’écrase contre les vieilles pierres, m’intéresse à ses chuchotements, et puis, dans un flot gras, s’empresse de noyer son éternelle confidence.
Au printemps, en été, en automne surtout, j’ai cherché à déchiffrer ce soupir suspendu, cette tristesse voluptueuse dont Venise éternellement se pâme. Mon objet n’est point ici de peindre directement des pierres, de l’eau, des nuages, mais de rendre intelligibles les dispositions indéfinissables où nous met le paludisme de cette ruine romantique.
[p. 18]
La plupart des voyageurs qui décrivent Venise, et les artistes avec qui tant de fois je l’ai parcourue, ne cessent de se lamenter: «Ah! Venise, comme tu étais belle quand le Grand Canal reflétait les façades de tes maisons peintes à fresque, quand tes gondoles traînaient dans leurs sillages de fastueuses pièces de velours, et surtout durant ces pompes annuelles où la galère à la tête de bœuf paradait au large de San Giorgio Maggiore.»
Ces magnificences me parlent sans me conquérir. Tout comme un autre, je puis goûter un décor où je tiens un rôle; mais suis-je un marchand de curiosités, un collectionneur de bibelots, pour que des objets auxquels rien ne me lie m’occupent? «Fort bien, dis-je à la beauté qui n’est point ma parente, fort bien, mais on voudrait voir ton âme. Quand le poignard sortira-t-il de ce fourreau? Frappe [p. 19] donc, ô beauté!» Rien ne m’importe qui ne va pas fouiller en moi très profond, réveiller mes morts, éveiller mes futurs. Je ne dédaigne point les grandes courses de taureaux, car le péril et le meurtre troublent les jeunes femmes, ni certaines danses, car elles paraissent asservir la beauté à la force mâle qui se repose et qui regarde. Voilà des spectacles d’une valeur universelle. Ils agissent sur notre inconscient et par là, en tous lieux, à toutes les époques, ils intéressent la vaste humanité, ou, plus vaste encore, l’animalité chez l’homme. Les taureaux de Séville, les danseuses de Bénarès ou de Montmartre suscitent nécessairement un émoi vieux comme l’amour et la mort. Mais cette foire de la Piazzetta que regrettent les dévots de Venise, croyez-vous que, pour la visiter, je quitterais nos expositions universelles? Et même, que me dirait la pompe des rentrées victorieuses, le défilé devant San Giorgio des galéasses qui vont atterrir au môle de la Giudecca? Je ne suis point prédestiné pour les grandes cérémonies de cette religion municipale.
[p. 20] Bien que mon amour de l’ordre, amour auquel je m’oblige, et un sentiment instinctif de reconnaissance, car il n’est point une civilisation dont je ne me déclare débiteur, me convainquent de respecter tous ceux qui présidèrent au développement des diverses nationalités, je ne trouve qu’un froid plaisir au musée municipal Correr et dans San Giovanni e Paolo, où l’on voit les effigies et les ossements des chefs vénitiens. Ceux-ci réunissent à l’ordinaire trois caractères de diplomate, de commerçant et de guerrier qui les différencient des chefs de ma race. Ils n’ont pas collaboré à ma notion de l’honneur. Quand je parcourais la Grèce et que les forteresses franques m’occupaient, faut-il l’avouer? plus que les vestiges de l’hellénisme, ce n’étaient pas les grands guerriers commerçants de Venise que j’évoquais, mais tout mon cœur rejoignait mes seigneurs naturels, les aventureux chevaliers de Bourgogne et de Champagne.
Au terme d’un livre fameux, Condorcet, [p. 21] qui vient de tracer le «tableau des progrès de l’esprit humain», déclare: «Cette contemplation est pour moi un asile où le souvenir de mes persécuteurs ne peut pas me poursuivre.» Cette phrase, qui me touche vivement, ne me vint jamais à l’esprit quand j’essayais de m’imaginer la Venise glorieuse, mais plusieurs fois elle exprima délicieusement ma pensée intime, tandis que j’errais aux solitudes de la Venise vaincue.
Le génie commercial de Venise, son gouvernement despotique et républicain, la grâce orientale de son gothique, ses inventions décoratives, voilà les solides pilotes de sa gloire: nulle de ces merveilles pourtant ne suffirait à fournir cette qualité de volupté mélancolique qui est proprement vénitienne. La puissance de cette ville sur les rêveurs, c’est que, dans ses canaux livides, des murailles byzantines, sarrasines, lombardes, gothiques, romanes, voire rococo, toutes trempées de mousse, atteignent sous l’action du soleil, de la pluie et de l’orage, le tournant équivoque où, plus abondantes de grâce artistique, [p. 22] elles commencent leur décomposition. Il en va ainsi des roses et des fleurs du magnolia qui n’offrent jamais d’odeur plus enivrante, ni de coloration plus forte qu’à l’instant où la mort y projette ses secrètes fusées et nous propose ses vertiges.
Je plains Venise au point où les siècles l’abandonnèrent, mais je ne voudrais point que ma plainte la relevât. C’est une bizarrerie; s’il faut l’expliquer, je décrirai, entre mille impressions qui, selon moi, la justifient, ce que j’éprouvai quand M. Franchetti restaura la Cà d’Oro.
Pendant longtemps notre plaisir, devant ce chef-d’œuvre du gothique vénitien, eut la qualité douloureuse qu’inspire une beauté imprudente, si elle n’oppose aux fièvres que ses grâces. «Eh! quoi, se disait-on, avec sa galerie du bas et ses deux loges superposées, avec ses colonnes et ses arcs transparents au soleil qui les baigne, et si délicatement ouvragée que le courant d’air du canal [p. 24] devrait suffire à la déchirer comme une dentelle de femme, cette maison d’Ariel vit depuis le XIVe siècle? Comment ne pas s’attendrir d’une telle vaillance? Que n’ai-je la fortune d’intervenir dans les destinées de ce petit palais! Je voudrais le secourir.»
Le secours est venu. L’harmonieuse, l’aérienne demeure ne demande plus notre compassion, elle prétend à notre hommage admiratif. Avec plaisir, je le lui portai, mais tout de suite comme elle me parut luxueuse et d’un goût trop riche! Je me sentis froid pour un art qu’aucun mystère ne baignait plus.
En face de cet heureux joyau qu’admiraient de nombreuses barques, et sur ce Grand Canal inondé de soleil, l’image s’offrit à moi, avec une grâce irrésistible, des régions écartées de Venise.
A côté de cette voie pompeuse où l’on parvient à maintenir, tant bien que mal, quelques beaux instants de l’apogée vénitienne, tous les petits sentiers de pierre ou d’eau, rio, fondamenta, salizzada, calle, continuent lentement leur régression. Ce réseau solitaire [p. 25] nous invite au plaisir délicat du repliement. J’y désirai revoir, entre mille perles malades, l’humble et délaissée Sainte-Alvise.
Sur la droite de la Cà d’Oro, par le rio San Felice, mon gondolier s’engagea...
Le charme puissant de ces petits canaux, pleins d’ombre dans le bas et violemment illuminés au faîte, vient en partie du contraste de leur fraîcheur avec la réverbération du soleil sur les eaux plus larges. Jusqu’à midi, dans ses quartiers pauvres et resserrés, Venise a cette jeunesse étincelante qui, dès neuf heures, disparaît de la campagne avec la rosée. Et puis, que les cris sont jolis dans son grand silence! Ce silence, à bien l’observer, n’est pas absence de bruits, mais absence de rumeur sourde: tous les sons courent nets et intacts dans cet air limpide où les murailles les rejettent sur la surface de la lagune qui, elle-même, les réfléchit sans les mêler. C’est ainsi que, dans les solitudes forestières, les trilles des oiseaux, parce qu’ils gardent pour notre oreille une signification [p. 26] précise, font valoir le repos plutôt qu’ils ne le rompent.
Le mouvement des ondes sonores va sur Venise, comme l’ondulation perpétuelle de l’eau, sans heurts et sans fatigue. Les sons jamais ne nous y donnent de chocs; on les goûte, on connaît leurs qualités, leurs sens. Tandis que l’eau se déplace avec un frais murmure sous le poids de mon gondolier, j’entends au loin s’approcher, s’effacer les pas d’un promeneur invisible, dont je distingue la jeunesse légère ou l’âge alourdi, et dans ces quartiers solitaires la chaussure d’un étranger ne fait pas le claquement des sandales de bois d’une humble Vénitienne.
Inappréciable netteté de ces sensations qui viennent avec abondance émerger sur notre organisme délicieusement hyperesthésié! Une telle tension nerveuse serait intolérable dans un climat sec, mais Venise nous baigne et, sauf les jours de sirocco, ne nous laisse pas savoir que nos nerfs sont à vif.
Pour les yeux non plus, rien n’est incertain ou confus dans Venise. Nous y recueillons [p. 27] sans trêve des images distinctes, qui jamais ne se heurtent, et, de quelque point qu’on les embrasse, elles se disposent merveilleusement. La pauvre loque jaune, violette ou rouge, qui sèche sur une fenêtre, fait à elle seule une valeur somptueuse, en même temps qu’elle concourt au romantisme général du palazzo, rose et lumineux par en haut, vert et humide par en bas, et de tout le canal qui s’enfonce avec ses barques stationnaires, avec ses poteaux d’amarre, avec ses eaux miroitantes ou mornes. Dans ces paysages de pierre, si de quelque petit jardin un arbre élève ses hautes branches et par-dessus un mur les abaisse sur le sentier d’eau qui les reflète, cette rareté végétale ajoute un miracle de jeunesse aux prodigalités de l’invention architectonique.
Bien que les choses vénitiennes soient servies par des jeux de lumière, il ne faudrait pas aller jusqu’à dire: «Ce sont des artifices de théâtre, toutes les combinaisons des nuages et de l’eau», car au milieu d’une mise en scène assez savante pour que des torchons [p. 28] délavés semblent les voiles d’une sultane invisible et pour qu’un tilleul malingre chante, si j’ose dire, et devienne, au tournant d’un canal, une voix sublime, il y a des ingénuités déconcertantes: sur ses arrière-plans, cette Venise courtisane disperse des perfections qu’un musée exalterait dans sa salle d’honneur. Ce matin d’octobre, sur le chemin parcouru trente fois par où je gagne Sainte-Alvise, je fais encore des découvertes. Les feuilles rouges d’une vigne masquent au mur une Vierge de quelque Sansovino, une belle vierge réaliste qu’on entrevoit humble et belle comme un fruit et que l’artiste plein de goût posa lui-même dans cette place.
Mélancolie délicieuse de ces palais déshonorés par des fenêtres closes de planches, pillés par tous les marchands et plus dignes d’amour dans cette détresse que leurs frères du Grand Canal, réparés, irréparables, où je crois voir à la loggia le visage de Jézabel.
Auprès de Sainte-Marie-de-la-Miséricorde, ma barque franchit un des rares ponts de bois qui subsistent du moyen âge. Puis la [p. 29] porte de l’ancienne Scuola me présente, au-dessus d’un arc exquis, des figures touchantes d’humilité et d’élégance, cependant qu’à côté de ce précieux morceau gothique, l’Église de la Miséricorde ne veut pas que je néglige les moyens d’étonner dont la surchargèrent les Bolonais du XVIIe siècle. Deux mouvements encore de mon gondolier, et pour qu’ici toutes les puissances de Venise, sans se confondre, s’affirment, voici le palais délabré où vécut vingt années et mourut le Titan Tintoret, auteur de cette Crucifixion (à la Scuola San Rocco) dont je m’étonne que les innombrables personnages, si furieux de vie, aient pu tenir en même temps dans un cerveau.
Je regarde les balcons croulants d’où cet homme, lourd d’une œuvre qui déconcerte notre expérience des forces humaines, a puisé dans les pompes du levant et du couchant son incomparable tragique. C’était un dur vieillard, et qui devint farouche quand il perdit sa fille Maria, avec qui sa coutume était d’emplir de beaux concerts cette [p. 30] heureuse maison. Si le portrait que l’on appelle la fille du Greco (aujourd’hui dans la collection de sir Stirling Maxwell, à Londres) doit être restitué, comme certains pensent, au Tintoret, je voudrais que ce fût l’image de sa chère Maria...
Michel-Ange, Shakspeare, Beethoven, Balzac, et je penche à leur adjoindre ce Tintoret, veulent abattre à coups de front—front de béliers sublimes, comme celui du Moïse cornu—les parois qui emprisonnent l’intelligence humaine. Éternel Ignorabimus! Tous et toujours nous demeurerons emprisonnés dans notre ignorance. Mais à l’intérieur de ces hautes murailles qui cernent l’humanité, le génie subit une pire solitude: d’épaisses cloisons l’isolent de ses contemporains. Dans cette maison demi-éboulée qu’habitent encore, paraît-il, ses lointains héritiers, Tintoret subit l’abandon, puis la mort. On dit que les grands artistes, avant que tombe sur eux la nuit définitive, connaissent une suprême illumination, un jet plus haut de leur génie. Beethoven, dans son dernier moment, recouvra [p. 31] l’ouïe et la voix; il s’en servit pour répéter certains accords qu’il appelait ses «prières à Dieu». Par lesquels de leurs personnages Shakspeare et Balzac se virent-ils assister au seuil de la mort?
C’est une grande audace qu’un passant ose s’interroger sur les pensées d’agonie, sur les «prières à Dieu» du Tintoret; mais il y a dans Venise cette douce sociabilité, cette atmosphère exquise et simple dont un salon aristocratique enveloppe le plus insignifiant invité au point de lui donner la brève illusion qu’il est de la famille. Un étranger, que son aigre pays ne préparait point à s’associer à ces magnificences excessives, va tout naturellement dans l’église voisine, à la Madona del Orto, saluer avec sympathie la tombe du Tintoret.
Le lecteur excusera-t-il que, depuis la Cà d’Oro, nous naviguions si lentement vers la petite église Sainte-Alvise, située à la pointe nord-ouest de Venise, mais où, tout de même, nous pouvions arriver en vingt minutes? Je [p. 32] cherche à rendre sensibles les impressions d’une flânerie du matin. C’est une des cent promenades, en dehors des magnificences classées, dans la pleine et abondante vie vénitienne.
Les guides ignorent Sainte-Alvise, que Burckhardt se borne à mentionner, et le seul Ruskin la célèbre éperdument. L’abandon de tout ce quartier, son silence, l’herbe qui croît et la présence continuelle du passé collaborent à la physionomie d’une telle petite église, un peu en recul sur son perron de trois marches, dans une place déserte, usée lentement par le clapotis de l’eau, mais où la limpidité de l’air ne laisse pas déposer une poussière.
On trouve à Sainte-Alvise de belles œuvres de Tiepolo et des petits tableaux puérils, les premiers que peignit Carpaccio. Quelle virtuosité tendre et lyrique dans ces Tiepolo! S’il peignit alternativement, comme je le crois, des ballets et des opéras, ne cherchez point ici des jambes adorables, mais l’un de ses grands airs, une composition héroïque et romanesque que baigne l’atmosphère du Tasse [p. 33] ou de l’Arioste. Avec les mêmes qualités que sa Cléopâtre du palais Labbia, c’est une brillante variation sur le thème de Jésus entre les larrons. Pour prendre le bon point de vue sur cette toile, gravissez une tribune branlante parmi les toiles d’araignées: voici l’orgueil romain qui joue de la trompette, un fier cheval (auprès de qui celui d’Henri Regnault et du général Prim se donne bien du mal pour avoir des reins), et puis les deux bandits juifs. Cette trompette toujours et surtout! elle emplit les oreilles du spectateur: c’est elle qui précipite dans les airs ces fanfares de couleurs. Quant aux disciples, grands, élégants dans leur douleur, quel noble deuil de patriciens! La pompe de Tiepolo est très propre à désobliger les personnes qui ont de l’humilité d’âme. Elle contraste avec les huit tableautins que peignit Carpaccio dans sa première enfance. Sur de telles reliques, vous pensez si Ruskin s’excite! Les visiteurs que leur tempérament, leur sexe féminin, leur religion anglicane et surtout leur virginité, disposent à supporter les [p. 34] bavardages ruskiniens, goûteront un plaisir complet s’ils songent que Carpaccio, quand il s’exerçait à ces bégaiements, gentil enfant du peuple, avec un costume pittoresque, ressemblait certainement beaucoup à ces gamins qui, sur le campo de Sainte-Alvise, guettent l’approche d’une gondole et courent chercher le sacristain pour qu’il ouvre la porte de l’église...
C’est un précieux coffret, cette église défaillante qui cache dans un lointain quartier la maëstria du dernier des grands Vénitiens et les tâtonnements de leur initiateur; mais, fût-elle dépouillée de ses trésors par la brocante, elle n’en parlerait pas moins, car, plutôt qu’un objet, elle semble une personne, oui, vraiment, une créature modeste, exquise et sans défense.
Le soleil et l’humidité viendront à bout de Sainte-Alvise, où leurs deux puissances se combattent. Mais cette agonie prolongée, voilà le charme le plus fort de Venise pour me séduire. Et si l’on juge d’après une sensibilité que je ne prétends pas commune à toutes les [p. 35] âmes, mais que je voudrais rendre universellement intelligible, les magnificences des grandes époques vénitiennes et la Cà d’Oro restaurée ont moins de pointes pour nous toucher au vif que les mouvements d’une ville quand sa désagrégation libère des beautés et d’imprévues harmonies que contenaient ses premières perfections.
Jamais cette Venise moderne ne nous émeut davantage que dans les quartiers écartés de son cœur, d’où toute richesse se retire. Ah! bénissons sa pauvreté! Une administration qui jouirait d’excédents budgétaires ouvrirait certainement de larges voies, voudrait mener les trains jusqu’à la Dogana et jeter un pont sur le canal de la Giudecca. Se bornât-elle à soigner ses merveilles, que déjà je m’inquiéterais. Admirons et encourageons ceux qui consolident Venise, mais craignons les «restaurations», qui sont presque toujours des dévastations. Nous ne voulons pas qu’on paralyse rien, fût-ce une ville morte, fût-ce un ordre d’activité, que j’ose appeler la vie d’un cadavre. Il ne faudrait point qu’une [p. 36] discipline générale figeât ces canaux de fièvre et vînt étendre sur la beauté cette perfection convenue qui glace dans les musées.
Ces allées secondaires, étroites, obscures, mystérieuses, serpentantes, sont les réserves où Venise, sous l’action du soleil, de la pluie, du vent et de l’âge, continue ses combinaisons.
Acceptons qu’elle nous montre des états éloignés de ses magnifiques floraisons historiques dont nous avons, comme elle, perdu l’âme. Le soleil aussi passera de la phase éclatante, de la phase jaune, à cette phase rouge que les astronomes appellent de décrépitude. Le centre secret des plaisirs, tous mêlés de romanesque, que nous trouvons sur les lagunes, c’est que tant de beautés qui s’en vont à la mort nous excitent à jouir de la vie.
Le secret des puissances qu’a Venise sur les rêveurs, on le saisit mal tant que l’on étudie une à une ses perfections. Pour nous faire une philosophie des choses, il faut que notre barque s’éloigne du rivage et que nous embrassions l’ensemble. Sur la lagune on peut connaître les états extrêmes où parviendra la ville des doges si nulle intervention grossière ne contredit sa destinée, si les bandelettes des embaumeurs ne viennent pas entraver ses successives délivrances, ses mouvements vers le néant.
A quelques heures de gondole, visitons la brèche où le silence et le vent de la mort, déjà installés, prophétisent comment finira [p. 38] la civilisation vénitienne. Dans Saint-Michel, Murano, Mazzorbo, Burano, Torcello et Saint-François-du-Désert, îlots épars sur cet horizon désolé, les hommes de jadis essayèrent plusieurs Venises avant de réussir celle que nous aimons, et le chef-d’œuvre se défera comme aujourd’hui les maquettes où ils le cherchèrent.
Nulle ville mieux orientée que Venise. Les magnificences du Grand Canal ont le soleil pour coadjuteur. Si nous passons à la partie septentrionale, que n’atteignent plus ses rayons directs, déjà le frissonnement de l’eau, l’atmosphère tout accablée attristent nos sens. Dès les fondamente nuove où l’on embarque pour ces îles mortes, l’imagination qui n’est plus soutenue et concentrée par les monuments de l’art, accepte des impressions plus vagues, se disperse en rêveries et flotte sur l’horizon de deuil.
La première étape de ce pèlerinage, c’est, après vingt minutes, Saint-Michel, l’île de la Mort. Ce cimetière de Venise est clos par un grand mur rouge, et présente une cathédrale de marbre blanc, avec une maison basse, rouge elle aussi, dont les fenêtres ouvrent sur [p. 39] les eaux vertes et plates à l’infini de cette mer captive. Chateaubriand remarqua ces fenêtres, en 1831, quand il se rendait de Venise à Goritz auprès de Charles X. Chassé jadis du ministère par ses coreligionnaires, il leur avait dit: «Je vous montrerai que je ne suis pas de ces hommes qu’on peut offenser sans danger.» Il était de ceux (au dire de Guizot) envers qui l’ingratitude est périlleuse autant qu’injuste, car ils la ressentent avec passion et savent se venger sans trahir. Sa vengeance, maintenant, il la tenait; il allait s’incliner respectueusement devant le vieillard déchu: «Sire, n’avais-je pas raison?» Plaisir d’orgueil, satisfaction amère et qui ne rétablit rien. La gloire sans le pouvoir, c’est la fumée du rôti qu’un autre mange. Le brisement de la mer sur des pierres délitées qui protègent un charnier lui aurait donné un rythme large pour le psaume monotone de ses dégoûts.
Bœcklin a peint une «Ile de la Mort» fameuse en Allemagne. Il put prendre à San Michele son point de départ. Sa toile cherche le tragique par de longs peupliers lombards, [p. 40] par des cyprès, de lourdes dalles, par le silence et des eaux noires; mais la joie des gondoliers y manque qui conduisent ici les cadavres et qui, couchés dans leur barque mouvante, à la rive du cimetière, plaisantent en caressant un fiasque. Pour nous désespérer sur notre dernière demeure, il ne faut pas l’environner d’une horreur générale; c’est nous flatter, c’est un mensonge; faites-moi voir plutôt l’indifférence: seules pleurent deux ou trois personnes impuissantes et bientôt elles-mêmes balayées, pour qu’il en soit de nous et de notre petit clan exactement comme si nous n’avions pas existé[1].
[1] On trouvera les notes à la fin du volume.
Franchissons ce digne seuil de notre voyage, cherchons plus avant des images plus funèbres et plus rares.
Notre gondole oblique de San Michele vers sa voisine, Murano. Tous les étrangers y visitent les verreries, et les poètes commémorent les délices de ses jardins, fameux [p. 41] dans toute l’Europe avant que la République eût fait la conquête de Padoue et que les grands seigneurs peuplassent la Brenta. C’est ici qu’au milieu des fleurs de l’Orient, que la nuit faisait plus odorantes, et tandis que la vague balançait les gondoles à la rive, les voluptueux, les amants discrets et les politiques venaient s’attarder sous le masque. Mais à travers ces ruelles et ces sombres canaux, cinq siècles d’art sont trop contrariés dans leur décomposition pour que les amants eux-mêmes du romanesque, du douloureux et de l’extrême automne, y puissent séjourner. C’est bien que les puissants et délicats palais sarrasins, lombards, gothiques, reçoivent sur leurs marches déjointes l’eau que chasse en glissant notre barque; c’est bien qu’aux deux rives leurs façades perpétuent la galerie du rez-de-chaussée, la loge du premier étage, les gracieuses fenêtres en guipure de pierre et les marbres de couleur; mais pourquoi des planches, des briques, pourquoi de grossiers matériaux apportés par la misère sordide étançonnent-ils des œuvres [p. 42] de luxe qui se refusaient à persévérer dans la vie? Ces logis, abandonnés par l’intelligente aristocratie de marchands qui les édifia, n’épuiseront pas noblement leur destin. Dégradés par une appropriation industrielle, ils deviennent d’ignobles masures, quand ils pouvaient être un pathétique mémorial. La mort qui les couvre de ses sanies ne leur apporte ni le repos ni l’anonymat. Notre guide nous désigne des cloaques: «Ici furent les chambres consacrées à la musique, à la poésie, à l’amour, par de jeunes patriciennes et par des artistes.» Une telle exploitation de l’agonie passe en déplaisir le cimetière de San Michele. Puisse-t-il mentir, ce miroir présenté à Venise! Allons chercher, toujours plus loin, des précédents qui promettent à la beauté qu’elle mourra intacte. Sur l’extrême lagune, des îlots flottent, dit-on, où les plus précieux objets s’abîment sans mélange aux liquéfactions de la mort.
Notre gondole balancée longeait et tournait le mur qui ferme Murano. Sur ces eaux peu [p. 43] profondes et pâles, qui présentent parfois les couleurs excessives des fleurs d’automne, nous suivions un chenal entre des balises, tandis qu’affleurait çà et là un limon mal dissous. Une voile, violemment colorée d’ocre, coupait seule devant nous le frémissement brillant de l’air et la solitude de la plaine. Ces vastes espaces liquides, qui, vers le septentrion, bordent la ville des doges, sont aussi tristes que la campagne romaine: l’artiste et le philosophe aiment à peser cette désolation presque palpable et lourde comme la vraie beauté.
Mazzorbo, Burano au loin émergèrent pareilles à des nymphéas flottants. Mazzorbo eut jadis des couvents de Bénédictines. Nobles viviers pour le plaisir! Le doge André Contarini, au XVIe siècle, se faisait un mérite d’avoir résisté aux séductions des religieuses. Ces belles complaisantes, sans doute grasses comme des cailles, ont depuis longtemps augmenté de leur chair pécheresse la maigre terre végétale de l’îlot. Elles revivent dans les grenades, les figues et le lierre vigoureux qui composent une parure classique [p. 44] à des ruines informes. Comme on aime ces fruits, parmi ces décombres et cette misère, de n’avoir pas désespéré! Ils ont de la rosée le matin, et le soir des couleurs éclatantes, des parfums plus forts que la fièvre. Sur une chaussée marécageuse et déserte, ces bouquets espacés d’allègre végétation semblent l’effort de quelque magie. Les beaux bras des nonnes impénitentes se tendent encore du rivage sur la mer dans ces longs acacias.
Un pont de bois réunit Mazzorbo à Burano. Ce second îlot rappelle Martigues, en Provence, que Charles Maurras m’a fait aimer, mais qui ne montre ni ces tons roses, ni cette indigence.
Sur le seuil des maisons basses, le long du canal ou dans une rue pauvre, on voit les dentellières faire leur point fameux, non pas avec le fuseau, mais avec l’aiguille à coudre. Ces belles affamées se détruisent la vue pour créer des parures fragiles, dont c’est juste de dire qu’elles coûtent les yeux de la tête. Les hommes sont pêcheurs, mais l’Adriatique s’appauvrit de poissons en même temps que [p. 45] la vente devient moins rémunératrice. Misère nécessite saleté; ces pauvres pourrissent leur sol que pourrit aussi la lagune.
Dans ce nid de boue, j’ai souhaité que la désolation s’aggravât d’un degré, afin que l’humanité disparût d’un site où elle ne peut plus se nourrir. La mort ne rabattrait rien d’un spectacle dont elle fait la magnificence.
Quand notre gondole, après avoir navigué un quart d’heure dans cet éternel silence, toucha la boue du rivage, nous suivîmes un sentier, le long du canal de desséchement, entre deux haies de raisins, de grenades et de figues mêlés, pour atteindre l’unique place de Torcello, où l’on trouve la cathédrale de Santa-Maria, l’église de Santa-Fosca et le Baptistère.
La cathédrale est de cette sorte d’églises qui se rattachent aux basiliques romaines. Le Baptistère octogonal et le petit temple de Santa-Fosca appartiennent au noble système byzantin, qui ne donne pas de perspective longitudinale, mais a pour élément essentiel [p. 46] la coupole centrale. Quand cette petite place ne nous présenterait pas des beautés suivant notre goût, ces styles vénérables nous inviteraient du moins à rêver sur l’histoire. Les joyaux de Torcello ne cèdent à rien de Venise et sont figés dans une mort aussi forte que Ravenne.
Un vent tragique soufflait sur ces trois sépulcres, qu’une femme aux longs voiles vint rapidement nous ouvrir. Il semblait qu’elle fût pressée de retourner chez elle veiller un cadavre. Quand nous pénétrâmes à Santa-Maria, une moisissure d’eau et de siècles arrêta notre respiration: le bruit de la lourde porte qui retombait en s’opposant à l’air et au soleil nous parut le glissement d’une dalle sur un in-pace. Que ne puis-je lire les mosaïques qui tapissent la cathédrale! J’y trouverais tout un système dogmatique et poétique; j’entendrais la voix mystérieuse de l’an mil, car, autant qu’il décore, cet art explique: il est une écriture figurative. Je ne sais pas déchiffrer ces magnifiques rébus, et quand je comprendrais leurs lettres, leur [p. 47] esprit me deviendrait-il intelligible? Pourtant j’appréciai dix-sept têtes de morts enfilées par les yeux, auxquelles faisaient pendant dix-sept têtes vivantes avec des boucles d’oreilles. Élégante variation sur nos frivolités! Cette double brochette nous convainc mieux que les danses qui bouffonnent aux murs du cimetière à Bâle.
La pureté, la jeunesse, la grâce de ces trois monuments oubliés dans cet éternel novembre font la boue malsaine de Torcello voisine, dans mon amitié, de la prairie pisane, où le Dôme, le Baptistère, la Tour penchée et le Campo-Santo maintiennent un printemps plus doux que l’avril sicilien. Sous deux climats moraux différents, Pise et Torcello sont également excitateurs de l’âme. La prairie pisane et son trèfle architectural à quatre feuilles s’enorgueillissent d’une féconde invention artistique, car l’esprit renaissant y soumit la matière à des lois nouvelles; Torcello se borne à utiliser les fragments antiques suivant un système traditionnel: l’homme reçoit ses motifs d’action et des tombes et des berceaux.
[p. 48] La vénérable basilique, le Baptistère et Santa-Fosca furent construits avec les ruines d’Altina, édifiée, elle-même, par des fugitifs, alors qu’Attila venait d’anéantir la puissante Aquilée; et cette succession de désastres, qui tient dans un bref espace de siècles, donne à l’imagination une vaste perspective. J’eusse aimé de m’y attarder, mais comment passer plusieurs jours sur ce sol malade? Une fièvre apportée par l’air et par l’eau le corrompt, cependant que lui-même s’empoisonne de ses émanations.
De cette terre pourrie, des enfants avaient surgi et augmentaient à toute minute. On n’imagine pas de pauvres plus sympathiques et plus abandonnés. MM. Molmenti et Mantovani, historiens véridiques, virent une femme manger une tranche de polenta avec une galette de terre pressée en guise de pain. Le jeune troupeau de ces condamnés à la faim et à la fièvre me poursuivait en m’offrant des trèfles à quatre feuilles. Enchantés de ma crédulité, ils ravagèrent les ruines, et, ma gondole déjà loin, ces infortunés marchands de [p. 49] bonheur me tendaient encore des talismans à pleines poignées.
Au quitter de Torcello et revenant vers Venise, nous côtoyons des espaces où la pourriture s’est faite liquéfaction. Le gondolier nous désigne l’emplacement où fut l’Isola delle Donne, «l’île des Dames». Insalubre et battue de courants marins, cette île, qu’ornaient de nombreuses églises, devint un nid de serpents et de voleurs; en 1665, on y transporta les ossements exhumés des églises trop pleines. Confus amas que l’industrie moderne employe impudemment à raffiner ses sucres. On affirme que les restes du fameux doge romantique, Marino Faliero, échouèrent ici pour cet usage. Les poètes, dégoûtés par cette utilité industrielle, vont jeter par-dessus bord un héros qui pourtant leur a rendu bien des services. Finir dans la mélasse et dans les poèmes d’opéra, c’est trop de platitude. Il vaudrait mieux dans un charnier infâme rassasier les chiens de Jézabel.
[p. 50] Je me penchais vainement sur la lagune polie et homogène pour distinguer Anania, l’îlot qu’elle a submergé. Les plongeurs visitent, sous ces eaux mortes, des maisons englouties avec leurs richesses architecturales. Tandis que j’essayais dans le silence d’entrevoir ce passé, les minces sons d’une musique qui faisait danser, en l’honneur de Sainte-Marie-du-Rosaire, dans une salle basse de Burano, traversèrent ces vastes espaces éblouissants. Le désert donnait cette fête suave sans spectateurs, mais un peuple entier se fût retenu de respirer pour n’en pas ternir la délicatesse.
La journée s’avançait quand nous touchâmes à Saint-François-dans-le-Désert et aux parties les plus sublimes de désolation. L’heure tardive collaborait avec le paysage. C’est dans cet îlot que François d’Assise, au retour d’Égypte, débarqua. Il voulut prier; les oiseaux tapageaient; il leur dit la parole fameuse: «Petits oiseaux, mes frères, cessez de chanter, sans quoi je ne pourrais louer [p. 51] Dieu.» En Ombrie c’eût été une gentillesse, mais dans ce décor tragique cette parole a tout dévasté. Quand il eut fait oraison, le saint fut coupable de ne pas ranimer le ramage des oiseaux.
«Le soleil d’Assise, dit Dante, épousa une femme à qui, comme à la mort, personne n’ouvre la porte du plaisir.» Quels sont les amants que désignent ces paroles mystérieuses? François et la Pauvreté. Voilà un beau décor pour ce mariage mystique. Un chien aboyait derrière les hauts murs du couvent des Franciscains qui ne laisse libre sur l’îlot qu’une étroite bande de désert.
Nul sujet de rêverie ici que la préparation à la mort. Des lieux d’un tel caractère provoquent chez tous les hommes, moines catholiques ou passants sceptiques, quelques doctrines qu’ils professent, un ébranlement de même ordre. Les solitaires chrétiens appelaient vivre pour l’éternité ce que nous appelons s’observer, comprendre le néant de la vie. Plongés dans un même milieu, nous élaborons, tous, des raisonnements et des [p. 52] images analogues. De plus en plus dégoûté des individus, je penche à croire que nous sommes des automates. Nos élans les plus lyriques, nos pensées les plus délicates sont d’un ordre tout à fait grossier et général. Enchaînés les uns aux autres, soumis aux mêmes réflexes, nous repassons dans les pas et dans les pensées de nos prédécesseurs.
Je fus averti qu’un tel jour approchait de son terme par les torrents de sang qui se mêlèrent à la lagune. Le soleil, en la quittant, ne voulait-il laisser derrière lui qu’une belle assassinée? De monstrueuses araignées travaillaient à relier de leurs fils les chétifs arbustes de la rive. Les crabes se hissaient hors de l’eau. C’était l’heure de la plus active fermentation, et pour gagner Venise j’avais encore un long temps de gondole.
L’eau qui entoure San Francesco est plus morte que sur aucun point de cette mer esclave. Nous serpentions dans un chenal étroit, à travers des terres demi-noyées et faites d’herbes pourries, d’où se levaient de grands [p. 53] oiseaux. Tout auprès de nous, les perches dressées pour avertir les bateliers semblaient des tracés posés sur un tableau sublime pour guider d’inhabiles copistes. Là-bas, sur notre droite, Venise, au ras de la mer, s’étendait et devait faire une barre plus importante à mesure que le soleil s’anéantissait. Des colorations fantastiques se succédèrent qui eussent forcé à s’émouvoir l’âme la plus indigente. C’étaient tantôt des gammes sombres et ces verts profonds qui sont propres aux ruelles mystérieuses de Venise; tantôt ces jaunes, ces orangés, ces bleus avec lesquels jouent les décorateurs japonais. Tandis qu’à l’Occident le ciel se liquéfiait dans une mer ardente, sur nos têtes des nuages enivrants de magnificence renouvelaient perpétuellement leurs formes, et la lumière crépusculaire les pénétrait, les saturait de ses feux innombrables. Leurs couleurs tendres et déchirantes de lyrisme se réfléchissaient dans la lagune, de façon que nous glissions sur les cieux. Ils nous couvraient, ils nous portaient, ils nous enveloppaient d’une splendeur totale, et, si je [p. 54] puis dire, palpable. Vaincus par ces grandes magies, nous avions perdu toute notion du réel, quand des taches graves apparurent, grandirent sur l’eau, puis nous prirent dans leur ombre. C’étaient les monuments des doges.
Nous rentrâmes dans la ville avec un sentiment de stupeur et de regret, avec la courbature générale que dut avoir Lazare à sa résurrection. Au sortir des sépulcres de Burano, de Torcello et de Mazzorbo, nous venions d’être ravis, la fièvre aidant, jusqu’aux fulgurations que les croyants placent après la mort.
Au reste, il est impossible de rapporter l’agonie du soleil sur la lagune vénitienne. Après s’être prodigué jusqu’à nous contraindre à sortir de notre personnalité, il nous touche le front d’un dernier rayon pour nous dire: «Et maintenant, oublie; il ne faut pas que ces choses soient révélées.» C’est qu’alors nous atteignons aux points extrêmes de la sensibilité, quand le rare s’élargit et se défait dans l’universel, et que notre imagination, [p. 55] à poursuivre le but sans trêve reculé de nos désirs, s’abîme dans une lassitude ineffable. La nuit qui succède à ces aspects extraordinaires envahit aussi notre cerveau, et leur conjuration ne nous laisse que des souvenirs vacillants.
Je suis allé respirer un myrte du désert: comment prouver son parfum, dont la poésie provient de ce qu’il se dissipe stérilement et retombe aux miasmes d’un rivage décrié!
Il faut pourtant faire un effort. Ne soyons pas si lâches que d’épeler Venise, ses pierres, ses eaux, ses rivages et de renoncer à lire sa pensée. Essayons de lui saisir l’âme. Si nous ne recueillons rien de la grande Venise commerçante et dominatrice, qu’est-ce donc que notre augmentation de poids sur ses lagunes? Au risque de laisser en chemin une partie des sentiments dont un séjour à Venise nous charge, essayons de les dénombrer. Révisons avec une volonté systématique ce que nous avons d’abord enregistré à notre insu. Le plaisir d’une longue réflexion méthodique n’est pas inférieur aux abandons de la rêverie.
[p. 57] Il y a, tout au bas, dans Venise, une population débonnaire, naïve, ignorante du mal: de vrais pigeons. Oui, des pigeons. Le mouvement de l’oiseau, son frisson qui monte jusqu’à son cou en soulevant un peu son duvet, c’est le geste de la Vénitienne écartant soudain les coudes pour rouler son châle sur la nuque, pour mieux en disposer les plis. Et puis, son regard si honnête, si doux, content de plaire à l’étranger sans mauvaise pensée, moins d’une femme qui connaît son prix que d’un bon animal qui promène et lustre, comme veut la nature, sa beauté!
Les gens du peuple, à Venise, sont pauvres, très pauvres. Aussi leurs frères, les pigeons de la place Saint-Marc, se méfient-ils. Les chats aussi se méfient. Parfois, me promenant le soir, j’ai vu un homme penché dans l’ombre, et puis une longue plainte; l’homme serrait avec ses deux mains.
Au-dessus de cette plèbe, l’antique aristocratie subsiste, qui habite toujours ses palais de famille. Désirez-vous y louer un étage, vous l’aurez tout meublé, et, si vous insistez [p. 58] pour acheter le palais même, je pense que pour cent mille francs vous obtiendrez une belle demeure historique (mais il faudra dépenser la même somme pour les réparations urgentes). Ce n’est point que ces descendants des Magnifiques manquent d’argent, mais leurs intérêts sont dans leurs propriétés du Veneto. Ils manquent encore moins d’esprit, mais ils ne sont plus reliés à rien dans Venise où le patriotisme municipal fut toujours leur vertu et le service de l’État leur emploi. Quand cette grande tâche qui les portait leur fut enlevée, ils glissèrent naturellement aux mœurs de leurs compatriotes, c’est-à-dire à l’indolence.
A travers les siècles, en effet, les Vénitiens, doucement et despotiquement gouvernés par une étroite oligarchie qui fit de l’espionnage son principal moyen intérieur, ont vécu dans une telle méfiance qu’ils se sont désintéressés de la chose publique. Quand la ville perdit son indépendance, elle ne devint pas triste. En 1824, Stendhal écrivait: «Les Vénitiens, les plus insouciants et les plus gais des [p. 59] hommes, se vengent de leurs maîtres et de leurs malheurs par d’excellentes épigrammes.» Aujourd’hui cette grande République semble tout bonnement la ville italienne moderne, aimable, cancanière, à peu près pareille aux autres (du moins pour nos yeux mal avertis d’étrangers).
La République de Saint-Marc est morte, aussi morte que l’Égypte des Pharaons. L’une comme l’autre ont laissé des témoignages fastueux, mais leurs efforts et leur grandeur ne se rattachent plus à rien de réel. L’activité et l’ordre de l’univers sont à cette heure comme si Venise la guerrière, la dominante, n’avait point guerroyé ni dominé. Nul de ceux qui poursuivent les aspects du soleil sur le Grand Canal et qui prennent des glaces sur la Piazza et qui disent: «Combien j’aime Venise!» ne signifie par là qu’il recueille l’héritage de volontés et d’aspirations que symbolise le lion de Saint-Marc. A proprement parler, pour nous, il n’est plus de Vénitiens. La population réelle de Venise semble faite de cosmopolites, millionnaires ou artistes, à peu [p. 60] près fixés dans les vieux palais historiques et sur lesquels passent d’incessantes caravanes de touristes.
En avril 1797, le général Bonaparte dit au commissaire de la République: «J’ai 80000 hommes... je ne veux plus d’inquisition, plus de Sénat... Je serai un Attila pour Venise.» Sur ces terribles menaces, dans un conseil hâtivement réuni par le doge épouvanté, le procurateur François Pezaro prononça une phrase qui, plus sûrement encore que l’épée de Bonaparte, déchire le vieux pacte et désagrège Venise: «C’en est fait, dit-il de ma patrie. Je ne puis la secourir, mais un galant homme se trouve toujours une patrie.»
Je vous propose de recueillir ces mots pour y voir dorénavant la devise de Venise, la formule de sa moralité nouvelle.
Aussi bien, depuis longtemps, elle était en formation, cette Venise cosmopolite. Il ne serait point malaisé de suivre à travers ses annales un élément qui l’a toute envahie aujourd’hui. Le seigneur Pococurante, noble [p. 61] Vénitien, chez qui Voltaire mène Candide, fait voir une belle satiété de dilettante. Les six rois, de qui le souper parut une mascarade de carnaval, précèdent dignement les singularités et les malheurs de don Carlos.
Des causes variées peuvent nous déterminer à un séjour habituel hors du pays natal; Madère, Cannes, Nice, Monaco, Florence, Rome, Corfou, attirent, chacune, des catégories différentes d’exilés volontaires. Les déracinés qui fréquentent Venise sont, plutôt que des amuseurs mondains, des mélancoliques naturels ou des attristés, des âmes ardentes et déçues. En effet, pourraient-ils habiter un tel lieu s’ils ne cherchaient les voluptés de la tristesse? Quelque composite que la fassent ses origines, la société qui se soumet à l’action d’un si rare climat doit nécessairement prendre des mœurs communes. Ce n’est point impunément qu’on s’approprie un même fonds d’images, qu’on enregistre continuellement des sensations si puissantes et si particulières. Toute réunion d’hommes, la supposât-on plus incohérente [p. 62] encore que les cosmopolites qui peuplent aujourd’hui Venise, tend à former une tradition. Elle travaille instinctivement à mettre debout un type sur lequel elle se réglera. Nulle société ne peut se passer de modèle: elle se donne toujours une aristocratie.
Bien des fois, quand la lumière horizontale du soir incendiant Venise magnifie la pointe de la Dogana et la Salute, qui est en somme une fort médiocre église, à l’heure où les magies du soleil descendent sur le canal cependant que les miasmes s’en exhalent, j’ai entendu les airs du carnaval de Venise, ces airs nostalgiques qui retentissent d’une génération à l’autre, et j’ai vu les grandes ombres qui chargent d’un sens riche ces espaces plats. Elles filaient comme les nuages, mais nuages elles-mêmes, à bien examiner, elles font ici l’essentiel et le solide, tout le poids dont Venise aggrave les prédispositions de ses dignes visiteurs.
Les ombres qui flottent sur les couchants de l’Adriatique, au bruit des angélus de Venise, tendent à soumettre les âmes.
Un jour, errant sur les canaux, je trouvai près d’un pont, Ramo dei fuseri, une inscription allemande: «Gœthe habita ici du 28 septembre au 14 octobre 1786.» C’est l’auberge Victoria. Elle fait un bon et solide palais. Au rez-de-chaussée, il y a un marchand de tapis, Faust Carrara. Je me plus tout naturellement à chercher si Gœthe avait promené ici des sentiments qui fussent propres à renouveler ma curiosité.
En 1786, Gœthe ne donna de soins qu’aux édifices de Palladio qui s’est formé par l’étude de l’antique romain.
Avec des œillères, lui aussi, Chateaubriand parcourut Venise. Pour un véritable homme, la discipline, c’est toujours de se priver et de maintenir fortement sa pensée sur son objet. Rien de pire que des divertissements et des excitations de hasard, quand il faut veiller que toutes nos nourritures fortifient un dessein déjà formé. L’auteur du Génie du [p. 64] Christianisme allait quitter, le 28 juillet 1800, le môle de la Piazzetta pour quérir aux ruines d’Athènes, de Jérusalem, de Memphis et de Carthage, les émotions et les images qu’attendaient ses Martyrs. Il mentionne dédaigneusement qu’il a vu dans Venise «quelques bons tableaux». Comme c’était son génie d’enrichir la sensibilité catholique, il ne se plut qu’à s’attendrir près des tombes illustres, dans les églises, tandis que sonnaient les cloches des hospices et des lazarets...
Quelle opposition dans les deux domaines classique et romantique où s’enferment ces deux pèlerins! Mais c’est moins par leurs doctrines que par leur élan que les hommes nous entraînent. Gœthe qui voulait se former une conception sereine de l’univers, et Chateaubriand qui courait conquérir la gloire pour mériter à Grenade une jeune beauté, nous sortent l’un et l’autre des basses préoccupations. Avec l’Iphigénie en Tauride aussi bien qu’avec les Martyrs, nous prenons en dégoût les asservissements de la vie.
L’Iphigénie allemande, jeune bourgeoise ou [p. 65] princesse, ne dira pas tout ce que contient son cœur d’exilée. Mais cette captive se sent de grande race. Ses hautes et fortes pensées sont comprimées, prêtes à éclater. Iphigénie, sur la falaise barbare de Tauride, quand elle entend son frère Oreste, exhale une plainte qui nous émeut, comme fait aux landes bretonnes Lucile caressant René.
Magnifiques annonciateurs! Deux grands poètes, il y a cent ans, passèrent ici, qui cherchaient des formes pour incarner avec le plus de noblesse une même idée d’exil,—exil loin du sol natal et des ancêtres, exil des paradis rêvés. Le jeune Gœthe, si solide, un peu lourd, assuré envers et contre tout, et le vicomte de Chateaubriand, à la fois artificiel et le plus sincère des hommes, voilà deux cariatides, deux beaux pendants au seuil de la Venise cosmopolite.
Sur le sable du Lido, quel est ce rassemblement d’ombres? Mickiewicz, Sand, Musset, [p. 66] Chateaubriand vieilli lui-même viennent chercher les traces des chevaux de Byron. On note ici certaine scène de magie. Au monticule le plus élevé de cette grève, en octobre 1829, par un soir de lune sans brise, tandis que la mer grondait doucement, Mickiewicz appuyé contre un arbre eut une belle vision mystique. Il arrivait de Weimar; l’atmosphère sereine de Gœthe l’avait influencé; elle le détournait des chemins rudes où l’engageait le sentiment de ses devoirs propres et de sa destinée. L’âme de Byron lui apparut; elle le soutint contre cette tentation bien connue de tous les héros. Ce fut sa transfiguration. Il se détermina irrévocablement à conformer sa vie extérieure à sa vie intérieure, et, laissant là toute humaine habileté, à se régler non point sur des calculs personnels, mais, comme il disait, sur la volonté divine.
Que de belles choses nous rencontrerions s’il nous était loisible de suivre ce prophète polonais, ce véritable inspiré, mais il ne fait que traverser Venise où Byron conquiert la place la plus en vue par trois années d’un [p. 67] séjour presque ininterrompu (de la fin de 1816 au début de 1820).
Souhaitez une occasion de remonter la Brenta sur ces barques lentes qui seules cheminent encore de Fusine à Padoue. Par un doux et magnifique automne, tandis qu’aucune lettre de France ne peut ici nous rejoindre, qu’il fait bon sur cette vieille eau désertée! Les deux rives en septembre-octobre ont la belle couleur des fruits mûrs. C’est par cette route que nos aïeux gagnaient Venise, devant une suite continue de maisons de plaisance que le XVIIIe siècle emplit de musique, d’amour et de douceur de vivre. Les guides n’en mentionnent même plus le souvenir. Vainement chercheriez-vous les ruines des villas palladiennes et le dessin des parcs de plaisir. Cependant après un long temps, quand le batelier qu’étonne votre caprice vous nomme Mira, accostez, errez dans cette petite bourgade, car voici l’instant favorable pour évoquer Byron. Ce n’est plus au Lido qui manque de solitude, ce n’est point au fort mauvais palais Mocenigo, dont il n’habita somme [p. 68] toute qu’un étage loué en garni, c’est sur cette rive solitaire, c’est à Mira où il reçut Shelley et sa chère Guiccioli, la comtesse de seize ans, qu’on peut trouver encore l’ombre insolente de l’Anglais.
Mais si, pour évoquer Byron, il n’est pas encore assez de tristesse ni de délaissement sur cette Brenta déchue, allez donc le chercher dans ses pages vénitiennes, dans le quatrième chant de Childe Harold et dans le premier du Don Juan.
Quand la gloire de Byron ne serait plus que la charpente dénudée qui survit au feu d’artifice, j’y porterais encore volontiers mes regards. C’est pour une raison singulière, mais qui ne sait la diversité des motifs sur quoi chacun de nous compose son Panthéon! J’aime Byron parce qu’il ressemble au plus fameux ennemi de mon pays, ennemi qui m’est cher pour ses puissances redoutables elles-mêmes, car nous l’avons glorieusement vaincu. Tous les portraits de Byron font voir cette expression énergique jusqu’à la fureur, impudente, avide de risques et de domination [p. 69] immédiate, magnifique parce qu’elle veut tout briser et qu’elle se brisera elle-même, qu’on voit au Charles le Téméraire peint par Hugues van der Goes (dans le Musée de Bruxelles). Ah! cette belle lèvre inférieure proéminente, chez l’un et l’autre si caractéristique!
Byron le Téméraire! si je parlais pour des hommes libres, je dirais qu’il fut un scélérat, un merveilleux poète et le plus haut philosophe. Oui, Don Juan où Venise secrètement collabore (et je ne dis point seulement par l’influence de l’Arioste, mais encore par une atmosphère de débauches) est la plus haute philosophie. «A Venise, disait Shelley, il s’est ruiné la santé. Sa faiblesse était telle qu’il ne pouvait plus digérer aucune nourriture et il était consumé par la fièvre.» A l’automne de 1819, Moore lui trouva une certaine bouffissure du visage. Avec son incomparable puissance cynique, lui-même écrit dans ses plus belles strophes de Venise: «L’ambition fut mon idole; elle a été brisée sur les autels de la douleur et du plaisir: ces deux déités [p. 70] m’ont laissé plus d’un gage où la réflexion peut s’exercer à plaisir.» Quand il eut trouvé le moyen de pousser sa destinée dans la voie où il suivait les aventuriers normands et les chevaliers errants, en même temps qu’il précédait Garibaldi, quand une mort précoce où l’on voit ses excès interrompit à Missolonghi sa lecture de Quentin Durward, son cerveau, un cerveau formidable, supérieur, dit-on, à celui de Cuvier, était une masse affreuse, mise en bouillie par l’alcool, l’opium, certaine tare et tous les abus destructeurs: un cloaque. Il avait une émotivité formidable: il était perméable à toutes les puissances qu’a la vie pour nous affecter. Il a fait souffrir, torturé tout le monde autour de lui; il a aussi exprimé les plus nobles idées. C’était très naturel qu’il y fût sensible. Dans chacune de nos tourmentes françaises, n’avons-nous pas vu des personnages qui étaient, en même temps que des bandits, les êtres les plus accessibles aux grandes causes généreuses et capables de se faire tuer pour elles? Il a toujours voulu se détruire, ce Byron.
Auprès de ce lord bruyant et de son immense scandale, quel petit personnage que ce jeune Français de vingt-trois ans, presque un gamin, et qui, pour venir à Venise, dut obtenir la permission de sa maman. Ah! la maigre aventure! Une banale histoire d’étudiants et pas très propre de détails. Mais, prestige des grands écrivains, madame Sand, dans sa trentième année, svelte, brune, si souple et si nerveuse, nous dispose à la volupté, et du jeune Musset le nom sonne et craque comme les bottes vernies d’un dandy fringant et confiant jusqu’à la naïveté dans les luttes de la vie. Les anciens avaient de belles anecdotes, familières au menu peuple, où leurs poètes, tour à tour s’essayaient et que les philosophes eux-mêmes employaient pour donner un corps à des idées très subtiles. La caravane que deux poètes firent à Venise en 1834, et dont ils continuent par-delà la mort mille récriminations, pourrait devenir pour [p. 72] nous quelque chose d’équivalent: leurs fureurs, largement étalées, rappellent la brouille mémorable de Didon et d’Énée.
De Venise,—où Byron venait de vivre comme un Anglais et n’avait rêvé que d’un acte qui lui rouvrît l’Angleterre—que connut exactement Musset? Dans cette saison triste et glacée d’hiver, il errait «à Saint-Blaise, à la Zuecca». Il y a peu, j’ai suivi la Giudecca jusqu’à San Biagio, où les coquelicots flamboyaient sous le soleil couchant, au ras de la lagune; j’ai tourné, puis longé l’ancien cimetière juif par une rivière dont on fauchait les rives. «Comme elle frissonne!» me disait un jeune Italien en me montrant la végétation des tombes courbée par un vent humide; et c’est le mot dont se servait, à Paris, une jeune femme pour me vanter la Duse: «Elle frissonne si bien!» et c’est encore l’accent des jeunes Athéniens qui disent de leurs montagnes: «Elles sont si sereines!» Quel désert et quel ennui pour ceux que leurs nerfs impatientent! Je croyais voir le jeune Musset—fin, moqueur avec d’immenses [p. 73] réserves sentimentales, mais que protège une coquille de sécheresse—vaguer, chercher partout le boulevard de Gand, se distraire en petites débauches.
Elle était fort misérable, vers 1834, la vie de Venise que moi-même j’ai connue bien pauvre, il y a vingt années, et que les badauds de tous rangs sont en train de faire confortable (et allemande), mais inhabitable, car ils en chassent la solitude. «Me trouvant mal à l’auberge, a dit Musset, je cherchais vainement un logement. Je ne rencontrais partout que désert ou une misère épouvantable. A peine si, quand je sortais le soir pour aller à la Fenice, sur quatre palais du Grand Canal, j’en voyais un où, au troisième étage, tremblait une faible lueur; c’était la lampe d’un portier qui ne répondait qu’en secouant la tête, ou de pauvres diables qu’on y oubliait. J’avais essayé de louer le premier étage de l’un des palais Mocenigo, les seuls garnis de toute la ville, et où avait demeuré lord Byron[3]; le loyer n’en coûtait pas cher, mais nous étions alors en hiver, et le soleil n’y pénètre [p. 74] jamais. Je frappai un jour à la porte d’un casin de modeste apparence qui appartenait à une française nommée, je crois, Adèle; elle tenait maison garnie. Sur ma demande, elle m’introduisit dans un appartement délabré, chauffé par un seul poêle et meublé de vieux canapés. C’était pourtant le plus propre que j’eusse vu, et je l’arrêtai pour un mois; mais je tombai malade peu de temps après, et je ne pus venir l’habiter.»
Favorable maladie qui sort l’enfant Musset de toute cette médiocrité. Nous ne remercierons jamais assez quelques bulles de gaz malsain qui vinrent crever à la surface de l’eau autour de la gondole de Musset. La malaria de Venise met nécessairement dans l’organisme une certaine excitation qui le force à produire des images exaltées. En février et mars 1834, elle alla chercher, dans le fond de ce jeune homme un peu sec, des puissances qu’il ignorait. Nul doute qu’elle n’y ait aggravé la tare physiologique, je veux dire ce trouble nerveux, cette puissance de voir son double, auxquels nous devons les [p. 75] grandes incantations d’un poète, qui, en dehors de ces délires, est à peu près négligeable.
Les analystes ou, pour parler net, les aliénistes connaissent parfaitement une sorte d’hallucination qui est la vision de sa propre image. On trouve des traces nombreuses de ce phénomène dans la haute littérature. Nulle part on ne le rencontre plus précis, plus authentique que chez Musset. La sublime Nuit de décembre: «Sur ma route est venu s’asseoir—un malheureux vêtu de noir—qui me ressemblait comme un frère...» n’est pas une froide invention. Tout me crie qu’elle est faite de choses vues. Au cours de sa brève carrière, le génie de ce poète ne se témoigna jamais mieux que lorsqu’il subissait des reprises de la malaria vénitienne. Dans ces états fiévreux, les vieilles images de sa catastrophe d’amour, contemporaines de sa première infection, émergeaient nécessairement sur sa conscience. Le paludisme de Venise a collaboré activement à toute cette série d’excitations et de dépressions que nous admirons [p. 76] dans la prose et dans les vers de ce charmant énergumène.
Le soir, avant de s’endormir, quand il entr’ouvre ses fenêtres sur le golfe de Saint-Marc, le voyageur descendu à l’hôtel Danieli doit se dire avec reconnaissance, avec effroi aussi, en un mot avec piété: «Voici donc le décor où cet enfant subit les malaxations du climat vénitien.» Mais vingt fois nous traverserons le quartier de San Fantin et nous ne chercherons pas dans une arrière-cour fort humble, dans la corte Minelli, la casa Mesani où George Sand, auprès de son beau taureau Pagello, écrivait diligemment ses Lettres d’un voyageur. N’allons point déranger cette dame!... On sourit et l’on passe.
La justesse d’esprit est une si belle chose que nous l’exigeons des grands écrivains et ne leur pardonnons point de la gâter chez le lecteur. Nous réprouvons dans George Sand un symbole glorifié du désordre. Elle parut telle à Venise, mais, par la suite, nous pouvons saluer la fécondité, la puissance, la maîtrise de la châtelaine de Nohant. Tout ce qu’il y a [p. 77] de mauvais et d’irritant chez George Sand, c’est son romantisme de désorbitée, de désencadrée. Tout ce qu’elle a de santé, c’est le régionalisme. Tant qu’elle n’eut point trouvé son terrain, sa pente et son cours, elle faisait une force de destruction. Cette protestante qui avait des sens se querellait elle-même et nous obligeait à prendre parti dans son éloquente anarchie intérieure. Enfin, avec beaucoup d’énergie et une rare sûreté d’instinct, elle sut se conquérir un milieu, une tradition. A la prendre au total, ses années d’expérience, loin de nous scandaliser, peuvent nous édifier. J’admire dans la romancière apaisée du Berry une racinée qui, des déracinements même dont elle pâtit, sut faire sortir une démonstration très forte que l’acceptation d’une discipline est moins dure, au demeurant, que l’entière liberté.
A vingt-cinq kilomètres de Venise, la vieille petite ville de Chioggia baigne et s’allonge [p. 78] dans la lagune. Nulle architecture, mais toutes les barques, toutes les variétés d’engins pour la pêche, et vingt mille habitants qui vivent de la silencieuse Adriatique. C’est le bon endroit pour évoquer Léopold Robert qui, pendant ses trois dernières années, de 1832 à 1835, étudia sur cette plage son fameux tableau Le départ des pêcheurs de Chioggia pour l’Adriatique. Il y maria tout naturellement la misère des Chiojotes avec ses dispositions intérieures.
«Il y a une pensée qui me plaît dans ce Départ, écrivait-il; il annonce la fin de tout.» Après les Moissonneurs, chant de confiance dans la vie, les Pêcheurs, c’est le testament qu’un suicidé laisse sur sa table. Son tableau terminé, Léopold Robert se tua dans le palazzo Pizani, à San Paolo, dont il occupait un étage. Année 1835.
Si j’aime ce peintre malheureux et sec, c’est qu’il eut dans les herbages du Jura, au milieu des pâtres et des vaches, l’enfance virgilienne de Claude Gellée qui, sur ma Moselle, s’imprégnait de sentiments simples. L’Italie [p. 79] ne détruisit point l’âme extensible de mon compatriote; comme un beau fruit se nourrit de soleil, harmonieusement il s’augmenta de beauté. La sécheresse lorraine (de Callot, de Grandville) n’est point irrémédiable, elle devient aisément force et souplesse, toscane et romaine. Mais le Suisse Robert écrivait de Venise: «Je me sens malade du mal de ceux qui désirent trop.»
Suis-je le seul aujourd’hui, dans les salles du Louvre, à chercher l’Arrivée des Moissonneurs dans les marais Pontins et le Retour du pèlerinage à la Madone de l’Arc? Il ne faut point souhaiter que nos experts révisent cette gloire pré-romantique. Mais si l’on veut connaître les raisons qui la justifiaient, on les démêlera aisément dans l’apologie que Musset fit des Pêcheurs en 1836: Robert a montré «dans six personnages tout un peuple et tout un pays»; avec puissance, sagesse, patience (c’est ce que nous appelons sa sécheresse, sa difficulté), il s’est révélé capable de «renouveler les arts et de ramener la vérité»; il ne retraçait «de la nature que ce qui est beau, [p. 80] noble, immortel»; il peignait «le peuple»; il cherchait «la route de l’avenir là où elle est, dans l’humanité». Les heureux artistes qui, par la suite et en se divisant la tâche, trouvèrent ce que cherchait Léopold Robert, ne nous laissent plus sentir dans son œuvre que des tâtonnements, des efforts, et que le théâtral d’où il voulait s’évader. Toutefois à Chioggia, son chef-d’œuvre, aujourd’hui rebuté, revit, reprend un sens et, comment dirais-je?... un parfum. C’est l’anneau que nul n’essuie à la montre de l’antiquaire, mais que tous voudront baiser s’il retrouve la jolie main qu’un amoureux jadis bagua. Je rapporte à la sirène des lagunes cette relique tachée de sang.
Léopold Robert fut un jeune homme timide, hanté de mélancolie héréditaire (un frère suicidé), sujet à des découragements et que ce fiévreux climat devait à la fois attirer et détruire. En février 1832, quand il vint travailler à Venise, il souffrait d’un accident de jeunesse: une jeune femme, de qui le nom fait un excitant pour l’imagination, l’avait accueilli à Rome avec une douceur, une simplicité très [p. 81] puissantes sur un jeune Suisse. Cette princesse, Charlotte Bonaparte, fille de Joseph Bonaparte et belle-sœur de celui qui devint Napoléon III, se trouva subitement veuve en 1831, à l’âge de vingt-neuf ans; elle se retira chez sa mère à Florence où le jeune Léopold Robert continua ses assiduités. Il la plaignait; on s’accorde à dire qu’elle n’était pas belle; il l’aimait. Un mariage si disproportionné semblait impossible. L’honnête jeune homme, peu fait pour dompter une Napoléonide, s’enfuit à Venise. Depuis longtemps il projetait d’y peindre un brillant carnaval.
C’est quand Venise met son masque de satin noir qu’elle multiplie ses puissances de tristesse. D’ailleurs, les parties fastueuses de la ville des Doges ne pouvaient plaire à ce plébéien sentimental. On le vit errer dans les régions les plus misérables, à Pellestrina, à Chioggia. «Il faut que je te dise, écrivait-il à un ami, ce qui m’est arrivé à Chioggia; j’ai eu de ces moments que je ne sais à quoi attribuer. J’étais dans une mauvaise petite auberge, fatigué d’avoir couru toute la journée et [p. 82] de n’avoir pas dormi la nuit précédente, enfin je voyais tout en noir; je prends mon petit carton à lettres pour en commencer une; impossible de mettre deux mots, je ne pensais qu’à la mort. Je voyais sous mes yeux les débris d’une jetée battue par les vagues; enfin j’avais la fièvre, car je souffrais assez. Puis, au moment où je me sentais arrivé au dernier point, une sainte colère me prend contre moi de ma faiblesse; je jette tout par terre avec rage, je commence à me dire les injures les plus mortifiantes; mon amour-propre s’en est choqué et mon énergie est revenue. Je me suis dit: nous verrons si je suis une poule mouillée. Je tapais des poings sur la table pour exciter ma force morale par ma force physique; et dès ce moment je suis tout remis et je ris de mon aventure.»
Ho, ho! qu’il a tort de rire! Ces excitations et ces dépressions ne me disent rien qui vaille. La terre étroite de cette extrême lagune, un ciel d’hiver, des eaux mélancoliques, des types graves et nobles se marièrent à ses sentiments. Il décida de peindre le Départ des [p. 83] pêcheurs de Chioggia pour l’Adriatique. «Je n’aurais point fait mon tableau si mon cœur n’eût été plein d’affections. Elles donnent à mon énergie du ressort. Elles sont pour moi, dans la vie, les degrés qui me font monter...» Les degrés qui le font monter! Je pense à ces pontons qu’il y a dans les bains et que l’on gravit pour se jeter à l’eau.
Léopold Robert demandait-il à son travail ce que Le Tasse espéra du VIIIe chant de la Jérusalem? Prétendait-il par la gloire se hausser jusqu’à son idole? La divinité des lagunes l’entraînait. La Sirène ne fut jamais que cette fièvre délicieuse qui nous chante et nous convainc de ne plus vouloir vivre. En vain nos compagnons nous supplient. Leur activité nous fait horreur. «C’est drôle comme Venise m’a rendu, disait Léopold Robert: je ne souhaite que la tranquillité. Pouvoir m’occuper de ma peinture et rendre mes inspirations.» Comme il définit agréablement son mal! «Toute remplie qu’en soit mon âme, je trouve cet état moins pénible que le vide du cœur... La raison, le devoir, le caractère de [p. 84] mon attachement peut-être ne permettent pas à une tristesse violente de s’emparer de moi; c’est seulement une mélancolie qui ne peut nuire à mes travaux.» Sans doute, il a raison: un certain paludisme est très propre à la sensibilité artistique, mais si son infection réveille des germes héréditaires, c’est la destinée de notre race qu’il nous faut accomplir.
Pendant de longues semaines, Léopold Robert fut malade d’une fièvre cérébrale analogue à celle que, dans la même année et dans la même Venise, à quelque cent mètres, madame Sand et le docteur Pagello penchés sur le lit de Musset observaient avec l’involontaire mépris des gens solides pour les délirants. Toutefois le frère d’un suicidé fait un terrain plus dangereux qu’un simple épileptique.
En 1835, peu avant le dénouement qu’il n’avait pas encore décidé mais qui commençait à se développer en lui, Robert écrivit à son neveu des conseils où manque assurément le point de vue du déterminisme physiologique, mais qui sont admirables de [p. 85] clairvoyance. «J’ai cru remarquer chez toi, lui dit-il en substance, le goût de l’isolement, une pente à philosopher sur les choses et puis à mépriser la société; ne cède pas à ces dispositions pernicieuses.» On voudrait savoir ce qu’il advint de ce jeune averti. En mars 1835, Léopold Robert écrivit à ses sœurs: «Il me semble que je ferais bien d’entreprendre un voyage, et je ne sais ce qui me retient ici. Je suis comme un paralytique, moralement parlant: je ne suis plus capable de prendre par moi-même un parti; il faut donc écouter les autres. Dieu veuille que cette détermination soit avantageuse à tous! Le bonheur de vous revoir, mes bien-aimées, sera toujours senti par moi, mais l’idée que j’en ai maintenant est accompagnée d’un sentiment pénible. Je me figure que je ne puis plus donner de plaisir à ceux mêmes que j’aime le plus, à cause de la mélancolie profonde qui semble me suivre partout.» Le 29 mars 1835, il reçut des nouvelles de la princesse Charlotte qui venait d’accueillir, il n’en fallait pas douter, les tendres hommages [p. 86] d’un brillant Polonais. Il se fit chanter par deux musiciens allemands le Requiem de Mozart. Le lendemain, échappant à la surveillance de son frère, il s’enferma dans son atelier du palais Pizani et se coupa la gorge devant le Départ des Pêcheurs.
Ce printemps de 1835 est magnifique de sentimentalité romantique. C’est le suicide de Léopold Robert qui brûle avant de mourir les lettres de sa princesse; c’est la rupture de Vigny avec madame Dorval; c’est le conflit de Musset avec madame Sand. Et l’on remarque qu’à deux de ces fièvres le paludisme de Venise collabore activement.
Après un tel chuchotement d’intimités, c’est un délice d’écouter le noble son de violoncelle que met un pur artiste dans cette ville, et d’entendre sur le vieux thème du Carnaval de Venise la variation de Gautier:
Ce pauvre et bon Théophile Gautier, si honnête! il écrit plutôt lourdement, sans éclairs, sans frissons, mais il se campe avec solidité devant le fait, devant la pensée, devant la sensation qu’il veut exprimer, en sorte qu’il parvient toujours à nous les faire toucher et palper. En 1850, il passa deux mois place Saint-Marc. Il se proposait d’écrire une série de livres sur Florence, Rome, Naples: il nous donna du moins une Venise. Dans le minutieux inventaire qu’il a dressé de cette ville, vous chercheriez vainement une note sur le mal qu’avec son charme elle lui fit. Depuis Fortunio (1838), dernier livre où il [p. 88] exprima sa pensée véritable, l’invasion du cant, comme il disait, et la nécessité de se soumettre aux convenances des journaux l’avaient jeté dans la description purement physique; il n’énonçait plus sa doctrine, il gardait son idée secrète.
Devrons-nous donc ignorer à jamais les sentiments qu’il promenait sur les lagunes et ce regret, «ramier qu’on étouffe...»? Un lecteur superficiel considère peut-être la Venise de Gautier comme une suite de photographies prises à toutes les heures d’un voyage, mais d’où naturellement le photographe est absent. Nous ne partageons point cette manière de voir. Cette riche collection de camées, gravés dans l’isolement et loin de nos passions, nous renseigne mieux sur l’histoire morale du XIXe siècle que tant de confessions oratoires et vaniteuses. Dans la Venise de Gautier, vous prétendez chercher vainement l’âme; vous dites que ce sont des coquilles sans l’animal, des pierres dures ciselées en creux. Eh bien! que votre esprit se prête à la pression de ces intailles: comme [p. 89] autant de cachets, elles vous imposeront leur empreinte. Et si, les ayant lues, vous entonnez un hymne esthétique, si vous déclarez: «Je crois à la richesse, à la beauté et au bonheur», ne vous y trompez pas, c’est le cachet qui se décrit lui-même: le Credo de Gautier s’est imprimé sur votre âme.
Avec ses yeux nets, Gautier catalogue tous les détails de Venise. Dans toutes les formes qu’il excelle à saisir, il note avec une obstination inlassable et tranquille les dégradations modernes. Chacune de ses pages lentes et précises a un arrière-plan. Derrière les villes et les paysages qu’il peint et déroule sous nos regards, il se réserve un royaume de nostalgie, un vaste Eldorado où il réfugie ses dégoûts d’exilé.
Si j’étais chargé de rédiger un guide-âne, comme on en distribue dans les concerts pour aider à la compréhension des grandes symphonies, je dirais à peu près ceci à ceux qui veulent suivre Gautier à Venise:
Un homme s’imagine qu’il serait mieux où il [p. 90] n’est pas. Il s’occupe à feuilleter des albums en attendant de pouvoir jouir des beautés qu’ils représentent.
Il se berce dans quelque inexprimable rêverie orientale toute pleine de reflets d’or, imprégnée de parfums étranges et retentissante de bruits joyeux; il y développe des sentiments d’élégance, de fierté et de sensualité, et, au lieu de se dire que par leur nature même de tels états demeurent intérieurs, il pense qu’il les trouvera réalisés dans d’autres lieux.
Mais peu à peu il se convainc que toute la terre est gâtée, et sans cesser de poursuivre les parties excellentes qu’elle conserve, il éprouve un dégoût fait de saturation et d’exigence, parce qu’il voudrait participer à la civilisation totale dont il croit que ces parties sont des survivances fragmentaires.
Cela produit une satiété particulière: non pas l’ennui que connaissent les gens qui ont abusé de tout, mais cette nostalgie, cette grande fatigue que cause une perpétuelle et vaine tension de l’âme.
[p. 91] Avec quel amer retour sur lui-même Théophile Gautier écrit de son Fortunio: «Jamais un désir inassouvi ne rentra dans son cœur pour le dévorer avec des dents de rat!» Chassez l’image d’un matérialiste lourd, endormi, indifférent. Bien au contraire, c’est un idéaliste dévasté par sa puissance à concevoir nettement des objets qui le fuient. Mais cette activité unique et profonde, où Gautier absorbe toutes ses forces, livre son corps, sa vie, aux circonstances.
Dans ma jeunesse, je fis un long séjour à Venise. D’abord je passai mon temps à lire sur les palais l’histoire magnifique de la République,—à contrôler dans les musées et les églises écrasées d’or les catalogues,—à me réjouir, matin et soir, de la mer, du soleil et de l’air pur qui égaient la vie,—et sur les petits ponts imprévus à regarder la tristesse des canaux immobiles entre des murs écussonnés.
Après trois semaines, quand mes nerfs [p. 92] furent moins sensibles à cette délicate cité, je quittai la Piazza trop envahie de touristes choquants pour me confiner dans une Venise plus vénitienne. J’écrivis Un Homme Libre. «Pauvre petit livre où ma jeunesse se vantait de son isolement! J’échappais à l’étouffement du collège, je me libérais, me délivrais l’âme; je prenais conscience de ma volonté. Ceux qui connaissent la littérature française déclareront que ce livre eut des suites. Je me suis étendu, mais il demeure mon expression centrale. Si ma vue embrasse plus de choses, c’est pourtant du même point de vue que je regarde[4].» J’habitais Fondamenta Bragadin, ce qui me plaisait, car le noble Bragadin fut écorché vif et parfois il me sembla que, toute proportion gardée, j’avais reçu un sort analogue.
Je voudrais ramasser en une dizaine de tableaux très brefs les sensations de mes vagabondages vénitiens. Ces bonheurs légers, c’est sur la minute qu’il eût fallu les fixer.—Je vois un matin où j’étais assis, dans la basilique de Saint-Marc, sur les marbres [p. 93] antiques et frais, tandis que le bon chien muselé de ma propriétaire allongeait sur mes genoux sa vieille tête de serpent honnête. Et l’un et l’autre nous regardions avec une parfaite volupté le cabossement des mosaïques, leurs teintes sombres et fastueuses. Satiété et nostalgie, voilà les deux mots contradictoires qui rendent le mieux ce qu’il y avait de sommaire dans ma contemplation. J’étais saturé d’un rêve asiatique où manquaient toutefois les parfums, les danses et la monotone cithare.—Je vois au quai des Esclavons le vapeur du Lido chargé de misses froides. Une barque sous le plein soleil s’approche. Une fille de dix-sept ans, debout, avec aisance y chantait une chanson éclatante comme ces vagues qui nous brûlaient les yeux. Ces palais, cette mer, cet horizon, cette chanteuse et cette voix nerveuse qui frappait un ciel bleu et or me firent cruellement ressentir la morne hébétude de ces curieux sans âme. O mouvements de désespoir qu’il y a dans l’excès du plaisir! Nos mains vides nous déchireront-elles pour trouver dans notre cœur quelque [p. 94] chose qui nous rassasie, ou vont-elles continuer de battre le soleil, le vent et la vague? Une odeur fade s’élève des lagunes.
Dans cette ville de l’inquiétude, je connus toutes les délices sensuelles. Jamais pourtant, oserai-je le dire? je n’oubliai de sentir couler lentement les heures. Aux meilleurs détours de cette Venise si variée et dans une telle surabondance d’imprévu, toujours j’attendais quelque chose.
Vers le crépuscule, après une journée de travail, quand je débouchais de mes Fondamenta Bragadin en face de la Giudecca, soudain je voyais le soleil comme une bête énorme flamboyer au versant d’un ciel délicat, par-dessus une mer élégante et de tendresse vaporeuse. L’admiration m’envahissait. «Je suis certainement, pensais-je, devant un des beaux paysages du monde.» Puis, avec une vitesse singulière de réaction, mon âme désœuvrée me disait: «Quoi donc! es-tu certain que cela t’intéresse?»
Un jour je m’étendis sur un banc de marbre, quai des Esclavons, au ras de la mer; c’était [p. 95] le banc de M. Taine, le banc où il se plut dans son voyage à Venise, du 20 avril au 2 mai 1864. «Là, dans l’ombre qui est fraîche, on contemple les merveilleux épanchements du soleil, la mer encore plus éclatante que le ciel, les longues vagues qui se suivent apportant sur leur dos des éclairs innombrables et pacifiques, les petits flots, les remous frétillants sous leurs écailles d’or; plus loin les églises, les maisons rougeâtres qui s’élèvent comme du milieu d’une glace polie, et cet éternel ruissellement de splendeur qui semble un beau sourire... Le seul moyen efficace de supporter la vie, c’est d’oublier la vie.» Une telle phrase joint M. Taine à la foule des ombres qui vaguent sur Venise; il n’y vécut aucune aventure; seulement quelques heures il rêva sur un banc.
Encore qu’elles fassent un bon abécédaire pour débrouiller le jeune voyageur, on peut négliger les rédactions de Taine sur Venise, mais ses rêveries qui flottent sur cette ville n’en sont pas les moins riches nuages. Il se plut à se disperser l’âme sur la [p. 96] lagune, comme il la dispersait dans la nature.
Ce fils des puissantes Ardennes fut l’amant du Tintoret, de la même manière que l’amant des forêts. Certes, il ne permettait point à ces désordres de la rêverie qu’ils commandassent son activité. Contre la vie réelle, si pleine de dégoûts et de souffrances, il s’abritait dans une tâche, dans ses massives constructions. Il se contraignait à un travail systématique: analyser, classer. Mais sa détente était de courir la campagne, de s’abîmer dans la contemplation. Ainsi fit-il sur ce banc de marbre, en face de San Giorgio Maggiore.
Taine eût donné toute son œuvre pour la Chartreuse de Parme; sa peur de la vie ne lui permit jamais les expériences préalables, la cueillette des fruits d’or trompeurs, nécessaires pour cet âcre breuvage. Il aima comme des frères Byron et ce Musset dont il avait la ressemblance[5]; mais la perfection qu’ils poursuivirent, il savait qu’elle n’existe pas. «Si quelque chose approche de la perfection, ce n’est pas la femme, c’est l’homme, de sorte que mon idéal serait bien plutôt une amitié [p. 97] qu’un amour. Il y a plus: j’y ai renoncé. Cette tristesse calme, ce découragement raisonné qui m’a pris à l’endroit de la pensée me prend aussi à l’endroit de l’amour; je n’espère pas. Nul homme réfléchi ne peut espérer.»
Acceptation de l’échec, connaissance que toute vie, nécessairement, implique un échec: voilà qui enrichit le sens de cette Venise considérée comme le refuge des vaincus. Dans la formule du découragement raisonné, elle leur offre un nouvel abri.
Encore une nuance, et, dans ce beau ciel des orages vénitiens, nous aurons tout l’arc complet.
En 1853, Wagner, exilé d’Allemagne, écrivait à Liszt que, s’il n’obtenait pas de rentrer à Weimar, il abandonnerait l’art «pour aller courir le vaste monde et pour voir s’il ne lui serait pas possible de trouver encore quelque plaisir à vivre». Liszt lui répondit: «Tu voudrais vaguer à travers le vaste monde [p. 98] dans l’espoir d’y trouver vie, jouissances et délices! Ah! comme de tout cœur je souhaiterais qu’il en pût être ainsi! Mais ne sais-tu donc pas que l’aiguillon de la blessure dont tu souffres est dans ton propre cœur, que partout tu le porteras avec toi et que rien ne peut t’en guérir? C’est ta grandeur qui fait ta misère. L’une et l’autre sont inséparables et doivent te martyriser, jusqu’à ce que, te reposant dans la foi, tu trouves ta délivrance... C’est dans le Christ, c’est dans la souffrance résignée en Dieu qu’est seulement le salut.»
Wagner croyait encore qu’il est quelque part sur la terre un Eldorado et qu’on y atteint par l’amour. Optimisme à peine digne d’un berger de romance! Mais qui de nous n’a point, quelque jour, rêvé que la force d’attraction organiserait naturellement le bonheur, dès l’instant qu’on abolirait les lois?
En 1854,—fallait-il donc qu’il eût doublé la quarantaine pour qu’un sang trop chaud cessât d’envoyer à sa cervelle de si épaisses illusions?—sa philosophie s’épura. Il en vint à s’assurer que le salut résidait dans le [p. 99] renoncement: «J’ai aujourd’hui un calmant qui m’aide à trouver le sommeil: c’est le désir ardent et profond de la mort. Pleine inconscience, évanouissement de tous les rêves, non-être absolu: telle est la libération finale.»
Wagner était prêt à épandre les ondes infinies, les suaves harmonies où Tristan et Isolde aspirent à se perdre. En 1857, malheureux de son impuissance à développer publiquement ses véritables destinées artistiques, malheureux d’un amour impossible, il se rendit à Venise pour composer le deuxième acte de Tristan.
Je ne souhaite à personne de se soumettre aux influences de cette sublime tragédie, car ce qu’elle met dans notre sang, c’est une irritation mortelle, le besoin d’aller au delà, plus outre que l’humanité. Si les ivresses de la possession ne nous apaisent pas, si dans une folie d’amour nous continuons à nous déchirer contre la vie, notre aspiration normale à nous confondre dans l’objet de notre amour se mue en une sorte de désespoir au bout de [p. 100] quoi il n’est plus rien, qu’un anéantissement volontaire dans la mort. Vertige, ivresse des hauts lieux et des sentiments extrêmes! A la cime des vagues où nous mène Tristan, reconnaissons les fièvres qui, la nuit, montent des lagunes.
Bien souvent, aux fenêtres du palais Giustiniani, aujourd’hui hôtel de l’Europe, et que Wagner habitait durant l’hiver de 1857, j’ai vu flotter sur la Venise nocturne les fascinations qui le déterminèrent et qui furent les moyens mystérieux de son génie. Quand la pire obscurité pèse sur les canaux, qu’il n’est plus de couleur ni d’architecture, et que la puissante et claire Salute semble elle-même un fantôme, quand c’est à peine si le passage d’une barque silencieuse force l’eau à miroiter, et si les nuages, en glissant dans le ciel, découvrent çà et là une très faible étoile, la ville enchanteresse trouve moyen tout de même de percer cette nuit accumulée, et de ce secret solennel elle s’exhale comme un hymne écrasant d’aridité et de nostalgie... Voilà les heures, j’en suis assuré, qui de la profonde [p. 101] conscience de ce Germain surent extraire les déchirantes incantations de Tristan et d’Isolde.
Au reste nous tenons de Wagner lui-même, un texte où l’on voit la génération du deuxième acte.
Venise, qui s’en étonnera? avait donné à son hôte les insomnies habituelles, le subtil, le délicieux malaise qu’elle insinue toujours dans nos veines: «Une nuit, ne pouvant pas dormir, je m’accoudai sur mon balcon, et comme je contemplais la vieille ville romanesque des lagunes, qui gisait devant moi, enveloppée d’ombre, soudain du silence profond un chant s’éleva[6]...» Chacune de ces touches, vieille, romanesque, gisante, enveloppée d’ombre, silencieuse, que Wagner emploie spontanément ici pour qualifier Venise, est très caractéristique des forces de rêverie qu’il accepte de cette ville. De ce silence profond, un chant s’élève. Comment le poète va-t-il le comprendre?
«C’était l’appel puissant et rude d’un gondolier veillant sur sa barque, auquel les échos [p. 102] du canal répondirent jusque dans le plus grand éloignement; et j’y reconnus la primitive mélopée sur laquelle, au temps du Tasse, ses vers bien connus ont été adaptés, mais qui est certainement aussi ancienne que les canaux de Venise et leur population...» Merveilleuse décision du génie! Voilà donc que cette chanson de gondolier devient par la volonté instinctive du poète un chant puissant et rude de population primitive, mais chargé dans la suite de toute la mollesse, de toute la volupté, de tout le faste que symbolise ce nom, le plus grand du Midi, le Tasse. Toute puissance et toute rudesse enrichies de toute volupté et venant du fond des siècles!
«Après une pause solennelle, le dialogue retentissant dans le lointain s’anima, au point de se fondre en une seule harmonie, puis au loin, comme auprès, le son s’éteignit dans un nouveau sommeil...» Le chant de Venise se tait, c’est Wagner qui se charge de le continuer. Toutes les puissances de ce grand Allemand sont déchaînées par cet appel; il se raccorde à cette barbarie primitive, à cette [p. 103] volupté déchirante, et du silence qui leur succède il fait son domaine.
«Après cela, que pouvait bien la Venise ondoyante et bariolée m’apprendre d’elle-même sous les rayons du soleil, que ce rêve sonore de la nuit ne m’eût pas révélé d’une façon plus profonde et plus directe?»
Il n’a fallu que deux temps pour que cet Allemand substituât à cette ville latine sa Germanie intérieure. Dès la première pause, cette Venise magnifique par son manque de symétrie, par sa diversité même, il la réduit à l’unité. Sur la seconde reprise, il la renie, la dit inutile. Elle est la barque qu’il repousse après qu’il a touché la rive. Efface-toi, Venise ondoyante et bariolée. Par toi, nous avons atteint le point de vue indéfiniment fécond. Nous savons que les mouvements de l’âme façonnent le monde extérieur, font éclater les actes et les faits comme la tulipe s’exhale du magnolier et comme de la tulipe son parfum. Dès lors, Venise, tu nous deviens inutile; tu n’es que conséquence et nous sommes l’essentiel, le principe. Tu nous gênes, tu nous [p. 104] retiens dans un monde inférieur et qu’il faut dépasser. Effondre-toi sous ta lagune. Que les grandes ondes de l’océan musical s’épandent, que les vagues sonores noient et anéantissent tous les accidents! Plus de lumière: la nuit. La nuit fait pour Tristan le domaine de l’amour, pour le Germain Wagner, le domaine de la vie intérieure, et, pour Venise, le domaine de la fièvre. Le jour est dispersion, contrariété, amoindrissement. Sur la route immémoriale qui va du Nord par-dessus les Alpes, l’Allemagne entendit Juliette à sa fenêtre de Vérone se désoler du jour que les cris de l’alouette annoncent et qui la sépare de son tendre jeune homme. Un tel chant ne saurait s’oublier. La nuit plus belle que le jour! Ce thème empoisonne notre sang, s’il se développe indéfiniment, avec une ampleur grandissante, de la passion contenue à la volupté débordante, jusqu’à la transfiguration dans la mort. Après l’alouette matinale, après Juliette et Roméo, voici, dans le brouillard, les chants de Tristan et d’Isolde: «Haine au jour implacable et hostile! O jour perfide, anathème! Mais toi, [p. 105] nuit, vie sainte d’amour, auguste création de volupté, désir délicieux de l’éternel sommeil, sans apparence et sans réveil, recueille-nous dans ton sein, affranchis-moi de l’univers!... Le monde pâlit, le monde, spectre décevant que le jour place devant moi, et c’est moi-même qui suis le monde.»
Ces harmonies où Tristan aspire à se perdre et qui flottent autour du Saint-Graal, Wagner, en 1883, revint les solliciter des bercements et des fièvres de la lagune. Il travaillait à son opéra des Pénitents sur la légende de Bouddha... Apothéose de Venise, dernier terme de la série dont nous vîmes les numéros successifs... Avec ses moyens brutaux, il eût fixé dans ce suprême opéra les sensations que nous effleurâmes un soir de Venise que nous nous livrions au silence de ses lagunes et au vent de ses sépulcres. C’est ici que nous aurions touché les points extrêmes de la sensibilité, quand le rare s’élargit et se défait dans l’universel et que notre imagination, à poursuivre le but sans cesse reculé de nos désirs, s’abîme dans une lassitude ineffable. La [p. 106] musique seule—car nous sommes convaincu qu’il n’y a point discontinuité entre les arts divers—peut intervenir à cet instant où la littérature et la peinture depuis longtemps confessent leur échec.
Wagner est mort dans l’entresol du palais Vendramin Calergi, le 13 février 1883, d’une maladie de cœur. Auprès de lui se tenait celle qu’il obtint de Hans de Bulow par un héroïsme romantique. L’intendant qui conduit le visiteur de salle en salle dit: «Oh non! ce n’est pas ici (dans les beaux appartements) qu’il est mort; ici habite la propriétaire (Madame la duchesse della Grazia); Wagner logeait au-dessous, dans un appartement plus bas de plafond.» Ce serviteur sincère, par son accent légèrement dédaigneux, force le passant à se remémorer des banalités, qui sont d’ailleurs des vérités, sur la position subalterne d’un aristocrate sans pouvoir réel auprès d’une puissance de fait comme le grand Allemand.
Que sont les «grandeurs d’établissement», [p. 107] c’est-à-dire les grands que la coutume installe, auprès de ces magiciens que nous venons de surprendre dans leur activité obscure quand ils relèvent la domination de cette Venise abolie et qu’avec ses couleurs et ses odeurs de mort ils font tout simplement de l’âme! Le Don Juan, la Confession d’un Enfant du Siècle, les Pêcheurs, l’Italia, Tristan demeurent en suspens sur la ville des lagunes et s’ajoutent, quand nous la visitons, à nos âmes inertes. Venise au XIXe siècle fait encore des conquêtes. Le politique l’abandonne à sa décadence, mais Wagner, Taine, Gautier, Léopold Robert, Sand, Musset, Byron, Chateaubriand et Gœthe forment son «Conseil des Dix».
—Ils ne sont que neuf, me dit un lecteur.
—Qu’on réserve le dixième siège. Je connais telle candidature.
L’Europe, qui se complut toute dans les images romantiques où les fièvres de Venise avaient collaboré, cherche aujourd’hui la raison, [p. 108] l’équilibre, et se vante d’échapper à de tels désordres... Mais aux canaux de Venise, le sillage des Byron, comme l’ornière d’un char, maîtrise toujours les gondoles. Ici, l’on ne peut sentir que selon les poètes. Qu’ils nous enseignent la révolte ou la soumission, cette ville privée de son sens historique, et qui n’agit plus que par sa régression, nous enveloppe d’une atmosphère d’irrémédiable échec. Ville vaincue, convenable aux vaincus. Comme un amant abandonné, au lit de sa maîtresse, glisse toujours vers le centre où leurs corps réunis d’un poids plus lourd ont pesé, le véritable voluptueux dans Venise revient toujours à quelques psaumes monotones... Tel un sultan dépossédé, dans les veilles bleuâtres d’Asie, des femmes que la nuit embellit, des roses que la nuit parfume, du jet d’eau que le sérail endormi fait plus secret, ne reçoit que des confidences sur l’insolence de ses ennemis triomphants.
Avec ses palais d’Orient, ses vastes décors lumineux, ses ruelles, ses places, ses traghets qui surprennent, avec ses poteaux d’amarre, ses dômes, ses mâts tendus vers les cieux, avec ses navires aux quais, Venise chante à l’Adriatique qui la baise d’un flot débile un éternel opéra.
Désespoir d’une beauté qui s’en va vers la mort. Est-ce le chant d’une vieille corruptrice ou d’une vierge sacrifiée? Au matin, parfois, dans Venise, j’entendis Iphigénie, mais les rougeurs du soir ramenaient Jézabel. De tels enchantements, où l’éternelle jeunesse des nuages et de l’eau se mêle aux artifices composites des ruines, savent mettre [p. 110] en activité nos plus profondes réserves.
A chacune de mes visites, j’ai mieux compris, subi la domination d’une ville qui fait sa splendeur, comme une fusée au bout de sa course, des forces qu’elle laisse retomber.
En même temps qu’une magnificence écroulée, Venise me paraît ma jeunesse écoulée: ses influences sont à la racine d’un grand nombre de mes sentiments. Depuis un siècle, elle n’a plus vécu qu’en une dizaine de rêveurs qui firent ma nourriture. Putridini dixi: pater meus es; mater mea et soror mea vermibus. «J’ai dit à ce sépulcre qu’il est mon père; au ver, vous êtes ma mère et ma sœur.»
A chaque fois que je descends les escaliers de sa gare vers ses gondoles, et dès cette première minute où sa lagune fraîchit sur mon visage, en vain me suis-je prémuni de quinine, je crois sentir en moi qui renaissent des millions de bactéries. Tout un poison qui sommeillait reprend sa virulence. L’orchestre attaque le prélude. Un chant qu’à peine je soupçonnais commence à s’élever du fond de ma Lorraine intérieure.
[p. 111] Ceux qui ont besoin de se faire mal contre la vie, de se déchirer sur leurs pensées, se plaisent dans une ville où nulle beauté n’est sans tare. On y voit partout les conquêtes de la mort. Comment appliquer son âme sur la Venise moderne et garder une part ingénue? «Un galant homme se trouve toujours une patrie.» Mais de celle-ci ceux-là seuls s’accommodent qui s’acceptent comme diminués, touchés dans leur force, leur orgueil, leur confiance. Ils ne sont plus des jeunes héros intacts.
Plainte fiévreuse éclaboussant l’espace comme du sang sur le sable, silence tragique comme une dalle sur un tombeau, peu importe la manière de réagir contre le premier soufflet de la vie. Il n’appartient à personne que ce qui est n’ait pas été. Nul homme ne s’est jamais guéri. Le regard perd sa clarté droite, le cœur son innocente confiance, le courage sa sécurité. Celui que trahirent une fois des amis n’est plus un beau fruit sans meurtrissure, celui qui subit un échec, une offense, [p. 112] ne partira plus jamais comme un beau trait, spontanément à l’appel qui l’émeut. Je le vois qui tâtonne, hésite. Le son n’a plus sa pureté exquise.
Que cette lente mort,—comme elle met aux yeux de la biche des larmes qui l’introduisent dans notre Panthéon intime—soit un principe de beauté, j’y consens. Un homme qui se défait, c’est tout le pathétique. Mais qui ne préférerait périr sur le coup? Je ne passe pas une journée sans que se présente à mon esprit, pour l’empoisonner, ce que m’a raconté un jour Alphonse Daudet d’un père assis au chevet de son petit garçon de dix ans, très malade, et qu’il entendit soudain dans le silence: «Père, cela m’ennuie de mourir.» Un nuage tombe sur la vie. Levez-vous vite, orages suprêmes!
Orages, levez-vous, accourez. Je marche à toutes les lueurs qui s’enflamment sur l’horizon. Hélas! à chaque fois, la vague de tristesse qui s’enfle nous ébranle: on croit qu’elle va nous jeter bas; mais elle s’éloigne, sitôt que nous sommes couverts de son écume. [p. 113] Venise laisse tomber sous la vase de sa lagune quelques fragments dessinés par Sammichele, Tremigiane, les Lombardi, Sansovino ou Palladio. Les fièvres de Byron, de Musset, de Robert, de Wagner remontent à la surface des canaux. Je demeure, et la tourmente m’a seulement dénudé les nerfs.
Pensées fiévreuses du soir, intolérables quand les exagère encore notre insomnie; pensées mornes du matin debout à notre chevet; images constantes de notre échec qu’une ville elle-même dégradée nous met constamment sous les yeux. Un esprit capable d’humilité céderait. Que de fois, dans Venise, n’ai-je pas médité comme un des plus autorisés testaments de la gloire la phrase qu’inscrit Lamartine au front de son œuvre complet: «Si j’avais à recommencer ma vie, je n’y chercherais pas le bonheur, parce que je sais qu’il n’y est pas, mais j’y chercherais soigneusement l’obscurité et le silence, ces deux divinités domestiques qui gardent le seuil des moins malheureux.» Le vaincu de Saint-Point—noble cygne avec une âme d’ange [p. 114] et tel qu’aucun de nous ne peut prétendre à ses vertus—ne cesse pourtant d’avoir soif de la vie qu’après que ses puissances se sont épuisées dans toutes les ivresses. Nous qui manquons d’humilité de cœur, et qui ne voyons pas derrière notre épaule un chemin de gloire où consoler notre souvenir, comment pourrions-nous retenir un cri de révolte contre la nécessité qui ferme à nos rêves leurs routes?
Les églises délitées, les vastes palais ruineux, les îlots de plaisir où seules la misère et la fièvre se courtisent, les poètes romantiques qui scandent leurs imprécations font dans Venise un concert plus haut, mais non pas plus poignant que la musique monotone de chambre close qui berce un vaincu quand, sur les lagunes, il se gorge de solitude.
De plus en plus, si je suis seul, je ne sais plus me soustraire au roman vaporeux de la mort. Durant des jours et des semaines, un philtre d’insensibilité m’isole de la vie. Durci par l’indifférence, je me sens tout glacé de [p. 115] morne, cependant qu’au secret de mon âme tournoient dix souvenirs les plus aigus, les dominantes de mon mécontentement. De la profondeur sous une surface calme. Brillante lagune qui reflétez deux rives de palais, sous ce miroir mensonger que faites-vous de la Venise écroulée? Je m’abandonne avec jouissance à la plus stérile mélancolie, en éprouvant tout ce que ma situation offre de poignant ou d’amer. Rêveries douloureuses, mais inépuisables, enivrantes. Cilices sous les brocarts; mais quelles étoffes d’or et d’argent, quelle musique, quelles combinaisons harmonieuses!
A Bénarès, sous les feux d’un lustre, tandis que les vapeurs bleues montent des cassolettes, quatre femmes à la ceinture nue, la gorge, les reins et les jambes enveloppés de soies où tremblent des mouchetures d’or et d’argent, dansent durant les longues nuits brûlantes. Elles élèvent, jettent en arrière, laissent retomber languissament leurs bras; les corps frissonnent, les hanches ondulent, les petits pieds nus piétinent sourdement les [p. 116] planches, les têtes se renversent pâmées. Quelle nostalgie immobilise alors les chefs les plus actifs et les plus fiers? Les heures s’écoulent. Deux cymbales, un chalumeau, un tambourin, parfois une seule cithare, répètent indéfiniment la phrase mélancolique et grêle qui se dévide toujours pareille, et toujours demeure en suspens. Désir qui revient heurter sans trêve et qui ne trouvera pas à s’assouvir. Flot qui monte et descend l’escalier des palais de Venise sans laver leur affront, ni consommer leur ruine.
Ces quatre bayadères qui tournoient dans les parfums d’une chambre close par une nuit accablée d’Orient, ces beautés fières et tristes qui me rassasient des rêves de la mort et dont je n’ai jamais satiété, sont-ce des fantômes, une chimère de mon cœur, une pure idée métaphysique? Je sais leurs noms. L’une murmure: «Tout désirer»; l’autre réplique: «Tout mépriser»; une troisième renverse la tête et, belle comme un pur sanglot, me dit: «Je fus offensée»; mais la dernière signifie: «Vieillir». Ces quatre idées aux mille [p. 117] facettes, ces danseuses dont nous mourons, en se mêlant, allument tous leurs feux, et ceux-ci, comment me lasser de les accueillir, de m’y brûler, de les réfléchir?
Dans cette débauche, aurai-je un compagnon? Je ne me propose point ici de discipliner mes idées pour que ces belles danseuses fassent un raisonnement. Je me déchire sur leur beauté. Volupté, douleur? Je ne sais. Morne insensibilité, exquise émotivité? Je ne veux dire, je ne puis distinguer.
Qui pourrait être pleinement malheureux s’il trouve dans la souffrance une suite indéfinie de régions où s’enfoncer et s’enrichir! Tel le chalut, au soir d’un dragage, remonte à bord du navire le butin phosphorescent des grandes profondeurs.
J’aime à perdre pied, à lâcher les joncs de la rive, à m’abandonner au fort courant qui me violente pour me faire son jouet, m’engloutir à demi et m’entraîner en peu de semaines sur de longs espaces de vie. Après certaines de ces absences, je me retrouve vieilli de dix [p. 118] ans. De là mon grand âge. Dans ces courses immenses, et tandis que le fleuve de tristesse, gravissant ses berges et s’élargissant comme la mer, me faisait franchir les limites normales d’une destinée, j’étais baigné, recouvert, envahi, saturé par des ondes ténébreuses dont notre maigre langage ne peut rendre les puissantes répétitions. Toute cette tristesse se développait et me portait sans bruit sur des espaces immenses auxquels je servais de conscience. Où suis-je? Est-ce la nuit des lagunes? Aurais-je quitté Venise? Eh! que m’importe cette ville périssable? Elle n’était qu’un quai de marbre où j’attachai quelques minutes mon embarcation. J’ai rompu toutes les amarres; je me suis détaché du rivage et des cieux que je connaissais. Que vaut devant une telle heure l’agonie du plus beau soleil incendiant Venise! C’est ici vraiment que nous atteignons aux points extrêmes de la sensibilité, quand le rare s’élargit et se défait dans l’universel, et que notre imagination, à poursuivre le but sans trêve reculé de nos désirs, s’abîme dans une lassitude ineffable.
[p. 119] La fièvre était dans Venise comme la cartouche de dynamite obscure dans la roche. Tout est brisé, vole dans les airs; puis c’est l’anéantissement. Couche-toi, Venise, sous ta lagune. La plainte chante encore, mais la belle bouche est morte. L’Océan roule dans la nuit. Et ses vagues en déferlant orchestrent l’éternel motif de la mort par excès d’amour de la vie.
STANISLAS DE GUAITA
(1861-1898)
Si l’on ignore la platitude, l’anarchie et le vague d’une vie d’interne dans un collège français, on ne comprendra pas la puissance que prit, sur l’auteur de cette notice, la beauté lyrique, quand elle lui fut proposée par un de ses camarades du lycée de Nancy, Stanislas de Guaita. En 1878, il avait dix-sept ans et moi seize. Il était externe; il m’apporta en cachette les Émaux et Camées, les Fleurs du Mal, Salammbô. Après tant d’années, je ne me suis pas soustrait au prestige de ces pages, sur lesquelles se cristallisa soudain toute une sensibilité que je ne me connaissais pas. Et comme les simples portent sur le marbre ou le bois dont est faite l’idole leur sentiment [p. 124] religieux, l’aspect de ces volumes, leur odeur, la pâte du papier et l’œil des caractères, tout cela m’est présent et demeure mêlé au bloc de mes jeunes impressions. Il n’est de vrai Baudelaire pour moi qu’un certain exemplaire disparu à couverture verte et saturé de musc. M’inquiétais-je beaucoup d’avoir une intelligence exacte de ces poètes? Leur rythme et leur désolation me parlaient, me perdaient d’ardeur et de dégoût. Une belle messe de minuit bouleverse des fidèles, qui sont loin d’en comprendre le symbolisme. La demi-obscurité de ces œuvres ajoutait, je me le rappelle, à leur plénitude. Je voyais qu’après cent lectures je ne les aurais pas épuisées; je les travaillais et je les écoutais sans qu’elles cessassent de m’être fécondes. Force des livres sur un organisme jeune, délicat et avide!
Dans une règle monotone, parmi des camaraderies qui fournissent peu et un enseignement qui éveille sans exciter[7], voilà des voix enfin qui conçoivent la tristesse, le désir non rassasié, les sensations vagues et pénibles, bien connues dans les vies incomplètes. [p. 125] Et celui qui m’ouvre ces livres les interprète comme moi. Quel noble compagnon, éblouissant de loyauté et de dons imaginatifs! Nous le vîmes plus tard corpulent, un peu cérémonieux, avec un regard autoritaire; c’était alors le plus aimable des enfants, ivre de sympathie pour tous les êtres et pour la vie, d’une mobilité incroyable, de taille moyenne, avec un teint et des cheveux de blond, avec des mains remarquables de beauté. Dès 1878, je ne suis plus seul dans l’univers; mon ami et ses maîtres s’installent dans mon isolement qu’ils ennoblissent. Telle est l’origine du sentiment qui me liait à Stanislas de Guaita, lequel vient de mourir, âgé de trente-six ans. Nous nous sommes aimés et nous avons agi l’un sur l’autre dans l’âge où l’on fait ses premiers choix libres.
L’année suivante, un autre bonheur m’arriva: la liberté. J’étais malade de neuf années d’emprisonnement; on dut m’ouvrir les portes, et, tout en suivant les cours de philosophie au lycée, je vivais en chambre à la manière d’un étudiant. En été, la mère de mon ami (il avait [p. 126] déjà perdu son père), s’installait à Alteville, dans la plaine de l’étang de Lindre; il demeura seul: c’est ainsi que nous avons passé en pleine indépendance les mois de mai, juin, juillet, août 1880. Ce temps demeure le plus beau de ma vie.
La musique que faisait le monde, toute neuve pour des garçons de dix-sept ans, aurait pu nous attirer; en vérité, nous ne l’écoutions guère. Même notre professeur, ce fameux Burdeau, nous déplaisait, parce qu’il entr’ouvrait sur la rue les fenêtres de notre classe: nous le trouvions intéressé! Je veux dire qu’il nous semblait attaché à trop de choses. Je croyais voir le creux de ses déclarations civiques et des affaires de ce monde auxquelles il prétendait nous initier. Si je cherche à m’expliquer les images qu’ont laissées dans mes yeux mes condisciples, tels que je les vis au moment où, dans ses prêcheries, ce singulier professeur quittait l’ordre purement scolaire pour le champ de l’action, je crois comprendre que nous étions trois ou quatre dans un état en quelque sorte [p. 127] mystique, et disposés à lui trouver des manières électorales.
Ainsi nous avions atteint aux extrémités de la culture idéaliste, quand nous pensions être sur le seuil. Absolument étrangers aux controverses qui passionnaient l’opinion, nous les jugions faites pour nous amoindrir. En revanche, nous n’admettions pas qu’un romantique ou que le moindre parnassien nous demeurât fermé. Toute la journée, et je pourrais dire toute la nuit, nous lisions à haute voix des poètes. Guaita, qui avait une santé magnifique et qui en abusait, m’ayant quitté fort avant dans la nuit, allait voir les vapeurs se lever sur les collines qui entourent Nancy. Quand il avait réveillé la nature, il venait me tirer du sommeil en me lisant des vers de son invention ou quelque pièce fameuse qu’il venait de découvrir.
Combien de fois nous sommes-nous récité l’Invitation au Voyage, de Baudelaire! C’était le coup d’archet des tziganes, un flot de parfums qui nous bouleversait le cœur, non par des ressouvenirs, mais en chargeant l’avenir [p. 128] de promesses. «Mon enfant, ma sœur,—songe à la douceur—d’aller là-bas vivre ensemble!—Aimer à loisir,—aimer et mourir—au pays qui te ressemble...» Guaita s’arrêtait au tableau d’une vie d’ordre et de beauté: «Des meubles luisants,—polis par les ans,—décoreraient notre chambre;—les plus rares fleurs—mêlant leurs odeurs—aux vagues senteurs de l’ambre...» Mais le point névralgique de l’âme, le poète chez moi le touchait, quand il dit: «Vois sur ces canaux—dormir ces vaisseaux—dont l’humeur est vagabonde;—c’est pour assouvir ton moindre désir...» Mon moindre désir! j’entendais bien que la vie le comblerait.
En même temps que les chefs-d’œuvre, nous découvrions le tabac, le café et tout ce qui convient à la jeunesse. La température, cette année-là, fut particulièrement chaude, et, dans notre aigre climat de Lorraine, des fenêtres ouvertes sur un ciel étoilé que zébraient des éclairs de chaleur, la splendeur et le bien-être d’un vigoureux soleil qui accablait les gens [p. 129] d’âge, ce sont des sensations qui dorent ma dix-huitième année. Voilà le temps d’où je date ma naissance. Oui, cette magnificence de la nature, notre jeune liberté, ce monde de sensations soulevées autour de nous, la chambre de Guaita où deux cents poètes pressés sur une table ronde supportaient avec nos premières cigarettes des tasses de café, voilà un tableau bien simple; et pourtant rien de ce que j’ai aimé ensuite à travers le monde, dans les cathédrales, dans les mosquées, dans les musées, dans les jardins, ni dans les assemblées publiques, n’a pénétré aussi profondément mon être. Certainement Guaita avait, lui aussi, conservé de cette époque des images éternellement agissantes. Nos années de formation nous furent communes; c’est en ce sens que nous étions autorisés à qualifier notre amitié de fraternelle.
Mon ami était poète. Déjà du lycée il adressait des vers à une petite revue parisienne, et j’avais lu avec frémissement mon nom dans la [p. 130] dédicace d’un sonnet. Quand nous fûmes inscrits à la Faculté de Droit, je rêvai d’avoir du talent littéraire. J’employai le moyen recommandé aux élèves qui veulent devenir des latinistes élégants. Je possède encore les cahiers d’expressions où j’ai dépouillé Flaubert, Montesquieu et Agrippa d’Aubigné pour m’enrichir de mots et de tournures expressives. Après tout, ce travail absurde ne m’a pas été inutile. Ma familiarité avec les poètes, non plus. Un des secrets du bon prosateur n’est-il pas de trouver le rythme convenable à l’expression d’une idée? Ces soucis de rhétorique détruisent, je sais bien, le goût de la vérité, et l’on perd de vue sa pensée si l’on se préoccupe trop de moduler et de nuancer. Mais comment eussions-nous touché le fond des choses, quand nous ne connaissions que les brouillards divins qui flottent sur les cimes? On nous disait beaucoup que nous suivions une mauvaise méthode, mais on nous le disait d’une mauvaise manière. Quand on attaque l’esprit religieux avec l’esprit plaisantin, on se fait mépriser par toute âme un peu délicate; [p. 131] les arguments vulgaires de ceux qui méprisaient notre direction poétique ne pouvaient nous toucher.
Tout l’univers pour nous, je le vois maintenant, était désossé, en quelque sorte, sans charpente, privé de ce qui fait sa stabilité dans ses changements. A cette époque me suis-je jamais demandé: «Quelle est cette population, quelle est sa terre, le genre de ses travaux, son passé historique? Les sommes déposées dans ses caisses d’épargne augmentent-elles ou non? Et le nombre des élèves dans ses collèges, et la consommation de la houille?» Ces curiosités étaient au-dessus de ma raison, qui, si elle en avait eu quelque éveil, aurait mis sa fierté à les écarter. Et pourtant cet ordre réel que je croyais le domaine des hommes sans âme, des fonctionnaires ou des financiers, m’eût apparu magnifique si d’un mot l’on m’avait mis au point pour le voir en poète et en philosophe.
Puisque nous vivions chétivement de notre moi tout rétréci, nous aurions pu du moins examiner à quel rang social nous étions nés, [p. 132] avec quelles ressources, étudier les forces du passé en nous, enfin évaluer notre fatalité. Nous sommes les prolongements, la suite de nos parents. Ce sont leurs concepts fondamentaux qui seuls sauront, avec un accent sincère, chanter en nous. Dans ma maison de famille ai-je écouté végéter ma vérité propre? Frivole ou plutôt perverti par les professeurs et leurs humanités, j’ignorais le grand rythme que l’on donne à son cœur si l’on remet à ses morts de le régler. L’un et l’autre, au lieu de connaître, pour les accepter, nos conditions sociales, notre conditionnement (comme on dit des marchandises et encore des athlètes), nous évoquions en nous les sensations les plus singulières des individus d’exception qui s’isolèrent de l’Humanité pour être le modèle de toutes les exaltations.
Bien que nous fussions fort différents, Guaita, aimable, heureux de la vie, sociable, ouvert à toutes les impressions, et moi, trop fermé, qu’on froissait aisément, nous n’étions pas faits pour calmer notre pensée. Je crains que je ne l’aie détourné des études chimiques [p. 133] pour lesquelles il était doué et préparé. En ce cas, j’aurai nui à nous deux. S’il avait suivi son impulsion naturelle et son premier projet de travailler avec M. Sainte-Claire Deville, un peu de sciences exactes nous aurait rattachés aux réalités.
Certes, nous n’étions pas de ces petits esthètes, comme on en voit à Paris, qui collectionnent chez les poètes des beautés de colifichet et qui en rimaillant se préparent à être des vaudevillistes ou des mondains. La littérature n’était pas pour nous lectulus florulus, un petit lit de repos tout fleuri. Nous étions prodigieusement agités; je n’aurais pas passé les nuits de ma vingtième année avec des poètes s’ils eussent été incapables de me donner la fièvre. Guaita, dont les puissances alors intactes étaient avides de sensations, voyait dans les volumes de vers sur lesquels il passait sa jeunesse autre chose qu’un bassin d’eau claire où frissonnent des carpes baguées. Mais précisément les incantations des lyriques ont mis dans nos veines un ferment si fort que ce fut un poison.
[p. 134] Les poètes vivent sur un petit nombre de lieux communs; chacun d’eux les reprend, les rafraîchit, les renouvelle et les fortifie avec sa magie propre: aussi un être en formation, s’il se soumet à cette action constante et presque monotone de leur génie, verra forcément leurs thèmes se mêler à sa substance. L’indifférence de la nature aux joies et aux souffrances de l’humanité, notre incapacité de diriger notre destin, la vanité des succès et des échecs devant la fosse terminale, voilà quelques-uns de leurs principes, et, chevillés à notre âme, transformés en sensibilité, ils nous prédisposent à l’impuissance.
Je suis très frappé de ce que m’a dit un médecin sur la fameuse question des sœurs dans les hôpitaux. Après m’avoir expliqué comment ces nobles femmes valent pour créer une atmosphère, combien elles sont excellentes près du lit d’un mourant, où la coquetterie d’une jeune femme laïque pourrait être abominable, cet homme compétent ajoutait: «... Dans les services de chirurgie et quand il s’agit qu’un fil ne soit pas contaminé, [p. 135] quand il faut prendre des précautions extrêmement minutieuses, on ne peut pas compter sur des créatures qui croient à l’intervention d’en haut et qui disent: si Dieu veut le sauver, il le sauvera bien!... Nulle bonne volonté d’obéir n’y supplée: elles possèdent au plus profond de leur être une loi, une foi, qui les prédispose à ne pas tenir un compte suffisant de nos méthodes antiseptiques.»
Selon moi, ce raisonnement s’applique à ceux qui ont laissé le romantisme et ses grands thèmes lyriques descendre au fond d’eux-mêmes et les constituer. Qu’est-ce qu’un homme d’action qui s’est habitué à méditer sur la mort? Mettriez-vous votre enjeu sur un individu assez philosophe pour sourire des précautions minutieuses d’un ambitieux, sous prétexte qu’on ne peut guère prévoir utilement plus de cinq ou six accidents et que le nombre des possibles est illimité? Et comme c’est agréable de s’embarquer avec un sage qui nous déclare au moment critique: «Après tout, les choses n’ont que l’importance que nous leur donnons, et tourne qui tourne, il n’y [p. 136] aura rien de changé dans l’univers.» Je reconnais que dans certaines circonstances de ma vie active, je me serais évité des échecs, si j’avais pu écraser cette petite manie raisonneuse et dégoûtée qui fait si bon effet dans les grands ramages littéraires. Vivent le bon sens tout plat, la raison prosaïque, quand leur tour est venu! Dans un plan où seul le succès compte, les vérités supérieures ne sont plus qu’une cause de chute, et s’y élever, c’est précisément le fait d’un esprit subalterne.
Grande inconséquence de notre éducation française, qu’elle nous donne le goût de l’activité héroïque, la passion du pouvoir ou de la gloire, qu’elle l’excite chaque jour par la lecture des belles biographies et par la recherche des cris les plus passionnés, et qu’en même temps elle nous permette de considérer l’univers et la vie sous un angle d’où trois cents millions d’Asiatiques ont conclu au Nirvana, la Russie au nihilisme et l’Allemagne au pessimisme scientifique! Cette contradiction ne serait-elle pas le secret essentiel de cette élégante [p. 137] impuissance de nos jeunes bacheliers qu’on a signalée, qu’on n’a pas comprise et qu’on a appelée décadence?
De 1879 à 1882, toutefois, cette hygiène détestable nous avait fait heureux. Nous vivions de nos nerfs, sans connaître que nos réserves s’épuisaient. Comment fûmes-nous un jour placés en face de notre vide et de quel côté avons-nous cherché une nourriture et un terrain où prendre racine?
Je suis excusable d’avoir jusqu’à ce moment de mes souvenirs parlé autant de moi que de mon ami. Je ne pouvais démêler, sans en arracher des parties essentielles, nos jeunesses et nos sentiments qui se développèrent en s’enchevêtrant. En 1882, nous quittons Nancy et dès lors nos vies vont se différencier. Si je suis passé de la rêverie sur le moi au goût de la psychologie sociale, c’est par des voyages, par la poésie de l’histoire, c’est surtout par la nécessité de me soustraire au vague mortel et décidément insoutenable de la contemplation nihiliste. Mais Guaita, ayant cette originalité de n’être pas un analyste [p. 138] dans une époque où nous le sommes tous, évolua d’une façon autrement rare; il sortit de la situation morale un peu critique où nous nous trouvions par une porte magnifique et singulière que nous franchirons avec lui d’un élan impétueux, en ligne droite jusqu’à la tombe, où il repose, réconcilié par la mort avec les conditions générales de l’humanité.
Guaita avait peu d’analogie avec Paris; il ne sut guère en prendre l’esprit. Nous y débarquâmes vers le même temps (novembre 1882, janvier 1883); je courus au canon; après quelques excursions de reconnaissance, il se cantonna dans sa bibliothèque et dans ses tentatives poétiques.
De naissance il possédait un magnifique sens religieux. On ne peut s’en faire une idée complète sur ses recueils de vers, parce qu’il trouva un éditeur avant de s’être trouvé lui-même. Pourtant Mater dolorosa[8], Pueri dum sumus, A la dédaignée, A Maurice Barrès, Hymne à Cybèle[9], d’autres pièces flottantes encore marquent une direction [p. 139] significative. Quelque chose à définir, le sentiment du divin prenait possession de Guaita. Peu à peu il perdit le goût de la création pour s’abîmer dans la recherche des lois. Nous avons vu de même un Sully-Prudhomme se stériliser ou s’égarer dans les régions de la pensée spéculative. Celui-ci, pourtant, ancien candidat à l’École Polytechnique, possédait une préparation spéciale et puis il inclinait au positivisme où répugnait nettement mon ami. Schiller parle d’une certaine tendance philosophique qui caractérise les natures sentimentales; il ajoute fort justement que ce n’est qu’avec le secours de la philosophie qu’on peut philosopher et que, privé de cette base, on tombe infailliblement dans le mysticisme.
Quand des hasards de lecture mirent Guaita en présence des vieux mythes qui déjà par leur pittoresque baroque devaient échauffer ses instincts imaginatifs de poète, il s’éprit de systèmes où étaient traduits les efforts de pures énergies spirituelles pour s’affranchir de la matière qui les emprisonne, pour s’élargir [p. 140] dans l’espace et le temps, pour se désincarner. Il donna son adhésion immédiate à une doctrine affirmant la liaison de tous les phénomènes qui nous semblent séparés. Le chimiste qui connaissait l’hypothèse moderne de l’unité de la matière, le rêveur qui avait toujours usé instinctivement des procédés de l’intuition et de l’analogie pour embrasser les ensembles, trouva dans l’antique sentier des mages les matériaux pour se dresser un abri à sa mesure et selon ses besoins. Guaita était prédestiné; la grâce lui vint, je me le rappelle, sur une lecture du Vice suprême. Il lut Eliphas Lévy et visita M. Saint-Yves d’Alveydre. Dès lors ce fut fini de la versification; il devint l’historien des sciences occultes. Et ces vieilles momies dont il déroulait les bandelettes lui donnèrent leur sagesse en échange de sa santé dont il les ranima.
Dans les croyances de nos modernes Rose-Croix, que reste-t-il des cultes primitifs de l’Orphisme, des mystères antiques sur lesquels se greffèrent les doctrines néo-platoniciennes [p. 141] et les systèmes du moyen âge?... J’essayerai au moins de donner une impression des études que mon ami venait d’aborder et qui disciplinèrent sa vie.
La mosquée, aujourd’hui cathédrale de Cordoue, est une forêt de colonnes précieuses, marbres rares, jaspe, porphyre, brèche verte et violette. Jadis on en comptait quatorze cent dix-neuf; sept cent cinquante subsistent. Pour les accumuler, le calife Abderrhaman razzia d’immenses espaces. De Raya, de Constantinople, de Rome et sans doute des ruines de Carthage, elles furent apportées. Quelquefois leurs chapiteaux sont aussi barbares que ceux des temples primitifs de l’Arabie, et, tout à côté, on retrouve la délicatesse des mosquées du Caire, de Damas et de Ceifa. Dans la demi-lumière de cette incomparable Djamy, l’imagination s’enivre à s’associer au voyage de ces belles indifférentes qui, vers l’an 786, après avoir soutenu et paré durant des siècles les palais asiatiques et africains, vinrent, ballottées par les flots, dans cette Cordoue où notre main les caresse, et qui, [p. 142] par un nouveau détour des destins, issues des temples d’Astarté et de Janus, ayant cessé de glorifier Allah, collaborent aujourd’hui au prestige catholique.
La beauté de ces courtisanes nous attire, et, prolongée si tard dans la vieillesse, elle nous trouble. Quand tous les dieux dont elles portèrent les toits seraient vaincus, elles verraient encore des fidèles—artistes, archéologues, tous ceux dont les cordes de l’imagination s’ébranlent sous les doigts de la mort—baiser leurs marbres polis par une suite immense d’actes de foi...
A chacun des Essais de Sciences maudites qu’il me faisait parvenir, mon ami me pressait d’adhérer à ses croyances; je ne pus jamais les prendre que pour de magnifiques invitations au voyage. Ces rêveries naquirent jadis dans les vallées de l’Euphrate et du Tigre, ou plus avant encore dans les siècles où notre regard se perd; après avoir nourri Pythagore et ses émules, après avoir fourni des notions à Platon et retrouvé pour disciples les critiques et les philosophes érudits d’Alexandrie, après [p. 143] avoir apporté une part dans l’œuvre de Spinoza, de Hegel, et par là, si l’on veut, imprégné la conception de l’univers dont vit notre siècle, elles luisent doucement—comme les porphyres et les jaspes de Cordoue—dans un canton délaissé de l’esprit moderne, où Guaita trouva son contentement.
Des doctrines qui ont été les colonnes des temples les plus importants de l’humanité s’imposent à notre vénération. Et, pesant l’œuvre du compagnon de ma jeunesse, je dis: «Sa part fut noble, puisqu’il nous a donné l’expression la plus récente de la plus antique des littératures ecclésiastiques!»
Il paraît qu’à la fin du siècle dernier la tradition de l’occultisme se trouva fort compromise; une terrible lutte venait d’éclater entre les sociétés blanches (illuminés et martinistes) et les sociétés rouges (jacobins); la Révolution de 1789 fut un épisode de ces querelles. (Je parle d’après le Dr Encausse; je n’ai pas besoin d’avertir que je suis loin d’attacher à ces versions une valeur historique; mais pour faire connaître superficiellement ces [p. 144] doctrines, il faut indiquer leur partie légendaire aussi bien que leur partie dogmatique.) Les sociétés spiritualistes, diminuées, mais non écrasées, s’attachèrent à conquérir les intellectuels; la masse fut abandonnée aux philosophes et aux athées. Fabre d’Olivet, Eliphas Lévy, Lucas Wronski, Vaillant et Alcide Morin gardaient et augmentaient le trésor de l’occultisme. De 1880 à 1887, les initiés s’émurent, car des sociétés étrangères intriguaient pour dépouiller la France et pour porter à Londres la direction de l’occultisme européen. Peut-être même voulait-on anéantir l’œuvre des véritables maîtres de l’Occident! C’est alors qu’intervint Guaita. Il se proposait une triple tâche: l’étude des classiques de l’occulte, la méditation ou effort pour entrer en communion spirituelle avec l’unité divine, enfin la propagande. Pour mener à bonne fin cette reconstitution, cette «réforme», comme disent ses disciples, il sortit des ténèbres l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix qui comprend trois grades, le baccalauréat, la licence et le doctorat en Kabbale, accessibles par des [p. 145] examens. Il en fut le grand maître et il l’administrait avec le concours d’un conseil suprême, composé de trois chambres.
«L’école matérialiste officielle, nous dit le Dr Encausse, menaçait de faire disparaître à jamais les hauts enseignements des Hermétistes et des Kabbalistes chrétiens. A côté des classiques du positivisme, la Rose-Croix créa les classiques de la Kabbale, Eliphas Lévy, Wronski, Fabre d’Olivet, et mit à l’étude les œuvres des véritables théosophes, Jacob Boehm, Swedenborg, Martinez Pasqualis, Saint-Martin, qui sont les seuls que la théosophie, digne de ce véritable nom, connaîtra plus tard, comme ce sont les seuls qui furent connus du XVe au XIXe siècle. Bientôt des élèves nombreux et déjà versés dans les sciences et les lettres profanes, ingénieurs, médecins, professeurs, littérateurs, accoururent. Cette floraison d’intellectualité s’imposa vite à toutes les sociétés initiatiques de l’étranger par la publication d’une belle série de thèses de doctorat en Kabbale. C’est Guaita qui la dirigeait. Sa prodigieuse érudition lui permettait d’indiquer en toute sûreté les sujets de thèse pour la grande gloire de l’ordre et de la vieille réputation des écoles initiatiques françaises. Grâce à cet ordre de la Rose-Croix, une véritable aristocratie d’intellectuels était créée dans l’initiation, un Collège de France de l’ésotérisme était constitué et son influence s’étendait vite au loin.»
Telle est l’œuvre que les occultistes ont vu [p. 146] Guaita accomplir. Il a réformé leur petite communauté; ils sont juges de l’accroissement de forces qu’ils reçurent de son intervention. Il laisse trois gros volumes: Essais de Sciences maudites, qui semblent devoir se placer auprès des grands classiques de l’Occulte, respectés et consultés comme des Bibles[10].
Chacun a ses limites. Un ouvrage qui peut transformer tel être ne saura rien dire à tel autre. Qu’en conclure? Tout livre a pour collaborateur son lecteur. On l’accorde des traités de science et de philosophie où il faut que l’étudiant apporte des aptitudes et aussi une instruction préalable. C’est vrai d’une façon plus absolue encore pour des œuvres d’une qualité religieuse qu’on ne peut aborder qu’avec un état d’esprit spécial. Moi qui ne distingue qu’une poussière dont je suis tout incommodé sur la route royale des Boehm et des Swedenborg, je suis indigne de décrire les vastes espaces où mon ami avait installé ses tentes et recevait l’hommage de ses émules. Si je trouve à ses Essais une forme très [p. 147] déterminée et un sens peu arrêté, c’est que je ne me suis pas conformé à la maxime hermétique: «Lege, lege, lege et relege, labora, ora et invenies.» Mais quoi! je l’ai aimé, je me représente les états successifs de sa sensibilité. Je sais qu’il fut un philosophe, si, comme je le crois, la philosophie, c’est devant la vie le sentiment et l’obsession de l’universel, et devant la mort l’acceptation. J’avais pour devoir de fixer quelques-uns des traits de cette noble et chère figure. Quant à son œuvre d’occultisme, je la confie aux élèves qu’il a formés. Précisément, dans une étude sur Guaita, et parlant de leurs maîtres communs, les Guillaume Postel, les Reuchlin, les Klunrath, les Nicolas Flamel et les Saint-Martin, le Dr Marc Haven a écrit une phrase forte: «Ces hommes furent d’âpres conquérants, en quête de la toison d’or, refusant tout titre, toute sanction de leurs contemporains, parlant de haut, parce qu’ils étaient haut situés et ne comptant que sur les titres qu’on obtient de ses propres descendants[11].»
[p. 148] Nous avions gardé de notre jeunesse, Guaita et moi, l’habitude de lire à haute voix, quand nous passions une soirée ensemble. Une année avant sa mort et comme il m’avait lu une des autorités de l’Occulte, je pris l’incomparable conversation de Pascal avec M. de Sacy, qui avec ses deux pentes contrastées et fécondes est, pour mon goût, le sommet le plus solide à l’œil, le plus fier et le plus caractéristique du grand massif littéraire français. Mon ami, familier des nuages, se trouvait là, je crois bien, sur des coteaux trop modérés. Nous discutions, et je lui répétais après Pascal: «Il faut être pyrrhonien, géomètre, chrétien, c’est-à-dire qu’il faut d’abord une analyse aiguë, puis un raisonnement puissant, et, seulement après une dévotion passionnée, l’enthousiasme, le stade religieux.» A bien y réfléchir, ma critique ne portait pas complètement: Guaita n’était point un enthousiaste sans assises. Dans les croyances de nos modernes Rose-Croix une proportion notable d’éléments scientifiques se mêlent à ces monstrueux amalgames auxquels les superstitions de l’Orient [p. 149] et celles de l’Occident, les excès du sentiment religieux et de la pensée philosophique, l’astrologie, la magie, la théurgie et l’extase donnent une couleur propre à enchanter un ancien poète parnassien. Des vérités scientifiques forment le canevas sur lequel se plaisent à broder l’imagination, l’esprit de système et une érudition peu critique. Guaita aimait à s’autoriser d’une phrase de M. Berthelot: «La philosophie de la nature qui a servi de guide aux alchimistes est fondée sur l’hypothèse de l’unité de la matière; elle est aussi plausible au fond que les théories modernes les plus réputées aujourd’hui. Les opinions auxquelles les savants tendent à revenir sur la constitution de la matière ne sont pas sans analogie avec les vues profondes des premiers alchimistes.»
Le Dr Paul Hartenberg, qui fut un des familiers de Guaita dans les dernières années, nous donne son témoignage: «Guaita aimait à m’interroger sur le mécanisme psychologique des idées fixes, des obsessions, des hallucinations, qui ont une si grande part [p. 150] dans les préoccupations des occultistes. C’est qu’il avait la conviction que le merveilleux et le surnaturel ne présentent que des modalités, encore inexpliquées, du phénoménisme naturel et n’infirment en rien les grandes lois qui régissent la vie universelle. Il savait que sous les voiles complaisants des symboles se cachent quelques vérités simples et éternelles. Parfois même il regrettait toute cette terminologie mystérieuse, tous ces attributs déconcertants et surtout la rhétorique sonore dont certains entourent les doctrines ésotériques.»
Mais ne prendrais-je pas un souci superflu et un peu puéril en voulant faire rentrer Guaita dans les gros bataillons de la science? Ceux qui essaient de définir l’infini et d’exprimer l’ineffable sont entraînés à tracer des figures insuffisantes et un peu ridicules. Il serait injuste de s’arrêter à ce que les études des occultistes semblent avoir de bistourné, de confus et de verbal, puisque pour un groupe d’hommes de valeur elles sont un langage clair et un lien de haute moralité. Il serait criminel de chercher à extirper ce qui nous [p. 151] semble un peu charlatanesque dans ces doctrines, car on risquerait avec ce faux purisme d’atteindre leurs parties essentielles, les organes de vie par lesquels elles adhèrent si profondément à l’âme de leurs fidèles. Il me semble que si l’on veut se placer juste au point convenable pour apprécier un penseur comme Guaita, il faut d’abord méditer et accepter la belle formule gœthienne: «Ne rien gâter, ne rien détruire.» C’est entendu, mon ami ne marchait pas d’accord avec les idées à la mode de son temps. C’est entendu encore, ce mouvement général qui met aujourd’hui chaque génération à la suite des livres de classes arrêtés par M. le ministre de l’Instruction publique ne laisse pas d’avoir du grandiose, et un tel accord peut être interprété comme un hommage à la Vérité. Cependant, les types fortement accusés, s’ils n’ont plus d’emploi dans une société où tout tend à les réduire et qui marche en rang de collégiens, doivent être recueillis par les gens de culture. Les esprits vulgaires veulent que leur état propre soit le type de l’intégrité intellectuelle. [p. 152] Ils traitent d’aliénation la mélancolie si raisonnable des Rousseau, des Byron. Ces grands hommes, en effet, ne possédèrent jamais le magnifique équilibre des imbéciles. La bizarre indépendance de mon ami, chez qui il y avait du sang allemand, est un beau legs du Nord à notre discipline latine.
Si nous maintenons notre regard sur la biographie de Guaita et si nous la fixons avec ce sentiment généreux qui laisse les images prendre dans l’esprit toute leur importance, elle nous permettra de nous représenter ce que furent dans le passé certaines vies religieuses. J’ai lu de pitoyables notices sur Guaita. Pour mettre des couleurs exactes dans son portrait, nous devons marquer comme ses dominantes sa parfaite simplicité de manières et une sorte de beauté morale qui, ne cherchant aucun effet, conquérait d’autant plus fortement.
Osons le mot dans une notice sur un théosophe: Guaita s’enfermait dans la catégorie de l’Idéal. Son effort continuel était de s’en faire une image plus épurée et pour cela de [p. 153] se perfectionner. Lui qui écrivit des livres où la science de Dieu est tout abstraite et desséchée, il mêlait à tous les actes de sa vie le sentiment religieux le plus noble, le plus facile, le plus libre dans son développement. Nous avons le droit de considérer comme un culte permanent—peu arrêté, peu clair, mais par là d’autant moins critiquable—sa délicatesse de conscience, l’enthousiasme de ses veilles, les scrupules qu’il apportait avec les rares amis de sa solitude. Hors la beauté morale, tout lui était étranger.
Cette inaptitude à tout ce qui n’est pas la vie la plus hautement noble concordait d’une façon excellente avec ses manières d’homme parfaitement courtois. Ses amis l’ont vu dans deux cadres fort inégaux en agréments, mais l’un et l’autre appropriés à un solitaire mystique. Il passait cinq mois de l’année dans un petit rez-de-chaussée de l’avenue Trudaine, où il recevait quelques occultistes. Il demeurait parfois des semaines sans sortir. Il avait [p. 154] amassé là toute une bibliothèque étrange et précieuse; des textes latins du moyen âge, des vieux grimoires chargés de pantacles, des parchemins enluminés de miniatures, les éditions les plus estimées des Van Helmont, Paracelse, Raymond Lulle, Saint-Martin, Martinez Pasqualis, Corneille Agrippa, Pierre de Lancre, Knorr de Rosenroth, des manuscrits d’Eliphas, des reliures signées Derome, Capé, Trautz-Bauzonnet, Chambolle-Duru, des ouvrages de science contemporaine. «Dans cette atmosphère, habitée par les plus audacieuses intuitions de l’esprit humain, dit un de ses visiteurs, semblaient flotter des pensées et on respirait de l’intelligence.» On y était hors du temps. Guaita, qui lisait rarement les journaux, classait les hommes de notre époque, non d’après leur personnalité ou leur situation acquise, mais selon le profit qu’il tirait de leurs œuvres. Cette manière faite d’équité et d’égoïsme intellectuel l’amenait à contredire nos raisons, nos modes et aussi le sens commun. Dans cette faculté que garda Guaita de vivre et de penser en dehors [p. 155] des conditions générales de l’époque, je reconnais les habitudes que nous avions prises au beau temps de notre jeunesse et quand nous nous donnions nos fièvres cérébrales à Nancy. De telles conceptions comportent bien de la naïveté; on y reconnaît l’influence des poètes qui nous formèrent le jugement et qui pour la plupart ont écrit leur chef-d’œuvre quand ils étaient tout jeunes, tout inexpérimentés. Mais enfin, c’est une avoine, cette illusion, et qui aide à trotter. Tout un petit monde de travailleurs respirait de la force dans cet air raréfié où Guaita se confinait avenue Trudaine. J’y étais aimé sans variation à craindre, puisque c’était pour notre passé. Les amis de notre jeunesse qui meurent, ce sont des témoins dont l’absence peut nous faire perdre les plus graves procès: eux, voyaient les racines et reconnaissaient la nécessité de certains de nos actes, que les étrangers dorénavant jugeront en bien ou en mal, selon les convenances de leur politique.
Les sept mois qu’il passait hors de Paris, [p. 156] Guaita les vivait à la campagne, auprès d’une mère admirable, dans une intimité de sentiments religieux qui correspondaient à sa conception morale de l’univers. Le château d’Alteville est situé dans la partie la plus solitaire de la Lorraine allemande, parmi les vastes paysages de l’étang de Lindre. Un ciel le plus souvent bas, un horizon immobile, un silence jamais troublé que par le cri des paons, des bois de chênes toujours déserts, un vieux parc avec quelques bancs bien placés, des appartements où demeure le calme des vies qui s’y développèrent, tout ce décor immuable de son enfance favorisait ses méditations larges et monotones. Il les poursuivait durant toutes les nuits. En prolongeant ainsi ses réflexions voulait-il compenser la brièveté de sa vie? Il lui plaisait au terme de ses veilles de voir poindre le jour: aurore triomphant des épais rideaux, promesse que la nature faisait à ce chercheur d’absolu et que la mort vient d’acquitter! C’est auprès d’Alteville, contre l’église de Tarquimpol, que Guaita est enterré, le dernier, tout au moins pour la [p. 157] branche française, d’un nom estimé depuis des générations[12].
Si j’essaie de me rappeler le temps que j’ai vécu depuis ma jeunesse, je n’y retrouve que mes rêves. En remontant leur pente insensible, je m’enfonce dans une demi-obscurité qui leur est facile comme les nuits d’Orient. Elle me laisse apercevoir seulement des ruines et des feuillages; ce sont quelques images illustres et des temples, que jadis j’ai interrogés, et puis les lauriers, les chênes verts d’Italie, les jardins parfumés d’Espagne, qui m’ont excité à jouir de la vie. Sur ce petit chemin et dans cette atmosphère romanesque, il ne manquait rien qu’un tombeau. Celui qui dans un terme si court vient d’être élevé au compagnon de ces grandes débauches de poésie, pendant lesquelles nous avions presque effacé la vie réelle, m’avertit de l’unique réalité.
Juin 1898.
UNE IMPÉRATRICE DE LA SOLITUDE
A René Quinton, au savant biologiste que nous remercions de quatre pages inestimables sur la qualité fondamentale et la suprématie de l’esprit français.
Elisabeth de Bavière, impératrice d’Autriche! Par une fuite continuelle, par son éventail interposé et par la pratique de la restriction mentale, elle put jusqu’à sa mort cacher quel chef-d’œuvre ses propres soins secrets l’avaient faite. Aujourd’hui nous la contemplons: sinon directement, du moins telle qu’elle se réfléchit dans la mémoire d’un jeune poète, tout préparé par son tempérament et par les circonstances à ressentir la beauté.
Le docteur Constantin Christomanos se souvient que j’ai essayé de décrire une méthode pour gouverner notre sensibilité, et même, nous raconte-t-il, l’impératrice daignait se plaire à ces petits romans dont il lui donnait lecture. Il pense à juste titre que son mémorial [p. 162] d’une reine qui ne voulut d’autre royaume que sa vie intérieure nous fournira la plus abondante et la plus rare contribution au Culte du Moi. Il nous demande de présenter au public français son Elisabeth de Bavière[13]. Mais qui sommes-nous pour manier ce poème vraiment impérial où l’imagination du plus pauvre lecteur amassera d’elle-même un magnifique commentaire?
La divine Antigone de Sophocle dit à sa sœur Ismène: «Depuis longtemps je suis morte à la vie, je ne peux plus servir que les morts.» C’est une insensée, pense Créon. «Prince, lui répond Ismène, jamais la raison que la nature nous a donnée ne résiste à l’excès du malheur.» On aime à trouver dans la langue que préférait l’impératrice les mots qui touchent sa plaie sans l’offenser.
Du point de vue où nous nous plaçons, nous devons bénir les souffrances d’Elisabeth de Bavière. La jeune impératrice émerveillait ses peuples et la haute société européenne, mais, quel que fût le romanesque de sa première beauté, on préférera celle que lui firent [p. 163] les meurtrissures de la vie. L’impératrice Eugénie la copiait. Qui donc pourrait nier ce qu’ajoutèrent des larmes de sang et les stigmates de la vie à leurs charmes de déesses?
Au seul prononcer de ce nom, l’impératrice Elisabeth, le lecteur imaginatif—et celui-là seul poursuivra cette lecture—voit, de ses propres yeux, un confus amas d’horreurs autour d’un trône chancelant! Sa sœur, la duchesse Sophie d’Alençon, brûlée vive au Bazar de la Charité; une autre sœur qui perd héroïquement aux murailles de Gaëte un royaume; son beau-frère, l’empereur Maximilien Ier, fusillé à Queretaro; sa belle-sœur, l’impératrice Charlotte, folle de douleur; son cousin préféré, le roi Louis II de Bavière, noyé dans le lac de Starnberg; son beau-frère, le comte Louis de Trani, suicidé à Zurich; l’archiduc Jean de Toscane, renonçant à ses dignités et se perdant en mer; l’archiduc Guillaume, tué par son cheval; sa nièce, l’archiduchesse Mathilde, brûlée vive; l’archiduc Ladislas, fils de l’archiduc Joseph, tué à la chasse; son propre fils enfin, [p. 164] le prince héritier Rodolphe, suicidé, ou assassiné, dans une nuit de débauche dont l’horreur reste couverte d’un voile noir...
Dans sa maison le Meurtre, le Suicide, la Démence et le Crime semblent errer, comme les Furies d’Hellas sous les portiques du palais de Mycènes. Enfin une mort tragique vient donner un suprême prestige à cette âme que les coups acharnés du destin avaient travaillée comme une matière rare.
O sombre magnificence! M. Christomanos ne nous décrit point ce cursus honorum. On aimerait d’étudier les cruelles étapes antérieures de cette fille d’une vieille race, puis la lente altération qui la menait, impératrice, dans les solitudes et qui, morte, la sort de la foule vulgaire des ombres. Pour nous rendre tout intelligible cette cousine de Louis II[14], il faudrait une solide histoire des Wittelsbach[15]. Les événements ne firent sans doute que prêter leur pente à des inclinations naturelles. Mais il ne s’agit point aujourd’hui d’analyser cette prédestination. Acceptons une part de mystère. Sur un fond [p. 165] d’horreur sacrée s’accentue d’autant mieux la figure de l’impératrice. Nous prendrons ici Elisabeth d’Autriche comme une excitatrice de notre imagination, comme une nourriture poétique et une hostie de beauté. Elle peut faire un des refuges, un des sommets de notre rêverie.
Il faut d’abord que l’on sache d’où nous viennent ces précieuses révélations. Examinons l’instrument par lequel nous allons voir.
En 1891, il y avait un petit étudiant corfiote qui travaillait, tout le jour et fort avant le soir, dans une maison triste et décente d’un faubourg de Vienne. Seulement, quand il cherchait des citations latines pour sa thèse sur les «Institutions byzantines dans le droit franc», parfois il rêvait et soupirait. Au soir, un merle venait se poser sur le toit d’en face et chantait, chantait, jusqu’à ce que l’obscurité noyât sa petite forme et sa petite voix. Or, voici que l’impératrice d’Autriche eut le caprice d’apprendre le grec et voulut un jeune [p. 167] Hellène qui la suivît dans ses promenades. On lui parla de l’étudiant. Elle le fit chercher par une voiture de la cour.
Vous distinguerez les défauts et les qualités de M. Christomanos sur la première page de son livre, charmante de jeunesse et de perméabilité à tout ce qui est fastueux, esthétique et rare. N’est-il point quelque frère de Julien Sorel, frère, cependant, tout imprégné d’orientalisme?
«Un valet de pied, vêtu de noir, me reçut à l’entrée du parc, et me dit que Sa Majesté m’invitait à l’attendre. Il me conduisit près du château, et me laissa dans un bosquet, parmi les pelouses, après s’être profondément incliné. Subitement transporté de l’atmosphère grise et du banal tous les jours de Vienne dans cet impérial jardin fermé où ne pénétraient pas les simples mortels, ébranlé par l’attente d’un événement décisif, je me trouvais poussé pour ainsi dire hors de moi. C’était comme si j’éprouvais tout cela en une autre personne. J’avais le sentiment de rêver [p. 168] un rêve étrange et délicieux, et je craignais qu’il ne s’évanouît trop tôt; d’autre part, le désir impatient de ce qui allait venir m’exaspérait, comme si je ne pouvais pas attendre le réveil.
«Je ne connaissais l’impératrice que par ses portraits qui la représentaient presque toujours le diadème au front. Quel indicible émoi! Autour d’un buisson tremblant de mimosa, des essaims d’abeilles bourdonnaient. Certes, ces petites boules fleuries ne savaient pas qu’elles étaient là pour moi autant que pour les abeilles, pour que leur regard et leur souffle embaumé me rendissent cette heure inoubliable, autant que pour donner leur miel aux abeilles. Les abeilles et mon sang bourdonnaient à mes tempes, et je me disais: «Voilà un monde qui vit sans moi, qui ne semble pas me connaître et qui, cependant, d’un lointain infini tend vers moi et m’attend.»
«Je ressens encore la poésie de cette heure de merveilleuse angoisse qui m’emportait loin de moi-même vers un horizon de mystère sans limites. J’attendais et mon cœur [p. 169] s’emplissait de plus en plus de la certitude que j’étais sur le point de voir apparaître ce que ma vie aurait de plus précieux... Soudain, elle fut devant moi, sans que je l’eusse entendue venir, svelte et noire.
«Dès avant que son ombre m’eût atteint pour me tirer en sursaut du rêve où je m’abîmais, je sentis son approche. Elle se tenait devant moi, un peu penchée en avant. Sa tête se détachait sur le fond d’une ombrelle blanche que traversaient les rayons du soleil, ce qui mettait une sorte de nimbe léger autour de son front. De la main gauche, elle tenait un éventail noir légèrement incliné vers sa joue. Ses yeux d’or clair me fixaient...
«Je ne sus tout de suite qu’une chose: c’était Elle. Comme elle ressemblait peu à tous les portraits! C’était un être tout autre, et pourtant c’était l’Impératrice: une des apparitions les plus idéales et les plus tragiques de l’humanité. Que lui dis-je? J’ai honte de me le rappeler. Je balbutiai quelques phrases sur ma joie et le grand honneur... Mais elle dit, les yeux rayonnants d’une grâce infinie:
[p. 170] —Quand les Hellènes parlent leur langue, c’est comme une musique.»
Que parlai-je de Julien Sorel! Je crois distinguer la jeune Esther, quand elle s’évanouit devant Assuérus; je crois entendre, qui ranime cet enfant, le vers racinien:
Le docteur Christomanos, jusqu’à sa mort, demeurera persuadé de cette fraternité poétique. Il serait déplorable qu’une telle persuasion l’eût amené à dénaturer dans son journal les sentiments et les paroles de l’impératrice. Je crois qu’on peut retrouver sous la manière du jeune poète les mouvements d’Elisabeth de Bavière. C’est bien dans cette noble intimité que nous pénétrons à la suite de ce guide follement sensible et qui possède de naissance le goût des plus rares fantaisies esthétiques.
On doit regretter que le second Empire n’ait pas chargé Théophile Gautier de parcourir le monde pour en dresser le minutieux inventaire pittoresque; plût au ciel que le destin m’eût attaché à la personne de Bonaparte, depuis Brienne jusqu’à Sainte-Hélène, pour rendre témoignage des séances du Conseil d’État, des enivrements du triomphe et des tragédies terminales; félicitons-nous des circonstances qui permirent à M. Christomanos, nerveux qu’enivrent le luxe, le mystère et la beauté, de ramasser à la Hofburg, dans sa dix-neuvième année, tant de couleurs, de parfums, de saveur, toute une chaude poésie orientale, décorative et lyrique.
Ce jeune homme installé près de la [p. 172] souveraine prit des notes au jour le jour.
«Mon appartement, écrivait-il, est situé dans l’aile léopoldine. On arrive du Franzensplatz, à côté du corps de garde, par un étroit escalier en colimaçon, jour et nuit éclairé au gaz, «l’escalier des confiseurs», à un long corridor tapissé de nattes, «le passage des demoiselles». Une longue suite de portes avec des noms de dames d’honneur sur des cartons blancs. Tout au bout, des gardes de la Burg qui vont et viennent lentement avec des cliquetis de sabres. A ma surprise, je lis sur une de ces portes mon nom: voilà donc mon existence à venir étiquetée dans cette armoire à tiroirs qu’est la cour. Ma chambre est vaste, mais basse de plafond. Une grande double fenêtre donne sur la place extérieure du château et sur le Volksgarten que maintenant un crépuscule gris enveloppe. Sur le parquet poli comme un miroir, le feu du poêle envoie voleter des essaims de feux follets. Les tentures et les meubles sont à rayures grises et blanches. Un paravent de soie rouge masque à demi le lit recouvert, [p. 173] lui aussi, d’une lourde soie. Le tout, du reste, d’une simplicité de très grand air.
«Dès ce premier soir, l’impératrice me reçut. Un laquais du service privé vint m’avertir que Sa Majesté avait su mon arrivée et me priait de me rendre auprès d’elle. Je me hâtai, à pas muets sur les nattes, tout le long du couloir, parmi des laquais et des caméristes qui chuchotaient, puis, après un coude, par un corridor plus large, qui traverse l’aile dite de l’impératrice Amélie. C’est la partie du château qui regarde le Franzensplatz du gros œil de son horloge flamboyant dans la nuit; elle est habitée exclusivement par l’impératrice et sa suite. Par une porte secrète, j’arrivai au grand escalier d’honneur, puis, un étage plus bas, sur un palier, où un garde de la Burg en grand uniforme était planté immobile devant une très grosse portière de velours. Derrière cette draperie, un vestibule de style empire, avec ce luxe froid et nu des antichambres princières où l’on gèle si atrocement quand on n’est pas né laquais. Plusieurs huissiers à bas blancs, culottes vert-amande, [p. 174] s’inclinèrent devant moi jusqu’à terre, les portes s’ouvrirent comme d’elles-mêmes, et je me trouvai à l’improviste dans une seconde pièce qui était encore plus somptueuse, mais dont l’accueil me fut moins fermé et moins hautain. Là, un autre garde-porte, apparemment de rang plus élevé, en habit noir, vint à ma rencontre. Je m’aperçus que j’avais pris instinctivement une nouvelle allure, et que je la soutenais avec une grande virtuosité; il s’agit de marcher sans s’arrêter et sans hâte, en glissant sur le parquet plutôt qu’en le foulant, sans butter aux saluts ni aux révérences. Le valet de chambre de l’impératrice, également en noir (la livrée de deuil privée de Sa Majesté), sortit de la porte opposée, s’inclina profondément, et disparut aussitôt par la même porte, sur la pointe des pieds, pour m’annoncer. Tous ces gens retenaient leur souffle et leur âme, et n’étaient que frac et pointes des pieds. La porte s’ouvrit à deux battants, sans le moindre bruit. Derrière un paravent de soie écarlate, j’entrai dans une vaste salle brillamment éclairée. Sur les murs, [p. 175] des soies rouges, tout autour des meubles dorés, de larges et profonds miroirs tenant des panneaux entiers, puis, au milieu, de grands lustres pendants. Une atmosphère d’une pureté presque immatérielle s’exhalait vers moi.
«D’une autre porte ouverte dans le fond et qui laissait entrevoir un petit salon, l’impératrice m’apparut, venant à ma rencontre...
«... Les murs scintillaient de rouge sombre, des flammes sans nombre ruisselaient sur les dorures et rejaillissaient de la profondeur des miroirs, les cristaux en losanges des lustres étincelaient comme des pierres précieuses suspendues, et l’impératrice, vêtue de noir, se tenait devant moi, souveraine de toute cette splendeur. Elle me salua, d’abord, de loin, et me dit qu’elle se réjouissait de me revoir près d’elle. Et dès qu’elle eut ouvert la bouche et que sa voix eut résonné, le rayonnement autour d’elle pâlit. Ainsi je reconnus qu’elle était plus rayonnante encore que ce qui l’entourait. Je savais déjà, avant d’entrer, ce que je trouverais ici, et pourtant j’étais ébloui. Nous nous promenâmes, une heure durant, [p. 176] sur le tapis mat, où le pied s’enfonçait comme sur un jeune gazon, et dans des flots de lumière dont l’attouchement agissait comme un air tiède, ou, mieux, comme une musique.
«Tout autour, des meubles dorés se dressaient à de longues distances, et dans un calme parfait, comme des objets enchantés. Nulle ligne ne bougeait. De grands miroirs prolongeaient la pièce où la lumière rebondissait, comme une buée fluide d’or et de sang. L’atmosphère de l’étiquette espagnole baignait les coins sombres, les portraits princiers dans de lourds cadres dorés et les portes secrètes tapissées de soie. Mais je sentis plus que je ne vis, presque dissimulées par les lourdes soies et les dentelles des rideaux, des azalées grandes comme des arbres, épanouies, ô tendre floraison, en innombrables calices blancs et roses. Ainsi l’on peut s’imaginer que tous les jeunes arbres se tiennent cachés pendant l’hiver, en de semblables palais, chez quelque fée exilée.»
Il ne faut jamais craindre en art de forcer [p. 177] le caractère. Dans ce portrait d’Elisabeth de Bavière il y a quelque chose d’étrange. Songez à Vélasquez, à Delacroix, à Manet. Mais pourquoi citer ces trois peintres? Tout artiste, dans toute création, place naturellement un peu d’énigmatique, une note bizarre ou cruelle qui semble étrangère à la nature, qui nous donne une commotion et qui, d’une manière irrésistible, ouvre dans notre âme de profondes avenues. Si j’avais à considérer la vie d’Elisabeth de Bavière comme un document, comme le point de départ d’une invention artistique, je saisirais avec vivacité, pour en faire un des ferments de mon travail, le spectacle que cette impératrice offrit au jeune Christomanos, certain jour qu’elle l’avait appelé à Schœnbrunn. Il vit des cordes, des appareils de gymnastique et de suspension, fixés à la porte du salon impérial: Sa Majesté était en train de «faire des anneaux». Elle portait une robe de soie noire à longue queue, bordée de superbes plumes d’autruche, noires aussi. Le jeune homme n’avait jamais vu la souveraine habillée avec tant de pompe. «Suspendue aux [p. 178] cordes, elle faisait un effet fantastique, comme d’un être entre le serpent et l’oiseau. Pour poser les pieds à terre, elle dut sauter par-dessus une corde tendue assez bas.
«Cette corde, dit-elle, est là pour que je ne désapprenne pas de sauter. Mon père était un grand chasseur devant l’Éternel et il voulait nous apprendre à sauter comme les chamois.»
«Puis elle me pria de continuer la lecture de l’Odyssée[16].»
A travers le chant de ce page amoureux d’une étoile, commence-t-on de soupçonner le rythme singulier d’Elisabeth d’Autriche?
Pour faire sentir l’humeur individuelle de tous ses jugements et qu’on ne nous soupçonne point de prendre son portrait dans notre rêverie, il faut que sa ressemblance puisse se former sous les yeux d’un lecteur patient. Goutte à goutte, comme un parfum, laissons s’épandre autour de nous, un peu au hasard, cette sensibilité impériale. Qui donc plaindra le temps qu’il y donne?
On ne doit pas errer sur l’élément fondamental de cette impératrice. Dès les premiers jours, ayant surpris sans doute quelque [p. 180] étonnement chez M. Christomanos, elle lui disait:
—Quand une dame d’honneur est près de moi, je suis tout autre, n’est-ce pas? Vous l’avez remarqué. En effet, il me faut toujours dire aux comtesses quelque chose qui leur permette de répondre. C’est là exactement leur office. Le plus grand effroi des rois est de toujours interroger.
Cette franchise saisissante nous introduit au cœur du mystère que furent l’âme et la vie d’Elisabeth de Bavière. Dans cette richesse d’émotivité où nous allons nous éblouir tout à l’aise, la satiété et le mépris, voilà d’abord les deux caractères qui frappent. Cette impératrice n’aimait qu’une chose, impossible à trouver dans les cours: le pur, le simple, la nature dépouillée de tout artifice.
—Grâce à mes longues solitudes, dit-elle à Christomanos, je reconnais que la lourdeur de l’existence, on la sent surtout par le contact avec les hommes. La mer et les arbres enlèvent de nous tout ce qui est terrestre. Nous devenons nous-mêmes un des êtres sans nombre. Tout commerce avec la société [p. 181] humaine nous fait dévier dans cette ascension et aiguise la sensation de notre individualité, ce qui fait toujours souffrir. Certains hommes cependant me sont aussi agréables que les arbres ou la mer. Je pense aux pêcheurs, aux paysans et aux fous de village, gens qui se meuvent peu parmi la foule des mortels et qui commercent beaucoup avec les choses éternelles. Ils me donnent plus qu’assurément je ne pourrais jamais leur donner comme impératrice. C’est pourquoi je les quitte toujours avec une grande gratitude; ils me délivrent de quelque chose d’étranger et d’angoissant qui s’accroche à moi et m’oppresse.
Ceux qui ont quelque habitude des atténuations que les personnes bien élevées se plaisent à mettre sur leurs pensées, distingueraient déjà derrière cette haute et poétique philosophie une souveraine qui se dérobe, une impératrice réfractaire, mais elle ne permet point qu’aucun doute en subsiste; elle laisse glisser à ses pieds, devant nous, le sceptre et la couronne:
[p. 182] —Nos sentiments intimes sont plus précieux, dit-elle, que tous les titres et que toutes les dignités, guenilles bariolées par lesquelles on croit cacher des nudités...
Elle complétait cette pensée, peu convenable dans sa bouche, par une affirmation magnifique et féconde à méditer:
—Ce qui a de la valeur en nous, nous l’apportons de nos antérieures existences spirituelles.
Cette vue commande toutes ses opinions. C’est ainsi qu’elle dira: «Moins les femmes apprennent, plus elles ont de prix, car elles tirent d’elles-mêmes toute science. Le reste ne fait que les égarer; elles désapprennent une partie d’elles-mêmes pour s’approprier imparfaitement de la grammaire ou de la logique. C’est une illusion d’alléguer qu’ainsi cultivées elles donneront des fils intellectuellement mieux doués. Et puis, pour aider les hommes dans leurs affaires, elles ne doivent pas leur souffler des conseils et des pensées, mais, par leur seul contact, elles doivent éveiller et faire mûrir chez les hommes des idées et des résolutions.»
[p. 183] Si j’écarte le point de vue d’un sujet autrichien qui veut qu’on tienne l’emploi d’impératrice et reine, comment s’abstenir d’admirer ce cerveau qui comprenait, à une époque où ces simples notions sont étrangement méconnues, que des êtres ne peuvent porter que les fruits produits de toute éternité par leur souche? Amenée d’instinct par sa délicatesse esthétique à cette constatation des naturalistes, l’impératrice disait un autre jour: «La culture se rencontre même dans les déserts de l’Arabie, sur les mers et les prairies solitaires. La civilisation étouffe la culture; elle réclame pour soi chaque être humain et nous met tous dans une cage. La culture, chaque homme la porte en soi comme un legs de toutes ses existences antérieures. Souvent la civilisation et la culture viennent de directions opposées et s’entre-choquent; alors l’être humain est dégradé.» Elle ajoutait, et il y a un enchantement de poésie dans une phrase si forte de bon sens: «Les pauvres, quelles victimes! On leur a pris la culture, et, en retour, on leur montre la civilisation dans un lointain inaccessible.»
[p. 184] Des vues aussi saines, où nous vérifions, une fois de plus, la concordance de l’instinct et de la science, la rendaient méprisante. Elle aimait à réciter avec l’accent le plus ironique ces vers de Heine: «Le monde et la vie sont trop fragmentaires; je veux aller trouver le professeur allemand. Celui-là sait harmoniser la vie et il en fait un système intelligible: avec ses bonnets de nuit et les pans de sa robe de chambre, il bouche les trous de l’édifice du monde.»
Ces accents stridents, ces états nerveux qu’elle appréciait si fort chez Heine et qui sont proprement des accès méphistophéliques, lui étaient familiers. Ils naissent d’une sorte de désespoir, où l’humilité et l’orgueil se combattent; d’une nature hautaine qui raille les conditions mêmes de l’humanité. Aspirer si haut et se trouver si bas! Un jour, à Miramar, contemplant le pavillon où sa parente l’impératrice Charlotte, femme de Maximilien, enferma sa folie à son retour du Mexique, elle murmure, après une longue rêverie: «Un [p. 185] abîme de trente ans pleins d’horreur! Et avec cela on dit qu’elle engraisse!»
Des railleries de cette qualité et dans un pareil moment offensent la piété des gens simples. Mais ne semble-t-il pas au lecteur que des états analogues existent chez le philosophe? Épris des plus beaux cas de noblesse, il vit dans le siècle, il en voit la duperie et il devient dur. Il est amené à tirer de la vie des moralités cruelles, parce qu’il regarde d’un point où montent bien peu de personnes.
—La plupart des hommes, disait l’impératrice, ne veulent pas que les bandeaux soient dénoués de leurs yeux; ils croient ainsi se mettre à l’abri du péril... Ils sont malheureux parce qu’ils se trouvent en perpétuel conflit avec la nécessité. Quand on ne peut être heureux à sa guise, il ne reste qu’à aimer sa souffrance. Cela seul donne le repos, et le repos, c’est la beauté de ce monde.
Voilà une philosophie dont l’esprit animait Leconte de Lisle et que ce grand poète de l’Illusion, de la Mort et du Renoncement exprima par magnifiques fragments, mais il ne [p. 186] sut point les lier dans une formule aussi claire.
Isolée dans cette conscience douloureuse, l’impératrice Elisabeth s’appliquait à ne se laisser posséder ni par les choses, ni par les êtres. «Quand je me meus parmi les gens, je n’emploie pour eux que la partie de moi-même qui m’est commune avec eux. Ils s’étonnent de notre ressemblance. Mais c’est un vieux vêtement que, de temps en temps, je tire de l’armoire pour le porter quelques heures.»
On sait qu’elle interposait constamment son éventail, son ombrelle, entre son visage et les regards. Ceux-ci paraissaient vraiment la faire souffrir. Ils la privaient d’elle-même. «Nous devons songer autant que possible à sauver au moins quelques instants, pendant lesquels, chacun à notre manière, nous puissions pénétrer dans notre propre vie. Eh bien, quand je me trouve toute seule dans un site solitaire, dont je sais qu’il fut peu fréquenté, je sens que mes rapports avec les choses diffèrent absolument de ce qu’ils sont [p. 187] si des humains m’entourent. A cette différence seulement, je me reconnais moi-même.»
Un autre jour elle disait: «Nous n’avons pas le temps d’aller jusqu’à nous, tout occupés que nous sommes à des choses étrangères. Nous n’avons pas le temps de regarder le ciel qui attend nos regards.»
Elle trouvait enfin cette magnifique image, lourde et sombre et qui fait miroir à nos plus secrètes pensées: «J’ai vu une fois à Tälz une paysanne en train de distribuer la soupe aux valets. Elle n’arriva pas à remplir sa propre assiette.»
L’émotion éveillée en nous par la femme qui put, au hasard d’une promenade, laisser s’évader de son âme une pensée d’un tel raccourci, nous permet de vérifier sa théorie du tragique. «Je crois, disait-elle, que les conflits tragiques agissent parce qu’ils nous mettent dans un état où nous croyons nous approcher de quelque chose d’indéfini et que nous attendons toujours dans notre vie... Ce n’est point par le tragique du théâtre que nous sommes pris, mais par des vues plus profondes [p. 188] qui ont été éveillées dans notre cœur.»
Je me rappelle que la veuve de Napoléon III, l’impératrice Eugénie, sollicitée d’accorder une audience, déclarait un jour à son entourage: «Oui, je sais, on vient me voir comme un cinquième acte.» Il n’est guère d’hommes assez sages pour se refuser d’éveiller leur cœur, pour se détourner des figures tragiques. On veut élargir sa vie. En essayant de nous rendre intelligibles jusque dans leurs racines les pensées de l’impératrice Elisabeth, nous nous enrichissons certainement d’une très belle, très rare et très dramatique interprétation de la vie.
Sérieusement, mon cher, peux-tu vivre de la vie politique ou de ce qu’on appelle la vie réelle? Peux-tu aimer de toute ton âme autre chose que les choses parfaites que découvrent la science et la réflexion intérieure? (Lettre de jeunesse de Taine.)
Quelle détresse sous les pierreries de ce diadème! Le lecteur fasciné s’arrête devant cette âme de désirs qui ne sait où se porter. N’eût-il pas mieux valu qu’elle maîtrisât ces beaux frémissements et qu’au lieu d’entretenir sa solitude et ses tristesses, elle s’appliquât aux devoirs d’une souveraine, puisqu’aussi bien ils lui proposaient une discipline de vie?
Un jour, tandis qu’on coiffe l’impératrice [p. 190] et que Christomanos donne sa leçon de grec, l’empereur entre. La coiffeuse s’abîme sur le tapis comme dans une trappe et s’éloigne. L’empereur invite l’étudiant à rester et cause avec l’impératrice en hongrois. «L’impératrice avait sur les traits une expression d’intense attention; ses yeux regardaient devant elle, comme s’ils voulaient saisir de façon aiguë et pénétrante un infiniment petit objet; elle répondait à l’empereur et l’interrompait assez souvent. Parfois, elle haussait les épaules et esquissait une petite grimace, ce qui faisait rire l’empereur.» François-Joseph sortit, la coiffeuse rentra et l’impératrice dit en grec à Christomanos:
—Je viens de faire de la politique avec l’empereur. Je voudrais pouvoir être utile, mais peut-être suis-je plus avancée en grec. Et puis, j’ai trop peu de respect pour la politique; je ne la juge pas digne d’intérêt. Et vous, vous y prenez intérêt?
—Pas trop, Majesté; je la suis seulement dans ses grandes phases, quand des ministres tombent.
[p. 191] —Ils ne sont là que pour tomber, puis d’autres viennent, dit-elle avec une nuance curieuse, une sorte de rire intérieur dans la voix.
—Pour moi, Majesté, je m’intéresse davantage à la vie publique en France.
—Elle est assurément plus amusante. Les gens là-bas savent mieux jouer la comédie et avec plus d’esprit.
Au bout d’un instant elle ajouta:
—Les politiciens croient conduire les événements et sont toujours surpris par eux. Chaque ministère porte en soi sa chute et cela dès le premier instant. La diplomatie n’est là que pour attraper quelque butin du voisin. Mais tout ce qui arrive arrive de soi-même, par nécessité intérieure, par maturité. Les diplomates ne font que constater les faits.
Il faut avouer que ce déterminisme médiocre fait un indigne prétexte d’abstention. N’y cherchez que l’argument d’une Wittelsbach commandée par un impérieux besoin de solitude, par l’amour de la fuite.
[p. 192] Les frères de l’impératrice, le duc Louis et le duc Charles-Théodore, ont renoncé aux prérogatives de leur rang, le premier pour retrouver la liberté de son cœur, l’autre pour se rendre utile et donner ses soins aux malades. Elle-même, née romanesque, avait été fort mal élevée. C’est ce que Mme Arvède Barine a démêlé avec une admirable acuité féminine:
«Son père, Maximilien-Joseph des Deux-Ponts-Birkenfeld, duc en Bavière, était un parent pauvre de la famille impériale d’Autriche. Chargé d’enfants, absorbé par le souci d’établir les aînés, il travaillait laborieusement avec sa femme, la duchesse Ludovica, à trouver deux maris pour leurs grandes filles. On comptait s’occuper de la petite Elisabeth plus tard, quand les grandes seraient casées. Elisabeth se trouvait très bien de son rôle de Cendrillon (c’était elle-même qui s’était baptisée ainsi). Elle profitait de ce que personne ne la surveillait pour courir le pays et se lier avec tous les paysans des environs. Ce fut l’origine de ses malheurs. L’enfant grandit [p. 193] en dehors de l’idée monarchique, dans l’ignorance des sacrifices qu’elle exige de ses victimes, les têtes couronnées. Les chaumières où elle s’abritait familièrement pendant l’averse, où elle venait demander un verre de lait, lui enseignaient une autre leçon, bien dangereuse pour une future impératrice. Elle y apprenait à connaître les joies simples des humbles, leur absence de contrainte, et s’accoutumait à l’idée folle qu’elle pourrait y prétendre. Ce n’était pas sa faute; personne ne lui avait expliqué ce que c’est qu’une princesse. Ses parents croyaient avoir du temps devant eux; Elisabeth portait encore des robes courtes et ne dînait pas à la grande table; on pouvait passer des semaines entières chez eux, à leur château de Possenhoffen, sans apercevoir leur Cendrillon. Celle-ci avait seize ans lorsqu’il survint un grand événement dans sa famille. Le digne couple de Possenhoffen avait été récompensé de ses peines; la fille aînée venait d’être demandée en mariage par l’empereur d’Autriche. On attendait le jeune monarque au château pour [p. 194] célébrer les fiançailles. C’était à la fin de l’hiver de 1854, aux premières feuilles. François-Joseph arriva. Il avait vingt-quatre ans. Presque au débarqué, l’idée lui prit d’aller se promener tout seul dans les bois. Cette fantaisie a peut-être changé l’avenir de l’Autriche, et d’une partie de l’Europe avec lui. L’empereur vit venir à lui, sous les grands arbres, une petite fée vêtue de blanc, d’une beauté merveilleuse. Ses yeux bleus étaient pleins de lumière, sa chevelure flottante lui tombait jusqu’aux genoux. Deux grands chiens blancs gambadaient à ses côtés. Tandis que le jeune prince contemplait cette apparition, la fée s’approcha et lui jeta sans façon les deux bras autour du cou. C’était sa cousine Elisabeth, qu’on ne lui avait jamais montrée et qui avait reconnu son futur beau-frère d’après ses portraits. Le soir même, l’empereur d’Autriche déclarait à Maximilien-Joseph des Deux-Ponts-Birkenfeld, duc en Bavière, qu’il avait changé ses projets et qu’il n’épousait plus sa fille aînée, mais la petite Elisabeth.» (Arvède Barine, Les Débats, 8 novembre 1899.)
[p. 195] Le mariage eut lieu le 24 avril 1854. Le plus facile était fait pour une créature aussi séduisante. Restait d’apprendre et d’accepter le milieu et les charges d’une souveraine. Ce fut où échoua cette impératrice de seize ans qui trouva assommant le cérémonial minutieux et compliqué de la cour de Vienne, qui eut l’imprudence de le laisser voir et qui, c’est pis encore, rêvait d’idylle sur le trône, de bonheur tranquille et de fidélité bourgeoise.
C’est par la qualité particulière de sa sensibilité qu’Elisabeth de Bavière a échoué comme impératrice. Pourtant il lui arriva de trahir des pensées politiques singulièrement puissantes, vraiment issues de cette source jaillissante qui la fournissait, sans discontinuer, de passion et de sérieux.
—Le bonheur que les hommes demandent à la vérité est soumis, disait-elle, à des lois tragiques. Nous vivons au bord d’un abîme de misère et de douleur. C’est l’abîme entre notre état d’aujourd’hui et cet autre dans lequel nous devrions nous trouver. Dès que [p. 196] nous voulons le franchir, nous nous y précipitons et nous y fracassons. Quand ce gouffre sera une fois rempli de souffrance humaine et de cadavres de bonheur, alors on le traversera sans danger.
Peut-on pressentir avec plus de magnificence poétique cette loi que les nationalistes français ont de leur côté dégagée: tout dépaysement, tout déclassement, tout déracinement comporte les plus grandes chances de désastre. Le pourcentage des pertes est considérable. Mais cette rançon payée, l’individu qui est sorti de sa tradition pour aller à ce qu’il jugeait la vérité peut se raciner derechef et une société refleurir.
C’était un conte de fées réalisé... Un rêve de poète exécuté par un millionnaire poétique, chose aussi rare qu’un poète millionnaire, s’épanouissait comme une fleur merveilleuse des contes arabes. (Fortunio, Théophile Gautier.)
Où donc eussent été satisfaits les désirs intimes de cette impératrice méprisante et rassasiée?
Ses déplacements n’avaient point la belle et raisonnable régularité des migrations d’un oiseau voyageur; c’était plutôt le tournoiement d’un esprit perdu qui bat les airs, qui ne se trouve plus de gîte et qu’aucune discipline ne règle. «Elle s’était organisé un peu partout des résidences fastueuses ou originales. On la voyait errer perpétuellement des [p. 198] somptueux châteaux historiques des Habsbourg aux maisons inventées par sa fantaisie éphémère. De Schœnbrunn, le Versailles autrichien, au pavillon de chasse de Lainz, élevé par elle dans une profonde solitude forestière et qu’elle avait baptisé le Repos de la forêt, elle allait à Miramar, sur les bords de l’Adriatique, dans ce palais de marbre si tristement fameux par le souvenir de l’empereur Maximilien; à Godollo, dont elle avait fait un petit Trianon; au chalet d’Ischl; à la villa renaissance de Wiesbaden; au château de Sassetot-le-Mauconduit dans le pays de Caux, près des Petites-Dalles[17]; au cap Martin, où elle rencontrait l’impératrice Eugénie; à Strephill Castle, en Irlande; dans l’Achilleion de Corfou. La Hongrie, la Hollande, la Suisse, l’Écosse, les roseaux du Nil, comme les bruyères de Man, la voyaient passer. Elle aimait à se promener, à se perdre dans Paris. Son yacht, le Miramar, un trois-mâts de dix huit cents tonneaux et de quatre cent cinquante chevaux, la menait de rive en rive.—Croirait-on que, la dernière année de sa vie, c’est-à-dire [p. 199] de janvier à avril 1898, on l’aperçut à Biarritz, à Paris, à San Remo, à Kissingen, à Dresde, au château de Lainz, aux bains de Mannheim dans la Hesse, enfin sur le quai de Genève?» (Ernest Tissot.) Sur tous ces chemins, où peut-être elle regrettait le toit de son enfance et la vie paisible de Possenhoffen, elle n’oubliait pas l’antique maison où son mariage l’avait introduite. On l’a vue rêver sous les chênes qui entourent nos vénérables ruines de Vaudémont. Elle y trouvait les mânes des Habsbourg-Lorraine[18].
C’était une branche d’un grand arbre, mais une branche cassée. Des malentendus d’abord, puis des catastrophes l’avaient détachée de sa tradition propre. Les ancêtres dont elle était la suite morale, le prolongement, ne pouvaient plus lui parler utilement. Leurs conceptions fondamentales ne savaient plus chanter en sa conscience. Elle ne se connaissait plus que comme un individu.
On aurait dû dire et redire à la petite Cendrillon de Possenhoffen qu’«on n’est pas impératrice pour s’amuser, ni pour filer le [p. 200] parfait amour et qu’il y a après tout des compensations à ce qui manque à la femme dans la puissance pour le bien qui revient à la souveraine». Ce joli thème d’éducation est de Mme Arvède Barine. Dès les premiers temps de son mariage, la jeune souveraine s’évada sur son yacht à travers la Méditerranée, de peur d’être obligée d’entendre une parole de raison de son mari, coupable, si l’on veut, mais surtout étonné, qui se lançait à sa poursuite. La duchesse Ludovica écrivit à sa fille ainsi fugitive: «Vous avez agi comme si c’était vous qui fussiez coupable, et non votre mari... Plus nous sommes haut sur l’échelle sociale, moins nous avons le droit de venger nos offenses privées ou de nous libérer d’obligations pénibles. Rappelez-vous le bon vieux dicton: Noblesse oblige. Vous êtes partie intégrante de l’honneur d’une grande nation; vous manquez à vos devoirs et aux traditions de vos aïeux en agissant ainsi pour une offense personnelle et sous l’entraînement de la passion.»
Un autre jour, la voyant se ronger sans [p. 201] trêve sur ceci et sur cela, cette mère infiniment sage lui disait: «Mon enfant, il y a deux espèces de femmes dans ce monde: celles qui en viennent toujours à leurs fins, et celles qui n’y arrivent jamais. Vous m’avez l’air d’appartenir à la seconde catégorie. Vous êtes très intelligente, vous savez réfléchir et vous ne manquez pas de caractère; mais vous manquez de souplesse; vous ne savez pas vous mettre au niveau des gens avec lesquels il vous faut vivre, ni vous plier aux exigences de la vie moderne. Vous êtes d’un autre âge, du temps où il existait des saints et des martyrs. Ne vous faites pas remarquer en ayant trop l’air d’une sainte, et ne vous brisez pas le cœur en vous imaginant que vous êtes une martyre.»
On voudrait surprendre quelque point où cette fugitive, cette femme «d’un autre âge» et qui, pour prendre l’expression mystique, n’était point du siècle,—contentât son rêve intérieur.
Il n’est personne qui n’ait visité, ou du [p. 202] moins qui ne connaisse sur des récits enthousiastes, le palais de Corfou, le blanc palais d’Achille, l’«Achilleion» construit par l’impératrice dans la baie de Benizze. M. Christomanos y accompagna la souveraine. Quelle bonne fortune de les suivre et de connaître ce qui touchait Elisabeth de Bavière dans son «Eldorado»!
...Le canot impérial aborda. L’impératrice descendit sur le môle de marbre blanc où se dresse un dauphin de pierre. Elle l’avait montré du vaisseau à Christomanos en disant:
—Voyez là-bas, c’est mon philosophe riant qui me recevra le premier.
La plage de Benizze, blanche de galets, développait sa douce courbe et, dans son creux, tenait le village entre les orangers et les cyprès. L’impératrice, toujours en noir, abritée par son ombrelle blanche, franchit la porte de fer dentelé que surmonte l’inscription Achilleion en caractères grecs. Sous l’allée de citronniers en fleurs qui monte doucement [p. 203] vers le château le jeune poète enivré par ce prodigieux printemps murmura:
—Votre Majesté voit-elle comme ces arbres se sont parés pour lui faire fête?
—Ils ont endossé leurs robes de mariage, répondit-elle en souriant.
—Et ce parfum!
—Le parfum aussi s’en ira, et les citrons, après, sont fort aigres.
L’ensemble de la propriété est défendu par un mur de clôture très blanc et très haut, et par un épais voile de feuilles d’olivier.
—Les Anglais sont désespérés, dit l’impératrice; ils se postent pendant des heures sur la colline d’en face sans arriver à rien voir.
Le palais est bâti dans la montagne même. Sa façade, tournée vers la grand’route qui de Corfou par Gasturi descend à Benizze et au rivage, présente trois étages. Le premier fait un portique en saillie, il soutient sur d’énormes colonnes une large véranda, et comme le second et le troisième étage sont bâtis en retrait, il y a place pour deux loggias à droite et à gauche de cette véranda centrale, dite [p. 204] «des centaures». Les élégantes colonnes jumelles des loggias soutiennent elles-mêmes, au troisième étage, des balcons.
L’autre façade, tournée vers l’intérieur de l’île, se compose d’un seul étage qui donne sur une terrasse plantée d’arbres séculaires. Sa longue véranda prend vue sur Gasturi et sur Aji-Deka. Un Hermès ailé semble prêt à s’envoler de l’extrême bord de la balustrade par-dessus le bois d’oliviers.
Pour apprécier cette construction, il faut la mettre dans cette splendeur du paysage, de la chaleur, de la lumière, des parfums, des nerfs hyperesthésiés et des grands souvenirs homériques. Mais, dans un tel pays, l’inépuisable source des plaisirs, ce sont les jardins. Un escalier orné de Vénus, d’Artémis et de beaux adolescents, conduit des parterres du bas aux terrasses plantées du haut. Un péristyle, tout en marbre, borde l’édifice qui s’ouvre sur la terrasse. La longue suite des colonnes en rectangle qui portent le toit sont teintes à leur partie inférieure de cinabre; leurs chapiteaux sont richement dorés et peints en bleu et [p. 205] rouge; leurs corps blancs se détachent merveilleusement sur le mur pompéien du fond où de grandes fresques évoquent tout l’Hellénisme fabuleux. Du côté de la mer, à l’extrémité nord du péristyle, on voit une figure éblouissante de blancheur: c’est la Péri, la fée de la lumière, qui, sur une aile de cygne, glisse au-dessus de l’onde et sur son sein presse l’enfant endormi. Devant chaque colonne du péristyle se tiennent des muses, de grandeur naturelle, et à leur tête, Apollon Musagète.
—La plupart sont des antiques, dit l’impératrice, je les ai fait acheter à Rome. Elles appartenaient au prince Borghèse, mais il a fait banqueroute et, alors, il a dû aliéner ses dieux. N’est-ce pas que c’est affreux qu’aujourd’hui les dieux même soient les esclaves de l’argent?
Tout près d’Apollon, dans ce cercle des Piérides, l’impératrice désigne une statue de Canova, la Troisième danseuse, dont on dit, comme de la Venus victrix, qu’elle représente Pauline Borghèse.
[p. 206] —J’ai amené aux Muses une nouvelle compagne; j’espère qu’elles l’auront bien accueillie. Apollon, tout au moins, la regarde fort tendrement.
Une seule marche descend du péristyle à la terrasse jardin.
—«Le jardin des Muses», dit l’impératrice à Christomanos. Ici, sans nul doute, des poèmes en foule vous viendront à l’esprit.
Parmi les cyprès, vieux de plusieurs siècles, raides et vraiment hiératiques, et parmi les magnolias, épanouis en fleurs géantes, l’impératrice montrait des oliviers sauvages:
—Je les ai laissés là exprès, parce que sur l’Acropole il y avait aussi des oliviers consacrés à Pallas Athènè. Ici ils remplissent une haute mission: ils sont chargés de retenir à leurs sommets tous les rayons de soleil qui glissent le long des cyprès.
Nous ne pouvons suivre M. Christomanos dans son inventaire de cette architecture et de cette flore des jardins. La description la plus précise suggère peu de choses à qui ne peut la doubler de ses souvenirs. Après des [p. 207] parterres de roses et d’hyacinthes, à une extrémité du jardin d’où la montagne glisse à la mer, sous des vagues de feuillage, on atteint un banc de marbre hémi-circulaire, comme on en voit à Athènes au théâtre de Dionysos et tel qu’Alma Tadema les peint. Des taillis de lauriers l’entourent. C’est assise là que l’impératrice habillée de deuil contemple la mer qui s’élève très haut à l’horizon, la mer antique, passionnée, effrayante de mystère. Plus haut encore, les montagnes violettes de l’Albanie se fondent dans la buée du soleil.
Il y a trois de ces terrasses jardins. «Mes jardins suspendus», dit l’impératrice. La troisième se nomme la «terrasse d’Achille», parce que ses nombreuses allées couvertes de plantes grimpantes rayonnent autour de la statue d’Achille mourant.
Si nous prenions la liberté—mais il faut laisser quelque mystère—de parcourir l’intérieur du palais, nous verrions dans le grand escalier une colossale peinture décorative, le Triomphe d’Achille, Achille traînant autour des murs de Troie le cadavre d’Hector.
[p. 208] —J’ai consacré mon palais à Achille, dit l’impératrice, parce qu’il personnifie pour moi l’âme grecque, la beauté de la Terre et des hommes. Je l’aime encore parce qu’il était si rapide à la course. Il était fort et altier et il a méprisé tous les rois et toutes les traditions, et compté les foules humaines pour rien, bonnes seulement à être fauchées par la mort comme des épis. Il n’a tenu pour sacré que sa propre volonté, il n’a vécu que pour ses rêves, et sa tristesse lui était plus précieuse que la vie entière.
Des indications de cette puissance relèvent soudain le sens de ce palais où notre imagination peut-être insuffisante serait tentée de se dégoûter sur des réalisations artistiques médiocres. Dans ses fameux châteaux de Bavière, Louis II, par la faute des peintres, des sculpteurs et des tapissiers qu’il chargea d’exécuter ses rêves, subit et nous inflige un pareil échec. C’est qu’il n’est pas donné à des individus de grouper pour leurs caprices magnifiques, mais singuliers, cet ensemble d’ouvriers que la France disciplinée par plusieurs [p. 209] siècles mit à la disposition des volontés vraiment nationales de Louis XIV dans Versailles.
Nous ne faisons pas cette distinction entre l’individuel et le collectif pour diminuer la qualité d’Elisabeth de Bavière, car nous la considérons elle-même comme un fruit historique et comme le type expressif de cette étrange et grande famille des Wittelsbach. Et d’ailleurs l’individuel devient la plus précieuse valeur sociale (encore que je ne méconnaisse point ses dangers), quand il se hausse jusqu’à tenir, dans quelque ordre que ce soit, l’emploi de héros.
L’impératrice vécut vraiment dans une obsession héroïque. Elle disait un jour: «Les feuilles sont quelque chose d’accessoire, des désirs morts, oubliés et inaccomplis, tandis que les fruits sont le but direct de la création. Homère a raison, quand il compare les hommes qui combattent autour des héros aux feuilles de la forêt. Ils ne sont là que pour végéter à côté des sublimes.» Mais elle n’était point la dupe de son imagination. Et voici [p. 210] son dernier mot sur ses «Eldorados», sur ses rêves impuissants de vie héroïque:
—Lors de mon premier séjour à Corfou, je visitai souvent la villa de Baila. Délicieuse et tout abandonnée au milieu de ses grands arbres, elle m’attirait tellement que j’ai fait d’elle l’Achilleion. Hélas! j’y ai détruit l’antique mélancolie. Maintenant, à vrai dire, je regrette mon intervention: nos rêves sont toujours plus beaux quand nous ne les réalisons pas... C’est aussi à cause du voisinage de l’Aja Kyriaki que j’ai si fort désiré d’habiter ici. Je veux que l’on m’ensevelisse là-haut. Il n’y aura que les étoiles au-dessus, et les cyprès me donneront assez de soupirs, plus que ne sauraient faire les hommes. Je trouverai une plus sûre éternité dans ces lamentations des cyprès que dans la mémoire de mes sujets. Chez les cyprès, l’état de tristesse et les plaintes sont une fonction vitale, comme chez les hommes les méchants propos et les calomnies.
Quand elle eut fini de montrer son palais à M. Christomanos, elle dit:
[p. 211] —Nous passerons aussi peu que possible notre temps à la maison. Il ne faut consumer les précieuses heures de la vie entre les murs qu’autant qu’il est indispensable. Quant à nos logis, ils doivent être tels qu’ils ne puissent jamais détruire les illusions que, chaque fois, du dehors, nous y rapportons.
Voilà qui nous donne la mesure précise de l’importance qu’une Elisabeth de Bavière ou encore qu’un Louis II donnent à leurs châteaux, véritables rêves pétrifiés, sur lesquels des littérateurs en voyage ont publié bien des pages qui sentent le badaud. «Nos logis doivent être tels qu’ils ne puissent détruire les illusions que nous y apportons du dehors!» Je prendrais cette phrase pour épigraphe, si j’avais à récrire certain voyage que je fis autrefois à Neu-Schwanstein, à Linderhof, à Chiemsee, isolés aux forêts ou que baigne une eau morte. Mon récit se terminait sur ces mots que je vérifie dans l’Achilleion: «A qui n’a pas l’état d’âme de Louis II, que servirait de vivre aux châteaux de Bavière?»
Je confesse que l’amour infini que je porte au fond du cœur se trouve toujours empêché dans son essor lorsqu’il s’adresse aux réalisations finies de l’essence parfaite. Je ne sais quelle malheureuse clairvoyance me montre que tous les êtres manquent de ceci ou de cela et qu’ainsi ils ne peuvent pas donner prise à l’amour. Je dis la même chose de moi-même et je sens que je ne mérite pas non plus d’être complètement aimé. (Lettre de jeunesse de Taine.)
Dans tous ses châteaux, l’impératrice avait fait peindre Titania caressant la tête d’âne. «C’est la tête d’âne de nos illusions que nous caressons sans cesse», disait-elle.
Cette princesse singulièrement née jugea-t-elle toutes choses, comme fait Hamlet, d’après la vie de cour? Une existence infiniment [p. 213] luxueuse, une humanité infiniment fourbe, développent chez le plus délicat des êtres d’effroyables tristesses, des satiétés et des aspirations heureusement inconnues à la foule laborieuse.
M. Christomanos, qui a pris Schopenhauer pour sujet de sa thèse de doctorat à Innsbruck, interprète l’impératrice à l’allemande. «Plus je reste auprès d’elle, dit-il, plus se fait forte en moi la pensée que son existence vacille entre deux mondes. Quand nous errons pendant des heures sur la grève homérique, tandis qu’elle glisse, le long du clair rivage de la vie, pareille à une ombre qui a pris corps, tandis que les vagues éternelles nous assaillent de leurs clameurs, j’ai le sentiment qu’elle incarne quelque chose qui gît entre la mort et la vie. Elle-même, dans la solennelle allocution que la mer tient au sable, ne distingue jamais rien que ceci: des forces et des puissances, plus impérissables que celles que nous connaissons sur cette île de la vie, nous revendiquent pour elles.—Presque à chaque fois que nous allons à la mer, l’impératrice [p. 214] me dit: La mer veut me posséder toujours, elle sait que je lui appartiens.—L’atmosphère où vit l’impératrice est autre que celle où nous respirons. De notre point de vue, sa vie est vraiment un non-vivre; l’on pourrait dire qu’elle se trouve, en tant même que créature vivante, dans un état qui exclut la vie.»
On trouve dans le «journal» du jeune lecteur quelques notes qui nous permettent de comprendre à la française la vraie nature morale de sa souveraine.
.... Elle semblait s’adoucir en se reportant à son enfance. Un jour sur l’Aja Kyriaki, l’un des sommets de Corfou, elle dit:
—C’est ici seulement que je me plais tout à fait. Ici je pourrais même renier mon principe (de perpétuelle errante), et rester attachée pour toujours à cette motte de terre... La mer aujourd’hui est comme un lac... Je me sens si bien ici chez moi que je ne puis m’empêcher de penser au lac de Starnberg et à Possenhoffen.
.... Dans l’une de ses longues promenades [p. 215] de Corfou, elle surprit, sous un bois d’oliviers, des jeunes filles qui dansaient. Les mains dans les mains et l’une derrière l’autre, elles serpentaient lentement; une belle enfant aux cheveux noirs les guidait, qui tenait à toute la chaîne par un mouchoir de soie rouge. La conductrice chantait, puis toutes les autres reprenaient chaque strophe:
L’impératrice contempla ce spectacle avec ravissement, puis elle dit:
—Nous dansions de la même façon, mes [p. 216] sœurs et moi, à Possenhoffen, bien que nous ne fussions pas des grecques.
.... Une fois, M. Christomanos lui lisait Peer Gynt. Ils arrivèrent au couplet de Solweig:
—Pourquoi l’attendre? dit l’impératrice. Peut-être n’était-il pas celui qu’elle devait aimer et pour qui elle était née. On se trompe si souvent dans ses jeunes années. Et l’on veut faire soi-même sa destinée!... Il se peut bien que le véritable élu l’attendait, lui aussi.
Il y a quelque chose encore à noter dans le soin qu’elle mettait à prémunir son jeune lecteur contre les intrigues de la cour: «Ces gens-là, disait-elle, se nourrissent tous les jours de faisans et de perdrix, mais une heure sans cancans les ferait mourir.» Elle ajoutait: «Ah! oui, certainement, on est très dévoué [p. 217] à l’impératrice. Mais chaque salut a son but, chaque sourire veut être payé... Peut-être même je dois remercier Dieu d’être impératrice, autrement cela tournerait mal pour moi.»
Et montrant une petite chambre dont les murs étaient littéralement couverts de portraits de chevaux, elle les commentait ainsi:
—Tous ces amis, je les ai perdus et je ne gagnai pas un seul à leur place. Beaucoup de ces chevaux sont allés à la mort pour moi, ce que nul homme n’eût jamais fait; ils voudraient plutôt m’assassiner...
... Cette prévision déjà peut faire frissonner le lecteur, mais voici la plus significative anecdote.
Une après-midi, à Corfou, l’impératrice et Christomanos passèrent devant une hutte, un peu à l’écart d’une ferme, au milieu de grands arbres noirs. Une faible lueur passait par la porte ouverte. Soudain, un cri, un seul cri strident et prolongé trancha l’air. Puis il jaillit de nouveau et avec lui tout un chœur de [p. 218] sons gémissants. C’était une lamentation de plusieurs femmes qui venait de la hutte éclairée. Il y eut une pause, puis la complainte reprit plus puissante, pour se rompre encore une fois. Et au-dessus de ce flot sauvage, fait de quelques notes, qui montait et baissait comme la mer, de temps à autre s’élevait une voix unique à qui rien ne pouvait se comparer, qui surpassait toute terreur en épouvante et toute épée en tranchant.
—Qu’est-ce donc? demanda l’impératrice, avec effroi.
Et d’une voix que M. Christomanos ne lui connaissait pas, elle commanda:
—Allez, voyez ce qui est arrivé.
Il vit sur un sol de terre battue plusieurs femmes accroupies en cercle. Quelque chose de blanc gisait étendu sur un lit. Une vieille femme, ses cheveux gris en désordre, était affaissée au milieu du cercle des autres femmes. Il revint à l’impératrice.
—Quelqu’un est mort! c’est la plainte mortuaire des Grecs.
Elle demanda qui était mort. Il répondit [p. 219] qu’il avait cru voir une vieille femme gisante sur le lit.
—Voilà que vous vous trompez, dit-elle d’une voix basse. Ce doit être un enfant de cette femme qui crie plus horriblement que toutes les autres. Peut-être son fils. Allez vous informer encore une fois.
Mais elle le rappela aussitôt.
—Non, ce n’est pas la peine; je sais que c’est son fils.
Ils continuèrent leur chemin. Après quelques instants de silence, tout à coup elle dit:
—Pour cette femme, plus rien, plus rien que cela, plus de place en elle pour autre chose que ce soit. Maintenant, elle épuise toute son âme d’autrefois.
Après ces mots incomparables, elle se tut pour toute la soirée.
Ces pauvres anecdotes—pauvres, mais suffisantes pour jeter de larges clartés—permettent, me semble-t-il, de saisir les fils qui relient cette personne d’exception à l’ordinaire de l’humanité. Nous avons quelques [p. 220] mots de son cœur, la clef de sa première nature.
C’est une banalité de rappeler le goût qu’elle affichait pour Heine. Il aide pourtant à la comprendre comme une désabusée.
M. Christomanos lui demandant un jour quel poème de Heine elle préférait, elle répondit:
—Je les adore tous, car tous ne sont qu’un seul poème: un et le même. L’incrédulité de Heine quant à sa propre sentimentalité et à son propre enthousiasme est ma croyance aussi. Les journalistes me font un grand mérite d’être son admiratrice; ils sont fiers que j’aime leur Heine, mais j’aime en lui son infini mépris de sa propre humanité et la tristesse dont les choses de cette terre l’emplissaient.
Si séduisant que soit d’orgueil poétique, de volupté et de solitude, un tel état d’esprit, avouons pourtant ce qu’on voit, quand on en fait le tour. Un jour, à Madère[19], un vieillard offrit à l’impératrice un bouquet de camélias rouges; elle lui donna une pièce d’argent. Plus loin, sur la route, une jeune et belle fille, aux bras ronds et brunis, aux lèvres de fleurs [p. 221] de grenade, aux yeux de diamant, lui tendit un second bouquet de camélias rouges; elle lui donna une pièce d’or. Comme Christomanos demandait pourquoi de l’argent au vieillard et de l’or à la jeune fille, l’impératrice répondit:
—C’est qu’elle est belle!...
Qu’il me soit permis de placer sous cette histoire de qualité lyrique quelques réflexions chagrines, et de signaler le revers de la médaille que nous présentons dans son beau jour. «La spécialisation excessive d’une faculté aboutit au néant. Je comprends la fureur des iconoclastes et des musulmans contre les images. J’admets tous les remords de saint Augustin sur le trop grand plaisir des yeux. La folie de l’art est égale à l’abus de l’esprit. Une de ces deux suprématies engendre la sottise, la dureté du cœur et une immensité d’orgueil et d’égoïsme. Je me rappelle avoir entendu dire à un artiste: Ne donnez pas à ce pauvre-là, il est mal drapé; ses guenilles ne lui vont pas bien.»
D’où viennent ces lignes qui s’appliquent [p. 222] fortement à Elisabeth de Bavière? Je les extrais d’une étude sur l’École païenne où Henri Heine est pris vivement à partie pour sa «littérature pourrie de sentimentalisme matérialiste». (Janvier 1851.) D’ailleurs, il paraîtra curieux à certains lecteurs mal informés que cette étude soit de Baudelaire. On veut voir dans celui-ci le chef d’une école satanique, quand il est souvent un voisin de Veuillot.
Au moment de l’assassinat, Drumont publia un magnifique article, intitulé le Douzième Arbre, à la fois brutal et religieux, qui complète et fortifie la thèse de Baudelaire: «... L’impératrice emportait toujours en voyage les œuvres de Heine, son auteur de prédilection. Avant d’aller à Preigny présenter ses hommages à la baronne de Rothschild (c’est en cours de route qu’elle fut assassinée), cette descendante des Wittelsbach, devenue la femme d’un Habsbourg, aura peut-être relu, en écoutant le clapotement des eaux du lac, cette pièce atroce (sur Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine) où le poète s’égaye sur ces gorges de patriciennes dans lesquelles la [p. 223] hache du bourreau a fait une large entaille. Elle se sera divertie, peut-être, de cette reine qu’on ne peut plus friser, parce qu’elle n’a plus de tête, et de cette dame d’honneur réduite à faire la révérence avec son derrière... Derrière le Douzième arbre de l’avenue, l’anarchiste était déjà embusqué et guettait... Il ne faut pas trop rire à la Belle Hélène, lorsqu’on appartient à la famille des Atrides et que l’on est menacé par les Dieux d’avoir le sort de Klytemnestra...»
Je devais indiquer ce point de vue. Pour bien embrasser un spectacle, il faut de temps à autre que le spectateur se déplace d’un pas à gauche, d’un pas à droite...
Il suit de là que mon amour tend aux choses générales ou idéales. Mon objet est le Dieu ou l’Être. (Lettre de jeunesse de Taine.)
Ainsi empêchée dans son attrait vers des réalités finies, où s’orientera cette âme en détresse?
Écoutez, regardez une belle scène à peine indiquée. Un matin, traduisant Othello avec son lecteur, l’impératrice lit à haute voix la Chanson du Saule de la touchante Desdémone.
Mais voici qu’elle s’interrompt pour dire:
—Il y a cependant autre chose que la [p. 225] jalousie ou l’héroïsme, et ce sont les saules...
Magnifique indication! Depuis que le monde est monde, de telles sensibilités ardentes voient la nature elle-même comme un immense «buisson ardent». Elles se tournent vers les forces sourdes, vers les puissances primitives, vers les dieux. La solitude, les arbres, la mer, les sommets, l’ouragan, le réveil profond de ses vies antérieures, nous avons bien vu que c’étaient la vie véritable et le refuge constant de l’impératrice.
Un jour, à Corfou, elle gravit la cime bleue de l’Aji Deka. Rien que des granits solitaires, quelques chênes nains, le soleil et un vent furieux. Elle murmure:
—Comme dans une île, bien que l’on soit sur la terre ferme... Cette cime pourtant se rattache aux montagnes, aux vallées, aux hommes... Voilà à quoi l’on peut toujours arriver, si l’on veut.
—Qu’entend dire Votre Majesté? demande Christomanos.
—On peut toujours arriver à faire de soi une île.
[p. 226] —La cime ne peut interdire au vent de venir jusqu’à elle.
—Oh! le vent, je ne voudrais pas m’en priver, si j’étais la cime; ni des nuages non plus. Tout: le soleil, les nuages, la pluie tiède... Et quelle superbe lutte! Regardez ces pauvres buissons qu’agite le vent; voyez comme ils se cramponnent et se cachent: pourquoi aussi ont-ils voulu grimper si haut? Ils ne sont pas faits pour l’air de la montagne. Seule la roche reste ferme et étale sa poitrine.
Une seconde après, elle dit en souriant:
—Il y a quelque temps, un ermite habitait ici. Les gens de Corfou prétendaient que c’était un fou, qu’il causait avec les abeilles, les nuages, et qu’il n’avait commerce qu’avec des sorcières. Peut-être, de son côté, tenait-il les gens de Corfou pour des insensés. Mais le vent l’a tué, lui aussi, tout de même.
Un soir au crépuscule, contemplant depuis la grève solitaire de Corfou les montagnes d’Albanie incendiées par le soleil couchant, elle montrait deux gros nuages blancs qui descendaient [p. 227] d’un sommet lentement vers la mer:
—Ces nuages sont comme nous; ils vont aussi à la mer, pour s’y reposer de leur existence.
A la même heure, un autre jour, elle s’écriait:
—Comme les nuages se précipitent avec rage après le soleil! On dirait des sorcières qui poursuivent une jeune fille aux cheveux d’or.
Puis elle ajouta:
—Les passions du ciel que nous contemplons tous les jours nous font oublier nos propres soucis.
Des milliards d’hommes ont passé sur la terre; ils tenaient des rôles variés, mais tous cherchaient le bonheur.
Eh bien! leur philosophie dernière ne varie guère: le bonheur, c’est d’oublier la vie. Cette merveilleuse impératrice, quand elle promène sur la grève de Corfou son jeune page romanesque, s’accorde avec le vieux philosophe, [p. 228] disons le mot pour forcer le pittoresque, avec le vieux cuistre Taine. Un jour, celui-ci, faisant les cent pas le long du lac du Bourget en compagnie du sombre Maupassant et du jeune Chevrillon, leur donna sa formule: «Travailler toute la journée, et le soir nettoyer ses instruments pour recommencer le lendemain.»
Contempler, travailler; il existe une troisième méthode, la solution divine: le sacrifice. C’est toujours l’oubli de soi-même. Il n’y a plus rien à inventer sous le soleil; nous mettons nos pas dans les pas de nos pères. Mais l’impératrice Elisabeth mêle à ses pensées les feux des pierreries de son diadème et l’ardente couleur du sang que les hommes voudraient verser pour une beauté si défendue.
La contemplation n’a jamais suffi pour apaiser les déceptions et combler le vide de la race de René. En dépit du calme qu’elle célèbre et que marquent sa marche élastique de Diane et son port de déesse, Elisabeth, qui manque d’un principe de vie, se tourmente et cherche où se faire dompter. Levez-vous [p. 229] vite, orages désirés. Celle qui fut d’abord une Titania caressant la tête d’âne, voyez-la finir comme un roi Lear, trahie par les rêveries, filles de ses veilles, et qui court aux flagellations de la tempête.
Elle ne fit jamais de confidences; à peine si, dans un éclair, son obsession se laisse deviner. Voici, par exemple, une formule où l’on peut trouver la définition de l’impératrice par elle-même:
—Parfois, disait-elle, le destin choisit l’un de nous pour en faire un poème magnifique, ou pour s’en gorger comme d’Œdipe ou de Médée.
On croit voir passer sur ce ciel sombre d’orage des éclairs de prescience:
—Je marche toujours à la recherche de ma destinée; je sais que rien ne peut m’empêcher de la rencontrer, le jour où je dois la rencontrer. Tous les hommes doivent, à un certain moment, se mettre en route à la rencontre de la destinée. Le destin, pendant longtemps, tient ses yeux fermés, mais, un jour, il vous aperçoit tout de même....
Je ne sais rien de plus émouvant et qui donne mieux l’impression d’une fièvre qui veut s’éteindre, d’une génialité cherchant éperdument un milieu favorable, que les fuites continuelles de cette impératrice; et, par exemple, ce jour où elle entraîna le jeune Christomanos à Schœnbrunn, sous une pluie de neige fondue, dans une tempête de vent, à travers de grandes flaques d’eau. «Nous courons comme des grenouilles dans les marais, disait-elle. Deux damnés semblent errer dans le monde infernal. Oui, pour beaucoup de gens, ce serait l’enfer. Mais c’est mon temps préféré, car il n’est pas pour les autres, je puis en jouir seule. Cela ressemble aux représentations théâtrales que se faisait donner le [p. 231] pauvre roi Louis. Toutefois ce plein air est beaucoup plus grandiose.» Et elle ajoutait: «Certes, je voudrais que l’ouragan fût encore plus enragé; on se sent alors si proche de toutes les choses et comme en conversation avec elles!»
On touche ici aux parties les plus élevées de cette rare nature. Avec le strident des violons tsiganes qui pleurent et qui sourient, Élisabeth de Bavière laisse jaillir par courtes et brûlantes poussées l’hymne panthéiste, l’acceptation, la mort volontairement devancée. Et ce chant, je ne sais s’il monte plus haut dans l’atmosphère raréfiée des sommets ou soutenu par les profondes clameurs de la mer. «Sur la mer, dit-elle, ma respiration s’élargit. Elle se règle sur la houle. Quand les lames deviennent plus larges, je commence à respirer plus profondément. La mer nous déshumanise, elle ne souffre rien en nous de l’animalité terrestre. Dans la tempête, je crois souvent que je suis devenue moi-même une vague écumante.»
Les grands maîtres qui firent leur principale [p. 232] étude d’accepter et de mourir, de mourir continuellement, s’exprimèrent-ils jamais avec plus de magnificence que le jour où cette femme déclare: «L’idée de la mort purifie et fait l’office du jardinier qui arrache la mauvaise herbe dans son jardin. Mais ce travailleur veut toujours être seul et se fâche si des curieux regardent par-dessus le mur. Ainsi je me cache la figure derrière mon ombrelle et mon éventail, pour que l’idée de la mort puisse jardiner paisiblement en moi.»
Félicitons-nous d’avoir recueilli quelques-unes de ces brûlantes décharges qui devraient suffire à susciter la grande vie spirituelle chez l’être le plus morne! Songez que cette personne extraordinaire faillit s’abîmer sans rien nous trahir des puissances qu’avaient amassées en elle la préparation des siècles et ses douleurs. Mais pour contempler face à face l’idéal qu’elle dénude à demi dans ces grandes vérités voilées, il eût fallu surprendre ses sentiments, ses sensations, la vaste poussée des vagues au-dessous de sa conscience claire. Une certaine scène d’incomparable poésie eut pour [p. 233] cadre la première aube sur la mer de Corfou et les jardins d’Achille.
«Au petit jour, écrit Christomanos, je me suis levé et—sans savoir pourquoi—j’ai monté tout droit, par l’escalier des dieux, sur la terrasse d’Hermès. Un blanc reflet surgissait à l’est, derrière les croupes noires des montagnes, dont les corps immergeaient dans l’obscurité comme dans les ténèbres de leurs propres ombres. De la mer à peine visible sous son immense pâleur, le matin montait humide. Presque toutes les étoiles s’étaient éteintes; Sirius seul, d’une terrifiante grandeur et magnificence, était au zénith. Au-dessous se dressait un grand cyprès noir, incliné légèrement sous un souffle de brise que l’on ne sentait ni entendait... Soudain, je vis l’impératrice glisser, comme une ombre, entre les colonnes du blanc palais. Extrêmement surpris de la trouver là à cette heure, je voulus me retirer; mais elle s’approcha, rapide comme un ange noir qui aurait à défendre un paradis, et me dit: «Je suis toujours ici, avant le lever du soleil, pour voir [p. 234] comme tout s’éveille[20]. Il ne faudra plus monter jusqu’ici à cette heure. C’est le seul moment où je sois tout à fait seule.»
Magnifique témoignage, que nous laissons retomber faute de documents sur des rêveries si conjecturales! Sur ses hautes terrasses, le sphinx a gardé le mot de son énigme. Mais nous sentons bien autre chose que les plaintes d’une allemande malheureuse: les ravages de la satiété et la névrose des tout-puissants.
L’audace et l’ironie amère, l’accent sceptique et fataliste, l’invincible dégoût de toutes choses, la présence perpétuelle de l’idéal et de la mort, et même ces enfantillages esthétiques d’une mélancolie qui cherche à se délivrer, me font tenir l’existence d’Elisabeth d’Autriche comme le poème nihiliste le plus puissant de parfum qu’on ait jamais respiré dans nos climats. On croirait que des fusées orientales vinrent, chez cette duchesse en Bavière, irriter le fond romantique. Toutes ses forces de rêve, elle les astreint à des [p. 235] cadences que je trouve seulement chez ces incomparables soufis persans qui couraient le monde dans la familiarité de la mort. Et cette satiété qui n’empêche aucun frémissement évoque devant mon imagination certains rêveurs mystérieux des trônes asiatiques.
Bien entendu, je ne prétends point donner par ces rapprochements une explication; mais—comme un air de musique parfois nous transporte dans un paysage—l’atmosphère de silence, de fatalité et de beauté un peu bizarre qui flotte autour de l’impératrice évoque pour moi ces cours des khalifes où la philosophie du néant, parfois avec mièvrerie, développe ses sentences au milieu de drames qui la justifient.
Pourquoi poursuivrais-je davantage de rendre intelligibles ces incomparables angoisses? Ces psaumes monotones, ceux que nous appelons les heureux de ce monde les ont répétés à maintes reprises depuis Salomon. Aussi bien, en dehors de l’atmosphère des cours, nous avons entendu des pensées analogues. Ces états de faiblesse irritable, ces [p. 236] angoisses sans cause, ces vagues inquiétudes, ces noires lycanthropies, c’est la sécrétion particulière aux natures supérieures. Avec une régularité qui mènerait jusqu’au désespoir les hommes assez imprudents pour s’attarder à réfléchir sur notre effroyable impuissance, nous mettons éternellement nos pas dans les pas de nos prédécesseurs. Tous les grands poètes ont souffert, comme Elisabeth d’Autriche, de la vulgarité du siècle; ils se sont sentis soulevés, au moins de désir, vers un plus haut idéal; ils ont éprouvé un éloignement pour les intelligences obtuses et courtes, contentes d’être, satisfaites du monde et de la destinée. C’est que, sans but et sans frein, ils souffraient d’un manque de discipline. D’un tel état peuvent sortir les grandes singularités artistiques ou religieuses qui sont l’honneur de l’humanité! Qu’importe le fond des doctrines! C’est l’élan qui fait la morale. Ce qu’un Pascal appelle «vivre pour l’éternité», c’est ce que nous appelons «s’observer, comprendre le néant de la vie». Mais cette satiété qui réclame à toutes les minutes les [p. 237] assaisonnements de la mort, n’impressionne jamais autant que chez une femme divinisée par sa beauté, par son diadème, par son malheur qu’elle affrontait dans une perpétuelle méditation, et par son assassinat qui ne put l’émouvoir, car elle avait devancé la mort.
Quand une brute menée par la Fatalité qui préside aux tragédies antiques accosta l’impératrice sur le trottoir du lac, près de l’hôtel Beau-Rivage, sans doute celle-ci participait toujours à ce que le vulgaire appelle la vie, puisqu’elle réagissait encore, mais, n’ayant plus de but, de volonté, ni rien qui lui fût, elle était, selon le philosophe, une étrangère à l’existence et vraiment une morte.
M. Remy de Gourmont a écrit un mot qui mérite d’être recueilli: «L’homme qui assassina l’impératrice d’Autriche obéit peut-être à un instinct plus haut que son intelligence; croyant tuer la force, il poignarda le dédain.» Sans doute, mais encore, plutôt qu’une dédaigneuse, c’est une absente. Jam transiit; Déjà [p. 238] elle avait passé outre... L’imbécile Luccheni a tué une morte.
Le cœur percé de cette petite lame, elle continue encore à marcher. C’est seulement sur le pont du bateau qu’elle s’affaisse, et alors elle demande: «Qu’y a-t-il?» C’est elle qui meurt, et elle demande: «Quoi?»
J’étais assis dans un bureau de rédaction, à corriger les épreuves d’un article, quand arriva la dépêche de l’assassinat. Il y avait là des écrivains de l’espèce qu’on appelait jadis «symbolique» ou «décadente», c’est-à-dire qui se piquent de raffinement exquis, rejettent toute discipline et ne mettent rien au-dessus de l’art. Et l’un d’eux, avec une grande autorité, en tournant sa face ronde vers les cieux, déclara qu’«en somme, Luccheni était infiniment plus intéressant que cette femme».
Cette appréciation, qui ne fut pas contestée, me frappa vivement. Je sortis, sans mot dire, pour aller la méditer dans une magnifique promenade. Un tel mot demeure pour moi une précieuse expérience; je le tiens pour [p. 240] un de ces documents qui nous débrouillent les idées, qui nous font distinguer la véritable nature des êtres sous les affectations et les masques. C’est une autre question de savoir si le point de vue esthétique et aristocratique est le meilleur, mais le problème qui fut solutionné pour moi ce soir-là, c’est de savoir ce qu’ils valent comme esthètes et comme aristocrates, les poètes qui préfèrent ce «héros» à cette «héroïne». Je m’explique la misère de notre littérature récente: c’est goujaterie de l’âme.
Celle qui régla sa vie sur les maximes que nous avons recueillies est évidemment à cent mille pieds au-dessus des diverses personnes qui sont spécialement chargées d’avoir des opinions intellectuelles aujourd’hui. Il semble pourtant qu’un pâtre, pourvu qu’il fût capable d’entendre le plus naïf roman de Walter Scott, devrait être sensible à cette silhouette de fée entrevue dans le brouillard allemand.
Les personnes de cette nature, dans tous les milieux, souffrent beaucoup de la sottise des hommes; elles apprennent qu’il ne fait [p. 241] pas bon penser tout haut. Si, dans leur jeunesse, elles se laissent aller parfois à manifester ce qu’il y a de singulier dans leur vie intérieure, elles le regrettent très vite; dès lors, elles s’effacent volontairement derrière le personnage qu’il leur faut faire et elles renoncent à ce qui pourrait leur attirer la haine ou la sympathie. D’ailleurs, cette solitude claustrale, c’est encore moins prudence devant la vie qu’obéissance à des instincts et à des goûts de tristesse; il leur convient d’être ce que tout le monde appelle «enseveli vivant.»
M. Constantin Christomanos avait-il le droit d’arracher à cet in pace volontaire celle qu’il livre à la société des poètes? Jeune, frémissant de rêves et né pour leur donner un verbe, il n’a pas su, auprès de cette impératrice d’une si puissante poésie, crever ses yeux et couper sa langue. Il raconte ce qu’il a vu, et vraiment ne traduit-il pas en rythmes admirables les enchantements dont il subit la magie? Si, enflammé d’une telle approche, il [p. 242] a détourné quelque chose d’un brasier qui aspirait à se consumer tout, on ne doit pas l’accuser de rapt, mais de ravissement. Il n’a pu rejeter à la mer la coupe qu’un hasard providentiel, il doit le croire, lui permettait de soustraire au gouffre d’oubli. Je n’ai vu nulle part qu’on blâmât les amis de Virgile, qui refusèrent de détruire l’Énéide, comme à son lit de mort il avait ordonné.
Hélas! tant qu’elle gît sur le sable profond du gouffre, la coupe du roi de Thulé irrite notre sens du mystère et nous commande de tout risquer; mais que vaudra-t-elle, si on la fait circuler parmi les convives recrutés sur la place publique et déjà gorgés de boissons vulgaires? Plaise au ciel que cette impératrice de la solitude ne devienne pas un thème littéraire et, comme on dira sans doute, une figure esthétique! Voyez ce qu’on nous a fait de son cousin Louis II: un cadavre romantique étendu sur la grève du lac Starnberg et gâté par les commentaires qui s’y traînent en colonies informes et visqueuses. Il faut le granit de Pascal, de Rousseau, de Byron, [p. 243] de Chateaubriand et de Napoléon pour résister à ces parasites; ils déshonorent et déforment très vite des figures un peu flottantes, capables de susciter nos méditations, mais qui négligèrent de se réaliser dans une forme d’art et d’échanger leur mobilité séduisante contre la fixité de la perfection.
Si nous voulons maintenir autour de cette impératrice l’isolement qu’elle aimait et qu’on doit tenir pour l’atmosphère de sa beauté, prodiguons-lui les blâmes qu’aucune âme vigoureuse ne ménage à ces natures qui méconnaissent le sens de la vie, qui négligent de se rendre utiles et qui se perdent dans les problèmes insolubles, et par là puérils, de la contemplation. N’avons-nous pas à notre disposition une formule mémorable qu’Auguste Comte tenait de Mme Clotilde de Vaux: «Il est indigne des grands cœurs de répandre le trouble qu’ils ressentent[21].» [p. 244]
SOUVENIR DE PAU EN BÉARN
Les noms heureux des belles villes du Sud sont liés aux mornes images de la mort. Parmi nos parents, nos amis, plusieurs achevèrent leur vie à Menton, à Hyères et à Pau. Le plus souvent jeunes encore. Et le soleil qui perce l’hiver pour réjouir ces villes fortunées n’obtient pas que j’oublie des rayons prématurément glacés.
Les stations du littoral me semblent des tombes fleuries que frappe un flot d’azur. Mais, sous un ciel couvert, Pau surtout, avec sa douceur qu’aucun souffle jamais n’excite, prête à de mortelles rêveries.
C’est en octobre, novembre, quand la colchique perce entre les feuilles mortes, que [p. 248] Pau fait le mieux sentir son caractère dominant: un climat mol et qui cicatrise.
Je ne sais rien de plus doucement agréable que la suite des promenades aménagées au flanc méridional de cette ville. Elles forment un large balcon sur la verte vallée du Gave, sur d’innombrables collines arrondies et, tout au fond, sur la ligne dentelée des grandes Pyrénées bleuâtres.
On aboutit à un bois sur une colline. C’est le parc du Château, du Château d’Henri IV. M. Taine se promena dans cette allée solitaire, sous la colonnade des chênes et des châtaigniers, quand il avait vingt-six ans. Déjà les hautes tiges des taillis, en files serrées sur la pente, voilaient le Gave et la large campagne. Comme aujourd’hui, l’air demeurait immobile, sans un coin de ciel bleu, sans un bruit animal. «On est bien ici, disait-il, et cependant on sent au fond du cœur une vague inquiétude; l’âme s’amollit et se perd en rêveries tendres et tristes.»
Pourquoi ne les décrit-il point, plutôt que de mêler des facéties brutales contre les [p. 249] «philistins» à des extraits quelconques des vieilles chroniques?
Dans cette solitude, et sous ces arbres, où, vivantes, elles fuyaient la mort, des ombres errent indéfiniment. Elles étaient venues des pays du Nord trouver dans Pau un air plus tiède. Il ne les sauva point. Et maintenant personne ne les veut plus connaître dans ces maisons de passage où leur souvenir aggraverait les insomnies des locataires qui leur succèdent. Nulle piété familiale n’entoure et n’apaise ces morts étrangers; les lois du pays commandent de les chasser par les plus savantes fumigations.
Pareilles aux âmes sans sépulture que plaignaient les païens, ces ombres malheureuses s’attachent au promeneur isolé, et celui-ci, que ne distrait aucun soin, se livre à leur confuse société. Chaque jour, elles m’attendaient à l’entrée du parc. Instinctivement, pour les rejoindre je hâtais le pas. Elles me frôlaient, me chuchotaient une mystérieuse plainte. J’ignore ce que furent leurs destinées [p. 250] particulières, mais je ne me trompe pas sur leur commune préoccupation. Deux phrases du Guide qu’on trouve ici dans toutes les mains me donnent le fil de leurs rêveries: «Pour le malade il y a des jours mauvais à Pau, comme dans tous les climats analogues, et celui qui croirait pouvoir s’y livrer à tous ses caprices s’apercevrait cruellement de son erreur...» Et plus loin ce même «Guide», énumérant les avantages locaux: une atmosphère douce et calmante, de magnifiques promenades, termine par ces mots, durement ironiques: «Toutes les ressources dont la classe riche est habituée à disposer.»
Pauvres phrases, je le répète, et d’abord trop plates, semble-t-il, pour arrêter le lecteur, mais si j’étais poète, j’en tirerais deux magnifiques poèmes, et si j’étais musicien, je les fondrais dans une seule symphonie.
Une œuvre qui mettrait sous nos sens toutes les voluptés et qui, dans le même instant, nous obligerait à regretter cruellement de nous en être rassasiés, voilà un lieu commun irrésistible pour nous exciter et pour nous [p. 251] déchirer! Et quelle conclusion? Aucune, assurément. Il n’est point essentiel pour nous émouvoir qu’un poème soit clair. Quant à la musique, plus favorisée encore, elle peut nous présenter plusieurs idées dans le même moment; elle les fait chanter ensemble et par cette complexité elle déchaîne nos puissances profondes d’émotion que l’analyse littéraire ne sait pas toucher. Des espaces pleins, puis des élans, des repos, puis des enrichissements, et des élans plus audacieux, et des répétitions ornementales plus vastes, voilà les seuls moyens pour nous rendre sensibles certains états de l’âme. Ils se déformeraient au point de s’anéantir si l’on prétendait les faire entrer dans des formules. Ils inspirent et ne s’expriment pas. Les promeneurs de la semaine des morts, qui se prêtent aux nappes de rêveries suspendues sous les chênes du parc béarnais, ne peuvent s’expliquer ce qui les met en branle.
Parmi ces ombres qui m’accompagnaient, je ne tardai pas à distinguer une voix qui [p. 252] m’avait été chère. Un des amis de mon enfance, mon aîné de douze ans, vint jadis demander à ce ciel un sursis pour le mal dont il mourut vers la trentaine. Suis-je seul déjà sur la terre pour le maintenir au-dessus du gouffre d’oubli? J’ai cherché le toit qui l’abrita quelques hivers. Dans le livre de mes dettes morales, que j’aime à méditer, je l’ai inscrit comme mon bienfaiteur à cause d’une phrase qu’il dit devant moi quand j’avais quinze ans.
Il venait d’étudier la médecine à Paris; il en rapportait une remarque très juste: «L’avantage de Paris, c’est qu’on voit de près les grands praticiens et qu’on admet alors de les égaler un jour.» Ces mots tombés au hasard d’une conversation s’étant fixés sur l’heure dans mon esprit ne cessèrent pas de s’y enfoncer. Je dois beaucoup à cette pensée; elle me pressa, je crois, d’aller visiter à Paris les maîtres. Qui oserait, en effet, lutter avec des hommes mystérieux! Mais étudier un homme en chair et en os, et prendre sa suite à force de travail et de discipline, l’imagination [p. 253] d’un adolescent courageux accepte que cela soit possible.
Aujourd’hui, je donne à cette phrase de mon aîné un sens plus subtil et plus fort: je pense qu’il faut aller aussi dans les endroits où l’on meurt, pour apprendre à se résigner.
Quand le soleil, parfois, sans rompre la solitude ni l’immobilité des choses, perce les châtaigniers du parc, aussitôt sur les branchages les bêtes de l’air chantent leurs plumes sèches, leur bonne digestion et leur confiance insensée dans la vie. Le promeneur sort de son rêve; il écarte les morts qui le pressent, et les morts, plus obsédants, qui l’emplissent: espérances, désirs enterrés dans son cœur. Averti par ce brusque réveil de la vie, il croit devoir s’intéresser à ces beaux lieux et participer à leurs magnifiques largesses pour qu’elles étendent son existence.
Au pied de Pau se développe une vallée heureuse de verdure et de grands arbres, où fuit, entre les joncs, un gave rapide que brisent ses cailloux. Des routes sinueuses, des maisons [p. 254] de plaisance, des villages, d’innombrables vergers enrichissent cette harmonie. Et des collines à demi boisées, en bordant cette vega, lui donnent la forme d’une conque où flotte de l’or vaporisé, tandis qu’elles-mêmes ne sont que des enfants au pied des Pyrénées, magnifiques par leurs neiges et par leurs arêtes, et qui président sur l’horizon à la tranquillité générale.
L’apôtre a dit que sur l’homme inflexible, sur les cœurs sans tendresse ni pitié, s’étend un ciel d’airain qui n’a ni pluie ni rosée. J’en conclus qu’aucun homme inflexible ne vint jamais à Pau, car de toute éternité nul n’y vit un ciel d’airain.
Quelle douceur, quel brisement de nerfs! quel amour de la vie, quelle tristesse sans voix de se savoir périssable! Entre cinq et six surtout, quand le brouillard violet et tiède tombe sur la vallée et que les lanternes du gaz une à une s’allument sur la longue terrasse!
Ici la raison la plus épurée de sentimentalisme [p. 255] fait tout naturellement la part du cœur. Ici Charles Maurras inventa une belle consolation pour tous les déshérités.
C’est sur cette terrasse, je le sais, devant ce Château d’Henri IV, qu’en 1890 il advint à notre ami de sentir la nécessité naturelle de la soumission pour l’ordre et la beauté du monde. Un paysage agréable où toutes les parties se soumettent les unes aux autres, où celles-ci vivent ensevelies sans se flatter qu’aucun espoir les pousse jamais dehors, tandis que celles-là sont éternellement caressées des feux du Jour et de la Nuit, amenèrent Charles Maurras à constater allègrement que, malheur ou bonheur, tous les états qu’il y a dans l’humanité sont des conditions nécessaires à la qualité de chacun. «Le monde entier serait moins bon s’il comportait un moins grand nombre d’hosties mystérieuses amenées en sacrifice à sa perfection. Hostie ou non, chacun de nous, lorsqu’il est sage et qu’il voit que rien n’est, si ce n’est dans l’ordre commun, rend grâces de la forme qu’a revêtue son sort, quel qu’il soit; il ne plaint que les [p. 256] disgraciés turbulents dont le sort est sans forme et que leur destinée entraîne à l’écoulement infini.» (Anthinea.)
Ce jeune philosophe de la santé, de la saine raison, tout occupé à construire le roi, n’a point le temps d’être tendre. Parlons net, le véritable homme songe à créer, non point à guérir.
La vallée béarnaise prend un beau sens historique si elle fit rêver M. Taine en 1854 et, trente-six ans plus tard, l’un de ses meilleurs fils. Son esprit, toutefois, non plus que ses couleurs et ses formes, ne sauraient me retenir.
Il est des moments où notre pensée s’étend et trouve partout à profiter; d’autres fois elle se replie irrésistiblement sur ses réserves. Et c’est encore un hommage à l’ordre, une féconde soumission, d’accepter ces minutes de retrait où peut-être le ressort se bande pour une action importante.
Les voyageurs m’avaient bien prévenu que le gave pyrénéen et l’épais ruban des [p. 257] végétations qu’il déroule dans les landes ressemblaient à mon torrent et à ma vallée vosgienne. En vain ici les proportions sont-elles plus vastes et le motif décoratif infiniment multiplié: je vois à Pau la Moselle où je fus élevé, ses grèves, sa prairie, ses côtes boisées, à ma droite l’église de Charmes, et plus loin, à ma gauche, Châtel, le bien situé, c’est-à-dire tous les premiers objets qui me possédèrent et dont je méconnus longtemps ce qu’ils recèlent de discipline. Paysage plus simple que le béarnais, plus court et plus pauvre et que couvre un ciel rude, mais c’est le mien où m’attachent chaque semaine davantage des liens que ma raison n’a pas noués. C’est lui qu’embellirait mon nom, si mon nom quelque jour donnait de la beauté.
Mes morts et mon horizon natal m’enveloppent sous ce ciel nouveau et parmi ces étrangers. Ils composent un arrière-fond à toutes les images que le hasard me propose, et celles-ci ne valent qu’autant qu’elles s’harmonisent avec ma terre et avec mes morts. [p. 258] C’est ainsi que se forme un désir ardent de rompre tout ce qui nous distrait de nos idées maîtresses.
Pau, 31 octobre 1901.
DISCOURS
PRONONCÉ POUR L’INAUGURATION
DE LA
STATUE DE LECONTE DE LISLE
au Luxembourg, le 10 juillet 1898.
Messieurs,
Bien souvent les étudiants ont salué Leconte de Lisle sur cette terrasse qu’il traversait deux fois par jour. Sa structure, sa manière de marcher, ses mouvements calmes, fiers et grandioses, sa figure faite de plans accusés et d’espaces uniformes, sa force, sa lenteur, sa solitude, tout son être et son atmosphère constituaient d’ensemble un magnifique animal humain.
Quelques-uns de ces jeunes gens étaient admis avec d’illustres artistes, le samedi soir, dans ce salon glorieux et modeste de l’École des Mines que présidait le Moïse cornu de [p. 262] Michel-Ange. Le maître les émerveillait par le pittoresque serré de ses propos et par sa justice distributive; il n’avait d’indulgence que pour les débutants de lettres, qui sont des lionceaux encore incapables de nuire.
Comme un athlète exerce continuellement ses muscles, ce grand travailleur, à ses heures de délassement, se plaisait à faire jouer en lui la tendresse et la férocité, qui sont plus favorables que la bonté à l’inspiration d’un poète épris de relief, de couleur et de tumulte. Vous vous rappelez, messieurs, ses phrases brèves, nettes et lourdes! Et quel victorieux sourire venait affiner encore la belle ligne de sa bouche, découvrir ses dents éclatantes et le rajeunir, tandis qu’il approchait son monocle de son œil par l’instinct du sagittaire qui veut voir sa flèche dans le but!
De ses traits innombrables, il poursuivit surtout ces romanciers encombrés et vulgaires, alors favoris du public et dont il disait qu’ils ajoutent aux écuries d’Augias. Lui, pensions-nous, il épurait le monde littéraire. Aussi, dans les hommages dont nous l’entourions, [p. 263] il y avait le plaisir, si vif à vingt ans, d’aller contre l’opinion dominante.
Leconte de Lisle fut un poète impopulaire. Il dut supporter les sarcasmes de la presse, l’indifférence du public et la fortune des médiocres. Son pathétique et son tragique ne furent discernés que par ceux dont il fit l’éducation et qui se groupent ici pour lui rendre hommage.
Déjà son école était fameuse pour avoir ajouté des couleurs et des sonorités aux gammes de notre langue, et l’on méconnaissait encore son vrai titre poétique: c’est d’avoir concentré dans de courts poèmes les émotions qui accompagnent les grands travaux de résurrection historique.
Qu’un homme de ce temps s’attarde dans les musées où nous avons entassé les colonnes des temples, les membres des dieux et les poupées des morts; qu’il écoute les savants déchiffrer dans les textes les institutions et les mœurs des sociétés disparues; qu’il laisse son imagination avertie par les voyageurs [p. 264] s’enivrer des horizons, du soleil et des feuillages qui réjouirent des ancêtres épiques: il voit, sur un fonds de nature qui n’a jamais bougé, des groupes historiques s’échelonner, qui tous portent leurs dieux, et par là nul de ces groupes ne nous est étranger, car dans leurs dieux, saugrenus parfois, ils mettent des illusions toujours vivantes dans nos consciences.
Autour de telles évocations, flotte une certaine mélancolie vague et passive. Elle nous dispose à mieux entendre le thème essentiel de toute poésie: la caducité des choses humaines, opposée à l’éternelle jeunesse de la nature.
La marque d’un grand poète, c’est le besoin qu’on ressent de son œuvre. A certaines heures, semble-t-il, la France n’aurait pu se passer d’un Musset, d’un Lamartine, d’un Hugo. Pour une élite que nos grandes écoles augmentent chaque année, il était nécessaire qu’un Leconte de Lisle allât s’asseoir à tous ces foyers de civilisation récemment retrouvés, qui troublent [p. 265] notre imagination et qui nous prêchent la vanité de l’effort. Il eut la virilité de maintenir longuement son regard sur des ombres. Sans se laisser alanguir par une atmosphère de sépulcre, il les porta en pleine lumière et les revêtit avec une exactitude minutieuse de tout l’éclat de la vie. Par ce travail, il nous sort de la position fausse où nous nous trouvions vis-à-vis de ces revenants: au lieu d’être pour nous la cause d’évagations énervantes, ils sont devenus les éléments les plus essentiels de notre philosophie. Ces grandes rêveries archéologiques, quand il les eut fait entrer dans la poésie, s’épurèrent et devinrent même un ressort de notre vie intellectuelle.
Les poèmes splendides et monotones de Leconte de Lisle, d’un abord si dur qu’on les crut inhumains, ont une vertu réconfortante. Ils délivrent, au sens d’Aristote et de Gœthe, ceux qui, ayant pris une vue d’ensemble de l’histoire, ne se dégagent pas de son tragique nihilisme par la vie active.
Du moment qu’un grand poète a formulé avec netteté les conclusions désespérantes [p. 266] où nous amène l’enquête scientifique sur le développement des civilisations, nous voilà dispensés d’y revenir indéfiniment et de nous éterniser en hésitations et en inquiétudes stériles sur ce que la vie manque de but.
J’ignore si nos petits-fils retrouveront quelque sens dans l’histoire, comme faisaient les Bossuet, les Condorcet, ou ce politique qui crut pouvoir parler de justice immanente. Aujourd’hui nous n’y découvrons nul chemin tracé et l’espérance ne sait où s’y prendre. L’œuvre de Leconte de Lisle nie la Providence, la loi du Progrès et les revanches du Droit. La pensée divine, faiseuse d’ordre, qui construisit les sociétés et les temples, apparaît plus ou moins lumineuse sur des points divers de l’espace et des siècles, sans qu’on discerne la moindre trace d’un programme, ni d’une marche en avant. L’esprit souffle où il veut, nul ne sait d’où il vient, où il va.
Chronologiquement, Leconte de Lisle appartient à une génération enthousiaste qui a élaboré une philosophie de l’histoire d’un optimisme [p. 267] candide; on ne s’en aperçoit que s’il parle de l’hellénisme. Un instant, pense-t-il, autour de l’Acropole, la Liberté dompta la Fatalité. Hors cette brève période d’un étroit pays, ce grand poète voit partout la Fatalité planer au-dessus des hommes et des dieux, qu’elle fait plier sous la loi sans appel de son bon plaisir. Ce spectacle tragique lui fournit les fortes inspirations qu’utilisèrent déjà Homère, Eschyle et Sophocle.
Comme s’il ne s’était pas rassasié d’horreur dans la série des siècles, Leconte de Lisle en cherche dans la série naturelle. A nulle étape la vie n’a de quiétude. Il prend possession des heures implacables du jour, de toutes les solitudes et des grandes espèces condamnées, pour leur faire exprimer sa philosophie héroïque et morne. Les éléphants, les condors, les panthères et les buffles, tous tragiques, que ce gigantesque pasteur promène dans des paysages d’airain, semblent une autobiographie. Ses bêtes se désespèrent d’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve.
[p. 268] Parfois le poète nous donne directement son opinion sur l’être; c’est une imprécation égale aux plus désespérées de ce christianisme qu’il maudit d’avoir précipité les Olympes païens.
Notre Maître, messieurs, ne fréquentait volontiers que les dieux. Il mettait à leur service des accents et des allures d’une grandeur sacerdotale. Ils lui donnèrent du mécontentement; il reconnut que les meilleurs n’étaient pas immortels.
Heureuse désillusion, car elle fait le centre de sa poésie. Peut-être son génie se nourrit-il d’une seule idée, mais inépuisable: la mutabilité des formes du Divin.
L’absolu que Leconte de Lisle n’avait pu trouver dans la suite des dieux, il croyait fermement le tenir dans l’art. Il affirmait les lois de l’esthétique et formulait des canons. Il aura rempli l’office d’un Boileau. Il a donné une discipline à la poésie française, quand le génie des Musset, des Lamartine et des Victor Hugo allait entraîner nos talents dans la [p. 269] faconde. Il a restauré l’art classique de resserrer un sujet, d’ordonner des pensées et d’appuyer la poésie sur quelque chose de réel. Il répétait à ses élèves que la forme n’est pas une chose distincte du fond, et que bien écrire, ce n’est rien autre que bien penser.
Dans le même temps, c’est vrai, il créait une manière, et son gaufrier commence seulement à s’user. Le Parnasse, où personne n’a pensé bassement, doit être loué comme une école de travail minutieux et de respect. Des esprits nobles et libres s’y éveillèrent. Chez les plus modestes des poètes qui apprirent de Leconte de Lisle à travailler le vers et à transformer en matière poétique les découvertes de l’archéologie et de la philologie, un anthologue peut trouver le chef-d’œuvre qui sauve un nom et enrichit une littérature.
Ne fermons point cette cérémonie sans associer à la gloire du Maître ceux des bons Parnassiens restés dans le demi-jour. Aux plus humbles fragments d’un marbre éclaté sous l’action du génie, la postérité curieusement honore la trace du ciseau magistral.
LE 2 NOVEMBRE EN LORRAINE
Le jour des Morts est la cime de l’année. C’est de ce point que nous embrassons le plus vaste espace. Quelle force d’émotion si la visite aux trépassés se double d’un retour à notre enfance! Un horizon qui n’a point bougé prend une force divine sur une âme qui s’use. Le 2 novembre en Lorraine, quand sonnent les cloches de ma ville natale et qu’une pensée se lève de chaque tombe, toutes les idées viennent me battre et flotter sur un ciel glacé, par lesquelles j’aime à rattacher les soins de la vie à la mort.
Monotone psaume, formules dont nous savons l’apparente sécheresse, mais elles ramènent notre esprit au point où il trouve sa pente et s’enfonce dans des abîmes de méditations... Une fois encore, faisons glisser entre nos doigts ce chapelet.
[p. 274] Certaines personnes se croient d’autant mieux cultivées qu’elles ont étouffé la voix du sang et l’instinct du terroir. Elles prétendent se régler sur des lois qu’elles ont choisies délibérément et qui, fussent-elles très logiques, risquent de contrarier nos énergies profondes. Quant à nous, pour nous sauver d’une stérile anarchie, nous voulons nous relier à notre terre et à nos morts.
C’est une méthode dont je n’ai pas toujours distingué la bienfaisance. J’étais un fameux individualiste et j’en disais sans gêne les raisons. J’ai «appliqué à mes propres émotions la dialectique morale enseignée par les grands religieux, par les François de Sales et les Ignace de Loyola, et c’est toute la genèse de l’Homme libre[22]»; j’ai prêché le développement de la personnalité par une certaine discipline de méditations et d’analyses. Mon sentiment chaque jour plus profond de l’individu me contraignit de connaître comment la société le supporte et l’alimente tout. Un Napoléon lui-même, qu’est-ce donc, sinon un groupe innombrable d’événements et d’hommes? Et mon grand-père, [p. 275] soldat obscur de la Grande-Armée, je sais bien qu’il est une partie constitutive de Napoléon, empereur et roi. Ayant longuement creusé l’idée du «Moi» avec la seule méthode des poètes et des mystiques, par l’observation intérieure, je descendis parmi des sables sans résistance jusqu’à trouver au fond et pour support la collectivité. Les étapes de cet acheminement, je les ai franchies dans la solitude morale. J’ai vécu les divers instants d’une conscience qui se forme. Ici l’école ne m’aida point. Je dois tout à cette logique supérieure d’un arbre cherchant la lumière et cédant avec une sincérité parfaite à sa nécessité intérieure. Je proclame que, si je possède l’élément le plus intime et le plus noble de l’organisation sociale, à savoir le sentiment vivant de l’intérêt général, c’est pour avoir constaté que le «Moi», soumis à l’analyse un peu sérieusement, s’anéantit et ne laisse que la société dont il est l’éphémère produit.
Voilà déjà qui nous rabat l’orgueil individuel. Le «Moi» s’anéantit sous nos regards [p. 276] d’une manière plus terrifiante encore si nous distinguons notre automatisme. Quelque chose d’éternel gît en nous dont nous n’avons que l’usufruit, mais cette jouissance même est réglée par les morts. Tous les maîtres qui nous ont précédés et que j’ai tant aimés, et non seulement les Hugo, les Michelet, mais ceux qui font transition, les Taine et les Renan, croyaient à une raison indépendante existant en chacun de nous et qui nous permet d’approcher la vérité. L’individu, son intelligence, sa faculté de saisir les lois de l’univers! Il faut en rabattre. Nous ne sommes pas les maîtres des pensées qui naissent en nous. Elles sont des façons de réagir où se traduisent de très anciennes dispositions physiologiques. Selon le milieu où nous sommes plongés, nous élaborons des jugements et des raisonnements. Il n’y a pas d’idées personnelles; les idées même les plus rares, les jugements même les plus abstraits, les sophismes de la métaphysique la plus infatuée, sont des façons de sentir générales et apparaissent nécessairement chez tous les êtres de [p. 277] même organisme assiégés par les mêmes images. Notre raison, cette reine enchaînée, nous oblige à placer nos pas sur les pas de nos prédécesseurs.
Dans cet excès d’humiliation, une magnifique douceur nous apaise, nous persuade d’accepter nos esclavages: c’est, si l’on veut bien comprendre,—et non pas seulement dire du bout des lèvres, mais se représenter d’une manière sensible,—que nous sommes le prolongement et la continuité de nos pères et mères.
C’est peu de dire que les morts pensent et parlent par nous; toute la suite des descendants ne fait qu’un même être. Sans doute, celui-ci, sous l’action de la vie ambiante, pourra montrer une plus grande complexité, mais elle ne le dénaturera point. C’est comme un ordre architectural que l’on perfectionne: c’est toujours le même ordre. C’est comme une maison où l’on introduit d’autres dispositions: non seulement elle repose sur les mêmes assises, mais encore elle est faite des mêmes moellons et c’est toujours la même [p. 278] maison. Celui qui se laisse pénétrer de ces certitudes abandonne la prétention de sentir mieux, de penser mieux, de vouloir mieux que ses père et mère; il se dit: «Je suis eux-mêmes.»
De cette conscience, quelles conséquences dans tous les ordres il tirera! Quelle acceptation! Vous l’entrevoyez. C’est tout un vertige délicieux où l’individu se défait pour se ressaisir dans la famille, dans la race, dans la nation, dans des milliers d’années que n’annule pas le tombeau.
«Je dis au sépulcre: Vous serez mon père.» Parole abondante en sens magnifique! Je la recueille de l’Église dans son sublime Office des Morts. Toutes mes pensées, tous mes actes essaimeront d’une telle prière,—effusion et méditation,—sur la terre de mes morts.
Les ancêtres que nous prolongeons ne nous transmettent intégralement l’héritage accumulé de leurs âmes que par la permanence de l’action terrienne. C’est en maintenant sous nos yeux l’horizon qui cerna leurs travaux, [p. 279] leurs félicités ou leurs ruines, que nous entendrons le mieux ce qui nous est permis ou défendu. De la campagne, en toute saison, s’élève le chant des morts. Un vent léger le porte et le disperse comme une senteur. Que son appel nous oriente! Le cri et le vol des oiseaux, la multiplicité des brins d’herbe, la ramure des arbres, les teintes changeantes du ciel et le silence des espaces nous rendent sensible, en tous lieux, la loi de l’éternelle décomposition, mais le climat, la végétation, chaque aspect, les plus humbles influences de notre pays natal nous révèlent et nous commandent notre destin propre, nous forcent d’accepter nos besoins, nos insuffisances, nos limites enfin et une discipline, car les morts auraient peu fait de nous donner la vie si la terre devenue leur sépulcre ne nous conduisait aux lois de la vie.
Chacun de nos actes qui dément notre terre et nos morts nous enfonce dans un mensonge qui nous stérilise. Comment ne serait-ce point ainsi? En eux, je vivais depuis les commencements de l’être, et des conditions [p. 280] qui soutinrent ma vie obscure à travers les siècles, qui me prédestinèrent, me renseignent assurément mieux que les expériences où mon caprice a pu m’aventurer depuis une trentaine d’années.
Dans le pays où les miens ont duré, la vallée de la Moselle me paraît trop populeuse encore, trop recouverte de passants pour que j’entende bien ses leçons. J’aime à gravir les faibles pentes qui la dessinent, à parcourir indéfiniment, loin des centres d’habitation, le vieux plateau lorrain et, par exemple, le Xaintois, ancien pays historique où se dresse la montagne de Sion-Vaudémont.
Venant de Charmes-sur-Moselle, quand j’atteins le haut de la côte sur Gripport, au carrefour où passe la voie romaine, soudain dans un coup de vent je reçois sur ma face tout le secret de la Lorraine. Au loin s’étendent devant moi les solitudes agricoles, et, dans un ciel froid, brusquement, émerge, isolée de toute part, la falaise que spiritualise le mince clocher de Sion. Quel enchantement [p. 281] sous mes yeux, quel air vivifiant me baigne, quelle vénération dans mon cœur! Sainte colline nationale! Elle est l’autel du bon conseil. Dans toutes les saisons elle nous répète ce que Delphes disait aux démocrates mégariens: de faire entrer dans le nombre souverain leurs ancêtres, pour que la génération vivante se considérât toujours comme la minorité. Mais en novembre, quand d’épais nuages l’enserrent et que le vent y jette les voix de cent cloches rurales, je vais vers elle comme vers l’arche salvatrice, qui porte sur les siècles et dans le désastre lorrain tout ce qui survit à la mort.
Ma pensée française a trois sommets, trois refuges: la montagne de Sion-Vaudémont, Sainte-Odile, et le Puy de Dôme. Le Puy de Dôme régnait chez les Arvernes; il fut le maître et le dieu du pays où j’ai pris mon nom de famille. Sainte-Odile d’Alsace et Sion de Lorraine président la double région où je veux enclore ma vie; ils symbolisent les vicissitudes de la résistance latine à la pensée germanique. Pourquoi ne dirais-je pas [p. 282] un jour les beaux dialogues que font ces trois divinités, quand le massif central français contrôle et redresse la pensée de nos hardis bastions de l’Est? Mais le 2 novembre m’invite à des soins plus étroits; ma piété familiale ordonne qu’en ce jour je me préoccupe d’adapter, mieux encore, mon esprit aux vérités qui sont le fruit lentement mûri de la terre de mes morts.
La colline isolée de Sion-Vaudémont, haute environ de deux cents mètres, se voit de tous les monticules dans un rayon de vingt lieues. Elle a la forme d’un fer à cheval; sur son extrémité méridionale, elle porte le château démantelé des comtes de Vaudémont, d’où sortit la maison de Lorraine qui règne aujourd’hui en Autriche, et, sur sa pointe septentrionale, le couvent et l’église de Sion. C’est ainsi qu’elle élève au-dessus de l’antique grenier lorrain la double tradition religieuse et militaire que chacun de nous entretient dans sa conscience.
Elle fut le centre de notre nationalité. On y [p. 283] vient toujours en pèlerinage. Elle survit au duché de Lorraine,—qu’elle a longuement précédé, puisque les Romains y trouvèrent un dieu indigène. Elle est le point de continuité de notre région.
La plaine agricole, autour de ce sommet, a été négligée de la grande civilisation: ses cultures immuables disciplinent depuis des siècles ses habitants, et sur cette terre antique, l’énergie des autochtones n’a enregistré que les grandes commotions historiques. Tout s’est passé régulièrement. C’est ici un vieil être héritier de lui-même.
Nul lieu plus favorable pour que nous recevions, dans le recueillement, la pensée profonde de la Lorraine. Mais, à donner comme le fruit d’une seule journée ce qu’une longue suite de méditations a gravé dans notre cœur, je rendrais mal intelligible une discipline que j’ai acquise lentement. Nous irons d’autres fois de Sion à Vaudémont, du couvent à la forteresse, par les hauteurs, en marchant sur les ruines romaines. Je ne sais pas au monde une plus belle promenade. Aujourd’hui c’est [p. 284] déjà l’hiver, le sol est détrempé, le grand vent mal commode: ne quittons point le plateau de l’église et la douce allée des tilleuls dont l’ombrage enchante mes étés.
Voici la Lorraine et son ciel: le grand ciel tourmenté de novembre, la vaste plaine avec ses bosselures et cent villages pleins de méfiance. O mon pays, ils disent que tes formes sont mesquines! Je te connais chargé de poésie. Je vois sur ton vaste camp des armes qui reposent. Elles attendent qu’un bras fort les vienne ressaisir.
Je ne m’embarrasse point de savoir ce que vaut un tel paysage pour un amateur étranger. Si le vent de l’extrême automne ramassait par millions les feuilles multicolores de nos forêts pour les emporter à la mer, et quand même il voilerait de leur beau nuage le soleil, le sein de la mer—car elle ignore nos montagnes—n’en aurait pas une palpitation plus forte; mais un verger lorrain, admiré en juillet, que novembre dépouille, c’est assez pour que fermente en nous toute la série de nos aïeux.
[p. 285] Devant ces terres magnifiquement peignées des sillons de la charrue, devant cette multitude de petits champs bombés comme des cuirasses, je prononce pieusement le Salve, magna parens frugum... «Salut, terre féconde, mère des hommes...»
Quelle solitude pourtant! et, comment dire? hostile. En 1698, le Père Vincent, «religieux du Tiers-Ordre en la comté de Vaudémont en Lorraine», louait Sion d’être une solitude, tout autant que je fais deux siècles après lui; mais il ajoutait qu’à rencontre de tant de «solitudes affreuses», on trouve en celle-ci «ce qu’il faut pour satisfaire l’esprit et la vue... Il n’y a que Marie qui l’occupe et quelques religieux dédiés à son service qui, dans ce séjour charmant, éloignés du tumulte du monde, goûtent la douceur d’une vie tranquille et écoutent l’Époux de leurs âmes qui leur parle cœur à cœur». Ce qu’aujourd’hui nous entendons sur la haute terrasse n’est point pour nous «satisfaire l’esprit». Vézelise, qui ne se connaît plus comme notre capitale, se cache dans un pli du terrain. Les châteaux [p. 286] d’Étreval, de Frenelle-la-Grande, d’Ormes, de Mazerot, de Germiny, de Thélod, de Frolois-Puligny sont déchus, et les Beauvau ne veulent plus animer Haroué. La brasserie de Tantonville, où Pasteur conduisit ses études sur les ferments, appelle mon attention, mais le grand souvenir qu’elle évoque n’est pas proprement lorrain. Nulle part, semble-t-il, cette plaine ne garde conscience de sa destinée. Elle ne sait même point que l’on s’efforce, par un exercice continu, d’acquérir la possession plénière des richesses morales encloses dans ses cimetières.
Cette indéniable tristesse du paysage de Sion, quelques-uns l’attribuent aux ravins secrets qui ne laissent apercevoir aucune eau sur l’horizon. Et puis ici les maisons ne s’égaillent jamais confiantes dans la verdure qu’elles varieraient. Cette dispersion fait l’aspect joyeux de la riche plaine d’Alsace. Mais au comté de Vaudémont chaque village se ramasse contre l’hiver, contre l’envahisseur. Tant de fois le flot étranger nous recouvrit, [p. 287] sembla nous submerger! Tout fut ruiné, épuisé, hormis la patience de cette bonne terre.
Elle est infiniment morcelée. Ses parcelles composent une multitude de dessins géométriques. Tantôt étendus côte à côte, tantôt placés en étoile, ce sont une série de petits tapis de tous les verts, de tous les roux, plus longs que larges: des tapis de prière. Humble prière que chaque famille murmure depuis des siècles: «Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien.»
Les visiteurs qui voudraient plus de pittoresque disent que, devant cette immense marqueterie, ils croient avoir sous les yeux, plutôt que la nature franche, une sorte de cadastre. Mais le cadastre, quel livre excellent! Mon ami Frédéric Amouretti employa longtemps ses loisirs à lire le Bottin des départements. On le moquait, mais ce sage avait sa méthode et, par le Bottin, il mettait en mouvement les personnages qui vivent dans nos villes. Dans cette interminable lecture, il s’est rendu compte du riche mécanisme de la vie [p. 288] française. Voyage-t-il? En traversant une ville, il sait ses mœurs, ses travaux, ses délassements et même les noms de certains habitants, des principaux industriels. Il croit avoir tiré de ce livre mal fait plus d’informations que de tous les ouvrages spéciaux. Eh bien! si nous disposons notre esprit à lire notre paysage natal comme un cadastre, si nous nous renseignons, si nous suivons, de ci, de là, le morcellement des propriétés, leurs évaluations successives, leurs mutations, voilà de grands enseignements pour comprendre notre formation.
La motte de terre, qui paraît sans âme, est pleine du passé, et son témoignage ébranle les cordes de l’imagination. Plus que tout au monde, j’ai cru aimer le musée du Trocadéro, les marais d’Aiguesmortes, de Ravenne et de Venise, les paysages de Tolède et de Sparte, mais à toutes ces fameuses désolations je préfère maintenant le modeste cimetière lorrain où, devant moi, s’étale ma conscience profonde.
Cette colline, les légions l’assaillirent quand [p. 289] César les menait à la conquête du Xaintois, déjà riche en blé et en guerriers. Puis elle protégea la civilisation romaine, quatre siècles environ, contre les flots barbares de Germanie. Quelles divinités adoraient les propriétaires gallo-romains et les esclaves ruraux sur le sommet de Sion! Qu’est-ce que cet étrange Mercure marié à la mystérieuse Rosmerte? A quel Wodan succédaient-ils de qui le nom demeure dans Vaudémont? Le christianisme expropria les idoles impures au profit de la vierge Marie. Les hommes de tous ces villages, de ce Saxon, de ce Chaouilley, de ce Praye, tels que je les vois, et ni plus ni moins marqués pour être des héros, partirent à pied pour la première Croisade avec leur comte de Vaudémont qui chevauchait... Par la suite nous avons trop compté sur nous-mêmes; nous frappions à tour de rôle sur les Allemands et sur les Français, mais, ayant été les plus faibles, nous acceptâmes de nous joindre à la grande famille française... Du haut de Sion, je vois monter de Vézelise une horde de pillards: c’est 1793, et des idées venues [p. 290] de Paris habillent cette jacquerie... Maintenant nous formons les régiments de fer que la France oppose à la Germanie. C’est ainsi que les gens de ce paysage, qui faisaient déjà la bataille, pour le compte de l’empire romain, contre les barbares de l’Est, sont de nouveau les grands bastions orientaux de la civilisation latine. Au sud-est, voici la ligne des ballons vosgiens que les vicissitudes de la guerre attribuent aujourd’hui pour limites à la France; à l’ouest, voici les forts de Toul. Les Français, qui détruisirent les forteresses de Montfort et de la Mothe, n’ont pas changé notre destinée militaire. Comme furent nos pères, nous sommes des guetteurs. Qu’est-ce que la pensée maîtresse de cette région? Une suite de redoutes doublant la ligne du Rhin. Ce fut la destinée constante de notre Lorraine de se sacrifier pour que le germanisme, déjà filtré par nos voisins d’Alsace, ne dénaturât point la civilisation latine.
Aujourd’hui encore, les grands jours de pèlerinage, quand l’antique plateau rassemble une foule dont je connais les nuances et les [p. 291] puissances politiques, je distingue éternellement vivants les éléments de toutes ces grandes choses. Hélas! je mesure aussi de quelles énergies ces activités privèrent mon antique Xaintois...
On dit que la Vierge de Sion guérit les peines morales. Je puis en porter témoignage. Jamais je n’ai gravi la colline solitaire sans y trouver l’apaisement. Je comprenais mon pays et ma race, je voyais mon poste véritable, le but de mes efforts, ma prédestination. Jamais je ne rêvai là-haut sans que la Lorraine éternelle gonflât mon âme que je croyais abattue. Novembre, toutefois, demeure l’instant parfait d’une préparation qui dure toute l’année.
[1] (page 40). Sturel a vu ces gondoliers de la mort...
«Guidé par cette sorte d’appétence morale qui incite les âmes, comme vers des greniers, vers les spectacles et vers les êtres où elles trouveront leur nourriture propre, Sturel s’orientait toujours vers ceux qui ont le sens le plus intense de la vie et qui l’exaspèrent à la sonnerie des cloches pour les morts. Dans la société la plus grossière, sa sensibilité trouvait à s’ébranler. Au croisé d’un enterrement sur le Grand Canal, un gondolier l’émeut qui pose sa rame et dit: «C’est un pauvre qu’on enterre; s’il était riche, cela coûterait au moins trois cents francs: il ne dépensera que quinze francs. Il a de la musique, pourtant, et ses amis avec des chandelles, car il est très connu. Arrêtons-nous un peu, parce que, moi, j’aime à entendre la musique. Les voilà qui partent par un petit canal vers San Michele. Adieu! Il a fini avec les sottes gens... A droite, vous avez le palais de la reine de Chypre, qui appartient maintenant au Mont-de-Piété. Ici le palais du comte de Chambord, racheté par le baron Franchetti, dont la femme est Rothschild.»
(L’Appel au Soldat, chapitre premier.)
[2] (page 56). «En Italie, pour un jeune homme isolé et romantique, c’est Venise qui chante le grand [p. 294] air. A demi dressée hors de l’eau, la sirène attire la double cohorte de ceux qu’a touchés la maladie du siècle: les déprimés et les malades par excès de volonté. Byron, Mickiewicz, Chateaubriand, Sand, Musset ajoutent à ses pierres magiques de supérieures beautés imaginaires... Un jour de l’hiver 1887, comme Sturel parcourait la triste plage du Lido, il arrêta son regard intérieur sur les personnages fameux qui promenèrent ici leur répugnance pour les existences normales. Quand nous honorons un lieu tel que les grands hommes le connurent et que nous pouvons nous représenter les conditions de leur séjour, ces réalités, qui, pour un instant, nous sont communes avec eux, nous forment une pente pour gagner leurs sommets; notre âme sans se guinder approche de hauts modèles qu’elle croyait inaccessibles, et, par un contact familier de quelques heures, en tire un durable profit...
Les ombres qui flottent sur les couchants de l’Adriatique, au bruit des angélus de Venise, tendent à commander les âmes qui les interrogent.
(L’Appel au Soldat, chapitre premier.)
[3] (page 73). Il y a trois palais Mocenigo. Byron occupait celui du milieu.
[4] (page 92). Scènes et Doctrines du Nationalisme, p. 15.
[5] (page 96). Les Déracinés, p. 189.
[6] (page 101). Lettre de Wagner.
[7] (page 124). Je me reprocherais pourtant de ne point ici saluer notre maître, M. Albert Collignon, [p. 295] alors professeur de rhétorique, pour qui Guaita professait des sentiments que je garde.
[8] (page 138). La Muse noire (1883).
[9] (page 138). Rosa Mystica (1895), toutes pièces écrites avant la fin de l’année 1884.
[10] (page 146). On a dit et écrit que le Problème du Mal, dernier volume de la série des Essais des Sciences maudites, rédigé sur les notes de Guaita par ses disciples, paraîtrait. C’est une erreur. Les documents sont en lieu sûr. Notre ami supporta les lents derniers mois de sa maladie avec une force magnifique et sans perdre jamais sa curiosité intellectuelle. S’il avait voulu que son œuvre fût complétée après lui, il eût pris des dispositions pour en assurer l’achèvement dans des conditions offrant de sérieuses garanties. Son silence a dicté la conduite de sa famille. Aucune publication d’inédit, aucune réimpression.
[11] (page 147). Voici comment un initié, le Dr Thorion, apprécie l’œuvre du maître qui l’estimait et dont il reçut l’enseignement:
«Les Essais des Sciences maudites, dans leur ensemble, étudient le drame de la Chute originelle, en Eden. Le Seuil du Mystère nous promène parmi ceux qui ont passé leur vie sous les branches du pommier symbolique. Le Serpent de la Genèse élucide le triple sens littéral, figuré et hiéroglyphique du mot Nahash, qui, dans le texte de Moïse, désigne le tentateur.
«Au sens positif, Nahash, c’est le fait, l’ivresse [p. 296] quelconque qui, envahissant l’homme, le fait rouler au mal. De là cette interprétation erronée du vulgaire qui croit que l’esprit du mal s’est déguisé en reptile. Le Temple de Satan est donc consacré à l’examen des œuvres caractéristiques du Malin: la Magie noire et ses hideuses pratiques, envoûtements et maléfices. Guaita énumère les ressources infernales de la sorcellerie, il expose des faits réels ou légendaires, pêle-mêle, déclare-t-il lui-même, et sans souci d’en fournir une explication scientifique.
«Au sens comparatif, Nahash est la lumière astrale, agent suprême des œuvres ténébreuses de la Goetie. Son étude donne la Clef de la Magie noire, elle permet d’établir une théorie générale des forces occultes, et d’analyser les causes et les effets des rites et des phénomènes décrits dans le Temple de Satan.
«Au sens superlatif, enfin, le serpent Nahash symbolise l’égoïsme primordial, ce mystérieux attrait de Soi vers Soi, qui est le principe même de la divisibilité. Cette force qui sollicite tout être à s’isoler de l’unité originelle pour se faire centre et se complaire dans son Moi a causé la déchéance d’Adam. En l’étudiant, Guaita eût abordé le Problème du Mal, l’énigme de la chute humaine, chute collective et individuelle dont le complément nécessaire est la grande épopée de la Rédemption.»
Les amis d’étude de Guaita, les F.-C. Barlet, les Papus, les Marc Haven, les Michelet, les Sedir, les Jollivet-Castelot, les Thorion, inclinent à croire que l’audacieux penseur ne fut pas autorisé à faire ses révélations suprêmes.
[p. 297] [12](page 157). Les Guaita seraient d’origine germanique, venus en Italie avec Charlemagne. Certainement, durant tout le moyen âge ils ont exercé la puissance féodale sur la délicieuse vallée qui, de Menaggio à Porlezza, joint le lac de Côme au lac de Lugano. Hommes de guerre ou d’église, et, quelques-uns, poètes. En 1715, le quatrième aïeul de Stanislas de Guaita quitta cette belle région pour s’établir dans la ville libre de Francfort; il épousa une Brentano, de la famille du poète Clément Brentano et de la romantique Bettina, la petite amie de Gœthe. Deux générations de Guaita se sont succédées à Francfort et mariées dans des familles allemandes. Dès cette époque cependant l’administration des verreries de Saint-Quirin, dont ils étaient copropriétaires, les rapprochait de la France. Le grand-père de Stanislas de Guaita prit du service pendant les guerres du premier Empire et acquit la nationalité française. Son fils, le père de l’occultiste, habitait Nancy et le château d’Alteville, dans l’arrondissement de Dieuze, qu’il représenta au conseil général.
Quant à l’ascendance maternelle de Stanislas de Guaita, elle est toute lorraine. Il avait pour arrière-grand-oncle le maréchal Mouton, comte de Lobau.
Cette petite indication généalogique ne paraîtra pas superflue à ceux qui admettent, comme nous disons plus haut, que nous sommes les prolongements, la suite de nos parents et que leurs concepts fondamentaux parlent par notre bouche. Dans ce jeune lorrain se continuaient des âmes allemandes et italiennes.
[p. 298] [13] (page 162). Dans leur forme primitive, ces pages servirent de préface à «Elisabeth de Bavière, impératrice d’Autriche, pages de journal, impressions, conversations et souvenirs», par Constantin Christomanos, traduit de l’allemand en français par Gabriel Syveton.
[14] (page 164). M. Jacques Bainville, dans son Louis II de Bavière (1900), nous a donné la meilleure «psychologie» de ce prince. «Regrettons, dit-il, que les archives de Munich soient closes pour tout ce qui touche le roi de Bavière; elles le resteront longtemps encore. Le prince régent, Luitpold, qui prit le pouvoir dans des circonstances si extraordinaires, ne semble pas pressé de communiquer les pièces intéressantes... Qu’a-t-on fait des lettres nombreuses du roi? Qu’est devenu ce journal qu’il avait écrit?... Ah! si M. de Bürkel, rendu muet par la haute position qu’il occupe aujourd’hui, consentait à parler! Ancien secrétaire particulier du roi qu’il accompagna dans ses voyages secrets à Paris, que de faits intéressants il pourrait raconter, s’il ne craignait de se compromettre!... Puisse le comte Dürckheim-Montmartin, dernier favori du roi, fixer aussi ses souvenirs... Toutefois, les souvenirs de Mme de Kobell, de M. de Heigel et du chevalier de Haufingen, de nombreux portraits faits par les contemporains (et les lettres de Louis II à Wagner) fourniraient des détails sûrs...»
[15] (page 164). Le goût des arts se trouve chez les Wittelsbach dès leur origine. Quelques-uns même l’exagérèrent. «Ainsi, au XVIIe siècle, ce Ferdinand [p. 299] dont la femme, Adélaïde de Savoie, écrivait des comédies françaises, tandis que lui se retirait dans la plus grande solitude, en son château de Schleissheim, bâti sur le modèle de Versailles, pour y peindre, psaller, composer et tourner l’ivoire. N’était-ce pas un original aussi ce Charles-Albert qui, le jour où on le couronna empereur, écrivit au comte Tœrring qu’il était plus malheureux que Job? On reconnaît quelques traits du caractère de Louis II dans Charles-Théodore, de la branche palatine, qui, à Mannheim, voulut égaler les rois de France par le luxe et l’éclat de sa cour. Il rassembla les plus célèbres littérateurs et acteurs de l’Allemagne et fit jouer les premiers drames de Schiller, mais il ruinait son Palatinat. Le duc de Bavière étant mort sans enfants, ce Charles-Théodore dut quitter son cher Mannheim et venir à Munich. Le gouvernement de ce dilettante fut déplorable. Ennuyé, lassé, il songea à se mettre sous la protection de l’Autriche pour être délivré du fardeau des affaires. Il demeura pourtant souverain malgré lui, par la volonté énergique de Frédéric le Grand, qui intervint, et il se consola en faisant de l’Opéra de Munich un des meilleurs de l’Europe, au dire de Stendhal.
«Son successeur fut Max-Joseph (d’une autre branche) qui fut le premier roi de Bavière. Le fils de celui-ci, Louis Ier, fut un roi artiste. Il passa sa jeunesse dans la société de peintres et de sculpteurs, avec qui il fit de longs séjours en Italie. Poète lui-même, il composait d’assez jolis vers. Dans son premier recueil, paru en 1829, il chantait Rome et la Grèce. Ses poésies amoureuses et sentimentales ne [p. 300] manquent pas d’un certain charme; on imprime encore ses distiques sur les calendriers bleus que consultent les jeunes filles allemandes. Devenu roi, Louis Ier s’adonna à ses goûts de construction. C’est lui qui a fait de Munich ce qu’il est aujourd’hui. Il avait dit: «Je veux en faire une ville qui honore tellement l’Allemagne que personne ne puisse se vanter de connaître l’Allemagne s’il n’a pas vu Munich.» Mais s’il savait comprendre les chefs-d’œuvre étrangers, il ne put rien créer d’original. L’Athènes de l’Isar, comme disent les Allemands, n’est qu’une suite de froides imitations. On y voit des Odéons et des Propylées près d’un jardin du Palais-Royal, avec ses arcades et ses jets d’eau. L’église de la cour est copiée sur la Capella Palatina de Palerme; la Galerie des Maréchaux, sur la Piazza dei Lanci de Florence, etc. Il enrichit de tableaux excellents les galeries de sa capitale.
«Ce bon roi aimait toutes les manifestations de l’art. Il avait surtout un goût particulier pour la danse et pour les danseuses. Une aventurière, jolie femme et femme d’esprit, Lola Montez, se fit remarquer de Louis Ier par ses talents chorégraphiques et réussit bientôt à exercer sur lui la plus décisive autorité. Très ambitieuse, elle voulut jouer les premiers rôles et se prépara à mettre en ballet l’histoire de Bavière. La favorite s’imposa bientôt à la haute société de Munich. Et, non contente de ce succès, elle demanda au roi de l’anoblir. Le conseil d’État, dont l’avis était indispensable, refusa. Elle tint bon. Enfin, après de longues négociations, elle fut nommée comtesse de Landsfeld. Voir ses [p. 301] Mémoires amusants, mouvementés, mais peut-être apocryphes.
«Les Munichois détestaient Lola Montez, qui d’ailleurs ne prenait aucun soin de sa popularité. Quelques jeunes nobles, qui s’étaient constitués ses cavaliers servants et qui portaient ses couleurs, molestèrent des railleurs dans la rue. Elle-même distribua quelques coups de cravache. On faisait courir des bruits fâcheux sur ses dépenses et ses projets de gouvernement. L’effervescence générale de 1848 vint se joindre à ce mécontentement. Des troubles éclatèrent à l’Université; on éleva des barricades dans les rues. Pour éviter un conflit, Louis Ier renvoya la comtesse de Landsfeld et Berk, le ministre qu’elle avait fait nommer. Tout cela ressemble singulièrement aux rapports de Louis II avec Wagner.
«Quelques jours après, la nouvelle se répandit que Lola était revenue et l’émeute recommença. Alors, lassé de la sottise et de l’ingratitude populaires, Louis Ier abdiqua, le 19 mars 1848, en faveur de son fils aîné. Ni les prières de sa famille, ni celles des députations qui vinrent l’assurer de la fidélité de ses sujets, ne purent le déterminer à reprendre sa parole. Sans doute, il s’estimait trop heureux d’avoir reconquis son indépendance et de pouvoir vivre en artiste à sa guise. Il alla vivre à Rome où il se sentait toujours attiré. Il y était connu et aimé: on lui avait donné le surnom de Re amante delle belle arti. Il vivait là au milieu d’une société d’artistes qu’il appelait ses «enfants». Il revenait de temps en temps en Teutschland, comme il disait archaïquement. [p. 302] La bonne ville de Munich, dont il se proclamait dans une lettre «le plus heureux habitant», le recevait en triomphe comme le protecteur des arts. Il était traité en roi, sans avoir les soucis du pouvoir. Combien il devait remercier ces braves gens d’émeutiers, et Lola Montez, cause indirecte de tout ce bonheur! Tantôt, il se rend à Cologne pour surveiller l’achèvement de la cathédrale: car c’est là une chose allemande et qui lui tient à cœur; tantôt il s’occupe du Musée Germanique de Nurenberg, sa fondation, ou bien il fait élever une statue à Claude Lorrain, son peintre favori.
«Telle est la vie de dilettante que mènera longtemps encore, jusque sous le règne de son petit-fils, à qui il ressemble par bien des traits, cet étrange souverain volontairement détrôné.
«Son fils, Maximilien II, qui lui avait succédé après son abdication, fut aussi un prince original. Il s’occupait moins des beaux-arts, mais beaucoup plus de philosophie et de sciences. Jeune homme, il se proposait d’imiter sur le trône Marc-Aurèle. Il écrivit de petits traités moraux: Questions à mon Cœur, le Devoir et le Plaisir et aussi des Pensées, où l’on sent l’influence de Schelling, son philosophe préféré, dont il annotait les ouvrages, et avec qui il entretint une correspondance interrompue seulement par les soucis du pouvoir. Le Roi s’y montre rongé de mélancolie et de doutes métaphysiques: ce qui a pu faire dire un jour que, s’il avait vécu plus longtemps, il serait devenu fou comme ses deux fils. Il paraît néanmoins avoir été doué d’une lucide intelligence: à preuve ces causeries sur l’histoire qu’il [p. 303] demandait à Ranke et après lesquelles il faisait de curieuses remarques. On trouve ces sortes de dialogues résumés dans le dernier volume de l’Histoire universelle, de Ranke.
«Louis Ier avait voulu faire de Munich une cité d’art. Max compléta son œuvre en le rendant centre scientifique et en attirant autour de lui des savants. Le chimiste Liebig fut son favori. Et c’était vraiment une cour originale que celle des «élus» ou la Table Ronde du roi Max, comme ils se nommaient eux-mêmes; un jour ils allaient dans le laboratoire de Liebig assister à ses expériences sur les gaz et, le lendemain, ils entendaient une conférence de Dœnniges sur les chansons populaires de l’Allemagne.
«On voit que Louis II apportait en naissant, du côté paternel, des qualités rares et singulières. Il y a en puissance, chez ses ancêtres, d’inquiétantes dispositions qui atteindront en lui et en son frère leur développement parfait.
«Quant à sa mère, la princesse Marie, dans sa jeunesse on la surnommait l’Ange, à cause de son éclatante beauté: elle a donné à Louis II cette expression idéale qui en a fait un véritable Prince Charmant. Elle avait en elle le sang de Louise de Prusse, qui fut romanesque au point de s’imaginer que Napoléon lui rendrait Magdebourg contre une rose.»
(Louis II de Bavière, chapitre premier,
Jacques Bainville.)
[16] (page 178). L’impératrice devait recevoir quelques archiduchesses. De là cette robe de cérémonie.
[p. 304] —Si les archiduchesses savaient, disait-elle, que j’ai fait de la gymnastique en cet accoutrement, elles seraient pétrifiées. Mais je ne l’ai fait qu’en passant; d’habitude, je m’acquitte de cet exercice de bon matin ou dans la soirée. Je sais ce qu’on doit au sang royal.
[17] (page 198). M. Adolphe Aderer se rappelle avoir vu l’impératrice en 1875, quand elle habitait ce château de Sassetot, qui regarde la mer et domine l’étroite vallée des Petites-Dalles. «L’impératrice Elisabeth franchissait à cheval un champ de blé qui bordait la falaise. Les épis, grêlés et mêlés de coquelicots, se tendaient vers le soleil pour se réchauffer de la bise toujours froide envoyée par la mer voisine. Hantée par les souvenirs des poètes antiques qu’elle préférait, la cavalière, droite sur un grand cheval, que les barbes des épis piquaient à ses flancs vigoureux, se croyait plutôt la reine des Amazones que la souveraine d’un vaste pays, aussi éloigné de ses yeux que de sa pensée. Un frisson me saisit, parce que la belle dame s’approcha si près du bord de la falaise qu’il me parut qu’elle allait le dépasser: un cri d’épouvante me vint à la gorge. Au même instant, le cheval se retourna d’un bond, et il reprit sa course de vertige à travers les épis blonds. Au pays, on me dit que la souveraine se plaisait tous les jours à ce jeu violent qui valait, le soir, au majordome du château des réclamations apportées par les propriétaires des champs traversés: réclamations dont on ne parlait jamais à l’impératrice pour ne point troubler son sport favori. L’écuyère passionnée [p. 305] subissait aussi l’influence mystérieuse de la mer, qu’elle adorait. On avait mis un yacht à sa disposition: elle lui préférait une petite barque sur laquelle elle partait seule, avec le fils du maître baigneur des Petites-Dalles, un gamin de quinze ans. Elle allait ainsi jusqu’à l’une des plagettes du voisinage, où ses dames d’honneur, qu’on avait menées en voiture au même endroit, l’attendaient.» Il est curieux de recueillir ces images auxquelles nous restituons une âme. On sait maintenant à quoi rêvait cette solitaire dans ses grandes courses et sur la mer. Plus loin (¿p. 217), nous l’entendrons parler de l’un de ces chevaux auxquels elle demandait d’affronter la mort.
[18] (page 199). Voir cette scène de l’impératrice au pied de la Tour de Brunehaut, p. 127, Scènes et Doctrines du Nationalisme.
[19] (page 220). M. Christomanos n’a point écrit dans son livre le voyage à Madère; il a raconté cette anecdote dans la Nouvelle Presse libre, de Vienne, en septembre 1898.
[20] (page 234). Le Régime de l’Impératrice.—Que l’on m’accuse de mauvais goût! Mais à titre d’indication sur la physiologie de cette personne singulière qui nous enlève si haut, loin de terre, et pour reprendre pied, je demande à transcrire ici le régime, «régime de jockey anglais», qu’elle suivait: «Lever à cinq heures, bain d’eau distillée (massage suédois, bain de vapeur parfois), une heure de marche dehors, s’il fait beau; en cas de pluie, sous une galerie ou le long d’un corridor. Vers six heures, [p. 306] une tasse de thé et un seul biscuit, puis deux heures pour la toilette (pour la coiffure surtout). A dix heures, déjeuner composé d’une tasse de bouillon, d’un œuf, de quelques mets faciles à digérer, puis la grande promenade de quatre ou cinq heures, et tous les sports imaginables. (En escrime, en natation, en équitation surtout, elle était de première force. Elle préférait à tout les ascensions.) Était-elle seule? on ne servait jamais le dîner du soir; si elle avait des hôtes, elle se bornait à le présider sans y toucher, se contentant de lait glacé, d’œufs crus et de Porto.» Et en dépit de cette discipline, des insomnies. On le voit bien par cette belle scène du lever du soleil sur les terrasses de l’Achilleion. «Je suis toujours ici avant le lever du soleil.»
[21] (page 243). Je donne tout sec, aux gens d’imagination, un fait qui peut leur fournir un départ pour la rêverie.
L’impératrice Élisabeth possédait un magnifique collier de grosses perles qui s’abîmaient. On lui conseilla de les remettre à la mer. Seule avec un vieux moine du couvent de Paléocastrizza, qui est situé sur un promontoire abrupt de la côte occidentale de Corfou, elle monta dans une barque. Ils déposèrent les perles malades dans les rochers marins que dominent les ruines de l’Angelokastron, vieux château fort des despotes byzantins de l’Epire. Le vieux moine jura le secret. Il mourut dans le moment même où l’impératrice fut assassinée. Le collier repose sous la vague, dans le sublime horizon que préférait cette errante. Ses pensées précieuses [p. 307] trouvèrent-elles un cœur profond, très loin au-dessous des tempêtes et des regards?]
[22] (page 274). Ces méditations, ces analyses, c’est une méthode intérieure à laquelle je suis resté fidèle jusque dans la propagande politique (par exemple, quand je fondais le nationalisme sur la Terre et les Morts) et là encore je me trouvais peut-être en opposition avec des coreligionnaires qui, pour servir des idées analogues, employaient des moyens plus extérieurs, plus bruyants. Le «Culte du Moi» répondait certainement à une disposition de la jeunesse dans les dernières années, à une disposition qui n’avait pas encore été exprimée et satisfaite à ce degré. Combien de jeunes lecteurs me l’ont dit et me le répètent encore. Tel esprit de haute clairvoyance, mais qui n’acceptait pas ces dispositions ou qui ne les retrouvait pas en lui, sentait bien pourtant ce qu’elles avaient de fécond. Paul Bourget écrivait le 15 août 1890:
«Des jeunes gens qui sont entrés dans la vie littéraire depuis 1880, M. Maurice Barrès est certainement le plus célèbre. Il est aussi celui contre lequel les plus violentes attaques ont déjà été dirigées. C’est le sort de toutes les personnalités très distinguées, et par suite très différentes, de passionner l’opinion ou pour elles ou contre elles, aussitôt qu’elles apparaissent en pleine lumière. Les âmes originales sont rares, et le premier effort du vulgaire est de s’acharner à les détruire, à les abaisser du moins à son niveau. Il y réussit, hélas! bien souvent et, même quand il semble échouer, l’effort de résistance aboutit à déformer l’âme originale. Trop [p. 308] d’exemples attestent cette difficulté pour un moderne de rester lui-même, indépendant et sincère, ni soumis au monde qui l’entoure, ni révolté contre lui.—Ah! la destruction de notre vrai moi par l’esprit de révolte, aussi fatal aux sincérités que les pires préjugés, qui la dévoilera jamais aux nouveaux venus pour leur épargner de reprendre la route où se sont enlisés tant de beaux génies!...
«Ce souci presque douloureux de l’indépendance de son moi, d’une culture de ce moi d’après le type natif, sans concession de faiblesse, sans outrance de contraste, tel est le premier trait qui se dessine dans l’œuvre déjà publiée de M. Barrès, dans ces deux romans d’une si savoureuse nouveauté: Sous l’Œil des Barbares et l’Homme libre. Et, comme d’ordinaire cette simple syllabe: le moi, signifie dans la conversation courante: les pires instincts du cœur sans amour, il est devenu cela pour beaucoup de critiques, un apôtre de l’égoïsme. Voyez pourtant quels malentendus peut créer une petite formule. Si M. Barrès, au lieu de parler de son moi, en philosophe qui ne recule pas devant un terme un peu technique, avait exprimé sa pensée ainsi: «Rien n’est plus précieux pour un homme que de garder intactes ses convictions à lui, ses passions à lui, son Idéal enfin, et le grand travail de notre jeunesse doit être de découvrir en soi ces convictions, ces passions, cet Idéal», les mêmes critiques eussent bien été obligés de reconnaître ce qui eût rendu ce jeune homme si cher à Michelet,—un courageux, un fervent dévot de l’Ame humaine. Mais voici qui a aidé encore à ce malentendu: c’est le courage d’un Parisien obligé de s’armer d’ironie pour se défendre contre l’assaut des innombrables adversaires prêts à railler sans cesse tout ce qu’il aime, et c’est la [p. 309] ferveur d’un enfant de la fin du siècle en qui les besoins de la vie morale palpitent et souffrent à vide, sans cet aliment de la foi au mystère du monde, à la réalité vivante et aimante de l’Inconnaissable, à Dieu, pour tout dire,—et c’est le second trait de cette nature si profondément éprise de l’indépendance intellectuelle et sentimentale. Ce passionné d’indépendance est en même temps une sorte de mystique incroyant qui ne sait pas prier et qui met au-dessus de tous les livres celui qui d’un bout à l’autre n’est qu’une prière: l’Imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
«Ironique et méprisant par amour d’un Idéal dont il n’aperçoit pas de principe extérieur à lui-même, anxieux uniquement des choses de l’Ame et n’acceptant pas la foi qui seule donne une interprétation ample et profonde aux choses de l’Ame,—tel se montre le romancier trop compliqué de Sous l’Œil des Barbares, et il résulte de cette double disposition une maladie morale très singulière, dont un exemple déjà avait été donné par Benjamin Constant, et qui réside dans l’intermittence de l’émotion. L’homme qui met son Idéal infiniment haut trouve sans cesse des défauts qui le froissent dans les objets ou les êtres auxquels il s’attache, et l’intensité de ses goûts est proportionnée à l’ardeur de ses enthousiasmes. Leur rapidité aussi,—car il porte en lui-même un élément d’ironie, et il est immanquable que cette ironie s’applique à ces objets et à ces êtres aussitôt qu’il commence de voir ces défauts. «Tout ce qui me faisait frémir d’amour dans ma jeunesse», disait Alfieri, «me faisait presque aussitôt éclater de rire.» Cette alternance de l’ironie et de l’amour devient même si rapide qu’elle aboutit à la plus singulière des simultanéités et, [p. 310] pour douloureuse qu’elle soit, elle ne tarde pas à devenir aussi nécessaire, en vertu de cette loi des réactions qui gouverne le monde moral comme le monde physique. On se sent sentir davantage à sentir par contradiction, mais il n’est pas de gymnastique qui épuise davantage toutes les forces vitales du cœur. Alors, à des dépenses excessives d’émotion succèdent des atonies étranges, une mort intérieure et cette triste, cette lourde sécheresse dont Adolphe est le poème inimitable. Dans cette aridité cependant que devenir, avec une sensibilité qui souffre de sa torpeur? N’est-il pas un moyen de galvaniser cette sensibilité? N’y a-t-il pas des procédés pour échapper à l’adolphisme?—Il faut bien créer des mots nouveaux pour des phénomènes aussi mal étudiés. Son mysticisme incroyant a conduit M. Barrès à une audacieuse tentative pour appliquer à ses propres émotions la dialectique morale enseignée par les grands religieux, par les François de Sales et les Ignace de Loyola, et c’est toute la genèse de l’Homme libre que cette idée dont je ne peux qu’indiquer ici le point de départ.
«Le paradoxe qui est au fond d’une pareille thèse, M. Maurice Barrès a trop de sincérité pour ne pas le découvrir un jour. Ce jour-là, il prononcera la phrase admirable de notre maître Michelet: «Je ne peux me passer de Dieu.» Tous les dons si rares de sa noble nature seront alors éclairés et harmonisés. Mais n’est-ce pas une communication avec un hors de lui, n’est-ce pas une foi qu’il cherche quand il parle de cet instinct des foules dont il a le si profond amour? Ce besoin de l’action qui l’a saisi et son socialisme attestent encore chez lui cette soif et cette faim d’une croyance en quelque chose d’autre que lui-même qui lui permette de vivre enfin d’une [p. 311] vie morale, complète et féconde. Y parviendra-t-il? Ce que l’action, telle qu’il l’a choisie, comporte de médiocrités ambiantes n’est pas l’obstacle. Agir, c’est toujours accepter la mesquinerie de conditions autour de son Idéal. La plupart des gens ne voient que ces mesquineries, et, pour conclure ces quelques notes qui demanderaient un long développement, j’ajouterai que je ne doute pas qu’elles ne paraissent ridiculement solennelles à beaucoup, étant donné que pour le monde notre ami est simplement un jeune romancier, bizarre et tourmenté, qui s’est fait nommer député de Nancy dans le parti révisionniste, comme Alcibiade fit couper la queue de son chien légendaire,—par goût du tapage. Ceux qui jugent ainsi M. Barrès prouvent qu’ils n’ont pas le respect religieux de cette force saine qui est le talent. Pour moi, celui qui a écrit certaine page sur le Christ de Léonard de Vinci est un artiste d’une telle supériorité de pathétique et si fièrement doué, que je crois lui devoir de le prendre comme il se donne, comme je sais d’ailleurs qu’il est, pour une âme très sérieuse et très profonde, et si sincère même dans ses ironies, et c’est à cause de cela que je regarde avec une si fraternelle anxiété son chemin vers de nouvelles expériences et que j’attends, comme je n’attends guère de livre, sa prochaine œuvre, ce Qualis artifex pereo! qui achèvera les Barbares et l’Homme libre. Et il faudra bien voir alors autre chose qu’un décadent ou qu’un dilettante dans cet analyste de sa propre mélancolie, le plus original qui ait paru depuis Baudelaire.»
Paul Bourget.
| La Mort de Venise. | 11 | |
| I.— | Jusqu’à midi dans ses quartiers pauvres. | 23 |
| II.— | Une soirée dans le silence et le vent de la mort. | 37 |
| III.— | Les ombres qui flottent sur les couchants de l’Adriatique. | 56 |
| IV.— | Le chant d’une beauté qui s’en va vers la mort. | 109 |
| Stanislas de Guaita (1861-1898). | 123 | |
| Une Impératrice de la Solitude. | 161 | |
| I.— | Un petit étudiant corfiote. | 166 |
| II.— | Un spectacle somptueux et bizarre. | 171 |
| III.— | Une grande richesse d’émotivité. | 179 |
| IV.— | Que ne faisait-elle l’Impératrice! | 189 |
| V.— | L’Achilleion. | 197 |
| VI.— | Sentimentalisme matérialiste. | 212 |
| VII.— | Anecdotes chétives et larges clartés. | 224 |
| VIII.— | Les violons chantent: «Jam transiit». | 230 |
| IX.— | Rejetons la coupe à la mer. | 239 |
| Souvenir de Pau en Béarn. | 247 | |
| Leconte de Lisle. | 261 | |
| Le 2 Novembre en Lorraine. | 273 | |
| Notes. | 293 | |
6757-02.—Corbeil. Imprimerie Éd. Crété.
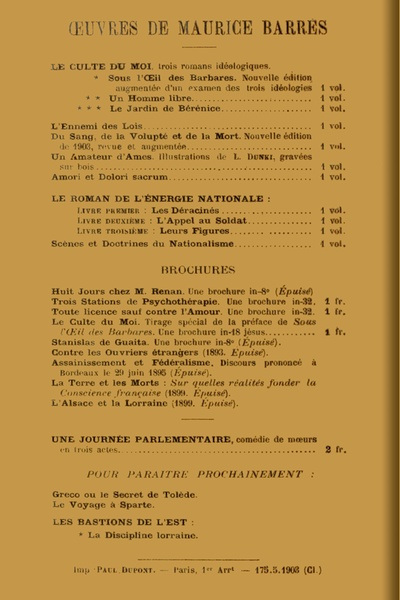
Au lecteur.
L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée, mais quelques erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. Ces corrections sont soulignées en pointillés dans le texte. Placez le curseur sur le mot pour voir l'orthographe originale.