


J'aime le français tel qu'on le parle à Witzheim, avec un accent gras et savoureux comme la cuisine du pays, mais le patois alsacien a bien aussi son charme bourru.
C'est un langage honnête et solide, tout plein d'une sorte d'humour rustique. La solennité de la phrase allemande, si rigide dans sa charpente, fait place ici à la bonhomie de grognements familiers.
L'Allemand dit: Ia; l'Alsacien dit: Iô. Ia est net, tranchant, affirmatif; Iô est traînant, ironique, dubitatif. Tout est là, et vous pouvez aller de Bischwiller à Mulhouse si vous prononcez Iô comme il faut.
Les mots français, semés dans la phrase alsacienne comme des truffes dans un pâté, retrouvent parfois dans ce terrain nouveau un parfum évaporé. Alors que chez nous: «Nom d'une pipe» est sans force, le «Nundepip» de mon ami Deck est encore un brillant juron.
Sur la place d'armes de Witzheim, entre le restaurant «Au Canon» et le restaurant «Au Saumon», je sonne à la porte de sa maison enveloppée d'un toit en pèlerine et coiffée de tuiles imbriquées que percent des mansardes en gradins:
—Nundepip! s'écrie-t-il en m'apercevant... Joséphine!... Süzele!... Wos e surprise!

Dans le salon de Mme Deck, aucun meuble n'a changé de place depuis le traité de Francfort. Les fauteuils et les tentures sont du Second Empire le plus pur. Au mur deux gravures naïves montrent Bonaparte au pont d'Arcole et Napoléon à Eylau. La médaille de Sainte-Hélène surmonte le congé du grand-père. Avec elle est encadré le ruban d'Italie de l'oncle Deck qui refusa d'acheter un remplaçant. Sur une console, deux statuettes en bonnet à poil veillent un casque de cuirassier ramassé à Reichoffen.
Je dis à mon ami Deck.
—Ils ont du cran, tes grenadiers.
—Iô!... répond-il... des bibelots!
Car M. Deck, en bon Alsacien, raille ses sentiments les plus vifs. De race forte et militaire, il aime les soldats et la gloire. Vivant malgré lui une histoire étrangère, il s'est attaché à des souvenirs que rien ne venait effacer. La fidélité alsacienne se cramponnait alors à l'image d'une France un peu désuète. Ici les vétérans ont conservé leur uniforme, les pompiers leur plumet rouge, et le langage des archaïsmes.
—Quel est le régiment français entré le premier à Witzheim?
—Le cent soixante toûssième te ligne, a répondu fièrement M. Deck.

Bien qu'il soit dix heures du matin, Joséphine apporte la tarte aux quetsches. Cinq ans de guerre ne m'ont pas fait oublier ce que Mme Deck appelle un petit morceau et j'observe depuis huit jours un demi-jeûne préparatoire.
Qui n'a pas vécu en Alsace pendant la saison des quetsches ignore les plaisirs du goût. Les fruits sont serrés comme les tuiles du toit; le jus sucré garde cependant encore une nuance d'âpreté qui le relève; la tarte immense est le symbole même de l'abondance heureuse.
Tout en savourant, j'interroge.
—Comme vous avez dû souffrir?
—Iô! souffrir!... On sait s'arranger... Ce qui a été dur, c'est le début... quand on les croyait victorieux... Ah! nundepip!
—Süzele, intervient Mme Deck, raconte voir un peu papa et les cloches.
Et Suzanne raconte son père et les cloches.
—Pendant le mois d'août 1914, presque tous les jours à midi, les cloches de l'église carillonnaient. La première fois on ne savait pas, et papa est sorti pour voir. Il a trouvé dans la rue tous les Allemands, toutes ces dames et filles d'officiers, tous pomponnés et radieux qui agitaient des drapeaux pour leur victoire de Sarrebourg. Papa est rentré en serrant les poings, la figure rouge.
Le lendemain à midi: les cloches. Papa s'est levé, a empoigné une chaise, et l'a brisée contre le mur. Cinq minutes plus tard l'agent de police frappait au carreau et demandait pourquoi nous n'avions pas sorti le drapeau. J'ai répondu que nous n'en avions pas. Il a ordonné d'en acheter un.
A la «victoire» suivante nous arborions le drapeau alsacien blanc et rouge. Le directeur du gymnase de garçons, un Allemand, est venu nous menacer. Papa est descendu à la cave pour ne plus entendre les cloches, mais le son arrivait jusque-là.
Alors quand un employé de chemin de fer nous a un matin appris Charleroi, papa a dit: «Moi, je ne peux plus. Ils vont encore sonner à midi: je vais à la campagne jusqu'au soir.» Il est parti; il a traversé toute la grande forêt, et il est monté jusqu'au sommet du Walburg. Et comme il s'asseyait, sur l'herbe, les cloches de Woerth se sont mises à sonner dans la vallée; celles de Witzheim ont répondu, puis celles de Lensbach, puis celles de Matstall, et, comme le vent portait de ce côté, papa, du haut de sa montagne, a pu entendre carillonner toutes les cloches de la basse Alsace.
—Oui, dit M. Deck, et c'était ma foi tellement bête d'être monté si haut pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de rire et que depuis ce jour-là j'ai supporté les «victoires» avec résignation. D'ailleurs la Marne est arrivée.
Après cela, quand le branle-bas commençait, les Alsaciens sortaient comme les autres dans les rues. Ils s'abordaient en se disant tout bas:
«Entends-tu comme on sonne le glas?»
Sur le visage il fallait l'air content pour ne pas être dénoncé, mais on se distinguait encore en ayant l'air trop content. On riait avec bruit, et les Allemands, qui se croient toujours mystifiés, disaient: «Qu'est-ce qu'ils sont encore à se moquer de nous, ces Welches?
Quand ils affichaient cent mille prisonniers, devant les dépêches on feignait l'admiration: «Croyez-vous? Ces Allemands! Encore cent mille! Où vont-ils les mettre? Et le Roth Sepel répondait: «Dans les journaux.»
Si les gamins s'ennuyaient, ils allaient sous les fenêtres de M. le Directeur Kruspe crier: «Extrablatt! Extrablatt! 10.000 canons!» Les volets s'ouvraient et le Herr Direktor congestionné hélait un vendeur invisible.
—En ce temps-là déjà, reprend Suzanne, la sœur Jules consolait maman qui ne voyait pas comment les Français seraient vainqueurs: «Il ny a pas de comment, madame Deck... Un matin quand on se réveillera, les Français seront là et les autres seront partis.» Ce qui est curieux, c'est que cela a été comme ça.

Mme Deck me demande la permission d'aller s'occuper du déjeuner; Deck veut sortir pour inviter son ami Roth et M. Tubinger, professeur. On laisse à Suzanne le soin de me distraire.
—Süzele, pendant ce temps-là, raconte voir un peu Bergmann et les draps.
Et Suzanne raconte Bergmann et les draps.
—Avant la guerre, nous avions en garnison à Witzheim un régiment de dragons badois. Les officiers étaient tous de ces agrariens vaniteux, pour lesquels l'homme commence au lieutenant. Papa m'aurait giflée si j'avais parlé à l'un d'eux, mais il tolérait Bergmann.
C'était un capitaine, très intelligent, qui, étant resté à Witzheim pendant quinze ans, s'y était fait respecter. Il connaissait Paris et Londres, l'Amérique et le Japon, et les voyages lui avaient fait voir qu'il n'y a pas au monde que des Allemands.
Il avait fait la conquête de papa en lui parlant patois, et celle de maman en faisant l'éloge de la cuisine alsacienne.
—Et toi, Süzele, me disait-il, épouserais-tu un Allemand?
—Jamais de la vie, monsieur le capitaine.
—Ah! petite Welche, tu y viendras.
Pendant la guerre, on le revit deux ou trois fois, quand il venait en permission. Il avait toujours une bonne parole pour les Français: il les trouvait courageux. Il écrivit une fois pour donner des nouvelles de parents à nous qu'il avait protégés près de Lille. Puis on l'oublia.
Huit jours avant l'armistice, dans chaque maison, en grand mystère, on se préparait. On découpait des cocardes tricolores; on apprenait la Marseillaise aux enfants, et, pour en faire des drapeaux, on taillait dans les draps de lit. J'avais obtenu de maman son plus grand drap que j'avais coupé en trois morceaux, et j'avais acheté du bleu et du rouge pour les teindre, dans ma cuvette.
Ma teinture avait très bien pris, et le lendemain soir, j'étais assise sur mon lit en train de coudre mon drapeau, quand j'entendis dans la rue un bruit de pas et presque tout de suite maman frappa à ma porte et me dit:
—Süzele, c'est le capitaine Bergmann qui revient, et qui cherche une chambre pour la nuit.
J'ai voulu cacher mon travail, mais maman avait ouvert trop vite, et Bergmann, qui était derrière elle, regardait mon drapeau bleu blanc rouge.
J'ai cru que mon cœur s'arrêterait tant j'ai eu peur. Car il était là avec ses hommes, les Français étaient encore loin, et Dieu sait ce qu'il aurait pu faire.
Mais il est devenu tout blanc lui aussi; il a dit d'une voix lente et triste:
—Ah oui! C'est donc comme cela maintenant?
Il a salué et il est sorti.
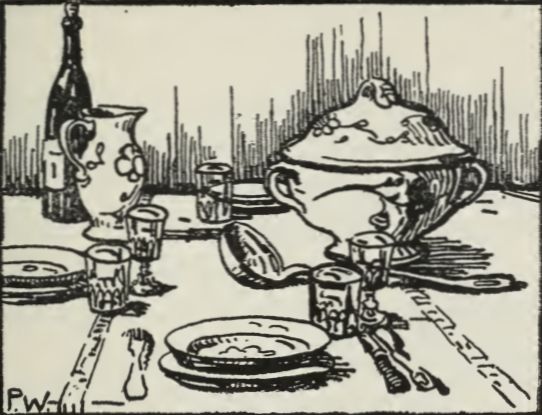
M. Deck revient avec ses invités: il me présente M. Tubinger, professeur, et Roth Sepel, qui est Directeur de la musique des pompiers.
Roth est son meilleur ami: quand l'un dit blanc, l'autre dit noir; l'un est catholique, l'autre est protestant; l'un est libéral, l'autre est radical; quand l'un est absent, l'autre est malheureux.
Joséphine apporte aussitôt un plat de foies gras chauds en sauce, Deck débouche ce Riquevihr qui est le Clos-Vougeot de l'Alsace, et M. Tubinger dogmatise.
—Cette façon de servir le foie d'oie est dans la vraie tradition alsacienne: le pâté est une invention assez moderne, faite par un Normand nommé Close, qui vint à Strasbourg comme chef de M. le Maréchal de Contades. Quand le maréchal quitta l'Alsace, ce Close épousa une pâtissière de la rue de la Mésange et fabriqua les premières terrines.
—Malheureusement, soupire Mme Deck, les foies sont très rares cette année: on faisait venir beaucoup d'oies de Russie et la Révolution empêche le commerce. Cependant les Allemands ont inventé une machine à gaver qui rend l'élevage plus facile.
—Ah! dit Roth: ils sont ingénieux...
—Iô, dit Deck, ingénieux! Ce n'était pas difficile à trouver.
—Écoute Joseph, dit Mme Deck, il faut reconnaître ce qui est: tu dis toi-même que dans les chemins de fer et les postes...
—Ça, on ne peut pas dire le contraire dit Deck: quand on voulait un renseignement, on n'avait pas besoin de courir de bureau en bureau.
—On ne peut nier, dit M. Tubinger, leur générosité pour les écoles... Ah! c'est une sale race.
—Une sale race, approuvent Deck et Roth avec un ensemble inattendu.
Je me permets de demander par quelle nuance de sentiment ils choisissent, pour les maudire, le moment où ils viennent de reconnaître certaines vertus à nos ennemis.
—Vous autres, Français de l'intérieur, dit M. Deck, vous ne comprendrez jamais rien aux Allemands.
Tenez, en ce moment, vous les conservez dans beaucoup d'administrations. Ils y sont très polis, très dévoués. Ils observent les règlements avec une conscience admirable.
Voyez celui qui donne encore aujourd'hui les billets à la gare de Witzheim. Il fait et refait le compte de chaque voyageur: «Funf und zwanzig... und acht und dreissig... und neun und neunzig».
Maintenant le supplément de guerre: «Zwei und fünfzig...» Et le supplément de Schnellzug: «Acht und dreissig». Il additionne, multiplie, recommence, ouvre des livres, consulte ses camarades; par moments un vrai Soviet examine vos trois billets.
Ah! qu'ils se donnent du mal! Ils s'en donnent tellement qu'une douzaine de bons Alsaciens manque chaque matin le train de Strasbourg.
Le soir l'Allemand les rencontre à la brasserie et les plaint: «Cette administration française! Si compliquée!»
Évidemment, c'est l'administration française, qui a inventé le Zuschlag et le Schnelzug... C'est elle qui a forcé le chef de gare allemand de Niederhausen à arrêter le train une heure par suite d'une erreur, bien involontaire, de signaux...
—Mais enfin monsieur Deck, que voulez-vous que nous fassions d'eux? Pouvons-nous expulser trois cents mille personnes? Nous ne saurions comment les remplacer.
—Nous ne demandons pas qu'on les expulse, mais nundepip, ne les mettez pas dans des postes où ils peuvent entraver la bonne marche des services.
—Et surtout, dit M. Roth, que l'Alsacien soit toujours bien au-dessus de l'Allemand: en ce moment il y a des administrations qui font examiner les compétences techniques des Alsaciens par des Allemands: ça ne peut pas aller.
—Enfin, monsieur Roth, nous les assimilerons.
—Iô!... Assimiler!... Un Allemand est toujours un Allemand.

Joséphine apporte un cuissot de chevreuil et le Riquevihr circule à nouveau.
—Süzele, dit Mme Deck, raconte voir un peu Plashke et sa femme.
Et Suzanne raconte Plashke et sa femme.
—Lui est né en Alsace, de parents Allemands: il a la carte B. Elle est une Badoise authentique. Au temps des Allemands, Plashke était un grand homme. Inspecteur pour la Basse-Alsace d'une compagnie d'assurances de Berlin, il recevait beaucoup. Des officiers venaient prendre le thé chez lui et les médecins militaires ont trouvé ce thé si bon, qu'au moment de la mobilisation Herr Plashke s'est trouvé malade. Il s'est dévoué pour les blessés et a été proposé pour l'Aigle rouge de quatrième classe.
Vers le mois d'août 1918, Frau Plashke, une personne énergique, a commencé à apprendre le Français. Herr Plashke est venu demander à papa les noms des meilleures Compagnies d'Assurances françaises. Quand le 172e de ligne est entré, ils ont sorti un drapeau français. Maintenant Plashke est inspecteur pour la Basse-Alsace d'une grande Compagnie d'Assurances de Paris. L'autre jour, Frau Plashke est venue nous faire une visite et, croyez-moi, son accent français est meilleur que le nôtre. Sa grande ambition, dit-elle, est que sa fille épouse un officier français. Ils sont déjà nombreux à ses thés. Quant à Herr Plashke, ayant raté son Aigle rouge, il voudrait les palmes académiques. Il les aura.
—Oui, dit Roth, peut-être même avant le Directeur de la musique des pompiers.
—Les palmes académiques! Vous ne direz pas que celui-là n'est pas assimilé.
—Iô!... Assimilé!... dit M. Deck, Inspecteur d'assurances, voilà ce qu'il est.

L'autre jour, dit Roth, j'avais été convoqué à une réunion de commerçants alsaciens... Iô! alsaciens!..Plus de la moitié de la salle était allemande. Enfin je me suis assis et j'ai écouté. Mais quand j'ai entendu des messieurs de Darmstadt et de Kœnigsberg parler de leur patriotisme, j'ai aussi voulu dire un mot.
—Messieurs, je ne veux nommer personne, mais comment s'appelait le père de la jeune fille qui a embrassé un lieutenant allemand sur la place d'Armes de Witzheim le jour de la prise de Douaumont par les fidèles Brandebourgeois?... Encore une fois je ne nomme personne, mais s'il y a quelqu'un que ça démange, il peut cependant se gratter.
Un certain nombre de ces messieurs se sont regardés et les vieux Alsaciens qui comme moi, s'étaient galvaudés là-dedans se sont mis à rire.
—Je ne veux toujours pas faire de personnalités, ai-je continué, mais qui a fait afficher en 1916 à la porte de sa boutique que le montant total des achats de la semaine irait à l'emprunt de guerre allemand? Je ne nomme personne, mais s'il y a ici quelqu'un qui vient de prendre une prise, qu'il éternue.
—Assez... Silence... m'a crié le banquier Schumann.
—Wos? Silence?... C'est ici la République Française... Liberté, Egalité... et si M. le Grand Lama n'est pas content, il a droit à un billet pour l'autre côté du Rhin et à cinquante kilos de bagages... Ce sera cinquante de plus qu'il n'en avait en arrivant.
—Tenez, m'a dit M. Tubinger, vous tenez-là une des clefs de nos sentiments à leur égard. Quand ces gens-là nous ont envahi, après 70, leur misère grossière, leur avarice ont choqué même nos paysans. Nous ne sommes pas des délicats, mais nous savons ce qui est bon. Nous avons senti que nous appartenions à une civilisation plus ancienne que la leur. On peut dire que c'est là un orgueil assez vain; on peut dire que la jeunesse est un beau défaut et que souvent dans l'histoire du monde des races barbares ont subjugué des empires plus affinés, mais vous n'empêcherez pas qu'à nos yeux, avec toute sa puissance industrielle, l'Allemand sera toujours un parvenu.
—Comment? appuie M. Roth, des gens qui sont venus ici avec une chemise dans le coin de leur mouchoir! Et ils voulaient faire les messieurs du monde. Ça ne pouvait pas aller!... Ces gens-là, ils sont très bien chez eux. Quand je vais en Allemagne je veux bien admirer leurs usines et leurs banques. Car ils travaillent, vous savez, ces Allemands: ils travaillent plus que vous et que nous... Mais quand je suis ici en Alsace, je veux être chez moi: voilà.
—Iô, dit Deck, en voilà des phrases: nous aimons les Français parce que nous sommes Français, et nous n'aimons pas les Allemands parce que nous ne sommes pas Allemands... Et ça suffit... Joséphine, ma fille, repassez le chevreuil, au lieu de m'écouter la bouche ouverte... Cette Joséphine, encore une qui m'a fait une belle peur le jour où la dernière brigade allemande a traversé Witzheim. Nous étions aux fenêtres et, au moment où le général passait, notre cheval s'est mis à hennir dans l'écurie: «Herr Deck! Herr Deck, m'a crié Joséphine, les chevaux eux-mêmes rient de les voir partir!» Le général a regardé en l'air...

—Si on pouvait aussi leur dire pendant la guerre ce qu'on pensait? Cela dépendait. Si on avait la réputation d'être un homme à bons mots, on pouvait dire beaucoup de choses.
Ainsi, moi Roth, j'avais mon franc parler, parce que je passais auprès d'eux pour un cerveau un peu brûlé... Si Deck ou Tubinger avaient dit la moitié de ce que je racontais, le Kreisdirektor les aurait fait coffrer, mais moi, il disait: «Ce n'est rien: c'est le Sepel!» Et ça passait.
J'ai longtemps logé dans ma maison un colonel, un Oberst, qui n'était pas un mauvais bougre. Il était fixé sur mes sentiments depuis le jour où il m'avait demandé:
—Eh bien, Herr Roth, quand tombera Verdun?
—Verdun ne tombera jamais, Herr Oberst, avais-je répondu avant d'avoir eu le temps de savoir ce que je disais.
Il ne m'en voulait pas trop: il essayait de me convertir.
—Que vous pensiez en Français, me disait-il, je l'admets encore: vous êtes né avant la conquête. Mais enfin pourquoi les Français, et les Russes, et les Italiens sont-ils assez bêtes pour «danser comme le fifre de l'Angleterre»? C'est pour elle seule que vous travaillez et que vos jeunes gens se font tuer.
—Herr Oberst, lui ai-je répondu, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un temps, encore pas très lointain, où l'Autriche, la Russie, et si j'ai bonne mémoire, la Prusse, dansaient assez volontiers comme le fifre de l'Angleterre. Pourquoi écoutaient-ils sa musique? Parce qu'il y avait alors en France un certain empereur très dangereux pour la paix du monde et quelles avaient besoin de l'Angleterre pour l'abattre: Herr Oberst, concluez vous-même.
—Et il tolérait ça?
—Iô... Tolérer... Il remerciait par-dessus le marché... Vous ne connaissez pas les Allemands. C'est quand on parle fort qu'ils sont polis.
—Les Alsaciens, dit M. Deck, avaient toujours le dernier mot. Tenez, un jour les Allemands avaient organisé une tournée de journalistes neutres en Alsace pour leur faire constater à quel point nous étions attachés à la patrie allemande.
Dans chaque ville la propagande germanique offrait un banquet aux gens du pays et les neutres pouvaient interroger librement tous les convives.
Vous pensez bien que lorsqu'ils sont venus ici le Kreisdirektor ne nous avait pas invités, ni moi ni Roth ni Tubinger. En ce temps-là nous passions notre temps à nous promener dans les récoltes et quand elles étaient bien mauvaises, les épis bien pauvres, les chaumes bien couchés par la grêle, nous nous réjouissions en pensant aux greniers qui se vidaient.
Les neutres banquetaient donc «Au Canon» et tout allait bien, car les convives avaient été choisis, quand un sacré Suédois s'avisa d'interroger Hauser, l'aubergiste, un vrai alsacien d'Alsace.
—Et vous, mon brave, lui dit-il, êtes-vous heureux sous le régime allemand ou souhaitez-vous le retour à la France?
Hauser, étonné, le regardait sans rien dire.
—Allons, cria le Kreisdirektor rageur, répondez! Répondez librement.
Il paraît en effet qu'il était surprenant de voir ce qu'il y avait à ce moment de libéralisme dans son regard.
Hauser ne voulait pas d'histoires: ce n'est pas possible pour un aubergiste. Il ne voulait pas non plus renier la France. Mais il n'est pas embarrassé.
—Herr Kreis Direktor, a-t-il dit lentement, moi, quand je veux me confesser, je vais à l'église.

Un plat de cèpes vient m'achever: le professeur explique que ce légume a été négligé par les Alsaciens jusqu'à l'arrivée de Stanislas, roi de Pologne, qui leur en révéla l'usage, et M. Roth me raconte l'arrivée des Français à Witzheim:
—C'était quelque chosse de vraiment bien... On avait décoré la rue du Marché d'un arc de triomphe avec une inscription: Salut à nos frères! J'avais appris la Marseillaise à la musique des pompiers et aux enfants des écoles. Tous les vétérans étaient là, avec leurs médailles et leurs cylindres...
—Wos? Cylindres? interrompt Deck... En français on dit gibus.
—Pour moi, dit Mme Deck timidement, cela a été comme le jour de mon mariage: un instant pour lequel il semble qu'on ait vécu toute sa vie. Quand ces soldats bleus ont défilé, quand ces clairons ont joué, j'ai cru encore avoir dix-huit ans.
Elle s'arrête, rougit et continue:
—Seulement, que voulez-vous, c'est comme dans tous les mariages. Après les premiers jours on s'aperçoit que le mari n'est pas tout à fait aussi parfait que le fiancé.
—Comment? s'indigne son mari... Wos? Ça, c'est un peu fort: dies isch dort zu aehrik.
Madame se défend, éplorée:
—Écoute, Joseph, on s'habitue vite aux défauts... on finit même par ne plus pouvoir s'en passer... mais enfin on a un homme, on n'a plus un rêve.
Je murmure, pour M. Tubinger:
—«Il peut y avoir de bons mariages: il n'y en a pas de délicieux».
—Très juste, dit-il. Pendant quarante-huit ans, la France a été pour nous une idole. Pour beaucoup d'entre nous, l'arrivée des Français devait marquer le début de l'âge d'or.
«Les Français, me disait le vieux savetier Jacob, les Français... ça veut dire du vin rouge et jamais de travail.» Un autre prédisait: «Ils installeront un tonneau sur la grand'place et tout le monde pourra boire pour rien.»
Le plus drôle c'est que tout arriva ainsi. Les poilus avaient du vin en abondance et le distribuaient généreusement. Après le départ des autres, maigres et affamés, cela parut miraculeux. Pendant un mois l'Alsace devint un pays de Cocagne: ce n'étaient que banquets et danses. Mais c'est un régime difficile à prolonger. Bien que les Français soient revenus, il faut encore travailler pour vivre: cela surprend.
J'ai rencontré ce matin le savetier Jacob; je lui ai dit: «Jacob, quand vas-tu t'y remettre?» Et Jacob m'a répondu: «Quand nous aurons une garnison à demeure.»

Il est quatre heures: on sort de table, et Deck, qui fabrique quelque chose, va faire un tour dans son usine. En l'attendant je déguste son kirsch et M. Tubinger m'instruit.
—Vous nous trouverez un peu grinchus; c'est pour vous que nous le sommes devenus. Trop bien séparés de vous pour partager votre vie, nous avons vécu pendant quarante-huit ans dans une retraite volontaire.
Vous nous trouverez puritains: il fallait l'être ou céder. Pour conserver les mœurs françaises, nous avons tenu nos jeunes filles enfermées et inaccessibles. Cette jeune Suzanne que vous voyez n'a jamais été dans un théâtre: c'est qu'on y jouait en allemand. Dépouillés par la défaite du droit de nous gouverner, nous nous sommes ankylosés dans l'attitude du spectateur sarcastique. La critique est devenue pour nous une habitude de l'esprit. Nous nous considérons comme des êtres un peu différents de tous les autres.
—Et alors, Monsieur Tubinger?
—D'abord et avant tout, liberté! L'Alsacien aime qu'on le laisse tranquille. Il y a une chanson là-dessus:
Ce qu'il a, il ne le veut pas,
Et ce qu'il veut, il ne l'a pas...
Dites-lui que les lois françaises ne s'appliqueront pas à l'Alsace, et il en réclamera l'application. Dites-lui de parler alsacien tout son saoûl, et il parlera français. Le patois, monsieur, voilà la grande question. Il y a deux façons de gouverner l'Alsace: celle de Saint-Just qui voulait transplanter sa population en Champagne pour lui faire apprendre le français et qui ne comprenait pas qu'un paysan pût avoir un beau gilet rouge. Et celle de Napoléon qui disait: «Laissez à ces braves gens leur dialecte: ils sabreront toujours en Français».
Ne parlez jamais de franciser l'Alsace: elle est française autant que province en France. Mais elle l'est à sa manière qui n'est pas celle de la Bretagne ou de l'Artois.
Donnez les emplois à des hommes instruits de nos besoins et parlant notre langue. Envoyez-nous des gens qui nous ressemblent, des gens solides, un peu graves et qui aient bon estomac. Employez beaucoup les Alsaciens eux-mêmes.
—Voilà le grand secret, dit Roth qui écoute... Il y a dans toutes nos petites villes, et même parmi les artistes, des gens qui auraient fait d'excellents sous-préfets...
—Il est certain, dit M. Tubinger, qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on envoie de France des directeurs d'écoles alors que parmi les professeurs... Enfin...
Quoi encore? Ne parlez pas trop d'Alsace-Lorraine: c'est une création des Allemands. Il n'y a pas d'Alsace-Lorraine. Il y a l'Alsace, et il y a la Lorraine.
—Il y a, dit Roth, qui est radical, la République Française Une et Indivisible... Département du Bas-Rhin... Et n'oubliez pas, monsieur Tubinger, de lui rappeler le principal: ...E Schwobe isch immer e Schwobe.
—C'est vrai, dit M. Tubinger. Vous en viendrez un jour à estimer certains aspects du caractère allemand: nous y sommes venus. Vous en viendrez à faire des affaires avec eux, et vous aurez raison. Mais n'oubliez jamais ce que vous dit M. Roth: un Allemand est toujours un Allemand.

Deck était déjà revenu. Il dirige fort bien son affaire, mais comme on le fait en Alsace où l'on sait mêler au travail des loisirs assez bien nourris. Il serait très malheureux s'il ne pouvait aller à son usine tous les matins à sept heures; il le serait aussi s'il était privé de sa chope à la brasserie et de la promenade en ville qu'il fait tous les jours à cinq heures.
Je l'ai accompagné dans sa tournée. Par la rue du Maréchal-Foch, nous avons gagné le Pfalz, où se trouvait autrefois la caserne des dragons allemands.
En face de la caserne j'ai remarqué deux boutiques où l'on vend des cartes postales. Sur la vitrine de l'une d'elles, une large bande tricolore: «Ici, maison française; à côté, maison boche.»
La maison allemande, petite et basse, semble rentrer la tête dans les épaules et encaisse le coup sans répondre. Beaucoup de passants y arrivent avant d'avoir vu l'écriteau et elle ne fait pas de mauvaises affaires.
Comme une petite campagnarde y entrait, nous nous sommes arrêtés Deck et moi, sur le pas de la porte.
—Je n'ai plus «Vive le France!» répondait l'Allemande, mais j'ai le soldat, avec «Vive l'Alsace!»
—Non, dit la petite, je veux: «Vive le France!...» C'est plus chentil.
Nous avons continué notre promenade sous les marronniers du Pfalz et j'ai risqué:
—Un symbole?
—Iô!... m'a répondu mon ami Deck, avec un mélange assez alsacien de tendresse et d'ironie.
Strasbourg, Août 1919.