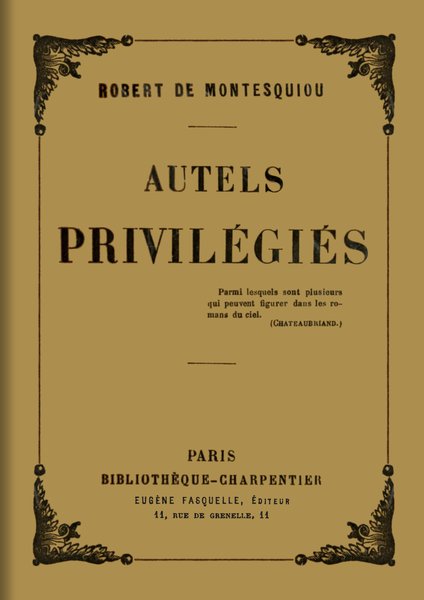
The Project Gutenberg EBook of Autels privilégiés, by Robert de Montesquiou This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Autels privilégiés Author: Robert de Montesquiou Release Date: February 21, 2020 [EBook #61472] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AUTELS PRIVILÉGIÉS *** Produced by Clarity, Hans Pieterse and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
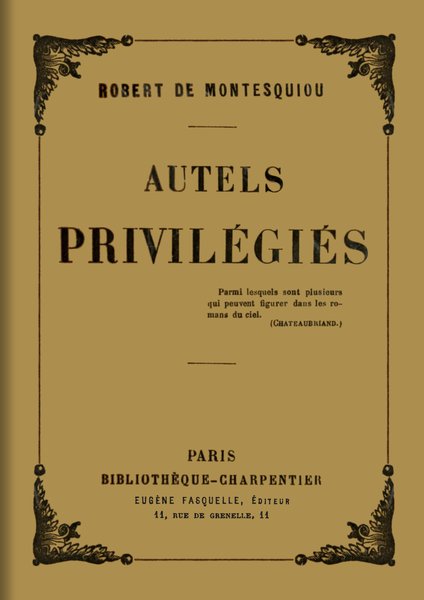
ROBERT DE MONTESQUIOU
Parmi lesquels sont plusieurs qui peuvent figurer dans les romans du ciel.
Chateaubriand.
PARIS
BIBLIOTHÈQUE-CHARPENTIER
EUGÈNE FASQUELLE, Éditeur
11, RUE DE GRENELLE, 11
1898
«Si mes propres reliques vous viennent sous le nom de martyr, recevez-les.»
Le relevé d’un procès en Cour d’art et d’amour, plaide tendrement avec d’éloquentes pièces à l’appui de la canonisation proclamée enfin pour Desbordes-Valmore.—Pour le demi-dieu Leconte de Lisle, plus encore qu’une canonisation, un culte, peut-être institué un peu trop tôt, célébré avec plus d’ostentation que de ferveur, sur ces pelouses du Luxembourg qu’on marchande à cette moins marmoréenne personne d’un Saint-Orphée, celui-là «bien toussottier et boitillant», ainsi que lui-même me l’écrivait, le pauvre Lelian, Paul Verlaine.—L’ensoleillé Mistral, notre Provençal Horus.—Une jonchée de Pensives Roses sur le parcours «l’une Fête-Dieu des Muses.—L’âpre Hello, Saint-Jean-Bouche-de-Fer, le nouvelliste précurseur, le polémiste Mangeur-de-sauterelles.—Goncourt, le noble patron de la Charité bien ordonnée.—Tolstoï, une icône.—Léonard, l’omniscient.—Blake, le peintre poète nécromant.—Burne-Jones, une idole.-Bœcklin, un prince des peintres.—Les Vernet, dieux désaffectés.—Un mystérieux retable de Chassériau.—Ghys, un Lare élégant.—Carriès, Oliab et Bélizéel, tout à la fois, sculpteur du réel et de l’idéal, qui cisela lui-même sa [p. 2] crédence.—Un exquis desservant, Helleu.—Sarah l’inspirée Sibylle; Eléonora, une frémissante pythie.—Versailles, un sanctuaire éteint...
Telles les vingt stations closes par une vingt et unième. L’Autel du Veau d’Or, le fétiche encensé et exécré de la Messe Rouge et Noire.
I
A la mémoire
de Pauline de Sinety,
comtesse Gontran de Montesquiou.
Je voudrais dire à mon tour, et s’il se peut, plus synthétiquement qu’il n’a été fait jusqu’ici, une poétesse admirable, ensemble merveilleuse et sublime, la Sapphô chrétienne, Marceline Desbordes-Valmore.
Pas un de nous en qui ces musicales syllabes, cristallines comme le son d’un harmonica, ne résonnent familièrement. A tous notre mémoire d’enfant signe de ce nom
et tels autres menus poèmes appropriés, dont se désennuyait notre étude, car
Le doux nom estampille encore pour tous quelques romances où notre adolescence s’égaya, et qui font sourire. Puis c’est tout. Peu se doutent que le gentil nom est celui de la poétesse admirable, ensemble merveilleuse et sublime, la Sapphô [p. 6] chrétienne. Et c’est vraiment pour quelques-uns seulement qu’il commence de se nimber du halo d’une auréole qui est une aurore, non qui se révèle, mais qui se relève.
Le sublime vers de Vigny, prélude pour celle dont la renommée, entre toutes, a ceci d’étrange, qu’appréciée à sa vraie valeur par les plus illustres de ses contemporains, Lamartine, Hugo, Vigny, Michelet, Dumas, Sainte-Beuve qui se faisaient honneur de son amitié, traitée à peu près dignement par la postérité banale qui consacre d’un nom de rue, sa vraie gloire est, jusqu’à ce jour, fermée ainsi que fut son âme, et pourtant, comme elle, toute pleine de ferveurs en puissance, de clartés latentes et de virtuelles vertus.
Appliqué depuis déjà des ans à tenter d’en fomenter l’éclat, il m’eût été douloureux de n’être pas des premiers de cette seconde période à divulguer nettement la bonne nouvelle dont se sont déjà plus ou moins brièvement et secrètement réjouis, après les maîtres dont je parlais tout à l’heure, Gautier, Baudelaire, Banville, Barbey d’Aurevilly et M. Verlaine.
Pour cela, je suis venu à vous[1] aujourd’hui, et vous demande de me suivre à travers cet exquis calvaire, ce douloureux et délicieux dédale, où les propres vers de Marceline, délicatement parfilés, nous serviront de fil conducteur en même temps que de sympathique lien.
[1] Des fragments de cette étude ayant été récités par moi, sous forme de conférence, en janvier 94.
[p. 7] On remet un jour à Hugo—selon une anecdote plus ou moins véridique—une lettre adressée Au plus grand Poète de France. Il la fait porter chez Lamartine, qui la retourne au premier.—«Nul ne saura jamais, aurait ajouté Vigny, lequel des deux s’est décidé à l’ouvrir.»
Que la suscription ait revêtu: Au plus mystique, c’était lui-même; au plus plastique, Gautier; au plus précordial, Valmore.
Il y a dans une des pièces du poète qui nous occupe, un vers, surtout un verbe, très simple, dont je ne retrouve nulle part ailleurs l’émouvante affixe et le significatif figuré:
Le cœur serré n’est que trop connu: cette étrange étreinte intérieure d’anxiété angoisseuse et froissante. Il s’agissait de desserrer cela, dénouer, délacer ce vêtement invisible et subcostal, immatériel et pourtant si réel, qui appuie et qui nuit.
C’est la propre action des poésies de Mme Valmore; de cette main mystérieuse et incorporelle qui s’immisce à travers l’âme qu’elle surprend et apaise, pour aller plus avant, descendit ad inferos, desserrer le cœur qui nuit.
Le seul mythe de Parsifal, la seule minute où le regard de la Sainte Lance, miraculeusement assainit, la tête et le cœur d’Amfortas, le noble prêtre qui a péché (et que Mme Valmore paraît avoir prévu dans ces deux vers:
peuvent équivaloir au réveil désenfiévré qui suit une pleine lecture tardive de cette poésie. On passe la main sur son front, d’un geste d’habitude, pour en chasser un nuage qui n’y est plus. On la porte à son flanc pour assagir sa plaie, et, comme Sainte-Elisabeth, on ne rencontre plus, sous son manteau, qu’un bouquet de roses...
Alors, ainsi que le Pur-Simple, cœur desserré sous l’onde baptismale, on murmure: «D’où vient que tout me semble si bel aujourd’hui?...»—C’est qu’en ce jour quelqu’un a pâti pour toi. Car, seule, la passion peut racheter la souffrance; et l’hostie blanche, la pure colombe a rougi, pleuré, saigné. Car il y a vraiment d’un christ féminin dans cette sainte femme.
J’ai dit lecture tardive. Oui. Les éditions éparpillées et incomplètes sinon interdirent, du moins entravèrent longtemps le vol d’oiseau sur cette œuvre. Les trois volumes de M. Lemerre permettent aujourd’hui[2] de diviser tour à tour et recomposer une grande partie du faisceau lumineux pour se délecter du détail ou se réjouir de l’ensemble.
[2] Depuis 1886.
[p. 9] Il y avait encore cet inéluctable silence qui succède aux oraisons funèbres, où se restreint presque intégralement encore le formulaire de la poétesse. Baudelaire, pourtant son plus subtil bien que bref panégyriste, apparaît visiblement gêné par ce manque de cohésion dans la gerbe des recueils. Nul doute que son bel article n’eût étendu ses accents, élargi ses accords sous la révélation plus tard totalement proférée; à l’effluve surtout de ce recueil posthume qui résume l’essence du flacon, la quintessence de l’essence.
Enfin, et de par la loi du suranné qui n’est déjà plus le démodé, et cependant pas l’ancien encore, mais bien la chrysalide à travers laquelle l’un devient l’autre,—entre notre génération et celle qui tenait encore à la contemporaine par le de visu, voltigeait ce prestige fané d’époque, ce brin un peu risible de coiffure en couette, par-dessus l’attitude troubadouresque et dessus de pendule, l’écho de «ce petit côté secret qui rend populaire, ce presque rien qui fait tache[3]» et grâce auquel notre mémoire d’enfant nous donnait la dame pour à peu près connue. Une résonnance de tous ces pianos mentionnés par Sainte-Beuve, et sur lesquels s’est transposé et tapoté le plus chantant de la lyre du poète, tandis que le silence en retient encore les traits les plus fulgurants et les plus suaves soupirs. Une odeur de Quel est ce gant rose—qui n’est pas le mien, invétérée en une récurrence, et longtemps empêchant de croire que s’y pût loger la main dont s’étancheraient nos douleurs.
[3] Baudelaire.
Oui, ces romances où des beautés sont souvent [p. 10] recélées, et dont, ailleurs, l’inconscient comique aboutit à quelque chose de touchant comme la demi-lyre de la gravure de Monziès, cet élément Pauline Duchambge, ce bout d’écharpe envolée dont les biographes entortillent le sujet trop complaisamment, n’ont plus qu’un intérêt parasite et documentaire; et la prétentieuse brume en fond au feu de ce qu’elle abrite et qui les habite; et le ruban de Desbordes-Valmore s’en ira rejoindre le turban de Staël, les cornettes de Sévigné, les bandeaux de Sand et les bandelettes de Sapphô, dans ce vestiaire des siècles où les atours s’évanouissent, pour laisser s’épanouir, hors du temps, la beauté nue.
Elle «résout la sécheresse du cœur», Michelet l’a dit, qui, seul, a légué les formules vraiment caractéristiques de ce doux-amer génie. Elles flottent par-dessus toutes autres paraphrases et surnagent ainsi qu’une arche sur un déluge, ou tout au moins comme le manuscrit de Camoëns pouvait reluire au-dessus du flot.
Les voici. C’est avec celle sur «le don des larmes, ce don qui perce la pierre», trois autres encore: «Le sublime est votre nature.»—«Mon cœur est plein d’elle. L’autre jour, en voyant Orphée, elle m’est revenue avec une force extraordinaire, et toute cette puissance d’orage qu’elle seule a jamais eue sur moi.»—Enfin: «Je ne l’ai connue qu’âgée, mais plus émue que jamais; troublée de sa fin prochaine, et, on aurait pu le dire, ivre de mort et d’amour!»
Ces quatre paroles constituent l’évangile de Madame Valmore. Quoi qu’on puisse écrire d’elle, désormais, ne saurait que graviter autour de cette [p. 11] quadruple épigraphe succincte, synthétique, suggestive.
Tous ceux qui abordent cette mémoire et en tirent du relief sans lui pouvoir ajouter de lustre (car la seule donnée en illumine l’interlocuteur de son approche d’arche sainte), brassent la légende en quatre versets, sans paraître se douter du dessous qu’ils infligent, de ce fait même, à leurs variations et à leurs trilles.
Au reste, du contingent biographique où se recrutent à peu près ordinairement ces appendices, devrait-on même user? La grille du tombeau n’a-t-elle pas droit de suture immédiate au mur de la vie privée? L’amalgame de la personne double de l’artiste et de l’être représente un des plus déplorables postulats et l’une des plus fâcheuses exigences du public sur le mage. Les parterres insuffisamment renseignés et attentifs qui ne sauraient l’aller chercher là qu’il réside uniquement, à savoir dans l’Œuvre, exigent néanmoins (et d’autant plus!) de le toucher, sans l’atteindre, par la frange de son manteau, et, mieux encore, par l’ouverture de ses plaies, où quelque secret espoir de faire expier le mérite de l’esprit prompt, met en quête d’une tare de la chair faible...
Mais, pour nous autres, à vrai dire, qui avons démêlé, ressenti, goûté tout le parfum dans l’extrait, toute la griserie dans la liqueur, peu nous chalent des pétales froissés ou des baies flétries; plutôt nous craindrions volontiers d’amoindrir notre extase par d’inopportuns contrôles, de rétrospectifs examens sur une grappe tarie ou une fleur séchée.
[p. 12] Bien mieux, nous tiendrions de celui qu’importunent ces bravos adressés au gosier de l’interprète plutôt qu’à la sonorité éparse de son chant, et qui se recule et recueille au fond de la loge, craintif de voir attribuer le charme qui l’enchaîne encore à quelque vieux visage de ténor teint ou de cantatrice déteinte.
Les métiers, d’où vers nous chatoient les joyeuses aunes des tissus fleuris, ne sauraient se démonter qu’en bois et cordes. N’est-il pas plus sage d’oublier canuts et tisserands pour voir courir des rinceaux sur des fonds, revoir rêver des oiseaux entre leurs branchages brochés, suivre revivre et s’iriser des iris sur de la soie?
C’est elle seule la douloureuse Félicité qu’il sied interroger sur elle-même. A cette confession surtout, à cette autoconfrontation vraiment nous aident les biographies. Sachons-en gré, rendons grâces. Le plus clair de l’éloge de Sainte-Beuve ne consiste et réside-t-il pas en ces extraits de lettres où reluisent tant de familières splendeurs?
Le meilleur et le pire de ces aveux, le plus sui generis du type, le plus artésiennement explicatif et révélateur de ce moi, c’est bien cette profession de foi de son arcane poétique: «A vingt ans, des peines profondes m’obligèrent de renoncer au chant PARCE QUE MA VOIX ME FAISAIT PLEURER; mais la musique roulait dans ma tête malade, et une mesure toujours égale arrangeait mes idées à l’insu de ma réflexion.»
Hélas! nul ne s’est encore trouvé, parmi les indiscrets, pour nous révéler l’«homme d’un [p. 13] talent immense», le «fauteur de ces peines profondes...»

La vraie Valmore à édifier et déifier est une Valmore, de vers, de ses vers groupés à l’entour de son nom en la délicate élite et la délicieuse prédilection d’une dédicace réversible. La citation est ardue en ces textes. Nuls autant ne menacent de la rendre envahissante; puisque le il faudrait tout citer de cliché immémorial est ici la vérité même. Telles pièces sont plus parfaites, plus délibérément réussies, mais qu’on n’oserait guère déclarer plus que d’autres adéquates à leur visée, mieux moulées sur nature. Fût-ce les trop célèbres romances, plusieurs drôlement datées et démodées et pour lesquelles l’indulgence tourne presque à du goût. «Dans Shakspeare, j’admire tout comme une brute,» fait un dire célèbre de Victor Hugo. Dans Valmore, faudrait-il varier, j’aime tout comme une âme; d’amant? non, d’enfant. Et c’est à noter que toutes les gloses meilleures ou pires exercées sur cette mémoire, en tirent la même fascination de mise en présence de leur âme enfantine et juvénile, de leurs «jeunes annales».

[4] Ailleurs:
[p. 14] Quels doigts au velouté de pistils, quelle âme à l’haleine de calice—non de quelle Fille-Fleur, à la façon de Wagner, mais de quelle Fleur-Flamme et Fleur-Femme s’approprieraient à ce précieux labeur? Combien d’heures enchanteressement passées à parfiler brin à brin, ligne par ligne, l’étoffe de cette poésie, pour en isoler les fils les mieux aimés, les plus émus.
Voilà de ces travaux auxquels il est plus suave de penser que les risquer n’est sage. Et quel autre qu’un immatériel Ariel oserait songer à parfaire un pastel avec du pollen récolté ou de la poudre d’aile de papillon prélevée?—Et puis la grosse besogne des heures nous réclame. Puissions-nous, une fois, nous abstraire assez idéalement pour volatiliser ce sublimé, que, nul autre jour, notre âme ne saurait se doser à l’état d’exquise transparence qu’exigent ce choix impondérable, cet impalpable tri.
Le moins massivement possible, une heure, nous tenterons d’offrir une épreuve de cette mellification artiste. Mais il faudrait pour y exceller ou même atteindre, toute la courte vie d’une géniale jeune fille marquée à l’aube comme un fruit touché et dont résorberait toute la sève immaturée d’un talent condamné, cette filiale tâche de tendresse: sans rien des odieux extraits; plutôt une de ces versicolores et vétilleuses couronnes que tresse un Breughel des plus larges et menues flores doctement entremélangées autour d’un médaillon de madone.
[p. 15] L’impression qui succède à celle que je viens de dire (à savoir notre rachat par cette souffrance, notre rafraîchissement par cette brûlure, notre apaisement par cette ardeur), c’est une impression d’immersion, puis de submersion. Nous sommes noyés d’efflorescences et d’effluves, de sourires, de soupirs et de souvenirs. C’est à cet assaut par une tempête de feux et de pleurs qu’il faut sans doute attribuer l’air d’incomplet et de vague même des meilleurs essais autour de cette œuvre. Études sous forme d’articles, reprises avec ardeur, puis qu’on dirait rebutées, et qui ont de la lutte des barques contre une mer démontée, une phosphorescente mer faite de larmes et de flammes.
Après bien des reprises, je vous livre la ruse dont j’usai pour essayer de vaincre cette tempête, en enfermer dans mes outres les ouragans et les caresses, les bises et les brises pour les y retrouver à loisir, vous les distiller et vous les dire. Puisse, au nom de cet inestimable bienfait, le subterfuge ne pas vous paraître puéril, si le service vous est tant soit peu rendu.
Au cours de mes promenades et mes rêveries entre les mystérieux bocages du sentiment, de ces volumes, ainsi que les nomme prestigieusement Baudelaire, il me sembla pourtant finir par en démêler le méandre. Et ce ne fut pas sans exultation qu’en ayant tracé et dressé le plan, je le vis subdivisé en autant de charmilles et de chapelles qu’en avait taillées et ciselées notre poétesse; et que j’en fis et y fis tour à tour rentrer son multiforme génie ainsi qu’il arriva à ce Protée du conte oriental qui se réintégra en sa fiole.
[p. 16] Mais si ce livre est bocage, il est aussi buisson ardent. Océan ou forêt, l’amour y brûle et roule

suivant ses appellations mêmes.
Promise aux profondes amours selon son expression propre, l’œuvre de Marceline Desbordes-Valmore est un Univers d’Amour.

Amour, hâtons-nous de le dire, et que là est le neuf et le merveilleux, d’autant plus passionné qu’il est plus pur.
Chaque écrivain, nous dit en substance Mme Valmore dans une de ses lettres, prodigue à son insu un vocable qui, de par son intensité et sa fréquence, révèle et trahit son auteur: «Mme Sand en a un comme cela: étreindre!»—Le mot de Marceline ne serait-il pas innocence?





Cœur du cœur, l’expression qui lui est commune avec Shakspeare, et qui la mène à l’amour de l’amour comme pour redoubler sa tendresse, fournit ce vers à Mme Valmore quand elle parle de son enfant:
Donc Amour sous forme sextuple: Amoureux, amical, filial et maternel, charitable et divin. Ajoutez l’amour de la nature et l’amour prorogé au delà du trépas, vous aurez les six divisions sous lesquelles m’ont paru pouvoir se ranger toutes les phases de cette âme incoercible, les phrases de cette œuvre vagabonde. A savoir: Amour, Tendresse-Tristesse, Maternité, Foi, Nature, Éternité[5].
[5] Mme Valmore, dans son recueil posthume (ou peut-être son éditeur), a rangé elle-même ses poésies sous des appellations similaires, mais sans beaucoup de suite.
Entre toutes séductions, celle du regard fascinait Marceline. Ses propres larmes et celles qu’elle consolait diamantaient sa vie.
Le son de la voix la captivait aussi.
Les Yeux et les pleurs et la Voix subdivisent donc naturellement cette grande division de l’amoureux amour.
Tendresse-Tristesse enferme Prisons et exils, les deux misères qui l’apitoyaient le plus éloquemment, et qu’elle a le mieux pleurées.—Ipsa contient ce qui semble le plus avoir trait à la personne même de l’artiste.
Maternité, c’est la mutuelle réversibilité de ce sentiment double, ascendant et descendant au cours comme au décours de ses jeunes annales: celles où elle joue le rôle de l’enfant; et d’autres où elle porte elle-même la croix de la Mère Douloureuse.
Nulle avant elle, nulle après elle, comme elle n’aura dit et ne dira cet incessant échange, ne fera frôler et gravir en ses deux sens l’échelle de Jacob de l’amour successivement filial et maternel par les ailes de tant d’expressions ingénieuses, caressantes et pures, pour parler tour à tour de celle qu’elle nomme divinement
et de ceux qu’elle appelle non moins célestialement



Oui, le bréviaire de l’amour filial est révolu. Nous la devons à Valmore cette
Il semble, entre ces autobiographies d’une enfance indéfiniment évoquée, il semble que ce menu tableau lumineux de résurgence des jours premiers dont on dit qu’il apparaît au noyé près de s’engloutir, se découpe incessamment pour notre poète toujours prêt à sombrer, et charitablement l’isole des circonvolutions poignantes, le fascine et tire hors de soi. C’est le magique miroir où la Belle revoyait le foyer quitté du fond du royaume de la Bête.
Ce vocabulaire, y peut-on ajouter? J’ose dire qu’on ne saurait l’égaler. En tout cas, le surpasser, [p. 20] jamais. Centre de ce double courant de passion entre ses propres enfants et cette mère dont le souvenir, parmi cent apostrophes qui font sursauter, lui dicte cette pièce: Quand je pense à ma mère, elle-même pieuse fille et «pâle couveuse d’immobiles tourments», ainsi qu’elle se qualifie, elle polarise tous les rayons de la maternité et de la filialité, passez-moi ce terme.
Ces apostrophes, en voici:


Enfin, ce passage qui rappelle et regrette les sépultures disposées jadis au pourtour extérieur des églises:
Quant à l’éloquence de sa maternité propre, je ne crois pas qu’on ait jamais parlé avec cette nostalgie des entrailles.—Jugez-en plutôt. Récemment mère, elle se plaint de ne plus faire corps avec son nouveau-né.

Et enfin, peut-être le vers d’imagination, de sensibilité et de formule, le plus curieux de toute l’œuvre:
Foi
C’est l’amour, toujours dévorant, mais transposé et sublimé, qui fait trouver à la muse devenue ange pour l’absorption finale, la résorption rédemptrice de sa terrestre passion contrainte dans le foyer de la ferveur éternelle, des images comparables aux seules Dantesques descriptions du paradis—mais avec moins de blancheur;

et par les plus touchantes variantes de charité et de prière, de croyances et de sentiments, atteindre, en même temps que Dieu même, les plus fluides matérialisations de la pensée et du langage.
[p. 22] Nature, c’est l’amour—je dirais volontiers atmosphérique, tant le poète y fait entrer de parcelles vivantes et vibrantes du Cosmos—de tout ce qui l’entoure, et tant son art spontané met de passion dans ses paysages, comme tout à l’heure il mêlait et fondait de chaleur et de lumière dans sa tendresse qui lui faisait s’écrier:

Les deux aires de ce naturel amour sont l’Amour des fleurs.

Et l’Amour de l’eau, dont je ne crains pas de dire qu’il pourrait bien être solidaire du goût de cette tendre femme pour les larmes, si j’en crois ce mystérieux vers:
et ces autres:
que je rapproche de celui-ci, de Vigny:
L’amour de l’eau déjà attribué à plusieurs poètes par Victor Hugo, dans ce joli distique:
L’eau où Marceline voit se réverbérer tous ses âges dans cette Scarpe qui lui était, comme à Brizeux, son Ellé. L’eau où nous lirons avec elle, et sous mille formes
L’onde enfin d’où découle son rythme.
auquel ne peut plus succéder que l’amour du silence, sa suprême passion[6]:

Ce silence qui nous mène à la dernière de ces divisions, si vous le voulez, factices, mais, certes point arbitraires: la mort, disons mieux: l’ÉTERNITÉ puisque c’est sous ce consolant aspect qu’apparaissent à Mme Valmore tant de tombes qu’elle a mélodiquement enguirlandées.
[6] Silence qu’elle ne veut même plus rompre par l’écriture: «n’écris pas!»




«Abîme à franchir seule!» cette définition en commun, cette fois, avec Pascal,
et la mort qui couronne son œuvre de vie, comme elle couronne toute vie, n’apparaît jamais hideuse à notre poète, mais toujours fleurie et touchante, puisqu’elle lui rouvre tous les paradis pleins de ses anges envolés. Tous les êtres aimés, sans oublier l’être aimé, voire à commencer par lui (selon une magnifique interpellation: Croyance); «Albertine, âme en fleur!» et d’autres amies de jadis; et cette noble tige maternelle, enlacée, cette fois à l’éternité, auprès de ses enfants enfuis:

[p. 25] Non, jamais rien de plus sereinement détaché, de plus véritablement et vénérablement sur le seuil, et déjà presque au-delà, n’a su se proférer pour nous parler de la mort, avec ce que j’appellerai une pareille liberté d’allures mortelles; nous apprivoiser avec cette «cueilleuse d’âmes» qui


Ainsi catégorisés les termes d’association de ces divers sujets d’inspiration, il nous sera utile—et plus facile de grouper les rythmes dont le poète les revêtit. Jamais de poème à forme fixe. Muse bien trop débordante, déchaînée avec résignation mais tumultueuse et torrentueuse—pour se ranger à si étroites digues, la muse à la fois digne et familière qui ose risquer cette déclaration à la Vierge:
[p. 26] Je distingue une première sorte ou famille de pièces, divisées en strophes, le plus souvent de quatre hexamètres (quelquefois plus; rarement de distiques). Pièces d’ordinaire peu étendues, mais d’allure large, sans doute les plus parfaites, presque en forme de menu poème à forme fixe pour soi, et pleines à leur manière de l’immortelle vibration du
de Victor Hugo; sans le charme ou le discrédit que confèrent à d’autres de ces poésies, des passades de rythmes non suivis, de vers irréguliers entrecoupés fortuitement, bizarrement, dithyrambiquement.
A cette première famille ressortissent La vie et la mort du ramier, Renoncement, La couronne effeuillée, etc., etc.; et de plus longues, Le mal du pays, Tristesse, Départ de Lyon, etc.[7]. J’énumère dans une note les titres des principales pièces englobées par chacun de ces groupements. L’auteur n’excelle point aux intitulés. Les siens (loin de cet art du titre qui nous semble devoir être fait d’un mot synthétique, jamais renouvelé au cours de la poésie qu’il désigne), les siens, dis-je, sauf parfois [p. 27] quelque douce ingéniosité d’ailleurs empruntée, telle que le Soleil des morts pour la Lune—ne contiennent que l’appel ou le rappel du sujet, sans dédaigner Simple Histoire ni même Merci mon Dieu! La croix de ma mère—qui n’y est point—s’y fût-elle rencontrée, qu’on en eût presque pu rapporter la vieille trouvaille à cette loi de Baudelaire: «Beauté du lieu commun.» Car n’est-ce pas du fait de cette beauté trop prisée que le lieu commun est devenu tel; mais qu’il porte en soi la force ou le charme de vaincre cette période de profanation, et le voilà promu lieu éternel.
[7] Prière pour lui.—Point d’adieu.—Pressentiment.—Le billet.—La vallée.—L’attente.—Amour.—La jalouse.—Je ne crois plus.—Abnégation.—Une fleur.—Les fleurs.—Amour et charité.—A celles qui pleurent.—Dieu pleure avec les innocents.—Dors.—Le mauvais jour.—Veillée.—Un moment.—L’Églantine.—A Madame ***.—Madame Emile de Girardin.—Dans la rue.—L’absence.—Les roses de Saadi.—La jeune fille et le ramier.—La voix d’un ami.—Le secret perdu.—Au livre de Léopardi.—L’esclave et l’oiseau.—Le nid solitaire.—Un ruisseau de la Scarpe.—Inès.—Loin du monde.—Hippolyte.—A une mère qui pleure aussi.—Quand je pense à ma mère, etc.
La Fileuse et Rêve intermittent d’une nuit triste quoique non en hexamètre pourront ressortir à ce groupe.
La strophe large, abdiquant l’hexamètre, s’allège et se familiarise, comme dans l’Élégie à Pauline Duchambge. Et c’est alors une autre veine où la précieuse élégance des Émaux et Camées, comme dans Un arc de triomphe, s’allie au virtuose esprit des Rues et des bois pour procréer un second groupe, dépendant du premier, qu’il égaie et subtilise[8]. Un troisième naît du mélange de l’hexamètre et de vers plus légers, toujours également disposés dans des strophes régulières. C’est Un billet de femme, le Soleil lointain; mais cette forme sert tout aussi souvent des poèmes de la seconde famille[9].
[8] Le rossignol et la recluse.—Les amitiés de la jeunesse.—Plus de chants.—Le billet d’une amie.—L’amour.—L’aumône.—Retour dans une église, etc.
[9] Croyance.—Ame et jeunesse.—Prison et printemps.—Jeune fille.—Qui sera roi?—Une lettre de femme.—Cigale.—L’innocence, etc.
Joignez-y les pièces en hexamètres[10] non divisées [p. 28] en strophes (Avant toi, La Fleur d’eau, L’Augure, etc.), et enfin celles où se faufile, puis se glisse et s’irrue le vers irrégulier, quelquefois un seul dans toute une longue pièce, comme dans La Maison de ma Mère, A mes Sœurs, Au Poète prolétaire, et ce sera (surtout de par ces dernières, les plus nombreuses)[11], la famille complète des poèmes plus ou moins descriptifs.
[10] La nuit.—L’isolement.—Le message.—Plusieurs élégies et des dialogues.—Le regard.—Les deux peupliers.—Révélation.—Pitié.—Détachement.—La crainte.—L’impossible.—L’éphémère.—Le convoi d’un ange.—Au médecin de ma mère.—L’hiver.—Au revoir.—Les roseaux.—L’augure.—La ronce.—L’Église d’Arond.—A madame A. Tastée.—Amour.—Prière pour mon amie.—A l’auteur de Marie.—Le soleil des morts.—Le Dimanche des rameaux.—L’ami d’enfance.—La jeune comédienne.—Une ruelle de Flandre.—Laisse-nous pleurer.—Les prisons et les prières.—Au citoyen Raspail.—L’amie, etc.
Et en vers plus brefs: Son image.—Les deux ramiers, etc.
[11] L’arbrisseau.—Les roses.—La journée perdue.—L’adieu du soir.—L’absence.—La fontaine.—L’inquiétude.—Le concert.—Le billet.—L’insomnie.—L’imprudence.—La prière perdue.—A l’amour.—Les lettres.—La nuit d’hiver.—L’inconstance.—A Délie, etc., etc.
Voici ce que, dans une étude précédente, abandonnée, me suggéraient ces entraînants irréguliers employés par Mme Desbordes-Valmore, avec, en une verve différente, un bonheur parfois égal à celui de La Fontaine: «Un réseau de poèmes moins ordonnés, mais dont les beautés partielles sont peut-être les plus ad imaginem de cette âme. Quand il est bien frappé un vers de cette lyre, suivant la banale expression, cette fois ennoblie, est si intense qu’il se suffit à lui-même, et presque ne pourrait qu’être gêné par le voisinage d’un aussi puissant. Il y aurait superfétation, étouffement, comme sur de ces orangers replets et redondants qui ressemblent à de vastes boules de senteurs, encombrés, presque incommodés qu’ils [p. 29] peuvent être à la fois par plusieurs sortes et règnes de végétation et de poussée: feuilles, fleurs, fruits nouveaux—et jusqu’à des fruits de deux ans s’assurant plus de suavité et de saveur d’un second retour de sève!
Cette clairière de poèmes moins touffus, plus aérés par l’étirement ad libitum de la pièce, parfois le vers libre intromis avec une aisance qui, chez tout autre, serait licence, mais ouvre là visiblement comme une prise d’air pour une poitrine oppressée, c’est le vrai champ d’évolution, la vraie aire de Valmore. Pas de dilettantisme exquis comme de l’y voir et suivre, voler, volter, courir, sourire, mourir... et se reprendre tout innocemment, inconsciemment, d’eurythmie native et d’ingéniosité ingénue, d’où ses compositions héritent ce galbe unique de complication naturelle et de simplicité si précieuse.
C’est là que sur la piste infailliblement originale jusqu’en la banalité, et captivante même en la niaiserie, éclatent avec plus de miracle, se détachent et s’isolent de ses prouesses consacrées inégalables par l’arbitre de ces tournois comme le juge judicieux de toute théorie d’esthétique: j’ai nommé Charles Baudelaire.
La deuxième famille est toute chantante: ode ou cantique, berceuse ou romance. L’auteur y englobait modestement toute son œuvre: «Quelques chansons méritent-elles que l’on s’occupe de moi et que l’on m’admette au livre de la science?»
L’Ode, c’est Au soleil, Au Christ, Chant des Mères, les Oiseaux, etc. Le Cantique, c’est Prière des orphelins, les Enfants à la communion, etc. Les deux [p. 30] Berceuses sont spécifiées telles par leurs titres: Dormeuse et Pour endormir l’enfant. Et il n’y aurait aucunement lieu d’être surpris d’apprendre que cette naïve inspirée qui nous avoue: «La musique roulait dans ma tête malade, et une mesure toujours égale arrangeait mes idées à l’insu de ma réflexion...» d’apprendre enfin qu’elle n’aurait composé ses Dormeuses que pour avoir trouvé leur rythme et leurs rimes, leur matière et leur manière tout simplement les mieux aptes à faire descendre le sommeil.

Pour les romances qui ne sont point toujours celles que le poète a étiquetées ainsi, et dont les plus belles concertent souvent ailleurs, elles sont sans nombre—rarement sans agrément, souvent pleines d’envol.
Sur ce sujet de Madame Desbordes-Valmore, j’ai lu les articles et le volume de Sainte-Beuve, un article de M. Montégut (remarquable par un juste tableau de l’isolement de cette mémoire), la préface de M. Lacaussade, l’appendice de M. Hippolyte Valmore. Tous travaux intéressants à des valeurs inégales, nourris de faits un peu répétés, de documents [p. 32] similaires, d’appréciations simultanées, néanmoins éloquents, utiles et nobles. Le volume de Sainte-Beuve est non seulement un bel acte, mais une bonne action. On y sent du cœur et de l’amour. Après qu’on fut tenté de trouver fastidieuse l’énumération de tant de noms vains et obscurs, l’idée qui la suggère au Maître critique apparaît touchante: «J’avais songé, dit-il, par une compensation bien due à réunir d’autre part autour d’elle, quelques-uns des noms dont elle eût le plus à se louer, bon nombre des êtres bienfaisants et secourables qu’elle avait rencontrés sur sa route et qui lui avaient été une consolation, une douceur et un réconfort au milieu de ses maux.»
Je pense de même que, pour en faciliter l’étude et relever l’éclat, il serait désirable de rassembler en un seul ouvrage tous les articles et études jusqu’à ce jour consacrés à cette poétique figure.
L’émouvante correspondance révélée par le livre de Sainte-Beuve pourrait aussi en être extraite pour s’unifier, se compléter.
Les brèves pages de Dumas, de Baudelaire, de Banville et de M. Verlaine ouvrent des appréciations plus subtiles. Et le sentiment du second, dans son expression incisive et pénétrante me paraît encore, pour le moment, le plus satisfaisant et le mieux venu.
La résultante de lecture de tous ces beaux essais demeure l’étonnement, non de la méconnaissance, mais de l’ignorance publique du détail d’une gloire ainsi révolue, puis résolue; enregistrée et muette: une renommée sans buccin.
[p. 33] Gloire, Lamartine couronnait déjà du mot Marceline attendrie et confuse. Et pourtant Baudelaire a beau se révolter et nous crier justement: «oubliée par qui, je vous prie? par ceux-là qui ne sentant rien, ne peuvent se souvenir de rien.» M. Verlaine lui répond avec non moins de justesse: «obscurité apparente, mais absolue.» Et c’est un si indéniable fait, au sortir de notre étonnement, qui nous sauve du scrupule: comment oser tenter d’accroître une illustration si faite et si parfaite?—C’est parce qu’elle est ainsi, décrétée et accréditée par ces grands qui la goûtèrent... et moururent, mais forclose à qui aime mieux croire qu’aller voir, surtout au prix d’un peu d’étude; et pourtant toute pleine de ce qui parle à tous par l’humanité poignante, brûlante et pleurante, qu’il faut s’efforcer de rompre et ce silence et cette digue, de livrer à ce gave bienfaisant de charité dans la mort comme durant la vie, bien des âmes désolées à irriguer et rafraîchir, bien des âmes dévorées à ensoleiller et consoler.
Toute œuvre, si grand et légitime qu’ait pu en être l’éclat du vivant de l’auteur, n’existe vraiment qu’à dater du jour où le silence mortuaire l’ayant ensevelie comme d’une lave refroidie, une curiosité éclairée et pieuse en vient retrouver les fragments qui survivent aux éruptions et aux cataclysmes. Et la vraie vie des ustensiles d’Herculanum n’est-elle pas sous les vitrines où la disponibilité et la sinécure de leur silhouette sans usage nous versent à voir et à boire tant de rétrospective rêverie. Œuvrons donc de notre mieux pour coopérer au livre que requérait Sainte-Beuve quand il [p. 34] écrivit: «Je ne fais qu’indiquer ici un développement qui sera mieux placé ailleurs, et dans le livre que je sollicite.» Car c’est encore le propre de la contagieuse ardeur née de cette œuvre, que chaque nouvel adepte brûle d’en voir propager le rayonnement, et convoque dans le présent et dans l’avenir quiconque peut contribuer à l’étendre.
Mais ce livre tel que le sollicitait l’illustre critique, n’est sans doute point faisable. Quel portrait écrit ou peint fût-il réalisé jamais qu’au fur des momentanéités de l’individu successivement saisies et fixées? Ce livre, ce sera le souhaitable assemblage des études et des articles tout à l’heure évoqués, lorsqu’il y en aura eu encore beaucoup d’autres, toujours et tous beaux, au moins de leur inclination et de leur visée.
Ce qui me surprend un peu, particulièrement dans Baudelaire et chez M. Verlaine, c’est l’exagération de ce reproche: le manque de forme, le vice de forme, le contenant du revêtement inégal au contenu du rêve. Je cite les textes de ces deux rhéteurs: «Tout ce qui lui manque de ce qui peut s’acquérir par le travail... négligence... cahot... trouble... parti pris de paresse,» réquisitoire du premier. «Une langue suffisante et de l’effort assez pour ne se montrer qu’intéressamment» ajoute le second déjà moins injuste, et plus loin reconnaissant à cette muse la priorité de rythmes inusités.
Certes, j’entends comme ces maîtres l’entendent, et me fais fort de renchérir où il sied; mais là, je m’insurge. La conclusion de M. Verlaine est exacte, mais peut-être pas assez ponctuelle. «Sublime [p. 35] artiste, sans trop le savoir,» c’est possible; mais aussi, et, je veux bien encore, sans le savoir, merveilleux virtuose. Guère de malignité, presque de rouerie poétique qui n’ait été inventée ou appliquée par cette innocente. L’allitération, ce ressort du vers, son élasticité et sa vertèbre, en même temps que sa pulsation et sa respiration, la circulation de sa vie depuis sa tête jusqu’à sa rime, l’allitération revêche aux balourdes plumes, exquise à la fine pointe des styles, dont aucun des élus ne l’a négligée sous peine de priver sa poésie du plus idéal de ses trucs et de la plus élégante de ses ailes, l’allitération chère à Virgile et surtout à Catulle ne pouvait tirer de plus ingénue justification que de sa génération spontanée en cette prosodie réputée originelle.






Oui, il semble que ces versatiles registres vont des vers tout âme par les vers tout nus jusqu’aux mieux ornés.
[p. 36] Qu’est-ce en effet que ceci:

[12] Des enfants.
Non seulement je ne reconnais pas là de date impliquant et infligeant vis-à-vis d’une génération intermédiaire, avant définitive consécration, le discrédit du passé de mode; mais j’y démêle de ces caractères d’éternellement déroutant qui ne permettent jamais de ne plus être de l’avenir.
Exemple:
N’est-ce pas bien le contraire de ce qu’on allait dire, qui eût été banal, et qui se transforme? Tout comme en cet autre:
Que langage eût été moins beau!
J’étendrai jusque-là mon avocasserie de signaler, hors de toute inculpation de pastiche et de plagiat de part ni d’autre, mais du seul fait d’une de ces fréquentes réverbérations de pensées, sans enquêtes de dates, et rien que pour faire ressortir toute l’étendue de ces vocalises, des parités d’inspiration de notre poétesse à de ses grands contemporains comme à de leurs brillants neveux. Que dis-je? Combien, de coupe et de couleur, répercute en ma mémoire classique l’illustre strophe:
cette invocation:
Mme Valmore est vraiment le seul poète dont on puisse parfois inventer les pensées sans les connaître et répéter les formules sans les avoir ouïes, parce que sa vision—disons sa voyance—allait cueillir les formes dans le lieu même des idées éternelles,
que même les plus inspirés d’entre les poètes appesantissent en les revêtant fût-ce des plus nobles rhétoriques terrestres.
De là vient que la poésie de cette muse, maintes fois exprime l’ineffable où, selon un de ses vers les plus divins:
Certains de ses morceaux ne rencontrent que dans Hugo leur équivalent de souffle et d’allure. Soit le Soleil lointain qui, par places, m’apporte comme un fraternel écho de A Villequier:

me reporte aussi vers la Claire du même Maître, que me rappelle ailleurs lointainement
et plus proche
avec enfin
[15] Ailleurs:
Mais la Mise en liberté de Hugo, encore, ne s’envole-t-elle pas tout entière de cette strophe troisième de l’Esclave et l’Oiseau:
Oui, chez le Grand-Maître et le Grand-Père seulement se retrouvent des pièces de la tournure de Croyance, Prison et Printemps, l’Enfant et la Foi, Au Revoir, aux Nouveau-Nés heureux, Ame et Jeunesse, Jeune fille.
n’est qu’une variation probablement anticipée du
que Hugo reprend lui-même à son Hernani sous cette forme:
Son:
qui n’est autre que l’antique
s’énamoure plus d’une fois chez notre Flamande:
Et mieux:
Tel que Marion de Lorme de son Didier, l’enfant répond, de son ramier: «Je l’aime!»
et
sont de véritables vers d’Hugo. Combien Le Pauvre a de lumineux frères dans l’œuvre d’Olympio!—Je rapproche encore:
de
Ensuite
de
Enfin
de

O Éva[20]
voici un écho de ta plainte pourtant sans seconde:

[20] Vigny.
[p. 41] Un Arc de Triomphe avec ses
n’offre-t-il pas, le paradoxe est fort: quelque mine des Émaux et camées?
Qu’est-ce que
sinon
[21] Lamartine.
ou réciproquement?
n’irait-il pas jusqu’à évoquer Celle qui est trop gaie elle-même? Pourquoi non? puisque du même Baudelaire pourrait s’échanger contre
son plus nerveux et verveux
Et, de nos jours
tinte bien le chant des oiseaux des courts étés, de Sully-Prudhomme.
Et pour finir, n’est-ce pas comme une surprenante [p. 42] résonnance préventive du lied de Tristan dans Wagner, cette dernière strophe du Dernier rendez-vous.
[22] Alors nous serions morts inséparés, unis à jamais, sans fin, sans réveil, sans crainte, sans nom, dans le sein de l’amour, livrés à nous-mêmes, ne vivant plus que par l’amour.
Wagner.
Il faudrait bien, bien des pages, encore et toujours des pages pour désenfiler toutes les blandices, Baudelaire l’écrit: les perpétuelles trouvailles de cette poésie. Même sans parler de ses curiosités pittoresques de locutions ou de métaphores, telles que,


Je dis, de cette poésie aux énoncés si touchants et toujours imprévus; de ces hirondelles qui sont
[p. 43] non loin de ce rossignol qu’elle dénomme:
de ce bal qui tourne
de ce médecin de la maison de sa mère, ce docteur ami à qui l’auteur écrit
de ces fillettes dans un décor de nature qui s’enjolive d’un vocabulaire de mobilier vieillot:
Si féerique mirage que peut-être je ne lui préférerais rien, s’il n’y avait encore, et sans doute par-dessus tout, ce poignant poème en trois strophes si tendrement murmurées autour d’un pénétrant sujet de psychologie maternelle, plus tard réalisé par Georges Rodenbach dans son subtil roman La Vocation.—Un sujet dont un équivalent plus spécieux m’avait dès longtemps moi-même tenté, et dont je trouve, dans mes plus anciennes notes, ce schéma embryonnaire: L’étrange jalousie sentimentale, [p. 44] quasi amoureuse qui vient à de certaines mères fort honnêtes, à propos de leur fils récemment pubère, constitue une douleur hybride d’un genre saintement incestueux, qui fut épargnée à Notre-Dame des Sept-Douleurs en foi de quoi on la pourrait dénommer le Huitième Glaive.
Ce commentaire, point par point, fleur par fleur, pleur par pleur, perle par perle, devra être [p. 45] l’œuvre d’un autre, je voudrais du prochain des coryphées de ce chœur qui se fera longtemps gloire et joie d’exalter cette unique muse. Je fais seulement remarquer ici, en passant, la noblesse dont elle sait empreindre l’usage familier du mot Madame[23]:



[23] Victor Hugo seul, spécialement dans son superbe sonnet à Mme Judith Gautier, en a fait un titre aussi vraiment royal.
[24] La Reine Marie-Amélie.
Puisse mon travail d’aujourd’hui faciliter la suite que je lui désire, de par cette classification[25] que je revendique, et que je crois utile et bonne; elle n’était guère plus aisée que celle dont parle le conte de fées, de ces duvets de mille couleurs [p. 46] emplissant une chambre, et qu’il s’agissait de répartir et de trier. La princesse y parvint pourtant; non, à vrai dire, sans des secours féeriques, qui, je crois bien, ne m’ont pas fait défaut. Les fées existent toujours. C’est un blasphème que de n’y point croire. Elles s’en vengent en ne secondant que ceux qui les en prient.
[25] Effectuée avec la plus minutieuse application dans un mien précédent travail, trop long pour être ajouté à cet essai.
Le temps, je le répète, qui sculpte et polit, selon leur dureté et leur beauté, ce que nous lui laissons de nos œuvres, ainsi que le flot fait des rocs et des falaises, respectera, chaque jour davantage, l’œuvre dont nous nous entretenons. Il le témoignera en en déblayant les entours et facilitant les approches, quand il aura découvert et compris que ce qu’il prenait pour une fragile et friable grève était un marbre, et que ce marbre fût ciselé par la nature et l’art associés, à l’égal d’un de ces monuments aux si capricieuses arabesques, qu’ils ne paraissent point bâtis de main d’homme, mais éclos, en une nuit, de quelque rêve, en guise de palais d’Aladin.
Mais s’il fallait qu’un détestable et imprévu désastre détruisît l’œuvre en n’en laissant subsister que les parcelles que je vous soumets, l’avenir, je n’en doute pas, se pencherait sur elles, tout comme nous faisons sur les vers isolés de ce Publius Syrus et de cette Sapho qui avaient écrit tant de mimes et de poésies dont il ne reste que des débris et des fragments pareils à des pulvérisations d’étoiles.
Ma collection, c’est un herbier—immarcescible. Je l’ai fait sans presque y songer, aux coups pressés d’une lame émue qu’annotent, les touches rapides [p. 47] d’un crayon sensible de fasciné. Plus d’ordre et de mesure, de pause et de dosage dans le choix sont malaisés et dangereux devers cette poésie fugace, et risquent toujours l’excès ou le manque. La fleur se fond en rosée ou s’enfuit en papillon.
C’est ma cueillette. Le massif, qui est une forêt mouillée, de combien de larmes! peut fournir cent autres bouquets renouveaux et surdivers au gré du style qui rédige et du cœur qui dirige.
Oui ce sont fleurs dont la sève est de sang et le rorate de larmes. Pleurs et Fleurs dont l’inconscient virtuose n’a su oser que partiellement le magnifique titre, devrait être celui de son édition ne varietur. A cette double source, le reproche encouru de monotonie n’est-il pas vain? Le chacun son métier, pour notre ouvrière se résolvait en larmes.
Son œuvre est un éloge des larmes. Celle qui cessait de chanter Parce que sa voix la faisait pleurer, ne devait-elle pas rencontrer les plus bouleversants des accents tracés?...
Moi, je me récuse, ou plutôt, j’abdique. A d’autres;
que si l’on requérait pourtant ceux des vers de Mme Valmore que je distingue par préciput sans omettre certains cris tels que:
[p. 48] Et:
j’élirais entre beaucoup


Exegi. Je conclus et clos ces pages qui ont du moins pour elles de ne pas ouvrir par «Marceline, Félicité, Joséphe... naquit à...» et sauves, j’espère, du vernis souvent un peu boursoufflé des faiseurs d’exégèses qui semblent croire qu’ils décorent le sujet—au lieu de s’en couronner.
Et je signe... cette critique? Dieu m’en garde?—Ce cantique?...—Je le voudrais!

Une dernière réflexion pour finir:
D’abord disons que ce qui précède n’a trait absolu qu’à l’édition Lemerre, et que les extraits en sont prélevés; cette édition étant, jusqu’à ce jour, la seule sur laquelle se puisse exercer une vue d’ensemble un peu intégrale. En cela, nous devons trop à son éditeur pour pouvoir que le remercier. Nonobstant, et grâce à ce zèle communicatif qu’engendre l’œuvre de Mme Valmore, il y a lieu de croire que les éditeurs aussi se relaieront dans le futur pour assurer toujours plus d’ampleur et d’envergure au geste entier de la poétesse.
Mais il sied aujourd’hui de constater un fait: [p. 49] l’édition n’est pas complète. Et puisque le bon goût qui y présida ne fait pas de doutes et que, d’autre part, d’importants fragments, voire de fort belles pièces en sont absents, il y a lieu d’attribuer cette lacune à une émotion filiale éliminant de parti pris tout ce qui lui semblait trop avoisiner cette double flamme; d’abord la passionnelle, déterminante de tout cet embrasement; puis la purifiante par le feu scrupuleux et sacrilège de quelque vengeur enfer de vertus:
et
voilà les deux notes qu’il s’agit, sinon d’étouffer, d’assoupir du moins.
Qu’un pareil ange, selon le mot de M. Verlaine, se montre plus ou moins timoré, bourrelé même, ce n’est qu’une aile de plus dont la candeur et la splendeur (plutôt que se voiler de silence imprudent et de réserves irrévérencieuses) doivent éclater en la pleine lumière de ce feu, lui-même générateur de tout ce buisson ardent, et si solidaire de l’amour divin qu’il ne saurait que refleurir et tout droit, en paradis.
Profession de foi qui va jusqu’à ce radieux blasphème:
La figure de Valmore, loin d’être définitive, [p. 50] s’ébauche à peine. Son œuvre est de celles dont la méconnaissance du vivant et l’oubli au sortir du trépas composent les deux premières phases d’engendrement naturel à la postérité; et qui, pour atteindre leur plein degré de manifeste et d’influence, doivent être retrouvées, ainsi qu’une Pompéï ou des grains de blé endormis renferment des germes de moisson en puissance. Rougir pour cette plaintive sublime amante du feu qui la dore, serait d’un culte inéclairé, sinon d’une offense aveugle. La suprême, décisive et impérissable Valmore doit entrer:
dans le temps et l’éternité, je l’ai dit au début, en Anactoria chrétienne, en Francesca pardonnée illuminant de son idolâtrie innocentée et couronnée un Phaon inconnu, un Paolo mystérieux de qui toute la gloire est d’avoir allumé cette ardeur dont elle résume la foi et le dogme dans sa magnifique Croyance:
J’augure un autre travail de réparation, de répartition et de décor dans la future réunion des lettres déjà publiées, entre elles, puis à d’inédites[26]. On en tirera une autre clef de ce cœur; clef de cloître, clef de voûte, ou du moins clef musicale [p. 51] revêtant bien, cette fois, la délicieuse définition de Shelley: Clef d’argent de la fontaine des larmes.
[26] Ce désir a reçu, depuis, d’importantes réalisations.
Mon désir d’encadrer un poème manuscrit de celle que je vénérais me mit d’abord en possession d’une ou deux de ses lettres dont le nouveau filon d’attendrissement auguste me rendit insatiable jusque-là de me faire successivement acquérir une centaine de ces autographes (que j’ai le bonheur de posséder aujourd’hui[27], et dirai-je pour quel gros chiffre menu qui rendrait surprises et confuses autant que le purent être certains dessins de Millet, si les choses qui ont des larmes ont aussi des sourires), ces mêmes lettres qui attendaient le départ, quelquefois de longs jours, toutes écrites, faute de l’affranchissement de leur timbre?
«C’est un affreux malheur, mais le plus beau malheur possible,» écrit quelque part Vigny. Propre chanson pour l’air de cette correspondance, indiscontinûment variée sur le leitmotiv plus ou moins lancinant, toujours détaché et digne de ce qu’elle y baptise elle-même son parfait tombé d’espoir. Lisez encore: «Le malaise que je traîne après moi dans tous mes vœux déçus.» Et plus grièvement: «Les peines, la terreur, l’humiliation ne tuent pas, et je vis enfin à travers des choses bien blessantes et que j’aurais jugées mortelles.»—«Je ne voudrais pas que mon sort changeât au prix de certaines démarches suppliantes qui me rendraient les douceurs accordées d’une amertume douloureuse.»—«Je retourne à souffrir,» concluait-elle dans une lettre déjà éditée.
[p. 52] Ces deux vers de l’auteur devraient épigraphier sa correspondance où l’on sent à chaque ligne une spirituelle et naturelle allégresse prête à éclore, refoulée par cette trop prochaine ondée des larmes, pour les siens, pour les autres,—ah! que si rarement et discrètement pour soi! Et cela sans jamais de ton pleurnicheur ni même larmoyant, en une aussi haute allure de style que d’attitude non voulue et du seul fait d’une nature fière avec modestie, humble avec noblesse.
Ajouterai-je que plus des deux tiers de ces lettres ne sont que de jolis placets implorant secours pour plus pauvre que soi? Il semble, et l’épistolière le dit, que l’expérience toujours plus aiguë et raffinée du malheur, n’ait pour effet que de la gagner plus effectivement et affectivement aux endolorissements d’autrui.
De ces pages, il y en a pour de ses amis Tripier-Lefranc, Derains, Nairac, Branchu, etc., puis à des illustres: Dumas, Auber, Chaix d’Estanges, etc., en lesquels son inlassable zélation rencontre des aides. Presque chaque épître enveloppe, disons entortille d’une grâce qui se fait chatte quand il s’agit du bien du prochain, un petit drame de misère adroitement présenté au profit d’un nouvel inconnu; de quelle grâce variant à l’infini la courtoisie des formules polies et jolies bien savoureuses et surprenantes à relire en notre ère de lettres de quête autographiées et pas même signées de la main de la demanderesse.
Voici d’abord des extraits, de mélancoliques, de spirituels:
Ici, madame, tout s’absorbe jusqu’à la mélancolie. C’est un [p. 53] mot élégant qui ne passe pas dans une ville de commerce, et vous êtes bien bonne de l’avoir lu sur ma figure.

Allez, monsieur, je sais beaucoup de vos peines, et si vous allez sur ces tombes d’amour et d’amitié pour être entendu, dites-moi quelque chose, je l’entendrai, je crois, car en vérité, la vie est souvent triste et isolée comme la mort.

Que je vous sais gré d’y être pour vous mêmes (à Paris), car enfin c’est encore là où on peut choisir ce qui convient le mieux aux goûts de l’esprit et de l’humeur. Ici (à Lyon) il faut prendre de la boue et des rubans, des rubans et de la boue, c’est la carte. L’autre printemps, c’était... affreux; des boulets et du sang, du sang et des boulets. Il m’en reste un horrible souvenir dans l’âme et dans les nerfs.

Monsieur Dutillœul me dit encore d’obtenir que Bra écrive au maire qui l’aime beaucoup; je n’oserai le faire de mon côté que si mon cousin m’appuie, car cela me paraît bien hardi pour une femme d’écrire à un maire, et de demander des grâces.

Sachez que je viens de recevoir un programme de la fête de Gayant. Il sent le gâteau, la bière et le jambon, j’ai eu presque faim en le lisant, et il y a bien longtemps que je n’ai eu faim.

Vous m’avez honorée d’un témoignage de votre amitié, beau pour toujours, cher Monsieur. Vous savez que c’est à cette seule condition du pour toujours que mon fils adorait la pomme ou les bonbons que je lui donnais.

Vos confitures ont-elles réussi? Moi je manque toutes mes romances.
Puis, intégralement une de ces belles et simples suppliques de recommandation.
[p. 54]Madame,
Je commence par vous demander humblement pardon d’une démarche qui n’a d’appui que votre extrême bonté.
Si vous vous étonnez, madame, que sans avoir l’honneur d’être connue de vous je me sente assez de courage pour recommander quelqu’un à votre sérieux intérêt, vous penserez avec raison qu’il faut avoir entendu sur votre caractère un récit bien encourageant pour avoir enhardi jusque-là mon humilité.
Il a été dit devant moi que M. le Duc et Mme la Duchesse de Luynes n’avaient pas encore arrêté le concierge qui doit garder prochainement leur nouvel hôtel.
Si j’étais assez heureuse pour que le pur motif d’obliger une honnête famille me fût inspiré par la Providence, qui se sert des plus faibles quelquefois pour ses desseins d’ordre et de charité, je me féliciterais d’avoir à signaler à Mme la Duchesse les nommés Roblin, concierges de la maison d’assurance et de gaz, rue de Richelieu, no 89. Cette vaste maison devant être prochainement démolie laisse un père de famille très probe et très intelligent à la triste liberté de chercher un autre asyle. Les répondants les plus graves et les plus honorables viendraient à l’appui de mon humble supplique près de Mme la Duchesse, et justifieraient avec empressement les premières paroles portées jusqu’à vous, madame, par votre plus humble servante.
Mme Desbordes-Valmore.
89, rue de Richelieu.
Ensuite deux lettres, deux placets à Alexandre Dumas. On en admirera le tour fémininement fraternel.
Lyon, le 29 mai 1835.
Je saisis, à travers une pluie d’orage, la bonne et belle occasion de me rappeler à vous. C’est pour vous rappeler que vous venez d’être encore pour moi aussi bon, aussi obligeant que si je le méritais. Je ne peux pas vous dire combien je vous sais gré d’être obligeant comme un enfant pour les enfantillages de tous ces hommes mûrs a moustaches noires ou grises. Ce brave Algérien eût été bien heureux de vous devoir (après son sabre) le bouquet de cerise qu’il voulait remporter à sa boutonnière; mais il m’a avoué qu’il était aussi fier de vos démarches pour lui et de votre accueil, que du ruban qu’il croit mériter. Que je vous aime donc de l’avoir consolé! et que j’ai à cœur votre gloire, votre bonheur en tout! Je vous conjure d’y travailler, [p. 55] de nous jeter vos fleurs, vos Christine, vos âmes de femmes qui doivent vous étouffer. Donnez-moi la joie de vos succès, car je vois bien que je n’en aurai jamais d’autres avec vous, et qu’il me sera toujours impossible de vous être bonne à rien sur la terre qu’à me faire du bien comme vous en avez pris l’habitude.
Soyez heureux!
Marceline D.-Valmore.
Paris, 16 août 1837.
Quand vous n’êtes plus là, je ne suis bonne à rien pour moi ni pour les autres.
Si vous étiez à Paris, vous prendriez par la main un charmant enfant qui n’a ni père, ni mère, et que nous avons fait entrer à l’Opéra pour jouer des petits génies et des demi-dieux ce qu’on lui fait jouer avec beaucoup de bonté, jusqu’à l’avoir admis aux fêtes de Versailles, en Mercure, ce qui l’a rendu à peu près fou de joie et de surprise. Mais les demi-dieux mangent, et depuis son admission (il y a trois mois) dans les classes de MM. Coraly, Mérante et Barré, le pauvre orphelin a reçu douze francs, pour prix de ses jolies petites jambes.—Vous le prendriez donc par la main, j’osais le penser, et vous diriez à M. Dupré, tout-puissant sur M. Duponchel, de donner quelque humble appointement à ce jeune garçon que nous avons fait monter dans la diligence sur la route de Lyon à Paris.
Envoyez-moi deux lignes de votre nom pour que j’ose moi-même chercher un appui à cet enfant. Je ne vous demande point pardon d’aller vous étouffer de mes prières. A qui voulez-vous que je demande de la bonté qui ne se lasse pas? Pas plus que je ne me lasse de vous aimer et d’être à vous de tout mon cœur.
Marceline Valmore.
Enfin cet étonnant compliment de noces:
A Monsieur Alexandre Wattemart,
Mme Valmore est allée avec empressement pour assister à la bénédiction nuptiale.
Il était près de midi. Après le temps de prier et d’attendre, nul mariage n’a eu lieu. Quelque obstacle a donc rendu, ce jour-là, Notre-Dame-de-Lorette, déserte de cette solennité, sur laquelle Mme Valmore appelle toutes les bénédictions du ciel.
Mme Valmore.
22 février 43.
DEUXIÈME PARTIE
LA FÊTE DU 13 JUILLET
«Car, enfin, vous avez déchaîné Mme Desbordes-Valmore!»—Cet élogieux reproche, qui venait, hier, m’enorgueillir, de la part d’un malicieux et spirituel interlocuteur, me faisait remonter le courant exégétique, lequel, depuis le 17 janvier 1894, charrie tumultueusement la gloire renouvelée de Marceline en ondes lumineuses et sonores entrecoupées d’étranges barrages, tels que cette incertitude autour du nom de son mystérieux ami, et diaprées de fleurs séchées ou de plumes de colombes, comme les feuillets de cet étonnant carnet de voyage, que sans doute une volonté prorogée de celle qui le crayonna, dirigeait récemment,—ainsi que la bouteille à la mer, vers l’estuaire d’une de ces respectueuses tendresses d’homme que fait éclore le culte rétrospectif de cette femme poète si amoureuse et si mère. C’est que
pour nous tous trouve un sursis dans de tels accents:
[p. 58] Le 17 janvier 1894. Mercredi sans doute mémorable au calendrier Valmore. Et comme plusieurs de mes élégantes écouteuses se vantaient d’avoir accompli, ce jour-là, en faveur de ma glose, cet acte héroïque en matière de mondanité féminine, qui consiste à déserter son jour! notre ami Rodenbach, subtil adorateur de cette poésie, concluait? «Vous avez institué le mercredi de Marceline.»
Ce jour-là, en effet, j’ose le revendiquer, j’ai pris rang parmi ses tendres exégètes, à la suite du dernier qui, à cette date, en eût écrit d’une lucide et sensible plume, de Verlaine qui m’encourageait, allègre, et—quoi qu’on en ait pu dire—bien sincèrement sympathique. Car les malignités et les quolibets ne me manquèrent pas; à vrai dire, «sans grande bonne foi plutôt,» eût dit le pauvre Lélian, et contradictoires toujours, les uns sous le prétexte que je célébrais une Muse soi-disant risible, les autres m’accusant de m’approprier une renommée déjà consacrée par de plus autorisés. Tandis que je ne visais à rien de plus que rafraîchir les fleurs et les palmes d’illustres ex-voto spontanés entrelacés autour de ce souvenir par tant de mains généreuses.
La suite a prouvé qu’il y avait encore à glaner sur le compte de la grande poétesse, et grâce à la contagieuse zélation qu’engendre une telle œuvre, puisque cette suite ne fut rien moins que les précieux et divers articles de MM. Verlaine, France, Lemaître, Rodenbach, Descaves, la correspondance de Desbordes-Valmore elle-même, publiée par M. Rivière.
Maintenant, faut-il s’attrister des réalités dont [p. 59] la publication de ladite correspondance dépoétise pour des lecteurs superficiels la figure de notre Muse? Ce serait renouveler une querelle à jamais brumeuse.
L’auteur de Bruges-la-Morte, qui voudrait nommer un curateur aux morts pour éviter des déformations et des discrédits posthumes, se prononce pour la négative.—L’auteur de Thaïs se réjouit, au contraire, des indiscrétions qui confèrent aux figures disparues plus d’humanité poignante. Et, quelles que puissent être nos appréhensions, et nos scrupules, là, sans doute, est l’acception vraie.
De même qu’il y a un corps matériel, de même il y a un corps spirituel, affirme saint Paul. On en pourrait arguer autant de la pure résultante finale des renommées. Le corps spirituel ne s’en élabore qu’à l’aide des corruptions successives pareilles à celles du grain d’où doit germer l’épi auquel l’apôtre assimile notre renaissance future et définitive, après que la mort aura été absorbée par la victoire. Résignons-nous donc aux constatations légales un peu touche-à-tout autour des phases les plus sacrées et les plus secrètes de la vie à jour de l’auteur des Élégies. Sa noble effigie ne peut que gagner à se dégager de ces scories enfin incorruptible et radieuse.
Depuis le jour où j’ai tenu à inscrire mon nom au bas d’un nouveau commentaire, tout au moins patient et passionné de l’œuvre bénie, je me suis borné à me réjouir de la répercussion en tant d’intelligentes sensibilités, de mon appel, de mon rappel. Mais je réclame aujourd’hui le rôle de [p. 60] rapporteur d’une question devenue familière, pour en résumer les péripéties et en dégager les efficacités immédiates.
Au lendemain de ma conférence de la Bodinière, un sculpteur douaisien, statuaire de talent, me venait entretenir de son désir d’ériger en la ville natale du poète une figure dont il avait ébauché la maquette.
Je passe les détails du lent avènement soumis aux plus compétentes juridictions, du projet enfin viable; de l’éclosion, sous le ciseau attentif et attendri de M. Houssin, d’une bien personnelle et poétique représentation de la Muse des Pleurs et des Fleurs, au profil éloquemment inspiré de celui de David d’Angers, et sous les atours dont la mode atténuée atteste une date sans trop l’accentuer[28].
La consécration, par deux expositions successives, des donations généreuses, enfin les efforts des comités se résolvent en l’inauguration, le 13 juillet, à Douai, du monument à la gloire de Marceline Desbordes-Valmore. Déjà les voix les plus autorisées, les élans les plus chaleureux et les plus sincères, les talents les plus puissants et les plus exquis s’apprêtent à exalter la lyre, entre toutes inspirée et vibrante, qui a chanté, d’elle-même, ces deux vers révélateurs inscrits sur le socle de notre statue:
«Car vous ne sauriez croire, affirme M. Lemaître, [p. 61] combien de bonnes âmes, en France, s’intéressent présentement à cette excellente créature.»
Et, comme pour solenniser encore et faire plus auguste l’hommage rendu à cette modeste immortelle, une voix d’outre-tombe, une voix sur laquelle la mort elle-même vient d’ouvrir les oreilles rebelles et de rallier les admirations réfractaires, la voix épurée de Paul Verlaine, fera retentir ces belles strophes inédites, dont je possède le manuscrit précieux, et que, le 21 avril 1895, il avait composées à ma requête pour embellir et harmoniser ce festival intime qu’il ne devait présider que de l’au-delà.
Certes! et il ne se trouvera pas, cette fois, d’esprit chagrin et illettré pour y contrevenir—redisons-le, avec de magnanimes ou d’autres simplement sensibles esprits, qui s’apprêtent à fêter ce jubilé de poésie; avec Verlaine qui n’a pas voulu [p. 63] mourir sans modeler, tout au moins, en ces survivantes strophes, le buste de Celle qu’il admirait entre tous, et dont la réverbération en son œuvre est à la fois directe et discrète:

C’est par cet article que je résumais dans le Journal, peu de semaines avant la magnifique journée de Douai, la campagne, j’ose le dire, par moi inaugurée en 1894. Le flacon est géant de l’encre qu’elle fit verser; le dossier volumineux des écrits qu’elle suscita. Je conserve une collection d’articles,—un véritable volume, paru de la fin d’août à la fin de juillet—et dont il est vrai de dire que se montrèrent bienveillants ceux qui furent éclairés, parmi lesquels je citerai, entre beaucoup d’autres, les noms brillants de MM. Armand Silvestre, Gaston Deschamps, Henry Fouquier, Marcel Prévost, Paul Mariéton, Edouard Comte, André Maurel, Henry Lapauze, Adolphe Brisson, Jules Troubat, Alexandre Hepp, etc. etc..., et une chaleureuse page de Mme Séverine. Toute ironie adoucie au contact mieux éprouvé de la poésie bénie, et rien d’amer ne se mêlant plus à la malice dont il serait d’un vœu inconséquent d’élaguer la plaisanterie parisienne. A vrai dire l’effort avait été considérable, et méritait cette déférence que ne marchandent point à ceux qui font preuve tout au moins d’une sincère persévérance, même d’intelligents et généreux rieurs.—Comité local à Douai, Comité d’honneur à Paris, groupant [p. 64] les plus harmonieuses lyres de la Poésie française[29], sous la glorieuse présidence du maître Sully Prud’homme. Souscriptions généreusement couvertes et fleuries d’éminents et doux noms chers aux arts, entre lesquels brillent toujours comme à toute noble entreprise ceux de la comtesse Henry Greffulhe, la comtesse de Wolkenstein, l’illustre amie de Wagner, la duchesse de Rohan, Mme Alphonse Daudet, Mme Madeleine Lemaire, la princesse de Brancovan. Mme Edouard André, etc., etc. Enfin le graduel affinement de la gracieuse figure dans les ateliers du statuaire et l’officiel avènement de l’entreprise sous de hauts et bienveillants auspices.
[29] MM. Coppée, Heredia, Mendès, Bourget, Mistral, Dierx, Mallarmé, Silvestre, Richepin, Rodenbach et le regretté Verlaine.
Une incessante vigilance, un effort continuellement maintenu sur tous les points à la fois et dont seuls connaissent toute l’épineuse responsabilité ceux qui se sont dévoués à telles fortes et délicates entreprises, avaient assuré la réussite de celle-ci qui surpassa toutes les espérances.
En effet, au jour dit:
le 13 juillet 1896, et par un soleil reconnaissant de l’ode admirable que lui dédia, jadis, l’héroïne de la fête, un train extraordinaire partit de Paris, presque à l’aurore. Dans ces wagons d’alliance il y avait nombre d’artistes élus, empressés à surmonter les difficultés pour témoigner de leur dévouement à la noble cause; des porte-parole [p. 65] insignes, d’éminents représentants de la presse, et pour la gentille apothéose douaisienne, tout un public d’élite tel que les Parisiens en voient peu, parmi lequel une particulière gratitude nous doit faire distinguer, à côté de notre éminent ami Barrès, le parfait dessinateur Caran d’Ache, l’humoriste malicieux sans fiel, dont tous agitaient comme un spirituel drapeau de ralliement la brillante affiche parue le matin même, en plein Figaro, et représentant la dernière diligence en route pour l’inauguration du monument de Marceline.
Et dès la réception à la gare par la famille Gayant, les antiques géants hérauts de ces fêtes du Nord, de ce groupe intellectuel et généreux emporté d’un élan réfléchi vers cette lointaine glorification de la tendre inspirée, ce fut l’entrée par les rues pavoisées de la ville fleurie, en un enchantement ensoleillé aux successives phases de fraternelles agapes en d’anciens palais, de représentations en des salles et dans des jardins pleins de musiques et de poésie.
L’heureux protagoniste de cette belle journée tint à honneur d’en inaugurer le déroulement et d’en préciser les origines, dans l’allocution qui suit et dont—il se fait gloire de l’affirmer, ne s’en attribuant que la joie—un accueil chaleureux y trouva et prouva dans tous ces cœurs, de flatteuses affinités, de sensibles correspondances.
Mesdames, Messieurs,
Je l’écrivais, l’autre jour, je tiens à le redire ici, je ne revendique aujourd’hui que le rôle de rapporteur [p. 66] d’une question, on peut le dire, conclue et close; close par cette inauguration comme le peut être un bracelet ou un collier par un fermoir précieux; et conclue, comme ces bâtisses où les ouvriers joyeux accrochent une gerbe de fleurs, en signe d’achèvement: conclue... par un bouquet.
Bien loin de moi, en effet, la prétention risible dont plusieurs auraient voulu m’affubler, à l’origine des événements que cet avènement couronne, d’avoir cru et voulu inventer Mme Desbordes-Valmore. Je le répète: je n’ai voulu que rafraîchir les fleurs et les palmes d’illustres ex-voto spontanés, entrelacés autour de ce souvenir par tant de gestes augustes et de mains généreuses.
Certes, on pourrait le dire—si le cœur et le génie ne s’inventaient pas tout seuls—les plus grands l’avaient inventée avant nous, inventée malgré elle! Et c’est une des plus saisissantes caractéristiques de la vie de notre héroïne (j’allais dire: de notre Sainte!) que cette modestie confuse, à tout jamais incertaine, qu’elles aient véritablement trait à elle-même, en présence d’admirations aussi sincères que magnifiques.
Au contraire, j’ai hâte de vous les rappeler ces radieux admirateurs de Mme Valmore, de formuler l’énoncé superbe et retentissant de leurs noms glorieux, de les faire éclater au-dessus de vos têtes, de les répandre, tels qu’autant d’inestimables joyaux, d’en illustrer comme d’autant de fleurs de pierreries, les roses et les palmes que nous entre-croisons aujourd’hui autour de son lierre.
[p. 67] Hugo, Vigny, Dumas, Sainte-Beuve, Gautier, Banville, D’Aurevilly, Baudelaire! Baudelaire, dont une page admirable et charmante vous sera lue tout à l’heure par un prince d’entre nos poètes: M. Catulle Mendès, le subtil Maître qui a tenu à venir tout exprès pour vous réciter l’œuvre d’un autre. Fier effacement qui nous permet de le remercier du double hommage qu’il apporte ainsi à la Grande Marceline: la page que lui a consacrée un poète mort—et immortel; et la page—sans nul doute bien exquise! que lui-même, heureusement bien vivant! lui a dédiée... dans son cœur!
Quant à Michelet, vous savez ce qu’il a dit d’Elle quand il a parlé de cette puissance d’orage qu’elle seule a jamais eue sur lui!
Cela nous permet, n’est-ce pas, de sourire de ces gens graves, ceux-là sans doute dont le penseur a écrit: «La gravité est un masque qui sert à cacher le défaut d’esprit»—qui trouveraient indigne de leur sérieux, de se sentir émus par celle qui bouleversait ce vaste génie; et qui voudraient maintenir à cette vraie muse le caractère un peu vieillot et suranné sous lequel elle fut longtemps discréditée;—tandis qu’il ne s’agit de rien moins lorsque l’on parle d’elle, que de l’un des plus purs, des plus hauts, des plus tendres et touchants génies dont l’humanité se soit honorée.
Et, pour Lamartine, on ne se lasse pas de ressasser l’anecdote à laquelle nous devons le sublime chant alterné qui va vous transporter dans une heure. Lisant, par hasard, dans un de ces Keepsakes si fort à la mode, en ce temps-là, une poésie dédiée à M. A. de L. par notre poète, l’auteur de [p. 68] Jocelyn ne douta pas que ces initiales ne fussent les siennes, et répondit, d’enthousiasme, un chant divin, à celle dont il ne connaissait que le génie et les souffrances. Elle, capable de s’élever aux plus ravissants des accents, mais non de proférer le plus ingénu des mensonges, devait bien avouer que le titulaire était un autre, et du même rythme mais d’un souffle, s’il se peut, plus inspiré, répondait, à son tour, une ode douloureusement enchanteresse.
Entre ces grands morts et les grands vivants qu’anime une pareille tendresse pour cette poésie, c’est encore un poète qui n’a pas voulu mourir sans modeler, tout au moins en de survivantes strophes que vous allez entendre, le buste de celle qu’il admirait parmi tous, et dont la réverbération en son œuvre est à la fois directe et discrète. Ce poète-là, Mesdames et Messieurs, que je le rappelle à votre respect attendri, c’est, vous le savez, Paul Verlaine!
Dans le présent, ce sont (entre autres), MM. Anatole France, Jules Lemaître, Rodenbach, Descaves qui se sont fait une gloire et une joie d’exercer autour de celle que je nomme La modeste immortelle, des talents si brillants et si divers.
Moi-même, je possède deux curieuses lettres à moi adressées; l’une de Dumas fils, l’autre de M. Henri Rochefort. La première au sujet de cette inauguration projetée, la seconde, à propos de ma conférence, me développent spirituellement leur prédilection pour l’auteur du trop célèbre «cher petit oreiller» qui longtemps (l’attention ne se pose-t-elle pas toujours de préférence sur les moindres [p. 69] cimes?) prévalut par-dessus de plus notables mérites.
D’où naît—et comment se l’expliquer, le vol de tant de prestigieux esprits à l’entour de cette passiflore désolée, de cette triste fleur dont elle a elle-même poétiquement écrit:
C’est que la poésie de Mme Valmore se pourrait dénommer: L’éloquence de l’amour. Et, entre toutes ces amours, le plus tendre, celui qui nous reporte à ce qu’elle appelle joliment: «nos jeunes annales» nous fait avec elle nous écrier:


Ce sera continuer mon rôle de rapporteur et de commentateur par la seule éloquence des faits, et la qualité des personnes, que de poursuivre et de conclure sur l’appel des noms illustres et charmants de ceux et de celles dont nul obstacle n’a su arrêter l’admirative sympathie.
M. Anatole France, le délégué de notre Gouvernement, l’auteur de Thaïs et de tant de chefs-d’œuvre, le maître, dont le nom est synonyme de séduction et de perfection, et dont la présence et la présidence, [p. 70] en cette assemblée, sont, pour elle, de tant de décor. J’ai nommé plus haut M. Catulle Mendès. Et voici près d’eux, pour fêter l’auteur des Roses de Saadi, M. Armand Silvestre, le merveilleux poète du Pays des Roses.
Parmi les artistes, que vous allez applaudir et qui ont su rehausser encore leurs rares mérites par la plus complaisante des bonnes grâces, je salue et remercie les plus célèbres noms de notre théâtre et de nos concerts: Mmes Brandès, Moreno, Segond-Weber, Eléonore Blanc; MM. Lucien Guitry, Léon Delafosse et tous les excellents musiciens de vos orchestres et de votre ville.
Quant à Mme Sarah Bernhardt, il me plaît—et qui d’entre vous n’y applaudirait?—de vous en parler davantage. C’est au retour d’une de ces glorieuses tournées, grâce auxquelles elle a porté si loin et placé si haut la renommée de notre Scène française, et qui ont valu à cette Reine de l’Art dramatique une part de l’empire du monde; c’est au sortir d’un de ces fatigants et indiscontinus triomphes, desquels, par un miracle bien dû à sa générosité et à son génie, elle nous revient chaque fois plus belle et plus grande,—qu’elle était, il y a quelques semaines à peine, allée goûter le repos lumineusement gagné, parmi la solitude de sa Mer sauvage. Mais le jour n’est pas proche où nous la verrons laisser sans écho l’appel de l’amitié et de l’enthousiasme. Et j’aime, Messieurs, à vous rapporter la noble et simple réponse—et qui mériterait de devenir historique—dont cette magnanime artiste accueillit mon importune demande de se reposer d’un an d’illustres travaux, par plusieurs [p. 71] jours et nuits de nouveau voyage: Je le ferai parce que cela me sera difficile.
Dans le public, à côté des hommes éminents qui ont assuré avec tant de zèle le succès de cette solennité, j’aperçois encore des plus distingués représentants de notre littérature et de notre art.
En présence de tels témoignages, de pareille admiration, de semblable sympathie, oseriez-vous bien le redire, Marceline Valmore, ainsi que vous l’écriviez à Lamartine, en ces émouvantes strophes:
Eh bien! entendez-le aujourd’hui, ce mot, quel que soit l’entêtement enfin périmé de votre inguérissable modestie, Marceline Desbordes-Valmore! Votre gloire, elle est levée, la voilà venue! C’est dans les flots mêmes de votre molle rivière, de cette Scarpe que vous avez tant chérie et tant chantée que s’en reflète pour vous la clarté douce.
Elle s’est transformée en votre étoile qui ne mourra point, votre lampe qui allait mourir. Et ce n’est plus avec cette nuance si touchante d’hésitation éternellement troublée et incertaine de votre dignité jugée par nous si haute, que vous diriez [p. 72] aujourd’hui de cette palpitante étoile enfin rassurée:

Après ce furent de suaves ou graves accents émanés d’apparitions adorables. Mlle Brandès en robe de velours pareil à de la mousse foulée par des Elfes, et parmi laquelle sa blancheur rayonnait comme un bouquet de lis, offrit à contempler une Silvia qui eût fait oublier tout autre Zanetto que celui qu’admira Zanetto lui-même, à savoir Sarah Bernhardt elle-même, applaudissant de bravos émus Mlle Moreno dans le rôle qu’illustre créatrice du personnage délicieux, elle a pour toujours marqué de sa griffe ailée.—Mlle Moreno, le visage d’ivoire, sous les bandeaux en métal fluide, vraiment «La vierge en or fin d’un livre de légende» de Musset; la novice aux fines et transparentes mains d’adoration disjointe.—De pénétrantes strophes de la Muse fêtée, mises en musique par un compositeur délicat, interprétées par une fraîche voix portaient aux âmes attendries, l’âme même de Marceline disposant à l’audition de ce long sanglot parlé que fut l’interprétation de Sarah Bernhardt, comme si elle fût devenue en ce jour la poésie même de la pure inspirée qui passa la vie à s’enivrer de ses pleurs.—Alors au pied de la poétique effigie, une première fois apparue, de ses doux ou magnifiques vers récités par chacun de ces interprètes fameux vinrent rappeler à l’auditoire heureusement troublé combien [p. 73] Marceline Valmore était par lui justement honorée. Acclamée, sous la forme de Sarah Bernhardt, on peut le dire sans froisser aucune fierté ou attrister aucune grâce, l’héroïne de cette fête à laquelle elle avait eu à cœur d’apporter de si loin, sans souci d’aucune entrave et au mépris de toute fatigue, le multiple prestige de son universel renom, de son art sans rival. De Sarah Bernhardt donnant la réplique à Lucien Guitry, le comédien au talent subtil et souple, à l’intonation câline ou terrible dans laquelle grinçaient les grelins du vaisseau démâté auquel le poète de Jocelyn compare les jours courageux et désolés de l’auteur des Élégies. Les Roses de Saadi s’effeuillaient des blanches mains de Silvia
Alors Zanetto redevenu femme vint porter l’émotion à son comble par une angélique récitation des vers pieusement, filialement composés, l’an d’avant, par Verlaine, pour cette commémoration qu’il devait présider de plus haut. Une merveilleuse émotion, une divine allégresse desserraient les cœurs, lorsque retentit le beau chœur inspiré à Delafosse par la Prière des Orphelins, et allègrement chanté par les enfants mêmes de ceux dont Marceline chérit les aïeules et qui remplissaient de minois surpris, familiers et joyeux les coulisses et les portants du joli théâtre.
Plus tard, dans le jardin où s’érigeait la statue, non loin de la maison de la Femme-Poète, entre [p. 74] toutes ces pierres qu’elle avait chantées, ce furent d’autres miracles, envol de vers ailés, biographies sans lourdeur, palpitantes apologies. France, en un discours dont le manuscrit me reste comme un graphique trésor—nous fit admirer cette douce et douloureuse figure, en bronze argenté, «la tête inclinée à gauche comme pour écouter son cœur»: et par un de ces traits de puissant et délicat génie qui lui sont familiers, sut faire des armes mêmes de la vieille cité, le propre et approprié blason de Marceline: «Un cœur saignant d’or percé d’une flèche.»—Catulle Mendès, le précieux poète, lui, tint, je l’ai dit, à n’être que le récitant de Baudelaire, deux fois éloquent, du verbe de son auteur et du sien propre immolé en un double hommage. Il fit valoir «le cri, le soupir naturel d’une âme d’élite, l’ambition désespérée du cœur, les facultés soudaines, irréfléchies, tout ce qui est gratuit et vient de Dieu» chez le grand poète Marceline Valmore. «Le charme tout original et natif, la perpétuelle trouvaille et les beautés non égalables dont elle vous transporte au fond du ciel poétique; son expression pittoresque de toutes les grâces naturelles de la femme, une chaleur de couvée maternelle, et cette torche qu’elle agite à nos yeux pour éclairer les mystérieux bocages du sentiment, ou qu’elle pose, pour le raviver sur notre plus intime souvenir.» Et sa voix merveilleusement enflée en cette finale comparaison à un romanesque jardin que le poète des Fleurs du mal fait de ce poète des fleurs du bien, retentit, «avec l’explosion lyrique et l’orage béni qui rend aux choses souffrantes la fraîcheur d’une nouvelle jeunesse». Et d’harmonieux [p. 75] poètes préludaient encore, et des défilés d’enfants faisaient moutonner vers le monument un flux mouvant et odorant de fleurs, que déjà la prestigieuse délégation parisienne était loin, léguant ainsi que font dans les contes, les fées et les esprits, des clartés et des harmonies, et remportant de ce jour de charité divine un goût de beauté et de bonté dont la saveur ne se passe point et qui désembrunit les sombres heures.
Et tout un livre d’or s’était créé autour de ce jour faste par la tendre et admirative contribution des plus nobles poètes, et des correspondances sympathiques toutes de félicitations ou de regrets exprimés pour l’absence ou l’abstention sincèrement déplorées.—J’en cite, entre beaucoup, d’éminents témoignages.
Trois poèmes dédiés à Marceline Desbordes-Valmore.
Ce plaintif sonnet du maître Sully Prudhomme:
Et cet autre, vibrant, de M. Albert Samain.
De Mme Alphonse Daudet, ces fraternelles strophes:
Puis, des lettres. Celle-ci, reçue antérieurement d’Alexandre Dumas:
«Monsieur,
«Je reçois Félicité et l’aimable mot qui l’accompagne. Vous avez fait acte de justice en ressuscitant ce poète charmant dans l’admiration duquel mon père m’a élevé. Je sais encore beaucoup de vers de Mme Desbordes-Valmore. Elle va [p. 78] revivre sous le souffle d’un poète capable et digne de la comprendre. Vous avez arboré là le drapeau du sentiment, si honni par quelques-uns. Mais cela ne m’étonne pas; vous êtes d’une famille où l’on réchauffe sur son cœur les drapeaux des vaincus pour les déployer au bon moment, malgré la neige de la défaite.
De M. Henri Rochefort:[30]
«J’aurais été bien heureux d’assister à votre conférence sur Marceline Desbordes-Valmore, dont j’admire depuis mon enfance le grand talent.»
[30] Londres. Janvier 94.
Et cette précieuse dépêche reçue à Douai:
«J’aurais bien voulu être des vôtres, car les premiers vers que j’ai lus et retenus sont précisément ceux de Marceline Desbordes. Attaché à mon travail sans pouvoir me permettre un jour de vacance, je ne peux pas me rendre à Douai. Tous mes regrets avec mes plus vives sympathies.»
«Henri Rochefort.»
De M. Catulle Mendès:
«Mon cher poète,
«Je vous remercie d’avoir songé à me convier personnellement à la fête triomphale de la chère et grande Marceline; je vous félicite du succès de l’effort que, tout seul, vous avez fait pour elle, et puisque vous voulez bien la désirer, vous pouvez compter sur ma présence.—Mais ce que je dirai [p. 79] ne sera point de moi; je sollicite la joie et la gloire de lire l’admirable page que Charles Baudelaire a consacrée à Desbordes-Valmore; cette lecture, je crois, ne sera pas déplacée, le jour de votre belle fête, car elle prouvera que, s’il a fallu attendre pour la glorification publique de Marceline, son culte intime n’avait du moins jamais été aboli dans l’âme des poètes de l’âge précédent.
«Recevez encore, mon cher poète, mes plus vives félicitations.»
De M. Paul Bourget:
«Je reçois, cher ami, l’invitation que vous m’avez gracieusement fait envoyer.
«Je vous souhaite pour la fête du 13 qui fait tant d’honneur à votre amour des lettres assez de ciel bleu pour qu’il y ait de l’azur autour du buste de Marceline.»
De Georges Rodenbach, un des plus tendres fervents de cet autel privilégié, ces lignes datées de Knocke-sur-Mer, par Bruges:
«Mon cher ami,
«Tout chagrin en pensant que vous serez avec Elle, lundi, et que je serai loin d’elle et de vous. La distance est grande qui nous sépare ici. Je ne pourrai donc être qu’en pensée et en cœur ému avec vous, mon cher ami, dont c’est l’honneur, et le restera, d’avoir intronisé et réalisé la canonisation de la très grande sainte de l’art.
«Dans le solitaire village de mer où je viens [p. 80] travailler, l’été, j’irai dimanche entendre la messe pour Elle, une de ces messes de campagne où il y a des sanglots d’orgue et des voiles blancs de congréganistes en procession dans le cimetière. Et ces choses seront tout à fait elle-même! Et quand l’hostie s’élèvera à la consécration, elle sera son propre cœur, qui fut aussi de blancheur infuse avec du sang dedans!
«Donc, avec vous, de toute communion en notre mère Marceline.»
De M. Lucien Descaves, l’heureux fidèle de Mme Valmore, qui trouvait chez un antiquaire le carnet de voyage dont j’ai parlé:
«Monsieur et cher confrère,
«Je vous remercie de m’avoir envoyé votre clairvoyante étude sur la poésie de Mme Valmore,—précieuse nappe étendue sur ce que vous appelez si bien un autel privilégié, ou tavaïolle ouvragée par vos mains, pour recevoir, comme des bouchées de pain bénit, tant d’admirables vers de ce génie pathétique, objet de notre culte.—C’est avec empressement que j’aurais joint, dimanche prochain, mon modeste hommage à ceux, plus éminents, que vous rassemblerez autour du monument de l’immortelle femme.—Mais je suis retenu, et ne pourrai, si l’Echo de Paris m’est favorable, que m’associer de loin à la réalisation du noble projet dont l’initiative vous honore.»
[p. 81] De M. Gaston Deschamps:
«Cher Monsieur,
«Merci de votre aimable envoi. Les vers que vous citez m’ont procuré de ravissantes délices. J’aurais voulu pouvoir vous accompagner à cette jolie fête de Douai. Je serai de cœur avec vous pour célébrer la mémoire de cette femme exquise[31].»
[31] Toutes lettres publiées ici avec la bienveillante autorisation des auteurs.
Enfin, dans les frémissantes pages d’Ultima, cette magnanime caresse d’Alphonse Daudet toute pleine encore du dernier souffle de Goncourt: «Il n’est question que du festival organisé par Montesquiou en l’honneur de Marceline Desbordes-Valmore, et qui aura lieu demain à Douai. Marceline est une ancienne amie de la famille; ma femme se souvient d’être allée chez elle tout enfant.» Et Mme Alphonse Daudet, fidèle à ce souvenir, était retournée ce jour-là chez Marceline.
Des présences si précieuses, de si éloquentes absences ne rendent-elles pas surprenant et tout au moins un peu arbitraire ce dernier trait de M. Lemaître affirmant[32] «que les lettres de Marceline et la découverte de son «malheur» créèrent en quelque façon la beauté de ses vers».—Quoi! ces vers que Lamennais admirait, que Lamartine honorait, que Michelet adorait, que Vigny et Hugo encensaient, dont Sainte-Beuve, pour ne parler que des plus éminents, consacrait le culte, ne devraient la création de leur beauté qu’à de récentes investigations autour du nom d’un [p. 82] séducteur dont c’est précisément le châtiment de son indignité de demeurer éternellement ignoré et innomé—ayant inspiré à celle qu’il trahit des chants immortels?—A vrai dire, c’est M. Lemaître lui-même qui s’avoue sujet, dans ses critiques, parfois si équitables, toujours si judicieuses et si brillantes «à partir quelquefois du mauvais pied». Rectifions respectueusement: d’une aile un peu divergente. #/
[32] Figaro. Novembre 1896.
A un dernier écrit simple, éloquent et bref, de nous faire
Je le livre dans le laconisme mystérieux de sa simplicité éloquente:
«Moi, Angélique Maximin[33], servante de la famille Valmore, propriétaire de sa sépulture, je déclare en faire le don, avec l’abandon de tous mes droits, de mon plein gré, et sur mon personnel, désir exprimé, à M. le comte Robert de Montesquiou-Fezensac, pour assurer, dans le présent et dans l’avenir, le maintien, l’entretien et la dignité de cette tombe.»
II
A Madame S. Pozzi.
Lumière, où donc es-tu?
peut-être dans la mort.
Leconte de Lisle.
A l’auguste émotion que nous communiquaient, hier, ces tragiques nouvelles: «Leconte de Lisle se meurt! Leconte de Lisle est mort!» se mêlent aujourd’hui les détails d’une visite funèbre. Et je me remémorais, durant le trajet qui sépare Versailles de Louveciennes, une autre visite que je fis au Maître, quelques semaines passées. Il était déjà grandement changé, et du fond de son fauteuil, dans le cabinet de travail du boulevard Saint-Michel, il s’écriait en m’apercevant: «Mon ami, c’est un moribond que vous venez voir.»
Mais, au cours de l’entrevue, sa conversation s’animant, toujours pleine de traits et de saillies, avec pourtant quelque chose d’atténué par la douleur et où l’amertume fondait en de la mélancolie, on ne pouvait tenir le grand malheur pour si menaçant; et les plus proches croyaient encore à quelque mal qu’un changement d’air pouvait enrayer, que la paisible et radieuse campagne allait attendrir et mettre en fuite. Et lui-même n’en goûta-t-il pas encore l’illusion, il y a une semaine, quand, sauf des fatigues de Paris, il crut, une journée, retrouver un peu de santé dans l’historique [p. 86] et paisible asile qui avait été la résidence de Fanny?
Mais la nature et les soins pieux ne pouvaient plus, hélas! l’une, qu’offrir ses fleurs; les autres, que se répandre devant l’illustre cercueil que nous saluons aujourd’hui. Le banc d’André Chénier, ce banc de pierre où il s’asseyait avec Fanny et dont l’auteur des Poèmes barbares nous parlait avec émotion, ne reçut point de visite d’adieu. Et le banc de Leconte de Lisle, une pierre brisée qu’il avait choisie pour s’y reposer, ajoute un souvenir historique à ces mémorables ombrages.
Nous voici dans la chambre mortuaire. Et le souvenir nous revient de celle de Victor Hugo, que nous eûmes le douloureux bonheur de contempler ainsi. Et dans l’aspect de ces deux habitacles, une différence nous frappe: la même qui distingue le génie et l’existence des deux poètes.
La première chambre, avec son damas rouge, ses gerbes de fleurs et de palmes, disait les grandes luttes et les victoires retentissantes; l’autre, plus froide et plus nue, parle de l’art unique dominant une vie calme. Deux élus sanctuaires où deux augustes fronts s’endormirent, desquels deux grandes âmes se sont envolées.
«Vous m’avez nommé, je suis élu!» On se souvient de ce digne remerciement de Leconte de Lisle à Victor Hugo, dont la voix fidèle et unique, lors d’une première présentation à l’Académie, [p. 87] assurait déjà le chantre de Kaïn d’un ultérieur vœu glorieux, et de l’honneur qui lui serait réservé d’occuper sous la coupole la sublime place d’Olympio.
Point n’est le lieu, en ces lignes rapides, de rappeler le magnifique rôle de Leconte de Lisle dans nos lettres françaises; son nom en tête des Parnassiens, devant ceux de MM. Coppée, Sully-Prud’homme, Heredia, Mendès. Ces détails ont été et seront commentés savamment entre maintes circonstances biographiques et bibliographiques.
J’en veux relever un seul. «On n’aime une femme que pour un détail,» nous disait un subtil amoureux des rousses. En devrait-on dire autant des poètes? Non, certes, d’un Leconte de Lisle. Néanmoins, vain ou odieux pour le profane, tel détail enchante souvent ou instruit le lecteur sagace. Ainsi de ce maintien des noms propres grecs, parmi le texte français, qui, dans les impeccables Traductions du Maître, exaspéra les lecteurs de Bitaubé, et qui constituait véritablement une révolution, une révélation: la cessation de l’anachronisme par la mise au point, dans leur atmosphère et dans leur lieu, des poèmes homériques, avec la seule magie de ces noms restaurés, dont les sonorités portent vraiment chlamydes et cnémides, quand leur inepte et arbitraire traduction avait embourgeoisé les héros antiques jusqu’à leur donner des faux airs du ménage Dacier! De même pour les appellations de cités, dont le travestissement d’un langage dans un autre (comme pour nous Paris et Londres) demeure à tout jamais un légitime sujet d’étonnement.
[p. 88] Mais ce qui me frappait aujourd’hui plus nettement dans cette silencieuse chambre mortuaire, c’était ce trait si caractéristique de la maîtrise et de la carrière de Leconte de Lisle, l’Odi profanum. Aucune vie ne me semble en offrir un exemple si frappant. Le merveilleux dédain qui rompait de plis amers la courbe de l’arc de la bouche si belle, dans ce masque puissant où la malice de Voltaire s’alliait à la bonhomie de Franklin, cachait-il la rancune ancienne de longues heures impardonnées d’une incompréhension qui ne pouvait pas finir?—La gloire de Leconte de Lisle était de la famille de celle de Milton dont Villiers de l’Isle-Adam, un autre grand méconnu, a si bien dit que le public s’incline devant elle de peur qu’on ne l’oblige d’y aller voir.
«C’est ennuyeux d’avoir toujours l’air d’écrire des choses que personne ne comprend!» Je me souviens d’avoir entendu tenir à Leconte de Lisle ce propos familier, qui révélait ses tristesses secrètes. Entre la génération qui le trouvait abstrus et celle qui lui eût volontiers reproché d’être trop simple, il n’y avait pour goûter et ressentir vraiment son œuvre admirable, si pleine de puissance et de ce charme dont seuls le pourraient croire dénué ceux qui n’auraient pas lu la Vérandah, le Sommeil de Leïlah et tant d’autres délicieuses pièces, que cette «élite de rares esprits» qu’il se plaisait à évoquer et dont il nous conseillait de rechercher uniquement l’estime.
Nonobstant, cet exil forcé de l’admiration des foules, qu’il eût sans doute rêvées plus réceptives, ne le pouvait laisser sans de graves nostalgies, [p. 89] celles qu’il épanchait dans ses cruels vers aux modernes:
ou qu’il consolait dans ses splénétiques fiat nox, et tant de douloureux appels à la mort et à l’oubli.
Oui, si le présent et l’avenir recherchaient dans le passé une grande figure en laquelle incarner la tristesse de ce somptueux et amer poète, ne serait-ce point un Moïse un peu pareil à celui d’Alfred de Vigny (dont, soit dit en passant, Leconte de Lisle aimait à rappeler de distingués traits dans ses brillantes causeries, auprès d’intéressants récits sur Lamartine, Baudelaire, Flaubert)—un Moïse empli de lassitude découragée faite de pitié et de mépris, en face de la Terre promise du succès facile et de la popularité banale, là où il eut rêvé l’appréciation consciente et le couronnement passionné;—et lui chantant son renoncement volontaire et son splendide adieu dans le Dies iræ des Poèmes antiques.

Mais la nature n’avait plus qu’un sourire pour ensoleiller de suprêmes affres, et ses bras sacrés [p. 90] ne devaient plus s’ouvrir qu’en forme de couronne et en guise de tombeau.
III
A Maurice Barrès.
«Une chose inexplicable, et qui fait, du reste, autant d’honneur à l’âme indépendante de Cervantès que de honte au ministre des faveurs royales, c’est l’oubli dans lequel fut laissé cet homme illustre, tandis qu’une foule d’obscurs beaux esprits touchaient des pensions qu’ils avaient mendiées en prose et en vers. On raconte qu’un jour Philippe III, étant au balcon de son palais, aperçut un étudiant qui se promenait, un livre à la main, sur les bords du Manzanarès. L’homme au manteau noir s’arrêtait à toute minute, gesticulait, se frappait le front avec le poing et laissait échapper de longs éclats de rire. Philippe observait de loin sa pantomime:
—Ou cet étudiant est fou, s’écria-t-il, ou il lit Don Quichotte.
Des courtisans coururent aussitôt vérifier si la pénétration royale avait deviné juste, et revinrent annoncer à Philippe que c’était bien le Don Quichotte que lisait l’étudiant en délire. Mais aucun d’eux ne s’avisa de rappeler au prince l’abandon où vivait l’auteur de ce livre si populaire et si goûté.»
Une autre anecdote rapporte que le 25 février 1615, l’archevêque de Tolède vint rendre visite à l’ambassadeur de France. Des gentilshommes [p. 94] français «aussi courtois qu’éclairés et amis des belles-lettres» parlèrent alors au chapelain du cardinal évêque, le licencié Francisco Marquez de Torrès, qui conte l’histoire—des ouvrages de Miguel de Cervantès.
Sur leurs éloges de ces œuvres, l’invitation adressée à ces jeunes gens de visiter l’auteur se vit accueillie «avec mille démonstrations de désir». Maintes questions s’ensuivirent sur son âge, sa profession et sa fortune; et plus encore d’étonnement d’apprendre qu’il était «vieux, soldat, gentilhomme et pauvre».
—Et quoi! s’écria l’un des interlocuteurs, l’Espagne n’a pas fait riche un tel homme.
—Alors, conclut le narrateur, un de ces gentilshommes, relevant cette pensée, reprit avec beaucoup de finesse: «Si c’est la nécessité qui l’oblige à écrire, Dieu veuille qu’il n’ait jamais l’abondance, afin que par ses œuvres, lui restant pauvre, il fasse riche le monde entier.»
Ne croirait-on pas lire, près de trois siècles écoulés, l’histoire de Paul Verlaine, le Pauvre Lélian qui s’était composé lui-même cette euphonique et véridique anagramme de son nom, posée sur lui comme le pas de chance de l’Infortuné cité par Baudelaire. «Existe-t-il donc, ajoute le poète, une providence diabolique qui prépare le malheur dès le berceau, qui jette avec préméditation des natures spirituelles et angéliques dans des milieux hostiles, comme des martyrs dans les cirques? Y [p. 95] a-t-il donc des âmes sacrées, vouées à l’autel, condamnées à marcher à la mort et à la gloire à travers leurs propres ruines?»
Des exemples tels que ceux de la mort de Barbey d’Aurevilly, de Villiers d’Adam, de Verlaine, ébranleront-ils un jour les cœurs en frappant les yeux et les oreilles; et fondant les égoïsmes plus ou moins inconscients, procréeront-ils une génération de satisfaits ingénieux et cordiaux qui désarment eux-mêmes leurs propres cruelles épreuves par la compréhension sensible et efficace des misères d’un supérieur autrui, d’un prochain de génie et de ses détresses sublimes? Ces fils de famille-là s’ennobliront d’un peu plus de préoccupations de la famille humaine, et de réhabiliter, entrecouper pour le moins leurs féeries et leurs fêtes d’un peu de soin de mortels et impériaux calvaires, et de la visite à de certains grabats où des être géniaux agonisent.
L’Antoine Watteau du vers vient de rendre le dernier soupir des Fêtes galantes; poète qui, par un miracle d’anomalie et par les douze cents tableaux d’un chemin de croix aux stations de garnis et d’hospices, a fait s’égrener tout le chapelet des vains aveux et le rosaire des baisers roses, s’ébruiter toute la musique des harpes en vernis de Martin et des guitares burgautées; a fait se condenser en précise et harmonieuse vapeur toute la grâce ensemble nerveuse et poupine, maniérée et mignarde des embarquements pour Cythère: Cupidos [p. 96] en abbé, Scaramouche et Mezzettin, Clymène et Clitandre, Cydalise et Tircis; toute la population en saxe, criblée de mouches, pailletée d’affiquets et de fanfreluches, des indifférents et des bergers aux miroitantes cassures du satin de leurs armures délicates, dont le poète a synthétisé l’élégante afféterie en ses derniers poèmes de porcelaine, et bien spécialement en cette petite pièce:
Est-ce pour se redonner l’illusion de ce gentil faste que le mourant d’hier avait, ces derniers temps, instauré dans son exigu logis la touchante et somptueuse manie de dorer lui-même au pinceau son mobilier si modeste? Tout y passait, pincettes et chaises, serrure et cordon de sonnette.
Et parmi le bariolage de quelques bégonias en [p. 97] carton, les nuances douces des balais à confetti, les taches crues d’autres souvenirs de carnaval, entre tout le jardin des Hespérides des oranges du jour de l’An sur des tasses retournées, le mirage lui revenait des pavanes de muguet aux relents de bergamote.
Mais il est un autre Verlaine, tant d’autres Verlaine qu’on ne saurait énumérer en un revenez-y rapide: le mystique, celui qui clamait lundi dernier devant nous, en un élan de pieux amour, la religieuse invocation:
et le désolé, dont ces exquises petites strophes résument toute l’essence:
Ce qu’il sied d’affirmer aujourd’hui, c’est en ce poignant désarroi d’existence, le cœur d’excellent et pur aloi qu’était Verlaine, «l’âme enfantine» qu’il a chantée, et qu’il remporte entière aujourd’hui, non contaminée par les douloureuses voies traversées.
Le sonnet suivant, inédit et inconnu, en contient une parcelle tendrement chantante. Verlaine l’écrivit pour la duchesse de Rohan[34] qui en possède le manuscrit,
[34] Le 22 novembre 94.
Je me souviens parmi des lettres, et des lettres reçues de lui, d’une entre autres, toute spontanée, violemment inspirée à sa bonne foi par [p. 99] la lecture irritée de quelque anodine malice à mon endroit que lui attribuait certaine feuille. Message aussi émouvant et attendri que celui des deux amis de La Fontaine[35]:
Et je finirai cette hâtive nénie par un dernier mot de Verlaine prononcé peu d’heures avant de mourir, mot mystérieux et oraculaire, éclairé déjà du jour de l’au-delà par celui qui connaîtra une fois de plus et prouvera l’exactitude du vers consolant:
Verlaine agrippait déjà ses couvertures du geste significatif caractérisé par l’expression antique «Stragulæ vestis plicaturas» et il murmura ces mots, comme écartant de dessus son lit un trop lourd faix invisible: «Otez, ôtez-moi toutes ces couronnes!»
Des couronnes, il s’en nouera quelques-unes pour lui dans le présent; combien et de toujours plus belles à venir, en immarcessible laurier, et de véritables immortelles!

Entre de plus modestes fleurs se tressa le tendre poème qui suit, dont le feston devait enguirlander un tombeau du Poète. Ce volume n’a pas paru; et sans que j’aie pu recouvrer mon manuscrit qui [p. 100] n’était pas double. C’est donc de mémoire que j’en rassemble les bouquets épars, pour les disperser de nouveau, incomplètement effeuillés au-devant d’une chère Mémoire:
IV
A Léon Daudet.
Mistral est un fleuve admirable de poésie, qui mire en son cours, chantant et nuancé, des rives sinueuses et fleuries, des sites peuplés et gazouillants, un ciel ensoleillé et sonore, plein de rayons, de rires et de rêves. Et c’est peut-être en ce temps de poésie, d’instinct plutôt brumeuse et languide, la plus distincte caractéristique de cette Muse de Mistral: la lumière et la joie. Lui-même, le poète, l’a bien exprimé dans sa chanson des Bons Provençaux, dont j’interprète librement ce couplet:
Et ailleurs:
Dix fois sur onze,—il me semble que les morts ont—moins de vieillesse—que les vivants d’aujourd’hui.—Car, dans tout son orgueil,—le siècle meurt d’ennui;—et, sans les jeunes filles—que largement nous donne—le bienfaiteur divin,—la joie prendrait fin.
[p. 104] Le merveilleux bruissement parfumé qui s’exhale des grands poèmes de ce trouvère, comme d’un beau paysage crépitant et criblé de clartés, à l’heure de midi, vibre tel qu’un orchestre, lequel assimilerait parfois leur chantre à un Wagner sans trouble, dont Mireille serait le Lohengrin et Nerto les Maîtres-Chanteurs. Oui, Mistral a, du maître de Bayreuth, le retour du Leitmotiv, l’art des énumérations familières et joyeuses, de noms ou de choses, l’instrumentation harmonieuse des voix simultanées de la foule; et, à plusieurs reprises, dans son œuvre, tels tours de pensée spiritualiste et sublime sur la survie de l’amour des âmes, aux transports sensuels[36].
[36] Calendal, ch. X, Str. 62.
Son goût descriptif de la nature, ses retours aux souvenirs d’enfance[37] l’apparentent souvent aussi à l’admirable Valmore, à cette différence près, des perles du rire qu’il égrène en de méridionaux paysages, tandis que le Nord de Marceline se diaprait du collier, perpétuellement défilé, de ses intarissables larmes.
[37] Les Iles d’or: Rancœur.
Et, plus près, moins sans doute en influence qu’en rapport d’esprit et contagion de pensée, simultanée matérialisation d’idées en divers cerveaux, voici, entre autres, deux curieuses similitudes.
De Mistral (Nerto):
[p. 105] De Verlaine:
On a goûté, non sans raison, le Couplet des cheveux, dans le Pelléas et Mélissande de M. Mæterlinck. Relisez, dans le cinquième chant de Nerto, les adieux de la Nonne à sa chevelure.
Et, pour conclure hâtivement sur un sujet qui requerrait bien des pages, que de pittoresques et poétiques expressions au cours de l’œuvre du chantre de Maillane: cette volée d’évêques au mariage du roi; et, dans la bagarre du cimetière, ces combattants qui jouent aux barres parmi les sépultures. Puis la colonnade à front divin—de cette forêt qui embaume—et lui tisse un manteau de calme, qui nous mène au magnifique morceau sur les arbres sacrilègement émondés, que dut tant admirer Michelet, avocat de la même cause de nature dans sa Montagne.
Eux, solennels chalumeaux—que l’air, à plein gosier—fait chanter comme des orgues,—eux, riches et bons, qui versent la fraîcheur et l’ombre—depuis des ans qui ne se nombrent,—eux, chevelure sombre—de la terre, et parrains des sources et des fontaines...—Laissez-les vivre!
Quel autre poème que La Mort du loup se pourrait, par exemple, comparer à la fin du Vieux Moissonneur, qui, debout dans son blé et mûr comme lui pour la récolte suprême, se voit fauché avec ses épis en un coup de faux aveugle et imprudent?... [p. 106] Le vieux moissonneur, mourant et mutilé, qui s’écrie: «Peut-être que le Maître, Celui de là-haut,—voyant le froment mûr, fait sa moisson.—Allons, adieu! moi, je m’en vais tout doucement...—Puis, enfant, quand vous transporterez la gerbe sur la charrette,—emportez votre chef avec le gerbier.»
Et le Blé lunaire, cette ballade à la lune, sans le vif esprit de celle de Musset, combien n’est-elle pas plus exquise! Voici,—non certes une version, mais une interprétation de cette enchanteresse mélopée, intraduisible au cours berceur de ses deux rimes, tour à tour paresseuses et cristallines:

Mistral inaugure un poème sans rimes. Il est de ces dieux auxquels on peut dire: Que leur volonté soit faite! La question en elle-même n’existe guère. Les rimeurs ont fait leurs preuves de chefs-d’œuvre. Les chemins sont ouverts à la rime assonante, que l’auteur des Poèmes Saturniens déclare ne pas aimer:
Plusieurs qui y excellent ont supérieurement enseigné d’exemple (et bien que leurs vers réguliers me semblent préférables), qu’on pouvait produire de nobles et charmants poèmes, aux gracieuses idées, aux images neuves, aux vers précieux, sans toujours les rimer. Et, si je leur adressais un reproche, ce serait même celui de rimer quelquefois. Il y a autant, voire plus de difficulté à ne rimer jamais qu’à rimer de temps à autre. Mais une expresse loi n’est-elle pas désirable et nécessaire? Si l’assonance peut sembler insuffisante, c’est après une série de rimes. De même, l’oreille [p. 111] exercée par une suite d’assonances se sentira blessée par la trop nette précision d’une rime inattendue.
Mais tel ne saurait être l’avis de poètes qui, précisément, prétendent libérer par l’extension des moyens, les idées soi-disant emprisonnées dans les moules des formes trop familières, les percussions de sonorités trop prévues.
Gautier ne pensait pas ainsi; la présente strophe en fait foi:
Et, n’y aurait-il pas bien de la mélancolie à enregistrer la monotonie du tour de roue de la Fortune ramenant le mode rejeté tout comme la mode condamnée: et l’indigence de prosodiques innovations consistant en la restauration, par leurs disciples, de ce que les grands ancêtres poétiques mirent tant de temps et prirent tant de peine pour forger: l’élision et la rime.
La suppression de cette dernière me semble réservée, ainsi qu’elle le peut faire, à exprimer occasionnellement et selon sa durée, un trouble momentané ou prolongé. Mais, en dehors de ces cas spéciaux, les plus réussis des poèmes sans rimes offriront toujours trop de ressemblance avec ces traductions littérales et linéaires, telles que celles du Palais hanté, dans la maison Usher de Poë[38].
[38] Vers eux-mêmes curieusement ressemblants à ceux évoqués plus haut des deux poètes Mistral et Verlaine.
[p. 112] Je m’en tiendrai donc, quant à moi, sur ce sujet de la rime, au sentiment de Jacques Peletier, dont M. Alphonse Daudet nous scandait, l’autre soir, expressivement, la jolie pièce de l’Alouette: «Il faut—profère gentiment ce poète du XVIe siècle—que je dise cela de moi, que j’ai été celui qui plus ai voulu rimer curieusement,—et suis content de dire superstitieusement. Mais ainsi est-ce que jamais propriété de rimes ne me fit abandonner propriété de mots ni de sentences.» N’est-ce pas concluant et bien dit?
J’ai écrit, dans mon étude sur la poésie de Marceline Desbordes-Valmore: «N’est-ce pas du fait de cette beauté trop prisée, que le lieu commun est devenu tel? Mais qu’il porte en soi la force ou le charme de vaincre cette période de profanation, et le voilà promu lieu éternel?»
Et quand Verlaine, dans sa Fête galante, écrit «au pâle clair de lune triste et beau», ne rend-il pas, de par le choix et la place, à ces trois épithètes, tout le lustre dont l’usage pouvait les avoir dédorées?
Non, la rime ne nuit point au rythme qui, lui-même, ne gâte rien à la rime.
Quelle meilleure preuve que le surprenant et délicieux poème de M. Dierx, un des plus parfaits poètes de ce temps et de bien des temps? Je veux dire l’Odeur sacrée, pièce prosodiée, ainsi qu’un chant de Virgile, en laquelle l’auteur s’est fait une loi et un jeu de prouver et trouver les souplesses de notre langue, et son pouvoir, de par l’allitération (naïvement et souvent niaisement reprochée à de plus audacieux), de babiller en dactyles et s’alourdir en spondées, lutter enfin avec le latin et [p. 113] finalement l’emporter sur lui, et non sans l’avantage triomphant des tintinnabulantes rimes.
Quant aux écoles, ne pourrait-on pas dire qu’elles ne font que des écoliers, et que les vrais maîtres sont les esprits avant tout conscients et respectueux des trésors acquis par un langage et par un art? Ceux-là, loin de vouloir tout remettre en question et de troubler de fond en comble, se contentent de joindre un jonc de plus à la Syrinx, et de faire moduler à la gamme éternelle un accord jusque-là inentendu et d’une plus ineffable mélodie.
V
A la princesse de Brancovan.
Je ne connais guère les vers de celle qui fut la belle Mme Emile de Girardin—et surtout l’étincelant vicomte de Launay; car c’est bien principalement—je dirais presque uniquement, s’il n’y avait la célèbre Joie fait peur—sous le pimpant habit de ce courriériste sémillant que la postérité, qui fait son tri parmi les œuvres qu’on lui lègue, et compose la figure définitive d’un écrivain de ceux de ses traits qui ont le mieux assuré sa conquête, nous conserve le souvenir de cette superbe Delphine.
Elle avait pourtant débuté Muse. Sa beauté, que trahit lourdement le massif buste du Théâtre-Français, et sur laquelle ne nous édifie pas beaucoup mieux le falot portrait d’Hersent au Musée de Versailles, concourut à cette première manière, ratifiée elle-même par un sacre collectif de tous les maîtres du temps, rênés sous les boucles dorées de cette Aurore.
Nombre de prestiges parmi lesquels une correspondance avec Victor Hugo, l’amitié de Balzac, qui lui confia, dit-on, la composition de quelques-uns des vers de Rubempré, dans Les Illusions perdues—(et jusqu’à la collaboration des tables tournantes!)—complètent pour nous la fulguration de cette auréole, sous laquelle notre confiante mémoire aime à revoir s’azurer, comme deux bluets dans la [p. 118] moisson, les yeux que son amie Valmore—une vraie Muse, celle-là!—fait se rouvrir éternellement dans ces deux nobles vers:
Les vers de Rubempré sont, comme il convient à ce bellâtre sans génie, emphatiques et médiocres. Il est probable que la finesse enjouée de Delphine Gay, collaboratrice de Lassailly pour ce travail, se plut à les meubler d’encensoirs et de sistres. Seul, l’impeccable Gautier, intraitable en matière prosodique, et qui ne pouvait recevoir une telle amicale commande sans livrer en échange un chef-d’œuvre, non d’ironie, mais de perfection, se montra traître à l’intention de l’auteur en attribuant à l’amant d’Anaïs l’admirable sonnet de La Tulipe, dénué de rapport avec le caractère et le talent du poète angoumoisin, qui n’aurait pu composer un tel poème sans infliger concurremment une tout autre allure à sa propre destinée.
Un malin rire avait de bonne heure dominé, sinon vaincu, la poésie, au moins sous sa forme pathétique, en cette nature malicieuse. J’en offre pour preuve l’anecdote suivante que je tiens du comte de Maillé, l’homme éminent dont la belle adolescence se montra valeureusement éprise d’idéal, au point de rosser un de ses camarades qui ne lui paraissait pas suffisamment enthousiaste de l’auteur de René. Et la lutte prenait fin sous cette apostrophe concluante du vainqueur à son adversaire justement tombé: «Eh bien? L’admires-tu maintenant?»
[p. 119] Un soir, dans le monde, le brillant jeune homme qu’était alors M. de Maillé avait à son bras la triomphante Delphine. Parvenus au seuil d’un salon isolé que les invités se signalaient en une sorte d’auguste effroi, et dans lequel se faisaient silencieusement vis-à-vis, près de celle qui avait été Juliette Récamier—M. de Chateaubriand et M. Ballanche, la belle promeneuse glissa dans l’oreille de son cavalier devenu moins intraitable sur le chapitre de ses dieux, ce sacrilège propos: «Sortons de cet ossuaire!»—Dès ce soir-là Delphine n’était déjà plus Corinne.
Et pourtant c’est à ce radieux début qu’il nous faut remonter pour trouver un pendant à la charmante émotion que nous cause l’entrée en religion littéraire de la comtesse Mathieu de Noailles. Certes je me glorifie d’avoir été le premier à faire pressentir, en un passage qu’on me permettra de citer, cette savoureuse éclosion, dans un essai publié le printemps dernier: Le quatuor des masques. Il s’agissait de quatre amateurs inconnus à mettre discrètement en lumière, et que j’avais assortis sous les plumages distinctifs d’un perroquet, d’un colibri, d’un cygne et d’une colombe. «La colombe c’est la Gourouli de Musset, mais une Gourouli au roucoulement plus suave. Atavis edita regibus, fille de poètes et de rois, on retrouverait en sa lignée, avec les princes des Mille et une Nuits, Saadi, Firdousi et Hafiz. Comme une odeur d’athergul flotte sur ces chants nourris de confitures de roses. Curieux et [p. 120] parfaits, deux incompatibilités qu’ils concilient, y ajoutant une érudition sans pédanterie, une rencontre du mot expressif, du verbe coloré, du terme savoureux, une précision et une propriété de langage riche et choisi qu’on admirerait chez un travailleur et qui sont l’apanage de cette jeune fille. La plus chaste réserve en la plus noble ardeur, la pudeur dans la passion les caractérisent encore.
On ne m’a permis d’en parler que de souvenir. Je citerai donc, pour mémoire et pour l’honneur d’en traiter le premier, un poème sur les parfums qui est une aromale symphonie. Je ne sais que le célèbre fragment de la Prière pour Tous auquel on puisse le comparer».
Les sept poésies que vient de publier, cette fois sous le véritable nom de leur auteur, devenu l’un des plus illustres noms de notre aristocratie, loin de mentir à cette allégorie élogieuse, y ajoutent au contraire, et dissipent, pour les lecteurs méfiants cette fois vaincus et charmés, ce que ma trop succincte annonciation leur avait paru offrir d’excessif.
La première est la pénétrante évocation des parfums, dont j’ai parlé:
Et sur cette incantation les spirales montent, brumeuses ou tièdes, opalines ou azurées: tendres parfums printaniers; aigres relents automnaux dans le silence un peu hostile des vieilles demeures réveillées; touffeur des fours; bibliothèques aux [p. 121] senteurs vétustes. Et toute la litanie odorante des cheveux aux aromes amoureux, du vin conseiller d’ivresse et de l’encens persuasif de prière; de l’iris cher, aux linges légers; du santal dont le satin ligneux double et embaume les coffrets de l’Inde. A travers ces soupirs délicats transpire la nature tout entière: la terre détrempée, l’aire des moissons, l’air des salines. Et c’est une alternance de jeux forts et de jeux doux comme aux registres d’un orgue:
La fraîcheur des forêts, la chaleur des treilles, et jusqu’à cette fine odeur du thé dont la chanteuse spirale s’évague vers le plafond, expire dans les draperies. Ce bal des odeurs tournoie au cœur de la jeune fille, ce cœur ardent et plaintif dont la nature et l’hérédité ont fait
L’invocation: A une statuette de Tanagra est pleine d’une saveur antique:
Les Paysages évoquent d’un rythme baudelairien, d’ingénieuses comparaisons pour leurs successifs états, leurs diverses parures. Les strophes à Hébé sont pleines de la grâce noble de Chénier, d’un [p. 122] auguste enseignement et d’une langue divine comme la démarche et le péplos même de la déesse:
La Mélancolie est un site de Millet. Les battements dolents de l’airain font fuir du clocher de l’église en même temps que leur écho fait s’envoler du cœur du poète, un tourbillon d’oiseaux, un tourbillon de souvenirs.
L’Invocation aurait plu à Leconte de Lisle. Elle respire son souffle païen et s’élève comme un de ses plus célèbres poèmes contre
Elle redemande aux rustiques divinités toutes les forces et toutes les grâces dont les bêtes émoussent ou déçoivent tant de maux, intolérables pour notre vigilante et lancinante pensée humaine. Et l’auteur de la Mort du Loup eût aussi goûté cette exécratoire libation en sa boutade profonde.
La dernière pièce, le chef-d’œuvre, avec la première, revêt la métaphysique de Sully-Prud’homme d’une parure qui n’est pas sans faire penser à Léon Dierx, mais bien inspirée, toute personnelle. C’est un cantique d’amour d’une grave et gracieuse beauté, plein d’une intense ferveur, d’une digne résignation préventive aux inévitables changements, et qui se clôt sur un vers précédemment cité, un vers exquis, une pensée égale:
J’ai sous les yeux, entre autres morceaux inédits de la jeune femme poète, un crépuscule des dieux qui eût dignement complété cette publication dont la Revue de Paris a droit d’être fière. Un filial—et sans doute cette fois héréditaire regret de la grâce antique, déjà sensible dans la prière à la statuette, dans les stances à la déesse de la Jeunesse, et dans la païenne oraison aux dieux gardiens de troupeaux—s’y accentue; et comme un soupir de Virgile s’unit au souffle de Chénier dans ce nostalgique élan vers
Ainsi donc, après la tendre et pantelante Marceline, après la forte et farouche Ackermann, voici surgir encore des Muses, à qui semble dévolu de matérialiser le plus subtil, de proférer le plus ineffable.
Parmi elles, Mme Edmond Rostand, cette rêveuse et radieuse Rosemonde de qui Leconte de Lisle admirait la riante beauté et dont il goûtait le sensible accord—module sur ses introuvables Pipeaux des notes ravissantes. L’épigraphe en pourrait être le délicieux vers de Villiers de l’Isle Adam:
[p. 124] Et ce serait la devise de l’auteur. Voici d’abord une confession à l’Aimé, qu’elle adjure de lui pardonner tous les innocents plaisirs goûtés avant sa rencontre, les fleurs respirées sans lui, et qui s’achève sur ce joli trait:
Puis un testament poétique où la donation de tant d’ingénus trésors de jeune fille, parmi lesquels
se couronne par cette clause:
C’est cette blonde Muse elle-même qu’il faut entendre moduler sur ses touchants pipeaux d’une juvénile suavité, d’un timbre frais, d’un accent attendri, et qui laissent inconsolable de n’avoir pas été des témoins de cette avant-dernière répétition du Cyrano, au cours de laquelle le rôle de Roxane, en l’absence de l’interprète, fut tenu par Mme Edmond Rostand; comme si les spectateurs incessamment renouvelés de cette belle œuvre eussent encore droit à cette illusion d’espérer le renouvellement de cet incomparable prestige.
Anna de Brancovan prélude à son tour; et déjà son chant est digne de son nom, ce biblique nom d’Anna, lequel, au dire d’Hello, signifie en hébreu: grâce, amour, prière.
Ces trois vocables n’étaient-ils pas contenus en [p. 125] celui dont j’avais tout d’abord, pour mon poète, alors mystérieux, élu la mystique allégorie? Mystique et profane aussi, comme la double inspiration de cette Muse antique et nouvelle. Écoutez-la chanter, cette Colombe:
Et regardez-la s’envoler, Paraclet de Cypris, dont le vol parfume nos esprits, comme ces oiseaux dont l’antiquité raffinée faisait voltiger à travers les salles et palpiter au-dessus des invités des festins, les blanches ailes imprégnées d’essences.
VI
A Madame Ernest Hello.
L’ange de l’isolement frappe tout ce qui s’élève.
Ernest Hello.
Un agissement habituel à ce qu’Ernest Hello appelait la petite critique, c’est de se récrier chaque fois qu’une plume nouvelle s’exerce autour d’une mystérieuse mémoire d’artiste, de ceux dont l’œuvre et la renommée sont si fort inégales, noms, quoi qu’on en dise, peu célèbres, œuvres parfois admirables vraiment, presque inconnues, vers lesquelles l’attention appelée ou rappelée fait partie de cette charité intellectuelle dont le noble écrivain que je nommais tout à l’heure l’implorait en vain. Et ce sont alors force quolibets, parfois insuffisamment neufs et maigrement spirituels, à l’adresse du soi-disant inventeur, qui, bien loin d’avoir cette prétention, ne demande qu’à faire connaître et apprécier davantage, en même temps que de nobles pages trop ignorées, les noms de ceux qui leur ont les premiers rendu justice.
Et, bien entendu, c’est de ces noms que se sert tout d’abord—s’en étant fait renseigner de la [p. 130] veille,—ladite petite critique pour attaquer ou accabler celui qui les sait mieux qu’elle et leur rend un culte plus conscient.
De pareils traits ne sont pas pour détourner—non de réparations ni de réhabilitations, longs mots un peu vains—les œuvres ayant toujours tôt ou tard la gloire qu’elles méritent, et dont l’anticipation n’est pas le meilleur signe, mais des rappels d’attention pareils à celui que je voudrais aujourd’hui tenter en l’honneur du penseur religieux dont M. Huysmans a justement pu écrire: «Le véritable psychologue du siècle, ce n’est pas leur Stendhal, mais bien cet étonnant Hello dont l’inexpugnable insuccès tient du prodige.»
«Pour moi—formulait Barbey d’Aurevilly en 1880, après nombre de lumineux articles consacrés à Ernest Hello—j’ai fait ce que j’ai pu pour cet homme... j’ai fait ce que j’ai pu, une fois, deux fois, dix fois; mais j’ai, à ce qu’il paraît, la main malheureuse. J’ai ouvert ses livres, j’en ai exalté les beautés. J’ai dit que cet homme trop ignoré méritait la gloire et qu’il ne l’avait pas, peut-être par l’unique raison qu’il la méritait.»
Les quinze ans écoulés depuis ont, à vrai dire, amené une réimpression de l’Homme, laquelle, bien qu’il me semble assez favorablement accueillie, n’a pourtant, pas plus que la très originale étude de M. Bloy, et de sérieux articles de M. Buet, pu vaincre l’inexpugnable insuccès, qui tiendrait véritablement du prodige s’il ne tirait son explication de cette réflexion même d’Hello: «Comme ce drame est suspect d’avoisiner les choses divines, les hommes lui ont toujours préféré Brutus, les [p. 131] trois Horace et Léonidas.»—Et nul éditeur ne se trouve, à l’heure qu’il est, encore, pour nous donner une quatrième édition de la traduction par Hello du Livre de la bienheureuse Angèle de Foligno, l’introuvable volume dont si on en ordonne la recherche à quelque libraire consciencieux, ce dernier vous répond d’un ton attendri de pitié: «A quoi bon prendre une commande pour laquelle avant vous plus de vingt communautés sont inscrites?»[39]
[39] Dans l’intervalle cette réimpression a paru.
Le portrait qu’il me plairait tracer d’Ernest Hello se devrait emprunter à lui-même, s’extraire, ainsi qu’il s’en est pour moi dégagé, d’une attentive lecture de ses œuvres, dessiner et peindre à touches élues et émues, à coups rapprochés des fragments de ses livres les mieux représentatifs de sa personnalité propre, l’homme douloureux qu’il fut, l’inspirée vox clamans in deserto qu’il avait conscience d’être, le maître qu’il est aujourd’hui dans l’appréciation de plusieurs, et qu’il deviendra plus amplement dans l’admiration de tous.
C’est une précieuse surprise, grâce à quelque improvisée exposition, dans certains musées de province, encore en telles villes natales, de grands morts, de découvrir, les y cherchant, ou mieux, au cours d’une visite désheurée et désœuvrée, des images d’inégal mérite, des figurations oubliées ou inconnues d’un maître ou d’une muse, des portraits qu’un abandon ou leur valeur artistique moindre a fait négliger par la reproduction courante, et qui présentent tout à coup sous une acception plus frappante, parfois plus sincère et [p. 132] fidèle, les traits familiers d’une personne célèbre, à laquelle un crayon souvent moins autorisé, mais plus sensible, a conservé plus de physionomie vraie, un aspect plus véridique et plus prenant.
J’en citerai volontiers pour exemple tel portrait, à Douai de Marceline Desbordes-Valmore, sans omettre cet œil étonnant, le sien, que son père, le peintre de panonceaux, avait, selon la mode du temps, fignolé au centre d’une guirlande de myosotis, avec tout le précieux léché d’une armoirie sur la portière d’un carrosse. Encore, à Versailles, certains portraits de Delphine Gay ou de Pauline Borghèse, ou—celui-là l’œuvre d’un maître,—ce singulier dessin récemment exhumé par M. de Nolhac, ce cadavre de Napoléon III, en uniforme, dans son cercueil placé debout, pour mieux poser devant le crayon de Carpeaux, qui retraçait l’impériale momie aux moustaches cirées piquant de droite et de gauche, telles que deux longues aiguilles, la ruche d’une garniture intérieure de cette bière.—C’est à Versailles aussi,—dans cette toile où cette fois encore, un peintre célèbre, M. Gérôme, a fait se dérouler la réception à Compiègne des ambassadeurs siamois,—ce portrait auquel il est sans doute donné de fixer pour l’avenir la cycniforme silhouette de celle qui fut l’impératrice Eugénie. Repliée en effet telle qu’un blanc cygne ceinturé, diadémé de perles comme le sont ces oiseaux dans le bronze empire, cette dame de beauté vantée qu’on demande en vain à de ses plus célèbres effigies, nous apparaît là, vraiment très enchanteresse, profilée sur l’eau sinueuse du velours bleu d’un manteau de cour. Et c’est, dans ce curieux makimono [p. 133] français, avec de rares roueries de dessin, des silhouettes contemporaines hiératisées, entre lesquelles, le duc de Cambacérès, tel qu’un bonapartiste Confucius, méditatif et debout sous son gazon linéamenté savamment. D’un maître encore, Eugène Delacroix, en certaine exhibition de la rue de Sèze, un bout d’esquisse, mais à quel point pénétrante et résurrectrice de Mme Sand, abritant, sous un rond chapeau d’amazone au voile de gaze, deux yeux ardents et veloutés, deux charbons cabochons d’un jais voluptueux et plein de flammes. Enfin, au musée de Tours, de faibles portraits de Balzac, trop voué à l’unique figuration de Boulanger qui l’enroba sous un froc de moine, nous donnent néanmoins à nous pencher sur ce miroir d’âme que sont les traits d’un visage, avec l’avidité d’y découvrir, dans l’œil, une autre arborisation d’agate, sur les lèvres, un plus explicite sourire.
C’est ainsi qu’après les magnifiques esquisses trop peu connues, bien que dix fois renouvelées par Barbey d’Aurevilly, ou de successifs et définitifs portraits plus poussés d’après le même modèle; après la saisissante étude d’un si beau style, de M. Léon Bloy, dans son brelan d’excommuniés, et les intéressants travaux de M. Charles Buet, se peut encore interroger, ainsi qu’une des sanguines ou sépias dont je parlais tout à l’heure, la présente incomplète ébauche dont le seul mérite est d’être surtout composée de traits épars dans l’œuvre et repris à cet Hello même, auquel il est temps de faire une place plus ample entre nos bibliothèques et nos musées, nos panthéons et voies triomphales.
[p. 134] Une lettre récemment éditée de Balzac à Mme Hanska nous a donné, du fait d’une de ces rétrospections qu’apprêtent les publications posthumes, de voir se projeter, moins comme un projet que sous forme d’une projection anticipée, le très net schéma de sa colossale comédie, alors ébauchée à peine, et réalisée depuis avec une ponctualité historiée, mais non sensiblement modifiée; en un mot, dans un écrivain encore presque juvénile, la futurition de l’écrivain plus tard très exactement accompli, mais dont ces fatidiques annonces, dès ses débuts, n’auraient pu que paraître outrecuidantes et infatuées à un Sainte-Beuve ou à un Taine. Balzac, et dans une confidence à une amie qui devait devenir sa femme, quelles que fussent la conviction de sa mission et la certitude de son génie, pouvait seul ainsi parler de lui-même. Qui sait ce qu’Ernest Hello aura plus discrètement confié à celle qui, par ses soins intelligents, eut une noble part dans son œuvre et, par conséquent, un rare mérite aux yeux de ceux que cette œuvre enchante et fortifie? L’humble orgueil du penseur puissant et original, de l’écrivain dont une stricte et neuve magnificence de style caractérise la manière et drape l’idée sans la voiler, ne se fût sans doute pas accommodé autant que Balzac d’un auto-panégyrique nominal; mais la rancœur du silence autour de ses travaux de forme souvent superbe, toujours généreux d’essence, et dont il avait cette juste opinion qu’ainsi qu’un ostensoir dont ils brandissaient le Dieu, ils méritaient de s’irradier sur les âmes en empourprant de leurs rayons le prêtre qu’il se sentait; ce sempiternel [p. 135] malaise, cette lancinante amertume des grands méconnus: le malentendu que crée autour d’eux leur propre fierté, dirai-je, rétractile devant la malice des envieux et la légèreté des faibles, nous permettent de penser qu’Hello ne refuserait pas de se reconnaître aujourd’hui dans le portrait dont nous détachons les lignes de son œuvre, pour le présenter à ceux en qui s’ignore le désir de le connaître et sommeille l’ardeur de l’admirer. «L’esprit, a-t-il écrit lui-même, c’est celui qui, percevant un homme grand et profond, le reconnaît parce qu’il l’a cherché, et l’aime parce qu’il l’a désiré.»
«Parmi ces vérités que le genre humain déserte et pour lesquels la conscience humaine a des surdités étranges, en voici une: la justice envers les vivants; il faut rendre justice aux vivants.

«Le genre humain aime les morts et n’aime pas les vivants. Quand un homme est vivant, sa grandeur est niée, oubliée, moquée par le fait même de son existence actuelle.
«Le genre humain attend sa mort pour s’apercevoir qu’il était grand. Ce crime invraisemblable et monstrueux est le fait habituel, presque universel de l’histoire humaine.
«Voici quelque chose de plus extraordinaire. Ce crime invraisemblable et monstrueux n’est pas remarqué de ceux qui le commettent.

«On se dit: «Oui, sans doute, c’est un homme [p. 136] supérieur. Eh bien, la postérité lui rendra justice.»
«Et on oublie que cet homme supérieur a faim et soif pendant sa vie...
«Vous oubliez que c’est aujourd’hui que cet homme supérieur a besoin de vous...
«Vous oubliez les tortures par lesquelles vous le faites passer, dans le seul moment où vous soyez chargé de lui!
«Et vous remettez sa récompense, vous remettez sa joie, vous remettez sa gloire, vous remettez son bonheur à l’époque où il sera à l’abri de vos coups...
«Et vous oubliez que cet homme de génie que vous ne craignez pas d’enfouir dans la vie présente, sous le poids de votre oubli, vous oubliez que cet homme, avant d’être un homme de génie, est d’abord et principalement un homme.
«En tant qu’homme il est sujet à la souffrance. En tant qu’homme de génie, il est, mille fois plus que tous les autres hommes, sujet à la souffrance.
«En tant qu’homme de génie, il a une susceptibilité inouïe, peut-être maladive, certainement incommensurable à vos pensées.
«Et le fer dont sont armés vos petits bras font des blessures atroces dans une chair plus vivante, plus sensible que la vôtre; et les coups redoublés que vous frappez sur ces blessures béantes ont des cruautés exceptionnelles, et son sang, quand il a coulé, ne coule pas comme le sang d’un autre.
«Il coule avec des douleurs, avec des amertumes, avec des déchirements singuliers.
«Il se regarde couler, il se sent couler, et ce [p. 137] regard et ce sentiment ont des cruautés que vous ne soupçonnez pas[40].»
[40] Les Plateaux de la balance.

Tels sont les premiers et principaux traits pour la terrible et dolente effigie de la victime sublime. Complétons-les de ceux qui suivent:
«Regardez les noms de ceux qui sont parvenus, non pas à la réputation, mais à la gloire: lisez leur histoire. Interrogez-les; ils vous répondront qu’ils ont usé, pour écarter la foule et se faire place, plus de force qu’il n’en fallait pour créer mille chefs-d’œuvre. Ils ont passé des heures, qui auraient pu être belles et fécondes, à subir le supplice de l’injustice sentie; ils ont dépensé le plus pur de leur sang dans une lutte extérieure et stérile qui arrêtait le travail fécond de l’art; le découragement leur a volé mille fois à eux et au monde leurs plus beaux transports, leurs plus jeunes ardeurs. Que d’heures qui auraient été des heures de génie, des heures de lumière, qui auraient rayonné dans le temps et dans l’espace, qui auraient produit des choses immortelles, ont été des heures stériles de tristesse et d’accablement! Or cela a peut-être été l’œuvre de la petite critique. Elle a pris pour tâche d’éteindre le feu sacré qu’elle était chargée d’entretenir. Puisse-t-elle être enterrée vive[41]!»
[41] L’Homme.

Et, pour rehausser encore ce tableau, le voici sublimé jusqu’à la comparaison christique. Ceci [p. 138] est une des belles pages mystiques d’Hello:
«Et pendant qu’il va en Égypte, il se souvient d’avoir cherché une place à l’hôtellerie et de ne pas l’avoir trouvée.
«Pas de place à l’hôtellerie!
«L’histoire du monde est dans ces trois mots; et l’éternité ne sera pas trop longue pour prendre et donner la mesure de ce qui est écrit dans ces mots: «Pas de place à l’hôtellerie.» Il y en avait pour les autres voyageurs. Il n’y en avait pas pour ceux-ci. La chose qui se donne à tous se refusait à Marie et à Joseph: et dans quelques minutes Jésus-Christ allait naître! L’attendu des nations frappe à la porte du monde, et il n’y a pas de place pour lui dans l’hôtellerie! Le Panthéon romain, cette hôtellerie des idoles, donnait place à trente mille démons prenant des noms qu’on croyait divins. Mais Rome ne donna pas place à Jésus-Christ dans son Panthéon. On eût dit qu’elle devinait que Jésus-Christ ne voulait pas de cette place et de ce partage.
«Plus on est insignifiant, plus on se case facilement. Celui qui porte une valeur humaine a plus de peine à se placer. Celui qui porte une chose étonnante et voisine de Dieu, plus de peine encore. Celui qui porte Dieu ne trouve pas de place. Il semble qu’on devine qu’il lui en faudrait une trop grande, et, si petit qu’il se fasse, il ne désarme pas l’instinct de ceux qui le repoussent. Il ne réussit pas à leur persuader qu’il ressemble aux autres hommes. Il a beau cacher sa grandeur, elle éclate malgré lui, et les portes se ferment, à son approche, instinctivement.

«L’enfant n’avait pas eu une crèche pour naître. La terre ne devait pas non plus lui donner une place sur elle pour mourir, elle devait, au bout de quelques années, le rejeter sur une croix.
«La planète fut comme l’hôtellerie; elle fut inhospitalière[42].»
[42] Physionomies de saints.

En trois touches magistrales, aux puissants rehauts et d’un saisissant relief, voilà bien notre petit Christ humain, l’artiste vrai en proie aux épines des piqûres d’épingles, au clou du gros rire des ineptes, au fiel de la mauvaise foi des jaloux. Groupées autour du personnage central, les figures de ces soldats et de ces Judas peupleront naturellement le tableau, compléteront le terrestre calvaire.
Voici d’abord l’homme médiocre:
«Fussiez-vous le plus grand des hommes, il croira vous faire trop d’honneur en vous comparant à Marmontel, s’il vous a connu enfant. Il n’osera prendre l’initiative de rien. Ses admirations sont prudentes, ses enthousiasmes sont officiels. Il méprise ceux qui sont jeunes. Seulement, quand votre grandeur sera reconnue, il s’écriera: Je l’avais bien deviné! Mais il ne dira jamais devant l’aurore d’un homme encore ignoré: Voilà la gloire de l’avenir! Celui qui peut dire à un travailleur inconnu: Mon enfant, tu es un homme de génie, celui-là mérite l’immortalité qu’il promet.

«L’homme médiocre n’a qu’une passion, c’est [p. 140] la haine du beau. Peut-être répétera-t-il souvent une vérité banale sur un ton banal. Exprimez la même vérité avec splendeur, il vous maudira, car il aura rencontré son ennemi personnel.

«Ce qu’il déteste par-dessus tout, c’est la chaleur.

«L’homme qui aime n’est jamais médiocre.

«L’homme médiocre, dans sa crainte des choses supérieures, dit qu’il estime avant tout le bon sens; mais il ne sait pas ce que c’est que le bon sens. Il entend par ce mot la négation de tout ce qui est grand.

«Le génie compte sur l’enthousiasme; il demande qu’on s’abandonne. L’homme médiocre ne s’abandonne jamais. Il est sans enthousiasme et sans pitié: ces deux choses vont toujours ensemble.
«Quand l’homme de génie est découragé et se croit près de mourir, l’homme médiocre le regarde avec satisfaction; il est bien aise de cette agonie; il dit: Je l’avais bien deviné; cet homme-là suivait une mauvaise voie; il avait trop de confiance en lui-même. Si l’homme de génie triomphe, l’homme médiocre, plein d’envie et de haine, lui opposera du moins les grands modèles classiques, comme il dit, les gens célèbres du siècle dernier, et tâchera de croire que l’avenir le vengera du présent.
«L’homme médiocre est beaucoup plus méchant qu’on ne le croit et qu’il ne le croit, parce que sa froideur voile sa méchanceté. Il ne s’emporte [p. 141] jamais. Au fond, il voudrait anéantir les races supérieures; il se venge de ne le pouvoir pas en les taquinant. Il fait de petites infamies qui, à force d’être petites, n’ont pas l’air d’être infâmes. Il pique avec des épingles et se réjouit quand le sang coule, tandis que l’assassin a peur, lui, du sang qu’il verse. L’homme médiocre, lui, n’a jamais peur. Il se sent appuyé sur la multitude de ceux qui lui ressemblent[43].»
[43] L’Homme.
Puis, le Monde.
«Le monde s’étend aussi loin que la tiédeur de l’air. Là où l’air est chaud ou froid, le monde s’en va, scandalisé.

«La loi du monde est peut-être l’insignifiance. Si un homme vivant se trouve par accident dans le monde, il faut qu’il se fasse insignifiant, plus insignifiant même que les autres, parce qu’il est suspect. Pourvu qu’il efface toute vérité et toute lumière, il peut être supporté un moment. Mais comme l’essence des choses ne se trahit jamais longtemps, il viendra un moment où le monde, dans sa clairvoyance, se détournera, et, dans sa justice, se séparera.

«Ce regard-là, quand l’homme qui le possède sera revenu à Paris, regardera, en face du génie, la forme d’un chapeau, et, dans les œuvres du génie, comptera les virgules dans l’espérance qu’il en manque une[44].»
[44] L’Homme.

Et pour brancher, comme il sied, l’arbre de cette [p. 142] humaine croix, de ses deux implicites rameaux chargés du vivant fruit de ses deux naturels acolytes, le critique vulgaire et le critique généreux représenteront ici le mauvais et le bon larron, aux côtés saignants du crucifié d’art.
La Petite critique:
«Ainsi fait une certaine critique. Elle se demande, pour vous juger, si vous avez quelque ressemblance apparente avec quelqu’un de ses vieux souvenirs.
«Offrez au critique vulgaire un chef-d’œuvre inconnu; il attendra votre avis avant d’oser donner le sien. Avant d’avoir une opinion, il consultera tous ses intérêts et le visage de tous ses amis. Ayant épuisé sa faveur sur les anciens, il n’a plus que raideur et indifférence pour ceux qui luttent, qui souffrent, qui ont besoin de courage.
«La critique doit commencer près de l’homme qui attend, le rôle de l’humanité, et préluder au concert que feront sur sa tombe ses descendants».
Et la glorification des rares prêtres et dignes ministres représentants de cette critique idéale finalement illustre et illumine la peinture de cette station sombre:
«Quant à ceux qui viennent au secours de ces grands malheureux, la gloire qu’ils méritent doit être aussi une gloire réservée, plus grande que la pensée, une gloire proportionnée à des choses sans proportions.
«Gloire étrange et magnifique!
«Soulever le couvercle qui pèse sur la tête des grands morts!
«Lever la pierre de leurs tombeaux! Inscrire [p. 143] son nom parmi les bienfaiteurs des bienfaiteurs de l’humanité! Consoler le regard et les ailes de l’aigle! S’entourer par avance des bénédictions de l’avenir. Prendre l’avance sur la postérité et dire déjà en actes ce qu’elle dira plus tard en paroles quand il ne sera plus temps! Le dire et le faire pendant qu’il est encore temps d’être bon et juste, n’est-ce pas réaliser le rêve des âmes généreuses?
«Vous qui encouragez le génie, vous êtes le père de cette sublime postérité.
«Vous qui découragez le génie, vous êtes homicide de toutes les âmes qui auront besoin de lui dans le présent et dans l’avenir.
«Vous égorgerez tous les aigles qui l’attendaient pour ouvrir leurs ailes; vous égorgerez toutes les colombes qui attendaient son souffle pour savoir de quel côté diriger leurs soupirs[45]!»
[45] Les Plateaux de la balance.
Et, pour fermoir de ce retable, cette mélancolique et magnanime citation du maître, que m’adressait récemment elle-même Mme Hello:
«La partialité pour les vaincus est la faiblesse des grandes âmes[46].»
[46] Le portrait de l’Envieux, le chapitre sur la Réputation et la Gloire, la spirituelle Lettre d’un docteur à Christophe Colomb dans les Plateaux de la balance, puis les torrents de l’injustice avec certain tableau du faux esprit de famille, dans les paroles de Dieu, compléteront, pour un esprit intéressé et assidu, ce portrait-étude.
Une particularité de la manière d’Hello, qu’il lui donne tour à tour à caractériser telle ou telle des trois formes de son talent, polémiste, conteur ou plus exclusivement mystique, c’est une ressemblance [p. 144] aux mathématiques. La théorie de l’art pour l’art en est formellement exclue, et volontiers apparierait pour notre écrivain tout le dégoût indigné que pourrait offrir une boîte de fard à une sainte Thérèse. L’abomination de la désolation de ce style serait d’évoluer pour lui-même. C’est Hello qui écrira: «Le plus grand malheur qui puisse arriver au style, c’est de se faire admirer indépendamment de l’idée qu’il exprime.» La fioriture, c’est le péché, pourrait être un des commandements de son écritoire. Le modèle d’Hello, c’est Joseph de Maistre avec parfois, dans la phrase, comme un reflet de Lamennais. Son absolu opposé, c’est Chateaubriand. Je ne me souviens pas d’avoir rencontré ce grand nom au cours de toute l’œuvre de l’écrivain de Kéroman, que le respect d’une même communion empêcha, sans doute, de formuler sur le maître de Combourg un jugement dont l’expression eût été curieuse à connaître[47]. Il y a, en effet, entre leurs deux églises toute la différence qui sépare une basilique romane d’une cathédrale de gothique flamboyant et fleuri.—Les questions chez l’auteur de l’Homme sont plutôt abordées sous forme de problème ou de théorème; et la phrase y procède volontiers par démonstration. Il y a toujours là quelque chose à prouver, une inconnue à dégager qui est une vérité à faire reluire. L’ardeur de la vérité qui enflamme Hello, non moins que saint Augustin, semble l’avertir du tort qu’ont fait au bien les manichéens de la pensée et de l’écriture. C’est presque par surprise, et alors avec tout l’irréfutable d’un ce [p. 145] qu’il fallait démontrer, qu’il voudrait faire éclater au-devant des résistances forcément démantelées les propriétés des divines grandeurs soudainement rendues calculables et mesurables. De là des vérités religieuses ou morales posées en manière d’équations dont les termes se doivent réduire successivement, pour à la fin se résoudre en le concluant aphorisme d’une transparente définition, d’un suprême axiome.
«Celui qui vit est celui qui aime; il est réuni et réunit.—Celui qui ne vit pas, n’aime pas; il est séparé et il sépare» déduit et conclut Hello, en ses heures de pure démonstration psychique. Mais cette idée, dont le plus grand malheur de style serait de se faire admirer indépendamment d’elle, suffit souvent pour imprégner de poésie, comme à son insu, ce style si résolument châtié. Et cette lumière intérieure soudain attisée au point de pénétrer de clarté son enveloppe comme un albâtre ou comme un azyme, et de rayonner à travers elle sans la rompre, devient une lumineuse vérification de cette splendeur du vrai, sous les espèces de laquelle la beauté fut définie. C’est dans ces moments de mutuelle réverbération de forme et de pensée que notre écrivain nomme l’amour: «un repos laborieux»;—la photographie: «un miroir qui se souvient»,—et le romantisme: «l’acceptation musicale du désespoir organisé».—«La science est la paix des connaissances réconciliées»;—«les désirs sont des larmes intérieures; les larmes sont des désirs qui coulent par les yeux».
Voilà pour les définitions. Combien d’aphorismes çà et là s’expriment heureusement ou avec [p. 146] grandeur; «certaines paroles ridicules, dans le sens où on les dit, sont vraies dans le sens où on devrait les dire.»—«En général, celui qui veut copier l’élégance atteint la grossièreté.»—«Le plaisir énervant de s’attendrir sans activité prostitue les larmes de l’homme.»—«Notre chute a la forme renversée de notre grandeur possible.»
Le polémiste en Hello est beau de son intransigeance même. Le chicaner sur les excès de ses jugements serait le vouloir dépouiller d’une rigoureuse part de sa vertu. C’est qu’il ne juge pas avec son goût, mais bien avec son caractère. Tout ce qui ne saurait s’ajuster à son cadre, qui n’est autre que le cintre de l’ouverture du tabernacle, se voit impérieusement rejeter, s’assimile aux vendeurs du Temple, ou bien à quelque Héliodore qu’il y faut flageller, qu’il en faut bannir.
Voici de ces cinglants verdicts qui se peuvent ressortir au mot du vrai maître d’Hello, Joseph de Maistre, à propos de Voltaire: «Si quelqu’un, en parcourant sa bibliothèque, se sent attiré vers les œuvres de Ferney, Dieu ne l’aime pas.»
«Si ce méchant homme avait eu le sort qu’il méritait, ajoute Hello, je n’exhumerais pas ce nom ignoble; Voltaire serait ce qu’il doit être, un gamin oublié.»
«Le XVIIIe siècle n’a pas voulu mourir sans nous laisser son portrait. Ce portrait, c’est sa peinture. Si quelqu’un était tenté d’attribuer à ces mauvais collégiens la proportion des grands hommes, je crois que le portrait de ces collégiens peint par eux-mêmes pourrait le guérir de cette maladie. La peinture du XVIIIe siècle n’est pas seulement ridicule, [p. 147] elle est honteuse! Watteau, Boucher, Fragonard sont les enfants de cette société pourrie, et ces enfants sont des enfants terribles qui disent aux passants les secrets de leur mère. Toutes ces figures déshabillées et fardées ne sont pas seulement laides, elles sont dégoûtantes. Si au moins ces cadavres étaient verts, on les reconnaîtrait pour des cadavres; mais comme ils sont roses, on ne sait plus de quel nom les nommer.»
«Ovide, c’est le XVIIIe siècle anticipé; c’est une menace de versification capable de faire prévoir la Henriade.»
«Parmi les auteurs connus, quelques-uns sont tellement au-dessous de la critique, qu’elle ne peut, en les regardant, que s’étonner de les connaître: Horace est de ce nombre.»
«Il faut pardonner à Virgile l’Enéide, en faveur de la quatrième églogue et en faveur de quelques mots prononcés sur la campagne.»
L’outrance,—faut-il dire l’outrage?—qui aurait droit de choquer dans des critiques, acquiert celui de s’exercer dans des anathèmes.
La phrase suivante nous en développe le motif: «Que de gens savent par cœur Cornélius Népos, et, parfaitement édifiés sur le compte de Pélopidas et d’Atticus, n’ont pas un souvenir précis du rôle historique de saint Jean Chrysostome et de son attitude magnifique devant l’empire et devant l’empereur? C’est que le christianisme est là. C’est pourquoi les hommes se taisent et oublient. La proximité de Dieu se mesure à leur injustice.»
Hello se fait conteur comme il fut polémiste, pour [p. 148] la plus grande gloire de son mysticisme, qui est l’interne flamme ardente et rayonnante à travers toute son œuvre. Ainsi qu’il a permis à cette lampe de sanctuaire de se transformer aux vases incandescents qui circulent à l’entour des impieux Jérichos pour en anéantir les murailles; de même il la laisse ici s’atténuer aux proportions d’une lanterne pour flétrir un vice ou dépister un crime. Renforcer à la lentille de son foyer la séduction d’une vertu ou l’horreur d’une déformation, c’est la mission de chacun de ces contes extraordinaires, lesquels méritent ce titre, entre ceux mêmes d’Edgar Poë et de Villiers de l’Isle-Adam, qui ni l’un ni l’autre ne renieraient Ludovic, le suréminent Avare, que ceux de Plaute, de Molière et de Balzac sont contraints de reconnaître pour leur roi.
Mais le mystique pur est, dans Hello, le plus admirable. J’ai cité précédemment sa superbe paraphrase du texte évangélique: Non erat locus in diversorio. En voici une autre, entre beaucoup, qui ne lui cède point. Il s’agit de l’attente de l’Enfant-Dieu par Siméon et par Anne:
«Probablement les siècles écoulés passaient sous les yeux de Siméon et d’Anne, et leurs années continuaient ces siècles, et le désir creusait en eux des abîmes d’une profondeur inconnue, et le désir se multipliait par lui-même, et le désir actuel s’augmentait des désirs passés, et ils montaient sur la tête des siècles morts pour désirer de plus haut, et ils descendaient dans les abîmes qu’avaient autrefois creusés les désirs des anciens pour désirer plus profondément. Peut-être leur désir prit-il à la fin des proportions qui leur indiquèrent que le moment [p. 149] était venu. Siméon vint au Temple en Esprit. C’était un Esprit qui le conduisait. La lumière intérieure guidait ses pas.
«Un frémissement inconnu de ces deux âmes, qui pourtant connaissaient tant de choses, les secouait probablement d’une secousse pacifique et profonde qui augmentait leur sérénité. Pendant leur attente, le vieux monde romain avait fait des prodiges d’abomination. Les ambitions s’étaient heurtées contre les ambitions. La terre s’était inclinée sous le sceptre de César-Auguste.
«La terre ne s’était pas doutée que ce qui se passait d’important sur elle, c’était l’attente de ceux qui attendaient. La terre, étourdie par tous les bruits vagues et vains de ces guerres et de ces discordes, ne s’était pas aperçue qu’une chose importante se faisait à sa surface, c’était le silence de ceux qui attendaient dans les solennités profondes du désir. La terre ne savait pas ces choses; et si c’était à recommencer, elle ne les saurait pas mieux aujourd’hui. Elle les ignorerait de la même ignorance, elle les mépriserait du même mépris si on la forçait à les regarder. Je dis que ce silence était la chose qui se faisait, à son insu, sur sa surface.
«C’est qu’en effet ce silence était une action. Ce n’était pas un silence négatif, qui aurait consisté en une absence de paroles. C’était un silence positif, au-dessus de toute action.
«Pendant qu’Octave et Antoine se disputaient l’empire du monde, Siméon et Anne attendaient. Qui donc, parmi eux, qui donc agissait le plus? Anne la prophétesse parla du monde suprême, [p. 150] Siméon chanta. De quelle façon s’ouvrirent leurs bouches après un tel silence?
«Peut-être dans l’instant qui précéda l’explosion peut-être toute leur vie se présenta-t-elle à leurs yeux comme un point rapide et total, où cependant les désirs se distinguaient les uns des autres, où la succession de leurs désirs se présenta à eux dans sa longueur, dans sa profondeur; et peut-être tremblèrent-ils d’un tremblement inconnu durant le moment suprême qui arrivait. C’était donc à ce moment si court, si rapide, si fugitif que toutes les années de leur vie avaient tendu? C’était donc vers ce moment suprême que tant de moments avaient convergé? Et ce moment était venu.
«Peut-être les siècles qui avaient précédé leur naissance se dressaient-ils dans le lointain de leurs pensées, derrière les années de leur vie, étalant d’autres profondeurs plus antiques, à côté de profondeurs qu’ils avaient eux-mêmes creusées! Qui sait de quelle grandeur dut leur paraître leur prière, et toutes les prières précédentes et avoisinantes, si les choses se montrèrent à eux tout à coup dans leur ensemble!
«Car la succession de la vie nous cache notre œuvre totale. Mais si elle nous apparaissait tout à coup, elle nous étonnerait. Les détails nous cachent l’ensemble. Mais il y a des moments où le voile qui est devant notre regard tremble, comme s’il allait tout à coup se lever. Un résumé se fait, le résumé des discours, le résumé du silence. Et ce résumé s’explique par le mot Amen.»
C’est un des beaux morceaux mystiques d’Hello. Ils abondent dans l’œuvre, on peut le dire, tout [p. 151] entière mystique, et qui, je le répète, ne revêt parfois d’autres formes que pour envelopper le divin de cette nuée qui le rend accessible aux mortels. Mais, à toutes pages, des phrases translucides, comme illuminées de cette lumière intérieure qui guidait Siméon, et semblables à ces boules de feu qui rougeoyaient sur le front du prêtre au cours des messes miraculeuses, éclairent le texte: «La pureté du regard est la force qui lève le voile et permet d’entrevoir le monde invisible à travers le monde visible; la création a de ces délicatesses; elle ne livre pas ses secrets au premier venu.»—«La science, pour être vraie, doit porter la paix avec elle, parce qu’elle saisit les choses dans le lieu de l’unité.»—Et cette belle réflexion à propos de saint Joseph: «Quand je pense aux noms de ceux qui obéissaient, je ne sais pas de quelle voix cet ouvrier devait donner des ordres dans sa maison.»
Le volume Physionomies de Saints présente de façon personnelle un groupe de bienheureux choisis parmi les plus célèbres, comme entre les moins connus. C’est un jour nouveau que darde sur les premiers l’œil perçant et ingénieux d’Hello, qui s’applique à faire jaillir de leurs circonstances des traits négligés ou omis par des Vies des Saints scrupuleuses et timorées, maladroitement empressées à atténuer ou effacer d’un type le geste qui personnalise la «singularité qui lui était propre» selon l’expression de Joubert. Hello les leur restitue originalement, et c’est encore cette présentation plus sapide qui nous conquiert aux plus obscurs élus que ce nouveau bollandiste remet pour nous en sa [p. 152] lumière. Tel ce merveilleux saint Goar: «Après avoir prié, il se rendit au palais épiscopal; il paraît qu’il entra d’abord dans une antichambre où il voulut laisser sa chape; mais, ne sachant pas très bien à quoi l’accrocher, il l’accrocha à un rayon de soleil, et la chape resta suspendue aux yeux de tous les assistants. Voilà la scène étrange et simple que nous pouvons méditer à travers le temps et l’espace. Saint Goar, et c’est ici que sa simplicité a quelque chose à nous apprendre, saint Goar ne s’était pas aperçu de ce qu’il avait fait. Il avait accroché sa chape au premier objet venu, sans regarder. Il avait cru que c’était un bâton. Il se trouva que c’était un rayon de soleil. Mais il est bien permis de se tromper de cette manière-là.
«Quant aux déjeuners servis aux pèlerins, saint Goar déclara que c’était une erreur de placer la perfection tout entière dans le jeûne et l’abstinence, et que la miséricorde leur était infiniment préférable.»
Et ce prodigieux Joseph de Cupertino que ses compagnons appelaient Frère Ane, à cause de son extraordinaire stupidité, et qui semble devoir typiser dans l’hagiographie la compatibilité de la sainteté avec l’absolue simplicité d’esprit: «Les œuvres divines, conclut Hello, portent le caractère des oppositions résolues dans l’unité.»
«En effet, frère Ane volait dans l’air comme un oiseau. Il n’y a guère dans la vie des saints un autre exemple de la même faculté poussée aussi loin.»
Et il ajoute: «Tel fut saint Joseph. S’il n’avait pas existé, personne ne l’inventerait. Il est extraordinaire. [p. 153] Il n’y a guère de saints, dans les bollandistes, qui déroute plus que lui les habitudes humaines.»
Paroles de Dieu, dithyrambe chrétien des saintes lettres, adorent la physionomie des versets élus comme le précédent ouvrage redorait l’auréole des bienheureux choisis. D’ineffables paraphrases y sont modulées avec mystère et précision, familiarité et grandeur.
A l’œuvre mystique d’Hello se rattachent encore les traductions et publications de ce Ruysbrœck si admirable, depuis plus expressément traduit par M. Mæterlinck, qui les élucide d’une préface magistrale. Puis ces dévorantes visions et instructions d’Angèle de Foligno préludant par dix-huit chapitres qu’elle intitule dix-huit pas; contre-partie mystique des dix-neuf profanes baisers du Hollandais Second. «Moi, dit la bienheureuse, entrant dans la voie de la pénitence, je fis dix-huit pas avant de connaître l’imperfection de ma vie.» Un ancien manuscrit formule de même sur l’eucharistie quinze pensées qu’il compare à quinze dents. «La triburation des dents, explique-t-il, ce sont les profondes et aiguës méditations sur le sacrement lui-même.» Enfin, les œuvres choisies de Jeanne Chézard de Matel, fondatrice de l’ordre du Verbe incarné.
Les Plateaux de la balance représentent avec l’Homme (le plus célèbre des ouvrages d’Hello) et Philosophie et athéisme la partie plus spécialement critique et polémiste de son œuvre.
Une réflexion m’est souvent venue: la prévoyante nature qui prépare aussi, tels que d’ethnographiques [p. 154] saisons, les mouvements de l’ordre social, a l’air d’apprêter concurremment, pour y pourvoir à leur heure, une réserve d’esprits-agents congénères qu’elle dote de facultés similaires, propres à déterminer ou régir telle révolution ou telle croisade. Il semble, comme dans l’organisation d’un opéra ou d’un drame, que les rôles aient été distribués au moins en double afin que la représentation politique ou la cérémonie religieuse, l’artistique ou scientifique développement, ne puisse être pris au dépourvu ni compromis par une abstention ou une absence. Les idées sont alors comme atmosphériques; elles stagnent ou flottent dans l’air; et dans le même instant plusieurs cerveaux en sont réceptifs et véhicules à peu près dans la même forme, quand il est nécessaire que la chose soit dite à cette minute-là. Quelquefois le premier sujet disparaît ou abdique, et celui auquel incombait l’office de le suppléer en tire l’occasion de se manifester avec un éclat que le premier n’aurait peut-être pas atteint. Providentiels revirements, correctifs invisibles.
Hello et Veuillot me paraissent avoir offert un exemple de cette prédestination en double. Mais Veuillot ne s’est jamais effacé, précisément peut-être pour s’être senti presser par cette nécessité de ne pas céder la place à l’autre, devers lequel, après d’initiaux encouragements témoignés, son indifférence pourrait bien avoir été tout au moins prudence.
Au reste, le petit côté qui rend populaire et qui fait tache, selon l’expression de Baudelaire (il la faut toujours citer quand on s’attache à de ces [p. 155] méconnus), manquait à cet autre; et telle virulente trompette dont usait, pour faire respecter l’arche, le grand coryphée de l’Univers, n’était point à la portée de la bouche hautaine d’Hello, et lui eût toujours fait défaut pour réaliser de certaines réussites.
Les plus purs et plus durables succès de cette immortelle survie qu’est la gloire posthume lui seront, on a le droit de l’espérer, de moins en moins ménagés. Et lui-même, n’a-t-il pas mis plus d’amertume que de conviction dans cette plainte: «La justice des hommes ne l’atteindra ni pour la récompense ni pour le châtiment, à l’époque où vous la lui promettez.»
Car, pour le citer une dernière fois, on peut lui appliquer ce qu’il écrivait d’un de ses saints: «Voici un saint peu connu et qui réunit une foule de qualités propres à faire connaître un homme.»
Cet homme-là, c’est bien Ernest Hello, «cet homme—et j’aime à conclure par cet extrait d’une lettre que m’écrivait récemment sa veuve—cet écrivain qui fut une âme visible errante sur la terre; blessée, souffrante, énergique, courageuse, désolée, fidèle à l’éternelle beauté, à l’éternelle lumière dont elle avait gardé le souvenir.
«Sa parole, d’une brûlante tendresse, et le pardon qu’il savait accorder à ses plus cruels ennemis, donnaient à son discours je ne sais quelle saveur très vigoureuse, céleste et victorieuse, qu’il avait, de son éternelle patrie, apportée ici-bas!»
VII
A Octave Mirbeau.
Il se flatte de tenir en main la balance.
Sainte-Beuve.
L’appropriation, l’adaptation, une certaine manière d’être adéquat à sa visée, à sa vision, à sa vie, n’est-ce pas la formule ensemble la plus succincte et la plus essentielle du relatif bonheur dont l’humanité semble susceptible? Certaines femmes, à l’aise dans leur beauté, quelques gymnastes, souples et assurés parmi le vol périlleux de leurs trapèzes, en font mouvoir de brillantes images. La disproportion, au contraire, est, à elle seule, une suffisante définition de la plus aigre forme du malheur. Fertile en hypocondrie et en spleen, elle engendre les atrabilaires et les mélancoliques, dont certaines chauves-souris
ont naguère essayé la ténébreuse allégorie.
En littérature, les écrivains qui se contentent d’un succès public, tout comme ceux auxquels suffit une ésotérique renommée, s’accommodent également bien de ces deux formes opposées de la gloire. Mais il y en a d’autres, ceux dont l’œuvre, sans s’imposer à tous du seul droit de foudroyer, comme du Shakespeare ou de l’Hugo, offre à chacun le loisir d’exercer sa critique incompétente [p. 160] et incomplète, sa bégayante ou inepte glose, ses jugements superficiels et erronés dont les mauvaises humeurs et les mauvaises fois, alternées d’incurables incompréhensions, pour manifestes qu’elles soient, ou à cause de cela même, n’en dégagent pas moins quelque chose de délétère et de corrosif comme la chute continuelle sur un marbre, d’une goutte d’acide.
Qu’est-ce alors qu’elles opèrent sur ce délicat pétale de fleur rare en lequel se peut transformer l’impressionnabilité d’un sensitif artiste? Ceux-là, quel que puisse être le visage de leur désintéressement ou le masque de leur indifférence, ceux-là sont condamnés à vivre troublés, véritables eauton-timoroumenoi de notre civilisation, comme ils le furent de l’ancienne qui avait trouvé pour eux cette appellation typique: rongeurs d’eux-mêmes, et, par ailleurs, cette définition de leur nature: maxime facti sunt suspiciosi, semperque credunt calvier. (Sont faits particulièrement soupçonneux, et croient toujours être lésés.)
Goncourt, à qui je citais un jour ce texte et que j’y sentais intéressé, fut, avec et après son frère, un transcendantal exemple de cette loi d’asymétrie dont Gautier a révélé l’arcane et précisé la formule dans cette phrase finale de l’oraison funèbre de Jules: «Il y avait peut-être après tout là-dessous un chagrin secret. Il manquait à Jules de Goncourt, apprécié, fêté par les maîtres de l’esprit... eh! quoi? Le suffrage des imbéciles. On méprise et on éloigne le vulgaire. Mais s’il se le tient pour dit et ne revient pas, les plus fières natures en conçoivent des tristesses mortelles.»
C’est le propre des esprits pénétrants et illuminés de ne pas voir que juste, mais loin et pour longtemps, et d’édicter des verdicts qui non seulement n’ont point à s’amender, mais se fortifient et justifient, gardant toujours, avec le mérite de l’antériorité, une acuité où les autres n’atteindront plus, sans fin surprenante et nouvelle. Telle la suave et savoureuse page de Baudelaire que nous lisait l’autre jour, à Douai, M. Catulle Mendès, la révélant à beaucoup, la rappelant à plusieurs. Nulle, en effet, ne contiendra jamais, résumée, résorbée en des termes d’atmosphérique langueur et d’électrique résonnance, plus de l’âme universellement amoureuse de Desbordes-Valmore.
Ces rêveries d’avant-garde, les unes plus métaphysiques, d’autres biographiques seulement, jouent, dans l’édifice d’une réputation, le rôle des assises premières aux fondations des architectures.
Et le final groupement en triomphal portique, ou en édifiante chapelle, de leurs cultes posthumes, de leurs zélations d’outre-tombe, semble une littéraire transposition de ces constructions-mosaïques de la foi, de ces temples dont chaque pierre, hommage d’un fidèle guéri ou d’une ouaille lénifiée, porte le nom du donataire, érigeant ainsi vers le ciel et dans l’histoire une forêt, de reconnaissants piliers, une pyramide de chantantes sculptures.
Et ces pierres, comme celles de l’éphod, ont chacune leur part de symbolisme ardent, révélateur et mystérieux, sans que l’archivolte ou l’architrave, [p. 162] l’entablement ou le vousseau, le modillon ou le listel, aient plus de droit à notre piété et à nos laudes dans l’élan de notre foi et l’élancement de notre prière. Mais avec une ferveur, seule, plus reconnaissante pour cette pierre angulaire, base de l’église «au cintre surbaissé» où passent et pleurent les âmes.
Quels que soient l’intérêt apologétique de l’article de M. Rosny, la valeur historique et sentimentale des émouvantes pages de M. Daudet, dans lesquelles le respectueux avenir écoutera palpiter les dernières pulsations de l’illustre défunt, et qui sont la dalle même incisée et fleurie de son littéraire sépulcre—le subtil portrait contemporain de Gautier que je citais tout à l’heure, se peut, entre tous, dans l’exégèse de Goncourt, assimiler à l’une de ces pierres aux caractères originaux et prophétiques non démentis par les réalisations ultérieures.
On pourrait la récrire cette phrase initiale, et s’écrier encore, aujourd’hui, avec cette solennelle modification reconstitutive: «La voilà donc refaite, cette individualité double qu’on appelait familièrement les Goncourt»—et réunir enfin dans l’immortalité à ce premier arrivé dans la mort, ce grand et triste distancé «qui luttait à chaque pas, comme s’il eût eu les pieds embarrassés dans les plis du linceul fraternel», et dont leur ami Théo nous a éloquemment légué l’image dédoublée et désolée: «Edmond, dans sa stupeur tragique, avait l’air d’un spectre pétrifié, et la mort, qui ordinairement met un masque de beauté sereine sur les visages qu’elle touche, n’avait pu effacer des traits de [p. 163] Jules, si fins et si réguliers pourtant, une expression d’amer chagrin et de regret inconsolable. Il semblait avoir senti, à la minute suprême, qu’il n’avait pas le droit de s’en aller comme un autre, et qu’en mourant il commettrait presque un fratricide. Le mort, dans son cercueil, pleurait le vivant, le plus à plaindre des deux, à coup sûr.»
C’était—ainsi l’ont discrètement relevé ces frères Rosny, dont la prestigieuse dualité prend dans notre estime et dans cette Académie Goncourt elle-même la place qu’y laissent libre les deux fondateurs,—une immanquable occasion pour les échenilleurs de psychologie et les redresseurs d’histoire, d’infirmer de si indéfectibles signes. Et la sincérité de la fraternelle affection de cette «seule personne en deux volumes» ne pouvait guère être moins mise en doute que la maternelle ardeur d’une Sévigné, pour celle qu’elle appelait «ses petites entrailles».
Rangeons-les plutôt, ces admirables hyperesthésies du sentiment, parmi celles dont la nature vient au secours de l’art, usant des séparations et des absences, pour en frapper, comme de baguettes divines, les rochers des cœurs, d’où jaillissent alors de touchants raphidims de musique, de sublimes hippocrènes de poésie.
N’y aurait-il pas même à inaugurer, en ces questions, une curieuse étude de la responsabilité; et, puisqu’on remettait dernièrement en scène les torts d’une George Sand à l’égard d’un Musset ou d’un Chopin, à spécifier la part d’agent providentiel de la traîtrise amoureuse, en matière de fécondation artiste, et de fabrication.
Pour nous, c’est sous l’aspect de ce fraternel esseulement, avec cette pâleur de «spectre pétrifié» et de «fantôme réel», qu’il nous a été donné de connaître Edmond de Goncourt, «cette pâle figure du frère, qui semblait reflétée par une lueur de l’autre monde, et avait l’air, sous le soleil ardent, d’un clair de lune en plein jour».
Et c’est encore ainsi qu’il nous est apparu, la dernière fois que nous le vîmes, quinze jours avant sa mort, cet inoubliable après-midi, dont nous nous appliquons depuis à revivre les heures,—chez notre ami Octave Mirbeau, dans ce merveilleux jardin de Poissy, qui demeure pour nous sa prairie d’asphodèles.
Nous avions dû faire route ensemble vers cet amical dîner; et comme, retardé, je ne survenais que vers la fin du jour, il m’accueillait de cet affable geste de bienvenue dont il était peu prodigue, et duquel sa glorieuse aménité m’a souvent fait fête.—Et dans cette heure dont le détail nous revient et s’accuse avec une netteté consolante et cruelle, ce nous fut, entre botanistes orientés diversement, amoureux curieux et attendris des flores, cent occasions de nous extasier sur celles que notre éminent hôte horticulteur se plaît à hybrider savamment, groupant leurs contours dilatés et leurs couleurs exaspérées en une apothéose de cannas fulgurants et de dahlias [p. 165] inconnus, aux buissons ardents de pétales et de pétioles où les tournesols semblent flamboyer et tournoyer tels que des soleils d’artifice.
Je me souviens d’un delphinium bleu Wedgwood et mauve rosé que le grand jardinier du Calvaire avait distingué de mon nom, et dont le Maître admirait les fuseaux d’étoiles aux irisations légèrement candies. Il y avait encore des penstemons vineux, des tigridias au cœur ocellé, des phlox à l’odeur de gâteau, des glaïeuls aux tons de chairs d’un poisson cru, et des œillets des Alpes aux pétales échevelés comme des mèches roses. Enfin ce fut une station enthousiaste auprès d’une centaurée de Babylone. Goncourt découvrait, dans les godrons de cette géante tige d’un gris cendreux de bouillon blanc, un motif nouveau pour l’enguirlandement gaufré d’un trumeau ou la bordure tuyautée d’un cadre.
Oui, tel, et sous ses cheveux blancs que Gautier voyait «se décolorer et pâlir à mesure qu’on approchait du terme fatal et de la petite porte basse où se dit l’éternel adieu», nous admirâmes, ce jour, et notre mémoire évoque ce noble visage pour lequel une dame d’esprit vif avait trouvé cette définition humoriste: une perle noire dans de la dentelle.
Certes la façon qu’avait ce grand homme d’interpréter l’amitié, d’entendre la camaraderie, n’était pas du goût de plusieurs, qui ne savent point mettre au-dessus de la lésion de la sensibilité la curiosité du phénomène. Goncourt aurait en effet volontiers spécifié pontificalement (le pontificat n’étant pas pour déplaire à l’un des auteurs [p. 166] de Madame Gervaisais) une différence ex cathedrâ entre les sentiments professés et la forme qu’il leur donnait dans ce journal qui était pour lui sa cathèdre. L’importance historique qu’il attribuait à son jugement le contraignait, croyait-il, à des exécutions dont la mesure ne sera donnée que par l’intégrale publication ultérieure de ses manuscrits. «Et il dira tout!» prophétisait pathétiquement Claudius Popelin, qu’inquiétaient ces annales. C’est sur le compte d’un homme qu’il estimait, jusqu’à le comparer à son frère, qu’Edmond de Goncourt tenait cet authentique propos: «Je ne pourrais pourtant pas publier de mon vivant ce que j’ai écrit sur lui.» Voici un non moins pittoresque exemple: J’ai acheté à sa vente un pamphlet contre la princesse Mathilde qui était, dit-on, son amie, et que lui-même faisait profession d’apprécier. En ce cas, n’eût-il pas été naturel de détruire l’exemplaire venu entre ses mains du libelle comminatoire? Non, le volume a été gentiment relié par ses soins, et après avoir complaisamment détaillé à l’encre rouge sur le premier feuillet, de son écriture la plus coquette, le rôle calomnieux que le pamphlétaire attribue aux deux frères, il ajoute qu’on va jusqu’à faire de la chute d’Henriette Maréchal une défaite pour l’impérialisme. Et il signe.
Au reste, chacune de ces épigraphes si finement calligraphiées par lui en tête de chacun des livres de sa bibliothèque ne fixe-t-elle pas un trait de son caractère, le même, à vrai dire, souvent? Je citerai encore celle-ci, sur un exemplaire des Géorgiques: «Le seul livre de l’antiquité que je sente.»—Et [p. 167] plus bas, d’une autre encre, comme en repentir d’un ostracisme sévère: «Avec Tacite cependant.»
Quant à certaine attitude rigide et frigide, que beaucoup prenaient pour de la hauteur, mais qui n’en était pas toute,—et qui valut à cet amateur de génie de se voir houspillé jusqu’à la fin dans sa sensibilité nerveuse et surexcitée; et, par delà le tombeau, encore quelque peu chansonné de ces libelles et de ces placards dont il avait collectionné les ancêtres typographiques,—ne pourrait-on pas dire qu’elle lui vint, pour une part, avec de la timidité naturelle et un peu de gaucherie, de «ces pieds embarrassés dans un pli traînant de linceul»?—Et, pour l’autre, de ce sentiment conscient d’inadaptation dont je parlais au début de ces lignes, et qui, du fait d’un anankè fatal, d’un magnifique ad augusta per augusta, d’un pas de chance glorieux, continuait de faire lutter le grand sensitif refoulé, contre des achoppements contradictoires ou risibles tous issus du même malentendu qui, à l’origine, avait fait paraître, le 2 décembre, le premier volume des deux frères. Car, en ces dernières années, n’était-ce pas lui-même, le titulaire vénéré du banquet à lui offert par de fidèles adeptes, qui, dès la porte, repoussé par un impudent maître d’hôtel lui réclamant sa cotisation et sa carte, confessait, dans son journal, avoir vainement cherché, de retour en sa maison d’Auteuil, de quoi satisfaire un violent appétit tardif, étranglé par l’émotion durant tout le cours de l’agape confraternelle?
Et, le jour de ses funérailles, enfin, ne se serait-elle [p. 168] pas exclamée: «C’est bien ma veine!» l’ombre de ce doux irrité, en présence des travaux de voirie qui barraient les abords de sa Maison d’un Artiste? Lui, que (malgré les coins pieux des illustres amis dont il était l’hôte) l’éloignement de sa demeure et la soudaineté de sa fin privaient d’être enseveli dans ce deuxième drap dont son frère avait emporté le premier et dépareillé la paire,—ce linceul dont le pli traînant avait, toute sa vie, embarrassé la marche du survivant;—lui qui ne fut pas, en outre, tout à fait exempt de ces habillements funèbres dont la «coquetterie posthume» lui déplaisait et desquels la crainte lui avait fait, plusieurs fois, répéter d’un de ces pittoresques dires qui lui étaient familiers: «Je ne veux pourtant pas me présenter devant le bon Dieu, habillé comme un Polichinelle!»
VIII
A Madame Polovtzow.
On me demande mon avis sur le récent opuscule de Tolstoï, intitulé: Qu’Est-ce que l’art?—sous le prétexte vaniteux que mon nom figure dans cet écrit. Et je l’y découvre en effet, dans le voisinage rassurant de mon éminent ami Georges Rodenbach. Interrogé sur l’œuvre d’un poète, Edmond de Goncourt donna une fois cet exemple peu commun d’un refus d’ingérence: «Comment voulez-vous, fit-il, que je vous réponde là-dessus, moi qui ne sais même pas quand un vers est sur ses pattes? Je me donnerai donc bien de garde de ne pas me régler sur un si prudent conseil de tact en une question d’Esthétique transcendantale, où le maître de Yasnaïa Poliana fait évoluer avec leurs citations tant d’experts dialecticiens, sans se donner pour satisfait de leurs définitions et de leurs textes. Je remarquerai seulement qu’après avoir glissé sur les dix leçons de Taine, il cite le Sar Peladan, mais ne nomme ni Prud’hon ni Ruskin.
Cependant, puisque l’illustre auteur de Michaïl qui serait sans doute étonné d’apprendre combien sont peu symbolistes les vers dont j’ai interprété cette œuvre de lui, délicatement sublime, me fait l’honneur de me nommer même confusément, je me permettrai, sur ce propos de son dernier-né, quelques réflexions moins nébuleuses.
[p. 172] «Toute la création est mangeante et mangée, écrit Hugo; les proies s’entremordent.»—Donc avant de dévorer tant d’esthéticiens pour nous les nommer pêle-mêle, Tolstoï esthéticien s’était vu lui-même dévoré par Nordau esthéticien, faute à ce grand romancier et à ce physiologue considérable d’avoir pratiqué le conseil de Goncourt.
Relisez ce passage de Nordau sur Tolstoï, en remplaçant le mot science par le mot art, et vous serez surpris de la part d’un artiste ayant donné de si authentiques preuves—de l’application qui se peut faire de ce jugement, au livre qui nous occupe: «La science véritable n’a pas besoin d’être défendue contre des attaques de ce genre. L’imputation de mauvaise foi ne serait pas de mise à l’égard de Tolstoï. Il croit ce qu’il dit. Mais ses plaintes et ses railleries sont en tout cas enfantines. Il parle de la science comme un aveugle parle des couleurs. Il n’a visiblement aucun soupçon de sa nature, de sa tâche, de ses méthodes et des objets dont elle s’occupe.»—Je le répète, appliqué à l’art, et dans le cas présent, le passage n’est pas moins vrai—et combien plus curieusement du fait de ce grand artiste! Et c’est encore la phrase de M. de Vogüé qui nous servira d’explication pour cette anomalie: «Ces phénomènes qui lui offrent un terrain si sûr quand il les étudie isolés, il en veut connaître les rapports généraux, il veut remonter aux lois qui gouvernent ces rapports, aux causes inaccessibles. Alors ce regard si clair s’obscurcit, l’intrépide explorateur perd pied, il tombe dans l’abîme des contradictions [p. 173] philosophiques: en lui, autour de lui, il ne sent que le néant et la nuit.»
C’est que, selon le dire lumineux de Taine: «Parmi les œuvres humaines, l’œuvre d’art semble la plus fortuite; tout cela est spontané, libre et, en apparence, aussi capricieux que le vent qui souffle. Néanmoins, comme le vent qui souffle, tout cède à des conditions précises et à des lois fixes; il serait utile de les démêler.»—Or, par une catégorique répartition d’attributions, il ne semble pas toujours que le producteur de l’objet d’art ait particulière qualité pour raisonner de son essence. C’est alors que ce regard si clair s’obscurcit, que l’explorateur perd pied, et qu’en lui, autour de lui il ne sent que le néant et la nuit. Permanente vérification de cette instruction de l’apôtre sur la nécessité pour chacun d’une haute et sereine conscience de sa vocation. Les uns ont le don des langues, les autres, le don de les interpréter.
Certes, loin de moi de m’élever contre le labeur humain, voire assidu, opiniâtre, constant, indispensable à la technique de l’art pratiqué; mais pour son aboutissement mystérieux, génial et vraiment divin, l’Art a ceci de précisément constitutif de sa nature, qu’il est presque nécessaire de n’y plus penser pour l’accomplir: «Je l’ai fait sans presque y songer» le vers de Musset peut être un impertinent badinage d’écolier, en même temps que le résumé conscient de ce qu’il faut d’oubli de soi au savoir pour reconquérir la grâce. C’est ce que nous représente l’immortelle maxime d’Okousaï, s’apercevant après la production de [p. 174] son inimitable Mangua qu’il n’a par elle appris que le secret d’apprendre; et ce secret qu’il ne nous livre pas (et qui nous apparaît aussi triomphalement à Haarlem dans l’examen des derniers Franz Hals),—et bien notamment dans toute l’œuvre de Whistler, c’est l’art de ne pas tout dire, le secret de ce qu’il faut paraître avoir oublié. Mais avant ce suréminent degré de perfection, plus souvent pourtant grâce à lui, l’art peut émaner et rayonner de ce que l’artiste a tenu pour un embryon, pour une ébauche; pourvu qu’il ait simplement, sincèrement, chaleureusement tenté de lui infuser un peu de son respect pour lui et de son amour.
Sollicité un jour de donner une définition de l’œuvre d’art, il ne me déplaît pas d’avoir répondu: L’œuvre d’art, c’est l’amour ayant autre chose que lui-même pour objet. Le chemin de l’art, c’est (je le répète, sans préjudice de la technique, mais quant à son aboutissant divin) ce sentier du conte de Fées dont on ne pouvait rencontrer l’accès qu’à la condition de ne le plus chercher.
L’art c’est le dieu dont la vision directe serait foudroyante et qui se voile d’ombre pour dicter ses lois. Et plus tendrement, c’est Eurydice qu’Orphée ne saurait reconquérir qu’à la condition de ne la point revoir avant l’expiration de l’épreuve. Moïse-Orphée-Tolstoï a voulu voir Dieu et considérer Eurydice, que dis-je? les dévisager, au cours même de son inspiration et de son chant: c’est pourquoi, pour cette fois, Dieu s’est abstenu et Eurydice a fui, désenchantée.
Je me suis laissé dire, par notre chère et véridique [p. 175] Judith Gautier, le jour où je l’ai le moins écoutée, qu’elle-même et son ingénieux père, qui en voulait à Stendhal de manquer de style, se seraient concertés pour organiser (saint Orphée me passe l’expression) à propos du livre: l’Amour, de Beyle, cette scie, en forme de canon, laquelle ne serait peut-être pas sans s’appliquer plus exactement à l’opuscule de Tolstoï: «L’as-tu lu?—Oui.—L’as-tu compris?—Non.—Moi non plus. Recommençons.» Et après un temps:—«L’as-tu relu?—Oui.—L’as-tu compris?—Non.—Moi non plus. Recommençons!»
Hugo a, dans quelque poème, amplement paraphrasé la prépondérance du libelle spirituel par-dessus le pédant infortiat. Quelle que puisse être sa prétention au libelle, cet infortiat-là c’est le pédant opuscule de Tolstoï. Et ce libelle délicat et délicieux qui le vainc et le nargue, profond sous sa désinvolture sémillante, c’est le Ten o’clock de Whistler, malicieux, subtil et par places sublime catéchisme d’art dont Tolstoï n’a point parlé, et où l’on voit, sur la fin, l’art, coquine cruelle, fuir les pédants, pour rejoindre ses préférés, ses amants de cœur (desquels il est, l’admirable Whistler) «indifférente à tout, dans sa camaraderie avec eux, excepté à leur vertu d’affinement.»
Les Orientaux ont, en leurs poèmes, une jolie façon de multiplier les charmes, les pouvoirs, les mérites de l’amant. Ils parlent de lui au pluriel, et au lieu de: il aime, il va venir, écrivent: ils vont venir, ils aiment.
La coquine cruelle de Whistler, nous offre un [p. 176] similaire artifice de langage. C’est faire de l’art une Galathée, toujours en fuite vers les saules, mais en posture assez alléchante pour s’offrir au plus digne de la saisir. Sed cupit ante videri.—C’est donc avec l’illustre portraitiste de Lady Campbell,—et j’ai le bonheur de pouvoir dire: le mien, que nous nous insurgeons contre la théorie apologétique du chef-d’œuvre accessible à tous. Ne serait-ce pas faire par trop voisiner Eschyle et Shakspeare avec M. Georges Ohnet. Le Prométhée enchaîné et le Roi Lear avec le Maître de Forges?—C’est aussi avec Baudelaire, à l’autorité d’ailleurs récusée par l’auteur du Qu’est-ce que l’art? que nous nous faisons gloire de proclamer que «les affaires d’art ne se traitent qu’entre aristocrates, et que c’est la rareté des élus qui fait le paradis».
Enfin, c’est à un ironiste mot de Madame Forain que nous laisserons de formuler sur la question un jugement en apparence léger, caractéristique en tout cas. Comme on s’étonnait devant elle de ce titre de questionnaire pédant banalement interrogatif: Qu’est-ce que l’art?—«Oui, s’exclama notre humoriste amie, bien un titre trouvé par un riche qui fait sa chaussure lui-même!»
IX
A André de Saint-Phalle.
Il est parlé dans l’apocalypse d’un ange qui, descendant du ciel un petit livre à la main, posait un pied sur la mer, l’autre sur la terre.—«Allez prendre le petit livre!» criait une voix. «Prenez-le et dévorez-le—confirmait l’ange—dans votre bouche, il sera doux comme du miel.»—«Je pris donc le petit livre et le dévorai, ajoute l’apôtre, et dans ma bouche il fut doux comme du miel...»
Saint Jean ayant dévoré le petit livre, nul vraisemblablement ne connaîtra, dans le temps, ce que le petit livre enfermait. Cependant, il viendrait à se découvrir que ledit petit livre n’était autre qu’un prototype du Cahier sur le vol des oiseaux, de Léonard de Vinci, que nous n’aurions vraiment pas trop lieu d’en être surpris.
Rien de plus mystérieux, en effet, que ce mince cahier à la couverture d’un grain de massepain et d’un ton de plaisir dont la typographie viennoise nous offre un fac-simile extraordinaire. Ce cahier de trente pages, mentionné pour la première fois en 1637, envoyé à Paris par Bonaparte en 1796, volé à la bibliothèque de l’Institut avant 1848, [p. 180] racheté à Florence en 1867 par le comte Manzoni, puis finalement, en 1888, par M. Sabachnikoff. Trente pages, dont les péripéties reportent à cette légende du Sancy, moins précieux diamant dont les hasards de la guerre allaient jusqu’à le faire extraire des entrailles du serviteur exhumé qui, lors du péril, l’avait avalé pour le conserver à son maître.
Admirable matière à faire réfléchir sur les entraves aux inventions et sur les vicissitudes de la gloire, que l’histoire de ce manuscrit, une première fois dérobé aux héritiers de Melzi, l’élève et le légataire de Léonard, puis rapporté, dix-sept ans après, au chef de la dite maison Melzi qui l’abandonnait au restituteur, en s’étonnant seulement «qu’il eût pris cette peine!»
Or, ayant moi-même goûté au petit livre, je le trouvai d’abord un peu amer, contrairement à l’apôtre; ensuite doux comme le miel.
Les quelques mesures pour rien par où débute le fascicule pourraient bien avoir, volontairement ou fortuitement (un subtil penseur a écrit: «Ses paroles, quoique vraies, ne pénétraient pas son esprit,»), une signification allégorique sous leur apparence accidentelle, épisodique et désintéressée. Elles enveloppent et protègent le sujet comme d’une gangue arcane et symbolique. Il y est traité de l’art d’empreindre les médailles: celle qui allait sortir de ce moule était bien curieusement frappée. On y indique ensuite la façon de piler le [p. 181] diamant en l’enveloppant dans du plomb. Encore on pourrait croire, un mythe de l’opération qui va pulvériser, dans les pages qui suivent, un si incroyable secret, par bribes comme intentionnellement embrouillées et disjointes, pour ne le livrer au monde qu’abrité du voile d’énigme qui, seul, permet d’en soutenir le fulgurant éclat; en laissant—comme dans le Scarabée d’or—la découverte et l’usage
à celui qui saura reconstituer le diamant gravé de telle recette surnaturelle et de cette trouvaille absolue qui, assimilant les hommes aux oiseaux, est bien voisine d’en faire des anges.
Suivent les moyens de faire «une belle couleur azur» et «un beau rouge», nuances du ciel et du couchant parmi lesquelles notre humanité volatilisée va pouvoir s’ébattre, faire des coupes et des brasses.
Puis l’ouverture prélude, magistrale et sérieuse: «La science instrumentale ou machinale est très noble, et par-dessus toutes les autres très utile, attendu que, par son moyen, tous les corps animés, qui ont mouvement, font toutes leurs opérations...»
La figure 23 seulement commence à distiller le miel et dissiper le mystère. De la forme et de la grandeur d’un timbre-poste, elle représente sommairement mais expressivement un homme ceinturé d’un appareil assez semblable à celui dont les campagnards occupés emprisonnent prudemment leurs marmots [p. 182] pour leur apprendre à se mouvoir et à marcher en même temps qu’il les garantit des chutes. Soutenus sous les aisselles dans cette armature roulante, ils y sont maintenus debout, oscillant de-ci de-là.
Voici le commentaire de cette vingt-troisième figure: «l’Homme dans les volatiles—notez cette désignation—a à rester libre de la ceinture en haut, pour pouvoir s’équilibrer, comme il fait dans une barque, afin que le centre de sa gravité et de l’instrument se puisse équilibrer et se changer, où nécessité le demande, au changement du centre de sa résistance.» Et dès lors nous voyons, à n’en pas douter, que, sous l’apparente modestie de son titre d’histoire naturelle, le Codice ne traite de rien moins que du vol des oiseaux humains; en un mot, du droit de volitation de notre pesante espèce, que voici retrouvé, dérobé aux méconnaissances et aux spoliations par un essaim de laborieux complices de ce Léonard-Prométhée—nous dotant cette fois de l’éther.
Dieu l’a prise du doigt pour la conduire au port, cette bouteille à la mer, qui contenait l’espace! Et nous n’avons plus qu’à proclamer dans l’attente d’une mise en œuvre définitive de ces préceptes surhumains par quelque Nadar-Edison de la mécanique aérostatique ce vœu enfin comblé du poète des hirondelles:
Viennent des conseils pratiques, scientifiques, détaillés à L’Homme dans les volatiles; des avis—entremêlés de discussions avec L’Adversaire—réglés sur l’exemple des oiseaux, l’inspection expérimentale de leurs instincts, l’examen de leur industrie, pour diriger fraternellement Adam au milieu des espaces, apprendre à Deucalion à se conduire, se maintenir et comporter à travers les nues. Parfois on dirait qu’il ne s’agit que d’une étude naturaliste du vol même des Légers navigateurs du vent, selon la jolie expression de Mme Valmore: «Toujours le mouvement de l’oiseau doit être au-dessus des nuages, afin que l’aile ne se mouille pas, et pour découvrir plus de pays, et pour fuir le péril de la révolution des vents parmi les gorges des monts, lesquels sont toujours pleins de tourbillons et tournants de vents.»—Mais ce n’est qu’une similitude et un tremplin pour s’élever à la déduction, au direct conseil. Et l’alinéa conclut ainsi: «Et outre cela, si l’oiseau se tournait sens dessus dessus, tu as un large temps pour le retourner en contraire, avec les ordres déjà donnés, avant qu’il retombe à terre.»—Plus loin: «A b c d sont quatre nerfs de dessus, pour élever l’aile... bien qu’un seul de cuir tanné, gros et large, pût par aventure suffire; mais pourtant, à la fin, nous nous en remettrons à l’expérience!»
En somme, tout ce qu’il faut pour planer, strictement déduit, démonté, démontré réellement par A plus B en techniques propos qu’il semble vraiment n’y avoir plus qu’à approprier, adapter, [p. 184] exécuter, mettre en fonctionnement aérien, en exercice supraterrestre, en circulation interplanétaire.
Mais soudainement l’éducateur Icarien s’interrompt, comme sous le heurt préventif et irrévérencieux de la stupide incrédulité coupant la parole au spéculateur des oiseaux, suivant son propre terme, au milieu de ses spéculations sublimes. Et Léonard interjette ce rappel à l’ordre admirable: «Et la menterie est de tant de mépris que si elle disait de bien grandes choses de Dieu, elle ôte de la grâce à sa déité; et la vérité est de tant d’excellence que si elle louait des choses minimes, elles se font nobles.
(En marge.) «Mais toi qui vis de songes, il te plaît plus les raisons sophistiques et coquineries des hâbleurs dans les choses grandes et incertaines, que de certaines naturelles, et non de si grande hauteur.»
Puis tout aussitôt après, dis-je, ce rappel à l’ordre, au sérieux, à la question, nous reprenons le fil des démonstrations matérielles éthéréennes. «On te rappelle (au spéculateur des oiseaux) à l’auditeur écolier sans doute absent et irréel, mais docile et attentif dans l’avenir, et suscité par le vouloir impérieux du maître voyant qui le prémunit ici contre l’erreur d’Icare; on te rappelle comment ton oiseau ne doit pas imiter autre chose que la chauve-souris, à cause de ce que les membranes sont une armure ou liaison aux armures, c’est-à-dire maîtresse des ailes.»
La chute est encore soigneusement prévue et prévenue, dirai-je aménagée, à l’aide de certaines [p. 185] outres, grâce auxquelles «l’homme tombant de six brasses de hauteur ne se fera pas de mal, tombant tant dans l’eau que sur la terre...» Et la prise à partie dans ces termes libres et précis: «Si tu tombes, de l’outre double que tu tiens sotto il culo, fais que tu frappes avec elle la terre.»
Mais ladite outre en forme de patenôtres nous fait rebondir bien haut, toujours plus près du zénith, avec cet aveu in margine, comme incidemment échappé, au cours de la démonstration, et pareil à la friandise qui incite l’enfant à poursuivre une aride étude: «La ruine de tels instruments...», nous disait tout à l’heure Vinci, mais l’usage de tels instruments?...—Le voici, l’usage: «On portera de la neige, l’été, dans les lieux chauds, prise aux hautes cimes des monts, et on la laissera tomber dans les fêtes des places, au temps de l’été.» Révélations dont la simplicité de son émission n’a d’égale que son envergure. Les voilà ces «certaines choses naturelles, non de si grande hauteur», que tout à l’heure nous promettait le maître.
Il est donc accompli, ce souhait des Héliogabales. Et ne voit-on pas que volontiers Léonard rééditerait ici son stupéfiant: «mais pourtant à la fin, nous nous en remettrons à l’expérience.»

Plus haut, plus haut encore!—Et en effet, nous atteignons le sublime en ce couronnement ineffable: «Le grand oiseau prendra le premier vol sur [p. 186] le dos de son grand cygne, et emplissant l’univers de stupeur, emplissant de sa renommée toutes les écritures, et gloire éternelle au nid où il naquit!»
Puis, comme pour refermer la gangue où gisait et luisait le métal de la médaille, refondre le plomb qui contenait le diamant pilé, la retombée sur la Terre du grand oiseau, avec et de par le lest de deux ou trois réflexions tout ordinaires, banales et bien humaines: «mardi soir, au jour 14 d’avril, Laurent vint demeurer avec moi: il dit être de l’âge de 17 ans... au jour 15 dudit avril, j’eus 25 écus d’or du camerlingue de Sainte-Marie-Neuve.»
Telle est l’histoire du grand oiseau. Oui, gloire éternelle au nid où il naquit!
X
A Antonio de la Gandara.
Un des plus merveilleux sujets de rêverie pour le contemplatif accoudé sur le pont des âges, à regarder couler, précipitées ou alenties, les ondes des jours, charriant les succès rapides, les gloires entravées, les oublis prématurés, les injustes abandons, c’est, parmi tant de flots directs et légers qui vont chantant leur cours facile, l’incompréhensible arrêt de certaines vagues, lesquelles semblent n’avancer point, comme attachées à quelque récif invisible avec le pétale qu’elles enferment ou la perle qu’elles roulent. Quel courant détourné, quel jet de pierre du rivage, peut-être quel ricochet d’enfant doit rendre enfin libre la vague prisonnière, avec ses déchets et ses trésors, l’œuvre captive, avec ses beautés et ses tares? Et cela, qu’il s’agisse d’un vivant ou d’un mort (car, s’il est des morts qu’il faut qu’on tue, il y a aussi des vivants qu’il faut qu’on ressuscite), d’un prophète longtemps méconnu dans son pays ou d’une renommée parfaite au delà des monts ou des eaux, et qui tarde indéfiniment à les franchir pour rayonner en deçà quand d’autres réputations des mêmes bords s’accréditent au hasard d’une chronique ou d’un bavardage.
[p. 190] Quelque chose de ce mystère flottait pour moi, il y a tantôt dix ans, sur les noms de Rossetti (dont rien n’a encore été exposé en France), de Watts, dès lors représenté, salle Petit, par un portrait d’Algernon Charles Swinburne, accompagné de fulgurantes esquisses, de Burne Jones enfin, dont, en ce temps-là, une seule toile, Merlin et Viviane, nous avait été exhibée, en 1878, au Palais des Beaux-Arts.
C’est en 1884 que le désir de voir de près certains fomentateurs et des éléments de ce mouvement esthétique préraphaëlite me menait à Londres, chez M. Burne Jones lui-même, et dans les salons qui contenaient de ses œuvres et de celles de ses devanciers; puis dans les boutiques où pullulaient les créations ingénieuses ou caricaturales dues à cette renaissance, agonisante déjà.
La comédie satirique de Patience, la mise en circulation et en vente de la fameuse et curieuse théière représentant un esthète et une esthète, dos à dos, avec leur double bras accolé pour goulot et pour anse, leur tournesol et leur arum respectifs, à la boutonnière et au sein, et cette épigraphe: «Fearfull consequences through the laws of natural selection and evolution of living up to ones Teapot»—c’étaient les coups légers sous lesquels avaient succombé sans doute les moins intéressants des disciples de M. Wilde. On n’en voyait plus errer qu’un petit nombre à Rotten Row, convaincus et résignés, victimés et falots sous des atours jonquille ou vert saule. Des thés en recélaient encore. Mais ce n’était déjà plus le temps où des groupes silencieux en défroque Henri VIII arboraient dans le [p. 191] salon de Sir Frederick Leighton des plumes de paon moins facétieuses que celles de nos fêtes foraines.
Pourtant le bon grain de la doctrine germait toujours chez M. William Morris, le poète-décorateur socialiste, sous la très haute et très mystique direction du grand maître Burne Jones.
Ce fut pour moi un bel après-midi, dont la mémoire me reste enchanteresse et fleurie, ce jour de notre visite sous la gracieuse conduite du célèbre préraphaëlite (qui avait tenu à nous mener là et s’était installé en guide sur le siège de notre landau) à l’abbaye-phalanstère où M. Morris, loge des familles d’ouvriers qu’il emploie à la féerique fabrication de ses rêveuses tentures, inextricables fouillis de branchages symétriques, derrière lesquels il semble que la Belle au Bois dormant sommeille; à ses toiles chimériques, à ses damas changeants, le tout diapré d’un décor ensemble médiéval et moderne, dont on dirait que le pollen fut soufflé par les fleurs de la robe de Primavera, avec tous les gazons de Botticelli, compliqués de ceux de la Dame à la licorne, entre lesquels le chèvrefeuille domine; le chèvrefeuille, la fleur de la passion de maître Morris, au point qu’elle le dénomme à travers le monde, et que, si vous devez télégraphier à cet ornemaniste, il vous suffira réellement d’adresser ainsi votre dépêche: Honeysuckle, London.
Quant à M. Whistler, l’illustre et admirable maître américain désormais installé parmi nous, il n’y a point lieu de le mêler à l’histoire de cette réforme à laquelle ne le rattachent que son amour [p. 192] délicat de la japonaiserie distinguée avant l’invasion du bibelot barbare, et l’éclaircissement de tout le fuligineux mobilier anglais de par quelques-unes de ses décorations lumineuses, et notamment son emploi du jaune pâle, du blanc ou du bleu turquoise dans l’ameublement et la tapisserie.
Toutes ces choses nous sont devenues depuis, familières et banales, bien moins par la grâce d’une démonstration savante et documentée, que du fait d’une mode et de la terminologie courante de certains enthousiasmes de confiance et à grand renfort de photographies qui n’allèrent point jusqu’à traverser le détroit pour admirer de visu, sur place, les objets inconnus de leur culte et les vagues sujets de leurs gloses. Partisans, voire prêtres de la religion nouvelle, rien que pour avoir communié des bonbons de Fuller sur des coussins de Liberty et Compagnie.
C’est ainsi que, dix ans après que nous eussions pensé:
il a fallu, l’an dernier, l’élégante effraction d’une porte ouverte par une brillante jeune dame-auteur pour révéler à beaucoup de Parisiens l’existence de Burne Jones que plusieurs, à vrai dire, ne différencient pas encore très bien de John Burns. Et pour la première fois seulement la question technique va être abordée d’une façon analytique et synthétique à la fois, par M. Gabriel Mourey, dans son ouvrage annoncé et attendu: l’École préraphaëlite anglaise, qui va nous déduire de lady [p. 193] Lilith et de la damoiselle Bénie les cuivres de Benson et les faïences de Morgan.
Ces deux derniers lustres, dans le même temps que s’opérait chez nous cette lente infiltration de Watts (l’Espérance et quelques autres belles et pensives toiles bleues en 89), de Burne Jones la même année, avec son King Cophetua, son chef-d’œuvre, inspiré des deux toiles de Melozzo da Forli, de la National Gallery; avec ses deux panneaux et son portrait d’enfant de l’an passé, de purs dessins, et, enfin, cette aquarelle rendue malencontreusement célèbre, jusqu’à l’extinction! par une mésaventure photographique—dans le même temps, dis-je, des traductions nous étaient offertes de plusieurs poètes anglais: Shelley—si tard après Byron! un volume de Swinburne, par M. Mourey, la Maison de vie de Rossetti par Mme Couve. Mais Keats, le délicieux Keats s’attarde. C’est ainsi que Walter Crane est déjà familier à beaucoup; que le nom de Holman Hunt apparaît quelquefois, plus rarement, au bec des plumes averties; mais que du plus curieux peut-être d’entre tous les artistes anglais, je ne démêle ici de trace en aucun esprit, l’effrayant nom ne m’apparaît dans pas un courrier, comme dans nulle causerie ne résonne.
Et j’ai nommé William Blake[48].
[48] M. Catulle Mendès m’a rappelé avec beaucoup de bonne grâce l’intéressante étude qu’il a lui-même antérieurement consacrée à ce curieux artiste.
Et pourtant, si quelque chose semble fait pour passionner notre fin de siècle éprise de curiosité [p. 194] et d’occultisme, n’est-ce pas ce peintre-poète à l’œuvre si prodigieusement vêtue de lumière et de ténèbres; l’homme qui se jouait à lui-même, sa femme lui donnant la réplique et tous deux dans le costume, des scènes du Paradis perdu; l’artiste qui exécutait la plupart de ses créations d’après des esprits posant véritablement pour lui; sorte de modèles fuyants dont on l’entendait dire, de temps à autre, durant la séance: «Il bouge,» ou bien: «Sa bouche a disparu»? C’est de la sorte qu’il nous a transmis, entre autres, le portrait authentique de l’homme qui a construit les pyramides.
La Galerie Nationale, qui possède deux peintures de Rossetti, ne donnant guère à voir que du Bouguereau bizarre: une figure de la Vita Nuova d’un sentiment poétique mais d’une coloration piètre, et une Annonciation dont toute la nouveauté consiste en ceci que le symbolique lys de la Vierge n’y figure que brodé, la tête en bas, sur un ruban rouge—la Galerie Nationale renferme aussi deux petits tableaux de Blake: une vision apocalyptique, et d’étranges funérailles d’un cercueil porté par des vieillards d’une taille démesurée.
Je n’entreprendrai point de donner ici l’idée d’une œuvre aussi inconcevable et aussi multiple que celle de William Blake, aujourd’hui célèbre en Angleterre, et dont les toiles, comme les gravures, sont cataloguées (par Rossetti) et cotées à des prix respectables, après s’être vues méprisées du vivant de leur auteur, comme il advint chez nous pour Millet et de tant d’autres. «Travail invendable!» formulait un Goupil du temps. Ce que je me contenterai de souhaiter et de saluer ici, [p. 195] dans un avenir, j’espère, prochain, c’est l’esprit, ensemble précis et mystérieux, qui abordera, ainsi que Baudelaire le fit pour Poë, mais avec, cette fois, des difficultés bien plus ardues, la traduction et l’interprétation de l’œuvre littéraire et graphique doublement touffue de l’auteur du Livre d’Urizen et du Mariage du Ciel et de l’Enfer. Cette œuvre, entièrement gravée et imprimée par Blake lui-même, entre tant de tribulations et d’infortunes que soutenaient seuls les fantômes qui posaient pour lui! Cette œuvre où la poésie, comme d’un Mallarmé plus philosophe et plus fécond, enchevêtre son texte d’un beau caractère à des compositions dont l’origine supra-terrestre explique, seule, la possibilité de tant de rêve concrété et d’infixable figé! En ces dessins, il y a du Michel-Ange, du Raphaël, du Primatice, de l’Odilon Redon, du Blake et de l’innommé.
Dans certaines figures de Redon seulement, il semble qu’on ait pu frôler tant de stupéfiant inconnu. Et il faudrait l’art avec lequel M. Huysmans décrivait naguère une série de ce dernier artiste dans la Revue indépendante, pour donner un aperçu des illustrations de Blake à son Livre d’Urizen, par exemple. Figures tournoyantes ou tourmentées dans le feu, figures surtout abîmées comme nul autre n’aura su l’exprimer, ramassées en des attitudes de douleur prostrée qui varient jusqu’à l’infini tout ce que peut donner l’anatomie humaine dans le rassemblement des membres sous le faix d’un supplice ou d’une résignation sans bornes.
L’illustration pour le Livre de Job, illustration que Blake méprisait comme tout ce qu’il tenait [p. 196] pour un travail manuel, à savoir ce qui n’était pas le fruit de ses visions—présente de beaux spécimens de ces postures accablées sous le désespoir ou devant l’extase. Mais l’admirable scène de paix que ce groupe de la Famille de Job avant l’épreuve, au milieu de ces paissantes brebis, d’une formule décorative évocative et charmante!
Aucun peintre trouva-t-il jamais des expressions révélatrices, des poses et des gestes indicateurs pour représenter les états d’âme avec une réalité si immédiate? Le cataclysme et la sérénité sont pareillement du ressort de celui-ci. Rien de plus ravissant que la courbe révérencieuse et attendrie de ses anges sinueux aux pieds de l’Éternel. Puis, comme leur épouvante s’accuse et s’accentue à la ruade enflammée de Satan au-devant d’un Jéhovah dont la sublime douleur est touchante, au penser des supplices consentis de son serviteur élu. Job cadavérique terrassé par le hideux mal, la saisissante horreur de ses amis, les yeux hagards et les bras levés, la lamentation de Job et sa plainte, l’accusation des témoins, et surtout les hantises nocturnes font des tableaux inouïs et inoubliables. Les personnifications répétées des chantantes étoiles du matin (dont M. Burne Jones a bien pu se souvenir en inventant les Jours de la Création) présentent un bel enchevêtrement de bras et d’ailes. Le geste du Seigneur Dieu désignant le Léviathan et le Béhémoth par-dessus le groupe des voyants, et enfin, avant la radieuse vision de l’allégresse de la maison rétablie célébrant sur les instruments sa délivrance et sa joie, le doux blottissement des trois filles de Job, comme dans un nid, sous l’incommensurable [p. 197] envergure de la bénédiction paternelle, c’est une faible énumération de cette série biblique, sur des ciels déchirés et visionnaires, entre des encadrements ingénieux, quasi japonais, de flammes et d’oiseaux, de serpents et d’anges, de coquillages et de champignons, d’insectes et de pampres.
Dans l’illustration de ses propres poèmes, celle que Blake préférait et où il donnait libre cours à sa voyance, c’est au texte même que sont entremélangées les araignées et les chauves-souris, avec des figures. La veine est tour à tour gracieuse et terrible. Au Livre de Thel que son sujet incline vers le premier genre, les filles-fleurs, avant Granville et avant Wagner, sont pleines de flexibilité gracile. Les lettres des titres escaladées de minuscules indications d’anges sous des retombées de branches filiformes et pleureuses où des oiseaux perchent, tiennent des paraphes ornementaux et vrillés des professeurs de calligraphie. Ailleurs (dans Jérusalem, le Chant de Los, et dans ce dessin qui sert de couverture aux volumes de Gilchrist), des repos, des étreintes de personnages dans des lis, l’allongement de deux génies, au cœur d’un pavot, sous deux campanules dont les pistils sont une ronde de sylphes, s’épanouissent en une fantaisie charmeresse. Ici, des suppliciés accroupis au bord des eaux noires; là, des chevauchées de serpents et de cygnes par de sveltes nudités sommaires. Puis, tous les élans, toutes les gambades, toutes les enjambées, dirai-je, toutes les acrobaties et toutes les culbutes, dans les espaces; les apparences les plus nobles, les aspects les plus bizarres. Dans le titre de Jérusalem, [p. 198] de séduisantes incarnations de papillons-femmes; plus loin, un chimérique cygne féminin. Partout des représentations vraiment de Patmos. Puis cette belle apparition du Christ à un personnage nu, qui n’est autre que Blake, dont les bras ouverts au pied de la croix, et qui répètent ceux du Crucifié, se tendent en une ampleur sublime. Enfin deux ou trois autres très augustes images qui font penser à la grande toile de M. Gustave Moreau: le Combat de Jacob avec l’Ange.
A l’entour de certains brouillons de poèmes, je remarque un sommeil d’ange vraiment raphaëlesque non loin de monstres agencés des structures les plus imprévues, et de mâchoires dévorant des corps en une voracité de cauchemar, qui évoque le musée Weerts de Bruxelles, tandis que cette larve enveloppée rappelle le masque de Préault: le Silence.
L’Ame veillant sur le corps du Saint, l’Étreinte—d’un élan prodigieux—du Saint et de l’Ame et les autres sujets de cette suite permettent de ne pas douter que Blake ait véritablement peint de ses visions. On demeure béant devant son œuvre comme en présence d’une Apocalypse versifiée et illustrée par un saint Jean de la poésie et du dessin, un Fra Angelico de l’étrange et du terrible.
XI
A Madame Stanley.
C’est grand dommage, devant un spectacle de nature ou d’art qui nous émeut, de ne point fixer dans quelque note, fût-elle hâtive, cette émotion du moment, émotion d’encre et de sang, vraie palpitation de notre feuillet, comme, au vent de l’inspiration, ces feuillages de l’antique forêt où s’inscrivaient des oracles. La houle des sensations une fois apaisée, et, ces feuilles retrouvées parmi les pages de nos souvenirs, nous reverrions entre leurs fibrilles, dont le temps a fait un tulle irisé, de remontants dessins pareils à ceux que peignent les Chinois sur les feuilles de mûrier dont le ver à soie a mangé la trame; dessins dont l’erreur ou la gaucherie garderait du moins de l’émotion primitive une sincérité et une fraîcheur qui réjouiraient, en les renseignant, ceux qui ont souci de nos impressions, s’enquièrent de nos jugements et s’inquiètent de nos pensées. Et ces pensées d’autrefois seraient, dans notre livre de mémoire, semblables à ces pensées-fleurs qui sèchent dans les missels, mêlant à celle des marges leur illustration à peine défunte, tachant le texte d’un peu de leur sang lilas et buvant de leur pétale pâli un peu de l’or d’une lettre onciale.
[p. 202] Nous risquerions moins ainsi, et de par la brusque mise en présence d’un objet jadis tendrement aimé, cette déconvenue du héros d’une histoire d’amour, rencontrant avec angoisse, toute couronnée de cheveux blancs, la beauté qu’il avait désirée.
Ainsi pensais-je moi-même de cette muse de Burne Jones qui une fois me sourit, à qui je fis de doux yeux et de tendres rimes, et qui m’apparaît aujourd’hui à travers ses cheveux argentés, vaguement lointaine et décolorée. Or c’est l’heure où l’on me demande ce que je pensai naguère de cette belle. Et ne retrouvant plus que mes sensibles strophes adressées alors à la «mendiante en gris», je regrette les billets doux que je lui rêvais sans les tracer, et qui se sont dispersés hors de mon esprit effeuillé, comme les pétales d’une rose envolée. Las! que n’ai-je en ces jours de la visite faite autrefois au maître, pris l’empreinte vive et colorée de mes sensations d’alors. J’aurais déroulé sur ces pages la gaze de cette écharpe, assez semblable aux diaphanes draperies des mobiliers esthétiques, et peinte d’incertains mais sincères rinceaux pleins de chimères et non sans charmes.
Aujourd’hui je ne répondrais pas: «Belle tête; mais, de cervelle, point», comme fit le renard, du buste. Pas non plus: «De loin, c’est quelque chose, et, de près, ce n’est rien», ainsi que dans le Chameau et les Bâtons flottants. Ce serait mensonger et irrévérencieux, et, par ce seul fait, bien loin de ma pensée et de l’expression appropriée à une désillusion délicieuse. Non,
Mais ce changement n’est pas non plus imputable à la désuétude et au discrédit dont nous stérilisent souvent nos sources d’émotions, des éloges élégants et des modes mondaines. De sérieux sentiments et des goûts motivés savent se tenir au-dessus de ces capricieuses faiblesses. Et ce n’était pas au reste pour détourner d’un art délicat que d’en voir pratiquer le rite et professer le cours par de jolis sourires féminins, qui, ces derniers ans, dessinèrent leur arc sur la sonore sinuosité des syllabes cristallines du nom de Botticelli, tout comme ces coquettes d’antan qui apprenaient à redire: «trois petits pruneaux de Tours»—ou «trois petits perroquets verts au bout de mon pied»—et autres phrases vides de sens, mais propices au précieux rondissement des lèvres, et bonnes à prononcer avant d’entrer dans un salon, pour se faire la bouche petite.
«Cela ressemble à quelque chose qui est très bien.» Ainsi jugeait de l’art de Burne Jones un artiste spirituel et merveilleux dont les démêlés avec le peintre anglais demeureront historiques et célèbres. Et bien notamment certaine déposition du témoin Burne Jones, relatée au Gentil Art de se faire des ennemis, dans cet épique procès de Whistler contre Ruskin, et où l’on voit, en cul-de-lampe, le papillon de Whistler se crisper sur le [p. 204] liard de dommages et intérêts à lui accordé par la Cour. Mais si—comme on fit de ceux d’Ingres et de Delacroix maintenant unis dans la paix de la mort et dans l’harmonie de nos admirations allant à leurs dissemblables génies—si quelque jour on parle de même des différends de Whistler et de Burne Jones, ce ne sera pour l’un ni l’autre un discrédit ou une offense.
«Cela ressemble à quelque chose qui est très bien»;—à beaucoup de choses qui sont très bien, aurait pu ajouter le malicieux maître. A Botticelli, d’abord—bien que pas assez—dans beaucoup des compositions de sir Edward, disons la plupart. Mais à un Botticelli exporté et monopolisé—patent—et dont la Primavera serait devenue une vendeuse de Liberty qui aurait débité sur des pelotes et sur des sachets tous les parterres de sa robe.—A Raphaël aussi, quand, plus rarement, s’arrondit le contour habituellement anguleux du maître de La Grange; par exemple dans Caritas, le décor du clavecin et le bambino de l’Étoile de Bethléem.—A Benozzo Gozzoli, dans le carton pour les vitraux de Jesus College, dont les anges sont bien les frères de ceux du palais Ricardi.—A Pisano encore—mais toujours en moins bien—dans certaine étude pour une cuirasse et un casque.—A Rossetti enfin, cette fois avec moins de distance, dans ce joli dessin de la Neige d’été et dans le tableau des Joueurs de tric-trac dont la figure de femme paraît avoir été posée par le même modèle aux cheveux larges et drus des jeunes gens de Bellini, et qui reparaît tant de fois dans les toiles de Dante Gabriel.—Mais, ne dirais-je pas même, à M. Alma [p. 205] Tadema, dans le décor maritime du fond de Circé, tableau qui semble prouver—horresco!—que M. Burne Jones pourrait bien avoir plus de responsabilité qu’on ne croit dans l’invention du tournesol.
Une froide raison dans la conception, une sage méticulosité dans l’exécution régulière, continue et brillante, ce sont les points par où M. Burne Jones déçoit les spectateurs épris de toiles douloureuses et passionnées dont la splendeur rayonne avec déchirement sur des ruines d’essais insatisfaits et d’études tourmentées. Il ne semble pas que ce travailleur appliqué et excellent, d’ailleurs si modeste et si fier, ait jamais pu ne pas réussir, et dans le temps voulu, aucune des plus difficiles tâches qu’il se soit imposées. Et l’on ne saurait jurer que, grâce à cette volonté si sûre d’elle-même, nous ne verrons pas cet Amour dans les ruines, malencontreusement gâté à Paris, resurgir de ses ruines propres et de ce blanc d’œuf qui lui fut fatal, avec toute l’alacrité d’une salamandre parmi la flamme, ou d’un phénix hors de ses cendres.
Mais aussi, cette impeccable sécurité dans l’exécution consciente, cette infaillible maîtrise dans le travail ponctuel donnent à ce qui sort de ces mains-fées cette apparence un peu textile qui n’y laisse guère subsister de charme qu’aux jeux des coloris et dans certains détails ingénieux juxtaposés selon une ordonnance dont je dirai la loi tout à l’heure. Œuvres décoratives, cette subdivision du Record and Review n’aurait-elle pas pu devenir le sous-titre de tout le recueil; et les tableaux de [p. 206] Burne Jones sont-ils moins des œuvres décoratives que ses tapisseries, ses verrières, ses mosaïques et ses hauts-reliefs dorés d’un or trop vif, et de genre italien, qu’il emploie pour des panneaux et pour des coffres? Objets du reste moins somptueux que ces incroyables vitraux de Tiffany, vitraux à double vitre—dirai-je à double trame?—dont quelques fragments se plissent en vrais pétales du magnolia qu’ils représentent, dernier mot américain de la somptuosité pour des chapelles funéraires, mais surtout pour de ces halls prodigieux où l’on prend du thé dans des tasses incrustées de perles.
Oui, ce sont de véritables tapisseries que ces toiles de Burne Jones, tant par le recommencement et la continuation toujours possibles du panneau, que souvent par la qualité même de la touche aux tons de laines et de soies mélangées d’or et affectant le sens des points du passé et du plumetis des vieilles broderies; touche vraiment presque filamenteuse avec des rugosités comme d’une toile d’amiante colorée.
Le Pauvre Pêcheur, la Pitié et tant d’autres toiles de Puvis de Chavannes, notre illustre peintre décorateur, sont des tableaux absolus; mais le Laus Veneris du peintre anglais, et même son Roi Cophetua, le chef-d’œuvre que son possesseur, lord Wharncliffe, jusqu’à l’Exposition récapitulative de 1893, se refusait à laisser reproduire: autant de tapisseries, de vitraux et de mosaïques. Et, pour ce fait, et de par ce sens invincible de son inspiration ordonnancée et de son exécution un peu mécanique, les meilleures œuvres de Burne Jones, celles [p. 207] où sa nature se donne carrière avec le plus de liberté et de grâce sont ses ouvrages purement décoratifs; principalement quand ils procèdent de certaine conception où il excelle et qui synthétise une allégorie dans un dessin enveloppant où ne reste plus guère qu’une formule ornementale. Tels, entre autres, le Buisson ardent et le Pélican, et ce paon funéraire (à mon sens, une des meilleures compositions de Burne Jones) et dont la traîne aux yeux réveillés symbolise l’immortalité sur la plaque commémorative d’une jeune fille morte. Beaux encore, ces vitraux de Saint-Philippe, dont les cartons sont à Kensington: une Adoration des bergers où les têtes d’anges s’échelonnent en grappe cintrée ainsi qu’on le voit aux porches gothiques; et un Golgotha certes moins fantaisiste que celui de Durer qui dut tant faire rêver Doré, avec le grouillement et le fouillis de ses chevaliers bardés de fer, et surtout de ce cavalier vu de dos sous l’empanachement de son casque par treize plumes d’autruche aux trois bouquets disposés en trèfle.
Des dessins de Burne Jones, si fins, si finis, si travaillés, si ouvragés, quelques-uns sont bien plaisants (quand ce ne sont point ces mains de l’ange de son Annonciation, ces mains poncif et actrices)—et dénotent un amour, sans doute un peu féminin, de la chose étudiée: les tresses d’une tête de femme, certains lis, exposés à Paris. Ailleurs, des études de roses, sans doute pour l’illustration du Roman; et particulièrement un corymbe [p. 208] de boutons de roses noisette qui me fait ressouvenir du fond que cette même sorte de rose tapisse pour lady Lilith, peut-être le chef-d’œuvre de Rossetti. Lady Lilith assise entre quelques bibelots qui donneront par la suite le ton à bien des brimborions de l’esthétisme—allongée plutôt en la neige de la chèvre du Thibet de sa pelisse dont les brins ondulés se nouent à la chevelure d’or annelée de la dame qui en démêle les ondes broussailleuses et crespelées, à pleines dents d’un large peigne. L’auréole blanche des pâquerettes qui la vont couronner s’arrondit sur ses genoux. Une digitale, symbole de quelque perfidie, sonne ses clochettes sur un guéridon, où dans un miroir de toilette attristé de deux bougies éteintes s’allume le vert prasin et cru du jardin reflété et de la campagne invisible.
Ces dessins de Burne Jones laissent, non moins que ces toiles, le même malaise d’insatisfait, et de par la même cause. On y sent plus de patience que de passion; le trait uniforme et monotone a la pâleur des copies à la presse, et rien ne s’y retrouve des pleins et des déliés d’un tracé vraiment cérébral.
Quant au détail de décoration propre aux dessins de l’artiste et que je me proposais d’indiquer tout à l’heure, il n’est autre qu’une adaptation du procédé de répétition en nombre ou à satiété dont fait si fréquent et malin usage le Japon, qui brode ou peint, non en semis, mais dans des groupements composés et savants, tant de papillons et de poissons, tant de singes et de grues. Ce procédé qui agit et pèse forcément sur l’esprit jusqu’à [p. 209] l’opprimer, heureusement d’abord, puis fastidieusement, se manifeste premièrement chez le peintre dans les plis de ses draperies. Rien, en elles, de ces faisceaux scrupuleusement étudiés et rendus qui, chez les maîtres anciens, s’agencent par renflements et par retombées; point non plus des antiques draperies mouillées, moulant sous l’étoffe plaquée ou en tuyaux, des formes quasi nues; mais un milieu entre ces deux manières, avec un réseau ondé ou des coulées de plis pareils à ce que les marchands de nouveautés appellent de l’indéplissable; de plis comme peignés, accusés à l’ongle dans un taffetas gommé, et plus souvent, hélas! dans un métal blanc complaisant comme celui qui, de par l’autorité ecclésiastique, dut revêtir en un sanctuaire italien cette nudité de marbre d’un tombeau, dont un touriste assidu et entreprenant courtisait les formes redondantes et lascives. La figure de Temperantia et celle de Spes, entre beaucoup, sont de parfaits spécimens de cette artificielle draperie de Burne Jones, tirant ses flexions de la fantaisie d’un crayon insatiable et de l’entraînement des traits, plutôt que de la similitude d’un modèle attentivement et soigneusement rendu par un Léonard ou un Mantegna. Et la curieuse Danaé n’a que faire de s’inquiéter ainsi de la tour qu’on lui érige, enclose qu’elle est elle-même préventivement dans l’infrangible guérite de ses vêtements en tôle rose.
Après les plis multiples ce sont les multiples plumes, dans les jours de la création, et spécialement dans le Dies Domini allant jusqu’à constituer une atmosphère d’ailes.—Dans la Nymphe des bois, [p. 210] c’est une atmosphère de feuillages; une atmosphère d’aubépines dans Viviane; et dans l’Amour et le Pèlerin, une atmosphère de colombes.—Du Golgotha, le fond est tout en étendards; de la Fiancée du Liban, tout en écharpes; du Bon Pasteur, tout en brebis; mais plus gracieusées que celles de Blake, et, pour cela, moins intéressantes et moins belles;—tout en flots enfin, dans ses vitraux pour une maison de Newport.—Voici trois reflets de visages, dans un puits; voilà, dans le miroir de Vénus, huit mirages de corps graciles; et, ceux-là, encadrés des myosotis du bord même de ce lac menu, de par l’exquise recherche d’une fantaisie mignarde mais séduisante.
Rien que de gracieux, si quelque peu obsédant, en ces pullulants accessoires. Mais où l’insistance tourne à de la persécution, c’est quand le personnage à son tour se répète en des attitudes diverses, repliant, dépliant vingt fois sous un même visage une anatomie unique d’une stature invariable; comme si le peintre nous donnait pour un ensemble cette série d’attitudes renouvelées d’après un même modèle, et dans l’inquiétant vis-à-vis de ce mage Zoroastre qui se rencontrait lui-même dans son jardin, ou de ce William Wilson se trouvant un jour en face de son double.
L’Escalier d’or nous offre le type le plus réussi de cette redite, avec sa même demoiselle qui descend dix-huit fois ses degrés luisants dénués de rampe en jouant d’instruments variés: tambourin et galoubet, buccin, violon et cymbales. Le Festin de Pélée assemble aussi bien des comparses accroupis et debout sans beaucoup de variété ni de trouvaille. [p. 211] On dirait les noces de Cana du malingre; quelque cène dans une Grèce anglaise; une fusion des Romains de Couture avec le banquet du docteur Goudron et du professeur Plume. Les portraits de Burne Jones, au reste peu nombreux, sont bien plutôt des prétextes à de trop éloquentes têtes d’expression—témoin ce crayon d’après Paderewski, au mystérieux profil d’archange foudroyé, et dont j’ai parlé ailleurs.
Mais tout cela contient beaucoup d’iris et bien des pierreries...—et quand il arriverait à s’avérer que les peintures de Burne Jones ne sont que des Christmas-cards géants et sublimes, bien des jeunes continueraient de s’en délecter et feraient bien. Et nous-même, quand nous repensons au créateur affable du monde monotone et papillotant de tant de tableaux et de tant de panneaux, de tant de vitraux, de tombeaux et de coupoles, homme plus exquis lui-même que son œuvre et dont le souvenir la domine en la surpassant, nous regardons encore la beggar maid avec les yeux de jadis; et nous lui murmurons en nous remémorant, tel que le héros de l’histoire sentimentale: «Quelquefois vos paroles me reviennent comme un écho lointain, comme le son d’une cloche apporté par le vent; et il me semble que vous êtes là, quand je lis des passages d’amour dans les livres.»
Juillet 1894.
XII
A Madame Richard Wagner.
Bâle jubile—et c’est justice, en l’honneur de la cessation, une fois de plus! d’un de ces malentendus locaux et familiaux qui consistent, de la part des pères et des patries, tout d’abord à refuser aux plus nobles de leurs enfants la prédilection et la protection auxquelles les désignent leurs naissantes facultés, de visibles dons, des pouvoirs virtuels, puis effectués; ensuite à leur marchander une renommée surabondamment acquise ailleurs, envers et contre ces procédés iniques.
Le «Tout Père frappe à côté» que le fabuliste écrit au sens paternel, serait encore plus vrai au sens ironique de la cécité et de la méconnaissance; qu’il s’agisse d’un lieu d’origine ou d’une souche natale, on ne se lasse pas de s’émerveiller de la renaissante indignation de ces merles obscurs en présence de l’insolite candeur de leur lignage.
Et pour ma part j’honore d’une toute particulière surveillance ce qu’il faudrait appeler, par une légère flexion de vers baudelairien:
[p. 216] Non que j’ignore la fatidique inutilité de tout général essai de réaction en cette matière, et de chaque particulière tentative de tels redressements avant l’heure, puisqu’il ne s’agit là de rien moins que d’une des spécieuses ruses employées par la nature à l’engendrement, puis à l’éducation des maîtres ouvriers et de leurs maîtresses œuvres; mais comme ce n’est rien moins non plus que l’aire où s’exerce l’un des pires maléfices de l’humanité, l’occasion de ses plus odieux attentats, de ses plus basses œuvres, la question devient d’ordre du jour éternel, et l’une de celles en l’examen desquelles la lésion de la sensibilité doit le céder à la curiosité du phénomène.
Et puis, n’y a-t-il pas de toujours plus judicieuses variations à broder sur ce thème constamment renouvelé du «nul n’est prophète dans son pays», devenu par l’incorrigible cécité des origines une sorte de transpositions du «je vais revoir ma Normandie»; une Normandie de l’art sans cesse fermée à ceux qui, en échange du jour reçu, y rapportent des trophées. L’honneur d’avoir entrepris de telles remises au point, et d’y avoir parfois réussi, n’est au reste pas seul à les récompenser de sa douceur, à en encourager les récidives. L’amour n’y vaque pas uniquement, l’humour en revendique sa part, et je ne sais rien d’aussi risiblement touchant que la palinodie tardive, contrainte, et faisant contre fortune bon cœur, en une confusion toujours un peu rageusement consentante, de ces ascendants vaincus par de trop indéniables triomphes. On y distingue de la bonne foi dans l’ignorance dessillée, du méchant vouloir [p. 217] macéré dans l’envie. Le tout amalgamé d’un orgueil de clocher, et d’un ahurissement malgré tout incompréhensif, du plus réjouissant spectacle. La nécessaire inutilité de l’effort le restreint, je le répète, d’ordinaire à une curiosité de dilettante; pourtant la gloire d’avoir été le Simon de Cyrène déchargeant certains nobles christs, de l’excédent fardeau de telles croix, demeure une invite à suivre ces calvaires.
Quand nous serons à dix nous ferons une croix. Cette croix-là, c’est celle qu’Hello, qui la porta, dénommait: le supplice de l’injustice sentie; celle même dont on courbe l’élan des génies; mais, pour le faire, je ne dis pas, malgré cela, mais à cause de cela même, se redresser plus haut, comme l’entrave des rochers précipite la course des eaux et transforme en torrent celle qui eût été stagnante. Et le magnifique, et entre tous aigrement cruel châtiment de ces sortes d’impedimenta, c’est, lors de l’avènement, s’ils sont tenaces, le rôle adjuvant que se trouvent avoir joué dans l’éclat et la splendeur du cours tumultueux d’une noble vie, les pierres de martyre ou d’achoppement dont la haine espérait lapider, retarder, atteindre.
Quand nous serons à dix, nous ferons une croix.—Disons: à dix mille!—Aujourd’hui, nous nous limiterons à des querelles de clocher, laissant, pour une fois, comme le gentil Passant, tranquilles, les familles.
Ne serait-ce pas, en effet, moins de l’ambition [p. 218] qu’une juste révolte contre des injustices senties qu’on trouverait, pour ne citer que ceux-là, au fond de la vie expatriée et de la mort volontairement exilée, du Suisse Holbein et de l’Allemand, Hændel, à Londres; de l’omniscient Italien Léonard, à Amboise, dans l’étroite cage de Clos-Lucé, et Dieu sait en quelles moroses délectations, le dieu humain qui s’écriait: à plus de sensibilité, plus de martyre!
Le Bâlois Bœcklin poursuit et achève, dans la gloire, à San Domenico, la vie de lutte qu’il a combattue et gagnée en Allemagne et en Italie.
Sa patrie repentante se décide à venir prendre dans l’exil cette main pleine de glorieux rameaux et par un dédommagement vraiment bien senti, la placer en un commun jubilé, dans l’auguste droite d’Holbein.
C’est, on peut l’affirmer, un nom, en France, à peu près inconnu que celui d’Arnold Bœcklin. N’est-ce pas, au reste, une des grâces, un des pouvoirs de notre cher pays que ce travers merveilleux qui faisait dire à un malin critique étranger s’étonnant de voir représenter au Théâtre-Français un Hamlet ainsi travesti, dans un décor nullement conforme au lieu décrit par Shakespeare, et aux sons d’une mélodie de plusieurs siècles ultérieure à la date du drame: «Ils ne savent pas qu’Elseneur est un lieu dont on peut prendre des photographies»!—Et il ajoutait: «L’ignorance des Français sera toujours pour nous une source éternellement jaillissante!»
Sans prendre de cet honorable verdict autre chose que ce qu’il a de spirituellement malicieux, [p. 219] qu’on se rappelle l’an passé la naïve découverte de la Duse par tant d’honnêtes Parisiens qui ne songeaient même pas à admirer parmi la belle chevelure noire de l’artiste depuis longtemps couronnée à travers le monde, les nobles rayons d’argent dont le triomphe irradie un tel diadème. Il est vrai que les mêmes Parisiens qui auraient bien ri d’un Anglais et d’un Italien demandant si Bernhardt n’allait pas jouer en leur langue à Londres ou à Rome insistaient despotiquement sur l’importance pour Mme Duse, toute pleine pourtant du génie de sa race, et de sublimes diphtongues, de jouer en bon français, à Paris, pour le caprice de l’enfant gâtée des nations.
Passant par hasard rue des Bons-Enfants, ces mêmes Parisiens-là n’auraient certes pas vu sans étonnement l’affiche au Centaure sur son fond nuageux (elle-même bien étonnée de se trouver là!) s’ils n’avaient eu la ressource de n’y faire aucune attention ou tout au moins de la prendre pour l’enseigne d’un maréchal-ferrant ou d’une nouvelle meringue. Un distingué article signé Meissner, dans la Gazette des Beaux-Arts, eût été le commentaire suffisant d’une exposition—qui faisait, hélas! défaut.
Quant à la lyrique étude publiée en Suisse par M. Ritter, elle ne pourra être appréciée ici à sa brillante et enthousiaste valeur, que le jour où l’initiation à l’œuvre de Bœcklin révélera au public français ce qu’il put y avoir de généreuse allégresse à danser devant cette arche.
La première salle de l’exposition de Bâle contient, il me semble, surtout des œuvres de début, à mon [p. 220] avis, moins séduisantes que celles où s’exercent, dans un cabinet du fond, les tout premiers essais de l’artiste. Je distingue, parmi ces derniers, un petit portrait de famille peint par l’auteur à dix-huit ans, et en de certaines parties presque digne d’Holbein.
La petite toile mesure à peu près les dimensions de la fameuse Laïs Corinthiaca du vieux maître; mais elle ne représente qu’une pauvre petite parente de province au maintien compassé dans sa robe de taffetas vert changeant, au corsage sans appas, sous un visage sans charme, encadré du rose soyeux de son fichu, à la bordure tramée de fleurs glacées. C’est encore, dans cet instructif cabinet d’épilogue en même temps que de préface, un intéressant portrait du célèbre peintre Lenbach en 1860; et déjà des études de ces effets, que j’appelle de couchant couché, dont l’un me fait penser à notre La Berge, et dans lesquels le peintre qui doit y exceller versera plus tard toute une prenante poésie.
Dans la première salle de l’Exposition, je note un grand paysage mythologique; une des chasses de Diane, que le peintre a plusieurs fois mises en scène.
Je ne saurais, il me semble, donner le mieux l’idée de celle-ci, qu’en affirmant qu’elle représente ce que ferait une Rosa Bonheur, qui s’adonnerait à la peinture héroïque.
Ajoutons bien vite, et une fois de plus, que nombre d’artistes passés et présents seront ici nommés à propos de Bœcklin, sans nulle accusation de plagiat. Sa manière est complexe, multiple. La seule façon d’en éveiller l’idée chez ceux qui [p. 221] n’ont pas vu, est d’en dégager le rapport avec des œuvres déjà connues.
Au reste, j’y insiste, ayant eu déjà l’occasion de l’écrire, c’est à mon sens une dignité de plus, j’ajouterai volontiers sine quâ non, que dans une véritable originalité, le rapport inconscient avec d’autres arts individuels, de proches et de lointains, comme résorbés en un suprême bouquet réunissant nombre d’aromes divers du personnel parfum de ses fleurs propres.
Je note encore dans cette salle, outre un aride ermite se flagellant, un peu frère des saints Jérômes de M. Gérôme et qui est célèbre, un Pétrarque à la fontaine de Vaucluse que je n’aime pas, et une grande Vénus aux chairs modelées dans un savoureux clair-obscur, affectionné par M. Hébert.
Je parlerai plus tard, en même temps que des autres sujets religieux, d’une Madeleine exposée là et qui appartient au Musée de Bâle.
Je n’oserais pas écrire en ce grave sujet, comme le fit Veuillot à propos de Thérésa. «Tout de suite après ce fromage blanc, le tord-boyaux tout pur de la demoiselle», mais je dirai qu’il y a eu savante gradation dans le choix des œuvres qui garnissent cette première salle au sortir de laquelle l’entrée en la salle voisine tient de l’éblouissement et du charme.
Ce n’est pas que je goûte complètement, ni même peut-être beaucoup tout le tableau de la belle et douce Calypso, déjà furieusement nostalgique au penser du héros dont les bras sont dénoués, et qui bien qu’encore dans le tableau est comme hors de la scène et presque du cadre. Ulysse et Calypso, ou [p. 222] si vous l’aimez mieux, Tanhauser et Vénus; et M. Ritter a justement relevé des correspondances de leitmotiv entre cette œuvre et celle de Bayreuth.
Mais la grande Eleonora Duse qui disserte hautement de ces choses me disait de cet Ulysse des choses admirables; silhouette hautaine et lointaine, bien faite pour subjuguer une connaisseuse, une créatrice d’attitudes tragiques; éloignement d’exilé drapant aux plis de son manteau le mal du pays de tous les exils, l’espoir de tous les retours. A droite de cette toile, une autre Calypso, moderne celle-ci, bien que les plis droits de sa blanche tunique, son geste replié, l’enroulement de la noire écharpe autour de sa tête pensive, puissent l’assimiler à la Polhymnie. Mnémosyne aussi toute pleine de souvenirs qui tombent sur son âme avec le crépuscule de plomb, roulent à ses pieds avec la vague mal apaisée.
Ce personnage qui tient si peu de place dans la toile n’en représente pas moins le coryphée des voix de la nature et de l’art, éloquent et figuratif de la magnifique décoration du lieu, de la majestueuse mélancolie de l’heure. Heure d’un net crépuscule de soir éclairant un lieu qui est le temple de l’amour détruit, un état d’âme qui est la détresse de la délaissée. Oui, il y a de la Femme abandonnée de Balzac dans cette composition tragique et simple.
Bœcklin l’a peinte plusieurs fois cette Villa au bord de la mer, ainsi qu’il l’intitule modestement et d’un titre générique: mais dont il semble que ce panneau-ci doive être l’expression la plus heureuse. Dans une autre, le personnage antique devenu [p. 223] Iphigénie en Tauride, réduit l’éternel et poignant drame humain aux plus restreintes proportions d’un épisode historique. Là, rien que la tristesse du jour tombant, du flot expiré, de l’amour détruit, de la mer morte. Mystérieuse villa au bord de la mer avec ses portes closes comme des bouches, sa fenêtre ouverte comme un œil qui ne veut plus voir, sa galerie déserte, au couronnement de statues effritées. Alentour, la mer murmure, l’huile écumeuse d’un flot qui fut démonté, plein encore des mugissements étouffés de la tempête qui s’apaise, de cris d’invisibles oiseaux d’orage, peut-être de victimes ensevelies...
Flots des cœurs aussi!
Je ne vois qu’un homme qui sache dessiner l’eau comme Bœcklin, l’architecture des vagues, le remous des ondes et ces courants entrelacés comparés par Vinci aux tresses de la chevelure de Léda. J’ai nommé Thaulow. Mais, chez ce dernier, ce ne sont que les phases intelligemment étudiées, habilement rendues de ces variations aquatiques, lesquelles sont mystérieusement haussées par Bœcklin au commentaire du sujet qui s’y mire. Et sous cette lumière d’un gris de fonte un peu pareille à celle de l’orage de Millet, entre les noirs cyprès eux aussi haussés à la dignité de personnages, Sophocléen chœur d’arbres commentant le tableau du faîte de leurs cimes recourbées comme des cimeterres, quatre notes rouges piquent leurs braises amorties: les briques du [p. 224] mur éboulé, des vases de terre cuite, une automnale vigne vierge, et le rose vif d’une fleur de laurier-rose.
Ce sont encore des figurants de Bœcklin, ces éloquents cyprès dont le mode d’expression est cette sensible inflexion de la cime infligée à l’arbre rigide comme par une orageuse et magnétique atmosphère. Je les retrouve dans cette autre villa au bord de la mer en une orientation opposée. Cette fois, l’architecture et le paysage seulement, en la solennité de la nuit tombée, le rouge adieu du soleil noyé, ne perlant plus à l’horizon qu’une larme de sang dont meurt le reflet sur la villa silencieuse.
Et l’Ile des Morts les recèle aussi dans sa fatidique enceinte. De sentiment un peu pareil à la première de ces villas au bord de la mer et à un Voyage de noces qui me plaît moins, me semblent devoir être deux toiles de Bœcklin dont je n’ai vu que la reproduction: la Solitude, une femme au bord de l’eau et drapée de blanc dans un paysage de composition savante, et la Pensée d’automne, en laquelle une sœur de ces deux rêveuses regarde flotter au fil de l’eau la feuille étoilée d’un platane.
Mais ces pages de rêveuse vérité ne disent qu’une face du génie de Bœcklin. Et curieuse anomalie: le revers est d’un réalisme jovial, expressif d’une caricaturale mythologie. Oui, Zénith et Nadir, Ariel et Caliban se partagent l’esprit de ce maître. Il est l’inventeur d’une variété de mythe caricaturale; quelque chose comme une invasion du Fliegendeblætter dans l’Olympe; mais sans la mièvrerie ni l’irrévérence de similaires déformations de chez nos peintres ou de nos auteurs, plutôt on [p. 225] l’a justement écrit—avec une verve rabelaisienne. Donc, le Chiron goguenard,—comme dans son Centaure chez le Forgeron;—le faune ou le triton égrillards, la sirène replète au type assez semblable à celui d’une kellnerin des ondes au torse sainement rougi par le salubre baiser des salines; enfin, le Tritonet pleurnicheur, hybride composé de l’esturgeon et du marmot braillant sous l’assaut d’une vague trop grosse.
Car c’est toujours la puissante et délicate sœur-eau de saint François, remise en lumière par le subtil Gabriele, qui se peuple de ces radieuses bouffonneries, qu’elle pare de ses irisations et de ses chatoiements.
«Les récifs battus par les embruns, l’atmosphère pleine d’éclaboussures salines, les ressacs furieux pulvérisés en poussière blanche—écrit expressivement M. Ritter—voilà l’un des éléments de l’improvisation de Bœcklin, lequel s’y joue avec l’aisance même de ses tritons et ses naïades.» Le Jeu des Naïades, qui appartient au Musée de Bâle et figure à l’exposition du Jubilé, est la plus étonnante de ces marines. La mer y rayonne avec des irradiations aussi violentes que celles dont les Pharaeglione, les rouges rochers de Capri font miroiter sur les flots bleus leurs ombres violettes. Une Néréide, vue de dos, incendie l’eau du flamboiement de ses cheveux couleur d’orange; un menu scombre qui sert de joujou à un poupon squammeux, moire d’une ombre transparente le torse d’une plongeante Ondine, et toutes ces queues de poisson luisantes et moites ont des tons d’ailes de papillons et de pétales de fleurs.
[p. 226] Dans l’Idylle marine, le visage de la première Néréide, sur la droite du tableau, répète exactement l’expression de certaine Chasseresse exposée à Venise. Et, comme l’écrit M. Ritter, il s’agit bien là «de mythes réels» et non de froides allégories.
Je n’aime pas beaucoup les portraits de Bœcklin. Un enfant effeuillant une rose, et l’idéal portrait de bébé ne me semblent pas dépasser une idéalité photographique; et l’on s’étonne que le peintre des vivants enfants du Vita somnium breve ait pu se satisfaire de ces faibles grâces. Cependant le portrait d’une signorina Clara de Rome, bien que d’excessives et massives proportions, et gâté par de ces trop grands yeux, trop luxuriamment ciliés qui banalisent presque toutes les grandes figures de ce peintre, apparaît beau d’une marmoréenne attitude et d’un matronal contour dont Ingres eût goûté le dessin pur et savant au masque alourdi entre deux boucles d’oreilles aux pendants de chrysoprases. Viola est une figure qu’il sied de rapprocher de celle-là. C’est encore une lourde Romaine modelée dans les tons fiévreux chers à Hébert, mais qu’enveloppent d’une belle harmonie, en assortissant leurs couleurs, un voile vert, une draperie de brocart éteint, un bandeau d’or pâle et d’améthystes, un bouquet de violettes aux pourpres profondes. Une harmonie similaire se peut admirer dans la Clio dont je n’aime pas le geste et dont les draperies rappellent ces méandres de plis en crêpe de coton [p. 227] qui plaisent aux Anglais dans les tableaux de Moore.
Une autre bonne tête d’expression est celle d’une Sapho agrémentée de la trouvaille physiologique et révélatrice de certains mystères—d’un sombre duvet naissant aux commissures des lèvres. Une Sapho qui ressemble à Phaon, et de qui le volubilis d’un bleu dur serpentant au bord de son manteau n’aurait pas déplu à M. Ingres.
Quant aux propres portraits de Bœcklin qui, le catalogue nous l’atteste en ses reproductions—s’est peint au moins quatre fois—seul, un peintre bâlois peut rencontrer indulgence pour avoir cru enrichir du peu caractéristique numéro de son effigie, flanquée d’un squelette musicien, la célèbre Danse des morts. Et pour son dernier portrait, le triomphal mauvais goût de son pantalon à larges carreaux bleus, de sa cravate au nœud tout fait, bariolé de rouge, nous offre une occasion de dire que c’est précisément ce mauvais goût, souvent éclatant en ses meilleures œuvres, qui a sauvé Bœcklin des mièvreries du faux goût, lesquelles sont mille fois pires.
Mais, en revanche, bien des délicats détails en ses compositions, ces fines colchiques dans la prairie humide, au premier plan de son bois sacré, et dans la figuration de l’une de ses nombreuses sources, ce voile qui enveloppe sa tête gracieuse, comme pour spécifier qu’il s’agit d’une source ombreuse et discrète.—A ce propos, faisons une remarque: Bœcklin n’aime pas les nus complets, qu’il coupe au moins d’une draperie (témoin sa Calypso, sa Vénus genitrix, et la jeune femme du Vita Somnium);—quand ce n’est pas d’une queue de poisson, ou d’un train de cheval qu’il supprime [p. 228] ces jambes qui semblent le gêner et accentuer ses prédilections pour les déformations inférieures. Quand elles subsistent, ces jambes de femmes, il les laisse deviner à travers des gazes pailletées et qui ne sont autres que celles dont le clinquant fait rutiler les divinités dans nos pièces-féeries.—Hélas! ce même clinquant, Bœcklin en afflige de plus nobles dieux, et c’est le lieu de parler de ses sujets religieux dont l’inspiration ne me semble pas heureuse. Deux seulement figurent à l’exposition du Jubilé: une Madeleine de mélodrame et une madone d’un tragique d’emprunt pleurant sans profondeur vraie et à trop de fracas sur un Adonis de Calvaire, dont le bellâtre aspect détonne plus que partout dans la cité du Christ d’Holbein et de ce Golgotha de Mathias Grunewald, épouvantable et sublime.
Bœcklin ne se résigne pas à dépouiller de tels personnages pieux des étoffes transparentes qu’il affectionne. Est-ce une erreur irréfléchie ou d’autres habitudes des yeux qui font s’étonner d’une sainte femme voilée de crêpe noir? Quoi qu’il en soit, le tableau en hérite une apparente modernité, un effet de maison de deuil qui choque dans ces scènes. Une autre Marie, elle-même tout entière ensevelie en son voile ainsi que d’un obscur linceul et pleurant étendue au long du corps de Jésus n’est pas moins mélodramatique.
Et certaine célèbre descente de Croix, dont je n’ai vu que la reproduction sans le prestige de cette couleur souvent triomphante chez Bœcklin, me laisse sans émotion devant une Mère noble de Jésus, un saint Jean jeune premier et une prima [p. 229] donna Madeleine. Une autre Madeleine, aux yeux rouges et gonflés, et qui ferait un pendant pour la chasseresse exposée à Venise, ressemble extraordinairement à l’impératrice Eugénie. L’allégresse de la jeune Vierge dans un tableau de Nativité me semble d’une vivacité peu digne. La Madone, qui, entre des rideaux dont l’ouverture se gradue avec recherche, occupe le centre de ce tryptique, m’apparaît comme une contre-partie mystique de la Vénus genitrix, que je veux dire encore.
Le pire reproche à faire à tout cela est, si je ne me trompe, l’engendrement de l’Évangile-mélo à la Gabriel Max, lequel en vint à peindre une Sainte-Face (certes moins édifiante que celle de M. Dupont, à Tours!), dont un bas trompe l’œil, sans nulle parenté avec l’art, semble faire se soulever les paupières dans leur pénombre, pour récompenser d’un regard celui qui la contemple!...
Deux sujets religieux ont mieux inspiré M. Bœcklin: un Père éternel un peu parent du Jupiter-Pèlerin de Wagner et toujours drapé dans son manteau à constellations de paillettes, introduit dans un paradis terrestre qui pourrait bien être un miracle (je n’ai vu que le fac-similé de ce tableau), l’homme-enfant, un Adam adolescent et non encore déniaisé, le pauvre petit père futur du genre humain, dont la maigre nudité à peine pubère contraste avec les géantes formes dont la peinture le dote d’ordinaire.
Une prédication aux poissons, selon les Fioretti, me semble très supérieure au traitement de ce même sujet par M. Merson. Il y a un touchant et comique apostolat dans la conviction du bon saint [p. 230] Antoine, mal piété sur le rocher du plat des sandales de ses pieds noueux, la robe crottée, troussée haut sur ses maigres jambes, le geste bénisseur et persuasif, l’élan courbé de toute sa personne rugueuse et bistrée dont l’édification se communique à l’œil béat de ce requin aux dents de scie, à cette lune d’eau pleine d’un ferme propos de ne plus s’arrondir d’un fretin illicite.
Sied-il de ranger dans les sujets pieux cette Suzanne au bain, curieuse œuvre du peintre? Imaginez, entre certains nus de femme de Rembrandt et des études de tub de Degas, une commère ultra rondelette, la femme de quarante ans de l’Ancien Testament, une Marneffe biblique. Accroupie toute nue au fond de la vasque de marbre en laquelle elle barbote honnêtement, elle se sent tout à coup tapoter son dos potelé sous la caresse d’une main velue. Je ne sais rien de tragique dans le risible comme l’angoisse des yeux ronds de cette grasse poulette effrayée à ce contact inattendu d’un violateur invisible pour elle, mais de qui le luxurieux influx l’emplit d’une noble pudeur dont la pire peine est, en ce personnage replet, de ne pouvoir revêtir d’autre aspect que celui d’une ridicule honte.
Ce qu’elle devine, nous le voyons, nous; et les plus extrêmes craintes de la vertueuse dondon ne sauraient se hausser jusqu’à telle horreur. Deux antiques vieux cochons, selon l’expression de Forain, sont perchés sur la muraille à hauteur d’appui qui contourne la vasque. L’un, coiffé d’une casquette à la Daumier, est le bilieux à l’œil égrillard, à la babine lippue et simiesque. L’autre, encore plus monstrueux, représente tout le [p. 231] déshonneur des cheveux blancs, un bout de langue obscènement coulé et presque vibratile, dans l’escalade et la luxure du sale désir, entre les deux gencives qu’on devine édentées et baveuses. Et dans le clapotis de sa chair, sous la claque lubrique, l’infortunée Suzanne, la petite mère aux mains courtes, dont la pire misère est d’être drôlatique en un tel déduit, se ramasse, se pelotonne, se met en boule.
Et, comble d’ironie, son savon dans une soucoupe imite, près de la pleine lune de son opulent arrière-train, un œuf que cette poule dodue viendrait de pondre.—Et l’on reconnaît aisément, en cette bedonnante sirène des livres saints, la sœur des Tritons ventrus des toiles mythologiques.
On raconte que Bœcklin a caricaturé de ses ennemis dans les mascarons qui grimacent sur la Kunsthalle. Les vieillards de la Suzanne au bain pourraient bien être de tels vengeurs; et, qui sait? la Suzanne elle-même.
Le Prométhée de Bœcklin, à vrai dire, exposé en de détestables conditions d’embu, me semble un grand effet manqué. Un géant sans assez d’énormité dans un site, sans assez de grandeur; et le bondissement des cent mille océanides Eschyliennes réduit à l’écume d’un sorbet.
En revanche, le Berceau du jardin, sous lequel deux vieillards, un Philémon et une Baucis cossus, coulent les dernières heures d’un jour heureux, d’une existence fidèle, entre des pots de jacinthes et des carrés de tulipes, forment un tableau dont la reproduction même a du charme. M. Ritter le décrit bien. Non moins que ce retour du chevalier, [p. 232] d’une très pénétrante poésie, et dans lequel le roux des cheveux du voyageur et la rousseur des cimes du bouquet d’arbres se répondent et se rallument avec plus d’éclat dans la fenêtre éclairée dont l’œil rouge fait battre le cœur du chevalier qui
—Dans le Vita Somnium breve, grand panneau allégorique, de Bœcklin, qui appartient au musée de Bâle, il faut admirer, outre des mérites de composition, de tenue générale, d’atmosphère limpide et rutilante, de couleur harmonieuse et riche, la vraie vie des deux marmots du premier plan, deux mioches associant Jordans et Renoir et dont la triomphante nudité suit attentivement le trajet étoilé d’une pâquerette mise par eux à flot sur un ruisselet translucide.
Dans la Vénus genitrix, c’est le volet de droite de ce triptyque qui est remarquable. Je démêle bien dans le central panneau la difficultueuse allégorie d’une Cypris debout sur une terre fumante de germes, invitante déesse dont le torse s’azure de l’obscure clarté du bleu de la nuit propice aux amours. Mais dans ce volet de droite qui me paraît la plus notable des œuvres exposées là, ordonnance, composition, dessin, coloris, concourent à un effet intense et puissant, réalisé sans faiblir. Sous un pommier, arbre de science du bien, aux rouges fruits savoureux entre lesquels blonde et chaude apparaît aussi la tête dorée du travailleur qui les cueille, la famille ouvrière resplendit. Assise, l’épouse,
allaite son poupon d’une mamelle restée blanche à l’abri de la chemise et juste au-dessous de la brune région du cou baissée, dorée par le hâle. Un garçonnet tout nu, fruit déjà plus mûri de la Vénus Génitrix, s’étire et croît tel qu’une vive plante de chair; et le bleu luxuriant de la toile des pauvres vêtements rapiécés comme d’oripeaux de turquoises et de haillons de lumière, le sang rose sous les jeunes tissus, le bistre de la peau de l’adulte et jusqu’à ses callosités rudes, enfin la pulpe étincelante des fruits cueillis, tout cela chante et s’exalte en une symphonie de tons éclatants pleine d’allégresse et de vie. #/
Et, pour conclure maintenant, si vous entendez prononcer le nom de Titien au sujet de l’Angélique, de Véronèse, à propos de la Muse d’Anacréon, et de Murillo à l’occasion de tels ou tels petits anges; si l’on vous dit que les cavaliers maures dans un paysage évoquent le souvenir de Delacroix; le combat devant la Burg et certaine source, celui de Gustave Moreau; la Nymphe et le Satyre, celui de Baudry; la Nuit, celui de Watts; telle Bacchanale, celui de Corot; quelques muses, celui de Fantin, et cette lourde Flore aux épaules bien modelées, à la belle draperie violette arpentant cette prairie diaprée, du pas velouté de ses vilains chaussons rouges que le peintre a bien fait de transformer en cothurnes dans son projet de vitrail, la funeste comparaison d’un Tadema suisse, répondez qu’il faut de suggestives images pour susciter [p. 234] la mémoire de tant de grands et charmants noms, sans omettre ceux de Millet et de Millais. Ajoutez qu’un de ceux qui serait rappelé de moins loin à propos de Bœcklin, serait celui d’Élie Delaunay qui traça une gracieuse image de la veuve de Bizet aux yeux pleins d’une sombre flamme; mais qu’une gloire plus magnifique, entre tant d’attributions diverses, est celle qui reparle de Giorgione—s’il est vrai que certaines toiles de Bœcklin, pleines de tons savoureux et d’ors blondissants, d’ambres chauds et de rousses ombres, auxquels le temps promet une maturité plus harmonieuse encore—se haussent jusqu’à la dignité de rappeler le Concert champêtre.
XIII
A Jean-Louis Forain.
M. Vernet a reçu et recevra quelque temps encore les faveurs du suffrage universel, mais l’avenir lui sera dur.
Malheur aux artistes qui n’auront travaillé que pour amuser la plèbe contemporaine! De leur vivant ils reçoivent toute leur récompense. Le succès leur arrive éclatant, sans mesure. Qu’ils demeurent ensevelis dans cette gloire, plus banale peut-être que la fosse commune.
(Théophile Silvestre.)
«Pourquoi voit-on toujours le mal l’emporter sur le bien?» demande au docteur Rémonin de l’Étrangère, pour lequel posa notre Henri Favre, une de ces caqueteuses chères au théâtre de Dumas. Et Favre de répondre ce mot plus profond que Rémonin: «Parce qu’on ne regarde pas assez longtemps.»—Oui, l’affamement de justice clamé par la tête demi-décollée d’André Chénier, dans son suprême vers, rencontre tôt ou tard son assouvissement, toujours. La satisfaction contenue, pour un noble esprit, dans l’idée de justice, vient moins de l’espoir d’une consécration que de l’introublable sérénité qui découle de ce penser: un contemporain engouement ne saurait pas plus assurer la gloire à un ouvrage vain que le dédain n’en pourrait priver un valable effort. La gloire est comme [p. 238] l’onde; elle reprend à la fin son niveau. Et c’est dans cette proportionnelle loi qu’il faut rechercher l’explication de ces brusques sautes de la mode et du goût qui transforment un indigne mépris pour une œuvre d’art en un enthousiasme non moins excessif.—Et cette sécurité, pour les autres et pour nous-mêmes, de la justice finale incessamment in fieri, demeure le lest de bien des étonnements, la tare de bien des malentendus, la rectification de bien des maldonnes. C’est donc une indignation irréfléchie que celle qui nous agite en présence de certains succès, qu’il faudrait déclarer immérités si l’on ne devait au contraire voir dans cette éphémère ampoule du succès l’immédiat salaire seul assorti à des productions vaniteuses.
Ce n’est pas tout à fait ou même du tout une illusion que ce pèse-réputations souvent par nous rêvé: une balance dont l’aiguille marquerait pour chacun son degré de mérite, rarement confirmant les verdicts, infirmant souvent les apothéoses. Seulement, le mécanisme en est patient comme Dieu, parce qu’il est comme lui éternel.—Il y a des notoriétés sans bases, improvisées de toutes pièces, pareilles à ce palais d’Aladin, duquel au matin la campagne ne portait pas trace, et qui, le soir, y multipliait des clochetons enguirlandés de feux, de fleurs et de féeries. Mais, au lendemain, la rase campagne s’étendait encore où le mensonger édifice avait lui, tandis qu’une construction lente et appliquée avait, quelque part, dans l’ombre, augmenté d’un rang de granit la base d’une tour immortelle.—J’userai encore de cet exemple: la lentille revêt en quelques heures, d’un tendre duvet [p. 239] verdoyant, le quelconque objet sur lequel on la sème. Et c’est un émerveillement de l’enfance d’admirer au lever, tout fourré de ce vivant verd-naissant, un vase, un ustensile. «Oh! ferait s’écrier à cet exemplaire bambin un moraliste amène, l’admirable plante qui croît en un moment! combien préférable à ce grain, à ce gland, depuis des mois enfoui dans le sol, et dont nous n’avons plus de nouvelles!» Mais, aussi vite qu’elle avait levé, l’insipide végétation se fane au pied de la séculaire forêt, au bord de la moisson mûrissante. Et le laboureur réfléchi en conclut «à quel point il doit croire—à la fuite utile des jours»!
La postérité est donc une permanente cour d’appel pleine de pourvois en cassation d’où sortent perpétuellement révisés des procès civils, historiques ou artistes. La réhabilitation de Pierre Vaux offrit, ces derniers temps, un éloquent exemple de l’éternel devenir de la justice et de la réalité de ce recours en grâce. «La création est une grande roue—qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un,» dit Hugo. Voiturer quelqu’un présente avec non moins de régularité l’autre tour de la même roue. «C’est Polichinelle, c’est Garibaldi!» écrivait à son tour Veuillot des mythes et des types auxquels Hugo, selon lui, prostituait l’airain de sa cloche. Disons, nous: c’est Bonaparte à travers les napoléoniennes collections, par le livre et la scène, l’exposition et l’imagerie devenue graduellement conforme à ce frappant vers d’un autre poète
[p. 240] A qui le tour? Chaque notable flot de la marée humaine apprête à rectifier à l’exégèse et dresse derrière le flot expiré, sa crête d’écume, un bandeau de perles. Napoléon révolu fait place à son fils. Le duc de Reichstadt envahit les volumes et les théâtres, et déjà Napoléon III vient prendre son rang dans le dessin exhumé par Nolhac dans le Musée de Versailles. Certains hommes semblent élus pour en appeler, à l’égard des disparus oubliés ou trop vantés, de jugements excessifs, en tout cas influencés, trop proches, trop rapides. Une sorte d’envoultement a lieu. Chaque grande mémoire a, selon le degré de méconnaissance qui l’opprime ou l’oppresse encore, son défenseur, son protecteur, son metteur en œuvre. On dirait qu’elle le trouve, qu’elle le choisit, qu’elle l’organise. Rien qui le rebute durant cette période d’incubation ou de combat. Au contraire, il joue la difficulté, progresse sous l’embûche, prospère sous l’agression, aboutit par le martyre. Et quand les hauts lieux sont définitivement conquis à ceux que nous aimons, un étonnement nous vient presque des paladins que nous nous fîmes pour les leur gagner, comme si leurs âmes apaisées ou satisfaites nous avaient désertés, nous léguant un brin de leurs palmes.
C’est ainsi, pour n’en citer qu’un petit nombre d’exemples, que Roselly de Lorgues se dévoue à Christophe Colomb; Chateaubriand ressuscite Rancé; un prêtre saint et savant poursuit en cour de Rome la canonisation de Jeanne d’Arc; M. Tamizey veille autour du curieux Peirese; la trouble mémoire de Lucrèce Borgia déjà s’élucide, et, qui sait? peut-être un jour celle de Gilles de Retz.
[p. 241] L’admirable de ce ressort, c’est que les procès mal jugés ne l’étant pas seulement par défaut, mais aussi par excès, nous voyons reparaître à la barre du temps ceux à qui le passé récent se montra trop doux et rentrer dans le rang ceux qu’en avait indûment tirés une faveur inéclairée ou irréfléchie. C’est donc une imprudente réapparition que celle qui vient faire déjuger de trop hâtives renommées. Mais un tel redressement est, non moins que l’autre, nécessaire à l’équilibre de la balance; ce n’est pas assez de couronner les méritants si leur diadème n’est fait des rayons impudemment attribués aux médiocres.
Il y a de ce dessillement dans celui que nous cause la réapparition à la surface de tant de louanges, de la trinité des Vernet, en l’honneur de laquelle il n’y a plus à se signer, et que le Saint-Esprit n’a pas visitée. Pas même sous la forme de ce frère Philippe, supérieur vénéré des Ignorantins, dont le portrait hérita sans doute de l’estime que le modèle inspirait et que nos parents tinrent pour chef-d’œuvre. Rien autre pourtant qu’en ce désagréable et superficiel miroitement de toile cirée commun à toutes les toiles et surtout aux portraits d’Horace Vernet, la fausse bonhomie du personnage vêtu de drap d’un noir sans beauté, la fausse édification théâtralement graduée, d’un rameau de buis, d’un crucifix, d’une statuette; la fausse simplicité d’une lézarde de portant dans un mur truqué, le tout amalgamé dans la fausse dignité d’un faux chef-d’œuvre. Que dire des autres portraits? Si celui de la maréchale de Castellane, née Greffulhe, [p. 242] à défaut d’immortalité peut paraître assuré d’une élégante durée, c’est à la touchante grâce du modèle qu’il le devra, sous la fine auréole de ses frisons dorés, en l’exquise délicatesse d’un visage de fleur dont la tige est ce buste jeune, ce corps charmant simplement infléchi en une très féminine attitude que le peintre sut au moins surprendre et fixer, bien plutôt qu’à ce dernier qui le fut si peu, en dépit de pauvres recherches de complémentaires, dans ce que le savant et savoureux Whistler eût appelé un arrangement en rouge et vert, et qui ne présente pas plus la riche alliance de ces deux tons chez la Sibylle persique de van Eyck des collections Rothschild, que la criarde harmonie rouge et verte d’un devant de cabaret que Baudelaire avait intitulé: Douleur délicieuse. Non, rien que le rappel, par le feuillage d’un camélia se détachant sur une tenture garance, des carreaux de même ton d’un tartan dont s’enveloppent prosaïquement les genoux de l’idéale jeune femme.
De même, exposé sous le no 311, le portrait de son fils ne nous offre que l’image d’un joli garçonnet, à la moue volontaire, hardi sous sa calotte de cheveux blonds, et tout fier d’avoir battu en brèche... un pot de laurier-rose.—Au reste, c’est une si parfaite habitude de mal peindre en laquelle les toiles de ce plus illustre des Vernet entretiennent notre œil, que les organisateurs de l’exposition ont dû, sans doute pour n’en pas troubler l’ordonnance, reléguer presque hors de vue un portrait de femme qui, le premier jour, figurait en meilleur rang, et dont la moins inférieure qualité jurait parmi l’entourage.—Le portrait de [p. 243] Mme Delaroche-Vernet, petite châtelaine anémique et moyen-âgeuse, une fleur à la main, tient du dessus de pendule et de l’en-tête de romance. Certes, vous demanderiez en vain à ce pauvre portrait-étude de Mlle Mars la raison de tant de triomphes. Combien près de lui s’éveille victorieusement, dans le souvenir, la magnifique étude-portrait de Mlle Georges dans la collection Pourtalès!
La famille royale du Czar Nicolas Ier au XVIe siècle, représentée sous la forme d’une chevauchée de dames et de varlets comme on en voit aux devants de cheminée en papier peint des hôtelleries, fait presque regretter l’alliance russe. Une tête de Christ n’est peut-être pas inférieure à celles de Dagnan-Bouveret; mais est-ce beaucoup dire?
Le portrait de la marquise de Girardin est d’un ridicule touchant. La dame vogue toute seule sur un canot du nom de L’Aimée. Un saule pleure au-dessus; un voile flotte au travers; une écharpe trempe dans l’eau; et rien ne nous est épargné: souliers à cothurnes et lorgnons en bésicles. Mais la palme—une palme qui devrait être un bouquet d’édelweiss!—est, pour un petit portrait de Louis-Philippe à Reichenau, bien précieuse pour le Club alpin. Dans un paysage de montagne, le roi, en toupet et l’alpen-stock à la main, s’apprête à noter sur un agenda les beautés de ce site alpestre.
Un autre portrait de Louis-Philippe, comme duc d’Orléans, nous rappelle l’extraordinaire portrait-écrit de ce prince tracé par les Goncourt dans leur Italie d’hier.
Et, dans le tableau du genre, La Ballade de Lénore, [p. 244] L’Aigle russe déchirant la Pologne, Mazeppa, ne sont que de romanesques couplets à prétentions grandioses. C’est ainsi que le petit tableau de l’Oiseleur fait penser à un Millet sans génie.
Oui, sans génie; tel est le correctif, le privatif qui s’ajoute forcément à tout grand nom dont le souvenir s’évoque au cours de cette exposition trilogique. C’est à un Canaletto sans génie que font penser ce port de Toulon, ce port de Marseille de Joseph Vernet. Sans génie encore ces Corot[49], aussi pourtant préventifs en leur fin mélange du rose des édifices romains, du bleu tendre du ciel, de l’eau qui les redit et où ils tremblent. Les deux toiles les plus délicates de cette exposition de Joseph, gâtées pourtant par ce ridicule feuillé de l’époque, duquel Gavarni fait dire à un de ses personnages: «Pourquoi le fais-tu toujours avec les mêmes 3?» Hubert Robert, sans génie dans ce tout de même joli tableau des Lavandières, au groupe agréable. Mais surtout, parmi tant de tempêtes de carton et de clairs de lune en tôle, entre tant de soleils levants ou couchants aux tons de coing, Claude Lorrain sans génie!
[49] Qui, lui-même, n’en peut mettre dans la toile de Joseph Vernet, dont il fit la copie en 1820.
Certes Carle m’en paraît moins dénué, avec au moins des idées cocasses, son clerc de procureur, le nez dans son cornet, durant que son coiffeur le poudre; un pisseur renouvelé de Jan Steen dans un coin de tableau: sorte de besogneux naturels et pressés, qu’il aimait peindre, accroupis sous l’escabelle même de l’afficheur qui interdit les ordures; des gens en perruques en proie à cet inconvénient [p. 245] prévu par Poë, et dont il écrit: «Je ne sais comment l’accrochement se fit, mais il eut lieu»; avertissement redevenu salutaire en notre temps où les femmes se remettent à porter perruque. Et d’autres caricatures, dont deux[50] ont quelque chose de Constantin Ghys; puis ces montgolfières qui mènent un peintre assez près du soleil pour le portraiturer, ou font voir à l’aéronaute la lune en plein midi, en le plaisant retroussement de jupes d’une Incroyable pendue à sa nacelle. Je ne parle que pour mémoire de maladroites aquarelles représentant des exercices équestres. Celles-là ne valent guère mieux que les surprenants ex-voto qui déconcertèrent notre piété dans un couvent de la Turbie. Il y en avait plus de mille qui figuraient des gravats ou des attelages arrêtés par la Sainte-Vierge au-dessus d’un enfant miraculé; je me souviens surtout de l’une d’elles, où se voyait un cochon noir reniflant un marmot, auquel Marie, pour le sauver du groin menaçant, infusait sans doute une odeur délicieuse. Enfin, bien des amusantes gravures de modes aux drôlatiques appellations: cravates à oreilles de lièvres, cheveux François Ier, chapeau en barque ou en bateau, habit crottin, charivari de breloques.
[50] No 141.
Si je veux encore décrire une petite Sapho en lithographie, attribuable à je ne sais lequel des trois, des quatre Vernet, en son modeste cadre, c’est qu’elle m’émeut sous la pluie à bâtons rompus qui noie son paysage de rochers incisés d’inscriptions grecques, sous ses faux bijoux, ses culottes, son turban de sultane de Mme Cottin, en [p. 246] son attitude prête pour le malassin à côté d’un pissenlit symbolique: c’est que je vois en elle, en dépit de ces détails falots, l’aînée de deux nobles filles de Chassériau, la Sapho qui se jette, laquelle inspira Gustave Moreau, qui n’en faisait pas mystère; et cette autre plus pathétique Sapho, théâtre de mouvements opposés, non résolus encore entre sa torture amoureuse et l’épouvante du trépas, les traits convulsés d’une éparse horreur, la main crispée d’un vertige mortel, tout le corps ramassé en un élan retenu, blotti au fond de cette tragique anfractuosité comme un alcyon humain terrifique et tendre.
Nous voici loin de la risible Sapho de Vernet, qui eut du moins cette grâce de nous rappeler ces sœurs poétiques. Ainsi de nombre de leurs tableaux, desquels on peut résumer qu’ils offrent un éminent et historique exemple de ce que des contemporains peuvent supporter de génie: à savoir en manquer.
C’est pour cette instructive conclusion qu’il faut savoir gré aux distingués instigateurs de cette exposition d’avoir dérangé les Vernet dans leur immortalité revisable. «L’on ne peut pas être et avoir été», dicton qui devient profond quand on l’applique à l’usurpation des royautés d’art. Mais une voix l’avait déjà chanté de son vivant au brillant Horace: «Vous n’avez qu’un temps à vivre!»—La même oraculaire voix qui prônait Wagner sous les sifflets parisiens en 1861, voix de métal incorruptible dans lequel vibrent toutes les notes et reluisent tous les filons de nos plus puissantes ou subtiles admirations d’aujourd’hui: Delacroix, Ingres, Millet, Manet, Gautier, Flaubert, Leconte [p. 247] de Lisle, Desbordes-Valmore, Pierre Dupont, Whistler, Seymour-Haden, Legros, Bracquemond, Jacquemard.—Et c’est un si sagace discernement qui rend plus inexorable, un tel oracle formulé à propos d’Horace: «Je hais cet homme parce que ses tableaux ne sont point de la peinture, mais une masturbation agile et fréquente, une irritation de l’épiderme français.»—Et c’est à Dumas père,—dont l’art n’est pas sans rapports avec celui de ce Vernet, que le critique dédiait cette autre appréciation pittoresquement similaire: «Éruption volcanique ménagée avec la dextérité d’un savant irrigateur.»
Quant à l’immortel instantané de Théophile Silvestre sur Horace Vernet, le peintre à la fois «dépourvu de caractère dans le dessin, d’unité dans la composition, de magie dans le clair-obscur, de concentration dans l’effet et d’harmonie dans la couleur»,—«un peintre sans émotion, sans poésie, sans caractère; qui comprend le paysage en officier d’état-major, l’histoire en sténographe, la splendeur en tapissier»,—en un mot «le Raphaël des cantines»! qui n’a gardé «dans sa mémoire qu’une bigarrure des objets»,—«à qui la gravité et la réflexion vont comme le silence et la solennité conviennent à la pie et à l’écureuil»,—et «qui a tué quarante ans d’un pinceau impassible tous les peuples du monde», c’est une magistrale interview, au réquisitoire inéluctable, au questionnaire habilement insidieux: «La quantité n’est pas la qualité, et Dieu me préserve d’établir entre l’artiste français et le peintre flamand un rapprochement sacrilège. Le génie de Rubens s’épanche en splendeurs immortelles; [p. 248] la verve d’Horace Vernet flue en vulgarités éphémères; le maître d’Anvers répand triomphalement l’éloquence et l’art; le faiseur de Paris en répète intarissablement le caquetage: l’un est le lion, l’autre est le singe.»—«Les plus importants tableaux du peintre de la Smala sont des ouvrages mort-nés.»
Conclusion sévère. Moins pourtant que celle-ci, la plus caractéristique, du peintre sur lui-même: «Je n’ai qu’un robinet, mais il a bien coulé, et quiconque, après moi, s’avisera de l’ouvrir, n’en verra sortir rien de bon.»
Ce robinet a la forme d’un canon, et la gloire d’Horace Vernet, qui en a tant coulé, ressemble à ce petit rond de fumée qu’il a peint dans sa Bataille de l’Alma, et dont il a dit: «Ça, c’est une observation très exacte que j’ai faite sur l’artillerie; cet anneau de fumée paraît ainsi quand la pièce a fait feu.»
L’avenir, et pas très lointain, jugera-t-il que le seul tableau d’Horace Vernet vendu son juste prix fut cette tulipe qu’il peignit à onze ans pour Mme de Périgord, et qu’elle lui paya vingt-quatre sols?—Le petit anneau de fumée lui-même est-il près de se dissiper?—Et çà, est-ce une très exacte observation faite sur la gloire?
XIV
Au Baron Arthur Chassériau.
J’ai prononcé le nom de Chassériau dans un précédent essai. Je salue une heureuse occasion d’y revenir et d’insister, bien que partiellement, aujourd’hui, sur le propos de cet artiste privilégié, mort jeune, aimé des dieux, et de Théophile Gautier—qui n’en est pas le moindre.—Occasion de m’étonner aussi en lisant un ample ouvrage d’ailleurs bien inspiré par la noble et charmante mémoire de Chassériau, qu’une telle amitié dut parfois gêner cet artiste.—Gêner? L’adjuvant réconfort, l’incessant concours d’un commentaire de poésie, d’un dithyrambe d’amour, d’une paraphrase de beauté; d’infiniment sensibles incantations, d’indéfiniment subtiles variations sur chaque nouveau thème proposé par le peintre ingénieux à son génial coryphée.—Gêner dans sa modestie peut-être?—Pas même. L’échange d’une haute compréhension plane au-dessus de la flatterie embarrassante et fastidieuse, pour atteindre à l’apologie.—Quel que soit donc le malentendu générateur du mot que je viens de citer, le terme demeure fâcheux et gênant lui-même. Au reste, il ne semble pas qu’une égale lumière dirige les [p. 252] travaux d’un même critique au travers d’une œuvre à cataloguer et à expliquer; autour d’un artiste à biographier, et à entendre. L’Apôtre l’a transcendantalement différencié: les uns ont le don des langues; les autres, le don de les interpréter: ce ne sont pas les mêmes.—C’est donc une surprise plus grande encore que nous cause la totale, l’injurieuse méprise—à notre sens—du même appréciateur de bonne foi, à l’égard d’une peinture du même maître. Une œuvre somptueuse et vertueuse dont je ne crois pas faire un mince éloge en affirmant qu’elle aurait plu à Hello, qui exécrait la peinture du XVIIIe siècle, et ce qu’il appelait «des cadavres roses».—Un tableau dont M. Degas parle avec émotion et duquel Gustave Moreau a placé la reproduction au seuil de son Musée, afin d’affirmer, au delà du Temps, son admiration pour elle.
C’est le lieu d’insister sur ce point capital en l’artistique histoire de notre époque, je veux dire le partiel engendrement par l’œuvre du peintre du Tepidarium, de deux maîtres-peintres contemporains: Gustave Moreau et Puvis de Chavannes.
Rien d’ailleurs de moins malaisé à constater et qui, en aucun moment, ait pu se donner pour une trouvaille. Une simple visite à la collection que M. Arthur Chassériau a réunie des œuvres de son parent suffit, sous son obligeante et éclairée conduite, à faire éclater aux yeux et toucher du doigt cette constatation capitale.
Il faut le répéter, chaque fois que s’impose une telle remarque, nous ne voyons en ces rapprochements qu’une réverbération mutuellement élogieuse. [p. 253] Une œuvre immense peut gésir tout entière en germe dans le pli d’une draperie; comme toute une forêt, dans un gland de chêne, et toute une moisson dans un grain de blé. L’important, en la suture historique de ces chaînons traditionnels, c’est le point circonscrit et pourtant soutien de tout l’art du passé, support de tout l’art de l’avenir; le point de contact des deux chaînons, l’affleurement des deux pensées. Chez le grand maître du Ludus pro patriâ, ce point est fugitif et restreint. Mais indéniablement il existe, et se manifeste en certains allongements de figures couchées et moulées par leurs draperies; en des complications ou des simplifications de gestes symboliques; en d’expressifs tournoiements de voiles.
Je relève dans les cahiers de Chassériau les deux phrases qui me semblent, entre plusieurs, dépositaires de l’alliage de ces deux artistes: «Faire un jour dans la peinture monumentale, ou en tableaux, des sujets tout simples tirés de l’histoire de l’homme, de sa vie,—ainsi le penseur, le joueur, le désœuvrement, la douleur, le retour, le voyageur voyant les fumées bleuâtres de sa ville monter dans l’air, les prisonniers, la liberté, le dégoût, l’épouvante, la colère, le courage, la misère, le faste, l’amour, et autant de sujets où l’on peut être émouvant, vrai, et libre.» «La science, l’harmonie, les astres, les étoiles. Des jeunes hommes qui contemplent le ciel illuminé, avec les instruments nécessaires aux mains; d’autres, qu’on aperçoit dans le fond de l’édifice, travaillent et méditent sur l’Histoire et les Sciences. L’un qui regarde, l’autre qui dicte, le troisième qui [p. 254] écrit.» Éloquente résurrection des formules de Giotto, dont Chassériau a effectué quelques-unes (notamment l’allégorie du Silence, dans les fresques de la Cour des Comptes) et dont Puvis de Chavannes a multiplié la réalisation magnifique. Écoutez encore: «Faire à la Méditation une draperie traînante et négligée. Le Silence très enveloppé, l’Etude moins couverte.»—«Deux enfants qui remplissent les buires ou les corbeilles (penser aux églogues de Virgile), leur mettre dans les cheveux des vignes, et un rayon de soleil sur l’un d’eux.»
Au reste, les existences des deux artistes, elles-mêmes, durent affleurer, et j’ai admiré, dans la collection Chassériau, une gracieuse figure de jeune femme: la princesse Cantacuzène.
Quant à Gustave Moreau, son atmosphère n’éblouit-elle pas tout entière dans ces quelques phrases de Chassériau: «Le ciel, d’un bleu exquis, les montagnes ordinairement comme du tapis le jour, l’air poudré d’or, ce qui donne une vapeur splendide; le petit bois extrêmement bleu et lumineux près d’une eau vert émeraude, et, çà et là, des trous éclatants de soleil»?—«Faire le ciel d’un bleu pâle qui devient rosé vers les nuages, les nuages d’or rosé, la mer bleue; les lumières des nuages très vives, les nuages du fond déjà pâlis et plus doux de couleurs qui s’effacent, la montagne rougeâtre comme une brique.—Un ciel tout marbré d’un ton verdâtre et blanc, certaines places bleues, la lune éclatante, le tout fantasque et triste.—Le soleil en face, le ciel rouge pourpre, le tronc des arbres d’un noir bleu, [p. 255] sourd, les petits nuages du ciel or sur bleu, les cyprès d’un ton sérieux, le haut du pin très vert, doré et rouge.—Dans la montagne d’un ton radieux, un ciel avec des nuages blancs et exquis, bleu doux en haut; des troupeaux blancs dans la plaine verdâtre.—Dans les seconds plans, faire les choses très précises par les plans et grandes masses qui ôtent les détails vrais, sans aucun trait noir; l’air qui passe entre ces objets et ceux du premier plan leur donne quelque chose de velouté.»—Rapprochements d’autant plus curieux qu’on est plus familiarisé avec l’œuvre de Moreau.—Achevons par celui-ci, des plus marquants: «Quant à mettre dans la peinture du soir des tons riches, brillants et forts, il ne faut guère, quand ils sont clairs, les mettre que par parties peu grandes et avec art, comme un bouquet, et surtout vers le milieu.» Oui, on peut dire que la transformation de la Daphné, peinte par son ami, fut moins le changement de cette Nymphe en un rose laurier, que la conversion de l’œuvre de Moreau incertain, peut-être autrement orienté, en tant de verts lauriers et de palmes d’or, que lui cueillirent ses glorieux Mythes. La modeste mais révélatrice égratignure d’une eau-forte, en laquelle tenait pourtant tout le saut de Leucade, put bien alors enfanter à soi-même le futur illustre peintre de tant de Saphos empourprées ou bleuies des rouges adieux des couchants ou de froids baisers lunaires, non moins que de la fulgurante irradiation de leurs cuirasses en pierreries.
Aussi ne fut-ce que justice, le commémoratif hommage que fit à la mémoire de Chassériau, [p. 256] fauché en sa fleur, Moreau survivant et lui dédiant: Le Jeune Homme et la Mort, funéraire libation d’art, nénie colorée.
L’intéressant volume, lequel contient une appréciation que nous n’aimons pas, d’un tableau qui nous est cher, et que nous nous réservons de décrire, nous étonne en nous parlant du contour «chaste» de l’entre tous sensuel Ingres; mais il nous offre à glaner, suivant notre particulière prédilection, dans l’histoire de celui qui fut, un temps, son élève préféré, des traits de caractère ou des détails d’existence. Il plaît à notre goût du rapprochement historique des personnalités et des circonstances, que Chassériau se soit montré pince-sans-rire, comme Villiers-de-l’Isle-Adam, autre mémorable défunt, et qu’il ait devancé dans cette avenue Frochot, de lumineux séjour, Alfred Stevens, autre vivant admirable.—Il sourit à notre fantaisie qu’il ait accroché l’arbre généalogique de tant de chevaux qu’il avait aimés, aux murs mêmes de ce boudoir dont les miroirs auraient reflété tant de femmes qu’il avait chéries. Et nous nous complaisons à imaginer qu’une épigraphe courant en bordure autour de ce mystérieux retrait ait bien pu être ce distique de Musset, succinct exposé de tant d’amours légitimes:
L’Océan et l’azur (Thalamos, Thalassa) Chassériau en fait le lit amoureux et le lumineux dais de son Anadyomène. Les femmes, toute son [p. 257] œuvre, comme tout le tendre secret transparent de sa noble vie ébruitée, dit à quel point il en fut épris. Les femmes qui, sur la route des Marais Pontins, lui apparaissent «toutes auréolées de cheveux d’or».
Ses souvenirs à la plume en esquissent de charmantes, ou de leurs atours; et «des changements dans les figures des femmes» lui semblent pouvoir suffire à indiquer dans un tableau, l’heure claire ou crépusculaire de la scène. Observation digne d’un amoureux bien précieusement raffiné et sensitif.
A l’égard des chevaux, lisez ses croquis écrits, en lesquels ils piaffent, quelques-uns, sous des harnais roses. J’en fais défiler deux ou trois, entre cent: «De beaux jeunes gens à cheval... chevaux vifs avec des yeux ardents et fins et de petites narines.—Faire un alezan doré, le nez avec des tons roses et bruns (tache blanche).—Les chevaux nourris d’orge sont lestes, détachés, fins de contours et lustrés. Ne pas oublier que dans l’ombre les yeux des chevaux ont des tons brillants, bleuâtres, luisants et mats comme des reflets glauques qui brillent; tout le noir de l’œil luit dans l’ombre.—Une robe de cheval assez rare, gris fer mêlé de bleu et pas très pommelé, presque uni, les naseaux roses.—Deux chevaux avec des crinières dorées arrêtés à un char et l’un mordant l’autre en jouant.» Enfin, cet aphorisme: «Penser à la vie musclée des chevaux» qui donne lui-même à penser que Chassériau pourrait bien, tout comme Fromentin et surtout Boëcklin, avoir connu l’état de Centaure! C’est encore sous un [p. 258] céleste vélum d’azur qu’il fait s’ébrouer les chevaux du calife Ali-Ben-Ahmet qui mériteraient de traîner l’Aurore. Enfin, les roses et les lauriers s’unissent et se greffent sur ce laurier-rose en lequel le peintre a changé sa Daphné. Et n’est-ce pas encore une fleurette de cet arbuste païen, qui symbolise, aux lèvres de certain jeune Arabe, tout cet Orient coloré, parfumé, lequel fut aussi une des passions de l’artiste, qui, dans la réalité poétique, nous paraît offrir une ressemblance avec Chénier, et dans la poétique fiction, avec le Coriolis des Goncourt.
Au premier il s’apparente fraternellement par ce passage bien symptomatique de ses notes: «Il faut voir les maîtres et l’antique à travers la nature, autrement on n’est plus qu’un souvenir usé; et, avec cela, un souvenir vivant.»—Du second, il procède par le sentiment très délicatement sensorial de toutes les nuances.—Le ciel lui apparaît comme une «coquille de nacre grise avec des reflets d’argent[51].»—Il voit des tons de satin dans les ombres des villes ardentes du Midi; de la tendresse dans l’effacement des troncs d’arbres; et, parmi les teintes de l’automne, certains bleus qui lui rappellent les cernures des yeux des mourants. Certain paysage d’hiver lui semble chaste, et c’est encore cette métaphysique invasion de l’humanité dans la nature qui le relie à Gustave Moreau, en lui faisant décrire un ciel soucieux ou un ciel sauvage. «Des oiseaux blancs qui courent sur des terrains verts» sont pour lui «ombrés et mordorés par les ombres des nuages». Il veut peindre un [p. 259] ange avec des vêtements d’un ton de ciel qui l’y rattachent pour ainsi dire, «comme s’ils en faisaient partie et qu’il remontât dans sa patrie». Déduction vraiment de poète, à laquelle ne le cède pas ce mémorandum finement lumineux d’un rendez-vous sidéral: «Pour l’étoile dont j’ai besoin,—hier 24, le soir à neuf heures, l’étoile était d’un blanc doré, le ciel bleu mêlé de gris, et tout autour une lueur blanche et fine. C’est l’unique fois que je l’ai vue ainsi.» Ne dirait-on pas le mémorial d’une rencontre d’amour?—Une élégante ou pénétrante sensation de l’Orient fait encore de Chassériau le frère de Coriolis: «Un Arabe mourant près d’un ravin plein de lauriers-roses... des femmes maures pleurant sur des tombes.—Des hommes et des femmes coiffés de jasmin blanc qui pend à leur coiffure, en guirlandes... des étoffes légères couvertes de points d’or comme des étoiles.—Un enfant en veste d’or, les cheveux attachés par derrière avec un ruban orange.»
[51] Notes de Chassériau.
Ces notes de Chassériau contiennent des conseils de métier, voire des directions de conscience, en lesquels on sent se magnifier comme l’impérieuse prescription d’un Léonard: «Prends garde, avant de faire une chose belle et charmante, qu’elle puisse se voir.—Une chose inventée, si grande qu’elle soit, est inférieure à une chose médiocre copiée; l’idée de l’art, c’est l’exécution, la reproduction intelligente de ce qui est.—Ne laisser l’œuvre que presque satisfait.—Regarder, pour arriver aux tons des étoffes, si sous le ton réel, il n’y en a pas un autre dessous, et commencer par celui-là, afin d’arriver à la transparence; que [p. 260] la forme soit plutôt au-dessus de l’idée, que l’idée au-dessus de la forme.—Les conviés (de Macbeth) ne comprennent rien; lui seul comprend.—M’écouter et me croire toujours seul; ce que j’éprouve sur moi est toujours la vérité, c’est le résultat de l’expérience de ce que j’ai souffert; on ne connaît que ses souffrances, on ne peut savoir si d’autres les ont eues, et il ne faut croire qu’en soi.—Chercher dans le hasard qui a quelquefois des forces.» Et ce beau compliment à un coucher de soleil: «C’était sublime, ne pas l’oublier.»—Enfin, le choix des épithètes qu’il pose comme des touches et accumule dans ses notes, comme des couleurs sur une palette, nous donne la couleur de bien de ses façons de ressentir: «Fier et grand.» Ceci bien d’accord avec cette indication valeureuse: «Faire un champ de bataille couvert de morts, tous avaient reçu leurs blessures de face.»—«Doux, riche et nouveau.—Superbe, varié et distingué.—Doux, ferme et profond.—Grand, sublime et attendrissant.—Pur, net et bleu.—Est-il nécessaire d’ajouter que toutes ces citations ont été élues dans l’ensemble des pensées d’art de Chassériau, avec une application tout au moins très vétilleuse qui constitue, de par l’assortiment, la répartition, l’appropriation et leurs conséquences, le meilleur titre du présent travail.
«Chaque tête aimée et trouvée belle, pour une raison, devient une chose originale, rendue comme on la sent.»—Et, ailleurs: «voir dans les têtes [p. 261] en les copiant la beauté éternelle, et choisir la minute heureuse»—tels sont les deux aphorismes de Chassériau (le second un peu teinté de Baudelaire), lesquels nous introduisent parmi ses portraits, bien solennelle région de son œuvre. Ajoutez-y, pour certaine partie matérielle, une remarque de profonde ironie philosophique sur «la question de prix, toujours si grave pour tous les gens riches».
Les indications de types ou de costumes qui nous guident à cette terre promise sont, entre autres, les suivantes: «Une robe d’un vert exquis en soie verte forte, un peu foncée, et des tons changeants or doux.—Faire avec mon croquis d’Avignon un jeune homme blond roussi avec des yeux bleus, clairs comme les eaux du Rhône.—Faire, pour un portrait de jeune femme, une robe blanche en mousseline, et une écharpe de même, des cheveux blond cendré, avec un peigne bleu d’azur à dessins d’or; pour un autre portrait, une robe à grands plis cassants, gris extrêmement clair, perle, presque blanc.»—Il y a d’un Ricard, dans cette description.—«Une femme a l’air doux et tendre. Elle cause en s’appuyant sur une chaise; tout en gaze blanche, avec une écharpe de tulle qui tombe négligemment sur l’épaule droite, les chairs grenues et satinées, les ombres tendres et mystérieuses, non pas la nature, mais la poésie de la nature. Le vêtement du haut, blanc, doux, le teint franc et riche, les cheveux tordus, la robe du bas bariolée bleu et or chiné, riche et étranger.—De beaux yeux bleus tristes, le haut de l’œil cerné et un peu cave, des cheveux blond [p. 262] cendré; quand je me servirai de cela, appuyer sur la grâce, la finesse et l’originalité de cette nature.—La peau rose, blanche et mate, les cheveux doux, blonds et cendrés, des fleurs rouges, une robe grise, dans les joues des fossettes d’un modelé large et bon, les cils très blonds, ce qui donne un air pur et particulier...»
Ces premiers jets de vision, succinctement, mais nettement descriptifs, ces prises de possession du modèle par un coup d’œil exercé, synthétique et analytique à la fois, renseignent d’avance sur la maîtrise animique avec laquelle Chassériau dut aborder ce genre du portrait, dans lequel, en effet, il excella. Il a peint de modernes Bronzino, des Sébastien del Piombo contemporains, sans imitation, sans recherche archaïque de costumes; du seul fait d’une de ces concentrations de volonté presque magnétiques, lesquelles font s’emparer du modèle et le traduire magistralement, avec une exactitude et une vérité qui n’appartiennent d’ordinaire qu’aux portraits qu’on fait de soi, au moyen d’une glace. Un tel et bien caractéristique portrait de lui-même, en sa redingote ajustée de taille, aux basques bouffantes, servit de début au peintre, et l’habitua dès lors sans doute à considérer ses modèles avec cette fixité qui les confessait, et à les rendre avec cette précision qu’enseigne seul le connais-toi toi-même.
Un autre portrait de Chassériau peint antérieurement par lui (à l’âge de seize ans) nous paraît offrir quelque ressemblance avec Elémir Bourges.
Un portrait de femme d’une captivante simplicité est celui de cette jeune fille en brun, duquel [p. 263] Gustave Moreau était féru. Il le contemplait longuement. Sans doute, cette toile quasi-monacale exerçait sur le mystique joaillier des Saphos, des Hélènes et des Salomés l’impérieuse et presque redoutable fascination de la bure.—Je ne connais que la reproduction d’un autre et plus célèbre portrait, celui-là véritablement ascétique, duquel la correspondance du peintre nous entretient et dont le seul fac-similé semble brûlant: Le Lacordaire. Un autre portrait de femme (Mme de La Tour-Maubourg, je crois) est saisissant d’attitude et d’expression, et d’un arrangement étrange. Celui de Mme de Girardin n’offre heureusement rien de la théâtrale Muse en ringlets, par Hersent, au Musée de Versailles; et puisque la peinture de Chassériau semble, après tout, devoir être la plus sympathique, sinon la seule représentation de cette célèbre Delphine, il est d’autant plus regrettable que toutes traces de cette importante toile soient pour le moment perdues.
Arrivons au chef-d’œuvre de Chassériau, selon nous, à ce captivant portrait des Deux Sœurs, que l’avenir intitulera plus cristallinement de l’argentine allitération de leurs deux jolis noms, Alice et Aline; eux-mêmes fraternels déjà, et revêtant leurs deux personnes en une, de similaires sonorités, ainsi que feront de leurs plis de même coupe et de même couleur, de pareils vêtements, de semblables étoffes.
J’entends déjà tinter les deux noms jumeaux dans les lettres que Chassériau écrit de Rome. C’est pour ces jeunes filles qu’il fait bénir des chapelets dont j’aime à m’imaginer que ce sont [p. 264] leurs pieux grains alternés d’ambre et de corail qui se nouent au col des deux sœurs dans le portrait d’Alice et Aline.—C’est maintenant le lieu de se demander comment de maussades contemplateurs d’une si harmonique dualité—et tout en s’efforçant de lui rendre justice—ont bien pu voir en elle, quoi?—des modèles ingrats! (Entendons-nous: ingrats comme La Monna Lisa, de Vinci, ou La Princesse d’Este, de Pisanello, ces deux modèles de Chassériau appartenant au contraire précisément à cette famille de femmes aux visages sans grâce poupine, mais bien aux traits accusés et sérieux qu’une grande époque d’art a justement appelés: La Belle Simonetta, La Belle Ferronnière.)—Ce n’est donc pas sans stupeur qu’il nous arrive d’entendre décrire ces deux nobles types, sous l’aspect «d’une réalité sèche et dure, de vêtements étriqués, de corps raides et sans grâce, de visages solidement construits sans beauté, d’un sourire qui cause une sensation de peine;»—enfin une destinée de «célibat à perpétuité par la disgrâce de la nature et de la fortune»; l’horreur d’être «inutile», et de se sentir «à charge» en un avenir aigre de vieille fille!»—Toutes ces médiocres horreurs dans cet auguste duo virginal, cet assemblage éloquent et muet de deux sphinx féminins indevinés, morts sans avoir proféré leur secret d’amour. Mais s’il fut celui que leur conseillèrent un fier amour-propre et une pudeur chaste, leur volontaire célibat, plus altier que tous les hymens, loin de mériter l’honneur d’être blâmé, ou l’affront d’être plaint, n’aura revêtu que la forme, ensemble brûlante et frigide d’un culte de Vestale consumée [p. 265] au trépied d’un idéal pur, fût-il que le respect de soi-même.
Tout le détail de ce tableau, à mesure qu’il déroule à l’examen respectueux et ému son sévère prestige, est d’une suggestion puissamment rêveuse. Ses «voyantes couleurs» ne sont que sobre magnificence et polyphonique mélodie: un fond bleu paon; et, pour les «étriqués vêtements», deux robes étranges, d’un ajustement bizarre et d’une mode compliquée, lesquels, par leur exacte similitude, renforcent encore cette poignante parité des visages.
Shelley parle d’un mage qui se rencontre soi-même dans son jardin: ingénieuse comparaison de la vie intérieure, retrouvée dans la solitude, et que Musset aussi a bien rendue en sa Nuit de Décembre.—Les Deux Sœurs, semblables à deux magiciennes de Shelley, paraissent le redoublement de l’une par l’autre, dans un miroir qui est leur tendresse.—Les deux écharpes en cachemire des Indes, rouges de ce rouge de géranium fané qu’affectionnait Moreau, sont aussi de celles qu’aimait Ingres, qui en drapa les idoles Rivière et Devauçay; et que Prud’hon a enroulées autour de sa cycniforme Joséphine, qui, elle, les chérissait au point d’en posséder pour des fortunes.—Les robes sont d’une souple gaze rayée (peut-être un barège) de ce ton chaud que le siècle de Louis XIV appelait: couleur cheveux, et que la chevelure de Marie-Antoinette fit ensuite, en l’éclaircissant, qualifier: cheveux de la Reine. C’est une sorte d’amadou diaphane, une nuance d’écaille blonde un peu foncée en laquelle joue le soleil. Des anneaux [p. 266] sont curieusement disposés aux doigts, selon une méthode d’Ingres. Une grosse bague d’homme, laquelle rappelle la multiforme chevalière de Bruyas, alourdit l’index de la cadette. On dirait une de ces larges bagues d’aïeul défunt, dont s’orne par coquetterie autant que par souvenir, une jeune fille sentimentale et peu fortunée.
Un douloureux bracelet tressé d’une natte de cheveux ajoute à cette impression. Natte toute pareille à celle qui couronne, dans le beau tableau de Gustave Moreau, la mystique pleureuse d’Orphée. Enfin un réticule fait d’une bande de tapisserie encadrée de velours et retenu par une cordelière; une ombrelle au manche, à la béquille d’ivoire ciselé, et dont les plis, lorsqu’ils se referment, se viennent emprisonner en ce large cercle pendant, pareillement ivoirin: de ces détails dont Ingres enseignait à caractériser les accessoires.
Tel est, et trop rapidement, par le menu et dans son essence, ce tableau historié, simple et profond à qui rien n’est supérieur, auquel peu de choses sont égales. Un de ces pans de matière et d’esprit devant lesquels vont rêver les meilleurs d’entre nous; un de ces spirituels vases d’élection que les poètes osent effleurer du suave baiser d’une fleur.
Quant à moi je ne sais rien de plus tendrement imposant que la grave et sensible allégorie de virginité de ces deux sœurs philadelphes. Elles représentent précisément (et c’est pour cela que le rigide et fervent Ernest Hello les eût aimées) le contraire du chef-d’œuvre de Fragonard: le Sacrifice à la Rose;—et ce ne serait que justice de les [p. 267] dénommer: les Roses sacrifiées?—la Fleur d’Harpocrate, la Rose du Silence et de l’Amour, je ne dirai pas se fane—elle est immarcescible!—entre les mains de celle, non qui parle, mais qui se tait pour toutes les deux: la sœur aînée. Une de ces intangibles jeunes filles, que Chassériau, selon son expression même, rêvait de peindre «dans une église solitaire, priant près d’un mur, et sans rien auprès d’elle, que son ombre portée!»
A certain poète étranger désireux de séjourner dans Babylone, les anciens de la ville présentèrent, dit-on, une coupe remplie jusqu’aux bords d’une précieuse liqueur, afin de lui témoigner silencieusement que leurs murs regorgeaient de Musagètes. Mais ce dernier, plus prudent que ses hôtes, et plus subtil que ses juges, se contenta de leur prouver que sa présence ne serait qu’un prestige de plus pour leur glorieuse cité—en couronnant la coupe comble, et sans en répandre rien, avec un pétale de rose.
Le sublime et touchant portrait des Deux Sœurs est pareil à cette coupe.
Le peintre, par le miracle d’attentive fixité dont je parlais plus haut, y a transsubstantié de la plénitude des sentiments refoulés, débordant du cœur des deux vestales.
Cette toile est comble; mais l’art délicat et magnanime de Chassériau—et sans en répandre rien a su, comme sur la coupe babylonienne, y poser cette rose divine, qui ne fait déborder que nos âmes!
XV
A Caran d’Ache.
Certes, ce serait quelque chose de bien plus qu’outrecuidant, surérogatoire, vain et superflu, aligner des alinéas au-dessous du nom de Constantin Ghys, après l’article de Baudelaire, la plus adéquate des études qui ait jamais été consacrée à un artiste, et à laquelle, par un singulier prestige, faisait seul défaut le nom du peintre; s’il n’y avait parfois une utilité et un intérêt (sans parler de l’attention rappelée sur un sujet oublié de plusieurs, inconnu de beaucoup) à tirer des conclusions et vérifier des oracles.
Car c’est vraiment cela seul qui reste à faire pour tout commentateur présent ou à venir de Ghys, analysé et synthétisé dans l’unique étude célèbre avec une acuité et une maîtrise que n’atteignent point les multiples touches et les incessants repeints exercés à l’entour de mémoires plus vivantes et au profit de tombes moins abandonnées. Quelques détails ultérieurs, tels que ceux consignés dans le beau premier-Paris de M. Nadar, après la mort de Ghys, en 1893, ont droit et devoir de s’inscrire en note et en marge du peintre de la vie moderne, avec leurs dernières circonstances précises et leurs amicales oraisons funèbres; le reste ne peut plus être que considérants et critique [p. 272] d’art, dont la seule excuse, sinon le seul mérite est d’inaugurer la véritable justice posthume à rendre désormais à une telle œuvre; à savoir une exhibition de plus en plus ample et rassemblée de ce qui fut du vivant de l’auteur une exfoliation incessante et spontanée de feuillets d’album, aujourd’hui, pour la première fois réunis depuis l’automne suprême de leur inépuisable forêt.
C’est encore M. Nadar, le même fidèle ami de Constantin Ghys, et qui l’accompagnait naguère éloquemment à la tombe, qui l’introduit aujourd’hui dans la gloire, de par l’intéressante exposition d’aquarelles du maître admiré de Baudelaire, ouverte, pour quelques jours, en mars[52], dans les ateliers de la rue d’Anjou, et de là, transportée, rue de Sèze, par M. Georges Petit, en un coup d’enthousiasme motivé. Nadar, un de ces noms qui ne vieillissent pas plus que les hommes qui les portent. Celui-là toujours debout dans l’incandescente vareuse rouge qui tenta Carolus Duran, assortie à l’inextinguible flamme de la chevelure rousse; en la haute vigie de l’intelligence sans cesse en éveil et de la mémoire jamais endormie. De beaux et curieux souvenirs se lèvent pour moi sous l’N zigzaguant de l’aéronaute célèbre; dirai-je «de l’illustre photographe»? N’est-ce pas chez lui, en effet, que nous vîmes préluder la cessation du malentendu attaché aux œuvres de Wagner, et les entachant? Le bonnet des gâte-sauce acharnés contre Lohengrin reçut là sa première sérieuse atteinte. En cette hospitalière et artistique demeure, on apprit à penser et à comprendre que les plus que [p. 273] légitimes rancunes patriotiques n’avaient rien à voir avec les œuvres d’art; et ce fut comme toujours une femme qui effectua ce miracle. J’ai nommé Mme Judith Gautier.
[52] 1895.
Aucun être épris de nobles manifestations légèrement ésotériques n’a perdu la mémoire de ces soirées de 1880, un peu équivalentes à des messes de néophytes chrétiens dans les catacombes, et où, pour la première fois, la fille aînée de Théophile Gautier m’apparut bien belle. Elle portait une étrange robe taillée dans un ancien cachemire des Indes d’un fond vert; et sous une toque arrangée d’un seul lophophore, son visage lunaire s’arrondissait et s’apâlissait entre les deux étoiles en turquoises de ses larges pendants d’oreilles. Une autre apparition,—terrible, celle-là,—tranchait sur l’auditoire composite; l’ex-Païva, hideuse sous son masque flétri aux yeux de crapaud, enlaidi encore d’un chapeau charmant, et éclairé de deux solitaires infernaux contrastant avec les célestes étoiles azurées de Judith, magnifique et pure.
Ghys faisait-il partie de ces assemblées? Nadar ne peut me l’affirmer. Mais il me plaît me rappeler presque l’y avoir entrevu sous sa blanche chevelure et tel que le peignit Manet dans un portrait connu.
Ce fut chez une belle et aimable dame (que peignit aussi Manet), qu’il me fut donné de contenter, pour la prime fois, mon vif désir de m’initier à une œuvre de ce peintre de la vie moderne, dont c’est encore aujourd’hui le même incorrigible Nadar qui nous offre, par un nouveau miracle, la révélation, ensemble fulgurante et mystérieuse. Le [p. 274] maître Coppée, averti de mon désir, voulut bien alors, avec son affabilité habituelle, me conduire à cette entrevue; mais deux ou trois aquarelles rapides n’étaient que pour donner, d’un pinceau si fécond, un aperçu bien insuffisant à qui pouvait dire avec le poète des Fleurs du Mal: «Pendant dix ans j’ai désiré faire la connaissance de M. Ghys...»
Voici plus de cent aquarelles aujourd’hui juxtaposées, à peu près dans l’ordre savant que leur assigna Baudelaire qui, si subtilement, régla leur famille et tria leurs catégories. L’impression générale qui s’en dégage, au rebours de celle émanant d’une réunion d’aquarelles de Regnault, par exemple, qui éclaboussaient au point d’aveugler, illumine au contraire de lueurs douces, qui s’accentuent en y repensant, les paupières une fois closes.
Aux noms que prononça Baudelaire à propos de Ghys, il siérait d’ajouter celui de Whistler; certaines délicates luttes d’ombre et de lumière, de telle ou telle feuille volante méritant d’évoquer l’art admirable du maître des arrangements en gris. Ceux encore de Goya pour de certaines juxtapositions de noir et de rose; de Baudouin, de Lawreince, à l’occasion d’un lavis de danseuses emmousselinées d’un coup de pinceau léger et tourbillonnant. Trois autres ballerines assises et chaussées de hautes bottines—à la Souvarov!—apprêteraient à rêver à M. Rops. Chaque branche de l’art n’est-elle pas une chaîne dont tout chaînon a double contact entre celui qui précède et celui qui succède.
[p. 275] Ceux auxquels manquent ces points d’origine et d’engendrement peuvent avoir leur intérêt en soi; mais ils ne font pas partie de la chaîne. En sorte, on le peut dire, qu’une œuvre d’art (s’il s’en trouvait une), n’évoquant aucun nom de précurseur et de disciple, ne saurait pas plus prendre rang que celle dont l’aspect n’évoquerait d’emblée et sans nulle trouvaille personnelle qu’un art pastiché et un nom volé. Ce n’est dans aucune branche d’art ou de science, jamais de tout remettre en question ou de tout recréer, qu’il s’agit; mais d’enrichir d’une innovation un trésor lentement accru. Le musicien et le poète ont assez fait, qui inventent une cadence et un rythme, pourvu qu’ils aient tout d’abord prouvé qu’ils sauraient recommencer Bach et Ronsard, la fugue et l’ode.
Or, dans la lignée humoristique,—dirons-nous caricaturale?—après Gavarni, Daumier, Devéria, Lami et Monnier; avant Forain et Caran d’Ache, avec lesquels il a de commun «l’art de réduire la figure, sans nuire à la ressemblance, à un croquis infaillible, et qu’il exécute avec la certitude d’un paraphe,» selon l’expressive formule de Baudelaire, se place, s’interpose, se soude un chaînon peu connu: Constantin Ghys.
De Gavarni, mais rarement et plutôt comme par désir de s’essayer dans cette matière et cette manière, et d’y justifier de son droit, il emprunte parfois le velouté d’une étoffe sur un dos de jeune lorette. Mais le précipité de sa combinaison résulte bien plutôt de la douloureuse et ironique tristesse de Daumier ne s’exprimant plus par de la laideur, [p. 276] et ne gardant de sa grimace qu’une teinte sombre qui descend sur le personnage de Lami, le dépouille du costume trop vif de Mme de Bauséant ou de la Palferine, voire de leur trop brillant rôle, les enveloppe de plus de spleen ou de mystère et leur confère selon une esthétique particulière à Ghys, ou des prédilections que nous allons noter, des beautés autres, peut-être plus aiguës.
Dans la femme, ainsi que le fait observer pittoresquement M. Nadar, les pectoraux et le capillaire fascinent tout particulièrement notre artiste. Les tétonnières de la troupe, selon la formule de M. de Goncourt, abondent en cette œuvre, au fond des bouges comme sur le bord, des loges, en boursouflements de petits ballons du Louvre à pleins hémisphères envolés hors des corsages.
Les cheveux sont en bandeaux russes, et vont jusqu’au chignon de 67. Ainsi font les ajustements qui répètent et copient les modes de l’Impératrice Eugénie à Biarritz, les retroussis, les biais, les pattes, sans oublier le saute-en-barque, ni le ruban noué derrière le col et retombant en longs bouts presque jusqu’à terre, tel que des rênes abandonnées, le ruban au nom invitant de: «Suivez-moi jeune homme!» Mais, pour Ghys, et bien que—mort à quatre-vingt-sept ans, il n’y a que deux années—il ait travaillé beaucoup plus tard, la mode s’arrête là; comme si son pinceau se fût enlizé dans les atours où ses amours s’étaient prises.
Les premières de ces élégantes de Ghys apparaissent en ces crinolines dont les albums de la Compagnie Lyonnaise nous ont conservé les surprenantes draperies et les enguirlandements [p. 277] parfois jolis. Les dernières ont aplati leurs jupes, et ressemblent un peu à cette allégorique Cigale de M. Gustave Moreau, dans ses Fables de la Fontaine, la seule figure moderne qui me soit connue de ce Maître. Mais les premières sont les plus nombreuses dans l’œuvre de Ghys, avec leurs tours de tête et leurs bavolets, leurs brides et leurs barbes, leurs berthes, et leurs guimpes, leurs volants et leurs canezouts, leurs châles et leurs manchons, et comme s’appliquant, du fait d’une prestidigitation de haute volée, à prouver qu’Eve peut s’extraire de ces accessoires disproportionnés et monstrueux; et que Vénus sait naître de la vague des jaconats et de l’écume des organdis.
Un autre gentil bibelot de la toilette féminine dont la formule décorative nous a été conservée par Ghys, c’est l’ombrelle dite marquise. Qui de nous ne se souvient d’avoir, enfant, caressé et malmené, au retour de la promenade, ce gracieux complément de l’élégance maternelle? Replié, l’objet, gris ou blanc, souvent vert (plus rarement bleu ou rose), ressemblait, sous sa longue frange, à un bichon aux oreilles soyeuses. Le manche en émergeait guère plus grand qu’une branche d’éventail ancien, ivoire travaillé, corail ciselé, incrusté d’une perle baroque en forme d’un cœur. Ouvert, l’intelligent instrument abritait; ou, brusquement renversé par un ressort, faisait écran; et de doux regards, entre l’effilé de l’ombrelle, se pouvaient couler vers ces dandies à pantalons écossais, sous les arbres de cette avenue dont le nom se prononçait alors—sans doute du fait d’un caprice de Lion euphuiste: les chan-Elysées.
[p. 278] Deux sorties de théâtre, d’un beau jeu de rayons et d’ombres, nous présentent encore de ces élégantes. Puis, de similaires silhouettes, mais exagérées, encanaillées, nous entraînent devers Musard, jardin de Paris préventif; ou bien au Casino Cadet, au château des Fleurs, à Mabille. Des toilettes blanches, mousseuses, savonneuses comme battues et fouettées en crème, dans des victorias et sous des verdures. Ghys y excelle. Et celles-là nous conduisent à cette prédilection de l’artiste, qu’il aima sans doute à l’égal de la femme: le véhicule, la voiture. Non pas seulement ces calèches et ces dorsays, ces phaétons et ces tilburys, ces ducs et ces demi-ducs, ces breaks, ces poney-chaises et ces araignées, dont il dessine si amoureusement les anatomies diverses, l’ellipse des roues, les jantes radieuses comme des rayons de soleils véloces; dont il peint avec tendresses les nuances de fleurs: jaune de primevère, bleu de pervenche; non pas seulement ce cabriolet du duc de Brunswick où notre jeune âge s’épouvantait de voir reluire sous la capote relevée les yeux du croquemitaine à la perruque calamistrée ainsi que celles des archers du palais de Darius; ou bien encore ces grands-coupés pareils à ceux de la Reine, à Windsor, sorte de carrosses aux sièges à housses passementées, et surmontées de colosses poudrés et galonnés, dont les derniers spécimens nous ont été offerts devant Saint-Philippe du Roule, lors du mariage Uzès-Luynes. Mais bien aussi nombre d’attelages étrangers, de-ci, de-là. Dans Rome, certain landau de louage, où quatre héroïnes de Stendhal ou de Gautier, [p. 279] s’attardent un peu, sous leurs boléros à houpettes. A Naples, c’est de la voiture du roi Ferdinand que s’inquiète notre illustrateur alerte. En Orient, voici la voiture du sultan, toute semblable, avec ses huit glaces, à une grosse lanterne roulante.
Des silhouettes hippiques, chères encore à Ghys, parfois telles que des ombres chinoises, mais le plus souvent finement modelées, découpent et diversifient toutes les positions du cavalier avec une variété à déconcerter Crafty. Il y a du bonhomme qu’on fait dessiner aux enfants, de par cinq points, pour leur apprendre à figurer toutes sortes d’attitudes, dans ces retournements de cavaliers, envolement d’amazones, piaffements de montures et cambrements de tigres et de grooms; hippisme d’un dandysme raffiné, nerveux et verveux, endiablé, capricant, steppant et caracolant, toujours luisant, correct et fashionable.
Enfin, le militaire, la troisième passion graphique de Ghys, détache entre cent redressements de taille et tournements de moustaches, un bien spécial trio de cent gardes, bras dessus, bras dessous, aux élytres rouge et noir de coléoptères.

Telle, en quelques phrases hâtives, se montre cette première exposition de Constantin Ghys, récente surprise que vient de nous sortir de sa féconde boîte à malices M. Nadar, qui nous en réserve d’autres; sans omettre certaine admirable correspondance de Veuillot, que doit nous révéler bientôt le Figaro, et dont une lettre à propos de l’Amour de Murger est une des plus saisissantes choses que j’ai lues.
[p. 280] Nadar, n’avais-je pas raison, tout à l’heure, après l’avoir nommé le célèbre aéronaute, de l’appeler: le photographe illustre? Certes, cet ingénieux esprit plein de passé a droit à ce titre dans son sens le plus noble et selon cette admirable définition qu’en a faite un puissant et subtil penseur en des pages sublimes: «L’humanité a aussi inventé, dans son égarement du soir, c’est-à-dire au XIXe siècle, le symbole du souvenir; elle a inventé ce qui eût paru impossible; elle a inventé un miroir qui se souvient. Elle a inventé la photographie.»
Février 1895.
XVI
A Maurice Lobre.
C’est de 1881 que date pour moi le souvenir de Jean Carriès. Les quatre têtes par lui exposées au Salon venaient de me frapper, ces quatre têtes que le passant né malin, dérouté de ne leur point voir affecter l’allure consacrée des bustes, appelait: des têtes coupées.
Il y en avait bien une: celle de Charles Ier, depuis acquise par le Musée du Luxembourg, et que l’on y voit exposée sur un si vilain socle. Les autres, c’étaient trois marmiteux, aussi beaux que minables; des Clopins Trouillefous dans lesquels s’alliait du Hugo à du Dante, du Callot et du Cellini. Notamment un aveugle,—ne l’étaient-ils pas tous?—qui bayait à l’espace et faisait songer à ce vers:
La chose émouvait; moins du fait d’une pitié dictant le choix du motif de douleur que par une [p. 284] de ces saisissantes disproportions d’art entre le sujet de misère et la délicatesse du rendu.
En cette sculpture des Champs-Élysées, entre tant de duchesses dégrossies dans du sucre, il semblait merveilleux que le seul véritable ciseleur, à qui pourtant pas une d’elles n’aurait accepté de confier sa ressemblance, eût dû se faire le portraitiste de cette Cour des Miracles.
Ce précieux de l’enveloppe fut sans doute, entre tous, le don privilégié, la qualité mère de Carriès.
Il est peu probable qu’il ait jamais mis dans ses œuvres tout ce qu’on y vit, et dont en sa malice de paysan,—par de certains points parente de celle de Bastien-Lepage,—il n’était pas fâché de laisser croire qu’on l’y trouvait; riant dans sa fine barbe aux interprétations qu’on lui faisait de ces soi-disant concepts, mais uniquement soucieux du morceau, et d’un thème où promener une des plus amoureuses prédilections qui fût jamais de la matière et de la patine.
Voilà le vrai. Les belles dames qui se seraient gardées de lui confier leur ressemblance n’auraient pas eu tort en ceci qu’il ne l’eût que faiblement réussie. Une longue série de poses n’aurait engendré qu’une apparence plus ou moins lointaine du modèle, inévitablement costumée en Loyse Labbé, mais qui n’aurait point «fait japper le chien de la maison», selon la jolie expression de Mme d’Agoult. A coup sûr, un objet d’art caressé jusqu’aux plus subtiles limites du poli et de l’atténué, par de savantes alternances; le point lumineux glissant en des lisses savoureux, presque savonneux, et tels que d’ordinaire l’usage seul les obtient—disons [p. 285] l’usure, aux bas-reliefs florentins du socle d’un Persée de Benvenuto, effleurés de dos d’enfants et de touchers de touristes; encore à de certaines rampes intérieures de Saint-Marc de Venise, sous des doigts de prêtre; enfin dans Rome, à cet orteil de saint Pierre, tout usé de baisers de fidèles.
Non, Carriès ne fut point un compositeur. L’outrance même, dans l’ordonnance de sa célèbre porte, pour vouloir démentir ce reproche, n’en démontre que mieux la justesse. Mais Carriès fut un exécutant admirable. Et ce fut pour donner essor à ce que j’appellerai cette virtuosité des patines, qu’il ébaucha, lors de sa trouvaille des poteries émaillées, et d’accord avec son savant ami M. Grasset, le projet et le plan de la porte en carreaux de grès qui devait l’occuper longtemps encore, et pour laquelle il vient de mourir.
J’ai dit que je sortais d’admirer au Salon de 1881 les quatre têtes exposées là par Carriès, quand je rencontrai le jeune homme. Mme Judith Gautier, dont le haut goût et la généreuse sympathie vont toujours aux nobles artistes et aux intéressantes œuvres, connaissait de la veille le sculpteur mystérieux; elle nous mit en relations. Sauf certain empâtement survenu depuis dans la face, il était alors, avec un peu plus de négligences dans le costume, ce qu’on le vit ces derniers ans. Beau d’une beauté de masque florentin en ivoire, la barbe et les cheveux ténûment broussailleux, [p. 286] les yeux clairs, le nez mobile, volontaire et délicat. La grande séduction de son visage, c’en était l’illumination par un franc rire d’enfant, allant parfois aux gaietés tonitruantes et aux tintamarresques facéties, avec quelque chose de gracieux, mais le plus souvent de véhémentement enthousiaste à l’exposé d’un projet. On lui reprochait certain point de vue par trop personnel, son atonie ou son ironie sur le sujet d’autrui, une façon de ne s’enflammer qu’au récit de ses propres luttes. En ces excès consistait pourtant le montant de ses dithyrambes. Je les entendis maintes fois; je le vis souvent; jamais de façon bien suivie, mais sans non plus cesser, et nous entretînmes couramment des rapports de cordialité sympathique.

En ce temps (en 1881) on plaisantait doucement l’artiste sur sa mine de bohème et sa mise de rapin. Les têtes se vendant, des commandes annoncées, il fit lui-même des commandes de toilette; et je me souviens d’un certain Pomadère (célèbre sous Balzac) qui fut imprudemment conseillé à notre ami. Il en résulta des complets gris, qui ne valaient pas ses précédentes tenues; et surtout des factures protestées—car la fortune ne vint pas si vite; et Carriès me parla souvent de faire pulluler autour de sa propre statue un peuple lilliputien de créanciers, entre lesquels ledit Pomadère jouerait le rôle de tourmenteur en chef.
Un médaillon alors ébauché de Mme Gautier ne vint pas à bien. Je visitai Carriès dans son atelier de la rue Boissonade; puis boulevard Arago, dans un agréable décor. Je me souviens d’une [p. 287] petite cuisine garnie de poteries et de bouquets de légumes secs ayant des airs de Chardin. Souvent aussi je le reçus chez moi. Nous fîmes encore ensemble des promenades et des visites; une entre autres dans un hall du quartier Monceau qui recélait de belles œuvres du jeune maître: chez Leys, le parent et l’associé de l’éminent décorateur, M. Georges Hœntschell, un des meilleurs amis de Carriès, chez qui le sculpteur vient de s’éteindre, entouré de soins touchants.
A partir de 1892 seulement, après le grand succès consacré par la croix qui le réjouit: «ça éclaire», disait-il,—apparut un Carriès un peu plus officiel, plus soigné, vêtu d’étoffes sombres, et d’un abord plus habituellement affable.
La dernière fois que je le vis ce fut à Paris, chez un restaurateur, en janvier. Ma fin de dîner s’associait à son entrée et nous restâmes à causer une heure librement et joyeusement. Il retournait, comme toujours, à Montrivault, pour travailler à sa fameuse porte. Jamais je ne le vis si gai, spirituel, brillant, presque serein. Et certes, il avait fallu bien des adoucissements de la fortune pour assurer cette grâce à telle nature ardente et troublée.
Sa formule toujours mordante, concise, incisive, avait pris un tour bellement expressif, voisin de certaines légendes de Forain, d’un pythagorisme brutal et ouvragé, élégant et corrosif. Puis, une fois encore, la dernière; le rapide bonjour du vernissage, au Champ-de-Mars. «Votre portrait de Whistler est admirable!» Il me clamait cela joyeusement, de loin et des séances étaient enfin arrêtées [p. 288] pour un buste dès longtemps projeté. Pauvre beau buste que seul ébauchera l’ombre, que le silence achèvera seul!
Un trait bien symptomatique de cette prédominance de l’exécution sur la conception dans le travail de Carriès, c’était, par exemple, cette tournure de sa réplique à la commande d’un buste. Il ne répondait pas: «Je vous donnerai telle attitude». Non; il disait: «Je le ferai en grès.» Et les larmes lui en perlaient aux yeux, comme l’eau monte à la bouche du gourmet au penser d’un fruit mûr. Et certes, il y avait d’un fruit dans la saveur des œuvres du potier-statuaire. Non pas seulement dans ses vases qui ne sont que des courges d’art admirables; mais dans ses têtes. Je ne sais de lui qu’un buste tant soit peu portrait: celui de M. Vacquerie. Il y a bien aussi M. Breton; mais costumé encore. Un autre, ébauché d’après Mlle Ménard-Dorian, de ressemblance jugée insuffisante, tournait à la fantaisie décorative, de par une collerette ou quelque détail de toilette amplifié comme il ne pouvait guère n’en point échapper à l’auteur, toujours enclin à tirer d’un modèle moderne un Franz Hals ou une jeune Flamande.
Ces œuvres, je les revois, les unes isolées, les autres en de successifs groupements publics ou privés. Au Salon, encore, en 1883, parut en compagnie d’un Courbet, un évêque chapé, mitré, gemmé, dont on parla peu. Carriès, à cette époque, [p. 289] ne recevait guère de commandes que d’un seigneur étranger dont il fit le portrait et me parla toujours avec une respectueuse sympathie. Un peu plus tard, s’agglomérait, rue Vivienne, un essai d’exposition d’ensemble: une vingtaine de têtes et de bustes où le comique délabré et débraillé de Callot, dans ses gueux, s’allie au caricatural de Daumier ou de Gavarni, pour modeler un pêcheur à la ligne sous son chapeau de paille en auréole bossuée, ou quelque moderne Rabelais à la barrette de travers. En somme des prétextes à des trouvailles d’expressions moins qu’à des recherches de patines,—non encore pourtant poussées au sublime du genre.
Puis éclôt une série de têtes d’enfants, visibles de-ci de-là; de nouveaux fruits, ceux-ci de fraîcheur et de candeur, de grâce et de tendresse; des pêches, vaguement pensantes et penchées, avec tout l’indécis des yeux errants, et contournées de petites collerettes qui se plissent comme des feuillages. Enfin, tout cela se revit nombré, massé, catalogué, exhibé bienveillamment dans la prestigieuse résidence de Mme Ménard-Dorian, rue de la Faisanderie, la même année que furent exposés, salle Petit, les dessins et manuscrits de Victor Hugo. L’exhibition privée, bien présentée, fit du bruit, et Carriès me vint prendre pour que nous l’allions parcourir ensemble. Il y avait là toutes les têtes déjà citées, entre autres cette belle Cordière[53] commandée par Lyon, la ville natale de la femme poète.
[53] Louise Labé.
[p. 290] Puis un buste de jeune homme, le fils de l’étranger, un plâtre coloré, et l’une des plus charmantes créations de Carriès. Aussi une tête couchée de Bottom, aux oreilles allongées et pendantes, un objet d’art d’une patine sans égale. Mais surtout la propre statue du statuaire en cire vierge d’un jaune de vieux miel. Cet ouvrage, très compliqué, devait faire partie de la décoration d’un puits, si je me souviens bien d’un dire de l’auteur. On l’y voyait debout, à mi-corps, sous un petit chapeau de feutre gondolé, et tenant dans une main la gracile figurine d’un seigneur Louis XIII. Vers le bas où s’agençait encore un vase de fleurs, un fin masque de femme, les yeux clos, se modelait, s’effaçant: propre effigie de la mère de Carriès.
A cette étape se ferme la première période de la vie publique de Carriès. Ceux qui l’avaient connu à l’issue de son premier succès ne le virent plus guère. Dégoûté de Paris, et déjà fatigué du monde,—un peu comme un autre Rollinat,—il ne demeura en relations qu’avec un petit nombre.
Soudain un bruit courut, que voici réduit à son rudiment boulevardier et blagueur d’alors: «Carriès vient de découvrir les grès des Japonais dans la forêt de Fontainebleau!—Bizen et Fizen en Seine-et-Marne[54]!» Je me rappelle avoir rencontré le nouveau potier, à cette saison de printemps très [p. 291] frais, sur le pont de la Concorde. C’était un de ses jours rébarbatifs et soucieux. Je le vis venir de loin, sous un vaste manteau, et cravaté d’un cache-nez de tricot qui pouvait bien auner trois mètres. Il me fit part de son étonnante trouvaille dont je n’eus garde de douter, en quoi je fis bien, puisqu’elle était vraie.
[54] Plus tard seulement, l’entreprise fut transportée dans la Nièvre.
C’est en 1892, au Salon du Champ-de-Mars, que la découverte, déjà connue et appréciée des amateurs, éclata aux yeux de tous avec l’éblouissement dont on se souvient. Entre nombres de têtes et de bustes,—comme si, dans un pressentiment qui semblait alors à plusieurs un manque d’adresse, le jeune maître eût voulu, par cette livraison un peu envahissante, faire embrasser au moins une fois de son vivant, presque toute son œuvre,—apparut cette fascinatrice vitrine étagée en un fruitier prodigieux, de tant de vases et de gourdes, de bouteilles et de lagènes où se mariait, comme aux têtes d’antan, la même saisissante antithèse du précieux et du fruste.
De forme à peine que la plus rudimentaire, voire la plus rude. Des aspects artificiels de calebasse, pour l’apparence et le grain, depuis le mat de la coloquinte fraîchement cueillie jusqu’au brillant de la gousse laquée du caroubier, par le granulé et le poli de toutes les coques et de toutes les cosses.
Et, là-dessus, glissant somptueuse et pensive, une larme dorée, pareille à celle dont usent les Japonais pour recouvrir la suture des riches objets qu’ils réparent visiblement, leur occasionnant ainsi un lustre nouveau, d’une cassure ostentatoire et luxueuse...
[p. 292] Peu d’objets, sous notre ère d’estampage et de refait, auront, autant que les vases de Carriès, donné l’impression du bibelot unique. On sent que le pareil,—le plus humble,—n’est pas loisible à leur céramiste, tout comme l’exacte répétition d’un visage ne semble pas permise aux moules même du Créateur éternel.
Plusieurs exaltèrent l’œuvre du potier du Morvan; les vases, en nombre restreint et toujours uniques, furent acquis, chèrement, par des amateurs et des Musées; et Carriès se vit, à cette heure, et très justement, quelque peu proclamé:
Mais des parties d’un autre ouvrage bien plus important occupaient encore la vitrine: la porte dont j’ai parlé plus haut. Nous sommes plusieurs à posséder la collection d’une dizaine de vues des fragments successifs constituant l’ensemble de cette arche. Et, sur l’une de ces photographies, la signature de Carriès au-dessous de cette rubrique emphatique et zigzagante: «Mon Calvaire!»
Encore une fois je ne suis point de ceux que peut délecter la conception de cette œuvre, dont le plan ne semble pas au reste revenir tout entier à Carriès. M. Grasset, s’il accepte sa part de paternité dans cette élucubration singulière, dira sans doute qu’il n’a voulu que disposer pour son ami un motif inépuisable aux recherches des colorations et des [p. 293] émaux. Et n’est-ce point beaucoup déjà, si ce n’est pas assez?
Car, que pourraient bien philosophiquement signifier, et en dehors de la pure et simple fantasmagorie décorative, ces deux hauts piliers aux irrégulières alvéoles meublées et peuplées de mascarons reflétés de Boilly, de Cruikshank et de Doré; des Debureaux, la collerette tuyautée et le rictus falot; grimaces de bouches édentées, de trognes pleurardes, de faciès joviaux, dont Carriès m’a souvent dit qu’il se les posait à lui-même, se faisant des moues devant le miroir. Dans le cintre, des soleils jocrisses et des lunes renfrognées, entourés de poissons et de lapins, de singes attifés et accroupis, et de truies caracolantes[55]; des chauves-souris en forme de cartouches, ayant un visage pour ventre, sans omettre, aux angles, d’étonnantes figures de femmes gracieusées en des postures de grenouilles, et certain hideux bébé coiffé d’un bonnet d’âne et montrant son sexe avec dégoût, sous toute l’horreur beuglante de son visage de mandarine écrasée. Et le couronnement de ce cauchemar: une gueule de poisson à oreilles humaines, et d’où s’échappe, s’avançant avec naturel, une demoiselle en pied, mi-médiévale, mi-actuelle, d’une intéressante laideur et gantée haut, telle qu’une fille de bonne maison qui tient à conserver les mains blanches. D’aucuns verront sans doute émerger de tout ce brouillamini la distincte allégorie de l’art ou de la vertu planant par-dessus les laides cocasseries de l’existence. Rien ne s’y oppose, et la version en suffit. Mais la [p. 294] plus vraie est encore celle-ci, que peut-être,—disons sans nul doute, nous qui savons le prestige même d’un éclat de brique échappée aux doigts de ce cuiseur,—que cela eût été, que cela est beau; car l’état présent de l’œuvre permet d’espérer sa possible édification presque intégrale. Les quelques chapitres qui font défaut à cette autre arche surprenante, celle-ci de Flaubert: Bouvard et Pécuchet, empêchent-ils de s’incliner en y rêvant? Les circonstances invisibles qui disposent souvent pour le mieux de leur fini absolu les œuvres en apparence interrompues et inachevées, pratiquant d’elles-mêmes, préventivement, le travail d’extraits que la postérité toujours exige, ont peut-être, par cet arrêt tragique et violent, en apparence désastreux et injuste, donné à toute l’œuvre de Carriès l’aspect si précieux de négligé et de fini qu’il affectionnait lui-même pour chacun des ouvrages sorti de ses mains.
[55] Du Hieronymus Bosch en relief.
J’ai sous les yeux un mascaron qu’il m’avait donné; c’est une sorte d’Othello maussade, aux tons de pois cassés, vernissés et verdâtres, au nez camard, à la babine cruelle et dégoûtée. De noires irisations fluent dans les poils et par les rides, et la plus sombre coule et roule de l’œil gauche comme une larme sur ton sort échappée à l’une de ces grimaces que tu te faisais à toi-même devant le miroir, quand tu posais pour toi, noble endormi d’hier!
Certes, malgré le prématuré de ta disparition terrifiante et soudaine, tu peux sommeiller sans trouble, Jean Carriès, sous ta belle porte ainsi attribuée à plus éloquent usage que celui dont la [p. 295] pouvaient consacrer les Thés mondains—où s’échangent des propos fades, selon l’expression du poète;—ta porte mystérieuse où je te vois couché, ainsi que fut Raphaël, sa Transfiguration lui servant de lumineux catafalque. L’avenir est sûr de toi, comme toi de lui. Ta place est marquée dans l’immortel permanent où fusionnent les avenirs et les passés. Ta droite y rencontre et étreint celles d’Adam Krafft et de Pierre Wischer de Nuremberg, et celles de ces artistes anonymes et merveilleux qui ont fait de la cathédrale d’Innsbrück un éternel enterrement de Maximilien à tout jamais religieusement célébré debout par une population espacée de chevaliers et de rois, de seigneurs et de prêtres, de dames et de reines, dont le bronze pleure!
XVII
A Maurice Bernhardt.
«Je l’ai vue une fois dans ma vie, et je me souviens qu’elle m’avait tellement captivé, que chaque fois qu’elle finissait de parler, il me prenait des démangeaisons de marcher sur le théâtre et de jeter dans le parterre tous les autres personnages dramatiques.»
James Beresford.
Elle m’apparaîtrait volontiers comme un gracieux épilogue des fêtes franco-russes—et c’est sous cet aspect que je la veux envisager tout d’abord—la manifestation qui se groupe aujourd’hui autour du nom cher à tous les bons,—de notre belle Sarah Bernhardt. Je vois à cela plusieurs raisons. La distance n’est pas grande qui sépare ce précieux nom des plus nobles interprétations du patriotisme. Ce ne fut le moins cher ni le moins glorieux de ses rôles que ce rôle d’ambulancière de l’Odéon qu’elle tint avec autorité et valeur dans l’époque troublée dont ces récentes fêtes de l’alliance nous apparaissent enfin comme un radieux erratum.
Or, durant ce long et douloureux intervalle, ce fut encore une de nos fiertés que le refus maintenu sans ostentation, comme sans faiblesse, par la [p. 300] première de nos comédiennes, des plus brillantes offres qui lui purent venir d’outre-Rhin. Et je sais tel éminent homme politique, lequel tint à honneur de la mander expressément pour lui adresser en son nom propre, tout comme au nom de l’État et du pays, des félicitations et des grâces.
C’est donc d’une ingénieuse et charmante justice de reporter sur celle qu’on nomme équitablement «la grande artiste», l’excédent de tendresse que laisse inactif en beaucoup de cœurs le passage météorique des Altesses.
Car il fut d’un ordre exceptionnellement délicat, le désenchantement qui suivit les journées d’octobre.[56] Certes, les résultats étaient mieux que satisfaisants; et c’était de l’acuité même de tant de sensations qu’une exquise tristesse nous était née. Un regret de qualité, ne pouvant se faire aux plis disparus de l’impériale écharpe envolée. L’habitude reprise d’acclamer, inhérente à notre nature, et se résignant mal à refouler à peine éclos, des hourras arrêtés trop net, des vivats, coupés si vite.
[56] Fêtes de l’Alliance russe.
C’est, je le répète, à mon sens, et pour une part, de cette sensible disposition d’esprit que la journée Sarah Bernhardt s’effectue. Non pas en fait, mais en date. Certes, l’illustre titulaire n’a besoin d’aucun héritage de bravos ni de triomphes. Sa rayonnante carrière n’en est qu’un incessant tissu, une mosaïque indiscontinue. Sarah ressemble à cette sultane Zobéide qui se plaisait à entendre psalmodier le Koran autour de son palais par des milliers de fidèles. Ainsi de nos permanentes admirations, de nos ferveurs adorantes.
[p. 301] Les grouper en un banquet, les concréter sous forme de gala, n’est qu’une virtualité effectuée, et je désire qu’on entende bien que si j’en attribue en quelque sorte la présente réalisation à la plus-value d’un vœu national, c’est un fleuron de plus dont je veux fleurir le couronnement de notre dramatique Tsarine.
Relire le Traité des couronnes de Tertullien, pour distinguer et spécifier, serait, en l’espèce, oiseux et superflu, puisqu’il faut, tout d’abord, celles-là, les lui décerner toutes. Mieux vaut donc le composer à nouveau, pour ouvrer des bandeaux inconnus, des diadèmes irrêvés, mieux faits aux tempes de notre Muse.
Les couronnes! Mais il ne faut que remonter au fil des jours, l’onde même où Sarah-Ophélia s’est coiffée de tant de fleurs immarcescibles, pour les reprendre à son souvenir acclamé et les lui rejeter comme autant d’odoriférantes auréoles. Ces couronnes, je les respire ou les revois, au cours lumineux et embaumé de ma mémoire qui les charrie. Alcmène, roses attendries sous un blanc linon. Andromaque, myosotis obscurcis d’un sombre crêpe. Marguerite, couronne de camélias; Phèdre, couronne de camées. Orchidées, Izéyl et Gismonda; Cleopatra, couronne de lotus; Théodora, couronne de pierreries. La Princesse Lointaine, couronne de lys d’argent aux pétales de perles. La litanie s’en énumérerait comme une hymne de sainte Hildegarde ou un chant de Marbode; sans omettre cette couronne de cheveux blancs dont il [p. 302] plut, un jour, à la jeune sociétaire, de couronner coquettement l’aveugle et sexagénaire Posthumie.
Sarah Bernhardt! (Pourquoi pas Bernard? écrivait jadis M. Sarcey) ces simples syllabes devenues magiques ne sont-elles pas elles-mêmes comme une musicale couronne dont la prêtresse d’un verbe inouï vint ceindre le monde?
Sarah Bernhardt, admirable et désespérante matière à mettre en vers et en prose. Par où commencer, par quel rayon prendre?—C’est l’infirmité des biographies, maladroites et balourdes touche-à-tout d’une draperie qu’il sied, pour demeurer dans le vrai, de ne relever qu’avec des clous d’étoiles.
«Je ne l’ai vue qu’une fois, dans Cordélia, me disait le maître Gustave Moreau. Je ne l’ai jamais oubliée.»—Simple parole révélatrice et mémorable.
Quels sont ceux d’entre nous, en effet, pour lesquels l’art de Sarah Bernhardt n’a pas incarné une fois ou mille fois, la plus subtile part de leur rêve? Tous, cette minute-là nous a faits siens par la plus inaliénable des reconnaissances de l’esprit, et rien qu’à cet appel nous nous devons de diaprer notre guirlande. Quant à moi, n’y en eût-il pas cent meilleures raisons, j’évoque telle attitude et certaine intonation du Sphinx (cependant écrit pour une autre) auxquelles j’ai dédié dans le passé plus d’une pensée et bien des immortelles.
Pour ceux qui, moins heureux que Gustave Moreau, n’ont pas même vu Cordélia, c’est le type, dirais-je, le mythe de Sarah elle-même, qui incarne en eux son personnage.
Et ceux-là ne sont ni les moins captivés, ni les [p. 303] moins férus. Sarah, qui une bonne fois, du temps de l’Étrangère, s’est emparée de son Paris et de ses Parisiens, pour ne s’en plus dessaisir jamais; que dis-je? de ses Parisiennes, lesquelles s’ajustèrent toutes à la Sarah, et qu’on rencontrait engoncées de certaines collerettes et coiffées de certains frisons à la mode de leur idole.
Ce sont ces attiques Parisiens-là, les vrais habitants de sa bonne ville, qui, les nuits de brouillard, quand le légendaire cab de l’actrice la ramène du théâtre, lui crient de paternels: «Prends garde, Sarah!» ou autres avis de sollicitude familière.
C’est que le Français né malin sait le prix de ses objets d’art et soigne ses bibelots; il évalue le relief dont sa célèbre enfant gâtée rehausse la cité: et puis ne s’agit-il pas de cette mobile tragédienne qui, le même soir, d’une note gamine, déride un esprit chagrin, et de la comédienne dont le tragique accent trouve le chemin d’une humeur rude?
Il y a autre chose. Si l’on regarde longtemps, selon le mystérieux mot d’un autre personnage de Dumas, les légendes s’assouplissent, les caractères s’accomplissent et rehaussent les vraies réputations artistiques, d’édifiants corollaires. Or, il faut en prendre son parti, c’en est fait, des excentricités de Sarah Bernhardt. Ou plutôt, en quoi elles consistaient réellement, on a fini par le connaître.
Toujours la première au devoir et à la peine, pleine de vaillance allègre et de communicatif entrain, rendre la justice avec équité, dissiper des [p. 304] malentendus, apaiser les dissidences, avec pour les seules palmes dont elle entende être récompensée, une réussite d’art ou le remerciement d’une amitié, c’est tout d’abord de cette façon-là que Sarah Bernhardt se montre excentrique. Mais ce n’est pas tout. Donner aux timides, comme aux plus forts, l’indéfectible exemple du courage, sans oublier ce remontant exemple de jeunesse et de beauté dont nos extases sont remplies.—«Si ce n’était pas pour vous qu’on vous aimait, ce serait pour soi;—je l’ai souvent dit à notre miraculeuse amie;—vous êtes le seul être auprès duquel on ne se sente pas vieillir!»
Les mêmes demeures, les mêmes objets, les mêmes amis, les mêmes serviteurs—dirai-je les mêmes chiens... et les mêmes tigres? Que de gens l’on étonnerait à leur démontrer que celles de ses qualités qui rendent Sarah Bernhardt le plus justement admirable sont, avant tout, ses vertus domestiques. Or c’est ainsi; et nul n’y contredira de ceux qui, reçus par elle dans ces féeriques ateliers-halls qu’elle inventa, se sont émerveillés d’y goûter entre tant d’exotiques raretés, un charme discret d’intimité et de famille.
Loin de moi, ma chère Sarah, l’idée de vous métamorphoser en une auguste bourgeoise. Mieux que personne j’ai su, dès longtemps, apprécier ce que votre vif et fin esprit recèle et dégage d’aimable ou savante fantaisie. Mais la forme prime-sautière et spontanée qu’elle revêt toujours la range parmi ces originalités naturelles subtilement définies par Gautier, et qui seraient obligées de «se travailler beaucoup pour être simples».—Je n’en [p. 305] veux pour preuve que ces gentils dîners sur l’herbe, où nous fûmes conviés en la loge de la Renaissance, il y a deux ou trois automnes, et dans lesquels le couvert se mettait réellement à terre sur d’antiques tapis d’Orient aux tons de lichen alpestre et de mousse fanée.
J’ai dit votre fin et vif esprit. Que ne dirai-je point de votre grand et profond cœur?—Combien vous fûtes propice et douce aux lettrés inquiets dont les débuts incertains, les talents contestés, les sincères essais rencontrèrent tant de fois en vous une protagoniste géniale, une auxiliatrice inspirée, cela est connu de beaucoup. Que votre magnanime ambition place une réussite esthétique avant un succès d’argent, cela s’applaudit et s’apprécie. Mais le témoignage que je veux choisir entre mille, de votre grandeur d’âme, sera celui qui me fut récemment si cher, lorsque pour rehausser nos fêtes de Douai de la suréminence de votre jeu et du prestige de votre personne, vous n’avez pas craint de vous imposer un voyage de plusieurs jours, dans le seul but de servir un ami et d’honorer une poétesse oubliée.
Donc aujourd’hui, pas d’autres considérants sur votre sidérale carrière, que le plus éloquent de tous, l’affluence autour de vous de nos enthousiasmes maintenus, de nos fidélités inaliénables, amplifiés des innombrables élans que la distance retient et que l’éloignement afflige. Point non plus de fastidieuses biographies. Rien que votre art [p. 306] suprême, votre florissante beauté, votre impérial sourire. Et devant eux, ce seul point de repère charmant, digne de leur gracieuse Trinité et de vous-même: A Versailles, un jour, dans un couvent de la rue des Rossignols, naquit une voix, à qui ce joli nom devait porter bonheur, et qui allait enchanter le monde.
«D’autres sont les grands hommes, disait Victor Hugo parlant de George Sand. Elle est la Grande Femme!» Qu’on me permette de reprendre à l’auguste maître et à l’illustre immortelle qu’il célébrait ce lapidaire éloge et d’en faire don en ce jour à Sarah Bernhardt, ainsi qu’ils l’eussent tous deux voulu, pour l’inscription commémorative de son jubilé et ses noces d’argent avec nos âmes.
Et puisque j’ai parlé de couronnes, en voici une dernière. La rose mourante que le Passant prit aux sombres cheveux de Silvia, dans un début inoubliable, s’est faite roseraie. Et ce sera, Madame, l’une des pages les plus colorées et odorantes de vos récits de voyages qui nous sont promis, que ce lac lointain, tout chargé de barques et de musiques voguant et jouant pour vous, sur une eau si jonchée de fleurs que tout l’azur en disparaissait lui-même, noyé sous des pétales de roses.
Telle est la géante et mouvante couronne qui vous convient, ô grande Sarah Bernhardt, pour le feu sacré et le souffle d’art dont vous avez embrasé et rafraîchi le monde. Nos cœurs aujourd’hui pour vous fleuris les secondent et les suppléent, ces milliers de pétales qui flottèrent ce jour-là vers vous, ainsi que de tendres cœurs parfumés et de roses lèvres murmurantes.
XVIII
A Giovanni Boldini.
Ce vers, ainsi bizarrement transposé, n’exprimerait-il pas bien ce qu’il y a de retardataire ensemble et de novateur dans l’explication que, de temps à autre, les montreurs doivent faire de certains sujets, rebattus au delà des monts, lettre close en deçà? De ceux-là est l’artiste dont le nom intitule cet article. D’aucuns la disent attendue à Paris, lesquels pourraient bien compter sans une de ces neurasthénies qu’apprête à celles qui n’ont retrempé ni reçu l’inexplicable invulnérabilité d’une Sarah, la crise factice, mais ressentie au point de se faire véritable, des cinq actes quotidiens d’une Dame aux Camélias ou d’une Fédora.
L’heure est sans doute venue pour ceux qui, dès longtemps, goûtèrent l’art de la célèbre Italienne, de donner à d’autres qui l’apprécieront demain un avant-goût de sa pénétrante saveur. M. Duquesnel, à qui demeurera l’honneur d’avoir proclamé et soutenu, envers et contre plusieurs, la jeune Cordélia plaintive et non encore advenue qui devait devenir l’illustre Sarah Bernhardt, nous disait l’autre jour, dans une de ses intéressantes monographies d’artistes, qu’en 1892, le nom d’Eleonora Duse lui [p. 310] était inconnu. N’était-ce pourtant pas un peu tard pour déjà parler d’elle?
Ce dut être vers 1885 que, sans commentaire, je reçus, un matin, de notre ami Gualdo[57], l’aimable et habile littérateur milanais, qui écrit avec autant de grâce en notre français que dans sa langue natale, une étrange photographie que j’ai encore sous les yeux. Elle représentait, jusqu’à mi-corps, une pensive, mélancolique, presque douloureuse jeune femme, les yeux baissés, les cheveux peu coiffés, la mise discrète, la mine découragée, en l’attitude la plus simplement désespérante des mains dénouées, après le désenlacement d’une dernière illusion, d’une suprême chimère. La carte-portrait ne portait aucun nom, pas la moindre épigraphe. Je rimai une interprétation de cette antithétique vision, insignifiante et pourtant dominante, comme vide de pensées et cependant méditative; fascinante sans regard, captivante sans beauté, séduisante sans coquetterie.
[57] Décédé depuis, à Paris, en 1898.
Mon petit poème préludait ainsi. Je l’adressai interrogativement à mon correspondant mystérieux,—lequel me répondit: «La Duse».
Des fréquentes causeries qui s’ensuivirent entre [p. 311] nous sur le sujet de l’actrice, me vint un vif désir d’entendre cette curieuse Eleonora. L’occasion s’en offrit pour moi lors de son passage à Florence au printemps de 1887. Une affiche annonçait la Societa equivoca, autrement dit: le Demi-Monde; et, pour un jour suivant, Francillon. Je vis donc la Duse dans ces deux rôles avec beaucoup de bonheur, de surprise, d’admiration. Elle me parut constituer un terme de transition entre Sarah Bernhardt et Desclée; cela, sans aucun pastiche et dans une combinaison toute personnelle.
Ce qui me surprit le plus alors dans sa manière, c’était une certaine façon d’être en scène sans rien qui décèle tout d’abord le premier sujet, presque l’effaçant plutôt, comme pour faire bénéficier la suite du rôle de cette soustraction originelle,—à la guise de ces plus subtiles des coquettes qui s’enlaidissent à dessein la veille du jour où leur beauté doit se montrer le plus sensationnelle. Des amis de l’Italienne, des auditeurs assidus et attentifs m’ont détourné de cette croyance. Le calcul de Mme Duse ne va pas si loin.
Plutôt elle se laisse entraîner au cours de son émotion, à la passion de son tempérament, au penchant de sa nature, où rien n’est si composé, mais volontiers spontané et véhémentement expressif. Aux premières scènes, son don pythique n’a pas encore reçu toute la chaleur dont la communication graduée doit porter à leur comble par la diction saccadée ou le débit emporté, dans les scènes médianes ou finales, ses qualités naturelles de pathétique élégant, de tragique dolent ou formidable.
Ces jours derniers—à huit ans d’intervalle,—un vif désir me revint de me retrouver sous l’influence de ce jeu électrisant—dirai-je électrique?—toujours comme gros d’orage, et dans lequel la foudre éclate, zigzagante au milieu d’une tirade posée. Et je me rendis à Bruxelles, pour entendre la Duse dans la Cavalleria rusticana, la Locandiera, la Moglie di Claudio, la Signora delle Camellie et Magda.
Certes, il faut toujours, à ces secondes auditions, défalquer l’étonnement dont l’admiration s’appauvrit. Y eut-il encore de l’air dépaysé d’une plante méridionale, en ce climat pluvinant de Rodenbach; de la froideur aussi d’une salle quasi déserte?—Ou bien réellement l’exportation et les tournées ont-elles, comme souvent il arrive, unifié l’art, il me semblait naguère plus divers de la comédienne? Au cours de ces représentations plus nombreuses, mon impression, toujours fort admirative, se montra plus raisonneuse, moins miraculeusement subjuguée. En voici les conclusions:
«Le moins possible de pas entre la fiction et la réalité,—me disait pittoresquement un éminent diplomate ami de la femme, admirateur de l’artiste,—ne serait-ce pas une juste définition de l’interprétation dramatique la plus adéquate?—Or, nulle de celles qu’il nous a été donné d’entendre n’a logé dans cet intervalle moins de pas que la Duse.»
Cela—qui peut-être est vrai—s’explique ainsi, et c’est, entre autres, la grande différence qui [p. 313] sépare la Duse de notre inimitable Sarah Bernhardt, dont l’art est conscient et réfléchi. Chez cette dernière, la préoccupation de faire vrai ne se sépare jamais de la volonté de faire esthétique. La mort de Fédora, si poignante soit-elle, n’abdique point le décor dans le trépas, la grâce dans l’empoisonnement et jusqu’à toute une chorégraphie giratoire dans la chute suprême de l’agonie. Rien de tel chez la Duse, qu’une attitude disgracieuse, voire une grimace, ne détourneront aucunement d’assurer par leur moyen, plus de prenant à telle phase du personnage qu’elle représente, certaine phrase du rôle qu’elle joue. Tel est l’avis de notre grande tragédienne, avec laquelle je me suis plusieurs fois entretenu de la célèbre Italienne, qu’elle admire grandement et qu’elle a souhaité voir faire ses débuts[58] à Paris, sur le théâtre même de la Renaissance.
[58] Réalisés depuis.
«La scène italienne,—me disait en substance la créatrice de Gismonda,—est une école de vérité. Il n’est pas rare d’y voir des acteurs de second ordre s’y montrer étonnamment vrais. Et c’est de ses études et séjours en Italie que Desclée avait contracté ces qualités de jeu naturel, de mimique juvénile et spontanée qui constituaient le meilleur de son talent et composèrent une bonne part de sa renommée.»
Je citerai moi-même, à l’appui de ce dire, telle scène de la Dame aux camélias, durant laquelle des qualités similaires portent à son comble l’art réaliste, disons naturaliste, de Mme Duse.
Le père d’Armand vient d’obtenir de la jeune [p. 314] femme l’immolation irrévocable; et Marguerite s’apprête à quitter pour jamais ce fleuri salon de campagne, où, contre tout espoir, elle s’est retrouvée heureuse, contre tout droit crue réhabilitée. Tout est révolu pour cette repentie rejetée, de son rêve d’amour pur, dans l’ancienne vie de honte. Le pas dont elle s’éloigne est celui d’une bête blessée, démontée et qui se traîne. D’un geste machinal et automatique, elle attire à elle du bord de quelque causeuse, le manteau qu’il lui faut pour ne pas sortir demi-dévêtue. Mais rien de son âme n’est dans ce geste, rien de cette coquetterie qui survit aux accablements, de cette féminité abdiquée avec l’amour, telle qu’une royauté abolie. Et le manteau se pose sans élégance ni grâce sur les épaules de la volontaire abandonnée.
Rien de navrant comme l’éloignement stupéfié dans l’ouverture de la porte creusée aux proportions d’un gouffre, de cette silhouette subitement dénuée de sa naturelle beauté, et que le désespoir vient de sculpter dans l’amoureuse de tout à l’heure. Alors, elle se retourne pour embrasser d’un récapitulatif regard le paradis perdu de son nid d’extase; et sans force, sans conscience ni pensée, elle y rentre une fois encore, somnambule et comme égarée; puis, là, dans un brusque allongement sur une chaise longue, elle laisse d’étranglés sanglots secouer tout son corps aveuli, des sanglots d’enfant affolé à qui l’on a repris son jouet, sa friandise, sa poupée.
Une monotonie est afférente à ce jeu, de par un [p. 315] petit nombre d’effets caractéristiques, singuliers ou violents, en une mimique parfois exagérée, ou un peu vulgaire; entre les mouvements versatiles mais comptés du masque sans grande beauté, mais tour à tour charmeur, pervers, douloureux ou terrifique; et dont la sensitive mobilité exécute ces variantes avec une prestesse de pianiste nuançant un doigté ou phrasant un trait. L’intonation se ralentit ou précipite, le débit se saccade volontiers et à l’excès, le tout en une manière d’être et de proférer un peu périodique et prévue qui fatigue l’attention et émousse la surprise au cours de cinq actes, quand la brève Cavalleria rusticana mettait, elle seule, mieux en valeur tout ce registre.
Ce petit drame de Verga offre sans doute la plus succincte en même temps que la plus intense occasion d’apprécier et juger l’artiste. La gamme de ses dons s’y parcourt sans récidive et dans toute son étendue. La jalousie corrosive ou plaintive, la passion énervée et criminelle portent au summum, chez le spectateur, une émotion qui ploie, faiblit et se lasse au long de plus durables tableaux. Et je conseillerais à Mme Duse de faire le choix de ce morceau pour se révéler au public parisien, quand elle ne craindra plus de voir déjuger par cet aristarque malicieux et fantasque une réputation plus qu’européenne.
Avouerai-je que j’avais espéré d’obtenir cette représentation théâtrale au nom de Marceline Desbordes-Valmore, et au profit du monument que des cœurs épris de cette touchante muse souhaitent de lui ériger en sa ville natale? Mme Duse aurait, à cette requête, répondu qu’elle ne se souciait [p. 316] point de paraître acheter le suffrage du public de Paris en y débutant par une bonne action. Scrupule merveilleux, singulier après tout, peut-être légitime. Le succès de Mme Duse, ici, me semble pourtant au-dessus et à l’abri de pareilles préoccupations, et pourrait bien ressortir à celui de Mme Ristori, la géniale artiste, la femme éminente qui m’a souvent parlé de sa compatriote avec une admiration sympathique.
Enjolivant son magnifique talent, le féminin prestige mettra sans nul doute Mme Duse à l’abri d’une aventure du genre de celle qui advint, en ce même Paris, au grand Salvini, lequel, devers 1881, déploya son génie en l’honneur des quinquets et des banquettes du Théâtre Italien agonisant, près de tourner en maison de banque. Rossi, moins grand, l’an d’avant, avait fait recette.
Le goût de la prestigieuse Eleonora devra pourtant, avant de se manifester aux Parisiens, surveiller, avec parfois un peu sa mimique, deux choses encore: son affiche, afin de n’y pas laisser imprimer des pièces comme la Locandiera, de Goldoni, dont on s’étonne de voir la noble interprète de Nora et de l’Abbesse de Jouarre, ressasser, entre le blanchissage de Madame Sans-Gêne et les couplets finaux de Scribe, des fadaises que l’auteur du Domino noir eût désavouées. D’autre part,—outre une compagnie beaucoup plus qu’insuffisante,—ses toilettes, dont les régulières erreurs entre les folies de Liberty et les atours bourgeois, on ne sait comment arrachés aux meilleurs faiseurs, trouveront les Parisiennes inexorables.
Et pour assurer le grand succès déjà certain, [p. 317] un peu de bonne grâce ne nuira pas. Mme Duse refuse implacablement et impunément de recevoir des rois et de rendre visite à des reines. Je prévois tels interviewers qui se pourraient montrer moins patients.
28 juin 1895.
XIX
A Paul Helleu.
Le jeune et brillant comte de Castellane vers lequel sont anxieusement dirigés bien des regards pleins de rêves artistes à réaliser, sera-t-il le Mécène promis; un collectionneur non content de meubler des galeries reconstituées selon d’antiques plans, d’authentiques mobiliers issus de la légitime union du Boulle femelle avec le Boulle mâle; mais un Aladin compliqué de Louis, une baguette et un sceptre, la féerie et l’histoire?—Et puisqu’on nous parle de Trianon à propos de l’étage de marbre rose que Paris voit s’édifier en une nuit, entre non moins d’étonnement que n’en fit jaser le palais du Conte oriental—un vers célèbre méritera-t-il de courir sur son sarancolin:
L’éternelle et palpitante question se pose à cette occasion et d’une éloquence cette fois embellie d’espérance en la jeunesse et la fantaisie. Nos amateurs d’art persisteront-ils à demeurer des amoureux de bric-à-brac, dénués de la géniale autorité et de la préventive indépendance d’un Goncourt devançant la mode, la créant de par sa [p. 322] richissime collection de dessins amassés avec des sous, rien qu’à garder ou racheter des papiers d’emballage, des enveloppes de paquets—(Veuillot l’aurait dit ainsi)—«autour d’un ressemelage!»
Certes, d’importantes leçons nous sont venues de cette vente, qui ne méritera pas seulement l’épithète d’interminable. Le billet de mille froissé autour de cette épreuve de la Bouquetière de Boucher, en marge de laquelle se lisait encore au crayon le prix que l’avait vendue aux deux frères le père même de l’expert Danlos: trois livres dix sols, devra, s’il est bien compris, persuader aux acheteurs qui ont un autre souci que de se montrer riches, que c’en est fait de ces antiques achats enlaidis de gros prix et qu’il faut désormais laisser aux maniaques et aux musées.
Il est encore de nobles et plus récents objets méconnus qu’il siérait de grouper glorieusement et modestement ainsi que l’ont fait les Goncourt pour la première et la plus importante partie de leur collection—c’est ceux-là qu’il est spirituel de rechercher: et puisque la mode est aux reconstitutions, c’est le suranné qu’il faudrait reconstituer pour ne pas retarder sur les trouvailles.
Et le Bertin d’Ingres était, il y a quelques semaines encore, à la portée d’inintelligentes collections qui n’en ont pas voulu et qui se seraient haussées, en l’acquérant, à une noblesse historique.
Mais de plus sensibles conseils se devraient imprimer dans les cerveaux sous le martel de ces enchères; et cette conviction que Watteau n’a pas toujours vécu, et qu’il s’est parfois rencontré des [p. 323] amateurs éclairés pour faire exécuter par des vivants des décorations et des objets d’art d’autant plus discutés à leurs débuts que l’avenir leur doit être plus clément ou plus fervent et qui deviendront des chefs-d’œuvre. Car c’est une haute dignité, considérer les choses actuelles avec le regard renseigné dont les contempleront dans l’avenir ceux qui les comprendront enfin!
Un ardent désir de se signaler en ce sens me semblerait une noble et charmante descente du Saint-Esprit sur une tête fortunée, et l’on ne cesse de l’espérer, même après tant d’espoirs avortés, d’exaltations follettes, de consécrations falotes et de formidables oublis.
Des erreurs, des écoles, comportent, en cette voie, plus de dignité, que de timides réussites sur des chemins parcourus; et j’aime mieux certains essais violents et saugrenus du pauvre rêveur de Bavière qu’une récidive de Salon-Soleil ou de boudoir rococo, que ce Louis-là sut du moins rater tous!
Oui, je veux réjouir les yeux, d’une extase jeune, et d’un nouvel appétit, au début d’un repas, à l’aurore d’une fête; j’exige de m’enivrer réellement, fictivement en de modernes vases murrhins; je veux un surtout de table qui soit en cristal d’un verrier Fée, serti d’émaux du magique bijoutier Lalique;—et que le festin qu’ils brillantent soit servi sous des coupoles peuplées de muses de Stevens et de Whistler, de femmes-fleurs par Boldini et par Besnard, entre des lambris qui se creusent sur des Versailles exquis d’Helleu et de Lobre, et des frises où l’on prenne pour des bouquets de roses de gentils cupidos de Willette.
J’y pensais, l’autre jour, comme depuis quinze ans, devant ces Versailles merveilleux exposés au Champ-de-Mars par notre subtil ami Paul Helleu, en faveur de qui l’on pourrait bien—en train d’anciennes citations—transposer ce vers:
Car, entre à vrai dire de flatteurs succès, il faut pourtant la cécité même de ceux qui l’admirent et le font œuvrer pour n’avoir pas encore entendu les mélodiques accords qu’un tel peintre musicien pourrait faire rendre aux heureuses parois qui lui seraient confiées.
C’est avec plaisir et peine que je l’ai appris, un amateur intelligent vient d’acquérir un des trois panneaux automnaux de l’Exposition. Ce ne sera qu’un doux et triste tableau dans une collection, sans nul doute délicatement élaborée. Mais le bel et mélancolique boudoir de l’Automne, aux tentures en quinze-seize bleu pâle, dont c’étaient là les dessus-de-porte nés, et que l’artiste eût complété des fresques exquises et impatientes desquelles ses pinceaux sont remplis, le voilà veuf d’une de ses tapisseries dorées. Tous les brocards de l’automne pittoresquement décrits par la Sévigné, Helleu les a souvent peints dans ses toiles enchantées. Octobre y pleure ses larmes d’or sur des olympiens désolés; et ce sont des automnes plus anciens dont s’attardent les reflets sur les groupes de ce bassin où des feuillages jaunis se sont défilés comme les [p. 325] grains de chapelet d’un abbé musqué, les perles mortes d’un collier de favorite.
Mais combien d’autres chambres en des styles divers et différemment élus se sont offertes aussi vainement, sous le pinceau d’Helleu, au millionnaire inéclairé ou inattentif, à l’affût d’un Hubert Robert retouché ou d’un Canaletti apocryphe!
J’ai vu de quoi tendre toute une Salle des Fraîcheurs, sous des panneaux de mer, glauques et azurés où claquent et se diaprent les drapeaux des yachts, où des jetées se fleurissent harmonieusement de toilettes ombellifères.
De plus suaves rayons ont couru sur la palette de notre peintre. Il les faudrait décrire longuement. Si les navires lui furent chers, il aima non moins les nefs de notre salut, les frais vaisseaux pleins de reflets et d’encens des cathédrales pensives. Les taches arcenciélées que le soleil fait se mouvoir au long des murs et courir sur les tombeaux en jouant à travers les verrières, le peintre a su fixer leurs insaisissables tons d’althæas satinés et lisses. Mais, agonies d’automne, flots soleilleux, mausolées où le jour expire, saurait-on vous peindre que de tons de fleurs, que de teints d’enfants et de femmes?
Femmes-fleurs, fleurs-enfants, ce sont les vrais modèles d’Helleu, rare maître des élégances; ses pastels de la comtesse Greffulhe seront des émerveillements de l’avenir, et ses bleus hortensias sont pleins de rêves.—Goncourt l’a dit dans la délicate préface, dont, à ma requête, un peu,—j’ose le rappeler,—il ornementa, en 1895, un catalogue de ces eaux-fortes d’Helleu, aujourd’hui [p. 326] célèbres, et dont une importante collection en très belles épreuves fut le joyau d’une suprême vacation de la vente d’Auteuil: «Je ne sais pas un autre mot pour les baptiser, ces pointes sèches, que de les appeler les instantanés de la grâce de la femme.»
Qu’ajouter à cela, si ce n’est qu’il y faudrait moins—et plus encore?—à savoir, après la décorative consécration de cette préface d’un Goncourt et l’estime ancienne des critiques perspicaces et des amis compréhensifs, il y faudrait, dis-je, comme aux Mille et une Nuits, l’apparition imminente d’un palais d’Aladin, mais aux murs blancs et nus, et qui s’en retourneraient délicieusement revêtus par Helleu avec toutes les nuances des yeux et des eaux, et de la mort du soleil dans les vitraux, et de l’agonie des étés dans les automnes...
XX
A la comtesse Potocka,
née Pignatelli.
«J’aime ce Café, Monsieur, il meurt noblement,» disait Barbey d’Aurevilly parlant du café d’Orsay, sorte de Tortoni de la rive gauche, qui, naguère fashionable aux jours de jeunesse du polémiste-romancier, employait la même indigente magnificence dont le vieux dandy luttait contre l’âge, à lutter tout aussi vainement contre la faillite, au coin de la rue du Bac et du quai dont il se nommait, d’un nom de dandy, lui-même.
Cet éloge dont il récompensait la lente agonie du café d’Orsay, l’auteur des Diaboliques ne pourrait le refaire du Café de Louis XV; je veux dire ce pavillon Français de Trianon qui fut un temps loué à un limonadier, et auquel on vient, sans doute en raison de ce souvenir, d’infliger le rajeunissement d’une guinguette magnifique. Certes il mourait noblement, quand la restauration cupide et inéclairée est venue le réveiller sous les respectables plaques grisonnantes de son stuc, pour le rendre à la vie artificielle, sans dignité, sans harmonie et sans durée d’un enduit de ton beurre frais et d’un clinquant misérable.
C’est cette mort noble qu’il serait temps qu’un conseil supérieur et conscient prît le parti d’assurer à tout Versailles; ce tout Versailles si pitoyablement [p. 330] hésitant entre l’écroulement, et la factice et désolante survie d’un replâtrage, parmi tant d’impérities et d’exactions, ensemble onéreux et économique. Ce tout Versailles qui semble proclamer silencieusement mais désespérément comme son auteur le Roi-Soleil agonisant qu’il n’est pas difficile de mourir. Certes, il est moins difficile de mourir que de vieillir. Combien de visages, combien d’édifices en font foi, faute d’avoir établi par de judicieuses observations et de nettes définitions, ce qu’un intelligent entretien, une restauration vraiment digne de ce nom, doivent sauvegarder de vétusté à un aspect senescent, pour ne pas accuser des désordres graduels, souligner des désastres successifs; en un mot ne pas disproportionner, déshonorer les phases souvent harmonieuses de la dévastation et de la décrépitude.
Une vieille parente mienne dont j’ai cité un trait dans mon Saint-Expédit, et qui fut une intrépide Dame de Charité, nous égayait, nous épouvantait de ce récit: un jour que son zèle généreux mais indiscret l’avait poussée à franchir un seuil entr’ouvert auquel elle avait heurté vainement, elle se trouva tout à coup en présence d’une monstrueuse figure mi-partie sexagénaire et juvénile, une vieille coquette brandissant les fards dont elle était en train de se badigeonner, décrépite d’un côté, recrépie de l’autre, sorte de Janus de l’enjolivement et de l’horreur, qui se mit à vociférer—à vrai dire à bon droit, contre l’envahisseuse.
Les beautés d’architecture et de nature du vieux Versailles pourraient bien, devraient crier ainsi, mais contre les envahisseurs qui les reboutent à [p. 331] faux, les raboutent à rebours. C’est une erreur de la coquetterie de croire qu’il faut ne pas changer. Au contraire être immuable, en matière d’ajustement et sur le chapitre décoratif, c’est la première et la pire façon de dater, par conséquent de vieillir. D’antiques beautés célèbres et conservées nous apparaissent encore ainsi sous les bandeaux et dans les toilettes des portraits de Winterhalter. Plus habiles sont celles qui ont suivi la mode; plus touchantes, plus décentes, plus conformes—et finalement plus adroites aussi celles qui se contentent de décroître simplement selon le décours naturel de l’âge, lequel console des fraîcheurs évanouies par des attraits d’un autre ordre, et de plus de grandeur. Le poète les a magnifiquement spécifiés:
«Une vieille femme folâtre fait les délices de la mort,» cet adage antique ne convient pas moins aux monuments ci-devant jeunes, équivalents marmoréens de ces jeunes premiers du théâtre sur lesquels le parterre reprend son droit de sifflet sans pitié même pour de radieuses carrières. On a publié la lettre si tendrement cruelle par laquelle Mme Valmore rappelle à Mlle Mars la nécessité de rompre avec une illusion trop peu partagée. L’illustre actrice comprit, au point de paraître pardonner à son amie et de céder; mais non sans avoir subi de plus durs rappels. Une fois elle dut elle-même interrompre le spectacle et les rires d’un public irrévérencieux par cette douloureuse rectification [p. 332] verbale: «Mlle Mars a soixante ans; mais l’héroïne dont elle joue le rôle n’en a que dix-sept.» Et elle reprit sa tirade. Et la véritable héroïne fut ce soir-là, non pas celle de la fiction, mais l’artiste elle-même. Elle abdiqua donc dans une dernière représentation où son aigreur expira par ce trait. Elle jouait Valérie, où figure certain bouquet, dont l’abandon, après la pièce, était une occasion de marivaudage. Et comme en cette suprême soirée d’adieu, elle le jetait à son fidèle amoureux le comte de Mornay, les fleurs furent interceptées par un autre. Et la vieille jeune première murmura malicieusement dans le dernier soupir de Célimène: «Pauvre Charles! il n’a pas eu la première fleur, il n’aura pas le dernier bouquet.»—Pauvres vieux jeunes premiers, ils se complaisent confraternellement à l’entour des vieux monuments replâtrés; ils y demeurent dans un décor qui lutte comme eux pour ne pas vieillir, et j’en rencontre parfois chuchotant des vers de Musset à l’oreille de cette divinité que le poète accuse le praticien d’avoir égorgée en faisant des degrés de ce marbre sanguinolent qui voulait être une statue.
Je dirai encore une triste et risible histoire de vieille actrice. Celle-ci, au cours d’une tournée de province, s’était audacieusement fait précéder de ses portraits à vingt ans, exposés chez les marchands de musique. Le public le prit mal, et certain titi alla jusqu’à saluer de l’épithète de vieux veau! l’entrée de l’antique ingénue.
De tels rappels à l’ordre devraient, je le répète, si l’irresponsabilité des pierres qui, elles-mêmes et elles seules ne demanderaient qu’à s’effriter magnifiquement, [p. 333] ne rejetait tout le tort sur leurs avides ou maladroits curateurs, s’appliquer aux ci-devant jeunes monuments qui ne savent pas s’acheminer par une graduelle dégradation jusqu’à cette totale extinction de laquelle doit résulter et ressusciter finalement cette survie des œuvres d’art qui est la part des Musées.—«Tel qu’en lui-même enfin l’Éternité la change» est non seulement un beau vers, mais la formule d’une loi de transformisme applicable aux êtres et aux choses.
Il y a une forme de résurrection laquelle donne le sens de l’inconnue qui devrait être la résultante définitive d’un objet d’art et d’un homme. Pour le personnage historique, ce n’est pas, s’il s’agit de tel héros ou de certaine sainte, cette force et cette beauté qui ne furent de leur vivant que le germe de leur survie; non, ce n’est souvent—ironie et dérision—avec une histoire qui sera maintes fois légende entêtée et fausse, qu’une mèche de cheveux, un osselet exhibés en un reliquaire.
Saint François de Sales, c’est un cœur dans une pyxide à Lyon; saint Césaire, c’est une dent, en un monastère de Bernardins. Débris auréolés sur lesquels l’édification plane.
Le reliquaire, pour les œuvres d’art, que dis-je, pour les édifices, voire pour les cités, c’est un muséum. Le palais de Darius, repeinturluré, recuit, parvenu pour tout avènement à cette froide immortalité qui précède la cendre de l’incendie ou la trituration du cataclysme, n’a du moins plus rien à redouter des restaurateurs. Et l’on respire à le contempler en songeant que tant de siècles ont œuvré et tant d’autres contemplé, pour ce délicat [p. 334] aboutissement que Pierre Loti, qui s’est une fois déguisé en archer persan, rencontrât ce modèle de costume. Tels sont les résultats inattendus des treuils et des cabestans, des siècles et des architectures. Qui sait à quelle plus minime fin concourront les derniers reflets des mobiliers en or et en argent qui meublaient autrefois la galerie des glaces;—les derniers rayons du Roi-Soleil couché dans le lit de Delobel, et du Soleil-Roi expirant tous les soirs dans le linceul empourpré des miroirs d’eau jaune et mauve;—les derniers parfums des deux mille orangers, les suprêmes retombées cristallines des quatorze cents jets d’eau; les derniers soupirs des trente mille ouvriers morts pour l’inutile aqueduc de Maintenon—et de tant d’autres milliers d’agonies; les derniers tintements des quatre cent cinquante-sept millions, cinq cent dix-huit mille, quatre cent soixante et dix-huit francs, quatre-vingt-quinze centimes—qu’a coûté Versailles!
En quelles vapeurs danseront, en quels échos se condenseront ces reflets et ces soupirs après quelques centaines, quelques milliers d’ans, quand une Mme Dieulafoy, du Nouveau Monde sera venue mirer triomphalement par les ruines de la galerie des glaces et du parterre d’eau les basques d’un habit d’une coupe imprévue; quand les Louis-Curtins du cavalier Bernin, passés métopes seront mis au rang d’un marbre d’Elgin, et que des rubriques flotteront comme des gazes autour de leurs faux cheveux fouillés et de leurs plis torturés, d’où se lèvent des astres? Diront-elles—et pour tout Nunc Erudimini! que Louis XIII, lors de sa première [p. 335] volerie, qu’il fit à l’âge de six ans, prit un lièvre, six cailles et deux perdrix; et qu’il aima la chasse jusqu’à voler tout indistinctement et même la chauve-souris, parmi les ombres;—que le Cabinet des Pendules n’était pas le même que le Cabinet des Perruques;—que le frère du Roi, dans le tableau de Nocret représentant la famille royale, fut peint sous les traits de l’Étoile du Matin, ce qui fit de ce Monsieur Stella Matutina un bizarre émule pour la sainte Vierge;—que Louis XIV aimait fort le raisin muscat;—que les cardinaux bénissaient la couche où les princes allaient copuler, et que le Père de la Chaise lors de la célébration du mariage du roi avec la Maintenon portait une étole verte; que Louis XV écoutait aux cheminées et fit avec passion de la tapisserie; qu’il inventa en 1743 le nom de la Grippe; que l’an 1738 fut pour lui une année de dégoût, puisqu’il cessa de toucher les écrouelles... et de coucher avec la Reine; que cette dernière entendait jusqu’à trois messes chaque matin, tandis que le dauphin fumait jusqu’à douze pipes!
Fumées!... Fumées!... Fumées!...
A moins que par un anachronisme naturel, et faisant peu de différence des élégances contemporaines à celles qui s’y exercent de nos jours, on ne vienne à en conclure que le pavillon de Madame a été construit par M. Chauchard, et que ce fut dès l’origine que l’automobile de Gordon-Bennet occupa la niche de l’éléphant, et que son yacht mouilla sur le bassin du cachalot dans la Ménagerie.
Fumées! Fumées! Fumées!...
L’important, quels que soient le sens de leurs tournoiements et le bleuissement de leurs bouffées, [p. 336] est de laisser s’évaporer, s’évader enfin ces volutes et ces spirales; de leur rendre la liberté leur criant le beau vers qu’Hugo jette à l’oiseau détenu:
car les marbres n’en peuvent mais, et parce que les arbres tant de fois martyrisés aspirent à ne plus pousser sous la dictée—de M. l’Abbé Batteux.—Laissons toute cette poussière se poser et toute cette cendre reposée enfin, murmurer dans un historique lointain, le Memento quia pulvis des Ages.
Le Maître des Contemplations fait se héler avec une majesté inquiète les antiques cités dévastées. Babylone, Thèbes, Ninive, Tyr?
Ce qui fut doit faire place à ce qui doit être.
Le Frère, il faut mourir! est un cri religieux des civilisations et des empires. Et les pompeuses pierres de Versailles imprégnées de solennité et de solitude, de lassitude et d’ennui le baillent muettement de tout l’hiatus et de tout le rictus de leurs fissures et de leurs lézardes...

Ce mélancolieux cri des pierres avides de s’effriter dans l’oubli, un distingué écrivain, un sincère amant de Versailles l’a proféré pieusement, et excellemment. M. Émile Hovelacque a dit ce qu’il fallait, mêlant les chiffres au style et la technique à la rêverie en ses éloquents et fervents articles de la Gazette des Beaux-Arts, qui auraient [p. 337] mérité plus de retentissement. Nonobstant l’alarme a été donnée, l’appel a été entendu. D’heureux effets en résultent déjà. L’enlèvement des baraques qui devaient servir à la soi-disant restauration de dômes inexistants, a prouvé, se relevant sur du vide, que ces gobelets en planches n’avaient d’autre mission que d’escamoter des crédits moins chimériques.
L’épuisement prématuré auquel l’écrit de M. Hovelacque semble destiné, chez les libraires versaillais, factice ou réel, est de bon augure, puisqu’il prouve que le coup a porté sur des juges iniques et inquiets, ou sur des lecteurs désireux de lumière. C’est que le Jonas de cette Ninive n’y va ni de main ni de lettre morte. Il appelle des choses par leur nom: un Cubat un Cubat, et un restaurateur un fripon. C’est plaisir de l’entendre parler de «destructions arbitraires, de retapages, d’un faux luxe effectué sans aucune garantie; de toc lamentable et grotesque; d’enlaidissement inutile accompli sans retard, au mépris de réparations urgentes; d’étranges mixtures versées à faux sous prétexte de patiner de faux bronzes; enfin de toute cette campagne de dévastation onéreuse et sacrilège.»—«La destruction analogue du bassin de Cérès ne coûtera que dix mille francs,» ajoute l’inexorable vérificateur en son ironie attristée. Mais que de poésie et de vérité dans ces doléances motivées! «Cet ensemble unique créé par le génie, que les saisons, que les années, que les siècles ont doré d’une suprême gloire mélancolique, en une heure on le dépouille de sa vieillesse vénérable, de son passé séculaire, de son [p. 338] émouvante beauté, on le maquille, le rajeunit, le déshonore.
«Les pierres avaient vieilli avec les arbres qui les entourent, avec les charmilles dont la cime pourprée, dont les troncs moussus ont le ton des plombs bronzés des bassins, des pierres riches des margelles; ensemble ils avaient connu les vicissitudes des saisons, subi les événements des années, vécu d’une vie commune d’où une commune beauté était née: peu à peu la Nature avait repris l’œuvre d’art, l’avait rendue sienne et pareille à ses œuvres. Le patient effort du temps avait fait de cet ensemble, arbres et pierres, une harmonie, un seul objet d’art. Cette unité, on l’a brisée. On ne remplace pas ainsi en une heure le mystérieux travail de la nature. Elle a ses nécessités, ses lois, son imprévu que les restaurateurs ne comprennent pas. Les hasards du feu sur un grès flammé ne sont pas plus étranges que ses caprices, ni plus beaux. Les patines sont l’effet de réactions mutuelles: elles manifestent la vie propre d’une œuvre qui a su durer, en résistant sur tel point, en cédant sur tel autre. Elles sont l’affleurement et le signe de forces profondes et multiples. Sourdement, inconsciemment, la présence de ces forces nous émeut: obscurément nous sentons sur ces pierres, sur ces bronzes, sur ces plombs harmonisés à la nature, leur silencieuse activité, nous jouissons de la logique de leur effort.»—Poétique et véridique tableau, tendrement contrastant avec ce donner partout à l’ancien l’aspect du neuf, qui semble, au dire de l’écrivain processif, l’inepte et hideux propositum d’aujourd’hui. Car c’est contre [p. 339] cela qu’il importe de réagir. Le remplacement de tous les balustres (il en manquait un sur vingt) est aussi malséant dans la restauration de Trianon que l’apparition d’un râtelier éblouissant et complet dans une bouche âgée où suffisait un plombage.
N’infligez pas plus longtemps à ces monuments dont la ruine est, comme Montaigne écrivait de celle de Rome: glorieuse et enflée, le prolongement d’un retour d’âge calamiteux. N’allez pas jusqu’à faire dire d’eux ce qu’un seigneur osait chuchoter du vieux Roi: «Il garde contre moi la seule dent qui lui reste,» ni contraindre d’appliquer à la maison du soleil cette triste phrase de Chateaubriand: «Il y avait déjà longtemps qu’elle n’existait plus, à moins de compter des jours qui ennuient tout le monde.»—Que celui qui a commencé achève de me réduire en poudre! s’écriait Job. Il est bon d’entendre la même plainte s’exhaler de la ruine glorieuse et enflée. Le Trianon de porcelaine est révolu, et parvenu à cette survie dont j’ai parlé plus haut, qui est la relique collectionnée. La sienne consiste en quelques céramiques, débris peints de roseaux et d’oiseaux. Reliquat satisfaisant et impondérable. Le temps est venu pour les autres Trianons de s’acheminer vers cette sorte d’achèvement qui renaît de l’abolition. Et cela est suffisamment attesté par les abominables objets, Sèvres modernes montés en plomb verni, qui sont venus remplacer les bibelots anciens sur les consoles et les cheminées. Tous les œillets en bronze des petits candélabres de Marie-Antoinette qui avaient graduellement disparu dans les poches [p. 340] des Touristes, ont maintenant refleuri tout flambant neufs. C’est justement le contraire qu’il faut: la conservation avec authenticité, d’une antiquité même tronquée. C’est encore le lieu d’une comparaison à l’humanité: un squelette est un filigrane qui fut vivant; un crâne offre la beauté d’un vieil ivoire. Mais quoi de plus choquant que la coquetterie au delà de la vétusté, dans la corruption, des cadavres du ménage Necker ou du pianiste Thalberg marinés dans leurs bocaux par une admiration mal entendue. «Réveillez-moi, vous voyez bien que je suis mort!» s’écrie M. Waldemar, ce personnage d’Edgar Poë, le Magnétisé in extremis désireux de s’anéantir. Et puisque nul richard patriote ou étranger ne s’est trouvé pour assurer par le legs de sa fortune à ce palais des palais, autre chose que des cataplasmes architecturaux, de coupables amputations et de grossières éclisses, épargnons-lui cette caricaturale prorogation de sa splendeur. Et pourtant l’originalité eût été pour séduire un milliardaire Américain: Versailles légataire universel, héritier des perles de Mme Ayer et de ses rubis sanguinèdes. Cependant New-York afflue ici; et j’y ai rencontré ce type qui aurait tenté Balzac, ce remplaçant de l’ancien Anglais qui venait passer les hivers à Tours: l’Américaine valétudinaire en annuelle saison aux Réservoirs.
«L’Ile Royale est devenue un dépotoir,» nous affirment les guides précis et iconoclastes. Assez de ces tragiques transpositions. L’éditeur du Journal de la santé du Roi, après nous avoir présenté Fagon penché durant soixante-quatre ans sur les [p. 341] augustes déjections, déplore que ce prototype de Purgon s’étant abstenu les quatre derniers ans, se soit appliqué le célèbre vers: «Grand Roi, cesse de... vaincre, ou je cesse d’écrire!» N’allons pas jusqu’à ce dégoût. Grâce pour quelques souvenirs. C’est encore le grand Rêveur de Combourg qui a écrit: «Rompre avec les choses réelles, ce n’est rien; mais avec les souvenirs! Le cœur se brise à la séparation des songes, tant il y a peu de réalité dans l’homme.» L’heure est venue; la vigilance de l’histoire est là pour nous l’indiquer avec ses prévoyances. De puissants et délicats iconographes ont surgi, dont l’œuvre a résorbé la grâce expirante des lambris et des bocages: Lobre qui depuis plus de dix ans fixe avec autant de prestige que de précision dans ces panneaux qui nous charment et qui feront tant songer, les ors mourants des ors moulus, et jusqu’à cet or vivant que le couchant oublie dans les vieilles vitres de l’extérieur avec des opalisations semblables à l’iris des lacrymatoires. Helleu qui, lui, fige, dans ses mélancoliques panneaux, moins précis, plus attendris, les pleurs d’or feuillus dont l’automne sanglote l’agonisante amour des dieux, au-dessus des Danaés pétrifiées. Boldini enfin qui nous a peint les marbres de la colonnade de tons si soyeux, qu’on ne sait si ce ne sont pas plutôt des atours de favorites en lesquels se transforment ces piliers polis. Et n’est-ce pas le même mot qui nomme ces vêtements et ces revêtements: brocatelles? Et cette Vénus Anadyomène d’un galbe moins pur, d’un tour plus grand siècle, que le peintre italien a reproduite au crépuscule d’octobre, sur l’entrecroisement [p. 342] lilassé des branchages dénudés qui semblent des ferraillements d’épées, traversés par la végétale main d’une feuille de marronnier en suspens, et dont les cinq doigts mordorés, agitent comme un signe d’adieu de la mort des choses.
C’est cette noble mort des choses qu’il convient; je ne dis pas de précipiter mais de laisser s’accomplir, ne luttant que du soin respectueux qui nous fait veiller sur des vieillards aimés, sans tourmenter leurs derniers ans de serums néfastes. Et s’il convient de l’accélérer, que ce soit de belles libations de vin nouveau qui fasse se convulser les vieilles outres. Plutôt que la mort pâteuse des replâtrages vains, un retour aux embrasements d’antan qui assimile Louis à Sardanapale et le consume dans sa féerie.
Nocturnæ illuminationes vasis statuisque pellucentibus ad palatii Versaliani fenestras et per omnes hortorum areas et xystos apte dispositis.—«Lorsqu’on jouit d’une imposante renommée, dit un grand auteur, il faut s’épargner des travestissements peu dignes.» Ces travestissements-là, pour notre Versailles, ce sont ceux que lui inflige un culte simoniaque; et non des déguisements joyeux et royaux qui le faisant participer à la vie moderne ne l’exposeraient qu’à ce désirable accident de mourir couronné de fleurs et de flammes.—Ce sont d’importants gêneurs qu’a révoltés l’entrée en moderne civilisation de la place Vendôme. «On ne compte ses aïeux, que lorsqu’on ne compte plus!» Un vieil édifice compte encore assez pour pouvoir, dût-il s’en consumer, participer à notre vie. Tels [p. 343] de respectables parents fiers de leur âge, lisible dans leurs rides et orgueilleusement assumé, ennoblissaient de jeunes réunions, qu’attristent des vieillards douteux et d’âge anonyme. C’est un semblable accommodement aux plus avancées inventions de la vie moderne que je rêverais pour l’hôtel de Lauzun, dans lequel il me plairait voir quelque élégante fantaisiste prenant la place de Mademoiselle «Grand Urluberlu» comme Chateaubriand l’appelle, unir le passé au présent par un automobile chauffant au quai d’Anjou, et par un yacht mouillé en Seine.
J’ai écrit dans les Roseaux Pensants sous ce titre: le Clou de 1900, la sorte de rajeunissement et de remise au point que je souhaiterais pour Versailles en début de ce nouveau siècle. La société des Fêtes Versaillaises vient de nous en donner un avant-goût, le jeudi 11 août 1898, à huit heures très précises du soir. Il est admirable. Qu’on imagine le bosquet d’Apollon éclairé doucement et magnifiquement par des milliers de fleurs lumineuses. «Cette obscure clarté qui tombe des étoiles,» tombée du vers de Corneille avec ces étoiles elles-mêmes, sous forme de fleurs, sur le bocage d’Hubert Robert. D’électriques vers luisants logés aux cœurs des filles fleurs de Parsifal, ou tout au moins sous leurs bonnets florifères. Shakspeare éclairant d’Urfé et le Songe d’une nuit d’été rêvant sur l’Astrée. Je n’ai rien imaginé d’aussi beau, rien vu de si Bayreuthien, sans omettre Bayreuth lui-même. Wagner et Lulli, Louis XIV et Louis II ont dû s’en congratuler parmi les ombres. De rosoyants, de virides reflets, [p. 344] couraient, mouraient en souriant sur les coursiers de Guérin et de Marsy, sur les nymphes de Girardon et de Regnaudin. Et les étoiles filantes, les étincelles du gril de saint Laurent qui s’irradiant cette nuit-là même dans le firmament le sillonnaient de paraboles enflammées comme celles que font dans la gouache de Van Blahrenberghe les grenades enflammées au siège de Berg-op-Zoom, rejoignaient les feux mouvants disposés parmi les xystes. Et ce fut une nouvelle application de l’homme courant après la fortune qui l’attend dans son lit. Nombre de Parisiens en route vers de plus ou moins chimériques Mecques d’art, tandis que son voisin si proche et si lointain, son frère ennemi le bourgeois-soleil, s’offrait sous couleur de bienfaisance le phénoménal divertissement de cet Apollon aux Lanternes.
Versailles, août 98.
XXI
A Bernard de Gontaut-Biron.
Léopardi et Ernest Hello, l’un en sa hautaine ironie, l’autre en son sens profond, son aiguë, auguste et quasi oraculaire pénétration du mystère, ont formulé sur ce propos de l’argent des choses pleines de frisson. C’est que l’argent est essentiellement mystérieux; et ceux-là seuls l’ont traité dignement qui l’ont abordé sous ces espèces frissonnantes. Léopardi, dans un saisissant paragraphe de ses œuvres morales, nous désabuse sur l’effectivité des offres de service en la matière; quand bien même, dit-il, le supposé prêteur serait entré dans le détail (il ne s’y attardera que pour nous faire rougir!) de toutes les circonstances de temps et de lieu où nous pouvons, nous devons nous adresser à lui. Que l’éventualité prévue se présente ainsi qu’il l’a lui-même spécifié, et sommes-nous assez naïfs pour le lui rappeler, avant que nous ayons eu le temps de l’en saisir, le voilà en fuite! Ce que Léopardi nous laisse à deviner—et il faut qu’il en soit ainsi pour la totale perpétration du mystère—c’est que le pseudo-prêteur doit être d’une égale bonne foi lors de sa proposition et dans sa retraite, car c’est précisément l’accomplissement [p. 348] de la loi pécuniaire qui s’oppose ainsi fatalement à la réalisation de l’offre et de la promesse.
Une spirituelle et généreuse femme sans grande fortune, avec qui je raisonnais de ces choses et qui s’en étonnait comme moi, concluait après un silence: «Et qui sait si, devenus riches, nous n’exercerions pas nous-même l’iniquité qui nous indigne, comme ces piétons énervés qui finissent par se précipiter sous les pieds du cheval qu’ils ont vu venir?»
L’étrange pudeur qui s’attache à toute sollicitation de pécune est encore une des manifestations de ce mystère. Hors quelques natures étriquées et basses, ignorantes de l’éloquente beauté du désir simplement exprimé, incapables de la noble satisfaction de l’exaucement immédiat (bis dat qui cito dat, disait l’antique), on craindrait à peine de laisser paraître son appétence d’un objet d’art, voire d’un bijou, dont l’acceptation pourrait réjouir le donateur et l’obligé, même le postulant. Mais s’il s’agit de ce qui sert à tout acquérir et dont, sans doute, le prix réside en la variété des emplois qu’on peut, dans le même instant, assigner à sa virtualité, la valeur en semble si grande qu’on n’osera jamais parler que d’un prêt, même quand les deux parties sont édifiées sur l’euphémisme de ce terme. L’illusion est telle, le malentendu—qui, je le répète, n’est peut-être qu’une loi sociale et cosmique—si grand qu’on ne saurait défier toutes les plus ironiques situations qu’ils revêtent. Protée n’est pas plus profusément versatile que la résolution naïve, physique, simplement humaine de ne pas obliger sous laquelle se débattent certains riches [p. 349] sans parcimonie outrée. Une veuve, dotée de huit cent mille livres de rentes, sans enfants et sans charges, traversera la rue un jour de pluie pour aller confier à une amie l’impossibilité où elle est de retrouver le sommeil avant d’avoir imaginé le moyen de soulager une infortune, que deux ou trois billets de mille francs aboliraient. Des enfants d’un cœur haut placé, se privent des plus innocentes fantaisies plutôt que de solliciter d’un grand-parent riche et avaricieux un accroissement de leur pension minime: «J’aimerais mieux mourir!» est la formule habituelle et souvent à peine hyperbolique de cette honte. On pourrait dire que les questions d’argent sont les parties honteuses de la conversation; on baisse la voix pour en parler; et si quelqu’un insiste, une rougeur en résulte, il y a obscénité consommée.
Peut-être y a-t-il aussi, dans cet excès, quelque chose de l’importance dont nous exagérons les choses désirées. L’or et l’argent vierges sont le sang et la lymphe de la terre. Leurs filons courent et circulent en les animant dans les veines du globe. Ainsi font ces filons monnayés dans les veines des sociétés, dans l’organisme des peuples. Une assimilation physiologique ne saurait-elle être faite d’une perte d’argent à une saignée; et de son retour, à une transfusion monétaire? Considérez une grande cité populeuse et houleuse, et demandez quatre syllabes à votre choix pour agir sur cette marée. Que ces deux dissyllabes soient amour et argent, et renseignez-nous sur ce qui survit du mouvement à leur ablation double. Une légende nous représente le globe créé parfait, et le Père [p. 350] Éternel accédant, béat et imprudent, à la requête de Satan d’y laisser tomber rien qu’une pièce de monnaie; laquelle, naturellement, suffit à bouleverser le monde.
On pourrait encore démêler une autre vraie et subtile raison de ce que j’appellerai la pudeur pécuniaire, dans ce que je dénommerai aussi l’ingratitude inverse des obligeants, car il s’en rencontre. Je m’explique. L’ingratitude des obligés, qui n’est peut-être qu’un phénomène d’ordre physiologique,—une répulsion, une révulsion, ou d’ordre religieux, par l’obligation pour le donataire de recevoir sa récompense de plus haut,—est chose enregistrée. Mais ces donataires eux-mêmes n’en sont pas exempts; et il n’est pas rare de les voir assez naïvement, à la suite de doléances préventives, commencer par se refroidir eux-mêmes à l’égard de leurs obligés, tout plein de sincères intentions de reconnaissance.
Un autre mystère de l’argent par lequel s’accuse assez son origine diabolique, ce sont les bizarres interversions de ses effets. Rien que d’assez naturel dans celle, surprenante de prime abord, qui consiste à voir devenir avaricieux après fortune faite, un homme qui s’était montré généreux en une médiocre aisance. Il y a du collectionneur dans le thésauriseur. Et la collection ne prend de l’intérêt qu’une fois sérieusement ébauchée. Une moins explicable et par conséquent plus perverse malice de la richesse est la cécité, le mauvais goût dont elle afflige les yeux de ceux qu’elle favorise. N’y aurait-il pas là en même temps qu’une plus plausible explication du bandeau de la Fortune, une touchante compensation pour les pauvres que leur clairvoyance [p. 351] enrichit; un Sauvageot, simple musicien d’orchestre réalisant une inestimable collection en regard du millionnaire aveugle et maladroit dont les lourds achats et le choix saugrenu, après avoir de son vivant attristé les yeux de ses déplorables invités, assurent après soi des déboires à ses collatéraux et le mépris à sa mémoire? Des grandes collections israélites, je ne parle pas. Celles-là, souvent constituées avec un grand goût, n’impliquent pas, n’admettent pas l’élément sine qua non de la collection géniale: la découverte du nouveau; mais paraissent au contraire presque toujours s’édifier sur ce principe de l’objet d’art devenu valeur par le taux enregistré de l’époque de la production choisie, valeur aisément et immédiatement convertissable et réversible.
A vrai dire, nul millionnaire dont l’attitude me semble tout à fait louable. Le comte Greffulhe, et on ne l’en saurait assez vanter, est un millionnaire fastueux. Il aurait, dit-on, offert cent mille francs pour un siège de député. Je regrette que l’imputation soit fausse. Se pourrait-il un plus éloquent sermon sur le mépris des richesses? Le comte de Castellane s’annonce comme un milliardaire fantaisiste et généreux. Le ciel en soit béni! Mais ne saurait-on leur reprocher quelque chose d’exclusif dans l’emploi de leurs moyens?
On nous parle aussi d’une richarde (dont le nom est connu) qui se serait retirée à l’écart de ses millions, dans l’attente d’une vraie détresse à soulager—qu’elle espère encore!—Cette sœur Anne de la munificence guette les malheurs derrière un judas grillé, et les passe en revue, mais [p. 352] aucun cas de pitié ne lui semble assez triomphalement à plaindre pour décider son bienfait, pas plus jeunes filles du monde à doter que bazar incendié à reconstruire. On ne cite encore à l’actif de ses services, que le trousseau d’un Saint-Cyrien qui, du reste, aurait refusé dignement le cadeau anonyme. En somme, ardente charité qui pourrait bien n’être qu’une forme plus spécieuse de l’avarice, et qui me fait penser à ce mot inédit de Forain dans la bouche d’un passant devenu subitement songeur, à l’aspect d’un cul-de-jatte qui lui demande l’aumône: «Si seulement, murmure le Crésus en n’ouvrant pas sa bourse, on était certain que ce fût une véritable infortune!...»
Quant à la personne qui hésite à payer cinquante mille francs un portrait d’Ingres mais qui, d’enthousiasme, en donne le double pour une œuvre maîtresse du peintre de la Cène Inférieure (selon Degas), celle-là fut créée et mise au monde pour le rafraîchissement des indigents éclairés qui n’échangeraient pas contre une bourgeoise cécité, leur pauvreté clairvoyante. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes.
Mais la plus odieuse espèce de mauvais riche est celle du riche effacé. Notez que je ne parle pas de l’avare de qui le type est classique depuis Plaute, avec Molière, Balzac et Hello, et dont l’espèce est classée. Non, je veux dire le riche poltron, comme peureux des rayons de son or, moins par crainte d’être sollicité, que sans doute par ennui, dégoût de ce qui le désigne de son flamboiement latent, partielle et momentanée abdication des soucis dont il l’assiège.
[p. 353] «Qu’est-ce qu’elle veut?... demandez-lui ce qu’elle veut?» gémit le grand financier à l’annonce du retour persistant d’une quémandeuse. Et ce calice de l’homme d’argent contient moins de la crainte d’obliger, même magnifiquement, que l’ennui de se voir ainsi monopolisé monétairement, et surtout l’espoir, qui sait? luisant «comme un caillou dans un creux», l’espoir de Verlaine, d’être enfin sollicité pour quelque autre spécialité qu’on se connaît, philosophe, exégète, sociologue, lettré, artiste, botaniste, naturaliste, et de se révéler tour à tour Kantien, Talmudiste, Fouriériste, Ibsénien, Wagnérien, Rodiniste, jardinier de la fleur d’Açoka ou maître-chanteur de l’oiseau asfir... Et le Crésus qui se consulte lui-même sur tant de titres à un questionnaire moins restreint, continue de gémir désespérément: «Qu’est-ce qu’elle veut?... Demandez-lui ce qu’elle veut.» Mais l’employé qui n’a pas bougé, et sans prendre la peine d’interroger l’invisible cliente atteint au cœur du trop éclectique richard, le droit qu’il ose se croire de faire autre chose que «le compte de ses deux milliards» et l’étrangle de ces deux mots: «Monsieur le baron sait bien... elle veut... elle veut de l’argent!» L’amusante ode funambulesque de Banville, bien connu sous le nom de La Pauvreté de Rothschild, en dépit de certains traits un peu lourds, s’apitoie lyriquement et spirituellement sur ce cas de misère archidorée.
Est-ce à de telles causes, soin d’accroître, inquiétude de maintenir, souci de perdre, qu’il faut référer cette mélancolie propre au richard, qu’elle désigne à l’observateur.
écrit La Fontaine.
«Monsieur aussi est millionnaire!» disait une gracieuse et soucieuse Fortunata, en désignant un partner d’une assez silencieuse gravité pour faire un pendant à ce délicat tædium vitæ fait de satiété, d’inappétence et d’ennui dont elle nous offrait elle-même l’image. Et cette réplique nous venait aux lèvres: «Monsieur aussi est millionnaire; vous n’avez que faire de le spécifier; cela se voit de reste à cette ombre opaque et bleuâtre des forêts [p. 355] qu’il possède et jamais ne parcourra; mais, qui cerne ses paupières, obnubile son front, terrifie son cœur; à la froideur de ses viviers qui filtre en ses prunelles; à la rigidité de ses marbres qui pétrifie sa chair. Oui, monsieur est millionnaire, et vous n’avez que faire de nous le spécifier, cela se voit de reste et tout autant qu’à vous-même, pauvre Calypso de l’or, inconsolable du départ de vos rêves...»
Au reste, n’est-ce pas de vous, la même confitens rea, que je tiens l’ingénue et peut-être décisive explication de cette psychiatrie des riches: «C’est parce qu’ils reçoivent trop de lettres!» Il est vrai qu’ils prennent le parti de n’y pas répondre; et cela, j’ose l’affirmer, sans distinction de personnes, puisqu’une de mes plus nobles et charmantes amies a bien pu quêter pour un intéressant bénéfice un richissime Américain, sans en recevoir, fût-ce rien qu’un remerciement d’un si précieux autographe; et que pareille mésaventure quand j’eus résolu de statufier Mme Valmore, m’est advenue, je mets certain orgueil à l’avouer, avec un raffinement d’impolitesse de la part d’un jeune Plutus et d’une dame Mécène. Mais notre écriture, à mon amie et à moi, est périlleuse. Et le moyen de s’arracher, pour la déchiffrer, aux douceurs même spléenétiques, de ces demeures dont la mirobolante façade me remémore le savoureux refrain qui fait briller les yeux de l’enfance:
[p. 356] C’est une erreur pour un médiocre exécutant d’apprendre un morceau de musique dont l’audition l’a charmé. L’exercice en rend fastidieux pour lui les plus agréables traits, et quand l’interprète s’en sera tant bien que mal assimilé les mélodiques circonvolutions dont le mystère le séduisait, elles ne lui offriront plus que rengaine. «Restons où voyons!» a dit le poète. Ou nous entendons aussi: «Un pot de fleurs donne toutes les jouissances d’une propriété,» affirme George Sand. Les exigences de l’entretien ne laissent plus voir au propriétaire blasé et lassé que des comptes courants qui raturent pour lui seul les grâces de son jardin français doux à ses hôtes; et qui salissent de leurs griffonnages aussi laids que «les noms entrelacés de Victoire et d’Eugène», le Carrare de ses groupes et le Paros de ses vases. Il y a de l’évasion hors de tels soucis dans la teinte neutre dont se déguisent certains riches. Leur fortune est leur royauté, par moments aussi gênante que celle-ci; et l’on sait toutes les douceurs que les grands-ducs incognito goûtent dans nos cabarets de Montmartre. C’est un plaisir encore plus vif que la difficulté vaincue. Rien n’égale celui-là, à en juger par les prodiges d’ordres si divers continuellement effectués de son ressort. Je citerai entre autres parmi ses effets, non des moindres, et pour prendre deux exemples sans autre rapport apparent: la construction de Venise et l’hilarité des estropiés, la gaîté des infirmes. Il sied d’y joindre l’illusion de la pauvreté que réussissent à se donner certains riches. On sait que la grande Catherine devançant le lever du jour et celui de ses valets, allumait elle-même son feu, et [p. 357] qu’il lui arriva de roussir—sinon de rôtir, ainsi, un ramoneur dans sa cheminée.—Les affaires de l’État motivaient de telles habitudes, qui pouvaient bien néanmoins ressortir à certaine soif de médiocrité dorée. Mais je sais une opulente matrone qui se lève dès patron-minette, et grâce à dix heures d’un obstiné travail de couture dont elle s’assure le débit, entretient ses pauvres sans attenter à ses revenus, et s’offre à elle-même le fruit défendu, d’avoir gagné sa journée! Et ce sont des jeunes femmes de la même famille qui firent recouvrir d’argent jusqu’à la moitié les diamants de leur rivière, afin de les faire paraître plus petits!
Dans le même temps, et dans le même esprit, le même désir de donner le change, de plus touchantes illusionnistes se constellent de bijoux faux, et leur mensonge m’est plus cher, car il me plaît qu’on puisse juger les gens sur la mine, et que l’on sache de prime abord à qui l’on s’adresse; que les rois se promènent avec leur couronne, à la ville et par les forêts, ainsi que dans les contes de fées. Ainsi approuverais-je que les millionnaires marchassent escortés de lingots ou de ces sacs ventrus qu’on voit reproduits dans les rébus et sur lesquels des zéros infinisés sont précédés d’une unité qui les qualifie. Les gamins et les adultes arrêteraient au passage de telles sacoches et les éventreraient au besoin; et l’on verrait ces Crésus enfin consentants, répondre aux nazardes des gavroches à coups de dragées d’un baptême doré, et de confetti monétaires.
Ces mystères de l’argent, Hello, qui ne les a pas énumérés, les fait tenir tous dans la monstrueuse [p. 358] idolâtrie de son Ludovic, l’avare agenouillé devant son trésor stérile. Le Veau d’or adoré comme Dieu ne peut qu’engendrer d’abominables anomalies. Et M. Valdemar, l’étonnant hypnotisé au delà du trépas, dont Poë nous rapporte le ton ondoyant quand l’interrogateur le force à répondre sur Dieu, questionné sur l’argent n’aurait peut-être pas employé de moins évasives formules.
Or, exercée à l’égard d’un somnambule plus vivant, la dite sommation pourrait bien lui coûter ce qu’il advint à cet enfant magnétisé qui tour à tour Socrate, Praxitèle, Napoléon selon qu’on le lui enjoignait, parlait avec sagesse, polissait des marbres, et gagnait des batailles. Mais quand on en vint à ce sacrilège de lui dire qu’il était Jésus, le sujet pâlit horriblement, et se mit à dire du même ton bas de M. Valdemar: «Vous savez bien que cela n’est pas possible!» Et l’impie interlocuteur ayant insisté, l’enfant tomba mort.
Qui sait en effet si ce mot de l’argent, de la malédiction et de son mystère, ne serait pas l’histoire des trente pièces dont fut payé le Haceldama, le champ du sang, le champ du potier, après que Judas les eut rejetées?
Car c’est le dernier mystère de l’argent sur lequel je veuille conclure ce frontispice, qu’il n’y ait pas de richesse et pas de pauvreté; que seule l’aberration dont frappe Moloch constitue ces deux états qui n’existeraient pas sans elle. La disproportion entre les ressources et les dépenses fait seule les véritables pauvres. Cette affirmation digne de La Palisse—et de La Bruyère! se vérifie chaque jour en la gêne manifeste de bien des Crésus et la relative [p. 359] opulence de certains Lazares. J’en veux pour preuve cette historiette édifiante: un ménage de serviteurs retirés vivait économiquement avec aisance d’une rente d’environ mille francs servie par la famille des anciens maîtres. Un de ces derniers, touché par les miracles d’entente de ces braves gens, leur ayant proposé d’augmenter leur mensualité trop modique, s’entendit refuser avec gratitude mais non sans effroi de la part de ces vieux domestiques. Ils auraient craint que ce surcroît de ressources, par la nécessité d’en trouver l’emploi, ne vînt attenter à leur bonheur! Lui, pêchait à la ligne, sans doute par la prolongation de son geste d’ancien cocher, d’un siège occupé trente ans, rejeté au bord d’une rivière. Elle, à l’occasion d’une exposition universelle, et désespérant si elle attendait plus longtemps, de lui trouver un autre usage, s’était décidée à utiliser pour s’en faire une petite capote, un chiffon de velours gros vert, reste d’une blouse gâtée dans un goûter, plus de quarante ans en arrière, par un des marmots, devenu barbon, de la respectable famille.
La République de Saint-Frusquin est le lieu du monde le plus propre à étudier en ce qu’ils ont de plus spécieux les phénomènes pécuniaires. Saint-Frusquin est une de ces Maisons de jeu comme celle qui fit la prospérité de Baden-Baden, du temps de M. Bénazet, et que je vis quand j’étais enfant; comme celles qui fonctionnent encore aujourd’hui à Monaco et à Spa, et que les chroniqueurs déclarent [p. 360] établies «avec le minimum d’inconvénients inséparables de ces sortes d’établissements». Les inconvénients nous les verrons tout à l’heure.
Je me souviens, un radieux après-midi de septembre à Belliago, avoir rencontré une étrange voyageuse. Nous étions parvenus à l’extrémité de ce panoramique sentier qui contourne la Villa Serbelloni et se termine par un de ces bancs dans le voisinage desquels une pancarte anglaise annonce souvent: The view, comme pour préparer le touriste réfléchi à porter un jugement comparatif sur la Nature.
En effet, le bruit de nos pas, une déférence hospitalière non moins sans doute qu’un rapide visa à délivrer à quelque autre contrée du globe, firent se lever automatiquement une miss qui s’éloigna sur ce brevet encyclopédique, dont d’une voix nette elle sut récompenser le lac enchanté, le soleil couchant, la minute exquise: «Le troisième point de vue, en beauté, dans le monde?»
Je ne sais au juste le rang qu’assignerait à Saint-Frusquin, cette pédagogue des paysages. Nul doute pourtant qu’elle ne le juge digne de figurer parmi les dix premiers, comme nous disions au collège. Étagée au bord de la mer, cette grosse bourgade n’est pas le contraire d’une petite Carthage. Elle m’y fait songer, quand du haut de ma terrasse qui la domine et sous l’estompe du soir qui descend, j’y vois aborder non les navires chargés de murènes ou de vases murrhins, de byssus ou de pourpre; mais les yachts des cosmopolites nomades des eaux, attirés par le cliquetis des roulettes. Certes, le soir y est nécessaire pour [p. 361] draper d’antiquité l’architecture-joujou des villas modernes, toutes vêtues de ce kennédia dont la fleurette semble une glycine minuscule, et de bougainvilléas, ce pariétaire aux feuilles d’un magenta vif, donnant aux murailles qu’il habille l’air de constructions élevées par un couturier, des maisons en ruches. Seul, le soir aussi permet de prendre pour quelque avenante Salammbô, Mlle Petit-Pois, qui n’a pas les cheveux poudrés de poudre bleue et dont les chevilles ne sont pas réunies par des chaînettes. Mais cette gracieuse Carthaginoise, loin de rougir de sa fraîche ascendance de primeurs, en verdit allègrement son nom de guerre et de paix; se pare de cette riante couleur que le XVIIe siècle appelait le verd naissant, et toute fière de sa rame dont elle porte en bijou la parlante armoirie, se proclame avec esprit: de la famille des Pois, branche cadette.
Mais le soir y est obligatoire surtout pour la révélation par l’éloquente cernure de ses feux, de la Maison-Mère de l’endroit, le Casino, le Temple de Saint-Frusquin en personne. Huysmans a trouvé pour notre Trocadéro la singulière comparaison d’une femme hydropique, les jambes en l’air. La partie centrale du Temple (ainsi le désignerai-je au cours de ces pages), laquelle n’est pas sans rapports avec ce hideux palais, s’interprète, dans l’obscurité, d’une signification diabolique. Deux cornes deviennent ses deux tours; deux rougeoyantes prunelles, ses deux cadrans lumineux striés par les fibrilles, les unes mobiles, les autres fines de leurs aiguilles et de leurs heures. Au milieu du premier étage, une baie s’ouvre sur un balcon, [p. 362] pareille aux narines d’un nez camard plein de reniflements mortuaires, au-dessous duquel les deux cordons superposés de globes laiteux qui contournent la véranda font grincer comme le rictus géant d’une double rangée de dents lumineuses.
La «Cathédrale du Jeu», comme l’appelle non sans éloquence un des naïfs guides de l’endroit; tel s’érige grossier et insolent, et couronne le rocher maudit, le Temple de Saint-Frusquin, sanctuaire de Moloch et de Mammon, tandis que le patron chrétien de la région, saint Modeste, a son église on ne saurait dire édifiée, mais évidée, une sorte de crypte, au creux d’un ravin de cent mètres de profond et qui semble mise en pénitence par l’orgueilleux Casino, tout au fond de ce cul de basse-fosse.
Certes, c’est bien un culte qui s’accomplit là, l’idolâtrie du veau d’or remis au vert sur le tapis du trente et quarante. Autels plus saignants que les druidiques dolmens, ces tables de jeu mi-partie noires de bien des deuils et rouges du sang rejailli sur elles. L’office s’y célèbre de l’entrecroisement de tant de regards anxieux, véhicules de tant de désirs. «Là où vous serez plusieurs réunis en mon nom, je serai au milieu de vous,» assure Jésus. Le diable, de qui la manie est de singer Dieu, s’approprie ce précepte. C’est de la concentration de toutes ces volontés, qu’il surgit, de la tension de tous ces espoirs. La preuve en est que la rupture, certains jours de moindre presse, du cercle magique autour d’une de ces tables-autels, supprime de ce seul fait la perpétration du mystère. Je l’ai plusieurs fois observé. Un malaise, plus pénible que ne l’était tout à l’heure la [p. 363] coudoyante cohue dont on se plaignait, trouble ces fidèles décontenancés et qui se hâtent de rechercher une moins incomplète célébration de la messe rouge et noire. Messe du démon de midi, vespres de Satan, ténèbres de Belzébuth, messe de minuit, communion de la plaque sont tour à tour et à la suite célébrés par des fidèles infatigables.
Les prêtres en sont les croupiers; troupeau de laïques abbés que vomissent à des intervalles réguliers de mystérieuses sacristies. Mais quantum mutati ab illis, ces sacerdotes! Plus rien en eux de ces pontifes du hasard, hiératiques et inconscients arbitres de tant de destinées, séparés du joueur par un dédain qui les vengeait de ses mépris; éclaboussés du sang qui, sur leur noir, complétait la livrée méphistophélique. Aujourd’hui, à peine des commis de magasin de deuil, de vagues jardiniers de la verte plate-bande du drap, fleurie des coquelicots et des iris de Suse des deux couleurs, et des boutons d’or des chiffres, entre lesquels leur geste désormais sans autorité, ratisse mollement le gravier d’or et d’argent des allées de la fortune; des employés quelconques, ayant leur tirelire au bureau de tabac, avides du pourboire qu’ils réclament cyniquement aux gros joueurs, jusqu’à chuchoter un impudent «glissez-la-moi dans le cou!» à ceux dont ils sollicitent la pièce.
Au point que l’évangélique. «Si le sel perd sa force, avec quoi salera-t-on?» se puisse transposer sous cette forme: «Si la corruption se vicie avec quoi corrompra-t-on?» pour ce simoniaque vicaire. Et ne serait-ce pas un tableau digne du crayon fantastique d’un Rops que le petit coucher [p. 364] de ce croupier-jupin faisant s’éparpiller autour de lui pour sa Danaé, la pluie d’or de ses pourboires?
C’est depuis l’ouverture du temple, à midi, jusqu’à sa clôture, à minuit, un curieux déroulement de ces pompes sataniques. Rien n’y manque, depuis la solennelle vérification au début de la séance de ces démoniaques agnus carrés qui sont les cartes, dont chaque jeu, à tout jamais renouvelé, fut estampillé d’une vignette jamais la même, un coq, un poisson, qui en assure l’identité et le différencie; jusqu’à, au début et en conclusion, la sortie du tabernacle, la rentrée dans la custode, des sac et des coffres, des espèces mêmes de Saint-Frusquin, l’argent, l’or, les billets dont les yeux se rassasient.
Car là réside le mystère profond qui mieux que la sagesse de Salomon attire de loin tant de Reines de Saba, évoque des mages chargés de présents plus que l’étoile messianique; c’est que l’adoration des douze heures est permanente en ce lieu, et que le dieu s’y montre nu en la réalité de ses espèces. Cette pudeur inhérente aux demandes d’argent, et dont j’ai parlé plus haut a sa revanche là, dans l’étalage même de la divinité offerte à tous les cynismes. Et cet attrait est si fort que tous les autres sont oubliés. L’autre dissyllabe tout puissant, que nous avons vu se partager avec l’argent les mouvements humains: l’amour, ou ce qui en est aussi la sacrilège singerie, s’efface devant le métallique veau bondissant dans le parc des nombres.
La mine ensemble avide et déconfite de Phryné est impayable à étudier là. Vainement frisée, [p. 365] fardée, décolletée et parée pour les regards distraits du joueur, une réflexion sur la qualité du dieu qu’on lui ose préférer peut seule la consoler de l’échec momentané, du déboire surprenant de se voir chasser à coups de râteau par un Aréopage outrageant, s’il lui prenait fantaisie, en guise de masse, de s’offrir nue. Et puis son dépité sourire n’est pas sans malice. Elle sait pour qui l’on travaille, et se garderait de risquer en somme un préjudiciable attentat, dont du reste les fidèles de Saint-Frusquin auraient vite fait de tirer vengeance.
Car Lucifer est plus exigeant qu’Adonaï; et c’est une des traces de sa griffe. Dieu a le plus d’indulgence.
Au cours de la visite d’un sanctuaire chrétien interrogez un pieux guide sur les sacrilèges qui ont mis en deuil le saint lieu, tabernacles fracturés, ciboires violés, azymes répandus. Il vous en citera de récents qui ne sont les premiers ni les derniers, et vous serez peut-être surpris de leur nombre. Rien de pareil dans la basilique de Saint-Frusquin, seul parvis vierge de scandales. A peine vous en citera-t-on d’anodins, tels que l’histoire de cet innocent joueur de maximum, qui se le voyant enlever dûment, puisqu’il avait perdu, ressaisit sa liasse en criant: «Arrêtez, malheureux! c’est la dot de ma fille!» Il y eut bien encore ce personnage éminent qui, lui, s’était fait une loi de gagner un numéro plein, à chaque séance. Quand donc la chance ne l’avait pas favorisé, et l’heure du départ approchant, il lui fallait bien prendre le parti de s’emparer d’une masse sur un numéro sortant. Et [p. 366] sur les hauts cris du véritable gagnant, on payait deux fois pour une. Mais une sommation plus menaçante fut celle de cet officier de marine étranger de qui l’administration, dirai-je le clergé du lieu, reçut un jour ce saisissant ultimatum: «Ayant mouillé dans cette rade, j’ai joué, j’ai perdu douze mille francs qui m’appartenaient, plus vingt mille qui faisaient la provision de mon navire; me trouvant trop jeune pour en finir avec la vie et résolu à ne pas vivre déshonoré pour une heure d’imprudence, je vous prie de me faire rendre aujourd’hui même cette seconde somme de vingt mille francs que je m’engage sur l’honneur à rembourser avant trois mois. Maintenant si la somme n’est pas à mon bord à l’heure désignée... je bombarde le Casino!» Quant aux admonestations privées, menaces d’expulsion adressées à un joueur bruyant par un inspecteur rabat-joie, il n’y a lieu d’en tenir compte que si ce bedeau se montrait insolent. Dans ce cas, à défaut d’une pièce bien placée, un coup de râteau bien appliqué peut suffire à rafraîchir son zèle. Et le délinquant en sera quitte pour voir prolonger son abonnement, avec salamalec à l’appui.
Quant à l’atmosphère du Temple, elle est faite du seul encens que puissent dédier au dieu qui tourne les sangs, tant de souffles aigris, toutes ces bilieuses haleines. Il s’y mêle un souvenir d’étouffés hommages offerts à la plus sonore des idoles antiques par tous ces culs-de-plomb échauffés, et des relents de ces ronds de cuir qu’on voit se relever sur les chaises des présidents, et qui sont comme les auréoles vertes de Crepitus.
[p. 367] Et, pour l’atmosphère morale plus irrespirable encore, elle se trame péniblement de tant de bouquets fanés et croupis dans l’eau saumâtre des espérances. L’analyse psychologique décomposerait son interlope amalgame en odeur de prostitution, d’escroquerie et de mouchardise.
Ajoutez deux caractéristiques: immobilité et silence; la première seulement rompue au début de la séance, à midi, par l’irruption des candidats aux premiers sièges. Sic vos non vobis; car la plupart ne sont que des substituts, petits rentiers avisés qui se font un revenu du prix de leur place cédée aux retardataires. Le second, un silence étoupé de chambre de malade (attestée par la fade senteur des cataplasmes dissimulés, de vagues cautères, ou parfois d’un triomphant iodoforme;) de dortoir d’hospice, et sur lequel se détache clairement le bruit des pièces, pareil au tintement d’une chaîne d’argent perpétuellement manipulée sur un sourd tapis, à la fois cliquetante et lourde. Complétez-le d’un bas chuchotement incohérent assez semblable à ce Pater infernalement contrefait dont Boïto fait saluer son Mefistofele par des démons à plat ventre.
Maintenant, les fidèles de ces cérémonies?
Baudelaire a décrit dans son jeu, les suppôts de tripots moindres: «Dans des fauteuils fanés des courtisanes vieilles... L’œil câlin et fatal... et qui font de leurs maigres oreilles—tomber un cliquetis de pierre et de métal.»—Transposez ce Rops et certain grand tableau de Gustave Doré qui m’impressionna dans l’un des premiers salons que je visitai enfant. On y voyait Cora Pearl en [p. 368] chapeau Bibi, saute-en-barque et suivez-moi jeune homme. Quelques-uns des modèles qui ont posé jeunes pour ce tableau sont peut-être encore là plâtrés, chenus et cacochymes, en train de garder une place et de pointer le numéro sortant pour un joueur à système—lequel les paiera d’un louis, un de ces mêmes louis qui vingt ans auparavant glissèrent des mains de ces vieux débris, alors tendrement baisées.—Je me souviens d’une vieille bouquetière absinthique rencontrée naguère à Passy. Elle s’affalait de bancs en bancs sous le poids d’ailleurs léger d’un panier de fleurs dès longtemps fanées. Et comme nous l’interrogions, intéressés par des traces de beauté dans ce Gavarni posthume, elle nous fit cette réponse digne du grand caricaturiste: «Quand je pense que le prince Trois-Étoiles et le marquis un Tel ont dételé mes chevaux pour traîner mon duc, à Baden-Baden?»—Les propos des vieilles joueuses qui s’éternisent ici ne sont pas moins extraordinaires.—L’une d’elles que l’on complimentait d’un assez beau collier de corail qu’elle avait au col répondit à la gracieuseté par ce corollaire étonnant: «J’avais aussi les boucles d’oreilles, mais je les ai données au cardinal Antonelli.»
Il faudrait un crayon bien aigu pour rendre ces miroirs d’âme égratignés par le souci, ces teints verts qui emportent jusque sous la lumière du dehors, le reflet du tapis des tables; ces yeux jaunes du mirage de l’or.—Ronde Mesmeriste, en séance autour d’un baquet de Plutus; miraculés en demande et en attente au bord d’une piscine probatique agitée par un ange aux mains crochues.
[p. 369] Un auteur a écrit: «Il semble que mon cœur veuille se fendre en deux!» Et c’est une juste description du côté physique de la douleur morale, dont il semble qu’elle agisse matériellement sur le cœur, au point que nous avions projeté avec un ami d’écrire un traité de la déformation du cœur par la souffrance sentimentale. Je dirai de même et moins hyperboliquement que certaines déformations physiques doivent être infligées au masque humain par les émotions du jeu; et qui sait si la seule hérédité ne pourrait suffire à perpétuer dans les traits d’un être qui, lui-même, n’aurait jamais joué, certains tics douloureux de la face?—Le trente et quarante surtout me semble propre à créer cet accident nerveux avec son éternelle alternative de perte ou de gain saccadé, sans cette diffusion d’angoisse et d’espoir que les chances multiples de la roulette rendent moins nette, moins tranchante, moins inexorable. Danaïdes, Tantales éternels passant la vie à voir leurs mains s’emplir et se vider de l’eau du Pactole. C’est de l’argent qui découche, disent pittoresquement les vieux habitués de Saint-Frusquin, de ce gain qui doit demain revenir à la caisse.
«Essayez avec des haricots», conseillent les guides dits de bonne foi avec une naïveté dont eux-mêmes n’ont pas sondé la perfidie. Autant vaudrait conseiller à quelqu’un qui doit passer par le feu d’essayer avec un bain tiède. L’honnête phaséolus inspire moins de respect qu’un louis, et ne vous croyez pas en droit de partir pour faire sauter la banque de Saint-Frusquin, parce que vous vous [p. 370] serez retiré d’une roulette joujou avec un formidable gain de haricots que vous aurez laissé porter. Sous forme de napoléons, vous en auriez retiré plus des trois quarts à tous les coups gagnants, tandis que pour les coups de perte, vous auriez doublé, triplé, décuplé la mise.
C’est une grande erreur du joueur néophyte, ou plutôt une indubitable marque où distinguer de l’amateur, le joueur professionnel, puisque là aussi ces démarcations sont établies, d’attacher du prix à la pièce gagnée. C’est avec l’argent de la banque qu’il faut jouer. Mais l’inexpérimenté n’est audacieux que dans la perte; tandis qu’il voudrait faire monter en épingle, comme me le disait Rochefort, le louis qu’il est fier de devoir à Saint-Frusquin; et il n’est pas rare de voir revenir à pied pour épargner la pièce de cent sous qu’elle vient de gagner, la femme qui n’a jamais hésité à prendre une voiture. C’est que cette pièce n’est plus la même, n’est plus elle-même, mais bien toutes les pièces qui en peuvent résulter et qu’elle engendre déjà par une de ses martingales mentales, un de ces parolis de Perrette, qui sont le mal contagieux et endémique. La montante d’Alembert, la Garcia, la Philiberte autant de systèmes hasardeux qui ne valent même pas ce coup dit de la femme saoule, lequel consiste à laisser s’ouvrir sa bourse au hasard, et les pièces choisir elles-mêmes leurs places. De gros bouquins ont été écrits annonçant la découverte du système sûr, avec les preuves à l’appui dont la conclusion est, en fin de compte, le rendez-vous que l’auteur vous donne au café, avec la recommandation de ne vous point déranger sans espèces.
[p. 371] Méry qui était gros joueur ne jouait qu’à la rouge. Il prétendait avoir observé que depuis la fondation des maisons de jeu, la noire était sortie 296,000 fois de plus que la couleur adversaire, et que ce déficit allait se combler. «Vous ne prétendez pourtant pas, lui répondait Rochefort qui me contait l’anecdote, tomber sur une série de 296,000!» Ne vous étonnez pas de voir un joueur qui vous a préconisé son système, en venir pour toute philosophie du jeu, à battre des cartes autour de la table pour mettre à la couleur qu’il se tire à soi-même. Quant au poursuivant de la série, jugez de sa terreur de manquer un coup, par les appels désespérés de cette grosse dame conjurant le croupier de ne pas donner le branle à l’instrument avant qu’elle ait eu le temps de retirer de son bas la liasse de billets qu’elle y a mise à l’abri des voleurs. Car les pick-pockets ne sont pas rares à Saint-Frusquin. Ils ont beau jeu de s’exercer sur les poches d’un public qu’on dirait continuellement occupé—ainsi que me le faisait remarquer une spirituelle amie, à voir retomber des fusées. Fusée d’or et fusée d’argent, mais qui partent d’en bas, et que l’on contemple en baissant la tête. Les exploits de ces détrousseurs se haussent ici jusqu’au brigandage.—Témoin cette histoire advenue à une belle Otero quelconque en séjour dans la région. Comme elle venait, chaque après-dînée, d’une localité voisine, achever sa soirée dans le casino, et que ses bijoux étaient célèbres, on l’avertit, un certain minuit, de rentrer chez elle par une autre voie. Quant à sa voiture, au détour de la route désigné pour l’agression, les larrons [p. 372] déçus en virent s’irruer, au lieu de l’idole endiamantée, un gros d’employés de l’administration, agrémentés, pour tous joyaux, de boutons de chemise en os, et de pistolets de première marque. A quelques jours de là, cette belle, rassurée, ayant offert à son coiffeur de le faire reconduire en voiture, l’homme remercia prudemment d’une réponse à peu près semblable à celle du savetier de la Fontaine.
Pour en revenir au jeu, on pourrait dire de lui, si son essence n’était pas précisément de décevoir toute prévision, qu’il est menteur même à son essence. Sinon, il semblerait que des raisonnements du genre de celui-ci eussent quelque chance de porter juste. Étant donné le hasard mobile, et pourtant enchaîné entre quatre termes, un système fixe, s’exerçant sur le même tableau, sera forcément rencontré par lui. Mais va t’en voir s’ils viennent, s’ils reviennent les fafiots enfuis!
Et dans tous ces adultes gâtés, en quête de l’esprit de la taille, et qui n’auraient pas d’excuse, s’ils lui demandaient autre chose que l’émotion qui les désaccorde précisément selon le rythme de leur détraquement (Mme Jourdain dit excellemment: «il le gratte où il se démange!»), il me semble voir les aînés de ces enfants à qui l’on persuade qu’il suffirait, pour attraper un passereau, de lui placer trois grains de sel sur la queue.
De mystérieuses coïncidences se renouvellent trop fréquemment pour qu’on n’en puisse pas conclure à des concordances.
Il n’est pas rare, à la roulette, dans l’instant où la boule va tomber, de voir un joueur, comme [p. 373] averti, placer son enjeu sur le numéro qui va sortir. Faut-il en conclure que ce chiffre éclôt dans l’espace à cette minute préventive, et se reflète en certains cerveaux soumis au nombre, comme un jasmin ou une jacinthe cachés se révèlent durant la nuit, au promeneur du jardin obscur? La plus péremptoire réponse n’est-elle pas encore celle du guide dit de bonne foi: «Considérez ces dorures splendides!»
Bien révélatrice est encore la présence de ces joueurs endurcis qu’on a rencontrés là vingt ans auparavant, qui y sont toujours, mais qui ne jouent plus; qui peut-être se vengent de leur ruine en retenant des places pour des confrères, satisfaits du louis ainsi gagné qui leur assure leurs cigares; un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort; ce louis est pour eux le fidèle chien qui les console des morts enfuis, ainsi que Musset les dénommait naguère. Pour le vivre, le couvert, l’entretien enfin, ils leur sont, dit-on, fournis par la République elle-même. Moins par pitié que pour éviter de dangereux chantages, elle a dû prendre le parti de pensionner ainsi de notables décavés, rivés par leurs pertes à ce coin du sol, seul endroit du monde où ces malheureux qui l’ont enrichi de leur or, et ne furent pas loin de l’engraisser de leur sang, se sentent un peu sur leurs terres! et qui le font bénéficier de la caressante citation antique: Ille mihi terrarum præter omnes angulus ridet.
Rictus terrestre, étrange fin de vie que celle de ces déshérités de leur héritage, vieux élégants écœurés entre les chicanes dont on lésine sur leur trousseau annuel pour un chapeau de feutre gris, [p. 374] une paire de bottines jaunes. Au reste, qui sait si le Casino n’en tire pas, à l’occasion, les grands premiers rôles? Je veux dire ces gros joueurs de maximums, ces périodiques gagnants de huit cent mille qu’on fait mousser dans les journaux de la localité, et qui font eux-mêmes affluer le menu fretin alléché, proie imbécile de l’entreprise.—Oui, ce serait une ironie digne d’Edgar Poë—et de la République de Saint-Frusquin, que ce déguisement en terreurs de la banque, de pauvres hères incapables même de plus jouer la matérielle, l’entretien du jour; et qui préfèrent l’obole gagnée par ce tragi-comique faux semblant, aux douze billets de mille du maximum qui arrive à ne leur sembler rien de plus qu’une pièce de cent sous brochée!
Un voyageur, débarquant un jour à Saint-Frusquin, se préparait à monter dans un de ces omnibus dont la livrée est aux couleurs de la République, lesquelles sont aussi celles du Diable. Diabolo juvante n’est-elle pas au reste la significative devise des armoiries locales? Notre homme sentait déjà son cœur se serrer de cette particulière anxiété bien décrite par Mme de Staël, celle des gens que nul n’attend à leur arrivée, quand un visage familier de matrone le fit sourire; mais il ne se la remettait qu’incomplètement, quand elle vint en aide à sa mémoire. C’était la patronne retirée d’une maison hospitalière du Midi, dont le bonhomme avait été chaland. Et comme il s’étonnait de retrouver en ce lieu l’ancienne matrulle: «—Écoutez-moi bien, lui répliqua celle-ci; mon commerce m’avait bien apporté de la fortune; mais lorsque j’eus [p. 375] vendu mon fonds, il me manquait une chose: la considération! Alors je suis venue ici.»
Ainsi ne semblent pas penser les honnêtes dames qui font porter leurs lettres chez le fleuriste ou chez le pâtissier pour que leurs correspondants ne se doutent pas du lieu de l’envoi, et qu’elles soient mises à la poste en terre de France.
J’ai parlé de la devise de Saint-Frusquin. N’est-il pas singulier qu’elle s’inscrive au-dessous d’un blason héraldiquement divisé en compartiments tout pareils à ceux de la roulette, tout comme ceux de l’écusson des Grimaldi à Monaco, reproduit singulièrement en rouge et en blanc le losange de la rouge et la noire. Armes celles-là véritablement parlantes. La pièce, à l’effigie du duc de Saint-Frusquin, a été ciselée par Roty; allégorie (prétendent les joueurs décavés) du traitement dont il sera puni dans l’autre monde.
«Qu’avez-vous fait de votre journée?» demandait gracieusement ce souverain à l’un de ses invités, et dans le froid (qui n’en fut pas dissipé) inséparable du début d’un dîner de cérémonie. «Hé! monseigneur, répliqua l’interpellé, que voulez-vous qu’on fasse ici, hors aller jeter son argent dans ce satané tripot?»
Est-ce une circonstance atténuante aux universelles exactions de ce souverain, que l’apparent protectorat tutélaire et paternel qui lui fait n’autoriser à ses sujets l’accès de la maison de jeu, qu’une fois l’an, le jour de sa propre fête? Bonasse rouerie à l’adresse du badaud sensible. Cet après-midi de réjouissance locale suffit à l’épuisement du pécule de l’indigène,—j’allais [p. 376] dire de l’indigent,—dont la présence ne fournirait plus, le reste du temps, qu’à l’encombrement et au scandale.
En résumé, Saint-Frusquin a des jardins assez pareils aux jardins de Klingsor. On y rencontre des filles fleurs attristées de voir Parsifal leur préférer les fleurs d’un autre tapis; mais qui prendront leur revanche.
L’aspect des plus animés de ces quartiers est celui d’une permanente Exposition universelle en laquelle se rencontrent des marchands de lorgnettes, des Arabes travestis et de faux tziganes.
Une des plus diplomatiques ruses de l’Alphand de Saint-Frusquin a été d’y rendre odieux tout ce qui n’est pas la Salle du jeu. Et ce n’est pas un mince mérite que d’y avoir excellemment réussi, la beauté du paysage rendant cette tâche difficile. C’est ainsi que le séjour d’une admirable terrasse en vue de la mer, et sur laquelle aucune porte ne donne accès, a été rendu impossible par le voisinage immédiat, bruyant et fuligineux du chemin de fer; et que l’escalier qui conduit au salon de lecture, étant raide comme un perchoir à dindons, on doit quitter toute envie d’aller y parcourir les journaux et faire sa correspondance.
Enfin on a installé dans un cabinet attenant et badigeonné de caca-au-lait, une sorte de bastringue également propre à étouffer le râle des agonisants et à faire rentrer brusquement dans les salles de jeu ceux qui seraient tentés d’en sortir sous le prétexte fallacieux d’entendre de la musique.
La misère de ces spectacles est rendue plus saillante par l’intervention de premiers sujets en vacances. [p. 377] Ceux-ci en prennent souvent le prétexte pour jouer (leur rôle) sans aucun souci; et quand leur art les en empêche, la bassesse de l’entourage n’en est que plus éclatante. D’autres signes qui distinguent encore ce théâtre de Saint-Frusquin c’est le mélange au programme, de chefs-d’œuvre et d’œuvres médiocres, avec cette différence que tous les soins de la direction se portent justement sur ces dernières, comme pour suppléer à ce qui leur manque. En outre les comptes rendus adressés aux journaux à la suite de ces opéras et de ces concerts offrent encore cette particularité d’être rédigés ainsi: De Saint-Frusquin: acclamations! (lisez: bâillements prolongés); salle entière debout! (lisez: pour sortir sans esprit de retour!)
Cela dit, ajoutons pour conclure, que Saint-Frusquin est l’endroit du monde où se vendent les plus beaux porte-monnaie; cet article s’y débite chez les bijoutiers; les plus riches sont en réseaux de mailles d’or constellés de pierres précieuses. D’autres ont des formes et des bouchons de flacons; et quand leurs propriétaires s’apprêtent à donner deux sous, vous jureriez qu’ils vont respirer de la bergamote. Enfin les plus modestes, en maroquin, n’en ont pas moins pour fermoirs des têtes de serpents en joyaux, des boutons de turquoises ou de perles.
Les porte-veine sont encore en usage à Saint-Frusquin, trèfles à quatre feuilles, petits cochons et petits bossus sous forme de médaillons et de breloques. Mais une plus maligne ruse de cette république du jeu, c’est l’entretien d’un grand nombre de ces petits bossus en chair et en os. On [p. 378] sait la favorable superstition que les joueurs attachent au simple contact des hommes ainsi déformés. Leur présence dans les jardins, dans les salles de Saint-Frusquin donne de l’espoir aux pèlerins; et ces gnomes ont pour prescription de rouler constamment des yeux furieux pour ne pas éventer la mèche.
Voulant un jour faire d’un trait l’éloge d’un dîner auquel il avait assisté, Banville le résuma ainsi: «Le mot madère ne fut pas prononcé!» A Saint-Frusquin on pourrait en dire autant du mot mort. Et c’est ce qui fait de son territoire la capitale du plaisir, la Capoue actuelle, le séjour privilégié des vieillards et des valétudinaires.
De temps à autre seulement, un cercueil apparaît. Dans la rue, des inconnus à qui vous ne demandez rien, vous accostent pour vous certifier, qu’il s’agit bien là de la mort naturelle d’un sommelier atteint de l’influenza, etc. Or, si vous alliez au fond des choses, et du cercueil, celui-là pourrait bien se trouver vide.
La bière est vide? alors c’est que Franck est vivant!
Ainsi se rétablirait le premier des bons renoms de Saint-Frusquin, qui est celui d’une terre où l’on ne saurait mourir.
Paradoxale terre de Saint-Frusquin, où réside la paix pour ceux en qui le démon du jeu ne charrie pas, comme en d’humains flacons d’eau-de-vie de Dantzick, des particules aurifères. Bienheureux et unique territoire où expire la despotique tyrannie du piano relégué aux garde-robes! Seul lieu du monde où l’on ne soit pas en butte aux trop fréquents bonjours de ses amis perdus en des spéculations moins extérieures. Gardez-vous donc bien de conclure à [p. 379] un refroidissement pour un sourire pincé: les voisins du zéro ne sont pas sortis; mais les transversales ou les chevaux vous dédommageront demain et vous vaudront une accolade toute fraternelle.
C’est encore une particularité de Saint-Frusquin que la forme sociale d’anxiété qu’y revêt le regard du riche, lequel dans la transe incessante de l’emprunt (lisez: d’être tapé) prend l’offensive en vous offrant à tout bout de champ, sous le rusé prétexte de vous porter bonheur, un trèfle à quatre feuilles ou une fleur de lilas à six pétales.
N’écoutez donc pas les visionnaires fatals, les funestes empêcheurs de jouer en rond, qui vous affirmeront que le minimum des inconvénients inséparable de ces sortes de fondations et dont il a été parlé au début de ce chapitre, c’est deux à trois suicides par jour. Par an, transposeront les optimistes endurcis; et ceux qui se prétendent renseignés rectifieront: de vingt-huit à trente-deux, à quarante, les bonnes,—pardon! les mauvaises années. «—Hier encore, un jeune homme allait donner de la tête ainsi qu’un taureau furieux contre une des colonnes de l’atrium—vous dira le sot moineau de fâcheux augure; un serviteur que son maître avait envoyé retenir des places à la gare, ayant joué et perdu cet argent qu’il espérait doubler, vient de se brûler la cervelle. Un des gardiens qui veillent nuit et jour sur le toit du casino pour surveiller les jardins comme une Brangœne du suicide, découvre souvent au matin, dans les branches d’un ficus, des fruits humains qui n’y pendaient pas la veille. Et les Gnidiennes filles de l’Aurore qui, pareilles à celles de Montesquieu, seraient tentées [p. 380] d’aller voir se lever leur Mère, pourraient faire crier par Mlle Poil-de-Brique: «Cette penderie rafraîchit!» Ainsi que le faisait Mme de Sévigné, des paysans pendus par le bon duc de Chaulnes. Un vieillard que la chaleur incommodait et qui s’était laissé choir au bord du trente et quarante, se vit tout à coup entortillé du linceul vert dont on recouvre les tables à la fin de la soirée. Puis après s’être senti descendre par des couloirs secrets, il reprit ses sens, allongé sur une table en un lieu fort mystérieux, et dans une macabre compagnie. Mais le comique de l’affaire, c’est qu’une fois revenu à lui, il trouva dans sa poche un billet de cinq cents francs qu’il ne se connaissait pas, et que, sa résurrection constatée, on s’empressa de lui faire rendre.—Les employés de l’établissement, lesquels au reste ne changent pas plus que le personnel des hôtels, reçoivent à leur entrée la formelle instruction pour le cas où un suicide se produirait dans le casino, de mettre aussitôt le mort debout et de l’emporter ainsi, la mort n’étant véritablement terrifiante qu’horizontale.
En outre les hôteliers ont reçu le sage conseil souvent exécuté, de mettre le feu aux rideaux de tout client dont la mort subite dans son établissement ne serait pas suffisamment «expliquée».—Il est vrai que nulle part ailleurs les lecteurs nocturnes ne sont autant qu’à Saint-Frusquin, victimes de leur désir de s’instruire.
—«Du reste, poursuit notre corneille qui abat des pendus en guise de noix, déchiffrez les symboles de ces magnifiques et terribles jardins. Ces tranchées du gaz ne vous apparaissent-elles pas [p. 381] comme des fosses? Linceul, ces toiles vertes dont on recouvre les massifs pendant la nuit, comme est linceul le vert oripeau dont on enveloppe les tables. Mais le choix de ces fleurs elles-mêmes ne vous divulgue-t-il pas leur secret: toutes mélancoliques fleurs de tombeaux, pensées, cinéraires dont la multiplicité endeuille toute la contrée; et jusqu’à ces tendres mères de famille dont le nom évoque de lointaines douleurs maternelles?
J’allais oublier ces bougainvilléas qui barbouillent comme de sang caillé les maisons dans les paysages.
Fleurs accusatrices sous lesquelles frissonnent à l’heure de la toilette les femmes qui les piquent dans leurs cheveux, et qui voient au fond du miroir des mains vagues les leur ajuster, de pâles mains de jeunes inconnus, de fines mains rouges.
C’est alors que murmurent dans l’air lascif et frémissant des orchestres dont les musiques se pourraient intituler la valse des nœuds coulants, et la polka des râles; mélodieux soupirs à servir d’accompagnement en sourdine pour cette poésie appropriée.
N’écoutez pas ce «prophète oiseau de malheur, oiseau ou démon» pareil au corbeau d’Edgar Poë. Oiseau qui mériterait de revêtir la forme de Miss Winterbottom, l’institutrice hurluberlu dont j’ai depuis longtemps promis l’histoire, que je donnerai; naïve redresseuse des torts de l’humanité, et qui ne manquerait pas à sa descente à Saint-Frusquin, d’appeler les croupiers: des croupions, de s’enquérir du cimetière des suicidés, d’appeler avenue des sépulcres, l’avenue des Spélugues, et de feindre de confondre l’hôtel Métropole avec l’hôtel Nécropole.
Balivernes! qui donc ose parler ici de crispations? Entendez plutôt cette distinguée compagne d’un travailleur éminent, opulent aussi; elle vous dira de ce jeu calomnié, qu’il est pour lui une détente. Voilà qui est bien dit; à la bonne heure. Et si cette détente s’égare parfois jusqu’à presser celle d’un pistolet, cela mérite-t-il d’oublier la grisante odeur du Pittosporum qui sature les jardins de Klingsor et les terrasses de Saint-Frusquin? et si les panés Tant-pis ouvrent sur son propos leur Victor Hugo à ce verset:
[p. 383] Les gagnants Tant mieux le citeront à cet alinéa digne du Temple de Saint-Frusquin
Mars 98.
En 1894 je prévoyais, je pronostiquais, j’appelais une abondante rééclosion de la correspondance de Mme Valmore. Elle a refleuri. En 96 ce sont en effet les deux volumes publiés par M. Rivière, selon un choix fait parmi des lettres quatre fois plus nombreuses, et qu’il n’appartient de juger qu’à ceux qui ont pris connaissance de l’ensemble de cette correspondance léguée à la bibliothèque de Douai par le fils de la femme-poète. Ce qui a paru est plein de toujours tendrement saisissantes beautés. Une chose étonne: la publication de la lettre à son frère (1813) et des deux suivantes, publiées dans la préface, moins par le fait de ce qu’elles révèlent[59]—(que la poésie qui les accompagne, parue dans les premières éditions, avait révélé au lecteur attentif); mais parce qu’Hippolyte Valmore, soucieux (il l’a prouvé par la destruction d’une partie de la correspondance) de supprimer, d’anéantir toute cette région du passé maternel, n’a pu léguer ce manuscrit aux archives Douaisiaines. D’où émane-t-il? Est-il unique? ou d’autres lettres contiennent-elles d’autres parts du secret?—M. Loliée, dans un juste et judicieux article (18 juin 98, Revue Encyclopédique), écrit ceci: «En premier lieu, manquent totalement les lettres de jeunesse [p. 386] et de passion, celles dont la recherche a été la plus active, celles qui auraient enfin résolu d’une manière flagrante le problème irritant dont on s’occupe encore.»—«Peut-être qu’en cherchant bien, écrit Chateaubriand, on pourrait retrouver quelques-unes des lettres que Rancé écrivait dans sa jeunesse à Mme de Montbazon, mais je n’ai plus le temps de m’occuper de ces erreurs.»—Et il ajoute: «Il s’est formé une solitude dans les lettres de Rancé, comme celle dans laquelle il enferma son cœur.» Cette noble phrase s’appliquerait à la correspondance amoureuse de Marceline Desbordes.
[59] J’y renvoie le lecteur.
A ce propos, sied-il de tenir compte du fascicule paru à Douai en 96 sous ce titre: un Épisode peu connu de la vie de Marceline Desbordes-Valmore d’après une lettre inédite écrite à son amant, reproduite en fac-simile, par Louis Vérité—et publiée dans une intention peu sympathique. «Un collectionneur de nos amis, écrit l’auteur de cet opuscule—possède une lettre autographe de Marceline non datée ni signée, la seule connue de ce genre et vraisemblablement écrite vers 1809 ou 1810, lettre des plus suggestives qui a probablement échappé au feu. Après bien des tergiversations, et en présence de l’indiscrétion commise par M. Rivière[60], notre ami a fini par nous autoriser à la reproduire en fac-simile.»—Le malheur est que ladite lettre et dont l’écriture est reproduite en réduction de moitié, et qui pourrait bien être authentique, est vraiment d’une suggestion anodine. Les appellations de bien-aimé, petit ami, mon Olivier (du nom fictif d’un personnage des Elégies) sont [p. 387] insuffisantes pour éclairer le débat que d’un anonyme rayon de tendresse. La réclamation de trois nouvelles promises, ou d’une seule dont les trois personnages seraient un amputé, un «pauvre poète déchu» et surtout un «barbier laid et intéressant» tous trois évoluant «en Espagne»—ne renseignent que faiblement sur l’œuvre de l’homme de lettres adoré. Qui sait pourtant (le document supposé authentique, et dans le cas où ce projet de nouvelle se serait effectué) si là ne réside pas pour quelque fureteur de bouquins surannés le germe de la vérité enfin connue?—La dernière ligne de la lettre: «Je te verrai samedi, au coin du feu de mon amie» concorde bien avec le rôle à la fois tutélaire et funeste prêté à cette amie Délie (Zélia) par ce qui est avéré de l’aventure.
[60] La publication des trois lettres précitées.
Une autre collection de lettres, dont quelques-unes, ce me semble, avaient déjà paru, fut mise au jour par M. Pougin qui publia son premier article sur La jeunesse de Desbordes-Valmore dans la Nouvelle Revue, en février 1894.—«On pourrait reprocher à l’auteur de cet intéressant recueil, écrit M. Loliée, d’avoir passé sous silence les différents promoteurs du dernier mouvement de renaissance littéraire, comme il s’est manifesté de 1896 à 1898, fervent et bruyant, autour du nom de Marceline Desbordes-Valmore.»
Mais que d’inédit encore! Ma personnelle collection s’est récemment encore augmentée d’une correspondance: trente-quatre lettres à Mme de Bussières, née Héloïse Saudeur, grande amie de la famille; et une douzaine de touchantes lettres d’Ondine à la même.—Collections toujours abondantes [p. 388] en de ces charmes douloureux d’un tour personnel, d’un accent passionné et contenu, qui, lorsque l’ensemble en sera mieux présenté par des éditions moins fragmentaires, seront reconnus pour une originale forme de pensée et de sentiment bien spéciale à celle qui, Sapho chrétienne, en poésie, méritera, comme épistolière, d’être qualifiée: une tendre Sévigné du malheur.
Une autre bien émouvante correspondance, historique celle-là (inédite aussi), m’est communiquée par M. Georges Charpentier. Cinquante lettres adressées à son père, dont une tracée sur un papier du même rose qu’une autre que je transcris de Verlaine. Un rose éteint et lassé dont se dut énamourer la chère femme qui aimait les rubans; le rose de cette pâte de fleurs qu’on fait en Orient de roses cueillies à l’entour du Saint-Sépulcre, et dont on fabrique des chapelets parfumés. Nuance allégorique du Calvaire gravi dont ces lettres, en dépit de l’intelligente bonté du correspondant, énumèrent les stations poignantes. Que de détails éloquents! que de notes originales en cette misère magnanime! «Lettre adressée (a tracé au crayon l’Éditeur éminent sur une page datée de Lyon en 35), en apprenant par le journal l’incendie de la rue du Pot-de-fer où j’ai perdu plusieurs milliers de volumes».—«Si nous avions autre chose que les dettes de notre ancien directeur à payer sur notre travail, écrivait Mme Valmore, je vous enverrais de l’argent. Cette joie m’étant refusée, je vous envoie, par cette lettre, la quittance des derniers trois cents francs que mon mari avait acceptés pour les Nouvelles Anglaises.» Et il ajoute: [p. 389] «Inutile de dire que j’ai refusé les 300 francs de cette admirable femme.»—Plus loin, c’est cette lubie superstitieuse et artiste en cette pénurie généreuse: «Cher monsieur Charpentier, depuis hier je suis plus triste. J’ai mis dans ma tête que ce nombre treize que vous m’avez donné de l’Atelier du vieux peintre me portait malheur. Ayez pitié de cette faiblesse de femme, et reprenez-moi cent francs que je vous envoie. Le sort me semblera rompu, et je terminerai d’un cœur plus libre.—Si vous refusiez, vous me feriez du mal.»
Je voudrais encore dire un mot de l’iconographie de Mme Valmore. L’article de M. Loliée la reproduit presque intégralement. «Si l’on m’a aimée, c’est pour autre chose qu’une grande beauté», écrit Marceline. Ses portraits en font foi. Il y a pourtant du charme dans le portrait à la lyre de la bibliothèque de Douai, œuvre de l’oncle tant aimé, Constant Desbordes. Mais le buste n’est-il pas bien opulent, la taille bien courte? C’est sans doute ce dernier défaut qu’a voulu dissimuler le grand portrait par Desbordes encore, au Musée de Douai. Mais l’autre défaut s’y accuse davantage. Ce dernier portrait, accoudé de face et la tête dans les mains, à rêver au-dessus d’un livre qu’on ne lit plus, mais dont les souvenirs «roulent dans la tête malade», est une figure d’inspirée, de voyante, de Sybille, avec presque une expression de stigmatisée. Les deux autres portraits de Langlois et de Baugé, reproduits par M. Loliée, ne sont vraiment que des caricatures sans même l’intérêt de se donner pour telles. Le trois quarts de Devéria, que j’ai mis en tête de mon étude [p. 390] parue chez Lemerre, est d’une grâce agréable. Je possède encore une lithographie dont je ne connais pas d’autre exemplaire[61]. Celle-là de face, mais d’un visage bien lourd, à l’expression faussement pathétique d’un regard levé exagérément, sans extase vraie. Plus extatique le regard baissé du profil de David d’Angers[62], en cette expression de recueillement interne que j’ai notée chez la sublime Vierge de Botticelli de la collection Leyland:
[61] Un autre portrait non encore reproduit est, je crois, la propriété de Mme Henri Lavedan.
[62] Que je suis étonné de ne pas retrouver dans la nombreuse collection de médaillons de David d’Angers exposés au Louvre.
J’avais moi-même retrouvé, dans une ancienne édition de Mme Valmore, une épreuve jaunie de sa photographie, en 1865. La Revue encyclopédique en reproduit une semblable. Portrait suprême, émouvant en sa laideur triste, au sourire qui s’efforce au-dessous du regard, pénétrant encore, bien que si las! Les mains gourdes dans des mitaines sortent des manches pagodes, auxquelles s’assortissent bien la fanchon plate retenue par trois épingles, et le ruban à carreaux qui retombe en deux brides. Cette belle strophe pourrait s’inscrire au dessous:
[p. 391] C’est donc une heureuse palingénésie que celle qui fait de la figure allégorique de M. Houssin (érigée à Douai en 1896) comme une résurrection de la femme poète, au-dessus de ses ans vécus, de ses atours fanés et de ses douleurs vaincues; sorte de Lady Macbeth innocente et étonnée de ne plus retrouver sur ses dolentes et courageuses mains la blanche traînée de tant de larmes.
Je dois à l’obligeance de Mme Maximin le don de souvenirs précieux, de petits sachets en rubans damassés ou chinés, sans doute assemblés de la main de Marceline elle-même, ou de ses filles; des fragments de bibelots sans valeur, mais sans prix; une agrafe à manteau figurant des cygnes de style Empire; une tasse de Chine; un coupe-papier d’ivoire au manche en forme d’un serpent dont l’aiguillon s’essaie en vain sur un miroir; symbole de cette vérité si chère à notre poète;—un livre de prières offert à Mme Valmore en août 43 «comme un hommage d’affectueuse admiration et un témoignage de vive sympathie pour un noble cœur affligé»—signé: Clémence.—Un album en cuir vert aux minces coins en argent, on dirait un ancien spécimen de cette élégante maroquinerie anglaise, depuis, si fort à la mode. Peut-être un souvenir du séjour d’Ondine à Londres, durant son professorat, dans la famille Curie. L’album contient une photographie d’elle, d’expression sympathique et pensive. Une autre d’Inès enfant. Puis de petits dessins, des griffonnages, sans beaucoup d’intérêt, ni d’art; des adresses, des copies fragmentaires, des citations, souvent anglaises, des fleurs séchées aux suscriptions sentimentales: [p. 392] «cueillie sur la place Saint-Ouen, à la porte fermée d’un ami.»—Un monument à la mémoire de l’inoubliable amie Gantier: un petit dessin à la plume représentant, sur un lit de fleurs et d’épines, un cœur ailé accablé par une croix, et dont émane une flamme en forme de banderolle où court l’inscription: satis, Domine, satis!—Et au-dessous: «La croix l’accable, mais il est soumis.» Puis de l’écriture de Mme Valmore: «dix avril, Calvaire de mon cœur. Les années n’ont pas aplani ta cime. Avec mes anges qui t’entourent, du moins es-tu heureuse, Albertine! Sperent in te.» De la sensiblerie d’imagerie religieuse, relevée par le haut goût du cœur, la profonde sincérité de l’inaltérable attachement. En un autre agenda, celui-là, de style Empire, seul bibelot joli, le «Souvenir» à la monture de nacre et de bronze, aux douze vignettes coloriées des mois, ce sont encore, et toujours entre ces griffonnages au jour le jour (rappel d’une visite de Mme Gay le 8 septembre 1822) des fantômes de fleurettes, violette, pensée, volubilis, bourrache, primevère; du lierre, des mousses, une graminée; et surtout une blonde mèche de cheveux dorés, de ces cheveux d’enfant desquels elle a écrit ce vers divin:
En somme, tout le délicat décor interne de cet autre agenda dont l’intelligent hasard d’une vente a fait refleurir aux mains d’un ardent admirateur de Mme Valmore, tant de transparentes fleurs fanées entre lesquelles voltige plus délicatement [p. 393] encore un duvet de colombe, une plume de La Vie et la Mort du Ramier.
Quoi encore? une lorgnette monocle, à la monture dédorée, à l’ivoire jauni et fondu et dont l’unique regard dut si souvent se fixer sur la grande amie Mars.—Enfin une guitare, sans nul doute celle dont il est parlé dans cette lettre de la correspondance: «Hilaire a fait arranger ma guitare.—Pour la première fois depuis trois ans, j’ai rejoué de ce pauvre instrument dédaigné et les enfants se sont mis à danser jusqu’à nuit close...»—Pauvre guitare, elle n’a plus qu’une corde, l’incorruptible fil sur lequel le peintre anglais Watts fait à tout jamais voltiger invinciblement les consolatrices illusions de l’aveugle espérance!
Je possède plus d’une soixantaine de lettres et billets à moi adressés par Verlaine.
Je choisis parmi eux cette lettre des plus touchantes:
Paris, le *** mars 1895.
«Cher monsieur et cher poète,
«J’ai lu et peut-être avez-vous lu dans le... d’aujourd’hui, sous la signature... une ligne où votre nom et le mien étaient rapprochés dans une intention désagréable pour vous. Je m’empresse de vous assurer de toute la peine que m’a faite cette lecture. Vous connaissez trop mes sentiments de si haute estime à l’égard du vrai poète que vous êtes pour que, sans attacher quant à ce qui vous [p. 394] concerne la moindre importance à de pareils coups d’épingle, vous puissiez douter un instant du véritable ennui que m’a causé ce bout d’article.
«Je n’ai pas voulu que la journée s’écoulât sans vous témoigner à nouveau ma sincère et profonde sympathie littéraire, en même temps que les sentiments d’affectueuse gratitude de votre tout dévoué
«P. Verlaine.»
En 97, j’ai reçu, à la date du 6 septembre, cette lettre de M. Stanislas Millet, professeur au Lycée de Lorient:
«Monsieur,
«Vous avez publié dans la Nouvelle Revue du 1er février 1896, sur Hello, une remarquable étude où je relève cette phrase: «Je ne me souviens pas d’avoir rencontré ce grand nom (celui de Chateaubriand) au cours de toute l’œuvre de l’écrivain de Kéroman, que le respect d’une même communion empêcha sans doute de formuler sur le maître de Combourg, un jugement dont l’expression eût été curieuse à connaître.»—Je ne crois pas, en effet, que Chateaubriand soit nommé dans celles des œuvres d’Hello qui ont paru en volumes. Mais parcourant dernièrement, grâce à la bienveillance de Mme Hello, les manuscrits inédits du grand penseur, et les articles qui n’ont encore eu jusqu’ici que la publicité des journaux ou des revues, j’ai découvert une longue étude sur Chateaubriand, [p. 395] qui sans doute vous donnera satisfaction. Etc.»
L’article, dont j’ai dû la copie à l’obligeance de Mme Hello et de M. Millet, est curieux, intéressant et surtout bien conforme à mon pronostic.
«Il faut d’abord, écrit Hello, rendre justice à qui veut et fait le bien. M. de Chateaubriand a voulu le bien et certainement il l’a fait. Avant de l’entendre parler, il faut regarder ceux à qui il parlait. Il faut se figurer une nation qui n’était pas encore réveillée du XVIIIe siècle, une nation qui pleurait d’attendrissement devant les bergers de Florian et qui riait en face des saints. Il ne fallait parler ni à des hommes instruits, ni à des enfants naïfs et disposés à la lumière: il fallait s’adresser à de tristes vieillards, et c’était un triomphe de leur apprendre que le christianisme n’est pas ridicule...—Voilà comment la question se posait. Il s’agissait de faire prendre la religion au sérieux (par un peuple de qui Voltaire était l’aliment universel)...—En d’autre temps, ce serait une hardiesse d’affirmer que le christianisme n’est pas une stupidité honteuse et ridicule. C’était quand il (Chateaubriand) est né, un acte voisin de l’héroïsme...—Quand on apprécie ceux qui remontent la pente d’un torrent il faut exagérer l’éloge pour rencontrer la justice... Et comme je vais prendre la liberté d’apprécier son œuvre considérée en elle-même, je dois la considérer ici dans son principe, dans son intention, dans ses rapports avec les hommes et les choses qui rendent cette intention particulièrement belle et honorable.»—Ceci dit, Hello exagère-t-il le mérite de Chateaubriand? Non; le rhéteur lui est trop antipathique.
[p. 396] L’ironie éclate: «Ainsi, il n’est pas tout à fait vrai que les divinités chrétiennes soient ridicules dans les batailles. Cela est à peu près vrai, mais pas tout à fait. Ce tout à fait est précieux, mais ne vaut pas le presque dont il est couronné. Les milices célestes font presque un aussi grand effet que les dieux ennemis de Troie.
«—M. de C. demande grâce pour Josué, Élie, Isaïe, Jérémie, Daniel, parce qu’il pourrait les peindre avec une tête flamboyante et une barbe argentée. Vous avez le cœur dur si cette circonstance ne vous inspire pas un peu d’indulgence en faveur d’Élie. Quand vous lisez dans l’Écriture la scène du Mont-Carmel et celle du Mont-Horeb, vous êtes disposé à le traiter un peu légèrement; mais si vous vous dites à vous-même que M. de Chateaubriand pourrait le peindre avec une barbe argentée, il est impossible que le respect ne vous saisisse pas à l’instant même.»
Ces réflexions qu’un ruisseau représenté dans son cours naturel est toujours plus agréable que dans sa peinture allégorique—et que «l’ange de l’amitié pourrait porter une écharpe merveilleuse» exercent encore la verve d’Hello: non sans un peu de lourdeur: «Quel bonheur! les saintes sont sauvées: car elles ne remplacent pas les ruisseaux que les saintes supprimaient... etc.—Il est impossible que l’ange de l’amitié affublé de cette écharpe ne trouve pas grâce devant les muses.»—Voici des motifs plus sérieux:
«Le regard droit et central manque à M. de Chateaubriand. Il parle des choses les plus graves, mais il n’en parle pas gravement. Il a beau se [p. 397] tourner ou vers la terre, ou vers le ciel, on dirait toujours qu’il est en face d’une question de rhétorique. Quoi qu’il dise, il a toujours le temps et le goût de s’entendre parler; quoi qu’il regarde, c’est toujours lui-même qu’il contemple, et il se contemple toujours à la lueur menteuse de la rhétorique. Sa parole est sans joie; et la gloire de l’écrivain consiste à s’oublier dans le sens de l’amour-propre. Jamais chez M. de C. la pensée ne brise la phrase. Non, la phrase est faite d’avance, elle est inviolable, elle est fondue dans un certain moule: c’est à la pensée d’obéir. Jamais sa parole n’est l’explosion subite, spontanée, d’un sentiment qui éclate. Le sentiment pour lui est une occasion de parler.—M. de Chateaubriand écrivain est un modèle à éviter.» (Suit une curieuse comparaison entre le style organique qui est «la parole vivante au service de l’idée vivante»; et le style mécanique qui est «le produit artificiel d’éléments extérieurs et de pièces juxtaposées».)—Mais voici le grand grief; le véritable horresco referens:
«Enfin M. de Ch. dit, en parlant de Voltaire: Ce grand homme.—Ce mot est écrit dans le génie du christianisme, deuxième partie, chap. V.—Il est permis de douter un moment, même devant l’évidence, même devant le livre ouvert. Mais quand on a lu plusieurs fois le paragraphe, il faut se rendre. Le mot est écrit. Ce mot là ferme sur M. de Chateaubriand, critique littéraire, la discussion. J’aurais eu beaucoup de choses à citer, mais après ce mot-là, je n’en citerai aucune.
«Je ne veux pas rester sur cette parole, parce que si elle était le dernier mot de ce travail, elle [p. 398] semblerait en être la conclusion; elle semblerait offerte comme la pensée générale de M. de Chateaubriand et le résumé de sa vie. Cette apparence serait une injustice.»—Et la conclusion: «Il eut l’éclat presque toujours, très rarement la splendeur. Son strass fut pris pour du diamant. L’illusion peut et doit finir: mais plus elle tombera, plus doit monter et grandir le respect de son intention et l’admiration légitime que nous avons pour ce qu’il tenta.»
Et je conclurai moi-même par cette phrase de Chateaubriand, dans son dernier ouvrage: «Voltaire naissait, cette désastreuse mémoire avait pris naissance dans un temps qui ne devait point passer: la clarté sinistre s’était allumée au rayon d’un jour immortel.»
—Hello ne prend-il pas garde que c’eût été vouloir ne pas être écouté des tristes vieillards auxquels s’adressait le Génie du Christianisme, que de commencer par briser leur idole? Mais s’adressant à l’abbé Séguin, l’auteur de la vie de Rancé pouvait, devait, et il l’a fait, tenir un autre langage.
| Ordo | 1 | |
| I. | Félicité (Desborde-Valmore) | 5 |
| II. | Le dieu (Leconte de Lisle) | 85 |
| III. | Pauvre Lélian (Paul Verlaine) | 93 |
| IV. | L’Aède (Mistral) | 103 |
| V. | Roses pensantes | 117 |
| VI. | L’Apôtre (Ernest Hello) | 129 |
| VII. | Un seul Goncourt | 159 |
| VIII. | Tolstoï Esthéticien | 171 |
| IX. | Le Grand Oiseau (Léonard de Vinci) | 179 |
| X. | Le Voyant (William Blake) | 189 |
| XI. | Le Spectre (Burne Jones) | 201 |
| XII. | Un Mythologue (Arnold Bœcklin) | 215 |
| XIII. | Vernet Triplex | 237 |
| XIV. | Alice et Aline (Théodore Chassériau) | 251 |
| XV. | Fashion (Constantin Ghys) | 271 |
| XVI. | Le Potier (Jean Carriès) | 283 |
| XVII. | Les noces d’argent de la Voix d’Or (Sarah Bernhardt). | 299 |
| XVIII. | Le Masque (La Duse) | 309 |
| XIX. | Un Féministe | 321 |
| XX. | Apollon aux Lanternes | 329 |
| XXI. | La République de Saint-Frusquin | 347 |
| Post-Scriptum | 385 | |
Sceaux.—Imprimerie E. Charaire.
Extrait du Catalogue de la BIBLIOTHÈQUE-CHARPENTIER
à 3 fr. 50 le volume
EUGÈNE FASQUELLE, ÉDITEUR, 11, RUE DE GRENELLE
DERNIÈRES PUBLICATIONS
| MAURICE BARRÈS | |
| Les Déracinés | 1 v |
| CLAUDE BERTON | |
| Au Coin d’un Bois | 1 v |
| PAUL BOSQ | |
| Désillusion | 1 v |
| FELICIEN CHAMPSAUR | |
| Sa Fleur | 1 v |
| JULES CLARETIE | |
| La Vie à Paris, 1897 | 1 v |
| ALPHONSE DAUDET | |
| Soutien de famille | 1 v |
| Mme ALPHONSE DAUDET | |
| Journées de Femme | 1 v |
| LEON A. DAUDET | |
| Alphonse Daudet | 1 v |
| GYP | |
| Le Baron Sinaï | 1 v |
| ERNEST LA JEUNESSE | |
| L’Holocauste | 1 v |
| MAURICE MÆTERLINCK | |
| La Sagesse et la Destinée | 1 v |
| FELIX MARTIN | |
| Le Japon vrai | 1 v |
| CATULLE MENDES | |
| Le Chercheur de Tares. | 1 v |
| JEAN RICHEPIN | |
| Contes de la Décadence romaine | 1 v |
| LOUIS DE ROBERT | |
| L’Anneau | 1 v |
| EDOUARD ROD | |
| Le Ménage du Pasteur Naudié | 1 v |
| GEORGES RODENBACH | |
| Le Miroir du Ciel natal | 1 v |
| EDMOND ROSTAND | |
| Cyrano de Bergerac | 1 v |
| ARMAND SILVESTRE | |
| Les Tendresses (Poésies) | 1 v |
| ANDRE THEURIET | |
| Lys Sauvage | 1 v |
| EMILE ZOLA | |
| Paris | 1 v |
ENVOI FRANCO PAR POSTE CONTRE MANDAT
11398.—I.—Imprimeries réunies, rue Saint-Benoît, 7, Paris.
Au lecteur.
L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée, mais les erreurs clairement introduites par le typographe ou à l'impression ont été corrigées. Ces corrections sont soulignées en pointillés dans le texte. Placez le curseur sur le mot pour voir l'orthographe originale.
Également, à quelques endroits la ponctuation a été corrigée.
End of Project Gutenberg's Autels privilégiés, by Robert de Montesquiou
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AUTELS PRIVILÉGIÉS ***
***** This file should be named 61472-h.htm or 61472-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/1/4/7/61472/
Produced by Clarity, Hans Pieterse and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive/Canadian Libraries)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.